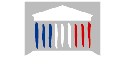______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2014
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim
TOME II
AUDITIONS ET DOCUMENTS
Président
M. François BROTTES
Rapporteur
M. Denis BAUPIN
Députés
——
Voir les numéros : 1507, 1595 et T.A. 256
La commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim est composée de : M. François Brottes, président ; M. Denis Baupin, rapporteur ; M. Philippe Baumel, Mme Sabine Buis, MM. Franck Reynier et Michel Sordi, vice-présidents ; MM. Christian Bataille, Patrice Carvalho, Claude de Ganay et Jacques Krabal, secrétaires ; MM. Damien Abad, Bernard Accoyer, Julien Aubert, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Yves Blein, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dubois, MM. Hervé Gaymard, Jean-Pierre Gorges, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, MM. Marc Goua, Francis Hillmeyer, Mme Sandrine Hurel, M. Hervé Mariton, Mme Frédérique Massat, MM. Patrice Prat, Éric Straumann, Stéphane Travert et Mme Clotilde Valter.
SOMMAIRE
___
Pages
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 7
Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE (Commission de régulation de l’énergie) 9
Audition de M. Gilles-Pierre Levy, président de chambre à la Cour des comptes, et de Mme Michèle Pappalardo, conseiller-maître 21
Audition de M. Jean Desessard, sénateur de Paris, et M. Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Eure 33
Audition de M. Thierry Morello, chief operating officer et membre du directoire d’EPEX Spot 40
Audition de M. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE, directeur général délégué chargé de l’économie, des marchés et de l’innovation 48
Audition de M. Jean-Philippe Bucher, président-directeur général de FerroPem 58
Audition de M. Andreas Rüdinger, chercheur « Politiques climatiques et énergétiques » à l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) 64
Audition du Pr. Stephen Thomas, professeur en études énergétiques à l’Université de Greenwich, et de M. Humphrey Cadoux-Hudson, directeur exécutif « Nouvelles constructions nucléaires », EDF Energy 79
Audition de M. Manuel Baritaud, analyste senior « Électricité » de l’Agence internationale de l’énergie 91
Audition de Mme Gwenaëlle Huet, directrice des affaires européennes de GDF-Suez, et M. Claude Turmes, député européen 100
Audition de M. Philippe Van Troye, directeur général d’Electrabel, et de M. Eric De Keuleneer, professeur à l’Université libre de Bruxelles 112
Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA 120
Audition de M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible nucléaire » d’EDF 133
Audition de M. Yves Kaluzny, conseiller auprès de la Mission de soutien aux secteurs stratégiques, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (Ministère des Affaires étrangères), et de M. Charles-Antoine Louët, sous-directeur « Industrie nucléaire » à la Direction générale de l'Énergie et du climat (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) 143
Audition de M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 152
Audition de M. Étienne Dutheil, directeur-adjoint de la Production nucléaire (EDF) 162
Table ronde avec les syndicats représentés au comité central d’entreprise d’EDF (CFDT, CGC, CGT, FO) 174
Audition de M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et de M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 187
Audition de M. Dominique Minière, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie (EDF) 197
Table ronde d'entreprises prestataires d'EDF : M. Pierre Dambielle, directeur Activités nucléaires de ORTEC, M. Damien Gousy, vice-président du GIP Nord-Ouest, M. Alain Bertaux, président de CICO Centre, M. Michel Dupiech, directeur général adjoint d’ONET Technologies et M. Jean-Claude Lenain, président-directeur général de Mistras Group SA 208
Audition de M. Philippe Jamet, commissaire de l’ASN, et de M. Jacques Repussard, directeur général de l'IRSN 220
Audition de MM. Yannick Rousselet, responsable du dossier nucléaire, et Cyrille Cormier, chargé de campagne climat-énergie de Greenpeace France 231
Audition de M. Hervé Machenaud, directeur exécutif groupe Production–Ingénierie d’EDF 245
Audition de M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA 256
Audition de M. Yves Marignac, directeur de WISE-Paris, et de M. Sébastien Blavier, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace 263
Audition de M. Laurent Michel, directeur général de l'Énergie et du climat, et de M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l’Énergie (ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie) 271
Audition de M. Benjamin Dessus, président de Global Chance, et de M. François Lévêque, professeur d'économie au CERNA-Mines ParisTech 282
Audition de M. Arnaud Gay, président, et de M. Philippe Bernet, vice-président du groupe de travail “Démantèlement” du Comité stratégique de la filière nucléaire 290
Audition de MM. Jean-Claude Delalonde, président de l’ANCCLI (Association nationale des comités et commissions locales d’information), Jean-Paul Lacote, vice-président de l’ANCCLI et membre de la CLI de Fessenheim, et Florion Guillaud, trésorier de l’ANCCLI et membre de la CLI du Blayais 304
Audition de M. Jean-Michel Malerba, délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim 314
Audition de M. Jean-Luc Lépine, président de la CNEF (Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des INB et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs) 320
Audition de M. Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe chargé des finances d’EDF, de M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA, de M. Christophe Gégout, directeur financier du CEA, et de M. Pierre Aubouin, directeur général adjoint chargé des finances d’AREVA 327
Audition de M. Philippe Germa, directeur général du WWF France 342
Audition de M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN 348
Audition de M. Michel Bourguignon, commissaire de l’ASN, et de M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l’ASN 358
Audition de M. Sylvain Granger, directeur de la division Combustible d’EDF, de M. Hervé Bernard, administrateur général adjoint du CEA, et de M. Dominique Mockly, directeur du Business Group Aval d’AREVA 365
Audition de M. Jacques Percebois, membre de la Commission nationale d'évaluation (CNE2) 375
Audition de M. Sylvain Granger, directeur de la division Combustible (EDF) 385
Audition de M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA 393
Audition de M. Mycle Schneider, consultant 405
Audition de M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA 411
Audition de M. Raymond Sené et Mme Monique Sené, Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN) 420
Audition de M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 429
Audition de M. Gilles Trembley, directeur du GIE Assuratome, de M. Maurice Corrihons, directeur des Spécialités de la Caisse centrale de réassurance, et de M. Pierre Picard, professeur au département d’économie de l’École Polytechnique 436
Audition de Mme Céline Grislain-Letrémy, M. Reza Lahidji et M. Philippe Mongin, auteurs du rapport « Les risques majeurs et l'action publique » (Conseil d'analyse économique, décembre 2012) 447
Audition de M. Francis Delon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et M. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN 458
Audition de M. Jean-Pierre Charre, vice-président, M. Michel Demet, conseiller du président, et M. Alexis Calafat, secrétaire, du bureau de l’ANCCLI (Association nationale des CCLI) 473
Audition de M. François Moisan, directeur exécutif scientifique Recherche et International de l’ADEME, et de M. Jacques Bittoun, président de l’ANCRE (Alliance nationale de coordination pour la recherche sur l'énergie) 479
Audition de M. Robert Durdilly, président de l’UFE (Union française de l'électricité), et de M. Thierry Salomon, président de l'association négaWatt 491
Audition de M. Jacques Percebois, président de la commission « Énergies 2050 », et de M. Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences, docteur en économie de l’énergie, ancien directeur général de l’AFME (aujourd'hui ADEME) 505
Audition M. Nicolas Boccard, professeur associé d’économie, Université de Girona (Espagne) 513
Table ronde avec les confédérations syndicales représentatives au plan national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) 523
Audition de M. Jean-Pierre Roncato, président d'Exeltium 541
Audition de M. Fabien Choné, président de l’ANODE (Association nationale des opérateurs détaillants en énergie) 549
Audition de M. Raymond Leban, directeur « Économie, tarifs, achats » (EDF) 562
Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE (Commission de régulation de l'énergie) 569
Audition de M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF 576
Audition de M. Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public, et de M. Claude Bernet, président de la Commission particulière du débat public Cigéo 594
Audition de Mme Marie-Claude Dupuis, directrice générale, et de M. Thibaud Labalette, directeur des programmes (ANDRA) 604
Audition de MM. Jacques-François Lethu (KPMG), Alain Pons et Patrick Suissa (Deloitte), commissaires aux comptes d’EDF 623
Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA 636
Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA 644
Audition de Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie 651
DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU RAPPORTEUR 663
Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE
(Commission de régulation de l’énergie)
(Séance du jeudi 9 janvier 2014)
M. le président François Brottes. Notre commission d’enquête a souhaité consacrer ses premières auditions à un panorama des travaux récemment effectués sur tout ou partie du sujet sur lequel elle a mandat de se prononcer. Nous avons donc le plaisir d’accueillir M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Le rapport publié par la CRE en juin dernier ne se limite pas aux coûts de production de l’électricité nucléaire : il traite des coûts totaux d’EDF, non seulement en matière de production mais aussi en matière de commercialisation, domaine où ils ont d’ailleurs considérablement augmenté. Par construction, néanmoins, les informations relatives à la filière nucléaire y tiennent une place essentielle. Lors de la présentation de ce rapport à la Commission des affaires économiques, monsieur le président, vous avez indiqué que nombre des sujets ouverts restaient à préciser.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande au préalable de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Philippe de Ladoucette prête serment)
M. le président François Brottes. Je vous donne la parole pour un exposé introductif, non sans vous avoir informé que l’enregistrement vidéo de nos échanges sera ultérieurement mis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.
M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie. Comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, la CRE a récemment procédé à une évaluation des coûts de l’entreprise EDF.
Permettez-moi tout d’abord de rappeler le cadre dans lequel nous intervenons.
La Commission de régulation de l’énergie s’est vu confier deux missions directement ou indirectement reliées à la question des coûts du nucléaire : la première et la plus ancienne, prévue par la loi du 10 février 2000, porte sur les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité, sur lesquelles la CRE doit rendre un avis fondé sur la couverture des coûts de production et de commercialisation de l’électricité supportés par EDF ; la seconde, prévue par la loi du 8 décembre 2010, dite « NOME » (nouvelle organisation du marché de l’électricité), concerne spécifiquement les coûts du nucléaire puisqu’il s’agit, dans un premier temps, de donner un avis sur le prix de l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) proposé par le Gouvernement puis, dans un second temps, de proposer le prix de l’ARENH en appliquant une méthodologie définie par un décret en Conseil d’État.
En mai 2011, la CRE avait appliqué une méthode de calcul du prix de l’ARENH inspirée des travaux de la commission Champsaur en s’appuyant sur des données de coût du nucléaire fournies par EDF. Cette méthode utilise la valeur nette comptable du parc nucléaire historique comme représentation du montant résiduel des capitaux investis à l’origine dans ce parc : elle traduit la réalité de l’amortissement des capitaux immobilisés, de l’obsolescence des matériels, et tient compte des investissements consentis tout au long de la durée de vie du parc.
Elle s’inscrit dans la continuité de la construction tarifaire actuelle puisque, depuis 2000, la CRE calcule les coûts de production d’EDF à couvrir par les tarifs réglementés de vente en tenant compte des dotations aux amortissements et d’une rémunération normale de la valeur nette comptable.
Au premier semestre 2013, la CRE, en préparation de son analyse tarifaire et dans un souci de transparence des coûts, mais aussi pour répondre à un souhait de la ministre chargée de l’énergie de l’époque, Mme Delphine Batho, a réalisé un exercice inédit dans lequel elle a analysé tant pour le passé, de 2007 à 2012, que pour le futur, de 2013 à 2016, les évolutions de l’ensemble des postes des coûts de production et de commercialisation supportés par EDF. Cette étude portait donc pour une part importante sur les coûts de production nucléaire et apportait une visibilité pluriannuelle éclairée notamment par les contraintes industrielles et techniques de l’entreprise.
Lors de la présentation de ce rapport, j’ai indiqué que nous procéderions à des analyses complémentaires portant notamment sur les coûts de production du nucléaire, en lien avec les missions conférées à la CRE par le code de l’énergie. Nous en sommes à ce stade. Ce que je vous dirai ce matin correspond à ce que nous savons à l’heure actuelle. Nous en saurons plus dans les semaines et les mois qui viennent, puisque nous publierons un nouveau rapport d’ici au mois de juin 2014.
Les informations dont nous disposons n’étant pas tout à fait complètes, je ne pourrai vous livrer ce matin que des orientations. Nous restons bien entendu à la disposition de la commission d’enquête pour lui fournir les éléments complémentaires que nous aurons établis au fil des mois.
M. le président François Brottes. Je vous confirme que nous vous ferons revenir !
M. Philippe de Ladoucette. Je l’avais bien compris, monsieur le président !
S’agissant des coûts du passé, la CRE ne fait que se référer aux travaux de la Cour des comptes, sans y ajouter d’élément particulier.
S’agissant des coûts d’investissement, à l’instar des coûts du passé, il convient de distinguer l’enveloppe globale annuelle de dépenses d’investissement et son mode de répercussion dans les tarifs ou dans le prix de l’ARENH, ce dernier dépendant de la politique d’amortissement choisie et de la rémunération attendue pour ces investissements.
M. le président François Brottes. Peut-être pourriez-vous préciser ce qu’est l’ARENH.
M. Philippe de Ladoucette. Le dispositif d’« accès régulé à l’énergie nucléaire historique » institué par la loi NOME contraint l’entreprise EDF à vendre à ses principaux concurrents une partie de sa production nucléaire à un prix déterminé et pour un volume plafonné à 100 TWh par an. Dans la mesure où seul le nucléaire historique est concerné, le prix est calculé sur la production des centrales amorties, pas sur les centrales en construction comme l’EPR.
Pour en revenir aux coûts d’investissement, le lien entre les montants de dépenses que j’exposerai ci-après et le coût de production n’est ni direct ni immédiat.
Le poids des investissements dans le coût de production nucléaire s’est considérablement accru depuis quelques années pour trois raisons principales : la nécessité d’assurer la conformité des équipements des centrales et le déploiement d’un référentiel de sûreté toujours plus exigeant ; le remplacement des gros composants qui arrivent en fin de vie technique (générateurs de vapeur, alternateurs, transformateurs, etc.) ; l’obligation de mettre en œuvre les prescriptions émises par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à la suite de l’accident de Fukushima.
Premièrement, les investissements liés aux visites décennales et aux autres arrêts de tranche augmentent d’environ 10 % par an depuis 2007. Le contenu des visites se densifie du fait de l’augmentation des contraintes du référentiel de sûreté et la tendance devrait se poursuivre dans le futur, le référentiel de sûreté n’ayant pas vocation à s’alléger. En 2013, ces investissements représentent un montant de l’ordre de 1,1 milliard d’euros. Ils devraient continuer d’augmenter d’environ 14 % par an, l’exploitant disposant de peu de marges de manœuvre pour ces investissements de sûreté.
Deuxièmement, les investissements réalisés dans le cadre du programme de remplacement des gros composants du parc nucléaire ont augmenté de 30 % par an depuis 2007 ; ce programme devrait se poursuivre à un rythme soutenu dans les années à venir. À la fin de 2012, les générateurs de vapeur, principal poste de coût puisqu’ils représentent près des deux tiers de l’ensemble, ont été remplacés dans vingt-deux des cinquante-huit tranches nucléaires. Ces investissements s’élèvent, pour 2013, à 1,2 milliard d’euros. La CRE en anticipe une croissance tendancielle dans les prochaines années de l’ordre de 5 % par an, tendance qui peut cacher de fortes disparités d’une année sur l’autre et qui peut encore largement évoluer dès lors que de nouveaux arbitrages industriels seraient pris par EDF.
Troisièmement, les investissements consécutifs à l’accident nucléaire de Fukushima sont estimés à un peu plus de 10 milliards d’euros en valeur 2010 et devraient s’étaler sur les dix à quinze prochaines années. Les discussions entre EDF et l’ASN portant sur le calendrier de mise en œuvre des préconisations de sûreté de cette dernière – en particulier la mise en place du diesel d’ultime secours et du centre de crise local – sont toujours en cours. Elles auront naturellement un impact sur le calendrier d’engagement des dépenses futures correspondantes. La CRE avait estimé dans son rapport de juin 2013 que ce poste d’investissement représenterait 650 millions d’euros au titre de l’année 2013 et anticipait une accélération de la hausse sur les trois prochaines années. Ce scénario pourrait toutefois se voir modifié en fonction du résultat des discussions avec l’ASN.
Enfin les autres investissements, liés notamment aux mesures de protection de l’environnement, de prévention des incendies et de constitution de pièces de rechange stratégiques, ont augmenté de 17 % par an depuis 2007. Ils représentent 1,2 milliard d’euros en 2013. Ce poste d’investissement comporte également les investissements de maintenance courante et de contrôles planifiés, ces derniers étant désormais immobilisés à compter de 2012 au lieu d’être comptabilisés comme des dépenses courantes.
Plus généralement, EDF a amorcé depuis 2012 un programme de requalification de certaines dépenses d’exploitation en dépenses d’investissement. Ce transfert ne modifie pas le montant total des dépenses annuelles, mais a un impact comptable puisqu’il améliore le résultat de l’entreprise.
En conclusion, en termes de dépenses d’investissement, la hausse moyenne observée sur la période 2007-2012 a été de l’ordre de 16 % par an, traduisant une reprise massive des investissements après une assez longue période de baisse de la fin des années 1990 au milieu des années 2000.
Avant d’aborder la question des coûts d’exploitation, il est nécessaire de dire quelques mots des volumes de production, qui constituent une importante source de variation du coût unitaire. Les années 2000-2010 ont vu se multiplier des avaries génériques sur certains gros composants, comme les générateurs de vapeur ou les turboalternateurs, consécutives d’une baisse sensible des investissements que je viens d’évoquer. Ces avaries ont eu pour conséquence une baisse significative de la production du parc nucléaire et, par voie de conséquence, de sa rentabilité.
Cette situation s’est nettement redressée en 2011 et 2012. Les investissements de maintenance, qui ont repris à un rythme soutenu, commencent à porter leurs fruits et devraient se maintenir à l’avenir compte tenu des niveaux d’investissement que l’entreprise envisage de consentir pour le maintien en condition opérationnelle de son outil de production.
En revanche, c’est désormais l’ampleur des travaux à conduire lors des arrêts de tranche dans le cadre des opérations de grand carénage – avec la poursuite des opérations de remplacement de gros composants, le renforcement des référentiels de sûreté et le déploiement des mesures faisant suite à l’accident nucléaire de Fukushima – qui devrait devenir à l’avenir le facteur limitant de la disponibilité du parc.
Je rappelle qu’une baisse de 5 TWh de la production nucléaire occasionne une augmentation des coûts de l’ordre de 50 centimes d’euro par MWh.
J’en viens maintenant aux coûts d’exploitation.
Les charges d’exploitation sont inhérentes à la production. Elles correspondent aux charges auxquelles l’entreprise doit faire face chaque année et comportent plusieurs composantes que je vais successivement examiner.
La composante « coût du combustible », tout d’abord, recouvre plusieurs éléments.
D’abord le coût du combustible lui-même, consommé pour produire les TWh de l’année. Il est valorisé au coût moyen du stock de combustible et reflète la stratégie pluriannuelle d’approvisionnement en uranium d’EDF, avec un décalage dans le temps compte tenu du temps de passage du combustible en réacteur. La période 2010-2012 a vu arriver à échéance un certain nombre de contrats d’approvisionnement à des prix inférieurs aux prix de marché, avec des conséquences à la hausse sur le coût amont du combustible. Cette tendance va vraisemblablement se poursuivre dans le futur étant donné la hausse des coûts d’approvisionnement d’uranium.
Ensuite le coût de traitement aval, qui correspond aux dotations aux provisions pour les prestations de l’aval du cycle. Une révision des coûts de stockage ou de démantèlement – par exemple la révision du devis du stockage profond de Bure – aurait des répercussions sur ce poste.
Au total, le coût du combustible, qui a été de l’ordre de 5 euros par MWh en 2013, devrait vraisemblablement avoisiner les 7 euros par MWh en 2015. Pour donner un ordre de grandeur, je rappelle que le prix de l’ARENH est aujourd’hui de 42 euros par MWh.
La composante « charges de personnel » est en forte augmentation – près de 6 % par an sur les cinq dernières années –, sous l’action combinée, d’une part, du renforcement et de la densification du programme de maintenance, qui entraîne une augmentation structurelle des embauches pour absorber la charge de travail, et, d’autre part, du renouvellement des compétences : les pyramides des âges de l’industrie nucléaire sont actuellement très déséquilibrées, avec un départ en inactivité massif d’un personnel essentiellement recruté dans les années 1970-1980. Afin de maintenir un niveau de compétence compatible avec les exigences de l’Autorité de sûreté, et compte tenu des durées de formation très longues dans les métiers du nucléaire, il est nécessaire de procéder à une anticipation du tuilage avec du personnel jeune sur une longue durée.
L’augmentation des salaires – due à la hausse du salaire de base et à la professionnalisation croissante des effectifs – et l’évolution des charges sociales ont également joué un rôle significatif dans l’augmentation de ce poste de coût, qui représente en 2013 un peu moins de 7,50 euros par MWh.
La tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’en 2015, pour se stabiliser ensuite, une fois résorbée la problématique du renouvellement des compétences.
La composante « achat de prestations de maintenance » concerne à la fois les dépenses d’exploitation, de maintenance des centrales et de déconstruction. Une part significative de ces dépenses a été requalifiée en investissement, comme je l’ai indiqué. Toutefois, pour des raisons de compréhension et de cohérence avec les données historiques, les éléments d’appréciation que je donne ici ne tiennent pas compte de cet effet comptable.
La composante hors déconstruction, qui représente 2,4 milliards d’euros en 2013, est essentiellement composée de dépenses de prestations de main-d’œuvre et constitue donc une approximation des dépenses de sous-traitance. Elle a significativement augmenté depuis 2007, de 6,5 % par an, sous le double effet de l’augmentation du volume de maintenance en lien avec l’augmentation des investissements dans le parc nucléaire – pour deux tiers de la hausse – et du prix des prestations – pour le tiers restant. Cette hausse devrait vraisemblablement se poursuivre à l’avenir dans les mêmes proportions, même si une partie de la dépense vient désormais augmenter l’enveloppe de dépenses d’investissement.
Au total, hors requalification comptable, ce poste pèse environ 7 euros par MWh.
Le dernier poste du coût d’exploitation, sur lequel je ne m’étendrai pas, recouvre les impôts et taxes, dont le poids est de l’ordre de 3 à 4 euros par MWh.
Bien que la CRE n’ait pas de compétence particulière en la matière, je veux également aborder la question des coûts de démantèlement, de retraitement et de stockage à long terme des déchets
L’article 20 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs impose à tout exploitant d’une installation nucléaire de base l’obligation de couvrir les charges futures nucléaires par un portefeuille d’actifs dédiés. Le niveau des actifs est donc directement lié au montant actualisé des charges futures, soit le niveau provisionné au bilan de l’exploitant. Le temps vient affecter, dans un régime normal, les provisions et les actifs dédiés en augmentant le niveau des charges futures chaque année par le jeu de la désactualisation, tout en augmentant en parallèle le niveau des actifs dédiés par leur propre rendement. Le niveau du taux d’actualisation est réglementé pour en assurer une estimation prudente. L’opérateur constitue son portefeuille d’actifs dédiés pour que le taux de rendement attendu corresponde au taux d’actualisation, dans le respect des textes réglementaires.
Le calage du niveau légal des actifs dédiés sur le niveau des provisions a donc pour effet de répercuter toute modification du niveau des provisions sur le niveau des actifs dédiés à constituer. En d’autres termes, toute révision du devis de démantèlement aura pour conséquence l’obligation pour EDF de constituer des actifs dédiés supplémentaires.
À ce jour, sur la base du devis actuel, le niveau des actifs dédiés spécifié par la loi a été atteint par EDF, notamment par l’intégration à ce portefeuille de la moitié du capital de RTE (Réseau de transport d’électricité) et de la créance d’État concernant la CSPE (contribution au service public de l’électricité).
La Cour des comptes s’étant livrée dans son rapport à une analyse très détaillée des dépenses liées au démantèlement et à la gestion à long terme des déchets nucléaires, je n’irai pas plus loin sur ce sujet.
Enfin, si l’on appliquait la méthode que nous avions proposée dans le cadre de notre avis de mai 2011 – et sans préjuger des décisions du Gouvernement dans le décret à venir définissant les modalités de calcul de l’ARENH –, le montant de l’ARENH serait supérieur d’environ 10 % à celui qui est en vigueur aujourd’hui.
M. le président François Brottes. Cette annonce d’une hausse de 10 % de l’ARENH ne manquera pas d’être relevée par les acteurs intéressés.
Les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont fixés pour couvrir les coûts de production du fournisseur historique. La CRE, qui est en quelque sorte le principal gendarme dans ce domaine, les élabore en lien avec le Gouvernement mais il est devenu habituel qu’ils soient contestés. Le Conseil d’État a même annulé certains arrêtés tarifaires. Le moins que l’on puisse dire est que le dispositif n’est pas d’une grande clarté pour le non-initié !
M. Denis Baupin, rapporteur. Votre intervention, monsieur le président de Ladoucette, confirme ce que le rapport de la CRE avait mis en exergue : nous sommes dans une période d’augmentation significative des coûts de fonctionnement des centrales nucléaires. Il convenait de le rappeler : derrière la notion comptable d’« amortissement » du parc nucléaire, qui laisse à penser que le système continue de fonctionner sans encombre, on s’aperçoit que le parc coûte de plus en plus cher.
Peut-on parler, au sujet de la longue période de baisse des investissements que vous avez mentionnée et qui s’est traduite par des avaries génériques, de sous-investissement ? Le coût de la production nucléaire n’a-t-il pas été maintenu à un niveau artificiellement bas, ce que nous payons maintenant au prix fort ?
Le taux de disponibilité des centrales n’a cessé de baisser, passant en dessous des 80 % en 2013 alors que le président d’EDF avait fixé un objectif de 85 %. On invoque des opérations de maintenance plus longues que prévu, ce qui dénote les difficultés de l’entreprise à gérer ses périodes d’investissement. La situation, selon vous, s’est redressée. Pourriez-vous étayer cette affirmation que les chiffres ne démontrent pas ? Quelles sont les conséquences de la baisse de la disponibilité sur les coûts ? Comme vous l’avez souligné, une diminution des recettes pèsera aussi sur la rentabilité du parc industriel.
S’agissant des investissements à venir, vous avez évoqué les opérations de grand carénage prévues par EDF pour prolonger la durée de vie des centrales jusqu’à quarante ans mais vous n’avez pas cité de chiffre. On a parlé de 50 milliards d’euros. Faites-vous la même évaluation ? Faut-il ajouter à ce montant les 10 milliards d’investissements que représentent les opérations complémentaires de sûreté décidées après Fukushima ? Quel pourrait être le montant total après que l’Autorité de sûreté nucléaire aura fixé un référentiel de sûreté pour une éventuelle prolongation de centrales au-delà de quarante ans ?
La sous-traitance dans le domaine nucléaire, souvent évoquée par l’ASN, atteint parfois huit niveaux successifs. Les conséquences sur la sécurité des personnes et la sûreté des équipements peuvent être préoccupantes. Avez-vous étudié cette sous-traitance – étant entendu que le renouvellement de personnel que vous évoquez ne concerne sans doute qu’EDF – et sa traduction en matière de coûts ? L’entreprise en tire à l’évidence un gain, mais peut-être subit-elle aussi des conséquences négatives : il est souvent rapporté que des incidents survenant dans les centrales sont dus à l’insuffisance de la formation des personnels.
En matière de sécurité des installations, la presse s’est largement fait l’écho de la facilité avec laquelle des militants de Greenpeace ont pu pénétrer dans plusieurs centrales. Des programmes de renforcement de la sécurité ont été annoncés – conformément, du reste, à l’objectif poursuivi par l’association. Quel sera leur coût ?
Enfin, au-delà de l’évolution tarifaire de l’ARENH que vous avez évoquée, je relève que le Gouvernement n’a pas totalement suivi les préconisations que vous formuliez dans votre dernier rapport concernant la hausse des tarifs réglementés appliqués aux consommateurs : il a retenu une hausse de deux fois 5 % et souhaite un plafonnement plus important à l’avenir. Quelles seraient, pour l’entreprise EDF, les conséquences d’un plafonnement plus sévère que celui que vous recommandez ?
M. le président François Brottes. En matière de sécurité au sens large, il faut distinguer les dépenses liées à la sécurisation des sites, les dépenses de sûreté destinées à prévenir les incidents techniques en renouvelant certains équipements, et les dépenses dites « post-Fukushima », qui concernent la gestion de crise en cas de défaillance, avec, par exemple, les générateurs permettant de maintenir une alimentation électrique. Il faut bien dissocier les problèmes, même si, au bout du compte, on obtient une addition !
M. Philippe de Ladoucette. Certaines questions excèdent sans doute la compétence de la CRE.
On a pu constater en effet, monsieur le rapporteur, entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000, une baisse des investissements par rapport à la période précédente et un sous-investissement par rapport à la période suivante. Mais c’était également le cas des investissements dans les réseaux, notamment de distribution.
Quant à savoir s’il s’agissait d’un moyen pour diminuer le coût du nucléaire, je ne peux porter aucun jugement. La CRE ne peut que faire le constat factuel du manque d’investissement dans cette période ; elle n’a pas de compétence pour en juger les causes.
Le débat sur le taux de disponibilité des centrales françaises est ancien. Il fut un temps où ce taux était de 82 ou 83 %, très inférieur à celui des centrales américaines ou belges, par exemple, qui tournent en général à 90 %. La raison en est connue : contrairement à ce qui se passe à l’étranger, nous n’utilisons pas seulement nos centrales en base mais aussi en semi-base. Néanmoins, nous sommes actuellement en dessous de 80 %. J’ai exposé ce qui explique les problématiques de maintenance présente et future, mais c’est l’entreprise elle-même qui est la plus compétente pour répondre aux questions sur le taux de disponibilité. La CRE se contente de constater.
M. le président François Brottes. Il est tout de même possible de distinguer entre indisponibilité choisie et indisponibilité subie. Avez-vous des éléments à ce sujet ?
M. Philippe de Ladoucette. Je pourrai vous les transmettre. La CRE ayant aussi pour mission de surveiller le marché de gros, elle se doit de déterminer, à chaque arrêt intempestif, s’il n’y a pas suspicion de rétention de production. Toute modification du programme des arrêts du fait d’un incident ou d’un événement non prévu nous amène à demander des explications à l’opérateur, et celui-ci nous les donne. Cela dit, notre activité de surveillance des marchés n’a jamais mis en évidence une volonté de manipulation du marché de la part d’EDF de ce point de vue-là, depuis cinq ou six ans que nous exerçons cette compétence et que nous consacrons un rapport annuel à ce sujet.
M. le rapporteur. Autrement dit, l’augmentation des arrêts fortuits, très significative en 2013 par rapport à 2012, n’est pas liée à une volonté de l’entreprise mais bien à des incidents intervenus dans les centrales.
M. Philippe de Ladoucette. Il y a moins d’arrêts fortuits aujourd’hui et plus d’arrêts programmés. Les avaries que l’on a constatées sont la conséquence d’un manque d’investissements durant la période que j’ai évoquée.
Concernant le grand carénage, nous ne disposons pas d’autres chiffres que ceux qu’EDF a communiqués, à savoir 55 milliards d’euros d’ici à 2025, les 10 milliards des mesures post-Fukushima étant inclus dans ce montant. Il se peut que nous ayons des données complémentaires dans les semaines ou les mois qui viennent.
Par ailleurs, les coûts de maintenance – 2,4 milliards d’euros en 2013 – sont essentiellement constitués de dépenses de prestation de main-d’œuvre. Le montant indiqué est donc une approximation des dépenses de sous-traitance. J’ai indiqué que ce poste avait significativement augmenté depuis 2007 – de l’ordre de 6,5 % par an – sous le double effet de l’augmentation du volume de maintenance et du prix des prestations. Son coût est d’environ 7 euros par MWh.
Je n’ai pas d’éléments particuliers, en revanche, au sujet des évolutions en matière de sécurité des installations et des coûts qui en résulteront. Comme je l’ai dit, nous sommes en train d’approfondir les chiffres avec EDF. Si nous avons des éléments nouveaux, nous vous les communiquerons.
Pour ce qui est de l’évolution future du prix de l’ARENH, monsieur le président, permettez-moi de rétablir la teneur exacte de mes propos : ce que j’ai dit est que, si l’on devait recalculer le prix de l’ARENH aujourd’hui selon la même méthode que celle que nous avons appliquée en 2011, le résultat serait, toutes choses égales par ailleurs, une hausse de l’ordre de 10 %. Rien ne dit que le décret conservera cette méthode et je ne fais aucune prévision sur le prix futur de l’ARENH.
La loi NOME prévoit également que la construction des tarifs réglementés sera modifiée à partir du 1er janvier 2016 au plus tard et se fera alors par empilement, la première brique de cet empilement étant le prix de l’ARENH auquel s’ajouteraient le complément de 20 % – que l’on trouverait peut-être sur le marché, peut-être autrement –, les coûts de commercialisation, le coût du marché de capacités et l’acheminement. Ce nouveau dispositif devrait être, sinon tout à fait lisible, du moins plus compréhensible.
Ainsi, après l’annonce faite par le Gouvernement de la hausse pour 2014, il reste une inconnue pour 2015 mais la construction des tarifs pour 2016 sera assez claire. J’ignore – sinon par des « fuites » parues dans la presse – quelles sont les intentions du Gouvernement. Je pense qu’il attendra de connaître précisément la nature des besoins, notamment de couverture, et la réalité des coûts.
M. Yves Blein. Comment évolueront les amortissements compte tenu des investissements à venir ? Quelles sont les durées d’amortissement prises en compte dans la fixation du tarif de l’ARENH ? Quel pourcentage – au même titre, par exemple, que le combustible – représentent-elles dans le coût par MWh ?
M. Bernard Accoyer. Je souhaite que nos auditions permettent d’établir un panorama plus exhaustif. Le rapporteur cible ses questions en fonction d’une arrière-pensée précise, qu’il partage avec les membres de son groupe : la remise en cause de l’énergie nucléaire elle-même. Étant donné cette position de parti pris, il serait utile que notre commission d’enquête dispose d’éléments comparatifs.
Je serais donc heureux que le président de Ladoucette nous éclaire sur les coûts respectifs de l’électricité d’origine éolienne, solaire, hydraulique, etc. Je ne doute pas qu’il a des chiffres à ce sujet, comme il en a sur ces points essentiels que sont la sécurité en général et la sécurité des approvisionnements.
En outre, quelles seraient les conséquences – y compris financières – si la France en venait à ne plus respecter ses objectifs en matière de rejets de gaz à effet de serre ? Quelle perspective tracer si, comme certains le souhaitent, on procédait à un démantèlement du parc nucléaire plus important que celui de la centrale de Fessenheim ?
M. Jean-Pierre Gorges. La France se fait une spécialité, chaque fois que survient un accident, de tout transformer. Pourriez-vous, à cet égard, détailler les opérations prévues à la suite de l’accident de Fukushima ?
Notre commission d’enquête étant consacrée aux coûts, nous devons pouvoir établir des comparaisons. Dans la plupart des modes de production d’électricité, le dispositif comprend la source d’énergie en amont – chaudière, etc. –, une turbine, des générateurs et un système de distribution. Existe-t-il une analyse détaillée des coûts par type de production ? Même si le terme fait peur à tout le monde, une centrale nucléaire, par exemple, n’est pas très différente d’une centrale thermique : il existe dans l’un et l’autre cas une chaudière, une turbine et des générateurs, à tel point qu’une grande partie de la fabrication est la même. Et l’on voit aujourd’hui refleurir des centrales thermiques au fioul – plutôt en France – et au charbon – surtout en Allemagne. La partie mécanique constituée par les turbines et les générateurs n’a rien à voir avec le nucléaire. Peut-être un défaut d’entretien est-il le moyen de masquer des coûts : quoi qu’il en soit, j’aimerais que la commission d’enquête parvienne à obtenir un état analytique des coûts. S’agissant des centrales thermiques, il faut comptabiliser l’ensemble comprenant l’extraction du combustible, son acheminement, ainsi que tous les coûts afférents à la pollution provoquée par les installations.
Il ne serait pas inutile, d’ailleurs, que nous disposions de schémas explicitant les composantes des systèmes de production. On verrait ainsi que tous les dispositifs, y compris les éoliennes, ont des éléments communs. Si nous ne réalisons pas ce travail d’analyse, nous ne parviendrons à rien. Nous risquons au contraire d’« enfumer » les gens.
M. Philippe de Ladoucette. Ce ne sont pas là des questions simples. Les travaux de la CRE – qui dispose d’une large expertise en ce domaine puisqu’elle fait la plupart des appels d’offres – ont néanmoins permis d’établir des éléments d’évaluation du coût de développement des énergies renouvelables. Ainsi, le tarif d’achat de l’éolien terrestre est aujourd’hui de l’ordre de 80 euros par MWh, celui de l’éolien en mer de 200 euros. Pour les installations photovoltaïques au sol avec dispositif de suivi de la courbe du soleil, le tarif des parcs les moins chers est d’environ 95 euros par MWh dans le dernier appel d’offres que la CRE est en train d’instruire. Pour les petites installations résidentielles, les tarifs actuels sont d’environ 150 euros par MWh s’agissant de la technologie standard d’intégration simplifiée et de 300 euros s’agissant de l’intégré au bâti. Le tarif de l’électricité produite à partir de la biomasse varie entre 130 et 180 euros par MWh en fonction de la technologie. Pour la cogénération – fonctionnement en « chaleur fatale » –, le tarif est de 130 euros par MWh. Il est de l’ordre de 60 euros par MWh pour les petits ouvrages hydrauliques. Quant à l’électricité produite par les centrales thermiques, son prix est public et facile à trouver.
M. le président François Brottes. Parle-t-on ici des mégawattheures produits ou des mégawattheures consommés ?
M. Philippe de Ladoucette. Il s’agit des mégawattheures produits.
S’agissant des conséquences du non-respect des objectifs de rejets de gaz à effet de serre, monsieur Accoyer, les textes n’établissent pas encore très clairement les sanctions. Vous trouverez certainement plus compétent que moi pour répondre à cette question.
Pour ce qui est des opérations « post-Fukushima », c’est à l’Autorité de sûreté nucléaire qu’il revient de déterminer la nature précise et le calendrier – mais non le montant – des investissements à réaliser. Le calendrier est d’ailleurs en cours de discussion entre EDF et l’ASN, pour déterminer si l’échéance sera de dix ou de quinze ans. Je ne peux donc aller plus loin que ce que je vous ai indiqué tout à l’heure.
La durée d’amortissement comptable des centrales nucléaires, monsieur Blein, a déjà été portée de trente à quarante ans en 2003. Cette disposition s’est accompagnée, dans les années qui ont suivi, d’autorisations techniques délivrées par l’ASN tranche nucléaire par tranche nucléaire. Aujourd’hui, la durée d’exploitation prévue est de quarante ans pour l’ensemble du parc. Le passage de trente à quarante ans d’exploitation a nécessité la réalisation de plusieurs investissements, notamment des investissements de sûreté mais pas uniquement.
La durée de vie industrielle d’un générateur en exploitation, par exemple, est de trente ans, ce qui correspond à la durée de fonctionnement prévue initialement pour une centrale nucléaire. Au-delà de trente ans, les conditions d’extraction de chaleur du circuit primaire vers le circuit secondaire deviennent de plus en plus délicates, jusqu’à altérer significativement la production de la centrale – d’où l’avarie générique observée sur les générateurs de vapeur dans les années 2000-2010, qui a très fortement affecté la disponibilité du parc nucléaire dans cette période. Ces avaries sont susceptibles de poser une problématique de sûreté nucléaire, puisque le générateur de vapeur est à la jonction entre le circuit primaire, qui extrait la chaleur du combustible, et le circuit secondaire de puissance, qui alimente le turboalternateur et produit l’énergie.
Il s’agit donc d’un poste majeur du coût du programme d’investissement « grand carénage » dans la perspective d’une prolongation à cinquante ou soixante ans. À ce jour, je le répète, vingt-deux des cinquante-huit tranches nucléaires ont été équipées de générateurs de vapeur neufs. Mais on peut également dire que ce remplacement pourrait déjà se justifier pour une prolongation à quarante ans, sachant que l’âge moyen du parc est aujourd’hui de vingt-huit ans seulement.
Je suis bien conscient de ne pas avoir répondu à l’ensemble de votre question, monsieur Blein. Sur ce sujet complexe, le mieux est que vous interrogiez directement l’entreprise EDF.
M. le rapporteur. Pour en revenir à la question de M. Accoyer, la France a pris des engagements tant en matière d’émissions de gaz à effet de serre qu’en matière de production d’énergie renouvelable. Je pense que le niveau de sanction serait le même si nous ne tenions pas les engagements du paquet énergie climat, adopté sous la présidence de M. Sarkozy et durant la présidence française de l’Union européenne.
Pourriez-vous, monsieur de Ladoucette, compléter votre réponse en fournissant une évaluation du coût du MWh produit par l’EPR de Flamanville, y compris au regard des accords récents passés par EDF en Grande-Bretagne pour produire le même type de réacteur – moyennant une garantie de trente-cinq ans, ce qui est phénoménal ?
Par ailleurs, quel poids représente l’assurance dans les comptes d’EDF et dans le prix du MWh produit par les centrales nucléaires, vu l’évaluation du coût des accidents ? Toutes les autres énergies sont, à ma connaissance, assurées. J’imagine que c’est également le cas, en proportion, concernant le nucléaire.
M. Philippe de Ladoucette. Nous n’avons pas encore fait d’évaluation très précise des coûts de l’électricité de l’EPR pour deux raisons. Premièrement, ce réacteur n’étant pas en exploitation, il n’entre pas dans le calcul de la couverture des coûts des tarifs réglementés ; autrement dit, les tarifs réglementés ne paient pas l’EPR. Deuxièmement, l’ARENH ne concerne par définition que le nucléaire historique. Nous devrions cependant disposer d’éléments complémentaires – que nous vous communiquerons – avant la remise de notre rapport au mois de juin.
D’autre part, seuls les coûts des assurances payées par EDF sont pris en compte dans les coûts de production. Dans la mesure où l’État assure aujourd’hui gratuitement une partie du risque responsabilité civile en cas d’accident, les montants sont faibles.
M. le rapporteur. Cela méritait d’être dit…
M. le président François Brottes. L’État est souvent son propre assureur. Cela n’est pas inhérent au nucléaire.
M. le rapporteur. Sauf erreur de ma part, EDF n’est pas une entreprise d’État.
Cela étant, je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’État prenne en charge une partie des coûts des différentes énergies, pour peu que l’on fasse la comparaison. Nous interrogerons tout à l’heure la Cour des comptes sur la part des coûts pris en charge par la collectivité et non par l’exploitant.
M. Philippe de Ladoucette. L’entreprise Charbonnages de France, que j’ai présidée, était son propre assureur en cas d’accident.
M. le président François Brottes. J’en reviens à la question de l’amortissement. Vous avez évoqué les actifs destinés à couvrir le démantèlement et le sujet des déchets. Cela étant, la modification de la durée d’exploitation d’une centrale change la donne quant à la prise en charge des coûts d’amortissement. Même s’il y a des investissements nouveaux, les investissements d’origine ne courent pas de la même façon. La CRE a forcément réalisé des simulations.
M. Philippe de Ladoucette. Elle en a réalisé une pour l’évolution des tarifs réglementés : nous avons estimé dans notre rapport que la prolongation de la durée de vie comptable des centrales nucléaires faisait baisser le besoin d’augmentation des tarifs réglementés de 2,6 points.
M. le président François Brottes. Autrement dit, les évolutions tarifaires indiquées intègrent une prolongation de la durée de vie des centrales…
M. Philippe de Ladoucette. Non. Nous avions une hypothèse avec prolongation et une hypothèse sans prolongation. Dans les avis que nous avons formulés à l’intention du Gouvernement, nous nous en sommes tenus à la seconde.
M. le président François Brottes. Que dit la trajectoire actuelle ?
M. Philippe de Ladoucette. Elle ne prend pas en compte les prolongations.
M. le rapporteur. Il est évidemment plus rentable d’amortir un équipement sur cinquante ans que sur quarante ans, à ceci près que les générateurs de vapeurs ont été construits pour trente ans. Une fois cet âge atteint, les avaries se sont multipliées, ce qui n’a pas été sans conséquences sur la sûreté. Sachant que certains éléments des centrales nucléaires, telles la cuve ou l’enceinte de confinement, ne peuvent être modifiés, la prolongation du fonctionnement est certes plus rentable sur le plan comptable, mais cela peut se révéler beaucoup moins intéressant si les avaries se multiplient en accroissant les risques. Ce n’est un hasard si l’avis de l’ASN est requis avant toute prolongation !
Compte tenu de ces incertitudes, estimez-vous raisonnable d’amortir des équipements dont rien ne garantit qu’ils tiendront au-delà de quarante ans ?
M. le président François Brottes. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre précisément à cette question, monsieur de Ladoucette !
M. Philippe de Ladoucette. En effet ! Si la CRE devait émettre un avis sur le sujet, elle le ferait en formation collégiale. Mais je ne vois pas sur quoi elle pourrait se fonder : elle n’a pas assez de compétences.
M. le président François Brottes. En effet, le régulateur fait des comptes et des comparaisons mais il ne peut se substituer ni à l’ASN, ni à l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), ni à l’entreprise elle-même.
M. Jean-Pierre Gorges. J’ai fait dans ma ville une expérience similaire : l’installation de chauffage urbain, prévue pour cinquante ans, présente des signes d’usure au bout de quarante ans. Les nouvelles installations intégreront cette dimension. Lorsque les dispositifs technologiques sont conçus pour cette durée, il y a des ingénieurs pour réfléchir aux évolutions. Les cuves et les chaudières évolueront, de même que les avions ou les voitures évoluent. Tout bouge ! Il n’est pas du tout objectif de critiquer un système en le figeant au moment où il a été inventé. Si, au contraire, on continue d’investir dans la filière, il y a de grandes chances pour que les techniques s’améliorent. On le voit en médecine, en informatique, dans tous les secteurs de la technologie. Je ne comprends pas l’intervention du rapporteur !
M. le rapporteur. L’objectif de notre commission d’enquête est précisément d’établir un état des lieux afin que d’éventuelles prolongations se fassent dans la transparence en matière de coûts et de risques. Mon but est d’obtenir les informations et non de considérer par avance, comme le font certains, qu’il serait facile et simple de poursuivre. Il est important d’éclairer les parlementaires avant l’ouverture du débat sur la transition énergétique. Nous devons savoir à quoi il faut s’attendre s’il est décidé de prolonger certains réacteurs.
M. Jean-Pierre Gorges. C’est pourquoi j’en appelle à une approche plus analytique. Beaucoup de gens pensent que le panache qui s’échappe des centrales nucléaires est de la fumée et non de la vapeur d’eau ! Il est important d’expliquer que le dispositif est en fait très proche de celui d’une centrale thermique, avec de nombreux composants communs. Le principe de base est très simple et certains éléments s’améliorent, même s’il faut peut-être continuer de travailler sur une partie d’entre eux. Il est faux de dire qu’au bout de trente ans tout se fissure ! Les techniques progressent. Le revêtement du bassin des piscines, par exemple, est maintenant en inox alors qu’il était auparavant en carrelage. Bref, toute une partie des infrastructures peut continuer de vivre trente ou quarante ans, voire beaucoup plus.
M. le président François Brottes. Il est normal et utile que le débat s’engage entre les membres de la commission, de manière à identifier quelle définition chacun d’entre nous met derrière les mots.
M. Yves Blein. Connaît-on la part du poste que représente l’amortissement dans les coûts de revient des différents modes de production d’énergie ?
M. Philippe de Ladoucette. Oui. Je vous transmettrai les chiffres.
M. le président François Brottes. Je vous remercie, monsieur le président, et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour une deuxième audition.
Audition de M. Gilles-Pierre Levy, président de chambre à la Cour des comptes, et de Mme Michèle Pappalardo, conseiller-maître
(Séance du jeudi 9 janvier 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314003.pdf
M. le président François Brottes. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Gilles-Pierre Levy, président de chambre à la Cour des comptes, et Mme Michèle Pappalardo, conseiller maître.
C’est sous votre égide, monsieur, madame, qu’a été élaboré le rapport public thématique sur les coûts de la filière électronucléaire que la Cour des comptes a publié en janvier 2012. Ce rapport, qui a fait grand bruit à l’époque, fait désormais partie des ouvrages de référence pour quiconque s’intéresse à l’économie de la filière nucléaire. Le travail approfondi et précis de la Cour a permis de clarifier nombre de points importants. Cependant, les incertitudes qui subsistent et les hypothèses qui restent à préciser feront l’objet de travaux complémentaires dont nous vous saurons gré de nous tenir informés.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Gilles-Pierre Levy et Mme Michèle Pappalardo prêtent serment)
M. le président François Brottes. Avant de vous donner la parole pour un exposé introductif, je précise que l’enregistrement de cette audition sera mis à la disposition du public sur le site de l’Assemblée nationale.
M. Gilles-Pierre Levy, président de chambre à la Cour des comptes. Je vous remercie du commentaire que vous avez bien voulu faire sur nos travaux.
Après avoir rappelé le contenu de ce rapport paru il y a deux ans, j’évoquerai les points qui nous paraissent mériter d’être soit actualisés, soit approfondis. La Cour a en effet l’intention de se pencher cette année de nouveau sur plusieurs sujets relatifs au nucléaire.
Notre rapport répondait à une demande formulée par le Premier ministre en mai 2011, après un entretien entre le Président de la République et les représentants de différentes organisations non gouvernementales. Il était demandé à la Cour d’analyser, non pas les seuls coûts affichés par EDF, mais l’ensemble des éléments qui constituent le coût total de production de l’électricité nucléaire en France. L’exercice avait cependant ses limites : il ne s’agissait pas d’étudier les modes de financement, ni le prix de l’électricité incluant les taxes et les coûts de distribution ; l’analyse s’entendait à production nucléaire constante en volume, et le propos n’était pas non plus de comparer cette production avec d’autres énergies.
Le rapport a été élaboré selon les méthodes habituelles de la Cour : collecte de sources, documents et comptes ; application, dans un délai court, du principe de dialogue contradictoire avec les organismes concernés – EDF, AREVA, CEA, ministère de tutelle, etc. – ; collégialité ; mobilisation d’une quinzaine de rapporteurs et d’un comité d’experts de sensibilités diverses, dont quelques étrangers ; nombreuses auditions, notamment des organisations non gouvernementales, des entreprises, des administrations, des syndicats.
La première conclusion que nous avons tirée est qu’il n’existait pas de coûts cachés, même s’il y avait beaucoup à explorer et, à cette fin, nous avons analysé les coûts passés, présents et futurs, les coûts qui se trouvent dans les comptes des exploitants, les coûts supportés par les crédits publics – financement public de la recherche, coûts de la sécurité et de la transparence –, et la prise en compte, explicite ou implicite, du coût des assurances contre les accidents.
Aux yeux de la Cour, le principal facteur de variation des évaluations réside dans la prise en compte du coût du capital. Selon que l’on applique la méthode du coût comptable, qui constate ce qui est déjà amorti, la méthode Champsaur, qui prend en compte la rémunération du capital non encore amorti, ou la méthode du « coût courant économique », qui retient une rémunération à loyer sur la base d’une évaluation de la valeur du capital, avec pour objectif la restitution, à la fin de la vie des centrales, de la valeur initiale actualisée, le coût du mégawattheure (MWh) varie entre 33 et 50 euros, sans compter 1,50 euro de frais publics complémentaires.
La Cour a estimé que le chiffre le plus élevé était celui qui correspondait le mieux à la réalité des coûts en l’état actuel du parc.
En deuxième lieu, elle a mis en exergue les incertitudes relatives à l’évaluation des charges futures.
D’abord en matière de coûts de gestion à long terme des déchets : théoriquement, l’évaluation doit faire l’objet d’une décision en 2015 car, entre le chiffre de 16 milliards d’euros avancé en 2005 et celui, plus récent et fortement contesté par les exploitants, de quelque 36 milliards d’euros, l’écart est de plus du simple au double.
Ensuite en matière de charges de démantèlement. Le sujet est d’autant plus complexe que les quelques centrales déjà démantelées ne sont pas de même type que celles du parc actuel : on ne bénéficie donc pas de l’avantage de série que met en avant EDF en faisant valoir que le démantèlement de cinquante-huit installations de même type coûterait moins cher grâce à l’expérience progressivement acquise.
Nous avons recensé trois méthodes d’évaluation : une méthode « historique » qui ne nous a pas convaincus ; la méthode « Dampierre », fondée sur l’analyse détaillée des opérations de démantèlement d’une centrale type et qui nous est apparue relativement solide, mais dont nous avons jugé qu’elle exigeait d’être approfondie et davantage expertisée ; enfin, les comparaisons internationales. Alors que l’évaluation d’EDF n’est que de 18 milliards d’euros, on arrive, en transposant les études disponibles, à un montant compris entre 20 et 62 milliards d’euros.
En troisième lieu, le rapport fournit une estimation de la sensibilité du coût moyen à l’évolution des charges futures, afin de donner une idée des répercussions que pourraient avoir d’éventuelles erreurs ou des changements d’évaluation. Il apparaît que cette sensibilité est relativement faible. Un doublement des charges de démantèlement se traduirait par une hausse de l’ordre de 5 % du coût courant économique. Le doublement du devis de stockage profond aurait une incidence limitée à 1 %. La sensibilité à une diminution d’un point du taux d’actualisation, qui est actuellement d’environ 5 % dont 2 % au titre de l’inflation, est de + 0,8 %. En sens contraire, si le taux d’actualisation augmentait d’un point, le coût annuel diminuerait de 0,6 %.
En quatrième lieu, la Cour a insisté sur l’importance stratégique de la durée effective de fonctionnement des réacteurs. Bien entendu, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la part que doit occuper le nucléaire dans le bouquet énergétique français et sur les orientations que le Président de la République a fixées en ce domaine. Elle a simplement constaté que l’âge moyen de nos réacteurs était de vingt-cinq ans en 2010 et que vingt-deux d’entre eux, soit 30 % de la puissance installée, auraient quarante ans avant la fin de 2022. Or il paraît très difficile de remplacer cette capacité à cette date – que ce soit par de nouveaux réacteurs ou par des sources d’énergie renouvelables – sans un effort considérable, étant donné les délais importants que demande l’organisation d’investissements de ce type, et cette situation aurait pour conséquence une augmentation des coûts de maintenance.
En cinquième lieu, une hausse des coûts à court et moyen terme est par conséquent prévisible. Je rappelle que le rapport a été élaboré juste après la catastrophe de Fukushima. Les conclusions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont été connues au début de janvier 2012 et notre rapport a été publié à la fin du même mois. Le travail s’est fait en parallèle et en très bonne entente, mais, du fait de cette concomitance, nous n’avons pas pu exploiter l’intégralité des résultats publiés par l’ASN. Nous avons néanmoins indiqué qu’il fallait s’attendre à une augmentation des investissements annuels, que le coût de l’EPR serait vraisemblablement très supérieur au coût actuel de production, et nous avons posé la question des investissements de remplacement. D’autre part, il nous est apparu que l’engagement d’un programme de recherches sur la quatrième génération supposait des investissements considérables. Le programme d’investissements d’avenir prévoyait dans ce domaine quelque 650 millions d’euros pour un premier réacteur d’essai mais, selon les experts, les ordres de grandeur pour les coûts d’une quatrième génération – si quatrième génération il doit y avoir – seront de plusieurs dizaines de milliards d’euros.
La question des investissements de maintenance nous a semblé cruciale. EDF a plus que doublé ces investissements entre la période 2003-2008, où ils étaient en moyenne de 800 millions d’euros par an, et 2010, où ils s’élevaient à 1,7 milliard. Avant que l’ASN ne demande des équipements supplémentaires, l’entreprise prévoyait de passer à une moyenne annuelle de 3,4 milliards d’euros sur la période 2011-2025, soit un programme de l’ordre de 50 milliards d’euros au total. Après les demandes complémentaires de l’ASN, elle indiquait que ce programme passerait de 50 à 55 milliards, estimant qu’une partie des 10 milliards d’euros d’investissements réclamés par l’Autorité était déjà comprise dans les 50 milliards. Selon ce calcul, les dépenses de maintenance atteindraient une moyenne annuelle de 3,7 milliards d’euros.
Ces dépenses ont un effet sur les coûts immédiats bien plus important que les dépenses futures, dans la mesure où ces dernières sont diminuées par l’actualisation.
Le travail que nous avons effectué il y a deux ans déjà peut être actualisé sur plusieurs points. Je citerai les coûts d’exploitation d’EDF ; les dépenses de recherche – qui ont été stables, pendant cinquante ans, s’établissant à un milliard d’euros par an dont 400 millions financés sur crédits publics, si bien que l’on peut se demander si le but premier n’était pas de remplir les laboratoires de recherche du CEA – ; les coûts de la sécurité et de la transparence ; le démantèlement, pour lequel il reste à examiner la suite donnée à la recommandation de la Cour d’affiner la méthode Dampierre pour le calcul des provisions d’EDF. Il conviendrait également de prendre en compte d’éventuels nouveaux chiffrages, réalisés à l’étranger et en France, et plus généralement les éléments de benchmarking disponibles, en matière de démantèlement, de gestion des combustibles usés et de gestion des déchets radioactifs.
La Cour s’était par ailleurs interrogée sur les provisions destinées aux travaux futurs, considérant qu’une partie en était financée par des actifs dédiés qui n’étaient pas totalement indépendants de l’industrie nucléaire.
Les approfondissements possibles devraient d’abord concerner les coûts de l’EPR, compte tenu de deux éléments nouveaux : la réévaluation à la hausse des chantiers en cours et le contrat passé avec l’industrie britannique, qui prévoit un prix d’achat de l’électricité nucléaire de l’ordre de 112 euros par MWh, soit très au-dessus des 49,50 euros du coût courant économique calculé en 2010, mais également de la fourchette de 70 à 90 euros par MWh annoncée à l’époque – sans que la Cour ait pu la valider.
Il sera intéressant également d’observer l’évolution des investissements de maintenance par rapport aux chiffres annoncés, maintenant que nous disposons d’un peu de recul par rapport aux travaux consacrés à l’accident de Fukushima.
Il conviendrait enfin de vérifier s’il n’existe pas d’études nouvelles en matière d’externalités et d’intégrer celles qui ont été publiées en matière d’assurances. À ce dernier égard, la Cour avait constaté que les engagements correspondaient à une « petite » catastrophe, mais que la France devait ratifier une convention les portant au double. En revanche, l’estimation des conséquences d’une catastrophe considérable était et reste insuffisante – il est vrai que celles des trois catastrophes majeures qui se sont produites à ce jour, à Three Mile Island, à Tchernobyl et à Fukushima, sont difficiles à évaluer.
Nous ne disposions, lorsque nous avons rédigé notre rapport, que d’une étude réalisée par une petite équipe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sur l’hypothèse d’une catastrophe « moyenne », évaluée à 70 milliards d’euros. Aussi avons-nous examiné les conséquences qu’aurait sur le prix de l’électricité la constitution en quarante ans d’une dotation couvrant un tel choc. Cela étant, il serait utile d’analyser les éventuels travaux réalisés à la suite de la catastrophe de Fukushima.
La Cour a prévu de travailler sur toutes ces questions en 2014, en faisant appel, comme de coutume en pareil cas, à des experts extérieurs. Il ne s’agit pas, bien entendu, de chiffrer les objectifs et les conséquences d’un changement de composition du parc, question qui relève du politique. L’idée est plutôt d’approfondir la compréhension d’une partie des données concernant les coûts.
M. Denis Baupin, rapporteur. Le rapport rendu par la Cour des comptes en 2012 marque un progrès notable en matière de transparence. Comme vient de nous le confirmer la Commission de régulation de l’énergie (CRE), il montre que nous sommes dans une période de croissance significative des coûts de la technologie nucléaire, ce qui ne vient pas forcément à l’esprit des gens lorsqu’on leur dit que le parc est censé être amorti. Et les coûts du nucléaire nouveau connaissent, avec l’EPR, une hausse plus importante encore.
Vous avez souligné un point important pour les responsables politiques : il est urgent de prendre des décisions compte tenu de l’âge moyen du parc et des délais nécessaires au remplacement des centrales par d’autres centrales – quoi qu’on en pense par ailleurs –, à la prolongation de leur durée de vie ou à la mise en place d’autres moyens de production. Ce sera d’ailleurs l’objet de la loi sur la transition énergétique.
J’en viens à mes questions.
La Cour met en évidence que l’industrie nucléaire s’est développée en France avec un fort soutien public. Selon ses chiffres, le coût de construction du parc actuellement en exploitation s’élève à environ 96 milliards d’euros, pour un investissement total dans la filière de 188 milliards d’euros, soit du double. Entrent dans ce dernier montant les 55 milliards consacrés à la recherche publique, financée donc par le contribuable, ainsi que la prise en compte des coûts en cas d’accident. Cependant, le coût de la gestion des déchets et des démantèlements apparaît, lui, sinon sous-évalué, du moins insuffisamment évalué.
La Cour ne le relève pas, mais le réseau de transport d’électricité en France s’est structuré en fonction d’un système de production extrêmement centralisé. Lorsqu’on affirme que la transition énergétique entraînera des coûts considérables sur ce poste, on omet de dire que ce réseau a été conçu pour un mode de production bien particulier.
Il s’agit là d’autant d’avantages publics accordés pour le développement de l’industrie nucléaire. Je ne suis pas choqué sur le principe, mais ne conviendrait-il pas, pour comparer les différents modes de production d’électricité, de distinguer pour chacun d’entre eux non seulement son coût de fonctionnement, mais aussi ce qu’il coûte en soutiens publics ? Il faudrait alors, pour comparer le prix des énergies renouvelables à celui du nucléaire, prendre en compte toutes les aides publiques accordées à celui-ci et à celles-là, en plus du coût de production du MWh.
Vous avez fait état d’un coût de 55 milliards d’euros pour les opérations de « grand carénage » en y incluant les évaluations complémentaires de sûreté (ECS). Au moment de l’élaboration du rapport, les informations à ce sujet étaient peu nombreuses. Disposez-vous d’éléments plus précis sur ce que recouvrent ces chiffres ? Le travail que vous mènerez cette année comprendra-t-il une expertise plus approfondie ? Nous avons été un peu surpris d’entendre EDF affirmer, presque au lendemain de la publication de ses préconisations par l’ASN, que les ECS étaient déjà prises en compte et que, sur les dix milliards qu’elles exigeraient, cinq étaient couverts par les investissements déjà prévus, de sorte que la facture totale s’établirait à 55 milliards. Nous en sommes restés à ces chiffres sans disposer de la moindre expertise. La commission d’enquête aura à se pencher sur le sujet mais l’éclairage de la Cour lui serait utile.
Qu’en sera-t-il, par ailleurs, des coûts potentiels à la charge de la collectivité ? Dans un rapport récent consacré au recensement et à la comptabilisation des engagements hors bilan de l’État, la Cour recommande d’inscrire dans le hors bilan des comptes de la France le coût des risques d’accident nucléaire assumé par l’État à la place de l’exploitant. Pourriez-vous nous en dire plus, sachant que les parlementaires peuvent prendre des initiatives en la matière ?
Commentant ce qui s’est passé au Japon, la Cour relève à quel point l’impréparation législative en matière d’indemnisation et de prise en compte des coûts peut être handicapante lorsque se produit une situation d’urgence et qu’on a autre chose à faire qu’élaborer des lois ! Un pays qui compte un aussi grand nombre d’installations nucléaires que le nôtre se doit donc de mieux anticiper.
Le rapport retient l’évaluation de 70 milliards d’euros pour le coût de ce que vous appelez, dans un quasi-oxymore, une « catastrophe moyenne », mais il cite aussi l’estimation avancée par l’IRSN du coût des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima : entre 600 et 1 000 milliards d’euros, soit le décuple – depuis, cet organisme a publié d’autres chiffres.
M. Bernard Accoyer. À Fukushima, il y a eu un tsunami !
M. le rapporteur. Sachant que les autres modes de production d’énergie sont assurés, une comparaison des coûts exige que l’on établisse le coût de l’assurance du nucléaire. Selon vos chiffres, une assurance à hauteur de 70 milliards provisionnés sur quarante ans induirait un surcoût de 1,41 euro par MWh, soit 3,52 % du coût actuel du nucléaire. Si l’on retient l’hypothèse d’une catastrophe majeure, il faut multiplier ce montant par dix, soit une augmentation de 35 % du coût du MWh !
Je ne dis pas que cette hausse doit forcément être répercutée sur l’usager, je demande seulement de la transparence dans la comparaison entre les énergies. Les Charbonnages de France, nous a dit M. de Ladoucette, s’assuraient eux-mêmes. Mais pas le nucléaire !
Le rapport évoque peu la question du retraitement et de la fabrication du MOX. Pourtant, la Cour aurait légitimité à établir si cette « sous-filière » est efficace d’un point de vue industriel ou si, au contraire, elle est coûteuse pour la collectivité. Le problème est complexe car il exige qu’on considère l’ensemble de la gestion des déchets avant et après retraitement. Votre expertise nous serait précieuse. Certains laissent entendre que le retraitement serait une forme de recyclage, qui améliorerait l’efficacité de notre système. L’assimilation laisse à désirer…
M. Bernard Accoyer. Vous voulez parler de Superphénix ?
M. le rapporteur. Superphénix a coûté 12 milliards à la collectivité. Mais vous avez raison, monsieur Accoyer : derrière tout cela se pose la question de la quatrième génération. Une évaluation générale serait intéressante !
Ma dernière question concerne les provisions pour coûts futurs du nucléaire actuel, c’est-à-dire pour le démantèlement des centrales et pour la gestion des déchets. Certains préconisent que l’on affecte ces montants à des fonds de refinancement ou à des fonds de garantie dans la perspective de la transition énergétique. C’est la position du Fonds mondial pour la nature, le WWF, ainsi que celle de notre collègue Hervé Morin qui a proposé la création, à partir de ces provisions, d’un fonds souverain consacré à la transition énergétique. Qu’en pensez-vous ?
M. Gilles-Pierre Levy. Les 55 milliards de dépenses de recherche n’ont pas été financés uniquement sur fonds publics et, même, la proportion, de 70 % à l’origine, était tombée à 40 % en 2010 – le reste venant des exploitants dont la contribution est ainsi devenue prépondérante. Nous n’avons pas examiné ce qu’il en était pour les autres sources d’énergie, notamment pour les sources d’énergie renouvelables qui bénéficient elles aussi de financements publics.
Notre estimation du coût des investissements à réaliser, également de 55 milliards, mériterait d’être actualisée. À l’époque où nous rédigions notre rapport, EDF avait prévu de doubler le rythme de ses investissements de maintenance, qui contribuent à prolonger la vie des centrales – étant entendu que cette prolongation est autorisée par l’ASN, chaque fois pour une durée de dix ans. Le président de l’ASN, André-Claude Lacoste, avait alors évalué à une dizaine de milliards le coût des mesures complémentaires de sûreté à demander à EDF, mais admettait qu’une partie de celles-ci était comprise dans les investissements ainsi programmés. Le rapport de l’ASN n’ayant été disponible que trois semaines avant la publication du nôtre, nous n’avons pu établir que tel était bien le cas, mais je n’ai pas eu le sentiment de divergences majeures sur ce point entre l’autorité de sûreté et l’entreprise.
Faut-il inscrire dans le hors bilan les charges futures incombant à la collectivité ? Je serai prudent sur ce point dans la mesure où sont en jeu à la fois des considérations comptables et des considérations politiques. La logique conduirait à répondre positivement à la question, mais cela supposerait d’être en mesure d’évaluer ces charges et de vérifier si, en stricte méthode comptable, ces risques peuvent être pris en compte. Comme vous le savez, il existe des charges vraisemblables – charges d’accident ou de procès – qui sont rarement, ou inégalement, provisionnées dans les comptes des entreprises. Décider ce qu’il pourrait en être en l’espèce exigerait un travail technique que nous n’avons pas fait.
Nous n’avons pas évalué le coût d’une catastrophe nucléaire – nous ne saurions du reste pas le faire. Comme je l’ai dit, nous disposions sur le sujet d’une unique étude, conduite par une petite équipe de l’IRSN, qui avançait un montant de 70 milliards. Nous avons repris ce montant pour le cas où il aurait été décidé de constituer un fonds sur quarante années – soit la durée de vie d’une centrale nucléaire telle que fixée à l’époque –, mais nous n’avons pas parlé d’assurance : il serait bien difficile en effet de déterminer la probabilité, sans doute faible – mais non nulle –, à mettre en face d’un risque au coût très élevé.
Traitant des actifs dédiés, nous ne nous sommes pas penchés sur l’emploi qu’on pourrait en faire ; nous avons seulement examiné, d’une part, si leur montant était à la hauteur du risque actualisé et, d’autre part, s’il s’agissait d’actifs indépendants de l’industrie nucléaire et immédiatement réalisables le jour où serait entreprise une opération de démantèlement ou de stockage des déchets, puisque tel est l’objet auquel ils sont destinés. Nous avons constaté que l’indépendance de certains à l’égard de l’industrie nucléaire pouvait être contestée : autrement dit, si cette industrie venait à connaître de grandes difficultés, leur valeur en serait amoindrie de sorte que nous pourrions ne pas disposer de toutes les sommes nécessaires au moment où nous en aurions besoin – ainsi, quelle garantie offriraient les actions d’AREVA en cas de catastrophe nucléaire ? Par ailleurs, nous nous sommes interrogés sur l’affectation de la moitié des titres de RTE au portefeuille d’actifs dédiés d’EDF, la possibilité de réaliser ces titres apparaissant discutable.
Mme Michèle Pappalardo, conseiller maître à la Cour des comptes. Il est vrai que certains pays ont constitué des fonds véritablement dédiés. Pour notre part, nous nous sommes bornés à vérifier que les textes prévoyant des actifs dédiés étaient convenablement appliqués et à examiner si la rentabilité de ces fonds, telle que nous pouvions la calculer, était suffisante pour maintenir les moyens nécessaires au financement des dépenses de démantèlement et de stockage, mais il reste que le choix fait par la France n’est pas celui de tous les États nucléaires et nous l’avons relevé dans notre rapport.
Pour ce qui est du retraitement et du MOX, la question qui nous était posée portait uniquement sur le coût dans la situation telle qu’elle était à l’époque. Nous n’avons donc pas tenté des comparaisons avec d’autres pays ni cherché à esquisser des scénarios alternatifs – ce dont nous n’aurions pas eu le temps, d’ailleurs, dans le délai qui nous était imparti et ce qui n’est au surplus pas conforme à la vocation de contrôle a posteriori de la Cour. Nous avons seulement relevé qu’en bonne comptabilité, les combustibles usés non retraités devraient être considérés comme des déchets et faire comme tels l’objet de provisions prudentes.
Lorsque nous rédigions notre rapport, nous savions que l’IRSN travaillait à de nouvelles études, mais celles-ci n’ont été publiées qu’une fois notre travail achevé. Nous prévoyons cependant de les regarder de près afin de préciser nos calculs de coûts. En revanche, si nous avons manqué de temps pour exploiter le rapport de l’ASN tirant les conséquences de l’accident de Fukushima, publié à peu près en même temps que le nôtre, celui-ci résultait de travaux menés au cours des quatre ou cinq mois précédents en concertation avec les opérateurs, de sorte que nous avons eu une bonne idée de la répartition des 10 milliards de dépenses exigées par ces mesures de sûreté complémentaires – à peu près à égalité entre des investissements déjà prévus et des investissements à programmer. Cela étant, il ne s’agissait encore que d’un chiffrage grossier et les travaux à réaliser doivent être précisés. Nous comptons donc affiner notre analyse sur le sujet.
M. Bernard Accoyer. Il faut féliciter la Cour pour la façon dont elle s’est acquittée de la commande qui lui avait été adressée, tout en regrettant que celle-ci n’ait couvert qu’une part très restreinte du sujet qui nous occupe. S’il est en effet une question transversale, c’est bien celle du coût de l’énergie dont l’évolution, depuis le premier choc pétrolier, a bouleversé la donne économique et sociale partout sur notre planète. Or, quelle que soit par ailleurs sa qualité, ce rapport se focalise, si on peut le dire ainsi, sur les microbes alors qu’il faudrait considérer toute la personne du malade. De ce fait, il nous manque des éléments de comparaison internationale – cette étude est limitée à la France – et de comparaison avec les autres sources d’énergie.
La décision visionnaire prise de lancer la France des années 1960 dans l’aventure de l’électronucléaire a permis de fait d’anticiper les chocs pétroliers. Nous nous inscrivons à cet égard dans une histoire continue et il eût été bon que la Cour en considère les effets bénéfiques sur notre balance commerciale, sur notre endettement ou sur le niveau de vie de nos concitoyens. En revanche, aujourd’hui, alors que quelque 80 % de notre électricité est fournie par l’énergie nucléaire, diminuer la part de celle-ci au profit de sources d’énergie renouvelables dont ni le coût ni les fragilités n’ont encore été évalués nous condamnerait à augmenter nos importations de combustibles fossiles, comme c’est le cas en Allemagne, et conduirait en tout état de cause à une hausse du prix de cette électricité. Il y avait donc là des éléments à considérer pour l’évaluation financière que nous devons conduire et ces éléments nous font pour l’heure cruellement défaut.
S’agissant d’une question aussi essentielle pour notre souveraineté nationale que le nucléaire en général, n’était-il pas normal qu’une grande part de la recherche soit publique ? L’enjeu de sécurité, y compris militaire, nos intérêts en matière technologique et industrielle, l’équilibre de notre balance commerciale, voire la renommée de notre pays dans le monde le justifiaient, sans parler des possibilités de partenariats internationaux que nous ouvre notre maîtrise de cette filière. Les bénéfices de cette maîtrise reconnue ne méritent-ils pas d’être, eux aussi, évalués et pris en compte ?
Puisque vous avez évoqué les réacteurs de quatrième génération, monsieur le rapporteur, je rappellerai que la France avait pris une avance technologique décisive en matière de surgénération, se dotant d’un surgénérateur expérimental. On a malheureusement décidé de démanteler celui-ci au prétexte qu’il n’était pas raccordé au réseau, comme si le fait était anormal ! On s’est ainsi privé du moyen de progresser dans le traitement des déchets radioactifs.
Je respecte votre engagement anti-nucléaire, monsieur Baupin, mais la bonne information de notre commission d’enquête et, à travers elle, de nos compatriotes commande de ne pas s’en tenir à des considérations financières. Et si, dans ce domaine comme d’ailleurs dans bien d’autres, y compris du fait de la nature, une catastrophe est toujours possible, on ne peut par exemple faire abstraction de ce que serait le réchauffement climatique si la France et d’autres pays n’avaient pas depuis de longues années recouru à l’énergie nucléaire. Nos travaux gagneraient donc à être élargis à bien des éléments.
M. Christian Bataille. Notre rapporteur, qui est un habile homme, ne se contente pas de poser des questions : il avance aussi des affirmations… dont nous pourrions longuement disputer si nous en avions le temps. Je relèverai simplement que le retraitement ne se limite pas à un coût : c’est aussi un progrès qui permet de réduire le volume des déchets – les États-Unis, qui ont abandonné cette voie de recherche après les années soixante-dix, croulent maintenant sous des montagnes de combustible usé ! Cependant, eux ont une chance que nous n’avons pas : celle de disposer d’un vaste territoire sur lequel entreposer ces déchets. D’autre part, avec le MOX, nous bénéficions d’un combustible exceptionnel qui permet de réutiliser le plutonium dans la moitié de nos réacteurs, nous évitant des achats massifs d’uranium. Mais ce mélange n’a d’avenir que si nous développons une quatrième génération de réacteurs, dont la raison d’être est précisément de permettre la réutilisation du combustible usé sur plusieurs cycles. En ce sens, c’est une réponse à la pénurie d’énergie d’origine nationale et il serait très dommage de ne pas exploiter les avancées réalisées en la matière grâce au CEA.
Monsieur Levy, il y a quelques années, s’agissant des fonds dédiés, Claude Birraux et moi-même avions rédigé pour le compte de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) une étude qui nous avait conduits à avancer une proposition, finalement écartée par le rapporteur de la loi de 2006. Pour dire les choses comme elles sont, EDF avait collecté des fonds auprès des industriels et des consommateurs mais, à travers elle, c’était l’État, avec lequel elle se confondait à l’époque, qui agissait. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir s’il est légitime que des entreprises – EDF, mais aussi AREVA et le CEA – détiennent des fonds destinés à couvrir le coût du démantèlement des centrales et du traitement des déchets radioactifs, d’autant que ces sommes sont ensevelies dans leurs comptes car on a jugé qu’il serait malvenu de laisser dormir cet argent. En demander la restitution mettrait certes EDF en difficulté et l’idée provoque l’émoi de sa direction, de sorte que l’État n’aborde plus le sujet qu’avec beaucoup de précautions, mais il serait tout de même plus sain de rattacher progressivement ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Qu’en pense la Cour des comptes ?
M. Jean-Pierre Gorges. Attention à ne pas truquer les chiffres, monsieur le rapporteur ! Lorsqu’on entreprend d’intégrer la prise en compte des risques dans l’évaluation des coûts de la filière nucléaire, il ne faut pas comprendre n’importe quoi dans cette notion. On estime à quelque 700 milliards le coût d’une catastrophe comme celle de Fukushima, qui résultait à la fois d’un tremblement de terre, d’un tsunami et d’une mauvaise conception de la centrale. Mais quel serait le coût de la rupture du barrage de Sainte-Croix si elle se soldait par une submersion de la vallée faisant 500 000 morts ? Allez-vous le prendre en compte pour comparer les énergies nucléaire et hydraulique, comme la cohérence l’exigerait ? Si ce n’est pas le cas, nous n’avancerons jamais. Toute activité comporte des risques : quand vous prenez le volant, la probabilité que vous écrasiez vingt personnes n’est pas nulle. Je souhaite donc que nous soyons très précis sur ces questions.
J’ai apprécié l’intervention de notre collègue Christian Bataille. Je n’en dirai pas autant, monsieur Levy, de votre remarque à propos de la cinquantaine de milliards consacrés à la recherche : ce milliard par an, avez-vous dit, aurait permis d’occuper les chercheurs du CEA. Sous-entendiez-vous que cette dépense n’avait pas lieu d’être, ou au contraire qu’elle était insuffisante ? Pour ma part, je pense que si nous avions davantage investi dans la recherche nucléaire, nous n’en serions plus aujourd’hui à l’EPR, mais déjà à la quatrième génération de réacteurs et nous aurions avancé dans le traitement des déchets – car ce sont deux technologies différentes même si, en 2007, deux candidats à l’élection présidentielle les confondaient ! Le général de Gaulle a su anticiper mais, ensuite, l’effort de recherche n’a pas été poursuivi comme il aurait fallu, de sorte que le premier choc pétrolier nous a condamnés durablement au déficit budgétaire. Il importe aujourd’hui de reprendre cet effort. Or, en mettant l’accent sur les coûts de la filière, on peut en arriver à accréditer bien des idées erronées. Le fait que le nucléaire soit l’énergie la moins chère gêne ? On insiste alors sur sa dangerosité pour conclure que c’est en fait la plus chère, bien que l’histoire n’ait rien démontré de tel, même en prenant en compte Three Mile Island et Tchernobyl – étant entendu qu’il est encore trop tôt pour mesurer les effets exacts de Fukushima.
Mme Marie-Noëlle Battistel. En vue de faire face aux charges de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs, EDF, AREVA et le CEA ont constitué des provisions couvertes par des actifs dédiés. Une baisse du taux d’actualisation applicable aux provisions ne peut qu’entraîner une dégradation du résultat de ces entreprises. En avez-vous étudié l’effet, à la fois dans l’hypothèse où l’on s’en tiendrait aux échéances actuellement fixées et dans celle où l’on prolongerait la durée de vie des centrales ?
M. le rapporteur. Notre collègue Christian Bataille a raison : cette commission d’enquête doit se pencher sur la question du retraitement et sur celle des centrales de quatrième génération. Quelles que soient mes convictions, j’estime en effet qu’on ne peut éluder ces sujets et nous devrons donc y consacrer des auditions.
En réponse à MM. Accoyer et Gorges, je maintiens – en tant qu’écologiste, mais ce devrait être le point de vue de tous – que nous ne pouvons faire l’économie de nous prémunir contre tous les risques. Pour reprendre l’exemple de l’automobile, les conducteurs ne sont-ils pas obligés de souscrire une assurance, et ne demande-t-on pas aux constructeurs de fabriquer des véhicules de plus en plus sûrs ? Il est dès lors normal de chercher à calculer le coût des assurances nécessaires pour toutes les activités du domaine nucléaire. Ce n’est au reste pas un hasard s’il existe une Autorité de sûreté nucléaire, mais pas d’Autorité de sûreté de l’automobile : c’est que les risques sont bien plus importants dans ce secteur industriel…
M. Jean-Pierre Gorges. Il y a plus de morts sur les routes que du fait d’accidents nucléaires !
M. le rapporteur. En France, mais n’oubliez pas Tchernobyl et Fukushima ! D’autre part, les présidents successifs de l’ASN, André-Claude Lacoste et Pierre-Franck Chevet, n’ont pas exclu la possibilité d’une catastrophe nucléaire majeure dans notre pays ; nous devons donc essayer d’en évaluer le coût et le prendre en compte pour comparer entre elles les différentes sources d’énergie. L’écroulement d’une éolienne et un accident dans une centrale ne font pas exactement les mêmes dégâts ! Plutôt que de faire semblant de nier les risques, nous gagnerions à en prendre la mesure aussi précisément que possible.
M. Jean-Pierre Gorges. En les pondérant par la probabilité !
M. le président François Brottes. Lorsqu’on veut réduire le nombre des accidents de la route, on y met des radars et le risque diminue…
La commission Champsaur, dont j’étais membre, a eu de longues discussions à propos de la méthode du « coût courant économique ». L’amortissement étant fonction de la durée d’exploitation des installations, la question de la prolongation ou non de la durée de vie des centrales est décisive mais, comme l’a relevé la Cour dans la synthèse de son rapport, nous nous heurtons à cet égard à un mur qu’il sera difficile de franchir. Peut-être même est-il trop tard pour prendre une décision.
S’agissant de la technologie de quatrième génération, avez-vous écouté d’autres voix que celle du CEA ? Est-ce d’ailleurs, de ce que vous avez pu en percevoir, une véritable quatrième génération, ou seulement une troisième génération bis, un EPR amélioré ?
M. Christian Bataille. Il y a tout de même ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) !
M. le président François Brottes. Il s’agit d’un programme de recherche sans prototype à ce stade. C’est une des voies de la quatrième génération : il en existe d’autres.
Il faut garder à l’esprit que l’EPR de Flamanville est un prototype, que par ailleurs le cahier des charges évolue en fonction de la réglementation et que tout cela influe sur les coûts et sur les délais de construction – sans parler des incidents imputables à un certain amateurisme. Cependant, ce réacteur devant être plus sûr que les précédents et produire moins de déchets, on pourrait attendre que ces surcoûts de fabrication soient compensés par un moindre coût d’exploitation : ne pourriez-vous examiner ce point dans le travail complémentaire que vous allez réaliser ?
M. Gilles-Pierre Levy. Avant de répondre à toutes ces questions, je veux rappeler que la tâche de la Cour n’est que de dresser des constats factuels, d’approfondir les données obtenues, et non d’effectuer des simulations, et que notre rapport n’avait pas pour objet de comparer l’énergie nucléaire et les autres énergies. Cela étant, nous avons produit cet été un autre rapport consacré à la politique de développement des énergies renouvelables et, à la demande d’une commission d’enquête du Sénat, Michèle Pappalardo a conduit en 2012 un travail sur les évolutions prévisibles de la contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Le rapport que nous avons remis il y a deux ans maintenant visait à répondre à une question implicite : y a-t-il des coûts cachés de l’électricité nucléaire ? Toutefois, il est vrai que nous n’avons pas pris en compte les externalités – impact sur l’emploi, sur l’environnement, sur la balance des paiements, etc. –, non qu’elles n’existent pas, mais parce que leur évaluation pose des problèmes économiques compliqués. Et si nous avons fait état d’un faible niveau d’émission de CO2, nous ne nous sommes pas engagés dans une comparaison sur ce point avec les sources d’énergie alternatives.
Pour ce qui est des fonds dédiés, ce que nous avons cherché à déterminer, c’est s’ils étaient suffisants, convenablement isolés, constitués d’actifs indépendants de l’industrie nucléaire et suffisamment diversifiés. Nous avons constaté que ces actifs couvraient seulement 78 % des provisions actualisées et qu’y figuraient des titres d’activités de la filière, dont la réalisation serait donc affectée par un accident nucléaire. Peut-on isoler ces titres ? Nous n’avons pas étudié ce point, mais je serais tenté de répondre par l’affirmative tout en notant qu’il en résulterait pour les entreprises détentrices une moindre valeur de leur action, sauf attribution d’une compensation.
M. Christian Bataille. Il ne faut pas seulement réfléchir à l’emploi qui pourrait être fait de ces fonds dans l’hypothèse d’une catastrophe : n’oublions pas qu’ils doivent notamment servir à la réalisation du centre industriel de stockage géologique (Cigéo).
M. Gilles-Pierre Levy. Pour l’instant, ils sont uniquement prévus pour couvrir les dépenses de démantèlement et de stockage des déchets, soit des dépenses certaines. Nous avons, à titre exploratoire en quelque sorte, étudié l’hypothèse d’un fonds destiné à faire face à une catastrophe – nous avons estimé qu’il devrait être doté de 70 milliards d’euros sur quarante ans –, mais rien de tel n’existe pour l’heure.
Je me suis probablement mal exprimé en ce qui concerne les dépenses de recherche. Nous avons simplement été frappés par la constance des budgets qui y ont été consacrés 55 années durant. Cette constance se justifie : il faut du temps pour constituer des équipes et celles-ci ne peuvent être renouvelées en un seul coup, ce qui permettrait de relâcher l’effort ensuite. En revanche, comme je l’ai dit, nous avons constaté que la part financée par des crédits publics, majoritaire au début de la période, est aujourd’hui devenue minoritaire, tombant à quelque 40 %. Est-ce trop ou trop peu ? Nous n’avons émis aucun jugement sur ce point, notre seule préoccupation étant, je le répète, de déterminer si nous devions ou non prendre en compte dans les coûts de l’électricité nucléaire les dépenses de recherche publique et de sécurité. Nous avons par ailleurs constaté, même si les deux choses n’ont aucun lien, que les montants en cause équivalaient approximativement à ceux de la taxe sur les installations nucléaires de base.
Il est incontestable qu’une modification du taux d’actualisation aurait un impact sur le montant des provisions à constituer, et donc sur le résultat comptable des entreprises.
S’agissant de la durée d’exploitation, nous avons constaté que si nous devions, à consommation d’électricité à peu près identique, substituer d’ici à 2025 à vingt-deux de nos réacteurs actuels soit des EPR, soit des sources d’énergie renouvelables, il y faudrait un effort financier très important et qu’en tout état de cause, sauf cas de force majeure, nous n’y réussirions probablement pas, sachant que la construction d’une centrale demande environ dix ans.
M. Christian Bataille. Voire quinze ans !
M. Gilles-Pierre Levy. La Cour ne dispose d’aucune expertise en ce qui concerne la quatrième génération. Nous avons simplement écouté les experts du CEA, qui nous ont expliqué que l’EPR n’était rien de plus qu’un réacteur actuel plus puissant et plus sûr et que cette nouvelle génération représentait par rapport à lui un saut technologique, moyennant quoi on pourrait désormais brûler du plutonium. Cela étant, vous avez entièrement raison, monsieur le président : s’agissant de l’EPR, il faut considérer l’ensemble des coûts.
Mme Michèle Pappalardo. Ceux qui calculent ces coûts nous disent que, par construction, le coût d’exploitation de ces réacteurs devrait être plus faible que celui des précédents. La Cour ne peut pour l’instant que prendre acte de leurs explications, en attendant d’en vérifier la véracité lorsqu’un premier EPR fonctionnera.
M. le rapporteur. Il faut préciser que les coûts de l’EPR sont appréciés sur une durée d’exploitation de soixante ans, avec un taux de disponibilité de 90 %, alors que ceux des réacteurs actuels sont calculés sur une durée de vingt-cinq ans, avec un taux de fonctionnement de 80 %. Mais les contrats signés avec les Britanniques fournissent une évaluation du coût réel, garanti pendant trente-cinq ans, excédant notablement le coût de l’éolien, par exemple.
M. le président François Brottes. La Cour pense-t-elle être en mesure de nous fournir des éléments complémentaires avant la conclusion de nos travaux ?
M. Gilles-Pierre Levy. Nous aurons en tout état de cause travaillé et nous pourrons faire devant vous au moins un point d’étape.
M. le président François Brottes. Nous ne manquerons donc pas de vous solliciter. Je vous remercie.
Audition de M. Jean Desessard, sénateur de Paris,
et M. Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Eure
(Séance du jeudi 9 janvier 2014)
M. le président François Brottes. Nous avons le plaisir de recevoir M. Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Eure, et M. Jean Desessard, sénateur de Paris, qui ont été respectivement président et rapporteur de la commission d’enquête du Sénat « sur le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents agents économiques ». Certes, depuis les travaux de cette commission d’enquête, qui se sont déroulés durant le premier semestre de l’année 2012, certains paramètres ont évolué ; toutefois, les analyses d’ensemble proposées à l’époque restent valides. Il nous a donc paru utile de vous entendre, messieurs, car, sans recourir au copier-coller, nous entendons tenir compte de ce qui a été fait par le Sénat. Certes, notre champ d’enquête est plus restreint que ne l’était le vôtre, puisqu’il se limite à l’électricité d’origine nucléaire, mais notre réflexion s’inscrit forcément, selon les termes de la proposition de résolution, « dans le périmètre du mix électrique français et européen ».
Avant de vous laisser la parole, je dois vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de bien vouloir jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Ladislas Poniatowski et Jean Desessard prêtent serment)
Je vous informe que cette audition fait l’objet d’une captation audiovisuelle qui sera rendue publique.
M. Ladislas Poniatowski, sénateur. Comme la vôtre, notre commission d’enquête a été créée à l’initiative du groupe écologiste. Nous avons bénéficié de la suspension des travaux parlementaires liée aux élections présidentielle et législatives, ce qui nous a laissé le temps de mener de très nombreuses auditions. Notre champ d’investigation était, dès l’origine, plus ouvert que le vôtre car il ne concernait pas seulement le nucléaire ; nous l’avons encore élargi, d’un commun accord, en fonction de ce que suggéraient nos auditions et de ce que semblait exiger le sujet, en nous affranchissant chaque fois quelque peu des termes précis de l’exposé des motifs de la proposition de résolution créant notre commission d’enquête. Cependant, si nous avons pu prendre en compte dans notre rapport les travaux de sécurité exigés par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) après l’accident de Fukushima, nous ne pouvions anticiper ni la décision du Président de la République de fermer Fessenheim, ni l’explosion de la production de gaz de schiste, dont nous n’aurions pas pu nous désintéresser en ce qui nous concerne, puisqu’elle affecte le coût de l’électricité en général.
M. le président François Brottes. La Commission des affaires économiques de l’Assemblée a créé une mission d’information « sur l’impact du gaz de schiste sur le marché du gaz et sur l’équilibre de nos systèmes européens de production et de distribution d’énergie »…
M. Ladislas Poniatowski. L’exposé des motifs de la proposition de résolution présentée au Sénat par les écologistes était politiquement très orienté – il me semble que, dans une moindre mesure, c’était également le cas du texte examiné par l’Assemblée. Pour ma part, j’ai apprécié qu’à mesure qu’il avançait dans son travail, le rapporteur de notre commission d’enquête ait fait preuve d’une réelle ouverture d’esprit sur tous les sujets. Je n’insinue pas qu’il a cessé d’être écologiste pour devenir partisan du nucléaire, mais cela a permis d’aboutir à un rapport assez complet, me semble-t-il, et dépourvu de certaines « connotations ».
Lors de nos auditions et de nos déplacements sur le terrain, nous avons beaucoup travaillé sur certains des sujets qui vous intéressent, qu’il s’agisse des dépenses de recherche, du démantèlement des centrales et de la gestion des déchets, ou encore des investissements de maintenance, qu’ils soient destinés à assurer le bon fonctionnement des centrales, à les rendre plus sûres compte tenu des enseignements tirés de l’accident de Fukushima ou à permettre de porter leur durée de vie à quarante ou cinquante ans, voire à soixante, comme l’a autorisé l’autorité de sûreté des États-Unis pour les trois quarts des centrales de ce pays. Même si, comme la Cour des comptes, nous considérons qu’il nous manque des éléments pour nous faire une idée précise du coût des opérations de démantèlement et du coût de la gestion des déchets, j’estime que nous sommes allés assez loin sur l’ensemble de ces sujets.
Nous avons également abordé des questions qui concernent moins directement votre commission d’enquête : par exemple la contribution au service public de l’électricité (CSPE), qui influe sur le prix de l’électricité payé par tous les Français et qui garantit, en plus de la péréquation tarifaire en Corse et dans les départements d’outre-mer, le développement des énergies renouvelables – la Cour des comptes nous a remis sur le sujet un rapport très intéressant –, ou encore le problème de la gestion des pointes de consommation, problème spécifiquement français puisque lié à l’importance prise par le chauffage électrique dans notre pays.
Je conclurai en profitant de l’occasion qui m’est donnée de rendre hommage à M. Desessard. Même si son approche de départ était assez orientée sur un problème aussi complexe que la prise en charge des risques d’accidents nucléaires, par exemple, son esprit critique l’a finalement emporté.
M. Jean Desessard, sénateur. Les membres d’une commission d’enquête étant désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques, vous imaginez bien que les défenseurs du nucléaire et ceux qui ne partagent pas cette cause n’étaient pas représentés à parité dans la nôtre. Si les conclusions du rapport ont montré la persistance de divergences, nous avons pu toutefois dégager entre nous quelques points de consensus.
Ainsi nous sommes tombés d’accord sur le fait que le prix du kilowattheure dans notre pays – aujourd’hui parmi les plus bas du monde, même si nos factures sont élevées du fait du niveau de consommation – serait appelé à augmenter en raison de la progression des coûts de production, de celle des dépenses nécessaires à l’entretien du réseau ainsi que de l’augmentation des taxes.
L’augmentation des coûts de production de l’énergie d’origine nucléaire est liée en particulier aux exigences toujours plus fortes en matière de sécurité. L’ASN nous a confirmé que chaque accident, où qu’il se produise dans le monde, l’amène à faire des recommandations qui se traduisent par des coûts supplémentaires. L’électricité d’origine thermique devient également plus chère en raison de la raréfaction du pétrole et du gaz. Et, en attendant que les coûts de l’éolien maritime et de l’énergie solaire baissent, ces deux ressources restent assez onéreuses.
L’entretien du réseau sera de plus en plus coûteux en raison, d’une part, de l’insuffisance des investissements consentis ces dernières années en faveur de la maintenance, et, d’autre part, de la nécessité de construire des interconnexions. Selon certains la substitution de nouvelles sources d’énergie au nucléaire pourrait en outre obliger à renforcer notre réseau. Quoi qu’il en soit, RTE comme ERDF nous ont confirmé que les coûts de transport et de distribution de l’énergie augmenteraient.
Il en sera de même des taxes, si l’on veut continuer à favoriser le développement des énergies renouvelables et à combattre la précarité énergétique.
Notre commission d’enquête a également été unanime pour donner la priorité aux économies d’énergie – mais développer ce point nous éloignerait du champ de vos investigations.
Nous avons ensuite cherché à déterminer les coûts de production pour l’ensemble des filières – nucléaire, éolienne, solaire et, malgré les nombreuses inconnues propres à ce dernier secteur, hydraulique. Puis, afin de tenir compte de la diversité des sensibilités au sein de la commission d’enquête, nous avons établi trois scénarios afin de déterminer le niveau des investissements nécessaires. Un premier scénario dit « de sobriété », qui avait évidemment ma préférence, prévoyait une diminution progressive et inexorable de la part du nucléaire. Un deuxième scénario dit « nucléaire nouvelle génération » considérait le nucléaire comme une filière d’avenir dans laquelle il fallait réinvestir pour franchir une nouvelle étape technologique. Le troisième scénario, intermédiaire, combinait développement des sources d’énergie renouvelables et maintien d’une part de nucléaire. Dans chacune des trois hypothèses, les investissements à prévoir se sont révélés être considérables, mais du même ordre de grandeur.
La commission d’enquête a également travaillé sur le stockage, élément déterminant pour arbitrer entre les différents moyens de production. Elle s’est aussi intéressée à la durée d’utilisation des centrales. Le prix du nucléaire est évidemment conditionné par la durée d’amortissement de celles-ci, mais il faut également prendre en compte les temps d’utilisation au cours de l’année. EDF calcule la rentabilité sur un temps d’utilisation global alors que le marché à court terme prend de plus en plus d’importance, de sorte que, certains jours de l’année, l’éolien peut à terme devenir plus compétitif que le nucléaire.
Ayant passé en revue les incertitudes, le prix de l’ARENH (accès régulé à l’énergie nucléaire historique), le coût courant économique calculé par la Cour des comptes et les travaux post-Fukushima, nous avons proposé un tableau en deux colonnes : celle de gauche présentait un prix minimal, celle de droite un prix maximal prenant en compte les incertitudes relatives au coût d’un démantèlement, aux provisions nécessaires, au traitement des déchets, aux assurances, au coût d’un accident… Évidemment, nous n’avons pas additionné les incertitudes, ce que les journalistes nous ont reproché, mais cette double approche a permis de donner satisfaction à tous les membres de la commission d’enquête, chacun privilégiant la colonne qui correspondait le mieux à ses convictions.
Nous nous sommes d’abord entendus sur un prix assez bas de 54,20 euros le mégawattheure (MWh), qui reste toutefois supérieur à celui élaboré selon les méthodes de calcul de coût courant économique de la Cour des comptes, notamment en raison des investissements rendus nécessaires par l’accident de Fukushima. Nous avons ensuite estimé les incertitudes, qui pouvaient avoir sur ce prix un impact considérable. Nous étions tous d’accord pour considérer que le coût de l’EPR serait encore plus élevé – le prix de vente à la Grande-Bretagne l’a montré. Cela dit, confrontés à de nombreuses incertitudes, nous n’avons pas été en mesure d’analyser finement le dérapage d’un coût de construction qui a tout de même doublé ou triplé.
La commission d’enquête a aussi travaillé sur les réseaux intelligents, se partageant entre partisans d’un déploiement immédiat du compteur Linky et partisans d’un délai, cet outil requérant selon eux d’être amélioré. Nous nous sommes également interrogés sur la décentralisation du service public de l’électricité, posant la question des entreprises locales de distribution. Quant à l’instauration d’un tarif progressif de l’électricité, elle nous a paru poser un problème difficile – et je pense que ce diagnostic reste d’actualité.
M. Ladislas Poniatowski. Le rapport de notre commission d’enquête rend bien compte du travail très complet que nous avons mené et c’est sa force. Il souffre toutefois d’une faiblesse : il ne comporte pas de véritables conclusions. En effet, parce que celles que proposait le rapporteur revenaient, en quelque sorte, à la tonalité très orientée de l’exposé des motifs initial, les membres de la commission d’enquête s’apprêtaient, à l’exception de deux d’entre eux, à rejeter un document qui, alors, n’aurait même pas été publié. Afin que nous n’ayons pas accompli tout ce travail pour rien, j’ai proposé, une fois n’est pas coutume, que le rapport comporte six conclusions, sous forme de contributions de chaque groupe politique. Et ces conclusions sont malheureusement très différentes les unes des autres.
M. le président François Brottes. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je profite de l’occasion pour recommander l’excellent rapport d’information présenté en octobre dernier par Mme Marie-Noëlle Battistel, ici présente, et par M. Éric Straumann sur l’hydroélectricité, au nom de la Commission des affaires économiques.
M. Ladislas Poniatowski. Je serais très heureux d’inviter ses auteurs à s’exprimer devant les sénateurs membres du groupe d’études de l’énergie que j’ai l’honneur de présider. Et nous serions de même heureux de vous entendre, monsieur le président, sur votre sujet de prédilection !
M. Denis Baupin, rapporteur. Messieurs, votre rapport m’a paru particulièrement riche ; il comporte de nombreux éléments qui seront très utiles à notre travail. J’entends aussi ce que vient de dire M. Poniatowski sur la faiblesse dont souffrirait ce document comme une mise en garde, ou plutôt comme une incitation à nous appuyer sur des éléments consensuels afin d’avancer tous ensemble : nous ne devons pas oublier en effet que nous aurons dans les mois à venir à nous prononcer sur la stratégie énergétique de notre pays.
M. Desessard a d’ailleurs mentionné certains points sur lesquels tous les membres de votre commission d’enquête se sont accordés et il a eu raison d’insister à ce propos sur la certitude d’une hausse à venir du prix de l’électricité. L’impact social et économique de cette évolution sera en effet considérable, d’autant que, comme votre rapport l’a souligné, malgré un prix à l’unité faible, les Français payent déjà l’une des factures d’électricité les plus élevées.
Je relève aussi le constat selon lequel des investissements importants seront indispensables, qu’on maintienne ou non l’option en faveur du nucléaire. Il est en effet clair qu’il n’existe pas de voie facile vers l’avenir : dans quelque direction que nous allions, nous aurons à prendre des décisions lourdes de conséquences et nous devons être éclairés sur celles-ci.
En ce qui concerne le nucléaire, le rapport appelle à réviser le cadre actuel de la responsabilité civile des exploitants en cas d’accident, suggérant d’inscrire au hors bilan du budget de la France les risques encourus par la collectivité. Vous soulignez d’autre part l’importance de l’impact qu’a le choix d’un taux d’actualisation des coûts futurs du nucléaire : plus ce taux est élevé, plus il traduit un arbitrage en faveur du présent, au détriment de l’avenir. Notre famille politique, à M. Desessard et à moi, considère que nous devons préserver les droits des générations futures et assumer par conséquent les charges qui nous incombent au lieu de les leur transférer.
Après ces constats, j’en viens à quelques questions.
Vous avez évoqué les évolutions du coût de construction de l’EPR. Selon votre rapport publié à l’été 2012, AREVA estimait alors que le coût du mégawattheure se situerait entre 50 et 60 euros mais les contrats passés avec la Grande-Bretagne font état de montants proches du double. Avez-vous disposé d’informations permettant d’expliquer un tel écart ? Il aurait paru logique que le prototype de Flamanville coûte plus cher que les réacteurs suivants, mais c’est l’inverse qui semble se produire…
Avez-vous obtenu d’EDF des détails sur ses investissements à venir en faveur du parc actuel, en particulier sur son programme de « grand carénage » ? Quelle part servira à prolonger la vie des réacteurs existants jusqu’à quarante ans – et, éventuellement, au-delà – et quelle part sera consacrée aux mesures complémentaires de sûreté demandées par l’ASN après Fukushima ?
Que penser du retraitement des déchets et de la production de MOX ? Doit-on y voir un atout pour la filière nucléaire ou une charge supplémentaire pour la collectivité ?
Enfin, estimez-vous qu’il serait légitime que la transition énergétique – je pense notamment au développement des énergies renouvelables – bénéficie du même niveau d’aides publiques que celui qui a permis l’essor de la filière industrielle nucléaire ?
Mme Sabine Buis. Notre président a mentionné la constitution par la Commission des affaires économiques d’une mission d’information « sur l’impact du gaz de schiste sur le marché du gaz et sur l’équilibre de nos systèmes européens de production et de distribution d’énergie ». Sans vouloir mésestimer l’intérêt du travail ainsi entrepris, il me semble qu’on ne peut s’en tenir à la dimension économique du sujet et que l’étude devrait être étendue aux questions environnementales et sociétales posées par l’exploitation de cette source d’énergie.
Pour en revenir au rapport de la commission d’enquête sénatoriale, il est décevant en effet qu’un travail de qualité n’ait pas permis d’aboutir à une conclusion unique. Je souhaite qu’il puisse en être autrement à l’Assemblée nationale car, d’ici à quelques mois, nous débattrons d’un projet de loi de programmation sur la transition énergétique qui dessinera un véritable projet de société. Or, en entendant ce matin les interventions des membres de notre commission d’enquête, j’ai parfois eu le sentiment d’assister à des plaidoyers en faveur de positions déjà bien arrêtées. J’avoue que cela m’inquiète car je me demande comment, dans ces conditions, les uns et les autres pourront évoluer vers des positions communes. Mais nous disposons heureusement encore de plusieurs semaines pour rapprocher les points de vue.
M. le président François Brottes. Madame Buis, la Commission des affaires économiques a décidé de créer une mission d’information après avoir entendu M. Gérard Mestrallet, président du groupe GDF-Suez, annoncer la fermeture de centrales thermiques en raison, notamment, de la baisse des prix du charbon consécutive à l’essor de l’exploitation du gaz de schiste en Amérique du Nord. En dehors de toute considération environnementale, il nous est apparu que nous devions prendre en compte cette nouvelle donne qui bouleverse les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs d’énergie en Europe.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le rapporteur, nous nous accordons sur la nécessité où nous serons d’investir quel que soit le bouquet énergétique et nous nous accordons aussi sur l’importance du choix d’un taux d’actualisation adéquat. En revanche, je ne puis vous suivre lorsque vous dites que nous avons en France à la fois un prix de l’électricité parmi les plus bas et les factures « les plus élevées ». Certes, grâce au nucléaire, le coût de l’électricité est dans notre pays parmi les plus faibles du continent cependant que la forte consommation liée à l’utilisation pour le chauffage pèse sur la facture payée par chaque Français, mais cette dernière est loin d’être la plus élevée d’Europe.
M. Jean Desessard. Pour ce qui est du coût de production du mégawattheure par l’EPR de Flamanville, nous avions retenu dans notre rapport le chiffre avancé par la Cour des comptes – même si celle-ci n’avait pu le valider –, soit 70 à 90 euros. M. Claude Turmes, député européen et rapporteur de plusieurs directives ou règlements relatifs au secteur de l’énergie, a considéré que le prix garanti demandé par les opérateurs pourrait être de l’ordre de 90 à 110 euros/MWh. Pour ma part, j’estimais à l’époque que l’on approcherait les 100 à 110 euros/MWh et que l’intervention de la puissance publique serait nécessaire pour apporter une garantie portant à la fois sur le risque d’accidents – aucune société d’assurance n’est prête à couvrir un risque de type Fukushima – et sur le temps d’utilisation des centrales en cours d’année sachant que le marché fonctionne de plus en plus au jour le jour.
Madame Buis, le champ couvert par notre commission d’enquête était considérable, ce qui, ajouté à nos divergences sur le nucléaire, ne nous a pas laissé le temps de parvenir à une conclusion commune. Vous avez l’avantage de travailler sur un champ plus étroit ; j’espère que vous réussirez à vous mettre d’accord au moins sur une fourchette des prix de l’électricité d’origine nucléaire. Nous sommes évidemment prêts à vous y aider.
M. le président François Brottes. Je ne suis pas certain qu’il soit vraiment plus facile de s’entendre sur une question plus précise ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Notre travail sur la durée de vie des centrales nous a amenés à soulever plusieurs problèmes. En particulier, parce que les unités en service ont été fabriquées sur le même modèle et dans une période relativement restreinte, il est à craindre que la défaillance de l’une d’entre elles ne s’étende bientôt à toutes les autres. En prolongeant leur durée de vie, nous augmentons donc les risques de rencontrer des problèmes de production. D’autre part, nous avons eu des difficultés à évaluer les coûts de cette prolongation, étant entendu qu’il faudra rénover l’ensemble des installations, cœur du réacteur excepté.
Nous n’avons pas étudié la question du MOX et du retraitement, hormis les éléments que nous avons intégrés dans le tableau que j’évoquais tout à l’heure : à côté du coût du démantèlement tel qu’estimé par EDF – l’un des plus bas d’Europe –, nous avons fait figurer, dans l’autre colonne, un coût qui serait le plus élevé du continent. J’admets que l’analyse pèche par insuffisance, mais de très nombreuses incertitudes demeurent en tout état de cause, comme j’en ai eu la confirmation lors de ma visite à Bure, ne serait-ce que sur la faisabilité d’un enfouissement définitif des déchets qui soit réversible durant une centaine d’années. Quant au coût de telles opérations, je vous souhaite bien du courage pour parvenir à l’estimer !
La gestion des périodes de pointe pose également des questions ardues, compte tenu de l’irrégularité de la consommation au cours de la journée ou d’une saison à l’autre. Ni la production d’énergies renouvelables ni celle de l’énergie nucléaire ne correspondent aux « pointes » et aux « creux » de consommation ; cela n’est pas sans avoir un impact sur les coûts.
M. Ladislas Poniatowski. Si vous vous reportez à nos auditions, dont le compte rendu figure dans le second tome de notre rapport, vous constaterez que nous avons eu du mal à obtenir des chiffres précis concernant le coût de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, et ce même de la part du producteur. Nous disposons néanmoins de fourchettes. Suivant l’état des cinquante-huit réacteurs et de chacun de leurs éléments – cuve, enceinte de confinement, etc. –, ce coût pourrait osciller entre 350 et 600 millions par centrale ! Comment parvenir à une estimation globale sur le fondement de telles données ? Mais, dans la mesure où elle se met au travail alors qu’est déjà intervenue la décision de fermer Fessenheim – quelques semaines seulement après que l’ASN, seule compétente, avait autorisé à prolonger l’activité de cette centrale ! –, votre commission d’enquête aura peut-être la chance de recueillir des éléments plus précis sur le coût total de cette opération. Ce serait en tout cas mon souhait, car l’impossibilité d’obtenir cette information a provoqué en moi un sentiment de frustration !
M. le président François Brottes. Messieurs, je vous remercie. Nous devions commencer nos travaux en vous entendant sur un travail dont l’intérêt et l’exhaustivité ne nous ont pas échappé.
Audition de M. Thierry Morello, chief operating officer et membre du directoire d’EPEX Spot
(Séance du jeudi 16 janvier 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314005.pdf
M. le président François Brottes. Comme nous l’avions indiqué la semaine dernière, nos séances sont désormais retransmises en direct sur l’Internet.
Le programme de nos auditions, je le rappelle également, est conçu pour aller du général au particulier. Nous nous efforçons donc, dans un premier temps, de resituer la filière nucléaire dans le fonctionnement d’ensemble du système électrique français et européen, pour déterminer quelle place elle y tient et quel y est son avenir.
Nous accueillerons successivement ce matin M. Thierry Morello, directeur général des opérations et membre du directoire d’EPEX Spot, bourse européenne des marchés spot de l’électricité, M. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE, et M. Jean Philippe Bucher, président-directeur général de l’entreprise électro-intensive FerroPem.
L’entreprise EPEX Spot, monsieur Morello, contribue à la négociation entre les producteurs et fournisseurs d’électricité et les négociants intermédiaires – dont vous faites d’ailleurs partie – avant que l’électricité ne soit livrée sur le réseau aux clients finaux. Vous nous expliquerez le rôle qui est le vôtre dans ce marché très interconnecté aussi bien sur le plan du business que sur celui de la technique. Peut-être nous direz-vous aussi dans quelle mesure les prix de l’électricité, n’en déplaise à M. le rapporteur, sont à la baisse. Est-ce à cause du gaz de schiste – ou grâce à lui –, comme certains l’affirment ? L’envahissement du marché mondial par le gaz de schiste américain semble avoir redonné quelques lettres de noblesse au charbon et pose des problèmes aux centrales thermiques à gaz en France et en Europe, qui ne sont plus aussi réactives qu’attendu. Leurs difficultés se répercutent-elles sur votre activité ?
Au-delà de ces aspects, votre regard sur l’évolution du marché de l’électricité en fonction de phénomènes mondiaux qui ne nous épargnent pas sera utile à notre réflexion.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Thierry Morello prête serment)
Je vous donne maintenant la parole pour un exposé introductif.
M. Thierry Morello, directeur général des opérations et membre du directoire d’EPEX Spot. Nous vous remercions de nous donner l’occasion de contribuer à vos débats. Par rapport au sujet principal de votre commission, les informations que nous pourrons vous apporter concernent le contexte.
EPEX Spot est une plateforme de commercialisation d’électricité en Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse. Elle est au cœur du marché européen de court terme. Elle procède essentiellement à la facilitation des échanges d’électricité convenus la veille pour une livraison le lendemain et des échanges infrajournaliers.
Notre activité consiste à collecter les ordres de nos clients – pour l’essentiel des producteurs et fournisseurs européens, ainsi que quelques traders, banques et institutions financières spécialisées – et à leur servir de plateforme d’échanges. Notre société est née de la libéralisation des marchés de l’électricité. Après les deux étapes les plus importantes de cette libéralisation – la fin du monopole de la commercialisation et de la distribution d’électricité dans les différents États européens, la séparation entre la production, le transport et l’ensemble constitué par la commercialisation et la fourniture – il s’est créé un vide que le législateur n’avait pas vraiment prévu à l’époque : la séparation d’entreprises auparavant complètement intégrées a conduit les producteurs à se demander s’ils devaient poursuivre une activité de commercialisation et si, dans ce cas, leur parc de production était suffisant pour faire face à la diversité de la demande des clients.
M. le président François Brottes. C’est la Commission européenne et non pas le législateur qui a imposé ce mode de fonctionnement et omis certaines exigences propres au marché de l’électricité.
M. Thierry Morello. En effet, mais la législation française ne l’avait pas prévu non plus. La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité n’envisage aucun système de bourse. Il n’y est pas question, une fois les entités séparées, de cette fonction intermédiaire qui existe pour toutes les autres marchandises de la planète : le marché de gros, par lequel les acteurs équilibrent en permanence l’offre et la demande. Or la dimension d’échange commercial, inhérente à toute marchandise librement négociée, est encore renforcée par le caractère non stockable de l’électricité. Les producteurs et les commercialisateurs, contraints par la nature du réseau de transport et de distribution, doivent équilibrer en permanence l’injection et le soutirage.
M. le président François Brottes. En d’autres termes, il faut négocier le couteau sous la gorge : on n’a d’autre choix que de trouver une solution !
M. Thierry Morello. Pour éviter d’avoir le couteau sous la gorge, la plupart des producteurs possèdent une unité de négoce qui traite leurs emplois de ressources en portefeuille, de manière à calculer en permanence leurs engagements et la manière dont ils pourront les servir : nature de leur portefeuille de clients, besoins prospectifs desdits clients et moyens de production susceptibles d’être mis en face de ces besoins, qu’il s’agisse de leur propre production ou de moyens alternatifs – par exemple le recours à des achats sur le marché si le prix de marché est inférieur à leur coût de production.
Notre rôle d’intermédiaires est donc de permettre aux producteurs et aux fournisseurs de s’équilibrer sur tous les horizons temporels. Il existe des bourses de futures qui organisent le marché des dérivés, tel EPD (EEX Power Derivatives) en Allemagne et en France. Nous nous occupons pour notre part du marché à court terme, où l’urgence se fait plus sentir puisque, l’échéance de la livraison se rapprochant, il faut absolument être équilibré au moment de la fourniture sur le réseau de transport. L’essentiel de notre liquidité se situe donc au niveau de l’équilibrage. Comme vous l’expliquera M. Pierre Bornard, le réseau de transport est une « plaque de cuivre » à laquelle se superpose une plaque « commerciale », un hub, où interviennent les responsables d’équilibre – producteurs, fournisseurs ou toute entité raccordée directement au réseau de transport. Pour parvenir à l’équilibre auquel ils sont tenus, ces responsables calculent la veille pour le lendemain quels seront les équilibres entre emplois et ressources heure par heure, et même, en Allemagne, quart d’heure par quart d’heure. S’ils constatent un déséquilibre, qu’il s’agisse d’un excédent ou d’un déficit, ils le font passer sur notre plateforme.
On le voit, notre existence est inhérente à ce système d’échange libéralisé où les fonctions de production et de commercialisation sont séparées. Dans la chaîne de valeur énergétique, nous jouons le rôle de « troisième pilier ». Nous intervenons sur le marché du jour au lendemain – day-ahead – et sur le marché infrajournalier – intraday –, juste avant le marché d’ajustement en temps réel.
Outre notre rôle de facilitateur auprès des responsables d’équilibre, la collecte de l’offre et de la demande nous permet de diffuser un prix de la marchandise électricité toutes les heures, voire tous les quarts d’heure. Comme vous le savez, l’électricité livrée sur le réseau un jour d’hiver à dix-sept heures n’a pas du tout la même valeur que l’électricité livrée un jour d’été à trois heures du matin, lorsque la demande est très faible. La marchandise n’étant pas stockable, sa valeur est extrêmement variable dans le temps.
Une des fonctions importantes de la bourse d’électricité, peut-être pas vraiment prévue au départ, est donc la diffusion de prix de référence. Notre but est d’organiser une confrontation de l’offre et de la demande aussi large que possible pour que nos prix reflètent l’état du marché au moment où nous les diffusons. Les tarifs réglementés étant appelés à disparaître progressivement, ces prix servent par exemple de référence pour l’indexation de contrats ou pour le marché de l’ajustement.
M. le président François Brottes. Il doit être bien entendu qu’ils sont fonction de l’offre et de la demande et n’ont rien à voir avec le mode de production de l’électricité.
M. Thierry Morello. En effet. Sur le réseau de transport, les électrons sont tous les mêmes et n’obéissent qu’aux lois de la physique, qu’ils soient d’origine éolienne ou nucléaire ! Et nos marchés, qui cherchent avant tout à favoriser la liquidité de manière à accroître la possibilité d’équilibrage entre les acteurs, ne font pas non plus la distinction. Si nous avions, par exemple, à organiser un marché de l’électricité verte, il porterait sur le « coupon vert », le certificat d’énergie verte, et nous veillerions à ne pas trop déstabiliser un marché global où un mégawattheure d’électricité verte équivaut à un mégawattheure d’électricité d’origine nucléaire ou thermique.
En revanche, la zone de livraison a une importance considérable. L’Europe n’a pas attendu les marchés pour interconnecter ses réseaux. Le bouquet et les besoins énergétiques variant d’un pays à l’autre, l’objectif du réseau de transport est de couvrir le territoire le plus large possible de manière à aboutir à une sorte de mutualisation du parc de production. Ainsi, la France utilise depuis longtemps les réserves hydrauliques de la Suisse pour faire face à ses besoins de pointe.
M. Bernard Accoyer. Et, la nuit, la Suisse reconstitue lesdites réserves avec de l’électricité nucléaire importée de France !
M. Thierry Morello. Exactement. L’eau est remontée dans les barrages par pompage. Mais c’est un stockage que l’on ne peut faire à grande échelle et les contraintes environnementales sont importantes.
Le Conseil européen a décidé, dans sa séance du 4 février 2011, de renforcer l’interdépendance électrique européenne par la mise en place, à l’horizon 2014, d’un marché intérieur de l’électricité. Nous sommes un instrument important de cette intégration puisque nous organisons, avec d’autres bourses européennes, un « couplage de marchés », c’est-à-dire l’utilisation de la capacité d’interconnexion disponible telle qu’elle est prévue par les réseaux de transport de la veille pour le lendemain pour équilibrer au maximum les prix entre les différentes zones de livraison. À l’interconnexion physique des réseaux s’ajoute ainsi un marché commercial européen. On ne peut plus raisonner en termes uniquement nationaux : la France n’est pas un îlot électrique, elle est au centre d’un grand marché européen.
Je terminerai mon propos en évoquant les inquiétudes que nous inspirent la disparité des politiques nationales et ses répercussions sur la liquidité de chaque marché.
Au moment où les tarifs vert et jaune vont disparaître, la France a besoin d’un marché de détail compétitif qui ne peut lui-même exister sans un marché de gros compétitif. Or le marché de gros français a beaucoup pâti du dispositif de l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) instauré par la loi NOME (nouvelle organisation du marché de l’électricité). Selon les chiffres de la Commission de régulation de l’énergie, les volumes négociés sur marché de gros sont passés d’environ 700 TWh en 2011 à 600 TWh en 2012, soit une perte correspondant au volume de l’ARENH, tandis que le marché allemand s’élève à 10 000 TWh. La différence est encore plus grande sur les marchés de dérivés : pendant que l’Allemagne traite 100 TWh par mois, la France en traite à peine 3. Alors que le volume de consommation et le niveau technique des acteurs sont tout à fait comparables, le marché allemand, extrêmement liquide, devient la référence européenne et le marché français se trouve marginalisé du fait de dispositifs qui « verticalisent » la production en la captant dès sa source : lorsqu’elle sort de la centrale, l’électricité réservée à l’ARENH est déjà engagée chez un client ou chez un fournisseur, elle ne passe pas par le marché de gros.
M. le président François Brottes. L’électricité fournie dans le cadre de l’ARENH est peut-être perdue pour le marché de gros, mais pas pour ceux qui l’utilisent de façon captive. C’est un choix que l’on a fait. Il ne faudrait pas donner le sentiment que les consommateurs y perdraient !
Pour en revenir à ma remarque précédente, le coût et le mode de production vous importent peu : ce qui compte, c’est le besoin au moment où il s’exprime. Soutenir, comme on le fait parfois, que le prix de l’électricité est facturé au consommateur en fonction du mode de production tient de l’arnaque ! En réalité, ce prix s’établit en fonction d’un marché qui, comme tout marché, obéit à la loi de l’offre et de la demande et monte lorsque l’on est en tension.
M. Thierry Morello. Tout à fait. À titre d’exemple, l’entreprise EDF traite elle-même ses productions en portefeuille. Au niveau de la commercialisation, donc, elle ne fait pas véritablement de distinction entre les différentes origines. Pour le négociant, l’important est de savoir quel est le coût marginal de production de ses centrales et quelles sont les centrales disponibles. Si les besoins dépassent ses capacités de production, il ira chercher sur le marché les approvisionnements qui suppléeront ses capacités de production. De même, si le prix de marché est de 40 euros et son coût marginal de production de 45 euros, il cherchera à s’approvisionner sur le marché pour éviter de mettre en activité une centrale qui lui coûtera plus cher.
Cela étant, il est possible d’encourager la production d’électricité verte tout en conservant un marché de gros très liquide. L’Allemagne a mis en place à cet effet un dispositif financier garantissant aux producteurs d’électricité verte un certain prix. Le réseau de transport prend en charge cette électricité et la met à la disposition du marché. Le prix de marché auquel elle est vendue vient en déduction de la charge que représente le dispositif pour la communauté – en l’occurrence les consommateurs, qui acquittent une charge spécifique.
M. le président François Brottes. Ce qui signifie que le prix de marché est inférieur au prix garanti…
M. Thierry Morello. Nettement inférieur : celui de l’électricité éolienne est d’environ 90 euros le MWh, celui du marché de 43 euros en moyenne. Le consommateur paie la différence, mais cette électricité est tout de même vendue et occasionne un revenu.
M. Denis Baupin, rapporteur. Les prix de l’électricité seraient à la baisse « n’en déplaise au rapporteur », affirme le président Brottes. Que je sache, notre commission d’enquête travaille sur les coûts, pas sur les prix ! C’est, du reste, toute la difficulté : dans un même temps, les prix diminuent et les coûts augmentent.
Pour l’observateur que vous êtes, cette évolution des prix à la baisse sur la plaque européenne paraît-elle durable ? Est-elle le signe d’une surproduction électrique ?
Lorsque des installations produisent de l’électricité à un prix plus élevé que celui du marché, leur rentabilité baisse. En matière nucléaire notamment, pensez-vous que la diminution des prix de marché pèse sur la rentabilité des centrales ?
Vous évoquez aussi la place différente que la France et l’Allemagne occupent sur les marchés. Je ne suis pas un grand adepte des marchés mais, en tout état de cause, c’est leur logique qui s’impose ici. Le handicap de la France par rapport à son voisin tient-il, selon vous, à la centralisation – caractéristique de l’énergie nucléaire – de notre production électrique et à l’importance du pôle EDF ? Dans un marché qui évolue tous les quarts d’heure, est-il pertinent de construire des installations de production électrique dont on ne pourra évaluer la rentabilité que sur soixante ans de fonctionnement, quand la durée de vie et l’équilibre financier d’installations d’énergies renouvelables se calculent sur dix, quinze ou vingt ans ? Le fait de ne pouvoir équilibrer une installation que sur une durée très longue ne la rend-elle pas plus vulnérable au marché ?
Alors que l’Allemagne subventionne ses énergies vertes, le récent accord signé entre la France et la Grande-Bretagne pour la vente de deux EPR prévoit, pendant trente-cinq ans, un prix garanti plus élevé encore que celui qui est prévu en Allemagne pour les éoliennes. Cette clause risque-t-elle de provoquer une distorsion du marché ?
Ma dernière question concerne les équipements de production en pointe et les marchés de capacité. Pour les centrales à cycle combiné gaz conçues pour intervenir en appoint en période de pointe, la rentabilité est déjà faible eu égard au temps durant lequel l’énergéticien vend son électricité, et d’autant plus faible que les prix baissent. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Vous avez beau être « neutre » quant au mode de production de l’électricité que vous vendez, la capacité à fournir ce produit à chaque instant en fonction des besoins ne peut pas vous être indifférente. Que pensez-vous du fonctionnement du système actuel ? Des interventions des pouvoirs publics sont-elles nécessaires pour permettre la pérennisation de la fourniture d’électricité aux particuliers et aux acteurs économiques ?
M. Thierry Morello. Je crains que mes réponses ne soient partielles car beaucoup de sujets échappent largement à notre compétence. Sans doute convient-il de ne pas se focaliser sur les prix du moment. Ainsi, la courbe des prix de l’électricité en Allemagne, en Suisse et en France sur le marché du jour au lendemain depuis juin 2000 fait apparaître d’importantes variations, et ces variations seraient encore plus importantes si l’on tenait compte des prix horaires maximum et minimum. Pourtant, les prix actuels – 43 euros par MWh en France, 37 euros en Allemagne, 44 euros en Suisse – ne sont pas très différents de ceux de 2009. On ne saurait donc parler de baisse tendancielle, même si nous sommes sur un plateau de prix plus bas que celui que nous avons connu en 2008-2009 ou que celui qui a suivi l’accident de Fukushima et l’arrêt de sept centrales nucléaire nucléaires en Allemagne. Comme dans tout dispositif de marché, les amplitudes de prix sont importantes. Sans que ce soit extrêmement marqué, la tendance de période actuelle est plutôt baissière et les causes en sont connues : premièrement la conjoncture économique, mais aussi – et c’est heureux – des dispositifs d’économies qui font que la demande est moins forte ; deuxièmement l’exploitation du gaz de schiste aux États-Unis, qui fait de ce pays un exportateur de charbon et entraîne une baisse des prix mondiaux du charbon ; troisièmement les prix des quotas d’émission de CO2, qui ont atteint des niveaux tellement dérisoires que, contre toute attente, les centrales à charbon sont devenues très rentables, tandis que d’autres centrales sont mises sous cocon par leurs exploitants ; quatrièmement, les énergies renouvelables affluent sur les marchés, ce qui est une bonne nouvelle, mais à n’importe quel prix puisqu’elle est subventionnée en amont. Il faut ajouter que l’Allemagne accorde à ces énergies la préséance sur toutes les autres : pour soutenir la production renouvelable et la transition énergétique, le législateur a souhaité qu’elle ait la priorité sur le marché quelle que soit la situation. Dans la mesure où ces sources représentent 30 % de l’électricité en Allemagne et où les marchés sont interconnectés, l’effet est évidemment baissier.
Cette conjonction de phénomènes est circonstancielle. Je ne pense pas qu’elle soit durable, même si je serais bien incapable de vous dire si les prix vont repartir à la hausse ou à la baisse – ce n’est d’ailleurs pas notre rôle et ceux qui se risquent à de telles prévisions se trompent une fois sur deux !
De même, il nous est très difficile de nous prononcer sur la rentabilité du nucléaire. À l’évidence, les producteurs ne voient pas d’un bon œil les baisses de prix, qui réduisent leur marge bénéficiaire, et occasionnent même des déficits lorsque le prix passe sous le coût marginal de production. Pour notre part, nous en sommes plus préoccupés pour des raisons de sécurité du marché que pour des raisons de prix. Mais nous n’avons pas connu, jusqu’à présent, de périodes d’assèchement de l’approvisionnement. La production a plutôt tendant à être excédent en période de faible consommation. En hiver, néanmoins, il peut arriver que le prix de l’électricité atteigne 300 ou 400 euros par MWh.
M. le président François Brottes. Il n’y a donc pas de surproduction ?
M. Thierry Morello. Non, et rien aujourd’hui ne le laisse à penser : pour faire face aux pointes de consommation en hiver, la France doit importer de l’électricité.
M. le rapporteur. Ma question portait sur une éventuelle surproduction au niveau européen.
M. Thierry Morello. Je ne crois pas qu’il y ait surproduction. Le parc européen actuel fait face à la demande. Les prix bas s’expliquent moins par une hypothétique surproduction que par l’ordre de préséance économique. Certains investissements, notamment dans des unités de production au gaz, se sont révélés malheureux du fait d’une conjoncture imprévisible qui a rendu le charbon plus économique.
M. le président François Brottes. Plus polluant également.
M. Thierry Morello. Bien sûr. Normalement, le prix de la tonne de la CO2 devrait repartir à la hausse et le charbon devenir moins avantageux.
S’agissant d’une éventuelle distorsion des prix au sujet de l’EPR, je connais très mal l’accord passé avec la Grande-Bretagne et il ne m’appartient pas, de toute façon, de le commenter. Mais, dès lors que l’électricité passe par le marché de gros, il n’y a pas vraiment lieu de parler de distorsion des prix. Les prix du marché de gros ne sont que le reflet de l’état des fondamentaux – météo, état du parc de production – et des décisions politiques. Si l’autorité politique décide de favoriser les énergies renouvelables en les subventionnant en amont, celles-ci arrivent sur le marché à bas prix et ont un effet déflationniste.
Enfin, je ne pense pas que la différence entre les marchés français et allemand puisse s’expliquer par la centralisation de la production en France. Il faut certes souligner la plus grande diversité des acteurs en Allemagne, où les municipalités, les Stadtwerke, plus nombreuses et plus actives sur les marchés qu’en France, jouent un rôle important. Nous sommes toujours favorables à la diversité des acteurs. Cela étant, lorsque les marchés sont relativement concentrés comme en Italie ou en Suisse, les marchés de gros connaissent eux aussi un essor. Le marché du jour au lendemain traite 45 % de la consommation allemande, 30 % de la consommation suisse, et seulement 13 % de la consommation française. Ce sont les dispositifs de commercialisation, en particulier ceux qui « verticalisent » la production, qui engendrent une palette de prix non fixés par le marché.
M. le rapporteur. Pourriez-vous préciser votre réponse concernant les prix garantis par l’accord sur la construction d’EPR en Grande-Bretagne ?
M. Thierry Morello. Si cette électricité est commercialisée sur le marché de gros, il n’y aura pas de distorsion de prix. Si elle est « verticalisée », c’est-à-dire préemptée par des clients donnés, une partie de l’offre et de la demande échappera au marché.
M. le président François Brottes. Comme dans le cas de l’ARENH.
M. Thierry Morello. Exactement.
M. Bernard Accoyer. La question du stockage de l’énergie est un problème majeur. La commission Lauvergeon l’a d’ailleurs retenue parmi les « Ambitions 2030 ». Quel jugement portez-vous sur la technique existante, qui consiste à remonter l’eau dans les barrages ? Alors que des oppositions se sont manifestées, pensez-vous qu’il s’agit d’une technique d’avenir pour un pays possédant un parc électronucléaire important ?
Estimez-vous que la « grande panne » fantasmée par certains puisse se produire en Europe et en France ?
D’après vos données, la différence de prix de l’électricité en Allemagne et en France a singulièrement diminué entre 2011 et 2013. J’y vois l’effet du développement des centrales à charbon en Allemagne et de la baisse du prix du charbon depuis que les États-Unis exploitent leur gaz de schiste. Cette situation se traduit par une augmentation importante des rejets de CO2 et de microparticules. Pensez-vous qu’elle puisse être durable ? De la réponse à cette question dépend le jugement que l’on pourra porter sur la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire.
M. Thierry Morello. L’utilité des dispositifs de pompage de l’eau pour remplir les barrages ne fait pas de doute. L’importance que le solaire et l’éolien ont prise en Allemagne aboutit en effet à des phénomènes dits de ramping : la montée progressive – la « rampe » – de la production photovoltaïque au cours de la journée ne correspond pas forcément avec celle de la demande, qui commence un peu avant le jour. Le pompage et le relâchage de l’eau sont très utiles pour équilibrer ces rampes. Dans le marché infrajournalier, du reste, les acteurs nous ont demandé de développer des produits calculés sur un quart d’heure et non plus sur une heure. Ainsi, comme dans un jeu de Lego, le détenteur d’un portefeuille de production photovoltaïque pourra se fournir par quarts d’heure pour compenser sa « rampe ».
On le voit, ces dispositifs contribuent à l’équilibrage du réseau, donc à celui du marché. Est-il opportun, compte tenu des contraintes environnementales et autres, de poursuivre leur développement ? Il ne m’appartient pas de répondre à cette question. Je ne peux que constater que des énergies renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque ne permettent pas de maîtriser exactement les rampes de production et donnent d’autant plus de valeur aux outils de « flexibilité ». En Allemagne, par exemple, on voudrait éviter de mettre sous cocon les centrales traditionnelles au gaz ou au charbon, très utiles pour compenser les rampes, mais les exploitants estiment qu’il n’est pas rentable de les faire fonctionner à cette seule fin.
M. François Brottes. Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au paradoxe, il ne pourrait pas y avoir de renouvelable s’il n’y avait pas de charbon…
M. Thierry Morello. L’Europe a la chance d’avoir un bouquet énergétique très diversifié.
M. le rapporteur. La réponse est plus nuancée que la question ! (Sourires.)
M. Thierry Morello. Le sujet excède nettement notre compétence.
Quant à la « grande panne », les prémices en sont indécelables dans nos courbes. Nous avons une grande confiance dans les dispositifs destinés à la prévenir. Il est clair que l’usage du chauffage électrique en France provoque des pics de demande en hiver et met le système en tension, mais celui-ci a pour l’instant très bien tenu, grâce aux moyens de délestage et au développement de l’effacement. Le marché est à cet égard très utile car il permet une valorisation de cet effacement.
M. le président François Brottes. Dans l’hypothèse d’un développement du stockage et de l’arrêt d’une partie du parc nucléaire français, quelle serait l’évolution du marché ?
M. Thierry Morello. Le marché valoriserait le stockage et ce serait une très bonne chose : nous deviendrions un marché lambda, un marché où la relation entre les prix au comptant et les prix à terme serait très facile à établir puisqu’il suffirait de prendre en compte le coût et le financement du stockage, selon la relation de cash & carry des marchés de dérivés. Le marché s’exprimerait encore mieux du fait de la continuité qui s’établirait entre les différents compartiments. Aujourd’hui, l’offre et la demande sont différentes selon que l’on est sur les marchés de dérivés, qui portent sur des horizons temporels longs, ou sur des marchés fonctionnant quasiment en temps réel. Le stockage permettrait de les lisser et détendrait considérablement les contraintes liées au temps réel.
M. le président François Brottes. Et dans l’hypothèse où le stockage ne progresserait pas et où l’énergie fournie en base par les centrales nucléaires connaîtrait une forte diminution ?
M. Thierry Morello. On assisterait à des pics de prix pendant les heures de base, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. C’est plutôt l’inverse qui se produit : la forte différence de prix entre les périodes de pointe et les périodes de creux – c’est-à-dire, dans les journées d’hiver, entre l’intervalle 8h-20h et l’intervalle 20h-8h – s’est réduite grâce au photovoltaïque, ce qui a d’ailleurs posé des difficultés aux Suisses qui, pour leur part, jouaient sur cette différence. Le solaire, par définition, produit de l’électricité pendant la journée. Sous cet aspect, il suit bien la demande.
M. le président François Brottes. Que pensez-vous de l’éventuelle décision de la Commission européenne requalifiant en aides d’État les tarifs d’achat de l’électricité renouvelable ou les tarifs du nucléaire en Grande-Bretagne ? Bien que le marché, selon vous, soit indifférent à ces soutiens, leur suppression pourrait-elle avoir des conséquences ?
M. Thierry Morello. Il y aurait assurément des conséquences sur l’ordre de préséance économique, puisque le coût d’exploitation serait de nouveau pris en compte. Mais cela ne changerait pas grand-chose en ce qui concerne le photovoltaïque et l’éolien, ces dispositifs réclamant des investissements importants mais peu de dépenses d’exploitation. Le marché existant reflète assez bien les coûts d’exploitation, car les aides portent surtout sur la dimension de l’investissement.
M. le président François Brottes. Je vous remercie pour cet échange.
Audition de M. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE, directeur général délégué chargé de l’économie, des marchés et de l’innovation
(Séance du jeudi 16 janvier 2014)
M. le président François Brottes. Nous sommes heureux d’accueillir M. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE (Réseau de transport d’électricité) et directeur général délégué chargé de l’économie, des marchés et de l’innovation.
En plus d’en être le numéro deux – le président Maillard n’a pu être avec nous ce matin –, vous êtes en quelque sorte un membre fondateur de cette maison, monsieur Bornard. Vous en connaissez parfaitement le fonctionnement depuis sa création, c’est-à-dire depuis la partition qui a fait de RTE un acteur autonome, indépendant d’EDF et en situation de monopole pour le transport de l’électricité.
Vous avez la responsabilité de maintenir constamment en équilibre le réseau électrique français. On dit que RTE est le meilleur opérateur européen en ce domaine et on lui demande de réaliser des prouesses.
Bien que notre commission d’enquête porte plus spécialement sur le coût de la filière nucléaire, nous avons souhaité avec le rapporteur commencer par un tour d’horizon du système électrique avant d’en arriver à la filière elle-même. Nous venons d’entendre un acteur du marché spot, avec lequel vous êtes particulièrement en contact lorsque la production est abondante ou lorsque le réseau est au contraire en demande. Mais RTE est lui-même un organisateur : la loi lui donne le pouvoir d’utiliser des outils comme l’effacement ou de mobiliser la production à certains moments pour éviter une panne de réseau majeure.
Nous sommes dans une période d’évolution significative. Le réseau est alimenté par des sources d’énergie beaucoup plus nombreuses que par le passé et la tendance du marché de l’électricité est à la baisse.
Notre commission devant étudier les coûts de production de la filière nucléaire, de son démantèlement éventuel, ou encore de la prolongation de la durée de vie des centrales, elle sera heureuse de recueillir, après que vous aurez rappelé le quotidien de votre métier, votre sentiment sur ces questions, en particulier sur la production en base que l’énergie nucléaire, avec l’hydraulique au fil de l’eau, est la seule à fournir.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Pierre Bornard prête serment)
Je vous donne maintenant la parole pour un exposé introductif.
M. Pierre Bornard, vice-président du directoire de RTE, directeur général délégué chargé de l’économie, des marchés et de l’innovation. Je vous prie d’excuser le président du directoire de RTE, M. Dominique Maillard, qui préside ce matin à Bruxelles une réunion sur la coordination opérationnelle des opérateurs européens.
Comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, RTE est un des opérateurs du système européen, dont il faut rappeler que c’est en réalité une immense machine qui s’étend de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie jusqu’à la Tunisie. Il s’agit d’un seul ensemble physique que les différents opérateurs pilotent en se coordonnant : quand une centrale tombe en panne en Pologne, cela se répercute instantanément sur la prise de courant à Tunis !
Outre la forte coordination que cette configuration impose, la dimension de l’optimisation est très importante et suscite des échanges croissants entre pays.
La situation française a ses spécificités, certes, mais notre réseau est un morceau d’un ensemble plus important où les enjeux sont à la fois techniques – un incident à un endroit donné peut se propager et toucher tout le monde – et économiques – une électricité bon marché s’obtient en optimisant le mix énergétique à l’échelle d’un continent.
Selon les statistiques récemment publiées, le nucléaire représente 73,3 % de l’électricité produite en France en 2013. L’hydroélectricité arrive en deuxième position avec 13,8 %, puis viennent charbon avec 3,6 %, le gaz avec 3,5 %, l’éolien – qui continue sa croissance – avec un peu moins de 3 %. Le fioul représente 1 %, le photovoltaïque arrive juste derrière, et le dernier pourcent regroupe la cogénération et toutes les autres énergies renouvelables.
Il faut être bien conscient que la puissance instantanée est tout aussi importante que l’énergie annuelle consommée. Ce n’est pas parce que l’on dispose d’une capacité de production correspondant à la consommation moyenne en une année que l’on peut satisfaire les besoins en électricité à tout instant. L’équilibrage à chaque seconde est fondamental, particulièrement en France où la dynamique de consommation est supérieure au reste de l’Europe. Le seul pays européen comparable est la Norvège, où l’on constate aussi un fort usage du chauffage électrique, entraînant une plus grande sensibilité de la consommation à la température.
D’après les observations que nous avons réalisées ces dernières années, la puissance maximale appelée au cœur de l’hiver par des températures froides s’accroît en France deux fois plus vite que la consommation annuelle. Comme il faut équilibrer à chaque moment la puissance fournie et la consommation, cela se traduit par la nécessité d’investir – suivant la logique traditionnelle – dans des moyens supplémentaires de production en pointe comme les turbines à combustion. Or ces équipements sont coûteux et on n’a besoin de les faire fonctionner que peu de temps, si bien que peu d’opérateurs ont envie de les construire.
Cette situation est très préoccupante pour RTE mais les parlementaires s’en sont aussi souciés. Deux mesures législatives visent à corriger cet effet : l’une, dont les textes d’application sont en cours de finalisation, instaure un mécanisme de capacité permettant aux fournisseurs de se procurer en puissance ce qu’ils ont vendu à leurs clients pour un meilleur équilibrage de la consommation et de la production.
M. le président François Brottes. La distinction entre puissance et quantité d’énergie est très importante. Il arrive souvent que l’on mentionne la capacité de production d’énergie en omettant totalement la question de la puissance. Je vous remercie de faire de la pédagogie à ce sujet !
M. Pierre Bornard. C’est en effet une question fondamentale. Dans une région comme la Bavière, qui a beaucoup développé le photovoltaïque, la production peut être très abondante à des moments où l’on n’en a pas vraiment besoin et absente à des moments où l’on en a besoin. Cette énergie est très utile pour le système électrique européen, mais elle n’est pas sans conséquences sur l’équilibrage et les flux d’énergie. Cette année, à la fin du printemps et au début de l’automne – périodes où cette production est la plus importante –, on a constaté des productions photovoltaïques dans le Sud de l’Allemagne de l’ordre de 22 000 ou 23 000 MW vers 13 heures 30, ce qui a pour effet d’inverser les flux d’énergie entre la France et l’Allemagne avant qu’ils ne repartent dans l’autre sens le soir. Bref, si l’apport du photovoltaïque en énergie est important, on ne peut non plus ignorer la question de la synchronisation avec le besoin de puissance.
La deuxième évolution législative récente, à laquelle vous n’êtes pas étranger, monsieur le président, est la création d’un cadre juridique visant à développer les effacements de consommation. Ce terme d’« effacement », quelque peu restrictif, mérite explication : dans un monde qui, je l’espère, est derrière nous, l’équilibrage entre production et consommation se faisait en laissant libre cours à la consommation et en s’efforçant de produire exactement ce qu’il fallait pour l’alimenter ; on a désormais conscience qu’il faudra de plus en plus de souplesse et qu’un moyen d’égaliser en permanence la production et la consommation est de jouer aussi sur la consommation. Une grande partie des usages de l’électricité peuvent être différés de quelques minutes, de quelques heures ou de quelques jours. Sans doute pas l’éclairage de cette salle, mais son chauffage et sa climatisation pour quelques minutes. De même, un congélateur pourra fonctionner un peu plus entre quatre et cinq heures du matin en accumulant du froid, sans aucune perte de confort pour le consommateur et sans modification des coûts de production et du process pour l’industriel.
Cette adaptation de la consommation à la production est un facteur de souplesse considérable. Nous comptons bien l’utiliser pour limiter la progression de la puissance de pointe consommée et pour faciliter l’intégration de nouveaux mix énergétiques. En Allemagne et en Espagne, où l’on a développé très fortement les filières éolienne et photovoltaïque, cette intégration soulève de nouveaux défis. Ces énergies, qui dépendent de paramètres physiques tels que la vitesse du vent et l’ensoleillement, sont dites « fatales » : le volume de la production ne peut qu’être constaté en fonction des conditions météorologiques. Bien que ces conditions se prévoient assez bien, elles impliquent le développement de nouveaux mécanismes, notamment en matière de flexibilité. Pour reprendre l’exemple du photovoltaïque en Bavière, la production est nulle à huit heures du matin, elle peut atteindre 22 000 MW à 13 heures 30 pour revenir à zéro à 19 heures. Pour s’adapter à cette forte variabilité, il faut ménager de la souplesse. Historiquement, c’était un des rôles des centrales à gaz, mais des incertitudes pèsent aujourd’hui sur leur développement en Europe.
M. le président François Brottes. En raison du gaz de schiste.
M. Pierre Bornard. À l’origine, en effet, l’exploitation du gaz de schiste aux États-Unis a fait chuter les prix du charbon, si bien que les producteurs européens ont eu intérêt à privilégier une production de bord de mer au charbon. C’est le cas en Allemagne, mais aussi en France, où la production au charbon dépasse la production au gaz quand il fait moyennement froid.
Quant aux défis de l’intégration des énergies renouvelables, ce sont des défis d’ingénieurs et ils doivent être traités comme tels. J’ai évité à dessein l’expression un peu trop générale de « réseaux intelligents » – smart grids –, mais il existe bien, derrière cette notion, l’idée que l’on peut piloter le système électrique de manière plus fine et plus intelligente, en utilisant des ressources que l’on ne pouvait pas exploiter autrefois.
Nous sommes particulièrement attentifs à l’évolution du mix énergétique. Dans ce domaine technique complexe, les ingénieurs savent trouver des solutions à peu près à tout. Pour RTE, donc, le mix énergétique de demain relève de la décision politique. Quoi que l’on décide, nous saurons le faire techniquement. Il y a néanmoins des précautions à prendre. Le choix d’un mix énergétique donné emporte des conséquences précises. L’électricité, produit qui ne se stocke pas ou très mal, se caractérise par des contraintes très forte. La production et la consommation doivent s’équilibrer en permanence et respecter des règles physiques strictes, faute de quoi des événements catastrophiques de type black-out risquent de survenir. On ne peut donc ignorer les ressources et les conditions nécessaires au fonctionnement d’un mix énergétique. La seule cause d’échec, c’est le déni de réalité : il faut absolument envisager et traiter l’ensemble des conséquences de tel ou tel choix. Dans le bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France que nous publions annuellement, nous envisageons à la fois l’évolution, relativement prévisible, du mix énergétique dans les prochaines années, mais nous élaborons aussi des scénarios à l’horizon 2030. Ces scénarios sont contrastés mais cohérents : si l’on prend telle décision concernant le mix énergétique, il convient de traiter les conséquences que cela entraîne, notamment en matière d’infrastructures.
C’est pourquoi je veux insister sur l’aspect temporel de la question. Certaines décisions sont à effet immédiat, d’autres – par exemple le changement des règles de marché pour développer l’effacement – sont l’affaire de trois ou quatre ans. Le développement d’énergies renouvelables peut se faire rapidement : en Italie, à la suite de la fixation de tarifs de rachat peut-être mal ajustés, on a construit dans la seule année 2012 une capacité de 9 000 MW d’électricité photovoltaïque. En revanche, la construction d’une ligne de grand transport prend huit à dix ans, si bien que nos collègues italiens ne savent pas très bien quoi faire de l’électricité photovoltaïque produite dans le Sud du pays tant qu’ils ne disposeront pas des infrastructures permettant de l’acheminer. Il est possible de gérer les problèmes, mais à condition d’anticiper et de bien articuler les différentes temporalités. Une décision prise aujourd’hui portera différents fruits à différentes échéances.
M. Denis Baupin, rapporteur. Ce que vous dites du charbon casse certaines idées reçues : l’augmentation de l’utilisation du charbon en Allemagne mais aussi en France n’est pas liée aux choix de mix énergétique dans ces pays, elle tient bien plus au contexte international affectant le gaz et le charbon.
Je vous sais également gré d’avoir indiqué que le choix du mix électrique, pour peu que l’on prenne les précautions que vous avez mentionnées, ne posait pas, comme on l’objecte souvent, de problèmes techniques insurmontables – même s’il ne s’agit nullement, de ma part, d’en nier la complexité.
Pensez-vous que la tendance à la baisse des prix de l’électricité constatée actuellement s’inscrira dans la durée ? Est-elle liée à des phénomènes de surproduction sur la plaque européenne ?
La variabilité de la consommation est particulièrement préoccupante en France. Alors que le photovoltaïque et l’éolien engendrent une variabilité de la production, nous avons pour spécificité des variations de consommation qui sont fonction de la météo, du fait de l’usage du chauffage électrique. La part que ce mode de chauffage a prise en France ne se traduit-elle pas par une vulnérabilité particulière ? Vous avez évoqué différents moyens d’y répondre – effacement, marché de capacité, centrales à cycle combiné gaz –, mais ne conviendrait-il pas de s’attaquer au problème à la source, par des politiques de diversification du chauffage et d’isolation thermique des logements ? Que peut-on attendre de ces initiatives dans l’évolution des problèmes de pointe électrique ? Dans ces périodes hivernales de pointe, il est rapporté que la France représente la moitié de la pointe européenne.
Qu’en est-il également de la variabilité en cas d’arrêt fortuit d’une centrale nucléaire, comme cela se produit de plus en plus souvent ? Selon la Commission de régulation de l’énergie, que nous avons auditionnée la semaine dernière, ces arrêts ne correspondent pas à des choix destinés à peser sur le prix de l’électricité, mais bien à des incidents. Comment les gérez-vous, sachant que, certains jours, ce sont plusieurs fois 900 MW qui s’arrêtent ?
Le plan d’investissements de RTE prévoit la construction d’environ 2 000 km de lignes à haute tension dans les dix prochaines années. Les chiffres sont sensiblement les mêmes en Allemagne, à ceci près que, chez nos voisins, le plan s’inscrit dans la transition énergétique (Energiewende) : l’éolien produit de l’électricité en quantité dans le Nord et il faut la transporter vers le Sud. On le voit, c’est la modification de la politique électrique qui explique cet investissement massif. Ce n’est pas le cas en France, où aucune décision n’a été prise quant à une éventuelle réorganisation de la production électrique. Dès lors, quels sont les motifs de ces investissements dans des lignes à haute tension ? S’agit-il d’une anticipation des besoins futurs ?
Enfin, RTE sera-t-il capable de faire face à l’arrêt définitif de la centrale de Fessenheim en 2016 et de continuer à assurer, sur le territoire concerné et sur l’ensemble du territoire, l’acheminement de l’électricité ? Confirmez-vous que vous serez prêts à la date fixée par le Président de la République et par le Gouvernement ?
M. Pierre Bornard. La formation des prix de l’électricité est une mécanique européenne, du moins pour l’Europe de l’Ouest et du Nord. L’Espagne et l’Italie sont dans une situation un peu à part : en raison notamment des insuffisances d’interconnexion, les échanges ne sont pas libres avec ces deux pays qui, du coup, jouent un rôle plus limité dans la formation des prix.
Le grand marché du Nord-Ouest européen, qui a été conçu dans les années 2000 en suivant un modèle où la production n’était pas subventionnée, se trouve aujourd’hui dans une situation quelque peu différente puisque deux modes de production aux logiques économiques distinctes y coexistent. À côté d’une production qui suit les règles anciennes s’est développée, en particulier en Allemagne, une production renouvelable subventionnée dont la mise sur le marché se fait en général selon des règles dites « à tout prix », c’est-à-dire même si son prix est nul, voire négatif.
M. le président François Brottes. Pourriez-vous expliquer brièvement le mécanisme des prix négatifs ?
M. Pierre Bornard. En raison des inerties propres au système électrique, on peut être confronté, pendant quelques heures dans la journée ou dans l’année, à une surproduction que l’on ne peut réduire. Le jour de Noël, par exemple, la consommation en Europe est très basse, mais elle reprend dès le 26 décembre. La plupart des grandes centrales – dont les centrales nucléaires – ne pouvant être arrêtées et redémarrées du jour au lendemain, elles doivent continuer à produire un minimum technique. En ajoutant à cette production les productions fatales hydrauliques, éoliennes et photovoltaïques, la quantité produite dépasse la consommation. Aussi les producteurs sont-ils prêts à payer pendant quelques heures pour ne pas arrêter leurs centrales, car leur indisponibilité au moment où les besoins augmenteront de nouveau aurait un coût économique supérieur. Dans cette configuration, les prix deviennent négatifs : le consommateur est payé pour consommer et le producteur doit payer pour produire.
Ce phénomène a parfois pris de l’ampleur. Il traduit le déséquilibre de l’offre qui, à un moment donné, excède la demande sans que l’on puisse la réduire.
Il y a là une explication des prix bas. De nombreux producteurs européens s’en émeuvent, affirmant que cela met leur avenir économique en danger. Au-delà de ce constat, je ne peux guère apporter d’appréciation sur l’évolution des prix. Tout au plus peut-on signaler que le marché européen est dit energy only, ce qui signifie que l’on ne commercialise que des KWh. La puissance à un instant donné et la flexibilité sont réputées sans valeur économique et ne font pas l’objet d’une commercialisation. Pourtant, nous l’avons vu, il arrive que l’on manque de puissance ou de flexibilité, ce qui conduit à penser que ces caractéristiques physiques ont une valeur économique et que, logiquement, elles devraient être valorisées et intégrer le prix de l’énergie. Dans le prix du kilowattheure acquitté par le consommateur final, le coût de la sécurité d’approvisionnement devrait être intégré : on a développé le parc de production et les mécanismes de souplesse de la consommation pour s’assurer que l’on pourra s’adapter à tous les aléas possibles.
Cette évolution possible du modèle de marché européen, sur laquelle la France peut avoir ses propres positions, s’inscrit dans une logique qui est celle du continent. La Commission européenne et les autres pays y travaillent. Nous devons parvenir à une certaine harmonisation car la qualité économique des échanges avec nos voisins est cruciale pour disposer d’une électricité sûre et bon marché. Les décisions nationales ont évidemment un poids important, mais la dimension européenne est fondamentale.
Quant à la surproduction, il peut arriver en effet que ce produit non stockable qu’est l’électricité soit en fort excédent. Pour autant, cela ne signifie pas que nous soyons en surcapacité structurelle : à d’autres moments, on manquera au contraire de capacité. Les prix bas peuvent donc caractériser des moments de surproduction, mais ce n’est pas contradictoire avec les périodes de forte tension.
S’agissant de la variabilité, vous avez raison de souligner que l’aléa le plus important en France est celui de la température. En hiver, lorsque la température baisse d’un degré, la consommation d’électricité augmente d’environ 2 300 MW. Si la France est loin de représenter la moitié de la pointe européenne, elle entre en revanche pour plus de la moitié dans la sensibilité européenne globale à la température : lorsque la température moyenne européenne baisse d’un degré, la consommation européenne augmente d’un peu plus de 4 000 MW, dont 2 300 en France. Mais la pointe européenne dépasse largement les 300 000 MW tandis que celle de la France est de 100 000 MW.
Les aléas climatiques auxquels le système électrique est soumis se prévoient assez bien, même s’il arrive que Météo France se trompe sur la vitesse de progression d’un front froid. D’autres aléas peuvent concerner la production : une centrale qui tombe en panne, une production éolienne ou photovoltaïque différente des attentes… Le brouillard, par exemple, peut faire baisser sensiblement la production photovoltaïque attendue.
Le facteur temps est de toute façon très important dans la gestion des aléas. Un aléa connu quelques heures à l’avance est très différent d’un événement qui se produit brutalement. Pour nous, les conséquences techniques et économiques de la déconnexion d’une centrale ne sont pas du tout les mêmes selon que nous sommes prévenus un peu auparavant ou que la déconnexion est instantanée.
Le chauffage électrique constitue-t-il une vulnérabilité ? De notre point de vue, c’est une question qu’il faut traiter et il existe des solutions techniques pour le faire. Quant à savoir si cela est souhaitable ou pas, c’est un autre sujet sur lequel l’opérateur n’a pas à se prononcer directement. Nous constatons seulement que la nouvelle réglementation thermique des bâtiments, mise en œuvre en 2012, a fait considérablement diminuer l’équipement en chauffage électrique des logements nouveaux. Mais je doute que ces mesures aient une incidence sur le chauffage électrique d’appoint dans les logements collectifs équipés du chauffage central.
Quoi qu’il en soit, nous approuvons et suivons avec un grand intérêt tout ce que l’on peut faire en matière d’isolation et d’économies d’énergie en général. Je l’ai dit, la maîtrise de la demande d’énergie et la maîtrise de la puissance sont deux choses distinctes et complémentaires. Dans le premier cas, il s’agit de faire baisser la consommation globale, dans le second, il s’agit de faire varier la consommation à des moments donnés.
Comme toutes les autres installations de production, il arrive que les centrales nucléaires tombent en panne. J’y insiste, la situation est très différente selon que le réseau est prévenu ou que la déconnexion est brutale. RTE a beaucoup insisté pour que l’on établisse une transparence complète en la matière. Ainsi, depuis quelques années, nous publions sur notre site Internet, en accord avec les producteurs qui nous fournissent les données, toutes les prévisions d’arrêt des centrales pour cause de maintenance, de défaillance, etc., et tous les incidents : la survenue d’une panne sur une centrale y est indiquée en temps réel.
La panne inopinée reste le point le plus sensible. Le système électrique, qui est un ensemble extrêmement complexe, y est exposé quelle que soit la nature de la production. Les règles d’exploitation lui confèrent néanmoins une certaine robustesse : s’il y avait une grande défaillance ou un black-out chaque fois qu’une centrale tombe en panne, ce serait intolérable !
Les opérateurs européens se sont mis d’accord pour définir des règles de sécurité prévoyant notamment des réserves disponibles instantanément. Le système actuel est conçu et exploité pour faire face à tout moment, d’une seconde à l’autre, à une panne de production de 3 000 MW survenant en n’importe quel point du réseau. Si une telle panne se produit, toutes les centrales se mettront automatiquement et immédiatement à produire un peu plus. Au bout de quelques minutes, d’autres réglages prendront le relais pour que le pays qui en est à l’origine compense la défaillance lui-même et que les autres reviennent à leur point d’équilibre.
C’est, hélas, d’une grande banalité dans les systèmes électriques : il arrive que les centrales tombent en panne. Il n’y a rien nouveau de ce point de vue et la question est maîtrisée. L’augmentation de la taille unitaire des centrales peut cependant soulever des questions. C’est le cas de l’EPR, mais un seul modèle est pour l’heure en construction et les opérateurs européens dans leur ensemble estiment que la problématique n’en est pas affectée et qu’il n’est pas nécessaire de changer les règles.
Des questions se posent également pour l’éolien, où l’aléa le plus fort n’est pas l’absence de vent mais son excès. En cas de tempête dans le Nord de l’Allemagne, la production éolienne atteint son maximum puis, quand le vent dépasse 90 km/h, les éoliennes s’arrêtent pour se mettre en sécurité. Le phénomène n’est pas absolument instantané, mais les baisses de puissance peuvent atteindre 5 000 à 6 000 MW en l’espace de quinze ou vingt minutes. Après de savants calculs, on a établi toutefois que cela ne justifiait pas de changements dans le dimensionnement des réserves. Le délai d’extinction est suffisant pour la mise en œuvre de la capacité de réaction actuelle du réseau.
Pour conclure s’agissant des aléas, le nucléaire ne représente pas une problématique nouvelle ou spécifique.
Mme Sabine Buis, vice-présidente, remplace M. François Brottes à la présidence de la commission d’enquête.
M. le rapporteur. Confirmez-vous l’augmentation des arrêts fortuits que fait apparaître votre site ?
M. Pierre Bornard. Je ne sais pas si cela tient à l’établissement d’une transparence complète où à une véritable augmentation de la fréquence de ces arrêts. Par ailleurs, tout arrêt non programmé est défini comme un arrêt fortuit. Mais la réalité est pour nous très différente selon que nous avons ou non le temps de prendre des mesures. De par mon expérience, je peux dire que nous ne constatons pas d’augmentation des difficultés. Les pannes de centrales nucléaires ne sont pas plus nombreuses. Si c’était le cas – je n’ai pas ici les chiffres –, je le saurais !
Quant aux investissements prévus dans les infrastructures de transport en Allemagne et en France, ils ne sont pas tout à fait comparables même s’ils concernent dans tous les cas la très haute tension – 225 000 et 400 000 volts.
À ma connaissance, les 2 000 km programmés en Allemagne sont uniquement des couloirs nord-sud. L’Allemagne connaît un déséquilibre structurel entre un Nord producteur – notamment en raison de l’éolien – et un Sud davantage consommateur. L’interconnexion entre ces deux zones étant insuffisante, le plan Energiewende prévoit la mise en place de couloirs spécifiques pour faire face aux urgences. Mais il faut y ajouter des ouvrages plus conventionnels destinés à répondre au développement de la production et de la consommation à certains endroits. En France également, bien que la hausse de la consommation soit très faible, les disparités régionales s’accroissent. Certaines régions consomment de plus en plus, d’autres de moins en moins, on assiste à des déplacements de populations, etc.
Le détail des investissements de RTE figure dans notre schéma décennal de développement, publié tous les ans. Comme pour tout le réseau européen, il y a trois principales raisons à notre développement : le changement de forme de la consommation ; le changement de forme de la production, que l’on constate en dépit de l’absence de grande décision sur le futur mix énergétique ; l’amélioration de l’interconnexion du réseau, qui nous amène, entre autres, à développer l’interconnexion avec l’Espagne et l’Italie de manière à tirer le meilleur parti de la production.
À titre d’exemple, nous sommes en bonne voie pour achever une liaison avec l’Espagne, où, à l’heure actuelle, il n’est pas rare que la production d’électricité renouvelable soit arrêtée. C’est arrivé lors de la semaine de Pâques 2013 pour l’ensemble de la production éolienne et pour une partie de la production photovoltaïque, qui se trouvaient alors gratuites et abondantes du fait de la situation de quasi-île électrique de l’Espagne.
M. le rapporteur. Ce n’était donc pas un arrêt pour des raisons météorologiques mais un arrêt volontaire du fait d’une surproduction.
M. Pierre Bornard. Le système devenait ingérable. Il fallait arrêter ces productions pour éviter le black-out.
L’interconnexion de l’Italie est également insuffisante, avec les mêmes excédents de production renouvelable à certains moments mais aussi des excédents de production thermique au fioul que l’on pourrait économiser.
Dans le même ordre d’idées, RTE travaille actuellement à un projet avec l’Irlande, où l’éolien connaît un grand essor mais où la production de base est insuffisante. Relier l’Irlande au continent via la France serait une bonne décision pour la collectivité.
Enfin, notre schéma décennal prévoit le renouvellement d’ouvrages vétustes.
Mme Sabine Buis, présidente. Qu’en est-il des conséquences de la fermeture de la centrale de Fessenheim ?
M. Pierre Bornard. Cette centrale injectant de la puissance dans une zone où d’autres fermetures ont eu lieu du côté allemand, des enjeux de gestion du réseau se posent. En conséquence, RTE a décidé d’installer sur ses lignes des contrôleurs-déphaseurs de manière à contrôler les flux, qui risquent de devenir excessif sur les lignes nord-sud en Alsace en raison de la situation en Allemagne. Ces « robinets » devraient être en fonction en 2016.
Du point de vue de l’équilibre entre l’offre et la demande, nous avons publié l’analyse des conséquences de l’arrêt de deux réacteurs de 900 MW dans notre bilan prévisionnel de 2013. Même si, globalement, les marges de sécurité se réduisent, nous continuons à respecter le critère de sécurité d’approvisionnement tel que la loi française le définit. Nous menons en outre des études poussées avec nos collègues allemands pour identifier qui sera touché et pour trouver des solutions communes.
Mme Sabine Buis, présidente. Vous avez mentionné le décalage entre le développement de la production d’électricité photovoltaïque en Italie et la construction d’infrastructures de transport. Une des réponses ne pourrait-elle pas être l’autoproduction et l’autoconsommation ?
M. Pierre Bornard. C’est un sujet dont on parle beaucoup. Le concept est très séduisant. Il faut à la fois en explorer toutes les implications techniques et le considérer avec un peu de recul. Beaucoup de graphiques existent sur les moments où l’on produit de l’énergie solaire et les moments où on la consomme. En poussant le raisonnement jusqu’à la caricature, lorsque la personne est partie en vacances, le panneau photovoltaïque installé sur son toit produit beaucoup et l’autoconsommation est nulle. De même, si elle rentre du travail à 19 heures, elle aura besoin d’une énergie que le panneau ne peut plus produire.
En résumé, je considère les dispositifs d’autoconsommation avec beaucoup de sympathie s’ils sont globaux, avec beaucoup d’antipathie s’ils sont locaux. Sur un maillage aussi large que possible – le niveau pertinent est l’Europe –, on peut utiliser très intelligemment cette énergie produite en milieu de journée et lui substituer une autre source à 19 heures. Mais l’idée assez répandue d’une autarcie énergétique à un niveau très local conduit à de grandes difficultés à la fois techniques – sans moyens économiques de stockage, les défaillances seront inévitables – et économiques – sans le foisonnement et l’optimisation d’ensemble, les coûts augmenteront fortement.
Cette idée recèle cependant de vrais gisements. Il convient de consommer localement autant que possible et certaines utilisations sont tout à fait pertinentes. En Italie du sud, il n’est pas absurde qu’un supermarché alimente sa climatisation par des panneaux photovoltaïques, puisque sa consommation correspondra aux moments où le soleil et la chaleur sont à leur maximum. Il faut porter un regard lucide sur les différents cas de figure. Comme je l’ai dit, on peut tout faire ; la seule erreur, c’est le déni de la réalité.
Mme Sabine Buis, présidente. Vous l’avez dit dans votre intervention liminaire : « Le mix énergétique de demain relève de la décision politique. Quoi que l’on décide, nous saurons le faire techniquement. » On devrait donc pouvoir avancer sur tous les terrains !
M. Pierre Bornard. J’aurais pu ajouter un codicille : tout a un coût ! Nous avons des ingénieurs brillants, capables de trouver des solutions à tout, mais ces solutions peuvent revenir très cher. La décision doit donc être globale.
M. le rapporteur. Le problème des périodes de pointe a aussi un coût !
M. Pierre Bornard. Lorsque j’ai commencé ma carrière, la France était alimentée essentiellement par des petites centrales à charbon ou au fioul, d’une puissance comprise entre 125 et 250 MW. Après que l’on eut pris la décision de passer à un vaste programme nucléaire, mes collègues plus âgés étaient persuadés que cela ne marcherait pas. Ils estimaient que de grosses installations n’auraient pas la souplesse nécessaire. Or nous l’avons fait ! De même, il m’est arrivé d’entendre qu’il devenait impossible d’exploiter un système électrique à partir de 10 % d’énergies renouvelables. Nos collègues allemands – et nous-mêmes à certains endroits – ont démontré le contraire. Bien sûr, il existe des conditions dans lesquelles on n’y arrive pas. L’objectif est de les anticiper et de les modifier.
Mme Sabine Buis, présidente. Je vous remercie pour la clarté de votre présentation et de vos réponses.
Audition de M. Jean-Philippe Bucher, président-directeur général de FerroPem
(Séance du jeudi 16 janvier 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314007.pdf
Mme Sabine Buis, présidente. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Jean-Philippe Bucher, président-directeur général de FerroPem, accompagné de MM. Laurent Neulat, directeur énergie, et Benoist Ollivier, directeur des opérations France.
Nous serons heureux, monsieur Bucher, d’entendre le point de vue d’un industriel électro-intensif sur le fonctionnement du marché de l’électricité. Ces entreprises ont en effet plus que toutes les autres besoin de disposer d’électricité à un prix modéré et stable, la part de la fourniture d’énergie dans leur facture d’électricité pouvant atteindre les quatre cinquièmes, soit une proportion très nettement supérieure à celle des autres composantes – transport, distribution, commercialisation et taxes. Se pose donc pour elles la question du coût auquel elles peuvent accéder à l’électricité nucléaire historique.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demanderai, monsieur Bucher, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Philippe Bucher prête serment)
M. Jean-Philippe Bucher, président-directeur général de FerroPem. Je représente effectivement ici un gros consommateur d’électricité, et je suis là pour témoigner du fait que le prix de l’électricité en France constitue pour notre entreprise un enjeu de survie – d’ici à deux ans.
FerroPem est une PME dont le chiffre d’affaires s’élève à 400 millions d’euros par an environ. Nous exportons 85 % de notre production et nous sommes leader mondial dans notre secteur, la production de silicium – le silicium est notamment utilisé comme matière première par l’industrie du photovoltaïque, marché, vous ne l’ignorez pas, en plein développement. Nous sommes donc aujourd’hui apparemment une société prospère.
Mais notre compétitivité dépend de trois facteurs dont la maîtrise nous échappe : le taux de change entre euro et dollar ; les protections douanières contre les pratiques agressives de la Chine, qui cherche à s’assurer une suprématie mondiale dans le domaine des métaux – celles dont nous bénéficions aujourd’hui ont été arrêtées par l’Union européenne il y a vingt-cinq ans ! ; enfin, le prix de l’énergie, qui représente environ 30 % de nos coûts.
Notre survie est en jeu à échéance de deux ans parce que la compétitivité de notre électricité est doublement menacée. D’une part, alors que nous sommes l’un des derniers industriels à avoir conservé les tarifs publics régulés d’EDF, ceux-ci vont disparaître à la fin de l’année prochaine. D’autre part, les contrats hydrauliques dont nous bénéficions pour des raisons historiques disparaissent aujourd’hui progressivement. Nos coûts d’électricité sont déjà en train d’augmenter mais vont subir une hausse brutale au 31 décembre 2015.
Or les solutions de remplacement existantes, comme l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique), condamnent notre compétitivité.
Nous intervenons sur un marché mondial extrêmement concurrentiel. Aujourd’hui, nous ne sommes plus en mesure d’investir pour nous développer en France, par manque de visibilité sur le prix de l’énergie ; si nous passons des tarifs verts à l’ARENH au 31 décembre 2015, les simulations que nous avons faites avec EDF nous font passer, en termes de compétitivité, du premier tiers aux tout derniers rangs. Nous serons dès lors les premiers à disparaître en période de crise. C’est aussi simple que cela !
Depuis des dizaines d’années, nous avons travaillé avec EDF, puis par nos propres moyens, à améliorer le profil de notre consommation. Ressemblant en cela aux industriels de l’aluminium, nous avons un facteur de charge très important : quand nos usines tournent, c’est en moyenne à 85 % de la puissance maximale, mais dans des conditions de stabilité qui facilitent l’exploitation des réseaux et des centrales, notamment nucléaires. Nous avons également investi dans des technologies qui nous permettent, à l’inverse, d’être extrêmement flexibles et de disparaître du réseau en quelques secondes si on nous le demande ; cet effacement peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, voire quelques mois. Enfin, notre industrie est née en même temps que l’hydroélectricité et nos usines, installées dans les vallées des Alpes principalement mais aussi des Pyrénées, se sont développées il y a une centaine d’années en même temps que la houille blanche, de manière à pouvoir consommer l’électricité à l’endroit même où elle produite… Notre proximité avec les sources d’énergie fait que nous n’avons pas de coûts de transport, techniquement parlant, et indépendamment de la politique tarifaire – quelques centrales d’EDF sont même intégrées à nos sites.
Mais, comme je l’ai dit, nous ne nous développons plus en France. Chargé au sein de notre actionnaire FerroAtlantica des développements stratégiques du groupe, je négocie l’accès pour notre industrie à des contrats d’énergie dans tous les pays du monde qui disposent de ressources énergétiques importantes. Pour être compétitifs, il nous faut en effet un prix du mégawattheure rendu aux bornes de nos usines qui se tienne en dessous de 30 dollars – au delà, tout développement est exclu. Pour simplement maintenir notre activité, ce prix ne doit pas dépasser quelque 40 dollars, soit 30 euros.
En France, l’enjeu pour nous est par conséquent de travailler avec les pouvoirs publics et avec les opérateurs de l’énergie à des solutions qui nous permettent d’atteindre, au 1er janvier 2016, sinon le niveau autorisant un développement de notre entreprise, à tout le moins le niveau qui lui permette de survivre. Nous nous présentons donc devant vous comme une PME dont les comptes sont aujourd’hui rassurants, mais qui se dirige tout droit vers un gouffre.
Il est possible, nous en sommes convaincus, de trouver ces solutions, mais elles ne dépendent pas de nous. Ce qui est en jeu, je le répète, c’est l’entreprise avec ses usines et ses emplois, mais c’est aussi l’exploitation de certaines ressources nationales : si nous sommes leader mondial, c’est parce que notre pays dispose de réels atouts – minerai, proximité des clients, réseau de transport structuré, bonne infrastructure de recherche et développement… Notre disparition reviendrait à gâcher ces ressources !
Autrefois filiale de Pechiney, nous en sommes parvenus à un stade auquel ne sont pas arrivés les industriels de l’aluminium. Grâce au repreneur que nous avons trouvé en 2005, FerroPem est devenue une PME, avec des coûts de structure réduits et une forte concentration sur son métier. Cette taille d’entreprise nous convient bien et notre actionnaire joue le jeu, mais nous n’avons d’autre ressource pour survivre que de régler ce problème du coût de l’énergie.
Mme Sabine Buis, présidente. Merci de cette description aussi claire qu’inquiétante. Les PME sont nombreuses dans le secteur énergétique et il nous paraît très important de leur permettre de faire entendre leur voix.
En Allemagne, les industries électro-intensives sont exonérées, au moins en partie, des coûts de transport. Est-ce une possibilité que vous excluez pour la France ?
M. Jean-Philippe Bucher. Les solutions pour atteindre un niveau de 30 euros par mégawattheure rendu aux bornes de nos usines sont certainement multiples, et je ne suis pas entré dans le détail.
Compte tenu de notre proximité avec l’industrie hydraulique, nous aurions souhaité prendre part au processus de renouvellement des concessions hydroélectriques d’EDF. Nous sommes également prêts à contribuer le cas échéant, y compris en capital – à notre mesure, bien entendu –, au financement de la prolongation de la vie des centrales nucléaires. Pour ce qui est des coûts de transport, la référence à l’Allemagne ne me semble pas de mise : nous sommes désormais le seul électrométallurgiste de taille critique en Europe, nos concurrents se trouvant aujourd’hui en Amérique du nord, en Asie et au Moyen-Orient. Le seul pays européen où l’énergie est encore compétitive, c’est l’Islande, qui dispose d’énergie hydraulique à profusion mais qui est coupée des marchés et de l’approvisionnement en matières premières.
Pour parler franchement, je n’ai pas la compétence pour dire exactement comment il faut agir. Nous savons ce que nous pouvons apporter au réseau grâce à notre flexibilité et à la régularité de notre consommation, et nous pouvons encore améliorer le profil de celle-ci. Pour le reste, la mise au point de solutions sous l’angle technique ou administratif ne dépend pas de nous. Il n’y a certainement aucune recette magique, ne serait-ce qu’en raison de la surveillance exercée par l’Union européenne – surveillance qui n’existe pas sur les autres continents, où je négocie avec des gens qui cherchent plutôt à proposer des prix situés en deçà des tarifs publics.
Nous continuons de parler avec les responsables d’EDF, avec qui nous collaborons depuis cinquante ans, mais, aujourd’hui, nos intérêts sont contradictoires : ils nous considèrent comme de mauvais clients car, à leurs yeux, nous ne payons pas l’électricité assez cher.
M. Denis Baupin, rapporteur. Merci de votre témoignage : la question des industries électro-intensives, et plus largement énergo-intensives, doit effectivement être prise en considération pour mener à bien la transition énergétique.
Comme l’Allemagne, la France a adopté certaines mesures en faveur des industriels électro-intensifs, mais ces dispositions sont aujourd’hui fragiles juridiquement, différents recours ayant été déposés auprès de la Commission européenne pour distorsion de concurrence. Il faudra donc élaborer un dispositif juridiquement solide.
On entend souvent dire que l’électricité est très peu chère en France ; or vous semblez dire le contraire : pourriez-vous développer ce point ?
Je ne comprends pas du tout pourquoi vous vous vous déclarez prêt à participer au financement de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires : en quoi cela influerait-il sur le coût de l’électricité, et donc sur le prix que vous payez ?
M. Jean-Philippe Bucher. Nous sommes conduits à nous intéresser aux prix de l’électricité à l’échelle mondiale pour mener à bien notre développement stratégique et nous avons établi une short list de pays et de régions où nous pourrions obtenir de l’électricité à bon marché. Y figurent l’Islande, le Canada et les États-Unis, le Moyen-Orient, la Russie dans sa partie sibérienne, la Malaisie. La plupart ont en effet fortement investi dans la production hydraulique – c’est le cas en Sibérie, au Québec et en Malaisie – ou thermique – ainsi les États-Unis, avec le gaz de schiste, et le Moyen-Orient.
Je ne peux pas donner trop de détails car nos contrats comportent des clauses de confidentialité, mais on peut trouver, même dans certains pays européens, des prix inférieurs à 30 dollars par mégawattheure et, dans le Golfe persique, des tarifs de 15 euros ! En tout état de cause, aucun des pays que j’ai cités ne pratique des prix supérieurs à 40 dollars et, la plupart du temps, il s’agit de tarifs publics, non négociés donc, accordés aux industriels grands consommateurs d’électricité pour les alimenter en tension de l’ordre de 200 kiloVolts. Je précise qu’il s’agit à chaque fois de prix aux bornes de l’usine, donc transport compris.
Nous arrivons également à négocier des clauses d’indexation sur vingt ans, avec des plafonds d’augmentation de 2,5 % par an. C’est pour nous la garantie d’un prix compétitif sur toute la durée d’un investissement. On peut certes s’interroger sur la stabilité des prix que peut garantir un pays comme les États-Unis, où la pérennité de l’exploitation des gaz de schiste fait question, mais aucune volatilité de ce genre n’est à redouter lorsqu’il s’agit d’énergie hydraulique.
Les pays que j’ai cités offrent donc des tarifs, et souvent, je le redis, des tarifs publics, bien plus faibles que l’ARENH.
L’idée de contribuer à la prolongation de la vie des centrales nucléaires françaises est une vieille idée. Le groupe FerroAtlantica est un groupe familial, non coté en bourse, qui exploite des centrales hydrauliques et des centrales thermiques à gaz, mais dont le dirigeant, aujourd’hui âgé de 82 ans, admire depuis longtemps le programme nucléaire français et regarde avec envie notre situation en matière énergétique ; soucieux de garantir durablement l’approvisionnement de son groupe mais aussi de prendre part à ce qu’il regarde comme une aventure prestigieuse, il est disposé, non seulement à participer au processus de renouvellement des concessions hydrauliques, mais aussi à investir personnellement dans cette prolongation de la vie de nos centrales. Ce projet peut prêter à polémique mais c’est dire que nous ne sommes pas venus ici seulement pour pleurer et tendre la main : j’ai reçu aussi pour mandat de faire état de cette proposition de mobiliser du capital pour trouver des solutions.
(Présidence de M. François Brottes, président de la commission d’enquête).
M. le président François Brottes. Il faut absolument que nous prenions tous conscience qu’aujourd’hui, la France et l’Europe ont beaucoup perdu de leur attractivité pour des industries très énergivores : le risque de délocalisation est dès lors bien réel, comme le montre votre propos.
M. Jean-Philippe Bucher. Nous ne pouvons effectivement envisager aucun développement en France, et des délocalisations sont bien sûr à craindre si les choses devaient tourner au pire pour nous.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il faut aussi souligner que vos usines, installées dans des fonds de vallée, ont également, de ce fait, des charges de transport importantes, puisque vos usines sont situées sur des sites reculés.
Vous avez dit votre volonté de poursuivre votre partenariat historique avec l’industrie hydroélectrique : sachez que je me penche sur ce dossier avec le président Brottes et que nous serons très attentifs à ce point.
Pour anticiper la fin des tarifs préférentiels, condamnés par l’Europe, vous pratiquez depuis plusieurs années une forte politique d’effacement, souvent sur de longues périodes, mais cette politique n’a-t-elle pas atteint aujourd’hui ses limites ?
M. Jean-Philippe Bucher. Nous avons collaboré avec EDF sur ce dernier sujet pendant de nombreuses années, ce qui nous a permis de bénéficier de tarifs d’effacement de longue durée. Nous continuons à bénéficier des tarifs EJP (effacement des jours de pointe). Nous pratiquons également la saisonnalisation, c’est-à-dire l’arrêt de nos activités l’hiver – avec les contraintes que cela emporte pour nous – afin de permettre un effacement complet de longue durée.
Je voudrais remercier ici le président Brottes pour son rôle dans la promotion des effacements de courte durée.
M. le président François Brottes. C’est maintenant tout le Parlement qu’il faut remercier !
M. Jean-Philippe Bucher. Nous travaillons sur ces effacements de courte durée, effectués sans préavis, depuis plusieurs années. Mais alors que la législation semble aller dans le bon sens, la réalité nous déçoit : les appels d’offres pour les effacements de l’année 2014 et probablement de l’année 2015 marquent une régression. Nous vivons plutôt mal d’en avoir été écartés au profit d’entreprises utilisant des groupes électrogènes diesel déjà amortis : c’est un non-sens économique et une absurdité du point de vue environnemental.
La politique d’EJP, c’est-à-dire la valorisation de l’effacement, ne cesse de s’affaiblir depuis dix ans. Nous sommes convaincus qu’à terme les effacements prendront toute leur valeur, mais nous pensons qu’il ne faudrait pas laisser la part belle aux producteurs : c’est en effet les inciter à investir dans des moyens destinés à faire face aux périodes de pointe, moyens qui, amortis ou non, finiront par être intégrés dans le réseau de production d’électricité, contribuant à tarir encore l’aide accordée aux industries électro-intensives tout en provoquant des dommages à l’environnement.
M. le président François Brottes. Merci de cet hommage rendu aux vertus de l’effacement, que j’ai effectivement pris l’initiative, dans une proposition de loi, de valoriser. Je me suis récemment ému d’un avis de l’Autorité de la concurrence, qui considérait que cette pratique pouvait porter préjudice aux producteurs, comme si le meilleur moyen de tuer un tel dispositif n’était pas, précisément, d’y laisser entrer les producteurs – mais quand ceux-ci ne peuvent pas entrer par la porte, ils passent par la fenêtre ! Je m’en suis expliqué avec le président de l’Autorité de la concurrence, dont la position devrait être revue, mais cela montre les résistances que peut rencontrer tout nouveau dispositif, fût-il destiné comme celui-ci à économiser l’énergie. Pour l’imposer, la loi ne suffit pas toujours…
M. Yves Blein. Le problème des industries qui consomment beaucoup d’énergie est effectivement majeur, puisque l’électricité coûte de plus en plus cher en France et en Europe – et on ne voit pas comment cette tendance pourrait s’inverser compte tenu de la diversification en cours de notre bouquet énergétique – tandis qu’on trouve ailleurs des prix du mégawattheure quasi dérisoires, auxquels nous ne pouvons espérer descendre : 15 euros parfois, avez-vous dit, quand on en est chez nous à 43 euros, transport non compris.
M. le président François Brottes. Avec le transport, on en arrive à un rapport de un à cinq. Si l’on veut réindustrialiser, c’est un problème dont il faut s’occuper.
M. Jean-Philippe Bucher. Au Québec, le tarif consenti aux industriels électro-intensifs se situe aux alentours de 40 dollars par mégawattheure mais, pour le gouvernement québécois avec lequel je négocie actuellement, il ne s’agit que d’une référence plafond. Les responsables avec qui je discute sont prêts à faire des efforts substantiels pour attirer les entreprises.
Pour nous, je le redis une dernière fois, le coût de l’électricité est une question de survie à très court terme. J’agite donc un chiffon rouge, alors même que nos résultats financiers sont tout à fait rassurants. Nous sommes une industrie cyclique : nous arrivons à gagner un peu d’argent en bas de cycle – et, bien sûr, beaucoup plus en haut de cycle – et nous avons traversé la crise de 2009 sans enregistrer de pertes. Cela risque de ne plus être le cas dès demain matin.
M. le président François Brottes. Voilà qui doit nourrir notre réflexion : il en va de la survie de l’industrie en Europe.
Audition de M. Andreas Rüdinger, chercheur « Politiques climatiques et énergétiques » à l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales)
(Séance du jeudi 23 janvier 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314008.pdf
M. le président François Brottes. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Andreas Rüdinger, chercheur en politiques climatiques et énergétiques à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).
Notre commission entame ainsi l’étude de la place présente et future de la filière dans différents pays voisins. Nous évoquerons d’abord le cas de l’Allemagne, puis ceux de la Grande-Bretagne et de la Belgique.
Le rapporteur et moi-même avons souhaité organiser ces auditions de manière à permettre l’expression simultanée de deux voix : celle d’un expert, dont nous attendons qu’il décrive de façon aussi objective que possible la situation dans le pays concerné, et celle d’un acteur opérationnel, qui nous dira comment, le cas échéant, il s’adapte aux nouvelles conditions d’exercice de son métier.
Cependant, les interlocuteurs que nous avons sollicités pour représenter le secteur électrique allemand nous ont fait savoir que le gouvernement de leur pays consacrera demain une réunion importante à ce sujet, qui infléchira sans doute la trajectoire et changera la perspective. Ils ont jugé peu opportun de présenter à notre commission des analyses qui risqueraient de devenir sans objet le lendemain même. Nous les entendrons donc plus tard.
M. Rüdinger connaît bien le contexte énergétique allemand et est l’auteur de nombreuses publications sur la transition énergétique.
Avant de vous donner la parole, monsieur, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Andreas Rüdinger prête serment)
M. Andreas Rüdinger, chercheur en politiques climatiques et énergétiques à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). Je remercie votre commission de me donner l’occasion de présenter ces travaux de recherche. J’espère qu’ils lui seront utiles.
Cette audition vient à point nommé : non seulement nous avons fêté hier le cinquante et unième anniversaire du traité de l’Élysée, mais beaucoup de choses se passent actuellement en Allemagne concernant la transition énergétique.
Je commencerai par un rappel historique des principales étapes du tournant énergétique allemand et du rôle qu’y joue la sortie du nucléaire. J’aborderai ensuite l’évolution du système électrique allemand dans le contexte, pour le moins turbulent, du marché européen de ces dernières années. Je terminerai par quelques réflexions sur les aspects économiques.
La décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire remonte à la coalition SPD-Verts de 1998. Elle trouve sa traduction dans deux textes principaux. Le premier est l’accord passé en 2000 avec les industriels de l’électricité pour poser le principe d’une sortie définitive et pour mettre en œuvre un mécanisme de flexibilité qui permettait aux opérateurs de prolonger certaines centrales au-delà de la durée de vie maximale de trente-deux ans en leur transférant le « productible restant » d’autres centrales, à des fins d’optimisation du parc.
M. le président François Brottes. Que signifie le « productible restant » ?
M. Andreas Rüdinger. En principe, les centrales ne doivent pas dépasser une durée de vie de trente-deux ans. On a cependant souhaité optimiser ce parc vieillissant en donnant la possibilité aux opérateurs exploitant plusieurs centrales d’en fermer une plus tôt et de transférer le quota restant sur une autre centrale pour en prolonger d’autant le fonctionnement au-delà de trente-deux ans.
Dans ce dispositif, la date définitive de sortie dépend en partie des choix réalisés par les opérateurs et ne peut donc être strictement établie. D’après le calendrier fixé en 2002 sur la base de ce mécanisme, il était néanmoins estimé que la sortie serait complète vers 2024.
M. le président François Brottes. J’imagine qu’une autorité indépendante se prononce aussi, à partir de données techniques, sur la prolongation des centrales.
M. Andreas Rüdinger. Il faut bien entendu l’autorisation de l’autorité allemande de sûreté. Mais c’est l’accord politique qui avait posé le principe des trente-deux ans de durée moyenne. Le choix par l’opérateur de transférer le productible d’une centrale à une autre n’équivaut pas à la décision, en France, de prolonger la durée de vie d’une centrale.
Le second grand texte est la réforme de la loi sur le nucléaire menée en 2002, qui confirme l’objectif de sortie complète vers 2024.
Dès le début des années 2000, donc, on parle en Allemagne d’un « tournant énergétique » comprenant trois objectifs globaux : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Dans cet ensemble, la sortie du nucléaire est un symbole très fort, mais n’est pas le seul enjeu. Je tiens à le préciser, car on lit souvent des articles consacrés au « coût de la sortie du nucléaire » en Allemagne alors qu’il est pratiquement impossible d’isoler un tel élément. L’évaluation économique doit prendre en compte l’ensemble de la transition.
J’en veux pour preuve, d’ailleurs, les décisions prises après 2002. La coalition CDU-FDP formée en 2009 décide par exemple de retarder de douze années en moyenne la sortie du nucléaire, pour une sortie définitive en 2036, mais ne remet pas en cause le principe même de la sortie, eu égard à l’analyse des risques et aux alternatives disponibles. En contrepartie de cette prolongation, le gouvernement allemand demande aux grands électriciens une contribution financière qui emprunte deux circuits : d’une part, pour une recette estimée à 2,3 milliards d’euros sur la base de la production nucléaire de 2009-2010, la taxe sur le combustible nucléaire, toujours en vigueur aujourd’hui et qui fait l’objet de recours juridiques ; d’autre part une contribution exceptionnelle au financement de la transition énergétique, qui est restée dans les limbes puisque la nouvelle réforme de la loi sur le nucléaire, votée à la fin de l’année 2010, a fait l’objet de trois recours devant la Cour constitutionnelle allemande pour vice de procédure – en particulier parce que la chambre haute n’avait pas été saisie.
M. le président François Brottes. De qui les recours émanaient-ils ?
M. Andreas Rüdinger. Le premier a été formulé par la société civile le 3 février 2011. Un deuxième a été déposé le même mois par six Länder et un troisième par des partis d’opposition, le SPD et Les Verts.
M. le président François Brottes. Portaient-ils sur cette contribution en tant que telle ?
M. Andreas Rüdinger. Ils portaient sur la réforme dans son ensemble et sur la décision de retarder la sortie de 2024 à 2036.
M. le président François Brottes. En d’autres termes, si l’on n’a pas mis en place la contribution, c’est parce que l’arrangement global n’a pas été validé.
M. Andreas Rüdinger. On a en effet mis en suspens l’application de cette loi dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle. C’est alors qu’est survenu l’accident nucléaire de Fukushima. Trois jours après, la chancelière Merkel décidait de fermer les huit réacteurs les plus anciens en Allemagne, ceux dont la construction était antérieure à 1980. On a beaucoup parlé en Europe de cette décision, qualifiée d’abrupte et de radicale, mais ces centrales auraient de toute façon dû fermer avant la fin de 2012, en application de l’échéancier initial de sortie du nucléaire. Certes, il y avait là quelque chose de radical, mais on ne peut affirmer que cela n’aurait pas pu être anticipé. Le système allemand était préparé pour répondre à une telle éventualité.
Le nouveau paquet législatif adopté en juin 2011 comportait six textes, dont une nouvelle réforme de la loi sur le nucléaire, un dispositif d’accélération du développement des infrastructures de réseau et des mesures relatives aux pouvoirs des collectivités en matière de transition énergétique. Il a fait l’objet d’un quasi-consensus, puisque 83 % des députés l’ont voté. Seul le Parti de gauche s’y est opposé, mais parce qu’il estimait qu’il fallait mettre en œuvre encore plus rapidement la sortie du nucléaire.
Comment le système électrique allemand a-t-il répondu à ce défi ?
Je veux tout d’abord réfuter l’idée selon laquelle l’arrêt des centrales nucléaires aurait été compensé par une hausse de la production d’électricité à partir de combustible fossile, en particulier de charbon.
M. le président François Brottes. Vous voulez dire que l’Allemagne produit son électricité sans charbon ?
M. Andreas Rüdinger. Non, bien sûr, mais je veux démontrer que la hausse de cette production ne vient pas compenser la réduction de la production d’origine nucléaire.
Entre 2010, dernière année de pleine production nucléaire en Allemagne, et 2013, la part du nucléaire dans le mix énergétique baisse de 43,6 TWh. Elle est presque intégralement compensée, du moins en volume, par l’augmentation de la production renouvelable, qui atteint 42,3 TWh. Dans le même temps, la consommation intérieure d’électricité se réduit de 19 TWh, soit l’équivalent de deux réacteurs nucléaires, et ce en dépit d’un rattrapage économique fort après la crise de 2008 et de trois années successives de croissance en Allemagne. Dès lors, on peut estimer que l’efficacité énergétique connaît, au moins en partie, une amélioration structurelle dans le secteur de l’électricité.
Le solde exportateur net d’électricité de l’Allemagne a également connu une augmentation significative ces trois dernières années, pour atteindre en 2013 un record historique de 33 TWh. Ce n’est d’ailleurs pas forcément une bonne chose.
M. le président François Brottes. La cause en est sans doute la production importante d’énergie « fatale ».
M. Andreas Rüdinger. Non, ou pas uniquement.
Enfin, selon les statistiques de Réseau de transport d’électricité (RTE), l’Allemagne a été exportatrice nette vis-à-vis de la France tous les mois de l’année 2012.
Pour en revenir à l’électricité issue du charbon, cette production a augmenté, en Allemagne, de 9 % entre 2010 et 2013. Je pourrai également, si vous le souhaitez, vous communiquer un bilan de la production d’électricité en Allemagne selon les sources pour les dix dernières années. Cependant, dans le même temps, la production d’électricité thermique à partir d’énergies fossiles – charbon, gaz et fioul cumulés – n’a pas augmenté : elle a même baissé de 2 TWh. Voilà pourquoi je dis que ce n’est pas le charbon qui a compensé le nucléaire : en l’état, et toutes choses égales par ailleurs, il aurait fallu non seulement que la production au charbon augmente, mais que ce soit également le cas de l’ensemble de la production d’électricité à partir d’énergies fossiles.
Ce qui se dessine en arrière-plan est un phénomène plus global – notamment en Europe – de transfert de la production au gaz vers la production au charbon. Les experts de RTE et de la bourse EPEX Spot vous ont déjà décrit le fonctionnement du marché et l’évolution des fondamentaux, avec l’afflux de charbon sur les marchés mondiaux sous l’effet de l’exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. Parmi les autres facteurs, la demande chinoise de charbon a été moins forte ; le prix du gaz, du fait de l’indexation sur le prix du pétrole, a augmenté en Europe ; enfin, le prix des certificats d’émission de CO2 a chuté, ce qui a considérablement amélioré le bénéfice procuré par la production au charbon par rapport aux années précédentes. En revanche, la rentabilité de la production au gaz, qui se mesure à partir de la différence entre le prix du gaz à l’achat et le bénéfice que l’on peut tirer de l’électricité vendue sur le marché, n’a pas seulement baissé, elle est devenue négative. Les opérateurs s’exposent donc à perdre de l’argent en produisant de l’électricité à partir de gaz.
Le phénomène, plus ou moins accentué selon le mix électrique des pays, touche l’ensemble de l’Europe. En Allemagne, la production au gaz a diminué de 23,3 TWh entre 2010 et 2013, tandis que la production au charbon augmentait de 23,1 TWh, soit presque le même volume.
M. le président François Brottes. Sans doute faut-il y voir l’effet gaz de schiste.
M. Andreas Rüdinger. Pas uniquement. Une analyse économétrique serait nécessaire, mais elle est très difficile à envisager du fait de l’absence de référentiel, c’est-à-dire de scénario alternatif permettant d’évaluer exactement le poids de chaque facteur. Toujours est-il que le gaz de schiste n’explique pas tout. Son effet sur le prix du charbon aurait pu, en théorie et si nous avions eu la réactivité nécessaire au niveau européen, être compensé par une hausse substantielle du prix des certificats d’émission de CO2. Or ce prix a chuté simultanément, augmentant le différentiel entre charbon et gaz.
L’Europe devrait également peser davantage pour négocier à la baisse les contrats d’approvisionnement en gaz de l’Europe – actuellement gérés de façon bilatérale – dans un contexte d’augmentation de la production mondiale.
M. le président François Brottes. En résumé : le charbon tue le gaz ; si le charbon a baissé, c’est à cause du gaz de schiste ; nous aurions pu nous défendre, mais nous ne l’avons pas fait.
M. Andreas Rüdinger. On aurait pu trouver une réponse politique.
M. le président François Brottes. Il n’en reste pas moins que le fait générateur de la baisse du prix du charbon est bien l’avènement du gaz de schiste sur le marché mondial.
M. Andreas Rüdinger. Le gaz de schiste joue un rôle important, mais il ne faut pas négliger la faiblesse structurelle de l’ETS (Emissions Trading System). Lorsque l’on a fixé le prix initial de la tonne de CO2 à 25 euros, on tablait sur une hausse des quotas. Or ils se sont totalement effondrés, atteignant un niveau de 3 à 4 euros la tonne l’année dernière.
L’augmentation de la production au charbon, je l’ai dit, n’est pas un phénomène allemand, mais européen. En France, où le parc de production fossile est beaucoup moins important, la production au gaz a diminué de 7,3 TWh entre 2011 et 2012, tandis que le charbon augmentait de 5 TWh. Quant à la Grande-Bretagne, que l’on oppose souvent à l’Allemagne dans ses choix de transition énergétique et que l’on cite en exemple dans la lutte contre le changement climatique, la production au charbon a augmenté de 32 TWh entre 2011 et 2012 – soit beaucoup plus qu’en Allemagne, alors que la consommation est nettement inférieure – et la production au gaz a baissé de 47 TWh. En Espagne, le charbon augmente sur la même période de 11,2 TWh, et le gaz diminue de 12 TWh. Il y a donc eu substitution entre ces deux sources de production en Europe. Le charbon a remplacé le gaz dans l’ordre de mérite des centrales.
M. le président François Brottes. Revenons-en aux chiffres qui, selon vous, montrent que la hausse du renouvelable aurait compensé la baisse de la production nucléaire en Allemagne. Que reflètent-ils ? Ce qui est produit et consommé sur le territoire allemand, ou ce qui est produit en Allemagne sans y être forcément consommé, qu’il s’agisse de l’électricité exportée ou de celle que produisent les éoliennes à des moments où on n’en a pas besoin ? Il faut comparer ce qui est comparable.
M. Andreas Rüdinger. Comme je l’ai bien précisé, ces chiffres traduisent l’évolution du volume de la production totale annuelle entre 2010 et 2013. Pour le reste, il est impossible de détecter l’origine d’un électron sur le réseau. On ne peut donc savoir si l’intégralité de la réduction de la production nucléaire a été compensée par la hausse du renouvelable. Cela dépend des dynamiques sur le marché européen, sachant qu’auparavant une grande partie de l’électricité nucléaire allemande était déjà exportée. Mais, à ce stade, je ne peux donner qu’un bilan statique en volume. Les énergies renouvelables comprennent assurément un facteur de variabilité important, qui demande un effort de flexibilité supplémentaire dans le réseau. L’argument selon lequel ce sont les centrales à charbon qui assurent cette flexibilité ne me semble cependant pas tout à fait fondé. Si tel était le cas, on assisterait à une évolution du facteur de charge de ces centrales : là où elles fonctionnent en base, elles devraient désormais moduler leur production en fonction de la production d’énergie renouvelable intermittente. Il n’en est rien. Dans la période considérée, leur facteur de charge n’a que légèrement augmenté pour des raisons économiques. Produire de l’électricité à partir de charbon en Europe est très rentable et les opérateurs font fonctionner leurs centrales autant qu’ils peuvent, que ce soit pour la consommation intérieure ou pour l’exportation.
M. le président François Brottes. En France, il ne nous reste plus beaucoup de charbon !
M. Andreas Rüdinger. L’Allemagne importe aussi une grande partie de son charbon.
M. le président François Brottes. Avez-vous analysé les courbes de production d’électricité et d’utilisation des différentes sources heure par heure ? RTE propose sur son site une application pour téléphone mobile qui permet de suivre en temps réel d’où vient l’électricité que l’on consomme. C’est le seul moyen de déterminer si une source en compense une autre. Les volumes annuels en disent beaucoup moins.
M. Andreas Rüdinger. J’ai ces chiffres, mais je pense que le fait de disposer du profil de consommation ne permet pas de mener l’évaluation jusqu’au bout. Si, comme c’est le cas en Allemagne, le parc fossile ne s’adapte pas entièrement à la variabilité des énergies renouvelables, doit-on considérer que ce sont les électrons « renouvelables » qui seront exportés ou les électrons « thermiques » ? Quoi qu’il en soit, je maintiens que le parc allemand de centrales à charbon a maintenu, voire augmenté son facteur de charge, et qu’il manque de flexibilité, aujourd’hui et dans les dix prochaines années, pour faire face à cette variabilité. C’est bien pourquoi nous avons besoin de centrales à gaz très performantes, avec un effet de rampe beaucoup plus rapide leur permettant de passer à 50 % de leur capacité de production en dix minutes et à 100 % en vingt minutes, ce qui est impossible pour des centrales à charbon vieilles de vingt ans.
M. le président François Brottes. Quelle est la part du lignite dans la production d’électricité en Allemagne ?
M. Andreas Rüdinger. En 2013, le lignite représentait 162 TWh, soit 26 % de la production totale d’électricité, et la houille 124 TWh, soit 20 %. La part du charbon est donc de 46 %.
La question du charbon est très importante, mais elle l’est pour toute l’Europe et pas seulement pour l’Allemagne. Il faut trouver d’urgence les moyens politiques d’assainir ce marché en augmentant le signal prix des quotas de CO2, afin notamment de structurer les décisions d’investissements futurs et pour instaurer une visibilité qui fait aujourd’hui défaut sur ce marché. On s’attendait à la disparition des capacités des centrales thermiques vieilles et polluantes sous l’effet conjugué de la directive sur les polluants atmosphériques et de la directive ETS. Or cela ne s’est jamais produit. Le parc des centrales à charbon ne s’est pas réduit en Europe. Il n’y a donc pas de place pour d’autres moyens de production décarbonés.
M. le président François Brottes. Ne pensez-vous pas que le phénomène a tout de même partie liée avec la décision de réduire le parc nucléaire ? Si l’on instituait une taxe carbone d’un montant plus vertueux, cela ne servirait-il pas les intérêts du nucléaire ? Si l’on ne s’y résout pas, c’est peut-être que l’on est dans une phase de transition où d’autres énergies renouvelables ne sont pas arrivées à maturité. Si l’Allemagne, la France et quelques autres grands pays étaient favorables à une hausse de la taxation des émissions de CO2, l’Europe devrait pouvoir y arriver. Cela ne dépend ni des Américains ni des Chinois !
M. Andreas Rüdinger. En théorie, l’augmentation du coût des émissions de CO2 devrait évidemment avantager le nucléaire, mais tout autant les énergies renouvelables.
Je rappelle que les mesures proposées par le nouveau ministre allemand de l’environnement, M. Sigmar Gabriel, visent à diminuer le surcoût des énergies renouvelables à l’avenir : elles n’affectent pas le surcoût historique, qui s’élève à 23 milliards d’euros au total. Pour diminuer le poids de cette charge historique, il faut d’abord influer sur le prix du marché européen, qui a atteint il y a quatre ans 70 euros le MWh pour retomber aujourd’hui au-dessous de 40 euros. Si ce prix revient à un niveau plus sain, la charge des énergies renouvelables baissera automatiquement, puisqu’elle est calculée sur la différence entre le prix du marché de gros et le tarif d’achat. L’Allemagne aurait tout intérêt, pour ce qui concerne du moins le coût des énergies renouvelables, à un assainissement du marché européen et à un renforcement des quotas de CO2. Mais, bien entendu, ce n’est pas l’intérêt des opérateurs de centrales à charbon.
M. le président François Brottes. Ces opérateurs ont-ils à voir avec la filière nucléaire ?
M. Andreas Rüdinger. Ce sont les mêmes : Vattenfall, qui est détenu par l’État suédois, RWE, EON et EnBW. Tous quatre exploitent à la fois des centrales nucléaires et des centrales thermiques à charbon. RWE possède même le plus grand parc de centrales à charbon d’Europe.
M. le président François Brottes. Mis à part EON, dont le projet de production à partir de la biomasse fait débat, ils sont peu présents en France.
Mais revenons-en à la réduction de la consommation intérieure allemande de 19 TWh. Quelle est la recette d’une telle prouesse ?
M. Andreas Rüdinger. C’est en grande partie une conséquence du signal prix très élevé.
M. le président François Brottes. Pour les particuliers. Les industriels allemands, en revanche, bénéficient de nombreux avantages. Ils ne paient pas le transport de l’électricité, par exemple.
M. Andreas Rüdinger. Ils ont beaucoup d’avantages par rapport aux ménages allemands. Par rapport aux industriels des autres pays, l’analyse mérite d’être approfondie…
Le prix moyen de l’électricité pour les particuliers atteint 26 à 27 centimes par kWh, alors que le tarif réglementé est en moyenne de 14,3 centimes en France. La différence est presque du simple au double. Elle a évidemment un effet sur les comportements, notamment sur les achats d’équipements. Une étude comparative des systèmes énergétiques français et allemand publiée en 2011 par l’IDDRI et l’association Global Chance a montré que la consommation d’électricité « spécifique » – appareils électriques et éclairage, mais pas chauffage et chauffe-eau – par habitant était au même niveau dans les deux pays en 1998.
C’est à cette date que commence le tournant énergétique allemand, avec l’instauration d’une taxe « écologique » sur l’électricité dont les recettes – 6 milliards d’euros par an – sont affectées à l’abaissement des charges sociales sur le travail. L’Allemagne a ensuite connu une augmentation régulière des tarifs de l’électricité, imputable au surcoût des énergies renouvelables à hauteur de 40 % environ, à deux hausses de la TVA, à la hausse d’autres contributions, à une légère hausse des charges de réseau et à une augmentation de la marge bénéficiaire des opérateurs. Lorsque le prix du kilowattheure atteint 27 centimes, on comprend bien que la décision d’acheter un réfrigérateur ou un lave-linge de catégorie « A++ » est plus facile à prendre. Un même équipement se rentabilise en dix ans en France, en cinq ans en Allemagne.
Selon l’étude citée, la consommation des ménages français en électricité spécifique a donc poursuivi sa trajectoire après 1998, tandis que celle des ménages allemands s’est stabilisée, si bien que la seconde est aujourd’hui de 30 % inférieure à la première.
Après la publication de ces résultats, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a commandé aux cabinets Sowatt et Enerdata une étude qui met en évidence la différence du taux de pénétration d’équipements très performants entre la France et l’Allemagne. On le voit, le signal prix affecte les décisions d’achat des ménages, et l’on peut supposer qu’il a aussi induit des usages plus sobres.
M. le président François Brottes. Cela ne peut expliquer à soi seul les 19 TWh d’économies. Il y a forcément eu des transferts de consommation. On aura remplacé sa cuisinière électrique par une cuisinière au gaz, on se chauffe au bois plutôt qu’à l’électricité, etc. Avez-vous des éléments à ce sujet ?
M. Andreas Rüdinger. Pas directement, car il est très difficile d’isoler les effets de transfert. Il existe des dynamiques d’évolution tendancielle des besoins par énergie, mais certains usages peuvent en effet donner lieu à des substitutions.
M. Denis Baupin, rapporteur. Le groupe de travail « Compétitivité » du débat national sur la transition énergétique a relevé que les dépenses d’énergie du logement – en dépit de débats sur ce que l’on mesurait réellement – représentaient 4,8 % des revenus, aussi bien pour les ménages allemands que pour les ménages français.
Votre présentation, monsieur Rüdinger, montre l’ampleur et la complexité de la transition énergétique. Je ne reviendrai pas sur la question du charbon, au sujet duquel nous partageons tous les mêmes préoccupations : malgré le rôle de ce mode de production sur le dérèglement climatique, les choses ne risquent pas de s’arranger tant que l’on ne mènera pas une politique climatique au niveau européen.
Les sénateurs Jean Desessard et Ladislas Poniatowski, que nous avons entendus, affirment dans leur rapport d’enquête sur « le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents agents économiques » que, si le prix de l’électricité en France est parmi les plus bas d’Europe, le montant des factures est en revanche sensiblement le même. Il serait même plus élevé en France qu’en Allemagne. Qu’en pensez-vous ?
Une partie importante de l’électricité renouvelable est produite par l’éolien en mer dans le nord du pays, alors que les besoins de consommation se trouvent surtout dans le Sud. Il semblerait que les projets de ligne d’acheminement entre ces deux secteurs rencontrent des difficultés. Quelle est votre analyse ?
On dit que les grands producteurs d’électricité en Allemagne sont en difficulté. La part de production d’énergie renouvelable serait plus le fait de petits producteurs – producteurs locaux, coopératives, mouvements associatifs – que des industriels. Quelles sont les conséquences de cette situation en matière de politique industrielle ?
Vous avez par ailleurs constaté – ce qui ne fait pas débat – que les électro-intensifs allemands ont des avantages clairs par rapport aux ménages. En revanche, vous estimez qu’il faut approfondir la comparaison avec les autres industriels européens. Votre analyse nous serait utile, car les éléments que l’on nous a fournis sur la situation des électro-intensifs français et allemands ne sont pas totalement concluants. L’atténuation de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont bénéficient les entreprises françaises est-elle comparable aux avantages dont bénéficient les entreprises allemandes ? Le prix final est-il sensiblement le même dans les deux pays ou les Allemands sont-ils avantagés ? Selon que l’on écoute le MEDEF ou d’autres sources, les échos ne sont pas les mêmes.
Le Président de la République a indiqué il y a quelques jours qu’il souhaitait le renforcement de la coopération franco-allemande par un « Airbus de l’énergie ». Parmi les pistes évoquées figuraient les énergies renouvelables et le stockage de l’électricité. Comment cette proposition est-elle accueillie du côté allemand ? Est-elle compatible avec la voie choisie pour la transition énergétique en Allemagne ? Quels pourraient en être les axes prioritaires ?
S’agissant enfin de la centrale de Fessenheim, qui est très proche de l’Allemagne, une étude réalisée par l’Öko-Institut pour le Land de Bade-Wurtemberg fait apparaître que l’installation ne pourrait fonctionner si elle se trouvait de l’autre côté de la frontière, car elle n’est pas conforme au référentiel de sûreté allemand. Ces différences de référentiel à quelques centaines de mètres de distance ont de quoi étonner. Pourriez-vous apporter des précisions ?
M. le président François Brottes. On parle d’une éventuelle agence franco-allemande de la sécurité d’approvisionnement. Ce projet pourrait-il s’intégrer à l’« Airbus de l’énergie » ?
M. Andreas Rüdinger. L’effet économique de la hausse du prix de l’électricité a été très fort en Allemagne. Pourtant, les statistiques officielles françaises et allemandes indiquent exactement les mêmes valeurs : la part des dépenses d’énergie dans le logement – incluant l’électricité – est de 4,8 % des dépenses totales, et elle atteint 8,4 % si l’on y ajoute le carburant et les transports. Mais le niveau des loyers est plus bas en Allemagne, de même, en général, que les prix de l’immobilier.
Peut-être la facture d’un ménage français est-elle plus élevée, monsieur le rapporteur. Encore faudrait-il parvenir à comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire extraire la part du chauffage et des chauffe-eau électriques, voire prendre en compte l’électrification supérieure des logements en France – fours électriques, etc. Je ne peux donc me prononcer sur ce sujet et je m’en tiens aux données disponibles : l’effort énergétique des ménages est le même en France et en Allemagne. Il faudrait approfondir les analyses pour déterminer si les Allemands réduisent leur consommation en réaction à l’augmentation de leur facture ou si d’autres facteurs jouent, comme la substitution d’autres énergies non prises en compte.
Le réseau est le talon d’Achille du tournant énergétique allemand, d’où les mesures successives prises en 2011, 2012 et 2013. L’Agence des réseaux évalue le besoin en infrastructures à moyenne et haute tension à 2 600 km de lignes nouvelles, notamment selon un axe nord-sud pour faire face au différentiel croissant entre une production renouvelable majoritairement installée sur les côtes de la mer du Nord et les centres de consommation, notamment industrielle, concentrés dans le Sud, et à 2 500 km de renforcement et d’optimisation de lignes existantes, sachant que les opérateurs de réseau allemands ont adopté le principe NOVA (Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau¸ c’est-à-dire « optimisation du réseau avant de le renforcer et de le développer »). À peine un dixième de ce programme, qui s’échelonne jusqu’en 2022 et est actualisé chaque année, a été réalisé.
M. le président François Brottes. Est-il facile de construire des lignes à haute tension en Allemagne ?
M. Andreas Rüdinger. Les problèmes d’acceptabilité sont les mêmes qu’en France. Peut-être arrive-t-on à les atténuer dès lors que l’on fait passer le message que ces lignes servent avant tout le tournant énergétique et le développement des énergies renouvelables. Cela dit, de nombreux problèmes se posent au niveau local. La réforme de la procédure administrative d’étude d’impact et de consultation fait de l’Agence des réseaux un guichet unique, ce qui devrait en théorie accélérer le processus.
La dernière mesure en date, annoncée par le précédent ministre de l’environnement Peter Altmaier, visait à permettre aux citoyens concernés au niveau local de participer financièrement au développement des réseaux, le rendement de l’investissement dans ces infrastructures étant garanti par l’Agence des réseaux à hauteur de 9 % par an. Cette idée s’inspire du succès rencontré ces dernières années par les projets citoyens en matière de développement des énergies renouvelables.
M. le président François Brottes. L’acceptabilité par l’actionnariat, en somme. Pourquoi ne pas l’envisager aussi pour les centrales nucléaires ? (Sourires.)
M. Andreas Rüdinger. Je doute moi aussi de l’efficacité de ce dispositif. Pour en savoir plus, votre commission pourra contacter l’Agence des réseaux. Le problème se pose également pour le développement de l’éolien en mer : l’installation des câbles a pris un retard considérable.
Pour ce qui est des consommateurs électro-intensifs, je vous renvoie à une étude comparative de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui compare les mécanismes qui, en France et en Allemagne, avantagent les industriels. Ainsi, 20 % de la consommation française bénéficie d’un taux privilégié de CSPE, et 20 % de la consommation allemande est partiellement exonérée de la contribution pour le développement des énergies renouvelables. L’analyse intègre le dispositif Exeltium, consortium constitué par les électro-intensifs français pour obtenir des prix à la fois bas et stables sur des périodes allant jusqu’à vingt ans. Elle conclut que les niveaux de prix sont très semblables dans les deux pays. L’avantage relatif de l’un par rapport à l’autre dépend de l’évolution du prix de gros sur le marché européen – je rappelle que ce prix est identique en France et en Allemagne pendant 92 % du temps. Si ce prix dépasse 44 euros le MWh, les électro-intensifs français sont légèrement avantagés. Dans le cas contraire, ce sont les électro-intensifs allemands, qui s’approvisionnent directement sur le marché.
M. le président François Brottes. Il faut aussi poser la question du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Les industries allemandes ne paient pas le transport de l’électricité.
M. Andreas Rüdinger. Elles le paient peu, ce qui est un problème en soi. Tout dépend de la frontière que l’on pose entre avantage relatif et avantage indu. Si l’on considère que, par nature, les Allemands devraient payer plus cher leur électricité, le niveau de prix similaire qu’acquittent aujourd’hui les industriels allemands et français est un avantage indu. C’est une position qui se défend. La Commission européenne venant d’engager une procédure contre l’Allemagne pour établir si les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables constituent des aides d’État, je pense que nous aurons bientôt des éclairages sur ces questions.
M. le président François Brottes. Des industriels électro-intensifs français nous ont affirmé que la différence de prix était de 7 à 13 % par rapport à leurs concurrents allemands. Les Länder ont-ils un rôle d’atténuation des prix ?
M. Andreas Rüdinger. Non. Le pouvoir politique intervient au niveau national via les dispositifs d’exonération. Les Länder n’ont aucun moyen d’influer sur les prix. Pour le reste, comment reconstruire un coût relatif et tirer des conclusions globales quant à la compétitivité des industriels, sachant que les entreprises allemandes s’approvisionnent individuellement sur le marché ou, de plus en plus, produisent leur propre électricité ? Auditionné l’année dernière dans le cadre du débat national français sur la transition énergétique, le ministre allemand de l’environnement Peter Altmaier a remarqué que les industriels électro-intensifs français et allemands se reprochaient mutuellement les avantages qui leur sont accordés. Une analyse claire et objective de la question est difficile !
M. le président François Brottes. La France débat avec l’Union européenne du tarif réglementé et des concessions hydrauliques, l’Allemagne des aides d’État aux énergies renouvelables ou du TURPE. Si chaque pays va au bout de ces contentieux et les perd, la donne s’en trouvera-t-elle significativement modifiée pour les consommateurs ?
M. Andreas Rüdinger. Les contextes sont différents. Une remise en cause des tarifs réglementés pourrait affecter les petites entreprises et les ménages français. Dans le cas de l’Allemagne, le plus probable est que la Commission considérera que les conditions d’éligibilité aux différents mécanismes d’exonération sont trop larges. La presse s’en est d’ailleurs fait l’écho : l’année dernière, on s’est aperçu que des terrains de golf ou des boucheries, nullement soumis à la concurrence internationale, bénéficiaient de ces avantages du fait de l’abaissement du seuil de 100 GWh à l’origine à 1 GWh aujourd’hui, ce qui a contribué à dégrader l’image du dispositif aux yeux de la population. La Commission demandera sans doute que l’on revoie, non pas le mécanisme lui-même, mais les conditions d’éligibilité, afin de les harmoniser avec celles qui prévalent dans l’ETS, où les États peuvent justifier dans certaines conditions d’une compensation du surcoût lié au prix des émissions de CO2 en faveur des industriels non producteurs d’électricité.
M. le président François Brottes. Ce mécanisme ne rencontre pas un grand succès.
M. Andreas Rüdinger. On n’en sait rien, dans la mesure où le prix des quotas ne l’a jamais déclenché. Le principe en est assez simple : on a défini les conditions d’éligibilité en fonction de l’exposition des entreprises à la concurrence internationale et de l’intensité de leur consommation énergétique par rapport à la valeur ajoutée, puis on a défini des benchmarks se référant aux émissions de CO2 des entreprises européennes les plus performantes secteur par secteur, de manière à favoriser les industries les moins polluantes. Ce dispositif qui retient les critères de l’exposition à la concurrence internationale, d’intensité énergétique et de performance énergétique, est aisément transposable aux exonérations liées au prix de l’électricité en Allemagne.
Vous pourrez recueillir directement l’avis des producteurs allemands d’électricité si vous les auditionnez par la suite. Je crois que la faiblesse du prix de marché fait que la situation est assez désastreuse pour les grands opérateurs, d’autant que certains d’entre eux
– notamment EON – ont massivement investi dans les centrales à gaz et ont perdu, avec la fermeture des centrales nucléaires, des actifs à forte rentabilité. Il faut ajouter qu’ils ont refusé pendant longtemps de prendre au sérieux les décisions du tournant énergétique. Jusqu’en 2006, ils ont soutenu des recours devant les instances européennes, arguant que le dispositif de tarif d’achat violait les règles du marché. Ils se sont donc battus contre le développement des énergies renouvelables sans y prendre part. Tout en restant ultra-dominants sur le marché de la production d’électricité, dont ils conservent 75 %, les quatre grands électriciens n’ont construit que 6 % des 60 GW – l’équivalent de la puissance du parc nucléaire français – de capacité électrique renouvelable installée en Allemagne entre 2000 et 2010. Pendant ce temps, les petits producteurs, notamment les projets citoyens, ont connu un fort essor. La moitié de la capacité renouvelable est détenue par des propriétaires privés, qu’il s’agisse du citoyen qui s’engage financièrement via une coopérative ou du boulanger qui décide d’installer des panneaux photovoltaïques sur son toit.
M. le président François Brottes. Finalement, il serait logique qu’il en aille de même pour les réseaux.
M. Andreas Rüdinger. Cela a en effet grandement contribué à faire accepter les coûts de la transition énergétique. Sans cette forme d’appropriation citoyenne, l’opposition à la charge du renouvelable aurait été beaucoup plus forte. Le citoyen n’est plus seulement payeur, il est également bénéficiaire d’un processus auquel il participe activement.
Pour en venir à l’« Airbus de l’énergie », l’idée n’est pas nouvelle. L’année dernière, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire du traité de l’Élysée, le ministre Peter Altmeier avait fait une annonce similaire dans un entretien accordé au Monde. Savoir si cela est réaliste est une autre question. Existe-t-il une volonté politique et économique de construire une entreprise comparable à Airbus, dont la gestation a tout de même duré plusieurs décennies ? Une telle démarche est-elle pertinente dans le secteur des énergies renouvelables ? Je rappelle qu’un projet associant les plus grands centres de recherche allemands, français et suisses sur le photovoltaïque – Fraunhofer, Institut national de l’énergie solaire et Centre suisse d’électronique et de microtechnique – est actuellement en cours pour étudier la possibilité de créer un grand pôle de recherche et d’industrie commun à ces trois pays. L’objectif est de réaliser des économies d’échelle dans un centre de production de panneaux photovoltaïques de taille suffisante pour rivaliser avec la concurrence chinoise, mais également d’accélérer le transfert entre la recherche et l’industrie.
Si la volonté de renforcer la coopération franco-allemande dans le secteur de l’énergie a été saluée par le gouvernement allemand, la référence au symbole que constitue Airbus a néanmoins suscité quelques critiques, puisque ce sont principalement des PME qui sont actives dans le secteur des énergies renouvelables en Allemagne et que l’on y considère l’intervention de la puissance publique de manière plus circonspecte. Le tissu économique allemand semble un peu réticent à l’idée d’un « Airbus » des énergies renouvelables.
M. le président François Brottes. Airbus n’en est pas moins une entreprise performante.
M. Andreas Rüdinger. Je pense que le projet est réalisable et que ce serait un symbole fort de la coopération franco-allemande, laquelle est déjà étroite. L’année dernière, l’Office franco-allemand des énergies renouvelables a augmenté significativement ses activités et élargi son champ d’action. L’Allemagne nourrissait même le projet de transformer le site de Fessenheim en laboratoire franco-allemand de la transition énergétique. Je rappelle que la centrale appartient à EDF, mais aussi à l’allemand EnBW et à des groupes suisses. En cas de fermeture, la transformation en pôle de recherche ou en pôle industriel permettrait de sauvegarder l’emploi et constituerait un symbole fort. Le ministre de l’environnement, du climat et de l’énergie du Land de Bade-Wurtemberg, M. Untersteller, a activement soutenu le projet auprès de responsables publics français.
Quant à l’étude de l’Öko-Institut que vous mentionnez, monsieur le rapporteur, je ne peux pas la commenter, car je ne l’ai pas lue et ne suis pas expert en sûreté nucléaire.
S’agissant enfin du projet d’agence franco-allemande de la sécurité d’approvisionnement, monsieur le président, il faudrait d’abord savoir s’il concerne uniquement l’électricité ou toutes les énergies. En soi, c’est une avancée souhaitable qui pourrait par la suite prendre une dimension plus européenne, en commençant par le Benelux.
Mme Frédérique Massat. L’Allemagne détient le record européen d’émissions de CO2, avec 728 millions de tonnes rejetées en 2012 contre 472 millions pour la Grande-Bretagne, 366 millions pour l’Italie et 332 millions pour la France. La politique de transition énergétique s’accompagne-t-elle d’une politique de réduction des émissions de CO2 ?
Qu’en est-il du développement des véhicules électriques en Allemagne ?
En matière de réseau, applique-t-on des règles d’automaticité de raccordement du producteur ou existe-t-il des délais ?
Mme Sabine Buis. Hier, la Commission européenne a annoncé un nouveau cadre pour le paquet énergie-climat. Comment analysez-vous les conséquences de ce nouveau dispositif qu’il faudra décliner au niveau national ? Contribuera-t-il à la réussite, que nous souhaitons tous, de la vingt et unième conférence sur le changement climatique que la France accueillera en 2015 ?
M. le président François Brottes. La technique du véhicule à hydrogène semble être arrivée à maturité en Allemagne. Quel est votre avis sur ses qualités et ses défauts, y compris au regard des émissions de CO2 ?
M. Andreas Rüdinger. L’Allemagne a toujours été et reste le premier émetteur de CO2 en Europe. Mais il faut également se référer au bilan tous GES (gaz à effet de serre) par habitant. Pour le seul CO2, les émissions atteignent 5,6 tonnes par habitant en France et 9 pour l’Allemagne ; si on intègre tous les GES, on passe à 11,2 tonnes en Allemagne et à près de 9 tonnes en France. L’écart se réduit considérablement. En France, le CO2 ne représente que les deux tiers des émissions de GES ; du fait de l’élevage, le méthane a une part importante.
M. le président François Brottes. Et vous être plus nombreux que nous…
M. Andreas Rüdinger. Plus pour longtemps ! (Sourires.)
Par ailleurs, l’Allemagne mène des politiques sur le climat, du reste beaucoup plus affirmées au niveau local qu’au niveau national, où la question de l’électricité et des énergies renouvelables occulte souvent, dans le débat politique, d’autres domaines tout aussi importants pour la transition énergétique comme le transport et le bâtiment. Les villes allemandes sont très impliquées dans la Convention des maires. Environ un tiers des bassins de vie font partie d’une association de collectivités qui vise une transition énergétique beaucoup plus forte et un taux de pénétration des renouvelables beaucoup plus élevé. Il existe également un projet pilote de « villes libres de CO2 » à bilan d’émission neutre.
On peut cependant regretter l’absence de nouvelles mesures au niveau national pour traiter de la question du charbon. La Grande-Bretagne a proposé pour sa part de mettre en place un standard national de performance en matière d’émissions, ce qui revient à imposer la régulation la plus dure possible au secteur de l’électricité : à un moment donné, on n’autorisera plus les centrales qui dépassent un certain seuil d’émissions par kilowattheure produit. On a d’ailleurs envisagé la même chose aux États-Unis pour les nouvelles centrales.
En Allemagne, certains partis d’opposition réclament une loi sur le climat et des budgets spécifiques. La question du climat fait clairement partie du tournant énergétique, mais elle pourrait être mieux valorisée dans le contexte politique actuel.
Cela dit, l’Allemagne s’est toujours fixé des objectifs ambitieux au plan européen. Son objectif de réduction de 40 % des émissions de CO2 à l’horizon 2020 – contre 20 % pour la France et pour l’Europe – est le plus fort de tous les pays.
M. le président François Brottes. Cela reste des objectifs.
M. Andreas Rüdinger. Certes, mais l’Allemagne avait tout de même atteint, à la fin de 2012, une réduction de 26 % par rapport à 1990. Pour l’instant, la trajectoire est tenable. Elle le sera moins si l’on ne trouve pas une solution à la question du marché électrique européen et de l’ETS.
Le véhicule électrique fait partie des choix politiques allemands, avec un objectif de 1 million de véhicules en circulation en 2020. Les chiffres actuels sont très faibles – quelques dizaines de milliers de véhicules vendus. Dans le contexte de crise, les industriels se soucient surtout du présent et veillent à ce que les objectifs européens d’émissions des véhicules traditionnels n’augmentent pas trop. Je pense qu’il y a une opportunité de coopération franco-allemande renforcée dans le domaine du véhicule propre, où nous avons beaucoup d’expertise à partager.
Pour en venir aux véhicules à hydrogène, je crois que l’euphorie suscitée par cette technique il y a quinze ans est retombée. Alors que tous les grands constructeurs menaient des projets dans ce domaine, ils se tournent maintenant vers les hybrides et les véhicules électriques. L’hydrogène présente des difficultés techniques et des risques du fait de sa compression dans les réservoirs et de la nécessité de développer des stations spécifiques. La piste n’est donc pas entièrement poursuivie, même s’il existe des projets : on prévoit par exemple que les véhicules qui circuleront dans le nouvel aéroport de Berlin seront à hydrogène ; c’est le français Air Liquide qui a la charge du projet.
S’agissant du raccordement au réseau des producteurs d’énergie renouvelable, je vous renvoie à l’Office franco-allemand des énergies renouvelables, qui a consacré plusieurs études au sujet et dispose de tous les chiffres. La procédure est légèrement différente en Allemagne et le partage des coûts est, pour l’instant, plus favorable à l’installateur qu’en France. Le délai au-delà duquel une absence de réponse de l’administration vaut autorisation est également plus court.
Comme vous l’avez indiqué, madame Buis, la Commission européenne a fait des premières annonces au sujet du paquet énergie-climat pour 2030. En première analyse, il me semble que la proposition représente la limite basse des ambitions disponibles en Europe. On peut l’attribuer à une stratégie politique de la Commission, qui voudrait, en ne plaçant pas la barre trop haut, arriver directement à un consensus.
Au-delà, une grande hésitation est perceptible dans la politique européenne, d’autant que la mise en œuvre du paquet 2020 se heurte à de grandes difficultés. Sur le plan économique, on ne sait pas comment réagir au problème des prix de l’énergie. Sur le plan politique, le débat s’est cristallisé sur une question trop restreinte à mon sens : faut-il fixer un seul objectif ou trois ? Le choix des mécanismes que l’on met en œuvre ou que l’on renforce a parfois plus d’utilité que la définition d’objectifs. La Commission n’aborde pas vraiment cet aspect.
Cela dit, il s’agit là de premières propositions qui seront négociées au Conseil européen. On peut s’attendre à des évolutions. En matière d’énergies renouvelables, une coalition d’États, dont la France, s’est engagée pour des objectifs contraignants. En l’état, les annonces d’hier ne sont pas assez ambitieuses si l’on veut démontrer une réelle volonté politique avant la Conférence sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en 2015. L’objectif interne de réduction de 40 % des émissions de GES à l’horizon 2030 n’est pas suffisant, en soi, pour restaurer le signal prix de l’ETS, loin de là ! La Commission n’apporte de réponse concrète ni à la question de l’assainissement du marché ni à celle, centrale, de l’efficacité énergétique.
Or l’efficacité énergétique reste le premier potentiel en Europe. En France et en Allemagne, pays pourtant très performants sur le plan industriel et économique, on constate des gisements d’économies de 50 % et plus dans le bâtiment. C’est dire l’étendue du potentiel dans les autres États !
M. le président François Brottes. Certains annoncent une baisse du prix du pétrole de 20 à 30 % dans les deux ou trois prochaines années. Cette hypothèse est-elle crédible ? Arrangera-t-elle les affaires de ceux qui veulent un mix différent ?
M. Andreas Rüdinger. J’avoue ne pas avoir d’avis complet sur la question. Les scénarios de l’Agence internationale de l’énergie ou de l’OCDE n’ont pas, jusqu’à présent, intégré cette éventualité.
Structurellement, je ne crois pas que les fondamentaux qui définissent le marché du pétrole aient beaucoup changé avec l’apparition des huiles de schiste.
M. Patrice Prat. À la lumière de votre analyse du cas allemand et de ce que vous nous avez dit sur la difficulté à déterminer le coût de la sortie du nucléaire, quels paramètres devrions-nous retenir pour évaluer un tel coût en France et quels obstacles devrions-nous surmonter pour réussir cette sortie ?
M. Andreas Rüdinger. En premier lieu, je vous renvoie aux travaux du Débat national sur la transition énergétique, notamment ceux des groupes de travail « Mix et scénarios énergétiques » et « Coûts et financement ». Un plan français de sortie du nucléaire serait un défi très important, car le secteur de l’énergie est incertain à un horizon de trente ou quarante ans. Les scénarios montrant la faisabilité technique d’une telle sortie existent néanmoins. Le Débat national a permis de commencer différents exercices d’évaluation économique de ces scénarios. Ces documents, qui sont disponibles, montrent que cela peut marcher, sachant que les incertitudes pèsent de toute façon, quel que soit le mix énergétique.
À mon sens, le premier enjeu d’un tel objectif est l’effort de maîtrise de la demande énergétique. Pour le reste, le potentiel naturel de la France en matière de vent, de biomasse, d’hydraulique et d’ensoleillement est supérieur à celui de l’Allemagne. Le pays détient toutes les clés de la réussite. De même, le réseau à très haute tension est mieux structuré en France qu’en Allemagne. Si l’on associe une politique de réduction progressive du nucléaire à une planification du développement des énergies renouvelables et à une valorisation des points d’accès au réseau qui se libèrent, le potentiel est considérable.
À ce propos, l’ADEME a lancé une étude visant à modéliser un système électrique alimenté à presque 100 % par les énergies renouvelables en 2050 en France. Il s’agit non seulement d’une évaluation technique, mais aussi d’une évaluation économique.
M. le président François Brottes. Au nom de l’ensemble de la commission d’enquête, je vous remercie pour la clarté de vos réponses.
Audition du Pr. Stephen Thomas, professeur en études énergétiques à l’Université de Greenwich, et de M. Humphrey Cadoux-Hudson, directeur exécutif « Nouvelles constructions nucléaires », EDF Energy
(Séance du jeudi 23 janvier 2014)
M. le président François Brottes. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Stephen Thomas, professeur en études énergétiques à l’université de Greenwich, et M. Humphrey Cadoux-Hudson, directeur exécutif « Nouvelles constructions nucléaires », EDF Energy au Royaume-Uni.
Cette commission d’enquête, constituée à l’initiative du groupe écologiste et en particulier du rapporteur Denis Baupin, tâche d’examiner la manière dont fonctionne le réseau européen, comment les pays voisins de la France s’adaptent politiquement, techniquement et financièrement aux conditions d’exploitation de l’énergie nucléaire. Nous venons d’entendre un expert allemand sur la sortie du nucléaire et, en attendant de recevoir nos amis belges, dont le pays dispose d’un parc important, nous allons écouter aujourd’hui des experts britanniques, le Royaume-Uni ayant, semble-t-il, décidé de redonner vie à cette filière.
Au terme d’un processus de plusieurs années, le Royaume-Uni a en effet engagé le renouveau de son programme nucléaire. Cette décision paraît s’inscrire dans une stratégie de réduction du contenu en carbone de la production d’énergie et de construction ou de reconstruction d’une filière industrielle nucléaire capable de servir un marché national renaissant et de se développer à l’international. Le gouvernement britannique a ainsi fixé, en collaboration avec l’industrie nucléaire, un objectif de 16 gigawatts (GW) de capacités nucléaires nouvelles d’ici à 2030, soit douze réacteurs sur cinq sites d’exploitation. Par ailleurs, les énergies renouvelables devraient représenter 35 GW de capacités supplémentaires. Tout cela se fait dans un contexte où des tarifs d’achat garantis visent à donner aux producteurs d’énergie non carbonée de la visibilité et une rentabilité minimale. Quand on évoque des tarifs d’achat garantis, on a immédiatement à l’esprit des initiatives de la Commission européenne.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Stephen Thomas et Humphrey Cadoux-Hudson prêtent serment)
M. Humphrey Cadoux-Hudson, directeur exécutif « Nouvelles constructions nucléaires », EDF Energy. Je m’occupe des nouveaux projets nucléaires pour EDF Energy – filiale d’EDF –, le plus grand producteur et fournisseur d’électricité, puisqu’il exploite, en toute sécurité, huit centrales nucléaires. Depuis l’acquisition de British Energy par EDF en 2009, nous avons considérablement investi dans la filière nucléaire, ce qui s’est traduit par une amélioration de la production, passée de 40 TWh en 2008 à 60,5 TWh ; or il faut remonter aux années 2002-2003 pour retrouver le même niveau de production.
EDF propose de construire deux réacteurs EPR, à Hinkley Point, dans le Somerset, puis deux autres réacteurs à Sizewell, dans le Suffolk. Ces projets ambitieux s’appuient sur l’expertise et le savoir-faire du groupe EDF. Plusieurs étapes restent à accomplir, notamment le parachèvement des accords avec nos partenaires industriels, le financement par émission d’actions, par participations croisées et, évidemment, l’obtention de la garantie du Gouvernement pour l’émission d’obligations. Il conviendra d’attendre ensuite les décisions de l’Union européenne en matière d’aides publiques.
Quelque 40 % des sites de production d’électricité au Royaume-Uni doivent être démantelés au cours des quinze prochaines années, le coût de construction des infrastructures de remplacement étant estimé par le gouvernement britannique à quelque 110 milliards de livres sterling. Une nouvelle politique énergétique a été définie au cours de ces dernières années, déclinée selon les différentes technologies dans des Déclarations de politique énergétique nationale qui ont été soumises au Parlement. Aux termes de cette politique énergétique, le nucléaire doit pouvoir répondre au maximum de besoins, qui sont d’environ 10 à 14 GW. La réforme du marché de l’électricité a par ailleurs été engagée pour résoudre ses dysfonctionnements et promouvoir les investissements nécessaires dans le domaine des technologies à faible émission de CO2.
C’est ce contexte d’ensemble qui a permis que nous concluions avec le gouvernement un accord-cadre sur les clauses principales du contrat d’investissement dans Hinkley Point C.
La nouvelle centrale de Hinkley Point C fournira de l’électricité décarbonée à 5 millions de foyers, soit 7 % des besoins en énergie du Royaume-Uni. De grandes étapes ont d’ores et déjà été franchies : le gouvernement a délivré l’autorisation de construction ; pour la première fois depuis vingt-cinq ans, l’organisme de tutelle a accordé les licences nécessaires à l’exploitation d’une nouvelle centrale ; nous avons conclu avec les collectivités locales des accords visant à optimiser l’implantation de l’EPR et à réduire les désagréments ; nous avons également conclu des accords avec les principaux syndicats, afin que le site soit productif et que les personnels soient bien formés. Enfin, nous avons signé des accords de principe avec le gouvernement britannique sur les tarifs garantis pour l’électricité produite pendant la première phase d’exploitation.
Des co-investisseurs pourront par ailleurs se joindre à EDF, notamment deux sociétés chinoises qui apporteront non seulement des fonds, mais également leur expérience issue de la construction de deux réacteurs EPR à Taishan. Nous nous félicitons qu’AREVA ait décidé de s’associer au consortium, non seulement en tant que fournisseur, mais en tant qu’investisseur. Alstom, Bouygues et Laing O’Rourke seront également associés au chantier. Un groupe sera créé qui permettra la participation de PME sous-traitantes aussi bien britanniques que françaises – l’idée étant de renforcer le partenariat entre les entreprises impliquées.
Un accord a été conclu avec le gouvernement britannique pour émarger au dispositif de garanties publiques pour les grands projets d’infrastructures, ce qui facilitera la bonne réalisation de la partie du financement qui sera réalisée par endettement.
Un accord souscrit avec le gouvernement britannique garantit un tarif – le strike price – pour l’électricité produite par la centrale de Hinkley Point C pour les trente-cinq premières années de l’exploitation – sur soixante ans prévus – à 92,5 livres par MWh. Si la construction de Sizewell C est confirmée, des économies d’échelle permettront de le ramener à 89,5 livres. Ce tarif garanti inclut le coût de production, celui de l’élimination des déchets et du démantèlement des centrales. Rappelons, comme point de comparaison, que le gouvernement a fixé le prix de rachat garanti à 140 livres par MWh pour l’électricité produite par les éoliennes offshore pour les projets postérieurs à 2018 et à 90 livres par MWh pour l’éolien terrestre, pour les projets postérieurs à 2017 ; ces deux modes de production devront par ailleurs supporter des coûts d’intégration au réseau et au système électrique d’environ 10%. L’électricité d’origine nucléaire sera donc compétitive avec les autres formes d’électricité sobres en carbone et pourra s’aligner sur les prix de l’électricité produite par le gaz. Les coûts de production sont à peu près similaires dès lors que l’on tient compte des émissions en carbone. Le taux de rentabilité devrait être de 10 %, avec quelque 16 milliards de livres investis dans la construction de la centrale.
Cet accord est le résultat de longues négociations. Le gouvernement britannique a minutieusement étudié les coûts et la rentabilité du projet, en y associant des experts tiers, et a jugé qu’ils étaient raisonnables. Le contrat d’investissement offrira un juste prix à nos clients en les prémunissant contre la volatilité des coûts de l’énergie dans les années à venir ; il sera donc équitable aussi bien pour les clients que pour les investisseurs, condition indispensable à une relation stable à long terme. Il s’appuie sur un mécanisme de marché qui évite la surcompensation. Le Gouvernement ne versera la différence que si le prix du marché est inférieur au prix d’exercice, et toutes les économies réalisées dans la construction seront partagées avec les clients par le biais d’une révision du tarif garanti. EDF et ses partenaires assumeront le risque de la construction, notamment pour les coûts et les délais. Et si le refinancement du projet permet de réaliser des économies, le consommateur pourra également en bénéficier sous forme de baisse du tarif garanti.
L’accord a été soigneusement construit de façon à ne procurer que le soutien indispensable à la viabilité du projet : c’est un accord juste et équilibré.
Nous avons tiré et nous tirerons encore les enseignements des expériences antérieures – Flamanville, Olkiluoto et Taishan – et avons une connaissance approfondie des différentes étapes de la construction d’une telle centrale. Il est fondamental pour l’équilibre économique du projet que le calendrier soit réaliste et solide. Nous bénéficions d’une conception d’ensemble stabilisée, qui a été intégralement examinée par l’autorité de sûreté ; nous avons aussi défini les disciplines fondamentales associées au projet, la clef étant que nous ne commencerons rien tant que nous n’aurons pas la certitude qu’il n’y aura pas lieu de faire machine arrière. Nous disposons, avec nos partenaires industriels, de toute l’expertise nécessaire pour nous assurer que nous pouvons construire la centrale dans les temps et en respectant le budget. Reste qu’il est difficile de comparer les coûts des différents projets : ils sont le produit d’une situation propre à chaque site et de réglementations nationales différentes. Ainsi, la fiscalité locale, qui constitue une part importante des coûts d’exploitation, varie considérablement d’un pays à l’autre. Les coûts propres aux sites varient également : la centrale de Flamanville a été construite sur un site préétabli alors que celle de Hinkley Point le sera sur un site vierge ; la géologie du site est différente ce qui conduit à définir un cadre de protection sismique différent et à augmenter la quantité de béton à couler.
De nombreuses années ont été nécessaires pour arriver à ce point, à commencer par la fixation d’objectifs ambitieux et contraignants visant à réduire de 80% les émissions de CO2 d’ici à 2050. Le gouvernement a examiné les coûts et l’impact sur la sécurité d’approvisionnement des différentes techniques de production à faible teneur en carbone. Il a vu le besoin d’une nouvelle réforme du marché de l’électricité en vue de susciter les investissements nécessaires à la mise en place des infrastructures de production d’énergie faiblement carbonée. Ces décisions ont été prises à l’issue d’un processus démocratique rationnel et exhaustif qui a duré plusieurs années, auquel nous avons pris part.
La loi de 2013 prévoit ainsi une réforme du marché de l’électricité devant favoriser les investissements dans les infrastructures de production d’électricité sobre en carbone, principalement à travers les « contracts for difference ». Outre les contrats pour Hinkley Point C, onze projets de production d’énergie renouvelable sont actuellement engagés dans le même processus. Il s’agit de produire de l’électricité décarbonée au moindre coût. La réforme entend donc conjuguer les meilleurs aspects du marché et de la réglementation, non pour réduire la taille du marché, mais pour améliorer son efficacité.
Le Gouvernement a obtenu l’appui des trois grandes formations politiques pour la réforme du marché de l’électricité et pour le redémarrage du nucléaire : la Déclaration de politique nationale pour la production d’énergie nucléaire a été adoptée par 267 voix contre 14 en juillet 2011 – un moment significatif – et l’amendement du parti écologiste, qui proposait de revenir sur la partie nucléaire de la loi sur l’énergie, a été rejeté par 502 voix contre 20 en juin 2013. Et l’on constate un soutien croissant de l’énergie nucléaire au sein de la population – 67 % des citoyens britanniques sont en effet favorables à ce que l’énergie nucléaire fasse partie de notre futur mix énergétique. Le Premier ministre, David Cameron, s’est rendu à Hinkley Point en octobre dernier, à l’occasion de l’annonce de notre accord avec le gouvernement, et a déclaré au personnel de la centrale existante – Hinkley Point B – que c’était sa participation à l’exploitation sûre de la centrale, jour et nuit, qui avait permis d’envisager la construction d’une nouvelle tranche.
Notre projet est donc en bonne voie. Il offre un parfait exemple de collaboration harmonieuse entre des équipes françaises et britanniques. Les prévisions de budget et de calendrier sont établies sur une base solide et ont fait l’objet d’examens soignés aussi bien de la part de nos équipes que du Gouvernement et des investisseurs. La mise en service de Hinkley Point C sera très bénéfique pour le marché et pour la population britannique.
M. Stephen Thomas, professeur en études énergétiques à l’université de Greenwich. Une récente enquête a montré que les Britanniques accordaient aux fournisseurs d’électricité moins de confiance encore qu’à ces banques qu’il a fallu sauver à coups de milliards ! Pour ma part, je ne le cache pas, je vois d’un œil très critique l’accord dont il est ici question. Ce n’est pas que je m’oppose par principe à l’énergie nucléaire, mais ses aspects économiques m’apparaissent défaillants. Il s’agit d’un accord à haut risque, non seulement pour les consommateurs et les contribuables britanniques, mais également pour EDF.
Les médias se sont fait l’écho du prix très élevé de l’électricité que nous devrons payer : près de deux fois le prix de gros actuel. Cet accord a été conclu pour 9,6 milliards d’euros par réacteur. Un mois auparavant, le prix n’était que de 8,4 milliards d’euros et, il y a cinq ou six ans, quand le ministère a publié le Livre blanc sur le nucléaire, il était admis qu’on pouvait construire un EPR pour 2,4 milliards d’euros. En six ans, le prix du réacteur a donc été multiplié par quatre, avant même que ne débute sa construction ! Le prix des réacteurs de Hinkley Point est supérieur au coût estimé de ceux des centrales de Flamanville ou d’Olkiluoto en Finlande. Nous allons devoir payer pour les deux réacteurs de Hinkley Point plus que ce qu’on coûté deux réacteurs sur lesquels pratiquement tout ce qui pouvait aller de travers est effectivement arrivé. C’est donc une facture particulièrement élevée.
Le risque qui pèse sur les contribuables vient des garanties : deux tiers du coût estimé de la construction de la centrale devant être couverts par un emprunt, 12 milliards d’euros ont été engagés par le Trésor britannique. Si les choses se passent mal, si le consortium fait faillite, c’est le contribuable britannique qui devra payer cette note de 12 milliards d’euros.
En outre, le contrat nous lie jusqu’en 2058 – si toutefois il est réalisé dans les délais et entre en service vers 2023. N’est-il pas extraordinaire de s’engager pour quarante-quatre ans sans prévoir une possibilité de révision des prix ? Si l’on se reporte quarante-quatre ans en arrière, dans les années soixante-dix, on voit que la perception du marché de l’énergie était bien différente : le pétrole et le gaz étaient bon marché et paraissaient inépuisables, personne n’imaginait que le changement climatique s’imposerait comme un problème majeur et, si quelqu’un avait annoncé qu’on aurait bientôt recours à l’énergie éolienne pour produire de l’électricité, on l’aurait pris pour un prophète de malheur prédisant le retour au Moyen Âge !
Pour prendre conscience du risque que court EDF, il convient de revenir sur l’EPR. Les choses se passent très mal à Olkiluoto et à Flamanville. Elles semblent aller mieux en Chine, mais il est difficile de savoir exactement ce qu’il en est, en raison d’une certaine opacité de la société chinoise. Il ne s’agit pas d’un échec isolé : certaines centrales en France – Civaux et Chooz B – ont posé d’énormes problèmes et, du début de la construction jusqu’à la mise en service industriel, il a fallu de onze à quinze ans. Peut-être saura-t-on tirer les leçons de ces expériences et peut-être que tout se passera bien pour la centrale de Hinkley Point C, mais, pour le moment, il ne peut s’agir que d’un pari hasardeux.
Alors que la centrale doit être construite par le consortium NNB Generation Company, les Britanniques ont le sentiment qu’EDF en est seule responsable ; si le projet tournait mal, si ce qui s’est passé à Olkiluoto et à Flamanville se répétait – ce qui est très vraisemblable –, il se pourrait que NNB GenCo fasse faillite, que le consortium s’effondre et qu’EDF se retrouve seule à en assumer les conséquences. Cet accord comporte donc de nombreux risques pour les deux parties.
Il n’est du reste pas complètement conclu, puisqu’il doit être encore validé par la Commission européenne qui déterminera si les aides publiques ne sont pas exagérées. Onze États membres de l’Union européenne ayant indiqué qu’il s’agirait peut-être d’un modèle pour eux, la Commission se doit d’éplucher le dossier, ce qui prendra du temps : un an, peut-être deux. Si elle rejetait l’accord ou imposait de nouvelles conditions – par exemple une réduction à 20 ou 25 ans de la durée du mécanisme de prix garanti –, le projet pourrait ne plus être financé comme prévu ou les coûts pourraient exploser. Rien n’est donc acquis quant à une éventuelle poursuite du projet.
Enfin, ce qui est le plus critiquable est le coût d’opportunité de cet accord. Il est si onéreux qu’il sera probablement le seul contrat de ce type pour le nucléaire au Royaume-Uni ; il interdira toute autre politique de l’énergie pendant plusieurs années. Nous n’avons pas les moyens de tout développer en même temps et nous risquons de négliger d’autres énergies à faibles émissions de carbone.
M. le président François Brottes. On ne pourra pas prétendre que cette commission d’enquête n’entend pas des points de vue contrastés…
M. Denis Baupin, rapporteur. Même si vous avez concentré l’essentiel de votre propos sur la centrale de Hinkley Point, le but de cette commission est de mieux connaître la situation énergétique au Royaume-Uni en général.
Pour quelles raisons le Royaume-Uni a-t-il décidé de fermer quatorze réacteurs nucléaires dans les années qui viennent, après en moyenne trente-cinq années d’activité ?
M. Thomas a rappelé la très forte augmentation du coût de construction du réacteur par rapport aux projets initiaux. On constate le même phénomène en France à Flamanville et en Finlande à Olkiluoto. On nous a expliqué que la centrale de Flamanville était un prototype et que, du fait d’un effet de série, le coût des EPR suivants diminuerait. Mais le retour d’expérience se solde en fait par un renchérissement… De même, pour ce qui est du calendrier, les chantiers français et finlandais ont pris un grand retard. Comment l’expliquez-vous ?
Quelle évaluation faites-vous de l’évolution du coût de ce premier contrat sur l’ensemble du programme nucléaire qu’entend développer le gouvernement britannique ? La décision de construire un certain nombre de réacteurs risque-t-elle d’être remise en cause ?
En cas d’échec du projet, M. Thomas envisage des conséquences pour EDF, société largement détenue par l’État français. Quelles seraient-elles pour le contribuable français ?
J’en viens aux tarifs garantis. Il y a quelques mois, devant la commission d’enquête sénatoriale sur le coût de l’électricité, les représentants d’AREVA évaluaient le coût du MWh autour de 50 euros et non de 110 euros comme ici. Ce qui confirmerait que le coût du nucléaire nouveau aurait très fortement grimpé.
Les tarifs d’achat ne sont pas prévus par la réglementation européenne en ce qui concerne l’énergie nucléaire. Comment comptez-vous réagir à la décision que prendra la Commission européenne ? Existe-t-il des marges de manœuvre ? Le projet pourrait-il être abandonné par EDF ? Quel impact le projet aura-t-il sur le prix de l’électricité pour les ménages britanniques – on parle d’un doublement ? Pensez-vous que le tarif garanti prévu reflétera le prix du MWh produit par la centrale de Flamanville ?
Je terminerai par deux questions plus générales. D’abord, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont le Royaume-Uni va traiter la question des déchets nucléaires ? Enfin, concernant le mix énergétique, il nous a été indiqué tout à l’heure que le transfert d’une partie de la production d’électricité fossile depuis le gaz vers le charbon équivaudrait au Royaume-Uni à 32 TWh, soit une augmentation de 31 % de la part de charbon dans la production d’électricité en 2013. Confirmez-vous ces chiffres ?
M. le président François Brottes. Monsieur le professeur Thomas, selon vous, le programme nucléaire du gouvernement britannique serait cher et loin de pouvoir aboutir. Quelles sont donc vos préconisations et combien coûterait leur réalisation ?
M. Humphrey Cadoux-Hudson. Nous avons en effet estimé l’âge moyen des centrales à trente-cinq ans. Mais nous avons beaucoup travaillé à l’extension de leur durée de vie. Cette décision ne relève pas d’une politique du Royaume-Uni mais du projet industriel de l’exploitant, qui tient compte des coûts de démantèlement et de l’appréciation qu’il fait de l’équilibre économique de la centrale. Nous sommes actuellement autour de trente-huit ans et nous pourrons même peut-être étendre cette moyenne à quarante-deux ans. En ce qui concerne le parc actuel, nous voulons nous assurer que les centrales pourront prolonger leur activité au-delà. À l’origine, il était prévu que les réacteurs AGR (advanced gas-cooled reactors) auraient une durée de vie de vingt-cinq ans, et les perspectives d’extension de la durée de vie sont similaires, en proportion, à celles avancées pour les réacteurs à eau pressurisée.
J’en viens à la variation des estimations de coût. Si je compare ce que l’on peut appeler la conjecture initiale du ministère de l’énergie à l’estimation robuste issue de tous nos travaux, je pense qu’il n’est pas juste d’y voir une augmentation. Nos propres estimations du coût de construction de la centrale de Hinkley Point – fondées sur les données de conception et les informations résultant des appels d’offres auprès des fournisseurs – sont restées très cohérentes au fil du temps et n’ont guère varié au cours des négociations avec les pouvoirs publics. On ne saurait donc parler d’augmentation sensible, même s’il y a eu des spéculations en ce sens à un certain moment. Nous parlons maintenant d’une base de coûts qui a fait l’objet d’un travail détaillé et long et qui a passé avec succès l’examen approfondi du gouvernement, d’experts extérieurs et d’investisseurs.
Le calendrier de construction a également été étudié dans les moindres détails, de l’ingénierie jusqu’à la mise en service, en fonction notamment du calendrier de construction des autres EPR. Ce souci du détail, j’y insiste, est de nature à renforcer la confiance.
La décision est très lourde pour EDF comme pour le Royaume-Uni. Le choix des pouvoirs publics pour les énergies à faible émission de carbone coûte entre 140 livres par MWh pour l’éolien en mer, et 90 livres pour l’éolien terrestre, montants auxquels il faut ajouter le coût systémique de l’intégration au réseau, pour environ 10 livres, ce qui est beaucoup plus cher que le projet de Hinkley Point. Par ailleurs, il est désormais difficile de trouver des sites pouvant se prêter à l’éolien terrestre. Les pouvoirs publics doivent donc parvenir au meilleur équilibre possible et traiter la question du manque de capacité pas à pas. Pour l’heure, le programme britannique prévu par ce contrat est de loin le moins cher.
Cela signifie que, pour EDF, le contrat doit être solide et lui être bénéfique. C’était le principal enjeu du « contract for difference » que d’assurer que les critères d’investissement fixés par le groupe seront bien remplis ; cela prend en compte aussi la perception du risque. L’objectif que nous poursuivons est un dispositif dans lequel nous serons partie prenante au capital ; le mécanisme de garantie publique donnera une assurance de « confort » au capital qui sera apporté et contribuera à la solidité de la structure de capitaux.
Quant au tarif, s’il est de 92,5 livres par MWh pour la première tranche, il devrait baisser pour les suivantes. Le gouvernement britannique et d’autres investisseurs sont très engagés : Hitachi a récemment repris le site de Wylfa au Pays de Galles et investit avec détermination dans la conception du réacteur ABWR. De même, Toshiba a annoncé que Westinghouse nouait des partenariats pour développer le site de NuGen. Ce sont donc deux autres projets qui sont dans les tuyaux au Royaume-Uni.
Les besoins sont tels que nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. Il faut prendre des décisions, sinon les foyers ne seront plus éclairés ! Nous devons fournir l’électricité à nos clients en émettant le moins possible de dioxyde de carbone grâce à un système sûr et fiable et cela suppose de construire des équipements.
L’examen du projet par la Commission européenne est un passage obligé. Il a déjà commencé et la première phase a été assez courte. Nous pensons que les étapes suivantes avanceront de façon satisfaisante et nous restons relativement optimistes quant au résultat de la procédure. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de Hinkley Point C, mais, au-delà, de la fourniture en temps et heure d’électricité à faible émission de CO2 et nous sommes tenus d’atteindre l’objectif légalement contraignant de 80 % d’ici à 2050. Nous entendons donc suivre à la lettre les orientations de l’Union européenne.
Comme je l’ai dit, l’accord que nous avons conclu avec le gouvernement nous amène simplement au point où l’investissement devient envisageable et cela doit être pris dûment en considération par l’Union européenne. Nous sommes convaincus que le « contract for difference », dans sa forme actuelle, est essentiel pour la réalisation de notre investissement.
Nous tâchons de tirer tous les enseignements des projets existants. Il convient de tenir compte du contexte de chaque site si l’on souhaite se lancer dans des comparaisons, les situations n’étant pas les mêmes en France, en Finlande et au Royaume-Uni.
En ce qui concerne le mix énergétique, il y a au Royaume uni un marché à court terme qui détermine le mode de production d’énergie à partir de son coût marginal. Le prix du charbon étant inférieur à celui du gaz au Royaume-Uni, la part du charbon a augmenté récemment, ce qui ne fait qu’exacerber le problème puisque les centrales à charbon ont une durée de vie limitée. Il faut garder à l’esprit la nécessité de remplacer le charbon tout en maintenant la fourniture d’électricité. National Grid, qui est responsable de la distribution, a indiqué que, si l’hiver devait être rigoureux, la marge de capacité serait inférieure à ce qui est généralement attendu.
M. Stephen Thomas. Les déclarations sur la durée de vie de nos réacteurs nucléaires sont quelque peu trompeuses : on prétend que sept centrales sur huit seront arrêtées d’ici à 2023. Ce n’est pas vrai. Ce qui est le plus vraisemblable est que les deux plus vieux réacteurs AGR seront arrêtés en 2023, après quarante-sept ans de service. Il est difficile d’établir des comparaisons avec les centrales à eau pressurisée, car les technologies française et britannique sont très différentes et les paramètres qui déterminent la durée de vie des centrales ne sont pas les mêmes : les différences s’expliquent, me semble-t-il – je ne suis pas expert en la matière –, par la présence ou l’absence de modérateur graphite.
M. Cadoux-Hudson estime la durée de vie moyenne d’une centrale à quarante-deux ans. Deux seraient par conséquent arrêtées en 2023, trois en 2027 et deux autres en 2031. Le réacteur le plus récent, à eau pressurisée, serait, lui, arrêté en 2037, ou 2057 s’il tient soixante ans. Le déclin de la capacité nucléaire est donc beaucoup plus progressif que ce l’on veut bien nous faire croire. L’urgence n’est pas telle qu’on nous la présente.
Selon une idée reçue, la courbe du coût des technologies en général et de l’industrie nucléaire en particulier serait orientée à la baisse sur le long terme – phénomène qui ne s’est jamais vérifié pour l’industrie nucléaire au cours des soixante dernières années. Ainsi la dernière centrale construite en France a-t-elle coûté beaucoup plus cher que la première, malgré les économies d’échelle et les progrès technologiques. Cela ne signifie pas que le prix ne finira pas par baisser un jour, mais certains facteurs n’incitent pas à le croire, surtout si l’on se réfère à la catastrophe de Fukushima qui a rebattu toutes les cartes. Tous les enseignements de la catastrophe de Tchernobyl n’ont pas été tirés dans la conception des réacteurs qui sont sur le point d’être lancés et il faudra donc un certain temps pour intégrer les leçons de Fukushima. Il paraît donc improbable que les coûts diminuent.
L’échec total du programme de Hinkley Point C n’entraînerait pas la faillite d’EDF, qui est un groupe solide, mais il aurait une incidence très négative sur son image. Il y a cinq ans, EDF projetait de devenir le fournisseur d’énergie nucléaire du monde entier avec cinq marchés cibles : l’Italie et les États-Unis – deux pays où ce marché a disparu –, l’Afrique du Sud et l’Inde – qui restent une perspective très distante –, et le Royaume-Uni. Si ces derniers marchés cibles devaient disparaître, la réputation d’EDF serait gravement compromise. De même, si la centrale de Hinkley Point C n’est pas construite dans les délais et les limites budgétaires prévus, la notation du groupe en serait affectée et il lui serait plus difficile de lever des fonds.
On ne peut parler du coût de l’énergie nucléaire sans tenir compte des deux paramètres essentiels que sont le coût de construction et le coût du capital. Si le coût d’endettement est faible pour le projet de Hinkley Point C, c’est parce que les garanties couvrent l’intégralité de l’emprunt : en raison de la garantie publique, les prêts accordés par les banques au projet seront équivalents à des prêts au gouvernement britannique, dont la signature est excellente, ce qui permet de réduire le taux d’intérêt. Mais, sans ces garanties, le coût de l’énergie de Hinkley Point C serait bien plus élevé et atteindrait sans doute les niveaux de l’éolien en mer.
Quant aux projets d’élimination des déchets hautement irradiés nous ne prévoyons pas de prendre de décisions ou de chercher des sites avant une cinquantaine d’années. Ce que nous avons à gérer, à plus brève échéance, est un vaste stock de plutonium ; sur ce sujet, le débat est loin d’être clos quant à ce qu’il convient de faire des 116 tonnes de plutonium qui ont été séparées. Trois possibilités s’offrent à nous. En mélangeant ce plutonium avec de l’uranium pour obtenir du MOX, on peut l’utiliser comme combustible dans les réacteurs à eau pressurisée, mais je ne crois pas qu’EDF ait donné son accord ; il faut rappeler que le Royaume-Uni a construit une usine de production de MOX qui n’a guère fonctionné, ne produisant, en dix ans, que 4 tonnes de ce combustible au lieu des cent tonnes qui étaient escomptées chaque année. On peut ensuite construire un ou deux petits réacteurs destinés à brûler le plutonium. Une option consisterait à mettre au point et construire un réacteur à neutrons rapides d’un type totalement nouveau ; l’autre option consisterait à adapter les technologies à eau lourde canadiennes.
Il paraît assez injuste de dire que l’Allemagne utilise beaucoup plus de charbon parce qu’elle a décidé d’avoir recours aux énergies renouvelables, sans souligner que le Royaume-Uni en utilise également davantage parce qu’il a choisi la voie du nucléaire. N’ayons pas la vue courte : on ne passe pas d’une situation à l’autre du jour au lendemain. Peut-être sera-t-il nécessaire ou économique d’utiliser davantage de charbon dans un premier temps, mais il convient de se projeter dans une dizaine d’années pour évaluer le succès de la transition.
La question de savoir quelles sont les solutions de rechange à l’énergie nucléaire suppose a priori que le nucléaire est une solution ; or je n’en suis pas du tout convaincu, compte tenu des coûts et des risques. Du reste, il n’est pas exclu que toute l’industrie nucléaire soit remise en question si le projet dont nous parlons échouait. Nous devons avant tout rechercher l’efficacité énergétique, et une entreprise britannique, Npower, filiale de RWE en Allemagne, a déclaré hier que, si les factures d’électricité sont aussi élevées au Royaume-Uni, c’est à cause d’un gaspillage considérable. La qualité du bâti, de l’isolation thermique, des chaudières est mauvaise. Nous pourrions préserver notre confort tout en consommant moins d’électricité grâce à des appareils électroménagers moins gourmands.
M. Cadoux-Hudson a souligné le coût élevé de l’énergie produite par les éoliennes offshore ; c’est qu’on ne leur offre pas les mêmes conditions qu’au nucléaire, avec des contrats à trente cinq ans et des garanties d’emprunt… Je me demande si, toutes choses égales par ailleurs, la différence de coût serait aussi importante entre les deux sources d’énergie. J’ajoute que, contrairement au nucléaire, la courbe du coût de l’éolien connaît une véritable inflexion.
M. le président François Brottes. Monsieur Thomas, dans votre analyse, vous n’établissez aucune distinction entre les technologies respectives de Tchernobyl, de Fukushima ou de l’EPR ?
M. Stephen Thomas. Le réacteur de la centrale de Tchernobyl n’avait rien de commun avec ceux construits en Occident. Pourtant, l’influence de la catastrophe a été considérable sur la façon dont les autorités de tutelle ont repensé la sûreté des réacteurs. Ainsi a-t-on conçu des systèmes pour éviter qu’une défaillance du circuit de refroidissement n’entraîne la fusion du cœur de la centrale et la sortie du corium hors de l’enceinte de confinement. Quant au réacteur de la centrale de Fukushima, s’il est très différent d’un réacteur à eau pressurisée, il en est beaucoup plus proche que du réacteur de Tchernobyl.
M. le rapporteur. Je reviens sur le tarif garanti sur trente-cinq ans pour l’EPR britannique. Peut-on le considérer comme un bon indicateur du coût de l’électricité que produira la centrale de Flamanville ?
M. Humphrey Cadoux-Hudson. Ne connaissant pas suffisamment le dossier de Flamanville, je ne suis pas en mesure de répondre.
Je ne pense pas, par ailleurs, que les développeurs d’éoliennes off shore pensent qu’elles tiendront trente-cinq ans. Aucune n’a été conçue avec un tel objectif. Par ailleurs, la durée d’application du tarif garanti pour Hinkley Point – 35 ans – ramenée à la durée totale de fonctionnement – 60 ans – est, en proportion, équivalente à celle dont bénéficient les éoliennes pour lesquelles les tarifs sont garantis pendant 15 ans. D’ailleurs, le Département de l’énergie a cherché à mettre au point des solutions équilibrées entre les différentes sources d’énergie.
M. Stephen Thomas. Je serais, pour ma part, très malheureux de penser que le coût de production à Flamanville serait très inférieur à celui de Hinkley Point. Après tout, les coûts de construction sont analogues – peut-être légèrement inférieurs dans le cas de Flamanville –, et le coût du capital est similaire. Si le coût de production de la centrale de Hinkley Point était en revanche très inférieur à celui de Flamanville, cela signifierait qu’on ferait payer au consommateur britannique un surcoût injustifié.
M. le président François Brottes. Pensez-vous que la catastrophe de Fukushima a eu un impact sur le chantier de la centrale de Flamanville ? Les exigences nouvelles posées par les autorités de sûreté ont-elles pu avoir un rôle dans l’apparition de retards ou de surcoûts ? Peut-on vraiment comparer les choses compte tenu de la séquence des événements que nous observons depuis 4 ans ?
M. Stephen Thomas. Nous ne savons pas encore exactement ce qui s’est passé à Fukushima et il nous faudra un certain temps pour disposer d’un scénario complet. C’est cinq ans seulement après l’accident survenu à Three Mile Island que l’on a constaté qu’il y avait eu une fusion du cœur du réacteur ; or les dégâts à Fukushima ont été bien plus importants. Il nous faudra donc un certain temps avant d’en tirer tous les enseignements et de pouvoir les intégrer dans la réglementation. Les autorités de sûreté seront donc contraintes de donner le feu vert au projet de Hinkley Point et les éléments nouveaux devront être intégrés au fur et à mesure.
M. Humphrey Cadoux-Hudson. Le Royaume-Uni a demandé au directeur de l’autorité de sûreté d’enquêter sur les circonstances de l’accident de Fukushima. Son rapport prévoit certaines mesures pour le parc existant, mais aussi pour Hinkley Point C. Parallèlement, nous avons nous-mêmes étudié de près l’architecture de la centrale en la comparant à ce que nous savions de celle de Fukushima ; nous avons revu la conception du réacteur EPR au Royaume-Uni et procédé à des adaptations limitées. Sans doute d’autres informations nous parviendront-elles, mais l’enquête nous donne à penser que nous maîtrisons assez bien les incidences des circonstances de l’accident de Fukushima. Nous savons que le cas de Fukushima n’est pas comparable à celui d’autres centrales britanniques.
M. le rapporteur. Pouvez-vous détailler ces modifications ?
M. Humphrey Cadoux-Hudson. Les principales leçons de Fukushima concernent la prise en compte des situations hors dimensionnement. Quand on construit une centrale, on prévoit par exemple les risques d’inondation. Certains événements peuvent se produire après la mise en exploitation. Il est notamment prévu, dans ce cas, de faire parvenir sur le site du matériel d’urgence pouvant se raccorder à la centrale, comme les blocs électrogènes. Il faudrait de très nombreuses années avant qu’un risque théorique se produise. Reste que, aussi bien pour le parc installé que pour celui en construction, ce type de scénario – tout improbable qu’il soit – est prévu. Le moindre événement se produisant quelque part dans le monde est analysé et, si l’on peut améliorer la sûreté, on le fait.
M. le président François Brottes. Il ne s’agit pas de modifications concernant le process industriel, mais de mesures de riposte en cas d’incident, qui correspondent d’ailleurs aux préconisations de l’Autorité de sûreté nucléaire en France pour l’ensemble du parc.
M. le rapporteur. Je n’ai pas tout à fait la même analyse : on compte mille recommandations issues des évaluations complémentaires de sûreté par l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment sur la mise à distance des centres de commandes afin qu’ils ne puissent pas être affectés en cas d’accident, mais aussi sur la bunkérisation. Je note du reste que Hinkley Point est au bord de la mer : qu’en est-il de la prise en compte du risque d’inondation ou d’autres risques, même si, bien sûr, on doit écarter l’hypothèse d’un tsunami ? Si je vous ai bien entendu, monsieur Cadoux-Hudson, les seules modifications apportées visent à faire venir des secours supplémentaires ? Vous n’avez prévu aucun changement quant à la configuration du site ? Ces modifications n’ont donc aucun impact sur le coût du chantier.
M. Humphrey Cadoux-Hudson. Il y a une incidence, mais elle reste modeste. Quand on compare les mesures prises en France et au Royaume-Uni, on ne peut pas affirmer la supériorité d’un système sur l’autre : tous deux travaillent à un niveau de précision extrême. Encore une fois, les normes de sûreté en France et au Royaume-Uni sont tout à fait comparables. Le réacteur EPR comporte de nouvelles normes de sûreté qui vont bien au-delà de ce qui avait été prévu initialement, et qui répondent à une nouvelle philosophie en la matière. Il n’est pas nécessaire de revoir de fond en comble la conception de la centrale que nous souhaitons construire. Nous avons tiré tous les enseignements possibles de Fukushima et des autres accidents.
M. le président François Brottes. Nous avons bien compris que, si l’un de vous faisait la promotion de l’évolution du parc nucléaire britannique, l’autre n’avait que peu de sympathie pour la filière nucléaire. Comment la société britannique appréhende-t-elle ces questions ?
M. Stephen Thomas. Il s’agit sans doute de la question la plus difficile. J’ai du mal à m’expliquer le consensus de la société autour de l’industrie nucléaire au Royaume-Uni. Le public ne manifeste pas une grande inquiétude. Il y a certes eu un grand débat après l’annonce du projet de l’EPR, mais il a surtout porté sur les considérations économiques, sur le prix et non pas sur la sûreté ou l’élimination des déchets. Depuis une cinquantaine d’années, le Royaume-Uni parle régulièrement d’un nouveau programme nucléaire sans que rien ne se produise ; le public, qui est peut-être devenu cynique ou sceptique, se dit que, de toute façon, il ne se passera rien.
En outre, on n’annonce la création d’aucun nouveau site : ce sont les sites existants qui seront transformés, ce qui suscite une certaine indifférence du public. Ainsi, à Hinkley Point, le réacteur C devrait prendre la relève en 2023, lorsque le réacteur existant sera arrêté : du point de vue de l’économie locale, la transition devrait se faire en douceur.
M. le président François Brottes. Le prix d’acquisition des sites avait provoqué un grand débat en France.
M. Humphrey Cadoux-Hudson. Il y a tout de même un débat public sur la politique énergétique, sur le fait de savoir si la capacité sera suffisante, sur l’opportunité de construire des centrales au charbon ou au gaz, sur la nécessité ou non d’investir dans l’éolien terrestre. Toutes les sources d’énergie sont contestées, hormis le nucléaire qui semble en effet faire l’objet d’un consensus. Le plus bel exemple en est que le Liberal Democrat Party, qui est, chez nous, celui qui s’apparente le plus à un parti Vert, a récemment changé d’attitude à l’égard de l’énergie nucléaire, à laquelle il est désormais favorable.
Autour de Hinkley Point, tout le monde est favorable au lancement du chantier, qui va créer des milliers d’emplois, sur place mais aussi en France chez les fournisseurs. Nous entretenons un dialogue très constructif avec les syndicats, qui ont compris que nous allions créer des emplois qualifiés et soutenir l’économie – certaines zones proches du site sont en effet sinistrées.
Les gens considèrent que nous allons dans le bon sens dès lors qu’ils ont l’assurance d’être approvisionnés, pour un prix raisonnable, en énergie sobre en carbone. D’après les sondages, et malgré Fukushima, 67 % des personnes interrogées, je le répète, sont favorables à l’énergie nucléaire : ce chiffre ne fait que s’accroître année après année.
Nous sommes à un moment où le pays doit construire de nouvelles capacités et faire les bons choix de mix énergétique. Le nucléaire fait partie de ces choix.
M. le président François Brottes. Au nom du rapporteur et des commissaires, je vous remercie, messieurs, d’avoir fait le voyage jusqu’à nous pour répondre à nos questions.
Audition de M. Manuel Baritaud, analyste senior « Électricité » de l’Agence internationale de l’énergie
(Séance du jeudi 30 janvier 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314010.pdf
M. le président François Brottes. Suivant avec attention la couverture de nos auditions par la presse, je vous rappelle, chers collègues, que nous ne tirerons nos conclusions qu’à l’issue de nos travaux. Entre-temps, si chacun est libre de s’exprimer à titre personnel, personne ne peut prétendre le faire au nom de la commission d’enquête.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE), dont M. Manuel Baritaud est un analyste senior, est un observatoire international qui travaille depuis plusieurs années sur un plan d’action pour la sécurité électrique. Dans le cadre de cette étude – demandée lors de la conférence ministérielle de l’AIE de 2011 –, l’agence s’est intéressée à la sécurité et à l’efficacité de la fourniture d’électricité pendant la transition vers des systèmes électriques faiblement carbonés. Ses travaux, qui abordent l’économie globale des marchés de l’électricité dans un contexte de présence croissante des énergies renouvelables, montrent également les répercussions de ces évolutions sur la filière nucléaire. Un opuscule synthétisant les analyses de l’AIE dans ce domaine – dont vous êtes, monsieur Baritaud, le principal concepteur – tire les conclusions de ces travaux et semble suggérer que la santé du marché de l’électricité et de l’énergie contribue à la bonne marche de l’économie dans son ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Manuel Baritaud prête serment)
M. le président François Brottes. Je vous donne la parole pour un exposé liminaire synthétisant vos travaux.
M. Manuel Baritaud, analyste senior « Électricité » de l’Agence internationale de l’énergie. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de vous présenter les travaux de l’AIE en matière de sécurité de fourniture électrique. Le principal objectif de l’agence est de traiter des problèmes de sécurité énergétique ; commençant par le pétrole, les pays membres de l’AIE ont progressivement étendu ses travaux à d’autres aspects de la question – notamment, depuis deux ans, à l’électricité. Je suis chargé des recherches dans ce domaine.
L’AIE étant une émanation de l’OCDE, ses pays membres sont les principaux pays riches de la planète, dotés de marchés de l’électricité libéralisés et développant des politiques en matière de déploiement des énergies renouvelables. Nous analysons l’impact de ce déploiement sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et sur leur capacité à assurer la sécurité d’approvisionnement – question fondamentale dans nos sociétés développées où toute l’économie en dépend. Lors de la dernière réunion ministérielle de l’AIE – rendez-vous qui rassemble la quasi-totalité des ministres de l’énergie des pays membres –, en novembre 2013, nous avons publié un résumé de nos travaux depuis deux ans, dont je vous présenterai les principales conclusions.
Dans les prochaines années, le secteur électrique des pays membres de l’AIE sera confronté à trois principaux défis : le vieillissement des infrastructures électriques – centrales et réseaux ; le déploiement des énergies renouvelables variables qui changeront le fonctionnement des marchés ; et enfin l’adaptation au changement climatique et la résilience des systèmes électriques.
Dans les pays de l’OCDE, plus de la moitié de la capacité nucléaire et charbon aujourd’hui en exploitation a plus de trente ans ; 20 % a plus de quarante ans. D’ici à 2035, les nouvelles centrales – à charbon, à gaz ou à l’énergie nucléaire – qui seront construites dans les pays de l’OCDE ne feront que remplacer celles qui seront arrêtées. Seules les nouvelles centrales à énergie renouvelable augmenteront les capacités installées. Ces projections valent pour les États-Unis comme pour l’Union européenne ; en revanche, dans les pays tels que la Chine, en raison de la forte croissance de la consommation d’électricité, on installera des capacités renouvelables, mais également nucléaires et fossiles.
L’introduction des capacités renouvelables – le solaire et l’éolien – dans le système électrique change le fonctionnement de ce dernier dans la mesure où ces installations produisent de l’électricité de façon variable. Dans les pays comme l’Allemagne, où les capacités installées sont d’ores et déjà importantes, on observe des pics de production solaire pendant la journée et une production éolienne fluctuante. L’énergie électrique pouvant difficilement être stockée, le déploiement des renouvelables changera, dans les prochaines décennies, la dynamique des marchés électriques et les besoins d’investissement. En effet, il faudra disposer de suffisamment de capacités de production installées pour faire face aux situations où le vent et le soleil feront défaut – comme au moment de la pointe de consommation électrique qui, en France, se situe en hiver et la nuit. Cet élément apparaît essentiel dans la dynamique de remplacement des infrastructures vieillissantes.
Le dernier défi auquel sont confrontés les systèmes électriques renvoie à la question de la résilience et de l’adaptation au changement climatique. On a tous en tête les images de l’ouragan Sandy qui a plongé la moitié de Manhattan dans le noir ; or les épisodes de ce type, affectant le fonctionnement des réseaux, sont appelés à devenir de plus en plus fréquents. De manière générale, le système électrique sera de plus en plus exposé aux aléas climatiques, tant dans le cas de la production solaire et éolienne que dans celui des installations plus classiques, les éléments climatiques extrêmes risquant de créer des coupures sur le réseau de distribution.
À côté de la sécurité d’approvisionnement et de la soutenabilité du système électrique, le troisième pilier de la politique énergétique est celui de l’efficacité et de la compétitivité. Les travaux comparatifs que l’AIE a menés l’année dernière montrent que le prix de l’électricité est bien plus bas aux États-Unis qu’en Europe, en raison d’un prix du gaz quatre fois plus faible et de l’absence de tarification du CO2. Les prix sont encore inférieurs en Chine. Cet aspect doit également être pris en compte quand on réfléchit aux arbitrages à faire en matière d’évolution du mix électrique.
Les travaux de l’AIE sur cette question explorent quatre principales activités, liées les unes aux autres. Ainsi, nous avons interrogé l’aptitude des marchés électriques à délivrer de bons signaux pour impulser l’investissement dans de nouvelles capacités de production et assurer une exploitation efficace des capacités existantes. La même question s’est imposée à propos des réseaux. Nous avons également étudié le problème – de plus en plus important – de la réponse de la demande d’électricité et celui de l’intégration régionale – et notamment européenne – des marchés électriques. Au centre de tous ces travaux se trouve la question de la préparation aux situations d’urgence, le système devant pouvoir faire face aux coupures d’électricité.
Voici, parmi nos conclusions, celles qui me semblent les plus pertinentes dans le cadre des travaux de votre commission d’enquête. D’abord, les gouvernements des pays membres de l’AIE doivent fournir plus de certitudes concernant leur politique environnementale. Pour bien fonctionner, les marchés de l’électricité doivent connaître les perspectives de déploiement tant des énergies renouvelables que des capacités nucléaires. En effet, les décisions d’investissement s’appuient sur les prévisions d’évolution du marché à l’horizon de dix, quinze ou vingt ans, et les opérateurs ont besoin de disposer d’informations sûres en cette matière.
Il est également très important de disposer de bons signaux-prix sur les marchés électriques. Ainsi, pendant les périodes de rareté, lorsque les marges du système électrique sont faibles, les prix de l’électricité doivent correctement refléter cette situation de tension. Il faut également que les marchés rémunèrent à sa juste mesure la flexibilité – nécessaire pour faire face à la variabilité et au relatif manque de prévisibilité des énergies renouvelables.
Les pouvoirs publics doivent clarifier le cadre réglementaire relatif à la sécurité de l’alimentation électrique. En France, le principe devant guider les investissements dans les moyens de production est celui du maintien du risque de défaillance du réseau en dessous de trois heures par an ou de trente heures tous les dix ans ; mais tous les pays membres de l’AIE ne disposent pas de ce type de critères, qui doivent rester cohérents avec les conditions économiques du secteur électrique. Il est enfin important que ce cadre réglementaire soit correctement reflété dans les signaux-prix sur les marchés.
L’introduction de mécanismes de capacité doit pouvoir être envisagée lorsque le bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de systèmes électriques fait apparaître des déséquilibres à terme entre l’offre et la demande. La France fait partie des pays qui avancent actuellement dans le processus d’introduction d’un marché des capacités.
Enfin, nous conseillons d’améliorer l’intégration géographique des marchés de l’électricité. Si l’on veut introduire dans le système électrique une part croissante de renouvelables variables, alors ces marchés doivent être suffisamment dynamiques et flexibles pour permettre des échanges d’électricité entre pays, susceptibles de pallier la variabilité du solaire et de l’éolien. Plusieurs pays membres de l’AIE ont œuvré en ce sens ; pour aller plus loin, il est nécessaire de mieux coordonner les activités des gestionnaires de réseaux électriques grâce à l’harmonisation du cadre réglementaire en matière de sécurité d’approvisionnement. À défaut, les coûts de la transition énergétique risquent de s’avérer trop élevés, pesant sur la compétitivité des économies. Il faut donc absolument travailler sur ce sujet pour continuer à développer les énergies bas carbone de façon efficace.
M. le président François Brottes. Les électrons ne connaissent pas les frontières ; au vu de l’étroite intrication des marchés d’énergie internationaux, est-il encore pertinent – voire possible – de mener une politique nationale en matière d’électricité, et plus largement d’énergie ? Vous en appelez à plusieurs reprises aux pouvoirs publics, mais qui visez-vous : l’Europe, le monde, la France, les régions ?
M. Manuel Baritaud. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’AIE s’intéresse en priorité à ce que peuvent faire les gouvernements des pays membres. La sécurité électrique repose sur plusieurs piliers dont le premier renvoie à la sécurité de l’alimentation en combustible fossile. À l’échelle européenne, celle-ci est notamment améliorée par la constitution de marchés gaziers, qui permet d’accroître les liquidités et de multiplier les sources d’approvisionnement. Les deux autres piliers sont l’adéquation de la fourniture – il faut disposer en permanence de suffisamment de capacités de production, de transport et d’interconnexion disponibles pour faire face à la demande – et la sécurité du système électrique, les gestionnaires de réseaux devant définir et exploiter les réseaux de façon à éviter les coupures. Or, comme le montre la directive relative à la sécurité de l’approvisionnement en électricité, dans le contexte institutionnel européen actuel, cette compétence relève clairement des États membres. L’introduction des marchés des capacités dans différents pays est d’ailleurs décidée par chaque État membre, et non à l’échelle européenne.
Cette fragmentation pose problème, alors même que l’on essaie de développer un marché européen intégré. En effet, l’absence de coordination entre les investissements de production réalisés dans différents pays risque de multiplier les inefficacités. Il faut donc travailler à une meilleure synchronisation des politiques nationales en matière de sécurité de l’alimentation électrique.
M. le président François Brottes. Ainsi, sans coordination, pas de politique nationale possible !
M. Denis Baupin, rapporteur. Je vous remercie d’avoir dès le départ insisté sur le problème du vieillissement des installations, qui se pose dans beaucoup de pays européens. Quelles que soient les appréciations que l’on porte sur les réponses à y apporter – et notamment sur les différentes solutions technologiques –, l’obsolescence des réseaux et des installations exige des décisions que l’on ne peut pas éternellement repousser. Dans tous les cas, nous devrons consentir des investissements massifs.
Vous avez évoqué la question de la résilience des réseaux face au changement climatique ; mais cette résilience ne concerne-t-elle pas également certaines installations qui, en cas d’événements climatiques extrêmes, peuvent être menacées ? Ainsi, au moment des tempêtes aux États-Unis, certains sites de production ont dû fermer. Quant aux installations nucléaires, qui se situent toujours à proximité de cours ou de plans d’eau, leur fonctionnement peut être perturbé tant par l’élévation du niveau des mers que par les sécheresses.
Toujours en lien avec les enjeux climatiques, si le prix de l’électricité est beaucoup plus faible aux États-Unis qu’en Europe, il ne faudrait pas en conclure que la recherche de la compétitivité exige de le faire baisser chez nous. En effet, ces prix bas s’expliquent par l’absence de la prise en compte du coût du carbone. L’AIE ayant à de multiples reprises attiré l’attention sur le risque climatique et ses conséquences sur la sécurité énergétique et plus globale de nos pays, je n’imagine pas qu’elle puisse suggérer d’imiter les États-Unis en cette matière.
La pointe hivernale constitue indéniablement un élément important de variabilité de la consommation électrique en France. Pour l’affronter, il convient entre autres de travailler directement à la source du problème : le chauffage électrique. Il s’agit donc d’une politique nationale à mener dans le cadre de la transition énergétique.
Dans son rapport de 2011, l’AIE recommandait d’adopter, face aux dérèglements climatiques, une série de mesures dont 70 % concernaient l’efficacité énergétique, 18 % les énergies renouvelables et 3 % le nucléaire. Cette répartition reste-t-elle valable aujourd’hui ?
En matière de sécurité d’approvisionnement, vous avez évoqué, avec raison, la variabilité des énergies renouvelables qui reste problématique tant que l’on ne sait pas correctement stocker l’électricité. Pourtant, lorsque la production est concentrée dans quelques installations de grande puissance, l’arrêt d’une d’entre elles entraîne également des conséquences importantes. La variabilité est donc valable pour toutes les énergies. Ainsi, un accident majeur dans une centrale nucléaire – comme au Japon –, voire un accident générique obligeant à fermer plusieurs installations – scénario mis en exergue par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française –, auraient un impact très considérable. Comment évaluez-vous, en cette matière, les différentes énergies non carbonées, porteuses de mérites et de vulnérabilités différentes ?
Le président Brottes s’est demandé si l’on pouvait mener une politique énergétique nationale ; que pensez-vous aujourd’hui du marché électrique européen ? Plusieurs de nos auditions ont mis en évidence ses dysfonctionnements, son incapacité à prendre en compte l’adaptabilité aux situations de crise. Comment le rendre plus efficace ?
Enfin, les mécanismes de capacité – compléments permettant de faire face aux moments de pénurie d’électricité lors des pointes –, se limitent pour l’instant en général aux énergies fossiles, et de plus en plus souvent – en raison de son faible prix – au charbon. Or toutes les énergies fossiles ne se valent pas ; d’après vous, lesquelles d’entre elles correspondent le mieux à l’objectif de transition énergétique que se sont fixé les pays de l’Europe et de l’OCDE ?
M. Manuel Baritaud. En matière de résilience des installations nucléaires, EDF est en effet obligée, lors des périodes de sécheresse, de baisser le niveau de production des centrales pour des questions de température de rejet. Ce phénomène bien réel affecte les bilans prévisionnels réalisés par les gestionnaires de réseaux – en France, Réseau de transport d’électricité (RTE) –, qui livrent une estimation de nature probabiliste de la disponibilité du parc nucléaire et plus généralement de la sécurité de fourniture électrique. Ces projections peuvent difficilement se fonder sur des données historiques car on anticipe une multiplication des événements climatiques extrêmes dans les années à venir. Mais la question de l’impact du changement climatique sur l’infrastructure énergétique me paraît bien analysée à ce stade, y compris par l’AIE.
Si l’absence d’une tarification du carbone – et de tout projet de ce type – explique en partie le faible prix de l’électricité aux États-Unis, ce phénomène apparaît secondaire tant le prix du carbone reste faible en Europe. La principale différence vient plutôt du prix du gaz, quatre fois plus faible aux États-Unis. N’étant pas spécialiste de la question, je ne saurais vous dire comment le prix de cet hydrocarbure peut évoluer en Europe, en particulier si l’on y autorise l’exploitation des gaz de schiste. Il est toutefois certain que le marché européen du gaz est affecté à la fois par les dynamiques du marché américain – notamment via l’impact du gaz naturel liquéfié (GNL) – et par celles du secteur électrique, marqué par la forte décroissance de la demande de gaz pour la production d’électricité en Europe.
Selon l’AIE, si l’efficacité énergétique des bâtiments constitue une priorité dans la lutte contre le changement climatique et pour la réduction des émissions de CO2, son impact sur la pointe électrique reste limité. Cela dit, dans les scénarios envisagés par l’agence, la part des différentes énergies bas carbone est appelée à augmenter ou à se maintenir. Ainsi, le nucléaire fait partie du mix électrique que l’on prévoit pour 2035 ou 2050, dans des proportions comparables à aujourd’hui, voire supérieures dans des scénarios ambitieux de décarbonisation du mix, compatibles avec une trajectoire de stabilisation des émissions de CO2 et de réchauffement climatique inférieur à 2°C.
Il apparaît délicat de comparer, comme vous le faites, la variabilité des énergies renouvelables avec les arrêts de centrales nucléaires, ces phénomènes étant de nature différente. L’arrêt d’une centrale concerne une tranche parmi une multitude d’autres - problème que le système électrique sait gérer depuis des dizaines d’années. La variabilité du solaire et de l’éolien affecte, en revanche, de grandes zones géographiques aux conditions climatiques corrélées, où l’on a du vent et du soleil en même temps. L’impact et les implications de ces différentes variabilités sont donc incomparables. De plus, les prévisions de production photovoltaïque et éolienne sont relativement peu fiables deux, voire un jour avant le temps réel ; leur qualité s’améliore au fur et à mesure pour devenir relativement bonne à trois heures du moment effectif de production. Le système électrique comme les marchés de l’électricité doivent s’adapter à ce phénomène en devenant plus dynamiques.
Le processus d’intégration des marchés électriques européens a d’ores et déjà amené énormément de bénéfices. Ainsi, il a amélioré la sécurité d’approvisionnement et de fourniture électrique en permettant à chaque pays de pouvoir compter sur les voisins pour assurer l’exploitation du système. Les échanges commerciaux d’électricité depuis vingt ans ont pratiquement doublé en valeur absolue, ce qui montre bien que les acteurs y trouvent un intérêt. Ces échanges permettent d’assurer une meilleure utilisation du parc en favorisant l’emploi prioritaire des ressources les moins chères. L’approche européenne d’intégration des marchés consiste à procéder par étapes ; cependant, malgré l’adoption de trois paquets de directives relatives à l’électricité, le marché européen semble avoir encore du chemin à faire pour devenir parfaitement intégré et concurrentiel. Pour le rendre plus efficace, il faudrait non seulement renforcer les interconnexions internationales, mais également travailler sur l’harmonisation de la réglementation de la sûreté électrique au niveau européen, de façon à améliorer la coordination entre gestionnaires de réseaux lorsqu’on s’approche du temps réel – seule façon d’intégrer efficacement la variabilité des énergies renouvelables dans les échanges internationaux.
S’agissant des mécanismes de capacité, je ne crois pas me souvenir de décisions récentes de construction de nouvelles centrales, les installations en préparation correspondant aux choix faits il y a plusieurs années, au moment de l’introduction du système d’échange de quotas d’émission de CO2 en Europe. Bien conçus, les mécanismes de capacité ne favorisent pas une technologie au détriment d’une autre, se contentant d’ajuster la réponse de la demande. Il est donc important qu’ils soient neutres d’un point de vue technologique afin de permettre à l’ensemble des procédés de contribuer à assurer l’adéquation du système électrique.
M. le rapporteur. Dans ce cas, ces mécanismes doivent-ils également être neutres en termes de carbone ?
M. Manuel Baritaud. Oui. Chaque question doit être réglée au moyen d’un instrument adapté. Le problème d’émission de carbone ne relève pas du marché des capacités, mais de celui des quotas d’émission du CO2.
M. le président François Brottes. Des mécanismes d’effacement peuvent parfois y être associés.
M. Jean-Pierre Gorges. Je rappelle au rapporteur que cette commission d’enquête est consacrée au coût de la filière nucléaire, et non à la transition énergétique, sans cesse évoquée. Il ne faut pas noyer le poisson. Je souhaite que l’on se concentre sur le sujet afin que le rapport final puisse faire l’objet d’un vote !
M. le président François Brottes. La commission d’enquête est relative à l’électricité nucléaire dans le périmètre du mix électrique ; nous devons donc considérer celui-ci dans son ensemble.
M. Jean-Pierre Gorges. Monsieur Baritaud, vous avez montré l’opposition entre les filières stables – le nucléaire, l’hydraulique, le charbon – et les sources d’énergie variables promues dans le cadre du développement durable – l’éolien et le photovoltaïque. Une modélisation de leurs évolutions sur vingt-cinq ans devrait permettre de chiffrer le surcoût de la désinstallation des centrales nucléaires, qui devra être compensée d’une manière ou d’une autre. Or, comme vous l’avez souligné, la production des filières éolienne et photovoltaïque reste aléatoire et uniquement prévisible dans le très court terme. De plus ni le temps ni la météo ne s’arrêtent aux frontières : même si les pays limitrophes bénéficiaient d’un marché intégré, ils resteraient soumis, à un instant donné, aux mêmes conditions climatiques et lumineuses, le jour et la nuit survenant en même temps en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et dans les autres pays voisins. En croisant la courbe de l’évolution des besoins - en augmentation –, celle de la désinstallation des centrales nucléaires et celle du potentiel d’installation de l’éolien et du photovoltaïque – dont la production estimée doit tenir compte de leur caractère aléatoire –, on doit pouvoir déterminer le manque restant. Pour le combler, l’outil de substitution actuellement mis en œuvre est la centrale à charbon, tant en Allemagne qu’en Chine où ce phénomène explique le bas prix de l’électricité. Calculer, à l’horizon de vingt-cinq ans, le surcoût généré par cette substitution nous ferait réellement entrer dans les coûts de la filière nucléaire.
M. Manuel Baritaud. Plusieurs travaux font cette démarche qui consiste à estimer les coûts du système électrique correspondant à différents niveaux de déploiement des énergies renouvelables variables. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, et tout d’abord le coût du développement des réseaux électriques capables d’intégrer les sites de production des nouvelles énergies, généralement situés loin des centres de consommation. Le phénomène a également un impact sur les coûts globaux du système électrique. En effet, l’augmentation de la part du solaire et de l’éolien dans le système électrique diminue le besoin en électricité de base. Cependant, comme la production des énergies renouvelables est variable, les moyens de production réguliers restent nécessaires pour faire face aux situations où vent et soleil font défaut. Moins utilisées, ces installations classiques coûtent alors plus cher par mégawattheure produit. Ces effets de système ont été analysés, notamment dans un rapport récent de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). L’AIE s’apprête également à publier des observations quant à l’impact qu’aura la nécessaire augmentation de la flexibilité des systèmes électriques sur leurs coûts. Notre agence s’est donc intéressée à ces questions de manière générale, même si nous ne les avons pas considérées spécifiquement dans le cas français.
Cela dit, si le recours au charbon tend en effet à croître aujourd’hui en Europe, je pense qu’il s’agit d’un phénomène essentiellement conjoncturel. La technologie des centrales à gaz est mieux adaptée pour compenser la variabilité des énergies renouvelables. Par ailleurs, les réglementations relatives au charbon réduisent les chances de voir construire de nouvelles centrales de ce type, en Europe comme aux États-Unis. À terme, le nombre de capacités à charbon devrait donc décroître.
M. Michel Sordi. Dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques de la planète, paru en novembre 2013, l’AIE prévoit un réchauffement des températures à long terme de 3,6°C si les gouvernements en restent aux objectifs actuellement fixés. Que faut-il penser des décisions politiques consistant à fermer les centrales nucléaires non émettrices de CO2, ces fermetures étant le plus souvent compensées par des centrales à gaz et encore plus souvent à charbon, bien plus polluantes ?
Le calcul des coûts d’amortissement de nos centrales nucléaires se fait à partir de la durée théorique d’exploitation. En France, la centrale de Fessenheim est la première à avoir reçu de l’ASN l’autorisation de continuer à fonctionner au-delà des trente ans. En Suisse, la durée d’exploitation s’élève pourtant à cinquante ans, et aux États-Unis, jusqu’à soixante ans. La France est-elle le seul pays au monde à arrêter prématurément ses installations ?
Quand on sait que le kilowattheure ne coûte que 15 euros dans certaines régions du monde – telles que les États-Unis ou le Canada –, est-il réaliste, à court et moyen terme, de réduire notre part d’électricité provenant du nucléaire ? Cette politique risque d’alourdir encore plus notre facture énergétique et d’amener certaines activités à quitter notre territoire, causant des pertes d’emplois.
M. Manuel Baritaud. En effet, les scénarios du World Energy Outlook qui correspondent aux politiques actuellement menées sont compatibles avec une augmentation élevée de la température. Si nous voulons tendre vers une augmentation ne dépassant pas 2°C, il faut accélérer le développement des énergies bas carbone. Tous les scénarios de l’AIE fondés sur ces objectifs ambitieux donnent une part croissante au nucléaire, y compris dans les pays de l’OCDE. Quant aux pays comme la Chine, même s’ils installent beaucoup de centrales à charbon, ils construisent aussi, d’ores et déjà, beaucoup de centrales nucléaires.
On ne saurait sous-estimer le problème du coût de l’électricité et de la compétitivité. De fait, on arbitre en permanence entre les différents objectifs de la politique énergétique : prix abordable, réduction des émissions de CO2, sécurité de l’alimentation électrique. Actuellement, à cause de la crise économique, les gouvernements sont de plus en plus préoccupés par les questions de compétitivité, la réduction des émissions de CO2 passant au second plan.
Allonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires existantes fait clairement partie des solutions les moins chères pour produire de l’énergie bas carbone. Aux États-Unis, la durée de vie de certaines d’entre elles a été prolongée jusqu’à soixante ans.
M. le rapporteur. Sur quels référentiels de sûreté vous basez-vous pour le dire ?
M. Manuel Baritaud. Je ne suis pas un expert en sûreté nucléaire ; je vous fais simplement part des décisions prises aux États-Unis.
M. Bernard Accoyer. Les conditions de travail de notre commission d’enquête laissent à désirer. Il est d’ailleurs paradoxal de nous retrouver, à l’étroit, dans cette salle de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), compte tenu de l’attitude de la majorité qui refuse tout progrès scientifique et nous détourne de l’objet de notre commission d’enquête pour nous mener vers une forme d’obscurantisme. Le rapporteur multiplie les interventions personnelles – qui constituent des plaidoyers dogmatiques contre l’énergie nucléaire plutôt que des questions pertinentes – et nous fait perdre beaucoup de temps pour satisfaire à ce caprice de l’écologie politique.
Le coût de l’énergie a des conséquences lourdes sur l’emploi : comme nous pouvons le constater dans nos circonscriptions, la baisse du prix de l’électricité aux États-Unis multiplie d’ores et déjà les fermetures de sites d’industrie chimique. Quant à la remise en cause du nucléaire, portée par le mouvement politique auquel appartient notre rapporteur, elle n’a pour le moment qu’une seule conséquence, bien visible en Allemagne : l’explosion de la consommation de charbon, et donc des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution. Les écologistes sont peu diserts sur cette réalité, alors que la surconsommation de cet hydrocarbure à bas prix crée des déséquilibres dont il faudrait connaître le coût.
De toute façon, le solaire ne fonctionnant pas la nuit, l’éolien nécessitant du vent, et l’hydroélectrique des précipitations, nous ferions mieux de parler du mix énergétique plutôt que de nous cantonner à une question purement politique et dogmatique qui constitue l’objet de notre commission d’enquête.
M. le rapporteur. Votre discours, président Accoyer, est évidemment exempt de tout soupçon d’idéologie ! Je vous rappelle cependant que même l’OPECST – institution dont vous avez une vision décalée – compte en son sein des personnes portant un regard critique sur la science. Au moins deux « obscurantistes » ici présents en sont d’ailleurs membres.
Vous qui invoquez l’Allemagne de façon récurrente auriez dû assister aux auditions de la semaine passée – ou au moins en lire les comptes rendus –, qui montrent clairement que, comme en Grande-Bretagne et en France, l’explosion de la consommation de charbon dans ce pays est principalement due à la hausse du prix du gaz et à l’effet d’éviction du gaz par le charbon qui s’ensuit. Ce phénomène – largement démontré – n’a rien à voir avec la politique de transition énergétique allemande.
Auditionnée hier par la commission des affaires européennes, Mme Connie Hedegaard – commissaire européenne chargée de l’action pour le climat – a évoqué le paquet climat-énergie et la préparation de la Conférence des parties (COP) 2015 qui aura lieu à Paris. Elle a également souligné qu’entre 2010 et 2012, le prix du gaz aux États-Unis avait augmenté de 200 % ; la bulle liée au gaz de schiste et à son faible prix serait donc déjà en partie derrière nous. Mme Hedegaard a enfin noté – tout comme le rapport de l’OPECST rédigé par Christian Bataille et Jean-Claude Lenoir, ainsi que bien d’autres études – que l’exploitation potentielle de cette ressource en Europe n’aurait pas d’impact sur le prix du gaz. Qu’en pensez-vous ?
M. Manuel Baritaud. Ce n’est pas mon domaine, mais je crois en effet que les conditions géologiques des gaz de schiste aux États-Unis et en Europe ne sont pas exactement les mêmes. J’ai également cru comprendre que, quand bien même on en développerait l’extraction en Europe, on n’atteindrait pas des niveaux de coût de production comparables à ceux des États-Unis. L’AIE a publié plusieurs rapports identifiant les bonnes pratiques en matière d’exploitation de cette ressource ; les technologies compatibles avec les contraintes environnementales sont d’ores et déjà disponibles, mais la France a jusqu’à présent fait le choix de ne pas les considérer.
M. le président François Brottes. Ne trouvez-vous pas contradictoire de la part de l’Europe de promouvoir la lutte contre les gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables tout en promettant d’être permissive en matière de gaz de schiste ?
M. Manuel Baritaud. Il m’est difficile de répondre à cette question. Ce qui me paraît important dans la politique européenne, c’est la réaffirmation de l’objectif ambitieux de réduire les émissions de dioxyde de carbone à l’horizon 2030.
Mme Sylvie Pichot. Ni pro ni anti-nucléaire, je ne suis là ni pour militer ni pour prendre une posture, de quelque bord que ce soit. Si nous voulons, en tant que parlementaires, avoir un rôle efficace et cohérent, nous devons sortir de l’affrontement pour aborder toutes les questions, même celles qui nous dérangent, par-delà nos positions respectives.
M. le président François Brottes. Je partage totalement vos remarques. Monsieur Baritaud, je vous remercie pour cet échange.
Audition de Mme Gwenaëlle Huet, directrice des affaires européennes de GDF-Suez, et M. Claude Turmes, député européen
(Séance du jeudi 30 janvier 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314011.pdf
M. le président François Brottes. Les éclairages qui nous ont été présentés ces derniers jours montrent que les marchés de l’électricité ont subi des chocs importants. Ceux-ci résultent de la faible taxation du carbone – voire de son inexistence –, de l’avènement du gaz de schiste, d’une baisse des prix de gros qui ont pour origine la compétitivité retrouvée du charbon et la présence croissante des énergies renouvelables au sein du mix énergétique.
Douze énergéticiens européens – dont GDF Suez – ont exposé il y a quelques semaines, dans un appel commun, les conséquences de cet écroulement du prix de l’électricité sur leur parc de production, notamment les centrales à gaz, et ont appelé à une redéfinition de la politique européenne de l’énergie. Observons au passage que le consommateur n’a pas noté sur sa facture les effets de cette baisse.
Denis Baupin, rapporteur de la commission d’enquête, et moi-même avons souhaité que deux voix s’expriment devant notre commission : celle de l’un des énergéticiens concernés par l’appel que je viens de mentionner, Mme Gwenaëlle Huet, directrice des affaires européennes de GDF Suez, et celle de M. Claude Turmes, Luxembourgeois, député européen du groupe écologiste, membre de la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, et rapporteur, en juillet 2012, sur la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Gwenaëlle Huet et M. Claude Turmes prêtent serment)
M. le président François Brottes. Je vous remercie et donne la parole à Mme Gwenaëlle Huet pour un court exposé.
Mme Gwenaëlle Huet, directrice des affaires européennes de GDF Suez. Je vous remercie de me donner l’occasion de présenter la vision des énergéticiens sur la politique énergétique européenne.
Il est extrêmement important pour nous de témoigner, pas nécessairement pour brosser un tableau catastrophiste mais pour proposer des solutions, une évolution du modèle énergétique européen, des pistes de réflexion, et pour alimenter le débat en vue des élections européennes.
GDF Suez, présent dans 13 pays européens, est un acteur de premier plan en Europe dans les domaines de l’électricité, du gaz et de l’accompagnement des consommateurs pour les aider à mieux utiliser les services dédiés à l’efficacité énergétique. Cette présence nous permet de comprendre les évolutions de la consommation d’énergie dans de nombreux pays. Nous sommes partenaires, aux côtés de nos clients, de la transition énergétique.
En ce qui concerne la politique européenne de l’énergie, les autorités communautaires avaient fixé trois objectifs : la compétitivité, la sécurité d’approvisionnement et le développement durable.
Où en sommes-nous ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre le groupe Magritte.
Le premier objectif, la compétitivité, consiste à assurer au consommateur une énergie au juste prix. Les prix de gros sur le marché ont diminué, au cours des cinq dernières années, de 35 à 45 %, mais le consommateur final, lui, a vu sa facture augmenter. Cette décorrélation s’explique en grande partie par l’évolution de la fiscalité énergétique. Dans le rapport qu’elle a publié la semaine dernière, la Commission européenne indique que les taxes, pour les consommateurs industriels, ont augmenté de 127 %.
M. Claude Turmes, député européen. Ce sont les marges des revendeurs d’électricité qui ont augmenté !
Mme Gwenaëlle Huet. Reprenons les trois objectifs fixés par les décideurs européens.
S’agissant de la compétitivité, l’augmentation du prix pour le consommateur n’est pas forcément négative car elle l’incite à faire des efforts en termes d’efficacité énergétique. Pour autant, un certain nombre d’industriels, surtout les consommateurs intensifs en énergie, commencent à prendre position sur la différence de compétitivité des prix en Europe et aux États-Unis.
Quant à la sécurité d’approvisionnement, elle doit être assurée à 100 %. La crise nous a placés en situation de surcapacité, et nous constatons en Europe un phénomène rapide et massif de fermeture de centrales extrêmement flexibles : 50 gigawatts de capacité ont ainsi été supprimés au cours des deux dernières années. C’est regrettable, car si nous n’avons pas besoin aujourd’hui de toutes ces centrales d’appoint, il se pourrait qu’un jour nous en ayons besoin. Or, ce jour-là, nous ne les aurons plus.
En ce qui concerne le développement durable, nous avons largement atteint notre objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en 2020 puisque nous en sommes déjà à 18 %, mais ce résultat est surtout dû à la crise qui a eu pour conséquence de diminuer la consommation.
M. Claude Turmes. C’est faux !
M. le président François Brottes. Monsieur Turmes, veuillez laisser Mme Huet s’exprimer. Vous aurez la parole dès qu’elle aura terminé son intervention.
Mme Gwenaëlle Huet. Nous avons traversé une crise très sévère qui a détruit la valeur des actifs sur le marché, nous plaçant dans une situation critique.
Un certain nombre de pays ont pris des décisions – comme l’Allemagne qui a décidé de sortir du nucléaire – mais ces décisions ne sont pas suffisamment coordonnées à l’échelle européenne.
Enfin, le secteur énergétique a dû faire face à des évolutions mondiales brutales et fulgurantes, en particulier le développement du gaz de schiste aux États-Unis – le shale gas –dont nous ressentons les effets aujourd’hui en Europe. Nous n’avons pas assez anticipé ces bouleversements.
Notre groupe d’énergéticiens entend contribuer au débat, non pour critiquer les politiques énergétiques mais pour essayer de faire mieux, dans la perspective de la nouvelle politique énergétique européenne.
Tout a commencé pour notre groupe par l’appel que nous avons lancé, le 21 mai 2013, devant le Conseil européen de l’énergie au cours duquel nous avons proposé aux chefs d’État une autre vision de l’évolution du marché. Nous étions alors huit au sein du groupe Magritte ; nous sommes aujourd’hui douze dirigeants de grands groupes européens, dans des secteurs très différents allant du charbonnier au producteur d’énergies renouvelables, tous réunis autour d’un même message et d’un même constat : certes, la politique énergétique européenne a le mérite d’exister, mais il faut la promouvoir et faire en sorte qu’elle réponde mieux encore aux attentes des citoyens européens. Nous avons présenté nos réflexions devant le Parlement européen et différents chefs d’État et de Gouvernement, et nous avons communiqué avec la presse pour alimenter la réflexion du public.
Quelles sont les pistes que nous proposons ?
La première consiste à rétablir un véritable signal carbone. En effet, l’évolution du système souffre d’une absence totale de visibilité – le prix du carbone est actuellement de 5 euros alors qu’il devrait avoisiner les 30 euros – ce qui entraîne la méfiance des industriels et des énergéticiens.
Aujourd’hui, le marché connaît un excédent de 2 milliards de tonnes de quotas de CO2. Nous proposons de mettre en place le back loading qui consiste à retirer momentanément des quotas du marché. Vous allez me dire, monsieur Turmes, que ce n’est pas suffisant. C’est exact, c’est pourquoi nous allons plus loin en proposant de retirer des quotas et, pour leur ôter toute valeur, de « déchirer les billets de banque ». Ce retrait, en créant une pénurie, ferait remonter les prix. Un certain nombre d’industriels ne souhaitent pas que le marché dépende d’un signal politique. Qu’ils soient rassurés : le retrait, justifié par la seule crise économique, ne serait effectué qu’une seule fois.
Il convient parallèlement de donner de la visibilité à long terme. Pour cela, il faut définir un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, qui pourrait aller de 25 à 50 %. La Commission l’a fixé à 40 %, nous pouvons nous en féliciter. C’est un premier pas. Mais il nous faut attendre l’aval du Conseil européen.
Le marché de quotas d’émissions de CO2 est une enveloppe de quotas définie à un instant t, indépendamment de l’évolution de la demande. Nous proposons de créer une « banque centrale carbone », dont la mission serait d’ajuster les quotas sur le marché pour prendre en compte l’évolution de la demande et éviter les écarts de prix brutaux.
Parmi les énergéticiens qui composent le groupe Magritte se trouvent des charbonniers. Cela n’a rien d’étonnant car tous les énergéticiens ont un rôle à jouer dans la transition énergétique, tous développent de nouvelles activités et proposent de nouvelles offres à leurs clients.
Certes, les industriels très énergivores ont une position beaucoup plus modérée sur le marché carbone et pourraient menacer de délocaliser les industries fortement consommatrices d’énergie. Ce n’est dans l’intérêt de personne. Nous essayons naturellement de les écouter, mais l’orientation générale du secteur de l’énergie relève de choix politiques. C’est donc à vous, mesdames et messieurs les députés, de définir la boîte à outils que vous souhaitez mettre en place.
Une autre piste consiste à mettre en place un mécanisme d’inclusion carbone qui permettrait de taxer les importations vers l’Europe en fonction du contenu carbone des produits.
Une autre, enfin, pourrait être de réinjecter le revenu généré par les enchères du marché carbone au profit des industriels très consommateurs.
J’en viens aux énergies renouvelables. La presse a parfois présenté de façon très négative notre position sur ces nouvelles énergies, mais je vous rassure, nous sommes les plus gros investisseurs dans ce domaine. Iberdrola est le premier producteur d’énergies renouvelables au monde et GDF Suez le premier producteur d’éolien en France. Il n’est donc pas de notre intérêt de batailler contre les énergies renouvelables, mais nous aimerions qu’un cadre soit mis en place afin de sécuriser les investissements. Si certains pays d’Europe - l’Espagne, la Roumanie, la Pologne – reviennent sur des systèmes existants, c’est qu’ils ont été mal « designés ». Un certain nombre d’investisseurs ont signé des contrats qui n’ont pas été honorés. Pour éviter de telles situations, nous proposons d’améliorer les schémas, de rendre les technologies de plus en plus compétitives et de développer les filières.
Nous proposons, par ailleurs, d’engager une réflexion sur le nouveau modèle de marché « energy only » car s’il reflète la valeur de l’énergie sur un marché de gros, il n’attribue aucune valeur à la sécurité d’approvisionnement.
Pour attribuer une valeur à la sécurité d’approvisionnement, certains États membres, dont la France, ont développé des mécanismes de rémunération de capacité. Nous y sommes favorables s’ils sont bien « designés », ouverts à tous et transparents, mais nous mettons en avant une approche européenne. Nous espérons notamment travailler avec les Allemands sur un mécanisme de capacité propre à maintenir un marché intérieur intégré, fluide et transparent.
M. le président François Brottes. Mes chers collègues, je rappelle que cette commission d’enquête, constituée à la demande du groupe Écologiste, engage notre responsabilité collective car elle devra aboutir à une conclusion représentant l’ensemble de ses membres. Nos invités s’expriment pour eux-mêmes et sont libres de faire valoir des points de vue marqués. C’est tout l’intérêt de ces auditions.
M. Claude Turmes. Je vous remercie, monsieur le président, de m’avoir invité. Je précise que j’ai été rapporteur sur la directive relative à l’efficacité énergétique, mais également sur le marché européen de l’électricité et la directive relative aux énergies renouvelables. J’espère pouvoir vous convaincre qu’il existe bien une politique énergétique de l’Union européenne et que celle-ci est cohérente, notamment avec les objectifs fixés par votre Président de la République.
Aujourd’hui, le marché carbone et le marché de l’électricité de gros ne fonctionnent pas. C’est donc sur ces points que je vais vous faire part de l’analyse de mes collègues du Parlement européen.
Pourquoi nous sommes-nous engagés dans la transition énergétique ? Pour faire face au changement climatique, certes, mais également pour réduire la dépendance géopolitique et l’énorme dette énergétique de l’Union européenne. Le déficit de la balance commerciale de la France est ainsi dû pour 90 % aux importations d’énergie, et celui de l’Union européenne pour 80 %.
L’Union européenne a importé l’année dernière pour 500 milliards d’euros de gaz, de charbon et de pétrole, soit près de 4 % de son produit brut. Cette manne permet à M. Poutine d’acheter l’Ukraine, ou tout au moins les oligarques russes et une partie du gouvernement ukrainien. En important des énergies fossiles, nous affaiblissons l’Europe sur les plans géopolitique et économique.
Pourtant, l’Europe détient le leadership technologique en matière de réseaux intelligents et d’énergies renouvelables. Schneider est ainsi l’un des meilleurs du monde en matière d’efficacité énergétique – et même les écologistes de Bruxelles reconnaissent le savoir-faire d’Areva et de quelques acteurs du nucléaire français.
Si le débat sur l’électricité est aussi passionné depuis quelques années, c’est que nous sommes à la fin d’un cycle d’investissements : les deux tiers du parc de production européen doivent être remplacés d’ici à 2025-2030. En outre, la Commission européenne nous a fait savoir que la modernisation des lignes à haute tension et des réseaux de distribution nécessiterait quelque 200 milliards d’euros.
Le marché actuel, avec une surcapacité en base et un manque de production flexible, permettra-t-il de gérer cette situation ? Je ne le crois pas et cette complexité fait apparaître les contradictions du groupe Magritte et de GDF Suez.
Si l’industrie du charbon se porte bien, à l’inverse de celle du gaz, c’est que le marché carbone européen s’est effondré. En 2008, le prix d’un certificat d’émission de CO2 se situait aux alentours de 30 euros. À l’époque, le charbon lignite était très bon marché, mais les industries de hard coal ne tournaient pas car elles étaient remplacées par les industries du gaz, moins intensives en CO2 et donc moins pénalisées par le prix du certificat.
Depuis, le prix du carbone s’est effondré, ce que certains attribuent au développement des énergies renouvelables. En réalité, l’effondrement du marché est dû au surplus de certificats, estimé à 2,6 milliards, ce qui correspond à 7 % des émissions européennes. Sur ces 2,6 milliards, 40 millions seulement correspondent aux énergies renouvelables, soit une part légèrement plus élevée que ce qui était prévu dans la modélisation.
Quant à la crise, on lui doit une baisse de 600 millions de quotas. Elle n’est donc que très partiellement responsable de l’effondrement du prix du CO2.
Le reste est dû aux crédits internationaux. En 2012, les grands industriels intensifs et les électriciens ont acheté, en Chine et ailleurs, un milliard de certificats d’émissions de CO2 d’une valeur de 0,30 centime d’euro. En 2012, le système a été totalement submergé de certificats, ce qui a causé la mort du marché carbone. Après la décision prise la semaine dernière à Bruxelles de laisser 7 % des émissions dans le système, il est très probable que, d’ici à 2025, le prix du carbone restera extrêmement bas, ce qui signifie que les unités de production de charbon tourneront à plein régime et que le gaz sera hors jeu.
Cette décision prise à Bruxelles ne va pas dans le bon sens. Il n’existe qu’une solution pour financer l’efficacité énergétique, c’est que la France et l’Allemagne décident, comme l’ont fait les Anglais, d’instaurer un prix plancher du carbone. Cela permettra de gagner de l’argent et de financer ainsi l’efficacité énergétique.
En outre, les subventions aux énergies renouvelables dépendent du différentiel entre leur coût de production et le prix du marché. En Allemagne, en 2008, le différentiel entre l’éolien et le prix du marché était faible – de 90 à 60 euros. Aujourd’hui le prix de l’éolien est inférieur à 40 euros, mais le différentiel a augmenté. Relever le prix du carbone résoudra le problème de l’opposition entre charbon et gaz, apportera des revenus à l’État et affaiblira la distorsion de concurrence entre le charbon et les énergies renouvelables.
Ne nous leurrons pas : si le charbon ne paie pas la pollution qu’il génère – et à 10 euros par tonne, il ne la paie pas – l’éolien, le solaire et le nucléaire ne pourront jamais le concurrencer.
C’est la première des urgences. Je sais que l’entourage de François Hollande travaille sur cette question ; j’espère qu’une solution sera trouvée sous peu.
J’en viens aux prix de l’énergie.
Les industries du gaz et l’industrie chimique sont aujourd’hui confrontées à la shale gas revolution, ou plutôt, comme le considèrent certains, à la bulle du gaz de schiste qui a entraîné une baisse du prix du gaz aux États-Unis, ce qui incite les industriels chimiques à s’y implanter. Cela étant, depuis 2008, le prix du gaz en Europe a augmenté beaucoup plus qu’il n’a diminué aux États-Unis. C’est dû au fait que les contrats européens de gaz sont indexés sur le pétrole. Les contrats avec Gazprom, par exemple, stipulent qu’en cas d’augmentation du prix du pétrole, le prix de la fourniture de gaz est plus élevé.
Fatih Birol, économiste en chef de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a relevé il y a plus d’un an que deux tiers des contrats à long terme passés entre l’Union européenne et ses fournisseurs pour la fourniture de gaz seraient renégociés au cours des six à huit prochaines années. Voilà une occasion en or de casser un mécanisme qui avait du sens dans les années 1970 mais n’en a plus aucun aujourd’hui. Combiner des infrastructures européennes de pipe-line de gaz, un marché de gaz liquide et une volonté politique de supprimer l’indexation sur le pétrole : voilà ce qui, à terme, permettrait au gaz de revenir dans le jeu.
Les objectifs de l’Union européenne pour 2020, le fameux « 20/20/20 », sont en accord avec ceux de l’Allemagne, à savoir réduire les gaz à effet de serre de 40 %, porter la part des énergies renouvelables à 18 %, réaliser 20 % d’efficacité énergétique et abaisser la part du nucléaire de 22 % à zéro.
Les objectifs de la France sont du même ordre : 30 % de réduction des gaz à effet de serre, 20 % d’efficacité énergétique, 23 % d’énergies renouvelables – car votre pays avait pris de l’avance en investissant dans l’hydroélectricité – et diminution de la part du nucléaire de 75 à 50 %, comme le Président Hollande en émis le souhait. La France suit donc la même trajectoire que l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal : elle augmente la part des énergies renouvelables, renforce l’efficacité énergétique et abandonne en partie de vieux outils que, de toute façon, il faudra remplacer.
Lorsque nous avons élaboré le paquet énergie-climat, nous pensions qu’il permettrait de fermer les industries du charbon, mais la défaillance du marché carbone entraîne la fermeture de nombreuses unités de production de gaz. Il faut donc corriger cette défaillance.
Pour aider le marché, il faut limiter l’offre, donc fermer les vieilles centrales. L’Allemagne devrait ainsi fermer six à huit centrales à charbon dont elle n’a plus besoin. La France, suivant le scénario voulu par M. Hollande de diminuer la part du nucléaire, pourrait elle aussi fermer un certain nombre de centrales nucléaires. Cela rassurerait les Luxembourgeois. Je rappelle à cet égard qu’André-Claude Lacoste indiquait dans un récent rapport que si des problèmes survenaient dans un réacteur situé près de la frontière, les procès intentés à l’encontre de la France auraient des retombées financières gigantesques. Le choix des centrales que vous déciderez de fermer fera l’objet de discussions entre vous. N’oubliez pas que les populations du Bade-Wurtemberg portent un regard différent sur la centrale de Fessenheim que celui que vous portez à Paris…
Enfin, si les marchés français et allemand de l’électricité n’existent plus, le marché européen de l’électricité n’existe pas encore, quant à lui. Le marché réel de l’électricité est le marché pentalatéral, créé en 2005 pour des raisons politiques entre la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, rejoints ensuite par le Danemark, l’Autriche et la Suisse. C’est lui qui offre à nos pays la possibilité d’entreprendre des projets communs, notamment l’implantation d’éoliennes en mer. Je souhaite vivement que soit mis en place un régime commun d’éolien en mer entre les pays de la Mer du Nord. Une concurrence entre la Belgique et la France n’aurait pas de sens. Les marchés de capacité nationaux ont des effets pervers. GDF Suez ne saura pas si elle doit situer son nouvel outil à Strasbourg ou de l’autre côté de la frontière : cela n’a aucune importance dans le marché pentalatéral de l’électricité.
Je souligne à cet égard l’incohérence dont fait preuve GDF Suez en demandant la fin des subventions pour les énergies renouvelables tout en voulant les conserver pour les unités de production d’énergies fossiles. Toute aussi incohérente est l’alliance contre nature qu’elle a noué avec le lobby constitué par RWE et Vattenfall qui gagnent beaucoup d’argent grâce au charbon et veulent tuer le back loading. Cette alliance est une énorme contradiction et a pour premier objectif d’empêcher que l’Union européenne mène une politique forte en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.
M. le président François Brottes. Je crois savoir, monsieur Turmes, que le Luxembourg est importateur d’électricité française.
M. Claude Turmes. Pour une très faible part !
Mme Gwenaëlle Huet. Monsieur Turmes, nous sommes globalement d’accord sur un grand nombre de points.
Instaurer un prix plancher du carbone est effectivement une piste intéressante, mais pour redonner de la compétitivité au gaz par rapport au charbon, il faudrait que ce prix se situe aux environs de 50 euros, ce qui, s’agissant d’énergies intensives, risque d’être difficile.
En ce qui concerne l’indexation des contrats sur le pétrole, nous sommes d’ores et déjà en train de renégocier tous nos contrats à long terme.
Non, nous ne demandons pas la suppression des subventions aux énergies renouvelables, nous souhaitons simplement que celles qui sont matures et déployées à l’échelle européenne soient progressivement intégrées dans le marché. Il ne s’agit pas de les priver de subventions, mais plutôt de leur accorder des primes en attendant que l’électricité qu’elles produisent soit vendue sur le marché.
M. Denis Baupin, rapporteur de la commission d’enquête. Je vous remercie, madame, monsieur, de nous avoir livré deux points de vue différents sur la politique énergétique européenne.
Vos analyses sont assez convergentes, en particulier sur le fait que les entreprises attendent des signaux politiques cohérents et que le libre marché ne saurait à lui seul opérer une transition énergétique. Vous êtes également d’accord sur le fait que le marché carbone ne fonctionne pas, ce qui pénalise la transition énergétique.
Madame Huet, l’Europe est-elle vraiment en surcapacité en base, sachant que les pointes et les aléas ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre ?
Mme Gwenaëlle Huet. Nous sommes en moyenne en surcapacité, et en sous-capacité dans les périodes de pointe. Nous sommes donc préoccupés par les multiples fermetures d’installations très flexibles, qui ont le mérite de pouvoir être mises en service en quelques minutes. Instaurer un mécanisme de rémunération de capacité permettrait de laisser tourner ces centrales qui seraient ainsi disponibles le moment venu. Actuellement, certaines centrales tournent 2 000 heures par an, or pour être rentables elles devraient tourner 6 000 heures.
M. Michel Sordi. Monsieur Turmes, je peux comprendre que le Bade-Wurtemberg porte sur Fessenheim un regard différent, mais cette centrale représente l’équivalent de 85 % de la consommation de ma région. Je rappelle, en outre, que le Bade-Wurtemberg achète de l’énergie à la centrale aux heures creuses et que nos amis allemands en sont les partenaires.
Madame Huet, l’émergence du gaz de schiste aux États-Unis bouleverse en effet le marché de l’énergie en entraînant la baisse du prix du charbon et de la tonne de CO2 ainsi que la relance des centrales à charbon. Dans ce contexte, que pense GDF Suez du marché européen de l’énergie ? Comment votre entreprise envisage-t-elle le développement du mix français ?
Comment donner de la visibilité aux prix de revient dans la durée ? Compte tenu des incertitudes géopolitiques, techniques et politiques qui pèsent sur l’exploitation des gaz de schiste en Europe, quel niveau d’indépendance énergétique minimal faut-il garantir à nos pays pour que leur économie ne soit pas trop exposée aux évolutions du prix du gaz ?
Monsieur Turmes, l’Allemagne a choisi d’engager la transition énergétique en sortant du nucléaire et en promouvant de façon volontariste les énergies renouvelables. Que pensez-vous de cette orientation ?
La production d’électricité en Allemagne est issue pour 45 % du charbon – dont 26 % de la lignite, dont la production vient d’atteindre son niveau le plus élevé depuis la réunification – pour 23 % des énergies renouvelables et pour 15 % de l’énergie nucléaire. Cette nouvelle répartition a entraîné une augmentation des émissions de gaz à effets de serre de 2 % en 2012 et de 2 % en 2013. Les conséquences des rejets de particules fines sur la santé des citoyens sont-elles prises en compte ?
Par ailleurs, le prix de l’électricité a atteint les limites du supportable en Allemagne. Jusqu’à quel niveau, selon vous, les consommateurs allemands accepteront-ils ces augmentations ?
M. Jean-Pierre Gorges. Madame Huet, l’électricité est fournie par des systèmes stables – le nucléaire et l’hydraulique – des systèmes d’appoint – l’énergie thermique, le gaz, le charbon – et des énergies renouvelables aléatoires – l’éolien et le photovoltaïque.
Dans le cadre de la transition énergétique, notre objectif est de maîtriser les émissions de carbone et les coûts de ces énergies, tout en conservant une certaine indépendance.
Nous sommes en train de changer de système alors que nous n’avons pas encore de solution stable. L’éolien et le photovoltaïque sont des productions très variables que nous ne mettons pas en service aussi souvent que nous devrions le faire. Lorsque c’est nécessaire, nous utilisons l’énergie issue du charbon et du gaz. En fait, nous ne sommes pas prêts pour la transition énergétique, faute de réponses technologiques fiables. L’extraction de gaz de schiste par les Américains a totalement perturbé le marché mondial et produit une réaction en chaîne plus grave que le nucléaire…
N’avez-vous pas le sentiment que tant que nous n’aurons pas de solution pour exploiter les énergies réellement renouvelables, le meilleur outil pour assurer la transition énergétique reste le nucléaire car il associe un coût intéressant, la propreté et une certaine indépendance énergétique. Ne devons-nous donc pas prolonger les centrales, en attendant de trouver des solutions efficaces et qui évitent toute spéculation ?
Mme Gwenaëlle Huet. La stratégie du groupe GDF Suez est de favoriser un mix équilibré et diversifié. Nous sommes présents partout et nous investissons dans toutes les nouvelles technologies. Nous sommes opérateurs en matière d’énergie nucléaire car nous pensons qu’elle est nécessaire en Europe. Mais nous agissons aussi pour la décarbonisation de l’ensemble de l’outil industriel énergétique en investissant dans les nouvelles technologies comme le stockage de l’électricité, les véhicules de demain et la capture de CO2.
Pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons besoin de signaux politiques. Si les représentants politiques ne se donnent pas pour mandat de mener à bien la transition énergétique, ils découragent les investisseurs. Notre rôle, en tant qu’énergéticiens, est de proposer à nos clients une large gamme d’offres énergétiques en leur montrant que tout est potentiellement réalisable et que nous sommes prêts à investir dans les nouvelles technologies. C’est ainsi que nous contribuons à la transition énergétique.
M. le président François Brottes. La capture de CO2, en redonnant aux centrales thermiques une virginité, ne risque-t-elle pas de donner une troisième vie au charbon ?
Mme Gwenaëlle Huet. Tous les démonstrateurs sont à l’arrêt ou ont été fermés. Le seul qui subsiste est le projet E.ON de GDF, à Rotterdam, mais il a été mis en difficulté par l’effondrement du prix du carbone.
Quel niveau d’indépendance faut-il conserver ? Il est généralement admis qu’un pays doit être indépendant : nous pensons, quant à nous, qu’il faut surtout avoir un approvisionnement très diversifié. C’est pourquoi notre approvisionnement n’est pas entre les seules mains de Gazprom. Nous allons renégocier tous nos contrats pour les rendre plus compétitifs et plus proches des prix du marché.
M. Jean-Pierre Gorges. Il est clair que vous répondez aux questions au nom de GDF Suez…
M. le président François Brottes. C’est à ce titre que nous avons invité Mme Huet.
M. Claude Turmes. L’Allemagne commet une erreur. Un clivage s’est d’ailleurs fait jour au sein même du CDU et du SPD et avec les industriels électro-intensifs qui voudraient que le carbone soit gratuit. La solution est d’instaurer un prix plancher commun à la France et à l’Allemagne, car la consommation d’électricité de ces deux pays représente 80 % du marché pentalatéral. Mme Merkel et M. Hollande se rencontrent le 19 février. Ils doivent impérativement mettre ce point à l’ordre du jour.
Par ailleurs, le rapport de la CRE (Commission de régulation de l’énergie) indique que lorsque le prix de l’électricité en Allemagne est inférieur à 42 euros – il devrait être de 38 euros en 2018 – les industriels électro-intensifs allemands obtiennent un meilleur prix que leurs homologues français.
M. le président François Brottes. Vous confirmez donc que les industriels électro-intensifs allemands ont accès à une électricité moins chère ?
M. Claude Turmes. Ces chiffres figurent dans le rapport de la CRE que j’ai adressé à la Commission européenne.
La stabilité de la consommation d’électricité est un mythe. En réalité, elle est très variable. Il suffit, pour s’en persuader, de regarder la consommation d’électricité en France le jour de la finale de la Coupe du monde de football.
Dans les années 1960, la France était équipée de quelques lignes à haute tension, situées essentiellement entre Paris et le Rhône du fait de la présence de barrages hydroélectriques. Lorsque votre pays a engagé son programme nucléaire, il a construit massivement des lignes à haute tension – dont la construction, d’ailleurs, a coûté aussi cher que celle du parc nucléaire ! Mais un réacteur nucléaire n’est pas assez flexible pour réagir aux fluctuations de la consommation. Certains proposent de construire des parcs de trois éoliennes, ce qui nécessite naturellement la présence d’un back up. Faut-il un back up derrière chaque réacteur nucléaire ? Non ! Ce n’est donc qu’en laissant toutes les productions dans le système que nous pourrons trouver un équilibre. Le marché pentalatéral permet précisément de réaliser des économies d’échelle car les pointes sont différentes d’un pays à l’autre.
RTE considère qu’il peut rencontrer deux problèmes majeurs : si deux centrales nucléaires françaises quittent le réseau en même temps et en cas de pic d’utilisation du chauffage électrique – nous savons qu’une baisse d’un degré entraîne une augmentation de consommation de 2 400 mégawatts. L’année dernière, le Portugal a produit 70 % d’électricité d’origine renouvelable, sans que le réseau ait eu à collaborer. Le Danemark en produit certains jours 80 %, l’Espagne 50 %. Nul doute que RTE et ERDF, qui sont parmi les meilleurs en Europe, sauront gérer ce problème.
S’agissant du stockage, nous travaillons à l’amélioration des piles à combustible, des batteries. Mais n’oublions pas que nous avons en Europe la chance de disposer d’un nombre important de barrages hydroélectriques. Au cours des cinq dernières années, nous avons quasiment doublé la capacité des barrages en Suisse, en Suède, en Norvège, au Luxembourg – qui possède le deuxième plus grand barrage hydroélectrique d’Europe. Notre capacité hydroélectrique est suffisante d’ici à 2025-2030.
Quant à la capture de CO2, je n’y étais personnellement pas opposé car si nous prenons au sérieux le changement climatique et si nous voulons que les industries décarbonisent, il nous faudra utiliser cette technique car c’est la seule que nous connaissons. Je suis d’ailleurs favorable au projet de démonstrateur industriel de Florange.
En ce qui concerne la production d’électricité, les courbes d’apprentissage de l’éolien sont bonnes et celles du solaire sont gigantesques : il est possible aujourd’hui de construire en France une grande centrale photovoltaïque pour un coût inférieur à 100 euros par mégawatt/heure. Mais, tous les experts le disent, il sera très difficile de parvenir au même prix pour une unité de production de charbon car ce prix doit tenir compte de l’usine chimique nécessaire pour extraire le CO2 et des travaux de forage. Le charbon est une solution pour certains pays comme la Pologne, mais il ne sera pas concurrentiel par rapport à l’éolien ou le solaire.
Pourquoi EDF ne fait-elle pas partie du groupe Magritte ? Parce que ses dirigeants savent pertinemment que le prix de marché actuel rend impossible, sans une garantie, de réinvestir dans le nouveau nucléaire. Je vous rappelle que le Gouvernement britannique projette de construire deux EPR à Hinkley Point.
Tous ceux qui considèrent que les coûts de production de l’éolien sur terre – environ 80 euros – et de l’énergie solaire – entre 90 et 110 euros – sont élevés devraient relativiser car le nouveau nucléaire coûtera quant à lui entre 130 et 150 euros. C’est la raison pour laquelle EDF, dans un souci de cohérence, n’a pas intégré le groupe surréaliste mis en place par GDF Suez.
M. le président François Brottes. Que pensez-vous de la logique européenne, parfois confrontée à des contradictions inextricables, par exemple entre les aides d’État aux tarifs de rachat pour les énergies renouvelables et le nucléaire en Angleterre, ou encore le fait que les industriels allemands ne paient pas le transport de l’électricité ? La Commission joue-t-elle correctement son rôle ? La Direction de la concurrence va-t-elle dans le sens d’un mix énergétique plus vertueux, ou chacun joue-t-il sa partition dans son coin ?
M. Claude Turmes. Je fais la différence entre les exonérations exagérées que l’Allemagne octroie à ses industriels – et qui posent un problème à l’industrie française – et les mesures prises par la Direction générale de la concurrence contre les aides aux énergies renouvelables. Il faut éviter que les industriels électro-intensifs s’implantent dans le pays où ils obtiennent les meilleures conditions. Demandez à un industriel électro-intensif à quel prix il veut payer le mégawatt/heure : il vous répondra 30 euros !
M. le président François Brottes. La semaine dernière, au cours d’une négociation à Québec, il a été fixé à 17 euros.
M. Claude Turmes. Si vous promettez à ceux qui consomment 40 à 50 % de l’électricité un prix dumping alors que l’Europe doit remplacer les deux tiers des centrales nucléaires et moderniser un réseau vieux de plus de 30 ans, il faudra faire payer les PME et les citoyens. Un rapport de la Banque publique allemande indique que depuis 30 ans, les prix de l’électricité pour les industriels sont moitié moins élevés aux États-Unis qu’en Allemagne. Pourtant l’industrie allemande est plus compétitive que l’industrie américaine : c’est que l’outil industriel européen est beaucoup plus productif et que nous sommes plus efficaces.
Selon Fatih Birol, d’ici à 2035, le prix de l’électricité sera légèrement plus élevé en Europe qu’en Chine, en Inde et aux États-Unis. N’allez pas croire qu’il baissera encore – sauf à trouver des budgets publics pour financer les investissements nécessaires.
La seule défense pour l’Europe est de rester la meilleure en matière d’efficacité énergétique. Je me bats à Bruxelles pour que les autorités européennes fixent un objectif contraignant et réduisent notre dépendance géopolitique. La dette énergétique de l’Europe – 500 milliards par an, soit 4 % de son produit brut – est plus élevée que la dette de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et de la France, et elle constitue le plus gros transfert de richesse entre un continent et les autres. C’est une gabegie monstrueuse. Au lieu de cela, nous pourrions créer de l’emploi en Europe en rénovant les bâtiments, nous pourrions aider les PME et les industriels à retrouver de la compétitivité. En bref, l’efficacité énergétique est plus importante que le développement des énergies renouvelables.
M. le président François Brottes. Ce qui est clair, c’est que le prix du marché de gros diminue, tandis que le prix pour le consommateur augmente. Nous marchons sur la tête !
M. Michel Sordi. Pouvez-vous me dire un mot sur l’impact de l’explosion du charbon en Allemagne sur la santé publique et le réchauffement climatique ?
Même s’ils suscitent l’appréhension de nos concitoyens, devons-nous augmenter le nombre des sites de stockage de gaz ?
Vous dénoncez le coût des lignes à haute tension, mais je rappelle qu’en Allemagne les champs d’éoliennes se trouvent dans le nord tandis que la plus forte consommation se trouve au sud, ce qui pose d’importants problèmes de transport. Cela ne doit-il pas nous inciter à conserver notre parc nucléaire, situé dans la plupart des cas près des zones où la consommation est la plus forte ?
M. Claude Turmes. Je pense que nous devons multiplier les sites de stockage de gaz.
Les centrales au charbon en Allemagne posent les mêmes problèmes que les véhicules diesel à Paris.
Enfin, les Allemands se sont effectivement heurtés à des problèmes d’acheminement de l’éolien du nord vers le sud, mais le dernier gouvernement a pris la décision de construire trois autoroutes de courant continu de la Mer du Nord et la Mer Baltique vers les centres de consommation. Nous sommes d’ailleurs en pourparlers pour prolonger ces autoroutes de l’électricité vers la Suisse.
M. Jean-Pierre Gorges. Cela entraîne d’énormes pertes en ligne !
M. Claude Turmes. Le courant continu génère peu de pertes ; or la plupart des nouvelles lignes transporteront du courant continu.
Autre avantage, une ligne de courant continu est comme un robinet qui peut être ouvert ou fermé à la demande, ce qui permet d’améliorer la stabilité du système et de résoudre le problème des électrons non contrôlés.
M. le président François Brottes. Nous connaissons en région PACA des problèmes d’acheminement des électrons en toute sécurité.
Mme Gwenaëlle Huet. GDF Suez est opérateur en matière de stockage de gaz en Europe. Le stockage est un instrument de flexibilité qui nous permet, avec les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), de fournir du gaz à nos clients pendant les périodes de forte tension.
Pour conclure, nous sommes satisfaits, chez GDF Suez, de la façon dont évolue la discussion. L’avenir de la politique énergétique européenne est désormais un sujet de débat dans la perspective des élections européennes.
M. François Brottes. Je vous remercie d’avoir participé à cette audition.
Audition de M. Philippe Van Troye, directeur général d’Electrabel,
et de M. Eric De Keuleneer, professeur à l’Université libre de Bruxelles
(Séance du jeudi 30 janvier 2014)
M. le président François Brottes. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Philippe Van Troye, directeur général d’Electrabel, opérateur principal – sinon unique – en Belgique, et qui appartient au groupe GDF-Suez, ainsi que M. Éric De Keuleneer, professeur à l’Université libre de Bruxelles.
Cette commission a choisi d’observer la place du secteur électronucléaire dans trois pays voisins dont l’approche est sensiblement différente : le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne.
La Belgique se trouve dans une situation quelque peu similaire à celle de la France puisque l’électricité d’origine nucléaire représente une part majoritaire de la production totale – 54 % –, part destinée du reste à décroître. On peut relever néanmoins une différence entre nos deux pays : les centrales nucléaires françaises sont principalement utilisées en base alors qu’elles sont en Belgique en semi-base et de ce fait – est-ce une réalité ? – davantage sollicitées.
La Belgique a fait un choix clair : la loi adoptée en 2003 proscrit la construction de nouvelles centrales nucléaires et impose la fermeture des centrales existantes après quarante ans d’exploitation, en l’occurrence entre 2015 et 2025. Cette limite est-elle intangible ?
Il semble que cette décision ait fait l’objet de débats assez vifs. L’exploitant principal des réacteurs devant fermer en 2015 a en effet travaillé à obtenir leur prolongation. Je crois savoir, en outre, qu’en raison de fissures, neutralisées par la suite, certaines centrales ont dû être fermées pendant un temps assez long, ce qui a suscité des problèmes entre les pouvoirs publics belges et l’opérateur, relevant même du contentieux, beaucoup d’argent étant en jeu. On rapporte enfin que la rente nucléaire a donné lieu, en 2011 et 2012, à des évaluations contrastées entre le régulateur – la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, la CREG – et l’exploitant – manière pudique de dire qu’ils n’étaient pas d’accord du tout.
Nous devons échanger librement sur tous ces points : loin de nous l’idée de juger les comportements de nos voisins.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Philippe Van Troye et Éric De Keuleneer prêtent serment)
M. Philippe Van Troye, directeur général d’Electrabel. Electrabel est en effet l’opérateur principal mais pas le seul propriétaire des centrales nucléaires belges. Nous partageons l’unité de Tihange 1 avec EDF à hauteur de 50 % chacun et EDF Luminus a une participation dans les unités de Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3.
M. le président François Brottes. Qui commande à Tihange 1 puisque vous êtes à parts égales avec EDF ?
M. Philippe Van Troye. L’opérateur prend les décisions quotidiennes mais des comités techniques et des comités de gestion communs se réunissent régulièrement. C’est le résultat d’une histoire du nucléaire qui était assez commune, au début, entre la Belgique et la France concernant les PWR.
La durée de vie des centrales nucléaires est limitée à quarante ans d’exploitation, non pour des raisons techniques mais politiques. Une loi a été votée en 2003 en ce sens et a été amendée fin décembre 2013 pour autoriser l’unité de Tihange 1 à poursuivre son activité jusqu’en 2025. Nous avons entamé depuis plusieurs années des discussions avec le gouvernement belge et avec le régulateur chargé de la sûreté nucléaire, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), de manière à développer un programme visant à identifier les éléments critiques qui doivent faire l’objet ou d’une maintenance particulière ou d’améliorations de la sûreté si la centrale est exploitée au-delà de quarante ans.
Plusieurs organismes jouent un rôle dans la gestion des déchets et le démantèlement des centrales : la Commission des provisions nucléaires (CPN) procède tous les trois ans à une révision de nos connaissances en matière de coûts de démantèlement et de gestion des déchets, laquelle est elle-même confiée à l’Organisme national belge des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF).
Notre programme de provisionnement se fondait jusqu’à présent sur des scénarios prévoyant une fermeture de toutes les unités après quarante ans d’exploitation. Nous sommes en train de le réviser à la suite de la décision de prolonger l’activité de l’unité de Tihange 1 de dix ans, avec l’idée de démanteler tous nos sites suivant un séquencement, les plus récentes devant fermer vers 2025 et les plus anciennes en 2015.
La rente de rareté nucléaire a fait l’objet d’un long débat, d’expertises et de contre-expertises. La Banque nationale de Belgique a publié un rapport en avril 2011 établissant la méthodologie à utiliser.
M. le président François Brottes. Qu’entendez-vous par « rente de rareté » ?
M. Philippe Van Troye. Selon la logique de merit order – de préséance économique – des unités utilisées, dans un marché libre, le prix de vente de l’électricité est fixé par la dernière unité mise en service à son coût marginal. Si vous utilisez du gaz naturel, le prix sera fonction du coût marginal de production du gaz naturel et, pour les technologies nucléaires, la marge sera importante entre le prix de l’électricité et son coût variable de fonctionnement – il s’agit donc d’une marge intramarginale qui n’a rien d’anormal.
Je reviens au débat sur l’énergie en Belgique, un second aspect ayant fait l’objet de discussions. Quand le marché de l’énergie, jusqu’alors régulé, a été ouvert, le secteur nucléaire avait été amorti (il l’a été au bout de vingt ans de fonctionnement), et les unités nucléaires pouvaient générer une rente intramarginale. Comme aucun dispositif particulier n’a été mis en place au moment de l’ouverture de ce marché, dans un contexte où les prix, dans les années 2000, ont augmenté sensiblement, l’exploitant a vu sa marge s’accroître. Cette situation se reproduit si vous décidez de prolonger une unité nucléaire amortie car les investissements que vous réalisez éventuellement ne seront pas ceux de la construction d’une nouvelle unité. Se pose donc toujours la question de savoir quel est le profit raisonnable qu’on peut réaliser – et je rappelle que ce secteur n’est pas le seul concerné.
M. le président François Brottes. J’ai travaillé sur la question du bonus-malus consistant à augmenter la facturation pour neutraliser les tensions de consommation et, à l’inverse, à diminuer la facturation lorsque la consommation est faible. Or, si j’ai bien compris, une facturation qui ne serait pas au prix moyen ferait disparaître la rente en question.
M. Philippe Van Troye. Seulement, en Belgique, nous n’avons pas gardé de tarification. Il est difficile de comparer nos deux pays où l’approche n’est pas tout à fait la même. Les autorités politiques belges ont instauré une redevance pour recapturer une rente jugée excessive. Une loi programme a été votée à cette fin en 2008, complétée par une loi en 2012 fixant l’ensemble des contributions de répartition à 550 millions d’euros par an, sur la base d’une analyse de rente réalisée en fonction des coûts de 2007. Or, du point de vue de l’exploitant, si l’on observe l’évolution des marchés de l’électricité en Europe, cette rente devrait faire l’objet d’une réévaluation.
M. Éric De Keuleneer, professeur à l’Université libre de Bruxelles. Je suis le secteur de l’énergie, tout en lui restant extérieur, depuis une vingtaine d’années. J’ai été appelé par le gouvernement belge en 1999 à présider un groupe d’experts pour préparer la libéralisation du marché de l’énergie. Celles de nos recommandations concernant la rente nucléaire, alors déjà évidente, n’ont malheureusement pas été suivies. Aussi m’arrive-t-il encore de formuler des suggestions et certaines sont parfois entendues.
Le débat en Belgique tourne en effet autour de la rente nucléaire et sur la manière de la capter. En France, le problème se pose différemment puisque vous avez gardé un système de tarification, de contrôle des prix, une bonne partie de la rente nucléaire revenant par conséquent au consommateur sous la forme de prix raisonnablement plus bas que dans d’autres pays et plus bas que les prix du marché. En Belgique, en revanche, la rente a été pendant de nombreuses années captée entièrement par les producteurs et, depuis 2006-2007, très partiellement par l’État. J’ai observé que les producteurs nucléaires, partout en Europe, avaient, de façon très concertée, fortement combattu toute taxation de la rente et qu’ils avaient toujours présenté cette obligation légale comme une contribution qu’ils payaient presque volontairement en échange d’une prolongation de l’activité des centrales.
M. Philippe Van Troye. La première redevance était basée sur un accord avec le gouvernement belge, établissant bien le lien entre les 250 millions d’euros et la prolongation des unités de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Or cet accord n’a pas été respecté.
M. Éric De Keuleneer. Tout à fait. Le propos de M. Van Troye illustre le fait que c’était une obsession pour les producteurs nucléaires de bien lier le paiement de la redevance à une prolongation de l’exploitation des unités. Le Gouvernement est revenu sur ce point, selon moi à juste titre, parce que l’accord était fondé sur des informations mensongères concernant le prix de revient. Electrabel continuait de prétendre qu’il était de 30 à 35 euros par mégawattheures (MWh) alors que je prétendais qu’il n’était, en 2004-2005, que de 15 à 20 euros par MWh. Les études évoquées l’ont estimé à quelque 20 euros par MWh.
M. le président François Brottes. Ce prix comprend-il le démantèlement, le traitement des déchets… ?
M. Éric De Keuleneer. Tout à fait. Mais il ne tient pas compte du risque civil.
Le débat reste centré autour du prix de revient du nucléaire amorti, du nucléaire prolongé, du nucléaire nouveau, prix variant très sensiblement selon le cas. Pour le nucléaire amorti, il est de l’ordre de 15 euros par MWh. Les études de la CREG et de la Banque nationale l’évaluent, quant à elles, à quelque 20 euros mais en tenant compte de marges bénéficiaires importantes.
M. le président François Brottes. En fonction de quelle durée de vie pour les centrales ?
M. Éric De Keuleneer. Sur une durée de vie de quarante ans. Les centrales belges ont été amorties en vingt ans et prolongées de vingt à quarante ans sans compensation économique. Le consommateur a, par conséquent, supporté la charge de l’amortissement sur vingt ans.
M. le président François Brottes. Vous considérez donc que le coût, auparavant plus élevé, est réduit à presque rien après vingt ans d’amortissement.
M. Éric De Keuleneer. Tout à fait : la charge d’amortissement était bien sûr plus élevée pendant les vingt premières années d’exploitation de chaque centrale ; comme le marché était régulé, le coût de production était intégralement facturé au consommateur. On lui a promis que les coûts baisseraient une fois les unités amorties pour ensuite lui expliquer que, le marché étant désormais libéralisé, la rente profiterait à l’exploitant et non à lui. Cette vision certes quelque peu schématique ne vise pas du tout M. Van Troye qui n’était en fonction à l’époque. Je pense également que les pouvoirs publics belges et le régulateur belge se sont montrés complètement naïfs ou complaisants.
Le prix de revient du nucléaire belge amorti est très faible et, depuis 2002, il n’est retourné à la collectivité belge que sous forme de cette petite taxe représentant quelques euros par MWh. J’évalue donc le prix de revient à 14 euros par MWh en exploitation courante. La prolongation pour une tranche de 900 MW se fera aussi grâce à des investissements de jouvence et un impact sur les prix à mon avis beaucoup plus faible que celui accepté par le Gouvernement.
Le coût du démantèlement et du retraitement a déjà été dans une très large mesure entièrement facturé au consommateur et a fait l’objet d’une mise en provision d’abord comptable puis effective au sein d’une filiale du groupe GDF-Suez, Synatom. Ces montants sont significativement plus importants, proportionnellement, que ceux dont il est question dans votre étude mais sans qu’on sache s’ils sont suffisants. Ces provisions sont encore largement détenues par les producteurs, ce qui est un non-sens économique et financier puisqu’elles se trouvent par là à la merci de la santé de ces derniers. Ces provisions ont été individualisées afin de s’assurer que l’argent sera disponible même en cas de défaillance du producteur nucléaire.
M. le président François Brottes. Il s’agit d’une sanctuarisation, en quelque sorte.
M. Éric De Keuleneer. Ces provisions n’ont pas vraiment été sanctuarisées puisqu’elles restent au sein du groupe. Je fais partie de ceux qui plaident, depuis quinze ans, pour leur sortie du groupe et les progrès en la matière se sont révélés très faibles.
Il y a donc de l’argent pour le démantèlement et pour le retraitement.
M. Denis Baupin, rapporteur. De quel retraitement parlez-vous ?
M. Éric De Keuleneer. De celui du combustible.
M. le rapporteur. Pour le stockage ?
M. Éric De Keuleneer. Oui.
M. Philippe Van Troye. Pendant plusieurs années, nous avons retraité le combustible usé, en France, mais cette opération a été interrompue par une décision politique, il y a plusieurs années. Il est aujourd’hui stocké dans des piscines ou à sec selon qu’il provient du site de Doel ou de celui de Tihange. Différents scénarios sont envisagés tous les trois ans : celui de la reprise du retraitement ou celui d’une évacuation directe.
M. le président François Brottes. Quand vous évoquez une décision politique, il s’agit d’une décision prise par les pouvoirs publics et non par l’opérateur ?
M. Philippe Van Troye. Tout-à-fait.
M. le rapporteur. Le débat se pose en effet en termes différents dans les deux pays, notamment pour ce qui concerne la rente.
M. le président François Brottes. Néanmoins, même si la schizophrénie n’est pas tout à fait la même qu’en Belgique, l’opérateur nucléaire, en France, verse des dividendes à l’État.
M. le rapporteur. La loi belge prévoit la fermeture des réacteurs nucléaires au bout de quarante ans d’exploitation avec une exception pour l’unité de Tihange 1. Qui a décidé cette prolongation de dix ans : l’opérateur, l’AFCN ou le Gouvernement ? Est-ce pour des raisons de vieillissement trop important de la centrale que cette décision n’a pas été prise pour Doel 1 et 2 ? Est-ce que les investissements se seraient révélés trop importants pour pouvoir prolonger la durée de l’exploitation de ces unités ? Votre réponse m’intéresse d’autant plus que les mêmes questions vont se poser en France.
Ma deuxième question porte sur la prolongation de l’unité de Tihange 1 : le programme d’investissements est de 600 millions d’euros. Dans le même temps, EDF a annoncé 50 milliards d’euros pour le « grand carénage ». Malgré la difficulté d’établir des comparaisons, comment expliquez-vous qu’on consacre, d’un côté, 600 millions d’euros pour un réacteur et, de l’autre, 50 milliards d’euros pour les 58 réacteurs français.
Ma troisième question concerne les unités de Doel 3 et Tihange 2, fermées pour cause de fissures, puis rouvertes. L’Autorité de sûreté nucléaire française avait émis des réserves sur cette réouverture et souhaité que soient réalisés des tests complémentaires. Nous avons donc une autorité de sûreté, d’un côté de la frontière, qui estime que ces réacteurs ne peuvent pas redémarrer, et une autorité de sûreté, de l’autre côté de la frontière, qui considère que la reprise d’activité est possible. Quelle est votre appréciation sur cette divergence plutôt inquiétante ?
M. Philippe Van Troye. La décision de prolongation de l’unité de Tihange 1 est avant tout politique et fait suite à une étude lancée par le secrétaire d’État à l’énergie sur les perspectives de sécurité d’approvisionnement d’électricité en Belgique. Cette étude a conclu que si l’on maintenait la décision de fermeture à la fois des unités de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, des problèmes surviendraient à l’horizon 2015, et que le meilleur moyen d’y répondre était la prolongation de dix ans de l’une des unités. Le choix de Tihange 1 ne répond pas à des considérations techniques – nous avions établi des dossiers de prolongation pour les unités de Doel 1 et 2 et Tihange 1 – mais en partie économiques : on a préféré le moindre coût.
M. le rapporteur. De ce point de vue, quelles sont les différences entre les sites concernés ?
M. Philippe Van Troye. Les différences ont essentiellement porté sur les plans de jouvence à réaliser au sein de ces unités. Il fallait remplacer certains équipements des unités de Doel 1 et 2 – d’ailleurs pas spécifiquement nucléaires –, ce qui n’était pas le cas pour le site de Tihange 1.
M. le rapporteur. À combien a été estimée la différence entre Doel 1 et 2 et Tihange 1 ?
M. Philippe Van Troye. La prolongation de l’exploitation des unités de Doel 1 et 2 aurait coûté 900 millions d’euros contre 600 millions d’euros pour l’unité de Tihange 1.
M. le président François Brottes. Il s’agit donc d’une décision politique et économique mais qui n’a rien à voir avec la sûreté nucléaire !
M. Philippe Van Troye. De manière à préparer cette décision, nous avions dès 2008 lancé des études sur la question de savoir quels investissements seraient nécessaires pour pouvoir prolonger les unités au-delà de quarante ans et nous avions fourni à l’Autorité de sûreté un dossier proposant des éléments de réponse sur le remplacement des équipements vieillissants et sur les améliorations à apporter en matière de sûreté.
M. le rapporteur. Aussi, les sommes de 600 et 900 millions d’euros évoquées concernent également la sûreté ?
M. Philippe Van Troye. Tout à fait. Les 600 millions d’euros consacrés au site de Tihange 1 prévoient le remplacement d’équipements mais aussi des améliorations de sûreté. Sur ces 600 millions, 200 seront consacrés à ce qu’on appelle en France la « bunkérisation » qui permet de mettre le réacteur à l’arrêt en toute sûreté et garantit sa résistance aux agressions extérieures. Ce dispositif est spécifique au site de Tihange 1 car toutes les autres unités disposaient d’emblée d’un système de « bunkérisation » de plusieurs trains de mise à l’arrêt, de plusieurs sources de refroidissement.
Quant à la comparaison entre les 600 millions d’euros dont il est ici question avec les 50 milliards d’euros qu’EDF va consacrer au grand carénage, il convient de rester très prudent : la configuration initiale n’est pas toujours la même. Les stress tests réalisés à l’échelle européenne sont à cet égard instructifs.
M. le rapporteur. Que sous-entendez-vous exactement ?
M. Philippe Van Troye. Je sous-entends que les systèmes de sûreté mis en place dans le design initial, complexes, peuvent être très différents. En Belgique, les centrales étant très proches de zones très habitées ou très industrielles, on a fait le choix, pour les unités de Tihange 2, Tihange 3, Doel 3 et Doel 4, de plusieurs trains de sûreté bunkérisés, de plusieurs sources de refroidissement indépendantes, ce qui a certes renforcé le coût de l’investissement initial mais, si l’on procède à un stress test, on obtient un design globalement plus robuste.
M. le président François Brottes. Quelque 600 millions d’euros pour prolonger l’exploitation d’une centrale, ce n’est pas grand-chose…
M. Philippe Van Troye. Si vous partez du principe que 1 000 MW produisent en moyenne, si l’on retire les révisions, 7,5 TWh par an, cela représente environ 8 euros de coût supplémentaire par MWh qui vous donnent droit, en toute logique, à une rémunération raisonnable sur le capital nouveau que vous investissez.
M. le président François Brottes. À quel chiffre cela nous amènerait-il ?
M. Éric De Keuleneer. Le gouvernement belge a accepté que le coût de ce plan de jouvence serait d’environ 14 euros par MWh ; ce qui, à mon avis, est excessif. Il faudrait vérifier la somme de 600 millions d’euros. Quant à la rémunération du capital, le gouvernement belge a accepté qu’elle soit de l’ordre de 9 % sur un financement constitué entièrement de fonds propres. C’est très curieux car le régulateur, pour des investissements dans le secteur électrique, n’accepte un coût du capital que de 4 à 5 %, estimant qu’une partie substantielle peut être financée par l’emprunt et eu égard à la rémunération du marché. Donc fixer un rendement à 9 % semble très élevé, d’autant qu’il concerne les 600 millions d’euros pendant toute la durée de la prolongation alors qu’année après année, les montants sont amortis. Le calcul de la rémunération du capital est exorbitant.
M. le président François Brottes. Vous êtes en train de nous expliquer qu’il est très rentable de prolonger la vie des centrales.
M. Éric De Keuleneer. Tout à fait. La Belgique est un cas spécifique : les centrales amorties permettent de produire à un coût très faible et le plan de jouvence ne devrait pas augmenter ce coût réel de plus de 10 euros par MWh. Si l’on part de 14 ou 15 euros aujourd’hui, on arrive à 25 euros par MWh alors que les prix du marché, même après leur baisse, sont encore de l’ordre de 40 à 45 euros par MWh. Et l’opération reste d’autant plus rentable que le coût de démantèlement est déjà intégré et que, dans une certaine mesure, la prolongation de dix ans retarde la nécessité du coût du démantèlement. On aurait presque dû imputer les coûts de jouvence sur les provisions de démantèlement.
M. le rapporteur. J’y insiste : en France, en cas de prolongation de l’exploitation d’un réacteur nucléaire au-delà de quarante ans, l’Autorité de sûreté nucléaire exigerait le respect des normes de sûreté les plus importantes en vigueur sur le territoire national, à savoir celles concernant l’EPR. Estimez-vous que les normes en vigueur à Tihange 1 équivalent à ce référentiel de sûreté ou bien, comme cela ne vous est pas demandé, vous n’avez pas pris les mesures le permettant ?
M. Philippe Van Troye. Les autorités de sûreté belge et française ont une approche assez similaire. Elles demandent que les options de sûreté supplémentaires permettent de répondre aux mêmes exigences de résistance à différents types d’incidents et d’accidents. Évidemment, pas plus en Belgique qu’en France on ne saurait faire d’une centrale d’il y a quarante ans un EPR. C’est une question de fonctionnalité, pas de design. En outre, les autorités de sûreté française et belge travaillent régulièrement ensemble sur ces sujets.
M. le rapporteur. Alors comment expliquez-vous cette différence d’appréciation tout de même frappante entre l’Autorité de sûreté française et l’Autorité de sûreté belge concernant les unités de Doel 3 et Tihange 2 ?
M. Philippe Van Troye. Il y a eu en effet une demande de l’Autorité de sûreté nucléaire française – qui participait d’ailleurs à l’analyse du dossier avec l’Autorité de sûreté belge – de ne pas autoriser dès le début 2013 le redémarrage des unités mentionnées avant que ne soit réalisée une série de tests complémentaires, notamment en matière d’essais mécaniques et de résistance des cuves. Or les unités concernées sont restées fermées pendant six mois pour que ces essais soient effectués, cela sous le contrôle de l’Autorité de sûreté belge qui, puisque tous les tests complémentaires ont répondu aux attentes, a émis un avis positif.
M. Michel Sordi. L’expertise et l’indépendance de l’Autorité de sûreté nucléaire française sont unanimement reconnues dans le monde. Reste qu’elle a autorisé l’exploitation des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim pour dix années supplémentaires mais que pour des raisons politiques, un autre chemin a été pris…
L’autorisation a été donnée pour cinquante ans par l’Autorité de sûreté belge pour l’unité de Tihange 1 avec 600 millions d’euros d’investissements. Le rapport qualité-prix est tout à fait raisonnable. Je rappelle que la centrale de Fessenheim apporte à EDF 500 millions d’euros par an.
M. Philippe Van Troye. Dans l’un des documents que j’ai fait distribuer se trouve un résumé de la décision du conseil des ministres à propos de la prolongation d’exploitation de l’unité de Tihange 1, qui montre que la base des coûts ne se situe plus aux alentours de 15 euros par MWh. Les ordres de grandeur sont donc assez différents.
M. Éric De Keuleneer. C’est vrai mais la manière dont on est passé à 28 euros reste tout de même un mystère.
M. Philippe Van Troye. Ce n’est pas un mystère : la CREG vérifie nos coûts et ce sera le cas dans le cadre de la programmation de Tihange 1.
M. Éric De Keuleneer. Mais les 28 euros ne sont pas validés.
M. Philippe Van Troye. Ils vont l’être.
M. le rapporteur. Il est très intéressant pour cette commission d’entendre des personnalités qui n’ont pas le même point de vue, ce qui nous permet d’être mieux éclairés. Une dernière question : la prolongation de l’exploitation de l’unité de Tihange 1 a-t-elle été prise par le Gouvernement ou par le Parlement ?
M. Philippe Van Troye. Par le Parlement qui a modifié la loi.
M. le président François Brottes. Merci d’avoir répondu à notre invitation.
Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA
(Séance du jeudi 6 février 2014)
M. le président François Brottes. Monsieur Oursel, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête. À titre exceptionnel, cette audition se déroulera à huis clos et ne fera pas l’objet d’un enregistrement vidéo.
Nous nous concentrerons ce matin sur les questions liées au combustible nucléaire. Le nucléaire est souvent présenté comme une énergie non carbonée, ce qui choque toujours notre rapporteur, M. Denis Baupin. Il est aussi présenté comme une énergie propre, alors qu’il génère des déchets. On souligne aussi que cette énergie permet de garantir l’indépendance nationale, mais notre sous-sol ne recèle plus, ou pas, le combustible nécessaire à cette autonomie – cette question a donné lieu naguère à de vigoureux débat avec M. Yves Cochet. Le combustible nucléaire est-il inépuisable ? Les générations de réacteurs à venir sont-elles susceptibles de nous libérer de notre dépendance à l’égard de l’uranium ?
En 2013, AREVA a réalisé près de 19 % de son chiffre d’affaires, soit 1,8 milliard d’euros, dans le secteur minier, et près de 24 %, soit 2,2 milliards d’euros, dans le secteur amont, qui regroupe les activités de conversion, d’enrichissement et de fabrication de combustible. Ces chiffres, qui ne concernent pas seulement EDF, mais l’ensemble des clients d’AREVA, donnent la mesure des enjeux pour votre entreprise. Votre prédécesseur insistait du reste sur le fait qu’AREVA intervient sur la totalité du cycle nucléaire, en faisant même une affaire d’éthique pour l’entreprise. Je ne pense pas que cette stratégie ait changé sous votre autorité.
Le nucléaire est l’une des industries les plus capitalistiques et l’essentiel de ses coûts sont liés au capital, de sorte que la compétitivité de la production d’électricité nucléaire n’est acquise qu’à condition que le coût du combustible soit maîtrisé. Ce combustible est-il rare ou non ? La France est-elle prise dans des négociations « impossibles » avec certains États ? Par ailleurs – et c’est l’une des raisons justifiant la tenue de cette audition à huis clos –, la production de combustible peut mettre en jeu la vie d’hommes et de femmes dans certains pays, comme on l’a malheureusement déjà observé. Tout-à-l’heure, nous interrogerons d’ailleurs un représentant du ministère des affaires étrangères sur la dimension politique du problème. Il reste toutefois cette question essentielle que nous vous posons en premier : quelle est la réalité de notre dépendance à un combustible rare et, peut-être, de plus en plus cher ?
Monsieur Oursel, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande maintenant de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Luc Oursel prête serment)
M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA. Mon exposé se concentrera particulièrement sur l’uranium naturel, c’est-à-dire sur l’activité minière d’AREVA, car les autres activités de l’entreprise – conversion, enrichissement et « assemblage » de combustible – sont réalisées en totalité dans nos installations situées sur le territoire français, ce qui les rend moins tributaires des difficultés géopolitiques et internationales.
Je dresserai donc rapidement un panorama du marché international de l’uranium naturel, avant d’évoquer son impact sur le coût de la filière, puis la place qu’occupe aujourd'hui AREVA dans ce domaine.
Les réserves identifiées d’uranium naturel sont aujourd’hui évaluées par l’OCDE à 130 années de consommation, compte non tenu des conséquences positives que pourraient avoir le développement de nouvelles technologies moins consommatrices d’uranium naturel, comme la quatrième génération de réacteurs, et la généralisation du retraitement tel qu’il est pratiqué en France. Que le chiffre retenu soit celui de 130 ou celui de 100 années, on peut le comparer aux évaluations des réserves de pétrole et de gaz – une cinquantaine d’années pour le pétrole et légèrement plus pour le gaz – et de celles de charbon, évaluées à 100 ou 110 années.
Quarante-quatre pour cent de ces ressources se situent dans des pays de l’OCDE, contre 17 % pour le pétrole et 8 % pour le gaz. Le pays qui en détient le plus est l’Australie, avec 31 % du total, suivie du Canada, avec 9 %, des États-Unis, avec 4 %, le Kazakhstan et le Niger comptant ensemble pour 20 %.
En 2013, le total de la production mondiale d’uranium naturel s’élevait à 54 000 tonnes, ce qui est peu par rapport à d’autres combustibles, mais c’est précisément une caractéristique de l’énergie nucléaire que de ne pas nécessiter la manipulation d’une importante quantité de matière pour obtenir un important potentiel énergétique.
La liste des principaux producteurs ne correspond pas à celle des principaux détenteurs de ressources. En tête vient le Kazakhstan, avec 40 % de la production mondiale. Dès le début des années 2000, en effet, ce pays a lancé une politique très agressive de développement de son potentiel, politique qui porte aujourd’hui ses fruits. Viennent ensuite le Canada, avec 15 % de la production mondiale, puis l’Australie avec 10 %, le Niger avec 8 % et la Russie avec 6 %.
Cette offre « primaire », c’est-à-dire issue des mines d’uranium naturel, est complétée par des ressources « secondaires », correspondant au recyclage de l’uranium très enrichi issu du démantèlement des arsenaux nucléaires russe et américain. En 2013, ces ressources ont représenté pour AREVA un montant très important. S’y ajoutent les matières issues du recyclage des combustibles usés et les stocks importants détenus par le Department of Energy américain, qui les relâche régulièrement sur le marché en fonction de ses propres besoins budgétaires. Enfin, les nouvelles technologies d’enrichissement permettent aujourd’hui de réenrichir l’uranium appauvri, qui constitue désormais une ressource assez significative.
On dénombre sur le marché de l’uranium peu de vendeurs et d’acheteurs – ces derniers étant, à l’exception de quelques traders, les compagnies électriques elles-mêmes. Les stocks sont importants : deux ans et demi de consommation aux États-Unis et trois ans et demi en Europe, tandis que la Chine a engagé une politique très agressive de constitution de stocks stratégiques pour accompagner le développement de son programme nucléaire.
La part de l’uranium naturel représente moins de 5 % du coût de production du kilowattheure nucléaire. En y ajoutant la transformation de cet uranium en combustible – conversion, enrichissement et assemblage –, cette part est encore inférieure à 10 % du coût complet du nucléaire. De fait, l’essentiel de ce coût – jusqu’à 70 % – est constitué par les dépenses d’investissement, les 30 % restants correspondant aux charges d’exploitation et de maintenance, dont 10 % donc pour le combustible. Ainsi, un doublement du coût de l’uranium naturel induirait une augmentation de moins de 5 % du coût total de la production d’énergie nucléaire – de l’ordre de 3 à 4 % au cours actuel.
M. le président François Brottes. Est-ce là un appel invitant les fournisseurs à doubler leurs prix ?
M. Luc Oursel. AREVA ne pourrait que se réjouir d’une telle évolution – qui devrait du reste se produire, car les prix sont, à la suite de l’accident de Fukushima, très bas. C’est en tout cas une caractéristique de l’énergie nucléaire que son coût soit relativement insensible au prix de la matière première, à la différence de celui des centrales à charbon ou au gaz – où le coût de production dépend pour 60 % du coût du gaz.
Selon nos estimations – car AREVA ne fournit pas 100 % de l’uranium qu’utilise cette entreprise –, les importations d’uranium naturel coûtent annuellement à EDF entre 500 et 600 millions d’euros, ce qui est marginal par rapport à la facture énergétique française, laquelle se situe, selon le prix des combustibles, entre 60 et 70 milliards d’euros.
La proportion des transactions effectuées sur le marché spot de l’uranium naturel n’est que de 10 à 15 %, car la plupart des électriciens préfèrent signer des contrats d’approvisionnement de long terme. Nous avons ainsi signé en 2013 avec EDF un contrat portant sur des livraisons jusqu’en 2035 – EDF est à cet égard un bon client, car les électriciens américains préfèrent les achats à plus court terme. Ces 85 % de transactions à long terme sont assorties de prix mixtes associant un prix de long terme, un prix spot et, parfois, des composantes liées aux coûts.
Après l’arrêt de quelques réacteurs nucléaires allemands et, surtout, celui des réacteurs japonais à la suite de l’accident de Fukushima, le prix spot a connu une très forte diminution, passant de 73 dollars la livre avant Fukushima à 44 dollars à la fin de 2012, puis à 35 dollars à la fin de 2013 – soit une diminution de moitié. Cela ne signifie pas que le prix des approvisionnements a été divisé par deux, car le prix spot ne s’applique qu’à une partie des transactions. Elle montre cependant le très fort impact sur le marché du retrait des acheteurs japonais. Ce déséquilibre passager est partiellement compensé par les achats importants effectués par la Chine pour constituer des stocks stratégiques.
L’analyse réalisée par un organisme spécialisé a montré que le prix à long terme avait lui aussi diminué, passant de 56 dollars la livre à la fin de 2012 à 50 dollars à la fin de 2013. Face à cette situation, de nombreux producteurs miniers ont annoncé le report, voire l’annulation de projets de développement de nouvelles mines. D’ici à 2020, la croissance du marché, notamment avec l’augmentation des capacités nucléaires dans le monde, en particulier en Asie, devrait se traduire par une augmentation des besoins, et donc des prix de long terme – qui, selon les prévisions de la profession, devraient retrouver en 2020 leur niveau de la fin de 2012, soit 56 dollars la livre.
Les activités minières occupent une place très importante dans les activités d’AREVA qui, avec une production de 9 300 tonnes en 2013, fait partie des quatre principaux producteurs, avec le Kazakhstan, le Canadien CAMECO et le russe Rosatom. Sur une quarantaine de milliards d’euros de commandes pour l’ensemble des activités d’AREVA, l’uranium représente près de 10 milliards d’euros.
Notre entreprise bénéficie déjà d’une relative diversification géographique de sa production, avec un site au Kazakhstan, deux mines au Niger et un site au Canada. C’est là une spécificité par rapport à nos concurrents, qui sont généralement beaucoup plus concentrés géographiquement : KazAtomProm ne produit qu’au Kazakhstan et de grands concurrents comme Rio Tinto ne le font en général que dans deux pays.
Nous procédons également à des achats sur le marché. Nous avons ainsi acquis, à la suite de l’arrêt des centrales du pays, des stocks détenus par les consommateurs japonais et nous avons commercialisé, à des fins évidemment pacifiques, une partie de l’uranium hautement enrichi mis sur le marché au terme d’un programme de démantèlement des armes russes et américaines, soit 2 600 tonnes.
La diversification n’est cependant pas encore arrivée à son terme et nous avons engagé deux projets en vue de la poursuivre.
Le premier est celui de la mine de Cigar Lake, au Canada, que nous exploitons en partenariat avec l’un de nos concurrents – car, comme c’est le cas dans l’industrie pétrolière, la taille des projets pousse souvent les producteurs à s’associer – et où la production débutera en 2014. Cette mine présente des teneurs en uranium très élevées et son exploitation sera totalement automatisée. Les premiers indices géologiques révélateurs de ce gisement ont été découverts alors que je faisais mes premiers pas dans une mine d’uranium, au Gabon, en 1982 : ces trente années sont un délai particulièrement long, mais il n’est pas rare qu’il s’écoule une quinzaine d’années entre la découverte des premiers indices d’un gisement et sa mise en exploitation.
Le deuxième projet important sur lequel nous travaillons est celui de la mine d’Imouraren, au Niger, qui pourrait produire jusqu’à 5 000 tonnes par an. Afin d’éviter le risque de déséquilibre que pourrait avoir la mise immédiate sur le marché d’une telle quantité d’uranium, nous réfléchissons au moment qui serait le plus opportun pour le lancement de cette production.
Nous poursuivons en outre nos activités de développement et d’exploration. Au Canada, la loi qui interdisait à un opérateur étranger de posséder plus de 49 % d’un gisement minier et imposait donc systématiquement le recours à un opérateur canadien a été abrogée à la suite des négociations qui ont eu lieu avec l’Union européenne. Nous pourrons ainsi intensifier nos activités dans ce pays.
En Mongolie, après de nombreuses années d’efforts, nous avons constitué en octobre 2013, à la suite de la visite du ministre des affaires étrangères, une joint venture avec la société nationale pour commencer à développer des gisements qui entreront en production d’ici une dizaine d’années.
En Namibie, un projet achevé à 80 % a été mis sous cocon car nous pensons qu’il n’aurait pas de débouchés sur le marché.
Les explorations se poursuivent d’autre part au Gabon et au Canada, pour certaines en partenariat avec le groupe japonais Mitsubishi.
Nos réserves représentent actuellement 28 années de production, l’objectif étant de disposer toujours de réserves supérieures à vingt années de nos besoins. Mais l’activité d’exploration et de développement est également nécessaire pour maintenir la compétence des géologues et notre capacité à traiter les minerais afin d’en extraire l’uranium.
Partout où nous travaillons, nous adoptons une logique de long terme, ce qui suppose une attention particulière à la sécurité, à l’environnement et à la bonne insertion dans l’économie locale.
En matière de sécurité, nous appliquons partout la même norme, indépendamment des réglementations nationales, parfois moins exigeantes : nos personnels doivent recevoir moins de 18 millisieverts par an et font l’objet d’un contrôle individuel, effectué par des organismes indépendants. Au Niger, nos employés et sous-traitants ont reçu moins de 3 millisieverts, la dose maximale enregistrée par une personne étant de 16 millisieverts.
Nous sommes également très attentifs à la sécurité des activités minières souterraines ou à ciel ouvert. Le taux de fréquence des accidents est de 1,08, soit 24 fois moins que la moyenne de l’industrie française, toutes activités confondues.
En ce qui concerne l’environnement, nous développons dans tous les pays où nous sommes présents, notamment au Niger, des systèmes de surveillance constante de l’eau, de l’air, des sols et de la chaîne alimentaire et respectons la limite fixée de 1 millisievert par an de dose ajoutée pour le public, qui correspond à peu près au rayonnement naturel.
Sachant que notre présence dans ces pays est durable, nous veillons à assurer un développement de nos activités en harmonie avec l’environnement économique et social national. Au Niger, par exemple, nous avons construit des hôpitaux, que nous faisons fonctionner et dont l’accès est gratuit pour la population d’Arlit, les employés d’AREVA ne représentant que 30 % des consultants. Nous menons également de nombreuses actions dans les domaines de l’éducation et du développement économique, par exemple un programme d’irrigation lancé avec le gouvernement dans le nord du pays. Bien entendu, plus nous sommes avancés dans les projets miniers, plus ces partenariats économiques font l’objet de discussions avec les gouvernements locaux.
J’en viens à l’amont, c’est-à-dire aux trois étapes de la fabrication du combustible. La conversion est réalisée en France, à Malvési et au Tricastin. À Malvési, nous avons investi plusieurs centaines de millions d’euros, dans le cadre du projet Comurhex 2, pour renouveler nos installations et les rendre capables d’assurer dans la durée la sécurité de l’approvisionnement et de l’environnement. Au Tricastin aussi, nous avons investi plusieurs millions d’euros pour construire une nouvelle usine d’enrichissement, beaucoup moins énergivore, dénommée Georges-Besse II, qui utilise des technologies de centrifugation. Nous avons déjà atteint 75 % de la capacité d’enrichissement que nous visions. Quant à l’assemblage du combustible, il est principalement réalisé à l’usine de Romans, qui couvre la quasi-totalité des besoins d’EDF. À la différence de nos concurrents, nous assurons la mise en œuvre du zirconium et des châssis d’assemblage d’une manière parfaitement intégrée entre différentes usines situées sur le territoire français.
La relation avec EDF est bien évidemment essentielle mais, comme pour l’ensemble de nos activités, notre objectif est d’être présents dans le monde entier auprès des électriciens nucléaires. Avec 25 % du chiffre d’affaires d’AREVA, EDF en est aujourd’hui le premier client, mais non le seul, les 75 % restants étant réalisés sur le marché international.
M. le président François Brottes. Combien d’emplois les activités que vous venez d’évoquer représentent-elles ?
M. Luc Oursel. L’activité minière ne procure pratiquement pas d’emplois en France, hormis pour trois centaines d’ingénieurs et d’experts chargés du développement des projets et du traitement des minerais, notamment dans notre centre de recherche de Bessines, au centre du Limousin. Les effectifs miniers, très variables selon les technologies, se montent à 6 000 personnes sur l’ensemble de nos projets.
M. le président François Brottes. Et CERCA, à Romans ?
M. Luc Oursel. CERCA fabrique essentiellement des combustibles pour les réacteurs de recherche et emploie environ 250 personnes. Je précise que ce site travaille avec de l’uranium naturel plus enrichi.
M. Denis Baupin, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur la question de l’indépendance nationale, car vous avez bien montré que, si la France doit importer l’uranium, votre entreprise s’emploie à minimiser les risques pesant sur l’approvisionnement et à limiter les coûts. Mes questions porteront plutôt sur vos prévisions quant à l’évolution du marché et sur l’impact que peut avoir celle-ci sur votre entreprise.
Tout d’abord, des prix bas se traduisent-ils par une moindre rémunération de la matière première ou par une réduction de la marge de l’entreprise ? Qu’en est-il en cas de hausse des prix ?
Votre entreprise envisage-t-elle d’avoir une activité en Australie ?
Le fait que 36 % de l’uranium vienne du Niger et 38 % du Kazakhstan, deux pays dont la stabilité n’est pas garantie, ne peut-il laisser craindre une vulnérabilité géopolitique de vos approvisionnements ? Quelle est, en particulier, votre analyse des perspectives du Kazakhstan ?
Répondant hier à une question d’actualité d’un député du groupe écologiste, le ministre délégué au développement a déclaré que l’État, actionnaire majoritaire de votre entreprise, souhaitait que la négociation avec le Niger prenne davantage en compte les attentes de ce pays. Quelle évolution attendez-vous pour les contrats avec le Niger et quel est l’état des négociations ? Pouvons-nous avoir accès à l’audit évoqué par le ministre ?
Les questions environnementales, que vous avez rapidement évoquées, soulèvent aussi quelques interrogations, notamment en ce qui concerne les poussières générées au Niger. Des études sont-elles menées sur les conséquences de l’exploitation minière pour les populations ? Quelle est l’acceptabilité de cette exploitation pour ces populations et les revendications de ces dernières pourraient-elles avoir une incidence sur l’accès à la ressource et sur les coûts d’exploitation ?
Le gain d’efficacité réalisé grâce à l’usine Georges-Besse II s’est-il soldé par une baisse des prix pour vos clients, ou simplement par un bénéfice pour votre entreprise ?
Quel est enfin, du combustible produit à partir de l’uranium naturel ou du combustible issu du retraitement, le plus économique ? Compte tenu de l’ampleur des réserves mondiales, quelle pertinence y a-t-il à nous doter d’une filière aussi complexe que celle du retraitement et de la fabrication du MOX ?
M. Luc Oursel. L’indépendance énergétique est une question qui doit être traitée en termes de sécurité d’approvisionnement par rapport à un marché dont l’histoire a montré qu’il était régulièrement secoué par des chocs géopolitiques. Dans un monde marqué par une grande interdépendance économique, les choix de politique énergétique doivent donc plutôt viser à limiter les conséquences de ces chocs. J’ai déjà indiqué que nos approvisionnements étaient diversifiés et que les coûts de production étaient pour l’essentiel locaux, ces éléments confirmant l’intérêt de l’industrie nucléaire.
L’évolution du marché de l’uranium naturel devrait nous réserver quelques années difficiles, car ni les prix spot ni les prix de long terme ne sont élevés. À de tels niveaux, certaines mines de nos concurrents ne sont déjà plus rentables. La reprise probable de la production d’électricité nucléaire au Japon, même partielle, et le développement de nouvelles capacités en Asie et en Europe laissent présager une augmentation des besoins, et donc la nécessité de développer ou de mettre en production de nouvelles mines à l’horizon 2020. Je rappelle que le prix de long terme, qui est le plus représentatif des transactions, est passé de 56 dollars la livre en 2012 à 50 dollars aujourd’hui, et devrait atteindre à nouveau 56 dollars en 2020.
L’activité minière d’AREVA enregistrera en 2013 des résultats économiques remarquables et sera l’un des contributeurs majeurs au redressement de l’entreprise que nous avons engagé. C’est là tout d’abord le résultat de notre choix de ne pas exploiter n’importe quels gisements, mais de développer les mines les plus performantes économiquement afin de réduire les coûts de production. Ce choix assure notre robustesse face aux variations économiques.
En deuxième lieu, notre diversification géographique assure notre crédibilité lorsque nous prenons à l’égard de nos clients des engagements de long terme. Nous pouvons ainsi signer des contrats comportant une forte composante de prix de long terme ou établissant un lien entre prix et coûts de production. Nous sommes ainsi moins sensibles que certains de nos concurrents aux variations du prix spot.
L’année 2013 a également été très bonne grâce aux ventes d’uranium hautement enrichi. Nous nous attendons à un certain tassement de ces résultats, mais le modèle économique d’AREVA est ainsi fait que, lorsqu’une activité faiblit, d’autres prennent le relais, comme les activités amont d’enrichissement, sur lesquelles je reviendrai tout à l’heure. C’est ainsi que la montée en puissance de l’usine Georges-Besse II nous permettra de compenser le ralentissement de l’activité minière.
Le fait qu’AREVA ne soit guère présente en Australie, où l’uranium est abondant, est un constat et une source de frustration. À la différence de nos concurrents, qui ont développé de grands gisements, nous ne sommes pas parvenus à percer dans ce pays. Le permis de recherche que nous y avions obtenu a été suspendu par une loi de protection des populations aborigènes, mais nous redémarrons quelques activités avec le groupe Mitsubishi. Notre souci de diversification nous incite clairement à développer nos activités en Australie, bien sûr dans un cadre compatible avec les exigences locales.
Une large diversification est en effet la réponse à la vulnérabilité géopolitique, tant pour les mines existantes que pour les projets à venir, tant en Australie qu’au Canada, en Mongolie et peut-être en Afrique. Je ne vois aujourd’hui ni au Niger, ni au Kazakhstan d’instabilité géopolitique susceptible de remettre en cause ces activités. Du reste, celles-ci représentent des ressources très importantes pour ces deux pays, qui ont donc autant intérêt que nous à les voir se développer.
Les mines du Niger sont parmi les plus coûteuses de notre portefeuille de production. De fait, le coût des mines a tendance à augmenter avec le temps et l’exploitation des deux mines de la SOMAÏR et de la COMINAK est déjà ancienne – la fin des gisements devrait du reste survenir vers la fin de la décennie. Dans un pays qui connaît des besoins énormes et une pression démographique colossale, et dont la situation sécuritaire est difficile, il est compréhensible que le gouvernement souhaite tirer davantage de ses ressources naturelles – la découverte de pétrole apporte heureusement un complément bienvenu à cet égard.
Pour ce qui concerne l’uranium, AREVA est confrontée à la fois à la nécessité de répondre aux demandes du gouvernement nigérien et à la réalité économique de ces mines. Pour la période récente, 70 à 80 % des bénéfices des mines ont été attribués au Niger, qui en est actionnaire, et cette part n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. Ce mouvement a bien évidemment une limite. En 2006, période de renaissance nucléaire qui ouvrait des perspectives d’augmentation beaucoup plus importante des prix de l’uranium naturel et où le prix spot était bien plus élevé qu’aujourd’hui, le Niger avait adopté une nouvelle loi minière qui, si elle était intégralement appliquée aujourd’hui, mettrait immédiatement les exploitations existantes en lourd déficit, les condamnant à court terme.
L’audit, que le président Issoufou et moi-même avons confié d’un commun accord à un cabinet indépendant, avait pour premier objectif de vérifier la situation économique de ces mines et d’étudier l’impact de cette nouvelle législation minière. Il a confirmé notre diagnostic selon lequel, si cette législation était appliquée, les mines cesseraient à très court terme d’être viables – or elles représentent, je le rappelle, près de 6 000 emplois directs et indirects au Niger, sans parler des personnes qui vivent autour de ces activités. Les négociations se déroulent, je le rappelle, dans un contexte très défavorable pour le marché de l’uranium.
On insiste sur le fait que cet audit serait le premier exercice de ce type, mais l’État du Niger est associé à la gouvernance des mines du pays : ses représentants siègent à tous les conseils d’administration de celles-ci et ont accès à l’ensemble des données.
Dans les négociations en cours, nous nous efforçons de trouver un bon équilibre, au moyen d’aménagements qui pourraient être apportés à la législation nigérienne et de programmes que nous pourrions de notre côté mettre en œuvre pour contribuer au développement économique du pays. L’objectif est de maintenir ces mines en vie. La pire des situations serait celle où des prélèvements excessifs à court terme remettraient en cause les exploitations du Niger.
Dans le domaine de l’environnement et de la sécurité, nous suivons bien sûr, comme nous le faisons partout dans le monde, l’ensemble de nos équipes au Niger, mais nous avons également créé des observatoires consacrés à l’eau, à l’air et à la santé, auxquels nous avons associé diverses parties prenantes locales afin de partager toutes les mesures que nous prenons et d’évaluer les conséquences éventuelles de notre exploitation. Au Niger spécifiquement, un observatoire est destiné à examiner l’état sanitaire des anciens travailleurs des mines et nous recherchons – ce qui n’est pas facile – les personnes ayant travaillé pour la COGEMA, puis pour AREVA, pour la COMINAK et pour la SOMAÏR. Sur près de 350 qui ont déjà été retrouvées, il n’a pas été mis en évidence de cas avérés où le travail dans le domaine minier aurait eu un impact sur la santé.
De façon générale, nous sommes bien conscients que l’acceptabilité de nos activités dépend d’un travail régulier avec les parties prenantes, car notre présence à long terme n’est possible que si nous répondons aux questions légitimes des populations et des gouvernants des pays concernés.
Pour ce qui est de la montée en puissance de l’usine Georges-Besse II, le fait qu’elle bénéficie d’abord à AREVA n’est qu’un juste retour des choses, car le fonctionnement d’EURODIF (European gaseous diffusion uranium enrichissement consortium) consommait énormément d’énergie et les coûts de production y étaient donc beaucoup plus élevés, ce qui nous faisait régulièrement perdre des parts de marché, que nous regagnons maintenant progressivement.
Ce n’est pas nous qui fixons le prix de l’enrichissement : comme pour l’uranium naturel, il existe un prix spot – mais qui concerne des quantités encore plus limitées – et un prix de long terme, qui a baissé après l’accident de Fukushima pour les mêmes raisons qu’a baissé celui de l’uranium naturel – il est passé d’environ 130 dollars à 100 dollars par unité de travail de séparation (UTS).
Le retraitement a deux finalités : l’une, économique, est de mieux valoriser les ressources, et l’autre de mieux gérer les déchets et les combustibles usés. La réponse à votre question est donnée par les électriciens : plus d’une quarantaine de centrales dans le monde, soit plus de 10 % du parc, fonctionnent avec du MOX et plusieurs pays y trouvent un intérêt au regard des deux finalités que je viens de mentionner.
M. le rapporteur. Votre réponse ne m’a pas permis de comprendre comment vous entendiez prendre en compte les déclarations du ministre délégué relatives au Niger. Il semblerait en effet que vous lui opposiez une fin de non-recevoir. Quant à l’audit, est-il accessible et pouvons-nous en prendre connaissance ?
M. Luc Oursel. Selon la dépêche de l’Agence France-Presse publiée à 21 heures, par laquelle j’ai pris connaissance des déclarations du ministre Pascal Canfin, celui-ci indiquait que la négociation devait tenir compte des attentes du Niger et viser à préserver la viabilité économique des mines en exploitation.
Quant à l’audit, il appartient aux deux actionnaires et, à ma connaissance, le gouvernement du Niger ne souhaite pas le rendre public.
M. le rapporteur. S’il le souhaitait, en seriez-vous d’accord ?
M. Luc Oursel. Nous en discuterions afin de définir les conditions de sa publicité. Cet audit, réalisé avec le plus grand sérieux, comporte des informations commerciales très sensibles dont la communication pourrait nous mettre en difficulté face à nos concurrents ou avoir une incidence sur nos relations commerciales avec nos clients. C’est là un des cas où la transparence peut être préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, ainsi qu’à ceux du Niger, actionnaire de ces exploitations.
M. Jean-Pierre Gorges. Vous avez rappelé que l’énergie nucléaire était celle qui disposait aujourd’hui des réserves les plus importantes, pouvant couvrir 130 années de production contre 50 à 100 ans pour les autres sources d’énergie, et vous avez souligné la faible sensibilité du coût de l’électricité nucléaire au prix de la matière première. De leur côté, les énergies renouvelables se trouvent en situation instable, d’autant que le Conseil d’État doit répondre dans les deux mois à la question de savoir si elles peuvent être subventionnées. L’Europe étant opposée à de telles subventions, il existe un risque important, y compris à titre rétroactif pour ceux qui en ont bénéficié. La transition énergétique ne peut donc pas s’appuyer sur ces technologies ni sur la fiscalité associée.
Aussi le nucléaire est-il aujourd’hui le meilleur outil de cette transition, en particulier grâce à l’ampleur des ressources disponibles et à la stabilité des approvisionnements. Quant à la pollution, le charbon a tué à ce jour beaucoup plus de gens que le nucléaire. Pourquoi alors la France ne parvient-elle pas, à l’instar de pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, à amortir les technologies du nucléaire sur cinquante ou soixante ans ? En rester à trente ans a forcément un impact sur le coût. Ne pourrions-nous pas adapter notre parc pour en prolonger l’exploitation de vingt ou trente ans, le temps de trouver des solutions alternatives durables et budgétairement plus acceptables que celle qui consiste aujourd’hui à consacrer 20 milliards d’euros de subventions aux énergies renouvelables ?
M. le président François Brottes. Je vous invite, chers collègues, à concentrer vos questions sur le combustible. AREVA sera de nouveau convoquée le 27 février afin que nous puissions aborder les autres aspects de ses activités.
M. Michel Sordi. J’ai moi aussi été satisfait d’apprendre que des réserves d’uranium importantes sont disponibles dans des pays stables, que le prix de cette matière première devrait lui aussi rester stable et qu’au demeurant, son augmentation n’aurait qu’une faible incidence sur le prix de l’énergie. Cela étant dit, au vu de ce qui s’est produit en Allemagne, il conviendrait d’étendre aux mines de charbon et de lignite la question du rapporteur relative à l’incidence des mines sur l’environnement, notamment pour ce qui concerne l’émission de poussières.
J’en viens à mes propres questions. Tout d’abord, pourquoi AREVA a-t-elle voulu prendre une participation financière dans les EPR britanniques ? Quelle est la finalité de cette diversification ?
Par ailleurs, la publication, la semaine dernière, des premiers résultats d’AREVA en 2013 fait apparaître une augmentation globale de 7 % des ventes dans le secteur nucléaire, contre une chute de 30 % dans celui des énergies renouvelables, qui ne représente en outre qu’un peu plus de 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Comment expliquer ces difficultés à progresser et quel avenir peut-on imaginer pour l’industrie « lourde » des énergies renouvelables en France ? Existe-t-il de vraies perspectives, en dehors de l’éolien offshore pour lequel, suite aux appels d’offres de l’an dernier, AREVA a annoncé la construction de deux usines au Havre ?
Enfin, la filière nucléaire française, dont votre présence aux côtés du Premier ministre en Chine, en décembre 2013, devait manifester l’excellence, est-elle crédible lorsque, dans le même temps, le Gouvernement envoie des signaux contraires sur le territoire national en annonçant, pour des raisons politiciennes, la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim, bien que l’Autorité de sûreté nucléaire ait autorisé la poursuite de son activité pour dix années supplémentaires ?
M. Philippe Baumel. Certaines questions ne relèvent peut-être pas de M. Oursel et devraient plutôt être posées dans l’hémicycle.
Pour revenir au sujet, pourrions-nous connaître l’évolution des recettes budgétaires de l’État nigérien depuis le début de l’exploitation des mines ? Pourriez-vous également nous communiquer le montant des achats récurrents du groupe AREVA auprès des entreprises nigériennes ? Quelle est, enfin, la part des emplois d’expatriés et des emplois locaux liés à l’activité minière ?
Mme Frédérique Massat. Ayant moi aussi accompagné le Premier ministre en Chine, j’ai pu constater que l’accueil fait à la France, notamment lors d’un colloque sur le nucléaire et de la visite d’un site, témoignait que l’autorité de notre pays dans ce domaine n’était nullement remise en cause.
Aviez-vous prévu que la croissance des revenus de la division minière d’AREVA serait aussi forte qu’elle l’a été ? Quels sont, outre EDF, vos clients ? Avez-vous pris des parts de marché à certains de vos concurrents et, si tel est le cas, comment analysez-vous cette progression ?
M. le rapporteur. Des ONG sont-elles associées aux observatoires que vous avez mis en place au Niger ? Leur participation contribuerait à la transparence et permettrait d’éviter les contestations.
Je ne peux que déplorer, comme M. Sordi, la pollution provenant de l’usage du charbon et je regrette que le secteur des énergies renouvelables ne contribue que pour 1 % au chiffre d’affaires d’AREVA. Mais je salue la diversification de votre entreprise en direction de ces énergies d’avenir…
M. Luc Oursel. AREVA s’est en effet lancée, bien qu’un peu tard, sur le marché des énergies renouvelables. La proportion de 1 % n’a de valeur que comptable, la part de ce secteur dans nos activités est en fait, aujourd’hui, de l’ordre de 5 ou 6 %. Dans ce domaine, nous sommes partis de zéro pour atteindre un montant de quelques centaines de millions d’euros : certaines start-ups pourraient nous envier une croissance aussi rapide. Il ne nous en faut pas moins poursuivre ce mouvement.
Malgré l’intérêt porté par nombre de pays aux énergies renouvelables, les prises de commandes sur l’ensemble du marché mondial ont chuté de près de 30 % entre 2011 et 2013, car certains pays qui s’étaient lancés vigoureusement dans cette voie se sont brusquement interrogés sur la possibilité de soutenir un effort nécessairement important à coups de subventions. Cela s’est traduit par des difficultés majeures pour la quasi-totalité des fournisseurs d’équipement, qui ont dû prendre des mesures de restructuration ou arrêter certaines activités – comme Siemens, qui a renoncé à être présent dans le secteur de l’énergie solaire.
L’éolien terrestre, qui requiert de moins en moins de subventions, est cependant pour nous un marché totalement occupé, sur lequel AREVA n’a pas la possibilité de prendre pied – Mme Lauvergeon, qui avait souhaité acquérir certaines entreprises dans les années 2003-2004, n’a pas été suivie par l’actionnaire. Dans le domaine du solaire photovoltaïque, il est de même impossible à un nouvel entrant d’accéder à un marché totalement saturé, en particulier par les fournisseurs chinois. AREVA a donc choisi de se porter sur des technologies nouvelles, où nous pensons que nos savoir-faire technologiques et notre expérience de la gestion de projets peuvent permettre de faire baisser les coûts : l’éolien offshore, le solaire à concentration, la biomasse et le stockage d’énergie, qui devrait être prioritaire pour nous tous.
Afin d’accélérer nos efforts en faveur de l’éolien offshore, nous avons décidé de nous unir à Gamesa, entreprise espagnole leader dans le domaine de l’éolien terrestre. Nous poursuivrons cet effort et espérons que la part des énergies renouvelables dans nos activités continuera de croître. Nous n’avons pas l’intention d’intervenir seuls dans le secteur des énergies renouvelables et nous chercherons donc à constituer des partenariats, comme c’est notamment le cas avec Schneider Electric pour le stockage de l’énergie. Cette recherche de partenariats nationaux, européens ou mondiaux est absolument indispensable si nous voulons être capables de faire baisser progressivement le coût de ces technologies et de rendre ainsi leur développement supportable.
Ces technologies ont, comme le nucléaire, l’avantage de permettre une production locale et une réduction des émissions de CO2. Elles ont évidemment aussi leurs inconvénients, comme l’intermittence. Nos efforts doivent tendre à créer, comme nous l’avons fait pour l’ensemble des filières énergétiques, une industrie nationale ou européenne capable de se battre sur les marchés internationaux.
M. le président François Brottes. S’agissant de l’énergie marine, est-on parvenu à élaborer des modèles permettant de neutraliser les caprices de la mer ?
M. Luc Oursel. AREVA a installé ses premières turbines offshore en 2009, en mer du Nord. Les conditions y sont parfois difficiles et la construction des 120 turbines que nous avons programmée est actuellement interrompue à cause des tempêtes. La solution réside dans une plus grande coopération avec l’industrie pétrolière, qui a développé des technologies adaptées. L’aléa météorologique demeurera cependant, même s’il faut aussi noter que le taux de disponibilité des six turbines installées en 2009 a été de 98 %.
Dans ce domaine, le nucléaire peut lui aussi apporter une contribution grâce à la fiabilité technologique à laquelle il est parvenu et à son savoir-faire en matière de maintenance prédictive et de contrôle de la résistance des matériaux.
Quant à la décision d’AREVA de participer à la construction de l’EPR britannique, il ne s’agit pas d’un choix de diversification, mais de la réponse à une demande d’EDF ainsi que d’une manière de montrer qu’AREVA croyait à ce projet. Nous serons doublement intéressés au bon déroulement de la construction de cette centrale : d’abord au titre du contrat que nous avons conclu ; ensuite au titre du retour que nous pouvons en attendre en tant qu’investisseur.
Notre développement en Chine est très satisfaisant et, en 2013, notre chiffre d’affaires dans ce pays a approché du milliard d’euros pour l’ensemble de nos activités – fourniture d’uranium naturel, services et maintenance. Nous avons déjà créé six joint-ventures et en créerons d’autres pour participer au développement du programme nucléaire chinois et en retirer un retour pour l’entreprise.
M. le président François Brottes. La rumeur dit que nous avons fait beaucoup de cadeaux à nos partenaires chinois.
M. Luc Oursel. Je ne crois pas que ce soit le cas. Un partenariat déséquilibré n’aurait pas tenu trente ans et, d’autre part, la Chine ne me semble pas être un concurrent sérieux et redoutable sur le marché international des réacteurs.
Pour ce qui est des chiffres, nous les communiquons par l’intermédiaire de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), qui vise à assurer la transparence vis-à-vis des gouvernements sur les flux financiers entre les entreprises et les États. Pour le Niger, les recettes – dividendes et impôts – s’élevaient à 120 millions d’euros en 2012. Je vous ferai communiquer les chiffres se rapportant à l’évolution de ces recettes, qui accusent une hausse constante sur les cinq ou six dernières années, à partir d’un niveau il est vrai assez bas.
Les achats nécessaires au fonctionnement des mines du Niger s’élèvent à environ 180 millions d’euros par année, dont plus de la moitié faits auprès d’entreprises locales. Certains produits, comme les réactifs utilisés dans les mines, ne sont pas disponibles dans le pays. En revanche, les activités de service, de construction et de génie civil sont locales et nous avons également aidé au développement d’un certain nombre de fournisseurs locaux. En outre, bien qu’en règle générale l’industrie minière soit très capitalistique et ne soit pas créatrice d’emplois au prorata de son chiffre d’affaires, nos activités génèrent dans le pays, comme je l’ai dit, 6 000 emplois directs et indirects.
Notre chiffre d’affaires dans le secteur minier a bondi de près de 30 % en 2013 grâce à la vente du matériau issu du programme – achevé en 2013 – de démantèlement des armes, à nos efforts de gestion, notamment à la vente de stocks sur le marché, et au fait que nous avons conquis des parts de marché – sans que ce soit au détriment des prix et de la rentabilité. Nos clients sont attirés par la diversification géographique de notre production, qui nous permet de prendre des engagements de très longue durée, ainsi que par la variété de notre offre. AREVA a ainsi construit une centaine des 440 centrales nucléaires qui existent dans le monde et entretient des relations commerciales avec 360 d’entre elles, qui nous achètent au moins une partie de notre catalogue. Il n’est pas rare, par exemple, que nous nouions une relation commerciale en commençant par fournir un service de maintenance ou d’enrichissement, puis que nous étendions peu à peu notre présence en proposant l’ensemble de nos services, que ce soit au coup par coup ou dans le cadre d’offres « packagées » où nous vendons à la fois de l’uranium naturel et des activités de conversion et d’enrichissement, voire de fabrication de combustible.
Au Niger, les observatoires intègrent bien les parties prenantes locales, y compris des ONG dont je pourrai vous communiquer la liste exacte.
M. Michel Sordi. L’arrêt de la centrale de Fessenheim est-il pertinent dans le contexte actuel ?
M. Luc Oursel. Je n’ai pas d’avis à formuler sur ce sujet au nom d’AREVA. L’entreprise peut toutefois contribuer à ce débat grâce à ses activités internationales qui lui permettent d’analyser ce qui se fait dans d’autres pays. En particulier, nous connaissons bien la situation aux États-Unis, où nous réalisons près de 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires même si nous n’y avons pas construit de centrales. Le parc américain est plus ancien que celui de la France et l’autorité de sûreté américaine fait tout autant référence que celle de notre pays. Aujourd’hui, 75 % des centrales américaines ont reçu l’autorisation de rester en activité pendant soixante ans – moyennant bien sûr des travaux, le renouvellement de certains composants et des précautions dans l’exploitation. Ces autorisations sont génériques, mais l’autorité de sûreté peut à tout moment arrêter une centrale si elle estime que celle-ci ne respecte pas les conditions mises à l’extension de la durée de vie de toutes. Certains électriciens américains travaillent même déjà, en lien avec l’autorité de sûreté, à l’extension de la durée de vie des centrales jusqu’à quatre-vingts ans. Le système français, quant à lui, est fondé sur des autorisations par tranches de dix ans et j’écoute régulièrement ce que l’autorité française de sûreté dit des conditions qu’elle mettrait à l’extension de la durée de vie des centrales.
M. le président François Brottes. Monsieur Oursel, je vous remercie.
M. Luc Oursel. Je reste à votre entière disposition.
Audition de M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible nucléaire » d’EDF
(Séance du jeudi 6 février 2014)
M. le président François Brottes. Après avoir essayé de cerner la façon dont le concept de bouquet énergétique était mis en œuvre à l’échelle de l’Europe et étudié la place du secteur nucléaire en France, notre commission d’enquête s’intéresse désormais à la filière elle-même en commençant par son combustible principal. Si nous parlons à ce propos de « l’aléa uranium », c’est qu’on peut se demander si notre dépendance à l’égard de cette matière première ne risque pas de poser problème à court ou moyen terme. Quelle est l’évolution de son prix ? En tant que directeur de la division « combustible nucléaire » d’EDF, vous êtes, monsieur Granger, directement responsable du milliard et demi d’euros que le groupe, selon la Cour des comptes, consacre chaque année à ses achats de combustibles. Vous êtes également responsable des stocks constitués pour sécuriser son approvisionnement – une charge que l’on pourrait d’ailleurs imaginer de faire porter sur AREVA, avec laquelle vous partagez le même actionnaire principal.
AREVA est le principal fournisseur d’EDF, mais non son fournisseur exclusif, que ce soit pour la matière première elle-même ou pour les services rendus en amont – conversion, enrichissement et fabrication des assemblages. L’électricien met en œuvre une politique de diversification dont nous aimerions connaître les tenants et aboutissants, car les dissensions au sein de « l’équipe de France du nucléaire » ne sont pas toujours comprises.
Avant de vous laisser la parole, je dois vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de bien vouloir jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Sylvain Granger prête serment)
M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible nucléaire » d’EDF. Je souhaite rappeler, en six points, quelle est la contribution du combustible uranium à l’économie de la production d’électricité d’origine nucléaire, ainsi que ses spécificités par rapport à d’autres combustibles associés à des moyens de production d’électricité non intermittente.
Premièrement, comparé au pétrole, au gaz ou au charbon, l’uranium est un combustible à haute densité énergétique. Une tonne d’uranium naturel permet de produire la même quantité d’énergie thermique que 10 000 tonnes de pétrole, 10 000 tonnes de gaz naturel liquéfié ou 14 000 tonnes de charbon. Ainsi, alors que le fonctionnement d’un réacteur nucléaire d’à peu près 1 000 mégawatts électriques nécessite chaque année 150 tonnes d’uranium naturel pour son fonctionnement, il faudrait 1,5 million de tonnes de charbon pour produire la même énergie à partir d’une centrale à charbon supercritique.
Deuxièmement, l’uranium naturel est une matière première abondante dont les réserves se trouvent dans des zones géographiques nombreuses et variées. Les réserves prouvées – je parle de réserves conventionnelles – suffiraient à assurer environ cent ans de production, soit un rapport entre ressources et production comparable à celui du charbon alors que, pour le gaz et le pétrole, on ne dispose de réserves que pour cinquante à soixante ans.
Surtout, à la différence des autres modes de production d’énergie à base de combustibles fossiles – pétrole, gaz, charbon –, le rendement des réserves d’uranium naturel pourrait être considérablement accru grâce au développement de nouvelles technologies de réacteurs. Alors qu’aujourd’hui, on n’utilise que 1 % de l’uranium extrait des mines, on pourrait parvenir à en exploiter une part beaucoup plus grande : utilisées dans des réacteurs de quatrième génération à spectre rapide, les réserves prouvées d’uranium naturel représenteraient alors à peu près 5 000 années de production potentielle.
Comme je l’ai dit, les gisements d’uranium naturel sont bien répartis dans le monde, ce qui permet de diversifier et donc de sécuriser l’approvisionnement. Il existe trois grandes régions de production, la première en Amérique du Nord – principalement au Canada, mais aussi aux États-Unis – ; la deuxième en Australie, qui compte les plus grandes réserves mondiales ; et la troisième en Asie centrale et en Russie. Mais on trouve également de l’uranium naturel en Amérique du Sud et en Afrique.
Troisièmement, l’uranium naturel, avant d’être chargé dans le réacteur, passe par trois étapes de transformation – la conversion, l’enrichissement et la fabrication –, tous services disponibles en France et dont le poids économique est le double de celui de la production de matière première.
Cette dernière, extraite de la mine – le yellow cake –, est donc transformée dans une usine de conversion, puis dans une usine d’enrichissement, où elle est concentrée afin de porter de 1 % à 4 % la partie de l’uranium réellement combustible. Puis elle est mise sous forme de pastilles et conditionnée dans des tubes, lesquels seront insérés dans les assemblages de combustibles chargés dans les cuves des réacteurs.
Quatrièmement, pour sécuriser son approvisionnement et optimiser le coût de son combustible, EDF a développé une stratégie consistant à agir sur différents leviers. En premier lieu, l’entreprise intervient à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement : elle achète l’uranium à la sortie de la mine, puis se procure auprès de différents industriels les services de conversion, d’enrichissement et de fabrication, avant de récupérer les assemblages de combustibles pour les mettre à disposition des centrales.
Il n’est pas sans intérêt de noter qu’elle a une certaine latitude pour arbitrer entre investissement dans la matière première et investissement dans l’enrichissement : elle peut charger les réacteurs, soit avec une plus grande quantité d’uranium naturel moins enrichi, soit avec de l’uranium plus enrichi mais en moindre quantité.
Les autres leviers sont la diversification des sources d’approvisionnement et la constitution de stocks de sécurité – des moyens classiques utilisés dans d’autres secteurs industriels –, ainsi que l’anticipation et la contractualisation à long terme sur chacun des segments de la chaîne d’approvisionnement, qui permettent de limiter considérablement les effets d’une volatilité des prix et, dans le meilleur des cas, d’obtenir un avantage économique sur la durée. Ainsi, au cours des dix dernières années, alors que le prix spot de l’uranium naturel a un peu plus que triplé en raison de l’entrée dans un nouveau cycle d’investissement minier, le coût de l’approvisionnement en combustible pour EDF – achat d’uranium, conversion, enrichissement et fabrication – a augmenté de moins de 20 %.
Cinquièmement, le coût complet du combustible nucléaire intègre les externalités. La production d’énergie nucléaire ne génère pas de CO2, mais des déchets hautement radioactifs. Après quatre ou cinq ans de production d’énergie au sein du réacteur, le combustible usé est traité à La Hague afin de séparer les déchets radioactifs ultimes des matières pouvant être recyclées – uranium résiduel et plutonium. Aujourd’hui, les assemblages à base de matières recyclées représentent environ 15 % des assemblages de combustibles chargés en réacteur.
Le traitement du combustible usé et les charges futures de gestion des déchets radioactifs sont provisionnés dans les comptes d’EDF et intégrés, en tant que coût « aval », au coût complet du combustible tel qu’il a notamment été rendu public par la Cour des comptes. Cela représente à peu près un quart du total, soit l’équivalent du coût d’acquisition de l’uranium naturel. De même, toujours grosso modo, la conversion et l’enrichissement représentent un quart du coût complet, le quart restant étant consacré à la fabrication.
Sixième et dernier point : par rapport aux autres sources d’énergie non intermittentes comme le gaz et le charbon, la part du combustible dans le coût de production est faible. Son coût complet – acquisition, transformation, coût aval – représente en effet environ 10 % du coût de la production nucléaire tandis que cette part est, hors coût du CO2, de 60 à 70 % du coût de production pour une centrale au gaz et de 30 à 40 % pour une centrale à charbon. Il en résulte que le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire est beaucoup moins sensible aux incertitudes et aux cycles inhérents aux marchés de matière première. En outre, du point de vue macroéconomique, cette caractéristique représente un avantage considérable pour notre balance commerciale.
M. Denis Baupin, rapporteur. Nous aurons l’occasion de revenir sur la question du coût du retraitement ainsi que sur les charges de gestion des déchets, notamment parce que la Cour des comptes s’interroge sur la justesse des évaluations avancées. Mais cette réunion concerne plus précisément les questions liées au combustible.
M. Oursel, que nous avons entendu tout à l’heure, nous a décrit l’activité d’AREVA, mais cette société n’est pas votre seul fournisseur. Quelle part représente l’uranium que vous lui achetez dans votre consommation totale ? Et en dehors du Kazakhstan, du Canada et du Niger, où AREVA est implantée, d’où provient le combustible que vous utilisez ? Cette information est importante pour évaluer l’éventuelle vulnérabilité de votre approvisionnement.
De même, pour les opérations de transformation du combustible, AREVA n’est pas votre seul prestataire. M. Oursel a tenu à nous dire que l’ensemble de ses usines étaient situées en France. Est-ce qu’une part des opérations destinées à transformer le combustible utilisé par EDF est effectuée en dehors du territoire national ?
Quel est l’état actuel de vos stocks en années de consommation et quels sont vos objectifs en la matière ?
Quelles sont les parts respectives des achats réalisés dans le cadre de contrats à long terme et de l’approvisionnement sur le marché spot ?
Vous nous avez indiqué que le prix de l’uranium avait fortement augmenté. Pourtant, M. Oursel nous a dit au contraire qu’il avait notablement baissé depuis l’accident de Fukushima. Pouvez-vous être plus précis sur ce point ? Quelle sera à l’avenir, selon vous, l’évolution du prix du combustible ? Selon le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ce prix, qui a été de l’ordre de 5 euros par mégawattheure (MWh) en 2013, devrait vraisemblablement avoisiner les 7 euros par MWh en 2015, ce qui représente une augmentation non négligeable.
M. Sylvain Granger. AREVA est à l’origine de 30 à 40 % de notre approvisionnement. Les besoins d’EDF en uranium – entre 9 000 et 10 000 tonnes par an – sont à peu près l’équivalent de la production minière d’AREVA mais, depuis le début des années 2000, la majeure part de celle-ci – jusqu’à 70 % – est vendue à des clients étrangers. La politique de diversification de ses clients adoptée par AREVA, associée à sa volonté de proposer ce qu’elle a appelé le « multiservice » – par exemple en fournissant et le combustible et les réacteurs – a en effet eu pour effet de réduire significativement la quantité d’uranium qu’elle vend à EDF par rapport aux années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.
Dans le même temps, et pour prendre en compte certains risques, EDF a jugé préférable de diversifier non seulement les zones géographiques de provenance du minerai mais aussi ses fournisseurs. Jusque-là, la part du Niger dans notre approvisionnement était d’environ 30 %. Aujourd’hui, elle est, selon les années, de 10 à 20 %.
Certains acteurs sont prépondérants, ou du moins mieux installés, sur certaines zones géographiques : il s’agit, au Canada, de CAMECO, dont AREVA écoule une partie de la production et, en Australie, de BHB Billiton et de Rio Tinto. Les deux plus grandes mines mondiales sont Cigar Lake au Canada, que CAMECO est en train de mettre en service, et Olympic Dam en Australie, une gigantesque mine de cuivre et d’uranium appartenant à BHB Billiton.
Notre stratégie de portefeuille consiste à faire approximativement correspondre les zones de provenance de notre combustible à la part qu’elles représentent dans la production mondiale. Cela signifie que nous achetons principalement de l’uranium canadien, australien et kazakh même si, en réalité, toutes les zones de production mondiales sont sollicitées pour nous approvisionner, y compris l’Afrique – Niger et Namibie –, la Russie et l’Ouzbékistan. Et, par exemple, la part du Niger dans nos achats – 10 à 20 % comme je l’ai dit – reste supérieure à sa part dans la production mondiale, de l’ordre de 6 %.
Pour ce qui est de la conversion et de l’enrichissement, le marché est mondial. Les sociétés du secteur se situent principalement aux États-Unis, au Canada, en Russie et en Europe. Dans ce domaine, nous tentons de concilier deux préoccupations : celle de diversifier les fournisseurs pour garantir la sécurité de l’approvisionnement et celle de maintenir avec eux des relations durables et de conclure des partenariats. À cet égard, AREVA est notre partenaire principal : il nous fournit à peu près 40 % des services de conversion et d’enrichissement, une proportion significativement supérieure à celle de ses capacités de production rapportées aux capacités mondiales.
M. le président François Brottes. Cette contribution à hauteur de 40 % résulte-t-elle d’un choix d’EDF ? Ne subissez-vous pas, dans le cadre du conseil de politique nucléaire, des pressions pour la réduire ?
M. Sylvain Granger. Ces questions sont en effet examinées régulièrement avec les services de l’État, lors des réunions du conseil de politique nucléaire ou dans d’autres cadres.
Les capacités de conversion et d’enrichissement d’AREVA qui ne sont pas employées par EDF sont consacrées à d’autres clients. Or ces capacités sont bien évidemment limitées : dès lors que la société a une stratégie de développement, il convient de définir la part pouvant être réservée à EDF et celle qui pourra être utilisée pour gagner des marchés à l’international.
Les marchés de l’extraction, de la conversion et de l’enrichissement – c’est un peu moins vrai pour la fabrication – sont extrêmement internationalisés. Les raisons en sont industrielles : les capacités de conversion sont plutôt concentrées en Amérique du Nord, tandis que celles d’enrichissement sont principalement situées en Europe – aux mains d’URENCO et d’AREVA. Comme il s’agit de deux étapes indispensables de la chaîne d’approvisionnement, les logiques industrielles ne peuvent qu’être internationales. À cet égard, AREVA, en tant que grand acteur de l’amont du cycle nucléaire, a sa propre stratégie, de même qu’EDF, qui doit sécuriser son approvisionnement, a la sienne.
C’est en effet à notre société, et à nulle autre, que les services de l’État ont confié la responsabilité d’assurer la sécurité de son approvisionnement. EDF a ainsi toujours constitué des stocks de combustible. Chaque année, nous analysons l’ensemble des risques – techniques ou autres – pesant sur tous les pays d’approvisionnement, puis, en fonction des résultats, nous calculons nos stocks et décidons de les positionner à tel ou tel point de la chaîne. Si nous identifions un risque sur certaines mines, les stocks seront par exemple plutôt constitués après la conversion.
Il y a quelques années, l’enrichissement a connu une importante mutation, avec le passage de la diffusion gazeuse – une technologie maîtrisée principalement par la France et les États-Unis – à l’ultracentrifugation, sur laquelle ces deux pays avaient pris du retard. Le risque que nous avions alors identifié nous a conduits à déporter les stocks vers le point de la chaîne situé après l’enrichissement. C’était plus coûteux, mais en termes de sécurité d’approvisionnement, cette décision a permis de compenser les difficultés de développement de l’ultracentrifugation, notamment en France.
En quantité, les stocks représentent un peu plus de deux années de consommation pour EDF, ce qui est considérable par rapport aux autres matières premières comme le pétrole ou le gaz.
Notre portefeuille d’approvisionnement est constitué de contrats de long terme. Mais ces contrats comportent systématiquement des options et des clauses de flexibilité, nécessaires pour que nous puissions nous adapter à la demande. Dans le cas, exceptionnel, où une option se révèle plus chère que le prix du marché spot, il est possible de ne pas la lever et d’acheter de l’uranium sur ce marché. Mais cela ne porte que sur des quantités très faibles.
D’ailleurs, dans le marché de l’uranium, le marché spot est principalement un marché d’ajustement.
M. le président François Brottes. Quel est son horizon temporel ?
M. Sylvain Granger. Il s’agit d’un marché sur lequel des professionnels observent les transactions effectuées au quotidien afin d’en déduire les prix à un instant donné. Ces transactions portent généralement sur de petites quantités, pour des livraisons à court terme – de l’ordre de quelques mois –, mais qui ne conduisent pas nécessairement à une utilisation finale. J’ai par exemple appris que la Deutsche Bank avait constitué un petit stock d’uranium, mais je doute qu’elle songe à l’utiliser dans ses établissements…
M. le président François Brottes. L’uranium fait donc l’objet d’une spéculation ?
M. Sylvain Granger. Cela a sans doute été le cas dans les années 2006-2007, lorsque les prix se sont élevés jusqu’à un niveau de 150 dollars pour une livre, contre 10 à 20 dollars en 2002 et 2003. Aujourd’hui, le prix spot est d’environ 35 dollars la livre, après avoir longtemps connu un palier situé aux alentours de 40 dollars. La tendance, depuis 2003, est donc bien à un triplement des prix, même si on observe une légère baisse depuis quelques mois. Et en 2007, anticipant ce que l’on appelait la « renaissance du nucléaire », un certain nombre d’acteurs – qui étaient loin d’appartenir tous au secteur du nucléaire – s’étaient précipités sur ce marché, faisant gonfler les cours. Pour autant, EDF n’a jamais acheté son uranium 150 dollars la livre. Grâce à notre stratégie d’anticipation, de conclusion de contrats de long terme et de partenariats, non seulement nous avons bénéficié de prix stables, mais leur évolution a été économiquement favorable par rapport à celle du marché spot.
M. le président François Brottes. Ce marché est-il sensible à l’actualité ? L’accident de Fukushima, un référendum en Suisse sur l’énergie nucléaire, une prise de position de la part de certains mouvements politiques en France peuvent-ils avoir un impact ?
M. Sylvain Granger. Trois événements ont eu un impact important. Le premier est l’anticipation de la renaissance du nucléaire dont j’ai déjà parlé. Le deuxième est la décision prise par les Chinois en 2011 d’acheter plus d’uranium qu’ils n’en avaient besoin pour alimenter leurs centrales. Les Chinois ont en effet une politique très forte de sécurisation de leur approvisionnement, y compris pour l’avenir, grâce à la constitution de stocks, à des prises de participation et au développement international. Même si l’information sur le sujet est rare, on peut, en observant leurs achats, en déduire la politique du pays en matière de construction nucléaire. Cela étant, lors du pic observé en 2011, le prix spot de l’uranium n’a pas dépassé 50 dollars la livre.
Enfin, le troisième événement est l’accident de Fukushima. L’arrêt des réacteurs japonais et, en conséquence, l’absence de demande en provenance du Japon ont entraîné une baisse du cours, qui est descendu de 40-45 dollars à 35 dollars la livre.
En définitive, et si l’on excepte la spéculation quasiment autoréalisatrice survenue en 2006-2007, on constate que les variations ne sont pas d’une amplitude exceptionnelle. Par ailleurs, la volatilité des prix masque une tendance structurelle à la hausse. En effet, de nombreuses mines d’uranium découvertes dans les années soixante et soixante-dix sont en déclin. Ce qui est arrivé en France, où on n’extrait plus d’uranium depuis 2001, va se répéter dans d’autres régions du monde. C’est pourquoi nous sommes entrés dans un cycle de réinvestissement minier. Alors que l’investissement réalisé dans ces anciennes mines était presque amorti, il est à nouveau nécessaire d’apporter du capital. Il en résulte une augmentation structurelle des prix.
Pour savoir si cette évolution va perdurer et pour évaluer le niveau auquel le prix de l’uranium pourrait se stabiliser, il importe donc d’apprécier le coût complet de développement des nouvelles mines, qui varie d’une région à l’autre : alors qu’il est d’environ 30 dollars la livre au Kazakhstan, il peut atteindre ailleurs 60 à 70 dollars. Toutes ces mines ne seront pas exploitées : si de très grandes comme Cigar Lake et Olympic Dam peuvent être développées à un coût raisonnable, on peut envisager un équilibre entre l’offre et la demande rendant inutile l’ouverture des mines plus coûteuses.
Selon nos propres estimations, toutefois, le prix de l’uranium pourrait monter jusqu’à 60 dollars la livre dans les dix prochaines années. Dans cette hypothèse, l’augmentation à venir serait plus modérée que celle que nous venons de connaître au cours des dix dernières années où, de 10 à 20 dollars, il est passé à 40 dollars.
De toute façon, le coût de l’uranium naturel ne représente, je le rappelle, qu’un quart de celui du combustible, qui lui-même ne compte qu’à hauteur de 10 % dans les coûts de production de l’énergie nucléaire. Si je me trompe et que l’on constate un doublement du prix sur le marché spot dans les dix ans à venir, non seulement EDF n’en subirait pas nécessairement les conséquences, puisque nous ne nous fournissons qu’exceptionnellement sur ce marché, mais l’augmentation réelle ne porterait, au bout du compte, que sur 2,5 % des coûts de production de l’énergie nucléaire, et serait de surcroît étalée sur dix ans.
M. le président François Brottes. AREVA va pouvoir augmenter ses prix…
M. Sylvain Granger. Si une telle augmentation était justifiée par l’évolution du marché, alors elle serait appliquée par tout le monde. Mais une société qui proposerait des prix éloignés de ceux du marché aurait du mal à vendre sa production. Les mécanismes en jeu ne sont pas propres à l’industrie nucléaire.
M. Jean-Pierre Gorges. En ce qui concerne les réserves d’uranium, vous nous avez rassurés, puisque de 130 ans, elles sont passées à 5 000 ! On peut donc parler de ressource illimitée, même si j’ai bien compris que cela supposait des efforts de recherche et donc des investissements.
J’ai déjà eu l’occasion d’insister sur la fragilité des énergies renouvelables, sur leur instabilité, ainsi que sur le caractère peu sain de leur statut fiscal. C’est pourquoi il est intéressant d’apprendre que le combustible nucléaire ne représente que 10 % des coûts de production. Certes, faute d’uranium sur notre territoire, nous sommes obligés de l’importer et nous pouvons donc être exposés à des difficultés pour nous en procurer. Mais grâce au stockage et à la recherche, il est tout de même possible de garantir notre approvisionnement pour une très longue durée.
Le problème réside plutôt dans nos centrales. En France, on leur prête une durée de vie de trente ans alors que, selon M. Oursel, cette durée est plutôt de soixante ans aux États-Unis, où on envisage même de la porter à quatre-vingts ans. En Grande-Bretagne, l’amortissement financier se fonde sur des amortissements techniques de soixante ans.
Vous n’êtes certes pas spécialiste du sujet, mais vous côtoyez les personnes qui travaillent sur cette question : que faudrait-il faire – bien sûr dans le respect des règles de sécurité françaises, sans doute plus strictes qu’aux États-Unis – pour prolonger de trente ans la durée de vie de nos centrales, le temps de préparer sérieusement la transition énergétique ? Je suis convaincu, en effet, que c’est le nucléaire qui permettra de réaliser cette transition, qui se fera peut-être vers les réacteurs de quatrième génération.
M. le président François Brottes. Je rappelle que le sujet de notre réunion est le combustible nucléaire. Vous avez parfaitement le droit de répondre à cette question, monsieur Granger, mais n’étant pas spécialiste, vous pouvez aussi vous y refuser. De toute façon, ce sujet sera abordé avec EDF lors d’une prochaine réunion.
M. Sylvain Granger. Je ne suis en effet pas spécialiste, et vous aurez l’occasion de recevoir des gens beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine. Je me contenterai donc de quelques précisions.
Je n’ai pas dit que les réserves d’uranium étaient de 5 000 ans. Si j’ai cité ce chiffre, c’est pour montrer que la question de la ressource en uranium ne se pose pas réellement dès lors que l’on croit au progrès technique. Le débat qui a lieu sur le niveau des réserves en l’état actuel de la technologie – 100 ou 150 ans – n’aurait en effet plus de sens si nous développions une autre génération de réacteurs. L’ordre de grandeur ne serait alors plus du tout le même.
Bien sûr, une telle progression ne serait ni simple, ni rapide. Mais ce qui est certain, c’est que pour les autres sources d’énergie fossiles, telles que le pétrole ou le gaz, nous n’avons pas les mêmes perspectives de progrès technologique, même si elles bénéficient également d’améliorations qui permettent d’en prolonger l’exploitation. C’est notamment le cas pour le pétrole, dont les réserves s’accroissent avec les progrès accomplis en matière d’exploration et d’extraction – il faut donc rester très prudent en parlant de réserves prouvées.
En tout état de cause, il n’y a aucune raison de craindre une pénurie d’uranium. S’il y a une matière première susceptible d’être très longtemps disponible, c’est bien celle-là, à condition de réaliser les développements technologiques adéquats, notamment de passer à une nouvelle génération de réacteurs.
S’agissant des réacteurs en fonctionnement, leur durée de vie n’est pas de trente ans, ni de quarante ou de soixante : ils sont examinés tous les dix ans par l’Autorité de sûreté qui, selon les résultats, donne ou non à EDF l’autorisation de les exploiter pendant une décennie supplémentaire. Il est vrai que le système est très différent aux États-Unis, où les exploitants disposent d’une plus grande visibilité sur la durée de vie des réacteurs – hier quarante ans, aujourd’hui soixante dans la plupart des cas. Les électriciens américains commencent même, vous y avez fait allusion, à constituer des dossiers pour obtenir une prolongation jusqu’à quatre-vingts ans. Sur le plan physique, ils n’ont pas tort : les progrès réalisés dans le domaine des matériaux, ainsi qu’en matière de surveillance du comportement des éléments des centrales, autorisent à se montrer optimiste. Mais une fois de plus, cette décision relève chez nous de l’Autorité de sûreté et de son appui technique.
M. le président François Brottes. Quelle est la proportion du combustible utilisé qui finit en déchets ultimes ? Et comment évolue-t-elle ?
M. Sylvain Granger. Pour simplifier, la réaction nucléaire au sein de la centrale conduit à la transformation de 4 % d’uranium en déchets hautement radioactifs et non recyclables, et de 1 % d’uranium en la même quantité de plutonium. Il reste donc 95 % d’uranium inutilisé, dont la concentration en combustible est à peu près la même que celle de l’uranium naturel.
Mais dans la mesure où c’est tout l’assemblage de combustibles qui a été irradié, la structure métallique qui le compose constitue aussi un déchet. AREVA a donc développé une technologie de retraitement permettant de découper l’assemblage, d’extraire et de compacter les parties métalliques, et de séparer les déchets ultimes de l’uranium réutilisable et du plutonium – lequel fait l’objet d’un recyclage particulier sous la forme de MOX.
Dans un réacteur à eau pressurisée, le bilan de la combustion ne peut être amélioré qu’à la marge : il est possible de réduire la proportion de déchets à 3,8 %, mais guère en deçà. En revanche, un réacteur de quatrième génération à spectre rapide pourrait être doté d’un système de multirecyclage permettant la production d’une même quantité d’énergie avec un meilleur rapport entre consommation d’uranium et production de déchets. En théorie, un réacteur rapide pourrait utiliser tout l’uranium extrait de la mine, et non pas seulement 1 % de cette quantité. Mais une estimation prudente conduit plutôt à tabler sur une proportion de 50 %.
M. le président François Brottes. Qu’en est-il de l’EPR ?
M. Sylvain Granger. Comme son nom l’indique – Evolutionary Pressurized Reactor –, l’EPR est un réacteur à eau pressurisée. Son rendement est un peu amélioré par rapport aux précédentes générations, si bien que le rapport entre consommation d’uranium et production de déchets sera un peu meilleur. Mais le gain n’est que marginal et on ne peut pas parler de rupture technologique.
M. le rapporteur. Entre le combustible fabriqué à partir d’uranium naturel et le MOX, quel est le plus coûteux ?
M. Sylvain Granger. Il faut comparer ce qui est comparable, car il s’agit de deux systèmes industriels différents.
Le coût de fabrication du MOX, composé en partie de plutonium, est significativement plus élevé que celui du combustible réalisé à partir d’uranium naturel. Mais le plutonium lui-même est obtenu sans coût supplémentaire, puisqu’il s’agit d’un sous-produit de la combustion de l’uranium. En outre, dans la mesure où le traitement des combustibles usés est considéré essentiellement comme un moyen de limiter le volume des déchets radioactifs ultimes, son coût est intégré au coût complet du combustible. Dès lors, si l’on tient compte de toutes les étapes de la chaîne de production, en amont – achat, conversion, enrichissement et fabrication pour l’uranium naturel, fabrication seulement pour le MOX – et en aval – retraitement –, le coût de l’uranium et celui du MOX apparaissent équivalents.
M. le rapporteur. C’est une question que le rapport de la Cour des comptes n’a pas examinée dans le détail. Nous serions donc très intéressés de connaître les bilans comparés des deux technologies.
M. Sylvain Granger. Ces données existent et peuvent vous être communiquées, même si elles sont commercialement sensibles.
M. le président François Brottes. Quel est l’intérêt du MOX sur le plan économique ?
M. Sylvain Granger. Dès lors que les coûts sont équivalents, l’intérêt du MOX n’est pas vraiment économique. Mais son usage réduit nos besoins en uranium et contribue donc à notre sécurité d’approvisionnement. En outre, il permet de diminuer considérablement – de l’ordre d’un facteur dix – le volume de déchets de haute et moyenne activité à vie longue, et donc le coût de leur stockage. C’est son principal intérêt.
M. le rapporteur. Dans ce cas, pourquoi les autres pays n’ont-ils pas recours à cette technologie ?
M. Sylvain Granger. Il n’y a sans doute pas une réponse unique à cette question. Mais on peut remarquer que les pays qui ont développé cette technologie – comme la Grande-Bretagne – ou tenté de la développer – comme le Japon – partagent certaines caractéristiques avec la France : une part non négligeable de l’électricité provenant de l’énergie nucléaire, un territoire peu étendu et fortement urbanisé. Dans ces conditions, la possibilité de réduire le volume de déchets à stocker prend une plus grande valeur. A contrario, les États-Unis, qui disposent d’un vaste territoire, peuvent accorder moins d’importance à l’économie d’espace. Quant à la Chine, qui envisage également l’utilisation du MOX, elle dispose, comme la France, de très peu de ressources naturelles sur son territoire. Quand on ne bénéficie pas, à la différence des États-Unis, de réserves abondantes en pétrole, en gaz et en uranium, on est plus soucieux de l’économie et du recyclage.
M. le président François Brottes. Le MOX joue donc le rôle d’amortisseur.
M. Sylvain Granger. Et il conduit, voire contraint, à adopter une vision à plus long terme, et à mon avis plus pertinente.
M. Michel Sordi. En 1997, Mme Voynet a pris la décision d’arrêter Superphénix. Pouvez-vous nous rappeler ce qu’était ce programme ?
M. Sylvain Granger. Phénix et Superphénix étaient deux réacteurs à spectre rapide, et constituaient en quelque sorte une première étape dans le développement des réacteurs de quatrième génération. Le premier, un réacteur de moyenne puissance exploité par le Commissariat à l’énergie atomique, a fonctionné de manière plutôt satisfaisante. La construction du second a répondu à une volonté de changer d’échelle et de passer à une exploitation industrielle. Les deux ont été arrêtés.
M. le rapporteur. La décision d’arrêter Superphénix a été prise par tout un gouvernement, et non par un ministre en particulier.
M. Michel Sordi. Mais elle résultait d’un marchandage politique, comme l’abandon du canal Rhin-Rhône !
M. le président François Brottes. Je vous remercie, monsieur Granger, pour cet échange qui a été à la hauteur de nos attentes. Je vous prie de nous communiquer le bilan comparé de l’uranium et du MOX dont nous parlions à l’instant.
Audition de M. Yves Kaluzny, conseiller auprès de la Mission de soutien aux secteurs stratégiques, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (Ministère des Affaires étrangères), et de M. Charles-Antoine Louët, sous-directeur « Industrie nucléaire » à la Direction générale de l'Énergie et du climat (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie)
(Séance du jeudi 6 février 2014)
M. le président François Brottes. Je remercie M. Yves Kaluzny, conseiller politique auprès de la mission de soutien aux secteurs stratégiques, au sein de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (ministère des affaires étrangères), et M. Charles-Antoine Louët, sous-directeur « Industrie nucléaire » à la direction générale de l’énergie et du climat (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) d’avoir accepté notre invitation. Vos regards croisés, messieurs, nous aideront à mieux cerner les fragilités et les forces d’AREVA et d’EDF, dont nous venons d’entendre les représentants.
Durant ces auditions, nous avons notamment évoqué la pression à la hausse qu’exerce la demande asiatique sur les cours de l’uranium, ainsi que la prise de position du Gouvernement demandant à AREVA de prendre en considération les intérêts du Niger dans les négociations en cours. L’argument que nous a opposé AREVA est d’ordre technique : si l’exploitation de l’uranium nigérien devient trop coûteuse, elle perd de son intérêt pour l’entreprise. Nous avons également discuté du rôle du Conseil de politique nucléaire, où la question de l’approvisionnement et celle des relations entre AREVA et EDF sont souvent traitées.
Nous attendons de vous que vous abordiez ces sujets sous un angle politique. Les contrats à long terme d’approvisionnement en uranium, généralement passés par des sociétés ayant un fort caractère national, font jouer les relations entre États et relèvent donc de la diplomatie et de la géopolitique.
Avant de vous donner la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Yves Kaluzny et Charles-Antoine Louët prêtent serment)
M. Yves Kaluzny, conseiller auprès de la mission de soutien aux secteurs stratégiques, direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (ministère des affaires étrangères). Je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller politique, mais chargé de mission pour le secteur nucléaire.
M. le président François Brottes. Vous ne conseillez personne ?
M. Yves Kaluzny. Je m’efforce d’apporter des éclairages techniques.
Lorsqu’on aborde la question de l’uranium, il faut avoir en tête la localisation des ressources et la répartition de la production par pays et par sociétés.
L’uranium est abondant sur la planète. Le « Livre rouge » publié par l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE et par l’Agence internationale de l’énergie atomique recense plus de 5 millions de tonnes de réserves prouvées et plus de 15 millions de tonnes de réserves estimées, sans tenir compte du minerai contenu dans les phosphates ou dans l’eau de mer.
À s’en tenir aux tendances actuelles, ces réserves représentent respectivement 100 et 300 ans de production d’énergie électronucléaire. Par comparaison, les réserves prouvées de pétrole équivalent à 59 ans de production, celles de gaz à 56 ans et celles de charbon à 109 ans.
Pour ce qui est de la répartition sur la surface du globe, 44 % des ressources en uranium sont situées dans des pays faisant partie de l’OCDE, principalement l’Australie, le Canada et les États-Unis. Cette proportion est de 17 % pour le pétrole et de 8 % pour le gaz.
Le continent américain pèse pour un peu moins de 20 %, de même que l’Afrique
– Niger, Namibie et Afrique du Sud. L’Asie centrale et la Russie disposent de 25 à 30 % des réserves et l’Australie de plus de 20 %. Les coûts de l’exploitation des ressources sont également évalués selon les pays producteurs.
M. le président François Brottes. Je relève, dans le tableau que vous nous avez fourni, que ces coûts sont élevés au Niger.
M. Yves Kaluzny. Le Niger dispose de 5 % des ressources mondiales. C’est loin d’être négligeable, mais on n’est pas obligé de passer par le Niger si l’on veut s’approvisionner en uranium…
Pour ce qui est maintenant des pays producteurs, c’est le Kazakhstan qui arrive en tête. Sa production a connu la plus forte croissance de ces cinq dernières années. Le Canada, pays qui exploite l’uranium de longue date, garde un niveau de production élevé. L’Australie également, même si elle limite les quantités de minerai extrait de son sol. Le Niger occupe le cinquième rang, avec un niveau non négligeable de production.
Les principales compagnies productrices sont, par ordre d’importance, la société kazakhe KazAtomProm, AREVA, le canadien CAMECO, le russe ARMZ Uranium One, puis les mineurs généralistes Rio Tinto et BHP Billiton.
Ce tour d’horizon montre que nous disposons d’uranium pour de nombreuses décennies et que la ressource est bien répartie entre les continents.
M. le président François Brottes. Parmi ces entreprises, lesquelles sont liées aux États ?
M. Yves Kaluzny. KazAtomProm est lié à l’État kazakh et ARMZ Uranium One à l’État russe par l’intermédiaire de son actionnaire principal RosAtom. En revanche, Rio Tinto et BHP Billiton sont des sociétés cotées en bourse avec un flottant important.
S’agissant de la sécurité de l’approvisionnement de la France en uranium, il faut d’abord souligner le rôle majeur d’AREVA et d’EDF.
L’entreprise EDF mène une politique de diversification multiple, puisqu’elle concerne à la fois les mines, les régions de provenance et les fournisseurs. Aujourd’hui, AREVA reste un fournisseur de référence pour EDF, mais sa part est limitée à 40 % pour des raisons de sécurité d’approvisionnement – le reste provenant d’une dizaine d’autres fournisseurs.
L’entreprise complète cette politique de diversification par la constitution d’un stock de sécurité. Ce stock d’uranium sous toutes les formes correspond à un peu plus de deux ans de besoin. En pratique, les électriciens européens disposent d’un peu plus de trois ans de stock en moyenne, afin d’avoir le temps de pallier une éventuelle rupture d’approvisionnement.
Quant à AREVA, sa politique consiste à maîtriser des ressources lui assurant sur ses livraisons une visibilité de plus de vingt ans. Cet objectif stratégique a été approuvé par le conseil de surveillance de l’entreprise.
À la fin de 2012, AREVA avait en portefeuille environ 200 000 tonnes de réserves prouvées d’uranium, 100 000 tonnes de réserves mesurées et 175 000 tonnes de ressources inférées. C’est à partir des deux derniers chiffres que l’on réalise des études supplémentaires permettant de quantifier l’uranium réellement présent dans les dépôts et de déterminer s’il est exploitable. Ces quantités seront alors requalifiées en « réserves prouvées » et entreront en compte dans la constitution de la visibilité à vingt ans que l’entreprise se donne pour objectif.
En tant que deuxième producteur mondial, AREVA recherche des gisements de fort volume et souhaite se placer comme un fournisseur de référence vis-à-vis de ses clients.
Parmi les mines les plus importantes, on peut citer le gisement de Cigar Lake, au Canada, dont les teneurs en uranium sont les plus fortes au monde, les mines du Kazakhstan, qui figurent parmi les plus rentables et dont les ressources potentielles sont importantes, et la Mongolie, où existent des perspectives de gisements de fort volume, mieux situés par rapport aux clients potentiels que les mines des zones arctiques.
Ce sont les organes de gouvernance d’AREVA et d’EDF qui assurent le premier contrôle sur les politiques de ces sociétés. Les conseils d’administration, conseils stratégiques ou conseils de surveillance examinent et approuvent régulièrement la politique minière de la première, la politique d’approvisionnement de la seconde.
La gestion des risques implique que l’on considère ceux-ci sous leurs différentes natures.
D’abord le risque minier : une mine n’est jamais à l’abri d’un incident d’exploitation conduisant à une interruption de la production. Il faut donc s’approvisionner à des mines différentes, ce qui ne signifie pas forcément auprès de producteurs différents : compte tenu des investissements nécessaires, il est courant que les producteurs s’associent en joint-venture (coentreprise) pour l’exploitation d’une mine donnée.
Le deuxième risque tient à l’environnement de la mine. À cet égard, la conclusion de partenariats locaux constitue une précaution primordiale.
Vient ensuite un risque global et géopolitique, plus difficile à appréhender en tant que tel. La parade réside dans la diversification géographique des approvisionnements, de manière à éviter qu’une région ne pèse de façon excessive.
Une stratégie robuste repose donc sur des réponses diversifiées : plusieurs mines et plusieurs fournisseurs dans plusieurs régions du monde. On doit l’assortir de la constitution de stocks stratégiques permettant de faire face à une interruption brutale de la fourniture.
Plus généralement, je rappelle que le réseau diplomatique apporte un soutien aux entreprises dans leurs relations avec les pays qui détiennent des mines d’uranium ou qui envisagent d’en ouvrir. En effet, comme vous l’avez indiqué, monsieur le président, les interlocuteurs des entreprises françaises sont souvent des sociétés d’État et les questions d’exploitation minière sont traitées dans ces pays au plus haut niveau politique.
M. le président François Brottes. Le président du directoire d’AREVA a indiqué qu’il avait fait réaliser, en accord avec les autorités du Niger, une étude indépendante sur les potentialités des mines de ce pays. Le ministère des affaires étrangères a-t-il la copie de ce document ?
M. Yves Kaluzny. Vous faites allusion au rapport d’audit commandé conjointement par AREVA et l’État du Niger sur les coentreprises COMINAK et SOMAÏR. Ce document, que je n’ai pas en ma possession, devait établir un bilan technico-économique de la situation minière afin d’alimenter les négociations entre l’État nigérien et AREVA.
M. Denis Baupin, rapporteur. Vous semblez parfois parler d’AREVA et d’EDF comme de sociétés privées complètement autonomes alors qu’elles sont très majoritairement détenues par l’État. Dès lors que l’État français intervient sur le plan diplomatique pour aider localement ces entreprises dont il est l’actionnaire principal, on pourrait s’attendre à ce qu’il dispose des informations nécessaires au suivi des négociations !
Qui plus est, le ministre délégué chargé du développement a pris hier dans l’hémicycle des positions claires à ce sujet, dans le droit fil de la rupture avec la « Françafrique » annoncée tant par le Président de la République que par le ministre des affaires étrangères. Sachant que les relations que ces pays amis et fragiles entretiennent avec les pays occidentaux peuvent se révéler compliquées, comment analysez-vous l’évolution de nos liens avec le Niger ?
Nos interlocuteurs d’EDF et d’AREVA nous ont déjà donné des indications sur la sécurisation et la diversification de l’approvisionnement. Comment ces questions s’articulent-elles avec la politique étrangère de la France ?
En Australie, l’exigence croissante d’un respect des populations autochtones a contraint AREVA à abandonner un projet. Le ministère des affaires étrangères a-t-il une idée de la façon dont on pourrait relier la problématique de l’accès aux ressources et ces attentes en matière de respect des populations, mais aussi de respect des normes environnementales ?
M. Jean-Pierre Gorges. Vous avez évoqué les risques géopolitiques qui pourraient peser sur l’accès aux ressources d’uranium. Confirmez-vous néanmoins que, au-delà des 130 ans de réserves estimées, on pourrait aller jusqu’à 5 000 ans si la recherche conduisait au saut technologique attendu ?
Au moment où s’engage le débat sur la transition énergétique, il est important de montrer que, à la différence de ce qui se passe pour le pétrole et le gaz, la ressource exigée par nos centrales nucléaires est quasiment inépuisable si la France continue d’investir dans la recherche, non pas sur l’EPR qui est une technologie d’attente, mais sur la quatrième et sur la cinquième génération.
J’aimerais donc que l’on retire du débat la question de la rareté de la ressource. Certes, la quasi-absence d’uranium en France est en soi un handicap mais, de ce point de vue aussi, les risques me semblent moindres que pour le pétrole ou pour le gaz.
M. Michel Sordi. Quel intérêt présente la production nucléaire au regard des enjeux de maîtrise des importations de matières premières et, plus globalement, de maîtrise de la ressource ?
M. le président François Brottes. L’État donne-t-il à des sociétés comme AREVA des consignes concernant la sécurité de nos concitoyens à l’étranger, notamment face au risque de prise d’otages ? Existe-t-il des échanges entre les entreprises et les services de renseignement ?
M. Yves Kaluzny. Bien que je ne sois pas expert en la matière, je sais qu’il existe des consignes et des coopérations avec les États pour assurer la sécurité des sites, notamment dans le Sahel.
Vous avez tous entendu les déclarations du ministre Pascal Canfin sur l’état de la négociation avec le Niger. Le problème qui se pose est de trouver un juste équilibre entre la rentabilité commerciale des sociétés impliquées et l’aspiration de l’État du Niger à recueillir les bénéfices de l’extraction de l’uranium. Le ministère des affaires étrangères s’est efforcé de jouer le rôle de facilitateur entre la société AREVA et l’État du Niger en proposant la désignation d’un médiateur, M. François Bujon de l’Estang, pour jouer les bons offices entre les deux parties et globaliser les différents aspects de la négociation. Mais il n’appartenait pas au ministère de s’immiscer dans le détail d’une négociation commerciale que seule AREVA doit mener.
Les exigences croissantes en matière de respect des populations locales et de l’environnement s’imposent à nous indépendamment de toute relation d’État à État. Ce ne sont évidemment pas ces relations qui pourraient amener l’Australie à passer outre la volonté de ses populations et d’ouvrir contre leur gré une mine d’uranium !
Un projet minier, quel qu’il soit, est toujours complexe. Une mine a toujours des effets sur l’environnement. Il convient de les réduire au minimum et cela impose des discussions avec les populations locales, qui doivent trouver leur intérêt dans le projet.
Ainsi, après la récente signature par AREVA et une société mongole d’un accord créant une société minière pour mettre en exploitation des gisements prometteurs, les premières actions consisteront à expliquer aux populations ce que sont réellement les implantations minières et à insérer cette activité dans le tissu économique local. Le ministère des affaires étrangères et son réseau diplomatique sont présents pour aider nos entreprises dans leurs relations avec les États et pour leur suggérer telle ou telle action ; ils ne peuvent certainement pas imposer à la Mongolie d’accepter une activité minière d’AREVA si l’implantation locale ne peut être réalisée correctement. L’exemple du Canada est à cet égard emblématique, puisque les principales mines d’uranium se trouvent au nord du pays et qu’il faut composer avec les exigences des populations autochtones.
L’estimation des réserves et de l’horizon que nous avons devant nous, monsieur Gorges, dépend beaucoup des technologies que nous saurons mettre en œuvre. Avec les réacteurs actuellement en fonctionnement et ceux de la troisième génération, l’horizon est en effet de l’ordre du siècle. Dans l’hypothèse d’un passage à la quatrième génération – réacteurs à neutrons rapides –, cet horizon recule à environ 2 500 ans pour les ressources connues et 8 500 ans pour les ressources estimées. En d’autres termes, si l’on arrive à transformer les perspectives de quatrième génération en technologie fiable, la barrière de la ressource sera levée. Cependant, même si nous n’arrivons pas tout de suite à ce niveau de développement, nous n’avons pas le couteau sous la gorge pour ce qui est de l’approvisionnement.
La production électronucléaire actuelle, monsieur Sordi, permet d’éviter l’importation de combustibles fossiles. Son arrêt total devrait être compensé, dans un premier temps, par des importations de gaz et de charbon, ainsi que par des investissements dans les infrastructures correspondantes. Mais le représentant du ministère en charge de l’énergie sera plus à même que moi de parler du bilan énergétique de la France.
M. le président François Brottes. Je donne donc la parole à M. Charles-Antoine Louët, à qui incombe la tâche difficile de nous dire à quelle heure surgira la quatrième génération. (Sourires.)
M. Charles-Antoine Louët, sous-directeur « Industrie nucléaire » à la Direction générale de l’énergie et du climat (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). Le principe de la quatrième génération est de valoriser l’ensemble des isotopes de l’uranium, donc de faire un usage beaucoup plus complet du minerai. Gardons-nous toutefois de présentations trop schématiques. Comme l’a dit M. Kaluzny, cette technologie est en développement. Des réacteurs à neutrons rapides ont fonctionné mais il n’y a pas aujourd’hui de déploiement à l’échelle industrielle. Or cette technologie aura nécessairement un coût et obéira à des équilibres économiques différents de ceux que nous connaissons. Comme pour les hydrocarbures, la durée des réserves est fonction du prix que l’on est disposé à consacrer à l’extraction de la ressource. Si les prix de l’énergie augmentent, peut-être sera-t-on prêt à payer l’uranium beaucoup plus cher, ce qui conduira à une réévaluation des réserves à technologie inchangée – avant qu’un basculement ne se produise en faveur de la quatrième génération. Je ne crois pas qu’on puisse opposer les deux technologies de ce point de vue. Leurs équilibres, je le répète, sont différents. L’avenir nous dira comment l’une se développera par rapport à l’autre.
Sur le plan purement physique, néanmoins, un parc exclusivement composé de réacteurs à neutrons rapides supprime le besoin de mines. Les chiffres que vous évoquez, monsieur Gorges, proviennent d’une étude du CEA réalisée à partir d’une hypothèse très schématique : si le parc français était uniquement composé de réacteurs de quatrième génération, nous aurions 5 000 ans devant nous avec les seules réserves d’uranium appauvri présentes sur le territoire national.
Pour en venir à une présentation plus générale, l’approvisionnement en uranium est un enjeu important de la sécurité énergétique de la France. Au même titre que l’approvisionnement en hydrocarbures, il est régi par la loi de 1974 relative aux économies d’énergie, laquelle soumet EDF, opérateur unique de nos centrales nucléaires, à des obligations en la matière, ce qui n’est pas le cas pour AREVA.
M. le président François Brottes. Ce sont les représentants de l’État au sein du conseil d’administration qui s’assurent du respect de ces obligations ?
M. Charles-Antoine Louët. Elles n’ont un caractère régalien que sur un point, la constitution d’un stock stratégique correspondant à deux ans de consommation du parc nucléaire. EDF fait une déclaration annuelle qui est vérifiée.
La constitution d’un stock fait partie, à côté de la diversification des fournisseurs et des pays d’origine, de la panoplie de mesures que les entreprises peuvent prendre pour assurer la sécurité de leur approvisionnement. Mais pour EDF et pour elle seule, il s’agit d’une contrainte juridique.
Il vous a été montré ce matin que les réserves et les mines d’uranium étaient plutôt bien réparties dans le monde et que les risques géopolitiques sont de tout autre nature que ceux qui pèsent sur l’approvisionnement en hydrocarbures, d’autant que la part du minerai d’uranium dans le coût de la production d’électricité est très faible. Il faut y ajouter une considération d’ordre cinétique : compte tenu de la taille des stocks que l’on est en mesure de constituer, une rupture de l’approvisionnement en gaz ou en pétrole provoque immédiatement l’entrée en gestion de crise ; le processus serait beaucoup plus lent s’agissant de l’uranium, en raison du stock stratégique mais aussi des « en-cours » de fabrication. Il n’y a pas de pipeline ou de point d’entrée pour l’uranium.
M. le président François Brottes. Le stock stratégique de gaz est de trois mois…
M. Charles-Antoine Louët. L’ordre de grandeur n’est pas le même, en effet. C’est ce qui explique que notre suivi opérationnel et géopolitique soit moins rapproché. Sur le plan juridique, nous nous en tenons à l’obligation concernant les stocks. Cette disposition permet quand même de voir venir : dans l’hypothèse d’une rupture brutale de 25 % de nos importations, nous pourrions tenir huit ans, ce qui laisse le temps de trouver d’autres sources d’approvisionnement.
Cela dit, l’État exerce un suivi important de l’action d’EDF et d’AREVA dans le cadre des organes de gouvernance de ces deux entreprises. Nous nous assurons qu’EDF a bien une politique d’approvisionnement à long terme et son représentant vous a sans doute expliqué que la couverture à long terme de ses contrats d’approvisionnement lui a permis de maîtriser les soubresauts récents du marché à court terme de l’uranium. Nous vérifions aussi la diversification des origines géographiques et des fournisseurs, dont dépend la sécurité d’approvisionnement d’EDF – même si le rôle d’AREVA doit rester majeur.
M. le président François Brottes. Dans le parcours professionnel des fonctionnaires de votre service, quel degré d’étanchéité existe-t-il avec les opérateurs que sont AREVA et EDF ?
M. Charles-Antoine Louët. L’éthique et l’intégrité des fonctionnaires ne sauraient être mises en cause, quelle que soit l’évolution de leur carrière. Du reste, personne dans mon service n’a travaillé chez EDF ou chez AREVA. Et ceux qui voudraient travailler ensuite dans ce secteur sont soumis à des règles déontologiques strictes. Il me serait impossible de rejoindre demain ces entreprises !
M. le rapporteur. Pourtant, un de mes camarades de promotion est conseiller politique du directeur général de l’énergie et du climat alors qu’il a travaillé à Fessenheim.
M. Charles-Antoine Louët. Je parlais de ma sous-direction.
M. le rapporteur. À ma connaissance, le précédent directeur général avait aussi travaillé dans le secteur nucléaire.
M. Charles-Antoine Louët. Oui, mais pour l’administration.
M. le rapporteur. Au vu des recherches en cours, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a-t-elle une évaluation de ce que pourrait être le coût du mégawattheure produit par des centrales de quatrième génération, comparé par exemple à celui du mégawattheure éolien ? Si l’on nous affirme que la technologie de quatrième génération nous ménage une ressource en uranium pour à peu près 5 000 ans, que dire des réserves de vent, de soleil, d’énergie hydraulique marine, etc. ? Puisque certains semblent fantasmer sur la prolongation de ressources épuisables, je rappelle qu’il existe des ressources inépuisables qui sont encore plus intéressantes, et à des coûts, semble-t-il, largement inférieurs à ceux que permettrait une exploitation industrielle des réacteurs de quatrième génération. Ces aspects ne sont pas négligeables pour une commission d’enquête consacrée aux coûts de l’énergie.
Lors de l’audition du représentant d’EDF, j’ai été étonné d’apprendre que près de 60 % des activités de fabrication du combustible – conversion, enrichissement… – se font à l’étranger, alors même qu’AREVA a les capacités pour le faire en France. La DGEC exerce-t-elle un suivi à ce sujet ? Existe-t-il une politique au niveau national, ou, à défaut, une réflexion sur le fait qu’un électricien national, très largement détenu par l’État, recourt à l’étranger pour se procurer ces services ?
Enfin, quelle est la vision de la DGEC concernant les deux filières d’approvisionnement des réacteurs, celle qui consiste à enrichir de l’uranium naturel et celle qui consiste à fabriquer du MOX ? Les services de l’État ont-ils évalué leur rentabilité respective ?
M. Charles-Antoine Louët. Pour ce qui est de la quatrième génération, le développement industriel d’une technologie plutôt que d’une autre est affaire de coût. En l’état actuel des études, il serait envisageable – si l’on décide un jour de le faire – de déployer des réacteurs de quatrième génération dans les années 2040 ou 2050. À de tels horizons, ce sont des objectifs de coûts qui sont fixés, dans l’idée que ces coûts seront en concurrence avec ceux de l’éolien, de l’EPR, du gaz, etc. L’ordre de grandeur est donc d’une centaine d’euros le mégawattheure. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de concept industriel permettant d’annoncer un coût précis. En dernier ressort, si les études montrent qu’il ne faut pas passer à la phase industrielle, il faudra se conformer à la rationalité économique et renoncer !
Quant à la fabrication du combustible à l’étranger – mais cela vaut aussi pour la conversion et pour l’enrichissement –, elle résulte d’un mouvement que l’on observe depuis les années 2000. Alors qu’AREVA était le fournisseur quasi exclusif d’EDF, l’électricien a désormais un portefeuille de fournisseurs beaucoup plus diversifié. Mais la réciproque est vraie : le portefeuille de clients d’AREVA s’est également diversifié. L’État, bien entendu, s’assure que les usines de cette entreprise trouvent des débouchés et observe le taux de diversification d’EDF. S’il considère que ce taux descend au point de mettre en péril les bases industrielles françaises, il peut demander un réexamen. L’enjeu n’est pas de contraindre l’électricien national à commander à AREVA, mais de disposer d’un outil industriel performant qui puisse vendre aussi bien à EDF qu’à d’autres électriciens. Lorsque des opérations importantes d’investissement et de rénovation sont nécessaires dans notre pays et que d’autres pays choisissent de ne pas réinvestir, nous devons alors pouvoir demander à EDF de participer à la couverture des surcoûts.
J’en viens à votre dernière question. Le traitement-recyclage qui permet de fabriquer le MOX est prescrit par la loi française – en l’occurrence par le code de l’environnement. C’est donc avant tout pour des raisons écologiques qu’il est opéré en France, l’objectif étant de réduire la consommation des matières premières et la quantité de déchets. Mais il convient aussi de prendre en compte les aspects économiques. Un recyclage qui serait antiéconomique est à éviter. En l’espèce, les coûts paraissent assez équilibrés entre la filière MOX et la filière uranium. Les modèles économiques étant différents, la variation de certaines données – par exemple les cours de l’uranium – pourra donner l’avantage à l’une ou à l’autre…
M. le président François Brottes. Et en termes d’emploi en France ?
M. Charles-Antoine Louët. Il faut prendre en compte les différents segments de la valeur. Dans le cas des hydrocarbures, une grande partie de cette valeur réside dans les molécules. La valeur ajoutée provient donc largement de l’étranger, où se trouvent de ce fait le plus grand nombre d’emplois. S’agissant de l’uranium, l’extraction se fait également à l’étranger. La filière MOX en revanche, ne produit des emplois qu’en France, puisque c’est à l’usine de La Hague que s’effectue le recyclage.
M. le président François Brottes. En résumé, selon vous, cette filière est écologique et créatrice d’emplois.
M. le rapporteur. Nous demanderons à l’Autorité de sûreté nucléaire son avis sur la question !
M. Charles-Antoine Louët. Le recyclage est écologique dans la mesure où le code de l’environnement précise bien qu’il s’agit de réduire la production de déchets…
M. le rapporteur. Beaucoup d’activités mentionnées par le code de l’environnement ne sont pas écologiques pour autant !
Disposez-vous d’études démontrant que les deux filières ont des coûts équivalents ?
M. Charles-Antoine Louët. Oui. Je vous les adresserai.
M. le président François Brottes. Merci, messieurs, pour votre contribution.
Audition de M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
(Séance du jeudi 13 février 2014)
M. le président François Brottes. Monsieur le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), vous pourriez être l’invité permanent de notre commission d’enquête, qui demandera peut-être à vous réentendre.
Vous garantissez la transparence du fonctionnement des centrales nucléaires et, le cas échéant, c’est vous qui indiquez aux opérateurs qu’ils doivent cesser d’exploiter une centrale.
Quelle appréciation portez-vous sur la maintenance de nos installations nucléaires ? La transparence est-elle totale dans de domaine ? Y a-t-il lieu de s’inquiéter, comme le font l’opinion publique et certaines organisations syndicales, de l’importance accordée à la sous-traitance ? Que penser de la décision de fermer une centrale ou de prolonger la durée de vie d’un réacteur, quand elle émane d’une autre instance que l’ASN ?
Sûreté et sécurité ne sont pas synonymes. Le risque d’une attaque terroriste ou d’une autre intrusion relève moins de l’ASN que des forces de police. Nous vous laisserons définir le périmètre de votre compétence, quitte à regretter qu’elle ne s’étende pas à la sécurité des centrales.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Pierre-Franck Chevet prête serment)
M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire. Le problème de la sous-traitance et de la maintenance pendant les arrêts de tranche n’est pas nouveau, mais il est monté en puissance au cours des années quatre-vingt-dix, et se posera de manière plus aiguë encore dans les prochaines années, lors du grand carénage programmé par EDF.
La maintenance est facteur de sûreté, puisqu’elle vise à entretenir les matériels, notamment de manière préventive, en profitant des arrêts de tranche. On se souvient néanmoins de l’incident de niveau 3 survenu à Gravelines en 1989. Une équipe de la société qui avait travaillé sur l’ensemble des soupapes protégeant le circuit primaire principal avait utilisé de mauvaises vis, ce qui empêchait les soupapes de fonctionner pendant le cycle. De ce fait, le réacteur n’était pas protégé contre les surpressions. L’incident a montré que, faute d’être effectuée de manière rigoureuse, la maintenance peut devenir contre-productive.
Or EDF a opté pour un recours accru à la sous-traitance. En cinq ans, le volume de travaux réalisés pendant les arrêts de tranche, pour des raisons de disponibilité ou de sûreté, a plus que doublé. Il faut en effet rattraper un sous-investissement de cinq à dix ans en matière de maintenance. Le volume de la sous-traitance devrait encore augmenter de manière significative.
Lors des inspections que nous effectuons pendant les arrêts de tranche, nous constatons que le temps qu’EDF consacre à la réalisation des travaux dépasse en moyenne de 50 % les prévisions. Or tout écart par rapport au planning compromet la qualité de la réalisation, sinon la sûreté de l’installation. Seul un tiers des dépassements tient à une bonne raison, par exemple au fait qu’une intervention a révélé un problème technique qui appelle une réparation. Dans les deux tiers des cas, la planification initiale a été mauvaise ou la maintenance insuffisante, ce qui implique une seconde intervention.
Le défaut de maîtrise des arrêts de tranche, d’une grande acuité aujourd’hui, sera encore plus préoccupant dans trois ou quatre ans, quand EDF effectuera le grand carénage, qui suppose des interventions encore plus lourdes. En outre, l’entreprise est confrontée à un renouvellement massif de ses effectifs, qui concernera, en cinq ans, plus de la moitié du personnel. Les jeunes embauchés se forment tandis que des seniors se préparent à la retraite, ce qui explique peut-être certaines difficultés de planification ou d’organisation des travaux. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est stratégique pour préparer le grand carénage.
Nous poursuivons des discussions très serrées avec EDF. Nous vérifions la qualité des déclarations en cas d’anomalie. En 2013, 700 événements significatifs en matière de sûreté ont été signalés. Le chiffre est inférieur à celui de 2012, mais supérieur à celui des années précédentes. Le fait qu’il soit étale peut rassurer sur le plan de la transparence ; il est moins rassurant que plus de la moitié de ces événements s’expliquent par un défaut de qualité de la maintenance.
La sous-traitance résulte d’un choix industriel qui peut se justifier, car le recours à des spécialistes semble une garantie de compétence. Reste que les employés du sous-traitant n’ont pas toujours le niveau de qualification attendu. Il faut non seulement qu’EDF conserve en propre la capacité d’exercer une surveillance, en allant contrôler le travail au bon endroit et au bon moment, mais que sa surveillance soit effective.
L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base l’oblige à surveiller les travaux sur toute la chaîne des prestataires. Ce document est actuellement en cours de déclinaison. Par ailleurs, un texte sur le système de management intégré de la sûreté, de la radioprotection et de l’environnement est en consultation publique jusqu’au 24 février. Il fait obligation à EDF, et à toute la chaîne d’action, de posséder une organisation assurant la bonne qualité des opérations.
Ces sujets sont complexes au sens où ils touchent à des facteurs sociaux, organisationnels et humains. Nous avons été amenés à travailler dessus après l’accident de Fukushima, à la demande du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), auquel nous avions communiqué nos travaux et qui a souhaité que nous allions plus loin. Nous avons créé un groupe de travail ouvert rassemblant tous ceux qui sont intéressés à la question : les exploitants et les sous-traitants, leurs syndicats respectifs, des universitaires, des représentants des ONG et même des cabinets de juristes, car le sujet soulève des problèmes de droit. Ainsi, au nom de la sûreté, chacun souhaite qu’EDF exerce un contrôle entier et intrusif sur l’organisation interne des sous-traitants et le pilotage de leurs actions, mais la logique de l’inspection du travail veut qu’on interdise l’intrusion du donneur d’ordre dans le travail du prestataire.
Plusieurs questions méritent d’être précisées, comme la situation de la sous-traitance en situation normale d’activité ou le cadre contractuel dans lequel elle interviendrait en cas d’accident. L’épisode de Fukushima a montré qu’en cas de crise, si l’exploitant doit faire le nécessaire pour préserver la sûreté de l’installation, des sous-traitants sont indispensables. Dès lors, il faut s’assurer que l’entreprise et les hommes seront capables d’intervenir, le jour dit, dans des conditions qui s’apparentent à celles de la guerre. Le problème se pose aussi pour le personnel des services publics – pompiers ou conducteurs de car –, dont l’aide pourrait être requise en cas de crise. Il faut s’assurer que les personnels interviendront sur la base du volontariat ou d’un engagement contractuel.
Ces questions sont étudiées par le Comité d’orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains (COFSOH). Elles seront résolues dans quelques années, mais j’espère recevoir des résultats intermédiaires avant un ou deux ans.
M. Denis Baupin, rapporteur. Je vous remercie d’avoir évité la langue de bois. Les observateurs de tout bord s’accordent à reconnaître que la transparence a beaucoup progressé depuis quelques années.
Selon les rapports rédigés par l’ASN en 2012, EDF n’a pas assez anticipé le vieillissement des équipements nécessaires à la sûreté et n’a pas réfléchi au moyen de s’approvisionner en pièces de rechange, ce qui engendre des anomalies récurrentes. Dans un rapport publié en janvier 2013, l’inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection d’EDF signale l’augmentation du nombre d’événements significatifs de sûreté provenant d’activités de maintenance en arrêt de tranche ou en marche. Il écrit à ce sujet : « Je suis préoccupé par ces résultats qui traduisent une dégradation régulière de la qualité dans les activités de maintenance et je m’interroge sur les organisations en place, les ressources disponibles ainsi que sur la rigueur et les moyens. » Il dit aussi que « tous les ingrédients sont réunis pour un manque durable de ressources » et qu’« une pièce sur deux n’est pas encore approvisionnée par le processus standard. » Le référentiel de maintenance d’EDF est-il au bon niveau ? L’entreprise a-t-elle réellement pris la mesure des objectifs, des moyens et de l’organisation à mettre en œuvre ? Que penser quand on découvre que les opérations de maintenance requièrent 60 % d’activité de plus que ne le prévoit le programme initial ? Pensez-vous que les moyens humains sont en place ?
Partagez-vous la crainte des commissions locales d’information (CLI) de la Manche, dont les membres ont signalé, dans le Livre blanc qu’ils ont rédigé après leur visite à Fukushima, que le recours à la sous-traitance risque d’entraîner une perte de la culture de sûreté au sein de l’entreprise ? Fait-on trop appel aux sous-traitants, qui travaillent souvent en cascade ? Dans certains cas, on compte jusqu’à huit niveaux de sous-traitance…
Votre travail est-il de contrôler uniquement EDF ou intervenez-vous aussi dans le champ de la sous-traitance ? Est-il exact que 80 % des doses radioactives émises par les installations nucléaires sont reçues par des intervenants extérieurs ?
M. Pierre-Franck Chevet. Pour les questions de sûreté, le référentiel de maintenance n’est pas en cause. D’une part, certaines opérations menées en arrêt de tranche portent non sur la sûreté mais sur la production, la productivité ou la disponibilité. D’autre part, le volume important des travaux actuels devrait nous rassurer. Compte tenu du retard accumulé par EDF, il est normal que la charge de la maintenance augmente, même si c’est cela qui pose des problèmes de qualité et de livraison. C’est à la qualité des travaux qu’il faut réfléchir.
En matière de moyens humains, il faut poser la question des capacités globales et des compétences, notamment de leur renouvellement. Il est difficile aux personnels de se charger d’un chantier qu’ils viennent seulement de découvrir. EDF doit organiser la transmission des compétences pour retrouver la pleine maîtrise des travaux en arrêt de tranche.
En tant qu’Autorité indépendante, nous ne portons pas de jugement sur le recours à la sous-traitance. Celui-ci résulte d’un choix industriel qui comporte ses aspects positifs. En revanche, notre cheval de bataille est de nous assurer qu’EDF conserve une compétence qui lui permet un contrôle sur la chaîne des prestataires, et que ce contrôle est effectif.
Une grande partie des inspections a lieu lors des arrêts de tranche, pendant lesquels nous pouvons accéder à toute la chaîne de sous-traitance. Nous allons voir sur place de quelle manière les gestes sont faits, soit par EDF soit par un sous-traitant, fût-il de huitième rang. Nous vérifions aussi que ceux qui les exécutent possèdent les compétences requises, et que leur travail bénéficie de la surveillance du donneur d’ordre.
Les textes nous chargent de réaliser des inspections sur les installations nucléaires, mais, lorsqu’un sous-traitant prépare une action de maintenance, il exécute les travaux de préfabrication ou de fabrication en dehors de ces installations. Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, voire dans un autre cadre législatif, nous souhaitons être autorisés à inspecter ce travail préalable, dont la qualité est déterminante.
Nous vérifierons les chiffres concernant la proportion de doses radioactives reçues par les intervenants extérieurs. Le taux de 80 %, que vous citez, n’est pas surprenant, puisque ce sont essentiellement les actions dosantes qui sont sous-traitées.
Quant au défaut de qualité de la maintenance, qui concerne plus de 30 % des problèmes rencontrés lors des arrêts de tranche, il tient pour moitié à des problèmes d’organisation ou de planification imputables à EDF, pour moitié à la qualité des gestes exécutés par les sous-traitants.
M. le président François Brottes. Selon vous, les annonces relatives à l’avenir de la filière déterminent-elles les vocations ?
M. Pierre-Franck Chevet. L’attractivité de la filière dépend de l’avenir qu’on lui réserve. Actuellement, EDF peut embaucher du personnel de bon niveau, mais il faut du temps – en salle et sur le terrain – pour le former à la réalisation d’opérations complexes. Je ne préjuge pas de la politique énergétique, qui n’est pas de mon ressort, mais il va de soi que le secteur cesserait d’attirer si l’on annonçait la fermeture des centrales à brève échéance.
M. Hervé Mariton. Depuis qu’on présente la fermeture d’un réacteur comme une décision politique, on parle plus volontiers de démantèlement que d’arrêt d’un réacteur. Existe-t-il une différence, en matière de sûreté nucléaire, entre les deux termes ? Un risque peut-il survenir entre le moment où l’on prend une décision législative ou administrative de fermeture et celui où un processus physique l’exécute ?
M. Philippe Baumel. Est-il exact que 80 % des travaux de maintenance décidés par EDF sont dédiés à la sous-traitance ? Avez-vous une vision claire des conditions de travail, du niveau de formation et de la protection des sous-traitants contre les risques d’exposition ? Des contrôles sont-ils réalisés dans ce domaine ?
En 2011, une mission parlementaire, qui avait rédigé des préconisations en matière de sûreté nucléaire, a plaidé pour la prééminence du mieux-disant sur le moins-disant, pour le suivi médical des personnels sous-traitants par un correspondant référent et pour une limitation de la sous-traitance en cascade, qui multiplie le risque d’opacité et la dilution des responsabilités. Avez-vous constaté une évolution dans ces domaines ?
M. Jean-Pierre Gorges. Au cours d’une audition précédente, on nous a expliqué que les réserves d’uranium correspondent à cent trente ans de consommation, mais que le passage de la génération III à la génération IV peut prolonger de quelque cinq mille ans la ressource du combustible. En termes de sûreté, quel est l’apport de la génération IV ? La consommation des déchets induit-elle un avantage supplémentaire ?
Puisque l’on envisage de prolonger de trente à soixante ans les centrales nucléaires, comment augmenter leur sûreté jusqu’à ce qu’elles accèdent à la génération IV, ce qui sera possible dans une dizaine d’années ?
Ne peut-on pas attribuer la « perte de la culture de sûreté au sein de l’entreprise », évoquée par le rapporteur, au fait que certains politiques annoncent constamment qu’on va désinstaller l’outil nucléaire ?
M. Michel Sordi. Comment appréciez-vous le niveau de sûreté de la centrale de Fessenheim ? Je rappelle que l’ASN a approuvé la prolongation de son exploitation pendant dix ans et que les mesures décidées au lendemain de Fukushima sont en cours de réalisation. Émettez-vous des réserves sur la capacité des réacteurs à fonctionner l’un, jusqu’en 2019, l’autre, jusqu’en 2021 ?
La Suisse et les États-Unis entendent prolonger jusqu’à soixante ans la durée d’exploitation des centrales nucléaires, y compris celle de Beaver Valley, en Pennsylvanie, sœur jumelle de Fessenheim. Qu’est-ce qui nous empêche de les imiter ?
L’ASN intervient-elle pour adapter l’évolution de la réglementation au calendrier fixé par le Gouvernement pour fermer Fessenheim ?
M. Stéphane Travert. Les dirigeants de la centrale nucléaire de Flamanville, située dans ma circonscription, tentent, dans le respect des règles de sécurité, d’intégrer une démarche de work in blue, consistant à supprimer l’obligation faite à tous les salariés et sous-traitants de porter des tenues de protection. Comment appréciez-vous leur initiative ?
M. Bernard Accoyer. Comment jugez-vous la décision, prise il y a près de dix-sept ans, de démanteler le surgénérateur expérimental Superphénix de Creys-Malville ?
M. Pierre-Franck Chevet. Le terme de démantèlement n’est pas nouveau. Avant la loi de 2006, on distinguait l’arrêt définitif d’une centrale, enregistrant la cessation d’activité sans perspective de redémarrage, et l’acte approuvant les conditions du démantèlement, qui est un processus technique assez lourd. Hélas, lorsque les exploitants avaient fait prononcer par la puissance publique l’arrêt définitif d’une centrale, leur taxe sur les installations nucléaires de base (INB) diminuait, et ils manifestaient peu de hâte pour préparer les opérations de démantèlement.
La loi de 2006 a fusionné les procédures, en faisant le pari que, si les exploitants restaient redevables de la taxe, ils seraient incités à démanteler. Toutefois, celle-ci n’est pas assez élevée pour jouer ce rôle. D’où l’idée de réintroduire un dispositif distinguant les deux actes, mais limitant à un ou deux ans le délai qui les sépare. On parle alors de « démantèlement immédiat », expression légèrement impropre, car il s’agit en fait de préparer le démantèlement le plus rapidement possible.
Il est essentiel que cette opération très lourde, qui exige plusieurs dizaines d’années, soit préparée par ceux qui connaissent l’installation, c’est-à-dire par ceux qui l’ont exploitée. Si l’on n’anticipe pas cette étape, les personnes compétentes qui peuvent démonter le site ne seront plus disponibles. Or la loi prévoit le même niveau d’exigence réglementaire pour le démantèlement que pour le démarrage d’une centrale, car les risques d’irradiation sont réels. Le nouveau dispositif doit encore être approuvé par le législateur, mais nous soutenons l’idée, conforme à la pratique internationale, qu’il faut réduire le délai entre la constatation de l’arrêt du site et le dépôt du dossier de démantèlement.
M. Baumel m’a demandé quelle proportion des travaux de maintenance était confiée à la sous-traitance. Le chiffre de 80 % paraît exact. Durant un arrêt de tranche, jusqu’à 2 700 personnes peuvent intervenir sur un réacteur, en plus des 800 à 1 000 personnes qui y travaillent ordinairement.
Nous veillons au niveau de protection et de qualification des agents. Les textes que j’ai mentionnés prévoient que, quelle que soit la nature des interventions, les personnels de la société ou les sous-traitants soient qualifiés, ce qui est facile à vérifier lors des inspections. Le bilan de celles-ci est en cours de rédaction. Nous présenterons notre rapport annuel au Parlement en avril, mais, si vous le souhaitez, je pourrai vous en présenter un premier aperçu.
Plus la chaîne de sous-traitance est longue, plus grand est le risque d’une dilution des responsabilités ; mais, avant de réduire la chaîne, il est essentiel de travailler sur le résultat, ce qui suppose que le personnel qui exécute le travail soit qualifié et que celui-ci soit contrôlé par EDF.
Monsieur Gorges, après la génération II, que nous connaissons actuellement, la génération III, qui est celle de l’EPR, apporte une amélioration importante en termes de sûreté. La génération IV donne l’impression de franchir un nouveau cap en la matière, mais son objectif est avant tout d’améliorer la réutilisation des déchets. Une de nos préoccupations est de mettre en service des réacteurs d’après EPR, qui pourraient être installés en 2040-2050. À cette date, les exigences de sûreté auront encore augmenté. Nous avons demandé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) que l’on tente d’introduire, au moins dans un prototype intermédiaire, des facteurs d’amélioration supplémentaires par rapport à la génération III, afin de les tester avant une éventuelle utilisation dans la génération IV.
J’ai supervisé une expérience menée en France avec Superphénix sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Il est difficile de contrôler leur évolution en service et d’observer la dégradation éventuelle des matériaux, car le sodium, pour rester liquide, doit être maintenu à une température élevée. En outre, celui-ci ne fait pas bon ménage avec l’eau, ce qui induit des risques spécifiques. Il faudra franchir un saut technologique afin de trouver une parade à de tels inconvénients avant de retenir ce type de réacteur.
Sous réserve d’une vérification réacteur par réacteur, nous considérons comme acquis le principe d’une prolongation de l’exploitation jusqu’à quarante ans, mais non jusqu’à cinquante ou soixante ans. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une simple réserve d’examen. D’importants obstacles techniques doivent encore être levés.
Sur certains sujets majeurs, nous attendons des propositions d’EDF. Forts de l’expérience acquise lors du passage de trente à quarante ans, nous pensons pouvoir émettre un premier avis en 2015 et un avis définitif en 2018-2019. Il va de soi que la prolongation doit être examinée au regard des exigences de la génération moderne, ce qui soulève des questions concrètes. Des améliorations doivent être apportées aux piscines des réacteurs, dont on a vu à Fukushima qu’elles représentaient un enjeu essentiel. D’autre part, les réacteurs de troisième génération possèdent, sous la cuve, un récupérateur de corium (core catcher), qui n’existe pas sur les réacteurs actuels. Sur ces sujets, nos questions n’ont pas encore reçu de réponse. En tant qu’autorité de contrôle, nous vérifierons les travaux menés par EDF.
Il faut augmenter le niveau de sûreté pour prolonger les réacteurs au-delà de quarante ans, sachant que la solution alternative est la mise en place de réacteurs de troisième génération, régis par des standards nouveaux. Cette stratégie, également retenue par mes homologues européens, est conforme à la position adoptée par la France sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Elle consiste à mettre en œuvre a posteriori, durant la durée de vie d’une exploitation, les technologies qui viennent d’être découvertes. À l’inverse, sauf événement majeur ou risque grave, les Américains s’en tiennent aux standards qui prévalaient lors de la conception des réacteurs. Dans ce cas, la réflexion est plus simple : soit les systèmes – essentiellement la cuve du réacteur et les enceintes de confinement – sont remplaçables, et on les remplace ; soit ils ne le sont pas, et l’on s’assure qu’ils n’ont pas trop vieilli.
M. le président François Brottes. D’une centrale à l’autre, le modèle et, par conséquent, le coût des préconisations sont-ils identiques ?
M. Pierre-Franck Chevet. Non. Au cours de nos visites de réévaluation de sûreté, nous avons identifié des défauts importants sur la cuve d’un réacteur de Tricastin, ce qui implique que son vieillissement posera des problèmes particuliers. Sur certaines centrales de 1300 mégawatts des bords de Loire, comme Belleville, la qualité des enceintes pose problème, ce qui appellera sans doute un traitement différencié. Je ne suis pas certain que les récupérateurs de corium soient identiques pour une unité de 900 et 1300 mégawatts. À Fessenheim, ce n’est pas un core catcher, mais un dispositif comparable qui a été installé. Le radier étant moins épais qu’ailleurs, on a trouvé le moyen de retarder, le cas échéant, la traversée d’un cœur fondu, mais le système offre moins de garanties qu’un récupérateur de corium.
Je vous confirme que la sûreté des réacteurs de Fessenheim est assurée, pour l’un, jusqu’en 2019, pour l’autre, jusqu’en 2021, sous réserve que ne survienne aucun incident non prévu et que nos prescriptions soient mises en œuvre – à moins que l’arrêt soit intervenu entre-temps.
Selon certaines études, le work in blue aurait un bénéfice en termes de radioprotection collective, mais nous procédons encore à des analyses avant de rendre notre avis. Actuellement, tout le personnel porte la tenue de protection qui permet d’aller partout. Il semble que certaines personnes qui restent dans le bâtiment du réacteur pourraient s’en dispenser, à condition que le balisage des zones à problème soit extrêmement rigoureux.
Nous effectuons des inspections sur le démantèlement de Superphénix. Aucune difficulté particulière n’a été signalée, mais, dans l’attente d’une solution, l’atelier pour l’entreposage du combustible (APEC) sera maintenu plus longtemps que les autres installations.
M. Michel Sordi. À Fessenheim, il a fallu réaliser des travaux importants pour épaissir le radier. Quelle différence y a-t-il entre ce dispositif et un récupérateur de corium ?
M. Pierre-Franck Chevet. Dans un réacteur, quand le combustible fond, il se masse au fond de la cuve, qu’il attaque. À Three Mile Island, la cuve a été fortement attaquée mais pas percée. Quand le combustible la traverse, il peut se retrouver en contact avec le béton du radier, qu’il attaque à son tour. Partout en France, le radier a une épaisseur de deux à trois mètres, ce qui n’est pas le cas à Fessenheim.
EDF, à qui nous avons demandé de l’épaissir, a proposé une solution astucieuse, consistant à modifier la configuration du dispositif situé sous la cuve. Si le cœur fondu sort de celle-ci, il s’étalera, ce qui le rendra moins actif, de sorte qu’il traversera le béton moins vite. Reste qu’il le traversera tout de même, alors qu’il pourrait traverser dans un autre réacteur. Le dispositif n’est donc pas un “récupérateur” au sens où l’on serait certain que le corium resterait confiné, mais il agit seulement comme un retardateur ; un récupérateur comprend un circuit de refroidissement sous la zone d’étalement, ce qui permet de figer complètement le cœur. Notre objectif est d’obtenir à Fessenheim le même niveau de sûreté que dans le reste du parc.
M. le rapporteur. Existe-t-il d’autres centrales dont la situation soit aussi problématique que celle de Fessenheim ? Je rappelle que son réacteur se situe seulement deux mètres au-dessus de la nappe phréatique, et que l’épaisseur du radier ne peut pas freiner le corium pendant plus de quarante-huit heures.
Les moyens juridiques dont dispose l’ASN lui permettent-ils d’adresser une mise en demeure officielle à EDF, à Areva ou au CEA ? Souhaitez-vous que la loi vous donne plus de pouvoir ?
M. Pierre-Franck Chevet. À Civaux comme à Fessenheim, la nappe phréatique est assez proche de la surface. Il est toujours difficile de porter un jugement global, compte tenu des spécificités de chaque site, mais le niveau de sûreté de Fessenheim est comparable à celui de l’ensemble du parc.
Pardon si cette remarque ne s’inscrit pas dans l’air du temps, mais le principal problème que rencontre l’ASN est celui des moyens humains. Pour l’instant, nous n’avons pas la capacité de nous saisir de dossiers très lourds. Il faudra encore dix ans de travail pour tirer les conclusions post-Fukushima. En janvier, nous avons rendu public ce que nous appelons le « noyau dur », c’est-à-dire les dispositions de sûreté supplémentaires qui permettraient de protéger les centrales de toutes les agressions. Ce schéma n’est qu’une étape. La prochaine consistera à recevoir, puis à étudier des plans, ce qui augmentera notre charge de travail.
Pour prolonger la durée de vie des centrales, nous devrons nous saisir de sujets très complexes. J’ai le sentiment que la question des compétences et des moyens humains se pose aussi chez les exploitants.
Pour la mise en service de l’EPR, nous sommes face à un mur de charges. Je ne vois pas comment y faire face, compte tenu des moyens dont nous disposons, même si l’on y ajoute ceux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). La loi de transition énergétique ne réglera pas le problème.
Nous avons la possibilité d’arrêter à tout moment une installation. C’est en quelque sorte l’arme atomique, réservée aux cas très graves. Nous pouvons aussi effectuer une mise en demeure, c’est-à-dire adresser un document public et formel constatant qu’une installation s’écarte des consignes. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, nous dressons un procès-verbal qui est transmis à la justice, dont on connaît les lenteurs. Entre ces deux extrêmes, il manque une procédure intermédiaire, qui prévoirait, par exemple, une astreinte journalière tant qu’une installation n’est pas mise en conformité.
Dans la situation économique actuelle, les opérateurs ont tendance à repousser les investissements de mise en conformité. Ils pensent qu’un léger écart de sûreté peut attendre quelques mois, quand ce n’est pas quinze ou vingt ans, ce qui, à force, finit par poser un problème de sûreté. Il faudrait que la loi permette de moduler les sanctions en fonction des problèmes. Quand on sait qu’un jour d’arrêt de tranche coûte un million d’euros, on comprend que la sanction journalière ne peut pas être de 1 500 euros.
M. Bernard Accoyer. Votre objectivité, dont je vous remercie, vous permet de délivrer un diagnostic technique sur des situations apocalyptiques. Vous n’ignorez pas, cependant, que certaines mouvances dogmatiques peuvent utiliser chacune de vos phrases pour remettre en cause l’évaluation du bénéfice/risque propre à toute technique.
M. Michel Sordi. Quelle est l’articulation entre l’ASN et l’IRSN ?
M. le président François Brottes. Pour aller plus loin, quel est votre droit de tirage sur les compétences de l’IRSN ? Comment jugez-vous le scénario catastrophe que celui-ci a échafaudé en cas d’accident ?
M. Pierre-Franck Chevet. Nous devons dire ce que nous savons avec toutes les nuances nécessaires et assurer la transparence du dispositif technique comme du processus de décision. C’est pourquoi, après Fukushima, nous avons rendu public l’avis de l’IRSN et d’un groupe permanent d’experts, qui complète ses analyses techniques. Notre devoir est de faire connaître ces éléments sans cacher ni certaines incertitudes ni la diversité des points de vue qui peuvent s’exprimer même au sein du système de contrôle. Tant pis si certains exploitent nos propos en un sens favorable ou défavorable au nucléaire.
M. le rapporteur. Le contrôle citoyen est-il, pour vous, une aide ou un frein ?
M. Pierre-Franck Chevet. Plus une question est difficile, plus il faut ouvrir le champ du débat. En 2005, nous avons engagé un travail sur le post-accidentel, particulièrement sur les mesures à prendre dans les heures suivant l’accident. L’épisode de Fukushima a montré la nécessité de réfléchir à plus long terme, quand toute la vie économique et sociale d’une région est impactée. La gestion de l’eau, par exemple, n’est pas la même pendant vingt-quatre heures, quand il suffit de confiner la population pour la protéger d’un panache radioactif, et pendant une semaine, quand l’approvisionnement en eau risque de devenir insuffisant. Sur ces sujets, il n’y a pas d’autre solution que d’ouvrir le débat à toute la société civile, y compris aux élus ou aux détracteurs du nucléaire, car c’est avec eux qu’il faudra traiter les problèmes.
Cette méthode a permis d’enrichir le plan gouvernemental sur la gestion de crise, qui vient de paraître. Nous continuons les travaux, en réfléchissant à partir de risques encore plus importants.
La France a adopté un système dual, qui existe d’ailleurs dans d’autres pays. Une institution, l’ASN, prend les décisions, réalise les contrôles et édicte les réglementations ; une autre, l’IRSN, lui apporte un appui technique et des compétences scientifiques. Chacune emploie environ 500 personnes en équivalent temps plein. Entre ces deux instances, nous avons mis en place des groupes permanents d’experts, qui, sans participer à l’analyse de premier niveau, tentent de porter un jugement avant que nous ne prenions une décision.
À mon sens, même si le système intégré fonctionne bien aux États-Unis, la distinction entre l’expert et le décideur est un atout majeur pour la sûreté. Désireux d’améliorer le modèle français, nous avons choisi d’ouvrir plus largement les groupes permanents d’experts à la société civile. Nous recrutons en ce moment des personnalités de l’université, pour peu qu’elles possèdent une expertise ou se montrent prêtes à l’acquérir, car les débats sont complexes sur le plan technique. En mai, nous aurons renouvelé et élargi la composition de tous ces groupes.
Reste qu’il est toujours difficile de piloter un travail sur deux niveaux et de le synchroniser. À cet égard, nous pouvons encore progresser.
M. Jean-Pierre Gorges. Je fais partie des cinq députés qui ont voté contre l’inscription du principe de précaution dans la Constitution. Je pense, en effet, en tant que scientifique, qu’on supprime toute possibilité d’amélioration en arrêtant la science. D’ailleurs, au Japon, il y a eu moins de morts à Fukushima que dans des accidents d’avion ou de voiture. Je suis convaincu que la transition énergétique se fera vers le nucléaire et grâce à lui.
Votre rôle ne devrait-il pas consister à éclairer la réflexion par des statistiques ? Au lieu d’enfermer le pouvoir dans votre décision – parce que vous considérerez que le nucléaire est dangereux ou non –, mieux vaudrait répertorier les risques en évaluant leur probabilité. C’est ainsi que le pouvoir politique français s’est déterminé en faveur du nucléaire. Vous l’avez compris : l’avis du scientifique m’intéresse plus que celui du responsable.
M. Pierre-Franck Chevet. La loi de 2006 nous a constitués en autorité indépendante, ce qui donne à notre responsabilité en matière de sûreté un caractère technique et évite que notre diagnostic ne soit contesté sur une base politique. Au début de ma carrière, n’appartenant pas encore à une autorité indépendante, j’ai travaillé sur un rapport consacré à Superphénix ; l’avant-projet, qui avait été envoyé au ministre de l’environnement et à celui de l’industrie, a fuité dans la presse, si bien que le rapport n’a pu être utilisé, ni dans un sens ni dans l’autre, en raison d’un soupçon de bidouillage totalement infondé. Cette anecdote montre l’importance de posséder une autorité indépendante.
Par ailleurs, la France a toujours préféré à l’approche probabiliste une approche déterministe. Nous cherchons à imaginer des solutions en partant d’une situation donnée. S’il est facile de calculer la probabilité qu’une vanne tombe en panne, ce qui se produit partout dans le monde, il est très difficile d’évaluer celle d’un événement qui ne s’est jamais produit. Quelle était la probabilité qu’un tsunami se produise à Fukushima ?
M. Bernard Accoyer. Elle était loin d’être nulle !
M. Pierre-Franck Chevet. Certes, mais on peut travailler dix ans sur le sujet sans trouver autre chose qu’un chiffre extrêmement aléatoire, qui tendra vers zéro. On obtient des résultats plus robustes en s’éloignant de l’approche probabiliste, privilégiée par les Anglo-saxons.
Réfléchissons sur l’exemple de Fukushima. La France n’ayant pas les mêmes zones sismiques que le Japon, il y a très peu de risques qu’elle soit frappée par un tsunami. La méthode probabiliste pourrait l’inciter à ne rien faire. Cependant, il n’est pas impossible qu’un événement non prévu par les systèmes attaque brutalement plusieurs réacteurs d’une installation. Notre démarche post-Fukushima consiste donc à revenir aux fondamentaux physiques : pour sauver un réacteur, il faut de l’eau, donc des pompes, donc de l’électricité. C’est un raisonnement qui ne fait pas beaucoup de place à l’approche probabiliste, mais dans lequel je me sens très à l’aise.
M. le président François Brottes. Je vous remercie.
Audition de M. Étienne Dutheil, directeur-adjoint de la Production nucléaire (EDF)
(Séance du jeudi 13 février 2014)
M. le président François Brottes. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Étienne Dutheil, directeur-adjoint de la production nucléaire à EDF.
Nous allons pouvoir confronter vos réponses avec les informations que vient de nous donner le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), faisant état de défauts assez significatifs dans la maîtrise des arrêts de tranche. Même si la situation s’est notablement améliorée, peut-être nous confirmerez-vous la réduction, pendant une certaine période, de l’effort financier consacré à la gestion des avaries. Autrement dit, un bon compte d’exploitation nécessite-t-il une mauvaise maintenance des centrales ? Si la formule est caricaturale, elle permet d’aller au cœur de nos préoccupations : les coûts de la filière, de son maintien en bon état de fonctionnement et de son éventuelle prolongation.
L’organisation des arrêts de tranche a connu des dérives avec des allongements des durées programmées importants – une vingtaine de jours en moyenne et même plus de vingt-cinq jours en 2012. Les mauvaises langues pourraient en conclure qu’EDF ne maîtrise pas suffisamment le processus industriel, maîtrise qui est la garantie d’une maintenance réussie et performante.
Au moment où le débat sur la transition énergétique bat son plein, où l’on se demande s’il faut prolonger, arrêter ou remplacer les centrales nucléaires, le projet de grand carénage revêt un caractère crucial pour EDF.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Étienne Dutheil prête serment)
M. Étienne Dutheil, directeur-adjoint de la production nucléaire à EDF. La maintenance des centrales nucléaires en exploitation recouvre à la fois des opérations de maintenance courante et de contrôle des installations, systèmes et matériels, ainsi que le remplacement de gros composants ou des modifications visant à garantir et améliorer régulièrement la sûreté et la disponibilité des installations. Les opérations de maintenance sont effectuées le plus souvent lors des arrêts de tranche, tous les douze à dix-huit mois suivant le type de centrale. En 2012, les dépenses totales d’investissement de maintenance se sont élevées à 2,748 milliards d’euros et le montant des dépenses d’exploitation liées à la sous-traitance à 1,351 milliard d’euros, soit un total de 4,099 milliards d’euros.
L’appel à la sous-traitance pour les opérations de maintenance répond à un triple besoin. Tout d’abord, c’est le moyen de bénéficier des compétences pointues ou rares, acquises et entretenues en permanence, que seuls des constructeurs et des entreprises spécialisées, qui travaillent aussi pour d’autres industriels, peuvent mettre à la disposition d’EDF. Ensuite, la sous-traitance permet de faire face à la forte saisonnalité des arrêts de tranche et donc d’absorber des pics de charge. Pour information, une visite décennale mobilise, à elle seule, plus de 1 500 salariés de différents métiers. Enfin, dans des domaines tels que la logistique ou le nettoyage, la présence permanente sur site de cette main-d’œuvre spécialisée est un gage d’efficacité dans les périodes d’arrêt de tranche.
Dans tous les cas, EDF conserve la maîtrise technique et industrielle des opérations de maintenance confiées aux entreprises prestataires, ce qui lui permet d’actualiser régulièrement sa politique industrielle. C’est ainsi qu’elle a procédé à la réinternalisation partielle de la maintenance de la robinetterie ou des activités de tuyauterie-soudage, en vue de pérenniser ses compétences de maîtrise d’ouvrage.
Le recours à des entreprises prestataires répond à une politique industrielle qui vise à garantir en permanence la performance dans tous les domaines, et non pas à réduire les effectifs d’EDF. Autrement, pourquoi procéderait-elle à 6 000 recrutements par an, dont 2 000 correspondent à des créations nettes d’emploi ? Un tiers des collaborateurs ainsi embauchés est affecté au domaine nucléaire.
EDF a fait le choix de confier à des entreprises prestataires la majeure partie des opérations de maintenance effectuées dans ses centrales depuis plus de vingt ans. Ces entreprises sont aujourd’hui des partenaires et des acteurs essentiels du parc nucléaire français. En 2012, elles ont effectué 32 millions d’heures de travail et mobilisé régulièrement quelque 22 000 salariés. Plus de 19 500 d’entre eux sont intervenus en zone contrôlée, c’est-à-dire dans la partie nucléaire de l’installation. Pour leur part, les salariés d’EDF étaient 27 000 à être directement affectés au domaine nucléaire, dont 20 000 sur les sites de production.
L’ASN procède régulièrement à des inspections externes sur le recours à des entreprises prestataires.
Depuis plus de quinze ans, EDF et les entreprises prestataires mènent une action commune pour améliorer la radioprotection des intervenants, stabiliser les emplois, détecter d’éventuelles situations de sous-traitance anormale, améliorer la sûreté et la qualité des interventions ainsi que les conditions de travail et de vie des salariés de ces entreprises. À cet effet, depuis le début de 2013, EDF intègre dans ses appels d’offres et ses marchés le cahier des charges social établi en juillet 2012 par le comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN).
Les opérations de maintenance sont soumises à des procédures strictes et à de nombreux contrôles internes et externes, prévus notamment par le droit du travail et l’arrêté du 7 février 2012. Celui-ci fixe les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, en particulier en matière de contrôles dosimétriques et de suivi médical.
Un processus rigoureux de sélection des entreprises prestataires permet de s’assurer qu’elles ont les compétences nécessaires pour obtenir la qualification requise pour travailler dans les centrales nucléaires. Cette qualification est décernée sur examen d’un dossier d’aptitude remis par l’entreprise, suivi d’un audit complet de celle-ci.
À la fin de l’année 2013, 810 entreprises prestataires de service de toute taille étaient qualifiées pour effectuer des opérations de maintenance sur les centrales nucléaires d’EDF. Elles soutiennent ainsi la filière nucléaire, qui génère directement 220 000 emplois et dont 60 % des acteurs industriels sont en recherche de collaborateurs. Elles contribuent également au renforcement du tissu industriel français. Bon nombre de ces entreprises interviennent, en effet, dans d’autres secteurs d’activité, comme la pétrochimie ou la papeterie, et trouvent dans la maintenance nucléaire un moyen de consolider leur plan de charge et leurs emplois.
EDF impose à toutes les entreprises prestataires travaillant en zone nucléaire d’avoir obtenu la certification du comité français de certification des entreprises pour la formation et le suivi des personnes travaillant sous rayonnement ionisant (CEFRI). Elle appliquera également, dès le 1er juillet 2015, les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2013, qui renforce la procédure de certification.
En matière de passation de marchés, EDF relève de la directive européenne 2004-17 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, qui a été transposée dans le droit français. À cet égard, elle doit respecter les principes généraux de mise en concurrence avec publicité européenne préalable, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de non-discrimination.
Le dispositif d’analyse des offres mis en place par EDF exclut toute sélection d’une entreprise qui offrirait des prix moins élevés dus à une prestation technique de mauvaise qualité ou non conforme aux exigences techniques et contractuelles d’EDF ou des prix anormalement bas. La règle de base pour l’attribution des marchés est aujourd’hui la « mieux-disance » : les offres ne sont plus évaluées sur le seul critère du prix, mais également sur ceux du professionnalisme, de la sécurité et de la radioprotection, de la protection de l’environnement, des conditions de travail et de l’environnement social des salariés de l’entreprise. De tels critères peuvent peser jusqu’à 20 % dans l’attribution, notamment sur les marchés à forte composante de main-d’œuvre.
La durée moyenne des marchés de maintenance passés par EDF est aujourd’hui de l’ordre de cinq ans – sept ans pour les marchés de logistique, parfois plus pour les marchés de modification couvrant l’ensemble d’un palier technique. Ces durées longues sont privilégiées pour donner de la visibilité aux entreprises et leur permettre d’investir dans les ressources, les embauches et la formation. EDF s’est d’ailleurs mobilisée au cours de l’année 2013 contre la révision de la directive européenne 2004-17 limitant la durée des marchés à quatre ans.
Au renouvellement de ces marchés, EDF impose désormais aux entreprises « entrantes » la reprise des salariés de l’entreprise « sortante » qui étaient présents de manière permanente sur un site donné pour l’exécution du marché, sur la base du volontariat. Les conditions fixées par EDF pour cette reprise sont définies dans l’appel d’offres : maintien de la rémunération, maintien de l’ancienneté, pas de période d’essai dans la nouvelle entreprise. Cette exigence renforce les dispositions déjà prévues à l’article 10 du cahier des charges social du CSFN.
Six grands groupes français réalisent 50 % du chiffre d’affaires de la maintenance sous-traitée par EDF : Alstom, AREVA, Onet, SPIE, Suez, et VINCI.
Toute sous-traitance doit être déclarée à EDF par l’entreprise prestataire, qui doit répercuter l’intégralité des exigences d’EDF à ses sous-traitants et contrôler les prestations réalisées. Le nombre de niveaux de sous-traitance « en cascade » qui existeraient sur les centrales nucléaires a fait l’objet de nombreuses polémiques. En septembre 2011, EDF a proposé, dans les dossiers d’évaluation complémentaire de sûreté remis à l’ASN, de les limiter à trois pour toutes les opérations de maintenance effectuées sur les centres nucléaires de production d’électricité (CNPE). Cette disposition a été reprise en juillet 2012 par l’ensemble des exploitants nucléaires civils dans le cahier des charges social du CSFN. EDF a décidé de mettre en œuvre de manière volontariste cette disposition dans tous ses appels d’offres dès le 1er juillet 2012, et de l’imposer également de manière rétroactive à tous les marchés en cours ou en négociation à cette date. Ainsi, depuis le 1er juillet 2012, tout titulaire d’un marché signé avec EDF n’est autorisé qu’à deux niveaux de sous-traitance. Précisons que les salariés étrangers ne représentent, quant à eux, que 6 à 7 % des salariés des entreprises prestataires.
L’arrêté « Installation nucléaire de base » (INB) du 7 février 2012 prévoit que l’exploitant exerce une surveillance sur les intervenants extérieurs exécutant des activités importantes pour la protection des intérêts (AIP). La surveillance opérée par EDF répond à ces exigences. Elle permet également, à la fin d’une opération de maintenance, d’établir une évaluation de la prestation, qui constitue un outil à la fois de dialogue avec l’entreprise prestataire et de retour d’information sur la qualification de l’entreprise prestataire.
En matière de formation à la prévention des risques, pour pouvoir travailler en zone nucléaire ou sur des matériels importants pour la sûreté, tout salarié d’une entreprise prestataire doit avoir suivi un cursus de trois, voire quatre, formations obligatoires aux règles de l’assurance qualité, de la sûreté et de la radioprotection. Quelque 750 000 heures de formation ont ainsi été délivrées en 2012 par quatorze organismes.
En matière de radioprotection et de sécurité, EDF a pour politique d’offrir à tous les intervenants, salariés EDF comme salariés d’entreprises prestataires, les mêmes conditions de travail. Les différences d’exposition aux rayonnements ionisants sont liées aux métiers exercés, non au statut des salariés. Chaque intervenant en zone nucléaire doit obligatoirement porter deux dosimètres. Les données provenant du dosimètre électronique fourni par EDF sont collectées en temps réel, à chaque sortie de la zone nucléaire. Tous les résultats des deux mesures de dosimétrie sont collectés par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Trois portiques successifs constituent une chaîne complète de contrôles pour s’assurer de l’absence de contamination externe des intervenants.
Depuis 2005, la réglementation française fixe la limite de dose reçue par exposition aux rayonnements ionisants à 20 millisieverts sur douze mois glissants pour les travailleurs du nucléaire. La même limite réglementaire a été retenue en Belgique ; elle est de 20 millisieverts par an en Allemagne et au Royaume-Uni, et de 50 millisieverts par an aux États-Unis. EDF s’est fixé pour objectif qu’aucun intervenant ne dépasse 16 millisieverts par an, instituant un seuil d’alerte à 14 millisieverts.
En 2013, le seuil de 16 millisieverts n’a pas été dépassé, et seulement huit intervenants ont atteint les 14 millisieverts à un moment de l’année, ce qui a déclenché une procédure de concertation avec l’employeur. La même année, la dose moyenne reçue par les intervenants en zone nucléaire qui ont reçu une dose non nulle était de 1,40 millisievert pour les salariés des entreprises prestataires et de 0,50 millisievert pour les salariés d’EDF. Dans les deux cas, elle a été réduite d’un facteur deux en dix ans. Pour information, la limite d’exposition pour le public est de 1 millisievert par an, un habitant de la région parisienne reçoit 2,5 millisieverts par an, et un scanner peut délivrer une dose de plus de 10 millisieverts.
Les travailleurs intérimaires ou en CDD ne sont pas autorisés à travailler dans les zones orange et rouges, où le débit de dose est le plus élevé. Ils bénéficient également d’une disposition particulière dite de prorata temporis, qui détermine une limite de dose proportionnelle à la durée de leur contrat de travail.
Dans le cadre de sa relation avec les entreprises prestataires, EDF a développé, depuis plus de quinze ans, un partenariat avec les sous-traitants marqué par plusieurs étapes clés. En 1997, une première charte de progrès a été signée avec neuf organisations professionnelles ; une seconde a suivi, en 2004, avec treize autres organisations. Cette charte de progrès et de développement durable porte des engagements, notamment en matière de conditions de travail des salariés des entreprises prestataires. Quoique signée avant la conclusion de l’accord interne EDF de 2006 sur la sous-traitance socialement responsable, elle s’inscrit pleinement dans cet accord.
Une nouvelle et importante évolution a eu lieu en 2012, avec la mise en place du cahier des charges social du CSFN, que tous les exploitants nucléaires doivent intégrer à leurs appels d’offres pour toutes les activités de service et de travaux sur les INB. Ce cahier des charges social a été transmis, le 20 juillet 2012, au Premier ministre, au ministre du redressement productif et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à l’issue de dix réunions d’un groupe de travail spécialement constitué, composé des quatre exploitants nucléaires civils, des organisations syndicales, d’organisations professionnelles, d’entreprises prestataires, de représentants d’administrations et de représentants de l’ASN.
Ce document vise à mieux encadrer le recours à la sous-traitance sur les installations nucléaires, à garantir le savoir-faire, les compétences et l’expérience des intervenants sur site. Il prend comme critères incontournables la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail. Il constitue désormais une pièce contractuelle intégrée aux appels d’offres et aux marchés, qui lie l’exploitant nucléaire et l’entreprise prestataire, ce qui lui confère un poids bien plus important que celui d’une charte signée avec des organisations professionnelles.
Le cahier des charges social encadre notamment le recours à l’intérim et limite à trois les niveaux de sous-traitance. La qualification des entreprises inclut désormais l’existence d’une grille des salaires et la prise en compte de l’ancienneté et des qualifications ; des seuils qualitatifs sont aussi fixés pour l’indemnisation des grands déplacements, complétés par des critères de « mieux-disance » renforcés. Tous les exploitants nucléaires se sont engagés à mettre en œuvre ce cahier dès le début de 2013. EDF l’intègre dans ses appels d’offres depuis la fin janvier 2013.
Les dispositions dont je viens de faire état ainsi que leurs résultats font l’objet d’un rapport annuel sur les conditions de recours aux entreprises prestataires sur le parc nucléaire en exploitation. Le rapport annuel 2012 a été transmis, le 16 septembre 2013, au ministre du redressement productif et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ainsi qu’au président de l’ASN et au président du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN).
M. Denis Baupin, rapporteur. Votre intervention tranche singulièrement avec la précédente. En effet, les rapports de l’ASN mettent en évidence que, par le passé, EDF n’a pas suffisamment anticipé le vieillissement des équipements ni pris en compte le retour d’expérience internationale. En outre, EDF n’identifierait pas assez tôt les équipements importants pour la sûreté. On note également des problèmes d’approvisionnement. L’inspecteur général de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui fait partie des personnels d’EDF, relève, dans son rapport de 2012, une augmentation de plus de 40 % du nombre d’événements significatifs de sûreté provenant d’activités de maintenance, dont la dégradation régulière est préoccupante, malgré le volume des interventions pratiquées ces dernières années.
Le président de l’ASN et le président de la commission de régulation de l’énergie (CRE) estiment qu’une partie des problèmes actuels est liée au défaut d’investissement dans les centrales nucléaires pendant une dizaine d’années. Pouvez-vous nous donner une explication ?
Estimez-vous qu’EDF consacre suffisamment de moyens humains aux activités de maintenance, sachant que, selon l’ASN, la moitié des problèmes survenant pendant la maintenance sont dus à EDF, et que l’autre moitié est imputable aux prestataires ? Dans ces conditions, comment envisagez-vous la préparation du grand carénage, qui impliquera des opérations de maintenance de bien plus grande ampleur ?
Enfin, on entend dire que près de 80 % des doses de radiations reçues au sein des centrales nucléaires le sont par les sous-traitants. Confirmez-vous ce chiffre et, en ce cas, comment l’expliquez-vous ?
Dans leur rapport sur l’organisation de la maintenance, les comités locaux d’information (CLI) de la Manche estiment que le recours à autant de sous-traitants dans les centrales peut entraîner une perte de la culture de sûreté au sein de l’entreprise à cause de la rotation des personnels. Partagez-vous ce point de vue ?
M. le président François Brottes. Nous sommes à un moment charnière du travail de notre commission, c’est pourquoi vos réponses, monsieur Dutheil, doivent être le plus précises possible.
M. Étienne Dutheil. Les avaries techniques qui conduisent à incriminer d’éventuels défauts d’investissement concernaient des matériels du secondaire, c’est-à-dire de la partie non-nucléaire de l’installation – alternateurs ou transformateurs. Dans le même temps, EDF consacrait à l’amélioration des éléments de sûreté l’essentiel des moyens alloués aux modifications. Ce sont là deux champs différents.
M. le président François Brottes. Pourrez-vous nous fournir une note sur ce point ?
M. Étienne Dutheil. Tout à fait.
Le sous-investissement dans l’outil de production s’explique par les choix de l’entreprise à l’époque. Aujourd’hui, elle développe un projet industriel qui ouvre des perspectives de fonctionnement dans la durée, ce qui change complètement la donne : elle a donc réinvesti dans ses moyens de production, à la fois pour les fiabiliser et pour s’inscrire dans une perspective de fonctionnement au-delà de quarante ans.
Aujourd’hui, EDF consacre des moyens suffisants à la modernisation de ses installations et à leur maintenance, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Nous nous attachons à commencer la mise en œuvre de ce programme de rénovation des gros composants en même temps que nous continuons d’en renforcer la sûreté.
Les effectifs de la division Production nucléaire ont atteint leur plus haut niveau historique : nous sommes plus de 22 000, soit un millier de plus que l’année précédente, la plupart travaillant sur les sites de production, et 1 500 à 2 000 au sein des services centraux.
La maîtrise industrielle de nos arrêts de tranche n’ayant pas été conforme au résultat attendu, on peut légitimement se demander comment nous maîtriserons, demain, la charge encore plus importante du grand carénage. Nous avons élaboré un plan d’action en partant d’une idée simple : plus le volume d’activité augmente, plus les activités différentes s’ajoutent et plus elles sont compliquées à gérer. Il dépend des choix de programmation qu’un arrêt de tranche soit complexe ou réalisé de manière fluide.
Traditionnellement, les programmes d’activité étaient définis de façon centralisée pour être ensuite intégrés par les sites pour les arrêts de tranche. Selon cette logique industrielle, EDF avait décidé de rénover chaque année un nombre précis de transformateurs dans les CNPE. Pour faire face à l’accroissement d’activité, il va falloir renverser la logique et permettre aux CNPE de définir eux-mêmes, dans une perspective pluriannuelle et, bien sûr, en lien avec le niveau national, la programmation de leurs activités afin de faciliter la maîtrise industrielle des arrêts de tranche.
Un autre levier très important est le développement des compétences. Les métiers qui concourent à la maîtrise des arrêts de tranche s’apprennent peu à l’école ; aussi avons-nous développé des formations internes. Conjuguées à nos nouveaux recrutements, elles contribuent à renforcer nos compétences et s’inscrivent dans le plan d’action destiné à maîtriser ce volume d’activité croissant, et donc à nous préparer au grand carénage.
S’agissant de la répartition de la dosimétrie, je confirme que 80 % des doses de rayonnements sont reçus par les salariés des entreprises sous-traitantes. Ce chiffre correspond exactement à la répartition des activités entre les salariés des entreprises extérieures et les salariés d’EDF ; l’exposition n’est pas liée au statut des salariés mais à la nature des activités effectuées. Il va de soi que les robinettiers d’EDF qui réalisent des opérations de maintenance sont exposés exactement de la même manière que les employés des entreprises extérieures. Pour les deux types de salariés, nous avons le même souci de réduire autant que possible les doses reçues. Celles-ci ont été divisées par deux en dix ans et représentent aujourd’hui environ 1 millisievert par an, ce qui correspond à l’exposition naturelle. En moyenne, l’exposition naturelle en France est de 2,4 millisieverts par an. La dose moyenne est ici de 1,4 millisievert par an pour les salariés des entreprises extérieures et de 0,5 millisievert par an pour les salariés d’EDF.
M. le président François Brottes. Cela représente quel pourcentage par rapport à la dose tolérable ?
M. Étienne Dutheil. Sur l’ensemble des personnels qui travaillent sur un site, 80 % de la dose est reçue par les salariés des entreprises extérieures et 20 % par les salariés d’EDF. La limite réglementaire est de 20 millisieverts par an, et je rappelle que l’objectif d’EDF est que personne ne reçoive une dose supérieure à 16 millisieverts par an ; des mesures sont prises dès que la dose annuelle reçue atteint 14 millisieverts.
M. le rapporteur. Comment assurez-vous le suivi des personnels d’une centrale à l’autre ?
M. Étienne Dutheil. Le système de suivi de la dose est centralisé. La dosimétrie électronique est collectée par EDF sur le plan national. Nous sommes capables de suivre les doses reçues par les salariés quel que soit l’endroit où ils travaillent. Ces données sont envoyées chaque semaine à l’IRSN.
Je n’ai pas bien compris, monsieur le rapporteur, ce que vous entendiez par le risque de perte de la culture de sûreté. La culture de sûreté est la conscience que chacun doit avoir en permanence des conséquences de ses actes en matière de sûreté nucléaire, ainsi que le définit l’International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG).
M. le rapporteur. Le Livre blanc sur la sûreté des installations civiles nucléaires de la Manche, publié par les trois CLI concernés en décembre 2013, rappelle que, selon le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’EDF : « La sous-traitance ne participe en rien au développement de la culture de sûreté ; au contraire, elle peut être la source d’un risque de dilution de cette culture. On peut parler d’une perte de compétence des gestes techniques en déléguant systématiquement, comme aujourd’hui, ces travaux à la sous-traitance. Lors des arrêts de tranche, le travail de près de 2 000 personnes de la sous-traitance est parfois contrôlé par une petite dizaine de salariés d’EDF seulement. »
M. Étienne Dutheil. Je ne partage pas l’idée d’un risque de perte de la culture de sûreté. La conscience de la conséquence de son activité sur la sûreté relève de nombreux facteurs, tels que la formation ou le management, mais elle n’est pas liée à la sous-traitance. La question est celle du maintien des compétences à EDF pour maîtriser ces activités. Le processus d’apprentissage des personnels, notamment au démarrage des installations, n’est plus reproductible pour les installations telles qu’elles fonctionnent aujourd’hui.
Il faut avoir présent à l’esprit ce qui est essentiel pour maîtriser une activité de maintenance. Par exemple, afin de déterminer l’état de fonctionnement d’une pompe, deux opérations sont nécessaires : mesurer les vibrations puis les analyser. Les deux activités n’ont pas les mêmes conséquences sur les choix de maintenance ; il est évident que l’analyse implique bien plus de conséquences sur le choix à opérer que la collecte elle-même.
Au sein d’EDF, 27 000 personnes travaillent dans le secteur de l’énergie nucléaire à la conduite des installations, dans l’ingénierie et dans les choix de maintenance. Nous avons choisi de maintenir certaines compétences en interne, souvent dans des services qui interviennent dans plusieurs CNPE. Sont concernées la maintenance des groupes motopompes primaires, la maintenance de la robinetterie et les activités de soudage. Il nous est, en effet, apparu utile de compléter les dispositifs d’acquisition des compétences par la réalisation.
Notre politique industrielle prend donc en compte cette dimension de maintien des compétences. Elle n’est pas figée dans le temps : en fonction des retours d’expérience et de l’évolution de nos cartographies des compétences, nous pouvons être amenés à la modifier. La réponse est toujours plurielle, avec des activités qui relèvent de la réalisation et de la formation ainsi que des chantiers-écoles que nous développons. Ceux-ci constituent un levier très intéressant puisque l’on peut y réaliser des gestes en étant déconnecté des contraintes, de sûreté ou autres, liées à l’installation. La maintenance des automatismes – calculateurs, capteurs, contrôle-commande – est très majoritairement, voire intégralement, opérée par des agents EDF.
La situation est assez différente en fonction des domaines, et la préoccupation de l’entretien des compétences est une donnée d’entrée pour notre politique industrielle.
M. Michel Sordi. Les entreprises sous-traitantes se déclarent satisfaites des conditions contractuelles avec EDF, mais connaissez-vous le point de vue des personnels de ces entreprises ?
Le groupe écologiste a récemment soutenu au Parlement européen une proposition, finalement rejetée, consistant à diminuer la durée des marchés relevant des directives sur les marchés publics. Quel est votre point de vue ?
Pouvez-vous donner la position d’EDF sur la part de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique d’ici à 2025 ?
Quel rôle le nucléaire joue-t-il dans le respect des engagements de la France au protocole de Kyoto en matière de lutte contre les gaz à effet de serre ?
Aura-t-il un rôle à jouer dans la garantie d’un approvisionnement stable en électricité sur le réseau ?
M. Philippe Baumel. Vous avez rappelé que 80 % des travaux dans les centrales étaient effectués par des entreprises sous-traitantes. Comment cette proportion évoluera-t-elle dans les années à venir ? Envisagez-vous d’autres réinternalisations que la robinetterie ?
Existe-t-il un véritable suivi des radiations que peuvent éventuellement subir les personnels ? A-t-on installé sur chaque site un correspondant référent de la médecine du travail afin de rendre les contrôles encore plus efficients ? Existe-t-il un dossier personnel de chaque intervenant permettant de vérifier les situations au cas par cas ?
Enfin, en ce qui concerne le niveau de formation des intervenants, avez-vous le sentiment que tous les efforts soient faits ? Les formations intermédiaires, de niveau BTS par exemple, intègrent-elles suffisamment les compétences nouvelles permettant de faire face aux nouveaux besoins et aux difficultés constatées sur les chantiers ?
M. Jean-Pierre Gorges. Le nucléaire est au cœur d’un débat politique, et même idéologique : alors que l’Allemagne a basculé d’un côté, le Royaume-Uni envisage de relancer le nucléaire, les États-Unis le développent et la Chine s’y met. Le risque d’une perte de la culture du risque existe donc bien. Quel est l’état d’esprit d’EDF, et celui des employés qui travaillent sur des dispositifs voués à disparaître, semble-t-il, si le contexte politique actuel perdure ? A-t-on envie d’investir dans des systèmes dépourvus de pérennité ? Peut-on motiver des équipes alors qu’on réfléchit à démonter ultérieurement ce qu’elles sont en train de faire ? Ressentez-vous une ambiance particulière, une atmosphère de travail trop dépendante du politique ?
Les échéances sont, de surcroît, de plus en plus courtes puisque le cycle est ramené à cinq ans ; ainsi, en 2017, des décisions pourraient être prises pour le passage de la génération III à la génération IV, ce qui conduirait à l’accroissement du nombre de personnels.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le président de l’ASN a relevé un écart de 50 % entre les prévisions et les réalisations des temps d’arrêts de tranche, les deux tiers de cet écart étant liés à une mauvaise planification ou à un défaut de maintenance. Êtes-vous d’accord avec ces chiffres et comment y remédiez-vous ?
M. le rapporteur. Le taux de charge du parc nucléaire français se situe au-dessous de 80 %. À quoi l’attribuez-vous ? Ce taux est-il dû à des difficultés de maintenance ou à une surcapacité ?
M. Étienne Dutheil. Chaque année depuis 2005, nous réalisons, en partenariat avec le centre de recherche en gestion de l’école Polytechnique, une enquête anonyme de satisfaction auprès des salariés des entreprises prestataires. Environ 10 % des salariés des entreprises sous-traitantes répondent. Les résultats sont fournis site par site et concernent la qualité de l’hébergement, les temps d’attente et autres. En 2012-2013, quelque 90 % des personnes interrogées se sont dites satisfaites de leurs conditions de travail dans les centrales, contre 83 % en 2009. On peut également percevoir cette satisfaction quand on rencontre ces personnels sur les chantiers. Cela n’exclut pas, sur une population de 20 000 personnes, qu’il puisse y avoir des difficultés avec l’employeur.
C’est bien le fait de travailler dans la durée qui donne sens à la relation contractuelle avec les entreprises prestataires : celles-ci n’investissent dans le développement des compétences que si elles disposent de visibilité et de lisibilité. La durée est aussi un moyen de créer un climat de confiance qui permet un dialogue franc et une meilleure évaluation des besoins pour améliorer la qualité des prestations. C’est pourquoi nous privilégions les contrats de longue durée, de cinq à sept ans. À cet égard, la disposition de la directive européenne 2004-17 visant à réduire cette durée à quatre ans était, selon nous, très contre-productive. Nous sommes donc heureux que ce projet n’ait pas abouti, car il aurait mis à mal l’esprit même du cahier des charges social du CSFN.
EDF n’a pas de position sur le mix énergétique ; nous mettons en œuvre celui décidé par les pouvoirs publics, si tant est qu’ils veulent bien nous confier le soin de produire l’électricité. Reste que la production d’électricité d’origine nucléaire joue un rôle positif dans la maîtrise des émissions de dioxyde de carbone puisque le process n’en émet pas lui-même et que les activités annexes n’en émettent que fort peu si on les compare aux moyens de production à base d’énergies fossiles ou de bois.
Le choix de l’énergie nucléaire avait été dicté par des nécessités d’indépendance énergétique et de compétitivité économique. L’outil de production nucléaire est, en effet, un facteur très fort de stabilité de l’approvisionnement en électricité puisqu’il permet de disposer de visibilité sur la capacité à produire mais aussi sur les coûts.
La part d’activité confiée aux sous-traitants n’a pas évolué depuis quinze ou vingt ans. La politique de « faire » ou « faire faire » est ajustée, et j’ai déjà évoqué la réinternalisation des activités de maintenance en matière de robinetterie dans lesquelles nous employons 200 à 250 robinettiers. Nous suivons un processus identique de réinternalisation pour les activités de soudage, notamment à des fins de maintien des compétences. Il est important de disposer de capacités internes avec un haut niveau d’entraînement et susceptibles d’être rapidement déployées dans un CNPE. D’autres évolutions sont possibles, dans la mesure où la politique du « faire » ou « faire faire » n’est pas dogmatique et qu’elle est régulièrement révisée. Nous envisageons d’étendre le champ d’action des équipes chargées de la maintenance des groupes turbo-alternateurs et des motopompes primaires vers la maintenance de machines auxiliaires. Ainsi, si les grands équilibres restent stables – avec la proportion déjà évoquée de 80 % de sous-traitants –, la situation peut évoluer concernant des segments particuliers.
Par ailleurs, le suivi individuel de la dosimétrie des intervenants garantit la traçabilité des doses reçues au cours de toute intervention sur une INB quelle qu’elle soit. La proposition de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de mettre en place un correspondant référent de la médecine du travail pour chaque site n’a pas connu de suite. En revanche, dans le cadre de la réflexion menée sur le cahier des charges social, le CSFN a proposé de limiter le nombre des services inter-entreprises qui assurent le suivi médical des salariés des entreprises extérieures, de manière à pérenniser les compétences de ces services médicaux dans un contexte où le recrutement de médecins du travail est difficile. En outre, la diminution du nombre d’opérateurs facilitera la traçabilité et le traitement de la dosimétrie. Aujourd’hui, pour les salariés des entreprises sous-traitantes, le suivi médical est assuré soit, lorsqu’ils en ont les compétences, par des services inter-entreprises qui prennent également en compte le suivi médical renforcé au titre des rayonnements ionisants, soit par le service autonome d’une centrale.
En matière de formation des personnels, EDF recrute, tout comme le secteur du nucléaire dans son ensemble. Certaines initiatives communes entre EDF, les entreprises et l’éducation nationale ou les collectivités territoriales pour ce qui est de l’apprentissage, répondent en partie au réel besoin de développer des formations donnant un accès plus facile à nos métiers. Des formations de type baccalauréat professionnel, BTS et Bac+3 ont ainsi été développées en logistique nucléaire – qui inclut la radioprotection – et en robinetterie. En général, les jeunes qui sortent de ces formations trouvent un emploi avant même d’obtenir leur diplôme.
Il est difficile de maintenir la culture de la sûreté dans un contexte d’incertitude. Néanmoins, il faut vivre avec les débats qui animent la société et garder le cap : notre priorité et devoir d’exploitant est de garantir la sûreté, et de faire notre métier le mieux possible. EDF applique les décisions prises en dehors du groupe la concernant, mais, en interne, elle s’efforce d’avoir une vision claire : celle-ci est aujourd’hui incarnée par le projet industriel de l’entreprise, qui fait sens pour les salariés, et qui vise à permettre de fonctionner au-delà de quarante ans en toute sûreté.
Mme Battistel m’a interrogé sur les arrêts de tranche dont la réalisation ne coïncidait pas avec les prévisions. La vie d’une tranche nucléaire se divise en deux parties : l’arrêt de tranche – assimilable à un arrêt technique –, pendant lequel on renouvelle une partie du combustible et on réalise des opérations de contrôle et de maintenance ; le cycle de production, qui se poursuit jusqu’à l’épuisement du combustible et un nouvel arrêt de tranche. En 2013, la disponibilité des centrales durant le cycle de production a été en moyenne de 97,4 %, et de 99 % pour plus de la moitié des tranches. C’est dire si la fiabilité de redémarrage après arrêt est élevée ; elle a progressé ces dernières années. Le niveau de disponibilité des tranches en marche est comparable à celui qu’on trouve chez les autres exploitants internationaux parmi les meilleurs.
Reste le problème de la durée des arrêts, due en particulier à la priorité accordée à la sûreté. Le redémarrage d’une tranche ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre d’un programme d’essais et de contrôles très rigoureux ; tant que le dernier contrôle n’est pas satisfaisant, la centrale ne redémarre pas. Il n’y a aucune impasse possible sur l’ensemble des critères – et il y en a beaucoup. Le tout est donc d’y parvenir du premier coup. Or les programmes d’activité sont parfois trop ambitieux ou bien sont construits de telle manière que les difficultés rencontrées conduisent à une prolongation de l’arrêt. C’est pourquoi il est important de reprendre la main localement sur une programmation des opérations optimisée et mieux répartie.
M. le rapporteur s’est étonné du taux de disponibilité, un peu inférieur à 80 %. Il faut prendre en compte à la fois l’excellente fiabilité des tranches une fois remises en service, et la durée des arrêts supérieures aux prévisions et qui explique le taux de charge.
M. le président François Brottes. Concernant ces arrêts, quelle comparaison peut-on établir avec les autres pays ?
M. Étienne Dutheil. Les méthodes permettant de réussir un arrêt de tranche sont à peu près les mêmes partout. Dans ce domaine, les performances d’EDF sont en retrait par rapport à celles des meilleurs exploitants, notamment américains. En revanche, pour ce qui concerne les tranches en marche, la fiabilité du parc français est à peu près la même que celle du parc américain.
Les écarts de performance sur les arrêts de tranche ont deux origines. L’une est structurelle : des différences de règles d’exploitation entre les deux pays jouent sur environ 6 % de la disponibilité annuelle, ce qui est assez considérable. Néanmoins, abstraction faite de cet écart, il reste un différentiel de 4 à 5 % entre les meilleurs résultats obtenus par les tranches américaines et celles d’EDF. L’autre cause est donc que, objectivement, nous avons des progrès à accomplir, et c’est bien le sens de notre projet industriel.
Pour illustrer mon propos, la salle des machines d’une centrale est équipée du groupe turbo-alternateur, d’un pont roulant qui sert à la manutention des pièces et d’un réservoir d’eau utile au circuit d’alimentation des générateurs de vapeur. Conformément à la réglementation, si une épreuve hydraulique de ce gros réservoir doit être effectuée, le pont de la salle des machines ne peut plus être utilisé. Programmer des travaux importants sur le groupe turbo-alternateur l’année même où devra être opérée l’épreuve hydraulique est donc une mauvaise idée. Cet exemple est évident et connu, mais il est plus facile de construire un programme d’arrêt pour de grosses opérations que pour les petites, qu’il faut prévoir très en amont. Cela exige que la décision de mise en œuvre des stratégies de maintenance soit davantage décentralisée.
M. Michel Sordi. À Fessenheim, dans ma circonscription, les ingénieurs qui pilotent les réacteurs s’entraînent en permanence sur un simulateur ; mais il y a aussi des salles de formation équipées de tuyauteries, de pompes, de contacteurs, où les techniciens se rodent à respecter les procédures.
M. Étienne Dutheil. Il s’agit des chantiers-écoles dont je parlais tout à l’heure.
M. le président François Brottes. Merci, monsieur Dutheil. Nous ferons éventuellement de nouveau appel à vous ou à un autre représentant de Production nucléaire d’EDF.
Table ronde avec les syndicats représentés au comité central d’entreprise d’EDF (CFDT, CGC, CGT, FO)
(Séance du jeudi 13 février 2014)
M. le président François Brottes. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, en vous priant de nous excuser pour ce retard.
Les précédentes auditions de ce matin nous ont permis d’aborder les questions de la maintenance, de la gestion des arrêts de tranche et de la sous-traitance, tous sujets sur lesquels nous considérons que les organisations syndicales ont à dire. Toutefois, la parole est libre, et votre avis sur la filière nucléaire et ses perspectives nous serait utile également.
Je tiens à préciser que vous vous exprimerez au nom de vos fédérations respectives, et non de celui du comité central d’entreprise (CCE) d’Électricité de France (EDF), qui ne vous pas mandaté pour cela.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Denis Cattiaux, Jacky Chorin, Étienne Desdouits, Marc-Jacques Kuntz, Philippe Page, Vincent Rodet et Serge Vidal prêtent serment)
M. Vincent Rodet (FCE-CFDT). Je vous remercie de prendre en compte le point de vue des organisations syndicales, tout en m’étonnant qu’il faille chercher entre les lignes du long intitulé de votre commission d’enquête pour y trouver un objet social et salarial. Pour les salariés, la question du coût est quelque peu épidermique, voire stigmatisante : sans doute l’expression « bénéfices passés, présents et futurs » eût-elle été plus heureuse à leurs yeux.
Cela dit, les coûts s’apprécient par rapport aux bénéfices : à cet égard, l’Agence des participations de l’État n’est sans doute pas perdante. Nous nous interrogeons d’ailleurs sur le taux de redistribution des bénéfices de l’entreprise – qui atteint de 55 à 65 % –, notamment au regard de la lourdeur des investissements à venir.
Le mix énergétique est un sujet qui occupe plusieurs fédérations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), notamment celle de la chimie et de l’énergie et celle de la métallurgie ; il a donc fait l’objet de délibérations au niveau confédéral, dont il ressort que l’objectif de porter à 60 % la part du nucléaire dans ce mix à l’horizon 2030 paraît réaliste ; mais cette cible peut, bien entendu, évoluer en fonction de l’intensité de la reprise économique.
Par ailleurs, nous estimons raisonnable de fixer à cinquante ans la durée de vie des installations. Il ne s’agit, là encore, que d’un repère, car la longévité dépend d’abord du vieillissement des matériaux et de la résistance au bombardement neutronique. En ce domaine, la décision appartient à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : les salariés de la filière comprennent très bien qu’en cas de défaut majeur, une installation peut fermer du jour au lendemain. À l’inverse, si le vieillissement est moins avancé que prévu, nous pensons qu’une prolongation, étape par étape, doit être envisagée afin de garder en vie, le plus longtemps possible, ce qui est un actif national.
M. Étienne Desdouits (CFE-CGC). Votre invitation, dont nous vous remercions, nous donne l’occasion de dire notre fierté d’appartenir à une entreprise, EDF, qui est une référence mondiale dans le domaine du nucléaire, y compris en termes de sûreté : tout doit être fait pour que cela perdure ; c’est une mission qui incombe à chacun d’entre nous.
Nous sommes évidemment disposés à répondre à vos questions sur la maintenance et la sous-traitance.
M. Marc-Jacques Kuntz (CFE-CGC). Je n’ai rien à ajouter à ce qui vient d’être dit.
M. Philippe Page (FNME-CGT). Je vous remercie de votre invitation, tout en exprimant notre frustration quant à la limitation du champ d’interrogation à la sous-traitance, même si vous nous avez invités, monsieur le président, à ne pas nous y cantonner. L’avenir du parc nucléaire et la prolongation des tranches, notamment, sont des enjeux industriels importants à nos yeux. La Confédération générale du travail (CGT) estime que l’annonce de la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim est une ineptie ; sur cette question, nous avons réalisé plusieurs études en collaboration avec le CCE, qui les a unanimement validées.
La CGT a toujours défendu la transparence des coûts, pour tous les modes de production, notamment dans l’optique de la fixation des tarifs de vente ; elle demande une analyse de l’impact sur les coûts de la déréglementation du marché de l’électricité. Certains jeux, capitalistiques en particulier, n’ont entraîné aucune production de mégawatts supplémentaires. Nous plaidons en faveur de la vérité des prix, dont la fixation est totalement opaque. Une commission d’enquête parlementaire sur le sujet nous paraîtrait d’ailleurs très utile.
La CGT a également proposé, l’an dernier, la constitution d’une commission d’enquête parlementaire sur la sécurité d’approvisionnement du pays, qui, à notre sens, soulève des questions à court terme. Elle condamne, par ailleurs, les scénarios fumeux, actuellement mis sur la place publique, relatifs à l’avenir des concessions hydrauliques. Nous aimerions être entendus de façon sérieuse sur ce point.
La sous-traitance dans le nucléaire est un vaste sujet auquel la CGT travaille depuis longtemps, sur les sites comme au sein de la fédération des mines et de l’énergie. Cette pratique a connu des dérives dont on peut faire le procès ; mais on ne fera pas celui du nucléaire. La sous-traitance, au demeurant, touche de nombreux autres secteurs industriels, comme l’automobile ou l’aérospatiale : il serait utile de se pencher sur le phénomène dans son ensemble, notamment quant à ses conséquences pour les salariés.
Depuis une bonne dizaine d’années, la CGT a installé sur les sites des syndicats multiprofessionnels, auxquels peuvent aussi adhérer les salariés de la sous-traitance. Nous entretenons donc, avec eux et leurs représentants, des contacts quotidiens, sur l’ensemble des centres nucléaires de production d’électricité (CNPE), notamment pendant les périodes d’arrêt de tranche au cours desquelles leur charge de travail est particulièrement intense.
Le collège « exécution », le premier collège d’EDF, qui regroupe les employés et les ouvriers, a vu ses effectifs divisés quasiment par dix en vingt ans : un site de tranche qui employait entre 150 et 200 ouvriers de maintenance, n’en emploie plus que 25 à 30 aujourd’hui. Autant dire que la politique dite du « faire faire », mise en œuvre par la direction, a parfois dérivé en « faire faire faire » ou en « voir faire faire ». Depuis une bonne dizaine d’années, nous luttons pour que certaines activités, selon nous abusivement sous-traitées, soient réinternalisées au sein du premier collège, afin d’y maintenir toutes les compétences techniques.
Quoi qu’il en soit, la présence de la CGT sur les sites est une bouée de sauvetage pour certains salariés de la sous-traitance, au regard de leur situation spécifique ; notre insistance auprès du CCE nous a permis d’obtenir des garanties pour ces salariés, notamment, en 2011, quant à leur réembauche en cas de nouvelle passation de marché. Cela dit, il faut une vigilance quotidienne des organisations syndicales pour rendre ce droit effectif.
La justice nous a donné raison contre la société chypriote Atlanco qui, à Cherbourg, employait sur le site de l’EPR des salariés polonais sous-payés et privés de droits, pendant qu’elle engrangeait des profits à Dublin. On voit là à quelles situations ubuesques peut conduire la sous-traitance en cascade.
La sous-traitance a connu un développement inverse à la fonte des effectifs depuis vingt ans. Certains salariés bénéficient, à travers des conventions collectives, de garanties qui, au fil du temps, ont été nivelées par le bas. Naguère, un bon nombre de salariés bénéficiaient, par exemple, des conventions de la métallurgie, qui sont d’un bon niveau. Aujourd’hui, la convention Syntec, mise en œuvre par le patronat, est un cancer pour les salariés du nucléaire : en principe destinée aux salariés des bureaux d’études, notamment employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), elle se révèle inadaptée aux personnels employés par 95 % des sous-traitants du nucléaire. Dès lors qu’elle possède un bureau d’études, une entreprise qui répond à une sollicitation de marché peut inscrire tous ses salariés sur cette convention ; ceux qui exercent des activités mécaniques ou logistiques dans la métallurgie ont ainsi vu leurs garanties sociales ramenées au plus bas. Il serait bon que le législateur y mette bon ordre, car la loi permet ce scandale.
La question des garanties collectives est d’autant plus importante que l’arrivée d’une nouvelle génération, au sein d’EDF comme dans la sous-traitance, pose le problème du renouvellement des compétences : il est essentiel de préserver l’attractivité des métiers, faute de quoi, si le marché du travail repart, les salariés de la sous-traitance s’orienteront, à rémunération équivalente, vers des métiers moins contraignants.
Depuis plusieurs années, la CGT a fait des propositions aux différents gouvernements et au patronat, comme l’intégration de certains prestataires dans le statut de branche des industries électriques et gazières (IEG), ainsi qu’Areva l’a fait pour les personnels de gardiennage. Bien que nos projets aient jusqu’à présent accusé des fins de non-recevoir, nous entendons, au printemps prochain, en soumettre de nouveaux, conçus avec d’autres fédérations de la CGT impliquées dans le nucléaire.
Le parc nucléaire d’EDF emploie 22 000 salariés de la sous-traitance ; ceux-ci y travaillent toute l’année, et certains y effectuent même toute leur carrière. Il existe donc bien un volume d’emplois suffisant pour pérenniser les carrières. Dès lors, ces personnels doivent pouvoir bénéficier d’une garantie d’emploi : cela leur éviterait de venir travailler avec la « boule au ventre » et apaiserait leurs inquiétudes pour l’avenir.
Le nucléaire ne fait mourir personne et fait vivre beaucoup de monde : les bassins d’emploi autour des sites le montrent. Notre pays ne compte que peu de filières industrielles aussi dynamiques. Dans ces conditions, la fermeture du site de Fessenheim serait aberrante, un luxe que nous ne pouvons pas nous payer.
Comme je l’ai dit, certaines activités devraient, à notre sens, être réinternalisées, comme le sont désormais les interventions sur les groupes motopompes primaires ou les activités de robinetterie – ce qui laisse à penser que la direction a reconsidéré sa position sur le sujet avant le grand carénage des tranches. La CGT a d’ailleurs fait la démonstration que, pour plusieurs activités, l’internalisation était moins coûteuse que le recours à la sous-traitance : c’est ainsi qu’il y a dix ans, le coût de la mesure de temps de chute des grappes de commande a été divisé par six – sans parler de celui de la surveillance. Au sein des centrales, l’activité de surveillance représente environ 6 000 emplois sous statut ; si l’on réinternalisait certaines activités, ces emplois assez techniques pourraient être réaffectés ailleurs : ce serait d’autant plus facile avec le renouvellement générationnel. Nous faisons des propositions en ce sens.
La politique du « faire faire » est allée trop loin : le bon sens commande de revenir en arrière et d’intégrer les salariés de la sous-traitance effectuant toute leur carrière sur les sites aux effectifs statutaires, étant entendu que certaines activités nécessiteront toujours le recours à des prestataires. À ce sujet, Denis Cohen, ancien secrétaire général de la fédération des mines et de l’énergie, avait adressé, en 2003, un courrier au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et, en 2009, nous nous en étions entretenu avec M. Sarkozy, M. Fillon et Mme Lagarde. Si chacun a toujours déclaré comprendre nos arguments, ceux-ci sont pourtant restés sans effet. En tout cas, la CGT a toujours interpellé les ministres sur cette question, à l’occasion de leurs déplacements sur les sites.
Les modules de formation dont bénéficient les agents d’EDF sont de grande qualité ; ils leur permettent d’avoir une connaissance approfondie de toutes les installations. La garantie de formation devrait donc aussi bénéficier aux sous-traitants. L’amélioration technique des tranches est une occasion de jouer cette carte. Nous sommes favorables à la prolongation de l’activité des sites, moyennant les rénovations nécessaires – remplacement des gros matériels et renforcement de la sûreté des installations –, mais l’amélioration technique n’a de sens que si elle s’accompagne d’une amélioration des conditions sociales. Une fois rénovées, les tranches devront être exploitées ; c’est pourquoi il est essentiel de motiver la nouvelle génération.
Nous proposons que soient menées des études sur la robotisation de certaines activités, afin notamment de limiter l’exposition aux doses radioactives. Les jumpers qui interviennent dans des générateurs de vapeur sont obligés, par exemple, de décompter mentalement les secondes afin de limiter leur durée d’exposition. Nous considérons qu’en 2014, on devrait être en mesure d’envisager la robotisation de telles activités, comme de celle de décontamination des piscines des bâtiments réacteur ; au demeurant, les techniques de robotisation pourraient être exportées.
Le surcoût des réinternalisations reste à démontrer : nous avons, je le répète, établi qu’elles réduiraient, au contraire, les coûts de plusieurs activités, sans parler des avantages en termes de redéploiement d’emplois. Au reste, un éventuel surcoût ne doit pas forcément se répercuter sur les tarifs : une modulation à la baisse des dividendes versés aux actionnaires est toujours possible. Le coût du travail est actuellement dans la ligne de mire, mais l’on a tendance à oublier le coût du capital : le développement de la sous-traitance doit bien profiter à certains – certes pas aux salariés –, car il génère forcément des sommes faramineuses.
Nous sommes disposés à discuter de la sous-traitance – sans faire le procès du nucléaire – comme des mesures à mettre en œuvre pour améliorer les conditions sociales des salariés de la filière. Cependant, il faut d’abord pointer les vrais problèmes : la semaine dernière, à Cherbourg, l’audience consacrée au décès d’un salarié sur le chantier de l’EPR en 2011 a tourné au procès non de l’intérim, mais des intérimaires. Rappelons que certains salariés restent toute leur carrière en intérim.
M. le président François Brottes. J’organiserai une nouvelle table ronde, dont les thèmes seront laissés à votre appréciation ; notre réflexion, je le rappelle, vise le mix électrique français et européen. L’hydraulique, à cet égard, est un complément indispensable au nucléaire et aux énergies intermittentes.
Je rappelle également que, depuis trois ans, un seul scénario est officiellement sur la table : la mise en concurrence des concessions hydrauliques. Cela n’empêche pas la recherche de solutions alternatives, notamment au sein de la commission des affaires économiques. C’est pourquoi vos idées seront toujours les bienvenues.
M. Serge Vidal (FNME-CGT). Le CCE, dont je préside la commission économique, ne nous a pas mandatés, comme vous l’avez rappelé, pour nous exprimer ce matin ; néanmoins, votre commission d’enquête est passée par lui pour contacter les organisations syndicales, alors qu’elle aurait pu le faire directement.
Le CCE, par nature, est soucieux de la qualité du service rendu, de l’efficacité de l’entreprise et des intérêts des salariés : il est donc concerné par tous les champs d’investigation de votre commission d’enquête. Au cours des dernières années, nous avons fait réaliser une série d’expertises, dont nous tenons les synthèses à votre disposition. Ces expertises ont trait aux conséquences sociales, économiques et environnementales des choix énergétiques – notamment d’une éventuelle sortie du nucléaire ; à la durée de fonctionnement des tranches de 900 mégawatts ; à la disponibilité du parc nucléaire ; à l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité jusqu’en 2030 ; aux conditions de poursuite de l’exploitation de la centrale de Fessenheim ; aux aspects sociaux d’une fermeture de celle-ci ; à l’historique, enfin, de l’intervention publique – en particulier de votre assemblée – dans les choix énergétiques français, notamment quant au nucléaire.
Je crois me faire l’écho de chacun d’entre nous en émettant le souhait que votre commission d’enquête reste objective sur la question des coûts, comme sur les avantages du choix qui a été fait, depuis la Libération, de mettre à la disposition de l’économie française une électricité moins chère. On peut néanmoins craindre un renchérissement de son prix, indépendamment des coûts, car il existe une convergence de vues, en ce domaine, entre ceux pour qui un tel renchérissement encourage les économies d’énergie, ceux qui veulent discréditer le nucléaire à tout prix et ceux qui, à l’instar de notre direction, veulent augmenter les profits au service des actionnaires, au premier rang desquels l’État. Nous espérons que votre commission d’enquête démêlera le vrai du faux, et qu’elle ne préconisera pas, pour le nucléaire, des règles comptables qui ne vaudraient pas pour d’autres activités présentant des caractéristiques équivalentes.
Le rapport publié en 2012 par la Cour des comptes montre qu’il n’y a pas de coûts cachés dans le nucléaire, que l’impact des incertitudes est limité et que le secteur ne bénéficie plus de subventions publiques ; il émet également plusieurs hypothèses, que votre commission devrait réexaminer, pour convertir les milliards d’euros en euros par kilowattheures : l’une d’elles repose sur une durée de fonctionnement limitée à quarante ans et sur un taux de marge annuel de 7,8 % pour un secteur relativement protégé. La Cour propose alors trois méthodes de calcul, qui donnent chacune des résultats très différents ; or seul le chiffrage le plus élevé est retenu, alors que l’intermédiaire paraît tout aussi pertinent.
Enfin, s’agissant de la sous-traitance, le management par processus ou par objectif pratiqué à EDF ne favorise ni le contrôle social ni le suivi des engagements pris par la direction.
M. le président François Brottes. Notre règlement donne, à chacun des groupes politiques, un droit de tirage annuel sur les commissions d’enquête. Le périmètre de celle-ci, créée à l’initiative du groupe Écologiste, a été légèrement amendé, avec son accord, en commission des affaires économiques. Je vous invite à suivre nos travaux, qui sont publics. Je rappelle aussi que notre commission d’enquête réunit toutes les sensibilités politiques de notre assemblée, ou presque, et qu’elle entend travailler avec la plus grande objectivité.
M. Jacky Chorin (FNEM-FO). Je vous remercie, à mon tour, de votre invitation, et commencerai par quelques considérations d’ordre général.
La fédération nationale de l’énergie et des mines de Force ouvrière (FNEM-FO) a toujours été favorable à l’énergie nucléaire, dès lors qu’elle est régie par des règles de sûreté exigeantes, qu’elle reste gérée par des entreprises publiques, qu’elle contribue à la protection du pouvoir d’achat des ménages – à travers un prix au kilowattheure parmi les moins chers d’Europe – et de l’emploi dans les entreprises, et que les salariés du secteur bénéficient d’une protection sociale de haut niveau.
À nos yeux, le nucléaire est une énergie d’avenir. FO est favorable à la prolongation de l’activité des centrales, dès lors que l’ASN l’autorise ; elle réitère son opposition à la volonté du Gouvernement de fermer la centrale de Fessenheim et de plafonner, pour des raisons politiques, la part du nucléaire dans le mix électrique. J’ajoute que les discussions actuellement menées dans le secret des cabinets suscitent un vif émoi chez les hydrauliciens d’EDF, et même de GDF-Suez. Nous souhaitons également être entendus sur ce sujet, qui nous concerne directement, car nous ne partageons pas la vision qui semble émerger des discussions en cours.
Sur le thème qui nous occupe, FNEM-FO tient à rappeler deux éléments fondamentaux. En premier lieu, la décision de sous-traiter telle ou telle activité relève du choix de l’employeur après consultation – et non accord, hélas ! – des institutions représentatives du personnel. L’augmentation sensible du recours à la sous-traitance ne concerne d’ailleurs pas que le nucléaire : EDF fait appel à beaucoup de prestataires dans la partie commerciale et dans l’informatique. Cependant, dans le nucléaire, cette pratique a entraîné, dès l’origine, compte tenu de la spécificité du secteur, de vives réactions parmi les organisations syndicales, notamment FO.
Nous considérons que la part de la sous-traitance dans la filière nucléaire doit être réduite ; c’est pourquoi nous n’avons eu de cesse de nous battre pour la réinternalisation d’un maximum d’activités, et pour l’intégration dans le statut des industries électriques et gazières (IEG) du plus grand nombre de prestataires. Nous commençons, d’ailleurs, à être entendus, puisque EDF a embauché un certain nombre de salariés – robinetiers, responsables de zone, coordinateurs ou planificateurs – afin de conserver des compétences dans des domaines importants.
Cette évolution nous semble devoir être poursuivie, l’État, avec 84 % des parts au capital, ayant son mot à dire, même s’il ne s’est guère manifesté jusqu’à présent ; pire, il continue, par la voix de Bercy, d’exiger de l’entreprise, donc des travailleurs, une part conséquente de dividendes, dont 56,5 % sont distribués, soit l’un des taux les plus élevés du CAC40. On entend même dire qu’il pourrait s’engager dans une nouvelle dilution de son capital, selon la logique financière qu’il impose à l’entreprise. Pour notre part, nous rejetons une telle éventualité, et continuons à revendiquer la renationalisation d’EDF, dans l’intérêt du service public comme des salariés du secteur, y compris ceux de la sous-traitance.
Par ailleurs, même si notre fédération ne couvre que les salariés relevant du statut des IEG, nous restons engagés auprès des autres fédérations pour l’amélioration de la condition sociale des prestataires. Dans cet esprit, nous participons activement aux travaux du comité stratégique de la filière nucléaire – dont la confédération avait demandé, et obtenu du précédent Gouvernement, la création –, ainsi qu’à divers groupes de travail, en particulier au comité d’orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains créé par l’ASN. En juin 2012, Jean-Claude Mailly avait adressé un courrier au Premier ministre pour revendiquer la négociation, sous l’égide du Gouvernement, d’un accord collectif améliorant les droits, les garanties et les conditions de travail des salariés du nucléaire.
De notre point de vue, le cahier des charges social intégré aux appels d’offre des donneurs d’ordre marque une évolution mais, comme il ne constitue pas un accord négocié entre employeurs et syndicats, il ne produit pas les mêmes effets juridiques.
Un premier pas a été franchi au niveau de la division de la production nucléaire d’EDF, avec l’accord du 2 août 2013 intitulé « Une ambition sociale pour le projet industriel du parc nucléaire », que notre fédération a signé. Cet accord contractualise le cahier des charges social du comité de pilotage stratégique de la filière nucléaire (CSFN), en y ajoutant des éléments supplémentaires de reprise du personnel en cas de perte de marché ; mais il ne concerne pas tous les donneurs d’ordre, et ne constitue, je le répète, qu’une première étape, qui en appelle d’autres.
M. Denis Baupin, rapporteur. Merci pour ces exposés liminaires. Je veux rassurer ceux qui auraient encore des doutes : mon objectif, comme celui du président Brottes, est de supprimer toute forme de discrimination entre les différentes formes d’énergie ; c’est pourquoi nous souhaitons une transparence complète sur leurs coûts respectifs.
Je connais le souhait de FO d’une renationalisation d’EDF. Les autres organisations syndicales pourraient-elles nous donner leur point de vue sur le sujet ?
Le niveau du mur d’investissement lié au grand carénage, à la mise aux normes après Fukushima, voire à une éventuelle prolongation des installations au-delà de quarante ans, peut apparaître préoccupant pour les coûts et l’endettement de l’entreprise : comment appréhendez-vous cette question ?
Les chiffres donnés par M. Page relativement aux conséquences du recours à la sous-traitance – division par dix du nombre de salariés du premier collège d’EDF – semblent contredire les propos d’un responsable que nous avons entendu tout à l’heure, selon lesquels les parts respectives des emplois en interne et dans la sous-traitance n’ont pas évolué depuis vingt ans. La réinternalisation qui, selon vous, permettrait de diminuer certains coûts, est-elle également susceptible de réduire le nombre d’incidents lors des opérations de maintenance ?
Enfin, j’ai trouvé intéressantes vos analyses sur la robotisation, qui permettrait de limiter l’exposition aux radiations. Confirmez-vous que 80 % des doses sont reçues par les salariés de la sous-traitance ? En ce domaine, le suivi et le contrôle vous semblent-ils satisfaisants ? Certains personnels peuvent-ils passer à travers les mailles du filet, et recevoir ainsi des doses supérieures aux normes autorisées ?
Mme Frédérique Massat. EDF s’était engagée sur un chiffre de 6 000 créations d’emploi en 2013, objectif atteint, selon la direction, avec 1 700 nouveaux postes d’ingénieurs et de cadres, 2 600 postes de techniciens et 1 700 postes d’ouvriers, tous en CDI, auxquels s’ajoutent 3 000 nouveaux contrats en alternance. Confirmez-vous ces annonces ? Quelle est la part réservée au nucléaire dans ces embauches ? Que penser de l’annonce faite par la direction de 6 000 nouvelles embauches en 2014 ? Êtes-vous associés à la répartition de ces emplois au sein de l’entreprise ?
La diminution des emplois en interne n’est-elle imputable qu’à la sous-traitance ? La modernisation des installations n’a-t-elle pas aussi un impact ?
Enfin, la formation permet-elle des passerelles, au sein d’EDF, entre les activités nucléaires et les autres, comme l’hydraulique ?
M. Michel Sordi. Quelles seraient, d’après vous, les conséquences de la fermeture du site de Fessenheim ?
La filière du démantèlement des réacteurs nucléaires est-elle génératrice d’emplois ?
Enfin, la presse s’est récemment fait l’écho de l’intention du Gouvernement de fermer une vingtaine de réacteurs parallèlement à la construction de deux ou trois EPR. Ce scénario vous paraît-il crédible au regard de l’équilibre entre la production et la consommation dans le pays ? Quelles en seraient les conséquences pour l’emploi ?
M. le président François Brottes. La presse ne relaie pas la parole officielle du Gouvernement.
M. Stéphane Travert. Quelle a été la part d’activités externalisées par EDF au cours des dix dernières années ?
Quels garde-fous permettraient d’éviter les situations constatées sur le chantier de Flamanville, s’agissant notamment du travail irrégulier ?
M. Vincent Rodet. EDF est une entreprise très capitalistique dont le retour sur investissement s’évalue à horizon décennal. Indépendamment du statut juridique, l’État actionnaire majoritaire n’a jamais laissé l’entreprise constituer des réserves pour faire face à l’enchaînement des cycles de construction et d’exploitation. EDF aborde le prochain cycle de réinvestissement – rénovation des centrales actuelles et construction d’autres centrales en France et à l’étranger – avec une dette et un taux de prédation du dividende élevés. Dans la perspective du mur d’investissement, les leviers ne sont pas si nombreux : en dehors de la diversification de la dette et l’allongement de son remboursement sur les cent prochaines années obtenus par le service financier d’EDF, l’activation de la diminution du taux de distribution du dividende, du dégagement de marges de manœuvre endogènes, et du transfert d’une partie du capital de l’État vers les fonds propres de l’entreprise – option qui paraît douteuse au vu de l’état des finances publiques –, apparaît problématique.
La CFDT considère que la montée en puissance des énergies renouvelables (EnR) et le maintien des outils de production actuels sont compatibles et tous deux indispensables. Dans ce cadre, fermer la centrale de Fessenheim reviendrait à se priver de création de valeur, alors que, hormis quelques sites d’éolien terrestre, les EnR n’ont pas atteint la maturité suffisante pour être autoportantes sans subvention publique. À Fessenheim, le nombre d’emplois détruits dépasserait largement celui des emplois créés ; le centre d’ingénierie, de déconstruction et d’environnement (CIDEN), situé à Lyon, travaille déjà sur les techniques de déconstruction, si bien que peu de nouveaux postes seraient nécessaires, les emplois de démantèlement n’étant pas les mêmes que les emplois d’exploitation.
De même, en matière de passerelles, la filiale EDF Énergies nouvelles, qui assure le développement des EnR, n’appartient pas à la catégorie des IEG, ce qui rend difficile la mobilité salariale pour des raisons de statut, notamment au regard des droits à la retraite. La solution du « Pack Rem globale » permet de lever une partie des obstacles.
Nous sommes très attachés à la formation. Chaque CNPE comporte une base de formation et un simulateur sur lequel les exploitants peuvent se confronter à des scénarios ultimes, comme la perte de contrôle de l’installation. Outre qu’il permet de renforcer la sûreté, cet outil présente l’avantage de briser la routine du fonctionnement de la centrale ou de l’EPR.
En matière de suivi de dose, tout salarié, qu’il soit d’EDF ou d’une entreprise sous-traitante, doit passer par des contrôles d’accès. Il est difficile d’y échapper. Une bonne gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la filière doit permettre d’anticiper et de proposer au salarié proche d’une limite de dose maximale de travailler dans une activité moins exposée.
Il fut un temps où EDF, Areva et même Total se tiraient dans les jambes pour attirer à elles les salariés des entreprises prestataires. Depuis le rapport de M. François Roussely sur l’avenir de la filière française du nucléaire civil, tout le monde a conscience que « l’équipe de France nucléaire » gagnera ou perdra ensemble : le temps où les dirigeants d’EDF se gaussaient des déboires d’Areva, et inversement, est heureusement révolu ; quant aux salariés, les ingénieurs des deux entreprises ont toujours travaillé en étroite collaboration.
M. Marc-Jacques Kuntz. Je ne dispose pas d’un mandat de mon syndicat pour m’exprimer ici sur la renationalisation.
Pour améliorer la fiabilité des matériels, EDF a mis en œuvre, depuis quelques années, le programme AP 913 qui permet vraiment d’anticiper les défaillances du matériel et de le remplacer avant qu’il ne cesse de fonctionner. Ce programme a des effets concrets sur les effectifs puisque, sur le site de Penly où je suis employé, ceux du service ingénierie ont doublé pour passer à quarante personnes. Cet investissement permet de travailler dans la sérénité en réduisant l’exposition à l’aléa. Cette situation contraste avec la décennie précédente, au cours de laquelle la fin de vie annoncée des alternateurs a conduit l’entreprise à ne pas débloquer les crédits permettant de lancer le programme de leur remplacement, si bien que de grosses avaries se sont produites et que des arrêts fortuits n’ont pu être évités. Or un tel arrêt entraîne trois mois de réparation et empêche de préparer le prochain arrêt de tranche. Aujourd’hui, un programme de remplacement de tous les transformateurs de puissance a été déployé, et les problèmes sur les alternateurs ne se sont pas reproduits.
M. le président François Brottes. Existe-t-il un document retraçant l’historique que vous venez de brosser ?
M. Marc-Jacques Kuntz. Oui, mais c’est à la direction de l’entreprise qu’il vous faudrait le demander.
S’agissant du contrôle de la dose reçue par les intervenants, nos résultats sont parmi les meilleurs dans le monde, ce que confirme le rapport annuel de l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection (IGSN). Des progrès sont accomplis chaque année et peu de déviances sont à déplorer sur le terrain, ce qui n’a pas toujours été le cas.
La plupart des personnels évoluant sur un site nucléaire ne travaillent pas en zone contrôlée parce que l’on n’entre pas dans un bâtiment réacteur lorsque la tranche est en fonctionnement ; on y pénètre uniquement pour y effectuer la maintenance. C’est pourquoi les arrêts de tranche ont un effet de saisonnalité : comme ils ont lieu tous les douze ou dix-huit mois, les agents chargés de l’effectuer ne restent pas sur le site en permanence. En raison de la nature même de leur métier, ils sont le plus exposés aux radiations ; ils sont aussi souvent employés par des entreprises sous-traitantes, la logique économique et industrielle voulant qu’on ne garde pas sur un seul site des compétences spécifiques à certains matériels.
L’entreprise embauche beaucoup actuellement, au-delà du simple remplacement des personnes partant à la retraite. Au mois d’août dernier, un accord social a été signé à la division de la production nucléaire (DPN), qui prévoit l’embauche de 2 000 personnes supplémentaires, réparties dans différents secteurs de la direction dont l’effectif atteindra 22 000 personnes.
Nous mettons un point d’honneur à développer l’alternance, qu’un autre accord social vise à accroître dans nos établissements. C’est ainsi qu’elle devrait atteindre 5 % alors que le taux légal est fixé à 3 % des effectifs. Il s’agit d’une démarche dans laquelle tous les acteurs se retrouvent gagnants : l’entreprise bénéficie de personnels présents dans l’entreprise pendant un à trois ans, et elle peut les embaucher s’ils donnent satisfaction ; ces personnels profitent d’une formation professionnelle et perçoivent une rémunération qui leur permet de financer leurs études. Des efforts importants sont consentis sur certains sites, comme celui de Penly où 7 % des salariés sont en alternance. Par contraste, la situation nationale a vu le nombre d’alternants diminuer en 2013.
La formation assurée à EDF est d’un excellent niveau grâce à l’allocation d’importants moyens horaires et financiers. Des simulateurs ont été installés sur la plupart des sites nucléaires, des plans de formation très ambitieux ont été élaborés, des obligations de formation des prestataires ont été intégrées dans les cahiers des charges, des académies des métiers ont été créées pour former les nouveaux arrivants et des systèmes de tutorat très efficaces ont été mis en place en interne et promus par la direction et les syndicats par le biais de la signature d’un accord social.
Les passerelles entre les activités sont limitées par l’augmentation du travail dans le nucléaire due aux opérations de maintenance, aux nouvelles pratiques développées à la suite de l’accident de Fukushima et aux nombreux départs en retraite. Les ressources humaines formées dans le parc nucléaire ont fait l’objet d’un investissement important du fait de la haute technicité des tâches, et l’on est réticent à les voir partir rapidement.
Mon organisation syndicale ne m’a pas non plus donné mandat pour m’exprimer sur la fermeture de Fessenheim, mais sa position est connue.
La politique de l’entreprise n’a pas fondamentalement changé en matière de prestations externalisées, si ce n’est que les prestataires doivent répondre à davantage de contraintes, et apporter une « mieux-disance » dans le domaine social en particulier. On peut toutefois regretter qu’il n’existe pas de statut protecteur, offrant de meilleures garanties à des salariés qui peuvent malheureusement rester en intérim durant toute leur vie professionnelle.
Travaillant dans une centrale nucléaire en fonctionnement, je connais mal la question des travailleurs non déclarés du chantier de construction de l’EPR de Flamanville. Les travailleurs salariés d’entreprises extérieures assurant la maintenance ou d’autres prestations particulières font, en tout cas, l’objet de nombreux contrôles.
M. Étienne Desdouits. EDF cherche à améliorer les conditions de travail des salariés, notamment en développant la robotisation des tâches dangereuses et en traitant la question des doses. Nous soutenons, bien entendu, cet effort qui donne des résultats : la dose par intervenant a été divisée par deux en dix ans.
Les embauches massives opérées actuellement servent à remplacer les départs en retraite, mais sur les 6 000 recrutements effectués annuellement, 2 000 correspondent à des créations d’emplois. Un tiers du total des personnes engagées est affecté au domaine nucléaire.
Les conditions économiques et le besoin de compétences particulières expliquent le recours à la sous-traitance. La maintenance d’un groupe diesel ou frigorifique n’est pas une activité spécifique au nucléaire et l’on souhaite que l’entretien de nos matériels soit assuré par des spécialistes. La durée relativement brève de l’arrêt de tranche rend préférable l’intervention de prestataires.
Il convient de distinguer le prestataire du sous-traitant, le premier étant le contractant d’EDF, le second étant un contractant du premier.
M. Philippe Page. La CGT reste attachée à la nationalisation, signée de la main de Marcel Paul en 1946. Le schéma actuel s’avère hélas ! bien différent, et l’on se demande comment renationaliser une entreprise qui évolue dans un contexte concurrentiel lié à la disparition du monopole. Nous souhaiterions qu’émerge un pôle public de l’énergie qui regrouperait l’ensemble des acteurs de ce secteur, mais nous doutons qu’une telle volonté politique existe.
Lorsque l’entreprise était complètement publique, elle avait déjà recours à des sous-traitants. En outre, le changement du statut de l’entreprise ne s’est heureusement pas accompagné d’une modification de celui des personnels, et ce grâce aux actions et aux mobilisations orchestrées par les organisations syndicales.
Je confirme que, sur les trois collèges de salariés dans l’entreprise, le collège « exécution » représentant les ouvriers et les employés a bien connu une division par dix de ses effectifs en vingt ans, alors que l’effectif total de l’entreprise est resté stable. Un fort recrutement de cadres a eu lieu ces dernières années du fait de contraintes nouvelles pour le parc ; en outre, nous connaissons actuellement un pic d’embauches rendues nécessaires par le départ prochain de nombreux salariés à la retraite et par la longueur des temps de formation dans nos métiers.
Nous réclamons une augmentation du niveau de formation des personnels opérant pour le compte de l’entreprise, en aucun cas dans une optique de remise en cause du professionnalisme des sous-traitants et des prestataires : selon nous, 20 % seulement des défauts de maintenance entraînant des incidents sont dus à des sous-traitants.
M. le rapporteur. L’ASN a avancé le chiffre de 50 %.
M. Philippe Page. Il convient d’analyser une telle estimation avec du recul, car rares sont les tâches des sous-traitants qui s’accomplissent sans aucune participation des agents statutaires.
À nos yeux, la formation et l’attachement à l’outil de travail sont des éléments fondamentaux, qui contribuent à accroître la sûreté et qui se trouvent plus développés chez les agents appartenant à l’entreprise.
Les doses ont massivement diminué ces dernières années pour la population statutaire comme prestataire. D’importants efforts ont été consentis pour éliminer les nombreux points chauds dans les circuits des bâtiments réacteur très riches en doses. Aucun salarié ne dépasse les seuils, mais la répartition des doses entre les agents statutaires et les prestataires reste la même et s’établit à 80 % pour les seconds, voire à un taux légèrement supérieur. Par ailleurs, nous n’avons pas relevé de cas où des salariés tricheraient sur l’enregistrement de leur dose, alors même que ceux-ci ne risquent plus de perdre leur emploi en cas de mauvais niveau.
La CGT n’a pas signé l’accord dit DPN, considérant que la ventilation des 6 000 embauches était trop défavorable au collège « exécution ». Elle souhaite que ce collège bénéficie d’un flux plus élevé de recrutements, afin que l’entreprise conserve dans les services les compétences techniques et, ainsi, la maîtrise complète des installations. Or, lorsque l’on ne recrute que des agents de bac +2 à bac +5, il est délicat de les maintenir dix ans à un poste de technicien.
La décision de fermeture de la centrale de Fessenheim n’a pas d’autre sens que politique. Il s’agit d’une centrale rénovée et jugée sûre par l’ASN, ce qui pose la question du crédit de cette Autorité puisque ses avis ne sont pas suivis. Nous sommes très opposés à cet arrêt qui dégradera la situation énergétique, et nous tenons à votre disposition des études mettant en avant la détérioration sociale, énergétique et environnementale qu’il entraînera. Le démantèlement d’une centrale entraîne une diminution de 90 % du nombre des personnes employées sur le site.
La CGT est favorable à l’extension de la filière des EPR ; elle n’appartient à aucun lobby, si ce n’est celui de la réponse aux besoins énergétiques du pays. Les EPR représentent des outils de service public pour répondre aux besoins en matière de production d’électricité.
Des externalisations d’activité ont été opérées au cours des dix dernières années. Il est difficile d’obtenir le nombre de sous-traitants permanents sur chaque site ; on les évalue à plus de 8 000 pour les sites et à 22 000 pour l’ensemble de l’entreprise. L’activité de laverie des combinaisons des salariés intervenant en zone contrôlée a été sous-traitée depuis dix ans sur les sites les plus récents. Malgré notre opposition, il en va de même pour les magasins où sont traitées les pièces de rechange et pour les activités tertiaires telles que le secrétariat ou l’accueil. C’est ainsi que s’est développé le « tertiaire diffus », par greffage sur les activités techniciennes ou par multiplication des emplois précaires.
Quelques activités sont réinternalisées, mais cela ne diminue pas notre vigilance, car la direction pourrait décider d’en externaliser d’autres. Ainsi, après la décision du site de Saint-Laurent de sous-traiter la déminéralisation des circuits d’eau, notre mobilisation a contraint la direction à refuser cette évolution pour les autres sites – nous souhaitons néanmoins que cette activité soit réinternalisée à Saint-Laurent.
Des représentants des salariés doivent être présents sur chaque site, y compris sur des chantiers de construction, afin d’éviter que puissent se reproduire les incidents de travail dissimulé de la société Atlanco à Flamanville. Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent également pouvoir être créés, et les personnels doivent pouvoir s’entretenir avec des organisations syndicales. Sur le site de l’EPR à Flamanville, la situation s’est améliorée, mais des salariés voulant représenter leurs collègues ont été licenciés ou mutés à l’autre bout du monde par le groupe Bouygues. Il ne doit pas exister de zone de non droit, même sur un chantier !
M. Serge Vidal. Nous souhaitons que les salariés d’EDF Énergies nouvelles bénéficient du statut des IEG, comme l’a expliqué le représentant de la CFDT.
La CGT considère que nous avons besoin de prolonger l’activité des centrales existantes et d’en construire de nouvelles.
Ce n’est pas la robotisation qui a entraîné la diminution des effectifs du premier collège ; nous avons même défendu le lancement par la R&D d’EDF de programmes de recherche permettant de robotiser certaines tâches, mais ces projets n’ont débuté qu’il y a deux mois.
Je reviens sur certains aspects du mur d’investissement, et en premier lieu sur le grand carénage. L’objectif de ce dernier était d’abord de prolonger la durée de vie des centrales, ce qui pouvait se faire dans le temps avec un étalement des besoins financiers. Puis, à la suite de l’accident de Fukushima, il est apparu nécessaire d’y intégrer certains éléments de sécurité. Ce dont n’a pas tenu compte l’analyse de la Cour des comptes, c’est que certains investissements sont relativement urgents en matière de sûreté mais que d’autres peuvent être repoussés dans le temps.
En second lieu, agir sur les dividendes permettrait de dégager des marges de manœuvre, comme l’a montré une simulation effectuée par la commission économique du comité central d’entreprise reposant sur le non-versement de dividendes pendant trois ans. Toutefois, cet aspect lie étroitement coût du capital et rémunération de l’État.
M. le président François Brottes. Le budget de l’État y perdrait en effet !
M. Serge Vidal. Le CCE a également dressé un bilan financier des opérations de l’entreprise à l’étranger au cours des vingt dernières années : la situation critique qui en a résulté dans les années 2000 pourrait expliquer l’ampleur des sous-investissements. Ce tableau ne prend pas en compte l’opération sur British Energy, qui n’entre pas dans la catégorie de ces investissements hasardeux.
M. Jacky Chorin. Nous avons relancé l’idée de la renationalisation, que n’interdit pas la concurrence et que justifie l’existence du nucléaire. La notion de pôle public, portée par la CGT, nous semble plus floue car la question du seuil se pose : la proposition actuelle sur l’hydraulique fixant la détention publique à 51 % la ferait entrer dans cette catégorie. Pour notre part, nous pensons qu’il est plus clair de défendre la renationalisation et la propriété publique à 100 %, EDF n’étant pas une entreprise comme les autres.
En matière de mix énergétique, Force ouvrière fait preuve de pragmatisme : les centrales nucléaires ne peuvent être fermées que pour des raisons de sûreté, sur avis de l’ASN, ou pour des contraintes économiques liées au prix des travaux, la décision revenant à l’exploitant. En revanche, les motivations politiques perturbent les salariés du secteur du fait de leur caractère arbitraire et incertain. Ainsi, en 2025, quelle sera la situation démographique et quels seront les nouveaux usages ?
Pourquoi fermerait-on des centrales ? L’ASN a jugé que celle de Fessenheim était sûre et pouvait fonctionner plusieurs années. En outre, la réunion du groupe de travail sur le projet de loi relatif à la transition énergétique vient une nouvelle fois d’être annulée, preuve de la difficulté d’avancer sur ces sujets.
M. le président François Brottes. Pensez-vous que l’arbitraire que vous évoquez s’exerce davantage dans le cadre actuel d’une société anonyme dans laquelle l’État se trouve largement majoritaire, ou dans celui d’une société renationalisée ?
M. Jacky Chorin. Dans l’entreprise, beaucoup ont défendu l’idée selon laquelle le statut de SA garantirait l’absence d’immixtion de l’État dans la gestion quotidienne de l’entreprise. Je constate qu’il n’en est rien, et que nous pâtissons du plus mauvais des systèmes puisque nous devons rendre des comptes au monde financier en le nourrissant de dividendes, tout en nous trouvant soumis aux responsables politiques qui considèrent EDF non comme une entreprise, mais comme l’appendice d’un ministère, et qui exigent, avec raison, un service public d’une qualité toujours plus grande. Ce système finira immanquablement par engendrer un problème majeur.
M. le président François Brottes. Vous suggérez que les administrateurs de l’État présents au conseil d’administration donnent des instructions en permanence ?
M. Jacky Chorin. Je ne suis pas certain que les fonctionnaires des différents ministères portent la même parole sur la situation et l’avenir d’EDF. Le jour où un arbitrage clair sera rendu sur ce que l’on attend d’EDF, un progrès important aura été accompli.
La présence de syndicats et de fonctionnaires de l’ASN et de l’inspection du travail améliorerait la situation à Flamanville, mais est-ce compatible avec la politique de réduction des effectifs de la fonction publique ? Nous croyons à la possibilité d’un accord collectif offrant un socle de garanties à l’ensemble des travailleurs prestataires. L’État détient le pouvoir de réglementer, par le décret ou par la loi, pour définir les formations correspondant aux emplois occupés. Il existe donc des marges réglementaires et conventionnelles, encore faut-il vouloir les utiliser.
M. le président François Brottes. Je vous remercie d’avoir accepté de vous livrer à cet exercice. Les syndicats seront conviés à une autre audition, mais cette invitation sera adressée aux confédérations, libres à elles d’envoyer les représentants de leur choix.
Audition de M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et de M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
(Séance du jeudi 20 février 2014)
M. le président François Brottes. Les auditions de ce matin sont au cœur du sujet de notre commission d’enquête : nous disposons de la capacité de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, mais quel en est le prix et quel niveau de sûreté complémentaire peut-on atteindre ? Pour répondre à ces questions, nous sommes heureux d’accueillir M. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN et habitué de cette commission, et M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN.
Faut-il aborder le thème du parc globalement ou centrale par centrale ? Je constate que l’ASN s’exprime séparément sur chaque réacteur. Pourriez-vous éclairer notre commission sur le contenu du programme d’investissement industriel complexe annoncé par EDF et connu sous le nom de « grand carénage » ? Qu’en attend-on en termes de sûreté et de compétitivité de l’outil, celle-ci se mesurant par le rapport entre les coûts d’investissement et de production et le profit tiré du fonctionnement ? Le grand carénage se superpose à l’ensemble des dispositions prises après l’accident de Fukushima, les réflexions sur ce programme étant bien antérieures à la catastrophe ayant eu lieu au Japon. Monsieur le président de l’ASN, votre prédécesseur avait émis plusieurs recommandations pour mettre en œuvre des investissements relevant davantage de la gestion de crise que de la sûreté des centrales. Ils représenteraient 10 milliards d’euros qui viendraient s’ajouter aux 55 milliards estimés pour le grand carénage. Nous avons besoin que vous nous apportiez une évaluation financière de ces projets.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Pierre-Franck Chevet et Jacques Repussard prêtent serment)
M. Denis Baupin, rapporteur. Comme l’a indiqué M. le président, cette audition est primordiale pour notre commission qui cherche à déterminer la capacité d’investissement dans les réacteurs nucléaires. Le Parlement doit être éclairé, quelques mois avant de prendre des décisions sur la stratégie énergétique de la France.
On ignore ce que l’expression « grand carénage » recouvre exactement, et l’on souhaiterait que vous nous dévoiliez son contenu précis. Ces investissements sont-ils indispensables pour que les réacteurs atteignent une durée de vie de quarante ans ou pour qu’ils soient prolongés au-delà de cette limite ? Dans ce dernier cas, seront-ils suffisants ?
Le processus des troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MW a été lancé : la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN) entraîne-t-elle des modifications pour les visites des réacteurs de 1 300 MW ?
Pourriez-vous nous décrire les suites données aux évaluations complémentaires de sûreté ? Après l’accident de Fukushima, l’IRSN et l’ASN ont émis environ mille recommandations – que vous avez précisées ces dernières semaines – pour les réacteurs nucléaires et pour les installations d’Areva. Libération a rapporté l’existence d’un conflit entre l’IRSN et EDF, la seconde ayant formulé des préconisations que votre Institut, monsieur Repussard, aurait jugées non conformes, avant qu’un accord n’ait été trouvé. Qu’en est-il exactement ?
L’exploitant a affirmé que la mise en œuvre de vos recommandations coûterait 10 milliards d’euros, dont 5 milliards sont déjà prévus dans le grand carénage. Partagez-vous cette évaluation et celle sur le coût total de 55 milliards d’euros ?
M. Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire. La poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de quarante ans n’est pas acquise, et des sujets de sûreté cruciaux doivent être traités.
L’éventuel prolongement au-delà de quarante ans nourrit d’importantes interrogations, car les centrales ont été conçues pour cette durée et certains composants irremplaçables peuvent souffrir de vieillissement. Nous examinerons donc la question de l’allongement au regard des critères de sûreté de troisième génération, applicables à l’EPR de Flamanville. L’alternative, dans le domaine du nucléaire, consisterait à construire de nouveaux réacteurs qui seraient fabriqués selon les standards de sûreté les plus récents, qui sont ceux de la troisième génération. L’Europe partage cette exigence, au contraire des États-Unis qui se fixent comme objectif la conformité aux standards initiaux, qui datent de plus de quarante ans.
M. le président François Brottes. Il semble que le décompte ne commence pas au même moment.
M. Pierre-Franck Chevet. Un premier rendez-vous – la visite de contrôle initial (VCI) – a lieu trente-six mois après le démarrage de la centrale, les échéances décennales courant à partir de cette date. Parallèlement, la loi de 2006 a introduit la procédure de réévaluation de sûreté qui peut donner lieu à des prescriptions pour l’améliorer. Plutôt que de quarante ans, il conviendrait donc de parler de quatrième visite décennale.
M. le rapporteur. La question de M. le président portait plutôt sur le décalage de calcul entre la France et les États-Unis. À ma connaissance, les Américains commencent à faire courir le délai « au premier béton », dès le début de la construction de la centrale, alors que les Français prennent la première divergence comme point de départ, l’écart entre les deux méthodes s’élevant tout de même à dix ans.
M. Pierre-Franck Chevet. Au-delà de cette différence d’une dizaine d’années, les Américains s’appuient sur une conception différente de la nôtre en termes de normes de sûreté pour le prolongement, puisque ce n’est pas un processus d’amélioration, mais de conformité aux standards initiaux qui est privilégié.
Les cuves des réacteurs sont irradiées pendant le fonctionnement des centrales, ce qui peut fragiliser les aciers. Il y aura lieu de se pencher sérieusement sur cette question si nous décidons d’aller au-delà de quarante ans. Toutes les cuves du parc nucléaire français ne se trouvent pas dans le même état. Celle de Tricastin 1 présente des défauts – rendus publics –, et nous avons fixé, à l’issue de la troisième visite décennale de ce réacteur, un rendez-vous intermédiaire au bout de cinq ans.
Les enceintes doivent également faire face au vieillissement : ainsi, la centrale de Belleville a rencontré des problèmes de qualité de béton pour l’enceinte de confinement, qui devront être de plus en plus surveillés au fur et à mesure que les années passeront.
Dans une lettre publique du 28 juin dernier, nous avons dressé la liste de nos préoccupations : y figuraient la sûreté des piscines de stockage du combustible – sur laquelle l’accident de Fukushima a attiré notre attention –, la capacité à refroidir l’enceinte en cas d’accident grave – qui doit être renforcée pour les dispositifs de deuxième génération – et le récupérateur de cœur fondu, qui existe pour l’EPR, mais pas dans l’actuelle génération de réacteurs.
Ce sont ces raisons qui nous conduisent à affirmer que la poursuite du fonctionnement n’est pas acquise à ce jour.
Nous avons prévu deux séminaires de discussion avec l’exploitant d’ici à la fin de ce semestre, ces rencontres n’étant que le début du processus d’examen des propositions d’EDF. Après l’avis technique de l’IRSN, les groupes permanents d’experts se réuniront pour formuler une opinion technique ; nous ouvrirons ces groupes à la société civile et aux experts étrangers. Nous pourrons ainsi émettre un premier avis en 2015, et l’avis final – portant sur l’ensemble des aspects ou sur ceux partagés sur les différents réacteurs – pourrait être rendu en 2018 ou en 2019. Enfin, nous nous prononcerons sur chaque réacteur en tenant compte des spécificités de chaque site.
M. le président François Brottes. L’ASN dispose-t-elle d’un tableau de l’ensemble des réacteurs évaluant les fragilités de chacun d’entre eux ? Si l’on vous demandait de fermer un réacteur, pourriez-vous indiquer lequel doit l’être en premier ?
M. Pierre-Franck Chevet. Nous avons bien entendu des tableaux décrivant les installations, mais ils ne permettraient pas de répondre clairement à votre question, car les examens restent à effectuer.
À côté de la sûreté de la conception du réacteur, il convient de surveiller avec la même attention la qualité de son exploitation.
Le rendez-vous des quarante ans est primordial pour la sûreté et il doit donner lieu à une participation renforcée du public.
Il représente, par ailleurs, une charge de travail hors du commun pour EDF et pour l’ASN et son appui technique. EDF rencontre des difficultés pour gérer les arrêts de tranche et les opérations de maintenance qu’ils exigent, alors que le rendez-vous du grand carénage et, éventuellement, la mise en œuvre des recommandations émises après Fukushima et la prolongation au-delà de quarante ans sont devant nous. Cette situation pose la question de la capacité à faire face à ces défis.
Je ne connais pas le détail du programme du grand carénage. Au début de l’année 2012, EDF estimait le coût total à 55 milliards d’euros et nous avions fixé les premières grandes prescriptions de principe. Nous les avons affinées depuis cette date à la suite de discussions très serrées – comme c’est l’usage – avec l’exploitant. Deux éléments nouveaux se sont produits : nous n’avons pas retenu la solution proposée par EDF sur les moyens d’éviter la fusion du cœur et nous lui avons demandé d’emprunter une autre voie ; nous avons insisté pour qu’un système additionnel protège l’enceinte en cas de fusion et nous avons eu des échanges complexes sur le niveau de séisme auquel devait résister ce système complémentaire du noyau dur. Le déploiement de ces opérations entraînera un coût supplémentaire, même si j’ignore s’il pourra être inclus dans le chiffre actuellement avancé par EDF. L’éventuelle prolongation de la durée de vie des réacteurs modifiera également le coût final.
M. le président François Brottes. Disposez-vous de capacités d’analyse financière ? Si seul l’opérateur peut produire des chiffres, il est difficile de les confronter !
M. Pierre-Franck Chevet. La tutelle financière n’est pas exercée par l’ASN, dont la mission est d’assurer celle du contrôle de la sûreté.
M. le président François Brottes. Travaillez-vous avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ?
M. Pierre-Franck Chevet. Oui, la CRE intègre nos recommandations.
Les troisièmes visites décennales des réacteurs de 1 300 MW suivront la même procédure que celles de 900 MW, même si les aspects techniques peuvent diverger du fait des différences de nature des enceintes et de puissance.
M. le rapporteur. La loi de 2006 n’a-t-elle pas modifié le référentiel ?
M. Pierre-Franck Chevet. Non. La procédure habituelle a été suivie dans les discussions avec l’exploitant pour les évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima : un avis de l’IRSN a été soumis au groupe permanent d’experts et, après des discussions âpres, une décision a pu être prise en janvier dernier.
M. Jean-Pierre Gorges. Avec la troisième génération de réacteurs, nous disposons de réserves pour 130 ans, mais de plus de 5 000 ans avec la quatrième génération. Il n’existe pas, pour le moment, de solution durable et fiable en ce qui concerne les énergies alternatives, les dépenses liées à l’éolien, au photovoltaïque et à l’hydraulique s’avérant en outre élevées. Le Conseil d’État devra rapidement se prononcer pour dire s’il est normal que ces technologies soient subventionnées.
Les réacteurs de troisième génération sont d’un coût modéré, mais la durabilité du combustible est trop limitée, et la sécurité de fonctionnement se révèle moyenne, même si les perspectives de secousses sismiques près de nos centrales restent faibles.
Je m’interroge sur la transition énergétique, car nous la mettons en œuvre sans disposer de solutions définitives et viables ; je suis donc convaincu que la transition s’opérera vers le nucléaire et qu’il faut s’appuyer sur cette filière pour la mener à bien. Quelle est la durée de vie de la troisième génération ? Quand pourrait-on disposer de la quatrième génération ? En prenant en compte la situation géographique de la France, pensez-vous que notre pays sera capable d’augmenter la sûreté ? Vos réponses sont attendues pour éclairer le débat et la décision politiques.
M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Du point de vue de l’IRSN, certains des cinquante-huit réacteurs actuels du parc nucléaire continueront de fonctionner pendant un certain nombre d’années, car nous avons besoin de cette source d’énergie électrique et parce que la sûreté est considérée, à la suite du bilan réalisé après l’accident de Fukushima, comme bonne. Néanmoins, nous ne pouvons pas totalement exclure l’occurrence d’un accident très grave.
Comment éviter la survenue d’un accident avant la fin de cette exploitation ? Tout d’abord, en améliorant la conception des installations. Tel est le but des évaluations complémentaires de sûreté et des visites décennales. Ensuite, il convient de veiller à ce que l’exploitation soit conforme au cahier des charges et aux meilleures pratiques existantes, notamment au suivi de l’obsolescence de certains équipements, qu’ils soient remplaçables ou non. La sécurité, autrefois conçue pour éviter le vol de matières nucléaires, est maintenant pensée pour prévenir des actes de sabotage ou de terrorisme pouvant entraîner des accidents nucléaires majeurs.
Il convient également d’évaluer si la filière nucléaire dispose des ressources humaines et financières pour gérer l’ensemble des charges d’exploitation comprenant de nouvelles règles en matière de sécurité. Enfin, nous devons nous demander si le pays peut gérer une crise nucléaire en la circonscrivant, le degré de maîtrise d’un incident nucléaire par l’État ayant de fortes conséquences, y compris financières. Il faut savoir que, si l’on impose trop d’exigences à EDF, l’opérateur pourrait être conduit – par manque d’ingénieurs, par exemple – à détériorer les conditions d’exploitation.
Lorsque le Parlement et le Gouvernement auront défini des orientations, il conviendrait qu’une enceinte nationale puisse traiter de l’ensemble des sujets, qu’ils soient économiques, financiers, relatifs à la sûreté ou à l’ensemble de la filière nucléaire, car l’actuelle fragmentation nourrit les divergences de vues entre Areva, EDF et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). La situation actuelle n’est pas optimale et risque de peser à terme sur la sûreté nucléaire. Les experts techniques peuvent éclairer les débats, mais ne peuvent pas décider.
Les décisions d’augmentation des investissements dans les réacteurs les plus anciens ne se prennent pas rapidement : on vient seulement d’arrêter celles liées aux conséquences de l’accident de Fukushima, trois ans après sa survenue ; leur mise en œuvre nécessitera une dizaine d’années. Il ne faut donc pas oublier que la prolongation du parc induit des modifications substantielles d’équipements qui exigeront un travail d’une à deux décennies pour vingt ans d’exploitation supplémentaire. Ces contraintes posent la question de la construction de nouveaux réacteurs en fonction de l’équation énergétique du pays.
L’IRSN ne réalise pas d’études économiques, mais nous avons dû nous pencher sur le coût d’un accident – analyse simple et non intrusive des comptes d’EDF. Nous en avons conclu qu’il y avait là un déficit du système national de maîtrise de nos politiques énergétiques, car aucun organisme n’effectuait une telle expertise indépendante. Néanmoins, ne nous focalisons pas uniquement sur la question financière, car celle de la limite des ressources humaines s’avère également primordiale. EDF sera confrontée – comme l’IRSN à une échelle plus modeste – à des problèmes de renouvellement de génération, les départs à la retraite induisant la disparition de savoir-faire anciens qui devront être renouvelés. L’IRSN avait d’ailleurs rendu, l’année dernière, un avis dans lequel il insistait sur la nécessité de conserver des marges de production importantes : notre pays ne doit pas se retrouver dans une situation catastrophique où il devrait choisir entre les lumières allumées et la sûreté nucléaire.
Les conflits entre l’IRSN et EDF sur les évaluations complémentaires de sûreté remontent à un an, car notre rapport, s’il vient d’être publié, date de la fin de l’année 2012. À cette époque, notre réflexion divergeait de celle d’EDF, puisque nous avions montré, grâce à notre simulateur, que sa proposition de procédures de gestion d’un incident dans un réacteur n’abaissait pas suffisamment la probabilité d’une fusion du cœur. EDF a reconnu cette faille et a modifié son plan, ce qui n’a été possible que grâce aux moyens d’expertise technique dont dispose l’IRSN et au dialogue normal que l’Institut nourrit avec EDF.
M. le président François Brottes. Vous avez beaucoup insisté sur les ressources humaines : peut-on maintenir les compétences sans renouvellement et sans prolongation du parc ?
D’autre part, quelle est la probabilité que les scénarios catastrophes que vous avez élaborés se réalisent ?
M. Jacques Repussard. S’agissant des questions relatives aux réacteurs de troisième et quatrième générations, j’apporterai plus de réponses lors de l’audition de la semaine prochaine. Il reste des incertitudes relatives à la sûreté pour la quatrième génération. Le projet ASTRID, lointain successeur du Superphénix, doit permettre un progrès, mais il subsiste des zones d’ombre dans les propositions et les démonstrations effectuées par le CEA. Des décisions de principe doivent encore être prises : le réacteur ASTRID est-il un prototype ou la tête de série d’un futur parc de quatrième génération ? Cette question dépasse la seule sûreté nucléaire et englobe le sujet de la stratégie industrielle et énergétique, les lieux pour traiter de ce thème restant aujourd’hui insuffisamment organisés.
La troisième génération apporte, pour l’EPR, des améliorations certaines de sûreté, notamment grâce à la prise en compte, dès la conception, de la possibilité d’accidents de fusion du cœur. Mais la conception de l’EPR a une vingtaine d’années et il doit aujourd’hui être possible d’optimiser le coût de certains de ses éléments. En même temps, il convient de réfléchir à la question de la puissance : on constate que les réacteurs de 1 000 MW sont ceux qui répondent le mieux aux besoins à l’export, si bien que l’on peut se demander s’il est bien opportun que la filière industrielle française se singularise en continuant de fabriquer des réacteurs de puissance plus élevée. Sur toutes ces questions, qui n’ont pas été instruites, il est impossible d’émettre des recommandations tranchées.
M. Bernard Accoyer. Si notre commission d’enquête ne débouche pas sur une synthèse équilibrée des risques, des coûts et des conséquences, les informations que nous aurons rassemblées encourageront les prises de position partisanes et passionnelles. Ainsi, notre rapporteur cherche à exploiter médiatiquement certaines phrases coupées de leur contexte et éloignées du problème global que constitue le défi énergétique, si important pour l’avenir économique et social de notre pays.
Messieurs les experts, il est important de revenir sur la démarche qui a accompagné les progrès réalisés dans l’histoire et qui repose sur le rapport entre les bénéfices et les risques. Or je n’entends pas souvent la prise en compte de ce paramètre dans les exposés effectués devant notre commission, alors que nous en avons besoin du fait de notre ignorance de ces questions. Le point d’équilibre est fondé sur la sûreté nucléaire – élément le plus important –, sur l’approvisionnement énergétique et sur la capacité financière de la nation à assumer le coût de programmes qui s’étendent sur plusieurs décennies.
L’histoire a montré, notamment en 1997, que, lorsque des décisions politiques sont prises en matière d’énergie sans étude d’impact, elles sont souvent contraires aux intérêts supérieurs du pays et à la place de la France dans cette filière essentielle de l’électronucléaire – qui reste prépondérante dans le monde, même si certains s’emploient à la faire disparaître.
Monsieur le président, vous avez évoqué la probabilité de certains scénarios catastrophes : nous souhaiterions que les experts répondent à votre question en insistant sur le rapport entre les bénéfices et les risques. C’est à eux qu’il revient d’éclairer les politiques, pour que ceux-ci puissent assumer les décisions qu’ils arrêtent.
M. Michel Sordi. Je souhaiterais tout d’abord émettre une réclamation, monsieur le président, car c’est avant-hier soir, seulement, que j’ai reçu une invitation de M. Denis Baupin, rapporteur de notre commission, à assister à un entretien prévu cet après-midi. Cette manière de procéder est assez cavalière.
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, le bureau de l’Assemblée nationale a décidé une interruption des travaux de notre assemblée pendant plusieurs semaines, mais la commission d’enquête va poursuivre les siens, ce qui posera un problème pour certains membres de la commission. Pourriez-vous demander au bureau et au président de l’Assemblée nationale d’étudier s’il est possible d’accorder une dérogation à la procédure classique qui interdit à une commission d’enquête de mener ses travaux au-delà de six mois ? Nous ne voudrions pas imaginer que certains profitent de la situation pour prendre une part plus importante dans l’orientation des questions posées et débattues avec les experts invités par la commission.
M. le président François Brottes. Je prends acte de votre demande, monsieur Accoyer ; vous connaissez bien le fonctionnement de cette maison pour l’avoir présidée et les contraintes de délai attachées aux commissions d’enquête. Une dérogation est peut-être possible et je relaierai votre requête, mais le rapporteur et moi avons tout mis en œuvre pour ne pas amputer le temps de travail dont nous disposons ; nous avons ainsi prévu des réunions pendant la période où la séance publique est suspendue.
M. Michel Sordi. Monsieur Repussard, quel est le rôle de l’IRSN vis-à-vis de l’ASN ? On nous a expliqué que l’Institut assurait une fonction d’appui technique à l’ASN : est-ce exact ?
Vous remplissez une mission d’expertise, indépendamment des industriels. Quelle est votre évaluation du niveau de sûreté des centrales en France ? L’ASN a autorisé la poursuite d’exploitation pour dix ans supplémentaires des deux réacteurs du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Fessenheim. Les mesures prises à la suite de l’accident de Fukushima y sont mises en œuvre ou en passe de l’être : quelle est votre appréciation de la situation sur ce point à Fessenheim ?
M. le rapporteur. Monsieur Sordi, je suis désolé de l’arrivée tardive de cette invitation, mais je vous confirme que je compte bien exercer les compétences liées à la fonction de rapporteur pendant l’ensemble de la durée de cette commission d’enquête
– y compris durant l’interruption des travaux, d’autant plus que, étant opposé au cumul des mandats, je ne suis pas candidat aux élections municipales. Je ferai en sorte que tous les membres de la commission soient informés des entretiens que j’organiserai. Par ailleurs, je serai le premier à être heureux d’obtenir un allongement de la durée de la commission d’enquête.
Monsieur Accoyer, une audition spécialement consacrée à l’accident est prévue ; cela nous permettra de bénéficier de plusieurs éclairages sur les risques et les conséquences d’un accident – l’IRSN a d’ailleurs effectué un travail remarquable sur ce sujet.
M. Chevet et M. Repussard ont insisté sur l’adéquation entre les préconisations émises en matière de sûreté et les moyens de les mettre en œuvre : quelles sont, par rapport au référentiel existant, les marges envisageables de diminution de la sûreté pour répondre aux souhaits de l’exploitant ?
Monsieur Chevet, existe-t-il une alternative à l’installation d’un récupérateur de corium qui apporterait le même niveau de sûreté que ce qu’il apporte à l’EPR ? En effet, ce récupérateur peut avoir des conséquences importantes pour le réacteur.
S’agissant du calendrier que vous avez évoqué et qui s’étale de 2015 à 2019, le Gouvernement et le Parlement prendront des décisions sur la stratégie énergétique du pays dans les mois qui viennent. Si des responsables politiques vous demandaient, demain, s’il est envisageable de prolonger l’activité des réacteurs au-delà de quarante ans, quelle serait votre évaluation ? Quelle est la proportion des réacteurs qui pourraient continuer de fonctionner : 10 %, 25 %, 50 % ou plus ? J’ai bien conscience que la question est complexe, mais nous avons besoin d’être éclairés.
M. le président François Brottes. Monsieur le président de l’ASN, en répondant à ces questions, pourriez-vous mobiliser l’exemple de la Suisse, qui a autorisé l’une de ses centrales à fonctionner plus de quarante ans ?
M. Pierre-Franck Chevet. L’expression « quatrième génération » est source de confusion. Elle représente en réalité une avancée en termes de gestion et de recyclage des déchets, et non en matière de sûreté. C’est la troisième génération qui avait marqué un progrès dans ce domaine. Cependant, pour l’ASN, il faut faire en sorte que la quatrième génération – notamment le prototype ASTRID – permette également une amélioration de la sûreté par rapport aux générations précédentes. Son déploiement industriel pourrait se faire dans plus de vingt ans, en 2040 ou 2050, et il est difficile d’imaginer que, d’ici là, les référentiels de sûreté n’auront pas évolué. Comme le disait Jacques Repussard, il faut résoudre des problèmes techniques majeurs – notamment si l’on retient une option comprenant du sodium – en matière de contrôle et de réparation en service, et de passage du sodium à l’eau. La loi envisage la construction d’un prototype à l’horizon de 2020, qui permettrait de tester les améliorations de sûreté.
Le CEA préfère que les réacteurs de la quatrième génération soient au sodium. Mais d’autres types de réacteurs de quatrième génération sont conçus dans le monde et certains d’entre eux disposent de caractéristiques de sûreté plus prometteuses. Nous souhaitons donc que des études reposant sur ces comparaisons soient effectuées et nous avons mis en place un groupe permanent sur ce sujet, qui rendra ses conclusions à la fin du premier semestre de 2014. Il est logique que nous pensions à continuer de fabriquer des réacteurs à neutrons rapides, mais il ne faut pas refuser d’examiner d’autres types de réacteurs.
S’agissant de la pondération entre les bénéfices et les risques, la France a toujours été prudente vis-à-vis de l’approche probabiliste – même si elle l’utilise et la perfectionne –, au contraire des États-Unis qui l’utilisent beaucoup. Cette méthode s’avère précieuse pour les événements de faible portée mais à probabilité élevée – comme le dysfonctionnement d’une vanne –, et qui peuvent entraîner une succession de petits incidents pouvant provoquer un accident majeur. Elle se révèle beaucoup moins efficace lorsque l’accident résulte, comme à Fukushima, d’une agression puissante, mais à très faible probabilité, qui débouche sur un accident grave. Après la catastrophe japonaise, nous n’avons donc pas mené d’analyse probabiliste, mais nous avons étudié les fondamentaux permettant de protéger un réacteur, notamment la capacité de disposer d’électricité alimentant des pompes à eau.
M. le président François Brottes. Les probabilités sont importantes pour les assurances.
M. Pierre-Franck Chevet. Absolument, mais les assurances travaillent sur des risques récurrents que l’on peut estimer avec précision.
Monsieur le rapporteur, le récupérateur de corium a été mis en place pour les réacteurs de troisième génération, et cette question s’inscrit dans celle de la prolongation de la durée de vie. EDF peut proposer de maintenir un récupérateur de corium – qui vise à arrêter la traversée du plancher du bâtiment à réacteur et à refroidir le cœur –, mais peut également élaborer des solutions alternatives. Nous avons enjoint à EDF d’étudier la possibilité de créer une enceinte géotechnique autour du réacteur afin que, dans le cas d’une traversée du réacteur, la pollution des nappes souterraines soit contenue ; une telle protection pourrait être un complément du récupérateur de corium et pas forcément une alternative à celui-ci.
Dans le processus français de prolongation de la durée de vie des centrales, des experts étrangers viendront nous assister dans les groupes permanents : nous pourrons ainsi bénéficier de leur expérience.
M. le rapporteur. Monsieur Chevet, pourriez-vous répondre plus précisément à ma dernière question ?
M. Pierre-Franck Chevet. Les études n’ont pas encore été réalisées et, en tant que responsable d’une autorité de sûreté, je ne me lance pas dans les paris. Une première série de discussions avec EDF aura lieu dans quelques mois ; elles ne déboucheront pas sur une solution définitive, mais je pense que les jugements sur la prolongation seront différents selon les réacteurs.
M. Jacques Repussard. Monsieur Sordi, l’IRSN a une mission d’appui technique à la prise de décision, et, dans le cadre de cette fonction, nos interlocuteurs principaux sont l’ASN et le ministère de la défense – notamment le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) – pour le nucléaire militaire, mais nous avons également des relations avec le ministère du travail qui a des responsabilités en matière de radioprotection. Après saisine, nous remettons des expertises à ces demandeurs.
Nous consacrons 40 % des ressources de l’Institut à la réalisation de travaux de recherche destinés à faire progresser la sûreté nucléaire grâce à une expertise indépendante et performante. Seul l’IRSN doit décider de la nature de ces études, les industriels et l’administration ne devant pas nous passer de commandes dans ce champ de notre activité.
Nous assurons également la surveillance radiologique du territoire et l’exposition des Français au rayonnement ionisant, dont l’origine est naturelle et médicale, la population ne pouvant subir une irradiation provenant de l’industrie nucléaire qu’en cas d’accident.
Maintenant que les travaux d’épaississement du plancher du réacteur sont achevés, l’IRSN considère que l’état de sûreté des deux réacteurs de Fessenheim ne diverge pas de celui des autres réacteurs du parc. L’IRSN publie chaque année un rapport qui montre que la sûreté d’exploitation des réacteurs français est bonne – et au moins aussi performante que dans les autres pays –, même si nous devons toujours chercher à nous améliorer, le risque d’un accident grave étant très faible, mais non nul. En revanche, il existe des tensions dans certains sites, et la surcharge de travail pour l’exploitant, les équipes d’ingénierie, les commanditaires, les sous-traitants et les fournisseurs entraîne un allongement des délais de maintenance. Or les décisions de renouvellement des autorisations vont nécessiter beaucoup de travail supplémentaire dans les prochaines années. Il faut donc parvenir à un compromis qui permette de faire davantage en termes de sûreté, sans imposer à ceux qui font fonctionner le système nucléaire des demandes exorbitantes qui constitueraient un stress supplémentaire et pourraient, in fine, déboucher sur une diminution de la sûreté.
M. le président François Brottes. Monsieur le président de l’ASN, confirmez-vous ou infirmez-vous les propos de M. le directeur général de l’IRSN ?
M. Pierre-Franck Chevet. Nous devons porter une attention particulière à notre capacité industrielle à accroître la sûreté, car il faut absolument que les améliorations puissent être effectuées correctement. Rien ne serait plus dangereux que de penser pouvoir se reposer sur un système de sûreté qui s’avérerait défaillant. Si la mise en œuvre de changements de qualité se révélait trop longue, il faudra s’interroger sur l’opportunité de cette option. Comme l’affirme M. Repussard, il convient d’être attentif à la fois à la prescription théorique et à la possibilité de la déployer efficacement et dans des délais satisfaisants.
M. Bernard Accoyer. Monsieur Repussard, je vous remercie d’avoir rappelé que le risque zéro n’existait pas.
Monsieur Chevet, vous avez affirmé que, à ce stade, la quatrième génération de réacteurs n’apportait pas d’amélioration dans le domaine de la sûreté, mais la résolution – même partielle – du problème des déchets n’y participe-t-elle pas ?
Le réacteur de quatrième génération sera-t-il un prototype ? Superphénix a été un réacteur expérimental, mais il a été fermé par le Gouvernement de Lionel Jospin, sous pression des Verts suisses ; on a ainsi refusé d’aller plus loin dans le domaine de la recherche. Or innover exige d’imaginer, de concevoir et de construire un prototype, et l’on assiste actuellement à un mouvement d’opposition à la recherche, incarné par le refus de la mise en œuvre de l’article 2 de la loi du 13 juillet 2011, qui prévoit l’installation d’une commission indépendante chargée de découvrir de nouvelles techniques de prospection de gaz de schiste.
Monsieur Repussard, quelles sont les victimes actuelles – médicalement diagnostiquées – de Fukushima ? Ce réacteur, construit dans l’une des zones du monde les plus sismiques, possède-t-il un équivalent sur le territoire français ?
Quel travail les différentes autorités de sûreté nucléaire conduisent-elles au plan international ?
M. le président François Brottes. Monsieur le président Accoyer, je vous remercie pour vos questions, mais leur champ est trop large pour qu’elles soient traitées rapidement. Vous pourrez les réitérer lors des prochaines auditions consacrées au risque et à la quatrième génération. Si vous deviez être absent, je m’engage à les relayer.
M. Bernard Accoyer. Très bien, monsieur le président.
M. le président François Brottes. Nous vous remercions, messieurs, d’être venus répondre à nos questions. Nous nous reverrons à l’occasion des séances consacrées au risque et aux troisième et quatrième générations de réacteurs.
Audition de M. Dominique Minière, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie (EDF)
(Séance du jeudi 20 février 2014)
M. le président François Brottes. À l’issue de la précédente audition du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et du directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), personne ne semble savoir ce que signifie le « grand carénage » ni combien il coûtera. On ignore donc qui peut établir des devis, hormis le maître d’ouvrage. Nous souhaitons donc vous interroger sur le sujet, Monsieur Minière. On nous dit que vous êtes sous tension, en tant qu’opérateur, à cause d’une accumulation d’exigences et d’une difficulté à faire face en termes de ressources humaines et en termes d’investissements. Nous attendons donc de votre part des réponses franches.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Dominique Minière prête serment)
M. Dominique Minière, directeur délégué à la direction Production-Ingénierie (EDF). Merci de nous donner la possibilité d’affirmer notre conviction quant à la sûreté et à la fiabilité de notre parc en exploitation et à notre capacité de continuer de l’améliorer – élément-clef de notre projet industriel.
Nous avons la responsabilité de l’exploitation du premier parc nucléaire mondial et, comme le prescrit l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le premier responsable de la sûreté, c’est l’exploitant. La sûreté, qui est notre premier souci, s’est constamment améliorée au cours du temps, grâce, en particulier, au retour d’expérience. Tous les dix ans, sous le contrôle de l’ASN, nous procédons à une réévaluation complète du référentiel de sûreté. La conception est revue en profondeur en intégrant le retour d’expérience et les évolutions techniques et scientifiques. Notre parc a déjà tenu beaucoup plus que sa promesse d’origine en donnant à la France une électricité sûre, compétitive, décarbonée, contribuant à l’indépendance énergétique du pays et autour de laquelle s’est constituée une filière industrielle elle-même exceptionnelle, riche en emplois, troisième secteur après l’automobile et l’aéronautique.
Aussi notre projet est relativement simple : il consiste à maintenir et à exploiter ce parc aussi longtemps que ce sera possible et utile pour la collectivité. Il nécessite bien entendu des travaux de maintenance et d’amélioration de la sûreté que nous sommes prêts à engager comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent.
Le cap des quarante années est important et la question se pose de la possibilité d’une prolongation au-delà. Nous sommes les premiers conscients qu’il s’agit d’une étape majeure sur les plans politique, technique, réglementaire et sous l’angle financier. Nos centrales ont été conçues et construites pour une durée de vie technique de quarante ans. Les études de dimensionnement et la qualification des matériels ont bien été réalisées pour quarante ans. En même temps, elles ont été construites sur le modèle américain, celui de Westinghouse, avec des centrales de référence qui sont en voie d’obtenir une licence de soixante ans.
M. le président François Brottes. C’est l’équivalent de cinquante ans chez nous, puisque, apparemment, les Américains prennent pour point de départ le premier béton.
M. Dominique Minière. Non, le point de départ, chez eux, comme chez nous, c’est la connexion au réseau. Il y a bien quarante ans entre la date de connexion au réseau et la date de fin de licence – pour les États-Unis, car, en France, il n’y a pas de licence de quarante ans puisque le principe est d’améliorer le niveau de sûreté tous les dix ans. Nous disposons de toutes les données sur la situation américaine et nous pouvons, si vous le souhaitez, vous les faire parvenir.
La centrale de Beaver Valley, par exemple, qui a servi de référence pour notre palier de 900 mégawatts (MW), a obtenu l’équivalent d’une prolongation jusqu’à soixante ans. La centrale de South Texas, plus récente, qui nous a servi de référence pour le palier de 1 300 MW, est en passe d’obtenir une même prolongation. Plus généralement, la Nuclear Regulatory Commission (NRC) a déjà accordé une prolongation d’activité au-delà de quarante ans et jusqu’à soixante ans pour 74 des 100 réacteurs américains, et, à la fin de 2012, toujours aux États-Unis, 21 réacteurs ont déjà dépassé une durée de fonctionnement de quarante ans.
Outre la question de la sûreté, la possibilité d’aller au-delà de quarante ans d’exploitation repose sur deux éléments essentiels. Il faut, tout d’abord, que tous les composants de nos centrales puissent fonctionner en toute sûreté au-delà de cette durée. Dans une centrale nucléaire, tous les composants sont remplaçables, à l’exception de la cuve et de l’enceinte de confinement. Les composants remplaçables font l’objet soit de rénovation soit de remplacement. Cela correspond au cycle normal de vie des matériels concernés. Ainsi, les générateurs de vapeur, les alternateurs, les transformateurs ont souvent des durées de vie technique comprises entre vingt-cinq et trente-cinq ans, en France comme ailleurs. Ces composants nécessitent soit de grosses opérations de rénovation – comme les rebobinages d’alternateurs –, soit des opérations de remplacement – pour une large partie, par exemple, des générateurs de vapeur. Ces investissements sont donc souvent nécessaires au bout d’environ trente ans et, une fois réalisés, ils permettent aux composants de fonctionner techniquement pendant trente nouvelles années. La cuve et l’enceinte de confinement font pour leur part l’objet de programmes de surveillance, de recherche, de maintenance particulièrement élaborés. Ces programmes nous conduisent à estimer que la plupart de nos réacteurs peuvent fonctionner jusqu’à soixante ans au moins.
Sur le plan purement technique, la capacité de nos cuves à résister aux accidents graves est nettement meilleure que celle des cuves américaines, tout simplement parce que les nôtres ont été fabriquées grâce au tissu industriel français très développé des années 1980, créé grâce à l’effet palier que nous avons collectivement constitué. On constate bien le paradoxe technique, injuste pour la réputation de notre industrie, selon lequel l’exploitation des cuves américaines est prolongée alors qu’elle ne pourrait excéder quarante ans chez nous. Ce paradoxe ne manquera pas d’être exploité demain par les concurrents d’AREVA pour le nucléaire neuf.
M. le président François Brottes. Nous avons évoqué ce matin la cuve de la centrale de Tricastin.
M. Dominique Minière. Elle recèle quelques défauts, en effet, sur lesquels je pourrai revenir si vous le souhaitez, défauts qui restent sous surveillance et qui n’ont pas évolué depuis trente ans.
Ensuite, nous devons améliorer le niveau de sûreté de nos réacteurs à un niveau fixé par l’ASN, sous le contrôle du Parlement, notamment de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. En effet, vous le savez, la réglementation française, formalisée par la loi de 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ne prévoit pas, contrairement à la réglementation américaine, de limitation dans le temps à l’autorisation d’exploiter, mais elle repose sur des examens de sûreté périodiques, à un intervalle maximal de dix ans, qui conditionnent la poursuite de l’exploitation.
À chacun de ces examens, la loi exige qu’une réévaluation à la hausse du niveau de sûreté soit opérée, qui doit prendre en compte le retour d’expérience et l’amélioration des connaissances. En tant qu’exploitant, et donc premier responsable de la sûreté, nous partageons largement l’approche d’amélioration permanente. Nous la menons depuis le début des années 1990, avant même qu’elle n’ait été codifiée par la loi. Pour des réacteurs construits pour des décennies, il est en effet fondamental d’améliorer le niveau de sûreté en prenant en compte, d’abord, l’amélioration de la connaissance – nous disposons de moyens de calcul grâce auxquels nous pouvons modéliser des phénomènes impossibles à modéliser dans les années 1970 –, ensuite, le retour d’expérience des incidents et des accidents dans le monde.
Ainsi, à la suite de ceux de Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986, nous avons installé dans nos centrales des équipements – les recombineurs ou les filtres à sable – qui, s’ils avaient été mis en place à Fukushima, auraient évité les explosions d’hydrogène et la contamination des territoires pour plusieurs dizaines d’années. Il n’empêche que, après Fukushima, nous voulons aller encore plus loin avec un objectif simple : ne pas avoir, quel que soit l’accident, de contamination du territoire à long terme. C’est le sens des travaux de renforcement de la conception que nous menons sur nos réacteurs.
On nous a également invités à faire face à l’inconcevable. Or l’inconcevable ne pouvant par définition être pris en compte au moment de la conception, nous avons mis en place, pour compléter celle-ci, la force d’action rapide nucléaire.
C’est aussi le sens des actions que nous menons au sein de l’Association mondiale des exploitants nucléaires, présidée par un représentant d’EDF, mais aussi le sens du soutien que nous apportons à l’ASN ainsi qu’aux travaux de l’AIEA, tant à l’occasion de la précédente convention sur la sûreté nucléaire, il y a deux ans, qu’à l’occasion de la prochaine qui sera présidée par André-Claude Lacoste.
Enfin, il faut prendre en compte l’évolution de l’environnement. Nous avons ainsi revu en profondeur et augmenté la robustesse de nos installations aux inondations, tenant compte du retour d’expérience et de la multiplication d’événements climatiques, comme la tempête de 1999.
Nos centrales passent progressivement l’étape des trente ans. Une troisième visite décennale vient de se terminer pour dix-neuf réacteurs, dont cinq ont reçu un avis positif pour la poursuite de leur exploitation.
M. le président François Brottes. Dont la centrale de Fessenheim.
M. Dominique Minière. En effet.
L’ASN n’a pas identifié d’éléments mettant en cause la capacité d’EDF à maîtriser la sûreté des réacteurs de 900 MW jusqu’à quarante ans. Cet avis générique est important, même si les autorisations doivent être obtenues réacteur par réacteur.
L’extension de la durée de fonctionnement au-delà de quarante ans a déjà fait l’objet d’échanges nourris avec l’ASN. Pour franchir ce seuil, l’ASN a demandé à EDF que la réévaluation de sûreté à l’étape de quarante ans soit faite au regard des objectifs de sûreté définis pour les nouveaux réacteurs. Cet objectif ambitieux n’a pas d’équivalent dans le monde et nous le comprenons dans la mesure où le franchissement du seuil technique des quarante ans sera concomitant avec la présence de réacteurs de troisième génération dont la conception répond à des exigences de sûreté renforcées en France et dans le monde. Ces exigences visent à limiter pour les populations, dans l’espace et dans le temps, les conséquences d’un accident grave, avec fusion du cœur.
Nous y avons travaillé dès les années 2010 et, à la suite des travaux du groupe permanent d’experts réuni en janvier 2012, l’ASN a confirmé, dans sa lettre du 28 juin 2013, que la méthodologie que nous proposions était globalement satisfaisante. Ce courrier définit les attentes de l’ASN quant au référentiel de sûreté pour préparer les quatrièmes visites décennales des centrales de 900 MW, attentes qui correspondent au programme de travail sur la durée de fonctionnement réalisé par EDF. Dans un courrier que j’ai signé la semaine dernière, pour répondre aux demandes de compléments de l’ASN, nous formulons des propositions concrètes pour l’amélioration de la sûreté de l’entreposage des combustibles usés.
Ces discussions avec l’ASN vont se poursuivre en 2014. Elles sont habituelles pour chaque examen de sûreté et portent sur l’ensemble du palier de 900 MW. Elles n’enlèvent rien au fait que, in fine, l’ASN se prononcera réacteur par réacteur pour une période de dix ans après chaque visite décennale. Il faut prendre garde, dans une telle discussion, de mélanger les objectifs de sûreté – dont la définition incombe à l’ASN, sous votre contrôle – et les moyens de les atteindre, dont la responsabilité incombe à l’exploitant, avec l’aide du tissu industriel. EDF a ainsi engagé un programme de travaux à la fois pour maintenir son parc en bon état de fonctionnement et améliorer la sûreté, et dans la perspective de rendre possible une prolongation de l’exploitation au-delà de quarante ans.
Ces investissements destinés à conserver la compétitivité du parc nucléaire existant pour la durée de la prolongation représentent un coût significatif pour EDF : de l’ordre de 55 milliards d’euros d’ici à 2025. Les travaux menés par la Cour des comptes en la matière en 2012 ont évalué à 54 euros 2010 par MWh le coût complet économique de production du parc nucléaire existant pour la période 2011-2025 – investissement initial, combustible, exploitation, déconstruction, mais en intégrant déjà cette charge de rénovation et d’amélioration continue de la sûreté. Nous travaillons avec la Cour pour lui permettre d’actualiser ses chiffres dans le cadre de l’enquête que votre commission lui a confiée. Je puis d’ores et déjà vous indiquer que nos estimations sur les coûts d’investissements ont peu changé depuis le rapport de janvier 2012, car nous avons mis en place un dispositif de maîtrise de ces projets permettant d’en sécuriser la réalisation et d’en limiter la charge industrielle et financière.
Nous parvenons ainsi à un chiffre d’environ 55 euros par MWh, à comparer au coût des solutions alternatives : le coût de développement des moyens thermiques classiques est de l’ordre de 70 à 100 euros par MWh ; le tarif actuel de rachat des moyens ENR (énergies renouvelables) est de 85 à 300 euros par MWh, sans intégrer les surcoûts de renforcement du réseau, en particulier de distribution et de back up que ces énergies nécessitent du fait de la variabilité de leur production.
Du point de vue économique, le parc nucléaire existant constitue donc la source de production d’électricité la plus compétitive et la plus décarbonée, au moins pour la décennie à venir. Bien entendu, cela ne préempte en rien les choix de politique énergétique qui pourront être faits. Le parc existant nous donne en effet du temps pour préparer le mix électrique de demain avec des filières éprouvées sur le plan économique et industriel.
Enfin, ces investissements constituent également, surtout en cette période de crise économique, une véritable opportunité pour notre industrie, en particulier pour la filière nucléaire française. Le comité stratégique de la filière nucléaire française, présidé par M. Montebourg, a évalué à 110 000 le nombre d’embauches à réaliser d’ici à 2020 dans la filière du nucléaire, pour le parc existant et le nouveau nucléaire. Il s’agit d’emplois hautement qualifiés dans la métallurgie, la mécanique, l’électronique. Ces embauches sont pour partie le renouvellement d’emplois existants et pour partie des créations nettes d’emplois. Ils sont largement répartis sur le territoire. Une partie d’entre eux sont locaux, au plus près des centrales, donc dans des territoires souvent déshérités sur le plan économique et industriel.
Notre projet industriel est de maintenir et d’exploiter le parc nucléaire existant qui procure une électricité sûre, compétitive et décarbonée. Il suppose la réalisation d’investissements à la fois de maintenance lourde et d’amélioration de la sûreté qui n’ont de sens que dans une perspective de prolongation du parc, compte tenu de l’ampleur et du calendrier de ces investissements. Une certaine visibilité est donc nécessaire dans la perspective de prolonger l’exploitation des réacteurs, même si les autorisations ne sont octroyées in fine que tranche par tranche tous les dix ans. Ce projet ne préempte aucun choix politique de long terme, notamment en matière d’énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d’électricité, qui sont désormais une priorité stratégique du groupe EDF : le résultat pour 2013 montre une croissance de 23 % de la production d’ENR et, pour la quatrième année consécutive, un volume d’investissements de développement plus élevé pour les ENR que pour l’énergie nucléaire.
Aussi, pour nous, la prolongation du parc nucléaire existant n’est-elle pas contradictoire mais complémentaire avec la diversification des moyens de production d’énergie. Je vous rappelle que, en matière de puissance électrique installée en France, le parc nucléaire représente 63 % de la puissance EDF et 49 % de l’ensemble des moyens électriques installés.
M. Denis Baupin, rapporteur. Votre propos liminaire m’a quelque peu laissé sur ma faim. Les représentants de l’ASN nous ont d’emblée signifié qu’il n’y avait absolument aucune garantie de possibilité de prolongation de l’exploitation de nos centrales au-delà de quarante ans. Il est, selon eux, trop tôt pour se prononcer ; il faut attendre l’horizon 2018-2019.
M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas ce que nous avons compris !
M. le rapporteur. Vous n’étiez pas présent, monsieur Accoyer, mais nous pourrons réinviter M. Chevet pour le confirmer.
Il n’y a pas aujourd’hui de référentiel de sûreté connu pour la prolongation. Vous avez néanmoins l’air très confiant, monsieur Minière, sur la possibilité de la mener à bien. Comment amener les réacteurs existants au niveau de l’EPR, notamment en ce qui concerne le récupérateur de corium, la bunkerisation des piscines ? Disposez-vous en la matière d’évaluations de coûts, puisque l’ASN indique qu’il ne lui revient pas de les chiffrer ?
Quant au grand carénage, selon les documents de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ceux de l’ASN mais aussi d’EDF, il aurait pour principal objectif de supprimer les avaries génériques qui ont conduit à la diminution de la disponibilité du parc nucléaire, et donc au remplacement, notamment, de générateurs de vapeur, mesures qui n’ont rien à voir avec la prolongation de l’exploitation au-delà de quarante ans, mais qui sont nécessaires pour éviter que la disponibilité du parc ne continue de chuter. Qu’y a-t-il donc derrière ce grand carénage ? À ma stupéfaction, l’ASN n’en sait rien ! Quels investissements concernent la remise à niveau du parc existant pour qu’il continue de fonctionner jusqu’à l’étape des quarante ans ? Quels sont les investissements qui concernent la mise en œuvre des évaluations complémentaires de sûreté ? Vous dites les estimer à environ 10 milliards d’euros, pour préciser ensuite que la moitié serait en fait déjà mobilisée pour le grand carénage. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces 10 milliards d’euros ? Cette somme est-elle revue à la hausse au regard des dernières préconisations de l’ASN ?
Vous évoquez la somme de 55 milliards d’euros à l’horizon 2025. Et au-delà ? Nous voyons circuler des chiffres : 70 milliards, 100 milliards… Si l’on prend l’horizon 2035, quel sera le niveau d’investissement : en restera-t-on à 3 ou 4 milliards d’euros par an ? Faudra-t-il donc ajouter 30 à 40 milliards d’euros pour atteindre l’année 2035 ? Quel est le niveau exact des investissements pour les cinquante-huit réacteurs français ?
Quelle est la rentabilité de ces investissements pour les générateurs de vapeur qui ont été remplacés dans vingt-deux réacteurs ? En tant qu’exploitant, certes, vous souhaitez la prolongation de l’activité des réacteurs et, du reste, vous réalisez déjà des investissements, notamment pour les générateurs de vapeur. Êtes-vous d’accord avec la CRE, qui estime qu’un tel générateur s’amortit en une dizaine d’années ? Globalement, quelle est la capacité financière d’EDF pour répondre à ces investissements, sachant que l’endettement du groupe est très important, et quelle est sa capacité industrielle alors qu’il existe une tension au sein d’EDF pour répondre aux besoins de maintenance des réacteurs, avant même que ces gros investissements n’aient été lancés ?
M. Jean-Pierre Gorges. Monsieur le rapporteur, M. Chevet n’a pas tenu les propos que vous lui avez prêtés : il n’a pas contredit M. Repussard, représentant l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), un scientifique, quand celui-ci a dit que la sûreté était satisfaisante. Je vous invite à relire le compte rendu.
Nos centrales ont été prévues pour durer quarante ans, mais l’on change des composants au bout de trente ans. Aussi, si l’on arrête la centrale au bout de quarante ans, on devra payer ces composants pendant dix ans seulement. L’amortissement financier ne correspondra pas à l’amortissement technique, puisque ces composants peuvent vivre trente ans. Cette donnée a-t-elle été modélisée ?
Vous soutenez, monsieur Minière, que la prolongation de l’exploitation à soixante ans ne poserait pas beaucoup de problèmes en termes de sûreté, et vous acceptez qu’on vous en demande plus tous les dix ans. Je suis convaincu, pour ma part, que la transition énergétique se fera vers le nucléaire, vers la quatrième génération, puisque l’on disposera alors d’un combustible dont les réserves seront quasi illimitées : on passera de 130 ans à plus de 5 000 ans. La transition énergétique doit-elle du reste se faire avec le nucléaire ou avec l’éolien, le photovoltaïque dont les coûts, aléatoires, nécessitent des subventions de l’État, et qui contribue donc au déficit des comptes publics ?
M. le rapporteur. C’est faux !
M. Jean-Pierre Gorges. Bien sûr que si, puisqu’on achète la production plus cher qu’on ne la revend ! La Cour de justice de l’Union européenne considère que c’est interdit, ce que confirmera, je pense, le Conseil d’État.
Je regrette de ne pas avoir entendu l’avis de M. Repussard sur la quatrième génération – rien ne doit pouvoir m’empêcher d’obtenir deux avis, faute de quoi, si vous ne laissez pas le peu de députés présents poser des questions, monsieur le président, le travail de la commission s’en trouvera tronqué.
M. le président François Brottes. Les personnes que vous mentionnez seront à nouveau entendues.
M. Jean-Pierre Gorges. Je suis certainement le plus grand cumulard de France et je participe pourtant aux travaux de la commission d’enquête.
On évoque l’horizon 2040-2050 pour l’avènement de la quatrième génération. Or, si l’on prolonge l’activité des centrales existantes jusqu’à soixante ans, parviendra-t-on à faire la jonction techniquement, financièrement et politiquement ? Et qu’en sera-t-il de la recherche qui risque d’être surtout consacrée à la sécurisation de la quatrième génération, au détriment des autres domaines ?
M. Michel Sordi. Quelles sont les différences techniques en matière de sûreté entre le parc français et la centrale de Fukushima ? Quels sont les atouts d’une prolongation de l’exploitation des centrales au-delà de quarante ans ? De quel mix énergétique avons-nous besoin pour assurer notre indépendance énergétique, garantir un approvisionnement stable en électricité et limiter la production de dioxyde de carbone ?
Mme Frédérique Massat. J’ai lu récemment qu’EDF avait révisé le calendrier du grand carénage, prévoyant une montée en charge plus progressive des investissements avec, désormais, une estimation portée de 4 à 5 milliards d’euros. Qu’en est-il ?
Je lis, en outre, que ce lissage vise à faciliter la planification des chantiers, mais aussi à aider les fournisseurs à monter en gamme. Quand le nouveau programme des investissements sera-t-il présenté à la CRE ? Je lis encore qu’il devrait être également présenté à la présente commission d’enquête. Quand disposerons-nous de cette présentation ?
En outre, vous prévoyez que le coût du mégawattheure sera de 55 euros pour le grand carénage. Quel serait-il pour des réacteurs neufs ?
M. Dominique Minière. L’ASN ne nous a pas demandé de mettre le parc au niveau des réacteurs de la troisième génération, mais d’avoir des objectifs de sûreté identiques à ceux concernant les réacteurs de troisième génération. Nous n’avons pas laissé vieillir les réacteurs de deuxième génération sans leur apporter d’améliorations. Les objectifs de sûreté se sont ainsi rapprochés. Grâce aux visites décennales, la probabilité de fusion du cœur en cas d’événement interne sera quasi égale à celle de l’EPR. Il s’agit donc d’une transition douce.
Les 55 milliards d’euros prévus pour le grand carénage se répartissent comme suit : 10 milliards d’euros pour le déploiement des modifications post-Fukushima ; 20 milliards d’euros pour les investissements réalisés lors des arrêts de tranche, notamment des visites décennales ; 15 milliards d’euros pour la maintenance lourde des gros composants ; 10 milliards d’euros au titre d’autres projets patrimoniaux, concernant l’environnement, le risque incendie ou le risque « grand chaud, grand froid ».
Nous avions commencé à travailler sur le programme de la durée de fonctionnement en 2010, c’est-à-dire bien avant l’accident de Fukushima survenu en mars 2011, et nous considérions déjà que, pour mener à bien la prolongation de fonctionnement, nous devrions ajouter des moyens d’électricité et des moyens d’alimentation en eau – un accident nucléaire se produit quand un réacteur n’est plus alimenté en eau et en électricité. L’accident de Fukushima et les conclusions des évaluations complémentaires de sûreté ont confirmé la validité des dispositions que nous envisagions. Il faudrait en ajouter d’autres, et c’est pourquoi nous parlons souvent de 10 milliards d’euros dont 5 déjà engagés.
Que se passera-t-il après 2025 ? La Cour des comptes enquête, et nous lui fournissons l’ensemble des éléments de la trajectoire. Puisque la Cour travaille, si j’ai bien compris, pour votre commission, vous aurez accès à toutes les données. La plupart des remplacements auxquels nous devons procéder doivent intervenir au bout de vingt-cinq à trente ans. Notre parc a démarré, pour l’essentiel, entre 1980 et 1990, les dernières tranches en 1992. La plupart des grosses opérations auront été menées d’ici à 2025, et c’est pourquoi nous mettons l’accent sur cette année-là ; ce qui ne signifie pas pour autant que d’autres opérations ne seront pas à prévoir ensuite, notamment sur des réacteurs de 1 300 MW qui sont un peu plus jeunes.
Pour ce qui est de la capacité financière d’EDF, notre projet industriel depuis 2008-2009 est d’étendre la durée de fonctionnement de notre parc. Nous devons donc prévoir les ressources financières pour y répondre, ressources conditionnées par la vente d’électricité sur les marchés. Je vous rappelle, en outre, que l’endettement du groupe a baissé en 2013. Nous progressons et nous finançons le début du programme, car, j’y insiste, le grand carénage n’a pas vocation à naître d’un coup, mais c’est progressivement que nous rénovons notre parc et améliorons sa sûreté.
M. le rapporteur se demande par ailleurs si nous ne sommes pas déjà dans une situation difficile concernant les arrêts de tranche. L’augmentation de la durée des arrêts en 2013 est imputable à la progression du volume des activités à mener. Celles-ci sont de plusieurs types. Certaines consistent à remplacer les gros composants, et ce ne sont pas celles qui entraînent les retards. Grâce à ces activités, jamais notre parc n’a été aussi fiable : pendant les six premiers mois de l’année 2013, nous avons eu la plus basse indisponibilité fortuite jamais rencontrée. On note également une hausse des activités de modifications qui, elles non plus, n’ont pas d’impact sur la durée des arrêts de tranche puisqu’elles sont instruites suffisamment à l’avance. Enfin, la hausse des activités liées à la maintenance courante est due pour partie à une exigence de fiabilité de nos équipements, mais aussi, au moins à hauteur de 25 %, à des exigences supplémentaires de l’ASN depuis six ans. C’est ce dernier type d’activités qui a le plus fort impact sur la durée des arrêts. Nous travaillons à la diminution de ces activités.
M. le président François Brottes. Les arrêts sont-ils toujours programmés ? Le rapporteur parlait d’intermittence, et donc d’arrêts intempestifs.
M. Dominique Minière. Les arrêts pour renouvellement du combustible sont programmés et prévus pour une certaine durée, qui a augmenté. Et nous avons de temps à autre des arrêts fortuits, non prévus. Grâce aux investissements que nous sommes en train de réaliser pour fiabiliser notre parc, leur part se réduit progressivement pour ne plus atteindre que 2,5 % du temps.
M. le rapporteur. Certes, mais quand, par exemple, comme la semaine dernière, les deux réacteurs de Flamanville s’arrêtent en même temps, on ne peut nier que l’impact d’un arrêt fortuit sur le réseau est totalement différent de l’impact produit par un arrêt programmé.
M. Dominique Minière. C’est aussi pourquoi notre objectif est de réduire au maximum les arrêts fortuits. C’est le sens de nos investissements dans les gros composants, en vue de fiabiliser notre parc. Nous étions bien contents, il y a trois ans, de disposer de nos tranches nucléaires pour faire face à un hiver très dur, les autres moyens de produire de l’électricité ne brillant pas par leur présence lors des heures de pointe de consommation. Un parc nucléaire fiabilisé est un atout dans le mix énergétique.
Je reviens sur le renouvellement des compétences. Il est massif au sein de notre groupe : nous aurons renouvelé, entre 2007 et 2015, quelque 50 % de nos effectifs. Nous avons mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Nous avons embauché près de 10 000 personnes sur un socle de 28 000 personnes, en augmentant les effectifs, au total, de 5 300 personnes. Nous avons, par ailleurs, multiplié par 2,5 le volume d’heures de formation. Nous cherchons à augmenter la vitesse d’acquisition de l’expérience de nos salariés.
Enfin, nous avons renforcé nos méthodes de préparation des arrêts de tranche par davantage d’anticipation, en figeant notamment les programmes des arrêts très en amont, et nous cherchons à faire évoluer nos organisations durant les arrêts pour permettre plus d’activités, en appliquant le principe du 2×8 ou une plage élargie, comme le font de nombreux industriels.
Une de nos grandes préoccupations, et qui concerne l’avenir, est la capacité de l’ASN et de l’IRSN à conduire leurs instructions en temps et en heure alors que leurs moyens, notamment en effectifs, n’ont pas augmenté. Nous avons, pour notre part, anticipé en embauchant, en formant…
M. le président François Brottes. Ce n’est donc pas vous qui êtes en tension, mais eux…
M. Dominique Minière. L’instruction de la troisième visite décennale des réacteurs de 1 300 MW devrait être close en octobre 2014, soit six mois seulement avant le début du premier arrêt sur le site de Paluel. Il nous semblerait anormal de devoir choisir – pour ce qui est des équipes de travail – entre la fin de l’instruction des dossiers de Flamanville 3I et l’instruction des dossiers du parc en exploitation uniquement à cause des moyens réduits de l’ASN et de l’IRSN, alors qu’il s’agit de deux dossiers fondamentaux pour l’économie française. Je rappelle que la moitié des taxes sur les installations nucléaires de base payées par EDF constituent le budget de ces deux organismes, et qu’EDF acquitte 90 % de cette taxe.
J’en viens aux atouts de la prolongation. Il s’agit de bénéficier, sur le plan économique, d’un coût complet du mégawattheure de 55 euros, pour une énergie nucléaire décarbonée, qui contribue à l’indépendance énergétique du pays. Nous avons bien conscience que nous n’obtiendrons pas d’autorisation de prolongation de l’activité jusqu’à soixante ans dans l’immédiat – la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire donne une visibilité de dix ans, non de vingt. Nous discutons donc avec l’ASN d’une prolongation de dix années, soit un total de cinquante ans. En même temps, nous nous préparons à la situation qui prévaudra au terme de ces cinquante ans. Cela justifie, par exemple, l’installation d’un réacteur de type EPR à Flamanville 3. Il sera intéressant, par ailleurs, de prendre en compte le retour d’expérience dans la conception des futurs réacteurs.
J’ai lu dans la presse que le calendrier du grand carénage aurait fait l’objet de révisions. Nous avons travaillé sur un programme de montée en charge plus progressive que celui initialement envisagé. Nous avons donc lissé le programme pour en renforcer la maîtrise et la faisabilité industrielle, mais aussi la faisabilité financière. Cette courbe revue est actuellement présentée à la Cour des comptes qui vous y donnera accès.
Il existe, monsieur Sordi, d’importantes différences entre les réacteurs de Fukushima et les nôtres, notamment grâce à toutes les améliorations de conception que nous avons apportées depuis les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl. Nous avons mis en place des recombineurs à hydrogène, des filtres à sable, si bien que, en cas de fusion du cœur, notre objectif – et nous sommes en mesure de le tenir très largement – est d’éviter une contamination à long terme des territoires. Je rappelle que les filtres à sable retiennent le césium qui est responsable de la contamination à long terme des territoires autour de Fukushima. Une telle démarche suppose que les exploitants prennent vraiment leurs responsabilités, tant dans le design initial que dans ses évolutions.
À ce titre, je rappellerai un fait que vous ignorez peut-être. Fukushima se trouvait à 120 kilomètres de l’épicentre du séisme. On oublie que la centrale d’Onagawa, exploitée par le groupe japonais Tohoku Electric Power Company, se situait, elle, à 60 kilomètres de l’épicentre et a subi une vague beaucoup plus importante. Seulement, Tohoku est un exploitant responsable et avait étudié les précédents tsunamis, concluant qu’il fallait caler les plateformes des trois centrales à quinze mètres de hauteur, même si, d’un point de vue économique, il faudrait tenir compte du coût du pompage de l’eau pour l’apporter à bonne hauteur. La sûreté, à ses yeux, devait primer. Bilan : le site d’Onagawa a subi un tsunami de quatorze mètres et n’a donc pas été inondé. En revanche, les villages alentour l’ont été et la population s’est réfugiée… dans la centrale.
M. le rapporteur. Je tiens à rectifier ce qui a été dit : les énergies renouvelables, en France, ne sont pas subventionnées.
MM. Jean-Pierre Gorges et Michel Sordi. Si, par le biais du nucléaire…
M. le rapporteur. Elles font l’objet d’un tarif d’achat qui n’a aucun impact sur le déficit public. Le nucléaire, lui, est largement subventionné.
M. le président François Brottes. C’est la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui finance les énergies renouvelables, et non le budget de l’État, en effet. Ce sont les consommateurs qui les financent.
M. le rapporteur. Monsieur Minière, vous n’avez pas répondu à certaines de mes questions, que je vais donc reformuler. Le rôle d’une commission d’enquête parlementaire n’est pas d’attendre les réponses que vous donnerez à la Cour des comptes ; si nous vous invitons, c’est pour que vous nous donniez les éléments que nous sommes en droit d’attendre, notamment de la part de représentants d’une entreprise détenue à 85 % par l’État.
À combien évaluez-vous le coût du grand carénage non pas à l’horizon 2025 mais, par exemple, à l’horizon 2035 ? Il s’agit de savoir si les chiffres dont nous entendons parler sont réels.
Qu’en est-il de la rentabilité des générateurs de vapeur sur dix ans ? Est-il exact, comme l’estime la CRE, qu’ils sont rentabilisés au bout de dix ans sans qu’il soit nécessaire de prolonger ?
Quelle est votre évaluation du coût supplémentaire qu’engendreraient les préconisations de l’ASN en matière de référentiel de sûreté sur la prolongation ? Vous précisez qu’il ne s’agit pas d’amener les réacteurs actuels au niveau de l’EPR, mais au niveau de sûreté de l’EPR… On peut entendre la subtilité, mais malgré tout, M. Chevet nous a parlé de récupérateur de corium, de protection des piscines… Quel en est donc le coût, selon vous ?
Un audit interne a été réalisé au sein d’EDF sur le grand carénage. Qu’en est-il résulté et peut-il nous être transmis ?
Enfin, le Gouvernement et le Parlement auront à se prononcer, dans les mois qui viennent, sur la politique énergétique du pays. Quel est, à vos yeux, le taux de probabilité de prolongation jusqu’à soixante ans des réacteurs nucléaires existants ?
M. Dominique Minière. Je n’ai pas voulu dire que les informations que nous transmettions ne devaient passer que par la Cour des comptes ; si c’est l’impression qu’ont donnée mes propos, je vous présente mes excuses.
Je n’ai pas sous la main les chiffres concernant le grand carénage après 2025, mais je vous les transmettrai au plus tôt.
En ce qui concerne la rentabilité des générateurs de vapeur, une partie de ces derniers, notamment dans les centrales les plus anciennes, étaient remplacés plutôt avant le seuil de trente ans, mais pas au-delà. Nous ne nous sommes donc jamais posé la question, en termes de sûreté, quand nous remplacions un générateur de vapeur après vingt-cinq ou trente ans, de savoir s’il fallait vraiment le faire, puisque nous l’avons toujours fait. Pour les réacteurs qui restent, notamment pour ceux de 1 300 MW, les générateurs de vapeur ont un meilleur niveau de conception. Le seuil de remplacement, ici, n’est plus de trente ans, mais plutôt de trente-cinq à quarante ans. Dès lors se pose une question industrielle, d’autant qu’il faut commander les générateurs de vapeur cinq à sept ans avant leur mise en place. Nous avons donc besoin d’une certaine visibilité quant à l’autorisation de prolonger nos réacteurs au-delà de quarante ans, faute de quoi nous serons plongés dans l’incertitude au moment de prendre nos décisions.
M. Chevet a bien rappelé qu’il fallait distinguer objectifs de sûreté et moyens pour les atteindre. L’objectif est bien d’éviter la contamination du territoire à long terme par les gaz émis lors d’un accident ou par le corium. Il n’existe pas qu’une seule technique pour traiter le corium : le récupérateur de corium de l’EPR en est une parmi d’autres. Des travaux sont menés, pour des réacteurs d’une certaine puissance, sur la possibilité de garder le corium en cuve afin d’éviter qu’il n’en sorte – il s’agit de l’in-vessel retention (IVR). Nous en sommes encore en la matière au stade de la recherche. Mais cette technique a été incorporée dès la conception pour certains réacteurs. Nous aurons, dès le premier semestre, des échanges sur la question avec l’ASN.
Ces aspects ont été pris en compte dans les 55 milliards d’euros évoqués. Une partie de cette somme constitue une provision pour le passage de la quatrième visite décennale. Nous sommes prudents et les chiffres que nous donnons comportent une part de provisions. La semaine dernière, par exemple, les prescriptions de l’ASN faisant suite à l’accident de Fukushima n’ont pas eu d’impact sur notre courbe, car nous avions constitué des provisions, prévoyant quelles pourraient être les conclusions de l’instruction en cours. C’est notre métier d’industriel.
Ainsi, en tant qu’industriel, compte tenu de ce que je sais, j’estime que 100 % de nos réacteurs pourront être exploités jusqu’à soixante ans. Je n’ai sur ce point, d’un point de vue technique, aucun état d’âme.
Vous évoquiez l’existence d’un audit interne. Il n’y en a pas eu. Vous faites peut-être allusion à une mission d’évaluation sur le grand carénage conduite au sein d’EDF. Je la connais bien pour l’avoir pilotée. C’est à cette occasion qu’il est apparu qu’on pouvait davantage lisser la montée en charge et donc mieux maîtriser ce programme sur le plan industriel, tant chez nous que chez nos fournisseurs.
M. le rapporteur. Pourrez-vous nous transmettre ce rapport ?
M. Dominique Minière. Il n’y a pas eu de rapport à proprement parler, mais j’ai mené une mission d’évaluation qui se termine par la courbe réévaluée, courbe que je me suis engagé à vous communiquer.
M. le président François Brottes. Nous vous remercions.
Table ronde d'entreprises prestataires d'EDF : M. Pierre Dambielle, directeur Activités nucléaires de ORTEC, M. Damien Gousy, vice-président du GIP Nord-Ouest, M. Alain Bertaux, président de CICO Centre, M. Michel Dupiech, directeur général adjoint d’ONET Technologies et M. Jean-Claude Lenain, président-directeur général de Mistras Group SA
(Séance du jeudi 20 février 2014)
M. le président François Brottes. Vous représentez des entreprises sous-traitantes, qui sont plus souvent des PME que de grands groupes, ou bien le Groupement des industriels prestataires Nord-Ouest (GIP NO).
Comment se positionne votre activité par rapport à la filière nucléaire ? Dépendez-vous uniquement d’elle ? Comment y évoluent les compétences ? Quelles sont, en la matière, les exigences des maîtres d’ouvrage ? Comment sont traités les sous-traitants, sur le plan de la relation à l’acheteur, du contrôle de la protection des salariés et du droit du travail ? Quelles améliorations attendez-vous ? Quelles sont vos interrogations sur l’avenir de la filière ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Alain Bertaux, Pierre Dambielle, Michel Dupiech, Damien Gousy et Jean-Claude Lenain prêtent serment)
M. Damien Gousy, vice-président du GIP Nord-Ouest. Je suis chargé du volet emplois et compétences d’une association loi de 1901 régionale qui couvre le territoire des centrales nucléaires de Flamanville, Penly, Paluel et Gravelines. Le GIP NO rassemble quatre-vingts entreprises adhérentes, qui interviennent aussi sur d’autres centrales. Il appuie les entreprises dans deux domaines : emploi et compétences ; hygiène, sécurité, radioprotection et environnement.
Pour le volet emplois et compétences, nous assurons la promotion des métiers du nucléaire en travaillant avec les acteurs locaux : maisons de l’emploi, Pôle emploi, conseils régionaux, chambres de commerce et d’industrie. Nous facilitons le lien entre donneurs d’ordre et fournisseurs de services, pour permettre l’embauche, à travers des forums de recrutement, et la formation professionnelle de personnels intervenant dans les sites nucléaires. Les ingénieurs de l’association sont déployés sur les sites, tout comme les ingénieurs hygiène et sécurité, qui jouent un rôle d’appui et de conseil auprès des entreprises.
M. le président François Brottes. Avez-vous suivi la polémique sur la main-d’œuvre qui intervient à Flamanville sur le chantier de l’EPR ?
M. Damien Gousy. Le GIP NO couvre les centrales nucléaires en exploitation. L’EPR n’est donc pas dans son giron. Cependant, nous travaillons avec le responsable de la politique industrielle de l’EPR, que nous souhaitons inclure dans notre double activité. Les compétences requises pour y travailler sont et seront identiques à celles qui sont actuellement « en tension ».
M. le président François Brottes. En plein débat sur la transition énergétique, quelle est l’ambiance dans le groupement ?
M. Damien Gousy. Elle est bonne, car nous profitons d’une dynamique. Il existe dans le nucléaire un vrai projet industriel, des entreprises prêtes à répondre à la demande et des clients qui devraient évoluer. Nous manquons cependant de visibilité. Certains contrats s’échelonnent sur cinq à dix ans, ce qui est rare dans d’autres secteurs industriels et nous pose à moyen terme des problèmes d’organisation logistique et matérielle.
Depuis que je travaille dans le nucléaire, c’est-à-dire depuis dix-sept ans, les relations ont beaucoup évolué, par exemple en ce qui concerne la mise à disposition de moyens d’hébergement pour les prestataires ou la préparation des arrêts de tranche. Les entreprises sont globalement satisfaites de l’exploitant.
M. Alain Bertaux, président de CICO Centre. CICO Centre est une PME de 200 salariés qui intervient dans trois métiers : la tuyauterie industrielle, la chaudronnerie et le contrôle non destructif. Elle a signé la convention collective de la métallurgie et adhéré au Syndicat national de la chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle (SNCT).
Elle a commencé à travailler pour EDF dans les années soixante-dix, pendant lesquelles se sont construites les centrales. Depuis 1998, les activités de maintenance ont pris le relais. Nous sommes présents à l’année sur les sites d’exploitation. Par ailleurs, nous réalisons des travaux neufs et intervenons à Flamanville sur l’EPR.
Selon les années, nous réalisons avec EDF et son environnement 30 % à 40 % de notre chiffre d’affaires, qui se situe entre 24 et 25 millions d’euros. Nous sommes prestataires de rang un, seul ou en groupement. Nous intervenons également en sous-traitance de rang deux, généralement pour de grosses entreprises qui travaillent pour EDF.
M. le président François Brottes. Si vous intervenez en rang un, est-ce en raison de vos compétences ou de vos prix ?
M. Alain Bertaux. Nos qualifications nous permettent de répondre au cahier des charges.
M. le président François Brottes. Comment s’effectue la négociation sur le prix avec EDF ?
M. Alain Bertaux. Il faut se bagarrer. Toute négociation possède un aspect technique, commercial et financier.
M. Pierre Dambielle, directeur Activités nucléaires d’ORTEC. Le groupe ORTEC, basé à Aix-en-Provence, est dédié à la maintenance industrielle. Il emploie 7 000 personnes, qui se répartissent entre une division industrielle, une division études et une division environnement.
Au sein de la division industrielle, le nucléaire emploie 1 500 personnes, qui se partagent de manière égale entre, d’une part, les études, l’assistance à maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et le calcul, et, d’autre part, les travaux, qui concernent essentiellement la maintenance des centrales en exploitation. Ceux-ci portent sur la mécanique, la métallurgie et l’électromécanique, notamment la robinetterie, les machines tournantes, les ponts roulants et les activités de soudage. Une autre division traite de la gestion des déchets industriels.
EDF représente 65 % de notre chiffre d’affaires lié au nucléaire, lequel constitue 20 % du chiffre d’affaires de notre groupe. Le lien avec EDF est donc important en termes de positionnement, d’emploi et de capacité de développement, dans la perspective du grand carénage et des activités post-Fukushima.
M. le président François Brottes. Le travail de maintenance est-il fluide ou soumis à des à-coups ? Les contrôles sont-ils pénibles ? Les procédures sont-elles toujours respectées ?
M. Pierre Dambielle. Depuis vingt ans, les contraintes réglementaires en matière de sûreté n’ont cessé de s’alourdir, ce qui suppose, en amont des interventions, une préparation très lourde et, sur le chantier, une organisation opérationnelle des contrôles tant par l’entreprise que par les contrôleurs du client. Une autre partie du travail concerne les retours d’expérience ou analyses, car nous veillons à ce que les écarts constatés dans une centrale ne se reproduisent pas ailleurs.
Les contrôles sont fluides, même s’ils entraînent parfois le blocage de l’activité. Il faut beaucoup plus de temps aujourd’hui qu’il y a vingt ans pour réaliser les mêmes opérations, compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et des progrès intervenus dans l’analyse de la sûreté.
M. le président François Brottes. Quel regard portez-vous sur le fait qu’EDF internalise certaines opérations de maintenance ? N’est-ce pas une manière de prendre votre travail ?
M. Pierre Dambielle. En effet. EDF a recruté beaucoup de personnel au sein de nos entreprises pour constituer l’effectif de ses sections d’intervention. Un grand groupe possède une aura. En outre, il offre des perspectives de carrière et des conditions de rémunération qui n’ont rien à voir avec celles d’une PME.
Dans ce domaine, EDF n’intervient pas brutalement. On nous sollicite, sinon pour nous demander notre accord, du moins pour ne pas agir de manière trop brusque. Il nous serait difficile de débaucher quand nous travaillons en arrêt de tranche pendant cinq à six mois. Nous fixons avec EDF la date à laquelle les salariés sortiront de nos effectifs.
M. le président François Brottes. Où trouvez-vous de nouvelles compétences lorsque vous embauchez à votre tour ?
M. Pierre Dambielle. Dans les bassins d’emploi en tension, où nous nous tournons vers le personnel des métiers de métallurgie, de chaudronnerie ou d’électricité. Nous le « nucléarisons », c’est-à-dire que nous lui faisons suivre un cursus dédié, avant de l’amener au bon niveau, sur le terrain, grâce au compagnonnage. Par ailleurs, depuis trois ans, nous avons créé des passerelles entre certaines branches industrielles en difficulté et notre activité.
M. le président François Brottes. C’est avec un peu d’émotion que je donne la parole à M. Dupiech, car, lorsque j’étais encore lycéen, j’ai été technicien de surface dans l’entreprise Onet. Depuis cette date, les compétences de celle-ci se sont considérablement étendues.
M. Michel Dupiech, directeur général adjoint d’Onet Technologies. Merci pour cette remarque flatteuse…
Issu de l’industrie de la défense et de l’aéronautique, j’ai rejoint il y a dix-huit mois le groupe Onet Technologies, dont je suis directeur adjoint. Cette filiale est détenue à 100 % par le groupe Onet, fondé en 1876 et possédé pour 75 % par la famille Reinier, pour 23 % par les fonds d’investissement de Peugeot et pour 2 % par les salariés. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et emploie 58 000 salariés.
Onet Technologies est une entreprise de taille intermédiaire qui travaille principalement dans l’ingénierie, les constructions neuves, la maintenance et la logistique nucléaire. Elle forme 25 000 stagiaires par an dans le domaine nucléaire. Elle produit des études sur la réalisation des systèmes complexes, la maintenance et l’exploitation de centrales nucléaires, en tant que prestataire d’EDF, du CEA et d’Areva. Elle réalise un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros et emploie 2 600 collaborateurs. Son ambition est de poursuivre sa croissance dans la filière électronucléaire, où elle recrute 400 personnes par an, ce qui représente 1,8 recrutement par jour travaillé. Ses effectifs connaissent une croissance nette de 6 % par an.
Nous profitons des investissements d’EDF dans la perspective du grand carénage et des mesures post-Fukushima, ce qui nous permet de continuer à embaucher. En 2013, nous avons signé quarante-quatre contrats d’apprentissage et de professionnalisation, et consacré 8 % de notre masse salariale à la formation.
M. le président François Brottes. Il est intéressant qu’un groupe dédié au nettoyage industriel ait pu monter en qualification pour pénétrer dans un secteur aussi délicat que le nucléaire. S’est-il étendu dans d’autres domaines ?
M. Michel Dupiech. Le groupe a commencé dans le secteur de la propreté, qui représente encore la majeure partie de son chiffre d’affaires, lequel atteint 800 millions d’euros. Il possède trois pôles : Propreté et services, Sécurité et Technologies, où il réalise 17 % de son chiffre d’affaires.
Nous sommes présents en amont et en aval du travail d’EDF. Nous réalisons des études et installons des systèmes complexes dans les centrales nucléaires. Nous intervenons dans la perspective du grand carénage et répondons aux appels d’offres consécutifs aux recommandations post-Fukushima. Dans ce domaine où la concurrence est rude, nous avons signé un important contrat en 2013.
Le parc électronucléaire français représente de nombreux emplois industriels. Dans l’ingénierie comme dans la maintenance, on trouve des sociétés anciennes comme de nouveaux entrants. Grâce à notre politique salariale et à notre management, nous n’avons pas de mal à conserver notre personnel. Nous embauchons une cinquantaine d’ingénieurs par an et faisons appel au compagnonnage.
Onet Technologies intervient aux côtés d’EDF pour prolonger la durée de vie du parc électronucléaire, pour pérenniser la compétitivité de la production française d’électricité, dont dépend en partie celle de l’industrie française, et pour maintenir notre niveau actuel d’indépendance énergétique. Notre pays intéresse beaucoup les étrangers. Les Chinois nous sollicitent pour créer des partenariats.
M. le président François Brottes. Quand le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été instauré afin de réduire le coût du travail, vos clients vous ont-ils demandé de baisser vos prix ?
M. Michel Dupiech. Une négociation a eu lieu, qui s’est plutôt bien passée.
M. Jean-Claude Lenain, président-directeur général de Mistras Group SA. Mistras Group SA emploie 380 personnes. Les lecteurs des Échos du 22 janvier savent que ses projets de développement créeront encore des emplois. Nous sommes spécialisés dans l’inspection, le contrôle non destructif et la surveillance permanente des installations par l’instrumentation.
L’instrumentation en permanence des plateformes offshore et des réacteurs de raffinerie permet de vérifier l’évolution des défauts de structure dans certaines conditions d’exploitation ou de l’environnement. C’est ainsi que, sur le réacteur d’une unité pétrochimique, nous avons pu étudier la manière dont évoluait une petite fissure au cours des différentes répliques d’un tremblement de terre.
En dehors du nucléaire, nous intervenons dans le pétrole et le gaz, en contrôlant régulièrement les raffineries et les sites pétrochimiques. Nous travaillons aussi dans l’industrie, notamment aéronautique.
Dans le nucléaire, notre activité se situe à trois niveaux. Nous effectuons le contrôle qualité dans la fabrication, par exemple chez Areva. Nous réalisons des études pour EDF, pour qui nous effectuons des contrôles non destructifs pendant les arrêts de tranche. Enfin, depuis le 1er janvier, dans le cadre du contrat de huit ans que nous avons signé avec EDF, nous sommes devenus prestataires de rang un à travers un groupement d’intérêt économique (GIE), ce qui nous permet de nous développer davantage.
Quand nous effectuons un contrôle lors d’un arrêt de tranche, nous exécutons notre mission en respectant les procédures choisies par l’exploitant, en l’occurrence EDF. Nous menons également une activité de recherche et développement (R&D) visant à développer des techniques nouvelles, en lien avec l’évolution de la réglementation. Actuellement, les principales techniques de contrôle non destructif sont la radiographie et la gammagraphie, mais l’évolution de la réglementation, qui impose de nouvelles contraintes, nous incite à en développer d’autres. Nous recourons aussi à de nouveaux matériaux. Des aides de l’Agence nationale de la recherche, du Fonds unique interministériel (FUI) ou d’OSÉO facilitent notre activité de R&D. Nos programmes nucléaires ont reçu le label du pôle nucléaire de Bourgogne.
Dans ce domaine, Mistras Group SA intervient principalement à travers sa filiale Ascot, située à la fois à Chalon-sur-Saône et au Creusot. Celle-ci est présente lors de la fabrication et intervient dans les centrales lors des arrêts de tranche.
Ascot poursuit un important programme de création d’emplois, mais, faute de trouver du personnel qualifié sur le marché, nous embauchons du personnel sans qualification, essentiellement des jeunes, que nous envoyons dans notre institut de formation de Chalon. J’ai d’ailleurs décidé de développer ce centre et de l’ouvrir à d’autres acteurs du monde nucléaire. Selon le niveau des acteurs, il faut douze à vingt-quatre mois pour les former au contrôle non destructif.
C’est pourquoi il nous est indispensable d’avoir une certaine visibilité sur l’évolution du secteur. À cet égard, nous regrettons qu’une PME n’ait pas accès au même niveau d’information qu’un grand groupe.
Depuis 2013, j’ai lancé un programme de création d’emplois sur trois ans, car il faut recruter, former et innover pour faire évoluer les compétences, en particulier dans le nucléaire, qui représente 20 % de notre activité.
M. le président François Brottes. Vos clients formulent-ils certaines exigences en matière de confidentialité ou de protection contre l’espionnage ?
N’est-il pas gênant que le droit du travail interdise au donneur d’ordre de contrôler l’exécution du travail par les sous-traitants à l’intérieur d’une centrale ?
Enfin, êtes-vous présent sur le marché international du nucléaire, ce qui vous amènerait à travailler avec d’autres sociétés qu’EDF ?
M. Denis Baupin, rapporteur. Le secteur du nucléaire promet d’être très actif, notamment parce qu’il faudra mettre en œuvre les préconisations post-Fukushima. Des chantiers s’annoncent dans presque toutes les centrales. Les entreprises sous-traitantes seront-elles assez nombreuses pour prendre le relais d’EDF ou faudra-t-il faire appel à des entreprises étrangères ?
Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion des ressources humaines, par exemple pour conserver votre personnel ou organiser la transmission des compétences ?
Les salariés des sous-traitants, qui effectuent 80 % des activités dosantes, sont-ils suffisamment protégés par le cadre réglementaire ? Certains ne risquent-ils pas de contourner les contrôles, au mépris de leur santé ?
Mme Frédérique Massat. En tant que sous-traitants, avez-vous la possibilité de bénéficier des formations proposées en interne par EDF dans le domaine nucléaire ?
Dans vos rapports avec l’opérateur, avez-vous constaté une évolution des conditions de la prestation ? Il semblerait en effet, d’après les témoignages de certains techniciens sous-traitants, que la durée des arrêts de tranche ait été raccourcie, induisant des accélérations de cadence : alors que, il y a vingt ans, ils duraient trois mois, ces arrêts ne seraient plus aujourd’hui que de trois semaines en moyenne, si bien que les techniciens se voient parfois contraints de travailler le week-end et d’enchaîner les semaines sans prendre de repos, en dépit de la règle des quarante-huit heures de travail hebdomadaires.
Enfin, si vous avez déploré un manque de visibilité sur les perspectives d’embauche dans votre secteur, pourriez-vous cependant nous indiquer à quel niveau elles se situent, compte tenu du grand carénage à venir ?
M. Michel Sordi. Quelles sont vos attentes en termes de volume d’activité et de création d’emplois, en vue du grand carénage dont on dit qu’il représente un coût de 55 milliards d’euros ?
Les conditions d’intervention de vos salariés chez EDF vous paraissent-elles bonnes ?
Enfin, que vous inspire le projet de fermeture anticipée de la centrale nucléaire de Fessenheim ?
M. Damien Gousy. Le GIP NO n’est pas seul dans son domaine : il existe quatre autres associations régionales, intervenant sur les quatre autres territoires français et disposant exactement des mêmes prérogatives et du même mode de fonctionnement que nous.
Je pourrai aussi vous fournir des réponses sur le volet formation, car je dirige le SIFOP, centre de formation spécialisé dans le domaine nucléaire et filiale de la chambre de commerce et d’industrie Nord de France. Celle-ci est d’ailleurs la seule à avoir investi dans la formation en ce domaine.
M. le président François Brottes. Ce centre rapporte-t-il beaucoup à la chambre de commerce ?
M. Damien Gousy. La chambre de commerce est aujourd’hui actionnaire majoritaire à 60 % de la SAS que je dirige. Les deux autres actionnaires en détiennent chacun 20 % des parts : il s’agit d’entreprises de formation ou intervenant sur les sites nucléaires.
M. le président François Brottes. Encore une fois, combien cela rapporte-t-il ?
M. Damien Gousy. Notre chiffre d’affaires est aujourd’hui d’environ 2 millions d’euros. Notre activité reste localisée dans la région Nord-Pas-de-Calais. De fait, le monde de la formation continue – quel qu’en soit le domaine et a fortiori dans le domaine nucléaire – ne rapporte qu’une marge d’environ 7 à 8 %.
M. le président François Brottes. Chez vous, les entreprises paient donc deux fois : une fois pour leur cotisation et une autre pour la formation…
M. Damien Gousy. On peut en effet le voir ainsi.
Pour répondre à Mme Massat, je dirai qu’il est vrai que les agents d’EDF bénéficient d’un cursus de formation : les nouveaux embauchés arrivant au sein de la division de la production nucléaire (DPN) fréquentent une académie durant plusieurs semaines. Quant aux prestataires d’EDF, ils bénéficient eux aussi d’une formation académique, mais qui, d’une part, n’est pas aussi longue, puisque les métiers de base sont différents, et qui, d’autre part, est beaucoup plus centrée sur la sûreté nucléaire, la sécurité, l’incendie, l’environnement et la radioprotection. Depuis un an et demi, nous avons cependant la volonté de renforcer ce dispositif.
J’anime, pour ma part, un réseau regroupant des entreprises intervenantes et la vingtaine d’organismes de formation qui existent en France – parmi lesquels figure Techman, centre de formation du groupe Onet –, afin de diffuser de nouvelles formations en cours d’évolution. Ces « habilitations nucléaires », ainsi qu’on les nomme communément, visent tout intervenant entrant dans cette industrie. Le renforcement de la réglementation applicable aux formations depuis l’arrêté sur les installations nucléaires de base (INB) de février 2012 a en effet induit un enrichissement du contenu des formations ainsi que la prise en compte des retours d’expérience de terrain de l’exploitant. C’est la première fois, depuis que les formations existent dans les centrales nucléaires, que les besoins des entreprises fournisseurs de services sont véritablement pris en considération : le fait que les entreprises aient été totalement associées au projet, de même que les organismes de formation, constitue une véritable avancée.
Si les formations sont renforcées, c’est qu’elles sont désormais ciblées par activité, alors qu’elles étaient jusqu’ici centrées sur nos différents domaines d’intervention : la sécurité, la radioprotection et la sûreté. Des formations spécifiques sont désormais imposées aux entreprises préalablement à leur intervention chez EDF, dans le cadre du processus de qualification évoqué la semaine dernière par M. Dutheil.
La participation des salariés des entreprises prestataires aux formations dont bénéficient les agents d’EDF pose, quant à elle, un problème juridique : on ne peut en effet mélanger des prestataires et des salariés EDF dans le cadre d’une formation unique sans se trouver à la limite du prêt de main-d’œuvre. En revanche, le cursus que nous sommes en train de concevoir avec la DPN, que nous offrirons à partir de septembre prochain, sera de facto proposé aux agents d’EDF. Ce sont donc ces derniers qui bénéficieront des fruits du groupe de travail que nous animons depuis deux ans et l’académie EDF s’en trouvera ainsi renforcée.
M. le président François Brottes. J’ose espérer que ce dispositif est bordé juridiquement…
M. Damien Gousy. Il l’est.
M. le président François Brottes. Créez-vous des groupements d’achat pour que les petites entreprises du secteur puissent être référencées chez le grand client ?
M. Damien Gousy. Ce n’est pas l’objet de notre association, qui œuvre dans deux domaines : l’emploi et les compétences, la valorisation des métiers et la formation, d’une part, et la radioprotection et la sécurité, d’autre part. Les associations n’ont d’ailleurs aucun but commercial.
M. Alain Bertaux. C’est essentiellement par l’intermédiaire de la commission nucléaire du SNCT, qui se réunit tous les trimestres depuis sa création en 2011, que nous avons été informés des projets de grand carénage. En collaboration avec le groupe de travail créé en 2012 pour résoudre les problèmes de ressources d’EDF, nous avons estimé que, par comparaison avec la charge nécessaire dans un contexte de maintenance normale des sites, le volume de travaux nécessaires dans les métiers de tuyauteurs-soudeurs et de chaudronniers allait être multiplié par 1,7 pour la décennie à venir. Le groupe de travail en a conclu que, dans ces métiers, l’industrie française avait des ressources suffisantes pour y faire face en favorisant les passerelles entre les industries et en proposant des formations au fil des ans. Lorsque l’on planifie cette hausse d’activité dans la durée, en fonction de la géographie des sites concernés et selon notre connaissance actuelle des arrêts de tranche, le chiffre tend plutôt vers 1,5 que vers 1,7.
Cependant, nous ne serons en mesure de nous adapter que sous réserve de disposer d’une certaine visibilité. Car la formation aux métiers de tuyauteur-soudeur et de chaudronnier ne se prépare pas en un stage de trois à douze mois, mais peut durer jusqu’à dix ans. C’est d’ailleurs tant en termes de planification de travaux qu’en termes techniques que nous avons besoin d’y voir plus clair : il nous faut connaître le niveau de compétences requis et sur quel site nucléaire, mais aussi savoir quel sera le volume d’activité, si celle-ci s’appuiera sur un modèle d’organisation en 2×8 ou en 3×8, et enfin, comment seront gérées les périodes creuses. Telles sont en tout cas les conclusions du rapport que nous avons établi sur la courbe de charge à venir.
M. le président François Brottes. Pourrez-vous nous le transmettre ?
M. Alain Bertaux. Je m’en enquerrai auprès du SNCT.
Quant à l’évolution dans le temps des durées d’arrêt, le « temps métal » – celui réellement passé à accomplir le geste professionnel – est très faible par rapport à notre durée d’intervention, et la relation entre durée d’arrêt et durée d’intervention sur le site n’est pas nécessairement linéaire. Cela dit, les sous-traitants que nous sommes exercent des métiers où le geste technique est important, et nous n’agissons le plus souvent qu’en fin d’intervention, si bien que nous subissons des décalages dans nos horaires et emplois du temps, ainsi que des astreintes. S’ils restent dans les limites légales, ils exigent tout de même des entreprises et de nos compagnons présents sur le terrain qu’ils s’organisent de façon très réactive.
Enfin, je compléterai le propos de M. Gousy sur la formation : si nous avons essentiellement évoqué jusqu’ici les formations d’habilitation et de qualification, notre groupe a racheté une petite entreprise offrant une formation aux métiers. Car, s’il importe qu’une entreprise connaisse les règles d’intervention nucléaire, la formation aux métiers reste primordiale. Elle nous permettra d’ailleurs d’éviter de recourir à de la main-d’œuvre étrangère pour faire face à nos besoins.
M. le président François Brottes. Les conseillers d’orientation de l’éducation nationale remplissent-ils correctement leur mission en orientant les élèves vers vos métiers ? Avez-vous l’occasion de rencontrer des jeunes attirés par vos filières ?
M. Alain Bertaux. Nous n’en croisions plus jusqu’à ce que les choses changent, il y a cinq ou six ans. Nous commençons d’ailleurs aussi à rencontrer des personnes attirées par notre industrie, parce qu’ils savent qu’elle est susceptible d’embaucher dans la décennie à venir. Il conviendrait cependant de valoriser davantage ces métiers, car c’est toujours de façon péjorative que l’on parle des sous-traitants du secteur comme de « nomades du nucléaire », alors que l’on trouve dans toutes nos entreprises des compagnons dévoués et compétents.
M. Damien Gousy. C’est précisément le rôle des associations prestataires que d’aviser les conseillers d’information et d’orientation et de rendre nos métiers les plus attractifs possible – raison pour laquelle nous organisons des rencontres avec les personnels de l’éducation nationale, ainsi que des journées d’investigation et de visites de centrales.
M. Pierre Dambielle. Lorsque nous sommes confrontés à un problème de confidentialité, nos ingénieurs vont travailler dans les locaux d’EDF. Toutefois, cela ne représente qu’une faible part de nos activités d’ingénierie et d’études de réalisation.
En ce qui concerne les injonctions prononcées par l’ASN, nous sommes dotés au sein de nos entreprises de notre propre inspection du travail, qui peut s’entendre avec l’ASN pour réaliser des audits de terrain. En cas de signalement, l’inspecteur du travail ne fait aucune différence, dans ses rapports, entre EDF et les entreprises exécutantes. Nous recevons alors un courrier nous enjoignant de prendre les mesures consécutives aux constats réalisés.
En ce qui concerne la courbe de charge pour 2015, nous sommes confrontés à un grand manque de visibilité. On nous a parlé des pics d’activité qu’impliquera le grand carénage, mais nous avons beaucoup de mal à appréhender la prestation qui pourra nous être confiée et la manière dont le volume global d’activité sera réparti entre les différentes entreprises. Compte tenu de ces difficultés, nous avons tous embauché en 2013, suivant en cela la démarche d’EDF. Cela étant, les contrats, qui restent en cours de négociation, tardent à se concrétiser. Or une entreprise ne peut continuer à embaucher sans savoir comment s’organiser tant sur le plan économique qu’en termes de métiers et de régions concernées. Les formations constituant un investissement lourd, les entreprises ont besoin de s’assurer de la pérennité des besoins.
S’agissant de l’éventuel recours à des entreprises étrangères, EDF a souvent exprimé des doutes quant à la capacité industrielle des entreprises françaises à réaliser les travaux nécessaires dans un contexte de pics de charge importants. Le président du groupe ORTEC, André Einaudi, a donc pris le fanion en créant un club de France des entreprises nucléaires, équipe informelle réunissant tous les corps d’État, afin de faire preuve de volontarisme et de démontrer à notre client EDF la capacité des entreprises françaises à embaucher et à développer l’emploi national. Encore faut-il – une nouvelle fois – que nous disposions d’une réelle visibilité.
Parce qu’EDF nous l’a demandé, notre groupe comprend des entreprises étrangères. Or, si les ouvriers étrangers sont aussi compétents que les Français, nous entrons vite en conflit avec eux en raison de problèmes linguistiques et culturels – tenant certes à des différences de culture nationale, mais aussi de culture de la sûreté.
En matière de formation, le groupe ORTEC, comme toutes les entreprises présentes à cette table ronde, a créé sa propre école réservée à ses métiers spécifiques, qu’il ne retrouvait pas dans les centres de formation classiques. Notre but n’est bien sûr pas de faire de la formation notre métier principal. EDF met à notre disposition ses académies des métiers ainsi que ses centres de formation de Tricastin et de Bugey, afin que nos propres salariés puissent manipuler les différents équipements.
Certes, les arrêts de tranche sont plus courts et nos salariés doivent parfois travailler le week-end et faire des heures supplémentaires. Mais la situation a bien changé depuis trente ans ; nous veillons scrupuleusement à respecter les règles de temps de travail et à ne pas faire travailler nos salariés plus de six jours consécutifs. Il est vrai que certains d’entre eux doivent travailler le week-end, mais cela fait partie de notre prestation de services. S’ajoute à cela un important effet de saisonnalité : le nombre d’heures à fournir n’est pas le même en hiver et en été, et nous devons pratiquer des modulations.
Quant à nos perspectives d’embauche, elles sont liées au besoin de visibilité dont j’ai déjà parlé. En 2013, notre groupe a choisi d’embaucher 100 personnes, afin notamment d’assumer le renouvellement consécutif aux départs à la retraite. Nous avons également diminué la part d’intérimaires que nous employions pour parvenir à un solde d’embauche quasi nul. Nous tablons sur des prévisions d’embauche de 100 salariés par an.
L’industrie nucléaire est plutôt un secteur où l’on s’intéresse à l’homme et où l’on veille aux conditions de travail opérationnelles des différents acteurs. En ce qui concerne les « nomades du nucléaire », il existe aujourd’hui des organisations de suivi de la dosimétrie. Et s’il est vrai que 80 % de la dosimétrie concerne les salariés des entreprises sous-traitantes, les débits de dose reçus restent cependant extrêmement faibles : 90 % de mes employés sont exposés à moins d’un millisievert par an et seuls cinq à six cas isolés par an se voient exposés à sept ou huit millisieverts.
Quant à la fermeture de Fessenheim, elle conduirait évidemment mon groupe à perdre des contrats, puisque nous y sommes installés. Il m’est en revanche difficile d’extrapoler sur les conséquences globales de cette décision.
M. le président François Brottes. La sous-traitance semble donc mieux considérée que par le passé et les conditions de travail sont sans doute moins rigoureuses qu’auparavant.
M. Pierre Dambielle. Une charte sociale a d’ailleurs été conclue avec EDF, notamment pour veiller au sort des « grands déplacés », c’est-à-dire de ceux de nos salariés qui sont envoyés en grand déplacement sur différents sites, en fonction des arrêts de tranche.
M. Alain Bertaux. Nous passons désormais souvent, pour recruter, par l’intermédiaire des sociétés d’intérim. Pendant six mois, les personnels reçoivent des formations d’habilitation, puis nous assurons leur formation technique avant de les placer sur nos chantiers en comptant les embaucher en contrat à durée indéterminée au bout d’un semestre. Or, sur les dix intérimaires que nous avons voulu recruter au cours de la dernière période, huit ont préféré rester en intérim : l’intervention des intérimaires est en effet limitée à certaines zones peu dosantes, mais ils peuvent tout de même bénéficier de certains des avantages dont profitent les salariés en CDI qui, eux, interviennent en zone dosante. Je rejoins néanmoins M. Dambielle lorsqu’il dit que les doses en question restent très faibles par rapport aux seuils en vigueur – qu’ils soient nationaux, édictés par EDF, ou internes à nos entreprises.
M. Michel Dupiech. Onet Technologies dispose de 110 formateurs, dont 50 permanents, de vingt-cinq salles de formation réparties sur huit sites en France, de huit chantiers-écoles en prévention des risques, de sept chantiers-écoles en qualité sûreté des prestataires, de deux chantiers-écoles amiante et d’un atelier de formation en robinetterie, auxquels sont associées plusieurs certifications. Le volet formation est donc très important pour nous : nous formons 25 000 stagiaires par an.
Sur le marché nucléaire français, nous intervenons en ingénierie, de l’amont vers l’aval, dans l’intégration de systèmes complexes. L’ingénierie française étant très performante et notre savoir-faire très recherché, nous cultivons cette force. De nombreux étrangers viennent donc nous trouver dans l’intention d’établir des partenariats. Nous en avons, quant à nous, conclu avec de grandes écoles d’ingénieurs, dont nous prenons en stage certains étudiants, et nous continuerons à entretenir ce type de relations afin d’améliorer nos compétences dans le cadre du grand carénage et de l’après Fukushima.
Pour développer l’activité dans nos métiers, il importera que nous soyons ouverts à l’international tout en préservant nos emplois en France. Nous pourrions ainsi nous appuyer sur un système de front office en faisant travailler chez nous un maximum d’ingénieurs et en faisant appliquer l’installation des systèmes dans les pays concernés. Ainsi la propriété intellectuelle resterait-elle chez nous.
En ce qui concerne la cadence des arrêts de tranche, nous gérons nos interventions dans la maintenance nucléaire en intégrant des contraintes sous forme de plannings sur le chemin critique d’arrêt. Et, bien que nous soyons en activité en 3×8, sept jours sur sept, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui interviennent, car nous disposons d’un volet de sous-traitance tel que nous parvenons à absorber la charge. Le personnel ne subit donc aucune contrainte physique. Nous gérons également toutes les co-activités effectuées dans des environnements restreints, y compris les environnements irradiants, subaquatiques et confinés : Onet Technologies emploie notamment seize plongeurs qualifiés intervenant dans des piscines de stockage du combustible. Cette activité est parfaitement contrôlée et, à ce jour, il n’y a jamais eu d’accident.
S’agissant enfin de nos perspectives de recrutement, nous embauchons 1,8 personne par jour et comptons maintenir ce rythme dans la mesure où nous prévoyons une croissance organique de 6 à 8 % dans les prochaines années, dans le cadre du grand carénage post-Fukushima.
M. Jean-Claude Lenain. J’ai indiqué tout à l’heure que nous œuvrions, dans le domaine de la recherche-développement, à l’élaboration de nouvelles techniques de contrôle non destructif, qui nous permettent d’effectuer des contrôles en marche et donc de réduire le nombre de contrôles effectués pendant les arrêts de tranche. Nous développons également des techniques à distance permettant de réduire l’exposition du personnel à l’irradiation.
S’agissant des ressources humaines, le rapporteur nous a demandé tout à l’heure si nous serions en mesure de répondre à la demande, compte tenu du plan de charge à venir, ou s’il nous faudrait faire appel à des acteurs étrangers. Or, ces derniers frappant à notre porte, il est évident qu’ils entreront si nous ne sommes pas en mesure de disposer des ressources nécessaires pour répondre à la demande d’EDF. Il est donc essentiel que nous disposions d’une certaine visibilité : plus tôt nous connaîtrons ce plan de charge et la part de marché qui nous sera attribuée, mieux ce sera, d’autant que, si certains contrôles nous sont demandés directement par EDF, d’autres le sont par les chaudronniers. Il nous faudra donc attendre qu’EDF passe des contrats avec ses sous-traitants pour que nous passions les nôtres avec ces derniers.
Ainsi que je l’ai déjà souligné, nous sommes effectivement confrontés à des problèmes de recrutement. Aujourd’hui, ce sont plutôt des jeunes que nous embauchons. Comme nous devons ensuite les former, il faut compter douze à vingt-quatre mois pour qu’ils soient opérationnels. Afin de les attirer vers nos métiers, nous avons demandé à chaque adhérent du pôle nucléaire de Bourgogne, dont je suis le vice-président et où je représente les ETI, d’intervenir dans les écoles de tous niveaux – secondaire, BTS, DUT ou écoles d’ingénieurs – pour y présenter les différents métiers du nucléaire, notamment les métiers de contrôle.
M. Alain Bertaux. Je souhaiterais compléter mon propos en soulignant que, dans certaines régions, le déficit de médecins du travail compétents pour assurer le suivi médical renforcé applicable en matière de dosimétrie risque de bloquer certaines de nos interventions.
M. Damien Gousy. En effet, malgré la réforme, tous les services de médecine du travail ne sont pas encore spécifiquement habilités dans le domaine nucléaire pour faire passer les visites médicales renforcées que doivent régulièrement effectuer nos salariés avant toute intervention. Les entreprises ont donc des difficultés à faire passer en temps et en heure ces visites – qui sont forcément chronophages mais néanmoins indispensables à la délivrance d’habilitations nucléaires.
M. le président François Brottes. J’interrogerai le Gouvernement sur ce point.
M. Damien Gousy. Je souhaiterais in fine vous fournir deux exemples illustrant le travail fourni par les associations en matière de reclassement. À la suite de la fermeture de la raffinerie des Flandres Total à Dunkerque ainsi que de celle de Petroplus, nombre de salariés ont pu être reclassés dans le secteur nucléaire, notamment du fait de la proximité des centrales. En effet, pour intense qu’elle soit, avec ses huit usines Seveso II et la centrale de Gravelines, la vie industrielle de la région de Dunkerque connaît des hauts et des bas. Or, depuis une quinzaine d’années, lorsque l’activité est au plus bas, c’est systématiquement vers le nucléaire que l’on s’oriente pour reclasser les salariés.
M. le président François Brottes. Je vous remercie beaucoup pour cet échange.
Audition de M. Philippe Jamet, commissaire de l’ASN,
et de M. Jacques Repussard, directeur général de l'IRSN
(Séance du jeudi 27 février 2014)
M. le président François Brottes. Nous ouvrons aujourd’hui une séquence d’auditions consacrées au déploiement des réacteurs de troisième génération, et donc à l’EPR.
Lorsque l’on évoque la troisième ou la quatrième génération de réacteurs, on évoque davantage de sécurité, moins de combustibles et moins de déchets. Notre trajectoire est-elle fiable en la matière, sachant que l’on dit souvent que la troisième génération est assez peu différente de la génération précédente ?
J’insiste sur le fait que les questions de sûreté sont au cœur de nos préoccupations. L’EPR a été conçu pour être plus sûr que les réacteurs actuels. Cependant, la validation du processus de construction des deux centrales européennes n’a pas été acquise facilement et semble évolutive. Les années passant et la construction avançant, les autorités de sûreté posent des exigences nouvelles qui obligent à repenser les procédés.
Par ailleurs, les chantiers ont connu des vicissitudes de natures diverses, allant du non-respect du droit du travail à des défauts de construction en passant par des problèmes de sous-traitance, autant d’éléments qui peuvent nous conduire à douter de la sûreté de l’EPR, à l’approche de sa mise en service.
Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d’accueillir M. Philippe Jamet, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire, et M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande, messieurs, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Philippe Jamet et Jacques Repussard prêtent serment)
M. Philippe Jamet, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire. Le projet EPR date de 1990 ; initié dans le cadre d’une étroite collaboration franco-allemande, il est, du fait des circonstances politiques, devenu un projet strictement français.
Dès 1993, un certain nombre d’objectifs de sûreté ont été définis. Le premier d’entre eux consiste à réduire significativement le nombre des incidents par rapport au parc actuel, grâce, d’une part, à la fiabilisation des équipements et, d’autre part, à la prise en compte, dès la conception du projet, du facteur humain. Un deuxième objectif est de réduire très significativement, de l’ordre d’un facteur 10, la probabilité de fusion du cœur. Et l’EPR s’est également vu assigner des objectifs en termes de conséquences des accidents.
Pour les accidents sans fusion du cœur, le réacteur doit être conçu de telle manière qu’il n’y ait aucune mesure de protection des populations ou de l’environnement à prendre. Dans le cas d’un accident avec fusion du cœur, doivent être évités les phénomènes explosifs pouvant donner lieu à des rejets trop rapides ou trop importants pour permettre la protection de la population. Enfin, dans le cas d’une fusion du cœur lente – envisageable – les contraintes sont telles que les mesures de protection de la population qui devraient être prises seraient extrêmement limitées : pas d’évacuation au-delà de quelques kilomètres ; pas de relogement permanent et des restrictions alimentaires limitées dans le temps. Pour mémoire, à Fukushima 200 000 personnes ont été évacuées et 2 000 kilomètres carrés ont été déclarés zone interdite.
M. le président François Brottes. Voulez-vous dire que, s’il y avait eu un EPR à Fukushima, la catastrophe n’aurait pas eu lieu ?
M. Philippe Jamet. Ce n’est pas aussi simple que cela, et l’ASN va exiger des améliorations de l’EPR pour qu’il se comporte correctement en cas de cataclysme. Cela étant, on peut, en première approximation, estimer que vous avez raison.
Ces objectifs de 1993 ont été repris au niveau européen par l’Association des autorités de sûreté des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et complétés par des objectifs supplémentaires en termes de résistance à la malveillance, de gestion des déchets, de radioprotection et de management de la sûreté. Compte tenu de ces objectifs, il est clair pour l’ASN que le réacteur EPR marque, du point de vue de la sûreté, un progrès considérable par rapport au parc existant. Concrètement, dans le cadre d’un exercice de crise, un accident serait plus facile à gérer avec l’EPR qu’avec un réacteur où l’on ne pourrait empêcher la fusion du cœur, avec traversée de la cuve et risques de fuite à l’extérieur, comme à Fukushima.
La construction du réacteur nucléaire de Flamanville, engagée en 2007, est évidemment suivie par l’ASN, qui effectue sur le site une vingtaine d’inspections par an. Ces inspections ont permis de constater des problèmes mineurs et d’autres plus importants qui ont conduit l’ASN à arrêter le chantier et à soumettre sa reprise à autorisation. Je citerai, à titre d’exemple, des problèmes de soudage du liner, le revêtement interne de l’enceinte de confinement, en 2008, 2009 et 2010, ou des problèmes de génie civil : positionnement des câbles de précontrainte, nids de cailloux dans certaines parois, problèmes de fabrication du couvercle de cuve – lequel comporte davantage de conduits que les couvercles actuels – ou encore montage à l’envers de certaines vannes. Dans ce dernier cas, l’ASN a exigé qu’AREVA donne des explications sur les causes de cette erreur et fasse le nécessaire pour empêcher qu’elle se reproduise ; elle n’a autorisé la reprise du chantier qu’à partir du moment où elle a considéré qu’elle avait obtenu des garanties suffisantes.
Framatome, qui a construit les premiers réacteurs français, avait certes rencontré des problèmes identiques, mais EDF, pour expliquer ces incidents, met en avant la perte de compétences d’une industrie qui n’a pas construit de réacteurs depuis longtemps, les aléas liés à une première réalisation, la complexité de celle-ci et les d’études d’ingénierie exigées qui ont fait dériver le planning. S’il est facile en effet de parler de plans, de calculs et de procédures, la qualité d’une réalisation dépend en grande partie du savoir-faire dont elle a bénéficié. Or c’est une notion plus difficile à formaliser, à transmettre, et il faut sans cesse la réévaluer lorsque les objets changent. Quoi qu’il en soit, si l’ASN a bien constaté d’importants problèmes, qui ont été corrigés au prix d’un allongement des délais, elle n’a aujourd’hui aucun doute sur la qualité de la réalisation de l’EPR– et c’est là l’essentiel.
Pour l’ASN, un réacteur sûr, ce n’est pas uniquement un réacteur bien construit ; c’est un réacteur dont la sûreté est démontrable et pérenne. Cela exige certaines procédures d’examen, dont EDF devra fournir les justificatifs lors de la soumission du dossier de mise en service, fin 2014. La démonstration de sûreté a été examinée une première fois lors de l’étude du dossier d’autorisation de création, mais les documents administratifs qui seront fournis fin 2014 devront comporter d’importantes précisions techniques dans les domaines suivants : les études d’accident, qui démontrent qu’en cas d’accident dans le réacteur le système et les procédures de conduite garantissent la sûreté ; le programme des essais de démarrage, qui servent à vérifier, avant la mise en marche d’une installation nucléaire, que les performances attendues sont atteintes ; le plan d’urgence interne, qui détaille ce que l’exploitant doit faire en cas d’accident, et les règles générales d’exploitation.
Compte tenu du volume de travail à fournir, l’ASN a engagé dès 2011, avec l’appui de l’IRSN, l’examen anticipé de ces documents. Néanmoins, la poursuite des études et les aléas du chantier ont conduit à des évolutions et à des modifications qu’il faudra prendre en compte pour l’autorisation de mise en service définitive. Ce sont des circonstances assez classiques pour un prototype, mais l’ampleur de la tâche est telle que, dans la perspective d’une autorisation de mise en service prévue pour 2016, le planning est plus que tendu.
Le projet EPR français est couplé aux autres projets étrangers. L’ASN a des relations bilatérales avec toutes les autorités de sûreté des pays qui construisent ou envisagent de construire des EPR – non seulement la Finlande, évidemment, avec qui nous avons d’étroites relations, mais aussi le Royaume-Uni, la Chine, avec laquelle la collaboration n’est malheureusement pas aussi développée que nous le souhaiterions, et les Etats-Unis avec la NRC. Par ailleurs, plusieurs groupes de travail multilatéraux ont été mis en place.
À côté de l’EPR finlandais, extrêmement similaire au nôtre malgré quelques différences, il existe actuellement dans le monde trois types de réacteur à eau pressurisée dits de troisième génération : le réacteur russe AES-2006, d’une puissance de 1 200 MW ; le réacteur américano-japonais AP-1000 de la compagnie Westinghouse, en construction aux États-Unis et en Chine ; le réacteur coréen APR-1400, d’une puissance de 1 400 MW, en construction en Corée et dans les Émirats arabes. Il existe entre eux des différences significatives et, si nous avions à nous prononcer, je ne suis pas sûr que nous jugerions leur conception aussi robuste que celle de l’EPR. Il n’est pas certain que nous accepterions la démonstration selon laquelle, en cas de fusion, le cœur de l’AP-1000 reste dans la cuve et n’entre pas au contact du béton de l’enceinte. Nous ne l’accepterions probablement pas non plus pour l’APR-1400. Ces démonstrations ont un fort caractère probabiliste, peu conforme à notre conception de ce que doit être une démonstration de sûreté.
M. le président François Brottes. Le réacteur russe ne vous pose pas de problème ?
M. Philippe Jamet. C’est le réacteur dont la conception et le niveau d’exigence requis sont les plus proches de ceux de l’EPR.
Il faut également mentionner l’ATMEA, réacteur de 1 000 MW, très similaire à l’EPR en termes de conception, et dont la Jordanie, la Turquie ou le Vietnam ont envisagé la construction, mais qui, pour l’instant, n’a fait à ma connaissance l’objet d’aucun achat ferme. Nous collaborons cependant avec l’autorité de sûreté turque pour le cas où il serait choisi par la Turquie.
Je terminerai par trois remarques sur la quatrième génération. Premièrement, il est clair pour l’ASN que les réacteurs de quatrième génération doivent impérativement se caractériser par un progrès en termes de sûreté par rapport à la troisième génération. S’agissant d’une filière dont la durée de vie est d’un siècle ou d’un siècle et demi, il n’est pas imaginable que la technologie et le niveau de sûreté soient figés. Ensuite, compte tenu de cet impératif, le choix d’une technologie de quatrième génération doit être le résultat d’une analyse ouverte, qui compare non seulement les différentes technologies disponibles, mais également leurs implications en termes de sûreté : des réacteurs de 300, 1 000 ou 1 500 MW ne sont pas équivalents en termes de risques et de sûreté.
M. le président François Brottes. En clair, vous êtes en train de dire que ceux qui retiennent la quatrième génération pour seule option ne sont pas assez ouverts !
M. Philippe Jamet. Oui ! L’ASN a en tout cas demandé au groupe permanent d’experts d’examiner les avantages et les inconvénients des différentes options possibles. Et cela m’amène à ma troisième remarque, qui concerne le projet ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration). Pour les raisons que je viens d’indiquer, l’ASN considère que ce projet, dont le niveau de sûreté n’excède pas celui des réacteurs de troisième génération, ne peut constituer un prototype.
M. le président François Brottes. Mais ne réalise-t-il pas des avancées par rapport à la troisième génération en matière de combustible ou de déchets ?
M. Philippe Jamet. Vous avez raison, mais la condition pour qu’un prototype de quatrième génération puisse être construit, c’est qu’il permette d’expérimenter des solutions qui garantiront un niveau de sûreté significativement augmenté par rapport aux réacteurs de troisième génération.
M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Si l’EPR est porteur d’avancées notables en termes de sûreté, il ne réalise pas de progrès en matière de gestion des déchets liés au combustible. Un réacteur à eau légère fonctionne en effet selon les même principes physiques que les autres réacteurs.
M. le président François Brottes. Le volume de déchets est-il équivalent ?
M. Jacques Repussard. Il est plus important puisque le réacteur est plus puissant. En revanche, ce qui constitue un progrès, c’est que le démantèlement a été conçu ex ante, ce qui devrait permettre de limiter la volumétrie des déchets de déconstruction. C’est néanmoins un point secondaire par rapport à la question des déchets nucléaires à vie longue.
Pour l’IRSN, l’EPR n’est pas la fin de l’histoire des réacteurs à eau légère ; en d’autres termes, des améliorations sont encore possibles. Il correspond à un choix de filière et marque une étape et des progrès importants mais, si la France décidait de se doter d’un nouveau parc de réacteurs à eau légère, ce serait une erreur de se contenter de dupliquer l’EPR de Flamanville, dont la conception, je le rappelle, remonte à plus de vingt ans. Les coûts de construction de l’EPR peuvent être abaissés, les systèmes optimisés, et la question de la puissance doit être réexaminée.
M. le président François Brottes. Suggérez-vous qu’il faut opter partout pour des réacteurs de type ATMEA ?
M. Jacques Repussard. Non, mais je considère qu’il y a là des choix de politique énergétique et de filière industrielle à faire. Il existe maintenant des objectifs de sûreté harmonisés par WENRA et, juste avant la catastrophe de Fukushima, la Direction générale de l’énergie et du climat avait saisi l’IRSN pour que nous proposions un projet de document-cadre concernant non pas seulement l’EPR stricto sensu, mais les règles de sûreté applicables en France à l’ensemble des réacteurs de troisième génération, ce qui, à l’époque, incluait les réacteurs de type ATMEA.
Ce document, que nous tenons à votre disposition, contient les recommandations de l’IRSN pour décliner les objectifs fixés par WENRA. Il a été transmis à l’ASN et, avec l’accord de celle-ci, il sera communiqué à l’industrie nucléaire pour débat. Il doit aider à mieux définir ce que l’on entend par réacteur de troisième génération et suggère des avancées qui constituent moins une révolution que des pistes d’optimisation. Ce document ouvre la voie à l’examen de différentes options de puissance et en particulier à la possibilité de « maintien en cuve » pour des réacteurs de moindre puissance. Il se penche également sur les conditions d’utilisation des systèmes passifs. L’AP-1000 conçu par Westinghouse comporte de nombreux systèmes passifs de sûreté et, si nous avons de sérieux doutes sur la fiabilité de sa démonstration de sûreté, nous n’en condamnons pas pour autant l’utilisation des systèmes passifs qui pourraient se révéler utiles dans l’avenir.
M. Denis Baupin, rapporteur. Pourriez-vous préciser à quoi vous faisiez référence en parlant de « maintien en cuve » d’un réacteur ?
M. Jacques Repussard. L’EPR a été conçu selon l’hypothèse, raisonnable, qu’en cas de fusion du cœur, la cuve sera traversée par le combustible fondu. Il est donc équipé d’un récupérateur de corium pour éviter la mise en pression de l’enceinte et la traversée du radier. Mais il existe d’autres solutions, et certains ingénieurs nucléaires travaillent à l’étranger sur le concept du maintien en cuve du combustible fondu, ce qui empêcherait des conséquences graves en cas d’accident sérieux puisque le combustible se refroidirait dans la cuve. Reste à démontrer cette théorie, avec des arguments plus solides que des arguments probabilistes. Cela nécessite, selon nous, une expérimentation grandeur nature, réalisée grâce à des simulateurs.
Nous avons toute confiance dans la démonstration de sûreté de l’EPR en cas de fusion du cœur, mais cela ne signifie pas que la sécurité ne peut pas être renforcée. Ce serait une tromperie d’affirmer que ce réacteur, conçu avant Fukushima, nous garantit de tout accident grave. En effet, si l’EPR a grandement diminué la probabilité d’accidents dus à des causes internes, les accidents liés à des événements externes de très grande ampleur – guerre ou bouleversement géologique important – ne peuvent être totalement exclus. Le bâtiment a été conçu pour résister aux chutes d’avion, mais se pose la question de la vulnérabilité des piscines de combustible usé. D’où la nécessité de poursuivre notre réflexion sur le « noyau dur » de sûreté que nous avons élaboré après l’accident de Fukushima et qui va s’appliquer à Flamanville.
Si la France veut optimiser économiquement et industriellement son équipement électronucléaire de troisième génération dans les meilleures conditions de sûreté, elle doit donc poursuivre sa réflexion sur le choix de gamme de puissance de ses réacteurs et sur l’usage éventuel de systèmes de sécurité passifs.
Pour ce qui concerne la quatrième génération, l’enjeu est triple : améliorer la sûreté ; économiser l’uranium naturel et obtenir, avec le plutonium, une énergie quasiment renouvelable ; résoudre la question des déchets. Atteindre ces objectifs exige cependant de lever d’importantes difficultés. La première touche aux réacteurs eux-mêmes. Il reste des verrous technologiques à faire sauter en matière de sûreté pour atteindre, voire dépasser, les objectifs de WENRA, que ce soit pour les réacteurs à sodium ou pour les autres. Sur les six filières de quatrième génération identifiées par la communauté internationale, certaines n’ont pas encore dépassé le stade du bureau d’études. L’IRSN a produit, il y a deux ans, un rapport que nous vous remettrons et qui compare les avantages et les inconvénients des différents concepts en termes de sûreté. Il en ressort que certains de ces concepts posent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses.
Un changement de filière implique par ailleurs un autre cycle du combustible. Il ne suffit pas de construire des réacteurs, il faut fabriquer de nouveaux combustibles, qui apportent des bénéfices en termes de sûreté, mais au prix de profonds bouleversements industriels, en amont comme en aval.
Le passage à la quatrième génération suppose enfin des infrastructures de recherche dont nous ne disposons plus. Ces vingt dernières années, de nombreuses installations expérimentales du CEA ont été fermées, la filière des réacteurs à eau légère étant considérée comme mature. Pour des raisons de contrainte budgétaire, on a estimé que la modélisation et des essais menés à échelle réduite pourraient suffire. C’est ainsi qu’a été arrêté le réacteur expérimental Phébus, qui avait permis d’étudier les accidents provoqués par la fusion du cœur et de calculer les termes sources, fournissant des résultats qui ont été utilisés au moment de la catastrophe de Fukushima. Un autre réacteur, Cabri, qui sert à tester la capacité de résistance des combustibles nucléaires des réacteurs actuels à des pics de réactivité, notamment en fonction de la corrosion des gaines, est financé quasiment intégralement par l’IRSN, et nous avons les plus grands doutes sur son avenir. La quatrième génération implique donc de reconstituer toute une infrastructure de recherche.
En matière de déchets enfin, les réacteurs à neutrons rapides à l’étude en France n’apportent pas de progrès majeurs en matière de produits de fission dérivés de l’utilisation du combustible. Une filière de régénération et de retraitement des combustibles, qui reste à inventer et à financer, permettra de récupérer le plutonium, mais resteront les produits de fission dont la volumétrie ne sera pas très différente de celle obtenue avec les réacteurs à eau légère.
Si notre pays souhaite réellement développer, au-delà du prototype, les réacteurs de quatrième génération, cela mérite une étude d’impact qui intègre, au-delà des questions de sûreté, les aspects financiers et l’ensemble des enjeux qui dépassent le seul savoir-faire technologique. Cela ne m’apparaît envisageable ni à court ni à moyen terme ; tout au moins cela pourrait-il l’être à l’horizon d’un demi-siècle. D’ici là, se pose donc la question de l’approvisionnement énergétique de la France.
M. le président François Brottes. Monsieur Jamet, partagez-vous les analyses de M. Repussard ?
M. Philippe Jamet. Je suis entièrement d’accord avec ce qu’a dit Jacques Repussard sur les apports de la quatrième génération en matière de gestion du combustible et des déchets.
M. le rapporteur. Mes questions porteront essentiellement sur les réacteurs de troisième génération.
Vous avez évoqué une division par dix de la probabilité d’accidents. Pourriez-vous nous indiquer à quoi cela correspond en valeur absolue ?
Dans le cas de Flamanville, le coût a été triplé et le délai doublé par rapport au projet vendu originellement aux pouvoirs publics : était-ce totalement imprévisible ou les difficultés ont-elles été délibérément sous-estimées pour forcer la décision politique ?
Vous avez été, l’un comme l’autre, très catégoriques sur la qualité des performances du réacteur en matière de sûreté. Pourriez-vous nous donner des précisions sur les fissures apparues sur le radier lors de la construction ? Ont-elles été définitivement réparées ou y a-t-il là une faiblesse latente du réacteur ?
Vous avez évoqué la nécessité de renforcer la sécurité de l’EPR contre les risques de cataclysme et sa mise aux normes, à la suite des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) post-Fukushima. L’EPR est-il aujourd’hui aux normes ou doit-on redouter de nouveaux délais et de nouveaux coûts ? Une polémique s’est par ailleurs développée sur la résistance de l’EPR à un crash d’avion : pouvez-vous nous confirmer que le bâtiment a bien été conçu pour résister à un tel crash et pouvez-vous nous préciser ce qu’il en est des piscines, dont M. Repussard avait l’air de sous-entendre que leur sécurité pouvait être améliorée ?
Vous avez parlé d’un planning plus que tendu. Pouvez-vous nous en détailler les étapes et nous dire quelles seraient les conséquences d’un dépassement des délais ? Que se passera-t-il si le premier chargement en combustible nucléaire ne pouvait avoir lieu comme prévu le 11 avril 2017 ?
Le coût du kilowattheure produit a été évalué par EDF sur la base d’une hypothèse de fonctionnement à 90 % de la puissance du réacteur pendant soixante ans : cela vous paraît-il réaliste, sachant que c’est une norme bien supérieure à celle des réacteurs de deuxième génération ?
Monsieur Repussard, vous avez déclaré dans plusieurs entretiens à la presse qu’il fallait arrêter la course à la puissance, laissant sous-entendre que plus un réacteur est gros, plus l’accident peut être grave. Visiez-vous l’EPR ? Estimez-vous qu’il faut, à l’avenir, se tourner vers des réacteurs de moindre puissance ?
M. Philippe Jamet. Concernant les probabilités de fusion du cœur, contrairement aux Japonais ou aux Américains, nous n’accordons pas une grande confiance aux valeurs absolues, tellement entachées d’incertitude qu’elles n’ont pas de sens. En revanche, les valeurs relatives qui permettent d’établir entre deux réacteurs une différence de facteur dix sont clairement des indicateurs de progrès. C’est le cas pour l’EPR dont la probabilité de fusion du cœur est dix fois moins élevée que pour le parc actuel : pour les défaillances d’origine interne, elle est de l’ordre de 10-6.
Les coûts et les délais annoncés au départ étaient fondés sur des prévisions qui n’intégraient pas forcément la perte de savoir-faire consécutive à un long temps de latence de la construction nucléaire. Les aléas de construction et les retards engendrés étaient sans doute prévisibles, mais les constructeurs n’ayant ni la mémoire ni l’expérience de leurs prédécesseurs, ils les ont sans doute mal anticipés.
Nous avons connu des ennuis avec le radier, et le chantier a été suspendu à plusieurs reprises, mais aujourd’hui l’ASN considère que la réalisation de l’EPR répond aux exigences de sûreté.
L’EPR a été dimensionné pour résister à un séisme ou une inondation de référence. Cependant, la catastrophe de Fukushima a montré qu’au-delà de ce dimensionnement il était nécessaire d’avoir des systèmes extrêmement robustes permettant, même en cas de phénomène naturel d’une ampleur imprévue, le refroidissement du cœur et l’intervention d’équipes externes. Les prescriptions issues des ECS s’imposent à Flamanville : il s’agit du « noyau dur » et de la Force d’action rapide nucléaire (FARN). Le « noyau dur » est naturellement plus facile à mettre en place sur l’EPR que sur les réacteurs du parc actuel. Sans doute certaines exigences sont-elles d’ailleurs déjà remplies – le dossier de demande de mise en service nous permettra de faire le point.
Je confirme que l’enceinte de l’EPR a été conçue pour résister à un crash d’avion. L’aéronautique évoluant, je ne sais néanmoins si cela sera encore le cas dans un siècle.
Si l’EPR n’était pas mis en service en avril 2017, le Gouvernement pourrait annuler le décret de création. Au-delà de cet aspect réglementaire, un nouveau retard n’aurait pas de conséquences techniques majeures.
Après réception du dossier de demande de mise en service fin 2014, l’IRSN et l’ASN ont pour tâche d’analyser celui-ci en tenant compte des modifications intervenues depuis 2011, avant l’approbation de l’autorisation de mise en service, laquelle permet la réception et le chargement des combustibles sur le site. Le risque majeur à ce stade est que les délais ne permettent pas à l’instruction et au processus d’approbation du dossier de se dérouler dans des conditions satisfaisantes.
Quant aux évaluations d’EDF tablant sur une utilisation du réacteur à 90 % de sa puissance pendant soixante ans, elles constituent un objectif technique exigeant mais atteignable. Est-ce pour autant réaliste ? Probablement y aura-t-il des aléas…
M. Jacques Repussard. La probabilité d’incidents d’origine interne est très nettement inférieure, pour l’EPR, à celle des réacteurs actuels. Reste que les calculs ne tiennent pas compte des agressions externes hors dimensionnement – catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou de sabotage, et je ne pourrais pas affirmer sous serment qu’en cas de crash d’un avion de très grande capacité, chargé de dizaines de tonnes de carburant, les conséquences de l’incendie seraient maîtrisées.
Le risque zéro n’existe pas. J’ai donc recommandé que l’on appréhende la course à la puissance en termes de précautions et non plus en termes de performances technologiques. Les Coréens et les Chinois imaginent des réacteurs passifs de 1 600 MW, ce que je juge très déraisonnable. Mes propos à la presse ne visaient pas particulièrement l’EPR, mais je m’interroge : l’industrie nucléaire ne se trompe-t-elle pas de combat quand elle tente de baisser le coût du KWh en augmentant la puissance de ses réacteurs plutôt qu’en vendant des réacteurs moins puissants mais générant des risques dont la probabilité de maîtrise est plus grande ? La probabilité que survienne un accident consécutif à une catastrophe à laquelle les ingénieurs n’auraient pas pu parer est supérieure pour l’EPR à 10-6, et ses conséquences sont proportionnelles à la puissance du réacteur.
Les surcoûts générés par un projet industriel sont la plupart du temps prévisibles, mais la loi du marché fait qu’ils sont souvent ignorés au moment de la vente. Quant aux délais, il n’y a pas de différence significative entre les délais de construction de l’EPR et ceux des autres réacteurs du parc ; prétendre qu’on allait construire un EPR en quatre ans n’était pas très sérieux.
M. Jamet a bien indiqué que les défauts de construction constatés ont été réparés ou le seront avant la mise en service.
Toutes les préconisations consécutives aux ECS post-Fukushima n’ont pas encore été mises en œuvre, mais elles le seront.
Quant aux piscines de l’EPR, elles sont mieux protégées des agressions externes que celles du parc actuel, mais le système reste intrinsèquement vulnérable.
M. le rapporteur. Pouvez-vous préciser ?
M. Jacques Repussard. Les piscines de l’EPR sont en hauteur. À la différence de celles du parc actuel, elles sont protégées des crashs d’avion. Mais d’autres scénarios sont possibles, comme une vidange accidentelle de la piscine. Le système de liaisons aquatiques qui relient la cuve du réacteur au réservoir d’eau est un système assez sophistiqué qui comporte des vulnérabilités d’autant plus problématiques, en cas de vidange, qu’il y a communication avec le bâtiment où loge le réacteur. Si l’EPR constitue un progrès, des améliorations de la sécurité restent donc possibles, et le dôme de protection ne résout pas l’intégralité des problèmes. Je le répète, l’EPR est conçu pour résister à l’impact mécanique d’un avion de grande capacité, mais les effets qu’aurait l’embrasement de plusieurs dizaines de tonnes de carburant restent difficiles à évaluer.
La cuve de l’EPR a bien été conçue pour pouvoir être irradiée pendant soixante ans dans le cadre d’un fonctionnement à 90% de la puissance du réacteur. C’est techniquement possible dans le respect des exigences de sûreté. Reste que les aléas industriels de maintenance sont imprévisibles et qu’ils ne permettent pas de calculer le coefficient de disponibilité effective.
M. Michel Sordi. Des visites d’installations nucléaires étant programmées pour le mois d’avril, je souhaiterais, monsieur le président, que vous puissiez organiser celle de la centrale de Fessenheim.
Monsieur Jamet, la construction de réacteurs EPR sera soumise dans chaque pays à l’autorisation des autorités de sûreté locales. Pensez-vous possible, afin de maintenir la cohérence de la filière nucléaire française, d’atteindre partout des exigences de sûreté identiques et conformes à nos standards ?
Monsieur Repussard, l’autorité belge a sollicité votre expertise sur des défauts constatés il y a peu sur des cuves de réacteur belges. Quelle était l’origine de ces défauts, et auriez-vous autorisé le redémarrage des réacteurs si de tels défauts avaient été constatés en France ?
Vous avez dit qu’au vu de la tâche qui l’attendait et du renouvellement des compétences, EDF se devait de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois. Avez-vous, vous-même, mis en place une telle gestion au sein de l’IRSN ?
Si je vous ai bien compris, les réacteurs de nouvelle génération à neutrons rapides ne réduisent pas le volume de déchets. Il me semblait néanmoins que cette nouvelle technologie permettait de valoriser ces déchets ; or nous disposons aujourd’hui, pour plusieurs milliers d’années, d’une quantité de déchets qui pourraient être recyclés et faire tourner des centrales de nouvelle génération.
M. Stéphane Travert. Le coût élevé de l’EPR résulte pour une grande part des aménagements liés à la sûreté. Techniquement, la sécurité des deux réacteurs de Flamanville et de Finlande est supérieure à celle de tous les réacteurs du monde. L’ASN a néanmoins émis des réserves sur le contrôle-commande. Pourriez-vous nous préciser si ces réserves ont été levées et quelles garanties vous a apportées EDF sur le système informatique de sécurité et de commande ?
M. le rapporteur. Les premiers EPR mis en service seront sans doute les chinois. Est-il prévu un retour d’expérience ?
M. Jacques Repussard. L’examen en profondeur de la couche d’acier des cuves belges a révélé de très nombreuses microfissures. Notre expertise a été sollicitée pour déterminer si elles étaient dues à l’irradiation en service ou s’il s’agissait d’un défaut d’origine. L’enquête a été difficile car la société ayant fabriqué ces cuves n’existait plus, mais elle a conclu qu’il s’agissait bien d’un défaut d’origine. Si ces microfissures ne présentaient pas en elles-mêmes un grand caractère de nocivité, du fait de leur très grand nombre, les modèles mathématiques dont nous disposons n’ont pas permis de déterminer de manière probante leur impact sur la tenue du matériau. Les autorités belges ont jugé peu vraisemblable que survienne une rupture brutale et ont donc choisi de redémarrer les réacteurs en mettant en place un programme de surveillance.
M. le président François Brottes. Qu’auriez-vous conseillé si un tel incident s’était produit en France ?
M. Jacques Repussard. Les microfissures concernaient deux cuves belges, soit un tiers de la capacité de production. Dans ces conditions, l’IRSN n’avait pas de raison d’insister sur la nécessité de maintenir les réacteurs à l’arrêt.
M. le président François Brottes. Est-ce dangereux ou non ?
M. Jacques Repussard. Ma conviction personnelle est que ce n’est pas vraiment dangereux et que la mise en place d’un programme de surveillance est une solution raisonnable.
S’agissant à présent de l’aval du cycle, le plutonium n’est pas un déchet ; c’est une matière valorisable. Mes propos sur les réacteurs de quatrième génération ne visaient que les matières non valorisables, et il est clair, puisque c’est un objectif de la filière, que les réacteurs à neutrons rapides constituent un progrès gigantesque puisqu’ils permettent de valoriser efficacement le plutonium et l’uranium. Aujourd’hui, contrairement à d’autres pays, nous avons un processus de retraitement du plutonium et de l’uranium, et on ne stocke donc pas ces produits à Bure. Cela étant, entre les réacteurs à eau légère et les réacteurs de quatrième génération, la volumétrie des autres déchets ne sera pas très différente.
M. le président François Brottes. Vous saluez donc le processus de retraitement !
M. Jacques Repussard. Il faut une étude d’impact nationale. Les coûts du retraitement en aval du cycle doivent être intégrés aux coûts globaux de la filière. Il s’agit d’un choix politique majeur. Une filière à neutrons rapides sans industrie de retraitement n’a aucun sens, et il ne suffit pas de s’interroger sur la faisabilité du réacteur.
M. Philippe Jamet. Chaque pays procède à l’approbation de la mise en service d’un nouveau réacteur selon des normes différentes. Cela étant, tous les pays qui envisagent la construction d’un EPR ont à peu près les mêmes exigences, qui sont celles de WENRA. Ce socle commun, qui concerne notamment les accidents graves, est solide. L’une des différences d’approche touche au contrôle-commande. Nous travaillons à renforcer la cohérence des normes européennes et internationales, en particulier en matière de sûreté.
Reste que le passage du contrôle-commande classique, avec relais, au contrôle-commande informatique est une évolution incontournable mais techniquement difficile, car il est compliqué de garantir la fiabilité d’un système de contrôle-commande informatique. Nous avons sur le sujet des discussions approfondies avec nos collègues finlandais et américains, mais divergeons pour l’instant sur l’approbation du système.
La France a rejeté la première proposition d’AREVA, mais juge satisfaisante la nouvelle proposition faite par le groupe. Les Finlandais ont également rejeté cette première proposition, leurs objections portant, d’une part, sur l’indépendance des modules, qui doivent pouvoir fonctionner de manière autonome, et, d’autre part, sur le cumul de défaillances qu’il est raisonnable d’anticiper.
Sur le premier point, nous considérons que les réserves des Finlandais sont sans objet ; sur le second point, les exigences finlandaises dépassent très largement ce qui est requis par les normes internationales. J’ajoute que nous sommes en avance sur les Finlandais, car l’EPR n’est pas le premier réacteur pour lequel nous mettons en place un contrôle-commande informatisé ; cela a déjà été fait pour les quatre réacteurs du palier N4.
M. le président François Brottes. Croyez-vous à la thèse selon laquelle l’EPR finlandais ne démarrera jamais ?
M. Philippe Jamet. Je ne peux pas répondre à cette question.
Nous sommes très désireux de collaborer avec l’autorité de sûreté de chinoise, qui ne répond pour l’instant ni à nos attentes ni à nos espoirs, une des raisons expliquant la difficulté de nos relations étant que l’autorité chinoise manque de moyens et qu’elle ne sait plus où donner de la tête. Nous ferons néanmoins tout notre possible pour bénéficier du retour d’expérience des Chinois. EDF, de son côté, affirme avoir de meilleures relations avec les constructeurs chinois.
Quant à nos propres moyens, s’ils ne sont pas augmentés, l’ASN aura des difficultés, elle aussi, à faire face à l’ensemble des tâches qui l’attendent dans les années à venir.
M. Michel Sordi. Je n’ai pas eu de réponse sur la gestion prévisionnelle des emplois à l’IRSN.
M. Jacques Repussard. Nous pratiquons la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), conscients que nous devons non seulement faire face au manque de moyens, mais également assurer le maintien des savoir-faire. Depuis trois ans, l’IRSN mène une politique ambitieuse adossée sur la création d’une université interne et des modules de formation obligatoires pour les ingénieurs. Nous travaillons également activement à l’identification et à la capture des savoir-faire.
Je ne saurai en revanche vous répondre sur le devenir des infrastructures de recherche. Il n’y a pas d’expertise sans recherche, et il n’y a pas de recherche sans moyens d’expérimentation. Or le CEA est en train de détruire sa capacité d’expérimentation pour des raisons budgétaires, préférant se concentrer sur le projet ASTRID et le démantèlement de ses anciennes installations. C’est un problème qui pourrait devenir crucial.
La France est le seul pays qui n’a pas connu de grave accident de criticité, comme il s’en est produit en Russie, au Japon ou aux États-Unis. Or, faute de moyens financiers pour l’entretenir, nous avons renoncé à maintenir notre plate-forme expérimentale de Valduc, alors qu’il s’agissait d’une installation de très haut niveau, mondialement reconnue et dont le Japon veut aujourd’hui nous acheter les résultats. Nous dépendrons donc désormais de notre coopération scientifique avec les Américains, ce qui n’est pas une bonne solution en matière de sûreté nucléaire.
M. le président François Brottes. Nous vous remercions, messieurs, d’être venus répondre à nos questions.
Audition de MM. Yannick Rousselet, responsable du dossier nucléaire, et Cyrille Cormier, chargé de campagne climat-énergie de Greenpeace France
(Séance du jeudi 27 février 2014)
M. le président François Brottes. Nous avons considéré qu’après avoir recueilli les avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sur l’EPR, le réacteur pressurisé européen, il était nécessaire d’entendre sur le même sujet MM. Yannick Rousselet et Cyrille Cormier, respectivement responsable du dossier nucléaire et chargé de campagne Climat/Énergie chez Greenpeace France – qui a tenu hier une conférence de presse sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires au-delà de quarante ans.
Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. En janvier 2012, Greenpeace International faisait paraître une brochure dont le titre résumait le point de vue de l’organisation : « Le réacteur EPR : un gaspillage dangereux de temps et d’argent » – on reconnaîtra votre sens de la formule ! Mais vu que nous venons de passer une heure et demie à essayer d’identifier les causes du retard du chantier de Flamanville et de ses surcoûts, en faisant la distinction entre ce qui relèverait du prototype et ce que pourrait être la série, peut-être serait-il utile de dépasser le jugement lapidaire pour entrer dans le détail.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Yannick Rousselet et Cyrille Cormier prêtent serment)
M. Yannick Rousselet. Je vous parlerai de l’évolution du chantier de l’EPR en France et des problèmes de sûreté qui en découlent, tandis que Cyrille Cormier s’attachera aux questions budgétaires.
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, permettez-moi de vous rappeler que l’objet de notre commission d’enquête est le coût de la filière nucléaire ; compte tenu du temps qui nous est imparti, il serait bon que nous nous concentrions sur le sujet !
M. Yannick Rousselet. Je n’ai pas l’impression de m’en éloigner : je ne vois pas comment l’on pourrait parler de l’EPR, de son avenir et de son coût sans évoquer l’évolution du chantier et sa sûreté !
Si nous avons été si virulents, à l’époque, c’est que nous jugions qu’un mauvais choix stratégique avait été fait. La conception de l’EPR date des années 90 : EDF s’est enferré dans un projet qui n’était plus d’actualité – quelle que soit l’opinion générale que l’on peut avoir sur le nucléaire.
M. le président François Brottes. En ce qui vous concerne, vous y êtes opposés : c’est même une position de principe !
M. Yannick Rousselet. J’essaie justement de m’en détacher et de me prononcer sur le choix de l’EPR, dans l’absolu. Or il me semble que, même si l’on est pro-nucléaire, ce choix peut paraître déraisonnable. Il s’agit d’un réacteur extrêmement gros et complexe, qui pose des problèmes de réalisation, de coût et de maîtrise. Nous autres, militants contre le nucléaire, aurions été en difficulté si d’autres choix industriels avaient été faits : par exemple, si EDF avait décidé de se doter de réacteurs de 1 000 mégawatts, un certain nombre de centrales auraient déjà été construites et, commercialement, la situation aurait été bien différente.
M. le président François Brottes. Vous estimez que l’EPR est plus sûr, mais trop gros ?
M. Yannick Rousselet. En tout cas, il est certain qu’il est très gros et très complexe. En outre, l’idée que, grâce à des économies d’échelle, il permettrait de réduire le prix du mégawattheure me paraît erronée.
Le chantier a démarré en 2007. En tant que riverain et membre de la commission locale d’information (CLI) de Flamanville, j’ai pu en suivre l’évolution de bout en bout. On est allé de ratés en ratés. On dit que c’est parce que c’est un prototype, ou une tête de série, mais le chantier a été interrompu pour la première fois dès le début du terrassement, après que l’on a envoyé des gravats sur les réacteurs voisins ; ensuite, tout a été à l’avenant. On n’a pas été capable de réaliser la galerie de rejets telle qu’elle avait été initialement conçue, alors que l’on connaissait dans le détail la géologie du lieu, puisqu’une mine de fer y avait été exploitée durant de très longues années ; du coup, il a fallu modifier complètement les tracés. Quand on a commencé à couler le premier béton, on n’est pas parvenu à fabriquer un béton conforme, avec la teneur en eau nécessaire. Une fois les premiers ferraillages faits, on s’est aperçu que certains avaient été oubliés et que d’autres ne coïncidaient pas entre eux ; on a manchonné comme on a pu pour sauver la situation ! Puis ont commencé les soudures ; dès le début, il fut flagrant qu’il y avait un problème de formation, et que les soudeurs n’étaient pas assez compétents ; résultat : un taux d’échec phénoménal de 26 %, alors qu’il est de 4 à 5 % dans l’industrie classique. On n’a pas réussi à monter le « liner », l’enceinte interne, en raison de défauts sur les tolérances, les soudures, etc. Quant aux consoles du pont polaire, elles ont défrayé la chronique ; il suffisait d’avoir fait son apprentissage en chaudronnerie pour s’apercevoir que leur conception ne ressemblait à rien. Ce qui est incroyable, c’est que malgré ces erreurs, tous les seuils de contrôle ont été franchis et que l’on a fini par monter des produits imparfaits dans l’enceinte de l’EPR ; c’est à ce moment-là qu’un simple peintre, qui voulait sabler les consoles, s’est aperçu, à l’œil nu, que toutes les soudures étaient défectueuses ! Il m’a immédiatement appelé pour me signaler le problème.
M. le président François Brottes. Ah bon ? Vous étiez le chef de chantier ?
M. Yannick Rousselet. Non, mais je suis de très près son avancée, et nous visitons régulièrement les installations.
Autre exemple : bien qu’il n’y ait eu qu’un couvercle de cuve à construire, il a fallu refaire les soudures des traversées et des bossages. Résultat : on en est réduit à monter un couvercle bricolé sur une cuve censée être neuve !
Je passe sur les procès en cours concernant les conditions d’emploi et les malfaçons ; au-delà même de la question de savoir si l’on est pour ou contre le nucléaire, on se heurte de fait depuis le début du chantier à un vrai problème de savoir-faire.
M. le président François Brottes. Auriez-vous quand même un compliment à adresser à l’EPR ?
M. Yannick Rousselet. Oui : il s’agit d’une machine très impressionnante. Quant à savoir si sa construction est justifiée – et réaliste –, c’est une autre affaire.
On nous a vanté les mérites de l’EPR en matière de sûreté, mais, pour ne prendre que ce seul exemple, la démonstration de l’efficacité du « core catcher », le « cendrier » censé récupérer le corium en cas de fusion, n’a toujours pas été faite. De même, s’agissant de la résistance au crash d’un avion, au regard des documents que nous avons pu consulter, et malgré le « secret défense » que l’on ne manque jamais de nous opposer, il ne semble pas que la démonstration ait été faite que le réacteur pourrait résister à un volume important de kérosène enflammé. J’ai d’ailleurs noté que M. Repussard est resté très prudent sur ce point tout à l’heure.
M. le président François Brottes. Vous contestez donc l’analyse de l’Autorité de sûreté nucléaire ?
M. Yannick Rousselet. Jusqu’à présent, je n’ai jamais entendu l’ASN soutenir que l’EPR serait capable de résister à la chute d’un gros-porteur.
M. le président François Brottes. Cela a été dit tout à l’heure, en audition publique et sous serment.
M. Yannick Rousselet. J’ai écouté M. Jamet avec attention, et je n’ai pas la même interprétation que vous de ses propos.
M. le président François Brottes. Il a dit qu’avec les avions qui circuleront dans vingt ans, les garanties ne seront pas nécessairement les mêmes, mais qu’à ce jour, il considérait que tel était le cas.
M. Yannick Rousselet. Chacun jugera.
L’idée était émise encore ces derniers jours de faire évoluer l’EPR, par exemple en diminuant la quantité de ferraillage. Cette manière de mettre en relation le coût, la réalisation et la sûreté m’étonnera toujours ; soit l’on considère que le ferraillage réalisé sur l’EPR est nécessaire pour des raisons de sûreté, et dans ce cas une telle décision reviendrait à réduire le niveau de sûreté du réacteur, soit tel n’est pas le cas, et l’on reconnaît implicitement que l’on a commis une erreur.
On a également dit que l’EPR offrait une amélioration notable du niveau de sûreté des piscines d’entreposage ; nous sommes nous aussi de cet avis. Toutefois, il n’a pas été fait la démonstration qu’il n’existait aucun risque de « dénoyage » du combustible dans les piscines ; j’en veux pour preuve une lettre de juin 2013, dans laquelle l’ASN demandait à EDF de réviser sa stratégie de gestion des combustibles irradiés. Cela vaudrait la peine de savoir ce qu’il en est aujourd’hui. Les conséquences sur les coûts pourraient être importantes, notamment s’il s’avérait qu’il faille « bunkériser » les piscines ou changer complètement de système – par exemple en privilégiant un entreposage à sec, sur le modèle américain. Ce qui est certain, c’est qu’en l’état, les piscines de l’EPR ne résolvent pas le problème de l’entreposage intérimaire des combustibles irradiés.
Quant à la valeur du terme source, c’est-à-dire la quantité de matière fissile contenue dans le réacteur, elle nous avait fait dire qu’il s’agissait du réacteur le plus dangereux au monde : du fait de sa puissance de 1 650 mégawatts, l’EPR est en effet celui qui, en cas d’accident majeur, serait susceptible de libérer la plus grande quantité de matière radioactive. À ce titre, je suis satisfait que Jacques Repussard ait insisté sur la question du dimensionnement.
Je ne reviendrai pas sur la situation en Finlande : là-bas, on ne sait même plus quand l’EPR pourra démarrer ! Il faut reconnaître que l’autorité de sûreté finlandaise, la STUK, est particulièrement exigeante – encore plus que l’ASN.
Antoine Ménager, directeur du chantier de Flamanville, affirme que l’EPR français sera mis en service en 2016. Il convient néanmoins de rester prudent, car la CLI subit depuis le début du chantier un enfumage permanent sur la date de mise en service, qui est régulièrement repoussée. Les générateurs de vapeur, qui devaient arriver à Flamanville d’abord le 1er novembre, puis le 15 décembre, ont été laissés sur le quai de Cherbourg, soumis à la corrosion due à l’air salin. J’ai demandé à l’ASN comment elle comptait réagir, et elle a finalement exigé que les générateurs soient entreposés dans des hangars – ce qui a été fait, mais ils sont encore à ce jour à Cherbourg, leur transport ayant été de nouveau reporté pour des raisons techniques. C’est incroyable : on a l’impression que rien ne marche ! Au fur et à mesure que le chantier avance, un nouveau problème technique ou organisationnel se pose.
Pour nous, il s’agit bien d’un échec industriel, qui découle d’un choix stratégique erroné. De ce point de vue, le dimensionnement du réacteur est particulièrement inquiétant.
M. le président François Brottes. Monsieur Accoyer me faisait remarquer que vous n’aviez pas toujours contribué à accélérer le chantier…
M. Yannick Rousselet. Je ne suis pas sûr qu’une manifestation de quelques heures ait eu des répercussions considérables sur l’avancement d’un chantier qui dure depuis plusieurs années !
M. Cyrille Cormier. Greenpeace est une organisation non gouvernementale qui n’a pas vocation à produire des expertises, même s’il nous arrive de fournir des éléments d’analyse ; en revanche, nous commandons des expertises indépendantes. Par exemple, nous avons publié, au début de 2013, le Scénario de transition énergétique, qui comparait deux hypothèses : d’un côté, le renouvellement du parc nucléaire ; de l’autre, la sortie définitive du nucléaire, avec le remplacement des réacteurs par des moyens de production d’énergie renouvelable. Plus récemment, nous avons commandé à l’agence WISE – World Information Service on Energy – un rapport sur une éventuelle prolongation du parc nucléaire actuel au-delà de quarante ans ; nous avons d’ailleurs demandé à être auditionnés à nouveau par votre commission d’enquête sur ce thème spécifique. Dans quelques jours, nous diffuserons, toujours dans un souci de transparence et avec la volonté d’apporter de nouveaux éléments d’expertise, une étude sur les réseaux électriques aux échelles française et européenne, et sur leur évolution comparée en cas de maintien de la puissance nucléaire en France et de la production de charbon en Pologne ou en cas d’évolution vers un taux élevé d’énergie renouvelable d’ici à 2030. Je vous ferai parvenir ces documents, qui intéressent directement l’avenir de la production électrique en France dans la mesure où ils permettent de s’interroger sur le coût du système global : moyens de production, mais aussi moyens de transport et de distribution, et éléments constitutifs de la consommation d’électricité.
Yannick Rousselet vous a présenté les informations relatives au chantier qui conduisent à avoir aujourd’hui une meilleure connaissance de la durée et du coût réels de la construction d’un EPR. Il reste encore au moins quatre ans de chantier en France, et de un à deux en Finlande, suivant que l’on écoute Areva ou l’opérateur TVO, mais il est d’ores et déjà certain qu’il y aura une multiplication par deux de la durée du chantier de Flamanville et un retard de cinq à sept ans sur celui d’Olkiluoto. Quant aux coûts, ils ont été multipliés par trois par rapport aux évaluations données en 2005, au moment du débat public ; à l’époque, EDF annonçait un EPR à 2,8 milliards d’euros et la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) tablait sur 1,6 milliard. C’est sur cette base qu’a été décidée la construction du réacteur de Flamanville. En avril 2007, au moment où le chantier a débuté, l’estimation d’EDF avait déjà été portée à 3,4 milliards – mais nous savons tous que, dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre et d’une négociation industrielle, ce type de dépassement est monnaie courante. Le problème, c’est que l’augmentation s’est poursuivie : 4 milliards d’euros en décembre 2008, 5 milliards en 2010, 6 milliards en 2011, et ce jusqu’en décembre 2012, date de la dernière mise à jour, où le coût total de la construction de l’EPR a été relevé par EDF à 8,5 milliards, en même temps qu’était annoncé un retard supplémentaire de deux ans pour la mise en service du réacteur. Comme il reste encore au moins deux ans de chantier, le dérapage des coûts peut se poursuivre.
Pour sa part, le Réseau de transport d’électricité (RTE), dans sa dernière mise à jour du schéma décennal et du bilan prévisionnel, envisage une injection sur le réseau des premiers kilowattheures produits par l’EPR vers la fin 2016 – tout en précisant que rien n’est certain. RTE a également réalisé des tests afin d’assurer la stabilité du réseau sans tenir compte de la disponibilité de l’EPR. Tout le monde est donc très prudent.
Pour ce qui concerne les réacteurs étrangers, les dernières estimations tournent autour de 9 milliards d’euros pour le projet d’EPR à Hinkley Point, et de 8,5 milliards d’euros pour le chantier d’Olkiluoto, en Finlande. Par conséquent, une évaluation réaliste de la construction d’un EPR serait aujourd’hui d’environ 9 milliards d’euros pour le coût et de huit à dix ans pour la durée – étant entendu qu’aucun chantier n’a encore été achevé.
L’EPR en est en effet au stade du démonstrateur. Sa capacité à fonctionner n’a pas été démontrée, et ses performances supposées, notamment s’agissant du taux de charge de 90 %, restent hypothétiques. Or cela aura une incidence sur le coût de production de l’électricité.
La multiplication par trois du coût de construction s’est déjà traduite par une multiplication par trois à cinq du prix annoncé du mégawattheure. Lors du débat public, Areva avait fixé ce dernier à 30 euros – ce qui pouvait sembler ambitieux. EDF l’a revu à la hausse une première fois en 2007, puis en 2008, à respectivement 46 et 55 euros. En janvier 2012, la Cour des comptes, sur la base d’un chantier à 6 milliards d’euros, a fixé une fourchette allant de 70 à 90 euros. Si l’on extrapole ces résultats sur la base d’un chantier à 8,5 milliards, il semble évident que le prix du mégawattheure produit par l’EPR de Flamanville dépassera les 100 euros et qu’il pourrait même aller jusqu’à 130 euros – cela a été confirmé entre-temps par les tarifs d’achat négociés en Angleterre. Vu qu’il reste encore deux ans de chantier, ces chiffres sont à prendre avec prudence : nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle augmentation. Pour comparaison, les nouvelles capacités de l’éolien terrestre en France permettent aujourd’hui de produire de l’électricité à un prix allant de 70 à 90 euros le mégawattheure.
M. le président François Brottes. Attention à ce type de comparaisons : le prix du mégawattheure se mesure, non par rapport à la puissance installée, mais par rapport à la puissance réellement utilisée compte tenu de la disponibilité des différents modes de production.
M. Cyrille Cormier. Il s’agit du prix du mégawattheure produit en tenant compte de la durée de fonctionnement de l’éolienne, c’est-à-dire d’un taux de charge d’environ 20 à 25 %.
M. le président François Brottes. Ce n’est pas la durée de fonctionnement qui compte ; c’est le taux d’utilisation effective.
M. Cyrille Cormier. Ce dernier étant traduit en taux de charge – que je viens de vous indiquer.
Le prix du mégawattheure produit par un EPR ne cesse donc d’être révisé à la hausse. Or la France est actuellement en excédent de production, ce qui la conduit à exporter une grande partie de son électricité – hormis durant les vagues de froid, où la tendance s’inverse, la France étant alors dépendante des importations pour stabiliser le réseau. Cette situation globalement excédentaire a été encore renforcée par la fermeture de l’usine Georges-Besse I, qui consommait la quasi-intégralité de l’électricité produite par la centrale du Tricastin. La production de l’EPR de Flamanville, même si elle venait remplacer celle de la centrale de Fessenheim, renforcerait donc une situation qui, dans l’ensemble, est de surcapacité.
M. le président François Brottes. « Dans l’ensemble » ne veut pas dire grand-chose : l’électricité, c’est à tout moment que l’on en a besoin. Ce qu’il faut prendre en considération, c’est la courbe de charge en fonction des besoins – sachant qu’il peut y avoir un apport supplémentaire lié à la récupération d’énergie fatale. Bref, il y a des moments où il y a abondance d’électricité, d’autres où il n’y en a pas assez ; il faut se méfier des moyennes en la matière.
M. Cyrille Cormier. C’est pourquoi je précisais que si, dans l’ensemble, nous étions dans une situation d’excédent, dans un certain nombre de cas particuliers, dont les vagues de froid, nous sommes extrêmement dépendants des importations.
M. le président François Brottes. Sauf que « dans l’ensemble » il y a toujours des cas particuliers !
M. Cyrille Cormier. Bref, la production de l’EPR sera principalement dédiée à l’exportation, et elle sera vendue sur un marché de gros européen où le mégawattheure se négocie entre quarante et soixante euros. Sa compétitivité est donc loin d’être garantie.
L’économiste Benjamin Dessus, coauteur en septembre 2000 du rapport Charpin-Dessus-Pellat relatif aux coûts de la filière électrique nucléaire, a analysé le rapport sur les coûts de la filière électronucléaire remis en 2012 par la Cour des comptes. Il observe que la courbe d’apprentissage de l’ensemble des réacteurs, de 1978 à 2002, montre une pente positive : en d’autres termes, le coût de production des réacteurs a augmenté avec le temps – pour une augmentation totale de l’ordre de 50 % sur l’ensemble de la période. Si l’on considère l’évolution par paliers, en distinguant les différentes séries de réacteurs – 900 CP0, 900 CP1, 900 CP2, 1 300 P4, 1 300 P’4 et 1 450 N4 –, on note une augmentation du coût des têtes de série d’environ 10 % à chaque nouveau palier, à l’exception de la tête de série du 1 300 P4, dont le coût fut bien supérieur. En revanche, l’effet de série reste incertain : dans certains cas, le coût de la série est supérieur d’environ 10 % au coût de la tête de série, dans d’autres, il lui est inférieur dans les mêmes proportions. Pour l’EPR, on pouvait donc s’attendre, pour la tête de série, à un coût d’environ 2 400 euros par kilowatt, soit un coût global de quelque 3,8 milliards, plus élevé que ce qui avait été annoncé au début du chantier ; ce coût est aujourd’hui estimé à 5 300 euros par kilowatt, soit un total de 8,5 milliards d’euros, c’est-à-dire un peu moins de deux fois plus ! La rupture de coût est donc très supérieure aux 10 % habituels ; or, en cas de construction d’une série, l’évolution des coûts n’est pas garantie. Tout ce que l’on sait, c’est que le coût de chacun des trois chantiers d’EPR en cours ou à venir est évalué à au moins 8,5 milliards d’euros : l’effet de série ne semble donc pas jouer très favorablement.
D’où un nouveau questionnement sur la justification de la construction du réacteur. Comme je l’ai dit, le besoin n’était guère évident si l’on se réfère au rapport entre notre capacité de production et le niveau de la demande – d’autant que celle-ci tend à se stabiliser depuis cinq ou six ans. Il existe certes de courtes périodes de déficit qui nous imposent de recourir ponctuellement à des importations, mais la construction d’un nouveau réacteur nucléaire était-elle la solution la plus adaptée pour y remédier ? N’aurait-il pas été préférable de privilégier d’autres moyens de production, ou d’améliorer la gestion de la demande ?
L’EPR de Flamanville étant un démonstrateur, il semble évident que sa construction était en réalité motivée par une ambition d’exportation : il s’agit d’un projet industriel plutôt qu’énergétique. Pourtant, il n’y a actuellement dans le monde guère de signes d’engouement pour le nucléaire ; depuis une vingtaine d’années, moins de 7 gigawatts issus du nucléaire sont raccordés chaque année au réseau mondial, alors que les capacités d’énergies fossiles – charbon et gaz – atteignent les 80 gigawatts, de même que celles des énergies renouvelables – dont une bonne moitié d’éolien.
Nous avons néanmoins testé l’hypothèse d’une utilisation de l’EPR pour remplacer le parc ancien, sur la base d’une durée de vie de quarante-sept ans pour les centrales actuellement en service – référence maximale en la matière, aucun réacteur au monde n’ayant dépassé une telle durée –, d’un effet de série favorable, avec une réduction de 10 % du coût actuel de 8,5 milliards, d’une réduction de 20 % de la durée de construction et d’un taux de charge de 90 % – objectif très ambitieux sachant qu’il est aujourd’hui d’environ 75 %. Sur cette base, la construction de trente-cinq réacteurs de type EPR en à peu près quinze ans coûterait quelque 270 milliards d’euros.
Certes, ce n’est peut-être pas la solution qui sera retenue ; peut-être privilégiera-t-on des réacteurs moins chers et moins puissants. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que nous revenions à des coûts similaires à ceux que nous avons connus au début du programme nucléaire français, dans les années 70 et 80. Les coûts seront de toute façon supérieurs à ceux des derniers réacteurs produits en France – soit plus de 4 milliards d’euros pièce. Cela signifie que le remplacement du parc ancien par des réacteurs de nouvelle génération représentera très certainement un investissement de plus de 200 milliards d’euros. Pour comparaison, une transition énergétique opérée par des moyens de production d’énergie renouvelable coûterait de 200 à 240 milliards d’euros.
L’EPR est un des moyens de production d’électricité les plus chers. Il semble d’ores et déjà peu compétitif par rapport aux sources d’énergie renouvelables, celles-ci ayant l’avantage non seulement d’être décarbonés, mais aussi de ne pas comporter les risques inhérents à l’exploitation de l’atome. Il conviendrait que dans les mois qui viennent, l’on examine de beaucoup plus près les chiffres fournis par les opérateurs et les industriels sur le coût du chantier, les éventuels surcoûts à prévoir, et leurs répercussions sur le prix du mégawattheure.
Il faudra également tenir compte du retour d’expérience du chantier de Flamanville pour les éventuels travaux sur le parc ancien ; cela nous permettra de savoir si nous avons vraiment la capacité de prolonger dans des conditions économiquement favorables la durée de vie des réacteurs.
M. le président François Brottes. Veillons toutefois à bien distinguer les coûts de production et les prix sur les marchés de gros – ces derniers, qui varient en fonction de la demande, pouvant être négatifs. Il ne faut pas comparer les choux et les carottes !
M. Cyrille Cormier. La rentabilité de l’EPR sera cependant fonction de la vente de l’électricité qu’il aura produite sur les marchés.
M. le président François Brottes. Les prix sur les marchés sont fixés par le mécanisme de l’offre et la demande. Si la croissance revient, les conditions changeront.
Il me semble que tout le monde est d’accord pour dire qu’il existe une perte de compétences au sein de la filière nucléaire. La construction d’une troisième génération de réacteurs, quels qu’en soient les défauts ou les atouts, serait-elle susceptible d’y remédier – sachant que nous aurons encore besoin de telles compétences, vu que le parc nucléaire français ne pourra pas être fermé du jour au lendemain ? Comment faudrait-il s’y prendre si cette troisième génération ne voyait pas le jour ?
M. Yannick Rousselet. Nous partageons en effet ce constat et nous sommes nous aussi convaincus de la nécessité de maintenir les compétences à leur niveau actuel. Quelle que soit la décision prise, nous aurons besoin du savoir-faire des travailleurs et des ingénieurs du nucléaire. Même si l’on adoptait la solution radicale que serait une sortie rapide du nucléaire – ce que nous souhaitons –, on ne pourrait pas fermer les centrales immédiatement ; il faudrait prévoir une période de transition et, durant celle-ci, continuer à gérer le parc nucléaire. Or les pyramides des âges chez Areva et, surtout, chez EDF sont inquiétantes. Que ce soit pour maintenir en fonctionnement les centrales existantes dans l’attente d’une solution de remplacement, pour gérer les installations du cycle ou pour procéder aux opérations de démantèlement, on aura besoin de compétences humaines.
La construction d’un EPR n’en assurera pas pour autant le maintien. Rappelons que la conception de ce réacteur remonte aux années 1993 et 1994, et que la réalisation actuelle découle des plans de l’époque – à quelques améliorations près apportées à la suite de la catastrophe de Fukushima. Il n’y a pas eu de changement technologique important.
À mon sens, le maintien des compétences sera assuré avant tout par le fonctionnement quotidien des centrales actuelles ; il faudra veiller au renouvellement des emplois dans les entreprises concernées. Les difficultés rencontrées sur le chantier de Flamanville sont essentiellement liées à la recherche exacerbée de la rentabilité, via l’utilisation de sous-traitants pas toujours compétents. Mais est-ce vraiment de techniciens capables de couler du béton de qualité nucléaire que nous aurons besoin à l’avenir ? J’en doute. Des personnes capables d’entretenir le parc existant et de participer aux opérations de démantèlement seraient plus utiles.
M. le rapporteur. Estimez-vous que les autorités de sûreté ont été suffisamment vigilantes lorsqu’elles ont validé la conception de l’EPR ?
Les défauts de construction que vous avez évoqués risquent-ils d’avoir des conséquences sur le fonctionnement du réacteur ou peut-on estimer, à l’instar de l’ASN, qu’il s’agit de simples incidents de chantier, sans incidence sur la sûreté ?
Estimez-vous que les évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima ont été menées à leur terme sur l’EPR ?
Que pensez-vous des autres réacteurs de troisième génération existant à l’étranger ? Selon l’ASN et l’IRSN, l’EPR serait le plus avancé en matière de sûreté. Partagez-vous ce point de vue ?
S’agissant de l’éventuel renouvellement du parc nucléaire actuel, pensez-vous que, pour l’EPR, l’effet de série sera faible ? EDF dit travailler sur des scénarios d’optimisation. Avez-vous des éléments d’information complémentaires ?
M. Yannick Rousselet. S’agissant de la conception de l’EPR, je rappelle qu’elle répond à une logique dite « évolutionnaire », et non « révolutionnaire ». Il s’agit d’un réacteur à eau pressurisée classique, dont la puissance a été gonflée et sur lequel ont été greffés des éléments nouveaux : le core catcher, une vanne de sécurité supplémentaire sur le pressuriseur, le liner des enceintes des réacteurs de 900 mégawatts associé à la double enceinte des réacteurs de 1 300.
M. le président François Brottes. Et un cœur qui peut fondre sans risque ?
M. Yannick Rousselet. Pour le coup, il n’y a pas de différence entre les réacteurs 1 et 2 de Flamanville et l’EPR s’agissant de la possibilité physique d’une fusion du cœur.
M. le président François Brottes. Vous contestez ce que dit l’ASN sur ce point ?
M. Yannick Rousselet. Que dit-elle ?
M. le président François Brottes. Que si le cœur fondait, on saurait gérer la situation.
M. Yannick Rousselet. Je ne crois pas que l’ASN ait prétendu qu’une fusion du cœur serait impossible. Elle a simplement dit qu’il existait sur l’EPR des systèmes de sauvegarde qui permettrait, en cas de fusion du cœur, de récupérer le corium.
Je maintiens qu’il serait nécessaire que vous en discutiez avec les personnes qui travaillent sur le core catcher, car l’efficacité de ce dernier n’a jamais été démontrée. Quand on compare avec ce qui a été fait à Fessenheim, on note des différences importantes de conception, notamment s’agissant des systèmes d’aspersion d’eau ; or je rappelle que l’aspersion d’eau présente un risque de dégagement d’hydrogène, avec les conséquences que cela a pu avoir à Fukushima. Tout le monde est favorable à la volonté de guider et d’étaler le corium, mais le core catcher suscite un débat technique, car rien ne dit qu’il sera réellement efficace. Posez de nouveau la question à l’ASN : ils vous répondront qu’il n’est pas sûr à 100 % ; il ne s’agit que d’une tentative d’évolution.
Globalement, en matière de conception, on a cherché à apporter sur l’EPR des améliorations en matière de sûreté. Cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble des scénarios ont été pris en considération ; par exemple, contrairement à l’AP 1 000 américain, l’EPR ne dispose pas de système de sûreté passif : il nécessite une source d’énergie externe, avec des lignes de raccordement et des générateurs de secours à moteur diesel pour que l’eau du circuit primaire puisse continuer à circuler et le système de refroidissement à fonctionner. C’est précisément un tel système qui avait fait défaut à Fukushima.
L’AP 1 000 américain, lui, n’a besoin d’aucune énergie extérieure : en cas d’accident, par simple échange thermique, le circuit d’eau chaude/eau froide continue à faire circuler l’eau dans le circuit primaire ; le réacteur dispose ainsi d’une capacité propre de refroidissement pendant au moins les vingt-quatre premières heures.
Cela montre que, contrairement à ce qu’on nous dit, et en dépit du niveau de sûreté atteint dans d’autres domaines, l’EPR n’est pas le modèle optimal en la matière.
M. le président François Brottes. Vous êtes là encore en divergence avec l’ASN, qui nous indiquait tout à l’heure qu’elle n’aurait pas donné sa bénédiction au réacteur américain.
M. Yannick Rousselet. Non, car l’AP 1 000 a bien d’autres défauts. Ce que je dis, c’est que le sentiment d’optimisation de la sûreté qui entoure l’EPR est discutable : on a développé dans d’autres réacteurs des systèmes qui auraient pu être inclus dans l’EPR.
Peut-on garantir que les malfaçons relevées sur le chantier n’auront aucune conséquence sur la sûreté du réacteur ? Je laisse à l’ASN la responsabilité de se prononcer sur le sujet. Ce que je peux dire, c’est qu’il a été procédé à des réparations, parfois importantes : pour le couvercle de la cuve, c’est la totalité des passages des mécanismes de commande qui a dû être refaite. Si l’on a un peu d’expérience dans ce domaine, on sait bien que la marge de sécurité a diminué – même si l’on reste dans le périmètre de tolérance.
M. le président François Brottes. Ce n’est pas ce qu’a dit l’ASN tout à l’heure…
M. Yannick Rousselet. Ceux qui ont travaillé dans l’industrie pourront vous confirmer que ce type d’intervention provoque des fragilisations. L’ASN estime que le résultat reste conforme aux exigences techniques imposées ; je ne le conteste pas, mais il n’empêche que la marge de sécurité a diminué. Il eût été préférable d’avoir immédiatement une pièce conforme.
Idem pour le béton : n’importe quel ingénieur du génie civil vous dira que les nids de cailloux et les trous dans le béton peuvent être réparés, mais que le résultat ne vaudra jamais une coulée de béton homogène, réalisée sur une longue durée, à une température précise. Là encore, l’ASN estime que les réparations aboutiront à une mise en conformité de l’ouvrage par rapport à la réglementation, mais il n’empêche que la solidité du béton ne sera pas la même. De même pour les ferraillages.
M. le président François Brottes. Vous saluez toutefois la qualité du contrôle ?
M. Yannick Rousselet. Tout à fait, avec une réserve cependant : le contrôle se fait très souvent par échantillonnage. Même si l’ASN procède à de fréquentes inspections du chantier, il est bien évident qu’elle peut passer à côté de problèmes. Certains seront déclarés directement par l’exploitant, mais pas forcément tous.
Je profite de ce que j’interviens devant la représentation nationale pour souligner qu’il faudra veiller, dans les années qui viennent, à procurer un niveau de ressources suffisant à l’ASN. Avec les mesures post-Fukushima et le démarrage de l’EPR, elle aura besoin de moyens financiers et humains !
S’agissant des mesures post-Fukushima, les nouvelles exigences ont été limitées. On a renforcé la protection volumétrique et la protection contre l’inondation. Partant du principe qu’une vague de submersion pourrait inonder la plateforme – bien que celle-ci soit à douze mètres au-dessus du niveau maximal de la mer –, il a été demandé de rendre étanches les bâtiments des groupes électrogènes de secours ; l’ASN a refusé par deux fois les propositions d’EDF concernant les portes, mais une amélioration de la protection volumétrique est en cours. Un débat a éclaté entre experts pour savoir s’il n’aurait pas mieux valu installer les groupes électrogènes sur la falaise de Flamanville. Certains au sein de la CLI, y compris des personnes pro-nucléaires, trouvent qu’il est dommage de ne pas l’avoir fait. Le problème, c’est qu’une telle solution ne pourrait pas être appliquée à Blayais ou à Gravelines, où il n’y a pas de falaises.
On procède aussi à des vérifications concernant le risque sismique : on s’est aperçu que les réserves d’eau sur la falaise de Flamanville étaient résistantes à un tel risque, de même que le réacteur, mais que les tuyauteries intermédiaires ne l’étaient pas. Le sujet est en discussion – sachant que ce sont toujours les délais qui font problème. Il existe aussi un conflit entre Alstom et EDF à propos des groupes diesel, les groupes provisoires n’étant pas à la hauteur de ce qui était attendu. L’ASN a exigé qu’ils soient remplacés avant 2018 : souhaitons qu’elle aura les moyens de coercition nécessaires pour que ce soit fait rapidement.
Quant aux autres réacteurs de troisième génération, ils sont plus petits, à la fois en taille et en capacité : 1 000 mégawatts au lieu de 1 650. C’est une différence importante, car en cas d’accident grave, la quantité de matériau radioactif en jeu ne serait pas la même. Le dimensionnement du réacteur est pour nous une question centrale.
M. Cyrille Cormier. S’agissant de l’effet de série, nous considérons qu’il sera, non pas faible, mais incertain. Historiquement, quand on examine l’ensemble du parc, il n’a jamais dépassé les 10 %. Dans notre simulation, nous avons retenu l’hypothèse la plus favorable, avec une réduction de 10 % des coûts de production des EPR à venir.
Quant aux scénarios d’optimisation, il faudra juger sur pièces. Il est aujourd’hui difficile d’évaluer avec précision ce qui est de l’ordre de l’aléa technique, c’est-à-dire de la légère variation de la durée ou du coût d’un chantier, ce qui tient à la nature propre d’un projet trop complexe et ce qui découle d’un défaut de savoir-faire. Certaines difficultés sont susceptibles d’être résolues plus facilement que d’autres.
Par ailleurs, à partir de quand pourra-t-on parler d’effet de série ? L’optimisation concernera-t-elle les fournisseurs et partenaires sur les chantiers, la main-d’œuvre, ou les processus mêmes de construction ? Quelles conséquences aura-t-elle sur la sûreté et sur la performance ? Sur tous ces points, il serait nécessaire que les scénarios retenus par l’opérateur et les industriels soient chiffrés avec précision.
M. le président François Brottes. Chacun sait que dans n’importe quel secteur industriel, l’effet de série est toujours supérieur à 10 % !
M. Cyrille Cormier. Vous ne m’apprenez rien : j’ai travaillé huit ans dans l’industrie. Toutefois, le nucléaire est un cas particulier ; en outre, dans certains cas, comme le Rafale, il n’y a pas eu l’effet de série escompté.
M. Michel Sordi. Vous dites que la consommation d’électricité en France n’augmente pas, mais il semblerait que l’on constate une hausse de l’ordre de 2 % par an, liée à l’accroissement de la population, à l’utilisation croissante de biens de consommation et de biens d’équipement, ainsi qu’à la promotion des appareils électriques.
Par ailleurs, à Fessenheim, un dispositif de traitement de l’hydrogène a été mis en place : ce qui s’est passé à Fukushima ne pourrait pas se produire. Il serait également bon de prendre acte que la sécurité électrique a été doublée, voire triplée, et que les nouveaux groupes électrogènes ont été installés de manière à tenir compte du risque de tsunami – pourtant limité.
Deux questions. La première est un peu hors sujet, mais je viens d’apprendre qu’une femme a été condamnée aux États-Unis à trois ans de prison ferme pour s’être introduite par effraction dans un site nucléaire. Que pensez-vous de la sanction ? Greenpeace a pratiqué ce type d’action en France. Comment appréciez-vous les risques d’accidents corporels que vous faites prendre à vos militants ?
Quel regard portez-vous sur la transition énergétique engagée en Allemagne, avec ces deux orientations majeures que sont la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables ? Le bilan, en 2013, était le suivant : une production d’électricité issue à 45 % du charbon – et, plus précisément, à 26 % du lignite : un record depuis la réunification ! –, à 23 % des sources d’énergie renouvelables et à 15 % du nucléaire ; les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 2 % en 2012 et d’autant en 2013 ; quant aux prix de l’électricité, ils ont atteint les limites du supportable pour les consommateurs allemands. Sur le site Internet de WISE-Paris, j’ai trouvé un document faisant état des émissions de CO2 en fonction des technologies de production électrique utilisées : le nucléaire, c’est 35 grammes par kilowattheure, contre 1 019 grammes pour le charbon et 1 050 pour le lignite. Pensez-vous que l’Allemagne a fait les bons choix ?
M. Yannick Rousselet. Les centrales du parc français étaient déjà équipées de recombineurs d’hydrogène avant l’accident de Fukushima ; il est évident qu’il eût été préférable qu’il y en ait au Japon. Il n’empêche qu’il ne s’agit que d’une solution partielle. La difficulté est de positionner ces recombineurs à bon escient. La gestion des dégagements d’hydrogène est très complexe ; toutes les études produites par l’IRSN sur la question montrent que si une bulle d’hydrogène se créait aujourd’hui dans un réacteur, les recombineurs pourraient limiter le risque d’explosion à condition qu’ils se trouvent à proximité de l’événement, et il n’est pas garanti que la totalité de l’hydrogène serait alors annihilée. En outre, il y a des recombineurs dans les enceintes de confinement, mais pas dans les piscines d’entreposage ; or, à Fukushima, il y a également eu un problème dans celles-ci. Nous sommes sur ce point en désaccord avec l’ASN, à qui nous avons demandé d’examiner la possibilité d’imposer aux exploitants la présence de recombineurs dans les bâtiments des piscines d’entreposage.
Votre question sur les militants me semble en effet un peu hors sujet. La femme en question avait quatre-vingt quatre ans, et a jeté de la peinture sur un bâtiment réacteur – comme quoi il semblerait que l’on puisse s’introduire facilement dans les centrales américaines. Il est évident que la sanction nous apparaît scandaleuse : cette femme a simplement voulu attirer l’attention sur un problème. Quant à la responsabilité de nos actions, nous la prenons, parce que nous estimons que les risques que font courir les centrales nucléaires sont autrement importants. Nous veillons à toujours très bien préparer nos opérations, de manière à assurer la sécurité des personnes qui nous accompagnent ; jamais nous n’avons voulu attenter à la sûreté des installations. Au contraire, nos actions ont permis d’ouvrir des débats, y compris au sein des instances officielles. Par exemple, une discussion de plus de deux heures a eu lieu au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire à propos de la fragilité de la sécurité des centrales. On m’a demandé d’introduire le débat en expliquant comment nous avions fait pour pénétrer dans la centrale du Tricastin ; puis le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité a donné son opinion, ainsi que le représentant d’EDF.
M. Cyrille Cormier. L’Allemagne a en effet un problème d’émission de gaz à effet de serre et une part historiquement importante de sa production d’électricité est issue du charbon. C’est un point sur lequel travaillent nos collègues en Allemagne : selon Greenpeace, la transition énergétique doit comporter une sortie du nucléaire et une sortie du charbon. Notre objectif est de réduire l’ensemble des risques que comporte la production énergétique, qu’il s’agisse de ceux liés au nucléaire ou de ceux liés aux émissions de gaz à effet de serre. La transition énergétique suppose le développement de sources d’énergie renouvelable, une meilleure adéquation de la production à la demande et une plus grande flexibilité du réseau et des moyens de production. Nous avons salué la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire, mais nous n’avons cessé de dire qu’il fallait qu’elle s’accompagne d’un plan de sortie de l’utilisation du charbon dans la production d’électricité et d’un programme de réduction des gaz à effet de serre.
Sur ce point, vous avez raison, on observe une augmentation des émissions en 2012 et en 2013 en Allemagne, mais il convient de préciser que celles-ci font suite à quinze années de réduction continue. Je ne veux pas excuser les hausses récentes, mais il faut les mettre en perspective.
Enfin, l’Allemagne gère sa production en fonction de la situation des marchés de gros de l’électricité et utilise préférentiellement le mode de production le moins cher, c’est-à-dire, le plus souvent, le charbon.
S’agissant de l’évolution prévisible de la consommation d’électricité, j’attire votre attention sur le fait que, dans le schéma décennal et le bilan prévisionnel mis à jour en 2013, RTE a prévu plusieurs scénarios ; 2 % est l’hypothèse haute, l’hypothèse basse étant une diminution de la consommation d’électricité.
Certains scénarios proposés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique – notamment par Greenpeace et négaWatt – se fondent sur une forte baisse de la consommation d’électricité, sans que cela ait nécessairement des répercussions négatives sur l’économie et sur la croissance du PIB. En outre, les scénarios de RTE – dont celui que vous mentionnez – ne tiennent pas compte des objectifs gouvernementaux de rénovation énergétique des logements et de réduction par deux de la consommation d’énergie à l’horizon 2050. Il est de la responsabilité du Gouvernement et du Parlement de proposer dans les prochains mois des mesures qui permettront de véritablement maîtriser la consommation d’électricité.
Enfin, lorsqu’on considère la totalité des scénarios proposés dans le cadre du débat sur la transition énergétique – il y en avait près de vingt –, on s’aperçoit que ceux qui permettront d’atteindre l’objectif « facteur 4 » sont ceux qui, d’une part, divisent par deux la consommation d’énergie, d’autre part réduisent très fortement la part du nucléaire.
M. le président François Brottes. Messieurs, je vous remercie.
L’audition s’achève à onze heures cinquante-cinq.
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, nous venons de passer deux heures à écouter deux militants antinucléaires, représentant qui plus est une organisation dont nous connaissons bien les méthodes illégales. Chacun se souvient en effet de la double intrusion dont ses membres se sont rendus coupables ici même, en grimpant sur le toit de l’Assemblée nationale et en descendant dans l’hémicycle au moyen de cordes, en pleine séance des questions au Gouvernement. Une commission d’enquête n’est-elle pas censée auditionner des experts, et non des militants ?
Ces deux heures perdues vont nous empêcher d’auditionner dans de bonnes conditions les représentants d’EDF et d’AREVA, deux entreprises qui sont des acteurs essentiels dans le dossier qui nous occupe, sans parler du rôle industriel et social qu’elles jouent dans notre pays.
Pourquoi avoir organisé dans cet ordre les auditions de ce jour ? Pourquoi nous faire entendre des militants plutôt que des experts ?
M. le président François Brottes. Monsieur le président Accoyer, l’ensemble des auditions passées et à venir garantit une représentation équilibrée des entreprises, des salariés, des sous-traitants, des responsables de la sûreté, des observateurs, des experts dits indépendants – qui ne le sont en réalité jamais, j’en conviens – et des organisations non gouvernementales. Notre commission d’enquête ne ferait pas bien son travail si elle n’entendait pas les représentants de ces dernières. Au demeurant, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire, l’entité dont l’expertise est la moins contestable, que nous entendons le plus souvent.
M. le rapporteur. Je ne suis pas d’accord avec M. Accoyer : nous parlons de personnes qui concourent à l’expertise citoyenne et sont reconnues comme telles par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Les outils de suivi du nucléaire que celle-ci a instaurés, en particulier les commissions locales d’information et le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire – dont M. Rousselet est membre –, sont d’ailleurs salués non seulement par Greenpeace, mais par tous les écologistes comme faisant partie des plus démocratiques au monde. On peut ne pas partager l’avis de ces experts, mais leur dénier cette qualité revient à leur manquer de respect.
M. Bernard Accoyer. Pas du tout ; simplement, du point de vue scientifique, ce ne sont pas des experts. Vous-même, monsieur le rapporteur, êtes un militant antinucléaire ; vous ne vous en cachez pas, et c’est la raison pour laquelle vous avez souhaité la constitution de cette commission d’enquête, où vous vous exprimez beaucoup, avant même que les commissaires ne prennent la parole, ce qui n’est pas conforme à l’usage.
Sans doute les conditions de travail de notre commission d’enquête, où nous demandons à ceux que nous auditionnons de s’exprimer sous la foi du serment, devront-elles donc être revues, y compris pour garantir la sécurité de nos installations.
M. le président François Brottes. Monsieur Accoyer, M. Rousselet fait effectivement partie d’une commission locale ; quant au point de vue de son ONG, plutôt défendu par M. Cormier, il mérite, je le répète, d’être entendu par notre commission. D’autre part, l’usage veut depuis toujours que le rapporteur de la commission d’enquête soit le premier à poser ses questions, ce qui n’empêche nullement nos collègues de faire ensuite de même. Enfin, contrairement à ce que vous avez dit, l’audition n’a pas duré deux heures, mais une heure et demie.
Audition de M. Hervé Machenaud, directeur exécutif groupe
Production–Ingénierie d’EDF
(Séance du jeudi 27 février 2014)
M. François Brottes. Votre tâche ne va pas être facile, monsieur Machenaud ! Selon les représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire que nous avons auditionnés, il a fallu prendre le temps de corriger les erreurs, voire les malfaçons, dont a pâti le chantier de l’EPR de Flamanville. À en croire le directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), la conception même de l’EPR pourrait être contestée, en particulier le choix de sa puissance, qui pourrait poser des problèmes à l’avenir. Quant aux représentants de Greenpeace que nous venons d’entendre, vous connaissez leur point de vue : M. Rousselet, souvent présent à proximité du site, s’exprime régulièrement sur la question.
Nous souhaitons vous interroger moins sur la pertinence du concept d’EPR – dont EDF ne doit pas douter, sans quoi elle ne se serait pas lancée dans sa construction – que sur son coût et sa capacité à résister à tous types de sinistres. Quelle part des surcoûts et des délais de construction faut-il attribuer à sa qualité de prototype ? Que doivent-ils à l’accident de Fukushima, survenu en cours de chantier, et aux pertes de compétence que la filière nucléaire, a subies de l’avis général, en particulier au stade de la construction des centrales ? L’exemple finlandais montre en tout cas à quelles difficultés on peut se heurter avant de parvenir à un réacteur opérationnel de ce type.
Comment assurer à la filière de l’EPR un équilibre économique raisonnable et raisonné ? Dans quelle mesure le prototype de Flamanville est-il destiné à rester singulier ou préfigure-t-il l’avenir ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Hervé Machenaud prête serment)
M. Hervé Machenaud, directeur exécutif du groupe Production et Ingénierie d’EDF. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de me donner l’occasion d’exposer le point de vue d’EDF sur les réacteurs de troisième génération, en particulier sur l’EPR de Flamanville, et, plus généralement, sur notre projet industriel concernant le nouveau nucléaire.
Avant de vous répondre à propos du coût – question majeure –, je rappellerai que nous sommes de loin, et pour quelques années encore, le premier exploitant nucléaire mondial. Nous avons construit et maintenu le parc français avec nos propres forces d’ingénierie, ce qui constitue une exception au niveau mondial, et avec l’ensemble de nos partenaires, dont AREVA, premier fournisseur de réacteurs nucléaires au monde. Notre filière industrielle est, après l’automobile et l’aéronautique, le troisième secteur industriel français pour le nombre des emplois directs. Elle est reconnue dans le monde entier pour sa compétence.
Notre responsabilité industrielle est donc double : c’est celle de l’énergéticien qui doit assurer la relève de ses parcs et, en particulier en France, celle de l’industriel leader de son secteur, qui doit veiller au maintien du tissu industriel dont il a besoin. Nous assumons chacune de ces deux tâches dans l’esprit qui nous a toujours animés : celui d’un opérateur du service public d’abord soucieux de l’intérêt général et responsable, dans son domaine, du patrimoine industriel français.
Parler des réacteurs nucléaires de troisième génération, c’est d’abord parler de l’avenir du nucléaire. Bien entendu, nous préparons aussi l’avenir en nous appuyant sur d’autres filières de production, classiques et renouvelables. Vous savez quel effort nous consacrons en particulier à la recherche et développement en matière d’énergies renouvelables, avec notre filiale EDF Énergies nouvelles. En 2013 comme en 2012, EDF a davantage investi dans ce secteur de son activité que dans le nouveau nucléaire. L’énergie nucléaire n’en reste pas moins une filière de production d’électricité indispensable dans le monde, compétitive, fiable, décarbonée, assurant indépendance énergétique et emploi – c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a été choisie dans les années soixante-dix.
On compte plus de 430 centrales en service dans le monde et 70 en construction. Si l’on fait exception de l’Allemagne, de la Suisse et, dans une moindre mesure, de la Belgique, tous les pays disposant du nucléaire poursuivent son exploitation et, pour beaucoup d’entre eux, son développement, et de nombreux pays sans nucléaire ont des projets ou des programmes de construction nucléaire.
M. Denis Baupin, rapporteur. Et le Japon ?
M. Hervé Machenaud. Le Japon a une politique nucléaire qu’il essaie de relancer tout en s’efforçant d’améliorer les conditions de fonctionnement de ses centrales.
La Chine et la Russie présentent des programmes nationaux extrêmement ambitieux et sont devenus des acteurs incontournables sur le marché international. Le Russe RosAtom construit un réacteur par an, et bientôt trois ; il propose à l’international une offre très complète allant de la formation au financement total du projet, et a décroché de très nombreux appels d’offres, en Turquie, en Finlande, en Jordanie, au Bangladesh et au Vietnam. Quant aux entreprises chinoises, elles construisent à un rythme soutenu sur leur territoire. Elles n’ont pas encore obtenu de véritables contrats d’export de technologies, sinon au Pakistan ; mais, en attendant de disposer d’un réacteur de troisième génération exportable, elles négocient des partenariats et investissent dans des projets de construction. D’autres pays, nouveaux entrants aussi divers que la Pologne, la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Pakistan, le Bangladesh, le Chili, le Vietnam, la Thaïlande ou l’Indonésie, envisagent de recourir à la production d’origine nucléaire en raison des avantages de cette énergie, tout en l’intégrant à des « cibles » de mix énergétique très variables d’un pays à l’autre : le charbon est majoritaire en Pologne alors que le nucléaire et le solaire le sont en Arabie Saoudite.
Les réacteurs de troisième génération, progressivement associés à ces constructions et projets, n’ont pas de définition précise, mais cette génération se démarque principalement de la précédente par la prise en considération des accidents graves. À la conception des réacteurs de deuxième génération, construits à partir des années 1970, présidait l’idée de rendre impossible ou infiniment peu probable un accident grave provoquant des rejets significatifs dans l’environnement. Leur conception, du moins celle d’origine, n’intègre donc pas la possibilité d’un tel accident, en particulier celle d’une fusion du cœur qu’ils sont censés exclure. Or Three Mile Island, Tchernobyl puis Fukushima ont montré que de tels accidents pouvaient arriver. D’où la principale caractéristique des réacteurs de troisième génération, conçus pour rendre ces accidents encore moins probables, mais surtout pour en intégrer la possibilité et en limiter les effets sur l’environnement, grâce par exemple à l’installation d’un récupérateur de corium, comme dans l’EPR, ou à d’autres dispositifs dont vous avez parlé la semaine dernière, comme la rétention du corium en cuve.
Cela ne signifie pas que nos réacteurs en exploitation soient moins sûrs. Plus que du modèle de réacteur, la sûreté dépend en effet de l’exploitant, de sa culture, de sa formation et, le cas échéant, des modifications qu’il opère dans la conception. Je suis entièrement d’accord avec le président de l’IRSN, qui a récemment insisté sur ce point. Depuis sa construction, nous avons continûment procédé à des modifications de notre parc, que ce soit en tirant les leçons d’accidents comme celui de Three Mile Island – et, aujourd’hui, de Fukushima – ou en exploitant le retour d’expérience tiré de l’exploitation de nos centrales et des incidents que nous avons pu rencontrer. Dominique Minière vous a ainsi expliqué la semaine dernière que nos centrales avaient été équipées de recombineurs d’hydrogène, pour éviter les explosions, et de filtres à sable qui retiennent en cas de rejet 99,9 % du césium, principal agent de contamination de l’environnement. Si la centrale de Fukushima avait été équipée de tels filtres, les populations évacuées auraient pu revenir rapidement sur leur lieu d’habitation. Qu’il s’agisse des réacteurs en exploitation ou des nouveaux réacteurs, notre objectif comme exploitant est donc le même : tout mettre en œuvre pour éviter, quel que soit l’accident, une contamination à long terme des territoires.
Les réacteurs de troisième génération intègrent cet objectif dès l’origine. Tous les constructeurs ont à leur actif le développement d’un modèle ou de plusieurs modèles de cette génération. En voici quelques exemples. L’EPR est le fruit d’un projet franco-allemand ; quatre réacteurs sont actuellement en construction : Olkiluoto 3, Flamanville 3 et deux en Chine, à Taishan. L’AP1000, réacteur américano-japonais de Westinghouse et Toshiba, est plus petit, dit de sûreté passive, et de fabrication modulaire comme dans la construction navale : quatre sont en construction en Chine et autant aux États-Unis. S’y ajoutent le russe AES-2006 et une version en cours de développement, le TOI. Cinq AES-2006 sont en construction : quatre en Russie et un en Biélorussie. Plusieurs projets chinois sont développés par les trois opérateurs principaux : CGN (China Guangdong Nuclear Power Holding Group), CNNC (China National Nuclear Corporation) et SNPTC (State Nuclear Power Technology Corporation), créé pour le projet d’AP1000 ; ils devraient converger à terme vers un modèle unique. Deux réacteurs devraient être lancés prochainement sur le modèle ACP1000 de CNNC. Et je ne parle pas des Coréens, ni des réacteurs bouillants américano-japonais.
Au-delà des batailles de technologie, tous ces pays et constructeurs traversent une phase de mise au point et d’apprentissage et connaissent des difficultés et des retards dans le développement de leurs réacteurs de troisième génération. Ainsi, l’AP1000 de conception Westinghouse pose des problèmes liés à la fabrication modulaire ainsi qu’au fonctionnement et à l’assurance qualité des pompes, qui, immergées, peuvent difficilement faire l’objet d’une maintenance pendant la durée de vie du réacteur. Quant aux Chinois, ils sont en retard sur leur propre modèle de troisième génération alors même qu’ils visent à en équiper leurs sites de bord de rivière, qu’ils continuent à développer.
Le premier défi industriel consiste donc à livrer et à faire démarrer ces réacteurs. Il s’agit ensuite d’engager de véritables fabrications industrielles assurant la qualité des réalisations et l’équilibre économique des projets.
Tant que les réacteurs n’ont pas démarré et qu’ils ne sont pas développés à une échelle industrielle, il est très difficile de comparer les coûts et les performances de ces nouveaux modèles. Leur multiplicité témoigne toutefois d’un bouillonnement d’initiatives qui rappelle à certains égards le foisonnement technologique de la première génération, avant les années 1970. Au fond, la situation actuelle au niveau mondial évoque celle de la fin des années 1960 en France, lorsque plusieurs modèles étaient en cours d’expérimentation avant le choix de la filière à eau pressurisée, qui s’est généralisée dans le monde – à ceci près que les besoins en développement nucléaire sont maintenant tirés par les pays extérieurs à l’OCDE, principalement la Chine. Il me semble vital que l’industrie française, qui bénéficie d’un modèle robuste alliant la filière industrielle et l’exploitant le plus expérimenté au monde, joue ses cartes et trouve sa place dans ce développement mondial.
L’EPR a été développé par EDF, par des électriciens allemands et par AREVA, associé avec Siemens, dans les années 1990. Ce réacteur nucléaire est le fruit de l’expérience accumulée de l’exploitation de centrales nucléaires pendant plusieurs décennies, notamment en France et en Allemagne. C’est aujourd’hui le premier réacteur de troisième génération licencié par quatre autorités de sûreté différentes : française, finlandaise, chinoise et britannique – et sa certification est en cours aux États-Unis. Quatre EPR, je l’ai dit, sont en cours de réalisation dans le monde : en France, à Flamanville, où EDF, investisseur et maître d’ouvrage, sera l’exploitant ; en Finlande, où un consortium formé par AREVA NP et Siemens AG construit l’EPR d’Olkiluoto pour le compte du client TVO (Teollisuuden Voima Oyj), dans le cadre d’un contrat de type clé en main ; enfin en Chine, où les deux EPR de Taishan 1 et 2 sont réalisés par la Taishan Nuclear Power Joint Venture Company, filiale détenue à 70 % par CGN et à 30 % par EDF, qui en assurera également l’exploitation.
En France, le chantier de l’EPR de Flamanville 3 a été lancé par la loi de 2005, à la fois pour laisser ouverte l’option du nucléaire et pour préparer le renouvellement du parc. En effet, notre projet de prolongation du parc existant ne doit pas nous empêcher de préparer l’avenir : il faudra de toute façon un jour le remplacer. Sans préjuger des choix de politique énergétique à cet horizon, notre responsabilité industrielle consiste bien à rendre possible le choix du nucléaire, qui sera aussi celui de la continuité de notre filière.
Ce projet a fait suite à une interruption de près de quinze ans de toute construction de centrale. Il cumule donc dès l’origine les deux difficultés de ce que nous appelons une tête de série ou, plus exactement, une « première du genre » – first of a kind, disent les Américains –, et de la reprise d’une construction neuve. Il n’est dès lors pas représentatif d’une filière EPR industriellement mature qui pourrait être développée par la suite – car c’est bien l’effet de standardisation qui a permis de construire le parc français à un coût inférieur de moitié à celui qu’ont supporté les États-Unis et l’Allemagne.
Le projet d’EPR à Flamanville fait aujourd’hui l’objet d’un pilotage très rigoureux, qui résulte d’un plan d’action prioritaire lancé en 2010 et qui a permis de mieux maîtriser le coût et les délais du chantier. L’avancement des travaux, en matière tant d’études que de réalisation, offre désormais une idée stabilisée du budget à terminaison. Bien entendu, compte tenu de l’ampleur du chantier, des risques et des incertitudes demeurent, mais ils sont clairement identifiés et font l’objet de plans d’action spécifiques permettant d’anticiper les difficultés et de regagner les marges, par exemple grâce à l’utilisation d’un simulateur pleine échelle pour préparer les essais d’ensemble puis de démarrage. Nous disposons à ce jour d’une vision détaillée des risques et de ce qui reste à faire, y compris par nos prestataires. Le planning et les coûts n’ont pas évolué depuis deux ans. Nous avons récemment franchi deux étapes très importantes : la pose du dôme en juillet 2013, puis, le mois dernier, l’introduction de la cuve dans le bâtiment réacteur. L’année 2014 verra la poursuite des montages, mais aussi les premiers essais de mise en service des équipements.
Au-delà de Flamanville 3, notre projet industriel prévoit plusieurs étapes. La première, déjà engagée, consiste à tirer le meilleur parti pour nos chantiers à venir du retour d’expérience des réalisations en cours : Flamanville 3, mais aussi Olkiluoto 3, bien que nous n’y ayons pas participé, et ce grâce à notre partenariat avec AREVA. Ces expériences ont déjà bénéficié aux deux EPR de Taishan, où de nouvelles techniques de génie civil ont pu être développées et mises en œuvre avec succès : le délai séparant le premier béton de la pose du dôme a été réduit de moitié entre Olkiluoto 3 et Taishan 1. Le chantier de Taishan profitera à son tour à nos projets ultérieurs, en Grande-Bretagne et ailleurs.
La deuxième étape, engagée elle aussi, est l’optimisation de l’EPR, à laquelle travaillent EDF et AREVA dans le prolongement de ce retour d’expérience et dans le but de répondre à de nouveaux appels d’offres. Différentes options sont à l’étude. Certaines relèvent de la seule optimisation – par exemple, le réalignement des voiles de béton de façon à limiter les reprises de charge, donc la densité de ferraillage et la quantité de béton – et ne remettent pas en cause le design du réacteur ni, par conséquent, sa certification. D’autres interventions, plus profondes, permettront d’évoluer progressivement vers un nouveau design qui fera l’objet d’une nouvelle certification et rendra le réacteur plus sûr, plus efficace et plus économique. Une conception de base (basic design) de ce nouveau réacteur pourrait débuter à l’été 2014, ce qui serait compatible avec les calendriers saoudiens.
Enfin, dans le but d’étendre notre offre de réacteurs, nous travaillons également avec AREVA et nos partenaires chinois à la conception d’un modèle de 1 000 mégawatts, destiné à l’export.
Au total, il s’agit pour nous et nos partenaires de continuer à écrire une histoire industrielle. Nous avons construit en France six modèles correspondant à trois paliers de puissance. Cette histoire dépend bien sûr de la filière que nous exploitons en France et des EPR que nous construisons. Elle a pour fil directeur le retour d’expérience de l’exploitation et de la construction. Premier exploitant mondial, nous disposons évidemment d’une expérience unique au monde, qui fait référence et qui intéresse la plupart des pays désireux de démarrer ou de redémarrer un programme nucléaire. Cette histoire a donc vocation à s’écrire aussi à l’échelle mondiale. Même si, bien entendu, chaque pays a ses spécificités et souhaite à juste titre impliquer sa propre industrie, notre développement international est indispensable pour obtenir une forme d’effet de série et pour accumuler une expérience que nous ne pouvons plus acquérir sur le seul sol français en attendant le renouvellement de notre parc.
Dans cette évolution, la France doit naturellement prendre une place particulière : point de départ, elle doit aussi être une ligne de mire permanente si l’on veut préserver la possibilité de remplacer le parc existant, au moins en partie, par du nucléaire de troisième génération. Ce remplacement est d’une telle ampleur qu’il doit être préparé et anticipé. Les premiers réacteurs de 900 MW auront cinquante ans aux alentours de 2030, ce qui implique des investissements au tournant de 2020 si l’on veut commencer de les remplacer, au moins en partie, par de nouveaux réacteurs. Il s’agit donc de faire mûrir dès aujourd’hui une troisième génération en France et dans le monde, grâce à notre industrie, pour, le moment venu, remplacer aisément des réacteurs en fin de vie.
La filière nucléaire réunit 2 500 entreprises en France, dont une écrasante majorité de PMI et PME extrêmement dynamiques sur le marché intérieur et à l’international ; 200 000 salariés techniques directs ; environ 450 000 emplois directs, et sans doute près d’un million si l’on tient compte des emplois que vaut à la France le coût comparativement bas de son électricité. Elle va recruter 110 000 personnes d’ici à 2020. EDF recrute pour sa part 3 000 personnes par an dans ce secteur.
L’histoire du nucléaire français, l’une des plus belles réussites de l’histoire industrielle mondiale, représente pour notre pays un atout à long terme, technologique, économique et politique. La France peut en être fière, mais soyez sûrs que notre filière saura en écrire les nouvelles pages.
M. le président François Brottes. Merci, monsieur Machenaud, mais nous ne sommes pas ici dans un congrès ou dans un colloque. Si je vous pose une question, ce n’est pas pour que vous vous lanciez dans un long exposé sans y répondre !
M. Bernard Accoyer et M. Michel Sordi. C’est ce qu’a fait Greenpeace !
M. le président François Brottes. Cela vaut de toutes les personnes que nous auditionnons.
Certes, l’exercice est difficile et vos propos, même s’ils ne sont pas nouveaux, ne sont ni hors sujet, ni dépourvus d’importance. Mais ce que nous voulons, c’est que vous répondiez à nos questions : que doivent retard et surcoûts au défaut de compétences consécutif à l’interruption de la construction et aux mesures post-Fukushima ? Le fait que l’EPR soit un prototype exclut-il de retrouver les mêmes problèmes de coût et de délais lorsqu’on en viendra à la construction de réacteurs en série ? Greenpeace estime à 10 % la baisse de coût résultant de l’effet série : qu’en pensez-vous ? Y a-t-il ou non des enseignements à tirer de ce qui s’est passé avec l’EPR finlandais ? Nous avons besoin d’éléments précis pour tirer nos conclusions des exposés parfois divergents que nous entendons.
M. Hervé Machenaud. Je vous prie de m’excuser et je vais m’efforcer de vous répondre de manière aussi précise et complète que possible, en m’appuyant d’abord sur les données objectives et connues, en essayant ensuite de tirer les leçons de l’expérience d’EDF dans la construction du parc nucléaire.
Le coût de construction de Flamanville 3 est aujourd’hui estimé à 8,5 milliards d’euros. C’est le budget que nous avons annoncé il y a près de deux ans. Sur ce total, 900 millions environ sont identifiés comme des coûts propres à la tête de série, liés essentiellement à de l’ingénierie, et amortissables sur la série. Il faut aussi tenir compte des difficultés, également propres à la tête de série, de mise en œuvre du génie civil, qui nous ont causé bien des ennuis liés à l’évolution de la préparation, en particulier à des évolutions techniques auxquelles on a procédé de manière quelque peu théorique et insuffisamment adaptée à la réalité industrielle. En d’autres termes, nous nous sommes fixé à nous-mêmes des contraintes qui n’étaient ni constructives ni réalistes du point de vue industriel. Nous évaluons à 1,5 milliard d’euros environ le coût de ces difficultés et des retards qui s’ensuivent. Ces deux calculs ramènent le coût de l’EPR à 6 ou 6,5 milliards d’euros.
Le fait de reprendre la construction après quinze ans d’interruption a mobilisé non seulement EDF, mais l’ensemble de l’industrie. En matière industrielle, l’efficacité résulte essentiellement de la pratique. Si Taishan a été un tel succès, aussi rapide, cela résulte du retour d’expérience joint au fait que les entreprises chinoises construisent dix centrales nucléaires par an. La tête de série du 1 300 MW de Paluel 1 a coûté 25 % de plus que l’ensemble de la série du 1 300 MW ; pour le palier N4, les deux tranches de Chooz B ont coûté 25 % de plus que les deux tranches de Civaux, mais la première, Chooz B1, a coûté deux fois plus cher, en raison d’accidents technologiques touchant en particulier le contrôle commande.
Nous pouvons donc raisonnablement espérer obtenir une baisse de l’ordre de 25 %
– par rapport aux 8,5 milliards d’euros annoncés – grâce à l’effet de standardisation, formule que je préfère à celle d’« effet de série », ou à l’effet d’apprentissage.
M. le président François Brottes. Cela reste sensiblement supérieur à ce qui était prévu.
M. Hervé Machenaud. Oui. Mais le travail que nous menons avec AREVA sur la plateforme dite « Pologne » et notre réflexion en vue d’améliorer la sûreté et l’efficacité, sur la base de cet EPR et éventuellement de modèles évolutifs, nous permettent d’escompter une baisse notable de ce montant à assez long terme. En ce qui concerne l’EPR de série, nous restons en tout cas dans la fourchette indiquée par la Cour des comptes, c’est-à-dire entre 70 et 90 euros par MWh.
Rappelons que le coût du programme nucléaire français s’élève aujourd’hui à quelque 1 200 euros 2012 par MW, soit deux fois moins que celui des programmes américain et allemand et trois fois moins que ceux de Sizewell ou du programme japonais. Cela résulte de la courbe d’apprentissage – les centrales à charbon installées en Chine valent quatre à cinq fois moins cher qu’en Europe parce que les Chinois en construisent deux par semaine –, mais aussi de l’excellence de notre modèle industriel et de notre filière industrielle, caractérisés par l’intégration entre l’exploitant et les concepteurs et fournisseurs principaux : AREVA et Alstom, d’une part, et l’ensemble des PME qui viennent à l’appui de l’exploitant, de l’autre.
M. le rapporteur. Monsieur Machenaud, je serai un peu moins lyrique que vous s’agissant de notre excellence supposée, surtout en ce qui concerne l’EPR de Flamanville. Les problèmes rencontrés sur le chantier, et que vous avez reconnus vous-même, étaient-ils totalement imprévisibles ? Pourquoi avoir prétendu construire cet EPR en quatre ans si, comme nous l’a dit tout à l’heure M. Repussard, ce n’était guère sérieux ? Le surcoût et le retard par rapport à ce qui était annoncé, à propos desquels nous ne disposons pour l’instant que d’hypothèses, ne risquaient-ils pas de mettre durablement en péril la crédibilité de l’entreprise ?
Quel est le coût du kWh de l’EPR de Flamanville ? Faut-il déduire de vos propos qu’il s’élèvera à 25 % de plus que les 70 à 90 euros par MWh estimés par la Cour des comptes pour l’EPR de série ?
Ces évaluations supposent que le réacteur soit disponible à 90 % pendant soixante ans. Un taux de disponibilité aussi élevé pendant une durée aussi longue vous paraît-il crédible, compte tenu de ce que nous savons aujourd’hui du mode de fonctionnement des installations nucléaires ? D’autre part, compte tenu de l’évolution des cours de l’électricité, des technologies alternatives au nucléaire et de leur coût, n’est-il pas quelque peu anachronique de construire des installations censées durer soixante-dix à quatre-vingts ans – de la conception à la fin de vie – et équilibrer leur budget sur toute cette période ? Tant de choses peuvent arriver dans l’intervalle, notamment du point de vue de la production ! Plus le réacteur est puissant, plus il faut de temps pour qu’il devienne rentable. N’est-ce pas une faiblesse structurelle ?
L’EPR de série fera, dites-vous, baisser les coûts, mais ce n’est pas ce que l’on constate à propos du projet de centrale de Hinkley Point, dont les réacteurs devraient coûter 9,5 milliards d’euros. En outre, si la Commission européenne l’accepte, le prix de l’électricité qui y sera produite – environ 110 euros par MWh – doit être garanti pendant trente-cinq ans. Est-ce raisonnable ? Est-ce compétitif ?
La courbe de l’investissement financier dans le nucléaire, établie par votre entreprise et consultable sur Internet, met en évidence trois « bosses ». Premièrement, les investissements initiaux consentis pour construire le parc actuel, soit environ 100 milliards d’euros selon la Cour des comptes. Deuxièmement, le coût de la maintenance et du grand carénage, dont nous avons parlé avec M. Minière la semaine passée ; il reste élevé au-delà de 2025, de sorte que le montant annoncé, de 55 milliards d’euros jusqu’à cette date, serait dépassé – d’un tiers environ, semble-t-il, ce qui le porterait à 75 milliards. Troisièmement, l’investissement massif dans le renouvellement, c’est-à-dire la construction de nouveaux réacteurs de troisième génération, qui nous occupe aujourd’hui. À combien d’EPR correspond-il, compte tenu du montant de 6 à 6,5 milliards par réacteur que vous venez d’évoquer ? Comment ces coûts ont-ils été évalués ? Les représentants de la CFDT nous ont parlé d’un « mur d’investissements » ; il est vrai que ces derniers sont appelés à augmenter considérablement par rapport aux dernières décennies, avec le grand carénage et les mesures post-Fukushima, puis la construction de nouveaux réacteurs.
M. Hervé Machenaud. S’agissant de la durée du chantier de Flamanville, EDF avait envisagé au début des années 2000 d’avancer le travail d’ingénierie de détail, de moitié environ, préalablement au début des travaux. Mais le projet était encore trop incertain, de sorte que l’on a renoncé à cette anticipation. Au moment où il a ensuite été décidé de construire l’EPR, l’évaluation s’est fondée sur le coût, les quantités et la durée de fonctionnement du N4. Dans l’intervalle, la réglementation et les contrôles ont été substantiellement modifiés – sans compter les difficultés propres à la tête de série et les faiblesses liées aux problèmes de mobilisation de l’industrie, largement responsables du retard pris.
Ailleurs dans le monde, la plupart des très grands projets de ce type ont eux aussi donné lieu à des prolongations de chantiers notables. Cela résulte d’une perte de maîtrise industrielle que nous nous efforçons aujourd’hui de reconquérir. Quant à notre crédibilité future, le fait que les délais aient été entièrement revus il y a deux ans et soient désormais tenus au jour près me semble très rassurant.
L’estimation des coûts s’est également fondée, probablement à tort, sur le N4 alors que le contexte était très différent. Partir de Civaux pour construire un EPR n’était probablement pas la bonne référence…
Nous n’avons pas évalué depuis 2008 le coût de production de l’EPR de Flamanville en le ramenant au MWh, car le résultat ne serait pas significatif dès lors qu’il s’agit d’une tête de série. En outre, les 25 % dont j’ai parlé s’appliquent au coût de construction, lequel ne représente que 50 à 60 % du coût de production au MWh, ce qui les ramène à 12 à 15 %.
M. le rapporteur. À combien le kWh sorti de Flamanville va-t-il revenir ? Vous devez bien en avoir une idée !
M. Hervé Machenaud. Nous ne faisons jamais ce calcul, pour aucune tête de série ni aucune centrale isolée.
M. le rapporteur. Le réacteur devra bien fonctionner, et il restera isolé pendant un certain temps puisque aucun autre n’est en chantier.
M. Hervé Machenaud. Nous calculons le coût de production par MWh de notre parc en France – dont l’EPR fera partie dès qu’il sera exploité –, mais pas de chacune des centrales qui le composent. En effet, ce coût dépend largement des choix de positionnement, d’arrêt, etc., liés aux arbitrages entre les différents réseaux de production et les différentes centrales, pour des raisons de sûreté ou de maintenance.
Les nombreuses simulations que nous avons réalisées le confirment : le taux de disponibilité annoncé est crédible. Cela s’explique par l’existence de quatre trains de sûreté et d’un train supplémentaire, ce qui permet d’assurer la maintenance en exploitation, et par les modalités de gestion du combustible.
M. le rapporteur. Si je comprends bien, il convient de distinguer la disponibilité du fonctionnement : vous ne faites pas l’hypothèse que le réacteur va fonctionner 90 % du temps pendant soixante ans, mais qu’il en est capable.
M. Hervé Machenaud. Exactement.
Quant aux soixante ans, ce que vous appelez une faiblesse peut être considéré comme une force : celle de savoir que l’on pourra produire pendant cette durée à un prix fixe assuré qui se situe dans la fourchette basse de tous les moyens alternatifs. Les trois dernières décennies attestent de cette stabilité et le point de vue des économistes sur les coûts de production le confirment : le nucléaire construit il y a trente ans constitue aujourd’hui en Europe le moyen de production le plus économique. Quel sera le prix du gaz dans vingt ans ? Quelle autre source d’énergie permettrait de s’engager en 2015 sur un prix ferme pour soixante ans ?
À propos de Hinkley Point, les 92 livres sterling par MWh doivent être rapportés au prix d’exercice (strike price) de l’éolien, qui s’élève à 90 livres en Grande-Bretagne et à 85 euros en France ; l’ordre de grandeur est le même pour les cycles combinés à gaz. Dans ce domaine, le prix est quasiment le même en livres et en euros, parce que l’énergie est plus chère de 30 % en Grande-Bretagne.
D’autre part, si l’EPR de Hinkley Point bénéficie d’un effet d’apprentissage dont le prix tient compte, il s’apparente en même temps à une tête de série. En effet, la réglementation anglaise diffère beaucoup de la nôtre pour des raisons historiques. Les règles relatives au risque d’incendie ou au contrôle commande ont conduit à redimensionner les bâtiments, ce qui n’est pas sans conséquences. En outre, le site très particulier de la centrale, au bord d’un estuaire où les marées sont très fortes, nécessite des travaux souterrains et maritimes lourds pour aller chercher l’eau et la rejeter très loin. De plus, si l’EPR de Flamanville bénéficie de toutes les installations du parc destinées notamment à la gestion des combustibles, il faut à Hinkley Point construire des piscines spécifiques. Bref, de nombreuses causes structurelles expliquent le surcoût.
Rappelons enfin que les 92,5 livres sterling par MWh correspondent à un prix de vente et non à un coût. Il convient de distinguer les deux, une rentabilité affichée étant nécessaire pour attirer les investisseurs.
M. le rapporteur. Quelle est-elle ?
M. Hervé Machenaud. Elle est de 10 % ; le chiffre est public.
J’en viens à la courbe de l’investissement financier dans le nucléaire. Monsieur le rapporteur, vous faites l’hypothèse que le grand carénage coûterait 75 milliards d’euros et non 55. Nous l’avons toujours dit, cette bosse des investissements résulte de plusieurs facteurs, dont le cap des quarante ans, qui nécessite des modifications, une augmentation significative du niveau de sûreté et le remplacement de gros composants comme les générateurs de vapeur ou les alternateurs. C’est le grand carénage, dont nous avons évalué le coût à 55 milliards d’euros entre 2012 et 2025, ce qui ne signifie pas que l’on n’aura rien fait auparavant et que l’on ne fera plus rien ensuite : il s’agit d’un ordre de grandeur de l’effort à consentir durant cette période.
M. le rapporteur. Ce qui veut dire que le coût global du grand carénage est supérieur à 55 milliards.
M. Hervé Machenaud. Un outil industriel fait l’objet d’une exploitation et d’une maintenance permanentes. Ce que l’on a appelé le grand carénage correspond précisément à la bosse localisée entre 2012 et 2025 et qui représente 55 milliards d’investissements, dont 10 dus aux mesures post-Fukushima.
M. le président François Brottes. Nous devons connaître le détail de la somme. EDF, qui est le seul à en disposer puisque l’Autorité de sûreté nucléaire ne l’a pas, s’est engagé à nous le fournir d’ici à la fin de nos travaux.
M. Hervé Machenaud. Ce sera fait, bien sûr.
La troisième bosse de la courbe – présentée, je le rappelle, dans un document à usage interne exposant les perspectives financières de l’entreprise – donne, je le répète, un ordre de grandeur, une image. Il s’agissait de relativiser le coût du grand carénage, qui paraît considérable, et de montrer l’intérêt que présente la prolongation de la durée de vie des centrales. Nous nous sommes fondés sur l’hypothèse d’une reconstruction de 63 gigawatts, soit une quarantaine d’EPR, à un coût équivalent au coût cible que j’ai indiqué.
M. le président François Brottes. Il s’agit d’un « document de travail à valeur informative non contractuelle ».
M. Hervé Machenaud. En somme, l’industriel EDF, opérateur de service public responsable de l’alimentation du pays en électricité, soulève là la question de savoir ce qu’il faut faire à l’approche de la fin de vie du parc nucléaire existant. Si ce n’est pas aux centrales nucléaires que l’on recourt, ce sera à un autre moyen, auquel cas il faut dire lequel et à quel prix. Or, aujourd’hui, il n’existe pas de moyen alternatif plus économique que le nucléaire.
M. le rapporteur. Dans votre hypothèse, la construction de quarante EPR coûterait 240 à 260 milliards d’euros.
M. Hervé Machenaud. Oui, mais y a-t-il une solution alternative qui coûterait moins ?
M. le rapporteur. Je cherche seulement à éclairer la décision à prendre le moment venu.
M. Patrice Prat. Monsieur Machenaud, les représentants de Greenpeace estiment que la compétitivité de l’électricité produite par l’EPR ne serait pas garantie. Qu’en pensez-vous ?
Si l’on suppose que l’EPR participera d’un cercle vertueux attendu du nucléaire de demain, quelles seraient les conséquences précises de son exploitation sur l’ensemble de la filière, s’agissant notamment des matières valorisables et des déchets ?
Puisque vous avez évoqué des perspectives d’optimisation, peut-on envisager que l’EPR utilise le MOX ? EDF a-t-elle des projets en ce sens ?
M. Hervé Machenaud. En ce qui concerne la compétitivité, au niveau dont nous parlons et compte tenu des objectifs fixés à l’EPR optimisé et aux modèles qui en dériveront
– puisque c’est l’activité industrielle qui permet de réduire substantiellement les coûts –, je maintiens qu’il n’existe à mes yeux aucun moyen alternatif dont le coût de production soit aussi faible.
À titre de comparaison, le coût d’un cycle combiné à gaz, sur lequel nous n’avons aucun contrôle, est aujourd’hui de 70 à 100 euros par MWh – pour combien de temps ? Quant aux énergies renouvelables, leur intermittence entraîne des surcoûts, de sorte que même l’éolien terrestre, le plus économique, est aujourd’hui très au-dessus des 100 euros, pour ne rien dire de l’éolien offshore ni du solaire.
Et je ne parle même pas des conséquences de cette intermittence sur l’équilibre global du mix énergétique ni du fait, toujours passé sous silence, que ces énergies renouvelables ne permettent pas une couverture systématique de la pointe de consommation –par exemple celle d’un soir de février où l’Europe se retrouve prise dans une zone de haute pression. Bref, il ne peut s’agir que d’une source d’énergie complémentaire. Il faut donc conserver les autres moyens nécessaires à la production le jour de la pointe, mais ces autres moyens arrêtés lorsqu’il y a du vent perdent alors en compétitivité et en rentabilité, ce qui renchérit encore le coût réel moyen de la production.
Dès lors, pour disposer d’une production durablement stable et mobilisable au moment où on en a besoin, l’EPR reste de loin le moyen le plus compétitif.
S’agissant du cycle du combustible, avec l’EPR, la production de déchets ultimes par kW est relativement réduite. L’utilisation de MOX pourrait donc être envisagée parmi les pistes d’optimisation. Mais, aujourd’hui, on « moxe » l’équivalent de notre production annuelle de plutonium. L’équilibre concerne donc la matière plus que le mode de production.
Plus généralement, nous avons été interrompus dans un processus d’amélioration continue de l’efficacité industrielle des réacteurs nucléaires en France. Nous améliorons constamment la sûreté de nos centrales par des modifications qui résultent de retours d’expérience, de sorte que les centrales conservent le même niveau de sûreté grâce à l’effet de standardisation. C’est cette standardisation progressive qui fait la force du parc nucléaire français : dès que l’on trouve une nouveauté, on l’installe dans l’ensemble du parc.
C’est ce processus que nous devons poursuivre. Nous observons les difficultés que nous rencontrons en construisant l’EPR, nous verrons en l’exploitant comment l’améliorer peu à peu et nous intégrerons ces améliorations au modèle suivant. On peut par exemple se demander s’il est plus sûr d’avoir deux enceintes qu’une seule, cinq trains de sûreté plutôt que deux. Bref, nous devons procéder à une analyse approfondie de la sûreté ; elle est en cours.
M. le président François Brottes. Merci.
Audition de M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA
(Séance du jeudi 27 février 2014)
M. le président François Brottes. Compte tenu du retard pris dans nos auditions, pour lequel je vous présente toutes nos excuses, monsieur Knoche, je vous propose d’en venir directement aux questions que nous souhaitions vous poser.
M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA. J’allais vous le proposer, monsieur le président. Je me permettrai simplement, si vous en êtes d’accord, de revenir en fin de réunion sur les points qui n’auraient pas été abordés.
M. le président François Brottes. « La bataille de la compétitivité de l’EPR n’est pas perdue », déclariez-vous en 2010. À l’époque, nous étions dans l’expectative la plus totale mais, en tant que premier directeur du projet EPR en Finlande, vous disposiez – et disposez – d’une certaine capacité de recul pour évaluer la situation en France.
Quoi qu’en disent les uns ou les autres, nous avons bien compris ce matin que l’EPR et sa conception assurent plus de sûreté, mais pas nécessairement une moindre production de déchets. Nous avons aussi compris que, parce qu’il s’agit d’un prototype, il coûte au moins 25 % plus cher que s’il était produit en série. En tout état de cause, le retard qui a été pris est lié aux contraintes qui se sont imposées en cours de route, en particulier du fait de l’accident de Fukushima, et au déficit de compétence des entreprises intervenant sur le chantier.
AREVA commercialise des réacteurs – pas seulement l’EPR – dans le monde entier. Pouvez-vous nous dire où en sont le réacteur ATMEA1 et les autres projets que vous menez en commun soit avec EDF, soit avec d’autres opérateurs ? Nous nous sommes demandé ce matin, notamment avec M. Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), si l’EPR ne présentait pas une puissance trop importante, et s’il ne convenait pas de revenir à des projets plus « raisonnables ». Je crois d’ailleurs savoir qu’AREVA a dans ses cartons un autre projet, dont le cahier des charges et la description de base sont assez aboutis mais qui n’a pas encore été mis en œuvre.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Philippe Knoche prête serment)
M. Philippe Knoche. Vous avez dit que l’EPR ne produisait pas nécessairement moins de déchets. Permettez-moi de préciser qu’au mégawattheure (MWh) produit, nous pouvons aller jusqu’à 10 % de déchets en moins, le cœur du réacteur étant plus efficace
– étant entendu que la nature des déchets est la même que dans les autres réacteurs.
M. Denis Baupin, rapporteur. Je vous poserai les mêmes questions qu’aux intervenants précédents.
En ce qui concerne l’EPR de Flamanville, nous constatons un écart significatif du calendrier et des coûts de la construction avec ce qui avait été prévu. Quelle est votre analyse ? Quelles sont selon vous les principales causes d’un tel écart entre ce qui a été vendu aux pouvoirs publics il y a une dizaine d’années et ce qui advient aujourd’hui, qui met en péril la crédibilité des entreprises concernées ?
L’EPR est vendu pour pouvoir fonctionner pendant soixante ans à 90 % de disponibilité. Estimez-vous cela crédible au vu de ce que nous pouvons observer – à savoir, pour ce qui concerne la France, des réacteurs âgés en moyenne de vingt-cinq ans et qui fonctionnent à moins de 80 % de disponibilité ?
Vous avez le privilège d’avoir une vue transversale sur les quatre EPR aujourd’hui en construction. Selon vous, lequel entrera le premier en fonctionnement ? Comment faire en sorte que le retour d’expérience bénéficie rapidement aux autres ?
Il semble que la construction des EPR chinois se heurte à bien moins de difficultés que celle de l’EPR finlandais et de l’EPR français. Quelles en sont les raisons ?
Qui va payer la facture de l’EPR finlandais ? Nous avons noté hier, à l’occasion de la publication de vos résultats, qu’AREVA avait passé une nouvelle provision dans ses comptes. J’ai eu l’occasion de discuter il y a une dizaine de jours avec un ministre finlandais : pour lui, il ne faisait pas de doute qu’il n’en coûterait que 3 milliards au client, et que le contribuable français payerait le reste. Sachant que la facture sera plutôt de l’ordre de 8,5 milliards, qui payera quoi ? Le contribuable français aura-t-il vraiment à payer pour la construction de l’EPR finlandais ?
Mes dernières questions porteront sur l’ATMEA. Est-ce ce modèle ou l’EPR qui domine aujourd’hui dans les efforts de recherche d’AREVA ? Investissez-vous de la même façon dans les deux projets, comme deux voies qui seraient complémentaires, ou en privilégiez-vous un ? D’autre part, où en êtes-vous en Turquie ? Avez-vous bon espoir d’y construire un jour ces ATMEA ? Vous noterez que je fais un effort pour ne pas parler des risques sismiques… (Sourires.)
M. Philippe Knoche. S’agissant de Flamanville, je rappelle que le rôle d’AREVA est limité à la fourniture de la chaudière. Cela étant, un certain nombre d’aléas expliquent les coûts et les retards qui ont été constatés, mais M. Machenaud a dû vous dire ce qu’il en est.
En ce qui concerne votre commentaire sur la perte de crédibilité des entreprises engagées dans le projet, je dirai qu’il y a une vertu à tous nos efforts. Dans le cas de la Finlande, il s’agit de la transparence – nous disons combien cela coûte.
Le monde de l’énergie a été confronté à de nombreux imprévus au cours de ces dix dernières années. Le coût des centrales au charbon a ainsi doublé sur la période, les prix de tout un ensemble de matières premières s’étant littéralement envolés. Personne n’avait non plus prévu l’évolution des prix du gaz, notamment en Asie, et donc de la compétitivité de ces énergies. Lorsque M. Machenaud dit que, malgré les surcoûts, l’EPR reste compétitif et certain, c’est-à-dire que l’on peut prévoir son coût sur la période d’exploitation, c’est donc un élément important.
Nous tirons bien sûr les leçons de nos erreurs. Il y a eu défaut de prévision ; il est évident que plus personne ne signe aujourd’hui de contrat pour un EPR à 3 milliards. En même temps, les centrales ont atteint un niveau d’achèvement – à la fois en construction, en fabrication et en montage – et de risque qui n’a plus rien à voir avec ce qui avait pu être envisagé au moment de leur lancement.
En ce qui concerne la disponibilité, le taux de 90 % est dépassé dans les centrales qui sont à la base de la conception de l’EPR, à savoir les centrales Konvoi allemandes – et vous savez que le régulateur allemand n’est pas le plus porté à être favorable au nucléaire… Elles le doivent à une architecture qui a été reprise pour l’EPR, comportant l’existence de quatre « trains » de sûreté, ce qui permet d’assurer la maintenance de l’un d’entre eux pendant que la centrale est en service. Ce taux de disponibilité est également dépassé aux États-Unis.
Les coûts de l’EPR incluent la justification de leur durée de fonctionnement : l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) nous demande de faire les calculs à la fatigue de tous les composants qui peuvent être sollicités pour prouver qu’ils vont durer soixante ans. On ne peut nous demander de comptabiliser cette preuve dans les coûts et nous dire en même temps que le total n’est pas raisonnable. J’ajoute que les dix dernières années, soit entre cinquante et soixante ans, on arrive 1,5 euro du mégawattheure compte tenu du fait que c’est une période très éloignée. Du point de vue économique, le débat sur ce qui se passera à l’année 52 n’est donc pas fondamental.
Vous me demandez lequel des quatre EPR en construction devrait entrer en fonctionnement le premier. En termes physiques, Olkiluoto est la centrale la plus avancée. Le premier test d’ensemble, celui de son bâtiment réacteur, a été réalisé avec succès il y a quelques semaines, à la satisfaction du client Teollisuuden Voima Oyj (TVO) et de l’autorité de sûreté finlandaise, et en présence d’ingénieurs d’EDF et du client chinois.
En parallèle, d’autres EPR sont d’ores et déjà en phase d’essais partiels. C’est notre métier – et celui d’EDF et de China General Nuclear Corporation (CGN) – de nous assurer que les leçons des retours d’expérience sont tirées.
Si Olkiluoto est la centrale la plus avancée physiquement, c’est aussi celle qui rencontre le plus de difficultés du point de vue contractuel. Son rythme d’avancement est donc comparativement le plus faible. EDF a annoncé la date de 2016 pour le chargement. Taishan fait figure de challenger et a les moyens d’être le premier réacteur à entrer en fonctionnement. Je ne peux cependant préjuger des résultats de chacun. Au demeurant, nous ne sommes pas dans une course : c’est la sûreté qui prime. Soyez donc assurés qu’il sera tenu compte de chacun des retours d’expérience en temps réel. Nous avons d’ailleurs organisé, avec le client chinois et EDF, une présentation de l’ensemble des essais des quatre EPR en construction et de la façon dont ils seront essayés auprès de l’ensemble des autorités de sûreté intéressées par l’EPR – dont les autorités britannique et américaine. Cette présentation, très appréciée, a montré à la fois la cohérence des essais et certains aspects de prototype.
La construction des deux EPR de Taishan 2 se heurte en effet à moins de difficultés que celle des EPR d’Olkiluoto ou de Flamanville. Tout d’abord, l’attitude du client, très impliqué dans la réalisation du projet, est très différente. Ensuite, on observe une maturité dans le design, car ce sont les troisième et quatrième EPR, lancés après ceux de Flamanville et d’Olkiluoto, mais aussi une maturité de l’exploitant, de l’autorité de sûreté et de la chaîne de fourniture : il se construit trois réacteurs par an en Chine, ce qui vaut des effets volume. Néanmoins, pour l’îlot nucléaire, Taishan 1 et 2 sont encore à 75 % d’origine européenne en termes de design et d’approvisionnement. Mais il est vrai que l’effet de série est important, de même qu’on observe graduellement une localisation en Chine, qui s’appuie sur cet effet de série.
Cela étant, plus l’état du chantier de Taishan se rapprochera de celui des autres EPR
– ce qu’il est en train de faire puisque le circuit primaire est déjà installé alors qu’il ne l’est pas encore à Flamanville –, plus grand sera le risque d’y rencontrer des aspects de prototype.
Qui va payer la facture de l’EPR finlandais ? Permettez-moi d’abord d’observer qu’on ne peut assimiler AREVA au contribuable français : AREVA a d’autres activités que la construction de l’EPR et paye des impôts en France ; il y a des actionnaires minoritaires chez nous. Néanmoins, je suis très attentif à ce point. Nous avons demandé devant le tribunal arbitral de la chambre de commerce internationale 2,7 milliards d’euros au client finlandais, qui a lui-même fait une demande reconventionnelle, pour un montant inférieur. Mais, même si nous sommes confiants dans la solidité de notre dossier, nous n’avons pas anticipé dans nos comptes un éventuel succès de cet arbitrage. À ce stade, c’est donc AREVA qui supporte les coûts. C’est d’ailleurs la raison qui nous a conduits à recourir à l’arbitrage, avec l’attitude de notre client finlandais, qui considère aujourd’hui qu’il peut à peu près tout demander sans en payer les conséquences. Pour notre part, nous estimons que cette position est difficilement défendable.
M. le rapporteur. Pouvez-vous revenir en détail sur ce point ? Nous sommes partis de 3,3 milliards d’euros ; nous arrivons à 8,5 milliards. L’écart est donc d’environ 5 milliards. Vous demandez 2,7 milliards au tribunal arbitral mais, si j’ai bien compris, AREVA a provisionné pour l’ensemble des surcoûts – soit 5 milliards. Pouvez-vous nous redonner les chiffres pour plus de clarté ?
M. Philippe Knoche. Comptablement, nous ne pourrons jamais retrouver ces 8 ou 8,5 milliards, ni par conséquent les 5 milliards dont vous parlez : ces chiffres sont en euros d’aujourd’hui, alors qu’ils ont été constatés au fur et à mesure dans notre comptabilité. Mais, et c’est public, AREVA a comptabilisé une perte de 3,9 milliards – sur laquelle nous réclamons 2,7 milliards au client.
S’agissant de l’estimation de 8 milliards, montant qui reste incertain en l’absence de chiffres publics, je dois préciser que notre partenaire dans le consortium, Siemens, est confronté aux mêmes difficultés que nous. Il a annoncé de fortes pertes et connaît les mêmes difficultés de calendrier qu’AREVA : même si sa turbine est achevée, il n’a réalisé que 4 % des phases de test à ce jour. Cette similitude de situation nous conforte dans l’idée que le client y a une responsabilité. Les 2,7 milliards demandés devant le tribunal arbitral le sont d’ailleurs par le consortium – où, pour mémoire, Siemens entre pour environ 30 % et donc AREVA pour 70 %.
L’ATMEA et l’EPR sont bien deux voies complémentaires. Nous avons entendu dire que la demande du marché porterait majoritairement sur des réacteurs de 1 000 MW, mais cette affirmation ne peut être vérifiée. La Chine développe aujourd’hui le CAP1400, sur lequel elle fonde une partie de son avenir nucléaire, au-delà de l’EPR, et on estime à environ 15 % la part du marché qui est « spécifique 1 000 MW », c’est-à-dire les cas où les exploitants ont indiqué qu’ils n’accepteraient pas de puissance supérieure. Dans les projets en cours, que ce soit en Chine, pour les tranches suivantes de Taishan, en Inde, en Pologne, en Afrique du sud, en Arabie saoudite ou au Royaume-Uni, ce sont le coût du mégawattheure, le risque de construction et la qualité du financement qui sont en débat. Ce sont donc des facteurs de compétitivité économique, de qualité de design et des critères de sûreté qui sont privilégiés, la taille ne jouant que pour une faible part.
À l’autre extrême, 10 à 20 % du marché est « spécifique grande taille ». Par exemple, les pays scandinaves donnant des autorisations pour la construction d’un réacteur sur un site, mieux vaut maximiser la puissance de celui-ci. Voilà donc pour la dynamique de marché.
En ce qui concerne les réacteurs de 1 000 MW, je rappelle que la négociation avec la Turquie se déroule sous leadership japonais – il s’agit d’une négociation exclusive Japon-Turquie. Elle a été engagée sur la base de la construction de quatre ATMEA en Turquie. Par parenthèse, monsieur le rapporteur, si les aléas sismiques sont en effet plus importants dans ce pays qu’en Finlande, il existe des moyens d’en protéger les installations !
Nous développons donc l’ATMEA comme une voie complémentaire, également par paliers. D’une façon générale, nous travaillons sur les nouveaux réacteurs avec EDF, pour développer de nouvelles technologies et être capables de proposer des configurations nouvelles tous les trois ou quatre ans. Cette démarche s’applique aussi bien à l’EPR qu’aux 1 000 MW. Comme je l’ai dit, elle consiste à développer des briques technologiques qui viendront améliorer les produits, et ce toujours en partenariat, que ce soit avec le Japon ou avec la Chine.
S’agissant de l’EPR, ce sont plus de 150 ingénieurs qui vont se consacrer à la seule amélioration du design à moyen et long termes. L’effort est comparable à celui consenti sur l’ATMEA, sachant que l’EPR est dans une situation très différente puisque nous pouvons bénéficier du retour d’expérience des plus de 1 000 autres ingénieurs aujourd’hui mobilisés sur les projets d’Olkiluoto, de Flamanville et de Taishan.
Pour bénéficier de la courbe d’expérience dont vous parliez tout à l’heure et pour gagner plus de 25 % sur le coût de l’EPR, il importe aussi de mieux exécuter à design identique – autrement dit, de ne pas refaire les mêmes erreurs que sur les premiers réacteurs. Nous pouvons d’ores et déjà observer des progrès quantitatifs entre Olkiluoto 3 et Taishan : le nombre d’heures d’ingénierie sur notre périmètre chaudière a baissé de 60 % ; nous avons gagné 50 % sur le temps de construction, 40 % sur les temps de fabrication et jusqu’à 65 % sur les délais d’approvisionnement, notamment grâce à l’effet de série constaté chez les fournisseurs et intégré par les autorités de sûreté. Voilà pour le deuxième axe d’amélioration de la compétitivité de l’EPR.
Le troisième a trait au financement. Il est intéressant de noter que, dans le cas de la Turquie, l’exigence de 2 % de taux de rentabilité interne peut représenter jusqu’à 25 % du coût du mégawattheure. Autrement dit, celui-ci, à EPR identique, n’est pas le même avec un financement finlandais à 5 %, un financement britannique à 10 % ou un financement à taux normal en France. C’est pourquoi EDF fait preuve de prudence en matière de chiffres. Il en va de même pour les énergies renouvelables, compte tenu du poids de l’investissement dans le coût du mégawattheure. Il faut donc toujours comparer à hypothèse de rentabilité identique. C’est pour cela que M. Machenaud a bien situé la problématique de l’EPR d’Hinkley Point dans le contexte compétitif britannique pour confirmer que, dans ce cadre, avec les mêmes coûts et les mêmes taux de rentabilité, le nucléaire est bien compétitif vis-à-vis des autres moyens de production comme il l’est dans d’autres pays.
Toujours s’agissant du financement, j’appelle votre attention sur le fait que nos concurrents étrangers bénéficient de financements à l’export dans lesquels les États – Russie, Japon, mais aussi États-Unis – sont prêteurs directs. Cela ne concerne d’ailleurs pas que le nucléaire, mais tous les grands contrats à l’export. Le système d’export français passe, lui, par les banques. Or celles-ci sont sous très forte contrainte de bilan. Aujourd’hui, nos financements ne sont pas compétitifs en Inde – et dans d’autres pays. Les États-Unis, le Japon ou la Russie proposent en effet des financements à 4 % ou 4,5 %, quand nous sommes plus proches de 6,5 % ou 7 %. Cela affecte fortement la compétitivité de nos offres.
M. le président François Brottes. C’est en effet un barrage à l’entrée. Les modèles ont changé : il faut désormais arriver avec le financement pour monter une opération. Ce n’est pas seulement vrai pour le nucléaire, en effet, et il y a là une question cruciale posée à l’Europe.
L’idée selon laquelle nous prenons davantage de risques en développant un réacteur plus puissant – qui a été avancée aussi bien par les représentants de Greenpeace, ce qui paraît logique, que par M. Repussard, ce qui est plus surprenant – vous semble-t-elle pertinente ?
M. Philippe Knoche. Il est difficile d’entamer un débat avec M. Repussard en son absence… Néanmoins, je crois pouvoir dire qu’aucune autorité de sûreté dans le monde ne s’est exprimée en ces termes. L’autorité finlandaise a estimé clairement que la sûreté de l’EPR se situait au plus haut niveau. Dans l’industrie, et dans l’industrie nucléaire en particulier, des moyens adaptés sont pris en présence de risques supérieurs. Ici, le terme source est supérieur – il y a plus d’assemblages de combustible dans le cœur – mais c’est compensé par un ensemble de moyens adaptés. Les systèmes de refroidissement sont ainsi dimensionnés à proportion de ce qu’est le cœur.
En tout état de cause, une autorité de sûreté ne saurait admettre que le niveau de sûreté soit inférieur parce que le réacteur est plus gros.
M. le président François Brottes. Je souhaite également vous interroger sur le grand carénage, en vue cette fois de prolonger l’exploitation du parc existant. AREVA va être fournisseur ou prestataire de services dans ce projet. Le secret des affaires vous contraint sans doute à une certaine discrétion, mais pouvez-vous nous dire si le montant de 55 milliards d’euros qui est avancé vous paraît totalement exagéré ou au contraire conforme à l’ordre des choses, au moins pour la partie qui vous concerne ? C’est un point qui préoccupe beaucoup le rapporteur – mais nous aurons certainement des devis détaillés d’AREVA.
M. Philippe Knoche. Non seulement des devis, mais aussi des factures ! En effet, les travaux ont déjà commencé. Nous avons lancé des fabrications, notamment de générateurs de vapeur ou de gros composants, qui sont liées au grand carénage. Cela étant, AREVA n’est fournisseur que sur un périmètre limité de ce devis. Je ne peux donc vous fournir que des éléments de comparaison internationale – nous intervenons aujourd’hui dans 360 des 430 réacteurs mondiaux et nous avons donc une certaine visibilité sur les programmes d’allongement de la durée de vie des centrales en cours dans le monde. Je puis donc vous dire que 75 % des centrales américaines ont vu leur vie prolongée jusqu’à soixante ans. Cinquante-cinq milliards d’euros correspondraient quasiment à un milliard d’euros par réacteur ; jamais nous n’avons vu de programme d’investissement approchant de ce montant, même en ne prenant en compte que les autorités de sûreté dont le niveau d’exigence est proche de celui, très élevé, de l’ASN.
M. le rapporteur. Certes, mais il me semble que votre analyse mélange plusieurs choses, dont les générateurs de vapeur qui auraient dû être renouvelés au bout de trente ans. Ne pensez-vous pas que si aucun client n’a mis un milliard par réacteur, c’est aussi parce qu’il y a eu un retard dans l’investissement, spécialement en France ?
M. Philippe Knoche. Quand je parle d’un milliard par réacteur, j’inclus bien les générateurs de vapeur. Les États-Unis, où nous avons 50 % de parts de marché, ont remplacé les leurs, couvercles compris. Malheureusement pour nous, un générateur de vapeur – voire deux ou trois – ne pèse pas dans la dépense par réacteur au point de porter celle-ci à un milliard !
M. le rapporteur. C’est la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui a avancé ce coût de 55 milliards.
M. Philippe Knoche. Je ne suis pas en mesure de porter un jugement sur ce chiffre. Je vous indique simplement qu’aucun de nos clients dans le monde n’a dépensé plus d’un milliard d’euros par réacteur, en une seule fois ou sur une plus longue durée.
M. le président François Brottes. L’une des principales questions posées à notre commission d’enquête est justement celle de la pertinence de cette estimation de 55 milliards. C’est pour cela que nous vous posons cette question.
M. Philippe Knoche. Si vous le souhaitez, nous pouvons essayer de vous fournir quelques éléments sur les programmes d’investissement des exploitants qui ont allongé la durée de vie de leurs centrales, par exemple aux États-Unis, qui sont le pays où les chiffres sont les plus facilement accessibles.
M. le président François Brottes. Avec plaisir.
Mme Frédérique Massat. Nous avons été spectateurs de la « guerre froide » entre EDF et AREVA. A-t-elle eu des conséquences sur l’EPR de Flamanville, notamment sur les retards constatés ? La hache de guerre est-elle vraiment enterrée ?
D’autre part, il me semble que des réflexions sont en cours sur les petits réacteurs de 300 MW. Où en sont-elles ?
M. Philippe Knoche. Les relations entre EDF et AREVA ont pu avoir un impact sur l’EPR de Flamanville : au milieu des années 2000, il est possible que le retour d’expérience entre la Finlande et Flamanville n’ait pas été aussi fluide qu’il aurait pu l’être.
M. le président François Brottes. C’est un facteur de retard que nous n’avions pas identifié jusqu’à présent…
M. Philippe Knoche. Dès que nous l’avons pu, nous avons fait en sorte que des ingénieurs d’EDF soient présents sur le chantier d’Olkiluoto, qui est un peu plus avancé que celui de Flamanville. Je ne peux pas vous confirmer que les relations entre EDF et AREVA ont été un facteur de retard pour Flamanville ; je me borne à constater que le retour d’expérience aurait pu être plus fluide.
Je ne suis pas certain que la hache de guerre ait été déterrée, madame la députée. Quoi qu’il en soit, nous travaillons et nous investissons de mieux en mieux ensemble. Nous sommes de plus en plus au diapason sur la façon d’aborder l’export : nous travaillons main dans la main en Arabie saoudite, en Pologne, en Chine. « L’équipe de France » est donc soudée. Hinkley Point en est un excellent exemple : AREVA a fait un effort exceptionnel pour participer au tour de table ; EDF et AREVA étaient ensemble demandeurs de licence ; l’EPR est le seul à être allé au bout du processus de licensing. C’est la preuve que lorsque nos deux entreprises coopèrent, le succès est au rendez-vous, et pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons techniques. Tous les concurrents ont abandonné ; seuls AREVA et EDF ont été capables – ensemble – de surmonter les obstacles.
Nous développons aussi des technologies nouvelles. À noter que cette « équipe de France » inclut aussi Gaz de France, qui peut être intéressé par l’ATMEA.
Aujourd’hui, il n’y a quasiment aucune construction de réacteurs de plus petite puissance : le marché est très faible. Il faut donc développer une politique d’offre technologique, ce qui implique des innovations. Nous y travaillons en France, en consortium avec EDF, avec DCNS et avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), mais aussi avec des partenaires internationaux, pour développer des briques technologiques qui permettent de créer un écart (gap) de compétitivité. Aujourd’hui, les petits réacteurs se situent au-delà des fourchettes de coût évoquées pour l’EPR ; nous devons donc travailler à les rendre plus compétitifs. Cela dit, ils ont d’autres avantages ; on peut par exemple envisager des coproductions de chaleur. Il y a certainement des choses à faire et nous investissons. Mais cela reste un sujet plus « amont » que les réacteurs de 1 600 ou de 1 000 MW.
M. le président François Brottes. Il nous reste à vous remercier pour vos réponses. Nous n’excluons pas de vous entendre à nouveau avant la fin de nos travaux.
Audition de M. Yves Marignac, directeur de WISE-Paris,
et de M. Sébastien Blavier, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace
(Séance du 26 mars 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314026.pdf
Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente. Je vous prie d’excuser le président François Brottes, dont le train a été retardé.
Messieurs, cette audition s’inscrit dans la suite de celles des 20 et 27 février derniers, consacrées à la question de la prolongation de l’exploitation des centrales nucléaires historiques. Greenpeace a, en effet, commandé au cabinet WISE-Paris un rapport, dont les médias ont beaucoup parlé, qui estime le coût d’une prolongation, dans des conditions de sûreté équivalentes à celles d’un réacteur nucléaire de troisième génération, à plus de 4 milliards d’euros par réacteur, soit quatre fois le montant estimé par EDF. Nous aimerions faire avec vous le point sur ce rapport, ses méthodes et ses conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relatives aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Sébastien Blavier et Yves Marignac prêtent serment)
M. Sébastien Blavier, chargé de campagne nucléaire à Greenpeace. La France est aujourd’hui en situation d’urgence énergétique ; avec ce rapport, nous voulions apporter une pièce supplémentaire au nécessaire débat sur nos choix énergétiques. Je n’ai pas besoin de vous rappeler que la loi sur la transition énergétique doit être débattue dans quelques mois à peine.
Aujourd’hui, une discussion technique sur les critères, les délais, les conditions d’éventuelle prolongation du fonctionnement de nos centrales nucléaires au-delà de quarante ans se déroule entre l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et EDF. Toutefois, le devoir de réserve et de neutralité de l’ASN, d’une part, et l’importance des intérêts industriels d’EDF, d’autre part, nous ont incités à commander ce rapport au cabinet WISE-Paris : nous souhaitons ainsi apporter un autre point de vue. M. Yves Marignac vous le présentera dans quelques instants.
J’insiste d’ores et déjà sur l’une de ses conclusions : pour que les bons choix énergétiques puissent être faits, pour structurer les filières industrielles du futur, il y a un besoin urgent de prévisibilité du cadre réglementaire. Pour Greenpeace, vous le savez, l’avenir réside dans les énergies renouvelables ainsi que dans les économies d’énergie.
M. Yves Marignac, directeur de WISE-Paris. Je vous remercie de votre invitation à présenter cette étude, dont vous allez constater que le champ est bien plus vaste que celui qui a été retenu par les présentations médiatiques qui en ont été faites.
L’échéance des quarante ans approche, et EDF s’est engagée dans une stratégie de prolongation de la vie de ses centrales, malgré les alertes lancées tant par la Cour des comptes que par l’ASN sur les obstacles que pourrait rencontrer cette stratégie. La plus grande incertitude règne sur les conditions dans lesquelles une telle prolongation est envisageable.
Mon rapport contient d’abord une étude détaillée, sur les plans technique et réglementaire, des caractéristiques du parc nucléaire français, qui présente des singularités fortes. Il analyse ensuite les enjeux de sûreté liés à la fois au vieillissement et au retour d’expérience de Fukushima, puis confronte ces données au renforcement déjà engagé ou prévu, conformément aux prescriptions de l’ASN. Je présente alors trois scénarios, avec différents niveaux d’exigence, et enfin une évaluation économique de ces différents scénarios.
Le parc nucléaire français est standardisé. Cela présente l’avantage indéniable de permettre un traitement générique de la prolongation, avec toutefois pour revers de la médaille un risque générique pesant sur la faisabilité de la stratégie de prolongation. La pyramide des âges du parc nucléaire pose problème, avec un « effet falaise » : 80 % des réacteurs ont été mis en service en dix ans, entre 1977 et 1987. L’examen du calendrier des réexamens de sûreté pose aussi problème, puisque l’on constate d’importantes fluctuations. Il existe un glissement important entre l’âge réglementaire et l’âge technique : selon mon décompte, vingt-sept réacteurs ont plus de trente ans de fonctionnement aujourd’hui, mais seulement cinq d’entre eux ont passé le cap réglementaire des trente ans, c’est-à-dire qu’ils ont reçu une autorisation de l’ASN de poursuivre leur exploitation jusqu’à l’âge de quarante ans. Cette décision a été obtenue après trente-quatre ans en moyenne de fonctionnement. Il y a donc un vrai problème : nous ne disposons aujourd’hui d’aucune définition claire de la date à laquelle chaque réacteur atteint l’âge de quarante ans ; on ne sait s’il faut compter à partir de la mise en service, du démarrage ou s’il faut prendre en considération un seuil technique, tel que l’irradiation cumulée des cuves, par exemple.
S’agissant maintenant des exigences de sûreté, le problème est triple : outre qu’il est nécessaire de compenser la dégradation liée au vieillissement par des renforcements, l’accident de Fukushima a incité à relever les exigences de sûreté. Dans le même temps, il faut aussi constater une incertitude sur l’état réel des installations : au fur et à mesure que l’écart entre l’état théorique et l’état réel s’accroît – le premier étant meilleur que le second –, on prend le risque que l’état réel ne corresponde plus aux exigences de sûreté.
Deux visions s’opposent donc : pour les uns, on peut, par le renforcement, compenser le vieillissement et conserver une marge de sûreté suffisante par rapport à des exigences de sûreté même accrues ; pour les autres, inéluctablement, le vieillissement nous empêchera de respecter les exigences de sûreté.
Concrètement, plusieurs problèmes de sûreté se posent. Il y a d’abord les limites irréductibles du dimensionnement initial des réacteurs. Ceux-ci ont été conçus pour fonctionner durant quarante ans au maximum. En particulier, la cuve a été conçue pour trente années de fonctionnement à pleine puissance, c’est-à-dire quarante ans en fonctionnement réel. Les réacteurs ont également été conçus pour l’essentiel avant les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, c’est-à-dire que n’ont pas été pris en considération ce que l’on appelle aujourd’hui les accidents graves. Ce sont des limites difficiles à dépasser. De plus, les problèmes inéluctables de vieillissement concernent tant les gros composants que l’on ne peut pas remplacer, comme la cuve et les enceintes, que les équipements diffus – ouvrages de génie civil, tuyauteries et câbles électriques, notamment.
Enfin, il faut achever de tirer les conséquences de l’accident de Fukushima, ce qui prendra une dizaine d’années : la « défense en profondeur » a présenté des défaillances majeures, ce qui conduit à réévaluer le risque d’accident grave et majeur des réacteurs, et surtout à mettre en évidence le risque d’accident grave sur les piscines d’entreposage du combustible.
De nombreuses questions restent ouvertes. L’ASN travaille à des prescriptions nouvelles, dans le triple cadre des visites décennales, des évaluations complémentaires de sûreté et des prescriptions sur les noyaux durs. Sur cinquante-cinq prescriptions génériques ou spécifiques à quelques réacteurs faites par l’ASN après l’accident de Fukushima, huit seulement sont directement applicables ; toutes les autres renvoient à des études qui doivent encore être faites, donc à de grandes incertitudes, tant sur le niveau des exigences de sûreté que sur la faisabilité des solutions à ces problèmes.
S’agissant des processus de décision, l’actuel schéma du réexamen de sûreté ne prévoit aucune phase de concertation, ce qui ne correspond plus aux principes d’accès à l’information et de participation du public. Au-delà, la décision de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires implique un changement de référentiel de sûreté, et donc, je crois, une « modification notable » au sens de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN. Juridiquement, cette prolongation pourrait être assimilable à une nouvelle autorisation, ce qui implique un décret spécifique, une étude d’impact, une enquête publique, voire, en fonction du niveau d’investissement, une saisine de la Commission nationale du débat public.
Je n’insiste pas sur le point très important, que vous connaissez bien, de la nécessaire cohérence des décisions d’éventuelle prolongation – ou fermeture – avec la trajectoire énergétique, et en particulier avec l’engagement pris par le Président de la République de réduire à 50 % la part du nucléaire en 2025.
Il faut enfin prendre en considération le calendrier de réalisation : d’abord, les décisions risquent d’être repoussées, dans les conditions que j’expliquais tout à l’heure ; il existe aussi un délai de déploiement et d’exécution des décisions prises. L’effet « falaise » que j’évoquais entraînera de toute façon un pic de charge, sur lequel l’ASN a déjà attiré l’attention : cela concerne l’ASN elle-même, l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) et EDF.
Après cet état des lieux, nous avons adopté une démarche prospective en déterminant cinq facteurs discriminants : référentiel de sûreté, maintenance pour assurer la conformité de l’installation, orientation technique, processus de décision, délais de réalisation. Il s’agit bien de prospective, c’est-à-dire que ces scénarios ne sont ni des prévisions ni des prescriptions, mais des visions cohérentes en fonction de différents niveaux d’exigence. Nous avons défini trois scénarios : sûreté « dégradée », sûreté « préservée » et sûreté « renforcée », ce troisième scénario correspondant à la recherche aussi systématique que possible de niveaux d’exigence de nouveaux réacteurs de type EPR. L’étude détaille, en neuf catégories, trente-six postes de renforcement avec, pour chaque scénario, une caractérisation technique des renforcements associés.
Une fois effectué ce travail d’analyse technique des opérations nécessaires – renforcement du bâtiment réacteur, de la piscine, du noyau dur –, j’ai essayé d’estimer l’ordre de grandeur des coûts associés. Les données disponibles en ce domaine sont peu nombreuses, et de toute façon ces opérations sont très souvent inédites. J’ai donc travaillé prudemment, en retenant des fourchettes d’incertitude très larges, jusqu’à un facteur 3 pour certains postes.
Je n’ai estimé que les coûts directs – coûts d’investissement et d’intervention – des renforcements liés à la sûreté, c’est-à-dire à la protection contre les événements accidentels. Je n’ai donc tenu compte ni des renforcements qui seraient liés à la sécurité, c’est-à-dire à la protection contre des actes de malveillance, ni des coûts de jouvence pour la partie conventionnelle du réacteur, c’est-à-dire turbine, alternateur et autres. Je n’ai pas non plus tenu compte des coûts indirects, tels que les coûts de constitution de stocks destinés à faire face à l’obsolescence de certaines pièces ou ceux liés à une éventuelle limitation d’exploitation au-delà de quarante ans. Enfin, je n’ai pas tenu compte des coûts que pourrait engendrer une immobilisation longue des réacteurs pour des opérations très lourdes : il y aurait une perte de productivité, mais aussi des coûts financiers associés.
De la sorte, j’arrive à une estimation de 350 millions d’euros, plus ou moins 150 millions, pour le scénario de sûreté « dégradée » ; de 1,4 milliard, plus ou moins 600 millions, pour le scénario de sûreté « préservée » ; et enfin de 4 à 5 milliards pour un scénario de sûreté « renforcée ».
Les fourchettes d’incertitude, je le souligne, ne modifient pas l’ordre des scénarios ni les ratios entre les scénarios. En revanche, une analyse de sensibilité montre que, dans le scénario de sûreté « dégradée », cinq postes représentent 50 % de l’incertitude de coût : ce sont les postes de « moyens ultimes » ; dans un scénario de sûreté « renforcée », quatre postes représentent 50 % de l’incertitude, mais ce sont cette fois les postes liés à la bunkerisation du bâtiment combustible, de la salle de commandes et du centre de crise ; dans le scénario médian, les coûts sont répartis plus uniformément. Un quart des postes constituent deux tiers de l’écart des coûts entre les scénarios, et pour la plupart ce sont des postes cruciaux pour atteindre des niveaux de sûreté élevés. Pour ces opérations inédites, les coûts sont extrêmement incertains : ainsi, pour le bâtiment piscine, j’ai retenu une fourchette entre 500 millions et 1,5 milliard d’euros.
L’échéance des quarante ans est très proche, même si elle est mal définie ; l’effet falaise impose une action urgente et massive. La prolongation au-delà de quarante ans de la vie des centrales excède les possibilités actuelles des centrales, et il n’est pas sûr qu’elle soit possible à de hauts niveaux de sûreté. Il semble nécessaire, pour maintenir des exigences élevées, de fixer un nouveau référentiel de sûreté spécifique aux centrales éventuellement prolongées, ce qui impose un processus complet d’autorisation, donc une enquête publique, un débat public. Aujourd’hui, le risque est grand d’aller vers des prolongations par défaut et par fait accompli dans un cadre réglementaire et politique insuffisant. D’un point de vue économique, les coûts liés à la prolongation restent très incertains et pourraient atteindre jusqu’à quatre fois les estimations actuelles, si l’on veut respecter des exigences fortes.
Dans ce cadre, l’engagement par EDF d’investissements sans visibilité réglementaire est une mauvaise pratique industrielle, porteuse de risques industriels et financiers importants. Compte tenu des incertitudes, des contraintes réglementaires, des délais, et de la capacité industrielle et financière d’EDF, le maintien de la capacité nucléaire à son niveau actuel ne me semble pas une option réaliste.
M. Denis Baupin, rapporteur. Merci de cette présentation très intéressante d’une étude réalisée par un organisme indépendant. Certes, il demeure des incertitudes, mais nous disposons là d’une vision globale et d’une base solide de réflexion technique, juridique, économique, politique.
Avez-vous pu débattre de vos conclusions avec l’ASN ?
Dans le troisième scénario, qui semble le plus proche des objectifs fixés par l’ASN pour une prolongation de la vie des centrales, existe-t-il des solutions alternatives moins coûteuses ? Votre chiffrage inclut-il le « grand carénage », qu’EDF estime déjà à 55 milliards pour l’ensemble du parc à l’horizon 2025, et jusqu’à 100 milliards peut-être par la suite ?
Quant à la question du seuil d’irradiation de la cuve, qui a été conçue pour fonctionner durant quarante ans, existe-t-il une possibilité technique de la remplacer, ou bien est-il simplement possible de changer la norme ? Dans ce dernier cas, s’agit-il d’une dégradation de la sûreté ou bien d’une simple adaptation ? Savez-vous combien de réacteurs disposent d’une cuve susceptible d’être utilisée pendant plus de quarante ans ?
Avez-vous calculé le seuil de rentabilité de tels investissements pour EDF ?
Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente. Parmi les cinquante-cinq prescriptions de l’ASN, huit, avez-vous dit, sont directement applicables. Qu’en est-il des autres ? EDF n’a-t-elle pas fait de proposition, ou bien fait des propositions qui n’ont pu être retenues ?
Avez-vous pu évaluer le coût des prescriptions qui restent à mettre en œuvre ?
M. Yves Marignac. Huit des cinquante-cinq prescriptions sont des instructions immédiatement applicables : l’ASN a, par exemple, ordonné le relèvement du niveau de protection volumétrique contre les inondations. Les autres prescriptions demandent des études. Il n’y a pas de défaut de réponse d’EDF, mais les solutions techniques n’existent pas encore. Il faut d’abord les mettre au point, puis en passer par une démonstration de sûreté qui prend en considération tous les paramètres : ainsi, il ne suffit pas de faire fonctionner un récupérateur de corium, il faut aussi montrer que, quel que soit le scénario d’accident, il n’y aura pas d’interaction eau-corium qui provoquerait, par exemple, une explosion qui serait pire que ce que l’on cherchait à éviter. C’est un exercice très long : le président de l’ASN a estimé que l’analyse du retour d’expérience de Fukushima prendrait dix ans, mais il faut bien comprendre que ce sont dix ans avec une charge de travail en progression constante. Cette durée pose d’ailleurs problème, car la question de la prolongation est urgente.
Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente. Les solutions restent donc à trouver, mais les objectifs fixés peuvent être atteints.
M. Yves Marignac. Pas nécessairement, car la faisabilité n’est pas acquise sur certains points : l’objectif de récupération du corium demande des études approfondies, un énorme travail de recherche de solutions techniques, ce qui est bien normal. Pour autant, il n’est pas sûr du tout qu’il aboutisse.
Les coûts associés ont été pris en considération dans le rapport.
S’agissant de la réception de ce rapport, nous n’avons malheureusement pas eu d’échanges avec EDF, et j’ignore quelle a été leur réaction. Nous avons présenté l’étude à l’ASN avant de la rendre publique : ni les chiffres, ni les niveaux d’incertitude ne les ont surpris ; les neuf catégories et les trente-six postes de renforcement correspondent aux questions que l’ASN considère aujourd’hui comme ouvertes. J’ai également présenté ce rapport à différents cabinets ministériels, qui s’interrogent non seulement sur les enjeux réglementaires mais aussi sur la viabilité de la stratégie industrielle d’EDF. Des échanges sont prévus avec l’IRSN ainsi qu’avec la CRE (Commission de régulation de l’énergie), car l’originalité de ce rapport est de relier problèmes de sûreté et problèmes économiques, ce que ne font pas les services de l’État.
S’agissant des seuils de rentabilité, je n’ai pas fait de calculs pour rapporter les coûts de renforcement au coût du kilowattheure, mais c’est un point majeur. Il revient à EDF de répondre à cette question, en indiquant quels seraient ces seuils de rentabilité en cas de prolongement pour dix ans ou pour vingt ans – ce ne sont pas les mêmes opérations. Est-il envisageable d’atteindre des niveaux de sûreté s’approchant de ceux de l’EPR tout en ne dépassant pas le seuil de rentabilité ? Aujourd’hui, je ne sais pas vous répondre.
Quant à d’éventuelles solutions alternatives moins coûteuses que celles proposées par le troisième scénario, pour le bâtiment combustible, il n’y en a, je crois, pas beaucoup. Le renforcement des enceintes est nécessairement très coûteux. Le premier scénario ne comprend aucun renforcement de l’enceinte ; dans le deuxième, j’ai retenu un effort de renforcement, sans aller jusqu’à une bunkerisation ; dans le troisième, j’ai retenu la mise en place d’une enceinte en béton résistante. L’IRSN et l’ASN considèrent que la conception des piscines et des circuits de refroidissement empêche d’écarter totalement le risque de vidange des piscines : dès lors, il est nécessaire que l’enceinte soit robuste. Je ne vois pas d’alternative.
M. le rapporteur. Serait-il envisageable de construire une nouvelle piscine, plutôt que de bunkeriser la piscine existante ?
M. Yves Marignac. On peut envisager un nouvel entreposage de combustible, notamment en vue de créer un entreposage de plus longue durée que la simple désactivation des combustibles ; cela renvoie à des questions plus générales de gestion du combustible dans lesquelles je ne peux pas entrer aujourd’hui. Cela pourrait constituer une bonne solution à certains problèmes. Mais, dans tous les cas, la piscine accolée au bâtiment réacteur est nécessaire : il y a là, de toute façon, un point de fragilité. Il est donc indispensable, dans tous les cas de figure, de renforcer la piscine actuelle.
Quant au grand carénage, les scénarios proposés par mon rapport le recoupent partiellement : mes évaluations ne prennent pas en considération, je l’ai dit, la jouvence de l’îlot conventionnel, contrairement, je crois, au chiffrage d’EDF ; à l’inverse, certaines opérations que j’ai prises en compte ne le sont pas par EDF. À vrai dire, il m’est difficile de répondre de façon détaillée à cette question : mes informations sur le détail de ce qui est compris dans le grand carénage demeurent insuffisantes, même après les auditions d’EDF par votre commission. Mon sentiment est que le chiffrage d’EDF se situe quelque part entre le premier et le deuxième scénario, l’orientation de l’ASN se situant, elle, quelque part entre le deuxième et le troisième scénario. Le scénario de sûreté « renforcée » est, en effet, une application systématique des exigences – par exemple, à la fois un récupérateur de corium et une enceinte géotechnique autour du bâtiment réacteur –, ce qui peut être considéré comme redondant. Il n’y a donc pas forcément besoin, pour atteindre un niveau de sûreté élevé, d’appliquer toutes les solutions disponibles. En revanche, il est certain qu’il faut aller bien au-delà du 1,4 milliard prévu par le deuxième scénario.
Enfin, un seuil d’irradiation a été prévu lors de la conception de la cuve. Au-delà de ce seuil, il existe un risque de fragilisation de la cuve, qui peut passer d’un état ductile à un état fragile : en cas de choc thermique, en particulier, la cuve peut se rompre. Ce serait là un accident majeur, qui reste écarté par conception dans la démonstration de sûreté : autrement dit, si ce scénario se produisait, l’ensemble des dispositifs prévus pour assurer la sûreté seraient défaillants. Le critère de sûreté actuel est un critère de « non-amorçage » : une fissure ne doit pas pouvoir commencer à se former. EDF cherche aujourd’hui à engager la discussion avec l’IRSN et l’ASN pour remplacer ce critère par « l’arrêt de fissure » : une fissure pourrait commencer, mais les conditions seraient telles qu’elle ne serait pas traversante. Cela constituerait évidemment, à mon sens, une dégradation des exigences de sûreté, et j’ai le sentiment que l’ASN partage cette position ; mais cela fait partie des discussions en cours. Cela renvoie à ce que j’appelais le changement de référentiel : soit l’on accepte cette dégradation, mais alors il faut prévoir des renforcements ailleurs pour se garantir contre l’accident grave ; soit l’on veut éviter cette dégradation, et alors il faut prévoir d’autres types de renforcements. En 2010, l’IRSN avait publié une étude indiquant que neuf réacteurs de 900 mégawatts seraient concernés par ce seuil de fragilisation à l’échéance VD3+ 5 ans, c’est-à-dire cinq ans après la troisième visite décennale, donc bien avant l’échéance des quarante ans. Aujourd’hui, la solution apportée est de préchauffer l’eau qui serait injectée en cas de perte de liquide réfrigérant du circuit primaire, afin de ne pas provoquer de choc thermique. C’est une illustration de ce que l’on peut considérer, de mon point de vue, comme une dégradation de la sûreté ou, au mieux, une préservation du niveau de sûreté actuel : ce n’est pas le type de solution de nature à nous amener à un niveau de sûreté de type EPR.
Mme Frédérique Massat. Vous dites manquer de données publiques détaillées : avez-vous eu du mal à accéder à l’information ? Comment avez-vous fait ? Les marges d’estimation paraissent très importantes puisqu’elles vont quasiment du simple au double. Pouvez-vous également expliquer ce que sont les « variations locales » que vous évoquez ?
S’agissant des capacités industrielles et financières d’EDF, sur quoi repose votre analyse ? L’entreprise fait beaucoup appel à la sous-traitance : avez-vous analysé cet aspect ?
Sans faire aucun lien avec ce rapport, pouvez-vous revenir sur la toute récente intrusion de Greenpeace à Fessenheim ?
S’agissant de la future loi de transition énergétique, j’ai compris que Greenpeace demande que la loi fixe l’âge limite des réacteurs à quarante ans, et souhaite l’inscription d’un objectif de 45 % d’énergies renouvelables en 2030. Aujourd’hui, l’exécutif s’est fixé un objectif de 50 % de nucléaire en 2025 : cela veut-il dire que vous êtes moins ambitieux ?
Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente. L’incertitude sur les coûts paraît effectivement très grande.
M. Yves Marignac. Pour estimer les coûts, je me suis astreint à travailler à partir de données publiques, provenant d’EDF notamment, mais aussi de la littérature internationale, surtout américaine ; beaucoup d’opérations de renforcement ont, en effet, été conduites aux États-Unis. S’il existe des publications spécialisées, comme Nucleonics Week, qui donnent de nombreuses informations, nous ne disposons toutefois que de peu d’informations publiques. Nous manquons également de points de référence puisque beaucoup d’opérations sont inédites.
On trouve, par exemple, des chiffres de l’ordre de 1 milliard d’euros pour la bunkerisation d’une piscine. Si l’on prend en considération le coût de l’investissement et celui de l’opération elle-même, cet ordre de grandeur paraît parfaitement raisonnable ; mais, parce que l’incertitude reste grande, j’ai pris des précautions en donnant une fourchette de 500 millions à 1,5 milliard. Une fois ces incertitudes signalées, il me semble surtout important de souligner que l’ordre des scénarios reste le même, tout comme le ratio entre eux. Dans la frange basse du scénario de sûreté « renforcée », on est tout de même à 2 milliards, voire 2,5 milliards.
Quant aux variations locales, elles peuvent être nombreuses : les contraintes sismiques et l’histoire de chaque réacteur diffèrent. C’est pour cette raison que je me suis refusé à extrapoler un chiffrage moyen par réacteur à un chiffrage sur l’ensemble du parc, car cela demanderait un travail plus fin.
S’agissant enfin d’EDF, je n’ai pas analysé le tissu de sous-traitance, ni d’ailleurs le tissu de fournisseurs, nécessaire aux opérations de maintenance. L’ASN elle-même a constaté les difficultés rencontrées pour la construction de l’EPR comme pour la maintenance des centrales en activité. Dans les conditions actuelles, il ne paraît pas réaliste d’envisager en plus le lancement des chantiers nécessaires au renforcement de 80 % des réacteurs, qui devraient s’étaler sur une dizaine d’années, avec cinq à dix tranches à traiter en parallèle.
M. Sébastien Blavier. Concernant les récentes intrusions de Greenpeace à Fessenheim et à Gravelines, il ne s’agissait pas de démontrer une faille de sécurité – même si cela peut être une conséquence indirecte de notre action –, mais de lancer un appel au chef de l’État, et plus largement aux décideurs européens : une véritable transition énergétique est nécessaire.
En nous appuyant sur des expertises très solides telles que celle présentée aujourd’hui par WISE-Paris, nous demandons que la durée de fonctionnement de nos réacteurs nucléaires soit limitée à quarante ans. L’objectif que nous souhaitons voir fixer est de 45 % d’énergies renouvelables – il faut bien, ici, distinguer entre électricité et énergie. La promesse de François Hollande concerne le mix électrique ; nous parlons, nous, d’énergie, donc de tous les secteurs confondus. Selon nous, la limitation de la durée de fonctionnement des réacteurs constitue le meilleur moyen pour le Président de la République de tenir sa promesse : cela permet d’anticiper, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui alors que c’est pourtant absolument nécessaire. EDF ne peut pas établir de scénarios en fonction des niveaux de sûreté exigés, puisqu’elle ne les connaît pas. Dès lors qu’on ne peut rien prévoir, on risque d’être placé devant le fait accompli. Les pouvoirs publics doivent donc agir.
Je vous remercie encore de nous avoir reçus aujourd’hui.
Audition de M. Laurent Michel, directeur général de l'Énergie et du climat, et de M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l’Énergie (ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie)
(Séance du 26 mars 2014)
Mme Marie-Noëlle Battistel, présidente. Le président Brottes, bloqué dans le train, me demande de vous présenter ses excuses. Il ne saurait tarder à nous rejoindre.
La commission d’enquête arrive au terme de ses auditions consacrées aux coûts de la prolongation du parc nucléaire et du déploiement de la troisième génération de réacteurs. C’est pourquoi elle a souhaité entendre la direction générale de l’énergie et du climat sur cette question qui sera au cœur de la discussion du projet de loi sur la transition énergétique.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relatives aux commissions d’enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Laurent Michel et Pierre-Marie Abadie prêtent serment)
M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). Le devenir du parc de production électrique recouvre des aspects multiples ; il ne saurait être réduit à la comparaison des coûts entre les deux options de la prolongation ou du renouvellement des centrales. Il s’inscrit dans une réflexion sur la politique énergétique et climatique, et sur les conséquences de celle-ci sur l’électricité, au regard notamment de la maîtrise de la demande et du transfert d’usage des énergies fossiles vers l’électricité décarbonée, mais aussi sur la diversification du parc, dans un souci de sûreté et de sécurité de l’approvisionnement. C’est, pour une part, le sens de l’objectif d’abaisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.
Outre la politique énergétique et climatique, les décisions à venir doivent prendre en compte de nombreux autres critères. En matière de sûreté, des critères généraux doivent être définis pour la prolongation éventuelle des réacteurs, au plan générique, et doublés d’un examen au cas par cas, qui relève de la responsabilité de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Sans vouloir interférer, nous suivons attentivement ce travail déterminant pour les choix futurs. Doit également être examinée la capacité physique à déployer un nouveau parc – qu’il s’agisse de prolongation ou de construction, d’énergie nucléaire ou de renouvelable –, qui soulève des questions réglementaires, d’acceptabilité ou de lissage industriel ; que ce soit pour une prolongation ou pour des constructions nouvelles, il y aura un surcroît d’investissements et de travaux que les graphes retraçant, par exemple, les dates de construction des centrales montrent clairement. Enfin, sur le plan économique, les investissements nécessaires et les coûts opératoires globaux – construction, réseau, stockage – doivent être évalués.
Le lissage dans le temps – et, entre autres, la prolongation des centrales – présente un intérêt économique en ce qu’il permet de développer et d’optimiser des technologies, tant dans le domaine des énergies renouvelables que pour un nouveau parc nucléaire. Dans le cas d’un remplacement de centrale existante par du nouveau nucléaire, cette méthode laisserait le temps d’optimiser le développement et les coûts de l’EPR ou d’autres moyens, ce que la construction simultanée de plusieurs EPR ne permet pas. L’intérêt du lissage pour la transition vaut également pour d’autres options de production.
M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l’énergie (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). L’approche par les coûts et les investissements doit être replacée dans un contexte général, car elle est un peu réductrice.
Selon le rapport de la Cour des comptes de 2012, qui est en cours d’actualisation, le coût de l’électricité nucléaire historique (y compris les investissements de prolongation) se situe entre 38 euros en 2010 – 43 aujourd’hui – et 50 euros par mégawattheure. Il ne faut pas oublier qu’un coût est une réponse à une question. L’écart de 7 euros avec les coûts avancés à l’époque par EDF s’explique par la méthodologie retenue, qui diffère selon que l’on veut évaluer les coûts comptables, économiques ou de régulation du parc historique. En l’espèce, il est lié à la rémunération des capitaux investis passés et à deux conceptions différentes de la régulation. Avec la méthode Champsaur, on considère ce qui reste à payer ; dans une vision de coût économique, on calcule ce que coûterait la reconstruction du parc dans les conditions de l’époque mais aux coûts actuels. Cette dernière approche n’a pas d’intérêt du point de vue de la régulation.
Selon la méthode Champsaur, le coût moyen, qui intègre la prolongation de la durée de vie, s’établissait en 2011 à 39 euros, dont 25 pour les charges opérationnelles, 8 pour les investissements futurs (maintenance et allongement de la durée de vie) et 6 pour le capital investi. Après Fukushima, ce chiffre a été réévalué à 42 euros pour tenir compte du renchérissement du coût et de l’accélération des investissements auxquels cet événement a conduit.
Dans le projet de décret relatif au calcul de l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique), le coût de l’électricité nucléaire a été fixé à 42 euros par mégawattheure pour la période 2011-2025, ce qui correspondrait à 46 euros pour la période 2014-2025, traduisant un effet de rattrapage de 10 % cohérent avec les indications qu’avait pu donner il y a quelque temps le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Pour ce calcul, nous avons choisi d’assimiler tous les investissements à des dépenses d’exploitation (OPEX) sans les amortir, par souci de prudence et afin de ne pas avoir à différencier ce qui relève de la maintenance ou de l’allongement de durée de vie ou d’investissements de toute autre nature.
S’il fallait doubler les investissements en faveur de la maintenance et de la prolongation des centrales, le prix actuel du mégawattheure de l’ARENH se verrait renchéri de 10 euros. Il resterait néanmoins dans une fourchette comprise entre 50 et 60 euros, bien au-dessous du prix d’un nouveau mix, qu’il soit nucléaire ou d’une autre nature, que l’on peut situer dans une fourchette de 80 à 100 euros par mégawattheure.
Il est difficile de déterminer ce que serait le coût du nucléaire en série à partir des seuls exemples de têtes de série français, finlandais et britannique – en ayant à l’esprit qu’au Royaume-Uni, les coûts d’ingénierie, de BTP, etc. sont bien plus élevés. On peut néanmoins estimer le coût du nouveau nucléaire entre 80 et 100 euros du mégawattheure. L’ordre de grandeur serait similaire pour les énergies renouvelables, entre 75 et 80 euros pour l’éolien, auxquels il faut ajouter le coût de l’intermittence, et entre 70 et 75 euros pour les centrales à gaz. Les coûts sont donc sensiblement supérieurs à ceux de la simple prolongation.
Je répète que cette vision exclusivement économique et financière est réductrice.
S’agissant du montant des investissements nécessaires, on dispose essentiellement d’ordres de grandeur, étant entendu que le détail dépendra des résultats de la discussion entre EDF et l’ASN. On a quand même de la part d’EDF une vision globalisée du montant des investissements, dont il faut bien voir qu’ils concernent des opérations très différentes : sous l’appellation de « Grand carénage », il y a une part de communication vis-à-vis du tissu de PME à mobiliser et des autres acteurs industriels ; le programme regroupe d’ailleurs des investissements nécessaires à date de 30 ans, d’autres qui sont nécessaires pour prolonger la durée de vie, d’autres enfin qui relèvent plutôt de rénovations variées. Selon l’estimation d’EDF, ces investissements s’élèveraient à 55 milliards d’euros pour la période 2014-2025. Initialement, ils portaient sur la période 2012-2025, ce qui a conduit certains à avancer un coût final de 70 milliards. Dans le cadre de l’exercice de détermination de l’ARENH, la DGEC a aussi utilisé des courbes fournies par EDF. Ces courbes ont plutôt vocation à être un majorant, pour deux raisons : en premier lieu, parce qu’elles prévoient que les investissements porteront sur tous les réacteurs, alors que certains pourraient ne pas être prolongés pour des raisons de sûreté ou de politique énergétique ; en second lieu, il est dans l’intérêt d’EDF de gonfler ce chiffre dans le cadre du calcul de l’ARENH. Dans ce contexte, les investissements de maintenance de toute nature ont été évalués à 3,7 milliards d’euros par an, contre un flux de 1,7 milliard d’euros aujourd’hui.
Les sommes en jeu sont importantes mais doivent être relativisées au regard des investissements habituels. Ce programme constitue un véritable défi industriel : il s’agit de mobiliser et d’organiser tout le tissu industriel avec la visibilité nécessaire. Nous avons encore à mieux comprendre la nature et le calendrier de ces investissements de 3,7 milliards par an ainsi que la rentabilité propre de chaque opération. Certaines opérations ont clairement une rentabilité propre dès lors qu’il y a une stratégie générale de parc et l’on peut accepter des “coûts échoués” sur telle ou telle centrale qui n’est finalement pas prolongée ; il existe des investissements beaucoup plus lourds et qui nécessitent de savoir plus finement quelle est la stratégie palier par palier, voire centrale par centrale.
Au regard des investissements actuels, le montant annoncé ne semble pas insurmontable. En 2013, les comptes d’EDF affichaient pour la France des investissements de 9,3 milliards d’euros – 3,5 pour les activités de réseau, plus de 5 milliards pour les activités non régulées et 1,4 milliard pour Réseau de transport d’électricité (RTE). À l’échelle internationale, les investissements opérationnels du groupe représentent 13,3 milliards. Le plan à moyen terme 2014-2016 prévoit des investissements annuels de 7 milliards pour les activités non régulées, de 3,5 milliards pour les activités de réseaux et de 400 millions pour les activités insulaires, qui couvrent les zones non interconnectées, ainsi qu’un investissement annuel du groupe de 15,7 milliards. Les investissements envisagés sont donc cohérents avec les montants qu’EDF a l’habitude de manier. À titre de comparaison, dans l’éolien, les investissements s’élèvent à 1,5 milliard d’euros par an pour un gigawatt.
M. Laurent Michel. Certains points en rapport avec les investissements méritent encore d’être approfondis. Le grand carénage traduit la vision d’EDF de la prolongation de la durée de vie des centrales. Ces prévisions ne garantissent pas l’acceptation générique et au cas par cas de l’ASN ni, par conséquent, l’émergence de besoins supplémentaires.
Les prévisions d’investissement dans la filière nucléaire intègrent des constantes de temps – huit ans pour un projet de générateur de vapeur ; huit à dix ans pour les moyens de production lourds et de transport. Pour les premiers parcs éoliens offshore, l’appel d’offres a été lancé en 2011 pour une mise en service à partir de 2018. Pour une grand projet de ligne de transport, la durée du projet est également de 8 à 10 ans, en ordre de grandeur. Le besoin d’anticipation industrielle et politique est donc important.
La maturité des technologies et les limites physiques, par exemple des gisements, sont d’autres paramètres qu’il ne faut pas négliger. Pour l’éolien terrestre, qui est la source d’électricité la plus mature et la moins chère, l’augmentation annuelle de capacité, tombée à 800 mégawatts, remonte, et l’on parviendra rapidement à 1 200 mégawatts grâce aux mesures de simplification et de clarification du cadre financier. Toutefois, on plafonnera assez vite autour de 1,5 gigawatt par an, faute de gisements, les meilleurs étant déjà exploités par les premiers parcs éoliens. Il faudra donc attendre l’obsolescence de ce dernier, vers 2025-2030, pour le remplacer par des machines nouvelles. Le rythme de construction de nouveaux EPR se heurtera de la même façon à des limites physiques.
Tout comme la prolongation des centrales, ce temps pourrait permettre d’optimiser et de développer les technologies, y compris de stockage. Pour l’éolien offshore, les deux premiers appels d’offres portaient sur une capacité de production de 3 gigawatts. En 2014, commence la recherche d’un site pour l’implantation d’un nouveau parc pour lequel on espère une diminution des coûts grâce au retour d’expérience. Mais la nouvelle frontière, c’est l’éolien flottant que la régularité des vents rend, selon ses promoteurs, moins cher malgré une plus grande distance de raccordement. Dans quelques années, des fermes pilotes seront installées, suivies par des parcs commerciaux.
Cette dimension temporelle de la transition énergétique, nous avons proposé au ministre de l’appréhender en dotant l’État d’outils adaptés. D’abord, la stratégie nationale bas carbone fixerait pour toutes les énergies et les émissions de gaz à effet de serre des objectifs sur quinze ans, révisés tous les cinq ans, et définirait des politiques publiques consacrées. Ensuite, une programmation pluriannuelle de l’énergie, sur une période de cinq ans, rassemblerait et compléterait les programmations existantes (électricité, gaz, chaleur) mais comporterait aussi des volets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Notre proposition a été soumise à la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique. Les deux outils envisagés, qui seraient présentés au Parlement et révisés périodiquement – c’est important –, seraient un gage de visibilité pour les pouvoirs publics et les investisseurs.
M. Pierre-Marie Abadie. Le temps est une donnée importante, à la fois pour l’émergence de nouvelles technologies et le franchissement des ruptures technologiques, mais aussi pour le renouvellement du parc, qu’il soit nucléaire ou pas. Selon la durée de vie choisie pour chaque centrale, suivant le nombre qu’on envisage de mener à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans, le lissage sera plus ou moins important : si elles s’arrêtent toutes à quarante ans, c’est un grand mur d’investissements qui se dressera devant nous ; en les prolongeant toutes jusqu’à cinquante ans, on ne fera que repousser le mur de dix ans. En revanche, si la durée de vie varie selon les centrales, jusqu’à soixante ans pour certaines, les investissements s’en trouveront lissés, ce qui emportera des conséquences visibles sur leur niveau.
M. le président François Brottes. Si vous deviez conseiller un gouvernement, je crois comprendre de votre insistance sur la dimension temporelle que vous marquez votre préférence pour la prolongation des réacteurs qui peuvent l’être.
M. Laurent Michel. Dans un premier temps, il faut se fixer un cap et une ambition globale, dont la déclinaison électrique repose sur la maîtrise de la demande et le transfert d’usage des énergies fossiles carbonées vers l’électricité décarbonée, pas seulement d’ailleurs au travers de la voiture électrique, à l’horizon 2025-2030. D’un côté, la maîtrise de la demande commence à porter ses fruits puisqu’on observe une déconnexion entre croissance et évolution de la consommation d’électricité ; de l’autre, le transfert d’usage entre énergies est un facteur de hausse.
Dans un deuxième temps, il faut se doter des outils opérationnels permettant de définir le mix énergétique souhaité.
Avec cette stratégie, on peut penser que la prolongation d’une partie du parc – sans faire le pari, déraisonnable aujourd’hui, d’aller au-delà de soixante ans, et si les conditions de sûreté sont réunies et validées par l’ASN –, pourrait offrir à la fois souplesse économique et élasticité dans le temps. Une incertitude demeure néanmoins sur la capacité de certaines centrales de satisfaire aux exigences de sûreté ainsi que sur la volonté de l’exploitant de supporter ou non les coûts imposés par ces dernières.
M. le président François Brottes. Échangez-vous avec l’ASN sur ces questions ?
M. Laurent Michel. Nous échangeons régulièrement avec l’ASN sur le processus de discussion avec EDF, mais aussi sur d’autres sujets comme la gestion des déchets, le démantèlement ou le retraitement. En revanche, il ne nous appartient pas de juger les options choisies par l’ASN.
M. Pierre-Marie Abadie. La compétence de la direction générale de l’énergie et du climat se limite aux aspects économiques et techniques. Il y a d’autres enjeux à prendre en compte.
Le temps est un enjeu essentiel, notamment au regard de la transformation du système – les réseaux, la production – et de la technologie. L’ANCRE (Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie) a travaillé sur les aspects technologiques des scénarios de la transition énergétique pour en mettre en évidence les ruptures. Or il s’agit d’un travail de technologues qui n’a pas encore permis d’identifier suffisamment les moments charnière, les « go-no go », ces moments auxquels nous serons sûrs de disposer des technologies qui permettront de franchir certaines étapes.
La prolongation de toutes les centrales pose évidemment des questions de sûreté mais aussi d’adaptation aux besoins. Si les énergies renouvelables se développent au rythme de 1 gigawatt d’éolien et 1 gigawatt de photovoltaïque par an, à l’horizon 2030, certaines centrales nucléaires ne seront plus nécessaires pour couvrir les besoins. La réponse n’est pas dans le tout ou rien.
La décision de prolongation ne s’appuie pas uniquement sur la conformité technique d’une centrale ; la marge de robustesse du système électrique entre également en ligne de compte. Devoir fermer une centrale au risque de déséquilibrer le système serait, en effet, une décision impossible pour l’ASN. Comme les centrales sont toutes très similaires, un défaut pourrait s’avérer systémique et affecter plusieurs centrales. Cette question de la marge de robustesse et de sécurité du système, soulevée par la Cour des comptes, est à ce jour insuffisamment documentée.
M. Laurent Michel. La gestion du temps est paradoxale puisqu’il faut décider rapidement d’un cap pour tenir compte des contraintes longues de l’industrie, quel que soit le mix. La prolongation n’est pas un moyen de repousser la décision, elle peut, au contraire, aider à mettre en œuvre la stratégie. Il importe que le cap et les outils soient arrêtés dès maintenant, car les murs sont bien devant nous.
M. Denis Baupin, rapporteur. Votre audition est sans doute l’une des plus importantes pour notre commission. Vous portez une double casquette puisque vous êtes à la fois les agents qui doivent aider l’État à définir sa stratégie en synthétisant les préoccupations des uns et des autres – et l’on a vraiment besoin de disposer d’un tel lieu –, et les représentants de celui-ci au sein d’EDF qui produit 100 % de l’électricité nucléaire en France.
Pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie de l’État au sein d’EDF ? Comment, en qualité d’actionnaire majoritaire à 85 %, concilie-t-il le besoin de dividendes en ces temps de disette budgétaire et son rôle de pilotage d’une politique énergétique ?
La définition du grand carénage manque de clarté. Nous attendons toujours un document d’EDF sur ce sujet. Êtes-vous en mesure – alors que l’ASN nous a dit ne pas l’être – de nous préciser le périmètre de ce programme ? On évoque les chiffres de 55 milliards d’euros jusqu’en 2025, tout en sachant que les coûts s’étaleront au-delà, ce qui n’était pas clair il y a encore quelque temps. Quel ordre de grandeur devons-nous retenir ?
S’agissant de la prolongation du parc existant – que je dissocie du grand carénage qui n’est qu’une condition nécessaire –, le référentiel de sûreté renforcée pour la prolongation que l’ASN souhaite voir appliqué ne sera pas connu avant 2018-2019. EDF, sans qu’on puisse le lui reprocher, n’est donc pas en mesure de savoir ce que seront les coûts liés aux exigences de sécurité renforcée. Nous venons d’auditionner l’agence WISE-Paris qui a réalisé une étude sur les coûts de la prolongation. Quel est votre avis sur cette étude ? Quelle est votre évaluation des coûts ?
Avant d’analyser au cas par cas chaque centrale, l’ASN doit déterminer dans un premier temps une orientation générale de la prolongation en termes de sûreté, celle-ci ne manquant pas d’avoir des répercussions financières et devant aussi être analysée en termes de rentabilité.
Nous nous retrouvons sur l’intérêt d’une stratégie lissée et non pas d’une durée de vie butoir pour tous les réacteurs. Selon vous, combien de réacteurs doivent être prolongés pour tenir l’engagement du Président de la République de passer à 50 % de nucléaire à l’horizon 2025 ?
Quant à la robustesse du système de production électrique, nous devons éviter qu’un défaut commun à toutes les centrales oblige l’ASN à choisir entre s’accommoder de ce défaut, donc d’une sûreté dégradée, ou arrêter des réacteurs, ce qui ne manquerait pas de poser des problèmes d’approvisionnement. Que conviendrait-il de faire pour atténuer la vulnérabilité de notre système ?
D’après vous, il est difficile d’évaluer les conséquences de l’effet de série sur les nouveaux réacteurs comme l’EPR. EDF affirme travailler avec Areva sur un « EPR light », au design revu, avec de moindres contraintes entraînant de moindres coûts. À quel horizon et à quel coût cette version pourrait-elle être réalisée, sachant qu’il faudrait à nouveau en passer par le processus de tête de série ? Dans l’hypothèse d’école où l’on construirait de nouveaux réacteurs, faudrait-il privilégier la reproduction des EPR existants ou le développement de l’« EPR light » ?
On sait qu’EDF connaît déjà des difficultés dans le domaine de la maintenance. Quelles que soient les hypothèses, l’évolution du parc nucléaire suppose des chantiers de grande envergure sur les cinquante-huit réacteurs – cinquante-six si l’on prend en compte l’arrêt de Fessenheim, sur laquelle, de toute façon, devront être réalisés les travaux consécutifs aux évaluations complémentaires de sûreté. L’entreprise et ses sous-traitants ont-ils la capacité d’assumer de tels chantiers ?
M. le président François Brottes. Est-il pertinent d’entreprendre le grand carénage si la prolongation n’est pas garantie ?
Dans le chemin vers les 50 %, quelle appréciation portez-vous sur l’évolution de la consommation ? Outre le transfert d’usage, on pointe les effets des hivers doux et de la désindustrialisation. Il importe également de prendre en considération les liens avec nos voisins, suisses, italiens, espagnols, allemands, etc. tant du point de vue des besoins que dans la réflexion sur la robustesse du système.
Mme Frédérique Massat. L’ASN a fait état des incertitudes sur le fonctionnement des centrales au-delà de quarante ans, tout en annonçant qu’elle prendrait une position définitive aux alentours de 2018-2019. Aujourd’hui, près de la moitié des réacteurs a plus de trente ans, ce qui laisse peu de temps avant de parvenir aux quarante ans. Je m’inquiète donc des délais annoncés par l’ASN.
Le rapport de WISE-Paris met en doute la capacité financière et industrielle d’EDF à mener à bien les chantiers de prolongation. Disposez-vous d’éléments précis sur ce point ?
Mme Marie-Noëlle Battistel. Dans la perspective de la vente de nouveaux réacteurs EPR, EDF annonce des effets de série de l’ordre de 25 % du coût. Qu’en pensez-vous ?
M. Pierre-Marie Abadie. Je suis commissaire du Gouvernement auprès d’EDF et non plus administrateur. Nous avons proposé ce changement du positionnement de la DGEC au sein du conseil d’administration il y a deux ans, afin de lever toute ambiguïté et de distinguer l’intérêt public, celui des actionnaires et celui de l’entreprise.
Alors que le conseil d’administration a vocation à défendre les intérêts de l’entreprise, les intérêts de l’État sont multiples : il est à la fois actionnaire, régulateur – puisqu’il fixe les tarifs réglementés – et responsable de la politique énergétique, qui doit voir une évolution du mix énergétique. C’est la raison pour laquelle la présence du commissaire du Gouvernement est nécessaire pour expliciter les orientations générales de politique publique.
Le Gouvernement doit concilier l’intérêt des consommateurs, la sécurité de l’approvisionnement à long terme et les enjeux de la transition énergétique. À cet égard, la hausse substantielle des tarifs en 2013-2014 avait pour objet de prendre acte des investissements importants à réaliser dans l’ensemble du système électrique (production, transport et distribution) et de leurs conséquences sur les coûts de l’entreprise. Elle constitue un exemple d’arbitrage du Gouvernement entre l’intérêt immédiat des consommateurs de payer le moins possible et l’intérêt de la collectivité de consacrer les investissements nécessaires à la transition énergétique et à la sécurisation de l’approvisionnement. Il en va de même de la décision courageuse de remettre de l’ordre dans la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et de résorber la dette de l’État auprès d’EDF. La CSPE est un élément essentiel du soutien au développement des énergies renouvelables.
M. le président François Brottes. Vous considérez qu’elle est en ordre aujourd’hui ?
M. Pierre-Marie Abadie. La CSPE est en ordre sur le plan financier. Les mesures d’évolution sous le plafond de 3 euros de la contribution et l’engagement de résorption de la dette à l’horizon 2018 peuvent être tenus avec les prévisions de consommation dont nous disposons. La dette s’élève à 5 milliards d’euros.
En revanche, des améliorations substantielles restent à apporter en matière de gouvernance afin d’assurer la pérennité de cet outil, qui est pertinent puisqu’il permet de faire payer par le système électrique son propre développement. C’est l’une des forces du système énergétique que d’avoir réussi à financer son évolution par ses propres moyens, contrairement aux infrastructures, par exemple.
On se focalise sur EDF, mais elle ne sera pas le seul acteur du système électrique, ni dans la production ni dans les autres domaines – l’effacement, la demande, les services aux consommateurs. De nombreux autres acteurs énergétiques, comme GDF Suez, mais aussi les effaceurs et les agrégateurs ou encore des opérateurs de télécoms ou d’internet, auront un rôle important à jouer entre les petits opérateurs et le système électrique. Il est très important que ces vecteurs d’innovation puissent intervenir dans le secteur énergétique : il ne faut pas se limiter aux gros opérateurs même s’ils sont incontournables.
M. Laurent Michel. De nombreuses études cherchent à évaluer les tendances de la consommation électrique. Certaines suggèrent que la croissance de la consommation électrique équivaut à la croissance économique minorée de 2 %, grâce aux efforts actuels et à venir d’économies d’énergie. Selon une étude de RTE, avec une croissance de 1,8 % par an d’ici à 2030, la croissance de la consommation électrique pourrait être de 0,4 % en raison des transferts d’usage. En 2011, la consommation, hors auto-consommation du secteur de l’énergie, était de 422 térawattheures. On peut envisager de passer à 440 ou 465 en tenant compte d’importantes économies d’énergie, de l’ordre de 120 térawattheures, dans le secteur tertiaire et l’industrie, mais aussi d’une augmentation de la consommation du fait des technologies de l’information et de la communication et des transferts d’usage.
Nous travaillons surtout sur des scénarios d’évolution modérée de la demande électrique, y compris après transferts d’usage. Compte tenu des besoins d’approvisionnement français et européen ainsi que du développement des énergies renouvelables, on s’achemine vers un doublement des capacités d’interconnexion aux frontières afin de passer de 10 gigawatts à 20-25 gigawatts à l’horizon 2025-2030.
Quant au nombre de réacteurs à prolonger ou à fermer, on peut l’estimer en fonction d’hypothèses de développement et de demande de nouveaux moyens de production. Actuellement, la capacité des installations nucléaires est de 63 gigawatts. Dans l’hypothèse d’une part du nucléaire de 50 % en 2025, les besoins seraient de 36 à 43 gigawatts, ce qui correspond, indépendamment des problèmes de sûreté, à un « non besoin » d’une vingtaine de réacteurs.
S’agissant de la déconnexion entre le grand carénage et la prolongation, on sait que certains investissements ont été faits ou restent à faire pour le passage de trente à quarante ans pour les réacteurs les plus jeunes. Or de tels investissements ne se conçoivent bien qu’avec un amortissement sur vingt à trente ans. Dans ces conditions, ne vaudrait-il pas mieux arrêter certaines centrales à trente ans et ne pas y entreprendre de travaux, et en prolonger d’autres directement à cinquante voire soixante ans, à condition que l’ASN l’autorise ?
M. le président François Brottes. Ce que vous venez dire change significativement la donne. Entre un grand carénage incontournable mais qui ne garantit pas la prolongation et la non prise en compte dans le grand carénage des centrales appelées à être fermées, la hauteur du mur des investissements est grandement modifiée. Ce n’est pas un point de détail !
M. Laurent Michel. Le volume et le calendrier du mur pour le nucléaire ancien sont certes modifiés, mais les investissements devront être redirigés vers les énergies renouvelables ou le nouveau nucléaire, dont les coûts en investissement sont également très lourds.
M. Pierre-Marie Abadie. La distinction entre le grand carénage et la prolongation de durée de vie est un peu théorique. Il est difficile de déterminer ce qui relève précisément de l’un ou de l’autre.
M. le président François Brottes. La prolongation a besoin du grand carénage, c’est indéniable.
M. Pierre-Marie Abadie. Absolument.
M. le rapporteur. En d’autres termes, le grand carénage est une condition nécessaire mais pas suffisante.
M. Pierre-Marie Abadie. Le grand carénage est en quelque sorte une marque commerciale. Il a vocation à sensibiliser les acteurs de la filière à la dimension industrielle du projet sur lequel il faut collectivement s’organiser ; il vise donc à fédérer le tissu des fournisseurs. L’analyse fine des besoins d’investissement – ceux qui doivent être faits dans tous les cas et pour lesquels, dans une stratégie de parc, on peut se permettre d’accepter des coûts échoués, et ceux qui dépendent de la possibilité de prolonger la durée de vie, appréciée au niveau de chaque centrale – n’a pas été faite. Cette distinction entre les deux catégories d’investissements doit rester en arrière-plan de toutes les analyses relative au passage éventuel des centrales à une durée de vie de 50 ans : l’essentiel n’est pas dans le fait de savoir si toutes les centrales passent à 50 ans mais si, globalement, le parc peut avoir un horizon de durée de vie qui justifie que l’exploitant y fasse des investissements, quitte à ce que certaines centrales s’arrêtent à 40 ans, d’autres à 50 ans et d’autres à 60 ans. Il reviendra ensuite à l’exploitant d’assumer son risque industriel sur l’ensemble du parc et de définir en conséquence ce qu’il accepte d’investir sur l’intégralité de son outil de production et ce qu’il réserve aux seules centrales dont il aura la quasi-certitude qu’elles seront autorisées à être prolongées. EDF n’en est pas encore là.
M. le président François Brottes. Qui peut faire ce travail d’analyse ?
M. Laurent Michel. Une fois que le cap général est fixé, le travail de documentation sur les possibilités de prolongation de chaque centrale ne peut être le fait que de l’opérateur qui connaît la situation de chaque installation. L’avis de l’ASN sur la sûreté sera également décisif. Nous aurons à travailler pendant plusieurs années avec EDF afin d’améliorer nos connaissances et de pouvoir conseiller le Gouvernement sur la programmation pluriannuelle de l’énergie et sur la pertinence de la prolongation.
M. le président François Brottes. Ce travail pourrait-il être fait par un autre que l’opérateur qui, on peut le comprendre tout en le regrettant, obéit à sa propre logique d’exploitation ? L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire saurait-il le faire ? Les services de l’État n’ont probablement pas les moyens de mener ce travail considérable sur toutes les hypothèses.
M. Laurent Michel. Les données essentielles ne peuvent provenir que de l’opérateur. Quant à l’État, il doit se doter d’outils d’expertise. Nous réfléchissons actuellement à un mécanisme qui obligerait EDF à fournir des éléments, à charge pour les pouvoirs publics d’expertiser et de contre-expertiser afin d’examiner les options en matière de sûreté mais aussi en matière économique.
La loi sur la transition énergétique peut être l’occasion de réfléchir sur la méthode de documentation.
La réduction de la vulnérabilité du système est une question importante qui ne peut être résolue d’un coup de baguette magique. On peut jouer sur plusieurs paramètres. L’objectif de 50 % en 2025 apporte déjà une partie de la réponse en obligeant à sortir de la monotechnologie. L’interconnexion est un autre paramètre important. On doit aussi travailler sur la gestion de la pointe, qui est un aspect majeur de la sécurité de l’approvisionnement, par exemple avec le développement de l’effacement. On peut également limiter les risques d’un incident générique qui affecterait toutes les composantes du système en diversifiant le parc nucléaire. Du reste, cette diversification est déjà engagée avec des centrales par paliers de 900 et 1 300 mégawatts comprenant eux-mêmes des sous-paliers, ainsi qu’avec l’EPR.
M. le président François Brottes. Quel est votre avis sur « l’EPR light » évoqué par le rapporteur ?
M. Laurent Michel. Il y a deux sujets à bien différencier. EDF et Areva travaillent sur l’optimisation de l’EPR actuel à partir des retours d’expérience. Les entreprises évoquent un gain de 20 à 30 %, assez commun sur le plan industriel pour des gros outils, qui permettrait d’abaisser le coût de 8 à 6 milliards d’euros. Parallèlement, un autre projet porte sur un EPR de même puissance mais avec des caractéristiques physiques moins lourdes.
M. Pierre-Marie Abadie. L’évolution de l’EPR passe par différents étages.
Premier étage, EDF peut s’appuyer sur les retours d’expérience d’Olkiluoto et de Flamanville pour améliorer l’EPR qu’il entend construire à Hinkley Point, au Royaume-Uni. Cela a permis de dégager des gains, qui ont cependant été amoindris par un coût du BTP plus élevé au Royaume-Uni, les exigences britanniques spécifiques ainsi que des particularités du site ayant même renchéri le coût final.
Deuxième étage, EDF peut travailler à un EPR optimisé, mais avec le même design. Il faut savoir que les EPR de Flamanville et d’Olkiluoto ont été construits sans que le design détaillé soit connu. C’est comme cela que les précédentes centrales ont été construites, mais EDF et AREVA avaient mal mesuré le changement que représentait le design de l’EPR. Le génie civil des deux EPR européens est d’une très grande complexité. Le design pour la construction peut être simplifié grâce à la collaboration avec les opérateurs du BTP, par exemple sur le ferraillage.
Troisième étage, EDF et Areva travaillent sur une optimisation de l’EPR à certification constante, sans changement majeur mais en tirant les leçons des chantiers précédents. Cette démarche est donc très intéressante en termes de délais.
Dernier étage, il est possible de travailler sur des options un peu différentes, par exemple sur les concepts de sûreté relatifs à la cuve, ce qui nécessite une nouvelle certification et verrait donc le jour à un horizon plus lointain.
L’EPR s’est heurté à plusieurs difficultés : il a été construit sans disposer du design détaillé, par des entreprises qui avaient perdu l’habitude de construire – c’est la grande différence avec le chantier de Taishan en Chine.
Le gain tiré de l’effet de série – ou du retour d’expérience – serait de l’ordre de 25 à 30 %, similaire à celui qui a été constaté sur les paliers précédents. L’effet de série n’est d’ailleurs pas produit par l’industrialisation de la construction mais par la non-reproduction des erreurs passées. Ainsi, l’absence de retard dans le calendrier des travaux induit-elle un gain mécanique.
M. Laurent Michel. S’agissant de vos inquiétudes sur le calendrier de l’ASN, madame Massat, sachez que le processus en cours est jalonné et que des échanges avec l’exploitant ont lieu régulièrement. Si des éléments négatifs importants touchant à la prolongation devaient apparaître, ils seraient révélés bien avant 2018. Nous échangeons régulièrement avec l’ASN sur l’avancée du processus. Les premières orientations devraient être connues en 2015.
M. Pierre-Marie Abadie. Il faut garder à l’esprit que le travail entrepris par l’ASN est progressif.
La question de la prolongation des centrales n’est pas univoque. Aux États-Unis, on sait que le parc peut être prolongé car, en matière de sûreté, l’approche consiste à maintenir le niveau de sûreté défini pour la centrale. L’exemple américain montre qu’à sûreté constante, les centrales peuvent être prolongées. Or l’ASN s’en tient à une logique différente qui consiste à rechercher l’amélioration de la sûreté. À cette fin, elle entretient avec l’opérateur un dialogue sur les améliorations à apporter. Il ne faudra donc pas attendre 2018 pour découvrir ce que contiendrait la boîte noire de la prolongation. En 2015, l’ASN devrait déjà prendre des positions de principe.
S’agissant de la capacité industrielle et financière d’EDF d’assumer la prolongation, il suffit que les opérations soient préparées et menées au bon moment, comme doit l’être tout projet industriel. Quant au financement, ce n’est pas une question de possibilité mais de profitabilité des investissements – s’ils peuvent être rémunérés, les financements seront trouvés. Au cas où la dette serait trop importante, il faudrait recourir aux fonds propres en augmentant le capital ou en sollicitant des co-investisseurs. L’EPR d’Hinkley Point est financé par de la dette, des fonds propres et des co-investisseurs. En France, des centrales ont déjà fait l’objet de co-investissements par le passé. De surcroît, la loi NOME permet aux consommateurs industriels souhaitant avoir des contrats à long terme d’investir. Des fonds d’investissement peuvent également être intéressés par les niveaux de rémunération garantis par de telles infrastructures lourdes.
M. le président François Brottes. Si vous deviez conseiller un gouvernement qui décidait de la fermeture de certains réacteurs, par lesquels faudrait-il commencer ?
M. Laurent Michel. Je suppose que vous attendez une autre réponse que
Fessenheim…
Dès lors que le cap est fixé d’une maîtrise de la demande couplée à la diversification du mix électrique, l’élaboration d’une programmation pluriannuelle de l’énergie permet de dessiner l’évolution du parc nucléaire. Toutefois, il faut ensuite disposer de mécanismes obligeant l’opérateur à échanger avec le Gouvernement afin de définir une vision globale et tracer un chemin pour l’arrêt à trente, quarante ou cinquante ans de la vingtaine de réacteurs qui pourraient devenir non nécessaires. C’est en confrontant le point de vue de l’exploitant et les objectifs de l’État, sous réserve que les centrales répondent aux exigences de sûreté, qu’on peut aboutir à un plan de prolongation ou de fermeture.
La discussion doit également impliquer RTE, car les fermetures ont des conséquences sur la soutenabilité du réseau.
Le plan doit être le résultat d’une interaction. Il n’est pas souhaitable que les grandes orientations stratégiques soient définies par l’entreprise ou l’administration seule.
M. Pierre-Marie Abadie. L’administration n’est pas en mesure de synthétiser l’ensemble des données techniques, même si elle dispose d’une capacité d’expertise lui permettant d’apprécier les différents critères : coûts d’investissement, conditions de sûreté, conséquences sur le réseau et redéploiement nécessaire des moyens de production, effets sur le mox et le cycle fermé. Cadencer les fermetures ne se résumerait pas à définir un calendrier ; de nombreux autres critères entrent en ligne de compte.
M. le président François Brottes. Je retiens un point essentiel : l’opérateur ne peut pas décider seul puisque la décision naît de l’interaction entre les différents paramètres. On ne peut pas dire : « on ferme et on verra après ».
M. Pierre-Marie Abadie. Cela dépend du nombre de centrales. Mais dès lors que celui-ci n’est pas marginal, la question se pose.
M. Laurent Michel. De la même manière, on ne peut pas se contenter d’attendre de développer les énergies renouvelables pour décider de l’avenir du parc nucléaire. L’anticipation est essentielle.
M. le président François Brottes. Merci de votre contribution.
Audition de M. Benjamin Dessus, président de Global Chance, et de M. François Lévêque, professeur d'économie au CERNA-Mines ParisTech
(Séance du 26 mars 2014)
Des documents mis à la disposition de la commission d’enquête sont accessibles à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314028.pdf
M. le président François Brottes. La commission d’enquête va procéder à l’audition de M. Benjamin Dessus, président de Global Chance, et de M. François Lévêque, professeur d’économie au CERNA – Mines Paris Tech.
Nos invités ont tous deux publié de nombreux ouvrages accessibles au grand public – ce qui n’est pas une mince affaire dans un domaine où les publications s’adressent souvent à des spécialistes ou relèvent d’une forme d’intégrisme pour ou contre le nucléaire. Si M. Lévêque revendique en la matière une certaine neutralité – ce qui signifie sans doute qu’il y est plutôt favorable –, M. Dessus assume un regard très critique et exprime régulièrement tout le mal qu’il pense du nucléaire dans les cahiers publiés par l’association Global Chance.
Dans quelques semaines s’ouvriront les débats sur la transition énergétique, qui feront une place importante aux coûts passés, présents et futurs du nucléaire. C’est d’ailleurs le cœur de la réflexion souhaitée par notre rapporteur Denis Baupin, dans un contexte d’interrogations sur la concurrence ou la complémentarité entre la prolongation du parc historique, avec ou sans grand carénage, et le déploiement de réacteurs de troisième génération, qu’il s’agisse d’EPR ou d’« EPR light », pour reprendre le néologisme aux contours encore imprécis employé ce matin par M. Baupin.
Messieurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous invite à prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.
(MM. Benjamin Dessus et François Lévêque prêtent serment)
M. Benjamin Dessus, président de Global Chance. Je présenterai aujourd’hui les chroniques d’investissement de parcs nucléaires d’une durée de vie de quarante, cinquante et soixante ans, renouvelés et produisant 400 térawattheures. J’évoquerai également les coûts de production associés aux divers scénarios envisagés.
M. Benjamin Dessus commente un document remis aux membres de la commission d’enquête.
L’hypothèse d’un parc de 400 térawattheures renouvelé correspond à l’évaluation des besoins en 2025 retenue par EDF, qui table sur une augmentation de la consommation d’électricité, étant également entendu que le nucléaire représenterait encore la moitié de la production totale. J’ai également élaboré d’autres scénarios, car celui-ci ne me semblait pas pleinement probable. Outre le maintien du parc à 400 térawattheures, les principales hypothèses que j’ai retenues sont les suivantes :
Un coût du grand carénage compris entre 1 500 euros et 4 000 euros par kilowatt – comme, d’ailleurs, a dû vous l’indiquer tout à l’heure M. Yves Marignac –, avec des temps d’arrêt croissants, bien plus longs pour un carénage très important que pour un carénage plus modeste.
Un coût de l’EPR fixé à 8,5 milliards d’euros selon l’estimation couramment avancée, d’une part, et entre 6 et 6,4 milliards d’euros selon EDF, qui considère que ce prix sera atteint lorsque cinq réacteurs auront été construits, d’autre part.
Un coût du démantèlement qui présente d’importantes marges d’incertitude et qui varie entre 300 euros le kilowatt selon l’estimation d’EDF et jusqu’à 1 000 euros le kilowatt selon la Cour des comptes et les éléments que l’on peut tirer de l’expérience des États-Unis en la matière.
Quant au stockage de Bure, outre l’hypothèse basse de 36 milliards d’euros proposée voilà quelques années par la Cour des comptes et l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), j’ai formulé une hypothèse haute tenant compte des exigences de la récupérabilité réelle des déchets, qui pourrait atteindre de 36 à 48 ou 50 milliards d’euros.
Les graphiques figurant en deuxième page présentent les différentes hypothèses envisagées.
Ceux du haut de la page font apparaître la chronologie des investissements pour un parc nucléaire de 400 térawattheures composé de réacteurs d’une durée de vie limitée à quarante et cinquante ans, auquel s’ajoutent, à partir de 2018, les EPR. Dans les deux cas, une hypothèse haute et une hypothèse basse sont envisagées.
Les graphiques du bas de la page présentent également des hypothèses haute et basse pour une durée de vie portée à soixante ans, puis un scénario différent, distinguant lui aussi une hypothèse haute et une hypothèse basse : l’arrêt progressif des centrales atteignant l’âge de quarante ans et leur remplacement par 400 térawattheures d’électricité renouvelable ou produite par des turbines à gaz.
Pour établir ces calculs, j’ai cumulé les investissements par périodes de cinq ans, ce qui explique des chiffres de l’ordre de 10 ou 15 gigaeuros : il convient de les diviser par cinq pour obtenir le montant des investissements annuels.
Quel que soit le scénario retenu, l’investissement nécessaire est considérable par rapport à celui qui a été réalisé lors de la constitution du parc nucléaire, dans les années quatre-vingt : il est trois fois plus élevé dans l’hypothèse minimale et six à sept fois plus important dans l’hypothèse maximale, avec des pics d’investissement annuels pouvant atteindre plus de 25 gigaeuros.
Il importe aussi de noter que les éléments liés au démantèlement et au stockage en centre industriel de stockage géologique (Cigéo) restent mineurs dans la chronologie des investissements.
Enfin, dans les scénarios qui intègrent les énergies renouvelables, d’importantes économies d’électricité sont réalisées. Un autre scénario, qui ne figure pas dans les graphiques, illustre le passage du parc nucléaire de 400 térawattheures à 260 térawattheures, comme le proposent les intervenants que vous avez entendus avant moi, pour parvenir en 2025 ou 2030 à un parc de 40 gigawatts au lieu de 60 ou 62 gigawatts.
Dans tous les cas, on observe que, face aux investissements très importants nécessaires pour remettre le parc à niveau, tout effort d’économie d’électricité est très payant.
Compte tenu de l’importance des investissements à consentir dans tous les scénarios, il faut donc tenter de réduire le parc à construire – nucléaire ou autre – et étaler ces investissements dans le temps. À cet égard, les économies d’électricité sont très efficaces car, si elles supposent elles aussi un investissement, celui-ci est beaucoup plus faible.
La deuxième partie de mon analyse consiste à examiner les coûts du mégawattheure pour un parc prolongé et non prolongé, et à les comparer à ce qu’ils pourraient être avec l’EPR.
Pour ce faire, j’ai recouru, comme l’a fait la Cour des comptes, au coût courant économique, qui consiste à considérer le loyer d’un investissement sur la durée de vie de cet investissement – à l’instar du loyer de remboursement d’un prêt immobilier –, et à y ajouter les frais annuels d’exploitation et de maintenance, les investissements futurs étant pris en compte au moyen d’un taux d’actualisation. J’ai repris à cet égard les taux choisis par la Cour, soit 7,8 % pour le loyer économique et 5 %, inflation comprise, pour le taux d’actualisation.
Selon l’hypothèse que j’ai retenue, un réacteur arrêté à quarante ans est amorti et ne coûte plus rien, ce qui me permet de considérer le réinvestissement nécessaire pour sa remise en état comme une nouvelle installation, c’est-à-dire un investissement qui créera un loyer économique sur une durée de vie de, par exemple, dix ou vingt ans. Cette hypothèse, défavorable à ma thèse, consiste à partir de zéro. De fait, d’un point de vue stratégique, il faut choisir entre l’arrêt du réacteur ou la poursuite de son exploitation, et on peut donc considérer que la valeur de l’investissement précédent est nulle. Ce choix favorise la prolongation, mais il me paraît correct.
La dernière courbe du document que je vous ai remis exprime le coût du mégawattheure en fonction de celui du grand carénage, dont la valeur varie, selon les hypothèses, de 1 300 ou 1 500 euros jusqu’à 4 000 euros par kilowatt. Deux courbes exprimant ce coût pour une durée de vie de dix ou vingt ans respectivement croisent celles qui figurent le coût du mégawattheure produit par l’EPR, tel que calculé par la méthode de la Cour des comptes, selon que ce réacteur coûte 8,5 ou 6,4 milliards d’euros.
Quelles que soient les hypothèses retenues pour le carénage, les coûts sont élevés : ils sont au minimum de 60 euros le mégawattheure et, très rapidement, dès qu’ils atteignent des valeurs de l’ordre de 70, 75, 80 ou 90 euros le mégawattheure, ils rattrapent le coût du mégawattheure produit par l’EPR – certes moins vite dans l’hypothèse haute pour ce dernier.
Sur le graphique, la barre verticale noire représente le coût tel que l’imagine aujourd’hui EDF, qui prévoit de dépenser 55 milliards d’euros d’ici à 2025 pour procéder au grand carénage des réacteurs qui atteindront quarante ans à cette date.
Il apparaît donc que le grand carénage, qui induit sur dix ou vingt ans des coûts qui ne sont pas sensiblement inférieurs à ceux de l’EPR, induit aussi un risque important de pannes génériques, avec des réacteurs moins robustes que des réacteurs jeunes, et donc le risque de dépasser les coûts de l’EPR.
M. le président François Brottes. Cela signifie-t-il qu’il vaut mieux faire des EPR ?
M. Benjamin Dessus. Ma conclusion est plutôt que tout cela est très cher, que l’on construise des EPR ou que l’on rénove les réacteurs sur dix ans – même si le coût est un peu moindre pour une rénovation sur vingt ans. Les coûts sont sans commune mesure avec celui du parc amorti – et encore m’en suis-je tenu au calcul de la Cour des comptes, qui n’intègre pas les assurances.
Nous avons donc clairement intérêt à ce que, renouvelé ou pas, le parc soit réduit au minimum. Il faut donc considérer le coût des économies d’électricité qui peuvent être réalisées, ce que ne fait pas du tout la politique française actuelle dans ce domaine. Tout ce qu’on gagnera sur ce plan aura des incidences considérables sur le coût final de l’opération.
En l’état, les coûts ne sont pas assez différenciés pour recommander plutôt de prolonger la durée de vie des réacteurs ou de construire dès maintenant des EPR.
M. le président François Brottes. Quel était le coût du pétrole lorsque le parc nucléaire français initial a été constitué ? Peut-on encore, comme à l’époque, intégrer dans les choix stratégiques du pays la notion de moindre dépendance énergétique ?
Par ailleurs, j’ignore comment réagiraient les actionnaires de Fessenheim autres que l’État, si on leur disait que, dès lors qu’on arrête le réacteur, il ne vaut plus rien.
Enfin, un coût doit toujours être estimé par rapport à une durée de vie et d’amortissement, et non pas dans l’absolu : sur quelle durée vos hypothèses de coût reposent-elles ?
M. Benjamin Dessus. Mes hypothèses de prolongation de la durée de vie des réacteurs sont de dix et vingt ans, et les coûts correspondant varient en fonction de celui du grand carénage, comme le montrent les tableaux que je vous ai remis. Pour ce qui concerne l’EPR, j’ai adopté la thèse classique d’une durée de vie de soixante ans. Je m’en suis donc tenu à l’hypothèse de la Cour des comptes.
Quant au pétrole, il faudrait comparer, outre les coûts de production depuis les années soixante-dix, les investissements pétroliers réalisés à l’époque. Je ne puis vous apporter une réponse immédiate, mais il me semble que le pétrole est relativement moins cher et que le prix du baril, passé de 25 dollars environ à 110 dollars aujourd’hui, a moins dérivé, compte tenu de l’inflation.
M. François Lévêque, professeur d’économie à Mines Paris Tech. Je me propose de partager avec vous quelques réflexions d’économiste autour de la question de l’ancien et du nouveau nucléaire.
Il faut d’abord souligner que la question de la durée de vie du parc existant et celle de savoir par quoi il sera remplacé sont tout à fait indépendantes : il faudra bien, un jour, fermer les centrales existantes, que ce soit à un horizon de quarante, cinquante ou soixante ans. J’en veux pour preuve empirique que certains pays qui ont décidé de ne plus construire de nouveau nucléaire, comme la Suisse ou l’Allemagne, ont adopté des calendriers de sortie différents : certains ont décidé de fermer rapidement les réacteurs existants, d’autres de le faire lentement. Certains ont choisi de ne pas les remplacer, tandis que d’autres envisagent de les remplacer par de nouveaux réacteurs. Ce sont donc deux questions qui se posent en parallèle : celle du calendrier et celle du remplacement – ou non – des réacteurs existants par de l’éolien, du gaz ou du nucléaire.
Le sujet important aujourd’hui est le calendrier : la France optera-t-elle pour une fermeture rapide ou progressive des réacteurs ? En Allemagne, deux options ont successivement été envisagées : une sortie progressive, avec la fermeture du dernier réacteur en 2034, et une sortie rapide, avec une dernière fermeture en 2022. À l’issue de l’accident survenu dans la centrale de Fukushima-Daïchi, la décision prise a été celle d’un calendrier accéléré. Ces deux calendriers n’ont pas le même coût, et l’option choisie par l’Allemagne coûte environ 50 milliards d’euros à l’économie allemande.
Compte tenu des conséquences qu’elle peut avoir sur l’économie, la question du calendrier de fermeture des réacteurs existants est un sujet économique.
En deuxième lieu, et aussi brutal que cela puisse paraître, on ne voit pas, d’un point de vue économique, pourquoi la décision de fermeture des réacteurs existants devrait être prise par des tiers autres qu’une autorité de sûreté et l’opérateur. De fait, dès lors que l’autorité de sûreté indépendante chargée de veiller au maintien ou à l’amélioration de la sûreté des réacteurs en activité indique à l’exploitant qu’il peut poursuivre l’exploitation d’un réacteur moyennant certains travaux, celui-ci évalue la rentabilité de cette prolongation en fonction de ses projections quant au prix de vente de l’électricité. Il s’agit là d’un raisonnement économique en termes de coûts et bénéfices.
Dès lors, le pouvoir exécutif et législatif doit-il intervenir sur ce calendrier ?
Une première réponse possible est qu’il le doit au nom de la sécurité de l’approvisionnement, comme c’est le cas en Allemagne et dans certains autres pays européens, où des régulateurs et des politiques interviennent pour empêcher la fermeture de centrales. La sécurité de l’approvisionnement est en effet, d’un point de vue d’économiste, un bien collectif qui relève du pouvoir politique. Une telle justification semble militer plutôt pour un prolongement de la durée de vie des réacteurs.
En dehors de ce cas, dès lors que l’autorité de sûreté est compétente, il n’y a pas de raison qu’un tiers détermine le calendrier de leur fermeture, à moins que le politique n’élève l’objectif de sûreté, qu’il n’appartient pas à l’autorité de sûreté de définir. Si l’apparition de nouvelles connaissances ou une évolution de la perception du risque par le public peut, en effet, justifier une intervention du politique, celle-ci ne doit pas pour autant viser la fermeture de centrales : le politique doit communiquer le nouvel objectif à l’autorité de sûreté, à qui il revient de prendre les décisions correspondantes. S’il court-circuite l’autorité de sûreté, le politique risque d’en compromettre la crédibilité.
Les travaux que j’ai consacrés à l’évolution des coûts du nucléaire mettent en évidence une tendance relativement connue des spécialistes : le nucléaire est – historiquement du moins – une technologie à coûts croissants, pour laquelle les économies d’échelle et d’apprentissage sont assez difficiles à observer en France, où les conditions ont pourtant été les plus favorables en termes de standardisation et d’expérience de l’opérateur.
En conclusion, je le répète, le sujet économique du moment n’est pas le déploiement de nouveaux réacteurs en France : il s’agit moins de savoir par quoi il convient de remplacer les réacteurs existants que de définir le calendrier de leur fermeture. C’est une question de gouvernance et de choix entre différentes options de fermeture – lente ou accélérée. C’est là une question clé pour l’économie française, que vous êtes en train d’éclairer et de documenter.
À la différence de M. Dessus, je considère que, comme l’illustrent les évaluations effectuées en Allemagne, fermer un réacteur dont l’autorité de sûreté a autorisé l’exploitation et pour lequel l’exploitant juge que le coût des améliorations exigées par cette autorité est nettement inférieur aux recettes futures, c’est jeter de l’argent – et beaucoup d’argent – par la fenêtre.
M. Denis Baupin, rapporteur. Merci pour ces deux exposés assez différents, qui contribuent à nous offrir une vision transversale, une vision macroéconomique globale de l’évolution des coûts.
Monsieur Dessus, il semble que, sous le terme de « grand carénage », vous réunissiez à la fois l’acception qu’EDF donne à ce terme et les conséquences qu’auraient les décisions de l’autorité de sûreté quant au référentiel de sûreté applicable pour autoriser une prolongation.
Par ailleurs, selon vous, la prolongation de la durée de vie des réacteurs et la construction d’EPR coûtent finalement plus cher que la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique. Sur quelles bases de calcul et sur quels documents vous fondez-vous pour évaluer les besoins d’investissement correspondant à une telle politique ?
Monsieur Lévêque, vous vous interrogez sur la légitimité au titre de laquelle l’État pourrait intervenir dans la décision de fermer des réacteurs. Cependant, c’est à l’État qu’il incomberait de faire face à l’impact d’un accident nucléaire majeur – qui, selon l’Autorité de sûreté nucléaire elle-même, n’est pas impossible en France. C’est là peut-être une raison justifiant qu’il puisse prendre des décisions de fermeture.
Par ailleurs, les logiques de fonctionnement des réseaux et les stratégies énergétiques définies avec les pays voisins, en fonction notamment des éventuelles surcapacités, peuvent avoir des conséquences sur les tarifs, lesquels relèvent aussi de l’État : celui-ci pourrait donc, au titre de la politique énergétique, décider de la puissance nucléaire qu’il convient de définir à un horizon donné.
M. le président François Brottes. L’État ne fait que contribuer à la fixation des tarifs. Lorsqu’il tente de les fixer, le Conseil d’État le censure.
M. le rapporteur. Certes, mais du moins les tarifs ne sont-ils pas définis seulement par l’offre et la demande, et il est donc assez légitime qu’il existe une politique visant à les réguler.
Quant à savoir si l’arrêt d’une installation existante qui pourrait continuer de fonctionner est une perte, cela dépend évidemment du coût de sa prolongation. Pour le parc nucléaire français, nous disposons d’hypothèses sur le coût du grand carénage nécessaire pour maintenir les réacteurs en activité jusqu’à quarante ans, ainsi que sur le coût de leur prolongation au-delà. Sur quelles hypothèses vous fondez-vous pour déclarer qu’il serait forcément plus coûteux de ne pas prolonger la durée de vie des réacteurs que de la prolonger ?
M. Benjamin Dessus. Ce que j’ai désigné comme un « grand carénage » recouvre, en effet, le grand carénage proprement dit et les mesures post-Fukushima – c’est-à-dire l’ensemble des opérations permettant de prolonger de dix ou vingt ans la durée de vie des réacteurs. Les chiffres que j’ai utilisés sont à peu près ceux du rapport Marignac – soit une fourchette correspondant à la somme du coût de la maintenance de la jouvence des réacteurs et de celui des opérations rendues nécessaires après l’accident de Fukushima.
M. le rapporteur. Il ne s’agit donc pas de la définition ordinaire du grand carénage.
M. Benjamin Dessus. Mon évaluation de l’investissement nécessaire pour les économies d’électricité se fonde sur des travaux que j’ai réalisés antérieurement. Les coûts que j’ai retenus par mégawattheure évité sont de 70 euros pour l’électricité thermique, de 50 euros pour l’électricité spécifique et de l’ordre de 40 euros pour l’industrie – seuil au-dessous duquel les investissements, dont le temps de retour est de quatre à cinq ans, ne sont pas engagés.
Ces opérations sont rentables si l’on en compare le coût, non à celui de la production, mais à celui de la distribution d’électricité, qui se situe entre 100 et 130 euros le mégawattheure selon que l’électricité est destinée à l’industrie ou à la consommation domestique.
C’est sur ces bases que j’ai évalué ce que pourrait être le coût d’une économie d’une centaine de térawattheures par rapport à celui de la mise en place d’un parc de 400 térawattheures en 2050. Je vous ferai parvenir une note qui analyse plus en détail la situation par secteur.
M. le président François Brottes. Les coûts de transport et de distribution, qui font par ailleurs l’objet d’une péréquation, sont-ils quantité négligeable quel que soit le scénario, ou pourrait-on travailler un peu plus sur ce point ?
M. Benjamin Dessus. C’est là un aspect sur lequel le déficit est considérable. Tout d’abord, le capital investi en transport et distribution, et le patrimoine industriel correspondant, est nettement plus important que celui consacré à l’outil de production lui-même. L’étude que Jean-Michel Charpin, René Pellat et moi-même avions réalisée pour le Premier ministre Lionel Jospin avait évalué ce patrimoine au triple de la valeur des centrales. Or ce patrimoine est à renouveler dans les trente à quarante prochaines années. Il s’agit donc là d’un problème majeur.
Il ne suffit pas de considérer, par exemple, que la production par des éoliennes suppose un réseau de distribution moins centralisé que celui que nous possédons actuellement, il faut aussi savoir quelle sera la quantité totale d’électricité à distribuer – la situation est différente s’il s’agit de 800 ou de 400 térawattheures, surtout dans une optique de renouvellement sur quarante ans. Dans mon étude, l’opération se justifiait davantage, d’un point de vue économique, par la diminution de la consommation d’électricité en 2050 que par le coût de production. Un travail important reste à faire sur l’outil de distribution et de transport, et cela d’autant plus qu’on oublie souvent de tenir compte de son renouvellement.
M. le président François Brottes. En outre, les lignes à haute tension sont aujourd’hui le plus souvent enterrées, y compris pour certaines liaisons entre pays. Ces décisions sont prises pour des raisons qui ne relèvent pas de la sûreté ou de la sécurité, mais de la qualité paysagère, sans que l’on s’interroge sur leurs incidences pour les ménages ou la compétitivité des entreprises.
M. Benjamin Dessus. Ce sujet, aussi important que celui des EPR, a été très peu traité. Nous l’avons abordé dans le rapport que j’ai cité, mais je n’en ai pas vu d’analyse prospective globale pour les quarante prochaines années.
M. le président François Brottes. De fait, même si RTE est capable de fournir des réponses en termes de réseau, le couple production-réseau est rarement étudié sur le plan économique.
M. François Lévêque. Pour l’économiste que je suis, l’intervention de l’État se justifie très fortement dans le choix du mix énergétique et du dispositif qui remplacera, le jour venu, les centrales nucléaires existantes, car le marché n’est pas capable de choisir un bon niveau de diversité technologique, et les questions de sécurité et d’indépendance énergétiques qui se posent touchent à un bien public.
Pour ce qui est, en revanche, du calendrier de fermeture des réacteurs existants, l’intervention de l’État ne se justifie pas, sinon au regard de sa responsabilité en cas d’accident. C’est à l’État, et non à l’autorité de sûreté ou à l’exploitant, que revient la décision de relever l’objectif de sûreté, par exemple lorsque de nouvelles connaissances apparaissent ou lorsque la perception du risque par la population se fait plus vive. Si le politique décide qu’il faut être plus ambitieux en matière de sûreté, il doit transmettre cet ordre à l’autorité de sûreté, sans la court-circuiter, en demandant d’accélérer la fermeture. Si l’État pousse l’ambition jusqu’au point où l’accident doit être impossible, il faut fermer les centrales nucléaires.
Un objectif de sûreté plus ambitieux suppose aussi un coût plus élevé. On retrouve là la question du coût du grand carénage. De fait, pour l’exploitant, deux raisons peuvent entraîner une augmentation du coût de sûreté : soit l’objectif est devenu plus ambitieux, soit on constate, pour un même objectif, une dérive des coûts.
Pour déclarer qu’il est toujours plus profitable pour l’économie du pays de maintenir les centrales nucléaires existantes dès lors que l’autorité de sûreté en est d’accord, je me suis fondé sur le coût du grand carénage avancé par EDF, soit 55 milliards d’euros. À un tel niveau, cela vaut la peine économiquement de continuer d’exploiter les centrales existantes si l’autorité de sûreté donne son aval.
La Cour des comptes s’est interrogée sur les coûts de la prolongation des centrales, mais je ne crois pas que ses conclusions soient déjà établies. Ma base de calcul reste donc le chiffre de 1 milliard d’euros par réacteur.
M. le président François Brottes. L’Autorité de sûreté nucléaire, que vous semblez présenter comme un prestataire de services de l’État, doit remplir des missions qui lui sont confiées par la loi, c’est-à-dire par le peuple. C’est elle qui, jusqu’à présent, a eu des exigences éthiques visant à élever le niveau de sûreté à mesure qu’elle le jugeait nécessaire ; il s’agissait rarement d’une demande de l’État. Il peut arriver que l’autorité politique décide de fermer une centrale, mais ce n’est pas nécessairement pour des raisons de sûreté. En effet, tant qu’une centrale est en activité, elle doit donner des garanties de sûreté et, dès lors que le niveau de sûreté exige des investissements supplémentaires qui ne sont pas réalisés, elle doit être fermée. En tout état de cause, l’autorité de sûreté n’est nullement un prestataire de services des pouvoirs publics.
M. Benjamin Dessus. L’autre raison justifiant que l’État soit impliqué dans la fermeture des centrales tient au risque économique global. Le fait que le parc nucléaire représente 75 % ou 80 % de la production peut ainsi représenter un risque lié, par exemple, à l’approvisionnement en uranium ou à des aspects techniques.
M. François Lévêque. Je suis un ardent défenseur des autorités de sûreté indépendantes, compétentes et transparentes, et je me réjouirais que l’exemple français ou américain essaime dans le monde entier. Ces autorités ne sont pas des prestataires de services, mais elles se voient transmettre par le Parlement un objectif de sûreté – lequel est, du reste, toujours qualitatif, car il est très difficile de le définir en termes quantitatifs.
Il est légitime que le législateur puisse, en fonction de l’évolution du monde et de la perception du public, souhaiter une plus grande ambition en matière de sûreté nucléaire, mais une autorité de sûreté ne doit pas avoir un pouvoir discrétionnaire total pour décider seule du niveau de sûreté applicable.
M. le président François Brottes. Messieurs, je vous remercie.
Audition de M. Arnaud Gay, président, et de M. Philippe Bernet, vice-président du groupe de travail “Démantèlement” du Comité stratégique de la filière nucléaire
(Séance du 26 mars 2014)
M. le président François Brottes. Dans la suite de nos travaux, nous en sommes arrivés à un sujet dont l’étude devrait apparaître à tous nécessaire : le démantèlement. En effet, aucun réacteur nucléaire n’est éternel et, si la date à laquelle elle doit intervenir fait l’objet d’opinions divergentes, cette opération est une étape inévitable qui soulève un certain nombre de questions relatives à sa faisabilité, à son coût et aux contrôles dont elle doit être assortie.
Le Comité stratégique de la filière nucléaire, émanation du Conseil national de l’industrie, a créé un groupe de travail spécifiquement consacré à cette activité. Mais existe-t-il une filière du démantèlement ? C’est une des questions que nous aborderons au cours de la présente audition, puisque nous recevons le président de ce groupe de travail, M. Arnaud Gay, par ailleurs responsable de l’activité « Valorisation des sites » chez AREVA, et son vice-président, M. Philippe Bernet, qui est, lui, directeur adjoint du Centre d’ingénierie de déconstruction et environnement (CIDEN) d’EDF.
Mais, avant toute chose, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demanderai, messieurs, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Arnaud Gay et Philippe Bernet prêtent serment)
M. Arnaud Gay, président du groupe de travail « Démantèlement » du Comité stratégique de la filière nucléaire. Je vous remercie d’auditionner le Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN), que je représente, dans le cadre de cette journée consacrée à l’éventuel arrêt définitif des centrales nucléaires françaises. Ce comité, placé sous la double présidence du ministre du redressement productif et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a pour mission essentielle de renforcer les relations entre les différents acteurs de la filière. Il rassemble des représentants du Gouvernement, par l’intermédiaire de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) et de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), des organisations syndicales, des exploitants nucléaires, des grands industriels et des PME du secteur, du Groupe intersyndical de l’industrie nucléaire (GIIN) et du Pôle nucléaire de Bourgogne – soit, au total, 80 membres.
M. le président François Brottes. Aucune ONG n’y est représentée ?
M. Arnaud Gay. Non.
M. le président François Brottes. Pourquoi ?
M. Arnaud Gay. Je l’ignore : je n’ai pas été associé à la composition du Comité.
Le processus de programmation des travaux et de prise de décision est collégial, dans le cadre d’un comité de pilotage qui se réunit à intervalles réguliers sous la présidence des ministres.
Je commencerai par dresser un rapide état des lieux de l’activité de démantèlement des installations nucléaires, puis je vous présenterai les réflexions du groupe de travail sur le démantèlement, l’assainissement et la reprise et le conditionnement des déchets.
Le démantèlement constitue la dernière étape du cycle de vie d’une installation nucléaire. Il consiste à assainir celle-ci en récupérant et en évacuant les matières accumulées durant la phase d’exploitation, à démonter et à évacuer les équipements contaminés, à éliminer la radioactivité des ouvrages de génie civil, puis, une fois leur déclassement obtenu, à démolir ces derniers selon des méthodes conventionnelles, enfin à éventuellement reconvertir tout ou partie de l’installation. Pour une centrale, l’ensemble du processus dure de huit à quinze ans.
M. le président François Brottes. Ce délai pourrait-il être réduit ?
M. Arnaud Gay. Pour l’heure, il semble difficile de faire plus vite.
Les opérations ne peuvent commencer qu’à l’issue d’une phase de préparation et de transition au cours de laquelle, une fois l’installation définitivement arrêtée, on évacue les matières et les combustibles usés et l’on élabore le dossier de demande d’autorisation de démantèlement. Cette demande est ensuite transmise à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et soumise à une enquête publique, de façon à obtenir la publication d’un décret. Le retour d’expérience dont nous disposons montre que cette phase prend de quatre à cinq ans.
La phase opérationnelle peut ensuite démarrer. Elle débute par la caractérisation radiologique de l’installation de façon à mieux identifier les contaminations, et se poursuit par l’assainissement, le démontage et l’évacuation des équipements nucléaires ; pour réaliser ces opérations, on utilise des techniques sophistiquées, comprenant des interventions à distance et sous eau, ainsi qu’un conditionnement des déchets adapté, dans la mesure où il existe un risque important lié à l’exposition aux rayonnements. Cela achevé, on entreprend la décontamination des ouvrages de génie civil, puis on fait une demande de déclassement.
M. le président François Brottes. À qui l’adresse-t-on ?
M. Arnaud Gay. À l’Autorité de sûreté nucléaire. Le dossier est soumis pour avis à la commission locale d’information (CLI), puis donne lieu à une enquête publique s’il existe des servitudes d’utilité publique.
M. le président François Brottes. Pourriez-vous nous donner un exemple ?
M. Arnaud Gay. Par exemple, sur le site de la Société industrielle de combustible nucléaire d’Annecy – qui n’est pas une installation nucléaire de base (INB) mais une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) –, on ne peut procéder à des travaux d’excavation sans avoir préalablement défini les procédures d’évacuation des déchets. Toutefois, les contraintes varient selon les sites et leur état.
M. le président François Brottes. Une ancienne centrale voit son démantèlement sans cesse stoppé. Est-ce pour une raison de ce type ?
M. Arnaud Gay. En l’occurrence, les difficultés se présentent au cours de la phase amont, celle de la demande d’autorisation de démantèlement.
Une fois le déclassement obtenu, on peut procéder au démantèlement – conventionnel, cette fois – des ouvrages de génie civil.
Toutes ces opérations nécessitent des compétences particulières, puisqu’il faut maîtriser des techniques relevant non seulement de la sécurité conventionnelle – un chantier est par nature générateur de risques –, mais aussi de la radioprotection – les travailleurs interviennent en milieu radioactif – et même de la protection des populations environnantes, tant en matière de sûreté que de lutte contre la contamination de l’environnement. Il faut donc prendre un ensemble de dispositions propres à sécuriser au maximum le chantier et son environnement. On procède en outre à des activités de recherche et développement (R&D), notamment pour les interventions à distance, pour la caractérisation radiologique et pour le conditionnement des déchets – ceux-ci apparaissant comme atypiques ou volumineux au regard de ceux qui sont générés durant la phase d’exploitation.
En France, outre Superphénix, huit réacteurs « historiques » d’EDF sont actuellement en cours de démantèlement : les premiers réacteurs de la filière uranium naturel / graphite / gaz (UNGG), ainsi que le réacteur à eau lourde de Brennilis et le prototype de réacteur à eau pressurisée (REP) de Chooz A. À cela s’ajoutent une vingtaine d’installations qui ont déjà été démantelées, dont sept réacteurs de recherche. L’activité de démantèlement a en France une histoire déjà longue de plus de trente ans, mais qui concerne surtout les installations du cycle du combustible.
En ce qui concerne les centrales de production d’électricité, c’est EDF qui assure, en tant que propriétaire, la maîtrise d’ouvrage de leur démantèlement. Il a été fait en France le choix d’un démantèlement immédiat ; cette décision, qui est en conformité avec une politique industrielle responsable et avec les exigences du développement durable, permet en outre de bénéficier de la connaissance qu’ont les exploitants de l’installation, connaissance qui complète utilement les registres écrits disponibles, notamment pour les premières étapes du démantèlement. Le démantèlement immédiat est d’ailleurs préconisé par l’ASN et par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le démantèlement est une activité très réglementée. Il faut d’abord transmettre, trois ans avant la mise à l’arrêt de l’installation, une mise à jour du plan de démantèlement, puis déposer, un an à l’avance, une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, laquelle demande fait l’objet de consultations et d’enquêtes publiques ; l’autorisation est ensuite délivrée par décret, après agrément de l’ASN ; enfin, à l’issue des opérations de décontamination, on dépose une autorisation de déclassement auprès de l’ASN. Toutefois, le décret d’autorisation de démantèlement se borne à définir le cadre général des opérations ; pour réaliser chacune d’entre elles, il faut obtenir de l’ASN une autorisation spécifique.
Du point de vue industriel, la filière du démantèlement – si tant est qu’elle existe – représente 8 % des emplois de la filière nucléaire, soit, si l’on se fonde sur les résultats de l’enquête réalisée par le CSFN en juin 2012 qui évaluait à 220 000 le nombre de ces derniers, environ 17 500 salariés.
M. le président François Brottes. Sous-traitants inclus ?
M. Arnaud Gay. Oui.
L’activité de démantèlement produit quelque 7 % de la valeur ajoutée de la filière nucléaire française, ce qui représente une activité annuelle d’environ 800 millions d’euros, dont une part importante est réalisée dans les installations du cycle du combustible.
En janvier 2013, le comité de pilotage du CSFN a décidé de créer un groupe de travail, dont il m’a confié la présidence, consacré aux sujets du démantèlement, de l’assainissement et de la reprise et du conditionnement des déchets. Ce groupe de travail réunit comme le CSFN des représentants des maîtres d’ouvrage, des industriels, des organisations syndicales, de l’État, des pôles de compétence et de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Notre mission est d’essayer de dynamiser l’activité de démantèlement en France en identifiant les leviers susceptibles d’améliorer le fonctionnement de la filière et en analysant le potentiel du marché à l’exportation.
Nous avons commencé par réaliser un état des lieux sur la base d’une trentaine d’entretiens avec les acteurs concernés. Il en est ressorti le constat, relativement partagé, que le marché du démantèlement restait un marché extrêmement difficile, en raison de son manque de visibilité. On met en avant des chiffres d’affaires potentiels extrêmement élevés, mais la réalité économique est tout autre, car ces chiffres couvrent l’intégralité de l’activité sur la totalité de sa durée, et non ce qui est réellement ouvert au marché.
M. le président François Brottes. Pourriez-vous être plus précis ?
M. Arnaud Gay. Comme je l’ai dit, le marché du démantèlement représente quelque 800 millions d’euros, mais une partie importante des provisions sont consommées, d’une part par les installations elles-mêmes – en coûts de surveillance, de fourniture en électricité, de maintien en condition opérationnelle…–, d’autre part par le stockage des déchets ; la part restante sous-traitée aux industriels ne correspond en réalité qu’à 20 à 30 % du total.
Autre source d’incertitude : les délais. Les opérations ont tendance à « glisser » dans le temps, en raison de procédures administratives souvent plus complexes et plus longues que prévu, et aussi parce que l’on travaille sur des installations contaminées et que la caractérisation nucléaire réserve parfois des surprises : il peut survenir en début de chantier des aléas qui obligent à interrompre les opérations pour faire de nouvelles études.
M. le président François Brottes. Il en va ainsi pour la plupart des opérations de dépollution des sites industriels, en particulier dans l’industrie chimique et dans la sidérurgie : on met des mois, voire des années, avant de se mettre d’accord sur ce qu’il faut dépolluer et selon quelles méthodes.
M. Arnaud Gay. Certainement.
Enfin, la rentabilité de l’activité est à renforcer : les industriels estiment que les marges sont trop faibles. Cela s’explique par le fait que les montants en jeu sont modestes et que l’activité est soumise à des aléas, alors qu’elle exige des niveaux de compétence élevés : les personnels doivent être dûment qualifiés et le maintien de cette qualification dans la durée a un certain coût. Il s’agit d’un marché restreint, très concurrentiel, avec des coûts élevés.
En conséquence, on rencontre des difficultés pour industrialiser l’ensemble du processus, qu’il s’agisse des opérations industrielles, de la gestion des ressources – en raison de l’existence de pics d’activité – ou des méthodes de travail – avec une succession d’arrêts et de reprises du chantier. Tout cela ne facilite pas l’organisation d’un système de travail fluide et efficace.
Néanmoins, la filière française possède des atouts. Elle bénéficie d’un tissu industriel extrêmement développé, dans le voisinage des sites comme au niveau national, de l’existence dans les installations en fonctionnement d’une main-d’œuvre qualifiée et abondante, de technologies éprouvées et d’une expérience acquise lors de situations particulièrement difficiles : en effet, l’activité de démantèlement a débuté dans les années quatre-vingt sur des installations du cycle du combustible mises en service à une époque où les modes de gestion étaient moins développés et qui ont pu connaître des incidents de production, de sorte qu’on a commencé par le plus compliqué. Les installations plus récentes seront plus faciles à démanteler.
M. le président François Brottes. Est-ce à dire que leur démantèlement coûtera moins cher et se fera plus rapidement ?
M. Arnaud Gay. Certainement.
M. le président François Brottes. Un EPR sera donc plus facile à démanteler ?
M. Arnaud Gay. Je pense qu’un réacteur de type EPR ou REP sera en effet plus facile à démanteler qu’un réacteur de la filière UNGG ou qu’un prototype comme Superphénix.
M. le président François Brottes. On ne pourra donc pas extrapoler le coût des démantèlements précédents pour évaluer les coûts à venir ?
M. Arnaud Gay. Il sera difficile de le faire si les réacteurs relèvent de filières différentes, car le processus de démantèlement n’est pas le même.
Si la filière française du démantèlement possède des atouts, elle est également confrontée à des difficultés.
Celles-ci sont d’abord liées au cadre réglementaire : celui-ci, qui s’impose à toute activité en matière nucléaire, a été défini par et pour l’exploitation. Or, si la phase d’exploitation vise à la stabilité et à ne pas perturber le fonctionnement des installations, on fait précisément le contraire dans le cadre du démantèlement : nous passons notre temps à modifier la configuration de l’installation, à ouvrir des chantiers et à provoquer des aléas. Le cadre réglementaire applicable à l’exploitation, qui est – à raison – très rigide, s’adapte donc mal aux activités de démantèlement. Il peut, en outre, provoquer des tensions dans les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants, les interruptions des chantiers pouvant déboucher sur des demandes d’avenants aux contrats, voire sur des conflits.
M. le président François Brottes. Vous souhaiteriez donc un cadre réglementaire spécifique ?
M. Arnaud Gay. Il faudrait au moins mettre au point de nouvelles relations contractuelles, afin de mieux gérer collectivement le risque.
Deuxième difficulté : les chantiers de démantèlement sont moins attractifs que les chantiers de construction et, même si l’on commence à se préoccuper davantage de développement durable, le recrutement y est plus difficile.
Troisièmement, certaines filières de déchets ne disposent toujours pas d’exutoires. Ainsi le stockage des déchets radioactifs de faible activité à vie longue – par exemple le graphite contaminé – n’existe toujours pas, ce qui laisse pendante la question de la façon dont ces déchets doivent être conditionnés. Certaines catégories de déchets engendrés par le démantèlement, comme les déchets amiantés contaminés, font aussi problème. Il serait nécessaire de se doter d’exutoires de filières pour l’ensemble des déchets à évacuer.
Enfin, il s’agit, comme je vous le disais, d’une activité trop peu industrialisée, qui n’est pas encore parvenue à maturité.
Pour tenter d’améliorer la situation, le groupe de travail a essayé d’identifier les leviers sur lesquels jouer. Après plus d’un an de travail, nous sommes sur le point d’arrêter nos conclusions, qui seront proposées au prochain comité de pilotage. Je ne pourrai donc vous les présenter en détail aujourd’hui car cela me mettrait dans une position délicate vis-à-vis du CSFN ; en revanche, je peux vous indiquer les constats auxquels nous avons abouti et nos grands axes de réflexion.
M. le président François Brottes. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous nous devez la vérité. Nous avons bien compris que les conclusions du groupe de travail n’avaient pas été validées par le comité de pilotage, mais il faut nous dire ce que vous savez, sinon notre réflexion ne pourra jamais progresser !
M. Arnaud Gay. Je compte bien vous présenter les principaux leviers que nous avons identifiés et les pistes que nous privilégions ; les actions précises, en revanche, ne sont pas encore définies. Je n’ai aucunement l’intention d’occulter la vérité !
Je commencerai par l’emploi. Actuellement, les besoins en effectifs varient selon les sites et selon les phases du projet ; il existe toutefois un consensus pour dire que, de ce point de vue, l’activité de démantèlement ne représente que 10 à 20 % de l’activité d’exploitation – le bas de la fourchette correspondant plutôt au démantèlement des réacteurs et le haut à celui des installations du cycle du combustible.
Il faut, en outre, gérer les fluctuations de l’activité, car celle-ci n’est ni étale, ni linéaire. L’ouverture d’un chantier de démantèlement provoque une bouffée d’activité, à laquelle succèdent des phases plus calmes – nouvelles mesures, procédures de requalification, demandes d’autorisation –, qui alternent avec des pics d’activité, variables en fonction des métiers.
Enfin, le démantèlement est par nature un métier très particulier. Alors que durant la phase d’exploitation, les opérateurs s’efforcent de maintenir le système en l’état, en en surveillant le bon fonctionnement et en assurant l’interface entre les entités, il s’agit dans le cadre du démantèlement de faire avancer un chantier et d’encadrer l’activité. Du coup, il faut gérer à la fois l’évolution de l’emploi sur le site, avec des reclassements, et le développement de compétences nouvelles. Nous en tirons la conclusion qu’un projet de démantèlement ne peut se développer de façon sereine s’il n’inclut pas un programme de gestion des ressources et un volet social – la relation doit être consubstantielle.
En second lieu, il serait nécessaire d’adapter le cadre réglementaire au démantèlement, afin notamment de mieux gérer le risque. L’activité de démantèlement visant à réduire la quantité d’éléments radioactifs présents sur le site, on pourrait concevoir d’adapter, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, la gestion de la sûreté au risque réel subsistant. Il faudrait pour ce faire engager une réflexion avec l’ASN. L’objectif serait de basculer d’une sûreté « sur le papier », garantie par des référentiels, vers une sûreté opérationnelle, qui encadrerait l’activité sur le chantier proprement dit.
M. le président François Brottes. Sur le site de Superphénix, l’ASN n’a-t-elle pas précisément noté un manque à ce dernier égard ?
M. Philippe Bernet, vice-président du groupe de travail « Démantèlement » du Comité stratégique de la filière nucléaire. Le site de Superphénix a pour particularité d’abriter deux INB : la centrale, qui est en démantèlement, et une installation d’entreposage de combustibles, qui est encore en exploitation. Sur un tel site, il faut maintenir des dispositions pour gérer les situations de crise à l’instar de ce qui existe sur les centrales en fonctionnement. C’est sur ce point que l’ASN a été amenée à faire un certain nombre de commentaires.
M. Arnaud Gay. S’agissant maintenant de la sous-traitance, il faudrait trouver des modes de contractualisation plus conformes à la réalité de l’activité, avec un meilleur partage des risques. En la matière, plusieurs formules sont concevables, comme par exemple un partage des analyses de risques dans un cadre contractuel ou un affermissement progressif des contrats, mais il convient en tout cas d’en imaginer de plus adaptées.
Voilà pour l’état des lieux en France ; j’en viens maintenant aux perspectives de développement à l’international.
Pour commencer, il convient de rappeler qu’une quinzaine de réacteurs ont d’ores et déjà été démantelés dans le monde, principalement des réacteurs de puissance aux États-Unis et en Allemagne – neuf avaient une puissance supérieure à 100 mégawatts. On dispose donc d’une certaine expérience en la matière.
Le marché du démantèlement est appelé à se développer de manière mécanique, sous l’effet de deux phénomènes principaux. Le premier est structurel : les installations de première génération ayant été construites dans les années 1950 et 1960, elles arrivent à des âges où il est raisonnable d’envisager de les démanteler.
M. le président François Brottes. C’est-à-dire ?
M. Arnaud Gay. Cela dépend des pays. Aux États-Unis, on a décidé de prolonger la durée de vie de certaines centrales jusqu’à soixante ans.
M. le président François Brottes. Et cela vous paraît raisonnable ?
M. Arnaud Gay. Si c’est validé par l’autorité de sûreté compétente, il n’y a aucune raison que cela ne le soit pas.
À ces raisons structurelles s’ajoute un phénomène conjoncturel, lié d’une part à l’accident de Fukushima, qui a conduit plusieurs pays, en particulier l’Allemagne et bien sûr le Japon, à prendre la décision d’arrêter des centrales, d’autre part à l’émergence du gaz de schiste aux États-Unis, qui a modifié l’équation économique du marché électrique : les centrales américaines les plus anciennes, qui auraient eu besoin d’engager de lourds travaux de mise à niveau, hésitent maintenant à le faire, l’investissement risquant de n’être pas rentable.
On évoque souvent dans la presse plusieurs dizaines de milliards d’euros pour le marché mondial du démantèlement, mais il faut là encore relativiser : cette somme correspond à une activité étalée sur plusieurs dizaines d’années. Par exemple, sur le site de Sellafield, au Royaume-Uni, le plan de démantèlement court jusqu’à 2100 – mais il est vrai que c’est un cas particulier. Le démantèlement des installations du cycle du combustible dure en général plus longtemps que celui des réacteurs.
Si l’on transpose en flux annuels les dizaines de milliards des projets identifiés, le marché réel est bien plus réduit, d’autant que, comme je l’ai dit, 40 à 60 % des coûts provisionnés ne sont pas accessibles aux industriels, mais sont consommés par le site lui-même ou par la gestion des déchets. En outre, il est bien évident que l’on a tendance à s’adresser de façon privilégiée à la chaîne de sous-traitance locale, présente autour des sites, de manière à limiter l’impact social de l’arrêt de l’exploitation. Il est dès lors difficile pour une société étrangère de pénétrer ces marchés.
Il s’agit donc d’un marché extrêmement restreint, qui nécessite un niveau de valeur ajoutée élevé.
Plusieurs entreprises membres du groupe de travail sont actives à l’international : AREVA est présent aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, Vinci au Royaume-Uni ainsi que dans les pays de l’Est où est également actif le groupe Onet, tandis que les sociétés d’ingénierie comme Assystem et Technip ont des implantations partout dans le monde. On peut espérer qu’il sera possible de développer une activité dans les pays concernés en s’appuyant sur cette présence locale. Ailleurs, il faudra probablement passer par des partenariats ; une des clefs pour accéder à ce marché extrêmement compétitif sera d’apporter de la valeur ajoutée.
Voilà les conclusions auxquelles a abouti le groupe de travail. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
M. le président François Brottes. Pour ma part, j’en ai trois.
Peut-on faire cohabiter sur un même site la construction d’un nouveau réacteur et le démantèlement d’un précédent ?
Est-il concevable de réaliser des démantèlements partiels, en sanctuarisant un site une fois les éléments les plus contaminés évacués ?
La durée d’un démantèlement peut-elle être prolongée sans que cela présente de risques – autres que ceux, financiers, qui résulteraient de l’étalement de la dépense ?
M. Arnaud Gay. Activités de démantèlement et d’exploitation cohabitent déjà sur certains sites. Par exemple, à La Hague, on est en train de démanteler UP2 400, la première usine de retraitement, alors que deux installations continuent de fonctionner juste à côté : cela ne pose aucune difficulté, sinon de bien définir les interfaces entre les différentes unités. Je ne vois pas en quoi un chantier de construction aurait un impact différent ; a priori, il n’existe pas d’incompatibilités entre les deux activités.
Quant aux démantèlements partiels, d’un point de vue strictement technique, on peut imaginer de poser des jalons d’activité et de définir des moyens de surveillance ad hoc qui permettront de laisser l’installation dans un état donné. C’est d’ailleurs plus ou moins ce qu’envisagent de faire les industriels américains.
M. le président François Brottes. Et cela ne risque pas d’être une source de danger ?
M. Arnaud Gay. Tout dépend du dispositif de surveillance mis en place. Si on laisse l’installation en l’état, il faut conserver celui qui existait au moment de l’arrêt, mais il serait probablement possible de l’adapter au fur et à mesure que le démantèlement progressera.
L’option retenue aujourd’hui est le démantèlement immédiat. Toutefois, techniquement, rien ne s’opposerait à un autre choix. Il faudrait alors déterminer des états intermédiaires, avec des moyens de surveillance adaptés de manière à maintenir l’installation en situation de sûreté durant un certain temps – qui dépendra aussi des moyens financiers requis.
Du coup, on peut prolonger autant que l’on veut la durée de ces opérations. La question est plutôt de savoir si cela est acceptable réglementairement et si l’on parviendra à définir des moyens de surveillance économiquement efficaces ; en effet, si le maintien en sûreté de l’installation coûtait plus cher qu’un démantèlement complet, il serait préférable du point de vue économique de mener à terme l’ensemble des opérations.
M. Denis Baupin, rapporteur. L’ASN préconise un démantèlement le plus rapide possible après la mise à l’arrêt définitive des installations, pour que les compétences des exploitants puissent être utilisées. Est-ce également votre position ? Constatez-vous, dans les chantiers, ce besoin de compétences ? Comment cela se traduit-il concrètement ?
On dit souvent que les activités de démantèlement sont plus dangereuses que celles liées à l’exploitation et qu’elles exigeraient des précautions particulières, notamment pour l’intervention des personnels. Qu’en pensez-vous ? Peut-on imaginer de robotiser une partie de la filière ?
S’agissant des effectifs de la filière, pourriez-vous préciser si les chiffres que vous avez cités – 10 à 20 % de l’activité d’exploitation et 17 500 emplois – concernent le démantèlement stricto sensu ou s’ils incluent des activités connexes, comme le gardiennage ?
Qu’adviendra-t-il si la rentabilité n’est pas au rendez-vous ou si les besoins financiers se révèlent plus élevés que ce qui était prévu ?
Quel est votre retour d’expérience concernant l’écart entre le coût réel du démantèlement et ce qui avait été prévu dans les devis et provisionné ?
Enfin, quand le démantèlement de Superphénix sera-t-il achevé ? Avant celui de Sellafield ?
Mme Frédérique Massat. Serait-il concevable d’organiser une filière industrielle française du démantèlement ? Qu’en est-il aux niveaux européen et mondial : en existe-t-il, et si oui, dans quels pays ? En Allemagne, par exemple, la décision de sortir du nucléaire a-t-elle débouché sur la formation d’une telle filière ?
Vous appelez de vos vœux une adaptation du cadre réglementaire, mais quels seraient, concrètement, les points à modifier ? D’autre part, j’ai trouvé vos propos opposant la sûreté opérationnelle et la sûreté sur le papier quelque peu inquiétants ; pourriez-vous préciser votre pensée ?
Qui se charge de la formation aujourd’hui : sont-ce les opérateurs du nucléaire ou existe-t-il des formations publiques ? Dans ce domaine, n’y aurait-il pas des mesures à prendre dans la perspective d’une mise en œuvre des annonces présidentielles sur la diminution de la part du nucléaire ?
M. le président François Brottes. J’ajouterai deux autres questions.
Disposez-vous d’informations sur le démantèlement des réacteurs en Allemagne ?
Les provisions pour démantèlement sont-elles suffisantes ?
M. Philippe Bernet. Dans le cadre du passage de l’activité d’exploitation à celle de démantèlement, il est fondamental d’assurer le transfert de la connaissance de l’installation, et la meilleure façon de le faire est d’établir un lien entre celui qui l’a exploitée et celui qui est chargé de la démanteler. Dans la phase de démarrage du démantèlement, il est fort utile de disposer directement des compétences de ceux qui ont assuré l’exploitation – c’est ce qui se passe sur plusieurs de nos chantiers ; mais, progressivement, les choses se simplifient et les personnes qui ont participé au fonctionnement et au début du démantèlement peuvent quitter le chantier en laissant l’installation entre de bonnes mains.
M. Arnaud Gay. Par nature, l’activité de démantèlement ressemble à celle de maintenance : il s’agit souvent des mêmes opérations, quoique plus inhabituelles. Leur dangerosité est-elle plus importante ? Oui et non. Oui, précisément parce qu’elles sont inhabituelles ; non, parce que les niveaux de radioactivité diminuent avec le temps. Là où ils sont élevés, on opère à distance et les individus ne sont pas particulièrement en danger.
M. le rapporteur. Les reportages sur le démantèlement de Brennilis montrent quand même les difficultés à atteindre le cœur du réacteur, zone où l’on intervient rarement pour des opérations de maintenance. N’est-ce pas plus compliqué ?
M. Arnaud Gay. Je ne connais pas le cas de Brennilis, mais quand il s’agit d’opérations à risque, on procède en général sous eau, à distance, avec des outils robotiques ; c’est notamment le cas pour le démantèlement de l’intérieur des cuves et des cuves elles-mêmes des réacteurs de puissance à eau pressurisée en Allemagne. Pour le reste, c’est-à-dire la décontamination des ouvrages de génie civil, le risque est plus raisonnable. L’avantage de travailler sur une filière de réacteurs, c’est que les configurations des cœurs se ressemblent : les solutions techniques sont donc transposables une fois qu’on a démantelé un réacteur type. C’est moins vrai pour le démantèlement des installations du cycle du combustible, où il faut à chaque fois adapter les solutions.
Le démantèlement nécessite-t-il de développer une robotique particulière ? Dans le cas des réacteurs de puissance, on bénéficie déjà d’un retour d’expérience, notamment en provenance d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie ; il reste à le qualifier et à l’adapter. Par contre, face à des prototypes ou à des installations uniques, il faudra développer des solutions spécifiques.
Quand je dis que les besoins en effectifs correspondent à 10 à 20 % de l’activité générée sur le site en phase d’exploitation, cela inclut les personnels de surveillance qui assurent la sécurité et la sûreté du site, ainsi que les personnels d’encadrement et les intervenants. En revanche, le chiffre de 17 500 correspond à tous les emplois directs et indirects, bien au-delà du travail sur site.
M. Philippe Bernet. Par exemple, un total de 100 personnes travaillent au démantèlement de la centrale de Chooz A, qui est bien avancé puisqu’on est en train de démanteler le circuit primaire principal : 25 agents d’EDF sont chargés de l’exploitation, de la surveillance et de la coordination générale – c’est-à-dire de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre – et un peu moins de 80 personnes participent aux opérations de démantèlement et de conditionnement des déchets.
M. Arnaud Gay. S’agissant de la rentabilité de l’activité, mon sentiment personnel est que le système n’étant pas encore industrialisé, on n’atteint pas un niveau de performance qui permettrait d’obtenir une rentabilité suffisante. Notre groupe de travail avait précisément pour mission d’identifier les points de faiblesse. Si nous parvenons à remédier à ceux-ci, nous atteindrons un niveau de fiabilité dans l’activité qui permettra de dégager une meilleure rentabilité ; les chantiers ne porteront pas sur des montants fondamentalement différents, mais ils s’en trouveront fluidifiés. Il faut le faire en impliquant les sous-traitants ; cela aura-t-il pour conséquence d’augmenter le montant des devis ? Je ne le crois pas, dans la mesure où il existe une réserve importante d’efficacité dans le système actuel.
Pour ce qui est de l’écart entre les provisions pour démantèlement et le coût réel de celui-ci, il me semble que le sujet échappe à la compétence du CSFN. Il m’est donc difficile de me prononcer, car nous n’avons pas du tout travaillé sur ces questions. Je vous invite à interroger sur ce point les représentants d’AREVA, d’EDF et du CEA lorsque vous les auditionnerez.
M. le rapporteur. Vous évoquez un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros et vous n’auriez pas regardé si cela correspondait aux provisions ? J’ai du mal à le croire !
M. Arnaud Gay. Nous nous sommes intéressés au niveau d’activité engendré par le démantèlement pour regarder s’il existait un marché potentiel, mais pas à l’efficacité des provisions : ce sujet regarde les donneurs d’ordres. C’est à ceux-ci qu’il faut vous adresser.
M. le président François Brottes. Il s’agit pourtant d’une question importante ! Il est difficile d’imaginer que vous ne l’ayez pas du tout examinée…
M. Arnaud Gay. C’est pourtant le cas. Pour ce qui concerne AREVA, vous avez prévu d’auditionner M. Pierre Aubouin la semaine prochaine : je pense qu’il se fera un devoir de vous répondre.
M. le président François Brottes. Et qu’en est-il à EDF, monsieur Bernet ?
M. Philippe Bernet. Nous n’avons pas examiné la question dans le cadre du CSFN ; dans le cadre d’EDF, il s’agit d’un autre exercice, monsieur le président.
M. le président François Brottes. C’est possible, mais peut-être pourriez-vous vous répondre à la question ?
M. Philippe Bernet. Je ne suis pas forcément qualifié, ni autorisé pour le faire. Tout au plus puis-je rappeler qu’en janvier 2012 la Cour des comptes a rendu sur le sujet un rapport très complet qui n’a pas remis en cause les méthodes de travail et les provisions d’EDF, tout en indiquant que celles-ci se situaient plutôt dans le bas de la fourchette par comparaison avec d’autres pays.
M. le rapporteur. Notre question ne porte pas sur l’avenir, mais sur votre retour d’expérience des chantiers en cours : ceux-ci coûtent-ils, oui ou non, plus cher que prévu ? Je ne peux pas croire que vous n’ayez pas cette information !
M. Philippe Bernet. Ce n’est pas un sujet que nous avons abordé dans le cadre du CSFN ; c’était hors de question, ce comité réunissant à la fois les donneurs d’ordre et les industriels qui travaillent pour eux.
M. le président François Brottes. Dans ce cas, à qui faut-il poser la question ?
M. Arnaud Gay. Aux représentants d’EDF, d’AREVA et du CEA, dans le cadre des auditions que vous avez prévues avec eux.
M. le rapporteur. Même s’agissant des installations qu’on a commencé à démanteler ?
M. Arnaud Gay. Ce sujet ne concerne pas le CSFN.
M. le président François Brottes. Notre commission est chargée d’évaluer ce que coûte la filière nucléaire ; par conséquent, nous avons besoin de savoir ce qu’il en est pour le poste du démantèlement. Et vous, vous nous répondez que vous examinez si le démantèlement est faisable et avec qui, mais que vous ne savez pas combien cela coûte et que vous ne voulez pas le savoir. Admettez que c’est fâcheux !
M. Philippe Bernet. Tout ce que je peux vous dire concernant EDF, c’est que ce qui apparaît dans les comptes consolidés de l’exercice 2012 reste d’actualité.
M. le président François Brottes. Y compris au regard de ce que vous observez sur les chantiers en cours ?
M. Philippe Bernet. Au cours des exercices successifs entre 2001 et 2012, il a été procédé à des réajustements. Du fait que nous ne disposions d’aucun retour d’expérience concernant le démantèlement du parc de la première génération, la méthode retenue fut de réviser régulièrement les estimations. Aujourd’hui, la dernière estimation, qui remonte à l’exercice 2012, est confirmée par les informations dont nous disposons.
M. le rapporteur. Posons la question différemment : on dit que le démantèlement de Brennilis coûterait 26 % de plus que les devis initiaux. Est-ce vrai ?
M. le président François Brottes. Et si tel est le cas, quelle en est la raison ?
M. Philippe Bernet. Les éléments de réponse figurent dans le rapport de la Cour des comptes.
M. le président François Brottes. Alors, quelles sont les causes de ce dépassement ? Est-il lié aux procédures que vous avez évoquées ? Avait-on sous-estimé les difficultés ? Les compétences ou les outils ont-ils fait défaut ? Ou est-ce parce que le chantier dure plus longtemps que prévu ?
M. Philippe Bernet. Il est difficile de répondre de manière simple à ces questions...
D’abord, EDF a changé de stratégie. Jusqu’en 2000, l’option retenue était l’attente : après l’arrêt des premières installations – celui de Chinon A1 remonte à 1973, il y a plus de quarante ans –, le combustible était évacué, les installations étaient mises en situation de sûreté après des démantèlements partiels, la plupart restant sous surveillance. En 2001, changeant de stratégie, EDF a décidé d’engager la phase suivante et d’aller jusqu’au démantèlement complet. Pour ce faire, certaines conditions doivent être réunies ; il faut notamment disposer de filières de gestion des déchets générés. Selon les hypothèses retenues à l’époque, et que l’on retrouve dans la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, plusieurs dispositions devaient être prises en ce sens, notamment la création en 2013 d’un centre de stockage des déchets de faible activité à vie longue – principalement destiné à accueillir le graphite entreposé dans les caissons des centrales UNGG. Ce centre n’a pas été ouvert et l’on sait aujourd’hui qu’il ne le sera pas de sitôt. Cela a nécessairement des conséquences sur le programme !
Du coup, il a fallu revoir le planning et l’on se heurte à quelques difficultés, mais tout est sous contrôle : les hypothèses de départ restent valables même si elles ont été actualisées en 2012.
M. le président François Brottes. Avez-vous auditionné les opérateurs chargés des démantèlements, pour qu’ils vous fassent part des difficultés qu’ils ont rencontrées et qu’ils retracent l’évolution des coûts ?
M. Arnaud Gay. Notre mission était, en partant d’un état de la situation actuelle, d’identifier les outils susceptibles d’être développés afin d’améliorer la performance du système. C’est ce que nous avons fait. Nous avons abouti à la conclusion qu’il existait trois principaux leviers – le levier social, le levier réglementaire et le levier contractuel – et qu’il serait également nécessaire de mieux caractériser les états initiaux. Nous avons travaillé dans l’optique de trouver, ensemble, des solutions globales plutôt que d’éplucher les coûts. D’ailleurs, ce n’était pas le lieu : les industriels n’avaient pas forcément envie d’en parler.
M. Philippe Bernet. S’agissant de Superphénix, précisons que l’on parle du réacteur, et que l’achèvement du démantèlement de celui-ci est prévu à l’horizon 2030. Une étape importante vient d’être franchie, dans le respect du planning arrêté il y a quelques années, avec la vidange de la cuve principale et le traitement du sodium qu’elle contenait. Il s’agit d’une opération atypique, qui a mobilisé beaucoup de ressources et des équipements particuliers.
M. le président François Brottes. Cela signifie-t-il que le démantèlement de Superphénix ne pourra pas servir de référence pour les autres chantiers ?
M. Philippe Bernet. En effet : l’opération qui vient de s’achever est spécifique à cette filière.
M. Arnaud Gay. Mais cela pourra servir à l’export !
Madame Massat, le fait de créer au sein du CSFN un groupe de travail sur le démantèlement et la reprise des déchets était bien une façon de s’interroger sur la possibilité de créer une filière spécifique. La conclusion à laquelle nous aboutissons, après plus d’un an de travail avec les organisations syndicales, les donneurs d’ordre, les sous-traitants, l’ANDRA et les représentants de l’État, est qu’il y a un réel intérêt à se rencontrer pour évoquer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et pour réfléchir ensemble à des solutions. N’est-ce pas là l’embryon d’une filière ?
La formation participe également à la constitution d’une filière. Or il existe des formations universitaires au démantèlement, notamment des masters 2 à Montpellier, à Cherbourg et à Avignon, ainsi que des formations interentreprises, avec un fonds de formation commun.
Au-delà, il existe un réseau d’entreprises, qui participent au groupe de travail. Doit-on en conclure qu’il existe une filière du démantèlement en France ? Ce serait peut-être aller vite en besogne, car celle-ci n’est pas encore formalisée en tant que telle, mais les éléments constitutifs sont présents.
Quant au cadre réglementaire, peut-être ai-je été un peu abrupt. Je vais nuancer mon propos. Aujourd’hui, la sûreté nucléaire repose sur une description précise des opérations à mener et sur une approche déterministe : il s’agit d’empêcher la survenue de tout imprévu dans le cadre du référentiel qui a été adopté. Autrement dit, il faut décrire avec précision, dix ans à l’avance, les interventions qui auront lieu dans une installation où l’on n’a pas encore commencé à travailler. En général, lorsque le chantier démarre, on s’aperçoit que la réalité physique n’est pas celle qu’on attendait. Dans le cadre réglementaire actuel, cela impose d’arrêter le chantier, de reprendre le dossier d’étude et de déposer une nouvelle demande d’autorisation. Cela ne favorise pas l’efficacité !
Il serait préférable d’avoir un système qui permette de gérer de multiples configurations sans figer la solution technique trop en amont ; il faudrait, en outre, renforcer la responsabilité opérationnelle en matière de sûreté, de façon qu’un plus grand nombre de personnes ait la capacité de réagir et d’adapter les scénarios en fonction des contraintes observées.
M. le président François Brottes. Si vous avez des propositions à faire en la matière, nous sommes preneurs !
M. Arnaud Gay. Elles ne sont pas encore formalisées : ce sera la prochaine étape de notre travail. Nous allons soumettre au comité de pilotage plusieurs thématiques sur lesquelles nous pensons qu’il conviendrait de faire des recommandations, et il faudra ensuite formuler celles-ci, ce qui ne pourra pas se faire sans l’aide de l’ASN – qui n’est pas représentée au sein du CSFN.
S’agissant de l’Allemagne, nous disposons d’informations puisque le responsable de la branche « Démantèlement réacteurs » chez AREVA est allemand. C’est là que nous avons de l’expérience et que le marché est susceptible de décoller ; mais c’est aussi un exemple de « glissement » du calendrier. Au départ, tout le monde disait que c’était merveilleux, qu’il y aurait beaucoup de centrales à démanteler et que cela engendrerait une activité qui prendrait naturellement le relais de l’exploitation. Or on s’est aperçu que, la décision ayant été prise quelque peu abruptement, les industriels n’étaient pas prêts au démantèlement et il a fallu tout reprendre à zéro, en lançant des études stratégiques et en définissant les schémas industriels. On en est encore à ce stade ; les demandes d’autorisation de démantèlement n’ont toujours pas été déposées.
M. le président François Brottes. Et le financement ? Est-il assuré ?
M. Arnaud Gay. Il doit l’être à peu près. Il s’agit d’un financement par les industriels pour lequel chaque entreprise a dû provisionner. En revanche, comme un certain nombre d’installations ont été arrêtées prématurément, il y a des conflits entre les industriels et l’État, les premiers indiquant qu’ils n’ont pas eu le temps de provisionner. On estime qu’il faudra encore deux ou trois ans avant que les opérations de démantèlement sur site puissent démarrer.
Quant au niveau des provisions, la question rejoignant celle sur l’écart entre coût prévu et coût réel, je vous invite à la poser aux représentants des donneurs d’ordres lorsque vous les auditionnerez.
M. le président François Brottes. Messieurs, merci d’avoir répondu à quelques-unes de nos questions… Pour les autres, nous nous adresserons ailleurs !
Audition de MM. Jean-Claude Delalonde, président de l’ANCCLI (Association nationale des comités et commissions locales d’information), Jean-Paul Lacote, vice-président de l’ANCCLI et membre de la CLI de Fessenheim, et Florion Guillaud, trésorier de l’ANCCLI et membre de la CLI du Blayais
(Séance du 26 mars 2014)
M. le président François Brottes. L’Association nationale des comités locaux et commissions locales d’information (ANCCLI) constitue en quelque sorte un club, au sein duquel se sont rassemblés les commissions locales et comités locaux d’information (CLI).
M. Jean-Claude Delalonde, président de l’Association nationale des comités locaux et commissions locales d’information. L’ANCCLI a une existence institutionnelle.
M. le président François Brottes. A-t-elle été créée par la loi ?
M. Jean-Claude Delalonde. Oui.
M. le président François Brottes. Le « cœur de métier », comme l’on dit, de l’ANCCLI consiste à organiser la transparence, le pluralisme et la vigilance citoyenne sur les grandes installations nucléaires en fonctionnement. Le législateur a tenu à ce qu’il existe une CLI par installation. Ces commissions regroupent des personnes très vigilantes en matière de nucléaire, dont beaucoup – vous nous direz si c’est exact – seraient plutôt défavorables à ce mode de production de l’énergie. Elles sont normalement un lieu où l’information doit circuler, dans un domaine dont l’opacité est souvent critiquée. Le législateur a en effet souhaité associer les citoyens au contrôle des centrales, en sus des acteurs traditionnels ayant un intérêt direct à agir. Le travail des CLI est donc complémentaire de celui, technique, de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), à laquelle s’impose également un devoir de transparence, d’intégrité et d’objectivité. Quelles relations entretenez-vous avec cette Autorité ?
Ne pouvant inviter des représentants de toutes les CLI, nous avons adressé notre invitation à l’ANCCLI. Nous vous savons toutefois gré d’être venus à plusieurs, ce qui vous permettra de nous éclairer sur le fonctionnement des CLI et sur les améliorations qui pourraient y être apportées. La présence parmi vous d’un représentant qui se trouve être élu en Allemagne nous permettra d’évoquer aussi le démantèlement des réacteurs dans ce pays.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Jean-Claude Delalonde, Jean-Paul Lacote et Florion Guillaud prêtent serment)
M. Jean-Claude Delalonde. Je vous remercie de nous avoir conviés à vos travaux. Nous espérons répondre à vos interrogations et lever certaines incompréhensions quant au rôle et aux missions respectives des CLI et de l’ANCCLI.
L’ANCCLI fédère les 38 CLI qui existent sur le territoire national autour d’un site nucléaire. Créées par une circulaire du Premier ministre, dite circulaire Mauroy, en 1981, les CLI ont été institutionnalisées par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Un décret du 12 mars 2008 a précisé leur organisation ainsi que leur fonctionnement et prévu qu’elles devaient se fédérer. Cette loi et ce décret ont conforté la fédération nationale, qui s’était constituée en 2000.
Il est vrai, monsieur le président, qu’en 2000, l’ANCCLI constituait plutôt un « club » des présidents de CLI. Sur la vingtaine de commissions qui existaient alors, dix avaient considéré que les problèmes génériques qu’elles rencontraient dans leur fonctionnement justifiaient de se doter d’une organisation plus structurée. C’est ainsi qu’a été créée une association loi de 1901 militant pour qu’autour de chaque centrale nucléaire, non seulement une CLI soit effectivement mise en place par arrêté du président du conseil général, comme il était prévu, mais qu’elle dispose d’authentiques moyens de fonctionnement – à l’époque, comme aujourd’hui encore d’ailleurs, toutes fonctionnaient exclusivement avec des bénévoles. Nous n’avons également cessé de demander aux gouvernements successifs que la loi reconnaisse leur existence institutionnelle, ce à quoi nous sommes parvenus, à la satisfaction de toutes les parties. Nous avons aussi défendu, non sans difficulté mais avec succès, la diversité de la représentation au sein des CLI – pro- et anti-nucléaires, élus, représentants des salariés, experts et personnalités qualifiées, représentants du monde économique….
Nous avons décidé à l’ANCCLI que prévaudrait au sein de l’association le principe « un homme une voix ». Comme les commissions locales, l’Association nationale est composée de quatre collèges, comptant chacun huit membres : un collège des élus, choisis par les CLI ; un collège des associations de défense de l’environnement, regroupant pro- et anti-nucléaires ; un collège des organisations syndicales des salariés des centrales – à l’exclusion de ceux des sous-traitants – et un collège de personnalités qualifiées.
Dans leur diversité, les 32 membres de l’ANCCLI ont toujours réussi à parler d’une seule et même voix. Toutes les orientations préconisées par l’Association depuis 2005 l’ont été à l’unanimité. Jean-Paul Lacote ici présent est bien connu pour ses positions anti-nucléaires. Pour ma part, je n’appartiens à aucun mouvement. J’ai été pendant 34 ans élu politique, comme Florion Guillaud. Quelles que puissent être parfois nos divergences, nous nous accordons toujours sur le rôle et la mission principale, unique même, des CLI et de l’ANCCLI, qui est de tout faire pour garantir la sûreté et la sécurité nucléaires.
M. le président François Brottes. Quel est le budget de l’ANCCLI ?
M. Jean-Claude Delalonde. J’allais y venir. Comme je l’ai dit, les CLI et l’ANCCLI fonctionnent avec des bénévoles. Seuls les élus sont indemnisés pour participer à leurs travaux, pas les membres des associations.
Le législateur avait prévu d’instituer auprès de chaque site Seveso un comité local d’information et de surveillance (CLIS). Ainsi à Dunkerque où, dans un rayon de cinq kilomètres autour de la centrale de Gravelines, dont j’ai présidé la CLI durant treize ans, il existe dix-huit sites Seveso : ce sont autant d’instances qu’il aurait fallu mettre en place, avec chacune les mêmes composantes. Comment de simples bénévoles auraient-ils pu assister aux travaux de dix-huit instances ? La difficulté aurait sans doute été la même pour les élus qui, soit dit au passage, bien qu’indemnisés, ont sans doute été les moins assidus. Nous avons donc mutualisé les moyens humains et les moyens financiers, même si, ou précisément parce que ces derniers étaient quasi nuls.
La circulaire Mauroy de 1981 prévoyait que l’exploitant accorde des moyens financiers aux CLI. Mais aucun cadre précis n’ayant été fixé, ces moyens ne sont pas venus. Nous avons milité, comme je l’ai dit, pour que le législateur fasse le nécessaire. Comme les centrales procuraient de substantielles recettes de taxe professionnelle aux communes, aux structures intercommunales et aux départements, et que le pouvoir de fixer la composition des CLI avait été confié aux présidents de conseils généraux, il a été jugé normal que les départements financent ces commissions. Alors même que la période était plus faste qu’aujourd’hui, il a été difficile d’obtenir à la hauteur souhaitée la contribution de toutes les collectivités concernées. Nous avons alors demandé que la loi permette d’affecter aux CLI et à l’ANCCLI une part du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB), dont l’exploitant s’acquitte auprès de l’État et qui représente près de 600 millions d’euros par an. Cette proposition a été reprise par le législateur, puis confirmée dans le décret. Mais, six ans plus tard, force est de constater que ce n’est toujours pas appliqué. La faute à Bercy, nous dit-on ! Celle du ministre ? Non, des services, nous précise-t-on !
En dépit donc des dispositions législatives et réglementaires, les CLI ne disposent toujours pas des moyens financiers nécessaires. Nous avons tenté d’obtenir des crédits par l’intermédiaire de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Et Bercy a en effet confirmé qu’une partie des crédits alloués par l’État à l’ASN – sans préciser toutefois à quelle hauteur – devait financer le fonctionnement de nos commissions et de leur association. Il y a quatre ans, le total de ces crédits ne s’élevait qu’à 300 000 euros pour l’ANCCLI et les 38 CLI. Ayant fait part de notre mécontentement et de notre inquiétude, nous avons réussi à obtenir, sous la majorité précédente, que ce montant soit porté à 600 000 euros par an, puis, après l’alternance, à un million d’euros.
Pour fonctionner convenablement, une CLI devrait en outre disposer au moins d’un local en propre – lorsqu’une commune en met gratuitement un à disposition, cela peut placer les élus en position délicate – et d’un minimum de moyens de secrétariat… à moins d’obtenir, comme c’était le cas pour beaucoup d’entre elles, la mise à disposition de personnels – mais n’est-ce pas là ce qu’on appelle en politique des emplois fictifs ?
M. le président François Brottes. Il existe aussi des emplois fictifs dans les entreprises !
M. Jean-Claude Delalonde. Je m’en tiens au champ politique car les CLI sont des instances créées par la loi.
M. le président François Brottes. Monsieur le président, nous vous avons laissé le temps d’exprimer vos doléances, comme il était normal. Il est prévu que nous auditionnions de nouveau l’ANCCLI lors d’une prochaine réunion mais, pour l’heure, nous nous intéressons aux problèmes soulevés par l’arrêt définitif d’une centrale. Quel peut être le rôle des CLI durant la phase de démantèlement d’une telle installation ?
M. Jean-Claude Delalonde. Je me contentais de répondre à votre question sur les moyens financiers. Pour les 38 CLI et l’ANCCLI, il faudrait un budget annuel non pas d’un million, mais de cinq millions d’euros.
M. le président François Brottes. Nous ne sommes pas Bercy !
M. Jean-Claude Delalonde. Nous l’avons bien compris depuis longtemps !
J’aborderai maintenant les cinq sujets sur lesquels l’ANCCLI souhaiterait vous fournir des éléments de réflexion : le mix énergétique…
M. le président François Brottes. Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui. Nous en traiterons une autre fois.
M. Jean-Claude Delalonde. Pour nous, le sujet de l’arrêt définitif d’une centrale est aussi lié à ceux du mix énergétique, du coût de la sûreté, des déchets, du démantèlement et du coût d’un accident nucléaire. Ce sont là les cinq points de l’exposé que nous avons préparé…
M. le président François Brottes. Nous ne traitons pas aujourd’hui d’accident nucléaire en phase d’exploitation.
M. Jean-Claude Delalonde. Pour nous, tout est lié et tourne autour de la sûreté. Même le jour où il sera décidé, décision sur laquelle nous n’avons pas à nous prononcer, d’arrêter une centrale puis de la démanteler ou de la sanctuariser, ce n’en sera pas fini des coûts. Que fera-t-on par exemple des déchets ? La part plus ou moins grande du nucléaire dans le mix énergétique n’est pas non plus indifférente sous l’angle du coût. Les CLI et l’ANCCLI s’interrogent sur ces sujets.
Je vais donc aborder rapidement les cinq points évoqués.
M. le président François Brottes. Nous avions invité l’ANCCLI également le 17 avril prochain. Si vous traitez de tout aujourd’hui, nous ne vous réentendrons pas.
M. Jean-Claude Delalonde. Vous en déciderez comme vous le souhaitez.
Sur le mix énergétique, il n’appartient pas à l’ANCCLI de formuler un avis…
M. le président François Brottes. Dans une commission d’enquête, la représentation nationale pose des questions et ceux qu’elle invite doivent y répondre. On n’y expose pas des réponses préparées d’avance à des questions qui n’ont pas encore été posées.
Nous avons organisé nos travaux par journées thématiques et traitons aujourd’hui du démantèlement des centrales. À élargir par trop le champ, le propos devient excessivement général. Comme nous n’ignorons pas que les CLI ont vocation, de par la loi mais aussi de par leur éthique, à s’intéresser à la vie d’une centrale, de ses débuts jusqu’à sa fin et même au-delà, nous vous avons invités une prochaine fois pour traiter des autres aspects. Nous vous demandons aujourd’hui de vous limiter au sujet prévu, faute de quoi l’organisation de nos travaux s’en trouverait perturbée. Voilà pourquoi je suis ferme.
M. Jean-Claude Delalonde. Je ne vous le reproche pas, monsieur le président.
Quelles que soient les décisions futures sur le mix énergétique et sur les autres sujets, qu’on ferme toutes les centrales demain ou qu’on le fasse en dix, quinze ou vingt ans, les problèmes soulevés par le nucléaire perdureront et la sûreté continuera d’être une préoccupation pour la société civile, que nous représentons. Le problème doit être pris très en amont. La seule façon d’éviter les surcoûts consécutifs à un éventuel incident ou accident est de faire de la prévention. La prévention, c’est la sûreté. Pour nous, cela passe, et c’est toute l’originalité du modèle français dont nous ne cessons de vanter les mérites au niveau européen et international, par l’existence d’une autorité de sûreté indépendante et efficace ainsi que d’une structure d’expertise publique hautement compétente – nous les avons avec l’ASN et avec l’IRSN, dont les moyens doivent impérativement être maintenus. Cela suppose également que la société civile soit en mesure d’exercer une vigilance permanente, en liaison avec ces deux instances.
Notre seule préoccupation est que, quelles que soient les décisions prises par l’État, la sûreté nucléaire demeure dans notre pays à un « haut niveau de standard ». C’est le cas aujourd’hui mais nous craignons que la crise économique ne conduise à rogner sur les moyens alloués à l’ASN et à l’IRSN, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement du point de vue environnemental et humain, mais aussi sur les coûts de la filière nucléaire, objet même de votre commission d’enquête.
M. le président François Brottes. Je vous remercie, tout en notant que vous ne nous avez pas dit grand-chose pour l’instant sur le démantèlement.
M. Denis Baupin, rapporteur. Notre commission s’intéresse à l’ensemble de la filière nucléaire, de l’extraction de l’uranium jusqu’au démantèlement des centrales et au traitement des déchets. Aujourd’hui, le président l’a dit, nous traitons de la fermeture des centrales, sujet d’actualité puisque est évoquée et préparée la fermeture de celle de Fessenheim.
Aux premières loges sur le terrain, comment voyez-vous la fermeture d’une centrale ? Comment la préparer et l’accompagner pour qu’elle s’effectue du mieux possible et ne soit pas vécue comme un drame ? Les CLI ont-elles d’ores et déjà engagé une réflexion collective sur le sujet ? Si oui, quels en sont les premiers éléments ?
Assurez-vous un suivi des opérations de fermeture en cours – je pense à celles des réacteurs graphite-gaz, ou encore des centrales de Brennilis et Creys-Malville ? Si oui, quel est votre retour d’expérience ? Quels éléments n’auraient pas été suffisamment pris en compte lors de ces arrêts et démantèlements ? La sûreté, capitale pendant l’exploitation d’une centrale, ne l’est pas moins ensuite puisque le risque ne disparaît pas avec la simple fermeture. Il est donc légitime que les CLI s’intéressent aussi au démantèlement.
Une autre préoccupation, dont je ne sais si elle relève ou non de votre compétence, est l’impact d’une fermeture d’une installation nucléaire sur le tissu économique local. Comment, à votre avis, devrait-elle être anticipée sous cet angle ? Quid de la poursuite de leur activité professionnelle pour les salariés de l’exploitant ? Quid des sous-traitants, pour lesquels l’incidence de la fermeture peut varier selon qu’ils travaillent ou non pour d’autres sites, proches ou non ? Quid des emplois indirects ? En bref, comment faire pour limiter au maximum les inconvénients économiques et sociaux d’une telle décision ?
Quel peut être le rôle particulier de l’ANCCLI, ne serait-ce que sous forme de sensibilisation aux problèmes posés, dans la phase d’accompagnement de l’avant-fermeture et de l’après-fermeture d’une centrale, de façon que cette opération, qui de toute façon interviendra nécessairement un jour, se déroule de la façon la plus fluide possible ?
Dernière question : seuls les salariés d’EDF sont représentés dans les CLI et à l’ANCCLI. Est-ce délibérément que les sous-traitants ont été exclus ? Est-ce parce qu’il aurait été difficile d’assurer leur représentation ? A-t-on essayé de les associer ? Il paraîtrait légitime qu’ils puissent faire part de leurs difficultés propres.
M. le président François Brottes. J’ajoute une question à l’intention de M. Lacote, qui est élu en Allemagne : quelles sont les procédures de concertation prévues pour accompagner la fermeture des réacteurs outre-Rhin ?
M. Jean-Paul Lacote, vice-président de l’ANCCLI et membre de la CLI de Fessenheim. Si, dans la CLI de Fessenheim, le collège des employés ne compte en effet que des syndicalistes d’EDF, celui des personnalités qualifiées comporte des représentants d’entreprises intervenant dans la centrale, parmi lesquelles des sous-traitants. Mais la représentation de ceux-ci est, il est vrai, minime.
À l’ANCCLI, comme à la CLI de Fessenheim, on est, hélas, davantage préoccupé par la prolongation de la durée de vie des centrales que par la problématique du démantèlement. On parle du plan de grand carénage d’EDF, d’utiliser les réacteurs jusqu’à soixante ans… De fermeture, il n’est pas question.
M. le président François Brottes. Même à Fessenheim ?
M. Jean-Paul Lacote. Il est interdit d’en parler à la CLI.
M. le président François Brottes. Qui l’interdit ?
M. Jean-Paul Lacote. Le président de la CLI. On parle de sûreté, pas de fermeture.
M. Jean-Claude Delalonde. Une dizaine de CLI existent depuis 1981…
M. Jean-Paul Lacote. Même depuis 1977 pour celle de Fessenheim !
M. Jean-Claude Delalonde. Instituées par la loi, ces commissions doivent respecter le rôle et les missions que leur a dévolus le législateur. De même que la loi de 2006 et le décret de 2008 disposent très précisément que c’est le président du conseil général qui arrête leur composition et désigne leur président, ils leur ont assigné un cahier des charges bien précis. Ni le démantèlement des centrales, ni les problèmes pouvant en résulter sur le tissu économique local, ni la sous-traitance n’entrent dans le champ de leurs compétences telles qu’elles sont aujourd’hui définies.
Les CLI ne sont vraiment en ordre de marche sur l’ensemble du territoire national que depuis 2011 – le décret de 2008 n’est entré en application qu’après les élections cantonales de cette année-là. Conformément aux dispositions voulues par le législateur comme à leur règlement intérieur, les CLI n’ont pas à traiter du démantèlement ni des problèmes économiques. Elles commencent néanmoins d’en parler, notamment depuis 2012, date où il a été pour la première fois officiellement question de la fermeture et du démantèlement de certaines centrales ainsi que d’un nouveau mix énergétique. Mais cela outrepasse clairement leur rôle et leurs missions.
M. le président François Brottes. À La Hague par exemple, où coexistent un site en exploitation et un autre en démantèlement, la CLI ne se préoccupe pas du tout du démantèlement ?
M. Jean-Claude Delalonde. Nous commençons d’en parler car nous avons pris conscience qu’une évolution importante se dessine. Le vieillissement des centrales et la prolongation de leur durée de vie ont longtemps été des sujets tabous, sur lesquels on nous disait plutôt « Circulez, il n’y a rien à voir ! », puisque notre mission se limitait à la sûreté du fonctionnement actuel des centrales.
S’agissant de la composition des CLI, la loi prévoit que ce sont des salariés d’EDF qui siègent au collège des salariés. Pour le reste, beaucoup d’associations souhaitent être représentées dans les CLI. Le choix s’opère à la discrétion du président du conseil général, qui décide seul lesquelles seront représentées.
Un mot supplémentaire sur la représentation des institutions représentatives du personnel. Il a été refusé qu’elle soit confiée aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, comme nous l’aurions souhaité. Ce sont les centrales syndicales nationales qui siègent à la CLI. Les syndicats des centrales nucléaires pensent pourtant que, notamment en cas de conflit sur un site, il serait plus pertinent que ce soit eux qui siègent plutôt que des représentants extérieurs. La loi, délibérément ou non imprécise, conduit à certains blocages. Il serait donc bienvenu de revoir ces points à l’occasion d’une prochaine réforme. Les CLI, et encore moins l’ANCCLI qui n’existe que par délégation de celles-ci, ne peuvent s’autosaisir de certains sujets. Ni la loi ni le décret ni leur règlement intérieur ne prévoient qu’elles traitent de démantèlement. Seules quelques-unes d’entre elles commencent de le faire. La représentation nationale s’interrogeant sur le sujet, nous estimons que nous devons nous aussi y travailler. Mais cela est très récent.
M. Jean-Paul Lacote. Sur des démantèlements en cours, par exemple à Chooz, des informations remontent à l’ANCCLI car nous les récupérons auprès de collègues des CLI locales, mais cela se fait de manière informelle et non thématisée.
Quel pourrait être le rôle de l’ANCCLI en phase de fermeture d’une centrale ? Comme nous le constatons depuis deux ans à la CLI de Fessenheim, et il risque d’en être de même ailleurs, seuls les représentants des associations de protection de l’environnement font des propositions. Ceux des trois autres collèges, qu’il s’agisse des élus, des salariés ou de la majorité des personnalités qualifiées, refusent toujours d’en parler. J’ai, pour ma part, rencontré les trois délégués interministériels successifs à la fermeture de la centrale, notamment récemment M. Malerba, mais nous sommes les seuls à avancer des propositions.
M. Florion Guillaud, trésorier de l’ANCCLI et membre de la CLI du Blayais. Je ne m’exprime pas ici au nom de la CLI dont je suis membre ni de l’ANCCLI. Je vous donne seulement le sentiment d’un élu d’un territoire sur lequel se trouve une centrale. La centrale du Blayais rapporte environ 20 millions d’euros par an aux collectivités concernées, ce qui est colossal. La communauté de communes où elle est implantée, qui ne compte que 12 500 habitants, perçoit une redevance importante. Pour présider une association d’insertion sur ce territoire, je sais aussi le poids de la centrale en matière d’emploi. Je puis vous dire qu’aucun élu local, hormis ceux qui ont fait en la matière un choix politique radical, ne sera jamais favorable au démantèlement de la centrale. C’est donc à un autre échelon qu’il faut rechercher des personnes disposées à aborder sereinement le sujet.
La CLI, dont la mission unique porte sur la sûreté et la transparence, pourrait a priori considérer que le démantèlement ne la concerne pas. Cette position n’est pas tenable, toutefois. En effet, le démantèlement aura un coût – je ne cite aucun montant car aucun de ceux qui circulent actuellement n’est avéré. Qui assumera ce coût ? L’industriel, dit-on. Soit, mais à la lecture de son bilan, tâche ingrate à laquelle je me suis livré, on s’aperçoit qu’EDF n’aurait pas les moyens de fermer simultanément plusieurs centrales. Au vu des provisions et du résultat net de l’entreprise, et à condition encore que l’État n’ait pas besoin qu’elle lui verse de dividendes, l’entreprise a assurément les moyens de fermer une centrale, peut-être deux, mais pas davantage.
M. le président François Brottes. Vous exprimez là un avis personnel ?
M. Florion Guillaud. Tout à fait.
M. le rapporteur. Bien que n’étant pas réputé défenseur d’EDF, je souligne que l’entreprise a constitué des provisions de plusieurs milliards d’euros pour faire face au démantèlement des centrales.
M. Florion Guillaud. Figurent à son bilan 62 475 millions d’euros de « provisions pour risques ». J’imagine que celles-ci ne sont pas destinées seulement aux démantèlements mais aussi à la couverture d’éventuels incidents – ne parlons pas d’accident nucléaire, car elles seraient alors notoirement insuffisantes. Comment, pendant dix, quinze ou vingt-cinq ans, EDF trouvera-t-elle les ressources nécessaires pour couvrir le coût de la fermeture de ses centrales ? Voilà la question.
Je suis, pour ma part, convaincu que, sur la pente actuelle, on se contentera dans quelques années de sanctuariser les sites, d’en interdire l’accès et d’y démanteler les équipements qui présentent le plus de risques radioactifs et ceux qui sont les plus faciles à neutraliser.
M. le président François Brottes. C’est votre avis personnel. Il faut dépassionner le débat : toute centrale fermera un jour. Par ailleurs, une fermeture n’implique pas qu’il n’y aura plus de centrale nucléaire sur le site. Il serait puéril de refuser d’évoquer le sujet. J’ai cependant bien compris que, dans la mesure où celui-ci ne fait pas partie des missions des CLI ni de l’ANCCLI, elles n’en traitent pas en tant que tel. Comment cela se passe-t-il en Allemagne ?
M. Jean-Paul Lacote. Après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement de Mme Merkel a décidé d’un plan de sortie du nucléaire, assorti d’un échéancier précis.
M. le président François Brottes. Des comités citoyens de suivi sont-ils saisis au niveau local ?
M. Jean-Paul Lacote. Il n’existe pas en Allemagne d’équivalent des CLI. Les commissions locales d’information, ou d’information et de surveillance, qui existent dans notre pays sont uniques en Europe. Outre-Rhin, ce sont les associations de protection de la nature et de l’environnement qui remplissent ce rôle. Mais il leur est plus facile d’accéder à l’information qu’en France.
M. le rapporteur. Vos remarques, messieurs, nous seront utiles pour faire évoluer le rôle des CLI dans la future loi.
Nous ne vous demandons pas si les CLI seraient favorables ou défavorables à une fermeture de centrale qui n’aurait pas été programmée. Nous comprenons très bien qu’il existe des opinions et des intérêts divergents. Mais, inévitablement, toute centrale nucléaire fermera un jour. Une centrale peut même avoir à le faire du jour au lendemain si l’ASN juge que les conditions de sûreté ne sont plus réunies, ou dans un délai très court si EDF décide, par exemple dans un contexte de surproduction d’électricité, qu’il n’est plus rentable d’exploiter autant d’installations qu’aujourd’hui. Cela peut aussi arriver parce que, dans le cadre de la politique énergétique nationale, l’État aura décidé de fermer certaines unités. C’est d’ailleurs déjà la question qui se pose pour Fessenheim.
Sans se sentir en porte-à-faux par rapport à ses convictions, chacun peut comprendre que mieux vaut accompagner une telle opération. S’il est trop difficile encore à Fessenheim d’évoquer le sujet, le jour où la décision sera vraiment prise d’engager la fermeture de la centrale, il serait judicieux d’y réfléchir pour que cela se passe du mieux possible. Nous conduisons pour notre part une réflexion globale, indépendamment de tel ou tel site, sur l’accompagnement qu’exigent ces opérations.
Quant à la possibilité ou non de couvrir le coût de celles-ci, c’est un autre sujet, même s’il n’est pas sans liens. On pourrait en effet imaginer d’arrêter des centrales même si on ne disposait pas des sommes nécessaires à leur démantèlement. L’une des tâches de notre commission d’enquête est précisément de savoir si les provisions constituées par EDF sont suffisantes. Contrairement à ce que vous affirmez, aux termes mêmes de la loi, l’entreprise doit en avoir constitué suffisamment pour démanteler l’ensemble de ses réacteurs. Imaginons que l’ASN décèle un défaut générique sur plusieurs d’entre eux : il faudrait bien que l’opérateur les ferme et les démantèle sans délai, c’est de sa responsabilité. Je respecte votre point de vue, monsieur Guillaud, mais, je le répète, la loi exige que les provisions de l’entreprise soient à la fois suffisantes et facilement mobilisables, des instances sont chargées de vérifier qu’il en est bien ainsi et il me paraît dès lors exagéré de soutenir qu’EDF n’aurait les moyens de ne démanteler que deux centrales.
M. Florion Guillaud. À côté d’une provision pour risques de 62 475 millions d’euros, figure dans les comptes une autre provision de 83 355 millions, sans précision quant à sa destination mais peut-être constituée dans cette perspective. Il ne faudrait pas que les provisions exigées d’EDF, ce qui n’est probablement que normal, la conduisent à réduire les dépenses de sûreté sur les centrales en exploitation.
M. le président François Brottes. Ces questions importantes, l’ANCCLI les a-t-elle posées à l’ASN ? Si oui, quelles réponses vous a-t-on apportées ?
M. Jean-Claude Delalonde. Même si cela ne fait pas partie de nos missions, nous en discutons bien évidemment entre nous. Je ne peux parler que de la CLI où je siège, mais je constate avec mes collègues de l’ANCCLI que les interrogations sont partout les mêmes et que nous n’avons pas de réponse. On nous dit que ce n’est pas de notre ressort.
M. le président François Brottes. Est-ce là ce que vous répond l’ASN ?
M. Jean-Claude Delalonde. Pour travailler sur le terrain avec les délégués régionaux de l’ASN à la vérification du bon fonctionnement des centrales, nous savons que l’Autorité est très préoccupée. Elle a fait part de ses inquiétudes devant votre commission, si je ne me trompe, et insisté sur la nécessité de garantir les moyens. Faut-il développer une politique assurantielle ? Faut-il constituer des provisions ? La sûreté et la sécurité en phase de démantèlement passent-elles par ces provisions, en espérant que celles-ci n’auront pas à être entamées suite à un accident en phase d’exploitation ? Ne vaudrait-il pas mieux consacrer les crédits à la sûreté au quotidien, et donc à la prévention ? Si le problème de la fermeture et du démantèlement n’est pas pris en compte très en amont et si l’horizon de ces fermetures demeure lointain, sans calendrier précis ni acte fort, le risque est que la sûreté en pâtisse. Surtout dans le contexte actuel de rareté des crédits, les sommes provisionnées auraient peut-être été mieux utilisées à réaliser des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) de façon que, si la durée de vie des réacteurs est prolongée, ce soit dans de bonnes conditions.
Oui, nous nous interrogeons et l’ASN fait de même, mais son président et son directeur général sont tributaires des décisions de l’État et ne peuvent que soumettre des idées. M. Repussard avait été critiqué pour les annonces qu’il avait faites dans un rapport de 2007 ; M. Chevet l’est à son tour lorsqu’il suggère de taxer davantage l’exploitant pour garantir la sûreté. Nous partageons ces inquiétudes et nous les relayons, mais la décision n’appartient pas à ceux que nous représentons.
J’en viens à votre question concernant les incidences sur le tissu économique local. Jamais, à la CLI de Gravelines, nous n’avons abordé la question du démantèlement parce qu’elle ne se posait pas. Mais comme nul ne sait si cette centrale ne sera pas l’une des six suivantes à subir un jour le sort de Fessenheim, il serait intéressant d’y réfléchir aujourd’hui. Jusqu’à présent, les syndicats s’y refusent. Nous essayons de leur faire entendre qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur une éventuelle décision de démantèlement, mais de préparer le terrain de façon qu’une telle décision, si elle devait intervenir, se transforme en opportunité économique. Nous avons fait remonter nos positions au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais qui a décidé, il y a deux mois seulement, d’entamer une réflexion stratégique à dix ans. Le développement économique étant l’une des compétences des régions, j’espère que d’autres conseils régionaux feront de même.
Nous sommes pugnaces et, même si cela ne fait pas partie des missions des CLI, nous souhaitons traiter du sujet, car au-delà, c’est de la sûreté et de son coût qu’il s’agit. Il faut de la lisibilité, que ce soit en phase d’exploitation, de prolongation de la durée de vie, de démantèlement ou de sanctuarisation. À titre personnel, je pense qu’il vaudrait mieux affecter des moyens à la sûreté que de constituer des provisions coûteuses, dont on ne sait pas exactement à quoi elles serviront demain – à supposer qu’elles n’aient pas été consommées entre-temps en raison d’un accident. En effet, les sommes affectées aux provisions ne le seront pas à la sûreté au jour le jour pour prolonger, s’il le faut, la durée de vie des centrales, en attendant de les arrêter.
M. le président François Brottes. Selon vous, l’ASN pourrait « faire des impasses », se contenter d’aménagements approximatifs et, pour des raisons budgétaires, abaisser ses exigences. Ce n’est pas notre sentiment. Il ne nous semble pas qu’elle fasse de concessions, son pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’à exiger la fermeture d’une centrale.
M. Jean-Claude Delalonde. Nous souhaiterions que s’impose aux niveaux européen et international le modèle français, tout à fait original, avec un IRSN fort et avec une ASN réputée pour sa compétence, pour son sérieux et pour son indépendance. Seulement, je le sais pour en être administrateur, l’IRSN a vu son budget diminuer de 10 %.
M. le président François Brottes. Je parlais de l’ASN. L’IRSN n’adresse pas d’injonctions et n’est pas totalement indépendant. Chacune de ces deux instances a son propre rôle.
M. Jean-Claude Delalonde. Si le budget de l’ASN devient par trop contraint et si l’Autorité ne peut plus demain se permettre d’en retrancher le million d’euros qu’il lui a été demandé d’allouer aux CLI et à l’ANCCLI, celles-ci peuvent fort bien disparaître. Et si notre budget devait retomber à 600 000 euros, nous serions obligés de limiter fortement notre action, ce qui amoindrirait inévitablement les capacités de réaction de la société civile. Nous comptons donc sur l’État et sur le législateur pour que l’ASN et l’IRSN continuent d’exercer comme aujourd’hui leurs missions de manière satisfaisante. Mais les décisions budgétaires prises nous inquiètent.
M. le président François Brottes. Si l’ASN poursuit son travail comme aujourd’hui, on peut donc considérer que la sûreté est garantie ?
M. Jean-Claude Delalonde. Je ne suis pas membre de l’ASN et ne sais donc pas si elle est satisfaite de sa situation. J’espère que tout ce qu’elle dit est vrai, qu’elle dispose des moyens suffisant à l’ensemble de ses tâches et qu’elle est bien indépendante, comme prévu dans les textes. Si toutes ces conditions sont réunies, il n’y a aucune raison d’être mécontent ni inquiet.
Si la crise, qui perdure, impose des économies, qu’on ne les fasse surtout pas sur le dos de l’ASN ni de l’IRSN ni de l’ANCCLI ni des CLI ! Et ce, quelles que soient les dispositions de la future loi sur la transition énergétique, que celle-ci prévoie ou non la fermeture ou le démantèlement d’une ou plusieurs centrales. Il ne nous appartient pas, en effet, de remettre en question les décisions du législateur mais celui-ci doit garder à l’esprit qu’il est de sa responsabilité de nous donner le minimum de moyens nécessaires pour que nous puissions accomplir dans de bonnes conditions notre travail de bénévoles.
M. le président François Brottes. Messieurs, nous vous remercions pour vos interventions passionnées. À ce stade, nous maintenons l’invitation qui vous a été adressée également pour le 17 avril.
Audition de M. Jean-Michel Malerba, délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim
(Séance du 26 mars 2014)
M. le président François Brottes. Nous terminons cette série d’entretiens consacrés à l’arrêt définitif des centrales par l’audition de M. Jean-Michel Malerba, qui a succédé à M. Francis Rol-Tanguy au poste de délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim. Il semblerait que le sujet soit tellement sensible qu’on n’aurait pas le droit d’en parler au sein de la commission locale d’information (CLI) de Fessenheim ! Pourtant, aucun réacteur n’est éternel et ce tabou n’a pas lieu d’être – en tout cas pour la commission d’enquête.
Nous souhaiterions donc, monsieur Malerba, que vous fassiez le point sur votre réflexion, qui couvre forcément un champ très large puisque sont en jeu des questions aussi bien techniques et juridiques que financières, économiques, sociales et même internationales, les parties concernées par cette fermeture n’étant pas toutes françaises.
Mais, auparavant, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demanderai de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Michel Malerba prête serment)
M. Jean-Michel Malerba, délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim. Je suis chargé par l’État du pilotage en mode projet de la préparation de la fermeture de la centrale de Fessenheim, ce qui suppose un travail transversal impliquant le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’environnement (MEDDE), le ministère de l’intérieur et Réseau de transport d’électricité (RTE). Par « pilotage en mode projet », il faut en effet entendre un pilotage coordonné des différentes interventions concourant à la préparation de cette fermeture.
Trois objectifs principaux ont été assignés à la délégation : premièrement, conduire la négociation avec EDF d’un protocole précisant les conditions juridiques, techniques, économiques et sociales de la fermeture, le calendrier du démantèlement, les modalités d’accompagnement des salariés concernés ainsi que celles de la participation de l’exploitant au devenir du bassin ; deuxièmement, élaborer, en concertation avec RTE, la stratégie propre à garantir l’équilibre du réseau local, national et transfrontalier de transport de l’énergie ; enfin, animer, avec le préfet de région, les travaux visant à élaborer une stratégie globale pour la reconversion du bassin de vie et d’emploi de Fessenheim.
En ce qui me concerne, je suis ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Après avoir exercé dans le corps des Ponts et Chaussées, j’ai dirigé jusqu’à sa fermeture l’établissement public d’aménagement d’une ville nouvelle, puis j’ai travaillé pour deux départements et une région : je connais donc bien le fonctionnement des collectivités, ce qui me sera utile pour œuvrer à la reconversion du site.
Comme vous l’avez dit, aucune centrale n’est éternelle et, à quelque échéance qu’elle intervienne, toute fermeture d’une de ces installations a forcément un impact sur le personnel de l’exploitant, à qui incombe sa reconversion, sur celui des sous-traitants et sur le territoire, qu’il faudra alors revitaliser. Cela étant, en l’espèce, l’exploitant ne sera pas tenu juridiquement de financer la reconversion de son personnel dans la mesure où il n’aura pas à présenter de plan de sauvegarde de l’emploi. En revanche, il lui faudra procéder au démantèlement de la centrale et au stockage définitif des déchets, toutes opérations pour lesquelles la réglementation lui a fait obligation de constituer des provisions. Dans tous ces domaines, la fermeture anticipée n’aura pour effet que d’avancer dans le temps les dépenses –mais pas forcément toutes.
S’agissant du réseau électrique, les travaux sont assez avancés et la question bien maîtrisée. La disparition de la centrale nécessitera des adaptations, mais il faut noter que le même cas de figure s’est déjà présenté lorsque les deux réacteurs étaient à l’arrêt en même temps. RTE considère que l’approvisionnement de l’Alsace sera assuré sans risque à compter de 2017 à condition d’augmenter d’ici là la capacité de transit de la ligne à 400 kilovolts et de veiller à la qualité de la tension en procédant à des travaux dans les postes. Dans cette optique, le gestionnaire du réseau a présenté en octobre 2013 un dossier qui a été validé par le directeur de l’énergie, celui-ci précisant toutefois que les mesures préconisées cesseraient d’être pleinement efficaces à partir du milieu des années 2020. Les travaux seront réalisés par RTE entre 2014 et 2016, pour un coût de l’ordre de 40 à 50 millions d’euros – qui ne sera pas à la charge de l’État puisque couvert par une modulation du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
M. le président François Brottes. Ce qui ne sera pas sans effet sur le prix de l’électricité…
M. Jean-Michel Malerba. La situation de la centrale sur les grandes artères de circulation de l’énergie constitue plutôt un élément favorable au projet de fermeture.
À moyen terme, RTE envisage de renforcer encore le réseau à 400 kilovolts, afin d’acheminer les flux supplémentaires provenant d’un futur corridor nord-sud prévu en Allemagne. L’étude n’est pas achevée et, pour l’instant, le projet qui figure dans le schéma décennal de RTE consiste en un doublement de la ligne sur le chaînon manquant, entre les postes de Scheer et Muhlbach.
M. le président François Brottes. Le prix de ce doublement est-il compris dans les 50 millions ?
M. Jean-Michel Malerba. Non. Il faudra probablement compter 100 millions, mais je n’ai pas de chiffrage précis.
Pour compléter notre réflexion sur le réseau de transport, nous avons également sollicité RTE pour savoir s’il faudrait une nouvelle unité de production afin de garantir la qualité de la tension après la fermeture de Fessenheim. Quand nous aurons la réponse, y compris sur la confirmation du renforcement du réseau de 400 000 volts, nous avons prévu de procéder début 2015 à une contre-expertise indépendante, au pilotage de laquelle la délégation proposera aux collectivités locales de s’associer.
M. le président François Brottes. Cette réponse dépend-elle ou non de la manière dont l’Allemagne produira son électricité ?
M. Jean-Michel Malerba. RTE est tenu de prendre l’attache de ses homologues suisses et allemands pour arrêter une solution cohérente avec ce qu’elle propose dans son schéma décennal, y compris en termes de calendrier.
Pour ce qui est des aspects sociaux, nous avons demandé à l’INSEE de mesurer l’impact de la centrale sur l’emploi en Alsace : selon les premiers résultats de cette étude, cette contribution serait comprise entre 1 580 et 1 700 emplois. Le président d’EDF nous a indiqué que les 850 agents de son entreprise seraient redéployés sur d’autres sites de production ou affectés dans d’autres services du groupe. Il n’y aurait donc pas de licenciement, EDF mettant en place des cellules de reconversion comme elle l’a fait lorsqu’elle a fermé des centrales thermiques.
Environ 300 personnes travaillent pour les sous-traitants, dont certains seraient plus touchés que d’autres – pour une vingtaine d’entre eux, la fermeture de la centrale devrait se traduire par une réduction de plus de 5 % de leur chiffre d’affaires.
M. le président François Brottes. Jusqu’à quel niveau pourraient monter ces pertes ?
M. Jean-Michel Malerba. D’après mes souvenirs, elles pourraient dépasser 50 % pour l’un des établissements, mais il s’agit d’une filiale d’un groupe relativement important.
Le solde des quelque 1 700 emplois correspond aux emplois induits, notamment dans les activités de commerce et de services des environs.
Cela étant, l’impact social de la fermeture de la centrale sera lissé dans le temps. Après l’arrêt définitif de la centrale et avant le début du démantèlement, l’effectif sur le site restera relativement important dans la mesure où il faudra maintenir les conditions de sûreté définies par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ensuite, le démantèlement proprement dit devrait prendre une quinzaine d’années pendant lesquelles EDF maintiendrait sur place une centaine d’agents et les sous-traitants 200 environ, mais sur des postes au moins en partie différents de ceux qu’ils occupent aujourd’hui.
Le territoire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, est dans une position relativement inconfortable pour ce qui est des perspectives de développement. Mais, pour l’instant, en matière de revitalisation, nous n’en sommes qu’aux travaux préparatoires – les discussions avec les communes et avec les structures intercommunales commenceront la semaine prochaine – et nous n’avons même pas encore d’enveloppe budgétaire dédiée. Je ne peux donc pas vous fournir d’indications précises sur le sujet.
Pour ce qui est de l’indemnisation de l’exploitant, rien dans le code de l’environnement ne permet aujourd'hui de fonder une décision administrative de fermeture sur des considérations autres que de sûreté nucléaire. Une disposition législative est donc nécessaire et c’est sur cette base que pourra être tranchée cette question de l’indemnisation et que pourront être arrêtées, le cas échéant, la méthodologie et la procédure à suivre.
Pour l’instant, EDF n’a pas encore formulé de demande chiffrée. Des échanges informels que nous avons eus, il ressort qu’elle escompte une compensation de son éventuel manque à gagner, qu’elle évaluera plus précisément une fois que sera connu le projet de loi. La délégation a prévu de se faire assister, pour la négociation, d’un conseil juridique et financier dont la procédure de sélection sera définitivement arrêtée d’ici au mois de juin.
M. le président François Brottes. Mais d’autres sociétés sont concernées…
M. Jean-Michel Malerba. EDF a conclu en effet avec des opérateurs suisses et allemands des contrats d’allocation de production, que l’entreprise n’a pas souhaité communiquer à la délégation à ce stade. Nous ne pouvons donc pas être très précis à ce sujet non plus.
La fermeture aura aussi une incidence sur les finances locales. En 2012, les cotisations payées par EDF au titre de la centrale approchaient 45 millions d’euros, dont 28 % sont allés aux collectivités locales, soit 12,6 millions environ. Une étude a été réalisée au printemps dernier par le service des études économiques et financières de la direction régionale des finances publiques en vue d’évaluer l’impact de l’arrêt de la centrale, toutes choses égales par ailleurs et sans prendre en compte des ressources procurées par l’activité de démantèlement. Ses conclusions, qui n’ont pas encore été présentées à toutes les collectivités – certaines n’ayant pas souhaité nous rencontrer à ce sujet – sont que seraient pour l’essentiel touchées la commune de Fessenheim et la communauté de communes Essor du Rhin. En particulier, la commune verrait sa capacité d’autofinancement devenir fortement négative à partir de 2020, dans la mesure où elle continuera à être taxée au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales à hauteur de 2,8 millions, ce pour une période non limitée dans le temps. Une réflexion est en cours pour apporter une solution à cette situation inédite et absurde…
M. le président François Brottes. On ne peut en effet laisser les choses en l’état !
M. Jean-Michel Malerba. …mais le groupe de travail n’a pas encore rendu ses conclusions.
Je terminerai par la question du coût du démantèlement, qui se pose à moi essentiellement à travers celle du calendrier. La fermeture anticipée conduirait EDF à engager plus tôt que prévu certaines dépenses et il conviendrait donc que l’entreprise fasse le point sur le calibrage des provisions qu’elle a constituées à cet effet et qui, je le rappelle, sont soumises à un taux d’actualisation de 4,8 %. Nous évoquerons donc prochainement le sujet avec elle. Quant à l’estimation de la dépense proprement dite, elle ne nous incombe pas. La question est traitée par la Cour des comptes qui est d’ailleurs en train d’actualiser ses conclusions, à votre demande. Cela étant, le cas de Fessenheim constituera sur le sujet un test grandeur nature qui nous permettra de vérifier si le coût du démantèlement a été correctement évalué.
M. Denis Baupin, rapporteur. Fessenheim fournira en effet le premier exemple de démantèlement d’une centrale en France, mais l’événement ne manquera pas de se reproduire ailleurs et nous devons donc nous y préparer au mieux. Cependant, avec les restructurations industrielles et la fermeture de certaines bases militaires, ne nous sommes-nous pas déjà dotés d’outils dont nous pourrions nous inspirer, en les adaptant ?
Il se dit que le futur contrat de projets État-région pour l’Alsace comporterait des mesures spécifiques pour compenser la fermeture de la centrale. Êtes-vous en mesure de le confirmer et avez-vous une idée des montants en cause ?
Même si les représentants de la CLI de Fessenheim viennent de nous dire qu’il leur était interdit de parler du sujet, ne pensez-vous pas que cette commission, qui regroupe beaucoup d’acteurs concernés, pourrait, tout en se préoccupant prioritairement de la sûreté du site, être un instrument de concertation utile tout au long du processus conduisant de la préparation de la fermeture jusqu’au démantèlement de la centrale ?
La question de l’indemnisation d’EDF ne pourra être réglée que lorsque sera connu le projet de loi, avez-vous dit. Il reste que les chiffres les plus faramineux circulent à ce propos, dans la presse comme au sein même de cette commission d’enquête.
Sait-on quelle aurait pu être la durée de vie de cette centrale dans le cas où l’État n’aurait pas décidé de la fermer ? Après sa troisième visite décennale, l’ASN a donné un avis favorable au maintien de l’exploitation du réacteur n° 1 pour dix ans ; en revanche, s’agissant du réacteur n° 2, l’avis, également favorable, ne précisait aucune durée, l’autorité ayant considéré qu’elle n’avait pas à se prononcer sur ce point. De quels éléments disposez-vous à cet égard ?
Je suis stupéfait que le délégué interministériel n’ait pas pu prendre connaissance des contrats conclus par EDF avec les autres opérateurs. Comment pouvez-vous travailler avec une telle inconnue, vous qui avez reçu du Gouvernement mandat de préparer la fermeture de cette centrale ? Ces contrats ont été passés par l’entreprise à l’époque où elle était entièrement publique et ils ont une incidence sur la fourniture d’électricité et sans doute sur les travaux demandés à la suite de la troisième visite décennale par l’ASN. Ceux-ci ont-ils été financés à 100 % par EDF ? Si un grand carénage devait être décidé, serait-il supporté par les co-contractants, Suisse et Bade-Wurtemberg, à hauteur de leur participation ? Ces questions sont légitimes dans la mesure où elles se poseront ailleurs.
Avez-vous eu l’assurance que les provisions pour démantèlement constituées par EDF seront débloquées en temps utile ? Avez-vous une idée du calendrier des travaux si la date de fermeture avancée par le Gouvernement, c'est-à-dire 2016, est confirmée ?
Mme Frédérique Massat. Les réseaux de distribution seront-ils affectés par la fermeture de la centrale ?
Avez-vous rencontré la CLI, ou allez-vous le faire ? Est-ce prévu dans la procédure de fermeture ?
Enfin, si la fermeture a bien lieu en 2016, à quelle date s’achèveront les opérations de démantèlement ?
M. Jean-Michel Malerba. Il existe déjà, en effet, des outils de revitalisation économique, en particulier les contrats de restructuration du ministère de la défense dont l’un concerne d’ailleurs un site dans le Haut-Rhin. On constate qu’en moyenne, l’État offre dans ce cadre près de 10 000 euros par emploi supprimé, ce qui donne un ordre de grandeur pour la dépense à consentir, étant toutefois entendu qu’on pourra recourir à d’autres dispositifs.
Il est bien envisagé qu’un volet spécifique à Fessenheim figure dans le futur contrat de projets État-région. Celui-ci n’en est encore qu’au stade de la préparation, le document devant être cosigné par les deux départements, par les trois principales villes d’Alsace et par les trois agglomérations correspondantes. Les documents stratégiques ont été envoyés à la DATAR et les préfets attendent de recevoir leur mandat de négociation et de connaître les arbitrages sur les enveloppes dont ils disposeront. Les montants dont bénéficiera la commune ne peuvent donc être précisés. Tout ce que je puis dire, c’est que parmi les mesures envisagées dans le document stratégique cosigné par le préfet de région, certaines concernent la transition énergétique, d’autres l’aide à l’emploi, avec des dispositions classiques d’accompagnement des salariés et des entreprises sous-traitantes les plus touchées. Une partie est également consacrée à la reconversion de la zone d’emploi, mais ne comporte guère de substance, les échanges avec les collectivités n’ayant pas encore eu lieu. De même, les perspectives concernant la recherche restent pour le moment un peu théoriques.
Par ailleurs, certaines des collectivités concernées pourraient bénéficier des aides à finalité régionale, moyennant une modification du zonage.
Selon les juristes du MEDDE, la fermeture de Fessenheim à l’initiative du législateur donnera certainement lieu à indemnisation de l’exploitant, en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques. L’indemnité devra couvrir la part « anormale » du préjudice, notion dont l’étendue prête évidemment à discussion même si l’on ne peut y faire entrer les exigences posées par l’ASN. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, estime que cette indemnisation ne doit pas excéder le montant du préjudice effectivement subi par l’entreprise, ce qui suppose d’évaluer celui-ci. Il n’existe pas de jurisprudence en la matière. Pour ce qui est de la perte, on pourra se caler sur la valeur nette comptable des immobilisations, c’est-à-dire sur la partie non amortie des investissements à la charge d’EDF. S’agissant du manque à gagner, rien n’est tranché au sujet de la période à retenir dans le calcul et de la méthode à suivre, mais beaucoup dépendra de la capacité de l’exploitant à vendre son électricité dans un contexte marqué, en principe, à la fois par la fermeture de Fessenheim et par la mise en service de Flamanville. Si EDF peut continuer à en vendre la même quantité, il lui faudra démontrer qu’il y a bien, malgré tout, préjudice – ce d’autant qu’elle a su au cours des dernières années moduler la production de ses centrales de manière à maintenir à peu près stable le niveau de ces ventes.
Personne aujourd'hui ne peut dire précisément quelle est la durée de vie des centrales. La possibilité de la prolonger au-delà de quarante ans fera l’objet d’études de l’ASN mais, ce travail restant à mener, nous ne savons pas quelles conditions pourraient être posées ni quelles centrales pourraient être concernées.
Les décisions de l’ASN relatives aux réacteurs n° 1 et n° 2 de Fessenheim ont été prises dans le cadre de la procédure de révision décennale et c’est dans ce contexte qu’il faut les comprendre toutes deux, même si l’une ne fixe pas de durée pour l’autorisation. Et l’autre n’exclut certainement pas une suspension de l’autorisation au cas où des raisons de sécurité particulière l’exigeraient avant le prochain réexamen.
Je ne peux que regretter comme vous qu’EDF ait invoqué les clauses de confidentialité pour ne pas communiquer aux services administratifs de l’État les contrats qui la lient à ses partenaires suisses et allemands.
M. le rapporteur. Que faut-il comprendre ? Que, si indemnisation il devait y avoir de la part de l’État, EDF recevrait une indemnisation globale qu’elle partagerait ensuite avec ses partenaires, cela sur la base de contrats auxquels nous n’aurions pas accès ? Un tel comportement est singulier de la part d’une entreprise détenue à 85 % par l’État et au conseil d’administration duquel siège un commissaire du Gouvernement qui vous a mandaté !
M. Jean-Michel Malerba. Nous avons demandé à EDF si, pour la partie de l’énergie utilisée par les Suisses et les Allemands, il fallait s’adresser directement à eux ou pas. EDF nous invite à les contacter, mais il nous semble préférable de le faire une fois les contrats en main… Nous en sommes là.
EDF nous a dit qu’aux termes desdits contrats, ses partenaires étaient tenus de financer leur quote-part des dépenses d’investissement comme de fonctionnement, soit 32,5 %.
M. le rapporteur. C’est donc ce qui s’est passé pour les travaux effectués à la suite de la troisième visite décennale ?
M. Jean-Michel Malerba. C’est ce que dit EDF, mais je n’ai rien pour en attester.
M. le président François Brottes. Y a-t-il eu une évaluation des risques de contentieux du fait d’une décision de fermeture ?
M. Jean-Michel Malerba. Une première analyse a été faite par notre direction juridique pour la partie française, au vu des éléments en notre possession. En revanche, faute de pièces, ce travail n’a pu être effectué pour la partie étrangère.
Enfin, nous nous sommes tenus informés des réflexions de la commission locale d’information mais je n’ai pas encore pris l’initiative de la rencontrer. J’ai déjà vu le directeur de la centrale et le préfet, qui en fait partie, ainsi que les acteurs plus traditionnels de la revitalisation. Cela dit, je n’ai aucune objection à rencontrer cette commission si elle le souhaite.
M. le président François Brottes. Je vous remercie de votre contribution.
Audition de M. Jean-Luc Lépine, président de la CNEF (Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des INB et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs)
(Séance du 2 avril 2014)
M. le président François Brottes. Nos auditions sont aujourd’hui consacrées aux charges futures du nucléaire. Nous nous intéresserons en particulier, ce matin, aux aspects financiers de la question, et cet après-midi aux aspects techniques de la gestion des déchets de haute activité, à travers le projet de stockage profond Cigéo.
La Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) a été chargée par la loi d’évaluer la façon dont les exploitants respectent leurs obligations financières pour la gestion des combustibles usés et des déchets, et pour le démantèlement de leurs installations. Les sommes nécessaires sont-elles bien provisionnées et sanctuarisées ? Correspondent-elles aux besoins qui ont été identifiés et aux solutions qui ont été imaginées ?
Le rapport de la CNEF paru en juillet 2012 offre un tableau complet de ces obligations et des problèmes qui ont surgi. Nous devons reconnaître que sa difficile mise en route n’a pas empêché la CNEF de mener à bien un travail essentiel, dont l’actualisation a peut-être déjà commencé.
Monsieur Lépine, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Luc Lépine prête serment)
M. Jean-Luc Lépine. Créée par la loi du 28 juin 2006, la CNEF a en effet connu un démarrage un peu lent : des divergences de vues s’étant manifestées entre le Gouvernement et les assemblées sur les modalités de son fonctionnement, ses membres n’ont été nommés qu’au bout de trois ans et elle n’a pu se réunir avant le 7 juin 2011. Les textes qui instituaient la commission ne précisant pas les modalités de son fonctionnement, on imagina que la présidence pourrait échoir au président d’une commission de l’une des deux assemblées. Mais, lors de la première réunion, le président de la commission des affaires économiques du Sénat déclina la proposition. C’est pour sortir de l’impasse que j’ai accepté d’animer les travaux de la CNEF durant une année.
Notre premier rapport d’activité a été publié en juillet 2012. Conformément à la loi, le prochain devrait paraître trois ans plus tard. Mais les mandats des membres de la CNEF prennent fin le 20 juin prochain et l’avenir de celle-ci paraît incertain : peut-être un prochain texte viendra-t-il modifier ses modalités d’intervention, voire réformer le régime existant, dans le cadre d’une future loi de transition énergétique.
M. le président François Brottes. La seule certitude, c’est qu’aucun texte ne sera promulgué d’ici au 20 juin.
M. Jean-Luc Lépine. Je précise que la CNEF n’a pas coûté un centime au contribuable – hormis le remboursement des frais de transport de l’un des membres de la commission, professeur de faculté à Toulouse – et qu’elle a fonctionné grâce à l’assiduité, à la bonne volonté et au dévouement de certains de ses membres, malgré le désintérêt des représentants des deux assemblées qui, passé les premières réunions, ne sont plus réapparus.
La commission ne s’est pas réunie depuis 2012, mais j’ai fait le point à plusieurs reprises avec l’autorité administrative – principalement la direction générale de l’énergie et du climat et sa sous-direction de l’industrie nucléaire –, afin d’actualiser les constatations faites en juillet 2012 et voir comment ont été traités depuis les problèmes qui avaient été identifiés.
Le point de départ de toutes les analyses est l’évaluation du montant des provisions que doivent constituer les exploitants pour garantir les opérations futures de démantèlement et de gestion des déchets correspondants. On raisonne en ramenant des coûts qui vont s’étaler sur des périodes très longues – jusqu’à soixante-dix ans – à la valeur actuelle par l’intermédiaire d’un taux d’actualisation. Il convient de rappeler que ces évaluations sont faites sous la responsabilité des exploitants.
À la fin de 2012, l’évaluation était de 34,8 milliards d’euros. À la fin de 2013, elle était de 38,3 milliards d’euros. Deux facteurs ont contribué à cette variation : d’une part, un phénomène de « désactualisation » – si l’on ne change rien dans les séquences chronologiques de démantèlement, plus le temps passe et plus la valeur actualisée augmente ; d’autre part, la discussion sur le taux d’actualisation.
Pour les évaluations figurant dans le rapport de 2012, les exploitants avaient utilisé un taux d’actualisation de 5 %. Nous avions signalé qu’un tel taux risquait de buter sur le plafond réglementaire calculé à partir de la moyenne mobile sur une période de quatre ans du taux des obligations d’État à échéance de trente ans auquel est ajoutée une marge de 1 %. Nous signalions également que l’on pouvait s’interroger sur la pertinence du taux d’actualisation retenu et qu’il serait plus prudent de le réduire. Les exploitants ayant ensuite appliqué des taux d’actualisation de 4,75 % ou 4,80 %, la facture a augmenté de 2 milliards.
M. le président François Brottes. Aujourd’hui, l’État emprunte à 0,3 % sur trente ans.
M. Jean-Luc Lépine. Les taux se situent plutôt entre 2 et 2,5 % sur dix ans. Sur des échéances plus longues, le taux, augmenté de la marge, est à 4,6 %.
Quoi qu’il en soit, les exploitants n’appliquent pas, à l’heure actuelle, le plafond fixé par la réglementation. L’autorité administrative pourrait vous parler des négociations en cours. D’après ce que j’ai compris, il serait question de modifier le taux de référence en le faisant porter sur une période plus longue – dix ans au lieu de quatre – tout en demandant aux exploitants de constituer des marges de sécurité supplémentaires.
En second lieu, les provisions prennent en compte le coût du dispositif de stockage géologique profond sur la base d’évaluations dont le rapport estime qu’elles sont probablement sous-valorisées – ce qu’a confirmé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans une lettre de janvier 2014.
D’autres éléments peuvent influer sur l’évaluation du coût de démantèlement et de gestion des stockages, notamment la modification de la politique énergétique – fermeture d’une centrale nucléaire ou révision de la part du nucléaire dans le mix énergétique.
Cependant, le portefeuille d’actifs constitué par les exploitants pour couvrir leurs engagements est passé de 31,6 à 38,7 milliards. Cette hausse s’explique à la fois par l’évolution générale des marchés, la baisse des taux d’intérêt, l’augmentation des valeurs des indices boursiers, mais également par les adaptations réglementaires, dont la plus importante a été, en février 2013, l’inclusion de la créance liée à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) d’EDF – de 4,9 milliards d’euros – dans le montant de ses actifs dédiés. La créance CSPE, dont le remboursement s’étalera jusqu’en 2018, est ainsi venue s’ajouter à la prise en compte, il y a deux ans, d’une fraction de la participation d’EDF dans le Réseau de transport d’électricité (RTE). Cela explique l’augmentation, dans les portefeuilles, de la part des éléments non liquides.
Signalons, par ailleurs, que la réglementation sur la dispersion des actifs éligibles a été modifiée dans un sens qui paraît tout à fait convenable : on applique maintenant intégralement la réglementation des entreprises régies par le code des assurances.
Observons enfin que, à la suite d’une remarque faite par la CNEF en 2012, le plafond des titres non cotés a baissé de 20 % à 15 %.
Les taux de couverture découlent de la comparaison entre les évaluations des provisions et les portefeuilles des actifs dédiés : il y a deux ans, le principal problème venait d’EDF, qui avait bénéficié d’un report jusqu’à 2016 pour atteindre un taux de couverture de 100 %, taux que presque tous les grands exploitants avaient atteint à la fin de l’année 2013. Le seul qui ne l’avait pas fait – et ne l’a toujours pas fait – est Eurodif. Si vous auditionnez les représentants du CEA, ils vous expliqueront que cette situation est essentiellement liée au problème des actionnaires minoritaires d’Eurodif – dont le CEA possède 60 % – et ils vous parleront des négociations qui se poursuivent en vue de la sortie de ces actionnaires minoritaires.
Que peut-on dire du fonctionnement de l’autorité administrative au cours de ces deux dernières années ? Le jugement que je me permets de vous livrer est positif, dans la mesure où la faiblesse des moyens, qui avait été dénoncée en 2012, a été corrigée : d’une part, les moyens des équipes qui se consacrent au suivi du provisionnement ont été nettement renforcés ; d’autre part, l’administration a passé en mars 2014 une convention avec le contrôle général et financier du ministère de l’économie et des finances pour qu’il l’aide à résoudre les problèmes d’évaluation et de suivi des portefeuilles des exploitants.
Dans le rapport de 2012, nous souhaitions que l’autorité administrative puisse bénéficier du concours de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui suit les compagnies d’assurance. Le gouverneur de la Banque de France, qui préside l’ACPR, avait refusé, considérant qu’un texte de loi était nécessaire. Cette piste a été temporairement abandonnée, mais, compte tenu de son expertise en matière d’évaluation des portefeuilles d’organismes ayant des engagements longs, il paraît souhaitable qu’une disposition législative introduise l’ACPR dans le circuit de contrôle des provisions des exploitants.
D’autre part, le rapport de 2012 estimait que l’administration devait développer sa capacité d’appréciation des évaluations faites par les exploitants, en réalisant notamment des audits. Ceux qui avaient été annoncés pour la fin de 2012 ont pris du retard. Nous sommes actuellement dans un processus d’appel à la concurrence, et on peut penser que, en juin 2014, sera lancé un audit portant sur cinq thèmes. Au lieu de concerner, sur un thème, tous les exploitants, il concernera un exploitant et portera sur les cinq thèmes choisis.
Enfin, la poursuite de la coopération avec l’ASN – dont le jugement est fort précieux pour signaler les points qui méritent d’être mieux étayés et mieux assurés dans les évaluations des coûts futurs – est un autre motif de satisfaction. À ce propos, une lettre très intéressante de l’ASN, de janvier 2014, pourra servir de base à de nouvelles discussions sur la méthodologie applicable. L’ASN y évoque divers problèmes qui méritent d’être approfondis : le niveau d’assainissement complet des sites lors du démantèlement ; l’impact de la non-disponibilité éventuelle des installations de stockage lors de la constitution des paquets de déchets ; l’impact des évaluations complémentaires de sûreté ; enfin et surtout, la réévaluation ou l’évaluation des coûts de solutions de gestion à long terme des déchets. Le schéma actuellement pris en compte est fondé sur une première évaluation de 15 milliards, alors que d’autres évaluations, plus récentes, atteignent 35 milliards.
À l’époque de son introduction en Bourse, EDF était très réticente à l’idée de constituer des provisions. À la suite d’une expertise à laquelle j’avais été associé, son président accepta une mise à niveau de son provisionnement. Mais il ne s’agissait que de 12 milliards d’euros, alors que ce provisionnement tourne aujourd’hui autour de 20 milliards d’euros. Par ailleurs, à l’époque, il n’y avait quasiment pas d’équipe administrative affectée au suivi des exploitants et la CNEF n’existait pas. Ainsi, en quelques années s’est constitué un système permettant de suivre, sur le plan technique, les opérations de fin de cycle. Nous ne pouvons que nous en satisfaire.
La CNEF a joué son rôle, en mettant en lumière les éléments qui méritent d’être approfondis et améliorés. Après des débuts difficiles, elle doit faire face à des échéances incertaines, puisqu’elle ne pourra continuer son action sans des textes qui ne seront pas sortis à la fin du mandat des membres actuels.
M. le président François Brottes. Les provisions existent donc, mis à part le cas d’Eurodif.
M. Jean-Luc Lépine. Elles correspondent aux besoins évalués par les exploitants.
M. le président François Brottes. Entre 15 et 35 milliards…
M. Jean-Luc Lépine. Non, ces chiffres correspondent à l’évaluation du coût du stockage géologique profond. Ramené à l’actualisation, le montant en cause est nettement moins important.
M. le président François Brottes. Si l’on ferme des centrales et des réacteurs plus rapidement, on ne dépensera pas plus, mais on dépensera plus vite.
Enfin, toujours de votre point de vue, la CNEF fait bien son travail.
M. Jean-Luc Lépine. Elle collabore bien avec l’autorité administrative.
M. le président François Brottes. Venons-en aux taux. Les émissions d’obligations sur dix ans sont bien aujourd’hui – je l’ai vérifié – à 2,6 %.
Pensez-vous qu’il y ait urgence à enclencher le processus de stockage à long terme ? Les dispositifs de stockage existant ne permettent-ils pas d’attendre encore quelques décennies ?
M. Jean-Luc Lépine. Je n’ai pas l’expertise nécessaire pour répondre sur cet aspect technique.
M. Denis Baupin, rapporteur. Une fermeture plus précoce des réacteurs aurait-elle un impact positif ou négatif ? Je me permets de souligner que moins longtemps on produira de déchets, moins il y en aura à stocker. Plus on fermera tôt, moins cela coûtera cher. Mais il est vrai qu’il faudra alors sans doute débourser l’argent un peu plus tôt.
Le sujet dont nous traitons peut paraître aussi technique qu’abstrait : il n’en est pas moins crucial. Ce qui est en cause, en effet, c’est l’argent qu’il faudra dépenser dans vingt, trente, quarante, cinquante ou soixante ans, à un moment où il n’y aura peut-être plus de nucléaire en France. Il n’est pas question que les générations futures assument le financement des charges induites par l’électricité que nous consommons aujourd’hui. Le démantèlement des centrales et la gestion des déchets ne rapportent rien, alors que les centrales nucléaires – quoi qu’on en pense – produisent au moins de l’électricité, et que cette production est finançable. C’est donc une charge totale que nous transmettrions aux générations futures si nous ne nous mettions pas en situation de financer correctement ces activités.
Pour cela, il faut remplir trois conditions : bien évaluer les coûts ; avoir un taux d’actualisation qui ne reporte pas les charges sur les générations futures ; sécuriser les financements pour qu’ils soient disponibles le moment venu.
Permettez-moi de citer quelques éléments tirés du document de référence d’EDF, destiné à informer les investisseurs éventuels : « Les provisions constituées par le Groupe pour les opérations de traitement du combustible usé et pour la gestion à long terme des déchets pourraient s’avérer insuffisantes. […] La déconstruction du parc nucléaire existant pourrait présenter des difficultés qui ne sont pas envisagées aujourd’hui ou s’avérer sensiblement plus coûteuse que ce qui est aujourd’hui prévu. […] Les actifs dédiés constitués par le Groupe pour couvrir les coûts de ses engagements de long terme dans le nucléaire (déchets radioactifs et déconstruction) pourraient s’avérer insuffisants et entraîner des décaissements supplémentaires. »
Dans ce même document, les commissaires aux comptes notent que « l’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, qui résulte des meilleures estimations de la Direction […] est sensible aux hypothèses retenues en termes de procédés techniques, de coûts, de taux d’inflation, de taux d’actualisation à long terme et d’échéanciers de décaissements. La modification de certains de ces paramètres pourrait conduire à une révision significative des provisions comptabilisées. »
L’Autorité des marchés financiers (AMF), que j’ai eu l’occasion de rencontrer pour évoquer, notamment, la situation d’EDF, a fait remarquer qu’il était plutôt rare qu’une telle observation figure dans le rapport des commissaires aux comptes d’une entreprise cotée au CAC 40. Lorsque c’est le cas, une solution ne tarde pas à être apportée au problème et, au bout d’un an ou deux, l’observation n’a plus lieu d’être. Or celle-ci figure dans le document de référence d’EDF depuis son introduction en Bourse : la situation n’a pas progressé depuis.
La situation actuelle ne paraît donc ni rassurante ni satisfaisante. A-t-on bien évalué le taux d’actualisation et les provisions à faire ? Ces provisions sont-elles sécurisées ? Le taux d’actualisation est actuellement fixé à 5 %…
M. Jean-Luc Lépine. C’était le cas en 2012. Pour l’exercice 2013, je crois qu’EDF l’a abaissé à 4,80 %.
M. le rapporteur. Le 23 juillet 2012, vous indiquiez devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques que, fixé à 5 %, ce taux « pourrait devoir être réévalué car un tel niveau ne permet pas de marge de précaution. Il serait prudent d’envisager une baisse du taux. » Vous dites que ce taux a été baissé à 4,80 %. Estimez-vous cette baisse suffisante ? La Cour des comptes a elle-même noté que ce taux d’actualisation reposait sur de fortes incertitudes.
D’autre part, André-Claude Lacoste, ancien président de l’ASN, a déclaré devant la commission d’enquête du Sénat sur le coût de l’électricité que le décret permettant d’affecter une partie des actifs de RTE aux provisions d’EDF constituait un contournement de l’esprit de la loi.
M. le président François Brottes. M. Lacoste, que j’admire par ailleurs, parlait en l’occurrence hors de son champ de compétences, qui se limite aux questions de sûreté.
M. le rapporteur. Ne peut-on estimer qu’un provisionnement suffisant est un élément de sûreté ? Quoi qu’il en soit, dans la mesure où RTE, qui remplit un service public, a un monopole de fait, ces actifs ne sont pas vendables, et donc pas valorisables pour financer les charges futures. En conséquence, on risque de devoir mettre en œuvre la garantie de l’État.
En ce qui concerne les actifs du CEA, les choses sont encore plus claires. Il a en effet été décidé au conseil de politique nucléaire du 12 février 2010 que le financement des dépenses de long terme du CEA serait assuré par le budget de l’État. L’État est donc totalement responsable de ces éléments.
M. le président François Brottes. RTE peut ouvrir son capital, par exemple à la Caisse des dépôts, et la loi pourrait permettre de valoriser ces actifs.
M. le rapporteur. Quant aux actifs dédiés d’AREVA, composés de titres financiers, la valeur du portefeuille a été réduite de 27 % en raison de la crise financière.
Ainsi, d’après la loi, les entreprises sont responsables, mais, en fait, les dispositifs mis en place les ont en partie déresponsabilisées. Quel est votre sentiment à cet égard ?
Enfin, est-il bien pertinent que ces fonds qui répondent à un service public et qui, s’ils n’étaient pas constitués de façon suffisante, devraient être garantis par l’État, restent au sein des entreprises ? Ne faudrait-il pas les mettre dans un fonds dédié, garanti à l’extérieur, par exemple à la Caisse des dépôts, afin de mieux les sécuriser ?
M. Jean-Luc Lépine. Je répondrai d’abord à votre question sur les actifs de RTE. Les exploitants sont soumis en permanence à des tensions contradictoires entre les fonds qui doivent être consacrés à garantir le futur démantèlement, ceux qui doivent servir au programme de développement de l’entreprise, et les charges à faire peser sur le consommateur. La tendance naturelle d’EDF est de privilégier les éléments de son propre développement, tandis que celle du Gouvernement est d’atténuer la charge à faire payer au consommateur. Au moment des arbitrages, la garantie du financement des opérations de fin de cycle n’est donc pas toujours considérée comme prioritaire. Le rôle de l’administration et de la CNEF est d’inciter les entreprises à prendre cette nécessité en compte. Cette démarche dialectique a conduit le Gouvernement à accepter des demandes d’EDF qui visaient à faire évoluer la réglementation pour inclure, dans les actifs dédiés qui représentent son provisionnement, des éléments concourant au développement de la stratégie d’entreprise.
Je comprends la réflexion du président Lacoste, mais j’observe que RTE génère des flux de revenus ; or un actif qui génère des flux de revenus peut être évalué. Nous avions donc demandé que l’administration s’assure – pour le maintien de la valorisation de RTE au sein des actifs dédiés – de la validité des hypothèses relatives à la pérennité des flux de revenus, c’est-à-dire des dividendes versés. Il est évident que, si RTE était conduit à diminuer les dividendes versés à ses actionnaires, la valeur pour laquelle elle devrait être prise au sein des actifs dédiés devrait être révisée. Cela justifie que l’administration surveille tout spécialement RTE et contrôle l’application du contrat d’origine.
Ensuite, sur les 10 milliards d’actifs dédiés du CEA, 7 ou 8 sont garantis par l’État, les 2 milliards restants représentant la valeur de la participation d’AREVA. C’est donc bien le budget de l’État qui, in fine, est le garant du financement de démantèlement ultime des installations du CEA.
S’agissant de la localisation des actifs dédiés, deux modèles extrêmes existent. Les pays scandinaves confient à des organismes extérieurs la gestion des actifs consacrés à la garantie des opérations de fin de cycle. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, de leur côté, confient à l’entreprise la responsabilité des fonds correspondants, tout en instituant un système de contrôle extérieur.
En 2006, la France a choisi l’option de la responsabilisation des entreprises. Celles-ci sont très attachées à ce système. Mais cela nécessite qu’il y ait, en face d’elles, des capacités de contrôle suffisantes.
M. le rapporteur. Est-ce le cas ?
M. Jean-Luc Lépine. Ce n’était pas le cas à l’origine, mais le système a été renforcé. Encore une fois, c’est la capacité de l’administration à contester les assertions des entreprises qui devra être améliorée.
Mme Frédérique Massat. Dans le rapport de la CNEF, on peut lire que « l’appréciation générale de la CNEF peut être résumée de la manière suivante : par définition le véritable coût des charges de démantèlement ne sera connu que lorsque seront terminées des opérations qui vont s’étaler sur plusieurs d’années jusque vers la fin des années 2100. » Une telle remarque n’est-elle pas surprenante, s’agissant d’une commission d’évaluation des charges ?
Le même rapport fait état de la faiblesse des effectifs de l’autorité administrative et s’interroge sur les capacités de contrôle de la CNEF, s’agissant notamment des provisions pour démantèlement constituées par les entreprises. Qu’en est-il ?
M. Jean-Luc Lépine. C’est une simple observation de bon sens : nous ne connaîtrons le coût ultime de démantèlement qu’à la fin des opérations. Partout dans le monde, les opérations de démantèlement n’en sont qu’à leur début. On peut malgré tout repérer, au fur et à mesure, les facteurs d’augmentation des coûts par rapport aux prévisions.
En 2012, certaines autorités nous ont fourni des éléments de comparaison ; par exemple, la Suisse, qui est engagée dans ce processus, a vu ses coûts augmenter au fur et à mesure des opérations. Reste que nous ne pouvons que nous doter d’une méthodologie nous permettant de faire apparaître les facteurs d’incertitude et laissant le champ à la discussion.
Vous m’avez également interrogé sur la faiblesse des effectifs de l’autorité administrative. À l’origine, cette dernière était effectivement extrêmement réduite en effectifs et en compétences, ce qui ne la mettait pas en mesure de remplir une de ses missions essentielles, qui est d’expertiser les évaluations réalisées sous la responsabilité des entreprises. Or ce n’est qu’en exploitant – notamment avec le concours de l’ASN – les méthodes utilisées par les entreprises que l’on peut, au terme d’un dialogue, faire évoluer les évaluations. Depuis, les effectifs ont été consolidés et le programme d’audits, qui lui permettra de se renforcer par une compétence de conseil extérieur, va être enfin lancé.
M. le président François Brottes. Votre allusion à la CSPE m’amène à penser qu’il est parfois aussi difficile d’évaluer les fins de cycle que les débuts de cycle. Ainsi la CSPE est destinée à financer, notamment, la montée en puissance des énergies renouvelables, mais on n’a pas encore trouvé de modèle pour la prendre en compte, y compris dans la durée. Les fins de cycle sont un peu confrontées aux mêmes difficultés. D’ailleurs, les solutions comptables qui ont été trouvées, dans un cas comme dans l’autre, se ressemblent.
J’ai bien noté que vous vous interrogiez sur ce qui se passerait après le 20 juin.
M. Jean-Luc Lépine. Nous disparaîtrons collectivement !
M. le président François Brottes. Nous en ferons état dans notre rapport. Monsieur le président, je vous remercie pour votre contribution.
Audition de M. Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe chargé des finances d’EDF, de M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA, de M. Christophe Gégout, directeur financier du CEA, et de M. Pierre Aubouin, directeur général adjoint chargé des finances d’AREVA
(Séance du 2 avril 2014)
M. le président François Brottes. Messieurs, quoique vous représentiez différents exploitants nucléaires, vous êtes soumis à une même obligation : ne pas faire supporter par les générations futures les charges financières créées aujourd’hui. Cette audition vise à évaluer ces dernières : vous commencez à bien connaître le coût des opérations de démantèlement, mais les devis peuvent-ils encore nous réserver de mauvaises surprises ? Comment estimez-vous le coût, moins bien connu, du stockage des déchets ultimes ? Comment, en général, réduire la marge d’incertitude ?
Nous nous pencherons notamment sur les provisions comptables, qui, pour éviter un appauvrissement futur de l’entreprise, doivent avoir pour contrepartie des actifs dédiés. Vous retenez un taux d’actualisation très légèrement inférieur au maximum légal : est-ce suffisant ? Selon vous, les problèmes dénoncés par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) sont-ils réels ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Thomas Piquemal, Bernard Bigot, Christophe Gégout et Pierre Auboin prêtent serment)
M. Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe chargé des finances d’EDF. Les provisions nucléaires et les actifs de couverture d’EDF sont très encadrés. Je n’ai pas besoin d’insister longuement ici sur l’encadrement législatif et réglementaire – loi du 28 juin 2006 et loi du 7 décembre 2010 sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite NOME, notamment.
Ils sont également encadrés par les structures de gouvernance d’EDF : le conseil d’administration fixe la politique de constitution et de gestion des actifs dédiés et valide la gestion des actifs et des passifs du groupe ; le comité d’audit revoit les provisions et éclaire les travaux du conseil d’administration ; le comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) suit l’évolution des provisions, donne un avis sur l’adossement actifs/passifs et supervise la gestion financière. Ces deux comités sont présidés par des administrateurs indépendants. Enfin, le comité d’expertise financière des engagements nucléaires rassemble des experts qui donnent un avis sur la gestion et la stratégie de placement des actifs dédiés.
Interviennent enfin différentes autorités de contrôle : office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) bien sûr, commission des finances à laquelle les comptes sont présentés chaque année, CNEF, Cour des comptes, direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), direction générale du Trésor, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), commissaires aux comptes d’EDF et Autorité des marchés financiers (AMF).
À la fin de l’année 2013, le coût brut des charges futures d’EDF est de 67,873 milliards d’euros. Le calcul des provisions repose sur les dernières estimations connues, à partir de contrats, de devis, d’études internes et externes. Nous établissons un échéancier de paiement de ces charges, qui sont inflatées, avec un taux d’inflation de 1,9 % – très supérieur, vous le voyez, aux derniers taux communiqués. Nous actualisons enfin les charges pour les ramener en valeur actuelle et les inscrire dans le bilan du groupe ; le taux d’actualisation, qui est de 4,8 %, repose sur des analyses de spread de sociétés comparables aux nôtres et des taux de marché. À la fin de l’année 2013, le montant total de nos provisions s’élève dont à 32,658 milliards.
Nous avons constitué, conformément à la loi, un portefeuille d’actifs dédiés. Les provisions qui doivent être couvertes sont de 21 milliards d’euros, c’est-à-dire environ les deux tiers des montants provisionnés : certaines charges futures – le combustible, notamment – seront couvertes par le cycle d’exploitation et n’ont donc pas besoin de l’être par des actifs dédiés. Les provisions pour la déconstruction des centrales nucléaires s’élèvent à 13 milliards d’euros, celles pour la gestion à long terme des déchets radioactifs à 7,5 milliards et celles pour les « derniers cœurs », c’est-à-dire le traitement du dernier combustible lors de la mise à l’arrêt des centrales, à 0,5 milliard d’euros. Le montant de notre portefeuille d’actifs dédiés est supérieur au montant des provisions, puisqu’il s’élève à 21,7 milliards d’euros : le taux de couverture des passifs est de 103 %.
Le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF est constitué de titres d’investissement dans des fonds obligataires ou dans des fonds en actions. Depuis quatre ans, nous avons adopté une stratégie de diversification : c’est un principe de bonne gestion. Nous nous attachons aussi à choisir le meilleur rapport possible entre risque et rendement. Auparavant, le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF était investi pour moitié en actions et pour moitié en obligations : lorsque EDF souhaitait ajouter des fonds dans son portefeuille d’actifs dédiés, l’entreprise émettait de la dette sur les marchés internationaux auprès d’investisseurs obligataires et réinvestissait ensuite 50 % de cette dette levée dans des fonds obligataires, notamment ceux qui avaient souscrit la dette EDF. C’était un peu circulaire, et certainement pas optimal. Nous avons donc aujourd’hui diversifié nos investissements, et créé notamment un compartiment « infrastructures » au sein du portefeuille d’actifs dédiés, dans lequel se trouvent 50 % des titres de RTE (Réseau de transport d’électricité) et 20 % de TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France), le réseau que Total a vendu l’année dernière. EDF dispose ainsi d’un rendement régulier, à faible risque, et augmente donc la valeur de son portefeuille à très long terme.
Enfin, depuis l’accord trouvé avec l’État au début de l’année 2013, nous avons affecté la créance du déficit de contribution au service public de l’électricité (CSPE), d’environ 4,9 milliards d’euros. Elle sera soldée d’ici au 31 décembre 2018. Le rendement est de 170 points de base environ. Il n’y a là aucun risque.
En 2013, la performance totale du portefeuille des actifs dédiés était de 9,4 % ; pour le portefeuille financier seul, c’est-à-dire hors créance de CSPE et trésorerie, elle était de 11,6 %. La performance de RTE était de 11,1 %. Sur les dix dernières années, le rendement moyen annualisé du portefeuille est de 5,8 %, ce qui est supérieur au taux d’actualisation. La performance sur les actifs dédiés est donc essentielle pour faire face aux coûts futurs du nucléaire.
M. le président François Brottes. Si RTE n’appartenait plus à EDF, votre schéma ne fonctionnerait plus.
M. Thomas Piquemal. Dans ce cas, il conviendrait d’investir dans d’autres infrastructures. Nous souhaitons que celles-ci représentent environ un quart du montant des actifs dédiés.
M. le président François Brottes. Sur ce montage, la Commission européenne a-t-elle fait des remarques ?
M. Thomas Piquemal. Pas à ma connaissance.
M. Bernard Bigot, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Je ne traiterai ici que des questions relatives aux activités civiles du CEA. Je pense d’abord à nos activités de recherche et développement passées, présentes et futures : nous nous efforçons de développer des technologies et d’accroître les connaissances au service d’un usage sûr et techniquement comme économiquement optimisé de l’énergie nucléaire, à des fins de production électrique. Nous avons également des activités de démantèlement, d’assainissement et de gestion des déchets pour des installations à l’arrêt, en activité ou en construction. Le CEA, créé en 1945, a développé de nombreuses installations qui ont servi la filière nucléaire ; il a aujourd’hui la responsabilité de leur démantèlement et de leur assainissement.
Les études que nous avons menées ont montré qu’il n’y a pas d’obstacle de principe à la poursuite de l’activité des réacteurs jusqu’à soixante ans. Cela nécessite néanmoins des examens réguliers et des moyens de diagnostic. C’est la mission de l’institut créé par EDF, AREVA et le CEA : développer les outils nécessaires pour assurer au mieux la sûreté des installations nucléaires. Le mécanisme de revue décennale permet en outre à l’autorité de sûreté d’indiquer à la puissance publique s’il est pertinent de poursuivre l’exploitation.
Toutefois, même s’il est décidé de prolonger l’exploitation des réacteurs jusqu’à cinquante ou soixante ans, les cinquante-huit réacteurs qui fonctionnent actuellement auront tous atteint cet âge en 2055 ou 2060. Dans l’hypothèse de la poursuite d’une activité nucléaire, même réduite – on peut estimer que trente-cinq réacteurs seraient nécessaires –, la bonne gestion voudrait que l’on prévoie d’ores et déjà le remplacement des réacteurs aujourd’hui en fonctionnement. Le CEA travaille sur ce dossier.
S’agissant enfin des charges de démantèlement et d’assainissement, l’évolution récente est forte : en 2002, nous dépensions 114 millions d’euros à ces fins ; en 2013, nous en avons dépensé 280 millions ; dans les années à venir, les dépenses annuelles vont croître encore, puisque nous prévoyons de dépenser entre 340 et 370 millions d’euros par an pour le démantèlement et l’assainissement. Depuis la fin des années 1990, le CEA a déjà dépensé plus de 2,5 milliards d’euros, essentiellement pour des activités industrielles : nous disposons donc déjà d’un retour d’expérience extrêmement significatif. Cette expertise nous est fort utile pour calibrer au mieux les provisions nécessaires.
Jusqu’en 2011, nous avions dépensé 2,1 milliards d’euros, dont 90 % étaient des financements hors subvention, venant essentiellement des dividendes AREVA – près de 950 millions d’euros – et des soultes versées par AREVA et EDF pour le démantèlement et l’assainissement de différents équipements – plus de 800 millions d’euros. Ces fonds ont été placés, ce qui nous a rapporté 330 millions d’euros.
Ces ressources s’épuisant, nous basculons désormais vers un dispositif nouveau : une convention-cadre avec l’État a été signée pour que nous disposions des moyens nécessaires, pour partie grâce à la vente à l’État de nos actions AREVA, mais aussi grâce à des subventions. En 2010, ces dernières se sont élevées à 189 millions d’euros et, cette année, elles sont de 249 millions d’euros. Les engagements financiers de l’État pour le plan triennal 2011-2013 ont été parfaitement respectés, ce qui nous a permis d’optimiser la planification des travaux de démantèlement et d’assainissement. À cet égard, je souligne qu’une partie des charges sont liées à la sûreté : plus nous repoussons le démantèlement et l’assainissement d’une installation, même si elle est déjà arrêtée, plus l’ensemble de l’opération sera coûteux. Chaque année, les coûts de fonctionnement – ventilation, électricité, sûreté, protection… – représentent pour le CEA plus de 100 millions d’euros, sur les 650 millions des opérations de démantèlement et d’assainissement civiles et militaires.
S’agissant des provisions, le montant du fonds dédié civil est de 4,670 milliards d’euros. Cela concerne essentiellement les installations antérieures à 2010. À partir de 2010, un nouveau fonds dédié a été mis en place ; il doit être approvisionné au fur et à mesure de l’ouverture de nouvelles installations ou de la production de nouveaux déchets. Ce nouveau fonds est aujourd’hui doté de 63 millions d’euros – les provisions nécessaires ne sont actuellement que de 20 millions, mais nous prévoyons l’ouverture, en 2019, du réacteur Jules-Horowitz (RJH). Notre expertise nous permet de calculer les provisions. Nous avons mis en place des dispositifs de contrôle opérationnel, avec un suivi annuel et des fiches précises, par installation, qui associent contenu physique des opérations de démantèlement à mener et couverture financière associée. Aujourd’hui, nous avons des coûts cibles, et nous avons prévu des aléas : la plupart de nos installations sont uniques, ce qui rend difficile de prévoir le coût d’un démantèlement. Je peux vous donner l’exemple du démantèlement et de l’assainissement des installations nucléaires du site CEA de Grenoble, notamment du réacteur Siloé. Une fois les opérations presque terminées – ce qui a représenté une dépense d’environ 200 millions d’euros, conforme à nos prévisions –, nous avons découvert qu’une fuite très limitée avait contaminé le radier, c’est-à-dire le plancher de l’installation : l’ASN a exigé que nous traitions cette contamination. Extrêmement faible, elle ne posait pas de problème sanitaire, mais l’engagement était le retour à l’herbe : nous avons donc dû dépenser 50 millions d’euros supplémentaires. Nous devons donc prévoir ce type d’événements.
Nos évaluations sont tout à fait robustes : en 2009, nous avons révisé entièrement nos perspectives, et nous avons accru le fonds civil de près de 700 millions. Nous restons dépendants de demandes externes – évolution des conditions de sûreté, des prix de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), des calendriers… Ainsi, nous devions démanteler le réacteur Phénix à Marcoule : pour des raisons électorales, l’enquête publique a été reportée d’un an ; il faudra donc payer les charges de fonctionnement de Phénix, soit plusieurs dizaines de millions d’euros, pendant une année supplémentaire.
Enfin, j’ai pris connaissance avec intérêt des auditions déjà menées par votre commission. Contrairement à ce que certains peuvent penser, notre effort de recherche ne faiblit pas : en 2010, nous avons dépensé en recherche et développement dans le domaine du nucléaire 460 millions d’euros, dont 150 millions provenaient de ressources externes, et en particulier de partenaires comme EDF, dont je salue ici l’engagement ; en 2013, nous en étions à 730 millions d’euros, avec une proportion semblable de recettes externes.
J’ai entendu aussi certaines interrogations sur les réacteurs de quatrième génération : je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions sur ce sujet.
M. Pierre Aubouin, directeur général adjoint chargé des finances d’AREVA. AREVA exploite en France dix-huit installations nucléaires de base qui entrent dans le champ d’application de la loi du 28 juin 2006. Il s’agit exclusivement d’installations du cycle du combustible nucléaire, en cours d’exploitation ou à l’arrêt. Nous sommes également concernés par la reprise et le conditionnement de déchets historiques sur certaines de nos installations.
À la fin de l’année 2013, les charges futures du groupe s’élèvent, en devis brut, à 12 milliards d’euros, dont les trois quarts à peu près sont concentrés sur l’établissement de La Hague. Nous constituons donc naturellement des provisions dans notre bilan, pour un montant actualisé et tenant compte de l’inflation qui est de 5,96 milliards d’euros. Le montant des actifs dédiés s’élève à 6,09 milliards d’euros. Le taux de couverture est donc de 102,2 %.
Historiquement, dès 1993, la COGEMA, prédécesseur d’AREVA, avait mis en place des actifs financiers dédiés pour faire face à ses obligations en fin de cycle. Aujourd’hui, le suivi de nos obligations fait l’objet d’un encadrement très particulier au sein des instances de gouvernance d’AREVA, avec plusieurs niveaux de contrôle interne. AREVA est une société à directoire et conseil de surveillance. C’est le directoire qui, sur proposition de la direction financière, arrête la politique de gestion des fonds dédiés, notamment la charte d’investissement et l’allocation stratégique du portefeuille à long terme. La mise en œuvre de cette politique est en retour déléguée à la direction financière, et notamment en son sein à deux départements : la direction du patrimoine nucléaire, qui gère le suivi des actifs et des passifs, et la direction des opérations de financement et de trésorerie, qui gère les fonds dédiés. Le conseil de surveillance a mis en place un comité de suivi des obligations de fin de cycle, qui revoit les choix du directoire. Le directoire a constitué un comité de suivi des opérations de démantèlement qui revoit périodiquement les estimations et favorise la diffusion des retours d’expérience au sein des différentes installations du groupe. Comme c’est le cas pour EDF et pour le CEA, nos travaux font bien sûr l’objet de nombreux contrôles externes : à la liste dressée par Thomas Piquemal, sur laquelle je ne reviens pas, j’ajouterai par exemple le Contrôle général économique et financier (CGEFi).
S’agissant des actifs dédiés, leur gestion par AREVA a jusqu’ici donné satisfaction. Le ratio de couverture est supérieur à 100 % en dépit d’événements défavorables, comme la baisse du taux d’actualisation intervenue en 2012, mais aussi la crise et la forte volatilité des marchés financiers depuis 2008. Les seules variations notables intervenues dans notre portefeuille sont le démantèlement de l’usine Georges-Besse, exploitée par Eurodif, et l’élargissement du périmètre de nos obligations, par exemple à la nouvelle usine d’enrichissement Georges-Besse II.
Depuis 2007, le rendement est légèrement supérieur à 4 % – n’oublions pas que nous avons traversé durant cette période une crise boursière majeure. Depuis 1993, année de la mise en place du fonds dédié, la moyenne annuelle de rendement du portefeuille est de 9,4 %. Le portefeuille d’actifs d’AREVA est diversifié et investi majoritairement à long terme dans l’économie française et européenne, ainsi qu’en dettes souveraines de la zone euro ; 85 % sont des titres financiers – actions pour 40 %, placements obligataires ou monétaires pour 45 % – et 11 % supplémentaires sont des créances à recevoir, notamment du CEA. Enfin, le solde est constitué d’une quote-part de tiers, c’est-à-dire la part du financement à la charge de certains actionnaires minoritaires de nos activités.
La liquidité de ces actifs est un point important. Nous nous assurons que les dépenses les plus proches dans le temps, c’est-à-dire celles des cinq prochaines années, seront financées sans avoir à revendre des actifs volatils ou risqués. Pour AREVA, cela représente environ 200 millions d’euros par an : nous utilisons les revenus du portefeuille, sans toucher au principal, et complétons par des cessions de parts de fonds monétaires ou d’obligations d’État notées AAA.
La gestion des passifs concerne dix-huit installations nucléaires de base. Celles-ci sont diverses : elles comprennent des ateliers de maintenance nucléaire, des usines de fabrication de combustible comme à Romans-sur-Isère ou comme l’usine MELOX dans le Gard, deux usines d’enrichissement d’uranium à Pierrelatte – l’usine Georges-Besse I, à l’arrêt, et l’usine Georges-Besse II –, l’usine de traitement des combustibles irradiés à La Hague… Elles sont également de générations différentes : les premières installations comme l’usine UP2 400 à La Hague date de 1966, quand la production de l’usine Georges-Besse II a démarré en 2011. Au fur et à mesure, les problèmes posés par le démantèlement ont été de mieux en mieux et de plus en plus tôt pris en considération. Ainsi, la technique de centrifugation utilisée par l’usine Georges-Besse II permet de diminuer fortement les volumes irradiés.
À la fin de l’année 2013, les provisions que j’évoquais tout à l’heure concernent à 85 % le démantèlement des installations et à 15 % la gestion ou la reprise des déchets.
L’évaluation des passifs fait l’objet d’un processus robuste, marqué par la récurrence des devis. Ceux-ci sont réévalués tout au long de la vie des installations. Le coût futur du démantèlement est pris en compte dès la conception de l’installation ; à la mise en service, nous réalisons un travail approfondi ; nous procédons ensuite à des révisions triennales des devis, afin d’intégrer tout événement particulier ou toute évolution réglementaire ; dès la fin d’exploitation, et avant même le décret de démantèlement, nous élaborons un « devis opérationnel », sur la base de consultations de fournisseurs. Enfin, à l’issue des travaux de démantèlement, nous effectuons un exercice complet de retour d’expérience.
Deux incertitudes demeurent. La première concerne le taux d’actualisation des passifs : ce n’est pas pour nous une question de normes comptables, mais plutôt une frustration causée par les modalités de calcul imposées par l’arrêté ministériel qui définit le taux plafond utilisable. Ce calcul est fondé sur une moyenne mobile historique de taux d’intérêt observés sur les obligations d’État, ce qui pose problème dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers. Nous dialoguons donc depuis plus d’un an avec l’autorité administrative, ainsi qu’avec les autres entreprises concernées, pour stabiliser dans le temps ce taux d’actualisation : cela permettrait une gestion sereine et durable du portefeuille d’actifs. Dans le cas contraire, la volatilité qui pourrait être introduite dans l’évaluation des passifs, du fait des variations du taux d’actualisation, pourrait provoquer des difficultés dans la gestion du portefeuille d’actifs.
La seconde concerne le devis du centre de stockage des déchets ultimes en couche géologique profonde. Nous indiquons dans nos états financiers la sensibilité de ce devis. Il nous semble qu’il y a tout intérêt à poursuivre l’optimisation technique et économique de ce projet.
Nous disposons en matière de démantèlement d’un fort retour d’expérience, très utile pour les opérations en cours ou à venir. Il est valorisé auprès de nos clients français ou étrangers. Plus de quarante opérations de démantèlement sont en cours dans les installations du groupe, pour un devis total de 2 milliards d’euros, principalement à La Hague et à Cadarache. Nous effectuons également des travaux de reprise et de conditionnement de déchets pour un coût à terminaison de 1,3 milliard d’euros : c’est donc pour nous une activité importante. Nous avons achevé le démantèlement de deux sites, à Annecy et à Veurey. Deux chantiers sont en phase finale, l’un à Miramas et l’autre à Dessel, en Belgique. Nous préparons actuellement le démantèlement de l’usine historique d’Eurodif au Tricastin. Nous participons enfin au démantèlement d’installations d’EDF – Chooz A – et du CEA – à Marcoule. L’opération de démantèlement de l’installation du CEA mobilise par exemple 900 salariés d’AREVA, soit près de 40 % des effectifs qui se consacrent au démantèlement.
Nous participons enfin de longue date à des opérations de démantèlement à l’étranger : nous avons ainsi mené divers chantiers en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis.
M. le président François Brottes. Monsieur Bigot, je voudrais vous poser une question quelque peu iconoclaste : pensez-vous que la solution du stockage de déchets en couche profonde soit toujours pertinente ? AREVA peut maintenant stocker des déchets de façon sûre pendant longtemps.
M. Bernard Bigot. Le stockage de déchets en couche géologique est, je crois, une solution qu’il faut mettre en œuvre sans tarder. La France a une activité nucléaire depuis plus de soixante ans ; nous entreposons des déchets dans des installations qui ne sont pas éternelles. Nous avons, je crois, intérêt à débuter le plus tôt possible, pour disposer d’un vrai retour d’expérience et ainsi consolider la confiance que peuvent accorder nos concitoyens à cette solution de gestion à très long terme des déchets nucléaires.
Ceux-ci, vous le savez, ont une radioactivité augmentée par rapport à la radioactivité naturelle des matières utilisées ; elle décroît progressivement, mais sur des échelles de temps très longues. Nous disposons aujourd’hui de grandes quantités de déchets « froids », aujourd’hui entreposés, et que nous pouvons stocker de cette façon. Il paraît donc judicieux de commencer dès que possible. Pour garantir le confinement de ces déchets à très long terme, les phénomènes naturels paraissent la meilleure solution.
Sans ce stockage, nous serons obligés d’investir plusieurs centaines de millions d’euros pour prolonger jusqu’à cinquante, voire cent ans, la durée de vie des installations d’entreposage, et il faudra tout recommencer dans cinquante ou cent ans. Ce n’est pas, je crois, une question iconoclaste ; c’est une question de fond : il faut sortir des schémas simplistes et approcher cette question avec sérieux et en prenant en considération les réalités physiques.
M. Denis Baupin, rapporteur. Je m’en tiendrai ici au sujet des charges futures. Nous ne devons pas répercuter les coûts d’aujourd’hui sur les générations futures.
Le document de référence qu’EDF a déposé auprès de l’AMF mentionne que « les provisions constituées par le Groupe pour les opérations de traitement du combustible usé et pour la gestion à long terme des déchets pourraient s’avérer insuffisantes ». Il prévient également que « la déconstruction du parc nucléaire existant pourrait présenter des difficultés qui ne sont pas envisagées aujourd’hui ou s’avérer sensiblement plus coûteuses que ce qui est aujourd’hui prévu » et que « les actifs dédiés constitués par le Groupe pour couvrir les coûts de ses engagements de long terme dans le nucléaire (déchets radioactifs et déconstruction) pourraient s’avérer insuffisants et entraîner des décaissements supplémentaires ». Ces précautions honorent plutôt EDF, qui fait preuve de transparence et de clarté. Elles sont d’ailleurs confirmées par les commissaires aux comptes dans leurs observations. L’AMF nous a indiqué que ces mentions étaient inhabituelles au sein des entreprises du CAC40.
S’agissant des déchets et de Cigéo (Centre industriel de stockage géologique), la procédure est en cours. L’ANDRA examine les conséquences du débat public et il est aujourd’hui difficile de savoir quelles seront les suites de ce projet. Je parlerai donc surtout ici des démantèlements.
Dès son rapport de 2012, la Cour des comptes a émis des observations sur les méthodes de calcul. Établissant des comparaisons avec les pratiques des pays étrangers, elle a pu constater que les évaluations par EDF du coût du démantèlement des centrales nucléaires étaient plus faibles que celles des autres pays. Pour expliquer cette différence, EDF a notamment argué de l’homogénéité de son parc de centrales, ce qui peut paraître insuffisant. Quelle est la marge d’erreur de ces évaluations ?
Le devis du démantèlement de la centrale de Brennilis – qui est d’ailleurs loin d’être achevé – aurait ainsi augmenté de 26 %. Pour l’usine UP2 400 à La Hague, le devis aurait augmenté de 37 %, et pour Eurodif de 43 %. Ces chiffres sont-ils justes ? Ils sont très élevés, surtout pour des opérations qui ne sont même pas achevées ! Lors de l’audition de responsables de la filière du démantèlement des centrales nucléaires, nous n’avons pas pu obtenir de chiffres sur les écarts constatés entre les devis et les coûts réels constatés. Tout cela est donc très flou. Bien sûr, les évaluations pour l’avenir sont très difficiles, mais cela rend d’autant plus nécessaires des évaluations précises du passé et du présent…
S’agissant du taux d’actualisation, la Cour des comptes comme la CNEF ont estimé qu’un taux de 5 % était trop élevé. Quel est votre sentiment ? Comment imaginez-vous le réévaluer pour qu’il remplisse son rôle ?
Si mes informations sont exactes, la crise a causé une perte de 27 % de la valeur des actifs dédiés. AREVA n’est pas responsable de la crise financière, mais un tel chiffre n’en est pas moins inquiétant. Comment mieux sécuriser ces placements ? La part de l’État dans la garantie des financements ne cesse de croître, et l’idée de créer un fonds souverain ou de localiser ces fonds ailleurs qu’au sein des entreprises est de plus en plus largement débattue. Qu’en pensez-vous ?
M. Thomas Piquemal. En ce qui concerne l’évaluation des charges futures occasionnées par le démantèlement des centrales, il faut distinguer les centrales en cours de déconstruction – onze pour EDF, notamment des centrales de première génération comme Brennilis et Chooz – de celles qui sont encore en exploitation.
Pour les centrales arrêtées définitivement, la provision est évaluée à partir d’un devis réactualisé à la fin de 2012. Cette mise à jour triennale s’appuie sur les analyses du Centre d’ingénierie de déconstruction et environnement (CIDEN) dont EDF s’est dotée en 2001 et sur le retour d’expérience des déconstructions déjà réalisées. Elle a donné lieu à l’inscription dans les comptes d’un supplément de provisions de 600 millions d’euros, traduisant une hausse du devis global, non actualisé, de l’ordre de 22 % – il est passé de 4 milliards 90 millions d’euros à 4 milliards 993 millions.
En ce qui concerne la centrale de Brennilis, pour laquelle vous avez mentionné une augmentation de 26 %, monsieur le rapporteur, le chiffre dont je dispose est inférieur : il n’est que de 15 %...
M. le président François Brottes. Quelles sont les causes de cette progression des coûts ?
M. Thomas Piquemal. Elle s’explique à 71 % par des raisons techniques, à 17 % par des complications réglementaires et à 12 % par la prise en compte des retours d’expérience. Les difficultés techniques tiennent au caractère unique de certaines opérations, à l’existence de spécificités radiologiques mal appréciées à l’origine, mais aussi à une meilleure connaissance des déchets ou encore à de nouvelles exigences de l’ANDRA. Parmi les difficultés d’ordre réglementaire, je citerai les annulations de permis dont ont fait l’objet le démantèlement de la centrale de Brennilis et le projet ICEDA (Installation de conditionnement et d’entreposage des déchets activés), ainsi que l’édiction de nouvelles obligations, touchant par exemple à la résistance aux séismes. Enfin, les retours d’expérience se rapportent principalement aux chantiers de déconstruction des centrales au graphite.
La fixation des provisions repose sur des estimations, sur des hypothèses ; tel est d’ailleurs le sens, monsieur le rapporteur, de l’observation – qui n’est pas une réserve – émise par les commissaires aux comptes : ceux-ci ont souhaité alerter sur la sensibilité de nos provisions à une variation du taux d’actualisation. Les hypothèses que nous formons découlent en effet d’analyses techniques malaisées, le cas extrême étant celui de Cigéo, projet à échéance de cent ans. Néanmoins, nous avons confiance dans nos chiffres, car ils sont réactualisés à la lumière des retours d’expérience et en fonction de l’avancement physique des chantiers ; en outre, nous disposons en interne d’un centre d’ingénierie qui conduit des études sur le sujet, notamment à partir d’une analyse des opérations similaires menées à l’étranger, et nous comparons constamment le taux d’avancement physique des chantiers et le taux de consommation des provisions. Enfin, tout se fait sous le contrôle de nos commissaires aux comptes.
M. le rapporteur. S’agissant de Brennilis, l’augmentation de la dépense que l’on m’avait indiquée concernait la période allant de 2001 à 2008 : celle de 15 % que vous avez mentionnée pour les années 2008-2012 s’y ajouterait donc ?
M. Thomas Piquemal. Je ne suis pas en mesure de commenter la hausse intervenue entre 2005 et 2008, mais je confirme que le chiffre que je vous ai fourni représente l’augmentation intervenue en 2012 par rapport au devis de 2008.
M. le président François Brottes. Cela s’ajoute donc…
M. Thomas Piquemal. Les provisions pour déconstruction sont évaluées sur le fondement d’une étude du ministère de l’industrie et du commerce datant de 1991, que l’on a confrontée à l’étude Dampierre de 2009 évaluant le coût de déconstruction d’un site de quatre tranches de 900 mégawatts et à des comparaisons internationales réalisées par un cabinet extérieur. En outre, dans le parc de première génération en cours de déconstruction, il existe à Chooz un réacteur à eau pressurisée (REP) dont la puissance est certes faible – 300 mégawatts contre 900 au minimum dans le parc actuellement exploité –, mais dont le démantèlement, en particulier celui de sa cuve, prévu à échéance de dix-huit mois à deux ans, nous procurera un retour d’expérience utile pour mettre à jour l’étude Dampierre en vue de nous en servir lorsqu’il s’agira de déconstruire les centrales aujourd’hui en fonctionnement.
À ce jour, aucun élément connu ne nous conduit à revoir l’évaluation des provisions arrêtée sur ces bases. Et si, comme l’a relevé la Cour des comptes, nous ne nous sommes pas appuyés pour cela sur l’étude Dampierre, c’est que celle-ci aurait conduit à constituer des provisions légèrement inférieures – de l’ordre de 70 millions d’euros – à celles qui figurent aujourd’hui dans nos comptes. J’ajoute que la direction générale de l’énergie et du climat a lancé un audit sur le coût du démantèlement des centrales à eau pressurisée qui nous fournira d’autres éléments d’information. Enfin, il faut préciser que notre évaluation repose bien sûr aussi sur l’hypothèse selon laquelle nous disposerions d’exutoires, c’est-à-dire d’installations de stockage définitif des déchets, Cigéo ou autres.
Comme je l’ai dit, le taux de rendement de nos actifs dédiés est nettement supérieur au taux d’actualisation. À cet égard, la composition de ce portefeuille se révèle décisive : toutes les analyses montrent que l’investissement diversifié dans les actions et les obligations permet de générer, à longue échéance, un rendement dépassant les 4,8 ou 5 % de ce taux.
Pour nous assurer que la performance de ce portefeuille garantira le passage de la provision actuelle à la couverture des charges futures, nous avons encore accentué, depuis quelques années, sa diversification en nous tournant vers des actifs offrant le meilleur rapport entre rendement et risque : il s’agit notamment des actifs d’infrastructures, très recherchés par tous les grands fonds, français ou internationaux, qui ont comme nous à provisionner à très long terme. L’évolution de la réglementation nous permettant désormais d’investir un quart des fonds dédiés dans cette classe d’actifs, nous avons créé un « sous-portefeuille » EDF Invest, doté de plus de 5 milliards d’euros et géré par une équipe spécifique, auquel nous avons affecté la moitié des titres RTE – soit 2,3 milliards d’euros car nous nous en sommes tenus à la valeur nette comptable au moment de l’opération, par prudence, mais ce montant a augmenté depuis trois ans grâce au niveau élevé du rendement, supérieur au taux d’actualisation. Nous l’avons pu dans la mesure où EDF ne contrôle pas RTE tout en en détenant la totalité. Pourquoi aller chercher ailleurs alors que cette infrastructure est, à mon avis, la plus belle de France ? Mais nous avons également investi dans une autre infrastructure remarquable, Transport et Infrastructures Gaz de France, en constituant à cet effet, l’an dernier, un consortium avec un fonds souverain de Singapour et avec un opérateur industriel italien, la SNaM (Società Nazionale Metanodotti), afin de racheter à Total ces installations de stockage et ce réseau de transport développé à partir de Lacq – nous en détenons aujourd’hui 20 %.
Faut-il loger les actifs dédiés dans un fonds indépendant des opérateurs ? Nous appliquerons bien sûr la loi, mais nous considérons qu’EDF doit être responsable de la totalité de son activité dans le nucléaire, y compris le démantèlement et la gestion du combustible, et qu’elle doit par conséquent se mettre en mesure d’assumer les charges futures qui en découlent, par une bonne gestion des actifs dédiés. C’est en effet le rendement de ce portefeuille qui permettra de compenser l’effet du temps et de faire face au passage de la provision à la couverture des charges. Si, demain, la gestion de ces fonds était externalisée et qu’ils étaient utilisés pour des investissements moins diversifiés, cela ferait courir un risque financier en raison d’un moindre rendement.
M. le président François Brottes. RTE se trouve aujourd’hui en situation de monopole, mais son capital peut être ouvert un jour. D’autre part, le régulateur peut prendre des décisions affectant fortement ses ressources, par exemple en modifiant le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE)…
M. Thomas Piquemal. Propriétaire de son réseau, RTE est obligé d’investir dans la maintenance et le développement de celui-ci, ce qu’il fait avec le soutien de son actionnaire EDF. À cet égard, le TURPE, fixé pour des périodes de quatre ans, offre une visibilité bienvenue sur le retour à attendre. Et ce retour a été au rendez-vous puisque le taux de rendement s’est établi à 6 % en 2011 et à 6,7 % en 2012, soit à un niveau nettement supérieur au taux d’actualisation. La stabilité du cadre réglementaire, assurée dans le transport de l’électricité alors qu’elle est loin de l’être en ce qui concerne la distribution, permet de minimiser le risque de notre investissement dans cette infrastructure.
M. le rapporteur. Si ce taux de rendement est si supérieur au taux d’actualisation, pourquoi avoir ramené ce dernier de 5 % à 4,8 % ?
M. Thomas Piquemal. Conformément aux principes comptables, nous calculons notre taux d’actualisation en analysant le taux sans risque, duquel nous retirons l’inflation et auquel nous ajoutons un spread de financement des entreprises comparables et très bien notées – entre A et AA – avant de réintroduire notre prévision d’inflation. Compte tenu de la baisse du taux sans risque observée sur le marché, nous obtenons un taux de 4,8 %. En revanche, nous n’appliquons pas le plafond réglementaire, qui ne repose pas sur des taux d’entreprise, mais sur des taux sans risque augmentés de 100 points de base, hypothèse arbitraire qui ne repose pas sur une analyse de marché. Nous avons donc entamé des discussions avec les pouvoirs publics afin de revoir ce mécanisme et d’éviter une volatilité qui serait préjudiciable à la gestion à long terme de nos actifs comme de nos passifs.
M. Bernard Bigot. Les coûts de démantèlement et d’assainissement dépendent fortement de l’état de l’installation et du niveau d’assainissement exigé au terme des opérations. À Sellafield, au Royaume-Uni, j’ai pu constater que l’état des installations nucléaires était sans commune mesure avec celui du parc d’EDF : ainsi les combustibles usés sont stockés dans des piscines à l’air libre ! Il peut en résulter des écarts de coûts notables. De ce point de vue, donc, comparaison n’est pas raison.
Le CEA a déjà dépensé 2,5 milliards d’euros pour le démantèlement et certaines opérations sont maintenant achevées, comme à Grenoble, ou très avancées, comme à Fontenay-aux-Roses ou à Cadarache. Nous intégrons continûment les retours d’expérience et lorsqu’il a été procédé, conformément à ce que j’avais demandé lors de ma nomination, à une nouvelle évaluation de l’ensemble de nos 44 installations nucléaires concernées par une phase d’assainissement ou de démantèlement, nous avons en outre requis l’aide de consultants extérieurs qui ont examiné les meilleures pratiques. En conséquence, notre estimation du coût total – constitué de la somme des différents devis majorée d’un taux d’aléa de 20 % – apparaît robuste.
Le taux d’actualisation des fonds dédiés civils constaté en 2010 pour les installations antérieures s’est élevé à 7 %, au terme de douze années. S’agissant des fonds nouveaux – plus modestes puisque nous n’en sommes qu’à 63 millions d’euros –, les rendements sont supérieurs puisque le nominal pour 2013 atteint 7 %, mais 12 % si l’on ne tient pas compte de l’inflation accumulée. Nous veillons en effet comme EDF à effectuer des placements sécurisés.
L’essentiel des 4,7 milliards d’euros de nos provisions – plus de 3,6 milliards – est constitué de dettes de l’État constituées à raison des travaux que nous avons effectués pour son compte ; nous avons également 900 millions d’euros de titres d’AREVA. Le taux d’actualisation n’est donc pas pour nous une préoccupation majeure et nos actifs n’ont pas à être sécurisés puisque les engagements pris par l’État se sont révélés solides jusqu’à présent.
Retirer la gestion de ces fonds aux entreprises serait pour moi également une mauvaise idée. L’exécution – qui constitue l’essentiel de la dépense – et les décisions de provisionnement doivent relever du même acteur. Aucune action de l’État ne permettra de garantir les niveaux de rendement aujourd’hui atteints, et nous ne pouvons responsabiliser les chefs de projets de démantèlement qu’en leur confiant un budget fixe.
M. Pierre Aubouin. Sur le site de La Hague, le démantèlement de la première usine de traitement des combustibles irradiés, UP2 400, n’a donné lieu qu’à une révision significative des coûts, en 2007, pour 326 millions d’euros, avant une hausse, entre 2010 et 2013, limitée à un peu plus de 120 millions d’euros. Le devis actualisé dans les comptes d’AREVA s’élève aujourd’hui à 1,4 milliard d’euros. Sur les 450 millions d’euros d’augmentation que je viens d’évoquer, 350 étaient dus aux coûts de la surveillance future des installations, nouvelle exigence posée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ainsi qu’à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) et à la taxe additionnelle destinée au financement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) : toutes choses qui n’ont rien à voir avec d’éventuelles difficultés techniques ! Pour ce démantèlement, nous sommes désormais passés d’un devis estimé par unité d’œuvre lors de la mise en service à un devis pleinement opérationnel et robuste, grâce à l’élaboration de scénarios précis et à la consultation valant engagement des sous-traitants et des fournisseurs d’équipements impliqués dans le chantier – devis qui a d’ailleurs corroboré le précédent. Cela étant, nous estimons à 20 % le risque d’aléas, ce taux étant inclus dans le devis en sus des coûts bruts, de sorte que nous disposons d’une marge de sécurité satisfaisante.
Le devis de démantèlement de l’usine Georges-Besse I, exploitée par Eurodif Production, a été sensiblement révisé à la fin de 2011, puisqu’il est passé de 660 millions à près d’1 milliard d’euros, cette augmentation résultant de la modification substantielle du scénario de démantèlement à la suite de la réalisation d’études avancées. Les causes principales de cette hausse résident dans l’accroissement de la durée des opérations –l’exiguïté des installations obligeant à échelonner soigneusement celles-ci – et dans l’augmentation des dépenses de surveillance qui en résultera, mais aussi, pour 100 millions d’euros, dans l’obligation de remplacer ou d’ajouter certains équipements comme des ponts de levage et, pour 130 millions, dans un besoin de main-d’œuvre supplémentaire. Ce devis, une fois majoré, a fait l’objet d’une analyse contradictoire par des tiers mandatés par les actionnaires minoritaires d’Eurodif, analyse qui a démontré au reste la possibilité de jouer sur certains leviers pour réduire le montant provisionné dans la proportion de quelque 5 %.
Les scénarios de démantèlement sont plus favorables pour les installations de génération plus récente – usines UP2 800 et UP3 à La Hague, usine Georges-Besse II d’enrichissement de l’uranium –, grâce aux choix technologiques opérés et à la prise en compte des exigences du démantèlement dès le stade de la conception. Il faut en outre souligner que, lorsque nous établissons les devis, nous ne prenons en compte ni les gains de productivité, ni le progrès technologique, alors même que nous fournissons, sur fonds propres ou dans le cadre d’initiatives partagées avec le CEA et EDF, d’importants efforts de recherche et de développement (R&D) qui nous permettent d’envisager une plus grande efficacité dans les opérations d’assainissement préalables à la déconstruction des installations – nous travaillons ainsi actuellement sur des procédés innovants de scan en trois dimensions permettant de connaître très précisément la configuration d’une cellule avant son démantèlement et les sources de contamination ponctuelle qui peuvent s’y trouver. À cela s’ajoute l’introduction d’un coefficient d’aléa supérieur à 10 %.
Je me retrouve dans le propos de M. Thomas Piquemal sur le taux d’actualisation ; la performance du portefeuille d’AREVA sur longue période a été très largement supérieure à ce taux, avec un rendement de quelque 9 % en moyenne. Ayant à fixer un taux d’actualisation pertinent compte tenu de l’étalement des dépenses sur une très longue durée, on doit prendre en compte le niveau des taux d’intérêt à long terme, relativement élevé si on le compare aux taux à court et moyen termes ; ainsi EDF, entreprise bénéficiant d’une excellente notation, a récemment effectué des émissions à cent ans avec un taux d’intérêt supérieur au taux d’actualisation des provisions. Si on reconstitue celui-ci sur le fondement du taux sans risque en prenant en compte le spread du surcoût lié au risque pour les entreprises jouissant d’une bonne notation, une prime de liquidité et une pondération en fonction de l’échéancier de nos passifs, on arrive à un résultat moyen pleinement cohérent avec le taux de 4,75 % que nous avons retenu, celui-ci étant très proche des 4,8 % retenus par EDF. Nous souhaitons en tout cas la plus grande stabilité possible de ce taux, sa volatilité étant un facteur perturbateur.
Concernant la proposition d’externaliser la gestion des fonds dédiés, je rejoins là également les commentaires de MM. Piquemal et Bigot : on ne peut pas désolidariser la gestion du passif de celle de l’actif ; certains passifs de nature sociale – engagements de préretraite ou de retraite, couverture de frais médicaux par les entreprises – peuvent être pris en charge par des assureurs, mais les charges de démantèlement n’entrent pas dans cette catégorie pour des raisons de responsabilité et de spécificité technique. Nous devons dès lors conserver la haute main sur ces actifs, ne serait-ce que pour pouvoir adapter nos placements à l’échéancier des dépenses, qui peut connaître des variations de plusieurs années en fonction de l’évolution des scénarios de démantèlement.
Les actifs placés en actions ont perdu de la valeur lors de la crise boursière de 2008, mais le taux de couverture, qui atteignait pour AREVA 102 % à la fin de l’année 2013, s’élevait à 107 % à la fin de 2007 avant de chuter à 92 % au cœur de la crise boursière de la fin de 2008 et du début de 2009, puis de dépasser à nouveau 100 % dès la fin de l’année 2009, et ce sans ajout de liquidités supplémentaires. À l’instar d’un assureur-vie effectuant des placements majoritairement en obligations mais également, pour une part significative, en actions, nous ne devons pas trembler devant la volatilité des marchés financiers. Lorsque l’hypothèse de taux d’actualisation reste stable, il est possible, au lieu de se précipiter pour vendre, de conduire une gestion prudente et d’obtenir un retour à meilleure fortune, une reprise de la profitabilité, liée au rendement des marchés financiers constaté sur le long terme.
M. le président François Brottes. Faut-il un fonds de type « bas de laine », dans lequel on empile de l’argent en espérant rester à l’abri d’une déflation, ou vaut-il mieux disposer d’un actif dynamique pour couvrir des besoins de très long terme ? Nous avons besoin d’actifs sûrs, mais les propos que vous tenez laissent ouvertes plusieurs hypothèses sur les moyens d’obtenir cette sécurité, car aucune ne garantit totalement contre une perte de valeur dans la durée. Quel est votre avis définitif sur la constitution d’un fonds sanctuarisé dont la gestion vous échapperait ?
M. Thomas Piquemal. Il n’est pas opportun de réduire la responsabilité de l’opérateur ou de la scinder en le cantonnant à la gestion de ses centrales. Nous possédons dans notre portefeuille des actifs ne présentant aucun risque – avec la contribution au service public de l’électricité (CSPE), par exemple, nous disposons d’un calendrier d’encaissement et de l’engagement de l’État de nous rembourser, ce qui nous garantit de la trésorerie et l’assurance d’un taux de retour. Nos investissements, engagés de manière à optimiser le rapport entre rendement et risque, le sont aussi conformément à la réglementation et sous le contrôle de nos organes de gouvernance.
Si vous me demandez un avis définitif, il me semble inefficient, voire dangereux, d’externaliser la gestion des fonds, car la couverture des charges auxquelles nous devrons faire face un jour repose sur le taux de retour de ce portefeuille. Si ce taux de retour n’est pas garanti, ce seront les clients qui devront payer.
M. Bernard Bigot. J’irai dans le même sens que M. Piquemal. L’intérêt de placer les actifs sous la responsabilité de celui qui devra assumer la dépense est d’obliger ce dernier à compenser les variations de taux constatées dans le temps, en puisant dans ses ressources. Je ne vois pas en quoi l’État ou quelque fonds que ce soit serait mieux à même de le faire que les entreprises.
Le démantèlement et l’assainissement dépendent éminemment du point d’arrivée recherché ; or, en France comme ailleurs, nous nous situons toujours dans une phase d’apprentissage, s’agissant de déterminer l’optimum technico-économique en matière de démantèlement. Nous avons entamé ce processus avec une exigence élevée : dans le cas de Grenoble, le CEA a déposé une demande d’autorisation de démantèlement prévoyant un niveau résiduel de contamination extrêmement bas, puisque cinquante fois inférieur à la dose considérée comme acceptable pour le public. De mon point de vue, nous nous sommes montrés trop ambitieux, ce qui explique le renchérissement des coûts de 50 millions d’euros – nous avions proposé que des servitudes nous soient imposées afin que l’enceinte du réacteur Siloé puisse être utilisée pour produire de la chaleur par biomasse, mais cela nous a été refusé, ce qui a entraîné ce surcoût, avec le transfert de milliers de mètres cubes de gravats jusqu’en Bourgogne, sans aucun bénéfice pour la santé du public et pour l’environnement. Il convient donc d’accepter l’idée selon laquelle le retour d’expérience de Grenoble nous permet aujourd’hui de mieux cerner l’optimum technico-économique. Maintenir pour l’exploitant l’obligation de « rendre à l’herbe » les sites ne devrait pas impliquer de descendre en dessous du tiers de la dose admise, soit 1 millisievert, et non du cinquantième – étant entendu que cette disposition ne concernerait pas le stockage des combustibles usés, dont la radioactivité est établie..
M. Pierre Aubouin. Il faut éviter l’irresponsabilité collective : à séparer la gestion des actifs de celle des passifs – qui, elle, restera forcément de la responsabilité de nos entreprises –, on court le risque de découvrir un jour que les fonds confiés à d’autres acteurs ne produisent pas les rendements attendus, car je ne vois guère la possibilité de trouver un organisme qui puisse garantir ces rendements dans la durée. En revanche, nous avons, nous, le plus haut intérêt à bien gérer les actifs, pour la raison qu’a dite M. Bigot : à savoir que nous devrions renflouer ces provisions si jamais elles venaient à se déprécier.
Le dispositif issu de la loi du 13 juin 2006 permet au reste, dès aujourd’hui, la sanctuarisation de ces actifs, sous le contrôle de nos commissaires aux comptes et de nos organes de gouvernance. Ils sont clairement cantonnés dans nos bilans et il est exclu que nous puissions puiser librement dans ce « bas de laine » : tous les prélèvements effectués pour financer les travaux de démantèlement font l’objet de contrôles systématiques.
M. Bernard Accoyer. Il convient de saluer la compétence, notamment technique, des experts que nous recevons aujourd’hui ; cela montre la qualité de la filière nucléaire, contestée par notre rapporteur et par le groupe politique à l’origine de cette commission d’enquête. Ces experts font aussi preuve d’un courage qui manque trop souvent aux responsables politiques, enclins à se cacher derrière des comités et des agences. Cette insuffisance se révèle particulièrement dangereuse lorsque certains s’ingénient à semer le doute et à utiliser les peurs pour remettre en cause les connaissances et les réalisations permises dans le temps par le progrès et l’innovation technologiques. J’ai également été étonné que notre rapporteur émette à plusieurs reprises des réserves sur la qualité des provisions détenues par les entreprises ou organismes dont nous entendons aujourd’hui les représentants ; j’y vois un parti pris préoccupant.
L’expertise remarquable que nous assurent ces entreprises et organismes ne peut déployer tous ses effets, notamment en matière de recherche et développement, qu’appuyée sur un montant de ressources « sanctuarisé », voire accru compte tenu de l’ampleur du défi énergétique et d’exigences de sécurité sans cesse plus élevées. Monsieur l’administrateur général, quelles sont les perspectives financières du CEA ?
Le transfert à d’autres de la gestion des actifs dont disposent EDF et AREVA, évoqué par notre président et par notre rapporteur, ne peut que déresponsabiliser ces opérateurs. Surtout, une telle décision ferait courir le risque de voir purement et simplement disparaître ces actifs dans le tonneau des Danaïdes des finances publiques, l’État étant incapable de maîtrise ses déficits. Accessoirement, ce même État, qui édicte la norme, pourrait bien réduire le niveau des provisions destinées à couvrir les charges de démantèlement et d’assainissement. Je note d’ailleurs à ce propos que, si ces coûts ont dérapé, c’est dans une proportion bien inférieure à ce que nous avons connu pour l’exécution du budget national, par rapport à la prévision de déficit pourtant établie récemment.
Le démantèlement du réacteur expérimental Superphénix, à Creys-Malville, a été décidé en 1997 sans aucune évaluation technique ou scientifique préalable, pour des raisons purement politiques. Où en est-on de cette opération, quel en sera le coût et quand sera-t-elle achevée ?
Quelles sont les perspectives de développement des réacteurs de quatrième génération ? Nous avons écouté sur le sujet, pendant des matinées entières, les militants de Greenpeace qui n’avaient pourtant aucune qualification pour informer le Parlement et le public. Il importerait maintenant d’entendre les experts, ce développement ne pouvant manquer d’avoir des incidences sur la gestion à venir des déchets.
M. le président François Brottes. Ce sera fait, mais dans le cadre d’une autre réunion.
M. Bernard Bigot. Le CEA perçoit chaque année des « recettes externes », pour près de 500 millions d’euros, à raison des prestations qu’il fournit à diverses entreprises – dont EDF et AREVA qui lui versent ensemble, à ce titre, 120 millions.
Les dettes du CEA liées au démantèlement, qui concernent et le fonds civil et le fonds de défense, atteignent des sommes considérables ; en effet, le Commissariat a dû développer des activités, créer des installations et assurer leur exploitation, mais ces installations sont aujourd’hui arrêtées et en attente de démantèlement. L’État a reconnu cette situation dans la convention que nous avons passée avec lui.
L’un des meilleurs placements d’AREVA réside dans la dette du CEA, dette qui a crû de 7 %. J’ai avancé des propositions en vue d’apurer la situation, mais rien n’a été décidé, alors que la Cour des comptes et notre comité d’audit soulignent régulièrement l’absurdité d’une situation dans laquelle 30 à 40 millions d’euros de dette supplémentaire sont contractés chaque année et ne pourront être couverts in fine que par l’État. Il serait donc opportun de rembourser cette dette en totalité.
Nous comprenons les contraintes qui pèsent sur les finances publiques, mais il s’avère compliqué d’assurer la gestion du CEA quand l’exécution du contrat d’objectifs et de performance, qui planifie l’activité du Commissariat pour quatre ans, révèle une diminution de la subvention de plus de 150 millions d’euros par rapport à ce qui était prévu. L’année dernière, le CEA a pâti d’une annulation de crédits de 47 millions d’euros, soit quelque 4,5 % de sa subvention de 1,1 milliard d’euros. Il en résulte pour nous des difficultés et nous préférerions bien sûr bénéficier d’une visibilité pluriannuelle sur notre budget.
Le réacteur Superphénix appartenait à un consortium NERSA (Centrale nucléaire européenne à neutrons rapides S.A.) dans lequel EDF était largement partie prenante ; le démantèlement progresse, mais le CEA n’en est pas le maître d’œuvre.
S’agissant des réacteurs de quatrième génération, nous serons entendus plus tard sur ce sujet ; je me bornerai pour l’heure à avouer ma surprise à la lecture des propos tenus par certaines personnalités déjà reçues par votre commission d’enquête.
M. Thomas Piquemal. C’est en effet EDF qui est responsable du démantèlement de Superphénix ; nous avons traité l’année dernière la totalité du sodium, ce qui constituait l’opération la plus complexe du chantier et qui pesait fortement dans l’augmentation du budget total. L’opération peut désormais se poursuivre dans des conditions normales. La semaine dernière, le vice-président du CIDEN a avancé, je crois, la date de 2025 pour son achèvement. Quant au budget qui y sera consacré, il devrait s’établir à 1 milliard 287 millions d’euros, aux termes de la mise à jour effectuée en 2012, notamment pour prendre en compte l’opération délicate de traitement du sodium.
M. le président François Brottes. Je vous remercie, messieurs, de vos contributions.
Audition de M. Philippe Germa, directeur général du WWF France
(Séance du 2 avril 2014)
Des documents mis à la disposition de la commission d’enquête sont accessibles à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314034.pdf
M. le président François Brottes. Nous avons souhaité vous entendre, monsieur Germa, pour que vous nous exposiez les positions du WWF sur le nucléaire et, en particulier, sa proposition de création d’un « fonds indépendant pour la transition énergétique et une sortie équitable du nucléaire » (TESEN). Les opérateurs que nous venons de recevoir nous ont dit tout le mal qu’ils pensaient de cette option, dont l’horizon affiché est la sortie du nucléaire. Selon eux, un fonds à part risquerait de déresponsabiliser les opérateurs.
Comme notre rapporteur, votre organisation estime que le coût de l’énergie nucléaire en France est profondément sous-estimé. Elle considère également que les provisions pour le démantèlement sont insuffisantes, opaques et très risquées. Il me semble que l’opacité s’est quelque peu dissipée depuis que notre commission a commencé ses travaux et que l’insuffisance n’est pas aussi importante que l’on a pu le dire, même s’il reste, à l’évidence, une part de risque. Toujours est-il que vous préconisez une gouvernance publique de ces fonds.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Philippe Germa prête serment)
Je vous donne maintenant la parole pour un exposé introductif.
M. Philippe Germa. Cette audition devant l’Assemblée nationale est un honneur et une fierté pour tous les collaborateurs du WWF.
Les écologistes n’ont jamais été favorables au nucléaire et ce pour trois raisons : les accidents, l’aval du cycle et les déchets. Dès les années 1970, nous avons dit que les friches industrielles laissées par les centrales nucléaires seraient contaminées, donc très différentes des autres friches. À cette époque, toutefois, l’impact de l’activité humaine sur l’effet de serre était moins connu qu’aujourd’hui. Nous ne disposions pas des informations catastrophiques fournies les rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat), notamment par le plus récent.
Par ailleurs, nous ne sommes pas des ingénieurs nucléaires. Nous n’avons pas les connaissances techniques de certains experts entendus par votre commission.
Enfin, si nous ne sommes ni des experts-comptables ni des commissaires aux comptes, nous savons lire. Notre réflexion, engagée dans le cadre du débat sur la transition énergétique, se fonde sur la lecture de différents rapports publics : celui de la Cour des comptes en 2012 – que mon prédécesseur, avec d’autres, avait d’ailleurs demandé –, celui de la CNEF (commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs) et celui de la Nuclear Decommissioning Authority britannique, publiés la même année, ou encore le rapport de la CRE (commission de régulation de l’énergie) en 2013. Elle s’inspire aussi des expériences finlandaise et suédoise.
Or certains chiffres font tourner la tête tant par leur ampleur que par leur imprécision, variant parfois du simple au double ou au triple. Il est très compliqué, dans ces conditions, de se faire une idée. Il revient à votre commission de faire la part des choses et d’en informer la société civile.
Si la sortie du nucléaire est mentionnée dans l’intitulé du fonds que nous proposons, c’est parce que le parc vieillit et qu’il faut penser à son inéluctable démantèlement.
Nous pensons que le coût production de l’électricité nucléaire en France est sous-estimé. « Les charges de démantèlement sont difficiles à estimer faute de précédents », écrit la Cour des comptes, et elles « pourraient augmenter du fait d’une plus grande exigence dans le futur des normes de dépollution des sites ». La CNEF partage cette conclusion, de même que l’Autorité de sûreté nucléaire, qui fait état des « très fortes incertitudes » quant à l’évaluation et à la réévaluation des coûts de démantèlement.
En 2010, année de référence du rapport de la Cour des comptes, les dépenses futures de démantèlement étaient estimées à 79 milliards d’euros en charges brutes, c’est-à-dire en chiffres non actualisés. La Cour relève que cette évaluation est très inférieure à celles qui sont faites à l’étranger. En Grande-Bretagne, les provisions pour démantèlement s’élèvent à 90 milliards non actualisés pour dix-huit réacteurs. L’estimation britannique extrapolée aux cinquante-huit réacteurs français conduit à un chiffre de près de 300 milliards d’euros.
M. le président François Brottes. Ce ne sont pas les mêmes réacteurs.
M. Philippe Germa. Bien entendu. Mais, bien que M. Proglio m’ait promis de mettre à ma disposition tous les chiffres, la responsable du développement durable à EDF s’est refusée à me communiquer quoi que ce soit. Je reconnais les incertitudes techniques, je reconnais que les réacteurs britanniques sont différents des réacteurs français, mais il conviendrait tout de même que la représentation nationale puisse se faire une idée claire des coûts et des sommes qu’il faut mettre de côté, à chaque kilowattheure produit par la filière, pour financer demain le démantèlement des centrales et la décontamination des sites.
M. le président François Brottes. On nous a donné des chiffres ce matin, notamment en ce qui concerne l’expérience de Grenoble.
M. Philippe Germa. Même pour la centrale de Brennilis – je tiens à votre disposition le livre écrit à ce sujet –, on n’en a pas encore fini. Certes, le réacteur est d’un type différent de ceux dont nous parlons aujourd’hui, mais il est intéressant de constater que les incertitudes demeurent.
M. le président François Brottes. S’agissant de Brennilis, on dit aussi que des procédures ont retardé le démantèlement. Y seriez-vous pour quelque chose ?
M. Philippe Germa. Je ne fais que représenter une ONG et, je le répète, je ne suis pas ingénieur nucléaire.
M. le président François Brottes. Sans doute n’était-ce pas votre ONG…
M. Philippe Germa. J’en viens aux taux d’actualisation. Celui d’EDF est très élevé, ce qui permet de réduire l’estimation des coûts. Or la CNEF montre que la rentabilité moyenne des actifs dédiés est de 0,8 % pour cette entreprise et de 1 % pour AREVA, très loin des 5 % retenus.
Bref, alors que les provisions sont très probablement insuffisantes par rapport aux travaux qu’il faudra réaliser, le taux d’actualisation tend à les réduire encore. Je ne doute pas que les travaux de votre commission permettront d’y voir plus clair.
En outre, comme le dit la Cour des comptes et comme la CRE le confirme, une grande partie de ces provisions n’est pas liquide et se trouve largement recyclée à l’intérieur de la filière électrique, voire de la seule filière nucléaire. EDF détient ainsi des actions de RTE (Réseau de transport d’électricité) à titre de provisions. L’infrastructure est de qualité, certes, mais elle ne peut être vendue. Cette absence de liquidité n’est pas conforme à l’esprit de la loi.
M. le président François Brottes. La loi permet d’ouvrir le capital de RTE.
M. Philippe Germa. Ce n’est pas le cas pour l’instant.
Par ailleurs, EDF fait entrer en ligne de compte sa créance sur l’État de 5 milliards d’euros au titre de la CSPE (contribution au service public de l’électricité). Qu’il s’agisse d’EDF ou du CEA, les actifs dédiés sont en fait des créances sur l’État ou s’y apparentent : directement ou indirectement, l’État apparaît, pour reprendre les termes de la Cour, comme le financeur en dernier ressort.
Pis, le journal Les Échos du 16 décembre 2013 rapporte qu’AREVA souhaite recourir à des financements « innovants » s’agissant des EPR britanniques, en utilisant notamment les provisions dédiées au démantèlement pour financer en capital ces chantiers. J’espère que le Gouvernement n’y donnera pas suite, mais on voit bien que cet argent, qui est l’argent des Français, risque d’être utilisé en dehors du contrôle de l’État et du Parlement.
Nous proposons donc la création d’un fonds indépendant qui permettrait de constituer un financement en dehors du bilan des opérateurs. Ce n’est pas chose facile et je vous invite à observer la manière dont les Suédois et les Finlandais s’y sont pris.
Rappelons que la société TEPCO a fait faillite quelques jours après la catastrophe de Fukushima. L’argent figurant au bilan d’EDF, d’AREVA ou du CEA – argent que ces entreprises, au surplus, utilisent en partie pour financer leurs opérations – n’est pas ce qui permettra, demain, de financer le démantèlement des centrales ou la gestion des déchets.
Le fonds dont nous préconisons la création serait géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont c’est le métier. Afin d’éviter les à-coups dans le bilan d’EDF, on le constituerait progressivement à partir des provisions actuelles puis on l’alimenterait, comme en Suède, par un pourcentage infime du prix de chaque kilowattheure produit par le nucléaire. On rassemblerait ainsi la masse financière nécessaire pour faire face à ces questions, en procédant à des réévaluations en fonction des connaissances techniques et des coûts de démantèlement.
Ce dispositif est en vigueur en Suède, où il semble bien fonctionner. Je comprends que les opérateurs fassent la grimace à l’idée de perdre ce volet mais je considère que, s’il faut leur laisser la responsabilité technique, la question du financement est à part.
Vous aviez d’ailleurs signé en 2006, monsieur le président, aux côtés de la nouvelle ministre de l’écologie, de l’actuel Président de la République et de bon nombre de députés de l’opposition de l’époque, une proposition de loi tendant à constituer un fonds indépendant. C’était une très bonne idée pour préserver ces provisions dont nos enfants et petits-enfants auront besoin, et j’invite votre commission à la mettre de nouveau en exergue.
Plusieurs personnalités de tous bords ont d’ailleurs signé la lettre ouverte que nous avons rédigée à ce sujet. On y trouve, aux côtés d’anciens ministres de l’écologie verts, Mmes Chantal Jouanno et Nathalie Kosciusko-Morizet.
La question n’est pas tant de savoir s’il faut conserver une part de production nucléaire que d’affirmer la nécessité de la transition énergétique et du rééquilibrage entre les sources d’énergie. Il revient aux politiques et à l’Autorité de sûreté nucléaire de décider s’il faut fermer ou non le parc. En revanche, nous nous soucions de la constitution des moyens financiers pour des démantèlements qui interviendront forcément.
Entretemps, l’argent provisionné pourrait servir à la transition énergétique. Une solution gagnant-gagnant est envisageable : les fonds ainsi collectés, protégés du risque de figurer dans le bilan des opérateurs, seraient placés auprès d’un organisme public contrôlé par le Parlement et contribueraient au financement de la transition énergétique.
Cette transition repose en grande partie sur des progrès en matière de sobriété, c’est-à-dire sur des investissements à dix ou quinze ans que les banques accordent difficilement, tant le coût de la liquidité sur le long terme est élevé dans leur bilan. L’argent en provenance du nucléaire pourrait servir à financer la transition énergétique en apportant aux opérateurs financiers une liquidité peu chère.
À titre d’exemple, il est possible de réduire de 30 % le coût de l’éclairage public dans les communes. La technique existe en France, chez Bouygues ou chez Vinci par exemple, mais exige des investissements importants, rentabilisés sur une durée de dix à quinze ans : changement des ampoules, connexion informatique avec le réseau électrique. Une partie de l’argent du démantèlement pourrait contribuer à ce financement tout en évitant le risque de mise en défaut. Il s’agirait d’apporter de la liquidité à des opérateurs financiers de premier plan, qui prendraient la responsabilité de rembourser sur leur bilan en cas de défaut.
Avec une trentaine de milliards d’euros, on pourrait ainsi amorcer assez rapidement le financement de la transition énergétique au moyen de l’argent du nucléaire
M. le président François Brottes. Vous en êtes presque à dire qu’il faut prolonger la durée de vie des centrales pour financer la transition énergétique ! (Sourires.)
Préconiseriez-vous un tel dispositif pour les autres industries soumises à obligation de dépollution ? Lorsqu’elles quittent un site, il est souvent difficile de trouver l’argent prévu à cet effet…
M. Philippe Germa. Le démantèlement d’une éolienne est très différent de celui d’une centrale. Il n’y a pas de contamination du site.
M. le président François Brottes. Je pense à des sites sidérurgiques ou chimiques.
M. Philippe Germa. Ce serait possible, mais le dispositif est surtout envisagé pour le secteur énergétique.
La question qui se pose est que le nucléaire relève en grande partie du public et qu’une proportion importante de ses provisions est recyclée dans le public. Ce n’est pas la même chose qu’une entreprise privée qui collecte de l’argent des consommateurs pour provisionner des charges futures. Le fait que les fonds ne soient pas provisionnés au bon niveau et soient constitués d’actifs publics fait peser trop de risques sur l’État. C’est EDF qui collecte aujourd’hui mais c’est l’État qui sera responsable demain.
M. le président François Brottes. Lorsqu’une entreprise dépose son bilan et laisse des sites orphelins, c’est de toute façon l’État qui doit intervenir. Il n’y a pas de système idéal. Je connais bien ces questions pour les avoir vécues dans ma région ! Au bout du compte, c’est le contribuable qui doit payer – éventuellement via le fonds Barnier, qui, soit dit en passant, est en baisse. J’y reviens donc : peut-on étendre le système que vous préconisez à l’ensemble des activités polluantes ?
M. Philippe Germa. Tout ce qui permet de sécuriser l’avenir est bienvenu. Pour gérer le temps long, nous nous heurtons malheureusement au temps court. Je constate que Bercy, à qui EDF verse plus de 2 milliards d’euros de dividende par an, a été le premier à refuser notre proposition. Dans la situation actuelle des finances publiques, on préfère utiliser cette somme tout de suite, sans en mettre une partie de côté.
M. le président François Brottes. Vu l’ensemble des taxes acquittées, on peut dire qu’EDF verse une somme beaucoup plus importante à l’État. Mais c’est un autre sujet !
M. Denis Baupin, rapporteur. Je ne pense que du bien du WWF et de sa proposition. Contrairement à l’un de nos collègues, je ne considère pas que seuls ceux qui sont d’accord avec moi sont des experts. Je remercie les membres de la commission qui sont restés pour écouter tous les avis défendus ! Après avoir entendu les arguments des uns et des autres, mon opinion à la fin de nos travaux sera différente de celle que j’avais au début.
Lors de l’audition précédente, les représentants des opérateurs ont notamment opposé à votre proposition leur méfiance – y compris s’agissant du CEA ! – quant à la capacité de l’État à assurer la pérennité des fonds pour qu’ils soient disponibles lorsque l’on en aura besoin. Les représentants d’EDF et d’AREVA estiment que les compétences de leurs entreprises en matière financière et la diversité des placements qu’elles peuvent effectuer garantissent mieux la performance nécessaire pour que l’argent soit disponible au moment opportun. Ce qui est sous-entendu est que l’État a un fonctionnement plus bureaucratique et doit répondre à d’autres contraintes. Quelle est votre réponse à cette objection ?
S’agissant de l’utilisation du fonds en faveur de la transition énergétique, confirmez-vous qu’il s’agit bien de refinancement ? En effet, certains se plaisent à dire que les écologistes veulent dépenser ces sommes pour la transition énergétique et qu’elles ne seront plus disponibles pour le démantèlement des centrales. Bien entendu, nous ne prétendons pas dépenser deux fois le même argent !
M. le président François Brottes. D’où ma boutade sur le prolongement de la durée de vie des centrales !
M. le rapporteur. J’ai préféré ne pas la relever afin d’éviter de mettre EDF en face de contradictions qu’elle n’a pas forcément à gérer.
M. le président François Brottes. La question est pourtant la même…
M. Philippe Germa. Notre diagnostic sur le financement du démantèlement se fonde sur le rapport de la Cour des comptes. Quant à la proposition, ce sont les députés de l’opposition d’alors qui l’ont faite en 2006. Pour notre part, nous avons trouvé que c’est une bonne idée pour sécuriser le financement du démantèlement et, éventuellement, pour contribuer à la transition énergétique.
La compétition oppose deux sources d’énergie de base : le nucléaire et le renouvelable. Il faut déterminer quelles sont les centrales dont on prolonge la durée de vie jusqu’à soixante ans, en mettant beaucoup d’argent à leur sécurisation, et quelles sont celles que l’on arrête.
M. le président François Brottes. Vous considérez donc que les énergies renouvelables – dont l’éolien et le photovoltaïque, qui sont intermittents – sont des énergies de base ?
M. Philippe Germa. Oui, dans la mesure où il faut les compléter par une production recourant aux énergies fossiles. Mais, encore une fois, je ne suis pas ingénieur. Pour notre organisation, le renouvelable est toujours préférable au fossile ou au nucléaire.
Pour en venir aux questions du rapporteur, je comprends que les entreprises craignent de voir retrancher 34 milliards d’euros de leur bilan, même si les risques relatifs au financement du démantèlement pèsent aujourd’hui sur leur valeur boursière. Cela dit, nous proposons de transférer les fonds à la Caisse des dépôts, laquelle n’est pas un organisme d’État mais un groupe financier public dont la gouvernance est contrôlée par les représentants du peuple qui siègent à sa commission de surveillance. Il appartiendra aux élus de s’assurer que l’argent est bien placé et géré de façon transparente. Depuis sa création en 1816, on ne peut pas dire que la Caisse des dépôts ne sait pas gérer les deniers publics !
En matière de transition énergétique, il doit être clair que nous ne voulons exposer le fonds à aucun risque. Dans notre idée, il doit assurer seulement le refinancement des établissements bancaires. Ces derniers seront seuls responsables des sommes prêtées au titre de la transition énergétique. Si, demain, une commune emprunte auprès d’une banque pour transformer son éclairage public, c’est la banque qui sera garante du remboursement des sommes au fonds lorsque celui-ci en aura besoin. J’ajoute que les créances sur les établissements bancaires sont assez liquides et que les besoins relatifs au démantèlement devraient être aisément planifiés. Cela devrait permettre d’équilibrer l’actif et le passif du fonds, en gardant une « poche de liquidités » permettant de faire face à des travaux immédiats.
Audition de M. Jacques Repussard, directeur général de l’IRSN
(Séance du 2 avril 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314035.pdf
M. le président François Brottes. Après avoir visité hier l’usine de retraitement de La Hague et le chantier de l’EPR à Flamanville, nous examinons aujourd’hui un aspect particulier des charges futures de la filière nucléaire : la gestion des déchets de haute activité. Nous nous intéressons notamment au projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Vous passez parfois, monsieur le directeur général, pour le « Monsieur Plus » en matière d’annonces relatives au chiffrage des coûts. Quoi qu’il en soit, compte tenu de votre expertise et de celle de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), il est important que vous transmettiez le maximum d’informations sur ce sujet à notre commission d’enquête, pour qu’elle puisse mener ses travaux à bonne fin.
Ce matin, j’ai demandé à l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) si les moyens actuels de stockage en surface – dont nous avons eu un aperçu à La Hague – ne pourraient pas suffire pour les cent ans qui viennent, et s’il était en fin de compte nécessaire de développer le stockage géologique et d’investir massivement dans le projet Cigéo. Il m’a fait une réponse assez vive. Quel est votre avis sur ce point ?
La gestion des déchets constitue un enjeu de sûreté essentiel : il convient de protéger non seulement la population actuelle, mais aussi les générations futures, des conséquences du mode de production d’énergie que nous utilisons. À cet égard, il serait utile que vous précisiez la distinction entre contamination et irradiation.
Fournissant une expertise indépendante et un appui technique aux pouvoirs publics et à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), que nous allons auditionner séparément, l’IRSN a étudié les différentes options en matière de gestion des déchets. Elles sont aujourd’hui connues, mais l’appréciation de leurs coûts respectifs évolue en permanence, presque d’un mois sur l’autre. Cela signifie-t-il que l’on s’est trompé dans les évaluations ? Ou bien dans le cahier des charges ? Ou est-ce parce que l’on ajoute au fil du temps de nouvelles tâches à réaliser ? En tous les cas, le chiffrage semble loin d’être stabilisé. Quelle est votre analyse de la question ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jacques Repussard prête serment)
M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. À l’IRSN, nous sommes experts en matière de risques, mais pas d’économie du nucléaire, même si nous travaillons sur certains aspects de ce domaine. Notre mandat ne consiste pas à surveiller l’équilibre des comptes des exploitants nucléaires.
Les déchets de haute activité à vie longue (HA-VL) sont actuellement, en France, le produit du retraitement des combustibles usés. L’inventaire en est connu et peut être anticipé pour les quelques années à venir. Cependant, il conviendra d’y ajouter, à terme, les combustibles usés non retraités qui apparaîtront le jour où la France cessera d’exploiter les réacteurs à eau ou à neutrons rapides : le retraitement de ces combustibles n’ayant plus d’objet, ils devront être stockés tels quels. Leur quantité ne peut pas être déterminée à l’avance, et la question de l’inventaire des déchets demeure donc ouverte. Nous devons faire de la pédagogie sur ce point, qui n’a pas toujours été bien compris.
Pour protéger la population et l’environnement de la toxicité des déchets HA-VL, trois solutions ont été envisagées et encadrées par des lois successives. La première est la transmutation : on espérait – certains espèrent peut-être encore – pouvoir réduire la toxicité des déchets et la durée de cette toxicité en les transformant au sein de réacteurs. La transmutation a fait l’objet de programmes de recherche en France, conduits par le CEA, et dans d’autres pays. La deuxième méthode consiste à entreposer les déchets en surface, dans des installations sûres surveillées par l’homme, comme nous le faisons à La Hague. La troisième option consiste à placer les déchets dans un stockage géologique, c’est-à-dire hors de portée de l’homme, pour des durées infinies ou, tout au moins, suffisamment longues pour que la radioactivité n’atteigne pas la surface.
Ces trois options ont été explorées et expertisées par l’IRSN. L’installation de La Hague a fait l’objet d’un rapport de sûreté et d’une évaluation des risques. Il en ressort que l’entreposage est une solution bon marché, sûre et pérenne à l’échelle de quelques générations, c’est-à-dire jusqu’à la fin du siècle en cours. Cependant, elle présente un inconvénient majeur du point de vue moral : nous laissons aux générations futures – celles qui viendront après nos petits-enfants – l’entière responsabilité de régler le problème des déchets. En effet, les installations d’entreposage construites en béton à la surface du sol ne dureront pas mille ans. Il conviendra donc d’extraire les déchets – opération coûteuse et probablement non dénuée de risques radiologiques, le bon état des emballages n’étant pas garanti au-delà d’une centaine d’années – et de les placer dans d’autres installations du même type, à moins que l’on n’ait trouvé d’autres solutions d’ici là. Il ne revient pas à l’IRSN de porter des jugements de nature morale ou politique, mais cette option apparaît peu courageuse et ouvre une porte sur l’inconnu : comment nos successeurs plus ou moins lointains traiteront-ils la question ? Cette solution n’est pas donc pas optimale du point de vue de la sûreté.
M. le président François Brottes. Combien de temps cette solution nous laisse-t-elle devant nous ?
M. Jacques Repussard. Jusqu’à la fin du XXIe siècle. Ces installations ont été construites avec des marges confortables pour ce qui est de la résistance aux séismes. Elles sont surveillées régulièrement – je les ai moi-même visitées à nouveau il y a quelques jours – et nous n’avons pas d’inquiétude sur le bien-fondé de leur démonstration de sûreté. Mais elles ont une durée de vie limitée à quelques générations humaines, ce qui ne constitue pas un horizon si éloigné.
S’agissant de la transmutation, les aspects théoriques ont été mis en lumière par les travaux du CEA. Mais, en 2012, à la demande de l’ASN, l’IRSN a rendu un avis négatif sur la faisabilité de cette transformation physique des déchets à l’échelle industrielle, sur la base des conclusions du CEA. Il nous est apparu que la radioprotection des installations que nécessiterait le recours à cette méthode ne pourrait pas être assurée avec les technologies que nous connaissons actuellement, si ce n’est à des coûts prohibitifs. Compte tenu de leur teneur en produits de fission, les matières concernées sont très dangereuses. Et les opérations de retraitement – en réacteur, mais aussi par des moyens chimiques – sont très délicates à mener. Cette solution nous paraît donc hors de portée pour un avenir assez long, pour des raisons tant économiques que tenant à la réglementation en matière de radioprotection.
Quant au stockage géologique, il repose sur l’hypothèse qu’une couche de roche mère – argile, sel ou granite – assurera une protection suffisante pour que la diffusion de radionucléides résultant de la dégradation des colis – inéluctable au fil du temps – se rapproche du « bruit de fond » naturel lorsqu’ils atteindront un environnement accessible à l’homme. Pour que la démonstration de sûreté soit convaincante, nous devons montrer que nous sommes capables de concevoir et de construire des installations pour un tel stockage, ainsi que de choisir des localisations géologiquement stables et présentant des couches de roche mère suffisamment épaisses, au travers desquelles le temps de transfert des radionucléides soit supérieur au nombre de demi-vies nécessaires pour que la radioactivité résiduelle des déchets – y compris celle de composants à vie longue et très mobiles dans l’environnement tels que le chlore 36 – atteigne des niveaux très faibles qui ne gênent pas la vie ordinaire des populations et des écosystèmes en surface.
Au début de l’année 2006, à la demande de l’ASN, l’IRSN a rendu un premier avis sur le stockage géologique. Partant d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), établi à partir des expériences qu’elle a menées à Bure, mais aussi dans d’autres laboratoires, en Suisse ou en Belgique, mais en nous appuyant sur nos propres analyses, car nous disposons de nos propres modèles et de moyens de recherche basés à Tournemire, nous avons validé la démonstration théorique : il nous semble possible de réaliser dans la région de Bure, en utilisant la couche d’argile qui s’y trouve et les méthodes d’emballage et de confinement proposées par l’ANDRA, une installation souterraine qui permette de stocker les déchets suffisamment longtemps pour que la radioactivité résiduelle soit inoffensive lorsqu’elle parviendra à la surface.
C’est désormais le passage de la théorie à la pratique qui nous préoccupe. Sur la base de ces premières études, la loi a validé la poursuite des travaux sur le stockage géologique, qui est devenu la solution de référence en France. En vue de construire un centre de stockage, l’ANDRA a été chargée de présenter un dossier technique chiffré – un devis – aux acteurs économiques et une démonstration de sûreté à l’ASN. Le calendrier fixé par la loi prévoit une instruction de la demande d’autorisation en 2015 et une mise en exploitation en 2025. Entre-temps, le législateur devra mener une réflexion complémentaire sur les conditions de la réversibilité.
Cependant, l’ANDRA et l’IRSN ont continué leurs travaux et butent sur plusieurs difficultés, en particulier au regard du calendrier prévu. Premièrement, l’IRSN a estimé à plusieurs reprises, notamment dans des avis officiels transmis à l’ASN en 2010 et en 2012, qu’il ne serait pas possible d’établir une démonstration de sûreté technologique sur laquelle elle puisse se prononcer de manière fondée sans que soient réalisées et testées au préalable des infrastructures grandeur nature. Or le dimensionnement du laboratoire de Bure ne permet pas d’y construire, à l’échelle 1/1, des exemplaires des futures galeries et alvéoles, ni d’expérimenter un début d’exploitation avec des colis chauffants, en utilisant les technologies qui seraient mises en œuvre par la suite. Il s’agit là d’un obstacle majeur : l’ASN sera gênée par l’absence d’avis de l’IRSN. Quant à l’ANDRA, elle reconnaît elle-même qu’elle ne sera pas en mesure d’apporter tous les éléments nécessaires à la démonstration de sûreté sans une expérimentation grandeur nature.
Deuxièmement, l’ANDRA éprouve des difficultés à arrêter les choix technologiques, qui auront eux-mêmes une incidence sur la démonstration de sûreté. D’une part, le dialogue avec les exploitants nucléaires est parfois compliqué. Il existe plusieurs concepts de construction et d’exploitation. Les différentes technologies possibles sont plus ou moins coûteuses et présentent tel ou tel avantage en termes de sûreté, de qualité ou de facilité de réalisation. D’autre part, la conception technologique devra tenir compte des règles fixées par le législateur en matière de réversibilité, règles qui ne sont pas encore connues.
Troisièmement, le débat public organisé par l’ANDRA conformément à la loi a connu certaines péripéties et a clairement montré que l’acceptation du projet par la société n’allait pas de soi, non seulement au niveau local mais aussi au-delà : les acteurs économiques et sociaux de la région ont du mal à en apprécier les coûts et les avantages, et le consensus sur son opportunité est fragile. Cette acceptation ne peut donc être considérée comme acquise à l’avance par la simple application des processus réglementaires usuels. Les responsables politiques et administratifs – Gouvernement, Parlement, ANDRA – doivent tenir compte de cette réalité.
Comme je l’ai indiqué, il ne sera pas possible d’établir d’entrée de jeu une démonstration de sûreté complète. Nous nous orientons donc inévitablement vers un phasage du projet. Dès lors, il nous semblerait judicieux d’associer les citoyens à chacune des étapes qui seront définies. S’agissant du Parlement, nous pourrions envisager trois rendez-vous : sur les conditions de réversibilité – ce débat est déjà prévu par la loi –, sur la validation de l’ouvrage opérationnel grandeur nature et sur l’inventaire final des déchets. De son côté, l’ASN devra trouver des solutions réglementaires.
En ce qui concerne la société elle-même, les pouvoirs publics pourraient encourager un dialogue avec les différents acteurs intéressés par le projet. L’IRSN, dont les experts ont depuis longtemps appris à dialoguer avec le grand public, pourrait y prendre part. Ainsi, elle a expérimenté un dialogue technique transparent sur les déchets HA-VL – dit « dialogue HA-VL » – avec l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) et le comité local d’information et de suivi (CLIS) du laboratoire de Bure qui en est membre. C’était un début d’expertise pluraliste : non seulement nous expliquions le contenu de nos rapports et répondions aux demandes d’éclaircissement, mais nous expertisions aussi certains points à la requête des participants, comme nous pouvons le faire pour l’ASN. Les questions que se pose le grand public peuvent s’écarter des thématiques de sûreté nucléaire au sens strict – certaines ont porté par exemple sur les autres ressources géologiques telles que la géothermie ou les gaz de schiste –, mais elles sont souvent pertinentes et méritent, de notre point de vue, d’être traitées.
Auparavant, l’IRSN avait également créé des instances de dialogue et d’expertise pluraliste sur des sujets sensibles, tels que l’impact local sur la santé publique de l’activité de l’usine de La Hague ou d’anciennes mines d’uranium dans le Limousin. Elles s’étaient révélées être des mécanismes puissants, non pas pour faire émerger le consensus – les différents participants conservent généralement leur opinion –, mais pour détendre l’atmosphère. Les connaissances qui résultent de tels dialogues acquièrent souvent une valeur supérieure à celles qui émanent uniquement de l’État. Cette méthode de travail pourrait renforcer l’acceptabilité du projet Cigéo, ce qui est indispensable s’il doit être mené à bien.
S’agissant des coûts, il n’est pas raisonnable de vouloir connaître le montant de la facture tout de suite : il est nécessaire de passer au préalable par une phase pilote, qui permettra d’affiner les choix technologiques, lesquels auront une incidence sur ce montant.
Pour ce qui est des effets de la radioactivité, on parle de contamination lorsque la source radioactive a été absorbée par le corps humain. Grâce à ses mécanismes de nettoyage naturels, le corps évacue progressivement les polluants. Mais certains éléments, tel le plutonium, ont une « demi-vie biologique » particulièrement longue. L’IRSN dispose de moyens d’expertise biomédicale qui permettent de mesurer la contamination des personnes qui ont absorbé une source radioactive et d’en déduire un facteur de risque. Dans la vie courante, les Français ne sont guère exposés qu’à deux sources de contamination : le radon, gaz qui existe dans l’air à l’état naturel, et les radionucléides d’origine médicale, s’ils sont amenés à subir des examens tels que des scintigraphies. Dans ce dernier cas, les éléments injectés ont une durée de vie très courte et sont entièrement éliminés par le corps au bout de deux ou trois jours.
On parle d’irradiation lorsque la source radioactive est extérieure. Nous baignons tous dans une radioactivité de faible niveau qui provient du rayonnement gamma du sol et des étoiles, mais qui ne gêne nullement la vie. En revanche, si l’on se rapproche d’une source radioactive, l’énergie reçue par le corps croît rapidement, de manière inversement proportionnelle au carré de la distance à la source. Les personnes qui ont manipulé à mains nues des sources radioactives – utilisées pour la gammagraphie, par exemple – sont ainsi victimes de brûlures très graves.
En résumé, si un individu est soumis à une radioactivité relativement importante mais diffuse, qu’elle soit de source interne ou externe, il risque de développer un cancer. S’il est exposé à des rayonnements très intenses, il risque des brûlures très graves lorsque l’irradiation demeure localisée, sinon la mort par arrêt des principales fonctions biologiques – destruction du système nerveux central ou du système digestif.
M. le président François Brottes. Je me fais l’avocat du diable : est-ce à dire qu’il vaudrait mieux envoyer les déchets sur orbite plutôt que de les enfouir, afin d’augmenter la distance à la source ?
M. Jacques Repussard. La distance serait en effet tout à fait satisfaisante, mais il serait alors nécessaire de soumettre l’utilisation des lanceurs à l’autorisation de l’ASN. Or celle-ci n’en délivrerait probablement aucune, tant les risques de retombées à la surface de la terre sont élevés.
M. le président François Brottes. Le Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN) estime que l’encadrement juridique des opérations de démantèlement est trop calqué sur celui qui est applicable en période d’exploitation, ce qui entrave ces opérations. Il conviendrait, selon lui, de revoir les procédures. Quel est votre avis sur ce point ?
M. Jacques Repussard. D’une manière générale, l’IRSN est favorable à ce que les règles juridiques tiennent compte de l’état de l’art de la science. Le principe de précaution ne doit jouer que lorsque les scientifiques ne peuvent pas apporter de réponse. Les observations du CSFN sont assez fondées : dans un réacteur électronucléaire, les éléments restant après le retrait du combustible et de la cuve, puis après le démontage du circuit primaire, présentent des niveaux de radioactivité très faibles. À ce moment-là, la qualification d’installation nucléaire de base (INB) ne se justifie plus complètement, même si je n’imagine pas qu’elle soit supprimée. Outre les INB, il existe des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nucléaires. Tel est le cas de certains laboratoires de l’IRSN, dans lesquels nous manipulons des éléments radioactifs. Ils ne sont contrôlés par l’ASN que pour ce qui a trait à la détention de la source radioactive. Pour le reste, ils sont soumis aux règles habituelles en matière de protection de l’environnement et au code du travail. Il conviendra d’étudier la question que vous soulevez, car il y a là un enjeu de compétitivité pour les opérations de démantèlement.
M. le président François Brottes. Pourriez-vous, à notre demande, formuler quelques préconisations en la matière d’ici à la fin de nos travaux ? Notre objectif est que les opérations de démantèlement puissent être réalisées dans les meilleures conditions et dans les délais les plus brefs.
M. Jacques Repussard. Nous pourrons vous remettre une fiche succincte.
Les opérations de démantèlement constituent une des phases de l’exploitation des INB. À ce titre, elles sont soumises au contrôle de l’ASN : la législation prévoit que l’exploitant fournit un dossier de sûreté pour chacune de ces phases. Ce mécanisme est globalement satisfaisant et je n’imagine pas qu’il soit remplacé par un autre.
En revanche, il serait intéressant qu’un dialogue s’engage à terme entre les experts de l’IRSN, ceux des exploitants nucléaires et les représentants de l’ASN sur le bon niveau de contrôle lors des opérations de démantèlement. Si nous parvenons à une compréhension mutuelle, nous pourrons optimiser les procédures.
M. Denis Baupin, rapporteur. Alors même que la France a lancé son programme nucléaire il y a quarante ans et que certains envisagent de construire de nouvelles installations, nous n’avons toujours pas d’idée précise sur la manière dont nous allons gérer les déchets, ni sur le coût que cela représentera. Il y a là, en effet, un vrai problème moral : nous laissons la facture aux générations futures – d’abord à nos propres enfants. Je suis très surpris que la filière nucléaire s’affranchisse à ce point de certaines règles, ce qui apparaîtrait irresponsable dans beaucoup d’autres domaines industriels, en tout cas au bout de tant d’années de fonctionnement. D’autant que nous devons absolument traiter la question des provisions : comment faire payer correctement aux consommateurs le coût de la production d’électricité et de ses conséquences si nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les charges futures induites par la gestion des déchets ? Même si les études réalisées à ce stade tendent à montrer que leur impact sur le prix du kilowattheure ne serait pas si important, nous ne pouvons faire l’économie de cette interrogation.
S’agissant de l’inventaire, les représentants d’AREVA nous ont indiqué que, selon leurs estimations, le coût du stockage des déchets sans retraitement et celui de l’ensemble de la filière du retraitement – y compris la production de combustible MOX – étaient à peu près équivalents. Faites-vous la même évaluation ? Il s’agit d’un élément important à prendre à compte dans nos choix de politique énergétique, qu’ils soient faits par nous dans les mois et les années qui viennent ou par d’autres ultérieurement. À un moment donné, la décision d’arrêter le retraitement finira par être prise. Quel en sera l’impact en termes de coûts sur la gestion des déchets ?
Concernant la sûreté du projet Cigéo, j’ai été étonné par certaines déclarations des membres de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs (CNE2) lorsqu’ils ont été auditionnés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : ils doutaient de notre capacité à construire des alvéoles qui tiennent suffisamment longtemps pour que l’on puisse récupérer les déchets dans un siècle ; en outre, ils s’interrogeaient sur le comportement de certains déchets ou mélanges de déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) – en particulier des bitumes – en cas d’incendie. Le président de la CNE2 a même évoqué le risque qu’une « grosse fumée noire » s’échappe du site de Cigéo, ce qui pourrait, selon lui, inquiéter la population. En effet, pour reprendre vos termes, cela ne renforcerait guère l’acceptabilité du projet !
Compte tenu de la nécessité d’établir une démonstration de sûreté dans de bonnes conditions, convient-il, selon vous, de revoir le calendrier, et donc de modifier la loi qui l’a fixé ?
Si l’idée de réaliser un démonstrateur industriel à l’échelle 1/1 pour le stockage géologique est retenue – elle est également ressortie du débat public –, ne devrions-nous pas en construire un deuxième pour le stockage en subsurface ? Cela nous permettrait de disposer d’une solution de repli au cas où le projet Cigéo ne pourrait pas être mené à bien, notamment si nous ne parvenions pas à établir une démonstration de sûreté convaincante. Et une telle installation pourrait durer plus longtemps – quelques siècles – que celle qui existe actuellement à La Hague.
M. Jacques Repussard. Comme je l’ai indiqué, l’IRSN n’est pas chargée d’expertiser les coûts des installations nucléaires. Nous observons simplement que le coût final des installations construites peut représenter jusqu’à trois fois le coût initialement prévu. Cela se produit assez couramment dans la filière nucléaire, de même que, probablement, dans d’autres domaines industriels. Cela dit, ce ne sont pas là des coûts infinis ou non maîtrisables. D’autre part, nous ne reportons pas de si lourdes charges sur les générations futures : des provisions sont intégrées dans le coût de l’électricité payée actuellement par le consommateur. Reste à savoir si elles sont suffisantes.
M. le rapporteur. S’il s’avère, dans cinquante ans, que nous n’avons pas suffisamment provisionné pour la gestion des déchets que nous sommes en train de produire ou que nous avons produits depuis quarante ans, il s’agira bien d’un report de charges sur les générations futures.
M. Jacques Repussard. En effet.
Pour ce qui est des autres industries, elles n’ont le plus souvent jamais provisionné pour la gestion de leurs déchets. Ainsi de l’industrie du carbone, qui a rejeté ses effluents dans l’atmosphère et est en partie responsable du réchauffement climatique. La filière nucléaire est finalement l’une des seules à qui l’on a imposé de confiner ses déchets et qui a su le faire. De ce fait, ils sont entreposés dans un petit nombre d’endroits bien déterminés et connus de la société. Jusque-là, l’humanité avait l’habitude de déverser ses déchets dans les fleuves, les mers, le sol ou l’atmosphère, sans plus s’en soucier. L’industrie nucléaire a fait de même à ses débuts, mais, depuis cinquante ans, la gestion des déchets radioactifs est très encadrée, en tout cas en France et dans les autres pays industrialisés. Dès lors, nous sommes confrontés à une difficulté nouvelle, notre société manquant de références : quels principes faire prévaloir ? Que faire de ces déchets ? Qui doit payer ?
S’agissant de l’inventaire, les représentants d’AREVA ont raison : le coût du stockage des combustibles usés n’est pas très différent de celui du retraitement. Celui-ci n’aurait pas d’intérêt s’il s’agissait simplement de stocker les déchets. Et il ne serait pas rentable si nous n’avions pas l’ambition de développer une autre filière nucléaire.
M. le rapporteur. En d’autres termes, en l’absence d’une quatrième génération de réacteurs, cela ne vaudrait pas la peine de continuer à retraiter les déchets.
M. Jacques Repussard. Le retraitement des combustibles usés n’a de sens économique que si l’on réutilise les matières qui en sont issues.
M. le président François Brottes. Il ne permet donc pas de réduire la quantité de déchets ? Ou alors à un coût trop élevé ?
M. Jacques Repussard. Il s’agit en effet d’une technique très coûteuse de séparation des déchets, qui n’a de sens que si elle est utilisée dans le cadre d’une politique énergétique telle que celle qui a été mise en place en France. D’autres pays envisagent d’ailleurs de stocker directement les combustibles usés sans les retraiter.
En ce qui concerne la sûreté du projet Cigéo, certaines des interrogations des membres de la CNE2 sont aussi les nôtres. En particulier, nous ne sommes pas en mesure de dire s’il sera possible de retirer les colis de leurs alvéoles dans un siècle. Ce délai est-il raisonnable ? Il convient de tester plusieurs manières de construire les alvéoles. D’où la nécessité d’une phase pilote : nous devons accepter l’idée que l’ouvrage soit réalisé en plusieurs étapes et fasse donc l’objet d’autorisations successives.
M. le président François Brottes. Existe-t-il des outils de simulation qui permettent de prévoir le comportement de l’ouvrage au cours du temps ?
M. Jacques Repussard. Oui. Si la couche de béton n’est pas assez épaisse, l’ouvrage finira par s’écrouler sous la pression de la roche, qui se déforme naturellement. Mais nous devons aussi prendre en compte des contraintes de coût et de densification de l’espace. Il y a donc des choix technologiques à faire. Des tests en vraie grandeur sont nécessaires pour arrêter la conception des alvéoles, déterminer l’épaisseur de la couche de béton et d’acier, calculer correctement l’interaction avec la roche. C’est indispensable si l’on souhaite que le stockage soit réversible pendant plusieurs dizaines d’années, voire un siècle. Mais si l’on fixe ce délai à 3 000 ans, ce sera évidemment une autre histoire.
M. le président François Brottes. Une phase de tests dont la durée dépasserait celle d’une génération ne serait plus vraiment une phase de tests.
M. Jacques Repussard. Nous estimons qu’une phase de tests de l’ordre de quinze ans devrait suffire pour disposer d’assurances raisonnables quant à notre capacité à récupérer les déchets pendant les cinquante à soixante-dix années suivantes.
D’autre part, l’IRSN et l’ANDRA sont en train d’étudier les risques en exploitation dans la perspective de la démonstration de sûreté. Le risque d’incendie est celui sur lequel nous nous interrogeons le plus. De notre point de vue, pendant la phase pilote, il ne sera pas souhaitable de stocker des emballages contenant des éléments combustibles, en particulier du bitume.
M. le rapporteur. Et après la phase pilote ?
M. Jacques Repussard. Il faudra les inclure dans la démonstration de sûreté et déterminer quelle technologie employer pour les traiter. S’il apparaît qu’il n’y a aucune solution satisfaisante en profondeur, il sera sans doute nécessaire de les reconditionner en surface. Mais j’extrapole : ce dossier n’est pas encore mûr.
S’agissant du calendrier, un rendez-vous est déjà prévu : une nouvelle loi doit intervenir pour fixer les conditions de la réversibilité.
M. le rapporteur. Oui, mais seulement une fois que l’ANDRA aura remis son dossier.
M. Jacques Repussard. Justement, il nous semblerait raisonnable que l’ANDRA puisse proposer un dossier sur la base d’une contrainte législative connue et non à venir. Il serait donc légitime que le Parlement revienne sur la loi de 2006, définisse ses attentes en matière de réversibilité et pose le principe d’un phasage du projet Cigéo, à charge pour l’ANDRA, l’IRSN et l’ASN de mettre en œuvre chacune des étapes ainsi définies.
D’autre part, le Parlement devrait aussi s’intéresser à l’interaction avec le public. La question de l’acceptabilité est importante : le projet Cigéo est unique, symbolique, et aura des conséquences pour tous les habitants du pays pendant une très longue durée. Le Parlement pourrait décider de la présentation qui en sera faite à la société et fixer un cadre pour le débat avec les citoyens lors de chacune des phases.
M. le président François Brottes. C’est loin d’être simple. Avez-vous une recette en la matière ?
M. Jacques Repussard. J’ai cité l’exemple des dialogues auxquels a participé l’IRSN. Il est ressorti du débat public que les citoyens sont demandeurs d’informations précises et d’une expertise pluraliste. Il y a, dans la société, de nombreux ingénieurs, qui ne travaillent pas dans les organismes en relation avec le nucléaire mais qui s’intéressent à ces sujets, ont des connaissances scientifiques, sont capables de comprendre et de poser des questions pertinentes, telles que celles qu’avaient formulées des collectifs de citoyens à propos de la géothermie. Avec raison, ils étaient allés consulter les dossiers, y avaient trouvé des failles et avaient demandé des réponses.
Soit on ne répond pas à ces questions et l’on risque de créer une insatisfaction qui s’exprimera de manière politique ; soit on accepte de les considérer comme des questions « adultes », qui méritent réponse, auquel cas ce dialogue doit se dérouler dans un cadre reconnu. Certes, il n’y a pas nécessairement besoin d’une loi : nous avions répondu aux interrogations suscitées par les incidents qui s’étaient produits à La Hague il y a une vingtaine d’années sans qu’aucun texte législatif soit adopté à cette fin. Néanmoins, la loi pourrait utilement donner quelques indications sur la manière de procéder. L’IRSN est prêt à participer à un tel dialogue. S’agissant du projet Cigéo, des instances existent déjà, en particulier le CLIS du laboratoire de Bure.
Entre autres points, il conviendrait de trancher une question de droit : l’IRSN est-il autorisé à diffuser des dossiers établis par l’ANDRA ? Quelles limites se fixe-t-on en la matière ? Dans le cadre du débat public sur l’EPR, EDF avait dû signer une convention avec la CLI pour pouvoir lui remettre des dossiers comportant des informations confidentielles relatives à la sécurité. Le législateur pourrait encadrer cette forme de démocratie directe, en en fixant les grands principes. Cela apporterait de la sérénité au débat sur ces sujets sensibles, et qui vont le demeurer.
J’en viens à l’opportunité de réaliser un deuxième démonstrateur industriel à l’échelle 1/1 pour le stockage en subsurface. Il existe actuellement deux modèles possibles pour la gestion des déchets. L’un est le stockage géologique, pour lequel nous avons besoin d’une phase pilote. Une fois celle-ci terminée, les galeries ainsi réalisées seront, sous réserve de validation, intégrées à l’installation finale. Tel n’est pas le cas du laboratoire de Bure, qui ne sera pas, lui, relié au site de stockage. L’autre modèle est l’entreposage en surface, pour lequel nous disposons déjà d’un démonstrateur, à La Hague. Le stockage en subsurface – par exemple à vingt mètres sous le sol – n’apporterait rien, sinon des ennuis. En effet, le concept même d’entreposage repose sur la surveillance par l’homme : nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier les déchets entreposés, ne serait-ce qu’en raison de l’érosion. Telle est d’ailleurs la principale difficulté de la démonstration de sûreté pour le stockage géologique : nous ne pouvons pas faire l’impasse sur le fait que, à long terme, peut-être, les hommes ne sauront plus ce que sont les déchets, ni quelles sont les technologies qui permettent de s’en occuper correctement. Il s’agit d’une question grave : si tel devait être le cas, non seulement nous léguerions le problème aux générations futures, mais nous dresserions sciemment un obstacle devant elles.
M. le rapporteur. Comme vous l’avez rappelé, la première loi sur les déchets prévoyait trois axes de recherche. Il n’est donc pas absurde d’envisager un stockage en subsurface, notamment si le projet de stockage géologique n’aboutissait pas ou si nous ne réunissions pas un consensus suffisant pour le réaliser. Nous devons choisir entre plusieurs options qui présentent, chacune, des avantages et des inconvénients. Si nous nous donnons quinze ans pour construire un démonstrateur pour le stockage géologique, nous pourrions très bien continuer à travailler également sur le stockage en subsurface. Nous aurions ainsi une alternative, au cas où l’une des deux solutions ne fonctionnerait pas.
M. Jacques Repussard. Ma remarque ne visait nullement à porter un jugement de fond sur aucune des trois options. La loi Bataille a été adoptée il y a un certain temps déjà, et ces trois solutions ont été étudiées. S’agissant de l’entreposage, le réaliser en subsurface n’apporterait qu’un bénéfice très faible au regard du risque majeur que cela ferait courir : celui d’un oubli de l’installation. Mais il n’appartient pas à l’IRSN d’en juger : en tant qu’organe technique de l’État, l’institut instruira les dossiers qu’on lui demandera de traiter. Pour le reste, nous répondons à toutes les questions qui nous sont posées, qu’elles le soient par les députés, par les journalistes ou par les citoyens. Il s’agit là d’une règle du jeu plutôt saine.
Mme Frédérique Massat. Selon vous, l’examen du projet de loi sur la transition énergétique, qui est annoncé pour le mois de juin, pourrait-il être l’occasion de préciser les conditions de la réversibilité ou de définir les nouvelles méthodes de gouvernance que vous avez évoquées ?
M. Jacques Repussard. En principe, en application de la loi de 2006, l’ANDRA doit proposer, pour 2015, un dossier de faisabilité incluant une démonstration de sûreté, en vue d’obtenir une autorisation pour construire les installations de Cigéo. Ensuite, sur la base de ces propositions et au vu de ce qu’il est possible ou non de faire sur le plan technique, le législateur doit arrêter une position sur la réversibilité. Tel est le cadre fixé initialement et toujours en vigueur. Or, compte tenu des difficultés rencontrées pour établir une démonstration de sûreté convaincante d’ici à 2015, il nous semblerait préférable qu’une loi soit adoptée plus tôt que prévu, c’est-à-dire entre maintenant et 2015, pour fixer les orientations politiques que devra respecter le projet Cigéo. Il s’agirait, d’une part, de préciser les conditions de la réversibilité – nous en savons probablement assez aujourd’hui pour nourrir un débat législatif sur ce sujet – et, d’autre part, d’instaurer un phasage du projet. Le Parlement pourrait également aborder la question de la réception de ce projet par la société. Le projet de loi sur la transition énergétique peut constituer un véhicule législatif à cette fin, mais il ne m’appartient pas de me prononcer sur ce point.
M. le président François Brottes. La loi de 2006 ne nous impose pas de revenir dès le mois de juin sur ces questions. Je vous remercie, monsieur le directeur général.
Audition de M. Michel Bourguignon, commissaire de l’ASN,
et de M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l’ASN
(Séance du 2 avril 2014)
M. le président François Brottes. Nous accueillons à présent M. Michel Bourguignon, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), accompagné de M. Jean-Christophe Niel, directeur général.
Messieurs, nous souhaitons vous entendre sur la gestion des déchets de haute activité. La conception, l’exploitation et le démantèlement des sites doivent répondre à des objectifs de sûreté, afin que les exploitants qui rejettent ces déchets puissent établir des projets précis et concrets.
L’Autorité de sûreté nucléaire a beaucoup travaillé sur ce sujet, et le tableau des exigences de sûreté se précise. Ce cahier des charges détermine en partie le coût des opérations de traitement et de stockage des déchets. Nous souhaiterions savoir si les choses sont stabilisées, sachant que vos exigences ne sont pas étrangères à l’évolution de ce coût, dont la fourchette varie du simple au triple.
Avant de vous laisser la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Michel Bourguignon et Jean-Christophe Niel prêtent serment)
M. Michel Bourguignon, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Professeur de médecine, spécialiste en biophysique et médecine nucléaire, j’ai été nommé commissaire de l’ASN par le Président de la République en 2006. Je remplace aujourd’hui Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité, qui représente la France à la convention internationale de sûreté nucléaire à Vienne, en Autriche.
M. le président François Brottes. Nous voyons ainsi que M. Chevet n’est pas un homme seul.
M. Michel Bourguignon. Je commencerai mon exposé par quelques considérations générales sur les déchets radioactifs. Ceux-ci ont des origines diverses ; ils proviennent des centrales nucléaires de production d’électricité, des réacteurs de recherche, mais également des petits producteurs industriels et du secteur médical. Ces déchets ont une activité et une durée de vie qui varie en fonction de leur catégorie – faible, moyenne ou haute activité ; vie courte ou vie longue. Selon leur nature physico-chimique, ils se présentent sous des aspects extrêmement différents, tels que gravats, liquides, solides ou boues.
La gestion des déchets radioactifs dans notre pays repose sur quatre principes fondamentaux. Premièrement, le producteur est le premier responsable de la sûreté et de la gestion de ses déchets. Deuxièmement, l’ASN est le contrôleur à tous les niveaux de la production et du transport des déchets, depuis leur utilisation jusqu’à leur fin de vie. Nous faisons en sorte qu’une filière soit identifiée pour chaque catégorie de déchets. Nous couvrons les aspects à la fois de sûreté et de radioprotection, car nous devons protéger les personnes et l’environnement. Troisièmement, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est l’établissement public responsable de la gestion des centres d’entreposage et de stockage ; elle est indépendante des producteurs de déchets. Quatrièmement, le cadre législatif et réglementaire est établi par la loi de 2006 et le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), initié en France dès 2003 et qui a servi de socle pour la mise en place d’une directive européenne. Il comporte un volet financier, inscrit dans le code de l’environnement, visant à garantir la disponibilité des fonds.
Depuis 1990, les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue sont conditionnés en ligne. Ils sont issus du traitement des combustibles des centrales nucléaires de production d’électricité, les déchets de haute activité provenant plutôt du combustible, les déchets de moyenne activité des gaines et des parties métalliques. Le traitement en ligne n’existait pas avant 1990, si bien que des déchets anciens sont entreposés à La Hague, à Marcoule et à Cadarache dans des conditions de sûreté que l’ASN considère comme non satisfaisantes. Cette situation pose des problèmes de reprise et de conditionnement. D’autres déchets provenant de combustibles divers sont en attente de traitement et de stockage – déchets militaires, déchets issus de la recherche ou des centrales de production d’électricité.
Les politiques énergétiques ont une incidence très importante sur les coûts. La France a fait le choix d’un cycle du combustible et du retraitement. Dans un centre nucléaire de production d’électricité, le combustible usé est entreposé durant quelques années, de un à trois ans ; suit une période de refroidissement à La Hague dans l’attente du retraitement ; enfin, intervient le retraitement qui obéit à la définition encore incertaine de ce qu’est une matière valorisable par rapport à un déchet. Bien évidemment, cette définition conditionne l’inventaire et les coûts associés.
La loi de 2006 a retenu le principe du stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. Au regard des enjeux de sûreté et de radioprotection, la pertinence de ce mode de stockage est internationalement reconnue, et plusieurs pays développent des projets similaires. Selon le calendrier établi par l’article 3 de la loi, l’ANDRA doit déposer une demande d’autorisation de création en 2015 pour une mise en exploitation en 2025. Ce calendrier serré doit conduire à s’interroger, alors que le laboratoire de Bure en est toujours au stade de la recherche et de la démonstration de faisabilité, et que le projet technique est en cours de définition. L’ANDRA n’a pas encore pu produire un dossier de demande d’autorisation.
À ce stade, nous identifions trois enjeux déterminants pour le dimensionnement et les coûts. Le premier est l’établissement de l’inventaire précis des déchets destinés au stockage. Il est encore incertain et dépend de choix industriels et de politique énergétique, en particulier au regard de la double notion de matières et de déchets. Ceux-ci peuvent conduire à la requalification en déchets de certaines matières radioactives, notamment des combustibles usés de CNPE ou de réacteurs de recherche. Il faut donc imaginer une flexibilité suffisante du stockage géologique profond pour préserver la capacité technique d’accueil de ces combustibles usés en stockage direct. Les coûts associés sont très importants, puisque les combustibles usés représentent des volumes considérables.
Le deuxième enjeu est l’entreposage intermédiaire de combustibles usés et de déchets radioactifs. L’ASN considère que les producteurs de déchets doivent se ménager des marges pour pallier d’éventuels aléas sur les filières aval et disposer en temps voulu de capacités d’entreposage suffisantes. En effet, selon les prospectives, l’entreposage en piscine des combustibles usés à La Hague et de l’uranium appauvri à Tricastin arrivera à saturation entre 2017 et 2023. En outre, les capacités d’entreposage préalable au stockage des déchets doivent être suffisantes, sachant que l’on arrivera également à saturation pour les colis vitrifiés à La Hague, par exemple.
Le troisième enjeu concerne les déchets dits « RCD », qui feront l’objet de reprise et conditionnement. Il s’agit de déchets anciens qui n’ont pas subi un conditionnement définitif : certains sont conditionnés, mais selon des modalités incompatibles avec leur gestion ultérieure ; d’autres, sous forme liquide ou solide – parfois en vrac –, ne sont pas conditionnés et sont entreposés dans des conditions de sûreté que l’ASN considère comme non satisfaisantes.
M. Denis Baupin, rapporteur. De quels déchets parlez-vous ?
M. Michel Bourguignon. Des déchets contenus dans des silos HAO (haute activité oxyde) à La Hague.
Les modalités de conditionnement définitif de ces déchets sont difficiles à définir en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques complexes ou hors du commun : ils sont très radioactifs et leur niveau de toxicité est très élevé. Le conditionnement reste à inventer, ce qui nécessite des ressources. La reprise, dans des silos ou des tranchées, ne sera donc pas facile au regard des incertitudes techniques, de l’enjeu de sûreté et de radioprotection ainsi que des incertitudes sur les charges financières associées.
M. le président François Brottes. Avez-vous visité le centre de La Hague ?
M. Michel Bourguignon. Je l’ai visité une bonne dizaine de fois.
Pour ce qui est du coût de Cigéo, la dernière évaluation date de 2005 ; il est nécessaire de la revoir afin d’actualiser les coûts en fonction des choix et de l’apparition de nouveautés techniques. Du reste, un système de réévaluation périodique des coûts nous semble devoir être mis en place afin d’assurer un niveau suffisant des actifs dédiés.
M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l’ASN. Les déchets dits « RCD », issus du retraitement avant les années quatre-vingt-dix, ne sont pas conditionnés. Pour un certain nombre d’entre eux, l’ASN considère que les conditions de sûreté ne sont pas satisfaisantes et que leur reprise doit être résolument engagée par AREVA. Ces opérations en milieu très radioactif seront complexes et s’inscriront dans la durée.
M. le rapporteur. Nous aurions aimé en savoir un peu plus sur ces déchets ainsi que sur le calendrier et le coût envisagés par l’ASN.
Hier, à La Hague, les représentants d’AREVA nous ont indiqué que le stockage direct coûterait aussi cher que l’ensemble de la filière du retraitement. Avez-vous la même évaluation ?
M. Michel Bourguignon. Nous ne disposons pas d’une évaluation technique précise de ces coûts. Peut-être est-ce une question de volume : les combustibles usés sont très volumineux, alors que le volume des déchets de haute activité à vie longue vitrifiés est considérablement réduit. L’estimation du coût que vous évoquez – du simple au double – pourrait venir du fait qu’il y aurait dans le stockage géologique profond deux zones très différentes, puisque les colis seraient différents, et que le volume occupé dans le sous-sol par les combustibles usés serait du même ordre de grandeur que les autres.
M. le rapporteur. Non, je parlais d’un prix identique. Le retraitement permettrait de diminuer par cinq le volume de déchets, mais son coût équivaudrait à celui du stockage cinq fois plus important nécessité pour les combustibles non retraités.
S’agissant de Cigéo, quelles conditions de sûreté l’ASN a-t-elle identifiées ? On parle de la capacité des alvéoles à tenir dans la durée, du risque d’incendie, des risques de mélange de déchets MA-VL, notamment des bitumes. Dans quels domaines avez-vous le plus d’attente vis-à-vis de l’ANDRA ?
Quels éléments essentiels de réversibilité – sur laquelle le Parlement aura à se prononcer – l’ASN a-t-elle identifiés ?
Le devis pour Cigéo a été évalué par la Cour des comptes à 35 milliards d’euros plutôt qu’à 16 milliards. Dans ces conditions, quelles sont vos recommandations s’agissant des provisions à prévoir par les exploitants ? Le calendrier prévu par la loi vous semble-t-il à revoir ?
Enfin, il ressort du débat public qu’une phase pilote d’une quinzaine d’années pour le stockage en profondeur serait bienvenue pour tester la résistance du dispositif. Sachant que la première loi sur les déchets avance plusieurs pistes, ne vous paraît-il pas opportun de tester également le stockage en subsurface ?
M. Michel Bourguignon. En matière de sûreté, le collège de l’ASN a indiqué dans un de ses avis que « si une installation de stockage en couche géologique profonde est créée, seule sera autorisée l’admission des colis de déchets dont la sûreté de stockage aura été complètement démontrée ». Nous y veillerons donc scrupuleusement.
La notion de réversibilité introduite dans la loi est très floue, et sans doute mérite-elle de faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. Selon nous, elle doit permettre d’arrêter un projet en cours si l’on se rend compte qu’il n’est pas faisable. Elle diffère de la notion de « récupérabilité », qui renvoie à la réextraction.
M. le président François Brottes. Je peux vous indiquer que les parlementaires avaient dans l’idée que l’on saurait peut-être traiter demain ce que l’on ne sait pas traiter aujourd’hui, et qu’il devrait être possible alors d’aller chercher des déchets enfouis pour éliminer le risque.
M. Michel Bourguignon. Dans votre esprit, réversibilité et récupérabilité sont donc synonymes.
M. le président François Brottes. C’est bien l’esprit du texte tel qu’il a été voté.
M. Michel Bourguignon. C’est un éclairage bien utile, car on a pu constater au cours de différentes réunions de travail que tout le monde n’appréhende pas ces deux notions de la même manière, probablement pour des raisons techniques. En particulier, la question de savoir si des colis entreposés depuis plusieurs années seront récupérables reste ouverte.
M. le rapporteur. Quelle est la doctrine de l’ASN en la matière ?
M. Jean-Christophe Niel. La loi prévoit que la réversibilité est possible pendant au moins cent ans. Pour notre part, nous pensons que l’ANDRA devrait formuler des propositions techniques, en particulier sur les moyens de garantir le maintien d’une alvéole ouverte pendant un temps suffisant, les outils de manutention utilisables pour la reprise, les moyens de contrôle des colis pendant la phase d’ouverture du site, les procédés de récupération en cas de défaillance sur les colis. Aujourd’hui, une installation d’entreposage de surface doit permettre de récupérer à tout moment ce type de colis. Tous ces éléments techniques permettraient de faire avancer le débat sur la réversibilité.
M. le président François Brottes. Précisons bien que la récupérabilité n’a de sens que si une solution de neutralisation des déchets est trouvée. On peut aussi imaginer que, concomitamment, de nouveaux outils seront mis en œuvre pour la récupérabilité.
M. Michel Bourguignon. À ce stade, nous avons besoin d’éléments techniques supplémentaires pour mettre les deux notions de réversibilité et de récupérabilité sur le pied d’égalité voulu par le législateur.
Pour en venir aux coûts, j’ai indiqué que les provisions faites en 2005 doivent être réévaluées. Je ne connais pas les montants précis qui seront nécessaires in fine. Du reste, on n’a pas besoin de tout l’argent tout de suite. L’important, c’est de sécuriser des sommes suffisantes à la hauteur des enjeux. N’ayant pas de visibilité sur la valeur des sommes déjà sécurisées, je ne saurais dire s’il faut accroître l’effort.
M. le rapporteur. Une fois le projet conçu, on saura si les provisions sont suffisantes.
M. Michel Bourguignon. C’est un projet qui s’étale sur plusieurs dizaines d’années, au moins pour les premiers colis.
M. Jean-Christophe Niel. L’ASN n’est pas directement chargée d’évaluer le coût. Sa responsabilité, pour le démantèlement comme pour les déchets, est de s’assurer que les bases utilisées pour le calcul du coût sont cohérentes avec les bases techniques dont elle a connaissance.
M. Michel Bourguignon. Le calendrier est prévu par la loi, avec deux échéances importantes : 2015 pour le dépôt d’une demande d’autorisation, et 2025 pour une mise en service.
En raison des incertitudes techniques, le dossier ne nous paraît pas suffisamment avancé pour que l’ANDRA puisse déposer une demande d’autorisation d’ici à 2015. Le Parlement devra se prononcer sur ce qu’il convient de faire. Je ne pense pas que l’on puisse aller plus loin dans ce calendrier, sauf à segmenter les décisions relatives au projet Cigéo en fonction des catégories de déchets – colis vitrifiés, combustibles usés, colis bituminés – qui présentent chacune des caractéristiques différentes en termes de sûreté et de préparation.
M. le président François Brottes. Quel est le niveau d’urgence ? Avons-nous le couteau sous la gorge ou nous reste-t-il quelques décennies pour ouvrir un centre d’enfouissement ?
M. Michel Bourguignon. Les premiers colis vitrifiés ne seront pas descendus avant 2060, à l’issue d’une phase de refroidissement en silo à La Hague, où ils seront stockés en attendant. Je ne sais si ces silos peuvent être assimilés à du stockage en subsurface. Quoi qu’il en soit, le processus existe depuis très longtemps, et il est parfaitement maîtrisé et sûr. Peut-être peut-on considérer qu’il constitue un test en grandeur réelle du stockage en subsurface.
M. le rapporteur. Dans ces conditions, et s’il ne faut pas commencer par les déchets de moyenne activité à vie longue, que fait-on d’ici à 2060 ?
M. Jean-Christophe Niel. Aujourd’hui, une grande partie des déchets en surface sont entreposés dans des conditions que nous jugeons satisfaisantes ; je pense en particulier aux entreposages de déchets vitrifiés à la Hague ou de coques et embouts.
Pour autant, ces entreposages n’ont pas vocation à être éternels. D’où l’intérêt d’aller le plus vite possible, avec néanmoins la contrainte pour l’ANDRA d’apporter la démonstration que le stockage en couche géologique profonde peut être autorisé de manière sûre. Même si la démonstration de sûreté demande du temps, dès lors que la décision est prise d’entreposer sur un tel site les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, le processus ne doit pas être ralenti.
Pour les déchets vitrifiés, qui doivent être refroidis, l’ANDRA a fixé l’échéance à 2060. Dans la mesure où les déchets bitumés sont sensibles au risque incendie, il nous semble prudent de stocker prioritairement des déchets aux caractéristiques plus stables, tels les coques et embouts cimentés. La phase pilote doit permettre d’observer le comportement des colis : il sera plus facile de réagir sur les coques et embouts cimentés que sur les bitumes ou les verres. Il y a donc une hiérarchie dans la prise en charge des colis, que ce soit pour la sûreté à long terme ou la sûreté en exploitation.
Le calendrier soulève deux sujets. Le premier a trait au délai nécessaire à l’ANDRA pour constituer un dossier correct. Alors que la loi prévoit une mise en service en 2025, la démonstration de sûreté ne pourra s’inscrire que dans un processus progressif. Sur le site de stockage de Cigéo, l’ASN n’a pas identifié d’élément rédhibitoire, mais n’a pas non plus donné son feu vert. De ce point de vue, l’ASN et l’IRSN sont en phase. Le second sujet concerne la chronologie entre le débat prévu au Parlement sur la réversibilité et le dossier de l’ANDRA. À notre sens, il serait plus logique que ce dossier soit présenté au terme du débat parlementaire, dont les conclusions pourraient conditionner des choix techniques.
La démonstration de sécurité et de sûreté devra prendre en considération deux périodes. S’agissant de la première, qui est une période de long terme s’appréciant en centaines de milliers d’années, l’ANDRA devra documenter l’impact du stockage sur l’environnement et les personnes, plus précisément sur la maîtrise du retour de la radioactivité à la surface, ainsi que sur le risque d’intrusion ou d’agression. La seconde période est la phase d’exploitation de cette installation de stockage unique. D’une part, aujourd’hui, peu d’installations sont conçues pour une exploitation d’au moins cent ans ; d’autre part, ce type d’installation souterraine présente des caractéristiques propres, comme le risque incendie auquel il faudra porter une attention particulière. D’où l’importance de la phase pilote avec l’entreposage des déchets les plus passifs possible. J’ajoute que le risque lié à la manutention ne doit pas être négligé, au vu du poids considérable des colis qui seront descendus à grande profondeur.
M. le rapporteur. Selon vous, il faudrait stocker en priorité les coques et embouts ?
M. Michel Bourguignon. Comme les déchets vitrifiés, ce sont des déchets passifs. Ils sont donc plus facilement manipulables.
M. le rapporteur. Mais vous avez indiqué que les déchets vitrifiés ne seraient pas concernés avant 2060. Par rapport à l’ensemble des déchets attendus pour Cigéo, quel volume les coques et embouts représentent-ils ?
M. Michel Bourguignon. Les coques et embouts, qui sont des déchets de moyenne activité à vie longue, occupent 11 000 containers pour un volume de 1 500 mètres cubes. Les déchets vitrifiés représentent 11 000 containers, soit 2 000 mètres cubes.
M. Jean-Christophe Niel. Ces chiffres figurent dans le PNGMDR.
Nous ne citons les coques et embouts qu’à titre d’exemple, parce que ce sont des colis non bitumés, qui n’ont pas la charge thermique ni le contenu radiologique des déchets vitrifiés. En fait, l’ASN demandera à l’ANDRA de lui présenter son schéma d’entreposage des déchets, en commençant par les plus passifs, pour des raisons de sûreté. Autrement dit, l’ANDRA définira, en lien avec les producteurs de déchets, les déchets qui devront être stockés en priorité, et l’ASN se prononcera sur ce programme industriel de gestion des déchets (PIGD). Nous pourrons vous faire parvenir des chiffres plus précis ultérieurement.
Mme Marie-Noëlle Battistel. À une époque, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ne considérait pas le stockage en couche profonde comme la meilleure solution, non seulement en raison de l’instabilité du sous-sol, mais aussi de l’eau qui y circule. Comment évaluez-vous ce risque, sachant que l’eau circule dans le sous-sol à des vitesses très faibles ?
Vous avez indiqué que les déchets anciens sont stockés dans des conditions non satisfaisantes. Il nous a été indiqué hier que ces déchets étaient recyclés progressivement. Quel serait le bon rythme et quel échéancier vous paraîtrait acceptable ?
M. Michel Bourguignon. Entre le sous-sol argileux et le sous-sol granitique, le choix s’est porté sur le premier. La roche argileuse, totalement sèche, est considérée au niveau international comme un très bon milieu pour maintenir et confiner l’ensemble des éléments radioactifs sur plusieurs milliers d’années – au moins cent mille ans. Je n’ai pas d’autres avis que ceux qui se fondent sur les modélisations et les expérimentations en la matière.
Le volume des déchets dits « RCD », entreposés dans des conditions non satisfaisantes dans le bâtiment HAO de La Hague, représente 10 000 mètres cubes. L’ASN prépare actuellement une décision visant à renforcer les échéances de reprise de ces déchets. Ces prescriptions à destination d’AREVA fixeront les échéances bâtiment par bâtiment ; elles ont été transmises à l’ANDRA pour consultation, et devraient être publiées dans un ou deux mois.
M. le président François Brottes. À Grenoble, dans le cadre du démantèlement de Siloé, l’ASN a exigé du CEA une valeur d’activité résiduelle acceptable bien inférieure aux normes de santé publique, ce qui a augmenté la facture de 30 %. Autre exemple, nous avons visité hier un bâtiment décontaminé d’AREVA ; or si ce même bâtiment devait être démoli, l’ASN exigerait qu’il soit traité comme un déchet à part entière. Expliquez-nous ces différences d’exigences.
M. Michel Bourguignon. Notre démarche n’est pas uniquement sanitaire, elle est également dictée par un souci de maintien de la propreté des sites. En France, comme dans beaucoup de pays, de nombreux sites sont plus ou moins propres et doivent être repris. C’est en particulier le cas de ceux pollués au radium par les élèves de Marie Curie. Dans notre pays, ces sites sont très mal acceptés par la société.
L’ASN vise une propreté maximale permettant au site d’être totalement libérable au public ou de recevoir de nouvelles servitudes. Nous avons fait le choix de ne pas établir de seuil de libération dans le but de nous prémunir contre la banalisation des niveaux de radioactivité observée au niveau international, qui aboutit à la présence de radioactivité dans des produits de consommation courante comme les ustensiles de cuisine.
M. le président François Brottes. Pourquoi les exigences de l’ASN sont-elles différentes selon que le bâtiment est debout ou démoli ?
M. Jean-Christophe Niel. Un bâtiment debout situé sur une installation nucléaire obéit à des règles de radioprotection destinées à protéger les travailleurs et répondant à des normes internationales. Il est donc sous contrôle.
Un bâtiment démoli relève de la gestion des déchets. Nous avons introduit, il y a une vingtaine d’années, une démarche d’absence de seuil de libération en réaction à des épisodes régulièrement médiatisés d’identification de radioactivité ici ou là. Selon cette démarche, tout élément susceptible d’être radioactif doit être traité comme un déchet radioactif. De la nature physico-chimique du déchet dépend le niveau de précaution : la présence de produits de fission nécessite une protection maximale, tandis que le grattage d’un béton superficiel pourra se contenter d’un traitement moins exigeant que le stockage profond. L’ASN considère, en effet, que les centres de stockage sont des outils précieux qui ne doivent pas être utilisés pour des déchets inadaptés.
M. le président François Brottes. Merci, messieurs, pour cette audition.
Audition de M. Sylvain Granger, directeur de la division Combustible d’EDF,
de M. Hervé Bernard, administrateur général adjoint du CEA,
et de M. Dominique Mockly, directeur du Business Group Aval d’AREVA
(Séance du 2 avril 2014)
M. le président François Brottes. Après le volet financier ce matin, nous examinons cet après-midi les aspects techniques des charges futures de la filière nucléaire, avec le stockage des déchets. Les deux questions ne sont d’ailleurs pas sans lien, puisque les décisions techniques ont nécessairement des implications financières.
En tant que futurs clients du centre industriel de stockage géologique (Cigéo), vous êtes naturellement intéressés à la définition et au coût de ses installations. Nous venons d’avoir, avec le représentant de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un débat très intéressant sur la notion de réversibilité et les contraintes que celle-ci implique. « Si le Parlement maintient le principe de réversibilité, nous dit l’ASN, nous aurons envers l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) des exigences en matière de récupération pour sécuriser les déchets, ce qui ne sera pas nécessairement le cas dans l’hypothèse inverse ».
Les devis oscillent entre 15 et 35 milliards : voilà qui laisse de la marge ! On peut comprendre, puisqu’il existe encore des débats sémantiques, qu’il soit difficile de donner des chiffres précis. Toutefois, depuis le temps que la filière existe, a coutume de dire le rapporteur, elle devrait savoir combien coûtera la gestion de l’aval du cycle.
Selon vous, existe-t-il des moyens d’optimisation ? J’ai proposé ce matin à l’administrateur général du CEA de se donner du temps, dans la mesure où il existe des dispositifs d’entreposage, comme ceux que nous avons vus hier à La Hague, qui peuvent nous laisser un répit d’au moins deux générations avant de devoir trouver une autre solution. M. Bigot a répondu qu’il ne fallait surtout pas attendre. Qu’en pensez-vous ?
Quant au débat entre stockage en subsurface et enfouissement, nous souhaiterions connaître votre opinion sur la question, la loi pouvant être amenée à évoluer au gré des progrès techniques réalisés en matière de traitement des déchets. Des sommes importantes sont en jeu, même si elles peuvent paraître marginales en regard du coût total de la production électrique et des durées considérées.
Avant de vous laisser la parole, je vous demande, messieurs, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Sylvain Granger, Hervé Bernard et Dominique Mockly prêtent serment)
M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible » d’EDF. En introduction, afin de clarifier le contexte, je voudrais situer le projet Cigéo dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs.
En France, aujourd’hui, les déchets radioactifs sont connus et classés, grâce à l’ANDRA qui tient à jour un inventaire accessible au public : 60 % des déchets radioactifs proviennent de l’industrie nucléaire, et 90 % d’entre eux sont des déchets dits « à vie courte », car ils perdent la moitié de leur radioactivité en moins de trente ans ; l’essentiel de la radioactivité est concentré dans les 10 % restants, qui correspondent aux déchets dits « à vie longue ».
Pour ce qui concerne le parc nucléaire d’EDF, les déchets issus de l’exploitation et de la maintenance des centrales, ainsi que ceux qui seront issus de la déconstruction de celles-ci, sont des déchets à vie courte ; ils représentent 90 % du volume global. Les déchets à vie longue sont, quant à eux, produits durant la réaction nucléaire et contenus dans le combustible usé déchargé des centrales.
Les déchets à vie courte disposent dès maintenant de filières complètes de gestion : ils sont triés, traités, conditionnés puis stockés dans l’un des deux centres exploités par l’ANDRA dans le département de l’Aube. EDF exploite, pour sa part, dans le département du Gard, via sa filiale SOCODEI – la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels –, un centre de traitement et de conditionnement des déchets faiblement radioactifs : l’usine CENTRACO.
Les déchets à vie longue sont extraits du combustible et séparés des matières recyclables – uranium et plutonium – dans l’installation de traitement du combustible usé exploitée par AREVA à La Hague. Ils sont ensuite conditionnés selon des procédés permettant de prévenir le risque de dispersion de la radioactivité sur une très longue durée – par exemple, le procédé de vitrification, utilisé pour les déchets de haute activité –, puis placés dans des sites d’entreposage en subsurface, dont la durée de fonctionnement peut atteindre cent ans.
La loi du 28 juin 2006 prévoit que ce dispositif soit complété, pour les déchets radioactifs à vie longue, par un stockage en couche géologique profonde : tel est l’objet du projet Cigéo, piloté par l’ANDRA. Il ne s’agit donc pas d’un projet isolé, qui fournirait la solution unique de gestion des déchets radioactifs que nous attendons. Cigéo résulte d’investissements importants réalisés durant les décennies précédentes ; il nous donnera la capacité de réduire significativement le volume et la radioactivité des déchets, et permettra un stockage simple, robuste et sûr.
Au moment où le projet s’engage dans sa phase de déploiement industriel, il est essentiel qu’il utilise les atouts du dispositif existant, en s’insérant dans ce dernier de manière cohérente et en bénéficiant de son retour d’expérience.
M. Hervé Bernard, administrateur général adjoint du CEA. Avant toute chose, je voudrais signaler que je suis également membre du conseil d’administration de l’ANDRA.
M. le président François Brottes. Y aurait-il conflit d’intérêts ?
M. Hervé Bernard. Non, je ne le pense pas, puisque j’ai été nommé en qualité de personnalité qualifiée.
En tant que producteur de déchets, le CEA a besoin de deux solutions de stockage : une pour les déchets de haute et moyenne activité à vie longue, une pour les déchets de faible activité à vie longue. La première est le stockage en couche géologique profonde – le projet Cigéo –, la deuxième est un stockage en subsurface, soit sous couverture remaniée, soit sous couverture intacte à faible profondeur, dans un lieu qui reste à définir.
Pour le CEA, il y a trois enjeux. Premièrement, il faut que nos colis de déchets radioactifs – ceux que nous avons déjà conditionnés et ceux que nous produirons dans les prochaines années – soient acceptés par l’ANDRA. Deuxièmement, nous souhaitons disposer de solutions de stockage suivant un calendrier compatible avec les opérations d’assainissement et de démantèlement en cours et avec celles programmées, afin d’éviter le surdimensionnement des installations d’entreposage temporaire actuelles ou la construction de nouvelles. Troisièmement, il serait souhaitable que les projets se conforment à une logique d’optimisation technico-économique tout en disposant du niveau de sûreté approprié, de manière à maîtriser tant le coût à la terminaison du projet que le niveau des provisions financières. À l’heure actuelle, le CEA provisionne 2,5 milliards d’euros – valeur en 2012 –, sur la base de l’estimation en 2005 d’un coût de 15 milliards d’euros pour le projet Cigéo ; si le devis doublait, le montant de la provision passerait à 5 milliards d’euros, et devrait donc être augmenté de l’équivalent de deux annuités de la subvention accordée par l’État au CEA pour charges de service public.
Le bon développement des deux projets, et plus particulièrement de Cigéo, importe donc au CEA, qui souhaite y contribuer en les faisant bénéficier de son retour d’expérience en tant que concepteur d’installations nucléaires de base et qu’exploitant nucléaire historique, ainsi que de son expertise en matière de recherche et développement, notamment sur le conditionnement des déchets. Le CEA voudrait que la totalité des pistes d’optimisation technique soient prises en considération dans la phase d’avant-projet sommaire, de manière à pouvoir réduire les coûts tout en conservant le meilleur niveau de sûreté. Cela suppose que les conditions de réversibilité soient fixées rapidement, afin que l’on puisse définir le projet Cigéo du point de vue technique. Nous proposons que ces conditions soient rédigées avant la demande de création de l’installation nucléaire de base (INB), qui sera soumise à enquête publique puis à l’ASN pour avis. Or la loi du 28 juin 2006 prévoit qu’elles seront fixées par une nouvelle loi qui devra être adoptée après l’instruction de la demande de création de l’INB. Le CEA appelle donc de ses vœux un amendement à la loi de 2006.
M. le président François Brottes. Permettez-moi de vous interrompre. Nous entendons le même discours depuis ce matin : alors que le législateur a posé un principe, vous dites qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et que tant que l’on n’aura pas défini la réversibilité en termes techniques, vous ne pourrez rien faire. De la sorte, vous obligez le législateur à jouer le rôle de l’expert technique – car ce n’est pas un simple amendement que vous nous demandez, c’est du lourd ! S’il faut inclure dans la loi un cahier des charges comparable à celui que l’ASN serait susceptible de produire, ne comptez pas sur le législateur pour le faire. Nous, nous posons des principes ; à ceux qui connaissent la matière de les mettre en œuvre.
M. Hervé Bernard. J’entends bien, mais comprenez également qu’il nous est difficile de préciser techniquement ce que sera une opération aussi compliquée que le stockage en couche géologique profonde si nous ne connaissons pas, au départ, les principes sur lesquels se fonderont les conditions de réversibilité.
Par exemple, devra-t-on laisser les machines que l’on aura utilisées pour placer les colis dans les alvéoles en état de fonctionnement permanent pendant cent ans ou ne devront-elles rester sur site que durant la période d’exploitation pilote ? Les incidences techniques et financières ne seront pas les mêmes selon que l’une ou l’autre des propositions sera retenue. Sans aller jusqu’à préciser dans un cahier des charges le schéma global du stockage et le diamètre des alvéoles – ce qui ne relève assurément pas de la compétence du législateur –, il serait nécessaire d’avancer dans la définition du principe.
M. le président François Brottes. Précisément, le législateur se moque de savoir si ce sont les mêmes machines qui devront ressortir les colis dans l’hypothèse où l’on aurait trouvé une solution pour les traiter ! L’important, c’est que, dès lors que le principe de la réversibilité du stockage est posé, on puisse effectivement récupérer les déchets qui avaient été entreposés à une certaine époque, et cela quelle que soit la machine utilisée.
M. Hervé Bernard. Mais pourquoi différer le moment de fixer les conditions de la réversibilité ? Cela ne nous semble pas clair.
M. le président François Brottes. Pourtant, ça l’est ! Si demain l’on trouve une solution pour neutraliser les effets de la radioactivité, il faudra pouvoir récupérer les déchets que l’on avait stockés pour les traiter. Peut-être une telle formulation paraît-elle absurde aux yeux d’un technicien, mais je ne crois pas que l’on puisse aller bien au-delà dans un texte de loi. On ne va pas écrire que cela devra être fait avec les machines qui auront été utilisées pour le stockage – ce serait d’ailleurs une ânerie : si l’on fait un pas de géant sur le plan technologique, il est bien évident que les machines seront modifiées !
Depuis ce matin, l’ASN, l’IRSN et le CEA nous disent que tant que nous ne serons pas plus précis sur le cahier des charges, ils ne pourront rien demander à l’ANDRA, mais c’est le serpent qui se mord la queue ! Notre commission d’enquête ne manquera pas de souligner que c’est là un point de blocage qui a des incidences sur le chiffrage et le calendrier. Permettez-moi de vous dire qu’il ne pourra pas être réglé par un simple amendement.
M. Hervé Bernard. Ce point ne relève pas de ma compétence. En revanche, il nous semble évident que, selon les spécifications techniques qui seront apportées, le devis final du projet variera dans des proportions importantes.
Nous souhaitons donc que toutes les pistes d’optimisation technique soient considérées. Parmi celles que le CEA a identifiées, j’en citerai trois.
Premier exemple, les bâtiments nucléaires de surface peuvent être optimisés.
M. Denis Baupin, rapporteur. Qu’est-ce à dire ? L’ANDRA ne l’aurait-elle pas prévu dans son projet ?
M. Hervé Bernard. Des pistes d’optimisation ont été identifiées, mais elles n’apparaissent pas toutes dans l’avant-projet sommaire. Il faudrait savoir quelles décisions seront prises à ce sujet.
M. le rapporteur. Par qui doivent-elles être prises ?
M. Hervé Bernard. Par le maître d’ouvrage qu’est l’ANDRA.
Par exemple, les bâtiments nucléaires de surface peuvent être soit construits en surface, soit enterrés, soit semi-enterrés. Or il s’agit de constructions imposantes : elles mesurent 300 mètres de long sur 300 mètres de large et 30 mètres de haut. Nécessairement, cela n’aura pas le même coût.
M. le rapporteur. Cette question a-t-elle été soumise au débat public ?
M. Hervé Bernard. Je ne pense pas que l’on soit allé jusqu’à ce niveau de détail, mais, n’ayant pas assisté aux réunions publiques, je préférerais laisser l’ANDRA répondre.
M. le rapporteur. Trente mètres de haut, c’est un gros détail !
M. le président François Brottes. C’est courant pour un bâtiment industriel.
M. le rapporteur. En matière de stockage des déchets nucléaires, on imagine qu’on va aller à 800 mètres de profondeur plutôt qu’à 30 mètres de haut !
M. Sylvain Granger. Il s’agit de bâtiments destinés à accueillir en surface les colis de déchets en provenance de nos sites avant qu’ils ne soient envoyés dans les installations souterraines. Ce sont des installations classiques d’entreposage, de logistique et de conditionnement – puisqu’il faudra procéder sur certains colis à un conditionnement supplémentaire pour pouvoir les stocker. On en trouve des exemples sur le site de La Hague,
M. le président François Brottes. Effectivement, nous en avons vu.
M. le rapporteur. J’ai eu l’impression que le débat public avait plutôt porté sur ce qui allait se passer dans le sous-sol. Je ne suis pas sûr que les gens aient pris conscience que l’emprise au sol serait aussi importante.
M. Sylvain Granger. Pour ce que j’en sais, une image de l’ensemble de l’ouvrage, en souterrain comme en surface, et avec les différentes options, a été présentée. Ce sera toutefois à confirmer auprès de l’ANDRA.
M. Hervé Bernard. Une deuxième piste d’optimisation est le stockage en profondeur des déchets de moyenne activité à vie longue. Il s’agit d’un point important pour nous, car le CEA a une quantité importante de déchets de ce type à stocker – 26 % de la production totale. Il a intérêt à ce qu’on trouve une solution qui concilie les aspects techniques et financiers, tout en conservant un niveau de sûreté élevé.
Troisième piste, l’optimisation des effectifs sur le site durant la phase d’exploitation – c’est-à-dire une centaine d’années. Sur ce point, le CEA peut faire bénéficier le projet de son retour d’expérience de l’exploitation d’installations nucléaires de ce type.
Enfin, pour terminer sur quelques chiffres, au CEA, les déchets de haute activité à vie longue représentent 4 % de l’ensemble des déchets à traiter par Cigéo, et nous participons à hauteur de 17 % au financement du projet.
M. Dominique Mockly, directeur du Business Group Aval d’AREVA. J’adhère à ce qui a été dit par les intervenants précédents. Chez AREVA, nous faisons d’ailleurs la synthèse, à notre échelle, entre les préoccupations d’EDF et celles du CEA, puisque nous avons à la fois des déchets de moyenne activité à vie longue issus de traitements anciens et d’opérations de reprise et de conditionnement de déchets entreposés dans des silos, et des déchets industriels à haute activité résultant du traitement des combustibles d’EDF.
Les débats que nous avons en France sur le nucléaire et la gestion des déchets sont, sachez-le, suivis avec beaucoup d’attention par l’ensemble de la communauté internationale. Cigéo est une brique parmi celles qui concourent à l’édification d’un vaste dispositif de traitement des combustibles et de réduction des déchets issus du recyclage : le stockage définitif des déchets est une solution à laquelle toutes les personnes qui s’intéressent au nucléaire ont pensé, et l’on note une assez forte adhésion à nos travaux.
Dans les années qui viennent de s’écouler, beaucoup de choses ont été validées. La crédibilité de Cigéo sur le plan technique est désormais assurée, même s’il reste encore à faire, notamment en ce qui concerne le dimensionnement des installations souterraines. S’agissant des installations de surface, ce qui existe déjà prouve que c’est faisable, et il faudra utiliser au maximum les retours d’expérience disponibles. Tout cela démontre que les solutions retenues sont viables.
Se pose désormais le problème des coûts. Là encore, je suis d’accord avec ce qui a été dit : on ne peut pas, sur un projet de cette nature et de cette taille, engager des dépenses importantes sans adopter une approche par étapes, de manière à s’assurer que les problèmes techniques ont bien été résolus et que les dispositifs retenus sont validés, car il reviendrait trop cher, à la collectivité comme à nous, de revenir dessus. C’est d’autant plus important que le projet Cigéo fait partie d’une chaîne : s’il ne voyait pas le jour, la question du stockage resterait en plan. Voyez ce qui se passe aux États-Unis, où il n’y a ni traitement du combustible usé ni stockage des déchets : tout le monde se demande ce qu’il faut en faire, et des conflits ont même éclaté entre les électriciens et l’État. Vous, politiques, ne pourrez donc pas éviter de vous saisir de la question du devenir des déchets.
L’enjeu principal, pour nous, est l’optimisation : comment assurer le stockage définitif des déchets au coût le plus acceptable à la fois pour la société et pour les entreprises que nous sommes ?
Pour cela, il faut travailler encore sur les aspects techniques, et mettre en place un dispositif de gouvernance qui permette de réaliser sur le long terme les optimisations idéales. Ce n’est pas parce qu’une idée est soumise par un producteur de déchets qu’elle doit être rejetée ; de même, des solutions proposées par une autorité indépendante peuvent se révéler bonnes également du point de vue du producteur. Ce genre de discussion demande du temps, car il faut arriver à un compromis entre l’ensemble des parties.
Enfin, pour faire avancer le projet Cigéo, il faut utiliser au mieux les compétences existantes. Parmi celles-ci, j’insisterai plus particulièrement sur la logistique. Il faudra, en effet, trouver des solutions pour apporter les déchets sur le site et les entreposer en surface avant de procéder au stockage en profondeur. Pour ce faire, nul besoin de réinventer le monde ! Il suffit d’utiliser l’expérience acquise, puisque nous exploitons déjà à La Hague des installations similaires. Voilà un exemple concret d’optimisation du projet qui permettrait de mieux en maîtriser les coûts.
Pour résumer : nous pensons que Cigéo est indispensable, car c’est une condition nécessaire pour assurer la crédibilité d’un nucléaire qui dure, et qu’il est essentiel d’en optimiser les coûts, ce qui suppose la mise en place d’une gouvernance équilibrée, fondée sur le dialogue entre les producteurs de déchets, les responsables du stockage définitif et le régulateur.
M. le rapporteur. J’ai beaucoup aimé, monsieur Mockly, vous entendre nous dire que nous n’échapperons pas à la question de l’avenir des déchets ! J’ai bien évidemment envie de vous la retourner : après quelque quarante années de production nucléaire, on aurait attendu de ceux qui produisent les déchets qu’ils apportent la réponse. À défaut, les responsables politiques devront bien trouver une solution, mais vos propos expriment un étrange retournement de situation ! Ils m’ont renvoyé à ceux de M. Repussard évoquant, lors de son audition tout à l’heure, les problèmes moraux que poserait le report sur les deux ou trois générations à venir des provisions nécessaires au traitement des déchets.
M. le président M. François Brottes. Pour être tout à fait juste, monsieur le rapporteur, ceux qui ont produit l’électricité avec du charbon durant des décennies ne se sont même pas posé la question des conséquences de son emploi en termes d’effet de serre.
M. le rapporteur. Raison de plus pour mieux apprendre à gérer les conséquences des déchets nucléaires en réduisant leur production !
Hier, à La Hague, les équipes d’AREVA nous ont présenté des éléments chiffrés, dont nous attendons une confirmation écrite, selon lesquels le stockage des combustibles à la sortie des centrales reviendrait aussi cher ou presque que leur retraitement. C’est un élément d’éclairage important dans la définition des coûts respectifs des différents procédés en aval de la filière, s’agissant notamment de la décision de poursuivre ou non le retraitement des déchets.
Par ailleurs, pour l’IRSN et l’ASN, la démonstration de sûreté de Cigéo est loin d’être faite : leurs représentants nous ont même affirmé aujourd’hui, au cours de leur audition, qu’ils n’étaient pas en situation de faire cette démonstration, que ce soit en matière d’incendie ou de résistance dans le temps des alvéoles dans la perspective d’une éventuelle récupérabilité des colis de déchets. C’est pourquoi ils demandent la mise en place d’un site pilote, rejoignant en cela les conclusions du débat public, conclusions qui n’ont pas encore été définitivement reprises par l’ANDRA. Selon M. Repussard, quinze ans seront nécessaires pour procéder aux évaluations nécessaires.
Vous vous rejoignez sur les optimisations possibles de Cigéo. Pour autant, leur coût n’est pas très clair : est-il de 15 milliards, comme vous l’avez évoqué, ou de 36 milliards, comme avancé par la Cour des comptes ? Débattre publiquement sur le budget sans que le maître d’ouvrage présente la moindre évaluation chiffrée est proprement surréaliste et n’est pas sans poser un grave problème à notre commission d’enquête, dont l’objectif est précisément d’acquérir la vision la plus claire possible des coûts du nucléaire en vue d’assurer des provisions suffisantes. Or nous sommes encore loin de posséder cette vision. Pensez-vous que vos entreprises respectives font des provisions suffisantes ?
Par ailleurs, l’ASN a évoqué les problèmes de toxicité posés, sur le site de La Hague, par la reprise et le conditionnement de certains déchets dont la conservation aurait un niveau de sûreté insatisfaisant. L’agence estime nécessaire de reconditionner ces déchets, qui représentent tout de même un volume de 10 000 mètres cubes, avant tout stockage. Selon quel procédé et dans quel délai AREVA compte-t-elle traiter ce problème ? Quel est le conditionnement prévu ? Quel impact celui-ci aura-t-il sur l’ensemble du dispositif ?
En matière de stockage intermédiaire, l’ASN souhaite que les entreprises que vous représentez aient des capacités suffisantes d’entreposage. Devant un risque de saturation à l’horizon de 2017-2023, elle préconise de les augmenter pour ne pas dépendre des décisions relatives à Cigéo, notamment en termes de calendrier. Partagez-vous le point de vue de l’ASN ?
M. Sylvain Granger. La démonstration de sûreté recouvre différents aspects. Le premier a trait à la capacité d’avoir, dans le temps, une maîtrise raisonnable, à la fois robuste et simple, du confinement des déchets dans l’ouvrage de stockage envisagé. Cet aspect est assez peu dépendant du détail de l’ingénierie du concept. En 2005, au vu des démonstrations de sûreté présentées par l’ANDRA, l’ASN a considéré que le stockage était une solution sûre. À l’époque, un groupe permanent d’experts s’était, du reste, penché de manière approfondie sur les documents de l’ANDRA.
Autre type de sûreté, la sûreté opérationnelle. Elle porte sur les risques d’incendie ou de chute des gros colis dans les installations et, pour le coup, les solutions dépendent du détail de la conception de l’ouvrage. L’avant-projet sommaire étant en cours de réalisation, il est pour le moment très difficile de connaître les détails des études : une fois qu’elles auront été instruites par le support technique de l’ASN, celle-ci pourra se prononcer sur les choix retenus en vue de maîtriser le risque incendie, le risque de chute ou tout autre aspect opérationnel. C’est, à mes yeux, parce qu’il ne dispose pas encore d’un dossier complet que l’IRSN a affirmé ne pas pouvoir se prononcer.
L’ANDRA devra, en vertu des dispositions législatives, remettre en 2015 une demande d’autorisation de création : la question de la démonstration de sûreté devra alors avoir été traitée. J’ignore si l’échéance pourra être tenue.
Les choix opérés peuvent avoir une influence sur le niveau de sûreté de l’ouvrage. Maintenir longtemps une alvéole ouverte est contraire à la sûreté à long terme de la phase d’exploitation. Refermer cette alvéole est plus sûr, sans pour autant compromettre la récupérabilité des déchets, qui sera simplement rendue plus difficile. La vérité en matière de réversibilité ne peut pas entièrement venir du Parlement : à un moment donné, les acteurs industriels et réglementaires devront prendre leurs responsabilités et faire les choix techniques nécessaires à l’application des principes définis par le législateur, s’agissant notamment du compromis entre réversibilité et sûreté.
S’agissant du coût de Cigéo, l’ANDRA a rappelé que les 35 milliards correspondaient à un stade antérieur des études ; le chiffre de 15 milliards a été avancé plus tard, en 2005. L’Autorité de sûreté a été impliquée dans ces évaluations, avalisées par le ministre de l’énergie d’alors. C’est donc bien ce dernier chiffrage, dont l’ordre de grandeur avait été considéré comme raisonnable au vu des conditions économiques de l’époque, qui nous sert de référence pour calculer la hauteur des provisions, étant entendu que des marges avaient été prévues, permettant de tenir compte des résultats des études d’ingénierie détaillées qui n’avaient pas encore été entièrement réalisées.
Or nous nous apercevons aujourd’hui que les coûts peuvent varier du tout au tout en fonction des techniques choisies. C’est ainsi que la technique du tunnelier a été privilégiée parce que c’est celle qui est la plus productive en matière de creusement tout en assurant le maximum de sécurité en phase de chantier. Lorsque l’ANDRA en était arrivée au chiffre de 35 milliards, la technique de creusement retenue était celle de la machine à attaque ponctuelle, plus lente et beaucoup plus onéreuse, tout simplement parce que c’était la seule qui avait été testée dans son laboratoire. Il faut évidemment tenir compte de la faisabilité des choix techniques en fonction des différents critères retenus en termes de sûreté, de respect de la roche et de confinement. Ces questions sont encore en cours d’instruction.
M. le rapporteur. Il est probable que Cigéo ne sera pas achevé avant l’installation du premier fût de déchets et que les travaux de creusement des galeries se poursuivront. Les deux technologies sont-elles compatibles avec cette situation ?
M. Sylvain Granger. Tout dépend du choix de dessin d’architecture de stockage : certains dessins interdisent de basculer d’une technologie à l’autre, d’autres permettent de conserver de la flexibilité dans les deux technologies. L’ANDRA est ainsi passée de dessins d’architecture grillagée à des dessins, présentés lors du débat public, avec courbure, qui sont compatibles avec les deux techniques de creusement. Les deux options sont donc ouvertes, même si l’ANDRA a, pour l’instant, fait le choix du tunnelier.
Il convient de regarder tous les choix possibles permettant des optimisations significatives. L’année dernière, l’ANDRA nous a associés à une analyse de la valeur du projet qui a fait ressortir la nécessité d’approfondir une centaine d’optimisations. La vingtaine étudiée à l’heure actuelle nous permet déjà d’envisager une économie de plusieurs milliards d’euros. J’ignore si les 80 % restant seront aussi fructueux, mais nous avons tout intérêt à achever ce travail prometteur, non seulement en termes d’économies, mais également de sûreté et de sécurité du chantier d’exploitation de l’ouvrage.
M. le président François Brottes. Je vous remercie d’être revenu sur la question de la récupérabilité : le législateur devra, en effet, se prononcer sur le niveau de confinement exigé avant une éventuelle récupérabilité, étant entendu que le niveau maximum ne doit pas interdire l’accès aux déchets stockés.
M. Sylvain Granger. La notion de réversibilité englobe à la fois le concept de récupérabilité, qui doit pouvoir être démontrée, et celui de progressivité.
Il est important de développer progressivement le stockage. Nous avons décidé de sélectionner, pour les envoyer à l’ANDRA, des colis de déchets représentatifs, qui permettent d’effectuer des tests significatifs sans pour autant créer immédiatement les difficultés les plus grandes. Il convient de progresser par étapes en introduisant dans le stockage des colis de déchets présentant des difficultés croissantes, afin que les retours d’expérience soient les plus pertinents possibles. Il ressort de nos échanges avec l’ANDRA que c’est également son souhait.
M. Hervé Bernard. Le CEA a pris en considération de longue date les questions soulevées par l’entreposage intermédiaire. Nous avons développé au centre de Cadarache une installation nucléaire de base, le projet CEDRA, à l’issue d’un débat public local supervisé par la Commission nationale du débat public. Ce projet consiste à entreposer, pour une période réglementaire de cinquante ans, des déchets de moyenne activité à vie longue dans l’attente du stockage profond de Cigéo. Nous sommes donc capables de construire des installations nucléaires de base destinées à un entreposage temporaire.
Dans cinquante ans, il conviendra soit de retirer les déchets soit de construire une nouvelle installation, car je doute fort qu’il nous soit possible de prolonger l’existence d’une installation de surface au-delà du siècle.
Les décisions déjà prises par l’ANDRA dans la chronique de réception des colis de déchets dans Cigéo ont un impact direct sur les installations d’entreposage intermédiaire dont le CEA aura besoin. Ainsi, le report de 2025 à l’horizon 2030 de la réception de colis de déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL), notamment des bitumes, nous oblige, compte tenu des contraintes réglementaires, à construire une alvéole supplémentaire à l’installation d’entreposage intermédiaire polyvalent (EIP) de Marcoule pour un coût approximatif de 110 millions d’euros, et ce pour une période maximale de cinquante ans.
M. Dominique Mockly. Je partage les constats de MM. Granger et Bernard.
Les remarques de l’ASN sur le conditionnement des déchets à La Hague s’appliquent au silo 130 de stockage des déchets issus du traitement de certains combustibles. Le silo, en sous-sol, se présente comme une fosse en béton, complètement étanche. Elle est située dans une zone fermée, où aucun bâtiment n’est construit. L’ASN a imposé l’installation de drains pour vérifier l’absence d’écoulement. Depuis le drame de Fukushima, la surveillance de la fosse a été encore renforcée.
Notre engagement est de reconditionner l’ensemble des déchets contenus dans la fosse avant de les envoyer à Cigéo.
M. le président François Brottes. Leur récupérabilité est donc possible.
M. Dominique Mockly. Oui.
Les difficultés rencontrées au silo 130 concernent le conditionnement des déchets. En volume réel, les déchets ont dégagé plus d’hydrogène que dans le cadre du programme pilote dont seule une petite quantité de ces déchets avaient fait l’objet. Le conditionnement définitif doit donc être repensé dans le cadre de la recherche et développement. C’est pourquoi, afin de répondre à l’urgence en termes de sûreté, nous avons proposé à l’ASN de reprendre ces déchets pour les réinstaller, pour dix ou vingt ans, dans un autre entreposage, et ce dans l’attente de l’élaboration du colis définitif. Nous en sommes à la phase de construction du programme de reprise – une mauvaise surprise sur le plan économique que nous devons assumer. L’impact sur Cigéo sera nul : nous enverrons simplement ces déchets plus tard.
M. le rapporteur. Quel est le coût de l’opération ?
M. Dominique Mockly. Nous ne le connaissons pas encore : sans doute quelques dizaines de millions d’euros, pris sur nos programmes de reprise et de conditionnement de déchets.
M. le président François Brottes. Combien de fosses semblables existe-t-il ?
M. Dominique Mockly. Trois, mais la fosse 130 contient des composants de la filière graphite-gaz, qui sont particuliers.
M. le rapporteur. Qu’en est-il des autres silos ?
M. Dominique Mockly. Ils contiennent des bouts proches des déchets compactés et conditionnés en conteneurs standards de déchets compactés (CSD-C), à cette différence que, à l’époque, au lieu d’être compactés, les déchets métalliques étaient stockés dans des fosses. Il faudra également cimenter des composés organiques selon des procédés qui sont aujourd’hui maîtrisés.
Sur Cigéo, la gouvernance du projet nécessite une phase pilote et une prise des décisions progressive. La phase pilote permet de procéder à des tests en grandeur nature qui ont l’avantage, sans engager de coûts trop importants, de consolider l’évaluation de la phase finale et la méthode de déclenchement des chroniques.
M. le rapporteur. Aucun de vous trois n’a répondu à la question des provisions. Certes, les incertitudes pesant sur la taille de Cigéo ne permettent pas de donner une réponse définitive : quelle est toutefois votre appréciation des marges possibles d’erreur ?
M. Sylvain Granger. Les études de détail ne sont pas achevées. Il est donc difficile de vous répondre.
En fonction de l’état d’avancement de ces études, nous nous sommes toutefois forgés la conviction que, si, tous, nous prenons en compte l’ensemble des retours d’expérience dont nous disposons, il n’y a aucune raison de ne pas réussir à rester dans l’enveloppe de 15 milliards d’euros qui avait été évaluée, à l’origine, de manière prudente. La comparaison de cette enveloppe avec des évaluations étrangères conduit à la même conclusion.
M. Hervé Bernard. Comme je l’ai souligné dans mon introduction, nous croyons vraiment à l’optimisation technico-économique. Si nous mettons en œuvre, avec le maître d’ouvrage, l’ensemble des pistes offertes après retour d’expérience, nous pourrons tenir le périmètre des provisions actuellement prévu.
M. Dominique Mockly. Je partage tous ces avis.
M. le rapporteur. J’en déduis donc que, dans vos trois entreprises, les provisions consacrées à Cigéo ne tiennent compte que du seul coût de 15 milliards. Toute évaluation allant au-delà impliquerait des provisions supplémentaires.
M. Sylvain Granger. Nous provisionnons sur la base d’un coût de 15 milliards puisque c’est le coût officiel. Lorsque les résultats des études d’optimisation seront connus, nous prendrons en compte la réactualisation de ce coût, selon le mécanisme prévu dans la loi, le ministre de l’énergie devant fixer la nouvelle évaluation du coût du stockage.
M. le président M. François Brottes. Messieurs, je vous remercie.
Audition de M. Jacques Percebois, membre de la Commission nationale d'évaluation (CNE2)
(Séance du 2 avril 2014)
M. le président François Brottes. Monsieur Percebois, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette dernière audition de la journée. Nous avons entendu aujourd’hui des propos pour le moins étonnants. Nos interlocuteurs nous ont dit en substance qu’ils ne pourraient pas déterminer le coût de la gestion des déchets tant que le législateur ne se serait pas prononcé sur ce qu’il entendait par « réversibilité ». Nous avons aussi compris que la récupérabilité, élément de cette réversibilité, poserait des problèmes de complexité inégale selon que l’on aurait opté pour un confinement total des déchets ou réservé une ouverture avec un couvercle.
Mais, économiste, vous abordez ces questions comme nous en généraliste plutôt qu’en technicien. Vous êtes aujourd’hui auditionné par notre commission d’enquête en qualité de membre de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, dite CNE2. Cette commission a une vision globale de l’ensemble des options qui s’offrent pour la gestion des déchets de haute activité, à commencer par le stockage géologique sur lequel subsistent nombre d’interrogations portant notamment sur les modalités techniques et sur le prix – deux questions d’ailleurs indissociables. Mais puisque les techniciens nous disent qu’il faudrait que le législateur affine sa demande pour pouvoir donner un prix, il est à craindre que ces incertitudes ne soient pas levées de sitôt…
Vous vous intéressez également à la séparation-transmutation des actinides, matière peu familière au grand public et au sujet de laquelle des définitions précises seraient bienvenues.
Toutes ces options n’entraînent pas les mêmes coûts ; elles nécessitent – ou non – des prototypes en vraie grandeur ; leur mise en œuvre présente – ou non – un certain degré d’urgence compte tenu de ce que nous savons faire en subsurface aujourd’hui dans des conditions de sûreté garanties par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Quant à l’impact sur les comptes des sociétés concernées, il se mesure aujourd’hui à l’aune du coût de 15 milliards d’euros annoncé initialement, mais ne faudra-t-il pas revoir cette évaluation ? On nous a par exemple parlé de mesures « technico-économiques » d’amélioration – mariage de notions qui me laisse d’ailleurs perplexe dans la mesure où on ignore laquelle des deux commande l’autre.
S’agissant du projet Cigéo, qui implique de lourds investissements, les incertitudes sont-elles moindres pour la CNE2 que pour notre commission d’enquête ? Comment analysez-vous le projet dans ses dimensions techniques et financières, qui sont intimement liées ? Faut-il se donner le temps de voir venir ? Quelle « commande » passer au législateur ? Autant de questions que nous souhaitons vous entendre aborder dans votre propos introductif.
Mais, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois auparavant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jacques Percebois prête serment)
M. Jacques Percebois, membre de la Commission nationale d’évaluation (CNE2). Je concentrerai mon propos sur les aspects économiques du stockage des déchets MA-VL et HA-VL – les déchets de moyenne et haute activité à vie longue.
Permettez-moi de faire deux observations préliminaires. Tout d’abord, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de même que l’Union européenne et le législateur français considèrent le stockage géologique comme la solution de référence pour garantir la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs HA et MA-VL. Ensuite, il est par nature difficile de prévoir le coût d’une installation dont la durée de vie dépasse le siècle. Ce coût sera évidemment très sensible à la chronique de livraison des déchets fournis par les producteurs, à savoir principalement EDF, AREVA et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
La CNE2 a pour mission d’auditionner l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), mais aussi les producteurs de déchets, sur le projet de stockage et, à partir de là, d’émettre des recommandations. Nous publions donc un rapport annuel dans lequel nous donnons notre avis sur les projets qui nous sont soumis et nous demandons régulièrement à l’ANDRA, et indirectement aux producteurs, de nous fournir des informations complémentaires.
Rappelons que le financement de la construction et de l’exploitation de Cigéo est à la charge des producteurs de déchets, via des conventions passées entre eux et l’ANDRA, et selon une clé de répartition, pour le moment acceptée, qui est fonction de la quantité de déchets à stocker, à savoir 78 % pour EDF, 17 % pour le CEA et 5 % pour AREVA – il est entendu que nous parlons ici du stockage des seuls déchets MA-VL et HA-VL, et non de tous les déchets issus du nucléaire, ce qui impliquerait un coût plus élevé.
Aux termes de la loi, ce coût du stockage est fixé, sur proposition ou après avis de l’ANDRA et des producteurs de déchets, par le ministre en charge de l’énergie. Il est public : il a été estimé en 2005 à 16,5 milliards d’euros pour Cigéo. Dans son rapport sur les coûts de la filière électronucléaire de 2012, la Cour des comptes considère néanmoins, à l’instar d’ailleurs de la CNE2, qu’il est sous-estimé. Elle a avancé, pour sa part, un ordre de grandeur de 36 milliards, mais cette évaluation n’est pas validée à ce jour. Un groupe de travail a été constitué sur le sujet au sein de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; y participent l’ANDRA et les producteurs de déchets et la CNE2 y est associée, puisque j’y siège en tant qu’observateur. En principe, le ministre chargé de l’énergie devrait arrêter le nouveau chiffre à la fin de juin prochain.
Il y a bien sûr débat entre les parties concernées sur le coût de ce projet, qui est un projet innovant, appelé à s’étaler sur une longue durée et qui implique, outre les coûts de construction, des coûts d’exploitation. Il y a d’autant plus débat que de nombreuses incertitudes subsistent en l’absence de retour d’expérience important à l’échelle internationale.
Premier élément d’incertitude : l’inventaire des déchets à stocker peut être modifié. Il l’a d’ailleurs déjà été, ce qui explique la dérive des coûts à la hausse.
En deuxième lieu, il n’est pas aisé de faire des projections à long terme sur la base de technologies que l’on ne maîtrise pas nécessairement, et il convient donc de prendre un grand nombre de précautions.
Mais on constate d’autres incertitudes encore, relatives à la structure des coûts, qui renvoient à la décision politique : je pense au coût des assurances et à celui des taxes. Ainsi, pour Cigéo, la question se pose de savoir si ce centre va payer toutes les taxes auxquelles est assujettie une construction industrielle ou s’il pourra, comme cela a déjà été le cas par le passé pour certaines installations nucléaires, bénéficier d’une dérogation votée par le législateur.
M. Denis Baupin, rapporteur. Pensez-vous à une subvention ?
M. le président François Brottes. Comme pour les énergies renouvelables ?
M. Jacques Percebois. Non, à une exonération de taxes – le problème étant qu’une exonération de taxes locales entraînerait des rentrées fiscales moindres pour les collectivités territoriales…
M. le président François Brottes. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais le sujet est délicat. J’ai le souvenir que pour le site de Bure, le législateur a voté un certain nombre de dispositions spécifiques dont dépend l’acceptabilité du projet au niveau local. Les remettre en cause serait, à mon sens, se fourvoyer. Ce débat a eu lieu à plusieurs reprises dans l’Hémicycle, sous plusieurs majorités et des engagements ont été pris sur lesquels il est difficile de revenir.
M. Jacques Percebois. Pour l’instant, c’est une interrogation. Au pouvoir politique de trancher.
M. le président François Brottes. Il me semble qu’il a déjà tranché ; vous lui demandez en fait de réviser sa position.
M. Jacques Percebois. La CNE2 observe ce sur quoi il y a convergence ou divergence entre l’ANDRA et les producteurs. À l’heure actuelle, il y a débat sur le niveau des taxes. L’ANDRA reviendra sans doute sur ce point lorsque vous l’auditionnerez.
M. le président François Brottes. Soyons précis. Des dispositions législatives existent. Or je comprends que vous demandez au législateur de les revisiter. Encore une fois, des dispositions spécifiques ont été votées pour le site de Bure.
M. Jacques Percebois. En effet.
M. le président François Brottes. Et vous parlez bien de les revisiter.
M. Jacques Percebois. Je n’ai pas dit que c’était la position de la CNE2. Au demeurant, celle-ci n’a pas à donner d’avis ou à formuler de jugement sur ce point. Je me borne à relever que la question a été posée.
Il nous semble d’autre part important de rappeler que nous aurons une meilleure connaissance du coût du stockage lorsque nous aurons commencé à construire le site. Nous avons aujourd’hui de nombreuses informations grâce au laboratoire, qui s’est révélé très utile. Il importe maintenant de lancer l’opération. Une procédure est prévue pour cela. La CNE2 a expressément demandé dans son rapport que l’on commence par réaliser une première tranche afin d’y voir plus clair sur les coûts. On parle aujourd’hui d’une « phase pilote », dénomination apparue à la faveur du débat public mais qui, pour la CNE2, ne renvoie pas à un pilote. Celui-ci serait une solution intermédiaire entre le laboratoire et le site définitif, alors que la phase pilote serait une première phase – autrement dit, on prévoirait de faire l’ensemble, mais on procéderait par étapes, dont la première permettrait notamment d’y voir plus clair sur les coûts. Dans son dernier rapport, la CNE2 a d’ailleurs souhaité avoir plus d’informations à ce sujet grâce à cette phase pilote.
M. le président François Brottes. Ce serait donc un prototype qui serait mis sur le marché…
M. Jacques Percebois. Ce serait la première étape d’un projet. Mais il faut partir avec l’idée de l’ensemble du projet ; l’évaluation du coût doit porter a priori sur la totalité de celui-ci.
Permettez-moi d’insister sur un autre point : il importe de bien distinguer le coût prévisionnel du stockage en tant que tel, exprimé en valeur absolue, de son coût rapporté au prix du kilowattheure ou du mégawattheure. Dans son rapport, la Cour des comptes estime que ce coût reste relativement faible – de l’ordre de 1 % à 2 % – par rapport à celui de la production du kilowattheure nucléaire, mesuré à la sortie de la centrale. Cela étant, pour un coût de stockage donné, si le facteur de charge des centrales nucléaires est modifié ou si certains réacteurs sont arrêtés, le nombre de mégawattheures évoluera et le poids relatif du stockage peut alors augmenter mécaniquement.
M. le président François Brottes. Plus on produit d’électricité nucléaire, moins le coût du stockage rapporté au mégawattheure produit est important.
M. Jacques Percebois. Ou inversement : moins on produit et plus le coût augmente.
M. le rapporteur. Vous voulez donc dire que plus l’on produit de déchets, moins ils coûtent ? C’est un peu surprenant.
M. Jacques Percebois. Si l’on considère que le coût du stockage est un coût fixe, son poids augmentera mécaniquement si le nombre de mégawattheures produit diminue. Sur le sujet, certains raisonnent en valeur absolue et d’autres en pourcentage du prix du kilowattheure. Aucune approche n’est meilleure que l’autre. J’observe simplement qu’il peut y avoir une ambiguïté.
M. le président François Brottes. Il en va de même pour l’éolien selon qu’on calcule le coût du mégawattheure installé ou celui de la production réelle. Il faut donc manier ces ratios avec précaution et toujours préciser quelle méthode on utilise.
M. Jacques Percebois. J’en viens aux modalités de financement de ces dépenses, point sur lequel la CNE2 a beaucoup insisté dans son rapport. Comme vous le savez, les producteurs de déchets doivent constituer des provisions, dont le montant devra augmenter si le coût est réévalué – et le chiffrage qui sera donné en juin aura à cet égard un impact important. Mais, si ce point est acquis, la CNE2 dispose en revanche de peu d’informations sur les modalités pratiques de ce financement. Le stockage Cigéo n’entraînera pas seulement des coûts fixes, mais aussi, pour toute la période pendant laquelle on fera entrer les déchets, des coûts d’exploitation qui sont loin d’être négligeables. En chiffres bruts, ils seront même relativement élevés.
Il y aura donc à la fois des coûts fixes et des coûts variables, dont certains seront facilement imputables à un opérateur, parce qu’ils correspondront à tel type de colis de déchets dont la provenance sera connue, tandis que d’autres coûts seront communs. Il faut donc définir une tarification qui permette de faire payer à chacun ce qu’il doit payer. Le législateur a posé le principe du pollueur payeur ; c’est donc au producteur de déchets de payer. Encore faut-il pouvoir l’identifier et définir selon quelles modalités il doit contribuer. Il faudra que l’ANDRA nous donne des informations plus précises sur le fonctionnement de ce système de financement au fur et à mesure que le site sera construit. Par exemple, paiera-t-on au moment de l’enfouissement des déchets, sachant que celui-ci peut intervenir dans soixante ans ? Il importe d’avoir la réponse à toutes ces questions.
M. le président François Brottes. Ce projet est-il créateur d’emplois ?
M. Jacques Percebois. Nous avons nous-mêmes insisté sur la nécessité de tenir compte de ce qu’on appelle les externalités. Il existe tout un programme d’accompagnement de Cigéo. Il faut en effet prendre en compte les conséquences macroéconomiques du projet, en termes de créations d’emplois, mais aussi de nuisances pour la population, avec une préoccupation : identifier ceux qui en profitent et ceux qui payent, car ce ne seront pas toujours les mêmes. On a beau se situer dans la même région, ceux qui supportent les nuisances ne sont pas nécessairement ceux qui seront indemnisés ! Il convient donc d’aller au-delà des conséquences macroéconomiques globales pour se pencher plus précisément sur ces aspects redistributifs.
On s’interroge sur les créations d’emplois à attendre selon les types d’énergie considérés. La réponse est compliquée, surtout si l’on veut prendre en compte, en sus des emplois directs, les emplois indirects, voire les emplois induits.
M. le président François Brottes. Avez-vous un chiffre en tête ?
M. Jacques Percebois. Nous ne disposons pas de chiffres.
Un débat est en cours sur un modèle d’accompagnement au niveau local. La préfecture de la Meuse est chargée de coordonner l’élaboration d’un schéma interdépartemental de développement du territoire. Il existe un rapport qui affirme qu’il y aura création d’emplois, mais cela restera sans doute assez modeste. Cela étant, la région peut profiter d’autres externalités, sous forme d’infrastructures par exemple.
Pour ce qui est de la dérive des coûts, il convient de faire la part de ce qui revient à un renforcement des contraintes de sûreté. L’ASN est de plus en plus exigeante – c’est là un des avantages objectifs du nucléaire – et une partie de l’augmentation des coûts tient donc au fait que les exigences de sûreté sont de plus en plus fortes, ce qui est une bonne chose. C’est plus ennuyeux lorsque la dérive se produit à niveau de sûreté identique, car cela signifie que l’on avait mal anticipé les opérations concernées.
Dans son dernier rapport, la CNE2 a précisé qu’elle attendait le chiffrage définitif, à savoir celui qui doit se substituer aux 16,5 milliards d’euros dont nous avons parlé. Elle a par ailleurs demandé à l’ANDRA de se pencher sur ce qu’il en est dans d’autres pays en matière de financement et de coûts, mais, s’agissant du stockage, les comparaisons sont délicates car il existe encore peu d’expériences étrangères et chacune est en quelque sorte un prototype. Nous avons quelques éléments venant de Suède et de Finlande mais, en l’état, les choix faits dans ces pays sont assez différents des nôtres. Les comparaisons seront sans doute plus aisées pour ce qui touche au démantèlement.
Comme je l’ai dit, la CNE2 fait des recommandations et demande des précisions à l’ANDRA sur sa méthode d’évaluation du coût de Cigéo.
M. le rapporteur. Vous indiquez que nous devrions connaître à la fin de juin le nouveau chiffrage arrêté par le ministère. N’est-ce pas en contradiction avec le fait que l’ANDRA dispose de trois mois, à compter de la publication du compte rendu et du bilan du débat public, pour indiquer les suites qu’elle entend donner au projet ? Sachant qu’il faudra ensuite que le Gouvernement définisse une position, cette échéance de fin juin vous paraît-elle vraiment réaliste ? D’autre part, le chiffrage du Gouvernement portera-t-il sur le seul coût de l’investissement, ou aussi sur le coût de fonctionnement pour toutes les années à considérer ?
Quant à la distinction entre « pilote » et « phase pilote », c’est un sujet à traiter d’urgence. L’ANDRA prendra certainement position sur la question. En effet, les implications ne sont pas du tout identiques dans les deux cas. Si je comprends bien, opter pour la phase pilote emporte la décision de tout faire en échelonnant la réalisation. Pour ma part, j’avais plutôt retenu du débat public et de l’audition de la CNE2 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) qu’il y avait besoin d’un pilote pendant une quinzaine d’années pour voir comment cela fonctionnait avant de prendre une décision pour la suite. Vous nous dites que la CNE2 serait favorable à une phase pilote plutôt qu’à un pilote. J’aimerais savoir si elle a défini cette position avant le compte rendu et le bilan du débat public ou après, et comment elle tient compte de ce qui a été dit par les citoyens.
Nous étions hier à La Hague. Selon AREVA, stocker directement les produits des réacteurs coûterait à peu près la même chose que les retraiter et produire du MOX. Comme nous l’a dit tout à l’heure M. Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le retraitement n’a donc d’intérêt que si l’on se place dans la perspective d’une quatrième génération : en dehors de cette hypothèse, la réduction du volume de déchets n’aurait que peu d’avantage au regard du coût qu’elle engendre. J’aimerais connaître votre analyse d’économiste, car ce point a des implications directes sur le dimensionnement de Cigéo. Selon vous, cette évaluation peut-elle être validée ?
L’ASN et l’IRSN nous ont indiqué cet après-midi que la démonstration de sûreté n’était pas faite, et que de nombreuses questions restaient posées, par exemple sur le risque d’incendie ou sur la résistance des alvéoles dans le temps. Partagez-vous leur sentiment ?
Il nous a aussi été dit à plusieurs reprises – notamment par l’IRSN, par l’ASN et par le CEA – que le calendrier prévu dans la loi de 2006 devait être modifié, parce qu’il serait un peu incohérent de demander un dossier à l’ANDRA avant que ne soit votée une loi sur la réversibilité et la récupérabilité. Quel est votre avis sur ce point ? Lors de l’audition de la CNE2 par l’OPECST, j’avais demandé à quels éléments les parlementaires devraient être attentifs en matière de réversibilité ; son président m’avait répondu que la CNE2 aimerait être saisie sur ce point, ce qui m’avait stupéfié. Je n’avais pas envisagé que cette question puisse ne pas être étudiée par votre commission !
Le président Brottes a peut-être été un peu… incisif tout à l’heure, mais convenez que les parlementaires ne peuvent décider seuls de tout ce qu’il faudrait mettre sous le terme « réversibilité » : il faudra bien que les techniciens compétents nous éclairent sur de grandes lignes et sur les diverses options possibles. Il est pour le moins inquiétant que la CNE2 n’ait pas été saisie sur le sujet, alors même que le Parlement est censé voter une loi l’année prochaine…
Enfin, quelle est votre analyse sur les provisions constituées par les entreprises ? Nous savons qu’elles l’ont été en fonction d’un coût de 15 milliards que la Cour des comptes et vous jugez sous-évalué. Il en résulte qu’elles sont, elles aussi, sous-évaluées, ce qui n’est pas sans poser problème. Même si, comme vous l’indiquez, l’impact sur le kilowattheure n’est pas très important, il s’agit bien de faire payer au consommateur – dès l’instant où il utilise l’électricité – l’ensemble des coûts, et non de les reporter sur d’autres. La juste évaluation des provisions est donc une question cruciale, ne serait-ce que d’un point de vue éthique.
M. Jacques Percebois. En tant que membre observateur du groupe de travail qui a été constitué à la DGEC, j’ai demandé plusieurs fois quand le nouveau chiffrage serait connu. Il m’a été répondu qu’il le serait en principe fin juin 2014. Mais vous avez raison, monsieur le rapporteur : compte tenu de toutes les contraintes que vous avez rappelées, il sera difficile de tenir le délai. Deux nouvelles réunions du groupe de travail sont prévues d’ici au mois de mai ; j’ignore cependant si la ministre sera en mesure de donner un chiffre à la date prévue.
Parlant du coût de Cigéo, nous parlons bien d’un coût brut, qui comprend non seulement une estimation du coût de construction, mais aussi une estimation des coûts de fonctionnement – qui peuvent aller d’un tiers à 40 % du total. Bien entendu, il faut dissocier les coûts bruts des coûts actualisés, les dépenses devant s’échelonner dans le temps. Mais je raisonne en coût brut, c’est-à-dire sur l’ensemble des coûts.
M. le président François Brottes. Comment procéder en pratique ? On ne peut pas additionner le coût de fonctionnement au coût d’investissement en une fois.
M. Jacques Percebois. Nous procédons par estimation des besoins annuels, en personnel par exemple.
M. le président François Brottes. Vous estimez donc, sur une base annuelle, un siècle de coûts de fonctionnement, et vous ajoutez cela au coût d’investissement ?
M. Jacques Percebois. Oui.
M. le rapporteur. Est-ce ce qui a été fait pour l’évaluation de 15 milliards ?
M. Jacques Percebois. De 16,5 milliards. Oui.
La question de la phase pilote est cruciale. Sur ce point, la position de la CNE2 a été constante : elle n’a jamais parlé de « pilote », et n’a parlé de « phase pilote » qu’à la suite du débat public. Dans ses rapports, il n’a été question que de « première phase ».
Depuis peu, l’ANDRA parle de « phase pilote ». Ce terme est ambigu, car il peut laisser penser que la phase pilote est un pilote. Or ce sont deux choses différentes. Opter pour la phase pilote signifie que l’on prévoit l’ensemble du projet, mais que, parce qu’on ne sait pas tout faire, on se concentre sur la première étape, dont les coûts pourront plus aisément être estimés. C’est donc une première phase, qui a valeur d’apprentissage. Je rappellerai à ce propos que la CNE2 a toujours insisté sur la nécessité d’avoir une vision flexible des choses, car des ajustements seront probablement inévitables. Dans la phase pilote, on prévoit donc le projet dans sa globalité, et on construit au fur et à mesure ce qui est nécessaire. Le pilote est autre chose ; cela consisterait à faire un mini-Cigéo.
M. le rapporteur. En termes de sûreté, cela ne peut aboutir à la même démonstration. Si l’on fait un pilote, l’autorité de sûreté pourra constater qu’il fonctionne alors que, dans le schéma de phase pilote tel que vous l’expliquez, elle devra se prononcer avant même que l’on bénéficie d’un retour d’expérience sur quelques années de fonctionnement. Je ne pense pas que ce soit son souhait.
M. Jacques Percebois. Il appartiendra à l’ASN de se prononcer. Mais jusqu’à présent, le terme de « pilote » n’a jamais été employé dans les rapports de la CNE2, qui lui préférait l’expression « première phase ». C’est d’ailleurs depuis peu que, comme je l’ai dit, l’ANDRA utilise l’appellation « phase pilote ». Dans notre esprit, il ne s’agit pas d’un pilote, mais d’une phase pilote. Cela étant, on peut changer d’avis et, en tout état de cause, je le répète, l’ASN tranchera.
Concernant La Hague, je suis d’accord avec ce qui vous a été dit hier. L’arrêt du retraitement et le stockage en l’état ne modifieraient pas fortement les choses. Cela signifierait bien sûr que l’on renonce à la quatrième génération, ainsi qu’à l’idée de profiter d’autres éléments de la filière, mais cela n’aurait pas une grande incidence sur les coûts. Simplement, il faut le prévoir ; à l’heure actuelle, en effet, l’enfouissement du MOX en tant que tel n’est pas envisagé. La CNE2 a toutefois demandé que soit ménagée une certaine flexibilité afin de pouvoir, le cas échéant, stocker un peu plus que prévu.
Je suis également d’accord pour dire que la démonstration de sûreté n’est pas faite. La CNE2 n’a jamais prétendu que nous maîtrisions tous les paramètres. Au contraire, elle est extrêmement vigilante : lors de chaque audition, elle cherche à savoir où nous en sommes sur les risques, d’incendie ou autres. En l’état actuel des choses, nous n’avons pas la réponse à ces questions. Nous avons donc appelé l’attention sur la nécessité d’avancer sur ces points. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la CNE2 qui donnera le feu vert, mais bien l’ASN.
La CNE2 a rédigé une note sur la réversibilité. Ce terme de « réversibilité » est un terme compliqué qui n’est pas compris de la même façon par tous. Pour certains, il signifie qu’on pourra aller rechercher ce qu’on voudra quand on voudra. Ce n’est pas très réaliste. Certes, on peut toujours aller rechercher, mais cela coûtera très cher. Ce qui est certain, c’est que le site de stockage devra être fermé un jour, au bout de cent ou cent vingt ans – c’est en tout cas la position de la CNE2. La réversibilité signifie que s’il y a un problème avec un colis de déchets, on doit pouvoir aller le rechercher. Il faut donc maintenir des options de flexibilité à cette fin, mais il faut aussi avoir conscience que plus le temps passe, plus ce sera difficile.
M. le président François Brottes. Permettez-moi de vous arrêter : il y a une loi. Ce n’est pas à la CNE2 de dire ce que le législateur a dit. Or ce que dit la loi, c’est que le jour où on aura trouvé une solution pour retraiter les déchets qu’on ne savait pas traiter auparavant, il faut avoir la possibilité de les récupérer pour les traiter. Que je sache, la loi se fait au Parlement, et non dans les commissions, quelle que soit la qualité de leurs membres. Il ne s’agit pas de réécrire la définition que le législateur a pensée, avec toutes les nuances qu’ont voulu exprimer des parlementaires qui sont, je vous l’accorde, des généralistes. L’idée est bien que si l’on enfouit des déchets, il faut pouvoir revenir sur cet enfouissement le jour où on saura les traiter, en neutraliser les effets nocifs, et non, comme vous venez de le dire, d’aller rechercher un colis sur lequel se poserait un problème. J’étais présent lors du débat sur la loi de 2006 – pour lequel je vous renvoie au Journal officiel – et je me souviens très bien de ce qui a été dit et décidé alors. Je conçois qu’on puisse le regretter, mais la définition de la réversibilité aujourd’hui en vigueur est bien celle-là.
M. Jacques Percebois. La récupérabilité peut être conçue pour le jour où on sera capable de traiter les déchets grâce à des technologies nouvelles ; mais elle peut aussi être utile en cas de problème avec un colis.
M. le président François Brottes. Je vous accorde que l’un n’empêche pas l’autre.
M. Jacques Percebois. Les provisions actuelles sont calculées sur la base des chiffres actuels ; on ne peut le reprocher aux producteurs mais, si le coût du stockage est revu à la hausse, ils devront bien entendu les réévaluer.
La Cour des comptes a insisté sur un autre élément : la nécessité de s’assurer que ces provisions sont bien constituées d’actifs dédiés sécurisés. La CNE2 a fait de même dans ses rapports : les provisions doivent être adaptées au coût du stockage et constituées d’actifs dédiés, sécurisés sur le très long terme.
Mme Frédérique Massat. Dans son rapport de fin 2013, la CNE2 « observe que la réunion de restitution par l’ANDRA du 21 mai 2013 visait à statuer sur les choix structurants pour le projet industriel Cigéo, alors que son esquisse avait déjà été présentée au Gouvernement, et ce quelques jours seulement avant le lancement d’un débat destiné à recueillir les observations du public. Il lui semble que ce mode de fonctionnement n’est pas satisfaisant. À l’avenir, la concertation souhaitable avec les producteurs, menée dans le respect des prérogatives des diverses parties prenantes, devrait être conduite suffisamment en amont de tout dépôt de dossier, notamment celui de la demande d’autorisation de création du stockage prévue à la fin de 2014. » Suite à ces observations, avez-vous constaté des évolutions ? Souhaitez-vous qu’à la faveur des projets de loi qui nous seront soumis, notamment sur la transition énergétique la gouvernance soit affinée dans ce domaine ?
M. Jacques Percebois. Nous avons en effet regretté d’avoir été informés trop tardivement pour pouvoir nous prononcer valablement. Nous l’avons dit de manière un peu abrupte dans le rapport. Il ne serait pas inutile que le législateur mette « les points sur les i ».
M. le président François Brottes. Nous allons nous y employer. Je vous enverrai aussi une copie des débats parlementaires sur la réversibilité. Vous n’êtes pas le premier à réécrire l’histoire sur ce point et je dois dire que cela m’inquiète un peu sur l’importance qu’accordent les experts à la législation en vigueur, et donc aux représentants du peuple…
Il me reste à vous remercier d’avoir livré vos remarques à la commission d’enquête.
Audition de M. Sylvain Granger, directeur de la division Combustible (EDF)
(Séance du 10 avril 2014)
M. le président François Brottes. Chers collègues, je vous informe que j’ai demandé au président de l’Assemblée s’il était possible de prolonger notre commission d’enquête. Mon courrier reste à ce jour sans réponse, ce qui n’augure pas d’une issue positive : nous devrons certainement mener à bien nos travaux dans les six mois qui nous sont impartis par le règlement.
La commission d’enquête s’intéresse aujourd’hui aux réacteurs de quatrième génération et au MOX, un combustible recyclé qui participe de l’économie circulaire chère au rapporteur, et dont nous avons pu observer l’élaboration lors de notre visite des sites de La Hague et de Marcoule.
Nous recevons à nouveau M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible » d’EDF, pour qu’il nous éclaire sur l’intérêt économique et stratégique que trouve l’entreprise dans la filière MOX, alors que d’autres opérateurs du nucléaire n’ont pas fait ce choix. Pour l’élaboration du MOX, EDF fait appel à AREVA, qui travaille aussi pour d’autres acteurs de la production d’énergie nucléaire.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Sylvain Granger prête serment)
M. Sylvain Granger, directeur de la division « Combustible » d’EDF. Le combustible nucléaire prend la forme d’un assemblage de tubes dans lequel sont insérées des pastilles d’uranium. Après avoir produit de l’énergie pendant quatre à cinq ans, il est déchargé du réacteur. Dans le combustible usé, l’uranium enrichi initial contenu dans les pastilles a été remplacé par une matière composée de 4 % de déchets de haute activité constituant les cendres de la combustion nucléaire, de 1 % de plutonium produit pendant la combustion, et de 95 % d’uranium résiduel, comparable à de l’uranium non enrichi. Les parties métalliques contenant la matière nucléaire, qui ont été exposées à la radioactivité, constituent des déchets de moyenne activité à vie longue.
EDF fait traiter ces combustibles usés par AREVA sur le site de La Hague. Ce traitement permet de séparer les déchets ultimes des matières recyclables – l’uranium et le plutonium.
Les déchets ultimes sont conditionnés selon des procédés qui permettent de prévenir le risque de dispersion sur une très longue durée, comme la vitrification. Une fois conditionnés, ils sont placés dans des entreposages de subsurface dont la durée de fonctionnement peut atteindre cent ans.
Le plutonium est recyclé via la fabrication du combustible MOX. Alors qu’un combustible standard contient de l’uranium enrichi, le MOX est constitué d’un mélange de plutonium, à raison de 8,5 %, et d’uranium appauvri. Aujourd’hui, vingt-quatre réacteurs sont autorisés à charger ce type de combustible à hauteur de 30 % du combustible total, le reste étant constitué de combustible standard à l’uranium naturel enrichi.
L’uranium récupéré à l’issue du traitement, appelé uranium de retraitement, est comparable à de l’uranium naturel du point de vue énergétique. Il peut donc être recyclé en substitut de l’uranium naturel à condition d’être de nouveau enrichi. EDF ajuste le volume de recyclage en fonction de ses anticipations en matière d’approvisionnement en uranium naturel.
Le système industriel de traitement-recyclage qui fonctionne aujourd’hui a été mis en service, pour l’essentiel, au cours des années 90. Les volumes de combustible usé traités chaque année ont été progressivement adaptés aux capacités de recyclage afin de ne pas extraire de plutonium qui ne soit pas recyclé dans un délai court. Les volumes de traitement sont passés de 850 tonnes par an pour vingt réacteurs chargés en MOX en 2010 à 1 000 tonnes pour vingt-quatre réacteurs pouvant recycler du plutonium aujourd’hui.
Pour EDF, le traitement-recyclage du combustible usé est avant tout un mode de gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, qui permet d’en diviser le volume par dix, d’adapter le conditionnement à leur durée de vie et de garantir un entreposage sûr dans un espace limité. Le recyclage permet également de réduire les besoins du parc nucléaire en uranium naturel. Il contribue ainsi à la sécurité de notre approvisionnement.
Les combustibles MOX usés ne sont pas recyclés dans les réacteurs actuels ou dans ceux de troisième génération : fonctionnant selon une technologie à spectre thermique, ces réacteurs ne sont pas adaptés au recyclage du plutonium contenu dans le MOX usé. En revanche, la réserve de plutonium qu’ils contiennent pourrait être exploitée par les réacteurs de quatrième génération qui fonctionnent selon des principes physiques différents – ce sont des réacteurs à spectre rapide. Dans ce cas, le traitement du combustible MOX permettrait de mobiliser rapidement le plutonium nécessaire pour amorcer la combustion de l’uranium appauvri et ainsi de pratiquement se libérer de toute contrainte liée aux ressources en matières premières pour la production d’électricité.
M. le président François Brottes. À ce stade, il est nécessaire que vous précisiez vos propos : selon vous, l’EPR n’aurait pas vocation à utiliser le MOX, alors que nous avons eu des informations contraires.
La quatrième génération s’inscrit dans une logique de réduction des déchets, grâce au recyclage, et de fin de dépendance énergétique, grâce au recyclage presque infini de l’uranium – ce qui pourrait ne pas plaire aux tenants de la sortie du nucléaire. Ai-je bien compris ?
M. Sylvain Granger. Il convient de distinguer le MOX neuf et le MOX usé. Dans un premier recyclage, le plutonium issu du combustible standard usé est utilisé dans la fabrication du combustible MOX auquel les réacteurs actuels sont tout à fait adaptés. L’EPR a même été conçu pour pouvoir effectuer ce recyclage de manière plus importante.
En revanche, tant l’EPR que les réacteurs actuels ne sont pas adaptés à un deuxième recyclage, celui du plutonium issu des combustibles MOX usés. En raison des principes physiques qui régissent ces réacteurs, le recyclage permanent ne présente pas d’intérêt industriel ou énergétique. En revanche, pour les réacteurs à spectre rapide, le recyclage à répétition est pertinent. Ces derniers ont la capacité d’utiliser le plutonium pour amorcer la combustion de l’uranium appauvri. L’intérêt des réacteurs de quatrième génération réside dans cette utilisation des ressources en matières premières.
La teneur en éléments combustibles de l’uranium naturel est de 1 % ; on utilise donc seulement 1 % de la matière qui est extraite des mines. Le reste, l’uranium dit appauvri, peut être utilisé en partie, mais, in fine, il restera des quantités importantes d’uranium très appauvri qui ne peut pas être utilisé dans les réacteurs actuels. En revanche, il pourrait faire office de combustible dans les réacteurs à spectre rapide, le plutonium servant d’allumette pour amorcer la combustion.
L’intérêt de conserver les combustibles MOX usés est de pouvoir mobiliser rapidement le plutonium dont on aurait besoin pour cette opération. Les quantités d’uranium appauvri qui pourraient alors être consommées dans ces réacteurs sont si importantes que cela reviendrait presque à s’affranchir des contraintes liées aux ressources énergétiques et à utiliser la totalité de l’uranium extrait des mines.
M. le président François Brottes. En résumé, et en essayant de ne pas trop caricaturer, le MOX « saison 1 », qui permet de diminuer les déchets et de sécuriser les approvisionnements, est accessible à tous ; le MOX « saison 2 » pourrait être utilisé par des réacteurs conçus différemment et n’a pas vocation à rejoindre les centres de stockage profond à brève échéance.
M. Denis Baupin, rapporteur. Pouvez-vous confirmer qu’il n’est pas prévu de charger en MOX le réacteur EPR de Flamanville ? Qu’en est-il pour ceux d’Olkiluoto en Finlande et de Taishan en Chine ?
Selon Bernard Laponche, le MOX est un million de fois plus radioactif que l’uranium, son taux de radioactivité et sa température rendent sa manipulation plus compliquée et, en cas d’accident, sa présence dans le réacteur et les piscines aggrave les conséquences possibles. M. Laponche considère que le recours au MOX permet de réduire de 15 % seulement la quantité de plutonium produite initialement. Que pensez-vous de cette appréciation des contraintes liées à l’utilisation du MOX ?
Lors de votre précédente audition, je vous avais interrogé sur les coûts respectifs du combustible standard et du MOX. Vous aviez répondu qu’ils étaient équivalents. Or, dans le courrier que vous m’avez adressé pour préciser votre réponse, vous indiquez que le coût par kilo de combustible est presque identique, mais que, pour un même service énergétique, le MOX coûterait cinq fois plus cher. Je vous demande donc de clarifier votre réponse. Quelle est, selon vous, la filière combustible la plus intéressante en termes de coût ?
Aux dires de certains, le stockage direct du combustible usé serait moins coûteux que le retraitement et le MOX. Qu’en pensez-vous ?
Vous avez été peu disert sur la quatrième génération, ce qui semblerait corroborer les rumeurs sur les réserves d’EDF à ce sujet. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Selon l’ASN et l’IRSN, la quatrième génération n’aurait de sens que si elle permettait à la fois de réutiliser le combustible et d’améliorer significativement la sûreté par rapport à la troisième génération. Cela implique de réussir un saut technologique et un saut en matière de sûreté tout en restant compétitif. Si les solutions technologiques sont trouvées, Jacques Repussard, le directeur général de l’IRSN, envisage un déploiement de la quatrième génération vers la fin du siècle. Êtes-vous fixé sur ce même horizon de temps, qui paraît assez éloigné ?
M. Sylvain Granger. S’agissant du MOX et de l’EPR, nous essayons de progresser par étape, et d’abord de démarrer des EPR. Dans un premier temps, nous avons demandé des autorisations pour l’utilisation de combustible à l’uranium enrichi, avec l’idée de les obtenir ensuite pour le MOX. Comme je l’ai dit, l’EPR est le premier réacteur conçu pour charger du MOX et les options de sûreté ont intégré cette contrainte. Quant aux Chinois, s’ils envisagent de construire une installation de retraitement à grande échelle, c’est bien parce qu’ils ont l’intention d’utiliser du MOX.
Pour charger en MOX un réacteur qui n’a pas été conçu initialement pour cette utilisation, il est nécessaire d’en modifier un certain nombre de paramétrages et d’éléments matériels, par exemple en ajoutant des grappes de commande. Il faut également déterminer le pourcentage de MOX qui peut être introduit dans le réacteur de sorte que le combustible d’ensemble soit sûr, acceptable et adapté. Ces contraintes expliquent que tous les réacteurs ne sont pas autorisés à charger du MOX. Pour obtenir les autorisations, il nous a fallu constituer un dossier de sûreté démontrant que toutes les conditions posées par la loi en matière de sûreté nucléaire étaient remplies.
S’agissant du coût du MOX, le courrier auquel vous avez fait référence est peut-être rédigé de manière maladroite. Il indique que le prix des services de fabrication du combustible MOX est significativement supérieur au prix des services de fabrication du combustible UOX rendant un service énergétique comparable. Or, lors de la précédente audition, j’avais indiqué que le coût du combustible à l’uranium enrichi ne se résume pas au coût de fabrication. Alors que le combustible MOX permet d’utiliser directement du plutonium sans devoir l’acheter, le convertir ou l’enrichir, dans le cas du combustible à l’uranium enrichi, il faut acheter l’uranium naturel, le convertir et l’enrichir. La somme des coûts – approvisionnement, conversion, enrichissement et fabrication – pour l’uranium enrichi est équivalente au coût de fabrication du MOX, qui est la seule composante du coût final. Même si le coût de fabrication du MOX est supérieur, les coûts complets des deux combustibles sont comparables.
Quant à la comparaison économique des deux filières de gestion des déchets, l’une par traitement, l’autre par stockage direct, elle doit tenir compte du fait que le stockage direct n’intervient en réalité qu’après conditionnement du combustible. La Suède est probablement le pays le plus avancé dans cette voie, mais le procédé technologique n’est pas encore arrivé à maturité. Les combustibles conditionnés sans traitement sont dix fois plus volumineux et leur stockage est donc plus coûteux.
De nombreuses études internationales comparent de manière un peu théorique les différentes options. Elles montrent que le conditionnement représente 40 à 50 % du coût complet du stockage direct, le stockage en lui-même coûtant deux fois plus cher pour le combustible que pour les colis conditionnés après traitement. Pour ces derniers, les économies réalisées sur le stockage compensent le coût du traitement. Il ressort donc de ces études une équivalence entre le coût du traitement et celui du stockage direct, étant entendu que des incertitudes importantes subsistent, la première concernant le stockage, que personne n’a encore exploité à ce jour, qu’il s’agisse de combustible usé ou de colis.
Il convient de considérer avec prudence l’argument de l’économie du stockage : il ne faudrait pas donner en quelque sorte une prime à celui qui n’a rien fait. Pendant que certains, comme la France, s’activent à chercher des solutions, d’autres font le choix de l’entreposage en attendant que les premiers trouvent. Dans ces conditions, cela coûte nécessairement plus cher de faire quelque chose que de ne rien faire. C’est pourquoi il est important de replacer l’économie du stockage dans la logique industrielle dans laquelle les différents pays se sont engagés.
M. le rapporteur. La logique française repose sur le pari de l’avènement d’une quatrième génération. Sans elle, le volume important de plutonium produit posera d’énormes problèmes de stockage.
M. Sylvain Granger. La réponse est non.
Sans quatrième génération, tous les combustibles seront traités, sauf le MOX qui ne peut pas être recyclé dans les réacteurs actuels ou de troisième génération.
Dans l’inventaire national des matières et déchets radioactifs publié par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sont présentés deux scénarios très contrastés : le premier envisage la poursuite de la production nucléaire avec un parc fonctionnant pendant cinquante ans et le traitement de l’ensemble des combustibles, MOX compris – implicitement, ce scénario prend donc en compte la quatrième génération ; le second scénario prend pour hypothèse l’arrêt du nucléaire après quarante ans de fonctionnement du parc et l’arrêt anticipé du traitement en 2019 pour éviter un stock de plutonium séparé sur étagère, considérant qu’il n’y aucune raison de séparer du plutonium si les perspectives de recyclage disparaissent.
Dans le premier scénario, les déchets ultimes représentent 80 000 mètres cubes – 10 000 mètres cubes de déchets de haute activité sous forme de colis vitrifiés et 70 000 mètres cubes de déchets de moyenne activité à vie longue, constitués des parties métalliques notamment. Dans l’autre scénario, sont récupérés 3 500 colis de déchets vitrifiés, plus 50 000 assemblages de combustibles UOX qui n’ont pas été traités et 6 000 combustibles MOX, le tout représentant environ 90 000 mètres cubes, auxquels il faut ajouter 60 000 mètres cubes de déchets de moyenne activité à vie longue. Au final, le volume total des déchets atteint 80 000 mètres cubes dans le premier scénario et 150 000 dans le second ; mais la comparaison la plus pertinente, selon moi, concerne les déchets de haute activité, qui concentrent l’essentiel de la radioactivité : 10 000 mètres cubes pour une durée de fonctionnement du parc de cinquante ans et la mise en service de générateurs de quatrième génération, contre 90 000 mètres cubes pour un parc arrêté à quarante ans. Quel que soit le scénario, le nombre de combustibles MOX après quarante ans de fonctionnement est très restreint : 6 000 assemblages, donc 3 000 tonnes, sachant que 1 200 tonnes de combustible sont utilisées chaque année. Sans traitement, les déchets combustibles seraient donc plus importants.
M. le rapporteur. Qu’en est-il de l’impact économique ? Vous avez bien démontré que les déchets sont plus importants dans un cas que dans l’autre, mais vous ne prenez pas en compte le processus de retraitement, le transport, et autres. Quel est le scénario le plus économique ?
M. Sylvain Granger. D’un point de vue théorique, si vous n’avez pas encore fait de choix entre traitement puis stockage, d’une part, et stockage direct après conditionnement du combustible, d’autre part, les deux solutions, indépendamment des incertitudes techniques, sont équivalentes.
D’un point de vue pratique et industriel, j’insiste, la France a fait un choix : les investissements ont été faits, les installations de traitement existent et sont récentes. Dès lors qu’une politique industrielle a été décidée, en changer est extrêmement coûteux : non seulement on détruit de la valeur en ne laissant pas aux investissements le temps d’être rentabilisés, mais il faut en consentir de nouveaux. En outre, la solution du stockage direct est plus complexe à mettre en œuvre en raison de déchets plus volumineux et en plus grand nombre.
M. le président François Brottes. Notre question était sans doute théorique puisque, d’après vous, la filière de traitement existante est déjà en partie amortie. Mais nous sommes obligés de faire de la théorie pour comparer les options. Vous n’avez pas répondu sur les dangers du MOX mis en avant par M. Laponche.
M. Sylvain Granger. Il faut distinguer le danger et le risque. En effet, le niveau de radioactivité du MOX est supérieur à celui des combustibles à l’uranium naturel enrichi. Est-on capable de gérer un combustible un peu plus radioactif ?
M. le rapporteur. Un peu plus ou un million de fois plus radioactif ?
M. Sylvain Granger. Je n’ai pas les ordres de grandeur, mais peu importe ; ce qui compte, c’est le résultat pratique. Aujourd’hui, des réacteurs sont autorisés à charger du MOX, et des gens manipulent ce combustible tous les jours. Les précautions que nous prenons ne sont pas celles prévues pour l’uranium naturel enrichi ; les modes de gestion sont plus contraignants.
Du point de vue de la sûreté, nous avons obtenu les autorisations car nous avons démontré notre capacité à gérer les risques et à mettre en place des dispositions adaptées. Du point de vue économique, ces adaptations ont un coût, mais celui-ci est intégré dans le coût total que j’évoquais précédemment, qui permet de conclure à une économie à peu près comparable.
M. Michel Sordi. Sur quels critères les réacteurs pouvant charger du MOX ont-ils été choisis ?
Comment le pourcentage de 30 %, correspondant à la proportion de MOX dans le combustible utilisé, a-t-il été déterminé ? Cette part est-elle ajustée dans chaque réacteur ?
S’agissant des réacteurs de quatrième génération, combien de temps pourrions-nous fonctionner grâce au recyclage du stock de combustible usé ? Pensez-vous que ces réacteurs verront le jour à la fin du siècle, comme le pensent l’IRSN et l’ASN ? Où en sont les recherches ?
Mme Frédérique Massat. Quels sont les réacteurs pour lesquels vous avez dernièrement obtenu une autorisation ? De nouvelles demandes ont-elles été déposées ?
La catastrophe de Fukushima a-t-elle eu pour conséquence d’ajouter des contraintes supplémentaires pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation ?
M. Sylvain Granger. Puisque les réacteurs actuels n’ont pas été conçus pour fonctionner au MOX, nous devons étudier les adaptations technologiques nécessaires, leur faisabilité – par exemple, y a-t-il la place de rajouter les grappes de commande nécessaires ? – et leur coût. Ensuite, nous constituons un dossier de sûreté afin de vérifier que les marges de sûreté sont suffisantes.
Les réacteurs pouvant être chargés en MOX sont ceux du parc 900 mégawatts, à l’exception des six premiers, soit vingt-huit réacteurs. Aujourd’hui, vingt-quatre d’entre eux ont obtenu l’autorisation. Nous avons choisi de réserver les quatre autres réacteurs, ceux de Cruas, pour recycler l’uranium de retraitement qui représente, je le rappelle, 95 % du combustible usé.
La part de 30 % de MOX dans le combustible total correspond à un compromis qui permet de limiter les adaptations matérielles nécessaires et de disposer de marges de sûreté suffisantes. Les études sur l’EPR envisagent une proportion entre 50 et 100 %.
Les derniers réacteurs autorisés à charger du MOX sont ceux de Blayais 3 et 4, et précédemment ceux de Gravelines 5 et 6. Depuis 2010, nous sommes passés de vingt à vingt-quatre réacteurs autorisés.
L’intérêt principal de la quatrième génération pour un énergéticien réside dans sa capacité à repousser les limites en termes de ressources en matières premières. Même si les contraintes sont moins fortes pour la production d’électricité d’origine nucléaire que pour d’autres types de production énergétique, les ressources sont néanmoins épuisables. En outre, elles sont loin d’être utilisées dans leur intégralité puisque, sur une tonne d’uranium extrait, 1 % seulement est brûlé dans un réacteur actuel. L’enjeu est de faire quelque chose des 99 % d’uranium restant.
Théoriquement, la quatrième génération peut utiliser l’uranium appauvri, à condition que la combustion soit amorcée par du plutonium. Cette capacité théorique a été démontrée puisque des réacteurs à spectre rapide ont fonctionné en France. La question est donc de savoir quand nous aurons envie de nous affranchir des limites imposées par les ressources en matières premières.
Pour la production d’électricité d’origine nucléaire, les ressources sont importantes et il n’y a pas d’urgence à se doter de réacteurs de quatrième génération avant 2050. Néanmoins, il faut pouvoir les développer dans le marché global de la production d’énergie sur lequel ils seront en compétition avec des réacteurs de troisième génération et de nombreuses autres sources de production d’électricité. Ils seront donc soumis à une double exigence de rentabilité et de sûreté garantissant un niveau au moins équivalent à celui des réacteurs de la génération précédente. Compte tenu de l’importance des travaux de recherche et d’ingénierie restant à mener pour satisfaire l’ensemble des exigences, fixer un horizon à 2050 semble plutôt salutaire car, avant de pouvoir envisager un déploiement industriel, il faudra passer par les prototypes et les expérimentations.
M. le rapporteur. S’agissant de Superphénix, l’ASN et l’IRSN considèrent que certains problèmes de sûreté n’avaient pas été résolus. On ne peut donc pas dire que l’expérience a été un grand succès. M. Accoyer a pour habitude de faire endosser aux écologistes la responsabilité, que j’assume, de la fermeture de Superphénix. Qu’on me permette tout de même de rappeler que, dès 1994, sous le gouvernement Balladur, l’installation a été déclassée en laboratoire de recherche, ce qui tend à indiquer que ni sa capacité à produire de l’électricité ni sa sûreté n’ont été démontrées. Je n’en tire pas de conclusion, mais il me semble hasardeux de tirer de cet exemple des assurances pour la quatrième génération.
Sur quelles hypothèses fondez-vous votre calcul sur les coûts respectifs du retraitement et du stockage direct ? Vous appuyez-vous uniquement sur l’exemple suédois ou également sur les évaluations de l’ANDRA relatives au projet Cigéo ? Dans ce cas, prenez-vous en compte le devis à 15 milliards d’euros ou celui à 36 milliards ?
M. Sylvain Granger. Je n’ai pas dit que toutes les démonstrations de sûreté avaient été faites, notamment avec Superphénix, pour la quatrième génération. J’ai fait référence à l’expérience Phénix qui, me semble-t-il, a été un véritable succès. Sur Superphénix, l’appréciation peut être contrastée : il y a eu des difficultés techniques qui ne doivent pas être sous-estimées, mais d’autres paramètres s’y sont ajoutés, vous l’avez rappelé. Mon propos tendait à souligner que la capacité à réaliser la combustion dans les réacteurs à spectre rapide était démontrée. Évidemment, il ne suffit pas de reproduire ce qui a déjà été fait pour obtenir les réacteurs de quatrième génération. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué qu’il restait beaucoup de travail pour respecter les nombreux critères. Nous apprenons beaucoup des expériences antérieures, des difficultés et des échecs. Dès lors que l’horizon est lointain, nous avons le temps d’approfondir l’ensemble des leçons tirées de cette expérience industrielle.
S’agissant des coûts, j’ai cité des études publiques, qui ne sont pas celles d’EDF mais de l’OCDE, des Suédois ou encore des Américains, et qui sont majoritairement centrées sur le stockage direct. Les études comparatives ont été principalement réalisées en France, en Belgique et en Allemagne.
Les études sur le stockage direct, qui portent sur des projets aux caractéristiques technologiques différentes – la Suède envisage un stockage dans du granit, la Belgique et la France dans de l’argile, les États-Unis, dans une roche volcanique –, aboutissent aux mêmes ordres de grandeur. À périmètre comparable dans la mesure du possible, les évaluations des coûts de stockage offrent des résultats homogènes avec les 15 milliards retenus par les pouvoirs publics français en 2005.
M. le rapporteur. Si le chiffre est de 36 milliards, le calcul n’est plus le même ?
M. Sylvain Granger. Évidemment, le calcul n’est plus le même non plus si le chiffre est de 70 milliards ou de 1 milliard.
M. le rapporteur. Je me permets simplement de citer les chiffres de la Cour des comptes.
M. Sylvain Granger. Comme je l’ai rappelé la semaine dernière, le chiffre de 36 milliards correspond à un chiffrage intermédiaire de l’ANDRA. L’Agence a elle-même précisé, me semble-t-il, que ce chiffre n’avait pas de signification particulière. Aujourd’hui, cent pistes d’optimisation ont été identifiées. En travaillant sur 20 % de ces pistes, on peut déjà espérer des économies de plusieurs milliards d’euros ; en travaillant sérieusement sur l’ensemble des pistes, nous avons bon espoir de revenir au chiffre officiel de 15 milliards d’euros qui s’impose à EDF.
M. le président François Brottes. Même si ce sujet n’est pas le cœur de notre commission d’enquête, je souhaiterais que nous nous arrêtions un instant sur la question de la prolifération, qui est inhérente à la filière nucléaire.
Les visites que nous avons effectuées nous ont permis de constater que les sites sur lesquels le MOX est traité sont sous très haute surveillance permanente. Nous avons appris que certains opérateurs, italiens notamment, font retraiter leur combustible usé afin de le revendre ensuite à d’autres. EDF recycle-t-elle pour sa seule consommation ? Se voit-elle, un jour, en revendeur de combustible retraité ?
M. Sylvain Granger. Notre politique industrielle a pour objet de ne rendre disponible du plutonium par traitement du combustible usé que dès lors que nous sommes capables de le recycler à court terme dans nos réacteurs.
M. le président François Brottes. Monsieur Granger, nous vous remercions.
Audition de M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA
(Séance du 10 avril 2014)
M. le président François Brottes. Les auditions que nous menons aujourd’hui sont consacrées au retraitement du combustible et à la filière MOX, ainsi qu’aux réacteurs de quatrième génération et à leurs performances en matière de réduction des déchets ultimes. Le retraitement et la production de MOX constituent l’un des piliers industriels d’AREVA. En 2013, le secteur aval a représenté un peu moins de 20 % du chiffre d’affaires total du groupe et a contribué à hauteur de 308 millions d’euros à son résultat opérationnel ; le montant des commandes s’élevait à 6 milliards d’euros, soit trois années d’activité. Cette même année, la production de l’usine de La Hague a été la plus élevée depuis dix ans. La filière est donc bien installée dans le paysage industriel français.
En réponse à une question du rapporteur, le représentant d’EDF que nous avons auditionné a estimé qu’il n’était guère pertinent de comparer des coûts en faisant comme si cette filière n’existait pas, alors qu’elle est un fait acquis. Selon lui, il serait absurde de se priver d’une industrie désormais performante ; nous devrions, au contraire, nous employer à la perfectionner. Néanmoins, d’autres pays ont fait le choix du cycle ouvert, c’est-à-dire d’un passage unique de la matière fissile en réacteur.
Nous avons bien compris que le MOX usé n’avait pas vocation à être retraité, mais qu’il pourrait éventuellement être réemployé dans les réacteurs de quatrième génération. Quel est votre avis sur ces réacteurs ? AREVA est-elle partie prenante dans le projet ASTRID – Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration ? Est-ce la seule solution pour l’avenir ? Est-ce la plus performante ?
La Chine semble intéressée par l’expérience française en matière de retraitement. Quelles sont les perspectives de cette forme de recyclage ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Philippe Knoche prête serment)
M. Philippe Knoche, directeur général délégué d’AREVA. Pour commencer, je souhaite insister sur les apports du recyclage pour la France : aujourd’hui, environ 15 % de l’électricité produite en France l’est à partir de combustible recyclé, ce chiffre variant d’une année sur l’autre. Ce recyclage permet une économie en matières premières, telle que la plupart des industries cherchent à en réaliser actuellement, et contribue à limiter les importations d’EDF à hauteur de 150 millions d’euros par an. Il est donc, en soi, vertueux.
De plus, en recyclant, nous conditionnons les déchets et réduisons leur volume et leur toxicité par dix environ, ce qui facilite leur gestion à long terme. Comme vous avez pu l’observer en visitant le site de La Hague, les produits de fission sont placés dans une matrice comparable à l’obsidienne, très durable. Le volume total de déchets ainsi vitrifiés et compactés s’élève à environ 300 mètres cubes par an pour l’ensemble du parc d’EDF. Ils sont ensuite stockés à l’intérieur de colonnes de protection en béton, dans des halls d’entreposage qu’il est possible de visiter sans prendre de précautions particulières, comme vous avez pu le constater à La Hague.
Ainsi que l’a indiqué l’intervenant précédent, M. Sylvain Granger, toutes les études réalisées montrent que le coût du recyclage des combustibles usés et celui du cycle ouvert sont équivalents, à supposer que le pays considéré ne dispose pas déjà d’installations de retraitement. Selon une étude de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE publiée en 2013, les coûts de production de l’électricité se situent entre 6 et 8 dollars par mégawattheure, que l’on aille de la mine au réacteur, pour le cycle ouvert, ou du combustible usé au réacteur, pour le cycle fermé. Si l’on décompose les coûts, ceux de l’extraction et de l’enrichissement de l’uranium naturel sont nettement plus élevés dans le cas du cycle ouvert et, inversement, ceux du recyclage et de la fabrication du MOX sont sensiblement supérieurs dans le cas du cycle fermé. Avec un taux d’actualisation de 0 % – ce qui n’est pas l’hypothèse la plus favorable au retraitement –, le total des coûts est de 7,45 dollars par mégawattheure pour le cycle ouvert, contre 7,89 dollars pour le cycle fermé avec des réacteurs à eau légère et 7,73 dollars pour le recyclage multiple avec des réacteurs à neutrons rapides.
L’étude de l’AEN indique également que, toutes choses étant égales par ailleurs, les coûts de stockage sont plus élevés pour le cycle ouvert que pour le cycle fermé : 0,58 dollar par mégawattheure contre 0,45 dollar. Cela tient au volume plus important des déchets, qui, en cycle ouvert, ne sont pas conditionnés dans une matrice. En outre, plus le coût de construction des installations de stockage est élevé – je renvoie au débat que vous avez eu avec M. Granger sur le montant de la facture du projet Cigéo –, plus l’écart entre les coûts de stockage s’accroît à l’avantage du cycle fermé.
D’une manière générale, la prévisibilité des coûts est plus grande pour le cycle fermé, en raison du meilleur conditionnement des déchets.
M. le président François Brottes. Je souhaite faire une remarque de méthode. Notre commission a longuement débattu de l’opportunité de rendre ses auditions publiques. J’avais quelques hésitations à cet égard, et ce que nous venons d’entendre tend à montrer qu’elles étaient justifiées : votre exposé, monsieur le directeur général, n’aurait peut-être pas été aussi cohérent avec celui de l’intervenant précédent si vous ne l’aviez pas écouté, comme chacun peut le faire.
M. Jean-Pierre Gorges. Les intervenants auraient très bien pu se concerter avant.
M. le président François Brottes. En l’espèce, l’argumentaire est le même, au mot près.
M. Philippe Knoche. Inversement, l’intervenant suivant, présent dans la salle, pourra ajuster son discours en fonction du mien.
M. le président François Brottes. Je ne vous fais aucun procès, monsieur le directeur général. Nous avons décidé collectivement que les auditions seraient publiques, et j’assume ce choix.
M. Philippe Knoche. Nous sommes capables aujourd’hui de recycler plusieurs fois du combustible MOX usé : nous l’avons fait pour certains clients étrangers. Cependant, ce n’est possible que pour des quantités limitées, le MOX réutilisé devant être mélangé à plusieurs reprises avec d’autres combustibles usés. Cela ne correspond donc pas à un optimum technique avec les réacteurs à eau légère dont nous disposons actuellement. De ce point de vue, les réacteurs de quatrième génération ouvrent des perspectives plus favorables.
AREVA travaille avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le projet ASTRID, de même que nous avions participé précédemment à Phénix et Superphénix. ASTRID est porteur d’avancées technologiques intéressantes, mais il n’est pas le seul projet de réacteur de quatrième génération. Comme souvent en matière de recherche, nous nous interrogeons sur l’opportunité de développer un concept distinct ou au contraire cohérent avec ceux de nos partenaires étrangers. Dans les grands pays nucléaires qui sont avancés dans leurs politiques de recyclage et de recherche sur les réacteurs de quatrième génération – Inde, Chine, Russie et États-Unis, où le modèle est néanmoins différent –, la filière privilégiée est celle des réacteurs au sodium.
Nous devons réaliser certaines avancées par rapport à Superphénix, et AREVA y contribue. L’horizon pour le déploiement industriel d’ASTRID est la deuxième moitié de ce siècle.
M. le président François Brottes. Quelles sont ces avancées ? Une sûreté et une sécurité accrues ? Une réduction de la quantité de combustibles et de déchets ?
M. Philippe Knoche. Elles concernent essentiellement la sûreté. Il s’agit en particulier d’éviter tout risque d’interaction entre le sodium et l’eau, point qui a posé problème dans le projet Superphénix, notamment pour ce qui est des dispositifs techniques de manipulation du combustible. Nous travaillons avec le CEA sur ces sujets.
Par nature, les réacteurs de quatrième génération utiliseront la ressource de manière plus efficiente et produiront moins de déchets : ils seront capables de régénérer leur propre combustible, grâce à une usine de recyclage. Nous sommes d’ores et déjà très confiants sur ce point : il a été prouvé que les réacteurs à neutrons rapides fonctionnaient très efficacement avec de l’uranium appauvri et du plutonium.
J’en viens aux performances industrielles du recyclage et de la filière MOX. Depuis l’origine, AREVA a traité 29 000 tonnes de combustible, dont 10 000 pour des clients étrangers. Nous avons donc exporté un tiers de la production de la filière et ce, dans de très bonnes conditions de fiabilité. En outre, nous avons su innover : au cours de la dernière décennie, nous avons mis en service un nouveau procédé de vitrification, qui permet de conditionner les déchets de manière encore plus efficace, notamment les effluents. Nous avons fourni du MOX à presque autant de réacteurs étrangers que français, respectivement vingt et vingt-deux. La filière emploie aujourd’hui 12 500 personnes, principalement sur le site de La Hague, dans l’usine MELOX et pour le transport. Ce chiffre n’inclut pas les effectifs de tous les prestataires.
Sur les cinq à sept dernières années, nos prestations de recyclage nous ont rapporté environ 600 millions d’euros par an à l’exportation. Le retraitement permettant, en outre, de réduire les importations d’EDF de l’ordre de 150 millions par an, l’effet net sur la balance commerciale de la France est positif à hauteur de 750 millions. Cela fait du retraitement une filière d’excellence française. C’est pourquoi nous avons été contactés par la Chine, qui souhaite réaliser des installations analogues aux nôtres, compte tenu de la croissance de son parc nucléaire.
M. Denis Baupin, rapporteur. S’agissant de « l’excellence » de la filière nucléaire française, plusieurs éléments relatifs notamment à la construction de l’EPR devraient inciter à une certaine prudence. Quant à votre exposé sur la réutilisation du MOX, il m’a paru quelque peu idyllique. Lorsque nous avons visité le site de La Hague et l’usine MELOX à Marcoule, nous avons été frappés par le nombre de dispositifs de surveillance mis en place par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), compte tenu des risques de prolifération et de la dangerosité du plutonium. En outre, les questions de sécurité ne paraissent pas résolues : les missiles sol-air déployés à proximité du site de La Hague après les attentats du 11 septembre 2001 ont été retirés, sans que, semble-t-il, d’autres mesures soient prises. Dès lors, il est légitime de s’interroger : cela vaut-il la peine de prendre autant de risques ?
D’autant que cela ne rapporte rien : selon les études que le représentant d’EDF et vous-même avez citées – vous nous l’aviez d’ailleurs déjà dit lorsque nous avons visité le site de La Hague –, le stockage direct des déchets ne coûterait pas plus cher que leur retraitement et la fabrication du MOX. Si le choix entre ces deux options n’a pas d’impact sur la production d’électricité ni sur son coût, et que, dans votre vision même, l’économie française dans son ensemble ne retire aucun gain du retraitement et de la filière MOX – même si j’ai bien noté les implications non négligeables en termes de développement industriel et d’emploi –, la question des risques mérite d’être posée. EDF a d’ailleurs confirmé la dangerosité du MOX et les difficultés liées à son utilisation. Elle affirme maîtriser ces risques mais, malheureusement, cela ne s’est pas toujours aussi bien passé dans d’autres pays.
Par ailleurs, selon le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le retraitement et la fabrication du MOX n’ont de sens que si l’on construit un jour des réacteurs de quatrième génération. À cet égard, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’IRSN nous ont indiqué qu’ils n’imaginaient pas de quatrième génération sans des améliorations en matière de sûreté, non seulement par rapport à Superphénix, dont les problèmes de sûreté n’avaient pas été résolus, mais aussi par rapport à la troisième génération et à l’EPR. Ainsi, selon une note qu’elle nous a transmise, « l’ASN considère que cette quatrième génération doit apporter un gain de sûreté significatif par rapport à la troisième génération et qu’ASTRID doit permettre de tester effectivement des options et dispositions de sûreté renforcée ». Quelles sont ces options et ces dispositions ?
De même, l’IRSN écrit à propos des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, dont fait partie ASTRID : « Des avancées notables sont nécessaires pour permettre une inspection en service des structures importantes pour la sûreté, les possibilités dans ce domaine se heurtant à la difficulté liée à l’opacité du sodium. » De telles inspections n’étaient pas possibles au sein de Superphénix. En outre, de nombreuses hypothèses d’accidents n’ont pas encore été discutées et, selon l’IRSN, il convient d’approfondir « la coulée des matériaux fondus ; la possibilité de les maintenir en cuve ; le déclenchement d’une explosion de vapeurs de sodium et son ampleur ; les transferts de radionucléides issus du combustible fondu au sodium du réacteur, à l’enceinte de confinement et à l’environnement ; la prévention des accidents d’endommagement sévère du cœur, notamment sa fusion ; les risques liés à la réactivité chimique violente du sodium avec l’air et avec l’eau ». Je suppose que vous travaillez sur ces questions avec le CEA, mais pouvez-vous nous en dire plus sur les réponses que vous pensez apporter ?
Dans la mesure où les réacteurs de quatrième génération devront permettre de recycler les matières et de réaliser un saut qualitatif en matière de sûreté, pourront-ils être compétitifs par rapport aux moyens alternatifs de production d’électricité ? Et à quelle échéance pourraient-ils voir le jour ? Le directeur général de l’IRSN a évoqué hier la fin du siècle en cours. Votre calendrier est-il plus « optimiste » que le sien ?
M. Philippe Knoche. En ce qui concerne le risque terroriste, nous avons pris de nombreuses mesures de protection en liaison avec les autorités compétentes, en particulier avec le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’énergie. Il convient de mettre en place des dispositifs protégés par le secret défense, mais aussi d’informer de manière transparente sur les risques et, dans la mesure du possible, sur les dispositions que nous prenons. Ainsi, nous faisons état sur internet des stocks de matières – uranium, plutonium, combustible usé – dont nous disposons, ce qui n’empêche pas ces stocks d’être très étroitement surveillés. Nous avons également répondu à toutes les demandes de rapport concernant les risques, s’agissant notamment des piscines d’entreposage.
Pour ce qui est du risque de prolifération, nous avons pris toutes les mesures nécessaires en France, et AREVA n’a jamais été mise en cause sur ce point. Les problèmes de prolifération que le monde a connus à ce jour étaient sans lien avec l’activité de recyclage.
Je suis surpris, monsieur le rapporteur, que vous affirmiez, à propos du recyclage et de la filière MOX, que « cela ne rapporte rien » en contraposition du fait que le stockage direct « ne coûte pas plus cher ». C’est un raisonnement un peu rapide. Ce que rapporte le recyclage, c’est une économie de ressources, le conditionnement des déchets dans une matrice adaptée et la réduction de leur volume par dix.
M. le rapporteur. Tout cela n’est-il pas déjà pris en compte dans votre calcul ?
M. Philippe Knoche. Ce sont des apports non économiques.
M. le président François Brottes. Ce n’est pas qu’une question d’argent, monsieur le rapporteur !
M. le rapporteur. Je l’ai bien noté. Cependant, j’ai rencontré le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’énergie, M. Vincent Mazauric, et ses collaborateurs ; ils n’étaient pas aussi optimistes que vous sur les questions de sécurité, notamment en ce qui concerne le site de La Hague.
M. Philippe Knoche. Je n’ai pas dit que tout était parfait ; on peut toujours s’améliorer. Il s’agit d’ailleurs d’une logique de base dans l’industrie nucléaire.
M. le président François Brottes. Il y a, d’un côté, les auditions menées par la Commission et, de l’autre, celles que conduit le rapporteur. Évitons de citer des personnes qui ne se sont pas exprimées sous serment devant la Commission. Ou alors, si l’on souhaite les faire parler, invitons-les pour une audition par la Commission dans son ensemble. Il faut être clair sur ce principe.
M. Philippe Knoche. Des dispositions très précises ont été prises sur le site de La Hague pour faire face à la menace terroriste. Elles sont adaptées en permanence, en liaison avec les autorités compétentes.
On ne peut pas dire que le recyclage du papier ou de l’acier ne rapporte rien. Pourtant, le papier et l’acier recyclés coûtent plus cher que leurs équivalents non recyclés. S’agissant du recyclage du combustible usé, son coût n’est pas plus élevé, mais du même ordre que celui du stockage direct. Et il a des avantages : outre ceux que j’ai déjà cités, il améliore l’acceptation de la filière nucléaire par la société.
J’en viens à la dangerosité du MOX. Il convient de distinguer les différentes étapes de la vie de ce combustible. Sa fabrication, d’abord, se fait à l’usine MELOX dans des « boîtes à gants ». Compte tenu du niveau de radioactivité du plutonium et de sa nocivité pour la santé – que nous ne contestons pas –, nous prenons des mesures de protection renforcées par rapport à celles qui s’appliquent pour la fabrication du combustible à l’uranium. Nous le faisons sous l’autorité de l’ASN, à laquelle nous adressons des rapports spécifiques. L’assemblage du MOX, ensuite, ne diffère pas fondamentalement de celui du combustible à l’uranium. Il est possible de s’approcher du produit ainsi obtenu. Par ailleurs, quand vous utilisez du combustible à l’uranium dans une centrale, vous obtenez de toute façon du MOX : le plutonium apparaît au bout de quelques heures d’irradiation dans le réacteur.
S’agissant du projet ASTRID, si tous les points soulevés par l’ASN et l’IRSN à propos des réacteurs de quatrième génération étaient réglés, nous en construirions déjà aujourd’hui. Il est tout à fait sain de se poser les questions dont vous avez rappelé la liste. J’ai déjà parlé des risques d’interaction du sodium avec l’eau et avec l’air. Pour ce qui est des possibilités d’inspection en service compte tenu de l’opacité du sodium, nous pouvons aussi simplifier les structures internes de façon à modifier les exigences d’inspection en service. Cela fait partie du processus d’amélioration technologique. Il est tout à fait bon de prendre le temps de ce débat. Quant au déploiement d’ASTRID, il pourrait intervenir, comme je l’ai indiqué, dans la deuxième moitié de ce siècle. Cela implique que nous mettions au point, au cours des décennies qui viennent, des prototypes qui nous permettront d’affiner les réponses aux questions posées.
M. le rapporteur. Le dossier pour le projet ASTRID devait être présenté en 2014. Cela signifie-t-il qu’il reste encore beaucoup d’hypothèses pour lesquelles vous n’avez pas de réponses ?
M. Philippe Knoche. Sur le projet ASTRID, nous en sommes au stade de l’avant-projet. L’échéance pour l’avant-projet sommaire est 2014, celle pour l’avant-projet détaillé 2017. Les études doivent se poursuivre au cours de cette période. Il n’est pas du tout question de commencer la construction en 2014.
Pour ce qui est de la compétitivité, nous aurions intérêt à pousser plus loin la convergence en matière d’exigences internationales. La France n’est pas le seul pays à développer un projet de réacteur de quatrième génération : l’Inde, la Russie, la Chine avancent sur leurs propres projets, sur la base de nos savoir-faire ou de savoir-faire indépendants. Nous appelons de nos vœux un échange au sein des instances multilatérales – l’AIEA ou l’Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) – de façon à harmoniser progressivement les exigences, comme cela se fait pour d’autres installations à risques, aéroportuaires ou chimiques. C’est dans ce cadre que nous pourrons traiter la question de l’équilibre entre réduction des risques et compétitivité.
M. le président François Brottes. Je me suis beaucoup intéressé à la filière du papier. Bien que la production du papier recyclé consomme davantage d’énergie que celle du papier neuf et que son coût soit plus élevé, il est indispensable de recycler le papier. Il ne suffit pas de s’intéresser aux coûts, même si c’est là l’objet principal de notre enquête ; il convient d’avoir une approche d’ensemble du recyclage. Certes, « comparaison n’est pas raison », mais ce raisonnement peut être conduit pour toutes les filières industrielles.
M. le rapporteur. La question que nous devons nous poser est la suivante : quelles sont les externalités qui devraient être internalisées dans le coût économique du recyclage ? Le papier recyclé présente un intérêt par rapport au papier neuf, parce que nous estimons que le recyclage crée des externalités intéressantes : moindre consommation de bois, réduction de la pollution et des déchets. Or je ne suis pas du tout certain que les externalités créées par le recyclage du combustible nucléaire usé soient positives, compte tenu de la dangerosité des matières radioactives et des risques associés. Il est légitime de se poser ces questions. À ma connaissance, l’AIEA ne s’intéresse guère aux usines de recyclage de papier !
M. Jean-Pierre Gorges. Bien que vous ayez rappelé l’objet de notre commission d’enquête, monsieur le président, le débat devient vite politique : le rapporteur défend souvent une idéologie plutôt que de travailler à établir des coûts. J’en profite donc pour donner, moi aussi, mon avis sur la transition énergétique.
L’intérêt du recyclage apparaît évident : il permet de réduire de 15 % la consommation de matières en amont du cycle. En outre, au début de nos travaux, nous avons fait le point sur la durée des réserves de charbon, de pétrole, de gaz et d’uranium. S’agissant de l’uranium, il nous a été indiqué que cette durée serait de cent trente ans avec les réacteurs de troisième génération, mais qu’elle passerait – c’était d’ailleurs une grande surprise pour moi – à cinq mille ou sept mille ans avec la quatrième génération. En d’autres termes, la ressource deviendrait illimitée. Par ailleurs, personne n’a encore proposé de solution qui permettrait d’arrêter les centrales nucléaires du jour au lendemain en les remplaçant par des modes de production alternatifs : éoliennes, panneaux photovoltaïques, barrages hydroélectriques. On le voit bien, cela ne peut pas marcher. Pour ma part, je suis assez convaincu que la transition énergétique se fera au moyen du nucléaire, grâce au développement des réacteurs de quatrième puis de cinquième génération, avec une étape intermédiaire par une génération III+. Dans tous les cas, il vaut la peine d’étudier cette solution, qui réglerait la question de la durée des réserves de combustible. Mais il s’agit moins, dès lors, d’un problème de sûreté ou de calcul de coûts : la décision sera de nature politique.
En 1972, on dénombrait 17 000 morts par an sur les routes en France. Nous sommes descendus aujourd’hui à 4 000, alors que la circulation a augmenté. Cela tient au fait que les voitures se sont transformées : grâce notamment à la ceinture de sécurité et à l’airbag, on sort de sa voiture vivant.
M. Philippe Baumel. Je souscris en partie aux remarques de M. Gorges. Malgré vos efforts pour recentrer le débat, monsieur le président, nous nous éloignons trop souvent de l’objet de notre commission d’enquête. Chacun peut avoir un avis, mais que vient faire dans nos travaux une plaidoirie antinucléaire a priori, surtout devant des intervenants qui viennent nous apporter un éclairage sur une filière essentielle pour l’avenir de notre pays ? En outre, je suis très étonné d’entendre un responsable des Verts nous expliquer que la question des déchets est secondaire et qu’il faudrait arrêter le retraitement ! Si l’on souhaite préserver l’environnement, il est nécessaire de recycler les déchets existants. Je comprends d’autant moins la position du rapporteur que le coût du retraitement est équivalent à celui du cycle ouvert. En outre, les enjeux en matière de développement industriel et d’emploi sont considérables, la France restant un des leaders mondiaux de la filière. Il conviendrait plutôt de s’interroger sur les coûts et sur les moyens de la faire progresser encore, tout en respectant des critères environnementaux. Cessons de nous accrocher à des vieilles lunes qui ne nous mènent nulle part !
M. le président François Brottes. Inévitablement, dans une commission d’enquête, le débat est aussi politique.
M. Bernard Accoyer. Il ne devrait pas l’être : nous sommes là non pas pour entendre une plaidoirie, mais pour recueillir des éléments factuels et des chiffres.
M. Jean-Pierre Gorges. Le débat deviendra politique.
M. le président François Brottes. Le débat est bien sûr technique, mais il est aussi fondamentalement politique : il n’y a rien d’anormal à ce que chacun se forge un avis en fonction de ses convictions éthiques ou idéologiques, surtout au Parlement.
M. Jean-Pierre Gorges. La France est en pointe en matière d’industrie nucléaire : celle-ci fournit 85 % de son électricité. Or, pour des raisons idéologiques, certains cherchent à tout arrêter brutalement, y compris la recherche. Selon la Cour des comptes, la France consacre, depuis cinquante ans, un milliard d’euros par an à la recherche dans le domaine nucléaire, ce qui est modeste rapporté aux 1 100 milliards de dépenses publiques annuelles. La Cour relève toutefois que cet argent a pu servir à occuper des chercheurs dans des laboratoires. Je souhaiterais donc disposer de chiffres plus précis. Compte tenu des enjeux que j’ai rappelés en matière de durée des réserves de combustible, quelle somme dépensons-nous chaque année pour accélérer le passage aux réacteurs de quatrième génération ? À combien ce montant devrait-il s’élever, selon vous ? Combien de personnes travaillent sur ce sujet ?
Quant à la date de déploiement de ces réacteurs, le directeur général de l’IRSN a évoqué hier la fin de ce siècle. Vous parlez, monsieur le directeur général, de la deuxième moitié du siècle. D’autres ont dit : « dans quinze à vingt ans ». En réalité, tout dépend des investissements que l’on y consacre et s’il existe ou non une forte volonté politique, comme cela a été le cas lorsqu’on a décidé de créer la filière nucléaire en France. Si, après avoir constaté qu’il n’est guère possible de développer les énergies renouvelables au-delà de 15 à 20 % de la consommation nationale, un gouvernement décidait de s’engager résolument dans le développement de la filière nucléaire, avec toutes les garanties de sécurité nécessaires, cela deviendrait un projet d’État.
M. le président François Brottes. Encore une fois, je souhaite que nous nous en tenions, les uns et les autres, aux déclarations qui ont été faites devant la Commission sous serment. Or je n’ai pas entendu le directeur général de l’IRSN évoquer la fin du siècle. Ne rapportons pas de propos tenus en dehors de cette enceinte, même s’ils sont tout à fait sérieux. Nous devrons d’ailleurs trouver une solution pour intégrer à nos travaux le contenu des auditions que mène le rapporteur, comme il en a parfaitement le droit. À défaut, notre rapport contiendra des informations de statut différent : certaines auront été recueillies sous serment, d’autres non.
M. Philippe Knoche. Une centaine d’ingénieurs d’AREVA travaillent actuellement sur les réacteurs de quatrième génération. Cet effort a plutôt été réduit au cours des dernières années, compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent notamment sur le CEA, avec lequel nous travaillons. C’est le CEA qui a une vision globale des investissements consacrés à ces projets.
L’horizon que j’ai mentionné – la deuxième partie de ce siècle, c’est-à-dire à partir de 2050 – correspond au déploiement industriel des réacteurs. Le démonstrateur ASTRID pourrait être déployé plus tôt, au cours de la décennie 2020, en fonction de l’évolution du débat avec les autorités de sûreté et des financements qui seront alloués au projet. En matière de réacteurs à neutrons rapides, la France était historiquement le pays le plus avancé, mais l’Inde – où de tels réacteurs sont déjà en service –, la Russie et la Chine progressent aujourd’hui plus rapidement qu’elle.
Mme Clotilde Valter. Un certain retard a été pris par rapport au calendrier de recherche initial sur les réacteurs de quatrième génération. Pouvez-vous nous rappeler quel était ce calendrier ?
M. Philippe Knoche. Comme je l’ai indiqué, s’agissant d’ASTRID, l’échéance pour la fin de l’avant-projet détaillé est 2017.
Mme Clotilde Valter. Mais à combien d’années évaluez-vous le retard pris par rapport au calendrier initial ?
M. Philippe Knoche. L’étalement des dépenses a conduit à un décalage d’environ deux ans.
M. le président François Brottes. En réalité, le retard par rapport aux échéances initialement prévues est assez limité, en tout cas pour le projet ASTRID.
Mme Clotilde Valter. Ma question ne portait pas uniquement sur le projet ASTRID.
M. Philippe Knoche. D’une manière générale, le moment choisi pour déployer tels ou tels réacteurs est aussi une question d’optimum technico-économique : il serait plus urgent de passer à la quatrième génération si l’uranium se raréfiait et que son prix était de 75 dollars par livre, et non inférieur à 50 dollars comme aujourd’hui. L’État, qui prend les décisions en la matière, doit procéder à des arbitrages en fonction de la maturité des technologies considérées et des contraintes technico-économiques. Actuellement, la construction de réacteurs de génération III+ retarde le déploiement de la quatrième génération. Il y a donc différents horizons possibles.
M. le président François Brottes. Il existe au moins trois ou quatre concepts de réacteurs de quatrième génération dans le monde. Pour la France, il s’agit du projet ASTRID.
M. Philippe Knoche. Tout à fait.
Mme Clotilde Valter. Le calendrier fixé il y a quelques années pour les réacteurs de quatrième génération était plus resserré que celui dont nous parlons aujourd’hui. Pourriez-vous nous le rappeler ?
M. le président François Brottes. Je suis les questions nucléaires depuis une dizaine d’années et je ne me souviens pas avoir entendu parler d’échéances plus rapprochées que celles qui viennent d’être évoquées.
M. Michel Sordi. En 1997, Mme Voynet a arrêté deux grands projets en France : le canal Rhin-Rhône, pour des raisons environnementales, et Superphénix. L’arrêt de Superphénix a-t-il été une erreur pour la recherche française ?
M. Philippe Knoche. Si votre question est : « Aurions-nous pu effectuer des recherches sur Superphénix entre 1997 et aujourd’hui ? », la réponse est oui.
M. Bernard Accoyer. Depuis plusieurs années, plus particulièrement depuis le discours de politique générale de Lionel Jospin en 1997, la filière nucléaire, qui est l’un des fleurons et l’une des fiertés technologiques et industrielles de notre pays, est mise à mal par un mouvement d’idées qui agit avec des méthodes problématiques, dont l’analyse montrerait à quel point elles surfent sur les peurs, les contrevérités et les amalgames. En 1997 a été prise la décision purement politique de fermer et de démanteler Superphénix, un réacteur expérimental de quatrième génération. L’un des arguments avancés par les idéologues qui réclamaient cette fermeture – dont beaucoup étaient d’ailleurs des étrangers – était que le réacteur n’avait pas été raccordé suffisamment longtemps au réseau. S’agissant d’un réacteur expérimental, c’était pourtant bien normal ! Ce projet devait permettre à la France de rester à la pointe dans le domaine énergétique. Il était d’ailleurs visionnaire, puisqu’il s’agissait alors de la seule énergie décarbonée dont la puissance était déjà exploitée. Le mal fait par cette décision idéologique, impulsive, de convenance politicienne, fruit d’accords électoralistes, est considérable. Je viens d’entendre que la France a commencé à prendre du retard précisément à ce moment-là dans son programme de recherche et d’innovation dans ce domaine phare pour notre science, notre technologie, notre rayonnement et notre histoire. Avec un recul de dix-sept ans, pouvez-vous nous dire quelles ont été les conséquences réelles de cette décision ? Et quelles pourraient être les conséquences pour l’avenir énergétique, industriel, économique et social de notre pays du discours démagogique, partisan et dogmatique qu’assène, dans un but uniquement militant, le rapporteur au fil des réunions de la Commission, et des coups qu’il porte ainsi à la filière nucléaire ?
M. Philippe Knoche. Nous devons désormais nous tourner vers l’avenir de la filière. Il nous faut poursuivre le développement des réacteurs à neutrons rapides, voire l’accélérer en fonction des partenariats internationaux que nous pourrons nouer. Le recyclage, je le rappelle, emploie directement plus de 12 000 personnes et crée des externalités positives : réduction du volume de déchets et conditionnement fiable de ceux-ci dans une matrice adaptée. Le groupe AREVA consacre plus de 800 millions d’euros à la recherche et développement pour améliorer ses technologies, y compris en matière de conditionnement des déchets, ce qui lui permet de remporter des contrats à l’exportation et, ainsi, de contribuer positivement à la balance commerciale de la France. Nous devons poursuivre dans cette voie. Les montants consacrés à cette recherche sont très importants, mais ils sont en partie financés par les contrats que nous avons conclus tant avec EDF qu’avec les électriciens étrangers.
M. le rapporteur. J’assume totalement mes convictions. Je ne pense pas que l’on puisse dénoncer le caractère « politique » de mon discours, tout en qualifiant d’« apolitique » celui de M. Accoyer, qui est tout en nuances et dénué d’idéologie ! Nous avons été, les uns et les autres, élus pour défendre des convictions, mais cela ne nous empêche nullement de mener un travail sérieux dans le cadre de cette commission d’enquête. Nous auditionnons des intervenants – beaucoup d’entre eux travaillent d’ailleurs dans le secteur nucléaire – et recueillons des éléments d’appréciation susceptibles d’éclairer l’ensemble des élus.
Monsieur Baumel, je m’intéresse de près à la question des déchets et de leur impact : nous nous sommes rendus la semaine dernière sur les sites de La Hague et de Marcoule, et j’ai également visité le laboratoire de Bure. Simplement, nous n’avons pas nécessairement les mêmes convictions, ce qui est tout à fait respectable. Si l’on pouvait trouver des solutions qui permettent de rendre les déchets beaucoup moins nocifs et leur gestion beaucoup moins coûteuse pour la collectivité, je m’en réjouirais.
À propos de Superphénix, il me semble utile d’apporter des éléments d’information complémentaires. Cette installation a coûté plus de 9 milliards d’euros en investissement et plus de 1 milliard chaque année en fonctionnement. En 1994, elle a été déclassée en laboratoire de recherche et de démonstration par le gouvernement Balladur. Cette décision a d’ailleurs été annulée ultérieurement par le Conseil d’État, car les formes de l’enquête publique n’avaient pas été respectées. Plus tard au cours de l’année 1994, un nouvel incident majeur s’est produit sur Superphénix. Son démantèlement est aujourd’hui en cours et devrait coûter près de 65 % de plus qu’initialement prévu. Cela jette d’ailleurs un certain éclairage sur la question de l’évaluation des coûts de démantèlement.
Mme Sabine Buis. Nous avons déjà eu à plusieurs reprises les échanges auxquels nous assistons ce matin. Le débat s’écarte souvent de la question des coûts pour s’engager sur un terrain politique. Je souhaiterais connaître votre position, monsieur le président : le débat politique a-t-il ou non sa place dans le cadre des auditions ? Si la réponse est non, chacun doit s’en tenir à cette règle. Si la réponse est oui, il convient d’accorder la même place à chacun. Or certains condamnent le discours politique des autres, tout en se prévalant de cette dénonciation pour défendre leurs propres positions.
M. le président François Brottes. Ma position est claire et je l’ai exprimée à plusieurs reprises. Notre commission d’enquête réalise une expertise sur les coûts de la filière nucléaire, dans l’absolu et en termes relatifs par rapport à ceux des autres modes de production d’électricité, en France et à l’étranger. L’Assemblée nationale est une institution fondamentalement politique et démocratique, où s’exprime une pluralité d’opinions. Si les travaux de notre commission d’enquête se déroulaient à huis clos, les guerres de position ne présenteraient guère d’intérêt et nous nous concentrerions sans doute davantage sur les aspects techniques. C’est pourquoi j’avais suggéré que nous adoptions ce mode de travail. Mais, dans la mesure où nos auditions sont publiques, il n’est pas anormal ni incongru que chacun fasse part de sa position en préalable ou au détour des questions qu’il pose. Cela ne me choque pas. Cela prend un peu plus de temps, c’est parfois redondant et ce n’est pas toujours pédagogique pour ceux qui suivent nos travaux, mais il s’agit de la vie politique du pays. Il ne m’appartient pas de censurer l’expression de femmes et d’hommes qui ont été élus sur des bases politiques, quelle que soit leur sensibilité.
Mme Sabine Buis. Je me retrouve parfaitement dans votre réponse, monsieur le président. Dès lors, nous devrions nous écouter les uns les autres. Le fait que deux positions différentes s’expriment ne devrait pas susciter d’agitation, et il n’y a pas de raison que certains élèvent la voix plus que d’autres. Nous gagnerions à débattre dans des conditions plus sereines, d’autant que nous sommes regardés et écoutés.
M. Bernard Accoyer. Ce qui se passe est grave, monsieur le président : cela pose le problème du droit de tirage en matière de commissions d’enquête octroyé aux groupes minoritaires et d’opposition par la réforme du règlement de 2009.
M. le président François Brottes. Vous avez soutenu cette réforme, monsieur Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Oui, tout à fait, mais nous constatons aujourd’hui une dérive dans l’utilisation qui en est faite. D’un côté, les personnes que nous invitons à nos auditions sont tenues de comparaître devant nous – la force publique peut être mobilisée pour les y contraindre – et de déposer sous serment. De l’autre, la parole des parlementaires est libre – il ne saurait en être autrement – et ils peuvent donc s’écarter du sujet, exprimer leurs convictions, voire dire des contrevérités, sciemment ou non. Mais il est de votre responsabilité, monsieur le président, de nous ramener à l’objet de notre commission d’enquête : les coûts de la filière nucléaire et du démantèlement de la centrale de Fessenheim. Les longues déclarations et les questions ciblées de notre rapporteur conduisent naturellement les autres membres de la Commission, quelle que soit leur sensibilité, à regretter la dimension politique de ses interventions et à faire valoir leur propre point de vue. D’autant que le rapport de notre commission sera un document public. L’erreur a été commise d’offrir à M. Baupin une tribune en le désignant rapporteur, ce qui était d’ailleurs l’objectif de son groupe politique.
M. le rapporteur. Notre groupe politique serait-il moins légitime que les autres ?
M. Bernard Accoyer. Le rapporteur a fait le forcing pour que les auditions ne se déroulent pas à huis clos. Cela nous met dans une situation très ambiguë, alors que notre tâche est de réunir des chiffres pour alimenter la réflexion des responsables politiques et éclairer leurs choix, en vue du prochain débat sur la transition énergétique. Je vous demande, monsieur le président, d’exiger que le rapporteur s’en tienne au sujet. C’est aussi une question de respect pour les personnes que nous entendons.
D’autre part, à la demande expresse du rapporteur, nous avons auditionné à plusieurs reprises des militants, dont certains – je pense à Greenpeace – ne respectent pas les règles de la République : ils s’introduisent par la force dans des équipements pourtant hautement sécurisés et ont fait, il y a quelques années, une intrusion dans l’hémicycle, elle aussi violente. L’institution parlementaire est au cœur de la République et de la démocratie. Il vous revient, monsieur le président, d’en faire respecter les principes.
M. le président François Brottes. Je vous prie de nous excuser, monsieur le directeur général, de nous éloigner du sujet pour lequel nous vous avons invité. J’ai, en effet, la difficile tâche de présider cette commission d’enquête et de tenter de ramener les uns et les autres à son objet. Il existe une technique assez simple pour remédier à ce problème : limiter le temps de parole et interrompre les orateurs quand ils l’ont épuisé, ce qui les oblige à se concentrer sur le sujet. Vous avez vous-même employé cette méthode, monsieur Accoyer, lorsque vous étiez président de l’Assemblée nationale, notamment avec le temps législatif programmé. Je prends bonne note de vos remarques. Si, dans la suite de nos travaux, la tonalité de nos échanges, bien que je n’en réprouve pas le fond, l’exige, je minuterai le temps de parole de chacun, comme je le fais à la commission des affaires économiques.
M. Bernard Accoyer. Y compris celui du rapporteur, en exigeant qu’il s’en tienne au sujet.
M. le président François Brottes. Dans les commissions d’enquête, le rapporteur est toujours celui qui interroge, à titre principal, les personnes auditionnées. Telle est la règle, et elle est tout à fait logique. Chaque membre de la commission peut ensuite poser ses propres questions.
Nous nous sommes un peu écartés du sujet, mais il est bon, de temps en temps, de soulever le couvercle de la cocotte-minute, pour pouvoir reprendre ensuite nos travaux en toute sérénité.
M. Jean-Pierre Gorges. Je suis d’accord avec Mme Buis : tout le monde doit pouvoir exprimer ses idées, et la confrontation est utile. Mais l’erreur a été de créer une commission d’enquête sur ce sujet.
M. le président François Brottes. C’est un droit prévu par le règlement : chaque groupe politique a un droit de tirage annuel en matière de commissions d’enquête. Ne remettons pas sans cesse en cause les règles que nous avons adoptées !
M. Jean-Pierre Gorges. Tel n’est pas mon propos. Selon moi, cela n’a guère de sens de demander à des scientifiques de jurer que tel ou tel chiffre est vrai. L’outil adapté pour un sujet de cette nature aurait été un travail du Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) ou de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC). J’ai moi-même été corapporteur pour le CEC sur le dispositif de promotion des heures supplémentaires prévu par l’article 1er de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) et pour la MEC sur le crédit d’impôt recherche. Même si j’avais souvent une opinion divergente de celle de l’autre corapporteur, nous sommes parvenus à réaliser notre évaluation en toute sérénité, à objectiver la situation et, in fine, à nous mettre d’accord. Il aurait été plus facile à M. Baupin de mener un tel travail, et il aurait pu intervenir de la même manière au cours des auditions. En constituant une commission d’enquête sur un sujet qui fait débat, vous avez suscité de la suspicion et créé une situation conflictuelle. C’est maladroit.
M. le président François Brottes. Ce n’est pas maladroit, c’est un droit. Par ailleurs, je nuancerais votre propos : à deux reprises, l’intervenant précédent a préféré ne pas répondre, parce qu’il ne connaissait pas le chiffre exact. S’il n’avait pas prêté serment, il aurait peut-être cité des chiffres approximatifs. Le cadre de la commission d’enquête peut donc avoir son utilité, même sur des sujets très précis. Pour le reste, il est plutôt normal que nos débats soient passionnés.
Monsieur le directeur général, avez-vous le sentiment d’avoir répondu à toutes les questions que nous vous avons posées ?
M. Philippe Knoche. Pour autant qu’un sentiment puisse être exprimé sous serment, oui.
M. le président François Brottes. Je vous remercie.
Audition de M. Mycle Schneider, consultant
(Séance du 10 avril 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314041.pdf
M. le président François Brottes. Nous accueillons M. Mycle Schneider, qui a, pendant de nombreuses années, animé le cabinet WISE-Paris. Il est le principal auteur d’un rapport annuel sur l’état de l’industrie nucléaire dans le monde et fait partie de ceux qui portent un regard pour le moins critique sur l’énergie nucléaire, et plus particulièrement sur le retraitement et le combustible MOX. En témoigne un article qu’il a fait paraître en 2001 – mais peut-être son point de vue a-t-il évolué depuis – dans la revue Contrôle, publiée par l’Autorité de sûreté nucléaire, et intitulé « L’industrie du plutonium : de l’effritement d’un mythe à l’urgence d’une reconversion ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Mycle Schneider prête serment)
M. Bernard Accoyer. On nous a distribué un curriculum vitae indiquant que M. Schneider a enseigné les « stratégies Énergies et environnement » dans le cadre d’un master international à l’École des mines de Nantes. Je souhaite connaître le détail de sa formation scientifique et ses titres universitaires.
M. le président François Brottes. Peut-être pourriez-vous répondre à cette question dans votre propos liminaire, monsieur Schneider.
M. Mycle Schneider, consultant. Je suis autodidacte.
Permettez-moi de débuter mon propos en replaçant la séparation et l’utilisation du plutonium dans un contexte historique, qui fut dans un premier temps militaire ; très rapidement, par la suite, ont été lancés les surgénérateurs, des réacteurs à neutrons rapides, avec le premier réacteur EBR-1 aux États-Unis.
Après la crise du pétrole de 1973, le CEA prévoyait que, en l’an 2000, 540 surgénérateurs de type Superphénix seraient en activité dans le monde, dont vingt en France. Les conséquences de telles prévisions se sont révélées très importantes puisque le prix de l’uranium s’est envolé, quadruplant en deux ans, et que fut signée la première grande série de contrats de retraitement, notamment pour la construction de l’usine UP3 à La Hague. Ce contexte est à l’origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Au début des années 80, alors qu’il apparaissait que tous les surgénérateurs prévus ne seraient pas construits, il a tout de même été décidé de poursuivre le programme de retraitement et de l’option MOX. Il ne s’agissait pas d’une décision sur le fond, les conditions économiques de séparation et d’utilisation du plutonium s’étant très sensiblement dégradées, mais d’une décision destinée à honorer des engagements. On craignait, par surcroît, que l’arrêt de la construction de l’usine UP2-800, donc l’arrêt du retraitement français, n’eût un grave impact sur l’activité du nucléaire dans le reste du monde. Aussi, le système actuellement en vigueur date-t-il de la fin des années 80, avec notamment la construction de l’usine de fabrication de combustible MOX – l’usine MELOX.
Dès 1995, EDF donne une valeur comptable zéro aux stocks de plutonium et d’uranium retraité, ce qui est étonnant quand on sait que la séparation du plutonium nécessite des sommes importantes. Vers 2000, le directeur du service « Combustible » d’EDF a même déclaré qu’il n’y avait pas de marché pour le plutonium et que s’il y en avait un, la valeur du plutonium serait négative. Or nous savons que des accords ont été signés, aux termes desquels EDF a été payée pour reprendre du plutonium néerlandais. Nous ne savons pas ce qu’il en est, en revanche, avec les électriciens italiens ou allemands.
Le système mis en place exige une organisation de transport très importante entre les différentes installations. Ce transport se fait par route ; entre La Hague et l’usine MELOX, séparées de quelque mille kilomètres, il a lieu environ deux fois par semaine.
M. le président François Brottes. Il s’agit plutôt d’un transport par semaine.
M. Mycle Schneider. Il faut compter les rebuts de fabrication de MOX, et la moyenne dont je dispose est bien de deux transports par semaine.
Sur le plan industriel, la séparation du plutonium a considérablement augmenté jusqu’à la fin des années 90. Ces dix dernières années, le facteur de charge des usines de La Hague, qui ont une capacité autorisée de 1 700 tonnes par an, était de 61 % en moyenne. La situation commerciale des usines de La Hague est très influencée par le fait qu’il n’y a pratiquement plus de contrats étrangers. En 2012, les combustibles stockés sur le site de La Hague étaient quasi exclusivement français.
La France est parfaitement isolée. Le retraitement commercial au Royaume-Uni se poursuit, certes, mais la décision d’arrêter les installations à la fin des contrats en cours pourrait être effective avant 2020. La Russie, pour sa part, ne retraite qu’à hauteur de 25 % de la capacité de l’usine RT1. Quant au Japon, il essaie désespérément de mettre en service une usine de retraitement, mais en vain.
M. le président François Brottes. Il ne faut pas oublier le projet chinois, tout de même.
M. Mycle Schneider. Je n’évoque pas ici les usines pilotes, militaires ou de démonstration, à savoir de petites unités. La Chine a mis en service une petite unité de retraitement et elle envisage peut-être de retraiter à grande échelle, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.
M. le président François Brottes. Ils ont bien un projet d’usine comparable à celle de La Hague ?
M. Mycle Schneider. Absolument, mais, si vous permettez, je n’entends pas entrer ici dans le domaine des spéculations : j’aborde uniquement la situation présente.
M. le président François Brottes. Donc vous n’évoquerez pas les réacteurs de la quatrième génération ?
M. Mycle Schneider. En effet, je considère qu’il s’agit aujourd’hui d’une pure spéculation.
En ce qui concerne la fabrication de MOX, la France est parfaitement seule. AREVA devait être le principal acteur d’une grande usine de fabrication de combustible MOX aux États-Unis, mais le Département de l’énergie vient de supprimer les fonds alloués au projet, notamment à cause de la dérive des coûts estimés pour l’immobilisation des 34 tonnes de plutonium militaire : on parlait de 34 milliards de dollars, soit un million de dollars le kilogramme de plutonium, vingt fois le prix actuel de l’or. Le gouvernement américain a annoncé qu’il examinerait les solutions alternatives au conditionnement du plutonium séparé. J’appelle votre attention sur cette dynamique qui aura des conséquences sur d’autres pays.
Par ailleurs, concernant les matières stratégiques, le rapport 2011 de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs précise que « la France adapte le flux des opérations de traitement-recyclage aux besoins de consommation » – en l’occurrence de plutonium – « afin de minimiser l’inventaire du plutonium séparé ». En outre, aux termes de la déclaration du sommet de la sécurité nucléaire, qui s’est tenu le 25 mars 2014, les pays signataires, dont la France, encouragent « les États […] à maintenir à un niveau minimum leurs réserves de plutonium séparé […] ».
Au milieu des années 80, il n’y avait pas de stock de plutonium en France. Il s’est constitué puis a augmenté continûment dès 1988, après la mise en place du programme MOX et le chargement du premier réacteur en 1987. Ce stock est aujourd’hui de quelque 60 tonnes de plutonium. La part du plutonium stocké en France et appartenant à des pays étrangers a continuellement diminué et atteint un peu plus de 20 tonnes.
La France est aujourd’hui le deuxième propriétaire le plus important de stocks civils, après le Royaume-Uni. Il importe de souligner que le plutonium existe sous forme de plutonium séparé et sous forme de rebuts de la fabrication de MOX. La France a, par ailleurs, repris à son compte la partie du plutonium des participants étrangers dans les combustibles de Superphénix. C’est vrai également pour le combustible du réacteur de Kalkar en Allemagne, qui n’a pas été mis en service, et pour le traitement duquel La Hague n’a pas reçu d’autorisation.
EDF a toujours utilisé moins de combustible MOX qu’autorisé.
M. le président François Brottes. En utiliser plus que la limite autorisée eût été illégal.
M. Mycle Schneider. Et qui plus est, une mauvaise idée.
Le schéma opérationnel de retraitement pour la conversion et l’enrichissement de l’uranium est apparemment au point mort : on ne fabrique pas actuellement de combustible sur la base de l’uranium retraité, ce qui pose la question de son avenir.
La partie la plus importante du plutonium étranger appartient au Japon. C’est une question particulièrement difficile sur le plan géopolitique puisque les stocks de plutonium au Japon et du Japon ont été montrés du doigt par différents pays de la région.
Force est de constater que la stratégie actuelle conduit à une impasse : l’augmentation de tous les stocks – combustibles irradiés, plutonium, uranium retraité, appauvri et autres – accroît les risques induits et les coûts, complexifie le système pour EDF et a d’importantes implications géopolitiques. D’où l’urgence de revoir le système, le schéma de fonctionnement et de bâtir une nouvelle stratégie vraiment cohérente – de ce point de vue, mes convictions de 2001 n’ont pas changé d’un iota.
Présidence de Mme Sabine Buis, vice-présidente
M. Mycle Schneider. Trois facteurs contribuent à créer une perspective qui n’a pas été anticipée ; ils plaident tous pour la nécessité d’une nouvelle stratégie. Le premier facteur est la décision du président Hollande de réduire la part de l’énergie nucléaire à 50 % à l’horizon 2025 ; le deuxième est la perspective d’un « non-besoin » d’une vingtaine de réacteurs, ainsi que l’a évoqué devant cette commission le directeur général de l’énergie et du climat ; le troisième est l’échéance des quarante ans pour les réacteurs de 900 mégawatts, notamment ceux qui sont moxés : que fera-t-on si ces derniers ne reçoivent pas leur autorisation de fonctionnement jusqu’à quarante ans, sachant que, en début d’année, seule l’unité n° 1 de Tricastin avait reçu un avis favorable ?
Un document de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), cité lors d’une précédente audition ce matin, envisage deux scénarios pour la durée de vie des réacteurs, l’un prenant en compte leur renouvellement, l’autre se fondant sur leur arrêt au bout de quarante ans. Selon les responsables de l’ANDRA, que nous avons interrogés, ce schéma a été conçu par EDF. Je suis donc surpris qu’EDF cite l’ANDRA en la matière ; une clarification s’impose peut-être. Reste que l’arrêt des réacteurs moxés à l’âge de quarante ans impliquerait qu’on cesse de séparer le plutonium, donc qu’on arrête le retraitement, si l’ensemble des stocks de plutonium est susceptible d’être absorbé dans les réacteurs existants. L’arrêt de retraitement en 2018-2019 a été envisagé avec vingt-deux réacteurs moxés, soit deux ans et deux réacteurs de plus qu’initialement prévu. Se pose de toute façon, de manière aussi urgente, la question des stocks de plutonium étranger.
À partir de ces constats, nous avons bâti trois scénarios. Le premier prévoit une reconversion du retraitement vers l’entreposage prolongé des combustibles irradiés, notamment à sec, le démantèlement, le conditionnement des déchets et l’immobilisation du plutonium. Le deuxième scénario envisage une sortie du retraitement au rythme de la fermeture progressive des réacteurs 900 mégawatts moxés, ainsi que l’envisageait l’accord préélectoral PS-Verts. Enfin, le troisième scénario propose de remplacer les réacteurs 900 mégawatts par d’autres réacteurs moxés – il pourrait s’agir, théoriquement, des réacteurs 1 300 mégawatts ou de l’EPR de Flamanville, mais, pour le moment, aucune autorisation n’a été donnée ni aucun détail technique, et aucun dossier n’est instruit par l’Autorité de sûreté nucléaire.
M. Denis Baupin, rapporteur. Quel est, sur la base du rapport Charpin-Dessus-Pellat, l’équilibre économique du dispositif selon que l’on opte soit pour la filière du retraitement et du MOX, actuellement utilisée, soit pour le stockage direct ? Il semblerait que vous n’ayez, sur la question, pas le même point de vue que les représentants d’EDF et d’AREVA.
Par ailleurs, que pensez-vous du risque de prolifération du plutonium, non seulement via les États mais aussi, éventuellement, via d’autres organisations qui voudraient s’emparer de certaines ressources à la faveur des transports nombreux de matières fissiles ?
M. Mycle Schneider. Depuis une trentaine d’années, de nombreuses études ont démontré que, quelles que soient les hypothèses émises, le retraitement se révèle plus coûteux que le stockage direct. Ce type de comparaison reste néanmoins très problématique dans la mesure où l’on ne connaît pas le coût réel d’un site de stockage définitif. Cela dit, si le retraitement conduit à une réduction du volume des déchets de haute activité, il entraîne une augmentation du volume de tout autre déchet, comme les effluents radioactifs, qui sont rejetés dans la nature sous forme gazeuse ou liquide, ou les déchets de démantèlement. Une stratégie de retraitement sur la base des volumes calculés dans un site de stockage définitif n’est pas vraiment pertinente. Il a été démontré clairement, je le répète, que la séparation et l’utilisation du plutonium se sont révélées beaucoup plus coûteuses que les autres systèmes. Ce surcoût a été évalué de 14 à 25 % par une étude de l’OCDE publiée en 2013, s’appuyant elle-même sur un éventail d’autres études.
En ce qui concerne la prolifération, elle est l’affaire autant de considérations géopolitiques que de groupes terroristes subnationaux. Elle implique, d’un côté, des pays hautement développés ayant la capacité latente de fabriquer un très grand nombre d’armes nucléaires en un temps relativement court. Si l’on prend l’exemple du Japon, depuis une dizaine d’années, le ton monte, dans la région, avec la Corée du Sud et, fait nouveau, avec la Chine qui demande explicitement au Japon de rapatrier aux États-Unis du plutonium de qualité militaire qui lui avait été prêté à des fins de recherches. De l’autre côté, la prolifération peut être le fait de groupes terroristes ayant pour objectif de fabriquer un engin explosif ou d’en dérober un. Il me paraît assez étonnant qu’on puisse transporter du plutonium séparé non-irradié sur des routes publiques parfaitement accessibles à n’importe quel véhicule. Vous pouvez ainsi croiser sur l’autoroute un camion transportant du plutonium ou du MOX frais. Je m’inquiète de l’impact que pourrait avoir l’attaque d’un camion à des fin de libération ou de vol de plutonium, malgré les mesures de sécurité évidemment mises en place.
M. le rapporteur. L’essentiel du plutonium étranger stocké à La Hague est japonais. On constate, sur le schéma que vous nous avez fourni, que cette part a décru de quelques tonnes entre 2007 et 2012, même s’il en reste plus d’une quinzaine. Quel est le statut de ce plutonium ? AREVA est-il censé le rendre au Japon ? Quel contrôle l’AIEA peut-elle effectuer sur l’utilisation potentielle de ce plutonium ?
M. Mycle Schneider. Il y a peut-être du plutonium japonais à l’usine MELOX, car la France a fabriqué du combustible MOX pour le Japon – raison, d’ailleurs, de la décrue du stock de plutonium japonais à La Hague. Aujourd’hui, plus aucun réacteur n’est en activité au Japon et leur remise en service reste très incertaine, d’autant que l’utilisation de combustible MOX y est très impopulaire – plus encore que la remise en service d’un réacteur. On ne sait, par conséquent, pas du tout si le Japon reprendra ce plutonium qui appartient aux électriciens japonais, même si la responsabilité de récupérer ces matières lui incombe.
J’ai évoqué l’existence d’accords, notamment avec les Néerlandais et les Allemands, permettant de « swapper » du plutonium. C’est ainsi que du plutonium séparé et disponible, considéré comme prélevé du stock allemand, a été envoyé en Allemagne pour y être utilisé dans des réacteurs. Il est donc parfaitement envisageable que la France reprenne une partie du plutonium dont il est question pour l’utiliser dans ses réacteurs. Toutefois, la capacité des réacteurs est limitée – on a déjà du mal à absorber les stocks français –, et je ne suis pas sûr qu’EDF serait ravie de récupérer du plutonium supplémentaire qui lui coûte très cher, même si elle ne le dit pas ouvertement. À ma connaissance, un nouveau contrat commercial postérieur à 2012 n’a toujours pas été signé entre AREVA et EDF, à moins qu’il n’ait pas été publié. Toute activité de retraitement et de fabrication de MOX fait l’objet d’accords ad hoc entre les deux groupes.
Mme Sabine Buis, présidente. Le plutonium qui sort de La Hague est-il de la même qualité que le plutonium militaire ? Peut-on en faire le même usage ?
M. Mycle Schneider. On utilise l’expression « qualité militaire » pour qualifier le plutonium spécialement fabriqué pour l’armement, c’est-à-dire que la part d’isotopes fissiles y dépasse 90 %, se situant généralement autour de 93 %, alors que la part d’isotopes fissiles dans le plutonium qui sort de La Hague est de l’ordre de 60 à 70 %.
Un État qui a un programme d’armement ne va pas utiliser, de prime abord, du plutonium tel que celui qui sort de La Hague. Cela ne signifie pas pour autant que celui-ci n’est pas utilisable dans la fabrication d’un engin explosif. Sa « performance » serait médiocre, peu calculable et il se révélerait difficile à manier, mais on peut parfaitement fabriquer un engin explosif avec la matière qui sort de La Hague. L’AIEA ne fait d’ailleurs pas de distinction dans le calcul des quantités significatives et estime qu’on peut aussi bien utiliser le plutonium de qualité réacteur que du plutonium de qualité militaire pour faire des explosifs. Cela s’applique également au MOX frais, ce qui est un point très important, car le plutonium peut être séparé de l’oxyde mixte par voie chimique, dans une installation très modeste comme un garage.
Mme Sabine Buis, présidente. Merci pour votre participation.
Audition de M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA
(Séance du 10 avril 2014)
Mme Sabine Buis, présidente. Nous accueillons maintenant M. Bernard Bigot. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a engagé un important projet : le démonstrateur technologique ASTRID, qui vise à revivifier les études et les recherches sur les réacteurs à neutrons rapides et à sodium – la filière de Phénix et de Superphénix. Le CEA participe également aux études sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis à l’hélium, en particulier dans le domaine du combustible. Pour sa part, le CNRS préfère explorer la voie des réacteurs à sels fondus, pour lesquels les verrous technologiques à faire sauter semblent encore plus nombreux que pour les deux filières précédemment citées.
Pour envisager le déploiement d’une nouvelle filière de réacteurs, la dimension technique n’est pas tout : il faut aussi mettre au point un cycle du combustible, valider le modèle économique et démontrer une sûreté robuste. La route est donc longue. Un organisme de recherche a certes vocation à défricher des voies et à prendre des risques. Encore faut-il, s’agissant d’argent public, que ces risques ne soient pas inconsidérés, que les pistes de recherche ouvrent des perspectives crédibles de succès et que l’objet des recherches permette de répondre à un besoin fondamental de notre société.
C’est pour faire le point sur tous ces aspects des réacteurs de la quatrième génération que nous avons souhaité vous entendre, monsieur l’administrateur général.
Avant de vous donner la parole, et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Bernard Bigot prête serment)
M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA. Je vous remercie de me proposer de vous faire la partager la vision qu’a le CEA du réacteur de quatrième génération.
La technologie des réacteurs à neutrons thermiques ne permettant d’utiliser que 0,6 % du contenu énergétique de l’uranium naturel extrait du sous-sol, la technique retenue pour les réacteurs français est d’enrichir l’uranium. On parvient de la sorte à 5 % de matière fissile – l’uranium 235 –, et l’on constitue ainsi un combustible dégageant la chaleur qui est à la base du cycle de production d’électricité. Mais ce combustible s’empoisonne progressivement et, au-delà de 4 à 5 % de la transformation de la matière, il ne permet plus l’indispensable réaction nucléaire en chaîne. Il convient alors d’extraire du réacteur le combustible usé, composé pour quelque 95 % d’uranium 235 et 238 en proportion variable, dont l’isotopie est supérieure à l’isotopie naturelle, pour environ 1 % de plutonium et, pour le reste, de produits de fission.
Ensuite, deux stratégies sont possibles : l’une consiste à stocker, avec un soin tout particulier, le combustible usé, pendant des périodes extrêmement longues puisque la radioactivité artificielle introduite par l’usage de ce combustible est, lorsque celui-ci sort du réacteur, de cent mille à un million de fois plus forte que la radioactivité naturelle qui a présidé à sa formation. C’est notamment le cas pour le plutonium, caractérisé par sa très longue décroissance radioactive, sa forte radiotoxicité et aussi sa criticité, autrement dit le risque de déclenchement spontané d’une réaction nucléaire en chaîne si une certaine quantité de cette matière est réunie dans un volume limité. Le choix de cette stratégie impose donc de prendre toutes les précautions nécessaires pour confiner ces déchets pour un temps très long, et dans des quantités qui ne permettront pas le démarrage spontané d’une réaction nucléaire en chaîne.
La deuxième voie possible est de traiter ce combustible usé en le dissolvant pour dissocier l’uranium non consommé, le plutonium et les produits de fission. Ces derniers n’ont plus de potentiel énergétique et leur décroissance radioactive est relativement rapide : au bout de cinq cents ans, leur niveau de radioactivité est revenu au même niveau que celui du combustible initial. Cette piste semble attractive : en séparant le plutonium – 1 % du combustible usé – des actinides mineurs, on diminue considérablement le temps de confinement nécessaire et l’on prévient tout risque de criticité. C’est le modèle des réacteurs de quatrième génération. Pour prévenir toute incompréhension, je signale d’emblée qu’il n’y a pas nécessairement substitution des réacteurs de quatrième génération aux réacteurs de la troisième génération ; j’expliquerai pourquoi ils doivent fonctionner en parallèle.
Tel est le scénario que le CEA vise à exploiter : construire le prototype d’un réacteur de quatrième génération à neutrons rapides, capable de multi-recycler l’uranium et le plutonium et de consommer, non seulement l’uranium 235 mais aussi l’uranium 238. Dans le combustible composé d’un mélange d’uranium et de plutonium, on commencera par fissionner le plutonium, ce qui permettra l’émission de neutrons qui, capturés par l’uranium 238, le transformeront à son tour en plutonium, régénérant ainsi la matière consommée. Ce mécanisme permettra d’utiliser non plus 0,6 % du contenu énergétique de l’uranium naturel extrait du sous-sol mais bien davantage : on peut espérer au moins 100 fois cela, soit 60 %, sinon davantage.
La donne est alors complètement changée. On estime que les réserves mondiales d’uranium naturel qui peuvent être extraites du sous-sol permettent de couvrir les besoins pendant deux cents ans dans les conditions d’exploitation actuelles. En utilisant l’uranium au centuple de ce à quoi l’on parvient en ce moment, on modifie radicalement les perspectives, le matériau naturel permettant alors de couvrir l’exploitation pendant vingt mille ans.
La démonstration de la faisabilité scientifique du multi-recyclage ayant été faite, le moteur de la recherche est d’apporter la démonstration de la faisabilité industrielle du réacteur ; c’est ce qui explique l’idée d’un démonstrateur technologique.
Lorsque le CEA a été chargé par la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006 d’explorer la piste d’un réacteur de quatrième génération à neutrons rapides, plusieurs options technologiques se sont ouvertes, dont celles que vous avez citées : des réacteurs à sodium, à hélium, au plomb ou à sels fondus. Si l’on ne veut pas ralentir la réaction en chaîne, le caloporteur choisi doit être transparent aux neutrons. Étant donné l’expertise acquise en France et ailleurs, tous les pays – Russie, Inde, Chine et Japon notamment – qui, visant le multi-recyclage du plutonium, ont l’intention de mettre en œuvre au cours de ce siècle la technologie des réacteurs à neutrons rapides ont choisi pour caloporteur le sodium, le métal qui présente les plus grands avantages en termes de faisabilité technologique. Lors du forum international Génération IV, l’option du réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium est apparue la plus prometteuse. Elle présente des avantages et aussi des risques, mais ces risques peuvent être maîtrisés.
Mme Sabine Buis, présidente. Quels commentaires pouvez-vous faire sur l’implication d’EDF dans ce projet ? Les réacteurs de quatrième génération vous paraissent-ils correspondre à la stratégie de l’entreprise ?
M. Bernard Bigot. EDF est l’un des partenaires du CEA dans la phase actuelle de développement du prototype ASTRID, d’une puissance de 600 mégawatts, pour faire la démonstration de sa sûreté et de son opérabilité puisque, comme vous l’avez souligné, la maîtrise complète du cycle s’impose. L’État nous a fait obligation de réunir un concours financier de l’ordre de 20 % des dépenses associées à la première phase, celle de l’avant-projet sommaire. EDF, comme AREVA et d’autres entreprises, est explicitement associée à cette démarche. EDF est aussi associée à la réflexion sur les différents scénarios possibles.
EDF est directement intéressée par ce projet. L’entreprise a la maîtrise de la technologie des réacteurs à neutrons thermiques, mais elle a aussi la responsabilité – cela a été évoqué ici même, en ma présence, il y a quelques jours – de la gestion du cycle.
Je l’ai dit, les combustibles usés peuvent être stockés en tant que tels ou recyclés. Aujourd’hui, un premier recyclage est possible et les MOX, mélanges de plutonium et de dioxyde d’uranium, peuvent être utilisés comme combustibles dans une vingtaine des cinquante-huit réacteurs à neutrons thermiques d’EDF. Cependant, ils ne peuvent être recyclés qu’une fois ; ensuite, la modification de la composition isotopique du plutonium issu de ce premier retraitement ne permet plus le maintien de la réaction en chaîne. Que faire, alors, du combustible MOX usé ? S’il est stocké en l’état, il faut prévoir le coût de son confinement pendant un temps très long et de la prévention de tout risque de criticité. EDF est donc intéressée par la démonstration technologique de la faisabilité de la solution précédemment évoquée, qui améliorerait grandement la gestion du cycle en réduisant considérablement la charge que représente la gestion du combustible usé. Voilà pourquoi le CEA et EDF travaillent de concert sur le plan technique, sur le plan conceptuel et sur le scénario propre à permettre l’utilisation de réacteurs à neutrons rapides.
Nous considérons qu’aussi longtemps que l’on pourra extraire de l’uranium naturel en quantité suffisante, les réacteurs à neutrons thermiques poursuivront leur activité ; la gestion actuelle du combustible usé continuera donc elle aussi. Or le MOX n’est pas une matière inerte : une partie du plutonium qu’il contient se transforme en américium, un radionucléide dont les caractéristiques radiologiques compliquent le traitement ultérieur du combustible usé. En outre, le MOX perd très vite ses qualités de producteur d’énergie, ce qui représente une perte considérable. Parce que l’on n’a pas intérêt à stocker les MOX usés pendant de trop longues périodes, EDF est potentiellement intéressée à ce que, parallèlement aux réacteurs de troisième génération, soient mis en marche quelques réacteurs de quatrième génération qui, après un temps suffisant de refroidissement du MOX, commenceront à brûler le plutonium extrait des combustibles MOX usés. Nous travaillons en collaboration étroite avec EDF à ce sujet.
Mme Sabine Buis, présidente. Quel sera le montant total de la dépense engagée par EDF dans le projet ASTRID ?
M. Bernard Bigot. Un financement de 625 millions d’euros est prévu pour ce projet dans le cadre du programme des investissements d’avenir. S’y ajoutent quelque 400 millions provenant de la subvention du CEA et les contributions de différents acteurs. Plutôt que d’avancer un montant erroné, je vous communiquerai les chiffres précis plus tard, mais je puis déjà vous donner un ordre de grandeur : la contribution financière des acteurs industriels associés au projet est d’une vingtaine de millions d’euros chaque année, et l’apport d’EDF est d’environ un tiers de ce montant.
Mme Sabine Buis, présidente. Pendant combien de temps ?
M. Bernard Bigot. Le projet a démarré en 2010, avec l’objectif d’aboutir en 2017 à l’avant-projet détaillé, c’est-à-dire la consolidation des concepts fondant la réalisation du réacteur, le dessin de ses composants essentiels et l’estimation des coûts. Étant donné la contrainte budgétaire, l’État nous a demandé de prolonger cet exercice jusqu’en 2019. Deux étapes sont prévues : l’avant-projet sommaire se terminera fin 2015 ; ensuite viendra l’avant-projet détaillé. Il nous a été demandé de réunir des contributions de nos partenaires industriels à hauteur de 20 % au moins du coût pour l’avant-projet sommaire – et nous sommes à 23 % –, et de 30 % pour le coût de l’avant-projet détaillé.
M. Denis Baupin, rapporteur. Parlant de la toxicité du plutonium usé, vous avez évoqué deux solutions possibles : le stocker ou le recycler dans les réacteurs de quatrième génération. On pourrait aussi considérer qu’il faudrait éviter d’en produire, mais je conviens que ce n’est pas l’objet de notre discussion ce matin.
Les réacteurs de quatrième génération permettraient donc de recycler le plutonium et l’uranium. J’aimerais que vous précisiez ce qu’il en serait de la transmutation des autres déchets à haute activité et à vie longue (HAVL), car je crois comprendre que ces réacteurs ne permettent pas d’envisager cette hypothèse.
Vous avez expliqué que tous ceux qui, dans le monde, veulent mettre au point des réacteurs de quatrième génération ont retenu la solution des réacteurs refroidis au sodium. Cela signifie-t-il, selon vous, qu’aucune des autres options ne permettrait d’aboutir au cours de ce siècle ?
Aussi bien l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) estiment que si l’on se lance dans la construction de réacteurs de quatrième génération, un saut est nécessaire en matière de sûreté. L’ASN considère ainsi que la quatrième génération « doit apporter un gain de sûreté significatif par rapport à la troisième génération et qu’ASTRID doit permettre de tester effectivement des dispositions de sûreté renforcée ». Lesquelles de ces dispositions sont à l’étude au CEA, sachant par ailleurs que le caloporteur sodium n’est pas sans poser des problèmes, comme on l’a vu avec les réacteurs Phénix et Superphénix ? On sait la criticité induite par les réactions chimiques entre le sodium, l’air et l’eau. L’IRSN évoque plusieurs points qui méritent d’être réétudiés : les capacités d’inspection en service de l’installation compliquées par l’opacité du sodium, les accidents potentiels qui pourraient être induits par les coulées de matériau fondu et la possibilité de les maintenir en cuve, l’éventualité du déclenchement d’une explosion de vapeur de sodium et son ampleur, les interactions énergétiques entre sodium et combustible fondu et le transfert de radionucléides à l’enceinte de confinement… Ces questionnements donnent le sentiment que le refroidissement au sodium suppose des progrès de conception par rapport à l’EPR et que, de plus, cette technologie présente une dangerosité spécifique. À ces interrogations, quelles réponses pourrez-vous apporter, et dans quels délais ? L’avant-projet sommaire doit être terminé en 2015, mais l’IRSN considère que le dossier d’options de sûreté devrait être rédigé en 2014. Ce calendrier sera-t-il tenu ?
Si la question de la faisabilité scientifique est tranchée, la sûreté doit encore être améliorée, et il reste à connaître le coût de l’énergie ainsi produite – car s’il apparaît, au terme de la démonstration, qu’il est largement supérieur au coût d’autres modes de production de l’électricité, la question de la pertinence du projet peut se poser. Quelle est, selon vous, la compétitivité potentielle de la production des réacteurs de quatrième génération ?
Enfin, il existe une divergence de vues entre EDF et AREVA, qui visent la mise en service de réacteurs de quatrième génération au milieu du siècle, d’une part, et l’IRSN, qui envisage plutôt la fin du siècle, d’autre part. Lequel de ces calendriers nettement différents faites-vous vôtre ?
M. Bernard Bigot. Avant de répondre à vos questions, je tiens à insister sur un point important. Du cycle de production électronucléaire sont issues chaque année, en France, environ dix tonnes de plutonium. Pour un parc nucléaire comme le nôtre, dont la durée moyenne de fonctionnement est de quarante ans, cela signifie donc la production de 400 tonnes de plutonium. Quoi qu’il advienne et quels que soient les choix, ce problème devra être traité, et je considère qu’il serait totalement déraisonnable de stocker 400 tonnes de plutonium dans notre sous-sol, car même si elles sont considérablement dispersées, le risque de criticité demeure.
Il est établi que les produits de fission ne sont pas transmutables techniquement. Leur durée de vie est de l’ordre de la centaine d’années et, au-delà de cinq cents ans, leur niveau de radioactivité rejoint celui de la radioactivité naturelle initiale. Voilà ce qu’il en est des quelque 4 % de matières non recyclables, qui peuvent être stockées dans des matrices de verre.
M. le rapporteur. Ai-je bien compris qu’au bout de cinq cents ans, les colis vitrifiés stockés à la Hague auront retrouvé un niveau de radioactivité naturelle ?
M. Bernard Bigot. Oui, s’ils ne contenaient que des produits de fission. La radioactivité du plutonium – qui constitue 1 % du combustible usé – décroît beaucoup plus lentement : à l’échelle d’un million d’années. Les actinides mineurs – américium, neptunium et curium – représentent, eux, 0,1 %. Conformément à la loi, le CEA est engagé dans la recherche sur leur transmutation. Mais le premier problème à traiter pour l’envisager est celui du plutonium : s’il n’est pas multi-recyclé, le problème demeure irrésolu et il n’y a aucune pertinence à penser transmuter l’américium. Il faut donc procéder par étapes. Aussi, le réacteur ASTRID est-il conçu pour multi-recycler le plutonium puis, une fois le multi-recyclage démontré, pour transmuter l’américium, produit à haute activité et à vie longue, en produit à vie plus courte.
J’en viens au calendrier qui doit permettre le développement industriel de ce réacteur au cours du siècle. Si l’avant-projet détaillé disponible en 2019 est robuste et qu’il satisfait certains des critères que vous avez évoqués, ce pourquoi nous sommes effectivement mobilisés ; si la décision politique est prise au bon moment ; si les moyens financiers sont réunis avec les intérêts potentiels associés, on construira ce démonstrateur technologique. On peut estimer qu’il y faudra six ans – sa durée de fabrication sera un peu plus courte que celle de l’EPR, dont il n’aura pas la puissance. On sera alors en 2025. Une dizaine d’années seront ensuite nécessaires pour démontrer les capacités de sûreté et d’opérabilité du prototype, explorer toutes les pistes de son optimum de fonctionnement et apprécier son économie ; cela conduira à 2035. À ce moment, le choix devra être fait de construire ou pas le premier réacteur de quatrième génération avec obligation d’opérabilité. Dans l’affirmative, il y faudra une dizaine d’années, et l’on sera au milieu de ce siècle, précisément le moment où les premiers combustibles MOX usés seront suffisamment refroidis pour que la démonstration soit faite qu’ils sont susceptibles d’être recyclés.
M. le rapporteur. Une première tête de série industrielle sera donc prête en 2050 ?
M. Bernard Bigot. Oui, avec un premier apprentissage des possibilités nouvelles offertes par le multi-recyclage du plutonium.
La compétitivité économique suppose une bonne opérabilité. Dans le rapport que nous avons remis au Gouvernement en décembre 2012, nous estimons le coût du kilowattheure produit dans le cas du multi-recyclage du plutonium – technologie qui dispense de l’obligation d’enrichir l’uranium – de 15 % supérieur à celui de la production d’électricité par les réacteurs de troisième génération.
M. le rapporteur. Donc, de 15 % supérieur au coût de l’électricité produite avec l’EPR ?
M. Bernard Bigot. Oui. Ce réacteur, plus complexe que les précédents et associé à un cycle de production également plus complexe, ne peut entrer en compétition stricte avec ses prédécesseurs. Mais ce surcoût peut être effacé par le bénéfice obtenu à ne devoir stocker in fine que des colis vitrifiés contenant des produits de fission à durée de vie plus courte au lieu de devoir confiner pendant un temps extrêmement long les combustibles usés. Ces derniers devront d’ailleurs être reconditionnés, car ils n’ont pas été conçus pour pouvoir être stockés durablement sans conditionnement supplémentaire ; il faudra des gainages plus résistants aux échanges thermiques de très long terme. Aussi longtemps qu’il n’y a pas déficit d’uranium naturel disponible pour faire fonctionner les réacteurs de la troisième génération, la production d’électricité par le biais d’un réacteur à neutrons rapides induira un surcoût, mais l’économie globale d’un parc où cohabiteraient des réacteurs à neutrons thermiques et quelques réacteurs à neutrons rapides serait favorable. L’un des objets de la construction du prototype est d’en faire la démonstration.
Je ne dis pas que les autres technologies – réacteurs à caloporteur plomb ou hélium, filière à sels fondus – ne pourraient faire l’objet d’une démonstration au cours de ce siècle, mais je ne pense pas leur développement industriel possible au XXIe siècle. Le grand avantage du sodium est qu’il peut être travaillé à la pression atmosphérique ; cela élimine le risque de surpression existant dans les réacteurs à eau pressurisée et facilite les démonstrations de sûreté. La Russie utilise des réacteurs à caloporteur sodium depuis quarante ans et le réacteur Phénix a fonctionné pendant trente ans ; nous disposons donc d’un retour d’expérience considérable sur lequel nous pouvons nous appuyer. J’observe que les réacteurs qui n’ont jamais fonctionné sont toujours dits plus sûrs, moins cher et meilleurs. Je doute des vertus dont ils sont ainsi parés. Dans le cas qui nous occupe, des étapes ont déjà été franchies, il faut en franchir d’autres : l’enjeu de sûreté d’abord, puis l’opérabilité, qui conditionne l’économie générale du projet.
Venons-en à la sûreté. Il est toujours très facile de prétendre que le réacteur qui vient doit avoir un niveau de sûreté supérieur à celui de la génération précédente. Selon moi, nous avons atteint, avec les réacteurs de troisième génération, un niveau de sûreté très élevé. Néanmoins, même s’il est extrêmement peu probable, un accident est toujours possible, et il aurait des conséquences dommageables. Le seul objectif qui vaille en matière de sûreté, la condition absolue, c’est qu’il ne doit pas y avoir de relâchement de radionucléides à l’extérieur du site nucléaire, même dans le cas du pire accident nucléaire. Autrement dit, il faut éviter ce qui s’est passé à Fukushima, où un relâchement de radionucléides a neutralisé pour quelques décennies un territoire de quelque 400 kilomètres carrés. C’est, pour nous comme pour nos concitoyens, l’exigence absolue, et c’est l’objectif que doivent atteindre les réacteurs de troisième génération, ce qui a impliqué des renforcements considérables en matière de conception et d’organisation. Les réacteurs de quatrième génération doivent avoir le même niveau de sûreté.
M. le rapporteur. Vous considérez que l’on en fait assez en matière de sûreté avec les réacteurs de troisième génération et que l’on n’est pas obligé de faire plus. Vous êtes donc en désaccord avec l’ASN, pour laquelle le réacteur de quatrième génération doit apporter un gain de sûreté significatif par rapport aux réacteurs de troisième génération ?
M. Bernard Bigot. Si, après un retour d’expérience de plusieurs décennies, nous avons atteint un niveau de sûreté satisfaisant, celui des critères les plus exigeants pour l’ensemble des acteurs et pour la population, pourquoi me donnerai-je pour objectif d’aller encore plus loin, handicapant ainsi le développement en question ? Si déjà la démonstration claire est faite que le premier réacteur de quatrième génération a le même niveau de sûreté que celui que j’évoque et qu’il est capable de satisfaire les exigences de sûreté les plus élevées, je ne sais pas ce que signifie « plus de sûreté » que cela.
Nous devons engager avec l’ASN un dialogue sur ce point depuis plusieurs années, mais plusieurs réunions ont été programmées qui n’ont pas eu lieu. Vous me demandez abruptement si je suis d’accord ou non avec l’ASN, mais une déclaration aimable devant votre commission ne constitue pas un débat scientifique approfondi. L’exigence que je donne à mes équipes, c’est le même niveau de sûreté que celui qui a été atteint pour les réacteurs de troisième génération et que je considère comme l’optimum – et je ne vois pas ce qu’il y a de mieux que l’optimum. De plus, nous disposons de plusieurs atouts. Le premier, je vous l’ai dit, est l’absence de surpression. Le deuxième est une inertie thermique considérable, qui donne des temps longs pour réagir. Ensuite, le nouveau réacteur est conçu comme l’EPR, avec l’acceptation que, dans les cas les plus extrêmes, il peut y avoir fusion du cœur – et dans ce cas, les matières seront confinées à l’intérieur d’une enceinte.
Il est vrai que, le sodium n’étant pas transparent à la lumière visible, la question se pose de l’inspection dans le réacteur en service. Pour cette raison, nous développons avec nos partenaires industriels une technique d’observation du bain de sodium chaud utilisant des ultrasons et d’autres moyens – comme, en médecine, le progrès scientifique a permis la conception de techniques non invasives, telle que l’utilisation de la fibre optique, pour parcourir le corps humain. C’est le genre de progrès technique majeur sur lequel nous sommes mobilisés.
À cet égard, quand l’aspect financier du projet a été évoqué, chacun aura compris que son coût ne s’explique pas seulement par des dessins : nous devons faire des recherches approfondies pour qualifier les indispensables outils de diagnostic, d’observation et de réparabilité. Nous avons ainsi mis au point et breveté un cœur « auto-sûr ». Dans le nouveau réacteur, le sodium lèche la gaine du combustible ; un « point chaud » peut se former, entraînant la vaporisation locale du sodium, dite « effet de vide sodium ». Alors que le refroidissement doit toujours être assuré, s’il n’y a plus de sodium liquide au contact de la gaine, une spirale s’enclenche et la température ne peut que croître. Ce scénario peut aboutir à une fusion locale de la gaine. Aussi avons-nous conçu un nouveau modèle de cœur qui prévient ce risque : si un tel phénomène se produisait, la réaction s’étoufferait d’elle-même.
Ce progrès technique majeur aboutit à une amélioration substantielle – et, sur ce point, je rejoins l’ASN – par rapport aux réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium qui ont fonctionné jusqu’à ce jour. L’enjeu de l’innovation est bien une amélioration par rapport à la situation actuelle ; pour autant, je ne sais pas ce qu’est la « sûreté améliorée ». Selon moi, la sûreté repose sur deux piliers. Le premier est la conception, qui doit être la plus robuste – et notre vision, j’y insiste, est que, quels que soient les événements, il n’y aura pas de radioactivité à l’extérieur. Le deuxième, c’est l’organisation, la culture de la sûreté, l’information et l’expertise des opérateurs, ce qui nous a conduits à concevoir le nouveau réacteur de la manière la plus ergonomique possible. En particulier, la radioactivité que les opérateurs travaillant dans la centrale seront susceptibles de recevoir sur le site de ces nouveaux réacteurs sera inférieure à celle d’aujourd’hui. Sur ce point, je veux bien entendre qu’il y a amélioration de la sûreté.
Mais je ne veux pas laisser accroire que le réacteur de quatrième génération permettrait d’éviter tout type d’accident. Le risque d’accident existe toujours, il faut en avoir conscience – et il est sain d’en être conscient, car cela entretient la vigilance et la mobilisation nécessaire pour que soient rigoureusement respectées les règles de fonctionnement des réacteurs.
M. Damien Abad. Je me félicite de la qualité de cette audition. Je pense, comme M. Bigot, que la conscience du risque entretient la vigilance ; le risque zéro n’existant pas, il nous faut mettre tous les moyens de notre côté pour éviter des désagréments.
J’aimerais revenir sur ce qui fait l’essence de notre commission d’enquête, l’examen du rapport coût/avantage du nucléaire. Le débat se focalise sur les fermetures de réacteurs, mais les conséquences économiques de ces fermetures ne sont-elles pas moins graves que l’absence de projets d’ouvertures ? Par ailleurs, pourriez-vous nous dire ce que le CEA attend du logiciel DEM+ d’aide au démantèlement ?
M. Bernard Bigot. Nous sommes les premiers conscients que l’on ne décide pas la construction de réacteurs nucléaire à la légère mais parce que c’est une nécessité. Dans un monde qui dépend à plus de 80 % d’énergies fossiles, l’énergie nucléaire sera nécessaire, complémentaire des énergies renouvelables. Celles-ci ont assuré les besoins d’énergie de l’humanité pendant des millénaires. Aussi longtemps que la population mondiale était inférieure à un milliard d’hommes vivant de manière dispersée selon des modes essentiellement agricoles, elle pouvait dépendre uniquement d’énergies renouvelables, diffuses et intermittentes. Dans un monde industrialisé qui comptera sous peu 9 milliards d’êtres humains aux fortes attentes en termes de conditions de vie, les énergies renouvelables à elles seules ne suffiront pas. Sauf révolution scientifique majeure qui nous rendrait capables de stocker l’énergie solaire, nous aurons toujours besoin d’une capacité de production continue et massive d’énergie. Le choix est alors entre énergie nucléaire et énergies fossiles. Étant donné le caractère fini des ressources fossiles et l’impact sur l’environnement et sur la santé de leur utilisation massive, le nucléaire est une nécessité – mais il faut faire les choses bien, ce qui signifie aller jusqu’au démantèlement et pouvoir rendre l’espace occupé par les sites nucléaires à des usages alternatifs dans les meilleures conditions.
Le CEA dépense quelque 650 millions d’euros chaque année au démantèlement de ses installations, et continuera de le faire pendant vingt ans. Le parc nucléaire français existant devra être démantelé ; il faut optimiser les techniques de démantèlement et d’assainissement. Cela suppose, avant toute chose, de diagnostiquer en quels lieux se trouve la radioactivité majeure à traiter et quelles sont les zones de radioactivité réduite qui ne posent pas de problème, car il faut trier les déchets pour ne plus traiter les matériaux usés les moins radioactifs comme doivent l’être les déchets à haute activité et à vie longue. C’est l’objet des logiciels que nous développons avec nos partenaires industriels : mieux caractériser, dès le début, là où il faut intervenir avec un haut degré de protection radiologique et là où on peut le faire dans d’autres conditions. C’est un enjeu très fort, qui nous mobilise.
Le rapport coût/avantage du nucléaire est clair. Une fois qu’un réacteur est conçu et construit, ses coûts de fonctionnement – y compris le stockage des déchets usés, le démantèlement et l’assainissement – représentent une faible fraction du coût de l’électricité. Le rapport 2012 de la Cour des comptes, confirmé par celui qui est en cours d’élaboration à votre demande et sur lequel j’ai rédigé les observations que l’on m’invitait à faire, montre que l’on est dans une fourchette comprise entre 10 et 15 % du coût associé à l’exploitation et à la gestion. Même si le prix du combustible venait à doubler, sa part dans le coût demeurerait relativement modeste. Il n’existe pas beaucoup d’installations capables de produire de l’énergie pendant soixante ans. C’est que les réacteurs nucléaires contiennent peu de pièces mécaniques en mouvement et que celles-là sont remplaçables ; il n’y a donc pas d’usure rapide. L’essentiel de l’installation, c’est la cuve en acier, objet, dans un réacteur à caloporteur sodium, d’effet thermique et d’un bombardement neutronique qui déplace chacun des milliards d’atomes une dizaine de fois par an. La redistribution incessante de l’organisation de l’acier ainsi provoquée induit, au bout d’un certain temps, une fragilité croissante, mais nous avons les moyens de la détecter, de l’observer et donc de garantir la sûreté.
Il y a donc un coût intrinsèque avantageux à l’énergie nucléaire, et ce n’est pas sans raison que des pays qui ont peu de ressources fossiles ou dont l’usage des ressources fossiles perturbe profondément l’environnement investissent fortement dans le nucléaire. C’est le cas de la Chine, de l’Inde, de la Russie et du Brésil, mais aussi des États-Unis qui, même s’ils extraient du gaz de schiste, ne veulent pas perdre la maîtrise de la technologie nucléaire, dont M. Moniz, secrétaire d’État à l’énergie, sait qu’ils pourront avoir besoin. L’énergie d’origine nucléaire présente un avantage compétitif réel si la sûreté est assurée de manière crédible.
Enfin, le nucléaire est une industrie qui se planifie. En 2050, les cinquante-huit réacteurs du parc nucléaire français existant ne seront plus en usage : outre qu’ils auront fonctionné de cinquante à soixante ans, ce sont des réacteurs de deuxième génération qui ne sont pas à l’optimum de la sûreté telle que je l’envisage pour les réacteurs de troisième et de quatrième génération. Et même si nous avons pour objectif que l’électricité que nous consommons ne soit plus alors que pour moitié d’origine nucléaire, je ne vois pas comment nous pourrons faire avec moins de trente-cinq réacteurs. La logique commande de planifier la substitution progressive des réacteurs existants par des réacteurs nouveaux, en couplant la programmation des ouvertures et des fermetures pour préserver la capacité de production, et les avantages économiques et de sûreté d’approvisionnement énergétique qui lui sont associés.
Voilà pourquoi il faut s’engager fermement dans la réalisation d’un démonstrateur technologique de quatrième génération : on pourra alors faire la démonstration que l’on est capable, avec une sûreté comparable, de fermer le cycle ancien sans aller vers de nouveaux équipements en laissant cette hypothèque ouverte.
Mme Sabine Buis, présidente. Monsieur l’administrateur général, je vous remercie.
Audition de M. Raymond Sené et Mme Monique Sené, Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN)
(Séance du 10 avril 2014)
M. le président François Brottes. Pour traiter du risque nucléaire et de son évaluation, nous accueillons cet après-midi M. Raymond Sené et Mme Monique Sené. Madame, monsieur, vous avez fondé ensemble en décembre 1975 le Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN), afin d’appeler l’attention du public sur les risques de l’énergie nucléaire. Ce groupement est devenu au fil des ans un interlocuteur connu et reconnu des instances chargées de la sûreté, des médias, des associations et des commissions locales d’information (CLI). À la demande des CLI, il a mené des expertises à l’occasion des visites décennales des réacteurs de Fessenheim, du Blayais et de Golfech. En quoi ont consisté ces expertises ? Quelle méthode avez-vous suivie ? Quels moyens avez-vous mis en œuvre ? Ces expertises peuvent-elles être comparées à celles réalisées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui déploie d’importants moyens et fait appel à de nombreux inspecteurs ?
Selon vous, où en est-on aujourd’hui en matière de maîtrise du risque nucléaire ? Qu’y a-t-il de rationnel et d’irrationnel dans l’approche de cette question ? Pour une centrale nucléaire, le vieillissement comporte un risque. Un réacteur doit être en aussi parfait état le jour où il est décidé de le fermer que le jour où il a démarré parce qu’il doit être aussi sûr. Sinon, cela signifierait qu’il aurait été potentiellement dangereux. Le progrès technique révèle de nouveaux facteurs de risque, mais donne aussi des moyens nouveaux de circonscrire celui-ci. Les exigences formulées au fil des ans par les instances chargées de veiller à la sûreté des installations ont conduit les opérateurs à neutraliser certaines incertitudes potentiellement génératrices de risque. Les évaluations probabilistes de sûreté sont censées éclairer sur le déclenchement et le déroulement de séquences accidentelles et permettre d’évaluer le niveau de risque. Le calcul de probabilités vous paraît-il un moyen pertinent d’évaluation du risque ? À Fukushima, c’est une catastrophe naturelle qui a déclenché la catastrophe nucléaire. Peu importe, me direz-vous, comment l’accident s’est déclenché. Pour autant, il me paraît important de hiérarchiser les différents paramètres pour être pédagogique sur le sujet. C’est sur tous ces points que nous souhaitons vous entendre.
Conformément aux dispositions de l’article 6 l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Raymond Sené et Mme Monique Sené prêtent serment)
Mme Monique Sené, membre fondateur du Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN). Le GSIEN est né d’une prise de conscience de physiciens, d’un côté des chercheurs qui faisaient de la recherche fondamentale en physique des particules, de l’autre des ingénieurs industriels qui travaillaient dans le domaine de la physique nucléaire. La construction des réacteurs allait en effet très vite après que la décision de création avait été prise, alors même que, comme il ressortait des dossiers que nous avions pu analyser, beaucoup d’éléments de connaissance faisaient encore défaut, notamment en matière de métallurgie et de radioprotection. Les conditions de l’approvisionnement en uranium, avec une possibilité limitée d’en extraire en France qui supposait de s’approvisionner à l’étranger, paraissaient aussi n’avoir pas été assez étudiées. Quant aux riverains des installations, ils n’avaient pas été du tout consultés. Des représentants de ces riverains avaient d’ailleurs pris contact avec nous, dans nos laboratoires, pour savoir ce qu’était exactement un réacteur nucléaire et quels problèmes cela pouvait poser. Nous-mêmes, chercheurs au CNRS en physique fondamentale, ne savions pas très bien encore de quoi il s’agissait.
En 1974, nous avons donc lancé un appel pour l’arrêt du programme nucléaire tant que les populations n’auraient pas été consultées. Cet appel n’ayant pas eu de succès, nous avons créé le GSIEN l’année suivante, puis un an plus tard, La Gazette nucléaire, journal destiné à communiquer au public, accompagnés de notre avis, les dossiers tels qu’élaborés par l’exploitant et, à l’époque, l’Institut de protection et de sûreté nucléaires (IPSN), ancêtre de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Nous espérions ainsi faire prendre conscience aux populations des problèmes que nous jugions importants. Cette gazette existe toujours…
M. le président François Brottes. Comment est-elle diffusée ?
Mme Monique Sené. Par abonnement. Nous avons encore 500 abonnés. Nous en avons eu de 1 500 à 2 000 au démarrage. Le Groupement, quant à lui, qui regroupait au départ 400 membres – ceux de l’Appel des 400 – n’en compte plus aujourd’hui que 42. Nous commençons à n’être plus tout jeunes, mais nous ne voyons pas émerger une structure qui pourrait prendre le relais du GSIEN. Cela dit, d’autres groupes étudient eux aussi de manière approfondie les rapports de l’ASN, de l’IRSN et d’EDF, de façon à pouvoir formuler un avis, ce que nous avons essayé de faire pendant quarante ans. Il est peut-être temps que nous passions la main…
M. le président Françoise Brottes. Depuis les années 1974-1975, plusieurs lois ont été adoptées, relatives à la transparence et la sécurité en matière nucléaire, à l’indépendance de l’Autorité de sûreté... Avez-vous suivi l’élaboration de ces textes ?
Mme Monique Sené. Nous avons toujours suivi ces sujets. Dès leur mise en place, nous avons participé aux commissions locales d’information. J’ai été membre dès l’origine, et je le suis toujours, en tant que personnalité qualifiée, de la CLI de l’usine de retraitement de La Hague, mise en place à l’initiative du député-maire de Cherbourg, Louis Darinaud, qui souhaitait obtenir de l’exploitant de l’époque, la COGEMA, toutes informations sur le retraitement. Quelques incidents – feux de silos, rejets de produits radioactifs… – avaient alors mis le Cotentin en émoi.
Nous avons beaucoup œuvré pour que l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) prenne de l’ampleur et puisse mutualiser les travaux réalisés par chaque commission locale. La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a imposé la mise en place d’une CLI auprès de chaque installation nucléaire de base (INB) – c’est ainsi que l’on compte aujourd’hui 38 CLI. Même auprès des INB secrètes, propriétés de l’armée, il a été demandé que soient mis en place des comités d’information capables de renseigner la population, non pas sur ce qui se passe au sein de ces installations mais de manière générale. Il existe un tel comité à Bruyères-le Châtel, à Cadarache, à Marcoule, à Valduc… Il n’y en a pas encore partout.
Nous avons toujours suivi l’évolution de la législation. Nous avons été heureux que l’ASN devienne indépendante et que l’IRSN puisse s’ouvrir à la société civile. Le dialogue avec les experts officiels nous a toujours paru fécond car ceux-ci ont accès à une documentation qu’il est indispensable de pouvoir consulter afin d’avoir une idée de ce qui se passe à l’intérieur des installations.
Nous avons participé aux visites décennales, dont la première à Fessenheim en 1989. Il y a été très difficile d’obtenir la documentation qui avait été demandée par la CLI. C’est à Fessenheim qu’en 1977, avait été mise en place la première CLI, après une grève de la faim de la militante écologiste Solange Fernex. Cette commission s’appelait à l’époque non pas commission locale d’information, mais commission locale de surveillance (CLS) et aujourd’hui encore, à Fessenheim, on parle non pas de CLI, mais de CLIS – commission locale d’information et de surveillance.
Lors de cette visite décennale, la direction de la sûreté des installations nucléaires a fini par donner accès à l’information, mais EDF n’y était pas prête. Les choses ne se sont donc pas très bien passées. Heureusement, nous avions à nos côtés un ancien expert belge de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le professeur Gillon, qui avait déjà participé à des visites en Belgique. C’est grâce à lui que nous avons pu faire notre travail correctement.
M. le président François Brottes. Depuis lors, EDF a changé de statut, l’ASN a été confortée. Comment cela se passe-t-il aujourd’hui ? Avez-vous donné votre avis lorsque l’ASN a dit que la durée de vie des réacteurs de Fessenheim pouvait être prolongée de dix ans ?
Mme Monique Sené. Nous bénéficions d’une convention d’accès à la documentation. C’est d’ailleurs pourquoi les CLI font appel à nous. Comme les dossiers sont énormes et que nous ne sommes en général que trois – un spécialiste de métallurgie, mon mari et moi – pour réaliser l’expertise, nous nous concentrons lors de ces visites décennales sur les éléments les plus importants : tout d’abord, la cuve et l’enceinte, parce qu’elles ne peuvent pas être remplacées, puis les pompes, etc. Nous analysons les dossiers ; nous organisons des réunions de travail avec EDF, l’ASN et l’IRSN ; nous visitons aussi les centrales à des moments précis. Ainsi tenons-nous à être présents lorsque les machines inspectent les cuves de façon à pouvoir discuter avec les ingénieurs. Nous regardons aussi comment les déchets sont stockés sur les sites, comment y est assurée la radioprotection… À la suite de quoi, nous rendons un avis général. Il faut savoir qu’une visite décennale dure une centaine de jours si tout se passe bien – elle peut durer le double en cas de problèmes particuliers. Les délais peuvent aussi être allongés s’il faut procéder à des travaux exceptionnels, dont la visite décennale peut être l’occasion, comme le remplacement des générateurs de vapeur. Le rapport que nous élaborons à la suite de ces visites fait une centaine de pages.
M. le président François Brottes. Les inspecteurs de l’ASN vous paraissent-ils parfaitement indépendants vis-à-vis de l’opérateur ? Percevez-vous de la connivence ?
Mme Monique Sené. J’aime beaucoup me rendre sur les sites avec les inspecteurs de l’ASN. Ils connaissent très bien les installations, ce qui nous facilite la tâche pour examiner les éléments les plus importants. Je n’ai pas noté beaucoup de connivence. Ils sont parfois très sévères.
M. le président François Brottes. Peu de connivence ou pas du tout ?
Mme Monique Sené. Non, il n’y en a pas. Ils connaissent certes si bien le sujet que cela pourrait parfois donner le sentiment d’une connivence, mais je ne n’ai personnellement jamais rencontré d’inspecteur entretenant des liens familiers avec l’opérateur – je ne dis pas qu’il n’y en a pas. Le travail a toujours été correct, aussi bien à Fessenheim qu’à Gravelines, à Golfech ou au Blayais. Les inspecteurs posent les bonnes questions et s’ils repèrent un problème, ils n’hésitent pas à imposer des mesures et fixer un délai de mise en œuvre. Ils peuvent dresser un procès-verbal et aller jusqu’à exiger la fermeture d’une centrale.
Je trouve constructif notre dialogue avec EDF, l’ASN et l’IRSN. Nous ne sommes pas toujours d’accord avec eux bien sûr, nous avons nos propres idées et les exprimons. Mais nous avons pu avoir accès aux dossiers d’EDF, notamment celui relatif à l’évolution de l’acier des cuves sous irradiation, et donc formuler un avis.
M. Raymond Sené, membre fondateur du Groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire. L’intérêt d’associer des personnes extérieures comme nous à une expertise est que, n’ayant pas « le nez dans le guidon », le regard neuf que nous portons nous permet de voir des choses auxquelles des habitués ne prêteraient même pas attention. En effet, les ingénieurs d’un site, voire les inspecteurs de l’ASN, parce qu’ils connaissent parfaitement les installations, peuvent ne plus déceler une anomalie, précisément parce qu’ils passent à côté tous les jours.
Prenons l’exemple de l’inspection des cuves. La machine d’inspection en service (MIS), robot qui effectue des mesures par rayons X et par ultra-sons, est pilotée par un programme informatique. Toutes ses mesures sont enregistrées et interprétées par le biais d’un autre programme informatique, à l’instar de ceux d’une échographie. Deux équipes, l’une d’EDF, l’autre d’Intercontrôle, analysent en parallèle, chacune de leur côté, ces résultats, à la recherche d’éventuels défauts de l’acier. Mais les deux équipes exploitent les mêmes données informatiques. Si le programme comporte un bug ou si une erreur s’est produite au départ qui a faussé les résultats, il est tout à fait possible qu’aucune des deux, tout en faisant très sérieusement son travail, ne le repère. Nous avons signalé ce problème et il semble qu’il ait été pris en compte. Le regard neuf de personnes extérieures est indispensable pour poser « les questions qui fâchent ».
Lors de la première visite décennale de Fessenheim 1 en 1989, nous avions, avec le professeur Gillon, pointé le risque d’explosion de l’hydrogène. Il a fallu plus de dix ans pour qu’on admette en France que ce risque pouvait exister. Les équipes françaises avaient même quitté le programme international consacré au sujet. Les représentants officiels auxquels nous avions affaire alors nous expliquaient que le risque était nul. On ne trouvait d’ailleurs dans le pays qu’un seul recombineur d’hydrogène, encore en kit, sur le site de Fessenheim pour l’ensemble du parc. Lorsque nous faisions valoir qu’à la centrale de Three Mile Island, une explosion d’hydrogène s’était produite dans l’enceinte au bout de dix heures, on nous répondait que c’était parce que les Américains n’avaient pas su faire face. Il a fallu très longtemps pour qu’EDF accepte d’installer des recombineurs d’hydrogène sur les sites, s’en vantant d’ailleurs lorsque cela fut fait ! Cela ne faisait jamais que quinze ans que nous alertions sur le problème !
Il est souvent arrivé que les ingénieurs d’EDF ou les spécialistes de métallurgie que nous rencontrions n’aient pas de réponse à nos questions « naïves » de non-spécialistes et que celles-ci les placent devant des abîmes insoupçonnés.
Vous ne savez peut-être pas ce qu’est la transition ductile-fragile pour les métaux, mais vous connaissez tous le récit de Jack London dans lequel un trappeur du Grand Nord canadien voit le fer de sa hache voler en éclats alors qu’il cherche à couper du bois dehors par très grand froid. Eh bien, c’est tout simplement qu’à partir d’une certaine température en dessous de zéro, le fer sort de sa zone de déformation élastique, devient fragile et casse.
Dans le cas des centrales nucléaires, il importe que l’acier des cuves n’atteigne jamais la température de transition ductile-fragile. Pour les matériaux utilisés, cette température se situe au départ autour de – 30 °C mais sous irradiation neutronique, elle ne cesse de s’élever. Pour certaines cuves, elle dépasse aujourd’hui les 60 °C, à tel point qu’il est hors de question de faire une injection de sécurité à basse température parce que la cuve serait susceptible de se casser. Lors des longues discussions que nous avons eues avec EDF et l’ASN sur le sujet, notre collègue, éminent spécialiste de mécanique, a fait observer qu’on ne pouvait aujourd’hui qu’extrapoler des théories bien connues dans le domaine fragile au domaine ductile, qui est celui concerné en l’espèce, car pour ce dernier domaine, il n’existe aucune théorie… Nous avons tant insisté sur ce point que l’ASN a récemment embauché un thésard pour travailler sur le sujet. Au moins notre action n’aura-t-elle pas servi à rien !
M. Denis Baupin, rapporteur. Merci, madame, monsieur, de votre témoignage. On voit comment la vigilance citoyenne a permis d’aller progressivement vers plus de transparence et de contrôle des installations et donc, au final, de sûreté.
L’idée de prolonger la durée de vie des réacteurs au-delà de 40 ans vous paraît-elle raisonnable ? Existe-t-il des indices vous amenant à penser que tel ou tel réacteur particulier ne pourrait pas être utilisé au-delà de ce qui était prévu au départ, notamment pour des raisons de solidité de la cuve et de sûreté de l’enceinte de confinement ?
Que pensez-vous de l’approche probabiliste pour l’évaluation du risque d’accident nucléaire ? Elle amène souvent à dire que le risque est si infime que l’hypothèse n’a finalement pas à être envisagée, même si on sait que les conséquences d’un accident seraient incommensurables. On oscille ainsi entre zéro et l’infini… Or, en dépit d’une probabilité sans doute extrêmement faible, il y a bel et bien eu des accidents nucléaires. À chaque fois, on a expliqué qu’il s’agissait d’une situation particulière : Three Mile Island, un cas particulier nous a-t-on dit ; Tchernobyl, la conséquence de la gestion qui prévalait en Union soviétique ; Fukushima, celle d’un séisme suivi d’un tsunami…
M. le président François Brottes. Tout cela n’est pas faux.
M. le rapporteur. Certes, mais ces accidents ont néanmoins eu lieu.
M. le président François Brottes. Ce n’est pas faux non plus.
M. le rapporteur. Il est toujours facile de trouver des explications a posteriori. Si tout cela était prévisible, pourquoi n’a-t-on pas pris les précautions nécessaires en amont ? La probabilité d’accident serait d’environ 10-5 par année.réacteur pour la fusion du cœur. Qu’en pensez-vous ?
L’IRSN a rendu publiques plusieurs études sur l’impact et le coût potentiel d’un accident nucléaire. Avez-vous été, à un moment ou un autre, consultés pour ces études ? Les chiffres avancés vous paraissent-ils réalistes ?
M. Raymond Sené. Peut-on prolonger la durée de vie des cuves ? La question peut en effet se poser sachant qu’elles ne peuvent pas être remplacées. Un paramètre essentiel est l’évolution de la température de transition ductile-fragile qui évolue en raison de l’irradiation neutronique en provenance du cœur. Les neutrons provoquent le déplacement des atomes au sein des structures cristallines de l’acier, entraînant son durcissement. Progressivement, la température de transition s’élève. Tout cela est fonction de la fluence, c’est-à-dire du flux neutronique total reçu par la cuve. Les aciers ont été au départ conçus pour une durée d’utilisation de 40 ans, soit, à 80 % de charge moyenne, 32 années en équivalent pleine puissance.
On examine régulièrement des éprouvettes placées à l’intérieure de la cuve, plus ou moins près du cœur et absorbant donc un flux de neutrons plus ou moins puissant. La marge d’erreur est très importante dans ces études, très complexes et très délicates. On peut se dire que si on continue de faire fonctionner une cuve au même régime qu’antérieurement alors qu’elle fonctionne déjà depuis trente ans, à un horizon de cinq ans, la limite constructeur sera atteinte. Au-delà, on ne connaît rien et à l’élévation de la température de transition, il n’existe pas de remède. Des solutions ont été développées par EDF consistant à placer des assemblages usés sur certaines zones périphériques, de façon à atténuer la puissance du flux de neutrons. Mais quoi que l’on fasse, prolonger la durée de vie des réacteurs de 40 à 60 ans, c’est nécessairement soumettre les cuves à 50 % d’irradiation de plus. Or, rien ne permet d’affirmer que l’acier n’atteindra pas une température de transition excessive et que les cuves pourront continuer de fonctionner en toute sécurité. Les seules expériences menées en ce domaine l’ont été par les Russes. Dans des cuves plus petites que les nôtres, ils ont pu procéder à des recuits de cuve avec de la vapeur sous pression à haute température. Chauffer ainsi la cuve redonne en effet un peu de liberté aux atomes des structures cristallines qui reviennent à leur position d’équilibre, ce qui fait redescendre la température de transition. Sur nos cuves, d’un plus grand volume, cela n’est tout simplement pas possible.
M. le président François Brottes. Lorsque l’ASN dit qu’on peut prolonger de dix ans la durée de vie des réacteurs, fait-elle l’impasse sur cette difficulté ?
M. Raymond Sené. Non. L’ASN dit qu’elle assure la surveillance nécessaire et que le jour où elle constatera qu’une cuve ne peut pas continuer d’être utilisée, elle ordonnera d’arrêter le réacteur. L’ASN ne peut pas, de façon générale, édicter une durée maximale d’utilisation car il faut tenir compte des périodes où un réacteur a pu être arrêté, pour maintenance par exemple. Deux réacteurs âgés de trente ans n’ont pas nécessairement subi la même irradiation. L’appréciation doit donc être modulée. L’ASN a une approche de précaution, sachant toutefois que de petits défauts peuvent migrer et se propager assez rapidement, au risque qu’une cuve corrodée ne se perce. C’est là un phénomène physique, lié au fonctionnement du réacteur, et contre lequel on ne peut rien.
M. le président François Brottes. L’ASN exerce sa mission de surveillance. Si elle constate quelque chose d’anormal, elle fait arrêter le réacteur. Il n’y a pas de risque d’accident ?
Mme Monique Sené. Pour la cuve de la centrale du Tricastin, qui est celle où ont été décelés le plus de défauts, l’ASN a demandé une réinspection à cinq ans. En revanche, elle a estimé que le réacteur de Fessenheim 2 pouvait continuer d’être utilisé. Elle est en train de rendre son avis pour les autres.
M. le président François Brottes. Si l’acier se dégrade comme vous le dites, l’ASN, en permanence vigilante, fait arrêter le réacteur. On ne risque pas d’être pris au dépourvu et il n’y a pas de risque d’accident ?
Mme Monique Sené. Les cuves sont surveillées et leur évolution est analysée. Mais de là à dire qu’un accident est impossible, nous n’en savons rien. Je serais, pour ma part, plutôt encline à considérer qu’un accident peut toujours se produire, avec bien sûr davantage de probabilité sur les cuves présentant des défauts. On sait qu’une quinzaine de réacteurs présentent des défauts, d’origine nous dit-on et qui, jusqu’à présent, n’auraient pas évolué. Ce n’est pas le cas à Fessenheim 2 où un défaut qui n’avait pas été classé s’est soudainement accru. Une fissure de cinq à six millimètres reste toutefois encore acceptable.
M. le président François Brottes. Les outils d’inspection utilisés aujourd’hui sont plus perfectionnés qu’il y a vingt ans et leurs mesures plus précises. On peut certainement détecter des défauts qui n’auraient pas pu l’être auparavant.
Mme Monique Sené. Certes, mais la connaissance concernant la propagation possible d’un défaut sous irradiation n’a pas progressé. Ce problème ne peut être étudié autrement que de manière empirique. Depuis quarante ans, bien des thèses ont porté sur le sujet mais on n’en sait toujours pas beaucoup plus. Des formules de calcul ont certes été élaborées. On pense que c’est à partir d’une fissure de 10 millimètres que la dégradation pourrait s’accélérer. Les fissures repérées ne dépassent jamais cinq millimètres. Pour l’instant, aucune cuve n’a dépassé la limite.
M. le rapporteur. En Belgique, les réacteurs de Doel et Tihange ont été arrêtés, ont redémarré puis ont de nouveau été arrêtés. Quels tests ou quelles simulations ont conduit à réévaluer le risque ?
Mme Monique Sené. Il n’y pas eu de simulation, mais un essai sur échantillon. Celui-ci n’a pas permis de conclure que les fissures observées ne progresseraient pas. Sur ces réacteurs belges, il s’agit de défauts parallèles à la paroi, alors que ceux qui ont été détectés sur certains réacteurs en France y sont perpendiculaires et proviennent de la méthode de beurrage. L’acier qui est plaqué sur la cuve doit l’être à une certaine température : si cette opération n’est pas parfaitement réalisée, des défauts peuvent apparaître, comme cela s’est produit sur les cuves du Tricastin et de Fessenheim.
M. Raymond Sené. En France, la machine d’inspection est réglée pour analyser l’interface entre la zone de protection en inox et le métal de la cuve, car c’est là que le risque de fissuration est le plus élevé, dans la mesure où c’est là que s’exercent les plus fortes contraintes au moment de la soudure. La machine est réglée pour inspecter une zone de 30 millimètres d’épaisseur, alors qu’en Belgique, elle analyse toute l’épaisseur du métal de la cuve, et pas seulement l’interface revêtement inox/cuve. Les Belges ont décelé des défauts à un endroit où nous, nous n’avons pas regardé ce qui se passait !
Mme Monique Sené. C’est une même machine d’AREVA qui est utilisée en France et en Belgique, mais ses faisceaux d’ultrasons peuvent être réglés pour examiner soit toute l’épaisseur du métal, soit seulement l’interface. Il est exact qu’en France, on ne regarde que l’interface.
D’après mes renseignements, on a mis au rebut certaines viroles qui présentaient des défauts. Il ne s’agit pas là de défauts nés d’une décohésion sous irradiation ; ils sont apparus au forgeage. De l’hydrogène a été inclus et c’est ainsi que sont apparues les 8 000 petites lacunes dont il a été tant question. En France, il y en a eu et justement, on a pu faire un coupon présentant de telles lacunes et étudier son évolution sous très forte irradiation. Ces coupons sont le moyen traditionnel d’étudier comment les éléments peuvent évoluer au fil des ans. L’expérience conduite en Belgique a conclu que, contrairement à ce que l’on pensait, les lacunes progresseraient. En France, je pense que les viroles qui présentaient des défauts n’ont pas été utilisées.
M. le rapporteur. L’ASN ordonnera la fermeture d’un réacteur si elle y détecte un problème, dit-on. Le problème est que beaucoup de réacteurs s’approchent de quarante ans, que l’ASN a renforcé les exigences de sûreté, que des investissements importants vont être nécessaires, coûteux pour l’exploitant et donc au final pour le consommateur car leur prix sera répercuté sur celui de l’électricité. Cela vaut-il la peine de se lancer dans ces opérations pour des réacteurs qui risquent de devoir être arrêtés peu de temps après parce qu’on s’aperçoit que leur cuve n’était pas aussi résistante qu’on l’avait imaginé ? Beaucoup d’incertitudes demeurent sur les investissements à réaliser, sur la capacité du pays à produire l’énergie électrique dont il a besoin… Peut-on se contenter d’attendre des inspections dont on tirera les conclusions au coup par coup ? Vu les enjeux, ne pourrait-on pas anticiper davantage ? Je sais bien que ces questions ne s’adressent pas à vous, mais quel est votre sentiment sur le sujet ?
Mme Monique Sené. Pour moi, les réacteurs ont été conçus pour une certaine fluence, qui correspond à un certain nombre d’années de fonctionnement. Comme il n’est pas possible d’établir que sous une irradiation supérieure, les matériaux ne se dégraderont pas, la raison voudrait qu’on s’en tienne à la fluence, et donc à la durée d’utilisation, prévue initialement. De toute façon, outre la cuve, tous les autres éléments du réacteur (commandes, pompes, robinets…) vieillissent aussi et leur maintenance est très difficile à assurer car elle s’opère en milieu très radioactif sur des éléments eux-mêmes très radioactifs.
Par ailleurs, au bout de trente ou quarante ans, les usines qui ont fabriqué les pièces d’origine n’existent plus. Il faut donc refaire fabriquer des composants, mais ceux-ci le sont avec les méthodes actuelles, si bien qu’ils ne correspondant pas exactement à ce qui est souhaité. EDF a rencontré des problèmes lorsqu’il a dû refaire faire des coussinets pour ses diesels. Une seule usine était capable de les fabriquer. Or, les diesels d’EDF présentent la caractéristique qu’ils doivent monter en régime le plus vite possible – ce qui n’est pas le cas des diesels d’un bateau par exemple. Il y a eu des problèmes également avec les turbines et les robinets. D’autres sont apparus après le changement de certains contacteurs dans les transformateurs : les nouveaux contacteurs ne marchent pas, et c’est ainsi que des feux ont pu se déclarer dans certains transformateurs. C’est un gros dossier qu’EDF cherche à traiter depuis 2004.
Tous les éléments d’une centrale vieillissent. À l’exception de la cuve, on pourrait imaginer de les changer tous ou presque. Mais ne rêvons pas, on aura beau avoir fait le plus gros stock imaginable de pièces détachées, jamais cela ne suffira, sans compter que ces pièces détachées, il faut les vérifier régulièrement pour s’assurer qu’elles restent en bon état. Il faudra donc nécessairement faire fabriquer de nouvelles pièces, au risque de retomber sur les problèmes évoqués ci-dessus. C’est pourquoi la raison dicte d’arrêter les réacteurs dès que les pannes y deviennent plus fréquentes, ce qui crée des problèmes sur les structures. Ils ont été conçus par le constructeur pour une certaine fluence mais aussi un certain nombre seulement de transitoires en pression et en température – de 150 à 300. Les techniciens doivent tenir compte de tout cela.
Un autre problème vient d’apparaître avec les gaines des aiguilles de combustible. On savait très bien que le zircaloy, nom de marque d’alliages de zirconium, était un matériau difficile à travailler mais on n’a pas tenu compte du fait qu’il pouvait désquamer. Pour un matériau de cinquante microns d’épaisseur, desquamer peut vite devenir dangereux. Cela ne signifie pas qu’en résultera une catastrophe, mais on ne pourra pas laisser le combustible aussi longtemps que prévu dans le réacteur. La production électrique sera donc moindre et les combustibles, ayant moins longtemps brûlé qu’ils auraient dû, émettront davantage de radioactivité lors de leur retraitement.
Pour ce qui est de l’approche probabiliste, on peut certes établir que la probabilité d’un accident n’est que de 10-5, mais lorsqu’un accident survient, sa probabilité est devenue de 1. À Fukushima, le seul facteur explicatif n’est pas le séisme et le tsunami qui a suivi. Le fait que l’exploitant, Tepco, ait laissé ses diesels en sous-sol, problème qui lui avait d’ailleurs été signalé mais qu’il n’avait rien fait pour résoudre, et que ses réservoirs n’aient pas été assez résistants, a aussi joué dans la catastrophe. Nul ne nie la violence du séisme et du tsunami, mais il est clair que Tepco n’avait pas pris les mesures de prévention nécessaires, sauf pour les réacteurs 5 et 6, les deux derniers à avoir été construits et placés sur une plate-forme. Pour autant, le séisme, qui était de nature cisaillante, y a aussi cassé des éléments, même si certains ont prétendu que non. À Fukushima, il s’agissait non pas de réacteurs à eau pressurisée comme les nôtres, mais de réacteurs bouillants qui se pilotent par l’adjonction de toutes sortes de tuyaux arrivant à différents niveaux du réacteur. Si les canalisations sont abîmées, on ne parvient pas à y rajouter de l’eau.
Un tel scénario d’accident, avec perte à la fois de l’alimentation électrique et des circuits de refroidissement, n’avait jamais été envisagé, non plus que le fait que quatre réacteurs puissent se trouver « en folie » en même temps. On n’avait jamais imaginé que deux, a fortiori quatre, puissent être abîmés simultanément. On n’a jamais imaginé en France que les quatre réacteurs de la centrale du Blayais ou les six de celle de Gravelines puissent tous à la fois ne plus marcher. Lors de tests réalisés justement après la catastrophe de Fukushima, on s’est aperçu que les tuyaux des réacteurs 1 et 2 de Gravelines n’étaient pas compatibles avec ceux des réacteurs 5 et 6. Il a d’ailleurs été immédiatement prescrit de remédier à cette incompatibilité : il faut impérativement que sur un site, un réacteur puisse en alimenter un autre.
Pour étudier le scénario d’un accident nucléaire et ses conséquences, il faut considérer que l’accident s’est produit, sans, comme le fait EDF, affecter d’un coefficient de probabilité chaque événement potentiel. L’approche probabiliste a certes un sens, mais pour être pertinent, il faut considérer que chaque événement s’est produit et voir quelle solution on apporte à chaque problème. C’est ce qu’a demandé l’ASN.
M. le président François Brottes. Madame, monsieur, nous vous remercions.
Audition de M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
(Séance du 10 avril 2014)
M. le président François Brottes. Monsieur le directeur général, soyez le bienvenu. Notre commission d’enquête se penche aujourd’hui sur la question des risques et des coûts d’accidents nucléaires. En cette matière, les estimations réalisées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont de quoi donner le vertige.
Selon M. le rapporteur et M. Gorges, vous auriez déclaré, à l’occasion d’une conversation informelle, que les réacteurs de quatrième génération ne verraient pas le jour avant la fin du siècle. Or les responsables d’EDF, d’AREVA et du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) que nous avons auditionnés ce matin nous ont confirmé les dates de 2017 pour l’avant-projet sommaire (APS), de 2019 pour l’avant-projet détaillé (APD) et de 2050 pour la mise en service industrielle ; au passage, ils se demandent comment, sans les avoir interrogés, vous pouvez avoir un avis à ce sujet. Avant d’en venir au thème qui nous occupe, il serait utile de vous entendre sur ce point dans le cadre de notre instance.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jacques Repussard prête serment)
M. Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Je vous confirme mes propos d’hier : un déploiement industriel à grande échelle des réacteurs de quatrième génération ne me semble pas envisageable avant les dernières années de ce siècle. Ce n’est pas l’avis officiel d’un expert de l’IRSN ; c’est un sentiment personnel, fondé sur ma connaissance des pratiques du système nucléaire français. Il est difficile d’imaginer que la construction de tels réacteurs commence au cours du présent quinquennat, d’autant que l’IRSN a soulevé des questions qui n’ont pas encore trouvé de réponses. Une fois les expertises réalisées – ce qui, au vu de l’exemple de l’EPR, devrait prendre dix ans – et le réacteur construit, il faudra attendre le retour d’expérience, sur lequel s’appuieront les décisions économiques relatives à l’exploitation : tout cela prendra assurément plus de temps que pour les réacteurs à eau légère construits dans les années 70 et 80. Mon raisonnement tient compte de la viscosité des procédures au sein de la filière.
M. le président François Brottes. Si je vous suis bien, c’est l’ensemble des éléments de contexte, et non le seul aspect technologique, qui justifie votre point de vue.
M. Jacques Repussard. Oui, monsieur le président.
M. le président François Brottes. Le rapport de la Cour des comptes de janvier 2012 fait état des chiffrages de votre institut en matière d’accidents nucléaires : 120 milliards d’euros, soit 6 % du PIB, pour un accident grave, et 450 milliards pour un accident majeur – vous nous expliquerez la différence entre les deux. D’autres chiffres ont circulé, que je peinerais à prononcer tant ils sont élevés. Quelle est la robustesse du raisonnement économique à l’origine de ces estimations ? Est-on en mesure d’établir des probabilités en matière d’accidents nucléaires ? Vous me direz que, si un accident survient, peu importe la probabilité qu’il soit arrivé… Reste que la probabilité est un critère d’appréciation du risque.
M. Jacques Repussard. Dans le cadre de l’amélioration au fil de l’eau des mesures de sûreté, EDF a proposé à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en 2007, d’inclure le paramètre coût-bénéfice, que l’ASN nous a à son tour demandé d’expertiser. Il s’agit donc de calculer le coût, pour EDF, des décisions de l’ASN tendant à prévenir un accident au regard du bénéfice que représenterait le fait d’éviter le même accident. Nous nous sommes aperçus qu’EDF avait oublié d’intégrer de nombreux éléments à ce coût, ce qui valorisait d’autant le bénéfice.
M. le président François Brottes. Votre expertise a été une douche froide…
M. Jacques Repussard. Après avoir publié un premier rapport confidentiel sur le sujet, nous avons décidé d’approfondir notre expertise – notamment à travers la création d’un laboratoire de recherche dirigé par M. Momal –, afin de réduire les marges d’incertitudes, qui demeuraient grandes.
Les scénarios étant en nombre infini, il convient tout d’abord de définir ce qui serait un accident de référence, d’un coût médian. Parmi les nombreux types possibles, nous en avons ciblé deux, avec rejets radioactifs : l’accident « grave » s’accompagne de rejets importants mais maîtrisés par l’exploitant, et l’accident « majeur », de type Fukushima, de rejets non maîtrisés. Les mécanismes de défense en profondeur et les procédures de sûreté rendent l’accident majeur très improbable ; aussi l’industrie nucléaire a-t-elle été prolixe sur cette probabilité, qui cependant n’est pas nulle – d’où le parti pris de nos travaux.
Un scénario d’accident doit évidemment prendre en compte l’environnement socioéconomique du département où est implantée la centrale, mais aussi la météorologie, par définition imprévisible longtemps à l’avance. Nous avons donc choisi un site français de référence, représentatif d’une situation moyenne, et, à partir d’un scénario d’accident, lancé nos simulateurs en y intégrant, au jour le jour, les données météorologiques réellement observées sur la zone tout au long d’une année antérieure. L’ensemble de ces données a été pondéré afin de constituer une moyenne.
M. le président François Brottes. Pourriez-vous donner quelques précisions sur la nature de cet accident théorique ?
M. Jacques Repussard. Dans l’accident grave, une partie des espèces volatiles du cœur est rejetée.
M. le président François Brottes. Qu’est-ce qui provoque ce phénomène ?
M. Jacques Repussard. À la limite, peu importe ; mais le scénario-type est celui d’une interruption du refroidissement du cœur entraînant une fusion de celui-ci au sein de la cuve. Si aucun autre refroidissement n’intervient, le circuit primaire s’ouvre et la montée en pression à l’intérieur de l’enceinte oblige l’exploitant, s’il veut garder la maîtrise de l’installation, à ouvrir les filtres, si bien que la radioactivité s’échappe à l’extérieur.
M. le président François Brottes. Il importe quand même de connaître la probabilité d’un tel scénario !
M. Jacques Repussard. La probabilité, je le répète, est faible mais non nulle ; d’où la nécessité d’un scénario physiquement réaliste, qui permette d’évaluer les coûts a priori.
Nous nous sommes efforcés d’identifier les composantes du coût. Les composantes radiologiques, autrement dit imputables à la présence de radioactivité, étaient déjà connues des industriels : évacuation des populations, éventuels dommages sanitaires si celle-ci n’est pas assez rapide ou pertes de productions agricoles. Mais, l’exemple de Fukushima le montre, il faut ajouter d’autres composantes non prises en compte par les acteurs du nucléaire à travers le monde, États-Unis en tête, depuis une quarantaine d’années. Ce sont d’abord les coûts liés, pour l’exploitant, au démantèlement du réacteur accidenté et à la remise en état du site ; ce sont ensuite les coûts élevés du remplacement de la source d’énergie électrique, car un accident, même de faible ampleur, entraînerait l’arrêt de la production des réacteurs du même type, et ce dans l’urgence : au Japon, cette mesure de précaution a d’ailleurs fait monter le prix du gaz au niveau mondial. Ce sont enfin les coûts d’« image » générés par l’aversion des acteurs économiques aux risques radiologiques, ce dont pâtirait l’attractivité de tous les territoires, et pas seulement de ceux qui ont été contaminés. Au Japon, des produits en provenance de zones très éloignées de Fukushima sont ainsi devenus invendables. Grâce à l’IRSN, l’Union européenne est revenue sur son intention d’interdire l’accès au port de Yokohama des bateaux battant pavillon européen – je vous laisse imaginer quelles eussent été les conséquences d’une telle décision pour le commerce japonais. Il faut donc tenir compte de l’impact d’un accident sur des secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, voire l’industrie.
Selon nos estimations, dans un pays comme la France, ces différentes composantes peuvent représenter jusqu’à 50 % du coût total ; d’où les chiffres que vous avez cités, monsieur le président.
M. le président François Brottes. Il y en a un troisième, que je n’ai pas cité.
M. Jacques Repussard. Les chiffres de 450 milliards et 120 milliards d’euros correspondent respectivement aux coûts médians d’un accident majeur et d’un accident grave.
Nos travaux, toutefois, n’avaient pas pour objectif de fixer des coûts, par définition très aléatoires, mais d’expertiser les approches ayant cours, dans le monde, sur le paramètre coût-bénéfice. Notre but, en d’autres termes, est d’éclairer les décideurs publics sur les composantes du coût – celui-ci déterminant les réflexions sur le calcul des indemnisations, les assurances et les pratiques de l’industrie –, afin de leur permettre d’en tenir compte, étant entendu que les chiffres peuvent grandement varier en fonction des décisions : le coût ne résulte pas seulement de l’accident lui-même, mais aussi de la façon dont celui-ci est géré par les nombreux acteurs. Le sens de notre rapport n’est évidemment pas de procéder à un chiffrage au centime près, mais de mettre en évidence des paramètres sur lesquels il est possible d’agir, notamment dans le cadre des politiques de prévention. M. Ayrault a autorisé la publication d’un nouveau plan de gestion des risques nucléaires, relayant ainsi la décision de M. Fillon après l’accident de Fukushima. Ce plan présente des pistes d’action dont certaines font écho à notre rapport, en particulier sur le problème de la continuité de l’activité économique au regard du droit de retrait des travailleurs : l’impact serait d’autant plus lourd qu’il n’a pas été mesuré à l’avance.
M. le président François Brottes. Par le fait, votre rapport sert davantage à dresser l’inventaire des éventuelles conséquences collatérales, afin de les limiter autant que faire se peut, qu’à présenter une addition dont on perçoit les marges d’incertitude.
M. Denis Baupin, rapporteur. Je vous remercie de votre travail, monsieur le directeur général. Dès lors que l’ASN comme l’IRSN estiment qu’un accident nucléaire est possible en France, la meilleure chose à faire est évidemment de l’empêcher, mais il faut aussi en mesurer les impacts éventuels.
La probabilité d’un tel accident, avez-vous déclaré, est très faible. On a l’habitude d’entendre que le risque de fusion du cœur équivaut à 1x10-5 par année-réacteur ; or ce sont 3 480 de ces années qu’il faut prendre en compte si l’on fait fonctionner les cinquante-huit réacteurs français pendant soixante ans, comme le souhaite EDF ; si bien que le risque atteint alors près de 3,5 %. Par ailleurs, un certain Jacques Repussard n’a-t-il pas déclaré au journal Le Monde, après Fukushima, qu’au vu des accidents déjà intervenus, la sous-évaluation atteignait sans doute un facteur 20 ? Afin de n’effrayer personne, je me garderai de multiplier 3,5 % par ce facteur mais, au-delà de la vérité des chiffres, on a le sentiment que la probabilité n’est pas aussi infime qu’on le dit.
Quant aux coûts, vous avez montré qu’ils sont liés aux interactions possibles dans nos sociétés complexes. C’est ce qui explique la difficulté des évaluations, d’autant que le facteur météorologique est loin d’être négligeable : lors de la catastrophe de Fukushima, le vent, heureusement pour les Japonais, avait soufflé non pas vers Tokyo, mais vers la mer ; dans le cas contraire, les conséquences humaines, environnementales et économiques eussent été bien plus lourdes. Or, sauf erreur de ma part, le rapport de la Cour des comptes fait état, pour les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, de factures comprises entre 600 et 1 000 milliards. Les ordres de grandeur ne sont donc pas très éloignés de vos propres projections. J’imagine, par exemple, que vos scénarios ne décrivent pas des accidents survenus à proximité des grandes agglomérations – auquel cas le coût se situerait plutôt dans le haut de la fourchette.
Il ne s’agit pas d’agiter des chiffres pour faire peur, mais de mettre en lumière certaines carences du système assurantiel français, dérogatoire en matière de risques nucléaires. Cela peut se justifier au regard de la nature de ces risques, mais le fait que la collectivité assume les conséquences financières d’un accident représente une forme de subvention au profit du nucléaire : cela mérite à tout le moins une évaluation, notamment dans le cadre de notre commission d’enquête, ne serait-ce que pour comparer les énergies entre elles et leurs coûts respectifs pour la collectivité.
Aux dires des assureurs, il faudrait, pour calculer la prime annuelle, multiplier le coût d’un accident – de 120 à 450 milliards d’euros, donc – par la probabilité que celui-ci survienne, selon le chiffre que j’indiquais tout à l’heure, et tenir compte, éventuellement, d’un autre facteur touchant à la disponibilité des sommes. Quel est votre sentiment sur ce point, sachant qu’aujourd’hui, les exploitants ne sont responsables qu’à hauteur de 91,5 millions d’euros ? Il est question de porter ce chiffre à 700 millions lors de la révision de la Convention de Paris, mais la différence avec les ordres de grandeur que vous avez mentionnés resterait encore d’un facteur 1 000 : même si l’ensemble du coût ne peut être couvert, une telle disproportion laisse un reste à charge considérable pour l’État. Ce coût, dont on espère évidemment qu’il demeure théorique, figure d’ailleurs parmi les comptes « hors bilan » pointés il y a quelques mois dans un rapport de la Cour des comptes.
Je me permets également de vous poser, une nouvelle fois, les questions que je vous ai posées hier lors de notre déjeuner de travail. La loi de transition énergétique entérinera peut-être la révision de la Convention de Paris quant à l’augmentation du plafond de responsabilité de 91,5 à 700 millions d’euros. La loi peut-elle fixer un plafond plus élevé ? Que dit exactement la Convention de Paris à ce sujet ?
En cas d’accident touchant des centrales situées non loin des frontières, les conséquences pourraient concerner d’autres pays – ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes pour la gestion des risques. Comment, alors, envisager les questions d’indemnisation ? Y a-t-il des risques de contentieux juridiques avec des pays voisins, dont certains ont décidé d’arrêter le nucléaire parce qu’ils l’estiment dangereux ?
Quid, enfin, de l’indemnisation des particuliers, sachant que les contrats d’assurance excluent le risque radiologique ? En d’autres termes, si des logements deviennent inhabitables à la suite d’un accident nucléaire, leurs occupants ne seront pas indemnisés. Le droit japonais n’avait rien prévu non plus pour les populations qui ont dû être déplacées suite à l’accident de Fukushima. Une procédure spécifique, déclenchée par l’État, existe pour les risques de catastrophe naturelle ; elle permet d’indemniser les victimes à des niveaux et dans des délais raisonnables. Ne pourrait-on s’en inspirer pour les catastrophes nucléaires ?
M. le président François Brottes. Le calcul qui consiste à multiplier le facteur 10-5 par le nombre de centrales et d’années.réacteur ne vous semble-t-il pas spécieux ?
La couverture contre les catastrophes naturelles n’est pas universelle. Pour avoir été maire d’une commune de montagne exposée à des risques d’éboulements, je sais qu’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) peut placer certains habitants en zone rouge, si bien que la valeur de leur patrimoine s’en trouve du jour au lendemain réduite à zéro, et que les assureurs refusent de les couvrir s’ils ne construisent pas, à leurs frais, des digues contre ces éboulements. Bref, le droit assurantiel n’est pas muet que pour les risques technologiques.
M. Hervé Mariton. Le fonds Barnier n’assure-t-il pas une couverture ?
M. le président François Brottes. Non, il vient seulement en soutien ; mais lorsque, sur l’injonction d’un PPRN, une commune modifie son plan local d’urbanisme (PLU), la valeur des logements situés en zone à risques s’effondre et les assureurs refusent de s’engager faute de travaux à la charge des propriétaires.
M. Hervé Mariton. Les accidents auxquels songe le rapporteur ne sont pas du même type que ceux visés par le facteur 10-5. Pourriez-vous apporter des précisions sur ce point ? Vous n’avez pas non plus évoqué, me semble-t-il, le troisième chiffre auquel le président Brottes a fait allusion.
M. Jacques Repussard. Fixer un chiffre maximal n’a pas de sens. Le coût de l’accident de Three Mile Island – une fusion du cœur sans rejet radioactif – n’a pas dépassé quelques milliards ; celui de l’accident de Fukushima atteindra peut-être le millier de milliards de dollars. Plutôt que de spéculer sur des minima et des maxima, il convient de s’en tenir à des chiffres médians, à partir desquels on peut définir des politiques publiques.
Sauf votre respect, monsieur le rapporteur, il ne faut pas confondre calcul statistique et calcul probabiliste. Le facteur de 10-5 – voire 10-6, selon certaines estimations – résulte de l’addition de fragments de probabilités portant sur des arborescences de causes susceptibles de provoquer la fusion du cœur – laquelle n’entraîne pas forcément un rejet radioactif. Ces calculs n’intègrent pas l’ensemble des variables. Le paramètre de l’interface entre l’homme et la machine, par exemple, est difficile à quantifier. Par construction, les probabilités affichées par l’industrie nucléaire sont donc minorées, même si ce n’est pas de beaucoup. Ces chiffres ne prennent pas non plus en compte les aléas extérieurs à la centrale, aléas que l’on peut donc représenter autrement – périodicité de retour d’un séisme, par exemple.
Il y a quelques années, monsieur le rapporteur, j’ai voulu dire la chose suivante : au vu du nombre de centrales exploitées dans le monde, le nombre d’accidents graves est statistiquement proche de celui que l’on constate pour d’autres grandes installations technologiques, telles que les raffineries. Dès lors, je m’interrogeais sur le fait de savoir si l’humanité était capable d’aller plus loin dans la prévention des risques technologiques. Je ne renie en rien ce calcul, mais le transposer à la France serait une faute mathématique. Votre calcul, par exemple, ne prend pas en compte les années écoulées, au cours desquelles il n’y a pas eu d’accident grave. De plus, beaucoup de mesures de prévention des risques ont été prises depuis la construction des centrales, notamment après les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Bref, votre multiplication oublie un certain nombre d’éléments.
M. le rapporteur. Je ne prétendais pas que cette démonstration fût mathématiquement vraie : j’entendais seulement mettre en évidence que la probabilité n’est pas aussi infime qu’on le répète, comme le confirme d’ailleurs votre comparaison statistique avec d’autres secteurs technologiques.
M. Jacques Repussard. C’est vrai mais, je le répète, cette comparaison est à l’échelle du monde. On est en droit de penser, au vu des moyens déployés, que la probabilité d’un accident est plus faible en France.
M. le président François Brottes. De fait, à ce jour, les cas d’accident sont plutôt survenus à l’étranger…
M. Jacques Repussard. Tout le système français, depuis l’exploitant, principal responsable de la gestion des installations, jusqu’aux autorités compétentes en passant par les commissions locales d’information (CLI), tend à la sûreté. Nous faisons davantage d’efforts que d’autres, ce qui se traduit dans les probabilités. Il faut espérer, bien entendu, que nous n’ayons jamais à faire un calcul statistique au niveau français, et que le numérateur reste égal à zéro. S’il fallait donner une probabilité, elle avoisinerait sans doute le 10-4.
M. le rapporteur. Par année-réacteur ?
M. le président François Brottes. À mon avis, monsieur le rapporteur, une telle mise en facteur est fallacieuse.
M. Jacques Repussard. Je vous avais adressé un courriel à ce sujet : j’en ferai un document que je vous communiquerai, monsieur le président. Sur cette question complexe, il convient de manier les chiffres avec prudence.
Le système assurantiel français fait l’objet de dispositions législatives elles-mêmes issues de traités internationaux, qu’il s’agisse de la Convention de Paris ou du protocole de Bruxelles. Ce dispositif définit tout d’abord la responsabilité de l’exploitant qui, aux termes d’une disposition adoptée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), est considéré comme responsable, qu’il soit ou non en faute ; en contrepartie de quoi cette responsabilité fait l’objet d’un plafond fixé par la loi. Le protocole de Bruxelles, que notre pays doit encore ratifier, prévoit de porter ce plafond à 700 millions d’euros. S’y ajoute un complément d’indemnisation par les États, financé pour partie par l’État où survient l’accident, et pour une autre partie via un mécanisme de solidarité entre États nucléaires géré par le FMI, le Fonds monétaire international. La France pourrait ainsi, par l’intermédiaire de cette double contribution, mobiliser jusqu’à 1,5 milliard d’euros. Au-delà de ce plafond, nous sommes dans un vide juridique qui ne pourrait être comblé que par des évolutions législatives.
Au regard des projections de l’IRSN, il est donc hautement probable qu’en cas d’accident, les montants d’indemnisation soient environ dix fois inférieurs aux seuls coûts radiologiques, lesquels ne constituent bien entendu qu’une partie des coûts pour la société. Par conséquent, la question reste posée de savoir s’il faut s’en tenir à ce montant de 1,5 milliard d’euros ou aller au-delà. Il y a là matière à un débat politique, étant entendu que ces montants, jusqu’à présent, ont été négociés dans le cadre de l’OCDE et d’Euratom ; j’ignore s’ils figurent dans le « hors bilan », mais il me paraît sage de rester dans le cadre international, afin de ne pas pénaliser financièrement notre pays.
M. le président François Brottes. Le cas d’AZF illustre la lenteur des procédures. Il existe plusieurs unités à risques en Europe, y compris dans des pays peu nucléarisés, où l’indemnisation, objet d’intenses querelles entre assureurs, dépend de décisions de justice qui se font attendre pendant des années : il n’y a pas de cadre comparable à celui qui existe pour les catastrophes naturelles.
M. Jacques Repussard. Pour les accidents nucléaires, cette question ne se poserait pas compte tenu de la responsabilité sans faute de l’exploitant et des mécanismes d’indemnisation par l’État. La question posée est celle du niveau de l’indemnisation. C’est d’ailleurs parce que le risque nucléaire est pris en compte par la loi que les assureurs s’en déchargent en toute bonne conscience. Le mécanisme de solidarité internationale est utile et vertueux, mais les moyens mobilisables sont sans doute, je le répète, très inférieurs aux besoins.
M. le rapporteur. Nous parlons donc d’une petite vertu…
M. Jacques Repussard. Je vous laisse la responsabilité de cette remarque…
M. le président François Brottes. La maille est sans doute trop étroite ; mais au moins le problème a-t-il été traité pour cette filière industrielle, fût-ce partiellement, alors qu’il ne l’a pas été pour d’autres.
M. Jacques Repussard. Oui, même si, en matière de catastrophes naturelles, l’État pallie les insuffisances des primes d’assurance à travers le système de réassurance. Le mécanisme d’indemnisation existe pour les risques nucléaires ; c’est sur son dimensionnement qu’il faut s’interroger – c’est là le rôle de l’État et du Parlement.
Ce mécanisme ayant une dimension internationale, la question de l’indemnisation hors des frontières, monsieur le rapporteur, relève sans doute moins des tribunaux que d’un jeu institutionnel.
Le fait est que l’indemnisation ne pourrait couvrir l’ensemble des coûts d’image, tant le lien direct entre l’accident et ce type de préjudice, par exemple dans le secteur du tourisme, serait difficile à établir malgré un impact bien réel. Bref, tous les coûts ne sont pas indemnisables, et seule une partie de ceux qui le sont serait effectivement indemnisée, compte tenu des montants prévus.
M. le rapporteur. La collectivité pourrait tout à fait décider, comme elle le fait parfois, de soutenir des filières ayant subi un préjudice en termes d’image : cela représenterait alors un coût supplémentaire à sa charge.
M. Jacques Repussard. Bien entendu : rien n’empêche le Parlement de voter des mécanismes de solidarité ; nous disons seulement qu’à ce jour, aucune disposition n’est prévue au-delà de celles dont j’ai parlé.
M. le président François Brottes. Existe-t-il des dispositifs pour les barrages hydrauliques ?
M. Jacques Repussard. Je l’ignore, monsieur le président.
M. le président François Brottes. Monsieur le directeur général, je vous remercie.
Audition de M. Gilles Trembley, directeur du GIE Assuratome, de M. Maurice Corrihons, directeur des Spécialités de la Caisse centrale de réassurance, et de M. Pierre Picard, professeur au département d’économie de l’École Polytechnique
(Séance du 2 avril 2014)
Des documents mis à la disposition de la commission d’enquête sont accessibles à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314045.pdf
M. le président François Brottes. Je remercie MM. Gilles Trembley, Maurice Corrihons et Pierre Picard d’avoir accepté notre invitation. Nous traitons cet après-midi du risque nucléaire, de son impact, de ses effets collatéraux non maîtrisés et de ses modalités d’assurance. Nous n’aborderons pas en revanche la question des probabilités de ce risque ni les différents scénarii auxquels l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a travaillé.
Contrairement à ce que l’on observe dans d’autres domaines tels que la forêt et l’agriculture – où la question des assurances est si complexe à traiter que le ministère continue d’y travailler, alors même que les accidents sont très fréquents – la loi et le règlement ont clairement défini les obligations et responsabilités de la filière nucléaire. Notre but étant d’évaluer les coûts réels de celle-ci, nous souhaiterions examiner si l’assurance y est portée au bon niveau et à quelle fin.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Gilles Trembley, Maurice Corrihons et Pierre Picard prêtent serment)
M. Pierre Picard, professeur au département d’économie de l’École Polytechnique. Notre régime d’assurance du risque nucléaire est conforme à des principes de responsabilité – limitée, en l’occurrence – des opérateurs et des États qui ont été définis par plusieurs conventions internationales. Lorsque l’on s’intéresse aux coûts d’une activité à risque, il importe de bien garder à l’esprit l’objectif d’internalisation de ce risque, qui vise à faire en sorte que les acteurs économiques dont l’activité est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables puissent en être tenus responsables et que ces dommages potentiels s’imputent dans leur calcul économique, pour deux raisons principales. D’une part, parce que de tels mécanismes de responsabilité constituent aussi des incitations permettant d’envoyer les bons signaux-prix et, d’autre part, afin de faciliter l’indemnisation, en favorisant notamment le provisionnement des risques.
Or, le caractère limité de la responsabilité des opérateurs nucléaires et des États signataires des conventions internationales est tel que cette internalisation n’est pas effective, ou du moins est-elle très limitée. Il est en effet difficile de couvrir des risques très importants mais de probabilité extrêmement faible à l’aide de mécanismes d’assurance traditionnels. Un tel constat soulève alors deux questions : d’une part, celle de l’évaluation du coût du risque nucléaire et, d’autre part, celle de son internalisation.
L’évaluation du coût du risque nucléaire ne nous est pas spontanément fournie par le marché sous forme de prix, contrairement à ce que l’on constate pour la majeure partie des activités économiques. Ainsi ma prime d’assurance d’automobile me fournit-elle une indication de ce que je coûte à la collectivité en termes de dommages potentiels lorsque je conduis – même en faisant très attention. Il n’y a en revanche pas de prix de marché des risques nucléaires, la responsabilité étant limitée : il revient donc à la collectivité d’évaluer ce coût.
M. le président François Brottes. Maintenant qu’il est plus facile de changer d’assureur qu’auparavant, la notion de prix de marché risque d’évoluer, y compris dans le domaine des assurances automobiles. Elle persistera, certes, mais cet exemple illustre bien qu’il est possible de faire jouer d’autres paramètres. Cela sera néanmoins plus compliqué dans le nucléaire …
M. Pierre Picard. La question du risque nucléaire nous éloigne des règles traditionnelles du calcul économique public en vertu desquelles, dans le cadre d’un grand projet d’investissement, l’État, lorsqu’il peut mutualiser la totalité de ses coûts d’activité risquée sur l’ensemble de la population, se comporte comme un assureur. Ce n’est pas le cas avec le nucléaire pour lequel toutes les conditions permettant cette mutualisation ne sont pas réunies. En effet, les grandes catastrophes nucléaires constituant des événements rares, on n’a pas affaire à une multitude de petits accidents pouvant se compenser mutuellement et pour lesquels chaque individu pourrait avoir une petite somme à payer tous les ans. De plus, ces grands accidents ont des effets macroéconomiques et sociétaux. Enfin, ils ont des conséquences intergénérationnelles. Pour toutes ces raisons, tout calcul consistant à diviser l’espérance mathématique du coût d’un risque nucléaire par la valeur de l’électricité produite tous les ans n’a pas le moindre fondement méthodologique sérieux. Il n’en aurait que s’il reflétait le comportement des compagnies d’assurance – ce qui n’est pas le cas – ou le calcul économique public d’un État parfaitement capable de mutualiser les risques – ce qui n’est pas possible non plus. Sur le plan méthodologique, l’évaluation du coût du risque nucléaire mérite donc une réflexion approfondie et suppose la prise en compte des dimensions spécifiques de ce risque aux effets à la fois macroéconomiques et de très long terme. De telles dimensions justifient l’ajout d’une prime de risque à cette espérance mathématique, sans doute négligeable en soi.
Dans ces conditions, il existe essentiellement deux manières d’internaliser le coût du risque, c’est-à-dire d’envoyer les signaux-prix adéquats. La première consiste à étendre le fonctionnement des marchés – d’assurance, notamment – et la seconde à faire en sorte que la collectivité joue le rôle d’auto-assureur en provisionnant une somme à déterminer. Quant à la première solution et, notamment à la manière d’améliorer les dispositifs assurantiels en vigueur, je vous renvoie aux interventions des deux autres participants à cette audition. Si la révision des conventions existantes a accru la responsabilité limitée des opérateurs et des États, les plafonds de responsabilité demeurent extrêmement faibles par rapport aux scénarios que l’on peut retenir – raison pour laquelle les mécanismes assurantiels ont été étendus en Allemagne où plusieurs opérateurs nucléaires ont établi entre eux des systèmes de mutualisation. Cependant, ces mécanismes de marché ayant leurs limites, comment faire pour que les finances publiques – et celles des opérateurs – assurent ce provisionnement ?
Je ferai ici une analogie entre le risque nucléaire et les risques financiers systémiques. Si le coût des grandes catastrophes nucléaires de Three Mile Island en 1979, de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011 fut très faible en termes de victimes, il fut néanmoins considérable pour l’industrie nucléaire puisque l’on a complètement arrêté toute construction de réacteur nucléaire après l’accident de Three Mile Island. Et il y a eu davantage de grands accidents nucléaires que de crises financières systémiques – c’est-à-dire de crises ayant comme facteur déclencheur des faillites bancaires dont les épargnants sont au départ les seules victimes, mais qui ont ensuite des conséquences sur l’ensemble du système économique mondial : les analystes considèrent en effet qu’avant la crise systémique qui a commencé avec la crise des subprimes, puis qui s’est prolongée avec la crise des dettes souveraines, la dernière grande crise de ce type fut celle des années 30.
M. le président François Brottes. Votre comparaison s’arrête lorsque l’on compare le nombre de banques concernées par les crises financières au nombre de réacteurs ayant subi un accident …
M. Pierre Picard. Certes, mais il s’agit de crises d’ensemble ! Quoi qu’il en soit, l’industrie financière et les régulateurs financiers internationaux ont fait évoluer la régulation financière dans le cadre des accords de Bâle III qui réglementent le provisionnement des risques financiers afin d’y faire contribuer les banques. L’imputation du risque par le provisionnement importe donc autant si ce n’est davantage que l’extension des mécanismes de marché, cette dernière étant inévitablement et rapidement vouée à trouver ses limites. Il existe des formes de provisionnement naturel, telles que les émissions de capital des opérateurs nucléaires, et d’autres plus complexes. Cela étant, demander à un opérateur nucléaire d’accroître son capital en émettant davantage d’actions qu’il ne le ferait s’il ne se souciait que du financement de ses investissements et de l’indemnisation des risques dans le cadre d’une responsabilité limitée aura inévitablement un coût pour lui. Ce coût correspond à la valorisation de la contribution au risque collectif que l’on exige de l’opérateur. Si les mécanismes de transfert – qu’ils soient assurantiels ou autres – ont des limites, l’État peut donc également agir sur d’autres instruments afin d’améliorer l’internalisation des risques.
M. le président François Brottes. Lorsque l’on souscrit une assurance automobile sans jamais avoir d’accident par la suite, les primes que l’on verse servent aux autres. Les banques et l’activité financière sont vouées à exister éternellement, ou du moins aussi longtemps qu’il y aura de l’activité économique, alors que les réacteurs nucléaires sont destinés à s’arrêter un jour. Et lorsque l’on a provisionné pour s’assurer contre le risque d’accident d’un réacteur, le jour où celui-ci s’arrête et donc où le risque disparaît, que fait-on de cet argent ? Il pourrait certes servir à provisionner le risque du réacteur voisin, mais qui est lui aussi voué à s’arrêter. Et la probabilité d’accident est très faible. Le raisonnement est donc beaucoup plus complexe s’agissant du risque qu’il ne l’est pour la gestion des déchets nucléaires et le démantèlement des centrales – qui supposent obligatoirement de provisionner. Dans le cas du risque, si aucun accident ne se produit et que les assureurs récupèrent ces provisions au passage, ils bénéficieront d’un enrichissement sans cause.
M. Pierre Picard. Lorsqu’un opérateur maintient un risque en auto-assurance – au sens où il n’a pas de partenaires à qui le transférer –, s’il le provisionne, il le transfère quand même aux investisseurs qui acceptent de prendre des parts dans son entreprise. Le provisionnement s’apparente donc à tout mécanisme de transfert de risque. Simplement, si l’on considère l’activité d’un opérateur nucléaire comme limitée dans le temps, lorsque le capital devra in fine être liquidé, les actionnaires récupèreront leur mise. On ne raisonne généralement pas en se fondant sur l’idée que les entreprises ont une durée de vie finie …
M. le président François Brottes. … mais l’on y est obligé dans le cas des réacteurs car aucun d’entre eux ne sera jamais éternel, ce qui n’est pas forcément vrai pour d’autres technologies.
M. Pierre Picard. Si jamais l’on passe à des technologies beaucoup moins risquées, que le capital auparavant nécessaire au provisionnement du risque devient superflu et qu’aucun accident ne s’est produit au bout de trente ans, les actionnaires seront contents qu’on leur rachète leurs actions à bon prix, voire qu’on leur verse des dividendes confortables.
Cela étant dit, lorsque l’on auto-assure un risque parce qu’il n’existe pas de mécanisme dédié pour le transférer, on a le choix entre plusieurs solutions. On peut très bien ne rien faire et considérer que l’on se procurera les ressources nécessaires si jamais un accident se produit. L’État pourra ainsi emprunter sur le marché national ou les marchés internationaux. Mais les générations futures sont alors victimes de ce choix puisqu’il faut des dizaines d’années pour rembourser les emprunts de reconstruction. Si l’on considère au contraire qu’il n’est pas possible de faire porter sur elles les conséquences d’un tel événement, on peut décider de mettre un peu d’argent de côté. Le provisionnement du risque n’est pas l’alpha et l’oméga de l’auto-assurance puisque l’on peut toujours arbitrer entre ces deux possibilités. Cela étant, reporter dans le futur le financement du risque soulève non seulement une question technique de choix de taux d’actualisation, mais aussi une question éthique d’arbitrage entre différentes générations.
M. le président François Brottes. Ma question était de savoir que faire des provisions effectuées lorsque l’on arrête un réacteur et qu’aucun accident ne s’est produit : peuvent-elles servir à provisionner le risque d’autres réacteurs en fonctionnement ? Est-il pertinent de provisionner pour ensuite redistribuer des dividendes alors que d’autres risques existent dès lors que la filière n’est pas arrêtée ? C’est là une des spécificités de notre sujet de réflexion.
M. Pierre Picard. On aura certes immobilisé du capital pendant trente ans. Mais lorsque l’on n’a aucun accident de voiture, on a toujours l’impression d’avoir souscrit une assurance automobile pour rien alors qu’en réalité, on aura contribué, grâce au mécanisme de mutualisation des risques, au provisionnement du risque des autres automobilistes.
M. le président François Brottes. Le cas est fort différent car on est alors solidaire d’autrui. En outre, la probabilité des accidents de voitures est beaucoup plus élevée que celle d’un accident nucléaire. Il y a donc bien une spécificité du risque nucléaire. Monsieur Trembley, avez-vous des solutions à nous proposer en la matière ?
M. Gilles Trembley, directeur du GIE Assuratome. Pas sur ce point précis. Mon exposé liminaire portera sur les modalités de fonctionnement de la première tranche d’assurance qui couvre la responsabilité civile des exploitants nucléaires et qui s’élève à 91 millions d’euros, soit les fameux 600 millions de francs institués dans les années 90. Compte tenu de l’intensité du risque potentiel et des spécificités du droit, il a été décidé par la communauté des assureurs, en France comme dans tous les pays du monde dotés du nucléaire civil, de cantonner ce risque dans le cadre de pools organisés par marché. Le marché français a ainsi organisé Assuratome, pool de réassurance dont sont membres la plupart des assureurs et réassureurs du pays et qui est destiné à couvrir les exploitants nucléaires, tant en matière de dommages matériels que de responsabilité civile. Assuratome dispose d’équivalents dans une vingtaine de pays. Les capacités de couverture des dommages matériels étant insuffisantes, les pools se réassurent les uns les autres.
M. le président François Brottes. Quelle place l’Allemagne occupe-t-elle dans ce contexte ?
M. Gilles Trembley. Il existe aussi un pool allemand …
M. le président François Brottes. Qui perdure ?
M. Gilles Trembley. Absolument ! Vous avez par ailleurs tout à fait raison de souligner que les réacteurs ne sont pas voués à durer éternellement – une voiture non plus, d’ailleurs ! Reste que même si l’on décide d’arrêter tous les réacteurs en France, leur assainissement et leur démantèlement dureront des années, au cours desquelles un risque non négligeable perdurera.
M. le président François Brottes. Il n’y aura plus de risque de fusion !
M. Gilles Trembley. Mais un risque de contamination extérieure demeurera – risque certes plus faible, mais suffisant pour remplir la première tranche d’assurance.
Pour en revenir à l’organisation de l’assurance nucléaire, chaque pool réunit la capacité qui lui est fournie par ses membres et l’utilise pour assurer les exploitants nucléaires. Les polices d’assurance en responsabilité sont soumises à un agrément de la sous-direction des assurances de la direction du Trésor. La tarification est quant à elle établie sur la base d’une analyse des risques et du coût potentiel des sinistres, en fonction de l’environnement des sites concernés. Objective et sans faute, la responsabilité est concentrée sur l’exploitant nucléaire : celui-ci est obligé de s’assurer jusqu’à une limite fixée à 91 millions d’euros, qui va être portée à 700 millions, avec tous les problèmes que cela soulève pour l’assurance même.
M. le président François Brottes. Est-ce à dire que ce dispositif nous prémunit de tout contentieux ?
M. Gilles Trembley. La loi oblige l’exploitant à trouver une garantie financière ou une assurance pour couvrir sa responsabilité et le rend objectivement responsable. Il ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité ni intenter de recours contre un tiers, sauf cas très particulier.
M. le président François Brottes. Tout est donc dans l’expression « sauf cas très particulier » ! Quant à vous, monsieur Corrihons, vous intervenez en réassurance …
M. Maurice Corrihons, directeur spécialités de la Caisse centrale de réassurance. Mon exposé portera sur le transfert de risque dans la chaîne de l’assurance, qui part de l’assureur pour passer par le réassureur puis par le rétrocessionnaire et, enfin, par les alternatives dans le cadre de la réassurance financière ou du transfert alternatif de risque (ART).
Tout risque ou portefeuille de risques souscrit par une compagnie d’assurances peut aujourd’hui être mutualisé ou fragmenté en pools, lorsqu’il s’agit de risques extrêmes. Il peut également être réparti ou transféré à un deuxième étage – celui de la réassurance – la compagnie d’assurances réduisant ainsi la volatilité de son portefeuille. Le réassureur lui-même peut couvrir ses expositions en transférant le risque à un troisième niveau, celui de la rétrocession. Il s’agit là d’un système pyramidal de transfert des risques, le nombre d’assureurs étant plus important que celui des réassureurs, eux-mêmes plus nombreux que les rétrocessionnaires.
M. le président François Brottes. Êtes-vous assujetti à des règles comparables à celles des Accords de Bâle III pour les banques ? Un incident systémique est en effet tout aussi plausible dans le secteur des assurances que dans le secteur bancaire …
M. Maurice Corrihons. Nous sommes effectivement soumis à la directive Solvency II, réglementation avec laquelle nous nous efforçons de nous mettre en conformité d’ici à 2016. Il existe un dispositif permettant aux assureurs, réassureurs et rétrocessionnaires de limiter leur exposition au risque en la transférant aux marchés financiers et non plus à la réassurance traditionnelle.
Quant à la caisse centrale de réassurance (CCR), elle est habilitée, avec la garantie de l’État, à intervenir, au cas où l’assurance privée ne pourrait pas satisfaire la demande, en cas de risque de guerre sur les transports pour les corps de navire et les facultés, d’engagement de la responsabilité civile des exploitants nucléaires, de catastrophe naturelle ou encore d’attentat ou d’acte terroriste.
S’agissant des principes généraux de l’assurance nucléaire, les polices portant sur les dommages matériels garantissent l’exploitant contre les dommages d’incendie, les événements naturels et les bris de machines portant sur les biens et installations lui appartenant. Quant au régime juridique de la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire, il est issu de la convention de Paris de 1960 qui définit une responsabilité objective, sans faute, exclusivement canalisée sur l’exploitant et limitée quant à son montant et à sa durée. Ce régime est fondé sur un principe de non-discrimination à l’égard des victimes d’un incident nucléaire, indépendamment de leur nationalité, de leur domicile ou de leur lieu de résidence.
Le protocole modificatif de 2004 à la convention de Paris a porté la limite de responsabilité de l’exploitant de 91,5 à 700 millions d’euros, et ce, à la charge de l’assureur, que ce dernier l’assume par une prise d’assurance ou par garantie financière. En outre, ce texte étend le champ des garanties aux dommages à l’environnement, aux mesures de sauvegarde et aux événements naturels à caractère exceptionnel. La limite de garantie s’entend par site nucléaire – la difficulté étant que plusieurs sites peuvent être touchés par un même événement, notamment en cas de tremblement de terre ou de crue dans la vallée du Rhône. Si la première tranche relève de l’exploitant, la deuxième tranche, à la charge de l’État dans lequel l’accident se produit, a été portée de 108 à 500 millions d’euros. Enfin, la troisième tranche, qui correspond à la contribution de tous les États contractants, a été portée de 140 à 300 millions. Cette garantie s’élève donc au total à 1,5 milliard d’euros contre 340 millions aujourd’hui. Les difficultés que soulèvent ces nouvelles règles sont les mêmes en France que dans tous les États signataires de la convention et du protocole.
J’exposerai à présent le mécanisme de réassurance que l’État pourrait envisager d’instituer dans l’hypothèse où le marché privé de l’assurance et de la réassurance ne pourrait couvrir les dommages prévus par le protocole de 2004. L’État ne peut en effet intervenir que si le risque n’est pas assurable par le secteur privé. L’opérateur ou l’exploitant est garanti par un assureur « fronteur » entièrement réassuré, sur les risques qu’il couvre, par le pool de réassurance qu’est Assuratome. Outre ce pool national, les pools étrangers peuvent eux aussi apporter une capacité de réassurance dans le cadre d’une mutualisation entre opérateurs. La CCR pourrait quant à elle intervenir avec une garantie d’État dans le cadre d’une convention de réassurance avec Assuratome.
Pour terminer, je présenterai une comparaison de ce système avec des dispositifs d’assurance à plusieurs étages couvrant d’autres risques exceptionnels, faisant intervenir des assureurs, des réassureurs privés et une réassurance par la CCR avec la garantie de l’État. À cet égard, le groupement d’intérêt économique le mieux adapté est en l’occurrence le groupement chargé de la gestion de l’assurance et de la réassurance des risques d’attentats et d’actes de terrorisme (GAREAT), créé le 1er janvier 2002 à la suite des attentats du 11 septembre 2001, pour couvrir les risques dont la police est supérieure à 20 millions d’euros. Dans le cadre des polices d’assurance, si l’assureur ne peut s’exonérer de garantir le terrorisme à l’assuré, cette obligation n’est en revanche pas imposée au réassureur. Une telle situation étant très inconfortable pour les assureurs, les représentants de la profession se sont entretenus avec les réassureurs sous l’égide des pouvoirs publics, à la suite de quoi a été institué un dispositif de mutualisation regroupant les quelque 200 membres des organisations professionnelles.
Au 1er janvier 2014, les membres du pool d’assureurs du GAREAT conservent entièrement en rétention une première ligne de 400 millions d’euros et ce GIE se protège par un programme de réassurance privée, en faisant appel à un marché ouvert jusqu’à un certain seuil. Avec la garantie de l’État, la CCR a ainsi signé une convention avec le GAREAT afin de le garantir au-delà du seuil de capacité que lui fournit le marché privé.
M. le président François Brottes. Entre la guerre, l’attentat terroriste et l’accident nucléaire, quel événement vous paraît-il le plus probable ?
M. Maurice Corrihons. Nous raisonnons sur des événements extrêmes, qu’ils soient le fait de l’homme ou de la nature, dont la probabilité d’occurrence est extrêmement faible. Il est cependant difficile de dire lequel d’entre eux aurait la plus forte probabilité de se produire.
M. Denis Baupin, rapporteur. J’ai bien compris, monsieur Picard, qu’il vous était difficile de chiffrer le coût du risque nucléaire et d’en définir les mécanismes d’internalisation adéquats. Mais en tant que rapporteur de cette commission d’enquête, mon objectif consiste à comparer entre elles les différentes filières de production électrique en termes de risque d’accident afin de déterminer quelle subvention virtuelle l’État apporte à la filière nucléaire en instituant ce type d’assurance. Car si nombre de personnes ne sont guère rassurées par le nucléaire, c’est bien parce qu’il présente un risque. Or l’une des manières de calculer le risque à internaliser consiste à mesurer le coût auquel s’élèverait l’assurance s’il devait être assuré.
J’ai d’ailleurs trouvé votre propos tout à fait pertinent lorsque vous avez jugé illégitime que ce soit les générations futures qui assument les conséquences financières d’un accident nucléaire plutôt que ceux qui consomment aujourd’hui l’électricité produite par les centrales et les dirigeants politiques ayant décidé de recourir à cette technologie pour la fournir. Si j’entends bien les remarques formulées par le président de la commission en matière de provisionnement du risque et reconnais que la situation du nucléaire n’est pas comparable à celle des millions de véhicules automobiles aujourd’hui en circulation, il reste que l’on recense cinquante-huit réacteurs en France et plusieurs centaines au niveau mondial. Ne pourrait-on par conséquent instituer un système de mutualisation du risque entre ces réacteurs, même si tous, parmi eux, ne représentent pas le même risque ?
MM Trembley et Corrihons ont quant à eux évoqué les modifications apportées par le protocole de Bruxelles à la convention de Paris et notamment le fait que le plafond de responsabilité des exploitants ait été porté de 91,5 à 700 millions d’euros : bien que ce plafond demeure très en deçà du coût potentiel d’un accident nucléaire, quelles sont les conséquences d’une telle augmentation sur le système d’assurance ? M. Trembley a certes parlé à ce propos de « bouleversement », mais il est resté très évasif. Or on peut lire dans le document de référence d’EDF que « le groupe EDF ne peut garantir que dans les pays où il est exploitant nucléaire, les plafonds de responsabilité fixés par la loi ne seront pas augmentés ou supprimés. Ainsi les protocoles portant modification de la convention de Paris et de la convention de Bruxelles, actuellement en cours de ratification, prévoient un relèvement de ces plafonds. L’entrée en vigueur de ces protocoles modificatifs ou toute autre réforme visant à relever les plafonds de responsabilité des exploitants nucléaires pourrait avoir un impact significatif sur le coût de l’assurance que la société n’est pas aujourd’hui en mesure d’estimer. Et le groupe ne peut pas garantir que les assurances couvrant cette responsabilité seront toujours disponibles ou qu’il arrivera toujours à maintenir ces assurances. » De toute évidence, EDF prend ici les plus grandes précautions pour expliquer aux potentiels actionnaires les conséquences de ces modifications.
Autre question d’ordre technique : dans son rapport, la Cour des comptes estime que la construction de pools nationaux est anticoncurrentielle et manque de transparence. Qu’en pensez-vous ? En outre, si les exploitants ont obligation de se couvrir par garantie bancaire ou par assurance à concurrence des montants fixés dans les conventions internationales, il n’existe selon la Cour aucun moyen de vérifier que ces obligations sont remplies parce qu’il n’existe aucune liste des exploitants devant s’y conformer et que la garantie financière instituée doit être agréée par le ministère de l’économie – cette exigence n’étant pas respectée. Datant de 2012, ces remarques sont-elles toujours pertinentes ou bien l’exploitant nucléaire principal et les autres entreprises nucléaires se sont-ils assurés comme ils le doivent depuis lors ?
Quant aux mécanismes de réassurance, comment sont-ils censés fonctionner dans l’hypothèse défavorable d’un accident dépassant le plafond d’assurance, et dont l’IRSN a évalué le coût moyen entre 120 et 450 milliards d’euros – selon qu’il s’agit d’un accident grave ou d’un accident majeur ? L’IRSN a certes précisé qu’il s’agissait de coûts globaux qui n’étaient pas totalement indemnisables, mais leur partie indemnisable dépassera les 1,5 milliard d’euros.
Qu’adviendrait-il en cas d’accident dont les conséquences – telles que les nuages radioactifs – ne se limiteraient pas au territoire national ? Ma question vise notamment les centrales de Fessenheim et de Cattenom. Quelle indemnisation nos voisins pourraient-ils alors réclamer à l’État français ?
Enfin, le risque nucléaire étant exclu des contrats d’assurance couvrant les biens mobiliers et immobiliers des particuliers, si l’on doit demain évacuer une grande ville ou une ville moyenne devenue inhabitable du fait d’un nuage radioactif, comment ces particuliers pourront-ils se faire indemniser de la perte de biens acquis après avoir économisé toute leur vie ? Faudrait-il prévoir, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, des mécanismes d’indemnisation comparables à ceux qui ont été instaurés en cas de catastrophe naturelle ?
M. Gilles Trembley. Le relèvement légal du plafond d’assurance de 91,5 à 700 millions d’euros représente effectivement un saut très important pour les assureurs. Il nous faudra donc déterminer avec nos autorités de tutelle, le ministère des finances, comment parvenir à nous y conformer, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne nous le permettant pas, sauf à des conditions de prix exorbitantes.
Quant à l’augmentation de la durée de prescription pour les dommages corporels de 10 à 30 ans, elle posera des problèmes de provisionnement importants aux assureurs, que nous avons également signalés aux pouvoirs publics.
M. le rapporteur. Le protocole datant de 2004, n’a-t-on aucunement progressé en dix ans ?
M. Gilles Trembley. La volonté de ratifier le protocole de 2004 est relativement récente. Cela fait néanmoins un certain temps que nous avons signalé ce problème à l’État. Sans doute avons-nous mis du temps à réagir mais le sujet fait désormais débat …
S’agissant des pools, il n’est pas tout à fait exact d’affirmer qu’ils ont un caractère anticoncurrentiel : les exploitants nucléaires ont en effet institué deux mutuelles spécialisées dans le risque nucléaire, l’une pour les dommages matériels et l’autre pour la responsabilité civile. C’est ainsi que la police de responsabilité civile d’EDF ne relève pas d’Assuratome.
Quant à savoir si les polices d’assurance des exploitants nucléaires ont bien été agréées par les autorités de tutelle, la réponse est affirmative en ce qui concerne les exploitants assurés par Assuratome – EDF, le Commissariat de l’énergie atomique et Areva. Et il est évident que la nouvelle police de responsabilité civile d’exploitant nucléaire en cours d’élaboration chez Assuratome le sera également.
Si les particuliers ne disposent d’aucune couverture du risque nucléaire dans leur police d’assurance multirisques habitation, c’est parce que c’est la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire qui couvre tous les dommages susceptibles d’affecter les biens et personnes en cas de sinistre nucléaire majeur.
M. le rapporteur. Mais que se passe-t-il une fois dépassé le plafond des 700 millions d’euros ?
M. Gilles Trembley. Au-delà, la couverture ne relève plus de la responsabilité des assureurs. Jusqu’à 91,5 millions d’euros aujourd’hui, et 700 millions demain, c’est la responsabilité civile de l’exploitant – qu’il s’agisse d’EDF, d’Areva ou du CEA – qui sera mise en jeu dans le cadre de son contrat d’assurance si jamais la population et les entreprises situées autour d’un site sont contaminées : l’ensemble des tiers lésés pourront réclamer des indemnités à l’exploitant dans le cadre de son contrat d’assurances.
M. le rapporteur. Si le plafond est nettement dépassé, qui sera indemnisé en premier ?
M. Gilles Trembley. Dans la tranche qui relève des assureurs, l’État français accorde une priorité à l’indemnisation des dommages corporels.
M. Maurice Corrihons. L’allongement de la durée de prescription de dix à trente ans signifie non pas que les victimes devront attendre plus longtemps pour être indemnisées, mais qu’elles disposeront d’un délai plus long pour se faire dédommager. Il s’agit donc pour elles d’une avancée.
M. le rapporteur. Concrètement, en cas d’accident, si l’on dépense les 700 millions d’euros prévus par les textes pour indemniser les dommages corporels et matériels des victimes identifiées, comment fera-t-on si l’on en identifie d’autres au bout de deux ans ? Cela est-il régulé par les textes ou bien le premier arrivé sera-t-il le premier servi ?
M. Gilles Trembley. Il m’est difficile de vous répondre en théorie tant chaque cas est particulier. Un groupe de travail piloté par la direction Énergie et climat et chargé de la question des sinistres de grande ampleur a prévu d’instaurer un dispositif permettant d’évaluer le plus rapidement possible le coût potentiel de l’indemnisation des dommages corporels par rapport à celui de l’indemnisation des dommages matériels, afin de pouvoir cantonner les sommes nécessaires au règlement de l’indemnisation des dommages corporels. Dans le cas de Fukushima, les dommages corporels sont restés limités …
M. le rapporteur. Pour l’instant ! Mais attendez une trentaine d’années !
M. Gilles Trembley. Il est effectivement très complexe de déterminer la part respective des dommages corporels et matériels, surtout que les assurances sont plafonnées. Mais si le cas devait se présenter, il serait traité de façon spécifique.
M. Maurice Corrihons. Il me semble que vous m’avez interrogé sur les transferts de risques entre les différents étages d’assurance …
M. le rapporteur. Ma question était de savoir comment financer les 450 milliards d’euros de dommages évalués par l’IRSN.
M. Maurice Corrihons. Je ne saurais vous répondre. Quant au niveau des transferts de risques, il sera déterminé par le marché et non par la CCR : les marchés privés de l’assurance, de la réassurance et de la rétrocession doivent déterminer les capacités qui peuvent être transférées sur les marchés financiers. Il revient ensuite aux pouvoirs publics d’évaluer les compléments à apporter, le cas échéant.
M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur, êtes-vous satisfaits de cette réponse extrêmement claire et limpide ? Le monde des assurances ne relève pas d’une science exacte …
M. le rapporteur. J’entends bien que vous n’ayez pas forcément la réponse. Reste que mon incompréhension est totale !
M. Pierre Picard. L’un des objectifs du rapporteur étant de comparer le coût du risque et, partant, l’efficacité relative des différentes filières énergétiques, il lui faut prendre en compte dans son calcul le coût de l’ensemble des externalités existantes, y compris celui des émissions de gaz à effet de serre. Quant à la méthode de calcul proprement dite, en cas de grande catastrophe, c’est à l’État qu’il revient, au-delà des limites de couverture assignées aux mécanismes d’assurance, d’opérer un arbitrage éthique et politique entre le coût qui sera financé ex post par l’emprunt, c’est-à-dire par les générations futures, et celui qu’il accepte de supporter. Un tel arbitrage tient au degré de probabilité que l’on assigne à la catastrophe et aux scénarios sur lesquels on s’appuie pour en évaluer les coûts, et comportera toujours un élément d’extrême arbitraire. Une fois cet arbitrage opéré, reste à définir des mécanismes de provisionnement de la partie du coût de la catastrophe à laquelle on souhaite se préparer : on peut ainsi demander à l’opérateur nucléaire d’accroître son capital et à un expert financier de calculer le coût de la rémunération des actionnaires sur toute la durée de vie de ce provisionnement, en fonction du coût du capital.
Quant à savoir s’il serait possible d’améliorer le fonctionnement et la portée des mécanismes d’assurance traditionnels, il existe deux manières d’étendre la taille du provisionnement. Puisque nous avons déjà évoqué le mécanisme de mutualisation entre les pools, sachez qu’aux États-Unis, la présence de plusieurs opérateurs nucléaires a permis l’instauration d’un mécanisme tout à fait spécifique, défini par le Price-Anderson Act, de responsabilité conjointe obligatoire entre tous les opérateurs en cas d’accident, si jamais la première tranche – celle de l’opérateur directement impliqué – est dépassée. Ce système permet ainsi aux Américains de disposer d’une capacité de plus de 10 milliards d’euros, soit une somme bien supérieure à celle que l’on pourrait mobiliser en France. Autre exemple : en Allemagne, les quatre opérateurs nucléaires ont depuis peu une responsabilité illimitée – évolution qui s’est accompagnée d’un accroissement des mécanismes d’assurance. Il existe par ailleurs d’autres mécanismes de transfert de risque : ainsi, depuis une vingtaine d’années, les assureurs concernés par les grands risques ont développé des innovations financières afin de pallier les insuffisances de capacité qui s’étaient fait jour sur les marchés de réassurance à la suite de grandes catastrophes naturelles : il existe notamment des obligations-catastrophes pour les ouragans, les tremblements de terre et les risques de mortalité liés à des épidémies. Il vaudrait donc la peine d’aller de l’avant en recourant à ce type d’innovations. Il serait certes complexe, mais pas impossible, d’élaborer des obligations nucléaires, sachant par exemple que les agences de notation spécialisées sont capables de calculer le prix de provisionnement d’un risque de grand tremblement de terre en Californie et de déterminer le pourcentage à additionner au taux de base de telle sorte que les investisseurs acceptent de financer pendant plusieurs années des obligations-catastrophes. Encore faut-il que les acteurs aient la volonté d’innover car les conventions internationales, en limitant la responsabilité de leurs clients, limitent de ce fait la tâche des assureurs et des réassureurs qui ne sont guère incités à améliorer leur capacité d’indemnisation ni à connaître le prix du risque d’assurance.
M. le président François Brottes. Pour poursuivre votre comparaison avec les États-Unis, en France, les opérateurs qui gèrent les réacteurs et les unités en démantèlement sont tous publics. L’État est donc impliqué dans tous les cas de figure, soit en tant qu’actionnaire principal, soit en tant que propriétaire, et sa responsabilité est plus largement engagée que sur les seuls sites dont il est propriétaire. Cela ne règle certes pas le problème des dommages que pourraient subir nos pays voisins, les pools internationaux pouvant ne pas suffire. Toujours est-il que l’on ne peut comparer différents pays qu’en tenant compte de chacune de leurs spécificités.
Quoi qu’il en soit, nous vous remercions pour tous ces éclaircissements.
Audition de Mme Céline Grislain-Letrémy, M. Reza Lahidji et M. Philippe Mongin, auteurs du rapport « Les risques majeurs et l'action publique » (Conseil d'analyse économique, décembre 2012)
(Séance du 17 avril 2014)
M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nos auditions de ce matin sont consacrées au risque nucléaire et à la gestion de crise. Les informations qui nous seront communiquées seront fort utiles, notre pays et nos opérateurs étant très attachés à éviter les dégâts collatéraux.
Nous accueillons Mme Céline Grislain-Letrémy, économiste de l’assurance et de l’environnement à l’INSEE, qui a également travaillé au ministère du développement durable ; M. Reza Lahidji, économiste de la gestion du risque et de la décision en situation d’incertitude, actuellement directeur de recherche à l’Institut de droit international, basé à Oslo ; et M. Philippe Mongin, directeur de recherche au CNRS, professeur affilié d’économie et de philosophie à HEC.
Madame, messieurs, vous êtes coauteurs d’un rapport publié en décembre 2012, intitulé « Les risques majeurs et l’action publique », élaboré dans le cadre du Conseil d’analyse économique. En couvrant les risques naturels, les risques technologiques en général, et le risque nucléaire en particulier, ce rapport développe une vision globale du risque.
Nos auditions précédentes ont montré que les propriétaires de patrimoine immobilier se retrouvaient pénalisés du fait de l’absence de réponse. En effet, qu’il s’agisse d’un risque technologique ou d’un risque naturel, les dispositifs peuvent s’enchevêtrer. Je connais même des territoires où les risques se multiplient et dans lesquels la technique du parapluie amène des fonctionnaires à être responsables en leur nom sur la manière dont ils délivrent les prescriptions destinées à éviter ces risques. Au demeurant, les plans de prévention des risques donnent lieu à un débat compliqué avec les élus dans le cadre des plans locaux d’urbanisme.
Vous vous êtes intéressés à la façon dont les acteurs publics évaluent le risque, définissent des mesures de prévention, et mettent en place des dispositifs d’indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Céline Grislain-Letrémy, M. Reza Lahidji et M. Philippe Mongin prêtent serment)
M. Philippe Mongin, directeur de recherche au CNRS. Nous sommes honorés de contribuer à votre réflexion.
L’objet de notre rapport n’est pas spécifiquement le risque nucléaire, mais le risque nucléaire à côté d’autres risques majeurs.
Les risques majeurs sont des risques comme les autres, si ce n’est que leurs conséquences socioéconomiques et environnementales sont considérables. Ce ne sont pas nécessairement des risques dotés de très petites probabilités, même si c’est le cas – et nous ne sommes pas les seuls à le croire – des risques nucléaires.
L’analyse du risque doit s’appliquer aux risques majeurs, puisque ce sont des risques. Elle s’applique sous la forme, chère aux géographes, des enjeux, de l’aléa, de la vulnérabilité ; sous la forme, chère aux ingénieurs, de la donnée d’une probabilité et d’un coût ; ou sous une forme chère aux économistes, qui raffinent le schéma précédent et introduisent notamment les attitudes par rapport aux risques et les primes de risque.
Nous avons pris le risque nucléaire – ou plus précisément le risque d’accident de centrale, car il ne sera question que de cela dans notre intervention – comme un risque majeur, à côté des risques de catastrophe naturelle et de catastrophe technologique, dont il est structurellement proche. Nous analysons donc le risque nucléaire par les mêmes moyens que ces deux autres risques. Cette position méthodologique, j’y insiste, ne va pas de soi.
En effet, les spécialistes de la sûreté nucléaire ont longtemps évité l’outil probabiliste ; les conceptions traditionnelles de la défense en profondeur sont déterministes. Il est vrai que des études plus récentes, dites probabilistes de la sûreté – les EPS –, font une certaine part aux probabilités, quoique pas suffisamment encore selon nous.
Le contraste est grand par rapport aux études sur les inondations, qui nous ont aussi beaucoup occupés dans le rapport, études que les réassureurs savent pratiquer en utilisant les données de coût aussi bien que celles de probabilité. L’administration française, sous l’influence des directives européennes, a également su développer des études de ce genre.
Une lecture attentive des rapports préparatoires à la commission d’enquête nous a permis de constater qu’il n’était guère question que des coûts, et que le mot « probabilité » n’y figurait pas ou peu. Nous expliquons cela par la tradition du domaine nucléaire – tradition avec laquelle, vous l’aurez compris, ce rapport voudrait rompre. En outre, les auditions précédentes ne semblent pas avoir privilégié le thème ; ce sera donc pour nous une raison de vous en parler.
M. Lahidji vous présentera nos réflexions sur les probabilités. Il vous parlera également des coûts qui, à notre avis, ne sont pas évalués de la manière la plus satisfaisante qui soit. Il combinera les coûts et les probabilités suivant le critère bien connu de l’espérance mathématique.
Nous distinguons la validité du critère de l’espérance mathématique comme une mesure synthétique du risque et la question de l’assurabilité. En d’autres termes, si le risque d’accident nucléaire majeur se prête mal à l’assurance – c’est un fait –, cela ne vient pas, selon nous, de ce que le critère de l’espérance mathématique ne s’appliquerait pas au nucléaire. Cela vient d’autres considérations, en particulier et peut-être le plus simplement du monde, d’une contrainte de liquidités.
Cela nous amène à la position selon laquelle il faut dire oui à l’assurance, mais aussi surmonter ce problème spécifique lié à l’immensité des enjeux. Nous considérons que l’État seul peut organiser l’assurance. Mme Grislain-Letrémy abordera plus précisément cette question et vous proposera en notre nom la création d’un fonds dédié, piste déjà ouverte par la Cour des comptes.
J’évoquerai un dernier aspect. Le risque nucléaire est un risque terrifiant. C’est aussi, sous un certain angle, le plus rassurant de tous. C’est en effet celui qui obéit au principe, que nous avons généralement recommandé dans le rapport, d’une séparation de l’évaluation et de la gestion, principe général malheureusement mal appliqué en matière de catastrophe naturelle et bien appliqué en matière de risque nucléaire. Le travail de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est universellement respecté. La distinction même, au sein des évaluateurs, entre un prescripteur et un expert est souhaitable et intéressante. Sous cet angle, le traitement du risque nucléaire a des leçons à donner au traitement des autres risques.
M. Reza Lahidji, directeur de recherche à l’Institut de droit international. Si l’on considère que le risque est la donnée de probabilité et de conséquence, force est de constater que le débat sur le risque d’accident nucléaire a foisonné de chiffres ces dernières années. Il nous a alors semblé que l’on ne savait plus très bien d’où venaient ces chiffres et comment les mettre en rapport. Je vais donc m’efforcer d’éclaircir la question.
Depuis les années 70, le secteur nucléaire a développé les outils d’évaluation du risque probablement les plus sophistiqués qui soit. Il s’agit des évaluations probabilistes de la sûreté dont le principe est d’explorer tous les scénarios pouvant mener à un certain type de conséquence, de caractériser ces scénarios en termes de probabilités et de conséquences précises et enfin de les agréger. Nous disposons de trois niveaux d’analyse : l’EPS de niveau 1 s’intéresse à la fusion du cœur d’un réacteur, l’EPS de niveau 2 aux rejets de matières radioactives en dehors de l’enceinte d’un réacteur et d’une centrale, et l’EPS de niveau 3 aux conséquences radiologiques sur les populations et les écosystèmes.
La France dispose d’EPS de niveaux 1 et 2. Celles de niveau 1, élaborées dans les années 80 et remises à jour, donnent une probabilité agrégée de fusion du cœur de 10-5, soit une occurrence sur 100 000 années.réacteur. Cette probabilité est assortie d’un ensemble de conséquences en termes de physique interne du réacteur. L’EPS de niveau 2, qui reprend les scénarios établis par l’EPS de niveau 1 et regarde ce qui se passe à l’extérieur de l’enceinte, obtient une probabilité agrégée de 10-6. Autrement dit, dans un cas sur dix, une fusion du cœur provoque des rejets importants de matières radioactives dans la nature.
Bien qu’extrêmement détaillées, les EPS françaises ont une base très limitée en ne s’intéressant qu’aux seules défaillances internes de la centrale. Plusieurs catégories d’événements défavorables peuvent conduire à des scénarios accidentels : les défaillances internes, c’est-à-dire propres aux équipements, systèmes et composants de la centrale ; les agressions internes, comme un incendie, une inondation à l’intérieur de la centrale ; et surtout les agressions externes : un séisme, une inondation, un acte terroriste. Le chiffrage que j’ai évoqué ne prend pas en compte toutes ces catégories d’événements : il est donc précis, mais très partiel.
En regardant dans les autres pays, on sait que ces catégories d’événements exclues contribuent pour environ 90 % du risque. Un calcul de coin de table – toutes sortes d’événements prises en compte –, nous donne alors des probabilités dix fois plus élevées : 10-4 pour la fusion ; 10-5 pour les rejets.
Vous le comprenez : dans ce domaine, l’incertitude est très importante en raison de la façon dont les EPS sont construites – il y a des types d’enchaînements causaux que l’on sait très mal évaluer, notamment lorsqu’il y a intervention de l’homme –, et de la prise en compte d’événements ou pas.
Comme je le disais, la France ne dispose pas d’EPS de niveau 3. D’autres pays n’ont pas fait le même choix. Néanmoins, l’IRSN a pris récemment l’initiative de réaliser une évaluation déterministe des coûts, en s’intéressant non aux probabilités, mais à un certain nombre de scénarios reprenant ceux de l’EPS de niveau 2 et en regardant comment le « terme source » se diffuse dans l’environnement, puis les conséquences sociales, économiques, environnementales et sanitaires qui en résultent.
Ce travail est détaillé sur le plan méthodologique. Il est évidemment bienvenu, car il comble en partie un grand vide. Néanmoins, il a été communiqué dans des conditions que l’on peut considérer anormales en raison d’un très grand délai entre la première étude et sa publication. En outre, le niveau de détail dont nous disposons sur la façon dont ont été menées ces évaluations est assez limité. Par conséquent, il est difficile de comprendre exactement de quelle manière l’évaluation est réalisée. Il semble qu’il y ait diverses estimations, dont l’une est présentée comme une estimation moyenne. Par contre, on ne sait pas quels scénarios ont été retenus pour moyenner.
En définitive, c’est bien une espèce de distribution implicite de probabilités dont on se sert pour construire des moyennes.
Ces limites n’invalident pas l’exercice. Néanmoins, il conviendrait de les dépasser dans des exercices futurs, notamment en mettant à la disposition des universitaires les travaux de l’IRSN qui pourront alors être approfondis et élargis.
Si l’on reprend malgré tous ces différents chiffres, dont je viens d’illustrer les limites, le scénario de référence présenté comme une moyenne par l’IRSN aboutit à 120 milliards d’euros de conséquences totales pour un accident grave. Ces conséquences doivent être comprises comme étant très élargies, et même très indirectes. Le fait qu’elles puissent un jour être imputées à un acteur unique, par exemple l’État, est donc très discutable. Si une perte d’image conduisait à terme à des pertes de recettes touristiques, l’État n’aurait probablement pas à indemniser ou à prendre en charge directement l’ensemble de ces pertes.
Pour lier ce chiffre à une charge financière de l’État, un travail supplémentaire devrait être réalisé. Il faut donc être très prudent. Soit on calcule le coût social général dans le cadre par exemple d’une analyse coût/bénéfices élargie de l’énergie nucléaire, et on peut reprendre ces chiffres. Soit on s’intéresse à la responsabilité financière des exploitants et de l’État, et c’est alors une sous-partie de ce chiffrage qu’il faut retenir.
Pour finir, si l’on applique un critère d’espérance mathématique aux composantes que l’on a obtenues, on obtient un coût du risque de 120 milliards par année réacteur multiplié par la probabilité de 10-5, soit 1,2 million d’euros par année réacteur. Comme vous pouvez le constater, ce coût n’est pas considérable.
M. le président François Brottes. Avez-vous procédé à un examen clinique de la crise de Fukushima ?
M. Reza Lahidji. Oui, et le cas de Fukushima montre l’incertitude de ce type d’exercice.
En parlant de probabilité de 10-4, 10-5, 10-6 par année.réacteur, il est entendu que l’événement « accident dans un réacteur » est indépendant de ce qui se passe dans les autres réacteurs. Ces calculs ne prennent pas en compte un effet « centrale », un effet « site ».
Avant l’accident de Fukushima, les probabilités communiquées par les autorités japonaises étaient de 10-6 pour un accident avec des rejets importants, soit un ordre de grandeur inférieur à ce qu’il est en France. Les réacteurs japonais sont en effet extrêmement solides, et ces chiffrages ne faisaient pas l’objet de contestations. Sur la base de ces probabilités, l’événement fusion du cœur avec rejets importants dans trois réacteurs donne une probabilité de 10-18.
Cependant, le déroulement de l’accident était en partie connu. Une partie de la communauté des sismologues avait indiqué que les hypothèses sismiques sur lesquelles était fondée l’évaluation du risque n’étaient pas les bonnes, en particulier en matière de tsunami, et que la récurrence d’un méga tsunami était à peu près de mille ans dans la région de Sendai. Bien avant la catastrophe, des travaux universitaires et des publications avaient tenté d’alerter sur ce problème. On se retrouve donc avec une probabilité d’un événement face auquel la centrale était totalement démunie, car la probabilité d’une catastrophe conditionnée à la survenue d’un méga tsunami est de l’ordre de 1 et que la probabilité d’occurrence du méga tsunami était de l’ordre de 10-3, probablement plus sachant que la dernière occurrence connue remontait à peu près à mille ans. In fine, on a une probabilité de 10-18 d’un côté, et une probabilité certainement supérieure à 10-3, de l’autre.
Ainsi, ce genre d’exercice comporte des risques. Il faut s’intéresser aux limites et aux incertitudes de l’évaluation de façon très précise – ce que n’ont pas fait les Japonais à l’époque.
Mme Céline Grislain-Letrémy, économiste de l’assurance et de l’environnement à l’INSEE. En ce qui concerne l’indemnisation du risque nucléaire, le régime repose sur la responsabilité sans faute de l’exploitant, limitée dans son montant et dans le temps, avec un système en trois tranches : la première est à la charge de l’exploitant, la deuxième de l’État, et la troisième à la charge des États signataires de la Convention de Bruxelles de 1963.
En 2004, un protocole a proposé d’augmenter les montants de ces tranches successives, ce qui est tout à fait souhaitable puisque le système actuel repose sur des valeurs désuètes, même en supposant un accident nucléaire d’une gravité modérée. Même si l’augmentation des plafonds est souhaitable, nous arrivons à organiser l’indemnisation jusqu’à hauteur de 1,5 milliard, ce qui est bien inférieur au coût de 120 milliards d’euros calculé par l’IRSN.
Se pose donc la question du provisionnement du coût restant – la majorité du coût – en cas d’accident nucléaire. À cet égard, il nous semble que trois voies méritent d’être envisagées, au moins intellectuellement.
La première solution repose – et c’est le cas actuellement – sur la solidarité nationale. C’est finalement une situation par défaut : aucun provisionnement n’est anticipé et, en cas d’accident nucléaire, l’indemnisation se fera aux frais des contribuables par une hausse d’impôt.
À l’opposé, la deuxième solution consisterait à considérer la responsabilité illimitée de l’exploitant, comme c’est le cas en Allemagne et comme, selon notre interprétation, pourrait le permettre le protocole de 2004. Bien entendu, cela ne signifie pas que l’exploitant sera solvable. Pour appliquer ce régime de responsabilité, une possibilité serait alors de s’inspirer du régime d’assurance des catastrophes technologiques qui fonctionne de la façon suivante. Lorsque vous êtes assurés en multirisques habitation, vous payez une surprime de quelques euros par an – une surprime catastrophe technologique – qui vous permet d’être indemnisé, en cas d’accident technologique, directement par votre assureur qui se retourne ensuite contre l’exploitant responsable ou l’assureur de ce dernier. Ce système, mis en place à la suite de la catastrophe d’AZF, a pour objet d’améliorer la couverture des victimes par deux moyens, la réduction des délais d’indemnisation, d’une part, et la couverture contre le risque de non-indentification, mais surtout d’insolvabilité de l’exploitant, d’autre part. Cette modalité d’application pourrait être étendue non seulement aux ménages, mais aussi aux entreprises et aux collectivités locales qui ont des contrats d’assurance multirisques entreprise et collectivité locale.
D’un point de vue normatif, cette solution de la responsabilité illimitée de l’exploitant nous semble préférable. Néanmoins, et malgré la modalité d’application permettant d’améliorer la couverture des victimes contre l’insolvabilité de l’exploitant, elle reste peu crédible.
Une troisième possibilité, intermédiaire, serait de conserver ce régime de responsabilité illimitée de l’exploitant, mais de créer un fonds dédié. L’idée serait que l’État explicite et organise son rôle d’assureur et demande à l’exploitant de lui payer une prime d’assurance venant alimenter un fonds qui lui permettrait de couvrir ses dépenses en cas de catastrophe nucléaire.
Nos calculs nous ont conduits à considérer qu’il serait raisonnable de proposer une alimentation de ce fonds à hauteur de 700 millions d’euros par an, ce qui représenterait sur quarante ans un provisionnement de 80 milliards. Ce provisionnement, inférieur au coût mentionné par l’IRSN pour un accident grave, de 120 milliards, est malgré tout relativement conséquent. Je pourrai détailler notre calcul si vous le souhaitez.
M. Denis Baupin, rapporteur. Vos probabilités sont comparables à celles que nous a fournies le directeur de l’IRSN. Sachant que le parc français de 58 réacteurs est supposé fonctionner soixante ans, si on multiplie 3 500 par 10-5, on obtient une probabilité d’accident grave de l’ordre de 3,5 % – ce qui est loin d’être infime. D’ailleurs, la meilleure preuve que les probabilités ne sont pas infimes est que des accidents nucléaires majeurs se sont produits. Au surplus, vous avez parlé de la sous-évaluation du risque par rapport au risque tsunami. Par conséquent, une probabilité s’ajoute à notre débat, celle qu’on se soit trompé dans l’évaluation du risque !
M. le président François Brottes. Nous avons déjà eu ce débat sur l’addition des choux et des carottes…
M. le rapporteur. En fait, j’aimerais savoir si vous estimez que la probabilité est infime ou non négligeable.
Selon les études de l’IRSN, le coût serait de 120 milliards pour un accident grave et de 430 milliards pour un accident majeur. La réalisation d’autres études, comme vous le proposez, relève du bon sens, le directeur général de l’IRSN lui-même le reconnaît. Ces chiffrages en centaines de milliards d’euros en recoupent d’autres établis par le passé – une étude a chiffré à 2 000 milliards de dollars l’évacuation de New York en cas d’accident nucléaire. Bien évidemment, l’ampleur des conséquences dépend de la météorologie et de la proximité d’une agglomération.
La mise en place d’un régime du type accident technologique serait préférable, mais peu crédible à vos yeux. Pourriez-vous en préciser les causes ?
Vous avez proposé la création d’un fonds dédié. Pouvez-vous détailler le calcul qui vous a amenés à ce chiffre de 700 millions par an ?
Enfin, un accident dans une de nos centrales nucléaires située à proximité de frontières aurait des conséquences graves dans d’autres pays, et inversement. Quels seraient le régime juridique et les indemnisations en cas de catastrophe internationale ? Comment un État pourrait-il se retourner contre l’État français, et inversement ?
M. Jean-Pierre Gorges. En réalité, les probabilités sont très basses – elles se rapprochent de zéro –, ce qui explique la difficulté à évaluer les coûts. Sachant que les coûts peuvent être infinis, c’est la multiplication de zéro par l’infini.
Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas ajouter des choux et des carottes et faire une multiplication aussi simpliste : les 60 réacteurs seront remplacés avec une technologie différente. Par conséquent, la probabilité d’incident sera beaucoup plus faible. Sans compter que les pannes sont plus fréquentes soit en début, soit en fin de vie.
M. le président François Brottes. On nous a dit que c’était le hors panne qui potentiellement…
M. Jean-Pierre Gorges. Un réacteur qui fond, c’est l’intérieur du système.
M. le rapporteur. La cause est externe à 90 %.
M. Jean-Pierre Gorges. Pas forcément. Le coût est élevé quand le problème est à l’extérieur. Fukushima, qui est un concentré de probabilités, est un très bel exemple : un tremblement de terre, qui a provoqué un tsunami, lequel a entraîné un arrêt électrique, et donc du système de refroidissement, puis l’explosion de la centrale. Je pense que cela n’arrivera pas deux fois. On peut donc faire du benchmarking et voir comment se réalise cette multiplication du zéro par l’infini – une probabilité très faible qui se produit, avec des coûts que l’on pensait infinis, mais qui se révèlent différents. Aucune personne n’est décédée à ce jour à cause de l’irradiation, c’est le tsunami lui-même qui a fait de nombreuses victimes, et le Japon souffre surtout d’une atteinte de son image, ce qui peut lui coûter très cher !
En matière d’assurance, le chiffre de 1,2 million par an que vous avez cité est l’équivalent du coût d’entretien de la cathédrale de Chartres ! C’est tout de même marginal !
On pensait voir le Japon tourner le dos au nucléaire, comme l’Allemagne l’avait prévu, mais les choses changent. La presse indique que le Japon choisit finalement de relancer ses centrales nucléaires !
En fin de compte, il faut pondérer les chiffres, en prenant en considération la durée de vie d’une centrale et l’évolution de la technologie, sachant que les modèles seront totalement différents grâce à la quatrième génération.
Vos estimations s’appuient-elles sur Fukushima pour mettre à jour les modèles et estimer le coût, ce qui in fine pourrait rassurer les populations ? Faut-il considérer un accident nucléaire comme une catastrophe naturelle ?
M. Philippe Mongin. Monsieur Baupin, votre calcul est correct, mais sous la réserve émise par M. Gorges. En effet, si vous prenez une durée aussi longue que soixante ans, vous devez prendre en compte les améliorations en matière de sécurité qui se produiront inéluctablement. Le calcul multiplicatif nous donne un majorant et il est perfectible.
M. le rapporteur. Ces améliorations en matière de sûreté vous semblent-elles suffisantes, sachant que 90 % des problèmes viennent de l’extérieur ?
M. Philippe Mongin. M. Lahidji vous répondra sur ce point précis.
Monsieur Gorges, en cherchant comme Pascal à multiplier l’infini par zéro, on risque de mystifier la question nucléaire, c’est-à-dire d’aller à l’encontre de l’objectif de vérité de cette commission. Dans notre effort d’objectivation, nous voudrions avoir des montants de coût élevés, des probabilités petites, mais ne pas jouer sur des infinitésimaux. Je suis partisan de calculs qui évitent une dramatisation des choses.
Monsieur le rapporteur, votre question sur une catastrophe internationale est légitime, car les produits radioactifs peuvent s’étendre au-delà des frontières. Néanmoins, je ne suis pas sûr que cela poserait un problème de responsabilité spécifique par rapport à ce que serait le problème national.
Sur les coûts, un travail de démystification s’impose. Nous souffrons d’une insuffisance de travaux. La Cour des comptes a salué le travail de l’équipe de l’IRSN – à laquelle nous sommes tous redevables de deux estimations, en 2007 et 2013 –, mais tout en soulignant qu’il s’agit d’une très petite équipe. Comme vous l’a expliqué M. Lahidji, la publication tardive de ces travaux nous a choqués – ceux de 2007 l’ont été en 2013, à la suite d’une fuite dans la presse. Nous ne connaissons toujours pas la méthodologie détaillée de ces estimations, qui nous intéresse en tant qu’économistes.
L’estimation de 2 000 milliards d’euros ne nous semble pas fondée. Nous connaissons celle de 430 milliards d’euros, dernière estimation autorisée de l’IRSN pour l’accident le plus gravissime, et celle de 120 milliards d’euros qui correspond à un niveau de gravité considérable. Nous connaissons par ailleurs un majorant stupéfiant, celui de 5 737 milliards d’euros qui a circulé en 2007, mais à propos duquel nous pouvons rassurer cette commission. En effet, grâce au document de l’IRSN datant de 2007 et finalement publié, nous pouvons dire que ce dernier calcul est aberrant, il a d’ailleurs été désavoué par son auteur.
En définitive, il faut raisonner à partir des chiffres les plus récents, mais aussi multiplier les expertises sur les coûts. Car si nous disposons d’un travail magnifique sur les probabilités, celui sur les coûts est tout à fait insuffisant.
M. Reza Lahidji. Mon collègue a indiqué que la multiplication conduit à un majorant, mais ce n’est pas tout à fait cela. Il convient bien sûr de se demander si la probabilité va rester à 10-5, diminuer ou s’accroître au gré des travaux. Ces derniers ne sont pas seulement internes, ils peuvent aussi consolider les centrales contre des événements externes, comme cela a été le cas pour la centrale du Blayais, à présent beaucoup moins exposée au risque de raz-de-marée. Mais ce calcul suppose que les événements dans chaque réacteur soient indépendants – supposition dont on connaît les limites. Par conséquent, en cas d’événement majeur dans un réacteur au sein d’une centrale où existent plusieurs autres tranches, il est très probable que cet événement déborde vers d’autres réacteurs.
L’argument de la durée de vie est valide. Pratiquement quarante années sur les soixante se sont écoulées : ce serait donc par vingt…
M. le rappporteur. Vingt-cinq années.
M. Reza Lahidji. Cela dépend des tranches : elles ont été construites entre le début des années 1970 et le début des années 2000, avec des technologies différentes. Il faudrait donc pondérer pour aboutir à un calcul plus précis.
Ainsi, il n’est pas aberrant de dire que sur la durée de vie restante, la probabilité d’un accident majeur, c’est-à-dire avec des rejets en dehors de la centrale, est de l’ordre de 1 % en France.
M. le rapporteur. Merci.
M. Reza Lahidji. Au-delà du chiffre lui-même, c’est à un changement de philosophie que nous invite ce débat.
La probabilité est une mesure de notre incertitude. La question est de savoir si l’on veut mesurer cette incertitude ou pas. La méthode sur laquelle s’est toujours appuyé le secteur nucléaire consiste à exclure cette incertitude, en prenant toutes les précautions qui semblent s’imposer pour nous prémunir contre tous les événements qui semblent réalistes et, une fois construite une défense à toute épreuve pour l’ensemble de ces catégories d’événements, en ne se préoccupant pas des événements résiduels. C’est cette méthode déterministe qui continue à orienter la doctrine de sûreté française.
Chercher à chiffrer ces événements résiduels, à leur donner une probabilité, revient bien à changer de philosophie. Or un certain malaise s’exprime à propos de ces événements, car ce chiffre de 10-5 est jugé très incertain. S’il s’agit d’une mesure effective de notre incertitude, on peut tenir le genre de raisonnement que vous faites ; sinon, il faut mettre ce type d’analyse sur la place publique pour corriger ses éventuelles faiblesses – approche certainement la plus fructueuse. Autrement dit, en considérant que 10-5 n’est pas l’exacte probabilité, mais que des précautions ont été prises pour son évaluation, on peut estimer arriver à des probabilités plus faibles.
M. Jean-Pierre Gorges. La catastrophe de Fukushima est due à des éléments externes, mais il est possible de s’en protéger puisqu’une centrale nucléaire plus proche de l’épicentre, surélevée et qui a continué de fonctionner, a accueilli les riverains venus s’y réfugier. En définitive, il est plus facile – et certainement bien moins cher – d’intervenir sur les 90 % d’éléments externes que sur la fusion du cœur du réacteur.
Je trouve le débat actuel sur les statistiques d’un accident nucléaire très surprenant car, en France depuis 1945, la voiture a fait beaucoup plus de morts que Hiroshima et Nagasaki ! Aujourd’hui, les voitures comportent des équipements de sécurité. Il faut savoir estimer le coût et choisir le matériel le plus performant. C’est plus une démarche idéologique que scientifique.
En outre, si nous avons 130 ans de réserve d’uranium avec la génération 3, nous aurons 5 000 à 7 000 ans de réserve avec la génération 4. La question est donc vitale pour notre pays !
Faut-il responsabiliser entièrement l’exploitant ? Est-ce à l’État d’assurer la prise en charge ? Chacun d’entre nous ne doit-il pas cotiser – comme c’est le cas, par exemple, pour nos centres de secours ? Ces questions sont importantes. Ne réduisons pas le débat à la question binaire consistant à se demander si on continue le nucléaire ou si on l’arrête !
Le Japon renoue avec le nucléaire ; l’Allemagne se désengage des énergies renouvelables ; l’Inde, la Chine, les États-Unis développent la génération 4. Et la France va arrêter la science, stopper l’évolution !
M. le président François Brottes. Notre commission d’enquête se penche sur la question du coût – et non sur celle de savoir si l’on continue ou si l’on l’arrête.
M. le rapporteur. Monsieur Gorges, si l’on vous suit, on peut aussi dire que le tabac provoque plus de morts que la circulation routière et qu’il ne faut plus s’occuper des dispositifs de sécurité dans les voitures !
M. Jean-Pierre Gorges. Il faut tout faire.
M. le rapporteur. Nous sommes d’accord, il faut tout faire. Le nucléaire provoque moins de morts que les accidents de la route, mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’en préoccuper. Au demeurant, il n’existe pas d’autorité de sûreté automobile. La décision des parlementaires de créer une Autorité de sûreté nucléaire démontre la pertinence de l’existence de dispositifs de sûreté. Et sachez que l’ASN et l’IRSN ont réalisé, après la catastrophe de Fukushima, des évaluations supplémentaires visant à renforcer la sûreté des réacteurs.
Le gouvernement japonais souhaite relancer le nucléaire, mais ce sont les autorités locales qui en décideront. Au demeurant, l’autorité de sûreté nucléaire japonaise estime à environ un tiers le nombre de réacteurs conformes aux nouvelles règles de sûreté qu’elle a fixées après l’accident de Fukushima.
Quant à l’Allemagne, j’espère que notre pays aura une politique aussi offensive qu’elle sur les énergies renouvelables !
Mme Frédérique Massat. Si j’ai bien compris, l’État est assureur en dernier ressort et ne fait pas payer le prix de cette garantie, dont il conviendrait de fixer la valeur. Cette garantie entraînerait la hausse des tarifs, puisque l’exploitant la paierait et la répercuterait sur le consommateur. Avez-vous analysé l’impact d’un tel dispositif sur le prix de l’électricité ? Serait-il supportable ? Avez-vous des pistes à suggérer aux parlementaires sur les évolutions nécessaires dans le cadre du texte sur la transition énergétique ?
Mme Céline Grislain-Letrémy. Le régime d’assurance des catastrophes technologiques pose le problème de la solvabilité de l’exploitant. Les seuls cas de responsabilité sans faute et limitée concernent la pollution par les hydrocarbures, les produits défectueux, et le nucléaire. Dans la majorité des cas, pour le risque technologique, il s’agit d’une responsabilité avec faute et illimitée, et les obligations de couverture – correspondant aux garanties demandées au ICPE – couvrent uniquement la remise en état et les frais de dépollution, et pas les dommages aux tiers. Par conséquent, aucun système ne garantit la solvabilité de l’exploitant industriel pour ce qui est de l’indemnisation aux victimes à l’extérieur de l’usine. Le système d’assurance des catastrophes technologiques est donc une couverture très partielle, en permettant simplement aux riverains d’être couverts pour les dommages au bâti de leur résidence principale – les dommages corporels sont exclus.
Pour le nucléaire, les montants seraient probablement beaucoup plus importants et il s’agit d’une responsabilité sans faute. Si l’on passait à un régime de responsabilité sans faute illimitée, se poserait à nouveau ce problème de l’incitation à la couverture des exploitants, lequel ne semble pas pouvoir être résolu aisément. C’est la raison pour laquelle la deuxième solution que je vous ai présentée nous semble peu crédible, même si normativement préférable.
Si l’on retient le chiffre de 120 milliards pour le coût d’un accident grave, comme le préconise la méthodologie de l’IRSN de 2013, en le multipliant par 10-5 (probabilité par année réacteur) et par 58 (nombre de réacteurs), on obtient une prime actuarielle d’EDF de 70 millions d’euros par an. Ensuite, en appliquant comme correctif une prime de risque d’un facteur dix, on arrive à une somme de 700 millions d’euros par an, ce qui correspond à peu près à 9 % des coûts d’exploitation d’EDF. Enfin, en faisant un calcul d’actualisation avec un taux de 4,5 % sur quarante ans, on obtient un provisionnement de 78 milliards d’euros.
Nous n’avons pas fait le calcul relatif à l’impact sur les tarifs.
M. Philippe Mongin. Avec un calcul différent, dont nous n’avons pas complètement compris le secret, la Cour des comptes est arrivée à un ordre de grandeur assez voisin pour le fonds dédié qu’elle propose.
M. Reza Lahidji. Quand on fait des comparaisons, il faut tenir compte de l’ampleur du risque et d’un trait du comportement humain que les économistes appellent l’aversion pour le risque. Plus un risque est important, plus vous êtes prêt à payer pour vous couvrir contre celui-ci. Autrement dit, si un risque de 5 millions de morts avec une probabilité de 10-6 est équivalent, en termes d’espérance, à cinq morts par an, vous allez payer beaucoup plus pour le risque de catastrophe.
Ainsi, il y a une justification à se prémunir contre le risque de catastrophe. C’est bien ce terme-là que nous faisons intervenir pour multiplier la prime annuelle et parvenir à ce que la collectivité serait prête à mettre de côté, chaque année, pour se couvrir contre le risque de catastrophe.
M. Jean-Pierre Gorges. Monsieur le rapporteur, il existe des instances pour la sécurité routière, le CNSR et le CISR, et le tabac, le CNCT.
En fait, il faudrait plutôt comparer la voiture et l’avion. Les avions continuent de voler, alors même que certains s’écrasent avec 350 personnes à leur bord.
M. Philippe Mongin. Pour une inondation de Paris comme celle de 1910, le coût serait de 40 milliards d’euros, à multiplier par une probabilité beaucoup plus élevée qu’un sur cent mille.
M. le président François Brottes. Merci, madame, messieurs, pour votre contribution.
Audition de M. Francis Delon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et M. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN
(Séance du 17 avril 2014)
M. le président François Brottes. Pilote de la coordination interministérielle, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dont M. Francis Delon est le secrétaire général, a impulsé l’élaboration du Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, qui a été rendu public en février 2014.
Responsable du contrôle et de la sécurité des installations nucléaires, dans son statut d’autorité administrative indépendante, l’ASN, dont M. Pierre-Franck Chevet est le président, a engagé depuis une dizaine d’années des réflexions sur la gestion post-accidentelle dans le cadre du CODIRPA – comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire. La catastrophe de Fukushima a quelque peu accéléré le processus.
Alors que, pendant très longtemps, on a affirmé que l’accident nucléaire était impossible, ou presque, le nucléaire est devenu aujourd'hui le secteur le mieux couvert par la prévention. La responsabilité de chacun exige de prendre en considération la question du risque.
Messieurs, comme il faut nous préparer à l’éventualité d’un accident nucléaire, nous souhaitons savoir à quelle échelle se situerait la réponse à un accident nucléaire majeur, en impliquant quels acteurs, sur quelles hypothèses et en poursuivant quels objectifs. La presse se fait l’écho d’exercices de secours auxquels participe la population.
Des réponses apportées dépendent en partie le coût de l’énergie nucléaire, au cœur des préoccupations de notre commission d’enquête. Les bons coûts sont-ils aujourd'hui assumés et pris en charge ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Francis Delon et Pierre-Franck Chevet prêtent serment)
M. Francis Delon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Avant de vous présenter le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, sur lequel vous avez souhaité m’entendre, et de répondre à vos questions, je souhaite brièvement rappeler les missions du SGDSN et préciser ses responsabilités dans le domaine des usages civils de l’énergie nucléaire.
Comme vous le savez, le SGDSN est un service du Premier ministre, qu’il assiste dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine nucléaire, il ne participe pas à la définition de la politique énergétique et n’a de compétence directe ni dans le domaine de la sûreté nucléaire, qui relève de l’Autorité de sûreté nucléaire, ni dans celui des coûts de la filière nucléaire. En revanche, il exerce des compétences de coordination interministérielle en matière de sécurité nucléaire, de lutte contre la prolifération de matière nucléaire et de gestion des crises nucléaires ou radiologiques.
Le SGDSN est en effet chargé de la préparation des pouvoirs publics à la gestion des crises majeures, tant du point de vue de l’organisation gouvernementale que de la planification de la réponse que les pouvoirs publics doivent apporter aux menaces et aux risques majeurs. Cette compétence s’exerce également en matière de gestion de crises nucléaires.
C’est au titre de ces responsabilités que le SGDSN a reçu mandat du Premier ministre, en juillet 2011, pour conduire les travaux de planification de la réponse à un accident nucléaire ou radiologique, survenant en France ou à l’étranger.
La catastrophe de Fukushima Daiichi, en mars 2011, nous a en effet rappelé que l’hypothèse d’un accident nucléaire d’ampleur exceptionnelle, et apparemment improbable, ne pouvait pas être écartée par principe.
Elle a conduit, dans le monde entier, à réexaminer les mesures de sûreté et les dispositifs de gestion de crises nucléaires. De nombreuses initiatives ont été lancées dans le domaine de la sûreté nucléaire, que ce soit en France, dans l’Union européenne ou à l’échelle internationale.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a établi en septembre 2011 un plan d’action de long terme comprenant plusieurs axes de travail visant à renforcer la sûreté nucléaire. Ce plan inclut notamment la révision de la convention internationale sur la sûreté nucléaire, qui impose aux pays signataires de se conformer à de hauts niveaux d’exigence en matière de sûreté, et le renforcement des textes relatifs aux procédures d’information ou encore à l’assistance en cas d’urgence radiologique. Dans ce cadre, la France s’est engagée en faveur de l’élaboration d’un mécanisme international d’intervention rapide en cas d’accident nucléaire en tout point de la planète et de la création d’un centre international de formation à la gestion d’une crise nucléaire.
En France, le Premier ministre a demandé à l’Autorité de sûreté nucléaire un audit de sûreté des installations nucléaires françaises, appelé évaluations complémentaires de sûreté (ECS), qui a pris en compte des aléas et des contraintes supérieures à celles retenues jusqu’alors.
Je n’irai pas plus loin dans ce domaine, qui relève de l’autorité de M. Chevet, si ce n’est pour relever que certaines prescriptions de l’ASN améliorent non seulement la sûreté, mais également les capacités de gestion de crise de l’exploitant : celles relatives au « noyau dur » des installations qui doivent résister à des conditions extrêmes, le poste de commande et les secours électriques durcis en particulier.
Il en est de même de la prescription visant à créer, pour chaque opérateur, des forces d’action rapide, capables d’assister en quelques heures les équipes d’une installation nucléaire en difficulté et de leur apporter l’expertise technique et, le cas échéant, des moyens d’intervention – énergie, refroidissement…–, leur permettant de conserver ou de reprendre le contrôle d’une installation et de la ramener à un état sûr.
Cette partie relève de la responsabilité de l’exploitant qui est tenu de se conformer aux règles fixées par l’ASN et d’assurer la sûreté de ses installations, mais l’État apporte son concours au déploiement rapide de ces forces d’intervention.
C’est ainsi que l’État finalise une convention avec EDF pour l’assistance par des hélicoptères d’État au déploiement d’urgence de l’équipe de reconnaissance de sa force d’action rapide nucléaire (FARN).
Pour revenir au dispositif national de gestion d’une crise nucléaire, il me paraît utile de rappeler ce que sont les grandes lignes de notre dispositif de réponse.
Sur le territoire national, pour chaque installation concernée sont établis des plans d’urgence interne (PUI), sous la responsabilité de l’exploitant, qui visent à ramener une installation accidentée à un état sûr et à éviter que les conséquences ne s’étendent hors du site. De son côté, le préfet élabore et déclenche, le cas échéant, pour chaque installation, un plan particulier d’intervention (PPI) qui prévoit les principales mesures de protection de la population en cas de menace ou de rejet radioactif hors du site. Il s’agit de mesures d’alerte, de mise à l’abri des personnes, de prise de comprimés d’iode, d’éloignement ou d’évacuation des personnes menacées, mesures dont le champ peut s’étendre jusqu’à dix kilomètres de l’installation. Les plans locaux sont complétés par des dispositions générales relevant de la sécurité civile (plans ORSEC).
Mais l’État doit aussi s’organiser quand un accident survient à l’étranger. La catastrophe de Fukushima a justifié l’activation d’une cellule interministérielle de crise, dont le Premier ministre m’avait confié la direction. Des sujets importants comme la sécurité des Français sur place, l’accueil des personnes revenant du Japon, l’assistance éventuelle aux autorités japonaises ou les importations de denrées et de produits japonais ont ainsi pu être traités.
Le retour d’expérience de cette crise a montré la nécessité d’élargir le champ couvert par le dispositif alors en vigueur pour faire face à toutes les situations envisageables et aborder l’ensemble des conséquences d’un accident nucléaire majeur. Cela a conduit le Premier ministre à demander l’élaboration d’un plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, destiné à compléter les dispositions existantes et à les mettre en cohérence avec le dispositif général de gestion des crises issu de la réforme de 2012. Ce dispositif est bâti autour d’une cellule interministérielle de crise (CIC), sur laquelle s’appuie le Premier ministre pour assurer le pilotage politique et stratégique de l’action du Gouvernement.
Pour mener à bien ce chantier important, le choix a été fait dès le départ d’élargir le cercle interministériel habituel à l’ensemble des acteurs du nucléaire. Les travaux ont été conduits en très étroite collaboration avec l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Autorité de sûreté nucléaire de la défense (ASND). Ils ont fortement mobilisé l’ensemble des acteurs détenteurs de l’expertise nucléaire : l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), appui technique de l’ASN et des ministères, ainsi que les trois exploitants nucléaires majeurs (EDF, le CEA et AREVA). Car une crise nucléaire ne se gère pas sans l’exploitant, sans l’Autorité de sûreté ni sans appui technique. Il est important que chacun des acteurs puisse exercer sa compétence dans son domaine de responsabilité et de façon coordonnée.
Le plan gouvernemental issu de ce travail, piloté par le SGDSN, a été approuvé par le Premier ministre en avril 2013, testé en juin 2013 lors d’un exercice et rendu public en février 2014. Conformément au principe d’information de la population qui prévaut dans le domaine nucléaire, il a été mis en ligne sur le site gouvernemental des risques majeurs et sur celui du SGDSN. Il a fait l’objet d’une présentation au CODIRPA, le 16 avril. Une communication est également prévue devant le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, dès que ses membres auront été renouvelés. Sur le plan territorial, les préfets sont invités à informer les commissions locales d’information (CLI). Enfin, le plan a été transmis au groupe de travail post-accidentel de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) en vue d’une prochaine présentation. Les opérateurs ont, pour leur part, intégré les dispositions du plan dans la formation de leurs responsables de gestion de crise.
Ce plan, qui constitue désormais la référence en matière de gestion de crise nucléaire en France, s’appuie sur les dispositifs existants, comme la chaîne d’alerte spécifique aux crises nucléaires ou les plans particuliers d’intervention. Il les complète en donnant au gouvernement les instruments de pilotage politique et stratégique d’une crise nucléaire majeure.
Le plan traite de l’ensemble des situations d’urgence nucléaire quelle que soit leur origine, en France ou à l’étranger, dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter nos concitoyens ou de perturber gravement la vie du pays.
Le Gouvernement a décidé de traiter, par ce plan, un champ très large d’installations ou de transports. Sont intégrés les accidents pouvant survenir sur les centres nucléaires de production d’électricité, sur les installations du cycle du combustible, dans les laboratoires de recherche, sur les installations de propulsion nucléaire et lors des transports de matière radioactive.
Le plan apporte aussi des avancées significatives. En premier lieu, à l’instar des plans gouvernementaux de la nouvelle génération, construits depuis le début des années 2010, il est conçu comme un outil de compréhension de situations complexes et d’aide à la décision.
Je souligne qu’il s’agit du premier plan français de niveau national traitant d’un ensemble large de situations d’accidents nucléaires ou radiologiques majeurs. Il ne se limite plus au niveau local et au périmètre établi autour du site où l’accident s’est produit. Il prévoit des actions sur un territoire plus large. Il s’applique également à des accidents survenus hors de nos frontières.
Il apporte une réponse à la crise sur le temps long. Il prévoit la conduite de l’action dans la phase d’urgence dès le début de l’alerte et propose une doctrine de prise en charge sanitaire de la population à court, moyen et long termes. Il définit aussi une politique de préparation de la phase post-accidentelle intégrant un objectif de continuité des activités économiques et sociales, en utilisant les travaux du CODIRPA conduits sous l’égide de l’ASN.
Il élargit enfin la participation à la CIC aux autorités de sûreté nucléaire – ASN et ASNDéfense – et, en fonction des besoins, à l’IRSN, au CEA et à l’exploitant concerné.
Le plan comporte deux parties.
La première traite des principes d’organisation et des différentes stratégies de réponse à huit situations de référence. La seconde constitue un guide d’aide à la décision pour chacune des situations ; elle propose des mesures à prendre pour mettre en œuvre les stratégies. Le plan est complété par un recueil de quarante fiches mesures, qui sont des outils opérationnels d’aide à la décision.
Les huit situations de référence auxquelles s’applique le plan sont les suivantes : une situation dite d’incertitude, correspondant à la phase dans laquelle un accident n’est pas encore caractérisé ; trois situations d’accidents survenus sur une installation nucléaire, avec rejets radioactifs, soit immédiats et de plus ou moins courte durée, soit différés et de longue durée ; une situation d’accident survenu au cours d’un transport de matière radioactive ; une situation d’accident survenu en mer, sur un navire à propulsion nucléaire ou transportant des matières nucléaires ou radioactives ; deux situations d’accident à l’étranger, distinguant l’éventualité d’un impact, significatif ou non, sur le territoire national plus ou moins proche – Tchernobyl ou Fukushima, de façon schématique.
La stratégie de réponse se décline selon les actions et objectifs concomitants suivants : activation de la cellule interministérielle de crise pilotée par le Premier ministre ; recherche du retour à l’état maîtrisé et stable de l’installation ou du transport par l’exploitant ; protection de la population et prise en charge sanitaire en distinguant les effets immédiats des effets différés de l’accident ; communication vers les populations afin de maintenir la confiance et de donner à chacun les consignes précises de comportement.
Lorsque survient un accident nucléaire, la priorité absolue qui s’attache à l’urgence de protéger, secourir et apporter des soins aux personnes pourrait faire perdre de vue d’autres enjeux qui, s’ils ne sont pas convenablement pris en considération dès le début de la crise, risquent de devenir critiques dans le cas d’une crise aux effets prolongés.
Il est ainsi indispensable de prévoir dès le début les moyens d’assurer la meilleure continuité possible de la vie économique et sociale afin de limiter les effets de la crise et de renforcer la résilience du pays.
De même, la dimension européenne et internationale d’un accident nucléaire justifie une coordination entre les pays et les institutions internationales concernés.
Enfin, le plan prévoit une transition de la phase d’urgence vers la gestion post-accidentelle de la crise. Certaines dispositions doivent être anticipées dès la phase d’urgence, comme par exemple la définition d’un zonage provisoire des territoires en fonction de leur contamination présumée et les restrictions associées, ou encore l’anticipation de la durée des mesures de protection ou d’éloignement des populations qui auront été décidées en phase d’urgence.
Si ce nouveau plan constitue une étape importante dans le renforcement de notre capacité à gérer une crise nucléaire, d’autres étapes sont déjà engagées.
D’abord, le plan national doit faire l’objet d’une déclinaison territoriale, sous la conduite du ministère de l’intérieur. La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a entamé l’élaboration d’un guide de déclinaison territoriale pour orienter les futurs plans zonaux et départementaux de gestion d’une crise nucléaire majeure. Ce guide devrait être disponible à la fin du semestre. Le plan national comporte l’essentiel des dispositions de mise en œuvre nécessaires. Il ne s’agit donc pas de le dupliquer, encore moins de le refaire, mais de planifier les actions complémentaires spécifiques au niveau zonal – je pense en particulier aux problématiques d’évacuation de populations – et au niveau départemental.
Ensuite, une feuille de route est associée au plan pour accompagner la consolidation de notre dispositif de réponse à ces crises. Je citerai à fin d’illustration quelques-unes de ces actions : la poursuite des travaux du CODIRPA sur la gestion post-accidentelle, sous l’égide de l’ASN, l’actualisation de la directive interministérielle de 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas de situation d’urgence radiologique, le renforcement des systèmes de collecte des données concernant l’état des installations nucléaires en cas de crise, l’environnement et la météorologie ou l’appui de l’État au déploiement de moyens exceptionnels de l’exploitant.
Pour conclure, je souligne que ce nouveau plan traduit l’exigence absolue du Gouvernement en matière de sûreté nucléaire et de protection des populations.
Pierre-Franck Chevet, président de l'ASN. La mission de l’ASN en temps de crise est fondamentalement la même que celle qu’elle assure en temps normal : contrôler l’action des exploitants et informer. Deux autres missions se rajoutent en cas de crise : notifier à l’international, notamment aux pays riverains, les informations dont nous disposons, ainsi qu’à l’Agence internationale de l’énergie atomique ; conseiller le Gouvernement sur les mesures de protection des populations à prendre.
L’exploitant doit mettre en application le plan d’urgence interne, dont il a assuré la maîtrise et qui prévoit des critères précis de déclenchement. Les plans d’urgences sont contrôlés par l’ASN. Les exploitants doivent également avoir prévu des procédures accidentelles préétablies, dont nous contrôlons la tenue. En cas de crise, au titre du contrôle, nous enverrions des inspecteurs sur le site ainsi qu’auprès du préfet directement concerné.
Notre système d’alerte fonctionne en continu. Il est testé tous les mois : nous envoyons un message par surprise à tous les agents et nous vérifions si le taux d’acquittement du signal est correct. Si l’ASN a l’obligation générale d’être présente en cas de besoin, pour des raisons administratives, elle ne dispose pas encore d’un système d’astreintes formalisé permettant de dédommager les agents et d’avoir une plus grande certitude sur leur présence effective. En effet, les textes de la fonction publique omettent l’astreinte dans le cas particulier des autorités indépendantes. Ce problème est en voie de résolution.
Nous testons régulièrement notre organisation et celle des exploitants via des exercices : nous effectuons notamment une dizaine d’exercices nationaux impliquant le centre de crise national de l’ASN.
En cas de crise, les acteurs qui participent à la gestion de l’urgence au plan local, encore appelés « urgentistes », jouent un rôle essentiel – je pense principalement au SAMU et aux pompiers. Michel Bourguignon, commissaire de l’ASN, a initié il y a une dizaine d’années des formations collectives en leur direction : 10 000 urgentistes y ont participé depuis la création de ces formations.
Je voudrais lancer cinq messages.
Le premier vise à prendre en considération le retour d’expérience de la catastrophe de Fukushima, durant laquelle nous avons activé notre cellule de crise pour informer le public. Au bout de deux mois, les agents de l’ASN étaient au bout de leurs forces et ce, alors que l’accident s’était produit au Japon. Imaginez la charge de la gestion d’un accident nucléaire qui se serait produit en France : elle serait encore plus lourde. L’ASN doit pouvoir disposer de renforts rapides, notamment en provenance des pays riverains, auxquels nous avons proposé d’envoyer des agents en vue d’aider nos équipes et de participer avec nous à la gestion de crise. Ce serait un moyen d’instaurer une relation de confiance entre pays riverains concernés par un accident nucléaire se produisant dans l’un d’entre eux.
Le deuxième message concerne l’amélioration de la cohérence des critères au plan européen. En effet, je tiens à rappeler non seulement qu’un accident nucléaire est possible, mais également que, s’il survenait en Europe, son rayon d’impact, s’il était équivalent à celui de Fukushima, soit quatre-vingts kilomètres, recouvrirait simultanément plusieurs pays. Or les critères de gestion de crise utilisés en Europe sont encore très disparates. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, les discours publics ont été différents. Si la vision des rejets était identique, en revanche, les critères de gestion de crise étaient différents de chaque côté du Rhin, si bien que les ordres donnés à quelques kilomètres de distance n’étaient pas cohérents, ce qui a nui à la crédibilité de l’action publique. Si des progrès ont été réalisés depuis trente ans, toutefois, les critères de déclenchement des actions de protection des populations – confinement, distribution de pastilles d’iode, évacuation – ne sont pas identiques en Europe. La France a initié une démarche au plan européen en vue d’harmoniser les critères, ce qui n’est pas simple. Il convient encore de progresser en la matière.
Troisième message : il convient de poursuivre les travaux sur la phase post-accidentelle. L’ASN a initié la démarche du CODIRPA en 2005 visant à gérer la crise non pas en phase d’urgence – les vingt-quatre premières heures – mais en phase post-accidentelle, ce qui change la donne. S’il n’est pas difficile, par exemple, d’ordonner le confinement de la population pour vingt-quatre heures, en revanche gérer un même confinement en phase post-accidentelle si les rejets radioactifs doivent se prolonger est plus problématique. Est-il utile d’ordonner un confinement si, après deux ou trois jours, se pose la question de l’alimentation en eau potable des populations concernées ? Les décisions à prendre seront donc différentes selon la durée des rejets. C’est pourquoi nous travaillons à l’heure actuelle, d’une part, sur des hypothèses d’accidents plus graves encore que ceux que nous avions envisagés dans la première phase des travaux et, d’autre part, sur la déclinaison locale de la gestion post-accidentelle. Les mesures à prendre ne seront pas les mêmes selon les territoires : ils dépendront notamment des possibilités d’approvisionnement en eau et plus généralement de l’environnement économique. Il faut travailler au plan local pour décliner le post-accidentel
Quatrième message : il convient de mieux former et informer les populations susceptibles d’être concernées par un accident, notamment en les impliquant davantage dans les exercices, lesquels jouent un rôle important. Les commissions locales d’information (CLI) doivent organiser un plus grand nombre de réunions réellement publiques, c'est-à-dire auxquelles participent non seulement les personnes intéressées mais tous les riverains. Le projet de loi de loi relatif à la transition énergétique pourrait prévoir des dispositions tendant à renforcer l’information des riverains des installations nucléaires.
Cinquième et dernier message : il faut inciter les autorités gouvernementales au plus haut niveau à participer à des exercices. En effet, Fukushima a montré que la cellule de crise n’a pas fonctionné tel que décidé par avance. Le plus haut niveau de l’État a très vite aspiré les centres de crise de chacune des institutions. En cas de crise nucléaire majeure, il est vraisemblable que, très rapidement, l’État se mobilisera au plus haut niveau et que nous serions aspirés par le cabinet du Premier ministre, voire du Président de la République, ce qui n’est pas sans poser des problèmes concrets. Qu’en sera-t-il, par exemple, du centre de crise de l’ASN, qui se réunirait pour prendre des décisions ? En tant que président de l’ASN, il est vraisemblable que je serais demandé à Matignon ou à l’Élysée et que je ne participerais pas à ces réunions. Comment ferais-je alors pour garder la liaison technique avec le centre de crise de l’ASN ? Ce type de questions pratiques se posera pour d’autres responsables d’institutions concernées. Il convient donc que les plus hautes autorités de l’État participent à des exercices afin de se préparer avec nous à la situation telle qu’elle est susceptible de se poser.
M. Denis Baupin, rapporteur. Vos interventions révèlent que, depuis Tchernobyl, nous avons beaucoup progressé sur la compréhension des enjeux, en termes notamment de communication publique ou de relations internationales.
J’observe toutefois comme un décalage entre la démarche du plan national et celle du CODIRPA. En effet, le plan national a été avalisé par le Premier ministre, testé et rendu public avant d’être présenté au CODIRPA, qui était lui-même chargé de préparer la phase post-accidentelle. N’est-il pas étrange que la préparation du plan national n’ait pas donné lieu à une meilleure connexion des deux démarches ?
Par ailleurs, qu’en sera-t-il de la réquisition des personnes dont les services publics auront besoin en cas de crise ? Cette question s’est posée lors de la catastrophe de Fukushima. Ne pourront-elles pas opposer un droit de retrait – je pense par exemple aux chauffeurs de bus réquisitionnés pour évacuer des populations hors de zones contaminées ou potentiellement contaminées ? Des dispositions législatives sont-elles déjà prévues en la matière, visant notamment, comme en cas de conflit armé, à suspendre le droit de retrait durant la période de crise ?
Comment, en outre, assurer la crédibilité de la parole publique en cas d’accident ? Les Français ont gardé en mémoire le mensonge des autorités consistant à prétendre que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté aux frontières de notre pays. Il faut prendre en considération le fait que nous vivons désormais à l’heure de Twitter et que les prises de parole pourraient être différentes entre pays riverains. Or les populations doivent avoir confiance dans les ordres qui leur seront donnés, comme rester confinées plutôt que fuir ou ne pas aller chercher les enfants à l’école.
Les PPI – vous les avez évoqués, monsieur Chevet – ne paraissent pas adaptés au retour d’expérience de la catastrophe de Fukushima : la radioactivité ne s’est pas limitée au périmètre défini autour de la centrale. Dans le cadre de la loi en préparation, ne conviendrait-il pas de revoir les périmètres et les dispositifs actuellement définis ? Aujourd'hui en Allemagne, les pastilles d’iode sont distribuées à la population dans un périmètre de cinquante kilomètres contre seulement dix en France. Pourquoi une telle différence ?
Le CODIRPA et le plan national semblent reposer sur deux philosophies différentes s’agissant du retour des populations à moyen terme dans les zones contaminées. C’est un sujet tout sauf théorique puisque le gouvernement japonais incite aujourd'hui les populations à retourner dans des zones jugées inhabitables au regard des critères français de radioactivité. La question est loin d’être anodine, compte tenu de l’objectif du CEA, évoqué lors de son audition, de retour à l’herbe après démantèlement d’installations radioactives et décontamination de sites de recherche.
M. le président François Brottes. « Un monde plus pur après qu’avant le nucléaire »…
M. le rapporteur. N’y a-t-il pas une frustration du CODIRPA par rapport au plan national ? Pourquoi deux appréciations différentes sur la gestion des territoires ?
Monsieur Chevet, vous avez évoqué le fait que les différences de critères entre la France et l’Allemagne subsistent trente ans après Tchernobyl, ce qui est loin d’être rassurant. N’a-t-on pas tiré les leçons, du côté français, du déficit de communication ? Comment de telles différences peuvent-elles subsister à l’heure des directives européennes, qui vont parfois jusqu’à s’occuper de questions de détail, ce dont les citoyens se plaignent ? Le périmètre de distribution des pastilles d’iode aux riverains de Fessenheim est-il différent des deux côtés de la frontière entre la France et l’Allemagne ? Il serait incompréhensible que les riverains ne disposent ni de la même information ni du même niveau de préparation en cas de crise majeure, ce qui nuirait à la crédibilité des mesures actuellement prévues en situation de gestion de crise.
M. Francis Delon. Si l’ASN a été associée dès le début à la préparation du plan national, il a été décidé, s’agissant de la phase post-accidentelle, de réserver la position du CODIRPA, qui est l’organisme dédié à la question : nous discutons actuellement avec lui de certaines dispositions du plan. Il n’y a donc eu de notre part aucune mise à l’écart d’aucun acteur. C’est l’ASN qui était notre interlocuteur : le CODIRPA n’a pas participé directement à nos travaux – à ma connaissance du moins, car je n’ai pas participé à tous les travaux.
En cas de crise, la mobilisation des personnes répond aux dispositions générales de gestion de crise, laquelle gestion est placée sous la responsabilité du préfet. Des personnes pourront être requises si nécessaire : aucun dispositif particulier en la matière n’est prévu en cas de crise nucléaire majeure. Les règles habituelles seront appliquées. Le préfet ajustera les modalités d’action en fonction des nécessités de la gestion de la crise.
S’agissant de la crédibilité de la parole publique, les pouvoirs publics ont tiré les leçons de Tchernobyl : ils avaient alors commis beaucoup d’erreurs, pour ne pas dire plus. C’est du reste dans le cadre de ce retour d’expérience qu’a été décidée la création d’une autorité administrative indépendante, l’ASN. Et c’est l’ASN, appuyée par l’IRSN, qui s’est exprimée sur les conséquences pour la France de la catastrophe de Fukushima. Les pouvoirs publics n’ont pas cherché à tenir un discours différent. La crédibilité de la parole publique repose sur le statut indépendant de l’ASN : c’est la grande différence avec l’époque de Tchernobyl.
S’agissant des PPI, il conviendra certainement de tirer des leçons de Fukushima. Nous avons toutefois refusé, pour des questions de méthode et d’organisation du travail, de le faire dans le cadre du plan national en termes d’élargissement du périmètre ou de modification de certaines règles : c’est dans le cadre de la phase territoriale, dont le ministre de l’intérieur est responsable, que ces questions seront traitées – nous nous y attelons à partir de maintenant.
Il n’existe pas à mes yeux de différence de philosophie entre le CODIRPA et le plan national sur la question du retour des populations dans les zones contaminées. Je le vérifierai toutefois dans le cadre du dialogue que nous entretenons actuellement avec le comité. Sachez en tout cas que les pouvoirs publics n’ont pas l’intention d’inciter les populations à retourner sur des territoires encore contaminés et donc dangereux, cela va sans dire.
Enfin, s’agissant de la gestion de crise au plan européen, M. Chevet a eu raison de plaider pour un rapprochement entre pays riverains des pratiques de gestion de crise. Nous y travaillons dans le cadre de coopérations. Nous sommes en revanche opposés à une gestion de crise pilotée au plan européen. Non seulement ce serait contraire aux compétences propres des États garantis par les traités mais une telle gestion se révélerait, de plus, inefficace, car trop éloignée des territoires. Un tel pilotage européen ne saurait apporter aux populations concernées les réponses immédiates qui s’imposent. Chaque État doit rester maître des règles applicables en matière de gestion crise. Mais il est en même temps indispensable de connaître les dispositifs prévus par les pays voisins et de les coordonner avec les nôtres, pour éviter les effets de bord que vous avez évoqués, monsieur le rapporteur.
Pierre-Franck Chevet. Je confirme que l’ASN a été pleinement associée à l’élaboration du plan national, nous-mêmes portant la vision du moment du CODIRPA. Je rappelle que les travaux actuels de cette instance visent le plan local puisqu’il s’agit désormais de décliner les éléments de doctrine du CODIRPA sur le terrain, au sein des plans accidentels, déclinaison qui ne saurait se faire au plan national, du fait que les réponses à apporter en gestion post-accidentelle doivent être adaptées à la situation locale. Il faut associer toutes les parties pertinentes au plan local à cette phase qui confirmera la cohérence entre CODIRPA et plan national.
S’agissant du droit de retrait, l’emploi de la force publique n’est pas de mon ressort. En revanche, la question se pose pour les sous-traitants et les agents du site. À la suite de Fukushima, nous avons mis en place un groupe de travail sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains, dont un des objectifs est de vérifier la façon dont il sera possible de mobiliser tous les acteurs ayant à intervenir sur le site en cas de crise. S’agissant des sous-traitants, nous n’avons pas pour l’heure la garantie juridique qu’en cas de crise les personnels voudront intervenir et nous ignorons dans quelles conditions ils le feraient. Ce groupe de travail, mis en place il y a un an et demi, et qui comprend des juristes, n’a pas encore remis ses conclusions.
M. le président François Brottes. Confirmez-vous, d’après les informations dont vous disposez, le recrutement à Fukushima, relaté ici ou là dans la presse, de personnes sans travail ni ressources et sans compétences particulières pour travailler dans les zones contaminées ?
M. Pierre-Franck Chevet. Des sources indirectes, via notamment l’ambassade, nous le confirment. Je n’ai pas pu constater de visu la véracité de tels faits.
Nous disposons par ailleurs de nos propres réseaux sociaux et nous les testons dans le cadre d’exercices. Si vous connaissez des experts en la matière…
Je confirme l’existence de disparités au plan européen. Nous avons conduit des travaux sur les pastilles d’iode, dans une zone couvrant la Belgique, la France, l’Allemagne et la Suisse. Il faut savoir que les comprimés n’avaient pas auparavant la même posologie : nous nous sommes mis d’accord et ce n’est plus le cas. Les périmètres de distribution ne sont pas les mêmes en Allemagne et en France, c’est vrai, mais il faut savoir que si, en France, la prédistribution de pastilles d’iode se fait dans un rayon de dix kilomètres, des stocks zonaux sont toutefois répartis sur l’ensemble du territoire afin de permettre une distribution d’iodes à l’ensemble de la population sur ordre des pouvoirs publics.
M. le rapporteur. Comment la distribution serait-elle effectuée en cas de crise ?
M. Pierre-Franck Chevet. Selon un document que j’ai sous les yeux, le ministère de la santé a ordonné la fabrication de 110 millions de comprimés en 2011 qui ont été acheminés dans des plates-formes zonales gérées par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).
M. Francis Delon. Il existe à l’heure actuelle 130 millions de doses à la disposition des préfets des zones de défense et de sécurité. Sous la responsabilité des préfets, un dispositif spécifique est mis en place dans chaque département et les populations en sont informées. Il n’existe pas de dispositif harmonisé sur le territoire : confiance est faite au terrain pour trouver les solutions les mieux adaptées. Le dispositif peut prévoir des distributions aux populations effectuées dans l’urgence comme des dépôts en pharmacie. Les pouvoirs publics se sont donc organisés pour distribuer des pastilles d’iode au-delà de la zone de dix kilomètres.
M. le président François Brottes. Ce produit se conserve-t-il longtemps ?
M. Francis Delon. Son délai de péremption est de dix ans. C’est un produit très stable.
M. le rapporteur. Comment serait-il possible en cas d’urgence de distribuer rapidement à la population de tout un département ce produit ? Le cas de la population parisienne serait en outre très différent de celui d’une zone rurale. Qui ferait la distribution ?
M. Francis Delon. L’organisation de la distribution est de la responsabilité du préfet. En situation de gestion de crise, ce sont les pouvoirs publics, en l’occurrence le représentant de l’État au niveau territorial, qui exerce ces compétences en liaison étroite avec le préfet de la zone de défense et de sécurité.
Ces stocks ne peuvent pas être disséminés partout sur le territoire. Nous n’avons pas voulu d’un dispositif unique sur l’ensemble du pays, préférant faire confiance aux préfets pour trouver les solutions les mieux adaptées au plan local. En effet, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, il y a de grandes différences entre une grande agglomération et des zones rurales profondes. Nous ne saurions imposer des dispositifs qui s’appliqueraient dans un cas et non dans un autre. Il faut rester près du terrain.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Monsieur Chevet, où se situe la France par rapport aux autres pays européens en matière d’exigence en situation de crise ?
Quel est par ailleurs le travail engagé au plan européen en matière d’harmonisation de la gestion de crise ?
Dans son rapport annuel rendu cette semaine, l’ASN réclame plus d’experts et davantage de pouvoirs, notamment celui d’arrêter des réacteurs en cas de danger et de prendre des sanctions intermédiaires. Estimez-vous ne pas être aujourd'hui en mesure d’assurer efficacement votre mission ou prévoyez-vous une charge de travail croissante du fait du vieillissement des installations ainsi qu’une évolution des exigences dans le contrôle et la prévention ?
M. Jean-Pierre Gorges. Je m’étonne de l’élargissement de l’objet de cette commission d’enquête qui, du coût du nucléaire, est passée à la transition énergétique puis à la gestion de crise. C’est une dérive : nous oublions l’objet de la commission d’enquête.
M. le président François Brottes. Monsieur Gorges, l’objet de la commission d’enquête est de connaître la totalité des coûts relatifs à la filière. Nous nous efforçons d’être exhaustifs.
M. Jean-Pierre Gorges. Alors ne passons pas autant de temps à évoquer la question de la distribution des pastilles d’iodes.
Fukushima, qui a été un malheur d’un côté, peut se révéler une chance de l’autre. La probabilité d’être confronté en même temps à un tremblement de terre, à un raz-de-marée, à la défection d’un système de la centrale nucléaire pour cause externe et à l’explosion d’un réacteur est très faible. Fukushima vous a-t-il permis de revoir vos modèles, qu’il s’agisse de la probabilité d’apparition ou de l’estimation des coûts de tous types engendrés ?
Par ailleurs, lorsque l’ASN fait des recommandations, tente-t-elle de chiffrer l’amélioration de la probabilité d’apparition d’un accident ? Il me paraîtrait important d’accompagner les recommandations d’un calcul de leur influence sur la fiabilité du système global. S’agissant des réacteurs actuels, ceux de la génération III, comment évoluent la probabilité et les coûts déclinés par composantes ? L’ASN a-t-elle mené ces mêmes études dans la perspective de la transition de la génération III vers la génération IV ?
Monsieur Chevet, une commission d’enquête ne s’interdit aucune question. Vous avez été nommé en septembre 2012. Or, à l’Assemblée nationale, plusieurs députés ont été surpris à la fois de votre changement de position vis-à-vis du nucléaire et du fait qu’en mai 2013 vous ayez bénéficié d’une augmentation de 72 % de vos revenus.
Mme Frédérique Massat. Monsieur Chevet, pour vous, les commissions locales d’information doivent organiser un plus grand nombre de réunions publiques : quelle est l’articulation des rôles respectifs de l’ASN et des CLI et quels moyens financiers l’ASN dédie-t-elle aux CLI ?
Pouvez-vous également nous préciser les modifications en matière d’information du public que vous souhaitez voir inscrites dans le futur projet de loi sur la transition énergétique ?
Convient-il, en situation de gestion de crise, de conforter le rôle des CLI en termes d’approche pour éviter notamment tout phénomène de panique ? Comment pourriez-vous les accompagner à cette fin ?
À l’occasion de la sortie de votre rapport, la presse numérique s’est fait l’écho du fait qu’après avoir jugé la situation du nucléaire « globalement assez satisfaisante », vous ayez ajouté, selon certaines sources : « J’aurais eu cette appréciation sur mon bulletin scolaire, je n’aurais pas été fier ». Le contre-effet provoqué par cette remarque était-il voulu ?
M. Michel Sordi. Monsieur Delon, que retenez-vous de l’intrusion de Greenpeace sur le site de Fessenheim ? Quelle est la logique d’intervention du peloton spécialisé de gendarmes mobiles ? A-t-elle été efficace ce jour-là ? Comment expliquer que cinquante-six militants aient pu pénétrer sur le site ?
Le changement de statut juridique des centrales nucléaires, qui avait été annoncé par le précédent ministre chargé de l’écologie, M. Martin, est-il engagé ?
M. Pierre-Franck Chevet. Le rapport annuel de l’ASN a été présenté avant-hier devant l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) avant de faire l’objet d’une conférence de presse le lendemain. Nous avons effectivement jugé, comme l’année précédente, « globalement assez satisfaisante » la situation en 2013 du nucléaire en France. Il s’agit donc d’un jugement positif nuancé. C’est en 2012 que j’avais répondu, à un journaliste me demandant de préciser ce que ce jugement signifiait exactement, que je n’aurais pas aimé lire sur mon bulletin scolaire une telle appréciation, qui correspond à un 12 ou à un 13 sur 20 – j’étais personnellement habitué à de meilleures notes.
Nous avons établi la liste de grands dossiers sans précédents à ouvrir dans les prochaines années : les suites de Fukushima, l’éventuelle prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires, le chantier de l’EPR à Flamanville, le radon – une question trop rarement évoquée alors qu’elle concerne trente et un départements français – et, enfin, le domaine médical. La somme de tous ces dossiers représente pour l’ASN une charge croissante. Or, compte tenu de l’état des finances publiques, je ne vois pas comment l’État pourra nous assurer les moyens supplémentaires dont nous avons besoin dans la forme actuelle de notre financement. Nous avions déjà souligné, dans l’avis que nous avions rendu l’année dernière sur notre budget, le problème posé par le financement pérenne et durable de l’ASN et de l’ISRN, avec lequel nous avons travaillé pour estimer la charge à venir, tout en tenant compte des efforts d’efficacité que nous devons faire en interne. L’ASN et l’ISRN emploient chacun 500 personnes : or nous estimons avoir encore besoin de 150 à 200 personnes supplémentaires.
Je tiens à rappeler que mon salaire est composé d’une partie indiciaire, fixée par la loi, et de primes, fixées par un décret puis un arrêté publiés au Journal officiel. Il est donc public. Les primes ont été augmentées pour me permettre de conserver le niveau de salaire qui était le mien lorsque j’étais directeur général de l’énergie et du climat. Mon salaire est désormais dans la moyenne de celui des présidents d’autorités comparables.
La France possède les outils nécessaires au calcul de probabilité des accidents graves : nous pouvons donc quantifier les gains de sûreté apportés par les améliorations que nous demandons. Toutefois, ce n’est pas ce calcul qui nous a guidés dans le passage de la génération II à la génération III et qui nous guidera dans celui à la génération IV. Les objectifs de génération III visent à écarter la contamination à long terme des territoires en évitant le relargage de radionucléide à vie longue, relargage qui, au Japon, rend inhabitable durant plusieurs dizaines d’années la zone dite d’exclusion qui fait quelque vingt kilomètres.
Les réacteurs de génération II ne sont pas encore dimensionnés à cette fin, contrairement aux réacteurs de génération III, comme l’ont montré les suites de Fukushima en France. C’est mon successeur qui définira les objectifs de génération IV – je ne suis nommé que pour six ans : toutefois, nous avons clairement souligné que génération IV était une appellation trompeuse qui ne recouvrait en soi aucune amélioration de sûreté, à la différence de génération II et de génération III qui désignent des niveaux de sûreté. Les générateurs de génération IV ont vocation à entrer en service entre 2040 et 2050 : or, d’ici là, de nouvelles exigences d’amélioration de niveau de sûreté auront été vraisemblablement formulées par rapport à la génération actuelle. Ce n’est pas en termes de probabilité que nous raisonnons. Après Fukushima, nous avons cherché à définir les besoins prioritaires qu’il convenait d’assurer pour éviter une catastrophe similaire. Or le premier d’entre eux est l’alimentation en eau du réacteur, laquelle suppose l’existence de pompes elles-mêmes alimentées en électricité. Il est donc nécessaire de prévoir à la fois des moteurs diesel et des puits supplémentaires : tel est le noyau dur de la sûreté à garantir. Une telle approche ne repose en rien sur un rapport coût-bénéfice, qui est une approche moins lisible et pertinente. Des dispositions provisoires ont été prises – sources d’eau d’appoint, pompes d’appoint et moteurs diesel –, l’année 2013 ayant été consacrée à préparer le schéma du système définitif. Une fois que celui-ci aura été arrêté, il sera de la responsabilité des exploitants de proposer des plans et de les mettre en œuvre sur les sites. Le plein déploiement de ces systèmes définitifs devrait être effectué en 2018. Il faudra une dizaine d’années pour tirer totalement les leçons de Fukushima.
Les CLI nous sollicitent pour obtenir des financements : nous leur versons quelque 1 million d’euros par an à leur demande sans intervenir sur le contenu de leur action ou l’opportunité de leur demande, qui doit évidemment être conforme à leur mission. Il est vrai que les dispositions de la loi de 2006 permettant de lever au bénéfice des CLI une partie de la taxe « installation nucléaire de base » (INB) ne sont pas entrées en vigueur, ce qui laisse évidemment en suspens la question de leur financement. Les CLI qui fonctionnent bien sont celles qui ont les moyens de disposer d’un permanent, qui fait vivre de vrais débats. Si nous participons aux séances de travail organisées par les CLI, nous regrettons en revanche qu’elles n’organisent pas davantage de réunions publiques – je l’ai déjà souligné – sur les questions de sûreté. Je leur ai déjà passé le message mais il leur appartient de le mettre en application : je n’ai pas autorité sur elles.
Quant aux dispositions à prendre pour renforcer l’information, il s’agirait simplement d’inscrire dans la loi l’obligation de mettre à jour et de diffuser auprès des riverains les informations pertinentes sur la gestion de crise.
M. Francis Delon. Je tiens à rappeler, à propos de l’intrusion de militants de Greenpeace sur le site de Fessenheim, qu’il convient d’assurer non seulement la sûreté des centrales mais également leur sécurité contre les agressions extérieures, en évitant notamment qu’un commando terroriste ne pénètre dans une centrale et ne porte atteinte à la sûreté du réacteur. À cette fin, le choix a été fait d’une défense en profondeur qui s’appuie à la fois sur des dispositifs de protection passifs – barrières et clôtures – et des personnels capables de répondre à une telle agression – ce sont des gendarmes dans les centrales d’EDF et d’autres personnels de sécurité sur les sites du CEA et d’AREVA.
S’agissant de Greenpeace, soixante militants sont arrivés au petit matin : ils ont arraché un portail à l’aide d’un camion, tout en menant une opération de diversion sur un autre point du site. Ils ont ensuite déployé une banderole. Le peloton de gendarmerie a parfaitement réagi. Je tiens à rappeler que, n’étant que six, ils ne pouvaient pas bloquer l’avancée de soixante militants. Par ailleurs, il n’était pas question pour eux de faire usage de leurs armes contre les militants de Greenpeace. Le peloton a donc fait le choix de protéger la sûreté du réacteur, ce qu’il a fait. Greenpeace a atteint son objectif médiatique sans réussir toutefois à démontrer que la sécurité des centrales n’était pas bien assurée. En effet, les gendarmes ou les personnels de sécurité des centrales ne réagissent pas de la même manière à l’égard de manifestants qu’à l’égard de personnes suspectées de vouloir porter atteinte à la sûreté du réacteur. Les militants de Greenpeace sont suffisamment responsables pour ne pas être suspectés de vouloir porter atteinte à la sûreté du réacteur et donc des populations. La réaction des services d’ordre a donc été proportionnée.
Une telle intrusion permet de vérifier d’éventuels dysfonctionnements ou insuffisances dans les dispositifs de protection ou les procédures utilisées. Il est toujours possible de faire mieux en matière de protection, ce que nous avons demandé aux opérateurs. Il faut avoir à l’esprit que pour EDF déployer des dispositifs performants en termes de détection ou de protection se chiffre en centaines de millions d’euros. Telle est la conséquence de ce genre d’action.
Quant au risque pénal encouru à l’heure actuelle par les personnes qui pénètrent illégalement dans une centrale, c’est la violation de domicile : les sanctions sont donc faibles. C’est la raison pour laquelle le précédent ministre de l’écologie a considéré comme nécessaire de modifier le régime juridique des centrales nucléaires. Le travail est en cours et est très avancé. J’espère qu’il aboutira prochainement, apportant une réponse pénale plus adaptée à la gravité de l’infraction commise. Les militants de Greenpeace peuvent en effet, même de manière involontaire, mettre en danger la sûreté de la centrale. Au surplus, tout le dispositif de sécurité est perturbé par de telles actions et Greenpeace ne peut pas savoir si, dans ses rangs, ne s’est pas infiltrée une personne malintentionnée désireuse de profiter du fait que les gendarmes, qui appliquent une réponse proportionnée à l’agression, n’utiliseront pas leurs armes, ce dont personne ne leur fera grief.
M. le président François Brottes. Personne n’est pas à l’abri de « faux Greenpeace ».
M. Francis Delon. En effet, monsieur le président : que se passera-t-il si parmi les militants se trouve un « faux Greenpeace » ? De telles actions menées sur les centrales sont irresponsables car elles compliquent considérablement la vie de ceux qui sont chargés d’assurer la sécurité et qui doivent faire le tri entre les « vrais Greenpeace » et les « faux Greenpeace ».
Le risque que prend Greenpeace est d’endormir la vigilance des forces de sécurité, qui pourraient se trouver confronter à une intrusion d’une tout autre nature.
M. le président François Brottes. Il avait été évoqué pour La Hague un dispositif de protection contre les attaques aériennes. Il semblerait que les dispositifs précédents aient été levés. Un dispositif semblable existe-t-il pour les centrales nucléaires ?
M. Francis Delon. La question portant sur un sujet classifié, je ne peux vous répondre, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Gorges. Alors que le moindre jeune qui vole une mobylette se retrouve dans une situation inextricable, je n’arrive pas à comprendre qu’on fasse preuve d’une telle tolérance à l’égard des militants de Greenpeace. Est-ce normal, alors même que leurs actions dévalorisent dans l’opinion publique l’image des centrales nucléaires, notamment en termes de sécurité et, à travers elles, l’image du pays ? Aujourd'hui, je n’ai guère envie d’aller au Japon, alors que je suis favorable à l’énergie nucléaire. Je voterai le changement de statut des centrales.
M. le rapporteur. Je ne suis pas le porte-parole de Greenpeace même si je soutiens les actions de l’organisation.
M. Gorges, est-il normal qu’un vice-président de l’Assemblée nationale se coiffe d’un bonnet rouge alors que des manifestants incendient des radars, qui sont des éléments de sécurité routière, ou démontent des portiques ? Votre organisation politique aurait dû tenir le même discours que vous aujourd'hui.
M. Jean-Pierre Gorges. Je suis d’accord avec vous.
M. le rapporteur. Les militants de Greenpeace n’ont rien incendié ni rien cassé, ils conduisent leurs actions à visage découvert et passent en justice. Ceux qui ont pénétré sur le site de Fessenheim ont passé de nombreuses heures en garde à vue et seront condamnés en fonction du droit existant. Si celui-ci évolue, ils prendront leurs responsabilités. Ils ne jouissent d’aucune impunité. Je connais beaucoup de ces militants, qui ont été condamnés : ils assument leur action qu’ils estiment légitime pour attirer l’attention.
Du reste, leur objectif à Fessenheim n’était pas de dénoncer les problèmes de sécurité de la centrale mais de sûreté – leur communication a failli sur ce point –, parce qu’ils estiment que c’est la centrale la moins sûre.
Toutefois, les problèmes que vous avez soulevés se posent effectivement, monsieur Delon.
M. le président François Brottes. Le découpage des responsabilités entre sûreté et sécurité, la première étant du ressort du ministère de l’énergie et l’autre du ministère de l’intérieur, est-il toujours pertinent ? Un tel découpage ne risque-t-il pas de créer des zones intermédiaires non gérées ?
M. Francis Delon. Je suis partial dans cette affaire puisque je m’occupe de la sécurité.
Le dispositif actuel fonctionne bien. Les affaires de sécurité réclament des moyens classiques, appliqués au nucléaire, de maintien de l’ordre et de protection : il n’est pas anormal qu’ils soient traités selon la voie normale.
M. le président François Brottes. Toutefois, s’il est vrai que 80 % des risques potentiels sont dus à des événements extérieurs à la centrale, le problème reste entier. L’ASN s’en est déjà émue, n’est-ce pas, monsieur Chevet ?
M. Pierre-Franck Chevet. Dans la situation actuelle, la coordination entre nos services est bonne. Je constate toutefois que mes homologues étrangers sont le plus souvent également chargés des problèmes de sécurité sans avoir toutefois le pouvoir de déclencher l’action des forces publiques.
M. Francis Delon. Il serait difficile de confier le maintien de l’ordre à une autorité indépendante.
Audition de M. Jean-Pierre Charre, vice-président, M. Michel Demet, conseiller du président, et M. Alexis Calafat, secrétaire, du bureau de l’ANCCLI (Association nationale des CCLI)
(Séance du 17 avril 2014)
M. le président François Brottes. Je remercie M. Jean-Pierre Charre, vice-président de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information, l’ANCCLI, M. Michel Demet, conseiller du président de l’ANCCLI, et M. Alexis Calafat, secrétaire du bureau de l’ANCCLI, d’avoir répondu à notre invitation.
Nous traitons ce matin de la question du risque nucléaire et de sa gestion. Connaissant le rôle des commissions locales d’information, les CLI, mises en place auprès des installations nucléaires, en matière de gestion de crise, nous avons souhaité entendre sur ces questions la voix de leurs représentants au niveau national.
Je précise que M. Charre est également vice-président de la CLI de Marcoule, que M. Demet est membre de la CLI de Gravelines, et que M. Calafat préside la CLI de Golfech, commune dont il est également maire.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Jean-Pierre Charre, Michel Demet et Alexis Calafat prêtent serment)
M. Jean-Pierre Charre, vice-président de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information. Au sein de l’ANCCLI, je pilote le groupe permanent « Post-accident et territoires » (GPPA), chargé d’étudier toutes les hypothèses d’intervention des CLI lors d’un accident sur un territoire donné, notamment en ce qui concerne la communication et l’information des populations.
Dès 2007, l’ANCCLI avait émis le souhait qu’on étudie l’éventualité d’un accident nucléaire sur le territoire français. L’objectif du GPPA est de définir les modalités d’information et d’intervention auprès des populations et de l’ensemble des acteurs locaux et de préparer les territoires aux situations post-accidentelles.
M. Michel Demet, conseiller du président de l’ANCCLI. En matière de gestion de crise, la législation est relativement récente. En effet, c’est la loi Bachelot du 30 juillet 2003 qui a institué les CLI auprès des sites classés « Seveso » et les plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. La loi de modernisation de la sécurité civile du 30 août 2004, quant à elle, impose aux collectivités la mise en place de plans communaux de sauvegarde, les PCS, et l’information des populations en matière de risque. Enfin la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, ou loi TSN, prévoit la mise en place de CLI auprès des installations nucléaires. Si ces lois rappellent le rôle de l’État en tant que maître d’œuvre en matière de gestion de crises majeures, elles donnent de nouvelles responsabilités aux maires dans ce domaine. Ceux-ci deviennent en effet, en vertu de leur pouvoir de police, juridiquement responsables de l’accompagnement de la gestion de la crise.
Sur le terrain cependant, on constate que ces législations peinent à être appliquées. Actuellement, à peine 50 % des 11 000 communes où la mise en œuvre d’un PCS est obligatoire l’ont effectivement mis en place, en dépit du guide de deux cents pages diffusé à l’époque par le ministère de l’intérieur à destination des élus et des techniciens des collectivités concernées.
M. le président François Brottes. Comment l’expliquez-vous ?
M. Michel Demet. Par le fait que toutes les collectivités n’ont pas les moyens de mettre en place un PCS. Les petites communes n’ont pas les moyens humains ni logistiques de mettre en place de tels plans.
M. le président François Brottes. Pensez-vous que cette compétence devrait être exercée par les intercommunalités ?
M. Michel Demet. Nous avions en effet demandé à l’époque que l’intercommunalité joue un rôle important dans ce domaine, et beaucoup d’entre elles l’assument dans les faits : c’est elles qui ont permis la mise en place des PCS dans les petites communes.
Il faut dire qu’un grand nombre d’élus, notamment dans les petites et moyennes communes, n’ont pas encore pris conscience de l’importance de la gestion des risques, notamment nucléaires, qui sont bien moins faciles à appréhender que les risques Seveso, par exemple, notre pays n’ayant encore connu aucun accident de ce type.
M. le président François Brottes. Selon vous, les élus ne sont pas assez mobilisés par cette question ?
M. Michel Demet. Il est vrai qu’on a du mal à mobiliser les élus, et cela risque de rendre le Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur difficile à mettre en œuvre dans les territoires. De même, la France peut s’enorgueillir des travaux du Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire, qui manifestent l’excellence de la France dans ce domaine au niveau européen, voire mondial, mais le plus difficile sera d’assurer l’application de la doctrine du CODIRPA – comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire – dans les territoires.
M. Alexis Calafat, secrétaire du bureau de l’ANCCLI. Je ne serai pas aussi radical que M. Demet. En tant que membre jusqu’à récemment du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, président de l’Association des représentants des communes d’implantation de centrales et d’établissements nucléaires, l’ARCICEN, et président d’une CLI depuis plus de vingt ans, j’ai pu mesurer l’évolution du discours sur le nucléaire. En 1989, on nous disait que le nucléaire ne posait aucun problème de sûreté, qu’on pouvait même déjeuner auprès du réacteur. Tchernobyl nous a permis de mesurer les conséquences d’un accident nucléaire et aujourd’hui on accepte la notion de risque nucléaire.
Il est vrai que toutes les communes ne se sont pas dotées d’un PCS, mais il faut dire aussi que beaucoup ont élaboré un PCS sans nécessairement le communiquer à la préfecture, du fait d’un formalisme peut-être excessif. En effet, beaucoup de communes avaient déjà mis en place des plans de gestion des risques avant que la loi ne leur en fasse l’obligation, notamment pour prévenir les risques d’inondation. Or les communes d’implantation de centrales nucléaires sont en principe situées au bord de l’eau. J’ai été moi-même à l’origine du premier plan d’action communale, ou PAC, suite au premier exercice de crise de la centrale de Golfech. Les élus gèrent naturellement les risques.
Il reste le problème de la perception du risque par la population. Il est vrai que les populations se reposent beaucoup sur les élus. Même si elles donnent l’impression de vivre avec le risque nucléaire sans y prêter plus que ça attention, l’expérience m’a appris qu’il y a toujours une inquiétude. Il y a quelques années, dans les communes situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de la centrale de Golfech, périmètre à protéger rapidement, la sirène, théoriquement destinée à signaler aux habitants la nécessité de se mettre à l’abri, s’était déclenchée, provoquant un attroupement de cinquante personnes devant la mairie. Cette anecdote vous permet de mesurer le manque d’information de la population. J’ignorais moi-même ce qui se passait.
M. le président François Brottes. Savaient-ils qu’ils devaient rester chez eux dans un tel cas ?
M. Alexis Calafat. Ils le savaient en théorie, mais ils ne l’ont pas fait. Il s’agissait heureusement d’un dysfonctionnement de l’alarme, mais il a montré que les mesures prévues par le PPI – plan particulier d’intervention – auraient sur la population des effets contraires à ceux attendus en cas d’accident réel. C’est la raison pour laquelle je déplore que la périodicité des exercices de crise ait été ramenée de trois à cinq ans. Ces exercices constituent pourtant la meilleure pédagogie qui soit. En cinq ans on perd les réflexes acquis, d’autant que la population a eu le temps de changer.
M. le président François Brottes. Ces exercices ne sont-ils pas coûteux pour la commune ?
M. Jean-Pierre Charre Ils mobilisent surtout des moyens départementaux et préfectoraux, qu’il s’agisse de la sécurité civile, des services départementaux d’intervention et de secours ou de la gendarmerie. Les communes sont peu sollicitées ; elles se contentent d’attendre les communiqués et les consignes de la préfecture, d’ailleurs peu nombreux. Sur le site lui-même, ce sont surtout les moyens humains et techniques de l’exploitant qui sont mobilisés. Il y a peu d’exercices qui prévoient la mobilisation des populations. Cela s’explique par le coût de tels exercices, qui supposent qu’on bloque des routes et les voies d’accès aux sites. C’est pourquoi les exercices de crise se déroulent essentiellement sur le site et en préfecture.
M. le président François Brottes. Ces exercices vous semblent-ils anxiogènes ou plutôt de nature à rassurer les populations ? Êtes-vous en train de nous expliquer que les maires ne sont pas suffisamment informés ?
M. Jean-Pierre Charre. En général, entre l’exploitant du site et les maires des communes concernés, l’information ne circule pas trop mal en cas d’incident. En revanche, la préfecture doit observer un devoir de réserve quant à la qualité des incidents. Je pense en particulier à ce qui s’est passé en 2011 sur le site de Marcoule, et qui a été abondamment médiatisé. Il faudrait que les services préfectoraux, voire l’Autorité de Sûreté nucléaire, l’ASN, et le ministère de l’intérieur communiquent davantage quand il y a un tel emballement médiatique. La préfecture devrait au moins confirmer les informations communiquées par l’exploitant, les élus communaux étant tenus d’attendre les consignes de la préfecture avant de déclencher un PCS ou de prévenir les populations.
M. Denis Baupin, rapporteur. Les CLI sont-elles suffisamment associées aux travaux du Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un accident nucléaire, le CODIRPA ?
Si j’ai bien compris le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les CLI devraient être associés à la déclinaison locale du Plan national : avez-vous été associés aux tests qui ont été effectués en 2012 ?
Selon vous, le législateur doit-il modifier le régime des PPI et avez-vous des propositions de modifications à nous faire, notamment en ce qui concerne leur périmètre, qui est aujourd’hui de dix kilomètres autour de la centrale, les modalités d’information, les règles de distribution des pastilles d’iode ? Votre exemple de la sirène semble indiquer qu’on doit s’interroger sur la crédibilité des mesures prévues. On peut ainsi se demander si les parents obéiront à la consigne de ne pas aller chercher leurs enfants dans les écoles.
Il existe par ailleurs des technologies de communication un peu plus performantes que les sirènes ! Ne pourrait-on pas, par exemple, rappeler à la population la conduite à suivre par SMS ?
Ma dernière question porte sur la gestion des risques quand les centrales sont situées à proximité des frontières. Nos auditions ont fait apparaître des différences significatives en matière de gestion des crises selon les pays. Une réflexion sur une gestion de crise transfrontalière a-t-elle été engagée avec les pays voisins et des voies d’amélioration sont-elles explorées, au moins en ce qui concerne le partage d’informations ? Quand on entend le président de l’ASN affirmer qu’il n’y a eu aucune homogénéisation des mesures nationales de gestion de crise depuis Tchernobyl, on est pour le moins « interpellé ». Ce sont là des questions qui ne sont pas que théoriques.
Mme Frédérique Massat. M. le président de l’ASN, que nous venons d’entendre, a émis le souhait d’une plus grande transparence en matière d’information du public. Comment vous-mêmes, qui êtes les acteurs principaux de cette information, pourriez-vous atteindre les populations qui ne vont pas jusqu’à vous ?
M. Michel Sordi. Quel est votre sentiment sur les intrusions de militants de Greenpeace dans les sites nucléaires ? Que pensez-vous du rôle des CLI en matière de transparence nucléaire ?
M. le président François Brottes. Les communes dotées d’un PCS disposent-elles toujours d’une réserve communale de sécurité civile – il s’agit de citoyens bénévoles qui concluent un « contrat d’engagement » avec le maire pour l’assister en cas de crise ou de catastrophe ?
M. Michel Demet. L’ANCCLI a récemment mis en place un groupe de travail consacré aux aspects transfrontaliers de la gestion de crise. Il s’est déjà réuni en début d’année et une deuxième réunion est prévue en juin. Sont notamment concernés les CLI de Gravelines, Cattenom, Chooz, Fessenheim.
En outre, le retour d’expérience des deux représentants de l’ANCCLI qui ont pu participer à l’exercice national de crise de Cattenom à titre d’observateur, a mis en évidence la différence entre les dispositifs français et allemand de gestion de crise post-accidentelle, notamment en ce qui concerne les règles de confinement.
Dans le cadre du groupe de travail, nous discutons également avec nos amis belges, que la proximité d’une centrale française contraint à prévoir des mesures de sécurité et des plans communaux de sauvegarde. La présence de représentants de pays limitrophes est par ailleurs envisagée.
Au niveau européen, l’ANCCLI appartient au Nuclear Transparency Watch, NTW, association qui comprend des ONG travaillant sur les mêmes thématiques que nous. Nous devons notamment évoquer, dans le cadre d’un prochain séminaire, les problématiques de l’emergency, notamment l’évacuation des populations.
M. Jean-Pierre Charre. L’ANCCLI a été dès l’origine associée aux travaux du CODIRPA, et elle prend une part active à tous les groupes de travail. Je pilote moi-même un groupe de travail consacré à la question de l’implication des acteurs locaux en cas d’accident nucléaire. Cette implication de l’ANCCLI constitue un progrès notable en matière d’information et de communication. Elle est surtout un moyen de faire participer la société civile aux questions liées à la gestion des risques post-accidentels.
Dans leur effort pour assurer une plus grande transparence de l’information, les CLI sont confrontées aux problèmes que rencontre toute vulgarisation des connaissances dans le domaine du nucléaire. Quand on communique sur le nucléaire, il faut le faire avec la plus grande prudence, tant le risque est grand de provoquer les effets contraires à ceux recherchés. Il faudrait qu’elles puissent être assistées dans cette mission par des spécialistes de la communication. D’ores et déjà, nous avons développé, en partenariat avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN, un Outil de sensibilisation aux enjeux post-accidentels à destination des acteurs Locaux, l’OPAL, outil informatique qui permet de visualiser les effets et les conséquences d’un accident nucléaire. Nous pensons que cet outil devrait être mis en place sur l’ensemble du territoire. Si cela n’est pas le cas, ce n’est pas par volonté de dissimuler quoi que ce soit : c’est tout simplement par manque des moyens propres à permettre à chaque CLI de communiquer avec la population autant qu’elle le devrait.
M. le président François Brottes. Le président de l’ASN a reconnu que les CLI les plus performantes étaient celles qui disposaient d’un permanent.
M. Jean-Pierre Charre. Exactement. Une structure fiable et pérenne d’information de la population suppose la présence de permanents, au minimum un spécialiste de la communication ou un chargé de mission, et donc des moyens financiers.
M. Alexis Calafat. La CLI de Golfech assure sa mission d’information largement au-delà du périmètre des dix kilomètres prévu par le PPI, puisque nous adressons la brochure que nous éditons en 60 000 exemplaires auprès des universités de Toulouse et de Bordeaux. Il reste que nous rencontrons des difficultés dans l’exercice de cette mission. Nous avons cependant été agréablement surpris de voir cent cinquante personnes assister à notre deuxième assemblée générale.
Je vous rassure, monsieur le rapporteur, nous disposons d’autres systèmes de communications que la sirène !
M. le président François Brottes. Les Parisiens sont convaincus qu’en province on ne connaît que la sirène !
M. Alexis Calafat. Nous bénéficions du système SARRPE, mis en place par EDF, et les élus locaux ont mis en place un dispositif similaire d’alerte des populations par téléphone, initialement mis en place pour prévenir des crises sanitaires. Un tel système a aussi des limites, puisqu’il ne nous permet pas d’atteindre plus de 50 % de la population.
S’agissant de la protection des enfants, population la plus exposée au risque nucléaire, dans le cadre d’un plan de gestion de crise, ma position n’a pas varié depuis des années : le seul moyen d’empêcher les parents de rallier le périmètre contaminé pour les récupérer serait que le PPI prévoie la mise en lieu sûr des enfants dès le début de l’alerte.
S’agissant des préfectures, je partage les observations de Jean-Pierre Charre. Il fut une époque où elles se montraient plus coopératives avec les communes. Depuis quelque temps elles ont pris l’habitude de nous mettre devant le fait accompli : cela a été le cas notamment lors de la dernière refonte des PPI, à laquelle nous n’avons pas été véritablement associés. Autant nos rapports avec EDF se sont améliorés, via notamment une convention d’échange d’informations, autant nous déplorons les réticences des services préfectoraux à communiquer. Cela dit, cela dépend beaucoup de la personnalité des préfets, certains étant plus que les autres enclins à favoriser la participation des élus.
M. Jean-Pierre Charre. Chacun s’accorde à reconnaître que le périmètre de dix kilomètres prévu par les PPI actuels est trop restreint. S’il peut être suffisant en cas d’incident ou d’accident mineur, il ne correspond pas à la réalité d’un accident d’importance moyenne. La communication et l’information des populations sur les risques devraient porter sur un périmètre plus large.
M. Michel Sordi. Pour assister régulièrement aux réunions d’information relatives à la centrale de Fessenheim, je peux vous dire qu’elles sont ouvertes très largement à nos voisins suisses et allemands, alors que la réciproque n’est pas vraie. Cela prouve que nous sommes beaucoup plus transparents que nos voisins.
M. Jean-Pierre Charre. La constitution de réserves communales est à la discrétion des élus. Il en existe très peu. À Marcoule, où nous avons eu la chance d’être sollicités par la préfecture pour la gestion des risques d’inondation, cela a très bien fonctionné. C’est un bon moyen d’information et de mobilisation de la population, à condition là encore qu’il y ait une volonté et une mobilisation suffisantes pour vaincre les obstacles administratifs.
M. le président François Brottes. Le maire peut en prendre l’initiative, sans être actionné par la préfecture.
M. Jean-Pierre Charre. L’ANCCLI ne peut que constater qu’il y a des intrusions de militants de Greenpeace dans une centrale nucléaire, nous ne pouvons que le constater. Connaissant tous les dispositifs de sécurité qui protègent le site de Marcoule, je m’étonne qu’on puisse aussi facilement pénétrer dans un site nucléaire.
M. Michel Demet. L’information ne suffira pas à elle seule à mobiliser les populations. Ce qu’il faut, c’est impliquer davantage la population dans les exercices de crise, via notamment des évacuations en temps réel. Il faut également revoir les modalités des campagnes de distribution de comprimés d’iode. Le mode de distribution actuel assure un taux de pénétration très insuffisant. Il vaudrait mieux laisser aux collectivités le choix du mode de distribution. Une distribution au porte-à-porte par des bénévoles, par exemple, assure un taux de pénétration de près de 95 % au bout de quelques semaines.
Audition de M. François Moisan, directeur exécutif scientifique Recherche et International de l’ADEME, et de M. Jacques Bittoun, président de l’ANCRE (Alliance nationale de coordination pour la recherche sur l'énergie)
(Séance du 17 avril 2014)
Des documents mis à la disposition de la commission d’enquête sont accessibles à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314049.pdf
M. le président François Brottes. Ces auditions portent sur la place du nucléaire dans le mix énergétique français. J’ai souhaité, et le rapporteur l’a accepté, que la commission d’enquête réfléchisse à l’évolution du mix électrique dans les années à venir, sujet qui est au cœur du débat sur la transition énergétique et des engagements du Président de la République.
Nous accueillons M. François Moisan, directeur exécutif scientifique Recherche et International de l’ADEME, M. Jacques Bittoun, président de l’Alliance nationale pour la coordination de la recherche sur l’énergie (ANCRE) et Mme Nathalie Alazard. L’ANCRE est une alliance d’organismes publics nationaux qui a pour mission de mieux coordonner les recherches sur l’énergie qu’ils mènent et de renforcer leur efficacité. Il est à noter que l’ADEME ne fait pas partie des partenaires de l’ANCRE et que le scénario de l’ANCRE, publié très récemment, n’a pas été passé au crible du débat national sur la transition énergétique.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. François Moisan, M. Jacques Bittoun et Mme Nathalie Alazard prêtent serment)
M. François Moisan, directeur exécutif scientifique Recherche et International de l’ADEME. L’ADEME n’est pas un opérateur de recherche mais une agence qui soutient la recherche. À ce titre, elle est associée aux travaux de l’ANCRE et participe au comité de coordination de cette dernière.
Les visions de l’ADEME sur la transition énergétique à l’horizon 2030 et 2050 ont été présentées lors du débat national bien qu’elles lui soient antérieures.
Le scénario à l’horizon 2030, sur lequel je me focaliserai aujourd’hui, est une extrapolation des tendances passées tenant compte d’inflexions assez volontaristes, mais réalistes, et permettant de s’inscrire, à l’horizon 2050, dans la trajectoire d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, le « facteur 4 ».
En revanche, la vision à l’horizon 2050 obéit à une logique différente puisqu’elle présuppose la réalisation du « facteur 4 ». Elle considère 2050 comme un horizon normatif, dont elle évalue le réalisme au regard d’hypothèses techniques et économiques.
S’agissant du mix électrique et de la place des énergies qui y concourent, nous nous sommes d’abord intéressés à l’évolution de la demande. Selon le niveau de la demande, la contribution des différentes énergies varie : si la demande est élevée, il est plus difficile d’atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables.
Dans notre scénario, la demande en énergie finale passe de 151 millions de tonnes d’équivalent pétrole en 2010 à 123 en 2030, soit une baisse de 18 %, puis à 82 en 2050, soit une baisse de 46 %. C’est sur la base de ces chiffres, complétés par des prévisions sur les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l’agriculture, que nous évaluons la réalisation du « facteur 4 » en 2050.
M. le président François Brottes. À ce stade, il serait bon que vous rappeliez la définition de l’énergie primaire et celle de l’énergie finale.
M. François Moisan. L’énergie finale est l’énergie livrée aux consommateurs, qu’ils soient particuliers ou industriels. Pour produire cette énergie, il a fallu au préalable transformer des énergies primaires, qui peuvent être importées ou produites sur le territoire national. La différence entre énergie primaire et énergie finale tient à la consommation d’énergie liée à cette transformation.
La trajectoire de réduction par deux de la consommation d’énergie repose sur deux secteurs : le bâtiment et les transports.
Dans le premier, nous supposons une amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Elle passe par une performance accrue des bâtiments neufs rendue possible par l’obligation faite à ces derniers à compter de 2022 d’être des bâtiments à énergie positive. Mais les bâtiments neufs ne représentent qu’une faible part du parc en 2050 dont les deux tiers sont d’ores et déjà construits. En complément, un programme ambitieux de réhabilitation des logements – 500 000 logements par an –, qui a déjà été annoncé, doit donc permettre d’améliorer le stock existant. La réussite de ce programme demande des technologies de rénovation, l’accès au financement pour les ménages, et de la formation. Mais l’objectif nous semble réaliste. En matière de logement, la demande passerait ainsi de 44 millions de tonnes d’équivalent pétrole en 2010 à 21 en 2050 et 32 en 2030, sans baisse du confort et de la température de chauffage. En outre, cet effort de performance énergétique se traduit par la création d’emplois non délocalisables.
Dans le second secteur, plusieurs pistes permettent d’atteindre l’objectif d’une diminution de la consommation d’énergie : premièrement, l’amélioration des véhicules thermiques ou hybrides, à tout le moins de la chaîne thermique des véhicules, d’une part et le développement du véhicule électrique, d’autre part, deux domaines dans lesquels les progrès des constructeurs français sont encourageants. Dans notre vision, la part du véhicule électrique reste limitée : elle ne représente que 4 % du parc en 2030 pour devenir plus importante en 2050.
D’une manière générale, notre scénario n’est bâti sur aucune rupture technologique, quel que soit le secteur. Il ne tient pas compte des technologies dont la commercialisation n’est pas proche : nous n’avons ainsi pas envisagé, bien que nous soutenions les recherches dans ce domaine, le captage et le stockage du CO2 ou encore l’utilisation de l’hydrogène.
Pour en revenir au secteur des transports, nous parions également sur le déploiement des nouveaux services de mobilité. Alors qu’ils n’étaient pas pris au sérieux il y a quelques années, nous constatons que ces services – le covoiturage, l’autopartage – rencontrent un succès certain auprès des consommateurs pour des raisons pratiques et de coût. La France est très en avance dans ce domaine, avec des entreprises comme Bolloré ou BlaBlaCar, première société de covoiturage à l’échelle européenne. Nous avons donc imaginé que ces services représenteraient en 2050 une part significative. Les véhicules adaptés à l’usage urbain permettent de réduire considérablement les consommations : une voiture en libre-service consomme 7 kilowattheures aux cent kilomètres contre 30 pour une berline électrifiée.
En revanche, nous n’attendons pas de gains très importants dans le secteur industriel. Nous avons identifié des gisements d’économies d’énergie grâce à l’optimisation des procédés industriels mais nous ne prévoyons pas de réduction de la part des industries grosses consommatrices d’énergie ou des industries manufacturières dans la valeur ajoutée.
Je précise que cet exercice est fondé sur l’hypothèse d’un taux de croissance de 1,7 % par an, retenue par le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Ce choix nous permet de démontrer qu’il est possible d’atteindre l’objectif du « facteur 4 » sans recourir à la décroissance.
Pour l’agriculture, nous avons supposé que les pratiques agricoles permettaient de réduire les émissions des autres gaz à effet de serre sans pour autant atteindre le « facteur 4 ».
J’ai omis de dire que la consommation d’électricité finale passe de 37,7 millions de tonnes d’équivalent pétrole en 2010 à 32,4 en 2030, soit une réduction de 14 % quand la consommation globale d’énergie diminue de 18,5 %. L’électricité voit donc sa part relative augmenter, notamment dans le secteur des transports et du tertiaire.
Nous avons évalué le concours des énergies renouvelables à la production d’électricité décarbonée. En 2030, le mix électrique est composé de la manière suivante : l’éolien représente 7,2 millions de tonnes d’équivalent pétrole, dont 34 gigawatts d’éolien terrestre et 12 d’éolien offshore ; le photovoltaïque, 33 gigawatts dont 8 à 10 pour l’exploitation décentralisée – sur le toit de petits bâtiments – et 23 à 25 pour l’exploitation centralisée – une partie sur les toits de surfaces commerciales et une partie limitée de centrales au sol, 12 gigawatts ; l’hydraulique produit 38 térawattheures au fil de l’eau, grâce à une amélioration des performances des sites existants, et 7 gigawatts pour le stockage, contre 5,4 actuellement, sans envisager un stockage massif supplémentaire ; la contribution des énergies marines et de la biomasse est très faible – nous pensons que la production d’électricité n’est pas la meilleure utilisation de la biomasse. Enfin, 1,7 million de tonnes d’équivalent pétrole de gaz complète ce mix.
Quant à la part du nucléaire, nous avons retenu le chiffre de 50 %, conformément à l’objectif affiché pour 2025, sans nous prononcer sur le devenir du parc, prolongation ou renouvellement.
Notre analyse des besoins en matière de flexibilité nous conduit à envisager une part de 30 % d’électricité renouvelable variable dans le mix électrique en 2030, limite au-delà de laquelle un stockage plus important est nécessaire.
S’agissant des moyens flexibles, nous prévoyons en 2030, 7 gigawatts de stations de pompage et 3 gigawatts de capacité d’effacement, ce qui correspond aux projections de Réseau de transport d’électricité (RTE) pour 2016. Le développement des réseaux électriques intelligents pourrait néanmoins permettre d’aller plus loin en matière d’effacement. Enfin, nous avons évalué les interconnexions à 21 gigawatts, conformément à l’hypothèse de RTE. Nous n’avons donc pas subordonné la part d’électricité variable à des importations au-delà de cette prévision.
Pour 2050, nous avons évalué le niveau de la demande mais nous n’avons pas précisé le mix électrique. Nous avons essayé de déterminer la contribution des énergies renouvelables à l’ensemble du mix énergétique. S’agissant des biocarburants, nous sommes très mesurés compte tenu des surfaces disponibles entre 2030 et 2050. Nous avons estimé la part exploitable en 2050 des gisements éolien et photovoltaïque, les deux énergies renouvelables qui pourraient jouer le rôle le plus important à cet horizon, mais nous n’avons pas fixé la part du nucléaire.
Au-delà de cet exercice technico-économique, nous avons réalisé une analyse macroéconomique pour évaluer l’impact sur les grands agrégats des scénarios. Nous avons travaillé avec l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et un laboratoire de Sciences-Po qui a développé un modèle d’équilibre général, appelé ThreeME. À la différence des visions que je viens de présenter, nous nous appuyons là sur un scénario de référence, en l’occurrence celui élaboré par la direction générale de l’énergie et du climat qui prévoit une stabilité des parts des différentes énergies dans le mix et une relative croissance de la consommation. Nous émettons trois hypothèses sur le mix de 2050 : dans la première, la part du nucléaire demeure à 50 % ; dans la deuxième, en maximisant la contribution des énergies renouvelables pour atteindre une part de 70 %, le nucléaire représentant 18 % ; dans la troisième, la part du nucléaire s’établit à 25 %.
L’évaluation macroéconomique montre, par rapport au scénario de référence, une croissance du PIB légèrement supérieure, à l’horizon 2030, de l’ordre de 1,7, soit une année de croissance supplémentaire, et à l’horizon 2050, de 2,5. On est loin de la décroissance…
En outre, des emplois supplémentaires sont créés, environ 300 000 en 2030 et entre 650 000 et 850 000 en 2050, qui proviennent du secteur du bâtiment et de la production d’énergies renouvelables.
Enfin, le budget des ménages croît de manière importante puisqu’il est multiplié par 1,5 d’ici à 2050. Malgré la facture énergétique et la dette contractée pour financer la rénovation du logement, le revenu disponible progresse.
Le commerce extérieur est moins performant en début de période mais dès que les industries françaises sont installées sur les marchés de la transition énergétique, le solde redevient largement positif par rapport au scénario de référence.
M. le président François Brottes. Avez-vous réfléchi aux moyens de financer les scénarios ? La question de savoir qui paie reste posée et nous préoccupe.
Le gaz de schiste n’existe pas en France à ce jour. Mais doit-il pour autant être exclu des scénarios sur l’évolution du mix électrique ?
Votre réflexion considère-t-elle la France comme un pays aux frontières étanches ou prend-elle en compte les importations ?
M. François Moisan. L’évaluation macroéconomique tient compte des financements nécessaires pour parvenir à la transition énergétique. En revanche, nous n’avons pas détaillé les mécanismes qui devront être mis en place pour déclencher les investissements. Cela ne relève pas de la compétence de l’ADEME. Nous savons que la rénovation représente un coût de 20 000 à 30 000 euros par maison, qui est très important pour les ménages non solvables, alors que les dispositifs actuels s’adressent à des ménages avec un certain niveau de revenu. L’ADEME essaie de contribuer à la réussite du plan de rénovation des logements et travaille avec d’autres acteurs sur les mécanismes de financement et d’incitation.
Quant aux gaz de schiste, notre scénario ne s’intéresse pas à la provenance du gaz. Le réseau de gaz se décarbonise à l’horizon 2030 et beaucoup plus à l’horizon 2050 : à cette échéance, 47 % du gaz est d’origine renouvelable, notamment du biogaz ou de la méthanation – nous ne sommes pas les seuls à parier sur une forte pénétration du biogaz puisque les projections de GDRF retiennent également cette option. En revanche, nous n’avons pas différencié gaz naturel ou gaz de schiste. L’exercice consiste pour nous à décarboniser le mix énergétique par la réduction de la demande et le recours à des énergies moins carbonées. Or, nous ne disposons pas à ce jour de bilan carbone de l’exploitation des gaz de schiste en comparaison du gaz naturel.
Notre scénario reprend, pour l’importation ou l’exportation d’énergie électrique variable, les capacités d’interconnexions sur lesquelles s’appuie RTE. Il est souhaitable d’augmenter ces capacités afin de valoriser l’ensemble des productions au niveau européen. Mais nous n’avons pas émis d’hypothèses dépassant ces capacités, qui ne sont pas nécessairement liées à des frontières politiques mais plutôt à des frontières géographiques et physiques de capacité du réseau. En 2030, il n’y a pas de contrainte sur le volume de production d’électricité variable. Nous collaborons avec notre homologue allemand, DENA (Deustche Energie-Agentur), pour étudier ce sujet de l’échange de production électrique variable.
M. Jacques Bittoun, président de l’ANCRE. Je suis accompagné de Mme Natahalie Alazard, géologue et économiste, qui a été co-responsable de la rédaction des scénarios.
En préambule, je souhaite rappeler que l’ANCRE est une alliance, dépourvue d’administration et de crédits, à la différence d’une agence. L’Alliance rassemble des partenaires liés par une convention afin d’évoquer ensemble un sujet qui constitue leur mission commune, en l’occurrence, la recherche sur l’énergie. Quatre partenaires sont membres fondateurs : le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’Institut français du pétrole Energies nouvelles, qui tous deux s’intéressent exclusivement à l’énergie, mais aussi le CNRS qui mène des recherches généralistes et la Conférence des présidents d’université. Font également partie de l’ANCRE quinze organismes travaillant, parmi d’autres thèmes, sur celui de l’énergie : l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), etc.
L’ANCRE réunit donc 19 organismes de recherche publics représentant près de 400 experts afin de définir une stratégie nationale de recherche et de participer au débat national sur la transition énergétique.
Sur le plan méthodologique, face à la multitude de paramètres existants, les scénarios mesurent la variation de certains paramètres au regard de paramètres pré-définis. Nous avons bâti des scénarios contrastés qui s’appuient sur des trajectoires ambitieuses. Les hypothèses sur lesquelles ils reposent sont de nature scientifique et technologique mais aussi économique, industrielle, sociétale, environnementale ainsi que du domaine de la recherche et développement (R&D).
Les postulats correspondent à la feuille de route fixée par le débat national sur la transition énergétique : une division par quatre à l’horizon 2050 des émissions de gaz à effet de serre, une part de la production d’électricité nucléaire limitée à 50 % conformément à l’objectif affiché par le Président de la République, un recours accru aux énergies renouvelables, une sobriété et une efficacité énergétique plus grandes.
Trois scénarios ont été établis : le premier insiste sur la sobriété énergétique, en mettant en avant l’efficacité énergétique et les changements comportementaux ; le deuxième mise sur un usage accru de l’électricité pour réduire les émissions de gaz ; le troisième parie sur un développement cohérent de vecteurs diversifiés, associant la biomasse, la valorisation et l’utilisation de la chaleur fatale – la chaleur perdue dans les centrales.
Contrairement aux scénarios de l’ADEME, nous prenons pour hypothèse des ruptures technologiques. Nos scénarios nécessitent la levée de plusieurs verrous technologiques ou comportementaux qui ont fait l’objet d’un rapport distinct.
Le scénario sur les vecteurs diversifiés a été retenu par le groupe de travail des experts du débat national sur la transition énergétique pour illustrer l’une des quatre trajectoires qu’il a retenues.
À ces trois scénarios s’ajoute une variante, prenant en compte l’insuffisance des énergies renouvelables en raison de leur caractère intermittent, dans laquelle une partie du nucléaire est remplacée par du gaz. Afin d’éviter la remontée des gaz à effet de serre que cette solution provoque, nous proposons une autre variante dans laquelle la contrainte sur le nucléaire est relâchée.
L’étude de l’ANCRE a été publiée en janvier et fera l’objet d’un séminaire le 29 avril. Elle est complétée par une première évaluation multicritères selon une grille d’analyse prédéfinie. Elle doit évidemment être mise à jour en permanence et approfondie.
En conclusion, je souhaite souligner les caractéristiques communes aux différents scénarios : les hypothèses sur lesquelles l’étude est fondée sont précisément explicitées, ce qui n’est pas toujours le cas ; la coopération des experts au sein de l’ANCRE permet de couvrir un champ de compétences bien plus large que ce qu’aucune organisation pourrait à elle seule réaliser ; le respect des objectifs impose un déploiement massif des meilleures technologies dont certaines exigent une rupture, ce que des organismes de recherche ne peuvent que souhaiter. Les modèles économiques donnent de premières évaluations mais ils présentent encore beaucoup d’incertitudes, limitant d’autant la possibilité de s’y référer pour arrêter une planification au titre de la transition énergétique – dont l’objectif principal est la réduction de l’impact climatique et environnemental dans des conditions économiques viables et en limitant notre dépendance aux importations.
M. le président François Brottes. Contrairement à l’ADEME, vous n’avez guère prononcé les mots d’économies d’énergie.
M. Jacques Bittoun. Le scénario qui insiste sur la sobriété énergétique répond pleinement à cette préoccupation.
Mme Nathalie Alazard, membre du groupe programmatique prospective énergétique de l'ANCRE. Comme Jacques Bittoun l’a dit, nous avons travaillé sur des scénarios très contrastés. Notre objectif n’était pas de trouver le scénario optimal.
Les experts se sont d’abord intéressés à la demande en faisant appel aux groupes programmatiques de l’ANCRE qui travaillent sur les technologies liées à la demande par secteur – bâtiment, transport, industrie. Ils ont analysé les évolutions de ces secteurs sur la base d’hypothèses moyennes de croissance économique et démographique communes. Comme l’ADEME, nous avons retenu le chiffre de 1,7 % pour la croissance du PIB – très discutable, j’en conviens – et de 73 millions d’habitants à l’horizon 2050.
Ensuite, les experts ont évalué les gains possibles grâce à des efforts de sobriété et d’efficacité énergétique, soutenus par les performances des technologies. Ils se sont interrogés sur ce qu’on pouvait attendre du progrès technique selon le degré de maturité des différentes technologies.
Puis, le travail s’est porté sur l’offre d’énergie nécessaire pour répondre à la demande en favorisant au maximum les énergies renouvelables et en recherchant des gains de performance pour ces dernières.
À l’issue de ces études, le groupe de travail qui coordonnait l’ensemble des scénarios a évalué si les objectifs fixés – « facteur 4 » et 50 % de nucléaire – pouvaient être atteints et, selon les résultats, revoyaient les hypothèses avec les différents groupes programmatiques afin d’être au plus près de l’objectif.
Malgré le caractère très volontariste des scénarios en termes de changements techniques et de modification des comportements, nous avons néanmoins veillé à vérifier leur cohérence et leur réalisme, quant au rythme notamment. Le constat est néanmoins celui d’une accélération des rythmes dans tous les domaines.
Le premier scénario – sobriété renforcée – repose sur une décarbonisation du mix électrique qui passe par une efficacité énergétique poussée, une sobriété énergétique renforcée, donc une modification des comportements de consommation d’énergie et un développement des énergies renouvelables.
Illustration de ce scénario, dans le secteur résidentiel tertiaire, un effort très important de rénovation du parc est accompli : le rythme est multiplié par quatre par rapport au rythme actuel et les rénovations sont profondes de manière à dégager un gain de 70 % d’énergie.
M. le président François Brottes. Avez-vous trouvé les moyens pour les financer ?
Mme Nathalie Alazard. Le mécanisme de financement est une question légitime sur laquelle nous n’avons néanmoins pas travaillé.
Dans ce même scénario, nous avons envisagé des modifications des modes de vie qui contribuent à abaisser la consommation d’énergie : dans le résidentiel, l’arrêt de l’augmentation du nombre de mètres carrés par habitant ou une part plus importante de l’habitat collectif ; dans le domaine des transports, la baisse de la mobilité individuelle d’environ 20 % au profit des déplacements doux ou d’une autre organisation de la vie quotidienne.
M. Denis Baupin, rapporteur. Vous ne pouvez pas parler d’une baisse de la mobilité si elle est compensée par le recours aux déplacements doux. Vous pensez plutôt à une baisse de la mobilité motorisée ?
Mme Nathalie Alazard. Nous envisageons une diminution à la fois de la mobilité globale et de la mobilité motorisée. Nous comptons aussi sur un développement des modes de transport alternatifs à la voiture. Le rapport à la voiture se modifie également, avec le développement de flottes servicielles et de l’autopartage. Ces différents éléments concourent à une division par deux du nombre de véhicules. Ce scénario repose donc sur une évolution très poussée des comportements.
Le deuxième scénario – décarbonation par l’électricité – s’appuie également sur une efficacité énergétique accrue – cette donnée est incontournable pour atteindre l’objectif – mais aussi sur la diffusion du vecteur électrique dans tous les usages – mobilité, chauffage, procédés industriels. L’électricité est produite par des sources décarbonées : énergies renouvelables et nucléaire.
Illustration de ce scénario, dans le bâtiment, le rythme de rénovation est soutenu sans atteindre celui du premier scénario ; le parc rénové consomme 50 à 60 % d’énergie en moins ; on constate un effet rebond puisque, après rénovation, on se chauffe un peu plus. Dans le transport, les tendances actuelles sont maintenues sans augmentation mais tout l’effort repose sur une électrification des véhicules et plus généralement des modes de transport. En 2030, 65 % des véhicules vendus sont des véhicules électrifiés : hybrides rechargeables ou véhicules électriques.
Enfin, le troisième scénario – vecteurs diversifiés – mise sur une efficacité énergétique poussée et l’apparition de nouveaux vecteurs au sein du système énergétique grâce au développement de systèmes locaux, à une forte incorporation des bioénergies, sous forme liquide ou gazeuse, ainsi qu’à une forte valorisation des sources de chaleur basse température, notamment la chaleur des centrales.
Illustration de ce scénario, dans le bâtiment, les modalités de la rénovation sont les mêmes que dans le deuxième scénario mais les technologies alternatives à l’électricité sont privilégiées – solaire, réseau de chaleur, géothermie. Dans le transport, la baisse de la consommation de carburants fossiles est compensée par une hausse accélérée de l’efficacité énergétique des véhicules et le développement de carburants issus de la biomasse. Dans ce scénario, la part des biocarburants de première génération n’augmente pas, contrairement aux biocarburants issus de la biomasse lignocellulosique. Le développement des véhicules électriques est plus faible que dans les scénarios précédents.
Pour chacun de ces scénarios, la réalisation du « facteur 4 » nécessite l’avènement de ruptures technologiques – technologies mal identifiées ou dont l’acceptation peut poser problème. Dans le premier scénario, il faut faire appel au captage, au stockage ou à la valorisation du CO2 ainsi qu’au développement de solutions d’effacement pour la gestion du réseau électrique. Dans le deuxième scénario, des stockages massifs d’électricité sont nécessaires afin de gérer la variabilité saisonnière et de tirer le meilleur parti des énergies renouvelables. Dans le troisième scénario, l’exploitation de la chaleur basse température suppose des systèmes de cogénération nucléaire.
Concernant la production d’énergie, la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2030 est proche de 50 % et continue à diminuer jusqu’en 2050. La consommation d’électricité dans le premier scénario reste stable et dans le second, augmente de 30 %. Mais dans tous les cas, la capacité électrique installée double.
Dans la seconde partie de l’année 2013, nous avons travaillé à l’évaluation de ces scénarios selon des critères divers. Ce travail très lourd n’est pas achevé. Nous disposons de quelques chiffres qui figurent dans le rapport, notamment sur les investissements nécessaires dans les différents secteurs.
Je terminerai en vous faisant part des principaux enseignements que l’ANCRE a tirés de cet exercice. Les scénarios envisagés nécessitent une accélération des rythmes d’innovation et de diffusion de celle-ci ainsi qu’une inflexion, voire une inversion, des tendances de l’évolution des comportements.
Cet exercice, à cet égard très utile pour les équipes R&D de l’ANCRE, a également permis de mettre en évidence les grands invariants en termes d’innovations technologiques. Il montre également que certaines technologies de rupture permettent d’atteindre plus rapidement les objectifs.
Enfin, il nous est apparu évident pour la suite de nos travaux que l’apport des sciences humaines et sociales est indispensable pour une meilleure compréhension des comportements, pour la prise en compte de ce facteur comportemental dans les travaux sur les technologies au service de la transition énergétique, pour l’identification des systèmes de gouvernance favorables à la mise en place de certaines de ces technologies ainsi que pour la conception de nouveaux modèles d’affaires.
M. le président François Brottes. Je suis très sensible à cette question des modèles d’affaires parce que nous sommes aujourd’hui dépourvus de modèle économique pour de nombreux chantiers nouveaux et de nouveaux opérateurs. Avez-vous un document sur ce sujet ?
Mme Nathalie Alazard. Non, nous avons organisé un séminaire dans le cadre d’un groupe programmatique de l’ANCRE afin d’amorcer la réflexion avec les industriels sur cette question.
M. le président François Brottes. Le stockage n’a pas trouvé son modèle d’affaires alors que l’urgence l’impose.
M. le rapporteur. Je n’ai pas découvert les différents scénarios puisqu’ils ont été présentés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Ils ont le mérite de faire des projections et d’analyser les moyens d’atteindre les différents objectifs fixés, qui devraient trouver une traduction dans la loi sur la transition énergétique : la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre – alors que le dernier rapport du GIEC dresse un constat alarmant, personne ne peut plus en nier la nécessité – et le passage à 50 % de nucléaire en 2025, auquel j’ajoute l’objectif fixé par le Président de la République lors de la conférence environnementale d’une division par deux de la consommation énergétique à l’horizon 2050. Cet objectif est atteint par le scénario de l’ADEME – 48 % – et dans une moindre mesure par le scénario sur la sobriété de l’ANCRE – 41 %.
La comparaison entre vos études est rendue difficile par le fait que les horizons sont différents, l’ADEME privilégiant 2030 et l’ANCRE 2050, ce qui n’est pas sans conséquence au regard des évolutions technologiques. On peut en effet se permettre à l’horizon 2050 des ruptures technologiques beaucoup plus importantes.
Pouvez-vous confirmer que le choix d’une hypothèse de croissance du PIB de 1,7 % rend plus difficile la réalisation des objectifs ? En d’autres termes, une croissance plus faible faciliterait celle-ci ? Une croissance économique plus faible rend d’autant plus nécessaire le développement d’activités économiques créatrices d’emplois. Or l’ADEME a démontré les effets positifs de la transition énergétique en termes d’emplois tandis que l’ANCRE ne se prononce pas clairement, faute de temps semble-t-il. Cela renforce la nécessité de s’engager dans la transition énergétique.
M. le président François Brottes. Sous réserve de trouver les financements évidemment…
M. le rapporteur. Cette question clé n’est pas en effet traitée dans les études. Celles-ci ne se prononcent pas sur les modalités de réalisation de leurs scénarios.
M. le président François Brottes. …qui sont pourtant le problème du législateur !
M. le rapporteur. Cela ne m’a pas échappé. J’essaie néanmoins de ne pas interroger nos interlocuteurs sur des sujets sur lesquels ils n’ont pas travaillé.
S’agissant des 650 000 logements rénovés par an, je suppose que ce chiffre est une moyenne jusqu’à l’échéance. On peut en effet espérer un effet d’apprentissage et de montée en charge pour atteindre cet objectif. Malgré tout, est-il réaliste ?
Grâce aux 70 milliards d’euros par an que nous dépensons pour importer des énergies fossiles, le Qatar rachète par petits morceaux la France et la Russie achète l’Ukraine. Je considère que ce constat nous impose de revoir notre modèle économique afin de le rendre plus incitatif pour économiser de l’énergie, créer des emplois et conserver l’argent en France. Cela ne dit pas pour autant, j’en conviens, comment procéder.
L’épargne des Français comme les flux financiers représentent des montants très largement supérieurs aux besoins de financement de la transition énergétique. La question est de savoir comment rendre suffisamment attractif les placements afin de flécher l’argent dans cette direction.
Les propos sur l’évolution des comportements ne doivent pas laisser penser que l’on va restreindre la capacité des personnes à se déplacer. C’est la raison pour laquelle je vous ai interrompu au sujet de la mobilité motorisée. Ce n’est pas parce qu’il y a moins de véhicules que l’on se déplace moins dès lors qu’on est plus nombreux par véhicule.
Or, le rapport que j’ai présenté récemment pour l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le véhicule écologique, montre que l’évolution comportementale que traduit l’utilisation des véhicules partagés est très significative, notamment dans les jeunes générations. Si cette évolution se confirme, elle peut modifier durablement le rapport au véhicule automobile sans qu’il soit le résultat d’une décision imposée d’en haut.
M. Jacques Bittoun. Vous dites que l’ANCRE n’a pas tenu compte des créations d’emplois. Il me semble que nous sommes parmi les mieux placés pour apporter des perspectives dans ce domaine : les innovations et les nouvelles technologies qui sont le cœur des recherches menées par les partenaires de l’ANCRE seront à l’origine des nouveaux emplois.
M. le rapporteur. Mon intention n’était pas d’être insultant à l’égard de l’ANCRE. Il est écrit dans votre rapport que vous n’avez pas eu le temps de soumettre ces scénarios à des modèles macro-économiques permettant de les évaluer. Or, d’autres scénarios ont été passés au crible de ces modèles, sur la pertinence desquels on peut par ailleurs s’interroger compte tenu des horizons auxquels ils s’appliquent.
Mme Nathalie Alazard. Les effets en matière d’emplois directs et indirects par secteur ont été mesurés. Mais l’évaluation macro-économique – l’effet d’une énergie plus chère sur le reste de l’activité économique par exemple – n’a pas été faite.
M. François Moisan. Je précise que nos scénarios, pour 2030 comme 2050, ne prennent pas en compte les ruptures technologiques. Cela ne signifie pas que nous ne croyons pas à l’avènement de ruptures technologiques – l’ADEME soutient fortement l’innovation à travers les investissements d’avenir pour lesquels elle a déjà engagé plus de un milliard d’euros auprès d’entreprises françaises. Mais nous nous situons dans un exercice de prospective et non de prévision. Nous avons voulu montrer comment atteindre le « facteur 4 » avec le minimum d’incertitudes.
Ainsi, nous n’avons pas imaginé que les biocarburants de seconde génération, que nous soutenons, permettront à ce stade de développer un potentiel de carburants liquides plus important que les 3 millions de tonnes prévues pour 2030 parce que les surfaces ne seront pas nécessairement disponibles. Il en va de même pour le captage et le stockage de CO2 : des expérimentations sont en cours mais leur mise en œuvre nous semble difficile. En revanche, si ces innovations devaient percer, elles permettront d’accroître la marge de manœuvre.
Le problème du financement se pose principalement pour le résidentiel et les ménages. Les ménages investissent 30 milliards d’euros par an pour des travaux dans leur logement mais ces derniers ne sont pas orientés vers l’efficacité énergétique. Des outils et des incitations seraient nécessaires pour affecter ces sommes à l’efficacité énergétique. C’est un enjeu essentiel. En 2030, tous les logements n’auront pas été réhabilités au rythme actuel. Il faut prendre en considération l’ensemble de la période pour y parvenir.
S’agissant des transports, les gains attendus grâce aux nouveaux services de mobilité concernent principalement la période 2030-2050.
Quant aux modèles d’affaires des nouvelles activités, monsieur le président, vous avez évoqué le stockage. Mais dans les réseaux électriques intelligents, plusieurs modèles d’affaires sont possibles. Les démonstrateurs cherchent à identifier le modèle qui produira de la valeur ajoutée. Cela est vrai également pour l’agrégation des effacements. La France est dans ce domaine, avec 14 démonstrateurs, très en avance. Sur la mobilité, les modèles se cherchent encore. L’identification des modèles donnera de la flexibilité supplémentaire.
Dernier point sur les comportements, une récente conférence posait la question de savoir s’il est plus difficile de modifier les technologies ou les comportements. L’exemple de la mobilité servicielle montre que les deux se conjuguent : à Paris, on n’a pas modifié les comportements de manière volontariste mais l’offre technique a rencontré la demande des usagers car elle était plus pratique et moins coûteuse. Je suis donc mal à l’aise avec l’idée de modifier les comportements.
M. le président François Brottes. Avez-vous l’intention d’actualiser vos réflexions ? Les modèles d’affaires sont, il est vrai, liés aussi aux décisions de la puissance publique. Le déploiement d’un réseau de bornes de recharge électrique peut changer l’attitude du consommateur à l’égard du véhicule électrique et ainsi aboutir à une évolution plus significative que celle que vous prévoyez. Cela doit nous amener à revisiter souvent les modèles.
M. François Moisan. Nous avons plusieurs exercices en cours : en premier lieu, un bilan par grandes thématiques technologiques des expérimentations menées dans le cadre des investissements d’avenir. J’espère qu’ils contribueront davantage à conforter qu’à revoir nos hypothèses ; en deuxième lieu, un projet qui décrit la vie des Français en 2050 au travers de huit familles afin de s’assurer que nos scénarios ne sont pas source de contraintes pour les modes de vie ; en dernier lieu, une réflexion sur la consommation puisqu’une partie des émissions de gaz à effet de serre est le fait des produits que nous consommons et qui sont pour partie importés. Actuellement, la moitié de l’énergie que nous consommons est de l’énergie directe ; en 2050, celle-ci ne représenterait plus que 20 %, le reste serait consommé par le biais des produits.
Mme Frédérique Massat. Je souhaite revenir sur l’énergie hydraulique qui représente aujourd’hui près de 13 % de l’énergie. D’après ce que je comprends, non sans inquiétude, vos projections font état d’une production de 38 térawattheures au fil de l’eau, alors qu’elle est aujourd’hui de 68 térawattheures et de 7 gigawatts grâce à la modernisation des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). Vous ne prévoyez donc pas d’augmentation de la production par des ressources nouvelles – par la création de barrages – alors que cette énergie est aujourd’hui la seule énergie stockable. Enfin, avez-vous pris en compte dans votre réflexion l’évolution des réseaux de transport et de distribution qui sont des paramètres majeurs des évolutions énergétiques à venir ?
M. François Moisan. Rassurez-vous, nous avons distingué dans le mix électrique de 2030, pour l’hydraulique, le fil de l’eau et la flexibilité. Les 70 térawattheures sont répartis entre ces deux catégories. Nous supposons une amélioration de la performance des barrages et des stations de pompage. En revanche, nous ne prévoyons pas de nouveaux barrages. Nous ne diminuons pas la production d’énergie hydraulique mais nous la décomposons. Cela permet d’évaluer la flexibilité qui pourrait être apportée au mix électrique par les énergies variables comme l’éolien et le photovoltaïque. Nous envisageons la création d’une ou deux STEP.
M. le président François Brottes. Une ou deux ? Où les installe-t-on ?
M. François Moisan. Je dois vérifier les chiffres. Mais nous misons d’abord sur l’amélioration des STEP actuelles. La question de l’emplacement des STEP se pose.
M. Jacques Bittoun. Les deux précédents présidents de l’ANCRE ont mis en place dix groupes programmatiques parmi lesquels cinq portent sur les sources d’énergie, trois sur l’efficacité et deux sont transversaux, le premier sur les réseaux électriques et le second sur les aspects économiques et de prospective. C’est ce dernier qui a conduit la coordination sur les scénarios et qui poursuit ses travaux.
M. le président François Brottes. Je vous remercie. Sachez que le Parlement est très demandeur de vos réflexions sur les modèles d’affaires. J’ai le sentiment que nous avons mis beaucoup d’intelligence et de compétences à réfléchir à différents scénarios mais nous manquons cruellement, à quelques semaines du débat parlementaire sur la transition énergétique, de propositions sur les modèles économiques. Tirer des plans sur la comète à cinquante ans ne nous renseigne pas sur la manière d’amorcer les choses au premier jour. Si vous pouvez aider la réflexion sur ce point qui est crucial pour nous et pour la France…
Audition de M. Robert Durdilly, président de l’UFE (Union française de l'électricité), et de M. Thierry Salomon, président de l'association négaWatt
(Séance du 17 avril 2014)
Des documents mis à la disposition de la commission d’enquête sont accessibles à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314050.pdf
M. le président François Brottes. Pour évoquer la place du nucléaire dans l’écosystème énergétique, nous avons choisi d’inviter ensemble des acteurs qui ne partagent pas le même point de vue.
Ainsi l’Union française de l’électricité (UFE), représentée aujourd’hui par son président M. Robert Durdilly, a-t-elle publié de nombreuses études dont, à l’automne 2013, une contribution à la réflexion sur la politique énergétique de la France à l’horizon 2050. L’UFE met l’accent sur la politique de décarbonation, sans exclure le nucléaire, ainsi que sur la nécessité de préserver la compétitivité et la sécurité des approvisionnements. Elle s’intéresse, en outre, depuis peu à l’effacement.
De son côté, l’association négaWatt, représentée par son président, M. Thierry Salomon, propose une vision plus radicale qui repose sur un système presque totalement décarboné, conjugué à une sortie du nucléaire.
Je dois admettre que négaWatt a été parmi les premiers à bâtir un scénario pour la transition énergétique. Mais, pas plus que l’ANCRE ou l’ADEME, l’association n’apporte de réponses sur le coût et le financement de la transition énergétique, considérant qu’elles relèvent des politiques.
Quant aux modèles économiques des activités liées à la transition énergétique, ils suscitent encore des interrogations nombreuses. Or, plus que jamais, ces chantiers sont devant nous.
Nous sommes impatients de vous entendre, messieurs, et de confronter utilement vos visions pour aboutir à un scénario cohérent qui reste à écrire. La prospective est un exercice difficile dont nous ne sommes pas coutumiers. Essayons ensemble de trouver une voie utile.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Robert Durdilly et Thierry Salomon prêtent serment)
M. Robert Durdilly, président de l’Union française de l’électricité (UFE). L’UFE mène une réflexion de fond pour éclairer les décisions politiques. Afin d’évaluer l’impact de la transition énergétique sur le système électrique, les coûts de l’énergie, le bilan carbone et la balance commerciale, elle propose des scénarios contrastés sur le mix énergétique.
Je commencerai en abordant les grands enjeux et les objectifs de la transition énergétique avant d’évoquer la place du nucléaire dans le mix électrique au regard de ce nouveau paysage énergétique.
En matière de transition énergétique, l’objectif majeur est la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. A cet égard, le nouveau rapport du GIEC est alarmant ; il montre que la progression des émissions continue et même s’accélère. Nous sommes face à un enjeu planétaire. En 2015, la France organise la COP21 dont l’issue est cruciale dans cette lutte. La France doit montrer un engagement sans faille en faveur des objectifs que j’ai rappelés. Il lui faut articuler sa politique autour d’une stratégie bas carbone, comme elle en a déjà exprimé l’intention, voire en devenir la vitrine. Pour ce faire, la France doit s’appuyer sur ses points forts : elle émet moins de 1 % des gaz à effet de serre dans le monde ; elle est très bien placée au niveau européen ; elle a réduit ses émissions de 13 % entre 1990 et 2011 grâce à son atout : un parc hydro-nucléaire faiblement carboné.
Nous devons néanmoins améliorer notre performance en matière de CO2. Cela suppose une stratégie bas carbone ambitieuse qui cible en priorité la consommation de pétrole – le pétrole représente 60 % des émissions de CO2 en France tandis que le fuel est la troisième source de chauffage – sur laquelle on a moins travaillé.
Deux leviers peuvent être mis au service de cette stratégie : le premier réside dans l’efficacité et l’intensité énergétique. Cette dernière, qui correspond à la performance intrinsèque des équipements, n’a cessé de s’améliorer, tirée par le progrès technique : les performances des LED sont cinq à six fois supérieures à celles des ampoules à incandescence. La marge de progression est encore importante, mais les améliorations sont conditionnées par la croissance économique. Il est donc crucial de maintenir une forte dynamique de croissance pour pouvoir capitaliser sur l’intensité énergétique. Quant à l’efficacité énergétique, elle doit être adaptée en fonction des exigences en matière de carbone et des coûts en recherchant une meilleure efficience.
Le deuxième levier tient à la réduction de la consommation de pétrole par des transferts d’usage vers des énergies décarbonées, principalement dans deux grands secteurs : le bâtiment, pour lequel les solutions existent, et le transport, encore en devenir mais qui compte de nombreuses filières porteuses.
Le transfert d’usage doit profiter aux énergies renouvelables thermiques, domaine dans lequel la France est le plus en retard et qui représente les deux tiers de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Les pompes à chaleur, les co-générateurs et la biomasse constituent les principaux gisements.
Pour mettre en place cette stratégie, la France dispose de nombreux atouts : des filières industrielles en matière d’efficacité énergétique, des champions énergétiques nationaux et des compétences reconnues dans l’hydraulique, l’éolien offshore et le nucléaire. Elle est donc bien placée pour tirer parti de la transition énergétique.
Nous relevons avec satisfaction que, parmi les 34 plans de reconquête industrielle, 27 intéressent directement l’électricité, qu’il s’agisse de transfert d’usage, de gestion de la demande ou de stockage. Ces plans vont dans la bonne direction.
La transition énergétique ne peut pas être synonyme de repli ou de décroissance. Elle doit être un facteur de progrès.
S’agissant de la place du nucléaire, la politique énergétique s’inscrit nécessairement dans un temps long. Il faut être capable de se donner du temps pour réussir et pour lever les verrous technologiques. Les interrogations portent non pas sur le bien-fondé de la transition énergétique, mais sur ses modalités et son rythme.
Dans cette perspective, l’exploitation du parc existant, dans des conditions de sûreté optimale, est indispensable pour faire les bons choix. La prolongation du parc donne le temps de se préparer et de disposer des solutions technologiques de remplacement les plus performantes possibles.
Dans la gestion du temps, l’Allemagne est un contre-exemple car la trop grande rapidité d’exécution, en dépit d’objectifs louables, produit de l’inefficacité économique. En raison des choix qui ont été faits, de 2010 à 2013, les émissions de CO2 ont augmenté de 13 millions de tonnes par an, soit plus 40 % des émissions du parc de production électrique français. Au Danemark, malgré le développement des énergies renouvelables, le charbon représente encore 60 % de la production d’énergie. En revanche, la Suède offre un bon exemple : grâce à une stratégie bas carbone inscrite dans la durée, le mix électrique, composé de 58 % d’énergies renouvelables, 40 % de nucléaire et 2 % d’énergie fossile, est presque totalement décarboné. La compétitivité reste remarquable puisque le prix du mégawattheure est de l’ordre de 30 à 35 euros.
Plusieurs conditions et principes, qui relèvent presque du bon sens, doivent être respectés pour réussir : en premier lieu, il faut s’interdire de développer des moyens de production en l’absence de besoins, au risque de créer des surcapacités coûteuses pour la collectivité. Plusieurs pays européens sont en train d’en payer le prix. Dans la situation économique actuelle, cette préoccupation doit passer au premier plan et demande un pilotage sérieux.
En deuxième lieu, il convient d’agir en bon gestionnaire, d’une part, en privilégiant les solutions à bonne rentabilité, y compris dans les énergies renouvelables, par le choix de filières à maturité qui ne demandent pas de subventions ; d’autre part, en tirant parti des synergies européennes, sans toutefois se départir du souci de la sûreté du système électrique européen.
En troisième lieu, il faut adresser un signal prix-carbone, comme la Suède a su le faire. En l’absence de signal, l’arbitrage se fait en fonction du coût de l’énergie et le charbon en sort inévitablement vainqueur.
En conclusion, il est raisonnable de ne pas dresser les unes contre les autres les énergies qui composent le mix électrique. Il faut, au contraire, tirer profit de leur complémentarité. Il faut mener la transition énergétique dans la durée grâce à un pilotage intelligent, qui tienne compte des progrès technologiques et de l’évolution du marché de l’énergie, et parvenir ainsi à un mix de production équilibré, sécurisé, décarboné et au moindre coût pour la collectivité.
M. le président François Brottes. Le ministre australien de l’industrie m’a indiqué que son pays renonçait définitivement à la taxe carbone, ce qui ne facilitera pas la tâche de la France pour la COP21.
Plusieurs notions méritent, me semble-t-il, d’être précisées car elles ne recouvrent pas nécessairement les mêmes réalités pour ceux qui réfléchissent sur ce sujet.
Il en va ainsi de la distinction entre énergie finale et énergie primaire ou entre puissance installée et énergie consommée. S’agissant de l’électricité, on mélange parfois volume et puissance. Sur l’effacement, deux approches s’opposent sans que la réglementation du marché de l’effacement ne les différencie : dans un cas, l’effacement consiste à ne pas consommer à des moments utiles pour la collectivité, dans l’autre, à consommer autre chose que l’énergie fournie par les réseaux. Quant à l’énergie fatale, la volonté de l’utiliser dans le réseau d’énergie peut conduire à créer des réseaux extravagants.
Il faut s’entendre sur ces notions qui sont essentielles pour déterminer le mix électrique pour les décennies à venir.
M. Robert Durdilly. La guerre sur la distinction entre énergie primaire et énergie finale doit être dépassée. La notion d’énergie finale est pertinente pour valoriser les efforts sur l’aval tandis que la notion d’énergie primaire porte plus sur le mix en amont. Cette dernière est donc plus délicate à appréhender car le mix de production évolue, au niveau européen notamment. En outre, dès lors que la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité augmente, la notion d’énergie primaire est moins pertinente.
L’UFE est favorable à une référence européenne pour le mix énergétique et à un ratio d’énergie primaire, qui reflète le plus fidèlement possible la montée en puissance des énergies renouvelables. Mais ce sujet n’est pas épuisé.
Quant à la puissance, depuis la mise en place d’un marché de l’électricité, les efforts en la matière se sont dégradés et cette notion est moins perceptible pour le consommateur. Forts de ce constat, nous avons préconisé l’introduction d’une composante supplémentaire, la capacité, qui fait l’objet d’un marché et d’obligations réglementés, même si la France est précurseur. En revanche, il est important que des notions représentent la dualité intrinsèque de l’électricité – puissance et énergie. Ce sujet n’est, il est vrai, pas toujours bien connu, d’autant qu’il est formulé de manière nouvelle en raison de l’évolution du système électrique et des règles du marché.
La question de la puissance n’est pas sans lien avec celle de l’effacement : en valorisant correctement la puissance, vous parvenez à déterminer la valeur économique de l’effacement. C’est le défaut de valeur qui prive l’effacement du moteur économique nécessaire à son développement. Or, c’est le marché de la capacité qui permet de donner sa valeur à l’effacement. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité introduire cette notion de capacité.
La question de l’énergie fatale est posée au niveau européen à travers la priorité d’accès des énergies renouvelables. Pour développer ces énergies, il faut leur accorder une forme de priorité. Mais, plus leur part augmente, plus cette priorité pose problème. Il faut probablement revoir ce point dans le sens d’une plus grande rationalité. De même, on mesure les limites des mécanismes de soutien sous forme d’obligation d’achat. De nouvelles formes de soutien aux énergies renouvelables doivent donc être imaginées qui ne présentent pas les inconvénients constatés. Il faut également optimiser le développement des réseaux pour une meilleure efficacité. Celui-ci doit être piloté en fonction de l’évolution de la demande.
Nous sommes tous d’accord pour considérer l’électricité comme l’un des instruments privilégiés de la transition énergétique puisqu’elle agrège toutes les formes d’énergie.
M. Thierry Salomon, président de l’association négaWatt. Les réponses à vos questions, monsieur le président, éclairent bien les fondamentaux qui sous-tendent le scénario négaWatt.
Avant même l’énergie finale, on trouve l’énergie utile, c’est-à-dire la chaleur, le nombre de calories nécessaires pour maintenir la température d’une pièce par exemple. En choisissant de passer de 21 à 19 degrés, on obtient des négawatts grâce à la sobriété énergétique.
L’énergie finale correspond à l’énergie distribuée au consommateur tandis que l’énergie primaire correspond à la ressource énergétique initiale. L’analyse de la chaîne énergétique réserve de belles surprises : on constate ainsi que l’usage peut permettre des gains énergétiques importants dès lors que le service attendu et les besoins sont déterminés afin d’éviter les consommations superfétatoires ou le gaspillage.
Dans la production nucléaire actuelle, le volume d’énergie lié au rendement des centrales, sous forme de chaleur, est perdu. Il représente 830 milliards de kilowattheures, soit plus que le chauffage de tous les logements et les bâtiments tertiaires de France. Il y a très peu de co-génération. La différence entre l’énergie primaire et l’énergie finale reflète le rendement énergétique du système.
Certaines notions utilisées, que vous n’avez pas citées, n’ont aucun sens. C’est le cas de l’électricité primaire : elle n’existe pas – il n’y a ni gisement, ni mine. L’électricité est un vecteur énergétique, c’est l’uranium qui est l’énergie primaire. Il faut faire plus de pédagogie.
NégaWatt propose un scénario – le troisième pour elle – qui a demandé dix ans de travail à des experts qui sont des gens de terrain. On ne peut pas comprendre ce scénario si on ne s’interroge pas sur les risques énergétiques. Cette question n’a pas été suffisamment posée lors du débat sur la transition énergétique alors qu’il s’agit d’une question sociétale et politique forte. Doit-on prendre le risque nucléaire ou pas ? Le risque est faible, nous l’admettons, mais ses conséquences sont immenses. Peut-on continuer malgré les risques ou essayer de limiter ceux-ci ? Il existe, en outre, d’autres risques, notamment les risques géopolitiques liés au pétrole.
Le scénario que nous présentons repose sur une gageure : peut-on sortir de tous les risques sur une période de trente ou quarante ans ? Existe-t-il une trajectoire possible pour y parvenir ? La trajectoire nous semble d’ailleurs plus pertinente que l’horizon.
M. le président François Brottes. Quel scénario proposeriez-vous si vous aviez une filiale en Ukraine ?
M. Thierry Salomon. Si l’Ukraine avait adopté un scénario négaWatt, elle serait plus résiliente face à l’ours russe.
La notion de résilience est très importante dans le système énergétique. Il faut construire un système dans lequel la prise de risque est minimale.
La sobriété et l’efficacité énergétique ainsi que le développement des énergies du pays – la France possède les six grands types d’énergie renouvelable – permettent d’être mieux armés face aux risques.
Le scénario de négaWatt propose un mix décarboné à hauteur de 90 % pour la production d’électricité en 2050. Il est composé de la manière suivante : 48 % d’éolien, 21 % de photovoltaïque, 20 % d’hydraulique, 6 % de gaz d’origine renouvelable et 5 % pour la géothermie et les énergies marines, ce qui laisse une marge en cas d’innovations technologiques. Ce travail examine l’équilibre entre l’offre et la demande sur le réseau d’électricité de manière très précise.
Notre scénario ne s’oppose pas à l’électricité, mais plaide pour le développement de ses usages les plus nobles. La part de mètres carrés chauffés à l’électricité dans le résidentiel reste stable, tandis que la part des voyageurs par kilomètre effectué grâce à l’électricité passe de 8 % en 2010 à 31 % en 2050, soit une multiplication par quatre, et celle des tonnes transportées par kilomètre passe de 7 à 38 %.
S’agissant du nucléaire, nous avons décidé d’examiner la situation réacteur par réacteur et de partir de l’hypothèse qu’aucun d’entre eux ne dépasserait les quarante ans. Autrement dit, sur le plan économique, la vie et la production de l’ensemble des réacteurs seraient soumises à cette limite de temps. Cela éviterait de repartir sur cinquante, voire soixante ans. Or il est clair que l’on se dirige vers les soixante ans, dans la mesure où les investissements sont considérables. Cette limite une fois fixée, il faut prévoir le développement des énergies renouvelables. Mais dans la mesure où celles-ci ne se développent pas en un jour, leur montée en puissance doit être réaliste et acceptable.
Notre scénario porte sur une diminution du nucléaire en trois phases : premièrement, un arrêt rapide des réacteurs qui semblent présenter le plus de risques, soit sept ou huit ; deuxièmement, une phase de réduction assez régulière, mais évidemment rapide ; troisièmement, une phase de clôture assez rapide vers 2030-2033, un peu comme le prévoit l’Allemagne – en effet, à un certain moment, il faut fermer l’amont et l’aval du cycle. Cela suppose d’avoir réfléchi aux contraintes de sûreté et aux contraintes énergétiques qui y sont liées.
Le développement des énergies renouvelables doit être maîtrisé et cohérent. Selon notre scénario, pour l’éolien, le rythme maximal d’installation, à terre, serait de 1,75 GW par an. En Allemagne, 3 GW ont été installés en 2013. Les Allemands ont donc déjà fait deux fois mieux. Pour le photovoltaïque, nous envisageons d’installer au maximum, vers 2025, 3 GW par an. L’année dernière, en Allemagne, 3,4 GW ont été installés. Nous sommes donc sur des rythmes que notre voisin a connus et même dépassés.
Au final, on arrive à un résultat assez intéressant, qui est la stabilisation du gaz fossile. Pourquoi du gaz d’origine fossile importé ? Parce que ce scénario ne développe pas le gaz de schiste.
M. le président François Brottes. Les scénarios sont malgré tout très liés.
M. Thierry Salomon. Nous avons refusé dès le départ une prise de risque environnemental, car celui-ci nous a paru inacceptable. Notre réflexion a donc exclu toute prise en compte du gaz de schiste.
M. le président François Brottes. Je parle du marché mondial. Tout est lié. L’avènement du gaz de schiste a fait bouger les lignes, notamment sur les modes de consommation du gaz naturel ou du charbon. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je fais un constat.
M. Thierry Salomon. Vous avez raison. Aujourd’hui, on assiste à un bouleversement mondial et l’on s’aperçoit qu’en matière de régulation, et notamment de régulation sur le prix du carbone, on est loin du compte.
Nous prévoyons la maîtrise, à un niveau d’environ 500 TWh, du gaz d’origine fossile, à peu près jusqu’à 2030-2035. Ce gaz naturel, que l’on va retrouver sur la mobilité, sur le chauffage, sur la production d’électricité, servira de variable d’ajustement. Mais un phénomène de vases communicants se produira. On utilisera moins de gaz pour se chauffer parce que l’on mènera une politique d’efficacité et de sobriété ; de ce fait, il y aura davantage de molécules gaz utilisables pour des usages plus nobles. D’où cette relative stabilité.
La stabilité du gaz et la baisse considérable du pétrole et du charbon entraîneront évidemment une décarbonisation du système énergétique de l’ordre d’un facteur 15, uniquement sur les émissions de CO2.
La question de la décarbonisation fut abordée lors du débat sur la transition énergétique. Le « facteur 4 » est maintenant inscrit dans deux lois : la loi de programmation fixant les objectifs de la politique énergétique (loi POPE) de 2005 et la première loi Grenelle. Or très peu de scénarios aboutissent au « facteur 4 ». En réalité, s’agissant de l’émission de CO2 due à la combustion, il faudrait un facteur de réduction d’au moins 6 à 7 pour aboutir, en 2050, au « facteur 4 » tous gaz à effet de serre confondus. En effet, il sera beaucoup plus difficile de réduire les émissions de méthane et des autres gaz à effet de serre, notamment dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. C’est donc bien le secteur énergétique qui servira de moteur pour diminuer l’ensemble de ces gaz et aboutir à un facteur élevé. Il est vraisemblable que le « facteur 4 », au travers des travaux du GIEC, est déjà dépassé. Enfin, par rapport à l’augmentation de la population à venir, le facteur de réduction à atteindre par habitant, est non pas de 4, mais de 5,3. L’enjeu est donc considérable.
Nous sommes des ingénieurs énergéticiens et tentons, dans un premier temps, de définir une trajectoire possible et réaliste en prenant en compte certains risques. Et depuis un an et demi que l’on débat sur la transition énergétique, ce scénario tient de plus en plus la route. Il a même été rejoint par d’autres sur certains points. Pour autant, nous nous sommes dit qu’il fallait aller un peu plus loin sur le plan économique. Trois études ont donc été réalisées, non pas par nous, mais en partie à partir de données que nous avons fournies.
La première montre qu’il y a un potentiel de création d’emplois pérennes dans le secteur de la transition énergétique. Le volume d’emplois créé sera en effet maintenu, dans la mesure où les technologies utilisées requièrent certains emplois, notamment en matière d’exploitation.
La seconde, qui sera publiée d’ici à quelques semaines, a été faite sur un modèle macroéconomique, le modèle ThreeMe, qui a été développé par l’ADEME et l’OFCE. L’ADEME a eu pour mission d’étudier l’ensemble des scénarios, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique (DNTE), au travers des différentes trajectoires. L’une des trajectoires s’appelle SOB, pour sobriété, et reprend très exactement les valeurs de négaWatt.
Les résultats sont très intéressants. Le scénario développé par cette étude est marqué, sur la phase 2010-2035, par une croissance de l’activité, de l’ordre de 4 à 5 points de PIB, puis par une stabilisation. On aboutit en quelque sorte à un équilibre du pouvoir d’achat et du revenu disponible des ménages. Autrement dit, dans ce modèle, la baisse de la facture énergétique compensera les investissements et le taux de chômage baissera, essentiellement à partir du moment où la transition commencera à s’opérer, c’est-à-dire vers 2030.
Une baisse considérable de la facture énergétique, pétrolière et gazière, bien que progressive, permettra de retrouver des fondamentaux macro économiques beaucoup plus acceptables que maintenant : baisse de la facture énergétique et, derrière, baisse de la dette de la Nation.
Ce scénario montre une voie possible. La transition énergétique n’est pas seulement le fait de choisir telle ou telle énergie. C’est aussi un modèle économique sur lequel il faudra continuer à travailler. En effet, certains modèles ne reflètent pas encore tous les bénéfices que l’on peut en attendre sur le temps de travail et sur le passage vers une société de services, notamment en termes de mobilité et de transports.
Enfin, une analyse a été publiée, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, par le groupe de travail sur les investissements et sur les coûts, puis par le groupe de travail numéro 2 sur les trajectoires.
Quatre trajectoires possibles ont été comparées : la trajectoire DEC, avec plus de 50 % de nucléaire ; la trajectoire DIV, reprise d’un des scénarios de l’ANCRE ; la trajectoire EFF, reprise du scénario de l’ADEME dans sa version 2050 ; et la trajectoire SOB issue du scénario négaWatt.
On constate un niveau d’investissement actuel sur l’énergie de l’ordre de 37 milliards d’euros, et une montée, sur l’ensemble des scénarios, entre 50 et 65/69 milliards d’euros – autrement dit, un différentiel de l’ordre de 20 à 30 milliards d’euros annuels. Lorsque l’on fait un calcul rapide cumulé, le niveau d’investissement se situe entre 2 200 et 2 400 milliards d’euros jusqu’à 2050.
Par ailleurs, dans le scénario de référence, le cumul de la facture énergétique s’élève à 4 500 milliards d’euros sur la période, tandis que dans les quatre scénarios de transition, il varie entre 2 000 et 2 900 milliards d’euros. Il est intéressant de constater que dans le scénario négaWatt, SOB, l’investissement est un peu plus important que les autres sur certaines années – notamment sur la phase de transition 2020-2040 ; évidemment, la réduction de la facture énergétique est, elle aussi, plus importante. Ce scénario aboutit à un écart de 800 milliards d’euros par rapport à des scénarios avec plus de 50 % de nucléaire, comme le scénario DEC.
On peut prendre ces chiffres « pour argent comptant ». Ce n’est pas nous qui les avons établis : ils résultent d’un travail du DNTE, piloté par Dominique Dron, commissaire générale au développement durable. Je pense que vous serez d’accord avec moi pour dire qu’il faut aller encore plus loin et que les quelques semaines de travail qui ont été consacrées à ces scénarios ne sont sans doute pas suffisantes. Nous avons vraiment besoin d’une feuille de route. Quoi qu’il en soit, et pour répondre avec retard à votre question d’il y a quelques années : oui, la trajectoire énergétique est faisable ; oui, d’après ces analyses, un modèle économique semble tenir la route.
M. le président François Brottes. Je crois qu’il peut y avoir un accord assez large pour dire que l’idéal est de gagner en efficacité et sobriété énergétiques, de n’avoir plus que du renouvelable, de savoir stocker l’énergie intermittente, et donc de pouvoir se débrouiller tous seuls. Mais avant d’en arriver là, il nous faudra gérer une période transitoire. Nous serons alors face à plusieurs risques : la précarisation énergétique d’une partie de la population, précarisation plus importante qu’aujourd’hui ; la perte de compétitivité industrielle de nos électro-intensifs, qui s’en vont les uns après les autres ; des risques environnementaux ; des risques technologiques ; des risques géopolitiques ; des problèmes d’approvisionnement.
Si je comprends bien, nous avons le choix entre plusieurs énergies de transition : le nucléaire, le gaz, le charbon. Dans le monde, c’est plutôt le charbon qui a été choisi. De votre côté, vous ne nous parlez, ni du charbon, ni du nucléaire, mais du gaz. Or, dans le même temps, GDF Suez ferme ses centrales à gaz. Comment gérez-vous ces contradictions ?
M. Thierry Salomon. Si nous parlons ainsi du gaz c’est parce que les sources d’approvisionnement sont relativement nombreuses. Certaines sont européennes – je pense notamment à la Norvège. Ce n’est pas négligeable dans la mesure où le risque géopolitique s’en trouve amoindri. Ensuite, la combustion du gaz n’émet que du CO2, ou presque. Eu égard à la très importante question des GES, la molécule de méthane a deux avantages : premièrement, elle est moins polluante dans la phase de transition ; deuxièmement, il est possible d’utiliser les équipements déjà existants, ce qui permettra, dans cette phase, de limiter les investissements.
Nous ne choisissons pas l’hydrogène parce que, contrairement à ce que pourrait dire Jeremy Rifkin, la transition de nos véhicules vers le gaz est faisable : la technologie existe, il faut à peu près 2 000 stations service. Nous disposons d’un formidable réseau qui distribue du gaz vers un peu plus de 70 % de la population sur les centres les plus importants. Nous avons une possibilité majeure d’utiliser des stockages déjà existants. En effet, GDF achète du gaz au prix le plus bas pour le stocker en vue de l’hiver.
Nous ne devons pas considérer le vecteur électrique comme le vecteur unique. Il y a un autre mix possible, qui est celui du gaz. En effet, dans ce scénario, on passe progressivement, au fur et à mesure des équipements et des installations, du gaz naturel au gaz d’origine renouvelable issu de deux sources : la source biologique (méthanisation, gazéification, etc.) et une source de gaz de synthèse, au moment où, vers 2030, la puissance installée renouvelable sera – notamment en matière d’éolien et de photovoltaïque – supérieure à la demande. L’idée de repasser, au travers de l’électrolyse, par de l’hydrogène et par du gaz, est donc tout à fait intéressante. Deux voies sont alors possibles. La première est l’injection directe de l’hydrogène dans le réseau de gaz actuel – pour l’instant, on sait le faire sans difficulté jusqu’à à peu près 8 %. La deuxième est la transformation par méthanation, qui est intéressante parce qu’elle permet d’imaginer des systèmes industriels qui produisent de la chaleur – la méthanation étant une réaction très exothermique. C’est ainsi qu’actuellement, en Allemagne, existent des systèmes prototypes de méthanation, dont le business plan est fondé sur la vente de chaleur à 320 degrés pour faire fonctionner l’ensemble. C’est un magnifique exemple d’économie circulaire avec production d’énergie, récupération de chaleur et utilisation de l’ensemble des renouvelables.
M. Denis Baupin, rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour dire que la transition énergétique passera par la réduction de la consommation de pétrole et de charbon. Je n’y reviendrai donc pas, préférant aborder les questions électriques qui font aujourd’hui débat.
Commençons par la question de l’effacement de la consommation d’électricité et celle des pics de consommation, que notre président a évoquées à plusieurs reprises. Je me suis rendu y a deux jours à une réunion du Conseil supérieur de l’énergie, au cours de laquelle furent examinées les propositions de RTE sur les marchés de capacité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a mis au point des dispositifs compliqués – une véritable « usine à gaz » – pour éviter, pendant quelques heures ou quelques jours par an, de se retrouver en situation de blackout si notre consommation venait à dépasser nos capacités de production.
Cette course-poursuite pour couvrir les besoins très spécifiques de la France en matière de chauffage électrique nous amène à nous interroger sur les conséquences que les hypothèses sur lesquelles vous travaillez les uns et les autres peuvent avoir sur ces éléments de pointe. Je souhaiterais connaître votre point de vue.
J’observe qu’on s’intéresse davantage aux moyens de production d’électricité qu’aux investissements en matière de réseaux. Pourtant, si la transition énergétique doit se traduire par un changement des moyens de production, elle entraînera des conséquences importantes sur les réseaux, en termes de transport comme de distribution. Ces conséquences seront différentes selon que la production est centralisée ou décentralisée, et selon leur histoire. De ce point de vue, les nouvelles installations, qu’il s’agisse des renouvelables ou du nucléaire, exigent des modifications de réseaux. La nouvelle ligne THT de l’ouest de la France, liée à l’EPR de Flamanville, illustre la nécessité qu’il y a à investir en matière de réseaux si on produit du nouveau nucléaire. J’aimerais connaître votre analyse sur cette évolution des réseaux.
Monsieur Durdilly, dans la mesure où vous ne nous avez pas présenté de scénario UFE, il nous est difficile de comparer votre intervention à celle de négaWatt et de connaître la vision d’avenir de l’UFE en matière de production électrique. Vous nous avez dit que vous étiez favorable à un équilibre entre les différentes productions. Mais comment se répartiraient les différents moyens de production d’électricité ? Si vous parlez d’équilibre, c’est qu’il n’existe pas aujourd’hui ? Selon vous, où se situe-t-il ?
Vous nous avez dit, par ailleurs, que vous souhaitiez que l’on prolonge la durée de vie des réacteurs nucléaires. J’aurais tendance à poser la même question que celle que le président avait posée à négaWatt : avec quel financement ? En effet, si l’on en croit les personnes que nous avons auditionnées jusqu’à présent, rien que pour entretenir les réacteurs jusqu’à quarante ans, le grand carénage lancé par EDF coûtera 55 milliards jusqu’en 2025, et donc probablement 75 à 100 milliards en tout – maintien à niveau des installations nucléaires et rattrapage des investissements qui n’avaient pas été effectués dans le passé.
Ensuite, il faudra déterminer quels réacteurs sont en mesure de fonctionner au-delà de quarante ans. Ce sera le travail de l’ASN, qui se prononcera notamment au vu de la tenue des cuves et des enceintes de confinement. Mais avez-vous vous-même une idée du pourcentage de réacteurs susceptibles de tenir plus de quarante ans ? Par ailleurs, l’ASN souhaitant que les réacteurs qui seraient prolongés au-delà de quarante ans atteignent un niveau de sûreté équivalant à la troisième génération, des investissements supplémentaires seront encore nécessaires. Le cabinet Wise, que nous avons auditionné, nous a fait part de son évaluation. Mais peut-être en avez-vous une. En un mot, combien cela coûterait-il et qui financerait ces investissements ?
Dès cette année, en tant que législateurs, nous aurons à choisir une politique de transition énergétique. Pour ce faire, nous devrons répondre à cette question cruciale : peut-on faire reposer l’ensemble de la production électrique française sur le pari que x centrales fonctionneront au-delà de quarante ans ?
Vous avez dit également que nous n’avions pas intérêt à être surcapacitaires en matière de production électrique. Au début de notre commission d’enquête, nous avons auditionné plusieurs intervenants, notamment des électriciens. L’avis général était que, globalement, l’ouest de l’Europe était surcapacitaire. De combien ? Comment le traduire en nombre de réacteurs nucléaires ? Le taux d’utilisation des réacteurs nucléaires étant en dessous de 80 %, on peut imaginer que si on en avait quelques-uns de moins, on ferait mieux fonctionner ceux qui restent, et finalement, cela coûterait moins cher à la collectivité.
Il y a quinze jours, le directeur général de l’énergie et du climat (DGEC) nous a dit que sur la base de l’objectif fixé par le Gouvernement d’atteindre 50 % de part du nucléaire dans la consommation électrique française, et au vu d’hypothèses qui allaient d’une évolution de la consommation électrique de - 0,2 % à + 0,4 % par an, il y aura sans doute une vingtaine de réacteurs nucléaires de trop – sur 58 – à l’horizon 2025. Partagez-vous ce point de vue ?
Enfin, pouvez-vous nous donner votre vision de l’emploi dans le secteur de la production d’électricité ? Selon négaWatt, quelques centaines de milliers d’emplois peuvent être créés dans les énergies renouvelables. Nos voisins allemands nous disent qu’ils en ont créé à peu près 430 000, ce qui n’est pas négligeable. Avez-vous procédé à une évaluation ?
Cela m’amène à une dernière remarque, que nous avions d’ailleurs faite dès notre première audition avec la Cour des comptes, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et nos collègues du Sénat : en France, nous manquons d’un lieu où l’on pourrait croiser l’ensemble des scénarios énergétiques établis par des ingénieurs et les analyses conduites en matière économique et sociale sur ces questions. Quoi qu’il en soit, quelles sont vos hypothèses en matière d’emploi à l’horizon 2025 ?
M. Robert Durdilly. Je vous remercie pour vos questions, qui me permettront d’aborder les vrais problèmes et de réagir aux propos de Thierry Salomon.
Sur la question de l’effacement et des pointes de consommation, vous avez fait référence aux modalités de lancement des marchés de capacité, qui sont effectivement complexes. Mais nous pensons que cette évolution est nécessaire sur la durée. S’il ne plane pas de menace immédiate sur la sécurité du système électrique, des problèmes réels sont envisageables à moyen et à long terme. Au fur et à mesure que l’on sera davantage en tension, que les moyens de production intermittents occuperont plus de place dans le système électrique, on se rapprochera de ces difficultés. Mieux vaut les anticiper. En même temps, ce sera, selon nous, l’occasion de stimuler et de développer les effacements intelligents, qui auront un rôle de variable d’ajustement dans le système électrique. De ce point de vue, il n’y a pas la moindre réticence de notre part. Nous avons été les instigateurs de ces mécanismes et souhaitons qu’ils se concrétisent. Reste à savoir comment les inscrire dans une logique européenne. Nous commençons à travailler avec nos voisins au niveau de la plaque électrique européenne.
Les EnR posent des problèmes de raccordement, au même titre que le nucléaire, mais l’on doit s’assurer de leur bon foisonnement en fonction des lieux de production pour diminuer l’impact des intermittences. De ce fait, les conditions de leur raccordement au réseau sont plus exigeantes.
J’en viens aux points de divergence que nous avons avec négaWatt. L’essentiel – au-delà du fait de choisir, ou non, du nucléaire – porte sur la capacité de notre pays à réduire la demande et la consommation d’électricité. négaWatt part du postulat que nous pourrons procéder à cette réduction de manière drastique sans pénaliser la croissance économique. Or cela n’est pas démontré. Nous trouvons donc très dangereux de construire un scénario ou de piloter une évolution en imaginant maintenir un certain niveau de croissance, d’autant que celle-ci est « boostée » par la démographie, beaucoup plus importante en France qu’en Allemagne. Construire un tel scénario, même s’il est cohérent en lui-même, sur des hypothèses aussi lourdes, peut se révéler risqué pour l’ensemble du système électrique.
Ensuite, il faut prendre en compte les coûts économiques de chacune des options possibles. Voici quelques chiffres, qui devraient vous donner des ordres de grandeur, si l’on prolonge le nucléaire de vingt ans : la production d’un gigawatt nucléaire coûte en gros un milliard d’euros, avec une disponibilité de 85 %. En revanche, la production d’un gigawatt d’éolien onshore coûte environ 1,5 milliard d’euros…
M. le rapporteur. Sur quelles études vous fondez-vous ? EDF évalue le coût du grand carénage à 55 milliards d’ici à 2025 et table, au final, sur environ 100 milliards d’euros. Mais la prolongation du nucléaire dépendra des conditions de sûreté qui seront décidées par l’ASN. D’où viennent donc vos évaluations ?
M. Robert Durdilly. Nos calculs nous ont amenés à 1 milliard d’euros. Mais c’est une première étape. Le coût sera peut-être plus élevé. Mon objectif était simplement de vous donner des ordres de grandeur, pour le nouveau nucléaire comme pour les énergies renouvelables. Quoi qu’il en soit, la disponibilité n’est pas du tout la même pour le nucléaire, pour l’éolien onshore, et a fortiori pour le photovoltaïque.
Pour un gigawatt de nucléaire qui coûte 1 milliard (voire 2 milliards) en investissement, l’éolien onshore en coûte 6, l’offshore 12 et le photovoltaïque 21. Le rapport est donc de 1 ou 2 à 21. Les écarts de coût sont considérables. Il faudra le prendre en compte quand on fera des choix.
Nous considérons donc qu’en l’état actuel des technologies, nous avons intérêt à prolonger le nucléaire existant, tout en renforçant par ailleurs et de façon significative la sûreté nucléaire – ce qui a été intégré dans les coûts.
Encore une fois, la variable temps n’est pas la finalité. L’important est le chemin. Et aujourd’hui, cette prolongation est indiscutablement le moyen le plus efficace pour gérer la transition énergétique.
M. le président François Brottes. Vous avez parlé de « productibilité ». Nous sommes bien sur un MW utilisé, et non pas sur un MW potentiellement utilisable ?
M. Robert Durdilly. Absolument.
M. le président François Brottes. C’est tout à fait différent. Tout à l’heure, j’ai moi-même évoqué la puissance installée et la production réellement utilisée.
M. Robert Durdilly. C’est exactement l’illustration de cette différence entre une puissance installée et ce que produit réellement cette puissance installée sur la durée, par exemple sur l’année, en moyenne. Les écarts entre les deux peuvent être considérables.
Je voudrais dire un mot sur les implications macroéconomiques, ce qui me permettra de répondre à la question sur les emplois.
On sait très bien faire des évaluations de créations d’emplois liées à des investissements lourds. Mais on ne sait pas apprécier avec certitude l’effet d’une augmentation du prix de l’énergie induite par ces investissements. L’exemple allemand est illustratif : la transition très rapide a provoqué une vertigineuse augmentation des prix pour les consommateurs, qui amène à réviser la trajectoire. Nous voudrions éviter d’avoir à procéder à de telles révisions.
Le prix actuel de l’électricité est assez compétitif en France par rapport aux pays européens, mais beaucoup moins par rapport aux États-Unis – du fait du gaz de schiste. Il faut prendre en compte ces éléments, car un coût de l’énergie plus bas est un véritable stimulant pour l’économie.
L’on peut toujours parler de la création de 100 000, 200 000, voire 600 000 emplois, mais la vraie question est de savoir combien seront supprimés si la transition se traduit par une forte augmentation du coût de l’énergie. À cet égard, l’exemple de la Suède est très intéressant : les Suédois ont en effet réussi une transition vers une économie très peu carbonée en maintenant une très forte compétitivité du prix de l’énergie, notamment du prix de l’électricité.
J’insiste : attention aux scénarios construits, par principe, sur une réduction de la demande, pour respecter le « facteur 4 » – voire aller au-delà – sans se préoccuper de la faisabilité du scénario en question. Il faut se poser la question suivante : si l’on n’y arrive pas, que se passe-t-il ? Dans un contexte international où l’évolution du prix de l’énergie peut être pénalisante, nous devons veiller à adopter un mode de transition énergétique qui nous garantisse les prix les plus compétitifs.
Ensuite, l’UFE a pris comme hypothèse une croissance économique de 1,7 %, niveau qui n’est pas déraisonnable et qui, en tout cas, est celui qui garantit à peu près le maintien de l’emploi en France. Or le maintien de la croissance, l’évolution démographique et les transferts d’usage – dans la mesure où une stratégie bas carbone suppose un transfert d’usage vers l’électricité – font que l’on ne peut pas baisser drastiquement la consommation d’électricité, parce que ce serait aller à l’encontre de la transition et cela aurait des conséquences très graves.
Sur le fait que notre parc électrique est un peu surdimensionné par rapport à nos stricts besoins, j’ai plusieurs observations à faire. Premièrement, l’exportation d’électricité nous rapporte à peu près 2 milliards d’euros par an, ce dont nous ne saurions nous plaindre. Deuxièmement, si la demande électrique est soutenue pour les raisons que j’ai indiquées, même si nous devons faire d’énormes efforts en matière d’efficacité énergétique, même si l’intensité énergétique doit s’améliorer dans les prochaines années, il nous faut un socle solide en matière de production électrique. Troisièmement, nous ne saurions renoncer à la prolongation possible des centrales nucléaires, car cela nous priverait d’une valeur économique réelle dans notre système, à une période où cela nous est bien nécessaire.
Je ne répondrai pas à votre question portant sur le nombre de réacteurs nucléaires dont nous aimerions voir prolonger la durée de vie. La décision relèvera de la responsabilité de l’ASN. Il faudra simplement se mettre en situation, quand c’est possible, de prolonger au-delà de quarante ans la durée de vie de ces réacteurs. Si c’est possible pour tous, ce sera très bien. S’il faut en arrêter certains, on le fera. Mais pour les raisons économiques que j’ai indiquées, chaque fois que l’on y réussira, ce sera un bienfait pour l’économie française. Nous en sommes persuadés.
Enfin, qui devra payer ? La réponse est assez claire : la loi a prévu que les coûts de production d’électricité et d’acheminement, et plus généralement tous les facteurs de coût, devraient être répercutés dans les tarifs. Même si des incertitudes planent sur les coûts de l’éventuelle prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, cela reste encore un très bon investissement au regard des coûts des autres filières alternatives.
M. Thierry Salomon. Sur la question de la demande et de la croissance, je vous invite à réfléchir sur un cas de figure assez simple, celui de la rénovation d’un logement. Une rénovation poussée peut permettre une baisse significative de la consommation d’énergie – par exemple de 300 kWh par m2 à 75 ou 85 kWh par m2, comme on sait le faire actuellement en énergie primaire. Cela signifie, pour l’usager, une baisse du niveau de l’énergie à acquérir pour satisfaire à ses besoins. Cela signifie, sur le plan économique, des travaux réalisés par des artisans et des PME, et de nouveaux services énergétiques – par le biais de la garantie de performance, par exemple. D’où un transfert de la production vers des services. C’est cela qui fait la croissance et l’emploi, et qui permet la réalisation de nouveaux équipements en matière de renouvelables.
Il faut donc avoir une vision systémique et ne pas se dire que si l’on consomme moins d’énergie, la France va dépérir. La question est bien entendu beaucoup plus large, et il peut être intéressant de travailler sur des modèles macroéconomiques, malgré leurs faiblesses et leurs difficultés d’usage.
Venons-en à la problématique de l’effacement et de la puissance. Dans le scénario négaWatt, nous avons été très précautionneux. Nous avons choisi, sur l’ensemble de la période, un niveau d’effacement qui ne dépasse pas celui d’aujourd’hui, et qui se situe aux alentours des 3 GW.
On peut imaginer que les réseaux intelligents, les smart grids, en se développant, viendront encore accroître les possibilités d’effacement. Moi qui travaille dans le milieu des études sur le bâtiment et l’urbanisme, je suis étonné par le fait que des objets quotidiens, comme les congélateurs ou les réfrigérateurs, seront connectés et permettront de faire de l’effacement. Tout cela va très vite et ouvre des marges de manœuvre. Malgré tout, nous avons voulu être prudents.
Notre scénario prévoit, par ailleurs, un glissement vers beaucoup moins de chauffage à effet Joule, qui est le problème du réseau actuel. RTE, qui vient de refaire ses calculs, a évalué la sensibilité électrotechnique à 2 400 MW par degré : autrement dit, à chaque fois qu’en hiver la température baisse d’un degré en France, il nous faut mettre en marche deux réacteurs et demi de 900 MW. Vous savez que cette sensibilité électrotechnique est une malheureuse caractéristique française : nous avons la moitié de la sensibilité électrotechnique de l’Europe. Si on baisse cette valeur-là par une politique d’efficacité énergétique, de transfert vers des usages beaucoup nobles de l’électricité et vers d’autres énergies, on retrouvera une marge de manœuvre. Dans notre scénario, nous redescendons cette consommation maximale sur l’ensemble du réseau aux alentours de 60/70 GW, donc bien en dessous des records que vous connaissez, qui sont à 110 GW.
S’agissant des coûts de l’énergie, je suis très étonné par les chiffres que je viens d’entendre. Je travaille moi aussi sur ces questions et j’observe que certains coûts sont en train de descendre de façon stupéfiante. C’est vrai du photovoltaïque – y compris sur les installations domestiques – au point que la parité réseau ne paraît plus inaccessible. C’est vrai de l’éolien. Des éoliennes pouvant travailler sur des vitesses de vent un peu plus faibles, une vraie révolution s’annonce ; il sera ainsi possible de les déployer sur le territoire de façon beaucoup plus intéressante.
Les toutes dernières évaluations et analyses en matière de projection de la consommation d’énergie font apparaître pour la première fois une baisse tendancielle à long terme (2030) de la consommation d’énergie électrique dans le scénario dit « de croissance plus faible ». Ces éléments sont sortis ces derniers jours. En tout cas, les trois dernières années ont été marquées par une stabilisation.
Il est intéressant de regarder l’historique de la prospective : chaque année, la projection amène vers des niveaux plus bas pour ce qui est de la demande. Ces niveaux sont conformes à ce que l’on voit en Europe, avec une forte stabilisation, voire une baisse de la consommation d’électricité. Cela renforce les hypothèses que l’on peut prendre au fur et à mesure dans notre scénario.
M. le président François Brottes. J’observe tout de même que plus les prix augmentent, plus la parité réseau est proche, et que le facteur climatique et la désindustrialisation ne sont pas forcément étrangers à la baisse de consommation. Mais il faut regarder ce qui se passe sur plusieurs années pour pouvoir confirmer, ou pas, cette tendance.
Messieurs, je vous remercie. Vous nous avez donné des informations qui seront très utiles pour notre rapport.
Audition de M. Jacques Percebois, président de la commission « Énergies 2050 », et de M. Bernard Laponche, polytechnicien, docteur ès sciences, docteur en économie de l’énergie, ancien directeur général de l’AFME (aujourd'hui ADEME)
(Séance du 17 avril 2014)
Des documents mis à la disposition de la commission d’enquête sont accessibles à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314051.pdf
M. le président François Brottes. Nous allons donc maintenant procéder à l’audition de M. Jacques Percebois, président de la commission « Énergies 2050 », qui a réfléchi avec M. Claude Mandil aux perspectives du mix énergétique en 2050 et à la place du nucléaire dans ce dispositif, et de M. Bernard Laponche, dont on connaît les positions très critiques à l’égard de la filière nucléaire. M. Laponche, qui a été directeur général de l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) – aujourd’hui Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) –, est un membre actif et éminent de Global Chance. Ces deux personnalités, qui possèdent une compétence reconnue, devraient donc nous présenter des positions clairement différenciées, sinon contradictoires.
Messieurs, la question principale que nous souhaiterions vous poser aujourd’hui est de savoir ce qui est le plus coûteux : rester dans le nucléaire ou en sortir très vite.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Jacques Percebois et Bernard Laponche prêtent serment)
M. Jacques Percebois, président de la commission « Énergies 2050 ». Je m’efforcerai d’être aussi synthétique que possible et de résumer l’essentiel du rapport rendu en février 2012 par la commission « Énergies 2050 ». Cette commission, mise en place par le Gouvernement en octobre 2011 et composée d’une cinquantaine de membres, a auditionné 80 personnes et avait reçu du ministre une feuille de route consistant à s’interroger sur la situation énergétique de la France à l’horizon 2030-2050, en privilégiant l’électricité et en examinant notamment quatre scénarios.
Le premier était une prolongation de quarante à soixante ans du parc nucléaire actuel, sous réserve que l’Autorité de sûreté nucléaire donne son accord, réacteur par réacteur, tous les dix ans. Le deuxième était une accélération du passage à la troisième, voire à la quatrième génération de réacteurs. Le troisième, une réduction progressive de la dimension du parc nucléaire, en arrêtant un réacteur sur deux atteignant l’âge de quarante ans et en le remplaçant par un autre mode de production d’électricité. Le quatrième scénario était une sortie complète du nucléaire par l’arrêt successif de tous les réacteurs atteignant quarante ans.
La commission a examiné les différents scénarios disponibles à l’époque, notamment ceux de l’Union française de l’électricité (UFE), du Réseau de transport de l’électricité (RTE), de l’ADEME, de négaWatt, de Global Chance, du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ou d’AREVA, et étudié diverses trajectoires de demande, s’appuyant particulièrement sur le scénario tendanciel de RTE, assez proche du reste de celui de l’UFE. Nous avons choisi des hypothèses de coûts et avons utilisé, pour tester certains des impacts macro-économiques, le modèle NEMESIS de l’École centrale de Paris.
La commission, estimant l’horizon 2050 trop lointain pour formuler des conclusions dans les délais impartis compte tenu des ruptures technologiques possibles, a ramené cet horizon à 2030. Quelle que soit néanmoins l’hypothèse choisie, tous les réacteurs actuels auront cessé de fonctionner en 2050 – qu’ils aient été remplacés ou qu’ils aient simplement été stoppés.
Les principales hypothèses sont d’abord que les énergies fossiles continueront de jouer un rôle important. On a ainsi considéré que le prix du pétrole, déjà élevé lors de la rédaction du rapport – de l’ordre de 80 dollars le baril –, continuerait de monter pour atteindre en 2030 le chiffre de 150 dollars, en monnaie constante de 2011. On a également considéré que le prix du gaz suivrait le prix du pétrole, excluant donc l’idée d’une chute semblable à celle qui est survenue aux États-Unis, ce qui est important car, s’il fallait passer à des centrales thermiques, ces centrales seraient à gaz.
En matière de lutte contre les émissions de CO2, nous avons formulé l’hypothèse optimiste que le prix de la tonne passerait de 13 euros en 2010 à 50 euros en 2030 – nous en sommes loin aujourd’hui, ce prix s’établissant aux alentours de 6 ou 7 euros.
Une hypothèse centrale pour comprendre la suite est que la demande d’électricité va continuer à croître, même si c’est moins vite que le taux de croissance économique. À l’époque, nous avions en effet considéré que la croissance économique serait à nouveau au rendez-vous, avec un taux de 1,5 % à 2 %. La consommation d’énergie primaire pouvait alors être relativement stable et déconnectée de la croissance économique. Nous avons en revanche fait l’hypothèse que la consommation d’électricité croîtrait de 1 % par an, en raison des nouveaux usages de l’électricité susceptibles d’apparaître tant pour les particuliers que pour l’industrie ou pour les transports, notamment avec le véhicule électrique, et de la croissance démographique – alors que l’évolution de la population allemande est plutôt orientée à la baisse, on estime que la population française devrait s’accroître d’environ 6 millions d’habitants d’ici à 2030.
Pour ce qui est des coûts de production de l’électricité, nous avons choisi les chiffres alors retenus par la Cour des comptes pour son rapport remis en janvier 2012 au Premier ministre – elle doit aujourd’hui les réviser, à la demande du Parlement. M. Claude Mandil et moi-même, qui avions besoin de ces chiffres, avons été nommés au groupe d’experts de la Cour des comptes. Pour les substituts au nucléaire, nous avons utilisé les chiffres de l’Agence internationale de l’énergie, repris du reste dans le rapport de la Cour des comptes. Nous avons ainsi considéré que la production d’électricité augmenterait, passant d’un peu moins de 500 térawatt-heure (TWh) à 600 TWh.
Nous n’avons donc envisagé, je le répète, ni chute du prix du pétrole, ni forte baisse de la demande d’énergie, ni forte baisse technologique, ni prix très bas du CO2. Nous n’avons pas non plus pris en compte, même si nous les avons signalés, des coûts tels que ceux du back-up ou les coûts de réseaux – dont nous savions qu’ils seraient élevés dans tous les cas de figure dans le cadre du marché unique de l’électricité en Europe.
L’évolution du prix de l’électricité est déterminante pour l’ensemble de l’économie française et joue sur la compétitivité. En termes d’emploi, par exemple, on peut considérer que les créations compensent les destructions, même si la structure de l’emploi est différente, mais le coût de l’électricité est un facteur déterminant pour les emplois induits, liés à la compétitivité de l’industrie. Ainsi, une hausse du prix de l’électricité liée aux investissements de substitution aura des effets sur la compétitivité de certaines industries.
Dès lors, le scénario de l’accélération du passage à la troisième génération de réacteurs n’a pas semblé optimal, car le coût de l’EPR est sensiblement supérieur à celui des réacteurs de deuxième génération – le prix du mégawatt-heure (MWh) serait sans doute encore supérieur au chiffre de 75 MWh retenu alors par la Cour des comptes. Nous avons, en outre, considéré que l’industrie française ne serait pas en mesure de construire deux EPR par an pendant dix ans – mais nous n’en avons pas moins intérêt à construire quelques EPR pour maintenir la compétence dans le domaine nucléaire.
Quant à la quatrième génération de réacteurs, elle était de toute façon hors du champ, que nous avons borné à 2030 – ce qui n’exclut pas pour autant de poursuivre l’effort de recherche et de développement en ce sens.
La consommation d’électricité ne devant, par hypothèse, pas diminuer et les substituts au nucléaire étant coûteux, la réduction progressive du parc nucléaire suppose d’investir dans de l’électricité renouvelable ou du thermique gaz. La prolongation du parc actuel semble donc la solution la moins coûteuse des trois – ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle ne soit pas coûteuse car, outre l’autorisation nécessaire de l’Autorité de sûreté nucléaire, il faut prendre en compte les investissements de jouvence, estimés à l’époque à 55 milliards d’euros et dont la Cour des comptes doit désormais déterminer s’ils ne coûteront finalement pas plus cher.
Dans le scénario tendanciel, le nucléaire, légèrement réduit, restait autour de 70 %, car l’arrêt de réacteurs qui fonctionnent lorsque la demande continue à croître revient à une destruction de valeur économique. C’est du reste ce que nous avons fait avec le gaz, en arrêtant des centrales à cycle combiné dans lesquelles nous avions beaucoup investi. Le président de GDF-Suez a ainsi annoncé qu’il avait provisionné une somme correspondant à des investissements qui ne sont plus rentabilisés dans le contexte économique actuel.
Dans la plupart des scénarios, la sortie du nucléaire se traduit par un besoin important d’investissement, ce qui pèsera sur le prix de l’électricité. Le rapport, plus nuancé et moins unilatéral que certains ne l’ont dit, souligne néanmoins que « seule une très forte baisse de la consommation énergétique pourrait, si elle était réalisable, nuancer cette conclusion et inverser la tendance ».
Enfin, la prolongation de la durée de vie du parc actuel paraissait la moins mauvaise – ou la meilleure – solution, sous la condition absolue qu’elle soit autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire et que les investissements de jouvence soient réalisés.
M. Bernard Laponche, ancien directeur général de l’AFME (aujourd’hui ADEME). Je tiens à préciser que j’ai travaillé plusieurs années sur les comparaisons des prospectives énergétiques et soutenu une thèse sur ce sujet devant un jury présidé M. Percebois, de sorte qu’il n’y a pas d’incompatibilité absolue entre nos travaux.
Ayant entendu l’audition de ce matin, il me semble utile de souligner certains points qui dépassent le cadre de l’exercice « Énergies 2050 » dont il est ici question.
Mon intervention traitera de la demande, puis de l’offre, dans le domaine nucléaire.
Pour ce qui concerne tout d’abord la demande, souvent évoquée comme étant une question compliquée et comme moins importante que l’offre, je tiens à souligner que, selon l’Agence internationale de l’énergie – dont M. Mandil a été directeur –, la réalisation des objectifs fixés pour 2050 suppose que la moitié des efforts soient consacrés à l’efficacité énergétique. Les économies d’énergie ont commencé en Europe dès 1975 et ce n’est pas parce que certains ne découvrent qu’aujourd’hui l’efficacité énergétique que nous n’avons pas d’expérience en la matière – notamment sur le plan industriel ou en matière de financement.
L’exercice européen Odyssée indique que les économies d’énergie cumulées réalisées par l’Europe des vingt-sept de 1990 à 2010 représentent 2 700 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), soit 277 millions de TEP pour l’année 2010, ou 24 % de la consommation d’énergie finale, à comparer aux 24 % que représente également la part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale. Le nucléaire représente un tiers de ce chiffre à l’échelle européenne. En France, où il compte pour 65 % de la consommation – et 75 % de la production –, on atteindrait à peu près le niveau des économies d’énergie réalisées. Or, tandis que l’on consacre des rapports de 400 pages au nucléaire, on évacue en trois pages la question de l’efficacité énergétique. Celle-ci est pourtant fondamentale pour toute la transition énergétique. Si en effet la consommation d’énergie diminue de moitié, conformément à l’objectif fixé par le Président de la République, tous les problèmes liés au climat et à la sécurité énergétique, ainsi que tous les risques, diminuent de façon pratiquement proportionnelle. On voit bien du reste que, si l’essentiel des économies d’énergie réalisées en Europe l’ont été dans l’industrie, des économies importantes l’ont aussi été dans le résidentiel et dans le secteur tertiaire.
Je ne saurais trop insister sur les objectifs de réduction de 20 % sur lesquels la France s’est engagée pour 2020 en termes tant de climat que d’intensité énergétique – laquelle se définit, je le rappelle, comme le rapport entre la consommation d’énergie et le produit intérieur brut (PIB). Il convient en effet d’éliminer les scénarios qui ne correspondent pas à ces engagements. Des objectifs de baisse de l’ordre de 30 % en 2030 ne sont, à cet égard, pas forcément extravagants.
L’hypothèse de doublement de la consommation d’électricité tous les dix ans, qui était la loi dans les années 70, est radicalement fausse : ce doublement n’a jamais eu lieu et la progression de la consommation d’électricité de la France entre 1970 et 2006 a été strictement linéaire. De fait, certaines hypothèses de pourcentage adoptées dans les études prospectives sont démenties par la réalité. Il n’y a pas d’exponentielle et la consommation d’électricité est à peu près stabilisée depuis 2006.
Pour ce qui est du potentiel d’économies d’électricité, qui est au centre du rapport de la commission « Énergies 2050 », les courbes de variation de la consommation d’électricité spécifique par habitant, hors chauffage – comportant donc l’électroménager, l’éclairage, l’audiovisuel et l’informatique – font apparaître les mêmes valeurs en France et en Allemagne entre 1990 et 2000. À partir de 2000, l’Allemagne commence à stabiliser sa consommation d’électricité spécifique par habitant dans le logement, tandis que la courbe de la consommation française continue d’évoluer de façon quasi linéaire. En 2010, la différence de la consommation par habitant est de 15 % et de 27 % par ménage. Il faut aussi préciser qu’en France, les deux-tiers de la consommation d’électricité sont liés aux bâtiments, l’industrie représentant moins d’un tiers de la consommation. C’est donc dans les bâtiments que se trouve le potentiel d’économies d’énergie. En outre, les deux tiers de ces deux tiers, soit moins de la moitié de la consommation française d’électricité, correspondent à des usages spécifiques de l’électricité. Fixer un objectif raisonnable d’économie de l’ordre de 15 % n’a donc rien de scandaleux.
En Allemagne, l’augmentation des émissions de CO2 tient non pas à la sortie du nucléaire, mais au fait que l’exploitation du gaz de schiste américain a tellement fait baisser le prix du charbon que les producteurs allemands d’électricité recourent désormais à ce combustible. Peut-être donc a-t-on eu tort de supprimer la loi européenne qui avait longtemps interdit les centrales au charbon.
Les échanges d’électricité entre la France et l’Allemagne, déficitaires pour la France jusqu’à 2010, connaissent une inversion pour la seule année 2011, avant d’accuser à nouveau un important déficit en 2012 et en 2013. Il importe donc de tenir compte des exportations d’électricité dans les scénarios envisagés.
M. le président François Brottes. Le prix négatif est une grande nouveauté mondiale.
M. Bernard Laponche. Sur 15 milliards de kilowatt-heure, un nombre négligeable avait un prix négatif ; aujourd’hui, ce ne sont pas les prix négatifs qui font le marché de l’électricité. Pour 2012, le rapport de RTE indique en outre que les échanges étaient déficitaires chaque mois.
Pour ce qui est du marché spot de l’électricité, alors que le rapport de la commission « Énergies 2050 » indique que « le moratoire sur le nucléaire en Allemagne a induit une inversion du différentiel de prix sur le marché spot français et allemand à partir du 15 mars 2011, le prix spot allemand devenant supérieur au prix spot français », le rapport de RTE observe qu’« en 2013, la moyenne annuelle des prix spot de la bourse de l’électricité se situe à 43,20 euros par mégawatt-heure en France », contre 37,80 euros par MWh en Allemagne. Il convient donc de veiller à tenir compte des aspects européens de la question, souvent mal connus ou mal utilisés en France.
M. le président François Brottes. Est-ce à dire que la France connaît une sous-production ?
M. Bernard Laponche. La France est probablement en surcapacité pour certains aspects, mais les coûts ne sont pas favorables. Il faudrait connaître le détail des chiffres.
Du point de vue de l’offre, le rapport est un peu léger. L’absence de l’ADEME dans le choix des scénarios illustre un manque d’intérêt pour la demande et le rapport se limite en fait au poids du nucléaire dans le mix électrique. Or, il est très grave de ne pas prendre en compte la demande car, selon que cette dernière sera de 350 ou de 600 milliards de kilowatt-heure, la réflexion sur l’industrie nucléaire sera très différente : la différence est un facteur 2, même si la part du nucléaire reste de 50 %.
Les comparaisons quantifiées figurant dans le rapport ne comportent ni le scénario de négaWatt ni celui d’Enerdata, et il n’est tenu compte ni des incertitudes de sûreté ni de l’éventualité et du coût d’un accident nucléaire. Un exercice de prospective peut aussi bien viser à rechercher la perspective optimale pour les auteurs de la prospective elle-même qu’à présenter aux décideurs politiques l’ensemble des avantages et des risques. Or, le seul risque pris en compte dans le rapport – comme d’ailleurs de nombreuses autres études – est le risque climatique, sans que soient évoqués ni les autres pollutions ni le risque nucléaire.
Ce matin, pour la première fois, il a été question des coûts et de l’assurance : évoquer une probabilité d’accident grave de 10-4 par année.réacteur n’a de prime abord rien de très évocateur, mais cela signifie qu’il existe une probabilité d’accident pour 10 000 cas possibles, c’est-à-dire pour 250 réacteurs PWR, soit à peu près l’ensemble de ceux qui existent dans le monde, pour une durée de fonctionnement de quarante ans. Pour 58 réacteurs, l’occurrence annoncée par cette probabilité est de 0,23 accident. Il ne s’agit pas là, contrairement à ce qu’a dit M. Thierry Salomon, d’une probabilité de zéro – ni même epsilon – multipliée par l’infini.
Il y a là une grande faiblesse dans un exercice de prospective qui, même s’il était moins détaillé, pourrait au moins poser la question du risque. Les anomalies génériques introduisent une incertitude considérable dans les scénarios et, même lorsque le nucléaire joue un rôle important, on pourrait veiller à ce que sa proportion soit moins sensible à ces anomalies.
L’exemple du Japon est à cet égard très intéressant. Selon une étude que j’ai réalisée sur l’énergie au Japon après Fukushima, l’arrêt des réacteurs, qui fournissaient moins d’un tiers de la consommation, n’a pas cassé le système électrique, ce qui n’aurait pas été le cas si la consommation d’électricité avait reposé pour 65 % sur ces réacteurs nucléaires. Le risque aurait alors été pratiquement impossible à maîtriser.
M. le président François Brottes. Comment expliquez-vous que le Japon revienne au nucléaire ?
M. Bernard Laponche. Par l’importance de l’industrie nucléaire. Quand on sait que la cuve de l’EPR est fabriquée au Japon, on comprend que ce pays ait envie de vendre des réacteurs.
On entend souvent affirmer que l’accident de Fukushima a donné lieu à une augmentation colossale des émissions de CO2, de la facture énergétique et à une importation considérable de charbon. Or, s’il est vrai que les émissions de CO2 ont augmenté, elles étaient les mêmes en 2012 qu’en 2007 car, depuis 1990, le Japon n’a pas du tout respecté les seuils fixés à Kyoto. La remontée des émissions après la crise économique n’est donc pas si considérable.
En second lieu, l’importation de charbon n’a pas augmenté entre 2010 et 2012. En revanche, les importations de gaz ont augmenté, ce qui a certes contribué à accroître la facture énergétique – qui a pratiquement doublé –, mais cette augmentation tient pour 20 % à la disparition du nucléaire et pour 80 % à l’augmentation des prix de l’énergie. Une grande prudence s’impose donc dans l’analyse de ces chiffres.
Le rapport procède à des comparaisons quantifiées entre douze scénarios, dont cinq issus d’AREVA, trois d’UFE, un de Global Chance et un de Négatep – mais aucun de négaWatt ni d’Enerdata.
La comparaison entre les coûts complets des différentes options repose sur les mêmes scénarios – et pâtit donc des mêmes absences, alors qu’Enerdata a proposé six scénarios et que négaWatt en a proposé un remarquable. En outre, le coût complet des économies d’électricité ne figure pas dans cette comparaison. La seule mention de ces économies consiste à rappeler que le coût du mégawatt-heure économisé a été évalué à 600 euros par Global Chance, en la personne de M. Benjamin Dessus, et à 1 400 euros par l’UFE, pour déclarer que ces valeurs ne sont pas cohérentes. Or, l’estimation du coût des économies par l’UFE est invraisemblable.
Dans l’analyse qualitative des différents scénarios, les chiffres cités pour illustrer le propos sont, à six reprises, ceux qui ont été fournis par AREVA. Tous ces chiffres doivent donc être pris avec précaution.
Entre la fin des années 1990 et 2012, la production allemande d’électricité d’origine renouvelable a augmenté d’environ 100 TWh. Le potentiel est plus important en France et une évolution en ce sens est possible.
Pour ce qui est de la facture énergétique de la France, c’est la consommation totale qui importe : la question est de savoir pour quel montant le pays importe de l’énergie. Ne raisonner que sur le système électrique peut être mauvais d’un point de vue économique, car les économies réalisées sur la facture peuvent se doubler d’économies insuffisantes sur le reste pour obtenir des baisses de la facture énergétique. Ce critère doit donc être examiné sur l’ensemble du scénario.
M. Denis Baupin, rapporteur. J’avais moi-même noté que le rapport citait très souvent des éléments provenant d’AREVA, de l’UFE ou d’autres acteurs dont le point de vue sur le nucléaire ne peut guère être considéré comme totalement indépendant de leur propre intérêt.
Je ferai d’abord deux remarques. Tout d’abord, selon un rapport réalisé voilà environ un an par le Conseil d’analyse économique, à l’exception des énergo-intensifs – soit environ 5 % des emplois en France, qui doivent être protégés –, l’augmentation des prix de l’énergie est plutôt un facteur de compétitivité, poussant à l’efficacité énergétique et à la réduction des consommations, voire à la mise au point de processus importants pour l’exportation. La question appelle donc une réponse moins simpliste que celles que l’on entend parfois.
Par ailleurs, que l’on soit favorable ou défavorable au nucléaire, il existe une vulnérabilité liée à la dépendance à une seule énergie ou à un seul mode de production de l’électricité, ainsi qu’aux risques d’accidents génériques. Or, cet élément n’est pas souligné dans le rapport.
Il faut trouver un équilibre entre les différentes sources de production d’électricité et tenir compte de ce que l’on sait aujourd’hui des coûts de l’EPR et de la prolongation des réacteurs – significativement plus élevés que les 55 milliards d’euros initialement affichés, compte tenu du grand carénage, évalué entre 75 et 100 milliards d’euros au total, et des impératifs de sûreté qu’imposera l’ASN.
M. le président François Brottes. Ce chiffre, cité plusieurs fois aujourd’hui, n’a jamais été vérifié.
M. le rapporteur. Les réponses – certes très partielles – d’EDF sur le grand carénage montrent une courbe qui est loin de s’arrêter en 2025.
Comment rédigeriez-vous aujourd’hui votre rapport au vu de ces scénarios énergétiques et n’y a-t-il pas une certaine pertinence à viser une proportion qui serait de l’ordre de 50 % de nucléaire en 2025, afin de mieux répartir les risques ?
M. Jacques Percebois. Si l’on refaisait aujourd’hui le rapport, avec des hypothèses différentes, il s’orienterait très certainement vers une proposition plus nuancée. Cependant, bien que les hypothèses et scénarios retenus se traduisent par un chiffre de l’ordre de 70 % en 2030, le rapport ne fixe aucun chiffre pour la part que devrait avoir le nucléaire dans les bilans électriques.
Par ailleurs, le choix d’une technologie unique pour l’ensemble des réacteurs aurait pu donner lieu à un problème générique. Nous avons eu de la chance que ce ne soit pas le cas et notre pari a réussi.
Bien que la France se soit toujours efforcée de limiter sa vulnérabilité par rapport à une seule source d’énergie, cette vulnérabilité demeurera pour les énergies fossiles – pétrole et gaz. Si le rapport s’est focalisé sur l’électricité, c’est conformément à la feuille de route – il n’était en outre pas possible de faire en trois mois un rapport complet sur l’ensemble des choix énergétiques de la France à l’horizon 2050.
Sans doute vous référez-vous, en évoquant la compétitivité, à l’intéressant rapport de M. Dominique Bureau et de ses collaborateurs, qui montre bien comment l’augmentation du prix de l’électricité pénalise les industries en pesant sur les exportations, mais qui souligne aussi que l’augmentation des prix incite à l’efficacité et au dépôt de brevets, comme on l’a notamment vu dans le secteur du transport. Il serait donc intéressant de réactualiser ce type de rapport, dont les conclusions seraient probablement différentes – c’est du reste un problème auquel les universitaires sont couramment confrontés lorsqu’ils relisent leurs écrits précédents. Il est peu stimulant, sur le plan intellectuel, de constater que peu de rapports se sont vérifiés.
M. le président François Brottes. J’ai été l’un des rares à tenter de chiffrer le scénario de négaWatt avec le système du bonus-malus.
Monsieur Laponche, faites-vous aussi l’apologie du gaz comme énergie de transition ?
M. Bernard Laponche. Oui, à condition de réduire suffisamment la consommation d’énergie. Comme l’a dit M. Salomon, il faut en effet réaliser des économies d’énergie et de consommation d’électricité. L’effort doit notamment porter sur le chauffage électrique, avec la rénovation des bâtiments. Le remplacement du nucléaire par le gaz ne représente pas une augmentation considérable de la consommation de gaz. Le calcul a même été fait dans la situation actuelle : si l’on arrêtait aujourd’hui le nucléaire pour le remplacer totalement par des centrales à gaz à cycle combiné, la consommation de gaz doublerait. Or, cette consommation est relativement faible en France – de l’ordre de 30 mégateps. Le gaz est donc très bon pour la transition et il est clair qu’il est le plus intéressant des trois combustibles fossiles. En outre, dans le scénario négaWatt, il est de moins en moins importé, car il s’agit de biogaz.
L’enfermement dans le pétrole demeure la question majeure et il ne serait pas mauvais de rééquilibrer le rapport entre le pétrole et le gaz – à condition, je le répète, de réduire les consommations d’énergie et d’électricité.
M. le président François Brottes. Messieurs, je vous remercie.
Audition M. Nicolas Boccard, professeur associé d’économie,
Université de Girona (Espagne)
(Séance du 30 avril 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314053.pdf
M. le président François Brottes. C’est sur la suggestion de notre rapporteur que nous avons souhaité vous entendre, monsieur le professeur.
Spécialiste du nucléaire français, vous avez publié récemment un article tendant à démontrer que le renouvelable reviendrait moins cher que le nucléaire. Était-ce ce que vous souhaitiez démontrer a priori, en vous donnant ensuite les arguments pour le faire ? Est-ce au contraire au terme d’un travail fouillé et objectif que vous êtes parvenu à une telle conclusion ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Nicolas Boccard prête serment)
M. Nicolas Boccard, professeur associé d’économie, université de Gérone (Espagne). Je remercie votre commission de m’avoir invité à contribuer à ses débats.
Si j’ai en effet publié un article consacré au coût de l’énergie nucléaire en France, je ne suis pas, pour autant, un spécialiste du nucléaire mais plutôt un économiste qui s’intéresse à l’électricité. J’ai d’abord écrit sur l’électricité d’origine renouvelable, notamment l’éolien. Mon approche du nucléaire est donc fortuite. Je ne prétends pas avoir fait une démonstration : j’ai étudié les faits et je suis arrivé à certaines conclusions que je vais essayer de vous exposer.
Ayant lu les comptes rendus des auditions précédentes, je sais que votre commission est déjà très bien informée. J’ai aussi relevé un désir de consensus de la part de ses membres…
M. le président François Brottes. Ce n’est pas gagné ! (Sourires.)
M. Nicolas Boccard. À tout le moins, tous les membres souhaitent disposer d’éléments de comparaison, afin d’examiner les options qui s’ouvrent à la France en matière de production électrique. C’est dans cette optique que j’ai préparé cette présentation.
Tout d’abord, je me suis fondé sur la comparaison des durées de construction des réacteurs en fonction de l’année de mise en service et de la technologie employée. J’ai également utilisé l’article de l’Autrichien Arnulf Grübler réalisé sur la base des informations parcellaires du rapport Charpin de 2000. Au sujet du développement du nucléaire en France, Grübler parle d’un « apprentissage par la pratique négatif ». Cette conclusion s’est révélée erronée mais la démarche était scientifiquement honnête. Les données nouvelles du rapport de la Cour des comptes sur les coûts de la filière électronucléaire permettent, de ce point de vue, un saut qualitatif.
J’ajoute qu’un rapporteur de la revue Energy Policy s’est montré très critique à l’égard d’une première version de mon article, allant jusqu’à m’accuser de falsifier les chiffres et à accuser la Cour des comptes de mensonge et d’invention. Bien que dénuée de fondement, cette charge s’est révélée utile, m’obligeant à plus d’objectivité et de précision.
Si l’on confronte maintenant le graphique des durées de construction et celui du coût du capital, toujours selon l’année de mise en service, on observe que le coût du capital augmente moins rapidement que la durée. L’enchérissement est principalement dû aux changements de technologie. À l’intérieur de chaque « palier » technologique, en revanche, le coût du capital est stable.
Il faut insister sur le succès du programme nucléaire français, en net contraste avec l’échec relatif des programmes américain et britannique. En rapport avec la transition énergétique, permettez-moi de rappeler ce propos de M. Marcel Boiteux, ancien président d’EDF : c’est grâce à l’expérience acquise sur les grands barrages qu’EDF a été capable de maîtriser les immenses chantiers du nucléaire et a fait le choix judicieux de la réplication d’un modèle, ce que les Américains n’ont pas su faire et qui leur a coûté si cher. A contrario, les déboires actuels de l’EPR montrent quelle perte en capital humain et en capital de connaissances représente une décennie sans construction. Il est essentiel de se fonder sur ce que l’on sait faire pour réussir ce que l’on désire faire.
J’ai également reproduit le tableau comparatif du facteur de charge, c’est-à-dire du ratio entre la production réelle d’une technologie et la production maximale, mesuré pour les différents modes de production, en France et en Allemagne, en 2013. Ce ratio, qui varie beaucoup selon les technologies, a un poids important dans le calcul du coût courant économique d’une technologie. S’agissant de la France, la capacité du système nucléaire est stable depuis une dizaine d’années, de même que l’énergie délivrée au consommateur final. Le facteur de charge moyen de la période 2002-2012 est de 76 %, en retrait par rapport aux valeurs observées à l’étranger. L’impact sur le coût courant économique est significatif.
Pour expliquer ce phénomène, EDF invoque une erreur commise à un moment donné. L’argument ne tient pas la route, dans la mesure où ce facteur de charge a toujours été faible. Le problème n’est pas conjoncturel mais structurel. Il ne s’agit pas non plus de l’arrêt forcé de réacteurs en raison d’une baisse de la demande : on observe, en effet, une forte corrélation entre la disponibilité des centrales et les exportations, ce qui signifie que, si les centrales sont arrêtées, ce n’est pas parce qu’elles n’ont pas de clients. Nous pourrons revenir, si vous le voulez bien, sur la raison de ces arrêts intempestifs.
M. le président François Brottes. Les arrêts ne sont pas tous intempestifs.
M. Nicolas Boccard. Ce sont des arrêts prévus, mais la raison pour laquelle ils se produisent est spécifiquement française.
M. le président François Brottes. Il faut distinguer deux sujets : les arrêts eux-mêmes et leur durée.
M. Nicolas Boccard. Ce qui compte pour les calculs économiques, c’est le nombre d’heures durant lesquelles une centrale produit de l’électricité au cours d’une année.
M. Denis Baupin, rapporteur. Qu’est-ce que ces arrêts ont de « spécifiquement français » ?
M. Nicolas Boccard. D’après ce que m’a dit le vice-président d’un exploitant nucléaire espagnol, c’est probablement parce que le nucléaire français est utilisé en pointe en hiver. Étant donné le fort taux d’équipement en chauffage électrique dans notre pays, on ne peut pas se permettre d’arrêter les centrales en hiver. Et, pour garantir leur fiabilité durant cette période, on a besoin de les arrêter de façon récurrente en été. Tel n’est pas le cas à l’étranger.
M. le président François Brottes. En effet. À l’étranger, on n’utilise les réacteurs qu’en base ; en France, on les utilise en base et en semi-base – mais pas, comme vous l’avez dit, en pointe.
M. Nicolas Boccard. Vous avez raison. Toujours est-il que le nucléaire français ne fonctionne pas seulement en base, ce qui fait qu’il n’est pas utilisable aussi souvent que le nucléaire d’autres pays et que son coût s’en trouve augmenté.
Pour établir le coût courant économique, il faut additionner tout ce que la société française a dû dépenser pour sa production d’électricité thermonucléaire. S’agissant du coût du capital, les chiffres que je présente sont directement issus du rapport de la Cour des comptes. J’ai choisi de traiter le combustible comme un facteur de production au même titre que le capital ou la force de travail, et j’ai distingué le coût d’acquisition, le coût de stockage et le coût de la gestion du combustible usé.
M. le président François Brottes. Intégrez-vous à ce calcul le retraitement et la production de MOX, qui est une spécificité française ?
M. Nicolas Boccard. Cet aspect apparaît dans la rubrique relative aux coûts futurs. Ce que j’intègre ici, c’est l’entreposage en piscine qu’il faut assurer pendant quatre ou douze ans avant qu’il soit possible de faire entrer le combustible usé dans le cycle du retraitement.
Autre rubrique, celle du coût des opérations et de la maintenance. Ces chiffres sont sans doute ceux qui mériteraient le plus un complément d’étude, tant certains éléments sont d’estimation difficile. Le chiffre de 3,8 milliards d’euros annuels, par exemple, inclut les dépenses courantes et les investissements de maintenance, à partir d’une moyenne que j’ai essayé de calculer sur vingt ans. La ligne « Fukushima » correspond à une estimation – bien approximative – des coûts de grand carénage et des dépenses extraordinaires mentionnées par EDF. Le sujet mériterait plus ample discussion pour peu que l’on dispose de davantage d’informations.
M. le président François Brottes. Précisons tout de même que les dépenses consécutives à Fukushima n’ont rien à voir avec le grand carénage, qui était prévu de toute façon. Les investissements exigés par l’Autorité de sûreté nucléaire après Fukushima sont encore autre chose.
M. Nicolas Boccard. Vous avez raison, l’intitulé de la ligne n’est pas des plus justes. Il conviendrait de distinguer le coût « post-Fukushima » et le coût, plus important, du grand carénage.
M. le rapporteur. Vous indiquez un coût annuel de 2 milliards. Est-ce la somme de ces deux éléments ?
M. Nicolas Boccard. Oui. Cela correspond au montant total de 50 milliards d’euros annoncé par EDF. Mais ces estimations dépendent de la durée de vie des centrales, sur laquelle nous manquons d’informations. Je conviens que cet aspect de mon étude manque de robustesse et demande à être complété.
Il faut néanmoins retenir que les coûts de maintenance d’EDF représentent presque quatre fois le coût du combustible. Aux États-Unis, par exemple, cette proportion est inférieure.
S’agissant enfin des coûts de démantèlement et de stockage des déchets, je ne vous apprendrai rien en soulignant la différence entre l’appréciation de l’exploitant et les comparaisons internationales ou les calculs de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Lorsque l’on additionne l’ensemble des coûts, il apparaît que les coûts de démantèlement et de stockage équivalent à la moitié du coût de construction du parc nucléaire français.
M. le rapporteur. Vous indiquez un coût de 23 milliards d’euros pour le traitement des déchets produits par EDF. Cela correspond-il au coût du projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique) ?
M. Nicolas Boccard. Oui, il s’agit du stockage à très long terme des déchets à Bure. Je prends également en compte le CEA, considérant que cet établissement est un organisme de soutien à la filière et que les dépenses qui lui ont été consacrées font partie de celles qui nous permettent de bénéficier de l’électricité thermonucléaire.
Dans l’hypothèse où l’on construirait une centrale aujourd’hui, son coût futur ne commencerait à être réalisé qu’à la fin de sa durée de fonctionnement, soit quarante ans. Il suffirait donc de provisionner annuellement un peu moins de 1 % de ce coût pour pouvoir l’assumer, ce qui est presque négligeable par rapport aux autres éléments. Ce phénomène intertemporel est très présent dans les discussions sur le changement climatique : le futur rend les choses moins chères.
Mon analyse prend également en compte l’assurance dommages. Dans un texte adopté par le Sénat en 2012, il est en effet prévu d’obliger les opérateurs à s’assurer contre un grand accident. Je l’ai constaté lors de la présentation de mon travail à Paris : la question, déjà traitée devant votre commission par le professeur Picard, ne laisse personne indifférent. Dans le scénario du « pire » en matière de coûts, j’ai retenu un montant de 4 milliards d’euros par an.
Mon étude récapitule également tous les coûts de recherche et développement depuis 1952, à l’exception des recherches relatives aux réacteurs de quatrième génération, qui devraient être payées par les usagers de l’EPR. L’énergie que nous utilisons aujourd’hui est censée payer toutes les dépenses de recherche, fructueuses ou non, faites dans le passé.
Pour intégrer ce coût global au coût courant économique, on le rapporte à la totalité de la production thermonucléaire depuis son début en 1968 – et, surtout, depuis l’augmentation en volume qu’a représentée l’ouverture de la centrale de Fessenheim en 1977. J’intègre ensuite tous ces éléments dans un tableau synthétique permettant de calculer le coût courant économique. Les deux scénarios que je propose sont le reflet de l’incertitude des hypothèses que j’ai retenues.
Il apparaît ainsi que l’électricité thermonucléaire dont nous jouissons depuis quarante ou cinquante ans nous aura coûté, en termes actuels, 60 euros par mégawattheure (MWh) lorsque nous aurons fini de la payer – il faut en effet inclure des dépenses qui adviendront dans un futur lointain. L’exercice consiste à collecter coûts passés, présents et futurs, et à tout ramener à la date d’aujourd’hui, avec le problème sous-jacent des taux d’intérêt à appliquer pour actualiser les montants.
Dans l’hypothèse la plus mauvaise – augmentation des coûts, résultats négatifs, taux d’intérêt correspondant à un financement privé et non à un financement public –, le coût du MWh pourrait monter jusqu’à environ 80 euros.
M. le rapporteur. Pourriez-vous préciser cette différence entre taux d’intérêt ?
M. Nicolas Boccard. Le calcul du coût du capital repose sur un taux d’intérêt qui représente la rémunération du prêteur. Lorsque l’investissement est public, ce taux s’élève à 3 ou 4 %. Le rapport Quinet a établi comment procéder à ce calcul pour les investissements publics énergétiques en France. En revanche, si l’on considère que l’opérateur est une entreprise industrielle financée par des capitaux privés, il faut retenir un taux plus élevé, de l’ordre de 10 % si l’on se réfère aux documents de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Le coût de l’investissement est alors beaucoup plus élevé. La question est ouverte : le nucléaire français doit-il être financé avec un taux d’intérêt public ou doit-on considérer qu’il s’agit d’équipements privés devant être financés par des capitaux privés ?
On retiendra cependant l’importance, en France, du coût courant par rapport au coût du capital. EDF a été un bon constructeur mais un piètre exploitant. Le grand succès du programme français, c’est d’avoir été exécuté de main de maître. Mais une exploitation efficace fait défaut. Par rapport aux exemples étrangers, les coûts sont élevés. Peut-être est-ce le prix à payer pour une meilleure sécurité, mais certains coûts ne relèvent pas seulement de la sécurité : il y a aussi des dépenses somptuaires. Les dépenses salariales par MWh, par exemple, sont très supérieures aux montants constatés à l’étranger.
L’estimation des coûts futurs est évidemment plus délicate. Avec tous les déboires qu’il a connus, le premier modèle d’EPR coûtera beaucoup plus cher que prévu. Si les suivants se révélaient aussi chers, les coûts seraient considérablement accrus. Je retiens, par ailleurs, une hypothèse d’inertie pour ce qui est du coût du combustible, du retraitement, ainsi que des coûts d’opérations et de maintenance. En revanche, le facteur de charge retenu pour les calculs est de 85 %, soit la norme internationale, contre 76 % actuellement pour EDF.
Étant donné le prix de l’EPR, le coût du capital prend une part prépondérante dans le montant total des coûts futurs, qui se situent entre 80 et 120 euros par MWh. Il est improbable qu’EDF soit à même de réduire le coût du capital dans le futur. Dans l’histoire des grands chantiers, on a rarement observé les baisses de coût de 5 % par an que l’on peut constater dans beaucoup d’industries innovantes. Si elle en venait à construire d’autres EPR, peut-être EDF arriverait-elle à empêcher les coûts d’augmenter. Quant à les faire baisser significativement, la question est ouverte… Je vous invite à auditionner à ce sujet des ingénieurs de la construction.
Mon travail reposant sur une méthode en usage dans les institutions internationales, il permet d’effectuer des comparaisons avec l’étranger. Aux États-Unis – le seul autre pays où l’on dispose d’informations sur le coût de construction et d’exploitation des réacteurs nucléaires –, l’étude réalisée par Koomey et Hultman en 2007 est construite de la même manière que la mienne. Elle montre que les Américains ont dépensé encore plus que la France en matière de recherche et développement, même si le coût per capita est moins lourd. Au total, le coût actuel du nucléaire aux États-Unis est supérieur de 10 % à celui du nucléaire en France, en partie parce que le pouvoir d’achat du dollar est plus élevé. En appliquant un taux de change PPA (parité de pouvoir d’achat), le nucléaire américain se révèle seulement un peu plus cher que le nucléaire français.
La technique du coût courant économique permet également des comparaisons avec d’autres technologies de production d’électricité. Pour le concurrent historique principal du nucléaire, le charbon, qui est aussi utilisé en base, les données très anciennes disponibles aux États-Unis montrent que le coût était, est et restera aux alentours de 50 dollars par MWh. Le calcul ne prend pas en compte le prix des émissions de CO2 – cela étant, vu le prix de marché actuel, cela ne ferait aucune différence. Abstraction faite de ses externalités négatives, le charbon est une énergie qui était et restera moins chère que le nucléaire pour la production de base.
S’agissant du gaz naturel, le calcul prend en compte un facteur de charge d’environ deux tiers, comme c’était le cas dans les années 1990 ou 2000. Mais l’année dernière, en France et en Allemagne, le facteur de charge n’a été que de 20 %, ce qui a provoqué la fermeture de nombreuses usines et ce qui rend le gaz beaucoup plus cher que le nucléaire actuellement, faute de débouchés. Cette énergie a été très bon marché dans les années 1990…
M. le rapporteur. Quel était son coût à l’époque ?
M. Nicolas Boccard. Je l’estime à 64 dollars par MWh. Il faut prendre en compte non seulement le facteur de charge, mais aussi le coût du gaz naturel. Aux États-Unis, l’utilisation de la fracturation le rend très peu cher. Mais la ressource est trois fois plus chère en Europe et quatre fois au Japon. Ce dernier pays s’approvisionne uniquement en gaz naturel liquéfié – aucun pipeline ne le relie au continent –, ce qui l’expose à la férocité des producteurs.
En matière d’électricité d’origine éolienne, nous disposons maintenant de vingt ans de données. Les coûts aux États-Unis – où il y a plus de vent – sont légèrement inférieurs aux coûts européens. En Europe, l’éolien terrestre coûte aujourd’hui un peu plus cher que le nucléaire, mais il bénéficie d’une amélioration lente et constante puisqu’il gagne 1 à 2 % par an sur le coût du capital. Le nucléaire ayant tendance à se renchérir, le rapport de coûts entre les deux modes de production devrait s’inverser dans la prochaine décennie, comme cela s’est déjà produit aux États-Unis.
Je conclurai en évoquant quelques pistes pour le futur.
La France a beaucoup investi dans son appareil de production nucléaire. Remplacer ne serait-ce qu’un tiers ou la moitié du parc nécessitera des investissements considérables : il faudra, par exemple, implanter des milliers d’éoliennes supplémentaires, consacrer des départements entiers à la plantation de biomasse, ouvrir des dizaines de fermes hydroliennes, obtenir que des milliers de consommateurs participent aux programmes d’effacement, installer des centaines de stations de pompage… Bref, exploiter à grande échelle toutes les solutions possibles.
La grande force du charbon, du nucléaire et du gaz naturel est que l’on peut installer dans 1 km2 une puissance capable de servir Paris. Pour délivrer la même puissance avec de la biomasse, il faudrait couvrir toute la Bretagne. Le solaire et l’éolien sont eux aussi, quoique dans une moindre mesure, consommateurs d’espace. Si l’on veut remplacer une énergie très concentrée géographiquement par des énergies renouvelables, il faut donc se donner de la place. Il y aura inévitablement concurrence avec l’agriculture ou les loisirs. Dans le golfe du Lion, par exemple, le secteur du tourisme est très opposé à l’installation d’hydroliennes. Les conditions y sont pourtant très favorables et il est étonnant que la France n’ait pas choisi d’y développer ce type de production.
M. le président François Brottes. Notons que les États-Unis disposent de beaucoup plus d’espace que la France pour déployer des modes de production alternatifs.
Plusieurs aspects de votre raisonnement me gênent.
Tout d’abord, vous vous référez toujours à des coûts moyens, omettant qu’une des spécificités de l’électricité est la grande amplitude de son prix selon que l’on est « en tension » ou non. Vous semblez regretter que les centrales françaises fonctionnent en semi-base, voire en pointe, mais il se trouve que c’est le moment où le prix de marché de l’électricité est le plus élevé. Il conviendrait de prendre en compte cette modulation.
La comparaison avec les États-Unis et les autres pays doit également tenir compte du fait que le dispositif français de sûreté est l’un des plus exigeants au monde. Depuis sa création, l’Autorité de sûreté nucléaire pose des impératifs en matière de travaux, d’investissements ou de maintenance qui n’ont pas forcément cours dans d’autres pays.
Ajoutons à cela que les États-Unis n’abordent pas la question de l’amortissement et de la durée d’exploitation de la même manière que chez nous.
Bref, il est bon de comparer, mais, lorsque l’on entre dans le détail, on s’aperçoit que comparaison n’est pas toujours raison. Non que votre démonstration soit dénuée de pertinence, mais un peu plus de subtilité rendrait vos conclusions plus convaincantes.
M. Nicolas Boccard. L’intérêt du coût courant économique est de déterminer ce que l’on a dépensé pour pouvoir bénéficier d’électricité thermonucléaire pendant cinquante ans. Nous avons consommé jusqu’à présent environ 10 000 térawattheure : qu’est-ce que la France a dépensé pour cela ? La question est totalement indépendante du prix auquel cette électricité est vendue. De même, lorsque l’on achète de l’électricité renouvelable à 400 euros le MWh alors que le coût de production est de 250 euros, la seule chose qui importe à l’économiste, ce sont ces 250 euros. Les 150 euros de différence – le bénéfice – ne représentent qu’un transfert entre le client et le producteur. Il est certes important de fixer le bon prix, mais mon étude concerne exclusivement les coûts.
Vous avez néanmoins raison de souligner que le nucléaire est une énergie de base contrôlable, que l’on peut obtenir quand on le désire, ce qui n’est pas le cas des énergies renouvelables. Dans une autre étude, j’ai estimé le coût de l’intermittence dans l’éolien à 10 euros par MWh en Europe, en supposant que les interconnexions étaient suffisantes.
M. le président François Brottes. Votre calcul comprend-il le coût des investissements spécifiques dans les réseaux ?
M. Nicolas Boccard. Mon hypothèse était que les réseaux à haute tension avaient une qualité suffisante. Mon travail portait sur les énergies alternatives à mettre en œuvre lorsque l’éolien vient à manquer et sur les sources à désactiver lorsque l’éolien est en excès.
M. le président François Brottes. Vous n’ignorez pas que, en Allemagne comme en France, on est obligé d’ajuster les réseaux de transport et de distribution pour accueillir les pics de fourniture d’électricité renouvelable. Le coût n’est pas neutre.
M. Nicolas Boccard. C’est un sujet difficile qui fait l’objet de nombreux travaux. Je crois qu’il y a eu beaucoup d’alarmisme, mais que les expériences originales menées au Danemark et en Espagne ont montré qu’il n’y avait pas de problème technique et que l’ajustement se faisait assez vite.
M. le président François Brottes. Et du point de vue financier ?
M. Nicolas Boccard. Les tarifs que Red Eléctrica de España obtient des producteurs électriques – entre 3 et 5 % du prix – lui suffisent pour développer le réseau, alors que l’Espagne est un des pays qui produit le plus d’énergie éolienne. Le surcoût, bien que peu élevé, existe. Il serait bon de l’ajouter aux calculs mais l’exercice est difficile, tant les situations sont différentes d’un pays à l’autre et tant l’augmentation rapide de la capacité rend quelque peu obsolètes des systèmes que l’on croyait très sûrs. L’Allemagne est en train d’en faire l’expérience.
Pour ce qui est de la sûreté nucléaire, je ne suis pas du tout spécialiste. Il serait souhaitable que des experts reprennent l’étude de Koomey et Hultman, qui a été réalisée avant Fukushima, et actualisent les coûts de la sûreté aux États-Unis. L’estimation s’en trouverait sans doute significativement augmentée.
M. le président François Brottes. Il se disait à une époque que, compte tenu des tarifs de rachat du photovoltaïque en Espagne, certains opérateurs éclairaient leurs panneaux au moyen de projecteurs alimentés par des groupes électrogènes. S’agit-il d’une légende ?
M. Nicolas Boccard. Je pense que c’est une légende. De même, on a dit que le propriétaire d’un supermarché de Bruxelles faisait tourner l’éolienne fixée au-dessus de son établissement avec le courant électrique de la ville, craignant que l’arrêt des pales ne mécontente ses clients !
Il est vrai que le tarif de rachat a été trop élevé en Espagne. Pour autant, la décision gouvernementale d’y mettre fin n’a pas été plus maligne. Il importe de s’inscrire dans la durée et de ne jamais revenir sur ses engagements.
M. le rapporteur. Merci pour cette présentation qui nous apporte des éléments de comparaison entre les différentes énergies et entre les différents pays.
Sans doute les espaces dont bénéficient les États-Unis expliquent-ils aussi que les exigences en matière de sûreté nucléaire soient moindres qu’en France.
S’agissant de l’éolien, vous estimez le coût de l’intermittence à 10 euros par MWh, sans prendre en compte la capacité de transport. Ce chiffre n’est pas éloigné de ceux d’EDF et l’UFE (Union française de l’électricité), qui se situent entre 10 et 15 euros.
Votre étude apporte deux éléments principaux par rapport au rapport de la Cour des comptes : elle prend en compte à la fois le coût de l’assurance accident et celui du taux d’intérêt qui serait applicable s’il ne s’agissait pas de commandes de l’État. Ce taux est particulièrement important pour les installations de production renouvelables, qui nécessitent un fort investissement en capital.
La Cour des comptes est en train de mettre à jour son rapport de 2012, où elle abordait déjà l’hypothèse d’un fonds destiné à couvrir un éventuel accident. Avez-vous eu l’occasion d’évoquer ces sujets avec elle ? La différence de taux d’intérêt est un avantage significatif. La Commission européenne est d’ailleurs en train d’examiner l’éventuelle distorsion de concurrence que représenteraient les garanties apportées par l’État en matière de taux pour la construction des EPR de Hinkley Point, en Grande-Bretagne.
M. Nicolas Boccard. Mes travaux sur l’éolien n’incluaient pas les investissements supplémentaires dans les capacités de transport pour profiter des différences de rythme de production entre les pays, ou dans des batteries ou autres systèmes de stockage. J’y insiste, la capacité de transport est peu coûteuse au regard de l’énergie transportée. Le problème est d’arriver à la construire. On aura mis soixante ans à réaliser la deuxième ligne entre la France et l’Espagne. Les Allemands s’aperçoivent, eux aussi, qu’il n’est pas si facile de mener de tels projets. La question se pose dans tous les pays du monde. La fameuse crise de 2001 en Californie est uniquement due aux lois restrictives qui ont interdit aux opérateurs de construire des lignes dans les années 1980. Le couloir existant était congestionné en permanence, ce dont Enron a d’ailleurs profité. On s’accorde désormais à considérer qu’il faut augmenter les capacités, mais les populations voient les choses d’un autre œil. Le choix est difficile : soit on rapproche les moyens de production des consommateurs, soit on construit des lignes. Il concerne aussi les énergies renouvelables : de véritables usines existent en mer du Nord et en Écosse, demain au Sahara, loin des centres de consommation. Le coût pour acheminer cette électricité n’est pas économique, il est social. Il faut convaincre les gens d’accepter les lignes, ce qui est très difficile à chiffrer.
Contrairement à ce qu’on m’a reproché, je n’ai pas inventé le coût de l’assurance accidents. Je vous invite d’ailleurs à entendre M. Christian Gollier, qui est le spécialiste en France des questions de risque et d’intertemporalité. Comme vous l’a dit le professeur Pierre Picard, la probabilité de survenue d’un accident est réduite – si bien que la couverture est peu coûteuse –, mais l’accident en lui-même est gigantesque. Le traitement mathématique de la question est très difficile et les opinions divergent. Je me suis contenté de retenir le chiffre qui apparaît comme la limite supérieure de prix pouvant être demandé par un groupement de réassureurs pour assurer un pays contre un dommage d’une valeur de 100 milliards d’euros. Ce montant, qui correspond aux dégâts provoqués par l’ouragan Katrina en 2005, est inférieur au coût du tremblement de terre au Japon en 2011, mais très supérieur aux estimations du coût de Fukushima – autour de 40 milliards de dollars, d’après ce qu’on peut lire dans la presse.
M. le rapporteur. Le directeur général de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) a évoqué le chiffre de 1 000 milliards de dollars. Et, d’après la presse, on a déjà dépassé la centaine de milliards.
M. Nicolas Boccard. Avant de présenter mon travail à Paris au mois de février, j’ai recherché sur Google News les sources d’information américaines et japonaises : toutes donnent la somme de 20 milliards pour le site et de 20 milliards pour la décontamination des territoires.
M. le rapporteur. Sans doute ne parlons-nous pas de la même chose. Les montants que vous évoquez sont ceux qui seront payés pour la réparation. Je me référais pour ma part à l’évaluation de l’impact sur le tourisme, la vente des produits, etc., c’est-à-dire à des coûts qui ne sont pas forcément assurables.
M. Nicolas Boccard. Le coût que j’ai retenu est celui que devrait assumer le responsable des dommages. On en est à 40 milliards de dollars, bientôt à 40 milliards d’euros. Le montant continuera d’augmenter, mais il n’est pas gigantesque au point qu’on ne puisse l’assurer. Le marché étant totalement illiquide, l’assurance sera chère. D’où l’idée de la caution, déjà pratiquée dans beaucoup d’industries : tous les producteurs mettent annuellement au pot un montant calculé au prorata de leur activité et le fonds ainsi constitué sert à payer les dommages. La généralisation de ce système permettrait de responsabiliser les acteurs : si l’un des membres se comporte mal, ce sont ses amis qui viendront lui rendre visite, et non des inspecteurs envoyés par un gouvernement.
Pour ce qui est des taux d’intérêt, les publications de l’OCDE et de l’Agence internationale de l’énergie tentent généralement de comparer les techniques de production d’électricité en les soumettant à un scénario de taux à 5 % et à un scénario à 10 %. La production au charbon, au gaz et à partir du renouvelable étant assurée par des investisseurs privés, il est d’usage de retenir le taux de 10 %. Si le nucléaire était logé à la même enseigne, il serait beaucoup plus cher. C’est le problème auquel est confrontée la Commission européenne : la garantie de l’État revient à prêter de l’argent à un taux qui n’est pas celui que paierait une entreprise privée. C’est assurément du state aid et il est évident que la Commission s’y opposera. De même, le financement du nucléaire français peut apparaître comme indu par comparaison avec le financement d’opérateurs privés. Dans la mesure où tout était financé par une seule entreprise, il n’y a pas eu de discrimination par rapport à l’hydraulique ou du charbon ; mais, dès lors que le marché est soumis à la concurrence, il convient d’examiner l’hypothèse du financement des techniques futures de production électrique avec des fonds privés levés sur les marchés.
M. le président François Brottes. En d’autres termes, la compétition aggrave les coûts.
M. Nicolas Boccard. Non. Nous avons été victimes de l’illusion, née dans les années 1990, que l’énergie sous toutes ses formes n’était pas chère.
M. le président François Brottes. Le gaz de schiste américain ne coûte pas grand-chose…
M. Nicolas Boccard. On ne récolte que les fruits de ce l’on a semé. L’exploitation du gaz de schiste aux États-Unis est le résultat de quarante ans de prospection sur le Barnett Shale grâce à des subsides fédéraux. On a l’impression que George Mitchell a gagné au loto, mais c’est faux. D’autres ont cherché à d’autres endroits et n’ont jamais trouvé. Ils ont perdu de l’argent, comme lui d’ailleurs, pendant vingt ans avant de trouver la technique miracle qui transformait cette énergie peu productive en énergie très productive. Il faudrait dix ou vingt ans de prospection pour parvenir à un résultat similaire en France, si tant est que la géologie s’y prête.
M. le président François Brottes. Merci pour votre contribution.
Table ronde avec les confédérations syndicales représentatives au plan national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO)
(Séance du 30 avril 2014)
M. le président François Brottes. Cette table ronde, qui réunit des confédérations syndicales nationales représentatives, leur permettra de s’exprimer sur les questions nombreuses qu’aborde notre commission d’enquête – tarifs de l’électricité, réacteur EPR, sûreté et sécurité.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Dominique Olivier, Alexandre Grillat, Francis Orosco et Henri Richard, Mme Marie-Claire Cailletaud, MM. Bernard Devert, Jacky Chorin et Éric Devy prêtent serment)
M. Dominique Olivier, secrétaire confédéral de la CFDT, chargé du développement durable. La CFDT approuve l’objectif d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, et donc celui d’une division par deux des consommations d’énergie finale. La sobriété et l’efficacité énergétiques doivent être les premières priorités des politiques publiques. Nous estimons aussi que le problème central, avant même celui de la place du nucléaire, est constitué par le recours aux énergies fossiles, qui représentent 75 % de l’énergie totale consommée.
S’agissant du nouveau mix énergétique, toutes les études montrent que l’électricité et le gaz ont un avenir assuré : ils seront demain, et pour longtemps, les sources et vecteurs principaux d’énergie. EDF n’est donc pas menacée si elle sait répondre intelligemment aux attentes de la société. Il faudra également accroître le recours aux énergies renouvelables – énergies intermittentes, mais aussi permanentes, comme les énergies marines ou le gaz de biomasse.
Quant au nouveau mix électrique, la CFDT préconise depuis longtemps un moindre recours à l’énergie nucléaire, pour atteindre environ 60 % à l’horizon 2030 ; cela nous paraissait un calendrier plus facile à gérer, plus raisonnable, que celui qui a été fixé par le Gouvernement de 50 % à l’horizon 2025. Nous soutenons néanmoins celui-ci, tout en étant conscients des difficultés techniques et industrielles, mais aussi sociales, qui se poseront.
Il est actuellement question du renouvellement des concessions hydrauliques : nous souhaitons fortement la préservation de ce patrimoine national. Il faut pour cela trouver les solutions juridiques appropriées ; le rapport Battistel-Straumann en a suggéré plusieurs.
Nous sommes depuis plusieurs années défavorables à la construction d’un deuxième réacteur EPR en France. Nous avons néanmoins accepté l’achèvement de la construction du premier ; il faudra tirer les leçons de cette expérience. La plus grande prudence doit être de mise, et il faudra prendre en considération les remarques du président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur la question des outils de production énergétique de très grande puissance, et sur les problèmes spécifiques posés en cas d’accident.
Nous estimons bien sûr qu’il faut donner la priorité aux questions de sûreté et de sécurité : cela n’est pas négociable, quels que soient les coûts. Nous sommes également favorables au renforcement des missions et des moyens de l’ASN, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Ces organismes doivent avoir les moyens de travailler.
S’agissant de la sous-traitance, nous estimons qu’elle doit être encadrée, notamment par une limitation des niveaux et des degrés de recours à la sous-traitance et à la prestation de services. Ce n’est d’ailleurs pas propre au nucléaire : nous avions déjà défendu cette position lorsqu’avait été établi un rapport sur la catastrophe d’AZF. Le problème apparaissait déjà clairement.
Nous souhaitons le renforcement de la filière nucléaire, qui doit être cohérente. Une partie « déconstruction-démantèlement » doit y être clairement identifiée, avec un objectif d’excellence pour la France et l’Europe, et dans un esprit de responsabilité : la France, qui a construit des centrales nucléaires hors de son territoire, doit aider à assurer la sûreté et la sécurité de ces installations, par la réglementation, mais aussi à les déconstruire et à les démanteler.
S’agissant du stockage sécurisé des déchets radioactifs, nous soutenons le projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique), tout en attendant certaines précisions essentielles. Nous estimons nécessaire une phase de pilote industriel, avec des colis bien identifiés, et notamment pas de colis bitumeux. Nous estimons aussi qu’une autorisation pour une vingtaine d’années, plus ou moins cinq, est pertinente. Une autorisation pour un siècle d’une activité qui présente de fortes incertitudes ne nous paraît pas judicieuse : une vérification de l’absence de dérives dans les conditions de stockage est nécessaire, en application des principes de précaution et de prévention.
Nous estimons également nécessaire que la gouvernance d’une installation si atypique soit citoyenne et partenariale, sur le modèle des collèges du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) – six ou « six plus un », cela reste à discuter. En tout cas, des structures comme les commissions locales d’information (CLI) ne nous paraissent pas suffisantes : elles rassemblent des communes en grand nombre, mais la société civile n’y est pas bien représentée. Pour ne pas multiplier les instances, cette gouvernance pourrait être exercée par une commission permanente du CNTE.
Enfin, nous estimons qu’une réponse sérieuse et circonstanciée doit être apportée au récent rapport de l’agence WISE-Paris sur les coûts de l’éventuelle prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Certes, ce rapport a été commandé par Greenpeace, ce qui suffit à le discréditer aux yeux de certains. Mais ce n’est pas notre cas : il est fondé sur des chiffres qui ne sont pas contestés.
M. Alexandre Grillat, secrétaire national « développement durable-énergie-logement-RSE » de la CFE-CGC. En matière de politique énergétique et de nucléaire, la CFE-CGC se veut pragmatique. Un projet de loi portant sur la transition énergétique est attendu très prochainement. Les enjeux en sont multiples, et le nucléaire constitue à notre sens un élément de solution. La transition énergétique devra être responsable, c’est-à-dire prendre en considération à la fois l’emploi, l’investissement en France, le pouvoir d’achat et la compétitivité.
Nous devons répondre à l’urgence climatique. Les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont sans appel : la lutte contre le réchauffement climatique doit être notre priorité, notre combat pour les générations futures. C’est la perspective de la COP21 qui se réunira en décembre 2015. Pour la CFE-CGC, c’est la mise en œuvre d’une stratégie « bas carbone », reposant sur un mix décarboné et diversifié, qui doit être au cœur de la transition énergétique.
La transition énergétique est aussi un enjeu économique : assurer la compétitivité énergétique du pays, c’est non seulement défendre le pouvoir d’achat des Français, mais aussi contribuer à redresser la compétitivité de notre économie – et en particulier celle des industriels électro-intensifs. Cela suppose que la transition énergétique soit la plus rationnelle possible, tant économiquement qu’industriellement, pour être aussi peu coûteuse que possible.
Bâtir une stratégie de sécurité des approvisionnements par la réduction de la consommation de matières premières et de l’importation des énergies fossiles, c’est réduire le déficit commercial du pays et contribuer à son indépendance énergétique. La crise ukrainienne nous rappelle la dimension géopolitique des questions énergétiques : la sécurité des approvisionnements énergétiques est bien un impératif stratégique.
Pour la CFE-CGC, l’impératif industriel de la transition énergétique est tout aussi crucial. Les derniers rebondissements de l’affaire Alstom ont montré l’absence dramatique de politique industrielle de l’Europe, tant dans le domaine de l’énergie que dans celui des transports ferroviaires. Soutenir les industries françaises qui sont des leaders mondiaux grâce à leur expertise technique et technologique, relancer les investissements en France, favoriser l’innovation technologique, développer de nouvelles filières industrielles : c’est ainsi seulement que la transition écologique défendra les emplois d’aujourd’hui et préparera ceux de demain, et les emplois qualifiés, à haute valeur ajoutée, qui permettront à la France de gagner dans la compétition mondiale.
La transition énergétique, c’est aussi une question de service public. En 1946, le service public a été au centre d’une aventure industrielle, sociale et politique qui a offert à la France une énergie sûre, compétitive et abordable, facteur de progrès social et économique. Aujourd’hui, le service public doit être au centre de la transition énergétique.
Car la transition énergétique, c’est aussi une question de gouvernance – qu’il s’agisse de la gouvernance de la politique énergétique ou celle des énergéticiens. En effet, la crise économique est une crise énergétique qui ne veut pas dire son nom, mais aussi une crise de gouvernance. Croire, comme beaucoup le font, que les marchés constituent le cadre nécessaire à la mise en œuvre de la transition énergétique serait une erreur. Pour financer le mur d’investissements qui est devant nous, il faudra poser la question du taux de rémunération du capital (WACC). EDF, en son temps, n’a pu financer un système électrique unique au monde, sûr et compétitif, que parce qu’il bénéficiait d’un WACC public. Ni la libre concurrence ni la logique boursière – bref, les seules règles du marché – ne semblent, à nos yeux, compatibles avec les enjeux de la transition énergétique.
La transition énergétique ne réussira que si elle suscite l’adhésion des salariés du secteur énergétique français ; elle se fera avec eux, et pas contre eux. La CFE-CGC demande donc aux pouvoirs publics de doter la transition énergétique d’une ambition sociale, en créant un collectif pour l’ensemble des salariés œuvrant à cette transition, comme avait, en 1946, été créé le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
En matière d’énergie, nous devons nous fixer plusieurs objectifs. La priorité doit être donnée à l’efficacité énergétique, passive et active, résidentielle autant qu’industrielle, voire territoriale. Cela pose la question des politiques d’urbanisme, d’habitat et de mobilité. Il faut en particulier mettre en œuvre une politique de transports qui favorise les véhicules propres. Nous devons également réduire notre consommation d’énergies fossiles fortement carbonées et utiliser un mix de production électrique décarboné, peu émetteur de CO2, diversifié et compétitif, c’est-à-dire reposant sur le nucléaire, l’hydraulique et les énergies renouvelables, dans une logique de complémentarité entre ces différentes énergies. Cela suppose que le prix du carbone soit stable et dans la mesure du possible européen.
Nous devons aussi préserver les atouts du système électrique français, dont l’organisation nationale a permis l’optimisation technique et économique – ce qui nous permet de bénéficier de tarifs bas – et la structuration de filières industrielles reconnues mondialement. Une organisation nationale est indispensable tant pour la distribution d’électricité que pour l’hydroélectricité ; l’annonce faite hier d’une organisation régionale pour l’hydroélectricité va à l’encontre d’une optimisation à l’échelle nationale, qui permet de limiter l’inflation des coûts.
Que l’on parle de compétitivité, de filières industrielles, de créations d’emplois, de valorisation internationale, ou de stratégie bas carbone, le nucléaire apporte des solutions. Il doit être au cœur de la transition énergétique.
Cela concerne le nucléaire existant comme le nucléaire futur. Car, si l’on doit comparer les coûts des différentes filières de production d’électricité, c’est au regard des services qu’elles rendent au système électrique dans son ensemble, tant économiquement que techniquement. Une centrale nucléaire est programmable et démarre quand le système électrique en a besoin, alors que les énergies renouvelables sont pour la plupart intermittentes. Pour assurer la sûreté du système électrique, il est donc indispensable de raisonner en termes de complémentarité entre les différentes sources d’énergie.
Qui dit transition dit évolution au fil de l’eau, et non révolution : le parc nucléaire existant nous permet de maîtriser le calendrier et donc de laisser le temps aux nouvelles filières industrielles d’atteindre leur maturité technique et économique, mais aussi de financer cette transition, de l’optimiser, de la rationaliser. Il faut donc prolonger la durée de vie du parc nucléaire existant, et ainsi en faire un atout pour la transition énergétique, dans le respect des prérogatives et des analyses techniques de l’ASN.
Enfin, les centrales nucléaires, fonctionnant en base, sont des infrastructures énergétiques intensément capitalistiques. Un financement de long terme est donc indispensable. Prenons l’exemple britannique : la quasi-faillite de British Energy, à la fin des années 1990, lorsque le parc nucléaire britannique dépendait entièrement du marché, comme la récente signature du « contrat de différence » ont bien montré que le nucléaire a besoin d’un cadre régulé pour s’épanouir. Or ce cadre régulé nous paraît difficilement compatible avec la logique dérégulée de la rémunération du capital introduite par la cotation en bourse des opérateurs. Fourniture en base assurant compétitivité et sûreté du système électrique, le nucléaire peut clairement être assimilé à une activité de service public.
Il ne vous a pas échappé que, depuis 2005, les dividendes servis par EDF – désormais cotée en bourse – ont fortement augmenté, sans que les augmentations tarifaires permettent de prévoir les provisions nécessaires aux investissements massifs qui seront nécessaires à l’avenir. La question du financement de la transition énergétique est donc posée. Or les contraintes sont fortes. Les tarifs ne permettent pas de couvrir les coûts, mais nous voulons aussi lutter contre la précarité énergétique et favoriser la compétitivité. Les opérateurs sont endettés, et les prix de marché sont parfois négatifs, car les règles de jeu européennes n’incitent absolument pas à l’investissement. À notre sens, il est donc indispensable d’inciter à l’investissement, et donc de limiter les dividendes versés par les opérateurs. Cela pose la question de la pertinence de la logique boursière.
Enfin, réussir la transition, c’est optimiser le système électrique. Le modèle national né en 1946 a fait ses preuves : nous appelons de nos vœux son maintien.
M. Francis Orosco, président de la fédération CFTC Chimie-Mines-Textile-Énergie. La CFTC souhaite une réduction de la part du nucléaire ; mais elle reste réaliste : il ne faut pas déstabiliser l’industrie, et notamment les industries électro-intensives dont beaucoup se sont délocalisées ou s’apprêtent à le faire. Il faudrait aussi évoquer le rôle de Bruxelles.
Les coûts bas de l’énergie sont un atout pour l’industrie comme pour le consommateur.
M. Henri Richard, conseiller technique CFTC. Je ne répéterai pas les propos du représentant de la CFE-CGC, car nous partageons l’essentiel de ses analyses.
Nous avons réfléchi à la politique des « Quatre E » : économie, énergie, emploi, écologie. Notre pays doit aujourd’hui prendre des décisions. Nous ne sommes pas opposés par principe à une réduction de la part du nucléaire, mais il faut être réaliste et s’interroger sur le calendrier. Est-il possible de prolonger la durée de vie des centrales ? Comment remplacer l’énergie nucléaire ?
La création d’emplois doit être une priorité : pour cela, il faut créer ou maintenir des filières industrielles capables d’exporter. La filière nucléaire est l’une d’elles. On ne réindustrialisera pas le pays sans une énergie bon marché. Or le nucléaire est une énergie bon marché, abondante, récurrente, et qui permet d’assurer l’indépendance de notre pays – à peu près la seule, si l’on refuse de développer les gaz de schiste.
Si l’écologie est une priorité, si nous voulons nous montrer responsables vis-à-vis des générations futures, alors il faut recourir à une énergie qui émette aussi peu de CO2 que possible : là encore, le nucléaire, qui n’en émet pas, est indispensable à l’équation.
La sûreté des installations, à laquelle nous sommes très attachés, a un coût. Mais on peut atteindre un même niveau de sûreté sans copier pour toutes les centrales existantes ce qui se fait aujourd’hui pour l’EPR – ce serait absolument irréaliste. L’ASN, organisme indépendant, vient de préciser que, à Fessenheim comme à Cattenom, la sûreté était bonne. Au passage, je note que nous nous interrogeons beaucoup sur l’EPR, alors que les Chinois ou les Anglais veulent construire de nouveaux réacteurs EPR…
L’énergie hydraulique, qui n’émet pas non plus de CO2, a été évoquée. Notre parc hydraulique est essentiel à la continuité de fonctionnement de la filière nucléaire, en permettant notamment d’assurer le refroidissement des centrales. On ne peut donc pas gérer l’avenir des concessions hydrauliques sans réfléchir aux conséquences possibles de nos actions pour le parc nucléaire.
L’avenir d’Alstom, qui est aujourd’hui en cause, est au cœur de ces questions. Le Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN) a mené une réflexion sur la construction d’une filière globale française, un « pack France all-inclusive » : Alstom en faisait partie, car il fabrique les turbines. Aujourd’hui, avec EDF, AREVA, mais aussi avec des entreprises de taille moyenne comme Assystem, et donc avec Alstom, nous pouvons vendre toute la gamme, de l’amont à l’aval. Ce sont là des emplois qui ne sont pas faciles à délocaliser. Il faut donc bien réfléchir : pour exporter, il est nécessaire d’affirmer sa confiance dans le produit que l’on veut vendre. Le meilleur vendeur du monde ne pourrait pas vendre un outil que nous-mêmes voulons détruire !
Enfin, il faut évidemment réfléchir à un mix énergétique qui réponde à nos propres préoccupations, mais il faut aussi regarder ce qui se fait à l’étranger ; or, aujourd’hui, même après Fukushima, beaucoup de pays parient sur le nucléaire, notamment le Royaume-Uni, la Russie, les pays du Moyen-Orient, le Japon même…
Nous disposons donc d’une filière qui fonctionne bien, qui crée et qui maintient des emplois techniques et à haute valeur ajoutée. Il serait dommage de l’oublier.
Mme Marie-Claire Cailletaud, membre de la Commission confédérale « Politique industrielle » de la CGT. Pour parler de la place du nucléaire dans le mix électrique, il faut repartir des besoins. C’est le contraire d’une position dogmatique qui voudrait prédéterminer une composition a priori, par exemple 50 % de nucléaire d’ici à 2025. Nous constatons le rôle central joué par l’énergie pour le développement d’un pays et de son industrie. Économiser l’énergie relève du bon sens, mais pas au point de sous-estimer les besoins de développement et la démographie dynamique du pays.
Nous sommes pour des économies d’énergie. Cela concerne en premier lieu deux secteurs : celui des transports, qui représente plus du quart de la consommation d’énergie et qui est également le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, et le résidentiel tertiaire, qui à lui seul consomme de l’ordre de 44 % de l’énergie totale. Nous regrettons le peu de place accordée jusqu’à présent à ces deux enjeux dans la préparation de la loi sur la transition énergétique. La question des transports a été évacuée ; la filière professionnelle et les financements nécessaires à l’isolation du résidentiel tertiaire restent des points durs.
Nous sommes très circonspects sur les annonces de diminution drastique de la consommation d’énergie. Ne nous trompons pas d’enjeu !
Le véritable objectif qu’il ne faut pas perdre de vue est bien celui de la diminution de l’émission de gaz à effet de serre. Si nous voulons répondre à ce défi – ce qui nous permettrait également de diminuer le déficit de notre balance commerciale, dû essentiellement à l’importation de pétrole, pour 55,5 milliards, et de gaz, pour 14 milliards, ainsi que d’améliorer notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement –, il faudra effectuer des transferts d’usage. Les baisses de la consommation observées ces dernières années ne sont dues qu’aux conséquences de la crise sur l’activité et à la disparition de l’industrie dans nos territoires. Le développement des services est également consommateur d’électricité. Prendre en compte ce double mouvement – économies d’un côté, besoins nouveaux de l’autre – implique que notre consommation d’électricité ne doit pas diminuer dans le futur, bien au contraire.
Dans ce contexte, la fixation a priori de la structure du mix énergétique et la détermination à l’horizon 2030, voire 2040, des proportions respectives des différents types d’énergie n’a pas beaucoup de sens. Nous devons nous donner du temps pour bâtir la meilleure solution possible, celle qui permettra de réduire nos émissions de CO2 à un coût acceptable, tout en préservant l’indépendance nationale et la sécurité d’approvisionnement. Aujourd’hui, aucune technologie ne peut, à elle seule, permettre de relever tous les défis ; le coût de l’énergie et l’indépendance énergétique de notre pays sont deux questions importantes. On ne peut se résigner à une hausse massive du prix de l’énergie, qui aurait des conséquences dommageables pour l’industrie comme pour les ménages. La France fournit une électricité à un prix moyen inférieur à celui de ses voisins européens. En Allemagne, le prix de l’électricité pour les particuliers est supérieur de 80 % au prix français ! Pourtant, l’énergie rentre en moyenne pour plus de 8 % dans le budget des ménages ; c’est beaucoup plus encore pour les ménages modestes. Les taxes qui frappent l’énergie sont lourdes, et elles ne peuvent se cumuler avec une imposition au titre du CO2. Le maintien de choix énergétiques assurant une énergie accessible à tous est une priorité.
Vous l’aurez compris, nous pensons que la filière nucléaire a toute sa place dans le bouquet énergétique de demain. La fermeture de la centrale de Fessenheim serait un non-sens économique, social et environnemental : il faudrait, en effet, produire par d’autres moyens plus coûteux, ou importer ; les emplois perdus ne seraient pas compensés par de nouveaux emplois liés au démantèlement, et ces emplois ne seraient, de toute façon, pas de même nature ; enfin, il y a fort à parier que la substitution ferait appel, dans le meilleur des cas, au cycle combiné gaz et plus probablement aux centrales à charbon des pays voisins, comme l’Allemagne. Nous n’osons pas croire qu’un gouvernement soucieux de sa stratégie industrielle puisse prendre une telle décision.
L’électricité d’origine nucléaire nous protège d’une libéralisation complète et sans limites, du fait du prix modéré et stable de sa production. C’est une bonne chose, quand les tenants de la concurrence veulent faire grimper les prix. Ainsi, il a fallu inventer des subterfuges, comme la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (loi NOME). Obliger l’un des producteurs à vendre un quart de sa production à un prix fixé, telle est la concurrence libre et non faussée que l’on nous impose en Europe ! Mais nous vous savons gré, monsieur le président, de vous être battu contre cette loi dans l’hémicycle et nous attendons que votre majorité, maintenant qu’elle en a le pouvoir, revienne sur ce sujet.
Pour nous, il n’y a pas de rente nucléaire. Il existe aujourd’hui un parc de réacteurs qui a été entièrement financé par EDF. Là aussi, il faut tordre le cou aux idées fausses : l’État n’a jamais financé l’installation du parc nucléaire en France ; c’est l’entreprise publique, et elle seule, qui s’en est chargée, en recourant pendant plusieurs années à des emprunts sur les marchés financiers internationaux, sur injonction de l’État. Si elle a bénéficié des acquis de la recherche publique en la matière, elle a en contrepartie subventionné la filière et la recherche elle-même ; par exemple, la filière est le principal financeur du CEA, via les dividendes versés par AREVA. De surcroît, la recherche fondamentale ne peut se cloisonner ; le web est né au CERN, internet au département de la défense américain. Rappelons également que le nucléaire a des applications médicales – nous pourrions ici évoquer la fermeture du réacteur Osiris.
Les marges financières dégagées dans le secteur de l’énergie doivent pouvoir y retourner pour financer le renouvellement de l’appareil productif et pour permettre d’offrir des prix attractifs, qui bénéficieront aux usagers industriels et particuliers, et d’augmenter les salaires.
Permettez-nous d’insister ici sur un sujet central et bien maltraité : celui de la recherche et de l’ingénierie, pour lequel notre pays dispose pourtant de compétences reconnues.
En ce qui concerne les perspectives de structuration de la filière nucléaire, rappelons que, à la suite du moratoire sur la construction de tranches nucléaires en France dans les années 1990-2000, la filière a subi de nombreuses pertes d’emplois et donc de compétences, ainsi que d’importants désinvestissements industriels : la filière dépendait fortement de la sidérurgie et a subi de plein fouet les coupes claires faites dans cette branche ; les investissements industriels ont été gelés, des sites fermés, et les sous-traitants, privés de commandes ont été, pour beaucoup, conduits à se reconvertir ou à disparaître. La forte réduction des effectifs s’est accompagnée d’une énorme perte de compétences. La politique menée alors a été combattue par les salariés et les syndicats CGT des sites menacés ou fermés : ceux-ci ont agi pour défendre leurs emplois et la filière industrielle. En quinze ans, la France avait réussi à dilapider l’avance acquise dans cette technologie.
Faire abstraction des réalités techniques et industrielles, c’est s’exposer à faire de mauvais choix. Nous l’avons vécu pour Superphénix, nous le vivons en ce moment pour l’EPR. Nous espérons que l’histoire ne se répétera pas.
Les choix politiques qui ont conduit à des choix coûteux et peu efficients, que les Allemands n’ont au demeurant pas assumés, la désindustrialisation dramatique de notre pays, les pertes de compétence y compris en matière de gestion de grands chantiers, la sous-traitance exacerbée, la dégradation de la qualité de travail du bétonneur sont autant d’éléments qui expliquent les difficultés dans le déroulement du chantier de l’EPR.
Une prise de conscience semble s’être effectuée. Le CSFN pourrait être un lieu de mise en cohérence. Mais constatons quand même que l’État a la main sur les principales entreprises composant cette filière. Nous considérons que la filière nucléaire française doit s’articuler autour du CEA pour la conception des nouvelles filières, et des entreprises EDF, AREVA et Alstom, chacune jouant son rôle dans le développement de projets industriels puis dans l’exploitation des centrales et le cycle du combustible. AREVA a des compétences uniques dans le domaine du cycle du combustible et de la construction de la chaudière nucléaire, comme Alstom pour le groupe turboalternateur. EDF est l’exploitant du parc nucléaire ; il est aussi responsable de la conception d’ensemble des tranches, de leur construction et de leur mise en service industriel puis de leur exploitation en fonctionnement ; enfin, il doit s’efforcer de prévenir les accidents.
La loi rend l’exploitant de la centrale responsable de la sûreté. La CGT considère que le caractère public d’EDF est une condition fondamentale de l’acceptabilité du nucléaire dans notre pays.
Nous proposons également que les projets à l’exportation puissent être portés au travers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) entre les entreprises de la filière nucléaire française, afin de prendre en compte tous les cas existants en fonction des pays et des besoins et de tirer les leçons des difficultés rencontrées. L’expertise de l’autorité de sûreté française doit être prise en considération, sans se substituer à celle du pays. La compétence de l’ASN lui permet en effet de disposer d’une audience internationale.
L’État doit continuer de maîtriser la filière, car c’est la condition pour maîtriser les coûts, et permettre des tarifs les plus bas possibles. Redisons-le, l’acceptabilité du nucléaire est en partie due à sa maîtrise publique – c’est un point fondamental pour la CGT. Il est donc impératif d’écarter toutes les privatisations envisagées et l’idée de tout meccano industriel basé sur la concurrence. La proposition de pôle public de l’énergie portée par la CGT prend ici tout son sens, puisqu’elle permet de coordonner et de fédérer toutes les entreprises du secteur, y compris les sous-traitants, afin de mettre en cohérence les compétences et d’utiliser au mieux nos ressources humaines et matérielles. Le pôle public a pour vocation de placer l’usager, le citoyen et les salariés au cœur de son processus de concertation et de décision.
Votre troisième question porte sur les relations entre les grands exploitants nucléaires et leurs prestataires, notamment dans la perspective de la protection des travailleurs face au risque. La CGT s’est toujours impliquée très activement en la matière. En particulier, elle a considéré que la question des FSOH (facteurs sociaux, organisationnels et humains) était au cœur de la sûreté nucléaire. C’est grâce à son intervention – notamment lors d’une rencontre entre le secrétaire général de l’époque, Bernard Thibault, et la ministre alors chargée du dossier, Nathalie Kosciusko-Morizet – que les évaluations complémentaires de sûreté demandées après la catastrophe de Fukushima, qui devaient au départ porter exclusivement sur des aspects techniques, ont été étendues aux questions liées aux facteurs humains, en prenant en considération l’influence décisive des travailleurs en situation de crise comme en situation normale. La CGT se bat depuis longtemps pour la ré-internalisation des activités abusivement sous-traitées, et pour que les milliers d’ouvriers, techniciens, ingénieurs travaillant dans la sous-traitance, souvent hautement qualifiés, puissent bénéficier du même niveau de garanties que les personnels statutaires. Les représentants de la CGT que vous avez auditionnés sur le sujet ont pu développer plus en détail notre position.
S’agissant enfin de la question des relations entre EDF et l’État en matière industrielle et financière, nous estimons que l’État ne joue pas son rôle dans le secteur de l’énergie, où il dispose d’un réel pouvoir. Il ne joue pas son rôle d’actionnaire public dans les entreprises concernées : c’est le cas pour GDF-Suez, avec la non-intervention dans le bradage des actifs historiques de GDF ; c’est le cas pour EDF où les équilibres budgétaires de l’État passent avant toute considération économique et industrielle. Non seulement l’État ne joue pas son rôle de stratège et de planificateur, de pilote de la filière industrielle, mais il se comporte comme le premier actionnaire venu en calant ses exigences sur celles des actionnaires privés minoritaires.
Alors qu’EDF est déjà l’un des premiers contributeurs à l’impôt sur les sociétés, on lui demande de verser de copieux dividendes. N’y a-t-il pas mieux à faire avec ces milliards ? Ne vaudrait-il pas mieux investir dans les réseaux et les équipements, limiter les hausses pour les particuliers, réduire les factures des industries ?
L’économie du secteur énergétique est en plein bouleversement. Les investissements à réaliser pour financer la transition énergétique sont considérables. Il est donc grand temps aujourd’hui de remettre les questions essentielles au centre du débat et de penser vraiment sur le long terme, en contestant la croyance aveugle dans la capacité du marché à envoyer les signaux nécessaires aux investissements. La CGT estime urgent de bousculer de fond en comble les dogmes qui corsètent chaque jour un peu plus le développement énergétique de l’Europe et menacent gravement l’efficacité de nombreux secteurs industriels qui délocalisent un à un pour des lieux plus accueillants.
Nombre d’exemples montrent que les investissements fondés sur une régulation publique ou des contrats de long terme sont les seuls à survivre à la logique de marché.
Plutôt que de s’acharner à offrir aux entreprises de coûteux allégements de cotisations sociales, le gouvernement serait bien inspiré de proposer au pays et aux entreprises un autre pacte, un pacte de sécurité et de compétitivité énergétique qui s’articulerait autour de cinq objectifs : la garantie aux entreprises, et notamment à celles dont les coûts de production dépendent fortement du prix de l’énergie, de prix plus attractifs ; l’assurance pour les usagers de bénéficier d’un tarif réglementé maîtrisé et, pour les précaires énergétiques, de tarifs de première nécessité plus protecteurs et plus efficaces ; le développement de canaux de financement spécifiques des investissements dans les filières énergétiques, dont la filière nucléaire ; la recherche d’une plus grande efficacité des mécanismes de soutien au développement des énergies renouvelables ; la mise en place de mécanismes de financement pour la rénovation énergétique du bâti existant.
Cet effort renouvelé, associé à des coopérations européennes, doit pouvoir s’appuyer sur un pôle public de l’énergie – revendication que la CGT met en avant depuis plusieurs années. Nous sommes également favorables à la mise en place d’une Agence européenne de l’énergie.
M. Jacky Chorin, secrétaire fédéral FO Énergie et mines. La question de l’électricité et de son coût est centrale pour les citoyens – qui pensent à leur pouvoir d’achat, mais aussi à l’emploi, et en particulier, mais pas uniquement, aux risques de délocalisation des entreprises électro-intensives.
Comme nous l’avons déjà indiqué dans plusieurs instances, FO aborde les questions énergétiques avec pragmatisme et sans a priori, en partant du mix électrique actuel, des besoins et des investissements que la nation, à travers ses entreprises nationales, a déjà consentis et qu’il s’agit de valoriser au mieux. Gardons-nous, en cette période délicate économiquement, de toute prise de position hasardeuse.
Dans ce cadre, FO soutient l’usage de l’énergie nucléaire dès lors que plusieurs conditions sont réunies : le respect de règles de sûreté exigeantes ; sa gestion par des entreprises publiques et avec des salariés bénéficiant d’une protection sociale de haut niveau ; sa contribution à la protection du pouvoir d’achat des ménages et à l’emploi dans les entreprises – le prix du kilowattheure doit rester parmi les moins chers d’Europe ; enfin, sa contribution à une réduction de l’émission de CO2, enjeu majeur pour l’avenir de la planète. Notre usage de l’énergie nucléaire fait de la production d’électricité française l’une des moins carbonées d’Europe. Ne boudons pas notre plaisir : la France est en la matière un pays bien plus vertueux que l’Allemagne.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas étonnant que l’offensive des opposants au nucléaire se soit déplacée sur la question du coût du nucléaire, qui aurait été selon eux sous-évalué. En réalité, les travaux menés notamment par la Cour des comptes ont fait justice de ces allégations.
Forte de ces observations, FO considère que la question de l’énergie doit être posée dans sa globalité. Dans la mesure où la dépendance aux énergies fossiles est équivalente au déficit commercial de la France et parce qu’elle représente près des deux tiers de l’énergie consommée, il y a un enjeu majeur à décarboner notre économie. Cela va nécessairement se traduire par une augmentation de la part de l’électricité dans le mix énergétique : il faut prévoir des substitutions d’usage, par exemple une utilisation accrue de véhicules électriques. Il faut aussi tenir compte de la croissance naturelle des besoins en électricité, due à certaines utilisations en forte croissance – data centers, par exemple – et à la croissance naturelle de la population. Dans ces conditions, prévoir un volume de part du nucléaire à l’horizon 2025 ne nous paraît pas sérieux. Donner à l’État la possibilité de fermer des installations jugées sûres par une autorité dont l’indépendance n’est pas contestée, à seule fin de respecter un ratio déterminé de façon aussi arbitraire, crée une instabilité juridique préjudiciable non seulement à l’ensemble de la filière, mais à la nation elle-même. Nous nous opposons donc fermement à la décision de fermeture de Fessenheim. Nous considérons au contraire que, sous la réserve notamment que les conditions de sûreté continuent d’être remplies, la prolongation de la durée de vie des centrales est une bonne solution pour le pays.
La question des relations actuelles, notamment financières, entre l’État et EDF, qui est l’une des autres questions posées, démontre, à nos yeux, l’incohérence d’une politique publique qui, d’un côté, maintient EDF dans le monde du CAC 40 avec ce que cela implique en termes d’exigences exorbitantes de versement de dividendes – alors même que d’importants investissements seront bientôt nécessaires – et, de l’autre, prend des décisions qui ont des conséquences très importantes pour ses résultats. La loi NOME oblige EDF à aider ses concurrents à lui prendre des clients, ce qui est pour le moins baroque au regard des règles de la concurrence.
S’agissant des concessions hydrauliques, la ministre a annoncé hier que l’État réfléchit à la création de sociétés d’économie mixte – je note qu’elle n’en avait même pas parlé le matin même en CNTE. Nous y sommes opposés, ainsi qu’à l’introduction de la concurrence : nous continuons à militer pour une prolongation de la durée des concessions.
Ces deux exemples montrent la contradiction entre des politiques pourtant publiques qui exigent des taux de rentabilité exorbitants, et des prises de décisions sans concertation qui affectent l’entreprise.
L’entrée en bourse d’EDF – justement critiquée par l’opposition devenue aujourd’hui majorité – est un échec. Elle rend l’action de l’État envers EDF encore plus illisible pour les salariés qui ne savent plus ce que l’État attend d’eux. Nous demandons donc qu’EDF sorte de la bourse.
S’agissant de la structuration de la filière nucléaire, FO se félicite des travaux menés au sein du CSFN dont elle avait souhaité la création. Ces travaux ont notamment montré la nécessité d’un fort renouvellement de compétences à mener d’ici à 2020 pour quelque 110 000 emplois.
Nous aurions pu aborder de nombreux autres sujets. Nous estimons notamment qu’il est nécessaire d’accroître fortement notre effort de recherche en matière de stockage de l’électricité. Nous aurions également pu parler de l’efficacité énergétique, que nous opposons à la sobriété : pour nous, l’efficacité, à laquelle nous sommes favorables, c’est d’atteindre le même niveau de confort. Mais nous remarquons les difficultés de financement, en particulier en matière de rénovation thermique, sur lesquelles nous butons depuis plusieurs années. Nous aurions encore pu parler de la lutte contre la précarité énergétique.
M. le président François Brottes. S’agissant de la loi NOME, je voudrais rappeler, pour être juste avec la majorité de l’époque, que, en raison des contraintes européennes, la France avait le choix entre une partition du parc nucléaire et la mise à disposition d’une partie de la production d’un monopole public aux concurrents. On peut se demander s’il existait une solution satisfaisante…
M. Jacky Chorin. Fallait-il accepter cette alternative, en refusant de se battre contre la Commission européenne et contre les principes qui fondent son action ?
M. le président François Brottes. En l’occurrence, il s’agissait d’une directive, donc d’une loi, qui s’applique. Bien sûr, on peut changer les lois, perspective à laquelle certains songent actuellement !
M. Denis Baupin, rapporteur. Vous vous êtes exprimés sur l’engagement présidentiel et gouvernemental d’atteindre le mix énergétique à l’horizon 2025. Puisque nous aurons à légiférer sur cet engagement dans les prochains mois, nous aimerions connaître la façon dont se compose, à vos yeux, un mix électrique équilibré.
N’y a-t-il pas une contradiction, dans vos propos, entre l’intérêt du nucléaire pour le prix de l’électricité et l’impact du mur d’investissements sur les coûts ? Avez-vous des évaluations chiffrées à ce sujet ? Toute prolongation de la durée de vie des réacteurs au-delà de quarante ans n’est envisageable, avez-vous précisé, que sous réserve de la décision de l’ASN : s’agit-il d’une précaution oratoire ? Si tant est que cette hypothèse soit crédible, les coûts qu’elle implique ne conduisent-ils pas à s’interroger sur la compétitivité de l’énergie nucléaire ? Si, au contraire, la décision est prise de fermer certains réacteurs, quelles seraient les alternatives ?
Aucun d’entre vous n’a évoqué l’aval du cycle, en d’autres termes le retraitement du MOX. Dans certains pays, cette activité est intégrée dans le cycle de la filière nucléaire ; dans d’autres, elle ne l’est pas. Quelle est votre propre analyse ? Certains, par exemple, prétendent que la poursuite des activités de retraitement n’a de sens que dans l’hypothèse d’une quatrième génération de réacteurs.
Enfin, chaque entreprise dispose de son propre comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Êtes-vous favorables à des CHSCT de site, communs aux salariés d’EDF et des entreprises sous-traitantes ?
M. le président François Brottes. Certains d’entre vous s’opposent à l’idée d’un deuxième EPR, en tout cas avant d’établir un bilan du premier. Est-ce à dire que vos préférences vont vers ATMEA ?
J’ai bien compris vos arguments sur la territorialisation de la gestion des barrages. D’une façon générale, la décentralisation des réseaux suscite de nombreux débats. De votre point de vue, qu’est-ce qui peut et ne peut pas être régionalisé ?
Quant aux tarifs, ils traduisent et couvrent les coûts ; si bien qu’il faut soit que les coûts diminuent, soit que la facture du consommateur augmente. EDF dispose-t-elle, selon vous, de marges de manœuvre pour orienter les coûts à la baisse ? Nous ne parvenons pas à obtenir les détails financiers du grand carénage, dont le coût global s’échelonnerait de 50 à 55 milliards d’euros – un rapport situe même l’addition bien au-delà. Avez-vous des éléments d’information ?
Un débat s’est fait jour aussi, au cours de nos travaux, sur la réversibilité des déchets, par laquelle le législateur entendait la possibilité d’extraire les déchets au cas où une technologie de retraitement apparaît. Quel est votre point de vue ?
Enfin, aucun réacteur n’est éternel – même si d’aucuns n’ont pas la même conception de l’éternité que d’autres… La décision d’arrêter un réacteur ne dépend-elle que de l’ASN ? Des considérations économiques ou financières doivent-elles entrer en jeu ? Il serait bon de dédramatiser le sujet, car nous devrons forcément y faire face un jour, et pas seulement pour Fessenheim.
M. Éric Devy, délégué syndical central FO. En l’absence de scénarios sur le niveau de consommation à une échéance donnée, on ne peut se prononcer sur le bon mix. Dans une optique comparative, le coût du combustible doit aussi être pris en compte. Que représenteraient, à titre d’hypothèse, les parts respectives des coûts du gaz, du charbon et du combustible nucléaire dans une centrale de production électrique ? Si, d’autre part, le combustible nucléaire représente 25 % du coût de production de la centrale, mais que l’uranium n’entre dans le coût de ce combustible que pour 10 %, le coût de production n’augmentera pas à proportion du prix de l’uranium. Pour la première fois, des électriciens américains ont fermé des centrales, non parce qu’elles étaient déficientes, mais parce que, compte tenu de l’exploitation du gaz de schiste, elles n’étaient plus rentables. Des chutes de neige, cet hiver, ont fait croître la demande dans certaines régions des États-Unis, et donc le prix de l’électricité, librement fixé par le marché. Bref, sur quel scénario se fonder ? Celui de la décroissance ou celui de l’efficacité ? Pour notre part, nous privilégions le second. Dès lors, la question est de déterminer, à partir des hypothèses retenues, la composition du mix de production de base. Un électricien optera toujours pour la solution la moins chère, donc pour l’hydraulique d’abord, et le nucléaire ensuite.
On peut réfléchir aux alternatives, comme les bioénergies, mais elles nécessitent des filières d’approvisionnement. Confieriez-vous le développement de ces sources d’énergie à l’opérateur national, qui les produit en masse, ou aux collectivités ?
M. le rapporteur. Ce sont vos réponses, non vos questions, qui nous intéressent.
M. Éric Devy. Le nucléaire a d’abord vocation à assurer la production de base. Pourquoi ne pas demander à l’opérateur, pendant les périodes creuses, d’utiliser l’énergie disponible pour procéder à des électrolyses de l’eau, afin de stocker l’hydrogène ainsi obtenu ? Certaines entreprises, dont celle à laquelle j’appartiens, développent du « charbon vert », biomasse allégée – et ce faisant transportable – par l’extraction de son eau, que l’on peut ainsi utiliser dans les centrales à charbon.
M. Jacky Chorin. Le mix optimal est déterminé par les besoins, ainsi qu’on l’a rappelé, mais aussi par la demande, que l’on présume souvent à la baisse dans le débat sur la transition énergétique – sans toujours se demander, d’ailleurs, si l’opinion l’accepterait. En tout état de cause, on fait toujours comme si demande d’électricité et demande d’énergie devaient suivre la même courbe, en omettant les phénomènes de substitution. Il est absurde, à notre sens, de spéculer sur un mix électrique indépendamment du mix énergétique, et sans avoir de vision sur ce que sera la demande d’électricité en 2025. Comme vous l’avez suggéré, monsieur le président, la durée de vie des centrales dépendra des décisions de l’ASN et des arbitrages économiques internes à l’entreprise. Que l’État décide, au nom d’un mix gravé dans le marbre, d’arrêter certains réacteurs aurait peut-être des avantages en termes d’image politique, mais cela nous paraît juridiquement incertain et, pour tout dire, inconstitutionnel. Si l’on envisage le grand carénage, c’est bien parce que l’on estime qu’il permettra de faire fonctionner les centrales pendant une certaine durée.
La décentralisation des réseaux mettrait fin à la péréquation des tarifs, donc au principe républicain de l’égalité de traitement entre les usagers. Certains élus urbains y sont peut-être favorables, mais sans doute pas les élus ruraux. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), d’ailleurs, a revu sa position sur le sujet. Veut-on faire prévaloir des principes de service public ou d’autres principes ? Il faut une vision claire.
M. Alexandre Grillat. La logique qui consiste à fixer une date, en l’occurrence 2025 – pourquoi pas 2030 ? –, paraît aléatoire, et en tout cas peu évidente sur le plan économique et industriel. Comme le soulignait M. Chorin, le premier déterminant est la demande d’électricité, qu’il faut en effet découpler de la demande d’énergie, pour peu que la décarbonation reste la priorité. Dans l’objectif de réduire à 50 % la part du nucléaire, il faut bien que le taux se rapporte à quelque chose, en l’occurrence à la demande d’électricité ; si bien qu’assigner un tel objectif sans examiner précisément tous les scénarios – quitte à revoir ceux, un peu orientés, qui avaient été mis sur la table à l’occasion du débat national sur la transition énergétique – paraît peu réaliste.
La réussite de la transition énergétique passe par une bonne gestion du calendrier. Il faut se donner le temps de disposer de filières industrielles matures, aux plans économique et technologique, pour opérer, de manière progressive, la diversification du mix électrique. L’objectif fixé pour 2025 ne répond pas à cette exigence. Notre parc électronucléaire, destiné à la production de base, s’est aussi développé, dans les années soixante-dix à quatre-vingt-dix, pour exporter de l’électricité, au bénéfice de la balance commerciale. En production de base, le stockage de l’électricité est possible avec les stations de transfert d’énergie par pompage, les STEP ; et c’est la complémentarité entre le nucléaire de base et l’hydraulique de pointe qui permet d’assurer la sûreté du système électrique. Mon collègue de la CFTC évoquait l’utilisation de l’eau pour le refroidissement des centrales ; il faut aussi rappeler que les ouvrages hydrauliques de chute permettent, en cas de « black-out », le renvoi de tension vers les centrales nucléaires. Bref, le nucléaire et l’hydraulique sont parfaitement complémentaires.
Le bon mix, à nos yeux, doit d’abord être décarboné ; il dépend de la demande d’électricité, elle-même liée aux effets de substitution ; quant à la date de 2025, elle nous paraît correspondre, je le répète, à un dogme politique plutôt qu’à une réalité économique et industrielle.
Le parc nucléaire n’est pas vieux, mais il vieillit et réclame donc des investissements. Dans la mesure où les tarifs doivent couvrir les coûts, ils ne peuvent qu’augmenter.
M. le président François Brottes. Que faites-vous de l’amortissement ?
M. Alexandre Grillat. Le coût du grand carénage impose, pour réduire la pression sur la facture, de donner la priorité à l’efficacité énergétique.
Par ailleurs, le nucléaire doit être envisagé, non dans l’absolu, mais par comparaison. Il est un moyen de production programmable ; les autres énergies renouvelables, qui lui sont souvent comparées au regard de leur coût, ne rendent pas les mêmes services économiques et techniques au système électrique. Toute comparaison entre les coûts doit être appréciée en fonction des services rendus.
M. le rapporteur. Si l’ASN estime que tel ou tel réacteur doit fermer, quelles sont, à vos yeux, les alternatives prioritaires ?
M. Éric Devy. Pour répondre à votre question sur l’amortissement, monsieur le président, il faut savoir que le coût de remise en fonctionnement de quatre générateurs de vapeur avoisine les 400 millions d’euros, contre plus de 3 milliards pour la construction d’un nouveau générateur. Le générateur peut alors repartir pour vingt à quarante ans, sous réserve des visites décennales de l’ASN. Arrêter une centrale avant le terme possible suppose donc de nouveaux investissements ; on peut alors les consacrer au développement d’une nouvelle génération, par exemple un nouvel EPR – ATMEA 1 n’est pas, me semble-t-il, le modèle privilégié par EDF.
M. le président François Brottes. En l’espèce, je parlais de l’existant.
M. Éric Devy. Une ancienne centrale peut être remplacée par une nouvelle, mais seulement si le site le permet. Un « Flamanville 5 » est impossible – même le 4 sera difficile –, car la centrale est située au pied d’une falaise. Si l’ASN se prononçait pour la fermeture d’une centrale, le remplacement de celle-ci par une autre, ou le choix d’une solution alternative, relèvent d’une décision à la fois économique et politique. Importer du gaz ou du charbon n’est évidemment pas sans effet sur la balance commerciale.
Mme Marie-Claire Cailletaud. Il faudra bien entendu fermer les centrales nucléaires un jour ou l’autre : nous n’avons aucun état d’âme à ce sujet. La fermeture peut intervenir immédiatement si l’ASN le juge nécessaire ; quant à la prolongation, elle doit être envisagée en fonction des investissements : s’ils ne sont pas assez rentables, il faut fermer la centrale. La décision, pour peu qu’elle ait été anticipée pour l’appareil productif comme pour les salariés, ne nous pose en elle-même aucun problème.
Par hypothèse, on remplacerait une centrale par ce qui se fait de mieux au moment considéré. Toute solution doit être appréciée en fonction de trois critères, dont aucun ne doit manquer : le critère social, le critère environnemental et le critère économique. C’est pourquoi il nous paraît impossible de fixer a priori les pourcentages des composants d’un mix électrique ou énergétique. Ces mix dépendent de beaucoup de facteurs, à commencer par le financement de la recherche, qui à nos yeux reste à un niveau très insuffisant. Un stockage massif de l’électricité à moindre coût, par exemple, ferait changer de paradigme.
Tout le monde parle d’efficacité énergétique, mais nul n’est capable de dire à quel rythme pourront être mises en œuvre les actions qui s’y rapportent. La facture de la rénovation thermique des logements, mesure annoncée par le Président de la République, se situe dans une fourchette de 10 à 15 milliards d’euros par an. Où trouver cet argent ? Personne ne le sait. Comment affirmer que l’on pourra isoler de 500 000 à 1 million de logements par an, alors que 100 000 seulement ont pu l’être dans le cadre du Grenelle ? Le mix doit évoluer en fonction des deux critères que sont la réponse aux besoins et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
M. Alexandre Grillat. La fermeture d’une centrale sera anticipée dans la mesure du possible ; c’est l’opérateur qui devra y faire face, que cette décision vienne de l’ASN ou qu’il l’ait prise lui-même, au vu d’investissements jugés non rentables. Son choix dépendra alors de multiples facteurs, tous appréciés à l’instant t : sécurisation du portefeuille de clients, meilleure technologie disponible, signal prix donné à l’échelle française ou européenne, coûts des différentes technologies, prix du carbone.
M. le rapporteur. Il y a une légère contradiction entre le vœu d’une gestion publique et celui de s’en remettre au marché. L’idée est de définir une stratégie énergétique ; pour ce faire, nous aimerions connaître les pistes préconisées par vos organisations respectives.
M. Alexandre Grillat. J’évoquais seulement le scénario de fermeture d’une centrale. Pour la CFE-CGC, le mix doit être le plus diversifié et le plus équilibré possible, en fonction de la maturité des technologies à l’instant t. La fixation a priori d’un chiffre – 50 % – à une échéance donnée est contraire à la réalité industrielle et économique du secteur.
M. Henri Richard. Tout repose sur les « Quatre E » : économie, énergie, emploi et énergie. L’objectif de réduire à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025 n’a pas de sens, car il implique des décisions arbitraires, indépendantes des avis de l’ASN et de l’état réel des installations. La composition du mix, d’ici à 2025, 2030 ou 2040, suppose de réfléchir en termes d’économie, d’emploi et d’investissements ; cela relève, en somme, de la gestion prévisionnelle des moyens de production. Il faut aussi s’interroger sur l’électricité et ses usages futurs. Comment développer les véhicules électriques sans électricité nucléaire ? On n’entend pas brûler du pétrole, j’imagine, pour produire de l’électricité… Alimenter des véhicules décarbonés par des unités qui émettent du CO2 n’aurait aucun sens. Si les autorités politiques entendent, par exemple, développer les transports en commun dans les villes – tramways, métros ou bus électriques –, bref, réduire les émissions de CO2, il faut bien qu’elles prennent des décisions pragmatiques.
Notre vision de l’écologie est rationnelle et globale. Importer des matières premières pour produire de l’énergie, par exemple, génère de la pollution à cause du transport. Le mix énergétique doit tenir compte de plusieurs critères, parmi lesquels l’emploi. On ne peut prendre une décision qui nous engage sur quarante ans en se fondant seulement sur le coût, quand bien même, au regard de ce facteur, telle ou telle solution apparaît plus avantageuse que le nucléaire à un moment donné. La filière nucléaire fut créée, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, pour lever des incertitudes sur les coûts à long terme, créer des emplois et assurer l’indépendance énergétique. Il revient au politique de décider si nous continuons ou non dans cette voie. Fixer l’objectif de 50 % de nucléaire en 2025 n’est ni réaliste ni rationnel ; et la France, aujourd’hui, n’a pas les moyens de ne pas être rationnelle.
J’en viens au rapport coût/investissements. Par définition, l’ASN ne dira jamais, car il y va de son indépendance, qu’elle n’envisage pas l’hypothèse d’une fermeture de centrale ; en revanche, elle peut conditionner la prolongation à des investissements et à l’optimisation de systèmes de sûreté. L’hypothèse d’une durée de quarante ans suppose que l’on en reste aux modèles en construction, comme l’EPR ou ATMEA ; celle d’une durée de soixante ans – pas irréaliste au vu des tranches de 1 300 mégawatts, voire de 900 – implique le passage à une nouvelle génération de réacteurs.
Vous avez également évoqué l’aval. On impose aujourd’hui à l’opérateur de mettre de l’argent en réserve pour faire face aux futurs démantèlements. On peut y voir une sécurité, mais les 10 milliards d’euros bloqués en vue d’un démantèlement hypothétique dans trente ans ne seraient-ils pas mieux utilisés dans la recherche de solutions innovantes, en matière de démantèlement, justement, ou de retraitement des déchets ? Alors que l’État, dit-on, n’a pas les moyens d’investir dans la recherche, la Russie consacre des sommes considérables à la conception de centrales intégrant le retraitement. S’agissant des déchets, monsieur le président, la réversibilité passe par des méthodes de retraitement nouvelles ; d’où la nécessité de la recherche et développement.
Mme Marie-Claire Cailletaud. L’augmentation des coûts tient à plusieurs facteurs. Les énergies renouvelables sont assurément des voies d’avenir, mais la façon dont on les développe en France génère des bulles spéculatives. Le torchage du gaz ou l’eau non turbinée – au profit des énergies fatales et du photovoltaïque venu d’Allemagne – sont autant de gâchis qui tirent les coûts à la hausse. Obliger les entreprises à filialiser certaines activités, touchant par exemple aux systèmes d’information, a un coût qui, au final, se répercute sur les prix. La déréglementation désoptimise le système, et des voix commencent à s’élever pour la dénoncer, au niveau européen et parmi les industriels. Le temps est donc venu de faire une pause et d’en dresser le bilan ; pour notre part, nous estimons qu’elle a détruit des emplois et augmenté les coûts : le Gouvernement français doit aller porter ce message à Bruxelles, comme il aurait dû le faire à l’époque de la loi NOME. C’est au nom de la même logique que nous sommes, nous aussi, résolument opposés à la privatisation des concessions hydrauliques. Une autre politique est possible, pour développer des coopérations industrielles au niveau européen et une stratégie industrielle en France.
M. Alexandre Grillat. La maîtrise du calendrier est indispensable. Nous sommes convaincus que le nucléaire aura toujours sa place au sein du mix électrique à l’horizon 2050, mais avec la quatrième génération de réacteurs.
Quant à la décentralisation des réseaux, la CFE-CGC estime que l’échelon local a toute sa pertinence dans certains domaines, tels que les énergies thermiques renouvelables – biomasse, réseaux de chaleur ou chaufferies au bois –, même si cela pose la question de la disponibilité des ressources et des conflits d’usage. De même, les politiques de mobilité, d’habitat ou d’urbanisme visant à l’efficacité énergétique, ou encore la « consom’action », n’ont de sens qu’à l’échelon local. En revanche, la dimension nationale est nécessaire pour la péréquation des tarifs de l’électricité, socle républicain et garantie d’égalité entre les territoires, et pour l’optimisation technique et économique, grâce à laquelle les coûts peuvent être contenus. Bien entendu, cela n’empêche pas d’améliorer la concertation entre opérateurs nationaux et acteurs locaux, dans les domaines de l’électricité et du gaz, afin de répondre au mieux aux besoins des territoires.
Quant à la régionalisation des réseaux hydrauliques, nous estimons, nous aussi, qu’elle serait un non-sens économique et industriel.
M. Francis Orosco. L’Allemagne, que l’on cite en exemple, a été obligée de rouvrir ses centrales à charbon après avoir renoncé au nucléaire. Comme l’ont souligné mes collègues, le nucléaire a toute sa place dans l’industrie. Nous sommes également en phase sur la fermeture de certaines centrales ; d’où la nécessité de mettre en route l’EPR, qui pourrait en remplacer une ou deux.
En ce qui concerne la biomasse, la centrale de Gardanne, par exemple, possède une tranche au charbon de 600 mégawatts. Il y a bien d’autres projets, qu’il faut mettre en œuvre, car, pour se réindustrialiser, selon l’objectif annoncé par le Président de la République, la France aura besoin d’énergie. Celle dont nous disposons aujourd’hui suffit au regard de la dimension de notre appareil industriel, mais, si celui-ci se développe, nous aurons besoin du nucléaire.
La CFTC soutient, par ailleurs, l’idée de CHSCT de site, car ce n’est pas à l’échelle nationale ou régionale que les problèmes des salariés peuvent être vraiment pris en compte.
Il est difficile de se faire un avis sur la fermeture de sites en l’absence d’alternative réelle. Le démantèlement de Creys-Malville, suite à sa fermeture anticipée, s’est avéré et s’avère encore très coûteux.
Je suis sceptique en ce qui concerne la décentralisation des réseaux : seule une politique nationale est en mesure de garantir les coûts de l’énergie et de préserver notre industrie. Je suis également en phase avec mes collègues sur les concessions hydrauliques, qui doivent rester dans le giron public si nous voulons conserver la maîtrise en ce domaine.
M. Henri Richard. Remplacer le nucléaire par des énergies fossiles aurait aussi, ne l’oublions pas, un impact sanitaire, et donc un coût. Notre vision sur le mix, je le répète, est donc globale.
La construction d’un deuxième EPR n’est, à nos yeux, pas un tabou ; au reste, si l’on envisage d’en construire hors de nos frontières, c’est bien que l’on croit au projet. La priorité, cependant, reste de trouver les moyens de prolonger la vie des réacteurs actuels, pour une durée de quarante à soixante ans.
Sur l’aval, les investissements en recherche et développement pourraient apporter une solution au problème de la réversibilité des déchets, comme je l’ai dit.
Nous sommes favorables aux CHSCT de site. Sur la prise en compte de la sous-traitance, des travaux ont été menés au sein du CSFN, avec le GT1 ; une réunion s’est d’ailleurs tenue hier sur le sujet.
La CFTC soutient le lancement d’une quatrième génération de réacteurs à un horizon de vingt ou trente ans. ATMEA est un projet commun à AREVA et Mitsubishi Heavy Industries ; GDF Suez voulait en être le premier constructeur sur le territoire, mais le législateur l’a refusé, estimant que ce devait être EDF.
Cette dernière développe actuellement un autre projet, en partenariat avec la Chine ; d’aucuns s’y opposent, estimant qu’il implique un transfert de technologie et d’ingénierie. Cependant, aujourd’hui, seules la Russie, la Corée du Sud, la Chine et la France construisent des réacteurs nucléaires. La Russie et la Corée du Sud le font avec d’autres technologies, si bien que notre pays a, depuis l’époque du général de Gaulle, noué une alliance avec la Chine, désormais premier constructeur mondial. Il faut donc choisir entre laisser la Chine assurer seule sa production ou l’y aider, en récupérant une part du marché. Certes, les modèles construits dans le cadre de ce partenariat concurrencent l’EPR, mais ils peuvent répondre aux besoins d’un certain nombre de pays qui ne possèdent pas les réseaux adaptés à l’EPR, dont la capacité atteint 1 700 mégawatts.
Les réseaux, si l’on ne désoptimise pas le système, doivent rester nationaux, voire européens – et il faudra bien, un jour, surmonter la contradiction entre la demande croissante d’énergie et le refus d’accueillir des lignes à très haute tension, transfrontalières. C’est à cette condition que pourra être préservée la péréquation tarifaire, indispensable dans ce pays rural qu’est restée la France.
Le coût du grand carénage devrait osciller entre 50 et 55 milliards d’euros ; si votre commission d’enquête ne peut obtenir plus de détails auprès d’EDF, ce ne sont pas les syndicats qui le pourront. En tout état de cause, cet investissement sera étalé sur une trentaine d’années : ce n’est donc pas lui, à mon sens, qui pèsera le plus sur les coûts ; quant aux frais d’entretien, ils sont planifiés à l’avance. En réalité, l’augmentation du prix de l’électricité tient surtout aux subventions allouées aux énergies renouvelables.
S’agissant de la réversibilité des déchets, le projet d’enfouissement prévoit une exhumation possible. Cela dit, à l’échelle de temps considérée, cent ans, il est difficile de faire des pronostics sur les futures évolutions technologiques et institutionnelles. L’une des voies les plus sûres, je le répète, est d’investir dans la recherche et dans la quatrième génération de réacteurs.
M. Jacky Chorin. Le coût induit par la mise en concurrence et la désoptimisation n’a jamais été calculé ; il est pourtant considérable, et sera plus élevé encore si l’hydraulique tombe aux mains du secteur privé. Contrairement à ce qu’on a longtemps fait croire, la concurrence ne fait pas baisser les prix, bien au contraire : elle les fait monter.
Sur le grand carénage, je ne suis pas en mesure de documenter le chiffre avancé par EDF, mais j’imagine que les représentants de l’État qui siègent dans les comités d’audit, eux, le peuvent. Quoi qu’il en soit, on ne peut apprécier les coûts qu’en comparant ce qui est comparable. J’ai dit l’importance que revêt à mes yeux la recherche sur le stockage de l’électricité ; reste que les énergies intermittentes ne peuvent être comparées, en termes de coût, à l’énergie nucléaire. Dans le cadre de sa transition énergétique, l’Allemagne a programmé la construction de 3 800 kilomètres de lignes à haute tension, mais rien n’a été fait l’an dernier. Le grand carénage ne nécessite de construire aucune ligne nouvelle, contrairement aux énergies renouvelables. Les gens, par exemple, accepteraient-ils de voir passer, non loin de chez eux, des lignes à très haute tension, nécessaires à la conduction de l’électricité produite par l’éolien offshore ? Je n’en suis pas sûr. Aussi abordons-nous ces sujets avec pragmatisme.
Mme Marie-Claire Cailletaud. Si l’on considère, comme nous, que le nucléaire est une énergie d’avenir, il faut d’ores et déjà réfléchir au lancement de la quatrième génération, qui fournirait à notre pays de l’énergie pour plusieurs milliers d’années.
Le débat sur la transition énergétique avait déjà mis sur la table la question de la décentralisation. Dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, il convient de rapprocher les centres de décision des citoyens, des salariés et des usagers ; mais le secteur de l’énergie doit relever du cadre national afin de garantir la péréquation tarifaire et l’égalité territoriale. L’idée d’accorder aux régions une autonomie sur certains volets de ce secteur suscite chez nous la plus vive inquiétude. Nous nous sommes aperçus, lors de réunions avec des élus au plus haut niveau, que les réalités techniques et économiques, ou encore la contribution au service public de l’électricité (CSPE), étaient ignorées au profit de visions pour le moins idylliques.
M. Alexandre Grillat. Nous souhaitons que les pouvoirs publics abordent les sujets avec réalisme et pragmatisme, qu’il s’agisse de la prolongation du parc, des fermetures anticipées sur décision de l’ASN, de la comparaison entre les coûts du nucléaire et des énergies renouvelables, de la place du nucléaire dans le mix, de la valorisation à l’export ou de la sous-traitance socialement responsable : la sûreté des approvisionnements doit être l’alpha et l’oméga de la réflexion, car elle détermine la compétitivité de l’électricité et, surtout, sa disponibilité à tout moment.
M. le président François Brottes. L’équilibre du réseau est un effet un élément essentiel : il faut le rappeler, car ce n’est pas évident pour tous.
M. Henri Richard. La Russie, je le répète, a pris beaucoup d’avance sur la France en matière de recherche et développement, et pour la conception de la quatrième génération.
L’énergie d’origine hydraulique, enfin, est impérative pour la sûreté du système. Il faut y veiller, notamment dans le cadre du dossier Alstom, puisque cette entreprise produit des turbines.
M. le président François Brottes. Madame, messieurs, je vous remercie.
Audition de M. Jean-Pierre Roncato, président d'Exeltium
(Séance du 30 avril 2014)
M. le président François Brottes. Nous entamons une série d’auditions consacrées à l’accès des industriels à l’électricité nucléaire. Je retrace à grands traits l’historique du dossier.
La première étape a été la mise en place d’Exeltium, qui a mis beaucoup de temps à aboutir. Le législateur s’y est repris à plusieurs fois, car il a fallu convaincre la Commission européenne et les responsables européens compétents en matière de concurrence. Ceux-ci refusaient les notions de contrat à long terme ou d’achat groupé, incompatibles, selon eux, avec une concurrence libre et non faussée, sans voir qu’il n’est guère pratique pour les industriels de changer d’opérateur tous les mois et d’être confrontés à des prix qui varient en permanence ! La Commission a fini par valider le dispositif Exeltium, qui repose sur le principe suivant : en échange de leurs investissements, les industriels obtiennent un accès à l’électricité à un prix donné.
La deuxième étape a été la création, par la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) – il ne concerne donc pas l’EPR. Ce dispositif contraint l’opérateur EDF, qui détient le monopole de la production d’électricité nucléaire, à mettre 25 % de cette électricité à la disposition du marché. Nous avions le choix entre cette solution et une partition du parc nucléaire français. L’ARENH a été mis en place après de nombreuses discussions, d’abord autour de Paul Champsaur, puis avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Aujourd’hui, le prix de l’ARENH est sensiblement inférieur à celui négocié par Exeltium, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations.
Pouvez-vous, monsieur le président, nous donner votre sentiment sur la réalité et l’intérêt d’Exeltium : le dispositif était-il pertinent ? Le demeure-t-il ? Comment peut-il évoluer ?
En outre, comment voyez-vous l’avenir de la filière nucléaire, notamment en termes de coûts ? Celle-ci devra réinvestir à brève échéance, pour des raisons de sûreté et de sécurité, ou en vue de prolonger, le cas échéant, la durée de vie des réacteurs existants.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Pierre Roncato prête serment)
M. Jean-Pierre Roncato, président d’Exeltium. Exeltium est un consortium dont les actionnaires-clients sont des industriels « électro-intensifs » au sens de la loi de finances rectificative de 2005 et de son décret d’application du 3 mai 2006. Il réunit les principaux groupes implantés en France dans des secteurs très sensibles au prix de l’électricité tels que l’acier, l’aluminium, la chimie, les gaz industriels et le papier.
Pour ces industries soumises à la concurrence internationale, l’approvisionnement en électricité est un enjeu de compétitivité majeur : il représente 15 à 50 % de leurs coûts de production. Compte tenu de la durée du cycle d’investissement dans les lignes de production de ces sites industriels – dix ans au minimum –, toute incertitude sur l’évolution du prix de l’électricité obère leur pérennité.
En quelques mots, la genèse d’Exeltium est liée à l’ouverture du marché de l’électricité, dans les années 2000. Les industriels fortement consommateurs d’électricité sont alors confrontés à de graves difficultés conjuguant une spirale de hausse des prix déconnectée des réalités économiques de production et un alignement par le haut des offres de fourniture d’électricité, dans un contexte où il était impossible de contracter à long terme.
La première réponse du gouvernement français, avant la mise en place du tarif réglementé et transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM) puis de l’ARENH, a été de réunir, en 2005, une table ronde des producteurs d’électricité français et des sociétés électro-intensives. Exeltium est né de cette table ronde. Dès décembre 2005, la loi de finances rectificative que j’ai citée a défini le cadre juridique et, en mai 2006, Exeltium a été créé par sept sociétés. L’opérateur EDF a été retenu comme partenaire en 2007, au terme d’un appel d’offres européen. Les discussions avec la direction générale de la concurrence en vue de la validation du montage s’étant prolongées jusqu’en 2008, le contrat de partenariat industriel avec EDF n’a été signé qu’à la fin du mois de juillet de la même année.
Lorsqu’est venu le moment de se tourner vers les marchés pour financer le projet, la crise financière venait d’éclater. Faute de pouvoir accéder à des financements suffisants, la décision fut prise de réaliser le projet en deux phases. La phase 1, qui a démarré le 1er mai 2010, porte sur la fourniture de 148 térawattheures (TWh) sur vingt-quatre ans. Toutefois, compte tenu du contexte financier de l’époque, le financement n’a pu être assuré que pour neuf ans et demi. De plus, un refinancement est nécessaire d’ici à la fin de l’année 2014.
M. le président François Brottes. Il convient de préciser que certains des industriels qui ont eu accès au TaRTAM – qui était une solution transitoire, quelque peu bricolée – avaient bénéficié auparavant de tarifs spécifiques pendant de nombreuses années.
M. Jean-Pierre Roncato. Tout à fait.
Compte tenu des difficultés de financement initiales, la phase 2, qui doit porter sur la fourniture de 163 TWh pendant la même période, est en suspens depuis le démarrage de la phase 1. Elle n’a pas encore été relancée. À la fin de l’année 2013, Exeltium a livré au total 25 TWh à une centaine d’usines appartenant à ses vingt-six actionnaires-clients, soit 7,4 TWh en rythme annuel. Ce volume représente entre le tiers et la moitié des besoins des sites concernés.
J’en viens à la philosophie du projet Exeltium. Historiquement, la production électrique et les usines électro-intensives se sont développées en symbiose : les usines se sont implantées à côté des moyens de production existants ou des gisements d’énergie à exploiter, notamment dans les vallées alpines et pyrénéennes. Ainsi, avant la nationalisation de 1946, de nombreux industriels possédaient leurs propres centrales et s’approvisionnaient ainsi à prix coûtant. Après la nationalisation, pour compenser la perte de ces centrales, des tarifs spécifiques ont été mis en place. Prévus pour une longue période, ils sont arrivés à échéance récemment.
Aujourd’hui, alors que la possession de centrales par les industriels électro-intensifs eux-mêmes est révolue en France, les pays qui disposent d’une production électrique compétitive, souvent issue de ressources locales, s’appuient sur ces spécificités pour développer des dispositifs favorables aux industries électro-intensives – l’hydroélectricité au Québec, aux États-Unis, au Brésil, en Norvège et en Russie ; le gaz dans les pays du Golfe ; le charbon en Chine. Telle est également la philosophie du projet Exeltium : s’appuyer sur la spécificité française de notre parc nucléaire historique pour donner aux industries électro-intensives implantées dans notre pays un accès à l’électricité, dans le cadre d’un partenariat associant ces industriels à certains risques d’exploitation – disponibilité et capacité installée du parc –, ainsi qu’au développement de nouvelles capacités, qui devaient être à l’époque une petite série d’EPR.
Comment Exeltium fonctionne-t-il concrètement ? Le consortium se doit de fournir à ses actionnaires-clients de l’électricité à un prix compétitif et prévisible pendant vingt-quatre ans. Il acquiert cette électricité auprès d’EDF sous la forme de plusieurs rubans en « take or pay » – c’est-à-dire d’enlèvements constants – d’une durée de quinze à vingt-quatre ans. En contrepartie, Exeltium a versé à EDF au début du contrat, en mai 2010, une prime fixe initiale, dite « avance en tête », d’un montant de 1,75 milliard d’euros, financée à 90 % par de la dette et à 10 % par les fonds propres apportés par les actionnaires-clients. D’autre part, au fur et à mesure de la livraison d’électricité, Exeltium règle à EDF un prix d’enlèvement proportionnel. Le prix de l’électricité vendue par Exeltium à ses actionnaires-clients est donc constitué principalement de deux composantes : la première vise à rembourser la dette contractée pour payer l’avance en tête à EDF ; la seconde couvre la part proportionnelle du prix négocié avec EDF.
L’intérêt du montage Exeltium est de faire bénéficier les industries électro-intensives de la compétitivité du parc nucléaire historique. En outre, la forte part de dette pour financer l’avance en tête et la déconsolidation de cette dette leur permet de tirer parti d’un effet de levier important, résultant du différentiel entre le coût de la dette d’Exeltium, d’une part, et le coût moyen pondéré du capital d’un producteur d’électricité, d’autre part. Cet effet de levier assure à Exeltium une compétitivité à long terme.
La mise en place d’Exeltium, je le souligne, est un acte volontariste inédit : des groupes mondiaux ont investi 1,75 milliard d’euros en France pour assurer pendant plus de vingt ans la fourniture électrique d’une centaine d’usines, qui emploient 60 000 personnes. C’est un engagement fort en faveur du développement industriel.
Quel peut être l’avenir d’Exeltium à court et moyen terme ? Depuis le démarrage d’Exeltium en 2010, le contexte énergétique a considérablement évolué, tant en France qu’à l’échelle européenne et mondiale. En France, l’ARENH a été mis en place en juillet 2011, avec un prix de 40 euros par mégawattheure (MWh), puis de à 42 euros dès janvier 2012, reflétant en principe le coût de la production du parc nucléaire historique. Le coût total d’Exeltium pour ses actionnaires-clients revient, quant à lui, à environ 50 euros par MWh en 2014. Ce montant inclut différents éléments : le prix contractuel de l’électricité vendue par Exeltium à ses clients ; une provision liée au surcoût du futur EPR de Flamanville versée par les clients, qui découle du partage des risques avec EDF dans le cadre du contrat de partenariat que j’ai évoqué précédemment ; le coût pour les actionnaires de la non-rémunération par Exeltium des fonds propres qu’ils ont apportés. Le principe du montage est, en effet, que tous les éléments doivent être répercutés dans le prix et qu’il n’y ait aucun versement de dividendes.
Or le recours à l’ARENH est moins risqué et ne nécessite aucun apport en capital. En outre, la loi NOME limite l’accès à ce dispositif pour les actionnaires d’Exeltium : elle les oblige à consommer toute l’électricité achetée auprès d’Exeltium avant d’acquérir des quantités dans le cadre de l’ARENH, ce qui crée une réelle distorsion de traitement. Par ailleurs, le prix d’Exeltium reflète pour partie un développement du parc fondé sur la construction d’une petite série d’EPR. L’abandon tacite de cette option au profit d’une prolongation du parc existant, moins coûteuse, handicape donc Exeltium. Enfin, plusieurs décisions vont aggraver directement la dégradation de la compétitivité d’Exeltium : d’une part, la diminution annoncée de la capacité du parc nucléaire historique ; d’autre part, la modification, dès 2015, des règles fiscales applicables aux projets de cette nature, en particulier la fin de la déductibilité totale des intérêts d’emprunt.
Dans le même temps, au-delà de nos frontières, l’évolution du contexte concurrentiel est considérable : les prix du gaz nord-américain, deux à trois fois inférieurs aux prix européens, permettent de produire une électricité à un prix bien moindre qu’en Europe.
M. le président François Brottes. C’est là l’effet de l’exploitation du gaz de schiste ?
M. Jean-Pierre Roncato. Oui.
Grâce à son charbon, la Chine peut, elle aussi, développer d’importantes capacités électro-intensives dans d’excellentes conditions de compétitivité. Par ailleurs, en Europe – tout au moins hors de la France, où le prix de l’ARENH semble constituer à court terme un « plancher de verre » – plusieurs facteurs contribuent également à la faiblesse des prix de marché de l’électricité : une demande atone du fait de la crise ; la baisse du prix du charbon américain importé, induite par l’exploitation du gaz de schiste, qui permet un regain de compétitivité des parcs de centrales au charbon, dans un contexte de bas prix du dioxyde de carbone ; le fort développement de nouvelles capacités de production d’origine renouvelable, qui amènent des quantités toujours plus importantes d’électricité sur le marché.
Nous assistons ainsi à une inversion complète du rapport entre la France et l’Allemagne en matière de compétitivité des prix de l’électricité : alors que, en 2009, les prix de marché en Allemagne étaient supérieurs au TaRTAM de 30 euros par MWh, ils seront de 35 euros par MWh environ en 2015, à comparer aux 42 euros de l’ARENH et aux 50 euros d’Exeltium.
Enfin, de nombreux États ont mis en place des dispositifs spécifiques permettant d’abaisser encore le montant de la facture pour les industries électro-intensives. Des contrats de long terme à des tarifs très favorables ont été mis en place aux États-Unis et au Canada. D’autres pays, telle l’Allemagne, ont adopté un panel de mesures portant sur diverses composantes du coût de l’électricité : larges exonérations du coût de son transport, lequel représente en moyenne 6 euros par MWh pour les industries électro-intensives françaises ; compensation du coût des émissions indirectes de dioxyde de carbone, soit un peu plus de 3 euros par MWh ; rémunération élevée de l’effacement et de l’interruptibilité. Au total, en 2015, les grandes industries électro-intensives acquitteront en Allemagne une facture inférieure de 35 % à celle qu’elles paieront en France, tout en consommant une électricité plus carbonée.
Dans ces conditions, refonder la compétitivité à court-moyen terme du dispositif Exeltium est devenu une urgence industrielle, en particulier pour certains sites directement menacés à brève échéance. Nous menons, depuis quelques mois, des discussions avec EDF sur un certain nombre d’améliorations. L’objectif est d’adapter ce contrat privé, qui offre certes une compétitivité et une prévisibilité à long terme, aux évolutions violentes du contexte immédiat : compte tenu de la situation économique des industries électro-intensives en France, le long terme apparaît bien lointain, alors que la question posée à court terme peut être celle de la survie !
La solution en négociation consiste à sécuriser une baisse du prix pour les prochaines années et à introduire dans le contrat une souplesse qui permette de l’adapter aux aléas futurs de l’environnement économique. Pour simplifier, il s’agit de créer un « tunnel » autour du prix actuel, avec une modulation à la baisse, dans une certaine limite, lorsque le contexte est déprimé, et une modulation à la hausse, également dans une certaine limite, lorsque la situation économique est plus favorable et que les prix de l’électricité sont revenus à la « normale ». Les discussions avec EDF portent également sur une limitation plus stricte de l’impact pour Exeltium de la matérialisation des risques partagés avec EDF dans le cadre du contrat de partenariat.
Si, comme je l’espère, ces discussions aboutissent rapidement, la philosophie du contrat, validée à l’origine par la Commission européenne, ne sera pas modifiée : il s’agira toujours d’offrir une visibilité à long terme aux industries électro-intensives avec un prix compétitif sur l’ensemble de la période considérée, tout en permettant au producteur de couvrir ses coûts dans la durée. La variabilité introduite devrait permettre d’amortir les soubresauts du contexte économique et concurrentiel, sans remettre en cause l’économie générale du dispositif. Le schéma ainsi redéfini serait donc robuste, tant du point de vue économique que juridique.
En conclusion, malgré les difficultés apparues ces dernières années, Exeltium est un bon dispositif, qui renforce la compétitivité des industries électro-intensives et leur donne de la visibilité. Ce sont là deux éléments prioritaires pour elles. Les correctifs envisagés devraient apporter à Exeltium la souplesse qui lui manquait sans doute à l’origine et lui permettre de s’adapter aux aléas de la conjoncture.
Cependant, le prix de l’électricité n’est qu’une des composantes de la facture des industries électro-intensives. Dans ce contexte, il est essentiel que les réflexions engagées depuis deux ans aboutissent. Il conviendrait notamment de fixer une rémunération attractive des effacements et de l’interruptibilité industriels, en échange du service économique rendu par les grands consommateurs de base à l’équilibre du système électrique. Il apparaît également nécessaire de créer un dispositif ad hoc pour prendre en charge une partie du coût du transport ; là encore, la consommation en base profite à l’équilibre du réseau, sans exiger le surdimensionnement qu’impliquent des consommations plus fluctuantes. S’agissant de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), il est important de maintenir des plafonds adaptés aux industries électro-intensives et conformes aux lignes directrices de la Commission européenne. Enfin, d’une manière générale, il faut éviter que les modifications successives du régime fiscal applicable à des projets tels qu’Exeltium ne viennent compromettre leur équilibre économique délicat.
M. le président François Brottes. Merci, monsieur le président. Ce sujet mériterait une commission d’enquête à lui seul !
Quel était, à l’origine, le besoin en électricité des entreprises qui ont créé Exeltium ? Ce volume est-il toujours le même ou a-t-il baissé ?
M. Jean-Pierre Roncato. À l’origine, il était prévu qu’Exeltium fournisse 311 TWh : 148 font actuellement l’objet de la phase 1, et 163 devaient faire l’objet de la phase 2. La crise a certainement détruit une partie de cette demande. Cependant, les 311 TWh ne représentaient, à l’époque, que les deux tiers environ des besoins des clients d’Exeltium. Aujourd’hui, nous estimons qu’Exeltium couvre entre un tiers et la moitié de leurs besoins. Il pourrait donc fournir à l’avenir non pas le double des quantités qu’il livre actuellement, comme cela était envisagé à l’origine, mais 50 à 60 % de plus.
M. Denis Baupin, rapporteur. Pouvez-vous préciser en quoi consistent la phase 2 et la renégociation que vous devez mener d’ici à la fin de l’année 2014 ?
M. Jean-Pierre Roncato. Le financement de la phase 1 n’a pu être assuré que pour neuf ans et demi, en partie à cause de l’exigence de la Commission européenne de laisser aux clients d’Exeltium la possibilité d’exercer un droit de sortie au bout de dix, quinze et vingt ans. Le montage financier du projet s’en est trouvé fragilisé : dans le contexte difficile de l’époque, les banques n’ont accepté de le financer que jusqu’à la première de ces échéances. Pour éviter tout problème avant le terme de leur financement en 2019, elles ont posé un certain nombre de conditions qui nous obligent à refinancer 1,75 milliard d’euros d’ici à la fin de l’année 2014.
Quant à la phase 2, elle n’a fait l’objet d’aucun accord à ce stade.
M. le rapporteur. Quand doit-elle commencer ?
M. Jean-Pierre Roncato. Elle pourrait commencer dès qu’on le souhaite. Comme je l’ai indiqué, les besoins des clients sont supérieurs aux quantités que leur fournit actuellement Exeltium. Si nous aboutissons à un accord favorable avec EDF dans le cadre de la phase 1, nous nous interrogerons alors sur la suite : lançons-nous une phase 2 ou bien cherchons-nous une autre solution ?
M. le rapporteur. La France est censée avoir ouvert son marché de l’électricité, mais les dispositifs mis en place se révèlent dérogatoires et complexes. Il est néanmoins tout à fait justifié de protéger les industries électro-intensives.
L’opérateur EDF a été retenu au terme d’un appel d’offres européen dans un certain contexte. Compte tenu des renégociations en cours et de vos réflexions sur une phase 2, le contrat avec EDF est-il susceptible de prendre fin ? À quelle date ? Envisagez-vous un nouvel appel d’offres ?
Comment le contrat que vous avez signé avec EDF s’articule-t-il avec l’ARENH ? Si l’ARENH avait existé préalablement, auriez-vous mis en place Exeltium ? Les deux dispositifs sont-ils complémentaires ?
Dans le contexte de concurrence avec des pays où la production d’électricité est favorisée par différentes sources d’énergie locales, que pourrait faire, selon vous, le législateur dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour mieux protéger les entreprises énergo-intensives ? Lors du débat sur la transition énergétique, j’ai présidé le groupe de travail sur la compétitivité des entreprises. D’après un rapport du Conseil d’analyse économique, l’augmentation des prix de l’énergie pourrait être un facteur de compétitivité, dans la mesure où il inciterait les entreprises à réaliser des économies d’énergie. Cependant, les entreprises énergo-intensives seraient directement pénalisées par une telle augmentation, et il convient donc de les protéger au moyen de tarifs encadrés privilégiés ou d’autres formes d’aide qui ont été évoquées au cours des débats. Nous devons néanmoins veiller à ce que le signal prix incite à une meilleure performance énergétique. Quelle est votre analyse sur ce point ?
M. Jean-Pierre Roncato. Exeltium a consulté seize entreprises européennes dans le cadre de l’appel d’offres qu’il a lancé en 2007. La capacité à fournir une électricité produite à partir de sources d’énergie non carbonées était, pour nous, un critère déterminant. Il est vite apparu que très peu d’entreprises satisfaisaient à cette exigence, et le choix s’est porté sur l’opérateur EDF, avec lequel nous avons signé un contrat à long terme, portant sur une période de vingt-quatre ans.
Quant aux discussions en cours avec EDF sur les aménagements que nous souhaitons, elles correspondent à des réunions et à des remises à plat régulières prévues dans le cadre du contrat. Au vu de mon expérience des contrats de long terme, il est illusoire de penser qu’un contrat, même très bien construit à l’origine, puisse anticiper tous les événements qui se produisent dans la vie réelle. J’espère que les discussions actuelles vont aboutir dans un avenir proche. Je ne conçois pas qu’elles se soldent par une rupture du contrat et un arrêt de la phase 1 – cela signifierait que les partenaires dressent un constat d’échec. D’ailleurs, ce ne sont certainement pas les dernières négociations qui auront lieu entre les partenaires au cours de la vie du contrat. Il est indispensable de garder la possibilité de discuter afin d’adapter le contrat aux aléas et aux évolutions du contexte. Je n’envisage donc pas de nouvelle consultation ni de nouvel appel d’offres concernant la phase 1.
Quelles sont les solutions envisageables pour répondre aux besoins des industries électro-intensives non couverts par Exeltium ? Que se serait-il passé si la mise en place d’Exeltium avait pris encore davantage de temps et que l’ARENH avait été créé avant qu’il voie le jour ? Les industries électro-intensives se soucient non seulement du niveau du prix de l’électricité à un moment donné, mais aussi de la prévisibilité – et, si possible, de la stabilité – de ce prix à long terme. Or le montage Exeltium présente des caractéristiques qu’on ne retrouve pas dans l’ARENH : d’une part, la durée ; d’autre part, l’effet de levier que j’ai décrit, qui permet de lisser le prix et de lui donner une certaine stabilité dans le temps. L’ARENH a une durée plus limitée qu’Exeltium, et certaines incertitudes demeurent quant à son évolution. Il permet aux industriels de compléter à court terme la couverture de leurs besoins, mais ne répond pas à leur problématique de long terme.
D’une manière générale, les pays industriels adoptent deux types de mesures pour apporter de la sécurité et de la stabilité à leurs industries électro-intensives. Premièrement, des mesures dites patrimoniales, qui consistent à leur donner un accès, dans des conditions privilégiées, à une source d’énergie particulière, qui est disponible à un prix compétitif : l’hydroélectricité au Québec notamment ; le charbon ou le gaz dans les pays qui en produisent. Exeltium rentre dans cette catégorie : il donne un accès privilégié au parc nucléaire historique tel qu’il a été bâti en France.
Deuxièmement, les États peuvent prendre un panel de mesures complémentaires afin de réduire la facture d’électricité, en jouant sur les différents maillons de la chaîne de valeur, ce que font l’Allemagne et d’autres pays. Il est ainsi possible d’agir sur le coût du transport, de rémunérer les services que rendent les industries électro-intensives grâce à la régularité de leur fonctionnement – par exemple en matière d’interruptibilité et d’effacement – ou encore de ne pas imputer certaines charges, comme la CSPE en France ou l’EEG-Umlage en Allemagne, aux industries électro-intensives, en les répartissant de manière inégale entre les différents segments de consommation. Ces mesures apportent des réponses moins pérennes que les dispositifs de nature patrimoniale.
S’agissant de la France, il existe d’autres idées sur le moyen de fournir aux industries électro-intensives les quantités supplémentaires dont elles ont besoin. En particulier, la question d’un recours à l’hydroélectricité mérite d’être posée, mais cela sort de mon champ de compétence.
M. le président François Brottes. Justement, dans l’hypothèse où un nouveau barrage serait construit en France, seriez-vous prêts à co-investir dans ce projet, comme vous le faites dans l’EPR ? Par ailleurs, si des sociétés d’économie mixte étaient constituées pour gérer certaines concessions, pourriez-vous participer à leur capital, dans une approche analogue à celle d’Exeltium – investissements en échange d’un accès à long terme à un tarif privilégié ? Certains membres d’Exeltium ont déjà donné leur réponse sur ce point.
M. Jean-Pierre Roncato. Avec Exeltium, les industriels ont montré qu’ils étaient prêts à investir des sommes considérables pour sécuriser un approvisionnement en électricité à long terme à un prix compétitif. Le cas échéant, je n’exclus pas qu’ils prennent une décision collective de même nature dans le cadre d’un autre montage, mais je ne peux pas me prononcer en leur nom. Les dispositifs du type Exeltium apportent, en effet, une réponse adéquate en termes de stabilité et de prévisibilité. Néanmoins, il reste à voir si le coût de l’investissement et le coût de la production correspondante seraient compatibles avec les besoins des industriels. Quant à savoir s’il convient d’utiliser le dispositif existant ou d’en créer un nouveau, c’est une autre question.
M. le président François Brottes. Nos amis allemands – qui s’affranchissent parfois de règles auxquelles nous semblons très attachés – sont dans le collimateur de la Commission européenne parce qu’ils exonèrent certains de leurs industriels du coût de transport de l’électricité. Avez-vous des observations à faire sur ce point ? Pensez-vous que la situation va évoluer ou que les Allemands vont laisser passer l’orage et continuer à appliquer ces mesures, de manière à ce que leurs industriels bénéficient d’un prix de l’électricité inférieur de 35 % à celui qui est pratiqué en France ?
M. Jean-Pierre Roncato. Je réponds non pas en ma qualité de président d’Exeltium, mais à titre personnel, au vu des informations disponibles sur le sujet. Il semble que les Allemands envisagent de remplacer l’exonération totale des coûts de transport de l’électricité par des mesures qui permettent aux industriels de réduire ces coûts de manière très substantielle. Cependant, le résultat ne sera sans doute pas très différent : les entreprises qui achètent leur électricité en Allemagne continueront à bénéficier en la matière d’un avantage très important par rapport à celles qui le font en France.
M. le rapporteur. Les entreprises pour lesquelles vous travaillez envisagent-elles ou réalisent-elles des investissements qui visent à diminuer leur consommation d’énergie ? Cela peut être un autre moyen de réduire la facture.
M. Jean-Pierre Roncato. J’ai été précédemment responsable d’un centre d’expertise sur les consommations industrielles, qui aidait les entreprises à améliorer leur performance énergétique. Au vu de mon expérience, les industries fortement consommatrices d’énergie, que ce soit le gaz ou l’électricité, ont déjà envisagé toutes les solutions possibles en la matière et ont effectué, depuis de nombreuses années, les efforts nécessaires pour s’adapter. Pour elles, c’était une question vitale, l’énergie constituant une composante essentielle de leurs coûts de production. Paradoxalement, les gisements d’économie se trouvent plutôt chez les entreprises faiblement consommatrices ou pour qui l’énergie ne représente pas une part importante du prix de revient.
M. le président François Brottes. Je vous remercie, monsieur le président.
Audition de M. Fabien Choné, président de l’ANODE (Association nationale des opérateurs détaillants en énergie)
(Séance du 30 avril 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314056.pdf
M. le président François Brottes. Monsieur Choné, vous êtes président de l’Association des opérateurs détaillants en énergie, qui regroupe les nouveaux entrants – que l’on continue à appeler fournisseurs alternatifs – sur un marché de l’électricité et du gaz désormais concurrentiel.
Depuis l’ouverture du marché, on observe que les tarifs ne cessent d’augmenter. Est-ce un effet de la concurrence elle-même ? Ce qu’a constaté la Commission de régulation de l’électricité (CRE) en analysant les coûts d’EDF, c’est une croissance exponentielle de ses coûts de commercialisation. En effet, alors qu’un opérateur en situation de monopole n’a pas besoin de consentir des efforts commerciaux importants, il n’en est pas de même quand il doit se battre pour conserver ses parts de marché.
Les pouvoirs publics ont tenté de modérer cette hausse, mais ceux-là mêmes qui étaient à l’origine de l’augmentation des coûts de commercialisation, c’est-à-dire les nouveaux entrants, ont attaqué cette décision devant le Conseil d’État. Celui-ci a conclu à la nécessité d’augmenter les tarifs.
Quel est le nombre des nouveaux entrants, sachant que des fusions ont été opérées depuis l’ouverture à la concurrence ?
On peut d’ailleurs juger que le marché n’est pas si ouvert dans la mesure où de nombreux clients ont eu le réflexe d’opter, en matière d’électricité comme de gaz, pour les opérateurs historiques. Des sondages montrent même que certaines personnes n’ont toujours pas compris qu’EDF et GDF étaient désormais deux entreprises différentes.
En ce qui concerne la filière nucléaire, les pouvoirs publics ont choisi de ne pas répartir les centrales existantes entre différents opérateurs – je ne suis d’ailleurs pas sûr que les membres de votre association auraient eu la capacité financière d’investir dans ce type de production –, mais de développer la concurrence en aval, en mettant à la disposition du marché 25 % de la production d’EDF. L’ANODE étant directement concernée par cette disposition, nous aimerions connaître son avis sur l’organisation du marché et son éventuelle évolution.
Nous venons d’auditionner le président d’Exeltium, qui représente les industriels électro-intensifs. Ces derniers connaissent des jours difficiles : alors qu’ils ont investi beaucoup d’argent pour bénéficier d’un tarif particulier, celui-ci est aujourd’hui supérieur à celui de l’ARENH, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Au fond, ils sont comme vous : ils jugent que l’ARENH n’est pas suffisamment élevé. Vous comprenez, bien sûr, que je suis provocateur à dessein, pour vous inciter à réagir.
Nous souhaitons également savoir si le développement de la concurrence peut, selon vous, passer par une tarification de l’accès au réseau.
Par ailleurs, face aux personnes de plus en plus nombreuses qui, de bonne foi, ne parviennent plus à payer leurs factures, une loi issue de la proposition que j’avais déposée a étendu à tous les foyers la trêve hivernale de l’énergie. Or la rumeur prétend que les opérateurs alternatifs ont tendance à abandonner ces « précaires de l’énergie », au point que nous réfléchissons à l’idée d’instituer un fournisseur de dernier recours. La question n’est certes pas directement liée à la filière nucléaire et n’entre donc pas dans le cadre de notre commission d’enquête, mais l’aborder aujourd’hui permettra d’éviter de vous faire revenir plus tard.
Avant de vous laisser la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Fabien Choné prête serment)
M. Fabien Choné, président de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE). Avant de répondre à vos questions, permettez-moi de présenter notre association.
L’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie regroupe cinq membres : Direct énergie, fruit de la fusion entre la société du même nom et Poweo ; la filiale en France d’ENI, le groupe pétro-gazier historique italien ; Gaz de Paris ; Lampiris ; Planète Oui. Lampiris et Direct énergie sont présents à la fois sur les marchés de l’électricité et du gaz ; d’autres opérateurs ne vendent que du gaz, comme ENI et Gaz de Paris, ou uniquement de l’électricité, comme Planète oui. Ces cinq entreprises alimentent plus de 90 % des consommateurs ayant choisi de quitter les deux opérateurs historiques.
M. le président François Brottes. Cela représente combien de clients ?
M. Fabien Choné. Plus d’un million, ce qui peut, il est vrai, sembler peu par rapport au nombre total de consommateurs.
L’ANODE a été créée pour prendre part aux réflexions menées en 2006 sur la manière de prendre en compte la spécificité de l’énergie nucléaire dans un marché libéralisé. Ces réflexions avaient abouti au vote de la loi relative au secteur de l’énergie, qui a mis en place le tarif réglementé et transitoire d’ajustement au marché (TaRTAM), que l’ARENH, institué par la loi NOME (nouvelle organisation de l’énergie), a finalement remplacé. D’abord créée pour les détaillants en électricité, l’ANODE s’est ensuite élargie au marché du gaz.
Cette association a pour objet de promouvoir la création d’un marché libéralisé permettant aux consommateurs de bénéficier des avantages offerts à la fois par le développement de la concurrence et par les spécificités de la politique énergétique française. Nous pensons qu’il est tout à fait possible de conserver un monopole de la production d’énergie nucléaire tout en développant une concurrence efficace, non seulement dans les autres formes de production, mais aussi dans l’activité de fourniture d’électricité.
Je précise que l’ANODE n’a pas vocation à prendre position pour ou contre le nucléaire. Le recours à cette énergie relève d’un choix national de politique énergétique, et c’est dans le respect de ce choix que nous souhaitons pouvoir développer la concurrence.
Comme vous l’avez souligné, monsieur le président, nous ne sommes pas opérateurs dans la production d’énergie nucléaire, ni en France ni à l’étranger. Nous ne pouvons donc vous apporter aucun élément d’information additionnel sur le coût de la filière. Toutefois, l’intitulé de la commission d’enquête mentionne les « divers aspects économiques et financiers » de la « commercialisation de l’électricité nucléaire » : c’est sur ce sujet précis que nous avons souhaité participer à vos travaux.
En ce qui concerne l’organisation du marché, il convient de distinguer clairement la production et la fourniture d’électricité. Même si l’une est en aval de l’autre, ces deux activités sont très différentes et subissent des contraintes spécifiques. Aucune bonne raison ne justifierait que les difficultés que pourrait connaître une de ces activités entravent le développement de la concurrence dans l’autre. En clair, l’existence, en France, d’un monopole sur la production d’électricité nucléaire – que nous n’avons d’ailleurs jamais cherché à remettre en cause – ne doit pas empêcher le jeu d’une concurrence effective et efficace s’agissant de sa fourniture.
À cet égard, nous ne comprenons pas la position d’Alain Bazot, le président de l’UFC-Que Choisir, qui estime nécessaire de faire jouer la concurrence sur le marché de la fourniture de gaz, mais pas sur celui de la fourniture d’électricité, sous prétexte que la production fait l’objet d’un monopole. Nous sommes concurrents d’EDF en tant qu’entreprise commercialisant de l’électricité, pas en tant que producteur – et pour cause : c’est impossible.
À y regarder de plus près, les difficultés d’organisation que connaît le secteur sont toutes liées à l’activité de production, qu’il s’agisse de la sécurité de l’approvisionnement, du mécanisme de capacité, de la spécificité de l’électricité d’origine nucléaire, qui représente 75 % de la production. Comment organiser la concurrence quand un seul opérateur concentre les trois quarts de la production – et même plutôt 90 %, car il dispose de moyens de production autres que les centrales nucléaires ?
En dépit de ces difficultés, qui ne sont pas insurmontables et qui, en tout cas, ne concernent pas le marché de la commercialisation, nous pensons que la concurrence peut se développer. Le monopole de la production nucléaire ne fait pas obstacle à la libéralisation du marché de la fourniture de l’électricité. C’est même dans ce domaine que les consommateurs auront le plus à gagner.
Remarquons que la libéralisation a eu lieu en deux temps : la production a été ouverte à la concurrence dès 1999, tandis que la fourniture l’a été progressivement jusqu’en 2007. L’organisation du marché étant désormais réalisée, le développement de la concurrence dans l’activité de commercialisation de l’électricité peut être une source d’avantages pour le consommateur, et ce, sans aucun risque pour lui : aucun changement de compteur n’est nécessaire et, grâce à la réversibilité, il ne court même pas un risque économique.
Je ne parle pas seulement de modération tarifaire, même si la concurrence nous semble le meilleur moyen de maîtriser les coûts, qui connaissent, en effet, une tendance à la hausse. Vous avez noté, monsieur le président, la forte augmentation des coûts de commercialisation d’EDF. Or, si ma mémoire est bonne, le rapport de la Commission de régulation de l’énergie évalue à seulement 15 % la part de cette augmentation, qui est liée au développement des systèmes d’information rendus nécessaires par l’ouverture à la concurrence. La plus grande partie de la hausse n’a donc rien à voir avec cette dernière. Au contraire, la concurrence a incité les dirigeants d’EDF à mettre en œuvre des plans d’économies susceptibles de réduire les coûts.
M. le président François Brottes. Une des causes de cette augmentation tient à la nécessaire séparation des activités de distribution et de transport à laquelle a dû procéder EDF avant l’ouverture du marché à la concurrence.
M. Fabien Choné. L’effet le plus important de cette séparation pour l’opérateur historique est la multiplication des systèmes d’information. Or c’est bien ce phénomène qui explique la part de l’augmentation des coûts liée à l’ouverture de la concurrence.
Je le répète, la concurrence nous semble le seul vrai vecteur de modération tarifaire. Du reste, ce n’est pas son seul avantage : elle permet également le développement de nouvelles offres, de nouveaux services innovants permettant de consommer moins et mieux. Le montant de la facture d’énergie dépend non seulement du prix, mais aussi du volume consommé. En matière d’électricité, entrent également en ligne de compte les tranches horaires durant lesquelles le prix de l’électricité varie fortement. À condition d’être correctement organisée, la concurrence dans l’activité de commercialisation non seulement ne présente aucun risque pour les consommateurs, mais elle leur est bénéfique, tout en étant pleinement cohérente avec la notion de transition énergétique. En effet, les consommateurs vont devoir modifier, en le rationalisant, leur comportement de consommation. À cet égard, l’émulation entre les compétiteurs est de nature à susciter la création de services innovants, notamment par le déploiement des compteurs intelligents, et donc à favoriser la maîtrise de la demande en énergie. Nous autres, nouveaux entrants, pensons avoir un rôle à jouer dans la construction de ces nouvelles offres et de ces nouveaux services.
Malgré le processus de libéralisation, nous faisons le triste constat que la spécificité nucléaire française a été la cause d’une fermeture du marché aval de la fourniture, et donc d’un faible développement des nouveaux services en matière de M2E – maîtrise de la demande en énergie – et d’efficacité énergétique.
Pour l’expliquer, je reviendrai sur les différentes périodes qu’a connues le marché depuis son ouverture à la concurrence. Avant 2010, nous avons subi pendant une dizaine d’années un effet de ciseau tarifaire : la double contrainte des coûts de production nucléaire tels qu’ils étaient reflétés dans le tarif réglementé de vente et des prix de marché nous empêchait, de facto, de pénétrer le marché sans subir de lourdes pertes. Il a fallu attendre le vote de la loi NOME pour régler ce problème. En effet, le TaRTAM constituait une solution à la fois inefficace, contraire à la réglementation européenne et inadaptée au segment des clients du marché de masse.
M. le président François Brottes. C’est une solution dont je suis coauteur… Mais je reconnais qu’elle a été un peu bricolée.
M. Fabien Choné. Malgré la création, en 2010, de l’ARENH, que nous appelions de nos vœux, nous restons victimes du ciseau tarifaire, dont la loi NOME ne prévoit qu’une résorption progressive jusqu’au 1er janvier 2016. Nous perdons donc encore cinq ans, ce qui est très regrettable. En outre, nous n’avons pas accès à l’énergie nucléaire historique dans des conditions tout à fait équivalentes à celles dont bénéficie EDF en tant qu’entreprise commercialisant de l’électricité. La CRE a d’ailleurs reconnu l’existence, pour les nouveaux entrants, de surcoûts engendrés par les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables : présentation d’une garantie bancaire, application d’un plafond faisant peser un risque sur l’accès à cette énergie, pénalités infligées dans le cadre de la clause de prix complémentaire qui sanctionnent toute erreur dans les prévisions. Pour toutes ces raisons, l’article 1er de la loi NOME, qui prévoit, pour l’accès à l’énergie nucléaire historique, une équivalence entre les nouveaux entrants et l’activité de commercialisation d’EDF, n’est pas réellement respecté.
Ce qui nous préoccupe le plus, c’est l’organisation à venir du marché, d’abord pendant la période de régulation de l’ARENH, entre 2015 et 2026, puis au-delà de 2026. Nous sommes, en particulier, inquiets de l’effet sur la concurrence de la construction tarifaire de l’ARENH telle qu’elle est prévue dans le projet de décret mis à la consultation de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).
Nous avons effectué une simulation de l’évolution du prix de l’ARENH. Je rappelle que celui-ci a été fixé à 40 euros par mégawattheure pour l’année 2011 et à 42 euros à partir de 2012, dans l’attente de la publication du décret qui donnera à la CRE les moyens de le calculer pour les années à venir. Notre modèle, élaboré à partir des données contenues dans divers rapports et enquêtes, précise la répartition des coûts à prendre en compte dans la construction de l’ARENH : les dépenses courantes d’exploitation – y compris pour l’achat de combustible ; les investissements initiaux à effectuer pendant la période de régulation, c’est-à-dire jusqu’en 2025 ; les provisions destinées à financer le démantèlement des centrales ; le coût du grand carénage, c’est-à-dire de la maintenance lourde des centrales et, le cas échéant, de la prolongation de leur durée de vie ; le coût des travaux de sécurisation du parc réclamés par l’Agence de sûreté nucléaire.
M. le président François Brottes. Il sera peut-être nécessaire de réévaluer le coût de la prolongation de la durée de vie des centrales afin de tenir compte de « l’effet Baupin ».
M. Denis Baupin, rapporteur. Il s’agit moins d’un « effet Baupin » que d’un « effet transparence » !
M. Fabien Choné. Quoi qu’il en soit, nous sommes partis des données disponibles. Nous n’avons pas dû beaucoup nous tromper, puisque notre évaluation rejoint les chiffres avancés ici même par la DGEC : un prix moyen de 42,30 euros de 2011 par mégawattheure pour la période allant de 2011 à 2025, et de 46 euros de 2014 pour la période 2014-2025.
M. le président François Brottes. À lire vos résultats, on pourrait penser que ce prix permettrait de financer quatre fois le coût de prolongation de la durée de vie des centrales.
M. Fabien Choné. Ils sont exprimés en euros courants par mégawattheure.
Si nos estimations rejoignent celles de la DGEC, il n’en est pas de même pour la période postérieure à 2025. Cette année-là, le parc nucléaire aura un âge moyen de quarante ans. Dès lors, par prudence, le projet de décret prévoit de répercuter sur le prix de l’ARENH – et donc, in fine, sur le consommateur, via le tarif réglementé de vente ou les offres libres proposées par les opérateurs nouveaux entrants – la totalité des investissements effectués d’ici à 2025.
En imaginant que le dispositif de l’ARENH soit prolongé pendant dix ans, nous avons cherché à estimer son évolution à partir de 2026, à un moment où la totalité des charges d’investissement, de démantèlement et de sécurisation auront été payées. Nous avons toutefois pris pour hypothèse la nécessité de consacrer à nouveau 20 milliards d’euros de 2010 aux investissements de maintenance lourde. En effet, on évalue à 90 milliards d’euros la totalité des investissements nécessaires sur ce poste d’ici à 2048. Sur cette somme, 55 milliards seront payés pendant la période de régulation ; les 35 milliards restants seraient donc répartis à raison de 20 milliards entre 2026 et 2035, et de 15 milliards entre 2036 et 2048.
M. le président François Brottes. Vous avez donc anticipé l’effet « Baupin » !
M. Fabien Choné. Peut-être faudra-t-il encore prendre en compte d’autres paramètres. Quoi qu’il en soit, une prolongation de l’ARENH au-delà de 2026 se traduirait par un prix de l’ARENH très significativement inférieur entre 2026 et 2035, et donc par une chute du tarif réglementé de vente. Il est louable de faire preuve de prudence, mais la logique retenue par le projet de décret reviendrait à faire peser la plus grande partie des efforts sur les années 2014 à 2025. Une telle solution ne nous paraît pas très favorable aux consommateurs, dans la mesure où une partie non négligeable des investissements de maintenance lourde à effectuer pendant cette période sont destinés à prolonger la durée de vie des centrales nucléaires.
M. le président François Brottes. Vous proposez donc d’inclure le coût de la construction de l’EPR dans le calcul du prix de l’ARENH.
M. Fabien Choné. Non, d’autant que la loi ne le permet sans doute pas.
M. le président François Brottes. Elle peut être modifiée en ce sens. De fait, quand la nouvelle centrale sera construite, il faudra bien en tenir compte : il serait compliqué d’appliquer un autre prix à l’énergie produite par l’EPR. Inclure cet investissement dans le calcul de l’ARENH serait donc un moyen de lissage.
M. Fabien Choné. Nos simulations ne tiennent pas compte de l’EPR, qui ne concerne qu’un réacteur, contre cinquante-six réacteurs classiques.
M. le président François Brottes. Un seul réacteur, mais qui coûte cher.
M. Fabien Choné. Certes, mais ce coût est pondéré par celui de la production des autres réacteurs. Il est vrai qu’une fois en service, l’EPR produira de l’énergie nucléaire que l’on pourra qualifier d’historique. En tout cas, je le répète, nos simulations ne prennent pas en compte ce que l’on appelle le « nouveau nucléaire ».
Il ne paraît pas raisonnable de se montrer aussi prudent pendant la période de régulation, au risque de faire subir au consommateur une augmentation significative du tarif réglementé de vente. Une telle vision revient à faire payer tout de suite – et au plus mauvais moment, de surcroît – le coût d’investissements qui porteront leurs fruits au-delà de 2025.
Quant à l’autre hypothèse, qui ne verrait prolonger au-delà de cette date ni l’ARENH ni le tarif réglementé de vente, elle nous inquiète encore plus. Cela reviendrait, pour la collectivité, à faire un énorme cadeau à EDF en payant la totalité de sa maintenance et des investissements réalisés pour prolonger la durée de vie de ses centrales, tout en lui laissant l’entière liberté de fixer par la suite la tarification de l’énergie nucléaire correspondante.
M. le président François Brottes. Avez-vous saisi le régulateur de cette hypothèse de travail ?
M. Fabien Choné. Je ne le crois pas, mais nous avons répondu à la consultation de la DGEC.
Nous avons réfléchi à une proposition alternative au projet de la Direction générale, conciliant la volonté de faire preuve de prudence et la nécessité d’une répartition raisonnable des efforts au cours du temps.
Tout d’abord, s’agissant des actifs dédiés au démantèlement des installations nucléaires, il ne nous paraît pas légitime de faire payer pendant la période de régulation les quinze quarantièmes du total, alors qu’une grande partie de ces charges a déjà été couverte par le passé, ni de prévoir une rémunération de ces fonds à un taux de 8,4 %. Nous proposons donc, d’une part, que la méthode de calcul ne prenne en compte que les charges non déjà couvertes auparavant, et, d’autre part, que la répartition de la charge résiduelle soit actualisée au taux objectif de rendement des actifs dédiés, soit environ 5 %.
En ce qui concerne les investissements initiaux, le projet de décret envisage d’en faire payer la totalité pendant la période de régulation. Or une partie de ces investissements – entre 3 et 4 milliards d’euros – porte sur la période suivante. Nous estimons que cette part des investissements non amortis en 2025 ne doit pas être couverte par l’ARENH.
De même, s’agissant du grand carénage, une proportion non négligeable du coût total – lequel atteint 45 milliards d’euros – doit permettre la réalisation d’investissements qui serviront au-delà de la période de régulation. Ne disposant d’aucun chiffre permettant de justifier cette répartition, nous avons pris pour hypothèse de travail que ces investissements, qui devraient être payés après 2025, représentent 15 milliards d’euros.
En revanche, il est hors de question de toucher aux 10 milliards d’euros prévus pour les travaux de sécurisation du parc. Ces travaux doivent être réalisés de toute façon, que la durée de vie des centrales soit ou non prolongée.
Compte tenu de ces choix, nous aboutissons à un prix moyen de l’ARENH sur la période 2011-2025 de 37,90 euros de 2011 par mégawattheure. L’estimation de l’évolution de son prix en euros courants pendant la période de régulation montre que le prix actuel est suffisant pour couvrir l’ensemble des charges jusqu’en 2015.
Nous avons également estimé l’effet de notre proposition alternative sur l’évolution de l’ARENH pendant la période régulatoire et post-régulatoire, dans l’hypothèse où le mécanisme serait prolongé pour dix ans. Dans ce schéma, l’ARENH devrait couvrir après 2025 une partie des investissements initiaux, et la part consacrée à la maintenance lourde serait plus importante, dans la mesure où il faudrait financer les investissements non pris en compte pendant la période précédente. Le résultat est une évolution régulière du prix de l’ARENH au cours des vingt ans à venir : l’augmentation du tarif réglementé de vente ne dépasserait donc pas l’inflation. Au contraire, la prudence excessive manifestée par la DGEC dans son projet de décret reviendrait à faire payer par le consommateur, sur une durée très courte et à un moment où la situation économique est difficile, la plus grande partie des investissements nécessaires.
Vous l’aurez compris, notre proposition aurait pour effet d’éviter de rémunérer plus qu’il n’est nécessaire l’opérateur historique pendant la période de régulation. En effet, une tarification lui permettant de réaliser un bénéfice excessif serait contraire à la décision prise le 12 mai 2009 par la Commission européenne, qui a mis fin aux procédures intentées contre le TaRTAM et les tarifs réglementés. Par ailleurs, nous estimons qu’un tel choix aurait un impact très négatif pour le consommateur pendant la période de régulation, et par la suite, qu’il pourrait avoir un effet inquiétant sur la concurrence. C’est pourquoi nous demandons que le calcul du prix de l’ARENH pendant la période de régulation ne prenne en compte que les investissements qui porteront leurs fruits pendant cette période – même si nous ne savons pas quelle part exacte ils représentent dans le total.
Dans la mesure où le prix actuel de l’ARENH suffit à couvrir les coûts de production, nous proposons qu’il ne subisse aucune évolution avant la fin de l’année 2015. Il nous paraît, en effet, raisonnable d’en maintenir le niveau pendant la construction des tarifs réglementés par empilement des coûts, telle qu’elle est prévue par la loi NOME. En outre, il est nécessaire d’organiser au préalable la convergence des tarifs jaune et vert, qui doivent disparaître le 31 décembre 2015.
Tel est le message principal que nous souhaitons faire passer : l’importance de la production d’électricité nucléaire en France ne doit plus justifier implicitement que l’on fasse obstacle à l’ouverture du marché de la fourniture. Ce n’est pas dans l’intérêt du consommateur ni conforme à l’objectif de transition énergétique, alors que le déploiement de Linky doit nous conduire à proposer de nouvelles offres. C’est pourquoi nous demandons que le projet de décret soit modifié pour tenir compte de nos propositions.
M. le président François Brottes. Pour résumer, vous avez d’abord jugé que le tarif réglementé, trop bas, ne permettait pas le libre jeu de la concurrence, ce qui vous a conduit à engager une procédure contentieuse. Aujourd’hui, comme pour vous faire pardonner, vous estimez que l’on peut maîtriser le prix de l’électricité à condition d’étaler autrement les charges prises en compte pour le calcul de l’ARENH.
M. Fabien Choné. C’est tout à fait cela, même si notre but n’est pas de nous faire pardonner.
Deux choix sont possibles pour déterminer une politique tarifaire : couvrir les coûts ou ne pas les couvrir. Ne pas les couvrir peut avoir deux conséquences : soit on ne réalise pas les investissements nécessaires, ce qui, s’agissant d’un parc de production d’énergie nucléaire, nous ferait courir à la catastrophe ; soit on fait payer la différence par le contribuable. C’est ce qui est arrivé en Espagne, où le « déficit tarifaire » atteint 30 milliards d’euros, un montant tel que l’État a été obligé de le titriser sur les marchés financiers et d’en faire porter le poids sur le contribuable espagnol. Une telle solution ne peut pas être satisfaisante : faire payer par le contribuable une partie de la facture adressée au consommateur, c’est envoyer un mauvais signal économique.
M. le président François Brottes. C’est ce qui a failli nous arriver pour la contribution au service public de l’électricité (CSPE).
M. Fabien Choné. C’est même peut-être déjà arrivé, puisqu’EDF réclame 5 milliards d’euros d’arriérés correspondant aux charges de service public non compensées par la CSPE. Qui va payer ? Les consommateurs ou les contribuables ? Nous ne le savons pas. D’ailleurs, même si on fait appel aux consommateurs, ce sont ceux de demain qui rembourseront une dette du passé.
M. le président François Brottes. Cela peut se défendre, dans la mesure où il s’agit de financer le développement des énergies du futur. En tout état de cause, ce sont bien les consommateurs qui régleront l’ardoise, ne serait-ce que via les dividendes que l’État reçoit d’EDF.
M. Fabien Choné. C’est l’engagement qui a été pris, mais faute d’une modification du montant de la CSPE pour les années à venir, rien ne vient le confirmer aujourd’hui.
En Espagne, l’effort pèse sur le contribuable, ce qui perturbe la transmission d’un signal économique au consommateur et n’incite pas à réaliser des investissements en matière de rénovation thermique et d’efficacité énergétique. En outre, un tarif qui ne permet pas de couvrir les coûts a pour effet d’asphyxier la concurrence. C’est bien pourquoi nous avons été contraints, pour survivre, de nous défendre et d’engager une procédure contentieuse. Croyez-moi, cela ne nous amuse pas du tout.
En dehors de la part de 15 % sur les coûts de commercialisation que j’évoquais tout à l’heure, aucune des hausses de coût ayant un retentissement sur le tarif réglementé – qu’il s’agisse des réseaux, du parc de production nucléaire, des énergies renouvelables ou des autres moyens de production – n’a quoi que ce soit à voir avec le développement de la concurrence. Nous ne pouvons pas accepter que l’on fasse un tel lien. C’est, au contraire, quand on observe une hausse des coûts et des prix que l’on a intérêt à développer la concurrence, qui seule permettra la modération tarifaire – pour éviter toute ambiguïté, je parle bien de modération tarifaire et non de baisse des prix.
Nous préférerions de beaucoup nous développer dans un marché baissier, car la situation actuelle donne de la matière aux sophismes de nos contradicteurs. Néanmoins, dans un marché haussier, la concurrence ne peut que bénéficier aux consommateurs, à condition de la laisser jouer et de cesser d’invoquer, implicitement ou non, la spécificité nucléaire pour empêcher son développement dans l’activité de commercialisation. Non seulement la concurrence peut entraîner des gains – certes modestes – en termes de modération tarifaire, mais surtout elle peut permettre aux consommateurs de consommer moins et mieux, et d’absorber ainsi l’augmentation des prix.
M. le président François Brottes. J’imagine que vous avez réfléchi à la manière de faire accepter l’approche différente que vous proposez en matière de calcul du coût du nucléaire.
Dans ce domaine, toutes les décisions ne relèvent pas de l’opérateur historique ; le législateur, entre autres, a aussi son mot à dire, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets ou le coût du démantèlement. Nous sommes ainsi régulièrement amenés à nous poser la question de savoir si les provisions qui sont constituées sont suffisantes ou non.
En suggérant d’étaler autrement les investissements, vous proposez une approche innovante, ce qui donne tout son intérêt à cette audition. Je suis plutôt d’accord avec votre souci d’éviter une augmentation excessive du tarif suivie d’une chute brutale. Mais qu’en est-il de la faisabilité technico-juridique de votre proposition ?
M. Fabien Choné. Le fait de considérer, pour l’établissement du prix de l’ARENH, les investissements visant à prolonger la durée de vie du parc nucléaire comme des OPEX, c’est-à-dire des charges opérationnelles, constitue déjà une forme d’inventivité économique et financière ouvrant la voie à de nombreuses hypothèses. Le problème réside dans la faisabilité financière : l’opérateur historique de production nucléaire a-t-il la capacité financière de réaliser tous ces investissements, sachant que sa dette est supposée ne pas augmenter ? Nous n’avons pas fait le calcul, mais tout laisse penser que c’est envisageable. Pour autant, je le répète, nous ne disposons d’aucune donnée permettant de déterminer quelle est la part respective des investissements en matière de maintenance lourde qui porteront leurs fruits avant et après 2025. La répartition que nous avons retenue – 30 milliards pendant la période de régulation, 15 milliards après – est une simple hypothèse de travail proposée à titre d’illustration.
M. le rapporteur. Vos simulations sont construites à partir d’une vision très continuiste, ce que je peux comprendre. Toutefois, comment prenez-vous en compte l’engagement du Président de la République, confirmé dans la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, de réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité en 2025 ? Quel que soit le nombre exact de réacteurs devant être fermés pour l’atteindre – la DGEC l’a évalué à une vingtaine –, un tel objectif ne peut qu’entraîner une modification significative de vos prévisions. En effet, les coûts d’investissements liés à la prolongation de la durée de vie des centrales ne seraient pas les mêmes en cas de réduction du parc.
De même, vos simulations ne tiennent pas compte de l’EPR, et prennent donc pour hypothèse la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants. Or l’Autorité de sûreté nucléaire a précisé qu’une prolongation au-delà de quarante ans impliquerait l’élaboration d’un référentiel de sûreté spécifique, comparable en exigence à celui qui s’applique à la troisième génération. On sait que les réacteurs n’auront pas tous la capacité d’y répondre, ne serait-ce que parce qu’une enceinte de confinement s’use avec le temps – en particulier la cuve du réacteur, sous l’effet du bombardement neuronique – et qu’elle ne peut être remplacée. Il existe donc des risques de fractures, comme on l’a vu en Belgique.
Dès lors, le coût de la mise à niveau, en termes de sûreté, des réacteurs pourrait se révéler suffisamment important pour compromettre leur compétitivité, au point de conduire l’opérateur à renoncer à prolonger leur durée de vie alors même qu’il aurait été autorisé à le faire par l’Autorité de sûreté. Tous ces paramètres sont de nature à modifier la donne et rendent difficile toute projection à long terme. Ne peuvent-ils pas bouleverser vos scénarios ?
Vous avez parlé, dans un premier temps, de compteurs intelligents, puis cité dans un deuxième temps le cas de Linky. Selon vous, Linky est-il un compteur intelligent ? D’aucuns préfèrent l’expression de « compteur communicant ». Cet outil vous semble-t-il constituer une réponse en termes de maîtrise de l’énergie ?
Enfin, étant, comme moi, membre du Conseil supérieur de l’énergie, vous avez participé aux débats sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). J’aimerais connaître votre avis sur l’utilisation des réseaux : qui doit payer pour leur entretien ? Il s’agit d’un des éléments clés de la transition énergétique, au sujet duquel vous avez d’ailleurs formulé des propositions à plusieurs reprises.
M. Fabien Choné. La part d’électricité produite par le nucléaire ne peut s’apprécier que par rapport au reste de la production. Nous jugeons pertinent de favoriser un transfert d’usage vers l’électricité – en particulier pour alimenter des véhicules –, dès lors que ce transfert permet le développement des énergies renouvelables. Il n’aurait évidemment pas de sens de développer les véhicules électriques si leurs batteries sont rechargées avec de l’électricité produite à partir de fioul. La France pourrait relever le défi de la stratégie bas carbone en recourant massivement aux énergies renouvelables, notamment électriques. Dans cette hypothèse, le maintien du parc nucléaire existant ne serait pas incompatible avec la règle des 50 %, du moins en termes de puissance installée.
M. le rapporteur. Cela impliquerait une augmentation d’environ 50 % de la consommation électrique d’ici à 2025 !
M. Fabien Choné. Je triche un peu, je le reconnais, en parlant non d’énergie, mais de puissance installée. Celle-ci atteint aujourd’hui à peu près 100 000 mégawatts, dont 63 % viennent de l’industrie nucléaire. En développant significativement la puissance des énergies renouvelables et en organisant des transferts d’usage, on peut parvenir à un seuil de 50 % tout en allant dans le sens de la transition énergétique. C’est moins vrai quand on raisonne en termes d’énergie : la part du nucléaire atteint alors 75, voire 78 %.
Vous m’avez demandé ce qui se passerait si les coûts de maintenance lourde des centrales s’avéraient finalement bien supérieurs à ce qui était prévu, au point de devoir envisager de fermer des installations plutôt que d’en prolonger la durée de vie. Je le reconnais, nos simulations ne tiennent pas compte de telles hypothèses, pour la simple raison que nous ne disposons d’aucun élément permettant de les modéliser. Nos projections sont fondées sur des hypothèses simples : nous avons prolongé – peut-être de façon abusive – au-delà de 2025 la courbe retraçant l’évolution du prix de l’ARENH, afin d’envisager ce qui pourrait se passer à long terme.
M. le rapporteur. La question n’est pas que purement théorique. Vous envisagez de reporter au-delà de 2025 la prise en compte par l’ARENH de certains coûts. Une réduction de la taille du parc serait de nature à modifier significativement vos propositions, quel que soit l’avis que l’on peut avoir sur leur contenu.
M. Fabien Choné. Le problème est que le projet de décret raisonne à partir d’un âge moyen du parc – comme si toutes les centrales avaient quarante ans en 2025. Selon cette vision, pour faire preuve de prudence, il faut que toutes les charges soient payées avant, comme si l’on envisageait que tout puisse s’arrêter à cette date. En outre, le projet considère comme charges opérationnelles des dépenses qui sont en fait des investissements susceptibles d’être amortis.
Il serait préférable de raisonner tranche par tranche, ce qui permettrait de lisser l’effet d’éventuelles modifications du parc. Si l’on doit arrêter le fonctionnement d’une tranche parce que sa sécurisation coûterait beaucoup plus cher que ce qu’elle est susceptible de rapporter, cela aurait évidemment une incidence sur l’évolution du prix de l’ARENH, mais pas un effet brutal. Or le projet de décret ne repose pas sur un tel raisonnement : il conduit à faire payer tous les investissements avant 2025, même ceux réalisés en 2024 pour les années 2026 et suivantes. Nous ne remettons pas en cause ce raisonnement, mais nous appelons à ne prendre en considération, pendant la période de régulation, que les investissements destinés à porter leurs fruits pendant cette même période. Dans le cas contraire, l’ARENH baissera de façon très importante après 2025, ce qui rendra disproportionnés les efforts réclamés avant cette date aux consommateurs. Non seulement cela ne permet pas de lisser l’effort, mais le risque est que la différence ne soit pas rétrocédée aux Français, faute d’un cadre suffisamment concurrentiel.
En ce qui concerne l’EPR, la loi NOME prévoit la possibilité, pour les nouveaux entrants, et même pour les industriels, de participer au développement du nucléaire nouveau, une disposition à laquelle nous sommes favorables. Nous serons attentifs aux conclusions du rapport sur le sujet que le Gouvernement doit remettre au Parlement avant 2015. En effet, il nous paraît difficile de négocier nous-mêmes avec EDF les modalités de cette participation ; celle-ci devra être organisée par la puissance publique.
Je ne sais pas si j’ai qualifié Linky de « compteur intelligent ». De fait, il n’est pas si intelligent que cela, et est essentiellement communiquant. Néanmoins, il reste, de notre point de vue, éminemment utile pour développer les nouvelles offres et les nouveaux services que j’ai évoqués tout à l’heure. En revanche, nous regrettons que les spécificités de ce compteur soient issues du cahier des charges rédigé en 2007 par la CRE, alors que, depuis, la loi NOME a créé le mécanisme de capacité et l’ARENH, deux dispositifs spécifiques à la France qui sont très intéressants.
M. le président François Brottes. L’effacement a été ajouté après.
M. Fabien Choné. L’effacement existait déjà en 2007, mais il est vrai que vous touchez là un point sensible.
Quoi qu’il en soit, les 30 millions de compteurs Linky qui vont être installés chez les consommateurs ne prévoient pas de mesurer les consommations qui donnent droit à l’ARENH ou au mécanisme de capacité. En conséquence, pour les 20 millions de consommateurs ayant souscrit des tarifs réglementés de base, la mesure des droits à l’ARENH et de l’obligation de capacité continuera à passer par un profilage agrégeant les comportements de ces consommateurs. En d’autres termes, on ne saura pas différencier un consommateur se chauffant avec des radiateurs électriques d’un autre, et on leur attribuera exactement les mêmes obligations de capacité, ce qui est regrettable. Il aurait été plus efficace que Linky enregistre spécifiquement les obligations de capacité, d’une part, et les droits à l’ARENH, d’autre part, de façon à ce que cette information puisse être utilisée par les fournisseurs – soit celui du client, soit un autre fournisseur désireux de proposer une offre à ce dernier – de manière à optimiser la consommation. Il est trop tard pour modifier les 3 millions de compteurs déjà installés, mais il est impératif que les autres puissent mesurer ces deux niveaux de consommation, même s’ils ne sont pas pris en compte par la tarification du fournisseur en titre.
S’agissant des réseaux, nous regrettons qu’en France, comme un peu partout en Europe, les charges liées à leur accès ne soient imputées qu’au consommateur. C’est une aberration économique : une nouvelle fois, on n’envoie pas les signaux-prix permettant d’optimiser le réseau. La rationalité voudrait que les charges de réseau pèsent sur ceux qui en sont à l’origine. Or les producteurs ne participent pas au financement de ces charges. Même les pertes par effet Joule ne sont pas prises en compte. Si elles l’étaient, et si l’effet des producteurs sur les charges de réseaux faisait l’objet d’une tarification, on pourrait optimiser le réseau.
M. le président François Brottes. Ne serait-ce pas une façon de remettre en cause la péréquation de la perte en ligne ?
M. Fabien Choné. Non, parce qu’il est toujours possible de conserver une péréquation tarifaire au niveau du timbre de soutirage. Aujourd’hui, tout est payé par le consommateur dans le cadre d’une péréquation. En conséquence, il n’est pas possible d’envoyer un signal-prix selon des critères géographiques. C’est normal : on ne peut pas inciter les Marseillais à s’installer à Lille sous prétexte que le coût de production de l’énergie y est moins élevé. En revanche, si un producteur préfère, faute de signal-prix correspondant à l’injection dans le réseau, démarrer la centrale située à Lille plutôt que celle de Marseille et transporter l’électricité à travers tout le territoire, avec toutes les pertes par effet Joule que cela implique, il va à l’encontre d’une optimisation du système électrique.
M. le président François Brottes. Les 2 milliards de pertes en ligne annuelles ont fait l’objet d’un long débat au sein de la commission Champsaur. Qui, du transporteur, du distributeur, du producteur ou du client, doit payer ? La question reste entière.
M. Fabien Choné. Elle a d’ailleurs un lien avec le thème de cette commission d’enquête. Le fait de ne pas facturer au producteur l’accès au réseau entraîne une distorsion entre le producteur d’énergie nucléaire, très centralisé, et les producteurs d’énergies renouvelables, très décentralisés. En pratique, le premier crée beaucoup plus de charges de réseaux que les seconds.
M. le président François Brottes. Si on ne tient pas compte de l’intermittence !
M. Fabien Choné. Le mécanisme de capacité, s’il fonctionne – ce dont on peut douter –, devrait répondre en partie au problème de l’intermittence.
La construction de la ligne électrique Cotentin-Maine, par exemple, sera payée par l’ensemble des consommateurs, y compris ceux dont l’offre comprend une énergie d’origine 100 % renouvelable. Le système actuel ne donne aucun moyen de comparer les coûts de réseau de la production nucléaire à ceux des productions d’énergies renouvelables décentralisées. On parle souvent de « parité réseau » à propos de ces dernières, mais l’expression nous paraît galvaudée. Une véritable parité imposerait, pour pouvoir comparer les coûts de production, d’imputer sur les producteurs les charges dont ils sont responsables, et notamment les charges de réseau.
M. le président François Brottes. Un tel raisonnement reste très théorique. Il serait valable s’il existait un réseau par type d’énergie, ce qui serait pour le moins compliqué.
M. Fabien Choné. La tarification nodale d’accès au réseau des producteurs existe dans d’autres pays, notamment les États-Unis, et permet d’optimiser le réseau.
M. le président François Brottes. Les États-Unis n’offrent pas le meilleur exemple en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux d’électricité.
M. Fabien Choné. Ils ont pourtant, grâce à cette forme de tarification, divisé par deux ou trois les pertes par effet Joule sur le réseau.
M. le président François Brottes. En matière de continuité du service, ils sont moins bons que nous.
M. Fabien Choné. Je ne cherche pas à faire l’apologie du système adopté aux États-Unis : je ne parlais que de la tarification de l’accès au réseau des producteurs.
D’ailleurs, l’agence qui regroupe les régulateurs européens a publié, la semaine dernière, un avis sur le règlement de l’Union européenne prévoyant un encadrement de la tarification de l’accès au réseau par les producteurs : elle juge légitime la création de timbres d’injection pour financer les pertes, les services auxiliaires et le développement du réseau.
Je terminerai, monsieur le président, avec votre question sur la trêve hivernale. Je ne crois pas que les clients des membres de l’ANODE aient pu souffrir d’une forme quelconque de délaissement. Cette rumeur est infondée.
Cela étant, nous apprécions l’extension, par la loi Brottes, du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux, car le phénomène de précarité énergétique tend à s’aggraver. Face à l’augmentation des coûts de production de l’énergie, et donc des prix, la bonne solution est de protéger ceux qui en ont vraiment besoin, et d’envoyer les bons signaux économiques à tous les autres.
M. le président François Brottes. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie.
Audition de M. Raymond Leban, directeur « Économie, tarifs, achats » (EDF)
(Séance du 30 avril 2014)
Un document mis à la disposition de la commission d’enquête est accessible à la fin de la version PDF du présent compte rendu, à l’adresse suivante :
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cenucleaire/13-14/c1314057.pdf
M. le président François Brottes. Monsieur le directeur, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette audition consacrée à la commercialisation de l’électricité.
Nous venons d’entendre les présidents d’Exeltium et de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), qui figurent parmi vos clients. La question des tarifs de l’électricité est au centre de l’actualité : à peine Mme la ministre venait-elle de prendre son poste qu’on lui expliquait qu’il fallait que soit annoncée une nouvelle hausse. Dans ce contexte, personne ne comprend bien l’intérêt de l’ouverture du secteur de l’énergie à la concurrence ; en particulier, les industriels électro-intensifs paient en France l’électricité plus cher que dans d’autres pays, notamment en Allemagne.
Comment EDF, opérateur historique incontournable, qui intervient à toutes les étapes du cycle – production, transport, distribution –, voit-il les choses ? Peut-on imaginer qu’à l’avenir, les coûts puissent diminuer ? Car quand Mme la ministre dit qu’il faut revoir la manière sont constitués les tarifs, je ne vois pas d’autre piste possible – à part la vente à perte ! L’ANODE vient de faire des propositions intéressantes visant à baisser le prix de l’ARENH. EDF a-t-elle engagé des réflexions favorables aux intérêts du consommateur ?
Avant de vous laisser la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Raymond Leban prête serment)
M. Raymond Leban, directeur de la direction « Économie, tarifs et prix » d’EDF. Monsieur le président, je vous remercie de donner à EDF l’occasion de s’exprimer sur le sujet important de la commercialisation de l’électricité d’origine nucléaire en France, c’est-à-dire sur les conditions de vente de cette électricité en référence à son coût de production.
La première question que j’évoquerai est celle du prix auquel l’exploitant d’un parc nucléaire doit commercialiser l’électricité produite par ses centrales pour couvrir ses coûts sur la durée de fonctionnement de celles-ci.
Les coûts à couvrir entrent dans quatre catégories : les coûts liés à l’investissement initial dans la construction du parc de centrales, les coûts d’exploitation correspondant aux dépenses courantes de fonctionnement du parc, les coûts d’investissement de maintenance réalisés pour assurer une bonne performance de l’outil de production au plan de la sûreté et de la disponibilité et pour permettre un allongement de la durée de fonctionnement des centrales, enfin les coûts liés à la gestion à long terme des déchets et au démantèlement des centrales.
Selon l’approche dite « économique », la formule de prix prévoit, au-delà de la couverture des coûts annuels, la récupération de l’investissement initial dans la construction du parc, c’est-à-dire le remboursement et la rémunération des apporteurs de capitaux, à travers un loyer constant en monnaie constante, c’est-à-dire évoluant comme l’inflation. En d’autres termes, le prix de commercialisation de l’électricité produite est calé sur le « coût économique complet » du parc – on parle aussi de « coût complet économique » ou de « coût courant économique ».
Cette approche est celle qui prévalait en France, avant l’ouverture à la concurrence, pour fixer les prix de vente de l’électricité au client final – dits « tarifs réglementés de vente » : les tarifs étaient calés sur les « coûts marginaux de long terme ».
C’est également cette approche qui a sous-tendu le raisonnement du législateur au cours de la préparation et du vote de la loi du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l’électricité, dite loi « NOME » : d’une part, le représentant du Gouvernement de l’époque avait tenu à préciser durant les débats que seraient pris en considération « l’ensemble des coûts à valeur économique, et non pas simplement à valeur comptable » ; d’autre part, la loi elle-même fait référence aux « conditions économiques » de la production nucléaire.
Une politique de commercialisation de l’électricité nucléaire fixant le prix de celle-ci au niveau du coût économique complet du parc permet d’offrir au consommateur de la stabilité, en même temps qu’elle assure à l’opérateur la couverture des coûts dans la durée.
En janvier 2012, la Cour des Comptes a évalué le coût économique complet du parc actuel à 54 euros de 2010 par mégawattheure (MWh), en moyenne, sur la période 2011-2025 visée par la loi NOME – soit un niveau très en deçà du coût de développement de n’importe quel nouveau moyen de production.
Dans les faits, le prix de commercialisation de l’électricité nucléaire française, tel qu’il apparaît au travers des tarifs réglementés de vente, est toutefois inférieur au coût économique complet depuis le milieu des années 90 – époque à laquelle ont été pratiquées des baisses de prix assez brutales. Il est clair que cela participe largement à la situation de free cash flow (flux de trésorerie disponible) négatif que connaît le groupe EDF depuis que les investissements ont repris – ceux-ci ayant beaucoup augmenté entre 2011 et 2013.
En outre, ce sera mon deuxième point, le prix de commercialisation de l’électricité nucléaire est appelé à jouer un rôle clé sur le marché et pour EDF d’ici à 2025, du fait de la loi NOME.
Celle-ci, adoptée à la fin 2010 dans le but de concilier le développement de la concurrence induit par l’appartenance de la France au marché européen avec le maintien pour le consommateur français de l’avantage que constitue la compétitivité du parc nucléaire national, fait obligation à EDF de fournir un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique (ARENH) produite par ce dernier. Aux termes de la loi, tout fournisseur peut obtenir des volumes d’électricité nucléaire à un prix régulé pour approvisionner ses consommateurs finals, dans une proportion égale à « ce que représente la part de la production des centrales […] dans la consommation totale des consommateurs finals ». Le dispositif doit être décliné au travers de deux décrets : l’un, qui fixe les modalités d’accès à l’ARENH, a été publié le 28 avril 2011 ; l’autre, qui doit permettre de déterminer le prix de l’ARENH, est encore en discussion.
Le champ d’application de ce dispositif est très large. Aujourd’hui, EDF commercialise la plus grande partie de son électricité – 304 térawattheures (TWh) – via le tarif réglementé de vente, les entreprises locales de distribution d’électricité (ELD) disposant d’un contrat aux tarifs de cession pour un volume de 18 TWh. En 2013, la répartition de ce volume de 304 TWh était le suivant : 183 TWh destinés aux clients résidentiels et aux petits professionnels facturés au tarif bleu, 41 TWh pour les PME-PMI facturées au tarif jaune, et 80 TWh pour les gros industriels facturés au tarif vert. EDF réalise également des ventes sur offre de marché pour un volume de 55 TWh, ainsi que des ventes d’ARENH à ses concurrents pour 64 TWh.
Pour que la concurrence ne soit pas biaisée, EDF s’impose de construire ses offres d’électricité sur le marché en utilisant les mêmes règles d’attribution et de prix d’ARENH que celles appliquées aux autres fournisseurs, et en complétant, comme ses concurrents, les droits au nucléaire par l’achat de compléments aux prix de marché en vigueur. Nous faisons donc comme les fournisseurs alternatifs : il s’agit d’une obligation à la fois économique et réglementaire.
La loi NOME dispose, en outre, que les tarifs réglementés de vente aux clients résidentiels – le tarif bleu – seront construits au plus tard au 31 décembre 2015 par empilement, c’est-à-dire par « addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale » ; il n’y aura donc plus de risque d’effet de ciseaux. Quant aux tarifs jaune et vert, ils seront supprimés au 1er janvier 2016, ce qui conduira les consommateurs concernés à souscrire chez le fournisseur de leur choix une offre de marché. Ainsi, à l’horizon 2016, tous les consommateurs finals en France, qu’ils restent au tarif réglementé ou qu’ils souscrivent une offre de marché chez EDF ou chez l’un de ses concurrents, bénéficieront de volumes d’ARENH représentant globalement 75 % de la consommation française.
En conséquence, une très large part de la production nucléaire historique d’EDF sera vendue au prix de l’ARENH, qui sera directeur pour les recettes. Sa fixation est donc un enjeu majeur. Ce prix constituera toutefois un maximum pour EDF, car acheter du nucléaire historique est pour les fournisseurs, non pas une obligation, mais une option, intéressante seulement si le prix de l’ARENH est inférieur à celui du marché. Quand la loi a été conçue, on ne pensait pas que la situation contraire pourrait arriver – et pourtant !
Troisième point, la loi NOME donne des indications sur le niveau auquel le prix de l’ARENH doit être fixé. Elle précise ainsi que l’accès régulé est consenti « à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires ». Cette formulation a été explicitée par le représentant du Gouvernement, Benoist Apparu, le 28 septembre 2010, lors de l’examen du projet de loi par le Sénat : « Dans l’esprit du Gouvernement, conformément d’ailleurs à l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi, c’est bien l’ensemble des coûts à valeur économique, et non pas simplement à valeur comptable, qui seront pris en considération », a-t-il précisé.
Fixer le prix de l’ARENH au niveau du coût économique complet est donc conforme à l’esprit de la loi. C’est à cette condition qu’EDF pourra contribuer au financement de la transition énergétique, et cela sera d’autant plus bienvenu que les filières bas carbone sont les plus intenses en capital ; nous aurons besoin d’investisseurs, et il faut que ceux-ci disposent de moyens de financement.
En conclusion, je voudrais souligner que lorsque le dispositif ARENH a été conçu, il n’avait pas été envisagé que le prix de marché puisse être inférieur au prix de l’ARENH ; or nous nous trouvons aujourd’hui dans cette situation qui paraissait impossible. En conséquence, fixer le prix de l’ARENH au niveau du coût du nucléaire historique ne suffira pas à assurer qu’EDF pourra couvrir ce coût sur la durée de la période de régulation. En effet, dans les périodes où le prix de marché sera inférieur à celui de l’ARENH, EDF vendra sa production au prix du marché, alors que lorsque le prix de marché sera supérieur à celui de l’ARENH, EDF vendra sa production au prix de l’ARENH.
Néanmoins, le point positif est qu’un nucléaire existant au coût économique complet constitue sans aucun doute un avantage concurrentiel fort pour la France.
M. le président François Brottes. Où en sont les négociations avec Exeltium ?
M. Raymond Leban. Il s’agit de la renégociation d’un contrat d’un type particulier, que nous avions passé avec les industriels électro-intensifs il y a quelques années – j’imagine que M. Roncato vous a expliqué dans quelles conditions. Cela prend la forme d’un co-investissement, avec un partage des risques.
M. le président François Brottes. Certes, mais a-t-on une idée du moment où la négociation aboutira ?
M. Raymond Leban. Il est difficile de le savoir. Les discussions sont en cours de finalisation ; elles portent actuellement sur la nécessité de tenir compte des modifications des conditions. Cela pourrait aboutir relativement vite.
M. Denis Baupin, rapporteur. Vous avez conclu en disant que, dans les prochaines années, le prix de marché serait inférieur à l’ARENH, mais que son parc nucléaire historique était un atout pour la France. N’est-ce pas contradictoire ? Si nous produisons de l’électricité à un prix supérieur à celui du marché, en quoi notre parc nucléaire est-il un atout ?
De même, vous avez expliqué que si l’on calait le prix de commercialisation de l’électricité sur le coût courant économique du parc nucléaire, on aboutirait à un tarif de 54 euros du MWh, alors que depuis vingt ans les tarifs pratiqués sont largement inférieurs. N’est-ce pas le signe d’un dysfonctionnement profond ? Ferait-on de la vente à perte ? Il existe certainement des explications techniques à ce phénomène, mais du point de vue économique et dans la perspective de la transition énergétique, comment l’analysez-vous ? Que préconiseriez-vous pour réintroduire un peu de bon sens dans tout cela ? Pour le commun des mortels, les relations entre les coûts et les tarifs sont totalement opaques !
Selon vous, à quel niveau devrait être l’ARENH aujourd’hui ?
Je voulais, moi aussi, vous interroger sur la négociation en cours avec Exeltium, mais je crois que je n’obtiendrai pas plus de réponse que le président…
M. Choné, le président de l’ANODE, nous a dit que l’absence de timbre d’injection sur les réseaux n’incitait pas les producteurs à utiliser les installations de production les plus proches des consommateurs. Partagez-vous cette opinion ? Pensez-vous qu’une répartition plus juste des coûts d’utilisation du réseau entre le consommateur et le producteur serait nécessaire ?
Le projet de loi sur la transition énergétique est en préparation. Quelle que soit la position que chacun peut avoir sur les différentes technologies de production d’électricité, nous voulons tous faire en sorte de protéger nos entreprises électro-intensives afin d’éviter qu’elles ne partent ailleurs et que l’on perde encore de l’emploi. Quelles sont les préconisations d’EDF en la matière ?
M. Raymond Leban. Monsieur le rapporteur, le prix de marché est aujourd’hui à un niveau déraisonnable, au point qu’aucune technologie de production d’électricité, quelle qu’elle soit, ne peut trouver de rentabilité.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un argument qui est souvent employé mais, en général, pour affirmer que la construction d’installations neuves est moins rentable que l’utilisation des installations existantes.
M. Raymond Leban. Même pour les installations existantes, on n’arrive plus à couvrir les coûts variables ! La situation est devenue tellement critique que certaines centrales à cycle combiné gaz qui viennent d’être construites ont été mises sous cocon, parce qu’on ne pouvait pas faire face aux charges d’exploitation !
Les explications sont multiples : il y a la crise économique, bien entendu, mais aussi le très bas prix du CO2, actuellement de 5 euros la tonne, alors qu’il était auparavant aux alentours de 20 euros et qu’on espérait qu’il monterait à 30. On est actuellement dans un système complètement fou dans lequel il est plus intéressant de faire tourner des centrales à charbon que des centrales à gaz ! Le marché donne des signaux défavorables aux investissements. Les électriciens sont contraints de mettre des centrales sous cocon – ce qui leur coûte de l’argent – et n’investissent pas. Le fonctionnement du marché européen de l’électricité est un réel problème.
M. le président François Brottes. La présence sur le réseau d’énergie éolienne fatale contribue-t-elle à faire baisser les prix de marché ?
M. Raymond Leban. Il est certain que si les énergies fatales étaient rendues dispatchables, cela améliorerait les choses – c’est d’ailleurs ce qui se fait dans certains pays.
Tout dépend du rythme auquel les énergies renouvelables sont développées. Si, dans une période de contraction de la demande, on ajoute des modes de production sans coûts variables en les rendant prioritaires, ceux-ci vont prendre la place des autres et on va accroître le désarroi. Il importe de préserver l’équilibre du marché.
À la Commission européenne, il y a, d’un côté, les personnes qui s’occupent du marché de l’électricité et du coût marginal de production, et, de l’autre, celles qui s’intéressent au CO2 – alors qu’il faudrait qu’elles travaillent ensemble. Il conviendrait de rationaliser tout cela ; mais cela prend du temps et suppose des compromis et des accords politiques qui nous dépassent, nous autres électriciens. Il reste que le prix du CO2 est une variable essentielle.
La situation actuelle est totalement atypique : les prix de marché étaient à 50-55 euros il n’y a pas si longtemps. Il faut revenir à la raison et que le marché émette à nouveau des signaux cohérents et favorables aux investissements.
Quel est le bon prix pour l’ARENH ? Nous sommes convaincus qu’il convient de rester fidèle aux principes qui ont prévalu à l’élaboration des tarifs historiques de l’électricité en France, sous l’instigation de Marcel Boiteux. Il s’agit, non pas de se fonder sur ce que coûterait aujourd’hui le parc, comme je l’ai entendu dire, mais de récupérer les investissements consentis. On a mis un terme à cette logique à la fin des années 90. Or, si le phénomène reste dissimulé durant les périodes où les investissements – qui fonctionnent par cycles – ne sont pas importants, dès que ceux-ci redémarrent, des problèmes de cash-flow se posent. En conséquence, nous pensons que le coût économique complet est la valeur à retenir pour fixer le prix de l’ARENH.
M. le rapporteur. C’est-à-dire 54 euros ?
M. Raymond Leban. Tout à fait.
Je crois que cela a toujours été la position d’EDF, car elle est fondée sur une réalité économique.
La question du timbre d’injection est techniquement complexe, et me semble quelque peu hors sujet. Il faudrait l’étudier en détail.
Nous nous soucions de la situation des électro-intensifs, et c’est précisément pour cette raison que nous avons conclu un accord avec Exeltium et que nous avons fait un effort en faveur de Rio Tinto Alcan. En tant qu’électriciens, nous sommes avant tout soucieux d’assister et d’accompagner les industriels de tous les niveaux – y compris les PME – dans leurs efforts d’économies d’énergie. Par exemple, nous avons aidé les champagnes Feuillatte à doubler leur capacité de production à consommation électrique inchangée. Nous offrons également des tarifs avec effacement des jours de pointe (EJP), notamment pour ceux de nos clients qui ne bénéficieront plus des tarifs jaune et vert.
Les statistiques d’Eurostat montrent que, sauf pour les très gros industriels électro-intensifs, ceux dont la consommation annuelle est supérieure à 550 gigawattheures, le prix de l’électricité pour l’industrie est en France 35 % inférieur à son prix en Allemagne et 30 % inférieur à son prix dans la zone euro. Néanmoins, force est de constater que quelques très gros électro-intensifs allemands bénéficient d’exonérations sur la taxe CO2, la contribution au financement des énergies renouvelables (EEG), voire les coûts de transport. Ils évoluent ainsi dans un autre monde – mais c’est aux pouvoirs publics, et non pas à nous, d’en tirer d’éventuelles conclusions. En outre, ces différences ne sont apparues qu’en 2013 : avant, on n’en décelait aucune. Elles résultent uniquement des mesures très sélectives que notre voisin a décidé de prendre.
M. le président François Brottes. Les différences de tarifs me semblent un peu plus anciennes, mais on ne disposait d’aucune information sur ce que payaient réellement les entreprises. Or, pour avoir eu des témoignages de délocalisations d’entreprises de France vers l’Allemagne liées aux différences de coût de l’énergie, je sais que les choses étaient déjà bien engagées il y a cinq ans.
Quant à l’effacement, il en existe deux sortes : l’effacement vertueux, qui consiste à ne pas consommer pour favoriser l’équilibre général, et un autre qui l’est beaucoup moins, dans la mesure où l’entreprise continue à produire de l’électricité avec un moyen local, comme un groupe électrogène. Il serait temps que le législateur fasse la différence entre les deux ! Quelles sont les parts réciproques de l’un et de l’autre ?
M. Raymond Leban. Difficile à dire ! Nombre d’industriels possèdent des diesels, mais je ne peux pas vous donner de chiffres précis dans l’immédiat. Je vous les transmettrai ultérieurement.
M. le rapporteur. Pour fixer le prix de l’ARENH, l’ANODE suggère d’étaler la durée d’amortissement des investissements au-delà de 2025, dans la mesure où il n’y a, selon elle, aucune raison de la raccourcir si les centrales continuent de fonctionner après cette date. Que pensez-vous de cette proposition ?
M. le président François Brottes. En d’autres termes, il s’agirait d’anticiper une probable baisse de tarif en 2025 en fixant le prix de l’ARENH autour de 30 euros.
M. Raymond Leban. Le problème, c’est que nous ne sommes pas d’accord avec le postulat de l’ANODE. Nous pensons, quant à nous, que le prix de l’ARENH doit être calé sur le coût économique complet, qui, comme je l’ai expliqué, reste constant en monnaie constante sur toute la durée de vie du parc. Ce serait une solution simple, qui éviterait que l’on s’interroge sans cesse sur ce qui adviendra à l’issue de la période visée par la loi NOME – sachant que, contrairement à ce que sous-entend la note de l’ANODE, il n’est pas garanti que celle-ci soit prolongée.
Quoi qu’il en soit, j’observe que les représentants de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ont évoqué devant votre commission d’enquête une trajectoire croissante pour le prix de l’ARENH, et que le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a dit que celui-ci devait augmenter.
M. le président François Brottes. Il y a un fossé entre l’analyse de l’ANODE et la vôtre.
M. Raymond Leban. C’est une évidence, monsieur le président !
M. le président François Brottes. Monsieur le directeur, merci pour cet échange.
Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE
(Commission de régulation de l'énergie)
(Séance du 30 avril 2014)
M. le président François Brottes. Les tarifs de l’électricité ne cessent d’être contestés, les arrêtés tarifaires reconsidérés et même annulés. La nouvelle ministre chargée de l’énergie, qui a trouvé ce dossier sur son bureau à sa prise de fonctions, pense que le dispositif doit être revu. Monsieur le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), vous savez la difficulté de l’exercice. Pour connaître quelque peu ces sujets, je pense qu’il est difficile de reconsidérer les tarifs sans reconsidérer les coûts. Dans le rapport sur les coûts qu’elle a publié en juin dernier, la CRE exposait des certitudes mais faisait aussi partd’incertitudes. Le législateur sera sans doute amené à conduire un travail spécifique d’investigation tant cette affaire est parfois inextricable. Elle concerne au plus haut point notre commission d’enquête consacrée aux coûts du nucléaire – ses coûts propres mais aussi comparés à ceux des autres énergies.
Nous avons entendu cet après-midi le président d’Exeltium. Quel regard portez-vous sur les accords qui ont pu être passés entre EDF et ce consortium, qui regroupe des industriels électro-intensifs ? Nous avons également entendu le président de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE). Celui-ci nous a exposé qu’il était possible, avec un étalement différent dans le temps, de faire baisser de manière significative le prix de l’ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Il n’a toutefois pas su nous dire comment le faire sur des bases juridiques correctes. Que pensez-vous des propositions de l’ANODE ?
La régulation tarifaire évoluera nécessairement car, dans les années à venir, il n’y aura plus beaucoup de tarifs réglementés, du moins en théorie. La CRE n’observe pas passivement l’évolution des tarifs, elle peut interagir sur les questions relatives à l’effacement, au marché de capacité, à l’accès à l’électricité nucléaire historique. Autant de dispositifs, accessibles ou non à des compteurs intelligents – cela, c’est encore un autre sujet ! –, sur lesquels elle a son mot à dire. Pourriez-vous nous dresser un état des lieux, essentiellement pour ce qui concerne l’ARENH, sans oublier les coûts de transport et de distribution ? Qui les supporte ? Qui devrait les supporter ?
Chacun sait que les industriels allemands se débrouillent beaucoup mieux que leurs homologues français. Est-ce parce que le régulateur est de meilleure qualité outre-Rhin ? Un benchmarking montre qu’il existe en Allemagne une tolérance qui n’existe pas en France. Je ne ferai pas le procès de la CRE comme je fais parfois celui de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Nous n’en sommes pas encore à dénombrer trop de victimes dans le secteur de l’énergie, mais cela pourrait arriver.
Aujourd’hui, les consommateurs, industriels et domestiques, commencent à trouver la facture lourde. Jusqu’à présent, on nous assurait que nous avions la chance, en France, de payer notre électricité moins cher qu’ailleurs. Plus personne ne le croit.
Voilà, brossé à grands traits, de manière quelque peu caricaturale, je le concède et vous prie de m’en excuser, l’état de notre réflexion, centrée sur la question des coûts véritables. S’agissant, par exemple, du coût du grand carénage programmé par EDF, son évaluation varie du simple au double, voire plus. Quel est l’avis de la CRE sur le sujet ? Peut-être a-t-elle eu accès, en toute transparence, à des documents lui permettant de certifier les montants avancés par EDF. La Cour des comptes, pour sa part, se fonde sur ce qui lui est dit, sans nécessairement disposer des éléments de preuve. Vous indiquiez dans votre rapport de juin dernier, que j’ai lu avec grande attention, que de nombreux points restaient à expertiser. Le chantier est donc toujours ouvert.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Philippe de Ladoucette prête serment)
M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie. De tous les sujets que votre commission d’enquête doit embrasser, seule une partie concerne la CRE. Je commencerai par celui du prix de l’électricité payé par les industriels français et de leur situation comparée à celle de leurs homologues allemands. Pour faire bénéficier les industriels allemands d’avantages spécifiques, l’autorité de régulation allemande peut s’appuyer sur un support législatif, lequel fait aujourd’hui défaut en France. Pour autant, comme nous ne sommes pas du tout insensibles à la situation de nos entreprises électro-intensives, nous avons décidé hier, je vous l’indique ici en avant-première, d’abaisser pour elles d’environ 50 % le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité) pour l’année à venir, sous certaines conditions de volume de consommation.
M. le président François Brottes. Ce n’est pas là une nouvelle anecdotique.
M. Philippe de Ladoucette. J’en suis tout à fait conscient. Toutefois, il s’agit d’une mesure « à un coup ». Pour la suite, si le Gouvernement ou le législateur estime nécessaire de soutenir la compétitivité des entreprises électro-intensives en France, une loi sera nécessaire, précisant les niveaux de consommation à partir desquels telle ou telle réduction pourra être accordée sur le TURPE. Sans faire du benchmarking avec l’Allemagne, nous avons souhaité faire un geste à l’égard de ces entreprises qui connaissent une situation difficile.
Vous avez mentionné l’envolée des tarifs de l’électricité depuis l’ouverture du marché. Il faut tout de même rappeler qu’en dépit des augmentations successives, certes sensibles pour le consommateur, de 2002 à 2014, l’évolution du prix de l’électricité reste inférieure de 3 % à l’inflation. Les augmentations tarifaires qui ont eu lieu ne sont pas aussi importantes qu’elles peuvent en donner l’impression. Pour le gaz, sur la même période, la hausse est de 40 % en euros constants.
Comment pourraient évoluer les coûts à l’avenir ? Il est important d’en avoir une idée puisque les tarifs doivent être fixés de façon à couvrir ces coûts. Dans notre rapport de juin dernier, pour la première fois, nous avions fait un tour d’horizon approfondi du sujet. Nous approfondissons encore certains sujets importants dans le rapport que nous préparons actuellement et que nous ne devrions, hélas ! pas pouvoir remettre avant que votre commission d’enquête n’ait terminé ses travaux, EDF, très sollicitée, notamment par la Cour des comptes et peut-être par vous-mêmes, ayant pris du retard pour nous communiquer les informations nécessaires. Cela ne nous empêchera pas de vous fournir de premiers éléments, non écrits et non encore définitifs, qui vous apporteront un éclairage complémentaire.
Pour des raisons conjoncturelles, l’année 2013 ayant été plus froide en moyenne que les années précédentes, le TURPE n’augmentera pas cette année, et même diminuera. Une année plus froide signifie, en effet, plus de consommation d’énergie, donc plus de recettes que prévu. La diminution, au 1er août, du TURPE aura une incidence positive sur l’ensemble des tarifs. Cela sera encore plus sensible lorsque les tarifs réglementés seront, comme la loi NOME (nouvelle organisation du marché de l’électricité) dispose qu’ils le sont au plus tard le 1er janvier 2016, construits par empilement du prix de l’ARENH, du complément de 20 % pris sur le marché de gros, du coût du marché de capacité, des coûts commerciaux, du TURPE et enfin, comme il est dit, « d’une rémunération normale » – sur ce dernier point, nous ne savons pas vraiment ce qu’a voulu dire le législateur.
M. le président François Brottes. Il vous a laissé le soin de déterminer cette « rémunération normale » !
M. Philippe de Ladoucette. Nous attendons d’être saisis du projet de décret, qui est à la consultation. Au passage, la proposition que vous a présentée cet après-midi le représentant de l’ANODE a été communiquée à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), mais pas à la CRE. Tant que nous ne connaissons pas le contenu exact du projet de décret, quelques arbitrages restant à rendre, nous pouvons difficilement dire quel sera le prix de l’ARENH au 1er janvier 2015. Dès le décret connu, nous rendrons un avis et calculerons ce prix, vraisemblablement fin septembre début octobre.
Un autre décret est nécessaire, déterminant comment se constituera véritablement l’empilement. Je ne sais pas s’il sera pris dans les semaines ou les mois qui viennent, mais c’est indispensable pour stabiliser la mécanique permettant de calculer les tarifs par empilement à partir de l’ARENH.
M. le président François Brottes. Cette nouvelle modalité de calcul est-elle très différente de ce qui se pratiquait avec la prise en compte des coûts ?
M. Philippe de Ladoucette. Oui. Il existe aujourd’hui une sorte de schizophrénie autour des tarifs réglementés. En même temps que l’on a conservé ces tarifs, on a confié à la CRE la responsabilité de déterminer le coût de l’acheminement – transport et distribution. La logique aurait voulu que ce coût soit obligatoirement répercuté sur le tarif et qu’on y ajoute les coûts de production. En fait, les gouvernements successifs ont toujours proposé à la CRE une évolution globale des tarifs bleu, jaune et vert sans distinction ni clé de répartition entre coûts de production et coûts d’acheminement. Une hausse de 2 %, par exemple, était censée couvrir l’augmentation des coûts d’acheminement mais elle ne couvrait en aucune manière celle des coûts de production. En revanche, lorsque les tarifs seront élaborés par empilement, on pourra identifier précisément ce qui correspond à chaque élément de l’édifice, à la base duquel il y aura le prix de l’ARENH. Ce qui peut faire une différence, c’est le complément de 20 %, qui est un sujet assez sensible.
M. le président François Brottes. Très sensible même !
M. Philippe de Ladoucette. Si nous avons bien compris l’intention du législateur dans la loi NOME, ces 20 % pouvaient être pris sur le marché. J’ai le sentiment que, à l’époque, le législateur n’a envisagé que le contexte d’un marché haussier. Or le marché n’est pas haussier. La question est de savoir si, dans un autre contexte, ce complément de 20 % permettrait toujours de couvrir les coûts comptables d’EDF, sur la base desquels les tarifs réglementés ont été fixés jusqu’à aujourd’hui.
M. le président François Brottes. Avec l’empilement, la référence n’est donc plus nécessairement les coûts comptables.
M. Philippe de Ladoucette. Tout à fait. Nous ne faisons qu’appliquer les textes. Il pourra y avoir une divergence entre les coûts comptables et les prix de marché.
M. le président François Brottes. Ne pourrait-on pas faire un parallèle avec le gaz ? Lorsqu’on a révisé les modalités de calcul des tarifs du gaz, on a donné plus de place aux prix du marché, qui étaient plus bas que ceux des contrats d’approvisionnement à long terme.
M. Philippe de Ladoucette. Ce n’est pas la même chose. L’indexation du prix du gaz sur celui du pétrole n’est pas une décision de l’entreprise, mais des fournisseurs avec lesquels elle doit négocier. Cela correspond donc bien à un coût réel, c’est ce que nous vérifions en ce moment. Il y aura probablement une évolution aussi en ce domaine.
Si le marché est baissier, cela ne pose pas de problème pour la contestabilité en concurrence. En revanche, si même avec le complément de 20 % pris sur le marché, les coûts n’étaient plus couverts et que les fournisseurs alternatifs, nouveaux entrants, ne pouvaient pas contester les tarifs, se poserait un problème de concurrence. Cette difficulté est, pour l’instant, théorique, mais elle pourrait se présenter un jour, sans compter le problème pour EDF de continuer à investir. On n’en est pas là aujourd’hui, mais ce problème risque d’advenir dans les mois ou les années à venir.
L’élaboration des tarifs par empilement ne signifie donc pas nécessairement leur envolée. Elle peut aussi être un élément de maîtrise de leur évolution.
M. le président François Brottes. Comment seront prises en compte les fluctuations des prix de marché, et avec quelle périodicité ?
M. Philippe de Ladoucette. Environ tous les ans.
M. le président François Brottes. Même si les prix fluctuent mensuellement ?
M. Philippe de Ladoucette. On prendra une moyenne annuelle, pas le prix de marché au jour le jour, afin de conférer une certaine stabilité.
M. Denis Baupin, rapporteur. Les avantages dont bénéficient les électro-intensifs allemands sont aujourd’hui attaqués par la Commission européenne. La diminution du TURPE pour les électro-intensifs français, que la CRE s’apprête à décider, comme vous venez de nous l’annoncer, est-elle tout à fait solide sur le plan juridique ?
Autre question importante au regard de la transition énergétique : prend-on ou non en compte les timbres d’injection dans le calcul du TURPE, de façon à inciter au rapprochement entre producteur et consommateur ? Vous paraît-il pertinent d’introduire ce critère dans le calcul du TURPE ? L’ANODE nous a indiqué que des résultats avaient pu être obtenus aux États-Unis par ce biais et des économies significatives ainsi réalisées.
La CRE attend le décret pour fixer le prix de l’ARENH. Lorsque nous vous avions auditionné au début de nos travaux, vous nous aviez indiqué que, vu la façon dont avait été fixé le prix de 42 euros par mégawattheure (MWh), on serait plutôt aujourd’hui à 10 % au-dessus, soit environ à 46 euros. Dans le même temps, EDF dit que ce devrait être 54 euros, et l’ANODE, 37 euros. Entre 37 et 54 euros, l’écart est de 50 %. Vu le volume de mégawattheures en jeu, l’écart peut finir par représenter une somme rondelette ! Pourriez-vous revenir sur ce point ?
La CRE a-t-elle été plus chanceuse que nous ? A-t-elle pu se faire une idée de ce que recouvrent les opérations de grand carénage? Nous n’avons eu, pour notre part, que des réponses générales de la part d’EDF, n’offrant pas une vision complète de la situation. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ne le sait pas non plus, ni les syndicats d’EDF, que nous avons auditionnés ce matin. Votre éclairage nous serait très utile, car ce programme d’investissements ne sera pas sans impact sur les coûts de l’électricité.
M. le président François Brottes. Quel est votre avis sur les conclusions du rapport commandé par Greenpeace au cabinet Wise ? Qui dit la vérité ?
M. le rapporteur. Le cabinet Wise a essayé d’évaluer ce que coûterait la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires en les portant au niveau de sûreté de la troisième génération, que l’ASN dit être l’objectif si leur durée de vie est prolongée.
M. Philippe de Ladoucette. Nous n’avons pas ce rapport.
M. le président François Brottes. Nous vous le transmettrons.
M. le rapporteur. Ma dernière question porte sur le marché de l’électricité. Pas une seule des personnalités que nous avons auditionnées jusqu’à présent n’a jugé qu’il fonctionne bien ni n’incite aux investissements vertueux. Le représentant d’EDF que nous entendions avant vous disait que, globalement, les seuls à pouvoir s’en sortir étaient ceux qui produisaient de l’électricité à partir du charbon, ce qui n’est quand même pas ce qu’il faut souhaiter vu les dérèglements climatiques déjà observés. Le groupe Magritte des patrons de l’énergie, constitué autour de GDF-Suez, fait lui aussi le constat que ce marché, dont les règles ont été conçues à une certaine époque, dysfonctionne aujourd’hui. Le consensus semble général. Quel est le sentiment de la CRE ? Ne serait-il pas temps de se doter d’outils de régulation du marché incitant à l’efficacité énergétique, au développement des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au lieu, comme aujourd’hui, que le marché n’aille à l’encontre de tous les efforts faits en ces domaines ? Que proposeriez-vous en ce sens ?
M. Philippe de Ladoucette. Je l’ai dit, la décision que nous nous apprêtons à prendre concernant les électro-intensifs ne vaudra que pour cette année. Pour une parfaite sécurité juridique ultérieure, une loi sera nécessaire. Nous ne savons pas où en sont exactement les discussions entre l’Allemagne et la Commission européenne sur l’exonération du paiement de l’acheminement pour certaines entreprises – nous savons seulement où elles en sont pour ce qui concerne l’équivalent de notre CSPE (contribution au service public de l’électricité). Certains éléments laissent penser que la Commission pourrait accepter le principe d’une exonération. Si tel était le cas, je ne vois alors pas pourquoi nous ne pourrions pas, si le Gouvernement et le législateur le souhaitaient, mettre en place un dispositif équivalent en France. Mais un support législatif est indispensable. Le régulateur ne peut pas prendre seul une telle décision à long terme.
Pour ce qui est du timbre d’injection, sujet récurrent, le principal objectif est de donner un signal de localisation aux producteurs. Nous en avons beaucoup discuté lors de la définition du TURPE 4. S’agissant de la distribution, nous avons décidé d’attendre un retour d’expérience des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) afin d’éviter de donner des doubles signaux. Pour ce qui concerne le transport, nous estimons que le sujet doit être discuté au niveau européen, car cela pourrait avoir un effet contre-productif sur les interconnexions. Là aussi, comme sur le marché de capacité, nous estimons nécessaire une approche européenne. Nous serons certainement amenés à reparler de tous ces sujets lors de la fixation du TURPE 5.
Le marché de l’électricité ne fonctionne pas, dites-vous. Comment s’en étonner ? Les gouvernements nationaux et la Commission européenne ont mis en place, d’un côté, un marché intérieur de l’énergie qui fonctionne à peu près, et, d’un autre côté, une politique climatique, sans jamais s’interroger sur la coordination des deux. Lorsque la direction Climat de la Commission a présenté ses orientations aux autorités de régulation, elle a jugé ennuyeux de les engager alors que le marché ne fonctionnait pas encore très bien. Les deux directions, Climat et Énergie, de la Commission ont avancé parallèlement, chacune de son côté promouvant un système qui n’était pas véritablement coordonné avec l’autre : d’un côté, on mettait en place un marché, d’un autre côté, on incitait au développement des énergies renouvelables par le biais de subventions. Or, sans coordination, un système de marché et un système subventionné ne peuvent pas cohabiter sans aboutir à des dysfonctionnements. Et ce qui devait arriver est arrivé : le marché s’est bloqué et de mauvais signaux ont été adressés. Je ne porte pas de jugement de valeur, je ne dis pas que l’un est mieux que l’autre. Je déplore simplement un manque de coordination. Du fait de cette incohérence, plusieurs centrales à gaz ont, par exemple, été fermées parce qu’elles n’étaient plus rentables. À qui la faute ? Sans doute à un manque de vision globale de la part de la Commission européenne et des gouvernements nationaux qui n’ont pas perçu qu’en promouvant les deux ensemble, cela poserait un problème.
Le marché intérieur de l’énergie fonctionne. Le commissaire européen à l’énergie avait souhaité qu’il soit achevé en 2014 par le biais de l’interconnexion des réseaux. C’est en train de se faire, et tout sera bouclé, avec un peu de retard, en 2015, non que l’on ait réalisé assez d’interconnexions, mais parce qu’ont été créés tous les codes de réseau nécessaires, aussi bien pour le gaz que pour l’électricité, à tous les niveaux. D’ici à un an, toute la structure nécessaire à l’existence d’un véritable marché sera en place. Mais il faut, par ailleurs, que les décideurs politiques au niveau européen clarifient leurs positions et sachent ce qu’ils veulent vraiment. Ce n’est pas un problème de marché, mais de décision politique.
M. le président François Brottes. Je dénonce depuis longtemps ce manque de cohérence. Lorsque nous transposons les directives, nous transposons surtout ce qui a trait à la concurrence et à l’organisation du marché, assez peu le reste pour lequel on se contente de déclarations d’intention, donc non normatives. On n’analyse pas assez non plus l’impact d’un côté de ce qu’on exige de l’autre côté. La Commission européenne marche certes « à côté de ses pompes », mais les parlements nationaux, eux non plus, ne font pas d’effort de mise en cohérence. La réflexion demeure cloisonnée. Or, plus on avance, plus la logique de l’un s’éloigne de celle de l’autre.
Je vous remercie, monsieur le président de la CRE, de confirmer ce que je dis moi-même depuis longtemps. Que préconiseriez-vous pour que, au moins à l’échelle nationale, nous puissions rendre le tout plus cohérent ? Les contradictions sont devenues telles que les dysfonctionnements qui en découlent atteignent des proportions non négligeables, qu’il s’agisse de la fermeture de centrales thermiques à gaz ou des pertes d’énergie fatale. Le prix presque nul du quota de carbone fait qu’on ne peut rien réguler sur ce terrain-là, et les événements suivent leur cours sans qu’on ait prise sur eux. Nous serions vraiment preneurs de préconisations utiles sur le plan juridique.
M. Philippe de Ladoucette. Je reviens à la question du rapporteur sur l’ARENH. Lors de ma première audition par votre commission, j’avais dit que si l’on appliquait aujourd’hui la même méthode que celle que nous avions proposée dans le cadre de notre avis de 2011, le prix de l’ARENH serait supérieur d’environ 10 % à ce qu’il est. Mais d’après ce que l’on sait du décret en préparation, certaines modalités de calcul seraient revues. Quand j’évoquais 10 % de plus, c’était toutes choses égales par ailleurs. Attendons les derniers arbitrages et le texte définitif. Tout sera-t-il verrouillé ou la CRE disposera-t-elle de quelques marges de manœuvre sur certaines options ? Nous ne savons pas, par exemple, à quel rythme, plus ou moins rapide, les investissements seront pris en compte. Cela sera-t-il défini dans le décret ou laissé pour une part à notre appréciation ?
Pour ce qui est du grand carénage, j’avais cru comprendre qu’EDF n’utilisait plus cette dénomination.
M. le président François Brottes. Nous pouvons vous confirmer qu’elle est encore employée.
M. Philippe de Ladoucette. Je suis quelque peu embarrassé pour vous répondre. Nous n’y verrons clair que lorsque nous aurons terminé notre rapport. Cela ne nous empêchera pas de vous communiquer des éléments auparavant.
M. le président François Brottes. Je craignais que vous ne disiez que vous n’y verriez clair que lorsque le grand carénage serait terminé !
M. Philippe de Ladoucette. Notre rapport ira plus vite que le grand carénage. Cela dit, vous n’avez pas complètement tort, monsieur le président, comme toute prévision, elle comporte des incertitudes. Nous attendons encore certains éléments de la part d’EDF.
M. le président François Brottes. Même si votre rapport n’est pas achevé, merci de nous communiquer tous les éléments que vous aurez à votre disposition, car nous sommes, nous, tenus de remettre le nôtre dans un délai fixé par la Constitution et que nous ne pouvons allonger.
Monsieur le président, nous vous remercions.
Audition de M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF
(Séance du 6 mai 2014)
M. le président François Brottes. Notre commission d’enquête, qui achèvera ses travaux début juin, réfléchit sur le marché européen de l’énergie, notamment de l’électricité. Elle a étudié successivement le combustible, son retraitement, la maintenance des centrales, la sous-traitance, le coût de la prolongation des réacteurs, le coût et la faisabilité du démantèlement, puis le stockage et le traitement des déchets.
Au cours de nos travaux, monsieur le président-directeur général d’EDF, vous avez laissé s’exprimer plusieurs de vos collaborateurs, ce qui explique que votre intervention soit particulièrement attendue, notamment pour évaluer le coût du grand carénage.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Henri Proglio prête serment)
M. Henri Proglio, président-directeur général d’EDF. Je vous remercie de m’offrir l’occasion de vous présenter la vision d’EDF du coût de la filière nucléaire, c’est-à-dire de la performance économique du parc de production nucléaire d’EDF au service de la compétitivité de notre pays.
Sollicité pour dix auditions officielles, trois auditions individuelles, trois visites de centrale et des échanges de documents par courrier, le groupe a largement contribué à votre commission d’enquête. Vous en êtes probablement arrivés à la conclusion que le parc de production nucléaire français est un atout pour aborder la transition énergétique dans les meilleures conditions.
Concernant les coûts, je rappellerai deux éléments clés. D’une part, il n’existe pas de coût caché du nucléaire : tous les coûts sont identifiés et exposés par l’exploitant responsable qu’est EDF. D’autre part, le parc nucléaire existant est compétitif, les coûts de production actuels et futurs restant en deçà des coûts de développement de tout autre moyen de production d’électricité à partir du charbon, du gaz ou des énergies renouvelables, ce qui montre l’intérêt économique de tirer le meilleur parti, dans la durée, du parc existant.
J’y vois le résultat de la maîtrise industrielle d’EDF qui entend garantir à ses clients et à nos concitoyens un parc nucléaire sûr, bien entretenu et compétitif. Notre projet est axé sur ces trois objectifs.
La maîtrise industrielle vise d’abord à garantir la sûreté du parc. Le niveau de sûreté de nos réacteurs est notre absolue priorité. Nous l’améliorons en continu en déclinant des référentiels toujours plus exigeants et en prenant en compte le retour d’expérience de toutes les opérations nucléaires du monde, dont l’accident de Fukushima.
Notre objectif, partagé avec beaucoup d’autres exploitants, est de rendre impossible la contamination de long terme des territoires. L’énergie nucléaire ne peut être durablement acceptée que si, lorsqu’un accident survient, malgré toutes les précautions que nous prenons pour que ce ne soit pas le cas, les populations peuvent continuer à vivre normalement à proximité des installations. L’ensemble des évolutions que nous avons menées depuis trente ans, et que nous continuons de conduire dans le cadre du retour d’expérience de Fukushima, va dans ce sens. En France, les réacteurs sont équipés de filtres qui retiennent 99,9 % du césium, responsable de la contamination à Fukushima.
La maîtrise industrielle suppose que l’on sache investir. Comme vous l’avez constaté au cours de nos travaux, nous investissons fortement sur le parc nucléaire. De quoi s’agit-il ? D’emplois et de commandes au tissu industriel français.
Notre investissement est avant tout humain. EDF anticipe la gestion des ressources humaines et adapte ses effectifs pour pouvoir renouveler les compétences et assurer l’exploitation du parc dans la durée. Je me suis attaché à instaurer une dynamique du recrutement, vitale pour le groupe. EDF reste un employeur remarqué : en 2013, pour la troisième année consécutive et malgré la crise économique, nous avons procédé à 6 000 embauches, dont 2 000 créations nettes d’emploi, le parc nucléaire représentant à lui seul près de la moitié des embauches.
Nous investissons également dans l’outil de production, pour améliorer en continu la sûreté de nos réacteurs, ainsi que pour rénover et remplacer nos matériels. Nous avons accéléré notre programme de maintenance durant ces dernières années. Comme tout outil industriel, le parc nucléaire exige un entretien régulier pour fonctionner de manière pérenne, en toute sûreté, avec des performances attendues. Le niveau récurrent des investissements nécessaires atteint 50 millions d’euros par réacteur et par an, montant commun à nombre d’opérateurs nucléaires du monde occidental, notamment belges et américains. Nous connaissons leurs chiffres, car nous possédons des participations dans certains de leurs réacteurs. Sur l’ensemble du parc, le niveau d’investissement pour la maintenance courante est comparable à celui des autres infrastructures industrielles de grande taille, et légèrement inférieur à celui réalisé pour le réseau de distribution en France, qui s’élève à 3 milliards par an.
Toutefois, pendant quelques années, notre investissement sera supérieur à ce niveau récurrent, compte tenu du cycle de vie du parc nucléaire. Il faut en effet assurer le renouvellement des gros composants et procéder à des améliorations très significatives du niveau de sûreté, au lendemain de Fukushima. C’est dans cette optique que nous prévoyons 55 milliards d’investissements prévisionnels d’ici à 2025, avant de revenir, après cette date, au niveau récurrent.
La maîtrise industrielle suppose également que l’on sache maîtriser les coûts, notamment de production. Nous garantissons dans la durée l’équilibre économique, en réinterrogeant les différents projets pour identifier les marges de manœuvre, dans un cadre très contraint par les exigences réglementaires. Tous mes collaborateurs sont investis dans cette démarche, dont ils comprennent l’enjeu pour l’avenir du parc nucléaire français.
Depuis trois ans, nous avons réduit de près de 8 milliards nos prévisions d’investissement sur 2011-2025, ce qui représente une économie significative. Nous garantissons dans la durée un coût de production de 55 euros valeur 2011, en euros constants, par mégawattheure (MWh), avec la réalisation du programme de grand carénage et une durée de fonctionnement de cinquante ans. Nous garantissons ainsi à nos clients et à la collectivité nationale que le parc nucléaire existant est compétitif par rapport à toutes les alternatives, puisque le coût de revient du MWh se situe entre 70 et 100 euros pour les centrales au charbon ou au gaz, aux alentours de 85 euros pour l’éolien terrestre – sans compter les surcoûts d’intermittence et de réseaux – et jusqu’à quatre fois plus pour l’éolien offshore. La compétitivité s’apprécie sur l’ensemble de la durée de fonctionnement du parc.
Par ailleurs, il suffit de comparer nos dépenses de maintenance et d’exploitation à celles des autres opérateurs mondiaux, pour se convaincre que nous ne jetons pas l’argent par les fenêtres. Une étude comparative portant sur les parcs américains et français montre qu’en 2012, les Américains ont dépensé environ 50 % de plus que nous par réacteur.
La maîtrise industrielle du parc nucléaire existant s’inscrit dans une stratégie d’entreprise plus large, qui répond aux objectifs de la politique énergétique de notre pays. La conférence Paris Climat 2015 rappellera l’enjeu du bas carbone. Or notre parc hydronucléaire constitue un atout majeur, qui place la France parmi les plus faibles émetteurs de CO2 par habitant, en Europe comme dans le monde.
Nous soutenons l’activité économique, notamment industrielle, fragilisée par la crise, puisque de nombreux secteurs d’activité et de nombreuses régions de France observent notre programme d’investissement pour les dix ans à venir. Le maintien dans la durée d’un des parcs de production électrique les plus compétitifs d’Europe est facteur de compétitivité pour toute l’économie française.
Dans le bâtiment, particulièrement le logement social, et les transports, EDF participe à de nombreux programmes qui permettront d’économiser l’énergie. Dans ce secteur, qui concerne des milliers de petites entreprises, la formation aux nouveaux métiers et aux nouvelles technologies est déterminante. C’est pourquoi nous avons signé, la semaine dernière, avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), le partenariat FEE Bat (former aux économies d’énergie dans le bâtiment), en présence des ministres de l’énergie et du logement.
EDF s’engage résolument à préparer l’avenir énergétique avec les nouvelles énergies renouvelables. Tel est le sens du développement réalisé par EDF Énergies nouvelles, des green bonds, émis pour plus de 1 milliard d’euros, pour financer les investissements dans les énergies nouvelles, et de la multiplication des expérimentations sur les réseaux intelligents, menées en partenariat avec les collectivités locales, notamment les grandes métropoles comme Lyon ou Nice. L’avenir, c’est aussi le véhicule électrique, pour lequel EDF a noué des partenariats avec les grands constructeurs français et mondiaux.
M. Denis Baupin, rapporteur. Monsieur le président-directeur général, je remercie votre équipe, que notre commission d’enquête a beaucoup sollicitée, bien que, sur certains points, nous n’ayons pas obtenu toutes les informations demandées.
Nous ne disposons pas d’une évaluation précise des investissements nécessaires à la mise en conformité du parc nucléaire, dans l’optique du post-Fukushima. Comment se décompose le chiffre global de 55 milliards à l’horizon de 2025, que vous avez avancé ? Quels sont les investissements déjà réalisés ? L’entreprise pourra-t-elle financer des travaux qui entraîneront l’indisponibilité temporaire des cinquante-huit réacteurs ? À en croire le rapport de Jean Tandonnet, inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection du groupe EDF, il vous sera difficile de tenir vos objectifs de sûreté en menant un tel chantier.
Comment va évoluer le parc ? Situation sans équivalent à l’étranger, le nucléaire fournit 78 % à 80 % de notre électricité, ce qui nous fragilise, comme l’a relevé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : il suffirait que l’on découvre un défaut générique dans les installations pour que l’on doive les fermer en urgence. Comment évoluera le pourcentage du nucléaire dans l’électricité française, que le Gouvernement s’est engagé à réduire à 50 % en 2025 ? Est-il possible de prolonger la vie des réacteurs jusqu’à soixante ans tant sur le plan technique, sachant que l’ASN ne s’est pas prononcée sur une prolongation de l’exploitation au-delà de quarante ans, que sur le plan économique, la prolongation du parc actuel étant conditionnée à sa mise au même niveau de sûreté que celui des réacteurs de troisième génération ? Comment réagissez-vous au chiffrage effectué par le cabinet Wise-Paris ?
Comment envisagez-vous l’avenir de l’EPR ? Nous connaissons les difficultés rencontrées, en termes de délais et de surcoût, sur le chantier de Flamanville, que nous avons visité. Par ailleurs, le contrat signé avec la Grande-Bretagne prévoit un prix garanti pendant trente-cinq ans et une garantie de l’État sur les emprunts, ce qui oblige à reconsidérer la compétitivité sur des bases très différentes de celles qui avaient été d’abord envisagées. Allez-vous privilégier la construction d’installations plus légères, d’un montant non de 8 milliards, comme à Flamanville, mais de 6 à 6,5 milliards, ou préférerez-vous construire des réacteurs du type ATMEA ?
M. Hervé Mariton. L’exécutif envisage de fermer la centrale de Fessenheim avant la date envisagée par EDF. Il en a le droit, comme il a celui de nationaliser une entreprise, pourvu qu’il y ait une juste et préalable indemnisation. À combien évaluez-vous le montant de celle-ci ?
Aux termes du projet de loi sur la transition énergétique, le Gouvernement pourra, à sa seule initiative, contraindre l’opérateur à fermer d’autres tranches nucléaires. Trouvez-vous cela normal, alors que la fermeture de Fessenheim, comme toute décision du même type, exige l’accord du Parlement ? Le dispositif vous paraît-il constitutionnel ?
Enfin, sur quelle base allez-vous calculer le montant de la compensation, sachant qu’EDF envisage de poursuivre l’exploitation de ses réacteurs jusqu’à soixante ans ?
M. le président François Brottes. Hier, à Fessenheim, nous avons constaté de visu que beaucoup de travaux avaient déjà été réalisés, pour des sommes considérables, y compris dans le cadre du post-Fukushima. Quelle indemnisation devra être versée à nos partenaires suisses et allemands, présents dans le dispositif depuis l’origine ? Le conseil général a avancé le chiffre de 1 à 2 milliards. Envisagez-vous le versement d’une somme en euros ou un échange en nature ?
M. Michel Sordi. Je suis heureux que nous ayons pu nous rendre sur le site de Fessenheim. Nous avons ainsi pu voir une usine magnifique qu’il serait bien dommage d’arrêter aujourd’hui.
Selon une étude réalisée par le conseil général du Haut-Rhin, l’arrêt de cette centrale, qui devrait intervenir dans trente mois, posera à l’Alsace des problèmes énergétiques quantitatifs et qualitatifs. RTE est resté flou sur ce point, qui inquiète les entreprises électro-intensives. Il faut leur apporter des réponses, avant de procéder à des fermetures inconsidérées.
Quel impact auront, sur l’activité économique et les emplois, les 55 milliards qu’EDF consacrera au grand carénage ?
Député d’un département frontalier, je suis sensible au fait que l’Allemagne ait très vite remplacé le nucléaire par des énergies renouvelables, ce qui a fait flamber le prix de l’électricité outre-rhin. Quel serait l’impact – sur notre environnement, sur notre facture d’électricité et sur notre balance commerciale – d’un brusque arrêt du parc nucléaire français ?
M. Bernard Accoyer. Profitant d’une commission d’enquête voulue par le groupe EELV, le rapporteur semble décidé à mettre à mal la filière électronucléaire française. Ses propos, dénués d’objectivité, témoignent d’un dogmatisme regrettable. Est-il normal que nous ayons auditionné des personnalités sans qualification, uniquement connues pour leur militantisme anti-nucléaire qui a les amenées à malmener la sécurité des centrales, quand ce ne sont pas les lois de la République ?
La décision de fermer Fessenheim n’est pas sans rappeler celle de démanteler Superphénix, prise en 1997 par le Premier ministre, lequel avait mis à mal une filière de recherche que nous enviait le monde entier. Combien coûteront l’arrêt et le démantèlement de la centrale de Fessenheim ? Quelles conséquences auront-ils sur l’approvisionnement en électricité des régions voisines ? Combien coûterait la fermeture de vingt réacteurs évoquée par notre rapporteur dans le but de réduire à 50 % la part du nucléaire dans le mix énergétique français ? Quelles augmentations en découleraient pour les entreprises et les ménages ? Quelle conséquence aura la fermeture de Fessenheim sur notre recherche nucléaire, un des rares domaines où nous comptions encore au niveau international ?
M. Henri Proglio. Au-delà de la maintenance courante de l’outil industriel, qui représente 50 millions par réacteur et par an, le grand carénage est une opération de modernisation, de rénovation et d’amélioration de la sécurité, dont la terminologie rappelle celle de la navigation. Le coût de cette restructuration, qui permettra de prolonger la durée potentielle des réacteurs, a été estimé à 55 milliards.
Pour préciser notre méthode de calcul, plutôt que vous noyer sous les données, je préfère évoquer les grandes phases des opérations. Tous ces travaux vont être sous-traités par des filières industrielles – françaises, je l’espère, en tout cas prioritairement européennes – et si je m’aventurais à préciser les montants ligne à ligne, les appels d’offres risqueraient de prendre une curieuse allure. Je suis prêt à livrer à l’un ou l’autre d’entre vous le chiffrage précis dont nous disposons, mais l’officialiser ferait exploser tous les prix de revient : il suffit d’indiquer le montant que l’on est prêt à consacrer au remplacement d’un moteur pour qu’aucun garagiste ne veuille plus le faire à moins ! Telle est la raison de notre prudence en matière de chiffres. Sachez cependant que le montant de 55 milliards a été validé en interne. D’ailleurs, je rends des comptes à mes actionnaires, qui doivent, via le conseil d’administration, disposer de toutes les informations nécessaires.
Les travaux prévus renforceront la sûreté et amélioreront l’efficacité industrielle. Nous espérons, grâce à un investissement considérable, faire profiter nos clients d’un passage de quarante à soixante ans de la durée de vie des réacteurs. C’est toutefois sur une durée moyenne de cinquante ans que nous amortissons le coût économique complet des MWh électronucléaires produits par le parc français, ce qui aboutit, au terme d’un calcul qui nous semble prudent, au prix de 55 euros par MWh.
Pendant les travaux du grand carénage, la durée d’indisponibilité des réacteurs ne dépassera pas celle que nous connaissons actuellement, puisque les travaux seront réalisés dans le cadre de la maintenance du parc. Nous avons à cœur d’améliorer le coefficient d’indisponibilité qui a été anormalement élevé pendant l’année 2013, où il a fallu effectuer neuf arrêts de tranche et des travaux de maintenance lourde. Nous avons mis toutes nos équipes à contribution pour retrouver dès 2014 les objectifs que nous espérions atteindre en 2013.
En tant qu’opérateur d’un service public de l’électricité responsable, EDF fait réaliser les travaux de grande maintenance durant l’été, où les centrales sont moins sollicitées. De ce fait, pendant l’hiver 2013, le coefficient de disponibilité de notre parc a été l’un des meilleurs jamais atteint.
Je vous remercie, monsieur Sordi, d’avoir souligné l’excellente qualité de la centrale de Fessenheim, qui a été totalement modernisée. Ces dernières années, EDF a embauché massivement dans le nucléaire, pour conserver des compétences qu’aurait fragilisées un programme important de départs à la retraite : lors de mon arrivée en 2009, 40 % du personnel devaient quitter l’entreprise avant quatre ans. L’important programme d’embauche, qui va se poursuivre en 2014, puis en 2015, concerne essentiellement le nucléaire, où il faut cinq ans pour former un opérateur. Nous investissons massivement dans les ressources humaines, pour que les équipes puissent continuer à gérer le parc existant et à développer la présence d’EDF dans le monde.
Le grand carénage mobilisera quelque 110 000 emplois situés, pour l’essentiel, dans la filière industrielle, mais à l’extérieur d’EDF.
M. le président François Brottes. Comment réagissez-vous à l’évaluation du cabinet Wise-Paris ?
M. Henri Proglio. Nous avons pris connaissance de cette évaluation. À titre de comparaison, j’ai consulté l’estimation du même cabinet pour les diesels d’ultime secours, en cours de construction. Il les valorise à 200 millions par tranche, alors que le programme porte sur 2 milliards pour l’ensemble des cinquante-huit tranches. On peut donc relativiser la pertinence de ce chiffrage, ce qui est une bonne nouvelle pour l’économie française. Mais tout le monde a le droit de se tromper ! Dans le domaine nucléaire, nous avons une certaine antériorité par rapport aux cabinets anglo-saxons, ce qui nous permet de connaître les coûts de revient de nos propres tranches. Vous jugerez d’ailleurs, comme nos actionnaires, de la réalité de ces chiffres que nous annonçons aujourd’hui puisque nous aurons des comptes à rendre sur nos travaux, nos investissements, et les tarifs qui en résulteront. L’entreprise serait nécessairement sanctionnée, si elle manquait à ses engagements.
M. le président François Brottes. Beaucoup de travaux ayant été réalisés sur le post-Fukushima, vous avez, en matière de prix, des éléments de référence.
M. Henri Proglio. Bien sûr ! Une bonne partie du post Fukushima, que nous avons estimé à 10 milliards d’euros, a été réalisée. D’ailleurs, le grand carénage intègre le post-Fukushima, ce qui permet à EDF de réaliser des économies d’échelle.
Vous m’avez interrogé sur l’avenir de Fessenheim. À tout moment, l’ASN peut décider, pour des raisons de sûreté, de fermer une exploitation nucléaire sans compensation. Le président d’EDF peut également le faire. En revanche, si la décision est prise par la voie législative, qui exige un vote du Parlement et un décret d’application, il est logique que l’entreprise sollicite une indemnisation. Une telle démarche est aussi naturelle que nécessaire, compte tenu des responsabilités de l’entreprise vis-à-vis de ses actionnaires.
Le cas échéant, l’indemnisation devra être juste et précise. Elle fera l’objet d’une évaluation, qui n’a pas encore été arrêtée mais qui sera transmise, en temps voulu, pour analyse contradictoire, voire pour arbitrage.
M. Hervé Mariton. Aura-t-elle lieu avant ou après le vote de la loi ?
M. Henri Proglio. Après. L’indemnisation chiffrera le manque à gagner pour l’entreprise, ce qui fera peut-être l’objet d’une discussion. Pour l’instant, je n’ai pas été sollicité sur le sujet, et je ne souhaite pas ouvrir le débat avant l’heure. Nos partenaires demanderont bien entendu leur quote-part, puisqu’en tant qu’actionnaires de 34 % de la centrale, ils possèdent virtuellement 34 % de l’énergie produite pendant la durée d’exploitation.
M. le président François Brottes. Vous parlez de 34 % de l’énergie et des profits ?
M. Henri Proglio. Oui.
M. Hervé Mariton. L’entreprise s’exprimera-t-elle sur ces montants avant le vote de la représentation nationale ? Il est logique que le législateur souhaite connaître le prix de ses décisions.
M. Henri Proglio. Je comprends votre souci. Nous nous rapprocherons, si vous le voulez bien, pour savoir comment je peux y répondre sans lancer de polémique. Le principe de l’indemnisation, qui a d’abord fait débat, est désormais admis par tous.
Pour la nation, le coût économique de l’opération dépendra des compléments d’énergie qu’il faudra produire pour faire face à la baisse de production globale d’électricité et aux équilibrages de coûts. Il faudra calculer le montant des investissements et de leur approvisionnement en énergie fossile.
M. Hervé Mariton. Vous pourriez donc avancer un chiffre avant le vote de la loi ?
M. Henri Proglio. Les chiffres ne constituent pas un mystère. Nous les partagerons avec les décideurs.
M. Bernard Accoyer. Votre imprécision me laisse penser que le Gouvernement pourrait nous demander de nous prononcer sur la fermeture de Fessenheim sans que nous connaissions tous les coûts de cette décision.
M. Henri Proglio. Je dispose d’éléments techniques d’évaluation, mais il ne m’appartient pas de répondre précisément sur ce point.
M. le rapporteur. Je suis surpris de vous entendre dire que le grand carénage s’achèvera en 2025, alors que la courbe prévisionnelle, qui émane de vos services, des investissements liés à cette opération, s’étend jusqu’en 2047. Les opérations liées aux visites décennales, comme les quatrièmes visites décennales du palier de 1 300 mégawatts, débuteront en 2025. M. Minière, que nous avons auditionné, a indiqué que l’opération faisait l’objet d’un lissage. Enfin, d’après les responsables de l’ASN, certaines opérations, comme la mise en place des diesels d’ultime secours, interviendront à l’horizon de 2018-2019. Tous les travaux sont donc loin d’être réalisés, comme nous l’a confirmé hier le directeur de la centrale de Fessenheim. Ainsi, les diesels mis en place sont provisoires.
M. Henri Proglio. Les marchés ont été attribués il y a une semaine ou deux, ce qui nous a valu quelques turbulences avec des fournisseurs. Je vous confirme donc que les travaux ne sont pas réalisés. Ils le seront d’ici à 2018. Cela dit, le descriptif et les études d’ingénierie sont terminés. Les commandes viennent d’être signées, et les entreprises se sont engagées sur les chiffres.
M. le rapporteur. Comment pouvez-vous parler d’amortissement des coûts sur cinquante ans, alors que la durée de vie des réacteurs est de quarante ans ? Je m’étonne qu’une entreprise cotée en bourse puisse avancer ces chiffres sans savoir si ses installations fonctionneront aussi longtemps. L’AMF a d’ailleurs émis des réserves sur ce point.
M. Henri Proglio. Pour prendre la décision de lancer le grand carénage, qui constitue un investissement considérable, il faut que nous ayons une visibilité sur la durée de vie potentielle des installations concernées. Notre estimation du coût économique complet de la filière nucléaire – 55 euros par mégawattheure – intègre les travaux du grand carénage et a été réalisée en supposant un amortissement sur cinquante ans. Or actuellement, dans nos comptes, nous amortissons les installations nucléaires françaises non pas sur cinquante ans, mais sur quarante.
M. le président François Brottes. La durée d’amortissement de cinquante ans est-elle décomptée à partir de la date de mise en service de chaque centrale ou le sera-t-elle à partir de la réalisation du grand carénage ?
M. Henri Proglio. À partir de la mise en service. Nous amortissons sur la durée de vie restante les investissements que nous allons réaliser. À cet égard, il convient de distinguer le calcul estimatif des coûts économiques et l’établissement des comptes.
Il serait irrationnel pour une entreprise, quelle qu’elle soit, de réaliser un investissement aussi important sans estimer la durée de vie de son patrimoine industriel. La décision de lancer le grand carénage ne sera donc prise que si nous avons le sentiment que la durée de vie peut aller jusqu’à cinquante ans. En effet, investir 55 milliards d’euros sans changer la durée d’amortissement reviendrait à faire supporter à EDF chaque année 5,5 milliards d’euros supplémentaires au titre de l’amortissement, ce qui réduirait ses résultats à néant. Je ne crois pas que cela satisferait nos actionnaires, à commencer par le principal d’entre eux. Toutes ces questions restent en discussion.
M. le rapporteur. La décision de lancer le grand carénage n’est donc pas encore prise !
M. Henri Proglio. Il ne s’agit pas d’une décision binaire : réaliser ou ne pas réaliser cet investissement. Le grand carénage est un programme industriel énorme, dont certaines actions ont déjà été engagées, mais dont l’essentiel reste à venir.
M. le rapporteur. À quel horizon envisagez-vous de prendre cette décision ?
M. Henri Proglio. Du point de vue industriel, il serait nécessaire de le faire dans des délais relativement courts. Cela étant, aucune contrainte réglementaire ne nous y oblige. Nous le ferons donc réacteur par réacteur, ligne par ligne. Nous sommes ainsi amenés à prendre des décisions quotidiennement. Comme je l’ai indiqué, certaines initiatives ont déjà été prises, notamment l’équipement des centrales en moteurs diesels d’ultime secours, qui était une nécessité au regard des normes de sûreté.
Vous avez relevé, monsieur le rapporteur, que des investissements étaient prévus au-delà de 2025 dans les documents que nous vous avons communiqués. C’est tout à fait normal : le parc nucléaire français vivra bien au-delà de cette échéance, quelles que soient les hypothèses retenues. Selon les orientations prises par le Gouvernement, 50 % de l’électricité française seront encore d’origine nucléaire en 2025. Nous n’avons donc aucune raison de cesser tout investissement sur le parc nucléaire à partir de cette date : ce serait un non-sens et même un acte irresponsable. La grande opération de modernisation que constitue le grand carénage – y compris sur le plan symbolique – aura été réalisée d’ici à 2025. Une fois ce programme terminé, nous retrouverons des niveaux d’investissement de l’ordre de 50 millions d’euros par réacteur et par an, qui correspondent aux sommes nécessaires à la maintenance du parc.
M. Hervé Mariton. À la fin de l’année 2013, EDF avait eu un débat sur la durée d’amortissement avec son actionnaire principal, qui était tenté de passer à cinquante ans pour des raisons budgétaires. Ce sujet est-il toujours d’actualité ? Par ailleurs, compte tenu des positions de l’ASN et de l’AMF rappelées par le rapporteur, êtes-vous aujourd’hui durablement calés sur une durée d’amortissement de quarante ans ? Ou bien la question d’un passage à cinquante ans reste-t-elle à l’ordre du jour, à la demande d’EDF ou de ses actionnaires ?
M. Henri Proglio. Les actionnaires, y compris l’État, attendent d’EDF une attitude responsable tant du point de vue industriel qu’au regard de la mission de service public qui lui est confiée. Il ne saurait être question d’abîmer l’outil de production et de distribution de l’électricité en France, dont la valeur avoisine les 500 milliards d’euros. Cet outil n’appartient d’ailleurs pas en totalité à EDF : les réseaux de transport d’électricité sont la propriété des collectivités territoriales ; les barrages, celle de l’État. Quoi qu’il en soit, l’opérateur EDF est chargé de l’entretenir et de le moderniser, soit pour compte propre, soit pour compte de tiers. Il y consacre des investissements considérables, dans une vision de long terme : nous ne pouvons pas nous contenter d’une optimisation comptable ou financière à court terme.
La méthode d’amortissement est fonction de l’outil considéré. Certains équipements internes des centrales, notamment électromécaniques, ont une durée de vie de sept à dix ans. Nous ne les amortissons donc pas sur quarante ou cinquante ans. Les équipements les plus importants, tels les générateurs de vapeur – qui pèsent environ 600 tonnes dans un réacteur EPR –, ont une durée de vie probable de l’ordre de trente ans et sont garantis pour cette durée. Lorsque nous les installons, nous les amortissons sur trente ans. Lorsque nous procédons à leur remplacement, notre intention est de les faire durer plus de dix ans. Même si nous n’amortissons pas tous les composants sur la même durée, nous devons assurer une cohérence à l’échelle de l’outil industriel dans son ensemble. En particulier, les centrales ayant une durée de vie maximale, certains équipements sont amortis sur des périodes plus courtes que leur propre durée de vie.
Les débats entre l’industriel et les responsables des comptes sont naturels. Mais il ne faut pas confondre l’amortissement comptable d’un investissement avec son coût réel. D’un point de vue comptable, un amortissement sur une durée plus courte réduit le résultat comptable et donc le montant de l’imposition – ce qui ne présente guère d’intérêt pour une entreprise comme EDF. Cette durée d’amortissement comptable n’a, en revanche, aucun impact sur le résultat brut d’exploitation – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) – ni sur la capacité d’autofinancement de l’entreprise – cash flow –, qui sont les indicateurs de performance économique suivis par les marchés. Les agences de notation, en particulier, jugent EDF sur son ratio dette sur EBITDA.
D’un point de vue économique, pour réaliser des investissements lourds, il convient de satisfaire une équation économique viable dans la durée. À cet égard, j’ai des comptes à rendre à mes actionnaires et à mes clients. Cette exigence d’équilibre économique s’est trouvée au cœur des discussions quelque peu musclées que nous avons menées sur le prix de cession de l’électricité d’EDF à ses concurrents dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) mis en place par la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME). Ce coût de cession doit-il être inférieur ou supérieur au coût économique de la filière nucléaire – 55 euros par mégawattheure ? EDF doit-elle aider éternellement ses concurrents ou ceux-ci devront-ils être capables, un jour, de produire leur propre électricité ?
Quant à l’ASN, elle ne validera jamais la durée de vie des centrales a priori. Et c’est bien normal : elle ne souhaite pas s’engager, de manière à conserver la liberté d’arrêter les réacteurs à tout moment. Si EDF attendait que l’ASN émette un tel avis, elle ne réaliserait pas les travaux prévus. En revanche, l’ASN donnera un avis a posteriori : elle pourra reconnaître qu’il est légitime, au vu de la qualité des travaux réalisés, de prolonger en moyenne la durée de vie des centrales de telle ou telle durée.
D’une manière générale, chacun assume ses propres responsabilités : l’entreprise répond de son outil industriel et de son équilibre économique, c’est-à-dire de ses coûts et de ses revenus ; le conseil d’administration arrête les comptes présentés par l’entreprise, en choisissant notamment la méthode d’amortissement comptable qui lui semble la plus appropriée ; le marché sanctionne ; les pouvoirs publics peuvent également exercer à tout moment un pouvoir de sanction de nature différente.
M. le président François Brottes. Êtes-vous d’accord avec les deux assertions suivantes ? Premièrement, une centrale nucléaire doit être en parfait état de marche jusqu’au jour de sa fermeture : il n’est pas admissible que son fonctionnement se dégrade au cours de la dernière année ou des six derniers mois. Deuxièmement, aucun réacteur n’a vocation à être éternel.
M. Henri Proglio. Je suis tout à fait d’accord avec la première affirmation et reconnais que la seconde est également vraie.
Mme Frédérique Massat. Lors d’une audition récente, l’ASN a déclaré qu’EDF était débordée par les questions de maintenance, en raison d’un problème d’organisation des travaux qui remettait en cause la qualité de leur réalisation, avec un risque potentiel pour la sûreté des installations. Quels commentaires vous inspirent ces propos ?
S’agissant du programme de grand carénage, vous avez précisé que vous feriez appel à des compétences externes, ce qui est tout à fait normal, d’autant que la France dispose d’excellentes entreprises dans ce domaine. Mais vous mobiliserez aussi nécessairement les ressources internes d’EDF. Comment allez-vous les gérer ? Comment allez-vous programmer et organiser concrètement les travaux, au-delà de leur aspect financier ?
M. Henri Proglio. Ces travaux sont déjà programmés. Le rapporteur a d’ailleurs fait référence à certaines fiches techniques qui les détaillent et montrent, comme il l’a relevé à juste titre, un pic d’investissement très significatif. Nous avons beaucoup travaillé au cours des dix-huit derniers mois afin de lisser les courbes et de mieux étaler la charge de travail, dans un souci d’efficacité et d’accessibilité pour les équipes internes ou externes à EDF, cela sans remettre en cause la finalité du programme ni son point d’arrivée.
Le rôle de l’ASN est de mettre en garde, d’émettre des recommandations et de pointer du doigt les améliorations nécessaires. Il est donc assez naturel que l’ASN ait tenu les propos que vous avez rapportés. Je ne les condamne pas, bien au contraire. EDF, acteur le plus important mais non exclusif dans le domaine du nucléaire – il y a notamment AREVA et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) –, entretient des relations permanentes avec l’ASN. Nos points de vue sont très souvent convergents, mais il arrive de temps en temps qu’ils soient contradictoires.
M. le président François Brottes. S’agissant du programme de grand carénage, pourrez-vous nous communiquer la liste des prestations, ainsi que les grandes masses financières en jeu à défaut des coûts détaillés ?
M. Henri Proglio. Nous serons totalement transparents et vous fournirons toutes les informations que vous souhaiterez.
J’en viens à la question du rapporteur sur les perspectives d’avenir et les orientations du mix énergétique français. Dans le discours, il est souvent davantage question de « transition électrique » que de « transition énergétique ». Or je souhaiterais qu’on en revienne à cette dernière. Je rappelle les enjeux : les énergies fossiles représentent actuellement 70 % de l’énergie consommée en France et 98 % du déficit commercial de notre pays ; nous sommes totalement dépendants du monde extérieur pour ces énergies. En matière d’électricité, par contraste, nous assurons l’indépendance énergétique de la France à un coût très compétitif, inférieur de 40 % environ à la moyenne européenne. La France dispose là d’un énorme atout, le seul d’ailleurs en matière énergétique.
Quels seront les besoins énergétiques de la France à l’horizon 2025 ou 2030 ? Nous devons tenir compte de plusieurs paramètres. Premièrement, la France comptera 6 millions d’habitants supplémentaires en 2025 et environ 7 millions en 2030 – elle est l’un des rares pays européens à connaître une croissance démographique, ce qui est un atout. Deuxièmement, les besoins en électricité des particuliers – qui consomment aujourd’hui environ 70 % de l’électricité vendue dans notre pays – continueront à augmenter chaque année en raison de l’évolution du mode de vie, en particulier du développement des applications électroniques, des nouvelles technologies et des véhicules électriques. Troisièmement, les besoins de l’industrie – qui consomme les 30 % restants – sont étroitement corrélés à l’évolution du PIB ; leur estimation varie donc en fonction des hypothèses de croissance retenues.
Compte tenu de ces paramètres, en supposant que nous atteignions un taux de croissance de 2 % par an – ce qui n’est pas impossible au regard des performances actuelles de pays comparables à la France et correspond au minimum requis pour maintenir le taux d’emploi – et que nous réalisions 20 % d’économies d’énergie sur la période – un grand plan qui se fixe un tel objectif me paraît prioritaire dans un souci de bonne gestion des ressources énergétiques –, les besoins en énergie de la France continueront à augmenter à l’horizon 2025. Selon nos estimations – qui peuvent bien sûr être discutées et comparées à celles de nos voisins –, le parc nucléaire existant suffira à peine à fournir 50 % des besoins électriques de la France en 2025 ou en 2030.
M. le rapporteur. Vous êtes donc en total désaccord avec la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) ?
M. Henri Proglio. L’hypothèse de la DGEC est celle d’une décroissance.
M. le rapporteur. Elle table sur une évolution de la consommation d’électricité située entre -0,2 et +0,4 % par an.
M. Henri Proglio. Je suis en total désaccord avec la DGEC : ses hypothèses sont complètement différentes des nôtres. Il n’est pas possible de raisonner sans tenir compte de l’évolution des fondamentaux. Il conviendrait également de prendre en compte les économies à réaliser. À cet égard, la consommation des énergies fossiles constitue un élément clé, tant du point de vue de l’efficacité énergétique que des importations. Si nous avions une vision plus ambitieuse des perspectives énergétiques du pays, certaines orientations, notamment en matière de réglementation thermique, mériteraient d’être revues. Mais je ne veux pas élargir trop le débat.
Je défends une vision à la fois raisonnable et réaliste. Notre responsabilité collective, à EDF, est d’assurer l’indépendance du pays en matière d’électricité, la sécurité de son approvisionnement, sa compétitivité et son attractivité, afin de favoriser le pouvoir d’achat et le développement industriel. J’y insiste : les besoins de la France en électricité à l’horizon 2025 ou 2030 seront tels que des capacités de production supplémentaires seront de toute façon nécessaires. Cela laisse une large place aux énergies renouvelables et locales, en complément du système centralisé existant, qui a fait la preuve de son efficacité. Telle est ma conviction.
En ce qui concerne l’avenir de la filière nucléaire, je me place dans la perspective où elle assurera, à terme, 50 % de la production de l’électricité française. Il s’agit bien d’une part relative, et je ne raisonne pas à volume constant : je suis convaincu que la production d’électricité va continuer à croître. Les réacteurs n’étant pas éternels, comme l’a rappelé le président, de nouvelles installations devront prendre le relais du parc actuel. Quels sont les outils susceptibles d’assurer la permanence de la production électronucléaire française ? Aujourd’hui, l’EPR est l’outil de référence, car c’est le plus achevé des réacteurs de troisième génération existant en France. Il n’est pas exclu que nous développions des réacteurs de troisième génération de 1 000 mégawatts de différents types, mais aucun n’a été construit à ce jour, à la différence des réacteurs de 1 650 mégawatts de type EPR.
M. le président François Brottes. Lors de votre prise de fonctions, vous aviez exprimé le souhait de disposer d’un choix « sur étagère » plus large en matière de réacteurs de troisième génération.
M. Henri Proglio. Je le confirme, et c’est d’ailleurs toujours mon obsession. Dans de nombreux pays, les réacteurs de petite ou de moyenne dimension sont les plus recherchés, car ils correspondent davantage aux besoins et à la capacité d’absorption des réseaux de distribution existants. Je suis toujours aussi partisan du développement d’un réacteur français de 1 000 mégawatts, qui permette d’engager des coopérations internationales, plutôt que d’attendre de nos partenariats une réponse pour la conception d’un futur « produit sur étagère » de 1 000 mégawatts. Nous nous sommes mis d’accord avec AREVA pour avancer sur un tel projet.
L’EPR existe : EDF est en train d’en construire un à Flamanville – vous l’avez visité – et deux à Taishan en Chine ; de son côté, AREVA en bâtit un à Olkiluoto en Finlande. EDF a donc aujourd’hui un retour d’expérience sur trois réacteurs EPR. Le pilotage industriel a connu des aléas et des erreurs ont été commises tant en matière d’ingénierie que de réalisation. Toutes les entreprises de la filière ont dû réapprendre : elles n’avaient pas construit de réacteur depuis longtemps ; seule EDF avait continué à participer à la réalisation de réacteurs en Chine. De plus, l’EPR est un réacteur de nouvelle génération, révolutionnaire à bien des égards. Quoi qu’il en soit, il a coûté plus cher qu’il n’aurait dû.
Aujourd’hui, la construction d’un EPR normalisé – à distinguer d’un EPR optimisé – sur le même site de Flamanville coûterait moins cher, car nous ne reproduirions pas les mêmes erreurs. Par ailleurs, nous avons créé une plate-forme commune de travail avec AREVA afin de revoir la conception de l’EPR et de l’optimiser. Enfin, l’EPR bénéficiera d’un effet de série : dans l’hypothèse où nous nous plaçons, plusieurs réacteurs de ce type devraient être construits. L’impact sur le coût de revient sera significatif, mais je ne souhaite pas préciser le prix auquel nous pourrions parvenir, pour des raisons évidentes de confidentialité, compte tenu de nos perspectives à l’international.
M. le président François Brottes. Vos collaborateurs ont cité le chiffre de 6 milliards d’euros.
M. Henri Proglio. Dans les circonstances actuelles, vous comprendrez bien que je ne valide pas tel ou tel chiffre. À la suite de l’accord que nous avons conclu avec le gouvernement britannique, nous sommes en train de négocier avec la Commission européenne sur la question des aides d’État. Il serait malvenu d’annoncer que nous sommes capables de construire un réacteur à un prix qui serait très différent de celui dont nous sommes convenus avec les pouvoirs publics britanniques à l’issue d’une discussion difficile.
M. le président François Brottes. Vous ne confirmez donc pas le chiffre indiqué par vos collaborateurs ?
M. Henri Proglio. Non. En tout cas, le nucléaire restera un outil très compétitif de production d’électricité à long terme, même si nous en restons à la troisième génération.
M. le rapporteur. Nous avons auditionné des entreprises sous-traitantes et des représentants de leurs salariés. L’ASN elle-même estime que le nombre de niveaux de sous-traitance – qui va parfois jusqu’à huit actuellement – peut avoir des conséquences en termes de sûreté ; elle préconise de le limiter à trois. Quel est votre avis sur ce point ? En outre, nous entendons parfois des témoignages poignants de salariés d’entreprises sous-traitantes sur leurs conditions de travail et les risques auxquels ils sont exposés. Qu’en pensez-vous ? Quelles sont les marges d’amélioration en matière de protection des travailleurs ?
Avec plusieurs années de recul, quel regard portez-vous sur le retraitement des combustibles usés et sur la fabrication du MOX ? Cette filière relève de la compétence d’AREVA, mais EDF en est le principal client. Il nous a été indiqué que le stockage direct des combustibles usés aurait un coût équivalent à celui de leur retraitement et de la fabrication du MOX. Selon le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), cette filière n’aurait d’intérêt que si la France développait un jour des réacteurs de quatrième génération. Faites-vous également un tel lien ? Ou bien estimez-vous que la filière a, en tant que telle, sa propre pertinence ?
J’en viens aux charges futures, c’est-à-dire au coût du démantèlement des installations nucléaires et de la gestion des déchets. Nous auditionnerons demain l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), à la suite du débat public sur le projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo) et des diverses évaluations de coût auxquelles il a donné lieu. Le Parlement sera d’ailleurs saisi sur la question de la réversibilité. Que l’on poursuive ou que l’on arrête le nucléaire, notre pays se retrouvera probablement dans une situation où il devra assumer des coûts très élevés – il est question que Cigéo fonctionne pendant un siècle – alors qu’il n’existera plus d’opérateur nucléaire pour « rentabiliser » ces coûts. Il s’agira d’activités indispensables à la sécurité, mais qui n’auront pas d’utilité d’un point de vue économique. Ces coûts ne peuvent donc pas être reportés sur les générations futures, et il est indispensable de sécuriser aujourd’hui les financements nécessaires.
Depuis qu’EDF est cotée en bourse, les commissaires aux comptes font une observation sur l’évaluation des coûts futurs dans le document de référence que soumet chaque année l’entreprise à l’AMF : des incertitudes demeurent concernant ces coûts, notamment ceux de certaines installations. En outre, dans son rapport sur les coûts de la filière électronucléaire, la Cour des comptes a relevé que les coûts prévus par EDF pour le démantèlement des installations nucléaires françaises étaient plus bas que ceux qui sont anticipés par tous les autres pays qui disposent de telles installations. Votre doctrine a-t-elle évolué en ce qui concerne l’évaluation de ces coûts ? En outre, afin de mieux sécuriser les financements destinés à couvrir les charges futures, des parlementaires issus de familles politiques différentes estiment qu’ils devraient être versés sur un fonds souverain géré par la Caisse des dépôts et consignations plutôt que de demeurer au sein des entreprises concernées. Quel est votre avis sur ce point ?
Vous avez estimé que le prix de l’ARENH devrait être fixé à 55 euros par mégawattheure, c’est-à-dire à un niveau nettement plus élevé que le tarif actuel. Je suppose qu’il s’agit de la position d’EDF en début de négociation. En outre, nous avons auditionné des représentants des industries électro-intensives, en particulier le président d’Exeltium, qui nous a fait part des discussions en cours avec EDF. Quelle que soit la politique énergétique finalement retenue, nous estimons, sur tous les bancs de l’Assemblée, que les entreprises électro-intensives doivent être protégées compte tenu de leur importance en termes d’activité économique et d’emploi. Pensez-vous aboutir avec Exeltium à un résultat sécurisant pour ces entreprises ?
M. le président François Brottes. Et à quel moment cette négociation se terminera-t-elle ? Elle est en cours depuis longtemps.
M. Henri Proglio. Elle devrait se terminer rapidement. Mais si j’indique un jour et une heure, je risque de fragiliser la position d’EDF.
M. le président François Brottes. Se terminera-t-elle avant l’été prochain ?
M. Henri Proglio. Oui. La négociation est en bonne voie : les points de vue convergent.
M. le président François Brottes. Pour l’instant, ces entreprises continuent à batailler ferme sur leurs marchés respectifs. Et la question du prix de l’énergie nous concerne tous : c’est aussi l’entreprise France qui est en jeu.
M. Henri Proglio. J’en ai pleinement conscience. L’énergie représente aujourd’hui en moyenne 20 % des coûts dans l’industrie en Europe, tous secteurs confondus ; le coût du travail, 40 %. Les variations sont évidemment importantes en fonction du domaine considéré, les entreprises électro-intensives et l’industrie lourde se trouvant à un bout du spectre, et les sociétés de services à l’autre. Or diminuer le coût du travail peut créer des difficultés, voire des drames : le baisser de 1 % est déjà très douloureux. En revanche, la flexibilité peut être très importante en ce qui concerne l’énergie, dès lors que l’on dispose d’un atout compétitif significatif en la matière. Aux États-Unis, grâce à l’exploitation du gaz de schiste, le prix du gaz a été divisé par trois et on assiste à la relocalisation de pans industriels entiers. Un million d’emplois ont déjà été créés et bien davantage devraient l’être demain : après être parties en Asie, où les coûts du travail étaient moindres et où se trouvaient les marchés potentiels, les industries américaines considèrent plus rationnel de revenir aux États-Unis.
En France, nous disposons également d’un atout compétitif : la production d’électricité coûte en moyenne 40 % de moins que dans les autres pays européens. Il convient donc de réfléchir avant de renoncer au nucléaire. Sans rien concéder en termes de sûreté – je reconnais le rôle des autorités de sûreté et les respecte éminemment –, il est de ma responsabilité de rappeler certaines évidences : le coût de l’énergie est un élément discriminant à la fois en termes de pouvoir d’achat et d’attractivité, donc d’emploi. Les industries électro-intensives sont, bien sûr, concernées au premier chef. Mais nous sommes contraints par les règles européennes, et le coût de l’énergie doit être transparent. Notre engagement est clair : il nous faut produire de l’énergie à un coût suffisamment compétitif pour que ces industries restent sur le territoire français. La négociation avec Exeltium est près d’aboutir.
La question de la sous-traitance sera encore longtemps d’actualité. Nous souhaitons comme vous, monsieur le rapporteur, réduire le nombre de niveaux de sous-traitance, mais nous demandons dans le même temps à nos sous-traitants d’être compétitifs, pour les raisons que je viens d’évoquer. Il y a donc un arbitrage à faire, et nous recherchons en permanence le meilleur équilibre. Aucun donneur d’ordre en Europe n’est plus attentif qu’EDF aux conditions de travail, en particulier à la sûreté et à la sécurité. L’esclavagisme n’est pas la marque de notre maison ! Les parties prenantes de l’entreprise sont très vigilantes sur les conditions de travail, à commencer par les syndicats de salariés d’EDF. Nous sommes très exigeants et avons déjà beaucoup amélioré nos performances en la matière. Certes, ce n’est pas suffisant et nous devons encore progresser. Mais le problème est complexe, car nous n’avons qu’un pouvoir de décision indirect, lorsque nous sélectionnons les sous-traitants.
M. le président François Brottes. Il convient de distinguer deux types de sous-traitants bien différents dans la filière nucléaire : les sous-traitants permanents – à Fessenheim, cela représente 150 personnes – et ceux qui interviennent au moment de l’arrêt des tranches – environ 1 000 personnes à Fessenheim. Ces derniers se déplacent d’un réacteur à l’autre, par choix ou par contrainte.
M. Henri Proglio. Vous avez tout à fait raison. Nous faisons bien la distinction. Les travaux de modernisation des barrages hydroélectriques sont, eux aussi, réalisés par des sous-traitants employant des salariés itinérants. Nous sommes suffisamment conscients et responsables pour garantir à ces entreprises des programmes de travaux qui leur permettent de rémunérer du personnel qualifié, dans l’intérêt bien compris de tous. Les arrêts de tranche sont des moments particuliers dans la vie des centrales, qui ne relèvent pas de la maintenance courante, et dont le coût n’est donc pas comptabilisé dans le montant de 50 millions d’euros par réacteur et par an que j’ai cité précédemment.
M. le rapporteur. L’arrêt des tranches constitue la partie la plus dangereuse de l’activité des centrales : c’est à ce moment-là que les salariés reçoivent les doses de radioactivités les plus importantes.
M. Henri Proglio. En 2013, le groupe EDF a battu son record en termes de faiblesse des doses reçues. Le niveau de celles-ci est très inférieur aux normes. Cela figure très explicitement dans nos rapports.
M. le rapporteur. Dans son rapport annuel, l’ASN indique que la dose reçue a augmenté d’environ 20 % en 2013 par rapport à 2012, ce qui peut s’expliquer en partie par les travaux de maintenance.
M. Henri Proglio. Je démens complètement cette information. J’ignore quelle est la source de l’ASN ; ce n’est pas EDF en tout cas. Je ne remets personne en cause, mais je doute que ces chiffres concernent les installations d’EDF. La baisse des doses mesurées a été telle cette année qu’elle a été soulignée par l’inspecteur général pour de la sûreté nucléaire et la radioprotection d’EDF dans son rapport officiel, que nous avons remis à l’ASN et publié.
M. le rapporteur. Le rapport de l’ASN évoque la dose collective. Cela ne signifie pas que la dose par individu ait augmenté.
M. Henri Proglio. Évidemment, si l’on tient compte de tous les visiteurs impromptus, notamment des gens de Greenpeace…
M. le rapporteur. Les documents de l’ASN sont sérieux. Le rapport que j’ai cité traite de la dose collective reçue par les travailleurs qui interviennent dans les centrales, notamment les sous-traitants. Ces données n’ont d’ailleurs pas été contestées par le président de l’ASN lorsqu’il a été auditionné par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
M. Henri Proglio. Il me semble assez souhaitable que le président de l’ASN ne conteste pas ses propres décisions ou rapports !
Les années où nous réalisons beaucoup de travaux de grande maintenance, en particulier celles où les visites décennales sont nombreuses – nous entrons dans une telle phase –, beaucoup de personnes sont amenées à travailler sur les sites, et il n’est donc pas impossible que la dose collective augmente. Mais ce chiffre n’a aucun sens et on ne peut en tirer aucune conclusion. Comme je l’ai indiqué, la dose individuelle a fortement baissé. Et cela tient non pas à une multiplication des interventions pour effectuer une même tâche, mais à une amélioration globale de la sûreté nucléaire. Ces éléments figurent dans tous les rapports réalisés sur le sujet en 2013.
La décision de s’engager dans la voie du retraitement a été prise par les pouvoirs publics français. Nous constatons aujourd’hui la pertinence de cette orientation : elle est économiquement rationnelle et nous rend moins dépendants des importations d’uranium, le MOX jouant un rôle équivalant à celui de l’uranium naturel. Telle est, en tout cas, la vision de nos spécialistes. Bien sûr, le passage aux réacteurs de quatrième génération renforcera encore la pertinence du retraitement.
Toutes les charges futures liées au démantèlement des installations et à la gestion des déchets sont provisionnées dans les comptes d’EDF. Nous disposons d’un fonds de 20 milliards d’euros en numéraire destiné à faire face aux besoins de démantèlement du groupe à l’horizon de la fin de vie des centrales. Nous veillons tout particulièrement à ce que cet argent reste disponible et ne soit pas utilisé à d’autres fins. Du point de vue de la sécurité, il nous paraît plus efficace de conserver ce fonds en interne plutôt que de le confier à une autre structure. En outre, la gestion de ce fonds est parfaitement transparente. Elle est réalisée sous l’autorité de comités spécialisés et indépendants qui exercent un contrôle permanent. L’argent a été géré en bon père de famille : aucun risque particulier n’a été pris. Nous ne pouvons que nous féliciter des résultats : nous avons obtenu jusqu’ici une rémunération très supérieure au coût du capital et aux performances du reste du marché.
Des incertitudes demeurent en effet sur le coût définitif des installations de stockage. Nous prévoyons des charges pour l’année n + 40 et veillons à ce que les estimations des responsables des travaux ne divergent pas trop des estimations d’origine : il faut absolument éviter un tel surcoût, à conditions de sûreté inchangées – le cahier des charges étant très précis en la matière depuis l’origine.
La question des tarifs restera encore longtemps d’actualité. Ma vision est très claire sur ce point : la responsabilité d’EDF à l’égard du pays est de maintenir la compétitivité économique et de protéger le pouvoir d’achat. Dans le même temps, j’ai aussi une responsabilité vis-à-vis de mes actionnaires : je dois faire en sorte que les équilibres économiques soient observés dans la durée, que la société réalise ses investissements et qu’elle rémunère lesdits actionnaires. Tout cela dans un contexte général qui n’a pas de raison d’être bouleversé. Nous avons conclu l’année dernière avec le Gouvernement un accord qui prévoit une évolution tarifaire de 5 % sur les années 2013 et 2014. Ainsi, l’augmentation sera beaucoup plus lente que chez tous nos voisins européens, tout en étant suffisante pour que les tarifs convergent progressivement avec les coûts économiques, ce qui constitue un objectif naturel pour toute entreprise.
M. le président François Brottes. Comment percevez-vous l’évolution de la filière nucléaire à l’échelle européenne et internationale ? Les acteurs du nucléaire ne s’intéressent pas qu’à la France.
M. Henri Proglio. Et réciproquement : le nucléaire n’intéresse pas que la France. De nombreux pays ont choisi l’option nucléaire pour leur énergie demain. Parmi ceux qui ont déjà lancé ou s’apprêtent à lancer un programme électronucléaire, on compte : le Royaume-Uni, les pays d’Europe du Nord, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, la Chine, la Russie, l’Inde, le Vietnam, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil et le Chili. De plus, la plupart des pays pétroliers du Moyen-Orient et d’Asie centrale auront vraisemblablement un programme nucléaire à terme. Seuls les États-Unis font figure d’exception : ils disposent d’un parc de 122 réacteurs, mais ne prévoient pas de développement futur à ce stade, compte tenu de l’émergence du gaz de schiste.
La France dispose, avec EDF, du premier opérateur nucléaire mondial. C’est une spécificité. EDF contrôle et gère le plus grand parc nucléaire : cinquante-huit – bientôt cinquante-neuf – réacteurs en France et quatorze au Royaume-Uni. Le groupe est une référence à la fois en tant que premier électricien mondial et que premier expert en matière d’électronucléaire. Il n’existe aucun programme dans le monde sur lequel EDF ne soit pas sollicité, au moins pour un avis, une orientation ou un conseil. Les autres grands acteurs sont relativement peu nombreux : l’agence russe Rosatom est le deuxième opérateur mondial ; les sociétés chinoises CNNC – China National Nuclear Corporation – et CGN – China General Nuclear Power Group – sont, ensemble, le troisième ; l’entreprise coréenne KEPCO – Korea Electric Power Corporation – est, loin derrière, le quatrième. Les États-Unis ne disposent pas encore d’un grand opérateur, mais ils sont en train d’en constituer avec Exelon, qui rassemble progressivement les acteurs américains du nucléaire.
Le nucléaire est d’abord une opération de gestion à long terme. Cela implique qu’il existe un opérateur auquel on confie la sûreté nucléaire, c’est-à-dire la construction, l’exploitation et l’évolution des installations. L’opérateur et les autres acteurs de la filière – toutes les industries qui concourent à la construction et à l’exploitation des réacteurs, dont l’activité va de l’extraction du minerai à la maintenance lourde – doivent absolument coordonner leurs actions. Cette étape a aujourd’hui été franchie : « l’équipe de France du nucléaire » a été constituée et fonctionne. La filière nucléaire française est référencée comme l’une des meilleures au monde, en concurrence avec les filières chinoise, russe et coréenne.
Au Royaume-Uni, EDF a été choisi pour construire deux premiers réacteurs – encore faut-il passer l’étape de la Commission européenne – et devrait l’être pour trois tranches supplémentaires. Avec plus de 50 milliards d’euros au total, il s’agit de loin du plus gros investissement réalisé au Royaume-Uni depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. L’enjeu est donc considérable en termes de développement industriel et d’emploi, des deux côtés de la Manche.
Comme je l’ai indiqué, d’autres programmes nucléaires sont en discussion en Arabie saoudite, en Europe centrale et en Amérique latine. Enfin, il est important de nouer des partenariats avec les autres grands acteurs mondiaux, notamment chinois et russes, si nous voulons un jour avoir accès à leur propre marché.
M. le président François Brottes. Qu’en est-il du Japon ?
M. Henri Proglio. La situation du Japon est particulière. Les Japonais vont sans doute relancer la moitié de leurs réacteurs nucléaires à échéance assez brève. Ils disposent de grands acteurs industriels, mais n’ont plus d’opérateur digne de ce nom. Les industriels japonais sont donc un peu disqualifiés sur le marché mondial, mais ils cherchent activement à se reclasser en nouant des partenariats avec de grands opérateurs étrangers.
M. Michel Sordi. Les entreprises françaises font partie des meilleures dans le domaine du nucléaire. La volonté d’arrêter un réacteur par anticipation sur notre territoire ne risque-t-elle pas de compliquer la tâche des commerciaux qui font la promotion de ces mêmes réacteurs à travers le monde ?
M. Henri Proglio. Le discours et les termes employés ont une grande importance. Nous pourrons dire que cette fermeture a été décidée, par exception, pour des raisons politiques. Dont acte. Mais si l’on en venait à dire, dans le discours officiel, que le nucléaire n’est pas sûr et que la France ne veut pas prendre de risque en la matière au-delà de quarante ans, cela aurait un impact terrible sur la crédibilité du nucléaire français à l’international. Ne nous tirons pas une balle dans le pied ! La compétition mondiale est très dure, et les enjeux sont considérables en termes de développement industriel.
M. Michel Sordi. Et d’emploi.
M. Henri Proglio. Tout à fait.
M. le président François Brottes. Personne n’a jamais été choqué qu’un pays souhaite diversifier son mix électrique. C’est même considéré comme quelque chose de positif.
M. Henri Proglio. En effet.
M. le président François Brottes. Je vous remercie, monsieur le président-directeur général.
Audition de M. Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public, et de M. Claude Bernet, président de la Commission particulière du débat public Cigéo
(Séance du 7 mai 2014)
M. le président François Brottes. La séquence d’auditions que nous entamons fait suite à celle du 2 avril après-midi, au cours de laquelle notre commission d’enquête a pu entendre des représentants de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), d’EDF, du CEA et d’AREVA, clients potentiels de Cigéo, ainsi que M. Jacques Percebois, membre de la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs (CNE2).
Nous allons auditionner ce matin des protagonistes majeurs du dossier Cigéo, à commencer par les organisateurs du débat public – M. Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public (CNDP), et M. Claude Bernet, président de la Commission particulière du débat public Cigéo – qui a eu lieu pendant une partie de l’année 2013 et s’est conclu en février 2014. Peut-on dire, d’ailleurs, que ce débat s’est vraiment tenu quand les premières réunions ont connu des perturbations telles que la police a dû intervenir, contraignant à poursuivre le processus sur internet ?
C’est peu dire que le sujet des déchets nucléaires en général, et de leur stockage géologique en particulier, fait débat. Depuis bientôt vingt-cinq ans, il suscite un phénomène de « crispation publique » qui a conduit à l’implication croissante du Parlement dans un domaine que l’on pouvait penser réservé aux techniciens. Je le répète souvent aux opposants au nucléaire : quoi que l’on pense du sujet, il existe un stock de déchets dont il faut bien assumer la responsabilité, c’est-à-dire les traiter. Le Parlement s’est prononcé de façon relativement unanime sur la transparence ou sur la réversibilité – terme dont nous avons compris qu’il peut revêtir, pour les divers acteurs impliqués, un autre sens que celui auquel avait pensé le législateur.
L’expérience du débat public sur Cigéo montre à la fois les avancées et les limites auxquelles notre société reste confrontée lorsqu’il s’agit de débattre d’un grand projet, à plus forte raison s’il s’agit de nucléaire. Cela pose des questions fortes en termes de gouvernance de la politique énergétique nationale. Votre témoignage nous intéresse particulièrement, car il faudra bien que nous parvenions, en toute sérénité et maturité, à conjuguer efficience et transparence pour avancer sur ces questions.
Avant de vous laisser la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Christian Leyrit et Claude Bernet prêtent serment)
M. Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public (CNDP). Habituellement sollicitée par un maître d’ouvrage, la Commission nationale du débat public a été exceptionnellement saisie sur le projet de centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne (Cigéo) en vertu d’une disposition adoptée par le législateur. En effet, la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a imposé que la demande d’autorisation de création du centre de stockage soit précédée d’un débat public.
Fait également inhabituel, quarante-quatre associations, rejointes par le parti politique Europe-Écologie les Verts, ont demandé par écrit au Président de la République que l’opération soit reportée après le débat national sur la transition énergétique, initié à l’époque par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Avec ce désaccord sur le calendrier, tout ne se présentait donc pas sous les meilleurs auspices.
Le débat public s’est tenu à partir du 15 mai 2013. Initialement prévu pour durer quatre mois, il a été prolongé de deux mois. Après que les premières réunions publiques ont été perturbées par des opposants qui empêchaient le débat de se tenir, la CNDP a pris la décision de redéployer le dispositif sur d’autres moyens.
D’abord, des débats contradictoires interactifs se sont déroulés sur internet, qui ont connu un réel succès : avec près de dix mille personnes connectées en direct ou en différé, les participants ont été bien plus nombreux que ceux qui fréquentent habituellement les réunions publiques.
Ensuite, un partenariat a été noué avec la presse quotidienne régionale – Est Républicain et Journal de la Haute-Marne – qui connaît une excellente diffusion auprès de la population locale.
Enfin, une « conférence de citoyens » a réuni un échantillon représentatif de dix-sept personnes choisies sur une liste établie par un institut de sondage. À l’issue d’une formation pluraliste organisée sur deux week-ends et de l’audition de vingt-six personnalités diverses, opposées ou favorables au projet, le panel a rendu à l’unanimité un avis dont la très grande qualité a surpris jusqu’aux meilleurs experts du secteur. Les conclusions de cette conférence se trouvent être assez proches du bilan que j’ai pu dresser de l’ensemble du débat public, ce qui est assez remarquable.
Pour notre part, nous estimons que le débat public a bien eu lieu et qu’il a été extrêmement riche : une synthèse du dossier du maître d’ouvrage a été adressée à 180 000 foyers, le site internet a enregistré plus de 76 000 visites, 1 508 questions et 497 avis, et 154 cahiers d’acteur ont été rédigés, ce qui constitue un record si l’on excepte le cas du débat public relatif au Grand Paris.
Au-delà des quelque 150 personnes qui ont perturbé les réunions publiques, il faut bien constater que l’inquiétude et le sentiment d’impuissance, voire celui d’être méprisés, étaient largement perceptibles chez de nombreux citoyens. Les opposants au débat public avaient beau jeu d’affirmer que ce dernier était « bidon » puisqu’une loi avait déjà retenu le principe du stockage profond et du projet Cigéo. L’attribution de marchés par l’ANDRA en plein débat public, comme si tout était déjà décidé, a été particulièrement dommageable. Elle a renforcé la conviction, déjà très répandue, que les opinions exprimées par les citoyens étaient de peu d’importance et que tout allait se poursuivre dans la hâte et la précipitation, ce à quoi s’opposaient la quasi-totalité des citoyens et des responsables, y compris les plus favorables au projet.
Il est indispensable et urgent de restaurer un climat de plus grande confiance entre les citoyens, les experts, le maître d’ouvrage et les pouvoirs publics, faute de quoi on assistera à des blocages, comme nous en connaissons sur des projets moins sensibles. Il est également primordial que le maître d’ouvrage et les pouvoirs publics entendent les nombreuses interpellations exprimées au cours du débat public par les citoyens. La mise en œuvre du projet Cigéo ou de tout autre projet alternatif implique un impératif de vérité, de responsabilité et de précaution.
Une large majorité de personnes et d’experts indépendants ayant participé au débat, ainsi d’ailleurs que l’IRSN, s’accordent pour considérer que le calendrier de déploiement du projet prévu par la loi de 2006 est beaucoup trop tendu, et que des preuves supplémentaires doivent être apportées sur la sécurité du projet. L’idée d’un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. Cette étape doit notamment permettre de garantir la capacité à maîtriser les risques, étant entendu que si cette démonstration ne pouvait être apportée, un retour en arrière devrait être possible. Il faut donc que les colis qui auraient été mis en place à titre d’essai lors de la phase pilote puissent être retirés en toute sécurité. La réversibilité doit donc être entendue là au sens de récupérabilité. Ce n’est qu’à l’issue d’une étape de tests en deux phases – d’abord sans puis avec colis radioactifs – qu’il pourrait être envisagé de passer au stade industriel. Aux yeux de très nombreux experts, il serait totalement déraisonnable d’engager directement cette ultime étape à partir de la seule expérience du laboratoire de modélisation.
La volonté du ministère de l’écologie et du développement durable d’intégrer la question de la réversibilité du stockage Cigéo dans le projet de loi de programmation sur la transition énergétique qui doit être examiné en 2014, et donc d’accélérer le processus, apparaît en contradiction avec cet objectif largement partagé de desserrement du calendrier.
L’inventaire des déchets pouvant être accueillis dans Cigéo constitue un enjeu important puisque l’évolution de la politique énergétique française peut conduire à stocker des produits non prévus aujourd’hui. Une attention particulière doit également être apportée au risque incendie. La probabilité qu’en cent ans, plusieurs risques, dysfonctionnements ou erreurs humaines interviennent simultanément ne doit pas être négligée. En 1999, comme directeur des routes, j’ai vécu la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc ; tous les ingénieurs des Ponts considéraient pourtant qu’il s’agissait de la route la plus sûre de France. Je sais aujourd’hui d’expérience qu’un enchaînement d’incidents banals peut aboutir à un drame épouvantable.
Autre élément important, qui vaut d’ailleurs de manière générale dans notre pays, la demande de la société reste forte concernant les preuves d’indépendance de l’expertise par rapport au maître d’ouvrage, ce qui ne revient pas pour autant à remettre en cause la probité des différents acteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Les propositions émises sur ce point, lors du débat public de 2005 sur le principe du traitement des déchets radioactifs, en faveur de la construction d’une expertise plurielle ayant les moyens de jouer pleinement son rôle, restent donc d’actualité. À cet égard, il faut encourager la poursuite des efforts engagés notamment par l’IRSN dans ce sens. Les sujets qui apparaissent essentiels pour la sécurité du projet, qu’ils soient soulevés par les experts publics, privés ou issus de la société civile, doivent être débattus avec l’ensemble des acteurs concernés en toute transparence. La conférence des citoyens l’a montré : même sur les sujets les plus complexes, les citoyens bien informés ont la capacité de donner un avis pertinent. Aujourd’hui, les citoyens ne veulent plus se contenter d’entendre les experts du dispositif institutionnel les rassurer ; ils attendent que des associations et des experts indépendants, également étrangers, puissent participer au débat. Sans une évolution de la gouvernance et une expertise davantage pluraliste, il sera difficile de retrouver la confiance sur ce projet.
Pour nos concitoyens, les experts de l’ASN, de l’IRSN ou de l’ANDRA sont un peu toujours les mêmes qui passent d’un organisme à l’autre. Le renouvellement de la gouvernance pourrait avoir lieu dans le cadre du comité local d’information et de suivi (CLIS) et de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI), à condition de leur donner des moyens financiers plus conséquents.
Un autre progrès consisterait à ce que les instances de contrôle et de décision auditionnent publiquement les associations locales. Le président de l’ASN est assez favorable à cette proposition.
Il est également indispensable d’apporter au public des informations sur les financements et les coûts, en intégrant les coûts relatifs à la réversibilité. Je rappelle que, le 6 février 2013, la CNDP avait considéré que le dossier établi par le maître d’ouvrage était suffisamment complet pour être soumis au débat public, « sous réserve que soient explicitées à l’occasion du débat les questions financières et l’adaptabilité du projet aux évolutions de la politique nucléaire ». La Cour des comptes, dressant le bilan des divers coûts du projet, avait également souhaité que des éléments précis soient fournis à l’occasion du débat public. Sur ce point, force est de constater qu’aucune information supplémentaire n’a été apportée par la suite.
Si nous souhaitons que les citoyens fassent à nouveau confiance aux institutions et à la parole publique, il est indispensable de ne lancer de débat public que si l’opinion n’a pas le sentiment qu’une décision est déjà prise, et que si le maître d’ouvrage apporte tous les éléments d’information permettant de porter un jugement. En l’espèce, l’information sur les coûts, absente, a réellement manqué au public. Certains experts, il est vrai plutôt opposés au projet, ont même demandé qu’un nouveau débat se tienne quand les informations attendues seraient disponibles.
Dans son avis, le panel de citoyens indique : « Ce financement sera fait par “le contribuable et le consommateur”, dixit la Cour des comptes, et les producteurs de déchets EDF, AREVA et CEA, qui ajusteront leurs provisions en fonction de la nouvelle estimation de l’ANDRA. Ces provisions seront réévaluées à hauteur de 5 % (taux d’inflation estimatif), le chiffrage est rendu compliqué du fait de l’échelle de temps (sources : Cour des comptes, ANDRA).
« De plus, l’incertitude demeure du fait de l’inventaire des déchets non évalués à ce jour. Il en résulte une grande difficulté pour chacun des acteurs de présenter un chiffrage global conforme à la réalité.
« Le panel ne peut émettre d’avis faute d’information.
« Toutefois : quel que soit le chiffrage final du coût, il ne faut pas brader la sécurité au nom du profit. L’ANDRA a chiffré les différents risques “scénarisables” dans Cigéo mais n’a pas intégré le coût d’une catastrophe majeure. Ce coût potentiel devrait faire l’objet d’un chiffrage avant tout engagement. »
De nombreux autres acteurs estiment que le chiffrage du coût du projet doit également tenir compte du principe de réversibilité pendant cent ans, mais je ne suis pas certain que les estimations en la matière soient très avancées.
Le conseil de l’administration de l’ANDRA vient de faire connaître sa position sur les suites à donner au débat public sur Cigéo. Ses conclusions reprennent les principales observations formulées par la CNDP concernant la nécessité d’un nouveau jalonnement du projet et d’une phase de stockage pilote en deux étapes. Elles contiennent également des éléments positifs en matière de gouvernance et d’ouverture à la société civile. Pour ce qui concerne les coûts, l’ANDRA « s’engage, conformément à la demande de l’État, à lui communiquer une mise à jour du chiffrage en 2014, après prise en compte des suites du débat public et des études d’optimisation en cours. » En conséquence, nous pouvons espérer que l’évaluation du coût, qui, selon la loi de 2006, doit être rendue publique par le ministre en charge de l’énergie, sera connue au cours de l’année 2014.
M. le président François Brottes. Estimez-vous que les arguments avancés lors du débat public ont toujours été de bonne foi ?
Il me semble quelque peu contradictoire de proposer un dispositif déjà verrouillé au moment d’engager le débat : cela amoindrit la capacité d’amender le projet proposé. N’est-ce pas là un moyen dilatoire ?
M. Christian Leyrit. Depuis vingt ans, le débat est engagé de plus en plus en amont des projets et porte sur leur opportunité. Cette évolution positive a été consacrée par la loi Barnier du 2 février 1995, par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et par le Grenelle de l’environnement. De ce fait, les études sont nécessairement moins fines et les questions des citoyens légitimement plus nombreuses sur des points non résolus. Si les études étaient poussées à leur terme, les citoyens trouveraient des réponses à leurs préoccupations, mais les considérables montants engagés – parfois plusieurs centaines de millions d’euros – rendraient tout retour en arrière difficile. La question du moment pertinent de l’enquête publique se pose toujours.
Une enquête TNS Sofres, commandée après qu’une première réunion publique a été empêchée à Bure en mai 2013, montrait qu’un pourcentage très élevé de la population des deux départements concernés, la Meuse et la Haute-Marne, connaissait bien le projet Cigéo. Si 80 % des personnes interrogées estimaient que le débat était utile pour les informer, 70 % avaient la certitude qu’il ne modifierait en rien une décision prise antérieurement.
Il semble légitime que la société civile puisse s’exprimer sur des questions de sécurité. Le clivage aujourd’hui très marqué rend certes difficile de mettre sur la table les cahiers des charges relatifs aux risques, mais cette transparence paraît pourtant indispensable, comme d’ailleurs l’intervention d’une plus grande diversité d’experts, notamment étrangers. Car, à tort ou à raison, les citoyens auront toujours le sentiment que les experts de l’IRSN sont proches du maître d’ouvrage.
M. le président François Brottes. Surtout si vous instillez un doute !
M. Christian Leyrit. La CNDP est une autorité administrative indépendante. Neutre et impartiale, elle ne donne pas d’avis sur les projets soumis au débat public et est indépendante du maître d’ouvrage. Cependant, j’ai tenu à rappeler hier, lors de mon audition devant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, que les conditions juridiques de cette indépendance n’étaient pas suffisamment assurées par les textes en vigueur.
M. Claude Bernet, président de la Commission particulière du débat public Cigéo (CPDP). À l’été 2013, après deux tentatives de réunion publique, il est clairement apparu que le débat ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales et sereines, en tout cas sous cette forme. Le débat public consiste certes à diffuser de l’information, mais il permet surtout à la CNDP de faire remonter les opinions du public dont il effectue la synthèse. Pour recueillir ces opinions, à défaut de réunions publiques, nous ne disposions plus que de la voie de l’internet. L’instrument est évidemment utilisé par la CNDP depuis sa création, mais nous avons dû innover et programmer des débats contradictoires interactifs sur la toile. Grâce aux quelque dix mille connexions en direct ou en différé enregistrées, nous n’avons manqué ni d’arguments ni d’éléments d’information quand est venu le temps du bilan.
Une impression d’urgence excessive a marqué ce débat, enfermé dans un calendrier imposé par la loi de 2006 et lié à l’obligation de déposer la demande d’autorisation de création du centre de stockage au plus tard le 31 décembre 2014. Cette hâte, ne permettant pas de tenir compte du débat national en cours sur la transition énergétique, a conduit à négliger la demande de report formulée par plus de quarante associations. Elle n’est pas pour rien dans les difficultés que nous avons rencontrées.
Un autre enseignement tiré du débat est l’existence d’un clivage total entre ceux qui ne veulent à aucun prix du projet, et que personne ne pourra sans doute jamais convaincre, et ceux qui, intégrant la notion de risque calculé, envisagent d’avancer avec une extrême prudence. Si une dizaine de cahiers d’acteurs sur 150 restent neutres, les autres se partagent à égalité entre ces deux positions. Pourtant, alors que je ne suis pas parvenu à trouver la trace d’un compromis à l’issue du débat public classique, les dix-sept membres de la conférence de citoyens ont adopté une position à l’unanimité après qu’on leur a donné la formation et les moyens d’information indispensables. Ils ont non seulement compris le problème posé, mais ils se sont sentis investis de la mission de parvenir à un compromis. J’ai déjà présidé de nombreuses commissions de débat public, mais la conférence de citoyens a constitué pour moi une première dont l’excellent résultat me paraît particulièrement remarquable.
M. Jean-Pierre Gorges. Je m’interroge sur l’opportunité d’un débat public sur un sujet de nature éminemment politique. D’abord, il est indéniable que nous avons des déchets nucléaires à traiter. Ensuite, on parle de transition énergétique sans savoir où l’on va, les choix dépendant d’un contexte politique fluctuant : aujourd’hui, la France semble pencher pour un recul du nucléaire alors que d’autres pays renoncent à cette option – même les Allemands se posent des questions. Sur ce sujet, j’espère que notre pays deviendra bientôt raisonnable.
Comme le rapporteur de notre commission d’enquête, je considère que la véritable facture du nucléaire doit intégrer les coûts de stockage. Je m’interroge toutefois sur l’impératif de réversibilité qui me paraît être la meilleure façon de barrer la route à un projet. Quand le charbon a été extrait des mines pour produire de l’énergie, la question de son retour dans les sols pour éviter qu’ils ne s’écroulent a-t-elle été posée comme elle l’est aujourd’hui pour le gaz de schiste ? Je crains que la réversibilité ne soit exigée pour le nucléaire que dans l’intention de rendre son usage impossible.
Alors que nous sommes très déterministes sur le sujet, nous l’ouvrons au débat public à des gens qui n’y connaissent rien. De la même manière, j’ai honte lorsque, à l’Assemblée, nous nous mêlons de matières que les experts et les techniciens que nous recevons maîtrisent pour y avoir travaillé des années durant. On ne peut pas, comme pour un jury d’assises, demander à des citoyens de donner un avis sur un sujet qui les dépasse. Qui est vraiment en mesure d’aborder ces sujets ? Autant il me semble légitime que cette conférence se prononce sur le choix du lieu d’implantation du projet et sur les modalités de son installation, autant la question de l’opportunité du projet relève, à mon sens, du politique.
Le débat public n’est-il pas un outil de communication qui permet à bon compte d’affirmer que les citoyens ont été consultés ? Chacun sait parfaitement que l’on peut faire dire ce que l’on veut à un panel de 10 000 personnes interrogées sur internet. Est-il sérieux de faire reposer les choix stratégiques de notre pays sur le débat public tel qu’il est aujourd’hui organisé ? Je fais de la politique depuis de nombreuses années, et je ne rencontre dans les réunions publiques quasiment que des citoyens qui contestent mon action ; cela ne m’empêche pas d’être réélu. Prenons garde à ne pas remettre en cause des choix structurants pour notre nation.
Le travail que vous avez mené porte sur les déchets ultimes dans un contexte de génération 3. Avez-vous prévu d’en faire autant pour la génération 4 et le changement de nature des déchets ?
M. Denis Baupin, rapporteur. D’emblée, levons tout malentendu : nous sommes tous d’accord pour traiter de la question des déchets nucléaires ; ce qui est problématique, c’est que la filière ait pu voir le jour sans que celle-ci ait été préalablement réglée. Notre collègue Luc Chatel a d’ailleurs tenu des propos assez durs à ce sujet au cours de la réunion de la commission du développement durable d’hier.
Le débat public a au moins un mérite : il apporte de la transparence. Les citoyens comme les parlementaires n’auraient pas autant d’éléments d’information sans l’intervention de la CNDP et l’obligation pour le maître d’ouvrage de fournir un dossier. Il reste que les réserves émises le 6 février par la CNDP concernant « les questions financières et l’adaptabilité du projet » n’ont manifestement pas été prises en compte, ce qui interroge sur la capacité de la commission à obtenir des réponses. Elles sont pourtant d’autant plus essentielles qu’elles concernent la nature des déchets futurs et le coût de l’opération. Du reste, l’on peut se demander comment l’ANDRA compte fournir une estimation financière sans savoir ce qui devra être stocké, puisque cela dépend en partie de la future loi sur la transition énergétique. Il y a là une incohérence manifeste, d’autant que, le jour même du lancement du débat public, l’Autorité de sûreté nucléaire estimait dans un communiqué de presse que le débat ne pouvait se tenir que si l’inventaire des futurs déchets était connu, tout en avouant son ignorance de celui-ci.
M. Jean-Pierre Gorges. C’est le Parlement qui a introduit la notion de réversibilité – encore une fois, j’ai honte.
M. le rapporteur. Selon vous, le débat aurait-il pu se dérouler plus sereinement si la loi de 2006 n’avait pas préalablement opté pour le projet Cigéo et si plusieurs options étaient restées ouvertes ? N’aurait-il pas été plus crédible s’il avait, par exemple, proposé un choix entre stockage en subsurface et enfouissement ?
Quand, de surcroît, personne n’est en mesure de répondre à la question majeure de l’acheminement des déchets, cela ne peut, me semble-t-il, que nuire à la crédibilité auprès du public.
M. Christian Leyrit. La réversibilité a effectivement été introduite par le Parlement.
Le débat public ne se limite pas aux réunions publiques, que M. Chatel qualifiait d’ailleurs hier d’« obsolètes ». Il ne faut pas y renoncer, mais nous savons qu’elles ne rassemblent qu’une infime partie de la population et que le profil de ceux qui y participent reste spécifique, avec une surreprésentation des hommes âgés issus de catégories socioprofessionnelles supérieures. J’ai, en conséquence, souhaité diversifier les modes d’expression du public en favorisant internet, les réseaux sociaux et notre présence sur le terrain. Nous organisons ainsi des « débats mobiles » pour aller chercher les citoyens où ils se trouvent – dans les lycées et les universités, sur les marchés.
La défiance de nos concitoyens est telle qu’il nous appartient de répondre à leurs attentes. Ils souhaitent être davantage associés aux décisions. Chaque fois que les maîtres d’ouvrage les ont ignorés, comme pour l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, la situation s’en est trouvée inextricablement bloquée. Sans prétendre que les décisions doivent être remises entre les mains de conférences de citoyens, on peut s’appuyer sur l’expérience déjà ancienne des pays d’Europe du Nord ou du Québec pour dire que ces procédures permettent aux citoyens d’avoir le sentiment d’être entendus. L’avis qui nous a été rendu témoigne surtout qu’elles apportent un éclairage bien plus riche que les sondages d’opinion, pourtant souvent utilisés dans nos pays.
La CNDP organise un colloque international les 16 et 17 juin prochains sur le thème : « Le citoyen et la décision publique, enjeux de légitimité et d’efficacité ». Une enquête quantitative et qualitative est en cours sur le sujet.
M. le président François Brottes. Il y a tout de même des abonnés de la parole citoyenne qui concourent à la court-circuiter !
M. Christian Leyrit. C’est pourquoi nous cherchons à diversifier les modes d’expression.
M. Jean-Pierre Gorges. Je ne conteste pas l’utilité du débat public ; je constate seulement que l’opacité concernant le nucléaire est entretenue. Alors que près de 80 % des jeunes Français étudient jusqu’au baccalauréat, on ne leur a jamais parlé du nucléaire. L’éducation nationale doit faire un travail de formation des citoyens pour les aider à voter en toute connaissance de cause. L’information doit être démocratisée et transmise bien avant que la CNDP ait à intervenir.
M. Christian Leyrit. Les citoyens n’ont pas nécessairement le même point de vue sur le processus de décision selon qu’il concerne la santé, les transports ou le nucléaire. Nous avons le sentiment que, sur ce dernier point, des clivages plus forts se dessinent en raison de la perception par l’opinion d’une grande opacité du côté des experts. Diverses crises récentes ont amené nos concitoyens à remettre en cause plus facilement l’expertise. En tout état de cause, dans le trio de la décision publique que forment le citoyen, l’expert et le politique, on ne peut pas dire que le premier soit suffisamment considéré par les deux autres.
Pourtant, aujourd’hui, la société civile compte de plus en plus de jeunes retraités qui ont été eux-mêmes experts et qui ont accès à l’information à l’échelle mondiale grâce à internet. À l’époque où j’étais directeur des routes, il m’est arrivé de recevoir des contre-projets, élaborés par des associations regroupant d’anciens ingénieurs, géologues et conseillers d’État, de meilleure qualité que ce qui m’était proposé par ma propre administration. Il est difficile d’ignorer cette évolution. Plus l’information se diffusera, plus les citoyens voudront se prononcer sur les sujets qui les intéressent.
S’agissant de Cigéo, je ne suis pas certain que le débat public, imposé par la loi, constituait la meilleure méthode pour traiter du sujet. Il se serait probablement tenu dans de meilleures conditions si une alternative avait été soumise au public et que les citoyens n’avaient pas eu le sentiment que tout était déjà bouclé. Il est indispensable de restaurer la confiance des citoyens, sans laquelle tout peut se bloquer – c’est ce qui se produit en Corée du Sud, où l’on cherche à installer un équivalent de notre CNDP, et l’Allemagne rencontre également ce type de problème.
Il convient aussi d’assurer un continuum entre la loi, le débat public et l’enquête publique. La complexité favorise l’incompréhension, la méfiance et le contentieux. Il y a plus à gagner à consulter les citoyens de façon approfondie qu’à multiplier les textes. Les collectivités locales, mais aussi les maîtres d’ouvrage, prennent progressivement conscience de l’apport des débats publics qui peuvent améliorer les projets proposés.
Le débat public ne doit pas être lancé lorsque le dossier proposé par le maître d’ouvrage n’est pas satisfaisant. Le manque d’information, par exemple sur les coûts, n’est pas susceptible de renforcer la confiance des citoyens. S’agissant du financement de Cigéo, je relève que, dans sa délibération du 5 mai, « le conseil d’administration de l’ANDRA rappelle que les documents sur le coût et le financement du projet, consultables sur internet, vont au-delà du niveau d’évaluation habituellement mis en œuvre sur les projets soumis à débat public. ». Il me revient d’affirmer que, depuis 2002, soixante-dix débats publics ont été organisés par la CNDP, et que très peu d’entre eux ont donné lieu à la transmission d’une quantité d’informations financières aussi légère.
M. le rapporteur. Considérez-vous que les préconisations de l’ANDRA reprennent les conclusions que vous avez tirées du débat public ? A-t-elle entendu le souhait que les recherches se poursuivent pendant une quinzaine d’années en laboratoire au cours d’une phase pilote avant qu’une décision définitive soit prise ?
Le débat public a-t-il favorisé l’émergence d’idées pratiques susceptibles d’aider les parlementaires dans les choix qu’ils auront à faire au regard de la récupérabilité ? J’emploie à dessein ce terme qui me paraît plus clair que celui de réversibilité et correspondre mieux à la loi de 2006.
Vous avez évoqué les enjeux de la gouvernance future. Toutes les conditions n’étaient pas réunies lors du débat public pour garantir une certaine sérénité, même si la conférence des citoyens a constitué, j’en ai été le témoin, un moment de réelle écoute permettant de dégager un compromis. Je crains que nous n’en soyons pas encore à ce stade sur le terrain. Quelles instances permettraient, selon vous, de restaurer la confiance sur la durée ? Avez-vous des préconisations concernant la gouvernance même de l’ANDRA et l’amélioration de la transparence en son sein ?
Selon vous, les pouvoirs publics sont-ils aujourd’hui en mesure d’évaluer correctement les provisions que doivent prévoir les producteurs de déchets nucléaires ? Il est essentiel que les coûts soient anticipés et provisionnés dès aujourd’hui, car il se pourrait bien que Cigéo ne voie le jour qu’après que notre pays ait cessé de produire de l’électricité d’origine nucléaire ce qui tarirait cette source de financement.
M. Christian Leyrit. L’ANDRA a retenu l’idée d’une phase pilote, ce qui me semble très positif. Elle a également décidé du raccordement du site au réseau ferré national, pour permettre l’acheminement des colis de déchets par le rail jusqu’à Cigéo.
L’ANDRA a aussi indiqué, comme cela avait été demandé lors du débat public, que « les déchets présentant des problématiques spécifiques, comme les déchets bitumés vis-à-vis du risque d’incendie par exemple, font l’objet de programmes d’essais dédiés ».
En matière de gouvernance, le conseil d’administration de l’Agence propose, ce qui n’est pas vraiment nouveau, d’« élargir l’information et de favoriser les échanges et la concertation entre l’ANDRA, les experts et le public sur le projet Cigéo et ses impacts, sur la maîtrise des risques, la réversibilité et l’insertion du projet dans le territoire ». Aujourd’hui, l’ANDRA communique de façon intensive, mais elle délivre une information à sens unique et ne cherche pas vraiment à échanger. Désormais, elle entend « mener une concertation avec les parties prenantes locales et nationales pour l’élaboration du plan directeur pour l’exploitation de Cigéo et ses révisions », et « consulter le Comité local d’information et de suivi du laboratoire souterrain pour définir de nouvelles modalités d’échanges… ». Elle propose « de contribuer au développement de l’expertise pluraliste sur la gestion des déchets radioactifs ». Elle étudiera « les modalités d’ouverture de l’Observatoire pérenne de l’environnement aux parties prenantes locales », et elle renforcera ses liens avec « la société civile en se dotant d’un comité pluraliste chargé de l’éclairer sur la prise en compte des enjeux sociétaux… ». Tout cela me paraît aller dans le bon sens.
Je n’ai pas compétence pour émettre un avis concernant la capacité de l’ANDRA à estimer en 2014 les coûts et le niveau des provisions. L’ANDRA n’a pas tort de souligner qu’il est relativement inhabituel de demander à un maître d’ouvrage d’évaluer des coûts sur cent ans. La tâche est d’autant plus complexe que, comme le remarque la Cour des comptes, les résultats peuvent être très différents selon les hypothèses retenues et l’évolution monétaire.
M. le rapporteur. Nous débattons d’une structure qu’il faudra, à coup sûr, financer dans cent ans et qui a de fortes chances de ne plus rien rapporter financièrement, ce qui fait la différence avec les projets dont vous traitez habituellement.
M. Claude Bernet. Il y a trois ans, la Cour des comptes a porté un jugement plutôt positif sur le mécanisme institutionnel et sur le calcul des coûts complets de l’opération effectué en 2005. Le mot « complet » est pris ici dans un sens inhabituel puisqu’il tient compte, au-delà du seul coût d’équipement, des dépenses de fonctionnement actualisées sur cent ans. Ce qui est reproché par le débat public au maître d’ouvrage, c’est de ne pas donner l’actualisation qui, en fait, relève de l’État.
M. Christian Leyrit. C’est à l’État qu’il revient d’exiger des maîtres d’ouvrage qu’ils lui fournissent des informations. Le coût final est d’ailleurs communiqué par le ministre chargé de l’énergie. Cela dit, il est compréhensible que les producteurs de déchets ne souhaitent pas augmenter leurs provisions.
M. le président François Brottes. Messieurs, nous vous remercions pour votre intéressant témoignage.
Audition de Mme Marie-Claude Dupuis, directrice générale, et de M. Thibaud Labalette, directeur des programmes (ANDRA)
(Séance du 7 mai 2014)
M. le président François Brottes. On peut dire que cette audition de l’ANDRA, représentée aujourd’hui par Mme Marie-Claude Dupuis, directrice générale, et M. Thibaud Labalette, directeur des programmes, était très attendue. Elle est d’autant plus d’actualité que l’Agence a adopté hier les suites à donner au débat public sur le projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Nous venons d’ailleurs d’entendre le responsable de la commission nationale chargée d’organiser ce débat. Ce dernier, qui adopte une stricte neutralité et s’interdit d’avoir un point de vue sur le sujet concerné – ce qui est bien pratique, reconnaissons-le –, a dit de l’ANDRA, pour simplifier, qu’elle informait beaucoup mais pratiquait peu la concertation.
Notre commission d’enquête est sur le point d’achever ses travaux, et elle consacre logiquement ses dernières auditions à la question du traitement des déchets, après avoir examiné tout le cycle de production.
Est-ce le fruit du débat lui-même, qui s’est tenu dans les conditions que l’on sait, ou le résultat d’une réflexion mûrie de la part des experts que vous êtes ? Le conseil d’administration de l’ANDRA a décidé de faire évoluer sur quatre points le projet de centre de stockage en profondeur qui avait été soumis au débat public.
La première évolution est l’intégration d’une phase pilote au démarrage de l’installation. Vous devrez toutefois nous préciser s’il s’agit d’une installation pilote destinée à être abandonnée au moment de l’exploitation industrielle ou plutôt une première tranche du projet Cigéo.
Deuxième évolution, l’exploitation devra être pilotée selon un plan directeur régulièrement révisé. Il semble logique, en effet, de ne pas s’enfermer dans un schéma rigide.
La troisième proposition de l’Agence porte sur le desserrement du calendrier par le découpage du processus de demande d’autorisation de création. On a, en effet, le sentiment – mais peut-être le rapporteur me contredira-t-il sur ce point – qu’il est possible de recourir pendant encore plusieurs dizaines d’années au stockage en subsurface. La pression est donc moins forte et nous disposons de plus de temps pour trouver une solution alternative, que l’on soit ou non favorable au stockage en profondeur. C’est d’autant plus vrai que, s’agissant d’une opération aussi importante, on finit par multiplier les malentendus en voulant précipiter l’allure.
Enfin, la quatrième évolution tend à améliorer l’implication de la société civile dans le dossier. C’est une des interrogations nées du débat public : une telle implication peut-elle s’inscrire dans la durée, à l’instar de l’action menée par les commissions locales d’information (CLI) ?
L’histoire dira si ces aménagements auront permis d’ouvrir la voie à la création d’un site de stockage géologique profond, dont je rappelle qu’il s’agit de la solution de référence retenue par la législation pour la gestion de déchets de haute et moyenne activité à vie longue, en France comme dans de nombreux autres pays. Le Parlement a souhaité que les colis de déchets soient récupérables, dans l’hypothèse où l’on parviendrait à développer une technologie permettant d’en neutraliser la radioactivité. À cet égard, le débat entre récupérabilité et réversibilité n’est pas seulement de nature sémantique, puisqu’il a une incidence sur les coûts.
En tout état de cause, on peut saluer la volonté de l’ANDRA de mieux impliquer le public dans la gouvernance de ce projet. Ce n’est pas facile, compte tenu de la virulence de certains propos, et force est de reconnaître qu’il existe des postes moins exposés que le vôtre, madame Dupuis. Rassurez-vous, nous nous efforcerons, pour notre part, de rester courtois pendant cette audition. La matière est telle que le choix ne doit pas être laissé à la seule appréciation des technostructures, mais doit être effectué à l’issue d’un débat à la fois large et serein. Une chose est sûre : que l’on soit pour ou contre la filière nucléaire, les déchets sont là, et il faut bien en faire quelque chose. Pour cette raison, je pensais que la question du traitement des déchets nucléaires était de celles qui susciteraient le moins de passion. De toute évidence, j’étais bien naïf.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vais maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Marie-Claude Dupuis et M. Thibaud Labalette prêtent serment)
Mme Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Avant de répondre à vos questions, permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel nous travaillons. L’action de l’ANDRA s’inscrit dans un cadre législatif très précis. Elle a pour mission d’assumer le produit de cinquante ans d’industrie nucléaire française, c’est-à-dire plus de 3 000 mètres cubes de déchets de haute activité et plus de 40 000 mètres cubes de déchets de moyenne activité à vie longue. Ils sont certes entreposés en lieu sûr, mais de façon temporaire. Compte tenu de leur durée de vie et de leur dangerosité, il est nécessaire de trouver une solution de long terme.
Le Parlement s’est emparé du sujet à partir de 1991, avec le vote de la loi relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. En 2006, il a adopté une nouvelle loi qui assignait à l’ANDRA l’objectif de poursuivre les travaux sur le projet de stockage géologique, et notamment sur l’implantation et la conception des installations. Deux échéances ont été fixées à cette occasion : la présentation en 2015 d’une demande d’autorisation de création et, si celle-ci est délivrée, la mise en service à l’horizon 2025, après qu’ait été adoptée une loi sur les conditions de réversibilité du stockage. Le centre de stockage, le fameux projet Cigéo, serait installé à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Je dirai deux mots de son état d’avancement technique.
En 2012, nous avons achevé la première étape de la phase de conception industrielle – l’esquisse industrielle – en nous appuyant sur des maîtres d’œuvre externes : les plus grandes sociétés françaises d’ingénierie participent à ce projet, qui exige des compétences en matière de travaux souterrains et de nucléaire. C’est d’ailleurs ce qui fait de Cigéo un projet industriel atypique, y compris en termes de maîtrise des risques et de sûreté.
L’esquisse industrielle a été triplement évaluée en 2013, pendant le déroulement du débat public : par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et son appui technique, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; par la Commission nationale d’évaluation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (CNE2), instituée par le Parlement et qui réunit de nombreux académiciens ; par une revue d’experts industriels.
M. le président François Brottes. Des experts français ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Beaucoup étaient étrangers – des Suisses, des Belges, un Allemand –, et tous de réputation internationale. Je précise que les décisions prises lundi par le conseil d’administration de l’ANDRA donnent suite non seulement au débat public, dont les conclusions ont en effet nourri notre réflexion, mais aussi aux avis exprimés en 2013 par ces évaluateurs institutionnels, auxquels on peut ajouter l’Autorité environnementale, qui a précisé ses attentes en matière d’étude d’impact, ainsi que le Haut comité à la transparence et à l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), dont les recommandations concernent l’inventaire et le sort des combustibles usés dans le cas où ces derniers deviendraient des déchets.
Le centre de stockage aura plusieurs composantes. Les installations nucléaires de surface permettront d’accueillir les déchets radioactifs, de les contrôler, de les extraire de leur conteneur de transport et de les placer dans les colis de stockage. Ces derniers seront ensuite transportés dans une hotte blindée au travers de puits inclinés appelés descenderies, puis glissés par des robots dans des alvéoles creusées dans l’argile à 500 mètres de profondeur, et recouvertes soit d’acier, soit de béton. En surface, une deuxième zone servira de support aux travaux souterrains, et sera reliée à l’installation souterraine par des puits verticaux.
Ce projet industriel ferait travailler sur place 1 300 à 2 000 personnes pendant la construction, et de 600 à 1 000 personnes en phase d’exploitation, sans parler des emplois indirects.
À la suite du débat public et des avis exprimés par diverses autorités, le conseil d’administration de l’ANDRA a décidé d’adapter son projet en lui apportant quatre modifications qui lui paraissent importantes.
En ce qui concerne la phase industrielle pilote, vivement souhaitée par le public, mais aussi par l’ASN et l’IRSN, il s’agit moins d’un pilote à proprement parler que d’une étape prévue au démarrage de l’installation. Ceux qui suivent attentivement le dossier savent cependant que l’ANDRA avait déjà proposé, au cours du débat public, une montée en puissance progressive du centre de stockage, tranche par tranche, au fur et à mesure des besoins, et prévu d’effectuer des essais dans la première tranche.
Le débat public ayant révélé une demande très forte en faveur d’un passage plus progressif du laboratoire au stockage en vraie grandeur, nous avons été conduits à redimensionner cette première tranche en une vraie phase industrielle pilote. Cela entraîne deux changements importants : nous allons renforcer le programme d’essais et surtout le soumettre à une concertation. En effet, cette phase industrielle pilote sera la première pierre du plan directeur d’exploitation du stockage sur cent ans.
Outre cet aspect technique, cette phase comprend une partie politique : non seulement une concertation sera organisée, mais il reviendra au Gouvernement et au Parlement de définir les modalités de passage de la phase industrielle pilote à la phase d’exploitation courante.
Pour autant, je le répète, il ne s’agit pas d’un pilote puisque, depuis 1991, la France a dépensé, 1,5 milliard d’euros en études et recherches et pour construire le laboratoire souterrain de test. En outre, dès lors que l’on veut tester en vraie grandeur et en conditions réelles le stockage de déchets radioactifs, une installation nucléaire de base (INB), dont la création est soumise à autorisation, est nécessaire pour permettre l’accueil des colis de déchets quel qu’en soit le nombre, avec toutes les conditions de sécurité qu’un tel projet exige : double descenderie, double puits pour assurer la ventilation du chantier, et autres.
En revanche, l’investissement pour cette première phase industrielle pilote sera dimensionné au strict nécessaire pour réaliser les tests envisagés. Dans un premier temps, les essais concerneront des colis factices, sans radioactivité. Puis nous testerons le fonctionnement de l’installation en stockant des colis de déchets radioactifs représentatifs de l’ensemble de l’inventaire sur cent ans : des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ces derniers seraient stockés dans quatre alvéoles sur la cinquantaine prévue. Enfin, un troisième temps serait consacré à tester, de manière très progressive et en concertation avec les parties prenantes, la capacité de l’installation à atteindre les cadences industrielles prévues, c’est-à-dire 3 000 colis primaires par an.
À la fin de l’exploitation industrielle pilote, l’ANDRA remettra un rapport à l’État détaillant les résultats de cette expérience en vraie grandeur.
La deuxième évolution importante est l’adoption d’un plan directeur pour l’exploitation du stockage. Rappelons que la durée de vie de l’exploitation de Cigéo est d’une centaine d’années. Depuis le début, l’Agence est convaincue que les connaissances accumulées au cours des premières années d’exploitation ainsi que celles acquises grâce aux études et recherches, notamment sur les colis de déchets ou sur les alvéoles, vont conduire à une évolution dans la conception du projet. Le plan directeur d’exploitation est donc destiné à prévoir le déroulement du stockage sur la totalité de sa durée de vie, l’ampleur des flux de déchets et le planning prévisionnel de scellement des alvéoles et des ouvrages, la fermeture définitive n’intervenant qu’au bout de cent ans et après autorisation du Parlement.
Ce plan permettra également de définir les conditions dans lesquelles le centre pourra être adapté dans l’hypothèse, par exemple, où les combustibles usés deviendraient, pour des raisons de politique énergétique, des déchets nucléaires. Cigéo est, en effet, conçu pour les déchets d’aujourd’hui, mais il doit pouvoir faire preuve de la flexibilité que nécessiteront ceux de l’avenir. C’est pourquoi nous allons poursuivre les recherches sur le stockage des combustibles ou des MOX usés, bien que celui-ci ne soit pas prévu à l’heure actuelle.
J’en viens au calendrier, peut-être le problème le plus délicat à traiter pour le conseil d’administration de l’Agence. En effet, l’ANDRA s’efforce de respecter la loi, ce qui est la moindre des choses pour un établissement public. La loi de programme votée en 2006 a posé en son article 3 deux jalons, 2015 et 2025, et imposé en même temps le débat public dont les conclusions devaient être prises en compte. En 2006 également, le Parlement a voté une loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont le décret d’application a été pris en 2007. Cette loi a fait évoluer la réglementation sur l’autorisation des installations nucléaires de base. Dorénavant, le niveau de détail exigé par l’ASN pour de telles demandes d’autorisation est beaucoup plus fin qu’il ne l’était avant 2006, si bien que la demande d’autorisation pour Cigéo ne pourra être finalisée par l’ANDRA qu’en 2017.
Nous proposons donc de remettre, dès 2015, un dossier préliminaire comprenant les trois pièces essentielles de la demande : le projet de plan directeur d’exploitation, le dossier d’orientation de sûreté qui permettra à l’ASN de vérifier que nous sommes proches de la démonstration complète attendue, et un dossier d’options techniques de récupérabilité détaillant les moyens par lesquels l’Agence s’engage à assurer la possibilité de récupérer les colis de déchets pendant cent ans. Et ce n’est qu’en 2017, sur la base des avis et du résultat des études, que nous finaliserons la demande d’autorisation de création.
À plus long terme, un éventuel aménagement du calendrier dépendrait de conditions dont la maîtrise nous échappe : le vote d’une loi sur les conditions de réversibilité, sans lequel le stockage ne saurait être autorisé ; l’autorisation de création du centre ; mais aussi toutes les autorisations administratives nécessaires pour construire les routes, assurer l’alimentation en eau et en électricité, et apporter tous les aménagements adéquats.
Enfin, la quatrième évolution importante concerne l’implication de la société civile dans le projet. Sur ce point, je me permettrai de répondre aux propos du président de la CNDP.
M. le président François Brottes. Je les ai un peu raccourcis. Grosso modo, il nous a dit que vous étiez très forts en communication, mais que cela n’était que de la communication.
M. Denis Baupin, rapporteur. C’est du moins ce que beaucoup de gens pensent, selon lui.
Mme Marie-Claude Dupuis. Encore faut-il savoir qui sont ces gens. L’ANDRA n’agit pas toujours en fanfare, et nombreux sont ceux qui peuvent attester qu’elle a mené une concertation aussitôt après le vote de la loi de 2006, qui lui assignait pour premier objectif de trouver un site d’implantation pour Cigéo.
Jusqu’alors, la région située aux limites de la Meuse et de la Haute-Marne n’avait été sélectionnée que dans un but de recherche, afin d’y construire un laboratoire souterrain destiné à effectuer des essais et à travailler sur la démonstration scientifique de la sûreté à long terme d’un stockage géologique des déchets. Mais le 28 juin 2006, jour où le Parlement a voté la loi, les objectifs assignés à l’ANDRA ont changé complètement de nature : elle devait dorénavant travailler sur un projet industriel, proposer un site précis d’implantation et préparer une demande d’autorisation.
Dès lors, nous avons entrepris un travail énorme sur le terrain, rendant visite aux acteurs locaux – élus, entreprises, associations, institutions…
M. le président François Brottes. À l’époque, trois ou quatre sites étaient envisagés, dont l’un situé en Corrèze.
Mme Marie-Claude Dupuis. Cela, c’était avant le choix du site pour le laboratoire souterrain. Une fois ce choix effectué, l’engagement avait été pris de ne jamais y placer de déchets radioactifs ; il était donc exclu de transformer le laboratoire en centre de stockage. Néanmoins, pour des raisons de sûreté à long terme, il fallait rester dans la couche d’argile, qui présente d’excellentes qualités de confinement. Une zone de 250 kilomètres carrés a donc été identifiée en Meuse pour accueillir en profondeur des déchets radioactifs. Or un projet industriel aussi ambitieux ne comprend pas que des implantations souterraines : il a fallu sélectionner également une zone en surface, dans un milieu rural comprenant des terres cultivées et des forêts. La concertation a alors été engagée pour trouver le lieu où l’on dérangerait le moins, celui qui permettrait d’accéder à la couche argileuse tout en préservant la qualité de vie et les activités en surface. Nous avons accompli un important travail de terrain – dont beaucoup se souviendront – avant de proposer une implantation.
Il est vrai que ce travail a surtout concerné les élus locaux ; les propos du président de la CNDP faisaient donc peut-être référence à la société civile. C’est oublier que le Parlement avait confié au Comité local d’information et de suivi (CLIS) dédié à Cigéo un rôle important d’information et de concertation. Et il a accompli un gros travail en ce domaine. Bien entendu, cela n’a pas empêché l’ANDRA de mener ses propres actions de concertation. Avant même l’organisation du débat public, mes équipes avaient affrété un minibus afin de présenter, avec l’accord des maires, le projet Cigéo dans toutes les communes concernées. Souvent, cette présentation avait lieu le jour du marché. Or, en dehors du maire venu nous remercier de notre venue et de quelques personnes intéressées, nous n’avons eu que très peu de visiteurs. Nos échanges avec le CLIS de Bure révèlent d’ailleurs qu’il rencontre les mêmes difficultés.
Avant de recourir à ce minibus, nous avions organisé des réunions d’information et d’échanges dans toutes les communes de la zone Meuse-Haute-Marne : elles n’ont attiré au plus qu’une dizaine de personnes. Même en allant au-devant du public, il s’est avéré extrêmement difficile de l’intéresser.
En revanche, les journées « portes ouvertes » organisées au laboratoire de Bure sont un succès. Ces visites sont l’occasion d’un véritable échange avec les populations.
On ne peut donc pas affirmer que l’ANDRA ne fait que communiquer. Elle ne se contente pas de confectionner des dossiers de presse, mais réalise un travail considérable sur le terrain. Nous écoutons beaucoup, et le produit de cette écoute, au-delà même du bilan du débat public, est ce qui nourrit notre projet au quotidien.
J’en viens à la question de la réversibilité qui, selon moi, aurait pu constituer le cœur du débat public. Nos propositions sur ce sujet n’ont pas toujours été comprises, les quiproquos sur les notions de réversibilité et de récupérabilité contribuant à la confusion. C’est pourquoi le conseil d’administration s’est attaché à reformuler les choses dans sa décision.
Notre analyse est que la réversibilité comprend deux dimensions.
La première, qui répond à une demande forte, est d’ordre technique. Elle consiste à prévoir la possibilité, pour les générations futures, de retirer les colis de déchets. De fait, l’ANDRA s’engage à dimensionner les installations Cigéo de façon à permettre ce retrait pendant cent ans, avec des épaisseurs d’acier et de béton suffisantes, des robots capables de fonctionner dans les deux sens, etc.
La seconde composante est plus politique. Selon nous, la réversibilité se définit comme la capacité à offrir à la génération suivante un choix : soit opter pour le stockage en scellant les alvéoles, soit retirer les déchets. Cigéo permet ce choix, notamment parce que notre projet est flexible et sa mise en place très progressive.
En attendant le vote d’une loi sur les conditions de réversibilité, nous avons donc tenté de traduire cette notion avec nos propres mots et d’élaborer des propositions sur ce sujet.
Avant tout, le projet Cigéo intégrera, dès sa conception, la possibilité de récupérer les colis de déchets pendant les cent ans que durera la période d’exploitation, garantissant aux générations futures la possibilité de faire un choix.
Au-delà de la réversibilité ou de la récupérabilité, le vrai choix porte sur la fermeture plus ou moins progressive des alvéoles et des ouvrages de stockage. Afin de rassurer tout le monde, je me dois de préciser qu’aucune alvéole ne sera scellée pendant la phase industrielle pilote. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’elles resteront ouvertes à tous les vents. Les alvéoles pour les déchets de moyenne activité à vie longue, qui prendront la forme de tunnels de 400 mètres de longueur et de 9 mètres de diamètre, seront closes par des portes blindées pouvant être rouvertes. Pour assurer la sûreté à long terme – un million d’années –, le scellement définitif sera obtenu par des ouvrages en béton de 30 à 40 mètres associés à de la bentonite.
Pour résumer, pendant la phase industrielle pilote, les alvéoles seront fermées par des portes blindées pouvant être ouvertes : la réversibilité sera assurée à 100 %. Et l’ANDRA s’engage à n’envisager un calendrier de fermeture qu’à l’issue de cette phase. Même à ce moment, nous disposerons encore d’un choix et de temps pour le faire.
L’Autorité environnementale nous a invités à travailler, pendant la phase industrielle pilote, sur trois scénarios d’exploitation et de fermeture du stockage. Les évaluateurs – ASN, IRSN, CNE2 – préconisent d’effectuer le scellement le plus tôt possible, afin d’assurer la sûreté passive, tandis que la société civile tend à vouloir le plus possible retarder ce moment, afin de laisser les choix ouverts. Nous allons approfondir ces deux scénarios, ainsi qu’un troisième, intermédiaire, qui consisterait à fermer les alvéoles par quartiers compte tenu de la nécessité de les surveiller.
Tout cela sera inscrit dans le plan directeur, qui identifiera les points de décision. L’ANDRA, en effet, n’a pas l’intention d’exploiter le centre en cachette : elle présentera en 2015 les différents scénarios d’exploitation possible, puis le point sera fait après la phase industrielle pilote.
Par ailleurs, trois engagements forts ont été pris par le conseil d’administration. Le premier consiste à garantir la sûreté avant tout, un objectif qui reste la priorité absolue pour l’Agence. Le deuxième, à veiller à la bonne insertion du projet dans le territoire qu’il doit contribuer à développer. Nous avons notamment l’intention de demander une labellisation de type « grand chantier », susceptible de structurer le dialogue entre l’État, les collectivités territoriales, l’ANDRA et les autres entreprises de la filière nucléaire. Une telle intention rejoint d’ailleurs la proposition faite par certains de créer une zone d’intérêt national. Dans les deux cas, il s’agit de tenir compte du fait que Cigéo est plus qu’un simple projet industriel, un projet d’intérêt national qui doit être traité de manière spécifique. Enfin, le troisième engagement est de veiller à la maîtrise des coûts et de réduire les dépenses sans pour autant transiger sur la sûreté et la sécurité.
Cela m’amène à la question du chiffrage du coût du projet. Les derniers éléments rendus publics sur ce sujet sont contenus dans le rapport de la Cour des comptes, qui a d’ailleurs bien souligné la difficulté de l’exercice. La seule estimation officielle a été publiée en 2005 par le ministère de l’énergie, mais les travaux sur ce chiffrage se poursuivent.
J’insiste sur le caractère inédit de l’exercice assigné à l’ANDRA, qui n’est demandé à aucun industriel : chiffrer un coût complet, comprenant non seulement l’investissement initial correspondant à la phase industrielle pilote, mais aussi le coût de l’exploitation de l’installation pendant plus de cent ans, de sa fermeture, du démantèlement des installations de surface, etc. Or non seulement une telle estimation dépend de toutes sortes de paramètres techniques, mais elle ne peut être réalisée qu’à partir d’hypothèses de travail. Quelle sera, par exemple, la fiscalité applicable à Cigéo en 2020, année où le projet pourrait être autorisé ? Que dire alors sur une période de cent ans ? Sur de telles questions, nous attendons les hypothèses de l’État.
M. le président François Brottes. Vous semblez, en tout cas, tenir pour acquis qu’il existera toujours une fiscalité.
Mme Marie-Claude Dupuis. En effet. D’ailleurs, en ce qui concerne le stockage proprement dit, le dispositif législatif existe : lors de la réforme de la taxe professionnelle, une taxe de stockage a été créée par le Parlement, dont il reste à fixer les coefficients. Pour ce qui est de l’impôt foncier, le calcul de l’assiette, s’agissant d’une installation nucléaire souterraine comprenant également une emprise en surface, va constituer un exercice inédit pour les services de Bercy.
Le ministère chargé de l’énergie nous a demandé de lui remettre un chiffrage à l’été 2014. La loi est très claire : ce n’est qu’une fois en possession de ce document et après avoir consulté les producteurs et l’ASN que le ministère arrête et rend public son chiffrage. Dans l’attente, l’ANDRA a interdiction de communiquer sur ce sujet.
Par ailleurs, l’Agence ne remettra pas un seul chiffre, car proposer des chiffres bruts cumulés sur cent ans n’a aucun sens d’un point de vue comptable. EDF, AREVA et le CEA doivent prendre en compte le rythme des dépenses et les taux d’actualisation afin de les intégrer dans leurs comptes. Le dossier de chiffrage que nous remettrons à l’État comprendra donc le montant clairement identifié de l’investissement initial, correspondant à la phase industrielle pilote, et un calendrier de dépenses annuelles. Il proposera également des hypothèses de travail sur le volume de déchets.
En effet, le chiffrage doit être effectué sur l’ensemble de l’inventaire prévisionnel des déchets à stocker dans le centre. Nous souhaitons que cet inventaire soit fixé par arrêté ministériel, si possible dès 2015. Cela faciliterait la finalisation de la demande d’autorisation.
Nous connaissons déjà le volume des déchets produits depuis cinquante ans. Mais s’agissant de ceux qui proviendront du parc nucléaire en exploitation, le volume à prendre en compte n’est pas le même selon que la durée de vie des centrales est portée à quarante, cinquante ou soixante ans. Certes, le projet Cigéo est suffisamment flexible pour qu’il ne soit pas nécessaire de connaître exactement le nombre de réacteurs en fonctionnement. Il n’en demeure pas moins que l’inventaire des déchets a été une des importantes questions abordées pendant le débat public. Nous avons tout fait pour clarifier les choses en indiquant les conséquences pour Cigéo de chacun des scénarios de politique énergétique. Mais nous attendons aussi du ministre chargé de l’énergie qu’il prenne une décision à propos de l’inventaire, comme le prévoit d’ailleurs le décret publié en 2013 sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
S’agissant du travail d’estimation qui doit aboutir à l’été 2014, …
M. le président François Brottes. J’espère que vous êtes venue avec quelques vivres, parce que nous ne vous laisserons pas sortir d’ici sans avoir obtenu un chiffre !
Mme Marie-Claude Dupuis. Ce chiffre, pourtant, je ne l’ai pas encore, car le travail n’est pas terminé.
Il s’agit d’abord d’un travail technique. C’est bien pour cette raison que le ministère nous a demandé de finaliser le chiffrage après le débat public, afin de tenir compte de ses conclusions. On ne peut pas, tout à la fois, reprocher à l’ANDRA d’ignorer le débat public et lui demander un chiffre avant la fin de celui-ci.
Par ailleurs, le ministère nous a chargés d’approfondir les pistes d’optimisation technico-économiques identifiées l’année dernière : choix de modalités de creusement, longueur ou diamètre des alvéoles… Ces éléments ont un impact sur le coût du stockage, pas nécessairement sur la sûreté. Mais avant d’en tenir compte pour le chiffrage, il convient de vérifier quelles sont les hypothèses techniquement et industriellement valables. Nous venons de recevoir les résultats des études d’ingénierie sur cette question. Cela étant, les échanges avec les producteurs ont bien avancé et sont désormais apaisés ; nous sommes sortis des polémiques sur les coûts ou les solutions techniques.
Aujourd’hui, nous en sommes à l’estimation des effectifs prévisionnels, en équivalents temps plein, nécessaires pour exploiter une telle installation pendant cent ans – y compris les chargés de communication, les pompiers ou les gardiens.
Il nous reste à finaliser le dossier de chiffrage complet en y intégrant ces données. Nous rendrons notre copie cet été, comme nous l’a demandé le ministère.
Je ne peux donc pas vous donner de chiffre parce que je ne le connais pas encore.
M. le président François Brottes. Vous avez dit que vous ne désapprouviez pas l’estimation de la Cour des comptes.
Mme Marie-Claude Dupuis. Ce rapport de la Cour a été publié en 2012. Depuis, nous lui avons transmis l’état de notre travail, et elle doit vous en remettre la copie. Mais la loi précise bien que l’ANDRA ne rend pas public le résultat du chiffrage.
M. le président François Brottes. Il ne s’agit pas de le rendre public, mais d’informer une commission d’enquête parlementaire !
Mme Marie-Claude Dupuis. Si vous voulez que je donne à la commission d’enquête les éléments à ma disposition…
M. le président François Brottes. Il faut vous inviter à huis clos ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Non, nous avons tout donné à la Cour des comptes qui va vous rendre un rapport.
M. le président François Brottes. Vous ne pouvez pas nous donner moins d’informations !
Mme Marie-Claude Dupuis. J’ai juré de dire la vérité, et je la dis : ce chiffre, je ne l’ai pas.
M. le président François Brottes. Il est certain que si vous ne dites rien, vous ne pouvez pas mentir !
Mme Marie-Claude Dupuis. Je le répète, le travail n’est pas terminé. Ce que nous avons donné à la Cour des comptes, c’est l’état des lieux : quelles sont les pistes d’optimisation sur lesquelles nous travaillons, les enjeux, etc.
M. le rapporteur. Les responsables actuels de l’ANDRA ne sont pas responsables de toutes les décisions prises depuis cinquante ans ; il n’empêche que certaines questions restent en suspens, que nous devons poser à l’Agence parce que les autres acteurs de la filière nucléaire n’y ont pas répondu.
Le conseil d’administration de l’ANDRA a reconnu que le projet Cigéo n’était pas mûr. On voit, là encore, un exemple des comportements irresponsables qu’a dénoncés hier un collègue UMP de la commission du développement durable, en parlant de ceux qui, il y a plusieurs dizaines d’années, ont développé une filière sans savoir ce que l’on ferait de ses déchets. Nous devons donc nous montrer à la hauteur du défi et trouver des réponses.
J’aimerais d’abord savoir comment l’ANDRA compte traduire une préoccupation exprimée aussi bien par l’ASN et l’IRSN que par la CNE et le débat public : la nécessité de se donner le temps d’expérimenter avant de prendre une décision. À la façon dont vous présentez les choses, on a l’impression que la décision est déjà prise : l’ANDRA va certes continuer à expérimenter et rendra compte de ses résultats au bout d’une dizaine d’années mais, de toute façon, Cigéo sera construit.
Vous avez rappelé vous-même que 1,5 milliard d’euros a déjà été consacré à la construction d’un laboratoire à Bure. Plutôt que de prendre maintenant la décision de réaliser un site d’enfouissement, ne vaudrait-il pas mieux effectuer des tests dans ce laboratoire et recueillir ainsi, en profitant d’une installation existante – même s’il faudrait probablement l’aménager et en changer le statut –, le maximum d’éléments pour un coût limité ?
Pourquoi vous signer dès aujourd’hui une sorte de chèque en blanc, alors que dans cinq à dix ans, selon votre calendrier – mais l’IRSN parlait plutôt de quinze ans –, le Parlement sera, de toute façon, amené à prendre une décision, comme il en a d’ailleurs toujours été de sa responsabilité en matière de déchets nucléaires, en se fondant sur les résultats de l’expérimentation ? J’ai le sentiment que la façon dont l’ANDRA traduit la préoccupation soulevée n’est pas complètement neutre.
Dès lors que nous ne sommes pas sûrs de réaliser le centre de stockage souterrain, il faut élaborer un plan B, envisager d’autres solutions. La première loi sur les déchets avait identifié trois pistes : la transmutation, le stockage en subsurface et l’enfouissement. Le président a eu raison de souligner que ce dernier constitue la solution de référence, mais il faut envisager l’hypothèse qu’il pourrait ne pas aboutir, par exemple en raison d’un conflit entre réversibilité et sûreté. Je trouve dommage que l’ANDRA ne profite pas du temps qui lui est laissé pour aller plus loin dans la recherche sur le stockage en subsurface. Dans le cas où cette solution s’avérerait finalement la seule réalisable, l’Agence serait ainsi bien mieux préparée qu’elle ne l’est aujourd’hui.
J’en viens à certaines questions posées dans le cadre du débat public. Qu’en est-il de la cohabitation, pendant un siècle et sur un même site, de deux installations nucléaires de base ? Tout ne se passera pas en profondeur : pour entreposer les déchets nucléaires, il est prévu, si j’ai bonne mémoire, de construire en surface des hangars de 300 mètres de côté et de 30 mètres de haut – hangars qu’il faudra d’ailleurs démanteler à la fin. Sur le plan logistique, le système est-il au point ? Au vu des éléments que l’on peut recueillir ici ou là, on peut en douter.
J’ai été frappé que l’IRSN ne souhaite pas voir stocker les déchets bitumineux dans Cigéo au cours des premières années d’exploitation. Lors de son audition par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), M. Duplessy, le président de la CNE2, a souligné le risque, a-t-il dit, « qu’une grosse fumée noire provienne du site de stockage Cigéo par les puits qui y auront été creusés. Un tel incident inquiéterait considérablement la population, même s’il est techniquement possible d’y faire face. » Il recommande d’éviter de stocker ensemble des déchets de différents types, ce qui pourrait poser des problèmes en cas d’incendie.
Je pensais, naïvement, que ce genre de question ne pouvait plus se poser, que l’on avait sérié et réglé les problèmes posés par le stockage de différents types de déchets. Or le rapport publié il y a deux semaines par l’ASN montre qu’un certain nombre de déchets entreposés à La Hague peuvent être considérés comme mal conditionnés. Si l’existence de divers modes de gestion des déchets n’a rien d’illogique, considérant la succession, au cours de l’histoire, de plusieurs générations de réacteurs et de différentes technologies, il importe d’en tenir compte pour assurer la sûreté des installations.
Cela m’amène naturellement à la question de l’inventaire. L’ASN a besoin de connaître ce qui sera placé dans le centre de stockage avant même de prendre une décision sur son autorisation ; pour votre part, vous dites espérer une décision de l’État sur ce sujet avant 2015. Or une loi sur la transition énergétique doit être bientôt adoptée, qui pourrait avoir des conséquences significatives sur cette question.
Auditionnés dans le cadre de la commission d’enquête, certains interlocuteurs d’EDF ou d’AREVA nous ont ainsi appris qu’il ne coûterait pas plus cher de stocker directement les combustibles dits « usés », sans passer par le cycle de retraitement et de fabrication du MOX. Du point de vue du coût, les deux options semblent donc équivalentes. En revanche, le coût ne serait pas le même pour Cigéo, puisque la surface des installations du centre devrait passer de 15 à 25 kilomètres carrés pour pouvoir stocker le combustible usé. C’est un changement d’échelle significatif. Dès lors, comment pouvez-vous estimer les coûts du projet en 2014 avant même de connaître l’inventaire ? Allez-vous chiffrer les différentes options possibles ?
J’ai été stupéfait que l’on ne puisse pas savoir, pendant le débat public, comment seront acheminés vers le futur centre les centaines de milliers de colis qu’il doit accueillir. Seront-ils transportés par route ou par rail ? Je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance en détail des informations communiquées hier par l’ANDRA, mais j’ai cru comprendre que Cigéo serait raccordé au réseau ferré. Cela signifie-t-il que tous les déchets arriveront par le rail ?
En ce qui concerne la réversibilité, j’ai bien noté que le communiqué de l’ANDRA mentionne explicitement la possibilité de récupérer les colis de déchets. Cela lève toute ambiguïté. Certains propos laissaient, en effet, entendre que réversibilité et récupérabilité n’étaient pas équivalentes.
S’agissant de la gouvernance, le débat public a fait apparaître la difficulté de débattre de façon sereine. Je rappelle, pour éviter toute confusion, ce qu’a toujours affirmé ma formation politique : nous tenions à ce que le débat public puisse se tenir dans de bonnes conditions, parce qu’il relève du fonctionnement normal de la démocratie. Sur ce point, nous étions en désaccord avec d’autres personnes qui partagent pourtant des convictions communes avec nous.
Quoi qu’il en soit, l’ASN a souligné que de gros progrès devaient être accomplis en matière de gouvernance et qu’il fallait se montrer exemplaire en termes de transparence. Or, sur cet aspect, les décisions du conseil d’administration de l’ANDRA me semblent un peu légères. On ne peut pas parler d’un saut qualitatif majeur de nature, sinon à mettre tout le monde d’accord – ce qui ne semble pas un objectif atteignable –, du moins à mettre fin, chez les uns, au sentiment que l’on cache tout, et, chez les autres, à l’idée que tout ce que l’on pourra proposer se heurtera à la même opposition.
À propos du calendrier, si je comprends bien, votre proposition revient à modifier la loi. Cela paraît d’ailleurs logique, et l’ASN ne dit pas autre chose. Concrètement, quelle forme prendrait cette modification ?
En ce qui concerne les coûts, vous insistez sur la difficulté à évaluer, sur cent ans, l’ensemble des postes. C’est vrai, mais cela s’explique aisément : l’enfouissement des déchets nucléaires, contrairement à l’exploitation d’une autoroute, par exemple, ne génère aucun revenu ; ce n’est pas une activité rentable. Il est donc nécessaire d’estimer ce qu’elle va coûter pendant toute la durée de son fonctionnement, et de ne pas se tromper, faute de quoi les générations futures devront payer à notre place – ou plus exactement à la place de notre génération, des précédentes et de toutes celles qui profiteront des centrales – pour des déchets que nous aurons produits.
Vous affirmez que vous ne connaissez pas ce coût, mais peut-être pouvez-vous nous dire, à quelques semaines de l’échéance, de quelle estimation il est le plus proche : 15 milliards d’euros, comme l’affirme EDF, ou 36 milliards ? Pour calculer le coût du kilowattheure, nous avons, en effet, besoin d’évaluer correctement le montant des provisions destinées à financer la gestion des déchets radioactifs.
M. le président François Brottes. Vous parlez du coût du kilowattheure sur cent ans.
M. le rapporteur. Non, je parle du kilowattheure que nous payons aujourd’hui, correspondant aux déchets que nous produisons.
M. le président François Brottes. Il est vrai que cette question fait débat entre nous. L’investissement et l’exploitation sont deux choses différentes. Il faut distinguer les déchets d’aujourd’hui de ceux produits demain, dans l’hypothèse où la filière continuerait de fonctionner. Il est difficilement imaginable de faire payer ces derniers par la génération actuelle.
M. le rapporteur. Sur ce point, je suis d’accord. Quoi qu’il en soit, nous devons au moins contribuer à hauteur du volume de déchets que nous produisons. Il faut donc que les provisions soient suffisantes, ce qui exige une évaluation juste du coût.
M. Michel Sordi. Merci, madame, pour votre intervention, que j’ai trouvée très claire. M. Baupin se préoccupe de l’héritage que nous laisserons à nos enfants, mais je suis convaincu que l’arrêt de l’industrie nucléaire entraînerait la relance des centrales thermiques, émettrices de CO2, et aggraverait donc le réchauffement climatique. Or, contribuer à la montée des températures, ce n’est pas laisser un meilleur héritage.
Personnellement, je fais confiance à nos entrepreneurs, à nos ingénieurs et aux responsables tels que vous. Si les colis sont transportés par train, je n’ai pas besoin de savoir combien les convois comporteront de wagons, ni s’ils seront tractés par une locomotive électrique ou diesel. Je ne partage pas la tendance à la suspicion manifestée par certains.
Pouvez-vous préciser la nature des déchets à haute activité ou à moyenne activité qui seront stockés dans le centre ? Je ne dispose pas, en effet, des connaissances techniques accumulées par le président et le rapporteur.
Au sujet du scellement des cellules, que doit-on entendre par « le plus rapidement possible » ? Faut-il qu’il intervienne dans six mois, cinq ans, dix ans ?
Quelles seront les retombées financières du centre sur les collectivités locales –communes, communauté de communes, départements, région ?
J’ai cru comprendre que les réacteurs de la quatrième génération permettraient de réutiliser les déchets – qui ne seraient donc plus des déchets. Est-ce vraiment le cas ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Que le conseil d’administration de l’ANDRA reconnaisse que le projet n’est pas mûr ne signifie pas que l’on ne sait pas où on va. Quand ce même conseil d’administration décide de poursuivre le projet, il prend la seule décision qu’il peut prendre à son niveau, c’est-à-dire celle de poursuivre les études pour préparer la demande d’autorisation de création. Dans la délibération, nous avons veillé à rappeler systématiquement que toute nouvelle étape du projet – notamment la décision de le construire – était soumise à l’obtention des autorisations nécessaires.
Il en est de même s’agissant de notre capacité à proposer une démonstration complète de sûreté en 2017 : nous savons où nous allons. L’ASN et l’IRSN admettent eux-mêmes – la dernière fois, c’était dans un courrier de novembre 2013 – que nous sommes sur la bonne voie, que les questions sont bien identifiées et que nous sommes en train de les résoudre. De son côté, la CNE2, dans son rapport de 2013, affirme également que notre projet est industriellement crédible. Certes, il n’est pas encore mûr, mais nous poursuivons notre objectif.
Plusieurs raisons empêchent d’utiliser le laboratoire actuel comme une installation pilote. La première est politique : lorsque les départements ont accepté d’accueillir ce laboratoire souterrain, à la suite d’une démarche de consultation et de concertation menée par Christian Bataille, l’engagement a été pris de ne jamais y placer de déchets radioactifs. Il convient donc de respecter la parole donnée.
Cet engagement était si fort qu’il a conduit à dimensionner en conséquence le laboratoire de Bure : les puits de descente sont en particulier bien trop étroits pour que l’on puisse y transporter des colis de déchets.
En outre, une phase industrielle pilote en vraie grandeur ne peut être lancée qu’en ayant construit toutes les installations nécessaires, lesquelles doivent avoir le statut d’installations nucléaires de base. C’est donc, de toute façon, un nouvel investissement.
Quitte à réaliser ce nouvel investissement, autant faire en sorte qu’il soit utilisable à long terme. Et plutôt que de devoir reconstruire une nouvelle installation dans le cas où les tests en vraie grandeur s’avéreraient concluants, mieux vaut prévoir la possibilité d’en prolonger l’usage. À l’heure où l’État est à la recherche de 50 milliards d’euros d’économies, cela permettrait de réduire au strict nécessaire l’investissement initial, correspondant à la phase industrielle pilote.
M. le rapporteur. Dans votre esprit, qui prendrait la décision de poursuivre l’exploitation au-delà de la phase de test ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Plusieurs décisions doivent être prises, à commencer par l’autorisation de construire une INB, avant même d’envisager sa mise en service.
M. le rapporteur. La petite INB, vous voulez dire ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Non. Sur ce point, nous avons eu de nombreux échanges avec l’ASN. Avant de réaliser l’investissement initial à Cigéo, et donc de lancer la phase industrielle pilote, nous comptons déposer une demande d’autorisation de création pour l’ensemble de l’inventaire. Cela nous oblige – et l’ASN y tient – à faire une démonstration de sûreté sur ce même ensemble. Même après l’obtention de cette autorisation, la procédure réglementaire pour la création et la mise en service d’INB prévoit de nombreuses autorisations, pour la plupart du niveau de l’autorité de sûreté. Rien n’empêche, d’ailleurs, le Gouvernement ou le Parlement de renforcer ces niveaux de décision avant de passer en phase d’exploitation courante. En tout cas, cela ne relève pas de l’ANDRA.
La demande d’autorisation concernera donc l’ensemble de l’inventaire, mais les tests porteront sur un échantillon représentatif.
Vous avez évoqué les autres modes possibles de gestion des déchets. L’ANDRA n’a rien contre le stockage en subsurface, au contraire : c’est la solution de référence pour les déchets de faible activité à vie longue, qui sont principalement des déchets historiques – déchets dits de « graphite » ou contenant du radium. L’Agence poursuit donc sa recherche et développement sur ce type de stockage. Toutefois, l’Autorité de sûreté nucléaire l’a clairement dit dans un avis de 2005, et la loi l’a d’ailleurs confirmé : on ne peut pas stocker en surface et subsurface des déchets aussi dangereux et à durée de vie aussi longue que les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Vu la nature des risques, il faut les placer à 500 mètres de profondeur. C’est d’ailleurs la solution retenue au niveau international, ainsi que par l’Union européenne dans une directive.
Il est vrai que le centre Cigéo se décompose en deux grands blocs, dont une installation nucléaire de surface permettant d’accueillir les déchets, de les contrôler, de les faire passer de leur conteneur de transport à un conteneur de stockage, puis de les glisser dans une hotte qui sera transportée au fond. En moyenne, les déchets ne resteront pas plus d’une quinzaine de jours dans cette « salle d’attente ».
M. Thibaud Labalette, directeur des programmes de l’ANDRA. La conception de Cigéo s’attache à séparer physiquement la partie en exploitation nucléaire – qu’elle soit en surface ou en profondeur – de la partie souterraine en chantier : les ventilations sont indépendantes, de même que les flux de personnes et de matériaux. Il n’y aura pas de connexion entre les deux.
Concernant l’installation nucléaire de surface, un important travail d’optimisation est en cours, si bien que la hauteur des bâtiments serait plutôt de 15 à 20 mètres. Ils seront semi-enterrés, afin de limiter au maximum l’impact visuel, et leur taille sera étroitement liée au flux de colis que l’on nous demandera de prendre en charge, flux que les producteurs s’efforcent de lisser. Il sera tenu compte du résultat de ce travail d’optimisation dans le chiffrage remis à l’été 2014.
Mme Marie-Claude Dupuis. Sans parler de flux tendu, l’entreposage des colis de déchets en surface ne durera que le temps de les vérifier et de modifier leur conditionnement. Il n’a pas pour but, par exemple, de permettre le refroidissement des déchets vitrifiés.
Les déchets bitumineux ont été l’objet de toute l’attention de nos évaluateurs, et ces derniers seront très vigilants sur la démonstration de sûreté qui sera faite au sujet de leur stockage. Nos recherches montrent qu’il est tout à fait envisageable de stocker de tels déchets en profondeur mais, pour compléter notre demande d’autorisation de création, nous devrons obtenir des résultats très convaincants aux essais de réaction au feu. En ce moment même, en surface, des tests ont lieu en ce sens sur des matrices ne contenant aucun déchet nucléaire, mais dont la structure est comparable aux colis d’enrobés bitumineux – dont je rappelle qu’ils sont également constitués de béton.
M. Michel Sordi. Pouvez-vous préciser la nature de ces enrobés ?
M. Thibaud Labalette. Il s’agit de déchets historiques, produits pour l’essentiel sur le site de Marcoule. Les déchets radioactifs sont conditionnés dans des matrices solides, pour éviter toute dispersion. À une époque, on a utilisé du bitume, le même que celui des routes. Or ce type de conditionnement pose, en termes de stockage, des problèmes spécifiques liés à son comportement en cas d’incendie. Dans l’hypothèse où les déchets bitumineux feraient partie des déchets stockés à Cigéo, ils seraient donc insérés dans des boîtes en béton, elles-mêmes transportées dans des hottes blindées, afin d’assurer une protection contre les agressions externes. Tel est l’objet des essais en cours.
Mme Marie-Claude Dupuis. J’en profite pour rappeler qu’une éventuelle autorisation de construction du centre de stockage n’équivaudrait pas à un chèque en blanc ni ne permettrait de faire descendre toutes les sortes de colis. En même temps que sa demande d’autorisation, l’ANDRA remettra des spécifications d’acceptation des colis, détaillant les conditions dans lesquelles leur stockage pourra être envisagé. Ainsi, même si l’inventaire prévoit d’accueillir des déchets bitumineux, leur stockage sera soumis à des objectifs spécifiques de sûreté et de sécurité. C’est une nouvelle illustration des différents niveaux de décision applicables à Cigéo.
J’en viens aux combustibles usés et à la flexibilité exigée pour le centre de stockage. Même si nous avons besoin de connaître l’inventaire de référence pour finaliser notre demande d’autorisation de création, nous comptons poursuivre les études sur les combustibles usés, d’autant que la question de leur stockage ne se posera pas avant 2080. C’est d’ailleurs également vrai des déchets vitrifiés : ces déchets, issus du retraitement par AREVA, à la Hague, du combustible usé après séparation des matières valorisables – uranium et plutonium –, et fondus dans des matrices de verre conditionnées dans des colis en inox, sont en effet bien trop chauds pour pouvoir être déposés en profondeur. Certes, les qualités propres de l’argile rendent possible un confinement à long terme, mais à condition de ne pas la « cuire ». Il convient donc de laisser les colis refroidir pendant au moins soixante ans, voire quatre-vingts ans : plus longtemps on les laisse refroidir en surface, moins on a besoin de les espacer en profondeur, et plus on économise de l’emprise de stockage.
Quant aux combustibles usés, ils sont encore plus chauds. Dès lors, même si on décidait d’arrêter leur retraitement et donc de les considérer comme des déchets, la question de leur stockage en profondeur ne se poserait pas avant 2080, sachant que les déchets produits en cinquante ans d’histoire nucléaire nous donnent déjà du travail pour plusieurs dizaines d’années. Vous avez donc le temps de prendre des décisions en matière de politique énergétique, et nous avons le temps de les appliquer.
En ce qui concerne le transport des colis, je confirme la décision du conseil d’administration de raccorder le site prévu pour Cigéo au réseau ferroviaire national, en réponse à une demande très forte des acteurs locaux. La direction générale de l’énergie et du climat a d’ailleurs souhaité que l’ANDRA soit maître d’ouvrage de la ligne de raccordement privée. Nous allons donc entamer les études et demander les autorisations nécessaires. De leur côté, EDF, AREVA et le CEA sont d’accord pour transporter par voie ferrée les colis de déchets provenant de leurs sites – à l’exception, peut-être, de ceux du site plus proche de Valduc, mais ils représentent moins de 1 % de l’inventaire. Nous sommes, par ailleurs, convenus d’élaborer un schéma directeur des transports au niveau national, sur lequel nous saisirons le HCTISN.
M. le président François Brottes. S’agissant du MOX, dont le transport fait l’objet de plusieurs convois par semaine, la route a été préférée au rail.
M. Thibaud Labalette. Ces transports très particuliers sont assurés sous la responsabilité d’AREVA. Mais une bonne partie des combustibles usés transportés depuis les centrales nucléaires jusqu’au site de La Hague, et qui représentent des masses importantes, sont acheminés par voie ferrée.
S’agissant de Cigéo, en phase d’exploitation normale, le transfert des colis depuis les sites d’entreposage de Marcoule, Cadarache et la Hague représenterait une trentaine de trains par an, comprenant une dizaine de wagons. Chaque wagon contient un emballage de transport qui peut contenir plusieurs colis.
M. le président François Brottes. Qu’en est-il du risque de rupture de charge ?
M. Thibaud Labalette. Il peut y en avoir au niveau de l’expédition. Par exemple, la gare de Valognes se situe à une vingtaine de kilomètres de La Hague. Sur cette distance, AREVA doit donc transférer les déchets par camion. En revanche, il n’y aurait plus de rupture de charge jusqu’à Cigéo. Le raccordement ferroviaire du site est d’ailleurs un des points ayant recueilli le plus grand consensus pendant le débat public.
Mme Marie-Claude Dupuis. S’agissant de la gouvernance, j’ai voulu souligner le travail de concertation que nous avons mené avant même le début du débat public, mais cela ne signifie pas qu’il ne reste pas de progrès à accomplir en ce domaine. Nous allons continuer à y réfléchir, mais nous avons d’ores et déjà pris quelques décisions d’ordre pratique.
Nous allons ainsi contribuer au développement de l’expertise pluraliste. À cet égard, je tiens à souligner le travail utile effectué par l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI), l’IRSN et le CLIS de Bure pour promouvoir un dialogue technique autour des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Je suis surprise par les propos du responsable de l’ASN, car même un membre du CLIS opposé au projet comme M. Marie a dit qu’il ne reprochait pas à l’ANDRA son manque de transparence. Nous donnons toutes les informations. Ce que l’on attend de nous, c’est plutôt une plus grande transparence sur les points délicats. Nous avons peut-être tendance à être trop « bons élèves », et à vouloir ne présenter notre copie que lorsque nous sommes sûrs de pouvoir répondre à toutes les questions, quand tout est ficelé. Nous ne devons pas avoir peur de mettre sur la table les questions faisant l’objet d’une discussion avec l’ASN, la CNE2 et l’IRSN. Nous avons ainsi décidé de transmettre au CLIS la liste des sujets techniques sur lesquels on nous a demandé d’améliorer nos propositions, afin qu’il puisse, le cas échéant, commander des expertises.
En ce qui concerne d’éventuelles modifications de la loi, la délibération du conseil d’administration ouvre la voie à plusieurs scénarios : dans le premier, le Gouvernement et le Parlement considèrent qu’ils disposent d’ores et déjà de toute la matière pour inscrire dans la loi les nouvelles modalités d’élaboration du projet, voire les conditions de réversibilité ; dans le deuxième, ils attendent la remise du premier dossier en 2015 ; dans le troisième, ils préfèrent attendre la demande finalisée d’autorisation de création, en 2017. Les trois options sont possibles. Ce qui est clair, c’est que l’autorisation de création ne peut être donnée avant le vote d’une loi sur les conditions de réversibilité. Par ailleurs, le démarrage en 2025 de l’installation industrielle pilote suppose que les conditions de réversibilité aient été définies avant 2017.
M. le président François Brottes. C’est de principes que vous avez besoin, pas de prescriptions techniques. Il n’appartient pas au Parlement de définir les modalités techniques de la réversibilité.
Mme Marie-Claude Dupuis. Non, en effet. Le conseil d’administration de l’ANDRA propose, pour sa part, des définitions pour les notions de réversibilité et de récupérabilité, et préconise une approche par étapes en lien avec le plan directeur pour l’exploitation du stockage, révisable régulièrement, notamment après la phase industrielle pilote. Nous avons souhaité tendre une perche en suggérant le jalonnement du projet et l’adoption d’un certain processus décisionnel, mais nous n’avons pas osé aller plus loin, car il appartient aux responsables politiques de décider.
J’en viens au coût du projet. Nous sommes chargés de remettre à la DGEC un chiffrage global portant sur l’ensemble de l’inventaire prévisionnel et pour toute la durée de vie du stockage. EDF, AREVA et le CEA s’en serviront pour mettre à jour leurs provisions en fonction des déchets déjà produits. C’est pourquoi tous les chiffres qui ont pu être cités dans la presse doivent être mis en regard d’un certain type d’inventaire. Ainsi, le chiffre de 15 milliards avait été calculé en prenant pour hypothèse une durée de vie des réacteurs de quarante ans, et de cinquante ans pour l’estimation de 35 milliards effectuée en 2010.
Notre chiffrage dépend donc de certaines hypothèses telles que le volume des déchets et la durée de vie des réacteurs. Il sera fondé sur l’inventaire conforme à la loi de 2006, et ne prendra donc en compte que les déchets vitrifiés et les déchets de moyenne activité à vie longue, pas les combustibles usés. Néanmoins, l’État nous a demandé de mettre à jour en 2015 notre rapport sur le stockage de ces derniers dans Cigéo, dans l’hypothèse où ils deviendraient des déchets. De même, les provisions constituées par EDF tiennent compte du coût du stockage des MOX usés dans le cas où ne seraient pas développés les réacteurs de quatrième génération. La Cour des comptes a d’ailleurs salué la prudence d’une telle démarche.
Au moment du débat sur le coût global du projet, la Cour des comptes l’avait estimé à 1 ou 2 % du coût de la production d’électricité. Je pense que nous restons dans cet ordre de grandeur.
M. le rapporteur. Pour une estimation que vous allez rendre dans quelques semaines, elle n’est pas d’une précision redoutable : on va du simple au double !
Mme Marie-Claude Dupuis. Je le répète, les hypothèses techniques sont en train d’être arrêtées, et les discussions se poursuivent. Nous avons transmis tous les éléments à la Cour des comptes et au ministère, mais l’ANDRA n’est pas habilitée à rendre ces chiffres publics tant qu’ils ne seront pas finalisés.
M. le président François Brottes. Je ne comprends pas comment vous pouvez refuser de donner à la commission d’enquête ce que vous avez donné à la Cour des comptes.
Mme Marie-Claude Dupuis. Je peux le faire, mais pas en public.
M. le président François Brottes. Donc, vous nous transmettrez ces éléments.
Mme Marie-Claude Dupuis. Nous verrons avec le ministère. Mais j’ai cru comprendre que la Cour des comptes allait vous transmettre son rapport.
M. le rapporteur. Nous sommes une commission d’enquête parlementaire, pas une chambre d’enregistrement des travaux de la Cour des comptes.
Mme Marie-Claude Dupuis. De toute façon, je n’ai pas ce chiffrage : il sera finalisé en juin.
M. le président François Brottes. Vous ne pouvez pas, avec les conditions de confidentialité requises, donner à la commission d’enquête moins que ce que vous donnez à la Cour des comptes. Nous sommes les représentants du peuple et nous avons un mandat pour mener une enquête.
Mme Marie-Claude Dupuis. Je vous propose d’examiner cette question avec le ministère. Nous sommes un établissement sous tutelle.
M. le président François Brottes. Mais nous, nous ne sommes soumis à aucune tutelle, si ce n’est celle du peuple !
Mme Marie-Claude Dupuis. Et moi, je dois respecter la loi.
Du reste, je le répète, je ne dispose pas dans mon bureau du nouveau chiffrage de Cigéo. Je ne le connais pas. Les représentants de la Cour des comptes sont repartis avec les documents constituant la base de notre travail, à partir desquels ils vont effectuer leur propre analyse. Il s’agit de milliers de lignes de calcul !
M. le président François Brottes. Vous lui avez donc donné les éléments nécessaires pour qu’elle puisse proposer un chiffre à partir de sa propre expertise. C’est autre chose.
Vous avez, par ailleurs, affirmé au rapporteur que ce coût ne pouvait pas dépasser 2 % du coût total de la production d’électricité.
Mme Marie-Claude Dupuis. Ce n’est qu’un ordre de grandeur, le calcul n’est pas fait.
M. le président François Brottes. Mais on comprend qu’il s’agit de la limite haute.
Mme Marie-Claude Dupuis. Je ne sais pas. On ne peut pas l’affirmer avant d’avoir effectué le chiffrage.
D’ailleurs, ce n’est même pas à l’ANDRA d’effectuer ce calcul. Ce que nous élaborons, c’est un chiffrage sur cent ans avec des hypothèses d’inventaire de déchets. À partir de ces éléments – investissement initial, coûts fixes, coûts variables –, EDF, AREVA et le CEA vont se répartir les coûts fixes, appliquer leurs hypothèses comptables et de flux de déchets, et traduire tout cela de façon à mettre à jour le calcul de leurs provisions.
M. le rapporteur. Il est, en effet, important de préciser que cette estimation – 1 ou 2 % du coût de l’électricité, ce qui peut paraître relativement peu – dépend de certains taux d’actualisation pouvant faire l’objet de discussions. Sommes-nous d’accord sur ce point ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Une telle estimation est soumise à de nombreuses hypothèses, et toutes ne sont pas posées par l’ANDRA.
M. le président François Brottes. Parmi elles, il y a la durée de vie des réacteurs. On ne peut, en effet, anticiper les coûts de déchets non encore produits.
Pour autant, notre travail d’évaluation des coûts de la filière nucléaire se heurte inévitablement à la question du traitement des déchets. Or notre temps est limité par le règlement de l’Assemblée nationale. Allons-nous devoir enfermer les magistrats de la Cour des comptes dans le laboratoire de Bure jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de nous donner un chiffre ?
Mme Marie-Claude Dupuis. Il faudra sans doute, à l’avenir, mettre à jour régulièrement toutes ces données. La loi demande à EDF, à AREVA et au CEA de provisionner immédiatement dans leurs comptes les sommes nécessaires pour la gestion de leurs déchets déjà produits pendant la durée de leur stockage. C’est normal, et c’est une bonne précaution. Mais le chiffrage sur cent ans comprend tellement d’incertitudes qu’il faudra le réviser régulièrement. Nous en avons le temps.
M. le rapporteur. On ne sait rien de ce que seront devenus, dans cent ans, EDF, AREVA ou le CEA, ni de leurs capacités à financer ce projet. On ne sait même pas ce que sera, dans un mois, le sort d’une entreprise comme Alstom ! De même, personne n’est capable de déterminer quel sera le mix énergétique dans un siècle. Il est donc important, dès aujourd’hui, d’estimer correctement les provisions nécessaires, car c’est aujourd’hui que nous produisons ces déchets. Votre travail est sans doute difficile, mais il est très important d’un point de vue éthique. Pour s’assurer de la solidité du dossier, nous devons éviter de nous fonder sur des éléments peu prévisibles.
Mme Marie-Claude Dupuis. Il faut, en effet, bien évaluer le coût complet de façon à s’assurer que l’argent nécessaire sera disponible le moment venu. Je dis simplement qu’il faut mettre à jour régulièrement ce résultat – peut-être plus régulièrement qu’on ne l’a fait jusqu’à présent –, à mesure que nous allons progresser dans nos études. Le dernier chiffrage officiel date de 2005, le prochain est attendu pour 2014 ; une fréquence plus élevée permettrait de réduire la pression et de rendre plus douces les corrections à apporter.
Il faut plusieurs années, monsieur Sordi, pour construire les ouvrages en béton destinés à sceller les alvéoles. C’est un chantier lourd.
S’agissant des retombées pour le territoire, les producteurs, EDF, AREVA et le CEA, versent à des groupements d’intérêt public, via une taxe, 30 millions d’euros par an et par département pour l’accompagnement économique. Cet argent est réparti sur le territoire, sous le contrôle du président du conseil général, en fonction de projets et de décisions d’investissement.
En ce qui concerne la génération IV et la possibilité de réutiliser les matières nucléaires, je me dois d’être parfaitement claire. Les travaux menés par le CEA sur la séparation-transmutation ont fait l’objet d’un bilan complet public, dont vous avez probablement eu connaissance. Mais tout ce que l’on peut entendre au sujet de l’usage de cette technologie pour réduire le volume de déchets à stocker en profondeur ne concerne que les déchets du futur, ceux qui seraient produits par le parc de quatrième génération, dans la mesure où sa création serait autorisée. En effet, le travail effectué par le CEA dans le cadre du projet ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) a pour objectif de séparer et transmuter les radioéléments pendant la fabrication même de l’électricité. En aucun cas, ces travaux ne peuvent avoir de conséquences sur le projet Cigéo tel que nous l’élaborons. Il ne faut pas imaginer que l’on pourra extraire les déchets vitrifiés entreposés à la Hague de leurs colis en inox, les fondre à nouveau et les réutiliser.
Je profite toutefois de votre question pour insister sur un point : s’il faut, en effet, travailler sur les déchets du futur, il convient également d’accentuer les efforts de recherche et développement sur les déchets du présent. À cet égard, je salue le projet lancé par AREVA à partir de technologies du CEA et soutenu très fortement par l’ANDRA dans le cadre des investissements d’avenir, pour lesquels le Parlement a bien voulu nous donner une dotation de 75 millions d’euros. Il permet de travailler sur un prototype de traitement et de fusion de déchets de moyenne activité à vie longue – ceux de Melox – afin d’en réduire les volumes, permettant ainsi à tout le monde de faire des économies.
De même, l’ANDRA a proposé au Gouvernement un appel à projet, en lien avec l’Agence nationale de recherche, pour stimuler la gestion optimisée des déchets de démantèlement. En matière de recherche et développement sur les déchets, tous les efforts ne doivent pas porter sur le centre de stockage et sur les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Il faut aussi s’occuper des déchets d’exploitation ou de démantèlement – ces derniers sont peu dangereux, mais représentent de très gros volumes. Pour l’instant, la mission confiée à l’ANDRA ne concerne que le stockage, mais je pense que nous sommes les mieux placés pour stimuler les recherches sur ces solutions de fin de cycle.
M. le président François Brottes. Votre poste est peut-être exposé, mais il semble vous passionner. Je vous remercie pour vos réponses – mais moins pour vos non-réponses. Vous nous avez donné des explications sur ces dernières ; nous allons donc nous rapprocher de la Cour des comptes afin d’obtenir, avant la fin de cette commission d’enquête, une préfiguration du chiffrage.
M. Michel Sordi. On vous a tout de même opposé un article de loi, monsieur le président !
M. le président François Brottes. Mon cher collègue, quels que soient les textes en vigueur, on ne peut pas donner à une commission d’enquête moins d’informations qu’à une autre institution.
Audition de MM. Jacques-François Lethu (KPMG), Alain Pons et Patrick Suissa (Deloitte), commissaires aux comptes d’EDF
(Séance du 7 mai 2014)
M. le président François Brottes. Nous accueillons à présent MM. Jacques-François Lethu (KPMG), Alain Pons et Patrick Suissa (Deloitte), commissaires aux comptes d’EDF. Votre audition, messieurs, se déroule à huis clos, ce qui signifie qu’elle ne sera pas retransmise ; en revanche, elle fera l’objet d’un compte rendu, nécessaire au travail du rapporteur, mais qui ne sera pas publié. Tout ce que vous allez dire sera donc transcrit.
Rappelons, s’il en est besoin, qu’EDF est une société majeure du CAC 40, dont la capitalisation s’élève à 50 milliards d’euros environ. C’est aussi une entreprise particulière, dont une grande part de l’activité est régulée par l’État dans le cadre de directives européennes et dont le socle industriel est constitué pour l’essentiel, du moins en ce qui concerne la production, du nucléaire, secteur dans lequel EDF est en situation de monopole. De ce fait, et en raison de la nature même de l’activité nucléaire, l’entreprise abrite dans son bilan des charges futures qui atteignent un niveau insolite par rapport à celles des autres sociétés de la place. Ces charges futures font débat : sont-elles bien évaluées ou non, sont-elles suffisantes ? C’est sur leur montant précis que nous vous interrogerons, plutôt que sur ce dernier point qui n’est évidemment pas de votre ressort.
Cette audition ne vise pas à vous extorquer des secrets commerciaux ou financiers, d’autant qu’EDF est aussi très exposée à l’export, notamment dans les métiers qui nous occupent. Ce que nous cherchons, c’est à comprendre certains éléments des comptes d’EDF, Réseau de transport d’électricité (RTE) compris puisque cette entreprise est concernée par un certain nombre d’actifs liés à l’exploitation nucléaire. L’objet de notre commission d’enquête est de déterminer quels sont les vrais coûts du nucléaire ; c’est donc sur ce sujet que nous allons vous interroger.
Une question subsidiaire : on pourrait se demander, notamment à la lumière de l’audition du président Proglio hier, s’il ne serait pas judicieux de sortir EDF de la cotation pendant la durée du débat sur la place du nucléaire dans la transition énergétique, tant celui-ci engage d’hypothèses qui peuvent être perturbantes pour l’entreprise. C’est genre de problème auquel EDF est confrontée depuis son changement de statut. Quel est votre point de vue sur cette question technique d’ordre financier ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Alain Pons, Patrick Suissa et Jacques-François Lethu prêtent serment)
M. Alain Pons (Deloitte), commissaire aux comptes d’EDF. Au nom du collège des commissaires aux comptes, formé des cabinets Deloitte et KPMG et ici représenté par les trois signataires des rapports EDF, je vous présenterai brièvement notre mission légale et nos principales responsabilités.
Notre mission, définie par le législateur, consiste à délivrer au public ainsi qu’aux principales parties prenantes des états financiers une assurance de conformité de ces états, sur la base de diligences très réglementées, qui ont vocation à donner une assurance raisonnable, mais non absolue, que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative. Les états financiers incluent les comptes, mais aussi des notes annexes riches et dignes d’intérêt, ainsi qu’un rapport de gestion. C’est sur cet ensemble de documents que portent nos travaux.
Les états financiers, arrêtés par la direction, font également l’objet d’un arrêté des organes de gouvernance de l’entreprise. Ces comptes, pris dans leur ensemble, doivent traduire fidèlement les opérations de la période concernée, le patrimoine et la situation financière de l’entreprise. Ils sont établis en fonction des normes comptables en vigueur, qui sont précises et auxquelles l’on ne saurait déroger ; nous nous en assurons. Certains éléments s’expliquent par l’application de ces normes.
Nous devons également vérifier que les notes annexes donnent des informations suffisamment complètes, claires et pertinentes pour faciliter la compréhension des comptes par les lecteurs. Nos diligences consistent, au moyen notamment de sondages, de vérifications de conformité, d’appréciation des principales estimations significatives réalisées par la direction de l’entité, à nous assurer que ces estimations ne révèlent pas d’erreur, d’anomalie ou d’omission qui affecteraient substantiellement les comptes dans leur ensemble.
Afin d’exercer cette mission légale, nous faisons usage de notre jugement professionnel, en nous appuyant, le cas échéant, sur des documents produits par l’entité, sur des rapports d’experts, sur des entretiens, sur notre connaissance du secteur d’activité concerné, bref sur tout élément ou information qui nous semble pouvoir éclairer ce jugement.
Il nous est interdit de nous immiscer dans la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire d’accomplir, directement ou indirectement, des actes de gestion, mais aussi d’exprimer des jugements sur la conduite de la gestion de l’entreprise.
À l’issue de notre mission, trois cas de figure sont envisageables. Dans le premier cas, nous sommes en mesure de certifier que les comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à la fin de l’exercice. Nous pouvons alors formuler dans notre rapport toute observation utile destinée à appeler l’attention du lecteur sur une information fournie dans l’annexe et susceptible d’éclairer un point essentiel à l’élaboration des comptes. Dans le second cas, nous certifions avec réserves, si notre vision diffère de celle du management sur tel ou tel point. Enfin, nous pouvons refuser de certifier les comptes si nous estimons que l’image qui est donnée de la situation financière d’une entité n’est pas pertinente vis-à-vis du public. Ce cas est extrêmement rare. Une certification avec réserves ou un refus de certification doit être motivé dans notre rapport.
Ce rapport est régi par des normes auxquelles nous ne pouvons déroger. Il porte sur l’état financier arrêté par la direction et les organes de gouvernance et comprend les comptes, les annexes et le rapport de gestion. Je me permets d’insister à nouveau sur l’importance des notes annexes pour informer le public et éclairer son jugement.
S’agissant du cas précis de la société EDF, nous exerçons notre mandat de façon collégiale, conformément à la loi. Ce mandat est de six ans ; nous avons été nommés par l’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2011. Nous avons sur les comptes une responsabilité conjointe et solidaire. Nous exerçons également nos missions annexes, prévues par la loi.
J’en viens à un point essentiel à nos yeux, et qui vous permettra d’apprécier les obligations qui s’imposent à nous, y compris dans le cadre de cette audition : le strict respect du secret professionnel. Aux termes de l’article L. 822-15 du code de commerce, nous sommes tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont nous avons pu avoir connaissance à raison de nos fonctions. Ce secret professionnel est impératif et absolu ; il ne peut être levé que dans les cas où la loi l’impose ou l’autorise expressément, cas dont une audition par la commission d’enquête ne fait pas partie. Nous sommes donc tenus de déposer sous réserve des dispositions de l’article 226-13 et 226-14 du code pénal. Le non-respect du secret professionnel engage notre responsabilité civile, pénale et disciplinaire.
Naturellement, nous sommes autorisés et disposés à répondre sur tous les éléments qui ne sont pas couverts par le secret professionnel ; nous y sommes même tenus. Nous pouvons donc vous fournir toute explication relative à nos rapports ainsi que les comptes joints à ces rapports, et vous apporter l’éclairage des professionnels que nous sommes, ce que nous ferons très volontiers, autant qu’il nous est possible.
Je comprends que l’audition est enregistrée afin de faciliter la rédaction du compte rendu ; nous remercions les membres de la commission d’enquête et les autres personnes présentes de garantir la confidentialité des propos échangés.
M. le président François Brottes. Merci de nous avoir rappelé à quoi servent les commissaires aux comptes, ce dont nous avions déjà une petite idée.
Combien de temps consacrez-vous chaque année à EDF, si ce n’est pas un secret d’État ?
M. Patrick Suissa (Deloitte), commissaire aux comptes d’EDF. Ce n’est pas un secret d’État. Il y a des personnes spécifiquement dédiées à cette tâche.
M. le président François Brottes. Combien d’heures de travail cela représente-t-il ?
M. Patrick Suissa. On peut connaître le chiffre par cabinet. Nous y consacrons, au regard de nos normes professionnelles, le temps nécessaire pour pouvoir émettre une opinion.
M. le président François Brottes. Je vous ai posé une question. Combien de temps cela représente-t-il ? Deux jours, un mois ?
M. Patrick Suissa. Pour notre cabinet, 36 000 heures.
M. Jacques-François Lethu (KPMG), commissaire aux comptes d’EDF. L’ordre de grandeur est le même chez nous. À titre personnel, j’y passe plusieurs centaines d’heures par an.
M. Alain Pons. Notre hésitation ne résultait pas d’une quelconque volonté de secret, mais de la nécessité de tenir compte des filiales étrangères.
M. le président François Brottes. Il importe que nous nous fassions une idée du volume horaire que ce travail implique, afin d’en apprécier le sérieux.
M. Alain Pons. Ce volume est conséquent. Nous avons simplement un problème de mesure.
M. Patrick Suissa. Le chiffre mentionné ne concerne que la France, et non nos filiales étrangères.
M. le président François Brottes. Merci de cette précision.
M. Denis Baupin, rapporteur. Voilà quelques mois que nous travaillons sur les coûts de la filière nucléaire. Tous ne concernent évidemment pas EDF. Cela étant, nous aimerions disposer de votre éclairage sur plusieurs questions, dont je doute qu’elles soient couvertes par le secret professionnel ; vous en jugerez.
On a rappelé le statut spécifique d’EDF, dont le capital est détenu par l’État à 85 %, mais qui est cotée en bourse. L’État fixant les tarifs de l’électricité,…
M. le président François Brottes. L’État ou la justice !
M. le rapporteur. La justice oblige, certes, l’État à les revoir.
Usant de son pouvoir régalien, l’État, donc, peut agir, par le biais de la fixation des tarifs, sur les revenus de la société ; il peut aussi en arrêter les installations. Ces spécificités font-elles varier votre mode d’évaluation des comptes par rapport à ce qui se pratique dans les autres entreprises ?
Nous avons parlé hier avec Henri Proglio de la durée d’amortissement des installations, qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Les réacteurs nucléaires ont une durée de vie de quarante ans, et l’Autorité de sûreté nucléaire nous dit que rien n’est aujourd’hui acquis quant à la poursuite de leur exploitation au-delà de ce délai. Pourtant, l’hypothèse de l’allongement de leur durée d’amortissement a été évoquée, ce qui, selon l’Autorité des marchés financiers, est peu compréhensible. Je ne suis pas du tout expert en la matière, mais si la cotation d’EDF en bourse varie en fonction d’hypothèses quant à la durée de vie des réacteurs qui ne sont pas avérées et qui pourraient améliorer artificiellement la valeur du patrimoine, cela risque de poser des problèmes. Chaque fois que cette possibilité a été évoquée, on nous a dit qu’elle était soumise à l’accord des commissaires aux comptes. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, comment évaluer dans les comptes le fait qu’une autorité indépendante puisse faire fermer du jour au lendemain l’essentiel des installations de production d’électricité de l’entreprise pour des raisons de sûreté et que, en tout état de cause, l’incertitude règne quant à la possibilité d’en prolonger l’exploitation au-delà de quarante ans ? Ce risque est-il chiffrable ? Si oui, comment les comptes le traduisent-ils ?
M. le président François Brottes. Cette situation n’est pas propre au nucléaire, mais concerne toutes les entreprises soumises à autorisation.
M. le rapporteur. Certes, mais en l’espèce, elle est liée aux enjeux de notre commission d’enquête. Il serait intéressant de pouvoir établir une comparaison chiffrée avec d’autres filières de production.
EDF est confrontée à un mur d’investissements dans le parc nucléaire. Nous avons parlé avec Henri Proglio du grand carénage ; quelque évaluation précise que l’on en fasse, les montants à engager représentent plusieurs dizaines de milliards d’euros sur une dizaine d’années. L’entreprise peut-elle les assumer étant donné son niveau d’endettement ?
S’agissant de l’EPR de Flamanville, on constate une très grande différence entre l’estimation initiale du coût et l’évaluation actuelle du coût final. Comment s’impute-t-elle dans les comptes et quelles en sont les conséquences ?
La mesure des charges futures du parc nucléaire, c’est-à-dire des sommes qui devront être consacrées au démantèlement des installations et à la gestion des déchets radioactifs, est essentielle à la fiabilité de nos engagements vis-à-vis des générations futures. En d’autres termes, il est primordial de bien évaluer ce qu’il faut mettre aujourd’hui au pot pour financer ces activités si nous ne voulons pas que nos descendants le fassent à notre place. Or l’Autorité des marchés financiers a appelé mon attention sur l’observation que vous formulez systématiquement, depuis l’introduction en bourse d’EDF, à propos de ces charges et des méthodes qui ont été employées pour les évaluer. Selon l’AMF, il n’est pas commun qu’une observation des commissaires aux comptes à propos d’une société du CAC 40 soit réitérée pendant une période aussi longue. Il semble donc que vous ne soyez pas totalement rassurés sur ce point et que vous teniez à le signaler. Pour quelle raison ? À quelle autre méthode d’évaluation faudrait-il recourir pour que cette observation disparaisse ?
Par ailleurs, le niveau des provisions destinées à couvrir ces coûts futurs dépend en grande partie du taux d’actualisation retenu. Ce taux serait trop élevé à en croire la CNEF, la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des INB et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. Avez-vous voix au chapitre sur ce point ? Vous contentez-vous d’acter ce taux ou pouvez-vous en évaluer la pertinence ? Dans cette dernière hypothèse, faudrait-il, selon vous, le modifier ?
Enfin, les stocks de plutonium, qui représentent un volume non négligeable et servent à la fabrication du combustible MOX, sont valorisés à zéro dans les comptes d’EDF. Pouvez-vous nous donner votre avis et vos explications sur cette approche apparemment illogique ?
M. le président François Brottes. Je vous reposerai, pour ma part, ma question liminaire, à laquelle vous n’avez pas répondu : une société aussi exposée au débat public et à d’éventuels revirements stratégiques doit-elle rester cotée en bourse tant que les décisions qui la concernent ne sont pas arrêtées ?
M. Alain Pons. Il est exact qu’EDF est une entité régulée, soumise à un cadre réglementaire, à un dispositif législatif et à l’appréciation de la puissance publique sous toutes ses formes, ainsi que de l’opinion publique. Son statut est particulier et son activité sinon unique au monde, du moins singulière. Cela rend l’élaboration des comptes plus délicate et l’exercice de notre mission plus complexe, mais cela ne change rien aux règles comptables, aux rapports à produire ni aux éléments à porter à l’information du public.
M. Patrick Suissa. C’est cette complexité qui explique que des associés, des personnes expérimentées, doivent dégager assez de temps pour effectuer et suivre les prestations.
M. Alain Pons. Il s’agit assurément d’un dossier complexe, l’un des plus complexes que nos cabinets respectifs aient à traiter sur la place.
M. Patrick Suissa. Cela résulte de la spécificité d’EDF, mais aussi du secteur d’activité en lui-même : on retrouve cette complexité dans d’autres entreprises qui interviennent dans le secteur de l’énergie, en particulier nucléaire.
M. Jacques-François Lethu. La question de la modification de la durée d’amortissement n’est pas non plus spécifique au groupe EDF : dans les autres entreprises, on doit régulièrement s’interroger sur la pertinence des durées d’amortissement prévues au regard de l’utilisation probable qui sera faite d’un bien. Les normes comptables intègrent d’ailleurs expressément la possibilité de les réviser, qu’il s’agisse des normes IFRS applicables aux comptes consolidés ou des normes comptables françaises, applicables aux comptes sociaux d’EDF : la valeur résiduelle et la durée d’utilité d’un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle.
Dans le cas particulier d’EDF, aucune décision de modification n’a été actée dans les comptes. Lorsqu’elle le sera, il nous appartiendra de vérifier sa conformité aux principes comptables internationaux et français.
M. le rapporteur. Pourriez-vous me répondre plus précisément ? L’ASN nous dit qu’elle sera en mesure de nous préciser en 2017 ou 2018 le cadre dans lequel l’exploitation des installations nucléaires pourrait être prolongée au-delà de quarante ans. Pouvez-vous concevoir, avant cette date, une durée d’amortissement de cinquante ans, ou est-ce incompatible avec la sincérité des comptes ?
M. Jacques-François Lethu. Les normes comptables précisent que la durée d’amortissement correspond à la durée probable d’utilisation. C’est ce qui est écrit dans les textes. Nous apprécierons cette durée probable d’utilisation à la lumière des échanges entre la société et l’ASN. Certains groupes d’experts ont pris position, des demandes ont été formulées. Si, à la lecture de ces éléments, le caractère probable de la durée nous paraît confirmé, il ne nous semble pas impossible d’anticiper.
M. Patrick Suissa. Tout cela relève d’une décision de gouvernance qui, aujourd’hui, n’est pas prise. Nous nous prononcerons en temps et en heure en fonction de cette décision des autorités compétentes, au premier rang desquelles la direction de l’entreprise. On a parlé des débats avec les pouvoirs publics ; à ce jour, nous avons eu connaissance, comme l’ASN, d’ailleurs, de certains éléments techniques du dossier ; mais, je le répète, l’allongement n’est pas décidé.
M. Michel Sordi. La durée d’exploitation de la petite sœur de Fessenheim, aux États-Unis, a été portée à soixante ans. L’autorité qui veille à la sûreté nucléaire n’est certes pas la même dans les deux pays, mais, les Américains n’étant pas plus bêtes que nous, cela peut nous donner à réfléchir.
M. Jacques-François Lethu. De tels éléments seront effectivement pris en considération, comme ils l’ont été en 2003, lorsque la durée d’exploitation a été portée de trente à quarante ans.
M. le président François Brottes. L’analyse tient donc compte d’un environnement assez large.
M. Alain Pons. Absolument. Dans la même industrie, la durée de vie a pu être étendue aux États-Unis, en effet, mais aussi en Angleterre. La probabilité de la durée de vie dépend de la conjonction de trois facteurs : l’un est technique – sans être des techniciens du nucléaire, nous tenons compte des avis des experts qui sont disponibles –, un autre est économique et un autre est lié à la gouvernance. Pour notre part, nous ne faisons que comptabiliser et constater ; il ne nous appartient pas de décider. Si la gouvernance décide d’étendre la durée de vie en s’appuyant sur des considérations techniques et sur des éléments économiques substantiels, nous serons en mesure d’accepter cette extension du point de vue comptable. Il en va de même dans bien d’autres industries : sans être fréquente, la modification de la durée d’amortissement n’est pas exceptionnelle. Du fait de l’évolution technologique, les durées de vie ne sont pas figées, dans quelque secteur que ce soit.
M. le rapporteur. Je vais préciser ma question. Lors du débat à ce sujet, certains ont fait valoir que la durée de vie n’avait rien à voir avec la durée d’amortissement : la première pourrait être de quarante ans alors que la seconde serait de cinquante ans ; il s’agirait d’une question purement comptable. Cela m’avait quelque peu surpris. Votre réponse semble, au contraire, impliquer que les deux sont liées.
M. Alain Pons. Tout à fait.
M. le rapporteur. Cela ne va pas de soi, car ceux qui insistaient sur cette dissociation étaient des personnes assez haut placées. Pour vous, l’accord de l’ASN paraît quasiment être une condition sine qua non.
M. Patrick Suissa. Nous en tiendrons compte, mais il ne s’agit pas d’une condition sine qua non puisque, dans toutes les entreprises normalement constituées, la durée d’amortissement dépend de l’horizon auquel l’entreprise attend des retombées économiques – des flux financiers – de l’exploitation de ses actifs. Si l’on peut escompter un retour sur investissement durant quarante ans, voire au-delà, nous validerons donc la durée d’amortissement retenue.
M. Alain Pons. Si c’est autorisé, bien évidemment.
En ce qui concerne la déconnexion supposée entre amortissement comptable et amortissement économique, ce sont plutôt à des règles fiscales que vous faites référence. L’écart entre amortissements fiscaux et amortissements comptables passe en amortissement dérogatoire dans les comptes sociaux. Cela peut vous fournir un élément de réponse. Mais, dans les normes comptables internationales, celles qui sont applicables aux comptes consolidés d’EDF, il n’y a pas d’écart entre durée de vie économique et durée de vie comptable.
M. Patrick Suissa. Par ailleurs, l’ASN ne s’est jamais prononcée pour autoriser l’exploitation jusqu’à quarante ans. Elle ne peut le faire qu’à l’occasion de la troisième visite décennale : elle donne des autorisations d’exploitation de dix ans. Je ne sache donc pas que l’ASN ait jamais délivré un blanc-seing permettant l’exploitation de tout le parc d’EDF pendant quarante ans.
M. Alain Pons. Enfin, la durée d’amortissement actuellement inscrite dans les comptes est bien de quarante ans.
M. Jacques-François Lethu. Dès lors que l’on connaît les attentes de l’ASN, que l’entreprise est capable d’y répondre de manière appropriée et que la direction est décidée à mettre en œuvre les mesures nécessaires, il nous semble possible de prolonger la durée d’amortissement.
(Présidence de M. Michel Sordi, vice-président)
M. le rapporteur. Qu’en est-il de l’intégration des éléments d’incertitude dans les comptes ? La décision de prolonger l’exploitation des installations au-delà d’une certaine durée ne dépendant pas seulement de l’entreprise, mais aussi d’une entité extérieure, c’est un élément de vulnérabilité par rapport à d’autres producteurs d’électricité. Sait-on chiffrer cette vulnérabilité ?
M. Alain Pons. Elle est sans effet sur la comptabilisation et sur les états financiers produits. En revanche, elle influence vraisemblablement la valorisation, ce qui échappe à notre domaine de compétence. Lorsqu’une décision de fermeture est prise, elle est actée et nous en tirons les conséquences comptables – en général, des dépréciations d’immobilisations, des mises au rebut, le provisionnement des coûts qui en résultent. L’élément d’incertitude que vous évoquez fait partie de l’environnement ; il est naturellement pris en considération en tant que tel par les marchés.
M. Patrick Suissa. À ce jour, dans les comptes, il n’existe aucune incertitude quant à la durée d’amortissement de quarante ans.
L’endettement d’EDF a été ramené de 41,6 milliards d’euros au 31 décembre 2012 à 35,5 milliards fin 2013. Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, le ratio de l’endettement net rapporté à l’excédent brut d’exploitation, traditionnellement utilisé pour mesurer le niveau d’endettement, est de 2,1. Ce chiffre se situe dans la fourchette basse des perspectives d’endettement de l’entreprise, comprises entre 2,2 et 2,5. S’il ne nous appartient pas d’évaluer la capacité d’EDF à faire face au « mur d’investissements », en termes d’agrégats financiers, l’entreprise se situe à un niveau tout à fait convenable au regard des critères d’évaluation habituellement appliqués.
M. Alain Pons. Notre mission consiste à porter un jugement sur les comptes. L’endettement y figure. Nous constatons son évolution, mais nous n’avons pas à estimer la capacité financière de l’entreprise à couvrir au-delà d’une année les charges futures d’investissement. Notre responsabilité concerne la continuité d’exploitation : lorsque nous signons chaque année notre rapport sur les comptes consolidés, nous devons vérifier que la liquidité dont dispose l’entreprise permet d’assurer son fonctionnement courant pour l’année qui suit. Le « mur d’investissements » s’étendant sur plusieurs années, il échappe à notre compétence.
Tout ce que nous pouvons vous dire a été dit par mon confrère : l’endettement de la société, rapporté à ses capitaux propres et à ses résultats, est convenable.
M. le rapporteur. L’information du public n’est donc pas assurée par votre rapport, mais uniquement par le document de référence ?
M. Alain Pons. L’information du public provient d’éléments tels que le document de référence – comptes, rapport de gestion – ainsi que de toute communication de l’entreprise, notamment celles, régulières, auprès d’analystes financiers, qui commentent ses comptes.
M. le rapporteur. Est-ce ainsi qu’est diffusée l’information sur le grand carénage et ses conséquences potentielles ?
M. Alain Pons. Le grand carénage est mentionné dans les états financiers que j’ai évoqués, tout au moins dans le rapport de gestion.
M. Jacques-François Lethu. S’agissant de l’EPR de Flamanville, notre responsabilité consiste à nous assurer que les éléments relatifs au coût sont convenablement traduits dans les comptes, ce qui est le cas aujourd’hui. Le fait que des surcoûts soient possibles ne doit pas nécessairement faire obstacle à la traduction de ces éléments dans les comptes de l’entreprise.
Par ailleurs, l’entreprise ne gère pas son parc nucléaire réacteur par réacteur, mais de manière globale puisque c’est l’ensemble des réacteurs qui permet de satisfaire les besoins en électricité : tel ou tel réacteur n’est pas dédié à la production de telle ou telle usine.
M. le rapporteur. Les comptes ne permettent donc pas de savoir si tel ou tel réacteur rapporte une somme donnée par année.
M. Patrick Suissa. Il n’y a pas de flux de trésorerie associé à chaque centrale : le parc est géré globalement. Il est donc impossible de savoir quelle centrale a été appelée et d’identifier les flux financiers associés à cette production d’électricité.
M. le rapporteur. On n’est donc pas en mesure de dire que tel réacteur rapporte tant de millions d’euros chaque année.
M. Jacques-François Lethu. On peut dire, en fonction de sa production et du prix moyen de vente d’EDF, ce qu’un réacteur est susceptible de rapporter. En revanche, l’électricité étant fongible, l’on ne peut pas savoir que l’électricité de tel réacteur est vendue à telle entreprise ou à tel particulier, à telles conditions tarifaires.
M. le rapporteur. Je songe au débat sur les indemnisations en cas de fermeture d’un réacteur ou d’un autre, qui suppose que l’on sache si chacun des réacteurs a rapporté de l’argent pendant une période donnée. Est-ce aujourd’hui identifiable dans les comptes ?
M. Patrick Suissa. Ce qui est identifiable dans les comptes, c’est la valeur nette comptable de cet actif, non sa valeur économique.
M. Jacques-François Lethu. Par ailleurs, est également identifiable le revenu généré par la totalité du parc. Ces différents éléments permettent d’approcher le montant du revenu généré par un réacteur.
M. Alain Pons. Venons-en aux charges futures, dont l’importance ne vous a pas échappé : selon une évaluation qui figure en toute transparence dans les états financiers, elles correspondent à un agrégat de 67 milliards d’euros, en valeur consolidée et brute. En outre, cette valeur est actualisée. Du point de vue de la technique comptable, il s’agit de projeter des coûts futurs ; nous comptabilisons donc au bilan la valeur présente de l’ensemble des coûts à décaisser sur de nombreuses années. Les cycles sont extrêmement longs : de mémoire, le dernier décaissement est prévu pour 2117.
Ces provisions varient en fonction des taux d’actualisation retenus et des hypothèses de décaissement année par année ; cette sensibilité aux hypothèses choisies est importante. D’où la nécessité, selon nous, d’attirer l’attention du lecteur sur ces éléments. Avec cinquante-huit réacteurs, EDF est un opérateur unique au monde par son parc installé. Les provisions sont constituées à très long terme. Dès lors, les estimations sur lesquelles on se fonde pour les établir – les meilleures possibles du point de vue technique et des coûts – n’en sont pas moins sensibles aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’actualisation à long terme ainsi qu’aux échéanciers de décaissement. L’information que nous fournissons doit donc être transparente. En particulier, je le répète, il est important que le lecteur des comptes d’EDF prenne connaissance des notes annexes, qui expliquent comment la technique comptable a pu mesurer les éléments présents de ces charges futures et rappellent qu’ils sont bâtis sur des hypothèses raisonnables, solides, robustes même, mais sensibles, du seul fait de la durée pour laquelle on provisionne.
Le point le plus délicat, ce sont les flux de décaissement, tributaires d’hypothèses techniques et de gouvernance. On l’a dit, les provisions sont soumises à une réglementation très stricte incluant des revues régulières. Des décisions sont prises ou ne le sont pas, des calendriers sont revisités. Les flux de décaissement dépendent des décisions prises au fil de l’eau en la matière. Aujourd’hui, les provisions portées au bilan reflètent sincèrement et fidèlement les différentes hypothèses connues. Mais elles dépendent par nature de la décision de la puissance publique et d’hypothèses techniques qui peuvent varier avec le temps. Il faut donc fournir au lecteur une appréciation de ces différents éléments, ce que fait la société au travers des notes annexes. Notre responsabilité consiste à nous assurer qu’elles sont lues et que l’attention du lecteur est bien appelée sur ces questions.
M. le rapporteur. L’AMF nous dit qu’il n’est pas habituel de faire figurer une observation de manière aussi systématique.
M. Alain Pons. En effet, cette observation figure dans le rapport depuis que celui-ci existe, en conséquence depuis l’introduction d’EDF en bourse.
M. le rapporteur. Vous pourriez aussi bien formuler une observation sur l’incertitude affectant la durée de fonctionnement des réacteurs ou sur d’autres aspects encore. Je ne suis pas expert en documents de référence ni en rapports de commissaires aux comptes, mais le fait que vous décidiez de signaler ce point en particulier doit bien signifier quelque chose.
M. Alain Pons. Cela s’explique par le fait qu’EDF est un opérateur unique. Sur la place financière, des termes de provision aussi longs sont uniques ou extrêmement rares. Sur la place française, je n’ai pas connaissance de décaissements à 2117. Il ne serait pas sérieux de ne pas appeler l’attention du lecteur sur ce profil d’émetteur atypique. La présence en France de cinquante-huit réacteurs sur 450 à 500 dans le monde, cette grande sensibilité aux hypothèses, cet aspect régulé, tout cela pèse dans l’estimation et doit être signalé à des lecteurs qui ne sont pas nécessairement français, qui peuvent être des investisseurs étrangers.
M. le rapporteur. À ma question sur ce qui pourrait vous inciter à retirer cette observation, vous répondez donc que vous allez la maintenir ?
M. Alain Pons. Mes successeurs pourront vous répondre ! Aujourd’hui, je ne vois pas bien sur quel fondement nous pourrions, nous, la retirer.
M. Jacques-François Lethu. Sauf peut-être à disposer d’une perspective très claire sur certains éléments du cadre réglementaire… Mais, à ce jour, il n’y a aucune raison de ne pas reconduire l’observation.
M. Patrick Suissa. Nos normes professionnelles ne nous habilitent pas à délivrer une information qui ne saurait être mentionnée dans les comptes par l’entreprise, à moins d’être en désaccord avec celle-ci. Il ne s’agit pas ici d’une observation pour incertitude : nous appelons l’attention du lecteur sur des informations structurantes qui éclairent la compréhension des comptes et sont, à nos yeux, de qualité, dans la mesure où elles intègrent aux notes annexes certains éléments de sensibilité.
M. Jacques-François Lethu. Toutes les hypothèses sont convenablement et précisément décrites.
M. Alain Pons. Tous ces éléments étant très compliqués, nous avons pour obligation d’y appeler l’attention du lecteur et de les lui expliquer.
M. Patrick Suissa. En ce qui concerne le taux d’actualisation, les normes comptables prévoient que, dès lors que des décaissements sont programmés ou que des obligations doivent se dénouer dans un futur éloigné, les modalités de comptabilisation tiennent compte de la valeur temps de l’argent. D’où l’actualisation. S’agissant des provisions nucléaires d’EDF, conformément à la loi de 2006, le taux d’actualisation est soumis à un plafond dit réglementaire, lequel n’est pas totalement conforme aux normes comptables. Or, comme commissaires aux comptes, nous devons nous prononcer en fonction des référentiels comptables, mais aussi de la réglementation.
Conformément aux recommandations de l’AMF sur les méthodes comptables, EDF applique une méthodologie permanente, ce à quoi nous veillons. Pour calculer le taux d’actualisation, EDF retient un taux sans risque sur une moyenne glissante de dix ans, puis tient compte de la cotation des obligations des entreprises de première catégorie. C’est ainsi que, au 31 décembre 2013, le taux obtenu était de 4,8 %, identique à celui du 31 décembre 2012, comme précisé dans les comptes. Le taux plafond réglementaire est déterminé à partir de la moyenne sur quatre ans du taux de l’échéance constante à trente ans (TEC 30) et du spread plafonné à cent points de base – ce qui est contraire aux normes comptables qui ne prévoient pas de plafond.
À l’instigation de l’entreprise, des discussions ont été engagées avec la direction générale de l’énergie et du climat en vue d’obtenir l’autorisation de surseoir à l’application de ce taux plafond. Ce point est mentionné dans les comptes. La comptabilisation des engagements nucléaires d’EDF applique donc le taux de 4,8 % issu des calculs de l’entreprise, mais la sensibilité, de vingt points de base, de l’évaluation des provisions nucléaires est précisée en annexe.
Nous avons donc estimé que l’information fournie dans les états financiers était satisfaisante, pertinente et complète.
M. le rapporteur. Le détail de vos propos dépasse quelque peu mes compétences. Quel serait le taux plafond ?
M. Patrick Suissa. Tel que précisé dans les comptes, il s’élèverait à 4,58 %. Mais EDF a obtenu des autorités de tutelle l’autorisation de suspendre l’application de ce taux plafond en attendant l’issue des discussions en cours sur la transition énergétique et la gestion des déchets à long terme.
M. Alain Pons. Les normes comptables nous imposent de tenir compte des taux tels qu’ils existent, c’est-à-dire des taux à long terme. Il en résulte un taux d’actualisation de 4,8 %. Le taux réglementaire, qui a fait l’objet d’une dérogation cette année, était de 4,58 %. La principale raison de cet écart est que le taux réglementaire prévoit un taux normatif de cent points de base sur ce que l’on appelle le spread, alors que les marchés financiers ne connaissent pas de taux normatif.
Pour notre part, nous retenons le taux économique, imposé par les normes comptables. Ces éléments techniques ont suscité des discussions et nous avons demandé à la société, qui l’a fait très volontiers, de faire figurer en annexe les différentes hypothèses retenues et leur impact sur la valorisation des provisions au bilan.
M. Patrick Suissa. Si l’on retient des séries relativement longues, c’est afin de se régler sur la duration des passifs. S’agissant du nucléaire, alors que le taux réglementaire se fonde sur une durée d’observation des taux de quatre ans, le fait de déterminer une moyenne glissante sur dix ans produit un effet de lissage qui évite une volatilité du bilan d’EDF, et tient compte des évolutions structurelles de l’économie et non pas des à-coups liés aux périodes de crise économique.
M. Michel Sordi, vice-président. À quel montant cette différence de taux correspond-elle ?
M. Patrick Suissa. Ce montant figure en annexe aux comptes. L’effet joue soit sur le bilan lorsqu’il existe un actif de contrepartie de la provision, soit sur le résultat. Quoi qu’il en soit, on peut estimer que l’effet d’une réduction de vingt points de base sur la provision au bilan, laquelle représente 32,6 milliards d’euros en valeur actualisée, serait de 1,139 milliard, et d’environ 500 millions sur le compte de résultat. Vous trouverez ces chiffres dans le document de référence, à la page 340.
M. Jacques-François Lethu. Sur la valorisation des stocks de plutonium, je n’ai pas d’information.
M. Patrick Suissa. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit d’une technologie particulière qui nécessite très probablement des autorisations, donc des installations ad hoc permettant d’utiliser le stock. A défaut d’installations, il est difficile de reconnaître une valeur dans les comptes.
M. le rapporteur. Mais les installations existent.
M. Patrick Suissa. Peut-être faut-il des autorisations particulières. Je ne dispose pas de cette information.
M. le rapporteur. Issu du retraitement, le plutonium sert à fabriquer du MOX. C’est une activité à laquelle AREVA se livre depuis des années pour le compte d’EDF. Naturellement, cela suppose des autorisations : l’utilisation du plutonium est très surveillée.
Bref, vous n’avez pas d’éléments à ce sujet ?
M. Jacques-François Lethu. Non.
M. le rapporteur. Cela vous évoque-t-il d’autres cas dans lesquels un combustible potentiel ou une matière première potentielle serait valorisé à zéro ?
M. Patrick Suissa. Nous pourrions faire des recherches et vous transmettre la réponse, mais, à chaud, nous n’avons pas d’exemple qui nous vienne à l’esprit.
M. le rapporteur. Reste la question du président Brottes au sujet de la suspension de la cotation pendant le débat sur l’avenir d’EDF et la transition énergétique.
M. Michel Sordi, vice-président. Est-ce possible ? Souhaitable ?
M. Jacques-François Lethu. Cette question n’est pas de notre ressort. Les suspensions de cotation dépendent de l’AMF.
M. Alain Pons. C’est un sujet qui ne nous appartient pas, sur lequel nous ne sommes pas compétents.
M. Michel Sordi, vice-président. N’avez-vous pas un avis ?
M. Alain Pons. Nous pouvons toujours avoir un avis à titre personnel, mais pas dans le cadre de nos fonctions.
M. Michel Sordi, vice-président. Est-ce une question pertinente ?
M. Alain Pons. Je ne peux en juger.
M. Michel Sordi, vice-président. Indépendamment des provisions, EDF a aussi constitué une cagnotte financière. À combien se monte-t-elle ?
M. Jacques-François Lethu. Elle répond aux obligations réglementaires de la loi de 2006. À la fin décembre 2013, elle représentait 103 % des montants provisionnés dans les comptes et devant être couverts par les actifs dédiés, soit une vingtaine de milliards d’euros.
M. le rapporteur. Mettre en face de ces sommes des actifs de RTE assure-t-il une liquidité suffisante pour financer le démantèlement et la gestion des déchets, sachant que l’on ne pourrait revendre ces actifs qu’à la Caisse des dépôts ?
M. Patrick Suissa. Cette possibilité a été offerte par un décret ; nous l’actons dans les comptes.
M. Alain Pons. Dans les actifs dédiés figure aussi la créance CSPE.
M. le rapporteur. N’est-elle pas plus liquide que les actifs de RTE ?
M. Jacques-François Lethu. Des actifs, cela se vend.
M. le rapporteur. Mais, en l’occurrence, seulement selon certaines règles. Vous êtes aussi commissaires aux comptes de RTE ; vous le savez, ces actifs ne peuvent être vendus qu’à une entité publique, donc qu’à la Caisse des dépôts. Le président de l’ASN de l’époque avait parlé de contournement de l’esprit de la loi.
M. Patrick Suissa. Manifestement, les pouvoirs publics n’en ont pas tenu compte !
M. le rapporteur. Ce n’est pas faux.
M. Patrick Suissa. Nous n’avons pas d’avis sur la question. Tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’étant donné les horizons de décaissement, la réglementation peut changer, y compris au sujet de RTE. En outre, sur les 21 milliards constitués, on compte 12 milliards d’actifs liquides, voire très liquides.
M. Michel Sordi, vice-président. Merci, messieurs.
Je souhaite personnellement qu’EDF continue à bien se porter, à honorer ses engagements et à répondre aux besoins de notre pays et de ses habitants. Je pense que nous en serons tous d’accord.
M. Alain Pons. En effet, nous le souhaitons tous !
Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA
(Séance du 7 mai 2014)
M. le président François Brottes. Nous allons procéder à l’audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA, qui arrive tout juste d’une conférence de presse organisée dans un ministère voisin. Je rappelle que si les ministres sont au moins aussi importants que les commissions d’enquête, ces dernières, qui réunissent des représentants du peuple, ne doivent pas être moins considérées.
Reste que votre entreprise et quelques autres qui travaillent avec vous, monsieur Oursel, ont appris une bonne nouvelle aujourd’hui concernant les énergies renouvelables ; soyez-en félicité, à la fois pour vous et pour la France. Je me suis engagé, auprès de mes collègues, à terminer cette audition à dix-huit heures trente, ce qui, compte tenu du retard avec lequel nous commençons, nous obligera, dans l’hypothèse où vous n’aurez pu répondre à toutes les questions des députés ici présents, à programmer une nouvelle audition la semaine prochaine, d’autant que notre règlement nous oblige à remettre notre rapport dans quelques semaines. Or l’on ne saurait se passer de l’audition du patron d’une entreprise parmi les plus importantes de la filière nucléaire – vous êtes pour nous un interlocuteur de poids. Votre entreprise a à cœur de maîtriser la totalité de la filière – l’acquisition et le retraitement du minerai, l’ingénierie de la mise en œuvre des centrales… – ; et c’est bien l’ensemble de la chaîne qui intéresse cette commission.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Luc Oursel prête serment)
M. Denis Baupin, rapporteur. Je vous adresse également mes félicitations pour avoir remporté l’appel d’offres auquel M. Brottes a fait allusion, succès qui montre que la diversification de votre entreprise est positive. Et à en juger par la nature de cette diversification, je ne peux que m’en réjouir.
Je souhaite, presque au terme des travaux de cette commission d’enquête, que nous fassions le point sur la construction d’installations futures et sur l’aval du cycle.
Ma première question porte sur le projet finlandais. On lit dans la presse que le chantier pourrait être arrêté ou, tout au moins, qu’en l’attente d’arbitrages, on ne sait pas trop où l’on en est. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point dans la mesure où ce projet a un impact assez lourd sur les finances de votre entreprise, même s’il a été largement provisionné – autour de 4 milliards d’euros si je ne m’abuse ?
En ce qui concerne les réacteurs et leur construction, le groupe AREVA est impliqué dans les projets EPR et ATMEA. Le président Proglio nous a confirmé l’implication conjointe d’AREVA et d’EDF dans un projet de réacteur de 1 000 mégawatts (MW). Quel est votre sentiment sur les avantages et les inconvénients de ces différents projets, sur leurs coûts respectifs ? Et pourquoi mener en parallèle autant de projets différents ?
Pour ce qui est de l’aval du cycle, j’aimerais savoir où en est la contractualisation entre EDF et AREVA ? Voilà plus d’un an qu’il n’y a plus vraiment de contrats en activité… En outre, nous ne disposons pas, à ma connaissance, des évaluations des conséquences de la catastrophe de Fukushima réalisées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). EDF va investir environ 10 milliards d’euros pour sécuriser ses installations. Qu’en est-il pour les installations d’AREVA – en particulier à La Hague – à la fois en termes de sûreté et en termes de sécurité – je pense aux piscines ?
Dans son rapport annuel, le président de l’ASN a particulièrement insisté sur les dérives – c’est le mot employé – de calendrier, les échéances ayant été reportées concernant la reprise de déchets anciens produits par la première usine UP2-400 à la Hague. Les bâtiments dans lesquels ces déchets sont entreposés vieillissent et ne répondent plus aux normes actuelles de sûreté. Il s’agit notamment des boues entreposées dans les silos STE2, des déchets des silos HAO et 130 ainsi que des solutions de produits de fission entreposées dans l’unité SPF2. Selon l’ASN, le report de la reprise de ces déchets anciens remet en cause les échéances fixées par la loi du 28 juin 2006. Un certain nombre d’engagements ne semblent donc pas avoir été tenus. Pouvez-vous nous éclairer sur les délais dans lesquels AREVA compte les tenir et ce qu’il en coûtera ?
Nous avons auditionné ce matin des représentants de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Nous avons certes évoqué le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), mais la gestion globale des déchets nucléaires va avoir un impact sur le prix du kilowattheure (kWh) ; or nous ne saurions léguer aux générations futures un coût trop important en la matière.
Je souhaite enfin avoir votre sentiment sur les questions de démantèlement, surtout en termes de marchés publics. Est-ce qu’AREVA se positionne ? Le marché potentiel dans le monde est en effet considérable concernant non seulement les réacteurs mais aussi de nombreuses autres installations. Quel ordre de grandeur pourrait atteindre pour votre entreprise, selon vous, une activité économique de démantèlement ?
M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA. Je vous présente mes excuses pour mon retard dû à une conférence de presse consacrée à une annonce importante pour l’entreprise, vous l’avez évoqué. Je me tiens bien entendu à la disposition de l’Assemblée pour une nouvelle audition.
Le projet finlandais ne rencontre aucun problème technique, comme l’illustre la réussite récente du test de confinement de l’enceinte ou la validation par l’Autorité de sûreté finlandaise du système de contrôle-commande. Il y a en revanche un problème contractuel : alors que nous nous approchons de la phase des essais au terme desquels l’installation doit fonctionner, il faut que le client prenne toutes ses responsabilités en termes de ressources, d’engagement de planning pour nous permettre de bien comprendre jusqu’où ira le projet. Ces difficultés, ajoutées à une méthode de travail inefficace du client, ont créé des problèmes qui ont justifié de notre part le lancement d’un arbitrage. La provision qui figure d’ores et déjà dans les comptes d’AREVA est de 3,9 milliards d’euros et la demande de compensation que nous avons déposée, et qui ira hélas en s’accroissant, est déjà de 2,7 milliards d’euros. Les premières décisions de l’arbitrage seront rendues au premier trimestre 2015. Le chantier n’est pas arrêté pour autant – contrairement à ce qu’a parfois pu avancer la presse.
Nous avons décidé de nous concentrer sur toutes les priorités du projet afin de respecter le calendrier et, face, parfois, à des changements d’opinion du client, de reporter un certain nombre d’opérations pour être certains de les réaliser, quand nous les réaliserons, une bonne fois pour toutes. Cette décision s’est traduite par une diminution des effectifs de construction sur le site mais pas par un arrêt du projet, et elle n’a pas d’impact, aujourd’hui, sur le calendrier.
Il se trouve que, dans le même temps, l’Autorité de sûreté finlandaise confirme que l’EPR est la technologie la plus sûre et la plus adaptée pour répondre aux besoins, et que nous sommes appelés par le même client à participer à un appel d’offres pour la construction d’une éventuelle future centrale sur le même site…
M. le rapporteur. Quand la mise en service pour le projet finlandais aura-t-elle lieu ?
M. Luc Oursel. Nous avons décidé officiellement, lors de la présentation des résultats de 2013, de ne plus indiquer de calendrier tant que nous n’aurons pas d’engagements clairs de la part du client sur un certain nombre de contributions qu’il doit apporter ou de responsabilités qu’il doit prendre pour les étapes à venir. C’est une façon de lui faire comprendre, en particulier dans cette phase d’essai, que c’est lui qui exploite la centrale alors que nous nous occupons, nous, de l’assistance. Or, si nous n’avons pas d’indications claires sur les ressources qu’il va engager sur la durée des essais, sur la formation…, il nous est très difficile de nous prononcer sur un calendrier.
M. le président François Brottes. Une chose est le démarrage de la centrale, une autre est la livraison. Pouvez-vous donc nous en dire plus sur le délai de livraison ?
M. Luc Oursel. La fin de la construction peut être estimée à la fin 2016.
J’en viens aux réacteurs. Nous avons souhaité disposer d’une gamme de réacteurs. L’EPR a été conçu pour aborder une certaine tranche du marché. Sa forte taille, sa forte puissance était liée au souci d’économies d’échelle, à la rareté des sites, à l’intérêt pour un certain nombre d’économies qui ont des besoins énergétiques croissant très rapidement. Toutefois, du fait, dans certains pays, de l’évolution de la consommation d’électricité ou de la taille des entreprises électriques et de leurs moyens de financement, il nous est apparu, dès 2007, qu’il fallait compléter cette gamme par un réacteur de taille moyenne de 1 000 MW.
Le projet ATMEA est très avancé puisque le basic design est terminé, qu’il a reçu une première approbation par l’ASN. Son dessin de détail est avancé de l’ordre de 35 à 40 % ; il bénéficie de toute une série de retours d’expérience à la fois d’AREVA et de Mitsubishi, son partenaire japonais. Ce réacteur est engagé dans une négociation exclusive en Turquie pour la construction de quatre réacteurs.
En appel d’offres, suivant le client, nous pouvons par conséquent présenter l’EPR ou l’ATMEA. Ainsi devons-nous continuer à travailler : nos produits n’ont pas vocation à demeurer figés. C’est pourquoi l’EPR fait l’objet d’un travail d’optimisation permanent à court, moyen et long terme visant, à sûreté égale, à en améliorer la compétitivité. Nous réfléchissons avec EDF à la conception d’un nouveau réacteur 1 000 MW – franco-français, ainsi qu’Henri Proglio l’a évoqué devant vous –, impliquant des travaux à moyen et long terme dont certains justifient des travaux de recherche et développement. Nous n’avons pas établi de calendrier pour ce nouveau réacteur qui peut-être utilisera une bonne partie de ce qui a été développé pour ATMEA. Il s’agit donc de continuer à faire évoluer les types de réacteurs existants pour en améliorer la compétitivité, par paliers successifs.
M. le rapporteur. Partez-vous d’ATMEA, de l’EPR ou bien concevez-vous quelque chose de nouveau ?
M. Luc Oursel. Nous ne partons pas d’un réacteur ou de l’autre en particulier mais nous prenons un certain nombre de fonctions critiques ou d’éléments substantiels du coût et nous cherchons à les améliorer. Par exemple : faut-il ou non une seconde enceinte de béton ? À quel niveau de puissance le récupérateur de corium est-il nécessaire ? L’agglomération des thèmes que nous aurons choisis aboutira à un réacteur 1 000 MW.
Vous m’avez demandé, monsieur le rapporteur, pourquoi nous avions autant de projets. C’est exagéré : comme nos concurrents, nous proposons deux types de réacteurs sur le marché. Des réflexions sont en cours sur de plus petits réacteurs, de quelques centaines de MW – c’est la responsabilité d’une entreprise comme AREVA, en lien avec EDF. Qu’ont de commun ces deux réacteurs ? La sûreté et la disponibilité – nous tâchons de réduire les périodes de maintenance. Quant aux différences, elles sont liées à la taille et à certaines améliorations. Le coût d’un ATMEA est moins élevé en valeur absolue qu’un EPR mais il est légèrement supérieur quand on le ramène au kW – les économies d’échelle ne sont évidemment pas les mêmes avec un réacteur 1 000 MW qu’avec un réacteur 1 600 MW. Reste que le coût de production complet d’un ATMEA reste tout à fait compétitif. Vous avez pu constater que ce produit répondait en Turquie à un besoin particulier du marché.
M. le rapporteur. À combien évaluez-vous le coût du MWh ?
M. Luc Oursel. Aujourd’hui à 5 ou 10 % de plus que celui produit par un EPR, ce qui est normal eu égard au rapport de puissance entre les deux réacteurs.
M. le président François Brottes. Sur une durée de vie prévisionnelle du même ordre ?
M. Luc Oursel. La même, en effet, à savoir soixante ans. Une des grandes différences entre l’ATMEA et l’EPR, c’est que les composants comme les générateurs de vapeur sont dimensionnés dès le démarrage pour la durée de vie de soixante ans ; il n’est pas nécessaire de les changer au bout d’un certain temps comme c’est le cas pour les réacteurs actuels.
M. le rapporteur. À combien évaluez-vous le coût du kWh produit par l’EPR, à 5 à 10 % de moins qu’avec l’ATMEA donc ?
M. Luc Oursel. Ce sujet fait l’objet de débats très sensibles compte tenu des conséquences commerciales au Royaume-Uni. Je suis prêt à vous répondre par écrit. Le coût du kWh est très dépendant des conditions de construction. Cette question est en effet très difficile car le coût d’un EPR, d’un réacteur nucléaire, comprend le coût de construction qui varie d’un pays à l’autre. Il n’y a donc pas un coût du kWh standard. Ensuite, j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une donnée très sensible sur le plan commercial dans tous les appels d’offres, elle est encore plus sensible compte tenu du débat qui s’est tenu à Bruxelles. Mais, j’y insiste, je pourrai répondre par écrit à votre commission.
En ce qui concerne l’aval du cycle, nous ne sommes pas encore parvenus à conclure les négociations entre EDF et AREVA pour l’usine de La Hague et la production de MOX. La production n’en a pas été interrompue pour autant : nous avons pris les dispositions temporaires qui s’imposent.
C’est une situation tout à fait normale – il s’agit tout de même d’un contrat de plusieurs milliards d’euros, entre deux entreprises qui défendent chacune leur intérêt. Nous sommes les seuls à pouvoir retraiter les déchets d’EDF ; pour nous, EDF est l’un des clients les plus importants de l’usine de La Hague. EDF a des attentes en matière de productivité ; nous devons défendre nos marges...
La contractualisation se déroule, pour la première fois, dans une grande transparence, puisque nous avons accepté la réalisation d’un audit, très détaillé, de nos coûts. Cela a permis de rétablir la confiance. Le contrat aura probablement une durée plus longue que les contrats précédents, pour éviter que les échéances ne soient trop rapprochées ; il est également probable que les volumes retraités seront légèrement supérieurs, et qu’en contrepartie EDF nous demandera un prix légèrement inférieur. Cela répond d’ailleurs, je crois, à l’une des préoccupations de votre commission, celle des coûts de retraitement.
Nous ne sommes en tout cas pas loin de la conclusion du contrat.
M. le rapporteur. Pour combien d’années sera établi le contrat ?
M. Luc Oursel. Les négociations sont encore en cours, je ne peux donc pas vous répondre précisément.
S’agissant de la sûreté des infrastructures du groupe, notre plan stratégique, qui court jusqu’en 2016, prévoyait 2 milliards d’euros d’investissements pour la maintenance des différentes installations. Celles-ci ont toutes été revues après la catastrophe de Fukushima. Je souligne que nos installations ne comprennent pas de réacteurs ; elles sont aussi plus diffuses que celles des centrales nucléaires, comme vous avez pu le constater en vous rendant sur place. Les principales mesures prises concernent l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que la mise en place de PC qui pourraient être gréés en cas de crise.
Nous estimons que les coûts supplémentaires devraient être compris entre 200 et 300 millions d’euros sur la période.
Nous menons également actuellement, et c’est tout à fait normal, des discussions avec les autorités afin de renforcer la sécurité de nos sites. Le devis dont nous disposons aujourd’hui est de l’ordre de 120 à 150 millions d’euros.
M. le rapporteur. Je comprends donc que la bunkerisation des piscines n’est pas envisagée.
M. Luc Oursel. Non, car l’ASN ne la demande pas. La situation, vous le savez, n’est pas la même que pour un réacteur nucléaire. Dans nos installations, il suffit de garantir l’approvisionnement des piscines en eau et de garantir leur température.
S’agissant de la reprise des déchets anciens à La Hague, il est exact que nous n’avons pas tenu le calendrier que nous avions initialement proposé à l’ASN. La recherche et développement a en effet pris plus de temps que prévu, car nous voulions être absolument sûrs de la fiabilité des méthodes que nous allions employer. Nous prévoyons de proposer bientôt un nouveau calendrier à même de satisfaire aux exigences de l’ASN.
M. le rapporteur. Quel sera le coût ?
M. Luc Oursel. Le coût n’est pas exorbitant – quelques dizaines de millions d’euros sans doute. Pour nous, le problème est bien la stabilisation de la méthode : nous voulons employer la bonne méthode, tout de suite, pour bien traiter ces déchets.
En matière de démantèlement, vous l’avez rappelé, nous menons des actions qui peuvent être très diverses. Nous démantelons nos propres installations, mais aussi des installations du CEA ; nous travaillons également aux États-Unis, en Allemagne, au Japon... Pour le groupe AREVA, cela représente un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros et 1 500 personnes y travaillent.
Notre ambition est de nous positionner pour les activités où nous avons les compétences les plus grandes, notamment la cartographie initiale des situations et l’établissement d’un planning de démantèlement et d’un budget fiables, ce qui implique en particulier un dialogue avec les autorités de sûreté. Il s’agit là d’éléments très importants pour les décisions de nos clients électriciens. Nous n’avons pas l’ambition de réaliser toutes les opérations : nous interviendrons uniquement là où nous avons une forte valeur ajoutée, c’est-à-dire notamment dans la gestion des zones les plus contaminées, et dans les interventions robotisées. Nous avons également la capacité de mettre en place des systèmes de radioprotection pour intervenir dans ces différentes zones.
Nous développons donc une forte spécialisation dans certains domaines précis, car nous ne pouvons pas prétendre, depuis la France ou depuis nos bases industrielles, démanteler une centrale entière : beaucoup d’opérations sont, si j’ose dire, des opérations de génie civil inversé. Il faut également être conscient que les compagnies d’électricité sont rarement pressées de procéder à ces opérations, et qu’elles songent d’abord à utiliser leur personnel. En Allemagne, par exemple, il est très clair que le démantèlement des centrales est une façon de régler les problèmes sociaux liés à l’arrêt de l’exploitation.
C’est un marché dont nous estimons qu’il va se développer, mais plutôt lentement : le chiffre d’affaires pourrait doubler en dix ans.
M. le président François Brottes. Estimez-vous qu’il serait opportun de modifier les procédures de contrôle applicables aux démantèlements, qui sont aujourd’hui calquées sur celles qui sont applicables aux constructions ?
Vous paraît-il possible de réduire les délais de démantèlement ? Aujourd’hui, ils sont si longs qu’ils sont décourageants.
Enfin, les auditions auxquelles nous avons procédé ce matin permettent de conclure qu’en matière de déchets, grâce aux nouvelles méthodes utilisées à La Hague, il n’y a pas d’urgence absolue. Quel est votre sentiment ?
M. Luc Oursel. Il est certain que la législation actuelle rend l’instruction extrêmement longue : toute simplification serait bienvenue.
Il serait peut-être judicieux, si l’on modifie les procédures de démantèlement, de se poser la question des ferrailles : dans certains pays, comme l’Allemagne ou la Suède, une partie des ferrailles sont décontaminées, dans des installations très spéciales, et peuvent être recyclées dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes. La loi française ne le permet pas aujourd’hui. Cette solution, déjà pratiquée ailleurs de façon très rigoureuse, permettrait de réduire les masses à stocker : si les ferrailles ne peuvent pas être réutilisées après décontamination, elles sont considérées comme des déchets et doivent être stockées de façon spécifique.
Raccourcir les délais de démantèlement est évidemment l’un de nos objectifs. Sur les installations d’AREVA, le rythme est plutôt raisonnable. D’une opération à l’autre, nous gagnons en productivité : une augmentation importante des activités de démantèlement au niveau mondial permettrait sans doute d’aller un peu plus vite, peut-être de 10 à 15 % plus vite.
S’agissant de Cigéo, je m’en tiendrai bien sûr aux aspects techniques. À notre sens, les phases d’ingénierie doivent être très bien menées : il faut donc prendre tout le temps nécessaire, notamment pour dialoguer avec l’autorité de sûreté et pour mettre au point toutes les méthodes d’optimisation des coûts. Nous ne sommes pas loin de penser que l’extension de la phase d’ingénierie permettrait de mieux maîtriser le coût et la réalisation de l’opération. S’il faut prendre deux à trois ans de plus, faisons-le : notre expérience montre qu’il est préférable d’avoir bien mis au point les méthodes avant de se lancer dans la construction.
Enfin, dans la phase d’ingénierie de détail dans laquelle nous entrons, et ultérieurement dans les phases de construction, nous souhaiterions que l’ANDRA, tout en conservant ses missions, associe plus largement les compétences nucléaires des différents utilisateurs de ce futur centre.
M. le président François Brottes. Selon vous, d’un point de vue technique, attendre un peu ne poserait pas de problème de sûreté.
M. Luc Oursel. Les extensions de délais que j’évoquais me paraissent tout à fait maîtrisables.
M. Philippe Baumel. Est-il possible de conjuguer le développement de la filière MOX et l’objectif gouvernemental de réduction de la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2025 ? Quelles seraient les conséquences d’une telle réduction sur le parc de réacteurs ? Certains seraient-ils fermés, et si oui, comment seraient choisis ces réacteurs ? Quelles seraient les conséquences en termes d’emplois ?
Vous pardonnerez au député du Creusot de vous demander également quelles seraient les conséquences, en termes d’emplois, de la construction d’un EPR, en France mais aussi à l’étranger.
M. le président François Brottes. Cela n’emportera sans doute pas l’adhésion de notre rapporteur, mais le président d’EDF nous a indiqué hier qu’atteindre 50 % de nucléaire en 2025 n’impliquait pas de fermer des réacteurs, en raison de l’augmentation de la consommation.
M. Bernard Accoyer. Quel est le nombre d’emplois – dans votre groupe comme chez les sous-traitants – qui dépendent de l’activité d’AREVA dans le domaine nucléaire ?
M. Luc Oursel. On parle de 50 % en 2025, mais 50 % de quoi ? C’est la première question à se poser. On peut effectivement estimer – et c’est une vision que je ne suis pas loin de partager – que les consommations d’électricité pourraient augmenter, grâce au redémarrage de la croissance économique, grâce à des politiques ambitieuses d’utilisation de l’électricité dans le bilan énergétique. Plus largement, les raisons d’attendre une croissance de la consommation sont infiniment nombreuses : technologies de l’information, vieillissement de la population, développement du transport urbain, des voitures électriques, de la cité intelligente... À l’évidence, les objectifs changent selon la façon dont on anticipe l’avenir.
AREVA n’est pas un électricien, mais je me permets à titre personnel de penser qu’il serait judicieux d’imaginer une politique énergétique qui développerait le rôle de l’électricité dans notre économie, parce que c’est compétitif, parce que cela ne produit pas de CO2, parce que c’est une énergie facile à réguler...
Quant aux conséquences pour AREVA, ce sont les réacteurs les plus anciens, ceux de 900 mégawatts, qui utilisent aujourd’hui du MOX. Chaque fermeture de l’un de ces vingt réacteurs fait donc diminuer d’à peu près 5 % l’utilisation de MOX. Cela entraîne une diminution de l’activité à Marcoule et à La Hague – à moins que vous ne décidiez, ce qui est un choix politique, de remplacer ces vieux réacteurs par de nouveaux réacteurs capables d’utiliser du MOX. C’est le cas de l’EPR : dans leur conception actuelle, le MOX peut constituer jusqu’à 50 % d’un chargement.
Si l’on ne recrée pas de débouchés pour le MOX, les conséquences sont donc importantes.
Je comprends donc le soutien apporté à cette technologie MOX, sur laquelle votre commission s’est déjà penchée. C’est l’un des éléments que la politique énergétique doit prendre en considération : comment maintenir cet outil industriel qui emploie près de 6 000 personnes ?
AREVA, c’est aujourd’hui 45 000 emplois dont 30 000 en France, très majoritairement dans le domaine du nucléaire. Les énergies renouvelables ne représentent encore pour nous que quelques milliers d’emplois, ce nombre étant appelé à augmenter.
Nous estimons que la construction d’un EPR en France permettrait de créer 8 300 emplois pendant la période de construction. Pour la construction d’un EPR à l’étranger, il faut diviser ce nombre par trois, en particulier parce que les clients attendent toujours des embauches locales, et aussi parce qu’il existe parfois, comme en Chine, des compétences locales. Il faut souligner qu’une construction à l’export a des effets mécaniques sur plusieurs dizaines de PME françaises, qui sont qualifiées, reconnues, et qui participent avec nous à ces différents projets.
Quant au Creusot, enfin, la charge dépend des nouvelles constructions, en France et à l’étranger, mais aussi du programme mené par EDF de remplacement des générateurs de vapeur de 1 300 mégawatts ; ce programme a débuté mais nous sommes en train de négocier les tranches ultérieures. Les effectifs du site du Creusot sont maintenant à peu près stabilisés. Nous rencontrons actuellement, vous le savez, des difficultés dans l’interprétation de textes réglementaires : cela se traduit par de fortes discontinuités dans la production, ce qui – sauf le respect que j’ai pour l’ASN – ne va pas dans le sens de la qualité. Une bonne production industrielle est continue, avec des contrôles de qualité bien sûr.
M. le président François Brottes. Merci. Nous nous reverrons la semaine prochaine.
Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA
(Séance du 20 mai 2014)
M. le président François Brottes. Monsieur Luc Oursel, soyez une nouvelle fois le bienvenu. Depuis votre première audition par la commission d’enquête, le groupe AREVA s’est retrouvé sous les feux de l’actualité. Un pré-rapport de la Cour des comptes semble mettre sa gestion en cause, ce qui a suscité plusieurs tribunes dans les journaux du soir. Sans doute aurez-vous à cœur de répondre à ces accusations, avant d’aborder des questions que nous avions laissées en suspens, comme le passage à la quatrième génération.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Luc Oursel prête serment)
M. Denis Baupin, rapporteur. Quelles réponses entendez-vous faire au pré-rapport de la Cour des comptes, qui met en cause la solidité financière et le fonctionnement de votre entreprise ? Quelles conséquences aura l’affaire Uramin ? Les sommes provisionnées dans les comptes pèseront-elles sur l’équilibre financier d’AREVA ?
La Cour dénonce une fuite en avant, voire du forcing, lors de la vente du projet d’EPR à la Finlande. Le calendrier de livraison paraît optimiste, puisque, selon le directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), il n’est pas possible de construire un réacteur en quatre ans. Quel jugement portez-vous a posteriori sur la gestion de ce dossier ?
Quel est votre sentiment sur le modèle intégré retenu par AREVA ? Cette stratégie, que la Cour a remise en cause, vous semble-t-elle toujours pertinente ?
Comment réagissez-vous au jugement de la Cour, selon lequel EDF fragiliserait AREVA en sous-utilisant les installations de traitement de l’uranium situées en France et en s’adressant à des clients étrangers implantés sur le territoire ?
Selon la presse, AREVA envisage de faire de sa participation au projet de Hinkley Point un des actifs qui lui permettront de financer le démantèlement des installations. Cette stratégie est-elle compatible avec l’obligation légale de fluidité des capitaux, en matière de démantèlement et de gestion des déchets ?
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) regrette de n’avoir pas des relations aussi souples avec l’Autorité de sûreté chinoise qu’avec son homologue finlandais. Quelles sont vos relations avec les entreprises chinoises ? Vous laissent-elles un plein accès aux sites nucléaires ?
Comment abordez-vous le projet de réacteur de quatrième génération ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) ? Quel sera le calendrier de sa mise en place ? Est-il exact que le passage à la quatrième génération marquera, outre un progrès dans la gestion des déchets, une avancée en matière de sûreté ?
Quel sera l’impact sur vos comptes de la gestion des sites, notamment des mines désaffectées ou des anciennes installations qui ne sont plus exploitées mais ne peuvent demeurer sans signalisation ni surveillance ?
M. Luc Oursel, président du directoire d’AREVA. Le pré-rapport de la Cour des comptes, dont nous attendons la version définitive, appelle certaines remarques de notre part.
Il ne faut pas surévaluer les conséquences financières de l’acquisition d’Uramin, puisque les provisions correspondant à la dépréciation de cet actif sont d’ores et déjà intégrées dans les comptes. Nous avions commencé à développer un gisement en Namibie. Nous avions même mené certains travaux sur place, avant de mettre la mine « sous cocon », c’est-à-dire d’en suspendre le développement. Nous attendons que le cours de l’uranium remonte, avant de reprendre la production à Trekkopje. Depuis 2012, nous avons cessé les explorations en République centrafricaine, car, même si l’on parvenait à y identifier des réserves, leur exploitation serait difficile en termes de logistique comme de sécurité. De mémoire, le montant provisionné à la fin de 2011 se portait à 1,8 milliard – chiffre que je vous confirmerai par écrit.
La vente de l’EPR à la Finlande n’a fait l’objet d’aucun forcing, même si l’appel d’offres s’est déroulé, début 2000, dans un climat de forte compétition. C’était le premier projet européen de ce type, ce qui a suscité des rivalités avec les constructeurs américains et japonais. Il était impossible d’anticiper les difficultés que nous avons rencontrées sur place, où les procédures d’approbation des plans ont été beaucoup plus longues que prévu. Le client devant gérer lui-même les relations avec l’Autorité de sûreté, nous avons engagé un contentieux en lui demandant de nous dédommager à hauteur de 2,7 milliards, coût des interférences négatives qui ont caractérisé le projet. Les premières décisions sur cet arbitrage interviendront début 2015.
M. le président François Brottes. Le client aurait-il sous-traité sa défense à la Cour des comptes ? (Sourires.)
M. Luc Oursel. Nous ne partageons pas la vision de celle-ci sur la conduite du projet OL3. Le client s’est comporté de manière imprédictible. Dans le domaine nucléaire, il est exceptionnel de déclencher un arbitrage pour un montant aussi élevé.
Les questions que soulève la Cour des comptes sur le modèle intégré, nous nous les sommes posées dès 2011, quand nous avons élaboré le plan stratégique « Action 2016 ». Dès lors que celui-ci a été validé par les actionnaires comme par le conseil de surveillance, le sujet ne fait plus débat.
La notion de modèle intégré recouvre en premier lieu la possibilité de signer des contrats liant certaines activités. Celui que nous avons passé en Chine prévoit la fourniture d’EPR comme de combustibles, pendant une durée significative. En second lieu, elle ouvre à nos clients la possibilité de nous commander par un ou plusieurs contrats tous les services et produits qu’exige l’exploitation d’une centrale, de sa construction à son démantèlement. Le modèle intégré a prouvé sa force puisqu’il nous a permis, par une bonne exploitation de notre portefeuille, d’augmenter nos activités nucléaires de 7 % en 2013.
Au début des années 2000, AREVA fournissait 80 % à 90 % de l’approvisionnement d’EDF, qui a dû diversifier ses fournisseurs, dans une optique de mise en concurrence et de sécurité, et afin de respecter les réglementations européennes. Reste que la réduction de notre part ne doit pas remettre en cause l’efficacité de la filière. C’est pourquoi nous voulons signer avec M. Proglio des contrats de long terme, nous réservant dans chaque domaine un pourcentage significatif. Cette position nous permettrait de valoriser les investissements réalisés en France pour renouveler l’appareil productif, par exemple Comurhex II ou Georges Besse II.
M. le rapporteur. Qu’entendez-vous par « pourcentage significatif » ?
M. Luc Oursel. En fonction de la concurrence, on peut prévoir domaine par domaine une fourchette allant de 40 % à 70 % de l’approvisionnement. Pour ces contrats de long terme, nous proposerons à EDF des prix très compétitifs.
AREVA envisage d’entrer au capital du projet de Hinkley Point, qui possède un caractère stratégique dans le redémarrage du nucléaire en Europe. Nous montrerons notre engagement en étant présents, sinon durant toute la vie de la centrale, du moins pendant sa construction. Quand elle aura redémarré, nous serons libres de rester pour des raisons financières ou de valoriser notre participation, ce qui ne devrait pas être difficile.
Le fait que l’investissement soit pris, tout ou partie, dans le fonds dédié ne nous semble pas contradictoire avec l’obligation de fluidité des capitaux, puisque, lorsque la centrale redémarrera, après 2020, il sera aisé de retrouver des repreneurs intéressés par une fraction, voire la totalité de notre participation. La question, qui relève des règles de construction et de gestion des fonds dédiés, a été posée à la direction générale de l’énergie ou du climat (DGEC).
Sur le chantier de Taishan, nous travaillons avec le client chinois, lui-même en relation avec l’Autorité de sûreté chinoise, avec laquelle nous n’avons pas de problème particulier. Cette instance contrôle la qualité des documentations comme du travail réalisé sur le terrain. Elle entend que le design de Taishan se rapproche le plus possible de celui de Flamanville, pour bénéficier du contrôle de l’ASN française et pouvoir à terme coopérer avec elle.
Nous employons sur place 250 personnes, afin de fournir l’ingénierie et les équipements d’une partie de l’îlot nucléaire, mais nous ne sommes pas responsables de l’ensemble de la centrale. Celle-ci est construite par l’entreprise électrique chinoise, qui joue le rôle d’architecte ensemblier. Actuellement, nos ingénieurs finissent les plans et réceptionnent les équipements qui seront mis en place par l’électricien chinois.
Nul ne doute plus de la nécessité de développer une quatrième génération, comme le prouvent les projets lancés aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Inde ou au Japon. Le projet ASTRID fonctionne bien. Quelque 150 ingénieurs travaillent depuis quatre ans dans le cadre de contrats signés avec le CEA, qui joue ici le rôle de pilote. Ils élaborent l’avant-projet sommaire, en se concentrant sur la conception de la chaudière, le système de contrôle-commande et les principaux auxiliaires. Autant d’éléments essentiels en matière de sûreté, car il faut, dans une dynamique positive, que la quatrième génération soit au moins aussi sûre que la précédente.
ASTRID fera à terme l’objet d’une coopération internationale, ce qui semble nécessaire pour des réalisations aussi amples. Reste que, pour s’asseoir en position de force à la table de négociation, il faut avoir travaillé sur certains concepts. La France, seul pays à maîtriser totalement le cycle du combustible dans un réacteur de quatrième génération, apporte nombre d’éléments techniques au projet, auquel sa participation est particulièrement appréciée.
M. le président François Brottes. En matière de quatrième génération, n’est-il pas réducteur de ne travailler que sur ASTRID ?
M. Luc Oursel. Nous avons aussi participé à des programmes américains financés par le Department of Energy. À ce titre, nous pourrions apporter notre expérience si d’autres technologies révélaient des potentiels significatifs. Pour l’heure, c’est la filière du réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium qui semble offrir les plus grandes perspectives.
En 2009, nous avons signé avec le ministère un protocole qui nous engage à surveiller tous les sites de France où l’on a produit de l’uranium naturel, même s’ils n’étaient pas placés sous notre responsabilité. Il s’agit d’une mission de service public, que nous assumons sur nos propres fonds, sans compensation de la part de l’État, pour un montant de 25 millions d’euros par an. Ces sites ne sont pas laissés à l’abandon. Ils sont régulièrement analysés et contrôlés, notamment en matière de radioprotection.
M. Patrice Prat. Quelles sont les conséquences de la pression qu’exercent EDF et le CEA sur les prix ? Il y a quelques semaines, les syndicats du site de Marcoule m’ont interrogé à ce sujet. Quelles sont vos relations avec le CEA, qui, à l’heure où vous réduisez vos effectifs, s’adresse à d’autres prestataires réputés plus compétitifs ? Nul ne nie pourtant l’excellence de vos salariés, qui possèdent, outre leur qualification en matière de démantèlement, la mémoire des installations.
Comment réagissez-vous à la politique de diversification menée par EDF ? Où en sont les discussions pour établir un plan de charge qui préserverait la rentabilité de vos installations ? À quelle échéance celui-ci pourrait-il être finalisé ?
Le mauvais état des comptes d’AREVA ne risque-t-il pas d’hypothéquer vos projets d’investissement ou de réduire votre ambition commerciale ? Comment envisagez-vous de redresser votre situation financière ?
M. Bernard Accoyer. Les réponses de M. Oursel mettent en évidence des éléments que le rapporteur ne souhaitait peut-être va voir surgir, quand il a demandé l’ouverture d’une commission d’enquête. Qui pourrait se plaindre qu’un grand groupe français investisse en Afrique, puisque ce sera le continent du XIXe siècle ? Saluons au contraire le fait qu’AREVA mise sur le développement et la pacification.
Pour construire un EPR en Finlande, l’entreprise a fait preuve d’audace industrielle et commerciale. On dit trop peu souvent qu’elle demande réparation des lourdeurs administratives qui lui ont été opposées.
Dans une activité aussi sensible que le nucléaire, il est bon qu’un groupe ait une activité intégrée, afin qu’il puisse contrôler toute la chaîne, de la production jusqu’au retraitement du combustible et à la gestion des installations.
Je me réjouis qu’AREVA coopère avec la Chine, ce qui suscite l’envie de tous les pays. Les Chinois ne voient aucun obstacle au développement de l’électronucléaire, seul moyen pour eux de diminuer la pollution liée aux combustibles fossiles. Le projet avance vite, grâce aux 250 ingénieurs français qui travaillent sur place. Il ne faut pas brocarder le travail de nos entreprises.
Je souhaite que vous nous rappeliez les raisons pour lesquelles il faut développer la quatrième génération. Disons-le une fois encore : en 1997, pour des raisons purement politiques, la France a renoncé à Superphénix, perdant ainsi, non seulement des années d’avance en matière technologique, mais une somme de 5 ou 10 milliards d’euros.
Par démagogie, les gouvernements font pression pour qu’EDF offre aux consommateurs des tarifs intéressants. Pour les ménages, l’électricité est 80 % moins cher en France qu’en Allemagne. Pour les entreprises, en revanche, elle est meilleur marché en Allemagne, où la plupart des taxes d’accès au réseau ont été supprimées. Le souci de la compétitivité et de l’emploi devrait nous inciter à encourager la filière nucléaire au lieu de la détruire.
M. le rapporteur. Le contrat qu’AREVA a signé avec ATOX, à Fukushima, inclut-il la gestion des eaux contaminées ? Comment réagissez-vous au jugement sévère que porte la Cour sur la gouvernance et le contrôle d’interne d’AREVA ? Des évolutions sont-elles à prévoir au sein de la société ?
M. Luc Oursel. Depuis plusieurs années, le CEA cherche à introduire plus de concurrence dans l’attribution des marchés de démantèlement, ce qui s’est traduit par l’apparition de nouveaux acteurs et par une baisse des prix. Nous souhaitons organiser ces activités dans la durée, en signant des contrats de long terme qui ne soient pas remis en cause. Nous aimerions également que les compétences des personnels soient mieux reconnues, quitte à ce que l’industrie bâtisse des échelles de qualification, qui pourraient servir de critères pour attribuer les appels d’offre. Il faut considérer l’expérience de nos personnels et leur connaissance des sites, gages de la qualité et de la sûreté de leur travail. Autant de critères que le CEA pourrait prendre en compte, s’il renonçait, pour attribuer les marchés, à sa politique du moins-disant.
Sur le site de Marcoule, AREVA travaille en ce sens avec le CEA, en tentant de définir une vision du plan de charge jusqu’aux années 2020. Nous pourrons ainsi gérer la réduction des effectifs et le maintien des compétences, sans avoir à prendre des décisions sociales lourdes.
M. Patrice Prat. Dans quel calendrier s’inscrit la définition du plan de charge ?
M. Luc Oursel. Notre but est d’identifier et de négocier avant la fin de l’année les contrats qui garantiront un plan de charge sur les quatre prochaines années.
Si nous comprenons la politique de diversification d’EDF, nous pensons que c’est un atout pour ce groupe de bénéficier d’un fournisseur aussi fort qu’AREVA, qui mène des opérations en France. L’achat par EDF de services d’enrichissement ou de combustible à l’étranger pèse sur notre balance commerciale et sur l’emploi. Nous lui proposons non de créer un marché captif mais de signer domaine par domaine des contrats de longue durée par lesquels, en contrepartie d’un accord sur les volumes, nous nous engageons sur la productivité. J’espère qu’une partie de ces activités sera couverte à la fin d’année.
Parce qu’il porte sur la période 2006-2012, le rapport de la Cour de comptes ignore l’effort de redressement que nous avons accompli depuis 2011. En 2013, la trésorerie est revenue à l’équilibre, ce qui ne s’était pas produit depuis 2005. Le volume d’investissement, même s’il s’est réduit, reste significatif. En 2013-2014, nous consacrerons 1,3 milliard au renouvellement des capacités de production.
Le plan de redressement intervient alors que le marché du nucléaire reste incertain. Les centrales du Japon n’ayant pas redémarré, il n’y a pas lieu de développer de nouvelles capacités. Pour redresser l’entreprise, nous recherchons la croissance, qui constitue un des bénéfices du modèle intégré. Nous voulons également réduire d’un milliard, c’est-à-dire de 10 %, la base de coûts avant 2015. Nous avons aussi cédé des actifs, pour un total de 1,2 milliard. Enfin, nous avons régulé le programme d’investissement en nous concentrant sur les investissements prioritaires et en reportant les autres. Le plan de redressement ne prévoit aucune réduction d’effectif. Nous avons simplement bloqué certains recrutements et réorganisé le travail pour éviter de renouveler des postes.
AREVA va mieux, sans pour autant aller bien, car nous possédons encore 5 milliards de dettes. S’il n’est pas difficile de nous financer sur le marché, le plan de redressement ayant suscité la confiance des prêteurs obligataires, nous devons réduire l’endettement à l’horizon de 2015-2016. Ainsi, quand le marché redémarrera, nous pourrons envisager des opérations de croissance externe ou reprendre des investissements.
M. le président François Brottes. La situation d’AREVA serait-elle meilleure si la société T&D était restée dans son giron ?
M. Luc Oursel. Non. La rentabilité des activités nucléaires s’est lentement érodée entre 2006 et 2011, ainsi que le relève la Cour des comptes. La cession de T&D a permis de financer des investissements essentiels. Il importait d’améliorer la rentabilité des activités nucléaires.
M. le rapporteur. Les énergies renouvelables, notamment l’éolien offshore, vous ouvrent-elles des perspectives ?
M. Luc Oursel. Pour l’instant, il s’agit seulement de perspectives. En 2013, le chiffre d’affaires des renouvelables s’est monté à 450 millions, et la perte des activités correspondantes à 200 millions. L’année a été très difficile pour le secteur : le marché international s’est contracté, compte tenu des incertitudes pesant sur les systèmes de financement de plusieurs pays. En outre, le démarrage de certains projets a été délicat. Ces difficultés sont sans doute transitoires. L’éolien off-shore doit se développer en chiffre d’affaires et participer à la rentabilité du groupe.
Les enjeux du renouvelable sont tels que nous souhaitons nous développer en partenariat. Ainsi, pour l’éolien offshore, nous avons créé un joint-venture avec une entreprise espagnole. Si nous voulons devenir compétitifs et accompagner la baisse des subventions, nous devons partager l’effort en R&D et créer des champions européens.
Nous sommes présents depuis longtemps au Niger, où nous sommes le premier employeur privé. Nous y investissons et nous y développons nos activités. Le président Issoufou l’a annoncé récemment : nous finalisons avec son Gouvernement des accords qui nous permettront de continuer à travailler sur place.
Il faut croire que le modèle intégré est intéressant, puisqu’il est copié par d’autres sociétés, notamment russes ou japonaises, qui entendent proposer un ensemble de services aux entreprises électriques. Nous identifions deux grands domaines de synergie : la R&D et le commerce.
Le principal intérêt de la quatrième génération tient à la meilleure utilisation des matières en amont des centrales – uranium naturel, isotopes – et en aval – MOX, uranium appauvri issu du retraitement. Elle renforcera donc l’indépendance en matière d’approvisionnement.
Nous avons signé un joint-venture avec ATOX, entreprise japonaise de taille moyenne spécialisée dans le démantèlement, afin d’augmenter nos activités sur le site de Fukushima, particulièrement pour le traitement de l’eau et le suivi des stockages.
L’organisation de la gouvernance – du conseil de surveillance et du conseil d’administration – incombe à l’actionnaire. En revanche, nous avons pris nombre de mesures depuis 2011 afin de renforcer la gouvernance interne. Ainsi, nous avons créé des comités spécialisés, qui s’assurent de la qualité des offres, surveillent le bon déroulement des grandes œuvres et des grands projets, valident le niveau de nos réserves et ressources minières, ou identifient les risques qui pèsent sur nos activités.
M. le président François Brottes. Êtes-vous en contact avec Alstom, General Electric ou Siemens sur le dossier nucléaire ou celui de l’éolien off-shore ?
M. Luc Oursel. En la matière, nos relations avec les éventuels repreneurs d’Alstom sont pilotées et coordonnées par l’État. Nous avons signalé au Gouvernement deux sujets importants. Le premier concerne les activités nucléaires. Alstom fournit la turbine de cinq EPR sur six – quatre en construction et deux projetés. Le second est l’éolien. À cet égard, si des opportunités apparaissaient à terme, nous serions prêts à les examiner, compte tenu de notre ambition en matière d’énergies renouvelables.
M. le président François Brottes. Je vous remercie.
Audition de Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
(Séance du 21 mai 2014)
M. le président François Brottes. Nous accueillons aujourd’hui Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie.
Nous sommes à la fin de nos travaux, dont l’approche a été assez pragmatique : nous nous sommes successivement intéressés au minerai, à sa transformation, à son retraitement, au fonctionnement des réacteurs, à leur maintenance, puis aux déchets et au projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Nous avons également fait de nombreux déplacements, à Tricastin, La Hague ou Fessenheim notamment.
Ces travaux servent aussi de préambule au débat sur la future loi sur la transition énergétique.
Je rappelle que la Cour des comptes viendra nous apporter les éléments complémentaires que nous lui avons demandés le 27 mai prochain.
Madame la ministre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Ségolène Royal prête serment)
M. Denis Baupin, rapporteur. Cela fait en effet plus de cinq mois que nous travaillons dans le cadre de cette commission d’enquête. J’aimerais vous poser plusieurs questions.
S’agissant du parc nucléaire, nombre de nos interlocuteurs ont invoqué la nécessité d’un mur d’investissements face auquel se retrouverait aujourd’hui l’opérateur historique pour l’entretien des réacteurs ou les mises aux normes : à combien le Gouvernement les évalue-t-il et quel choix stratégique préconise-t-il ? Le rapport de la Cour des comptes de fin 2011 disait que les choix implicites faits par l’État jusque-là conduisaient à privilégier la prolongation des réacteurs existants plutôt que la création de nouveaux : est-il normal que ces choix soient faits implicitement par l’opérateur ? Comment le Gouvernement se positionne-t-il à cet égard, notamment dans le cadre de la loi ?
Deuxièmement, comment appréhendez-vous la question de la réduction du nucléaire à 50 % du mix électrique à l’horizon 2025, qui passe par la disparition d’une vingtaine de réacteurs ? Comment sera-t-elle traduite dans la loi ?
Troisièmement, concernant la sûreté des installations nucléaires, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a émis un jugement global assez satisfaisant, évoquant une note de 12 à 13 sur 20. Qu’en pensez-vous ? Des efforts supplémentaires doivent-ils être faits dans ce domaine ? Que peut prévoir la loi, notamment pour renforcer les moyens humains, juridiques et financiers ?
Quatrièmement, la fermeture du réacteur nucléaire de Fessenheim soulève la question de l’alimentation électrique du territoire, mais aussi celle de l’accompagnement social des personnes et économique au plan local. Quel devrait être le rôle de l’État sur ce point, notamment dans le cadre des contrats de plan État-régions ?
Se pose aussi le problème des charges futures du nucléaire, concernant en particulier les déchets et le démantèlement, sachant que nous devons sécuriser les financements. Il est par exemple proposé que des provisions alimentent à cet effet un fonds de la Caisse des dépôts et consignations : qu’en pensez-vous ?
S’agissant des déchets, nous ne savons toujours pas, malgré nos multiples auditions, à combien on peut évaluer le coût du projet Cigéo, dont le chiffrage varie selon les sources entre 15 et 26 milliards d’euros. Quelle est votre propre évaluation ? Et quelle est la position de l’État au regard des propositions formulées par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) lors de son dernier conseil d’administration, à savoir la mise en place d’une phase pilote avant de décider de l’éventuelle construction du site ?
Enfin, quelle est la doctrine de l’État s’agissant du retraitement et de la fabrication du MOX ? Nos interlocuteurs nous ont dit en effet que stocker en l’état les combustibles usés ne reviendrait pas plus cher que de mettre en place cette fabrication, sachant que l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) s’interroge sur l’utilité de cette dernière s’il n’y a pas un jour une quatrième génération de réacteur ? Quelle est à cet égard votre position sur la question de cette quatrième génération – notamment le prototype ASTRID –, dont l’ASN estime qu’elle devrait permettre un saut technologique pour la réutilisation des matières et en termes de sûreté ?
Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. Je vous remercie de votre accueil et vous félicite de votre initiative, qui intervient à un moment crucial, puisque nous allons avoir à débattre de la loi sur la transition énergétique. Il est en effet important de se pencher sur le coût de production de l’énergie pour éclairer les choix du Parlement et du Gouvernement, dans le cadre d’un dialogue que je souhaite le plus fructueux possible. Faire un bon diagnostic sur les choix du passé permet de déterminer les choix d’aujourd’hui et de demain. La France doit inventer un nouveau modèle énergétique : nous devons tenir compte à cet égard à la fois de la situation financière et de la situation économique des entreprises, la mutation énergétique étant une grande chance pour notre pays.
Nous sommes dans ce domaine observés par le monde entier, dans la mesure où nous tiendrons l’an prochain à Paris la conférence mondiale sur le climat.
Je rappelle que la production électrique française est dominée par l'électricité d'origine nucléaire. C'est le fruit d'un choix politique majeur des années 1970, poursuivi tout au long de la décennie 1980 notamment, pour réduire notre dépendance énergétique aux énergies fossiles.
Ainsi, notre taux de dépendance est de 50 %, contre une moyenne européenne et mondiale aux alentours de 80 %.
De même, notre pays est un des plus vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre – en moyenne 8 tonnes par an et par habitant contre 12 dans le reste de l’Europe.
Enfin, la filière nucléaire est une filière industrielle importante reconnue mondialement, avec près de 200 000 emplois et des savoir-faire exceptionnels.
Mais le contexte change : nous devons le prendre en compte, en réduisant encore notre dépendance aux ressources non renouvelables, en nous adaptant toujours plus aux risques du changement climatique et en faisant des choix financiers judicieux vis-à-vis de ce nouveau mix énergétique que nous devons mettre en place.
Si le nucléaire a des avantages, on ne doit pas masquer certains inconvénients. Des tragédies comme Tchernobyl ou Fukushima l’ont fragilisé et nous dictent l'ardente obligation de placer la sûreté nucléaire au premier rang de tous les enjeux. Le projet de loi de transition énergétique proposera donc des mesures améliorant encore notre niveau de sûreté. J'en profite pour saluer à cet égard l'action de l'ASN et de l’IRSN.
En outre, la filière nucléaire est confrontée à la gestion des déchets radioactifs. Le Parlement s'en est préoccupé très tôt, la dernière loi datant de 2006. Le projet de loi en préparation poursuivra cette démarche. Il nous faudra à ce sujet confirmer le principe de la réversibilité de Cigéo.
De même, nous tirerons les leçons du débat public qui vient de se dérouler, en vous proposant d'acter une phase préalable d'expérimentation.
Par ailleurs, tout le monde convient que les réacteurs en fonctionnement ont, par définition, une durée de vie limitée. En effet, on ne peut changer la cuve, ni l'enceinte de confinement d'un réacteur.
Il y a certes débat sur cette durée de vie. Mais il nous faut prévoir dès à présent les provisions nécessaires aux démantèlements futurs. Permettez-moi d'ajouter qu'une approche pratique du coût du démantèlement, en commençant par les deux premières unités, me paraît le meilleur moyen de ne pas connaître trop d'approximation.
Enfin, l'énergie nucléaire est adaptée à la production d'électricité en « base ». Or, elle dépasse aujourd'hui largement nos besoins.
La transition énergétique passe par une nouvelle vision de la place du nucléaire dans notre pays.
En fixant la part de cette énergie à 50 % de notre production d'électricité à l'horizon 2025, le Président de la République a tenu à rechercher cet équilibre, qui est celui d'une diversification, d'un nouveau mix.
Cela passe d'abord par un développement ambitieux et raisonné des énergies renouvelables. C'est une opportunité industrielle et écologique, y compris pour des entreprises comme EDF, qui se positionne par exemple sur l’éolien offshore.
Le choix d’un socle de production nucléaire à 50 % s'appuie d'abord sur ce que nous ont légué nos prédécesseurs en termes d'outil de production. C’est un atout dans la transition qui s'engage car cela nous évitera de devoir, à l'instar de nos voisins allemands, développer le thermique au charbon pour faire face aux besoins de consommation ou aux intermittences.
Enfin, il nous faudra enrichir les moyens de production de base par de nécessaires innovations à court et moyen terme. Je pense notamment aux capacités d'effacement, à l'autoconsommation et, à moyen terme, au stockage de l'énergie.
En matière européenne, il nous faudra toujours mieux veiller à nos capacités d'interconnexions pour renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe.
Par ailleurs, s’agissant des dépenses publiques en faveur du nucléaire, elles ont fait l’objet d’un recensement exhaustif de la Cour des comptes en 2012, qui se poursuit. Celle-ci a précisé qu’en 2010, les dépenses récurrentes sur crédits publics étaient d’un montant limité, proche de celui de la taxe sur les installations nucléaires de base. Cette situation est toutefois nouvelle : de fortes dépenses publiques dans la recherche ont été financées par le passé. Au-delà de ces dépenses récurrentes en baisse, des projets sont soutenus par le programme des investissements d’avenir : 50 millions d’euros pour la sûreté nucléaire, 75 millions pour la gestion des déchets, 250 millions pour le réacteur de recherche Jules Horowitz et 625 millions pour le projet ASTRID, c’est-à-dire le développement d’un démonstrateur de réacteur rapide au sodium.
Le maintien d’une capacité de recherche de pointe au sein de l’État est essentiel pour la préservation de sa capacité de décision en vue de préparer l’avenir, garantir l’avance technologique française et conserver un haut niveau de sûreté. Je veillerai à ce que ces efforts soient maintenus.
S’agissant des charges de long terme, le Gouvernement est attentif à ce que le dispositif de couverture par des actifs dédiés soit robuste, crédible et contrôlé. Les ministres de l’énergie et de l’économie sont conjointement chargés du contrôle. Nous sollicitons également l’avis de l’ASN.
J’ai commandé un audit sur les provisions de démantèlement du parc en exploitation. Le processus de sélection des entreprises est en cours : l’audit démarrera en juin prochain et se terminera en avril 2015. Il est important d’examiner les devis en détail pour se forger une opinion. Ces travaux seront évidemment communiqués à votre assemblée, sachant que le déroulement de l’audit tiendra compte de vos conclusions.
Le décret modificatif du 24 juillet 2013 inscrit le dispositif particulier du nucléaire dans un dispositif plus large et robuste, qui est celui du contrôle prudentiel des assurances. Les règles seront mieux stabilisées et ne pourront plus faire l’objet de modifications opportunistes. Il revient aux entreprises d’assurer cette charge et de gérer les placements. Le ministère souhaite à cet égard renforcer le contrôle en s’appuyant sur l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en charge du contrôle des assurances et des banques.
S’agissant de la sûreté, à la suite de l’accident de Fukushima, l’ASN a conduit des évaluations complémentaires et formulé un certain nombre d’exigences sous forme de décisions notifiées à l’exploitant à l’été 2012. Elle demande d’ailleurs des moyens d’action supplémentaires, notamment la possibilité d’ordonner certains contrôles – je vous proposerai probablement d’aller dans ce sens lors du débat sur le projet de loi sur la transition énergétique. Elle a également réclamé un renforcement des marges par la mise en place d’un noyau dur de dispositions matérielles et organisationnelles permettant de maîtriser les fonctions de sûreté dans des situations extrêmes.
EDF, qui est le plus impacté, estime le montant total des travaux à environ 10 milliards d’euros, dont la moitié aurait été de toute façon dépensée pour des améliorations de sûreté en l’absence d’un tel accident.
Concernant les coûts du grand carénage – correspondant à toutes les opérations de maintenance lourde –, je rappelle que l’âge moyen du parc nucléaire français est aujourd’hui proche de 30 ans : pour redresser les performances industrielles, se mettre au niveau de sûreté demandé par l’ASN et permettre l’allongement de la durée d’exploitation jusqu’à 40 ans et au-delà, EDF va engager des travaux importants sur l’ensemble de ses centrales. Ces investissements s’élèveraient à 55 milliards d’euros pour la période 2014-2025. Cela correspond à un doublement, voire un triplement des investissements de maintenance et fait suite à une période très faible d’investissement dans les années 2000, qui a permis de faire baisser les prix mais aussi les performances…
Ces sommes doivent être relativisées au regard des investissements totaux d’EDF, puisqu’en 2013, 9,9 milliards d’euros ont été prévus en France – dont 3,5 milliards pour les réseaux de distribution, 1,4 milliard pour les réseaux de transport et 5 pour les activités non régulées – et 13,3 milliards à l’international.
Au sujet de Cigéo et du stockage réversible en couches géologiques profondes des déchets radioactifs, il est de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures de mobiliser les meilleures techniques disponibles et les moyens financiers suffisants pour gérer au mieux ces déchets. Cela doit se faire en associant toutes les parties prenantes, notamment au plan local.
Ce projet est un des éléments de la solution à condition de respecter un certain nombre de principes, dont la sûreté du stockage – le débat public qui s’est tenu en 2013 a conclu à l’intérêt de commencer par une phase d’exploitation pilote et de desserrer le calendrier. L’ANDRA a également annoncé les suites positives qu’elle donne aux conclusions du débat. Le projet de loi de transition énergétique proposera des adaptations du calendrier du projet et un traitement plus rapide de la question de la réversibilité.
L’évaluation du coût est en cours de réalisation par l’ANDRA et sera disponible l’été prochain, après l’avis de l’ASN et les observations de producteurs de déchets. Dans ce domaine, la transparence est importante et nous permettra de faire clairement les différents choix d’investissement.
Il ne serait pas non plus inutile de s’interroger sur les coûts des énergies renouvelables, par type d’énergie, pour orienter les choix publics en vue de trouver le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure sécurité, la meilleure indépendance et le meilleur équilibre de mix énergétique nous permettant de remplir nos obligations internationales.
M. Bernard Accoyer. Force est de reconnaître que le rapporteur a surtout conduit cette commission d’enquête comme une opération à charge contre la filière nucléaire. En même temps qu’il se constituait une banque de données pour continuer son opération militante, il a orienté les questions et choisi les personnes auditionnées de façon partiale, ce qui est préoccupant pour l’objectivité du travail de notre commission.
Madame la ministre, j’ai noté avec satisfaction l’attention que vous portez à notre filière nucléaire, dont vous avez souligné l’excellence sur la scène internationale et les bons résultats en termes de rejet de CO2 et de gaz à effet de serre.
On a d’ailleurs oublié d’invoquer cet atout dans la négociation de l’objectif du triple 20 : alors que la France rejette à peu près un tiers de moins de CO2 que les autres pays de l’Union européenne, elle s’est placée sur un pied d’égalité, rendant l’atteinte de cet objectif plus difficile. Il est d’ailleurs paradoxal d’essayer d’améliorer nos rejets et de s’en prendre en même temps à la filière nucléaire, comme certains le font.
Existe-t-il un lien entre la mise en œuvre du réacteur pressurisé européen (EPR) et la fermeture annoncée d’une centrale de première génération ?
La décision de fermer la centrale de Fessenheim est-elle définitivement arbitrée ? Sur quelles bases en termes d’expertise technologique, financière et sociale ? Pourquoi cette centrale a-t-elle été choisie, alors que de l’avis unanime des experts elle a fait l’objet de tous les travaux nécessaires à sa maintenance et sa sûreté ?
Par ailleurs, qui va payer ce démantèlement ? Comment sera-t-il financé ? On a pu estimer à au moins 8 milliards d’euros les conséquences de cette fermeture, compte tenu de l’indemnité pour les trois actionnaires, du coût des travaux de démantèlement, ainsi que de la construction de nouvelles centrales thermiques pour fournir l’Alsace en électricité et de la mise en place de nouveaux réseaux.
Forts de l’expérience allemande, montrant que restreindre l’avenir de la filière nucléaire conduit à augmenter les rejets en carbone et à accroître le montant des factures – les foyers allemands payant l’électricité 80 % plus cher que les français –, n’est-il pas surprenant de décider une telle fermeture ?
En outre, comment à la fois demander 50 milliards d’euros d’économies et engager ainsi 8 milliards d’euros de dépenses supplémentaires ?
A-t-on évalué les conséquences de la fermeture de Superphénix ? Y êtes-vous favorable ?
Enfin, comment l’État français entend-il pallier les effets de cette commission d’enquête, qui a montré que si les installations nucléaires françaises étaient particulièrement sûres, leur sécurité vis-à-vis des actes malveillants a été mise à mal par des détails qu’elle a apportés à plusieurs reprises sur un certain nombre de points ?
Mme Frédérique Massat. Concernant l’information locale des populations vivant à proximité des centrales, les commissions locales d’information nous ont fait part de leurs difficultés à exercer leurs missions, notamment par manque de moyens. Elles souhaitent que la loi puisse, le cas échéant, améliorer l’information du public au regard du risque nucléaire. Le projet de loi prévoit-il des mesures en la matière ?
Par ailleurs, l’État se retrouve aujourd’hui en position d’assureur en dernier ressort – on nous a parlé à cet égard d’un coût de 700 millions d’euros par an, soit 78 milliards d’euros sur quarante ans –, sans répercuter le coût de cette garantie sur l’exploitant. Une telle répercussion pourrait en effet entraîner une hausse des tarifs. Quelle est la position du Gouvernement sur ce point ?
M. Michel Sordi. Madame la ministre, dans votre région, vous vous êtes battue comme une lionne pour défendre vos entreprises et vos emplois, et, dans ma circonscription, on veut fermer la belle usine de Fessenheim, qui emploie 2 200 personnes et est conforme à la réglementation : vous pouvez donc me comprendre !
Cette fermeture est une triple erreur. Économique, d’abord, au regard des conséquences sur le secteur en termes de vente de logements, de fermeture de classes ou de commerces, mais aussi parce qu’il va falloir indemniser l’exploitant et nos partenaires suisses et allemands et que, selon un rapport, cet arrêt ne permettra pas d’écrêter les pointes de consommation – nous aurions un problème de fourniture et de qualité qui viendrait impacter d’autres entreprises électro-intensives installées dans la plaine d’Alsace. Une erreur sociale, ensuite, en raison de la suppression de 2 200 emplois, sachant que la fermeture est prévue dans deux ans et qu’il n’y a pour l’instant aucun projet de substitution. Enfin, une erreur environnementale, car nos voisins allemands ont, du fait de la réduction du nucléaire, augmenté leur production de CO2 de 13 % au cours de l’année passée.
Ne faut-il donc pas repousser la fermeture de Fessenheim pour nous laisser le temps de mettre en place un plan de reconversion du site ? Je rappelle que l’autorisation d’exploitation de l’usine a été prolongée de dix ans et que l’exploitant ne souhaite pas pour l’instant la fermer.
M. Éric Straumann. Monsieur le rapporteur, les élus locaux et les salariés sont contre cette fermeture prématurée.
Madame la ministre, la fermeture de Fessenheim fera-t-elle l’objet d’un article dans la prochaine loi sur la transition énergétique ? Combien coûtera-t-elle ?
M. Stéphane Travert. Les salariés de la filière nucléaire souhaitent que leur travail soit reconnu, que ce soit sur les sites de production ou les sites de construction de l’EPR de Flamanville.
Je rappelle que pendant dix ans nous n’avons guère construit de centrales, ce qui a entraîné une petite perte de savoir-faire. Comment voyez-vous la continuité de la troisième génération pour pallier les demandes de production croissantes et les fermetures programmées, en attendant la montée en puissance des énergies marines renouvelables ?
M. Hervé Mariton. Le projet de loi de transition énergétique conduira sans doute à l’horizon 2025 à la fermeture, hélas, de Fessenheim et d’autres réacteurs. Quand le Gouvernement a-t-il prévu de présenter l’analyse économique et financière de cette décision, au-delà de la question du démantèlement ? Le fera-t-il dans l’étude d’impact ? Ce choix anticipé a en effet un coût, qu’il convient de connaître.
Se pose aussi la question de l’indemnisation de l’opérateur. EDF est une société cotée : elle n’aurait pas le droit de ne pas demander une indemnisation liée à une décision résultant du fait du prince. De même que pour une nationalisation, une telle décision exige de fait une juste et préalable indemnisation. Quand le Gouvernement fera-t-il connaître sa position sur le montant de celle-ci ?
M. Patrice Prat. Je rappelle que nous avons vu également le site de Marcoule, qui concentre les ressources et qualifications nécessaires pour être le pôle d’excellence du démantèlement en France et peut accueillir le prototype ASTRID.
Madame la ministre, je salue vos déclarations récentes selon lesquelles il ne faut pas opposer le nucléaire et les énergies renouvelables.
Pouvez-vous nous préciser le scénario retenu par l’État sur l’évolution de la demande d’électricité, qui peut avoir des conséquences directes sur la situation économique et le maintien du parc nucléaire ?
Par ailleurs, je suis préoccupé par la politique d’EDF et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur les prix pratiqués dans le cadre des appels d’offre, qui tendent à faire pression sur d’autres acteurs de la filière, notamment Areva pour l’exploitation des installations de démantèlement – ce qui n’est pas sans conséquence sur l’emploi, la sécurité et la sûreté. En ayant recours à des prestataires extérieurs qui n’ont pas forcément les mêmes qualifications et expérience, on pourrait en effet jeter le discrédit sur cette filière d’excellence. Quelles sont vos préconisations en la matière ?
M. Jean-Louis Costes. La montée en puissance des énergies renouvelables ne suffira pas à pallier la baisse de la production électrique liée à la fermeture de centrales à terme. Êtes-vous donc favorable à la construction de nouvelles centrales nucléaires dans des conditions maximales de sécurité ?
M. le rapporteur. Je répète que le rapport de la Cour des comptes sur les coûts du nucléaire disait qu’implicitement, l’État avait décidé de prolonger les réacteurs en activité plutôt que d’en construire de nouveaux. Celui-ci exerce-t-il son rôle, notamment de stratège et d’actionnaire principal des entreprises de la filière nucléaire ? Le projet de loi sur la transition énergétique tend-il à le lui permettre, qu’il s’agisse de la création, de la réglementation ou de la prolongation d’installations ?
Mme la ministre. Monsieur Accoyer, je salue au contraire les compétences du rapporteur, car on n’osait pas jusqu’ici aborder ces sujets. Le choix de la France avait été tellement massif en faveur de l’énergie nucléaire que plus personne ne se risquait à le contester. Je le dis d’autant plus aisément que je ne pense pas, au contraire du rapporteur, que l’on puisse sortir du nucléaire. Ce débat est fructueux car il nous permettra de justifier nos choix devant l’opinion publique, et ce, pour la première fois dans l’histoire de notre pays.
Cela est d’autant plus attendu par les Français qu’ils contestent vigoureusement la hausse de leurs factures d’électricité. Il est choquant en effet d’entendre que cette hausse est inéluctable alors qu’on leur dit que notre énergie nucléaire est performante. Je remets en cause ce dogme et je demande à voir pourquoi ces factures augmentent et pour quelle raison la Commission de régulation de l’énergie (CRE) est obligée de prendre des décisions en fonction du calcul des coûts de l’énergie communiqués par les grands énergéticiens. Je souhaite que la représentation nationale ait aussi son mot à dire et le droit à la transparence sur la formation de ces coûts.
Je suis d’ailleurs en train de réformer le décret sur la fixation du prix de l’énergie et de regarder de très près les motifs de l’augmentation annoncée pour le 1er juillet prochain, afin de la remettre en cause.
M. le président François Brottes. Je précise que le groupe socialiste prendra l’initiative dans les jours qui viennent d’une demande d’une commission d’enquête sur les tarifs de l’électricité.
Mme la ministre. Je n’opposerai pas les énergies les unes aux autres. Les choix sur le nucléaire ont été faits pendant des années, avec parfois des effets négatifs, car la production était tellement supérieure à la consommation que les Français ont cru que l’énergie serait bon marché et pléthorique ad vitam aeternam. C’est la raison pour laquelle nous sommes le pays le moins performant en matière d’isolation, de performance énergétique et de lutte contre les gaspillages d’énergie. Nous avons par là même pris beaucoup de retard par rapport à des pays qui avaient une énergie rare et chère et ont su développer des filières dans le bâtiment et des énergies renouvelables plus performantes, se positionnant ainsi à l’international sur des marchés créateurs de beaucoup d’activité et d’emplois.
En outre, avoir un discours d’opposition vis-à-vis de l’énergie nucléaire conduit à mettre en cause la dignité de milliers de salariés de la filière. Cela est d’autant moins acceptable que la France doit honorer un certain nombre de commandes internationales et qu’il faut assurer une continuité de l’État, indépendamment des choix énergétiques.
Nous sommes maintenant à un tournant : après les catastrophes nucléaires, la demande mondiale dans ce domaine est en train de baisser. L’État est actionnaire à 85 % de l’opérateur nucléaire : nous devons donc orienter judicieusement l’allocation optimale des ressources publiques, de manière visionnaire – par rapport à ce que seront la demande énergétique mondiale, les évolutions technologiques et les contraintes liées aux différentes formes d’énergie.
J’ai engagé avec EDF un travail sur cette vision de l’avenir et lui ai demandé d’y réfléchir avec ses dirigeants, qui sont actifs en la matière et conscients des positionnements internationaux à prendre, des enjeux industriels et du fait que l’État va mieux exercer ses responsabilités d’actionnaire. Nous convergeons vers l’idée que, d’ici 2025, il n’y aura pas de forte croissance de la demande intérieure d’électricité. Nous nous y engageons car la performance énergétique passe d’abord par les économies d’énergie.
La montée en puissance ambitieuse des énergies renouvelables devra parallèlement s’accompagner d’une évolution de la place de l’énergie nucléaire. Je souhaite que ce mix énergétique soit mis en œuvre collectivement. J’observe à cet égard qu’EDF, Areva ou Alsthom se positionnent de plus en plus sur les énergies renouvelables même si, paradoxalement, ils l’ont fait beaucoup moins en France que dans d’autres pays, qui ont capté le savoir-faire des industriels français.
Nous sommes confrontés à une course à l’innovation, comme le montre par exemple la nouvelle génération des parcs éoliens offshore avec des éoliennes flottantes, plus rapidement installées et moins nocives pour les écosystèmes marins, ou le positionnement d’entreprises comme DCNS sur l’hydrolien, notamment dans les mers chaudes, en couplant la récupération de chaleur et l’énergie marine. Il ne faut pas que nos grandes entreprises industrielles se figent sur un modèle passé et ratent ce tournant important de la conquête de nouveaux marchés mondiaux, de nouvelles technologies et de nouvelles innovations. Ce débat sur les choix énergétiques est crucial.
En tant que responsables de la bonne allocation des investissements publics et de la définition de notre modèle énergétique, nous devons montrer la voie de l’avenir et y entraîner les entreprises. C’est tout l’enjeu du prochain projet de loi.
Il serait donc regrettable que ce débat politique se focalise sur la question de l’énergie nucléaire et que celle-ci devienne un enjeu politicien. À cet égard, les questions que vous avez posées sont parfaitement légitimes et, même au sein du parti socialiste, il y a des divergences de vues. Je souhaite que nous ayons des groupes de travail spécifiques afin de nous permettre de répondre aux questions que se posent les Français au moment du vote de la future loi : allons-nous être efficaces sur la performance énergétique ? Les transports propres ? La montée en puissance des énergies renouvelables ? La question de la pollution de l’air ? Qu’allons-nous être capables de changer dans la vie quotidienne des Français pour maîtriser le coût de l’énergie et les rendre davantage citoyens dans les choix énergétiques, grâce par exemple aux compteurs intelligents ? Comment allons-nous pousser en avant nos filières industrielles, leur donner la possibilité de créer des activités et des emplois, sachant que le seul levier de la croissance aujourd’hui est la croissance verte ?
Je relève d’ailleurs que sur les 34 plans industriels prévus, 10 relèvent de la transition énergétique. Il faut donner de la visibilité à ces filières industrielles et les moyens d’investir et de créer des emplois en leur garantissant une commande publique, en leur donnant des règles juridiques et fiscales stables, en simplifiant les procédures, en réduisant les délais de recours et en sécurisant ainsi la décision juridique. Il n’y a aucune raison qu’en Allemagne, qui protège aussi bien son environnement que nous, les délais de recours soient quatre fois moins longs qu’en France.
S’agissant de la fermeture de Fessenheim, je comprends parfaitement vos inquiétudes, mais il y a des solutions, sachant que d’autres centrales arriveront à la fin de leur vie dans les années qui viennent.
On sait aujourd’hui qu’avec les normes nouvelles de sécurité, cette centrale ne serait pas construite – comme beaucoup d’autres du reste. Nous la fermons en premier car c’est la plus ancienne – je rappelle par exemple que son fond est d’1,5 mètre au lieu de 8. Le commissaire général à l’énergie atomique ne conteste d’ailleurs pas ce choix.
Je vous propose que nous en discutions dans le cadre d’un groupe de travail spécifique avec les représentants des salariés de la centrale et que nous mettions toutes les questions sur la table.
C’est d’ailleurs peut-être une chance pour Fessenheim d’être la première à fermer. Il y a aujourd’hui dans le monde 400 centrales à démanteler, ce qui constitue un marché considérable, que la France pourrait conquérir. Nous avons donc besoin d’un site expérimental menant toutes les opérations du démantèlement, du début à la fin. Fessenheim pourrait ainsi devenir un pôle d’excellence du démantèlement des centrales et permettre à EDF de se positionner sur le marché mondial. Il faut voir dans quelle mesure on pourrait par ce biais maintenir sur le site les emplois actuels.
Plus les transitions sont rapides, plus elles rapportent et moins elles coûtent. La fermeture de la centrale peut ne rien coûter si on se positionne sur un projet industriel d’avenir ; elle pourrait même rapporter.
M. Hervé Mariton. Pourrez-vous nous communiquer le montant précis du coût de la fermeture et des gains engendrés par le nouveau projet ?
Mme la ministre. Oui et il faudra présenter ces données sur plusieurs années. Comme elle s’est positionnée dans le passé sur son savoir-faire nucléaire, la France peut aujourd’hui se positionner sur le savoir-faire de la gestion de la durée de vie des centrales et l’émergence des centrales de nouvelle génération. Au vu de la demande mondiale, celle-ci correspond à des centrales de plus petite taille, plus proches et s’inscrivant dans le cadre d’un mix énergétique, avec une offre également dans les domaines de l’éolien, du solaire ou de l’hydrolien en fonction des caractéristiques et de la localisation des pays. On le sait depuis la catastrophe de Fukushima : ne proposer que le nucléaire est une impasse.
Monsieur Mariton, je vous propose que nous organisions rapidement une réunion technique pour voir comment accompagner cette mutation.
M. Michel Sordi. Lorsqu’il y a quelques mois, un appel d’offre sur le solaire a été lancé à l’échelon national, le sud l’a emporté, au détriment de l’est. Il eût été logique que celui-ci soit davantage positionné. Il faut aussi prendre en compte d’autres paramètres, comme la question du transport de l’énergie.
Par ailleurs, on n’aura jamais de projet de substitution en vingt-quatre mois. Nous allons être confrontés à un choc économique avec la fermeture de Fessenheim alors qu’on pourrait se donner davantage de temps. Cela dit, je suis tout à fait disposé à vous rencontrer pour approfondir la question.
M. Éric Straumann. Je répète ma question : la fermeture de Fessenheim fera-t-elle l’objet d’un article de la prochaine loi sur la transition énergétique ? Quelle en sera la base juridique ?
Par ailleurs, une étude d’impact est-elle en cours d’élaboration ?
M. Jean-Louis Costes. Je vous remercie, madame la ministre, de votre position en faveur de petites centrales s’inscrivant dans le cadre d’un mix énergétique.
M. Hervé Mariton. Au-delà des opportunités évoquées, la fermeture de Fessenheim a un coût économique, qu’il convient encore une fois de connaître. On a pu observer qu’EDF ne donne pas beaucoup de détail à cet égard, comme l’a montré l’audition de son président, que j’avais interrogé sur ce point.
Je précise que Marc Goua et moi-même avons prévu, en tant que rapporteurs spéciaux de la commission des finances, de présenter à celle-ci d’ici quelques semaines un rapport qui s’intéressera au coût de cette fermeture et à celle d’autres réacteurs.
Mme la ministre. Au sujet de Fessenheim, je vous propose encore une fois de créer un groupe de travail, dans lequel je m’impliquerai personnellement avec EDF.
Je répète également que nous devons saisir l’opportunité de conquérir l’important marché de démantèlement des centrales.
Aujourd’hui, le coût de démantèlement de Fessenheim, qui est évalué à un montant de 400 à 500 millions d’euros, est provisionné. Il faut que les entreprises du territoire se positionnent pour mettre en œuvre cette opération et que les sous-traitants soient correctement payés par les grands donneurs d’ordre qui obtiendront les marchés correspondants. Il convient également de calculer ce que seront les retombées de ce vaste chantier sur le territoire. Enfin, il faut accélérer la mise en place d’un pôle d’excellence de démantèlement des centrales, que je souhaite voir installé à Fessenheim, de manière que ce qui est ressenti comme un préjudice ou une injustice soit considéré comme une chance. Nous pouvons mettre sur pied à cet égard un groupe de travail de préfiguration de ce pôle, impliquant le préfet, de manière à voir comment il peut animer les parties prenantes sur le territoire. Je souhaite, en tout cas, qu’au moment du débat sur la future loi, ce problème soit réglé de façon positive.
Quand on freine des mutations évidentes, on en paye douloureusement le coût, mais quand on les accélère dans le cadre d’un projet commun, on crée des valeurs ajoutées et des énergies positives.
M. Éric Straumann. Encore une fois, sur quelle base juridique la centrale sera-t-elle fermée ? La décision sera-t-elle prise par décret ou dans le cadre de la future loi ?
Mme la ministre. Je souhaite que la décision soit prise contractuellement, sur la base d’un projet, entre l’État, EDF et les élus locaux. Je pourrais certes prévoir une disposition dans la loi à cet effet, mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je souhaite que l’on se mette d’accord avant l’adoption de la loi, quitte à prévoir ensuite dans celle-ci des dispositions nécessaires au bon déroulement du projet.
J’emploierai en tout cas toute ma capacité de conviction à l’égard de la direction d’EDF pour que ce problème soit réglé de cette façon.
M. Éric Straumann. Les collectivités locales seront-elles associées ?
Mme la ministre. Elles feront naturellement partie du groupe de travail. Nous ferons très rapidement des propositions à cet égard.
M. le président François Brottes. Je vous remercie.
DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU RAPPORTEUR
Les documents mis à la disposition du rapporteur sont accessibles sur le CD.
© Assemblée nationale