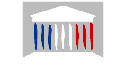______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre,
PAR M. Dominique POTIER
Député
Voir les numéros : 2625 et 2627.
SOMMAIRE
___
Pages
PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5
INTRODUCTION 7
I. INCITER LES ENTREPRISES MULTINATIONALES À PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME ET À L’ENVIRONNEMENT 10
A. LA NÉCESSITÉ DE L’ACTION POLITIQUE 12
a. L’abolition de la traite négrière occidentale, exemple de succès de démarches nationales 16
b. La protection des ouvriers face aux accidents du travail, exemple d’organisation de la responsabilité de l’entreprise par la loi 17
c. Le reporting extra-financier, exemple de la capacité d’entraînement de la France en Europe 20
3. L’attente manifeste d’une évolution législative 23
B. UNE ÉVOLUTION DU DROIT VERS UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITÉ DES GROUPES DE SOCIÉTÉS 25
1. Le principe d’autonomie de la personnalité juridique 26
2. Des atténuations toujours plus fréquentes 27
a. Des exceptions admises dans divers domaines du droit 27
b. Une accélération récente en matière de responsabilité 28
II. UNE PROPOSITION DE LOI JURIDIQUEMENT EFFICACE 29
A. LA COMPÉTENCE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE LOI DE POLICE 29
B. UNE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE EN CAS DE VIOLATION DE L’OBLIGATION PARTICULIÈRE DE VIGILANCE 31
1. Le plan de vigilance 31
2. Le rejet d’une responsabilité de plein droit 32
3. Le refus d’un renversement du fardeau de la preuve 33
4. Le plan de vigilance, clef-de-voûte de la proposition de loi 34
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 35
CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE HOUILLON, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 39
CONTRIBUTION DU GROUPE ÉCOLOGISTE (faite en application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement) 43
DISCUSSION GÉNÉRALE 47
EXAMEN DES ARTICLES 61
Article 1er (art. L. 225-102-4 du code de commerce [nouveau]) : Obligation d’élaboration d’un plan de vigilance 61
Article 2 (art. L. 225-102-5 du code de commerce [nouveau]) : Responsabilité en cas de manquement aux obligations du plan de vigilance 77
Après l’article 2 81
Article 3 : Extension du dispositif aux îles Wallis et Futuna 83
TABLEAU COMPARATIF 87
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 91
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 93
PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 11 mars 2015, la commission des Lois a adopté la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre présentée par M. Bruno Le Roux, M. Dominique Potier et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (n° 2578), en y apportant les principales modifications suivantes :
— À l’article 1er, à l’initiative de son rapporteur, la Commission a précisé la définition du contrôle direct ou indirect exercé par une société sur une autre, en faisant référence au II de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
— À l’article 1er, à l’initiative de son rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, la Commission a estimé que les sous-traitants et fournisseurs devaient entrer dans le périmètre du plan de vigilance de la société dès lors qu’elle entretient avec eux une relation commerciale établie ;
— À l’article 1er, à l’initiative de son rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, la Commission a restreint aux modalités de présentation et d’application du plan de vigilance le champ du décret d’application qui devait initialement porter sur la totalité de l’article ;
— À l’article 1er, à l’initiative de son rapporteur, de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et de M. Philippe Noguès, la Commission a supprimé la précision selon laquelle les juridictions compétentes en cas de litige sont les tribunaux civils et commerciaux ;
— À l’article 1er, à l’initiative de son rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, la Commission a confié au juge le soin de prononcer une amende civile en cas de violation de ses obligations par l’entreprise ;
— À l’article 1er, à l’initiative de son rapporteur, de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et de M. Philippe Noguès, la Commission a indiqué que l’amende civile ne pouvait faire l’objet d’une déduction fiscale ;
— À l’article 3, à l’initiative de son rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, la Commission a étendu l’ensemble du dispositif de la proposition de loi aux îles Wallis et Futuna.
« Nous sommes rendus responsables par le fragile. Or, que veut dire : rendus responsables ? Ceci : quand le fragile n’est pas quelque chose mais quelqu’un, comme ce sera le cas dans toutes les situations considérées — individus, groupes, communautés, humanité même — ce quelqu’un nous apparaît comme confié à nos soins, remis à notre charge. (1) »
Le combat politique de la majorité parlementaire s’inscrit résolument dans une perspective de progrès social et d’avancée des droits humains. Cette orientation fondamentale a déjà trouvé à s’illustrer par la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dite « loi Canfin », dont l’article 5 dispose : « La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. La France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires. La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l’étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (…). »
Les principes doivent désormais se transcrire en dispositifs concrets. Les quatre groupes de gauche de l’Assemblée nationale s’y sont attachés lorsque, après deux années de consultation dont Mme Danielle Auroi, M. Philippe Noguès et votre rapporteur ont été parmi les principaux animateurs, ils se sont accordés sur une rédaction commune. Quatre propositions de loi identiques ont été déposées pour responsabiliser les entreprises multinationales face aux conséquences de leur activité et de celle de leurs partenaires commerciaux sur les droits fondamentaux, la santé et l’environnement (2). Toutefois, des interrogations sur le dispositif juridique et la nécessité d’un nouvel échange de vues avec le Gouvernement n’ont pas permis à la majorité de se rassembler sur ces quatre propositions identiques. Inscrit à l’ordre du jour à l’initiative du groupe écologiste (3), ce texte a fait l’objet d’un renvoi en commission le 29 janvier 2015. Il ne s’agissait pas là d’un vote de défiance, mais de la condition de la poursuite du dialogue pour offrir à une ambition commune de meilleures chances de succès. M. Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, qui représentait le Gouvernement en séance publique, avait formulé un engagement sans ambiguïté : « Afin que les choses soient tout à fait claires, je précise que le renvoi proposé n’est pas un report sine die ni un renvoi aux calendes grecques, si vous me permettez cette allusion à l’actualité. Au contraire, le Gouvernement souhaite que ce travail aboutisse dans les toutes prochaines semaines, et je sais que cet objectif est aussi le vôtre (4). » Il avait également rappelé « la nécessité de ne pas se limiter au reporting. Oui, c’est vrai, et nous en sommes bien d’accord, il faut des mesures concrètes et un dispositif global qui s’applique aux entreprises dans toute la chaîne de production : sociétés mères, filiales et sous-traitants. Ce serait la première fois qu’un pays au monde, la France, se doterait d’un tel dispositif. Cette volonté-là est intacte (…). La volonté du Gouvernement d’aller vite, tout en menant, si elles sont souhaitées, des concertations, est claire, comme l’est celle de ne pas encore reporter les choses à des échéances trop éloignées. »
La présente proposition de loi soumise aux députés a fait l’objet de négociations fructueuses avec les différents ministères concernés par son objet – Économie, Justice, Affaires étrangères. Deux mois seulement se seront écoulés entre le renvoi en commission de la première version, le 29 janvier, et l’examen en séance publique, le 30 mars. Avec le soutien du Premier ministre et du président du groupe majoritaire de l’Assemblée nationale, la promesse a été tenue : les obstacles juridiques sont levés et les imprécisions clarifiées. La portée de la proposition a même été élargie puisque les discussions menées avec le Gouvernement ont fait apparaître l’opportunité d’y inclure un dispositif de prévention de la corruption.
Le texte proposé est la concrétisation d’une promesse de campagne du président de la République. Le 12 avril 2012, quelques semaines avant son élection, M. François Hollande déclarait : « Je souhaite que soient traduits dans la loi les principes de responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. » C’est une philosophie éminemment humaniste qui a inspiré sa rédaction, et qui devrait recevoir le soutien de tous les Républicains sur tous les bancs de notre assemblée. Comment, en effet, tolérer que se perpétuent les formes les plus manifestes d’esclavage moderne, les comportements les plus irrespectueux de la dignité des travailleurs et que l’on espérait disparus avec le XIXe siècle, l’exploitation la plus irresponsable des ressources naturelles et de l’environnement ?
L’opinion publique française a été profondément marquée par le naufrage de l’Erika au large des côtes françaises en 1999 (5) et par l’effondrement du Rana Plaza à Dacca, au Bangladesh, au printemps 2013 (6). Elle n’accepte plus que le droit international procure une immunité à des multinationales qui se dispensent volontiers du respect des droits de l’homme et des règles élémentaires de protection de la nature. Elle ne tolère plus les images d’hommes, de femmes et d’enfants réunis dans des ateliers géants au bout du monde, de ces travailleurs sans nombre dont les droits sont quotidiennement bafoués et les libertés niées, au nom de la maximisation du profit, dans de véritables institutions disciplinaires – au sens foucaldien du terme (7).
On reprochera à la présente proposition de loi de ne pas aller assez loin, de ne pas incarner le « Grand soir » de la responsabilité environnementale. Elle poursuit l’objectif plus modeste, mais aussi plus réaliste, d’ouvrir la voie et de montrer au monde que l’action est possible, que l’économie n’a pas entièrement, comme d’aucuns le prétendent, pris le pouvoir sur la politique. Votre rapporteur a travaillé à l’amélioration de sa rédaction, en parfait accord avec les rapporteurs pour avis des commissions des Affaires économiques, Mme Annick Le Loch, et du Développement durable, M. Serge Bardy (8).
Des précédents historiques montrent qu’une nation peut initier un mouvement de progrès qui se répand, peu à peu, sur tous les continents. La France est déjà parvenue à convaincre l’Union européenne de la suivre. Il faudra qu’il en soit ainsi, une nouvelle fois.
I. INCITER LES ENTREPRISES MULTINATIONALES À PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME ET À L’ENVIRONNEMENT
Le monde moderne entend tourner la page de l’économie d’hier, dominée par les seuls calculs économiques et par la recherche effrénée de la rentabilité. Les excès des deux derniers siècles, qui ont relégué le travailleur au rang de simple matière première et parfois de déchet, n’ont plus cours dans les pays développés à économie de marché – ni dans les mentalités, ni dans le droit. Une décision telle que l’arrêt Dodge v. Ford (9), emblématique d’un système productif gouverné par le profit, ne pourrait plus être rendue de nos jours sans provoquer une grande émotion de l’opinion publique, sans entraîner une réponse législative ou réglementaire. De la même façon, le propos provocateur tenu par l’économiste monétariste Milton Friedman selon lequel « la responsabilité sociale de l’entreprise, c’est de faire du profit (10) » ne rencontre plus guère d’écho aujourd’hui.
La croissance qualitative reste l’objectif d’une société en quête d’une nouvelle prospérité. La croissance quantitative n’est plus une condition suffisante de la bonne marche de ses affaires et de l’amélioration du cadre de vie des individus qui la composent. L’ambition poursuivie est désormais celle du développement durable, c’est-à-dire de la poursuite simultanée d’un progrès économique, d’avancées sociales et d’un respect de l’environnement. Des États expriment cette préoccupation, la France au premier rang : elle accueillera en décembre 2015 la prochaine Conférence des parties sur la lutte contre le changement climatique (COP 21) ; le Parlement poursuit actuellement l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique et à la croissance verte.
Mais le développement durable est aussi l’affaire des entreprises dont il est attendu une dimension socialement et environnementalement responsable. Respectueuses d’une réglementation qui progresse avec régularité dans le sens d’une meilleure protection des travailleurs et du milieu environnant, la plupart des multinationales développent aussi volontairement des actions de RSE (11). L’Organisation des Nations unies (ONU), dans un rapport fondateur publié en 2009, rappelait que « la responsabilité de respecter les droits de l’homme pour les entreprises est reconnue par presque toutes les initiatives RSE émanant d’entreprises ou de secteurs d’activité, approuvée par les plus importantes associations professionnelles au monde, affirmée dans le Pacte mondial et ses réseaux nationaux dans le monde entier, et consacrée dans des instruments de droit directifs. (12) ».
Cependant, les progrès découlant d’une démarche incitative et facultative, d’initiatives spontanées et de contrôles internes, semblent atteindre leurs limites. Si de nombreuses entreprises, et notamment d’entreprises françaises dont beaucoup se montrent exemplaires, se sont engagées à prévenir les atteintes aux droits de l’homme et à l’environnement que pourraient susciter leurs actions, d’autres profitent du silence de la loi pour perpétuer des pratiques qu’on espérerait révolues.
Par ailleurs, le volontarisme se limite fréquemment aux frontières de l’entreprise, déborde parfois sur les filiales, et s’étend rarement aux relations d’affaires que sont les fournisseurs et les prestataires. La multiplication des sous-traitances conduit même certains donneurs d’ordre à ne plus savoir précisément qui fait quoi en leur nom et en quel lieu, et à tenir cette ignorance pour excuse devant les abus commis alors. Or une personne responsable, individu ou société anonyme, ne saurait se prévaloir de turpitudes de cette sorte : mal cartographier les risques, mal connaître sa chaîne de valeur, mal identifier les différents opérateurs sous contrat, c’est déjà commettre une faute morale. En l’absence d’un mécanisme de responsabilité juridique des entreprises transnationales pour les violations des droits humains commises par leurs filiales et sous-traitants, cette faute est néanmoins dénuée de conséquence juridique. Il est par conséquent délicat, pour les victimes, d’obtenir réparation des préjudices subis. Les États n’ont que rarement transposé en droit interne les principes internationaux et, avec l’assentiment des représentants des firmes multinationales, se bornent à promouvoir des guides non contraignants à vocation interne ou à l’échelle des filières (soft law).
Mettre un terme à la déconnexion complète entre pouvoir économique et responsabilité juridique, telle est l’ambition de la proposition de loi présentée à l’Assemblée nationale. Parce qu’elle fait le choix de la prévention et qu’elle se refuse à stigmatiser les entreprises, elle écarte les perspectives d’une responsabilité sans faute et d’une inversion de la charge de la preuve. L’obligation de vigilance trouve sa concrétisation dans l’édiction d’un plan qui, établi de bonne foi, limitera les abus sans aucunement obérer la compétitivité internationale des sociétés françaises.
Les décennies récentes ont vu se constituer un mouvement toujours plus vaste en faveur d’une responsabilité accrue des entreprises face aux dommages suscités par leurs activités. Les textes internationaux, quoique déclaratifs et dépourvus de force contraignante, se sont multipliés en faveur d’une meilleure protection des droits humains et de l’environnement par le secteur économique. Ils proclament le devoir, pour les entreprises, de prévenir les accidents comme les abus en leur sein et, en fonction des circonstances, chez leurs cocontractants impliqués dans leur chaîne de valeur (13). Il en découle une extension de la responsabilité des entreprises sur leur sphère d’influence.
À ce titre, l’action des États souverains est considérée nécessaire pour veiller au respect des bonnes pratiques et pour instituer des sanctions adaptées en cas de comportement répréhensible sur leur territoire ou sous leur juridiction. Les législations nationales sont supposées transcrire l’obligation de vigilance et de réparation des dommages survenus. En leur absence, les principes internationaux ne servent que d’inspiration à la rédaction des guides internes, dont la violation n’engage guère la responsabilité des sociétés qui les ont elles-mêmes conçus.
Parmi ces textes internationaux, qui formalisent un cadre de référence dont les nations sont appelées à s’inspirer pour l’élaboration de leur législation interne, on citera les plus remarquables.
Les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à destination des entreprises multinationales ont été élaborés dès 1976 et révisés en 2011 (14). Normes de bonne pratique, elles proclament que les entreprises doivent « respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part ». Ces recommandations dépassent le cadre de l’entreprise puisque, « dans le contexte de la chaîne d’approvisionnement, si une entreprise s’aperçoit qu’il existe un risque d’incidence négative, elle devrait alors prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin ou pour l’empêcher ». La démarche responsable envers les partenaires commerciaux, sous-traitants et fournisseurs, se trouve donc clairement affirmée.
La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, rédigée par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1977 et révisée en 2006, recommande aux États comme aux partenaires sociaux de respecter les droits humains formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (15). Bien que dépourvu de valeur contraignante, et alors même que le dépôt auprès de l’OIT de rapports périodiques sur les réalisations effectuées reste de la seule volonté des États, ce document a l’avantage de formaliser la convergence de différentes parties prenantes sur la nécessité de garantir les droits de l’homme dans le monde de l’entreprise, par-delà les frontières et en dépit – voire en raison – du contexte de la mondialisation.
Le Pacte mondial des Nations unies a été adopté en juillet 2000 à l’initiative du Secrétaire général d’alors, M. Kofi Annan. Rassemblant 12 000 signataires répartis dans plus de 145 pays, il incite les entreprises à promouvoir et à respecter le droit international relatif aux droits de l’homme « dans leur sphère d’influence » et « à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales ». Les signataires adhèrent par simple lettre adressée par leurs instances dirigeantes au secrétaire général de l’ONU ; elles s’engagent ce faisant à « aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption (16) ». Par la suite, trois résolutions successives de l’Assemblée générale des Nations unies ont apporté un soutien explicite à cette démarche (17).
La réflexion de l’Union européenne sur le sujet a commencé dès 2001 par la publication d’un livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises (18). Si l’essentiel du document se concentre sur la prévention des abus à l’intérieur de l’entreprise, les relations avec les partenaires, fournisseurs et sous-traitants ne sont pas négligées. Elles figurent au paragraphe n° 48 : « Les grandes entreprises ont en même temps des relations commerciales avec de petites sociétés, que ce soit parmi leurs clients, fournisseurs, sous-traitants ou concurrents. Les entreprises devraient être conscientes que leurs performances sociales peuvent pâtir des pratiques de leurs partenaires et fournisseurs tout au long de la chaîne de production. Les retombées des mesures de responsabilité sociale d’une entreprise ne seront pas limitées à cette dernière, mais toucheront également ses partenaires économiques (…) ».
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a édicté le 12 décembre 2008 les lignes directrices de la norme ISO 26 000. Celles-ci définissent les orientations à suivre pour la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises. Elles conditionnent une démarche RSE exhaustive à la prise en compte de la notion de « sphère d’influence ». « Bien qu’une organisation ne puisse pas être tenue pour responsable des impacts d’activités qu’elle ne contrôle pas ou de décisions prises par d’autres, les impacts des activités et des décisions sur lesquelles elle exerce un contrôle peuvent être considérables. En général, l’organisation décide d’avoir ou non des relations avec une autre organisation et elle choisit également la nature ou l’étendue des relations en question. Il y aura des situations où il incombe à l’organisation, d’une part de faire preuve de vigilance vis-à-vis des impacts induits par les activités et les décisions d’autres organisations et d’autre part de prendre des mesures pour éviter ou atténuer les impacts négatifs en rapport avec les relations qu’elle entretient avec lesdites organisations (19) ».
En 2005, M. John Ruggie fut nommé par le Secrétaire général de l’ONU représentant « chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ». Ses travaux ont abouti à l’adoption unanime par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en 2011, de trente et une lignes directrices dites « principes Ruggie (20) ». Il s’y trouve notamment affirmé l’obligation pour chaque État de préserver les droits humains dès lors que des atteintes sont constatées sur son territoire ou sous sa juridiction (principe n° 1). Le droit à l’accès au juge doit être garanti (principe n° 13). Enfin, une nouvelle fois, ce texte international affirme que la responsabilité d’une société dépasse les conséquences de ses activités pour embrasser celles de ses partenaires économiques : « lorsqu’une entreprise contribue ou peut contribuer à une incidence négative sur les droits de l’homme, elle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser sa contribution et user de son influence pour atténuer les incidences restantes dans la mesure du possible. On considérera qu’il y a influence lorsque l’entreprise a la capacité d’apporter des changements aux pratiques illicites d’une entité qui commet un abus (…) » (principe n° 19).
Il convient de rappeler que ces textes, relativement comparables en ce qui concerne les comportements envers leurs relations d’affaires qu’ils promeuvent auprès des entreprises multinationales, s’inscrivent tous dans une démarche incitative. Leurs dispositions ne sont pas contraignantes et personne ne vérifie leur bonne application, sinon les organisations non gouvernementales vouées à la protection des droits de l’homme et de l’environnement. Certaines institutions internationales peuvent réclamer des rapports de suivi ; ils ne sont jamais impératifs et rien ne vient sanctionner ni l’inaction d’un État, ni les abus d’une entreprise. Ils constituent cependant une avancée considérable en balisant le chemin des multinationales qui souhaitent s’inscrire avec sincérité dans une démarche socialement responsable, en servant de fondement à la rédaction de la plupart des guides et des codes de bonnes pratiques.
Le 25 juin 2014, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a décidé de compléter son approche incitative d’une dimension juridiquement contraignante. Il a créé un groupe de travail chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits humains, les activités des sociétés transnationales (21). La France, qui a émis un vote négatif sur cette proposition, a justifié sa position par une préférence pour l’action normative des États au sein de leur ordre juridique interne – ce qui est, effectivement, le sens des « principes Ruggie ». Il n’en est que plus urgent de donner corps à cette position diplomatique, et de transcrire dans la loi un principe de vigilance des entreprises multinationales.
L’objectif poursuivi par la proposition de loi soumise à l’Assemblée nationale a suscité des oppositions fortes de la part, notamment, des organisations représentatives du patronat. Bien que chacun admette la modération de son dispositif au regard des textes précédemment présentés en ce sens au Parlement, il lui est reproché d’engager la France dans un cavalier seul sur un sujet éminemment lié à la mondialisation économique et qui, par conséquent, ne saurait trouver une réponse appropriée que dans le cadre international. Cette initiative, qui serait isolée, n’aurait pour effet que d’entraver la compétitivité de l’économie française.
L’Histoire est pourtant riche de précédents qui démontrent l’inanité de ces raisonnements. Que ce soit dans le domaine des droits de l’homme ou dans celui de la protection des droits des travailleurs, c’est l’action politique déterminée qui fait progresser les standards internationaux bien plus que l’espérance hypothétique d’une universalisation spontanée des bonnes pratiques. Ainsi que le signifiait Henri Lacordaire, « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
Trois exemples, d’inégale importance, montrent combien le recours à une loi nationale ne doit pas être écarté a priori lorsqu’il est question de renforcer la protection des individus face à la logique économique du commerce international.
La « traite négrière occidentale », ou transport d’esclaves africains vers les continents européen et surtout américain, débuta en 1441 par la déportation de captifs d’Afrique de l’Ouest vers la Péninsule ibérique. La première vente de captifs noirs razziés des côtes atlantiques s’est déroulée en 1444, dans la ville portugaise de Lagos. La colonisation des Amériques par les nations ibériques et le contrôle de la Méditerranée par l’Empire ottoman après la chute de Constantinople, en 1453, réorientèrent le flux d’esclaves vers les Caraïbes et l’Amérique du Sud. Les autres puissances européennes, la France et le Royaume-Uni au premier rang, organisèrent également une traite à destination de leurs colonies d’Amérique du Nord et des Caraïbes.
L’abolition de la traite négrière ne prit pas la forme d’un traité international élaboré conjointement par l’ensemble des nations, mais celle de l’engagement successif de puissances volontaristes qui, par la négociation ou par la force, parvinrent à convaincre leurs homologues de l’impératif de faire cesser le « commerce triangulaire » (22). Si les débats abolitionnistes les plus vigoureux avaient lieu en Angleterre et en France, c’est au Danemark que fut prononcée pour la première fois, en 1792, l’interdiction du trafic intercontinental d’esclaves.
Le Royaume-Uni procéda de même par le Slave Trade Act de 1807. Par la suite, la conviction britannique est parvenue à entraîner le reste du monde. Dès 1808, le Royaume-Uni avait convaincu les jeunes États-Unis de se joindre au mouvement hostile au commerce d’esclaves. Londres mobilisa par la suite toute son influence pour obtenir des autres pays pareil renoncement, imposant peu à peu l’abandon de la traite à ses ennemis vaincus et à ses alliés redevables, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux plus ou moins contraignants. Le Congrès de Vienne, réuni à l’issue des guerres napoléoniennes, prononce ainsi l’interdiction de principe de la traite sur l’ensemble du continent européen. Le Royaume-Uni met ensuite sa puissance maritime au service d’une mission de police des mers, obtenant – ou exigeant – des autres nations un droit de visite sur tous les navires susceptibles de transporter des esclaves quel que soit leur pavillon (23). Cette politique parvint à tarir les flux commerciaux dès la moitié du XIXe siècle. Les menaces et les mesures de rétorsion économique provoquèrent enfin un alignement progressif des États américains : le Brésil abolit officiellement la traite en 1850 alors que le dernier navire négrier accosta à Cuba en 1867.
Quant à la France, malgré l’abolition ancienne de l’esclavage sur le sol métropolitain par un édit du 3 juillet 1315 du roi Louis X, et en dépit d’une première abolition décrétée par la Convention le 16 pluviôse de l’an II (4 février 1794) et rapportée par la loi du 20 mai 1802, elle n’ordonna officiellement la fin de la traite négrière qu’en 1815. Le décret impérial du 29 mars 1815 (24), confirmé par l’ordonnance royale du 8 janvier 1817 et la loi du 15 avril 1818, met un terme juridique à ce commerce immoral.
Que retenir de l’Histoire, sinon la conviction que l’action déterminée d’un État couplée à une action diplomatique patiente peut parvenir à une avancée significative des droits de l’homme, sur laquelle personne n’envisage de revenir aujourd’hui, mais qui apparaissait à l’époque excessivement coûteuse pour les milieux d’affaires (25) ?
b. La protection des ouvriers face aux accidents du travail, exemple d’organisation de la responsabilité de l’entreprise par la loi
À la fin du XIXe siècle, l’industrialisation, le machinisme et la disparition des petits ateliers au bénéfice des grandes usines augmentent le nombre d’accidents du travail. Un débat profond agite la Chambre des députés qui, pendant près de vingt ans, discute et vote des projets de loi toujours rejetés par le Sénat. Il offre un parallèle saisissant avec la situation contemporaine à propos de la responsabilité des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : on y trouve des controverses juridiques, des hésitations de la jurisprudence, une opposition du patronat au nom de la compétitivité, et la détermination sans faille de parlementaires républicains pour bousculer les conservatismes (26).
Le problème du traitement juridique des accidents du travail est simultanément rencontré dans tous les pays industrialisés. Une nouvelle fois, un pays sert de référence et offre l’exemple qui emporte les réticences : l’Empire allemand, où les années 1881 à 1889 ont vu la naissance des assurances sociales. Entre l’assurance maladie en 1883 et l’assurance vieillesse en 1889, l’Allemagne a créé en 1884 l’assurance contre les accidents du travail. La IIIe République, encore fragile et contestée, ne pouvait laisser à son rival d’outre-Rhin le monopole du progrès social. Elle devait aussi démontrer que les idéaux de 1789 étaient capables de s’adapter à la société industrielle et d’apporter une réponse à la « question sociale », qu’ils ne garantissaient pas seulement la liberté de l’individu face à l’arbitraire, mais aussi la fraternité et la solidarité sociale (27).
L’indemnisation de l’accident du travail n’a pourtant pas manqué de soulever les objections des juristes. Événement involontaire et imprévisible, il s’apparente au cas fortuit ou à la force majeure, notions alors d’effet similaire exonérant l’employeur de sa responsabilité (28). À la fin des années 1830, la jurisprudence refuse la réparation des dommages survenus lors d’accidents du travail au motif que le « contrat de louage de services » se résume dans le seul échange d’un salaire contre un service. Il n’y a pas d’autre obligation juridique entre employeur et salarié ; le contrat fait écran aux règles de la responsabilité civile de droit commun. Le juge estime que, « par le contrat, l’ouvrier a accepté les chances de danger que le travail peut comporter. »
En 1841, la Cour de cassation change de jurisprudence : en cas d’accident du travail, l’ouvrier peut se retourner contre son patron, non en raison du contrat, mais par application du droit commun de la responsabilité civile. La Cour impose à l’employeur une obligation de sécurité à l’égard des salariés qui est d’ordre public (29) : il doit à l’ouvrier plus que son salaire. Mais l’article 1382 du code civil (30) laisse sans réparation tout ce qui est le fait du hasard, et la Cour déclare que la responsabilité patronale est purement délictuelle, c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour base un fait dommageable et non le contrat de louage de services, ce qui fait reposer la charge de la preuve sur le demandeur. Ainsi, entre les affaires où aucune faute ne peut être prouvée et celles où la victime a elle-même commis une maladresse, la grande majorité des décisions de justice tranchent en faveur de l’employeur et, lorsqu’elles statuent en faveur de l’ouvrier, il faut encore que l’entreprise soit solvable pour que l’indemnité soit effectivement versée.
En l’absence de réponses civile et sociale, la dispute se déplace progressivement sur le terrain pénal. En effet, le code pénal sanctionne celui qui aura été la cause volontaire d’homicide ou de blessures, même par machine interposée. Mais il faut la preuve d’une imprudence, d’une négligence ou d’une inobservation des règlements. Par ailleurs, les condamnations sont plus souvent un moyen d’apaiser une opinion révoltée par les catastrophes, en trouvant des responsables dans le personnel, qu’une sanction propre à pousser le patron à garantir la sécurité dans ses usines et sur ses chantiers. Cette voie pénale a finalement été explicitement écartée avec l’adoption de la loi du 9 avril 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail.
En 1880, le député Martin Nadaud, par ailleurs ouvrier, présenta une proposition de loi visant à renverser le fardeau de la preuve de la faute, sur le modèle des législations belge et suisse de l’époque. Alors que la procédure parlementaire suivait son cours, le droit allemand substituait à la responsabilité un principe nouveau : celui du risque professionnel, qui ne découle ni du droit civil ni de la volonté des parties. Il inspira la Chambre des députés qui, dans un nouveau texte en 1888, consacra le principe du risque professionnel dans les établissements à moteur mécanique et celui de la réparation forfaitaire graduée ou d’une indemnité en cas de mort. Mais le Sénat bloqua le projet. En 1893, les députés votèrent un nouveau texte sur la double base de la reconnaissance du risque professionnel et de l’assurance obligatoire des employeurs, mais se heurtèrent à nouveau à l’opposition sénatoriale. Finalement, après de multiples navettes, le Sénat consentit un compromis que la Chambre approuva à l’unanimité le 9 avril 1898.
L’accident pris en compte est l’atteinte au corps humain, provenant de l’action violente d’une cause extérieure (31), survenue par le fait du travail, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. La loi prévoit une indemnisation forfaitaire, fixée à l’avance suivant le degré d’incapacité causé par l’accident, qui permet d’éviter le recours au juge. Les compagnies d’assurances connaissent un essor considérable et les accidents du travail deviennent pour elles une activité importante. Quant aux patrons qui refusent de s’assurer, ils provoquent le vote d’une loi du 31 mars 1905, modifiant divers articles de la loi du 9 avril 1898, qui institue un fonds de garantie, alimenté par des cotisations et qui se substitue à l’employeur dans ses obligations à l’égard de la victime.
Dès 1880, le patronat s’était mobilisé pour combattre la perspective d’une assurance obligatoire et d’une responsabilité pour risque professionnel. Pour éviter l’intervention du législateur, il a promu ce qui ne s’appelle pas encore la soft law ou la diligence spontanée : l’Association des industriels de France (AIF), formée en 1884, a pour objet social de faire prendre conscience des problèmes de sécurité sur les lieux de production et de diffuser les moyens de prévention et de réduction des accidents. Il sollicite aussi les parlementaires conservateurs qui engagent, au Sénat, une bataille de retardement.
La loi de 1898 a donc été conçue comme une loi expérimentale, une première étape limitée aux ouvriers de l’industrie et à des cas précis. Mais c’est un texte qui a ouvert la voie, qui a été progressivement étendu pour protéger toujours davantage les salariés, et qui a permis l’aménagement des relations de travail sans empêcher ni la Belle Époque, ni les Trente Glorieuses.
Depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) et son article 116 (32), les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ont l’obligation d’intégrer au rapport annuel de gestion des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Ce dispositif contraignant a contribué à la mobilisation des entreprises dans une optique de RSE. Les thèmes sur lesquels les entreprises concernées devaient fournir des informations étaient énumérés, mais aucune sanction ne venait réprimer leur carence et aucune exigence de certification n’était formulée.
Le caractère insuffisant de cette disposition est rapidement apparu. L’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, a donc décidé son renforcement selon deux axes : élargissement du champ d’application du dispositif aux sociétés non cotées dont le total de bilan ou de chiffre d’affaires et le nombre de salariés dépassent des seuils fixés par décrets, d’une part, et extension du champ des informations figurant dans le rapport de gestion, d’autre part.
Toutefois, la perspective de son extension a soulevé de fortes protestations de la part du patronat, qui considérait le coût associé à un reporting extra-financier prohibitif pour les petites entreprises – c’est-à-dire pour les sociétés non cotées (33). Il en résulterait une atteinte grave à la compétitivité de l’économie française face à ses concurrents, et la mesure ne saurait être efficace au seul niveau national. Un rapport sénatorial a durement critiqué l’opposition des syndicats d’employeurs et leurs actions destinées à entraver la publication du décret d’application et à diminuer son envergure :
« Les actions de lobbying des associations patronales ont conduit à une première entorse à l’article 225 de la loi Grenelle II avec le vote de la loi de régulation bancaire et financière adoptée en octobre 2010 (34). Cette loi a supprimé la possibilité pour les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes d’émettre un avis sur le volet développement durable du rapport annuel des sociétés anonymes à leurs actionnaires. Le lobbying a ensuite visé à rehausser les seuils de déclenchement de l’obligation de reporting social et environnemental afin de réduire le nombre d’entreprises concernées par la réforme. L’article 10 de la proposition de loi Warsmann sur la simplification du droit et l’allégement des démarches administratives prévoyait que le décret en Conseil d’État nécessaire pour l’application de l’article 225 de la loi Grenelle II établisse deux listes précisant les informations sociales et environnementales à fournir selon que la société est ou non cotée. Le même article proposait que la société mère puisse effectuer le reporting RSE à la place de ses filiales françaises dépassant les seuils. Suite au rejet du texte par le Sénat le 10 janvier 2012 et à l’échec de la commission mixte paritaire le 18 janvier, la proposition de loi Warsmann a finalement été définitivement adoptée le 29 février 2012 par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (35). En matière de reporting social et environnemental, son article 12, anciennement article 10, établit une double liste d’informations à publier, en fonction du critère de cotation de l’entreprise, distinction qui constitue un recul par rapport au Grenelle. La loi entérine par ailleurs le report d’un an d’application de la loi, et permet aux filiales concernées par les seuils de ne pas publier de rapport autonome, si leur maison mère publie dans son rapport des informations détaillées filiale par filiale. (36) »
Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, quoique moins ambitieux que les débats législatifs tenus lors du vote de la loi Grenelle II pouvaient le laisser espérer, a finalement déterminé les seuils de chiffre d’affaires ou de bilan et d’effectif de salariés qui déclenchent progressivement l’obligation de reporting RSE :
• pour les sociétés cotées, application du dispositif aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 ;
• pour les sociétés non cotées dont le bilan ou chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, et dont le nombre de salariés est supérieur à 5 000, application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 ;
• pour les sociétés non cotées dont le bilan ou chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre de salariés dépasse 2 000, application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ;
• pour les sociétés non cotées dont le bilan ou chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros et dont le nombre de salariés dépasse 500, application aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
Le rapport obligatoire doit traiter des trois domaines du développement durable : social (emploi, organisation du travail, relations sociales, santé et sécurité, formation, égalité de traitement), environnemental (politique générale en matière environnementale, pollution et gestion des déchets, utilisation durable des ressources, changement climatique, protection de la biodiversité) et sociétal (impact territorial, économique et social de l’activité de la société, relations entretenues avec les parties prenantes).
Une nouveauté importante par rapport à la loi NRE est l’obligation de certification par un tiers des données apportées par l’entreprise. Ces certificateurs sont accrédités et ne peuvent être missionnés pour plus de six exercices dans la même société. Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés cotées, et à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2016 pour les autres.
Bien que certains volets du décret du 24 avril 2012 doivent encore entrer en vigueur, on ne peut que constater que l’application des premières mesures n’a pas provoqué la ruine des entreprises que certains redoutaient ou semblaient redouter. En revanche, l’engagement de la France en faveur de la reddition de comptes extra-financiers a décidé l’Union européenne à agir sur ce terrain qu’elle occupait jusqu’alors très faiblement (37).
Dès avril 2013, la Commission européenne présentait un projet de directive sur le reporting extra-financier. Il est devenu la directive n° 2014/95/UE du 22 octobre 2014, modifiant la directive n° 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Le seuil d’application des obligations édictées est similaire à celui de la réglementation française en termes d’effectifs (500 salariés), mais plus exigeant en matière de chiffre d’affaires (40 millions d’euros) (38). Plus de six mille entreprises européennes sont donc concernées.
Si l’exemple du reporting extra-financier ne saurait évidemment être comparé ni à l’abolition de la traite négrière, ni à l’instauration du régime des accidents du travail, il montre toutefois qu’un pays décidé à agir dans le sens d’un progrès social et humain peut convaincre les autres nations de partager son combat, pour peu qu’il ait le courage de montrer la voie à suivre. Il est fort probable qu’il en sera ainsi de la responsabilité des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, si la présente proposition de loi est menée à son terme.
Les discussions menées au sein de la plateforme RSE (39) n’ont pas permis d’aboutir à un consensus sur l’opportunité d’une législation française portant sur la reconnaissance de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs filiales ainsi qu’entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Si la totalité des syndicats a souscrit à cette perspective, y compris les syndicats de cadres, les réticences de la représentation patronale n’ont pu être levées.
Il est toutefois probable que les entreprises aient beaucoup à gagner à une généralisation de l’obligation de surveillance des sociétés donneuses d’ordre. Le renforcement de la responsabilité des entreprises transnationales soulève la question de la compétitivité de l’économie française en général, et des entreprises françaises en particulier. Outre son bilan humain et environnemental dans les pays où il est pratiqué, le dumping sur les droits humains et les normes environnementales pénalise les entreprises implantées sur le sol français, qui demeurent soumises au droit national et à ses exigences.
De plus, un meilleur contrôle de la chaîne de valeur profitera aux entreprises. Les coûts de réparation et de dédommagement en cas d’accident peuvent être importants et dépasser ceux liés à la prévention en amont des risques ; il est plus intelligent de consacrer des ressources à élaborer un plan de vigilance destiné à prévenir les accidents que de provisionner des sommes importantes dans l’éventualité de la survenue d’un sinistre. Sans même évoquer les risques de sous-traitance dissimulée, une catastrophe, voire la simple révélation de mauvaises pratiques, ont généré des situations délicates à travers le monde au cours des dernières décennies. Aucune entreprise ne souhaite affronter les campagnes négatives qu’a dû subir un célèbre fabricant de chaussures tout au long des années 1990, lorsque les consommateurs avaient découvert les conditions de travail qui régnaient dans ses chaînes de montage en Asie, alors même que la réputation de qualité et l’image de la marque constituaient ses principaux arguments de vente face à ses concurrents.
Les entreprises françaises sont conscientes des enjeux : beaucoup ont adopté des chartes éthiques ou adhèrent volontairement à des initiatives publiques ou privées dans lesquelles elles s’engagent à mettre en œuvre de bonnes pratiques. En majorité, elles conduisent déjà des audits internes et externes à différents niveaux de leurs chaînes de production. Elles mettent déjà en œuvre leur devoir de vigilance. Les grands groupes que vise la proposition de loi sont déjà assujettis à des obligations de reporting extra-financier ; ils s’assurent fréquemment de la bonne qualité de leurs rapports de développement durable en sollicitant l’expertise d’un tiers extérieur.
Il est regrettable que ces bons élèves peinent à valoriser leurs efforts face à des concurrents moins vertueux. Les bonnes pratiques spontanées n’obligent que ceux qui y souscrivent et, paradoxalement, il en résulte une forme de pénalité pour les entreprises qui se comportent bien par rapport à celles qui se comportent mal. La théorie économique admet de longue date la légitimité de la puissance publique à intervenir pour incorporer les externalités (40) dans les calculs de rentabilité, que ce soit par le règlement ou par la fiscalité. Certaines entreprises l’ont bien compris et se déclarent favorables à la généralisation, par la loi, des précautions qu’elles s’imposent déjà d’elles-mêmes (41). Elles n’accordent aucune foi à l’argument selon lequel édicter un plan de vigilance pour le respect des droits humains et de l’environnement reviendrait à obérer la compétitivité des entreprises françaises et à faire augmenter le chômage. Cette protestation reviendrait à revendiquer une compétitivité fondée sur la violation des droits humains. Ce serait un aveu en contradiction avec les bonnes pratiques mises en avant par les supports de communication des multinationales. Ce serait aussi prétendre que négliger les droits humains est une condition de la compétitivité. Ce n’est ni vrai ni acceptable.
La commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’est prononcée sur le sujet à la demande du ministre délégué chargé des affaires européennes et du ministre délégué chargé du développement, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action français de mise en application des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Dans un avis du 24 octobre 2013, elle plaide sans hésitation en faveur d’une action législative : « la CNCDH, regrettant l’insuffisante prise en compte des risques relatifs aux droits de l’homme, recommande que le plan d’action français (…) impose une obligation légale de diligence raisonnable (due diligence) en matière de droits de l’homme aux entreprises pour leurs activités et celles de leurs filiales et partenaires commerciaux, en France comme à l’étranger. (…) Pour remédier au risque que des violations des droits de l’homme commises par des filiales et des entreprises sous-traitantes à l’étranger restent impunies, la CNCDH recommande d’encourager la remontée de la responsabilité vers la société-mère ou donneuse d’ordre, notamment lorsque la société liée n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités. (42) »
Quant à l’opinion publique française, elle est très majoritairement favorable à l’extension des obligations de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (43).
Le principe d’autonomie de la personnalité juridique constitue la principale difficulté rencontrée dans la voie de l’instauration d’une obligation de vigilance des entreprises donneuses d’ordre et des sociétés mères. Traditionnellement très protecteur, hormis en cas d’abus manifeste, il connaît toutefois des exceptions que les dernières années ont vu s’accumuler.
Le terme économique de « groupe » est dépourvu de valeur juridique pour évoquer une société multinationale et ses filiales. Celles-ci demeurent en droit des entités séparées dont chacune assume sa propre responsabilité sans engager celle des autres. La Cour de cassation a rappelé dans une jurisprudence récente : « un "groupe de sociétés" ne peut, faute de personnalité morale, être titulaire de droits et d’obligations et se voir infliger une condamnation (44) ».
L’autonomie de la personnalité juridique des sociétés d’un même groupe constitue un « voile entre la société-mère et ses filiales. Elle empêche d’engager la responsabilité de la première pour les actions des secondes. La problématique est plus évidente encore dans une relation de sous-traitance, où seuls des engagements contractuels et non des liens capitalistiques relient les deux entités. Cette construction juridique néglige la réalité économique et les impacts que les sociétés du groupe peuvent avoir sur les droits humains et sur l’environnement.
Le droit commun de la responsabilité civile, fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil (45), détermine trois conditions d’engagement de la responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Or comment prouver que la faute ou la négligence de la société mère a causé un dommage si la filiale, ou le sous-traitant, est en charge des opérations sur un autre continent ? Il faudrait parvenir à établir une situation d’apparence pour engager solidairement l’entreprise de tête (46), ce que la jurisprudence admet rarement.
En dernier recours, le législateur a aménagé des exceptions pour combattre une irresponsabilité jugée inacceptable par la collectivité. Cette « levée du voile de la personne morale (47) » permet de contourner le principe d’autonomie de la personnalité juridique.
Différentes branches du droit admettent des atténuations au principe d’autonomie de la personnalité juridique. Si elles se réfèrent à des critères différents du fait d’objectifs dissemblables, ces dispositions ont le même effet : faire apparaître une cohérence de groupe en lieu et place d’une collection de sociétés.
En droit du travail, l’article L. 2331-1 du code du travail exige qu’un comité de groupe soit « constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies [par le] code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique. »
En droit commercial, l’article L. 233-16 du code de commerce indique que le « contrôle exclusif par une société résulte [soit] de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; [soit] de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; [soit] du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. » Un rapport de groupe et une consolidation comptable doivent être réalisés, qui s’affranchissent des règles fiscales et juridiques de séparation des patrimoines.
En matière de pratiques anticoncurrentielles, « l’Autorité de la Concurrence adopte une approche fonctionnelle des groupes de sociétés en considérant la réalité économique de l’entreprise à travers le contrôle de fait exercé sur la filiale par la mère. Cette approche vise à sanctionner la société mère pour la pratique anticoncurrentielle de sa filiale en considérant qu’elle ne constitue qu’une seule entreprise. L’Autorité de la Concurrence française présume ainsi qu’une filiale contrôlée à 100 % applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère, sans devoir vérifier si celle-ci a effectivement exercé ce pouvoir (48). » Cette approche se rencontre également en droit européen, où existe une présomption simple de l’influence décisive d’une société-mère sur la filiale qu’elle possède totalement (49).
Enfin, en matière de fiscalité, l’article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, qui prévoit une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Dans le cas d’une société mère d’un groupe fiscalement intégré, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d’assujettissement prévu est atteint s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Cette disposition intégratrice, contraire au principe d’autonomie des personnes morales, a été contestée au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument : « en retenant comme seuil d’assujettissement la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi (50) ». Il est donc loisible pour le législateur de fixer à la société-mère des obligations en rapport avec le groupe qu’elle dirige sans contrevenir à la Constitution.
Les exceptions anciennes n’ont pas d’effet sur l’engagement de la responsabilité des entreprises. Il n’en va pas de même des évolutions récentes qui ont institué des obligations de vigilance dont le mépris justifie des sanctions.
Dans le domaine de la protection de l’environnement, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a permis de percer le voile de la personnalité morale pour que la société mère finance les mesures de remise en état des sites en fin d’activité à la suite d’un défaut de la société contrôlée, à condition toutefois qu’il s’agisse d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). De plus, le même article 227 crée la possibilité d’engager des poursuites contre la société-mère en cas de « faute caractérisée commise qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale » pour les pollutions générées par l’activité de cette dernière (51).
Quant à la protection des droits fondamentaux des travailleurs, elle a justifié l’adoption de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, dite « loi Savary ». Ce texte instaure le principe de « responsabilité solidaire, permettant de poursuivre l’entreprise donneuse d’ordre pour les fraudes (travailleurs non déclarés, salaires incomplets, utilisation d’une société écran basée dans un autre pays de l’Union européenne pour l’emploi en France de Français sous le statut de travailleur détaché, etc.) commises par l’un de ses sous-traitants. (52) » Un devoir de vigilance incombe au donneur d’ordre qui sollicite des prestataires établis à l’étranger. La responsabilité des maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leurs sous-traitants est renforcée – quel que soit le pays d’établissement de ces derniers. Les droits fondamentaux des travailleurs détachés sont énumérés (53). La sanction d’éventuels manquements consiste en une amende administrative.
Plus de 20 % des cinquante plus grandes entreprises européennes ont installé leur siège social en France. Une loi française aurait donc un impact significatif sur la perception par l’Union européenne de la question de la responsabilisation des sociétés donneuses d’ordre. Par ailleurs, les chiffres collectés par votre rapporteur montrent que les seuils retenus par la proposition de loi concernent 80 % du commerce international réalisé par la France, et approximativement deux tiers des échanges avec les pays n’appartenant pas à l’OCDE. Elle représente donc un incontestable progrès, même si son périmètre d’application pourra être revu à l’avenir, tant par le législateur que dans le cadre d’une directive européenne.
En matière de contentieux de la responsabilité, le règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, détermine les règles de compétence des juridictions au sein de l’Union européenne. Son article 4.1 mentionne : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » L’article 63.1 précise que « les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement. » La victime étrangère d’un dommage causé à l’étranger du fait d’une entreprise transnationale peut donc saisir le juge français, en pratique, dès lors que le siège social de l’entreprise visée se trouve en France. En outre, l’article 15 du code civil établit une compétence des juridictions françaises dès lors que le défendeur est un national (54).
Le conflit de lois ne se résout pas aussi rapidement que le conflit de juridiction au bénéfice des tribunaux français. « La loi éventuellement applicable au fond du litige est sans effet sur la juridiction compétente », affirme une jurisprudence constante (55). En responsabilité civile prévaut normalement la lex loci delicti commissi – la loi du lieu de commission du délit (56). Par exception toutefois, une incompatibilité du droit de l’État où les violations ont été commises avec l’ordre public entraînerait le juge à écarter la disposition en cause et à s’en remettre à la loi française (57). Une législation peu protectrice des droits fondamentaux, attentatoire à la dignité humaine, ou liberticide, mais en tout cas inapte à sanctionner les opérateurs économiques fautifs, ne les protégerait pas de la loi française. Si le droit du pays du dommage est compatible avec l’ordre public français, en revanche, il sera appliqué – ce qui ne soulève aucune difficulté car il sera alors suffisamment protecteur des droits des victimes.
Les auteurs de la proposition de loi ont tenté de renforcer son effectivité en assortissant les manquements de sanctions. L’existence de pénalités est en effet un élément qui permet de conférer à un texte la valeur de « loi de police ». Cette notion, quoique courante, n’a pas reçu de définition dans le droit français. Seul le juge européen a livré son interprétation : « constitue, au sens du droit communautaire, une loi de police la disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire ou localisée dans celui-ci (58) ». Le professeur Cornu en donne la définition suivante dans son Vocabulaire juridique : « expression désignant les lois dont l’application, dans les rapports internationaux, serait commandée par leur contenu sans considération des règles de conflit (de lois). »
La sanction d’un défaut d’établissement, de publication ou de mise en œuvre effective d’un plan de vigilance peut prendre la forme d’une amende civile. La juridiction peut prononcer une astreinte et ordonner une publication dans la presse. Elle dispose donc de tous les éléments, si elle est saisie, pour considérer que le dispositif constitue une loi de police et qu’il convient de l’appliquer sans se référer aux règles de conflit de lois. De plus, le mécanisme envisagé prévoit une action sur le fondement d’une violation d’une obligation légale édictée en France et applicable aux sociétés dont le siège social se trouve sur le territoire français, autant d’indices qui devraient permettre à la loi française de prévaloir en cas de sinistre à l’étranger.
La proposition de loi entend assujettir les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre à une obligation de réalisation d’un plan de vigilance contenant les mesures raisonnables destinées à prévenir des atteintes aux droits de l’homme, à l’environnement et à la santé publique, ainsi que les pratiques de corruption.
La notion de mesure raisonnable est avancée par le dix-septième principe directeur relatif aux entreprises et aux droits de l’homme formulé par les Nations unies : « Afin d’identifier leurs incidences sur les droits de l’homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient, les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Ce processus devrait consister à évaluer les incidences effectives et potentielles sur les droits de l’homme, à regrouper les constatations et à leur donner une suite, à suivre les mesures prises et à faire savoir comment il est remédié à ces incidences ».
La diligence raisonnable constitue une obligation de moyen et non de résultat. Elle consiste en une série de mesures appropriées dans le but de réaliser un objectif défini dans une norme nationale ou internationale, à respecter un niveau minimal de prudence dans la prise en compte d’un standard extérieur. Selon les Nations unies, son contenu fondamental se réfère au minimum « à la Charte internationale des droits de l’homme – la Déclaration universelle et les deux Pactes internationaux − ainsi qu’à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Il y a deux raisons à cela. D’une part, les principes consacrés par ces instruments sont les plus universellement reconnus par la communauté internationale. D’autre part, c’est principalement à leur aune que les autres acteurs sociaux jugent de l’impact des entreprises sur les droits de l’homme (59) ». Ces normes sont explicitement citées dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, et c’est pour des raisons de bonne légistique qu’elles n’apparaissent pas dans le dispositif (60).
Sous le contrôle du juge, les « mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques » sont laissées à l’appréciation de l’entreprise en fonction des circonstances de droit et de fait dans lesquelles elles auront vocation à être appliquées. Les sociétés conservent dont un certain pouvoir de détermination de la norme qui leur sera appliquée ; c’est une forme de soft law qui évite l’édiction de règlements d’application excessivement touffus.
La proposition de loi poursuit l’objectif d’une juste corrélation entre le pouvoir économique des multinationales et leur responsabilité juridique. Ceci suppose de faciliter les conditions de l’action civile à leur encontre. Pour autant, il n’a jamais été envisagé d’élargir cette responsabilité au-delà de comportements fautifs, comme cela a pu être évoqué par le passé.
La responsabilité du fait d’un tiers existe dans le code civil depuis l’origine, à l’article 1384 (61). Dans ses réflexions sur la réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, la commission présidée par le professeur Catala (62) avait proposé d’étendre sa logique aux relations entre sociétés dominantes et entreprises contrôlées par la création dans le code civil d’un nouvel article 1360 : « De même, est responsable celui qui contrôle l’activité économique ou patrimoniale d’un professionnel en situation de dépendance, bien qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait dommageable est en relation avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires. » Une note de bas de page précisait viser « essentiellement les rapports franchiseurs-franchisés, sociétés mères-filiales (d’où la précision "bien qu’agissant pour son propre compte"). »
L’existence d’un dommage suffisait à engager la responsabilité d’une société-mère dès lors que son contrôle était établi sur les activités de la filiale. C’est une responsabilité sans faute à prouver qui était envisagée, très protectrice des droits des victimes, mais qui exposait grandement les entreprises que ni la bonne foi, ni les bonnes pratiques n’exonéraient de leur responsabilité.
Un groupe de travail de la Cour de Cassation a résolument écarté le dispositif proposé : « En ce qui concerne les autres cas de dépendance économique, la mesure proposée est à ce point imprécise quant à son champ d’application qu’elle apparaît dangereuse au point de receler en germe des risques de dépaysement de holdings implantées en France et plus généralement de délocalisation des fonctions de direction et de contrôle de certains pans de l’économie. En l’état, la mesure apparaît inopportune. Sur un plan plus juridique, la disposition appliquée à la société-mère responsable du fait de ses filiales méconnaît l’autonomie de la personnalité morale dont est dotée chacune des sociétés du groupe, alors que le groupe lui-même n’est consacré dans notre droit que de manière encore très marginale (en droit du travail pour la représentation sociale, en droit des sociétés pour le contrôle des seuils de participation ou encore en droit comptable pour les comptes consolidés), trop marginale sans doute pour qu’un système de responsabilité puisse être bâti sur ce fondement. En pratique, il est à craindre que la société mère, rendue responsable du fait de sa filiale, soit tentée, si ce n’est par la délocalisation de ses activités de holding, risque déjà évoqué, par une immixtion croissante et malsaine dans la conduite des affaires de la société contrôlée. Par une ironie du sort, le système, poussé à ses extrêmes, pourrait “retomber sur ses pieds”, car la société mère peut d’ores et déjà en droit positif engager sa responsabilité du fait de sa filiale lorsque la seconde est devenue une entité fictive du fait de l’ingérence de la première. (…) Cette disposition, dans son ensemble, appelle donc de la part du groupe les plus expresses réserves. (63) »
Les réticences exprimées par le groupe de travail de la Cour de cassation sont convaincantes. Il ne semble ni opportun, ni juste, de contraindre une entreprise à réparer civilement un préjudice alors même qu’elle n’aurait commis ni faute, ni négligence, ni violation de ses obligations. La suggestion d’extension du régime du risque professionnel qui fonde le régime juridique des accidents du travail au-delà des limites de l’entreprise et des frontières nationales, au bénéfice de personnels avec lesquels elle n’entretient pas de lien contractuel, en conséquence des dommages causés par des personnes morales différentes qui, même si elles sont ses cocontractants, disposent toujours de leur autonomie d’organisation et de décision, ne saurait emporter la conviction du législateur.
La précédente proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, renvoyée en commission par l’Assemblée nationale le 29 janvier 2015, entendait renforcer les chances des victimes de voir leur recours prospérer en justice en établissant une présomption de faute de l’entreprise. Le dispositif confiait à cette dernière le soin de prouver qu’elle avait bien mis en œuvre les diligences raisonnables destinées à empêcher la survenue du sinistre. Si aucune preuve en ce sens ne pouvait être avancée, la responsabilité civile – voire pénale – de la société était engagée.
En principe, le droit civil français exige que le fardeau de la preuve incombe au demandeur et non au défendeur. Tant le code civil (64) que le code de procédure civile (65) sont explicites à ce propos. Par exception cependant, la loi peut établir des présomptions, définies par l’article 1349 du code civil comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. » L’article 1352 précise que « la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. »
Ainsi, au cas d’espèce, si une violation des droits humains ou une pollution de l’environnement devait survenir du fait de l’activité d’un sous-traitant ou d’une filiale d’une multinationale, il incombait, aux termes de cette précédente proposition de loi, à la société-mère ou au donneur d’ordre d’apporter la preuve de la satisfaction de son obligation légale de vigilance. La présomption était simple, c’est-à-dire que la preuve contraire pouvait être apportée. Certes moins radical que la responsabilité du fait d’autrui, ce mécanisme donnait un grand avantage au demandeur à l’instance puisque sa requête ne devait démontrer que l’existence d’un dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l’entreprise – ce que l’existence d’un contrat de travail et la présence sur les lieux au moment critique pouvait raisonnablement suffire à établir.
Ce dispositif, bien que séduisant, n’était pas sans défaut. La qualification pénale du manquement à l’obligation de vigilance qu’édictait le texte apparaissait particulièrement obscure alors même que le droit pénal, d’application stricte, exige une grande précision dans ses incriminations. L’obligation de vigilance elle-même, formulée à la fois dans le code de commerce et dans le code civil, demeurait générale et la proposition de loi ne prévoyait pas de l’incarner dans un document particulier. Enfin et surtout, aucun seuil d’application n’était édicté et une même diligence raisonnable, certes tempérée par les moyens de chacun sous le regard du juge, était exigée de la firme multinationale et l’entreprise artisanale.
Ces lacunes ont conduit le Gouvernement et le groupe socialiste, républicain et citoyen de l’Assemblée nationale à privilégier un renvoi du texte en commission, puis à travailler de concert à la rédaction de la présente proposition de loi. Pour moins ambitieuse qu’elle apparaisse en première analyse, son dispositif plus opérationnel devrait lui permettre de cheminer avec succès tout au long de la procédure législative.
Contrairement à celle qui l’a précédée, la présente proposition de loi ne fonde pas un régime de responsabilité civile dérogatoire : sa force réside précisément dans son inscription dans le droit commun. C’est le manquement à une obligation légale, formalisée par le plan de vigilance que doivent établir les grandes entreprises – de plus de 5 000 salariés ou de 10 000 salariés en fonction de la répartition de ceux-ci entre la France et l’étranger – et donnant lieu à une publication, qui fonde la responsabilité de la société défaillante.
Si le dispositif renonce à un renversement du fardeau de la preuve, il l’aménage néanmoins pour rétablir l’égalité des armes entre les parties. L’obligation de communication au public du plan de vigilance permet au demandeur de connaître les mesures prises par l’entreprise pour prévenir les atteintes aux droits et les situations de corruption (66). Il est alors plus simple de comparer ces écrits avec la réalité du terrain et de constater, le cas échéant, un caractère insuffisant des précautions ou un défaut de mise en œuvre effective.
Le juge peut être saisi en dehors de toute action en responsabilité, par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, pour vérifier l’existence, la publication et la mise en œuvre effective du plan – donc aussi, implicitement, son adéquation aux risques identifiés. L’amende civile d’un montant de dix millions d’euros que peut prononcer le juge en cas de manquement permet de garantir la bonne application du dispositif (67).
Enfin, la proposition de loi s’inscrit dans une démarche de progrès continu. Si les représentants du patronat la jugent déjà excessive et les organisations non gouvernementales encore décevantes (68), ses auteurs revendiquent son caractère de première étape. Les seuils d’application sont certes élevés, mais ils correspondent à ceux retenus par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale. Ils pourront être abaissés par la suite, une fois que le dispositif aura fait la preuve de son efficacité et dissipé les craintes des sociétés, soit par l’intervention future du législateur national, soit à la suite d’une initiative européenne en ce sens.
En ce début de XXIe siècle, la question n’est pas de savoir s’il faut être pour ou contre l’entreprise ou la mondialisation, l’enjeu est de rendre ces dynamiques « vivables » autour d’un concept étonnamment moderne : la loyauté. La vraie compétitivité nourrit un cercle vertueux de croissance durable pour l’emploi et la dignité humaine. Cette proposition de loi pose un principe novateur qui permet de franchir un pas vers une nouvelle génération de droits – garants du principe de réciprocité dans la globalisation – à l’image du combat contre les paradis fiscaux.
Avec ce texte, la France adopte une position pionnière qui a vocation à être suivie par les pays membres de l’Union européenne. L’Histoire montre que le progrès social et humain, une fois engagé, continue sa marche.
La commission des Lois a examiné la proposition de loi le mercredi 11 mars 2015. Avant de procéder à son adoption, elle a souhaité lui apporter différents amendements. Outre des modifications rédactionnelles, elle a ainsi résolu, toujours sur proposition du rapporteur :
— de définir plus précisément définissant le contrôle direct ou indirect par la société-mère en faisant référence au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, aux termes duquel « le contrôle exclusif par une société résulte : [soit] de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, [soit] de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise (…), [soit] du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. » Cette évolution permet d’expliciter le périmètre d’application du plan de vigilance et d’indiquer qu’il dépasse les filiales dont le capital est contrôlé pour plus de la moitié ;
— de substituer la condition de l’existence d’une « relation commerciale établie » à celle d’une « influence déterminante » afin d’inclure dans le périmètre du plan de vigilance des fournisseurs et sous-traitants. En effet, on sait qu’un atelier tel que celui du Rana Plaza traite avec suffisamment de donneurs d’ordre pour qu’aucun ne dispose d’une influence déterminante sur lui. Par ailleurs, la suggestion d’une référence à l’ensemble des « relations d’affaires » telle qu’elle était proposée par certains amendements n’a pas été jugée pertinente : il ne semble ni possible d’inclure dans un plan les cocontractants ponctuels, ni souhaitable d’intégrer non seulement fournisseurs et sous-traitants, mais aussi clients et partenaires. La référence à une relation commerciale établie, définie par la jurisprudence comme un partenariat dont chacun peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l’avenir, ne présente pas de semblables inconvénients. Un amendement identique était présenté par Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques ;
— de restreindre le champ du décret d’application de l’article 1er aux seules modalités de présentation et d’application du plan de vigilance. Un amendement identique était présenté par Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques ;
— de supprimer la précision selon laquelle les juridictions compétentes en cas de litige sont les tribunaux civils et commerciaux, de sorte que les règles normales d’attribution des contentieux s’appliquent désormais. Deux amendements identiques étaient présentés par Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et par M. Philippe Noguès ;
— de confier au juge le soin de prononcer une amende civile, sans qu’une sollicitation des parties en ce sens soit nécessaire. Un amendement identique était présenté par Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques ;
— de préciser que l’amende civile prononcée par le juge ne peut faire l’objet d’une déduction fiscale. Deux amendements identiques étaient présentés par Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et par M. Philippe Noguès ;
— d’étendre l’application de la totalité du dispositif de la proposition de loi aux îles Wallis et Futuna, quand la rédaction initiale ne le prévoyait que pour l’article 1er. Un amendement identique était présenté par Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques.
CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE HOUILLON, CO-RAPPORTEUR
SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI
(Nommé en application de l’article 145-7 du règlement)
Ce texte vise à introduire une obligation pour les sociétés françaises de plus de 5000 salariés en France ou d’au moins 10 000 salariés en France et à l’international d’établir et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance destiné à prévenir les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, aux risques de dommages corporels ou environnementaux ainsi qu’à la corruption chez leurs sous-traitants ou fournisseurs.
Le non-respect de cette obligation fait peser sur les sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre trois sanctions : une amende civile pouvant atteindre 10 millions d’euros, une responsabilité civile pour faute, une publicité sanction. En se plaçant sur le terrain de la sanction, ce texte fait de la France le seul pays à avoir un tel niveau de contraintes couvrant tous les droits fondamentaux.
En effet, si d’autres pays ont prévu ce genre de dispositif, ils l’ont fait d’une manière ciblée, définie, limitée. Il en va ainsi de la corruption au Brésil, aux États-Unis ou au Royaume-Uni par exemple ou de l’esclavage et de la traite humaine en Californie, ou de la santé et la sécurité au Canada.
Il est dès lors irréaliste de penser que les autres États suivront cet exemple. À cet égard, la Finlande qui a adopté en octobre 2004, un Plan d’action pour la mise en œuvre des principes directeurs de l’ONU (plan que la France n’a toujours pas établi !) indique clairement que le fait de transformer la vigilance raisonnable en obligation légale n’est pas envisageable en raison de la difficulté de définir le contenu de l’obligation elle-même.
Par ailleurs, le contenu de l’obligation d’établir un « plan de vigilance » n’est pas précisément défini et sa portée extrêmement large génèrera nécessairement une insécurité juridique considérable. En effet, les normes dont les entreprises sont censées veiller à l’application ne sont pas déterminées. Quand l’article premier fait référence aux « atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, (aux) dommages corporels ou environnementaux graves ou (aux) risques sanitaires » on ignore en application de quel droit ces atteintes sont appréciées : s’agit-il du droit local, du droit français, de l’application directe du droit international (alors que les entreprises ne sont pas des sujets de droit international) ?
Le périmètre lui-même est mal défini puisque l’obligation est étendue aux fournisseurs et sous-traitants à condition qu’ils aient une « relation commerciale établie » avec la société donneuse d’ordre, notion à peine plus précise que celle du texte présenté à la Commission des lois qui retenait « une influence déterminante » sur les fournisseurs et les sous-traitants de la société-mère et de ses filiales, notion qui ne correspondait à aucune définition en droit.
Aussi, en l’absence de référentiel définissant un « plan de vigilance » acceptable au regard de la loi et les mesures préventives préconisées pour en assurer la mise en œuvre, il sera très difficile, voire impossible dans la pratique d’apporter la preuve matérielle du respect de la loi.
Certes, l’obligation d’établissement et de mise en œuvre d’un plan de vigilance est présentée comme une obligation de moyens qui pourrait exonérer l’entreprise des sanctions prévues à l’article 2. En réalité, la formule de l’article premier qui exige « la mise en œuvre de manière effective » du plan de vigilance, vise plutôt une obligation de résultat dans la mesure où la survenance du dommage sera la preuve même de l’insuffisance du plan de vigilance qui n’aura pas été en mesure de le prévenir.
Un contentieux nombreux est fort à craindre et en réalité les entreprises seront très exposées à l’appréciation du juge. En cas d’accident, c’est lui qui estimera si, au regard de leurs tailles et des moyens dont elles disposent, elles ont pris des précautions suffisantes.
Le dispositif proposé donne également un rôle important aux organisations syndicales et aux associations, qui pourront intervenir comme lanceurs d’alerte, en saisissant la justice pour faire prononcer une injonction ou une amende civile si elles repèrent des manquements. Cet intérêt à agir extrêmement large s’inscrira systématiquement dans une démarche contentieuse et risquera d’attirer les « mauvais plaideurs ». Les pouvoirs publics abandonneront alors le contrôle du respect de la loi à des intérêts privés pour lesquels aucune transparence, représentativité et exigence d’honorabilité n’est organisée.
En plus des incertitudes juridiques et de la prévision de procédures judiciaires longues et coûteuses, on peut également craindre des effets néfastes sur la compétitivité des entreprises françaises.
Sur le marché français cela pose directement le risque de distorsion de concurrence au détriment des productions nationales, comment par exemple justifier que seuls les constructeurs automobiles français soient impactés et non les constructeurs étrangers qui vendent sur le territoire ? C’est une nouvelle iniquité de traitement nuisible à la compétitivité des entreprises autant qu’à l’investissement en France.
On peut penser qu’une telle législation nationale pourrait contribuer à mettre en cause la localisation des centres de décisions des entreprises implantées en France, avec un risque important de perte d’emplois.
Au final, ce texte, sans atteindre le but recherché, pénalisera fortement les entreprises françaises alors même qu’elles sont parmi les plus avancées en matière de RSE et qu’elles sont en droit d’attendre un accompagnement constructif de la part de la représentation nationale.
CONTRIBUTION DU GROUPE ÉCOLOGISTE
(faite en application de l’article 86, alinéa 7, du Règlement)
Après de nombreux drames qui auraient pu être évités, comme dernièrement le Rana Plaza au Bangladesh, et des années de mobilisation de la société civile, le droit de l’économie mondialisée doit avancer et les principes d’intérêt général gagner sur la défense des intérêts privés. De fait, les institutions internationales et l’Union européenne ont commencé à fixer des règles afin que les acteurs de la mondialisation de l’économie ne se dédouanent ni des droits fondamentaux ni de la préservation de l’environnement. Il s’agit maintenant de transcrire dans le droit français les principes directeurs de l’OCDE et des Nations Unies concernant le devoir de vigilance, inscrit dans la loi-cadre sur le développement et la solidarité internationale, dite « loi Canfin ».
Dans la lignée des efforts accomplis par la France pour faire évoluer le reporting extra-financier et les droits des travailleurs détachés, Danielle Auroi, présidente de la commission des Affaires européennes et députée écologiste du Puy-de-Dôme, s’est saisie de cette question dès le début de cette législature et, conjointement avec Dominique Potier et Philippe Noguès, du groupe SRC, a proposé la création d’un cercle parlementaire pour la Responsabilité sociétale des multinationales.
Ces travaux, accompagnés de nombreuses auditions, ont abouti à une proposition de loi élaborée avec l’expertise d’éminents juristes. Dans une démarche collective, les quatre groupes de gauche de l’Assemblée nationale ont ainsi déposé des textes identiques.
Cette proposition de loi inscrite au débat par le groupe écologiste le 29 janvier dernier a reçu le soutien de 250 ONG européennes et de plus de 160 000 citoyens. Le Forum citoyen pour la RSE, qui regroupe syndicats et ONGs, a mené une forte mobilisation à cette occasion pour faire entendre la nécessité de faire évoluer le droit, conformément aux engagements pris par le Président de la République.
Pourtant, malgré les nombreuses expertises juridiques qui confortaient cette proposition de loi codéposée, les parlementaires socialistes ont fait le choix de la renvoyer en commission. Lors des débats, le gouvernement, a néanmoins exprimé le souhait d’aboutir « à des résultats concrets et exigeants, qui consacrent la mise en œuvre d’un devoir de vigilance» et a déclaré partager « le diagnostic et les objectifs de ce texte ».
Le groupe socialiste, dans les semaines qui ont suivi, a donc déposé la nouvelle proposition de loi qui fait l’objet de ce rapport. Ce texte, qui constitue un petit pas vers l’instauration d’un véritable devoir de vigilance, pourrait utilement être amélioré sur plusieurs aspects que cette contribution propose de détailler.
Dans le rapport qui accompagnait la proposition de loi initiale sur le devoir de vigilance, Danielle Auroi relevait les limites de la démarche incitative et facultative :
« En l’absence d’un mécanisme de responsabilité juridique des entreprises transnationales pour les violations des droits humains commises par leurs filiales et sous-traitants – notamment hors des frontières nationales –, il est délicat pour les victimes d’obtenir réparation des préjudices subis. (…) La déconnexion est complète entre le pouvoir économique et la responsabilité juridique, ce qui ne peut satisfaire personne. Il convient donc de faire évoluer le droit. » http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2504.asp
***
Malheureusement, cette nouvelle proposition de loi, si elle comporte des avancées concernant la mise en œuvre effective du plan de vigilance par les très grandes entreprises, ne suffira pas à éviter de nouvelles catastrophes du type du Rana Plaza, ni à combler le vide juridique en matière de responsabilité solidaire.
Plusieurs points importants gagneraient à être améliorés afin d’assurer une meilleure effectivité à ce texte. Les amendements portés conjointement en commission par les trois groupes écologiste, RRDP et GDR, reflètent cette volonté commune. Ces propositions ne sont pas radicales, elles permettent juste de replacer le débat à la hauteur des enjeux, pour aboutir sur un texte qui ait des implications réelles et fasse changer les comportements.
D’abord, le seuil prévu dans la proposition de loi s’avère par trop limitatif. Par souci d’effectivité mais aussi de cohérence, il serait utile de l’aligner sur la directive « reporting extra-financier » adoptée par le Parlement européen le 15 avril 2014, qui intègre ainsi toute société dont le total du bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net dépasse 40 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de 500.
Ensuite, afin de préciser la définition de la chaîne de valeurs, il est proposé d’élargir le périmètre aux relations d’affaires des entreprises et de ne pas les limiter à « l’influence déterminante » ni « aux relations commerciales établies » avec leurs fournisseurs et sous-traitants. En effet ces rédactions pourraient conduire à des « effets pervers », des sociétés mères pouvant décider en amont de limiter artificiellement leur relation avec certains sous-traitants et fournisseurs afin de réduire leur exposition aux risques. De même, le recours à la sous-traitance en cascade et les situations de sous-traitance non-déclarée pourraient échapper au contrôle qu’il s’agit ici de formaliser. Le terme « relation d’affaires », concept-clé des principes directeurs de l’OCDE, et plus large, renforcerait là aussi la cohérence avec les textes internationaux.
De même, il paraît utile de mieux définir le contour du plan de vigilance en s’appuyant sur les textes internationaux qui ont précisément défini les mesures nécessaires à prévenir et identifier les risques. Il est également indispensable que le juge puisse demander la mise en œuvre du plan de vigilance. Si le juge constate qu’un dommage est imminent il doit pouvoir demander à l’entreprise mère de prendre toutes les mesures possibles pour l’éviter – c’est bien là l’intérêt même du devoir de vigilance que d’éviter la réalisation des dommages.
En cas de manquement, la proposition de loi telle qu’elle est rédigée fixe un plafond qui pourrait, en fonction des circonstances, se révéler inadapté. Afin de laisser une latitude au juge pour tenir compte de la capacité financière des entreprises, il est proposé de corréler la sanction financière au chiffre d’affaires du groupe concerné.
Cette proposition de loi s’intéresse ensuite à la question cruciale de la responsabilité et décline les contours de l’obligation de vigilance des sociétés mères. Face à cet enjeu majeur, il est indispensable de fermer les portes qui permettraient à des sociétés peu scrupuleuses de se dédouaner de leur responsabilité en prouvant que le dommage survenu n’est pas la conséquence d’un non-respect de cette obligation. En l’occurrence, le mécanisme des articles 1382 et 1383 du Code civil oblige à réparer les dommages causés par son seul fait. Donc ces sociétés auront beau jeu de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de l’obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que les sociétés mères soient tenues pour solidairement responsables lorsqu’elles n’ont pas respecté leurs engagements. La probabilité existe pour que les dommages aient été évités ou atténués si ces sociétés avaient respecté leur devoir de vigilance. Il n’est donc pas illogique qu’elles soient solidairement responsables des dommages commis.
Enfin au-delà de la condamnation éventuelle de l’entreprise responsable, il n’existe aujourd’hui pas de système assurantiel pour indemniser les victimes de ces tragédies. C’est pourquoi, à défaut de créer immédiatement un fonds de ce type, il est proposé de demander au Gouvernement de produire un rapport pour étudier les formes possibles et les conditions à réunir pour créer un fonds d’indemnisation des victimes. Celui-ci pourrait utilement s’appuyer sur le FGTI, fond existant, créé en 1986 pour indemniser les victimes de terrorisme et qui a vu ses missions étendues, en 1990, à l’indemnisation des victimes d’infractions de droit commun et, en 2008, à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts obtenus par une décision de justice (SARVI).
***
En conclusion, le groupe écologiste souhaite souligner l’intérêt du premier pas accompli par ce texte tout en faisant valoir la nécessité d’aller plus avant sans attendre, notamment sur la question du seuil et de l’introduction de la responsabilité solidaire. Alors que la plate-forme pour la RSE s’est déjà amplement concertée à ce propos, il serait également préférable de ne pas devoir attendre la publication d’un décret pour inciter les entreprises à mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier et prévenir les risques évoqués.
Comme l’avait souligné Danielle Auroi lors de la présentation de la proposition de loi initiale sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants, «L’universalité du droit, voilà bien le fondement de nos valeurs. Pour le dire autrement : il n’y a rien que l’on puisse cautionner chez les autres quand on l’interdit chez soi. Et nous ne pouvons plus fermer les yeux parce que des décisions prises ici ont des conséquences tragiques là-bas. »
La France pourrait ainsi s’enorgueillir de montrer le chemin au niveau européen. En protégeant l’intérêt général et en prévenant des dommages graves, elle protégerait aussi ses entreprises, qui tant au niveau réputationnel que financier sont aujourd’hui exposées à de grands risques faute d’un cadre juridique stabilisé. Plus qu’un affaiblissement concurrentiel, la position de leader sur les valeurs de protection des droits humains et de l’environnement, inscrite dans la tradition française, donnerait sans aucun doute à notre pays un avantage comparatif soutenu par l’écrasante majorité des citoyen-ne-s.
Lors de sa réunion du mercredi 11 mars 2015, la Commission procède à l’examen de la proposition de loi.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’aimerais au préalable faire un point de méthode. Deux commissions se sont saisies pour avis du texte que nous allons examiner. Je souhaite d’ailleurs la bienvenue à leurs rapporteurs, Serge Bardy et Annick Le Loch. La commission des Affaires économiques a statué pour avis, et nous a transmis ses amendements hier, ce dont je la remercie. En revanche, alors que le débat va s’ouvrir, je n’ai pas reçu les amendements de la commission du Développement durable, qui s’est réunie ce matin. Cela soulève une question de méthode. Je n’accuse évidemment pas le rapporteur pour avis Serge Bardy, dont je connais la disponibilité et le travail, mais je vais en parler avec le président Jean-Paul Chanteguet, car c’est la deuxième fois que cela arrive avec l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Or cela pénalise tout le monde : nos collègues de la commission du Développement durable, qui ont travaillé sur des amendements que nous ne pourrons étudier, comme les membres de la commission des Lois qui ne peuvent bénéficier du travail de l’une des commissions saisie pour avis. Le rapporteur pour avis de la commission du Développement durable étant présent, je lui donnerai la parole au moment où nous évoquerons les points concernés par les amendements que cette Commission proposera. N’est-ce pas pour éviter cette difficulté que le Règlement de l’Assemblée nationale a prévu que les commissions saisies pour avis se réunissent avant celle qui est saisie au fond ?
Ce point étant précisé, je laisse la parole à notre rapporteur.
M. Dominique Potier, rapporteur. En défendant aujourd’hui cette proposition de loi, j’ai le sentiment de me faire le porte-parole d’une large coalition. En effet, la genèse de cette loi a mobilisé quatre groupes parlementaires de la majorité, qui y travaillent de concert depuis bientôt deux ans ; le texte s’appuie sur l’expertise et sur les propositions d’une dizaine d’organisations non gouvernementales (ONG) qui font partie des premières ONG françaises et qui mènent ce combat depuis plusieurs années ; il bénéficie du soutien des principales centrales syndicales du pays. Cette coalition a organisé un dialogue entre le monde parlementaire et la société civile, ainsi que le monde de l’entreprise.
Ainsi est né ce texte dont vous connaissez l’histoire. Une première proposition de loi a d’abord été portée par quatre groupes parlementaires et inscrite dans une niche du groupe écologiste, à l’initiative de Mme Danielle Auroi qui en fut la rapporteure. Puis, à l’occasion d’un dialogue avec le Gouvernement, la volonté s’est fait jour d’écrire une deuxième version, aujourd’hui portée par le groupe socialiste. J’espère que les autres groupes de la majorité l’enrichiront au fil du débat parlementaire, mais aussi et surtout que des groupes de l’opposition s’y joindront. Le dialogue avec certains de leurs membres m’y encourage. La portée de cette loi devrait susciter un consensus, et ses modalités faire l’objet de compromis acceptables par tous. À l’heure où la vie politique a besoin de prendre de la hauteur, ce texte de dimension internationale, qui a trait aux droits de l’homme, pourrait bien nous fournir l’occasion d’un important rendez-vous républicain.
La source de ce combat humaniste, je la trouve pour ma part à quelques kilomètres de l’endroit où je vis et travaille, là où est né Georges Guérin, fondateur, il y a près d’un siècle, de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). Il avait une devise qui devrait toujours nous inspirer : « la vie d’un jeune travailleur, disait-il, vaut plus que tout l’or du monde ». Ce qui s’applique à un jeune travailleur ici comme à un jeune travailleur ou à une femme au Bangladesh, ou dans n’importe quel endroit, même à l’autre bout du monde. Ce type de repères m’a profondément marqué, m’accompagne depuis toujours, et le combat dont je me fais aujourd’hui le relais est une forme d’hommage à ceux qui ont ainsi inspiré mon engagement politique.
Alors que l’essentiel du droit français et européen, inspiré par les Lumières, vise à protéger l’individu, à travers ses libertés fondamentales, d’un État despotique puis totalitaire, le monde contemporain, sous l’effet de la mondialisation, se caractérise par l’émergence d’une nouvelle génération de droits, plus collectifs : il s’agit désormais de protéger les faibles sous des formes inédites.
Aujourd’hui, certaines entreprises transnationales toutes-puissantes du point de vue économique peuvent, à la faveur de la fragmentation des droits nationaux et des sociétés, porter atteinte, dans une certaine impunité, à ce qui nous tient le plus à cœur, par-delà nos divergences politiques, en violant les droits de l’homme et les écosystèmes, et en se livrant à des pratiques de corruption. Cet état de fait largement constaté, et auquel le drame du Rana Plaza a sensibilisé l’opinion publique, doit être combattu par l’inventivité législative.
La proposition de loi s’inscrit dans cette logique et, comme il l’a dit lui-même en commission du Développement durable, dans la filiation de l’action de notre collègue Gilles Savary contre le travail détaché et pour une harmonisation sociale et fiscale par le haut en Europe. C’est aussi la suite du combat que nous avons livré avec nos collègues écologistes et d’autres groupes lorsque nous avons organisé la transparence sur les paradis fiscaux à travers le reporting obligatoire prévu par la loi de séparation bancaire. Dans les trois cas, il y va de ces nouveaux droits qu’il incombe à notre génération de défendre. Sans remettre en cause la dynamique de l’entreprise ni celle de la mondialisation, ce qui n’aurait guère de sens au xxie siècle, il s’agit d’y inscrire un principe de loyauté et d’en inventer des régulations modernes, adaptées au monde contemporain, propres à défendre jusqu’au bout du monde ce que nous valorisons. La France s’honorerait d’être pionnière en la matière.
Tel est bien l’objet des principales discussions et oppositions que cette proposition de loi peut susciter, comme on l’a vu dans la presse et lors des auditions : ce faisant, la France serait-elle isolée ? Je me contenterai de rappeler, notamment à l’intention de nos collègues de l’opposition, que l’initiative du reporting extrafinancier, due à la dernière législature, a été prise en 2012 et qu’il a suffi de deux ans pour qu’elle fasse l’objet d’une directive européenne. C’est dans cette dynamique que nous nous situons. Ce que la France propose dans ce texte a évidemment vocation à inspirer une directive européenne et une norme internationale la plus large possible. Mais comment y parvenir, comment être crédibles en Europe, si nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes, selon une évolution modérée telle que la prévoit le texte, les premières dispositions ?
Nos collègues européens et américains s’inspirent de dynamiques analogues. L’originalité de la proposition de loi est de proposer, tout en restant modérée, une vigilance à 360 degrés sur les atteintes aux écosystèmes et aux droits humains. Mais on trouve dans les législations américaine, canadienne, suisse, espagnole, italienne, des dispositions équivalentes visant à lutter ici contre la corruption, là contre le travail des enfants ou ailleurs contre les trafics illégaux.
J’aimerais enfin rappeler les dispositions essentielles de ce texte, qui tient en deux pages et deux principaux articles.
La première version s’appuyait sur l’inversion de la charge de la preuve, ce qui risquait de heurter certaines susceptibilités et de se révéler juridiquement fragile, en tout cas d’être difficilement exportable à l’échelle européenne. Au contraire, le présent texte instaure un principe de vigilance, d’assurance contre les risques d’atteinte aux droits de l’homme. Cette logique assurantielle prend la forme d’un plan de vigilance dont les moyens sont laissés à la liberté de l’entreprise ; l’obligation de moyens est donc assortie d’une certaine marge de manœuvre. La seule exigence porte sur la présentation du document. Le droit international, c’est-à-dire les principes définis par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2011, sert de socle à ce que l’on pourrait qualifier de « code du travail et des bonnes conduites environnementales » à l’échelle internationale. Une fois ce socle posé, l’élaboration du plan de vigilance admet une certaine liberté, mais le juge peut sanctionner son absence ou sa carence par une amende civile, une publication et une astreinte.
Aux termes de l’article 2, le non-respect du devoir de vigilance, qui représente une sorte d’assurance ou de comptabilité du risque au sein de l’entreprise – il s’agit là d’une forme moderne de management, plus assurantielle, plus respectueuse de ses partenaires – peut engager la responsabilité de l’entreprise lorsque des dommages doivent être réparés dans une filiale ou chez un sous-traitant au bout du monde.
En somme, cette loi crée une dynamique et un dispositif nouveaux. Elle n’a pas vocation à résoudre tous les malheurs du monde, mais elle apporte sa pierre, avec d’autres lois, à une nouvelle génération de droits, pour une mondialisation plus humaine, une civilisation économique qui incarne nos valeurs et fasse notre fierté.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je félicite le rapporteur et les initiateurs de cette proposition de loi, qui a l’immense mérite de résoudre deux questions très problématiques soulevées par le texte du groupe écologiste que nous avait présenté Mme Auroi il y a quelques semaines.
Le premier changement, c’est l’inversion de la charge de la preuve. Peut-on faire plus qu’affirmer un principe de vigilance assorti de contrôles ? Je ne le crois pas. S’il me semble, peut-être sous réserve de quelques amendements à venir, que le texte pourrait être plus resserré, j’en approuve donc la logique.
Mais le point principal, dont je sais gré aux auteurs de la proposition de loi, est l’inversion des principes à raison desquels le devoir de vigilance doit s’exercer. J’ai dit à quel point j’avais été choquée par le texte défendu par Mme Auroi, où les atteintes à l’environnement précédaient les atteintes aux droits humains, qui ne leur étaient reliés que par un simple « aussi ». Malheureusement, ce n’était pas simplement affaire de rhétorique : j’y vois un témoignage de la manière dont nous laissons progressivement le développement durable tout englober, les droits humains eux-mêmes venant après l’exigence de « sauver la planète », comme on le dit parfois en une formule bien malheureuse.
J’ai senti une tentation similaire chez le rapporteur lorsqu’il a évoqué les écosystèmes avant les droits de l’homme. Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 1er inverse bien l’ordre des priorités en évoquant « la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires » pouvant concerner aussi bien l’homme que la nature.
Cette inversion est essentielle : comme l’a souligné le rapporteur, la vie des hommes doit passer radicalement avant les atteintes à la planète. Oui, la vie d’un jeune travailleur vaut davantage que tout l’or de la planète et, ajouterai-je, en cas d’opposition, que tout le vert de la planète. N’oublions pas que le capitalisme financier, après avoir balayé le capitalisme économique, a introduit de nouvelles formes d’exploitation qui ne sont pas moins rudes que celles que celui-ci avait engendrées au XIXe siècle.
M. Philippe Houillon. Il est dommage qu’en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la culture de la majorité soit toujours celle de la sanction et de la pénalisation, et ce, alors même qu’aucun autre pays au monde n’a adopté des mesures aussi larges que celles prévues dans le texte. Les initiatives étrangères que vous avez citées, monsieur le rapporteur, sont limitées et ciblent des points précisément définis, ce qui n’est pas le cas de la proposition de loi. Vous avez oublié de souligner que la Finlande a refusé, à la fin de 2014, de légiférer sur un domaine aussi vaste : le faire aurait posé des problèmes de définition des obligations. Vous avez d’ailleurs vous-même confirmé indirectement mes propos en reconnaissant que c’est un problème international que, paradoxalement, vous réduisez à un problème franco-français.
Le texte pèche tout d’abord par l’imprécision des normes censées encadrer son application. Il ne contient aucune définition claire, ce qui est particulièrement grave à partir du moment où il prévoit des sanctions. À toute responsabilité encourue par les entreprises doit correspondre une détermination suffisamment précise de leurs obligations, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction actuelle. Par exemple, que recouvre au plan juridique la notion d’« influence déterminante » ?
Le fait que vous présentiez ces obligations comme des obligations de moyens cherche à rassurer. Mais la vérité est autre : le texte inscrit bien une obligation de résultat puisqu’il prévoit la mise en œuvre « de manière effective » des mesures propres à prévenir la réalisation des risques. La France devient ainsi le seul pays au monde à prévoir de telles contraintes. Il s’y ajoute l’instauration, au II de l’article 1er, d’un véritable procureur privé : en effet, toute association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts en cause pourra ester en justice, alors que l’action publique devrait, comme son nom l’indique, rester publique et ne pas être transférée à des associations privées, surtout de manière aussi large.
L’adoption du texte créera des distorsions de concurrence aux dépens des grandes entreprises françaises de plus de 5 000 ou de 10 000 salariés puisque les entreprises étrangères ne seront pas soumises aux mêmes contraintes. Oui, nous devons faire tous les efforts possibles pour promouvoir la RSE. Oui, comme vous l’avez déclaré d’emblée, la vie d’un ouvrier vaut plus que tout l’or du monde. Cela étant, je le répète : alors que le problème que vous visez est international, vous le réduisez à un problème franco-français, par idéologie probablement, même si je veux bien vous accorder le bénéfice de la bonne foi.
Vous attachez, une fois de plus, aux pieds des grandes entreprises françaises performantes des boulets qui les empêcheront de progresser aussi vite que leurs concurrentes étrangères, sans compter les problèmes d’attractivité du territoire voire les délocalisations que provoquera le texte. Faisons la promotion internationale de la RSE, d’autant que des textes existent déjà, mais n’appliquons pas aux seules grandes entreprises françaises des obligations de résultat dont les conséquences leur seront préjudiciables !
C’est pourquoi le groupe UMP ne votera pas le texte.
Mme Colette Capdevielle. Je tiens à féliciter le rapporteur de son volontarisme et de sa ténacité. Il a su trouver une solution juridique aussi efficace que pertinente pour transposer le devoir de vigilance des multinationales dans le droit français. Le texte crée de nouveaux devoirs dans un contexte international où légiférer pour protéger est nécessaire.
Il ne s’agit pas d’opposer l’environnement aux salariés. L’homme et l’écosystème sont liés. Il convient avant tout de rendre éthiques des pratiques très douteuses en suscitant la prise de conscience des entreprises. Si le développement des bonnes pratiques est, à l’heure actuelle, « tendance », en tout cas très anglo-saxon, il est insuffisant car il est souvent utilisé comme un vecteur de marketing, contribuant pour un grand nombre d’entreprises à se construire une bonne image, alors qu’il convient d’accorder des garanties effectives aux salariés.
Légiférant pour combler le vide juridique en matière de responsabilité, nous passons de la déclaration d’intention aux actes en créant les outils nécessaires pour protéger les droits de l’homme et l’environnement dans des pays où la vie humaine a bien peu de valeur. Les textes précédents étaient juridiquement fragiles : je félicite M. Potier d’avoir, en un laps de temps aussi court, repris les principes du texte initial dans un dispositif d’autant plus efficace qu’il sera plus clair et plus resserré.
La proposition de loi a un double objet. Le premier est la mise en place obligatoire d’un plan de vigilance préventif et public – une véritable novation en droit. Toute personne physique ou morale aura la possibilité de saisir le juge, même en référé, pour contraindre une société à établir le plan de vigilance et à le rendre public.
Le texte – c’est son second objet – permettra également de qualifier la responsabilité civile des sociétés comme une responsabilité de droit commun pour faute, telle qu’elle résulte des articles 1382 et 1383 du code civil, le juge devant s’interroger sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Je crains toutefois que l’amende civile ne soit déductible au plan fiscal. Je ne le souhaite pas. Pouvez-vous me rassurer sur ce point ?
Enfin, les dispositions n’excluent pas les sanctions pénales en cas d’infraction telle que la mise en danger de la vie d’autrui, celles-ci s’ajoutant aux indemnisations civiles.
Ce texte est une belle avancée qui repose sur le triptyque prévention, sanction et réparation.
Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Ce texte est au service de la compétitivité des entreprises. En effet, l’introduction d’un plan de vigilance obligatoire permettra de valoriser les efforts des sociétés vertueuses qui appliquent déjà des procédures d’identification et de réduction des risques d’atteinte aux droits de l’homme et à l’environnement. Il rétablira des conditions de concurrence équitables entre ces entreprises et celles qui ne s’y astreignent pas ou ne le font qu’à des fins de communication, ce qui permettra d’assurer une plus grande transparence des efforts consentis en la matière et une meilleure information du consommateur.
À l’échelle internationale, l’obligation de vigilance permettra de rétablir les conditions d’une concurrence plus juste entre les entreprises produisant sur le sol français et celles qui recourent au dumping en matière de droits de l’homme et d’environnement en localisant certaines de leurs activités dans des pays dont les normes sont moins rigoureuses.
Enfin, le devoir de vigilance constitue un facteur de sécurité pour les entreprises à l’heure où l’opinion publique est de plus en plus sensible à leur comportement en matière éthique et environnementale. Ce texte leur fournit un cadre d’action permettant de réduire tout risque d’atteinte à leur réputation. De plus, l’inscription dans la loi d’une procédure clairement définie leur fournit une plus grande sécurité juridique alors même que le devoir de vigilance commence à être reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation – je vous renvoie au jugement de septembre 2012 relatif à l’affaire du naufrage du pétrolier Erika.
L’examen du texte par la commission des Affaires économiques, qui a confirmé la pertinence du dispositif proposé, a débouché sur l’adoption de dix amendements qui élargissent notamment le périmètre du devoir de vigilance à l’ensemble des sociétés sur lesquelles un contrôle exclusif est exercé et aux fournisseurs et sous-traitants avec lesquels existe une relation commerciale établie.
À deux abstentions près, les membres de la commission des Affaires économiques ont émis un avis favorable à l’adoption du texte.
M. Serge Bardy, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire. Je regrette, monsieur le président, qu’en dépit de l’avancement de l’heure de nos travaux, la fin de nos débats à dix heures trente ne permette pas à la commission des Lois de proposer au vote les amendements adoptés par la commission du Développement durable.
D’aucuns ont parlé d’idéologie : les entreprises, pour leur développement, ont tout à gagner à l’adoption du présent texte, alors même qu’elles sont quotidiennement confrontées au dumping social et environnemental des fournisseurs et sous-traitants situés dans des pays moins exigeants que le nôtre. Les chômeurs pourront également bénéficier des effets des mesures adoptées.
Nos grandes entreprises n’ont rien à gagner à rechercher une compétitivité-prix avec les pays émergents : elles seront toujours perdantes. D’ailleurs un grand nombre d’entre elles a compris qu’elles doivent préférer la recherche et l’innovation et, donc, la qualité sociale et environnementale. Une société qui établira un plan de vigilance comprenant des mesures raisonnables et les mettra en œuvre aura satisfait à son obligation de moyens et dégagera sa responsabilité.
Ce texte introduit une véritable innovation juridique. Si des exemples étrangers ont été évoqués par le rapporteur, aucun n’est assez ambitieux pour prévoir une vigilance sur un spectre aussi large : nous devons nous en réjouir.
La commission du Développement durable a émis un avis favorable à l’adoption de la proposition de loi.
M. Arnaud Richard. Je tiens à saluer, au nom de l’UDI, le fait que les quatre groupes de la majorité aient travaillé ensemble sur le texte. Je partage le souci du rapporteur de prendre de la hauteur : sur un tel sujet, c’est une bonne chose. Oui, la vie d’un travailleur vaut plus que tout l’or du monde !
Je tiens toutefois à observer qu’aucun pays ne prévoit une législation aussi étendue en matière de responsabilité des entreprises. Fallait-il s’y atteler ? Penser que, ce faisant, nous ouvrirons la voie au monde me semble, malheureusement, irréaliste. Une proposition aussi ambitieuse ne devrait-elle pas être plutôt défendue par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou par une future organisation internationale de l’environnement ? Alors que l’ONU a établi depuis longtemps des principes directeurs, fondés sur la soft law, rares sont les États qui les ont transposés dans une législation contraignante. La Finlande nous a même montré que transformer la vigilance raisonnable en obligation légale est peu envisageable.
Les textes qui, en droit français, traitent de ce sujet sont ponctuels : ils visent l’hébergement contraire à la dignité, l’emploi de travailleurs détachés ou la mise sur le marché de bois issus de récoltes illégales – trente pages sont nécessaires pour transposer le droit européen sur la seule question du bois. Quant aux exemples étrangers que vous avez évoqués, Monsieur le rapporteur, ils ciblent la corruption, l’esclavage humain et la traite des esclaves : il s’agit donc bien de points précis. Or la proposition de loi nous propose de changer de logique en imposant une vision très large, ce qui implique de bien préciser les normes. Faut-il attendre les décrets d’application ? Ne serait-il pas préférable de nous limiter à la communication ? Que signifient au plan juridique les « mesures de vigilance raisonnables » ? Certes, l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou l’ONU débattent de ces sujets : toutefois, ce sont des organisations interétatiques dont les propositions ne sont pas obligatoirement transposées en droit français. En cas d’obligation de vigilance, il nous faudra des années pour en préciser le contenu.
La proposition de loi est d’ailleurs orthogonale avec la directive européenne de 2014 sur le reporting extra-financier et la vigilance raisonnée. Elle prévoit une obligation à la fois trop dure et trop large, éloignée des standards juridiques actuels. Elle oriente de plus les organisations non gouvernementales et les associations vers le contentieux et non vers la mise en valeur des bonnes pratiques : c’est dommage.
Ce texte ne nous semble pas en phase avec les réalités économiques.
M. Paul Molac. Les écologistes et trois autres groupes de gauche avaient déposé sur le sujet une première proposition de loi qui, je tiens à le rappeler, a été renvoyée en commission.
Si ce nouveau texte affiche une intention pertinente et louable, sa rédaction laisse à désirer : en effet, il contient encore de nombreuses zones d’incertitude, ce qui le privera de toute portée effective, alors que les enjeux humains et environnementaux sont très importants. Dois-je rappeler que 160 000 citoyens ont soutenu cette démarche par voie de pétition et que, selon un sondage du CSA, 80 % des Français estiment que les multinationales doivent être tenues juridiquement responsables des catastrophes humaines et environnementales provoquées par leurs filiales et leurs sous-traitants ? Un drame comme celui du Rana Plaza ne doit pas se reproduire.
Le texte qui nous est aujourd’hui proposé demeure très en deçà de la proposition de loi que nous avions présentée le 29 janvier dernier, après l’avoir préparée en étroite concertation avec les ONG – elle était soutenue par 250 d’entre elles. Cette proposition de loi s’inscrivait du reste dans la droite ligne des principes directeurs des Nations unies et de l’OCDE en instaurant une obligation de vigilance assortie d’une obligation de moyens. Or la mise en œuvre effective de l’obligation de vigilance a disparu du texte. De même, si certains des amendements du rapporteur sont intéressants, d’autres exigent une expertise complémentaire : ils nous ont été transmis tardivement et demeurent trop timides.
C’est pourquoi les radicaux et les écologistes ont déposé, ensemble, des amendements visant à améliorer le texte.
C’est ainsi que, ne retrouvant pas dans la rédaction actuelle le principe de responsabilité solidaire, nous avons déposé un amendement en ce sens. Il convient en effet de franchir ce pas pour interdire aux donneurs d’ordre de se dérober dans la dilution de la chaîne de responsabilités.
Nous nous interrogeons également sur les seuils fixés par le texte – 5 000 et 10 000 salariés – car de nombreuses sociétés échapperont à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance alors que, chacun le sait, elles passent directement, notamment dans le secteur du textile, des commandes à des entreprises situées, par exemple, au Bangladesh. Le renvoi à un décret en Conseil d’État des modalités d’application des dispositions prévues et la définition des liens de sous-traitance soulèvent également des interrogations.
Ne faisons pas preuve d’angélisme : pour modifier les choses, il faut légiférer. C’est ainsi que le législateur a dû interdire le travail des enfants pour y mettre fin. Il faut savoir inscrire nos valeurs dans la loi. Si nous ne luttons pas contre le dumping social, nous acceptons la baisse des exigences sociales dans notre propre pays tout en incitant nos entreprises à délocaliser. Un tel texte contribuera à éviter les délocalisations.
Pour soutenir une telle initiative à l’échelon européen, nous devons présenter un texte dont les implications réelles modifieront les comportements. Les amendements que nous présentons, sans être radicaux, permettent de hisser le débat à la hauteur des défis que nous voulons relever ensemble.
Notre position finale dépendra des avancées réalisées lors de l’examen du texte en commission et en séance publique.
M. Jean-Noël Carpentier. Je remercie moi aussi le rapporteur qui fait effectivement preuve d’un grand dynamisme dans ce dossier. Compte tenu des difficultés grandissantes de la planète, de ces années de crise économique profonde – qui bousculent notre vision du monde économique – et du chômage de masse, nos concitoyens souhaitent de plus en plus que le monde économique serve d’abord l’humain plutôt que l’inverse. Nous avons aussi désormais une vision plus claire des effets de la mondialisation : beaucoup considèrent que si cette mondialisation économique est fondamentale et peut être novatrice, elle doit impérativement être régulée et contrôlée, non pour empêcher le développement humain ou économique mais pour juguler la financiarisation. Une mondialisation plus solidaire : tel est l’objectif commun à tous les groupes de la majorité. Ce texte est donc une loi de bon sens. Si les inégalités s’accroissent depuis une quinzaine d’années, c’est aussi du fait de pratiques douteuses sur le plan des droits de l’homme.
Cette régulation ne va pas du tout à l’encontre du monde économique et des entreprises. Certes, monsieur Houillon, la question n’est pas simplement franco-française – et c’est bien pour cela que l’ONU et l’OCDE s’en sont également saisies. Mais il convient aussi que les États transcrivent certains grands principes dans leur législation nationale. Plusieurs pays y travaillent actuellement. Les États-Unis eux-mêmes ont repris certains de ces principes dans leur législation. En outre, cette volonté de réguler est favorable au monde économique car elle empêchera les tricheurs de développer leur activité.
C’est le sens de l’Histoire – l’ONU propose du reste depuis plus de trente ans un conseil de sécurité économique et social. Chaque pays doit en débattre. La France peut apporter sa contribution, non pas pour imposer sa vision aux autres, mais pour montrer que des possibilités existent.
Si nous portons un regard positif sur cette proposition de loi, notre groupe émet néanmoins quelques réserves quant à sa mise en application concrète. Nous proposons ainsi par amendement d’élargir son champ d’application à davantage de grandes sociétés et que le plan de vigilance soit établi de manière plus ferme. Sous réserve de l’adoption de ces amendements, notre groupe émettra un avis favorable à l’adoption de cette proposition de loi.
M. Guillaume Larrivé. J’ai écouté avec attention nos débats : beaucoup de grands principes ont été rappelés et de bons sentiments, exprimés. Alors pardonnez-moi de vous faire atterrir peut-être un peu brutalement en posant une question très directe : quel sera l’impact de telles mesures sur l’emploi alors que l’on compte 570 000 demandeurs d’emploi de plus depuis trois ans ? Le terme « emploi » ne figure nulle part dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi. En revanche, on peut lire à la page 10 de celle-ci que l’article 1er de la proposition de loi « propose une approche extensive des risques que l’entreprise génère de par son activité ». L’entreprise crée des risques : telle est l’idéologie sous-jacente de ce texte. Et la France, seule, par le biais d’une proposition de loi émanant du groupe majoritaire, va faire peser sur les entreprises dont le siège est en France des obligations fort contraignantes et sanctionnées, le cas échéant, par les juridictions. Philippe Houillon comme Arnaud Richard ont soulevé des questions fort pertinentes. J’ai le sentiment, pour ma part, que vous allez encore attacher des boulets aux pieds de nos entreprises, en décalage complet avec ce que l’on avait cru être la nouvelle approche du Gouvernement. Manuel Valls déclarait en septembre dernier qu’il était « pro-business », or pardonnez-moi de vous dire que votre texte est totalement anti-entreprises.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ce texte introduit une grande innovation et je m’étonne que la droite républicaine ne soutienne pas l’idée que la France puisse adopter une attitude différente par rapport à la common law, c’est-à-dire au droit anglo-saxon. Ce dernier est effectivement fondé sur l’idée que c’est la pratique qui construit le droit, celui-ci venant ensuite la confirmer. Notre droit étant au contraire fondé sur des principes ; il est normal que la France élabore un texte de loi qui s’appliquera à tous. De cette manière, nous nous inscrivons bien, en tant que puissance, dans la dynamique économique internationale, dans un monde qui a beaucoup changé et qui continue à évoluer : des démocraties y montent – douloureusement parfois. Dans les pays en voie de développement et les pays émergents, les sociétés humaines aspirent à la démocratie, à plus de richesse, à plus de confort et à plus de sécurité. Or, c’est bien de sécurité des personnes au travail qu’il est question dans cette proposition de loi. Si le monde a changé, c’est non seulement parce qu’il s’est agrandi mais aussi parce que tout y est visible immédiatement. L’image est instantanée ; le drame est là. Le législateur français ne peut donc y rester indifférent, faire comme s’il ne le voyait pas et continuer à « renvoyer la balle » à des instances internationales. Car si celles-ci délibèrent et construisent une agora mondiale, elles ont du mal à en faire une réalité concrète qui nous concerne au quotidien.
Je remercie donc Dominique Potier d’avoir eu le génie de prendre cette initiative, il y a deux ans, avec l’ensemble des groupes politiques de la majorité élargie. Cela était nécessaire. Mais il convenait aussi de faire en sorte que ce droit nouveau puisse s’appliquer. Nous y sommes : pour la première fois à l’échelle mondiale, la faute va être caractérisée par le défaut de vigilance. Nous conférons en outre au juge une palette d’options : l’astreinte, l’amende civile et la publicité. Cette loi est donc fondée sur la force propre de la société française, l’objectif étant d’exiger des sociétés qu’elles donnent à voir les plans de vigilance construits par leurs directions générales. Nous construisons de la démocratie dans l’entreprise, de la solidité, de la vigilance et du droit moral puisque nous visons à garantir le droit des personnes, leur sécurité, leur vie et leur avenir, autant que les nôtres, dans un monde globalisé. Ne nous recroquevillons pas sur notre petit territoire national, ne nous abritons pas derrière un système international qui ne trouve pas à s’appliquer et que nous transcrivons en droit national selon nos traditions ! Si l’Europe se construit à la fois sur la soft law et sur notre droit, bâtissons-la ensemble afin que, dans la mondialisation, notre continent devienne un lieu de sécurité des biens et des personnes et surtout de liberté des personnes physiques et morales.
M. Philippe Houillon. Je voudrais ajouter un mot à mon propos liminaire et, avant cela, réagir à ce qui vient juste d’être dit. « Faisons donc différemment de tout le monde » : voilà ce que je viens d’entendre. Et d’ailleurs, cela fonctionne, vous avez raison : la France a une bien meilleure croissance que les autres pays et bien moins de chômage ! C’est l’exception française, encore une fois ! Ce que je viens d’entendre est surréaliste !
Et puisque je n’avais pas cette information lors de mon intervention de tout à l’heure, je souhaiterais vous lire quelques lignes tout à fait intéressantes des Échos de ce matin : « Le sujet embarrasse le Gouvernement. Il ne veut pas désavouer le groupe socialiste à l’Assemblée, mais craint de jouer en défaveur des entreprises françaises par rapport à leurs concurrents étrangers, non soumis à ce type de responsabilité ». Tout est dit.
M. le rapporteur. Madame Marie-Françoise Bechtel, si mon ancien métier de paysan m’a rendu attentif aux écosystèmes, c’est en ce qu’ils avaient de bénéfique pour l’homme. Il n’y a aucune ambiguïté dans mon esprit et si jamais je trébuchais, je sais que vous seriez là pour me relever.
L’exemple finlandais cité par M. Houillon est fallacieux : l’obligation de vigilance au sujet duquel la Finlande a renoncé à légiférer n’a rien à voir avec le plan de vigilance, assorti d’une liberté de moyens quant à sa mise en œuvre, que nous proposons d’introduire. Cette objection ne tient pas en droit car il ne s’agit pas du même objet juridique.
Vous appelez de vos vœux une normalisation des droits humains ainsi qu’un respect des écosystèmes. Or, les entreprises, que je connais bien pour avoir été de leur monde, dénoncent quant à elles une saturation des normes et demandent plus de liberté dans le choix des moyens servant à atteindre les objectifs que nous partageons tous. La proposition de loi leur accordant une telle liberté, il est paradoxal que certains membres du patronat exigent que tout soit normalisé. Il convient de trouver un juste équilibre entre un objectif de vigilance défini par des traités internationaux – relevant de l’OCDE et de l’ONU et que la France a ratifiés – et la liberté de moyens qui relève du génie de l’entreprise. Cet équilibre est parfaitement préservé dans la loi.
S’agissant des liens d’« influence déterminante », votre souci sera satisfait par nos amendements. Là encore, votre attaque est infondée. S’il est en effet fait référence dans le code de commerce à l’influence déterminante, nous avons voulu être plus précis que vous en faisant référence à un autre article du même code.
L’idée selon laquelle les associations et les syndicats deviendraient des procureurs privés relève d’un débat idéologique : en cas d’abus, les juges seront parfaitement fondés à rejeter les requêtes. En tant qu’élu d’une petite commune, j’ai été nombre de fois en colère face à une justice classant des affaires qui me paraissaient importantes. En outre, les abus que vous signalez ne sont rien à côté des drames que provoquent l’impunité et le manque de transparence des sociétés multinationales.
Le texte n’impose aucune obligation de résultat, quoi que vous en disiez, l’article 2 étant parfaitement séparé de l’article 1er. Il permet de sanctionner les sociétés responsables de dommages, le juge devant s’interroger sur le lien de causalité entre la qualité et l’effectivité du plan de vigilance, d’une part, et la responsabilité juridique de la société d’autre part, mais en aucun cas nous n’imposons d’obligation de résultat – ce qui, comme vous l’avez souligné à juste titre, serait irréaliste en droit international.
Monsieur Larrivé, l’opposition archaïque entre l’entreprise et les droits de l’homme relève du « monde d’avant ». Les entrepreneurs les plus modernes et les plus performants intègrent cette exigence de transparence, de respect de ses partenaires et d’engagement durable pour la planète et les droits de l’homme. Ils savent que les marchés du futur, malgré les soubresauts de l’Histoire, sont dans cette direction. Les entreprises françaises et européennes les plus compétitives sont présentes sur ces marchés d’excellence et pratiquent d’elles-mêmes la RSE dans le cadre de la soft law. Ainsi, 84 % des entreprises françaises sont au-dessus de la moyenne des normes RSE européennes. Et l’on compte 11 championnes françaises parmi les 31 entreprises internationales les mieux cotées en matière de RSE. Trois quarts des multinationales ciblées par la loi souscrivent déjà aux obligations RSE. Il s’agit donc, comme d’autres l’ont souligné, de faire de la RSE un avantage compétitif plus qu’un handicap.
Deux tiers des requêtes exprimées par M. Molac et certains membres des groupes de la majorité sont satisfaites, dans des formulations juridiques comparables – plus précises peut-être. J’espère que cela orientera leur choix en faveur de la dynamique de progrès qui est la nôtre.
Si Mme Capdevielle m’a rendu un hommage exagéré, elle me donne l’occasion de saluer le travail de Philippe Noguès, de Danielle Auroi, d’André Chassaigne, ainsi que des collègues de l’UMP et de l’UDI qui ont rejoint le groupe de travail que nous avons institué avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) et Amnesty International, qui ont partagé nos objectifs, et accepté d’élaborer dans une logique de compromis cette deuxième version du texte. Transcendant les postures partisanes, ce groupe de travail, véritable communauté d’idées, nous a permis d’avancer dans un champ innovant. Au sein même de cette Commission, nous avons bénéficié du précieux appui d’Anne-Yvonne Le Dain, de Jean-Yves Le Bouillonnec et de Dominique Raimbourg.
Enfin, sachez que le Premier ministre s’est engagé en faveur de cette proposition de loi, ce qui n’allait pas de soi tant ce texte va contre vents et marées, s’opposant à une idéologie que vous avez largement colportée sur ces bancs – idéologie hostile à toute forme de régulation et de réglementation. Le Premier ministre partage nos objectifs et il a eu le courage de tenir sa parole. Et puisque vous parlez d’un embarras du Gouvernement, je puis vous assurer que nous avons eu le concours sans faille de Matignon, de la Chancellerie et de Bercy pour faire aboutir ce texte dans sa forme actuelle, et qu’ils acceptent les améliorations que nous proposons par amendement.
La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.
Article 1er
(art. L. 225-102-4 du code de commerce [nouveau])
Obligation d’élaboration d’un plan de vigilance
L’article 1er de la proposition de loi crée un nouvel article L. 225-102-4 au sein du livre II du code de commerce relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique, au sein du titre II abritant des dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales, au chapitre V portant sur les sociétés anonymes.
L’article 1er de la proposition de loi impose à « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger » d’établir un plan de vigilance. Ce sont donc des sociétés de taille significative qui sont visées : elles ont les moyens de mettre en œuvre cette obligation sans que leur compétitivité soit pénalisée, et leur activité constitue une part significative du commerce international (69).
Le droit positif retient le seuil de 5 000 salariés pour distinguer une entreprise de taille intermédiaire d’une grande entreprise : « une grande entreprise est une entreprise qui a au moins 5 000 salariés » (70). Ces sociétés seront amenées à se doter d’un plan de vigilance dès lors que leur siège social est établi en France, c’est-à-dire s’il s’agit de sociétés françaises.
Par ailleurs, l’article 1er prévoit également d’assujettir à cette obligation les entreprises employant plus de 10 000 salariés en leur sein ou dans leurs filiales, sans considération de la localisation de leur siège social. Cette disposition vise particulièrement les groupes internationaux : si quatre-vingt-onze seulement dépassaient le seuil de 10 000 salariés parmi ceux qui exercent leur activité pour tout ou partie sur le territoire français en 2008, ils représentaient plus de 38 % des effectifs de la catégorie selon l’Institut national de la statistique des études économiques (INSEE) (71). Tout laisse penser que ce ratio s’est encore accru depuis (72).
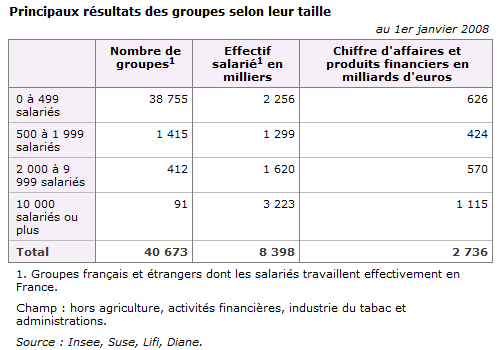
L’article 1er ne se cantonne pas aux frontières juridiques de la société. Il prend pour base le groupe que dirige l’entreprise et, de ce fait, permet de calculer le seuil de salariés pertinent en intégrant les effectifs des « filiales directes ou indirectes », expression qui apparaît à plusieurs reprises dans le code de commerce (73). Les sociétés détenues par l’intermédiaire d’autres filiales seront donc incluses dans le calcul de l’effectif du groupe aussi bien que les structures contrôlées sans intermédiaire.
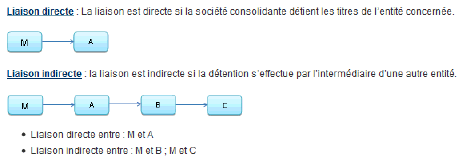
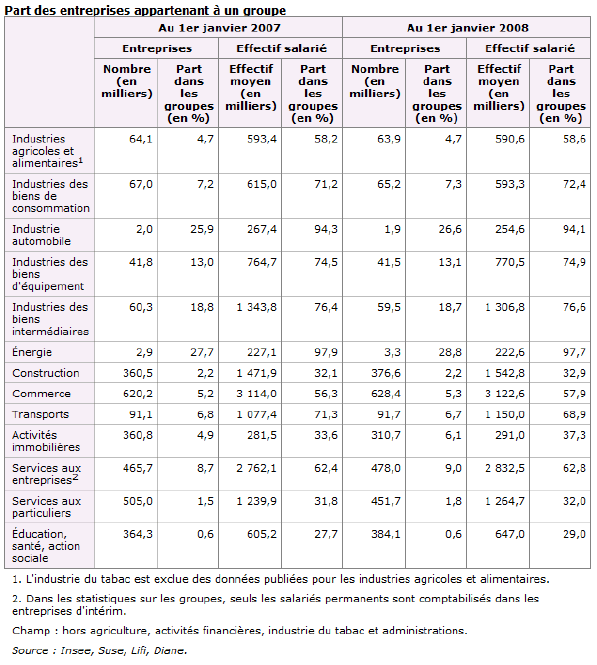
La proposition de loi s’appuie sur des précédents en retenant ces deux critères alternatifs d’effectif de la société-mère : ils sont déjà utilisés dans le code de commerce pour limiter aux grandes entreprises des prescriptions plus exigeantes que le droit commun. L’article L. 225-27-1 du code de commerce, qui impose la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein du conseil d’administration, utilise une formulation très voisine : « Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise (…), il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend (…) des administrateurs représentant les salariés. » Cette rédaction a suscité un consensus en son temps puisqu’elle transcrivait fidèlement l’accord conclu par les partenaires sociaux sur la sécurisation de l’emploi le 11 janvier 2013 (74).
L’article 1er s’applique enfin dans un périmètre restreint du fait de son inscription dans un chapitre du code de commerce réunissant des dispositions spécialement applicables aux sociétés anonymes. Ses prescriptions ne concerneront par conséquent ni les sociétés par actions simplifiées, ni les établissements publics, ni aucune autre forme juridique qu’est susceptible de prendre une entreprise (75).
Ce sont donc les groupes multinationaux réalisant tout ou partie de leur activité sur le territoire français qui sont assujettis aux obligations assignées par l’article 1er. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire sont explicitement exclues du dispositif.
L’article 1er de la proposition de loi fait obligation aux entreprises assujetties « d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance ». Ce plan détaille les diligences raisonnables propres à prévenir les risques « résultant de ses activités et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que les activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elle exerce une influence déterminante ». Il vise également à « prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle ».
La définition de la filiale figure à l’article L. 233-1 du code de commerce. Selon cette disposition, « lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée (…) comme filiale de la première. » Les situations économiques recouvertes par la proposition de loi sont donc relativement limitées, puisqu’elles supposent un contrôle capitalistique d’une société par une autre. Un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu en octobre 2013 (76), est venu illustrer les conséquences de cette définition. Dans cette affaire Venel, un salarié avait obtenu du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun une condamnation de l’entreprise Areva pour « faute inexcusable » en tant que « co-employeur ». Or, le contrat de travail avait été établi par une société nigérienne en charge de l’exploitation et dont Areva n’était qu’actionnaire minoritaire, aux côtés de l’État nigérien, à hauteur de 34 %. La stricte observation du droit a conduit la cour d’appel à infirmer le jugement de première instance et à relaxer le donneur d’ordre.
Quant à la sous-traitance, sa définition apparaît à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Celui-ci dispose : « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » Or, les entreprises multinationales fonctionnent aujourd’hui sur la base d’une « cascade de sous-traitance » rendant très délicate l’identification des responsabilités (77). L’expérience tragique de l’effondrement du Rana Plaza de Dacca, avec près de 1 200 morts le 24 avril 2013, en fournit un exemple cruel puisque les investigations sont toujours en cours.
L’article 1er impose aux sociétés-mères d’inclure leurs filiales et leurs sous-traitants dans le périmètre du plan de vigilance qu’elles devront établir. Si la précision selon laquelle sont concernées les filiales contrôlées aussi bien directement qu’indirectement n’appelle pas de commentaire, il n’en va pas de même de la mention selon laquelle les sous-traitants et les fournisseurs font également l’objet de mesures de vigilance raisonnable si l’entreprise donneuse d’ordre exerce sur eux « une influence déterminante ».
Cette notion figure dans le code de commerce au titre III du livre IV, c’est-à-dire dans les dispositions relatives au contrôle des concentrations (78). Selon le III de l’article L. 430-1, « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent (…) la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise (…). » Afin d’établir l’existence d’une influence déterminante, l’Autorité de la concurrence utilise la méthode du faisceau d’indices (79) : sens prévisible du vote des autres actionnaires, dispersion du capital, liens économiques entre les différents actionnaires ou encore absence de droit de veto. Il semble non seulement difficile de rechercher une influence déterminante ainsi définie dans une relation contractuelle, mais même contre-productif de limiter la portée de la loi à une telle situation de domination. En effet, l’usine du Rana Plaza travaillait pour des dizaines de donneurs d’ordre dont aucun n’exerçait d’influence dominante par rapport à tous les autres : contrairement aux secteurs des mines et de l’énergie (80), dominés par un nombre limité d’acteurs, la filière textile est suffisamment atomisée pour éviter les positions dominantes à l’échelle mondiale.
Quant au contenu du plan de vigilance, l’article 1er délimite un périmètre étendu : les mesures de vigilance devront prévenir les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les dommages corporels et environnementaux graves, les risques sanitaires et les comportements de corruption active ou passive.
On admet généralement une définition formelle suivant laquelle les droits fondamentaux sont proclamés par des textes de rang constitutionnel (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ou encore Charte de l’environnement du 1er mars 2005) ainsi que par des conventions internationales et européennes (Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Pactes de New York du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou encore Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000). Ils regroupent à la fois les droits de première génération et libertés publiques (droit de propriété, liberté de conscience, droits politiques, habeas corpus, etc.) de seconde génération (droit au travail, à l’accès aux soins, à l’éducation, droit de grève, etc.), et de troisième génération (environnement, bioéthique, etc.).
Il appartiendra de préciser dans le présent article le détail des droits et libertés à protéger ainsi que le caractère de gravité attaché aux dommages corporels et environnementaux à prévenir. Par ailleurs, une grande partie des droits de l’homme s’exercent dans les limites établies par la loi et, dès lors que les atteintes en question auront le plus souvent lieu dans des systèmes étatiques et juridiques étrangers, le degré de protection qui leur est attaché est susceptible de varier (81). Le rôle du juge consistera à apprécier les circonstances pour déterminer si l’entreprise a correctement satisfait à l’obligation de moyen qui lui est imposée.
À l’inverse, le délit de corruption est universellement identifié et suffisamment caractérisé par le droit français pour ne soulever aucune difficulté. Les auditions menées par votre rapporteur ont montré un relatif consensus autour de cette disposition (82).
Les groupes multinationaux devront prévenir la corruption et les atteintes aux droits de l’homme, à la santé publique et à l’environnement dans leurs filiales et dans leurs relations contractuelles. Il leur est assigné une obligation de moyens, de « vigilance raisonnable ».
Les entreprises sont responsables des dommages que leurs activités génèrent ; il leur revient de limiter les risques de survenue desdits dommages. Afin de parvenir à cet objectif, l’article 1er prévoit un dispositif de contrôle fondé en partie sur l’autocontrôle et sur la transparence, conformément à la tradition philosophique à la base de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) (83).
Si la loi et son décret d’application délimitent les ambitions du plan de vigilance, la détermination des mesures de vigilance est laissée à la liberté de l’entreprise assujettie. Celle-ci réalise des opérations commerciales et financières sur le terrain ; elle dispose d’une bonne connaissance des risques et des circonstances locales. Elle est la mieux placée, si elle est de bonne foi, pour édicter des mesures de vigilance raisonnable. En cela, l’article 1er s’inspire du champ de l’incitation (soft law) : les sociétés responsables élaborent déjà des codes de bonne conduite à usage interne, sur lesquels elles pourront s’appuyer pour déterminer les engagements dont la loi les obligera à rendre compte. La pertinence du contenu du plan sera d’autant mieux garantie qu’il fera l’objet d’une concertation avec les parties prenantes (84).
Ni les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ni les conclusions présentées en 2011 par M. John Ruggie, représentant spécial chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises devant le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des nations unies (ONU), ne définissent le devoir de vigilance de façon précise. Soumettre les entreprises à une obligation de vigilance ne constitue néanmoins une novation ni en France, ni à l’étranger. L’article L. 561-5 du code monétaire et financier indique déjà : « Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les [organismes financiers] identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant. [Ils] identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’[ils] soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. » Une logique analogue préside à l’article L. 8222-1 du code du travail, qui oblige le cocontractant à s’assurer que son partenaire ne s’adonne pas au travail dissimulé.
En Allemagne, la loi institue une responsabilité des entreprises en cas de manquement dans l’exécution du contrat d’embauche : il en découle une obligation de vérification renforcée dans les relations avec les sous-traitants (85).
Au Royaume-Uni, une loi sur la corruption (86) met en jeu la responsabilité d’une entreprise dès lors qu’elle bénéficie des agissements répréhensibles d’un tiers – filiale, intermédiaire ou toute relation économique autre. L’entreprise ne peut se défendre de l’accusation qu’en justifiant avoir mis en œuvre les procédures adéquates destinées à empêcher ses partenaires économiques de se commettre de la sorte : c’est sur elle que repose la charge de la preuve (87).
En Suisse, l’article 102 du code pénal prévoit que, dans une série de cas, « l’entreprise est punie indépendamment de la "punissabilité" des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. » Par ailleurs, une initiative populaire (88) « Multinationales responsables » a été lancée en janvier 2015 afin d’imposer à toutes les entreprises helvètes un « devoir de diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement ». Elle pourrait aboutir dès l’été 2015.
Au Canada, depuis 2004, une société doit protéger ses employés et la population voisine contre le risque de dommage corporel, et prendre des mesures raisonnables en ce sens au titre de l’article 217.1 du code criminel (89). Seuls les dommages survenus au Canada tombent toutefois sous le coup de cette disposition.
Enfin, aux États-Unis, une loi du XVIIIe siècle relative aux dommages causés aux étrangers (90) donne compétence aux juridictions américaines pour connaître des actions civiles engagées par des citoyens étrangers en cas de violation d’un traité conclu par les États-Unis ou d’atteinte au droit des gens (91). Elle fut peu appliquée jusqu’aux années 1980, où l’interprétation jurisprudentielle s’est faite plus extensive, jusqu’à affirmer la compétence de la justice américaine pour juger des actes commis hors de son territoire dès lors que ceux-ci attentaient aux droits de l’homme (92). La Cour suprême a finalement fait évoluer sa jurisprudence en 2013 pour éviter qu’émerge une compétence universelle des États-Unis dans ce domaine (93).
Le plan de vigilance est rendu public et annexé au rapport mentionné à l’article L. 225-102 du code de commerce (94). Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander, éventuellement en référé (95), à la juridiction civile ou commerciale d’enjoindre à la société d’établir le plan de vigilance, d’en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre. L’article 1er présume cet intérêt à agir pour toute association reconnue d’utilité publique et toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans (96), dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts protégés par le plan de vigilance. Le juge peut sanctionner un manquement d’une amende civile (97) d’un montant maximal de dix millions d’euros, aux termes du III du nouvel article L. 225-102-4 du code de commerce.
Cette sollicitation de la justice est d’ailleurs déjà prévue dans l’article L. 225-102 pour le rapport auquel le plan est annexé : le troisième alinéa précise ainsi que « lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » Les dispositions de la proposition de loi se montrent cependant plus pertinentes en prévoyant des sanctions plus dissuasives, une facilité plus grande pour saisir les juridictions, et une garantie de l’existence et de la mise en œuvre du plan.
Le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi impose l’obligation d’édicter un plan de vigilance aux sociétés répondant aux critères définissant une grande entreprise tels qu’ils figurent déjà dans le code de commerce : il s’agit des entreprises employant plus de 5 000 ou de 10 000 salariés suivant la localisation du siège social. Plusieurs amendements ont été défendus afin d’abaisser ces seuils en les alignant sur ceux définis en matière de reporting extra-financier, soit 500 salariés (98). Votre Commission, suivant en cela votre rapporteur, a considéré que la rédaction initiale de l’article 1er constituait une première étape qui en appelait d’autres, tant à l’échelon national qu’au niveau européen, et qu’il convenait d’en rester là pour l’heure.
Outre des précisions rédactionnelles, la commission des Lois a apporté des modifications sensibles à l’article 1er. Elle a ainsi adopté :
- un amendement du rapporteur définissant plus précisément le contrôle direct ou indirect par la société-mère en faisant référence au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, aux termes duquel « le contrôle exclusif par une société résulte : [soit] de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, [soit] de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise (…), [soit] du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. » Cette évolution permet d’expliciter le périmètre d’application du plan de vigilance et d’indiquer qu’il dépasse les filiales dont le capital est contrôlé pour plus de la moitié ;
- deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, substituant la condition de l’existence d’une « relation commerciale établie » à celle d’une « influence déterminante » afin d’inclure dans le périmètre du plan de vigilance des fournisseurs et sous-traitants. En effet, on sait qu’un atelier tel que celui du Rana Plaza traite avec suffisamment de donneurs d’ordre pour qu’aucun ne dispose d’une influence déterminante sur lui, voire que certains opérateurs économiques sollicitent les services d’un importateur et ne tissent donc aucun lien contractuel direct avec leurs fournisseurs et sous-traitants. Par ailleurs, la suggestion d’une référence à l’ensemble des « relations d’affaires » telle qu’elle était proposée par certains amendements n’a pas été jugée pertinente : il ne semble ni possible d’inclure dans un plan les cocontractants ponctuels, ni souhaitable d’intégrer non seulement fournisseurs et sous-traitants, mais aussi clients et partenaires (99). La référence à une relation commerciale établie (100), définie par la jurisprudence comme un partenariat dont chacun peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l’avenir (101), ne présente pas de semblables inconvénients ; elle a donc été retenue ;
- deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, restreignant le champ du décret d’application prévu par la proposition de loi aux seules modalités de présentation et d’application du plan de vigilance ;
- trois amendements identiques du rapporteur, de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et de M. Philippe Noguès, supprimant la précision selon laquelle les juridictions compétentes en cas de litige sont les tribunaux civils et commerciaux, de sorte que les règles normales d’attribution des contentieux s’appliquent désormais ;
- deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, confiant au juge le soin de prononcer une amende civile, sans qu’une sollicitation des parties en ce sens soit nécessaire ;
- trois amendements identiques du rapporteur, de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, et de M. Philippe Noguès, précisant que l’amende civile ne pouvait faire l’objet d’une déduction fiscale. Bien que le 2 de l’article 39 du code général des impôts dispose que « les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt », la commission des Lois a souhaité que le présent texte mentionne explicitement cette exclusion.
*
* *
La Commission examine en discussion commune les amendements identiques CL1 de Mme Danielle Auroi, CL9 de M. André Chassaigne et CL17 de M. Jean-Noël Carpentier ainsi que l’amendement CL29 de M. Philippe Noguès.
M. Paul Molac. Ces amendements visent à abaisser le seuil d’effectifs fixé par la proposition de loi afin que davantage d’entreprises soient concernées par ses dispositions.
M. Marc Dolez. L’amendement CL9 est défendu.
M. Jean-Noël Carpentier. L’amendement CL17 également.
M. le rapporteur. Avis défavorable : les seuils que nous avons établis permettent de couvrir 80 % du commerce mondial et deux tiers des activités réalisées en dehors de l’OCDE. C’est aux plus grandes entreprises françaises qu’il revient de donner l’exemple. Ce seuil, qui sert déjà de référence pour définir certains droits sociaux, s’agissant notamment des conseils d’administration, pourra bien sûr être réévalué ultérieurement. Nous examinerons d’ailleurs en séance publique des amendements en ce sens.
Le seuil proposé par les associations et les syndicats – 500 salariés et un chiffre d’affaires minimum – nous semble un horizon accessible à terme. Mais comme il ne nous appartient pas de déterminer à quel rythme nous pourrons y parvenir, nous proposons de nous en tenir au seuil énoncé dans cette proposition de loi, ce qui représente déjà un pas énorme.
M. Philippe Noguès. L’amendement CL29 vise à aligner les seuils mentionnés à cet article sur ceux applicables en matière de reporting extra-financier, afin d’éviter de multiplier les seuils applicables aux entreprises. Je rappelle que le drame du Rana Plaza était le fait d’entreprises du textile aux effectifs bien inférieurs à ceux dont il est question dans la proposition de loi.
M. le rapporteur. Avis défavorable : le mieux peut être l’ennemi du bien.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL39 et CL38 du rapporteur.
Elle examine ensuite en discussion commune les amendements CL50 de la commission des Affaires économiques et CL47 du rapporteur.
Mme Annick Le Loch, rapporteure pour avis de la commission des Affaires économiques. Cet amendement vise à étendre le périmètre du plan de vigilance aux sociétés sur lesquelles est exercé un contrôle exclusif.
M. le rapporteur. L’amendement CL47 vise lui aussi à étendre la portée de la loi aux entreprises que les sociétés commerciales contrôlent de manière exclusive, selon les termes de l’article L. 233-16 du code de commerce. En effet, il convient de prendre en compte non seulement le lien capitalistique mais aussi le lien de domination politique pouvant exister entre une société mère et une entreprise.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces deux amendements n’étant pas identiques, il conviendrait que l’un d’entre eux soit retiré. Or, l’amendement du rapporteur me semble mieux rédigé.
Mme Annick Le Loch, rapporteure pour avis de la commission des Affaires économiques. Dans ce cas, je retire mon amendement.
L’amendement CL50 est retiré.
Puis la Commission adopte l’amendement CL47.
Elle aborde en discussion commune les amendements identiques CL2 de Mme Danielle Auroi, CL10 de M. André Chassaigne, CL18 de M. Jean-Noël Carpentier, et les amendements identiques CL48 du rapporteur et CL51 de la commission des Affaires économiques.
M. Marc Dolez. La référence, au troisième alinéa, à la notion d’ « influence déterminante » étant trop restrictive, l’amendement CL10 tend à viser plus largement la relation d’affaires qu’entretient la société avec ses fournisseurs.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je partage l’intention des auteurs de ces amendements, la référence à la notion d’« influence déterminante » ne me paraissant effectivement pas satisfaisante. Mais j’ai formulé dans mon amendement CL48 une proposition alternative qui va plus loin que la leur, en faisant référence à une « relation commerciale établie », et ciblant ainsi davantage les sous-traitants et les fournisseurs. La notion de « relation d’affaires » à laquelle vous vous référez, chers collègues, présente le défaut de ne pas être liée au statut de sous-traitant et de fournisseur et de pouvoir être opposée à un petit fournisseur dans sa relation avec un très gros acheteur, ce qui va à l’encontre du but recherché. Il me semble que ma proposition satisfait pleinement votre attente. Autant, sur le plan vertical, nous nous sommes limités aux entreprises de plus de 5 000 salariés, autant, sur le plan horizontal, nous avons cherché à viser le plus loin possible la responsabilité des maisons mères (CHSCT).
La Commission rejette les amendements CL2, CL10 et CL18.
Puis elle adopte les amendements identiques CL51 et CL48.
Elle en vient à l’amendement CL27 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement vise à ce que les syndicats et représentants du personnel de l’entreprise soient dûment informés de l’existence et du contenu du plan de vigilance en rendant obligatoire sa présentation devant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise (CHSCT).
M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, le droit en vigueur prévoit déjà l’information du CHSCT. Ensuite, cette prérogative relève plutôt du comité d’entreprise. Enfin et surtout, nous ne voulons pas ajouter trop de dispositions à cette proposition de loi. L’ensemble des dispositions auxquelles vous faites référence font partie du droit commun des entreprises. Il est donc inutile de les rappeler.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine en discussion commune l’amendement CL30 de M. Philippe Noguès, les amendements identiques CL49 du rapporteur et CL57 de la commission des Affaires économiques ainsi que les amendements identiques CL3 de Mme Danielle Auroi, CL11 de M. André Chassaigne et CL19 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Philippe Noguès. L’amendement CL30 a pour objet de supprimer le cinquième alinéa de l’article, qui prévoit la publication d’un décret en Conseil d’État. Alors que ses modalités d’application me semblent suffisamment exposées dans la proposition de loi, rendre nécessaire le recours à la voie réglementaire risque de retarder l’entrée en vigueur de ce texte.
M. le rapporteur. Si je suis défavorable à la suppression de cet alinéa, je partage la crainte que ce décret ne permette au pouvoir réglementaire de réécrire la loi et d’en amenuiser la portée. C’est pourquoi l’amendement CL49 vise à limiter le contenu de ce décret aux seules modalités de présentation du plan de vigilance.
M. Serge Bardy, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. La commission du Développement durable a adopté ce matin un amendement identique à l’amendement CL49.
La Commission rejette l’amendement CL30.
Puis elle adopte les amendements CL49 et CL57.
En conséquence, les amendements CL3, CL11 et CL19 deviennent sans objet.
La Commission examine ensuite les amendements identiques CL34 de M. Philippe Noguès, CL40 du rapporteur et CL52 de la commission des Affaires économiques.
M. Philippe Noguès. Il n’est pas nécessaire de préciser que les juridictions civile et commerciale sont les juridictions compétentes, car cela exclut d’autres juridictions potentiellement compétentes selon les cas particuliers.
M. Serge Bardy, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. Un amendement identique a été adopté ce matin en commission du Développement durable.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL4 de Mme Danielle Auroi, CL12 de M. André Chassaigne et CL20 de M. Jean-Noël Carpentier, et l’amendement CL31 de M. Philippe Noguès.
M. Jean-Noël Carpentier. La mise en place du plan de vigilance prévu par la proposition de loi est indispensable. Il devra être précis et permettre le contrôle total du dispositif, l’entreprise devant exposer la réalité de ce plan. L’amendement complète ainsi la proposition de loi.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La rédaction de la proposition de loi comble déjà votre attente. Elle prévoit que le devoir de vigilance n’est pas seulement formel, mais se met en œuvre de manière effective. Ces mots garantissent son caractère opérationnel sur le terrain et donne une prise au juge dans son examen. Telle qu’elle est rédigée, la proposition de loi ne se contente pas de demander à l’entreprise d’apporter la preuve que des inspecteurs sont passés, par exemple, dans des ateliers textiles, mais bien de montrer qu’ils les ont effectivement contrôlés.
M. Philippe Noguès. La formulation que je propose me semble plus forte. Elle exclut que les inspecteurs rendent seulement un rapport.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine l’amendement CL33 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement vise, non à inverser, mais à alléger la charge de la preuve qui pèse actuellement entièrement sur les victimes. Or, les éléments d’information concernant la mise en œuvre effective du plan de vigilance sont difficiles d’accès pour elles alors qu’elles sont à la disposition de l’entreprise.
M. le rapporteur. Le plan de vigilance devant être publié, toutes les parties prenantes ont également la capacité de saisir le juge sur des arguments étayés. Votre souhait de revenir à l’inversion de la charge de la preuve va à l’encontre de la logique de la présente proposition de loi, qui se focalise sur la prévention, la précaution, la sanction de l’absence de prévention et, le cas échéant, la réparation. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL35 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement vise à donner explicitement intérêt à agir aux syndicats, qui ont exprimé des préoccupations en ce sens.
M. le rapporteur. Précision inutile. La proposition de loi prévoit que toutes les personnes physiques et morales justifiant d’un intérêt à agir pourront le faire. Si nous commencions à énumérer les différentes catégories, nous devrions également mentionner les associations, les organisations non gouvernementales…
Mme Anne-Yvonne Le Dain. D’autant que les syndicats sont de droit fondés à agir !
L’amendement est retiré.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL5 de Mme Danielle Auroi, CL13 de M. André Chassaigne et CL21 de M. Jean-Noël Carpentier, les amendements identiques CL41 du rapporteur et CL53 de la commission des Affaires économiques, et l’amendement CL36 de M. Philippe Noguès.
M. Paul Molac. La proposition de loi prévoit une amende civile dont le montant, plafonné à dix millions d’euros, pourrait, en fonction des circonstances appréciées par le juge, se révéler inadapté. Implicitement, ce plafond présente une garantie contre la prise en charge des catastrophes les plus coûteuses, a priori les plus graves. Il y a là contradiction. Afin de laisser une latitude au juge pour tenir compte de la capacité financière des entreprises, en vertu du principe de proportionnalité des peines, il est proposé de corréler la sanction financière au chiffre d’affaires du groupe concerné.
M. le rapporteur. Gardons-nous des confusions. À l’article 1er, la sanction porte sur le défaut de vigilance, tandis que la réparation des dommages causés est traitée à l’article 2. Une amende d’un montant maximal de dix millions d’euros est à un niveau suffisamment dissuasif pour encourager l’entreprise à développer un plan de vigilance, propre à assurer sa compétitivité dans un monde moderne, plutôt qu’à provisionner simplement dans ses comptes le risque d’une carence. Au demeurant, il incombe au législateur de fixer un montant maximal, sur lequel il pourra ultérieurement revenir. Quant à quantifier l’amende en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, cela n’est pas apparu pertinent. J’ajoute que le juge peut également prononcer des astreintes non plafonnées. Au-delà du risque réputationnel, les moyens de contrainte ne feront donc pas défaut.
D’une manière plus générale, la proposition de loi vise non à multiplier les amendes, mais à créer un climat propice à une pratique plus vertueuse de l’obligation de vigilance.
M. Philippe Noguès. Dans le même esprit, mon amendement vise à écarter le montant de dix millions d’euros auquel l’amende se trouve fixée pour on ne sait quelle raison, plutôt qu’à cinq ou à vingt millions d’euros. Je propose qu’elle soit plutôt proportionnelle au dommage et aux moyens de la société condamnée.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements CL5, CL13 et CL21.
Elle adopte les amendements CL41 et CL53.
Elle rejette l’amendement CL36.
Puis elle examine les amendements identiques CL37 de M. Philippe Noguès, CL46 du rapporteur et CL58 de la commission des Affaires économiques.
M. le rapporteur. Il a semblé bon de rappeler que le contribuable ne devrait pas supporter la faute de l’entreprise, en précisant que l’amende n’est pas déductible du résultat fiscal.
M. Serge Bardy, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. La commission du Développement durable partage cette préoccupation légitime ; elle a adopté un amendement identique.
La Commission adopte les amendements.
Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.
Article 2
(art. L. 225-102-5 du code de commerce [nouveau])
Responsabilité en cas de manquement aux obligations du plan de vigilance
L’article 2 de la proposition de loi crée un nouvel article L. 225-102-5 à la suite du précédent au sein du code de commerce. Son application est donc limitée, pour les mêmes raisons, aux sociétés anonymes.
1. L’engagement de la responsabilité de la société pour manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance
La principale difficulté rencontrée dans la voie de l’instauration d’une obligation de vigilance des entreprises donneuses d’ordre tient au principe d’autonomie de la personnalité juridique. Si le vocabulaire économique emploie volontiers le terme de « groupe » pour désigner une multinationale et ses filiales, celles-ci demeurent des entités séparées en droit. Chacune, par conséquent, assume sa responsabilité propre à l’exclusion de celle des autres. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans une jurisprudence récente : « un "groupe de sociétés" ne peut, faute de personnalité morale, être titulaire de droits et d’obligations et se voir infliger une condamnation (102) ». La problématique est identique, et plus évidente encore, dans une relation de sous-traitance.
L’article 2 contourne cette difficulté par un mécanisme astucieux qui renvoie au droit commun de la responsabilité civile, fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil (103). Celui-ci détermine trois conditions d’engagement de la responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La faute sanctionnée est la violation des obligations définies à l’article précédent, c’est-à-dire soit le défaut d’établissement d’un plan de vigilance, soit l’absence de sa publication, soit son imparfaite mise en œuvre.
Le préjudice subi dépend du requérant et des faits qu’il rapporte au tribunal. S’il s’agit d’une organisation non-gouvernementale, ce préjudice serait essentiellement moral et causé par la mauvaise édiction de mesures de prévention de la corruption et d’atteintes aux droits de l’homme, à l’environnement, à la santé publique. S’il s’agit d’un cocontractant, le préjudice peut être financier et fondé sur le caractère léonin (104) du contrat de fourniture ou de sous-traitance. S’il s’agit d’un salarié, tant les conditions d’exercice de son emploi que les conséquences d’un éventuel accident pourront faire l’objet d’une demande de réparation.
Quant au lien de causalité, il reviendra au juge d’en apprécier la pertinence. L’effondrement de l’immeuble abritant une usine, pour reprendre l’exemple du Rana Plaza, peut être prévenu par des précautions simples ; toutefois, il est certain qu’une mesure de vigilance raisonnable ne permet pas d’empêcher la survenue d’un événement irrésistible. Nulle entreprise, même multinationale, ne peut par exemple agir contre un séisme, une catastrophe climatique ou une insurrection armée (105).
En conséquence, il suffira à une société assujettie d’édicter un plan de vigilance comprenant des mesures raisonnables et de le mettre effectivement en œuvre pour satisfaire son obligation de moyens et dégager sa responsabilité. La survenue d’un accident ne signifie aucunement ipso facto qu’une faute a été commise, et même l’existence d’une faute ne présume pas d’une causalité entre celle-ci et le préjudice subi. La preuve de l’établissement du plan de vigilance et de sa publication peut être facilement établie. Quant à la mise en œuvre effective, elle peut être établie par tout moyen : des engagements contractuels, une certification, un label, un partenariat avec une partie prenante spécialisée dans la protection de l’environnement ou dans la défense des travailleurs, seront autant d’éléments propres à convaincre le juge. Du reste, il appartiendra au demandeur de prouver l’ineffectivité de la mise en œuvre et non au défendeur d’étayer l’affirmation inverse.
Outre la réparation du préjudice, le juge peut prononcer une amende civile d’un maximum de dix millions d’euros dans les conditions prévues à l’article précédent. Il peut aussi ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision : le risque réputationnel qui en découle pour l’entreprise renforce l’effet dissuasif de la sanction.
La responsabilité d’une société en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance relève du droit commun. Ces éléments seront appréciés factuellement par le juge. La survenue d’un accident n’aboutira donc pas automatiquement à la condamnation de l’entreprise puisqu’une obligation de moyens ne saurait garantir une obligation de résultat.
Par ailleurs, sur le modèle de la mutualisation du risque par assurance obligatoire qui prévaut dans le système de protection des salariés contre les accidents du travail, rien n’interdit à un groupe de sociétés de se structurer, éventuellement au moyen d’un accord de filière ou à travers une instance juridique ad hoc, afin d’organiser la mise en œuvre commune de leur responsabilité dans une démarche collective. Le fonds commun de solidarité, ou « Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh », créé après l’accident du Rana Plaza pour financer et piloter des activités d’inspection en matière de sécurité, en fournit un premier exemple plein d’intérêt.
La responsabilisation des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre aurait pu passer par une application de l’article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Toutefois, cette solution aurait présenté l’inconvénient d’instituer un régime de responsabilité objective du fait d’autrui, d’imposer à une société d’endosser pleinement les conséquences des actes commis par sa filiale ou par son cocontractant, sans avoir commis la moindre faute et peut-être même malgré une vigilance sincère de sa part face aux atteintes et aux comportements visés par le projet de loi. Par ailleurs, la mention de personnes ou de choses que l’entreprise a « sous sa garde » ouvrirait un débat sur la notion de contrôle contraire à l’objectif poursuivi par la proposition de loi.
Une autre option aurait consisté, sur le modèle du dispositif de la proposition de loi n° 1519 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre examinée en séance publique le 29 janvier 2015 sur le rapport de Mme Danielle Auroi, à instituer une présomption simple de faute (106) revenant à assigner à l’entreprise la charge de la preuve. Ce mécanisme permet de résoudre la difficulté à laquelle se heurtent, en son absence, victimes et associations : il est ardu de prouver un manquement à une obligation de vigilance sans disposer d’un accès aux documents et aux décisions de l’entreprise. Renverser la charge de la preuve équilibre le rapport de force entre les multinationales et les individus.
Toutefois, ainsi que les débats tenus à l’Assemblée nationale l’ont montré il y a deux mois à l’occasion de l’examen de ladite proposition de loi, un mécanisme de présomption de faute n’est pas exempt de critiques. Outre le fait qu’il jetterait la suspicion sur les entreprises françaises dans leurs opérations à l’étranger, un dispositif conçu uniquement pour l’indemnisation de dommages déjà réalisés aurait été uniquement réactif et non proactif. Enfin, alors que les personnes physiques victimes d’un accident sont seules fondées à en solliciter la réparation, le défaut d’établissement d’un plan, parce qu’il constitue un manquement objectif à une obligation légale dont la conséquence est un défaut de protection des droits fondamentaux et de l’environnement, peut faire l’objet d’une plainte d’associations constituées à cette fin. L’action en justice est donc facilitée.
Le dispositif institué par la proposition de loi lie la responsabilité de l’entreprise au non-respect de l’obligation légale relative au plan de vigilance. Il est sans lien avec la survenue d’un dommage sur le terrain, qui ne serait alors qu’un élément parmi d’autres à la disposition de la juridiction pour juger la responsabilité et, le cas échéant, évaluer le préjudice subi par le demandeur.
La commission des Lois a adopté l’article 2 dans une rédaction améliorée par trois amendements du rapporteurs et par trois amendements identiques de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, apportant des précisions et procédant à des coordinations avec les amendements adoptés à l’article 1er.
*
* *
La Commission examine les amendements identiques CL7 de Mme Danielle Auroi, CL15 de M. André Chassaigne et CL22 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Marc Dolez. Cet amendement vise à ce que les sociétés mères soient tenues responsables lorsqu’elles n’ont pas respecté leur devoir de vigilance. Il prévoit en particulier qu’elles apportent la preuve qu’elles ont pris toutes les mesures en leur pouvoir pour s’en acquitter.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine l’amendement CL32 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. La discussion sur les amendements précédents me laisse le sentiment que mon amendement, qui prévoit que les sociétés contrevenantes soient « solidairement responsables », est satisfait.
M. le rapporteur. En effet.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite les amendements de cohérence CL42 du rapporteur et CL54 de la commission des Affaires économiques.
Puis elle adopte les amendements de précision CL43 du rapporteur et CL55 de la commission des Affaires économiques.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite les amendements identiques CL6 de Mme Danielle Auroi, CL14 de M. André Chassaigne et CL24 de M. Jean-Noël Carpentier.
Puis la Commission adopte les amendements de cohérence CL44 du rapporteur et CL56 de la commission des Affaires économiques.
Elle adopte enfin l’article 2 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement CL25 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement reprend une proposition qui figure dans le rapport remis par Jacques Attali « Pour une économie positive ». Il vise à étendre le champ des objectifs poursuivis par les sociétés tels qu’ils sont définis dans la loi, afin de rééquilibrer les relations entre les parties prenantes de l’entreprise, lesquelles sont actuellement déséquilibrées au profit des actionnaires ou des associés. Il s’agit de repenser l’entreprise au XXIe siècle, de telle manière que nous puissions affirmer, en définitive : « L’entreprise, c’est nous ! »
M. le rapporteur. Vous avez, cher collègue, une vocation de pionnier et de défricheur. Vous posez d’ailleurs les problèmes dans les mêmes termes que plusieurs chercheurs, notamment de la Sorbonne et de l’École des Mines, qui ont participé à un cycle universitaire du Collège des Bernardins portant notamment sur la constitutionnalisation de l’entreprise. Il convient en effet de repenser l’entreprise au XXIe siècle, de rappeler que le profit n’est qu’un moyen au service de causes et d’objectifs qu’il faut redéfinir de façon plus collégiale. Ce ne sont pas là des choses évanescentes : il s’agit d’imaginer ce que pourrait être la dynamique économique dans un cadre moderne. Je salue votre proposition, qui est novatrice, voire prophétique, mais elle n’a pas nécessairement sa place dans le texte que nous examinons. Je vous suggère de créer un groupe de travail – dont je suis prêt à faire partie – en vue de réfléchir à une proposition de loi qui redéfinirait l’entreprise au XXIe siècle. Vaste programme et beau sujet !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL8 de Mme Danielle Auroi et CL16 de M. André Chassaigne.
M. Paul Molac. Le texte ne prévoit pas l’indemnisation des victimes. C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de rendre les dommages nés de la négligence des multinationales éligibles au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les contributions au FGTI sont assises sur les contrats souscrits par les assurés, c’est-à-dire par les citoyens. Il y a donc une profonde divergence entre ce mécanisme et l’objectif que vous poursuivez. D’autre part, il ne revient pas à la loi de préconiser la mise en place d’un système assurantiel. Néanmoins, je retiens l’idée que les entreprises pourraient, un jour, inventer un tel système et, pourquoi pas, un fonds d’indemnisation. Lors de la discussion en séance publique, nous pourrions mettre en valeur toutes les dynamiques collectives qui concourent à la création d’un système assurantiel interentreprises. Je rappelle que la loi révolutionnaire de 1898 qui a reconnu la responsabilité des entreprises dans les accidents du travail a ouvert la voie au système assurantiel que nous connaissons actuellement. Ce système a été la réponse intelligente des entreprises à une demande du législateur et à un combat syndical historique et pionnier, qui nous inspire aujourd’hui encore.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cette proposition de loi vise à prévenir les dommages. Son objet n’est donc pas de mettre en place un système assurantiel. Une fois le dommage survenu et avéré, d’autres lois s’appliquent. Néanmoins, il est nécessaire d’évoquer ces sujets de société, compte tenu de l’importance des enjeux humains.
La Commission rejette les amendements.
Elle en vient à l’amendement CL28 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement vise à rendre la proposition de loi applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS). J’ai déposé plusieurs fois des amendements analogues à celui-ci, car les SAS sont souvent oubliées dans les textes de loi.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les entreprises que nous avons retenues dans le cadre de cette proposition de loi sont celles qui sont soumises aux règles existantes en matière de responsabilité sociétale des entreprises. La question de l’application du texte aux SAS peut se poser lorsqu’il s’agit d’entités financières très puissantes, mais cela n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de PME. Nous pourrions approfondir cette question d’ici à la séance publique.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL23 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Les syndicats sont des acteurs à part entière des dispositifs de vigilance. Le comité d’entreprise peut déjà faire appel à un expert-comptable dans un certain nombre de cas. Cet amendement vise à compléter le code du travail de telle manière qu’il puisse également recourir à un expert-comptable pour l’assister dans l’analyse, la vérification et le suivi de la mise en œuvre d’un accord relatif à la responsabilité sociétale de l’entreprise.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par le 3° de l’article L. 2325-35 du code du travail, lequel prévoit déjà que l’expert-comptable peut assister le comité d’entreprise en la matière.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL26 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Il s’agit d’inclure le suivi du plan de vigilance dans les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société mère.
M. le rapporteur. Avis défavorable, compte tenu des arguments développés précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Article 3
Extension du dispositif aux îles Wallis et Futuna
L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Il en va ainsi de la Polynésie française (107), de Saint-Barthelémy et Saint-Martin (108), de Saint-Pierre-et-Miquelon (109) et des îles Wallis et Futuna. La Nouvelle-Calédonie est également soumise au principe de spécialité législative, mais sur le fondement de l’article 77 de la Constitution précisé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient toutefois que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit en dérogation au principe de spécialité. On parle de « régime de l’Atlantique » ou de régime du « tout est applicable sauf... » (110) . Il n’y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d’applicabilité.
La large autonomie dont dispose la Polynésie française, en vertu du statut de 2004 qui régit ce territoire, ne permet pas d’y appliquer les dispositions relatives au code de commerce et au droit des entreprises. En effet, l’article 7 précise que c’est seulement « dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État [que] sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ». L’article 14, qui dresse la liste de ces compétences, ne fait pas mention du droit commercial (111).
La situation de la Nouvelle-Calédonie est plus claire encore : l’article 22 du statut de 1999 confère expressément aux institutions néo-calédoniennes les compétences relatives au commerce international, au droit et à l’inspection du travail, ou encore à la santé.
C’est donc sur le territoire des îles Wallis et Futuna qu’il revient à la proposition de loi de prévoir son application. La loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, dispose en son article 4 que « le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi (…) par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l’ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d’outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ». Établi aux débuts de la Ve République, ce statut ne confère que peu de compétences aux autorités locales, au contraire des textes élaborés au cours des vingt dernières années.
Certaines prescriptions ne requièrent toutefois pas de mention expresse d’applicabilité. Il s’agit des lois nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République (112), des approbations et des ratifications de traités et accords internationaux, des ratifications d’ordonnances (113) et des textes destinés à ne s’appliquer que dans une ou plusieurs collectivités d’outre-mer (114). La création d’un dispositif incitant les sociétés à prévenir les comportements attentatoires aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales, à l’environnement et à la santé publique n’entrent pas dans ce cadre.
Il ressort de ces dispositions que, d’une part, le législateur a qualité pour imposer l’application de la loi sur le territoire des îles Wallis et Futuna et que, d’autre part, il doit expressément en faire mention si telle est sa décision. L’article 3 de la proposition de loi prévoit, par conséquent, cette application en ce qui concerne l’obligation d’établir et de mettre effectivement en œuvre un plan de vigilance (article 1er). Paradoxalement, il s’abstient de prévoir la même extension pour le mécanisme d’engager de la responsabilité pour faute (article 2).
La commission des Lois a étendu l’application de l’article 2 aux îles Wallis et Futuna en adoptant deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Annick Le Loch, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Par les mêmes amendements, elle a précisé que l’amende civile encourue en application des dispositions des articles précédents est prononcée en monnaie locale – le franc Pacifique (CFP) – compte tenu de la contre-valeur de l’euro dans cette monnaie.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques CL45 du rapporteur et CL59 de la commission des Affaires économiques.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à ce que tous les articles de la présente proposition de loi soient applicables dans les îles Wallis et Futuna.
M. Serge Bardy, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable. La commission du Développement durable a adopté un amendement identique.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.
M. Marc Dolez. Compte tenu du sort réservé ce matin à ses amendements, le groupe GDR s’abstiendra lors du vote sur l’ensemble du texte, en souhaitant que celui-ci puisse être amélioré d’ici à la séance publique.
M. Paul Molac. Le groupe écologiste s’abstiendra également.
La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre |
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre | |
Article 1er |
Article 1er | |
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code du commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. |
« Art. L. 225-102-4. – I. – (Alinéa sans modification) | |
|
Code de commerce Art. L. 233-16. – Cf. annexe |
« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de ses activités et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que les activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elle exerce une influence déterminante. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle. |
« Ce plan comporte des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de sa société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures … amendement CL39, CL38, CL47 |
|
Art. L. 225-102. – Cf. annexe |
« Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102. |
(Alinéa sans modification) |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. » |
… modalités de présentation et d’application des dispositions du plan de vigilance. » amendements identiques | |
II. – Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander à la juridiction civile ou commerciale compétente, d’enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d’établir le plan de vigilance, d’en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I de cet article. |
II. – … juridiction compétente … amendements identiques | |
Le Président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. |
(Alinéa sans modification) | |
Toute association reconnue d’utilité publique, toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts mentionnés au I, peut exercer cette action. |
(Alinéa sans modification) | |
III. – Toute personne mentionnée au II peut demander au juge de prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. |
III. – Le juge peut prononcer... … d’euros. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal. amendements identiques | |
Article 2 |
Article 2 | |
Après l’article L. 225-102-4 du même code, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. |
« Art. 225-102-5. – (Alinéa sans modification) | |
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou toute association mentionnée au II de l’article L. 225-102-4. |
… juridiction compétente par toute personne mentionnée … amendements identiques | |
« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III de l’article L. 225-102-4. |
… l’article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal. amendements identiques | |
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. |
(Alinéa sans modification) | |
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. » |
(Alinéa sans modification) | |
Article 3 |
Article 3 | |
Art. L. 225-102-4. – Cf. supra art. 1er Art. L. 225-102-5. – Cf. supra art. 2 |
L’article L. 225-102-4 du code de commerce est applicable dans les îles de Wallis et Futuna. |
Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce sont applicables dans … |
L’amende civile encourue en application des mêmes articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. amendements identiques |
Code de commerce
Art. L. 225-102. – Le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à l’assemblée générale rend compte annuellement de l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail.
Les titres acquis par les salariés dans le cadre d’une opération de rachat d’une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique ainsi que par les salariés d’une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production ne sont pas pris en compte pour l’évaluation de la proportion du capital prévue à l’alinéa précédent.
Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.
Art. L. 225-102-4. –
Art. L. 225-102-5. –
Art. L. 233-16. – I. – Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)
III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. – L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
Table-ronde réunissant des syndicats représentant les salariés
l CFE-CGC
— M. Jean-Frédéric Dreyfus, expert confédéral RSE
l CFDT (115)
— M. Gérald Dumas, secrétaire confédéral au développement durable
l CGT
— Mme Fabienne Cru-Montblanc, membre de la commission exécutive
l CFTC
— M. Anthony Ratier, conseiller technique à l’Institut de recherches économiques et sociales
Table-ronde réunissant des représentants d’entreprises
l Association française des entreprises privées (AFEP) (1)
— Mme Stéphanie Robert, directrice
— Mme Élisabeth Gambert, directeur RSE et affaires internationales
— Mme Aude-Solveig Epstein, chargée d’études
l Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (1)
— Mme Catherine Minard, directrice des affaires internationales
— Mme Isabelle Tremeau, directrice adjointe à la direction des affaires juridiques
— M. Matthieu Pineda, chargé de mission à la direction des affaires publiques
l Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
— M. Patrick Caron, directeur général délégué à la recherche et à la stratégie
l Entreprise VEJA
— M. Sébastien Kopp, co-fondateur
Table-ronde réunissant des organisations non gouvernementales (ONG)
l Amnesty International
— Mme Muriel Treibich, coordinatrice « Acteurs économiques et droits humains »
l Sherpa
— Mme Sandra Cossart, responsable du programme « Globalisation et droits humains (RSE) »
l Les Amis de la Terre France
— Mme Juliette Renaud, chargée de campagne sur les industries extractives et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSEE)
l Collectif Éthique sur l’Étiquette
— Mme Nayla Ajaltouni, coordinatrice
l CFDT-Terre Solidaire
— Mme Mathilde Dupré, chargée de plaidoyer RSEE, coordinatrice du forum citoyen pour la RSE
Table-ronde réunissant des universitaires
l M. Guillaume Delalieux, maître de conférences en science de gestion à l’Institut d’études politiques de Lille, responsable des masters « Stratégie et communication des organisations » et « Commerce et finance internationale »
l M. Olivier Favereau, professeur de sciences économiques à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, directeur de l’école doctorale « Économie, organisations, société »
l M. Armand Hatchuel, professeur à MINES ParisTech, directeur-adjoint du centre de gestion scientifique, co-responsable de la chaire « Théorie et méthodes de la conception innovante »
l Mme Cécile Renouard, docteur en science politique, directrice du programme de recherche « Entreprises et Développement », à l’Institut de la recherche et de l’enseignement sur la négociation en Europe (IRENE) de l’ESSEC
Table-ronde réunissant des juristes
l M. Nicolas Cuzacq, maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne
l Mme Anne Danis-Fatôme, maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
l M. Charley Hannoun, professeur de droit privé à l’Université de Cergy-Pontoise, avocat au barreau de Paris
1 () Paul Ricœur, « Responsabilité et fragilité », conférence donnée à l’Association des étudiants protestants de Paris, 24 mars 1992.
2 () Il s’agit des propositions de loi n° 1519 de Mme Danielle Auroi, n° 1524 de M. Bruno Le Roux, n° 1777 de M. Jean-Noël Carpentier et n° 1897 de M. André Chassaigne.
3 () Sur le rapport de Mme Danielle Auroi, n° 2504, 21 janvier 2015.
4 () Assemblée nationale, deuxième séance du jeudi 29 janvier 2015, n° 123.
5 () Le pétrolier battait pavillon maltais, était affrété par la société française Total, quand l’armateur et la société de classification étaient italiens. Le capitaine avait la nationalité indienne. La Cour de cassation a finalement retenu le contrôle exercé par Total sur la marche de l’Erika, et a déclaré la société coresponsable du sinistre en raison d’une faute de « témérité ». Le préjudice est chiffré à 200 millions d’euros (chambre criminelle, 25 septembre 2012, pourvoi n° 10-82.938).
6 () L’immeuble du Rana Plaza était situé à Dacca, capitale du Bangladesh. Il s’est effondré le 24 avril 2013, provoquant la mort de près de 1 200 personnes, lorsque les générateurs électriques installés au dernier étage ont fait entrer le bâtiment en résonance. Les ateliers de confection qu’il abritait travaillaient pour diverses marques internationales (canadiennes, britanniques, françaises et espagnoles). Des consignes d’évacuation données la veille, après l’apparition de fissures, n’avaient pas été suivies d’effet.
7 () Michel Foucault a développé le concept d’ « institution disciplinaire » en 1975 dans son ouvrage Surveiller et punir. Il y analyse un certain nombre de lieux (prison, asile, caserne, hôpital, usine...) qu’il juge analogues dans leur fonction : faire de l’homme un animal prévisible.
8 () Le dépôt des mêmes amendements, par les trois rapporteurs, devant les trois commissions saisies de la proposition de loi, témoigne de leur convergence de vues.
9 () Cour suprême du Michigan, Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich 1919). Henry Ford, président et actionnaire majoritaire de l’entreprise éponyme, souhaitait consacrer les bénéfices dégagés par la compagnie au financement de nouveaux équipements, à la baisse des prix des automobiles produites et à l’augmentation des salaires des ouvriers. Les actionnaires minoritaires, menés par les frères Dodge, contestèrent cette stratégie en justice, accusant Ford de les spolier de leurs dividendes. La Cour trancha en leur faveur, estimant qu’une entreprise a pour objectif principal le profit de ses actionnaires. Henry Ford fut contraint de racheter les parts de ses adversaires pour mettre en œuvre sa stratégie.
10 () Milton Friedman, Capitalisme et liberté, 1962.
11 () La responsabilité sociale des entreprises, ou responsabilité sociétale des entreprises, ou responsabilité sociale et environnementale des entreprises, globalement désignée sous le terme « RSE » est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes, sur une base volontaire ou dans le cadre des lois et règlements.
12 () Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter, réparer » des Nations unies, Conseil des droits de l’homme, 17e session, A/HRC/17/31, paragraphe 47.
13 () La chaîne de valeur est l’ensemble des activités interdépendantes dont la poursuite permet de créer de la valeur identifiable. Elle intègre toutes les étapes de l’approvisionnement en matières premières à la consommation finale, voire au service après-vente. Son efficacité repose essentiellement sur la coordination des différents acteurs impliqués et leur capacité à former un réseau cohérent. Les technologies de l’information ont favorisé un échange de données propice à une organisation efficiente de la chaîne.
14 () Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, version du 25 mai 2011, http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/48004355.pdf
15 () Les paragraphes 8 et 38 de la Déclaration affirment ainsi :
« 8. Toutes les parties que la présente Déclaration concerne devraient respecter les droits souverains des États, observer les législations et réglementations nationales, tenir dûment compte des pratiques locales et se conformer aux normes internationales pertinentes. Elles devraient respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux correspondants que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptés, de même que la Constitution de l’Organisation internationale du Travail et ses principes en vertu desquels la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu. Elles devraient contribuer à la réalisation de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée en 1998. Elles devraient également tenir les engagements pris librement par elles, en conformité de la législation nationale et des obligations internationales acceptées. »
« 38. Les entreprises multinationales devraient maintenir les normes de sécurité et d’hygiène les plus élevées, conformément aux exigences nationales, compte tenu de leur expérience correspondante acquise dans l’entreprise tout entière, y compris la connaissance de risques particuliers. Elles devraient aussi mettre à la disposition des représentants des travailleurs dans l’entreprise et, sur leur demande, des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs de tous les pays où elles exercent leur activité des informations sur les normes de sécurité et d’hygiène applicables à leurs activités locales qu’elles observent dans d’autres pays. En particulier, elles devraient faire connaître aux intéressés tous les risques particuliers et les mesures de protection correspondantes qui sont associés à de nouveaux produits et procédés. De même que les entreprises nationales comparables, elles devraient être appelées à jouer un rôle prépondérant dans l’examen des causes des risques en matière de sécurité et d’hygiène du travail et dans l’application, dans l’entreprise tout entière, des améliorations qui en découlent. »
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
16 () Les principes du Pacte mondial sont les suivants (https://www.unglobalcompact.org/languages/french/) :
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ; et
2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’homme.
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective ;
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. L’abolition effective du travail des enfants ; et
6. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;
8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement ; et
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
17 () Résolutions A/RES/55/215 de 2001, A/RES/56/76 de 2001 et A/RES/62/211 de 2007, toutes trois intitulées « Vers des partenariats mondiaux ».
18 () « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » [COM (2001) 366].
19 () http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm
20 () Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter, réparer » des Nations unies, op. cit.
21 () La résolution A/HRC/RES/26/9 en ce sens, présentée par l’Équateur, l’Afrique du Sud, la Bolivie et le Venezuela, a été adoptée par 20 voix pour (Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Chine, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Éthiopie, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kenya, Maroc, Namibie, Pakistan, Philippines, Venezuela, Viet Nam), 14 voix contre (Allemagne, Autriche, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, France, Irlande, Italie, Japon, Monténégro, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni), et 13 absentions (Arabie saoudite, Argentine, Botswana, Brésil, Chili, Costa Rica, Émirats arabes unis, Gabon, Koweït, Maldives, Mexique, Pérou, Sierra Leone).
22 () Le commerce triangulaire voyait les navires charger des esclaves en Afrique, débarquer leur cargaison aux Amériques où elles embarquaient alors des produits locaux (alcools, épices, etc.) et faire voile vers le continent européen.
23 () Le Slave Trade Act n’était pas conçu comme une loi vouée à demeurer d’application interne, mais comme le fondement d’une action diplomatique. Un des volets de cette diplomatie passait par la constitution d’une escadre africaine spécifiquement dédiée au sein de la Royal Navy. Le West Africa Squadron mena pendant plusieurs décennies la chasse aux navires négriers au large de l’Afrique, capturant entre 1808 et 1860 plus de 1 600 transports d’esclaves et permettant la libération de plus de 150 000 Africains. Cet engagement ne manqua pas de contribuer au prestige britannique parmi les esprits éclairés du temps.
24 () Napoléon Ier proclama l’abolition de la traite négrière pendant les Cent-Jours, sans doute dans une vaine tentative de se concilier les bonnes grâces du Royaume-Uni.
25 () Les ports de la façade Atlantique ont fortement souffert de l’arrêt du commerce négrier.
26 () Le propos emprunte beaucoup à l’article de Francis Hordern, « Le droit des accidents du travail au XIXe siècle », Cahiers de l’Institut régional du travail de l’Université d’Aix-Marseille II n° 3, 1991, Aix-en-Provence. Sauf mention contraire, les jurisprudences et les citations contenues dans ce paragraphe en sont tirées.
27 () Gérard Vindt, « La loi sur les accidents du travail a cent ans », Alternatives économiques n° 158, avril 1998.
28 () Selon Maurice Hauriou, « on peut poser la distinction de la façon suivante : le cas fortuit échappe aux prévisions humaines, mais se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service ; par exemple, dans une usine, c’est l’explosion d’une chaudière, dans une mine, c’est l’inflammation du grisou ; la force majeure, c’est encore un phénomène imprévu ; mais, de plus, il est extérieur à l’entreprise ou au service ; par exemple, c’est un tremblement de terre, une inondation, un cyclone, une guerre civile, une invasion étrangère. Poussons plus loin l’analyse ; dans le cas de force majeure, il ne peut absolument pas y avoir faute du chef d’entreprise ou de service, parce que l’événement ne dépend ni ne dépendra jamais en aucune façon de lui. Aucun chef d’industrie, par exemple, ne peut ni ne pourra empêcher ou prévoir un tremblement de terre ou un cyclone. Au contraire, dans le cas fortuit, si la prévision de l’accident et la possibilité de l’empêcher n’existent pas pratiquement à l’heure actuelle, elles existent théoriquement, et sont sous la dépendance de perfectionnements toujours possibles de la technique. Ainsi, il apparaît comme théoriquement possible d’éviter dans une mine les coups de grisou, bien qu’actuellement ce ne soit pas pratiquement possible. En définitive, la notion de la force majeure a quelque chose d’absolu, et il y a des événements qui seront toujours au-dessus des forces humaines ; la notion du cas fortuit, au contraire, a quelque chose de relatif ; il s’agit d’événements qui ne sont que provisoirement au-dessus des forces humaines et qui, plus tard, avec des progrès de la prévision de la technique, pourront être conjurés. » Il ajoute que « dans les relations du droit civil, il n’y a pas grand intérêt à les distinguer, parce que les règles du droit civil, fondées sur la théorie des fautes, les réunissent en général, pour en faire des causes équivalentes d’exonération de la responsabilité. Mais la législation de 1898, sur les accidents du travail, a créé un intérêt à la distinction, parce que, dans cette législation, fondée sur l’idée du risque, le patron ne répond pas de la force majeure indépendante du travail, mais répond des cas fortuits, vu que l’esprit de la théorie du risque professionnel est de considérer, en principe, tous les accidents du travail comme des cas fortuits. » (Note sous Conseil d’État, 10 mai 1912, Ambrosini, req. 33336, rec. p. 549)
29 () Une règle d’ordre public est obligatoire et ne peut être contournée. En droit des contrats, lorsqu’une règle est d’ordre public, les parties doivent impérativement la respecter et ne peuvent donc y déroger par une clause insérée dans leur convention.
30 () « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
31 () La maladie professionnelle, difficile à caractériser par la médecine d’alors, n’est pas envisagée.
32 () La disposition en cause est devenue l’article L. 225-102-1 du code de commerce.
33 () « Le patronat s’oppose aux nouvelles obligations prévues par le Grenelle », La Tribune, 31 janvier 2011.
34 () Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
35 () Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
36 () Rapport d’information n° 290 (2012-2013) de Mme Laurence Rossignol et M. Louis Nègre, fait au nom de la commission pour le contrôle de l’application des lois, déposé le 23 janvier 2013.
37 () La directive n° 2003/51/CE du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance, faisait suite à la recommandation n° 2001/453/CE du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports de gestion des sociétés. Elle invite à recourir « dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société » à « des indicateurs clés de performance (...) de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel ».
38 () Le décret du 24 avril 2012 devra donc faire l’objet d’une révision prochaine pour intégrer ces seuils plus exigeants. La date limite de transposition fixée par la directive est le 6 décembre 2016.
39 () Créée par le Premier ministre le 17 juin 2013, la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises (dite plateforme RSE) rassemble les différents acteurs de la société française ayant un intérêt pour la RSE (représentants des entreprises, des salariés, des associations) et les représentants des pouvoirs publics (administrations centrales, parlementaires, collectivités territoriales). Sa mission prioritaire consiste à préparer la réponse à la demande de la Commission européenne que chaque État-membre se dote d’un « plan ou liste d’actions prioritaires visant à promouvoir la RSE dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ».
40 () L’externalité caractérise le fait qu’un agent économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire une désutilité, un dommage sans compensation.
41 () Des travaux théoriques soutiennent, en outre, qu’un commandement par la loi montrerait une efficacité bien supérieure à une démarche volontariste, fût-elle généralisée. Voir notamment Richard Locke, Can global brands create just supply chains?, Boston Review, 21 mai 2013.
42 () http://www.cncdh.fr/sites/default/files/13.10.24_avis_entreprises_et_droits_de_lhomme_1.pdf, p. 2.
43 () Plus de 120 000 citoyens français ont signé la pétition « Rana Plaza, Bhopal, Erika : halte à l’impunité des multinationales » lancée par les organisations non gouvernementales actives sur le sujet. En outre, selon un sondage commandé à l’institut CSA par le Forum citoyen pour la RSE et publié le 27 janvier 2015, 9 Français sur 10 estiment que les marques qui faisaient fabriquer leurs vêtements dans les usines du Rana Plaza devraient être obligées d’indemniser les victimes. Pour 95 % des Français, ce type de drame, ainsi que les catastrophes environnementales telles que la marée noire de l’Erika, pourraient être évités si les multinationales prenaient plus de précautions. Enfin, 76 % des Français pensent que les multinationales françaises devraient être tenues responsables devant la justice des accidents graves provoqués par leurs filiales et sous-traitants.
44 () Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi 10-21701.
45 () L’article 1382 prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » tandis que l’article 1383 dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
46 () La « théorie de l’apparence » protège les personnes croyant légitimement contracter avec un mandataire, dont les pouvoirs se sont avérés insuffisants ou qui en était dépourvu, mais que les circonstances autorisaient à ne pas exiger qu’il produise ses pouvoirs. Son acceptation par le juge suppose un élément objectif à même de favoriser une confusion. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-16109) a précisé que l’immixtion d’une société-mère dans les activités de sa filiale devait revêtir « une apparence trompeuse propre à (…) permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant » pour engager sa responsabilité. Du reste, la théorie de l’apparence n’est applicable qu’en matière contractuelle, et non délictuelle.
47 () Cette procédure de common law (piercing the veil of incorporation) autorise la justice à transférer aux actionnaires la responsabilité d’une société. La Cour suprême britannique considère qu’elle doit être employée en ultime ressort à condition que d’autres voies de droit ne permettent pas une résolution acceptable d’un litige (Prest v. Petrodel Resources Ltd, 12 juin 2013).
48 () Amnesty international, Pour une obligation de vigilance des entreprises transnationales, janvier 2015.
49 () Cour de justice des Communautés européennes, Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contre Commission des Communautés européennes, 25 octobre 1983, affaire 107/82.
50 () Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015.
51 () Cette disposition figure désormais à l’article L. 512-17 du code de l’environnement.
52 () http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-renforcer-responsabilite-maitres-ouvrage-donneurs-ordre-cadre-sous-traitance-lutter-contre-dumping-social-concurrence-deloyale.html
53 () Ils sont énumérés à l’article L. 8281-1 du code du travail.
54 () « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. »
55 () Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 1986, pourvoi n° 85-42266.
56 () C’est le sens de l’article 4.1 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
57 () Selon l’article 26 du règlement Rome II, l’application du droit de l’État où le préjudice a eu lieu est écartée « si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for », c’est-à-dire du pays de jugement.
58 () Cour de justice des Communautés européennes, 23 novembre 1999, Arblade, C-369/96.
59 () Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, “Les entreprises et les droits de l’homme: Vers une traduction opérationnelle du cadre «Protéger, respecter et réparer»”, op. cit., paragraphe 53.
60 () Les conventions internationales régulièrement signées et ratifiées par la France, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, s’appliquent en droit français sans qu’il soit besoin de les mentionner dans la loi – à laquelle elles sont supérieures comme en dispose l’article 55 de la Constitution.
61 () « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » prévoit l’alinéa 1. Cet article fonde notamment la responsabilité solidaire du père et de la mère devant le dommage causé par le mineur dont ils ont la charge.
62 () Constituée d’universitaires et de magistrats, la commission Catala a remis ses conclusions au garde des Sceaux le 22 septembre 2005. Ses préconisations en matière de prescription ont directement inspiré la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Ses recommandations sur le droit des obligations sont, en revanche, restées lettre morte. L’article cité figure à la page 158 du rapport, consultable sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf.
63 () Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 15 juin 2007, paragraphe 79.
64 () Article 1315 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
65 () Article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
66 () Outre son absence et son défaut de mise en œuvre effective, la proposition de loi sanctionne d’une amende civile de dix millions d’euros le défaut de publication du plan, précisément parce que cette mise à disposition du public est essentielle à l’action en responsabilité.
67 () L’absence de sanction associée avait grandement limité l’intérêt des rapports de développement durable publiés par les sociétés cotées depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). Pareil écueil est donc évité.
68 () http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/deuxieme-proposition-de-4971
69 () Le travail parlementaire devra permettre d’établir qu’elles représentent aussi l’essentiel des risques d’atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels et environnementaux graves, de risques sanitaires et de comportements de corruption active ou passive.
70 () Article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. Une entreprise qui n’atteint pas ne nombre de salariés mais dont le chiffre d’affaires excède 1,5 milliard d’euros est également rattachée à la catégorie des grandes entreprises.
71 () http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T11F153
72 () « Depuis trente ans, les grandes entreprises concentrent de plus en plus d’emplois », Insee Première, n° 1289, avril 2010.
73 () Par exemple aux articles L. 225-27, L. 225-28, L. 225-71 ou encore L. 225-79.
74 () L’article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a transcrit ce dispositif dans le code de commerce.
75 () Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, C-41/90), la notion d’entreprise reçoit une définition particulièrement extensive, fondée sur le critère de l’activité économique : toute entité exerçant une activité économique est considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire et ce, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement. Les conventions internationales et la norme ISO 26 000 édictée par l’Organisation internationale de normalisation privilégient également le terme d’entreprise sur celui de société.
76 () Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 12/05650.
77 () L’exemple d’une cascade de dix-sept sous-traitances a ainsi été livré à votre rapporteur au cours des auditions qu’il a organisées.
78 () Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 430-1 du code de commerce, une concentration est l’opération juridique conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d’entreprises qui, soit par voie de fusion, soit par le jeu du contrôle qu’exercent certains de leurs dirigeants, soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d’une entreprise ou d’un groupement commun ou de toute autre manière, parviennent à contrôler tout ou partie de l’ensemble de ces entreprises et donc les activités économiques qu’elles exercent.
79 () Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, 10 juillet 2013.
80 () Il en va ainsi dans le secteur pétrolier où le terme « supermajor » est employé pour désigner les six grandes compagnies privées mondiales : Shell, BP, ExxonMobil, Total, Chevron Texaco et ConocoPhillips.
81 () La liberté d’expression est par exemple bornée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Quelques libertés fondamentales s’appliquent cependant sans limite : il en est ainsi de la prohibition de l’esclavage et de la traite (article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) ou de l’habeas corpus (article 9 du même texte).
82 () La corruption est la perversion ou le détournement d’un processus ou d’une interaction dans le dessein, pour le corrupteur, de bénéficier d’avantages ou de prérogatives particulières et, pour le corrompu, d’obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. On distingue la corruption active de la corruption passive : la première consiste à proposer de l’argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d’un avantage indu ; la seconde consiste à accepter cet argent. La corruption passive est notamment sanctionnée à l’article 432-11 du code pénal. La corruption active fait l’objet des articles 433-1 et 433-2 du même code.
83 () La notion de « responsabilité sociale d’entreprise » (RSE) a pour origine la locution anglo-américaine corporate social responsiblity apparue dans les années 1950 aux États-Unis, à partir de considérations éthiques et religieuses donnant lieu, essentiellement, à des actions philanthropiques. Elle s’est progressivement transformée pour exprimer la recherche d’une conciliation entre les activités économiques et les attentes et préoccupations de la société.
84 () Les parties prenantes sont, pour une entreprise, « ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par [ses] activités ». Cette définition a été retenue par le législateur à l’article 4 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement.
85 () Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dite loi Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) du 1er mars 1996, notamment modifiée le 24 avril 2009, n° 810-20.
86 () Bribery Act (c.23), 8 avril 2010.
87 () Il est délicat de transcrire en termes juridiques français les dispositions d’un droit étranger, de surcroît de common law. Mais la vicarious liability qui découle de la doctrine respondeat superior (littéralement « Que le maître en réponde ! ») correspond globalement à l’idée d’une responsabilité pour négligence dans la surveillance d’un tiers contrôlé.
88 () L’initiative populaire est un droit civique suisse, permettant à un nombre donné de citoyens ayant le droit de vote de faire une proposition et de la soumettre à la votation populaire. Pour ce faire, un comité d’initiative doit recueillir plus de 100 000 signatures d’électeurs en moins de dix-huit mois. La Chancellerie fédérale est alors tenue d’organiser la votation. Les organisations à l’origine de l’initiative sur les multinationales responsables se montrent confiantes dans la mesure où, en 2011, une pétition « Droits sans frontières » poursuivant les mêmes objectifs avait recueilli 135 000 signatures en sept mois.
89 () « Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. » Cet article, aussi connu sous le nom de « loi Westray », a été créé à la suite de la tragédie survenue à la mine de charbon Westray en Nouvelle-Écosse en 1992. Vingt-six mineurs ont été tués lorsque du méthane s’est enflammé et a causé une explosion. Malgré les graves préoccupations en matière de sécurité exprimées par les employés, les représentants syndicaux et les inspecteurs du gouvernement à l’époque, l’entreprise avait procédé à peu de changements. Après l’accident, la police et le gouvernement provincial n’ont pas réussi à faire condamner l’entreprise. (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, http://www.cchst.com/oshanswers/legisl/billc45.html#_1_2).
90 () Alien Tort Statute issu du Judiciary Act du 24 septembre 1789.
91 () Le droit des gens (du latin jus gentium) désigne soit les droits minimaux accordés aux membres des peuples étrangers pris individuellement (devenus les droits de l’homme), soit le droit des nations étrangères prises collectivement.
92 () Une cour fédérale avait ainsi condamné des firmes automobiles américaines pour leurs activités conduites en Afrique du Sud au temps de l’Apartheid. (« Judicial Foreign Policy We Cannot Afford », The Washington Post, 19 avril 2009).
93 () Cour suprême des États-Unis, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S.Ct. 1659 (2013).
94 () Cet article dispose que « le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à l’assemblée générale rend compte annuellement de l’état de la participation des salariés au capital social (…) ».
95 () Le référé est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du président de la juridiction saisie qui statue à juge unique. Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d’une provision. Il peut prononcer des astreintes.
96 () Cette condition apparaît relativement aisée à satisfaire. Il est donc peu probable qu’une société puisse durablement échapper à ses obligations en raison d’un défaut de demandeur ayant intérêt à agir.
97 () L’amende est généralement comprise comme une peine pécuniaire du droit répressif. L’amende civile est classiquement prononcée au profit du Trésor public en répression d’un comportement fautif à l’occasion d’un acte ou procès civil (articles 10, 50 ou 63 du code civil).
98 () Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, avait prévu d’imposer celles-ci aux sociétés les plus importantes d’abord, aux entreprises de plus petite taille d’abord. Les sociétés non cotées étaient ainsi concernées à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2011 lorsque le chiffre d’affaires dépassait 1 milliard d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents excédait 5 000. Ces seuils sont respectivement passés à 400 millions d’euros et 2 000 salariés pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012, et à 100 millions d’euros et 500 salariés pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
99 () Une telle rédaction aurait conduit une société à adopter un plan de vigilance couvrant des partenaires commerciaux potentiellement aussi importants et aussi riches qu’elle, voire plus encore. Or le fondement de la proposition de loi tient à l’alignement de la responsabilité des entreprises sur le pouvoir financier dont elles disposent dans un contexte de mondialisation. La commission des Lois ne pouvait donc qu’écarter cette option.
100 () La notion est définie à l’article L. 442-6 du code de commerce.
101 () Cour de cassation, chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19200.
102 () Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2011, pourvoi n° 10-21701.
103 () L’article 1382 prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » tandis que l’article 1383 dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
104 () Un contrat est dit léonin, unilatéral ou non synallagmatique lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l’autre en tire tous les avantages. Le code civil déclare nulle pareille convention (en droit des sociétés, par exemple, à l’article 1844-1).
105 () L’exonération de responsabilité par le cas fortuit et la force majeure perdure évidemment.
106 () Une présomption est une conséquence ou une déduction tirée d’un fait connu pour établir la vraisemblance d’un fait inconnu. Elle est dite simple lorsque la preuve contraire peut être rapportée, et irréfragable lorsque les parties ne peuvent la remettre en question.
107 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
108 () Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
109 () Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
110 () Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.
111 () Les autorités de l’État sont reconnues compétentes sur le territoire de la Polynésie française dans treize domaines limitativement énumérés. Il s’agit du droit civil, des libertés publiques, de la diplomatie, de la défense, du droit des étrangers, de la sécurité publique, des finances, de certaines liaisons aériennes, de la sécurité maritime, du fonctionnement des communes et de l’intercommunalité, de la fonction publique, de l’audiovisuel et de l’enseignement universitaire. Encore ces compétences s’exercent-elle « sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française ».
112 () Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18. Le législateur organique a plus tard formulé la même réserve à l’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Les contours de cette catégorie de normes, dite des « lois de souveraineté », sont définis restrictivement par la jurisprudence.
113 () Conseil d’État, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359.
114 () L’applicabilité résulte alors du texte même.
115 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale