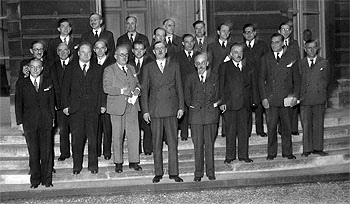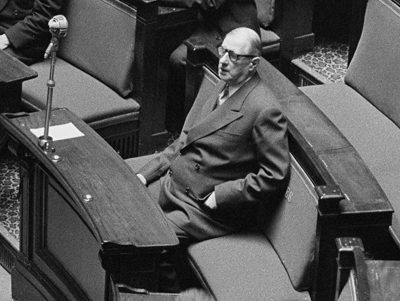Ministre une première fois pendant deux mois seulement, - 21
novembre 1945 - 26 janvier 1946 - après la Libération, André
Malraux l'a été de nouveau de la fin de la IVe République au
départ de Charles de Gaulle en avril 1969, pendant plus de
dix années sans interruption du 1er juin 1958 au 20 juin
1969.
Il a été officiellement ministre d'État chargé des Affaires
culturelles à partir du 22 juillet 1959. Mais, plusieurs
décrets l'attestent, il a exercé en fait ces fonctions dès
le mois de janvier 1959.
Les collaborateurs d'André Malraux ont récusé le cliché du «
brouillon de culture » dont on a usé à son égard. Pour André
Holleaux, qui dirigea son cabinet de 1962 à 1965, il était
assidu, ponctuel et même avait des aspects de « bureaucrate
tatillon et méticuleux ». Il avait « cure des règles
comptables ». Pierre Moinot relève son souci de rigueur, son
« acharnement d'artisan ».
Il faut sans doute distinguer selon les périodes de ce long
ministère dont le titulaire eut ses malheurs et ses
absences. Reste qu 'à la difficile : « Qu'est-ce qu'un bon
ministre ? » l'exemple d'André Malraux suggère de répondre
qu'on peut l'être sans être un praticien du droit
administratif, ni un familier du droit budgétaire, ni un
amoureux de la gestion. Et avec des crédits inférieurs à 1 %
du budget. La trace qu'il a laissée est profonde et durable.
|
«... Légende d'André Malraux
"brouillon de culture", incapable de se mouvoir dans le
vocabulaire et les règles de l'administration. En
réalité chacune des régions de ce domaine qu'il n'a pas
encore abordée lui inspire un respect qui le fait
parfois hésiter. Mais, lorsqu'il y est entré, la région
est très vite explorée, reconnue au long de sentiers qui
lui sont propres, et les ressources en sont utilisées
avec une astuce qu'on peut souhaiter à bien des
ministres. Au reste, il a su la plupart du temps trouver
ses tacticiens, mais c'est lui le stratège, travaillant
avec un acharnement d'artisan les dossiers dont ses
administrateurs lui ont expliqué les éléments... »
(Pierre Moinot « Tous comptes faits
» Quai Voltaire 1993, p. 133.)
|
Le
Gouvernement provisoire formé le 21 novembre 1945
Vidéo
(Internet Explorer 6 : rafraîchir la page)
Le Général de Gaulle, président du gouvernement provisoire,
Edmond Michelet,
Charles Tillon,
Vincent Auriol,
Francisque
Gay, Maurice Thorez,
Georges Bidault,
Jules Moch,
Jacques
Soustelle, René Pleven,
François Billoux, etc.
Au 3e rang, 6e à partir de la gauche, André Malraux,
ministre de l'Information.
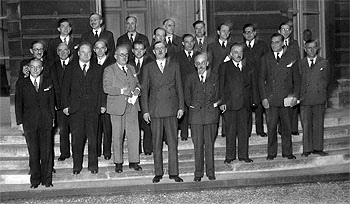
Photographie - AFP
Malraux se rendant au Conseil des ministres

Photographie - AFP
André Malraux, en décembre 1945, se rend au
Conseil des ministres, qui siège à l'Hôtel de Brienne, rue
Saint-Dominique. Cette photographie sent l'hiver, la guerre
encore très proche, le provisoire, le transitoire.
Parmi les journalistes : Pierre Cornelier
(Figaro, Le Progrès) - Robert Boulay (Agence
Reuter) - Maurice Tillier (Paris-Presse) - Henri
Barbe (Agefi-Information) - André Chassagnac (Presse-Française
Associée) - Jean Conedera (l'Aurore).

Éditions Gallimard
Gaston Defferre et André Malraux
Le général de Gaulle quitte le pouvoir le
20 janvier 1946 : il est remplacé à la tête du Gouvernement
provisoire de la République par Félix Gouin.
Gaston Defferre nommé secrétaire d'État à la Présidence,
succède dans ses attributions à André Malraux, ministre de
l'Information.
De Gaulle seul au banc du Gouvernement -
comme « président du Conseil désigné » le 1er juin
1958
Charles de Gaulle a été le dernier
président du Conseil de la IVe République, avant
d'être le premier président de la Ve République.
Quatre mois plus tard, la nouvelle constitution était
approuvée par un référendum.
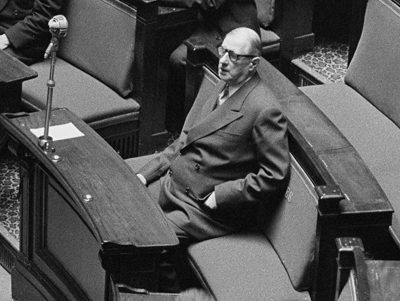
Photographie AFP
Présentation du 2e ministère
Georges Pompidou au général de Gaulle,
dans la salle des fêtes
de l'Élysée (7 décembre 1962)
Après la dissolution de l'Assemblée
nationale le 9 octobre et les élections législatives des 18
et 25 novembre, le premier gouvernement Pompidou démissionne
le 28 novembre 1962 et le Président de la République
témoigne sa confiance envers Georges Pompidou en le nommant
à nouveau à la tête du gouvernement le 29 novembre.

Photographie - AFP
De gauche à droite :
M. Jacquet (Travaux
publics), P. Dumas (Relations avec le Parlement),
M. Habib-Deloncle (secrétaire d'État aux Affaires étrangères),
R. Triboulet (Coopération),
A. Peyrefitte (Information)
[Tables d'archives],
P.
Messmer (Armées) [Tables d'archives],
J. Sainteny (Anciens combattants)
[Tables d'archives], M. Couve de Murville (Affaires étrangères)
[Tables d'archives],
F. Missoffe
(Rapatriés), G. Palewski (Recherche scientifique),
J. Marette (P. et T.),
L. Jacquinot (Départements et
territoires d'outre-mer),
R. Marcellin (Santé publique),
G.
Pompidou (Premier ministre) [Tables d'archives],
E. Pisani (Agriculture),
le
Général de Gaulle, G. Grandval (Travail) (à moitié caché),
A. Malraux (Affaires culturelles),
L. Joxe (Réforme
administrative) [Tables d'archives], J. Maziol (Construction),
J. Foyer (Justice)
[Tables d'archives],
J. de Broglie (secrétaire d'État aux Affaires
algériennes), R. Frey (Intérieur)
[Tables d'archives],
R. Boulin (secrétaire d'État
au Budget) [Tables d'archives], V. Giscard d'Estaing (Finances)
[Tables d'archives],
Ch. Fouchet (Éducation
nationale) [Tables d'archives], M. Maurice-Bokanowski (Industrie et commerce).
« ... Et si les États créent tour à tour
des ministères des Affaires culturelles, c'est que toute
civilisation est menacée par la prolifération de son
imaginaire, si cet imaginaire n'est pas orienté par des
valeurs... »
New-York, 15 mai 1962
|

Collection Pierre Moinot |
Notes de service envoyées par André
Malraux
à ses collaborateurs au Ministère des Affaires
culturelles
André Malraux fut un ministre
solitaire. S'il voyait peu ses collaborateurs, il leur
écrivait beaucoup, leur adressant par centaines des
fiches vertes, mauves, rosés ou blanches, selon les
destinataires. « Ses petites fiches multicolores s'en
allaient cheminer partout. De son écriture fine, il
faisait des rappels à l'ordre, esquissait les
stratégies, suggérait les tactiques, les voies bis,
ter..., terminant maintes phrases par de grands
points d'interrogation. » André Holleaux, numéro de
la Revue des Deux Mondes consacré à André Malraux, « Le
Ministre des Affaires culturelles »
(Novembre
1978, p. 356)
|
|
André Malraux à Machu-Picchu (Pérou)
1959
en compagnie d'Albert Beuret, chef de
cabinet,
et de Pierre Moinot
|

Photographie - Collection Pierre Moinot. |
|

Photographie - Collection Pierre Moinot. |
André Malraux au
Grand Palais vers 1967 |
Discours au Panthéon lors du transfert des cendres de Jean
Moulin, 19 décembre 1964.
... « Pauvre roi supplicié des ombres,
regarde ton peuple d'ombres se lever dans la nuit de juin
constellée de tortures.
« Voici le fracas des chars allemands qui
remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes
des bestiaux réveillés : grâce à toi, les chars n'arriveront
pas à temps. Et quand la trouée des Alliés commence,
regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les
commissaires de la République - sauf lorsqu'on les a tués. »
| |
Pour un réexamen des morts du Panthéon.
« II me disait qu'au
Panthéon il y avait des Grands : Voltaire, Jaurès, Jean
Moulin, mais qu'il y avait également toute une série de
protégés de Napoléon Ier, des gens qui ont des petits
tom beaux dans un coin, leur nom est tout à fait inconnu
aujourd'hui, tel général de brigade, tel ministre ou
sous-ministre. Il pensait que Napoléon avait alloué des
tombeaux comme on distribue des Légions d'honneur; il
m'a dit à plusieurs reprises : il faut refondre tout
cela; amener au Panthéon d'autres grands morts et
évacuer tous les inconnus, mais les évacuer où ?
problème ! Je lui disais : « Monsieur le ministre, ne
vous lancez pas dans cette opération, car si vous voulez
faire venir des grands morts de province, vous allez
avoir contre vous tous les maires, or vous m'avez dit à
notre première rencontre : les maires, pour moi, c'est
très important ; ils vont se dresser, il y a, c'est
vrai, des tombes illustres dans des petits villages mais
il n'est pas possible d'en priver les communes
bénéficiaires ». II nous a fait faire des recherches
très complètes sur les gens qui sont au Panthéon. »
André Holleaux,«
André Malraux ministre »
(Colloque de Cérizy-la-Salle, 16 juillet 1988.)
|
| |
Photographie - AFP
Vidéo
(Internet Explorer 6 : rafraîchir la page)
André Malraux prononçant un
discours lors d'une réunion de l'association
« Pour la
Cinquième République » en 1962 (campagne pour les élections
législatives).

Photographie - AFP.
François Mauriac, André
Malraux, Jean-Marcel Jeanneney
Meeting du 15 décembre 1965 pour la
réélection du Général de Gaulle à la présidence de la
République.
« ... Depuis la grande voix de Michelet
jusqu'à la grande voix de Jaurès, ce fut une sorte d'évidence,
tout au long du siècle dernier, qu'on deviendrait d'autant
plus homme, qu'on serait moins lié à sa patrie. C'était alors
la forme de l'espoir ; Victor Hugo croyait que les États-Unis
d'Europe se feraient d'eux-mêmes, et qu'ils seraient le
prélude aux États-Unis du Monde. Le vrai prophète n'a été ni
Michelet, ni Jaurès, ni Marx, si perspicaces dans d'autres
domaines ; mais bien leur ennemi Nietzsche, qui écrivait que
le XXe siècle serait celui des guerres nationales. A
l'heure de sa mort le Géorgien Staline, élevé dans
l'internationalisme, condamné pour internationalisme,
regardant par les fenêtres du Kremlin tomber la neige qui
ensevelit les Chevaliers Teutoniques et la Grande Armée, a eu
le droit de dire : "J'ai refait la Russie"... ».
Palais des Sports, 15 décembre 1965
|