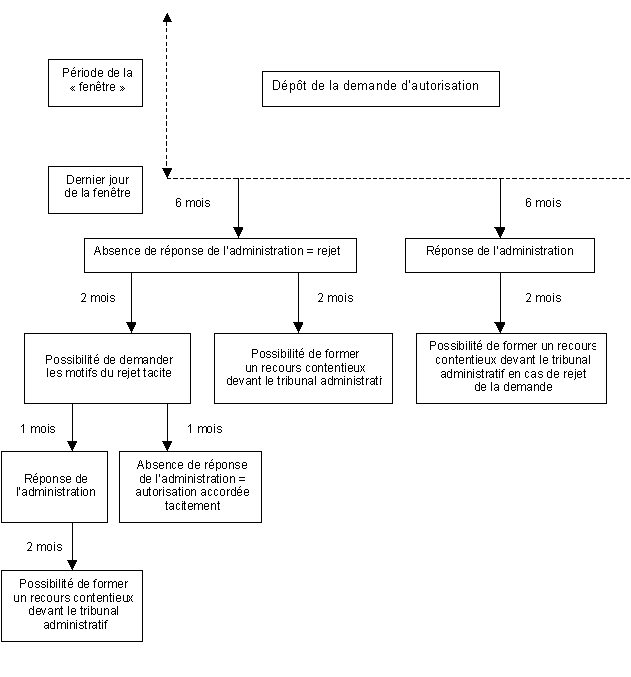Document mis
N° 752 (2ème partie) -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 710) portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit. PAR M. Étienne BLANC, Député. -- Administration. II. - L'IMPÉRATIF DE SIMPLIFICATION III. - LE CHOIX DE L'HABILITATION Audition de M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, et de M. Henri Plagnol, secrétaire d'État à la réforme de l'État, et discussion générale EXAMEN DES ARTICLES Chapitre Ier - Mesures de simplification de portée générale Chapitre II - Mesures de simplification des démarches des particuliers 2ème partie du rapport Chapitre III Mesures de simplification des procédures électorales 6 Article 12 Vote par procuration 6 Article 13 Formalités imposées aux candidats et modalités d'organisation de certaines élections 9 Article 14 Organisation des élections non politiques 20 Chapitre IV Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social 24 Article 15 Création d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux 24 Article 16 Organisation administrative et fonctionnement du système de santé 27 Chapitre V Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises 36 Article 17 Institution de régimes déclaratifs 37 Article 18 Rationalisation du système d'enquêtes imposées aux professionnels 38 Article 19 Simplification des déclarations sociales 40 Article 20 Clarification du droit du travail et du financement de la formation professionnelle 51 Article 21 Aménagement du droit des sociétés 70 Article 22 Exercice de certaines professions réglementées 89 Chapitre VI - Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption de la partie législative de codes Chapitre VII - Dispositions finales 43 SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D'ARTICLES AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION ANNEXE I : LES MESURES DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES ANNEXE II : AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AUX MODALITÉS ET EFFETS DE LA PUBLICATION DES LOIS ET DE CERTAINS ACTES ADMINISTRATIFS ANNEXE III : LISTE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES CREEES PAR UNE LOI LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
Chapitre III
Article 12 Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure utile à la facilitation du vote par procuration, par le biais, en particulier, de la mise en place d'un système d'attestation sur l'honneur et de la suppression du volet du formulaire de procuration destiné au mandataire. a) La nécessité de répondre de manière pragmatique à l'abstention L'abstention se développe. Par exemple, au premier tour de l'élection présidentielle, elle était de 28 % tandis qu'elle était de 35 % pour le premier tour des élections législatives. La participation des citoyens à une consultation relève d'abord d'un acte de foi dans la démocratie et dans ses représentants. Mais, le réalisme commande de ne pas négliger un aspect plus concret, celui de l'adaptation du dispositif législatif et réglementaire qui permet aux citoyens empêchés de voter. Tous les observateurs avisés de la vie politique et tous les élus appelés à tenir un bureau de vote s'entendent en effet sur un point : les dispositions du code électoral doivent être revues pour prendre en compte une caractéristique fondamentale de notre époque, la mobilité. Les initiatives ont été nombreuses en ce domaine (1). Résultat d'un choix ou d'une nécessité, professionnelle, de loisir ou d'étudiant, régulière ou occasionnelle, de courte ou de longue durée, la mobilité est aujourd'hui le fait de toutes les tranches d'âge et de tous les groupes sociaux. b) Le régime actuel du vote par procuration Dérogation par rapport aux principes fondamentaux régissant les conditions du droit de vote définis par l'article 3 de la Constitution qui dispose que le « suffrage est toujours universel, égal et secret », l'exercice du vote par procuration est encadré dans des limites strictes. Ainsi, l'article L. 71 du code électoral ouvre la possibilité d'un vote par procuration aux élections à trois catégories d'électeurs : - les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans la commune dans laquelle ils sont inscrits le jour du scrutin ; - les électeurs appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article qui sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, en raison notamment de leur profession ou de leur état de santé ou condition physique : fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 %, titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe, titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 %, personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne, personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes, malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ; - les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. En vertu de l'article premier du décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration, les électeurs doivent produire toutes les justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, à savoir les juges et les greffiers en chef des tribunaux d'instance et les officiers de police judiciaire, qui peuvent avoir une appréciation différente des justificatifs que les électeurs doivent produire. Le système permet aux seuls citoyens placés dans des situations limitativement énumérées et à même de produire un justificatif, dont la validité est appréciée dans des conditions fatalement différenciées et subjectives. Conçu en 1946, il a été complété à la suite de la suppression du vote par correspondance par la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 et élargi, notamment par la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 modifiant l'article L. 71 du code électoral et relative au droit de vote par procuration. Il apparaît inéquitable et décourageant. Il est enfin peu lisible : en témoignent les cas de mandataires titulaires d'une procuration et s'abstenant doublement, dans l'ignorance où ils sont de la durée exacte de leur procuration, laquelle peut être valable pour un an ou pour un seul scrutin. Par ailleurs, selon l'article L. 74 du code électoral, le mandataire doit présenter sa procuration et son vote est constaté, notamment, par l'estampillage de la procuration. Cette procédure le contraint à être muni du volet du formulaire de procuration qui lui est destiné, alors même que le bureau de vote doit lui-même être en possession du volet adressé à la mairie. Or, l'existence de mouvements sociaux dans les services d'acheminement du courrier peut empêcher le mandataire de recevoir, en temps utile, le volet de la procuration qui lui est destiné. Lors des deux dernières élections présidentielles, le Conseil constitutionnel avait proposé que le vote des mandataires soit accepté même en l'absence de présentation de leur volet de procuration. La situation juridique se révèle donc incertaine. Si le vote par correspondance a été supprimé en France en 1975, c'est notamment en raison des risques de fraude. Il reste que les règles en vigueur dans les pays européens apparaissent dans l'ensemble moins contraignantes que les nôtres et l'efficacité de certains des dispositifs mis en place à l'étranger, tels que le vote par anticipation, mériterait d'être analysée au travers du triple critère de la sécurité, de la participation et de la simplicité. Au Royaume-Uni, les moyens d'exercice du droit de vote ont été considérablement étendus ces dernières années : Internet, bornes dans les lieux publics, possibilité de voter par téléphone en utilisant le code d'accès figurant sur la carte électorale... D'autres États expérimentent les technologies modernes en matière de vote par Internet sous une forme sécurisée. Dès lors, l'obligation de se présenter en personne ne s'impose plus avec la même acuité qu'avant l'apparition de ces techniques. Il faut et il suffit que l'on soit certain que l'électeur veuille voter et qu'il puisse se prononcer librement. En conséquence, les motifs justifiant le recours à la procuration doivent indéniablement être élargis. Le ministre délégué aux libertés locales, M. Patrick Devedjian, l'a confirmé devant le Sénat à l'occasion de la séance des questions du 22 octobre 2002 : « il faut assouplir les conditions d'ouverture du vote par procuration, car elles sont trop restrictives. Certains citoyens absents de leur commune le jour du scrutin pourraient ainsi voter par procuration alors qu'ils ne le peuvent pas aujourd'hui. Il me semble qu'une déclaration sur l'honneur devrait suffire. Demander aux électeurs de justifier du motif réel de leur absence - par exemple, leur demander de présenter le faire-part de la communion de leur petite fille - relève d'une méfiance de mauvais aloi à l'égard du citoyen qui ne veut qu'exercer son droit de vote. Il me semble que la seule affirmation de son indisponibilité et de son désir de voter par procuration doit donc être suffisante. (...) Deuxièmement, il faut sans doute transférer l'établissement des procurations vers d'autres services publics, parce que ce sont toujours les mêmes services, et notamment les commissariats de police, qui y procèdent alors que ce n'est pas leur vocation. Ils ont d'autres problèmes à régler. Troisièmement, il faut davantage simplifier le formulaire de vote par procuration, qui - ceux qui ont tenu un bureau de vote le savent - n'est pas d'une grande clarté. » Aucun obstacle constitutionnel ne s'oppose à ce que les catégories d'électeurs susceptibles d'exercer leur droit de vote par procuration soient élargies ou à ce que les contraintes particulières devant peser sur eux soient définies en termes généraux. L'exception au suffrage secret, et donc personnel, constituée par le recours à la procuration ne se justifie que par la nécessité de favoriser l'exercice de ce droit de vote. Dès lors, il apparaît nécessaire de permettre au Gouvernement d'agir par ordonnance dans ce domaine pour une mise en œuvre rapide. Il sera toujours temps pour le Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de ratification, d'apporter des ajustements éventuels. Pourraient ainsi être autorisés à voter par procuration, outre les électeurs qui ne peuvent être présents dans leur commune d'inscription en raison d'obligations professionnelles, familiales ou de santé ou parce qu'ils sont en vacances, les électeurs n'habitant pas dans leur commune d'inscription, tandis qu'une simple déclaration sur l'honneur pourrait remplacer la production de pièces justificatives. En outre, la suppression du volet de formulaire de procuration destiné au mandataire pourrait être envisagée sans remettre en cause la validité de la procédure. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions de présentation, d'envoi ou de dépôt de la demande. Le rapporteur estime que la procédure prévue par la partie réglementaire du code électoral pourrait être également simplifiée. La possibilité pour les électeurs de recevoir les formulaires de demandes de vote par procuration et de les envoyer par voie électronique pourrait être utilement organisée. Après avoir rejeté un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti prévoyant qu'une ordonnance habilitera le maire à recevoir les procurations sous le contrôle de la commission des opérations électorales de la commune, la Commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 13 Le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'allégement des formalités que doivent accomplir les candidats aux élections politiques, qu'il s'agisse de la participation à la campagne radiotélévisée des élections législatives, du dépôt des candidatures pour l'élection des députés et des conseillers municipaux, des règles de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique en vue du financement des partis, du versement par les candidats d'un cautionnement, ou des modalités de dépôt des comptes de campagne et de la facilitation de leur contrôle.
Est également visé un
allégement des modalités d'organisation de certaines élections, qu'il
s'agisse des modalités de convocation pour les municipales et a) La participation à la campagne radiotélévisée des élections législatives Le régime d'accès des partis politiques à la campagne radiotélévisée des élections législatives est défini par l'article L. 167-1 du code électoral, en vertu duquel les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne. Deux types de partis sont distingués. D'une part, les partis déjà représentés par des groupes à l'Assemblée nationale disposent d'une durée d'émission de trois heures, divisée en deux parts égales, la première étant réservée aux groupes appartenant à la majorité et la seconde aux groupes de la minorité. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. À défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. D'autre part, les partis non représentés, à condition qu'ils présentent au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins, ont accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second. Pour bénéficier de ce temps d'antenne, les partis en question doivent déposer une demande qui doit être accompagnée de l'état des listes de candidats présentées aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé avec indication de la circonscription où chaque liste est présentée, auquel sont joints un état nominatif des candidats figurant sur chaque liste et une attestation de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée. Cette demande, qui doit intervenir au plus tard le vingtième jour précédant le jour du scrutin, est alors examinée par une commission présidée par un membre du Conseil d'État et dont la composition est fixée par l'article premier du décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. Au plus tard le quinzième jour précédant celui du scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président du conseil supérieur de l'audiovisuel. Le délai du dépôt de la demande est impératif. Dans une ordonnance de référé en date du 28 mai 2002, le Conseil d'État, statuant sur une requête du parti Les Verts, a eu l'occasion d'indiquer « qu'aucune disposition ne prévoit que ce délai pourrait être reporté de vingt-quatre heures s'il vient à échéance un jour férié ; que la condition de délai est donc impérative et qu'il appartient à la commission de faire application, en l'absence de circonstances particulières constitutives de force majeure, des dispositions du décret relatives à cette condition, dont les termes précités impliquent que les demandes reçues postérieurement à l'expiration du délai ne peuvent recevoir l'habilitation définie à l'article L. 167-1 du code électoral ». Ainsi, à l'occasion des élections des 9 et 16 juin 2002, la commission a retenu les demandes de douze partis et a rejeté quatre demandes en raison de leur caractère tardif. Ce rejet a concerné notamment les demandes du parti Les Verts, de Chasse Pêche Nature et Tradition et du Rassemblement pour la France. La commission a eu l'occasion de souligner, dans son rapport, certaines difficultés d'application de la réglementation. Certains partis ont pu évoquer la difficulté de concilier l'obligation de déposer leur demande de temps d'antenne au plus tard le vingtième jour précédant le premier tour avec la limite du dépôt de la déclaration de candidature qui doit intervenir quant à elle au plus tard le vingt et unième jour avant le premier tour en vertu de l'article L. 157 du code électoral. En effet, la nécessité de présenter une attestation des candidats certifiant leur appartenance au parti entrerait en contradiction avec le fait qu'ils ne disposent pas tous encore des récépissés définitifs de dépôt de déclaration de candidature. Si le fondement juridique de cette contestation n'est pas établi puisque les récépissés ne sont pas exigés à l'appui d'une demande de temps d'antenne, la question de la multiplicité des délais ainsi que celle de leur brièveté, qui pèse particulièrement sur les petites formations, sont posées. En effet, lorsqu'une formation dépasse de très peu le nombre de candidats requis pour obtenir un temps d'antenne, elle doit être assurée de disposer du nombre nécessaire de candidatures valables. Or, selon l'article L. 159 du code électoral, les candidatures peuvent être contestées par le préfet dans les vingt-quatre heures. Le tribunal administratif a trois jours pour statuer, ce qui éloigne la déclaration définitive d'une candidature de quatre jours. La commission chargée d'examiner les demandes d'antenne peut donc être amenée à réexaminer ces demandes le seizième jour précédant le premier tour du scrutin, c'est-à-dire la veille du jour où elle-même doit transmettre sa décision au conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Gouvernement pourrait, par ordonnance, simplifier la procédure que doivent suivre les partis et groupements politiques non représentés par des groupes à l'Assemblée nationale pour bénéficier d'un temps d'antenne à l'occasion de la campagne des élections législatives. Ces partis pourraient n'avoir qu'une formalité à remplir en déposant au ministère de l'intérieur une demande de participation à la campagne radiotélévisée, ce qui leur éviterait de constituer un dossier comportant les attestations de rattachement de soixante-quinze candidats. Ne serait prise en compte que la déclaration de rattachement faite par les candidats au moment du dépôt de leur candidature pour l'application de la législation relative à l'aide publique sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1998 relative à la transparence financière de la vie politique. Cette déclaration de rattachement qui n'est aujourd'hui que facultative permettrait donc de déterminer à la fois l'aide publique dont bénéficiera le parti et sa participation à la campagne radiotélévisée. La commission mise en place pour l'application du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral déterminerait alors les partis pouvant participer à la campagne radiotélévisée dès lors que soixante-quinze candidats au moins ont déclaré leur rattachement à chacun de ces partis. b) La procédure et la fixation du jour limite de dépôt des candidatures aux différentes élections - L'établissement de la preuve de la qualité d'électeur des candidats aux élections législatives Selon l'article L.O. 127 du code électoral, « tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale », sans qu'aucune disposition ne lui fasse obligation d'apporter la preuve matérielle de sa qualité d'électeur. Les candidats ne sont tenus que de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession (article L. 154 du code précité). En application de l'article R. 99 du même code, le candidat doit seulement indiquer la commune sur les listes électorales de laquelle il est inscrit, renseignement que les services préfectoraux vérifient. Le préfet peut contester l'éligibilité du candidat devant le tribunal administratif, il appartient alors à l'intéressé de justifier de sa qualité d'électeur devant le tribunal (2). L'augmentation du nombre de candidats et la multiplication des cas de candidats inscrits sur les listes électorales d'un autre département entraînent des difficultés croissantes. D'autres élections, telles que les élections municipales et cantonales, présentent une plus grande sécurité juridique. En application de l'article L. 210-1 du code électoral, la déclaration de candidature à l'élection au conseil général doit être accompagnée de toutes pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité (inscription sur une liste électorale, domiciliation dans le département ou inscription au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou héritage d'une propriété foncière dans le département). En ce qui concerne les élections municipales, l'article L. 265 du code électoral exige que les documents officiels remis lors du dépôt de la liste des candidats établissent les conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et notamment le fait que les candidats sont électeurs de la commune et inscrits au rôle des contributions directes. Pour renforcer les conditions de sécurité juridique des élections législatives, le Gouvernement pourrait décider, par ordonnance, de compléter l'article L. 154 du code électoral de telle sorte que le régime de dépôt des candidatures aux élections législatives soit aligné sur celui des élections municipales ou cantonales et que les candidats et leur suppléant soient obligés de fournir les documents établissant qu'ils ont la qualité d'électeur. En pratique, ils pourraient fournir une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire. - L'enregistrement provisoire d'une candidature contestée au deuxième tour de scrutin des élections législatives En application de l'article L. 157 du code électoral, les déclarations de candidatures aux élections législatives doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant, permettant de garantir l'enregistrement de sa candidature, quand bien même cette dernière serait contestée par le préfet dans les vingt-quatre heures de son dépôt, tandis qu'un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature. Or, la délivrance d'un récépissé n'est pas prévue au second tour. En effet, le premier alinéa de l'article L. 162 du code précité se contente de préciser que « les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour ». En conséquence, il apparaît utile d'habiliter le Gouvernement à compléter, par ordonnance, cet article L. 162 en prévoyant expressément la délivrance d'un récépissé provisoire attestant de l'enregistrement d'une candidature au second tour des élections législatives. - La mention de la nationalité des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne aux élections municipales En application de l'article L.O. 265-1 du code électoral, chaque fois qu'une liste candidate aux élections municipales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, comporte la candidature d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Or, l'article L. 265 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, indique que la liste ne doit comporter expressément que son titre, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats, sans référence à la nationalité ni renvoi à l'article L.O. 265-1. En conséquence, à l'occasion des dernières élections municipales de 2001, les préfets n'avaient pu exercer de contrôle de la mention, sur les listes, de la nationalité en face du nom des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Dans les élections des représentants au Parlement européen, l'article 9 de la loi n° 77-729 du 8 juillet 1977, tel que modifié par l'article 5 de la loi n° 94-104 du 8 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, prévoit explicitement que la nationalité des candidats doit figurer sur la déclaration de candidature. Afin de permettre un contrôle satisfaisant de cette mention aux élections municipales, il convient d'habiliter le Gouvernement à compléter l'article L. 265 du code électoral par un renvoi exprès à l'article L.O. 265 de ce même code. - La fixation du jour et de l'heure limite de dépôt des candidatures pour l'élection des députés et des conseillers municipaux Comme nous l'avons vu supra, le jour limite de dépôt des candidatures est fixé au troisième dimanche, soit le vingt et unième jour, précédant le premier tour (article L. 157 du code électoral) et, pour le second tour, au mardi suivant le premier tour (article L. 162 du code électoral). Dans les deux cas, l'heure limite est fixée à minuit. Ce système implique que les services de l'État travaillent le week-end lors de l'enregistrement des candidatures du premier tour et jusqu'à minuit le mardi lors de celui des candidatures du second tour. Cette charge supplémentaire de travail ne correspond pas à des besoins réels et pose indéniablement des difficultés pratiques d'organisation. Les mêmes problèmes se posent pour les élections municipales. Pour simplifier ce système, le Gouvernement pourrait fixer par ordonnance la date limite du dépôt des candidatures du premier tour au vingt-troisième jour précédant ce tour de scrutin, c'est-à-dire le quatrième vendredi précédant le premier tour à 17 heures, et la date limite du dépôt des candidatures pour le second tour au mardi suivant le premier tour à 17 heures. Cette réforme permettrait, en outre, aux tribunaux administratifs, qui sont saisis dans les vingt-quatre heures du dépôt des candidatures par le préfet et qui disposent de trois jours pour statuer, de prendre des décisions sur les candidatures litigieuses avant le début de la campagne, fixé par l'article L. 164 du code électoral au vingtième jour, soit le troisième lundi, précédant le scrutin. En revanche, le rapporteur s'interroge sur la différence qui subsisterait avec l'heure limite des dépôts des candidatures aux élections sénatoriales, qui est fixée, par l'article L. 301 du même code, à 18 heures. Sans doute conviendrait-il de modifier également cette heure. S'agissant des élections municipales, il est précisé, à l'article L. 267 du code électoral, que les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard, pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures, et, pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. Pour éviter également de mobiliser par trop les préfectures, le Gouvernement pourrait ramener les heures limite de dépôt des listes candidates de minuit à 17 heures. c) Le rattachement des candidats aux élections législatives à un parti La loi du 11 mars 1988 précitée relative à la transparence financière de la vie politique a institué un financement public des partis et groupements politiques. Une partie de ce financement public est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de suffrages que les candidats des partis et groupements politiques ont obtenu au premier tour des élections législatives générales. En vue de répartir cette aide publique, en application de l'article 9 de la loi précitée, les candidats aux élections législatives peuvent indiquer, s'ils le souhaitent, lors du dépôt de leur déclaration de candidature pour le premier tour, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Pour obtenir un financement public, le parti ou le groupement doit avoir présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions. Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques adopté définitivement par le Sénat, le 12 mars 2003, prévoit en outre que n'obtiendront un financement public que les formations politiques dont les candidats ont obtenu dans chacune de ces circonscriptions au moins 1 % des suffrages exprimés. La déclaration de rattachement est déposée en même temps que la déclaration de candidature. L'indication du rattachement à un parti ou groupement politique peut être, par exemple, mentionnée dans la déclaration de candidature elle-même ou dans un document séparé de forme libre. Elle peut également faire l'objet d'une déclaration ad hoc. La déclaration de rattachement est facultative. Les voix obtenues par un candidat qui n'aura pas indiqué de formation de rattachement n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul de la répartition de l'aide publique. Elle peut être différente de l'étiquette politique que le candidat revendique. Un candidat « sans étiquette » peut en effet souscrire une déclaration de rattachement de telle sorte que ses voix contribuent au financement d'un parti de son choix. Le parti ou groupement de rattachement doit être unique. La loi exclut qu'un même candidat puisse indiquer, au moment de sa déclaration de candidature, plus d'un parti ou groupement de rattachement. Il est possible toutefois que les candidats demandent à être rattachés à un groupement politique ad hoc constitué pour la circonstance. Ainsi le parti Y et le parti X peuvent créer une association dénommée « association XY ». Enfin, la déclaration de rattachement ou de non-rattachement souscrite au moment du dépôt de la candidature ou l'absence de déclaration devient définitive à l'expiration de la période de dépôt. La loi ne prévoit en effet aucune procédure par laquelle le candidat pourrait, passé ce délai, revenir sur sa déclaration initiale. Compte tenu de ce relatif manque de formalisation des déclarations de rattachement, l'expérience des élections législatives pour 2002, marquée par un nombre très important de candidats, s'est traduite pour la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par des difficultés importantes de gestion. Parallèlement, la commission chargée d'examiner les demandes d'accès à la campagne officielle radiotélévisée se doit de vérifier que le parti ou le groupement demandeur a obtenu le rattachement d'au moins soixante-quinze candidats. Une vérification double est donc opérée par deux instances différentes. Pour éviter ces doublons et supprimer toute ambiguïté sur le rattachement de tel ou tel candidat à une formation politique, il pourrait être utile, par exemple, de permettre à la commission contrôlant l'accès à la campagne radiotélévisée d'établir la liste des formations politiques demandant un temps d'antenne et de présenter cette liste aux candidats qui, expressément, choisiraient alors de se rattacher à telle ou telle de ces formations. d) Le versement d'un cautionnement par les candidats L'obligation de versement d'un cautionnement a été supprimée pour l'ensemble des élections au suffrage universel direct par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Seuls les candidats aux élections européennes se voyaient encore imposée cette obligation. Or, le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques adopté définitivement par le Sénat, le 12 mars 2003, a supprimé cette obligation dans ses articles 18 et 19, abrogeant l'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet relative à l'élection des représentants au Parlement européen. La suppression de toute obligation de versement d'un cautionnement imposerait donc de supprimer les références à cette formalité dans les différents articles du code électoral qui y renvoient, par exemple dans les articles L. 52-4 et L. 52-12, mais aussi dans l'article L. 161 (délivrance d'un récépissé de versement de cautionnement). Le présent projet de loi habilite le Gouvernement à opérer cette simplification. e) Les modalités de dépôt des comptes de campagne et leur contrôle Notre collègue Jérôme Bignon, dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (3), relevait la nécessité d'assurer un « toilettage » des dispositions relatives au financement des campagnes électorales, afin de mettre fin à un certain nombre d'imperfections qui compliquent singulièrement la tâche des candidats et du juge de l'élection. En outre, il appelait de ses vœux l'habilitation à légiférer par ordonnance sur ces matières, dans le but, en particulier, de modifier les modalités de dépôt des comptes de campagne et leur contrôle. Le présent article rencontre ces vœux. - La date limite de dépôt des comptes de campagne Sur le fondement de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, pendant l'année précédant le premier jour du mois de celle-ci. Et, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes. Le dépôt de ces comptes doit donc se faire un dimanche avant minuit. Selon la logique qui a présidé à l'avancement de l'heure limite de dépôt des candidatures, le Gouvernement pourrait avancer l'heure limite de dépôt des comptes de campagne à 17 heures, au plus tard le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, soit approximativement deux mois après. Le choix d'un jour précis empêchera que les formalités ne soient accomplies éventuellement un samedi ou un dimanche. - Les modalités de dépôt des comptes de campagne En application de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne et ses annexes doivent être présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Or, certains candidats indépendants ne réalisent aucune dépense. Ils sont néanmoins soumis à l'obligation de dépôt de compte présenté par un expert-comptable. Ce dernier devant être rémunéré, cette rémunération constitue alors la seule dépense inscrite au compte, ce qui paraît absurde. Dès lors, le Gouvernement pourrait être habilité à modifier les règles de dépôt des comptes des candidats n'ayant engagé aucune dépense pour leur campagne. Cette obligation de dépôt serait utilement remplacée par une attestation sur l'honneur fournie par le mandataire du candidat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 52-4 du code précité, un candidat ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise. En conséquence, lorsqu'un donateur verse une contribution pendant ou après le scrutin, il doit attester qu'il s'est engagé à le faire avant le début de ce scrutin. Or, il est fréquent que cette attestation ne rende pas compte de la réalité de dons qui ont été reçus par un candidat qui s'est aperçu pendant le scrutin que son budget ne pourra pas être financé dans sa totalité. Pour mettre en accord le droit avec les faits, il serait bon de simplifier cette règle et de permettre l'engagement et le versement de dons après la clôture du scrutin. En outre, sur le fondement de ce même article L. 52-4, un candidat à une élection peut recourir à un mandataire financier - personne physique - ou à une association de financement, intermédiaire qui est tenu, respectivement en application des articles L. 52-6 et L. 52-5, d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Lorsqu'un candidat n'a pas recours à un mandataire et n'utilise pas un compte dédié spécialement à ses dépenses de campagne, la commission nationale des comptes de campagne est parfois obligée de distinguer, dans le compte personnel du candidat, ce qui relève de ses dépenses personnelles et ce qui est imputable à sa campagne électorale, distinction qui s'avère souvent délicate. En conséquence, il pourrait être de bonne politique d'obliger tous les candidats à désigner un mandataire. Deux objections pourraient être faites à cette simplification. D'une part, certains candidats sont obligés de payer eux-mêmes certaines menues dépenses liées à leur campagne et leur imposer de passer par un intermédiaire peut sembler lourd. D'autre part, il arrive que certains candidats soient contraints de se séparer de leur mandataire et, avant d'en trouver un nouveau, soient amenés à régler eux-mêmes leurs dépenses électorales. Ces objections peuvent être facilement combattues. Dans le premier cas, s'il s'agit de menues dépenses, la commission nationale a, selon une jurisprudence constante, constaté la possibilité de les réaliser sans intermédiaire. Dans le second cas, la commission nationale accepte de prendre en compte les dépenses réalisées sans mandataire à condition que le deuxième intermédiaire régularise la situation en reprenant à son compte les dépenses faites pendant la période transitoire sans mandataire ou association de financement. L'imposition d'un mandataire à tous les candidats permettrait une véritable simplification du travail de contrôle des comptes de campagnes. Enfin, il convient de relever qu'en l'état du droit, selon l'article L. 52-12, les candidats doivent déposer leur compte et ses annexes auprès de la préfecture, qui elle-même les transmet à la commission nationale. Lorsque celle-ci est contrainte de se prononcer, en vertu de l'article L. 118-2 du code électoral, dans les deux mois parce que l'élection en cause est contestée, le délai de transmission des dossiers en provenance de la préfecture ampute d'autant le temps dont elle dispose pour examiner les comptes. À titre d'exemple, sur les 11 500 comptes liés à des élections locales générales, près de 2 500 sont liés à une élection contestée. La contrainte qui pèse alors sur la commission nationale est particulièrement forte. C'est pourquoi il serait utile de permettre une transmission directe des comptes à la commission nationale par les candidats. Cette amélioration pourrait être renforcée par l'attribution à la commission nationale d'une autonomie de gestion. - L'attribution d'un statut législatif d'autorité administrative indépendante à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques En application de l'article L. 52-12 précité, le compte de campagne et ses annexes déposés à la préfecture sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui en assure la publicité dans une forme simplifiée. Cette commission, instituée par l'article L. 52-14 de ce même code, comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret. Elle peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. Elle approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. La loi ne précise pas si elle relève de la catégorie des autorités administratives indépendantes. Or, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 31 juillet 1991 Assemblée nationale Paris 13e circonscription (4), et le Conseil d'État lui ont reconnu ce statut. Ce dernier, dans son Rapport public 2001, a pu la qualifier d'autorité administrative indépendante « par détermination jurisprudentielle » (5). Pour mettre en accord le droit avec les faits, le Gouvernement pourrait par ordonnance reconnaître explicitement l'appartenance de la commission à la catégorie des autorités administratives indépendantes, comme le législateur l'a fait pour la cnil dans l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cette reconnaissance lui permettrait de bénéficier d'une plus grande liberté de gestion, en particulier dans le recrutement de son personnel. Cette souplesse trouvera sa pleine utilité dans les périodes qui suivent les élections et qui nécessitent des moyens supplémentaires importants pour un temps relativement bref. Dans le cadre d'une élection générale, la commission doit examiner plusieurs milliers de comptes de campagne. Le nombre de candidats augmente régulièrement : ils étaient 2 788 aux élections législatives de 1988, 5 139 à celles de 1993 et 8 444 à celles de 2002. Comme dans tout traitement de masse, des erreurs peuvent survenir, ce qui oblige, par exemple dans le cas des élections législatives, le Conseil constitutionnel à prendre des décisions de désistement (6). Pour limiter ces risques et à l'appui de l'attribution du statut d'autorité administrative indépendante à la commission nationale, il faut rappeler que, dans son article premier, la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'État et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'État occupant de tels emplois précise que « les institutions administratives de l'État, dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission » sont dispensées de n'employer que des fonctionnaires titulaires. Il s'agit ainsi selon les termes du Conseil d'État « d'agir au nom de l'État sans être (subordonnée) au Gouvernement et de bénéficie, pour le bon exercice de (ses) missions, de garanties qui (lui) permettent d'agir en plein autonomie, sans que (son) action puisse être orientée ou censurée, si ce n'est par le juge ». Ainsi, à l'instar de la cnil, qui peut demander aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction, la commission nationale des comptes doit pouvoir faire appel à des ressources extérieures et ne plus dépendre des moyens contraints de tel ou tel ministère (en l'occurrence des ministères de la justice, de l'intérieur et de l'économie) pour faire face à des charges croissantes liées à l'augmentation des nombres de candidats aux élections. Aujourd'hui, la commission dispose d'une équipe permanente de trente-cinq personnes. En période post-électorale (la commission doit juger les comptes des élections faisant l'objet d'une contestation en deux mois et ceux des autres élections dans les six mois), cette équipe centrale est augmentée jusqu'à atteindre environ soixante personnes. Elle doit faire appel à du personnel capable de vérifier que le contrôle initial effectué de manière déconcentrée a bien réalisé toutes les vérifications de base, a respecté la procédure contradictoire et suivi les principes dégagés par la jurisprudence de la commission. Cet exercice exige donc une solide compétence juridique susceptible de s'exercer sur des cas souvent très spécifiques. Seule une autonomie de recrutement peut assurer de manière pérenne cette exigence. f) Les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales Pour les élections municipales, en application de l'article L. 227 du code électoral, la date est fixée au moins trois mois avant le scrutin par décret pris en Conseil des ministres. En revanche, en vertu de l'article L. 247, l'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas. À titre de comparaison, pour les élections législatives, les électeurs sont convoqués par décret et les élections ont automatiquement lieu le cinquième dimanche qui suit la publication de ce décret (articles L. 172 et L. 173 du code électoral). Un seul acte suffit également pour la convocation et la fixation de la date des élections sénatoriales, cantonales et régionales (articles L. 309 à L. 311, L. 218 à L. 220 et L. 357 du même code). La logique et le souci de simplicité doivent conduire à permettre au Gouvernement de fixer, par ordonnance, une règle identique pour les élections municipales : un seul décret en Conseil des ministres permettrait de fixer leur date et de convoquer les électeurs. g) Le régime de démission d'office des conseillers généraux et régionaux Lorsqu'un conseiller général devient inéligible ou demeure dans une situation d'incompatibilité à l'expiration des délais d'option, il doit être déclaré démissionnaire d'office. Le prononcer de cette démission appartient, dans l'état du droit, au président de l'assemblée délibérante. En application de l'article L. 205 du code électoral, tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 du même code ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est également déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. En vertu de l'article L. 210 du code électoral, tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 de ce même code, est également déclaré démissionnaire selon la même procédure. Cette situation a pu, dans les faits, s'avérer délicate pour les présidents d'assemblée délibérante contraints de demander à leurs collègues de prononcer la démission d'office de l'un des leurs. Il est des situations où certains présidents peuvent hésiter ou même refuser de faire prononcer la démission d'office. En ce qui concerne les conseillers régionaux, l'article L. 341 du code électoral prévoit que tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'État dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'État dans la région n'est pas suspensif. En application des articles L. 344 et L. 345, la même procédure s'applique en cas d'incompatibilité. La même question se pose pour les conseillers de Corse auxquels est applicable, en vertu de l'article L. 367 du code précité, le régime fixé par l'article L. 341 aux conseillers régionaux du continent. Un régime identique est applicable aux conseillers municipaux. Selon l'article L.O. 236 du code précité, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. Une procédure identique est engagée en cas d'incompatibilité sur le fondement de l'article L. 239 du code précité. De plus, l'article L. 236 précise que la démission d'office du conseiller municipale est immédiatement déclarée par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 du code précité. Cette précision n'existe pas pour la démission d'office des conseillers régionaux et des conseillers de Corse. Or, elle permet de clarifier la situation et d'indiquer de manière claire les voies de recours dans un délai adapté. Pour harmoniser les procédures applicables aux conseillers généraux et régionaux avec celle qui prévaut pour la démission d'office des conseillers municipaux, l'ordonnance que le Gouvernement est habilité à prendre sur le fondement du présent article pourrait, d'une part, substituer le préfet au président du conseil général comme autorité constatant la démission d'office d'un conseiller et, d'autre part, indiquer quelles seront les voies de recours à l'encontre des arrêtés par lesquels les préfets de région prononceront la démission d'office de conseillers régionaux devenus inéligibles ou étant demeurés dans une situation d'incompatibilité à l'expiration des délais d'option en situation de cumul des mandats. La Commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 14 Comme les élections politiques, les élections professionnelles souffrent d'une abstention importante. Les élections prud'homales de décembre 2002 en témoignent. Le taux d'abstention a atteint 67,3 %, au lieu de 65,59 % en 1997. Mais ce constat pourrait être également dressé pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux de commerce, aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux élections de la mutualité sociale agricole (msa). Outre ces problèmes de participation, les élections professionnelles emportent pour les préfectures et les mairies d'importantes charges, étant donné leur nombre, leur fréquence et la diversité des régimes applicables à chacune, qu'il s'agisse de l'établissement des listes, de l'enregistrement des candidatures, de la mise en place de la commission de propagande, de l'organisation et du contrôle des opérations de vote ou du suivi du contentieux. Les régimes applicables à ces élections apparaissent, en effet, divers, comme le montre le tableau suivant : Règles applicables aux élections professionnelles
Il faut alléger la charge des mairies, particulièrement sollicitées pour assurer la tenue des bureaux de vote et celle des préfectures, qui interviennent à toutes les étapes des élections. Il serait également utile de faciliter les modalités du vote. Le présent article offre donc la possibilité au Gouvernement d'élaborer des ordonnances qui pourront simplifier la composition des commissions de contrôle, encadrer l'organisation matérielle des opérations de vote confiées aux tribunaux et organismes concernés par les élections, systématiser le vote par correspondance ou du moins le rendre le plus ouvert possible, supprimer des bureaux de vote ou en diminuer le nombre, harmoniser les procédures et, en particulier, les voies de recours et enfin modifier le calendrier des élections consulaires. Les ordonnances de simplification devront être rédigées par un nombre important de ministères : affaires sociales, intérieur, justice, travail et agriculture. Leur élaboration impliquera également une large concertation avec tous les partenaires socio-professionnels. Le champ des modifications justifie pleinement ce travail de concertation. Sont en effet appelés à être modifiés les textes législatifs suivants : - pour les chambres de commerce et d'industrie, le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-15), dont la rédaction est reprise des articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ; leurs modalités d'application ont été définies par le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ; - pour les tribunaux de commerce, le chapitre III du livre IV du code de l'organisation judiciaire (articles L. 413-1 à L. 413-11), dans une rédaction reprise de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 précitée ; - pour les tribunaux paritaires des baux ruraux, les articles L. 441-1 à L. 444-1 du code de l'organisation judiciaire ; - pour les élections à la mutualité sociale agricole, le titre II du livre VII du code rural (L. 723-15 à L. 723-26), dont la mise en œuvre, dans l'attente de la publication de la partie réglementaire du nouveau code rural, est précisée par le décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 de l'ancien code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de msa ; - pour les élections prud'homales, le titre Ier du livre V du code du travail, en particulier son chapitre III relatif aux élections des conseillers prud'hommes, dont les dispositions ont été modifiées récemment par lois n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, n° 2001-1077 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Outre les simplifications qui sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des élections visées par le texte d'habilitation, des simplifications plus particulières sont prévues pour certaines de ces élections. Ainsi, pour les élections dans les organismes consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et chambres d'agriculture), il pourrait être prévu d'alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et à la mise en œuvre du vote électronique. Cette modalité de vote, inédite en France, pourrait être inaugurée à titre expérimental pour le prochain vote des Français de l'étranger, dans la circonscription d'Amérique du Nord, à l'occasion de l'élection de leur conseil supérieur, vote qui devrait se dérouler en juin 2003 (7). Pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges aux tribunaux de commerce et tribunaux paritaires des baux ruraux, il pourrait être envisagé d'adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin de simplifier les opérations électorales. Par ailleurs, le corps électoral ainsi que les conditions d'éligibilité pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce, pourraient être modifiés dans le sens d'un rapprochement. Le Gouvernement pourrait également modifier la composition des chambres de commerce et d'industrie. Il devra, par ailleurs, modifier un nombre important de textes réglementaires. Ainsi, le rapporteur relève que pour les élections aux chambres d'agriculture, outre l'article L. 511-8 du code rural qui prévoit que « les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture », la plupart des dispositions qui les régissent relèvent du pouvoir réglementaire (articles R. 511-8 à R. 511-53 du code rural). De la même manière, les élections aux chambres de métiers sont régies par les articles 7 et 8 du code de l'artisanat, dispositions qui ont un caractère réglementaire, par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et par l'arrêté du 4 août 1999 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers.
Enfin, le Gouvernement, par cet article, est autorisé à proroger par ordonnance le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des membres des tribunaux de commerce élus en 1999 pour quatre ans, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, ainsi que celui des conseillers prud'hommes élus en 2002 pour cinq ans, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008. Pour lutter contre l'abstention, ces mesures visent à éviter que les élections professionnelles visées aient lieu la même année que nombre d'élections politiques, en particulier en 2007. Après avoir rejeté un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnance la composition des collèges des conseils de prud'hommes pour y inclure un représentant des collectivités locales, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 10), puis l'article 14 ainsi modifié.
Chapitre IV Le domaine sanitaire et social constitue un secteur dans lequel la matière juridique se révèle particulièrement vivante et le législateur se montre spontanément créatif. À rebours de l'empilement quasi naturel des règles constaté ces dernières années, le présent chapitre propose de rationaliser l'organisation du secteur, de simplifier et d'harmoniser certaines procédures et d'alléger les charges administratives qui pèsent sur les différents intervenants, dans un souci de meilleur contrôle des finances sociales.
Article 15 Les instances chargées de suivre la création d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux sont nombreuses et parfois redondantes. Par ailleurs, la procédure d'autorisation de création présente une certaine complexité. Depuis la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, la création, la transformation et l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au nombre de 25 000 aujourd'hui, sont subordonnées à l'accord préalable de la puissance publique. Tout en maintenant le principe d'une autorisation préalable délivrée soit par le préfet, soit par le président du conseil général, soit par les deux conjointement conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a changé les règles jusqu'alors applicables. Les demandes portant sur des établissements ou des services de même nature sont désormais reçues pendant une période bien déterminée dans l'année (la « fenêtre »), afin que l'autorité administrative qui délivre l'autorisation soit à même de pouvoir comparer les projets entre eux. L'instruction du dossier, dès lors que l'établissement ou le service atteint une certaine importance, exige que le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale soit consulté pour avis, sans que ce dernier ait à être motivé. Lorsque les projets portent sur la création d'un établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle, l'avis du conseil régional et celui du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont également requis. La loi du 2 janvier 2002 a fixé à quinze ans la limite de validité à l'autorisation accordée. Néanmoins, elle ne s'applique pas aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse, qui continuent de bénéficier d'autorisations à durée indéterminée. En revanche, elle est raccourcie à cinq ans pour les équipements expérimentaux. En l'absence de dispositions expresses dans la loi du 30 juin 1975, les équipements expérimentaux, destinés par exemple à l'accueil des victimes de la maladie d'Alzheimer ou des personnes autistes, étaient soumis à une simple déclaration ; ces établissements devaient néanmoins obtenir une habilitation à accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale. Sauf si l'administration demande au gestionnaire de déposer une demande de renouvellement un an avant son expiration, l'autorisation est renouvelée tacitement pour l'ensemble des établissements visés. Le régime a été rendu plus rigide par le fait que le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de six mois vaut rejet. Mais, dans les deux mois, le demandeur débouté peut demander à cette dernière d'expliciter les motifs du rejet. Si elle ne répond pas dans le mois qui suit, l'autorisation est alors réputée être accordée au gestionnaire. Comme dans le secteur hospitalier en application de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, si l'administration motive son rejet dans les délais, sa décision peut être contestée par le gestionnaire devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivront la notification des motifs de rejets.
DÉLAIS APPLICABLES EN
MATIÈRE D'AUTORISATION DE CRÉATION, D'EXTENSION OU DE TRANSFORMATION D'UN
ÉTABLISSEMENT
Les autorisations sont délivrées selon des critères précis. Le projet doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sociale et médico-sociale, présenter un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables, être compatible avec le montant des dotations des financeurs et enfin satisfaire aux règles d'organisation et de fonctionnement. L'autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'État, seul ou conjointement avec le président du conseil général, elle permet de dispenser des prestations prises en charge par l'État ou les organismes de sécurité sociale. Face à la complexité de la procédure applicable à la création de ces établissements, le Gouvernement prendra, sur le fondement du présent article, les mesures nécessaires à une simplification des procédures, sous peine d'empêcher le secteur de se développer, à l'heure où les besoins sont croissants et ne sont pas tous pris en charge de manière satisfaisante. Il s'agira notamment de rationaliser le double système de classement des projets de création d'établissements ou de services, réalisé en amont par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et en aval lorsque l'autorité compétente est obligée de refuser l'autorisation faute de financements disponibles. De plus, il semblerait utile de supprimer le conseil supérieur de l'aide sociale, régi par les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de l'action sociale et des familles, en application desquels il est chargé de traiter de toutes questions intéressant l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale. Cette instance, organisée par le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, ne s'est jamais réunie. Selon la même logique, il faut s'interroger sur le maintien du conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, introduit par la loi du 2 janvier 2002 dans le code de l'action sociale et des familles (article L. 312-2) et dont le rôle consiste à donner des avis sur les principaux textes régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, alors même qu'il existe dans les grands secteurs couverts par cette loi des instances dont les fonctions intègrent la mission confiée au conseil supérieur : le conseil national consultatif des personnes handicapées, le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et la conférence nationale de la famille. La Commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 16 Le système de santé est marqué par une grande complexité liée à l'amélioration et à l'élargissement de la prise en charge des malades et au recours à des techniques de plus en plus perfectionnées. En outre, la réforme de son organisation, initiée en 1996, se trouve à un tournant. Lors de la présentation du plan « Hôpital 2007 », le 20 novembre 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a pu notamment déclarer que « les gestionnaires des établissements de santé sont découragés par les lourdeurs qu'ils affrontent tous les jours. Les contraintes administratives qui pèsent sur l'hôpital sont devenues un véritable carcan. » Cette initiative a été encouragée récemment par notre collègue René Couanau, dans son rapport d'information sur l'organisation interne de l'hôpital (8). Le haut comité de la santé publique, dans son rapport de 2002 sur La santé en France, justifie cette réforme : « Comme on l'a vu, notre organisation se traduit également par une accumulation successive de niveaux et de structures compliquant à l'extrême les modalités de fonctionnement et d'action. Une telle situation est sans doute à l'origine de surcoûts humains et financiers. (...) Il s'agit d'être plus simple et plus efficient, notamment pour que les démarches de coordination ou de travail en réseau apportent une véritable valeur ajoutée, au lieu de pallier une fragmentation et une segmentation obéissant à des logiques institutionnelles et non pas fonctionnelles. »
Plusieurs séries de
simplifications méritent à ce titre d'être conduites : elles doivent
porter à la fois sur la rationalisation de l'organisation sanitaire, sur
l'allégement d'un certain nombre de régimes d'autorisation, sur le
perfectionnement des mécanismes de a) La rationalisation de l'organisation sanitaire Le présent article délègue au Gouvernement le pouvoir de transférer des préfets aux directeurs des agences régionales d'hospitalisation (arh) certaines compétences, à remodeler l'organisation sanitaire, en vue de la suppression de la carte sanitaire, de l'aménagement du contenu du schéma régional d'organisation sanitaire (sros) et d'une meilleure articulation de ce dernier avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et les projets d'établissements. - L'élargissement des compétences des directeurs des agences régionales d'hospitalisation La création des arh est une réussite indéniable. Les résultats de l'action impulsée depuis 1996 sont à mettre au crédit de ces agences qui ont déployé des efforts considérables. Leur action doit, pour réussir, reposer sur l'adhésion de nombreux acteurs, en particulier les élus locaux, et s'inscrire dans la durée. Cependant, il convient de relever l'imperfection des moyens d'action dont elles disposent, qu'il s'agisse des systèmes d'information, des outils de planification ou de la cohérence de leurs compétences par rapport à l'administration centrale et aux préfets. Les arh éprouvent, en effet, des difficultés en raison du partage des compétences avec les préfets d'une part, l'administration centrale de l'autre. La gestion des personnels médicaux et des directeurs d'établissement et la programmation des contrôles de sécurité sanitaire dans les hôpitaux relèvent des préfets. Selon la Cour des comptes (9), « la répartition des compétences des agences avec l'autorité préfectorale n'est pas satisfaisante sur deux points : la responsabilité des contrôles et la gestion des carrières des directeurs d'établissements et des praticiens hospitaliers ». En matière de contrôle, le partage des compétences entre le préfet et le directeur de l'arh est à l'origine de difficultés de fonctionnement des services déconcentrés de l'État, notamment depuis la mise en place des missions régionales et interdépartementales d'inspection, de contrôle et d'évaluation au sein des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et placées sous l'autorité du préfet. Dans certaines régions, cette mise en place a provoqué des conflits avec l'arh qui est responsable du programme de contrôle des établissements de santé, à l'exclusion du programme d'inspection de sécurité sanitaire placé sous la responsabilité du préfet. En matière de sécurité sanitaire, ce dernier est, en effet, responsable de l'élaboration et de la réalisation du programme de contrôle des établissements. Mais, en cas de dysfonctionnement, c'est le directeur de l'agence qui en tire les conséquences, soit en attribuant des moyens financiers spécifiques facilitant la mise aux normes, soit en suspendant, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins de l'établissement défaillant. La gestion des personnels médicaux et de direction relève, pour l'essentiel, du préfet. Mais, il appartient à l'arh d'élaborer la stratégie de création et de transformation de postes médicaux et pharmaceutiques hospitaliers, le tableau des emplois médicaux, et d'autoriser le renouvellement des responsables de services. Les arh sont également chargées des tableaux des emplois de direction des établissements, tandis que c'est le préfet qui suit la gestion administrative de ces personnels. L'administration centrale intervient quant à elle pour la nomination des praticiens hospitaliers et des directeurs d'établissements. L'avis des arh n'est pas sollicité en dépit des liens qui existent entre la disponibilité de ces personnels et les opérations de restructuration qu'elles conduisent. Pour donner tous les moyens d'action nécessaires aux arh, il convient d'habiliter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour redistribuer une partie des compétences des préfets et du ministre aux directeurs des agences, afin qu'ils puissent disposer d'un bloc homogène de compétences. Cela passerait notamment par la modification de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique qui fixe les pouvoirs des directeurs d'agence. Sur ce fondement, pourraient ainsi être transférées aux directeurs des ARH les compétences relatives : - à l'autorisation et à la suspension des pharmacies à usage intérieur, l'article L. 5126-7 du code de la santé publique précisant aujourd'hui que la création, le transfert ou la suppression d'une de ces pharmacies (établissements de santé, associations à but non lucratif chargées d'un service de dialyse à domicile, établissements pénitentiaires) est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - à l'approbation et à la suspension de l'activité libérale d'un praticien hospitalier et des pharmaciens (articles L. 4113-14, L. 4221-18, L. 6154-4 et L. 6154-6 du code de la santé publique) ; - à l'autorisation de fonctionnement des lactariums (article L. 2323-1) et à l'autorisation de réviser les conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé (article L. 6145-10) ; - au pouvoir de suspension des praticiens ayant une activité dans un établissement de santé et de saisine des juridictions disciplinaires, en cas d'urgence et lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave (article L. 4113-14 du code de la santé publique tel que rédigé par l'article 45 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) ; - à la fixation de la dotation globale des institutions qui, sans être des établissements de santé, participent à la lutte contre les maladies mentales (article L. 3222-1) et dont les dépenses sont déjà incluses dans la dotation régionale limitative gérée par les agences régionales ; - aux missions de contrôles actuellement exercées dans les établissements de santé par les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales (articles L. 1421-1 et L. 6116-4 du code de la santé publique). L'objectif de constitution d'un pôle de compétences facilement identifiable, qui sous-tendait l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, pourrait ainsi être pleinement atteint. - La rationalisation des documents d'organisation sanitaire Le ministre chargé de la santé l'a souligné le 20 novembre 2002 : « Je souhaite également simplifier la planification car, aujourd'hui, plus personne ne s'y retrouve entre le sros, la carte sanitaire et les autorisations. Le projet consiste à faire jouer un rôle nouveau au sros et à ses annexes à travers un dispositif rénové et renforcé : revu tous les cinq ans, ce schéma, élaboré en fonction d'une appréciation géographique des besoins en activité de soins, par bassin de vie, deviendra ainsi le dispositif central du pilotage sanitaire régional. » Il s'agit à la fois de supprimer la carte sanitaire, d'aménager le contenu des sros, en y incluant notamment la psychiatrie, et d'articuler ces derniers avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et avec les projets d'établissement. La loi portant création d'une couverture maladie universelle est venue préciser la portée juridique du sros, dispositif déjà prévu par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. La première génération de sros, élaborés par les préfets (en fait les directions régionales des affaires sanitaires et sociales), a couvert la période 1994-1998. La révision des schémas, engagée en mars 1998, a débouché sur les sros dits « de deuxième génération » couvrant la période 1999-2004. Elle a été préparée par un comité national de pilotage placé auprès du directeur des hôpitaux en application d'un arrêté du 26 mars 1998 relatif au contenu des sros et une circulaire du même jour. Il faut relever qu'il existe, pour la psychiatrie, des instruments juridiquement distincts, les schémas régionaux d'organisation sanitaire de psychiatrie, qui ont également pour but de faire évoluer l'offre de soins en optimisant sa répartition et en assurant une meilleure adéquation aux besoins de la population. Le sros va désormais au-delà d'un simple exercice de répartition des moyens en installations, déterminés par la carte sanitaire. Il fixe les objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire. Il prévoit l'organisation territoriale des moyens qui permettent la réalisation des objectifs. Il vise à susciter les adaptations du dispositif hospitalier, notamment les coopérations entre les établissements de santé et avec la médecine ambulatoire. Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs qu'il fixe. Il peut comporter des recommandations pour la réalisation de ces objectifs. C'est un document de cadrage des grands axes de la recomposition hospitalière dans une région. Les objectifs qu'il retient visent à corriger les principaux dysfonctionnements que le bilan de l'existant et les différents diagnostics effectués par les arh ont révélés. Il indique les cibles à atteindre mais laisse des marges de manœuvre aux établissements de santé sur les modalités. Sa mise en œuvre s'appuie sur les contrats d'objectifs et de moyens qui sont négociés entre l'arh et chaque établissement de santé comme sur la délivrance des autorisations ou encore l'approbation des projets d'établissement ou l'agrément des réseaux. Au plan de la méthode, les sros ont largement mobilisé les experts de l'État, de l'assurance maladie et des établissements hospitaliers, tant pour procéder à l'analyse détaillée de l'offre de soins existants et des besoins de la population que pour mener les travaux au sein des groupes thématiques destinés à déterminer les objectifs et les plans d'action prévus dans les schémas. L'analyse des documents arrêtés montre une relative homogénéité des priorités retenues par les régions. Outre l'organisation des urgences et de la périnatalité qui correspond à une obligation réglementaire, le cancer, la cardiologie, l'insuffisance rénale chronique, la chirurgie sont les thématiques les plus fréquemment abordées. De même, les sros cherchent à promouvoir une mise en cohérence du dispositif hospitalier dans des espaces géographiques modulés selon les sujets traités, qu'il s'agisse du secteur sanitaire ou du bassin de vie. La complémentarité est recherchée par une organisation graduée des établissements et la coordination par le développement des réseaux de soins pour des pathologies ou activités spécifiques. Des priorités de santé publique, en lien avec les priorités fixées par les conférences nationale et régionale de santé, sont fixées pour l'hôpital : prise en charge de la douleur rebelle chronique, soins palliatifs ou pratiques addictives, suicide... Comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de 2000, l'articulation des sros avec les autres documents sanitaires pose problème. Il faut citer parmi ces derniers, en se limitant à l'échelon régional et aux documents élaborés par les services de l'État, les programmes régionaux de santé (prs) qui reprennent tout ou partie des priorités fixées par les conférences régionales de santé en associant aux actions prévues des moyens de financement, les programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (praps), créés par la par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 précitée relative à la lutte contre les exclusions, et enfin les schémas de services collectifs sanitaires, créés par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999. L'articulation de ces instruments mériterait d'être clarifiée. Si l'articulation des sros avec les prs et praps ne devrait pas être trop difficile, on peut déplorer en revanche qu'ils ne traitent que marginalement des soins de ville, secteur pour lequel les arh ne sont pas compétentes, et que les schémas de services collectifs sanitaires ne peuvent utilement aborder. Si l'on se place hors du seul cadre régional, il faut s'interroger sur l'articulation entre les sros et projets pluriannuels de moyens et d'objectifs et les projets d'établissement. Elle sera améliorée. La compétence en matière d'admission à participer au service public hospitalier pourrait être déconcentrée au niveau régional. Par ailleurs, il n'y aura plus deux sros séparés, un somatique et un psychiatrique. Le conseil départemental de santé mentale et le niveau départemental de planification en santé mentale seraient supprimés ainsi que le collège national d'experts. Le schéma régional de psychiatrie sera intégré comme volet obligatoire des sros, afin d'améliorer l'articulation entre les soins somatiques et psychiatriques notamment pour la réponse aux urgences, l'intervention des équipes de psychiatrie dans les autres services et la couverture des besoins somatiques des malades mentaux. Le secteur psychiatrique sera désormais déterminé par l'annexe du sros et non plus par la carte sanitaire, qui sera supprimée. - La suppression de la carte sanitaire et du collège national d'experts L'élaboration de la carte sanitaire, instituée par la loi hospitalière du 31 décembre 1970, est encadrée par des indices nationaux à l'intérieur desquels sont arrêtés les indices régionaux, qui tiennent peu compte des spécificités régionales. Ces indices limitent le nombre de lits ou d'équipements qui peuvent être autorisés. Ils constituent un carcan qu'il convient de supprimer, comme le ministre chargé de la santé l'a annoncé lors de la présentation du plan « Hôpital 2007 ». La carte sanitaire sera remplacée par une nouvelle annexe du sros. Le niveau de la réduction de capacité en lits à appliquer lors d'un regroupement ou d'une conversion d'activité sera désormais négocié dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens. Par ailleurs, le collège national d'experts, créé par la loi du 31 juillet 1991 précitée et prévu à l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, censé constituer une instance de conseil technique et d'expertise auprès du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale, n'a jamais été réuni. Il pourrait être supprimé sans dommage. b) L'allégement des régimes d'autorisation Aujourd'hui, les autorisations sont délivrées pour des durées différentes selon leur nature : les activités de soins (obstétrique, chirurgie spécialisée, soins de suite, ...) sont valables cinq ans, les équipements lourds (scanner, IRM) valent pour sept ans et les installations (lits de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de psychiatrie ou de soins de suite) sont autorisées pour une durée de dix ans. Parallèlement, le sros est établi pour une durée maximale de cinq ans. Le présent article doit donc permettre au Gouvernement de simplifier le régime d'autorisation des activités de soins et équipements matériels lourds et d'aligner la durée des autorisations sur celle du sros, c'est-à-dire cinq ans, tandis que devraient être supprimées l'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que la double autorisation, du préfet et du directeur de l'arh, applicable aux maisons d'enfants à caractère sanitaire (article L. 2321-3 du code de la santé publique) et aux établissements recevant des femmes enceintes (article L. 2212-2). Les modifications d'activité ou de regroupements devraient être facilitées. Devrait également être adapté et simplifié le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires d'analyse médicale à Mayotte. c) L'approfondissement des mécanismes de coopération Par cet article, le Gouvernement pourra également réviser les formules de coopération sanitaire, notamment le régime juridique du groupement de coopération sanitaire (gcs), afin de l'ouvrir aux professionnels libéraux, aux établissements médico-sociaux et aux réseaux de santé. Le gcs est une structure juridique qui permet une collaboration entre établissements publics et privés à but lucratif. Ce groupement réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux. Lors de la présentation du plan « Hôpital 2007 », le ministre de la santé a souligné que « le système de santé est devenu transversal entre la ville et l'hôpital aussi bien qu'entre le sanitaire et le médico-social. Il est impératif d'en tenir compte pour l'avenir et pour accompagner la recomposition du paysage sanitaire : ceci passe également par l'élargissement et la simplification des modalités de coopération hospitalière. Je souhaite simplifier et unifier les outils de coopération à travers la notion, réaménagée, assouplie et polyvalente, de groupement de coopération sanitaire. » Cette orientation a été confirmée par notre collègue Jacques Domergue dans son rapport sur la chirurgie française remis au ministre chargé de la santé, le 13 février 2003. Il faut rappeler que le régime des gcs, mis en place par l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée, a d'ores et déjà été assoupli une première fois par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et une seconde fois par la loi du 4 mars 2002 précitée, dans son article 87. Depuis lors, les associations entre établissements publics et établissements privés au sein d'un même groupement sont possibles. Selon le plan « Hôpital 2007 », un gcs élargi, souple et polyvalent, remplacera, à terme, les autres modalités de coopérations. Dans le dispositif de modernisation envisagé, le gcs pourra donc être constitué entre un ou plusieurs établissements de santé et des professionnels libéraux de santé. Il ne sera plus limité, comme aujourd'hui, aux établissements. L'objectif est de favoriser ainsi la coopération entre établissements publics de santé, établissements privés participant au service public hospitalier (psph) et médecins de ville. Cette mesure sera susceptible de répondre à la pénurie que connaissent les établissements hospitaliers publics pour certaines disciplines médicales ou chirurgicales. Le groupement pourra constituer le cadre d'une organisation commune des personnels médicaux susceptibles de dispenser des actes au bénéfice des patients des établissements membres et participer aux permanences médicales organisées dans le cadre du groupement. Il pourrait aussi devenir un cadre juridique ad hoc pour un réseau de santé. d) Le perfectionnement du système d'information sur la tarification des établissements de santé À l'heure actuelle, les établissements privés régis par l'objectif quantifié national, c'est-à-dire ayant passé convention avec les organismes d'assurance maladie en application ou contrat avec les arh, reçoivent des forfaits par journée et prestation délivrée, ce qui assure un financement en fonction des actes réalisés. Mais, comme l'a relevé la Cour des comptes, les données issues de leur comptabilité analytique ne permettent pas aux arh de déterminer précisément le coût de chacun des actes. De plus, les tarifs, qui sont complexes à arrêter, avec plus de vingt-cinq éléments de tarification déclinés par grandes disciplines, et à actualiser en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques, ne peuvent être suffisamment détaillés pour distinguer chaque type d'acte. En conséquence, ils ne reflètent qu'imparfaitement la réalité des coûts des établissements et peuvent conduire les établissements à se spécialiser dans les domaines les plus rémunérateurs. Dès lors, ils peuvent se traduire par des choix de spécialisation inadaptés aux besoins. Les patients pouvant librement choisir de s'adresser à un établissement public ou à un établissement privé, il apparaît difficile de justifier l'existence de deux modes de tarification différents, coexistence qui entraîne de fortes différences dans les moyens de fonctionnement des établissements et de réelles inégalités dans l'offre de soins proposée aux patients. Ainsi, une ordonnance pourrait harmoniser les informations relatives aux établissements de santé transmises à l'autorité de tarification, notamment pour faciliter l'évaluation des besoins des établissements de santé privés en investissement et éviter ainsi de trop grands décalages entre charges et financements de ces établissements. e) L'intervention des sociétés d'économie mixte dans le domaine hospitalier Au nombre de 1 200, réalisant un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros par an, les sem locales sont des sociétés anonymes (sa) associant dans leur capital des collectivités locales majoritaires (commune, département, région ou leurs groupements) et des partenaires économiques et financiers. Leur régime est défini par la mise en regard, d'une part, de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locale et codifiée aux articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés commerciales. Mais, en application de l'article L. 1521-1 du code précité, l'objet social des sem doit être en relation avec la réalisation d'une activité d'intérêt général entrant dans le champ de compétence reconnu aux collectivités locales. Or, le champ hospitalier en est exclu. Pourtant, la logique d'entreprise dans la réalisation de l'intérêt général qui découle de leur statut mixte offrirait une capacité de réaction dont les établissements publics hospitaliers ont besoin pour se moderniser. Ainsi, à l'occasion de la présentation du plan « Hôpital 2007 », le ministre de la santé, le 20 novembre 2002, a déclaré que souhaité « faciliter l'implication (...) des sociétés d'économie mixte dans les opérations de construction et d'aménagement immobilier à l'hôpital ». Parallèlement, les compétences de l'établissement public de santé et du service public hospitalier sont limitées par la loi, puisque son activité est cantonnée aux missions de service public qui lui sont attribuées en application des articles L. 6111-1 et suivants et L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique. Il ne peut ni sortir de son objet, ni utiliser son patrimoine à d'autres fins que cette activité. En conséquence, il est lui est interdit de prendre des participations dans des sociétés commerciales, telles que les sem. Certes, en vertu de l'article L. 6134-1 du code précité, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération avec des personnes de droit public et privé et créer, pour ce faire, des personnes morales limitativement énumérées : syndicats interhospitaliers, groupements d'intérêt public, groupements d'intérêt économique, groupements de coopération sanitaire, fédérations médicales interhospitalières. Mais, dans un avis du 1er août 1995 (10), le Conseil d'État a interdit la création de personne morale relevant d'une catégorie non prévue expressément par cet article, telle que les sem. L'habilitation accordée au Gouvernement pourrait donc faciliter l'intervention des sem dans le domaine hospitalier de deux façons : - en les autorisant à intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance des établissements publics de santé ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux ; - en autorisant, en retour, la participation des établissements publics de santé à leur capital afin de favoriser la conduite des opérations mentionnées ci-dessus. f) La simplification des démarches des professionnels de santé et des vétérinaires Le professeur Yvon Berland, dans le rapport de la mission « Démographie des professions de santé » de novembre 2002, a pu ainsi relever que les travaux de recensement du nombre des professionnels de santé ont été « l'occasion de constater la complexité des procédures actuelles d'enregistrement des professionnels de santé dans leur ensemble et le manque de coordination des institutions concernées (ordres, caisses, État, établissements employeurs) ». Par exemple, en application de l'article L. 4113-1 de la santé publique, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre. Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice. Il manque une procédure d'enregistrement unique. Les données statistiques, selon les sources, sont différentes pour une même profession, ce qui interdit de procéder à une analyse fine de l'offre en fonction du territoire, pourtant essentielle à la réalisation d'un accès à la santé égal pour tous. 196 000 médecins, 42 400 chirurgiens-dentistes, 15 100 sages-femmes et 62 000 pharmaciens, notamment, pourraient être susceptibles d'être concernés par la mesure de simplification. La mission menée par le professeur Berland a très logiquement relevé la nécessité de réduire la multiplicité des procédures d'enregistrement des professions de santé grâce à la mise en place d'un guichet unique permettant l'inscription et la mise à jour annuelle des données concernant les professionnels. Des modifications des règles législatives permettront d'accompagner les travaux de la mission « Modernisation de l'administration des répertoires d'identification nationale et études » (marine) lancée au printemps 2002. De la même façon, en application de l'article L. 241-1 du code rural, tout vétérinaire qui désire exercer sa profession est tenu de faire enregistrer son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme. Plus de 10 500 vétérinaires sont susceptibles de bénéficier de mesures de simplification. Il convient de faciliter l'installation des professionnels de santé et des vétérinaires. Cette politique pourra passer par la suppression de la formalité de l'enregistrement du diplôme de certaines professions réglementées auprès du greffe du tribunal de grande instance et par l'aménagement des formalités d'enregistrement auprès de l'autorité administrative. g) L'adaptation du régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires à Mayotte L'article L. 6412-6 du code de la santé publique soumet aujourd'hui le seul établissement public de santé de Mayotte au régime des autorisations. En l'état du droit, un établissement de santé privé peut donc s'installer à Mayotte sans être soumis à autorisation. Il conviendrait, par ordonnance, de combler ce vide juridique et de remettre les établissements privés dans le droit commun des autorisations. En application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, un laboratoire d'analyses médicales privé ne peut fonctionner sans une autorisation délivrée par le préfet de département qui doit alors vérifier que le laboratoire répond aux normes d'installation et d'équipement. Or, à l'heure actuelle, il n'est prévu aucune modalité particulière d'installation d'un tel établissement privé à Mayotte. En conséquence, il pourrait également être procédé à l'intégration de Mayotte dans le droit commun des laboratoires d'analyses de biologie médicale privés. La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Paul-Henri Cugnenc tendant à habiliter le Gouvernement à simplifier les modalités de versement des honoraires des praticiens hospitaliers consultant à l'hôpital dans le cadre de leur activité libérale. Mme Maryse Joissains-Masini ayant fait observer que de nombreux médecins avaient déjà tendance à privilégier cette activité, elle a exprimé la crainte que cet amendement n'aggrave cette propension. Après que le rapporteur eut rappelé que cet amendement avait pour seul objet de simplifier les modalités de paiement des médecins, et non d'encourager l'une des modalités d'exercice de leur profession au détriment de l'autre, la Commission l'a adopté (amendement n° 1). Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 11), elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.
Chapitre V La réforme de l'État passe aussi par l'amélioration des relations entre le monde économique et les autorités administratives. Or, les entreprises sont confrontées à des difficultés liées aux procédures parfois très lourdes qui s'imposent à elles. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a apporté diverses mesures de simplification de la vie sociale des entreprises, de la protection sociale et du droit du travail. Cette loi prévoit en particulier que les données relatives aux rémunérations et aux effectifs que les employeurs doivent transmettre aux organismes gérant des régimes de protection sociale (urssaf, assedic, caisses de retraite complémentaire, caisses de congés payés) font l'objet d'une déclaration établie sur un support unique et adressée à un seul destinataire. La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier a poursuivi cette évolution en simplifiant les formalités administratives incombant aux entreprises. Elles ont été suivies de mesures réglementaires adaptées aux besoins des petites entreprises : la création d'une entreprise dans le délai d'un jour franc ouvrable, ou encore la possibilité pour tout employeur, sauf les particuliers, de recourir à une formule déclarative spécifique dite « déclaration unique d'embauche » (décret n° 95-1355 du 29 décembre 1995), qui s'est substituée aux onze formalités liées à l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale. Le mouvement mérite d'être poursuivi. L'accès au droit a un coût pour les agents économiques. Il suffit pour s'en convaincre d'observer le cours annuel des modifications des règles fiscales, sociales et touchant l'objet social de l'opérateur économique. M. Patrice Maynial, dans son rapport de 1997 sur Le droit du côté de la vie : réflexions sur la fonction juridique de l'État, estime que : « Le temps demandé aux assujettis et aux administrés a un coût : modifier le droit équivaut à lever un impôt. C'est par le biais de ces dévotions à l'administration que l'image de production normative est altérée. » À la demande de M. Renaud Dutreil, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, un groupe de neuf parlementaires animé par notre collègue Xavier de Roux s'est attaché à proposer des mesures de simplifications administratives en faveur des entreprises. Ce groupe, qui s'est réuni régulièrement depuis septembre 2002, a remis une synthèse de ses travaux le 14 janvier 2003. Le présent chapitre habilite le Gouvernement à traduire certaines d'entre elles dans des ordonnances.
Article 17 Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à supprimer des régimes d'autorisation préalable auxquels sont soumises les entreprises, pour leur création ou certaines de leurs activités, et à y substituer des contrôles a posteriori. Devraient être définies les procédures selon lesquelles les administrations pourront manifester leur opposition à un acte soumis à une simple déclaration. En Italie, les lois annuelles de simplification ont permis peu à peu de remplacer les régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs. Ainsi, le nombre de fiches d'état civil, entre 1996 et 2000, est passé de 70 millions à 31 millions et celui des signatures certifiées conformes sur demande de l'administration de 38 millions à 6 millions. Pour les entreprises, les dispositifs de déclaration de début d'activité ont remplacé, dans 95 % des cas, les mécanismes d'autorisations et de licences. En 1995, le commissariat à la réforme de l'État avait inventorié 4 200 régimes d'autorisation préalable. Plus de 400 ont été supprimés depuis lors. Ce mouvement doit être poursuivi. L'allégement des formalités qui pèsent sur les entreprises est une préoccupation constante des pouvoirs publics. La création, dès le mois de mars 1981, des centres de formalités des entreprises (cfe), en témoigne. Le présent article permettra de réaliser une avancée substantielle dans cette voie en autorisant le Gouvernement à définir, par ordonnance, les modalités du passage d'un régime d'autorisation préalable à un simple régime déclaratif et à organiser un système de contrôle a posteriori, moins lourd et plus efficace. La mise en œuvre de ce programme implique de réaliser un recensement des autorisations préalables existantes et d'entreprendre une concertation interministérielle très importante. Dans son énoncé, cette habilitation se rapproche des principes énoncés dans le chapitre Ier et procède de la même logique que celle qui gouverne le remplacement des pièces justificatives par des déclarations sur l'honneur. La Commission a adopté à l'initiative du rapporteur un amendement de suppression de cet article par coordination avec l'amendement adopté à l'article premier (amendement n° 12).
Article 18 Cet article propose d'habiliter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la rationalisation du système d'enquêtes statistiques, ce qui passe par la coordination et la limitation de leur nombre, par l'établissement de bases de données générales et par la mise en commun des enquêtes entre services à vocation statistique. Il existe aujourd'hui un Conseil national de l'information statistique (cnis) qui assure la concertation entre les utilisateurs de l'information et les services publics producteurs d'information statistique, à savoir, à titre principal, l'insee, les nombreux services statistiques ministériels, les organismes publics (Banque de France, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut national d'études démographiques) et les organismes privés chargés d'un service public. En vertu de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique (11), les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude aux enquêtes statistiques revêtues du visa du cnis. Sur ce fondement, trois types d'enquêtes peuvent être distingués : les enquêtes émanant des services publics comportant obligation de réponse, les enquêtes émanant des services publics non soumises à obligation de réponse, les enquêtes réalisées par des organismes n'ayant pas la qualité de service public non soumises à obligation de réponse. Le défaut de réponse à une enquête obligatoire peut être sanctionné par une amende. La sanction est différente selon le type de question, selon qu'elle est d'ordre économique ou financier ou qu'elle a trait à la vie personnelle et familiale. Le contentieux, dans le premier cas, est confié à un comité du contentieux. En outre, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés impose au système statistique public un acte réglementaire portant autorisation. La demande d'avis adressée à la cnil doit comporter le projet d'acte réglementaire autorisant le traitement, des précisions concernant le service chargé de sa mise en œuvre, sa finalité et support juridique, le service auprès duquel peut être exercé le droit d'accès des personnes interrogées aux informations les concernant, ses fonctions et ses caractéristiques techniques, les dispositions prises pour assurer la sécurité du traitement, les catégories d'informations traitées et leurs destinataires ainsi que les interconnexions, rapprochements et cessions prévues. Cependant, pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la cnil établit et publie des normes simplifiées. Les traitements répondant à ces normes n'impliquent qu'une simple déclaration de conformité à l'une de ces normes. Ainsi, la cnil a publié des normes relatives aux traitements automatisés à des fins statistiques d'informations nominatives se rapportant à des personnes physiques, à leur qualité d'entrepreneurs individuels ou d'aides familiaux effectués par les services publics, se rapportant à des informations nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'État ou encore aux traitements effectués à partir de documents ou de fichiers de gestion contenant les informations nominatives sur les personnes physiques, par les services producteurs d'informations statistiques. Il convient de rappeler, par ailleurs, qu'il est de jurisprudence constante que le secret professionnel attaché à certaines données d'ordre privé détenues par un service public est opposable par lui à une autre administration. En revanche, la loi du 7 juin 1951 modifiée par celle du 23 décembre 1986 autorise une administration, un établissement public, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un service public à céder des informations relatives aux personnes physiques et aux personnes morales recueillies dans le cadre de leur mission à l'insee ou aux services statistiques ministériels à des fins exclusives d'établissement de statistiques. Pour les données sur les personnes morales, l'avis de la cnil n'est pas nécessaire. La loi du 7 juin 1951 précitée était fondée sur une double constatation qu'il convient de renforcer aujourd'hui : la statistique apparaissant comme rigoureusement indispensable, il est nécessaire que les personnes interrogées répondent aux questionnaires ; mais l'obligation de réponse doit être aussi peu gênante que possible pour les intéressés. Il convient donc de limiter le nombre des enquêtes en organisant une coordination efficace, de manière à supprimer les doubles emplois, et de n'y recourir que dans les cas strictement indispensables. b) La nécessité d'une rationalisation En 1997, M. Pierre-Rémy Houssin, parlementaire en mission, dans son rapport au Premier ministre sur La simplification de l'État dans ses relations avec le public et avec les collectivités locales, soulignait l'utilité d'« alléger de manière importante la demande d'informations statistiques adressée aux entreprises. Cela est devenu insupportable. Ces demandes devraient être labellisées. » Lors de la présentation du « Plan pme » en 1997, l'allégement des enquêtes statistiques en direction des petites et moyennes entreprises avait été annoncé. Ainsi, l'insee a arrêté pour 1998 et 1999 un programme d'enquêtes annuelles qui réduisait sensiblement les échantillons d'entreprises ainsi que la fréquence de l'enquête annuelle pour les entreprises de moins de vingt salariés. Le rapporteur souligne l'importance de concilier la simplification du dispositif d'enquêtes statistiques avec le respect des principes de protection de la vie privée. Le texte de la loi du 7 juin 1951 interdit à l'insee de communiquer un renseignement individuel à tout autre service administratif. De la même façon, il prévoit que les renseignements individuels d'ordre économique ou financier ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par le présent article, le Gouvernement pourra, par ordonnance, assurer une meilleure coordination et limiter le nombre des enquêtes statistiques relatives aux professionnels et aux entreprises, grâce à un renforcement du rôle du cnis et des ministres compétents et à l'institution d'une obligation d'utilisation des banques de données existantes lorsque les informations ont déjà été collectées par un service de l'État. À partir du 1er janvier 2004, le service détenteur des informations, après avoir garanti l'anonymat des données et dans le respect des règles fixées par la cnil, pourrait les mettre à disposition des autres services de l'État. Les conditions dans lesquelles les données recueillies pourront être exploitées à des fins de recherche scientifique devraient également être définies, novation réclamée depuis longtemps par les chercheurs et susceptible d'être encadrée sur le fondement des travaux que la cnil a effectués en la matière. Ces avancées exigeront de modifier la loi du 7 juin 1951. La Commission a adopté l'article 18 sans modification.
Article 19 La simplification de la vie des entreprises passe nécessairement par celle des formalités liées aux différentes déclarations sociales. Les organismes chargés de les recueillir sont dispersés. Les régimes applicables sont éclatés, qu'il s'agisse de la détermination des cotisations et contributions sociales, des allégements susceptibles de s'y appliquer, de leur mode de recouvrement. Des mesures de rationalisation ont été prises. Elles méritent d'être poursuivies. a) L'harmonisation des régimes d'allégement de cotisations sociales Notre collègue Yves Bur, dans son rapport sur les recettes et l'équilibre général du projet de financement de la sécurité sociale pour 2003, soulignait l'importance qu'il convenait d'apporter à la simplification du dispositif d'exonération de cotisations sociales (12). Il rappelait que « L'existence de nombreux dispositifs d'allégement de charges peut s'expliquer par l'histoire, la superposition de dispositifs successifs jamais remis en cause, la volonté d'atteindre un objectif particulier en plus de favoriser l'emploi en général. « Deux mesures de portée générale visent une baisse des charges sociales sur les bas et moyens salaires : il s'agit de la réduction dégressive sur les bas et moyens salaires, dite "ristourne Juppé" et de l'allégement lié à l'application de la durée légale du travail à trente-cinq heures, dit "Aubry II". « Les autres mesures sont ciblées et visent notamment : l'insertion professionnelle de publics spécifiques (jeunes, personnes en difficultés), le développement de certains types d'emplois (emplois saisonniers, premier emploi, emploi familiaux) et de l'emploi dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire (zones de redynamisation urbaine, de revitalisation rurale, zones franches urbaines...). S'ajoutent à l'ensemble de ces mesures les exonérations de charges sociales dont bénéficient les travailleurs non salariés. » Trente-six dispositifs sont ainsi répertoriés : - Réduction dégressive sur les bas salaires (« Juppé ») ; - Allégement en faveur de l'aménagement et de la réduction conventionnels du temps de travail (« Robien ») ; - Aide incitative à la réduction du temps de travail (« Aubry I ») ; - Allégement « trente-cinq heures » (« Aubry II ») ; - Abattement pour les emplois à temps partiel ; - Abattement pour les emplois à temps réduit dans les entreprises ayant réduit la durée du travail ; - Réduction majorée pour les salariés relevant de dispositions particulières en matière de durée maximale du travail ; - Avantage en nature « repas » dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) ; - Exonération de cotisations d'allocations familiales pour les salariés agricoles ; - Exonération de cotisations d'allocations familiales pour certains régimes spéciaux de sécurité sociale ; - Contrat d'apprentissage ; - Contrat de qualification ; - Contrat d'orientation ; - Contrats « jeunes » (« Fillon ») ; - Contrat initiative emploi (CIE) ; - Contrat de retour à l'emploi (CRE) ; - Entreprises d'insertion (EI) ; - Entreprises de travail temporaire d'insertion ; - Aide à la création et à la reprise d'entreprises (ACRE) ; - Contrat emploi solidarité (CES) ; - Contrat emploi consolidé (CEC) ; - Emplois de ville ; - Structures agréées d'aide sociale ; - Associations intermédiaires (AI) ; - Exonération premier salarié ; - Emploi de salariés occasionnels agricoles ; - Contrat « vendanges » ; - Exonération de cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ; - Créations d'emplois jusqu'à cinquante salariés en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ; - Zones franches urbaines (ZFU) ; - Zone franche de Corse ; - Contrat d'accès à l'emploi ; - Exonération dans les départements d'outre-mer ; - Contrat d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer ; - Emploi d'une aide à domicile par une personne âgée ou invalide ; - Associations et organismes employant une aide à domicile auprès d'une personne âgée ou invalide. Cette seule liste suffit à fonder une simplification pour une meilleure lisibilité du système, la suppression de tout « effet d'aubaine » et la réduction des coûts de gestion des dispositifs, aussi bien pour l'administration que pour les bénéficiaires. Notre collègue Yves Bur, dans le rapport précité, a souligné par ailleurs l'importance du nombre de contentieux avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (urssaf). Il recommandait une intégration dans le barème des cotisations du montant des différentes exonérations accordées. Le rapporteur souligne l'effort d'ores et déjà entrepris dans la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, qui prévoit de fusionner progressivement en un allégement unique les deux mesures générales que sont la réduction dégressive sur les bas salaires (dispositif « Juppé ») et l'allégement lié aux trente-cinq heures (dispositif « Aubry II »). Ce nouvel allégement s'appliquera indistinctement à toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2003 et sera déconnecté de la durée légale du travail. Le nouveau dispositif prend la forme d'une ristourne dégressive sur les salaires inférieurs à 1,7 fois le smic (« ristourne Juppé » : 1,3 fois le smic). Au niveau du smic, le montant maximum d'exonérations de cotisations est de 26 points (18,2 points pour la « ristourne Juppé »), soit l'équivalent du maximum initialement prévu pour l'allégement « Aubry II ». Cette voie de simplification doit être poursuivie. Elle devra tenir compte, en particulier, de la nécessaire compensation par l'État des charges qui en résultent pour les organismes sociaux. b) La création d'un « titre emploi simplifié entreprise » pour les petites entreprises Le présent article s'inscrit dans le mouvement de simplification des formalités incombant aux employeurs entamé ces dernières années et vise à permettre au Gouvernement de créer, en faveur des petites et moyennes entreprises, un « titre emploi simplifié entreprise » (tese) pour alléger leurs démarches lorsqu'elles souhaitent embaucher. - Les précédents : le chèque emploi service, le titre emploi simplifié agricole, le chèque associatif Les expériences de titres emploi simplifiés se sont multipliées ces dernières années, à commencer par le chèque emploi service créé en 1996 (voir article 10) et l'usage de la vignette pour les intermittents du spectacle. Plus tard, l'article 38 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 précitée a créé dans le titre premier du livre VII du code rural un nouveau chapitre, le chapitre IV intitulé « Titre emploi simplifié agricole » (tesa), qui comporte un seul article, l'article 1000-6. Cet article a constitué une innovation législative importante, en créant un nouveau dispositif destiné à simplifier les démarches administratives des employeurs et à les inciter ainsi à embaucher des salariés ou à régulariser des emplois existants. Cette mesure a élargi les dispositions relatives au « chèque emploi saisonnier » prévues par une circulaire du 27 mars 1997 à tous les contrats à durée déterminée, permettant ainsi d'élargir et de pérenniser plusieurs expérimentations qui étaient alors menées depuis deux ans. Depuis lors, les employeurs peuvent utiliser au moment de l'embauche d'un salarié un document unique, le tesa, délivré par les caisses de msa, pour accomplir un ensemble de dix formalités. Six d'entre elles sont liées à l'embauche proprement dite : la déclaration préalable à l'embauche du salarié à la caisse de msa ; l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel ; la remise d'un contrat de travail écrit au salarié ; la déclaration à la caisse de msa, en vue de l'immatriculation du salarié ; la déclaration en vue de l'abattement de cotisations pour embauche d'un travailleur occasionnel ; la déclaration à la médecine du travail enfin en vue de l'examen médical d'embauche. Le tesa permet en outre d'accomplir quatre formalités à la fin de la relation de travail : la remise d'un bulletin de paie au salarié dont les mentions sont simplifiées ; l'inscription sur le livre de paie ; la remise au salarié d'une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès des assedic ; la déclaration à la caisse de msa pour le calcul des cotisations sociales afférentes à l'emploi du salarié. Plusieurs propositions de titre emploi simplifié pour les petites entreprises ont été faites ces dernières années. Ainsi, M. Jean-Marie Bockel, dans son rapport sur la simplification de la vie des entreprises, a fait la proposition de créer un chèque emploi premier salarié, susceptible d'intéresser 1,2 million d'entreprises qui n'ont pas de salarié (13). Dans ce schéma, les formalités liées au calcul des cotisations sociales, à leur prélèvement et aux déclarations fiscales auraient été confiées à un organisme gestionnaire unique, qui aurait envoyé au salarié une attestation d'emploi équivalant à un bulletin de salaire lui donnant droit à une couverture sociale. Pour sa part, la cosa, à l'occasion de sa réunion plénière du 17 avril 2001, avait souhaité que soit créé un titre de travail simplifié dans le secteur du bâtiment permettant aux entreprises de recruter des salariés en étant réputées avoir satisfait aux obligations déclaratives. Ce mouvement de simplification des formalités des employeurs a également été initié en faveur des associations. Notre collègue François Sauvadet a déposé en mai 2000 une proposition de loi visant à étendre aux associations les facilités du chèque emploi services destiné aux particuliers. Ce texte a été repris par notre collègue Jean-Pierre Decool, en août 2002. Il a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002 et par le Sénat le 13 mars 2003. - La création d'un « titre emploi simplifié entreprise » M. Renaud Dutreil, secrétaire d'État aux pme, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, l'a indiqué, à l'occasion de la présentation du projet de loi sur l'initiative économique devant l'Assemblée nationale, le 14 février 2003 : le Gouvernement a prévu d'inscrire dans une ordonnance la création d'un « titre emploi salarié ». Le 13 mars 2003, devant le Sénat, M. François Fillon, ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité, l'a confirmé à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur le chèque associatif : « Une (des) propositions (du Gouvernement), qui ne figure dans ce projet de loi, consiste à créer un titre emploi salarié pour toutes les petites structures, pme ou petites associations, qui facilitera l'embauche et la rémunération de leurs premiers salariés. Ce titre emploi salarié (...) se composera de quelques formulaires simples que l'employeur utilisera pour toutes les déclarations et fiches de paye. Les paiements se feront par virement automatique ou par chèque classique. Une ordonnance sera élaborée en concertation avec les partenaires sociaux et les organismes de sécurité sociale, dès que la loi d'habilitation sera votée. » Ce titre d'emploi simplifié en entreprise (tese), équivalent mutatis mutandis du chèque emploi service utilisé par les particuliers et du tesa utilisé par les employeurs agricoles, sera à la fois le bulletin de salaire, le formulaire de déclaration d'embauche et la déclaration de charges sociales. Il pourrait être utilisé, par exemple, par toutes les entreprises de moins de dix salariés pour les embauches de moins de trois mois ainsi que par les tpe pour leurs trois premières embauches à durée indéterminée. Cette proposition avait déjà été formulée par M. Pierre-Rémy Houssin, parlementaire en mission, dans son rapport au Premier ministre sur La simplification de l'État dans ses relations avec le public et avec les collectivités locales de janvier 1997. L'Assemblée nationale a adopté, à l'occasion de la première lecture du projet de loi pour l'initiative économique, deux articles visant à créer un « chèque emploi entreprises » (articles 6 quater et 6 quinquies) qui servirait à la fois de bulletin de salaire, de formulaire de déclaration d'embauche et de déclaration des charges sociales. Cet instrument est destiné aux entreprises employant au plus trois personnes en équivalent temps plein. Le Sénat a retiré cette mesure du projet de loi pour l'initiative économique au cours de sa séance du 26 mars 2003. En effet, préfiguration du tese, ce « chèque emploi entreprise » n'a pas fait l'objet de négociations avec les partenaires sociaux. La voie de l'habilitation semble donc la plus sûre et la mieux à même de permettre, dans des délais rapides, la mise en place d'un système efficace et accepté de tous. Le tesa a pu être facilement mis en place grâce à l'existence d'une seule convention collective pour les travailleurs saisonniers et d'un seul organisme, la msa. En revanche, dans le monde des entreprises, on se trouve face à une multitude de conventions collectives et d'organismes sociaux : il pourrait être donc prévu, dans un premier temps, de créer par ordonnance le tese, et, dans un second temps, de l'étendre par voie conventionnelle secteur par secteur. Ce titre simplifié pourrait donc être expérimenté dans certains secteurs, tels que le bâtiment et les travaux publics ou l'hôtellerie par exemple, avant d'être étendu à l'ensemble des secteurs. c) L'allégement des déclarations sociales et fiscales pour l'ensemble des entreprises L'objectif du présent alinéa est de réduire le nombre de déclarations, leur périodicité et leur contenu par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics. Cette simplification pourrait porter notamment sur les déclarations relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et aux mouvements de main-d'œuvre ou sur les contributions sociales, mais aussi sur des déclarations de nature fiscale. C'est la mise en œuvre, dans le secteur particulier des entreprises, du principe posé par le sixième alinéa de l'article premier du présent projet de loi. Le 31 janvier de chaque année, toutes les entreprises, sans exception, doivent transmettre leur déclaration annuelle des données sociales (dads) à l'urssaf, qui les répartit aux caisses régionales et primaires, et à la recette des impôts. Plus de 1,8 million d'établissements sont concernés par ce document unique qui reprend, par salarié occupé dans l'année par l'entreprise, l'identification du salarié, la nature de l'emploi exercé et le montant des rémunérations perçues. Il est prévu un modèle normal de formulaire ainsi qu'un modèle de déclaration simplifiée pour les entreprises de faible importance (un seul établissement, effectif n'excédant pas trois salariés, etc.). Des pénalités particulières sont prévues par le code de la sécurité sociale en cas de non-production de ce document. La cosa, dans son rapport d'activité pour 2001, avait relevé la nécessité de mieux assurer l'information des cotisants. Les mesures de simplification pourront utilement s'appuyer sur les conclusions du groupe du travail mis en place en janvier 2001 par la cosa et rassemblant la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, la caisse nationale d'assurance vieillesse, le groupe d'intérêt public « Modernisation des données sociales » et la direction de la sécurité sociale. Il s'agira, par exemple, de supprimer les redondances entre les différentes déclarations de mouvements de main-d'œuvre. Dans cette logique, le groupement d'intérêt public « net-entreprises », réunissant l'ensemble des organismes de protection sociale, a déjà mis en œuvre un site Internet destiné aux non-salariés, qui a permis à ces derniers de réaliser un certain nombre de démarches déclaratives en ligne. L'utilisation de ce type de service doit être plus largement diffusée. Les organismes sociaux doivent y contribuer, dans la logique de la mise en place de la dads unifiée (dads-u) qui réunit, depuis 2002, les déclarations du régime général, des collectivités territoriales et celle des caisses de retraite complémentaire. Les déclarations des entreprises servant à déterminer l'assiette de cotisations ou contributions sociales pourraient être remplacées à bon escient par une transmission des fichiers informatiques entre le service public et l'organisme destinataire de la déclaration. À titre d'illustration, l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires dans le cadre du recouvrement par la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (organic), de la contribution sociale de solidarité des sociétés pourrait être supprimée au profit d'une transmission de ce renseignement par les services fiscaux. La simplification nécessiterait sans doute de modifier les articles L. 243-7 à L. 243-59 et les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail. d) La création d'un guichet unique pour le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants Le guichet social unique est une idée ancienne, jamais mise en œuvre. Elle demeure d'actualité. En janvier 2001, dans son rapport sur la simplification de la vie des entreprises, M. Jean-Marie Bockel l'appelait encore de ses vœux (14). Dans un sondage de janvier 2003 organisé par la Sofres, 55 % des personnes interrogées considéraient que la mesure à prendre en priorité était « la réduction du nombre de déclarations » et 39 % la « simplification des relations avec l'administration en limitant le nombre d'interlocuteurs ». Aujourd'hui, les travailleurs non salariés ont, au moins, trois interlocuteurs : la caisse d'assurance maladie qu'ils ont choisie lors de leur immatriculation, l'URSSAF pour les allocations familiales et la caisse d'assurance vieillesse correspondant à leur activité. Dans son rapport d'activité 1994-1997, la cosiform relevait, à propos de la déclaration unique de cotisations sociales, que « ce projet ne présente pas de difficultés techniques importantes et il répond à une attente forte des employeurs. Pourtant il tarde à émerger faute d'un effort suffisant d'harmonisation et de coordination des organismes de recouvrement (acoss, unedic, caisses de retraite complémentaires, caisses de congés payés, ...). (...) La multiplicité des intervenants du domaine social, trop soucieux de préserver leur identité jusque dans la définition et la gestion la plus pointilleuse des procédures de collecte des données, est un frein à la simplification des formalités administratives. » Le secrétaire d'État aux pme l'a annoncé à l'issue d'une table ronde qui s'est tenue le 14 février 2003 : le « guichet unique » confiera à un seul organisme le soin de collecter les cotisations, afin que les entreprises aient un interlocuteur unique. Cet organisme collecteur répartira ensuite les cotisations entre les différentes caisses sociales. Cette mesure pourrait concerner 630 000 entrepreneurs et 520 000 artisans. Elle devrait aboutir à la réduction de douze à quatre, du nombre annuel de déclarations et paiements obligatoires. Elle devrait également simplifier les relations entre les entreprises et les organismes de prélèvements sociaux. Elle a fait l'objet de demandes concordantes de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, de l'Union nationale des professions libérales, de la Fédération française du bâtiment, de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française et de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. e) La simplification du mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants Les travailleurs indépendants relèvent de plusieurs régimes sociaux et doivent effectuer des déclarations et des règlements auprès de plusieurs grands réseaux. Comme le soulignait la cosa, dans son rapport d'activité pour 2001, la complexité du système et son manque de lisibilité appellent des simplifications. Le Gouvernement, par ordonnance, pourrait simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles et harmoniser les dates d'échéance des versements. - Les modes de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants Dans le régime social des travailleurs non salariés, les cotisations sont calculées, au premier semestre, à titre provisionnel, sur les revenus professionnels imposables de l'année précédente, avant application de l'abattement pour adhésion à un centre ou à une association de gestion agréé, des allégements fiscaux et de la déduction des cotisations sociales facultatives. Ce premier calcul s'opère donc sur la base des revenus de l'avant-dernière année. Un deuxième calcul est réalisé au second semestre sur le fondement des revenus de l'année précédente. C'est l'ajustement. Enfin, les cotisations font l'objet, en fin d'année suivante, d'une régularisation en fonction des revenus réels déclarés. La première année, faute de revenus de référence, les cotisations provisionnelles sont calculées sur une base forfaitaire, mode de calcul peu lisible. Des mesures ont d'ores et déjà été prises en faveur des créateurs d'entreprise. Depuis la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement pour la sécurité sociale pour 2000, un allégement des cotisations des deux premières années a été accordé par une diminution de l'assiette forfaitaire, tandis que les organismes sociaux doivent s'engager à attendre la fin des trois premiers mois d'activité de l'entreprise pour commencer à recouvrer les cotisations sociales. Comme l'a préconisé M. Jean-Marie Bockel dans son rapport précité, il faut harmoniser et modifier les règles de calcul des cotisations entre les différents organismes concernés par les cotisations des travailleurs non salariés (urssaf, organic, caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés - canam, caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse - cancava). - Les dates d'échéance des versements des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants Les cotisations d'assurance maladie des travailleurs indépendants sont dues à compter de la date d'effet d'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances, l'une fixée au 1er avril et l'autre au 1er octobre de chaque année. Au 1er avril, la cotisation est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels non salariés nets de l'avant-dernière année d'activité (n-2). Au 1er octobre, la cotisation annuelle est calculée en fonction des revenus de la dernière année d'activité (n-1). La cotisation appelée au 1er octobre est égale au montant de la différence entre la cotisation annuelle calculée sur les revenus de l'année (n-1) et la cotisation semestrielle appelée au 1er avril. L'assuré a la possibilité de demander un paiement trimestriel de sa cotisation La cotisation d'assurance vieillesse invalidité décès est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et qui doivent être versées directement à la caisse le 15 février ou le 31 juillet au plus tard. Sur demande, les assurés peuvent être admis à verser leurs cotisations professionnelles en fractions trimestrielles comme pour les cotisations d'assurance maladie. Les cotisations familiales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants doivent être acquittées à terme échu dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil. Bien que cela ne constitue pas une obligation, l'urssaf adresse au cotisant, avant chacune de ces dates, un avis d'échéance trimestriel. En application de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, la contribution sociale généralisée (csg) et la contribution au remboursement de la dette sociale (crds) sont recouvrées par les urssaf selon les mêmes modalités que la cotisation d'allocations familiales. Il pourrait être envisagé d'harmoniser ces dates de versement, tout en prévoyant un dispositif d'échelonnement, afin d'accroître la prévisibilité et le caractère supportable dans le temps du système. f) La promotion de l'intervention des organismes de protection sociale en faveur des petites entreprises et des associations Les conseils d'administrations de l'organic, de la canam, de la cancava et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (acoss) ont présenté, au mois de décembre 2000, douze propositions de simplifications destinées à faciliter les relations entre ces organismes sociaux et les usagers. Deux d'entre elles, qui ont été inscrites dans la loi, l'offre commune de services et les offres « Impact Emploi », méritent plus particulièrement d'être étendues. L'offre commune a été inscrite par l'article 73 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 dans l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, les travailleurs indépendants reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières. Cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés. Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en œuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné. Le Gouvernement doit inciter les organismes de protection sociale à accroître leur aide en faveur des tpe et des associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives, dans le but de ne pas entraver leur développement et de faciliter l'embauche des premiers salariés. Le dispositif « Impact Emploi », régi par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, également introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, pourrait être étendu. Ce mécanisme permet la prise en charge par un « tiers de confiance » de l'établissement des déclarations sociales et des bulletins de paie des associations de moins de dix salariés et les tpe de moins de quatre salariés (15). g) La mise en place d'un fonds d'action sociale commun aux travailleurs indépendants en difficulté Le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté, qui constitue le troisième volet de l'offre commune définie dans l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale et organisée par l'organic, la canam, la cancava et l'acoss, est fondé sur l'octroi de délais de paiement ou de remises de majorations décidées conjointement par les organismes. Seules les caisses maladie et vieillesse ont organisé des fonds d'action sociale réservés au traitement des difficultés liées au paiement de leurs propres cotisations. L'acoss n'en dispose pas. Par ordonnance, le Gouvernement pourrait donner aux institutions susvisées un instrument commun destiné à faciliter le traitement de certains dossiers grâce à un fonds mutualisé d'action sociale, ce qui se traduirait par la création d'un fonds particulier géré par les urssaf. h) La réforme du guichet unique « spectacle occasionnel » Le guichet unique « spectacle occasionnel », créé par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 précitée et mis en œuvre par le décret n° 99-320 du 26 avril 1999, est destiné à collecter l'ensemble des cotisations sociales et des déclarations exigées par le code du travail, dans un but de simplification demandée par tous les acteurs du secteur, mais aussi de lutte contre le travail illégal et contre l'évasion des cotisations. Ce dispositif permet de réaliser à un endroit unique la déclaration préalable à l'embauche, l'établissement du contrat de travail, la déclaration annuelle de données sociales, l'attestation employeur destinée à l'assedic ou encore le certificat d'emploi exigé pour la définition des congés payés. Le guichet unique, situé à Annecy comme celui du « chèque emploi service » est situé à Saint-Étienne, s'adresse exclusivement aux organisateurs occasionnels, qui assurent moins de six représentations par an et qui emploient sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle et des techniciens qui concourent au spectacle vivant, tels que définis par l'article L. 762-1 du code du travail. Il rassemble l'urssaf, les Congés spectacles qui gèrent les congés payés du secteur, le groupement des institutions sociales du spectacle (griss) qui réunit les organismes de retraite complémentaire du spectacle, l'assedic, le fonds d'assurance formation des activités du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité et des loisirs (afdas) ainsi que le Centre médical de la bourse (cmb) pour la médecine du travail. La complexité de la simplification à réaliser avait commandé d'instituer cet outil à titre expérimental. Le Gouvernement, par ordonnance, pourrait utilement consolider le dispositif en apportant les ajustements nécessaires à son élargissement et en le rendant obligatoire. La Commission a tout d'abord adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel (amendement n° 13), le second réunissant dans un même alinéa l'ensemble des dispositions relatives à la simplification des obligations déclaratives exigées des entreprises (amendement n° 14). Elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 15) autorisant le Gouvernement à réduire, pour un même exercice, le nombre des versements des cotisations sociales effectués par les travailleurs indépendants, avant d'adopter l'article 19 ainsi modifié.
Article 20 Le droit du travail est un domaine de notre ordonnancement juridique particulièrement difficile à lire. M. Patrice Maynial, dans son rapport de 1997 sur Le droit du côté de la vie : réflexions sur la fonction juridique de l'État, pouvait ainsi constater qu'« en s'écartant des objectifs clairs et cohérents qui en forment le socle, le droit du travail s'est hypertrophié. Cet embonpoint, qui paraît sans limite, se nourrit de l'accumulation des systèmes dérogatoires qui diluent la référence à une finalité au profit d'une production normative au service de la gestion, dans un domaine pourtant marqué au sceau de l'ordre public. » Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 sur la loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique, a validé la possibilité, par ordonnance d'« apporter aux dispositions du code du travail les modifications permettant (...) de lever certains obstacles au recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire et (...) d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques générales ». Dans ce cadre, des simplifications notables avaient été apportées par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle : simultanéité des élections des représentants du personnel, réduction du crédit d'heures des délégués du personnel dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, modification de la périodicité des réunions du comité d'entreprise dans les structures employant moins de cent cinquante salariés, simplification du contenu et de la présentation de l'information économique et sociale dans celles employant moins de trois cents salariés. C'est également dans cette logique de simplification que s'inscrit le présent article. a) Les définitions et les seuils d'effectifs Le présent article a pour objectif de permettre au Gouvernement de réaliser, d'une part, l'harmonisation des définitions relatives aux effectifs et, d'autre part, un regroupement des seuils d'effectifs très proches. La question des effectifs en droit du travail est double : elle porte, d'abord, sur la manière dont ces effectifs sont calculés, ensuite, sur le niveau d'effectifs à partir duquel tel ou tel régime s'applique ou non (représentation du personnel, participation aux résultats, etc.). - La méthode de détermination des effectifs La détermination des effectifs peut dépendre soit du nombre des individus qui travaillent sans considération du temps de travail qu'ils effectuent, soit d'un nombre fictif représentant les travailleurs à temps plein selon la règle du prorata temporis. Le choix de la modalité de calcul dépend le plus souvent des textes qui instituent les obligations patronales. Si le texte vise la notion d'emploi habituel ou d'emploi régulier sans plus de précision, les individus doivent être pris en compte indépendamment du temps de travail qu'ils effectuent. Si la loi se borne à viser les entreprises employant au moins cinquante salariés liés par un contrat de travail, peu importe les modalités de celui-ci et il n'y a pas lieu d'apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, les salariés dont le contrat de travail est à durée déterminée (16). Certains progrès ont été réalisés dans l'unification des méthodes de calcul des effectifs. La loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel a unifié les modalités de décompte des effectifs pour la représentation du personnel. Le salarié lié par un contrat à durée déterminée est ainsi compté dans l'effectif au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. La règle du prorata temporis, valable en matière de représentation du personnel pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l'est également dans tous les autres domaines où la loi fixe une condition d'effectifs, sauf dispositions contraires. Ainsi, la règle du prorata est étendue par la loi pour déterminer le nombre des travailleurs à partir duquel le régime des autorisations d'absence pour congé de création d'entreprise ou congé sabbatique s'applique (article L. 122-32-22 du code du travail), pour déterminer la participation aux résultats ou encore en matière d'emploi des handicapés (article L. 323-4 du code du travail). En outre, certains salariés sont exclus du calcul des effectifs de l'entreprise. Une telle exclusion ne peut se produire que si un texte le prévoit expressément. C'est le cas, notamment, de l'article L. 981-12 du code du travail qui exclut du calcul des effectifs les titulaires de contrat de qualification, de contrat d'adaptation et de contrat d'orientation, sauf pour le calcul de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article L. 322-4-14 du code du travail fait application de la même règle s'agissant du contrat emploi-solidarité. Les apprentis sont exclus également (article L. 117-11-1 du code du travail). De plus, l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel a exclu du calcul des effectifs, pour l'application des dispositions relatives à la représentation collective du personnel, certaines catégories de salariés, telles que les salariés sous contrat à durée déterminée, lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. Reste la question du décompte des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel : doit-on faire une application cumulative de la règle du prorata temporis (durée du contrat, temps de présence) ou doit-on choisir entre les deux méthodes de calcul ? S'ajoute à ces principes de calcul la question de la détermination de l'unité susceptible d'être prise en compte pour calculer l'effectif : groupe, entreprise, établissement... - La multiplicité des seuils On pourrait multiplier les exemples. Pour n'en prendre que quelques uns, relevons que la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) est obligatoire dès lors que l'établissement a occupé au moins cinquante salariés en application de l'article L. 236-1 du code du travail. Dans les établissements occupant au moins trois cents salariés, les représentants du personnel au chsct bénéficient de la formation spécifique nécessaire à l'exercice de leur mission en vertu de l'article L. 236-10 du code précité. Le franchissement de certains seuils d'effectifs déclenche l'obligation légale de procéder à la mise en place des institutions élues. Ces seuils sont différents selon les institutions : à partir de onze salariés pour les délégués du personnel (article L. 421-1 du code du travail), à partir de cinquante salariés pour les comités d'entreprise (article L. 431-1). Les délégués du personnel peuvent constituer la délégation du personnel du comité d'entreprise, soit une délégation unique, dans les entreprises de cinquante à cent quatre-vingt dix-neuf salariés (article L. 431-1-1). En outre, le nombre de délégués ou de membres du comité d'entreprise à élire varie en fonction de l'importance des effectifs. L'article L. 412-20 du code du travail prévoit, dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés, l'attribution à chaque section syndicale, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit d'heures global s'ajoutant à celui dont dispose le délégué syndical, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord. L'article L. 412-9 dispose que dans les entreprises ou établissements comportant plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise doit mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Lorsque l'entreprise a plus de mille salariés, chaque section dispose d'un local. En application de l'article L. 412-11, dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, un délégué syndical est désigné. Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, il convient de désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement (article L. 412-12 du code précité). En vertu de l'article L. 323-1 du code du travail, tout établissement privé occupant au moins vingt salariés doit employer, à temps plein ou partiel, six pour cent de travailleurs handicapés sur l'effectif total de l'entreprise. Les conditions d'effectifs sont également foisonnantes dans le domaine de la formation professionnelle. Ainsi, dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise doit constituer une commission de la formation (article L. 434-7 du code du travail). Pour bénéficier du congé individuel de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins vingt-quatre mois. Toutefois, pour les travailleurs des entreprises artisanales de moins de dix salariés, selon l'article L. 931-2 du code précité, l'ancienneté nécessaire est de trente-six mois, dont douze au moins dans l'entreprise. Pendant la durée du congé « Jeunes travailleurs », la rémunération du salarié est maintenue par l'employeur, qui peut en imputer le montant et les charges correspondantes sur sa contribution au financement de la formation, dès lors qu'il emploie au moins dix salariés. Il est possible de suivre une autre voie que celle de la détermination des seuils d'effectifs par matière en se fixant sur le niveau même du seuil. Ainsi, pour un seuil identique (dix salariés par exemple), le code du travail utilise plusieurs expressions qui peuvent être source de confusion : il peut faire référence à « moins de dix salariés » (article L. 122-14 sur la procédure applicable aux licenciements individuels), à « au moins dix salariés » (cas des charges de financement dans le cas du congé « Jeunes travailleurs » évoqué ci-dessus, article L. 931-29), à « au moins onze » (conseiller du salarié licencié, article L. 122-14-14), à « moins de onze » (titre emploi simplifié dans les départements d'outre-mer, article L. 821-1). Ces multiples références sont source de confusion. L'objectif fixé par le présent article dans cette matière est de permettre au Gouvernement d'harmoniser les différents seuils commandant l'application de certaines dispositions du code du travail. Comme on l'a vu, la définition de certains seuils est mouvante : « moins de dix salariés », « au moins dix », « moins de onze ». Les modes de calcul des effectifs pourraient donc également être simplifiés de ce point de vue en regroupant les seuils très proches dont l'écart n'excède pas un salarié. b) Les délais applicables aux procédures individuelles de licenciement Comme l'a relevé la Cour de cassation dans son Rapport de 1996, la complexité du droit des licenciements est souvent dénoncée. Il en résulte pour les partenaires sociaux, employeurs et salariés, une grande insécurité juridique. Dans cette situation, la question des multiples délais applicables joue un rôle non négligeable. En application de l'article L. 122-4 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes que sous réserve du respect des dispositions prévues par le code du travail. Toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, hors la rupture en cours d'essai et les cas de force majeure et de mise à la retraite lorsque les conditions légales en sont remplies, constitue un licenciement. Le licenciement individuel n'est justifié que si l'employeur peut invoquer une cause réelle et sérieuse. - Les délais entre la décision de licenciement et l'entretien préalable L'employeur doit respecter la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-14 du code du travail dans toutes les hypothèses de licenciement pour motif personnel, quelle que soit l'ancienneté du salarié et quels que soient les effectifs de l'entreprise. La gravité de la faute commise par le salarié ne dispense pas l'employeur du respect de la procédure. L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Selon l'article précité du code du travail, l'employeur devra engager la procédure de licenciement pour faute dans un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La lettre de convocation doit être adressée soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée. Le salarié est en droit de la refuser en main propre. L'employeur doit respecter un délai entre la date de remise de la convocation à l'entretien préalable et la date de l'entretien, pour permettre au salarié de préparer sa défense. Mais, ce délai est différent selon que l'entreprise dispose ou non d'institutions représentatives du personnel. L'article L. 122-14 prévoit qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. En application de l'article 641 du code de procédure civile, le jour de l'acte ou de la notification ne compte pas. Le délai commence à courir le lendemain de la présentation, ou de la remise en main propre de la lettre. En application de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour suivant Le délai se décompose en jours ouvrables (travaillés), et en conséquence, sa date d'expiration est reportée lorsqu'il comprend un dimanche ou un jour férié. En présence d'institutions représentatives du personnel, la loi ne fixe pas de délai entre la convocation et l'entretien. Toutefois, le juge a considéré que le salarié doit disposer d'un délai suffisant et raisonnable pour préparer sa défense (17) Le juge doit rechercher la date à laquelle la convocation a été présentée au salarié pour examiner si le délai était suffisant (18). - Le délai entre l'entretien préalable et la notification de la décision de licenciement Outre ce délai entre la notification d'un entretien préalable et la tenue de cet entretien, la procédure individuelle de licenciement impose le respect d'un deuxième délai entre la date de cet entretien préalable et la notification du licenciement. En effet, en application de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué pour son entretien préalable. Par exemple, lorsque l'entretien préalable s'est tenu le jeudi, la lettre de licenciement peut être expédiée le samedi. Mais, lorsque le salarié est licencié pour un motif économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le délai entre l'entretien et la notification par lettre de la décision de l'employeur est supérieur à sept jours. Ce délai est de quinze jours si la mesure touche un membre du personnel d'encadrement. Lorsque l'entreprise ne dispose pas d'institutions représentatives du personnel, ces délais sont respectivement portés à quatre jours et douze jours. Lorsque le licenciement est notifié pour un motif disciplinaire, l'application de l'article L. 122-41 du code du travail impose que la lettre soit notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable, faute de quoi le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. En dehors de cette hypothèse de licenciement pour motif disciplinaire, la loi ne fixe pas de délai maximum pour l'envoi de la lettre de licenciement consécutivement à l'entretien préalable. - Une harmonisation nécessaire Devant la complexité du calcul des délais et des cas où tel ou tel délai s'impose (présence ou non d'institutions représentatives du personnel, membre du personnel d'encadrement ou non, jours ouvrables et jours francs), comme le montre le tableau ci-dessous, il convient de permettre au Gouvernement de procéder, par ordonnance, à une harmonisation de ces dispositions permettant aux salariés concernés de mieux faire valoir leurs droits.
À l'avenir, une partie de la simplification pourrait porter plus largement sur les sanctions présentes dans le code du travail. Ainsi, lors de leurs enquêtes, les contrôleurs du travail se réfèrent dans 95 % des cas à une dizaine d'articles du code du travail (19). c) La durée de la période de protection des représentants du personnel Institué par l'ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 portant institution des comités d'entreprise, le dispositif de protection spéciale a été régulièrement étendu à des catégories toujours plus nombreuses de salariés investis de mandats représentatifs. La procédure protectrice revêt un caractère exceptionnel et exorbitant du droit commun. En application de l'article L. 436-1 du code du travail, un ancien membre du comité d'entreprise ou un ancien représentant syndical, qui, ayant une expérience de deux ans, ne serait pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité, voit la protection spéciale qui couvrait son mandat se prolonger. En effet, en cas de licenciement, il bénéficie d'une période de protection particulière. Pendant les six mois qui suivent l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution, tout projet de licenciement à son encontre est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Lorsqu'il n'y a pas ou plus de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement. En revanche, lorsque le licenciement vise les candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, la durée de protection est ramenée à trois mois, à partir de la publication des candidatures. Elle concerne également les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser les élections. Cette période court à partir de l'envoi à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, des listes de candidatures. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. En résumé, les durées de protection ont différentes selon qu'il s'agit de candidats aux élections du comité d'entreprise ou de candidats aux élections des délégués du personnel ou de membres de la délégation unique du personnel. Dans tous les cas, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. En cas de faute grave, le chef d'entreprise a néanmoins la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Ces différences de délai induisent des erreurs qui imposent de reprendre les procédures. Il s'agit, par cet article, de permettre au Gouvernement d'harmoniser les durées de la période de protection contre les licenciements des candidats aux élections professionnelles. d) La procédure de demande de congés Le code du travail comprend, outre les congés annuels et les congés prévus par le livre IX (formation professionnelle), près d'une trentaine de congés de toute nature, qui sont liés la plupart du temps à des motifs personnels ou familiaux et qui obéissent à des règles de procédure souvent proches, mais élaborées de manière spécifique à chacun d'entre eux. À la différence des congés annuels ou des congés pour formation professionnelle, ces congés spéciaux doivent être demandés par le salarié. Par ailleurs, hormis le congé sabbatique, ils répondent à une finalité précise. Sont concernés notamment le congé accordé aux candidats aux élections politiques (article L. 122-24-1 du code du travail), le congé pour enfant malade (article L. 122-28-8), le congé de présence parentale (article L. 122-28-9), le congé pour la création d'entreprise et le congé sabbatique (articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28), le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (articles L. 225-1 à L. 225-5), le congé de représentation (article L. 225-8), le congé de solidarité internationale (articles L. 225-9 à L. 225-14), le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (articles L. 225-15 à L. 225-19). Pourraient également entrer dans le champ de la simplification le congé de maternité et le congé d'adoption (article L. 122-26) ou encore le congé parental d'éducation (article L. 222-28-8). Comme le montrent les tableaux suivants, les dispositifs de congé pour motifs personnels ou familiaux sont caractérisés par une très grande disparité. LES DISPOSITIFS DE CONGÉS POUR MOTIFS PERSONNELS ET FAMILIAUX RÉGIS PAR LE CODE DU TRAVAIL
Face à la diversité des régimes, une certaine harmonisation des procédures de demande de congés paraît souhaitable. e) Les modalités de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales au comité d'entreprise Les ressources du comité d'entreprise sont diverses, mais proviennent pour la plus grande part de la contribution obligatoire de l'employeur, qui est nettement distincte de la subvention de fonctionnement telle que définie par article L. 434-8 du code du travail issu de la loi du 28 octobre 1982 précitée. Le calcul de la contribution patronale légale obéit à des règles qui tendent à pérenniser l'effort financier que l'employeur faisait avant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité et à maintenir un rapport constant entre cette contribution et la masse des salaires. Visée par l'article L. 432-9 du code du travail, elle constitue une dette civile dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de grande instance. Le refus de son paiement est constitutif du délit d'entrave. La contribution versée chaque année par l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut pas non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence. Il en résulte qu'il n'y a pas de minimum légal général, que le taux de la contribution est variable d'une entreprise à l'autre, puisqu'il dépend de l'effort spontané que l'employeur avait précédemment accompli. Dans certaines entreprises, notamment celles qui n'avaient aucune œuvre sociale, la contribution peut être nulle sauf convention collective ou versement bénévole de l'employeur. Un projet de loi du 10 avril 1991 qui instituait une contribution légale minimale n'a jamais été soumis au Parlement. La détermination de la subvention reste difficile à effectuer ; elle implique de réaliser trois opérations : la détermination des dépenses sociales de référence ; la détermination de l'année de référence ; l'application d'un double minimum, celui de la valeur nominale et celui du rapport constant aux salaires. La vérification de ces éléments de calcul ne fait l'objet dans la loi d'aucune obligation particulière d'information du comité en sus du rapport annuel obligatoire. Le premier minimum ne présente plus d'intérêt, en raison de la dépréciation monétaire. Bien plus souvent, c'est le second minimum qui devra être respecté. Connaissant les dépenses sociales de l'année de référence, l'employeur doit donc établir le taux de la contribution par relation à la masse des salaires de l'année de référence et appliquer ce taux à la masse des salaires de l'année en cours. Les difficultés sont renforcées lorsqu'on se trouve en présence d'une pluralité d'établissements. Affirmée par l'article L. 435-1 du code précité et consacrée par la jurisprudence, la prééminence des comités d'établissement en matière de gestion des activités sociales et culturelles n'a cependant pas pour conséquence de concentrer au niveau de l'établissement l'ensemble des opérations de calcul de la contribution patronale. Selon la Cour de cassation, le taux de la contribution se détermine au niveau de l'entreprise avant d'être appliqué à chaque établissement. Ce système compliqué et coûteux en temps, empreint de risques de conflits, mériterait d'être simplifié. C'est pourquoi le présent article permet au Gouvernement d'opérer les ajustements nécessaires à cet effet. f) La tenue des registres obligatoires Autre illustration de la pesanteur parfois inutile du droit du travail, les obligations pesant sur les entreprises en matière de tenue de registres sont nombreuses et obéissent à des régimes différents. Certaines obligations légales s'imposent à toutes les entreprises. En revanche, le champ de certaines autres varie avec la taille et la nature de l'entreprise. En application du code du travail, l'employeur doit tenir des registres qui peuvent être consultés par un certain nombre de personnes. Toutes les entreprises doivent posséder un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés à quelque titre que ce soit (article L. 620-3). Ce registre est tenu à la disposition des délégués du personnel et des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Est également tenu à la disposition des mêmes personnes ainsi que des membres du chsct, le registre des observations et des mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail à propos des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques (article L. 620-4). Toutes les entreprises devaient aussi posséder un livre de paie sur lequel sont obligatoirement reproduites toutes les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés aux salariés (article L. 143-5). Cette obligation a été supprimée par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et social qui, en contrepartie, a imposé aux employeurs de conserver un double des bulletins de paie remis aux salariés pendant un délai de cinq ans (article L. 143-3). D'autres registres ne sont exigés que pour certaines entreprises. Un registre unique d'hygiène et de sécurité (article L. 620-6) doit être tenu par les employeurs soumis à des obligations particulières en ce domaine. C'est le cas également du registre des accidents du travail n'ayant entraîné ni arrêt de travail, ni soins médicaux (article L. 441-4 du code de la sécurité sociale), du registre des délégués du personnel (article L. 424-5 du code du travail), du registre d'ordre concernant les donneurs d'ouvrage à domicile (article L. 721-7 du code du travail). Des modalités pratiques facilitent la mise en œuvre de ces obligations. En application de l'article L. 620-7 du code précité, les entreprises peuvent substituer à la tenue des registres d'autres supports, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. Dans ce cas, les employeurs doivent mettre à la disposition des agents de contrôle un moyen leur permettant d'accéder rapidement aux informations stockées. Néanmoins la diversité des régimes applicables justifie l'habilitation du Gouvernement à assurer leur regroupement et leur harmonisation. Cette simplification apparaît particulièrement nécessaire en matière de santé au travail, domaine dans lequel le registre unique est souvent redondant avec des rapports particuliers. En outre, un certain nombre de régimes étant fixés par voie réglementaire, il y aura lieu également de procéder à leur harmonisation en ce domaine. g) Le rapport d'évaluation des risques professionnels Il s'agit de permettre au Gouvernement d'adapter le rapport d'évaluation des risques professionnels à la taille et à la nature des entreprises concernées. En matière d'évaluation des risques professionnels, un « document unique » prévu par une directive européenne du 12 juin 1989 (20), institué par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 (21) et précisé par un décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 et une circulaire ministérielle du 18 avril 2002, doit désormais regrouper sur un seul support les données issues de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, qui comporte deux phases : une identification des dangers (propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance ou d'une méthode de travail de causer un dommage pour la santé des travailleurs) et une analyse des risques (résultat de l'étude des conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers). Si aucun modèle n'est prévu par la réglementation, le document unique doit être mis à jour chaque année, ainsi qu'à l'occasion de chaque décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Les objectifs du document unique ne sauraient être contestés. En revanche, il faut s'interroger sur l'opportunité d'imposer, en l'état, cette charge administrative supplémentaire à toutes les entreprises. Les intentions sont louables, mais les modalités de mise en œuvre irréalistes. Le décalage est d'autant plus fort que le non-respect des dispositions légales et réglementaires emporte des sanctions pénales. Mais la Cour de justice des Communautés européennes a eu l'occasion de relever que la suppression du règlement unique était illégale, même pour les tpe. Toutefois, une adaptation des contraintes à raison de la taille des entreprises doit très rapidement être engagée, dans le respect des dispositions européennes. C'est l'objet de l'habilitation accordée par le présent article. h) La simplification du financement de la formation professionnelle continue des artisans Les travailleurs indépendants sont, depuis la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, assujettis à l'obligation de financer leur propre formation professionnelle. Le code du travail prévoit que les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées peuvent créer des fonds d'assurance formation (faf) de non-salariés. Aujourd'hui, le système de financement de la formation professionnelle continue des artisans repose sur un double réseau, celui des chambres de métiers régionales d'une part, celui des organisations professionnelles d'autre part. La formation professionnelle continue des artisans est instituée et organisée par la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982, complétée par son décret d'application n° 83-517 du 24 juin 1983. Les artisans participent au financement de leur formation professionnelle et versent à ce titre, au Trésor public, une contribution annuelle de 82 euros qui est redistribuée aux faf. Cette contribution leur ouvre un droit personnel à la formation. La loi de 1982 a institué trois faf nationaux pour les secteurs de l'alimentation de détail, du bâtiment et des métiers et des services et vingt-cinq faf régionaux, services de la chambre régionale de métiers ou de la chambre de métiers pour les départements d'outre-mer. Les faf informent les chefs d'entreprise sur les moyens et les besoins des artisans en matière de formation et traitent les demandes de prise en charge et de remboursement de leurs actions de formation. L'objectif de cet article est de donner au Gouvernement la possibilité de rendre plus transparent et plus cohérent ce système de financement, ce qui passe par la réforme les faf afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans. i) La justification d'activité des prestataires de formation Le but de l'habilitation accordée par cet article est de permettre aux prestataires de formation professionnelle continue de justifier directement de leur activité sans avoir besoin de justifier leurs dépenses par le rattachement de celles-ci à une convention ou à un contrat particulier. - Un régime libéral L'article L. 920-2 du code du travail reflète le libéralisme qui domine l'offre de formation en admettant que l'activité de dispensateur de formation puisse être exercée par « les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent ». Aucun agrément préalable n'est exigé, qui comporterait un quelconque contrôle de compétence ou de moyens administratifs, financiers ou pédagogiques susceptibles d'être mis en œuvre. Mais, en application de l'article L. 920-4 du code du travail, « Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'État et de la région une déclaration préalable ». Faute d'avoir souscrit une déclaration, une structure juridique de droit privé ne peut prétendre exercer une activité dans le cadre des dispositions du livre IX (formation professionnelle) du code du travail. Cependant, toute prestation de formation ne lui est pas interdite : l'article L. 920-1 du code précité dispose, en effet, que les actions de formation professionnelle peuvent faire l'objet de conventions, sans que cela ne soit une obligation. Toutefois, en l'absence de déclaration préalable et de possibilité de conclure des conventions de formation, le prestataire ne pourra prétendre avoir accès à l'ensemble des financements de la formation professionnelle continue. À titre d'exemple, si un industriel organise quelques formations dans l'année pour ses clients sans être déclaré, cette activité demeure licite mais elle ne pourra être financée par l'entreprise dans le cadre de son obligation de financement de la formation professionnelle continue, ni prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé (opca), organisme créé par convention collective et habilité par un agrément de l'État à gérer les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle des salariés. - Une contrainte de gestion forte Dans ce cadre général, l'activité de formation est soumise à une contrainte forte résultant de l'article L. 920-10 du code du travail, en vertu duquel toute dépense engagée pour l'exécution d'une convention de formation doit pouvoir être, par nature, rattachée à l'exécution de cette convention. Ainsi, le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 11 juillet 1991, CIFOP Mazamet, a jugé, en application de ce texte, que les dépenses de représentation ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation. L'article L. 920-11 du code précité organise la sanction et prévoit un reversement au Trésor public des sommes rattachées, à tort, à une convention. - Une clarification à apporter Il peut paraître paradoxal, dans un régime libéral comme celui de la formation, qui ouvre largement l'accès à cette activité, y compris aux sociétés commerciales, de sanctionner le fait qu'un organisme de formation réalise des dépenses de commercialisation. Ainsi, les acteurs du secteur sont soumis au seul pouvoir d'appréciation, changeant, de l'autorité de contrôle, ce qui constitue incontestablement un frein à leur développement. C'est pourquoi il est proposé de permettre au Gouvernement d'intervenir pour simplifier les règles applicables aux prestataires de formation professionnelle. j) L'allégement des formalités des exploitants agricoles - La déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelles En application de l'article L. 952-4 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés sont tenus d'effectuer une déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle, selon une procédure relativement lourde. Cette tâche pourrait être effectuée par les caisses de msa qui assure le recouvrement de tout ou partie de ces cotisations pour le compte de l'opca de branche. Le présent article autorise également le Gouvernement à opérer une rationalisation dans ce domaine, ce qui pourrait se traduire par l'habilitation des caisses susvisées à accomplir cette déclaration, dès lors que l'exploitant agricole en ferait la demande. - La dématérialisation et la transmission par des mandataires réels de l'envoi des déclarations de revenus professionnels des exploitants agricoles au bénéfice réel Les exploitants agricoles doivent, en vertu de l'article 371 A et M de l'annexe II du code général des impôts, adresser à la caisse de msa leur déclaration de revenus professionnels de l'année précédente grâce à un imprimé. Un allégement de cette formalité, lourde pour tous les acteurs, devrait être opéré. Cette simplification pourrait passer par l'autorisation de la dématérialisation et de la transmission des informations nécessaires à ce paiement par des mandataires. Le secteur agricole mériterait de bénéficier de mesures de simplifications plus amples car les agriculteurs sont soumis à d'importantes contraintes administratives. Dans le but de simplifier leurs démarches, le ministère de l'agriculture a mis en place, le 8 octobre 2002, un comité de simplification qui a pour objectif d'élaboration des propositions de simplifications pragmatiques. Aujourd'hui, de nombreuses procédures sont gérées par les caisses de msa. Elles pratiquent l'appel chiffré des cotisations et contrôlent les conditions d'éligibilité des employeurs aux mesures d'exonération et de réduction de charges patronales. Lorsque le bénéfice des exonérations n'est soumis à aucune condition autre que le niveau de la rémunération, la réduction est calculée directement par les caisses. D'autres dispositifs, tels les taux de cotisations réduits pour l'emploi de travailleurs occasionnels, fonctionnent sur un mode déclaratoire aux caisses de msa, lesquelles assurent ainsi leur rôle d'interlocuteur privilégié des employeurs du secteur agricole en matière de réduction des charges. k) La suppression de dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet De nombreuses dispositions du code du travail sont devenues obsolètes ou sans objet. Une ordonnance permettrait d'en supprimer plusieurs. Ainsi, pourraient être abrogés les articles L. 323-3 à L. 323-39 du code du travail issus d'une loi du 8 octobre 1940 et qui imposent un pourcentage obligatoire d'emploi de pères de famille nombreuse et de veuves ayant au moins deux enfants à charge dans les entreprises. De la même façon, devrait être supprimé l'article L. 142-5 qui prévoit la possibilité d'attribuer des boissons alcoolisées comme avantages en nature, alors que l'article L. 232-3 prévoit, au contraire, que les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels ne peuvent comporter de disposition prévoyant cette modalité de rémunération. L'article L. 211-3 encadre l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire. Or, le dispositif actuel d'enseignement professionnel permet de prendre en charge les mineurs concernés. En conséquence, cette disposition pourrait être supprimée sans dommage, comme les dispositions des articles L. 722-1 à 722-6 qui définissent les moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, coupe de velours de coton, teinture, blanchiment et apprêt des étoffes. Par ailleurs, pourrait être également supprimée, dans l'article L. 122-28-1, la référence à la notion d'« au moins un cinquième d'un temps complet » dans la définition du temps partiel, référence supprimée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Selon la même logique, il conviendrait de supprimer les dispositions de l'article L. 124-18 qui fixe les modalités de décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs des entreprises de travail temporaire pour l'appréciation du seuil d'effectifs de l'article L. 950-1 du code du travail relatif aux actions de développement de la formation professionnelle, tandis que la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi a supprimé la condition d'effectif continue dans l'article L. 950-1. Les dispositions législatives relatives à la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, mentionnée à l'article L. 992-4 du code, pourraient être supprimées, de même que celles relatives à la réalisation d'actions de formation liées au service national (article L. 992-5). Enfin, ce mouvement de suppression pourrait s'étendre au treizième alinéa de l'article L. 951-1, qui définit l'agrément « 10 % études » qui permet aux employeurs de plus de dix salariés, soumis à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle, d'inclure dans leur effort financier les versements aux organismes promoteurs d'études agréés par arrêté ministériel ou par arrêt du préfet de région. Or, les opca peuvent financer des études et des recherches. En conséquence, la mesure prévue à l'article L. 951-1 maintient une procédure d'agrément particulière, en concurrence avec les opca et très peu utilisée, La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti autorisant le Gouvernement à harmoniser et rehausser l'ensemble des seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail et à préciser le mode de calcul desdits effectifs. S'étant inquiété de la portée du dispositif proposé et souligné ses incertitudes, M. Gérard Léonard a indiqué qu'il convenait d'être prudent en ce domaine et a, en conséquence, exprimé ses réserves à l'égard de l'amendement. Après avoir abondé dans ce sens, M. Philippe Vuilque a par ailleurs dénoncé la volonté du Gouvernement de modifier des dispositions législatives du code du travail particulièrement importantes à la faveur d'une habilitation dont l'objet affiché est de simplifier et de codifier le droit. Il a souligné que c'était précisément pour lutter contre cette manœuvre que son groupe avait décidé de déposer à l'encontre du projet une exception d'irrecevabilité et une question préalable. M. Xavier de Roux a considéré que le souci de prudence, ainsi que les réserves exprimées par certains de ses collègues, ne devraient pas avoir pour effet d'entraver la volonté de simplification qui anime le Gouvernement, la Commission devant au contraire l'aider à poursuivre son action en lui indiquant les situations juridiques inextricables qui rendent nécessaires des modifications législatives. Après avoir rappelé qu'il avait déposé, sous une précédente législature, une proposition de loi ayant également pour objet de simplifier les différents seuils figurant dans le code du travail, M. Robert Pandraud a exprimé la crainte que l'adoption de cet amendement ne provoque de très nombreuses critiques et focalise l'attention sur ce seul point. Il a donc jugé préférable de le rejeter, afin de laisser aux partenaires sociaux le soin d'en débattre sereinement. Après avoir observé que ce projet de loi avait été déposé à l'Assemblée nationale le 19 mars 2003, M. Émile Zuccarelli a déploré que le Gouvernement impose de tels délais d'examen au Parlement et souligné que, compte tenu de l'ampleur de l'habilitation envisagée, les parlementaires n'étaient pas en mesure d'effectuer un travail satisfaisant. Tout en reconnaissant que l'article 38 de la Constitution exigeait que le Parlement se dépossède d'une partie de ses prérogatives, le président Pascal Clément a rappelé que le rapporteur avait ouvert à tous les membres de la Commission les réunions préparatoires qu'il a organisées pour l'examen de ce texte et qui lui ont permis d'entendre les représentants des ministères concernés par l'habilitation, avant même que le projet ne soit adopté en Conseil des ministres. Il a rappelé en outre qu'il avait lui-même suggéré la création d'une mission de suivi parlementaire, permettant ainsi d'associer, de manière inédite, le Parlement au processus d'élaboration des ordonnances. Revenant à l'amendement, Mme Maryse Joissains-Masini a exprimé la crainte que son adoption ne mette en difficulté le Gouvernement dans son entreprise salutaire de simplification administrative. Malgré l'avis du rapporteur, qui a rappelé la diversité des seuils figurant dans le code du travail et souligné la complexité et même la confusion qui en résultent pour les entreprises, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Xavier de Roux visant à introduire dans le champ de l'habilitation l'harmonisation et la simplification des dispositions relatives au détachement du personnel en cas de licenciement. M. Xavier de Roux a rappelé les ambiguïtés du droit du travail, qui obligent une société mère à proposer un reclassement au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement dans la filiale étrangère, y compris en cas de faute lourde. Il a déploré, de manière plus générale, que le droit français soit devenu impraticable, conférant en définitive à la Cour de cassation un pouvoir de caractère normatif qui devrait être exercé par le législateur. Ayant convenu que les dispositions législatives sur le contrat de travail des salariés en détachement étaient extrêmement complexes, le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement. M. Philippe Vuilque s'y est au contraire opposé, l'amendement lui paraissant excéder l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. M. Émile Zuccarelli a contesté une habilitation qui mêle une autorisation classique en matière de codification avec des dispositions disparates proposées sous couvert de simplification du droit. Mme Maryse Joissains-Masini a fait valoir que l'amendement proposé par M. de Roux s'inscrivait dans le droit fil de l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 16). Elle a examiné un amendement du même auteur étendant le champ de l'habilitation à la réforme des critères d'ordre prévalant en matière de licenciements économiques. M. Jérôme Lambert a contesté cet amendement qui, à l'inverse du précédent, est sans rapport avec l'objectif de simplification et ouvrirait la voie à une réforme de fond du droit du travail. M. Émile Zuccarelli a regretté qu'une telle disposition puisse figurer dans le projet de loi, préparant ainsi une réforme à la sauvette d'une législation très importante. La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur étendant l'habilitation à l'harmonisation et la simplification des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de projet de restructuration, le rapporteur ayant fait valoir que la contradiction entre les articles du code du travail évoquée par M. de Roux avait été résolue par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Xavier de Roux étendant le champ de l'habilitation aux règles de fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise, après que son auteur, approuvé par le rapporteur, eut souligné les différences injustifiées existant entre le chef d'entreprise et les salariés en ce domaine, puis déploré le recours excessif au juge des référés pour régler des différends mineurs. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 17), ainsi qu'un amendement du même auteur (amendement n° 18) habilitant le Gouvernement à légiférer sur l'emploi d'un salarié en contrat à durée déterminée en cas d'indisponibilité du chef d'entreprise ou de son conjoint non salarié. Après avoir adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 19 et 20) du rapporteur, la Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.
Article 21 Certaines des propositions faites par le groupe de travail réuni autour de notre collègue Xavier de Roux par le secrétaire d'État aux pme sont traduites dans les objectifs de l'habilitation octroyée au Gouvernement dans cet article. Les principales préconisations du groupe, dans ce domaine, portent sur des assouplissements tenant compte de la taille des entreprises et la suppression de certaines formalités pour celles qui ne font pas appel public à l'épargne. 1. Un assouplissement de la réglementation applicable au nantissement et à la location-gérance des fonds de commerce et des fonds artisanaux Aujourd'hui, de nombreux fonds de commerce et fonds artisanaux ne peuvent être transmis de manière satisfaisante compte tenu d'une réglementation trop complexe. Pour faciliter cette transmission et donc le développement du commerce, il serait souhaitable d'autoriser le Gouvernement à simplifier et moderniser par ordonnance les règles applicables au nantissement et à la location-gérance des fonds de commerce et des fonds artisanaux. a) Les règles régissant le nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal - Le nantissement du fonds de commerce Dans sa version contractuelle (22), le nantissement, créé par une loi du 1er mars 1898, modifié par loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et régi aujourd'hui par les articles L. 141-5 et suivants du code de commerce, est défini comme le contrat par lequel un fonds de commerce est affecté au paiement d'une dette, sans que le créancier soit mis en possession du bien qui constitue l'assiette de sa garantie. Ainsi, le débiteur continue à exploiter le fonds. Faute de dessaisissement, les tiers peuvent croire qu'aucune sûreté n'a été prise. Mais leur ignorance est rendue inexcusable par une mesure de publicité dont l'accomplissement confère au créancier le droit de préférence et le droit de suite. Très nombreux en pratique, les nantissements sur fonds de commerce sont souvent perçus comme peu fiables, en particulier par les banques qui ont tendance à les considérer comme des sûretés précaires. En effet, la valeur d'un fonds étant liée à son exploitation, il subit une dépréciation lorsque l'entreprise se trouve dans une situation difficile, précisément au moment où la sûreté deviendra utile pour son bénéficiaire. En conséquence, les établissements de crédits préfèrent n'utiliser le nantissement du fonds de commerce que comme une sûreté complémentaire, à laquelle on ne recourt que de manière subsidiaire. Le débiteur est alors amené à fournir d'autres garanties et notamment une caution. En outre, les règles encadrant la mise en œuvre d'un nantissement renforcent son caractère peu attractif. Les parties sont tenues de constater le nantissement par écrit. Elles ont le choix entre la passation d'un acte authentique et la rédaction d'un acte sous seing privé. L'acte constitutif de nantissement doit être enregistré. Cette formalité est préalable à la publicité de l'opération. L'inscription devant être prise dans les quinze jours de la signature du contrat, c'est dans cet intervalle que l'acte doit être enregistré. De plus, dans l'intérêt des tiers, la loi soumet le nantissement à une inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Si le fonds comporte des succursales, la formalité pourrait être accomplie auprès des greffes dont elles dépendent respectivement. La procédure commence par le dépôt au greffe de l'un des originaux de l'acte constitutif s'il est sous seing privé ou d'une expédition s'il s'agit d'un acte authentique rédigé en minute. En même temps que le créancier nanti remet au greffier l'acte constitutif, il doit lui présenter deux bordereaux où sont portées des informations relatives aux cocontractants, au fonds grevé et à la sûreté inscrite. Les indications suivantes sont exigées : les noms, prénoms, domiciles et professions du créancier et du débiteur, la date et la nature du titre constitutif, le montant de la créance exprimée au titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité, la désignation du fonds grevé et une élection de domicile par le créancier dans le ressort du tribunal où est situé le fonds. Dans l'hypothèse où le fonds de commerce donné en nantissement comprend des brevets, licences, marques, dessins, modèles, droits d'exploitation de logiciels, la loi prévoit une formalité supplémentaire. Une inscription doit en effet être prise à l'Institut national de la propriété industrielle. L'enregistrement s'effectue alors sur présentation d'un certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal où la sûreté a été prise. - L'extension récente de la procédure de nantissement au fonds artisanal Longtemps, l'impossibilité de nantir les fonds artisanaux interdisait aux artisans n'ayant pas la qualité de commerçant de bénéficier de financements dans les mêmes conditions que les commerçants. L'article 22 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la formation du commerce et de l'artisanat a prévu à la fois la reconnaissance du fonds artisanal et l'organisation de son nantissement. Les formalités applicables au nantissement des fonds de commerce ont été étendues à celui des fonds artisanaux. Les éléments du fonds susceptibles d'être compris dans le nantissement sont limitativement énumérés par la loi précitée. Il s'agit de l'enseigne et du nom professionnel, du droit au bail, de la clientèle et de l'achalandage, du mobilier professionnel, du matériel ou de l'outillage servant à l'exploitation du fonds, des dessins et modèles ainsi que des autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Les rigidités qui touchent le régime du nantissement aussi bien des fonds de commerce que des fonds artisanaux ralentissent le développement des entreprises. C'est pourquoi il serait utile de simplifier les règles applicables au nantissement. Il faudrait, par exemple, pouvoir radier un nantissement par un simple acte passé sous seing privé, comme cela se pratique lors de son inscription. b) Le régime de la location-gérance Le contrat de location-gérance est un bail de fonds de commerce ou de fonds artisanal, principalement constitué par la clientèle qui lui est attachée. Par ce contrat de location-gérance ou « gérance libre », le propriétaire du fonds de commerce, en s'affranchissant des risques de l'exploitation de celui-ci, en consent la location pour un certain temps à un locataire-gérant ou gérant libre qui, moyennant un loyer ou une redevance, en perçoit les bénéfices et en assume les risques, pendant toute la durée du contrat. La loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, codifiée aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, tire les conclusions de la nature juridique de ce contrat particulier en imposant au loueur du fonds une durée d'exploitation minimale de deux ans et une immatriculation au répertoire des métiers pendant sept années. Cette condition garantit effectivement que le loueur met le locataire-gérant en possession d'un fonds doté d'une clientèle. Si la condition de durée d'exploitation directe du fonds pour le loueur est supprimée afin de lui substituer une simple durée d'existence du fonds, le contrat sera rendu accessible à des personnes non exploitantes qui se porteront acquéreurs de fonds pour les donner en location dans une intention spéculative. C'est précisément contre cette pratique que la loi du 20 mars 1956 s'inscrivait. Au-delà de cette contrainte, la location-gérance présente de nombreux avantages. Compte tenu des circonstances économiques, le propriétaire d'un fonds de commerce, qui est dans l'obligation de cesser son activité, peut préférer la location de son fonds à une réalisation qui lui apporterait des capitaux plus ou moins importants, mais des revenus très faibles. Si le propriétaire est dans l'obligation de cesser son activité pour des raisons d'absence, de maladie ou d'incapacité physique, la location-gérance lui permettra de se décharger du souci de la gestion du fonds et des détails matériels de son administration pendant un certain temps et, donc, de conserver son capital tout en obtenant des revenus. Le propriétaire peut encore préférer la gérance à la vente lorsque le successeur qu'il s'est choisi n'a pas les disponibilités suffisantes pour régler le prix. La location-gérance permet au propriétaire d'éviter de céder son fonds de commerce dans de mauvaises conditions. En contrepartie, le locataire trouve, au cours de la location-gérance, la possibilité de prendre conscience de la valeur réelle du fonds et de ses possibilités de rendement et de se procurer l'argent nécessaire à son acquisition. Enfin, la pratique de la location-gérance de fonds de commerce peut être préférable lorsque le fonds de commerce fait partie d'une indivision successorale. Lorsque l'exploitation en direct est assurée par un indivisaire et n'est pas confiée à un locataire-gérant, les pertes entraînées par l'exploitation du fonds devraient être réparties entre les indivisaires. Mais si la gestion du fonds de commerce indivis est confiée à un locataire-gérant, seul celui-ci supportera les pertes découlant de l'exploitation. Ainsi, cette forme de bail doit être encouragée car elle assure une continuité de l'exploitation du fonds de commerce et du fonds artisanal et la vitalité de l'entreprise. C'est pourquoi il convient d'assouplir certaines de ses règles de mise en œuvre, en particulier celles exigées pour les propriétaires, et de permettre au Gouvernement de le faire par ordonnance. Il conviendrait également d'étendre au conjoint survivant qui n'a pas la qualité d'héritier ou au conjoint divorcé attributaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal la possibilité de le louer à un tiers lorsqu'il ne souhaite pas poursuivre lui-même l'exploitation. 2. Une modernisation du fonctionnement des coopératives de commerçants détaillants et artisans L'objectif des coopératives de commerçants détaillants est de donner à ces derniers qui désirent se grouper en coopératives, les moyens juridiques et financiers de se replacer dans la concurrence toujours plus forte et face à la progression de la grande distribution intégrée. Un dispositif similaire a été mis en place au profit des commerçants artisans. Apparus à la fin du XIXe siècle, les regroupements de commerçants ont dû attendre une loi du 2 août 1949 pour que le législateur leur donne une existence légale. Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont des sa à capital variable régies aujourd'hui par la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 modifiée à plusieurs reprises (23), en particulier pour les doter des instruments leur permettant de se mesurer aux autres formes de commerce (commerce intégré, franchises), et désormais codifiée sous les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce, les dispositions non contraires du titre III de la loi du 24 juillet 1867, codifiées sous les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code précité, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ainsi que par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, codifiée sous les articles L. 210-1 à L. 247-10 du code précité. Elles peuvent constituer, non seulement un groupement d'achats, mais également un groupement de vente et de services. La coopérative peut fournir à ses membres une assistance technique ou financière ou permettre la constitution de magasins collectifs de commerçants indépendants. Elle a la possibilité, pour le compte de ses associés, de réaliser des opérations commerciales publicitaires, ou non, pouvant comporter des prix communs. Elle a comme associés principalement des commerçants détaillants. Elle peut également accueillir des associés investisseurs qui n'ont pas vocation à utiliser ses services. En outre, la caisse centrale de crédit coopératif a été autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur des coopératives de commerçants et peut notamment leur consentir des prêts, donner son aval, sa caution, recevoir et gérer les fonds qui lui sont remis par les coopératives. Le capital varie en fonction des adhésions et des retraits volontaires ou par exclusions sans qu'il soit nécessaire de modifier les statuts. Dans une coopérative de commerçants, les associés, détaillants coopérateurs, disposent d'une voix quelle que soit leur participation dans le capital. Les excédents provenant des opérations commerciales réalisées avec les associés, peuvent leur être ristournés au prorata de leurs commandes. Rejoignant les objectifs d'une proposition de loi déposée sous la XIe législature par les membres du groupe socialiste (24), l'habilitation prévue par le présent article porte sur la nécessité d'adapter le régime applicable aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans, afin de faciliter et de simplifier le fonctionnement de ces coopératives dans quatre directions : - l'allégement du fonctionnement du conseil d'administration ; - la simplification des modalités d'internationalisation des coopératives ; - l'autorisation des relations directes entre associés d'une coopérative de commerçants détaillants et les autres coopératives de même nature dont ils ne sont pas adhérents ; - la simplification des conditions de mise en œuvre d'une politique commerciale commune en rendant possible la mise en place de groupements d'intérêt économique (gie). Cet effort de simplification pourrait être étendu aux coopératives de commerçants artisans régies par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative à certaines activités d'économie sociale et dont l'objectif est de créer une structure de moyens mettant en œuvre des services propres à rentabiliser leur entreprise (achats groupés, négociation de contrats de groupe, enseigne commune, services de gestion...) et à leur procurer des commandes (prises d'ordre pour le compte des associés). Ces mesures impliqueront de modifier notamment l'article L. 124-5 du code de commerce. 3. Une modernisation du régime applicable aux valeurs mobilières de sociétés commerciales Le droit des valeurs mobilières se caractérise par une superposition de textes dont les plus anciens remontent au XIXe siècle et qui n'obéissent pas tous à la même logique. Certains relèvent d'une logique commerciale, d'autres correspondent à des raisonnements de nature fiscale. En outre, l'unité de cette branche du droit s'est trouvée ébranlée par la réforme du droit des sociétés commerciales en 1966, qui, pour les valeurs mobilières, avait une portée limitée aux titres émis par les sociétés françaises. C'est pourquoi, par exemple, deux régimes juridiques s'appliquent aujourd'hui aux émissions obligataires des sociétés : celui issu de la loi du 24 juillet 1966 et aujourd'hui codifié au code de commerce et celui fixé par le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires. Par ailleurs, le code monétaire et financier, dans son article L. 211-2, a donné une portée générale à la définition des valeurs mobilières qui figure dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Il s'agit de titres négociables suivant des formes simplifiées, émises par catégories, qui confèrent des droits identiques. L'unité de la matière est cependant loin d'être acquise. Des règles particulières sont prévues pour chaque type de valeur : obligations remboursables en actions, titres émis en représentation d'une quotité du capital, titres de créances négociables, actions de priorité, certificats d'investissement... Un dispositif général, plus rationnel, portant à la fois sur la définition, la forme, les conditions d'émission et les opérations portant sur les valeurs mobilières, pourrait donc être utilement défini, ce qui permettrait parallèlement de prévoir des régimes de sanctions plus adaptés en cas de non-respect des règles qui seront édictées. En vue de faciliter l'accès des sociétés françaises aux marchés de capitaux, le régime juridique de l'augmentation de capital pourrait être réformé, tandis que la portée de la délégation de pouvoirs qui peut être consentie par l'assemblée des actionnaires aux dirigeants dans cette matière pourrait être élargie. Les titres de créances devraient relever du ressort du conseil d'administration ou du directoire, lorsqu'ils sont négociables ou lorsqu'il s'agit d'obligations. Les titres de créances sont constituent aujourd'hui un instrument financier largement utilisé et leur régime d'émission pourrait être empreint de moins de formalisme. Le régime des obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions et les obligations échangeables contre des actions, qui forment l'ensemble des valeurs mobilières donnant accès à terme à une quotité du capital, pourrait être unifié. 4. Une simplification de la gestion des petites entreprises sous forme de sociétés à responsabilité limitée Deux orientations permettraient de faciliter l'accès des petites entreprises à la forme de SARL : la première consisterait à leur permettre d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne et la seconde à assouplir leur statut. Aujourd'hui, en vertu de l'article L. 223-11 du code de commerce, les SARL ne peuvent émettre de valeurs mobilières à peine de nullité de l'émission. Comme l'a préconisé le groupe de travail piloté par notre collègue Xavier de Roux, les SARL, dès lors qu'elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et de remplir certaines conditions, pourraient émettre des obligations ordinaires sans appel public à l'épargne. Le régime de ces obligations pourrait utilement s'inspirer de celui des obligations que peuvent émettre certaines associations soumises à la loi de 1901, tel que fixé par les articles L. 213-8 et suivants du code monétaire et financier. Ce régime pourrait prévoir une transparence de l'information et une décision d'émission prise par l'ensemble des associés sur la proposition motivée des garants et un rapport du commissaire aux comptes. Des sûretés particulières pourraient, en outre, être décidées par les associés. Le présent article doit également permettre au Gouvernement de modifier le code de commerce pour accorder une plus grande liberté statutaire aux associés d'une SARL, en particulier pour la cession de leurs parts sociales et l'organisation de leur gérance. Une partie des dispositions fixées aujourd'hui par la loi pourrait fixée par les statuts. Ainsi, ces derniers pourraient aménager la majorité requise pour les cessions à des tiers, les transmissions de parts pour cause de mort, la procédure à suivre en cas de limitation de la cessibilité des parts entre associés et les conditions de révocation des garants. En outre, la mention du nom d'un ancien gérant pourrait être supprimée par décision collective des associés, tandis que ces derniers pourraient choisir l'organisation de la gérance en cas de pluralité de gérants entre la gérance traditionnelle et un conseil de gérance, dont le fonctionne collégial s'apparenterait à celui du directoire d'une sa. L'ordonnance pourrait également permettre la création de parts disposant de droits financiers préférentiels par rapport aux autres. Enfin, pourrait être augmenté le nombre maximum d'associés, fixé aujourd'hui à cinquante par l'article L. 223-3 du code de commerce. 5. Une dépénalisation embryonnaire du droit des sociétés et une extension des pouvoirs des actionnaires L'un des objectifs de ces articles est de permettre au Gouvernement de substituer à un certain nombre d'incriminations pénales un mécanisme civil d'injonction de faire qui serait accordé aux actionnaires. Le législateur qui met en place un outil répressif excessif, s'en remet au pouvoir modérateur du juge qui a contrario peut aussi, à son tour, l'aggraver. Faut-il vraiment des lois terrifiantes, c'est-à-dire des lois dont nul n'attend que leur extrême sévérité soit mise à exécution ? Tocqueville n'a pas tout à fait tort lorsqu'il relevait dans L'ancien régime et la révolution que les institutions françaises se caractérisent par « une règle rigide, une pratique molle ». Dès lors que l'État entend que ses prescriptions aient force obligatoire, il doit en préciser la sanction en cas de non-respect. La sanction, ce peut être la nullité d'un acte, la perte d'un avantage fiscal, une amende civile ou administrative. Le vice-président de la commission supérieure de codification, M. Guy Braibant, a pu relever, à l'occasion de l'examen du projet de code de commerce, qu'« il y avait un nombre incroyable d'infractions et de sanctions, j'avais même dit à cette époque que je ne deviendrais jamais chef d'entreprise de peur d'être mis en examen toutes les cinq minutes ». Un certain nombre de propositions sont issues du rapport de M. Philippe Marini. D'autres ont été portées par le groupe de travail réuni autour de notre collègue Xavier de Roux par le secrétaire d'État aux pme, qui a préconisé d'adapter les modalités de mise en œuvre des sanctions afin de permettre aux responsables de bonne foi de régulariser leur situation lors de manquements secondaires, de simples oublis ou erreurs de forme. Il ne sert à rien de prévoir des sanctions pénales trop fortes pour être appliquées. La « dépénalisation » proposée porte sur les infractions visées aux articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15, 1°, 2° et 3° et L. 245-13 du code de commerce. L'article L. 242-7 sanctionne pénalement le défaut de tenue d'un registre des délibérations. Le président, le vice-président ou le membre du conseil de surveillance, président de séance, qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil de surveillance par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société pourra ainsi être puni d'une amende de 3 750 euros. Aux termes de l'article L. 242-12 du code de commerce, sera puni d'une amende de 4 500 euros le président d'une sa qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 129 et 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les renseignements exigés par ces articles en vue de la tenue des assemblées pour leur permettre de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour. Destinée à protéger les intérêts des actionnaires, l'incrimination, lorsqu'elle joue en cas de défaut de publication de l'avis au Bulletin des annonces légales obligatoirement, touche nécessairement au thème général de la publicité. L'infraction sanctionnant une faute de négligence, la répression peut ainsi paraître excessive. L'article L. 242-13 du code de commerce punit d'une amende de 3 750 euros les dirigeants sociaux qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a fait la demande : une formule de procuration conforme aux prescriptions du décret du 23 mars 1967 précité ; la liste des administrateurs en exercice ; le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée ; le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ; les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ; enfin, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan. Les dispositions de ce texte ne coïncident pas avec les règles énoncées par le décret du 23 mars 1967 précité. En particulier, la loi sanctionne le défaut d'envoi « des rapports... des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée » alors que, pour l'assemblée générale ordinaire, le 6° de l'article 135 du décret vise seulement les rapports spéciaux. Par ailleurs, l'article L. 242-13 du code de commerce sanctionne seulement le défaut d'envoi de documents par les dirigeants sociaux au cas où la société a été saisie d'une demande expresse d'un actionnaire agissant dans le cadre des dispositions de l'article 138 du décret du 23 mars 1967. Lorsque la société prend d'elle-même l'initiative d'adresser à l'actionnaire une formule de procuration sans demande préalable de sa part, l'envoi d'un pouvoir non conforme aux prescriptions du décret, ou non accompagné des documents qui doivent normalement y être joints n'est pas passible des sanctions pénales prévues par l'article L. 242-13 du code de commerce applicables seulement au cas d'envoi d'une formule de procuration sur demande de l'actionnaire mais des sanctions civiles sont prévues. Il conviendrait d'étendre ces sanctions dans les cas où le défaut de communication suit une demande expresse des actionnaires, d'une part pour simplifier la procédure, d'autre part pour éviter une pénalisation excessive de ce qui ne constitue qu'une faute de négligence. L'article L. 242-15 du code commerce punit d'une amende de 3 750 euros le président ou les administrateurs d'une sa qui se rendraient coupables de trois types d'infractions. La première consiste à ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions, mais aussi les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions. La deuxième infraction est constituée lorsque le président ou l'administrateur n'annexe pas à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire. La troisième, enfin, est déterminée par le fait de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Dans ces cas comme dans ceux constatés plus haut, une sanction pénale paraît disproportionnée. L'article L. 245-13 du code précité punit d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Dans l'ensemble de ces cas, il apparaîtrait raisonnable d'introduire un dispositif de sanction civile, en lieu et place des peines correctionnelles aujourd'hui susceptibles d'être prononcées à l'égard d'actes qui ne relèvent pas à proprement parler de la matière pénale. Le rapporteur insiste sur la nécessité de commencer à décongestionner le traitement pénal du droit des sociétés, qui s'avère peu adapté et, in fine, inefficace. En conséquence, il pourrait être utile d'étendre la liste des articles susceptibles d'être modifiée par ordonnance. 6. Une souplesse accrue du droit des ventes en liquidation Certains groupes de ventes peuvent être subordonnés à une autorisation en raison du but poursuivi ou tout au moins annoncé par leur auteur, à savoir l'écoulement accéléré d'un stock. Cette autorisation est prévue, dans le but d'éviter une éventuelle perturbation du marché et de protéger les autres commerçants, par la loi du 30 décembre 1906, modifiée par l'article 17 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Codifiée à l'article L. 310-1 du code de commerce, l'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée. La demande d'autorisation des liquidations est adressée au préfet du département où est situé l'établissement commercial concerné cinq mois au plus et trois mois au moins avant le début de la vente. Cette demande, qui doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le nom commercial et l'adresse de l'établissement concerné ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation envisagée. Elle est accompagnée des documents suivants : un extrait du registre du commerce et des sociétés portant mention de l'établissement commercial où l'opération est envisagée ; toutes pièces justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le devis correspondant ; un inventaire des marchandises dont l'opération de liquidation envisagée a pour but d'assurer l'écoulement accéléré. L'administration préfectorale dispose d'au moins trois mois pour instruire le dossier, ce qui lui permet de consulter la chambre de commerce et d'industrie, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La demande est considérée comme tacitement acceptée si aucune décision n'est prise dans le délai de deux mois suivant la demande, ou, en cas d'urgence, dans les quarante-huit heures suivant le dépôt d'un dossier complet. Par nature exceptionnelles, les liquidations ne sont autorisées que sous la condition que les bénéficiaires justifient, dans les six mois qui suivent l'obtention de l'autorisation, du motif pour lequel elle a été demandée, par mention sur un extrait du registre du commerce et des sociétés soit de la cessation de l'activité de l'entreprise, soit du changement de l'activité, soit de la modification de la forme juridique de l'entreprise bénéficiaire, soit enfin du transfert de l'activité dans un autre local. L'objectif fixé au Gouvernement est de remplacer cette procédure d'autorisation des ventes en liquidation, particulièrement lourde, par une procédure de simple déclaration préalable. Cette mesure de simplification n'exclut pas le contrôle qui intervient au moment de la justification de la vente, six mois après le dépôt de la demande dans le régime actuel. 7. Une simplification du régime de l'organisation des foires et salons Plus de mille foires et salons sont organisés chaque année en France. Complexe, leur régime juridique, défini par l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 codifiée à l'article L. 310-2 du code de commerce, par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 et par un arrêté du 27 juillet 1988, fait intervenir à la fois le préfet du département, le préfet de région, le ministre chargé du commerce et les maires. Les foires sont des manifestations commerciales annuelles qui ont pour objet d'exposer à l'examen du public des échantillons de marchandises diverses, en vue d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer l'acquisition. Le salon est une foire consacrée à une catégorie déterminée de marchandises. En revanche, les brocantes n'entrent pas dans ce cadre. Les foires et salons se distinguent des expositions qui sont des manifestations destinées à montrer au public les richesses d'un pays ou d'une région sur le plan économique, culturel, artistique. Ainsi, le décret du 10 octobre 1969 précité exclut de la réglementation les expositions éducatives, scientifiques et d'information ne comportant aucune opération commerciale ainsi que les manifestations artistiques, les journées, semaines ou quinzaines commerciales organisées par des commerçants détaillants, les foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage, les fêtes foraines. Les foires ou salons doivent être préalablement autorisés par le préfet du département dans lequel doit se tenir la manifestation. Le préfet, après avoir pris l'avis du préfet de région, de la Fédération des foires et salons de France et de la Fédération française des salons spécialisés, statue avant le 1er novembre de chaque année et adresse au ministre ampliation de sa décision. Toute demande doit être adressée au préfet avant le 1er mai de l'année précédente, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'autorisation est acquise à la manifestation commerciale aussi longtemps qu'elle conserve les caractères en considération desquels elle l'a obtenue sous réserve d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur. Une manifestation commerciale autorisée peut être agréée par le ministre chargé du commerce. L'agrément est la reconnaissance officielle de l'intérêt économique de cette manifestation sur le plan régional national ou international. Un comité consultatif des foires et salons est placé auprès du ministre pour lui proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation de ces manifestations et d'en accroître le rendement économique. Parallèlement, le maire conserve ses pouvoirs de police mais il ne peut favoriser une catégorie de commerçant par rapport à une autre. C'est ainsi que la juridiction administrative a rappelé que la délibération d'un conseil municipal, qui a confié à une association de commerçants sédentaires l'organisation et le déroulement d'une foire traditionnelle et permis aux membres de cette association de fixer notamment les places assignées à chaque postulant, est de nature à entraîner une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, susceptible par là même de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Le maire est le seul compétent, dans le cadre des prérogatives que lui confère le code général des collectivités territoriales pour exercer la police des marchés et procéder à la répartition des emplacements. L'habilitation donnée par le présent article au Gouvernement lui permettra de simplifier la procédure d'autorisation, voire celle de l'agrément, de ces manifestations commerciales, conformément aux conclusions de la cosa énoncées lors sa réunion plénière du 17 avril 2001. 8. Un allégement du régime des marchés d'intérêt national Les ventes de marchandises en gros sont réglementées par les lois du 28 mai 1858 et du 3 juillet 1861, qui s'appliquent également aux marchés d'intérêt national (min), définis par le titre III du livre VII du code de commerce (articles L. 730-1 à L. 730-17) et organisés par le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968. Ces derniers sont des lieux de transactions, autres que de détail, portant sur des produits dont la liste est, compte tenu des règles de normalisation, fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme min ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'État après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture intéressées. Leur gestion peut être assurée, soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'État. Il existe actuellement vingt min, reconnus comme tels par décret en Conseil d'État. Le mode de définition du périmètre de protection dont ils bénéficient relève de la loi. L'article L. 730-4 du code de commerce prévoit, en effet, qu'un périmètre de protection peut être institué autour d'un min. Ce périmètre de protection interdit l'installation de tout grossiste dans la zone considérée, à l'exception des producteurs et groupements de producteurs pour les produits provenant d'exploitations situées dans ce périmètre. La réforme devrait porter à la fois sur les règles de création et de classement des min, mais aussi sur la définition des zones de protection éventuelles et sur l'ouverture à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés. Elle permettra de mener à bien la refonte réglementaire annoncée par le ministre chargé du commerce, le 28 février 2003. 9. Une adaptation du droit de la concurrence a) L'institution d'un seuil de minimis pour les affaires examinées par le conseil de la concurrence selon une procédure accélérée - L'absence de « seuil de sensibilité » dans le droit national de la concurrence En application de l'article L. 420-1 du code de commerce (25), les pratiques d'entente, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont prohibées. La notion d'entente recouvre les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, mais aussi à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, le conseil de la concurrence, en vertu de l'article L. 462-5 du code précité, peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée à l'article L. 420-1, sans restriction particulière si ce n'est le fait que le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans. Ainsi pas plus le code du commerce que l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ou les textes précédents ne subordonnent la qualification d'entente à une appréciation quantitative de l'ampleur de l'entrave réalisée par les pratiques mises en œuvre. Pourtant, dès 1973, la commission technique des ententes et des positions dominantes, ancêtre du conseil, avait affirmé qu'il existe « un seuil au dessous duquel le fait critiquable ne constitue même pas une infraction ». Elle se rapprochait ainsi des règles adoptées en droit communautaire sur les accords d'importance mineure qui sont tenus pour négligeables compte tenu de leur faible incidence sur la concurrence, de telle sorte qu'ils n'encourent pas de sanctions. La commission technique prenait également en considération la taille des entreprises en entente, notamment lorsqu'il s'agissait de petites ou moyennes entreprises à vocation régionale, confrontées à la concurrence de groupes puissants. La notion de « seuil de sensibilité » est apparue en 1981 dans les travaux de la commission de la concurrence, qui avait succédé à la commission technique en 1977. Dans son rapport annuel pour 1981, elle relevait les faits suivants : « Qu'elle soit visée par son objet ou par la possibilité d'un effet anticoncurrentiel, une entente ne doit effectivement tomber sous le coup de la prohibition que si la restriction de concurrence qu'elle apporte ou qu'elle vise à apporter au jeu de la concurrence n'est pas seulement théorique. En d'autres termes, pour qu'une infraction soit constatée et corrigée ou sanctionnée, il faut qu'elle soit assez sensible pour pouvoir affecter - tant soit peu mais réellement - le jeu de la concurrence ». Seul le franchissement du seuil de sensibilité était propre à déclencher le contrôle, tout comme il existe un seuil de concentration qui provoque le déclenchement du contrôle des concentrations économiques. Se prévalant du rapprochement de sa jurisprudence avec le droit communautaire, la commission s'était cependant toujours refusée à chiffrer l'atteinte sensible à la concurrence. Toute référence au seuil de sensibilité a progressivement disparu du droit national. Dans son arrêt en date du 12 janvier 1999, la Cour de cassation a rappelé qu'en l'absence de toute définition légale ou réglementaire d'un seuil de sensibilité, il appartient aux juridictions saisies de vérifier dans chaque cas d'espèce si l'effet potentiel ou avéré des pratiques incriminées est de nature à restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché concerné. - Le développement de la règle de minimis en droit communautaire de la concurrence En revanche, parallèlement, la Commission européenne s'est de plus en plus référé au concept de seuil de minimis. Cette règle permet de considérer que le droit communautaire de la concurrence n'est pas applicable à certaines affaires qui, bien que révélant éventuellement une restriction de concurrence et susceptible d'affecter le commerce entre États membres, sont d'une importance économique extrêmement réduite. En droit communautaire, la Commission européenne a en effet très tôt souhaité écarter l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, aux accords d'importance mineure ou « de minimis » qui n'apportaient à la concurrence qu'une atteinte proportionnellement très faible au regard du volume des échanges communautaires portant sur les produits en cause (26). Elle a ensuite consacré cette pratique dans plusieurs communications, la première en date du 27 mai 1970 ayant été régulièrement actualisée depuis lors. Dans une communication de 2001, après avoir distingué effet sur le commerce entre États et effet sur la concurrence, la Commission s'est concentrée exclusivement sur le second point et relève les seuils de sensibilité pour les restrictions horizontales ou verticales respectivement à 10 et 15 % de parts de marché. - La nécessité d'introduire une telle règle dans notre droit de la concurrence en lien avec le développement d'une procédure accélérée En droit français, le conseil de la concurrence s'est longtemps montré rebelle à l'utilisation de ces seuils de sensibilité, même si certaines décisions des juridictions judiciaires ont pu marquer quelques pas dans ce sens. Ainsi, la cour d'appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont pu chercher à apprécier l'effet sensible de la pratique au stade de l'incrimination ou de la qualification (27). Outre qu'elle s'écarte de la pratique communautaire, la non-application de cette règle de minimis en France pèse sur l'activité du conseil de la concurrence et alourdit sa charge de travail. Dans son treizième rapport pour 1999, cette autorité, en saluant l'avancée constituée par le développement de la procédure simplifiée et l'introduction en droit français d'une procédure de clémence, estime que « cette évolution n'est probablement pas allée à son terme et d'autres mesures tout aussi importantes restent à envisager : l'introduction d'une règle "de minimis" permettant de classer rapidement les dossiers qui ne représentent pas de réel intérêt du point de vue de la concurrence ». Dans son douzième rapport pour 1998, il avait déjà fait observer que cette condition de sensibilité était un élément de la qualification des pratiques et supposait donc d'examiner les effets concrets ou potentiels des pratiques en cause. Le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques prévoyait qu'une affaire pouvait être classée sans suite lorsque la pratique n'avait pas atteint un certain « seuil de sensibilité ». Cette disposition n'a finalement pas été reprise dans la loi du 15 mai 2001, les députés de l'ancienne majorité craignant que le conseil de la concurrence « néglige » les affaires concernant les pme. À l'occasion des débats qui s'étaient tenus devant la commission des Finances en première lecture de ce projet de loi, notre collègue Philippe Auberger avait contesté cette suppression, jugeant au contraire que le classement sans suite sur le fondement d'un seuil minimal aurait permis de remédier à la durée trop longue des procédures devant le conseil. Mme Nicole Bricq, partageant cet avis, avait suggéré que les moyens du conseil soient également renforcés pour remédier à son engorgement. Dans cette logique, l'objectif fixé par l'habilitation proposée dans le présent article est d'instaurer un seuil de minimis de saisine pour les pratiques d'ententes mentionnées à l'article L. 420-1, ce qui permettrait au conseil de la concurrence de se concentrer sur les affaires importantes, ce qui ne signifie pas que les pme soient exclues. b) Le relèvement du seuil de contrôle des concentrations Dans la même logique de plus grande efficacité du conseil de la concurrence, le Gouvernement pourrait augmenter le seuil des concentrations susceptibles d'être examinées par le conseil. La concentration économique est définie par l'article L. 430-1 du code du commerce, tel qu'il résulte de l'article 86 de la loi « nre » du 15 mai 2001. L'alignement sur le droit communautaire est manifeste puisque cette loi a repris les termes de l'article 3 du règlement n° 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié par le règlement n° 1310/97 du 30 juin 1997. L'opération de concentration est caractérisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent. Elle peut également être constituée lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. En application de l'article L. 430-2 du code de commerce modifié par l'article 87 de la loi « nre », le contrôle des concentrations impose aux entreprises concernées de notifier l'opération au ministre chargé de l'économie s'exerce, lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros et lorsque le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros. Ce système constitue déjà une simplification par rapport au système antérieur. En effet, auparavant, le contrôle d'une opération de concentration était subordonné au franchissement de deux seuils alternatifs : un seuil en valeur relative, calculé par référence à la part de marché détenue par les entreprises participant à la concentration (plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché), et un seuil en valeur absolue correspondant au chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises (total de chiffre d'affaires hors taxe de plus de 7 milliards de francs et un chiffre d'affaires réalisé par l'une des entreprises parties à l'opération d'au moins 2 milliards de francs). En conséquence, les opérations les plus modestes échappent au contrôle des concentrations, mais également les plus importantes, celles qui ont une dimension communautaire. En effet, aux termes de l'article L. 430-2 du code précité, le contrôle s'exerce si l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Conseil du 21 décembre 1989. Une opération est de dimension communautaire lorsque le chiffre d'affaires mondial réalisé par toutes les entreprises concernées dépasse 5 milliards d'euros et lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées atteint 250 millions d'euros. Si ces deux seuils ne sont pas franchis, il est précisé qu'une opération peut quand même être de dimension communautaire si quatre conditions positives et une condition négative sont remplies. La concentration est ainsi de la compétence exclusive de la Commission européenne lorsque : le chiffre d'affaires mondial combiné des entreprises concernées est supérieur à 2,5 milliards d'euros ; les entreprises concernées ont réalisé dans au moins trois États membres un chiffre d'affaires combiné supérieur à 100 millions d'euros ; au moins deux des entreprises concernées ont réalisé individuellement dans chacun de ces trois États membres un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros ; au moins deux des entreprises concernées ont réalisé individuellement un chiffre d'affaires total sur le plan communautaire supérieur à 100 millions d'euros ; sauf à ce que chacune des entreprises concernées ait réalisé plus de deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même État membre. La suppression du seuil national en valeur relative compensée par une diminution des seuils à partir desquels s'impose un contrôle de concentration amène donc le ministre chargé de l'économie à se prononcer sur toutes les opérations concernant les entreprises dont le chiffre d'affaires total est situé entre 150 millions et 5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires individuel compris entre 15 millions et 250 millions d'euros. Il peut prendre trois types de décisions. Soit il constate, en motivant sa décision, que l'opération notifiée n'entre pas dans le champ d'application du droit des concentrations économiques. Soit il autorise l'opération en la subordonnant éventuellement à la réalisation des engagements pris par les parties ; là encore, sa décision doit être motivée. Soit il saisit le conseil de la concurrence pour avis s'il estime que l'opération projetée est de nature à porter atteinte à la concurrence. Le ministre dispose d'un délai de cinq semaines, éventuellement prolongé de trois semaines, pour répondre. Quant au conseil de la concurrence, il doit, selon l'article L. 430-6 du code de commerce, remettre son avis au ministre dans un délai de trois mois. Le ministre doit prendre sa décision dans les quatre semaines qui suivent l'avis du conseil. Si les délais ont été raccourcis et si la règle selon laquelle l'absence de réponse dans les délais vaut acceptation a été érigée en principe, il n'en reste pas moins que nombre d'opérations, dans le système en vigueur depuis le 18 mai 2001, date d'entrée en vigueur de la loi « nre », ont été soumises à notification, ce qui décourage les moins importantes d'entre elles. C'est pourquoi le Gouvernement pourrait, sur le fondement de l'habilitation qui lui est accordée par le présent article, augmenter les seuils de chiffre d'affaires qui commandent la notification. Le rapporteur souhaite également appeler l'attention sur la nécessité à terme de résoudre d'autres difficultés et imprécisions nées de la loi « nre » du 15 mai 2001, s'agissant notamment de la présence d'un commissaire à la transformation en cas de transformation de sa en société par actions simplifiée (SAS) ou de sa en SAS (article 100 de la loi « nre »), de l'absence de pouvoir du directeur général de SAS (article 101), du choix des modalités d'exercice de la direction générale et de la mise en conformité du statut des dirigeants en matière de cumul de fonction (articles 106 et 131) ou encore de la révocation des directeurs généraux en cas de procédure collective sans justes motifs (article 107 de la loi précitée), des conventions réglementées soumises à l'autorisation du conseil d'administration (article 111) ou de l'application aux petites et moyennes entreprises des prescriptions relatives au contenu du rapport du conseil à l'assemblée générale (article 116). À cet égard, il faut se féliciter des apports du projet de loi de sécurité financière actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Xavier de Roux, tendant à compléter les références aux articles du code de commerce énumérées à l'alinéa 6° de l'article 21 du projet de loi, qui vise à supprimer dans ce code des incriminations, afin qu'elles soient remplacées par la sanction civile de l'injonction de faire. L'auteur de l'amendement a expliqué que l'excessive pénalisation du droit des sociétés, qui contient de multiples « délits sentinelles » selon l'expression du professeur Bernard Bouloc, contribuait à l'insécurité juridique, la sanction pénale étant dans la plupart des cas totalement inappropriée. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas de revenir sur les délits qui sanctionnent de véritables atteintes à l'honnêteté, mais seulement sur des incriminations qui ne sont en fait pas poursuivies. Le rapporteur, favorable à l'amendement proposé, a toutefois noté que le Sénat, à l'occasion du débat en première lecture sur le projet de loi sur la sécurité financière, avait d'ores et déjà voté, avec l'avis favorable du gouvernement, l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code de commerce, dont l'article L. 242-11 - dont la référence devrait être retirée du texte de l'amendement - et suggéré, à l'inverse, de compléter la liste proposée par M. Xavier de Roux par plusieurs autres références. M. Gérard Léonard a jugé préférable, dans le cadre de l'examen d'un projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier l'édifice juridique, de ne pas aborder de telles questions, qui lui paraissent relever de textes de loi distincts. S'il a partagé l'analyse des intervenants précédents sur l'excessive pénalisation et la trop grande judiciarisation de notre droit, il a estimé toutefois que le problème excédait le cadre de l'habilitation et invité la Commission à ne pas adopter des amendements de cette nature. Rejoignant ces propos, M. Jérôme Lambert a ajouté que le projet de loi portait en lui-même ce défaut consistant, sous couvert de simplification, à aller bien au-delà. Il a estimé par ailleurs que la suppression de la sanction pénale pour l'infraction visée à l'article L. 242-9 du code de commerce était discutable, dans la mesure où cet article traitait notamment des infractions graves commises dans le cadre des assemblées générales d'actionnaires. M. Xavier de Roux a objecté que les faits visés par cet article pouvaient être considérés comme constitutifs d'une infraction de droit commun, d'ores et déjà punie par le code pénal. M. Robert Pandraud a jugé que certains des amendements présentés dépassaient les compétences de la Commission, dans la mesure où ils traitent de questions de droit du travail ou d'organisation de la santé, qui devraient être examinés lors de la discussion des textes qui s'y rapportent. Le président Pascal Clément s'est dit frappé de constater que le législateur soit si enclin à multiplier les sanctions pénales, souvent pour des considérations liées à l'actualité, sans toujours prendre garde à la cohérence du dispositif global, ce qui conduit à une inapplication de nombre d'entre elles. Il a estimé que, même si le présent projet de loi relevait de la procédure bien particulière de l'article 38 de la Constitution, et si, par ailleurs, la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés constituée au sein de la Commission aborderait le problème de la pénalisation du droit des affaires, le texte en discussion représentait néanmoins l'occasion de procéder à un toilettage nécessaire des incriminations pénales surabondantes en droit des sociétés. En écho aux propos de M. Xavier de Roux, le rapporteur a rappelé que l'amendement proposé ne faisait que compléter la liste des articles du code de commerce mentionnés par le projet de loi et dont il convient d'expurger les incriminations pénales inutiles, lesquelles pourraient être remplacées, en particulier, par la sanction civile de l'injonction de faire. À l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement de M. Xavier de Roux, de même qu'un autre amendement du même auteur inspiré par la même logique. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Xavier de Roux ajoutant à la liste la référence à l'article L. 242-16 du code du commerce. Son auteur a expliqué qu'il s'agissait de dépénaliser l'inobservation des règles de calcul des voix lors des assemblées générales, une telle infraction entraînant déjà la nullité desdites assemblées, ce qui lui a semblé être une sanction à la fois plus adaptée et plus efficace. M. Gérard Léonard a souhaité dissiper tout malentendu en affirmant que le souci de dépénaliser certaines infractions était une préoccupation largement partagée. Il a cependant estimé que cette réforme ne pouvait être mise en œuvre par voie d'ordonnances, considérant qu'une telle façon de procéder équivaudrait à un véritable dessaisissement du Parlement sur des sujets de grande portée. M. Robert Pandraud, bien qu'approuvant l'orientation générale préconisée par M. Xavier de Roux, a lui aussi souhaité que le Parlement assume ses responsabilités plutôt que de déléguer ses compétences à l'administration. M. Georges Fenech a indiqué qu'il partageait également la volonté de l'auteur de l'amendement de dépénaliser certaines infractions, mais a considéré qu'il s'agissait d'un débat de fond, excédant les limites d'une réforme de simplification et de codification. Il a relevé, au demeurant, que si l'objectif recherché ne consistait qu'à transférer du code du commerce au code pénal certaines infractions spéciales, l'auteur de l'amendement n'allait pas au terme de sa logique. M. Émile Zuccarelli a jugé que ce débat révélait le vice originel du projet de loi, qui amalgame une codification à droit constant, des réformes importantes mais relevant classiquement du champ des ordonnances, ainsi que des mesures de fond qui ne rentrent pas dans les limites traditionnelles des habilitations accordées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Le rapporteur a observé que les amendements de M. Xavier de Roux ne faisaient que préciser et compléter une réforme déjà inscrite dans le projet de loi, tendant à simplifier la législation en vigueur en supprimant des redondances, certaines infractions pouvant être sanctionnées à la fois sur le fondement du code du commerce et du code pénal. Il a salué ce souci de précision tout en observant que, dans ce cas précis, la mesure proposée avait déjà été adoptée dans le cadre du projet de loi de sécurité financière, en cours d'examen au Parlement. M. Jérôme Lambert a jugé qu'il était contradictoire d'affirmer dans le même temps que l'article 21 du projet de loi et les amendements de M. Xavier de Roux engageaient une réforme de fond, celle de la dépénalisation, et qu'ils ne faisaient qu'abroger des incriminations superfétatoires. Le président Pascal Clément a insisté, à son tour, sur le fait que les amendements de M. Xavier de Roux ne faisaient que combler des omissions du texte du Gouvernement. Il a attiré l'attention de la Commission sur le caractère précis et limité de l'habilitation ainsi octroyée, le principe étant de conserver les incriminations générales prévues dans le code pénal et de remplacer une partie des incriminations spéciales figurant dans le code de commerce par des injonctions de faire. La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un autre amendement du même auteur tendant à supprimer du code du commerce les infractions portant sur les droits des titulaires des bons de souscription en cours de validité, le rapporteur ayant observé que cette mesure avait également été adoptée dans le cadre du projet de loi de sécurité financière. La Commission a en revanche adopté un amendement de M. Xavier de Roux (amendement n° 21) ajoutant à la liste des incriminations pénales à supprimer la référence à l'article L. 245-9 du code du commerce, qui assortit de sanctions pénales une disposition abrogée. Elle a ensuite adopté un amendement (amendement n° 22) du rapporteur remplaçant la référence aux injonctions de faire par un renvoi plus général à des « sanctions plus adaptées ». Puis elle a adopté l'article 21 ainsi modifié.
Article 22 La loi Le Chapelier du 2 mars 1791 a certes aboli les maîtrises, jurandes et règlements divers qui entravaient la liberté du commerce et de l'industrie. Mais, progressivement, pour de nombreuses professions, des règles de plus en plus strictes et tatillonnes sont réapparues. Les professions réglementées abondent encore aujourd'hui. Le rapport présenté par M. Jacques Rueff et Louis Armand de 1960 en avait fait un inventaire dans le but jamais atteint de les abolir (28). De nombreuses réglementations reposent sur une situation obsolète : protectionnisme commercial, politique de protectionnisme interne s'exerçant par le biais de statuts, d'accords, de subventions directes ou de faveurs fiscales mises progressivement en place depuis la crise années 1930, mesures corporatistes édictées depuis la même époque, puis par le gouvernement de Vichy, qui tendaient à fermer l'entrée de telle ou telle profession et à créer des rentes de situation. Ainsi, de nombreuses professions demeurent soumises à des régimes d'encadrement strict. Les antiquaires brocanteurs doivent se faire inscrire au registre des revendeurs mobiliers auprès de la préfecture, les bijoutiers doivent faire une déclaration d'existence pour métaux précieux auprès des services des douanes, les ferrailleurs doivent obtenir une autorisation d'ouverture au service des installations classées de la préfecture, les grainetiers doivent être autorisés par le groupement national interprofessionnel des semences, les pompes funèbres sont habilités par la préfecture... Simplifier l'exercice de certaines professions peut s'avérer compliqué. Les membres de ces professions sont les premiers à demander une réglementation ou à vouloir maintenir celle qui existe, souci qui souvent manifeste un souci de reconnaissance, conférée par une autorisation administrative, et parfois traduit des réflexes malthusiens. Dans un premier temps, avant que de supprimer éventuellement le système de la carte professionnelle, il pourrait être envisagé de prolonger systématiquement sa durée de validité et d'en harmoniser les différentes procédures d'obtention. 1. Modernisation des règles applicables à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, s'applique aux personnes physiques et morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à des activités diverses (achat, vente, échange, location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce...). L'exercice de ces activités est subordonné à la délivrance par le préfet d'une carte professionnelle précisant les opérations susceptibles d'être accomplies par le titulaire de la carte. Le texte énumère les conditions (aptitude professionnelle, garantie financière, assurance, absence d'incapacités ou d'interdictions d'exercer) auxquelles doivent satisfaire, en vue de l'obtention de la carte, les personnes physiques, les personnes morales et les représentants légaux et statutaires de celles-ci. Le décret n° 95-818 du 29 juin 1995 a modifié et complété le décret du 20 juillet 1972 précité. Il a, notamment, introduit une dispense des conditions d'aptitude à l'obtention de la carte pour les personnes satisfaisant à certaines conditions d'activité professionnelle antérieure et de formation. 2. Simplification de la réglementation applicable à certaines professions Le présent article habilite le Gouvernement à simplifier le cadre législatif des professions suivantes : agents de voyage, experts-comptables, coiffeurs, courtiers de marchandises assermentés, exploitants forestiers, voyageurs représentants placiers (vrp). La simplification de la réglementation applicable à certaines professions passe, notamment, par la suppression de certaines cartes professionnelles ou l'allongement de leur délai de validité et de renouvellement. Elle passe également par la modification des conditions d'accès et d'exercice. Les ordonnances devraient permettre de supprimer quelques dispositions trop lourdes ou devenues obsolètes. - Les agents de voyage Jusqu'en 1937, les agences de voyages bénéficiaient d'une liberté complète de création et d'exploitation. Depuis, les textes se sont succédé. La loi du 19 mars 1937, modifiée par l'acte dit « loi » du 24 avril 1942, avait institué une licence pour les agences de voyages. Leur activité est actuellement régie par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Sous l'influence de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, cette loi a modernisé la profession et abrogé la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975. Le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 en a fixé les modalités d'application. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 s'appliquent aux personnes physiques ou morales se livrant ou apportant leur concours à certains types d'opérations : organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; prestations de services pouvant être fournies à l'occasion de ces voyages ou séjours (délivrance de titres de transport, réservation de chambres, etc.) ; prestations de services liés à l'accueil touristique (visites de villes ou de sites, service de guides interprètes, etc.) ainsi qu'aux opérations de production ou de vente de « forfaits touristiques ». Ces opérations ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques et morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agents de voyages délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale de l'activité touristique. La licence peut être retirée ou suspendue, pour défaut de satisfaction aux conditions d'exercice ou de manquements graves et répétés aux obligations imposées par la loi et le décret, dans les mêmes formes que sa délivrance. L'arrêté préfectoral est susceptible de recours devant le ministre chargé du tourisme, après avis du conseil national du tourisme siégeant en formation disciplinaire. Le candidat à la licence doit justifier de son aptitude professionnelle, présenter des garanties de moralité et offrir une garantie financière. Les titulaires de la licence ne peuvent confier l'exécution des opérations mentionnées par la loi à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention préalablement approuvée par l'autorité administrative, spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence. Comme pour l'ensemble des professions visées par le présent article, la profession d'agent de voyage devrait bénéficier d'un réexamen des contraintes qui pèsent sur elle, afin d'en simplifier l'exercice, conformément à la décision prise par la cosa dans sa réunion plénière du 17 avril 2001, qui a prévu la réduction du nombre de régimes d'agrément de quatre à deux. - Les experts-comptables La profession est régie par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée notamment par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et mise en œuvre par le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié par le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables et le décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables. En l'état du droit, la profession d'expertise comptable peut être exercée par les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable inscrits au tableau. Par dérogation au monopole de l'ordre, les centres de gestion agréés peuvent être habilités à tenir des comptabilités dans des conditions qui dépendent de l'importance du chiffre d'affaires ou de l'activité exercée par l'entreprise adhérente. Cette dérogation est source de dysfonctionnements. En effet, certains centres réalisent des travaux comptables en dehors du cadre légal ou outrepassent le cadre définissant l'habilitation comptable. Les compétences des centres en matière de tenue de comptabilité, qui sont définies en fonction de la nature de l'activité (agricole ou commerciale) et du chiffre d'affaires des entreprises adhérentes, obligent ces dernières à s'adresser à un autre professionnel de la comptabilité dès qu'elles développent ou diversifient leur activité. Enfin, des règles différentes existent en matière de déontologie, d'indépendance et de loyauté vis-à-vis des clients entre les deux types de professionnels. Le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier de mai 2001, jamais inscrit à l'ordre du jour, avait ainsi prévu un aménagement de la réglementation applicable à la profession d'expert-comptable pour organiser la séparation entre les missions fondamentales d'assistance et de prévention fiscales conservées par les centres de gestion et la tenue de comptabilité qui relèverait de nouvelles structures. Dans cette logique de simplification de l'exercice de la profession comptable, le Gouvernement pourrait autoriser l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative, au sein « d'associations de gestion et de comptabilité », distinctes des centres de gestion agréés et qui exerceraient leur activité sans limitation de chiffre d'affaires ou de secteur socio-professionnel de leur clientèle. Ces associations pourraient apporter conseil et assistance en matière de gestion à l'ensemble de leurs adhérents. Elles seraient créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. Parallèlement, pour aller plus loin, l'habilitation accordée aux centres de gestion agréés, prévue aux articles 1649 quater D-II à 1649 quater D-IV, qui implique une procédure lourde, pourrait progressivement être supprimée. Au-delà de cette réforme, il serait utile de simplifier les règles d'accès à la profession et les modalités de stages et de soumettre les professionnels aux mêmes règles déontologiques que celles qui régissent les associations de gestion et de comptabilité. - Les coiffeurs La profession de coiffeur est régie par la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur, complétée par les décrets n° 47-476 du 18 mars 1947, n° 75-198 du 17 mars 1975 et n° 75-342 du 9 mai 1975. Les conditions d'accès ont été modifiées par l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. La loi du 23 mai 1946 précitée exigeait du titulaire du fonds la possession du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise, à défaut de six années de pratique professionnelle à la date de promulgation de la loi. Faute de satisfaire à cette condition, le recours à un gérant technique remplissant celle-ci était obligatoire. Aux termes de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements doivent être placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Cette disposition a pour objet de permettre le respect des règles d'hygiène dans le cas de chaînes à salons multiples. Selon le même texte, la dispense de diplôme, sous condition de validation de la capacité professionnelle de l'intéressé par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État, est prévue au bénéfice des entreprises de coiffure à établissement unique dont l'exploitant exerce, de façon effective à temps complet, une activité professionnelle de coiffeur. Cette dérogation étend aux nationaux le bénéfice d'une mesure qui concernait jusqu'alors les seuls ressortissants des autres États membres de l'Union européenne. Enfin, les coiffeurs exerçant au domicile des particuliers devaient, dans un délai de trois ans suivant la publication de la loi du 5 juillet 1996, justifier de conditions particulières de diplôme ou d'expérience professionnelle. Pour contrôler l'application de ces règles, une carte de qualification professionnelle, obligatoire pour l'exploitation d'un fonds, est délivrée par le préfet du département où le requérant veut exercer son activité. Le préfet est assisté à cet effet d'une commission consultative de professionnels. La carte est accordée non seulement aux patrons coiffeurs, mais aussi aux gérants techniques justifiant d'une pratique professionnelle. En cas de refus de la carte, une procédure d'appel est prévue devant une commission de professionnels, présidée par le ministre chargé du commerce. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, dans son article 197, a supprimé la possibilité de dérogation à l'obligation pour les responsables de salon de détenir un diplôme. Elle a supprimé par la même occasion la commission nationale de la coiffure et créé, en conséquence, des difficultés juridiques pour ceux des coiffeurs qui avaient obtenu une autorisation de la commission nationale. Il semble donc cohérent de permettre au Gouvernement de régler cette question par ordonnance. - Les courtiers de marchandises assermentés La loi du 18 juillet 1866, tout en proclamant la liberté du courtage de marchandises, a réservé l'exercice de certaines opérations à des courtiers appelés « courtiers de marchandises assermentés » ou « courtiers inscrits », soumis à un statut spécial. Ces courtiers, dont la profession est étroitement réglementée, se voient conférés par les textes des attributions particulières. Le statut spécial des courtiers assermentés a été renforcé par le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 modifié par le décret n° 94-728 du 19 août 1994. Pour pouvoir exercer, un courtier assermenté doit être inscrit sur une liste. C'est la cour d'appel dans le ressort de laquelle le candidat exerce son activité professionnelle qui statue en assemblée générale et en chambre du conseil sur la demande d'inscription. Elle statue souverainement sur la demande d'inscription. Dans la huitaine de sa décision concluant à l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, le candidat doit prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il désire exercer son activité professionnelle. Pour pouvoir être inscrit, le candidat doit répondre à des conditions de nationalité, de moralité professionnelle, d'âge, de probité, d'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel, d'expérience professionnelle et d'aptitude sanctionnée par un examen. Il doit, en outre, avoir versé au Trésor un droit d'inscription fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. La catégorie des courtiers de marchandises assermentés comprend également les courtiers en vins et spiritueux, qui, dans les régions de production et moyennant une rémunération fixe de courtage mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés avec les négociants acheteurs. Leur activité est encadrée par la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » qui subordonne son exercice à un agrément matérialisé par la délivrance d'une carte d'identité professionnelle établie sur le modèle de celle des voyageurs de commerce par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, et délivrée, après vérification de l'existence des conditions requises, par une commission de professionnels présidée par le préfet du domicile du requérant. Cette carte est renouvelable annuellement. Un décret du 27 mars 1951 a précisé les conditions de délivrance de la carte professionnelle et énuméré les professions dont l'exercice est incompatible avec celle de courtier de campagne : fonctionnaires, et notamment receveurs-buralistes et secrétaires de mairie, employés des caisses de sécurité sociale, membres des conseils d'administration, directeurs, gérants et employés des caves coopératives de vinification, etc. Tout retrait ou refus de carte peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes. Toute violation des dispositions de la loi est punie d'une amende. La confiscation du courtage peut être prononcée et le préfet doit, dans ce cas, opérer le retrait de la carte professionnelle. Cette réglementation, particulièrement lourde, mériterait d'être allégée, ce que l'habilitation inscrite dans le présent article permettra de faire Pourraient ainsi être supprimés le droit d'inscription perçu au profit du Trésor. L'article L. 322-8 du code de commerce relatif à la liste des marchandises pouvant être vendues aux enchères publiques volontaires par les courtiers pourrait aussi être modifié pour permettre la mise à jour de cette liste. - La profession d'exploitant forestier Les règles encadrant la profession d'exploitant forestier mériteraient ainsi d'être allégées. L'exploitant forestier est un commerçant. Il recherche et achète des coupes ou des produits façonnés. Il organise les chantiers, exploite les bois ou les fait exploiter en sous-traitance. Il vend les produits aux industries de première transformation. Pourrait être supprimé l'article 3 de l'acte dit « loi » du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière, qui impose aux producteurs vendant directement leur bois la possession d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet en droit, par les directions de l'agriculture et de la forêt en pratique, en particulier par les services régionaux de la forêt et du bois (serfob). M. Jean Glavany, alors ministre de l'agriculture, avait relevé, à l'occasion de la discussion au Sénat du projet de loi d'orientation sur la forêt le 5 avril 2001, que « ce système, instauré en 1940 par le régime de Vichy menant une politique très corporatiste, est en total décalage avec nos pratiques politiques et économiques contemporaines. Ses seules utilités résiduelles n'en justifient pas, à mon avis, le maintien. Pour les besoins statistiques, le service statistique du ministère de l'agriculture et de la pêche garantit qu'il peut utiliser d'autres sources pour définir la population à enquêter. » La suppression de l'article 3 de l'acte dit « loi » de 1940 précité pourrait donc être envisagée sans dommage, comme cela l'avait été par le projet de loi d'orientation sur la forêt en 2001. Il conviendra cependant de veiller à ce que la suppression de cette carte s'accompagne de mesures réglementaires. En effet, elle est également exigée par les préfectures des propriétaires forestiers qui exploitent eux-mêmes leurs bois et qui ne sont pas agriculteurs pour obtenir l'immatriculation de leur tracteur comme tracteur forestier, ce qui les autorise à le conduire sans permis poids lourd et en utilisant le carburant agricole, comme les agriculteurs et les exploitants forestiers. Pour éviter que la simplification ne soit synonyme de complication, la mesure d'ordre législatif devrait donc être complétée par la mise en place d'un régime réglementaire également plus souple. En définitive, comme l'a relevé la cosa lors de sa réunion plénière du 17 avril 2001, la nature de l'activité d'exploitant forestier n'implique pas de la réglementer a priori de manière aussi stricte. - Les voyageurs représentants placiers Les représentants de commerce, intermédiaires qui interviennent dans la distribution des produits en recherchant une clientèle pour une entreprise, doivent détenir une carte professionnelle délivrée en principe par la préfecture de leur domicile en vertu des articles L. 751-1 et L. 751-2 du code du travail issus de la loi du 8 octobre 1919. La possession de cette carte est obligatoire pour les personnes exerçant la profession de façon exclusive et constante et pour celles qui l'exercent de façon effective et habituelle, tout en se livrant à d'autres activités pour le compte d'un ou plusieurs employeurs. Elle n'est pas exigée, en revanche, des agents commerciaux, qui sont des mandataires, non liés à l'entreprise par un contrat de louage de services comme l'est le représentant, tenus seulement de se faire immatriculer sur un registre spécial au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils sont domiciliés. La demande de délivrance de la carte doit être accompagnée de pièces justificatives, notamment d'une attestation de l'employeur certifiant que le postulant exerce bien son activité dans les conditions fixées par la loi. Cette attestation doit être conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du commerce et le ministre de l'industrie. L'attribution de la carte comportant de multiples avantages, notamment fiscaux, les documents fournis doivent permettre un contrôle très strict de la part des services préfectoraux. L'allégement des contraintes qui pèsent sur la profession des vrp avait été annoncé dès le plan de réforme de l'État présenté par le Gouvernement précédent, le 5 novembre 1997. Le Gouvernement sera habilité à la mettre effectivement en œuvre. Le rapporteur souhaite relever que de nombreuses autres professions sont soumises à des contraintes qu'il conviendrait sans doute de réexaminer, à l'exemple des marchands, courtiers, commissionnaires ou importateurs de chevaux (acte dit « loi » du 12 avril 1941) ou encore des commerçants des produits de la mer, en particulier des mareyeurs-expéditeurs (loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948), alors même que la carte n'est plus exigée des importateurs de produits de la mer de puis la loi n° 75-389 du 21 mai 1975. 3. Le régime des commerçants étrangers Les conditions d'établissement et d'exercice des commerçants étrangers méritent d'être assouplies. Le décret-loi du 12 novembre 1938, dont les dispositions sont désormais codifiés aux articles L. 122-1 et suivants du code de commerce, a soumis l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale par un étranger en France à la détention d'une carte de commerçant étranger. Le principe d'une autorisation administrative préalable spécifique aux commerçants étrangers n'a pas été remis en cause par le droit français, le décret n° 98-58 en date du 28 janvier 1998 a aménagé de manière substantielle les règles, modernisant à plusieurs titres le droit applicable. Il a renforcé les facilités d'implantations des commerçants étrangers. Mais il reste des interférences avec les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France fixées par l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 qui nuisent à la lisibilité du dispositif. Plus largement, il conviendrait de supprimer une double formalité. En effet, la plupart des informations demandées pour la carte de commerçant sont redondantes avec les pièces exigées pour les demandes de visa de long séjour et pour l'enregistrement des activités dans les centres des formalités des entreprises. Il s'agirait d'un facteur non négligeable d'attractivité de la France. La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 22) puis l'article 22 ainsi modifié.
3ème
partie du rapport N° 0752 - Rapport sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de codification du droit (M. Etienne Blanc) 1 () Voir, par exemple, la proposition de M. Yves Nicolin tendant à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration, Assemblée nationale, XIe législature, document n° 2349, 26 avril 2000, celle de M. Claude Birraux modifiant l'article L. 71 du code électoral relatif au vote par procuration, Assemblée nationale, XIe législature, document n° 2889, 30 janvier 2001, ou bien celle de M. Christian Cointat tendant à faciliter et à simplifier la procédure de vote par procuration, Sénat, 2001-2002, document n° 307, 22 mai 2002 ou encore celle, plus récente, de notre collègue Éric Woerth, tendant à simplifier la procédure de vote par procuration, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 658 déposée le 5 mars 2003 et celle tendant à simplifier l'exercice du droit de vote par procuration de notre collègue Jean-François Mancel, n° 627, déposée le 13 février 2003. 2 () Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2662 du 24 octobre 2002, Côte-d'Or 5e circonscription. 3 () Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 605, 5 février 2003. 4 () Conseil constitutionnel, décision nos 91-1141/1142/1143/1144 du 31 juillet 1991. 5 () Conseil d'État, Rapport public 2001, Paris, La documentation française, Études et documents du Conseil d'État n° 52, 2001, page 301. 6 () Conseil constitutionnel, décisions du 5 décembre 2002, Bouches-du-Rhône 8e circonscription et Hautes-Alpes 2e circonscription. 7 () Le Sénat a adopté, en première lecture, le 22 mars 2003, la proposition de loi n°43 rectifiée (2002-2003) présentée par M. Robert Del Picchia et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étranger afin d'autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections dudit Conseil. Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée le 27 mars 2003. Elle est devenue la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003. 8 () René Couanau, Le désenchantement hospitalier, rapport d'information sur l'organisation interne de l'hôpital, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 714, 19 mars 2003. 9 () Cour des comptes, Rapport annuel au Parlement sur le financement de la sécurité sociale, septembre 2002. 10 () Conseil d'État, section sociale, avis du 1er août 1995, Rapport public 1995, Paris, La documentation française, page 476. 11 () Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises : voir notamment article 76 de la loi de finances pour 1969 n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et article 35 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. 12 () M. Yves Bur, Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, tome 1 - Recettes et équilibre général., Assemblée nationale, XIIe législature, n° 330, 24 octobre 2002. 13 () M. Jean-Marie Bockel, Rapport au Premier ministre sur la simplification de la création d'entreprise, de la vie des créateurs et de la gestion de leurs entreprises, 23 janvier 2001, page 44. 14 () M. Jean-Marie Bockel, Rapport au Premier ministre sur la simplification de la création d'entreprise, de la vie des créateurs et de la gestion de leurs entreprises, 23 janvier 2001, page 41. 15 () L'arrêté du 29 juillet 2002 pris en application du I de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale et relatif aux déclarations sociales par voie électronique fournit une liste de sept déclarations susceptibles d'être intégrées dans le dispositif « Impact Emploi » (déclaration unique d'embauche, bordereau récapitulatif des cotisations, déclaration nominative trimestrielle des particuliers employeurs...). 16 () Cour de cassation, chambre sociale, 7 avril 1976. 17 () Cour de cassation, chambre sociale, 31 octobre 1989. 18 () Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 1998. 19 () Cf. M. Patrice Maynial, Rapport au Premier ministre : le droit du côté de la vie, réflexions sur la fonction juridique de l'État, 1997. 20 () Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 21 () Loi modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail. 22 () Il existe également un nantissement judiciaire grâce auquel le créancier qui n'a pas pris la précaution de se faire accorder un gage conventionnel peut, s'il a des craintes pour le recouvrement de sa créance, demander au juge de lui procurer, à titre conservatoire, un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur. Créé par la loi du 12 novembre 1955, il a été réformé par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. 23 () Notamment par les lois n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives et n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 24 () M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste et apparentés, Proposition de loi relative aux sociétés coopératives de commerçants, Assemblée nationale, XIe législature, document n° 1709, 16 juin 1999. 25 () Cet article résulte de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il a été modifié par l'article 52 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 26 () Commission européenne, décisions n° 68/318, 17 juillet 1968, SOCEMAS, et n° 69/152, 5 mai 1969, Convention Chaufourniers. 27 () Voir, par exemple, Cour d'appel de Paris, 7 juillet 1995 et 18 mars 1997 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 1993. 28 () Rapport sur les obstacles à l'expansion économique présenté par le Comité créé par le décret n° 59-1284 du 13 novembre 1959. © Assemblée nationale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||