2ème séance : Débat sur les conclusions des sommets européens du 26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011; Budget 2012 (2ned partie) : Défense
- Aller au menu
- Aller au contenu
- Aller à la recherche
- Politique d’accessibilité
- Accueil
- Plan du site
- Aide
- Contact
Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > M. Jean-Claude Viollet
M. Jean-Claude Viollet
Charente (1ère circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
- Commission
- Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées
- Biographie
- Né le 9 juin 1951 à Ruelle-sur-Touvre (Charente)
- Assistant technique des travaux publics de l'Etat
- Suppléant
- M. Michel Boutant
- Contact

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Navigation
- Vous êtes ici: Actualité
- Fonctions
- Historique
- Contact
Actualité
DERNIÈRES VIDÉOS
-
Vidéo du 9 novembre 2011
Séance publique
-
Vidéo du 3 novembre 2011
Séance publique
3ème séance : PLF 2012 : - Anciens combattants (suite)
-
Vidéo du 18 octobre 2011
Séance publique
1ère séance : Questions orales sans débat
-
Vidéo du 5 octobre 2011
Séance publique
2ème séance : Service citoyen pour les mineurs délinquants (suite)
-
Vidéo du 30 mai 2011
Séance publique
1ère séance: engagement des sapeurs-pompiers volontaires (DG et art 1 à 10 bis)
- Toutes les vidéos de Jean-Claude Viollet
Travaux récents
Question écrite n° 132467 publiée le 01 mai 2012
santé - syndrome de fatigue chronique - prise en chargeM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les regrets que n'ont pas manqué de susciter la non-représentation de la France au sein du comité de consensus international sur l'encéphalomyélite myalgique (EM), également connue sous le terme de syndrome de fatigue chronique (SFC), alors que les malades atteints de cette maladie fondent les plus grands espoirs dans sa reconnaissance et son prochain traitement. En effet, alors que la dénomination « syndrome de fatigue chronique » avait, en l'état des connaissances, persisté de nombreuses années, les recherches les plus récentes et l'expérience clinique plaideraient aujourd'hui pour une inflammation généralisée et une pathologie neurologique multi-systémique, d'où le terme d'« encéphalomyélite myalgique », compatible avec la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans ce contexte qu'un comité de consensus international, composé d'un large éventail de spécialistes issus de treize pays différents, a été constitué dans le but de caractériser des groupes de symptômes de l'encéphalomyélite myalgique, à partir du dérèglement des systèmes nerveux central et immunitaire, des dysfonctionnements du métabolisme cellulaire énergétique et du transport ionique ainsi que des anomalies cardio-vasculaires. Les travaux de ce comité ayant, semble-t-il permis d'avancer sur les symptômes de la maladie, tant en ce qui concerne l'adulte que l'enfant, il lui demande, dans la suite de sa première question n° 100 955 publiée le 22 février 2011 et rappelée le 24 avril 2012, ce qu'il compte faire pour assurer une présence active, sur la durée, de la France dans les recherches en cours sur cette maladie complexe, évolutive et très invalidante.
Voir la questionRéponse à la question écrite n° 60048 publiée le 17 avril 2012
industrie - matériaux de construction - composition. information du consommateurM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les difficultés qui se feraient jour du fait du développement, sans contrôle, de toute une terminologie liée à la préoccupation « développement durable » dans le bâtiment. En effet, diverses appellations telles que « éco-conception », « éco-produits », « éco-matériaux »..., sont actuellement utilisées sans que, en l'absence de tout label ou certification reconnue, les particuliers ou même les professionnels puissent, de manière sûre, vérifier la sincérité des prétentions ainsi affichées et l'impact réel de l'utilisation des produits concernés sur l'environnement. Cette situation serait d'autant plus dommageable qu'elle conduirait même, dans certains cas, au dénigrement de produits dits traditionnels, mis sur le marché par des industriels ayant promu des règles environnementales reconnues comme la démarche HQE (haute qualité environnementale) et la méthode dite de « l'analyse du cycle de vie ». Aussi, il lui demande de quelle manière il entend remédier à cette difficulté, et garantir au consommateur, comme aux différents acteurs de la construction, l'accès à une information détaillée, claire et précise sur les composants et la fabrication des matériaux de construction, à même de permettre une juste évaluation de leur empreinte environnementale.
Voir la réponseRapport d'information n° 4350 déposé le 14 février 2012, publiée le 22 février 2012
Réponse à la question écrite n° 77444 publiée le 21 février 2012
handicapés - politique à l'égard des handicapés - loi n° 2005-102 du 11 février 2005. mise en oeuvre. bilan et perspectivesM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la mise en oeuvre de l'article 13 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, l'article 13 prévoit que, « dans un délai maximum de cinq ans après leur entrée en vigueur, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées ». Or, alors que la loi n° 2005-102 est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 12 février 2005, force de constater que cinq ans après, cette disposition qui visait à abolir le système modulant le montant de l'allocation de compensation du handicap en fonction de l'âge de la personne (plus ou moins de 60 ans) n'aurait toujours pas été mise en oeuvre. Ce faisant, une personne de plus de 60 ans pourrait toujours recevoir une allocation jusqu'à cinq fois moins élevée qu'une personne de moins de 60 ans, à handicap égal. Aussi, considérant que cette inégalité de traitement, désormais contraire à la loi, ne saurait davantage perdurer, il lui demande ce qu'il entend entreprendre pour y remédier.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées
Mardi 14 février 2012 - Séance de 17 heures 30
- -- Examen du rapport d'information sur les sociétés militaires privées (MM. Christian Ménard et Jean-Claude Viollet, rapporteurs).
Réponse à la question écrite n° 125450 publiée le 07 février 2012
bois et forêts - réglementation - loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010. décret d'application. publicationM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre d'une gestion durable de la forêt en l'absence de la publication du décret concernant le statut de gestionnaire forestier professionnel. En effet, la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a créé à l'article L. 224-7 du code forestier, un statut de gestionnaire forestier professionnel auquel les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel pour gérer durablement leurs forêts, conformément à un document de gestion. Ce faisant, le législateur renvoyait au décret la définition des conditions de qualification et d'indépendance de ce nouvel acteur. Or, si un projet a bien été élaboré et soumis pour avis au Conseil d'État qui l'a accueilli favorablement, ce texte n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune publication au Journal officiel. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais sera publié ce décret afin de permettre la mise en place de ce dispositif attendu par l'ensemble des professionnels de la filière.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 116548 publiée le 10 janvier 2012
agroalimentaire - tabacs manufacturés - ventes parallèles. lutte et préventionM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les difficultés résultant de la persistance d'un marché parallèle du tabac dans notre pays, qui représenterait aujourd'hui globalement quelques 20 % de la consommation, qu'il s'agisse des achats hors frontières, des achats de contrebande ou des achats sur internet. Au-delà du fait que l'existence de ce marché parallèle ruine une bonne partie des efforts déployés depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs, toutes sensibilités confondues, en matière de santé publique, ses effets sont majeurs sur l'activité des 28 000 buralistes qui participent au réseau des points de vente de tabac agréés par l'État, pour lequel il induit de surcroît une perte notable de recettes fiscales. S'agissant des achats de contrebande, faits auprès de vendeurs s'inscrivant dans l'illégalité, parfois dans l'ombre de véritables réseaux mafieux et qui représenteraient 30 % du marché parallèle, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire concrètement pour lutter plus efficacement contre ces réseaux, notamment à partir de l'action coordonnée, dans la durée, de l'ensemble des services concernés de l'État.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 117672 publiée le 03 janvier 2012
établissements de santé - centres de soins palliatifs - répartition géographiqueM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conclusions du rapport remis, le 6 juin dernier, au Président de la République par le président du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs. En effet, ce rapport, qui constitue un bilan, à mi-parcours, du programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012, fait apparaître des réalités très contrastées. On y note ainsi que, si l'ensemble des régions dispose d'au moins une unité de soins palliatifs (USP), la répartition des 107 USP existantes, pour un total de 1 176 lits, reste inégale, deux-tiers d'entre elles étant concentrées dans cinq régions qui comptent, à elles-seules, 71 % des lits d'USP alors qu'elles ne représentent que 48 % de la population, pendant que d'autres, dont le Poitou-Charentes, restent sous-dotées, avec 10 lits seulement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Cette inégalité dans la répartition des moyens vaut également pour les 4 800 lits identifiés de soins palliatifs (LISP) implantés dans les services de soins hospitaliers et qui doivent permettre d'atteindre le principal objectif du programme à savoir l'intégration de la démarche des soins palliatifs dans la pratique des professionnels des différentes spécialités médicales. Au-delà des disparités territoriales, le rapport évoque ainsi l'insuffisant développement des LISP en soins de suite et de réadaptation (SSR) - 25 seulement sur 157 en Poitou-Charentes - de même que l'absence de renfort de personnel soignant dans les services concernés, situation pour le moins paradoxale quand on sait que les LISP génèrent d'importantes ressources pour les établissements. Enfin, le rapport conclut à un maillage territorial relativement homogène et satisfaisant, d'une région à l'autre, des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) - 11 en Poitou-Charentes - qui constituent un levier essentiel pour la diffusion de la démarche palliative et son intégration dans la pratique de soins de l'ensemble des professionnels de santé concernés par la fin de vie. Mais il évoque également le fait que les sommes allouées et effectivement notifiées aux agences régionales de santé (ARS) puissent être, dans certaines régions, parfois assez largement amputées lors des délégations aux établissements de santé. Aussi, il lui demande quelles suites il entend donner à ce rapport pour parachever d'ici l'échéance du programme, en 2012, le maillage de l'offre hospitalière en soins palliatifs et la diffusion de la démarche palliative dans les établissements médico-sociaux et à domicile, en corrigeant les insuffisances recensées dans certaines régions et en veillant globalement au suivi des ressources affectées pour éviter les déperditions observées, afin d'en rendre l'accès effectif sur l'ensemble de notre territoire.
Voir la réponseQuestion écrite n° 124793 publiée le 20 décembre 2011
justice - tribunaux de commerce - fonctionnementM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés qu'entraîne l'absence de communication des rapports de contrôles faits par la profession de mandataire de justice au président de la juridiction dans laquelle le mandataire exerce ses fonctions. En effet, chaque mandataire de justice est soumis, tous les trois ans, à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Au-delà, il peut à tout moment être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Les modalités de ces contrôles sont définies aux articles R. 814-40 à R. 814-49 du code de commerce. Ainsi, le contrôle est effectué par trois contrôleurs : deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé et un commissaire aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. En vertu de l'article R. 814-48 du code de commerce, si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national. Pour les contrôles ne révélant pas d'irrégularités, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement de leur mission, un projet de rapport qu'ils adressent au professionnel contrôlé qui dispose d'un mois pour formuler ses observations, à la suite de quoi est établi un rapport définitif qui est adressé au président du Conseil national et aux autres autorités déjà citées. Mais, en l'état de la réglementation, le président de la juridiction dans laquelle exerce le mandataire n'est en aucun cas informé du résultat des contrôles opérés, y compris quand des irrégularités ont été constatées, qui pourraient justifier une prise de précaution de la juridiction quant aux dossiers qui lui ont déjà été confiés ou seraient susceptibles de l'être, afin d'éviter que ses manquements et abus éventuels prospèrent. Aussi, cette situation étant source de difficultés importantes, il lui demande s'il entend modifier l'article R. 814-48 du code de commerce, afin d'assurer l'information des présidents de tribunaux de commerce sur les résultats des contrôles opérés sur les mandataires de justice, pour qu'ils soient en mesure de veiller à la bonne application de la loi dans leurs juridictions et à la préservation de la sécurité juridique des actes édictés en leur sein.
Voir la questionRéponse à la question écrite n° 119358 publiée le 08 novembre 2011
automobiles et cycles - réparation automobile - carrossiers-réparateurs. revendicationsM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les difficultés qui persisteraient pour l'exercice du libre choix, par les assurés, de leur réparateur automobile dès lors que celui-ci intervient dans une procédure mettant en cause une assurance. En effet, la charte de bonne conduite signée en 2008 entre les compagnies d'assurance et les professionnels de la réparation automobile rappelle que « le libre choix du réparateur par l'assuré constitue un principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs ». Toutefois et alors que la charte indique seulement que, dans ce cadre, « l'assureur peut proposer des réparateurs à l'assuré », il apparaît, dans les faits, d'une part que nombre d'assurés ignorent leur droit au libre choix du réparateur et, d'autre part, que la pratique d'agrément de réparateurs, assortie du règlement direct de la réparation par les assurances, font de celles-ci un prescripteur de fait. Le principe même de concurrence libre et non faussée s'en trouverait mis en cause, puisque, selon la profession, environ 80 % des réparations indemnisées seraient aujourd'hui réalisées par des réparateurs agréés, avec une soumission croissante de la profession aux contraintes fixées par les assurances, notamment en termes de prix mais également de délais. Aussi, cette situation, au demeurant contraire à l'esprit comme à la lettre de l'engagement pris par les assureurs avec les réparateurs, étant de nature à remettre en cause l'existence même de certaines de ces entreprises artisanales qui participent à la vie de nos territoires - les premiers effets s'en faisant déjà sentir en terme de salaires ou de conditions de travail -, il lui demande ce qu'entend faire le Gouvernement pour y remédier, s'agissant notamment de l'information des assurés.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 117725 publiée le 11 octobre 2011
industrie - réglementation - équipements sous pressionM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés qui persisteraient, selon les professionnels du froid et du conditionnement d'air pour la mise en oeuvre de la directive n° 97-23-CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression. Selon ces professionnels, les dispositions prises pour la transcription en droit français de cette directive, s'agissant tant du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 que de l'arrêté du 15 mars 2000, modifié en mars 2005 puis en janvier 2011, poseraient notamment problème pour les installations déjà existantes et qui ont été modifiées depuis leur mise en place. Mais au-delà même, elles constitueraient également un certain nombre de contraintes difficiles à respecter pour les matériels neufs et susceptibles d'entraîner, dans l'un et l'autre cas, une interdiction pure et simple d'usage à la suite des contrôles susceptibles d'être opérés par les services compétents, ce qui ne manquerait pas de constituer un préjudice grave pour les utilisateurs. Aussi, ces dispositions réglementaires devant encore évoluer au 1er décembre 2011, il lui demande de lui faire connaître quels aménagements elle entend y apporter, à l'instar de ce qui semble avoir été déjà fait par plusieurs de nos partenaires européens, pour tout à la fois progresser dans le sens de la directive et préserver les activités concernées, déjà pénalisées par la crise que nous connaissons.
Voir la réponseQuestion écrite n° 117904 publiée le 13 septembre 2011
sports - manifestations sportives - épreuves sur la voie publique. réglementationM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les inquiétudes qu'a fait naître, dans le mouvement sportif, l'évocation d'un projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique et qui pourrait, s'il était publié en l'état, poser des difficultés sérieuses dans son application. La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, qui conditionne l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives à leur inscription préalable sur le calendrier établi, pour chaque sport, au niveau départemental, régional ou national par les fédérations agréées, selon les prérogatives dont elles jouissent de par les articles L. 235-1 et R. 131-26 de ce même code. En effet, cette façon de procéder, qui permet jusque là aux fédérations d'avoir connaissance de l'ensemble des évènements à intervenir, renforce leur rôle d'animation et de coordination du mouvement sportif dans leur champ de compétence, ce qui en fait, en cette matière, des interlocuteurs utiles et appréciés des collectivités territoriales comme des services de l'État et notamment des préfectures. Ce faisant, la suppression de l'actuel article R. 331-9 conduirait à affaiblir l'ensemble du mouvement sportif tout en compliquant inutilement la tâche aux collectivités territoriales comme aux services de l'État et notamment aux préfectures qui auraient à gérer le fait que toute personne - physique ou morale - pourrait prétendre à l'organisation d'une manifestation sportive sur voie publique, pour autant que la remise de prix y soit inférieure à 3 000 euros. Mais une deuxième difficulté, et non la moindre, résulterait dans le fait que la nouvelle rédaction de l'article R. 331-9 ne ferait plus obligation, dans ce cadre nouveau, d'une vérification systématique, pour toute manifestation sportive sur voie publique, de la conformité de son règlement particulier aux règles techniques et de sécurité établies par la fédération délégataire de la discipline concernée, jusque là agréées par les autorités ministérielles compétentes. La situation se compliquerait encore avec les autres dispositions figurant au projet de décret et tenant aux seuils de participants en-dessous desquels, suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, introduit les collectivités territoriales pour l'organisation de la sécurité du public et de la circulation, ce qui, ajouté à la suppression de bases de calcul des redevances correspondant à la mise en place d'un service d'ordre exceptionnel nécessaire pour ce faire, jusque là fixées par le ministre concerné, s'agissant de l'État, pourrait faire craindre une augmentation des coûts pour les organisateurs. C'est pourquoi il lui demande si elle entend, à tout le moins, réviser ce projet de décret, en concertation avec le mouvement sportif dont les prérogatives en la matière méritent d'être préservées, à défaut même d'être encore renforcées.
Voir la questionQuestion écrite n° 116740 publiée le 23 août 2011
commerce et artisanat - débits de tabac - gérants. contrats d'avenir. perspectivesM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation des 28 000 buralistes en activité dans notre pays, entrepreneurs individuels au double statut de commerçant indépendant et de préposé de l'administration, lorsqu'ils participent au réseau des points de vente de tabac agréés par l'État ou proposent d'autres produits de services publics (vente de timbres fiscaux, paiement d'amendes, etc.). En effet, ce réseau au « maillage » encore assez dense, puisqu'on comptait en moyenne 300 buralistes par département en 2010 et qui est, avec ses 110 000 emplois et ses 10 millions de clients accueillis quotidiennement, un acteur majeur de l'aménagement et du développement durable de nos territoires, est depuis des années confronté à un certain nombre de difficultés qui ont déjà conduit à la mise en oeuvre par l'État de dispositifs de soutien à travers deux « contrats d'avenir » signés en 2003, puis en 2006. Le dernier contrat en date prévoyait notamment un crédit d'impôt, effectif depuis 2007, pour la modernisation des bureaux de tabac, une évolution de la rémunération des buralistes sur la vente de tabac, la prolongation des aides mises en place en 2003 pour les frontaliers souffrant du marché parallèle encouragé par les distorsions de prix avec les pays voisins et un engagement de l'État à mettre en place la dématérialisation du paiement du timbre amende. Mais la profession, qui reconnaît l'apport qu'ont constitué ces aides, fruits d'une négociation qui s'est poursuivie en cours d'exécution du contrat et à l'issue de laquelle un avenant a été signé en octobre 2008, s'interroge aujourd'hui sur les suites susceptibles de leur être données à son terme en décembre 2011, sachant que près de 4 000 points de vente ont disparu depuis 2003. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser quelles orientations le Gouvernement entend proposer à la discussion sur les suites du « contrat d'avenir » 2008-2011, s'agissant notamment de la reconduction des aides déjà existantes, de l'évolution de la rémunération des buralistes sur les ventes de tabac mais aussi des produits de la Française des jeux et enfin pour développer leur activité de « relais de services publics ».
Voir la questionQuestion écrite n° 116547 publiée le 16 août 2011
agroalimentaire - tabacs manufacturés - ventes parallèles. lutte et préventionM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les difficultés résultant de la persistance d'un marché parallèle du tabac dans notre pays, qui représenterait aujourd'hui globalement quelques 20 % de la consommation, qu'il s'agisse des achats hors frontières, des achats de contrebande ou des achats sur Internet. Au-delà du fait que l'existence de ce marché parallèle ruine une bonne partie des efforts déployés depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs, toutes sensibilités confondues, en matière de santé publique, ses effets sont majeurs sur l'activité des 28 000 buralistes qui participent au réseau des points de vente de tabac agréés par l'État, pour lequel il induit de surcroît une perte notable de recettes fiscales. S'agissant des achats sur Internet, qui représenteraient 20 % du marché parallèle, officiellement interdits mais qui seraient en augmentation constante, il lui demande ce qu'entend faire le Gouvernement pour y mettre fin, en bloquant notamment l'activité dans ce domaine des quelques 400 sites accessibles depuis la France qui, selon l'Observatoire de prévention du tabagisme, proposeraient frauduleusement de la vente de tabac en ligne.
Voir la questionQuestion écrite n° 116546 publiée le 16 août 2011
agroalimentaire - tabacs manufacturés - ventes parallèles. lutte et préventionM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les difficultés résultant de la persistance d'un marché parallèle du tabac dans notre pays, qui représenterait aujourd'hui globalement quelques 20 % de la consommation, qu'il s'agisse des achats hors frontières, des achats de contrebande ou des achats sur Internet. Au-delà du fait que l'existence de ce marché parallèle ruine une bonne partie des efforts déployés depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs, toutes sensibilités confondues, en matière de santé publique, ses effets sont majeurs sur l'activité des 28 000 buralistes qui participent au réseau des points de vente de tabac agréés par l'État, pour lequel il induit de surcroît une perte notable de recettes fiscales. S'agissant des achats hors frontières, encouragés par les différentiels de prix observés avec nos voisins de l'Union européenne et qui représenteraient 50 % du marché parallèle, il lui demande si le Gouvernement entend renforcer les contrôles douaniers pour s'assurer du respect des dispositions en vigueur et notamment des articles 575 G et H du Code général des impôts qui limitent le transport du tabac en France par les particuliers.
Voir la questionQuestion écrite n° 116434 publiée le 09 août 2011
handicapés - allocations et ressources - cumul avec les revenus d'une activité professionnelleM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les conditions de cumul d'une activité professionnelle et des prestations sociales accordées aux personnes handicapées. En effet, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale dont l'objet est, en vertu de l'article L. 821-1 du code de sécurité sociale, de garantir un revenu minimum d'existence à toute personne handicapée qui ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins équivalent. Le décret n° 2010-307 du 22 mars 2010 relatif à la revalorisation de l'AAH a porté son montant à 711,95 euros au 1er septembre 2010 avec un plafond de ressources, pour une personne isolée, fixé à 854,34 euros. Au-delà, l'article L. 821-1-1 du même code, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dispose que « le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés [...] qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ». Enfin, il est ajouté à l'article L. 821-3 que « l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé [...] dans la limite d'un plafond fixé par décret ». Toutefois, les règles en vigueur pour le cumul de ces prestations avec les ressources obtenues grâce à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent s'avérer, dans la réalité et au regard des circonstances, particulièrement iniques. Ainsi, une personne âgée de 28 ans, atteinte d'un handicap moteur, dont le taux d'invalidité est supérieur à 80 % et la capacité de travail inférieure à 5 %, bénéficiait de l'AAH à taux plein et du complément de ressources, pour un montant global de 891,26 euros par mois. Cette personne ayant été recrutée pour exercer ponctuellement une activité pédagogique, la déclaration des 492 euros perçus à ce titre sur l'ensemble de l'année 2009 a conduit à la réduction du montant de l'AAH qu'elle percevait jusque-là, ce qu'elle ne contestait pas. Mais au-delà même cette personne s'est vue supprimer le complément de ressources, tant et si bien que ne percevant plus désormais que 706,78 euros d'allocation par mois, l'exercice d'une activité l'aura finalement conduit à une perte de ressources de plus de 2 200 euros, sur un revenu annuel de moins de 11 000 euros. Aussi, cette situation, qui ne serait pas isolée, lui semblant tout à la fois profondément injuste et contraire même à la volonté affichée de favoriser pour les personnes handicapées l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière, y compris par l'accès à l'activité, il demande ce qu'elle entend entreprendre pour remédier à cette difficulté.
Voir la questionQuestion écrite n° 107667 publiée le 10 mai 2011
automobiles et cycles - réparation automobile - pièces de rechange. politiques communautairesM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences économiques du monopole des constructeurs automobiles dans le domaine des pièces détachées de carrosserie. Selon l'étude récemment conduite par une association de consommateurs, le prix des pièces détachées de carrosserie aurait augmenté de 26 % entre 2005 et 2010, alors que dans le même temps, les prix à la consommation n'ont varié que de 7,63 %. Selon cette étude, ce dérapage tarifaire s'expliquerait, pour partie, par le monopole des constructeurs sur ce marché, qui contrôlent tant la production que la commercialisation de ces éléments. Pour preuve les économies importantes réalisées en achetant dans des pays européens voisins des pièces « alternatives », de qualité équivalente à celles proposées par les constructeurs en France. Pour dépasser cette situation, la Commission européenne a proposé un projet de directive (2004-0203) visant à libéraliser le marché de la pièce de carrosserie de rechange, en instaurant une « clause de réparation ». Mais, après un vote favorable du Parlement européen, l'entrée en vigueur de ce texte resterait aujourd'hui bloquée en raison du refus du Conseil des ministres de l'Union européenne de se prononcer sur ce sujet. Cette situation est hautement préjudiciable au pouvoir d'achat de nos concitoyens, de manière directe, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes un achat de pièces détachées de carrosserie pour leur automobile, ou de manière indirecte, à travers leur prime d'assurance, les éléments de carrosserie, majoritairement payés par les assurances à la suite d'accidents de la route, ayant représenté 47,3 % du coût total de la réparation automobile en 2010. Aussi, il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier, entre un soutien à l'adoption de la « clause de réparation » que propose d'instituer le projet de directive européenne visant à libéraliser le marché de la pièce détachée de carrosserie automobile et une action auprès des constructeurs automobiles pour qu'ils consentent à revenir à des conditions de prix correspondant davantage à la réalité des coûts de production et de commercialisation qu'ils supportent.
Voir la questionQuestion écrite n° 100955 publiée le 22 février 2011
santé - syndrome de fatigue chronique - prise en chargeM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique (SFC), également connu sous le terme d'encéphalomyélite myalgique (EM-SFC). Cette pathologie évolutive, caractérisée par une asthénie importante et invalidante, qui affecterait près de 20 millions de personnes dans le monde, a pour conséquence une perte d'autonomie de 30 % à 80 % pour les personnes qui en souffrent. Or, en raison de la complexité même de ses symptômes et malgré le développement, ces vingt dernières années, de la recherche en la matière, aucune définition diagnostique n'avait pu jusqu'ici être précisément établie, limitant de fait les moyens susceptibles d'être mobilisés pour la prise en charge des patients. Toutefois, un espoir est né avec la découverte du virus XMRV, troisième rétrovirus infectieux humain connu - les deux premiers étant le VIH, responsable du sida et le HTLV, responsable de certaines leucémies - dans le sang de 67 % des 101 personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique testées, alors qu'il n'est présent que chez 3,7 % des sujets contrôlés sains. À ce stade, les chercheurs estiment avoir découvert "une association hautement significative" entre le XMRV et le syndrome de fatigue chronique mais ces travaux doivent encore être vérifiés, le virus XMRV pouvant n'être qu'une des causes de la maladie et beaucoup reste à faire pour comprendre les mécanismes en oeuvre dans l'apparition et le développement de cette pathologie avant de pouvoir, le cas échéant, la traiter. Aussi, il lui demande de lui préciser quelles dispositions concrètes il compte prendre pour soutenir dans la durée la recherche sur cette maladie et, sans attendre son aboutissement, améliorer l'accompagnement médico-social des personnes qui en souffrent et de leurs familles.
Voir la questionQuestion écrite n° 98243 publiée le 25 janvier 2011
communes - DGF - calculM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés que rencontreraient un certain nombre de communes, telle celle de La Couronne, en Charente, du fait des règles de calcul actuellement en vigueur pour la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment de la composante dénommée « complément de garantie » de la dotation forfaitaire la constituant. En effet, la dotation forfaitaire, socle de la DGF versée aux communes, se compose de quatre sous-ensembles reposant, depuis 2005, sur des critères précis : une dotation de base par habitant, une part proportionnelle à la superficie, une part correspondant à l'ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu'à la compensation des baisses de DCTP, intégrées depuis 2004 dans la dotation forfaitaire, et le complément de garantie en question. Ce complément de garantie était censé assurer aux communes, en 2005, le montant de leur dotation forfaitaire de 2004 indexé de 1 %. Au-delà, la loi de finances pour 2007 a introduit un système de double indexation du complément de garantie qui fait que les communes dont le complément de garantie par habitant perçu l'année précédente est supérieur à 1,5 fois le complément de garantie moyen par habitant voient celui-ci gelé. Ce faisant, le montant de la DGF, qui prend en compte le potentiel fiscal des communes fondé sur les quatre taxes d'habitation, sur le foncier - bâti et non bâti - et professionnelle, résulte de leurs caractéristiques du moment mais également d'éléments historiques qui conditionnent le montant du complément de garantie. Or, dans le cas de la commune de La Couronne, appartenant à la communauté d'agglomération du grand-Angoulême, qui perçoit aujourd'hui la taxe professionnelle, il apparaît que ce mode de calcul ne correspond plus à la capacité financière réelle de la commune qui, en proie à d'importantes difficultés en termes d'activités économiques et d'emplois, ne peut faire face à l'augmentation de ses dépenses sociales, en même temps qu'elle est engagée dans d'autres chantiers importants et porteurs d'avenir, autour de la croissance verte et des éco-industries notamment. Aussi, la situation de la commune de La Couronne ne devant pas être isolée, il lui demande de lui faire connaître son appréciation sur cette situation et de lui indiquer, le cas échéant, de quelle manière il envisage d'y remédier.
Voir la questionQuestion écrite n° 44693 publiée le 17 mars 2009
urbanisme - rénovation urbaine - dotations budgétaires. conséquencesM. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés que rencontreraient aujourd'hui des communes engagées dans des opérations de renouvellement urbain (ORU). En effet, les ORU s'adressent à des communes qui cumulent des difficultés financières et d'habitat, caractérisées par une absence d'offre locative adaptée et/ou l'existence d'un habitat dégradé devant faire l'objet de réhabilitations lourdes ou d'opérations de démolition-reconstruction particulièrement importantes, souvent accompagnées d'actions coûteuses, comme le retraitement d'espaces publics, ou l'implantation de nouvelles infrastructures. Or la mise en oeuvre de ces ORU, du fait même de cette reconfiguration de l'offre de logement se traduit souvent par une baisse, parfois significative, de la population, laquelle a un effet mécanique de diminution des dotations d'État (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine, fonds de péréquation), versées en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de ratios par habitants qui, comparés à des moyennes nationales, deviennent défavorables à la commune concernée, en même temps qu'elle entraîne des pertes de bases de taxe d'habitation et sur le foncier bâti, et, par effet induit, un moindre rendement de la fiscalité des ménages. Ce faisant, alors que les communes concernées engagent des moyens considérables pour que ces ORU, à très fort enjeu social, se déroulent dans les meilleures conditions possibles de réussite, l'État, qui, d'une main, met en jeu des financements importants par l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), en reprend immédiatement, de l'autre, une grande partie par la diminution sensible des ressources affectées dans le cadre général de l'enveloppe normée et celui particulier de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Dans le même temps, lorsque les ORU entraînent des surcoûts non prévus par les conventions initialement conclues entre les villes et l'ANRU, les dépassements sont à la charge de la seule collectivité, maître d'ouvrage. Aussi, une telle situation étant susceptible de mettre gravement en difficulté un certain nombre de communes, contraintes, du fait de cette baisse de leurs ressources, de remettre en cause un certain nombre de leurs politiques au service de l'ensemble de leur population, ce qui serait pour le moins paradoxal, il lui demande de lui indiquer de quelle manière il entend, pour le succès de ces politiques publiques que sont les ORU, maintenir, tout pendant la durée contractuellement fixée pour leur réalisation matérielle et financière, le pacte de stabilité en faveur des collectivités concernées.
Voir la question
Fonctions
Mandat
- Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))
Commissions
- Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées
Groupes d'études
- Co-Président : - Défense
- Vice-Président : - Aéronautique - Imprimerie et culture papier - Maladies orphelines - Réserve citoyenne - Route et sécurité routière
- Secrétaire : - Forêt
- Membre : - Alimentation et santé - Artisanat et métiers d'art - Chasse et territoires - Cheval - Cinéma et production audiovisuelle - Commerce des armes légères et de petit calibre - Construction et logement - Croissance en Afrique - Dépendance - Eco-construction - Elevage - Enfant - Fonction publique - Intégration des personnes fragilisées et handicapées - Jardins, paysages et horticulture - Médicament et produits de santé - Mondialisation : régulations économiques et sociales - Musique - Partenariats publics et privés - Pauvreté, précarité et sans abri - Pénibilité du travail et maladies professionnelles - PME - Prisons et conditions carcérales - Professions de santé - Santé environnementale - Sport et éducation sportive - Textile - Tibet - Toxicomanie - Trufficulture - Vie associative et bénévolat - Villes d'art et d'histoire
Contact
Mél et site internet
Adresses
Assemblée nationale
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Téléphone : 01 40 63 04 52
Télécopie : 01 40 63 04 82
13 Boulevard de Bury
16000 Angoulême
Téléphone : 05 45 93 13 70
Télécopie : 05 45 93 13 71
Historique
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
- Élu le 01/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)
- Réélu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
Anciens mandats locaux
- Conseil municipal d'Angoulême (Charente)
- du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Membre)
- du 19/03/2001 au 16/03/2008 (Membre)
- Conseil municipal d'Angoulême (Charente)
Place dans l’Hémicycle
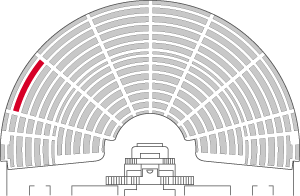
Numéro de la place occupée : 553
(la zone en rouge situe le banc)





