3ème séance : Simplification du droit et allègement des démarches administratives (nouvelle lecture)
- Aller au menu
- Aller au contenu
- Aller à la recherche
- Politique d’accessibilité
- Accueil
- Plan du site
- Aide
- Contact
Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > M. Étienne Blanc
M. Étienne Blanc
Ain (3ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
- Commission
- Membre de la commission des lois
- Biographie
- Né le 29 août 1954 à Givors (Rhône)
- Avocat
- Suppléant
- M. Olivier de Seyssel
- Contact

Union pour un Mouvement Populaire
Navigation
- Vous êtes ici: Actualité
- Fonctions
- Historique
- Contact
Actualité
DERNIÈRES VIDÉOS
-
Vidéo du 31 janvier 2012
Séance publique
-
Vidéo du 15 septembre 2010
Séance publique
1ère séance : Réforme des retraites (Vote solennel); Âge des magistrats ; Réforme des collectivités territoriales (Deuxième lecture)
- Toutes les vidéos de Étienne Blanc
Travaux récents
Question écrite n° 131825 publiée le 10 avril 2012
retraites : régimes autonomes et spéciaux - professions libérales : cotisations - médecins. emploi à temps partielM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'opportunité que pourrait présenter la création d'un statut spécial pour les médecins qui entendent prendre leur retraite mais qui souhaiteraient conserver une activité à temps partiel. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, les médecins qui souhaitent exercer cette activité à temps partiel n'y ont aucun intérêt au regard de l'importance des charges fiscales et sociales et du peu d'avantages financiers qu'ils pourraient en retirer. En effet, les médecins conservent des charges fixes qui ne peuvent être amorties sur une activité réduite. Au regard de la pénurie de médecins qui affecte tant la médecine de ville que la médecine hospitalière, il souhaite interroger le Gouvernement sur l'opportunité de la mise en oeuvre d'un statut fiscal et social particulier qui pourrait permettre de répondre à cette préoccupation.
Voir la questionRéponse à la question écrite n° 122578 publiée le 10 avril 2012
mort - pompes funèbres - modèles de devis. arrêté. contenuM. Étienne Blanc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la conformité des devis fournis par les prestataires d'opérations funéraires. En effet, l'UFC-Que choisir de l'Ain vient de rendre public les résultats d'une enquête menée dans sept magasins funéraires du département de l'Ain sur la bonne application de leurs obligations légales par les professionnels. Malgré la réforme de 2008 qui renforce l'information du consommateur et la mise en place d'un modèle de devis obligatoire (arrêté du 23 août 2010), les magasins funéraires ne se plient toujours pas aux règles de la transparence. Ainsi, dans un cas sur sept, aucun devis n'est communiqué aux familles, et aucun des devis récoltés ne respecte les modèles de devis obligatoires. Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession, s'établit à 3 522 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d'un opérateur à l'autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2 770 euros pour le plus économique à 4 633 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées : c'est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une fourchette de 55 euros à 263 euros alors qu'il s'agit d'opérations standardisées. Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n'utilisant pas le modèle de devis obligatoire. Il serait également opportun d'élaborer un livret d'information sur les obsèques qui serait mis à disposition des familles dans les mairies et les établissements de soins. La direction générale des collectivités locales pourrait fort bien établir un tel livret après consultation du Conseil national des opérations funéraires. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier aux dysfonctionnements constatés par l'UFC-Que Choisir.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 121456 publiée le 03 avril 2012
coopération intercommunale - EPCI - loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. mise en oeuvreM. Étienne Blanc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur les dispositions, introduites par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, relatives au transfert des pouvoirs de certains pouvoirs de police spéciale des maires au profit du président d'un EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales). En effet, en matière de déchets ménagers, l'article L. 5211-9-2 I § 2 du code général des collectivités territoriales précise que, sans préjudice des pouvoirs de police administrative générale du maire, sont transférés au président de l'EPCI compétent en matière de gestion des déchets ménagers, " les attributions lui permettant de réglementer cette activité " et ce, par dérogation à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. La référence à cette dernière disposition, et donc aux dispositions réglementaires d'application (articles R. 2224-23 et suivants du CGCT), permet donc de transférer au président de l'EPCI les pouvoirs de police afférents à la réglementation en matière de déchets ménagers (présentation des déchets, collectes séparatives, périodicité des collectes, conditions de collectes des déchets volumineux). En revanche, les dispositions du code de l'environnement relatives aux pouvoirs de police spéciale en matière de dépôts de déchets sauvages (article L. 541-3 du code de l'environnement) ne sont pas expressément visées par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier l'état du droit sur ce point et de lui préciser si les pouvoirs de police spéciale, prévus par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, relatifs aux dépôts de déchets sauvages sont inclus dans le transfert des pouvoirs de police en matière de déchets ménagers tels que visés par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Voir la réponseQuestion écrite n° 129577 publiée le 06 mars 2012
culture - financement - recettes fiscales. opacitéM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question du dispositif de financement de la culture en France. En effet, le système de financement de la culture tel qu'il existe actuellement n'offre pas de visibilité sur l'ensemble des revenus prélevés sur les consommateurs, ni sur l'affectation exacte de ces recettes. En France, le consommateur participe activement au financement de la culture au moyen de différents prélèvements directs, comme la copie privée, mais aussi indirects, à l'instar des nombreuses taxes sur les opérateurs internet. Le montant de la redevance pour copie privée est de 2,60 € en France, contre 1,50 € en Allemagne et 0,67 € en moyenne dans l'Union européenne, soit, pour la France, 70 % du prix de vente d'un CD ou d'un DVD vierge, comme le rappelle le collectif chere-copie-privee.org, dont fait partie l'UFC-Que choisir. Ce phénomène encourage les consommateurs à se tourner vers des modes d'approvisionnement permettant d'éviter cette redevance. De plus, les recettes sont affectées de manières très hétérogènes et empruntent parfois des circuits complexes, jonchés de multiples guichets. La Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits dénonce régulièrement le peu de transparence de ces institutions. Pourtant, nombre de rapports continuent de proposer des taxes supplémentaires afin de financer les infrastructures ou la création. Ce constat appelle une évaluation rapide des dispositifs dans leur intégralité, afin de cerner l'ensemble des revenus prélevés sur le consommateur et le système économique, ainsi que la manière dont ils sont affectés. Cette question est essentielle dans la mesure où le consommateur accepte de moins en moins une surenchère fiscale sans contrepartie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement entend améliorer la transparence de ces dispositifs, et partant asseoir une politique culturelle cohérente et ambitieuse.
Voir la questionRapport d'information n° 4421 déposé le 29 février 2012, publiée le 05 mars 2012
Intervention en séance publique
Première séance du mercredi 29 février 2012
- 1. Débat préalable au Conseil européen
- 2. Protection de l'identité (lecture définitive) (n° 4393)
- 3. Simplification du droit et allègement des démarches administratives (lecture définitive) (n° 4367)
- 4. Exécution des peines (lecture définitive) (n° 4410)
- 5. Ordre du jour de la prochaine séance
Intervention en réunion de commission
Compte rendu de réunion de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
Mercredi 29 février 2012 - Séance de 10 heures
- - Examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation relatif à l'exécution des peines en vue de sa lecture définitive (n° 4410) (M. Jean-Paul Garraud, rapporteur)
- - Audition, ouverte à la presse, de M. François Werner, directeur général du Fonds de garantie
- - Présentation du rapport d'information de M. Étienne Blanc, rapporteur de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures
- - Présentation, par M. Jean-Luc Warsmann, du bilan d'activité de la commission des Lois pour la XIIIe législature
Rapport n° 4397 déposé le 22 février 2012, publié le 27 février 2012
Travail : simplification du droit et allègement des démarches administratives
Voir le document Voir le dossier législatifQuestion écrite n° 127826 publiée le 07 février 2012
Parlement - ordre du jour - droits et protection des consommateurs. projet de loi. inscriptionM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le calendrier de discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. En effet, le Fonds monétaire international a déploré, fin janvier 2012, le retard pris par ce texte qu'il estime bénéfique pour la concurrence dans les services. Le FMI relève notamment les avancées que permet le projet de loi en matière de commerce, d'énergie, de télécommunications et de logement. Alors que le projet de loi a été adopté au mois de juin 2011 par le conseil des ministres, il n'a toujours pas été débattu en deuxième lecture, ce qui lui laisse des chances réduites d'être adopté avant la fin de la législature. Or il serait regrettable qu'un texte qui fait significativement évoluer les droits des consommateurs et dynamise la concurrence dans de nombreux secteurs ne puisse arriver au terme de la procédure législative. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire aboutir rapidement les principales dispositions de ce projet de loi.
Voir la questionQuestion écrite n° 127959 publiée le 07 février 2012
sociétés - sociétés d'exercice libéral - dirigeants. statutM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les disparités et les incohérences qui paraissent caractériser le statut social et le statut fiscal des personnes physiques exerçant leurs activités libérales (d'avocats ou de médecins par exemple) dans le cadre d'une société d'exercice libéral (à responsabilité limitée - SELARL - ou par actions simplifiée - SELAS - ou à forme anonyme - SELAFA -) dont ils sont par ailleurs associés voire dirigeants. En effet, du point de vue fiscal il est acquis que les associés, ainsi que les dirigeants de SELAS ou de SELAFA et les gérants non majoritaires de SELARL, sont soumis au régime fiscal des traitements et salaires (cf. CGI art. 1655 quinquies et DB 4-H-3-94, paragraphe 7, p. ex. pour les SELAS). Pareillement, ceux des associés qui sont mandataires sociaux sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (v. par ex. code séc. soc. art. L. 311-3, 23°, nouveau pour les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SELAS). En outre, selon les principes généraux du régime général, les dirigeants de SAS et SELAS n'étant pas assujettis au régime général lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération (cass. soc. 1er mars 1967, BC IV n° 197). Par ailleurs, le fait de ne pas percevoir de rémunération ne peut avoir pour conséquence de conférer au dirigeant la qualité de travailleur indépendant (cass. soc. 1er février 1989, n° 86-17704). Or certains services locaux des URSSAF, se fondant sur une circulaire n° 2010-001 relative aux modifications de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, à la détermination du caractère majoritaire de la gérance et à l'extension de la liste des bénéficiaires, considèrent que l'article 76 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et d'allègement des procédures ayant modifié les 11°, 12°, 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les dirigeants de SELAS sont affiliés au régime général par détermination de la loi, mais qu'en application de cette disposition (sic), il convient d'effectuer une distinction entre la rémunération des fonctions de mandataire social de SELAS qui désormais relèvent sans ambiguïté du régime général des salariés (URSSAF) et la rémunération de ces mêmes personnes lorsqu'elles exercent leur activité libérale qui relève du régime des travailleurs non salariés (TNS donc RSI), situation qui serait également celle de tous les associés ou actionnaires, même minoritaires. Étant observé que, dans un arrêt du 20 juin 2007, la Cour de cassation (pourvoi n° 06-17146 Bouvier publié à la RJS 12-07, n° 1329) a confirmé la possibilité de double affiliation par un pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire d'analyse médicale exploité par une SELAFA, d'une part, au régime des non salariés au titre de l'activité libérale, d'autre part, au régime général au titre des fonctions de mandataire social, et ce en dépit du fait qu'il était actionnaire minoritaire et titulaire d'un contrat de travail salarié, il s'avère donc nécessaire de procéder, dans les meilleurs délais possibles, à l'harmonisation du régime fiscal et du régime social des rémunérations versées aux professions libérales exerçant sous forme de SEL, et d'exclure à l'avenir l'obligation de deux immatriculations séparées à la sécurité sociale (URSSAF et RSI) pour une même personne exerçant cumulativement une activité professionnelle et des fonctions de mandataire social au sein d'une structure sociétaire (SEL) dont au surplus les pouvoirs publics ont prôné le développement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer selon quelles modalités il serait possible de mettre fin à cette disparité de statuts, et ce d'autant plus que certaines URSSAF en viennent même à considérer que tout praticien associé de SELARL (ou actionnaire de SELAS ou de SELAFA), détenteur ne serait-ce que d'une seule part ou d'une seule action, donc extrêmement minoritaire et n'exerçant pas de fonctions de dirigeant, ne peut néanmoins être considéré comme un salarié (ce qui le prive ainsi des assurances-chômage et de la protection prévue en cas de licenciement) mais doit être traité dans tous les cas et du seul point de vue social comme un travailleur indépendant, alors que, du point de vue fiscal, il est considéré comme salarié à part entière.
Voir la questionQuestion écrite n° 121623 publiée le 08 novembre 2011
plus-values : imposition - exonération - cessions immobilières. réforme. perspectivesM. Étienne Blanc souhaite attirer l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, sur l'instabilité fiscale dont sont victimes les signataires de promesses de vente immobilière antérieures à l'annonce du plan de rigueur. Adoptée le 8 septembre 2011, la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières piège de nombreux propriétaires de terrains qui, ayant signé une promesse avant l'annonce du plan de rigueur par le Premier ministre le 24 août 2011, ne pourront pas finaliser leur vente avant le 1er février 2012, date de son entrée en vigueur. En effet, pour les ventes de terrains, de nombreuses raisons peuvent expliquer une signature tardive de l'acte de cession après la conclusion de la promesse ou du compromis : attente d'une modification de la réglementation locale d'urbanisme, fouilles archéologiques préventives, autorisations administratives, assainissement, etc., autant de conditions suspensives qui peuvent retarder la cession définitive sans pour autant remettre en cause l'engagement du vendeur. Rétroactive de fait, la mesure bouleverse donc le modèle économique des ventes escomptées, l'imposition pouvant passer de 15 % à 45 % pour un terrain détenu depuis 16 ans ! Ainsi, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour corriger cette injustice avant le 1er février 2012 : un vendeur qui, dans le cadre d'une promesse ou d'un compromis de vente, s'est engagé sur la base d'une fiscalité connue n'a pas à subir les changements de fiscalité alors qu'il ne peut plus se rétracter ni renégocier les conditions financières. Le même constat avait d'ailleurs été fait par le Gouvernement dont le projet de loi excluait toutes les ventes issues de compromis et promesses signés avant l'annonce du plan de rigueur.
Voir la questionQuestion écrite n° 121557 publiée le 08 novembre 2011
impôts locaux - redevance d'enlèvement des ordures ménagères - réglementationM. Étienne Blanc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur les modalités d'application du neuvième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lequel, créé par l'article 67 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004, prévoit que le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. En effet, cette disposition soulève certaines interrogations de la part de gestionnaires de résidences, notamment de syndics de copropriété, qui refusent parfois de verser une telle redevance et de procéder à sa répartition entre les copropriétaires au motif que cette mission ne rentre pas expressément dans les prérogatives reconnues au syndic de copropriété par l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un syndic de copropriété chargé de la gestion d'une résidence peut, en tant que représentant des copropriétaires, être considéré comme un usager du service public d'enlèvement des ordures ménagères au sens de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et se voir ainsi facturer la redevance correspondante.
Voir la questionQuestion écrite n° 116839 publiée le 23 août 2011
marchés publics - services - prestations juridiques. réglementationM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés rencontrées par les avocats candidats aux appels d'offres de marchés de prestations juridiques mentionnant des prix forfaitaires et non des tarifs horaires pour des procédures éventuelles futures et non connues par avance. Il lui demande ainsi de préciser si l'exigence de prix forfaitaires pour des procédures contentieuses non encore nées, très souvent exigés par les collectivités dans les appels d'offres, n'est pas contraire aux règles déontologiques applicables à la profession d'avocat qui prévoient que les honoraires sont fonction de la nature et de la complexité du dossier. En effet, les prix forfaitaires que les avocats candidats sont appelés à formuler dans leurs offres impliquent pour ces derniers de fixer leurs honoraires sans connaissance des prestations qui leur seront demandées ultérieurement, les obligeant ainsi à proposer une offre basse non adaptée aux besoins des collectivités adjudicatrices ou au contraire une offre haute permettant de couvrir toutes les éventualités mais non susceptible d'être retenue et, d'une manière générale, cette pratique conduisant à retenir le moins disant, ce qui en pareille matière n'est pas toujours raisonnable.
Voir la questionRéponse à la question écrite n° 102511 publiée le 16 août 2011
politique extérieure - Haïti - enfants. adoption. procéduresM. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la situation que connaissent de très nombreuses familles qui ont décidé d'adopter un enfant originaire d'Haïti. L'adoption intervient en France sur un acte authentique ou un jugement d'adoption prononcé à Haïti et autorisant une adoption simple. Sur le fondement de cet acte, l'enfant peut regagner sa nouvelle famille française, laquelle effectue ensuite les formalités nécessaires auprès du tribunal de grande instance, pour que l'adoption prenne effet en France. Or, en ce qui concerne les enfants nés à Haïti, il semble que les juridictions françaises n'acceptent pas de prononcer une adoption plénière, considérant que le droit haïtien ne reconnaît que l'adoption simple. Cette situation est extrêmement pénible pour les familles françaises qui souhaitent faire bénéficier à l'enfant d'une adoption plénière, c'est à dire de lui donner des droits identiques à des enfants légitimes, nés au sein de la famille. Il est important qu'elle indique les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour permettre aux juridictions françaises de prononcer une adoption plénière en faveur d'enfants nés à Haïti.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 107940 publiée le 26 juillet 2011
industrie - meubles - collecte et recyclage. filière. mise en placeM. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les lourdes conséquences de l'obligation qui sera faite aux fabricants français de meubles de prendre en charge la gestion des déchets d'éléments d'ameublement à compter du 1er janvier 2012. D'après les estimations fournies par l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement, un gisement potentiel de déchets de meubles de 2,7 millions de tonnes aurait un coût de gestion pouvant atteindre 600 millions d'euros par an, soit plus du double du résultat net de la profession. Celle-ci estime que ce dispositif serait à même de déstabiliser gravement le secteur de l'ameublement en France et de pénaliser la compétitivité de ses entreprises avec les milliers de licenciements qui s'ensuivraient. Ainsi, il lui demande dans quelle mesure le projet de décret, actuellement en cours de préparation, pourrait prendre en compte ces différents éléments et si le Gouvernement envisage la possibilité d'un report de l'application de cette disposition afin de permettre à l'ensemble de la filière de se préparer et de mettre au point cette nouvelle obligation.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 100378 publiée le 26 juillet 2011
travail - durée du travail - réduction. finances publiques. coûtM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le rapport coût-avantages de l'application des 35 heures pour notre économie. Les lois de 1998 et 2000 ont fait passer la durée hebdomadaire du travail de 39 à 35 heures pour la plupart des salariés. En appui de la nouvelle durée légale du travail, la loi instaure des allègements de charges dégressifs pour les entreprises selon le niveau de salaire jusqu'à 1,8 fois le SMIC, ce seuil ayant été ensuite ramené à 1,6. Au total, l'ensemble du dispositif destiné à abaisser le coût des bas salaires pour les entreprises et à compenser la hausse du SMIC résultant des 35 heures ferait peser sur le budget de l'État une charge annuelle de 22 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les 4 milliards du dispositif d'encouragement aux heures supplémentaires. Alors que les 35 heures avaient vocation à favoriser la création d'emplois, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le coût pour les finances publiques, année par année depuis 2002 et en cumulé au 1er janvier 2011, des allègements de charges réellement consentis et de bien vouloir lui faire savoir, année par année depuis 2002 et en cumulé au 1er janvier 2011, le nombre de créations nettes d'emplois.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 93949 publiée le 19 avril 2011
industrie - matériel médico-chirurgical - prothèses dentaires. coûts. information des patientsM. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le rapport de la Cour des comptes du 8 septembre dernier constatant que « [...] le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés ». Ne serait-il pas logique que les prothèses dentaires soient payées directement par le patient au laboratoire fabricant comme cela existe pour tous les dispositifs médicaux, fussent-ils sur mesure. Cette mesure serait conforme au code de déontologie médicale et mettrait fin à toute suspicion de « bénéfice » ou de « rente » attribués aux chirurgiens-dentistes sur la fourniture de prothèses dentaires. Cette conception préconisée par l'association Perspectives dentaires ne génèrerait aucun coût supplémentaire de la part de l'État et des organismes sociaux. Cette mesure n'entamerait en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens pour leurs actes cliniques. La transparence tarifaire a par ailleurs bien été légalisée dans l'article 57 de la loi HPST. Il lui demande ce qui s'opposerait à cette mesure.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 92138 publiée le 08 février 2011
banques et établissements financiers - services bancaires - mobilité bancaire. mise en oeuvreM. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question des frais et de la mobilité bancaire des consommateurs. L'UFC-Que Choisir de l'Ain vient de rendre publique une enquête sur les frais et la mobilité bancaires. Les résultats démontrent que les établissements bancaires ne jouent pas le jeu de la concurrence et opposent de nombreux obstacles lorsqu'un client souhaite changer de banque. En effet, l'UFC-Que Choisir de l'Ain a sollicité 13 agences de l'Ain pour vérifier le niveau de prix des services et tester l'effectivité du service d'aide à la mobilité bancaire mis en place au 1er novembre 2009. L'évolution des prix entre 2004 et 2010 de trois produits stratégiques (carte bleue classique, commission d'intervention par incident, retrait au distributeur) met en évidence une hausse très supérieure à l'inflation constatée sur cette période (8 %). Par exemple, à la Banque postale, la commission d'intervention pour incident a augmenté de 48,9 % entre 2004 et 2010. De plus, malgré l'engagement pris par les banques, le changement d'établissement s'avère particulièrement difficile pour les consommateurs. D'après l'enquête, 77 % des conseillers financiers n'en parlent pas spontanément à un client qui vient les solliciter pour changer de banque. Dans 38 % des établissements, le client doit effectuer toutes les démarches, et dans 23 %, le travail est partagé avec la banque. Quant au délai nécessaire avant activation du compte, le consommateur de l'Ain doit attendre plus d'un mois dans 30 % des cas, alors que les banques s'étaient engagées à cinq jours ouvrés. Au vu de l'échec de l'autorégulation, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement envisage une réforme d'ampleur du secteur bancaire qui soit susceptible de dynamiser la concurrence, et en particulier d'assurer une véritable mobilité bancaire.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 85516 publiée le 12 octobre 2010
énergie et carburants - économies d'énergie - appareils électroménagers. bonus-malus. extension. perspectivesM. Étienne Blanc attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la problématique des économies d'énergie est devenue centrale, les statistiques soulignent que les dépenses d'électricité liées aux équipements ménagers, dite électricité spécifique, subissent une hausse exponentielle. En effet, en 20 ans, la consommation d'électricité spécifique a doublé. Soucieuse de vérifier si le consommateur est incité à acquérir des appareils économes en énergie, l'UFC-Que Choisir de l'Ain a mené une enquête dans le département afin de relever les prix en rayon et la classe énergétique de tous les modèles répondant à un type précis de réfrigérateur-congélateur et de sèche-linge. Or, sur les 51 (frigos + sèche-linge) modèles relevés, les résultats sont alarmants. En effet, les résultats montrent que les consommateurs du département de l'Ain ne sont pas réellement incités à acheter les appareils les moins énergivores, les appareils les plus performants étant absents des rayons. Pour les réfrigérateurs, seulement 2 produits de classe A++ ont été trouvés. Pour les sèche-linge, également 2 produits de classe A ont été trouvés. De plus, l'économie d'énergie est onéreuse : les prix augmentent significativement avec la classe énergétique et l'important surcoût entre deux classes n'est pas compensé par l'allègement attendu de la facture électrique. De fait, les appareils les plus performants sur le plan énergétique sont délaissés par les consommateurs. Pour démocratiser les appareils peu énergivores, il faudrait agir sur le signal-prix, en étendant à l'électroménager le dispositif du bonus-malus qui a déjà fait ses preuves pour l'automobile. En effet, à terme, le remplacement des appareils électriques par les plus performants permettrait de diviser par deux la consommation d'électricité spécifique des habitants du département de l'Ain et de 3097 Gigawatt heures pour la région Rhône-Alpes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'extension du bonus-malus à l'électroménager, déjà envisagée en 2008, sera bientôt effective.
Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 85915 publiée le 14 septembre 2010
santé - traitements - chirurgie esthétique. implants mammaires dangereux. conséquencesM. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences sanitaires liées à l'utilisation d'implants mammaires pré-remplis de gel silicone fabriqués par la société Poly Implant Prothèse (PIP), auparavant sise à La Seyne sur Mer (83). En effet, depuis une dizaine d'années, la société PIP a commercialisé des produits frauduleux, dangereux pour la santé, dans le cadre de chirurgie esthétique ou reconstructrice de la poitrine. Ces produits ont fait par ailleurs l'objet d'incidents de rupture anormalement élevés, générant une diffusion dans le corps des femmes de produits impropres. Fort de ce constat préoccupant, l'AFSSAPS a effectué une inspection dans les locaux de l'entreprise entre le 16 mars et le 18 mars, établissant la fraude. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire le 23 mars pour « faux et usage de faux, publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles d'un produit, mise en danger de la vie d'autrui ». Par arrêté en date du 29 mars 2010, le Directeur de l'AFSSAPS requiert le retrait et le rappel des produits PIP considérant qu'une « rupture nécessite une ré-intervention chirurgicale dont le risque pour les patientes n'est pas négligeable, et que la diffusion de silicone dans l'organisme peut également conduire à la survenue de complications locorégionales ». Le 30 mars, la société PIP est mise en liquidation judiciaire, parallèlement les propriétaires quittent le territoire national de leur propre fait. Entre 30 000 et 40 000 femmes seraient concernées en France, conférant à ce dossier une dimension de santé publique. Une association de défense a été constituée sous la dénomination « association PPP » sise à Besançon (25). Aussi, il souhaite obtenir les informations suivantes auprès de Mme la ministre de la Santé et des Sports : Comment le ministère explique-t-il que cette société ait pu exercer pendant près de dix années en poursuivant la commercialisation de ces produits frauduleux, comme l'attestent les résultats de ré-opérations sur certaines patientes ? Quelles mesures d'organisation interne au ministère sont envisagées ? Quelles dispositions elle compte prendre pour informer l'ensemble des personnes opérées avec ces produits, compte tenu que certaines ont été prises en charge par des chirurgiens qui ne sont plus en activité ou ont changé d'affectation ? Il souhaite savoir aussi quelles actions elle compte prendre afin de permettre aux patientes de pouvoir être réopérées dans les plus brefs délais pour raison de santé .
Voir la réponse
Fonctions
Mandat
- Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))
Commissions
- Membre de la commission des lois
Groupes d'études
- Co-Président : - Zone et travailleurs frontaliers
- Membre : - Agro-alimentaire et filière agricole - Artisanat et métiers d'art - Chasse et territoires - Cheval - Climatisme et thermalisme - Dépendance - Hôtellerie, restauration, loisirs - Mondialisation : régulations économiques et sociales - Prisons et conditions carcérales - Professions libérales - Systèmes juridiques européens - Tibet - Tourisme - Vie associative et bénévolat
Groupe d'amitié
- Vice-Président : - Kazakhstan - Suisse
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
- Membre du Groupe français de l' Union interparlementaire
- Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
- Juge suppléant de la Cour de justice de la République
Organismes extra-parlementaires
- Membre suppléant de la Commission supérieure de codification
Mandats locaux en cours
- Maire de Divonne-les-Bains, Ain
Mandats intercommunaux
- Président de la communauté de communes du Pays de Gex
Contact
Mél et site internet
- Mél : Écrire à M. Étienne Blanc
- Site internet : www.etienne-blanc.org
Adresses
Assemblée nationale
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Mairie
73 Avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains
Téléphone : 04 50 99 17 45
Télécopie : 04 50 99 16 75
Historique
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
- Élu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
Anciens mandats locaux
- Conseil municipal de Bourg-en-Bresse (Ain)
- du 14/03/1983 au 19/03/1989 (Membre)
- Conseil municipal de Divonne-les-Bains (Ain)
- du 20/01/1991 au 18/06/1995 (Maire)
- du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Maire)
- du 19/03/2001 au 16/03/2008 (Maire)
- Conseil régional de Rhône-Alpes
- du 23/03/1992 au 15/03/1998 (Membre du conseil régional)
- du 16/03/1998 au 11/12/1998 (Vice-président du conseil régional)
- du 16/03/1998 au 05/07/2002 (Membre du conseil régional)
- Conseil municipal de Bourg-en-Bresse (Ain)
Place dans l’Hémicycle
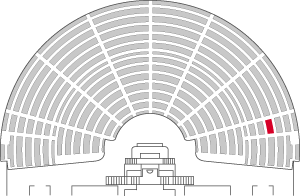
Numéro de la place occupée : 45
(la zone en rouge situe le banc)


