

N° 3125 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2006 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement Président M. André VALLINI, Rapporteur M. Philippe HOUILLON, Députés. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. La commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement est composée de : avertissement La commission d'enquête a entendu 221 personnes pendant plus de 200 heures entre le 10 janvier et le 12 avril 2006. Si les auditions avaient été présentées dans un second volume, celui-ci aurait compté plus de 1 600 pages. Aussi a-t-il été décidé de les graver sur un CD rom annexé au présent rapport, la liste des personnes auditionnées figurant à la fin de ce document. L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse punit de 15 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable. Pour cette raison, les prénoms des enfants victimes d'agressions sexuelles dans l'affaire d'Outreau et qui sont cités dans le rapport et dans les auditions ont été volontairement modifiés. Enfin, par respect de leur vie privée, les noms des personnes mises en cause mais qui n'ont pas été mises en examen, ont été rendus anonymes. avant-propos Si la France entière s'est réjouie de l'acquittement définitif des innocents d'Outreau en novembre 2005, le drame humain qu'ils avaient vécu ne fut pas effacé pour autant. Il était donc légitime que le Parlement exprimât à son tour, non seulement l'émotion qu'avait ressentie tout le pays devant cette affaire, mais aussi sa volonté d'en tirer les leçons. C'est le sens qu'ont donné le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré et le président de la commission des Lois, Philippe Houillon, à leur proposition de créer une commission d'enquête parlementaire, chargée de « rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement ». Deux questions se sont posées à nous : que s'est-il passé dans l'affaire d'Outreau et comment éviter d'autres affaires d'Outreau ? Notre commission d'enquête a donc travaillé avec le double souci de savoir et de comprendre : savoir ce qui s'était passé mais aussi comprendre pourquoi cela s'était passé. Comprendre pourquoi la chaîne pénale, qui semblait avoir fonctionné conformément aux textes, avait pu aboutir à un tel désastre pénal et pourquoi notre système judiciaire, qui semblait avoir fonctionné conformément aux règles, avait pu engendrer une telle catastrophe judiciaire. En France, bien souvent, les principes sont exemplaires. C'est ainsi que la présomption d'innocence est inscrite en lettres d'or dans notre code de procédure pénale qui dit que la détention provisoire doit être l'exception et la liberté la règle. Hélas, la réalité est parfois loin des principes et l'on sait que trop souvent la présomption d'innocence cède le pas devant une présomption de culpabilité. Ceux qui criaient le plus fort pour dénoncer l'emprisonnement des innocentés d'Outreau n'étaient-ils pas ceux qui avaient crié le plus fort pour qu'on les jette en prison ? Dans certaines affaires, la pression de la société est telle en effet, et la peur de ne pas condamner un coupable si forte, qu'on multiplie les risques de poursuivre et d'emprisonner des innocents. Et quand il n'y a plus d'espace pour la réflexion, quand la révolte l'emporte sur la raison, on en arrive à des désastres comme celui d'Outreau. Sur 60 000 personnes incarcérées aujourd'hui dans les prisons de France, 20 000 sont en détention provisoire et sur ces 20 000, 2 000 seront sans doute reconnues innocentes. Autant d'affaires d'Outreau dont on ne parlera probablement jamais. La justice traverse dans notre pays une crise de confiance sans précédent et trop de Français pensent qu'elle fonctionne mal. Ils disent même souvent la redouter. C'est grave pour la justice elle-même bien sûr. C'est dangereux aussi pour la démocratie car lorsque ce pilier du pacte social vient à se fissurer, c'est tout l'édifice républicain qui est menacé. Et quand le doute sur la Justice s'installe, c'est la société tout entière qui peu à peu se déchire. En tant que représentants du peuple, au nom duquel la justice est rendue, nous avons donc le devoir de nous en préoccuper. C'est ce que nous avons fait avec beaucoup de sérieux et notre commission n'a ménagé ni sa peine ni son temps devant faire face, de surcroît, à de nombreuses controverses. Et si des magistrats ont pu redouter notre travail, ils doivent aujourd'hui s'en réjouir car il a donné à la justice la place qu'elle mérite dans le débat public, non seulement pour engager les réformes nécessaires mais aussi pour lui donner les moyens de mieux fonctionner. Notre commission d'enquête qui fut une première dans l'histoire parlementaire pour avoir enquêté à la suite d'une affaire judiciaire, le fut aussi pour avoir travaillé sous le regard de millions de Français. Et si nous avons pu réussir ainsi à leur donner une image positive du travail parlementaire et les convaincre que la politique peut avoir ses vertus, nous aurons servi aussi la démocratie. André Vallini SOMMAIRE Pages Première partie : la radiographie d'un désastre judiciaire 31 i. le signalement des maltraitances et des abus sexuels : une réaction tardive, conséquence de cloisonnements excessifs 33 A. la réalité de l'affaire 33 1. Des enfants gravement victimes 33 2. Un contexte pénal, économique et social défavorable 38 B. L'absence de prise en compte des nombreux signaux d'alarme 41 1. Les notes des services de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) et de la Direction de l'enfance et de la famille (DEF) 41 2. Les notes des services de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ) 48 3. Le manque de circulation et d'analyse des informations concernant les enfants en danger 53 ii. la parole et le traitement des enfants : un défaut de prudence et de méthode 59 A. le recueil des déclarations des enfants par les services sociaux 59 1. Des déclarations mises en forme par les assistantes maternelles 60 2. L'établissement de listes de noms 61 3. Les contacts entre les enfants 63 4. Un foisonnement de dénonciations 64 5. Des assistantes maternelles critiquées 65 B. les modalités défaillantes du recueil des déclarations des enfants par la police et le magistrat instructeur 67 1. Des auditions nombreuses et étalées dans le temps 67 2. Les auditions des enfants par la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer 68 a) Seize enfants auditionnés le 6 mars 2001 68 b) Des auditions aux résultats contrastés 68 c) Les auditions faites en présence d'un tiers 69 d) Des policiers sans formation ni soutien 70 3. Les auditions de quelques enfants par le juge d'instruction 71 C. Les enregistrements des auditions : le détournement d'une procédure 72 1. Les motivations des refus d'enregistrement 72 2. Les réticences à l'utilisation des enregistrements 73 D. les auditions des enfants devant les assises : des conditions d'accueil à améliorer 74 E. le rôle contesté des associations parties civiles 75 F. des mineurs qui n'ont bénéficié que d'une défense collective 78 G. le placement des enfants : une procédure brutale et sans discernement 78 iii. une instruction univoque 91 A. dans ses méthodes d'enquête 91 1. Une analyse défaillante des déclarations et de leurs contradictions 93 a) L'interactivité incontrôlée des confrontations groupées 93 b) Des questions répétitives et inductrices 100 c) Des questions ne se fondant sur aucun élément du dossier 104 d) Des questions dissimulées ? 112 e) La retranscription contestée des propos par le greffe 114 f) Des contradictions nombreuses mais ignorées 118 2. Une appréciation orientée des éléments de preuve 122 a) Des albums photos non-discriminants 122 b) Des vérifications parcellaires 127 c) Des éléments à décharge parfois écartés 130 B. dans sa stratégie 137 1. Une analyse judiciaire identique de l'affaire 137 2. Un parquet accusateur à tout prix 141 3. Le symbole de la confusion des genres : la pratique du copié-collé 145 4. Une instruction toujours ouverte : l'affaire du meurtre de la fillette belge 148 C. Dans sa mise en œuvre solitaire 152 1. Un juge seul et pressé 152 2. Un juge hermétique aux signaux d'alerte 155 iv. une valorisation excessive du rôle des experts 159 A. les questions posées aux experts et leurs réponses 160 1. Le sens moral 161 a) La réponse des experts psychiatres 161 b) La réponse du psychologue 162 2. Les traits caractéristiques des abuseurs sexuels 162 a) La réponse des experts psychiatres 162 b) La réponse du psychologue 163 3. La crédibilité 164 a) La crédibilité des enfants 164 b) La crédibilité des adultes 169 c) La crédibilité, une notion commune aujourd'hui proscrite 171 B. Pourquoi des réponses aussi divergentes ? 172 1. Les contradictions entre les expertises psychiatriques et les expertises psychologiques 172 2. Les divergences entre les conclusions des psychologues 173 C. Les silences des experts 174 1. Les experts devaient-ils répondre ? 174 2. Les experts devaient-ils se taire ? 175 3. Ce dont n'ont pas parlé les experts 175 D. Comment les missions ont-elles été remplies ? 176 1. Les missions réalisées en unicité d'expert 176 2. Les missions réalisées en dualité d'experts 176 3. Des missions réalisées dans des conditions attestant de pratiques professionnelles contestables 178 a) Un psychologue à l'impartialité contestable 178 b) Un psychologue peu soucieux de son devoir de réserve 179 c) Deux psychologues aux méthodes de travail expéditives 180 E. Comment les expertises ont-elles été comprises et utilisées par les magistrats ? 181 1. Le profilage des personnalités 181 a) Des extraits d'expertises tirés de leur contexte 181 b) Des traits de personnalité arbitrairement choisis 182 2. Le recours hyperbolique à la notion de crédibilité 183 3. Le « psychologisme » de l'institution judiciaire 184 F. Une défense réduite à l'impuissance 185 1. Les refus des actes d'expertise demandés par la défense 186 2. Les motivations des refus des contre-expertises 186 3. Un mécanisme procédural peu favorable à la défense 188 4. Des retards de procédure préjudiciables aux droits de la défense 189 v. l'exercice entravé des droits de la défense 191 a. Devant le juge d'instruction 192 1. Au cours de la garde à vue sur commission rogatoire 192 a) Le cas de M. Daniel Legrand père : une mise en examen tardive ? 193 b) L'exercice de pressions 197 2. Un accès au dossier difficile 201 a) Un greffe surchargé 201 b) Des relations complexes entre le juge et les avocats 204 c) La demande de dépaysement 207 3. Les failles dans l'organisation du barreau de Boulogne-sur-Mer 212 a) Des confrontations et interrogatoires sans avocat 212 b) Une inégale implication dans la procédure 219 b. Devant le Juge des libertés et de la détention (jld) 222 1. Un juge saisi en bout de chaîne 222 2. Un débat « en trompe-l'œil » 224 c. Devant la chambre de l'instruction 228 1. Un pouvoir de filtrage du président contesté 229 2. Une intervention des avocats limitée à des « observations sommaires » et à huis clos 231 vi. les contrôles exercés par la chaîne judiciaire : une succession de défaillances 237 A. La détention provisoire généralisée 237 1. L'abus de la détention provisoire dans l'affaire d'Outreau 237 2. Les dérives d'une pratique générale 242 3. L'application des critères de l'article 144 du code de procédure pénale dans l'affaire d'Outreau 249 a) Les risques de « pression et de concertation » 249 b) La garantie du maintien à la disposition de la justice 252 c) Le trouble à l'ordre public 255 B. le juge des libertés et de la détention ou la théorie du « double regard » 258 1. À l'origine du JLD : la volonté d'instaurer un « double regard » 258 a) Le principe et l'objectif du « double regard » 258 b) Un objectif de réduction du recours à la détention provisoire qui a montré ses limites 261 2. Un juge qui n'est pas en mesure de maîtriser le dossier 263 a) Des compétences trop dispersées et un mode de fonctionnement trop empirique 263 b) Des conditions d'intervention déplorables et un examen au fond souvent défaillant 267 c) Un juge seul avec un « dossier papier » 270 C. La Chambre de l'instruction, chambre de confirmation 273 D. L'absence de culture du contrôle 276 1. Le défaut de transmission d'informations lors du passage de témoin entre magistrats 276 2. La pratique du « suivisme judiciaire » 277 3. L'absence de travail en équipe 282 4. La confusion des rôles dans l'accusation 283 vii. une pression médiatique excessive 285 A. le manque de prudence et de rigueur des médias pendant l'instruction 286 1. Des informations présentées comme des certitudes : un réseau constitué de « notables » 286 2. Des noms jetés en pâture 290 3. La diffusion d'images sans le consentement des intéressés 292 4. Les atteintes au respect de l'anonymat des enfants victimes 293 5. La stigmatisation d'un quartier 293 b. l'influence des médias sur la procédure 296 1. L'impact sur les déclarations des enfants 296 2. Un élément pris en compte pour justifier les maintiens en détention 298 c. le retournement des médias au procès de Saint-Omer 299 deuxième partie : rétablir la confiance des français dans leur justice 305 i. réformer le régime de la garde à vue 308 a. notifier les faits 309 b. motiver les raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction 309 c. enregistrer les interrogatoires pendant la garde à vue 311 d. autoriser l'avocat à accéder au dossier lors de la prolongation de la garde à vue 313 e. renforcer le contrôle du procureur de la république sur les mesures et les locaux de garde à vue 315 ii. rendre les enquêtes du parquet plus contradictoires 317 A. faciliter l'accès au dossier 318 B. reconnaître à l'avocat le droit de présenter des observations et des demandes d'investigations complémentaires 319 C. empêcher de fonder des poursuites sur des informations communiquées anonymement au procureur de la république 320 iii. limiter la détention provisoire 323 A. une priorité à la liberté qui n'est pas respectée 323 1. Des solutions alternatives insuffisamment exploitées 323 2. Un encadrement légal de la détention provisoire qui ne correspond pas aux objectifs affichés 325 b. réformer la détention provisoire 328 1. Limiter les durées maximales de détention provisoire 328 2. Justifier de l'impossibilité de recourir à une mesure alternative 330 3. Préciser les critères du placement et du maintien en détention provisoire et limiter le recours à la notion d'ordre public 332 a) Éviter des références abusives aux risques de pression ou de concertation 332 b) Reconnaître un droit à la déclaration d'innocence 333 c) Supprimer le recours à la notion d'ordre public en matière correctionnelle et l'encadrer davantage en matière criminelle 333 iv. limiter l'exercice des fonctions judiciaires isolées 337 A. faut-il supprimer le juge d'instruction ? 337 1. Faut-il introduire la procédure accusatoire ? 338 2. Ni accusatoire ni inquisitoire, instituer une procédure contradictoire 340 B. faut-il supprimer le juge des libertés et de la détention ? 343 1. Le juge des enquêtes allemand est-il un JLD renforcé ? 344 a) Le contrôle exercé à la demande de la personne détenue 345 b) Le contrôle exercé d'office 346 2. Quelles sont les limites au rôle du juge des enquêtes en Allemagne ? 346 C. Faut-il maintenir le JLD en cas de création de collèges d'instruction ? 349 v. créer la collégialité de l'instruction 353 A. organiser la collégialité 353 1. Les alternatives à l'emploi des jeunes magistrats instructeurs en début de carrière 354 a) Exiger un âge minimum pour entrer dans la magistrature ? 355 b) Envisager un stage probatoire pour tous les magistrats ? 356 c) Instaurer une période d'apprentissage préalable en juridiction pour les magistrats instructeurs ? 356 d) Instituer un tutorat ? 358 2. Les implications de l'instruction collégiale 359 a) Le nouveau statut du magistrat instructeur 361 b) Les effets de la réforme sur la carte judiciaire 364 c) Les effets sur les effectifs des juges d'instruction 368 3. La collégialité, cadre pour la diffusion des bonnes pratiques 368 B. définir les fonctions de la collégialité 369 1. Conduire l'instruction 369 a) Une saisine par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile 370 b) Des actes réalisés en garantissant davantage l'exercice des droits de la défense 370 2. Une décision collégiale pour ordonner le placement en détention provisoire assortie d'un réexamen automatique de la situation du détenu après trois mois 372 a) Un véritable débat contradictoire pour une décision collégiale de placement en détention provisoire 372 b) Un réexamen automatique par le collège de la situation des prévenus incarcérés 373 3. Une clause de rendez-vous annuel afin d'examiner l'état d'avancement des informations judiciaires 376 4. Une clôture de l'information plus contradictoire et équitable 377 c. déterminer les modalités de fonctionnement de la collégialité 378 1. La nécessaire organisation de la délégation 379 2. Une collégialité obligatoire pour les mesures restrictives de liberté et pour les moments clés de l'instruction 380 D. aménager le secret de l'instruction 381 vi. refonder la chambre de l'instruction 385 A. garantir la stabilité de ses membres 385 B. mieux respecter l'exercice des droits de la défense 386 C. assurer la publicité de ses audiences 388 D. conforter ses fonctions 390 vii. garantir l'accès au dossier 395 A. assurer l'accès au dossier pour la défense 396 b. prévoir l'accès direct au dossier de la personne mise en examen 397 c. organiser pour les personnes placées en détention provisoire la communication de leur dossier 398 viii. améliorer la qualité des expertises 401 a. redéfinir le rôle des experts psychologues 401 1. Organiser une conférence de consensus et proposer des règles de bonnes pratiques 401 2. Mieux distinguer les missions relevant de la psychiatrie, de la psychologie et de la criminologie 403 3. Proposer une mission-type aux experts psychologues et psychiatres 404 b. améliorer le statut des experts 404 1. Renforcer le contrôle de l'impartialité 405 2. Réviser les critères de rémunération 406 c. consolider les droits de la défense dans la procédure d'expertise 408 1. Les conséquences d'une procédure expertale conduite sans contradiction 408 2. Une procédure sous le contrôle exclusif du juge 409 3. Les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme 409 4. Le précédent de 1957 411 5. Des expertises discutées contradictoirement et ouvrant un droit à la contre-expertise 412 ix. mieux protéger les intérêts des enfants 415 A. transmettre les informations et coordonner les différents acteurs concernés en cas de soupçons de maltraitance 415 1. Décloisonner les services sociaux 417 2. Favoriser la concertation des personnels médicaux et sociaux 417 3. Créer un centre de signalement départemental 417 B. élargir les possibilités de saisine du juge des enfants 418 1. Ouvrir aux médecins une possibilité de saisine directe du juge des enfants 418 2. Clarifier les possibilités de saisine du juge des enfants par les services sociaux 419 3. Faciliter l'auto-saisine du juge des enfants en cas de danger pour l'enfant 420 4. Saisir systématiquement le juge des enfants en cas de procédure du parquet pour violences familiales contre un mineur 421 c. améliorer l'information des services sociaux sur les recours possibles en cas de classement sans suite de leurs signalements 422 d. assouplir l'obligation légale de recherche systématique de l'adhésion de la famille et du maintien du lien familial dans des cas extrêmes 423 e. mieux articuler les rapports entre le juge des enfants, le substitut chargé des mineurs et les magistrats chargés de l'instruction 424 f. confier au défenseur des enfants le suivi des enfants des personnes placées en détention provisoire 426 x. redéfinir les conditions du recueil des déclarations des enfants 429 a. compléter la formation des assistants familiaux 429 b. rendre obligatoires les enquêtes sur les circonstances de la révélation du mineur 430 c. améliorer les conditions du recueil des déclarations des enfants 431 1. Améliorer la formation des enquêteurs 431 2. Réserver les auditions des mineurs à des enquêteurs spécialisés 432 3. Augmenter les moyens consacrés aux enregistrements audiovisuels 433 d. supprimer les exceptions à l'obligation de procéder à l'enregistrement audiovisuel du mineur présumé victime 434 1. Les dispositions en vigueur 434 2. Des dispositions détournées dans la pratique 436 3. Une nouvelle approche des déclarations de l'enfant et une meilleure prise en considération de l'intérêt de toutes les parties 436 4. Les exemples britannique et italien 438 e. mieux utiliser les enregistrements 439 f. préciser le rôle des associations parties civiles 439 g. généraliser la désignation d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs 441 h. prévoir l'assistance d'un avocat dès le début de l'enquête pour le mineur présumé victime d'une agression sexuelle 441 xi. repenser la gestion des carrières des magistrats 443 a. favoriser des formations communes avec les avocats 443 b. clarifier les fonctions du siège et du parquet 446 c. instituer une gestion des ressources humaines 450 d. favoriser l'émergence d'une magistrature plus ouverte sur l'extérieur 454 1. Développer les recrutements sur titres 454 2. Imposer une mobilité 454 xii. responsabiliser les magistrats 457 a. mieux prévenir les fautes 457 b. mieux identifier les fautes 463 1. Améliorer l'évaluation des magistrats 463 2. Favoriser une culture de contrôle interne 469 3. Développer les contrôles externes 472 a) Saisir le Médiateur de la République 475 b) Saisir le CSM à la suite de la constatation de dysfonctionnements de la justice 479 c. sanctionner la méconnaissance manifeste des principes de la procédure civile et pénale 480 1. Le terrain de la responsabilité civile 481 2. Le terrain disciplinaire 488 d. rénover le CSM 495 a) Établir la parité au sein du CSM 497 b) Élire directement les magistrats au sein du CSM 498 xiii. responsabiliser les médias 501 a. améliorer les voies de droit existantes 501 1. Faciliter l'exercice de l'action civile 502 2. Réformer le droit de réponse dans le secteur audiovisuel 503 B. inciter les médias à élaborer un code de déontologie 504 xiv. rendre compte de la politique pénale devant le parlement 507 xv. doter la justice de moyens dignes de sa mission 509 synthèse des propositions 513 compte rendu de la séance du 2 mai 2006 527 contributions des groupes et des membres de la commission d'enquête 569 contribution des membres du groupe ump 571 contribution des membres du groupe socialiste 575 contribution de mme élisabeth guigou, députée de la seine-saint-denis 577 contribution du groupe des député-e-s communistes et républicains 581 contribution de m. léonce deprez, député du pas-de-calais 589 contribution de m. georges fenech, député du rhône, m. marcel bonnot, député du doubs, m. jean-yves hugon, député de l'indre, m. christian philip, député du rhône, et de m. xavier de roux, député de la charente-maritime 593 contribution de m. jean-paul garraud, vice-président de la commission d'enquête, député de la gironde 601 contribution de m. michel hunault, secrétaire de la commission d'enquête, député de la loire-atlantique 605 contribution de m. alain marsaud, député de la haute-vienne 609 examen du rapport 617 liste des personnes auditionnées par la commission d'enquête 619 Mesdames, Messieurs, L'État de droit postule la confiance dans sa justice. Parce que cette dernière constitue un des fondements de la démocratie, elle ne saurait être sujette à l'erreur sans entamer son crédit, sans instiller le doute parmi les justiciables et sans fragiliser le système judiciaire dans son ensemble. Or, force est de constater qu'à la suite des verdicts de la cour d'assises de Saint-Omer du 2 juillet 2004 et de celle de Paris, en appel, du 1er décembre 2005, cette confiance dans nos institutions judiciaires a été très sérieusement ébranlée. Nos concitoyens se sont, en effet, identifiés avec les treize acquittés de l'affaire d'Outreau. À l'origine, des adultes accusés notamment de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans en réunion et des enfants avaient dénoncé treize autres adultes. Si cette affaire a eu ce retentissement, c'est parce que deux coupables se sont rétractés et que l'accusation s'est effondrée, la cour d'assises de Saint-Omer acquittant alors sept des dix-sept personnes mises en accusation, tandis que la cour d'assises de Paris innocentait à son tour les six condamnés ayant relevé appel du premier verdict. Ont été acquittés, après avoir fait l'objet d'une détention provisoire, par la cour d'assises de Saint-Omer : MM. David Brunet, Christian Godard, Daniel Legrand père, Pierre Martel, Mmes Roselyne Normand épouse Godard, Odile Polvèche épouse Marécaux. A été acquittée par la cour d'assises de Saint-Omer, sans avoir fait l'objet d'une détention provisoire : Mme Karine Duchochois. Est décédé lors de sa détention provisoire : M. François Mourmand. Ont été acquittés par la cour d'assises de Paris, après avoir fait l'objet d'une détention provisoire : MM. Thierry Dausque, Franck Lavier, Mme Sandrine Legrand épouse Lavier, MM. Daniel Legrand fils, Alain Marécaux et Dominique Wiel. Ont été condamnés respectivement à quinze et vingt années de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saint-Omer, Mme Myriam Badaoui et M. Thierry Delay. Ont été condamnés respectivement à six années et quatre années d'emprisonnement par cette même cour, M. David Delplanque et Mlle Aurélie Grenon. Ces quatre condamnés n'ont pas fait appel. Dans la mesure où entre-temps, un mis en examen était décédé en prison1, où douze acquittés sur treize avaient accumulé près de vingt-six années de détention, où des vies avaient été brisées, où des enfants avaient été séparés durablement de leurs parents, les plus hautes autorités de l'État ont été conduites à présenter des excuses pour la première fois dans les annales de notre histoire judiciaire. Le 1er décembre 2005, le Premier ministre manifestait son émotion « devant un tel drame, un gâchis judiciaire » et reconnaissait « au nom du Gouvernement, au nom de l'État, la faute qui avait été commise ». Le 5 décembre 2005, le Chef de l'État écrivait aux acquittés en ces termes : « Au nom de la justice dont je suis le garant, je tiens à vous présenter regrets et excuses devant ce qui restera comme un désastre judiciaire sans précédent. » De son côté, le garde des Sceaux, ministre de la justice, présentait après l'acquittement des six accusés en appel, ses excuses « à tous les acquittés et à leurs familles » et témoignait de « l'émotion du gouvernement et la sienne devant toutes ces vies gâchées ». Enfin, le procureur général près la cour d'appel de Paris exprimait ses regrets aux acquittés à l'issue du procès devant la cour d'assises de Paris. S'il est vrai que les débats sur la justice pénale ne sont pas nés à l'occasion de l'affaire d'Outreau, ils ont conféré à cette dernière une dimension exceptionnelle. C'est en effet son caractère extraordinaire avec sa complexité et ses rebondissements qui a permis d'aborder des questions jusqu'ici peu évoquées devant l'opinion publique, en raison de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs. En même temps, cette affaire a eu pour effet de contribuer à la dégradation de l'image de la justice dans l'opinion publique. À en croire un sondage CSA, paru dans Le Parisien en janvier 2006, si 65 % des Français avaient peur de la justice à pareille époque, soit après le verdict de la cour d'assises de Paris, ce chiffre s'élevait déjà à 57 % en juillet 2004. Il est vrai que de précédents échecs judiciaires (Bruay-en-Artois, Vologne), les condamnations antérieures de la France par la cour européenne des droits de l'homme pour méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, l'écho rencontré par le rapport du commissaire du Conseil de l'Europe Gil Robles sur la garde à vue, la détention provisoire et les établissements pénitentiaires, avaient sensibilisé nos concitoyens à la réalité du fonctionnement de la justice et à certaines situations contestables de privation de liberté prévalant dans notre pays. La justice étant rendue au nom du peuple français2, ses représentants ne pouvaient pas rester à l'écart, en ignorant les répercussions de cette affaire sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Tout en s'inscrivant dans un contexte déjà peu favorable à l'image de la justice, l'impact du verdict de la cour d'assises de Paris dans l'opinion publique a donc été considérable. Il a justifié le dépôt d'une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête par M. Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée nationale et par M. Philippe Houillon, Président de la commission des Lois, le 5 décembre 2005. En ayant pour objet de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, cette proposition de résolution visait simultanément à tirer les leçons d'un fiasco judiciaire et à faire œuvre constructive. Si, faut-il le souligner, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette proposition le 7 décembre 2005, cette initiative a fait également l'objet d'un consensus en dehors des rangs de la représentation nationale. C'est ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a approuvé le principe de cette commission d'enquête dans un avis du 15 décembre 2005. Le CSM a fait valoir à cette occasion que « compte tenu de l'extrême complexité de l'acte de juger », il souhaitait « qu'à l'occasion de cette enquête parlementaire, une information publique sur les processus d'élaboration des décisions judiciaires permette de renforcer la confiance dans la justice. Celle-ci, dans une démocratie, ne peut être rendue que dans la clarté et la sérénité ». De son côté, le principal syndicat de magistrats (Union syndicale des magistrats), qui représente 64,3 % d'entre eux aux dernières élections professionnelles, avait considéré antérieurement dans la presse, par la voix de son Secrétaire général que « l'affaire d'Outreau était un véritable naufrage, un séisme, un échec judiciaire sans précédent. Elle marquera un véritable tournant pour l'institution... C'est toute la chaîne des responsabilités qu'il faut étudier ». L'accueil très positif ainsi réservé à cette démarche parlementaire ne devait pas occulter la nature particulière de la mission que confiait l'Assemblée nationale à cette instance de trente députés, composée à la proportionnelle de dix-neuf députés UMP, huit députés socialistes, deux députés UDF et un député appartenant au groupe des députés communistes et républicains. Suivant la pratique en vigueur sous la xiie législature, selon laquelle les fonctions de président et de rapporteur de commission d'enquête parlementaire sont occupées par des députés de l'opposition et de la majorité, les membres de la commission plaçaient à leur tête, lors de la réunion constitutive du 14 décembre 2005, M. André Vallini, député socialiste de l'Isère, et désignaient M. Philippe Houillon, député UMP du Val-d'Oise, comme rapporteur. N'étant ni une source de conflits préjudiciable au bon fonctionnement de la commission ni l'affichage momentané d'un consensus artificiel, cette organisation a permis de travailler dans un esprit constructif pendant le mandat de six mois que lui confère l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Saluée par nombre d'observateurs, cette expérience très positive montre au demeurant que le temps, le recul et la transparence peuvent nourrir une réflexion approfondie et constituer le creuset de réformes consensuelles et utiles pour la société. D'emblée la commission a refusé de se considérer comme un tribunal ou comme une instance disciplinaire. Elle a conçu son rôle conformément à celui que lui assigne le dispositif de l'article 6 de l'ordonnance précitée. Celui-ci, rappelons-le, prévoit que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés en vue de faire part de leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées. Elle était d'autant plus encline à ne pas prétendre être une juridiction disciplinaire à l'égard de certains magistrats intervenus dans le traitement de l'affaire, qu'elle n'était nullement habilitée à s'engager dans cette voie et que le garde des Sceaux avait saisi le jour même du verdict de la cour d'assises de Paris l'inspecteur général des services judiciaires, aux fins de procéder à une enquête administrative, susceptible, le cas échéant, de déboucher sur des sanctions disciplinaires. Plusieurs objectifs étaient fixés à cette enquête de l'inspection générale des services judiciaires : examiner l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles le dossier en cause avait été traité par l'autorité judiciaire ; rechercher si, aux différents stades de la procédure, des dysfonctionnements du service de la justice ou des comportements individuels constitutifs de fautes professionnelles avaient pu influer sur le traitement de cette affaire et proposer les mesures qui s'avéreraient utiles. On relève, par ailleurs, que depuis lors, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale de la police nationale ont été chargées d'examiner conjointement les conditions dans lesquelles la parole de l'enfant avait été recueillie avant et pendant la saisine du magistrat instructeur. Au surplus, les craintes que certains pouvaient nourrir au regard d'un empiétement supposé du pouvoir législatif sur l'autorité judiciaire étaient dénuées de fondement. En se réclamant de la séparation des pouvoirs, cette contestation de la légitimité de la commission d'enquête exprimée ultérieurement par certaines organisations professionnelles de magistrats feignait d'ignorer que la séparation des pouvoirs signifie, comme l'entendait Montesquieu, que les Constitutions doivent être conçues pour que les différents pouvoirs se limitent entre eux. Par ailleurs, la justice étant rendue au nom du peuple français, il était logique que ses représentants s'intéressent aux dysfonctionnements de la justice à partir d'un cas particulier et assument par là-même pleinement leurs fonctions naturelles de contrôle issues de l'article 6 de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958. Enfin, on rappellera qu'en vertu de ce même article, l'interdiction de la création de commission d'enquête ne porte que sur les affaires faisant l'objet de poursuites en cours. Or, précisément le dossier judiciaire de cette affaire était clos. La vocation de cette commission d'enquête dont l'objet constitue une première dans l'histoire de la Ve République, explique la particularité de ses méthodes de travail. La grande latitude laissée aux commissions d'enquête par l'ordonnance de 1958 et par le règlement de l'Assemblée nationale pour organiser respectivement la publicité de leurs auditions et leurs travaux, a permis à cette commission d'adapter chaque fois les règles applicables à ses auditions, en fonction du contexte. Sur plus de 200 heures d'auditions de 221 personnes - ce qui constitue un record rarement égalé depuis 1958 - les séances ouvertes à la presse se sont déroulées pendant 170 heures contre 30 heures d'auditions à huis clos. La forme de l'audition n'était pour autant nullement imposée, les personnes sollicitées ayant le choix entre les deux formules. On peut concevoir en effet qu'il soit plus aisé pour une personne auditionnée de s'exprimer à huis clos, lorsqu'elle est soumise à un lien hiérarchique fort que lorsqu'elle appartient à une profession libérale qui jouit d'une grande liberté d'expression. La commission a accédé à la requête du magistrat instructeur, M. Fabrice Burgaud, d'être entendu publiquement. Ce débat sur l'opportunité d'organiser ou non des auditions ouvertes à la presse a pris un relief particulier en raison de divergences de vues exprimées sur le sujet au sein de la commission au début de ses travaux. Toutefois, tout en respectant les vœux de chaque témoin, le recours aux auditions ouvertes à la presse est peu à peu devenu la norme. Si votre rapporteur comme la majorité de la commission admettent qu'ils étaient réservés au départ sur l'ouverture à la presse des auditions, au regard de la double nécessité de veiller à la sérénité des débats et de ne pas encourir le reproche de déstabiliser l'institution judiciaire, ils en ont reconnu les vertus démocratiques et pédagogiques. Celles-ci ont été incontestablement illustrées par l'écho dans l'opinion publique des retransmissions des travaux de la commission par la chaîne parlementaire LCP-AN et sur le site internet de l'Assemblée nationale. Il est en effet apparu qu'au travers de ces auditions, les Français s'appropriaient en quelque sorte la procédure pénale et les conditions de fonctionnement de la justice. Si l'on avait d'ailleurs à analyser l'impact des auditions, on constaterait aisément que c'est à partir du moment où celles-ci ont fait l'objet de publicité, que l'autorité de la commission a été définitivement assurée, l'audition des acquittés constituant à cet égard un tournant décisif. L'absence de précédents en la matière, le caractère très particulier de l'objet de la commission d'enquête expliquent sans nul doute cependant cette impression de tâtonnement qu'a pu donner celle-ci à ses débuts et justifient à plus long terme l'engagement d'une réflexion sur l'adaptation de l'ordonnance de 1958 et du règlement de l'Assemblée nationale à la dimension de plus en plus médiatique des travaux de certaines commissions d'enquête. Ont participé également de l'originalité de ces auditions l'autorisation donnée à des personnes auditionnées d'être assistées d'un avocat et la possibilité pour certaines d'entre elles d'opposer le secret professionnel ainsi que le secret du délibéré. Sauf à dénaturer leur fonctionnement et à entrer dans une logique quasi juridictionnelle qui n'a pas été voulue par les auteurs des institutions de la Ve République et dont les issues sont bien incertaines, encore une fois les commissions d'enquête parlementaire ne sauraient être assimilées à une instance disciplinaire ou à un tribunal. Cependant, en raison de la spécificité de la situation et sous réserve de la définition de règles préalables à l'audition concernée, la commission a accédé à la requête de certains magistrats souhaitant témoigner accompagnés d'un, voire de deux avocats, à condition que ces derniers soient taisants. Quatre magistrats (Mmes Véronique Carré et Jocelyne Rubantel, MM. Fabrice Burgaud et Maurice Marlière) ont bénéficié de cette faculté, ainsi que des journalistes d'un organe de presse (La Voix du Nord). Cette nouveauté mérite d'autant plus d'être soulignée que parallèlement l'inspection générale des services judiciaires déniait au magistrat instructeur, M. Fabrice Burgaud, le droit d'être assisté d'un avocat, alors même que ses conclusions pouvaient inciter le garde des Sceaux à saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour voir la responsabilité du magistrat engagée. On ajoutera au surplus que le refus de l'inspection générale d'entendre une seconde fois M. Fabrice Burgaud en présence d'un avocat a conduit l'intéressé à ne pas déférer à la convocation de l'inspection. Il convenait également de tenir compte du droit, pour certains témoins, de pouvoir opposer le secret professionnel et le secret du délibéré. Les personnes auditionnées par les commissions d'enquête parlementaires sont tenues de dire la vérité, toute la vérité rien que la vérité et prêtent serment à cet effet. L'article 6 de l'ordonnance précitée dispose cependant que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déposer « sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal », qui régissent le secret professionnel. Dans le même temps, l'article 226-14 du code pénal prévoit que l'article 226-13 réprimant la violation du secret professionnel n'est pas applicable à la personne qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, dont les atteintes sexuelles sur des mineurs, portées à sa connaissance. Par conséquent, en l'espèce, l'objet de la commission d'enquête avait pour effet de relativiser pour certaines personnes auditionnées la portée du secret professionnel. S'agissant du secret du délibéré, il se justifie par le souci naturel de soustraire le juge à toute pression extérieure et est garanti à la fois par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et par l'article 448 du nouveau code de procédure civile. Très attentive à respecter ce principe, la commission a rappelé ce droit au début de chaque audition, lorsqu'il pouvait être opposé par les magistrats directement concernés. La commission a également permis aux organisations professionnelles de magistrats d'assister aux auditions ouvertes à la presse et aux acquittés d'être présents dans la salle lors de l'audition du magistrat instructeur, M. Fabrice Burgaud. Certains voyant dans cette facilité la forme d'un jury populaire, celle-ci a été critiquée. Cependant on pouvait admettre légitimement que certaines personnes ayant été plus de deux ans en détention et ayant vu leur vie brisée étaient en droit de comprendre ce qui s'était réellement passé, d'autant qu'elles avaient reçu les excuses des plus hautes autorités de l'État. Le magistrat instructeur avait lui-même accepté que les acquittés soient présents à son audition. Si une partie de celle-ci fut retransmise en direct à la seule initiative des principales chaînes de télévision, il faut saluer ici la dignité des acquittés qui, présents dans la salle, ont suivi jusqu'au bout cette séance. On peut regretter à cette occasion que d'autres auditions tout aussi importantes pour la compréhension de l'affaire n'aient pas bénéficié du même traitement médiatique. De par la nature de sa mission, la commission d'enquête a consacré une première partie de ses trois mois d'auditions à l'affaire d'Outreau et la seconde à une réflexion sur d'éventuelles réformes. Tout au long de la première partie, afin qu'aucune responsabilité ne reste dans l'ombre, elle a veillé à entendre tous les acteurs de la chaîne judiciaire - représentants de la police judiciaire, de la défense, du parquet, magistrats instructeurs, juges des libertés et de la détention, membres de la chambre de l'instruction et gardes des Sceaux successifs - mais également les représentants des services sociaux, les psychologues et les psychiatres ainsi que les médias et le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En dehors des témoignages individuels de personnalités compétentes, cinq tables rondes sont venues jalonner le second cycle d'auditions : l'une sur l'enquête policière, deux sur l'instruction, une sur le recueil de la parole de l'enfant, une autre sur l'expertise et une dernière sur la responsabilité des magistrats. Les contributions des magistrats de liaison en poste dans de nombreux pays étrangers et à la qualité desquelles votre rapporteur tient à rendre hommage ont, par ailleurs, alimenté très utilement la réflexion de la commission. Non seulement ces données de droit comparé ont eu le mérite de souligner le retard du système judiciaire français dans certains domaines comme celui de la responsabilité des magistrats, mais en outre plusieurs propositions de réforme de procédure présentées par la commission ont été empruntées à ces exemples étrangers. Si la controverse sur les mérites comparés des auditions à huis clos et des auditions ouvertes à la presse n'est pas nouvelle et nourrit traditionnellement les débuts des travaux des commissions d'enquête, en revanche il est plus rare que l'objet d'une commission d'enquête soit durablement critiqué. Ce fut pourtant le cas, lorsque l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs furent régulièrement mises en avant par une organisation professionnelle de magistrats, des groupes de magistrats et des magistrats à titre individuel, pour récuser la légitimité de la commission d'enquête et contester à son rapporteur le droit de poser des questions aux magistrats ayant suivi la procédure de l'affaire d'Outreau. Le parquet général de la cour d'appel de Paris ayant mis à la disposition du rapporteur, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, l'ensemble du dossier composé de 28 tomes de procédure, soit plus de 6 800 cotes dont 3 000 pour les seules pièces de fond (D), le rapporteur était en droit d'interroger ces magistrats sur la base de ces documents, sous réserve du secret professionnel et du secret du délibéré. D'ailleurs l'opinion publique qui suivait ces auditions a tout de suite bien perçu l'enjeu de la commission d'enquête, en constatant que les questions posées et les débats qu'elles entraînaient n'avaient d'autre objet que de comprendre les dysfonctionnements qui s'étaient produits et d'en tirer les conséquences nécessaires pour proposer des réformes. Cette pédagogie a permis progressivement d'apaiser les esprits et d'appréhender des réformes possibles avec sérénité, en ne ramenant pas, par commodité et paresse intellectuelle, les problèmes de la justice française à de simples questions budgétaires comme certaines organisations professionnelles voudraient le faire croire. Ces travaux ont été accueillis peu à peu par les justiciables et les professionnels concernés comme une chance susceptible d'ouvrir des perspectives à la réforme de la justice. Au-delà de la curiosité et de l'intérêt suscités par l'audition du magistrat instructeur auprès de cinq millions de téléspectateurs, ces travaux ont incité nombre de nos concitoyens à soutenir la démarche de la commission, en s'adressant à elle soit par courrier, soit par courriel, une adresse e-mel ayant été ouverte à cet effet sur le site de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête a été en effet destinataire de plus de 700 lettres, certaines invoquant des affaires judiciaires identiques à celles d'Outreau, d'autres constituant des encouragements à persévérer dans la voie ainsi tracée, voire à étendre cette méthode au traitement d'autres problèmes. Lorsqu'il en a été jugé utile, la correspondance reçue a été transmise au garde des Sceaux pour information. Pendant ces six mois, si la commission d'enquête a pu travailler dans des conditions très satisfaisantes, c'est aussi parce que les plus hautes autorités de l'État et le garde des Sceaux, conscients de l'importance des enjeux en cause, avaient pris l'engagement d'attendre les conclusions de la commission d'enquête avant de se prononcer sur l'opportunité de toute réforme. * * * Tout en veillant à ne pas s'exposer au reproche de refaire le procès d'Outreau, la commission d'enquête, de par sa finalité, ne pouvait séparer l'analyse des dysfonctionnements de l'affaire en cause de ses propositions de réflexion. PREMIÈRE PARTIE : Les dysfonctionnements que la commission d'enquête a recensés peuvent être regroupés autour de sept thèmes : le signalement des maltraitances et des abus sexuels, la parole des enfants, l'instruction, les experts, les droits de la défense, les contrôles exercés par la chaîne judiciaire et la pression médiatique. I. LE SIGNALEMENT DES MALTRAITANCES ET DES ABUS SEXUELS : UNE RÉACTION TARDIVE, CONSÉQUENCE DE CLOISONNEMENTS EXCESSIFS Parce qu'il constitue le point de départ de l'affaire d'Outreau, le signalement des maltraitances et des abus sexuels commis sur les enfants Delay est essentiel pour comprendre la réaction de la justice à ces crimes. Or, celle-ci a été tardive malgré de nombreux signalements préalables des services sociaux. Cette affaire se caractérise à l'origine par des soupçons de maltraitance et d'abus sexuels sur des enfants et par l'existence d'un arrière-plan pénal, économique et social très chargé. 1. Des enfants gravement victimes3 Le 25 février 2000, suite à une demande expresse de Mme Myriam Badaoui épouse Delay dénonçant les violences répétées de son mari, Thierry Delay, sur ses enfants, la juge des enfants à Boulogne-sur-Mer décidait de placer ses trois plus jeunes fils (sept ans et demi, cinq ans et demi et trois ans et demi) dans deux familles d'accueil. Pierre, 10 ans, issu d'une première union de la mère, avait déjà fait l'objet d'une mesure de placement le 30 juin 1995 et se trouvait depuis 1998 en famille d'accueil. Retirés de la garde de leurs parents, les trois autres, Jean, Luc et Paul étaient pris en charge par la Direction de l'enfance et de la famille (DEF) du département du Pas-de-Calais. Deux d'entre eux étaient accueillis par une assistante maternelle à Samer, tandis qu'un troisième était accueilli par une autre assistante maternelle à Outreau. La famille Delay était, en fait, bien connue des services sociaux d'Outreau où elle vivait depuis 1990 dans la cité HLM de la Tour du Renard. Le couple avait toujours eu beaucoup de difficultés à assumer son rôle de parents, mettant en avant de lourds problèmes psychologiques. Cette situation les avait amenés périodiquement, depuis 1992, à demander le placement temporaire de l'un ou l'autre de leurs enfants. Des mesures éducatives, visant à maintenir les enfants dans leur famille, avaient alors été mises en place par la juge des enfants. Malgré cela, M. et Mme Delay sollicitaient régulièrement les différents intervenants sociaux pour être soulagés dans la prise en charge de leurs fils. Étaient évoqués la turbulence des enfants, des problèmes psychologiques, la fatigue des parents, les conflits assortis de violence au sein du couple, l'alcoolisme de M. Delay, la fuite du domicile de Mme Delay... Entre 1995 et 2000, plusieurs notes émanant de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Pas-de-Calais ou de la Direction de l'enfance et de la famille du département signalèrent ainsi la situation préoccupante de ces enfants et la nécessité d'assurer un suivi de la famille. Le 3 avril 2000, la juge des enfants délivrait une ordonnance de droit de visite et d'hébergement des parents. Ce droit d'hébergement était organisé par l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale d'Outreau (UTASS), d'abord un mardi sur deux, puis chaque week-end. L'objectif était de préparer un projet de retour dans la famille pour la fin du mois d'août. Le 25 mai 2000, l'UTASS d'Outreau adressait une note à la responsable de la Direction de l'enfance et de la famille rapportant les propos des enfants à leur assistante maternelle : l'un d'eux disait avoir peur de son père qui l'avait frappé, ainsi que son frère, lors du week-end du 1er mai, et leur avait dit de ne pas en parler, car si cela se savait, ils ne pourraient plus venir à la maison. Une entrevue avait eu lieu avec M. Delay le 18 mai. Le week-end suivant, les enfants étaient à nouveau frappés. La note se concluait par une proposition tendant à réduire le droit d'hébergement à un week-end sur deux. Celui-ci restait cependant maintenu au cours des mois suivants, sauf pour l'aîné, qui ne souhaitait plus voir ses parents. Le 30 novembre 2000, l'UTASS attirait à nouveau l'attention de la DEF sur le comportement particulier des enfants : Jean mettait des crayons dans son derrière à l'école, les faisant ensuite sentir aux autres ; Luc faisait de même avec ses doigts ; Mme Delay affirmait qu'ils avaient la même attitude en sa présence. Les assistantes maternelles avaient essayé d'en savoir plus, chacune de leur côté : Jean avait alors spontanément expliqué qu'il était obligé de regarder des films pornographiques avec ses frères, puis d'assister aux relations sexuelles de ses parents ; Luc avait, quant à lui, déclaré que lorsqu'il dormait à la maison, il mettait son sexe dans le derrière de son frère et que celui-ci procédait de même. Les assistants socio-éducatifs de l'UTASS ajoutaient dans cette note qu'ils constataient que Jean avait une crainte réelle d'aller dormir chez ses parents. Il rentrait le dimanche soir épuisé, racontant que sa mère lui donnait des cachets pour dormir. Les deux frères évoquaient également les films d'horreur qu'ils visionnaient, et les déguisements de leur père pour leur faire peur la nuit. L'UTASS terminait en indiquant que le couple Delay avait suspendu de son propre chef son droit d'hébergement depuis la mi-novembre, mais que tout rétablissement de celui-ci mettait désormais les enfants en danger. Le 5 décembre 2000, la DEF demandait au procureur de la République d'ouvrir une enquête judiciaire suite aux révélations des enfants et de suspendre le droit d'hébergement des parents Delay. Le 8 décembre, une nouvelle note de l'UTASS rapportait cette fois les propos de Pierre à son assistante maternelle après une visite faite à ses parents (qu'il n'avait plus vus depuis le mois de mai) le 28 novembre 2000. Il traitait sa mère de « putain » et racontait alors qu'à l'âge de 5 ans, le jour de Noël, il avait dû regarder les ébats sexuels de ses parents devant un film pornographique. Il ajoutait que cela se passait souvent ainsi et que son père les caressait partout. L'enfant précisait également qu'il n'en avait jamais parlé auparavant car sa mère lui avait expliqué que son père irait en prison s'il faisait de telles confidences. Au cours de cet entretien, il se montrait très nerveux et se souciait beaucoup des répercussions qu'auraient ses révélations sur la situation de ses parents. Les assistantes maternelles des trois plus jeunes recueillaient également d'autres témoignages, tous portés à la connaissance du parquet au cours du mois de décembre. Un des enfants parlait de son père déguisé en loup ou en sorcière, lui faisant l'amour avec son sexe dans son derrière. Il révélait aussi qu'il avait été frappé lors du dernier dimanche de sortie (le 26 novembre), parce qu'il avait parlé des cassettes pornographiques. L'autre enfant indiquait que son père le rejoignait dans son lit la nuit, et lui suçait le sexe sous le regard de sa mère. Il ajoutait : « Papa me mettait le zizi dans mes fesses. Ça faisait mal parce que papa avait un gros zizi. Il le faisait aussi à mon frère parce qu'il a de grosses fesses [...] Maman, elle a filmé papa en train de nous faire ça ; moi je l'ai vu dans le petit carré. Papa, il met son zizi dans ma bouche, même que je peux pas parler tellement il est gros. » Au cours de plusieurs entretiens, les enfants Delay se confiaient à leurs assistantes maternelles, ajoutant à chaque fois des détails supplémentaires, et illustrant parfois leur propos de dessins. C'est ainsi qu'il était fait mention de couteaux, de fourchettes et de saucisses dans le derrière (entretien du 13 décembre), ou encore d'argent et de la participation d'autres adultes aux viols (entretien du 18 décembre). Beaucoup de noms donnés semblaient correspondre à des personnes habitant dans leur immeuble. L'entretien de Pierre du 18 décembre apportait d'autres précisions. Interrogé sur l'endroit où ces scènes avaient lieu, il répondait : « Dans la chambre de ma mère et mon père, ou dans notre chambre à nous. Le monsieur, il me touchait partout [...] Mon frère, c'était pire. Il en a marre. Le dernier jour de Noël [...], mon père le faisait dans son derrière. Il saignait, ça saignait, alors on est allé à l'hôpital. Le docteur a demandé à mon père s'il faisait des trucs sexuels. Il a dit non et il m'a serré la main pour pas que je le dise. Il enchaînait : Ma mère était assise dans le salon. Elle buvait avec les autres hommes de la bière, du Ricard, du vin. Y'avait beaucoup de bière, et après ils étaient un peu bourrés. Sinon ils sont bien ces gens-là s'ils ne buvaient pas. Ces hommes là, ils me caressaient partout [...] » Le 21 décembre 2000, le droit de visite et d'hébergement était définitivement suspendu pour les quatre enfants. Seul un droit de visite médiatisé restait possible dans les locaux de l'UTASS. Le 4 janvier 2001, à l'appui de toutes ces déclarations, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer chargeait le commissariat de sécurité publique de la ville de diligenter une enquête pour agressions sexuelles. Une enquête préliminaire fut ainsi conduite par le commissariat de Boulogne-sur-Mer du 9 janvier au 22 février 2001. Au cours de celle-ci, les instituteurs étaient entendus séparément et, à partir du 15 janvier 2001, il était procédé de même, pour les assistantes maternelles des enfants Delay. Ces dernières confirmaient en tous points les contenus des signalements envoyés à la DEF au cours des derniers mois. Les témoignages des quatre enfants étaient recueillis par les fonctionnaires de la brigade des mineurs entre le 18 janvier et le 23 janvier 2001 (ces quatre entretiens firent l'objet d'un enregistrement audiovisuel). Les trois aînés, âgés à cette date de dix, huit et six ans, confirmaient les violences et abus sexuels dont ils étaient victimes de la part de leurs parents, l'audition du dernier, très jeune (4 ans) n'étant pas probante. Ils faisaient également part de la présence d'autres adultes et enfants au domicile des Delay lors des viols, citant des prénoms (pour les adultes, David, Aurélie, Thierry et un handicapé Jean-Marc). Leur demi-sœur, Solange, âgée de 15 ans, fille de Thierry Delay, vivant chez sa mère depuis la séparation du couple lorsqu'elle avait deux ans, était auditionnée quelques jours plus tard. Elle avait en effet l'habitude de passer quelques jours de vacances par an chez son père et ses demi-frères avaient déclaré qu'elle avait également été victime d'abus sexuels. Solange affirmait cependant n'avoir jamais eu connaissance des agissements de son père sur ses demi-frères et n'avoir jamais été victime elle-même d'abus sexuels. Parallèlement, des recherches étaient effectuées auprès du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir des renseignements sur les admissions des enfants Delay et les types de soins apportés. Le 20 février 2001, les époux Delay étaient placés en garde à vue. Une perquisition à leur domicile aboutissait à la saisie de plus de trois cents cassettes vidéo dont soixante cassettes de films d'horreur, cent soixante-trois cassettes pornographiques, une cassette filmant les ébats sexuels du couple et de nombreux ustensiles à caractère sexuel. Pendant la garde à vue, Thierry Delay niait toutes les charges portées contre lui, qualifiant ses enfants de menteurs et expliquant qu'ils avaient dû inventer de telles histoires pour ne plus retourner chez eux. Myriam Badaoui-Delay niait les accusations à son encontre mais déclarait ignorer le comportement de son mari dont elle disait avoir peur et justifiait avoir demandé le placement de ses enfants à cause de l'alcoolisme de ce dernier. Le 22 février 2001, les époux Delay étaient déférés au parquet de Boulogne-sur-Mer et présentés à M. Fabrice Burgaud, juge d'instruction. Devant le magistrat instructeur, alors que Thierry Delay continuait à nier, Myriam Badaoui indiquait que les enfants n'avaient pas inventé ce qu'ils racontaient. Elle précisait que de nombreuses personnes venaient chez eux et que son mari lui demandait alors de sortir. Elle reconnaissait l'utilisation de godemichés sur ses enfants, avouant avoir eu des relations sexuelles avec eux, précisait que son mari les violait et les sodomisait. Les époux Delay étaient écroués le 22 février 2001, tandis que l'enquête se poursuivait à compter du 27 février sur commission rogatoire du magistrat instructeur. 2. Un contexte pénal, économique et social défavorable Il paraît indispensable de rappeler, fût-ce brièvement, que l'affaire d'Outreau s'est déroulée dans une région fortement marquée par le nombre des affaires pénales en matière sexuelle, sur fond de misère économique et sociale. Certaines données statistiques peuvent, en elles-mêmes, contribuer à expliquer la difficulté de réagir rapidement à des signalements qui, pour être inquiétants, n'en sont pas moins noyés dans nombre d'affaires similaires, suivies tant par les services sociaux que par les services de police ou judiciaires. Les données nationales font ainsi apparaître l'accroissement important des dossiers de mineurs en danger dont les juges des enfants sont saisis : + 7,8 % pour la seule année 20044. Les informations présentées ici sont issues des données statistiques du ministère de l'intérieur (faits constatés en matière de mœurs) et du casier judiciaire national (condamnations). Elles font apparaître les spécificités du ressort de la cour d'appel de Douai en matière de criminalité et de délinquance sexuelles. · Les faits constatés en matière de mœurs La délinquance en ce domaine a augmenté entre 1994 et 2004 dans le département du Nord de 47 % et dans le département du Pas-de-Calais de 60 % contre 50 % au niveau national sur la même période. La part des victimes mineures dans le total des viols et agressions sexuelles (faits constatés en 2004 par les services de police et de gendarmerie) s'élève à 63 % pour l'ensemble de la France, à 45 % dans le ressort de la cour d'appel de Paris et à 75,1 % dans le ressort de la cour d'appel de Douai. · Les condamnations - En matière de criminalité sexuelle : La part des infractions sexuelles dans les condamnations criminelles prononcées en France est en hausse constante : de 24,6 % en 1984, elle est passée à 40,7 % en 1994 et atteint 53,4 % en 2004. Entre 1990 et 2003, dans le ressort de la cour d'appel de Douai, le nombre de condamnations pour crime sexuel a été multiplié par 3,2 (+ 222 %) alors qu'au niveau national, ce nombre a doublé sur la même période (+ 100 %). En 2003, les cours d'assises du ressort de la cour d'appel de Douai ont prononcé 7 % des condamnations criminelles, tout contentieux confondu. La même année, elles ont prononcé 8 % (sur 1 470 condamnations prononcées en France en ce domaine) des condamnations pour crimes sexuels. Ces 119 condamnations pour crimes sexuels représentaient 54 % de l'ensemble des condamnations criminelles prononcées dans le ressort de la cour d'appel de Douai contre 48 % au niveau national. - En matière délictuelle : Entre 1990 et 2003, le nombre de condamnations pour délit sexuel a crû de 63 % dans le ressort de la cour d'appel de Douai contre 32 % en France. En 2003, les tribunaux correctionnels du ressort de la cour d'appel de Douai ont prononcé 7 % des condamnations délictuelles, toute forme de contentieux confondu. La même année, ils ont prononcé 582 condamnations pour délit sexuel, soit 8,4 % de l'ensemble des condamnations délictuelles en matière sexuelle au niveau national. Tout en soulignant à de nombreuses reprises, lors des travaux de la commission, son souhait de ne pas voir ternie à tort l'image du Boulonnais, l'un des membres de la commission d'enquête, M. Guy Lengagne, député du Pas-de-Calais et ancien maire de Boulogne-sur-Mer, a rappelé que la commune d'Outreau elle-même avait déjà été endeuillée par la dramatique affaire dite « des frères Jourdain » qui en février 1997, dans des circonstances particulièrement horribles, avaient violé et assassiné quatre jeunes filles habitant cette petite ville. Point n'est besoin de rappeler également, puisqu'il s'agit d'un fait d'actualité à l'heure où la commission d'enquête procède à ses investigations, que le « second procès d'Outreau »5 porte sur une affaire de pédophilie et que les mis en cause Le cadre dans lequel se sont situées ces affaires d'Outreau est ainsi décrit par MM. René-Philippe Dawant et Georges Huercano-Hidalgo dans leur ouvrage intitulé Contre-enquête à Outreau : « La population a fort évolué. Les Aciéries Paris Outreau ont fermé. Si Boulogne-sur-Mer reste le premier centre de traitement du poisson, celui-ci est plus souvent transporté par camion que par bateau. L'industrie de la pêche s'est effondrée. Le textile également. Avec un taux de chômage de 15 %, le Pas-de-Calais détient le record de France. À la Tour du Renard, on compte 40 % de chômeurs. Les travailleurs ont cédé la place aux allocataires, aux chômeurs et aux retraités. _..._ Les ravages de l'alcoolisme sont perceptibles dans les rues, les magasins et les bistrots. La région et la municipalité consentent de gros efforts d'encadrement. Les services sociaux pallient de leur mieux toutes les carences. Le centre communal d'aide sociale garantit un quota de nourriture aux familles en difficulté, assure la gratuité des soins médicaux, encadre un surendettement endémique. » Plusieurs personnes auditionnées par la commission d'enquête ont évoqué la difficulté à réagir de façon adaptée et rapide à certains signaux d'alarme, lorsque s'accumulent les problèmes dans une zone géographique donnée. Ainsi Mme Claire Beugnet, responsable du service d'aide sociale de Boulogne-sur-Mer, a attiré l'attention des membres de la commission d'enquête sur les caractéristiques de cette population : « Il faut également tenir compte des populations auxquelles nous sommes confrontés. Dans un secteur en difficulté, avec tout un quartier de parents en difficulté le seuil de tolérance n'est pas le même que dans un quartier sans problème. »6 Le docteur Alain Leuliet, psychiatre, a pour sa part indiqué : « Dans le département du Pas-de-Calais règne malheureusement une grande misère sociale et économique. Quand je participe à un procès en cour d'assises, j'ai toujours l'impression d'un gâchis phénoménal. Nous arrivons après coup. Des sévices ont été commis, des enfants ont été victimes, des agresseurs attendent la sanction. Je me demande comment on pourrait anticiper un peu plus les situations. Vous avez été amenés à entendre les travailleurs sociaux. Nous essayons de travailler avec eux. On aurait peut-être pu éviter que des enfants soient victimes d'agressions sexuelles. Le problème des travailleurs sociaux est qu'ils sont isolés. Ils sont souvent anesthésiés, c'est-à-dire qu'ils côtoient tellement la misère sociale qu'ils sont amenés à relativiser certaines situations sociales en se disant qu'il y a pire. »7 Mme Hélène Sigala, juge des enfants à Boulogne-sur-Mer, a rappelé que, à l'époque où certaines des notes qui lui étaient adressées par les services sociaux témoignaient d'une suspicion d'agression sexuelle, elle avait dans son cabinet 600 dossiers en cours et « qu'environ 400 d'entre eux transpiraient plus ou moins les abus sexuels »8. Dans son témoignage au procès en appel à la cour d'assises de Paris, l'ex-directrice de l'école maternelle qu'avaient fréquentée les enfants du couple Badaoui-Delay à la Tour du Renard a notamment prononcé cette phrase qui, à elle seule, pourrait résumer toute la problématique du risque de banalisation et donc de moindre réactivité lorsque trop de clignotants sont allumés : « J'avais fini par m'habituer aux comportements des enfants de ce quartier. Mais tout ce que j'avais fini par trouver normal n'est pas tolérable, dans l'école où je travaille aujourd'hui. En fait, ce ne sont pas les mêmes normes » (propos rapportés dans un article de la Voix du Nord du 10 novembre 2005). B. L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES NOMBREUX SIGNAUX D'ALARME Qu'il s'agisse des avertissements de l'UTASS et de la Direction de l'enfance et de la famille ou de ceux de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, ces signalements n'ont manifestement pas été pris en compte. 1. Les notes des services de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) et de la Direction de l'enfance et de la famille (DEF) La Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais suivait, via les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du secteur de Boulogne-sur-Mer et de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) de la ville d'Outreau, la famille Badaoui-Delay depuis 1992. En sa qualité de responsable du service de l'ASE précité, Mme Claire Beugnet était en relation avec les assistants socio-éducatifs de l'UTASS d'Outreau, qui lui adressaient régulièrement des comptes rendus écrits de l'évolution des enfants et familles qu'ils suivaient. Elle-même, sur la base de ces informations, était amenée à transmettre des rapports de situation au juge des enfants, voire à effectuer des signalements au parquet. Si, entre 1992 et 1995, l'action de ces services s'est inscrite, pour ce qui concerne la famille Badaoui-Delay, dans un cadre de prévention relativement classique (intervention des services de protection maternelle et infantile, prise en charge de travailleuses familiales à domicile) néanmoins des placements temporaires des enfants sur demande de la mère eurent lieu avant le placement sur décision judiciaire de 1995. Il existe en effet deux catégories de placements dont il convient de rappeler les grandes lignes : le placement volontaire et le placement sur décision judiciaire, ce dernier intervenant après une saisine du juge des enfants. · Dans le cadre d'un placement volontaire, l'enfant peut être remis par ses père et mère au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Une autorisation écrite des parents est nécessaire et donne lieu à la conclusion d'un accord. La décision quant au lieu et au mode de placement de l'enfant est prise entre la famille et le service de l'ASE. Ce service peut également accorder des secours financiers aux père et mère de l'enfant. Le placement peut être très temporaire. En tout état de cause, lorsque l'enfant est remis volontairement par ses parents au service de l'ASE, celui-ci ne peut prendre aucune mesure concernant l'enfant pour une durée supérieure à un an. Le service de l'ASE doit en effet revoir chaque année l'ensemble de la procédure d'admission, afin de vérifier que les parents ne peuvent, pour des motifs matériels ou psychologiques, assumer leurs obligations vis-à-vis de l'enfant. Les parents doivent de nouveau consentir à la poursuite du placement de l'enfant. Le service de l'aide à l'enfance doit saisir le juge des enfants si le comportement de la famille est de nature à mettre en danger la situation de l'enfant. Le juge peut prendre des mesures d'assistance éducative, parmi lesquelles une décision de placement. · Dans le cadre du placement sur décision judiciaire ordonné par le juge des enfants, lorsque l'enfant est remis au service de l'aide sociale de l'enfance, la famille peut donner son avis quant au choix et au mode de placement de l'enfant. Cet avis ne lie pas le service de l'ASE. L'avis de l'enfant peut être recueilli pour toutes les décisions le concernant. Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision. Lorsque l'enfant est placé, la durée de la mesure ne peut excéder deux ans et peut être renouvelée par une décision motivée (cf. infra texte de l'article 375 du code civil). Les mesures d'assistance éducative peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur ou de sa famille. En cas de placement du mineur, les parents continuent, en principe, à exercer leur autorité parentale. Le juge fixe les modalités de leurs droits de visite, d'hébergement et de correspondance. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, les parents du mineur peuvent être privés provisoirement de ces droits. Or, entre 1995 et 2000, de nombreux rapports et notes de nature à attirer l'attention furent transmis à l'autorité judiciaire. C'est dès le 31 mars 1995 que fut établi par l'UTASS d'Outreau un rapport concernant la famille Delay, rapport envoyé à la responsable de l'ASE, Mme Claire Beugnet, qui l'amena à saisir l'autorité judiciaire. C'est cette alerte qui devait déboucher sur le placement judiciaire de Pierre. La famille comptait à l'époque trois enfants. Le rapport ne constatait pas de problèmes particuliers pour le bébé de dix mois. En revanche, il signalait déjà Jean comme « un enfant apparaissant comme très perturbé » et s'inquiétait particulièrement de la situation de Pierre, relevant par exemple : « En présence de M. Delay, il semble complètement renfermé sur lui-même, ne lui adresse que très difficilement la parole. » ou : « Il craint, apparemment, énormément M. Delay. » Le rapport soulignait que l'enfant lui-même souhaitait son placement. Il concluait de la façon suivante : « Les réactions de M. et Mme Delay envers l'enfant, la souffrance du petit garçon qui ne trouve pas sa place dans sa famille, la violence inhérente à ces problèmes de relations, font qu'il nous semble important de demander une mesure de protection envers cet enfant. » Lors de son audition par la commission d'enquête9 , Mme Claire Beugnet a fait valoir que sur la base des indications contenues dans ce rapport - et notamment du constat de rejet, devenant manifeste, de l'enfant par sa mère - elle avait estimé qu'il y avait danger au sens de l'article 375 du code civil, lequel dispose : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. « Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. » Mme Claire Beugnet transmit le 13 avril 1995 le rapport du service social avec une lettre d'accompagnement à en-tête du Conseil général du Pas-de-Calais (Direction de l'enfance et de la famille, antenne de Boulogne-sur-Mer), sous sa signature, par délégation du Président du Conseil général du Pas-de-Calais. L'ensemble fut adressé au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Le parquet informa Mme Claire Beugnet du fait qu'il estimait qu'effectivement il y avait danger au sens de l'article 375 et que la juge des enfants, Mme Hélène Sigala, était saisie. Celle-ci fixa une audience à laquelle furent conviés M. et Mme Delay, les travailleurs sociaux qui avaient rédigé le rapport ainsi que l'enfant concerné. À la suite de celle-ci, en juin 1995, une mesure de protection judiciaire, par le biais d'une ordonnance de placement, fut ordonnée par la juge au bénéfice de Pierre. Jean, dont les difficultés étaient signalées dans le rapport, resta toutefois en dehors du champ de la protection judiciaire. Cependant, l'UTASS d'Outreau continua à suivre, dans un cadre préventif, la famille Delay, et transmit à plusieurs reprises à Mme Claire Beugnet d'autres éléments d'information qui l'amenèrent à saisir à nouveau le parquet. Une seconde note fut ainsi transmise dès le 6 mai 1996 par la Direction de l'enfance et de la famille au procureur de la République du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Mme Claire Beugnet, toujours par délégation du Président du Conseil général, y sollicitait une mesure de protection judiciaire pour Jean, alors âgé de trois ans et demi. Dans le rapport social « en vue de signalement » qui y était joint, rédigé par l'UTASS, figuraient notamment les indications suivantes : - Jean, scolarisé en septembre 1995, avait très rapidement été signalé par l'école pour ses troubles importants de comportement ; - Mme Delay sollicitait auprès de tous les intervenants médico-sociaux, le placement de cet enfant. Les assistants sociaux signataires du rapport concluaient de façon alarmante : « nous pensons que la santé, la sécurité, le développement psycho-affectif de Jean risquent d'être gravement compromis et nous sollicitons, pour lui, une mesure de protection judiciaire. » Il s'agissait donc d'une demande claire de mesure de protection judiciaire pour cet autre enfant, formulée dès mai 1996. Une mention manuscrite inscrite au bas de la première page de la note fait toutefois état d'un classement sans suite, dès le 9 mai 1996. Interrogée par la commission d'enquête sur les raisons de ce classement sans suite, très rapide, par le parquet, Mme Claire Beugnet a indiqué que ce dernier avait expliqué sa décision par l'absence de danger, du fait de la collaboration de la famille. Une lecture, même rapide, de ce rapport de l'UTASS d'Outreau, lui-même daté du 30 avril 1996, pouvait laisser néanmoins planer des doutes sur la volonté réelle de collaboration des époux Delay. Y figuraient en effet des indications telles que : « Depuis mars 1995, nous avions demandé à M. et Mme Delay de prendre rendez-vous auprès de l'équipe du Centre médico-psychologique d'Outreau. Après plusieurs mois de tergiversations, ils se sont enfin décidés » (p. 4) ou encore : « Convoqués plusieurs fois (trois fois à ce jour), pour faire le point de la période d'observation et parler des soins qui s'avèrent indispensables, ils ne se sont ni présentés ni excusés » (p. 4) et : « Compte tenu du lourd passé des deux parents, de leur résistance à envisager des soins psychiatriques au long cours _..._, de la collaboration très épisodique de la famille avec les différents intervenants médico-sociaux rendant difficile la mise en place d'un projet thérapeutique ou éducatif » (extraits de la conclusion, p. 6). En décembre 1998, le parquet procéda cette fois au classement sans suite d'un « signalement judiciaire concernant des révélations faites par Mme Delay quant à des sévices sexuels sur son enfant ». Dans ce signalement en date du 1er décembre 1998, deux assistantes socio-éducatives de l'UTASS faisaient état de déclarations effectuées par Mme Delay lors de leur visite le jour même à son domicile, selon lesquelles Jean aurait été victime d'une agression sexuelle dans la cave de l'immeuble au cours de l'été 1997. Par ailleurs, durant l'été 1998, Luc se serait plaint de Jean, au motif qu'il lui faisait des « manières », en simulant une sodomie. Avant la rentrée scolaire Jean aurait désigné son agresseur, reconnu par les parents Delay sans qu'ils soient en mesure de donner son nom. Les parents Delay auraient envisagé de porter plainte mais - constataient les auteurs du signalement - ne l'avaient toujours pas fait à la date du 1er décembre 1998 (soit un an et demi après les faits supposés). Lors de l'audition des services de l'UTASS par la commission, Mme Sabine Joly, assistante socio-éducative, a expliqué que les parents Delay avaient déjà évoqué auparavant cette agression sexuelle contre leur fils et que c'est parce que, contrairement aux recommandations de ses collègues, ils n'avaient pas porté plainte, que l'UTASS avait procédé elle-même au signalement. La brigade des mineurs aurait alors mené une enquête et interrogé Pierre, ses parents ayant déclaré qu'il était présent lors de l'agression. Toutefois, malgré l'apparente possibilité de rechercher l'identité de l'agresseur (les parents Delay disaient le connaître de vue, l'enfant victime l'avait reconnu et son frère était présent), il ne semble pas que les recherches aient été poussées beaucoup plus loin, d'où un classement sans suite. De sorte que, chaque fois qu'après on fit état de perturbations de la sexualité des enfants, celles-ci furent systématiquement reliées à cet épisode, même s'il ne fut jamais établi qu'il s'était produit, en tout cas sous la forme décrite. Les suites de l'affaire feront ensuite apparaître que Myriam Badaoui avait entraîné ses enfants dans ce mensonge car il permettait de donner une explication à leur comportement à fortes connotations sexuelles, tout en masquant l'identité des véritables auteurs des abus. Le signalement de l'UTASS du 1er décembre 1998 concluait de la façon suivante : « Les troubles du comportement et les propos de l'enfant laissent à penser que Jean et peut-être Luc auraient été victimes de sévices. Mme Delay dit aussi qu'elle aurait parlé de ses problèmes avec Mme le juge Sigala lors d'une audience la semaine dernière. » Indépendamment de ces signalements ponctuels transmis au parquet, des informations plus ou moins inquiétantes arrivaient régulièrement dans le cabinet du juge des enfants qui, comme le rappelle la mention précitée, pouvait être amené également à suivre les problèmes de cette famille dans le cadre de ses audiences. En effet, des rapports de situation régulièrement établis par l'UTASS d'Outreau, au titre du suivi du placement de Pierre, étaient transmis au juge des enfants, pour information, par la responsable de l'Aide sociale à l'enfance de Boulogne-sur-Mer. Or, ces rapports, même s'ils étaient destinés avant tout à l'examen d'une possibilité de révision de la mesure de protection judiciaire de placement, contenaient des indications défavorables sur l'évolution de la famille. La poursuite du placement judiciaire de Pierre était d'ailleurs régulièrement proposée à la suite de ces bilans. Ainsi, dans un rapport de situation transmis au juge des enfants le 23 décembre 1997, figurait l'indication suivante, sous la rubrique relative à la situation actuelle des parents : « M. et Mme Delay rencontrent tous deux des problèmes d'ordre psychiatrique qui les mettent en grande difficulté quand il s'agit d'assumer l'éducation de leurs enfants. L'équipe du Centre médico-psychologique (CMP) est très inquiète quant à l'évolution de Jean, âgé de cinq ans et de Luc, âgé de quatre ans _..._ » Dans un autre rapport de situation en date du 15 décembre 1998, établi et transmis dans les mêmes conditions, étaient apportées les indications suivantes sur l'évolution de la situation familiale : « M. et Mme Delay évoluent toujours sur un mode conflictuel. Ils sont actuellement dans une phase où ils songent à se séparer, M. Delay s'étant remis à boire. Mme Delay craint la violence de son mari et parle de partir en foyer d'hébergement avec ses enfants. Elle dit, par ailleurs, qu'elle se sent incapable d'assumer seule la charge des enfants. Mme Delay s'affirme toujours prête à entamer une psychothérapie, mais ne fait aucune démarche en ce sens _..._ » Dans une note du 12 avril 1999, il est rendu compte d'un retour de week-end au domicile familial qui s'est très mal passé pour Pierre : il est expliqué « qu'il en est rentré extrêmement perturbé », qu'il a affirmé « qu'il n'irait plus en sortie chez ses parents ». Il est également fait état de violences de M. Thierry Delay qui, supportant mal d'avoir à charge les quatre enfants alors qu'il regardait à la télévision un film d'horreur, aurait pris un balai et corrigé les deux aînés qui l'empêchaient de voir son film, et aurait giflé le plus petit âgé de deux ans. Il ne semblait de toute évidence pas s'agir d'un week-end qui, exceptionnellement, se serait mal passé, la note mentionnant que Pierre avait dit explicitement qu'il ne supportait plus le climat régnant chez lui à chacun de ses retours. Les assistantes socio-éducatives soulignaient dans cette note que la vie de cette famille leur paraissait toujours aussi inquiétante pour l'équilibre de l'enfant placé, mais aussi pour celui des enfants restés à la maison. Elles mentionnaient que M. Thierry Delay était « animé d'une violence importante, capable de ressortir à la moindre contrariété » et que Mme Myriam Delay craignait que « comme il l'a annoncé, il tue toute sa famille et se suicide ensuite ». Une mention manuscrite au bas de la note fait état de sa transmission pour information au juge des enfants Mme Hélène Sigala. Un rapport de situation adressé à Mme Hélène Sigala le 10 janvier 2000 l'informait d'un changement d'organisation des liens enfant-famille à la suite des difficultés rencontrées lors des hébergements au domicile : Pierre voyait désormais ses parents ainsi que ses frères une heure tous les quinze jours dans les locaux de l'UTASS. L'équilibre relationnel revenant progressivement, des rencontres à domicile pourraient être bientôt envisagées, soulignait ce bilan avant de relater qu'à l'école, Pierre présentait des troubles du comportement et avait même dû être déscolarisé totalement pendant quelques jours compte tenu de sa violence. Le rapport concluait sur la nécessité du maintien du placement en famille d'accueil. Par ailleurs, parallèlement à toutes les notes précitées, d'autres au caractère non moins alarmant furent établies via un autre circuit, celui de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ). 2. Les notes des services de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ) La DDPJJ est intervenue au titre du suivi de la mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) finalement décidée par la juge des enfants pour Jean à partir du 16 juin 1998. En effet, dans le cadre de la tutelle aux prestations sociales décidée pour cette famille largement surendettée, Mme Badaoui-Delay avait demandé à nouveau que Jean soit, lui aussi, placé (après avoir fait l'objet de plusieurs accueils provisoires). À cette solution, la juge des enfants préfèra celle, plus légère, de l'IOE. Cette mesure d'assistance éducative fut étendue à son frère Luc à compter du 26 novembre 1998, donnant également lieu à un suivi par la DDPJJ. La juge des enfants, Mme Hélène Sigala, indiqua lors de son audition par la commission d'enquête avoir finalement ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) pour toute la fratrie restée au domicile. Il convient ici, par souci de clarification, de rappeler brièvement quels sont les grands principes de l'intervention judiciaire en matière d'enfance en danger. Les articles 375 à 375-8 du code civil organisent l'intervention judiciaire en faveur des mineurs en danger et posent des principes clairs : le juge doit privilégier le maintien du mineur dans sa famille et s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. La procédure débute par une phase d'instruction au cours de laquelle le juge peut ordonner diverses mesures, afin d'avoir une meilleure connaissance du mineur et de son milieu familial : enquête sociale, mesure d'investigation et d'orientation éducative, expertise. Des mesures urgentes de protection peuvent aussi être décidées, comme le placement provisoire du mineur, puis deux types de prises en charge sont possibles : · L'action éducative en milieu ouvert (AEMO) Elle consiste à apporter aide et conseil à la famille pour lui permettre de surmonter les difficultés éducatives et morales qu'elle rencontre. Elle présente un caractère impératif pour le mineur comme pour sa famille. Elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu actuel, maintien que le juge des enfants peut subordonner à des obligations telle que celle de fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation. · Le retrait du mineur de son milieu naturel S'il s'avère nécessaire de retirer le mineur de son milieu actuel, le juge des enfants peut le confier : - à l'un des parents qui n'en avait pas la garde ; - à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; - à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; - à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le juge des enfants peut confier le suivi de ces différentes mesures : - soit au secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse ; - soit au service d'aide sociale à l'enfance du conseil général ; - soit au secteur associatif habilité. C'est pourquoi, dans l'affaire d'Outreau, la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice, a été amenée, parallèlement au service d'aide sociale à l'enfance relevant du Conseil général, à suivre elle aussi la famille Delay et à transmettre à ce titre un certain nombre d'observations alarmantes. Ainsi, dans une note à en-tête du ministère de la justice, DDPJJ du Pas-de-Calais, en date du 28 octobre 1998 et adressée au juge des enfants de Boulogne-sur-Mer, Mme Hélène Sigala, une assistante sociale, Mme Françoise Lemaître, faisait état du refus de la famille Delay de participer au travail d'investigation et d'orientation éducative (IOE), résultant de la décision du juge des enfants en date du 16 juin 1998, concernant Jean. Les difficultés de cet enfant, son attitude très sexualisée et les carences éducatives familiales y étaient clairement identifiées, alors qu'il n'avait que six ans. Cette note mentionnait par exemple : « L'enfant mime souvent des scènes sexuelles, ce qui pose question, quant à ce qu'il peut entendre ou voir à la maison. » « Notons qu'au domicile se trouve une bibliothèque remplie de cassettes-vidéo de nature pornographique, ce qui vient démentir les déclarations du couple à madame le juge des enfants, lors de l'audience où l'IOE avait été décidée (Mme Delay avait alors déclaré la revente de ces cassettes). » « M. et Mme Delay craignent ce que les enfants peuvent raconter sur leur vie quotidienne. » « Le CMP d'Outreau exprime ses vives inquiétudes sur l'évolution psychologique des enfants. Aucun travail avec la famille n'est possible. » « L'attitude fuyante des parents, après avoir été si alertants sur la situation de leur fils, ne peut manquer de poser question. » Une autre note, datée du 20 novembre 1998, concluait de la façon suivante : « La demande d'aide du couple à mieux appréhender l'éducation de leurs enfants (qui s'est révélée illusoire) cache peut-être un souhait de placement, qu'il n'ose exprimer franchement. » Par lettre, la même assistante sociale de la DDPJJ saisit, le 2 décembre 1998, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer de la situation de Jean : elle soulignait des difficultés de comportement et notait que d'après les parents, les perturbations à connotations sexuelles de cet enfant remontaient à l'été 1997, date à laquelle il aurait été victime d'une agression sexuelle par un homme qu'ils connaissaient de vue, dans la cave de l'immeuble. Elle concluait : « Compte tenu de l'absence de mobilisation de Monsieur et Madame Delay face à l'agression de l'enfant, nous vous transmettons ainsi ces éléments. » Rappelons qu'à la même époque, l'UTASS d'Outreau via la Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais avait également adressé un signalement au parquet en ce sens. En juin 1999, le directeur de la DDPJJ transmit au juge des enfants Mme Hélène Sigala un bilan des mesures d'assistance éducative concernant Jean et Luc, âgés à cette date respectivement de sept et cinq ans. Ce rapport d'une quinzaine de pages avait été établi par la même assistante sociale, Mme Françoise Lemaître. Après avoir rappelé que les parents s'étaient souvent montrés réticents pour collaborer aux mesures d'assistance éducative, ce rapport, à la fois social et psychologique, appréhendait en réalité la situation de la famille dans sa globalité. Des éléments susceptibles de retenir l'attention y étaient rappelés et certaines observations psychologiques que l'on peut qualifier avec le recul de prémonitoires y étaient déjà formulées. En témoignent ces extraits : « Jean reproduit les scènes de violence observées chez son père. Il frappe sa mère, lui a déjà fait saigner le nez, les lèvres. _..._ Il fait des « manières » à Luc, l'embrasse sur la bouche, le tripote. » « Mme Delay évoque la possibilité d'un placement si la situation ne s'améliore pas. » « Mme Delay a pu exprimer sa lassitude à remplir tous les rôles à la maison. Madame, toujours dépressive, ayant besoin de dormir, de se promener seule, de voir ses amies, laissant son mari débordé par la surveillance des quatre enfants. » « En mars 1999, Pierre se plaignait d'avoir été battu par M. Delay et confiait à son assistante sociale référente (Mme Joly) son désir de ne plus venir chez ses parents. » « M. et Mme Delay ont tendance à se montrer méfiants par rapport à ce que les enfants peuvent raconter du quotidien familial. » « Luc est un enfant qui a souvent été hospitalisé suite à des blessures liées à sa turbulence. Il a également été opéré en urgence pour l'ablation d'un testicule. » « Les désirs de soins (psychologiques) de Mme Delay sont apparus illusoires. » « Il apparaît important de ne pas se laisser envahir par le discours dense de Mme Delay. » « Les troubles familiaux ne sont pas récents et les intervenants extérieurs ont remarqué la capacité des Delay à demander de l'aide tout en mettant en échec ce qui pourrait faire évoluer leur situation. » « L'attitude de Mme Delay illustre un fonctionnement général marqué par le paradoxe et la manipulation (où il s'agit de dire et d'annuler en même temps ce que l'on dit, le but étant essentiellement de mesurer son emprise sur l'autre). » « Les troubles de comportement sont repérés chez Jean depuis 1995. S'y ajoutent depuis 1998, des troubles du comportement sexuel. » « Il est souvent question de choses qu'il "sait" mais n'a pas le droit de dire. » « Ses récits et ses dessins sont saturés d'éléments anxiogènes. » « Luc, très agité, tour à tour anxieux ou excité, est un enfant "en errance."» « Luc trouve dans le déshabillage et le maniement de poupées une source d'excitation massive qu'il ne peut gérer. Cette attitude peut-elle s'expliquer par les attouchements sexuels dont il aurait fait l'objet de la part de son frère, et/ou par la présence au domicile des cassettes à caractère pornographique, ou bien y a-t-il lieu d'envisager une autre forme d'atteinte sexuelle chez ce petit garçon ? » La lecture de ce rapport, daté de juin 1999 et qui se fonde sur des observations antérieures, conduit à se demander si la détresse des enfants Delay, l'incapacité de leurs parents à les éduquer et même le profil psychologique manipulateur de leur mère, n'auraient pas pu être détectés beaucoup plus tôt. Certes la situation était partiellement brouillée par l'attitude de Myriam Badaoui-Delay, qui revenait souvent sur des demandes de placement aussitôt après les avoir formulées. Cette attitude a été interprétée comme la manifestation d'un certain attachement à ses fils. Elle pouvait s'expliquer aussi, mais cela n'a semble-t-il pas été pris en compte, par des raisons plus prosaïques, c'est-à-dire par le souci de conserver les prestations familiales qu'un placement durable des quatre enfants risquait de faire perdre au foyer, en vertu des dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. 3. Le manque de circulation et d'analyse des informations concernant les enfants en danger Les trois enfants Delay demeurant au foyer firent l'objet d'un placement par décision judiciaire en date du 25 février 2000 ; leur suivi resta assuré par la Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais. Dès le 28 mars 2000, dans une « note à transmettre au juge des enfants » envoyée à leur responsable hiérarchique, les assistants sociaux de l'UTASS indiquaient que les trois enfants avaient « manifesté immédiatement un immense soulagement à la suite de leur placement ». Ils précisaient qu'à son arrivée en famille d'accueil, l'un des enfants présentant de nombreux hématomes avait été examiné par un médecin : l'enfant leur avait indiqué que son père l'avait frappé, ajoutant qu'il n'avait pas le droit de le dire. Un droit de visite et d'hébergement chaque semaine fut néanmoins aménagé par ordonnance de la juge des enfants délivrée le 3 avril 2000. Le suivi de ce nouveau placement judiciaire ayant été confié à la Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais, l'UTASS d'Outreau continuait à adresser des notes à la responsable de la DEF, qui les retransmettait au juge des enfants. Leur contenu laissait planer peu de doutes sur le fait que les enfants étaient victimes de maltraitance lors de leurs retours au domicile parental : « nous avons découvert des enfants profondément marqués par le climat de violence ancien mais encore bien présent à chaque retour en week-end » (rapports de situation établis le 27 juillet 2000). Ce ne fut certes que le 30 novembre 2000 que, pour la première fois, des propos des enfants à leur assistante maternelle, faisant cette fois clairement état d'abus sexuels de la part de leurs parents, furent rapportés dans une note de l'UTASS, enclenchant dans les semaines qui suivirent la réaction de la machine policière et judiciaire. On peut toutefois se demander si une meilleure circulation et partant une meilleure analyse, après concertation, des nombreuses informations recueillies au cours des mois et années précédents n'auraient pas pu déclencher une protection plus rapide et plus efficace des enfants, évitant la prolongation d'une situation dont les conséquences furent dramatiques et permirent à cette affaire de prendre une dimension débordant largement de son cadre initial. Il n'y a tout d'abord pas eu de contacts suivis entre les services sociaux départementaux (l'UTASS d'Outreau) et les services sociaux dépendant de la Protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire du ministère de la justice (le Comité d'action éducative d'Outreau : CAE). Certes de tels contacts ne sont pas impossibles, mais la consultation des pièces administratives du dossier montre qu'ils n'ont pas eu lieu. Tout juste trouve-t-on la trace d'une tentative qui a tourné court dans le rapport déjà cité de la DDPJJ de juin 1999, qui mentionne : « La réunion de synthèse concernant Jean et Luc a eu lieu le 6 mai 1999. Le service social (UTASS de Boulogne-sur-Mer secteur Outreau) et le CMP, invités, étaient absents. » Interrogé sur ce point lors de son audition par la commission d'enquête, M. Henri Villeneuve, chef du service socio-éducatif local de Boulogne-sur-Mer a indiqué : « Habituellement, nous ne recevons pas les notes de la DDPJJ, mais nous pouvons en prendre connaissance. Il n'y a pas de travail systématique, c'est assez difficile de faire passer des notes d'un service à l'autre. »10 Mme Sabine Joly, assistante socio-éducative, a rappelé que la représentante de la DDPJJ leur avait fait part de sa difficulté à rencontrer la famille Delay et avait dû tenir une réunion avec l'UTASS une fois au début, et une fois à la fin, pour faire part des conclusions qu'elle allait demander au juge des enfants. Elle a précisé que néanmoins l'UTASS était souvent invitée aux réunions de synthèse de la DDPJJ. En réponse à une question du Rapporteur, M. Henri Villeneuve a considéré sans hésitation que la relation entre les deux services aurait dû être systématique et qu'elle l'aurait aidé si cela avait été le cas. Mme Claire Beugnet a expliqué que de par sa fonction, elle n'avait, pour sa part, pas directement de contacts avec la DDPJJ et qu'il était rare qu'un service extérieur la saisisse. Sans aller jusqu'à l'affirmation de concurrence et d'absence complète de communication évoquée par MM. Dawant et Huercano-Hidalgo dans l'ouvrage Contre enquête à Outreau : « L'examen des rapports de ces deux services qui semblent se concurrencer sur le terrain, indique qu'ils ne communiquent pas entre eux » (p. 51), la commission d'enquête déplore un certain cloisonnement de fait entre les services sociaux départementaux et les services de l'État. Rien ne sert de multiplier les suivis s'ils ne débouchent pas sur une synergie commune. La concertation, l'échange et le recoupement des informations, dans le cadre d'une coopération entre l'UTASS et le CAE d'Outreau, auraient sans doute contribué à conforter l'analyse des deux équipes sur l'évolution préoccupante de la famille Badaoui-Delay. Indépendamment de l'épisode, classé sans suite, de l'agression dont aurait été victime Jean durant l'été 1997, la suspicion d'atteintes sexuelles sur un enfant de la famille était clairement formulée dans la note de la DDPJJ de juin 1999. Un travail en commun et des signalements coordonnés auraient dû induire une plus forte réactivité des autorités destinataires. Par ailleurs, la prise en compte des informations détenues par les services médicaux peut, dans certains cas, venir conforter des soupçons de maltraitances ou d'abus sexuels. Or, les recherches entreprises dans le cadre de l'enquête préliminaire de police début 2001 auprès du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ont mis en évidence un nombre assez élevé d'admissions des enfants Delay à l'hôpital, sauf pour Pierre qui, placé très jeune en famille d'accueil, n'avait été hospitalisé qu'une seule fois pour un motif bénin. Ainsi Luc avait été admis à onze reprises en moins de trois ans (entre novembre 1994 et août 1997), cependant que Paul avait été hospitalisé à neuf reprises, en l'espace d'à peine trois ans (entre février 1996 et décembre 1998). Les motifs de ces hospitalisations étaient variés, certains semblant néanmoins susceptibles d'attirer a priori l'attention : · Concernant Luc, on peut citer les exemples suivants : - août 1995 : infection du prépuce avec ulcération du méat urétral, - octobre 1995 : traumatisme crânien et perte de connaissance initiale, - 12 décembre 1995 : inflammation de la bourse droite, - 30 décembre 1995 : infection du testicule. · Quant à Paul, il a été admis à l'hôpital notamment pour les raisons suivantes : - mars 1997 : douleurs abdominales (selles solides avec sang rouge), - septembre 1997 : diarrhée fébrile avec traces de sang dans les selles, - novembre 1997 : diarrhées à deux reprises, - février 1998 : diarrhée aiguë. Jean avait, pour sa part, été hospitalisé quatre fois, mais les recherches effectuées ne permirent pas de retrouver la trace d'une présentation à l'hôpital lors d'un Noël précédent, et donc de l'épisode relaté dans les premières révélations des enfants, faisant état d'une interrogation d'un médecin sur un éventuel abus sexuel de leur père. Selon les autorités médicales, la détection des pratiques de sodomie sur de jeunes enfants pose problème. Les faits sont éventuellement décelables pendant quelques semaines mais la cicatrisation est en général assez rapide. Cette difficulté quant à l'établissement d'une preuve médicale explique les conclusions de l'examen pratiqué sur les quatre enfants début 2001, lorsqu'ils eurent révélé des agressions sexuelles. Les conclusions du praticien étaient à peu près identiques chaque fois : l'examen général permettait de retenir un tonus sphinctérien légèrement amoindri ; l'hypotonie du sphincter anal était cependant manifeste pour l'un d'eux ; aucune trace d'agression sexuelle n'était relevée, mais il n'était pas possible d'exclure que les enfants avaient été sodomisés par le passé. En juin 2002, un nouveau rapport d'expertise médicale, très détaillé, rendu sur ordonnance du magistrat instructeur et signé par trois médecins experts, analysait notamment les admissions à l'hôpital des enfants à l'époque des faits. Des extraits du dossier de la procédure pénale, détaillant les actes dénoncés par les enfants, leur avaient été communiqués, ce qui, évidemment les plaçait dans une situation très différente de celle des médecins qui les avaient examinés sans plus d'informations. Il ressortait de cette expertise médico-légale que certains des motifs d'admission pouvaient tout à fait être mis en rapport avec des agressions sexuelles, sans que cette corrélation puisse pour autant être établie. Par exemple, pour l'infection du prépuce avec ulcération du méat urétral, après avoir relevé qu'il pouvait s'agir d'une infection banale explicable par un autre motif, les experts concluaient : « dans le contexte, bien que l'on ne possède pas de données bactériologiques, on ne peut exclure l'hypothèse d'une infection secondaire à une fellation par contamination d'une bactérie de la sphère buccale ». S'agissant des hospitalisations des 12 et 30 décembre 1995, correspondant à une orchi-épidydimite, les médecins, après avoir noté qu'il s'agissait d'une infection très rare chez l'enfant, concluaient que « bien que l'orchi-épidydimite constatée en décembre 1995 n'ait pas été documentée bactériologiquement, l'hypothèse d'une infection provoquée par une bactérie sexuellement transmissible est plausible ». S'agissant de Paul, leurs conclusions étaient rédigées dans les termes suivants : « En dehors de la diarrhée infectieuse prouvée, les épisodes diarrhéiques peuvent être rattachés à un syndrome d'irritation rectale secondaire à des pénétrations anales. L'existence d'une hémorragie de sang rouge par l'anus est très évocatrice d'une agression rectale. » Ces admissions à l'hôpital auraient-elles pu constituer des signaux d'alarme ? Recoupées entre elles et surtout avec d'autres informations, notamment celles contenues dans les notes des services sociaux, probablement. Considérées isolément, c'était sans doute plus difficile. Les médecins du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer entendus par la commission d'enquête ont indiqué que les motifs d'admission qui auraient pu a priori induire des suspicions n'étaient en réalité, à eux seuls, pas révélateurs d'une maltraitance ou d'abus sexuels. À titre d'exemple, le docteur Jean-François Lemaitre a confirmé que l'hospitalisation d'août 1995 - pour infection du prépuce avec ulcération du méat urétral - faisait partie des lésions touchant les organes génitaux mais susceptibles d'être observées en dehors de toute maltraitance sexuelle, si bien qu'elle n'avait pas suscité d'inquiétude particulière. Le docteur Jean-François Lemaitre a ainsi résumé la problématique posée : « Les hospitalisations, prises séparément, ne nous permettaient pas de suspecter une maltraitance sexuelle. L'ensemble des hospitalisations traduisait certes une situation inquiétante et c'est pourquoi nous avons contacté la PMI. Par contre, j'ai consulté tous mes collègues et leurs avis convergent : en faisant abstraction de tout ce qui s'est passé par la suite, ces éléments, quoique inquiétants, étaient insuffisants pour faire un signalement judiciaire. »11 En effet, juridiquement, s'il y avait eu constatation de sévices physiques ou sexuels, les médecins auraient pu saisir le procureur de la République en application de l'article 226-14, 2° du code pénal, qui dispose que le secret médical n'est pas applicable au médecin qui « porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises » ; l'article précise que l'accord de la victime n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'un mineur. Les médecins de Boulogne-sur-Mer ont indiqué qu'à l'issue d'une hospitalisation, lorsque des carences étaient constatées sans que la situation soit toutefois suffisamment nette pour formuler un signalement judiciaire, ils alertaient parfois les services sociaux, par l'envoi d'un double du courrier de sortie au médecin de la protection maternelle et infantile (PMI). Un tel signalement avait d'ailleurs été effectué à l'occasion de la seconde hospitalisation, un peu douteuse, d'un des enfants Delay. Le docteur Jean-François Lemaitre a précisé qu'à l'époque, des informations étaient ainsi transmises à la PMI, mais que les réunions entre les deux services étaient trop rares (une réunion hebdomadaire est désormais organisée dans l'unité de néonatologie). Ces échanges d'informations ont donc leurs limites : non systématisés dans tous les hôpitaux, car n'ayant pas de caractère obligatoire, ils dépendent de l'esprit d'initiative, de la bonne volonté et de la disponibilité des professionnels. De plus, ils concernent essentiellement des nouveau-nés. Si la PMI réagit habituellement en demandant à une puéricultrice de se rendre chez les parents, ceux-ci gardent le pouvoir de lui refuser l'accès de leur domicile et, de façon plus générale, de refuser de collaborer avec les services sociaux. Le docteur Claude Reguet, ancien médecin du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, a souligné comme son confrère la difficulté de distinguer les situations inquiétantes, légitimant un suivi, de celles, encore plus alarmantes, nécessitant un signalement judiciaire. En se référant à son expérience professionnelle, il a mis en évidence l'émergence d'un autre cloisonnement, qui a rendu plus difficile la transmission des informations sur les situations à risque : « À l'époque où il y avait très peu de sévices sexuels mais énormément de cas de maltraitance, d'enfants battus, délaissés ou abandonnés, je me souviens que nous téléphonions directement au juge des enfants, qui dirigeait vers le procureur les parents à condamner et prenait directement en charge tous ceux qui présentaient une possibilité de rédemption ou en tout cas de réintégration familiale. Dès lors que les délits sexuels sont devenus courants et que la littérature pédiatrique sur la pédophilie s'est développée, il est devenu obligatoire de passer directement par le procureur, ce qui complique le signalement judiciaire car il faut disposer d'éléments de preuve concrets. »12 Après le signalement, la deuxième étape de la procédure a trait au recueil des déclarations des enfants et à leur prise en charge judiciaire. II. LA PAROLE ET LE TRAITEMENT DES ENFANTS : UN DÉFAUT DE PRUDENCE ET DE MÉTHODE Les agressions dont il apparaissait que les enfants Delay avaient été victimes auraient pu faire l'objet d'une action judiciaire ne sortant pas du cadre d'une affaire d'inceste familial. Mais dans leurs révélations les enfants ont peu à peu désigné des agresseurs étrangers au cercle familial et ont mentionné d'autres mineurs, qui auraient été victimes des mêmes violences que celles qu'ils avaient subies. Ces derniers ont progressivement confirmé les propos des enfants Delay, témoignant de faits qui apparaissaient de plus en plus graves et ont impliqué à leur tour de nouvelles personnes dans l'affaire. Les enfants ont ainsi été victimes et accusateurs, et paraissaient d'autant plus victimes que leurs accusations étaient plus graves. La protection due à l'enfant par l'institution judiciaire s'est de fait transformée en une sollicitude sans discernement pour tout ce que le mineur révélait. Sous l'effet de l'intérêt porté pour leur sort, les enfants ont d'abord vu leur parole mise en forme par les travailleurs sociaux chargés de les suivre après leur placement. Puis cette parole a été reprise dans une procédure judiciaire peu adaptée à prendre en compte sa singularité. On peut donc se convaincre de l'inadéquation de ces méthodes à travers le recueil de la parole des enfants par les services sociaux, par la police et le magistrat instructeur et lorsque l'on prend connaissance des quelques enregistrements qui ont été effectués. Mais on ne saurait cantonner ces dysfonctionnements à la seule procédure préalable au jugement et négliger le moment des assises et les problèmes soulevés par le placement des enfants. A. LE RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES ENFANTS PAR LES SERVICES SOCIAUX Plus de vingt enfants ont été placés dans des familles d'accueil agréées par la direction générale des services départementaux du Pas-de-Calais. Les assistantes maternelles avaient la lourde de tâche de s'occuper d'enfants particulièrement fragilisés ; chaque assistante se voyait désigner un assistant socio-éducatif qui rendait compte au responsable de l'antenne de Boulogne-sur-Mer du service Enfance et famille. Les assistantes maternelles auxquelles avaient été confiés les enfants Delay se sont vite retrouvées confrontées aux révélations que ces derniers leur faisaient sur des majeurs qui auraient été auteurs d'agressions sexuelles et sur des mineurs qui en auraient été victimes. Les propos des enfants étaient rapportés par les assistantes à leurs référents ; le procureur de la République était informé de leur contenu par le chef du service local Enfance et Famille. 1. Des déclarations mises en forme par les assistantes maternelles Au travers des pièces du dossier judiciaire il apparaît au premier abord très difficile de savoir dans quelles conditions ont été recueillies les révélations des enfants. Certaines d'entre elles sont mentionnées dans les rapports rédigés par les assistants socio-éducatifs à l'occasion de comptes rendus verbaux que leur faisaient les assistantes maternelles sur la base de notes que celles-ci prenaient. D'autres paraissent émaner directement de l'enfant, soit sous forme de lettre écrite de la main même du mineur et adressée au référent, soit sous forme de listes de noms dressées sans indication de destinataire et recopiées par les soins de l'assistante maternelle. Aucune indication n'est donnée dans les rapports des services sociaux sur le caractère spontané ou sollicité des paroles transcrites. Cependant, l'intervention des assistantes maternelles transparaît nettement au travers de certains détails. Par exemple, dans une note de l'UTASS du 7 juin 2001 adressée à la responsable de l'antenne locale du service Enfance et Famille, Mme Claire Beugnet, il est fait part de nouvelles révélations de deux enfants : « Madame Chochois qui accueille Luc nous a interpellé le mardi 5 juin. Luc reparle de certains événements : Monsieur l'abbé Dominique filmait ce que ses parents faisaient... (cet abbé est un prêtre-ouvrier qui habite à proximité de Monsieur et Madame Delay) ; il est toujours à vélo et s'appellerait Dominique Wiel. Luc parle aussi d'un "docteur". À la question de Mme Chochois "Que faisait-il ?" Luc répond : "Ben, il me soignait." En insistant un peu, Luc précise : "Il mettait ses doigts dans mon derrière, puis dans ma bouche, maman filmait". » L'identification du prêtre est clairement le résultat d'une initiative des membres des services sociaux. On relève aussi la façon dont s'est déroulé le questionnement : l'adulte a interrogé l'enfant au sujet du « docteur » en donnant un sens singulièrement orienté à sa question (« que faisait-il ? ») puis, l'enfant ne comprenant pas où voulait en venir son assistante maternelle, celle-ci a obtenu la dénonciation d'une nouvelle agression « en insistant un peu ». La suite de cette note montre comment le nom du médecin dont parle l'enfant précité est obtenu auprès de son frère, placé dans une autre famille d'accueil : « Suite à l'appel de Madame Chochois à Madame Bernard, Jean se souvient de certaines personnes : "Tata, il y aussi un docteur, un monsieur qui visite, le docteur [prénom et nom de famille cités] à Outreau, lui aussi a fait des manières." » La même note poursuit en se référant à des informations fournies cette fois par une troisième assistante maternelle qui accueille une enfant également placée dans le cadre de l'affaire d'Outreau et domiciliée en face de Mme Bernard : « Mme Philippot nous a fait part des réflexions d'Estelle. Estelle ne voulait pas voir le médecin, elle disait avoir peur et qu'il était méchant. Le carnet de santé est signé du docteur [même nom de famille que celui précédemment cité], médecin de famille. » Les assistantes maternelles étaient ainsi en rapport les unes avec les autres, coordonnant à l'occasion les questions posées aux enfants et rassemblant leurs renseignements. Les informations ainsi obtenues de l'enfant pouvaient de plus être corrigées à l'initiative de l'assistante avant d'être communiquées aux référents. Ainsi à une note du 15 juin 2001 est joint un document écrit de la main de Jean : « madame marico je ses pas son prénon » que les assistantes maternelles précisent comme suit : « Jean parle aussi d'un couple de Samer "Monsieur et Madame Marescaux", Madame s'appellerait "Odile". Ils ont une maison à Wirwignes, mais Monsieur serait huissier et son cabinet serait à Samer. » Des précisions analogues sont apportées sur Mme L. Les référents des assistantes maternelles ont validé cette façon de procéder et semblent avoir participé, eux aussi, à ces enquêtes comme le laisse penser une déposition faite au commissariat de Boulogne-sur-Mer le 7 juin 2001 par Mme Gagneur, assistante socio-éducative, qui déclare que l'identité de « l'Abbé Dominique [...] prêtre ouvrier qui demeure à proximité des époux Delay » a été établie à l'issue « de nos recherches » 13. Si la mise en forme des déclarations des enfants constitue la première étape de ce processus, elle est le préalable à l'établissement de listes de noms. 2. L'établissement de listes de noms Des listes de noms de personnes figurent parmi ces notes. Mme Bernard fait parvenir à ses référents le 15 juin 2001 deux listes manuscrites. La première est écrite de la main de l'enfant dont elle a la charge et ne contient que des noms et des indications de liens de parenté. La seconde est rédigée par l'assistante maternelle qui précise, à côté de chaque nom, le commentaire qu'en a fait l'enfant : « [...] L'abbé Dominique - curé à Outreau, fait des manières, nous a tapés, pour pas qu'on le dise, il fait avec mon père et ma mère Dany legrand - en Belgique. On était avec ma mère et mon père. Il nous a fait des manières, ma mère lui a donné de l'argent. On a été avec le taxi Martel, enfant Vincent Martel Louis - un magasin d'Outreau, vend des cassettes, il a fait des manières [Prénom et nom de famille cités] - il fait des manières, docteur Didier - au café Outreau, sur la place [Prénom et nom de famille cités] - il fait des manières [...] » Cette liste contient au total quinze noms. Il paraît peu probable que l'enfant ait spontanément couché sur le papier ces informations. Celui-ci a été sollicité par l'adulte qui lui a demandé de citer tous les noms auxquels l'enfant pensait et de préciser les identités ; une présentation ordonnée des personnes mentionnées et des faits reprochés était ensuite tentée. S'il est difficile de rendre compte précisément de la façon dont cette sollicitation par l'adulte s'est exercée, elle a été suffisamment pressante pour obliger l'enfant à prendre la peine d'écrire et à rassembler ses idées. Une seconde liste, établie par la même assistante, sur la base des déclarations du même mineur est annexée à une note en date du 10 janvier 2002. Dans le souci d'apporter les informations les plus précises, les assistantes maternelles ont ainsi été conduites à mener un travail d'enquête et de systématisation des informations, qui a eu pour effet en retour de fournir à l'enfant les moyens d'enrichir son discours et d'en structurer le contenu. On s'est attaché, pour chaque personne évoquée, à en préciser le nom, le prénom, l'état de famille, le domicile, la profession et les faits reprochés. Mieux informé, l'enfant était ainsi mieux formé pour répondre aux questions posées par les policiers et les magistrats. Mme Bernard déclare cependant dans une audition devant les policiers avoir fait preuve de prudence : « J'ai toujours cru Luc mais avec prudence. Plusieurs fois j'ai tenté de lui tendre des pièges pour voir s'il mentait mais il n'a jamais failli. Mon fils lui a dit une fois que s'il disait qu'il avait menti il aurait deux desserts, mais Luc a persisté. » 14. Un extrait de l'audition du même enfant par le juge d'instruction le 13 décembre 2001 montre néanmoins l'empathie qui s'était créée entre l'assistante maternelle et l'enfant en position d'accusateur. À la question du juge « Quelles sont les personnes qui t'ont fait mal ? », l'enfant, habitué à dresser des listes, ne mentionne dans sa réponse que 27 noms ou prénoms d'adultes ou de mineurs. L'assistante maternelle intervient après l'enfant : « Spontanément Madame Bernard : Luc m'a dit qu'il y avait environ 40 personnes qui avaient participé aux faits. » 15 L'établissement de ces listes de noms a été nourri également par les informations échangées entre les enfants. 3. Les contacts entre les enfants Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les informations s'enrichissaient aussi à l'occasion des rencontres que les mineurs pouvaient avoir les uns avec les autres. Il est de fait que les enfants ont pu se parler : une fillette avait été placée dans une famille d'accueil habitant en face d'un des enfants Delay ; plusieurs enfants avaient été placés dans la même ville, à Samer, et fréquentaient les mêmes établissements scolaires. Le lien entre les fratries avait naturellement été maintenu. Une note des services sociaux en date du 10 avril 2001 souligne la « réelle entente et complicité » qui règnent à l'intérieur de la fratrie des enfants Delay. Dans une autre note, en date du 5 décembre 2001, il apparaît même que l'un de ces enfants recueille les déclarations de ses camarades : « les deux jumeaux [...] ils sont venus à la cantine me trouver, ils m'ont demandé si je voulais les écouter. Ils m'ont expliqué qu'il y avait des manières sur eux. » Il est par ailleurs singulier de constater que les enfants qui étaient à l'origine du plus grand nombre d'accusations étaient convoqués en même temps pour être entendus au commissariat de police et avaient ainsi la possibilité de parler entre eux en attendant d'être auditionnés. Que les enfants, pendant cette attente, aient dénoncé à leurs assistantes une personne qui sortait d'un bureau (cote D 877 et cf. infra) montre dans quelle disposition d'esprit ils se trouvaient. Un retour groupé après des examens médicaux a été de même l'occasion de donner de nouveaux détails, entre autres sur « Roselyne qui vendait des bonbons et qui faisait la même chose avec papa et maman et avec les enfants » 16. Le même constat peut être dressé pour les auditions devant les juges : les quatre auditions séparées de deux des enfants Delay devant le juge d'instruction ont eu lieu les mêmes jours, le 13 décembre 2001 et le 11 janvier 2002 et toute la fratrie Delay a été auditionnée ensemble devant le juge des enfants le 28 mai 2001. Dès lors, ces pratiques ont alimenté des dénonciations. 4. Un foisonnement de dénonciations Mis en confiance par leurs assistantes maternelles, les enfants ont lancé des accusations de plus en plus fantaisistes, systématiquement retranscrites dans les rapports des services sociaux et portées à la connaissance du procureur de la République. Ainsi la note déjà citée, en date du 22 novembre 2001, relatant le déplacement de deux des enfants Delay au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer fait part de nouvelles révélations : « Pendant l'attente à l'accueil, Madame Chochoy, assistante maternelle de Luc a dit bonjour à un monsieur qui sortait d'une pièce. [...] Tout de suite, Jean a dit à Madame Bernard, assistante maternelle : "je connais ce monsieur, il venait à la maison et faisait des manières". Ni Madame Chochoy, ni les enfants ne peuvent préciser le nom, mais Jean dit qu'il sait comment le décrire et qu'il est sûr de ce monsieur là. Madame Bernard nous décrit ce monsieur : "un grand monsieur grisonnant, dégarni sur le devant avec des lunettes [...] à l'aise dans la maison, semblant connaître les lieux". » Quelques jours plus tard, l'enfant précise : « L'autre jour au commissariat, ce n'est pas un monsieur que j'ai reconnu mais trois. Il y en avait deux autres qui sortaient des toilettes, avec des serviettes à la main. Ils venaient chez moi et nous faisaient des manières. »17 Dans un magasin d'articles de sport, Luc rencontre une personne « qui lui aurait fait des manières » et dans un café son frère reconnaît quelqu'un qui serait lié à l'affaire 18. Il est à remarquer que le procureur de la République, le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ne font aucune mention de ce foisonnement de dénonciations dans les actes de procédure qui ont renvoyé les mis en examen devant la cour d'assises. Il est clair que la crédibilité des propos des enfants aurait été entamée. C'eût été également utile de s'interroger sur le rôle des assistantes maternelles. 5. Des assistantes maternelles critiquées Les conditions dans lesquelles les premières déclarations des enfants ont été recueillies ont été particulièrement dénoncées par Me Hubert Delarue, avocat de M. Alain Marécaux, qui a parlé de « tata connection ». Les initiatives prises par les assistantes maternelles ont, en effet, eu pour conséquence de faire croire que les enfants étaient familiers des personnes qu'ils accusaient. Le caractère fantaisiste de nombre de leurs accusations en devenait moins manifeste. La multiplication des accusations a, par ailleurs, entretenu l'idée de l'existence d'un réseau d'agresseurs. Ainsi le 24 septembre 2001 une assistante maternelle dit d'un enfant qui lui a été confié mais qui ne dénonce encore personne (il le fera le 13 mars 2002) : « cet enfant est très vague ; il a l'air de savoir beaucoup de choses mais ne veut pas parler. »19 Il convient toutefois de remarquer qu'il ne revenait pas aux assistantes maternelles de remettre en cause la crédibilité des enfants dont elles avaient la charge. Leur rôle était de leur offrir un milieu familial stable et protecteur, ce qu'elles ont réussi à faire comme l'attestent de nombreuses remarques des enfants (« Nos tatas sont gentilles » déclarent, par exemple, les enfants Delay au juge des enfants, D 383). De plus, dans la phase initiale de l'affaire, elles ont parfaitement rempli leurs devoirs (cf. chapitre précédent). Cependant, face à des accusations d'une particulière gravité et à des enfants très perturbés, les assistantes maternelles ont voulu accomplir scrupuleusement leur mission en ne communiquant à leurs référents que des informations précises et répétées par l'enfant. Cette démarche, qui a fait perdre toute authenticité aux propos des enfants, a été confortée par les supérieurs hiérarchiques des assistantes maternelles ; il est manifeste qu'il revenait à ces derniers, en particulier aux assistants socio-éducatifs, de rappeler les règles de prudence nécessaires. M. Henri Villeneuve, chef du service socio-éducatif de Boulogne-sur-Mer a expliqué devant la commission d'enquête que « la consigne donnée aux assistantes maternelles est de prendre note en temps réel des propos spontanés des enfants, et de ne pas les interroger, afin que leur parole reste spontanée. » Il a cependant admis que si l'enfant ne doit pas être relancé « ça dépend des assistantes. Leur formation est un peu rapide »20. Il est par ailleurs regrettable que les services sociaux aient confié deux des enfants de Mme Myriam Badaoui à une assistante maternelle inexpérimentée qui effectuait sa première mission21 et que l'un des rapports signé par une assistante socio-éducative aurait été en réalité rédigé par une stagiaire (témoignage de Mme Sabine Joly, devant la cour d'assises de Paris, rapporté par Me Frank Berton au cours de son audition)22. Mais surtout, aucun document n'indique que les magistrats ou les policiers se soient interrogés sur la façon dont les assistantes maternelles procédaient pour alimenter si abondamment le dossier en cours. Les informations ont transité de façon unilatérale, intégralement transmises par les services sociaux aux autorités judiciaires, sans qu'aucun contrôle ne soit exercé en retour. Enfin, la commission d'enquête a dû constater que certains membres des services sociaux locaux s'étaient fait implicitement les porte-parole de la rumeur sans en mesurer vraisemblablement la portée. En atteste la déposition de Mme Dumont, assistante socio-éducative, faite le 25 juin 2001, au commandant de police du SRPJ de Lille, M. Pierre Coulombel : « Je viens d'assister à la déclaration de Mme Joly. Tout ce qui a été dit est juste, nous avons écrit le rapport ensemble. Je dois ajouter que selon les dires de Samer, Monsieur Marescaux a changé de look, il a rasé son bouc et sa moustache. Madame Marescaux serait hospitalisée en psychiatrie depuis peu. »23 On devine comment, dans ce contexte qui cultivait le soupçon et la dénonciation, les révélations des enfants ont pu être recueillies. B. LES MODALITÉS DÉFAILLANTES DU RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES ENFANTS PAR LA POLICE ET LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR Ces déclarations ont été ensuite reçues par la police et le magistrat instructeur. Il importe d'en rappeler les traits principaux, qu'il s'agisse de leur nombre ou de leur contenu. 1. Des auditions nombreuses et étalées dans le temps Les déclarations de 44 enfants ont été recueillies au cours d'une centaine d'auditions réalisée entre mars 2001 et juillet 2002. Le plus jeune des mineurs entendus avait 4 ans. Après la clôture de l'instruction, les enfants ont à nouveau déposé pendant le procès d'assises de Saint-Omer en 2004 et sept d'entre eux ont encore été auditionnés devant la cour d'assises de Paris en 2005. Certains mineurs ont été entendus une seule fois, d'autres l'ont été beaucoup plus. Deux enfants de la famille Delay ont ainsi été auditionnés à sept reprises ; en outre, ils ont été interrogés au deux procès d'assises de Saint-Omer et de Paris et ont, par ailleurs, eu à répondre aux questions des experts psychologues qui les ont examinés par trois fois en 2001, 2002 et 2004. Les faits sur lesquels portaient les témoignages des enfants s'étaient déroulés entre 1995 et 2000. À la fin de la procédure judiciaire, en décembre 2005 à Paris, entre cinq et dix ans s'étaient écoulés depuis la commission des agressions. La relation des faits par certains enfants s'est étalée sur plus de cinq ans, l'institution judiciaire n'ayant pu éviter la réitération d'actes de procédure identiques. Quant aux policiers et aux magistrats, les défaillances dans la procédure de recueil de la parole de l'enfant ont eu pour effet d'alourdir leur tâche, en les amenant à recueillir et à vérifier un grand nombre de déclarations dont le poids était déterminant pour l'enquête mais dont le contenu évoluait profondément avec le temps. Comme l'a commenté M. Paul Messerschmitt, expert psychiatre, au cours de son audition devant la commission d'enquête : « la parole évolutive s'est opposée à la logique de la conservation de la preuve. »24 C'est dans ce contexte que l'on rappellera les modalités des auditions des enfants par la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer. 2. Les auditions des enfants par la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer La lourde tâche de procéder aux auditions des enfants a été confiée à la brigade de police des mineurs de Boulogne-sur-Mer dirigée par le capitaine de police Didier Wallet. a) Seize enfants auditionnés le 6 mars 2001 Le 6 mars 2001, sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. Fabrice Burgaud, six personnes mises en cause par les enfants Delay ont été interpellées et seize enfants ont été auditionnés à la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer. Les conditions dans lesquelles s'est faite cette opération de police ont été dénoncées avec force devant la commission d'enquête par Mme Jeanine Couvelard25. Réveillés à 6 heures du matin, certains enfants ont assisté à l'arrestation de leurs parents. Parmi eux, les quatre enfants de Mme Sandrine Lavier âgés de 8 ans, 4 ans, 1 an et six mois. Il ressort des procès-verbaux que les auditions des mineurs ont commencé à 7 h 25 par une fillette de l'âge de 4 ans et se sont succédé jusqu'à 17 h 15 par l'audition d'un garçonnet du même âge, auditionné deux fois dans cette même journée. Dix interrogatoires de mineurs ont été dirigés par le capitaine de police Didier Wallet. Seules les deux dernières auditions ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo. b) Des auditions aux résultats contrastés Certains procès-verbaux laissent clairement transparaître les conséquences de la mise en forme de la parole de l'enfant par leurs familles d'accueil. Les commentaires des planches photographiques présentées aux enfants Delay sont en ce sens caractéristiques. Les déclarations des mineurs sont denses et circonstanciées ; les actes sont précisément imputés, les noms et les dates ne font pas l'objet d'hésitation. Le rôle de l'enquêteur pendant l'audition est minimal. De fait, l'absence complète de spontanéité du discours semble ne plus permettre d'évaluer l'authenticité de son contenu. Il est difficile à la commission d'enquête d'apprécier l'opportunité des questions qui ont été posées à ceux des enfants dont les propos présentaient un caractère plus spontané. Il est cependant apparu clairement que la gradation du contenu des questions, le moment opportun pour interroger sur un point précis, la nécessité ou non de mettre l'enfant devant ses éventuelles contradictions ou de confronter ce qu'il dit avec ce que les autres enfants disent, l'utilisation d'un vocabulaire que comprend l'enfant et la compréhension que l'adulte a des termes employés par le mineur, exigent de grandes qualités professionnelles qui ne peuvent s'acquérir qu'avec une formation approfondie et une solide expérience. Les récits des mineurs ont, en outre, évolué de façon marquée avec le temps : la figure de « Jean-Marc l'handicapé » s'est estompée à partir de novembre 2001, alors que celle de M. Dominique Wiel devenait prépondérante après son arrestation ; les voyages en Belgique n'ont pris forme qu'à l'été 2001 et sont sortis du cercle de la fratrie Delay en novembre ; le meurtre d'un enfant n'est apparu dans les propos des enfants qu'après les « révélations » de M. Daniel Legrand fils le 9 janvier. D'autres mineurs ont remis catégoriquement en cause le contenu des dénonciations : « Je ne connais pas ces gens »26, « C'est faux »27, « Il ment »28. Or, il n'est pas apparu que ces dénégations aient joué en faveur d'un regard plus critique sur les propos des enfants accusateurs. Il semble pourtant que l'appel à un simple bon sens aurait permis d'évaluer différemment les accusations des enfants. Mme Jeanine Couvelard s'en est étonnée devant la commission d'enquête. Le 6 mars 2001, le capitaine Didier Wallet lui rapporte les accusations qu'un enfant portait contre son fils handicapé : « Jean-Marc nous mettait des baguettes de pain dans le derrière. Mais comme elles étaient trop grosses, il en a fait fabriquer des plus petites. ». Le policier s'étonne en ces termes : " De toute évidence, madame, ce n'est pas lui, c'est impossible. C'est quelqu'un d'autre." Mme Jeanine Couvelard fait la remarque de bon sens suivante : « Il aurait dû ajouter : " Ou peut-être l'enfant dit-il des bêtises " Parce que ça aussi, ça peut arriver. »29 c) Les auditions faites en présence d'un tiers L'article 706-53 du code de procédure pénale autorise la présence d'un psychologue au cours des auditions de mineurs victimes. Quatre auditions se sont ainsi déroulées en présence d'un psychologue expert, M. Emile Leprêtre, dont deux d'une même enfant. Dans ce dernier cas, il est frappant de constater combien l'observation psychologique a conduit à souligner et à donner un sens à des attitudes dont le procès-verbal ne rendait pas compte. Au cours de l'audition du 5 mars 2002, la jeune Léa relate à son tour le meurtre de la petite fille belge qui, dans sa version, aurait eu lieu sur un parking. L'expert constate que l'enfant est « stimulée par l'intérêt qu'on lui porte », « satisfaite de se retrouver une nouvelle fois en situation d'audition » ; pendant l'audition le comportement de l'enfant « devient inadapté à la situation. Elle se déplace dans le bureau, touche aux différents objets, aux papiers qui s'y trouvent. Elle pose au capitaine Wallet des questions divergentes sur des objets placés sur son bureau sans rapport avec le sujet. » Ces détails ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de police ; ils permettent pourtant à l'expert de conclure au manque d'authenticité d'une enfant « qui cherche à capter l'intérêt de l'enquêteur avant toute chose »30. La présence d'un tiers a ainsi permis de donner un tout autre sens à la parole de l'enfant et, pour la seule fois dans le cadre d'un examen demandé par le juge Burgaud, à mettre en doute sa crédibilité. On s'étonne cependant que le même expert ait formulé des conclusions très différentes à l'issue de l'audition de la même enfant peu de temps avant. Le 15 février 2002, la mineure avait, en effet, été reconnue comme « cohérente et crédible » après avoir décrit une scène de viol au cours de laquelle elle disait avoir été victime d'une triple pénétration31. d) Des policiers sans formation ni soutien La lecture des procès-verbaux des auditions de mineurs réalisées par les policiers pendant l'instruction de l'affaire permet de mesurer toute la difficulté de la tâche de fonctionnaires qui doivent affronter des témoignages d'enfants décrivant des agressions sexuelles. Or, dans la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer, seul le capitaine Didier Wallet avait reçu une formation au recueil des témoignages d'enfants. La brigade était en outre en sous-effectif. Le capitaine Didier Wallet a dénoncé cette situation devant la commission d'enquête dans les termes suivants : « j'étais tout seul, sans soutien ni de ma hiérarchie ni du parquet, seul avec mes pensées, avec mes dossiers, sans appui psychologique. Seul aussi parce que les trois autres fonctionnaires du commissariat ont pris leur préretraite, sans obtenir la moindre prime car le travail de notre brigade n'a jamais été reconnu. L'un d'entre eux a fait une dépression et a disparu. Je suis donc le dernier à bord du bateau et je fais ce que je peux. »32 3. Les auditions de quelques enfants par le juge d'instruction Les questions posées par le juge d'instruction ne paraissent pas avoir procédé d'une méthodologie très différente de celle utilisée pour les adultes, ce dont on peut s'étonner. Le juge a ainsi commencé plusieurs auditions en rappelant à l'enfant ses déclarations antérieures, ce qui semblait peu susceptible de faire émerger d'éventuelles contradictions. Au cours de son audition devant la commission d'enquête, Me Blandine Lejeune a fait le commentaire suivant : « Voici un exemple des questions posées par le juge d'instruction : " Tu as déclaré que tu étais allé chez M. et Mme Delay et que des adultes t'avaient fait des manières. Pourrais-tu nous rappeler ce qui s'est passé ?" En commençant par confronter l'enfant à sa déclaration précédente, on l'empêche de se rétracter. Un expert que nous avons fait citer, M. Paul Bensussan, a expliqué qu'il aurait suffi de lui demander simplement : " Que s'est-il passé ? " pour ne pas induire la réponse et vérifier la concordance des déclarations. »33 On relève que le juge d'instruction a posé à deux mineurs la question suivante : « As-tu bien dit la vérité jusqu'à aujourd'hui ? »34, question qui attribue à l'enfant une capacité d'auto-évaluation identique à celle que peut avoir un adulte. Par ailleurs, il est étonnant de constater que deux auditions de mineurs ont été effectuées en l'absence de leurs avocats35 même si les règles de procédure ont été respectées. Me Frank Berton s'en est particulièrement indigné : « Procède-t-on en bon père de famille, travaille-t-on régulièrement et en toute conscience quand on entend une enfant de cinq ans en dehors de la présence de son avocat ? »36 C. LES ENREGISTREMENTS DES AUDITIONS : LE DÉTOURNEMENT D'UNE PROCÉDURE Si en effet les auditions des enfants suscitent des questions, on ne saurait passer sous silence les conditions dans lesquelles ces auditions ont pu faire l'objet d'un enregistrement. Évoquer ces enregistrements revient à s'interroger sur leur motivation et sur leur utilisation à la fois pour l'enquête et l'instruction. 1. Les motivations des refus d'enregistrement Sur la centaine d'auditions de mineurs réalisée, seules sept auditions ont fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 706-52 du code de procédure pénale. Au vu des procès-verbaux, les mineurs auditionnés auraient refusé de donner leur consentement. Les représentants légaux des mineurs ne semblent pas être intervenus dans ces décisions. Deux raisons ont été avancées pour justifier ces refus. D'une part, un problème matériel qui amène à déduire que les refus consignés dans les procès-verbaux ont été fortement suggérés, les policiers sachant qu'ils ne disposaient pas de moyens pour les réaliser. D'autre part, la prise en considération du fait que les enfants disaient avoir été filmés pendant qu'ils avaient été agressés. Si la très grande majorité des procès-verbaux exposent très laconiquement le refus du mineur, certains comptes rendus sont plus précis et paraissent traduire un véritable refus de l'enfant. Un procès-verbal en date du 9 avril 2002 en atteste : « L'enfant connaissant nos services est mis en confiance et nous demande dès lors s'il va devoir être filmé lors de son audition. Considérant que cela n'est pas une obligation, [l'enfant] nous déclare : "je voudrais que notre conversation ne soit pas filmée". Dans le souci d'apaiser le mineur procédons à un entretien hors vidéo. »37 On relève que certains procès-verbaux ne font pas mention de cette obligation légale.38 On constate avec étonnement que l'un des très rares enregistrements effectués l'a été malgré les réticences de l'enfant, âgé de 5 ans : « Disons que l'enfant refusait dans un premier temps de nous accompagner dans le local permettant de procéder au dit enregistrement. Mettons à disposition de l'enfant du mobilier adapté à sa taille et le mettons à l'aise. »39 Devant le juge d'instruction aucun enregistrement de mineurs n'a été réalisé. L'alinéa 3 de l'article précité dispose que le juge peut par décision motivée ne pas procéder à l'enregistrement. En l'espèce, cette décision a été ainsi justifiée : « Dans la mesure où les viols et agressions sexuelles que dénoncent la victime ont été filmés à l'aide d'une caméra vidéo, l'enregistrement vidéo de la partie civile aurait pour effet d'accroître son traumatisme, traumatisme déjà très important. Afin de ne pas accroître le traumatisme de la victime, la présente audition ne fera pas l'objet d'un enregistrement vidéo. » À deux reprises40, le juge a complété cette motivation par une référence aux conclusions des expertises psychologiques qui constataient le traumatisme très important des enfants. 2. Les réticences à l'utilisation des enregistrements Les quelques enregistrements effectués ont été peu utilisés. Une ordonnance du juge d'instruction en date du 3 juin 2002 a autorisé Me Philippe Lescène à visionner les enregistrements des enfants Delay et des enfants de Mme Sandrine Lavier ; Me Philippe Lescène a cependant constaté que les enregistrements des enfants de sa cliente n'avaient jamais été réalisés et que l'autorisation qui lui avait été délivrée portait sur des cassettes vidéo dont une partie n'existait pas41. Les deux experts qui ont examiné les enfants Delay ont pris connaissance des enregistrements les concernant et les citent dans leurs examens. Deux enregistrements ont été projetés pendant le procès d'assises à Saint-Omer et un à Paris42. L'audition du Président de la cour d'assises d'Angers, M. Éric Maréchal, qui avait dirigé les débats d'un procès d'agression sexuelle impliquant un nombre plus important de victimes mineures que dans l'affaire d'Outreau a permis d'obtenir des éléments de comparaison. À Angers « la cour a ainsi vu vingt et un des quarante-trois enregistrements réalisés par les policiers et trente-huit des quarante enregistrements effectués au cours de l'instruction pour une durée totale d'une quarantaine d'heures ». Toutes les auditions avaient été enregistrées par le juge d'instruction43. Le visionnage par la commission d'enquête des quelques enregistrements réalisés dans l'affaire d'Outreau a révélé, en outre, les mauvaises conditions dans lesquelles ils ont été réalisés. Les enfants ont été installés dans un bureau non aménagé. Les bruits de pas à l'extérieur du bureau, le crépitement d'un fax installé dans la même pièce parasitent l'enregistrement et ne contribuent pas à la concentration de l'enfant. Mais la projection de ces bandes vidéo a permis surtout de se persuader de l'importance qu'il faut attacher à de telles pièces de procédure. Elles révèlent d'abord parfaitement la difficulté qu'il y a à interroger un enfant. Elles donnent aussi des informations sur l'attitude du mineur. Il a été en particulier remarqué l'aisance avec laquelle s'exprime l'un des enfants de Mme Myriam Badaoui, la façon dont, malgré son jeune âge il donne des dates précises bien qu'anciennes, sa volonté manifeste d'être exhaustif dans ses descriptions, tous signes qui confrontés à d'autres documents du dossier comme les notes des services sociaux précédemment décrites, pouvaient susciter des doutes sur la spontanéité de sa parole. Des auditions d'enfants ont également été effectuées lors des procès d'assises. D. LES AUDITIONS DES ENFANTS DEVANT LES ASSISES : DES CONDITIONS D'ACCUEIL À AMÉLIORER Au cours du procès d'assises de Saint-Omer, le 17 mai 2004, Me Célia Rofidal, un des avocats de la partie civile a en un premier temps demandé, sur le fondement de l'article 306 du code de procédure pénale, que les mineurs soient auditionnés à huis clos. Puis, le 18 mai 2004, Me Yves Crespin, au nom de toutes les parties civiles a sollicité que le huis clos soit délimité à la salle d'assises et non plus à la salle de retransmission du procès. Cette solution satisfaisait deux exigences : protéger les enfants auditionnés d'une trop grande pression pendant l'audience et assurer une publicité des débats, propre à lever tout soupçon sur la façon dont étaient interrogés les enfants et sur le contenu exact de leur témoignage. Au cours des débats, le huis clos complet a cependant été demandé pour l'audition d'un mineur le 3 juin 2004. Pendant le procès d'assises de Paris, les auditions d'enfants se sont faites à huis clos complet sur la demande de quatre avocats de la partie civile. Les questions que les avocats de la défense ont posées aux enfants ont révélé la fragilité de leurs propos. Certains conseils des parties civiles se sont certes indignés de la vigueur avec laquelle les enfants ont été interrogés. On peut cependant constater que seul un interrogatoire contradictoire dans un contexte où la parole de l'enfant ne recevait pas une validation systématique de l'adulte a permis de révéler la fragilité des révélations des mineurs. Les insuffisances des techniques de questionnement auxquelles avaient eu recours les policiers et le magistrat instructeur en ont été d'autant plus mises en évidence. Les conditions matérielles dans lesquelles ont été accueillis les enfants au cours des deux procès d'assises ont été par ailleurs vivement dénoncées par Mme Claire Beugnet, responsable du service d'aide sociale de Boulogne-sur-Mer : « Qu'il s'agisse de la cour d'assises de Saint-Omer ou de Paris, certains ont été obligés de venir cinq jours de suite, d'attendre des journées entières dans une salle pour qu'on leur dise le soir qu'ils reviendraient le lendemain. Je trouve scandaleux que des enfants se soient trouvés enfermés pendant trois jours dans une pièce sans fenêtre, avec des sandwichs infâmes. Voilà le traitement qu'on leur a réservé ! »44 Si l'analyse des conditions dans lesquelles la parole de l'enfant a été recueillie aux divers stades de la procédure est essentielle, on ne saurait occulter à propos de la parole de l'enfant la part jouée dans la procédure par les associations qui se sont portées partie civile. E. LE RÔLE CONTESTÉ DES ASSOCIATIONS PARTIES CIVILES Six associations se sont portées parties civiles : « Enfance et Partage », « Équipe d'action contre le proxénétisme », « Enfant bleu - Enfance maltraitée », « La voix de l'enfant », « Enfance Majuscule » et l'association de défense de l'enfance et des parents séparés (ADEPS). L'association « Équipe d'action contre le proxénétisme » ne s'est constituée partie civile que pendant l'instruction, se retirant ensuite quand les accusations de proxénétisme n'ont plus été retenues ; inversement, l'association « Enfant bleu - Enfance maltraitée » ne s'est constituée partie civile que pendant les deux audiences de jugement. Le rôle de ces associations a été contesté devant la commission d'enquête en particulier par Me Éric Dupont-Moretti qui a estimé que « ces gens sont venus à l'audience comme des militants » et s'est scandalisé du fait que « des personnes parlent d'enfants qu'elles n'ont jamais rencontrés ». Me Éric Dupont-Moretti a donné un exemple d'intervention particulièrement intempestive d'un avocat d'une association : « Je me souviens d'un gamin qu'on interroge et qui hésite. On entend alors l'avocate de la partie civile qui souffle : "Lavier". Elle susurre à l'oreille de cet enfant qu'elle ne connaît pas le nom d'un de ceux qui sont présents et qui se dit innocent ! »45 Ce fait est confirmé par M. Stéphane Durand-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro : « C'est là que, le 2 juin, se passe un événement extraordinaire. Un enfant, un des plus grands, accuse, comme les autres, et dans la salle vidéo nous voyons en gros plan sur l'écran, à côté de lui, Me Padovani, avocate de l'association « L'Enfant bleu » [...]. On interroge l'enfant : " Est-ce que tu peux regarder dans la salle et dire qui t'a fait du mal ? ". L'enfant répond : " Thierry, Myriam, Aurélie et son mari. ". Et c'est tout. Alors, on peut lire sur les lèvres de Me Padovani qu'elle dit : "Lavier" ? en montrant Sandrine Lavier. L'enfant ajoute : " Elle. La dame en bleu. Mme Lavier. " À ce moment, il y a eu une clameur dans la salle vidéo. Comme chroniqueur judiciaire, j'étais très choqué, c'était la première fois que je voyais ça. Mais dans la salle d'audience, ça a passé très bien, le président a continué... »46 Me Éric Dupont-Moretti remarque, par ailleurs, que « ces associations sont surtout présentes dans les affaires médiatiques ». Les avocats des associations ont expliqué devant la commission d'enquête que leur rôle a été double. En premier lieu il s'agissait, comme l'a souligné Me Vanina Padovani, « de renforcer des équipes d'avocats d'enfants ». Les dix-sept enfants considérés comme victimes n'étant représentés que par deux avocats désignés par le Conseil général du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc, les associations ont adjoint cinq conseils à la défense des mineurs. Un meilleur équilibre s'instaurait ainsi avec la défense des mis en examen qui, elle, comptait dix-sept avocats. Par ailleurs, Me Yves Crespin a commenté le rôle des associations en expliquant qu'elles étaient présentes au moment du procès « pour essayer de faire passer un certain nombre de messages, auprès du public présent aux audiences, auprès des magistrats, et auprès de la presse [...] Car il ne faut pas nier que l'écho médiatique que nous pouvons rencontrer est important, non pas évidemment pour l'association, mais pour faire passer notre message au sujet de la défense des enfants, de leur protection. C'est notre premier souci. Ce que nous venons faire, dans le débat contradictoire, c'est essentiellement cela : faire passer des messages, dans le seul objectif d'obtenir une amélioration du système de protection des enfants »47. Tout en reconnaissant l'importance et la nécessité de l'action menée par ces associations, la commission d'enquête regrette qu'au cours du procès de Saint-Omer certaines de leurs attitudes aient plus relevé du militantisme que du souci de l'intérêt des enfants concernés par l'affaire. Elle regrette de même qu'un procès au cours duquel se décide le sort de justiciables puisse devenir la tribune d'une campagne de communication d'ordre général. Néanmoins elle reconnaît une légitimité réelle à l'intervention des associations au regard du problème de la représentation de l'enfant, tel que formulé par Me Isabelle Steyer : « L'autre grand problème est celui de la représentation de l'enfant. Il n'est pas représenté par ses parents, puisque ceux-ci se retrouvent dans le box, mais par un administrateur ad hoc. Qui est l'administrateur ad hoc ? C'est le conseil général. Qui est le conseil général ? C'est celui qui n'a pas fait les signalements dans un premier temps, puis qui a fait beaucoup de signalements dans un second temps. L'avocat du conseil général, c'est l'avocat du conseil général ou c'est l'avocat de l'enfant ? C'est un problème. L'avocat de l'enfant doit être neutre, par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport à la personne qui est dans le box, et qu'il connaît peut-être. »48 Pour autant la question demeure de savoir si une association peut remplir ce rôle de conseil neutre de l'enfant. Comme l'a rappelé Me Sylvie Molusson-David, dans l'affaire d'Outreau : « Nous n'étions pas avocats des enfants. Nous étions avocats d'une association. »49 À travers cette affirmation se pose plus fondamentalement la question de l'organisation de la défense des mineurs. F. DES MINEURS QUI N'ONT BÉNÉFICIÉ QUE D'UNE DÉFENSE COLLECTIVE La défense des 17 mineurs supposés victimes a été assurée par deux avocats, Me Thierry Normand et Me Célia Rofidal, désignés par l'administrateur ad hoc des mineurs, le président du conseil général du Pas-de-Calais. On relève qu'il n'y a pas eu de défense individualisée des enfants ; dix d'entre eux ont eu pour conseil Me Thierry Normand, les sept autres Me Célia Rofidal. L'importance de la tâche explique peut-être que deux auditions d'enfants devant le juge d'instruction se soient faites en l'absence de leur avocat Me Thierry Normand, le 22 mai 2002 et le 7 juin 200250. Les avocats ont, par ailleurs, fait connaissance tardivement avec les enfants ; Me Thierry Normand, saisi dès mars 2001, n'a pu entendre pour la première fois les enfants qu'à l'occasion des auditions devant le juge d'instruction à partir de décembre 2001. Cependant, le sort des enfants ne saurait être vu à travers le seul prisme de la défense. Un des mérites de la commission d'enquête a été, en effet, de mettre en lumière les problèmes soulevés par leur placement et la rupture avec leurs parents que celui-ci postule. G. LE PLACEMENT DES ENFANTS : UNE PROCÉDURE BRUTALE ET SANS DISCERNEMENT Les interpellations suivies d'une mise en détention provisoire des parents, dans le cadre de l'affaire d'Outreau, se sont accompagnées de séparations brutales avec leurs enfants, suivies d'un placement de ces enfants, effectué pour la plupart d'entre eux dans des familles d'accueil. Au total huit familles ont été concernées, correspondant à vingt-et-un enfants (ce chiffre ne tient pas compte des quatre enfants Delay, déjà placés). Interrogé sur ces procédures de placement, M. Erik Tamion, alors juge des enfants au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, a, au cours de son audition par la commission d'enquête, fourni les indications suivantes : « Dans ces dossiers, les saisines ont été effectuées par le parquet. Il n'y a pas eu de placement d'office par le juge des enfants. Il s'agissait d'ordonnances de placement provisoire prises par le parquet au moment où il saisissait le juge des enfants. De mémoire, sans être capable de donner de noms et en me référant à d'autres affaires, les parents sont interpellés, placés en garde à vue. C'est alors que se pose, concrètement, le problème de la garde des enfants et qu'intervient l'ordonnance de placement provisoire du parquet. Le procureur saisit dans la foulée le juge des enfants qui, désormais, depuis 2002, doit audiencer dans les quinze jours. _..._ Dès que les enfants sont placés, nous avons connaissance de l'endroit où ils sont accueillis. Même dans le cadre d'un placement provisoire ordonné par le procureur de la République et dont on est saisi dans les quinze jours, le service social, en vue de cette audience à délai rapproché, nous fournit un petit rapport où figure le nom de la famille à laquelle l'enfant est confié. D'un point de vue légal, ni le procureur de la République ni le juge des enfants, dès lors qu'il confie l'enfant à l'ASE, n'a le pouvoir d'intervenir dans le choix des familles d'accueil. C'est une décision de l'administration qu'on ne pourrait, d'un point de vue juridique, contester devant le juge administratif. Cela dit, dans la pratique, si on considère qu'une famille d'accueil ne fait pas l'affaire, on appelle la référente pour essayer d'arranger la situation. »51 En réponse aux questions des membres de la commission d'enquête sur les contacts qu'il avait pu alors avoir avec le juge d'instruction et avec le parquet, M. Erik Tamion a expliqué qu'en sa qualité de juge des enfants, il n'avait pas, durant cette période, de rapports directs avec le juge d'instruction ou avec le procureur de la République. Le cloisonnement entre ces différents acteurs judiciaires a suscité l'étonnement de la commission, mais il ne semble pas être exceptionnel. En témoigne cet extrait de l'audition de M. Erik Tamion : « M. le Président : Vous n'avez jamais fait part de votre étonnement au juge d'instruction devant cette cascade de mises en détention qui aboutissait, en ce qui vous concerne, à une cascade de placements d'enfants ? M. Erik Tamion : Non, les placements avaient lieu au moment de la mise en examen ou de la mise en détention des parents. C'est ce que l'on rencontre dans d'autres dossiers. » Mme Véronique Carré, alors substitut du procureur chargé des mineurs et à l'origine des ordonnances de placement provisoire du parquet, a indiqué lors de son audition n'avoir pas, elle non plus, été amenée à l'époque à évoquer le sujet avec le juge d'instruction. Elle a précisé, par ailleurs, n'avoir assisté à aucune audition d'enfant par le juge d'instruction. Les membres de la commission d'enquête se sont également interrogés sur les raisons du placement des enfants dans des familles d'accueil, plutôt que dans leur propre famille. À une question visant à déterminer si le maximum avait été fait en ce sens, Mme Véronique Carré a répondu : « Lorsqu'une décision de placement est prise, le juge des enfants travaille toujours avec la direction de l'enfance et de la famille. C'est au vu des éléments du dossier qu'un placement est décidé ou non. Il est très difficile de répondre de manière générale. »52 Les services sociaux ont fait état d'efforts pour maintenir les liens familiaux des enfants placés mais les membres de la commission d'enquête ne peuvent que constater que la réalité a été vécue de façon très différente par les acquittés d'Outreau. Pour ce qui concerne par exemple les enfants Lavier, l'audition des services sociaux de l'UTASS a apporté les éléments d'information suivants : « Le 29 mai 2001, une décision de placement des quatre enfants Lavier a été prise suite à l'incarcération des parents ; _..._ Le placement s'est effectué en présence des grands-parents qui en avaient la charge. Ceux-ci ont pu faire la connaissance des quatre familles d'accueil, situées dans un périmètre géographique relativement proche, ce qui a facilité les rencontres entre frères et sœurs. Le lien a été maintenu entre les parents et les enfants par l'échange de courriers et de photos, la possibilité d'écrire à leurs parents étant toujours proposée à l'enfant et non imposée. Par ailleurs, un courrier régulier, au moins une fois par trimestre, donnant des nouvelles de l'enfant ainsi que ses bulletins scolaires était envoyé aux deux parents. Ce courrier était rédigé par nous-mêmes ou par les assistantes maternelles. »53 Les témoignages des parents concernés font cependant état de leur grande souffrance par rapport aux conditions dans lesquelles les placements de leurs enfants ont été organisés. Mme Sandrine Lavier a ainsi mis en évidence une quasi-impossibilité d'obtenir le maintien des liens familiaux, doublée d'un manque réel d'informations sur les décisions concernant le sort de ses enfants : « Un mois et demi après mon arrivée à Rouen, j'ai reçu des papiers de placement de la DDASS. On m'annonçait que mes quatre enfants étaient tous placés, tous séparés dans des familles d'accueil différentes. Je me suis opposée tout de suite à ce placement. J'ai demandé à ce que mes enfants restent dans ma famille, mais je n'ai jamais eu de réponse à mes courriers. J'ai été très mal pendant six ou sept mois. J'ai été sous antidépresseurs. Je m'angoissais en raison de ce placement. » _..._ « Que ce soit les assistantes sociales ou les assistantes maternelles, elles ont une grande part de responsabilité. Elles ont également coupé les liens familiaux avec les grands-parents, en les empêchant de voir leurs petits-enfants. Et entre frères et sœurs, ils ne se voyaient qu'une fois par mois. »54 Il convient à ce sujet de souligner que la rupture du lien entre frères et sœurs semble très loin de la lettre comme de l'esprit de l'article 371-5 du code civil, issu de la loi du 30 décembre 1996 inspirée par le « Parlement des enfants » : « L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. » Si l'on comprend bien toute la difficulté à trouver des familles d'accueil pouvant prendre en charge une fratrie de quatre enfants, l'éclatement de la fratrie entre quatre familles d'accueil différentes pose également problème. Dans de telles conditions, l'organisation d'une seule rencontre mensuelle entre frères et sœurs semble en tout cas largement insuffisante pour répondre au souci de non-séparation des fratries. Cette séparation aurait pu à la limite se comprendre si l'intérêt avait été d'éviter la propagation de rumeurs entre enfants. Tel n'était cependant pas l'objectif puisque les enfants Lavier ne portaient, à cette date, pas d'accusations d'abus sexuels et que l'un d'entre eux a été placé dans une famille habitant juste en face de celle hébergeant l'un des enfants Delay (cf. supra chapitre II, A). En réponse à une question portant plus précisément sur les nouvelles qu'elle avait pu obtenir de ses enfants, Mme Sandrine Lavier a fait état d'une longue latence de l'administration (étant rappelé qu'elle avait été incarcérée le 29 mai 2001) suivie d'un espacement des informations transmises, ne correspondant pas aux dires du juge des enfants : « J'ai eu des nouvelles à partir de septembre 2001 par les référentes des enfants. Deux d'entre elles faisaient partie de l'UTASS d'Outreau. [...] J'ai vu le juge des enfants en novembre 2001 et je devais avoir des nouvelles tous les mois, avec photos, bulletins scolaires, etc. Par les référentes, j'en ai eu tous les trois, quatre, cinq ou six mois. » M. Franck Lavier a pleinement corroboré les propos de son épouse : « C'était : " Votre fils s'éveille, il commence à faire ses premiers pas. " C'était plus administratif qu'humain. On ajoute une ou deux photos pour faire joli. Quand on se présente chez le juge pour enfants, on vous donne des nouvelles. Ce n'était pas assez. Ils m'ont pris mon fils quand il avait neuf mois. On le récupère alors qu'il a cinq ans, il va avoir six ans. On n'a pas suivi son évolution, on n'a aucun souvenir, on n'a rien. Sauf trois phrases tous les trois, quatre, cinq ou six mois. Et cela pour chacun des enfants. »55 Les membres de la commission d'enquête se sont à maintes reprises émus de cette quasi-rupture des liens familiaux à l'occasion du placement en détention provisoire, y compris quant à l'information délivrée aux parents sur la vie quotidienne de leurs enfants. En effet, le détenu provisoire bénéficie de la présomption d'innocence, laquelle impose le maintien du lien de parentalité. Mme Hélène Sigala, juge des enfants, l'a expliqué elle-même lors de son audition : « Un placement en détention provisoire n'a pas pour conséquence de priver les parents de leur autorité parentale. En vertu, en effet, de la présomption d'innocence, le juge des enfants est obligé de convoquer les parents à chaque échéance de placement, quelle que soit leur situation, même quand ils sont détenus, et quelles que soient les raisons pour lesquelles ils le sont, y compris s'ils sont soupçonnés d'abus sexuels sur leurs propres enfants. Le juge des enfants n'est dispensé de cette audience et de cette discussion avec les parents que lorsque la déchéance de l'autorité parentale a été prononcée, laquelle n'est jamais demandée par le juge des enfants mais est prononcée par les cours d'assises ou le juge aux affaires familiales. »56 Toutefois, comme l'a souligné M. Franck Lavier, ces rencontres avec le juge des enfants sont largement insuffisantes pour permettre au parent détenu d'avoir des nouvelles de ses enfants. Il s'agit, en effet, de rencontres organisées uniquement à l'occasion du renouvellement des ordonnances de placement, donc beaucoup trop espacées (en principe tous les six mois). Il est difficile de comprendre pourquoi, en l'espèce, les parents ne pouvaient pas recevoir d'informations plus fréquentes et plus complètes sur l'évolution de leurs enfants, d'autant plus qu'ils n'étaient pas autorisés à correspondre avec eux. Car ce point faisait aussi problème, ainsi que l'a expliqué Mme Sandrine Lavier : « Vis-à-vis de notre famille, les services sociaux ont une grande part de responsabilité. Ils ont coupé au maximum le lien familial entre nous et nos enfants. Ils ont empêché tout contact écrit. Au début j'écrivais une lettre par jour à chacun de mes enfants. En novembre 2001, je suis passée pour la première fois devant le juge des enfants. Il y avait les référentes. _...] Elles m'ont demandé de ne plus écrire autant à mes enfants, car cela faisait beaucoup trop pour eux. Elles m'ont demandé d'écrire de moins en moins, ce que j'ai fait. Je suis passée à une lettre par semaine. En trois ans de détention, cela aurait dû leur en faire pas mal. Léa se trouve aujourd'hui en hébergement long à mon domicile, car elle a demandé à revenir vivre avec sa famille. Je lui ai demandé si au début de son placement elle recevait bien mes courriers, ainsi que ceux de mon mari. Elle m'a répondu que l'assistante maternelle ne lui remettait pas les courriers ; celle-ci l'empêchait de les lire. »57 Le problème de la communication avec son enfant s'est également posé pour M. Thierry Dausque, de façon d'autant plus cruciale que lui aussi a été laissé, de façon incompréhensible, extrêmement longtemps dans l'ignorance du sort réservé à son fils : « En plus de ça, quand on est en prison, on vous annonce, quatre mois après, que votre gamin est placé. Alors là, on ne comprend pas. J'ai demandé au juge à pouvoir sortir pour voir mon enfant. Jamais de nouvelles, jamais rien. Il s'en foutait. »58 M. Thierry Dausque a précisé, par ailleurs, dans son audition avoir lui aussi demandé à ce que son enfant soit placé dans sa famille, en vain et Me Caroline Matrat-Maenhout a rappelé à la commission d'enquête les conditions dans lesquelles M. Thierry Dausque fut informé de ses droits : « Il ignorait qu'un droit de visite lui avait été maintenu durant toute la procédure et durant toute sa détention. Et pour cause : on le prévenait des audiences d'assistance éducative à midi, au moment où il quittait la maison d'arrêt. Quant à moi, son conseil, connu dans le cadre du dossier d'instruction, je n'ai été avisée des audiences d'assistance éducative qu'après coup. »59 Quant à M. David Brunet, il a indiqué, lors de son audition : « J'ai remué ciel et terre pour avoir des nouvelles de mon fils parce que je n'en avais pas. J'ai écrit à Outreau, personne n'a donné de nouvelles. Des gens à Paris ont réussi à communiquer avec Outreau et à avoir des nouvelles, des photos, mais je n'avais pas le droit d'écrire directement à la famille d'accueil. »60 Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait été amené à intervenir pour maintenir des liens entre parents et enfants, un acquitté s'étant plaint, par exemple, de ne même pas avoir reçu les dessins de ses enfants, le juge des enfants, M. Erik Tamion, a fait valoir : « Le droit de visite et d'hébergement permet un contact. Le droit de correspondance, bien que cela ne soit jamais précisé dans les décisions, est toujours accordé. Dès lors que le juge des enfants ne le suspend pas, il est maintenu. De mémoire, je n'ai suspendu aucun droit de correspondance dans cette affaire, ni dans d'autres d'ailleurs, si ce n'est parce que les parents adressaient des propos délirants par écrit. Après, comme pour la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, encore faut-il que le juge d'instruction laisse circuler le courrier. Enfin, les services sociaux ne transmettent pas le courrier à l'enfant, comme cela, pour le lire. »61 L'ensemble de ces déclarations montre bien une réelle distorsion entre le droit et la réalité : si le lien parent-enfant est juridiquement maintenu, il s'avère pour le moins élastique, lorsqu'il n'est pas concrètement détruit. Les témoignages de M. et Mme Marécaux ont été, eux aussi, particulièrement émouvants à cet égard. Là encore, le contraste est frappant entre le souci affiché de maintien des liens familiaux et ce que vivent les parents. Lors de leur audition, les services de l'UTASS ont présenté les modalités de placement des enfants Marécaux qu'ils avaient arrêtées : « Le 14 novembre, une décision judiciaire de placement des trois enfants de la famille Marécaux a été prise suite à l'incarcération des deux parents, [...] Afin de maintenir les liens au sein de la fratrie, mais aussi avec la famille élargie, étaient organisées des visites au domicile de ces assistantes familiales, et éventuellement chez l'un ou l'autre des membres de la famille s'ils ne pouvaient pas se déplacer. »62 Mme Odile Marécaux a, au contraire, souligné la brutalité de la séparation et les grandes difficultés rencontrées pour obtenir que sa famille prenne en charge ses enfants : « Ensuite, on m'a dit, en présence des trois petits, que j'étais mise en examen pour attouchements sexuels sur enfant. Après quoi, on les a emmenés, sans même leur donner la possibilité de dire au revoir à leur père. Je leur ai dit : « Soyez gentils, partez au commissariat. Maman va s'expliquer. Elle viendra vous chercher dans la matinée. » Ma matinée a duré trois ans. Parce que mes enfants ont été placés. Ils ont passé trois mois en famille d'accueil. Il a fallu aller jusqu'en chambre des mineurs pour que mes parents aient la possibilité de s'en voir confier la garde. Il faut dire, en effet, que personne ne se souciait de savoir si la famille pouvait s'occuper de ces trois petits. »63 Elle a, par ailleurs, mis en valeur le contraste entre l'objectif affiché - la protection de l'enfant - et certaines méthodes utilisées dans la procédure : « Plus grave encore. L'enjeu majeur, dans cette affaire, était la protection de l'enfant. Or, les carnets de santé de mes enfants ont été saisis. Je ne les ai toujours pas récupérés. Pendant trois mois, mes enfants ont été placés. Ma fille avait un problème d'allergie. Les services n'étaient pas au courant. Heureusement que ma mère a récupéré les petits et qu'elle connaissait sa petite-fille. Mais elle n'a pas pu récupérer les documents joints au carnet de santé. On nous parle de protection de l'enfant : eh bien, j'aimerais récupérer les carnets de santé de mes petits pour les faire suivre à nouveau et avoir une idée d'où en étaient leurs vaccinations quand j'ai été arrêtée. C'est peut-être un détail pour vous, mais moi je suis infirmière, et c'est important. » La façon dont a été conçue la « protection » des enfants pendant la détention provisoire a été violemment critiquée par plusieurs parents, dont M. Alain Marécaux qui a souligné combien - paradoxalement - l'indifférence a été grande et l'administration absente face aux difficultés rencontrées par son fils, du fait de l'incarcération de ses deux parents : « Guy avait 13 ans et demi lorsque ma femme et moi avons été arrêtés. On lui dit : tes parents sont des criminels, des pédophiles, ils vont en prendre pour 20 ans. _...] Cet enfant est déscolarisé. Il avait un an d'avance, il devait entrer en seconde, se destinait à la filière scientifique. Quand on m'en a confié la garde, il était déscolarisé depuis l'âge de 14 ans. La scolarité n'est pas obligatoire jusqu'à 16 ans, en France ? Je le pensais. Mais pas du tout. Le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui m'a enlevé mes enfants le 14 novembre 2001, qu'a-t-il fait pour Guy ? Rien, sinon qu'il l'a détruit, qu'il l'a cassé, qu'il l'a bousillé. »64 Au sujet de la déscolarisation, M. Daniel Legrand fils a indiqué : « Mon petit frère de quinze ans n'est plus allé à l'école jusqu'au moment où mon père et moi sommes sortis de prison, alors qu'il avait une bonne scolarité. Maintenant, il a repris une formation, mais ce n'est pas normal. »65 Mme Karine Duchochois a expliqué comment, lorsque le juge d'instruction avait fait arrêter son compagnon sans la prévenir, elle avait dû elle-même, alertée par des proches, faire récupérer leur jeune fils par sa famille. À cette occasion, elle a mis en évidence l'absurdité d'un système censé protéger les enfants : « Après un certain temps, mon père, qui avait de gros problèmes financiers, n'a plus été en mesure de subvenir aux besoins de mon fils. Nous avons demandé des aides aux services sociaux, pour qu'il puisse garder mon fils chez lui. Tout a été refusé. Ils ont alors demandé le placement en famille d'accueil. Autrement dit, ils ont payé la famille d'accueil après avoir refusé de donner des aides à mon père pour que mon fils reste en famille. Du côté des services sociaux, je pense donc qu'il y a des choses à revoir. Tous les enfants des personnes acquittées ont été placés en famille d'accueil alors que des membres de leur propre famille auraient pu s'occuper d'eux, ce qui aurait fait un peu moins de dégâts sur les enfants. Parce que je rappelle quand même que dans toute cette affaire, on était censé agir pour protéger les enfants. »66 M. Christian Godard a évoqué, pour sa part, les conditions dans lesquelles sa fille s'est trouvée, en fait de protection, livrée à elle-même du jour au lendemain. Son témoignage a résumé en outre clairement le grand manque de tact - pour employer un euphémisme - avec lequel les enfants des personnes concernées par l'affaire d'Outreau ont parfois été traités : « Je vais aussi vous parler de ma fille. Le juge a mis beaucoup de monde en prison, il a placé les enfants, mais il ne s'est pas occupé de ma fille de dix-sept ans et demi, qui était à l'école à Saint-Omer. Elle a appris du jour au lendemain par la radio que son père était incarcéré et qu'il n'y aurait personne à la maison le week-end. Le juge n'a même pas prévenu une assistante sociale. On est allé interroger ma fille à son école, à Notre-Dame-de-Sion. Alors qu'il y a beaucoup de Godard dans toute la France et que là-bas on ne savait pas que c'étaient ses parents qui étaient incarcérés, le juge a envoyé trois inspecteurs pour l'interroger, pendant le cours de mathématiques ! »67 Enfin, de façon générale, les acquittés ont dénoncé les conditions douloureuses dans lesquelles, à l'issue de leur détention provisoire, les parents ont « récupéré » leurs enfants - lorsqu'ils ont été autorisés à le faire. En témoignent ces quelques extraits des auditions du 18 janvier 2006 : · Extrait du procès-verbal de l'audition de Mme Odile Marécaux : « L'action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en route un an après le retour des enfants. Cela faisait plusieurs années que je ne les avais pas eus avec moi. La reprise des contacts avec eux a certes été progressive dans le cadre de la modification de mon contrôle judiciaire - la dernière modification du contrôle avait permis qu'ils viennent en vacances avec moi - mais du jour au lendemain, fin août, début septembre, j'ai récupéré le petit dont je n'avais pas eu la charge depuis trois ans. « Voilà, on vous rend vos enfants. Vous n'avez plus rien à dire, vous les avez assez réclamés, on vous les rend. » C'est comme ça que je l'ai pris. » · Extrait du procès-verbal de l'audition de M. Alain Marécaux : « Et en février 2005, on me le rend : bon, on vous l'a cassé, on vous l'a détruit, maintenant on vous le rend, on n'en a plus besoin, démerdez-vous ! J'ai beau avoir demandé une mesure d'AEMO, aide éducative en milieu ouvert, je ne sais que faire. Quand je lui dis que s'il fait des bêtises, il va aller en prison, il me répond : "Mais papa, tu n'as rien fait et tu es allé en prison". De foyer en foyer, on ne lui a pas appris à respecter les règles, mais la loi du plus fort. Voilà où il en est. » · Extrait du procès-verbal de l'audition de Mme Karine Duchochois : Placée sous contrôle judiciaire avec interdiction, malgré ses demandes réitérées, de rencontrer son fils - alors, a-t-elle souligné, que du début à la fin de l'affaire il avait toujours déclaré que sa mère ne lui avait jamais fait de mal -, Mme Karine Duchochois a fait état de son immense difficulté à rétablir un contact avec ce petit garçon : « Parce qu'il faut que vous sachiez que, même si je ne peux pas dire que j'ai perdu un enfant, mon fils, aujourd'hui, ne veut pas vivre avec moi. Il m'en veut énormément, parce que je ne suis pas allée en prison et il ne comprend pas pourquoi je ne me suis pas occupée de lui. » · Extrait du procès-verbal de l'audition de M. Thierry Dausque : « Pour ce qui est de mon gamin, il est encore placé. Je ne le vois que le dimanche. » · Extrait du procès-verbal de l'audition de Mme Sandrine Lavier : « Léa a fait la demande elle-même de revenir définitivement vivre avec nous. La juge Sophie Carlier lui a répondu que c'était trop rapide. Elle a donc refusé la levée du placement, elle a seulement accepté un hébergement long, avec un suivi d'orientation éducative avec des psys - suivi qu'elle a aussi imposé aux deux petits. J'en ai plus que marre des suivis psychologiques, des services sociaux, des éducateurs et tout ce qui s'ensuit ! Nous aimerions bien reprendre une vie de famille tranquille. _..._ Estelle est encore placée en famille d'accueil, depuis 2001. J'ai demandé à la récupérer. La juge refuse de me la rendre. Je ne la vois que deux heures tous les mercredis. » Interrogée sur la situation de ces deux fillettes, Mme Claire Beugnet, responsable du service d'aide sociale de Boulogne-sur-Mer, s'en est ainsi expliquée : « La situation a évolué rapidement puisque Léa, qui a maintenant treize ans et demi, après une première rencontre médiatisée avec sa maman, a souhaité être hébergée au domicile de sa mère et de M. Lavier. Nous ne nous y sommes pas opposés. En revanche, si Estelle accepte de voir sa maman en visite médiatisée, elle refuse tout contact avec M. Lavier. »68 M. Franck Lavier a résumé de la manière suivante tout le désarroi de ces parents, brutalement séparés de leurs enfants, face au parcours du combattant parfois imposé pour les retrouver : « Avant Outreau, nous étions une famille normale, maintenant nous nous retrouvons avec cinquante référents, juges des enfants, etc. On ne comprend pas. C'est comme un puzzle dont on a battu les pièces et qu'on ne peut pas reconstruire. Je suis désolé : le 29 mai 2001, on nous a pris nos enfants, on nous a séparés du jour au lendemain. Je ne vois pas pourquoi, eux, de leur côté, prendraient leur temps pour nous rendre nos enfants. » Il est un fait que l'éclatement des familles des acquittés, les séparations des enfants et les difficultés à recréer le tissu familial constituent une des dimensions de cette affaire qui a le plus frappé l'opinion publique. Si les signalements des mauvais traitements et des abus sexuels sur les enfants ont été tardivement pris en compte par la justice, si le recueil des déclarations des enfants et leur prise en charge judiciaire ont été souvent maladroits, l'instruction s'est révélée quant à elle pour le moins unilatérale. Le caractère univoque de l'instruction de l'affaire d'Outreau se reflète dans les méthodes d'enquête retenues, dans la stratégie adoptée et dans leur mise en œuvre. A. DANS SES MÉTHODES D'ENQUÊTE C'est une antienne désormais bien connue : en matière d'infractions sexuelles, les preuves matérielles sont rares parce que sciemment détruites par l'auteur ou bien effacées par le temps. L'affaire d'Outreau ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire. Ainsi, près de deux mois se sont écoulés entre la suspension des droits de visite des parents Delay à leurs enfants, ordonnée par le juge des enfants69 en raison de suspicions d'abus sexuels, et le placement des époux Delay-Badaoui en garde à vue70. Or, un tel délai, résultant pour partie du cloisonnement administratif des services évoqué précédemment, fut largement suffisant pour permettre aux auteurs, et à leurs éventuels complices, d'organiser la disparition des éléments matériels probants. Mme Badaoui-Delay indiquait d'ailleurs, lors d'un interrogatoire mené par le juge d'instruction le 2 mai 2001, que « quand son mari a reçu la lettre du juge des enfants comme quoi il y avait eu des agressions sexuelles subies ou vécues, il a pris peur. [...] Mon mari a jeté les masques, les ongles en plastique, les godemichés qui avaient servi sur les enfants, une poupée gonflable qui avait servi pour montrer aux enfants comment il fallait faire avec une femme. »71 Notons ici qu'elle attribuera, par la suite, la responsabilité de la destruction de ces objets au « chef du réseau », Daniel Legrand père, qui les aurait brûlés dans la salle de bain du couple72. Que les faits évoqués par Mme Badaoui soient avérés ou non, force est de constater que, dans cette affaire, l'enquête judiciaire a vainement recherché les éléments de preuve matériels, les différentes investigations entreprises s'étant révélées infructueuses à une double exception près : · lors de la perquisition effectuée chez M. Delay le 20 février 2001, à l'occasion de laquelle plus de 300 cassettes vidéo étaient saisies dont 163 à caractère pornographique, 60 relevant du genre des films d'horreur ainsi qu'une cassette filmant les ébats sexuels du couple dans laquelle l'un de leurs enfants apparaît en arrière-plan. En outre, des ustensiles à caractère sexuel tels que des vibromasseurs, 12 godemichés, des forceps ou des menottes étaient saisis73 ; · lors des réquisitions adressées à un médecin des hôpitaux, expert, afin d'obtenir tous renseignements sur les admissions éventuelles des enfants Delay et les types de soins apportés. Parvenues aux enquêteurs de police du commissariat de Boulogne le 15 janvier 2001, les réponses de l'expert indiquaient que l'un des enfants Delay avaient été hospitalisé à onze reprises, l'autre à neuf reprises, notamment pour des infections du testicule, des constipations avec douleurs abdominales et selles avec du sang rouge. En outre, comme cela a déjà été indiqué, les quatre enfants Delay étaient examinés le 24 janvier 2001par un gynécologue-obstétricien, qui concluait que « l'examen génital permet de retenir un tonus sphinctérien légèrement amoindri ; aucune trace d'agression sexuelle n'est notée. On ne peut exclure que l'enfant ait été sodomisé par le passé, les faits datant de plus d'une année ». Dans ces conditions, le juge d'instruction et les enquêteurs de police n'ont disposé comme éléments à charge que des nombreuses accusations proférées par les mineurs victimes et par Mme Myriam Badaoui, Mlle Aurélie Grenon, M. David Delplanque et, de façon plus résiduelle, par MM. Franck Lavier et Daniel Legrand fils. Fonder la recherche de la vérité sur de telles déclarations, évolutives, souvent contradictoires, constitue une difficulté qui ne saurait être niée. La réussite de cette entreprise suppose que les différentes versions des faits soient confrontées avec une rigueur extrême, qu'elles fassent l'objet de recoupements précis permettant de démêler l'écheveau de l'avéré et de l'invraisemblable. Cette démarche suppose, on l'a vu, que le recueil des déclarations des enfants ait été effectué avec la plus grande précaution et le plus rapidement possible. Elle requiert également, s'agissant des adultes, que la technique des interrogatoires et des confrontations mette clairement à jour les convergences et les contradictions des versions, en prévenant d'éventuelles concertations entre les mis en examen. À cette aune, la méthode retenue par le magistrat instructeur dans ce dossier est critiquable puisque, en s'appuyant quasi exclusivement sur des confrontations groupées74 et des questions parfois inductives, elle n'a pas permis de relever et de tirer toutes les conséquences des contradictions dans les accusations. 1. Une analyse défaillante des déclarations et de leurs contradictions Qu'il s'agisse des déclarations des mis en examen ou des questions du juge, celles-ci ont été souvent interprétées dans un seul sens. a) L'interactivité incontrôlée des confrontations groupées Interrogé sur les raisons l'ayant conduit à n'organiser que des confrontations groupées, le juge Fabrice Burgaud a expliqué lors de son audition par la commission que, après avoir « longuement hésité » mais considéré que toutes les personnes avaient été entendues séparément, dans le cadre d'interrogatoires, « mieux valait procéder à des confrontations groupées, ce qui créerait une interactivité permettant aux uns et aux autres de contester tel ou tel élément avancé. J'ai pensé que ces confrontations permettraient d'approcher la manifestation de la vérité »75. Or, si cette interactivité a effectivement eu lieu, force est de constater qu'elle a plutôt eu pour effet d'éloigner, voire d'entraver, la manifestation de la vérité. Il ressort de l'analyse du dossier de la procédure, que les confrontations se déroulaient systématiquement de la même manière : dans un premier temps le juge d'instruction rappelait à Mme Myriam Badaoui ce qu'elle avait préalablement déclaré, puis, il le lui faisait confirmer et demandait ensuite au mis en cause ce qu'il avait à dire. Ce dernier généralement niait, à la suite de quoi le juge d'instruction interrogeait Mlle Aurélie Grenon et M. David Delplanque, qui confirmaient, dans la majorité des cas, les propos de Mme Myriam Badaoui, souvent de façon plus imprécise mais néanmoins sans peine. Confronté à cette convergence des accusations, le mis en examen persistait dans ses dénégations mais voyait sa position et la crédibilité de ses dires considérablement fragilisées, le juge concluant généralement en posant la question suivante : « comment expliquez-vous que trois personnes qui n'ont pu se concerter, puisqu'elles étaient détenues dans trois maisons d'arrêt différentes, aient pu faire des déclarations aussi précises et convergentes ? »76 Que pouvait donc rétorquer la personne mise en examen, dont certaines ont comparu sans avocat77, face à ce bloc d'accusation ? La question était identique lorsque le mis en examen était accusé par ces trois adultes et les quatre enfants Delay, comme l'illustre l'interrogatoire de Mme Roselyne Godard du 26 septembre 2001, à l'occasion duquel le juge d'instruction lui demande : « Comment expliquez-vous que sept personnes qui n'ont pu se concerter puisque les trois adultes étaient détenus dans des maisons d'arrêt différentes, vous mettent en cause de façon précise et circonstanciée ? » puis « Comment expliquez-vous que les déclarations soient convergentes alors qu'il est certain qu'ils n'aient pas pu se concerter ? » Bien évidemment, Mme Roselyne Godard ne pouvait que rétorquer : « Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas comment des personnes dans des lieux différents peuvent dire des choses pareilles. Je n'étais pas là. » À ce stade, il convient d'apporter les éléments de précision suivants : - il n'est pas assuré, loin s'en faut, qu'il n'y ait pas eu de concertation entre les enfants Delay. En effet, dans une note de l'UTASS du 10 avril 200178 à l'attention de la responsable du service enfance et famille du département, on peut lire que les services essayent « de mettre en place, avec les assistantes maternelles, des rencontres de la fratrie en dehors des rencontres pour les auditions [devant le juge des enfants]. Les enfants semblent très soudés entre eux et il est important de maintenir des liens ». Par ailleurs, l'un des enfants du couple Lavier a été placé dans une famille d'accueil résidant juste en face de celle de l'un des enfants Delay. Comme l'indique une note de la même source en date du 7 juin 2001, déjà citée dans le chapitre précédent du présent rapport, « Luc, depuis l'arrivée d'Estelle chez Madame Philippot qui habite la maison d'en face, reparle de certains événements [et notamment] d'un "docteur". À la question de Madame Chochois "que faisait-il" ? Luc répond : "ben, il me soignait". En insistant un peu, Luc précise : "il mettait ses doigts dans mon derrière, puis dans ma bouche, maman filmait" ». Puis, curieuse coïncidence, on apprend un peu plus en avant de cette note de l'assistante maternelle de l'enfant Lavier que celle-ci évoque à son tour un médecin et déclare « avoir peur et ne pas vouloir aller le voir »79 ; - l'absence de concertation entre les prévenus ne peut être purement et simplement écartée du seul fait de leur incarcération dans des établissements pénitentiaires distincts. En effet, certains ont été en mesure de consulter les pièces du dossier et, par voie de conséquence, de prendre connaissance des déclarations des autres prévenus. L'organisation même des confrontations a entraîné cette convergence des accusations dont la « précision », ainsi appréciée par le juge, est toute relative. Dans le cas de M. Thierry Dausque - et pour se cantonner à une seule illustration de ce processus interactif - Mme Myriam Badaoui, interrogée en premier par le juge d'instruction pour savoir « quand précisément les faits se sont déroulés », répond « je sais que c'était en 1998, bien avant Noël, mais je ne saurais pas vous dire la date précise »80. Renouvelant quelques instants plus tard sa question à l'adresse de Mlle Aurélie Grenon, cette dernière répond « En 1998, avant décembre 1998, peut-être en octobre ou novembre 1998 ». Enfin, interrogé sur ce point, M. David Delplanque se contentait d'indiquer que les faits s'étaient déroulés « en 1998, mais je ne pourrais dire précisément quand ». De même, questionnée afin de savoir « à quel moment de la journée les faits ont-ils eu lieu ? » Mme Myriam Badaoui indique « à des moments l'après-midi et à d'autres moments en soirée. C'était des jours de semaine ». Une page plus loin, Mlle Aurélie Grenon précise que les faits avaient lieu « à des moments l'après-midi, parfois le soir. C'était la semaine », M. David Delplanque répondant pour sa part que lesdits faits se déroulaient « le plus souvent le soir, il y a peut-être eu une fois l'après-midi ». Enfin, s'agissant de la tenue de l'accusé, Mme Myriam Badaoui déclare, la première, au juge « qu'il ne venait pas toujours avec la même tenue mais il était toujours en jogging, il n'avait jamais de pantalon de toile. Il avait un jogging de marque bleue, des baskets de marque Fila bleue et un pull blanc ». Interrogée sur ce point par le juge un peu plus tard, Mlle Aurélie Grenon répond « qu'il venait souvent en survêtement », ce que confirme de façon lapidaire M. David Delplanque. Ces trois exemples démontrent clairement le phénomène d'alignement progressif des déclarations des accusateurs mais surtout leur imprécision manifeste. En effet, comment peut-on considérer comme précises des accusations qui sont incapables de situer dans le temps la commission de faits aussi graves, si ce n'est sur une période d'une année, et indiquant qu'ils avaient lieu la journée ou le soir en semaine ? Certes, la méthode des confrontations collectives n'est pas à bannir par principe, car elle permet de gagner du temps et, par voie de conséquence, pourrait contribuer à ce que la procédure respecte les « délais raisonnables » exigés par la convention européenne des droits de l'homme. À défaut du recours aux confrontations groupées, le juge d'instruction aurait dû dans ce dossier en organiser près d'une cinquantaine, ce qui aurait eu de substantielles conséquences sur le délai d'achèvement de l'instruction, et par voie de conséquence, sur la durée de détention provisoire subie par les personnes mises en examen. Pour autant, le juge d'instruction aurait pu être à l'écoute des nombreuses demandes présentées par les avocats des mis en examen et tendant à obtenir des confrontations séparées avec chacun de leurs accusateurs, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Sans prétendre à une fastidieuse exhaustivité, on rappellera que des demandes en ce sens ont été présentées par les conseils de M. Christian Godard81 et Mme Odile Marécaux82 à une reprise, de M. Dominique Wiel à deux reprises83, de M. Alain Marécaux84 et de Mme Sandrine Lavier85, à trois reprises. Ces demandes de confrontations séparées ont toujours été refusées par le juge d'instruction, quel qu'il soit. En effet, le juge Cyril Lacombe, second juge d'instruction ayant eu à connaître de l'affaire, fit siennes les méthodes de son prédécesseur puisque, dans une série d'ordonnances rendues le 4 septembre 2002, soit le lendemain de son installation officielle au TGI de Boulogne, il rejetait toutes les demandes d'actes des parties en ce sens. S'agissant de celle introduite par l'avocat de Mme Sandrine Lavier, le juge Cyril Lacombe indiquait que « le 11 mars 2002, Mme Lavier avait déjà demandé de nouvelles confrontations entre Mme Lavier, Mme Badaoui, M. Delplanque et Mlle Grenon ; qu'il avait déjà été statué sur cette demande, le magistrat instructeur ayant rendu une ordonnance de refus partiel de mesure d'instruction complémentaire (D. 1507) ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis [...] justifiant l'organisation de nouvelles confrontations séparées ». Or, puisque l'une des originalités de ce dossier est précisément qu'il n'y eut quasiment aucune confrontation séparée, il est pour le moins curieux que le juge en refuse une, au prétexte qu'elle serait « nouvelle », alors même qu'elle aurait été la « première ». Et pourtant, les mémoires présentés par la défense faisaient clairement apparaître les effets pervers de cette méthode. Ainsi, à l'appui de sa demande de confrontation séparée du 26 août 2002, Me Philippe Lescène, avocat de Mme Sandrine Lavier, soutient que « la confrontation déjà intervenue a été faussée par la présence de ces trois personnes ensemble dont il a pu être constaté que Mlle Grenon et M. Delplanque s'alignent purement et simplement sur les propos de Mme Badaoui ». Comme l'a déclaré devant la commission Me Raphaël Tachon,86 ces confrontations groupées « reposaient sur sa conviction générale que tout le monde était coupable. Peut-être était-il dépassé par l'horreur de ce dossier, mais si l'on ne peut pas faire la part des choses, si on n'entend que sa compassion pour les victimes, on manque de recul. » Endossée par les juges d'instruction successifs ayant connu de cette affaire, la méthode des confrontations groupées a également été avalisée par la chambre de l'instruction. Saisie par les avocats de M. Alain Marécaux en appel du rejet par le juge d'instruction d'une demande de confrontation avec Mlle Aurélie Grenon et M. David Delplanque, à l'exclusion de Mme Badaoui, la chambre confirmait ce rejet, en considérant que son avocat avait « pu poser toutes les questions qu'il estimait nécessaires à la défense des intérêts de son client ; qu'Alain Marécaux lui-même a pu apporter la contradiction à M. Delplanque et à Mlle Grenon lorsque ceux-ci se sont expliqués très complètement sur la participation de celui-ci aux faits qui lui sont reprochés »87. Ce faisant, la chambre de l'instruction a donc estimé que ce qui importait était que des confrontations régulières en leur forme aient lieu, leurs modalités pratiques lui étant indifférentes, car soumises à l'appréciation du seul juge d'instruction. À ce systématisme dans les modalités d'organisation des confrontations entre adultes, a répondu une particularité inverse dans cette affaire : l'absence de confrontation des accusés avec les enfants accusateurs. Bien que demandées par la plupart des personnes mises en examen, à l'instar de Mme Roselyne Godard88, de Mme Sandrine Lavier89, de Mme Odile Marécaux90 ou de M. Alain Marécaux91, toutes les confrontations des adultes avec les enfants accusateurs ont été refusées par le juge d'instruction qui, là encore, a reçu l'aval de la chambre de l'instruction. La motivation du juge d'instruction, toujours la même, tient au fait que de telles confrontations « risquaient d'accroître le traumatisme des enfants », cette appréciation s'appuyant sur les conclusions des rapports de l'expert psychologue. En effet, la mission dévolue à l'expert par le juge, outre la description de la personnalité, de la psychologie, de l'existence de troubles mentaux, comprenait la question suivante : « Dire si une audition par le magistrat instructeur ou une confrontation avec le mis en examen serait de nature à accroître son traumatisme. »92 Or, dans tous les cas, l'expert commis, en l'occurrence Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, répondra sans aucune ambiguïté qu'une « confrontation avec le mis en examen serait de nature à accroître son traumatisme »93. Compte tenu de cette réponse, il était parfaitement légitime, et il est d'ailleurs fréquent en juridiction, que le juge d'instruction refuse les demandes d'actes déposées en ce sens par les parties. Toutefois, deux observations peuvent être présentées : - la formulation de la question du juge d'instruction à l'expert appelait, de la part de ce dernier, une réponse confirmant que la confrontation était de nature à aggraver le traumatisme. Comme l'a expliqué devant la commission le docteur Paul Bensussan, psychiatre, d'autres approches étaient envisageables : « Un juge neutre demandera à l'expert : "L'état de l'enfant est-il compatible avec une confrontation ?" Un magistrat très désireux qu'une confrontation ait lieu demandera : "Y a-t-il une contre-indication absolue à une confrontation ?" Mais un juge qui ne veut surtout pas faire de confrontation demandera : "La confrontation est-elle de nature à réactiver l'anxiété de l'enfant ?" et dans ce cas chacun comprend le message subliminal, la réponse est "oui", et il n'y a pas confrontation. Pourtant, c'est un acte utile à la manifestation de la vérité. Elle peut être éprouvante, mais j'ai vu de nombreux enfants en ressortir renforcés, et de nombreux auteurs "craquer" face à leur victime »94 ; - le refus de toute confrontation entre les enfants et les accusés n'a fait que retarder l'occurrence de cette rencontre tout en en aggravant ses éventuelles conséquences. En effet, c'est à l'audience de la cour d'assises, à Saint-Omer pour l'essentiel, que la confrontation a eu lieu. Or, compte tenu de l'âpreté des débats qui s'y sont déroulés il n'est pas certain que les enfants aient subi un traumatisme moindre à cette occasion que si la confrontation avait eu lieu préalablement dans le cabinet du juge d'instruction. Il convient de rappeler avec force ici que l'organisation d'une confrontation de l'accusé avec les témoins à charge est un droit reconnu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, la convention stipule que toute personne accusée a droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Dès lors, puisque cette confrontation doit, à un moment ou l'autre de la procédure, avoir lieu, il n'est pas certain que les intérêts de l'enfant aient été mieux préservés en la réservant à l'audience publique de la cour d'assises. Conçue comme devant permettre de « faire ressortir les contradictions des uns et des autres », la confrontation a, dans cette affaire, failli à sa mission, non par sa nature, mais en raison de ses modalités d'organisation ; de son absence d'organisation s'agissant des mineurs victimes ; de la personnalité de la principale accusatrice et des questions posées par le juge d'instruction. b) Des questions répétitives et inductrices Comme l'a expliqué devant la commission Me Hubert Delarue95, avocat de M. Alain Marécaux, « des pressions ont été exercées, notamment sur le maillon faible de cette affaire, le compagnon d'Aurélie Grenon ». Cet avocat se réfère en particulier à l'interrogatoire du 5 octobre 2001, au cours duquel le juge questionne une première fois M. Delplanque en ces termes : « Aurélie Grenon confirme les déclarations de Mme Delay. Sachant que vous étiez le concubin d'Aurélie Grenon, comment expliquez-vous que vous ne reconnaissiez pas Daniel Legrand et Alain Marécaux comme ayant participé aux faits de viols ? Réponse : Je ne connais pas de personnes s'appelant Daniel Legrand et Alain Marécaux. Question : Avez-vous peur de Daniel Legrand et Alain Marécaux ? Réponse : Non, comme je ne les ai jamais vus. Question : Avez-vous été menacé par Daniel Legrand et Alain Marécaux ? Réponse : Non, je vous dis que je ne les connais pas. » Puis, quelques instants après, le juge revient à la charge : « Question : Vous avez déclaré qu'Alain Marécaux n'a pas participé aux faits. Êtes-vous bien certain qu'il n'a pas violé les enfants ? Réponse : Je n'osais pas vous dire qu'il avait participé car il avait dit qu'il ne fallait pas le dire à tout prix. » Ayant partiellement obtenu ce qu'il recherchait, après quatre tentatives, le juge questionne ensuite à nouveau M. David Delplanque en ces termes : « Il ressort des investigations que Daniel Legrand, père, dit Danny Legrand et surnommé "Dada", et fils, ont également participé aux faits de viols. Êtes-vous bien certain qu'ils n'ont pas participé aux faits de viols ? » La réponse attendue parvient enfin : « En fait, ça me dit quelque chose. Le père est grand et fort rasé. Il venait avec un jeune mais je ne savais pas que c'était son fils. Ils ont participé aux faits. »96 Cette répétition des questions se vérifie également dans le cadre des confrontations lorsque ces dernières n'obéissent pas totalement au schéma précédemment décrit. En effet, à deux reprises au moins97, l'alignement des déclarations du triumvirat des accusateurs n'est pas absolu, ce qui conduit le juge à revenir de façon répétée sur ces discordances. Ainsi, le 17 janvier 2002, le juge rappelle à Mlle Aurélie Grenon qu'elle a déclaré que Pierre Martel avait sodomisé de nombreux enfants et lui demande si elle maintient ses déclarations. La suite est ainsi décrite : « Réponse : Non. Question : Comment se fait-il que vous ayez mis en cause M. Martel pour avoir violé des enfants ? Réponse : Je savais qu'il transportait Mme Delay. Mention : Mlle Grenon pleure et tremble. Question : Avez-vous été menacée par M. Martel ? Réponse : Non mais depuis tout à l'heure il me regarde drôle. J'ai peur de lui. Par la suite, quand il sortira. J'ai peur qu'il s'en prenne à moi du fait que je l'ai dénoncé. Question : M. Martel a-t-il oui ou non violé des enfants ? Réponse : Oui. » Ce passage est édifiant à double titre : d'abord parce que Mlle Aurélie Grenon livre l'une des clés de son attitude, à savoir, être au plus près de ce que déclare Mme Delay en confirmant en tous points les accusations que cette dernière porte contre nombre de personnes de son entourage, en l'occurrence le chauffeur de taxi qui la véhicule, ensuite parce qu'elle se sent prisonnière et de cette stratégie et des craintes des conséquences futures de ses accusations mensongères. À cet égard, on constate que tant le magistrat instructeur que la chambre de l'instruction n'ont pas perçu les conséquences que pouvaient avoir des questions répétées, voire obstinées, sur la personne de Mlle Aurélie Grenon dont « l'immaturité et le caractère influençable » est, précisément, l'une des motivations de sa remise en liberté et de son placement sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction98. Pour autant, malgré l'insistance du juge, MM. David Delplanque et Daniel Legrand fils, à la différence de Mlle Aurélie Grenon, ne cédèrent pas ce 17 janvier 2002 mais infirmèrent leurs précédentes mises en cause et affirmèrent qu'ils ne connaissaient pas M. Pierre Martel ou qu'il n'avait pas commis les faits lui étant reprochés. Cette pression par des questions répétées se vérifie également lors de la confrontation du 27 février 2002, en la présence des trois accusateurs et de Mme Karine Duchochois. À cette occasion M. David Delplanque innocente d'abord Mme Karine Duchochois en revenant sur ses précédentes déclarations et en déclarant ne pas la connaître. Là encore, le juge fait la lecture des anciennes accusations et, « curieusement », M. David Delplanque change à nouveau de version en accusant Mme Karine Duchochois. Interrogé par le juge sur les raisons de tels revirements, M. Delplanque indique simplement qu'il a agi de la sorte « parce qu'il en a marre ». Certes, des questions répétitives sont souvent nécessaires pour s'assurer de la sincérité et de l'exactitude des déclarations faites devant le juge, mais la frontière est ténue entre la légitime insistance, mue par la volonté d'établir la vérité, et la pression sur l'intéressé faite pour conforter des hypothèses de travail en rendant cohérentes entre elles les différentes versions. En l'espèce, compte tenu de la personnalité des mis en examen ayant fait l'objet d'une telle pratique, de leur caractère influençable et de l'absence de prise en considération des quelques rares revirements maintenus de certains accusateurs, tout laisse à craindre que cette frontière ait été franchie. Outre leur répétition, nombre de questions posées par le magistrat instructeur s'illustrent par une formulation suggérant fortement la réponse attendue. Sans vouloir constituer un florilège aussi abondant que lassant, les quelques exemples suivants méritent d'être cités : - Dans un interrogatoire de Myriam Badaoui en date du 2 mai 200199, le juge pose d'abord la question suivante : « Pourriez-vous nous indiquer ce que Mme Godard a fait à vos enfants ? » ce à quoi Mme Badaoui répond : « en ma présence elle n'a rien fait. » Cependant, le juge poursuit son questionnement en indiquant que : « Les enfants déclarent que Roselyne Godard les sodomisait avec du pain. Qu'est-ce que vous en savez ? » La réponse attendue ne tarde pas : « C'est pour cela que Jean avait le derrière abîmé. Je n'étais pas présente lorsque ces faits se sont produits. » Ce faisant, le magistrat livre donc l'information selon laquelle les enfants ont porté ces accusations contre Mme Roselyne Godard ; - De même, le 18 septembre 2001100, le juge débute l'interrogatoire de Mlle Aurélie Grenon de la façon suivante : « Vous avez déclaré que des personnes venaient chez vous pour vous menacer. Ne s'agissait-il pas de Daniel Legrand ? » Là encore, le juge induit, par l'énoncé de sa question, la réponse qu'il attend. Pour autant, en l'espèce, Mlle Aurélie Grenon rétorque, dans un premier temps, qu'elle ne connaît pas cette personne mais, deux pages plus loin, le lecteur apprend néanmoins que Daniel Legrand père est « l'organisateur de tous ces faits. C'est lui qui faisait tout. J'en ai peur car il est venu à la maison pour me menacer » et que Daniel Legrand fils « a aussi participé aux faits » ; - Enfin, et il s'agit d'une question au-delà de l'inductif, le 9 janvier 2002, à la suite des « révélations », qui s'avéreront fantaisistes, faites par Daniel Legrand fils au sujet du viol et du meurtre d'une fillette belge par M. Thierry Delay, le juge « donne lecture à Mme Delay du courrier » puis l'interroge pour savoir si les faits relatés sont vrais ou inventés. La tâche est alors aisée pour Mme Myriam Delay qui confirme la teneur de la lettre tout en ajoutant, par instants, de nouveaux détails pour la rendre encore plus « crédible ». C'est ainsi qu'elle indique que la fillette était « habillée d'un jogging bleu, un haut et un bas. Le bas était simple et le haut portait un petit lapin blanc. Elle portait des chaussures comme des tennis rouges avec des dessins fantaisie dessus. Elle n'avait pas de boucles d'oreille ». Le fait de lire préalablement à Mme Myriam Badaoui la lettre de Daniel Legrand fils fut lourd de conséquences dans ce dossier et constitue un manquement au devoir de prudence du magistrat que Me Thierry Normand a qualifié « d'erreur de jeunesse »101. c) Des questions ne se fondant sur aucun élément du dossier Des questions répétitives, des questions inductrices mais aussi des questions sans fondement matériel abondent dans ce dossier. À de nombreuses reprises, le juge formula des questions laissant accroire que des faits étaient avérés, alors qu'apparemment il ne disposait d'aucun élément de preuve en ce sens. Deux illustrations de cette attitude méritent d'être évoquées, l'une se situant dans la première phase de l'instruction, avant la vague d'interpellations de novembre 2001, l'autre à la fin de l'instruction, en juin 2002 : · Le 5 octobre 2001, le juge instructeur procède à l'interrogatoire de M. David Delplanque et affirme, au travers de ses questions, la participation aux faits de viols de 16 adultes qui ne sont pas mis en examen. La formulation des questions est toujours la même : « Il ressort des investigations que M. ou Mme X ont participé aux faits de viols. Qu'en est-il ? ». Comme à son habitude, M. David Delplanque confirme une grande partie des propos du juge, en ajoutant quelques détails sur les personnes ainsi mises en cause habitant le quartier de la Tour du Renard, ce qui était chose aisée. Pour autant, on est fondé à se demander quels sont les éléments « ressortant des investigations » auxquels se réfère le juge. Si de telles preuves avaient existé, ces personnes auraient également dû être mises en examen et, comme les autres, placées en détention provisoire. Le fait qu'elles ne l'aient pas été demeure une énigme. Au-delà de cette incompréhension, cette différence de traitement de personnes mises en cause selon le même procédé est inquiétante du point de vue du respect des principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice. Ces interrogations sur la cohérence de l'appréciation de la culpabilité des personnes ne sont pas pour autant le résultat d'une reconstruction a posteriori. En effet, ces doutes figurent clairement dans un mémoire de demande d'acte rédigé par Me Philippe Lescène et destiné au juge d'instruction. Dans ce document, en date du 24 août 2002102, il est écrit ceci : « Je constate qu'un grand nombre d'adultes ont été mis en cause sans être mis en examen. » [S'ensuit une énumération de 14 adultes dont deux médecins et deux huissiers]. « Tous ont été entendus par la police, tous ont contesté les accusations dont ils étaient l'objet, notamment de la part de Mme Badaoui, et pour certains, de la part des enfants, de M. Delplanque et Mme Grenon. Mais eux n'ont été l'objet, pour la plupart, d'aucune mesure de garde à vue et bien entendu, n'ont pas été mis en examen. Alors que les accusations portées contre certains d'entre eux, sont de même nature, et de même gravité, que celles portées contre certains des mis en examen. Faut-il y voir une lassitude, dans la recherche de la vérité ? Faut-il comprendre que les accusations, à être multiples, trop nombreuses, deviennent excessives, et font perdre toute crédibilité à leurs auteurs ? Mme Lavier, si les propos à son encontre avaient été tenus en fin d'instruction, aurait-elle échappé à une mise en examen ? Peut-il y avoir dans une affaire de cette nature, deux poids deux mesures ? Peut-on accepter que certaines accusations soient vraies et certaines accusations soient fausses alors que celles-ci n'ont pas été vérifiées ? » Comme l'a indiqué à la commission le commissaire de police François-Xavier Masson, il est vraisemblable que l'absence de mise en examen de certaines personnes pourtant accusées de faits graves par les enfants et Mme Myriam Badaoui soit le fait d'une prise de conscience, jamais reconnue par le juge d'instruction ni le procureur de la République, que « si nous continuions à écouter Myriam Badaoui, nous allions nous trouver avec la moitié la population d'Outreau accusée et l'autre moitié victime... Nous avons donc recherché d'autres éléments et au moins les déclarations d'autres adultes »103. · Le second épisode où les questions très directives figurent en bonne place a lieu lors de l'interrogatoire récapitulatif de Mme Myriam Badaoui, le 5 juin 2002104. À cette occasion, le juge affirme qu'il « ressort de l'enquête que Daniel Legrand père était une des personnes les plus importantes du réseau de pédophilie avec votre mari, c'est lui qui s'occupait de vendre les cassettes et photographies pornographiques. Est-ce exact ? Réponse : Oui. Question : Si c'est lui qui s'occupait des cassettes, des photographies et de l'argent collecté à l'occasion des faits, savez-vous ce qu'il a pu faire de l'argent ? Réponse : Non, il ne fallait pas que je m'occupe de tout ça. Je ne devais même pas en parler. Je disais aux enfants le soir qu'il ne fallait pas en parler car il me frappait violemment. » Poursuivant son interrogation, le juge en vient aux faits reprochés à M. Pierre Martel et questionne Mme Myriam Badaoui pour savoir si ce n'était pas ce dernier « qui avec votre mari et Daniel Legrand père géraient l'aspect financier de la revente de cassettes et de photographies ? », ce à quoi l'intéressée répond qu'elle l'ignore. Enfin, abordant le cas de Mme Roselyne Godard, le juge affirme qu'il « apparaît que Mme Godard a assuré, au moins en partie le transport de cassettes et de photographies à caractère pédophile. Est-ce exact ? Réponse : Oui, elle a bien transporté des films faits avec les enfants, les cassettes étaient mises dans des cartons avec des paquets de chips dessus. » Au travers de ces quelques questions, apparaît la conviction profonde du juge quant à l'existence d'un « réseau de pédophilie » ayant des activités de fabrication et de revente de cassettes ou de photographies pornographiques, qui semble s'appuyer sur des éléments de preuve faisant pourtant défaut. Comme l'a observé devant la commission Me Julien Delarue, avocat de M. Daniel Legrand père, « en réalité il ne ressort rien des investigations [...] Cela conforte Mme Badaoui dans ses accusations. Cet interrogatoire récapitulatif est un véritable réquisitoire, qui supprime tout espoir »105. En effet, ni la caméra ayant filmé les viols des enfants ni les cassettes ou les photographies n'ont été retrouvées par les enquêteurs. Dès lors, il semble bien que les « éléments ressortant de l'enquête » sur lesquels le juge fonde sa conviction soient les déclarations de Mme Myriam Badaoui, confirmées par ses acolytes, le cas topique étant celui de Daniel Legrand père. Un « couple Badaoui-Burgaud » ? Lors de son audition par la commission, M. Alain Marécaux106 a déclaré que le « couple » clé dans le dossier d'Outreau n'était pas le couple Badaoui-Delay mais le couple Badaoui-Burgaud. Votre rapporteur constate, pour sa part, à la lecture des courriers que Mme Myriam Badaoui a adressés au juge, qu'elle semblait persuadée que le magistrat exerçait une certaine forme de pression pour obtenir toujours davantage d'aveux. Les quelques extraits suivants, reproduits tels quels, des lettres enregistrées au cabinet d'instruction en sont l'illustration : « Mr le juge je vous écris car ça ma fait tilte dans ma tête vous m'avez dit que j'avais pas tout dit. J'ai tout dit. Pourquoi voulez vous pas me croire ? Dois je mentir, dois je dire se que j'ai pas fait ? »107 ; « je vous ecris ce courier c'est pour vous dire que vous dites que si je sors provisoire je me présenterai pas au jugement ; mais comment vous pouvez en être sûr ? j'ai eu confiance en la justice mais vous promettez la sortie provisoire si on parle ; je vous ai dit tout mais je commence à en n'avoir mar »108 « vous me demander des noms que je serais imcapable de vous dire je suis malade »109 ; « je me permets de vous écrire pour vous dire que j'ai reçu un courrier de l'avocat qui m'a fait beaucoup de peine ; vous tenez pas votre parole non plus car plus que je dis et plus que vous voulez que je mente ; j'ai violer 6 enfants de mon plain gré je l'avoue mais je n'ai pas participer à ce réseau de pédophilie : je suis à bout de nerf » 110 ; « je me permet de vous écrire pour vous dire que j'ai remarqué une chose : c'est que plus que j'ai dit la vérité plus vous cherchez que je mente »111. Pour autant, son avocate, Me Pascale Pouille-Deldicque, qui est intervenue dans ce dossier à partir du 24 juillet 2001, soit postérieurement à l'envoi de ces courriers, a indiqué avoir tenu à Mme Badaoui le « discours clair » suivant112 : « "Vous avez reconnu les faits, à un ou deux près ; ce n'est pas la peine de déposer des demandes de mise en liberté, parce que, de toute façon, nous ne les obtiendrons pas ; et la détention provisoire que vous êtes en train de faire viendra en déduction de la peine que vous aurez au principal". Par conséquent, il ne peut pas y avoir de chantage ou d'invitation à donner tel ou tel nom en vue de plaire au juge d'instruction, du moins pas à partir du moment où j'interviens dans le dossier, c'est-à-dire en septembre 2001, avant la seconde vague d'arrestations. Elle est prévenue. Je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Nous ne déposons pas de demandes de mise en liberté. Si elle en a déposé une, elle l'a fait seule. Je ne suis pas allée devant la chambre de l'instruction. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine de se battre sur ce terrain-là. Il n'y a donc pas de chantage pour obtenir une mise en liberté, ni une réduction de peine. » Par ailleurs, Mlle Aurélie Grenon porte une lourde responsabilité dans les accusations portées à l'encontre de certains innocents. Sur ce point, les propos tenus par le procureur Gérald Lesigne sont éclairants113 : « Le personnage le plus important, parmi les adultes qui reconnaissaient leur culpabilité, c'est Aurélie Grenon. Celle-ci a, d'une certaine façon, un statut de victime. Quand elle déclare qu'elle a été violée par M. Thierry Delay, que ce viol a été perpétré dans l'indifférence absolue de Mme Badaoui, qui continuait à vaquer à ses occupations dans la cuisine, elle se donne le statut de victime. Elle prétend également qu'elle a subi des pressions, qu'elle a été à plusieurs reprises menacée. De plus, après avoir été libérée, elle est totalement libre de ses déclarations. Or, elle va apporter des détails extrêmement précis, qui ont eu un effet dévastateur dans ce dossier. Elle dit, à la cote D 903, que Mme Odile Marécaux portait des dessous en dentelle. Elle dit, à la cote D 1749, pour écarter les doutes que fait naître le constat de la virginité des fillettes Lavier, que M. Thierry Delay donnait des consignes pour les filles : jamais par devant, parce que ça laisse des traces. Elle dit, à la cote D 1375, que M. Thierry Dausque est violent, qu'il frappe. Elle dit, à la même cote, que M. Pierre Martel est un homme gentil, mais qu'il a une double personnalité : quand les enfants lui résistent, il devient extrêmement violent. Elle a réponse à tout. » Il serait donc particulièrement réducteur d'attribuer la cause des dysfonctionnements de la justice à l'existence d'un tandem aussi improbable qu'incongru, quand bien même Mme Badaoui fit montre, en la matière, d'un talent de manipulatrice certain et d'une imagination sans limite, allant même jusqu'à accuser des personnes qu'elle venait à croiser dans les couloirs du palais de justice ! 114 Le 2 mai 2001, lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction, ce dernier interroge Mme Myriam Badaoui pour savoir « comment étaient recrutés les clients de la prostitution ? Réponse : par l'intermédiaire du monsieur qui tenait le sex-shop ». C'est ce « monsieur » que va devenir M. Daniel Legrand père, au fil des déclarations de Mme Myriam Badaoui, en particulier après l'interrogatoire du 27 août 2001 sur lequel on reviendra plus tard. Celui qui passait pour le propriétaire de sex-shops en France et en Belgique, M. Daniel Legrand père, aurait été le responsable du réseau aux côtés de M. Thierry Delay, comme l'affirma à plusieurs reprises Mme Badaoui, y compris lors de sa confrontation avec l'intéressé le 17 janvier 2002115, à laquelle M. Daniel Legrand participa sans bénéficier d'un avocat. Singulier chef de réseau que M. Daniel Legrand père, qui dort dans sa voiture puisqu'il n'a plus de logement. Interpellé le 14 novembre 2001 à l'aube, M. Daniel Legrand déclare aux enquêteurs du SRPJ de Lille qu'il a quitté son « logement pour un problème avec la société qui nous louait cette maison en vue d'une accession à la propriété. Actuellement cette affaire est portée devant le tribunal [...] Nous avons donc quitté ce logement en septembre 2000, au début nous sommes allés avec ma femme [et trois enfants] chez ma fille. Il y a environ six mois j'ai décidé de partir et de demander à ma belle-sœur de m'héberger. Question : Au moment de votre interpellation, vous avez déclaré avoir passé la nuit dans votre voiture. Pourquoi n'avez-vous pas dormi chez votre belle-sœur ? Réponse : Ma belle-sœur était absente lorsque je suis rentré du travail et elle avait fermé la serrure principale dont je n'ai pas la clef. J'ai seulement la clef du verrou. Hier elle avait fermé la porte et je n'ai pas pu rentrer, j'ai donc décidé de dormir dans la voiture ». 116 Singulier chef de réseau encore que M. Daniel Legrand, père de cinq enfants, modeste ouvrier « poseur métallier » au salaire mensuel de 8 000 francs et aux lourds horaires de travail censé néanmoins avoir « travaillé au sex-shop à côté de la petite poste de Boulogne-sur-Mer »117 tout en étant le dirigeant d'un autre sex-shop en Belgique et le locataire d'une ferme, également sise en Belgique. Là encore, les recherches entreprises par les enquêteurs seront vaines : M. Daniel Legrand père n'a jamais travaillé au sex-shop de Boulogne, nulle part ils ne trouveront qui un titre de propriété, qui un bail ou des avis d'imposition attestant que l'intéressé acquittait au minimum des impôts fonciers en Belgique. À défaut de preuves matérielles, des documents ou des éléments financiers, bancaires ou fiscaux auraient dû être identifiés, un trafic d'images pédophiles d'une telle ampleur devant, nécessairement, générer des profits substantiels. Il n'en fut rien. Par ailleurs, si l'interrogatoire récapitulatif de Mme Myriam Badaoui ne mentionne plus expressément la dimension internationale du réseau, cette hypothèse est sous-jacente dans les questions du juge. En effet, la fabrication, la vente et le transport des cassettes pédopornographiques s'effectuaient, aux dires antérieurs de Mme Myriam Badaoui, à destination de la Belgique, véritable plaque tournante du fameux réseau, sans élément probant aucun. En dépit de cette vacuité des preuves, il ressort des questions du juge d'instruction que celui-ci demeure fermement convaincu en juin 2002 de l'existence d'un réseau de pédophilie ayant potentiellement une dimension internationale. Or, à cette date, il doit être l'un des derniers à y croire. En effet, dès le 1er mars 2002, une pièce annexée au dossier118 fait état d'un contact des services de police belge avec leurs collègues français où l'on peut lire que l'enquête du SRPJ serait dans « une impasse » et « qu'il s'avère qu'il y a également des doutes en ce qui concerne le fait que des faits se sont bien déroulés en Belgique, plus précisément dans la ferme à Zonnebeke ». À la lecture de cet extrait du rapport de la police judiciaire belge, il est évident que non seulement les services de police belge, mais également leurs homologues français, nourrissent de sérieux doutes quant à l'existence d'une dimension internationale du réseau. Lors de son audition par la commission, M. Christian Godard en a apporté une autre preuve, puisqu'il a indiqué que les policiers l'ayant interpellé le 19 février 2002 lui avaient déclaré « ne plus croire à cette grosse affaire d'Outreau »119. Enfin, dans son rapport de synthèse versé au dossier le 15 juillet 2002 que le juge d'instruction avait obtenu préalablement sous la forme d'une disquette, afin d'être en mesure de faire part de ses remarques - ce qu'il ne fit d'ailleurs pas120 - son auteur, le commissaire François-Xavier Masson, écrivait ceci : « toutes les recherches entreprises ne permirent pas de confirmer cette hypothèse, ni d'envisager l'existence d'un réseau structuré. Il semblerait que la réalité était beaucoup plus simple et beaucoup plus sordide. » d) Des questions dissimulées ? L'un des interrogatoires de Mme Myriam Badaoui les plus surprenants est celui du 27 août 2001121. Ce jour-là, et en l'absence de son avocat, le juge d'instruction lui pose la question, assez brève, suivante : « vous avez écrit le 28 mai 2001 que les enfants allaient en Belgique et que là-bas ils devaient retrouver d'autres enfants et d'autres adultes. À quel endroit en Belgique vos enfants se rendaient-ils ? » Mme Myriam Badaoui répond à cette question, ce qui est inhabituel, pendant 33 lignes de procès-verbal, sans qu'aucune question de la part du magistrat ne semble interrompre ses déclarations, puisque le procès-verbal n'en fait pas mention. C'est à cette occasion qu'elle met en cause les Legrand, alors que l'on sait aujourd'hui qu'elle ne les connaissait pas, et leur attribue ce rôle décisif dans le réseau international. C'est à partir de cette date que le rôle de M. Daniel Legrand père, en tant que chef de réseau, prend corps pour « s'étoffer » sans limite jusqu'à la clôture de l'information à l'été 2002. On peut ainsi lire dans ce document : « Il y avait beaucoup de photos qui ont été prises. Le propriétaire s'appelle bien Daniel Legrand, il est originaire de Boulogne-sur-mer, il doit avoir 40 ans, il a un fils qui s'appelle Daniel Legrand, fils, tous deux ont participé aux faits. » Or, si le propriétaire s'appelle bien Daniel Legrand, c'est donc qu'il a vraisemblablement été demandé préalablement à Mme Myriam Badaoui de certifier que le propriétaire s'appelait ainsi et non d'indiquer, par elle-même, quel était son nom. Interrogé sur ce point par votre rapporteur, le juge Fabrice Burgaud a fermement nié avoir demandé à Mme Myriam Badaoui de confirmer que le propriétaire de la ferme s'appelait M. Daniel Legrand sans que le procès-verbal ne mentionne cette question. Comment Mme Myriam Badaoui a-t-elle pu « inventer » ce nom ? « Je n'en sais rien du tout » déclara le juge, « ce que je sais c'est qu'au départ, et cela apparaît dans la procédure, elle parlait d'un certain Dada. Dada, Dany. Voilà. Ce n'est pas moi qui lui ai soufflé ce nom-là, et si je lui avais posé une autre question elle serait notée au procès-verbal »122. Interrogé également sur ce point, le greffier présent alors, M. Patrick Duval, a déclaré ne plus se souvenir de cet épisode datant, il est vrai, de plus de quatre ans123. Votre rapporteur veut bien croire à l'exactitude des réponses apportées par le magistrat et son greffier, mais alors une question demeure sans réponse : comment Mme Myriam Badaoui a-t-elle pu donner le nom d'une personne qu'elle ne connaissait pas ? À moins, et ce n'est qu'une hypothèse pour tenter d'expliquer cette incohérence, que le juge ait commis une « seconde erreur de jeunesse » pour paraphraser Me Thierry Normand, en évoquant le nom des Legrand et sans faire apparaître ce qui a pu sembler, sur l'instant, une simple incise dans ce long monologue de Mme Myriam Badaoui. Cette hypothèse semble compatible avec les méthodes de travail du juge puisque, comme l'a reconnu Mme Nicole Frémy-Walczak, greffière, « la retranscription n'est pas au mot près, et le juge, pour éviter de couper le prévenu dans ses déclarations, regroupe en général, dans sa dictée, deux ou trois questions et leurs réponses ». Il est donc possible que certaines questions, brèves, de précision, n'apparaissent pas au procès-verbal de l'audition parce qu'elles ont été « regroupées » et synthétisées sous la dictée du juge124. Interrogé par votre rapporteur sur l'entrée dans la procédure des Legrand, le commissaire François-Xavier Masson, du SRPJ de Lille, semble également croire à cette explication125 : « Nous nous sommes procuré les photos [des Legrand] qui ont permis de les reconnaître, mais nous ignorons comment elles ont été présentées dans le bureau du juge d'instruction. A-t-on posé l'album sur la table ou a-t-on désigné les Legrand en demandant si on les reconnaissait ? M. le Rapporteur : Vous ne savez pas comment les choses se sont passées ? M. François-Xavier Masson : J'ai dans l'idée que les questions du juge étaient relativement orientées et qu'il désignait la personne à identifier. M. le Rapporteur : C'est-à-dire que le juge faisait les questions et les réponses ? M. François-Xavier Masson : Oui. C'était déjà criant au moment des confrontations, ça l'est devenu plus encore avec la révélation du « meurtre ». [...] M. le Rapporteur : À quel moment avez-vous appris que le juge avait fait les questions et les réponses à propos de Daniel Legrand ? M. François-Xavier Masson : Après son arrestation. M. le Rapporteur : N'avez-vous pas eu envie d'aller trouver le juge et de lui rappeler qu'il convenait, quelle que soit la vérité, de faire usage des bonnes méthodes ? M. François-Xavier Masson : Je ne suis pas intervenu sur la conduite de ses interrogatoires. Nous lui avons juste demandé, pour nous aider dans l'enquête, de nous donner des faits précis. » Au-delà de ce cas précis, c'est bien la question de la fidélité de la retranscription des propos par le greffe qui se trouve soulevée. e) La retranscription contestée des propos par le greffe Plusieurs acquittés et leurs conseils ont mis en cause, devant la commission, les méthodes de retranscription des propos échangés dans le cabinet du juge d'instruction. Ainsi, Mme Karine Duchochois et son avocate ont indiqué avoir été en désaccord avec la retranscription des déclarations de Mme Myriam Badaoui lors de la confrontation du 27 février 2002. Selon ces personnes, Mme Myriam Badaoui aurait indiqué que les faits de viols avaient eu lieu en novembre-décembre 1999 ce dont ne fait pas état le procès-verbal qui évoque l'année 1999, sans autre précision. Or, cet aspect est déterminant pour Mme Karine Duchochois, puisqu'elle avait quitté la ville d'Outreau en octobre 1999. Selon l'intéressée, un échange particulièrement vif se serait déroulé dans le cabinet du juge à ce propos dont le procès-verbal ne fait pas mention. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle Mme Karine Duchochois aurait refusé de signer ce procès-verbal alors même qu'elle avait accepté de signer le PV de son interrogatoire de première comparution. Une correspondance s'en est suivie entre l'avocate de Mme Karine Duchochois et le juge dont on trouve trace dans le dossier126. Dans un courrier daté du lendemain de la confrontation, Me Emmanuelle Osmont rappelle, en ces termes, ce que sa cliente et elle ont cru entendre : « J'ai moi-même entendu précisément ces paroles, me trouvant géographiquement positionnée juste derrière Madame Delay, mais j'ai également noté sur mes feuilles ces phrases. Ma cliente qui se trouvait assise à côté de Mme Delay, sur sa droite, après un agent de police, les a également entendus. Elle s'est à ce moment-là retournée vers moi et nous avons échangé un regard complice, puisque nous savions toutes les deux que Karine Duchochois ne se trouvait plus à Outreau en novembre et décembre 1999. Vous n'avez pas acté, Monsieur le Juge, ces propos qui s'avèrent capitaux pour la compréhension du dossier. Le juge d'instruction a, me semble-t-il, une obligation d'extrême vigilance auditive lors des confrontations, où les interventions spontanées des mis en cause sont riches de sens et je suis profondément navrée que vous n'ayez pas à ce moment-là porté une attention plus grande aux propos tenus par Mme Delay. C'est la raison pour laquelle Mlle Duchochois a refusé de signer cet acte, avec mon accord puisque j'étais moi-même témoin des propos qui ont été tenus. » En réponse à cette missive, le juge apportait, le 8 mars 2002, les précisions suivantes : « Au cours de la transcription, qui je vous le rappelle est faite au fur et à mesure des questions qui sont posées et des réponses apportées, vous avez demandé à deux reprises que soient actées des phrases que vous imputiez à moi-même, puis à une des personnes mises en examen, phrases qui n'ont jamais été tenues dans le cabinet d'instruction mais qui ne résultaient que de la déformation de propos, ce qu'ont confirmé non seulement le greffier mais également vos confrères présents. Vous en avez d'ailleurs convenu vous-même le jour de la confrontation. Puis, lors de la relecture, vous avez demandé à ce que des précisions soient apportées par une des personnes mises en examen, précisions que vous êtes la seule à avoir entendues car ni le greffier, ni vos confrères, ni les personnes mises en examen n'ont entendu les éléments que vous tentez maladroitement de faire apparaître au procès-verbal. D'autre part, il convient de rappeler que si Madame Duchochois n'a pas signé le procès-verbal de confrontation, ce n'est qu'à votre demande et qu'elle-même était prête à le faire et avait d'ailleurs commencé à signer la première page avant que vous ne l'arrêtiez d'un ton vif. » Que s'est-il réellement passé ? Votre rapporteur l'ignore, mais les modalités de la retranscription des propos tenus dans le cabinet du juge d'instruction ne peuvent demeurer en l'état127. Comme l'a expliqué le magistrat instructeur devant la commission « les retranscriptions, contrairement à ce que l'on pourrait penser, passent nécessairement par le magistrat et ne sont pas directement saisies par le greffier. Je procédais selon une méthode qui est généralement suivie par mes collègues, celle que j'ai apprise à l'école mais également lors de mes différents stages. Je note ma question, je note la réponse, et je demande au greffier de retranscrire la question et la réponse. Lorsqu'il y a une divergence, car on peut ne pas entendre quelque chose, ou mal l'entendre, le greffier est là pour attester, et les différentes personnes présentes sont également là pour dire ce qui a été dit. Certains collègues notent tout, puis dictent l'ensemble »128. Ainsi qu'il est indiqué dans le manuel de l'école nationale des greffes (ENG) sur le greffier du juge d'instruction, « le but commun du juge et du greffier d'instruction est la bonne marche du cabinet. Elle suggère une collaboration réciproque. [...] Le greffier authentifie les actes auxquels il participe par l'apposition de sa signature, notamment les auditions, interrogatoires, transports, perquisitions et saisies. Le greffier par sa signature atteste que ce qui est consigné dans les procès-verbaux est conforme à ce qui a été dit, fait ou prononcé pendant l'acte de la procédure »129. Pourtant, un peu plus loin, on peut lire que le greffier « sous la dictée du juge, fait figurer dans les PV d'interrogatoires, les questions auxquelles il est répondu. De même, il transcrit les questions du procureur de la République et des avocats ou leurs brèves observations et les déclarations sous la dictée du juge »130. Dès lors apparaît l'une des ambiguïtés du statut du greffier, authentifiant les actes de la procédure par sa signature, donc ayant une responsabilité propre, mais œuvrant sous la « dictée » du juge d'instruction, donc sous son autorité. Ainsi que l'a justement observé Me Éric Dupond-Moretti lors de son audition par la commission, « Le greffier est devenu en réalité le secrétaire du juge d'instruction. Je n'ai jamais vu, en vingt ans d'exercice professionnel, un greffier dire au juge : "monsieur le juge, ce n'est pas ce qui a été dit"»131. L'audition des greffiers par la commission a clairement mis en relief la conception que ces derniers avaient de leur rôle. Au-delà des différentes personnalités des quatre greffiers qui se sont succédé aux côtés du juge d'instruction, il en ressort l'impression d'une relation particulièrement hiérarchisée, peu susceptible de permettre l'émergence d'un dialogue voire l'expression d'une divergence d'analyse. Comme l'a indiqué sans ambages M. Patrick Duval, greffier du juge Fabrice Burgaud de mai 2001 à février 2002, « le juge était assez distant, froid, peu enclin à la conversation et au dialogue. Il ne faisait confiance à personne. Je n'ai pas souvenance qu'il ait parlé beaucoup avec ses collègues magistrats. Il s'enfermait tout seul dans son bureau pour étudier les dossiers et venait me voir ou me parler pour des choses importantes ou urgentes. Autrement nous communiquions surtout par écrit, ou par post-it »132. Autant dire que M. Patrick Duval n'a « pas de bons souvenirs » de son passage à l'instruction, expliquant avoir fait « pendant plusieurs mois, des semaines de 45 heures minimum, sans prendre aucun jour de congé. L'attitude de M. Burgaud était hautaine et méprisante : jamais un mot agréable, encore moins d'encouragement ». Par ailleurs, les pratiques semblent assez hétérogènes d'un greffier à l'autre. Certains, à l'instar de Mme Murielle Moine, ont expliqué qu'« après chaque question, je retranscrivais la question et la réponse » tandis que, concomitamment, « le juge lui-même prenait beaucoup de notes »133. En revanche, M. Patrick Duval, tout comme Mme Nicole Frémy-Walczak, ont reconnu ne prendre aucune note pendant les auditions, bien qu'étant les garants de la fidélité de retranscription, M. Patrick Duval considérant que « ce que j'ai à écrire est dicté par le magistrat ». Cette hétérogénéité n'est pas satisfaisante et peut introduire des interrogations sur la fiabilité de la retranscription des propos par le greffe, notamment compte tenu du climat de tension qui peut présider à la tenue de certains actes, tels que les confrontations, au cours desquelles invectives, cris et brouhaha sont fréquents. f) Des contradictions nombreuses mais ignorées La recherche de la vérité judiciaire est nécessairement émaillée, dans une affaire de cette complexité, de déclarations contradictoires. C'est au juge qu'il appartient d'opérer la sélection, entre ce qui relève de l'affabulation et de la vérité et d'identifier les contradictions entre des déclarations d'adultes, voire d'enfants, devant instiller le doute dans son esprit. Or, force est de constater que, en dépit de nombreuses contradictions dans les accusations proférées, les personnes ainsi mises en cause ont généralement été mises en examen et écrouées, ce qui supposait que le juge d'instruction estimait que des indices graves ou concordants étaient réunis à leur encontre. Sans prétendre à l'exhaustivité, les cas de Mme Roselyne Godard et des Legrand, accusés par Mlle Aurélie Grenon, sont représentatifs d'une appréciation contestable des éléments de culpabilité. · Le cas de Mme Roselyne Godard Le 27 mars 2001, les quatre enfants Delay sont entendus séparément par les enquêteurs - ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas eu d'occasions de discuter entre eux avant - et font des déclarations qui auraient pu être considérées avec circonspection : - Paul informe les enquêteurs que « la femme sur la photo 12 [Mme Godard] apportait du pain, des baguettes, qu'elle mettait dans notre derrière. Ensuite elle le mangeait » ; - Luc déclare : « Elle je connais, elle donne du pain à ma mère, photo 12. Elle ne faisait rien, mais son mari faisait la même chose que mon père, à moi et mes frères [...] » ; - Jean déclare : « En ce qui concerne le numéro 12 je la reconnais formellement comme étant Roselyne. Son nom c'est Douchain. Elle venait chez nous et donnait de l'argent à mes parents pour nous faire des manières sur nous. Je ne veux pas dire ce qu'elle faisait car je vais être embêté. Je veux qu'elle aille en prison. Elle venait avec son mari Marc Douchain. La dernière fois qu'elle est venue le dernier dimanche, elle a frappé son mari avec une pelle de jardin, qui appartient à mon père. Cela se passait dans la cuisine. Marc Douchain est tombé, il était ouvert à la tête. » Il convient d'observer que cet épisode sanglant n'est rapporté par aucun de ses frères. En outre, ce même enfant déclare que Mme Roselyne Godard a six enfants avec ledit M. Douchain alors même qu'elle est mariée à M. Christian Godard et n'a qu'un enfant134. - Enfin, Pierre dit notamment : « Sur la photo 12, je la connais bien. C'est la boulangère. Elle faisait des baguettes qu'elle mettait dans le derrière à Jean. Puis elle l'enlevait sans la manger. » À la suite de ces déclarations, Mme Roselyne Godard est présentée devant le juge d'instruction le 12 avril 2001. Au cours de cet interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction lui demande notamment : « Comment expliquez-vous que les quatre enfants qui ont été entendus dans des pièces séparées par les enquêteurs fassent des déclarations similaires vous concernant ? », ce à quoi elle ne sait que répondre. Toutefois, en dépit des contradictions entre les versions des enfants qui concernent l'existence ou non de faits, leur nature, l'identité des victimes, le nom de l'auteur des faits et de son mari, le nombre d'enfants du couple, Mme Roselyne Godard est mise en examen à l'issue de cet interrogatoire et placée sous mandat de dépôt. Pourtant, à cette date, elle n'a pas encore été mise en cause par des adultes, en particulier par Mme Myriam Badaoui. En effet, ce n'est que le 2 mai 2001135 que Mme Myriam Badaoui est interrogée par le juge sur l'implication de Mme Roselyne Godard et dans les termes suivants : « Pourriez-vous nous indiquer ce que Roselyne Godard a fait à vos enfants ? », ce à quoi l'intéressée répond d'abord : « En ma présence, elle n'a rien fait », avant d'ajouter « une fois, quand je suis remontée chez moi juste après le passage de Roselyne, Jean se plaignait du derrière et j'ai pu constater qu'il était abîmé, c'est-à-dire qu'il saignait du derrière. J'ai voulu l'emmener à l'hôpital mais mon mari a refusé. Juste avant la venue de Roselyne à la maison, Jean n'avait aucun problème au derrière. Il n'y a qu'elle qui est montée à la maison pendant le peu de temps que j'attendais. » C'est alors que le juge fournit l'explication à Mme Myriam Badaoui sous la forme d'une question inductrice : « Les enfants déclarent que Roselyne Godard les sodomisait avec du pain. Qu'est-ce que vous en savez ? ». La réponse est attendue : « C'est pour cela que Jean avait le derrière abîmé », et certainement pas parce qu'il était demeuré seul « quelques instants » avec son père. S'agissant des accusations portées à l'encontre de Mme Roselyne Godard par Mlle Aurélie Grenon, là encore il convient de souligner que les contradictions dans celles-ci n'ont pas joué en faveur de la personne mise en examen. En effet, interrogée par le juge d'instruction le 18 septembre 2001, Mlle Aurélie Grenon fait des déclarations circonstanciées sur les faits qu'aurait commis Mme Roselyne Godard, donnant beaucoup de détails et de précisions sordides. Or, le 12 juin précédent, dans le cadre d'un autre interrogatoire, Mlle Aurélie Grenon déclarait que Mme Roselyne Godard « montait [chez les Delay] avec des bonbons pour les enfants et de la bière pour lui. Je ne pourrais pas vous en dire plus car quand Roselyne Godard a commencé à aller chez M. et Mme Delay, nous étions fâchés avec eux depuis longtemps ». On ne peut que s'interroger sur les raisons ayant conduit le juge à ne pas questionner Mlle Aurélie Grenon sur cette contradiction, manifestement à décharge, puisque, chronologiquement, elle avait d'abord déclaré ne pas avoir assisté aux faits commis par Mme Roselyne Godard, pour ensuite les décrire avec précision, sans d'ailleurs mentionner l'épisode des « baguettes de pain ». · Les contradictions de Mlle Aurélie Grenon Le 12 juin 2001136, dans le cadre d'un interrogatoire, le juge d'instruction demande à Mlle Aurélie Grenon « quelles sont les mesures qui ont été prises avant votre interpellation ? » L'intéressée fait alors état de menaces proférées à son encontre par trois hommes. Ses déclarations sont les suivantes : « Avant l'arrestation de M. et Mme Delay, des hommes que je n'avais jamais vus venaient à deux ou trois. Ils étaient trois au total ils sont venus deux ou trois fois. Ils disaient qu'il ne fallait pas parler si on était arrêté et de toute façon ils nous retrouveraient. Ce n'était pas des gens du quartier ils devaient avoir 30 ou 40 ans. Ils sont un peu métis et semblent venir de banlieue. Il y avait un ou deux qui avait un accent drôle mais je ne pourrais pas vous préciser de quel accent il s'agit. » Il convient d'ajouter ici qu'interrogé le 14 août 2001137, le compagnon de Mlle Aurélie Grenon, M. David Delplanque confirmait que trois personnes étaient venues à leur domicile pour leur intimer l'ordre de ne pas parler. Sa description est la suivante : « Ils étaient à peu près de ma taille et bien larges, des épaules bien carrées. Ils ne venaient pas du quartier d'Outreau car je connais bien les gens du quartier. » Chacun conviendra que ces descriptions, avec toutes leurs imprécisions, demeurent fort éloignées de ce que sont MM. Daniel Legrand père et fils. Pour autant, le 18 septembre 2001138, le juge d'instruction débute l'interrogatoire de Mlle Aurélie Grenon de la façon suivante : « Vous avez déclaré que des personnes venaient chez vous pour vous menacer. Ne s'agissait-il pas de Daniel Legrand ? » Mlle Aurélie Grenon répond qu'elle ne connaît personne de ce nom-là mais, on le sait, peu après, elle affirme que M. Daniel Legrand père est « l'organisateur de tous ces faits. C'est lui qui faisait tout. J'en ai peur car il est venu à la maison pour me menacer. Il m'a dit que si je parlais ou que je disais quelque chose le concernant il me retrouverait et qu'il m'aurait envoyée au cimetière. » Par la suite, les menaces dont aurait été victime le couple Grenon-Delplanque ne seront plus attribuées qu'à M. Daniel Legrand père ainsi que l'illustre la confrontation entre ce dernier et les trois accusateurs du 17 janvier 2002139. Les « métis des banlieues » à l'accent venu d'ailleurs et âgés de 30 ou 40 ans ont bel et bien disparu, sans que cette disparition semble émouvoir, ni même susciter des questions chez le juge d'instruction. À l'analyse contestable des déclarations des mis en examen et de leurs contradictions, s'ajoute une appréciation souvent très orientée des éléments de preuve des crimes dénoncés. 2. Une appréciation orientée des éléments de preuve a) Des albums photos non-discriminants Afin d'identifier les auteurs des faits, les services d'enquête confectionnent, sous l'autorité du juge, des albums photographiques comprenant des clichés des personnes accusées, au milieu desquels sont généralement introduites des photos de personnes totalement étrangères à la procédure, afin de ne pas « induire » d'identification trop aisée des suspects par les victimes ou les témoins. Or, l'examen d'un certain nombre d'albums photos joints à la procédure fait apparaître des imperfections dans leur confection, susceptibles d'avoir orienté les déclarations des personnes auxquelles ils étaient présentés. Il en a été ainsi des premiers albums montrés aux enfants Delay et confectionnés par les services du commissariat de Boulogne au début de la procédure140 qui ne comprenaient que des photographies de personnes mises en cause. Certes, un autre album photographique, plus conforme aux bonnes pratiques, a par la suite été réalisé par le même service 141 mais tardivement, à savoir le 25 juin 2002. Par ailleurs, cet album ne comprenait pas l'intégralité des clichés des personnes dénoncées par les enfants. À la lumière des auditions menées par la commission, il apparaît clairement que ces albums ont été élaborés sous la direction très précise du juge d'instruction, comme en a témoigné le capitaine Wallet, du commissariat de Boulogne-sur-Mer142. « M. le Rapporteur : À partir du 7 mars [2001], vous entendez une nouvelle fois les enfants Delay en utilisant la méthode des portraits, avec présentation de deux planches photographiques, la première constituée de photos des adultes auteurs potentiels, la seconde de photos d'enfants victimes potentielles. Pouvez-vous nous indiquer comment cette méthode a été appliquée ? Comment les adultes et les mineurs dont les photos ont été présentées ont-ils été choisis ? Aviez-vous inclus des portraits de personnes totalement extérieures à l'affaire ? Sinon, pourquoi ? M. Didier Wallet : Le juge nous avait demandé de faire des clichés des adultes et des enfants et de présenter les planches de ces personnes. M. le Rapporteur : Seulement de ces personnes ? Pourquoi ne pas avoir glissé les photos de personnes complètement extérieures à l'affaire ? M. Didier Wallet : Le juge me l'a demandé. M. le Rapporteur : Il est allé jusqu'à vous donner des instructions sur la façon de procéder aux interrogatoires ? M. Didier Wallet : Pour les photos, oui. M. le Rapporteur : Vous, dont c'est le métier, lui avez-vous suggéré une autre méthode ? M. Didier Wallet : Non. Il me demandait de présenter ces photos-là. M. le Rapporteur : Je ne vais pas répéter trois fois chacune de mes questions... Lui avez-vous, oui ou non, suggéré autre chose ? M. Didier Wallet : Non. M. le Rapporteur : C'est donc le juge qui vous imposait la méthode de travail. Vous êtes policier depuis combien de temps ? M. Didier Wallet : Vingt ans. M. le Rapporteur : Vous avez donc une expérience professionnelle importante. En fonction de cette dernière, pouvez-vous nous dire si dans ce type de recherches, habituellement on ne fait pas figurer aussi les photos de personnes extérieures à l'affaire ? M. Didier Wallet : Si, on fait un panel. M. le Rapporteur : Là, le juge vous imposait de mettre uniquement ces photos-là et j'en tire donc logiquement la conclusion que vous étiez en dehors d'une pratique professionnelle normale. M. Didier Wallet : Oui. M. le Rapporteur : Comment l'expliquez-vous ? M. Didier Wallet : ... M. le Rapporteur : Cela ne vous a pas alerté ? M. Didier Wallet : Non. J'avais des instructions, je les appliquais. » Il en a été de même de la planche photographique143, qui a été présentée à Mme Myriam Badaoui afin qu'elle identifie Mme Odile Marécaux et qui ne comprenait que quatre clichés de femmes qui toutes, à l'exception de Mme Odile Marécaux, habitaient à la Tour du renard ou à proximité. Dans ces conditions, la reconnaissance de Mme Odile Marécaux par Mme Myriam Badaoui était on ne peut plus aisée et n'aurait pas dû être considérée comme probante. Cet argument figure d'ailleurs dans le mémoire adressé le 22 septembre 2004 au Ministre de la Justice par Me Frank Berton, avocat de Mme Odile Marécaux, tendant à constater que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour faute lourde commise par les services de la justice étaient réunies. Communiqué à la demande de votre rapporteur, ce mémoire ajoute que « Mme Badaoui a donné certains détails, jugés à charge à l'encontre de Mme Marécaux, qu'elle avait directement tirés de l'observation de cette photographie ». Il en a été ainsi de la couleur de ses mèches et du fait qu'elle portait soi-disant un tailleur noir lors de la commission des faits. Or, à la simple observation de la photographie, la représentant sur la planche D. 526, il est simple de remarquer qu'elle a une veste noire et des mèches blondes... Madame Marécaux a pourtant fourni des photographies de l'époque concernée, datées, où elle n'avait absolument pas ces mèches ». Cette présentation des albums photos a généré un important contentieux devant le juge d'instruction, dont a eu à connaître tout particulièrement le successeur de Fabrice Burgaud, le juge Cyril Lacombe. Ainsi, le 26 août 2002, Me Hubert Delarue, avocat de M. Alain Marécaux, fait parvenir un mémoire, fort détaillé et argumenté, tendant à obtenir du juge d'instruction un certain nombre d'investigations complémentaires144. Il lui est ainsi demandé : « 1° la jonction des photographies des différentes personnes mises en cause de manière précise et circonstanciée par plusieurs victimes ou personnes mises en examen : En fin de procédure, vous avez fait établir un album photographique récapitulatif des différentes personnes suspectées ou mises en examen dans ce dossier. Je constate que certaines personnes pourtant mises en cause de manière précise, circonstanciée et récurrente par différentes victimes ou personnes mises en examen, n'y figurent pas... Il en est ainsi de Me X, huissier de justice à Boulogne sur Mer qui a notamment été mis en cause de manière formelle à plusieurs reprises par Mme Badaoui ; Il en va également du docteur X ainsi que des époux Y dont l'épouse a été mise en cause par le jeune Pierre le 4 juillet 2001 en cote D. 520, lequel évoque une personne « non représentée sur les photos » en précisant « l'infirmière qui a une petite fille et deux jumeaux ». Il est donc tout a fait regrettable que certaines personnes aient été exclues de toute représentation photographique alors qu'elles étaient pourtant formellement mises en cause. Il en va également ainsi de Monsieur et Madame Z, Monsieur A, Monsieur. B, Madame C, Monsieur. D et Monsieur et Madame E. Il importe donc qu'un album photographique, exhaustif cette fois-ci des personnes mises en cause à un titre ou à un autre, soit montré à l'ensemble des enfants susceptibles d'avoir été victimes des faits que vous avez à instruire...[...] 2° La saisie, auprès des proches, famille ou belle-famille de M. Marécaux, des photos représentant celui-ci au titre des années 97, 98, 99 et 2000. Et ceci de manière à avoir une présentation photographique de mon client conforme à la réalité. » On le voit, il ressort de ce mémoire que près de 12 personnes mises en cause par les enfants ou des adultes n'ont pas été intégrées dans l'album photographique le plus exhaustif de la procédure, ce qui est considérable. Dans une ordonnance du 4 septembre 2002, le juge Cyril Lacombe rejette l'ensemble des demandes d'actes ainsi présentées, la chambre de l'instruction confirmant intégralement cette décision par un arrêt du 25 octobre 2002. Les motivations avancées par le juge sont les suivantes : - S'agissant de l'album photographique et de la jonction des clichés des mis en cause aux fins de présentation aux enfants, « les photographies des mis en cause dans le dossier ont été présentées à leurs accusateurs lorsque cette présentation s'avérait nécessaire ; que la jonction ou plus exactement l'annexion des photographies des personnes mises en cause non mises en examen et leur présentation aux enfants n'apparaissent pas à ce stade de la procédure d'information utiles à la manifestation de la vérité » ; - Sur la demande de saisie de nouvelles photographies il est indiqué : « attendu que M. Alain Marécaux sollicite le dernier jour du délai de l'avis de fin d'information que le magistrat saisisse et annexe au dossier des photographies de lui-même, photographies détenues par des proches, au motif que la photographie présente au dossier ne serait pas conforme à la réalité ; qu'une telle demande présentée aussi tardivement par M. Marécaux alors que son avocat avait la possibilité depuis des mois d'adresser au magistrat instructeur les photographies en question ne vise qu'à retarder l'instruction ; qu'en outre l'annexion de telles photographies ne présente pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité dans la mesure où il est établi que la photographie présente au dossier est bien celle de M. Alain Marécaux. » On ne peut que faire part d'une certaine perplexité devant ces motivations car quel peut bien être « l'intérêt » pour une personne mise en examen et incarcérée de retarder la clôture de l'information judiciaire ? Cette demande n'était-elle pas davantage motivée par l'espoir des avocats des parties de bénéficier d'un « nouveau regard » sur le dossier, et, peut-être, d'une capacité d'écoute supérieure de la part de ce nouveau juge d'instruction ? Par ailleurs, la motivation se référant au caractère inutile de ces actes au regard de la manifestation de la vérité est pour le moins discutable puisque, précisément, la modification des albums photos aurait pu permettre de mettre à jour les contradictions des accusateurs et l'inexactitude des prétendus détails qu'ils fournissaient à l'appui de leurs déclarations fantaisistes. Enfin, outre la question de la confection des albums photos, une autre interrogation est apparue lors des auditions menées par la commission et concerne leur utilisation par le juge d'instruction. L'échange suivant entre votre rapporteur et le commissaire Masson en est l'illustration : « M. le Rapporteur : Et que pensez-vous de la manière dont étaient organisées les présentations de planches photographiques ? Ne suggérait-elle pas les réponses ? M. François-Xavier Masson : Effectivement, au vu de la façon dont les noms surgissent, la question se pose : les questions étaient-elles fermées et orientées ? Soit l'enquêteur demande à la personne si elle reconnaît un, deux ou plusieurs visages sur la planche sans intervenir, soit il montre du doigt et demande : "Reconnaissez-vous untel" ? M. le Rapporteur : Pensez-vous que la deuxième méthode a été privilégiée ? M. François-Xavier Masson : Peut-être. En ce qui nous concerne, nous privilégions la première ! »145 b) Des vérifications parcellaires Le 1er décembre 1998, Mme Myriam Badaoui indique à l'UTASS que l'un de ses enfants aurait été victime de sévices sexuels de la part d'un homme d'une cinquantaine d'années au cours de l'été 1997. Les Delay ne portèrent pas plainte alors qu'ils disaient avoir reconnu la personne. Une enquête fut ouverte le 23 décembre 1998 et, comme on l'a vu dans le chapitre premier, a été classée sans suite au début de l'année suivante. Il s'avère en réalité que Myriam Badaoui avait inventé cette histoire en demandant à ses enfants de mentir pour ne pas accuser leur père et faire croire à une agression par un tiers, un certain « Jean-Marc » déjà, comme l'indique le rapport de synthèse du SRPJ de Lille du 15 juillet 2002146. Pierre le reconnaît en premier. Ses propos sont d'abord repris dans une note de l'UTASS du 8 décembre 2000, annexée au dossier 147 : « Tu te rappelles quand j'étais à la police pour raconter ce qu'il s'était passé avec Jean. J'avais du mal à dire "le monsieur", j'étais bloqué parce que "le monsieur" c'était mon père ! Maman nous a obligés à inventer une histoire pour qu'on comprend pas que c'était papa. » Il les renouvelle devant le capitaine de police M. Didier Wallet lors de son audition du 18 janvier 2001148 : « j'ai menti, ce n'était pas un Monsieur, c'était papa et comme je ne voulais pas qu'il aille en prison où il était déjà allé car il avait frappé maman. Jean avait menti aussi pour protéger papa. » Myriam Badaoui l'admet ensuite devant le juge d'instruction le 27 août 2001149, en ces termes : « Je voudrais aussi vous dire que Jean avait aussi accusé un homme pour l'avoir violé mais en fait c'était mon mari qui avait violé Jean. Moi il fallait que je dise que c'était ce monsieur-là. Il y a eu une enquête et ça n'a pas abouti car Jean a dit que ce n'était pas lui. » On comprend donc, à cette occasion, comment s'est mis en place un mécanisme de dénonciation d'un tiers aux fins de protection des parents qui semble avoir été, pour partie, à l'origine de la dimension prise par l'affaire d'Outreau. En prenant connaissance de ces témoignages, le système de dénonciation familiale orchestré par Mme Myriam Badaoui aurait pu être, à tout le moins, considéré avec prudence. Pourtant, le juge d'instruction ne décida pas, de sa propre initiative, de joindre la procédure de 1998/1999 au dossier. C'est à l'avocat de Mme Odile Marécaux qu'incomba cette initiative, par une demande d'acte du 4 janvier 2002. Le juge y fit droit le 1er février 2002 mais il fallut plus de trois mois pour que l'annexion de cette procédure au dossier judiciaire soit effective. Il apparut alors que la jonction ainsi opérée était incomplète car l'expertise médicale réalisée par le docteur Dickès le 6 janvier 1999 sur l'enfant Delay concerné n'était pas annexée. Cette expertise était déterminante pour Mme Odile Marécaux puisqu'elle est accusée d'avoir violé cet enfant en novembre 1998, soit peu de temps avant l'expertise, dans un délai où les traces de ces abus étaient susceptibles d'être encore visibles. En effet, il est généralement admis que « chez l'enfant, une réparation complète des tissus périanaux se produit en moins de six semaines, par conséquent au-delà de ce délai d'éventuelles traces immédiates peuvent spontanément disparaître »150. Or, dans ce rapport d'expertise il est précisément écrit « qu'aucun élément clinique ne permet de dire qu'il y a eu sévices sexuels ou attentat à la pudeur ». Me Frank Berton présenta donc, le 2 juillet 2002, une nouvelle demande tendant à la jonction de l'intégralité de la procédure que le juge d'instruction rejeta, la jugeant satisfaite, ce qui semble montrer qu'il n'avait pas procédé à l'examen attentif de la copie transmise par les services de police. En effet, si tel avait été le cas, il aurait vraisemblablement pris conscience du caractère incomplet de la copie et aurait, par voie de conséquence, demandé à ce que l'original de cette procédure lui soit délivré. En outre, il est pour le moins curieux que le parquet de Boulogne n'ait pas, de sa propre initiative, recherché ce précédent pour le joindre à la procédure, puisque l'enfant Delay évoqua ce mensonge devant le capitaine Wallet dans le cadre de l'enquête préliminaire qui précéda l'ouverture de l'information judiciaire et la saisine du juge Burgaud. Face à cette procédure parcellaire, l'avocat de Mme Odile Marécaux ne désarma pas et renouvela sa demande le 22 août 2002, en précisant bien que l'expertise médicale de l'enfant Delay faisait défaut. Il appartint alors au juge Cyril Lacombe de décider des suites à donner à cette requête. Dans son ordonnance du 4 septembre 2002, le juge rejeta cette demande, en indiquant que l'enfant Delay avait été examiné par trois experts près la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation et que la présence du rapport du docteur Dickès « n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ». Fort heureusement, le 25 octobre 2002, la chambre de l'instruction infirma cette ordonnance sur ce point et ordonna le versement de cette expertise au dossier, en expliquant « qu'un certificat médical de l'enfant Delay, contemporain de l'époque des faits objets de la présente information, est susceptible d'être utile à la manifestation de la vérité (sous réserve de la fréquence des abus évoqués, les experts de la présente procédure ayant rappelé que d'éventuelles traces disparaissent rapidement chez un enfant de cet âge) ». Et pourtant, tant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 13 mars 2003 que l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction en date du 1er juillet de la même année retinrent contre Mme Marécaux les accusations d'avoir, courant 1998, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des actes de sodomie, sur cet enfant Delay. Une fois encore, on ne peut que s'interroger sur l'appréciation ainsi portée par l'ensemble de la chaîne judiciaire sur l'un des rares éléments tangibles de ce dossier, manifestement à décharge. c) Des éléments à décharge parfois écartés Au-delà du cas de Mme Odile Marécaux, les trois situations suivantes, attestent, selon votre rapporteur, de l'imperfection de l'appréciation des éléments à charge et à décharge portée dans ce dossier. · Le cas de M. Pierre Martel Les enfants Delay mettent en cause M. Pierre Martel assez tardivement, à savoir à partir du mois de juillet 2001. Ainsi, entendu par les policiers du commissariat de Boulogne, Pierre indique le 4 juillet 2001151 que M. Pierre Martel avait caressé son frère, était accompagné de son fils et que les faits s'étaient déroulés « à la fête des mères de l'an dernier ». À cette même occasion, l'enfant Delay déclare reconnaître l'enfant de M. Martel parmi les clichés d'une planche photographique qui ne comprend que des « mineurs ». Réentendu par le juge d'instruction en tant que partie civile le 14 décembre 2001, l'enfant Delay maintint sa version des faits. Pour sa part, Mme Myriam Badaoui accusa également M. Pierre Martel d'avoir violé ses enfants en 1998 et en 2000, y compris en Belgique, mais sans fournir de date précise, le juge d'instruction s'abstenant de lui en demander lors de l'unique confrontation ayant réuni ces deux personnes, ce qui est regrettable152. Or, deux éléments de preuve fragilisent considérablement les accusations ainsi portées à l'encontre de M. Pierre Martel : - d'une part, M. Pierre Martel a deux enfants qui ont, à cette date, plus de vingt ans chacun, l'identification sur photo d'un mineur soi-disant enfant de ce dernier est donc une erreur flagrante qui aurait dû inciter les enquêteurs et le juge à davantage de prudence ; - d'autre part, pour la seule date précise fournie dans ce dossier, à savoir le jour de la fête des mères 2000, M. Pierre Martel a fourni la preuve de sa participation à une compétition de golf pendant toute la journée. À cet égard, il convient de souligner que c'est l'avocat de M. Pierre Martel, Me Hervé Corbanesi qui présenta au juge une demande d'acte153 tendant à vérifier ce point, et non le juge lui-même, censé pourtant instruire à charge et à décharge. Accepté le 12 juin 2002 par le magistrat instructeur, l'alibi de M. Pierre Martel fut confirmé par les policiers intervenant sur commission rogatoire. Comme le déclara devant la commission Me Hervé Corbanesi « Le seul lieu et la seule date d'infraction donnés par Mme Badaoui ont donc été démentis. [...] Il aura fallu six mois et la demande de l'avocat de la défense pour qu'il soit vérifié. [...] Pourquoi Pierre Martel entre-t-il dans le dossier ? Personne n'avait de permis de conduire ou de voiture. Le magistrat instructeur avait adopté la thèse d'un réseau international. C'est ce qui lui a permis d'appuyer la culpabilité de mon client. Il fallait bien que quelqu'un achemine les enfants. »154 Par ailleurs, le 5 mars 2002, M. Pierre Martel va être tardivement mis en cause pour viol sur une mineure dont les déclarations sont recueillies par le capitaine Didier Wallet accompagné de l'expert psychologue M. Émile Leprêtre. Précisons ici qu'elle mentionne le taxi « Marcel » et non « Martel ». Quinze jours auparavant, cette petite fille avait déclaré au même policier avoir été victime d'une triple pénétration de MM. Franck Lavier, « David, que je pense Legrand car j'ai entendu ce nom à la télé, jeune et Thierry Delay », ce qui atteste de la perméabilité des enfants à ce qu'ils entendent dans leur entourage et dans les médias. Or : 1. Le rapport de l'expertise médico-légale établi le 17 septembre 2001 par le docteur Bouvry conclut à la virginité de cette enfant, donc à l'impossibilité d'une triple pénétration ; 2. Le psychologue M. Émile Leprêtre indique dans son rapport qu'il faut accorder une « crédibilité toute relative » aux dires de cette jeune fille. Selon cet expert, le discours de la fillette, ce jour-là, « manque d'authenticité par rapport à ses premières révélations » et « la description qu'elle opère est marquée par la fantaisie, sous-tendue par le désir de plaire, plus que par le principe de réalité ». Pourtant, M. Pierre Martel fut renvoyé devant la cour d'assises 155 pour des faits de viol commis en France et en Belgique sur les enfants Delay, mais aussi sur cette petite fille vierge. · Le kyste de M. Daniel Legrand père Lors de la confrontation du 17 janvier 2002, Mme Myriam Badaoui accuse, entre autres, M. Legrand père d'avoir violé ses enfants à de très nombreuses reprises « en 1996, en 1998, en 1999 et 2000 ». À cette occasion, Mme Myriam Badaoui fournit de nombreux « détails » sur M. Daniel Legrand père, en particulier sur sa tenue vestimentaire lors de sa première venue dans son appartement en 1996, soit six ans auparavant, ce qui constitue une performance de la mémoire qui mérite d'être soulignée. À la fin de cette confrontation, l'avocat de M. Daniel Legrand père, Me Antoine Duport, pose la question suivante aux trois accusateurs de son client : « avez-vous le souvenir que M. Legrand père avait une anomalie au visage en 1998 ou en 1999 ? » Les intéressés répondent tous par la négative, Mlle Aurélie Grenon indiquant « qu'il faisait sombre » chez les Delay, M. David Delplanque déclarant qu'« en 1998, il avait la même tête », Mme Myriam Badaoui rétorquant qu'elle n'en avait pas de souvenir. Or, jusqu'au 8 octobre 1998, date de son opération, M. Daniel Legrand père était affligé d'un gros kyste déformant son visage. Un tel signe distinctif aurait dû être mentionné par ses accusateurs. Une telle omission était donc de nature à entacher gravement la crédibilité des accusations et l'insistance de l'avocat était on ne peut plus légitime. À cet égard, Me Antoine Duport fit parvenir au juge d'instruction Burgaud un cliché de M. Daniel Legrand sur lequel le kyste à l'oreille qui l'affecte apparaît156. Ces éléments auraient donc dû, à tout le moins, instiller du doute dans l'esprit du juge d'instruction, mais il n'en fut rien. En effet, lors de l'interrogatoire récapitulatif de Mme Myriam Badaoui du 5 juin 2002, le juge résout par la formulation même de sa propre question, cette incohérence : « il ressort de la procédure qu'il y aurait eu des faits en 1996, à la fin de l'année 1998 après l'opération du kyste à l'oreille de M. Daniel Legrand père qui eut lieu le 6 octobre 1998, en 1999 et en 2000. Est-ce exact ? » Réponse : Oui, en 1997, il n'y a rien eu. Il n'est plus venu jusqu'à la fin 1998 [...] Question : Saviez-vous pour quelles raisons M. Daniel Legrand père n'est pas venu chez vous de 1997 à la fin 1998 ? Réponse : Honnêtement, non. Question : Saviez-vous que c'était pour des problèmes de santé en particulier un kyste à l'oreille ? Réponse : Non, je ne savais pas. » On s'accordera à trouver ce procédé contraire à l'impartialité que le justiciable est en droit d'attendre du juge d'instruction. En effet, voilà une accusatrice qui, dans ses premières déclarations, omet un détail à décharge décisif, fragilisant l'ensemble de ses accusations mais dont le juge lui-même parvient à sauver la cohérence, en introduisant une nouvelle périodicité des faits, jamais évoquée auparavant et que Mme Myriam Badaoui confirme. · La mise en cause de M. Jean-Marc Couvelard Mis en cause par les enfants Delay dès le mois de janvier 2001 M. Jean-Marc Couvelard fait partie de ce qu'on a appelé la « première vague d'interpellations » qui eut lieu le 6 mars 2001. Le procès-verbal de sa tentative d'audition par les services du commissariat de Boulogne-sur-Mer est instructif de l'état de santé de M. Jean-Marc Couvelard puisqu'il y est indiqué « qu'il nous est impossible de recueillir le moindre renseignement du nommé Couvelard qui ne s'exprime que par des grognements et des cris ». Sa mère indique alors aux enquêteurs que son fils « ne sait pas s'habiller lui-même, ni même couper sa viande, ni se raser seul. Que s'il se déshabillait, il serait incapable de se rhabiller ». Afin de clarifier l'état mental de M. Jean-Marc Couvelard, le capitaine de police Bellenguer requit du docteur Ksra, neuropsychiatre, qu'il procède à l'examen de l'intéressé le jour même. Le rapport de cet expert est sans ambiguïté157 : victime d'une hydrocéphalie à la naissance, « M. Couvelard ne comprend pas le sens de l'entretien. Il ne parle pas, il pousse des cris inadaptés à l'entretien. Il a été reconnu handicapé à 100 % et actuellement il touche l'AAH depuis l'âge de 20 ans [il en a 43 au moment de son interpellation]. Son enfance a été marquée par un retard psychomoteur considérable (il a commencé à marcher à l'âge de 17 ans). M. Couvelard est incapable de répondre aux questions qui lui sont posées, son langage est incompréhensible. À la question sur les faits reprochés, il répond par des cris non significatifs. Conclusion : M. Couvelard présente des troubles caractériels inscrits dans une déficience intellectuelle profonde. » Comme elle nous l'a expliqué, la mère de M. Jean-Marc Couvelard a souhaité entrer en contact avec le juge d'instruction pour tenter de lui présenter son fils, afin que le juge constate de lui-même que son état n'était pas compatible avec les faits reprochés. Son récit, celui de la brutalité de la procédure pénale et parfois des hommes qui la mettent en œuvre, mérite d'être repris intégralement : « J'ai eu une convocation pour aller passer un examen psychiatrique à Roubaix. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas été convoquée par le juge d'instruction. Je me suis donc permis de téléphoner à M. Burgaud pour lui demander pourquoi il m'envoyait à Roubaix. Après, j'ai su que le docteur Balthazard, à Roubaix, était le médecin psychiatre de la cour d'appel de Douai. Mais quand j'ai reçu la convocation, je ne le savais pas. Donc, j'ai téléphoné à M. Burgaud, et je lui ai demandé de me recevoir, parce que je savais que s'il avait vu Jean-Marc entrer dans son bureau, il se serait forcément posé des questions. Son handicap est tellement grand que ce n'était pas possible. Je voulais aussi lui demander de faire une enquête dans l'établissement que Jean-Marc fréquente. Parce que vous savez bien que les établissements qui accueillent des personnes handicapées en France sont très bien structurés. Il y a la direction, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des médecins, et il y a le psychiatre. Les responsables de cet établissement connaissent Jean-Marc de A à Z depuis trente ans. Ils étaient capables de répondre à M. Burgaud aussi bien que moi. M. Burgaud m'a répondu : "Madame, vous irez à Roubaix, parce que si vous n'y allez pas, je ferai emmener votre fils par la police." Et il a raccroché. Par la suite, je n'ai jamais eu l'ombre d'une convocation. Je n'ai pas du tout été informée de ce qui était reproché à Jean-Marc. J'ai été convoquée pour le procès en cour d'assises à Saint-Omer. »158 Refusant de recevoir la mère d'une personne suspectée, le juge a également requis qu'une nouvelle expertise soit commise, celle-ci aboutissant aux mêmes conclusions que la précédente. Réalisée par les docteurs Jean-Louis Pourpoint et C. Balthazard, experts psychiatres, le 16 juin 2001159 , cette expertise constate, à son tour, que M. Jean-Marc Couvelard « se déplace difficilement, on note une hypertension musculaire, une maladresse, un défaut de synchronisation dans les mouvements. [...] il présente un handicap intellectuel sévère de l'ordre de l'arriération mentale. [...] Son degré d'autonomie est très faible, il peut se déplacer seul, fût-ce d'une façon maladroite, il n'est pas capable de s'habiller et de se déshabiller seul. [...] Nous n'avons pas trouvé de pathologie de nature sexuelle [...] Le sujet ne présente pas de trait de caractère que l'on retrouve chez les abuseurs sexuels. Il ne présente pas de désordre sexuel comme on peut en trouver chez certains arriérés. » L'expertise conclut de la façon suivante : « Au moment des faits qui lui sont reprochés, le sujet présentait un trouble psychique ou neuropsychique, une arriération intellectuelle profonde, qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » au sens du code pénal, ce qui en fait un irresponsable pénal160. Voici une personne accusée par plusieurs enfants de les avoir violés, sodomisés contre rémunération versée à leur père et qui est quasiment incapable de se mouvoir, tout en souffrant de graves problèmes moteurs de coordination et de synchronisation. Ces accusations n'étaient pas crédibles et auraient pu inciter les magistrats, procureur de la République d'abord et juge d'instruction ensuite, à les considérer avec la plus grande réserve. Par la suite, M. Jean-Marc Couvelard n'a jamais été convoqué par le juge et n'a pas été mis en examen. Cependant, il s'est trouvé dans une situation juridique particulièrement confuse. En effet, bien que non mis en examen, le procureur de la République161, puis le juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation, se sont prononcés en faveur d'un non-lieu pour l'ensemble des crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs qui étaient reprochés à M. Jean-Marc Couvelard sur le fondement de l'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal et non sur l'absence de charge. De surcroît, il résulte des règles de notre code de procédure pénale que seule une personne mise en examen peut faire l'objet d'un non-lieu, ce qui n'était pas le cas de M. Jean-Marc Couvelard. La chambre de l'instruction supprima cette erreur de droit en ne mentionnant plus M. Jean-Marc Couvelard dans le dispositif de son arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Toutefois, ce raisonnement, fondé en droit, a provoqué l'incompréhension de la mère de l'intéressé, par ailleurs citée comme témoin devant la cour d'assises de Saint-Omer le 28 mai 2004. À cette aune, votre rapporteur considère que davantage de pédagogie et d'humanité ne sauraient nuire à une justice rendue au nom du peuple français. À ce stade, on est en droit de se demander si le caractère univoque de l'instruction n'était pas délibéré et ne s'inscrivait pas dans une stratégie d'ensemble. Plusieurs éléments permettent en effet de confirmer cette impression de l'existence d'une stratégie : la convergence des analyses entre le magistrat instructeur et le procureur de la République, les convictions du parquet, la pratique du « copié-collé » et enfin les conclusions tirées de l'impasse du meurtre de la fillette belge. 1. Une analyse judiciaire identique de l'affaire La conduite de l'instruction judiciaire ne relève pas du seul juge d'instruction. Outre les avocats des parties, le procureur de la République joue un rôle déterminant en la matière. D'abord, c'est lui qui saisit le juge de faits par un réquisitoire introductif. Rappelons ici, que dans l'hypothèse où le juge d'instruction vient à découvrir de nouveaux faits n'entrant pas dans le champ de sa saisine initiale, il ne peut enquêter sur eux, à moins que le procureur ne l'en saisisse par l'intermédiaire d'un réquisitoire dit supplétif. En outre, chaque acte important du juge, notamment dans le domaine des mesures restrictives de libertés, fait l'objet de réquisitions du parquet : il en est ainsi lorsque le juge d'instruction demande au juge des libertés et de la détention (JLD) le placement en détention provisoire du prévenu. Par ailleurs, le procureur peut requérir à tout moment de l'information tous les actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité et demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert (article 82 du code de procédure pénale). Enfin, le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction (article 185 du même code). On le voit, ce rapide rappel des dispositions en vigueur illustre la place décisive qu'occupe le procureur de la République dans la détermination de l'orientation de l'instruction. En l'espèce, l'affaire a très rapidement été suivie par le procureur de la République lui-même, M. Gérald Lesigne, qui en a dessaisi son substitut chargé des mineurs, Mme Véronique Carré, au mois de juin 2001, comme l'a indiqué l'intéressée lors de son audition par la commission162. Directement supervisée par le procureur, l'information judiciaire, telle que conduite par le juge Burgaud, correspondait à l'analyse du dossier faite par M. Gérald Lesigne. En effet, le procureur a toujours fait droit aux demandes de réquisitoires supplétifs présentées par le juge d'instruction163, il n'a jamais requis des investigations supplémentaires ni même fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction en cours d'information. Cette communauté de vues du parquet et du siège s'est traduite, en pratique, par de nombreux échanges, y compris informels, entre ces deux magistrats ainsi que les intéressés l'ont déclaré devant la commission, ce qui est parfaitement habituel. Toutefois, au-delà de ces échanges de vues sur le dossier, il importe de s'assurer de l'équilibre des relations entre ces magistrats, et donc de l'indépendance du juge d'instruction. Or, comme l'a observé Mme Murielle Moine, greffière du juge d'instruction, lors de son audition par la commission164, en réponse à une question de notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec sur « la nature des liens entre le procureur et le juge d'instruction » : « Le procureur vient, parle avec le juge d'instruction, expose ce qu'il aimerait. Le procureur Lesigne a une personnalité très forte, que j'ai ressentie tout au long des cinq années que j'ai passées comme greffier au cabinet du juge d'instruction. Le prédécesseur du juge Burgaud avait aussi une forte personnalité, et il parvenait à s'opposer au procureur quand ce dernier essayait de diriger l'instruction, mais je ne pense pas que M. Burgaud avait une personnalité assez affirmée, qu'il se sentait assez sûr de lui pour s'opposer au procureur Lesigne. M. Jean-Yves Le Bouillonnec : Pensez-vous qu'il faudrait faire évoluer la relation entre procureur et juge d'instruction ? Mme Murielle Moine : Oui. Le juge d'instruction devrait être un peu plus indépendant du procureur. » Cette analyse des relations entre le juge d'instruction et le procureur ne correspond pas à la version livrée par le procureur de la République devant la commission. En effet, interrogé sur ce point par votre rapporteur, M. Gérald Lesigne déclarait : « Mes rapports avec le juge d'instruction sont tout à fait normaux, ce sont ceux d'un parquet avec l'instruction. Il faut être au contact du magistrat instructeur. Il faut rester disponible aux interrogations qu'il pourrait être amené à se poser. Pour autant, il ne s'agit pas de dicter sa conduite à un magistrat instructeur. L'équilibre est toujours un peu compliqué. M. le Rapporteur : Pardon de vous interrompre. C'était son premier poste. Il était saisi d'un dossier difficile. Lui arrivait-il de vous demander des conseils ? M. Gérald Lesigne : Les conseils que je lui donnais, c'était notamment les demandes d'expertise. Sur ce point, le rôle du parquet est clair. D'autre part, à partir de 2002, j'ai senti un dérapage complet dans l'attitude des enfants. Ils reconnaissaient véritablement tout le monde. Ils rencontraient quelqu'un dans un supermarché, dans un commissariat, et ils l'identifiaient comme auteur de faits dont ils avaient été victimes. C'est un phénomène malheureusement très classique. Dans un premier temps, un enfant révèle un certain nombre de choses. Et ensuite, il joue à la vedette. J'en avais discuté avec le magistrat instructeur, ce qui a d'ailleurs abouti à la non-mise en examen d'un certain nombre de personnes. Cette attitude s'imposait au regard de la longueur du dossier. »165 Étroitement « suivie » par le procureur de la République, l'affaire a également été portée à la connaissance du parquet général de la cour d'appel de Douai, en application du principe hiérarchique prévalant au sein du ministère public. Ainsi, selon les informations communiquées à votre rapporteur par la Chancellerie, 14 rapports administratifs ont été adressés au procureur général par le procureur de la République entre le 26 juin 2001 et le 19 mars 2003. Parmi ces documents, trois concernent le traitement de la plainte déposée par Me Frank Berton pour violation du secret de l'instruction, dont celui du 19 mars 2003. Cinq rapports sont consacrés au fond de l'affaire et à son évolution procédurale mais semblent s'interrompre, en l'état des informations communiquées à votre rapporteur, entre janvier 2002 et le 17 décembre de la même année, date à laquelle le procureur communique son réquisitoire définitif au parquet général. Ainsi, une affaire particulièrement signalée a-t-elle cessé de faire l'objet d'information écrite à destination du parquet général pendant de long mois, sans que celui-ci semble s'en émouvoir. Sur le fond, la communauté de vues entre le procureur de la République et le juge instructeur transparaît clairement à travers la lecture de certains de ces documents. Ainsi, dès le 26 juin 2001, le procureur informe sa hiérarchie « qu'il était avéré que les adultes tiraient également profit de l'exploitation sexuelle des enfants à l'occasion de la réalisation de documents pornographiques destinés à être commercialisés, une officine boulonnaise de vente de cassettes pornographiques, ayant, de toute évidence, servi d'intermédiaire dans ce négoce qui paraissait également mobiliser des structures équivalentes en Belgique », susceptibles d'impliquer « des personnes influentes au sein de la ville d'Outreau. » Ce passage est, aux yeux de votre rapporteur, remarquable à plusieurs titres : - en considérant en juin 2001 qu'il était « avéré » et de « toute évidence » qu'il existait une activité lucrative de commercialisation de documents pédopornographiques, le procureur procède à une affirmation péremptoire, puisqu'aucun élément de preuve en ce sens existait à ce moment là dans le dossier, et il en sera de même pas la suite ; - cette affirmation du procureur n'est pas sans rappeler les formules du juge d'instruction évoquées précédemment assurant « qu'il ressortait de l'enquête » certains faits, alors même que, précisément, aucune preuve ne figurait au dossier ; - cette analyse partagée du dossier entre juge d'instruction et procureur, scellée dès les premiers mois de l'information judiciaire, n'a pu que rendre extrêmement difficile la prise en considération des éléments discordants présentés par les avocats de la défense. Au cours de l'information, une seule et unique divergence a opposé le parquet et le juge d'instruction et s'est produite lorsque Mme Véronique Carré, substitut des mineurs, était en charge du dossier. En effet, cette dernière s'est opposée au placement en détention provisoire de Mme Karine Duchochois, demandé par le juge d'instruction mais finalement refusé par le juge des libertés et de la détention. En réalité une étude attentive du dossier montre le caractère accusateur à tout prix du parquet. 2. Un parquet accusateur à tout prix Défenseur de l'intérêt général, chargé d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi, le ministère public obéit à une organisation hiérarchisée allant du garde des Sceaux, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. Dans une telle configuration, les divergences d'analyse, si elles peuvent exister, ne devraient que fort rarement se traduire, sur une même espèce, par des réquisitions différentes entre le procureur et son supérieur hiérarchique, régulièrement avisé des développements de l'affaire. Par ailleurs, la défense de l'intérêt général doit également conduire à la mesure dans l'évaluation des charges afin de ne pas aboutir à une accusation excessive. Dans l'affaire d'Outreau, il ne semble pas que ces principes aient été pleinement respectés, comme en témoignent les trois illustrations suivantes : - La divergence d'analyse entre le parquet général et le parquet de Boulogne : le cas de Mme Odile Marécaux Dans son réquisitoire définitif, le procureur requit un non-lieu pour l'ensemble des crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs reprochés à Mme Odile Marécaux. L'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction refusa d'accorder ce non-lieu à Mme Odile Marécaux et la renvoya devant la cour d'assises, ce qui conduisit le procureur à interjeter appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction. Or, le parquet général de Douai ne suivit pas les réquisitions initiales du procureur de Boulogne et décida le renvoi de Mme Odile Marécaux pour des faits commis sur les quatre enfants Delay, alors même que le juge d'instruction n'ordonnait un renvoi que pour des actes commis sur deux d'entre eux, allant donc bien au-delà des demandes des principaux acteurs judiciaires de l'affaire. Un élément supplémentaire traduit cette volonté de défendre une vision du dossier : il s'agit de la non-citation à l'audience de la cour d'assises de Saint-Omer du commissaire François-Xavier Masson, signataire du rapport de synthèse du SRPJ de Lille du 15 juillet 2002. - Les véritables raisons de la non-citation comme témoin du commissaire Masson Interrogé par votre rapporteur sur les raisons de cette non-citation, le procureur Gérald Lesigne déclarait lors de son audition : « C'est le directeur d'enquête qui n'a pas été entendu par la cour d'assises. Par contre, les enquêteurs ont été convoqués devant elle. La raison en est que nous avions reçu des consignes du procureur général, qui étaient également relayées par les présidents de cours d'assises, lesquels souhaitaient entendre à la barre des enquêteurs de terrain. Par ailleurs, la défense aurait pu faire citer le directeur d'enquête. Nous avons d'ailleurs cité un certain nombre de personnes à la demande de la défense. Si cet enquêteur avait été sollicité, il aurait été cité au même titre que les autres. »166 Questionné sur l'existence de telles « consignes », le président de la cour d'assises de Saint-Omer, M. Jean-Claude Monier, s'est montré plus évasif. Pour sa part, le procureur général alors en fonction, M. Jean-Amédée Lathoud, a indiqué « ne pas avoir donné d'instruction à M. Lesigne » qui a été le seul à « prendre la responsabilité de citer les témoins qu'il estimait opportun de citer. Le procureur général n'a pas à valider la liste des témoins »167, ce qui semble contradictoire avec les déclarations faites devant la commission par le procureur Gérald Lesigne. À la suite de son audition par la commission, le procureur général a fait parvenir à votre rapporteur, le 7 avril 2006, une lettre précisant les raisons ayant conduit le parquet général à ne pas citer M. François-Xavier Masson. Au titre de celles-ci, M. Jean-Amédée Lathoud observe que le commissaire Masson, en tant que directeur d'enquête, « n'avait pas une connaissance suffisamment personnelle des faits et des opérations réalisées par ses subordonnés » et que ses conclusions s'apparentaient plus « à des analyses journalistiques qu'aux démonstrations objectives et rigoureuses habituelles, figurant en conclusion des rapports administratifs ». Cependant ainsi qu'en ont témoigné nombre d'avocats entendus par la commission, mais aussi la présidente de la cour d'assises d'appel de Paris qui fit témoigner ledit commissaire, la non-citation du directeur d'enquête ne correspond pas aux usages judiciaires généralement observés. Entendu par la commission, le commissaire Masson a fait d'ailleurs part de son étonnement de n'avoir pas été cité comme témoin à Saint-Omer. La véritable raison de cette non-citation se trouve ailleurs, en l'espèce dans un courrier daté du 8 juin 2004 adressé au garde des Sceaux, sous couvert de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, par le procureur général M. Lathoud. Dans cette missive, le procureur général communique plusieurs pièces de la procédure, notamment l'ordonnance de renvoi de la chambre de l'instruction du 1er juillet 2003 ainsi que le rapport de synthèse du commissaire Masson. À ce sujet, M. Jean-Amédée Lathoud écrit ceci : « Les conclusions particulièrement prudentes et subjectives de ce rapport, ont incité le ministère public, à ne pas citer à l'audience le commissaire Masson. » Que reproche donc le ministère public au commissaire Masson ? D'avoir fait preuve, à la différence de nombre d'acteurs de la procédure, de prudence et de circonspection à l'égard de certains éléments du dossier. Bref, d'avoir refusé de conclure définitivement sur la réalité des faits ce qui, il est vrai, est inhabituel. En effet, dans la conclusion du rapport de synthèse, on peut lire ceci, s'agissant de « la piste belge » et la dimension internationale du réseau de pédophiles : « toutes les recherches entreprises ne permirent pas de confirmer cette hypothèse, ni d'envisager l'existence d'un réseau structuré. Il semblerait que la réalité était beaucoup plus simple et beaucoup plus sordide. » Mises en regard avec les écrits du procureur de la République affirmant, certes en 2001, l'existence « de toute évidence » d'un réseau structuré et lucratif de pédophiles et maintenant, dans son réquisitoire définitif de mars 2003, les accusations de viols sur mineurs commis à l'étranger, en l'occurrence en Belgique, les analyses du commissaire apparaissent effectivement discordantes, voire troublantes, mais assurément davantage proches de la vérité. Faut-il donc voir dans l'absence de citation du commissaire Masson, qui précisément répondait au qualificatif d'enquêteur « de terrain » mis en exergue par le procureur Lesigne, la volonté manifeste du procureur, devenu avocat général, de « faire tenir » à tout prix le dossier ? Qu'il soit permis à votre rapporteur de s'interroger. Dès lors, l'une des causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau pourrait résider dans cette difficulté des acteurs judiciaires à se remettre en question, dans ce « mythe de l'infaillibilité », pour paraphraser le procureur Lesigne. Ce mythe a vraisemblablement davantage compté que le prétendu « mythe de la pédophilie », qui, lui, malheureusement ne fut pas imaginaire pour les enfants victimes. Comme l'a reconnu M. Jean-Amédée Lathoud : « nous nous sommes trompés faute d'esprit critique, faute de méthode d'analyse des événements. »168 - De la rumeur à l'accusation : le cas de la barbe de M. Alain Marécaux Le 25 juin 2001, Mme Monique Dumont, assistante sociale de l'UTASS à Outreau et qui est l'une des rédactrices des rapports d'attention destinés au procureur de la République, était entendue comme témoin par le commandant de police M. Coulombel. Après avoir confirmé le contenu de ses rapports, Mme Monique Dumont ajoute spontanément : « Je dois ajouter que selon les dires de Samer169, M. Marécaux a changé de look, il a rasé son bouc et sa moustache. »170 Voilà donc « ce qui se dit » à Samer à cette époque et qui va entraîner des conséquences judiciaires et humaines considérables. En effet, à la suite de ces déclarations, le coiffeur de M. Alain Marécaux est entendu par les enquêteurs du SRPJ de Lille. A propos de la barbe de M. Alain Marécaux, ses déclarations du 14 décembre 2001 171 sont les suivantes : « Cela arrondissait le bas du visage, mais lorsqu'on le connaît, on le reconnaissait aisément. » Et pourtant, dans le réquisitoire définitif du procureur Lesigne, parmi les éléments considérés comme révélant la culpabilité de M. Alain Marécaux il est écrit ceci : « Au moment de l'enquête, Alain Marécaux avait cherché à modifier son apparence physique. L'artisan coiffeur chez lequel il se rendait habituellement confirmait en effet que ce n'était qu'au début de l'année 2001 que son client avait exigé une coupe plus courte tandis que jusqu'à cette période, sa préférence allait à une coupe en brosse. De même, celui-ci dans le même temps, s'affichait avec des longueurs de barbe variables au lieu de s'en tenir à la taille courte qu'il affectionnait depuis plusieurs années. Or, selon le témoin, cela avait eu pour conséquence de modifier substantiellement les contours de son visage. »172 Il est inutile de préciser que cette appréciation se retrouve, à l'identique, dans l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction173. Cet exemple illustre la nature de certains enchaînements qui ont pu jouer dans ce dossier : une rumeur devenant un élément objectif laissant présumer d'une intention coupable de l'intéressé qui se transforme, in fine, en élément de preuve objective pour l'institution judiciaire. Interrogé sur cette hasardeuse genèse, le procureur Lesigne a admis qu'il s'agissait d'une « sémantique inappropriée »174... Un acte juridictionnel symbolise, plus que tous les autres, cette communauté de pensées, voire cette fusion des visions pouvant conduire à la confusion des rôles entre le juge d'instruction et le parquet : il s'agit de l'ordonnance de mise en accusation du 13 mars 2003. 3. Le symbole de la confusion des genres : la pratique du copié-collé Lorsque le juge d'instruction considère que son information est terminée, il doit, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, en aviser les parties qui ont alors un délai de vingt jours pour formuler une demande d'acte. Puis, à l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République qui doit adresser ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue. Enfin, au vu du réquisitoire et de l'ensemble des éléments en sa possession, le juge d'instruction décide, soit de prendre une ordonnance de non-lieu, soit d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises si les faits retenus contre la personne mise en examen constituent une infraction qualifiée de crime. On le voit, l'esprit de notre code de procédure pénale en ce qui concerne la phase de clôture de l'information s'inscrit dans la droite ligne des dispositions réglementant la conduite de l'information elle-même, à savoir que le juge instruit « à charge et à décharge »175. En effet, puisqu'il instruit à charge et à décharge, le juge d'instruction doit également évaluer in fine, seul et sereinement, après avoir recueilli l'avis de toutes les parties au procès dont le procureur, la réalité des faits et décider de leur issue judiciaire. Malheureusement, et l'affaire d'Outreau n'en est qu'une illustration parmi tant d'autres, la pratique judiciaire est fort éloignée de ce principe. Ainsi, la lecture attentive de l'ordonnance de mise en accusation signée par le juge d'instruction Lacombe le 13 mars 2003 d'une part, et du réquisitoire définitif du procureur de la République Lesigne daté du 6 mars 2003 d'autre part, fait apparaître de très fortes similitudes entre ces deux documents, pour ne pas dire une quasi-identité des termes employés. Or, comment expliquer qu'un document de 93 pages, soi-disant rédigé par le juge d'instruction en moins d'une semaine, soit à ce point ressemblant à un autre document, antérieur à lui, si ce n'est par la pratique du « copié-collé » entre documents, matériellement facilitée par les logiciels de traitement de texte ? En effet, l'ordonnance de mise en accusation reprend, très fidèlement, la rédaction du réquisitoire du procureur, aux erreurs typographiques et matérielles près. Sans prétendre être exhaustif, votre rapporteur se permet d'indiquer que, au bas de la page 79 du réquisitoire définitif, il est écrit que l'une des personnes mises en examen manifeste une « volonté de nomination » au lieu, vraisemblablement, d'une « volonté de domination ». Or, cette « coquille » se retrouve telle quelle dans l'ordonnance signée du juge d'instruction, page 73. Il est donc vraisemblable que le juge d'instruction n'a pas relu attentivement le document communiqué par le procureur. En outre, dans ces deux documents, M. Franck Lavier est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis « de septembre 1998 à mai 2000 »176 différents viols aggravés sur plusieurs mineurs, dont son fils qui n'est pas né à cette période, puisque sa date de naissance est le 10 août 2000. Fort heureusement, la chambre de l'instruction rectifia cette erreur qui ne fut donc pas lue à l'ouverture de la session de la cour d'assises de Saint-Omer. Somme toute, seule la police de caractère permet de distinguer les deux documents, à une différence près concernant Mme Odile Marécaux, à l'encontre de laquelle le procureur de la République, chargé de soutenir l'accusation, faut-il le rappeler, requit un non-lieu pour l'ensemble des crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs qui lui étaient reprochés. Cependant, comme on l'a vu plus haut, le juge Lacombe refusa d'accorder ce non-lieu et renvoya Mme Odile Marécaux devant la cour d'assises pour des faits de viols commis contre deux des enfants Delay, ce que confirma la chambre de l'instruction dans son arrêt du 1er juillet 2003. Interrogé par votre rapporteur sur ces troublantes analogies, le juge Cyril Lacombe eut quelque difficulté à s'en expliquer : « M. le Rapporteur : On a constaté de très fortes similitudes, pour ne pas dire un « copié-collé » entre le réquisitoire définitif du procureur de la République et l'ordonnance de mise en accusation. M. Cyril Lacombe : Oui. M. le Rapporteur : Est-ce une pratique habituelle ? M. Cyril Lacombe : Comme je vous l'ai indiqué, lorsque je partageais les analyses du procureur, je les ai reprises in extenso, dans sa présentation. M. le Rapporteur : C'est donc une pratique habituelle quand on est d'accord. M. Cyril Lacombe : Mais ce n'est pas un « copié-collé ». M. le Rapporteur : L'expression a été utilisée hier par la présidente de la cour d'assises de Paris. Le procédé a peut-être ses limites. En effet, suivant à la lettre le réquisitoire définitif, votre ordonnance renvoie M. Franck Lavier devant la cour d'assises pour avoir commis « de septembre 1998 à mai 2000 » des viols aggravés sur plusieurs mineurs, dont un de ses enfants né le 10 août 2000. M. Cyril Lacombe : C'est une erreur. M. le Rapporteur : Donc, vous n'avez pas vérifié. M. Cyril Lacombe : Si, mais c'est une erreur dans la reprise et dans la relecture de mon ordonnance, ce n'est pas par malice... M. le Rapporteur : J'en suis convaincu. M. Cyril Lacombe : Ce n'est pas comme si l'on avait tenté de reprocher des faits à une personne mise en cause. [...] M. le Rapporteur : Ne prenez pas mes questions comme une tentative de vous mettre en difficulté mais, dans la pratique, n'a-t-on pas tendance à ne pas aller au fond du dossier, et à recopier ? M. Cyril Lacombe : Je ne saurais vous dire si, « dans la pratique », on procède d'une manière ou d'une autre. En revanche, je vous ai dit que j'ai repris totalement les éléments de l'analyse que je partageais. »177 Pour sa part, Mme Odile Mondineu-Hederer, présidente de la cour d'assises d'appel de Paris dans cette affaire, a reconnu, pour le déplorer, la généralisation du « copié-collé » dans « 95 % des cas » comme elle l'indiqua lors de son audition par la commission : « Comme vous l'avez constaté, l'ordonnance de renvoi est le copié-collé du réquisitoire. Mais il en est ainsi dans 95 % des cas, depuis le moment où le législateur a décidé que ce serait le juge d'instruction qui rendrait l'ordonnance de renvoi. »178 Comme l'a fort justement souligné Me Hubert Delarue179, le copié-collé fait, qu'en réalité, il n'y a plus de différence « entre la position du parquet et celle du magistrat instructeur. Les avocats sont les seuls à exprimer un désaccord. Il y a donc un déséquilibre institutionnel ». 4. Une instruction toujours ouverte : l'affaire du meurtre de la fillette belge Le 4 janvier 2002, M. Daniel Legrand fils écrivit une lettre au juge d'instruction180 dans laquelle il révélait le viol et l'assassinat d'une fillette belge par M. Thierry Delay. Concomitamment, il fit parvenir cette missive à la rédaction de France 3 qui en fit rapidement état, en dépit des demandes contraires du SRPJ de Lille qui craignait, à juste titre, que cette publicité nuise à l'enquête en cours. Cette « nouvelle affaire » dans l'affaire donna une dimension et un retentissement exceptionnels à ce dossier que d'aucuns, à l'instar du commissaire Masson, analysent comme son véritable « basculement ». Comme l'a expliqué ce policier devant la commission : « si les faits étaient vrais, l'un des auteurs principaux, non identifié, ferait disparaître des indices ; si les faits étaient faux, la diffusion de cette information donnait à l'affaire une coloration inexacte. »181 Dès le 9 janvier, le procureur de la République choisit de confier ce dossier au juge d'instruction Burgaud en joignant cette affaire à la précédente par le biais d'un réquisitoire supplétif. Ce premier choix de procédure a été critiqué par le commissaire Masson, au motif qu'il n'a pas pu entendre Mme Myriam Badaoui sous le régime de la garde à vue ce qui aurait permis aux enquêteurs de mieux cerner sa personnalité. En effet, il convient de rappeler que ce sont les policiers du commissariat de Boulogne qui avaient placé Mme Myriam Badaoui en garde à vue au mois de février 2001, les enquêteurs du SRPJ ne l'ayant donc jamais interrogée. Cependant, il ne saurait être reproché au parquet d'avoir choisi de joindre des faits qui semblaient connexes de ceux instruits à titre principal par le juge d'instruction. De surcroît, ce choix était plus respectueux des droits de la défense car les personnes mises en examen accusées de ces faits nouveaux pouvaient être entendues en présence de leur avocat, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la garde à vue. Comme chacun sait, les recherches pour trouver le cadavre de cette petite fille s'avérèrent infructueuses malgré l'importance des moyens techniques mis en œuvre (pelleteuses, hélicoptère, etc.) et en dépit de la confirmation des faits par Mme Myriam Badaoui à qui, rappelons-le, le juge d'instruction lut préalablement la lettre de Daniel Legrand fils182. De surcroît, Daniel Legrand fils indiqua très rapidement au juge d'instruction183 pour quelles raisons il avait inventé de toutes pièces cette histoire : d'une part, pour sortir de prison comme Mlle Aurélie Grenon qui avait reconnu les faits et qui était libre et d'autre part, pour « coincer » Mme Myriam Badaoui, en mettant au grand jour le caractère affabulatoire de ses déclarations et sa volonté de « mettre en prison des innocents pour rejeter sa responsabilité sur eux ». Autrement dit en en « rajoutant » pour battre Myriam Badaoui sur son propre terrain. Conjuguée à l'absence de cadavre et de disparition de fillette signalée en Belgique à cette époque, la surenchère de Mme Myriam Badaoui sur les affabulations de M. Daniel Legrand fils aurait dû inciter le juge à reconsidérer la fiabilité de certaines de ses déclarations. De tels doutes sont d'ailleurs expressément formulés par les enquêteurs français et figurent au dossier dans une pièce datant du mois de mars 2002184. Dans ce document, déjà évoqué, les policiers belges, requis pour rechercher la trace de la fillette prétendument assassinée et de la personne l'ayant accompagnée chez les Delay, écrivent ceci : « En date du vendredi 1er mars 2002, nos services ont de nouveau pris les contacts nécessaires avec nos collègues français à Coquelles pour connaître l'état de leur enquête et jusqu'à quel point les faits commis dans notre pays entraient en ligne de compte dans leur enquête. - Nous apprenons par notre collègue français Frank DEVULDER que la déclaration au sujet de l'enfant qui aurait été assassiné a été inventée de toutes pièces et qu'ils ne travailleraient désormais plus sur cette affaire. [...] - Pour le moment, l'enquête se trouve dans une impasse étant donné que les enfants commencent à inventer toutes sortes de choses vu le nombre élevé d'auditions qu'ils ont déjà dû subir. - Il s'avère donc que le fils Legrand Daniel a inventé ces faits dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine et en ce qui concerne la mère qui confirmait cela, il s'avère qu'elle donne une réponse positive à toutes les données apportées de telle sorte qu'on ne peut pas tenir compte de ses déclarations. » Pourtant, plutôt que de reconsidérer l'ensemble du dossier avec un regard neuf, emprunt de doute, le juge d'instruction ordonna la disjonction de cet aspect de l'affaire le 19 avril 2002. Cette décision, techniquement simple mesure d'administration judiciaire, donc insusceptible de recours, fut lourde de sens et de conséquences. En effet, elle priva la défense des personnes mises en examen accusées par M. Daniel Legrand fils et Mme Myriam Badaoui d'être en mesure de prouver le caractère infondé de leurs déclarations et, par voie de conséquence, de l'ensemble des accusations proférées à leur encontre puisque cet aspect du dossier ne leur était plus accessible, car disjoint. Ce faisant, cette disjonction a été analysée par certains avocats comme une tentative désespérée de sauvetage judiciaire de l'affaire d'Outreau. Entendu par la commission, Me William Julié a vivement critiqué cette décision, estimant qu'il s'agissait d'« une pratique de bandit, et je pèse mes mots. Cela rejette les avocats en dehors de la procédure et cela prive la cour d'assises d'une information cruciale, sauf si le président fait bien son métier et use de son pouvoir discrétionnaire pour poser des questions. Ce fut une dissimulation réfléchie, décidée d'un commun accord entre l'instruction et le parquet pour faire tenir le dossier ; si ce n'avait pas été le cas, l'ensemble de l'affaire explosait. »185 Quant à Me Raphaël Tachon, il a considéré que « la disjonction est faite parce que, si le meurtre n'existait plus, le dossier était fragilisé. C'est fait dans le cadre d'une instruction à charge »186. Pour sa part, Me Blandine Lejeune l'a qualifiée de « scandale » : « pour avoir lu tous les procès-verbaux de l'instruction, le juge Burgaud lui-même n'est pas tout à fait convaincu du meurtre de la fillette. Avant même qu'il ait pu entendre Daniel Legrand fils, l'affaire sort dans la presse et Mme Myriam Badaoui confirme. Le juge ne peut plus faire autrement que de procéder à des investigations et les enfants ajoutent des détails accablants. Cette affaire rocambolesque constitue un magnifique élément à décharge puisque l'instruction à charge ne donne rien. Si elle n'avait pas été disjointe, nous aurions disposé d'un argument de poids. Mais, à Saint-Omer, lorsque nous évoquions le prétendu meurtre, on nous rétorquait que l'affaire était toujours en cours ; certains faisaient mine d'y croire encore, à commencer par M. Gérald Lesigne, avocat général. Cette disjonction était vraiment destinée à mettre à l'écart une partie du dossier qui aurait fait s'écrouler un pan entier de l'accusation. L'ineptie est telle que Thierry Delay est toujours mis en examen pour ce meurtre ; le non-lieu n'a pas été prononcé. »187 Si similitude de pensées il y a eu entre le parquet et le juge d'instruction, celui-ci a pourtant bien conduit tout seul l'instruction. C. DANS SA MISE EN œUVRE SOLITAIRE À la solitude de la fonction s'est ajoutée la solitude de la personne. « Ai-je commis des erreurs d'appréciation ? Peut-être, mais qui n'en commet pas ? Quel juge d'instruction n'en commet pas d'autant que le juge d'instruction est un juge seul ? Personne à l'époque ne m'a dit que je faisais fausse route : ni le procureur de la République qui était partie prenante, qui a délivré plusieurs réquisitoires supplétifs, qui consultait fréquemment le dossier, notamment lorsqu'il rendait des avis sur la détention ; ni le procureur général ; ni la chambre de l'instruction. » Voilà ce que déclarait le juge Fabrice Burgaud lors de son audition devant la commission188. Il est vrai que, si le juge d'instruction n'est plus « l'homme le plus puissant de France »189, il est demeuré, incontestablement, un juge seul. Cette solitude tient d'abord à sa fonction de juge du siège enquêteur, qu'il ne peut déléguer à quiconque et qui requiert qu'il soit indépendant. Certes l'indépendance n'exclut pas que le juge sollicite les conseils de ses collègues mais comment procède-t-il lorsqu'il est seul à exercer cette fonction ou bien lorsque l'autre juge d'instruction, le doyen dans la fonction, n'a que peu d'expérience ? Telle fut la situation dans laquelle se trouva le juge Burgaud puisque le doyen des juges d'instruction n'avait qu'un an d'ancienneté. Le magistrat instructeur peut bien se tourner vers le président de la chambre de l'instruction mais la cour d'appel est souvent éloignée et ce magistrat, plus expérimenté, peut ne pas sembler le plus à même de comprendre les interrogations du jeune juge d'instruction. À cette solitude fonctionnelle, s'ajoute l'inexpérience de nombre de juges d'instruction qui sont directement affectés à cette tâche à leur sortie de l'école. Là encore, le juge Burgaud se trouva dans cette situation puisque, c'est à sa sortie de l'ENM en septembre 2000, qu'il prit en charge un cabinet d'instruction vacant depuis plusieurs mois, alors même que son autre collègue juge d'instruction au même tribunal de grande instance sortait également de l'école. Mais alors, les juges sont ils suffisamment formés, préparés, armés pour exercer des fonctions aussi lourdes ? Interrogé sur ce point par votre rapporteur, le juge Fabrice Burgaud a clairement et courageusement répondu : « Non. La difficulté tient au fait que lorsque les juges d'instruction sont nommés dans des postes, parfois dans des petites juridictions, ils ne savent pas de quels dossiers ils vont être saisis. Deux jours après leur nomination, un meurtre peut être commis et ils sont obligés d'instruire cette affaire. La formation dispensée à l'École de la magistrature est relativement longue ; elle est de qualité ; nous travaillons beaucoup avec des collègues. Pour ma part, j'ai passé six mois à Dunkerque avec un juge d'instruction très expérimenté ; on nous donne un certain nombre de savoir-faire. Pour autant, aujourd'hui je ne travaillerais pas de la même façon : quand on est au jour le jour au contact des procédures, des personnes mises en examen ou auditionnées comme témoins, on change nos manières de faire et on appréhende peut-être les choses différemment. »190 Conjuguant inexpérience et solitude, cette situation résulte largement de l'organisation judiciaire de notre pays. En effet, chacun convient désormais que la répartition géographique des tribunaux de grande instance sur le territoire national s'agence selon des critères devenus obsolètes, obéissant parfois encore à des logiques administratives médiévales. Ainsi, selon les données communiquées par la Chancellerie, il existerait 74 juges d'instruction totalement seuls à exercer cette fonction dans leur TGI. À ces éléments s'imposant au juge, semble s'être ajoutée, dans ce dossier, une volonté propre du juge d'instruction de demeurer seul « maître à bord » en n'acceptant pas la cosaisine qui lui aurait été proposée. En effet, le procureur général M. Jean-Amédée Lathoud a indiqué lors de son audition avoir « suggéré par téléphone au procureur de la République, courant 2002, étant donné le nombre de personnes mises en examen, de proposer au président du tribunal de grande instance et au juge d'instruction - que je n'ai évidemment jamais rencontré - une cosaisine, avec un deuxième magistrat. Il m'a été répondu que M. Burgaud ne le souhaitait pas. »191 Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la Chancellerie, il semblerait effectivement que le président du TGI de Boulogne ait proposé, téléphoniquement, au juge Burgaud une cosaisine au mois de mai 2002, mais que le juge lui aurait répondu que ce n'était pas une demande de sa part et qu'il préférait voir sa charge de travail allégée par d'autres moyens. Le président de la chambre de l'instruction aurait également évoqué cette possibilité avec le juge Burgaud au cours du printemps de l'année 2002, en s'appuyant sur l'ampleur prise par le dossier mais aussi sur la nécessité de « regards croisés », le magistrat instructeur ayant alors indiqué qu'il avait des échanges réguliers avec le parquet. Or, compte tenu de la communauté d'analyse de ce dossier entre le procureur de la République et le juge d'instruction, il s'agissait davantage de regards « convergents » que de regards « croisés ». Il ressort clairement de ce qui précède que, pour éviter le renouvellement des dysfonctionnements observés dans l'affaire d'Outreau, il importe, au premier chef, de rompre avec la solitude fonctionnelle et géographique du juge d'instruction. La conduite de l'information n'a pas seulement pâti de cet isolement du juge d'instruction mais aussi, semble-t-il, de son empressement à quitter le TGI de Boulogne. Arrivé en septembre 2000, le juge Fabrice Burgaud a su, dès le mois d'avril 2002, qu'il allait être nommé substitut du procureur au TGI de Paris. Désireux, fort logiquement, de faire avancer au maximum son information, voire de la clôturer avant son départ, le juge a pu faire montre d'une certaine précipitation à partir du printemps 2002. Ainsi les expertises médico-légales d'un des enfants Delay et d'un autre mineur ont été notifiées aux parties le 7 août 2002, ce qui leur ouvrait un délai de 10 jours pour présenter leurs observations ou introduire une demande de contre-expertise. Or, ce 7 août 2002 est précisément le jour où le juge Burgaud adressa l'avis de fin d'information à toutes les parties, sans donc même attendre l'expiration de ce délai de 10 jours. Par ailleurs, la quasi-totalité des rapports d'expertises psychiatriques et psychologiques a été notifiée entre la fin du mois de mars et le 18 juin 2002, alors même que certains rapports avaient été déposés depuis plusieurs mois. S'agissant des demandes d'actes, force est également de constater qu'elles sont toutes rejetées à partir de la mi-juin 2002. Enfin, la commission ne peut s'empêcher d'émettre l'hypothèse selon laquelle la décision de disjonction de l'affaire du prétendu meurtre de la fillette belge du 19 avril 2002 n'est pas sans lien avec cette volonté d'achever au plus vite l'information, quitte à en faire sortir les éléments qui pourraient la ralentir, voire la fragiliser. Fût-il seul, le magistrat instructeur était-il réceptif aux mises en garde voire aux objections ? 2. Un juge hermétique aux signaux d'alerte « Personne à l'époque ne m'a dit que je faisais fausse route » nous a affirmé le juge Burgaud ; ni le parquet ni la chambre de l'instruction, certes, mais n'existait-t-il pas d'autres acteurs dans la procédure : les policiers, le juge des libertés et de la détention, les avocats ? Ces derniers n'ont-ils pas fait part de leurs doutes au juge d'instruction à certains moments de l'information ? Pourtant, lors de son audition par la commission, le juge Marlière, qui a exercé des fonctions de juge des libertés et de la détention pendant l'affaire, a déclaré : « J'ai eu quelques contacts avec le juge Burgaud sur des points très particuliers, notamment pour lui faire part de mon désaccord sur la manière dont il menait ses confrontations. J'avais moi-même été juge d'instruction, et je trouvais que la manière dont il menait ses confrontations - les trois accusateurs face à la personne qui contestait les faits - ne m'apparaissait pas forcément la meilleure solution. M. le Rapporteur : Ce que vous dites là est important. La question des confrontations est revenue sans arrêt au cours de ces auditions. Quelles conséquences en a-t-on tiré, et quelles conséquences en avez-vous tiré ? M. le Président : J'ajoute, monsieur Marlière, que c'est un point de désaccord de plus entre vous et M. le procureur Lesigne. M. Maurice Marlière : J'ai fait cette réflexion à M. Fabrice Burgaud sur la conduite de ses confrontations parce que j'avais moi-même été juge d'instruction et que je me pensais autorisé à donner un avis sur ce point. Mais en tant que JLD, et n'ayant en tant que tel, aux termes de la loi, aucun titre pour contrôler le travail d'un juge d'instruction, je lui ai simplement fait part de mon désaccord. Quelles conséquences en ont-elles été tirées ? Il faut bien dire qu'aucune n'en a été tirée, puisque les confrontations ont continué à être organisées de la même façon. Mais j'ai émis un avis personnel. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Ce procédé a été validé par la chambre de l'instruction. Moi, je n'aurais pas fait comme cela, c'est tout ce que je peux vous dire. Plus généralement, s'agissant de mes contacts avec M. Fabrice Burgaud, je dirai qu'il n'est pas celui qui vous a été décrit par un certain nombre de personnes. C'est un garçon extrêmement timide, introverti. Je pense intimement que, dans ce dossier, il avait beaucoup de certitudes, que c'est un garçon avec lequel on pouvait discuter, parce qu'il est d'un naturel affable, mais quand j'ai pu discuter avec lui, je n'ai pas toujours eu l'impression d'être entendu. »192 Au-delà de leurs demandes d'actes, des avocats ont également tenté de dialoguer avec le juge d'instruction afin de le sensibiliser aux risques qu'introduisait le recours exclusif à des confrontations groupées. Tel a été le cas de Me Fabienne Roy-Nansion, avocate de M. David Delplanque, qui déclara ceci : « Les confrontations ont effectivement eu lieu telles qu'on vous l'a décrit, toujours dans le même ordre : Myriam Badaoui, puis Aurélie Grenon, puis David Delplanque. Était-ce une bonne idée ? Je ne le crois pas. Je m'en étais ouvert à M. Burgaud. Un soir, avec Me Rangeon, nous sommes allés le voir, pour lui demander s'il n'y aurait pas une autre méthode, consistant à les entendre séparément, en posant des questions plus ouvertes ? [...] M. Bernard Derosier : Que vous a-t-il répondu ? Me Fabienne Roy-Nansion : Il nous écoutait, car il était courtois, mais il ne nous entendait pas forcément. Il nous a dit : « Ce n'est pas sot, mais ce n'est pas mon avis. » Que faire ? Nous n'avions pas d'autre solution. Même ceux qui se battaient pour leur innocence le lui ont demandé en vain. »193 Les juges d'abord, les avocats ensuite, les policiers enfin ont fait part de leurs doutes sur certains aspects de la procédure, sans davantage de succès. Il en a été ainsi du commissaire Masson : « Je me suis rapidement dit que, si nous continuions à écouter Myriam Badaoui, nous allions nous trouver avec la moitié la population d'Outreau accusée et l'autre moitié victime... Nous avons donc recherché d'autres éléments et au moins les déclarations d'autres adultes. M. le Rapporteur : En avez-vous parlé avec le juge ? M. François-Xavier Masson : Oui. Prenons l'exemple du docteur X, médecin de la famille, cité plusieurs fois, que le juge souhaitait voir assez rapidement interpellé. Faisant partie du voisinage, il a été entendu une première fois par le commissariat de Boulogne-sur-Mer, mais il était uniquement dénoncé par les enfants et par Mme Badaoui. Nous n'avons pas interrompu les investigations à son propos, mais il n'a pas fait partie de la première vague d'arrestations. Il n'a pas non plus fait partie de la deuxième vague qui est intervenue à un moment où nous n'avions plus rien et où nous n'avancions qu'au cas par cas. Il a été mis en garde à vue en même temps que les époux Y. Le cheminement a donc été le même. M. le Rapporteur : Mais pas les résultats ! C'est inquiétant car on se dit que c'est un peu la loterie... Et pourquoi Aurélie Grenon, qui, elle, avait reconnu les faits, a-t-elle été très vite mise en liberté ? [...] M. François-Xavier Masson : Je ne peux pas vous répondre. En tant que policier, je ne décide pas de la mise en détention. M. le Rapporteur : Le SRPJ a sûrement été bien plus en rapport avec le juge que ne l'ont été vos collègues de Boulogne-sur-Mer. Je souhaite comprendre ce qui a présidé à ses choix. Vous êtes-vous par exemple entretenu avec lui de la libération d'Aurélie Grenon ? M. François-Xavier Masson : Non ; cette libération est intervenue très vite et Aurélie Grenon ne faisait pas partie de nos objectifs. Nous n'intervenons bien sûr en rien dans ce qui se passe au sein du cabinet du juge d'instruction. En revanche, quand nous avons procédé aux arrestations dans le "deuxième cercle des notables", nous avons insisté sur le risque qu'il y avait à continuer à aller chercher tous ceux qui étaient dénoncés. »194 Au vu de ce qui précède, il semble difficile de soutenir que personne n'avait alerté le juge. IV. UNE VALORISATION EXCESSIVE DU RÔLE DES EXPERTS De nombreux experts ont été commis dans le cadre de l'affaire d'Outreau pour réaliser des expertises de natures diverses : techniques, médicales ou mentales. Sur cet ensemble, les travaux de la commission d'enquête parlementaire se sont portés sur les expertises psychiatriques et psychologiques en raison du rôle important qu'elles ont joué. En effet, en l'absence de preuves matérielles, les éléments à charge ou à décharge n'ont pu s'appuyer que sur les déclarations des différentes parties au procès. De fait, les informations relatives à la psychologie des personnes ont acquis, comme dans toute affaire d'agressions sexuelles, une particulière importance, tant il a semblé naturel de juger du contenu des témoignages, en les rapportant à l'état mental de celui qui les faisait. Une première série d'expertises psychiatriques et psychologiques de tous les mis en examen et de tous les mineurs victimes a été diligentée par le magistrat instructeur courant 2001. Une deuxième série d'expertises, uniquement psychologiques, a été diligentée en février 2002 aux fins de procéder à un nouvel examen des quatre enfants et des quatre adultes sur les déclarations desquels reposait l'essentiel de l'accusation. Dans le même temps, un expert psychologue a été commis à quatre reprises pour assister un officier de police judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans le cadre de l'audition de mineurs. Une troisième série d'expertises psychologiques a été réalisée sur ordonnance du président de la cour d'assises de Saint-Omer en date 1er avril 2004, en vue de réactualiser les examens déjà effectués des deux principaux protagonistes de l'affaire, Mme Myriam Badaoui et M. Thierry Delay. Enfin, une quatrième série d'expertises de tous les enfants parties civiles a été diligentée par le président de la cour d'assises de Saint-Omer, pendant le procès, le 11 juin 2004. Ainsi, en trois ans certains adultes ont fait l'objet de quatre expertises, dont trois par des psychologues. Tous les enfants ont fait l'objet d'au moins deux expertises psychologiques, voire de quatre pour l'un d'entre eux. Au total 84 expertises psychiatriques ou psychologiques ont été réalisées. Avant de s'interroger sur leur nature et sur l'utilisation qui en a été faite, il peut déjà être constaté que ces nombreuses expertises perdaient peu à peu de leur sens. Selon Mme Brigitte Bonnaffé, psychologue auditionnée par la commission d'enquête, « la multiplicité, la répétition des examens psychologiques ont nécessairement un impact sur la parole tant de l'enfant que de l'adulte, et viennent contaminer son expression. »195 Il apparaît ainsi que le recours massif et répétitif aux expertises a été non seulement abusif pour les personnes qui y ont été soumises mais que leur accumulation a engendré des effets inverses à ceux recherchés : plus il a été commis d'expertises pour cerner une personnalité, plus on s'est éloigné de la réalité de celle-ci. Il convient, par ailleurs, de remarquer que si le recours excessif aux expertises s'est révélé inutile et trompeur pour la manifestation de la vérité, il resterait encore à évaluer l'impact éventuel qu'elles ont eu sur des enfants déjà particulièrement fragilisés. Établir une radiographie des expertises revient donc à analyser successivement le contenu des expertises, les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées et leur utilisation par l'institution judiciaire. A. LES QUESTIONS POSÉES AUX EXPERTS ET LEURS RÉPONSES Sauf dispositions particulières196, les contenus des missions des expertises psychiatriques et psychologiques sont laissés à l'appréciation du magistrat instructeur. Dans l'affaire d'Outreau, certaines des questions posées sont restées très communes. Les psychiatres ont ainsi été interrogés sur les pathologies mentales dont pouvait souffrir le sujet qu'ils examinaient, sur son éventuelle irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal et sur l'évolution envisageable de son comportement. Il était demandé, par ailleurs, aux psychologues de procéder à une description de l'état de la personne examinée, à une évaluation de son intelligence et, pour les enfants victimes, à identifier les traces et les répercussions du traumatisme lié aux faits invoqués. Certaines questions apparaissent cependant comme ayant dépassé le cadre d'une enquête destinée à recueillir des éléments de personnalité. En interrogeant les experts sur le sens moral des personnes mises en examen, sur les traits d'abuseurs sexuels qu'elles pouvaient présenter et sur la crédibilité de leurs propos et de ceux des enfants - cette dernière question étant posée aux seuls psychologues - le magistrat instructeur a initié un processus interprétatif qui n'a jamais été mis en position d'être contredit. Pour chacun des mis en examen, le magistrat instructeur a demandé à l'expert psychologue et aux experts psychiatres de répondre à la question suivante : « Quel est son sens moral ? » Le magistrat n'a pas douté que le sens moral soit quelque chose qui puisse être décrit par une science, ne serait-ce qu'humaine ; les experts, de leur côté, n'ont pas douté que l'on puisse répondre à cette question. a) La réponse des experts psychiatres M. Jérôme Prizac, l'un des experts psychiatres commis, a certes reconnu, dans son audition du 23 février 2006, qu'il s'agissait là d'une question moins « classique » que les autres et qu'il lui avait fallu, avec son collègue, la reformuler : « Nous avons repris cette expression dans le sens d'une structuration des interdits ». Le diagnostic psychiatrique a été identique pour tous les sujets examinés : « une structuration normale du sens moral ». Traduisant ainsi les difficultés, pour une expertise mentale même menée par des médecins, à s'abstraire du contexte factuel du dossier judiciaire, cette réponse n'a cependant pas été exempte de nuances. Pour certaines des personnes examinées, des formules d'une particulière retenue ont été utilisées. Ainsi le sens moral de M. Daniel Legrand père « semblerait structuré malgré son niveau liminaire » ; à M. François Mourmand est simplement reconnue la possession d'« un sens moral ». Singulièrement, en ce qui concerne M. Alain Marécaux, Mme Odile Marécaux et M. Dominique Wiel, les experts ont laissé à ces derniers la responsabilité de l'analyse : Mme Odile Marécaux « évoque un sens moral structuré » ; M. Alain Marécaux « nous dit posséder un sens moral normalement structuré » ; M. Dominique Wiel « évoque un sens moral qui semblerait normalement structuré. » Aucune justification n'étant donnée dans le corps des analyses à ces prudentes combinaisons verbales, la clé de leur interprétation est laissée à l'intuition du magistrat instructeur. M. Michel Emirzé, l'unique psychologue commis en 2001 pour expertiser les mis en examen, n'a pas souligné de difficultés méthodologiques particulières à traiter ce point de sa mission. Il a reconnu, sans aucune réserve, un sens moral normalement structuré à neuf des mis en examen, en prévenant cependant que, de manière générale, la dynamique de groupe a tendance, entre autres, « à abaisser le sens moral ». Pour les neuf autres personnes examinées, l'expert a pu observer, par exemple, la « défaillance » du sens moral de M. Legrand fils, son « développement insuffisant » chez M. François Mourmand ou caractériser par la négative le sens moral de Mme Odile Marécaux, en constatant chez elle l'absence « d'une défaillance importante ». Bien que ne notant pas de défaillance du sens moral chez Mme Karine Duchochois ni chez M. Alain Marécaux, l'expert relève néanmoins « l'absence de référence » aux valeurs morales dans leurs propos spontanés. Il est procédé de même avec M. Dominique Wiel, pour lequel l'expert se dit cependant incapable d'apprécier « au fond la qualité de son sens moral ». Dans un courrier en date du 25 mai 2002, adressé au magistrat instructeur, M. Dominique Wiel s'est plaint de ces conclusions : « L'absence de référence aux valeurs morales ? Mais je ne me sens coupable de rien de ce dont on m'accuse. Pourquoi faire référence à la morale pour des actes qui n'ont jamais existé ? ». 2. Les traits caractéristiques des abuseurs sexuels Dans le cadre de leurs missions, les experts psychiatres ont eu à répondre à la question suivante, pour chaque mis en examen : « Présente-t-il des traits de caractère ou de personnalité caractéristiques des " abuseurs sexuels " ? » Une mission analogue était confiée à l'expert psychologue. a) La réponse des experts psychiatres Comme pour la réponse à la question du sens moral, les experts psychiatres ont répondu négativement : ils n'ont identifié chez aucun des 18 mis en examen de traits de caractère ou de personnalité caractéristiques des abuseurs sexuels. La question paraît cependant avoir été écartée plutôt que discutée. Contrairement à l'expert psychologue qui, sur ce point, a argumenté sa réponse, les experts psychiatres semblent en effet avoir appuyé leurs affirmations sur l'ensemble du tableau clinique qu'ils dressaient de la personne examinée. Il est à souligner que selon une stratégie tout aussi peu explicite que celle suivie pour justifier les nuances relatives au sens moral de M. Dominique Wiel, ce dernier a été l'objet, une fois de plus, de précautions oratoires peu compréhensibles : « [M. Wiel] ne semblerait pas présenter les traits de caractère ou de personnalités caractéristiques des « abuseurs sexuels », encore que la non-reconnaissance des faits doit inciter à la prudence ». Une conclusion analogue a été tirée au sujet de M. Daniel Legrand père. Au cours de son audition devant la commission d'enquête, le 23 février 2006, le docteur Jean-Louis Pourpoint a expliqué « qu'en tout état de cause, il n'y a pas de caractère spécifique aux abuseurs sexuels ». Le docteur Jérôme Prizac rappelle, dans la même audition, qu'une conférence de consensus de la Fédération française de psychiatrie a, en 2003, recadré l'usage de ce terme ; le rapport rédigé à l'issue de cette conférence indique en effet que « les typologies d'auteurs d'agressions sexuelles [...] n'expliquent jamais la singularité d'une situation et laissent la porte ouverte à toutes les dérives et raccourcis dangereux. » Les raccourcis dangereux dont parle la conférence de consensus des psychiatres ont été empruntés par l'expert psychologue. Un certain nombre de traits rencontrés habituellement dans le profil des abuseurs sexuels a été relevé par lui chez tous les mis en examen, à l'exception de quatre d'entre eux : Mlle Aurélie Grenon, M. Christian Godard, M. Pierre Martel et M. Daniel Legrand père. Pour l'expert faisant appel à la terminologie utilisée dans la profession, les traits de personnalité signifiants ont été les suivants : l'immaturité affective, le fonctionnement égocentrique de l'affectivité, la défaillance du sens moral, une imbrication des pulsions agressives et sexuelles, l'incapacité du sujet à se remettre en cause, un psycho-traumatisme d'origine sexuelle, des relations exclusivement utilitaires avec autrui, une certaine volonté de domination, un fond d'agressivité, un certain renversement des fonctions au sein de la famille, certaines difficultés relationnelles vécues comme intrusives, certaines difficultés dans la sexualité et une identité peu structurée. À suivre la méthode de l'expert il suffisait de posséder, sur cette liste abondante, deux de ces traits pour que la personnalité de la personne expertisée soit rapportée à celle d'un abuseur sexuel. Ainsi, l'immaturité affective et le fonctionnement égocentrique que l'expert a cru identifier chez Mme Sandrine Lavier lui ont fait rapprocher son profil psychologique de celui d'un abuseur sexuel. Au cours de son audition devant la commission d'enquête, le 23 février 2006, M. Michel Emirzé a déclaré : « Après le procès d'Outreau, qui m'a beaucoup fait me remettre en cause, je ne réponds plus du tout de la même façon à la question : la personne présente-t-elle les traits d'un abuseur sexuel ? » Il faut savoir qu'il n'y a pas, dans la nosographie, de personnalité-type de l'abuseur sexuel, comme il peut y en avoir pour le paranoïaque ou le schizophrène, ou la personne atteinte de névrose obsessionnelle. La notion est donc délicate. » Il se déduit de ces propos que l'expert a procédé à l'analyse des 18 mis en examen sur la base de l'hypothèse d'une personnalité-type d'abuseur sexuel qu'aucune description médicale sérieuse n'avait jamais documentée. Il reste à analyser un autre critère qui est intervenu, à savoir celui de la crédibilité des personnes interrogées. Les réponses aux questions portant sur le sens moral ou sur la personnalité d'abuseur sexuel ont certainement contribué à dresser une image à charge de certains mis en examen. La réponse à la question portant sur la crédibilité des enfants et de la principale accusatrice a eu une portée plus large. Elle a nourri le dossier de certitudes allant dans le sens de la culpabilité de tous les mis en examen, qui ont amené à remettre en cause cette notion. · Les expertises effectuées en 2001 C'est à l'expert psychologue, Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart que le magistrat instructeur a confié l'expertise de tous les enfants présumés victimes en âge d'être examinés, courant 2001. Pour chacun des 16 mineurs, elle a eu à répondre à la question suivante : « Préciser, compte tenu des constatations faites, le degré de crédibilité que l'on peut attacher à ses déclarations telles qu'elles figurent dans la procédure. » Au cours de son audition devant la commission d'enquête, le 23 février 2006, l'expert a expliqué la méthode suivie: « Sans porter de jugement sur qui que ce soit, je me suis attachée à dresser un récit traumatique objectif, sur la forme. Il y avait reviviscence visuelle, kinesthésique, auditive. Quant au contenu, j'ai appliqué l'échelle de validité universelle SVA, qui montrait que l'enfant était crédible. » Sur le premier aspect, Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, donne l'explication suivante : « Un enfant qui revit une scène traumatique ne peut pas fabuler, tandis que celui qui fabule est dans un état de contrôle total de l'autre et de lui. S'il y a reviviscence d'une scène traumatique, c'est un indice de validité extraordinaire. » L'échelle de validité universelle se présente de la façon suivante : « l'échelle de validité SVA permet de repérer les critères suivants : vraisemblance, cohérence, enchâssement contextuel, évocation de ses états psychologiques, évocation des spécificités des actes sans comprendre la finalité ; interactions sexuelles ; détails périphériques. »197 Cette méthode a eu la même efficacité que celle utilisée par M. Michel Emirzé pour identifier les traits d'abuseurs sexuels : tous les enfants ont été présentés comme crédibles. · Les expertises réalisées en 2002 La question de la crédibilité des enfants a été l'objet d'une attention croissante à mesure que le dossier s'alourdissait de nouvelles accusations et que l'absence d'éléments matériels se confirmait. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, M. Gérald Lesigne, a ainsi affirmé devant la commission d'enquête, le 9 février 2006, avoir « fortement » sollicité auprès du juge d'instruction le recours à de nouvelles expertises. Par ailleurs, dans la même période, ont été jointes au dossier deux autres expertises dont le contenu exprimait pour la première fois des doutes sur la crédibilité de certains enfants. Les révélations faites par M. Daniel Legrand fils, en janvier 2002, relatives au meurtre d'une petite fille, les confirmations qu'y apportaient les enfants et l'absence de preuves matérielles ont conduit le magistrat instructeur, le 22 février 2002, à ordonner une nouvelle expertise des quatre enfants sur le témoignage desquels reposait l'essentiel des accusations. L'importance de la mission a amené le juge d'instruction à adjoindre à Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, un expert de réputation nationale, M. Jean-Luc Viaux, docteur en psychologie, professeur de psychopathologie, expert agréé près la Cour de cassation. La mission confiée aux deux experts était particulièrement détaillée. Identique pour les quatre enfants Delay, elle comportait dix questions : 1. Prendre connaissance des pièces du dossier jointes en copie ainsi que des scellés que vous briserez pour les exploiter et que vous reconstituerez à l'issue de vos opérations. 2. Examiner le mineur. 3. Dire si l'enfant possède les traits de personnalité d'une personne mythomane. 4. Le sujet a-t-il des tendances pathologiques à l'affabulation ? 5. Existe-t-il des raisons particulières permettant de penser que le sujet a inventé les fait qu'il décrit ou qu'il les impute à des personnes qui ne seraient pas concernées par ces faits ? 6. Quelle est la perception de la réalité par le mineur ? 7. Compte tenu des faits que l'enfant dit avoir subis, ne peut-il pas avoir des troubles de perception de la réalité ? Dans l'affirmative, comment ces troubles se manifestent-ils ? 8. Vos constatations conduisent-elles à remettre en cause la crédibilité des déclarations de l'enfant ou viennent-elles renforcer la crédibilité qu'il est possible d'apporter à ces déclarations ? Quels éléments permettent de penser que leurs déclarations s'appuient sur des expériences vécues et non imaginaires ? 9. Quels sont les rapports du mineur à la sexualité ? Quels sont ses rapports à la violence et à la mort ? Quelles sont les connaissances du mineur en ces différentes matières ? Vos constatations sont-elles en rapport avec l'âge de l'enfant ? Ces rapports sont-ils la conséquence de ce que le sujet indique avoir vécu ou bien peuvent-ils avoir une autre origine ? 10. Faire toutes observations ou remarques jugées utiles à la manifestation de la vérité. Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart a contribué à la réalisation de cette expertise en appliquant la méthode déjà décrite. M. Jean-Luc Viaux a eu recours à des tests et des techniques s'appuyant sur la littérature spécialisée nationale et internationale. En particulier, lors de leur entretien avec le psychologue, « les enfants ont été sollicités de s'exprimer sur leur perception du vrai et du faux à partir de situations banales et de faire un récit libre sur un événement récent. » (Extrait de la présentation méthodologique des quatre expertises effectuées). Les experts précisent, par ailleurs, dans leur présentation du rapport, qu'« aucune question directe sur un événement figurant au dossier et non évoqué par l'enfant n'a été posée. » Les conditions semblaient avoir été réunies pour produire une expertise présentant une plus grande fiabilité que les précédentes. Les conclusions, identiques pour les quatre enfants dans la presque totalité des réponses, ont été les suivantes : l'enfant « n'est en aucune façon mythomane », il « n'a pas de tendance pathologique à l'affabulation » ; « aucun élément de nos examens ne permet de penser que [l'enfant] invente des faits, ou cherche à imputer des faits à des personnes non concernées ; son témoignage reste mesuré, discriminant ses agresseurs du reste des autres personnes mises en cause, avec constance et cohérence ; l'enfant a une perception de la réalité qui est celle de toute personne non délirante : il distingue le vrai du faux, le réel du rêve ; aucune étude publiée à la connaissance des experts n'indique qu'il y ait des troubles perceptifs ou une inadaptation à la réalité conséquents aux abus et violences sexuelles ; les déclarations de l'enfant sont suffisamment cohérentes et répondent à des critères de validité habituellement acceptés dans la littérature spécialisée. » Ces conclusions laissent clairement peu de place au doute sur la crédibilité des enfants dont les propos « discriminants » mentionnent plus de dix personnes parmi les présumés agresseurs. Néanmoins, M. Jean-Luc Viaux a insisté, au cours de son audition devant la commission d'enquête, sur le fait que le terme de crédibilité ne figurait pas dans ces analyses et qu'il n'avait, par conséquent, pas répondu à la question n° 8 que le juge d'instruction lui avait posée. M. Jean-Luc Viaux précise d'ailleurs avoir « l'habitude » de ne pas répondre à cette question : « Je dis depuis des années, dans les articles que je publie dans des revues scientifiques, que c'est une question absurde. Je suis opposé à l'emploi de ce terme piège, qui entraîne des conséquences. »198 Les magistrats avaient cependant toute raison de penser que cette question avait effectivement été traitée et qu'il y avait été répondu par l'affirmative. En effet, si le terme de crédibilité est effectivement absent de cette expertise, il est remplacé par celui de « validité du témoignage » sans que les experts ne donnent d'éclaircissements méthodologiques sur cette reformulation des termes de leur mission. La confusion avec la notion de crédibilité était d'autant plus aisée que Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, le second expert associé, avait systématiquement traité de la crédibilité des enfants examinés par elle en 2001 et que rien ne prévenait le magistrat destinataire du rapport d'un changement de cap interprétatif. Il est ainsi difficile de ne pas admettre que la crédibilité des témoignages des enfants a reçu, sur la base de cette expertise, une confirmation complète. Deux expertises se démarquent cependant de cette crédibilisation des propos des mineurs. M. Emile Leprêtre, psychologue-expert près la cour d'appel de Douai a été commis par le juge d'instruction pour réaliser les 15 février et 5 mars 2002, un examen psychologique d'une mineure auditionnée par le capitaine Didier Wallet au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer. Du premier de ces deux entretiens l'expert conclut que l'enfant « est totalement crédible par rapport à tout ce qui se rapporte aux faits ». Cette conclusion était tirée, alors que l'enfant relatait dans sa déposition une scène de triple viol dont le peu de vraisemblance n'a pas été relevé par l'expert. Après le second entretien, l'expert en arrivait cependant à des conclusions très différentes : « nous devons accorder une crédibilité toute relative aux dires » de l'enfant. Justifiée par l'attitude de la mineure pendant sa déposition, il s'agissait de la seule conclusion d'expertise qui en vienne à dresser un tel constat (cf. supra chapitre II). Par ailleurs, M. Alain Leuliet, commis dans une autre affaire, estimait peu crédibles les accusations que l'un des enfants qu'il examinait portait contre M. Dominique Wiel. Aucune conséquence n'a été tirée par les magistrats de ces expertises, qui n'allaient pas dans le sens de l'accusation. Or, il s'ouvrait là une opportunité réelle de porter un autre regard sur le dossier. Me Lescène a ainsi demandé que sa cliente, Mme Sandrine Lavier, soit expertisée précisément par M. Philippe Leprêtre ; sa demande a été rejetée. · Les expertises effectuées en 2004 La question de la crédibilité ne figurait plus dans aucune des missions d'expertise diligentée par le président de la cour d'assises de Saint-Omer, M. Jean-Claude Monier. Tous les experts ont reconnu que le temps écoulé depuis les faits invoqués (plus de quatre ans) et la répétition des expertises ne leur permettaient pas d'apprécier la réalité des propos des enfants. La question qui avait été l'élément essentiel du dossier pendant la durée de toute l'instruction se révélait vidée de son sens. Symétriquement à la question de la crédibilité des enfants se posait celle des adultes. Les réponses des psychologues désignés ont été aussi formelles que celles faites à propos des mineurs. · Les expertises effectuées en 2002 En février 2002, alors que le juge d'instruction diligentait en dualité d'experts une nouvelle expertise de quatre mineurs, il commettait parallèlement, par quatre ordonnances en date du 27 février 2002, M. Michel Emirzé déjà saisi en 2001 et M. Serge Raymond, psychologue expert près la cour d'appel de Paris, pour expertiser Mme Myriam Badaoui, Mlle Aurélie Grenon, M. David Delplanque et M. Daniel Legrand fils. L'opportunité de ces expertises tenait à la nature du dossier judiciaire qui, à ce moment de l'instruction, devenait particulièrement confus : M. Daniel Legrand fils était revenu sur sa révélation du meurtre d'une petite fille, qu'aucune preuve matérielle n'avait pu étayer mais que Mme Myriam Badaoui avait confirmé. Se posait la question de la crédibilité des propos de ces adultes. Elle fut soumise, pour évaluation, aux psychologues experts. Le contenu de la mission confiée aux psychologues est des plus précis. En premier lieu, elle consiste, après avoir pris connaissance d'un certain nombre de pièces du dossier, à examiner le sujet, à dire s'il possède les traits de personnalité d'une personne mythomane, s'il a des tendances pathologiques à l'affabulation et s'il existe des raisons particulières de penser qu'il a inventé les faits qu'il décrit ou qu'il les impute à des personnes qui ne seraient pas concernées par eux. Mais le juge d'instruction ne se limite pas à demander aux experts des éclaircissements sur les traits de personnalité des sujets examinés. Il leur demande aussi d'évaluer leurs déclarations faites dans le cadre de la procédure judiciaire. La question est formulée ainsi : « Est-il possible, après avoir pris connaissance des déclarations de l'intéressé, de porter une appréciation sur la sincérité et la crédibilité des déclarations faites devant le magistrat instructeur ? Dans l'affirmative vous pourrez dégager les éléments qui laissent penser que les déclarations sont crédibles, ou inventées ou constituent une altération de la vérité. Existe-t-il des critères objectifs permettant de dire que ses déclarations s'appuient sur des expériences vécues ? » Le magistrat instructeur va jusqu'à interroger les experts sur les revirements de certains mis en examen. Ainsi de M. David Delplanque : « Comment est-il possible d'expliquer d'un point de vue psychologique que le sujet soit revenu une fois sur ses déclarations lors d'une confrontation avec une autre personne mise en examen et qu'il ait impliqué plusieurs personnes avant de démentir ? Ces revirements peuvent-ils avoir pour origine des pressions ou des menaces [...] ? » Concernant Daniel Legrand fils, cette dernière question est libellée de la manière suivante : « Ces revirements peuvent-ils avoir pour origine l'attachement que l'intéressé porte à son père qui est également mis en examen dans la procédure et qui, aux dires de certains mis en examen serait un des dirigeants du réseau de pédophilie et quelqu'un de violent ? » La confiance du magistrat instructeur dans les capacités explicatives de la psychologie n'a pas été déçue par les deux experts. Toutes les questions posées ont trouvé la même réponse : les personnes examinées ont été jugées crédibles. En particulier, les conclusions portant sur Mme Myriam Badaoui sont sans appel : « L'examen psychologique de Mme Myriam Badaoui n'a pas mis en évidence de tendance mythomaniaque ; elle n'a pas de tendance pathologique à l'affabulation, peut se révéler volontiers manipulatrice, mais ceci rentre dans sa problématique abandonnique [...] ; ses déclarations sont crédibles et constituent les critères objectifs qui permettent de faire la différence entre expériences vécues et expériences imaginaires. » · Les expertises effectuées en 2004 Par une ordonnance en date du 1er avril, M. Jean-Claude Monier, président de la cour d'assises de Saint-Omer, demande à M. Michel Emirzé, commis une fois de plus, et à Mme Brigitte Bonnaffé, psychologue expert près la cour d'appel de Douai, de procéder, en une « unicité d'expert »199, à une expertise de « réactualisation » de M. Thierry Delay, pour le premier, et de Mme Myriam Badaoui, pour la seconde. La question de la crédibilité n'est pas posée dans ces missions. Cependant, Mme Brigitte Bonnaffé remarque, au sujet de Mme Myriam Badaoui, que « quiconque met en doute ses dires représente un élément potentiellement persécutoire »200. Au cours de son audition devant la commission d'enquête Mme Bonnaffé a donné les précisions suivantes : « Il me paraissait évident que les propos de Mme Badaoui ne pouvaient pas "tenir la route". »201 c) La crédibilité, une notion commune aujourd'hui proscrite Il convient de souligner que la notion d'expertise de crédibilité, en particulier d'enfant, était d'un usage commun. M. Fabrice Burgaud déclare ainsi : « Mes collègues l'utilisaient, les avocats de la défense m'ont demandé des expertises de crédibilité. Les experts utilisaient aussi ce terme. Mais je pense aujourd'hui qu'il n'est pas approprié. »202 La circulaire de la Chancellerie en date du 20 avril 1999 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore des mineurs victimes d'infractions sexuelles mentionnait que rien n'interdisait au juge « de faire réaliser une expertise de crédibilité au seul vu de l'enregistrement. » Revenant sur l'usage de cette notion, une circulaire de la Chancellerie en date du 2 mai 2005 a informé les magistrats qu'il était « indispensable de proscrire le terme même de crédibilité ». Des habitudes semblent cependant avoir été prises. M. Paul Bensussan, à l'occasion de son audition le 5 avril 2006, a transmis au rapporteur de la commission d'enquête un exemple d'une mission d'expertise qui lui avait été confiée le 7 mars 2006 dans laquelle il lui était demandé de dire si la personne expertisée était crédible. En dehors de ces multiples interrogations sur les critères auxquels il avait été recouru, la commission d'enquête a été très sensible aux divergences d'interprétation entre psychiatres et psychologues. B. POURQUOI DES RÉPONSES AUSSI DIVERGENTES ? Les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques diligentées en 2001 et 2002 sont contradictoires. Les conclusions des expertises psychologiques commises en 2001 et 2002 et celles diligentées en 2004 sont très éloignées les unes des autres. 1. Les contradictions entre les expertises psychiatriques et les expertises psychologiques Lors de son audition du 7 mars 2006, le docteur Messerschmitt a expliqué les contradictions entre les conclusions des expertises menées par les psychiatres et celles réalisées par les psychologues par la différence de formation entre les uns et les autres. Les psychiatres sont des médecins qui ont suivi une spécialisation de quatre ans. Leur expérience s'appuie sur la confrontation avec la maladie mentale : « c'est une expérience non livresque, d'une sorte d'épaisseur de la vie. » Leurs expertises se fondent sur un entretien clinique avec le sujet. Les psychologues sont des professionnels non répertoriés par le code de la santé publique et qui ont suivi une formation qui relève des sciences humaines, que Mme Christine Pouvelle-Condamin, lors de son audition du 7 mars 2006 appelle « sciences universitaires ». Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, dans son audition du 23 février, précise qu'elle-même est titulaire d'un DESS. Mme Brigitte Bonnaffé fait cependant remarquer que si « la psychologie n'est pas une science exacte [...], il est important de s'appuyer sur une démarche scientifique. » L'expertise psychologique consiste en un entretien avec le sujet, suivi de divers tests. Ces différences entre ces deux disciplines conduisent à s'interroger sur la pertinence qu'il y a à leur confier des missions d'expertise très semblables. Les experts œuvrent sur le terrain des pathologies mentales, les psychologues sur celui des vécus psychiques. Si la même question est posée aux uns et aux autres, on peut penser que celle-ci est mal énoncée ou qu'elle ne relève exclusivement que de l'une de ces deux disciplines. Cette difficulté, qui oblige chaque expert à reformuler la question pour lui donner un sens en fonction de sa compétence propre, rend la lecture des expertises particulièrement confuse. En outre, elle suscite l'illusion qu'une procédure contradictoire entre disciplines différentes est ainsi engagée, là où de fait il n'y a qu'une confusion de méthodes. 2. Les divergences entre les conclusions des psychologues La méthodologie des experts psychologues apparaît singulièrement disparate. Des seules auditions devant la commission d'enquête sont ressortis plusieurs désaccords. La connaissance du dossier judiciaire est pour certains un préalable indispensable à l'examen du sujet ; pour d'autres, elle ne peut que suivre cet examen ; certains pensent enfin que l'analyse peut être réalisée sans consulter les pièces judiciaires. M. Jean-Luc Viaux reconnaît l'existence de ce problème : « Je pense qu'il y a un problème, en effet. Nous ne sommes pas tous d'accord, au sein de la profession, sur la question de savoir si l'expert doit lire le dossier. [...] Je pense pour ma part qu'il est impossible de faire une expertise judiciaire sans savoir de quoi il s'agit. »203 Mme Brigitte Bonnaffé défend une démarche différente : « Sur l'accès au dossier, il me semble important d'aller tout d'abord à la rencontre du sujet, de travailler en aveugle, quitte, dans un second temps, à compléter l'expertise par la lecture du dossier. »204 M. Serge Raymond a une position plus marquée : « [...] en général, et ceux qui me nomment le savent, j'essaie de ne pas lire le dossier [...] J'ai l'habitude de ne pas prendre connaissance du dossier pour ne pas avoir d'a priori. »205 Les résultats des tests psychologiques sont aussi appréciés différemment. M. Paul Messerschmitt a remarqué, au cours de son audition du 7 mars 2006, que le choix, comme axe d'interprétation « d'une procédure d'équivalence sexuelle », relève surtout d'« une culture »206. M. Paul Messerschmitt rappelle également dans la même audition que « ce n'est pas le test qui décide de la vérité mais bien la personne de l'expert ». Ces remarques rejoignent celles formulées par Mme Odile Marécaux devant la commission d'enquête le 18 janvier 2006 et par M. Dominique Wiel sur l'utilisation faite par les psychologues du test de Rorschach : « jamais ces tests n'ont révélé autre chose que ce que celui qui les lit veut y mettre. »207. L'interprétation des dessins d'enfants peut faire l'objet d'erreurs grossières, a aussi rappelé M. Paul Messerschmitt208 . Les psychologues divergent également sur la durée des entretiens avec les personnes examinées. M. Serge Raymond a estimé que son expérience de trente ans d'expertise lui permettait d'effectuer une expertise sur la base d'une heure d'entretien. Mme Christine Pouvelle-Condamin s'est plainte du peu de temps dont elle avait disposé, ce qui, admet-elle, aurait dû l'amener à refuser la mission qui lui était confiée209. Ces désaccords sur des aspects aussi importants de la méthode et de l'interprétation conduisent à ce que les résultats des expertises soient d'une fiabilité difficile à apprécier. La difficulté est d'autant plus grande si, en outre, l'on prend en considération les oppositions entre les différentes écoles de psychologie auxquelles se rattachent les experts. 1. Les experts devaient-ils répondre ? Au cours de son audition, le docteur Jérôme Prizac a constaté qu'une partie de la mission d'expertise qui lui avait été confiée comportait des questions « inhabituelles », en particulier celle relative au sens moral et celle concernant les traits d'abuseurs sexuels. Il avait cependant répondu à ces questions « tout simplement parce qu'elles nous avaient été posées ! » M. Jérôme Prizac estime avoir eu « trop de respect à l'égard de l'institution judiciaire. »210 M. Jean-Luc Viaux reconnaît, lui aussi, qu'il n'aurait pas dû répondre à l'une des questions qui lui avait été posée, celle relative à l'imputation des faits. Celle-ci constituait plus une question juridique qu'une question de psychologie. En entraînant l'expert sur le terrain de l'imputabilité, le magistrat tentait de faire répondre le psychologue à une question qui n'était pas de la compétence de ce dernier. Ces deux experts regrettent de ne pas avoir eu d'entretien avec le magistrat instructeur pour discuter avec lui du contenu de ces questions. Il ne semble pas, cependant, qu'ils aient pris d'initiative en ce sens. On constate par ailleurs que les experts psychologues, à l'exception de M. Jean-Luc Viaux sur le point précis de la crédibilité développé plus haut, n'ont formulé aucune remarque sur le contenu des missions qui leur avaient été confiées, quelle qu'ait été la complexité de celles-ci. De même, à la différence des experts psychiatres qui ont tenté d'expliquer leur attitude en reconnaissant avoir eu une attitude trop respectueuse envers l'institution, les experts psychologues n'ont donné, au cours de leurs auditions, aucune explication sur leur attitude envers cette même institution. Il convient de rappeler qu'un expert ne peut accepter une mission que s'il est compétent pour la mener. Pour les médecins cette règle est explicitement posée par l'article R. 4127-106 du code de la santé publique, qui codifie la disposition du code de déontologie médicale invitant le médecin à se récuser, s'il estime que les questions posées par le juge sont étrangères à la technique médicale. Encore faudrait-il, en particulier pour les psychologues, que le savoir de l'expert soit suffisamment défini pour que lui soit reconnu un champ de compétence clair et distinct. 2. Les experts devaient-ils se taire ? Dans chaque mission d'expertise, le magistrat instructeur demandait de « faire toutes observations ou remarques jugées utiles à la manifestation de la vérité. » On constate que non seulement cette clause très générale n'a pas été mise à profit par les experts pour faire part des réserves méthodologiques qui s'imposaient devant certaines des questions du juge mais elle ne l'a pas été non plus pour informer le magistrat de constats qui relevaient de l'évidence. Ainsi, les médecins psychiatres, MM. Jean-Louis Pourpoint et C. Balthazard, qui ont expertisé M. Jean-Marc Couvelard le 16 juin 2001, ont conclu à son irresponsabilité pénale, sans relever que la commission des faits qui lui étaient reprochés était impossible au regard de son grave handicap physique -que les experts décrivent pourtant avec précision dans leur rapport. Pendant son audition du 23 février 2006, M. Jean-Louis Pourpoint explique que « Le principe de base de l'expertise est de répondre aux questions que pose le magistrat, sans déborder du cadre, et dans les limites de nos compétences. » Il se trouve que le cadre de la mission était ouvert par la clause précitée. Le respect de l'institution, dont parle M. Jean-Louis Pourpoint dans la suite de son témoignage devant la commission d'enquête, ne pouvait pas justifier de rester muet devant l'évidence de l'état de M. Jean-Marc Couvelard. 3. Ce dont n'ont pas parlé les experts La commission d'enquête a été particulièrement étonnée qu'aucune expertise n'ait tenté d'évaluer l'éventuel impact sur les enfants du visionnage de cassettes vidéo en tout genre. Il convient de rappeler qu'au domicile de M. et Mme Delay ont été trouvées 60 cassettes vidéo de films d'horreurs et 163 cassettes pornographiques. Les experts ne se sont pas non plus interrogés sur les rapports qu'avaient pu avoir les enfants entre eux, sur l'influence des informations échangées ou reçues des médias, en particulier de la télévision. L'impact du milieu n'a pas été évalué. D. COMMENT LES MISSIONS ONT-ELLES ÉTÉ REMPLIES ? 1. Les missions réalisées en unicité d'expert À l'exception de huit expertises, toutes les expertises psychologiques ont été réalisées en « unicité d'expert ». En particulier en 2001, tous les mineurs sont confiés à Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart et tous les mis en examen à M. Michel Emirzé. Des doutes peuvent être émis, comme l'a relevé Mme Annie Sanctorum au cours de son audition du 7 mars 2006, sur la possibilité, pour un seul expert, de réaliser la totalité des expertises de victimes dans une affaire aussi complexe. De plus, en ne sollicitant que deux experts pour examiner plus de quarante sujets, le magistrat s'interdisait de disposer de différents points de vue sur les personnalités des parties au procès. Ce choix était d'autant plus malheureux que l'impartialité de Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart pouvait faire l'objet d'interrogations (cf. paragraphe 3 ci-dessous). 2. Les missions réalisées en dualité d'experts Confier à une dualité d'experts les expertises des protagonistes les plus importants du dossier pouvait constituer une mesure de prudence destinée à asseoir la qualité des expertises rendues. De la confrontation de deux points de vue, il était à espérer que se dégagerait une appréciation d'une objectivité peu contestable. Or, ce sont à nouveau Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart et M. Michel Emirzé qui ont été sollicités en 2002 par le magistrat instructeur pour participer à ces expertises, en collaboration respectivement avec M. Jean-luc Viaux et M. Serge Raymond. La désignation des mêmes experts que ceux qui avaient procédé aux premières séries d'analyses de 2001 a eu pour conséquence que ces missions se sont naturellement orientées dans le sens de la confirmation des premières conclusions. De plus, pour les expertises des quatre adultes réalisées par MM. Michel Emirzé et Serge Raymond, il ressort du témoignage de M. Michel Emirzé devant la commission d'enquête que c'est ce dernier qui avait recommandé M. Serge Raymond au juge d'instruction211. Il est difficile de penser que le choix de ce second expert s'était fait dans l'intention de porter la contradiction au premier. Les rapports rendus par MM. Michel Emirzé et Serge Raymond ne font d'ailleurs le constat d'aucun désaccord. La même conclusion doit être tirée de la désignation de M. Jean-Luc Viaux par le magistrat instructeur. Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart explique, dans une lettre envoyée au rapporteur de la commission d'enquête le 13 mars 2006, que M. Fabrice Burgaud « souhaitait s'entourer d'un maximum de garanties et il m'a demandé de lui suggérer un nom, n'ayant pas la connaissance des milieux scientifiques. Je lui ai donc suggéré le nom du Professeur Jean-Luc Viaux. » M. Jean-Luc Viaux a expliqué, pour sa part, devant la commission d'enquête, comment il avait réalisé en commun avec Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart les expertises de quatre enfants. Leur accord sur le fond des analyses les avait amenés à ne pas faire état des divergences de formulation qu'ils avaient pourtant eues et des différences entre les méthodes adoptées par chacun d'entre eux. Ces différences, a expliqué M. Jean-Luc Viaux, les avaient tout de même conduits « à trancher de manière un peu systématique » leurs conclusions. On peut s'interroger sur la rationalité de cette systématisation qui a peut-être contribué, par ailleurs, à cette mauvaise interprétation faite, selon M. Jean-Luc Viaux, des conclusions de ses expertises. Elle a de plus abouti à proposer pour chacun des enfants des réponses identiques pour la majorité des questions posées. Cette coexpertise a ainsi amené à l'uniformisation quasi mécanique des conclusions. Il est à noter que les dispositions de l'article 166 du code de procédure pénale font obligation aux experts d'indiquer dans leurs rapports, non seulement leurs différences d'avis mais aussi leurs éventuelles réserves sur les conclusions communes. Plus fondamentalement, la commission d'enquête s'est interrogée sur les pratiques professionnelles de certains experts qui étaient intervenus dans cette affaire. 3. Des missions réalisées dans des conditions attestant de pratiques professionnelles contestables a) Un psychologue à l'impartialité contestable Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, à laquelle avait été confiée la réalisation des expertises psychologiques de 16 mineurs, a été récusée pendant le procès d'assises de Saint-Omer après la remise en cause de son impartialité par plusieurs avocats. Il s'est avéré que Mme Gryson-Dejehansart était, depuis 2000, présidente de l'association « Balise la vie », association ayant pour objet « de prendre en charge les enfants une fois que le processus judiciaire est terminé »212. Cette association était subventionnée par le département du Pas-de-Calais, qui par ailleurs était partie civile au procès dans lequel Mme Gryson-Dejehansart intervenait comme expert. Le président de la cour d'assises de Saint-Omer a pris acte de cette situation en commissionnant d'autres experts pour réaliser de nouveaux examens des mineurs. Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart a tenu à préciser que les subventions reçues par son association avaient pour seul objet de défrayer ses membres bénévoles et que l'existence de son association était connue des autorités judiciaires locales : « tous les magistrats connaissaient cette association. Peut-être pas M. Burgaud, qui était nouveau, mais au moins le procureur. » Par ailleurs, il ressort d'une note 213 émanant de la Direction de l'enfance et de la famille (antenne de Boulogne-sur-Mer) que le juge des enfants, M. Erik Tamion, avait été informé de l'intérêt que ce service portait pour les activités de Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart. Dans cette note en date du 12 avril 2001 Mme Claire Beugnet, responsable de service, fait part en effet de son souhait de confier la prise en charge psychologique de quatre enfants cités dans l'affaire d'Outreau à Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, ce à quoi faisait obstacle sa nomination en tant qu'expert ; il y est demandé « de revoir la question avec M. Burgaud ». Ce dernier a déclaré devant la commission d'enquête ne pas avoir souvenir de ce document. Il apparaît ainsi que si le magistrat instructeur a ignoré les liens de cet expert avec les parties civiles au procès, ni le magistrat du parquet, qui selon Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart connaissait les activités de son association ni le juge des enfants ne l'ont informé de ce risque de confusion d'intérêts. En tout état de cause, il revenait à Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart de renoncer à cette mission. b) Un psychologue peu soucieux de son devoir de réserve Pendant le procès d'assises de Saint-Omer, un avocat de la défense, Me Frank Berton, a déposé des conclusions aux fins de récuser M. Jean-Luc Viaux. Selon cet avocat, l'expert psychologue aurait violé les règles déontologiques régissant les experts judiciaires, en donnant des interviews à la presse dans une période précédant de près sa déposition devant la cour d'assises le 4 juin 2004. Il s'agissait d'une « lettre ouverte » publiée par le journal Le Monde le 25 mai 2004, d'une interview pour l'émission télévisée Envoyé spécial le 27 mai 2004 et d'une interview dans le quotidien Le Parisien du 4 juin 2004. Dans ces interventions, M. Jean-Luc Viaux critiquait vivement la façon dont était remise en cause la parole de l'enfant durant ce procès, se déclarant « en colère » « parce que l'absence de sérénité qui entoure ce procès est déplorable ». La requête de Me Frank Berton a été rejetée par le président de la cour d'assises sur la base d'un constat d'incompétence : « il n'entre pas dans la compétence de la cour de se prononcer sur d'éventuels manquements de l'expert en dehors de la manière dont celui-ci a rempli sa mission expertale (examen des parties civiles, rapports écrits, déposition orale) laquelle n'est pas en elle-même critiquée ni affectée en quoi que ce soit par les propos de J.L Viaux à la presse. »214 Il est cependant manifeste que les interventions de M. Jean-Luc Viaux dans les médias, portant sur une affaire dans laquelle il intervenait à titre d'expert, constituaient une violation flagrante du devoir de réserve auquel est tenu tout auxiliaire, même occasionnel, de justice. Si cette obligation n'est pas prévue expressément par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 régissant le statut des experts judiciaires mais s'applique aux fonctionnaires (article 6 du statut général) et aux magistrats (CE, 5 mai 1982, Bidalou), on est fondé au demeurant à penser qu'il serait opportun de l'insérer dans la loi de 2004. M. Jean-Luc Viaux a, au surplus, qualifié devant la commission d'enquête de « dérapage » regrettable sa déclaration faite le 17 novembre 2004, au sortir de l'audience de la cour d'assises de Paris, selon laquelle « quand on paye des expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femme de ménage. » c) Deux psychologues aux méthodes de travail expéditives MM. Michel Emirzé et Serge Raymond ont été commis par ordonnance en date du 27 février 2002 aux fins de procéder, en dualité d'experts, aux expertises psychologiques de Mme Myriam Badaoui, Mlle Aurélie Grenon, M. David Delplanque et M. Daniel Legrand fils. Les entretiens cliniques avec les personnes examinées ont tous été réalisés par ces experts le même jour, le 11 juillet 2002 : à la maison d'arrêt de Loos pour Mme Myriam Badaoui, à la maison d'arrêt d'Arras pour M. David Delplanque et à la maison d'arrêt de Longuenesse pour M. Daniel Legrand fils. Le rapport d'expertise ne précise pas le lieu où a été effectué l'examen de Mlle Aurélie Grenon, qui était alors en liberté provisoire. Rédigés, pour trois d'entre eux, le même jour que les entretiens, et l'un le lendemain, les rapports d'expertise sont naturellement succincts : une demi page d'analyse et une demi page de conclusions. Les conclusions de chacune des expertises portent mention que l'examen a été réalisé « après avoir pris connaissance des pièces du dossier jointes en copie », à savoir 50 pièces, fournies par le magistrat et que celui-ci enjoignait aux experts de lire dans le cadre de leur mission. Il ressort des déclarations de MM. Michel Emirzé et Serge Raymond devant la commission d'enquête que M. Serge Raymond, qui a invoqué des raisons de méthode, n'a pas pris connaissance de ces documents à l'occasion de l'expertise de Mme Myriam Badaoui. M. Michel Emirzé admet que « de mémoire, il avait sans doute pris au moins connaissance des déclarations de Mme Badaoui » et qu'il était « possible » qu'il ait lu les autres pièces215. Il est à constater cependant qu'il n'est fait référence à ces documents ni dans les analyses ni dans les conclusions de l'expertise de Mme Badaoui. Le constat étant le même pour les trois autres expertises réalisées le 11 juillet 2002, l'hypothèse peut être avancée que les documents joints à ces trois autres missions ont fait l'objet d'une exploitation analogue. Ainsi MM. Emirzé et Raymond ont réalisé, dans la même journée, plus de quatre mois après avoir été commis, les quatre expertises psychologiques des principaux protagonistes de l'affaire d'Outreau, et rédigé le jour même trois de leurs rapports, sur la seule base, selon toute apparence, des entretiens effectués. On ne peut que constater que ces quatre missions d'expertise ont été remplies avec la plus complète désinvolture et qu'il resterait à apprécier si, à cette occasion, le serment prêté par ces experts d'accomplir leurs missions avec honneur et probité a été respecté. Ces expertises n'ayant d'intérêt qu'au regard de leur interprétation, il reste à déterminer comment elles ont été interprétées par les magistrats. E. COMMENT LES EXPERTISES ONT-ELLES ÉTÉ COMPRISES ET UTILISÉES PAR LES MAGISTRATS ? Aussi contestables qu'aient pu être les missions, les réalisations et les conclusions de ces expertises, il revenait aux seuls magistrats de leur conférer un sens, dans le cadre de la procédure judiciaire qu'ils instruisaient. On relève qu'à certaines étapes de la procédure, il a pu être fait un usage détourné des rapports remis par les experts, qu'il s'agisse du profilage des personnalités, du recours hyperbolique à la notion de crédibilité et de la tentation de l'institution judiciaire à verser elle-même dans un certain « psychologisme ». 1. Le profilage des personnalités a) Des extraits d'expertises tirés de leur contexte Les psychiatres, comme il l'a été exposé précédemment, n'ont identifié de traits de caractère ou de personnalité caractéristiques des abuseurs sexuels chez aucune des personnes mises en examen. L'expert psychologue a conclu en sens inverse pour dix d'entre elles. Or, il ressort du réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 6 mars 2003, de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 13 mars 2003 et de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er juillet 2003 que pour Mme Sandrine Lavier, M. Thierry Dausque et M. Dominique Wiel la conclusion positive du psychologue est mentionnée mais la conclusion négative des psychiatres est tue. Ainsi, en s'inspirant essentiellement du réquisitoire du parquet ont été figés des portraits psychologiques allant dans le sens de l'accusation et qui ne rendaient pas fidèlement compte des analyses des experts. On constate, par ailleurs, que les rapports d'expertise ont été résumés au plus simple, réduisant les caractéristiques des personnalités examinées à quelques traits que les magistrats estimaient être saillants. Par exemple, « la volonté de domination et le fond d'agressivité » que l'expert psychologue avait identifiés chez Mme Roselyne Godard sont mentionnés en termes identiques dans les trois documents précités. Mais que l'expert ait nuancé son propos, en précisant que Mme Roselyne Godard « n'est pas apparue comme un sujet potentiellement dangereux du point de vue psychopathologique » n'est repris par aucun magistrat. À la lecture de ces mêmes documents il apparaît que « l'immaturité affective » et le « fonctionnement égocentrique de la personnalité » semblent avoir été les seuls ressorts de la psychologie de la majorité des personnes mises en examen. Certains traits psychologiques ont singulièrement retenu l'attention de tous les magistrats, par exemple « les signes d'obnubilation au travail » de M. Alain Marécaux, dans l'interprétation desquels les magistrats n'entrent cependant pas. Mais le fait que le psychologue ait écrit que « nous n'avons pas relevé de tendances à élaborer des relations exclusivement utilitaires avec autrui » ne figure dans aucun des résumés faits de la psychologie de M. Alain Marécaux. b) Des traits de personnalité arbitrairement choisis Il a également été fait une utilisation très libre des conclusions des experts dans les jugements statuant sur des demandes de mise en liberté. Ainsi, des conclusions d'expertises concernant M. Dominique Wiel, dans une version particulièrement résumée par les magistrats, ont été intégrées dans les « attendus » d'un jugement de rejet de demande de liberté : « Attendu que [...] l'expertise psychiatrique de Dominique Wiel n'a pas mis en évidence de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou aboli et entravé le contrôle de ses actes ; que l'expertise psychologique a relevé quelques traits comportementaux susceptibles d'être rencontrés chez des abuseurs sexuels ; »216 Certes, en l'espèce, ces « attendus » portent sur la partie biographique de M. Dominique Wiel, mais on constate qu'ils incorporent au plus près dans la décision judiciaire des éléments psychologiques sélectivement tirés d'expertises dont les nuances ou les contradictions, notamment avec les conclusions des psychiatres, sont ignorées. On relève aussi que l'interprétation des mêmes expertises psychologiques peut faire l'objet d'une présentation prenant le contre-pied des interprétations précédentes. Ainsi, la description de la personnalité de M. Alain Marécaux dans l'arrêt de la chambre de l'instruction qui décide de sa mise en liberté provisoire en date du 7 octobre 2003, cite la conclusion de l'expertise psychiatrique, qui n'identifie pas chez lui de traits d'abuseurs sexuels et précise que l'expertise psychologique « n'a pas mis en évidence de troubles psychopathologiques structurés ni d'organisation perverse de la personnalité ». Par touches plus ou moins appuyées sont ainsi brossés des portraits psychologiques outrageusement simplifiés, pour être rendus conformes aux attentes judiciaires. Au lieu d'être considérées comme des analyses formant un tout, à l'image de la personne examinée, les expertises psychologiques sont démembrées en petites phrases, transformées en catalogue dans lequel on vient, au gré des besoins, puiser les formules opportunes. 2. Le recours hyperbolique à la notion de crédibilité Dans un arrêt en date du 19 juin 2002 (n° 1067) de rejet d'une demande de contre-expertise, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai précise clairement les missions de l'expert : « la question de la " crédibilité " des propos de Mme Badaoui, Aurélie Grenon, David Delplanque, Daniel Legrand fils n'est pas du ressort de l'expert psychiatre, étant observé qu'indépendamment de leur degré de " crédibilité ", les propos en question peuvent être, soit le fruit d'un mensonge, soit le reflet la vérité, ce qui n'entre pas dans la mission d'un expert d'apprécier. » Le principe est clairement posé : aussi élevé que soit un degré de crédibilité, nul ne peut en déduire une vérité. Cependant, dans les actes de procédure, le caractère par nature relatif de la crédibilité a laissé place, au sujet des propos des enfants, à une notion plus ambiguë, reprise de la terminologie utilisée dans les expertises de Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart : leur « entière crédibilité ». En entretenant une proximité illusoire avec la notion de véracité, cette hyperbole a donné une assise à l'argumentation du réquisitoire définitif du procureur de la République, de l'ordonnance de mise en accusation et de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction. Érigée ainsi en absolu, la crédibilité n'a plus à être évaluée. Il est ainsi refusé à M. Alain Marécaux une audition des médecins traitants de sa famille susceptibles d'apporter leur témoignage « sur le degré de crédibilité » d'un de ses enfants sous prétexte que « l'expert psychologue qui a examiné l'enfant a estimé ses propos crédibles. »217 Comprise de cette manière, la crédibilité est mentionnée dans le corps même des attendus de certaines décisions. Par exemple, il y est fait référence dans une ordonnance rendue par le juge d'instruction M. Cyril Lacombe, le 31 décembre 2002, relative à une saisine du juge des libertés et de la détention suite à une demande de mise en liberté de M. David Brunet : « attendu [...] que tant les mis en examen qui reconnaissent les faits que les enfants de M. et Mme Delay ont été reconnus crédibles par les experts [...] » La crédibilité est ici utilisée comme un élément suffisamment probant pour argumenter une demande de maintien en détention. 3. Le « psychologisme » de l'institution judiciaire La crédibilité reconnue aux enfants par l'expert psychologue était manifestement contredite par les propos de ces derniers concernant à la piste belge. Pour sauver l'entière crédibilité des enfants, le procureur de la République, M. Gérald Lesigne, a été amené à développer l'argumentation suivante : « Sur ce point particulier, il apparaît nécessaire, néanmoins, de faire crédit aux mineurs victimes de leur extrême jeunesse. Ainsi, la Belgique n'était avant tout pour eux qu'une contrée lointaine, difficile d'accès, et susceptible d'être rejointe par une longue route. Il serait abusif d'attribuer à cette dénomination géographique la valeur de référence qu'elle n'aurait pas manqué de recouvrer dans le langage des personnes adultes. L'assimilation avec « la Belgique » avait pu s'opérer tout aussi bien après que la campagne de presse ait largement évoqué cette hypothèse. Il pouvait en définitive s'agir de tout autre lieu en France ou à l'étranger, présentant une configuration similaire. A tout le moins, on ne saurait user de cet argument pour remettre en cause les faits dénoncés, dès lors que la description des actes et leur imputation s'avéraient suffisamment précises et circonstanciées. »218 Il est manifeste que cette explication du magistrat ne relève que d'une approche psychologique. En proposant un complément d'analyse fondée sur une technique d'interprétation dont les fondements ne sont pas indiqués, elle comble les défaillances de l'expertise. La partie du dossier judiciaire la plus fragile reçoit ainsi sa justification principale d'une psychologie spontanée venant au secours de la psychologie des professionnels. De même, à l'occasion de réquisitions du parquet relatives à des demandes de mise en liberté, il est fait systématiquement appel à la motivation suivante : « la personnalité du mis en examen le prédispose à réitérer les actes qui lui sont imputés. » Cette assertion présentée comme une motivation vient en outre, à certaines occasions, en contradiction avec les conclusions des experts. Ainsi, le procureur de la République, le 24 octobre 2002 s'oppose à la mise en liberté de Mme Sandrine Lavier, sur le constat que sa personnalité présente un risque de réitération des actes ; M. Cyril Lacombe reprend le même argument dans l'ordonnance de saisine du JLD le 25 octobre 2002 ; or, l'expert psychologue avait conclu, dans son expertise de Mme Sandrine Lavier, le 25 juillet 2001 qu'il était « difficile d'évaluer ici le risque de récidive » et les experts psychiatres avaient déduit, le 18 mars 2002, qu'il n'y avait « pas d'élément d'ordre psychiatrique impliquant des risques de récidive. » F. UNE DÉFENSE RÉDUITE À L'IMPUISSANCE On ne peut ignorer non plus dans ce contexte le profit que la défense pouvait espérer tirer des expertises. Or, l'examen du dossier montre que bien souvent les contre-expertises demandées par la défense ont été refusées sans motivation convaincante et que d'une manière générale, en la matière, les droits de la défense n'ont pu s'exercer de manière satisfaisante. 1. Les refus des actes d'expertise demandés par la défense Dans un domaine aussi soumis à interprétation que l'expertise mentale, il aurait semblé naturel de donner à la défense les possibilités d'évaluer les méthodes suivies par les experts et de proposer de nouveaux actes d'expertise. Cependant, les spécificités de la procédure pénale font que l'exercice du droit au contradictoire est en cette matière particulièrement restreint. Dans l'affaire d'Outreau, ces règles de procédure ont conduit à écarter systématiquement la défense de tout ce qui aurait pu conduire à une réévaluation des certitudes qui s'étaient construites à partir des expertises menées par les psychologues. Toutes les demandes de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise psychiatrique ou psychologique formulées ont été rejetées par le magistrat instructeur, de même que tous les appels faits de ces rejets devant la chambre de l'instruction219. Le président de la chambre de l'instruction a pu, en outre, recourir au pouvoir qu'il détient de l'article 186-1 du code de procédure pénale et décidé de ne pas soumettre à la chambre de l'instruction au moins un appel de rejet de demande de contre-expertise (ordonnance n° 198 du 31 octobre 2002 relative à l'appel de Mme Karine Duchochois). 2. Les motivations des refus des contre-expertises Certaines des demandes ont été rejetées pour avoir été formulées en dehors des délais fixés par le magistrat instructeur. Les dispositions légales en vigueur au moment de l'affaire laissaient à la discrétion du juge d'instruction la fixation du délai de dépôt de la demande. M. Fabrice Burgaud l'avait arrêté à dix jours à compter de la notification des conclusions du rapport à l'intéressé. Ainsi, une demande de nouvelle expertise de Mme Sandrine Lavier a été rejetée pour avoir été déposée le 2 mai 2002, alors que l'expertise qui la concernait lui avait été notifiée le 25 mars 2002. Il convient de souligner que depuis lors la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a porté ce délai à quinze jours minimum. Il apparaît, par ailleurs, que le magistrat instructeur a été seul juge de la qualité des expertises rendues. Une motivation de rejet de contre-expertise est, par exemple, formulée comme suit : « Attendu que le psychologue a clairement et précisément répondu aux questions posées par le magistrat instructeur ; que l'expert nommé est particulièrement compétent dans cette spécialité ; que la personne mise en examen ne précise pas en quoi il serait utile d'effectuer une contre-expertise psychologique la concernant si ce n'est que " l'examen n'a pas été à son sens effectué dans de bonnes conditions ", ce que n'a pas relevé l'expert [...] dans ces conditions il convient de rejeter la demande de contre-expertise de Madame Roselyne Godard. »220 En l'espèce, on constate que l'absence de contrôle sur la façon dont s'est déroulée réellement l'expertise ne permet pas à Mme Roselyne Godard de faire valoir ses récriminations sur les conditions de l'examen ; la reconnaissance par le magistrat de la compétence de l'expert - il s'agit de M. Michel Emirzé - va de pair avec le fait que l'expert a été désigné par ce même magistrat ; l'appréciation de la qualité des réponses de l'expert relève, aussi, de la seule appréciation du juge. Une argumentation analogue est opposée à Mme Odile Marécaux qui sollicitait une nouvelle expertise psychologique de ses enfants. Il y est, en particulier, précisé que l'expert - il s'agit de Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart - « a parfaitement et précisément répondu aux questions posées par le magistrat instructeur ; qu'il n'existe en l'état aucune raison de mettre en doute l'objectivité de l'expert psychologue ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme Odile Marécaux, l'expert a parfaitement respecté dans le cadre de sa mission le principe de présomption d'innocence ; qu'en aucune manière elle ne s'est prononcée sur la culpabilité des personnes mises en examen mais s'est bornée, comme le veut la loi, à apporter son concours à la justice sur des questions d'ordre technique de sa compétence, à savoir la psychologie infantile »221. Dans ce cas, il était reproché à l'expert d'avoir, au cours de son examen, présenté le père de l'enfant comme étant son agresseur. L'argumentation montre, là aussi, combien le magistrat instructeur est le seul juge de l'objectivité d'un expert qui, par ailleurs, a été nommé par lui. Il est refusé, de fait, de soumettre à contrôle les techniques interprétatives utilisées par la psychologue. La demande de contre-expertise ayant été rejetée, Mme Odile Marécaux n'a pas eu les moyens que soit suggéré aux magistrats un autre regard sur la situation de sa famille. 3. Un mécanisme procédural peu favorable à la défense La demande déjà mentionnée de Mme Sandrine Lavier était formulée comme une demande d'expertise mais s'est vu opposer les délais de l'article 167 du code de procédure pénale sur la base de l'argumentation suivante : « Attendu que Madame Sandrine Lavier sollicite une nouvelle expertise psychologique ; qu'elle demande à être expertisée par Monsieur Leprêtre ; qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'il n'appartient pas aux personnes mises en examen de choisir les experts qui vont les examiner ; que cette décision appartient au magistrat instructeur ; que si l'avocat précise qu'il s'agit d'une nouvelle expertise psychologique, la demande doit nécessairement s'analyser comme une demande de contre-expertise psychologique ; que l'expertise de Madame Sandrine Lavier lui a été notifiée le 25 mars 2002 avec un délai de 10 jours pour présenter des observations ou des demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que la nouvelle demande d'expertise psychologique est présentée hors du délai de 10 jours qui avait été fixé le 25 mars 2002 ; qu'il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de la demande d'expertise psychologique présentée par Me Lescène. »222 La demande du conseil de Mme Sandrine Lavier était motivée par le constat qu'il y avait une contradiction manifeste entre les conclusions des experts psychiatres et celles de l'expert psychologue concernant les traits d'abuseurs sexuels qu'aurait possédés sa cliente. L'expertise psychiatrique ayant été versée au dossier plusieurs semaines après la notification des conclusions du psychologue, cette contradiction n'avait pu être relevée par l'avocat que bien après les délais de demande de contre-expertise. Formulée comme une demande d'expertise par le conseil de Mme Sandrine Lavier, elle est analysée par le juge d'instruction comme une demande de contre-expertise et appréciée par lui en fonction des délais stricts de l'article 167. Les contradictions entre les experts étaient le signe manifeste que les conclusions des expertises devaient être utilisées avec la plus grande circonspection. L'application mécanique des dispositions légales relatives aux demandes de contre-expertise a permis d'éviter toute interrogation et de cristalliser le dossier judiciaire. Il convient de souligner que la loi précitée du 9 mars 2004 a précisé les critères de demande de contre-expertise et de nouvelle expertise. Le texte dispose dorénavant que l'application des délais de l'article 167 du code de procédure pénale se fait « sous réserve de la survenance d'un élément nouveau ». L'évolution du dossier est désormais mieux prise en compte dans la procédure de demande d'expertise. 4. Des retards de procédure préjudiciables aux droits de la défense Les expertises réalisées courant 2001, tant des enfants que des adultes, ont été communiquées aux parties plusieurs mois après les dépôts des rapports, entre mars et juin 2002. Par exemple, les expertises psychologiques et psychiatriques de Mme Myriam Badaoui ont été notifiées toutes deux le 25 mars 2002, alors que la première avait été déposée le 11 avril 2001 et la seconde le 9 mai de la même année. Ces notifications très tardives ont doublement pénalisé la défense. D'une part, pendant une durée importante de l'instruction, les avocats des parties n'ont pas eu connaissance que les rapports d'expertise figuraient au dossier judiciaire. D'autre part, les notifications ayant été faites dans une phase où l'instruction s'achevait, le magistrat instructeur était naturellement peu enclin à accepter des demandes de contre-expertise qui auraient pu repousser la fin de la procédure. Le souhait de rendre un « dossier clair » à M. Lacombe pour le mois de juillet 2002, comme en a témoigné M. Emirzé223, a ainsi amené le magistrat instructeur à privilégier les intérêts de gestion du dossier judiciaire. Si la défense n'a pu exercer pleinement ses droits à propos des expertises, on constate plus généralement qu'elle n'a pu remplir entièrement son rôle dans cette affaire. V. L'EXERCICE ENTRAVÉ DES DROITS DE LA DÉFENSE « L'avocat n'est pas le bienvenu dans la procédure pénale française. Il est un intrus. Il y a d'abord des raisons humaines à cela : l'avocat, c'est celui qui vient vous apporter la contradiction qui, par nature, est insupportable. Le grand juge est celui qui accepte d'entendre autre chose que sa propre conviction » a déclaré avec force Me Eric Dupont-Moretti224 aux membres de la commission d'enquête. Bien évidemment, ces propos excèdent par leur portée la seule affaire d'Outreau, mais certains ont vu en celle-ci un concentré, voire la « caricature »225 , des difficultés auxquelles est confronté l'exercice du droit fondamental reconnu à tout accusé d'être défendu par le conseil de son choix. À cet égard, nombre d'avocats ont souligné qu'ils étaient considérés comme des « auxiliaires » de justice, l'auxiliaire étant défini par le dictionnaire Robert comme celui « qui est utilisé en second lieu, à titre de secours ». Les avocats sont-ils donc systématiquement réduits à cette place et à ce rôle secondaires ? Notre procédure est-elle véritablement contradictoire et équitable ? Cette affaire recèle-t-elle « tous les dysfonctionnements ordinaires d'une justice ordinaire » comme l'a soutenu Me Stéphane Dhonte226 ? D'aucuns pourraient objecter, à ce stade, que la cour d'assises est exclue de cet examen. À ceux-là il convient de répondre que, par son caractère oral et contradictoire, la cour d'assises a, dans cette affaire, parfaitement rempli sa mission et, s'il a existé un moment judiciaire où l'examen objectif, rationnel et méthodique des faits et des preuves a eu toute sa place, ce fut bien celui-ci. Certes, comme l'a indiqué le procureur de la République M. Gérald Lesigne, « l'audience est un moment de vérité » mais il est aisé d'objecter, à l'instar de Me Philippe Lescène, qu'« il est gênant que tout ce qui a été accompli en audience publique ait été demandé et refusé durant l'instruction »227. Dans ces conditions, on se concentrera sur le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction. A. DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION Les difficultés rencontrées par la défense devant le juge d'instruction se sont vérifiées en garde à vue, dans les conditions d'accès au dossier et dans les dysfonctionnements du barreau local. 1. Au cours de la garde à vue sur commission rogatoire Comme le prévoit l'article 81 du code de procédure pénale, si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire (OPJ), afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires. Dans ce cadre, les OPJ peuvent, par exemple, procéder à des perquisitions, à des interrogatoires, le cas échéant dans le cadre même de la garde à vue. Toutefois, l'article 152 du même code dispose que les OPJ, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, ne peuvent procéder à l'interrogatoire d'une personne mise en examen. Cette disposition s'explique par le fait que lorsqu'une personne mise en examen est entendue par le juge, elle doit être assistée par son avocat, ce qui n'est pas le cas devant les OPJ, en particulier dans le cadre de la garde à vue. En effet, à la différence de l'avocat intervenant dans le cadre d'une information judiciaire, son confrère dans le cadre d'une garde à vue n'a pas accès au dossier de la procédure, n'assiste pas aux interrogatoires de son client et ne peut s'entretenir avec lui que pendant une durée ne pouvant excéder trente minutes, comme le précise l'article 63-4 du même code. Cette restriction au pouvoir des OPJ prévue par l'article 152 est donc protectrice des droits de la défense. Cette protection est renforcée par la disposition de l'article 105 du code de procédure pénale, qui prohibe « la mise en examen tardive », à savoir l'audition en tant que témoin, tant par le juge que par les OPJ, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des « indices graves et concordants » d'avoir participé aux faits. Là encore, cette disposition tend à préserver les droits de la défense de la personne mise en cause, puisque la référence aux « indices graves et concordants » est celle de la mise en examen de la personne, qui a pour conséquence immédiate la présence d'un avocat aux interrogatoires et l'accès au dossier de la procédure. L'inobservation de cette disposition est susceptible de constituer une cause de nullité de la procédure, puisqu'elle a pour effet « de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » comme le prévoit l'article 802 du même code. Le rappel de ces dispositions fait apparaître ce que devraient être, aux yeux du législateur, l'organisation de l'enquête et la répartition des rôles entre les policiers œuvrant dans le cadre d'une commission rogatoire et le juge mandant : aux policiers revient le soin de réaliser le premier travail d'enquête dans le cadre imparti par le juge, de tenter d'identifier les circonstances, les éventuels témoins, auteurs ou complices des faits et de présenter le résultat de leurs investigations au juge. À ce dernier échoit la mission, difficile, d'en évaluer la solidité, de décider de la suite procédurale à leur donner, le cas échéant sous la forme d'une mise en examen d'une personne si l'enquête a révélé des « indices graves et concordants » à son encontre. En revanche, ne saurait être considérée comme une bonne pratique, respectueuse des droits de la défense, l'audition par des OPJ, y compris dans le cadre de la garde à vue, d'une personne à l'encontre de laquelle le juge croit d'ores et déjà posséder des indices graves et concordants qu'il souhaite faire vérifier par les policiers dans ce cadre précis, et non directement devant lui lors d'un interrogatoire en la présence de l'avocat de la personne. Or, dans l'affaire d'Outreau, il semblerait que ces bonnes pratiques n'aient pas toujours été observées, le cas de M. Legrand père en constituant une éclairante illustration. a) Le cas de M. Daniel Legrand père : une mise en examen tardive ? Placé en garde à vue le 14 novembre 2001, M. Daniel Legrand père fut interrogé à trois reprises au cours de cette mesure qui fit l'objet d'une prolongation. Lors de la première déposition devant les OPJ, il fut notamment demandé à M. Legrand s'il connaissait M. Thierry Delay, s'il avait un domicile en Belgique, si l'une des personnes de sa famille travaillait ou avait travaillé dans un sex-shop228, ce à quoi l'intéressé répondit par la négative. La seconde déposition de M. Daniel Legrand père est plus instructive car elle fait clairement apparaître que les questions des OPJ se fondèrent directement sur des éléments du dossier communiqués par le juge et présentés comme étant avérés, ce qu'ils n'étaient pas. Ainsi, les policiers débutèrent leur interrogatoire229 en indiquant que Mlle Aurélie Grenon, « lors d'un interrogatoire en date du 18 septembre 2001, déclare que vous avez participé aux viols sur mineurs et que vous l'avez menacée, elle déclare également que vous étiez en compagnie d'une personne étant probablement votre fils. Qu'avez-vous à dire à tout cela ? Réponse : J'ai à vous dire que tout ce que dit cette femme est faux et en plus je tiens à dire que je ne sors jamais avec mon fils. Je ne comprends pas pourquoi cette femme que je ne connais pas m'accuse ainsi. Question : Lorsque Mlle Grenon déclare dans ce même interrogatoire que vous étiez avec Thierry Delay l'instigateur des faits et que vous l'aviez menacé de mort si elle parlait. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Réponse : C'est faux, je ne connais pas cette fille, je ne comprends pas. » L'interrogatoire se poursuit mais change « d'accusatrice » en citant désormais Mme Myriam Badaoui. Il est ainsi écrit que, « lors d'un interrogatoire fait en date du 27 août 2001 par le même juge d'instruction, dans le cadre de cette affaire de pédophilie, Mme Myriam Badaoui épouse Delay déclarait qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises en Belgique dans une maison particulière avec des enfants et qu'il lui arrivait de transporter des cassettes vidéo avec des scènes pédophiles. Ces enfants étaient emmenés dans cette maison pour y subir des scènes de viols. Elle dit que cette maison vous appartient. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Réponse : Je vous réponds que je ne suis ni propriétaire, ni locataire d'une maison en Belgique, et personne de ma famille ou de mes connaissances ne me prête une telle maison. Cette femme est une menteuse. Question : Pourtant dans cet interrogatoire Mme Delay nous décrit avec précision cette maison, cette dernière ayant pu être localisée par la suite. Qu'en pensez-vous ? » Dans de précédents développements a été souligné le caractère très orienté de nombre de questions du juge d'instruction. Force est de constater à la lecture des PV d'interrogatoire de garde à vue qu'il n'eut pas le monopole de cette pratique. En effet, à ce stade de l'enquête, la « piste belge » souffrait cruellement d'éléments probants. Affirmer que la maison où avaient prétendument lieu les scènes de viol des enfants avait d'ores et déjà été localisée était donc hasardeux, voire infondé. L'ensemble de l'audition par les policiers de M. Daniel Legrand père est structuré sur ce modèle opposant une accusation directement issue des actes du juge d'instruction et les dénégations du mis en cause. À l'issue de sa garde à vue, et sans que d'autres éléments soient apportés par l'enquête policière, M. Daniel Legrand père fut présenté au juge d'instruction qui le mit en examen et obtint du JLD son placement en détention provisoire. Au vu de ce qui précède, il n'est pas certain que l'esprit de l'article 105 ait été pleinement respecté, puisque les policiers procédèrent à un interrogatoire sur le fondement de documents provenant du juge d'instruction et à l'endroit d'une personne à l'encontre de laquelle le juge semblait persuadé de détenir d'ores et déjà des indices graves et concordants car il la mit en examen immédiatement après sa garde à vue qui n'apporta aucun élément nouveau. Comme l'a déploré Me Éric Dupont-Moretti lors de son audition : « le juge d'instruction est celui qui délivre des commissions rogatoires, [...] qui délègue ses pouvoirs à la police. Finalement, on donne à la police des armes, notamment les écoutes téléphoniques, qui lui sont interdites par destination. L'une des dispositions essentielles était l'article 105 du code de procédure pénale qui interdit aux policiers d'entendre, dans le cadre d'une commission rogatoire, des gens sur qui pèsent des indices graves et concordants de culpabilité. Or, il a été vidé de son sens par la chambre criminelle de la Cour de cassation et vous ne trouverez aucune atteinte à l'article 105. De sorte que quelqu'un qui est soupçonné et contre lequel il existe des indices graves et concordants de culpabilité peut être placé en garde à vue et entendu par les officiers de police judiciaire, sans qu'aucun avocat n'intervienne, alors qu'il devrait être mis en examen pour que l'avocat intervienne immédiatement, prenne connaissance du dossier et élabore avec lui une défense digne de ce nom. » Par ailleurs, ces extraits de PV de garde à vue illustrent l'étroitesse du suivi de l'enquête par le juge d'instruction et la précision des consignes qu'il donnait aux enquêteurs, ce qui a pu paraître comme contraire aux habitudes de travail des policiers et nuire à leur capacité d'initiative. Le témoignage du capitaine de police Wallet230 devant la commission fut, sur ce point, particulièrement instructif : « M. le Rapporteur : Ma question est simple : ces personnes ont-elles été interpellées au regard de vos investigations ou bien sur instruction du juge ? M. Didier Wallet : Oui. M. le Rapporteur : C'est-à-dire ? M. Didier Wallet : Nous avons identifié ces personnes à la fin de l'enquête préliminaire. M. le Président : Les avez-vous identifiées vous-mêmes, ou est-ce le juge qui vous a demandé de les interpeller ? M. Alain Marsaud : Travailliez-vous dans le cadre d'une commission rogatoire générale ou bien le juge vous avait-il donné des noms de personnes à interpeller ? M. le Rapporteur : Le juge vous a-t-il demandé d'interpeller ces personnes ou l'avez-vous fait de votre propre chef ? M. Didier Wallet : C'est le juge qui me l'a demandé. M. Jean-Yves Le Bouillonnec : Nous ne pouvons aller plus loin tant que ce point n'est pas clair ! M. le Rapporteur : Rencontriez-vous le juge au fil de l'exercice de cette commission rogatoire ? Aviez-vous des entretiens de mise au point ? Receviez-vous des instructions verbales ? M. Didier Wallet : Nous recevions des instructions verbales par téléphone et, par la suite, nous avons eu des entretiens avec le SRPJ. M. le Rapporteur : D'accord mais, pendant cette phase de commission rogatoire confiée à vos services, quelle était la nature de vos relations avec le juge ? M. Didier Wallet : D'autres noms d'adultes sont apparus au niveau du cabinet du juge. M. le Rapporteur : C'est donc non pas à la suite de vos investigations mais sur demande expresse du juge, à raison d'indications obtenues dans le cadre de ses auditions, que vous avez procédé aux interpellations. M. Didier Wallet : Oui. D'autres noms sont apparus de la sorte par la suite, notamment Brunet et Duchochois. Le juge nous transmettait les auditions auxquelles il avait procédé dans son cabinet et nous demandait de recueillir des photos afin de les présenter aux enfants. [...] M. le Rapporteur : Quelle était la nature de vos relations avec le juge : vous donnait-il la marche à suivre ou lui faisiez-vous part de vos découvertes ? Si vous ne vous souvenez plus de rien, c'est tout de même embêtant. M. Didier Wallet : Il nous donnait la marche à suivre. M. le Rapporteur : Dans le cadre de cette commission rogatoire, aviez-vous moins de marges de manœuvre que dans d'autres ? M. Didier Wallet : Oui. Les noms de beaucoup de personnes mises en cause sont apparus dans son cabinet et il m'a ensuite demandé de les interpeller. M. le Rapporteur : C'est un peu l'inverse du processus habituel ? M. Didier Wallet : Oui. » Comme l'a rappelé Me Hubert Delarue, « Notre système judiciaire est marqué par le poids du secret mais aussi par le poids de l'aveu »231. En dépit du développement de la police scientifique et technique, des méthodes d'analyse faisant, notamment, appel à l'ADN, notre procédure reconnaît toujours à l'aveu, ancienne « reine des preuves », une valeur probante particulière. Cette situation prévaut d'autant plus aisément qu'un grand nombre d'affaires, dont celles d'Outreau, ont souffert d'un défaut d'indices matériels permettant de constater puis d'imputer les faits. Dans ces conditions, la manifestation de la vérité va nécessiter l'exercice d'une « pression » psychologique à l'encontre de la personne mise en cause, afin que les enquêteurs soient en mesure de discerner si elle est étrangère aux faits commis ou pas. La nature de cette pression a parfaitement été théorisée, dès 1947, par le commissaire Louis Lambert232, professeur à l'école nationale de police : « Il faut bien reconnaître qu'il existe un degré inférieur de torture qui ne tombe pas sous le coup de la loi, qui ne vicie même pas la procédure et qui aide grandement l'officier de police dans son interrogatoire du criminel : n'est-ce pas une forme de torture que l'interrogatoire qui se prolonge des heures et des heures, et où des policiers se relaient jusque dans la nuit pour profiter de l'épuisement intellectuel de l'adversaire, finalement acculé au vertige mental dont procède l'aveu ? Torture licite pourtant, car le code n'a nulle part fixé la durée des interrogatoires : c'est au criminel d'abréger lui-même sa torture morale en disant au plus tôt la vérité. Torture encore, et même torture physique, pourtant nullement prohibée que d'avoir à demeurer assis sur une chaise un jour entier, puis une nuit, et davantage encore : facteur d'aveu... Tortures aussi et tortures physiques que la faim de l'interrogé, que les circonstances empêchent de se satisfaire comme à l'accoutumée, son sommeil que nous lui refusons, son besoin de fumer que nous méconnaissons : toutes tortures licites, toutes facteurs d'aveu. » Les pratiques ont-elles évolué depuis lors ? Certains avocats, à l'instar de Me Éric Dupont-Moretti, n'ont pas hésité à le contester. Le témoignage de M. Alain Marécaux devant la commission montre que ces pratiques sont encore courantes233 : « Après les perquisitions arrive la garde à vue. Eh bien, je vous prie de croire qu'une garde à vue comme celle-là, je ne la souhaite à personne. J'étais enfermé dans une geôle. Qu'est-ce qu'une geôle ? C'est une pièce sans fenêtre, avec un banc de pierre, un néon blafard qui n'est jamais éteint, et deux couvertures malodorantes pour vous permettre d'avoir un peu de chaleur. Les conditions de détention sont effroyables. La garde à vue l'est tout autant. Le policier qui m'interroge utilisera trois méthodes. Première méthode : les injures. Je suis assis, menotté, accroché au sol. Je souffre d'un problème de dos. J'ai deux vertèbres qui se décollent. J'en fais part au policier qui m'interroge. J'ai même demandé, le lendemain, à être vu par un médecin, comme la loi m'y autorisait. La réponse du policier fut : « Tu commences à nous emmerder avec tes problèmes. Tu veux des médicaments, tu en auras. » Voilà la première méthode policière. C'est la violence, pour m'arracher des aveux. Je suis soumis à la question. Il faut qu'ils aient des aveux. Je suis coupable. Jamais il n'y a eu de présomption d'innocence dans ce dossier. La deuxième méthode, c'est le deal. Le policier qui est devant moi me dit que l'avocat ne sert à rien, que le meilleur avocat, c'est lui, et que si je reconnais tous les faits, ma femme et mes enfants seront libérés dans l'instant qui suit. Je vous prie de croire que quand vous avez devant vous un flic qui vous propose cela, quand vous vous dites que vous êtes embarqué dans une histoire grotesque, qu'une machine s'est mise en route, vous vous demandez si vous ne pourriez pas sauver votre femme et vos enfants. Mais je n'ai pas plié. Et là, nouveau flot d'injures, parce que je refuse d'avouer. La troisième méthode, c'est la méthode gentille. "Allez, avoue, et puis c'est tout. Ça va te faire du bien." Bien sûr le vouvoiement n'est pas de mise, le "monsieur" disparaît du discours des policiers. C'est "Marécaux, tu..." pendant 48 heures. » Or, c'est pendant la garde à vue que se scelle le procès pénal. En effet, lorsque des aveux sont obtenus en garde à vue, il sera particulièrement difficile pour le prévenu de revenir dessus, ses déclarations, investies de l'autorité que confère un document ayant la forme d'un procès-verbal, l'accompagnant jusqu'à l'audience de jugement. Pour autant, les dangers d'une pression psychologique excessive sont bien connus : faire « céder » une personne innocente en la conduisant à reconnaître des faits qu'elle n'a pas commis. Notre histoire judiciaire est riche d'exemples en la matière, que l'on songe à l'affaire « Dickinson », du nom de cette jeune Anglaise assassinée, dans le cadre de laquelle le principal suspect, qui avait reconnu de façon circonstanciée les faits, fut néanmoins mis hors de cause grâce à un examen d'ADN. Ce risque « d'aveu artificiel » est d'autant plus élevé que la personne placée en garde à vue est peu rompue aux usages policiers et à la procédure pénale. Comme l'a clairement indiqué le juge David de Pas : « La garde à vue [...] est devenue une phase de pressions psychologiques exercées au moment de l'interpellation, dans le processus d'isolement de l'individu et surtout par le fait que le mis en cause ignore tout de l'étendue et de la réalité des charges qui pèsent sur lui. Ce système assez vieillot est générateur d'inégalités puisque les personnes les plus fragiles sont les moins protégées. [...] La retranscription des propos du gardé à vue relève du pouvoir souverain de l'enquêteur. Or, les termes délicatement agencés sur le procès-verbal sont parfois en décalage saisissant par rapport au vocabulaire réel de la personne mise en cause. Lorsqu'il ne concerne que la forme, par exemple l'emploi d'un synonyme, ce décalage n'entraîne pas de sérieuses conséquences ; mais, lorsqu'il intéresse le fond, le sens du propos, il peut occasionner de réelles difficultés. D'autant que, par lassitude, épuisement, confiance vis-à-vis de l'enquêteur voire illettrisme, le gardé à vue ne lit en réalité que très rarement ce qui a été formulé à l'écrit. Cette difficulté est à prendre d'autant plus en considération que le contenu du procès-verbal de garde à vue poursuit le mis en cause tout au long du processus pénal, devant le juge d'instruction, auprès des experts et, le cas échéant, à l'audience. Il sera très difficile pour l'intéressé de modifier ou d'affiner son propos. Et le mis en cause ne peut même pas se réfugier derrière un refus de signer : dans cette hypothèse, le procès-verbal conserve une certaine puissance accusatrice, scellant le mauvais état d'esprit du réfractaire. Si les modalités du recueil de la parole ne sont pas modifiées, une inégalité des chances perdurera face aux interrogatoires policiers. Plus le mis en cause est suggestible ou fragile, plus il est novice dans ce rapport de force, plus il risque de tenir des propos dont il pense qu'ils vont satisfaire l'enquêteur, mais qui éloigneront la justice de la vérité. Le délinquant chevronné supportera beaucoup mieux la pression et sera beaucoup moins sensible aux effets de voix des enquêteurs. C'est tellement vrai que, pour les individus les plus rompus à la garde à vue, des régimes dérogatoires au droit commun ont été créés Chacun a pleinement conscience qu'il convient de ne pas faire preuve d'angélisme en matière de lutte contre la criminalité et que l'efficacité des enquêtes policières requiert l'exercice de pression psychologique, à défaut de quoi, le criminel demeurerait impuni et la victime ignorée. Toutefois, l'extorsion d'aveux à tout prix fragilise la solidité des procédures et le caractère équitable du procès pénal. C'est la raison pour laquelle, la commission plaide en faveur du renforcement des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. En effet, les modalités actuelles, qui autorisent l'avocat à intervenir au début de la garde à vue, mais sans avoir accès au dossier ni pouvoir assister aux interrogatoires ont été unanimement dénoncées par les avocats. Me Jean-Louis Pelletier est même allé jusqu'à les qualifier de « pantalonnade. Nous sommes des visiteurs de gardés à vue, avec, en outre, l'obligation de ne rien dire à personne de ce que nous venons de voir et de ce que nous venons d'entendre. Nous n'avons même pas le droit de dire à la famille que nous avons rendu visite au fils, au frère, etc. Au sens de la loi, nous n'avons même pas le droit de dire comment va la personne en question et ce qui lui est reproché. »235 Par ailleurs, l'amélioration des conditions matérielles des gardes à vue doit être considérée comme une priorité. En effet, les conditions décrites par M. Alain Marécaux sont indignes pour la personne faisant l'objet de la mesure, mais rejaillissent aussi sur les fonctionnaires de police qui se voient contraints d'exercer quotidiennement leurs fonctions difficiles dans des conditions déplorables. 2. Un accès au dossier difficile Si les méthodes et les conditions des gardes à vue dans cette affaire furent critiquables, l'accès au dossier s'est également heurté à de nombreux obstacles. Ces difficultés ont tenu au fonctionnement du greffe ainsi qu'aux relations prévalant entre le magistrat instructeur et le barreau. Afin de permettre à la défense de la personne mise en examen d'exercer pleinement sa mission, l'article 114 du code de procédure pénale prévoit, d'une part, que la procédure est mise à la disposition des avocats des parties quatre jours ouvrables au plus tard avant une confrontation ou un interrogatoire et, d'autre part, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables et « sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ». En outre, ce même article prévoit que les avocats peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Matériellement, il appartient au greffier du cabinet d'instruction d'effectuer les copies requises par les avocats. On le voit, l'exercice de la défense s'organise donc autour de deux droits : celui de consulter sur place le dossier et celui d'en obtenir une copie. Or, dans le cadre de l'affaire d'Outreau, la mise en œuvre de ces droits s'est heurtée à de sérieux obstacles qui tiennent à l'insuffisance des moyens accordés à notre justice. Ainsi, selon un document remis à la commission par les greffiers du TGI de Boulogne à l'occasion de leur audition, il apparaît que 6 835 actes ont été cotés dans le dossier d'Outreau, la pagination d'un document pouvant varier de deux pages à plus de 40 pour certains. Or, le greffe a dû procéder à la reprographie de 28 exemplaires du dossier qui se répartissent comme suit : un par avocat intervenant dans le dossier, un double conforme auquel s'ajoute la copie pour la chambre de l'instruction ainsi que celle à destination des magistrats ayant eu à connaître de l'affaire. De surcroît, si l'on suppose que chaque document reproduit comprend, en moyenne, cinq pages, ce qui est vraisemblable, il en résulterait que le greffe aurait eu à réaliser près de 957 000 copies !236 Face à une telle quantité de travail, les effectifs et les moyens dévolus au greffe étaient notoirement insuffisants. Ainsi, selon cette même source, il apparaît que le service techniquement en charge de la reprographie n'était pourvu, au moment de l'instruction, que d'un fonctionnaire qui exerçait ses fonctions à mi-temps. Certes, un poste d'agent des services techniques avait été budgétairement créé en 2000, mais il est demeuré vacant pendant trois années et n'a été pourvu qu'en 2003, alors même que cette instruction hors norme était clôturée. Par ailleurs, l'année 2001, date du début de l'information judiciaire menée par le juge Burgaud est également celle de la mise en place du juge des libertés et de la détention institué par la loi du 15 juin 2000. Cette nouvelle fonction a absorbé une partie importante des services des greffes en raison du nombre croissant des saisines de ce juge, qui sont passées de près de 500 en 2001 à plus de 800 en 2003 en ce qui concerne le contentieux de la détention, et, pour ces mêmes dates, de 1 633 à 3 527 dossiers en matière de contentieux des étrangers en situation irrégulière. Confrontés à cette brutale augmentation de leur charge de travail, les services du greffe n'ont reçu aucun moyen supplémentaire jusqu'en 2003, date à laquelle trois postes de greffiers supplémentaires ont été créés, quatre de plus l'ayant été depuis lors. En dépit de cette création de sept emplois depuis 2003, qui a porté le nombre total de postes de greffiers à 62 fonctionnaires, l'effectif réel demeure inférieur à l'effectif budgétaire en raison des vacances de postes et des emplois à temps partiel. La conjonction d'un dossier hors norme et de l'insuffisance des moyens de reprographie et de greffe a favorisé un retard dans la délivrance des copies. Ainsi, Me Julien Delarue dut-il patienter sept mois pour obtenir la copie des pièces dont il avait sollicité la reproduction237. Pour sa part, Me Aurélie Deswarte238, collaboratrice de Me Frank Berton, a témoigné dans les termes suivants des difficultés rencontrées par les avocats pour obtenir copie du dossier : « Nous avons eu des difficultés à accéder à la procédure. Nous n'avons pas disposé immédiatement de la copie de la procédure. [...] La première copie qu'on ait pu emmener au cabinet, en janvier 2002, était partielle - de la cote D 300 à la cote D 800. Ainsi, nous n'avions pas la première partie de la procédure, alors que nous avions besoin de comprendre comment Mme Marécaux avait été parachutée dans ce dossier et comment ce dossier avait été monté. Il a fallu attendre le 8 mars 2002 pour récupérer cette première partie. Il nous a fallu faire des déplacements réguliers, dans la mesure où nous avions choisi de faire un certain nombre de demandes d'actes afin d'éclaircir certains points. Nous avions besoin de connaître les dernières évolutions du dossier, d'autant que les interrogatoires étaient assez nombreux. J'ai donc fait des allers et retours entre Lille et Boulogne-sur-Mer, soit 300 km, tous les quinze jours ou trois semaines. On peut comprendre qu'on n'ait pas toujours des copies intégrales à disposition, surtout en cas de dossiers aussi volumineux. Mais on ne peut pas comprendre que, lorsqu'on prévient de son arrivée, on n'ait pas d'accès direct à l'original de la procédure. Quand le magistrat construit son dossier, il y a la procédure originale, qui comprend les procès-verbaux signés par les protagonistes, et il y a plusieurs copies : une pour la chambre de l'instruction, une qui est mise à la disposition des avocats. La copie mise à la disposition des avocats n'était pas régulièrement mise à jour. Nous ne pouvions avoir accès à l'original que lorsque le magistrat instructeur était dans son cabinet. C'est ainsi que Me Tery, un autre collaborateur de Me Berton, qui avait profité d'un déplacement à Boulogne-sur-Mer pour venir prendre connaissance de l'évolution du dossier, s'était entendu répondre : « désolé, j'ai pour instruction de ne pas communiquer le dossier lorsque le magistrat instructeur n'est pas là ». Me Tery s'en était offusqué par courrier. Généralement, lorsqu'ils savent que l'on exerce loin de l'endroit où le dossier est instruit, les magistrats instructeurs facilitent notre accès à la procédure. M. le Rapporteur : S'agissant de la copie, les problèmes de retard sont-ils liés, selon vous, à un manque matériel de moyens ou à une mauvaise volonté quelconque ? Me Aurélie Deswarte : Il s'agissait de problèmes purement matériels. » Comme s'en est ému Me Hubert Delarue : « L'instruction s'est déroulée dans des conditions caractérisées par l'absence de moyens. Notre justice est indigente. Elle devrait au moins se hisser au niveau moyen de ce qui se fait en Europe. Nous ne demandons pas plus. Les juges travaillent dans des conditions déplorables, de même que nous avons travaillé dans des conditions infernales. On ne pouvait pas obtenir ce dossier parce qu'il n'y avait pas de photocopieuses, ou parce que la photocopieuse était en panne. Mais où sommes-nous ? Dans une république bananière ? Il s'agit de savoir, Mesdames, Messieurs les députés, quels moyens vous souhaitez donner à notre justice. »239 Certes, notre justice ne bénéficie pas encore de moyens suffisants en dépit des efforts consentis depuis 2002, mais ces délais de reprographie tiennent également à des méthodes de travail inadaptées. En effet, à l'heure du numérique, il serait opportun de prévoir la duplication des pièces sur support informatique et non sur support papier, ce qui aurait le triple avantage de la rapidité, de l'économie en termes de consommation de papier et d'emploi, et de la sécurité juridique, puisqu'il existe désormais des moyens de s'assurer de l'authenticité d'un document numérisé, à l'instar des dispositifs de signature électronique ou encore de la transformation du document dans un format insusceptible de modification. Comme l'observe un rapport de l'institut Montaigne240 , l'informatisation de la Justice est un moyen qui peut résoudre nombre des difficultés de gestion, telle que la lenteur des processus. Les auteurs de ce rapport estiment qu'il « reste une forte marge de gains d'efficacité, voire de productivité, dans le domaine de l'informatisation de la justice » même si, dans nombre de cas, « les équipements sont souvent anciens, les formations insuffisantes, les outils inadaptés, [...] des logiciels résultant parfois de constructions personnelles d'agents de certains tribunaux ». b) Des relations complexes entre le juge et les avocats Confrontés à la difficulté d'obtenir des copies dans des délais raisonnables, certains avocats ont tenté d'en prendre connaissance sur place, auprès du greffier du cabinet du juge d'instruction avec, là encore, des fortunes diverses. Ainsi Me Pascale Pouille-Deldicque a indiqué, qu'étant du barreau de Boulogne-sur-mer, elle n'avait « pas eu de difficulté pour consulter ce dossier, puisque mon cabinet se trouve près du tribunal. Mais je peux comprendre que mes confrères soient embarrassés de devoir assister à une instruction sans avoir la copie du dossier. Il n'est pas rare, même dans d'autres dossiers, que nous n'ayons pas la copie du dossier dans les délais. Il y a des problèmes de maintenance. Nous sommes parfois amenés à faire nous-mêmes nos propres photocopies. Ce n'est pas normal. » Les obstacles les plus sérieux en matière de consultation du dossier ont donc été rencontrés par les avocats n'appartenant pas au barreau de Boulogne, à l'instar de Me Aurélie Deswarte, collaboratrice de Me Frank Berton du barreau de Lille, dont le témoignage fournit des éléments précieux sur le climat ayant pu présider aux relations entre les avocats et le juge dans cette affaire : « Il m'est arrivé de venir deux jours de suite pour prendre connaissance des modifications du dossier, à la suite de plusieurs commissions rogatoires. Comme nous passions prochainement devant la chambre de l'instruction et que nous nous attendions, cette fois encore, à constater des incohérences dans le dossier, j'avais besoin d'avoir une connaissance complète des nouvelles pièces. Le deuxième jour, le greffier du juge d'instruction m'a apporté ma copie de procédure, en me précisant que je pouvais l'emmener au cabinet ; le magistrat était d'ailleurs présent. Alors que je consultais le dossier original dans le couloir, le greffier m'a demandé de rendre cette copie. Comme je ne comprenais pas, je suis allée voir le magistrat instructeur qui m'a déclaré que ce n'était pas ma copie et qu'il avait autre chose à régler. J'ai ensuite demandé à consulter la suite du dossier original, après que le dernier acte ait eu lieu. Alors qu'il ne me restait plus que 20 cotes à lire, le greffier m'a fait comprendre qu'il souhaitait partir et que je devais également partir. Le magistrat s'étant engagé à ce que je puisse accéder au procès-verbal de confrontation qui avait eu lieu cet après-midi-là, je me suis rendue dans son cabinet. Il m'a dit qu'il avait autre chose à faire, qu'il travaillait, que le greffe était fermé et que si je ne partais pas, il me ferait jeter dehors manu militari. M. le Rapporteur : Avez-vous fait une démarche auprès du bâtonnier local pour de tels propos ? Si oui, comment a-t-il réagi ? Par ailleurs, il me semble que ce problème de dossier s'est posé à tout le monde. Y a-t-il eu une démarche collective de la part des avocats pour mettre les choses au point avec le juge d'instruction ? Me Aurélie Deswarte : J'ai prévenu Me Berton. J'ai réagi face au juge d'instruction. Nous avons prévenu le Premier président de la Cour d'appel et le parquet général. Quelque temps après, une copie nous a été donnée. [...] Je précise qu'on ne pouvait pas avoir accès au magistrat instructeur, qui était enfermé à clé dans son bureau quand je venais consulter le dossier. Il n'y avait aucun moyen de lui faire part de quoi que ce soit. M. le Rapporteur : Concrètement, comment cela se passait-il ? Me Aurélie Deswarte : Les actes avaient lieu dans le bureau de son greffier. Le bureau du greffier était accessible, pas celui du magistrat instructeur, qui s'enfermait à clé. » Pour autant, plusieurs avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer ont, à l'inverse, témoigné de la courtoisie et de l'ouverture du juge d'instruction. Il en fut ainsi de Me Deguines, ancien bâtonnier, qui déclara avoir bien : « connu M. Burgaud, un homme courtois et ouvert, qui n'hésitait pas à recevoir les avocats pour parler. Mais très vite, nous nous sommes aperçus que s'il était accessible, il semblait ne pas écouter ni prendre en compte ce que les avocats lui disaient. » Il n'est pas nécessaire de revenir en détail ici sur les demandes d'actes présentées par les avocats et rejetées par le juge d'instruction, ces aspects ayant été longuement abordés dans les chapitres consacrés aux expertises et à la conduite de l'instruction. D'un simple point de vue statistique, et selon les informations communiquées par la Chancellerie, sur 95 demandes d'actes introduites par les parties, le juge d'instruction en aurait accepté 27, rejeté 41, les 27 restantes ayant été déclarées irrecevables ou étant demeurées sans réponse, parfois parce déjà satisfaites241. Un grand nombre de ces demandes d'actes furent rejetées en septembre 2002 (18 sur les 41 précitées) par le successeur du juge Burgaud, M. Cyril Lacombe. Enfin, il serait inexact de considérer que la dénonciation des relations difficiles, voire tendues, entre le juge d'instruction et les avocats relèverait d'un discours corporatiste de la part des membres de cette profession. En effet, le procureur général près la cour d'appel de Douai au moment de l'affaire d'Outreau, M. Jean-Amédée Lathoud, a reconnu, avec franchise, que les relations entre les magistrats et les avocats étaient « mauvaises ». Ce procureur général a expliqué que « Les magistrats se considéraient trop souvent dans "une forteresse assiégée", craignant incidents et mises en cause personnelles. Les conflits relationnels étaient très nombreux. C'est ainsi que je m'étais efforcé, dans ce climat d'agressivité et d'hostilité, de prendre l'initiative de rencontres entre magistrats et avocats pour apprendre aux interlocuteurs du débat judiciaire à se parler, se connaître, s'écouter, s'estimer. »242 Conjuguée aux difficultés d'accès au dossier, cette tension entre juges et avocats s'est traduite, dans cette affaire, par une demande de dépaysement judiciaire présentée le 8 février 2002 par Mes Frank Berton et Hubert Delarue. Il convient de rappeler que l'article 665 du code de procédure pénale dispose que la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice », ordonner le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre. Lorsqu'une demande en ce sens est présentée par une partie au procès, elle doit soumettre sa requête au procureur général du ressort de la juridiction initialement saisie qui décide, le cas échéant, de la transmettre à la Cour de cassation. En l'espèce, la demande de dépaysement introduite par Mes Frank Berton et Hubert Delarue n'a pas été soumise à la Cour de cassation par le procureur général qui a fait usage de son pouvoir de « filtrage ». Sur le fond, la demande présentée par ces deux avocats s'appuyait sur le quadruple constat suivant : - « des difficultés inhérentes à la communication des pièces de la procédure ». Le mémoire produit par ces avocats souligne que, depuis le 16 novembre 2001, date de l'incarcération des époux Marécaux, ils « ne disposent toujours pas de l'intégralité des pièces de la procédure et ce malgré les demandes réitérées auprès du greffe », cette situation nuisant « manifestement aux droits de la défense [...] et porte atteinte au droit de l'avocat à l'accès au dossier, surabondamment quand les conseils des parties en cause résident pour l'un à Lille, pour l'autre à Amiens » ; - « des difficultés inhérentes à l'obtention d'actes d'instruction complémentaires ». À titre d'illustration, les avocats soulignent que de nombreuses demandes d'actes sont demeurées sans réponse, alors même que des faits nouveaux (le prétendu meurtre de la fillette belge) sont apparus, que les confrontations font apparaître de nombreuses contradictions et revirements nécessitant « sans délai » l'organisation de confrontations séparées ; - « des difficultés inhérentes à l'existence de déclarations contradictoires entre les co-mis en examen ». Les avocats mettent en avant les contradictions de Mme Myriam Badaoui concernant les époux Marécaux, comme la tenue vestimentaire de M. Alain Marécaux, la date de son intervention en tant qu'huissier que Mme Badaoui situe en 1998 alors même que l'unique dossier de son étude concernant les Delay est de 1995/96 etc. Après avoir, sur près de deux pages, recensé ces différentes contradictions, Mes Frank Berton et Hubert Delarue concluaient : « force est de constater, au vu de ces nombreux éléments contradictoires, que des mesures d'investigation et d'instruction supplémentaires s'imposent impérativement dans les plus brefs délais. En l'état la juridiction de Boulogne-sur-Mer ne paraît pas en état de les mettre en œuvre » ; - « des difficultés inhérentes au climat judiciaire délétère et malsain prévalant à Boulogne-sur-Mer ». À ce stade de leur raisonnement, les avocats dénonçaient « une couverture médiatique quasi quotidienne de cette affaire, tant par la radio que par la télévision, qui a pour effet de déchaîner les passions locales, et qui instaure un climat délétère s'illustrant notamment par une volonté générale de la population de vouloir participer maladroitement à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, et surtout, des mises en cause précises et circonstanciées de plusieurs personnes clairement identifiées n'ont encore à ce jour justifié aucune audition ou interpellation. C'est ainsi que plusieurs médecins, infirmiers ou officiers ministériels sont nommément mis en cause par des accusations de même nature que celle ayant justifié la mise en examen de M. Marécaux et de son épouse. Enfin, certaines de ces personnes ont manifesté leur volonté d'être entendues par le juge. Également plusieurs habitants de la commune d'Outreau sont nommément visés pour des faits identiques. Dès lors, il se distille depuis plusieurs mois un climat malsain de suspicion généralisée au sein de la ville de Boulogne et de ses environs, et ce notamment dans les établissements scolaires. De nombreuses violations du secret de l'instruction ont pu être constatées ayant notamment conduit au dépôt d'une plainte auprès du parquet de Boulogne. Davantage, l'égalité des citoyens devant la loi n'est plus respectée. Par conséquent, il est demandé à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai de constater que la bonne administration de la justice est largement compromise par les dysfonctionnements précédemment développés et qu'il convient que l'instruction de ce dossier puisse être délocalisée et confiée à telle juridiction qu'il appartiendra à la chambre criminelle près la Cour de cassation de désigner. » On le voit, cette demande de dépaysement de l'affaire résumait clairement les « dysfonctionnements » en cours, les obstacles auxquels se heurtaient certains avocats ainsi que la pesanteur du climat local. Pourtant, par une lettre datée du 13 février 2002, le procureur général, M. Jean-Amédée Lathoud, rejetait cette demande. Interrogé par votre rapporteur sur les motivations de ce rejet, M. Lathoud déclara devant la commission243 avoir reçu la demande de dépaysement début février 2002 : « Téléphoniquement, je demande au procureur de la République de me faire parvenir des informations précises sur la délivrance des copies de pièces à la défense. Je lui demande également de me dire ce qu'il en est de ces violations du secret de l'instruction et du "climat délétère" invoqués par Mes Berton et Delarue à l'appui de leur demande de dépaysement. Il me répond par un rapport daté du 11 février 2002, que je vous laisserai. Je sais du dossier ce que m'en dit par écrit le procureur de la République. D'autre part, j'indique au Premier président qu'il y a un problème de bon fonctionnement de la justice. Je crois qu'il a dû prendre contact avec le président du tribunal de Boulogne-sur-Mer pour faire en sorte que le greffier en chef veille à ce que les photocopieuses se mettent activement en action. En ce qui concerne la décision, je la motive pour les raisons suivantes. J'indique aux avocats que les moyens matériels nécessaires pour la délivrance des copies de pièces seront mis en œuvre. À l'argument selon lequel le juge d'instruction refuse trop de demandes d'actes, je leur réponds qu'ils doivent saisir le juge comme ils en ont le droit aux termes de l'article 82-1 du code de procédure pénale, et faire appel des refus qui leur seraient opposés. Nous savons que très peu de refus d'actes ont fait l'objet d'appel : six au total. S'agissant des violations du secret de l'instruction, je demande aux avocats si elles sont, selon eux, le fait du juge d'instruction. Ils me répondent que non. Je peux d'ailleurs vous assurer que ni Me Berton ni Me Delarue ne m'ont dit du mal du juge d'instruction. S'il y a bien une décision que je ne regrette pas et que j'assume complètement, c'est bien le refus du dépaysement, qui me paraissait, en fait et droit, largement motivé. J'ajoute que, depuis, je me suis préoccupé auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation des conditions dans lesquelles elle acceptait le dépaysement d'un dossier. J'ai fait faire une analyse des soixante demandes de dépaysement et des décisions qui ont été prises au cours de 2004 et 2005. Quels étaient les motifs pour lesquels la chambre criminelle acceptait le dépaysement ? Dans la grande majorité des cas, il s'agissait de la qualité des personnes mises en cause : magistrats, avocats, fonctionnaires du greffe. Le deuxième motif de dépaysement est l'existence de liens familiaux ou personnels entre les magistrats qui connaissent de la procédure et les personnes mises en cause. Le troisième motif est le fait que plusieurs procédures sont en cours dans plusieurs juridictions et qu'elles doivent être rassemblées. C'est ce que l'on aurait dû faire, par exemple, dans l'affaire dite des disparus de Mourmelon. Il me paraît essentiel de rappeler que c'est le concept de juge naturel qui est la règle en droit français. Il n'appartient pas au procureur de la République, au procureur général ou aux avocats de choisir, en fonction de leurs convenances, le lieu du procès ou le juge. Le juge compétent, c'est le juge naturel, territorialement compétent en fonction du lieu des faits et du lieu du domicile de la personne en cause. Pour toutes ces raisons, je suis persuadé, encore aujourd'hui, que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'aurait pas dépaysé l'affaire. Dans toutes les décisions de dépaysement qu'elle a rendues en 2004 et 2005, aucune n'a été motivée par l'insuffisance des moyens matériels ou de greffe dans la juridiction. » Il convient cependant d'observer que le procureur M. Lesigne n'a pas reconnu avoir réalisé un tel rapport au procureur général et a davantage insisté sur le fait que la demande de dépaysement judiciaire relevait de la seule compétence de ce dernier. En effet, questionné par votre rapporteur pour savoir s'il y avait eu « un débat avec le procureur général » sur cette demande, M. Lesigne répondit244 : « Non. Cette décision appartenait au procureur général. M. le Rapporteur : Pensez-vous qu'il était déjà informé du dossier, qu'il le connaissait, qu'il était en mesure de prendre une décision sans consulter personne ? M. Gérald Lesigne : Le dossier était transmis en temps réel au parquet général, du moins en ce qui concerne ses principaux aspects. Je me rendais d'ailleurs fréquemment au cabinet du magistrat instructeur pour prendre les pièces, notamment les pièces d'audition, aux fins de les transmettre aussitôt au parquet général. M. le Rapporteur : En temps réel, vous aviez les pièces pour les transmettre au parquet général ? N'y a-t-il pas deux poids, deux mesures ? L'accusation est-elle vraiment à égalité avec la défense, sur ce point particulier ? M. Gérald Lesigne : L'accusation était à égalité avec la défense, en ce sens qu'elle non plus ne disposait pas d'une copie du dossier. Elle n'avait qu'un dossier administratif nourri des pièces que nous allions chercher. Le dossier copie a été établi au bénéfice du parquet exactement au même moment qu'il l'a été pour les avocats. Les problèmes étaient liés à des difficultés matérielles. M. le Rapporteur : Donc, pas de contact entre vous et le parquet général au moment du rendu de l'ordonnance du procureur général sur le dépaysement ? M. Gérald Lesigne : Non. C'est une décision du procureur général. Je n'ai pas cherché à l'influencer, de quelque façon que ce soit. D'ailleurs, je ne me suis jamais comporté comme le propriétaire de cette affaire. Dans des dossiers complexes et difficiles, je suis le premier à proposer le dessaisissement de la juridiction. Il n'y avait pas de syndrome d'appropriation, de volonté de conserver un dossier. Certainement pas. » Par conséquent, au vu de l'argumentation étayée développée par le procureur général, il semble vraisemblable que la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait rejeté la demande de dépaysement. Pour autant, cette demande constituait un « signal d'alarme » que les autorités judiciaires locales auraient davantage dû prendre en considération. Comme l'a reconnu M. Jean-Amédée Lathoud, « il nous faut mieux discerner les " signaux d'alerte ". Dans ce dossier dramatique, beaucoup considèrent à juste titre qu'un " diagnostic critique " aurait dû être effectué à plusieurs occasions dans la procédure, pour éviter le désastre qui s'en est suivi ». 3. Les failles dans l'organisation du barreau de Boulogne-sur-Mer Des confrontations et des interrogatoires organisés sans avocat, des implications de la défense pour le moins inégales traduisent ces défaillances du barreau. a) Des confrontations et interrogatoires sans avocat Si les avocats ont rencontré de réelles difficultés dans l'exercice de leur profession, force est également de constater qu'un certain nombre d'actes importants furent pris en leur absence. Comme l'a reconnu Me Éric Dupont-Moretti devant la commission, « il a existé des dysfonctionnements parmi les avocats. Il y en a qui ne sont pas allés voir leur client »245. Sans prétendre à l'exhaustivité, trois illustrations de ces failles de la présence de la défense méritent d'être rappelées. Elles concernent Mme Sandrine Lavier, Mme Myriam Badaoui et M. Thierry Dausque. · Le cas de l'interrogatoire de première comparution de Mme Sandrine Lavier Comme le précise la circulaire du 20 décembre 2000 commentant l'article 116 du code de procédure pénale relatif à la première comparution, « la modification essentielle apportée [par la loi du 15 juin 2000] à l'interrogatoire de première comparution réside dans le fait que ce n'est qu'après avoir entendu la personne et son avocat que le juge d'instruction décide s'il met ou non la personne en examen ». Au vu de cette circulaire, il apparaît donc clairement que l'intention du législateur était de s'assurer de la présence de l'avocat à ce moment décisif de la procédure puisque cet interrogatoire ne concerne que les personnes que le juge d'instruction envisage de mettre en examen comme le prévoit le premier alinéa de l'article 116. En outre, le 4e alinéa du même article prévoit les hypothèses où l'avocat de la personne ne peut être contacté ou ne peut se déplacer. Dans ce cas, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut alors consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix de se taire, de faire des déclarations ou d'être interrogée. Enfin, précise cet article, « l'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat ». Or, le jour où le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de Mme Sandrine Lavier, celle-ci n'était pas assistée d'un avocat. Interrogé par votre rapporteur sur les raisons de cette situation, son avocat a apporté les éléments de réponse suivants246 : « Me Philippe Lescène : J'ai la décision sous les yeux. La personne déclare : "Je demande la présence d'un avocat commis d'office". Me X, avocat de permanence titulaire, informé par les moyens d'un appel téléphonique, est absent. Me Y, avocat de permanence suppléant, ne peut se déplacer. Sandrine Lavier accepte alors d'effectuer des déclarations spontanées et proteste de son innocence. Dans l'esprit de la loi, la présence de l'avocat, à cet instant, est effectivement fondamentale. Que s'est-il passé au barreau de Boulogne ? Je l'ignore. M. le Rapporteur : D'autres accusés sont aussi restés sans défense pendant un certain temps. Me Blandine Lejeune : Il est scandaleux que le juge procède à l'interrogatoire de première comparution, redoutablement important, sans présence d'un avocat. Il existe, au barreau de Lille et ailleurs, un système de coordination pénale très efficace, avec des avocats de permanence, qui, la veille des présentations, en fonction des besoins, appellent des avocats en renfort. À Lille, jamais un tel acte n'aurait lieu sans avocat, quitte à attendre jusqu'à minuit. M. le Rapporteur : Il semblerait donc qu'il y ait un problème d'organisation au barreau de Boulogne. Me Philippe Lescène : Ne faut-il pas envisager l'obligation de la présence d'un avocat ? » Cette absence d'avocat, juridiquement validée par le caractère « spontané » des déclarations de Mme Sandrine Lavier, soulève de sérieuses interrogations quant au respect des droits de la défense dans la procédure. Certes, le juge ne saurait être comptable des dysfonctionnements éventuels du barreau, mais le principe même d'un interrogatoire de première comparution ou d'une confrontation sans la présence d'un avocat devrait être proscrit, à charge pour les barreaux de s'organiser en conséquence. Le juge aurait-il dû procéder à cet acte dans de telles conditions, certains avocats ont répondu par la négative à l'instar de Me Lejeune : « rares sont les juges qui mènent à bien un interrogatoire de première comparution sans avocat, ne serait-ce que pour éviter d'être ultérieurement l'objet de griefs. Ils ne s'arrêtent généralement pas à deux coups de téléphone : ils appellent le bâtonnier et remuent ciel et terre, ce que n'a pas fait le juge Burgaud ; c'est un problème de déontologie personnelle. De même, il arrive que le président d'une juridiction de fond reporte une audience si l'un des prévenus demande à être défendu par un avocat. Les parties civiles s'inclinent car les droits de la défense sont fondamentaux. »247 · L'interrogatoire de Mme Myriam Badaoui du 27 août 2001 et l'apparition des « Legrand » Ce 27 août 2001248, le juge Burgaud procéda à l'interrogatoire de Mme Myriam Badaoui. La première question du juge, qui tient en trois lignes, était la suivante : « Vous avez écrit le 28 mai 2001 que les enfants allaient en Belgique et que là-bas ils devaient retrouver d'autres enfants et d'autres adultes. À quel endroit en Belgique vos enfants se rendaient-ils ? » À cette question, Mme Myriam Badaoui répondit pendant 33 lignes de procès-verbal, sans qu'aucune question du juge ne semble interrompre ses déclarations puisque le PV n'en fait pas mention. Or, ce fut à cette occasion qu'elle mit en cause les Legrand, alors même qu'elle ne les connaissait pas. Il n'est pas nécessaire de revenir sur les interrogations dont il a été fait état dans le chapitre relatif à la conduite de l'instruction et qui concernent l'existence d'éventuelles questions dissimulées n'apparaissant pas dans les PV. Pour autant, le jour de cet interrogatoire, l'avocat de Mme Myriam Badaoui, Me Didier Dehame, bien que régulièrement convoqué par télécopie cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, était absent. Là encore, compte tenu des suites judiciaires qu'entraînèrent ces accusations pour les intéressés, il est regrettable que l'avocat n'ait pas été présent et contestable, sur le principe, que de tels actes puissent être réalisés hors sa présence. · « L'oublié » du barreau de Boulogne-sur-Mer : M. Thierry Dausque Sur les trente-neuf mois en détention provisoire qu'il subit, M. Thierry Dausque demeura quatorze mois sans l'assistance effective d'un avocat. Dès lors de nombreux actes du juge d'instruction le concernant eurent lieu sans qu'il soit en mesure de bénéficier de la protection que représente la présence d'un avocat. Ainsi, le 7 janvier 2002 le juge d'instruction organisa la confrontation de l'intéressé avec ses accusateurs en l'absence de l'avocat de celui-ci. Cette situation a provoqué une profonde émotion au sein de la commission mais a également suscité une interrogation sur les circonstances ayant pu conduire à un tel résultat. À ce stade du développement, il convient de laisser la parole à l'avocate de M. Dausque, Me Caroline Matrat-Maenhout, qui eut, lors de son audition par la commission249 , un échange assez vif avec Me Antoine Deguines, le bâtonnier du barreau de Boulogne-sur-Mer d'alors : « Sans vouloir tomber dans la caricature, je considère que Thierry Dausque est l'illustration de la justice des pauvres. J'ai été désignée dans ce dossier en qualité d'avocat commis d'office en février 2002. Mon client était mis en examen, placé en détention depuis mars 2001. Durant un an, il a été seul, complètement seul : sans avocat, sans famille parce que l'avocat sert de courroie de transmission entre le détenu et sa famille. La famille ne comprend pas forcément ce qui se passe, comment s'y prendre pour obtenir les permis de visite et faire les démarches. La famille Dausque est précisément une famille modeste, qui s'est trouvée totalement dépourvue face au placement en détention de Thierry. J'ai été désignée en février 2002, après que l'intégralité des actes qui serviront de base au travail de la cour d'assises de Saint-Omer et de Paris ait été réalisée s'agissant de Thierry Dausque. J'aurai beau batailler, du haut de mes deux ans de barreau, pour obtenir une nouvelle confrontation, elle ne m'a pas été accordée. J'avais deux ans de barreau, autant dire que je n'avais que mon énergie à offrir à Thierry Dausque. Il a fallu que j'attende la cour d'assises de Paris pour qu'il soit entendu et que je sois entendue. Mon bâtonnier vous a parlé de ses rencontres avec M. Burgaud. Mais lorsqu'on n'a que deux ans de barreau, on est reçu avec beaucoup moins d'égards par un magistrat, même s'il n'a que deux ou trois ans de plus que vous. Je visite Thierry Dausque à la maison d'arrêt de Béthune. Depuis un an, il est tout seul, sans famille. Il subit le mépris, les crachats et autres difficultés. Il est méfiant, mais il est en attente de quelqu'un qui l'aide. Il va me parler d'une confrontation particulièrement traumatisante, avec Mme Badaoui et son avocat, Aurélie Grenon et son avocat, David Delplanque et son avocat, le magistrat et son greffier... et lui, tout seul. [...] Que pensez-vous que puisse faire Thierry Dausque, qui ne connaît rien du monde de la justice, qui est inhibé, qui a les plus grandes difficultés à s'exprimer en public, face à des accusateurs, leurs avocats, un magistrat dont on a décrit la personnalité et son greffier ? Il a été totalement déstabilisé. Ne croyez-vous pas que cet acte n'aurait jamais dû avoir lieu, dans la mesure où Thierry Dausque n'avait pas d'avocat, depuis plus d'un an ? M. le Président : Pourquoi n'en avait-il pas ? Monsieur le bâtonnier, est-ce un dysfonctionnement du Barreau ? Me Antoine Deguines : Ce n'est pas dû à un dysfonctionnement du Barreau, mais au fait qu'il n'avait pas souhaité d'avocat. Me Caroline Matrat-Maenhout : Ce n'est pas tout à fait exact. Thierry Dausque s'est vu, comme c'est habituellement le cas, désigner des avocats commis d'office. Mais nos confrères ne peuvent pas forcément toujours assumer la charge que représente une défense au titre de la commission d'office. Me Antoine Deguines : Il n'y a donc pas eu de dysfonctionnement de la part du barreau de Boulogne-sur-Mer, qui a mis à la disposition de M. Dausque, dans la mesure où il en avait fait la demande à l'époque, un avocat. M. le Rapporteur : Il y a donc eu des demandes d'avocat d'office, qui ont été honorées par l'ordre. Mais l'avocat désigné d'office n'y serait pas allé par manque de temps. Me Antoine Deguines : Je ne peux pas vous répondre sur ce point. M. le Rapporteur : C'est tout de même un dysfonctionnement. Sauf erreur de ma part, les instances ordinales sont là aussi pour voir comment cela se passe. Me Antoine Deguines : Encore faut-il que la personne qui a bénéficié des services d'un avocat commis d'office qui ne l'assiste pas le signale. Les services de l'Ordre ne peuvent pas suivre l'ensemble des dossiers. M. le Rapporteur : Vous étiez vous-même sur le dossier ? Me Antoine Deguines : Non, pas à l'époque. Je suis intervenu pour la première fois devant la cour d'assises. M. le Rapporteur : Il faudrait peut-être vérifier ce qui s'est passé. Me Caroline Matrat-Maenhout : Me Tachon a été désigné dans le cadre de la permanence pour l'interrogatoire de première comparution. Un deuxième avocat a été désigné au titre de la commission d'office. Il a quitté le barreau, après avoir été longtemps absent pour congé de maternité. Thierry Dausque a toujours souhaité avoir un avocat à ses côtés. Il aurait dû en avoir un le jour de cette confrontation organisée avec plusieurs accusateurs. Or il était seul ce jour-là. » À la suite de cet échange, votre rapporteur fut destinataire de deux courriers provenant de Mes Antoine Deguines et Thierry Normand, respectivement ancien et actuel bâtonniers de Boulogne-sur-mer. Dans sa lettre du 28 février 2006, Me Deguines écrit ceci : « Des vérifications ont pu être effectuées et ont permis d'établir que M. Dausque a toujours bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office par les services de l'ordre. Dès lors, les propos de Me Matrat qui a indiqué que M. Dausque s'était trouvé privé d'avocat pendant 14 à 16 mois ne sont pas exacts. Il est vrai cependant que pour un acte majeur de la procédure, c'est-à-dire la confrontation organisée par le juge d'instruction le 7 janvier 2002, M. Dausque n'était pas assisté de son avocate. En effet, cette dernière était en train de quitter le barreau de Boulogne pour intégrer le barreau d'Evreux où elle exerce toujours. Interrogée par mes soins, elle m'a indiqué que ce jour-là, le barreau d'Evreux avait voté un mouvement de grève pour protester sur les conditions d'indemnisation au titre de l'aide légale et que par solidarité, elle n'avait pas répondu à la convocation du juge Burgaud. Cette avocate, en accord avec Me Matrat a décidé de cesser d'assister M. Dausque en raison de son départ et Me Matrat a accepté de lui succéder, ce qui a été officialisé par mon successeur à compter du 31 janvier 2002, qui a commis d'office Me Matrat. Il n'est bien entendu pas dans mon intention de critiquer le travail de Me Matrat, mais il est regrettable qu'au mépris des dispositions de notre code de procédure pénale, elle n'ait pas cru devoir formaliser une demande de confrontation auprès du juge Burgaud qui, saisi dans les formes, aurait dû rendre une ordonnance motivée susceptible de recours devant la chambre de l'instruction. Il est permis de penser que dans ce cas, la décision du juge aurait pu être totalement différente soumise qu'elle était au contrôle de la chambre de l'instruction ». Que l'on permette à votre rapporteur de faire observer que l'ancien bâtonnier commet, à son tour, une inexactitude en regrettant que Me Caroline Matrat-Maenhout n'ait pas présenté de demande de confrontation séparée. En effet, cette demande fut présentée par l'avocate de M. Thierry Dausque dès le 27 juin 2002250. À l'appui de celle-ci, Me Caroline Matrat-Maenhout indique que son client « n'a pas pu jusqu'ici faire valoir correctement ses arguments de défense » et que, cette demande tendant à l'organisation d'une nouvelle confrontation « semble à la fois nécessaire à la manifestation de la vérité et justifiée par le souci de garantir à M. Dausque les mêmes conditions de défense qu'aux autres mis en examen ». En dépit de ces arguments, le juge d'instruction Burgaud rejeta cette demande le 4 juillet 2002. L'ancien bâtonnier fait également preuve d'une grande confiance dans la chambre de l'instruction et l'étendue de son contrôle. Or, là encore, force est de constater que les faits lui ont donné tort puisque dans un arrêt du 25 octobre 2002251, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai rejeta à son tour la demande introduite par l'avocate de M. Dausque. La chambre considéra que « l'absence d'avocat aux côtés de Thierry Dausque au cours de cette confrontation ne saurait justifier aujourd'hui l'organisation d'une nouvelle confrontation entre Mme Badaoui, Aurélie Grenon, David Delplanque et Thierry Dausque, alors que ce dernier - qui a persisté dans ses dénégations - a pu parfaitement répondre aux accusations portées à son encontre par ses co-mis en examen et faire valoir avec utilité ses arguments de défense et que, depuis cette confrontation du 7 janvier 2002, aucun élément nouveau n'est intervenu qui justifierait cet acte ». Cette motivation de la chambre de l'instruction laisse implicitement percer un certain doute quant à l'utilité d'avoir recours à un avocat dans le cadre d'une information judiciaire. Pour sa part, l'actuel bâtonnier de Boulogne-sur-Mer, Me Thierry Normand, adressa le 30 mars dernier, un courrier à votre rapporteur détaillant la chronologie des interventions des différents avocats aux côtés de M. Thierry Dausque. Selon cette correspondance, il n'aurait existé « qu'une quinzaine de jours entre le 16 et le 31 janvier 2002 pendant laquelle il y aurait eu une absence réelle d'avocat ». Votre rapporteur prend acte de cette précision mais force est de constater, à la lecture de cette chronologie, que six avocats se sont succédé auprès de M. Thierry Dausque, certains abandonnant le dossier puis le reprenant en charge, ce qui n'est pas le signe d'une véritable et rigoureuse implication de la défense dans la procédure. En effet, il ne peut être reproché par nombre d'observateurs, au titre desquels figurent les avocats, l'instabilité de la composition de la chambre de l'instruction et, partant, la méconnaissance du dossier de la part de ces conseillers occasionnels et ne pas être noté, par symétrie, à quel point ce raisonnement trouve à s'appliquer au cas de M. Thierry Dausque avant l'arrivée dans la procédure de Me Caroline Matrat-Maenhout. Devant le juge, comme dans d'autres domaines, l'efficacité de l'action requiert la constance de l'engagement. b) Une inégale implication dans la procédure Au-delà des cas particuliers évoqués précédemment, l'analyse globale du dossier fait apparaître de forts contrastes entre les personnes mises en examen dans l'exercice de leurs droits. Ce constat vaut d'abord pour les demandes d'actes présentées au juge d'instruction par les avocats des parties. En effet, sur les 95 demandes présentées au cours de l'instruction, et si l'on excepte les 26 jugées irrecevables, ce qui fait un total de 69 demandes, 80 % d'entre elles252 l'ont été pour le compte de quatre mis en examen : Mme Sandrine Lavier, M. et Mme Marécaux et M. Dominique Wiel. Une seule l'a été pour M. Franck Lavier. M. François Mourmand a présenté, à sept reprises, une même demande de confrontation, sans qu'à aucun moment sa démarche n'ait été relayée par son avocat. M. Thierry Dausque a connu une situation similaire puisqu'il a sollicité lui-même par trois fois une confrontation avant qu'au mois de juin 2002, près de seize mois après sa mise en examen, sa nouvelle avocate formule une même demande. En revanche, aucune demande d'acte n'a été présentée pour MM. David Brunet et Daniel Legrand père. S'agissant des demandes de mise en liberté présentées au cours de l'instruction, elles ont été au nombre de 158253 mais, là encore, fort inégalement réparties selon les personnes. Ainsi, M. Christian Godard a présenté environ neuf demandes de mise en liberté par mois, M. Alain Marécaux en présentant en moyenne trois par mois, tout comme M. François Mourmand. En revanche, MM. Thierry Dausque et Franck Lavier n'ont saisi le juge d'instruction qu'à trois reprises pour le premier et à une seule reprise pour le second. Par ailleurs, comme l'a déclaré devant la commission Me Thierry Marembert : « Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas le fait que M. Thierry Dausque ait été privé d'avocat mais que, pendant une partie de l'instruction, des personnes dépourvues de moyens financiers aient été défendues par des avocats commis d'office présents pendant une demi-heure d'interrogatoire puis quittant leur client parce qu'ils avaient une autre affaire à plaider et revenant deux heures plus tard. »254 Cette présence irrégulière de certains avocats dans la procédure tient d'abord à un problème de taille critique du barreau. En effet, selon les informations communiquées par la Chancellerie, sur les 1 271 avocats de la cour d'appel de Douai, le barreau de Boulogne n'en comprend que 72, contre 743 à Lille. Au sein de cette cour d'appel, les cinq TGI suivants comptent moins de 50 avocats inscrits au barreau : Avesnes-sur-Helpe (33 avocats), Cambrai (27), Dunkerque (48), Hazebrouck (15) et Saint-Omer (27). Une fois encore, la question lancinante de la carte judiciaire se pose et sa réforme apparaît comme une priorité absolue et la condition nécessaire, quoique non suffisante, d'une véritable rénovation de la justice. Certes, chacun connaît les obstacles d'une telle entreprise qui ont été rappelés devant la commission par Me Thierry Marembert : « Le fonctionnement de la commission d'office est certainement lié à la carte judiciaire, serpent de mer bien connu des parlementaires - qui perdent leur enthousiasme dès qu'ils retournent dans leurs circonscriptions. Nous savons tous que certains barreaux sont trop petits, à l'instar de certains tribunaux. Malheureusement, autant je crois que vous pourrez réformer en profondeur le code de procédure pénale, autant je suis circonspect sur votre capacité à revoir la carte judiciaire. » Pourtant, le contraste entre les difficultés d'organisation rencontrées dans cette affaire au sein du barreau de Boulogne, et le fonctionnement de la « coordination pénale » du barreau de Lille devrait achever de convaincre les plus rétifs. Ainsi que l'a expliqué Me Blandine Lejeune « Les coordinateurs sont des avocats ayant le plus souvent deux à cinq ans de barreau, désignés par une commission du conseil de l'Ordre en fonction de leur motivation et de leur connaissance de la procédure pénale. Ils sont chargés d'organiser le système de permanence pénale, dès la veille des auditions, en fonction des placements en garde à vue. Si les avocats de Boulogne-sur-Mer ont failli, ils devront aussi rendre des comptes, tout comme les magistrats responsables. À Lille, les avocats qui acceptent d'être désignés au titre de la commission d'office font leur travail sérieusement ; ils ne sauraient se contenter de toucher leur indemnité et négliger d'assister les mis en examen dans les actes les plus importants de la procédure. Du reste, si le justiciable n'est pas satisfait, il peut se plaindre auprès du bâtonnier ». Cependant, les difficultés de l'avocat commis d'office ne tiennent pas uniquement à l'absence de taille critique du barreau, mais aussi au temps dont il dispose et à sa rémunération. En effet, comme l'a rappelé devant la commission Me Alain Guidi, président de la Fédération nationale des jeunes avocats255 : « Il faut aussi savoir le montant de la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office : pour une instruction correctionnelle avec détention provisoire, sachant qu'elle peut durer plusieurs mois : 429 euros ; pour une assistance devant le tribunal correctionnel, où l'on risque dix ans de prison : 171 euros ; pour une comparution devant le juge d'instruction : 64 euros ; pour un débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire : 42 euros ! Tels sont les chiffres d'indemnisation des avocats pour des interventions pourtant très importantes. Aujourd'hui, tous les citoyens n'ont pas accès à une justice de qualité. Le contrat social entre le citoyen et l'État n'est plus respecté. Les avocats qui interviennent au quotidien, au titre de la défense pénale d'urgence, peuvent se demander si la France, patrie des droits de l'Homme, ne fait pas partie, en vérité, des pays qui les proclament sans pouvoir les respecter. » À cela, il convient d'ajouter que la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale pour une procédure criminelle, sachant que la durée moyenne d'une telle information était de 18 mois en 2003, atteint 1 042 euros (hors taxes). En outre, la part des personnes jugées par le tribunal correctionnel et prises en charge par l'aide juridictionnelle, qui reflète la réalité sociologique de la population pénale concernée, atteignait 25,3 % au niveau national en 2004, mais 35,8 % au TGI de Boulogne-sur-mer, 41,6 % à celui de Saint-Omer et 39,6 % à Dunkerque, ces trois tribunaux étant situés dans le ressort de la cour d'appel de Douai. Rappeler les difficultés relevées par la défense, c'est soulever également le rapport de la défense au JLD dans cette affaire. B. DEVANT LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (JLD) L'intervention tardive dans la procédure et le caractère tronqué du débat devant le JLD traduisent les limites des interventions des avocats. 1. Un juge saisi en bout de chaîne Introduire un « double regard » sur la détention provisoire en séparant l'autorité chargée de l'enquête, le juge d'instruction, de celle ayant la compétence pour ordonner le placement en détention : tel était l'objectif du législateur lorsqu'il créa le juge des libertés et de la détention (JLD) par la loi du 15 juin 2000. Bien évidemment, cette réforme procède d'un objectif partagé par tous : réduire la détention provisoire, ce « préjugement » qui ne dit pas son nom. Pour autant, force est de constater que les modalités de l'intervention de ce nouveau juge n'ont pas été à la hauteur de la mission qui lui a été dévolue. En effet, le rôle du JLD dans la procédure se distingue par son intervention dans l'urgence et souvent tardive, deux caractéristiques qui sont peu propices à l'instauration d'un authentique débat contradictoire. Comme le prévoit l'article 137-1 du code de procédure pénale, le JLD est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. En revanche, le juge d'instruction peut, seul, ordonner le placement sous contrôle judiciaire du prévenu ou décider de le remettre en liberté s'il est incarcéré. On le voit, la logique ayant présidé à la création du JLD fait que ce juge n'intervient que si le juge d'instruction estime nécessaire un placement en détention provisoire. Or, qui mieux que le juge d'instruction, connaît le dossier, évalue à sa juste mesure la nécessité de recourir à une mesure privative de liberté, généralement soutenue par des réquisitions en ce sens du procureur ? De fait, dans la pratique judiciaire, la répartition des rôles crée un rapport de force implicite qui amène le juge chargé de prononcer le placement en détention à satisfaire les demandes de ses deux collègues. Dans ces conditions, comment ne pas s'étonner du taux de confirmation des demandes de placement qui atteignait, selon les données communiquées par la Chancellerie, 92 % en 2001, 91,1 % en 2002, 89,9 % en 2003 et 89,7 % en 2004. En outre, le code de procédure pénale n'accorde aucun délai minimal au JLD pour prendre connaissance du dossier, lorsqu'il est saisi d'une demande de placement en détention provisoire, ce qui le conduit à prendre une décision quasi instantanément, donc - par un réflexe de précaution - conforme à la demande présentée par le juge d'instruction. Certes, la personne mise en examen ou son avocat peut solliciter un délai pour préparer sa défense, le JLD pouvant alors prescrire l'incarcération pour une durée ne pouvant excéder quatre jours ouvrables, comme le prévoit l'article 145 du code de procédure pénale. Cependant, cette faculté ne semble jamais avoir été mise en œuvre dans le cadre de l'affaire d'Outreau et paraît, en règle générale, peu utilisée dans les juridictions. Ce n'est que lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en liberté d'une personne incarcérée que le JLD se voit accorder un délai pour statuer qui est de trois jours, comme le prévoit l'article 148 du même code. Dès lors, comme l'a clairement expliqué M. Maurice Marlière, qui fut JLD au TGI de Boulogne pendant l'affaire d'Outreau, « les présentations tardives » des prévenus sont la règle puisque le JLD, en matière d'instruction, intervient en bout de chaîne. Comme l'a fait observer Me Julien Delarue, la création du JLD constitue une réforme inspirée par des « bons sentiments », mais ces derniers ne suffisent pas à instaurer une procédure pénale efficiente. Pour sa part, interrogée sur l'existence d'un dysfonctionnement dans l'affaire d'Outreau, Me Pascale Pouille-Deldicque répondit : « Si je ne devais en mentionner qu'un, ce serait le juge des libertés. C'est un mythe. Cela n'existe pas ailleurs que dans la loi. Vous savez comment fonctionne un juge des libertés ? Il est en même temps JAF, il est en correctionnelle, il est un peu partout, là où on le demande, là où on le requiert. Et puis, quand on a besoin de lui, on lui passe un petit coup de fil. Le juge des libertés arrive. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance du dossier ? On en revient toujours à la même chose, le juge des libertés, c'est le juge d'instruction. On lui fait un petit résumé du dossier, en lui disant ce qu'on souhaite. Et puis, il y a le parquet, toujours aussi convaincu de la nécessité de ces placements en détention provisoire, toujours pour les mêmes raisons. On connaît la litanie : l'ordre public, le risque de réitération de l'infraction, bref, on les connaît par cœur. Et c'est de l'automatisme. »256 2. Un débat « en trompe-l'œil » Comme le prévoit l'article 145 du code de procédure pénale, le JLD saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention, fait comparaître la personne mise en examen devant lui, assistée de son avocat et procède à un « débat contradictoire ». C'est « au vu des éléments du dossier » et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, que le JLD fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. Or, quelle peut être la réalité de ce débat contradictoire dans les conditions matérielles précédemment décrites ? Par ailleurs, le juge Marlière a considéré que ce débat était « tronqué » puisque, selon ce magistrat, « aux termes de la loi, le JLD ne peut pas aborder les faits, donc le fond du dossier. Il en a connaissance, naturellement, mais on ne peut pas en débattre avec la personne mise en examen ni avec son avocat. Il est évident qu'au moment du débat, ces faits vont être rapidement rappelés et abordés, mais toujours au soutien des arguments qui seront présentés par le parquet pour solliciter la mise en détention. Cela me semble un point extrêmement important. Le JLD m'apparaît, à ce niveau, comme un juge privé, de par la loi, de la possibilité de prendre une décision pleinement éclairée, du fait qu'il lui est impossible de poser des questions relatives aux faits à la personne mise en examen. »257 Il convient de souligner que le procureur de la République M. Gérald Lesigne fit une analyse assez proche de celle développée par M. Maurice Marlière puisqu'il estima « que le débat dans le cabinet du JLD est extrêmement artificiel. Du point de vue du parquet, le fond ne peut pas être abordé. On est privé de l'essentiel du débat, qui devrait porter sur le contenu du dossier. On fait simplement le constat des conditions de la détention. C'est dramatique. Ce serait une faute que d'aborder le fond : la loi nous l'interdit. » Or, cette interprétation particulièrement restrictive de la loi est contestable puisque l'article 145 précise bien que le JLD statue « au vu des éléments du dossier », ce qui signifie donc qu'il doit porter une appréciation sur ces derniers. De surcroît, on peut observer que cette pratique des JLD refusant d'examiner le fond du dossier n'est pas commune à tous ces juges, l'audition de Mme Françoise Barbier-Chassaing, vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil et JLD258, l'ayant illustré (cf. infra, chapitre VI). La lecture des procès-verbaux des débats contradictoires organisés devant le JLD est d'ailleurs la parfaite illustration de leur caractère « tronqué » ou « artificiel ». En effet, il ressort de l'analyse du dossier de la procédure, que ce débat « contradictoire » n'occupe que quatre ou cinq lignes toujours rédigées dans les mêmes termes : « Le ministère public entendu en ses réquisitions : « la personne mise en examen entendue en ses observations : « Me X. entendu en ses observations : Nous avisons la personne mise en examen que par ordonnance motivée de ce jour nous la plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt. »259 Les quelques rares variantes observées par votre rapporteur concernent l'ajout de déclarations lapidaires des mis en examen, à l'instar de M. Dominique Wiel qui affirma « je suis innocent »260 ou de Mme Sandrine Lavier qui déclara : « Je n'ai rien fait »261. S'agissant de Mme Sandrine Lavier, aucun avocat ne l'assista devant le JLD lors de son placement en détention provisoire ni même à l'occasion des deux prolongations de celle-ci, ce qui renvoie aux dysfonctionnements du barreau de Boulogne dont il a déjà été fait état. Le caractère étique du débat contradictoire devant le JLD tient également au fait que la loi n'a pas prévu la faculté pour les avocats de produire un mémoire en défense, qu'il s'agisse du contentieux du placement ou de la prolongation de la détention provisoire, à la différence du droit applicable en ces mêmes matières devant la chambre de l'instruction. Cette limite a clairement été soulignée par le juge Marlière : « Une autre difficulté à laquelle j'ai été confronté en tant que JLD réside dans l'absence, ou la quasi-absence, de mémoire déposé par les avocats de la défense au soutien d'une demande de mise en liberté, à l'exception notable des avocats de M. Alain Marécaux et de Mme Odile Marécaux, qui ont déposé quasiment systématiquement des mémoires extrêmement développés, et de l'avocat de M. Christian Godard. S'agissant de ce dernier, la lecture attentive de ce mémoire, lui aussi très développé - il devait faire vingt pages - m'a amené à ordonner la mise en liberté de M. Christian Godard, pour des éléments de fait qui y étaient contenus. La loi fait obligation aux avocats de la défense, lorsqu'ils sont en cause d'appel devant la chambre de l'instruction, de déposer un mémoire, ce qui est presque toujours fait. Mais devant le JLD, il est rare qu'ils déposent un mémoire. S'agissant de la prolongation de la détention, le débat se passe de la même manière que le débat initial. À l'occasion des différents débats contradictoires qui ont eu lieu, je n'ai eu que très peu de mémoires. Je n'ai pas le souvenir, d'ailleurs, d'en avoir eu. Je dois même préciser qu'en ce qui concerne deux personnes mises en examen, leurs avocats n'étaient ni présents, ni représentés. Ce n'est pas un procès d'intention que je fais aux avocats. Simplement, je constate que pour un moment important qui est celui d'un éventuel renouvellement de la détention, ils n'étaient pas là, n'ayant pas non plus pris soin de m'en prévenir. [...] Le JLD est en effet un spectateur épisodique du dossier. Il ne contribue en aucune façon à la construction de ce dossier. Il intervient ponctuellement à différents stades, et constate l'état d'avancement du dossier qui lui est soumis. »262 Cette absence de production de mémoire par les avocats n'est pas compensée par d'éventuels échanges que le juge pourrait avoir directement avec ces conseils. En effet, comme l'a indiqué le juge Marlière, le JLD ne semble pas encore « pleinement intégré par les différents acteurs de la vie judiciaire », ce qui le « distingue également du juge d'instruction [en raison de] l'absence de contacts, que j'ai eu à déplorer, avec les avocats de la défense. Lorsque j'étais juge d'instruction, je me souviens de conversations avec des avocats qui venaient me sonder pour savoir à quelles conditions la remise en liberté de leur client pouvait être envisagée. Jamais, en tant que JLD, et notamment dans le cadre du dossier d'Outreau, un avocat n'est venu me voir en me demandant : « Monsieur le juge, si je vous propose telle ou telle chose, par exemple tel hébergement, est-ce que vous seriez éventuellement d'accord pour réviser la position qui a été la vôtre jusqu'à présent ? » Enfin, ce débat contradictoire, plutôt mal nommé, se fait « en audience de cabinet » comme le prévoit l'article 145 du code de procédure pénale, c'est-à-dire de façon non publique. Certes, si la personne majeure mise en examen, ou son avocat, en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a alors lieu en audience publique. Dans le dossier d'Outreau, les demandes tendant à la publicité du débat ont été rares. À titre d'illustration, fut rejetée la demande introduite le 8 novembre 2002 par M. Dominique Wiel et son avocat, le JLD la motivant ainsi : « Attendu que la publicité est de nature à porter atteinte aux tiers ; « Attendu qu'en effet les observations présentées tant par le ministère public que par la personne mise en examen ou son avocat vont nécessairement porter sur le fond du dossier ; qu'il convient de rappeler que toutes les victimes sont mineures et que le huis clos à l'audience de jugement est de droit s'il est sollicité ; qu'en raison de l'incertitude actuelle sur la position qui sera adoptée par les avocats des parties civiles devant la cour d'assises en ce qui concerne la publicité des débats, il apparaît nécessaire de préserver autant que faire se peut les intérêts des mineurs en cause ; Par ces motifs, disons qu'il ne sera pas procédé au débat contradictoire en audience publique. »263 Si la référence à la minorité des victimes est habituelle et parfaitement légitime, en revanche, la mention, parmi les motivations de cette ordonnance, du fait que les observations allaient porter sur le « fond du dossier » est plus surprenante. En effet, elle implique, conformément à ce qu'a expliqué le juge Marlière, que le débat devant le JLD ne doit pas aborder le fond du dossier, ce qui est une interprétation fort contestable de la loi qui, si elle venait à être généralisée, interdirait de fait tout débat public dès lors que celui-ci conduit « nécessairement » les parties à aborder le fond du dossier. Il y a là une contradiction qui révèle les ambiguïtés du rôle du JLD. La dernière phase procédurale avant la cour d'assises au cours de laquelle la défense n'a pu exercer de manière satisfaisante ses droits est celle qui s'est déroulée devant la chambre de l'instruction. C. DEVANT LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Dans l'affaire d'Outreau la chambre de l'instruction est intervenue à deux stades de la procédure : pendant la phase de l'instruction, comme juridiction d'appel des décisions du juge éponyme et du JLD ; après la clôture de l'instruction et jusqu'à l'audience de jugement devant la cour d'assises, phase pendant laquelle elle a examiné toutes les demandes de mise en liberté des prévenus. Au cours de l'information judiciaire, les dispositions suivantes tendent tout particulièrement à garantir le respect des droits de la défense devant la chambre de l'instruction : - la possibilité pour les avocats d'interjeter appel du rejet par le juge d'instruction d'une demande d'acte. Toutefois, l'article 186-1 du code de procédure pénale reconnaît au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider « par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours », de ne pas saisir la chambre dans sa collégialité de cet appel ; - la faculté reconnue au détenu de demander sa comparution personnelle lorsque le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté, sauf si l'intéressé a comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; - la possibilité pour la personne mise en examen ou son avocat de solliciter la publicité des débats ; - le droit des avocats de déposer un mémoire et de présenter des observations sommaires lors de l'audience. On le voit, les dispositions du code de procédure pénale semblent garantir l'instauration d'un véritable débat contradictoire devant la chambre de l'instruction. Or, il résulte des auditions menées par la commission que, là encore, la réalité de ce débat semble incertaine et les modalités actuelles de son organisation insatisfaisantes car ne permettant pas à la défense de faire valoir pleinement ses arguments. 1. Un pouvoir de filtrage du président contesté Ainsi que l'a expliqué avec véhémence Me Frank Berton : « Nous avons sollicité contre-expertise sur contre-expertise après les expertises psychologiques qui ont été menées. Cela n'a jamais été accepté, ni par le juge d'instruction ni par la chambre de l'instruction, en raison du pouvoir de filtre exorbitant que détient le président de celle-ci. Une observation sur ce point : le président de la chambre de l'instruction décide de la saisir ou de ne pas la saisir de nos appels. Quand nous faisons appel de la décision de refus d'une contre-expertise, il dispose, dans notre code de procédure pénale, et c'est une hérésie, d'un pouvoir de filtre. Non, ce n'est pas utile à la manifestation de la vérité, donc je ne dérange même pas la chambre de l'instruction pour qu'elle statue ! Ce filtre exorbitant conduit le juge d'instruction à être renforcé dans sa conviction qu'il mène relativement bien son instruction. De sorte que finalement, seuls deux hommes décident du sort des demandes d'actes que nous présentons. Bien souvent, il n'y a pas eu de collégialité : la chambre de l'instruction n'a même pas eu à connaître de nos demandes. »264 Au-delà de ces vigoureuses déclarations, l'analyse objective du dossier de l'affaire d'Outreau atteste effectivement d'un recours fréquent du président de la chambre de l'instruction à son pouvoir de « filtrage ». À cet égard, il convient d'observer que les avocats semblent avoir assez peu relevé appel des ordonnances de rejet de demande d'actes supplémentaires, de l'ordre d'une dizaine de fois265. Cela étant, le président de la chambre de l'instruction a décidé à six reprises de ne pas saisir la collégialité, ce qui peut paraître élevé, puisque cela représente de l'ordre de 60 % des cas. Toutefois, dans trois cas, sa décision était motivée, non par des raisons de fond, mais par l'irrecevabilité des demandes. Ce n'est donc que dans trois cas que le président de la chambre a décidé de ne pas saisir la collégialité et, par voie de conséquence, approuvé la décision de rejet du juge d'instruction. Les demandes d'actes ainsi rejetées par le juge d'instruction et non soumises à la chambre de l'instruction sont les suivantes : - la demande tendant à l'organisation d'une confrontation entre Mme Lavier et les enfants Delay266 ; - la demande tendant à l'organisation d'une confrontation entre M. Marécaux et M. Legrand fils267 ; - une demande de contre-expertise psychologique présentée par Mme Duchochois268. Il semble donc inexact d'affirmer, comme le fit M. Didier Beauvais, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, lors de son audition du 22 février 2006 : « J'ai effectivement rendu certaines ordonnances seul, comme la loi m'y autorise mais, excepté une décision par laquelle j'ai estimé inopportun de confronter les enfants aux mis en examen, pour les raisons évoquées plus haut, je l'ai fait uniquement pour des décisions d'irrecevabilité, pour ne pas encombrer la chambre, et je n'ai pas à rougir d'avoir rendu ces décisions ». Il a été longuement expliqué, dans les développements consacrés à la conduite de l'instruction, que le refus d'organiser des confrontations entre les enfants et les personnes qu'ils accusaient pouvait, certes, se comprendre, mais qu'il n'avait fait que retarder leur occurrence à l'audience de la cour d'assises de Saint-Omer dans des conditions qui n'ont pas été les meilleures, ni même les plus protectrices des intérêts des enfants. 2. Une intervention des avocats limitée à des « observations sommaires » et à huis clos À la différence du débat contradictoire devant le JLD, celui ayant lieu à la chambre de l'instruction prévoit la possibilité pour les avocats de déposer un mémoire en défense269, qu'il s'agisse du contentieux de demandes d'actes ou de la détention provisoire. La première interrogation qui vient alors à l'esprit est de savoir si, dans l'affaire d'Outreau, les avocats ont effectivement déposé de tels mémoires. Or, à l'instar du constat dressé en ce qui concerne le JLD, force est de constater que l'implication de la défense devant la chambre de l'instruction fut inégale. Ainsi, en matière de contentieux de la détention provisoire au cours de l'instruction, donc en appel des décisions du JLD, les avocats des intéressés n'ont déposé de mémoire que dans un peu plus de la moitié des cas. Cette proportion globale masque de substantielles disparités puisque, si pour M. Pierre Martel et les époux Marécaux la présence d'un avocat et le dépôt d'un mémoire ont été quasi systématiques, aucun mémoire n'a été produit concernant M. Daniel Legrand fils lors de ses trois comparutions devant la chambre de l'instruction. S'agissant de M. François Mourmand, aucun avocat ne s'est présenté lors des huit audiences auxquelles il a comparu et un seul mémoire fut rédigé. En ce qui concerne l'examen par la chambre de l'instruction des demandes de mise en liberté après la clôture de l'instruction, il convient de rappeler qu'elle eut à en connaître 165, dont 129 émanant de M. Dominique Wiel. Sur ces 129 demandes, seules deux d'entre elles furent suivies d'observations sommaires de son avocat. Par ailleurs, là encore, on enregistre d'importantes inégalités selon les mis en examen. Ainsi, les demandes de M. Alain Marécaux furent-elles systématiquement soutenues par le dépôt d'un rapport270 et il en fut quasiment de même des demandes de M. Pierre Martel. En revanche, aucun avocat n'intervint pour soutenir les 12 demandes de mise en liberté introduites par M. Daniel Legrand fils. La seconde interrogation a trait à l'examen de ces mémoires par la chambre de l'instruction. En effet, en matière de détention provisoire, les délais particulièrement brefs d'examen des demandes de mise en liberté peuvent nuire à l'examen au fond du dossier en général et à la prise en considération des mémoires en défense en particulier. Le témoignage du président M. Didier Beauvais est, à cet égard, particulièrement éclairant : « Le volume d'affaires traité était impressionnant - plus de 3 000 arrêts par an. Lors de l'affaire d'Outreau, ce volume était encore très élevé puisque la chambre de l'instruction, composée d'un président et de quatre assesseurs, dont un travaillant à mi-temps dans une autre chambre, rendait, en moyenne, plus de 2 600 arrêts par an. À titre de comparaison, la chambre de l'instruction de Versailles, qui rend en moyenne 2 000 arrêts par an, possède deux sections, soit au total deux présidents et quatre conseillers à plein temps. À la chambre de l'instruction de Douai, j'ai donc signé plus de 20 000 arrêts en huit ans. Certes, je n'étais pas seul mais, avec mes assesseurs, il a fallu analyser, relire... Trois audiences par semaine sont nécessaires pour traiter le contentieux, à raison de 25 affaires en moyenne par audience et parfois davantage, entre 9 heures et 14 ou 15 heures, ce non compris le temps du délibéré. » Vous imaginez sans difficulté que les procédures qui nous sont soumises sont les plus complexes, qu'il s'agisse d'affaires de drogue ou de grand banditisme, de trafics en tous genres, d'affaires financières ou d'affaires de mœurs. Les faits sont le plus souvent niés, soit qu'ils soient importants, soit parce que l'on peut y avoir intérêt, comme je vous l'expliquerai. Ces affaires exigent un investissement en temps du magistrat, qui doit pourtant appréhender le dossier dans des délais extrêmement brefs. [...] Le rôle de l'audience, composé pour deux tiers de dossiers de détention provisoire, est définitif, dans le meilleur des cas, cinq ou six jours avant l'audience, ce qui ne veut pas dire que tous les dossiers parviennent au greffe de la chambre de l'instruction dans ce délai. Des rappels réguliers aux onze tribunaux de grande instance du ressort sont en effet nécessaires pour en activer l'acheminement. Dès que les dossiers arrivent, ils sont répartis, en général par parts égales, entre les membres de la chambre qui vont faire rapport à leurs collègues. Chaque rapporteur dispose, au mieux, de deux ou trois jours pour prendre connaissance de quelque huit dossiers et rédiger ses rapports, qui rappellent les faits, la procédure, les éléments de personnalité, et résument les mémoires des parties ainsi que les réquisitions du ministère public, sachant qu'il devra, pendant ce délai, participer à une autre audience et achever des rédactions d'arrêts de l'audience précédente. Comme je vous l'ai indiqué, le rôle est composé pour les deux tiers de dossiers de détention provisoire. Or, je tiens à rappeler les délais très courts imposés par le législateur pour traiter du contentieux de la détention : 20 jours lorsque la personne demande à comparaître sur l'appel d'une demande de mise en liberté ou d'une prolongation de détention provisoire, 15 jours si elle ne le demande pas, 15 jours si la personne demande à comparaître sur l'appel d'un placement en détention, 10 jours si elle ne le demande pas. À titre d'exemple, les époux Marécaux ont fait appel de leur placement en détention sans demander à comparaître ; l'affaire devait donc être évoquée dans les dix jours de leur appel et le dossier comprenait déjà sept ou huit tomes. Or, j'ai eu ce dossier à disposition environ 48 heures avant l'audience, car le ministère public en avait également besoin pour prendre ses réquisitions. J'ai dû en prendre connaissance en même temps que l'avocat de Mme Marécaux, et nous avons dû échanger les tomes dans le bureau commun pour pouvoir, dans le délai extrêmement bref que vous imaginez, moi, rédiger mon rapport, lui, rédiger son mémoire. Heureusement, nous avions eu connaissance du dossier précédemment, mais il était reparti et il a fallu le réclamer à grande vitesse. C'est là un exemple de nos difficultés quotidiennes. »271 Par ailleurs, à supposer que des mémoires aient été déposés et examinés par la chambre de l'instruction, il convient de souligner que l'article 199 du code de procédure pénale dispose que le parquet et les parties qui en font la demande présentent « des observations sommaires ». Or, ce serait recourir à un euphémisme que de constater que cette expression a suscité nombre de critiques de la part des avocats entendus par la commission : Ainsi Me Hubert Delarue s'est-il interrogé en ces termes : « est-il convenable que l'avocat n'ait le droit de formuler, selon l'article 199 du code de procédure pénale, que des « observations sommaires » ? Comment défendre un homme, comment expliquer que la justice est en train de se tromper quand on vous rappelle que vous ne devez faire que des « observations sommaires ? [...] Les « observations sommaires » renvoient à une justice qui peut être parfois sommaire et discrétionnaire. Ce n'est pas la justice de la République. » 272 Quant à Me Philippe Lescène, il a déploré que : « les avocats procèdent par voie d'observations : ils ne plaident pas. Alors que nous allons devant les juges de la cour d'appel pour parler de mise en liberté, ce qui est fondamental, nous sommes très rapidement interrompus : « Vous ne devez faire que des observations, cela suffit ! Vous ne nous intéressez pas, nous savons ! » Cette disposition est symbolique quant au rôle de la défense en matière pénale. »273 Enfin, pour clore ces témoignages, on peut citer Me Thierry Marembert qui a considéré qu'« il faudrait qu'à la chambre de l'instruction on ne se contente plus de formuler des observations mais on puisse plaider vraiment. Contrairement à ce que prévoit la loi, les chambres de l'instruction, à de rares exceptions près, ne sont pas de vraies juridictions d'appel des magistrats instructeurs ; elles exercent une sorte de contrôle restreint ou de contrôle manifeste de l'erreur d'appréciation. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le sentiment que les faits ont déjà été jugés, à charge et à décharge. Je suis catégoriquement favorable à la suppression du mélange des genres entre les fonctions d'enquête et les fonctions juridictionnelles, ce qui permettrait un contrôle plus féroce. Quand le tribunal correctionnel écoute l'avocat général, il prête attention à ses conclusions mais ne les suit pas forcément. La chambre de l'instruction n'a pas la même distance vis-à-vis du magistrat instructeur car elle considère que la chose est jugée. »274 Si les parties se sont plaintes de ces « observations sommaires », tel n'a pas été le cas du parquet général, pourtant également concerné par les dispositions de l'article 199. En effet, lors de son audition par la commission, le procureur général M. Jean-Amédée Lathoud ne l'évoqua pas. Ce fut, paradoxalement, le président de la chambre de l'instruction, magistrat du siège, qui déplora la relative absence du parquet en ces termes : « Il me semble aussi qu'il faut prévoir une implication plus grande du ministère public - parquet et parquet général - dans les procédures, pendant le cours de l'instruction, dans la définition des investigations utiles. Il m'apparaît, comme à mes collègues, que le ministère public a été un peu absent à des moments forts de la procédure. Il n'a jamais formulé une seule fois, devant toutes les demandes de mise en liberté, avec tous les appels, une réquisition de mise en liberté. Il est normal que l'avocat défende son client, mais il faut aussi que le ministère public apporte la contradiction, afin que le juge du siège puisse trancher. »275 Au vu de ce qui précède, on pourrait être tenté, pour paraphraser le juge Marlière, de considérer que le débat contradictoire devant la chambre de l'instruction semble également passablement « tronqué ». De surcroît, ce débat se fait, par principe, « en chambre du conseil » comme le prévoit l'article 199 du code de procédure pénale, donc non publiquement. Certes, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent en séance publique sauf « si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ». Dans le dossier d'Outreau, la publicité des débats n'a jamais été demandée au cours de l'instruction. En revanche, elle le fut à deux reprises après l'ordonnance de clôture de l'information par M. Alain Marécaux et accordée par la chambre de l'instruction. À titre d'illustration, l'arrêt du 12 septembre 2003 de ladite chambre considéra qu'attendu « que cette publicité n'est pas de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, désormais achevée, ni à nuire à la dignité des personnes ou aux intérêts des tiers », la publicité devait être accordée. Comme l'a observé le président de la chambre de l'instruction, M. Didier Beauvais : « Les avocats n'ont jamais demandé la publicité sur cette affaire, sauf une fois pour une audience relative à la détention provisoire, et leur demande a été acceptée. Au cours des huit ans que j'ai passés à la chambre de l'instruction, il y a eu un seul cas, peut-être deux, où cette demande a été faite, et elle a été acceptée. Je ne puis laisser dire que les avocats n'ont pas su ce qui se passait ! »276 Des délais d'examen des demandes de mise en liberté particulièrement brefs, des mémoires en défense produits de façon épisodique, des avocats cantonnés à des observations sommaires, une collégialité saisie à la discrétion de son président, tout concourt à faire de la chambre de l'instruction « une chambre de confirmation » comme l'a qualifiée Me Éric Dupont-Moretti.277 Selon cet avocat, la pratique judiciaire prévalant aujourd'hui conduirait les chambres de l'instruction à refuser d'assumer leurs responsabilités de contrôle des cabinets d'instruction en faisant en sorte « dans les affaires tangentes [de] renvoyer aux assises en disant : la souveraineté populaire appréciera. » Au-delà de ces formules, votre rapporteur a souhaité connaître plus précisément la réalité des pratiques judiciaires et, en particulier, obtenir le taux de confirmation des décisions soumises en appel aux chambres de l'instruction. De manière étonnante, les services de la Chancellerie ne sont pas en possession d'une telle information et on ne peut que suggérer fortement qu'ils le deviennent à l'avenir. À l'aune des enseignements tirés des auditions de la commission mais également de l'examen du dossier de la procédure, il ressort que les difficultés rencontrées par la défense sont de trois ordres : certaines sont matérielles parce qu'elles découlent d'insatisfaisantes conditions d'organisation du service du greffe mais aussi du barreau de Boulogne ; d'autres sont à imputer à la loi parce qu'elles sont la conséquence des limites juridiques posées à l'intervention des avocats prévues par le code de procédure pénale, notamment dans le cadre de la garde à vue, devant le juge des libertés ou la chambre de l'instruction ; d'autres enfin, tenant à la personnalité du juge et à la nature des relations qu'il entretenait avec certains avocats, ont une dimension plus humaine. VI. LES CONTRÔLES EXERCÉS PAR LA CHAÎNE JUDICIAIRE : UNE SUCCESSION DE DÉFAILLANCES Si les dysfonctionnements en amont de la chaîne judiciaire sont une réalité, ils n'ont pas été corrigés par les instances de contrôle ultérieur. Ce constat s'impose aussi bien pour le recours à la détention provisoire que pour l'intervention du juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction. Ces défaillances s'expliquent également plus largement par l'absence d'une culture de contrôle. A. LA DÉTENTION PROVISOIRE GÉNÉRALISÉE Au cours de ses auditions, la commission d'enquête a pu noter le nombre important d'intervenants qui avaient souligné que « sans la détention provisoire, il n'y aurait pas eu d'affaire d'Outreau ». 1. L'abus de la détention provisoire dans l'affaire d'Outreau Il est certes excessif de ramener tous les dysfonctionnements dans cette affaire au problème de la détention provisoire. Pourtant, l'affirmation d'une conviction aussi largement partagée et les témoignages très forts des acquittés sur ce sujet prouvent bien que l'utilisation qui fut faite de la détention provisoire et le caractère inopérant de son contrôle, resteront sans doute, par leurs conséquences humaines, le dysfonctionnement majeur de l'affaire d'Outreau. Ce qui frappe d'abord dans l'affaire d'Outreau, c'est la proportion de placements en détention provisoire par rapport aux solutions alternatives possibles, au premier rang desquelles figure évidemment le contrôle judiciaire. Toutes les personnes mises en examen et qui seront en définitive acquittées ont en effet été placées en détention provisoire à l'issue de leur présentation au juge des libertés et de la détention, à la seule exception de Mme Karine Duchochois, placée sous contrôle judiciaire le 18 février 2002 jusqu'à son acquittement le 2 juillet 2004 par la cour d'assises de Saint-Omer. Ensuite, ces détentions choquent par leur durée. Le triste record est détenu par M. Thierry Dausque, resté en détention « provisoire » pendant une durée de 39 mois. M. Franck Lavier y est resté 37 mois, cependant que Mme Sandrine Lavier, MM. Pierre Martel, Dominique Wiel, Daniel Legrand père, Daniel Legrand fils, ont tous subi des détentions provisoires supérieures à 2 ans et demi. M. David Brunet a dépassé le cap des 2 ans. M. Alain Marécaux ne l'a pas tout à fait atteint (23 mois), vraisemblablement parce que dans son cas le pronostic vital était engagé ; une autre des personnes incarcérées, M. François Mourmand, dont l'état de santé s'était beaucoup dégradé en prison, est décédé au bout de 14 mois de détention provisoire. Mme Roselyne Godard est restée 16 mois en détention provisoire et seuls Mme Odile Marécaux et M. Christian Godard (mis en examen plus tardivement) ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire qui, pour avoir été un peu moins longue, car inférieure à un an, n'en a pas moins été particulièrement traumatisante. Les membres de la commission d'enquête ont été particulièrement sensibles à la description des conditions de la détention provisoire et soulignent l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de cette catégorie de détenus qui, faut-il le rappeler, bénéficient de la présomption d'innocence dans l'attente de leur jugement. Il suffit de se reporter aux auditions des acquittés pour mesurer, par-delà la pudeur des divers témoignages, le degré de peur et de souffrance qui peut être celui d'un innocent plongé dans un univers carcéral traumatisant et dont point n'est besoin de rappeler le sort peu enviable qu'il réserve en général aux « pointeurs ». La longueur du maintien en détention provisoire après l'achèvement des investigations, dans l'attente d'un jugement, pose également question. C'est le 7 août 2002 que fut rendu par le magistrat instructeur l'avis de fin d'information. Le premier procès en assises n'étant intervenu qu'à compter du 4 mai 2004, ce sont ainsi 21 mois qui se sont écoulés entre ces deux dates, pendant lesquels la détention provisoire s'est poursuivie pour la plupart des personnes concernées. Seules deux personnes avaient été remises en liberté sous contrôle judiciaire avant le 7 août 2002 : M. Christian Godard le 13 mai 2002 et Mme Odile Marécaux le 12 juin 2002. Mme Roselyne Godard le fut peu après, le 13 août 2002 et M. Alain Marécaux, sur réquisition du parquet général, au bout de plusieurs mois, le 13 mars 2003, au vu de ses bilans médicaux alarmants. En revanche huit des acquittés d'Outreau subiront ces 21 mois en détention provisoire dans l'attente de leur jugement, avant d'être libérés par la cour d'assises de Saint-Omer pendant les débats : Mme Sandrine Lavier (le 19 mai 2004), MM. David Brunet, Thierry Dausque, Franck Lavier, Daniel Legrand père, Daniel Legrand fils, Pierre Martel et Dominique Wiel (le 27 mai 2004). Deux d'entre eux seront en outre réincarcérés à la suite de l'arrêt de la cour d'assises de Saint-Omer du 2 juillet 2004 : MM. Franck Lavier et Dominique Wiel, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction le 22 juillet 2004, dans l'attente du procès en appel. Ce délai d'attente peut s'expliquer partiellement par les règles applicables à la clôture de l'information, prévues notamment à l'article 175 du code de procédure pénale, s'agissant en particulier des délais de communication du dossier d'information au procureur de la République et des possibilités de requêtes des parties. Dans l'affaire d'Outreau, le dossier d'information a été communiqué au procureur de la République le 17 septembre 2002 et le 25 octobre 2002, la chambre de l'instruction de Douai a fait droit à un appel de la défense portant sur la jonction de nouvelles pièces (en particulier un certificat médical d'un enfant Delay en date du 6 janvier 1999). C'est le 18 décembre 2002, en application du délai de trois mois prévu par l'article 175, qu'a été communiqué au juge d'instruction le réquisitoire du procureur en date du 17 septembre 2002. Le 20 janvier 2003 a été communiqué un nouvel avis de fin d'information, consécutif à la demande précitée de versement de pièces complémentaires. Le 6 mars 2003 sont intervenues une nouvelle communication du dossier d'information du procureur (article 175 précité) ainsi qu'une nouvelle communication au juge d'instruction du réquisitoire définitif du procureur, ce dernier reprenant, à une phrase près, son réquisitoire du 17 décembre 2002, en l'absence d'éléments nouveaux. Le 13 mars 2003, l'ordonnance de mise en accusation a été signée par le juge Cyril Lacombe. Enfin, le 1er juillet 2003, à la suite de son audience publique du 4 juin, la chambre de l'instruction a rendu son arrêt de renvoi de dix-sept personnes devant la cour d'assises. La mise en accusation des intéressés est devenue définitive le 15 octobre 2003, après rejet par la Cour de cassation de leur pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction. En raison des délais d'audiencement, près de sept mois se sont encore écoulés entre le 15 octobre 2003 et le 4 mai 2004. Ce délai reste dans le cadre des limites fixées par la loi, laquelle permet le maintien en détention d'une personne définitivement renvoyée devant la cour d'assises pendant une durée d'un an avant sa comparution devant cette juridiction, avec possibilités exceptionnelles de prolongation (ancien article 215-2 du code de procédure pénale devenu article 181). En l'absence même d'irrégularité procédurale, force est néanmoins de constater que les détentions provisoires se sont poursuivies trop longtemps, alors que quasiment plus aucun élément nouveau n'est intervenu dans le dossier judiciaire d'Outreau, à compter de sa transmission par le juge Burgaud, dès septembre 2002, à son successeur le juge Lacombe. Les membres de la commission d'enquête s'en sont émus à plusieurs reprises. Il sera difficile de faire l'économie d'une réflexion sur la possibilité d'alléger à l'avenir certaines règles procédurales, notamment celles présidant aux suites de la clôture d'une information, ainsi que sur la possibilité de réduire les délais d'audiencement. La durée maximale légale des détentions provisoires apparaît excessive, eu égard notamment au principe, constamment réaffirmé dans notre droit, de la présomption d'innocence, auquel toute détention provisoire prolongée porte l'atteinte la plus flagrante, dès lors que l'on admet qu'elle ne saurait être érigée en pré-jugement. Le nombre important des demandes de mise en liberté et l'examen des conditions dans lesquelles elles ont été déposées et traitées, conduisent à s'interroger sur l'efficacité du dispositif de contrôle de la détention provisoire. Le nombre total de demandes de mise en liberté présentées par les futurs acquittés au cours de la procédure et par M. François Mourmand avant son décès a atteint le chiffre impressionnant de 363. Les conditions de traitement de ces demandes ont été différentes selon le stade de la procédure auquel elles ont été formulées. En effet, pendant la durée de l'information, le juge d'instruction et le JLD sont en principe seuls compétents pour examiner les demandes de mise en liberté, avec possibilité d'appel devant la chambre de l'instruction. Après la clôture de l'information intervenue en l'espèce le 13 mars 2003, date de l'ordonnance de mise en accusation, les demandes de mise en liberté doivent être portées directement devant la chambre de l'instruction en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale. Sur les 363 demandes présentées, 158 l'ont été avant l'ordonnance de mise en accusation du 13 mars 2003 et 165, soit plus de la moitié, après cette date, donc lorsque les personnes concernées avaient déjà passé de longs mois de détention provisoire. Pour ce qui concerne les 158 demandes présentées au cours de l'information, de fortes disparités ont été enregistrées, parmi les personnes en cause. Ainsi, si M. Christian Godard a présenté une moyenne de neuf demandes de mise en liberté par mois pour une durée totale de détention de trois mois, MM. Thierry Dausque et Franck Lavier n'ont formulé une telle demande respectivement qu'à trois reprises en 24 mois pour le premier et qu'une seule fois en 21 mois pour le second. Le droit d'appel devant la chambre de l'instruction a été également exercé de façon inégale selon les personnes au cours de l'information. En effet, si le taux d'appel global s'est élevé à 37 %, certains ont utilisé presque systématiquement leur droit, sans doute bien conseillés par leurs avocats (M. et Mme Marécaux ont ainsi interjeté appel de la quasi-totalité des ordonnances prononcées à leur encontre) cependant que d'autres, en l'occurrence MM. Franck Lavier et Daniel Legrand père n'ont jamais exercé de droit d'appel et que M. Thierry Dausque ne l'a exercé qu'une fois. Ces disparités conduisent à se demander si la mise en œuvre du dispositif de contrôle de la détention provisoire n'est pas trop dépendante de la seule réactivité des avocats des différentes personnes concernées. Devant la commission d'enquête, M. Thierry Dausque a fait comprendre quel sentiment de solitude pouvait être le sien, durant ces longs mois de détention provisoire subis sans l'assistance effective d'un avocat. Au surplus, plus la détention se prolonge, plus se pose la question de l'opportunité de son maintien, puisqu'elle devrait par définition rester « provisoire ». L'examen du dossier d'Outreau montre que les problèmes évoqués ci-dessus se sont aussi posés pour les demandes de mise en liberté formulées après la clôture de l'information. Sur les 165 demandes de mise en liberté - donc plus de la moitié - présentées directement devant la chambre de l'instruction après la clôture de l'information, 163 l'ont été avant le procès de Saint-Omer, les deux autres ayant été présentées par MM. Franck Lavier et Dominique Wiel après leur réincarcération par la cour d'assises. Là encore, l'occasion d'un contrôle sur ces détentions « provisoires prolongées » s'est présentée de façon très inégale selon les intéressés : MM. David Brunet, Thierry Dausque, Franck Lavier et Daniel Legrand père n'ont en effet jamais présenté de demandes de mise en liberté durant cette période, tandis que M. Dominique Wiel en présentait, à lui seul, 129, d'ailleurs toutes en vain. Si elles étaient assurées d'un examen véritable et régulier de leur situation, certaines personnes ne seraient plus acculées à multiplier les démarches vaines telles que les demandes journalières ou très rapprochées de mise en liberté, les lettres quotidiennes au Président de la République, voire les conduites suicidaires qui, véritables cris de détresse contre l'oubli, étaient devenues pour certains détenus d'Outreau le seul espoir de se faire entendre. Enfin, les membres de la commission d'enquête ont été particulièrement sensibles aux témoignages de certains acquittés relatant l'impossibilité pour eux, alors même qu'ils étaient détenus, de consulter leur dossier et donc de préparer leur défense. M. Dominique Wiel a ainsi indiqué qu'il n'avait pu obtenir l'ensemble du dossier qu'après le procès de Paris. Après avoir souligné que les avocats avaient fait leur travail, mais qu'on ne leur avait pas donné les moyens d'assurer correctement leur défense, Mme Odile Marécaux a également revendiqué un droit effectif d'accès au dossier : « Je ne sais pas si votre commission peut œuvrer en ce sens-là, mais je pense que la personne mise en détention provisoire devrait pouvoir avoir accès à son dossier. J'ai été en détention sept mois, et c'est parce que j'ai été libérée que j'ai pu préparer le procès de Saint-Omer. Je me mettais à la place de ceux qui étaient en détention, et je me demandais comment ils pouvaient arriver à se défendre sans avoir les pièces de ce dossier complètement fou. Il y a une inégalité entre ceux qui sont en détention et ceux qui sont en liberté. Ce n'est pas normal, car tous sont présumés innocents. Les textes devraient prévoir la possibilité pour la personne mise en détention d'avoir accès aux pièces de son dossier. »278 Les données générales relatives au placement en détention provisoire en France montrent cependant qu'Outreau ne constitue pas une exception. 2. Les dérives d'une pratique générale Selon le rapport de la Commission de suivi de la détention provisoire, paru en novembre 2005, il semble avéré qu'en intensité, le recours à la détention provisoire pendant l'instruction est revenu en 2002 et 2003 à un niveau sensiblement supérieur à celui de la décennie 1990. La pratique de la détention provisoire peut être analysée au regard de plusieurs paramètres : - La part des personnes placées en détention provisoire par rapport à la population incarcérée est stable : 33,7 % en 2000 ; 33,2 % en 2001 ; 37,6 % en 2002 ; 36,7 % en 2003 et 34 % en 2004279. La hausse des incarcérations, quant à elle, persiste depuis 2002. Les entrées en prison ont progressé cette année-là de 22 % par rapport à 2001. L'année 2003 est restée à peu près au même niveau avec environ 78 000 entrées pour les établissements pénitentiaires de la métropole, puis, en 2004, une nouvelle hausse de 4 % a porté ce nombre à près de 81 000, soit une augmentation de 26 % en trois ans (2001-2004)280. - La part des personnes placées en détention provisoire dans le nombre total des personnes mises en examen accuse une progression notable : 32,6 % en 2001 ; 36,9 % en 2002 ; 40,2 % en 2003 et 40,9 % en 2004. - Les effets de la durée de l'instruction M. Jean-Marie Delarue, Président de la Commission de suivi de la détention provisoire, entendu par la commission281, a rappelé que depuis 1990, le nombre des poursuites est resté à peu près stable, mais que le nombre des affaires confiées au juge d'instruction représentant environ 15 % du total il y a vingt-cinq ans s'élevait désormais à moins de 5 %, ce dernier pourcentage recouvrant les affaires présumées les plus compliquées. Cette complexité implique que la durée moyenne de l'instruction ne cesse d'augmenter. Elle est passée de 11,6 mois en 1990 à 27,1 mois en 2000, ce qui a un effet immédiat sur la durée de détention provisoire. Cette évolution est cependant moins marquée pour les crimes, dont on peut penser que l'instruction est toujours prolongée, que pour les délits graves confiés au juge d'instruction. - La durée de la détention provisoire suivant la qualification de l'infraction La durée moyenne de la détention provisoire en matière criminelle et correctionnelle est une donnée qui n'est disponible que depuis 1999. Exprimée en mois, elle s'entend de la durée de la détention provisoire effectuée jusqu'à la date de la condamnation. Elle est issue d'une exploitation statistique des condamnations inscrites au casier judiciaire. En conséquence, elle ne comprend pas les affaires pour lesquelles un non-lieu, une relaxe ou un acquittement a été prononcé.
- Les détentions provisoires et les mesures de non-lieu, d'acquittement ou d'une relaxe C'est cependant la question du pourcentage de détenus provisoires ayant fait l'objet d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'une relaxe qui, au regard de l'affaire d'Outreau, serait susceptible de présenter un intérêt tout particulier. Interrogée sur ce point, la Chancellerie a indiqué qu'en l'état des données statistiques, il n'est pas possible de disposer des chiffres sur le nombre de personnes ayant été placées en détention provisoire et ayant bénéficié d'une relaxe ou d'un acquittement. Le nombre de personnes ayant été placées en détention provisoire et ayant bénéficié d'un non-lieu n'est disponible que pour les affaires terminées durant l'année. Cette donnée est issue du répertoire de l'instruction :
M. Jean-Marie Delarue l'a souligné lors de son audition : « Malheureusement, les statistiques souffrent en ce domaine de graves lacunes. On a une petite idée au moins sur les non-lieux : parmi les détenus soumis à détention provisoire, on a trouvé 760 non-lieux, ce qui est beaucoup. Mais nous sommes incapables de relier le nombre d'acquittements et de relaxes au nombre de personnes qui ont été placées en détention provisoire, car les statistiques ne font pas apparaître les périodes de détention provisoire effectuées par des personnes libérées avant de venir au procès, les personnes comptabilisées étant uniquement celles qui sont en détention provisoire au moment du procès. Quant au nombre des personnes libérées au moment où elles ont été acquittées et relaxées par le tribunal, l'administration judiciaire nous dit qu'elles sont à peu près 300 alors que l'administration pénitentiaire en compte près de 400. Cette incapacité à rendre compte d'un fait qui est au cœur de nos préoccupations nous a beaucoup troublés. Les statisticiens du ministère de la justice que nous avons interrogés sur ce point ont été incapables de fournir une réponse satisfaisante, et nous souhaitons que l'on puisse davantage repérer ces personnes à l'avenir. »282 La commission d'enquête ne peut que s'interroger elle aussi sur les raisons d'un tel flou statistique, d'autant qu'il pourrait contribuer à accréditer l'idée que l'importance du phénomène de l'erreur judiciaire serait volontairement masquée. En tout état de cause, il laisse supposer que nombre de placements en détention provisoire sont prononcés de façon un peu trop légère. - La détention provisoire et le placement sous contrôle judiciaire Il est intéressant par ailleurs de comparer la proportion des détentions provisoires et des placements sous contrôle judiciaire. Dans l'affaire d'Outreau, le placement n'a été prononcé ab initio que dans le cas d'une personne. À cet égard, la comparaison avec le ratio général n'est pas concluante. Les statistiques fournies par la Chancellerie confirment en effet la constatation de M. Jean-Marie Delarue selon laquelle, alors que le nombre de personnes mises en détention provisoire par rapport aux mises en examen se stabilise autour de 40 %, les mesures de contrôle judiciaire décidées par le juge d'instruction ab initio augmentent. Cependant, dans ces statistiques, la part des personnes placées sous contrôle judiciaire et en détention provisoire dans le total des mises en examen n'est calculée que pour les affaires terminées dans l'année sans tenir compte des affaires s'échelonnant sur plusieurs années.
L'évolution du contrôle judiciaire avait déjà fait l'objet d'autres tentatives d'examen dans le rapport 2004 de la Commission de suivi de la détention provisoire. Il était alors observé que le recours accru à la détention en 2002 ne s'expliquait pas pour autant par une baisse du recours au contrôle judiciaire ab initio. Il apparaissait également que d'un point de vue statistique, la règle semble de plus en plus d'accompagner la mise en examen d'une restriction de liberté. C'est effectivement ce qui peut être constaté aujourd'hui dans plus de 85 % des cas, lorsque l'on additionne la part des mesures de contrôle judiciaire et celle des mesures de détention provisoire. En 1995 ce total s'établissait à environ 65 %, soit une proportion sensiblement inférieure. Le contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique a pour sa part fait son apparition dans la nomenclature statistique en 2003. Ce dispositif a représenté 1 % des mesures de contrôle judiciaire. S'agissant des remises en liberté, le rapport 2005 souligne que la mise en liberté sous contrôle judiciaire était curieusement encore en baisse en 2003, alors que l'ensemble des mises en liberté a connu une augmentation absolue et relative rompant avec une décroissance de plusieurs années. Mais l'analyse est rendue délicate par certains facteurs, les mises en liberté de 2003 pouvant notamment correspondre à des mandats de dépôt de 2002 qui étaient en forte augmentation. En tout état de cause, les mises en liberté sous contrôle judiciaire décidées au cours de l'instruction ont fortement décru entre 2000 (11 144) et 2003 (8 445) entraînant une baisse du ratio de mises en liberté sous contrôle judiciaire par rapport aux mandats de dépôt de 48,9 % à 35,2 %. Le contrôle judiciaire comporte toutefois encore trop d'incertitudes statistiques. Il ne figure pas depuis longtemps au nombre des réflexions menées sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, alors qu'il constitue l'alternative normale de la détention provisoire et qu'en cette qualité, il pourrait être amené à connaître de nouveaux développements. Il y a là un champ d'investigation à explorer, notamment par la Commission de suivi de la détention provisoire, ainsi que l'a suggéré son Président lors de son audition : « Je nourris un petit regret : celui que le législateur n'ait pas pensé en 2000 que nous pourrions aussi nous intéresser à cette question. » M. Jean-Marie Delarue a expliqué avoir demandé au garde des Sceaux « s'il pouvait considérer que notre mission englobait aussi la prévention de la détention provisoire, c'est-à-dire une réflexion sur le contrôle judiciaire, ce qu'il a bien voulu accepter ». L'article 72 de la loi du 15 juin 2000 dispose effectivement simplement : « Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministère de la justice _..._ » Les membres de la commission d'enquête souhaitent qu'au cas où la moindre ambiguïté ou difficulté se présenterait sur ce point, la clarification législative nécessaire soit rapidement apportée. - La détention provisoire et son indemnisation Un mécanisme d'indemnisation est prévu par l'article 149 du code de procédure pénale pour les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire en cas de décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu devenue définitive. La personne concernée a droit, à sa demande, « à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ». Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est notifiée, l'intéressé est avisé de son droit et peut demander une expertise contradictoire pour évaluer le préjudice. La demande doit intervenir dans les six mois de la décision (le délai ne court que si la personne, lors de la notification, a bien été avisée de son droit : article R. 26, dernier alinéa. La réparation est allouée par le Premier président de la cour d'appel du ressort. Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours, devant la Commission nationale de réparation des détentions, qui statue sans recours (articles 149-2 et 149-3). En 2002, l'une des réparations accordées a été de 7 622 € pour 15 jours de détention provisoire ; en 2003, 43 000 € pour 7 mois, 152 449 € pour 4 ans, 4 mois et 20 jours ; en 2004 (Paris), 275 630 € pour 7 mois, avec 11 ans avant non-lieu, pour un chirurgien283. Le montant des réparations accordées aux acquittés d'Outreau n'est pas public, celui-ci étant de nature contractuelle et l'une des clauses du contrat prévoyant sa non divulgation. Le mécanisme d'indemnisation de la détention provisoire ne prévoit par ailleurs pas de dédommagement direct des proches et notamment des enfants privés de leurs parents pendant de longs mois. Il convient de rappeler que la famille de M. François Mourmand, décédé en prison, n'avait pas reçu d'indemnisation lorsque la commission d'enquête a procédé à ses investigations. En réponse à un courrier de votre président et de votre rapporteur, le garde des Sceaux a indiqué, par lettre du 2 mars 2006, que l'avocat des ayants droits de M. François Mourmand avait récemment introduit une demande en vue d'une réparation financière auprès de ses services et qu'il veillerait à ce que ce dossier ne souffre pas de retard dans la réponse qui pourra y être apportée. Le tableau ci-après fait apparaître l'accroissement préoccupant du nombre de dossiers d'indemnisation présentés en matière de détention provisoire :
La convention européenne des droits de l'homme prévoit un mécanisme d'indemnisation tout différent. Il faut, mais il suffit, qu'au regard de la convention la détention ait été irrégulière, ou bien qu'elle excède un délai raisonnable (articles 5-1 et 5-3), toute la difficulté résidant, bien entendu, dans l'appréciation de ce qu'il faut entendre par « délai raisonnable », moyennant quoi la cour européenne de Strasbourg décide de la « satisfaction équitable » qu'il convient d'allouer au détenu provisoire. Au-delà de ces chiffres, si imparfaits qu'ils soient, il convient de s'interroger sur l'application qui a été faite dans cette affaire des critères de la détention provisoire. 3. L'application des critères de l'article 144 du code de procédure pénale dans l'affaire d'Outreau Rappelons qu'en application de l'article 144 du code de procédure pénale, « la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; - de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. » Ces trois cas de figure méritent d'être analysés. a) Les risques de « pression et de concertation » Dans l'affaire d'Outreau, la nécessité de conserver les preuves ou les indices matériels n'a jamais été opposée, puisque précisément il n'y avait ni preuves ni indices matériels, à l'exception du produit de la perquisition effectuée au domicile des époux Delay. En revanche, ont été invoqués parfois les risques de pression sur les témoins ou victimes ou les risques de concertation frauduleuse entre les intéressés. Ces risques étaient souvent mis en relation avec le « regard porté sur les faits », c'est-à-dire en réalité le refus de reconnaître les faits reprochés. Ainsi, dans son arrêt du 11 avril 2002, la chambre de l'instruction, saisie en appel d'une demande de remise en liberté de Mme Roselyne Godard, souligne notamment, pour justifier son rejet, que « compte tenu du regard porté sur les faits par Mme Godard, la détention provisoire est indispensable pour prévenir tous risques de pression sur les personnes qui la mettent en cause, en particulier les jeunes victimes et de concertation frauduleuse entre les membres de ce qui apparaît être un important réseau de pédophilie ». De même, dans des réquisitions du 21 octobre 2002, le procureur de la République « requiert qu'il plaise à Monsieur le juge d'instruction d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. Dominique Wiel », après avoir introduit comme suit son réquisitoire : « Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins, sur la victime ; - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ; En ce que : l'intéressé persiste malgré le caractère précis des charges réunies à son encontre à contester sa culpabilité ; que les victimes, toutes très jeunes, sont particulièrement influençables ». Le juge d'instruction, M. Cyril Lacombe, fait figurer mot pour mot cet attendu dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention provisoire, en date du 23 octobre 2002. Le JLD, M. Maurice Marlière, prolonge alors effectivement la détention provisoire de M. Dominique Wiel pour une nouvelle durée de six mois. La même argumentation reviendra ensuite de façon récurrente ; ainsi une nouvelle ordonnance de rejet de demande de mise en liberté concernant M. Dominique Wiel, rendue le 10 mars 2003 par le même JLD commence de la façon suivante : « Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; « Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices. » Toutes les autorités judiciaires, du juge d'instruction à la chambre de l'instruction, ont de fait utilisé à de multiples reprises cet argument du risque de pression ou de concertation, quel que soit le mis en cause, tout au long de la procédure, l'associant fréquemment au « regard porté sur les faits » et à une supposée insuffisance du contrôle judiciaire, celle-ci n'étant d'ailleurs pas démontrée. Ni les personnes sur lesquelles pouvaient s'exercer les pressions redoutées ni celles entre lesquelles risquait d'avoir lieu la « concertation frauduleuse » n'étaient clairement identifiées. Celle-ci pouvait sembler d'autant plus improbable que les membres du supposé réseau avaient tous été progressivement incarcérés. Comment, pour ne retenir que cet exemple, la « boulangère », Mme Roselyne Godard aurait-elle pu en avril 2002, c'est-à-dire à une époque où l'affaire et sa propre personne avaient déjà fait l'objet d'une très forte médiatisation, faire pression - à supposer qu'elle en ait eu l'envie - sur les enfants qui l'avaient accusée, alors que ceux-ci étaient placés en familles d'accueil et faisaient l'objet d'un suivi attentif des services sociaux ? De même, avec quels membres du « réseau » aurait-elle pu se concerter, étant observé qu'à cette date, même son mari, M. Christian Godard, l'un des derniers à avoir été inquiété, avait été lui aussi placé en détention ? À supposer qu'un risque de rencontre avec telle ou telle personne ait été réellement redouté, les multiples décisions de rejet des demandes de mise en liberté présentées par les acquittés d'Outreau ne précisaient pas quelles personnes étaient concernées, ni a fortiori pourquoi un contrôle judiciaire comportant interdiction de rencontrer ladite personne (ou lesdites personnes) aurait été insuffisant. Très ponctuellement, une décision de rejet pouvait être plus détaillée, sans être pour autant réellement plus explicite : ainsi un arrêt de la chambre de l'instruction du 28 novembre 2003 relève que « compte tenu du regard porté sur les faits par Pierre Martel, la détention provisoire de celui-ci s'impose également pour prévenir tous risques de pressions sur les témoins, en particulier les assistantes maternelles et les services sociaux qui ont révélé les faits ». Cependant, aucun élément ne permet de comprendre pourquoi M. Pierre Martel plus que ses compagnons d'infortune aurait cherché à faire pression sur les assistantes maternelles ou les services sociaux, ni qui au sein de ces services aurait pu se sentir particulièrement menacé par ce chauffeur de taxi qui n'avait jamais eu affaire à eux. De façon plus générale, une référence trop large à des catégories de personnes supposées menacées ne garantit pas le bon examen au fond du dossier présenté. Elle permet, en outre, d'écarter systématiquement le recours au contrôle judiciaire qui, s'il peut comporter interdiction de rencontrer des personnes clairement identifiées, ne peut évidemment comporter aussi facilement interdiction de contacts avec des entités aussi larges et indéterminées que les « services sociaux ». D'ailleurs, l'arrêt précité conclut qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en liberté de M. Pierre Martel, un contrôle judiciaire apparaissant insuffisant pour parvenir à ces fins. Il ne s'agit pas pour autant de revenir sur la possibilité de justifier des prolongations de détention provisoire par la volonté d'empêcher des pressions ou des concertations frauduleuses. Dans nombre d'affaires ces risques sont bien réels. Toutefois, il semble important de rechercher une formule qui permettra d'éviter qu'à l'avenir ils soient invoqués systématiquement et par simple décalque de la formule du 1° de l'article 144 du code de procédure pénale. La garantie du maintien à la disposition de la justice est un critère qui a été également largement utilisé pour justifier des prolongations de détention provisoire dans l'affaire d'Outreau. b) La garantie du maintien à la disposition de la justice Il est évident que le maintien en prison constitue le moyen le plus sûr d'empêcher tout risque de fuite. Cependant, le risque de soustraction à la justice a été bien souvent déduit du seul refus d'avouer les faits reprochés. Ce raisonnement a conduit à une situation pour le moins paradoxale. Mlle Aurélie Grenon, qui reconnaissait des faits particulièrement graves, a été remise en liberté dans des délais très rapides. Le 14 août 2001, soit moins de six mois après sa mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné, contre l'avis du juge d'instruction, son placement sous contrôle judiciaire en considérant que « le maintien en détention n'est plus justifié à ce stade de la procédure ni par les nécessités de l'enquête ni à titre de mesure de sûreté ». Le procureur de la République avait fait appel de cette décision mais la chambre de l'instruction, le 12 septembre 2001, avait confirmé le placement sous contrôle judiciaire de Mlle Grenon. Dans son arrêt, la chambre de l'instruction considérait : « Attendu que Mlle Grenon a reconnu la matérialité des faits, qu'elle avait vingt ans au moment des faits et qu'elle n'a jamais été condamnée, que le rapport psychiatrique écarte pour ce qui la concerne tout risque de récidive et la décrit comme influençable, qu'en habitant chez ses parents elle n'est plus en contact avec les résidents du quartier concerné par les faits et qu'elle justifie de garanties sérieuses de représentation en justice. » Certains acquittés ont indiqué, lors de leur audition par la commission d'enquête, que l'exemple d'Aurélie Grenon avait été cité pour les inciter à avouer, leur laissant espérer ainsi une remise en liberté. M. Daniel Legrand fils a clairement déclaré que cette situation paradoxale était l'une des causes de son affabulation sur le meurtre de la petite fille belge. Ayant un âge voisin, il n'a pas pu manquer de comparer sa situation à la sienne. De plus, comme elle, il n'avait jamais été condamné. Il n'avait jamais habité dans le quartier de la Tour du Renard et n'aurait donc pas été en contact avec les résidents du quartier en retournant chez lui. La seule différence réelle entre sa situation et celle d'Aurélie Grenon tenait donc effectivement, au départ, au fait qu'il niait toute implication dans des actes de pédophilie. Le maintien en détention semble avoir été utilisé comme un moyen de pression pour obtenir des aveux plutôt que comme une véritable mesure de sûreté au sens du 2° de l'article 144 du code de procédure pénale. Il a été reproché au juge d'instruction d'avoir tenu des propos tels que : À M. Dausque : « Vous avez intérêt à parler parce que pour vous c'est vingt ans. »284 À M. Martel : « J'ai trois ans pour instruire, vous aurez vingt ans pour réfléchir. »285 Dans les décisions ultérieures de rejet de demande de mise en liberté, le refus d'avouer a été très souvent couplé à la « sévérité de la peine encourue » pour justifier des craintes de tentatives de soustraction à la justice, comme en témoignent ces « attendus » relevés à la lecture de diverses ordonnances du JLD : - « Attendu que le système de défense qu'il a adopté et la sévérité de la peine encourue sont de nature à l'inciter à se soustraire à l'action de la justice et que face à ce risque, ses garanties de représentation sont manifestement insuffisantes » (extrait d'une ordonnance du JLD rejetant une demande de mise en liberté concernant M. François Mourmand, 4 juin 2002) ; - « que la sévérité de la peine encourue et le système de défense adopté par l'intéressé sont de nature à faire craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice » (extrait d'une ordonnance du JLD rejetant une demande de mise en liberté concernant M. Daniel Legrand, 7 août 2002) ; - « que par ailleurs, au regard du système de défense qu'elle a adopté et de la sévérité de la peine encourue le risque de fuite n'est pas à exclure alors qu'il est essentiel de maintenir l'intéressée à la disposition du magistrat instructeur » (extrait d'une ordonnance du JLD rejetant une demande de mise en liberté concernant Mme Roselyne Godard, 24 juillet 2002). Les intéressés se voyaient donc objecter par le JLD un risque de fuite reposant sur : - le « système de défense adopté » consistant en réalité en un refus d'avouer les faits très graves qui leur étaient reprochés ; - la sévérité de la peine encourue pour de tels faits : il s'agissait d'un élément objectif mais qui n'a pas été invoqué par le JLD dans le cas d'Aurélie Grenon, alors qu'elle était accusée des mêmes faits. Le refus d'avouer semble donc bien avoir joué un rôle déterminant dans l'appréciation du risque de « non-représentation » devant la justice, sauf dans le cas de Karine Duchochois, seule à n'avoir jamais été placée en détention provisoire bien que niant les faits. Parfois même, la sévérité de la peine encourue a paru suffisante pour invoquer le risque de soustraction à la justice. Ainsi, dans des réquisitions du 7 juin 2002 (qui ne seront toutefois pas suivies par la chambre de l'instruction), le substitut du procureur général a estimé que le maintien en détention d'Odile Marécaux s'imposait pour « garantir la maintien à disposition de la justice de l'intéressée eu égard à la peine criminelle encourue ». La question qui se pose est donc la suivante : peut-on déduire qu'il n'y a pas garantie du maintien à disposition de la justice, lorsque la personne refuse d'avouer ou lorsque la peine encourue est élevée ? La réponse ne va pas de soi. Un coupable qui a avoué peut être a priori tout autant tenté de fuir. Et il paraît difficile d'admettre qu'un innocent se voie refuser une mise en liberté, au motif qu'il se dit innocent ou encore que la loi prévoit des peines très sévères pour ceux qui sont réellement coupables. Pour autant, l'argument des garanties de représentation reste nécessaire. Peut-être serait-il néanmoins utile d'inciter le juge à le manier de façon plus circonstanciée, pour des raisons autres que la seule absence d'aveu et/ou la sévérité de la peine encourue. Il reste à apprécier l'usage qui a été fait du critère de l'ordre public dans cette affaire. c) Le trouble à l'ordre public Dans son rapport 2005, la Commission de suivi de la détention provisoire, relève « qu'on ne peut manquer de mentionner la persistance des interrogations que suscite parfois le recours formel aux critères légaux, plus particulièrement celui du trouble à l'ordre public, dont l'utilité n'est généralement pas niée, mais qu'il peut s'avérer délicat de continuer à appliquer au-delà d'une certaine durée de la procédure ». Dans l'affaire d'Outreau, le recours trop formel aux critères légaux a été parfois dénoncé par la défense, y compris à un stade avancé de la procédure. Ainsi, dans un mémoire produit par la défense de M. Pierre Martel devant la Cour de cassation, réunie en audience publique le 17 mars 2004, figure notamment l'argumentation suivante : « alors 1) que la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, sans se borner à reproduire les termes généraux de ce texte ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au demandeur, commis avec une grande violence, au préjudice de très jeunes enfants, avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble provisoirement apaisé par la détention des personnes mises en examen, sans relever d'éléments propres à la présente espèce et susceptibles de démontrer concrètement l'existence d'un tel trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations d'ordre général, n'a pas légalement justifié sa décision ; » « alors 2) que, pour justifier le maintien en détention, le trouble à l'ordre public, causé par l'infraction, doit être actuel et, partant, exister au moment où les juges statuent ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les faits reprochés à Pierre Martel, répétés dans le temps, commis avec une grande violence au préjudice de très jeunes enfants, par plusieurs adultes, avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, pour en déduire qu'il convenait de maintenir le requérant en détention, tout en énonçant que ce trouble était provisoirement apaisé par la détention de ceux désignés comme les principaux acteurs de ces faits et risquerait d'être ravivé par l'élargissement de l'un d'eux, ce dont il résultait que le trouble à l'ordre public n'était pas actuel, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; » La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi contre l'arrêt attaqué De façon générale, le recours au critère du trouble à l'ordre public tombe très souvent sous le coup de l'incompréhension, voire de la critique d'une utilisation trop facile, trop renouvelée et surtout insuffisamment motivée. Nos textes juridiques - et notamment le 3° de l'article 144 du code de procédure pénale - ne précisant pas ce qu'il faut entendre par trouble à l'ordre public, il est d'autant plus facile pour le juge de recourir à cette notion, soit sans la motiver, soit en la motivant par tout moyen. Il serait malvenu pour le législateur d'en faire le reproche au juge, dès lors que n'a pas été fait le choix d'un encadrement par les textes de cette notion. Il s'agit aujourd'hui de déterminer s'il est souhaitable et possible de l'encadrer législativement, lorsqu'elle est utilisée pour justifier la détention provisoire et en particulier sa prolongation. Rappelons que cette notion ne permettait pas, antérieurement à la loi du 9 septembre 2002, la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue était d'au moins dix ans d'emprisonnement (les prolongations motivées par l'ordre public restaient à ce titre tout à fait possibles dans l'affaire d'Outreau). Ce critère de l'ordre public en procédure pénale doit être rapproché du concept de l'ordre public en droit administratif. A quelles notions renvoie celui-ci ? Sans aucun doute à la trilogie traditionnelle de la sécurité publique, de la tranquillité publique et de la salubrité publique consacrée aujourd'hui par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et issue des lois révolutionnaires sur l'organisation départementale et de la loi communale de 1884. Dans l'affaire d'Outreau, le trouble à l'ordre public peut être rattaché à d'autres notions qui ont interféré avec ce critère, à savoir la médiatisation et le trouble à l'opinion publique. - La médiatisation excessive L'ordre public fut à de multiples reprises mis en relation avec la « médiatisation excessive » ou le « déballage médiatique », comme en témoignent ces quelques extraits d'attendus : · « qu'enfin, tant par leur durée et leur ampleur que par la mise à jour d'un réseau pédophile structuré, les faits ont causé à l'ordre public un trouble d'une telle intensité, encore aggravé par la médiatisation excessive de cette affaire que seule une mesure de détention est à même d'apaiser » (ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Franck Lavier, prise par le JLD le 3 mai 2002) ; · « Attendu, enfin, que les faits en cause sont à l'origine d'un trouble à l'ordre public particulièrement exceptionnel et persistant, encore aggravé par l'important déballage médiatique autour de cette affaire » (ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. François Mourmand prise par le JLD le 4 juin 2002) ; · « le maintien en détention d'Odile Marécaux s'impose : « en raison du trouble exceptionnel à l'ordre public causé par les faits qui ont fait l'objet d'une diffusion dans la presse nationale, l'information mettant à jour un réseau de prostitution enfantine organisé _..._ » (réquisitions du substitut du procureur général devant la chambre de l'instruction en date du 7 juin 2002) ; · « Attendu enfin que les faits reprochés à l'intéressé sont à l'origine d'un trouble à l'ordre public particulièrement exceptionnel encore accentué par l'important déballage médiatique qui s'est instauré autour de cette affaire » (ordonnance de saisine du JLD pour prolongation de la détention provisoire de M. Thierry Dausque prise par le juge d'instruction le 18 février 2003). Le maintien en détention provisoire pour cause de médiatisation paraît contraire au principe d'égalité des citoyens devant la justice. Selon qu'une affaire aura été « médiatisée » ou pas, un présumé innocent sera ou non privé de liberté. Si l'affaire est médiatisée, il restera en détention alors que l'absence de publicité pourrait conduire le juge à remettre en liberté beaucoup plus facilement un auteur qui reconnaît les faits. La remise en liberté d'Aurélie Grenon, qui rappelons-le ne contestait pas sa culpabilité, est intervenue en août 2001, soit avant la médiatisation et paradoxalement, la relation opérée entre l'ordre public et la médiatisation a conduit à rejeter ensuite les demandes de remise en liberté de ceux qui, à la différence d'Aurélie Grenon, proclamaient leur innocence. - Le trouble à l'opinion publique À la lumière de ces exemples, il est clair que le trouble à l'ordre public relève non pas uniquement de données objectives justifiant le placement en détention provisoire, mais également des réactions de l'opinion publique. Or, comme le souligne le rapport 2005 de la Commission de suivi de la détention provisoire (p. 51), « la différence doit être faite entre le trouble à l'ordre public et le trouble à l'opinion publique _..._ Si le juge ne doit pas nécessairement être insensible, ou indifférent à l'opinion publique, il doit veiller à trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires (ceux de la victime et de l'auteur notamment) dans le respect des droits de chacun et le souci de l'intérêt public, hors tout intérêt particulier ». En réalité, tout comme le juge administratif quand il statue sur des atteintes supposées ou non aux libertés publiques, le juge de la détention est amené à peser les implications d'une mise en liberté au regard de l'ordre public avec toutes ses composantes. Mais si ce critère de l'ordre public a été fréquemment invoqué pour des motivations contestables, on ne saurait omettre la responsabilité de l'institution du JLD dans cette affaire. B. LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION OU LA THÉORIE DU « DOUBLE REGARD » Si le JLD n'a pu exercer un réel contrôle sur la légitimité de la détention, c'est aussi parce que ce juge ne peut assumer correctement la charge qui lui a été confiée par la loi. 1. À l'origine du JLD : la volonté d'instaurer un « double regard » a) Le principe et l'objectif du « double regard » Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, le mandat de placement en détention provisoire n'émane plus du juge d'instruction. Lorsque ce dernier souhaite le placement en détention provisoire du mis en examen, il doit saisir un JLD, en application de l'article 145 du code de procédure pénale. La fonction de JLD elle-même a été créée par la loi précitée. Le législateur a souhaité qu'elle soit réservée à un magistrat d'expérience. C'est pourquoi à l'origine, le JLD devait être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, désigné par le président du tribunal de grande instance (article 137-1 du code de procédure pénale). L'article 145 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles le JLD doit, en théorie, prendre sa décision à l'issue d'un débat contradictoire notamment, où il entend les réquisitions du procureur de la République, les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (article 121) a introduit une possibilité pour le procureur de la République de saisir directement le JLD de réquisitions tendant au placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, lorsque le juge d'instruction n'a pas donné suite à ses réquisitions en ce sens (article 137-4 du code de procédure pénale). L'objectif poursuivi, lors de la création du JLD, était de permettre l'exercice d'un « double regard » sur la décision de détention provisoire, mesure d'atteinte par excellence à la présomption d'innocence. L'exposé des motifs du projet de loi, présenté par Mme Élisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, soulignait : « Le renforcement des droits des citoyens implique que le contentieux de la liberté et de la détention soit réservé à un juge du siège, en position d'arbitre impartial et "paraissant tel aux yeux de tous" selon les termes de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour que les mesures de détention provisoire fassent l'objet d'un examen rigoureux et soient réduites au strict nécessaire, leur prononcé doit être confié à un juge distinct du juge d'instruction. » Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 2 mars 2004, a estimé que l'article 121 de la loi précitée du 9 mars 2004 ne supprime pas le « double regard » en vertu duquel une mesure de placement en détention provisoire doit être examinée par deux magistrats du siège, mais se contente de l'aménager différemment : « En effet, la saisine directe du juge des libertés et de la détention ne peut intervenir qu'à la suite d'un premier refus du juge d'instruction de transmettre des réquisitions à fin de placement en détention au juge des libertés et de la détention. Même en cas de saisine directe de ce dernier juge, deux magistrats du siège auront en tout état de cause eu à connaître de la demande de placement en détention provisoire. Seul le "double assentiment" est donc remis en cause et non le "double examen" par des magistrats du siège. » (extrait de la décision n° 2004-492 DC). Outre sa compétence pour décider du placement en détention provisoire de la personne mise en examen, le JLD décide de la prolongation de la détention provisoire à l'expiration du délai prévu par la loi. En matière criminelle, c'est au bout d'un an que le JLD peut prolonger la détention provisoire pour une durée d'au plus six mois, renouvelable dans les conditions prévues par l'article 145-2 du code de procédure pénale. Il résulte de cet article que la décision de prolongation doit obéir aux mêmes conditions de forme que la décision de placement initial : notamment ordonnance motivée rendue sur demande du juge d'instruction et au vu des réquisitions du procureur de la République, à l'issue d'un débat en principe contradictoire... Le JLD peut, par ordonnance motivée, refuser la prolongation. S'il décide de prolonger la détention, son ordonnance de prolongation doit comporter, comme son ordonnance initiale de placement, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale. Selon la jurisprudence, les motifs de l'ordonnance de prolongation ne doivent pas se borner à reprendre purement et simplement ceux de l'ordonnance de placement en détention, car la situation a pu évoluer depuis ce placement. La prolongation doit se justifier par les éléments résultant de l'information à l'expiration du délai pour la durée duquel la détention a été ordonnée. L'article 145-3 du code de procédure pénale prévoit, en outre, que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions de prolongation ou de refus de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Les demandes de mises en liberté déposées par les détenus provisoires et leurs conseils sont, elles aussi, soumises au « double regard ». En application de l'article 148 du code de procédure pénale, de telles demandes, susceptibles d'être déposées à tout moment, sont adressées au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République, aux fins de réquisitions. Sauf s'il décide de donner une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant cette communication au procureur, la transmettre avec son avis motivé au JLD. Ce dernier statue dans un délai de trois jours ouvrables. Le débat contradictoire prévu pour le placement en détention ou sa prolongation n'est pas nécessaire (Crim., 26 février 2003) ce que certains estiment néanmoins contraire à la convention européenne des droits de l'homme. La personne concernée peut simplement faire appel du rejet, ou présenter à tout moment une nouvelle demande de mise en liberté. Dans ces trois hypothèses (placement en détention, prolongation de la détention ou demande de mise en liberté), la détention ne peut donc être prescrite ou maintenue qu'après examen de la question par au moins deux magistrats du siège. En revanche, il suffit en principe d'une décision d'un seul de ces magistrats pour y mettre fin, ce qui, soulignait l'exposé des motifs du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, « constitue une garantie nouvelle particulièrement importante au regard du respect de la liberté individuelle, et permettra de limiter les détentions à celles qui sont strictement et évidemment nécessaires. » b) Un objectif de réduction du recours à la détention provisoire qui a montré ses limites Ces limites peuvent résulter de l'évolution législative elle-même. Ainsi le « référé-détention » issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 permet au procureur de la République de faire appel d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le JLD, contrairement à ses réquisitions, dans les conditions prévues à l'article 148-1-1 du code de procédure pénale. Sur ce « référé-détention », c'est le Premier président de la cour d'appel qui statue, dans les conditions prévues à l'article 187-3, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Si ce magistrat estime que le maintien en détention est nécessaire au vu d'au moins deux des critères de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, qui doit statuer sur l'appel au plus tard dans les dix jours. Mme Jocelyne Rubantel, JLD, qui est intervenue de façon épisodique dans l'affaire d'Outreau, a dénoncé dans les termes suivants les limites imposées par l'évolution des textes : « Cela dit, si l'on considère que la détention provisoire est un problème, comment expliquer que la loi ait imposé au juge des libertés et de la détention de motiver son rejet d'une demande de placement en détention, alors que, dans un premier temps, la loi ne le prévoyait pas ? Cela doit tant que cela se motiver, une remise en liberté ? J'avoue qu'il m'est arrivé une fois de ne pas appliquer la loi. Quand j'étais juge d'instruction, cela me paraissait tout à fait évident, lorsque je décidais la remise en liberté d'une personne, que je n'avais pas à expliquer pourquoi je lui rendais sa liberté. Maintenant, le JLD doit donner une explication. Cette ordonnance motivée est une base permettant au parquet de faire appel de la décision. »286 Néanmoins, même si l'on s'en tient aux constatations statistiques, l'objectif poursuivi, à savoir la limitation du recours à la détention provisoire, semble bien ne pas avoir été atteint puisque, cinq ans après, le recours à la détention provisoire et sa durée moyenne sont en hausse régulière. Par ailleurs, le taux de confirmation par les JLD des demandes de placement en détention provisoire reste à un niveau élevé. Ce fut le cas dans l'affaire d'Outreau où, à l'exception de Mme Karine Duchochois, tous les mis en examen furent placés en détention par le JLD à l'issue de leur interrogatoire de première comparution. De même, toutes les demandes de prolongation des détentions provisoires présentées au JLD dans le cadre de cette affaire furent acceptées. Mais cette tendance est générale, comme le montre le tableau ci-après, même si une légère diminution du taux de confirmation des demandes de placement peut être constatée entre 2001 et 2004 :
Bien entendu, il n'est pas possible de tirer de véritable conclusion sur l'efficacité du « double regard » de seules données statistiques. Un taux de confirmation élevé des demandes de détention pourrait s'expliquer par le simple fait que ces demandes étaient justifiées. Mme Jocelyne Rubantel s'en est d'ailleurs expliquée lors de son audition : « J'ai beaucoup entendu dire que le JLD était un juge "suiveur", qui ne fait qu'entériner les demandes de mise en détention demandées par le juge d'instruction. Je me suis posé des questions. Chacun de nous ne peut que vivre douloureusement tout ce qui se passe, et nous pourrions être amenés à balayer un peu facilement les critiques qui nous sont faites. Je me suis demandé si ce grief était fondé ou pas. Finalement, tout est possible. Mais je suis intimement convaincue que la réalité n'est pas vraiment celle-là. En tout cas, je n'ai pas vécu les choses comme cela. D'abord, les magistrats du parquet et les juges d'instruction font déjà un tri très important. Quand on voit le nombre de dossiers d'instruction en cours et le nombre de personnes détenues, on constate qu'un premier tri important est fait par le parquet. Les JLD sont donc saisis de manière assez limitée. Par conséquent, que les JLD rendent régulièrement des décisions qui font droit à la demande de placement d'un juge d'instruction, ce n'est pas forcément le signe d'un dysfonctionnement absolu. »287 Le bilan de l'institution du JLD doit de fait s'inscrire dans une réflexion beaucoup plus large sur la place de ce juge. 2. Un juge qui n'est pas en mesure de maîtriser le dossier Parce que le JLD correspond plus à un emploi qu'à une fonction statutaire, parce que les conditions dans lesquelles il travaille sont souvent déplorables et parce qu'il s'agit d'un juge unique, l'institution du JLD a été bien peu défendue devant la commission. Ainsi que l'ont confirmé un certain nombre de témoignages devant notre commission d'enquête, les fonctions de juge des libertés et de la détention ne sont pas enviables. a) Des compétences trop dispersées et un mode de fonctionnement trop empirique Le tableau dressé par le « rapport Viout » sur le JLD est sans appel : « Le constat a pu être fait que les fonctions de juge des libertés et de la détention n'étaient pas fréquemment demandées par les vice-présidents qui, jusqu'à une modification législative récente (article 120 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), étaient les seuls à pouvoir prétendre à cette charge. L'objectif clairement affiché était que des magistrats d'expérience, ayant la distance nécessaire par rapport aux différents enjeux des dossiers, pourraient éviter des mises en détention hâtives et non indispensables à une bonne conduite de l'instruction préparatoire. Les fonctions du juge des libertés et de la détention sont parfois dépréciées, n'étant pas considérées comme intellectuellement stimulantes, le magistrat n'examinant le dossier que de manière ponctuelle, sans pouvoir influer sur le contenu de l'information. » Intervenant en sa qualité de JLD et de vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil288, Mme Françoise Barbier-Chassaing, a confirmé que la plupart de ses collègues se posaient aujourd'hui la question de savoir si le JLD était « une fausse bonne idée » ou « une bonne idée mal aboutie » et a mis en avant la diversification des tâches demandées à ce magistrat. Progressivement depuis sa création en 2000, le législateur a voulu en faire un « juge français de l'habeas corpus » en lui confiant des compétences exclusives sans pour autant en faire un magistrat spécialisé. De fait, outre les pouvoirs ci-dessus évoqués en matière de détention provisoire, le JLD s'est vu attribuer des compétences exclusives concernant notamment : - les autorisations pour des prolongations de garde à vue dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de flagrance en cas de criminalité organisée ; - les autorisations pour des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction dans les enquêtes préliminaires, pour les procédures fiscales et pour les enquêtes sur les prix et la concurrence ; - les autorisations pour des interceptions téléphoniques demandées par le parquet, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur une infraction relevant de la criminalité organisée ; - le contrôle des hospitalisations forcées ; - la possibilité, en cas de soustraction aux obligations du contrôle judiciaire, de prononcer le placement en détention provisoire ; - la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. Ce dernier contentieux revêtait d'ailleurs une importance tout à fait exceptionnelle au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à l'époque de l'affaire d'Outreau, compte tenu de la proximité et des problèmes posés alors par le camp de réfugiés de Sangatte, ainsi que l'a évoqué Mme Jocelyne Rubantel : « Lorsque nous étions JLD, nous avions le matin une audience de rétention qui nous occupait quasiment toute la matinée, en n'ayant parfois même pas le temps d'aller déjeuner. Nous passions ensuite aux comparutions immédiates, une tâche absolument redoutable, parce que vous vous retrouvez face à des dossiers qui sont traités par les services de police dans l'urgence, par un parquetier dans l'urgence, par un avocat qui intervient dans l'urgence, avec toutes les limites que cela comporte. À cette époque, le camp de Sangatte était encore ouvert, et était un gros pourvoyeur de comparutions immédiates extrêmement difficiles. J'ai le souvenir de bagarres générales qui se déroulaient dans le camp entre deux communautés, avec des CRS qui intervenaient pour tenter de calmer les choses. Ceux qui étaient identifiés clairement nous étaient déférés dans le cadre de comparutions immédiates. Je peux vous assurer qu'il est difficile, avec des photographies prises par les services de police pendant la bagarre, d'essayer de comprendre quel était le rôle de chacun et de savoir si par hasard certaines personnes n'étaient pas impliquées à tort. Bref, les présidences de comparution immédiate nous occupaient très largement. Et puis, nous traitions les demandes de mise en liberté et souvent, le soir, nous statuions sur des demandes de mise en détention. »289 Ces attributions très diversifiées relèvent de contentieux techniques souvent encadrés dans des délais très courts pour les saisines et les décisions. Ils allient donc technicité et urgence et ne sont pas, pour autant, confiés à des magistrats spécialisés ou volontaires pour exercer cette fonction. En effet, selon la taille des tribunaux, il s'agit du président de la juridiction, d'un vice-président ou de plusieurs vice-présidents. Ces derniers, contrairement aux autres magistrats spécialisés (VP instruction, VP application des peines...) sont statutairement des VP généralistes, ce qui signifie qu'ils ne choisissent pas de devenir JLD en demandant leur mutation, qu'ils ne bénéficient pas des garanties accordées aux magistrats spécialisés (leur délégation peut être retirée à tout moment) et qu'ils n'ont pas, avant leur prise de fonction, la formation continue adéquate. Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en cas d'empêchement du JLD désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le JLD est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance (article 137-1 du code de procédure pénale). C'est ainsi, a expliqué Mme Barbier-Chassaing, que l'on trouve parmi les JLD des « intermittents », mais aussi des magistrats permanents, qui font partie d'un service - c'est son cas à Créteil - mais ne sont pas nécessairement spécialisés. Or, a-t-elle ajouté, « le service des libertés et de la détention est un service de la crise et de l'urgence, qui requiert technicité, compétence, disponibilité et maturité. C'est un service qui demande des capacités professionnelles qui ne s'inventent pas, un service qui nous interdit le droit à l'erreur »290. En outre, le mode de fonctionnement empirique du service des libertés et de la détention provisoire débouche sur des pratiques variées, susceptibles d'engendrer des inégalités entre justiciables. En effet, selon l'importance des tribunaux et les vacances de postes, le service des libertés et de la détention provisoire est différemment organisé, ce qui influe considérablement sur les pratiques. Dans les petites et moyennes juridictions, le président et le, ou les vice-présidents, organisent par semaine une permanence et parfois confient au même vice-président le suivi des dossiers. Ils mutualisent leurs moyens avec les autres petites et moyennes juridictions du ressort pour composer les audiences correctionnelles, puisque le JLD ne peut juger une affaire dans laquelle il a statué es qualités. Souvent, il n'y a pas de greffe dédié au JLD, la loi ne faisant obligation que d'avoir un greffier présent aux audiences. Or, les greffiers JLD, contrairement aux greffiers instruction, ne bénéficient pas, pour cette raison, de la nouvelle bonification indiciaire (prime supplémentaire incluse dans le calcul des droits à retraite). Dans les juridictions plus importantes, il y a un service des libertés et de la détention avec, si possible, cinq JLD qui tournent, par semaine ou par jour, soit sur la permanence JLD soit sur la présidence des comparutions immédiates soit sur le contentieux des étrangers. Le suivi des dossiers d'instruction est soit aléatoire en étant fonction du JLD de permanence, soit affecté à un ou deux JLD. Cette organisation hétérogène issue, principalement, des contraintes générées par la carte judiciaire, explique que la fonction du JLD n'est pas stabilisée ni lisible et que, par voie de conséquence, les relations avec le parquet, l'instruction et les avocats ne soient pas organisées. Ce mode de fonctionnement empirique conduit à des pratiques variées, concernant notamment le contentieux de la détention provisoire : ainsi certains JLD considèrent qu'il faut s'en tenir à la lettre des textes et ne pas examiner le fond du dossier ; d'autres, au contraire, abordent le dossier en consignant dans leurs ordonnances les indices graves et/ou concordants et, parfois même, en subordonnant le placement ou la prolongation de la détention à la réalisation de certains actes. Ces JLD interventionnistes estiment que, seul, ce genre de contrôle contribue à éviter qu'un dossier ne dorme. Cette diversité des pratiques de l'exercice du « double regard », la façon différente dont les JLD conçoivent leur mission, mais aussi et peut-être surtout les mauvaises conditions dans lesquelles certains sont amenés à rendre leurs décisions sont sources d'inégalités entre justiciables. Ces inégalités sont particulièrement choquantes lorsqu'elles se répercutent sur l'examen au fond des dossiers présentés. b) Des conditions d'intervention déplorables et un examen au fond souvent défaillant À la multiplicité des fonctions de nombreux magistrats exerçant celle de JLD, s'ajoutent des conditions d'intervention, en cette dernière hypothèse, décrites comme parfois très difficiles. Là encore, la description fournie par le « rapport Viout » est éclairante : « les sujétions et contingences professionnelles inhérentes à cette fonction sont souvent redoutées par des magistrats qui aspirent à d'autres conditions de travail. Les juges des libertés et de la détention en activité sont souvent les magistrats récemment arrivés au sein de la juridiction et n'ayant pas nécessairement une connaissance approfondie du droit et de la procédure pénale. En outre, le système de rotation de plusieurs magistrats, actuellement adopté dans de nombreuses juridictions, est néfaste. « Bien souvent, l'attribution de cette fonction donne lieu à des négociations entre les vice-présidents et le chef de juridiction aux termes desquelles garantie est donnée qu'une priorité sera accordée au juge des libertés et de la détention pour changer de fonction et obtenir une affectation conforme à ses vœux, dès la nomination d'un nouveau vice-président dans la juridiction. » Les « présentations tardives » ont été particulièrement mises en exergue au cours des auditions de la commission d'enquête, tant par les principaux intéressés, que par les avocats ou les représentants des syndicats. M. Maurice Marlière, JLD à l'origine de la plupart des décisions prises en matière de détention dans le cadre de l'affaire d'Outreau, les a ainsi évoquées : « Je voudrais également dire un mot des présentations tardives. Le JLD, en matière d'instruction, intervient en bout de chaîne, après l'ouverture d'une information par le parquet et la mise en examen par le juge d'instruction, lequel prévient le JLD qu'il est susceptible d'être saisi. Nous ne savons jamais, en définitive, si nous le serons réellement. Le plus souvent, nous le sommes, mais il est arrivé que nous ne le soyons pas. Il est arrivé très souvent également qu'il s'agisse de saisines tardives, et dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. [...] Je prenais connaissance de la procédure aussi rapidement que possible. [...] À plusieurs reprises, je suis rentré à mon domicile à une heure, voire deux heures du matin, ce qui ne permettait pas de respecter la fameuse circulaire de Mme Lebranchu publiée en 2002, laquelle prévoyait onze heures consécutives de repos entre la fin d'une journée et le début de la journée suivante, puisque les audiences de rétention d'étrangers débutaient à l'époque à neuf heures. Je précise que je ne vous ai pas dressé ce tableau des conditions d'exercice de ma fonction dans le but de me retrancher derrière un surcroît de travail, mais pour vous faire état de la réalité de la tâche qui était la mienne et celle de ma collègue à l'époque. »291 Sa collègue, Mme Jocelyne Rubantel, a elle aussi évoqué la difficulté de sa tâche, exercée dans des conditions de précipitation incompatibles avec une prise de décision sereine et réfléchie : « Vous avez une personne qui a été gardée à vue, qui est souvent fatiguée, pour ne pas dire épuisée. Il est une heure du matin et elle n'a pas mangé, pas plus que vous. Vous avez un juge d'instruction qui était lui aussi fatigué, un avocat qui n'est peut-être pas au mieux de sa forme, et vous avez aussi des fonctionnaires de police qui parfois ont fait la garde à vue et assurent le défèrement au tribunal. Eh bien, vous sentez autour de vous que tout le monde a l'air de dire : "Bon, bon, bon. Quand est-ce qu'on commence ? Quand est-ce qu'on y va ?" C'est une réaction humaine. J'ai senti à certains moments une pression autour de moi. En gros, c'était : "Qu'on en finisse" Or, lorsqu'il s'agit d'apprécier des demandes de placement en détention provisoire, je crois qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Je crois qu'il aurait été opportun que la loi prévoie que le JLD puisse décider de statuer le lendemain, et pas à une heure du matin. La loi ne l'a pas prévu, et cela provoque de grandes difficultés. »292 Il est clair que, placé dans de telles conditions, le JLD qui prend la décision gravissime de l'incarcération est le plus mal placé pour en apprécier l'opportunité. Il ignore le plus souvent les détails de l'enquête et n'a guère la possibilité de prendre connaissance du dossier dans son entier, lorsque les premiers défèrements surviennent après plusieurs mois d'investigations. Il s'en tiendra donc aux arguments qui lui seront présentés fréquemment dans l'urgence et à des heures tardives. Les conditions d'intervention du JLD lorsqu'il se prononce sur des prolongations de détention ou sur des demandes de mise en liberté pourraient être, a priori, plus favorables. Il n'est plus obligé de statuer dans la même urgence et pourrait avoir alors acquis une meilleure connaissance du dossier, lui permettant de se prononcer après un examen au fond de l'affaire. La prolongation de la détention est en effet organisée selon les mêmes conditions de procédure que le placement, l'article 145-2 renvoyant à l'article 145. Or, ce dernier article prévoit que le JLD se prononce sur la détention « au vu des éléments du dossier ». La circulaire d'application de la loi du 15 juin 2000 (CRIM 00-16 F1 du 20 décembre 2000) est venue par ailleurs préciser que dans tous les cas, la date limite avant laquelle la prolongation doit intervenir étant connue à l'avance, il est souhaitable que les JLD soient informés au moins une quinzaine de jours avant la date prévue pour le débat. Cette information lui est donnée par le juge d'instruction. C'est en effet à ce dernier et non au JLD de suivre la durée des détentions concernant les dossiers de son cabinet, pour saisir en temps utile le JLD aux fins de prolongation d'une détention provisoire. Pourtant, ce n'est pas pour autant que l'examen du fond du dossier semble alors garanti, de grandes différences de pratique pouvant exister entre JLD, du fait d'une interprétation très restrictive des textes par certains d'entre eux. En témoigne cet extrait de l'audition de M. Maurice Marlière : « M. Maurice Marlière : Je voudrais également éviter qu'un malentendu naisse entre vous et moi. Tout à l'heure, vous m'avez dit que je ne m'intéressais pas aux faits. Ce n'est pas que je ne m'intéressais pas aux faits, c'est que la loi m'interdisait d'en faire état à nouveau dans mon cabinet. Il faut que ce soit clair. M. le Président : Quel article du code de procédure pénale vous l'interdit ? M. Maurice Marlière : Ce n'est peut-être pas écrit littéralement, mais c'est l'interprétation que je fais de l'article 145. Peut-être est-ce une interprétation trop restrictive. M. le Rapporteur : L'article 145 dit : « Au vu des éléments du dossier,... » M. Maurice Marlière : « Au vu des éléments du dossier,... », cela veut dire : au vu des éléments du dossier tel qu'on vous le livre. Cela dit, peut-être que je fais de cet article une interprétation trop restrictive. M. le Rapporteur : Peut-être est-ce une interprétation bien restrictive. Je ne suis pas sûr que ce fût l'intention du législateur, dans la mesure où le législateur ne souhaite pas a priori que soient mises ou maintenues en détention des personnes contre lesquelles il n'y aurait pas de charges suffisantes. »293 Précédemment au cours de cette même audition, M. Maurice Marlière avait également énoncé les raisons pour lesquelles le débat est nécessairement tronqué devant le JLD. Cependant, à aucun moment, la loi n'interdit au JLD d'aborder le fond du dossier, le second alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale énonçant précisément : « Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. » S'agissant enfin des demandes de mise en liberté, l'examen au fond de l'affaire paraît être également souvent défaillant, mais cette carence est plus particulièrement due à l'impossibilité pour le JLD de rencontrer la personne détenue. De façon générale, le JLD est un magistrat qui manque de contacts humains, trop soumis lui aussi, à l'emprise du « dossier papier ». c) Un juge seul avec un « dossier papier » · L'examen des demandes de mise en liberté sur « dossier papier » M. Maurice Marlière a exposé en termes particulièrement clairs le problème posé par l'impossibilité d'établir un contact humain à l'occasion des demandes de mise en liberté : « Un autre point me paraît devoir être souligné, qui pourrait, à moindre coût, faire l'objet d'une réforme législative. À aucun moment, au stade de l'examen d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention n'a de contact physique avec la personne qui sollicite sa mise en liberté. S'il est fait appel d'un rejet de la demande, la personne peut solliciter sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction, qui est de droit. Devant le juge des libertés et de la détention, cela n'est pas prévu. Dans le cadre du dossier d'Outreau, le premier avocat de M. Dominique Wiel, à l'appui d'une demande de mise en liberté, m'avait sollicité la comparution personnelle de son client. Je l'ai appelé et je lui ai indiqué que cette disposition était prévue pour la chambre de l'instruction mais pas pour le JLD, que je le déplorais, mais que malheureusement, je ne pouvais pas faire extraire son client. Je sais que Mme Odile Marécaux vous a dit qu'elle multipliait les demandes de mise en liberté et qu'elle ne voyait jamais le JLD : ce n'est pas du fait de la mauvaise volonté du JLD, ni d'une surcharge du travail, c'est une impossibilité légale. »294 Mme Jocelyne Rubantel a décrit de façon tout aussi précise le malaise de ce magistrat « dépourvu de sensations » trop seul face à son « dossier papier » : « La loi a fait du juge des libertés et de la détention un juge dépourvu de sensations. Ayant passé dix années dans des fonctions pénales, je me suis rarement sentie aussi mal à l'aise que dans celles de JLD. J'ai entendu des acquittés qui disaient : « mais enfin, quand même, ces JLD qui rejetaient mes demandes de mise en liberté, je ne les ai jamais vus ». Je me disais : « mais moi non plus ! Je ne les avais jamais vus ». J'ai découvert physiquement ceux qui ont été condamnés ou acquittés à la télévision, au moment du procès de Saint-Omer. Jamais je n'avais jamais vu aucun d'eux. Jamais je n'ai pu me faire une autre idée que celle du dossier papier, avec ses cohérences et ces incohérences. Un juge dépourvu de sensations peut-il vraiment bien juger ? »295 · L'impossibilité d'assister aux interrogatoires et aux confrontations Les magistrats auditionnés par la commission ont également mis l'accent sur ce point, source lui aussi d'isolement du JLD. Mme Jocelyne Rubantel a ainsi exprimé ses regrets : « Dans ce dossier, il y a des moments où, en tant que JLD, j'aurais vraiment aimé assister à des interrogatoires du juge d'instruction, non pas pour poser des questions, ce qui n'est pas mon rôle, mais pour regarder, observer, écouter, voir le non-dit, l'impalpable. À certains moments, ce n'est pas tant la réponse littérale à une question qui importe, mais tout ce que la personne a dégagé dans sa réaction : son indignation, ses accents de sincérité. Quand vous lisez un procès-verbal, même s'il est fait de manière remarquable, vous n'avez pas ces sensations. » M. Maurice Marlière a déploré d'être ainsi privé des « impressions d'audience » : « Les rencontres avec les personnes mises en examen sont bien trop brèves. Le JLD ne pouvant pas assister aux interrogatoires de celles-ci, il est privé de ce que j'appelle les impressions d'audience. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été magistrats instructeurs. Je pense qu'il leur est arrivé, à travers des rencontres avec les personnes mises en examen, de recueillir des informations d'une extrême importance, qui ne passent pas forcément à travers un procès-verbal mais qui permettent de se faire une idée. Cela n'est pas possible pour le JLD. »296 L'article 120 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 dispose en effet que le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions et ouvre la possibilité d'y assister au procureur de la République et aux avocats des parties (la loi n° 2000-204 du 9 mars 2004 ayant en outre étendu cette faculté aux témoins assistés) avec possibilité pour ces personnes de « poser des questions ou présenter de brèves observations ». Dans le cadre de l'affaire d'Outreau, le procureur de la République, M. Gérald Lesigne a indiqué ne pas avoir utilisé la possibilité qui lui était offerte par l'article 120 précité. Il n'en reste pas moins vrai que les JLD, effectivement, ne disposent pas légalement de la même opportunité que le procureur de la République. · L'impossibilité de rencontrer les détenus en maison d'arrêt Mme Barbier-Chassaing a souligné, en outre, l'absence de « suivi humain » découlant notamment de l'impossibilité, pour le JLD, de rencontrer en prison les personnes qu'il a placées en détention provisoire : « Pourtant, là encore, aucun suivi humain ne nous est permis. Le code de procédure pénale prévoit, pour les visites des établissements pénitentiaires, que le président de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction, le juge des enfants, le parquet, peuvent se rendre en prison voir les détenus et prendre des mesures. Rien n'est prévu pour les JLD, alors que ce sont eux qui placent en détention. C'est nous qui prolongeons la détention ! Quel peut être notre suivi ? Ce sont les demandes de mise en liberté, les prolongations de détention provisoire. Là encore, au gré de la carte judiciaire, les pratiques sont différentes. Des JLD suivent leurs dossiers, d'autres non parce que les dossiers sont affectés de manière aléatoire, en fonction de la permanence du jour. »297 · Un pouvoir limité et solitaire En définitive, le JLD apparaît comme un magistrat exerçant une fonction réductrice et éminemment solitaire. Il statue seul dans des délais très courts sans pouvoir recourir à la collégialité ni à une mise en délibéré. Pour le suivi des détentions provisoires, il n'a aucun contact avec les enquêteurs et ne peut donc avoir directement une influence sur le calendrier de l'enquête. De même, il ne peut, d'office, mettre en liberté, ou visiter les détenus qu'il a placés en détention. Le contact humain avec le mis en examen se réduit aux audiences de placement ou de prolongation des détentions provisoires : encore s'y exerce-t-il de façon limitée voire expéditive. Face aux constats démontrant que le JLD est une fonction inaboutie et que cette expérience a en grande partie échoué, se pose la question de la solution à apporter : faut-il renforcer l'institution du JLD en lui donnant des moyens supplémentaires pour répondre aux attentes initialement suscitées par sa création ? Faut-il au contraire la supprimer ? Si le JLD a été sous le feu de la critique dans ce dossier, la chambre de l'instruction n'a pas été non plus épargnée. C. LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, CHAMBRE DE CONFIRMATION On ne dispose pas au niveau national de statistiques sur le taux de confirmation ou d'infirmation des décisions des chambres de l'instruction. On sait seulement qu'en 2004 sur 34 888 arrêts, 460 ont statué sur une mise en accusation, 21 724 sur la détention provisoire (62 %) et 2 134 sur le contrôle judiciaire. La réalité du fonctionnement des chambres de l'instruction a été décrite sans détour par le Procureur général Viout : « Aujourd'hui, qu'il s'agisse des pouvoirs propres du président, du suivi de la procédure d'instruction, la chambre de l'instruction est dans l'incapacité absolue d'appliquer les dispositions du code de procédure pénale. Totalement submergées par les procédures, les chambres de l'instruction ne peuvent rendre leurs arrêts dans le bref laps de temps prévu par la loi. Les trois malheureux magistrats qui composent la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ont rendu l'an dernier 1 741 décisions. Comment serait-il possible, dans un dossier aussi volumineux que celui d'Outreau, qu'après qu'une première option a été prise, et à chacun des passages devant la chambre de l'instruction, le magistrat se replonge dans le dossier ? Les chambres de l'instruction sont donc obligées de s'en tenir à une approche sommaire. Or elles sont très importantes parce qu'elles devraient assurer la liaison, le dialogue permanent avec le magistrat instructeur »298 Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, le nombre d'arrêts statuant sur la détention provisoire est supérieur à la moyenne nationale, puisqu'il s'élève à 1 970 sur 2 679, soit un taux de 73,3 %. Dans le dossier d'Outreau, comme on l'a déjà vu, 165 demandes de mise en liberté ont été présentées à la chambre de l'instruction après la clôture de l'information par les huit personnes mises en détention. 163 l'ont été durant les sept mois précédant la comparution devant la cour d'assises. M. Dominique Wiel a présenté, à lui seul, 129 demandes, soit 18 par mois, dont 2 avec des observations sommaires d'avocat, tandis par exemple que les 11 demandes de M. Alain Marécaux étaient toutes soutenues par les observations sommaires de son avocat. Les représentants de la chambre de l'instruction se sont défendus devant la commission d'enquête de se considérer comme les membres d'une juridiction du second degré dont le rôle reviendrait essentiellement à confirmer l'activité des juridictions d'instruction du premier degré. Toutefois, la réalité vient démentir ces déclarations. Par exemple, si l'on se concentre exclusivement sur Mmes Myriam Badaoui, Roselyne Godard, MM. Daniel Legrand, Alain Marécaux, Pierre Martel, François Mourmand et Dominique Wiel, entre le 7 mai 2001 et le 1er avril 2003, 60 décisions de la chambre de l'instruction relatives au contentieux de la détention sur 67 ont confirmé les décisions du premier degré. Devant la commission d'enquête, M. Pierre Martel a exprimé avec force les doutes que pouvait ressentir un détenu devant la chambre de l'instruction sur l'utilité de sa demande de liberté : « On vient vous chercher, et on vous présente devant le président de la cour d'appel, qui vous demande ce que vous avez à dire. La première fois, vous criez votre innocence, vous êtes plein d'espoir. Vous vous dites que si le juge d'instruction n'a pas vu certaines choses, les magistrats qui exercent en appel vont les voir, ils sont là pour ça. Ils sont là pour déterminer si vous présentez toutes les garanties nécessaires pour une éventuelle mise en liberté, mais ils ne sont pas là pour aller au fond du dossier. Par conséquent, je ne pense pas qu'ils servent à grand-chose. »299 Comme arguments, les magistrats de la chambre de l'instruction ont mis en avant les délais dans lesquels leur décision était enserrée ; comme on l'a vu plus haut (cf. supra chapitre V), le président Didier Beauvais a insisté sur les échéances très courtes dans lesquelles la chambre de l'instruction statuait : « Compte tenu de la brièveté des délais, la chambre de l'instruction doit rendre sa décision le jour de l'audience ou, dans la meilleure des hypothèses, le lendemain ou le surlendemain. »300. En rappelant qu'il avait signé plus de 20 000 arrêts en huit ans à Douai, M. Didier Beauvais a fait état du volume de contentieux qu'il avait traité à raison de trois audiences par semaine et à raison de 25 affaires en moyenne par audience. Ces arguments de la brièveté des délais ont été repris le 28 février par Mme Brigitte Roussel, Présidente de la chambre de l'instruction de Douai. Ces contraintes n'ont pas empêché cependant les membres de la chambre de l'instruction, d'après eux, d'examiner au fond le dossier dont ils avaient été saisis. Devant la commission d'enquête, Mme Aude Lefebvre, membre de la chambre de l'instruction, qui a considéré que « l'institution judiciaire avait bien fonctionné » en l'espèce, a fait valoir que l'avis de la chambre de l'instruction n'avait jamais été « figé ». Elle a ajouté : « nous n'avons jamais tenu notre décision précédente pour acquise, sauf quand le dossier était au même stade. Et encore, même dans ce cas nous avons repris notre échange. Quand cela était possible, nous avons regardé à plusieurs le dossier... »301 Évoquant la décision du 11 avril 2002 relative au maintien en détention de Mme Roselyne Godard, Mme Brigitte Roussel a reconnu qu'« elle reprend la motivation d'un arrêt précédent de la chambre de l'instruction »302. Mme Sylvie Karas, membre également de la chambre de l'instruction a illustré cette tendance du magistrat à épouser les thèses de son collègue : « Si je lis cette décision (celle de mon collègue) attentivement, si mon collègue l'a motivée en faisant référence à tels éléments du dossier, si après avoir pris connaissance de ces éléments, je suis d'accord avec cette analyse, pourquoi aller plus loin ? »303 La lecture de ces explications donne raison au Président Guy Canivet, qui constate : « la décision n'est finalement imputable à personne. Entre le parquet qui requiert, le juge d'instruction qui la demande , le juge des libertés et de la détention qui l'ordonne et la chambre de l'instruction qui la contrôle, la décision est partagée entre de multiples intervenants, chacun s'en remettant finalement à l'autre . En définitive, c'est de la bureaucratie judiciaire. »304 En soulevant la question de la fonction de la chambre de l'instruction, M. Gilles Straehli, président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nancy, a laissé entendre que sa marge de manœuvre était réduite : « Nous n'avons jamais compris que le législateur attendait de nous que nous apportions systématiquement la contradiction aux décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. »305. L'analyse des décisions de la chambre de l'instruction conduit de fait à relever une certaine répétition dans les motivations, notamment lorsque le détenu clame son innocence, la référence au « regard porté sur les faits » par le détenu se retournant contre lui. On le vérifie par exemple dans l'arrêt rendu le 11 avril 2002 concernant Mme Roselyne Godard ; dans les arrêts des 26 septembre 2003 et 17 février 2004 à l'encontre de M. Daniel Legrand fils ; dans les arrêts du 29 juillet 2003 et du 12 mars 2004 rendus à propos de M. Pierre Martel. Il en va de même dans l'arrêt du 14 août 2003 rejetant la mise en liberté de M. Alain Marécaux. En dehors de cette motivation stéréotypée et qualifiée de peu « heureuse » par un membre de la chambre de l'instruction devant la commission306, on remarque aussi que le changement de composition de celle-ci peut influer de manière déterminante sa décision. Ainsi, alors que dans une formation différente la chambre de l'instruction avait refusé la mise en liberté de Mme Roselyne Godard quatre mois auparavant et que dans les deux cas un avocat avait présenté des observations sommaires, Mme Godard a été mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire le 13 août 2002. L'arrêt lui imposait de résider chez son frère. Mais quatre mois auparavant la chambre de l'instruction ne s'était pas assurée que son frère pouvait l'accueillir. En revanche, les garanties d'hébergement chez la sœur de M. Dominique Wiel en région parisienne ne furent pas prises en compte pour ce dernier par la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 25 février 2003 et il dut rester en détention. D. L'ABSENCE DE CULTURE DU CONTRÔLE Parmi les dysfonctionnements les plus saillants relevés par la commission d'enquête, l'absence de culture de contrôle au long de la chaîne judiciaire occupe indéniablement une place importante. Me Éric Dupont-Moretti a illustré cette dispersion des responsabilités lors de son audition par la commission d'enquête : « c'est l'institution qui est en cause. Elle a d'autant moins d'excuses que soixante magistrats ont vu ce dossier et que personne, ni à la chambre de l'instruction, ni au parquet général ni à Boulogne, n'a tiré la sonnette d'alarme. »307 La commission a pu s'en convaincre à partir de plusieurs constatations : le défaut de transmission d'information lors du passage de témoin d'un magistrat instructeur à l'autre ; la pratique du « suivisme judiciaire » ; le manque de culture du travail d'équipe au sein de la magistrature et enfin la confusion occasionnelle des rôles. 1. Le défaut de transmission d'informations lors du passage de témoin entre magistrats Loin d'être isolée, cette pratique semble au contraire assez fréquente. Une jeune juge d'instruction qui faisait partie de la délégation de magistrats entendue par la commission d'enquête le 29 mars 2006 n'a pas caché la surprise que lui a révélé sa première prise de fonctions : « Après le temps de la formation vient celui de la prise de poste. Ce moment est particulièrement délicat, pour tout magistrat, car il est marqué par une absence totale d'organisation. Il n'y a aucune transmission d'information prévue entre le magistrat qui s'en va et celui qui arrive le lendemain, ni sur l'état du cabinet, ni sur les dossiers prioritaires ou problématiques. Un contact peut s'établir entre les magistrats mais il reste à leur entière discrétion. Si ce contact ne s'établit pas, le magistrat doit s'astreindre en arrivant, à un état des lieux de son cabinet, qui peut être long et fastidieux. »308 La succession du magistrat instructeur Cyril Lacombe à son prédécesseur Fabrice Burgaud est éclairante à cet égard. M. Cyril Lacombe a été nommé par décret du Président de la République du 28 juin 2002 juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Désigné juge d'instruction par ordonnance du Président du tribunal de grande instance le 3 septembre 2002, il a rejeté le lendemain un nombre très important d'actes qui avaient été sollicités par Me Hubert Delarue, avocat de M. Alain Marécaux. Devant la commission d'enquête, M. Cyril Lacombe a fait valoir qu'il avait rencontré M. Fabrice Burgaud, alors que ce dernier était encore en fonctions mais qu'il lui avait peu parlé de l'affaire d'Outreau309. Cependant, on a du mal à croire que le juge d'instruction Lacombe ait pu se pénétrer d'un dossier aussi complexe au pire entre le 3 et le 4 septembre et au mieux entre la fin août 2002 et la notification du rejet d'actes, soit le 4 septembre. 2. La pratique du « suivisme judiciaire » Même si elle est contraire à la fois à l'impartialité et à une bonne administration de la justice, la tentation pour l'acteur de la chaîne judiciaire, qui intervient dans la procédure de confirmer purement et simplement la position de son prédécesseur par confort intellectuel ou par manque de temps n'est manifestement pas un cas d'école dans le système judiciaire français. Plusieurs exemples dans cette affaire illustrent la fréquence de cette pratique, qu'il s'agisse des refus d'actes de la part du juge d'instruction Cyril Lacombe ou de la retranscription du réquisitoire définitif. Les demandes d'investigations complémentaires évoquées ci-dessus, adressées par Me Hubert Delarue et figurant sous la cote D 2757, n'étaient pas sans importance pour l'orientation ultérieure de l'instruction. L'avocat demandait la jonction des photographies des différentes personnes mises en cause de manière précise et circonstanciée par plusieurs victimes ou personnes mises en examen. À ce titre, il souhaitait qu'un album photographique exhaustif des personnes mises en cause soit montré à l'ensemble des enfants susceptibles d'avoir été victimes des faits justifiant l'instruction. La défense désirait également saisir auprès des proches, de la famille ou de la belle famille de M. Alain Marécaux, des photos représentant ce dernier entre 1997 et 2000, afin d'avoir de lui une présentation photographique plus conforme à la réalité. La saisie des agendas professionnels de l'intéressé, pour prouver qu'il avait eu à traiter comme huissier de justice un dossier sur les époux Badaoui-Delay dans les années 1995/96 et non en 1998, comme le prétendait Mme Badaoui était aussi réclamée. Il en allait de même de l'audition du lieutenant de police Franck Devulder qui avait mené l'enquête en Belgique. Toutes ces demandes d'actes seront rejetées par le juge Lacombe. Ainsi dans son ordonnance, il considère que « la jonction ou plus exactement l'annexion des photographies des personnes mises en cause non mises en examen et leur présentation aux enfants n'apparaissent pas à ce stade de la procédure d'information utiles à la manifestation de la vérité ». La demande de nouvelles photographies est récusée, au motif « qu'elle ne vise qu'à retarder l'instruction et que l'annexion de telles photographies ne présente pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité dans la mesure où il est établi que la photographie présente au dossier est bien celle de M. Alain Marécaux ». Quant aux agendas professionnels des années 1995-1996, « s'ils n'ont pas été saisis à l'étude, c'est qu'ils ont été, selon toute vraisemblance, détruits ou jetés une nouvelle perquisition n'apparaît dès lors pas nécessaire ». Enfin il n'est pas accédé à la requête tendant à auditionner le lieutenant de police Devulder, dans la mesure où son audition « n'apporterait pas d'éléments supplémentaires par rapport à toutes les diligences effectuées qui sont présentes dans la procédure ». Cependant la motivation de l'ordonnance montre que le nouveau magistrat instructeur a pris connaissance du rapport de police belge, qui figure au dossier (D 1605). Or, ce document, on le sait, reflète un grand scepticisme de la police belge quant à la crédibilité des déclarations de Mme Badaoui et à l'existence réelle d'une piste belge. C'est ce même rapport qui, sans ambages, constate que « pour le moment, l'enquête se trouve dans une impasse étant donné que les enfants commencent à inventer toutes sortes de choses vu le nombre élevé d'auditions qu'ils ont déjà dû subir ». C'est lui qui affirme qu'« il y a des doutes en ce qui concerne le fait que des faits se sont bien déroulés en Belgique, plus précisément dans la ferme à Zonnebeke ». On rappellera aussi que le dossier du meurtre de la petite fille belge est disjoint depuis une ordonnance du juge d'instruction du 19 avril. En n'accédant pas à ces demandes de la défense, le juge Cyril Lacombe inscrivait ses pas dans ceux de son prédécesseur, validant, par là même, implicitement sa démarche. Dans le même ordre d'idées, par ordonnance du 4 septembre 2002, le juge Cyril Lacombe ne fait pas droit à une demande de Me Philippe Lescène, qui souhaite des confrontations séparées entre sa cliente, Mme Sandrine Lavier et Mme Myriam Badaoui, M. David Delplanque et Mlle Aurélie Grenon. Il fait valoir que « la confrontation déjà intervenue a été faussée par la présence de ces trois personnes ensemble dont il a pu être constaté que Mlle Grenon et M. Delplanque s'alignent purement et simplement sur les propos de Mme Badaoui ». Le juge Cyril Lacombe ne satisfait pas la demande de la défense car « le 11 mars 2002, Mme Lavier avait déjà demandé de nouvelles confrontations entre Mme Lavier, Mme Badaoui, M. Delplanque et Mlle Grenon ; il avait déjà été statué sur cette demande, le magistrat instructeur ayant rendu une ordonnance de refus partiel de mesure d'instruction complémentaire » (D 1507). Il ajoute qu'« aucun élément nouveau n'est intervenu depuis ... justifiant l'organisation de nouvelles confrontations séparées ». Cette motivation laisse à penser qu'il souscrivait ainsi à la méthode exclusive des confrontations collectives mises en œuvre par le juge Fabrice Burgaud. La pratique du « copié-collé » participe également de ce suivisme judiciaire. Un exemple dans le dossier en a été fourni par la similitude prévalant entre l'ordonnance de mise en accusation du 13 mars 2003 et le réquisitoire définitif du procureur de la République du 6 mars 2003. On a déjà relevé les similitudes tant rédactionnelles que matérielles de ces deux documents. Mais l'exemple de l'affaire d'Outreau n'est malheureusement que l'illustration de pratiques courantes. Elle a été dénoncée avec force par le juge Grellier dans le livre Les juges parlent 310 : « Je trouve très choquante la pratique du réquisitoire dit " définitif ". Tous les textes prévoient qu'à la fin de l'instruction, c'est le juge qui détermine quelles charges doivent être retenues. Or, ces textes ne sont absolument pas respectés et la pratique judiciaire est celle du réquisitoire dit définitif, rédigé par le parquet avec lequel il est rarissime que le juge d'instruction ne soit pas d'accord. C'est donc en fait l'une des parties au procès qui clôt l'instruction. Et j'ai vu de très nombreux jugements de tribunaux correctionnels ou de cours d'appel qui sont la copie, parfois la photocopie du réquisitoire définitif ! » Pour Mme Odile Mondineu-Hederer, Présidente de la cour d'assises d'appel de Paris dans l'affaire d'Outreau, il en irait ainsi dans « 95 % des cas. Pour remédier à cela, je pense qu'on devrait obliger le juge d'instruction à faire une synthèse de son travail au moment de l'application de l'article 175 du code de procédure pénale. Il ferait ainsi une évaluation de son travail en reprenant les éléments à charge et à décharge et inviterait les parties - accusation, parties civiles et défense - à se positionner par rapport à cela. Les demandes d'actes pourraient avoir lieu à ce moment là. S'il n'y avait pas de demandes d'actes, le parquet ferait alors son réquisitoire. On verrait peut-être l'inverse : la synthèse du juge d'instruction devenir réquisition du parquet. Et ce serait, à mon sens, davantage à charge et à décharge »311. Cette pratique du « copié-collé » s'applique d'ailleurs à d'autres étapes de la procédure. C'est ainsi que Me Eric Dupont-Moretti a évoqué pendant son audition un cas devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris : « Savez-vous ce qu'un avocat a découvert au greffe de la Chambre de l'instruction de Paris, alors qu'il venait consulter un dossier ? Un arrêt de renvoi devant la cour d'assises avant même que l'audience ait lieu ! On a dit que c'était la faute du greffier, âpre à la tâche et tellement consciencieux. Sauf que la décision était tamponnée " certifiée conforme " et que, dans le corporatisme judiciaire ambiant, les suites n'ont pas été celles qu'on aurait pu imaginer. »312 Le recours au « copié-collé » ne semble pas être ignoré non plus devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, comme l'a fait observer la défense dans l'affaire d'Outreau. C'est ainsi que Me Antoine Deguines a déclaré devant la commission d'enquête : « Chacun sait que ses arrêts sont rédigés avant même que l'affaire soit examinée. Au point que lorsque les magistrats prennent une décision contraire, ce qui est développé dans l'arrêt ne correspond pas à la décision finalement rendue. S'ils rédigent les arrêts à l'avance, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps matériel de statuer et de rédiger un arrêt complet une fois que l'audience est levée. »313 Ces propos n'ont été démentis ni par Me Franck Berton ni par Me Philippe Lescène : « J'en viens à la chambre de l'instruction. Elle a confirmé chaque refus de demande de mise en liberté. Les motivations qu'elle avance sont un copié-collé de celles du juge des libertés et de la détention. On fait référence au système de défense qu'elle a adopté. Comme si le fait que quelqu'un crie son innocence justifiait qu'on le prive de liberté ! »314 « Les chambres de l'instruction sont certes composées de trois magistrats mais il y a d'autres problèmes, à commencer par un problème de culture : la plupart du temps, elles sont solidaires vis-à-vis de leurs juges d'instruction et les couvrent. »315 Sans que cette remarque ne constitue une forme de « consolation », Mme Geneviève Giudicelli-Delage, professeur de droit à l'université de Paris I a admis lors de la table ronde sur la réforme de l'instruction et le regard du droit comparé, organisée le 23 mars 2006, que les systèmes étrangers, qu'ils soient accusatoire comme en Italie ou au Royaume-Uni ou empruntant aux deux modèles comme en Allemagne, n'échappaient pas au reproche de « suivisme ». Elle a relevé que « le juge de contrôle entérine quasi systématiquement les demandes du ministère public ou de la police, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, les contrôles se font le plus souvent en légalité et non en opportunité, et il va de soi que, dans l'immense majorité des cas, la légalité est respectée. Mais ne pas apprécier en opportunité risque fort de vider le principe de la garantie de son effectivité. Si un contrôle effectif fait défaut, cela conduit à donner au ministère public ou à la police tous les pouvoirs, à confondre toutes les fonctions ». Plus fondamentalement, « la deuxième raison tient à la confiance mutuelle qui existe entre les différents acteurs. Celle-ci emporte une position de retrait du juge du contrôle qui, connaissant bien moins le dossier que le ministère public ou la police, s'en remet à sa vision. Cette confiance apparaît d'ailleurs d'autant plus profonde à l'égard du ministère public par l'appartenance des différents acteurs à un même corps, et quand ils appartiennent à des corps différents, par une formation intellectuelle et professionnelle similaire ». Pour rejoindre les observations de Mme Geneviève Giudicelli-Delage, on relève des pratiques identiques en Espagne à propos du contrôle de la détention provisoire. Le rapport 2005 de la commission de suivi de la détention provisoire s'est fait l'écho de cette tendance : « De manière comparable à ce qui se passe en France, et sans pour autant que cela jette le discrédit sur les décisions de second degré, les juges d'appel (espagnols) confirment la plupart du temps, les décisions de première instance. »316 Dans l'affaire d'Outreau ce suivisme est particulièrement frappant et s'il a joué entre le magistrat instructeur et le parquet, il a, comme on l'a vu, également caractérisé les positions de la chambre de l'instruction. Si suivisme il y a, c'est aussi parce que les magistrats travaillent isolément, chacun s'inclinant devant l'appréciation de son prédécesseur tout au long de la chaîne. 3. L'absence de travail en équipe S'il n'existe pas de véritable formation au travail en équipe à l'ENM, on constate qu'elle n'est guère encouragée au cours de la carrière des magistrats. Mlle Vanessa Lepeu, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Senlis, déplore « l'absence de lieu de partage et de confrontation en ce qui concerne nos pratiques. Nous sommes amenés très vite à choisir des pratiques, à nous positionner, mais si j'ai fait ces choix, je n'ai pas encore eu l'occasion de les confronter à ceux d'autres collègues »317. Cet isolement est encore plus fort dans les petites juridictions comme s'est plu à le souligner Mme Fabienne Nicolas, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy318. Il est un fait que dans les petits tribunaux, le jeune juge d'instruction n'aura d'autre ressource que de se tourner vers le procureur de la République avec le risque de suivisme que l'on a précédemment dénoncé. C'est ce qu'observe Mme Odile Mondineu-Hederer : « Dans un petit tribunal, à qui le juge d'instruction s'adresse-t-il pour demander conseil ? Au procureur, qui a plus d'expérience et qui gère le pénal. C'est une question de personnalité, mais c'est aussi une question de proximité. »319 L'individualisme serait-il plus le fait des magistrats du siège que celui du parquet ? Le statut et les méthodes de travail des premiers pourraient l'expliquer. Devant la commission d'enquête, Mme Clarisse Taron, vice-procureur près le tribunal de grande instance de Nancy, a indiqué que le travail d'équipe était répandu au parquet : « S'il y a des magistrats qui travaillent en équipe, ce sont ceux du parquet... Je pense que le parquet est une excellente formation et une excellente école de travail en équipe. Chez nous, on travaille toutes portes ouvertes. On échange chaque heure avec les autres collègues pour savoir ce que l'on fait d'une procédure, ce que l'on pense d'une nullité. »320 Une grande diversité de pratiques prévaut manifestement en son sein car cet avis n'est pas partagé par les plus hautes autorités du parquet. Ainsi le Procureur général de Douai de l'époque, Jean-Amédée Lathoud, a regretté l'absence de travail en équipe : « Dans les parquets, nous n'avons guère l'occasion de discussions internes collectives sur un dossier, sur une situation complexe, sur une évaluation critique. Le travail " en réseau ", le brainstorming ne font pas suffisamment partie de notre culture professionnelle. Il nous fait surmonter notre individualisme foncier. Par exemple, en janvier dernier ont été organisés par l'ENM dans le cadre de la formation continue, deux stages, l'un pour les magistrats chargés de fonctions d'instruction, l'autre pour les magistrats du parquet. Le premier ne prévoyait aucune intervention de magistrats du parquet et n'avait inscrit à son ordre du jour aucune question concernant les relations avec les avocats. Dans le second, la formation n'était assurée que par des procureurs de la République. Rien n'était prévu sur les relations avec les juges d'instruction ni avec le parquet général ni avec les avocats. Dans le respect des attributions de chacun, un dialogue plus approfondi des magistrats du parquet avec la DACG est certainement souhaitable pour permettre une analyse critique des rapports de politique pénale et une " expertise extérieure " sur les affaires individuelles avec les chefs de parquet concernés, une description des relations à recommander entre substituts et procureur, entre parquets et parquets généraux, entre parquets généraux et Chancellerie. »321 Une autre illustration de ce suivisme réside dans la répétition des rôles pour le parquet. 4. La confusion des rôles dans l'accusation Le Procureur général Jean-Amédée Lathoud a déclaré à la commission d'enquête que c'était une bonne chose que M. Gérald Lesigne ait exercé les fonctions d'avocat général devant la cour d'assises de Saint-Omer : « Je considérais que c'était l'homme qui devait faire face à la situation. Il connaissait bien ce dossier. Il l'avait suivi. J'ajoute qu'il est habituel que le magistrat qui a rédigé le réquisitoire définitif aille soutenir oralement l'accusation qu'il a soutenue par écrit. C'est une motivation réelle pour les magistrats du parquet, qui ne doivent pas être des bureaucrates du réquisitoire définitif ; ils doivent en mesurer le poids et l'importance lors de l'audience. En termes de gestion des ressources humaines, il était également essentiel que le magistrat qui avait fourni ce gros travail de rédaction et de mise en perspective des charges puisse en assurer la responsabilité à l'audience. J'ajoute que, lorsque la cour d'assises n'est pas au siège de la cour d'appel, c'est le magistrat qui a rédigé le réquisitoire définitif qui va assumer l'accusation à l'audience. Et je crois que les magistrats du parquet apprécient de pouvoir suivre un dossier de bout en bout, de même qu'un avocat apprécie de pouvoir suivre la défense de son client du début de l'affaire jusqu'à l'audience. »322 Cette vision des choses a toutefois été contestée devant la commission, au nom de la nécessité de disposer d'un autre regard sur le dossier. Ainsi la défense s'est émue de ce que le procureur Lesigne ait représenté le parquet devant la Cour d'assises de Saint-Omer. Comme l'a fait valoir Me Éric Dupont-Moretti, « on aurait dû permettre à un autre magistrat du parquet ou du parquet général de soutenir l'accusation »323. L'avocat général Yves Jannier qui est intervenu devant la cour d'assises de Paris en appel, partage la même analyse, considérant « qu'il serait certainement opportun que celui qui les a suivies se départisse et n'accepte pas d'aller à l'audience »324. VII. UNE PRESSION MÉDIATIQUE EXCESSIVE Les médias se sont intéressés à l'affaire d'Outreau à partir de la mi-novembre 2001, lors de l'interpellation de six personnes rapidement qualifiées de « notables ». Alors que l'arrestation du couple Delay n'avait été relayée que par un seul article, de taille modeste, dans l'édition de Boulogne-sur-Mer de La Voix du Nord le 7 avril 2001, la presse locale et nationale décrit les détails de l'événement en ne s'interrogeant guère sur la véracité des informations qu'elle diffuse, bien que les personnes arrêtées nient toute participation aux faits qui leur sont reprochés. Mais c'est après la diffusion par FR3 Nord-Pas-de-Calais de la lettre de M. Daniel Legrand fils, le 9 janvier 2002, que la presse s'empare véritablement de l'affaire. Les images des fouilles réalisées dans les jardins ouvriers de la Tour du Renard pour retrouver le corps d'une petite fille belge renvoient à l'affaire Dutroux ; l'affaire d'Outreau devient une « affaire Dutroux à la française ». Après l'échec des fouilles et les rétractations de M. Daniel Legrand fils, fin février, deux ans s'écoulent, durant lesquels l'emballement médiatique retombe : la presse fait état, de temps à autre, de la grève de la faim d'un des mis en examen, du refus de mise en liberté de tel autre et s'ouvre aux déclarations des avocats de la défense qui dénoncent la vacuité du dossier ou le climat délétère qui règne au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Si quelques journalistes mettent l'accent sur les zones d'ombre qui subsistent dans le dossier, ce n'est qu'au procès d'assises de Saint-Omer que la presse dans son ensemble se fait l'écho des « ratés de l'instruction », pour se focaliser ensuite sur « la vie brisée des innocents » et le « fiasco judiciaire ». C'est, du reste, à partir du procès de Saint-Omer que l'on peut véritablement constater une « hyper médiatisation de l'affaire ». Cette pression médiatique se caractérise par un manque de prudence et de rigueur pendant l'instruction et par l'exercice d'une forte influence sur la procédure. A. LE MANQUE DE PRUDENCE ET DE RIGUEUR DES MÉDIAS PENDANT L'INSTRUCTION Lors de son audition par la commission d'enquête, Mme Jocelyne Rubantel, ancien juge des libertés et de la détention, déclarait que « les quotidiens nationaux, avant le procès de Saint-Omer, n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup de doutes »325. De son côté, M. Yves Jannier, avocat général près la cour d'assises d'appel de Paris, affirmait : « La presse a quand même présenté toutes les personnes mises en cause, dans un premier temps et jusqu'au premier procès, comme d'horribles criminels. »326 De fait, à quelques rares exceptions près, le traitement médiatique de l'affaire d'Outreau pendant l'instruction du dossier a donné lieu à des approximations, des contrevérités, des révélations « affriolantes » jetant l'opprobre sur des personnes présumées innocentes. Ces pratiques ne sont malheureusement pas exceptionnelles, les médias s'emparant de plus en plus des faits divers, notamment lorsqu'il s'agit d'affaires de mœurs. Comme le rappelait M. Jean-Pierre Berthet, ancien chroniqueur judiciaire à TF1, lors de son audition, « on est passé, en matière de faits divers, de la frilosité à la frénésie, avec une appétence et une consommation immodérées [...] et il est très vite apparu que les précautions élémentaires n'accompagnaient pas ce goût pour le fait divers. Ces précautions élémentaires, ce sont le respect de la présomption d'innocence, la vérification des informations, le contradictoire, le conditionnel, l'anonymat à protéger »327. En l'espèce, la présentation des informations recueillies, l'identification sans précaution de certaines personnes, la diffusion d'images sans le consentement des intéressés, les atteintes au respect de l'anonymat des enfants victimes et la stigmatisation de tout un quartier constituent autant d'éléments qui attestent d'un manque évident de prudence et de rigueur dans le traitement de l'information. 1. Des informations présentées comme des certitudes : un réseau constitué de « notables » Tous les médias ont relayé l'existence d'un réseau pédophile. À commencer par la presse locale. La Voix du Nord (édition de Boulogne-sur-Mer) informe ses lecteurs le 17 novembre 2001 en une, sous le titre « 24 enfants prostitués », que « six nouveaux suspects - un huissier de justice et son épouse, de Samer, un prêtre ouvrier et un chauffeur de taxi, d'Outreau, un patron de sex-shop et son fils, d'Ostende - ont été placés en détention, portant à quinze le nombre de personnes derrière les barreaux après le démantèlement d'un réseau de pédophilie franco-belge ». Les journaux télévisés de FR3 Nord-Pas-de-Calais parlent d'une « affaire qui éclabousse au moins seize personnes » (15 novembre 2001) et du « démantèlement d'un réseau de prostitution d'enfants aux ramifications très étendues, notamment vers la Belgique » (16 novembre 2001). La presse nationale n'est pas en reste. Le 15 novembre 2001, on apprend au journal de 20 heures de France 2 que « des enfants étaient prostitués par leurs parents ». Le lendemain, le journal de 20 heures de TF1 annonce « le démantèlement d'un réseau pédophile dans une ville voisine de Boulogne-sur-Mer où les parents vendaient leurs quatre enfants mineurs de moins de 15 ans aux personnes adultes ». Le Figaro publie, le 21 novembre 2001, un article sur l'implication des « notables » dans un réseau pédophile, article qui débute de la façon suivante : « Des enfants pauvres vendus par leurs parents pour assouvir les plaisirs sexuels des gens riches ? C'est ce que développe la rumeur depuis le récent démantèlement du réseau pédophile qui sévissait dans le Boulonnais. [...] Des faits sordides qui, même si par bonheur il n'y a pas de meurtres, dégagent certains relents d'affaire Dutroux, le réseau passe d'ailleurs par la Belgique ». Le même article s'appuie sur des déclarations de Me Thierry Normand qui, parlant des enfants victimes, indique : « Avec de telles précisions pour leur âge, ils ne peuvent avoir rien inventé ». L'on y apprend que le chauffeur de taxi aurait conduit les enfants en Belgique. L'emploi du conditionnel est oublié quelque temps plus tard (1er janvier 2002), le lecteur étant informé que le « chauffeur de taxi conduisait les petites victimes dans une ferme en Belgique, près d'Ypres où se déroulaient les soirées spéciales enregistrées par deux propriétaires d'un sex-shop d'Ostende ». Le 23 novembre 2001, un article du Point énonce, sans précaution aucune : « Depuis plusieurs mois, la rumeur courait dans la ville. On décrivait l'horreur, évoquant l'existence d'un réseau pédophile, chuchotant des noms des notables " compromis " mais " intouchables " [...] Le week-end dernier, la vérité a éclaté. Six notables ont été incarcérés. » Dans différents articles parus le 11 janvier 2002, dont l'un est intitulé « La cité de la honte », Le Parisien utilise parfois le conditionnel, mais n'hésite pas à informer ses lecteurs que les Legrand père et fils sont gérants « d'un sex-shop clandestin à Ostende » et qu'ils « sont également poursuivis pour la réalisation d'images vidéo à caractère pornographique mettant en scène des enfants », dont les tournages « s'effectuaient le plus souvent dans une ferme isolée dans la campagne d'Ypres, en Belgique ». Le Monde présente à son tour, le 14 janvier 2002, « Daniel L. et son fils Danny » comme des « Français qui vivaient en Belgique et tenaient un sex-shop à Ostende » et rappelle que Daniel Legrand fils est l'un des quatorze suspects incarcérés « lors du démantèlement d'un réseau pédophile à Outreau ». Les termes de « réseau pédophile » figurent dans les titres de plusieurs articles ; le 14 janvier 2002, il s'agit même d'un « réseau franco-belge ». Sous le titre « Pédophilie : le quartier de l'horreur à Outreau », Libération publie le 11 janvier 2002 un article selon lequel « Daniel L. père, tête pensante de ce réseau, se payait deux fois : la première fois lors de la prostitution des enfants, la seconde à la vente des cassettes, probablement en Belgique, à Ostende où il tenait un sex-shop ». Outre le manque de prudence qui caractérise ces informations, il n'est pas rare que, dans le même article, l'on passe de l'indicatif au conditionnel et inversement, ce qui ne peut qu'entraîner la confusion dans l'esprit du lecteur. Au reste, l'on peut s'interroger sur l'impact réel d'allégations formulées au conditionnel, vu le luxe de détails et de révélations « scabreuses » qui alimentent les articles parus à l'époque. Ainsi, après l'arrestation des « notables », paraît dans La Voix du Nord (édition de Boulogne-sur-Mer, 18-19 novembre 2001) un article très orienté sur la rencontre de certaines familles « sans repère » de la Tour du Renard avec des personnes d'un autre milieu social : « Le rôle de ces deux personnages [il s'agit de M. Pierre Martel, chauffeur de taxi censé avoir transporté en Belgique les enfants du quartier défavorisé et de M. Daniel Legrand père, présenté comme patron d'un sex-shop commercialisant des cassettes pornographiques] est la clé de la rencontre de deux mondes : l'un misérable et miséreux, et l'autre bien plus confortablement installé dans la société boulonnaise. Deux mondes qui se rencontrent et se partagent des enfants. » Le 20 novembre 2001, le journal informe ses lecteurs qu'un « réseau s'est construit petit à petit, au fil d'une misère qui s'installait », permettant le développement d'un tourisme sexuel local - une sorte de « mini-Thaïlande ». L'article précité du Point du 23 novembre 2001, après avoir indiqué que « les dernières arrestations ne seraient que la partie visible de l'iceberg », poursuit : « C'est la rencontre - dans l'horreur - de deux mondes. L'un miséreux, oisif et sans instruction, rongé par l'alcool. L'autre, beaucoup plus aisé et apparemment avide de déviances ». Le 12 janvier 2002, après avoir rappelé que le quartier abrite en majorité des familles défavorisées, Le Figaro affirme : « C'est parmi celles-ci que les organisateurs du réseau pédophile sont allés chercher leurs proies. Contre une poignée de francs ou la remise de dettes ou la non saisie d'objets, comme leur poste de télévision. Car côté acheteurs, il y a du beau monde : un huissier et son épouse, une infirmière scolaire, un prêtre ouvrier et un chauffeur de taxi chargé de livrer les enfants-marchandises à Geluweld, dans la banlieue d'Ypres, dans les Flandres belges, où deux Français propriétaires d'un sex-shop à Ostende, Daniel Legrand père et fils, tournaient des films pornographiques. » Selon Le Parisien du 16 janvier 2002, « Deux mondes se seraient croisés dans le petit F3 de Myriam Delay _..._ l'un oisif vivant des allocations familiales, l'autre fortuné assouvissant ses pulsions les plus sordides ». Libération indique, dans un article paru le 13 février 2002 : « Il y aurait un premier cercle, celui des parents abuseurs, issus de milieux modestes, qui prostituent leurs propres enfants. Et puis un deuxième, celui des notables pédophiles, qui choisissent les enfants des autres. » Ces informations sont certes présentées au conditionnel mais les mêmes journaux avaient révélé, peu de temps auparavant, des scènes très imagées de la prostitution des enfants, sans aucune précaution de style. S'appuyant sur une source proche du dossier, l'article précité de Libération du 11 janvier 2002 affirme : « Les séances avaient lieu dans un des appartements du quartier de la Tour du Renard à Outreau, ou dans une ferme de la région d'Ypres, en Belgique, à peu près toujours sur le même schéma : " le groupe d'enfants se trouvait au milieu d'une grande pièce, avec des jouets. Sur le côté, une table, avec des préservatifs. Les adultes se tenaient autour. Régulièrement, un adulte venait se servir, et repartait dans un coin avec l'enfant pour l'agresser sexuellement ou le violer, parfois avec des accessoires. Il s'agissait d'en utiliser le plus possible, puisque les séances étaient filmées, et les films vendus. " » Le Parisien publie le même jour des informations similaires. De son côté, Le Point annonçait dès le 23 novembre 2001 : « Des soirées sont organisées. Toujours selon le même rite. Les parents forment un cercle autour des enfants qu'ils ont dénudés, puis occupés avec des billes ou des jeux de société. À côté d'eux, un panier rempli de préservatifs et posé sur une table. Les hommes y piochent au fur et à mesure de leurs envies ou excitations. Les femmes participent aussi en utilisant des accessoires, apportés par les propriétaires du sex-shop. Sont également présents des animaux, et notamment un berger allemand. » Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, de « copié-collé » journalistique, l'on ne peut manquer de s'interroger sur cette similitude de narration et ce luxe de détails. L'article précité de Libération va jusqu'à préciser le tarif de ces séances : « entre 200 et 1 000 F (entre 30,4 et 152,4 euros) la passe, selon les revenus des clients » ! Cette information sera reprise au conditionnel le 24 janvier 2002, dans un article du Nouvel Observateur intitulé : « Outreau : les damnés de la tour des Merles ». Dès le 17 novembre 2001, La Voix du Nord publie les noms, professions et communes de résidence du « deuxième cercle » des personnes arrêtées : Alain Marécaux, huissier de justice à Samer, et son épouse ; Pierre Martel, chauffeur de taxi à Outreau ; Dominique Wiel, prêtre ouvrier dans la même commune ; Daniel Legrand, patron de sex-shop à Ostende (Belgique) qui serait l'instigateur du réseau et son fils Daniel, plus connu dans le milieu sous le nom de « Danny ». Interrogé par le rapporteur sur ce point, M. Jean-Michel Bretonnier, rédacteur en chef du journal, a rappelé que « pour les personnes étrangères aux familles des victimes, la loi ne nous interdit pas de publier les noms, mais de porter atteinte à la présomption d'innocence »328 . Il est vrai que, selon la jurisprudence, « le fait de divulguer le nom d'une personne majeure inculpée ou mise en examen n'est interdit par aucun texte et qu'il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes n'assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause. » (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2002). En l'occurrence, l'article de La Voix du Nord ne faisait que relater le placement en détention des personnes citées et donnait la parole à deux avocats de la défense faisant état d'une « machination incompréhensible » et d'« accusations sans fondements ». M. Jean-Michel Bretonnier s'expliquait ensuite sur les raisons de la divulgation des noms : « Lorsque paraît le papier dont vous avez parlé, tout le monde, à Boulogne, sait déjà qu'un huissier et un chauffeur de taxi sont en cause, et des personnes exerçant ces professions nous contactent pour faire savoir que ce ne sont pas elles ; notre intention est alors de circonscrire la rumeur. »329 Si l'on peut comprendre cette intention dans un contexte local où se propagent forcément des interrogations, voire des soupçons, l'on peut cependant noter que l'antenne régionale de France 3 ne s'est pas prêtée à cette pratique. M. Hervé Arduin, journaliste à FR3-Nord-Pas-de-Calais à l'époque des faits, a en effet déclaré à la commission d'enquête qu'il lui paraissait au contraire indispensable de « respecter l'anonymat des mis en examen »330. De surcroît, comment expliquer la diffusion des noms par la presse nationale ? Comme le remarquait Mme Florence Aubenas, grand reporter à Libération, lors de son audition, c'est après la lettre de M. Daniel Legrand fils, diffusée et abondamment commentée sur FR3 Nord-Pas-de-Calais, et les fouilles avec la pelleteuse à Outreau que « tous les verrous sautent, on donne les noms, on montre les visages, et tout le monde se vautre là-dedans » en se disant : « On peut y aller, c'est sur la place publique. Même les journaux qui disaient : "Nous, on ne donne pas les noms", se mettent à les donner. »331 Si Libération se contente le plus souvent d'identifier les mis en examen par leur prénom suivi de l'initiale de leur nom, c'est à partir de la mi-janvier 2002 que Le Figaro, Le Parisien, Le Nouvel Observateur et bien d'autres se mettent à publier ces noms. Le 15 janvier 2002, dans Le Figaro, M. Daniel Legrand fils est même qualifié de « pornocrate spécialisé dans la pédophilie ». L'on peut remarquer, au demeurant, qu'à partir du moment où des noms ont été publiés par certains organes de presse, le respect de l'anonymat par d'autres journaux perd de son intérêt. En outre, le fait de citer, par exemple, Dominique W., en précisant qu'il est prêtre ouvrier à Outreau ou qu'il habitait la résidence des Merles dans le quartier de la Tour du Renard au même étage que le couple Delay-Badaoui est-il vraiment protecteur ? L'on peut rappeler à cet égard les propos tenus par M. Christian Godard devant la commission d'enquête lorsqu'il parlait de sa mise en détention provisoire : « Le chef du premier étage [celui où se trouvent les violeurs, les « pointeurs »] m'avait dit : "ne dis rien de l'affaire dans laquelle tu es, ne dis même pas ton nom" [...] Le gars [avec lequel il partageait sa cellule] m'a dit : "Comment tu t'appelles ?" Je lui ai répondu : "Ça ne te regarde pas, tu peux m'appeler Christian". Il a regardé derrière la porte, il a vu mon nom, Godard Christian, et comme il avait lu dans la Voix du Nord qu'on avait arrêté le mari de la boulangère... »332 3. La diffusion d'images sans le consentement des intéressés Si la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'interdit pas de divulguer les noms de personnes mises en examen, la diffusion de l'image d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale constitue dans certains cas un délit. Aux termes de l'article 35 ter de la loi précitée, entré en vigueur le 1er janvier 2002, « lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou des entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie d'une amende de 15 000 euros ». En outre, la diffusion de l'image d'une personne sans son autorisation porte atteinte au respect de sa vie privée, droit consacré par l'article 9 du code civil. Ces dispositions n'ont pas toujours été respectées. Ainsi que l'a reconnu M. Michel Chiche, ancien rédacteur en chef de FR3-Nord-Pas-de-Calais, lors de son audition : « Des images ont pu parfois être floutées et parfois non. Certains visionnages n'ont pas été réalisés avec la rigueur nécessaire. »333 En effet, des images de M. Daniel Legrand fils à visage découvert ont été diffusées alors qu'il portait des menottes. Il a également été filmé, toujours à visage découvert, dans un bureau du palais de justice de Boulogne-sur-Mer - les images laissent supposer qu'il s'agit d'une de ses auditions par le juge d'instruction. D'autres images ont été diffusées sur les chaînes de télévision, provoquant l'indignation des personnes concernées ou de leur entourage. Mme Lydia Cazin-Mourmand, sœur de M. François Mourmand, a déclaré à la commission : « Quand la télé a montré sa photo, j'ai téléphoné moi-même aux journalistes pour leur dire d'arrêter, mais ils n'ont pas arrêté. »334. Mme Roselyne Godard s'en est également émue devant la commission d'enquête : « À Saint-Omer, j'ai vu mon image et celle de mon ex-conjoint à demi-masquées, défiler à la télévision. Que pouvait penser ma fille ? C'est meurtrier. »335 4. Les atteintes au respect de l'anonymat des enfants victimes L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 punit de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable. Pourtant, certains journaux n'ont pas hésité à enfreindre cette interdiction. L'Express dévoile, le 3 mai 2004, les prénoms de deux des enfants Delay. Le Monde cite, le 14 janvier 2002, les prénoms de quatre enfants en précisant que « les quatre garçons ont vite indiqué que leur père, Thierry D., les avait violés avec son amie, Myriam B. », avant d'informer ses lecteurs, dix jours plus tard, que « Myriam Delaye » (sic) est la « mère de quatre enfants violés et prostitués » et de révéler l'identité de « son mari, Thierry Delaye » (resic). Libération cite également les prénoms de trois des « enfants de la famille D. » dans un article paru le 12 août 2003. Si le nom des enfants ne figure pas dans le même article, il pouvait cependant être identifié sans grande difficulté. 5. La stigmatisation d'un quartier « La cité de la honte » (Le Parisien, 11 janvier 2002), « Pédophilie : le quartier de l'horreur à Outreau (Libération, 11 janvier 2002), « Dix-sept adultes face aux horreurs de la Tour du Renard à Outreau » (Libération, 12 août 2003), « Outreau : Les damnés de la tour des Merles » (Le Nouvel Observateur, 24 janvier 2002), tous ces titres accrocheurs révèlent une forme de mépris pour les habitants du quartier de la Tour du Renard et plus généralement de la commune d'Outreau. Lors de son audition, M. Bernard Seitz, journaliste reporter d'images à FR3-Nord-Pas-de-Calais, le rappelait en ces termes : « [...] la presse nationale a davantage privilégié, dans ses images comme dans ses commentaires, le côté plutôt sordide d'Outreau, allant jusqu'à choquer la population par l'image qu'on donnait d'elle. Dans une telle cité, n'est-ce pas, il ne peut que se passer des choses horribles. On est dans le cliché, dans la succession de clichés : Nord égale pauvreté égale chômage égale alcoolisme égale pédophilie égale coupables. Dès le premier reportage, on est déjà dans le dérapage. »336 En effet, selon la plupart des médias, les conditions économiques défavorables dans la région seraient la principale explication de l'affaire d'Outreau. Dans un article intitulé « Peut-on expliquer l'horreur ? », paru le 18 janvier 2002, Le Point met l'accent sur « le chômage endémique, la misère qui frappe le Nord-Pas-de-Calais, une des régions en tête du box-office de la mortalité infantile, de l'illettrisme, de l'alcoolisme » et rappelle que « la cité du Renard est le quartier le plus pauvre d'Outreau. On y compte 40 % de familles monoparentales, 20 % de chômage ». Le Figaro s'interroge, le 15 janvier 2002 : « La modeste cité de la Tour du Renard, à Outreau, est-elle frappée de malédiction ? On veut plutôt croire qu'elle est, comme beaucoup d'autres cités semblables dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, victime de l'explosif cocktail : chômage, alcool, oisiveté, promiscuité... L'inceste n'est alors jamais bien loin. [..._ Aujourd'hui, en tout cas, c'est la Tour du Renard qui décroche la palme de cette catégorie. On vient, en effet, d'avoir connaissance d'une nouvelle affaire de pédophilie dans le "quartier maudit", qui, curieusement, n'aurait rien à voir avec celle du réseau défrayant actuellement la chronique. L'une avait pour cadre le bâtiment des Merles, l'autre celui des Mésanges. » L'article précité du Nouvel Observateur décrit « un autre univers : un monde où pauvreté, précarité, promiscuité accablent une génération après l'autre, dans cette région sinistrée par la débâcle des industries de la sidérurgie et de la pêche. On entend tout, on sent tout au travers des minces parois des portes palières. Ici on cuisine un chou au son criard d'une télévision. Là un couple se dispute violemment. Plus haut, les décibels d'une sono poussée à fond font trembler sols et plafonds. Et pourtant, personne, parmi les vingt familles nombreuses se croisant quotidiennement dans l'escalier des Merles, n'aurait jamais entendu de pleurs ou de gémissements provenant des appartements des parents tortionnaires. Pas même l'abbé Dominique Wiel, dont le domicile jouxtait celui des Delay et des Delplanque ». Le Monde rapporte, le 24 janvier 2002, les propos d'un avocat, Me Antoine Duport, au sujet des violences sexuelles subies par les mineurs : « C'est la gangrène, c'est devenu une sorte de mode de vie dans les cités. On se tape une bière comme on se tape un garçon. » Dans son ensemble, la presse écrite et audiovisuelle s'est ainsi livrée à ce que l'on pourrait appeler une « médiatisation à charge » jouant souvent sur l'émotion et le sensationnel plutôt que de livrer une information objective. Du reste, à partir du moment où M. Daniel Legrand fils est revenu sur ses déclarations au sujet du meurtre d'une petite fille qu'il avait inventé, les journaux et télévisions ne se sont plus guère intéressés à l'affaire. Certains d'entre eux ont cependant effectué un travail d'analyse. Ainsi, le 19 août 2002, Le Monde publie un article sur les zones d'ombre qui subsistent après dix-huit mois d'instruction. On peut y lire que « sans preuves matérielles, le procès [...] reposera donc sur les témoignages des mineurs et les aveux controversés de quatre de leurs parents ». Après avoir qualifié le meurtre révélé par M. Daniel Legrand fils de « crime imaginaire », le même article souligne que « d'autres révélations sont jugées " peu sérieuses " par les enquêteurs, comme celle d'une ferme qui aurait été louée en Belgique pour y tourner des films commercialisés dans un sex-shop d'Ostende ». Le 4 février 2003, le même journal fait apparaître un article intitulé : « Doutes et confusions dans l'affaire de pédophilie d'Outreau. » Un article paru le 1er novembre 2003 dans Le Figaro, résumant les principales étapes de l'affaire, souligne que « même après deux ans de parcours judiciaire le dossier d'Outreau continue [...] de faire osciller les avocats entre doutes et certitudes ». Le même article précise au sujet de « ce que magistrats et enquêteurs avaient très rapidement perçu comme un authentique réseau pédophile » que « les ramifications ne dépassaient que rarement le palier voisin » et, à propos de la « piste belge », indique que « tout se dégonfle ». En avril 2002, France 3 diffuse dans son magazine Pièces à conviction, une contre-enquête, qui démonte nombre d'accusations portant sur M. Daniel Legrand père. Divers témoignages indiquent que cet ouvrier métallurgiste n'avait ni le temps ni l'argent d'aller en Belgique et qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce d'Ostende comme patron d'un sex-shop. Les journalistes s'interrogent également sur la fiabilité des témoignages de Mme Myriam Badaoui. M. Hervé Arduin a expliqué à la commission d'enquête sa méthode d'investigation avant de préciser : « Je regrette que cette émission n'ait pas été relayée par d'autres médias à l'époque de sa diffusion »337. En effet, ces quelques articles ou cette émission ne pouvaient effacer les images des pelleteuses dans les jardins ouvriers et les « titres choc » des mois précédents qui ont porté un préjudice considérable aux personnes mises en examen. Si la presse a manqué de prudence et de rigueur pendant l'instruction, par voie de conséquence son influence sur la procédure a été forte. B. L'INFLUENCE DES MÉDIAS SUR LA PROCÉDURE La couverture médiatique de l'affaire d'Outreau a eu non seulement un impact sur les témoignages des enfants mais elle a également été invoquée à l'appui de nombreuses décisions de maintien en détention provisoire. 1. L'impact sur les déclarations des enfants Les enfants placés chez les assistantes maternelles ont été marqués par les informations et les images auxquelles ils ont eu accès. Les auditions des enfants Delay en témoignent. Interrogés le 13 décembre 2001 par le juge d'instruction sur les lieux où se passaient les faits, l'un répond : « Dans ma maison. J'ai été aussi en Belgique dans une ferme qu'on a pu voir dans le journal et à la télé » 338, l'autre : « C'était à ma maison et en Belgique. En Belgique, c'est à la ferme. On l'a vu dans le journal, hier avec ma tata »339. Selon une note de l'UTASS du 10 janvier 2002, l'un des enfants Delay « a réagi immédiatement ce matin en entendant sur radio 6 l'information concernant le meurtre d'une enfant mis en lien avec l'affaire de ses parents. _Il_ dit : "Je le sais cela, ça s'est passé à la maison. Il y avait tout le monde (le gros Louis, l'abbé Dominique, Daniel Legrand, Roger Clochepin), et maman disait que c'était la fête. Il y en a qui disent que c'est mon père qui a tué la petite fille, mais c'est le père de Daniel Legrand. Il l'a tuée avec le bâton de mon père. Elle a été tuée parce qu'elle se débattait. Il y avait plein de sang partout. C'était une petite fille de 4 ans. J'ai des images dans ma tête. Je me souviens d'un petit garçon de un an qui est mort en Belgique, quelqu'un a appelé le SMUR et la police sur un portable". » Au cours de son audition, Me Philippe Lescène, avocat de Mme Sandrine Lavier, a évoqué ce problème : « Lorsque les enfants de Sandrine Lavier la mettent en cause, je demande une enquête, une expertise pour déterminer dans quelles conditions ces enfants accèdent aux informations publiées dans la presse. Devant la cour d'assises de Paris, l'assistante maternelle de [...] prétend que celle-ci n'a jamais rien entendu à la radio et à la télé alors que, dans ses rapports, elle écrivait le contraire : "l'enfant vient d'entendre à la radio que et nous déclare que" ou encore : "l'enfant vient d'entendre à la télé que et nous déclare que". Elle confesse également que l'enfant a vu un numéro de Détective qui traînait sur la table et dont le titre était : "L'immeuble de la honte", avec la photo de Franck et Sandrine Lavier ainsi légendée : "Les pédophiles d'Outreau". Comment voulez-vous que la pensée de cette enfant ne soit pas totalement polluée ? »340 La question est également abordée par Mme Florence Aubenas, dans son livre consacré à l'affaire d'Outreau : « En regardant la télévision, Dorian a reconnu le sex-shop en Belgique. Il a entendu le prénom de Dominique Wiel et il a dit : "Je le connais". L'enfant est convoqué. "Je suis allé dans le lit de l'abbé Dominique. Il s'est mis tout nu. Il y avait un petit rouge à son zizi. Il a voulu que je le mange. J'ai dit non, c'est dégoûtant. Berk." »341 Comme le soulignait M. Yves Jannier, avocat général près la cour d'assises de Paris : « il y a eu une progression dans les accusations des enfants : si les enfants Delay ont au début dénoncé les agressions sexuelles et des viols, d'autres enfants, par exemple les enfants Lavier ou ceux qui ont mis ultérieurement en cause l'abbé Wiel, sont passés de la dénonciation de comportements violents ou faisant mal chez les époux Lavier, à celle d'actes prenant une connotation sexuelle plus marquée. Ainsi, l'enfant Lavier ne formulera d'accusations de viol qu'en février 2002, lorsque l'épisode du viol et du meurtre d'une petite fille se répandra dans les médias, donnant à l'affaire une dimension complètement incontrôlable, complètement polluée par sa médiatisation, et on comprend mieux, dans ces conditions, l'évolution des déclarations des enfants. »342 Le procès-verbal d'audition de l'enfant Lavier est, à cet égard, explicite. Celle-ci déclare, en effet, aux policiers qu'elle a été « violée par trois hommes » dont « David que je pense Legrand car j'ai entendu ce nom à la télé, jeune »343. 2. Un élément pris en compte pour justifier les maintiens en détention Lors de son audition, Mme Jocelyne Rubantel a déclaré « avoir été sidérée devant l'impact de la presse, qui, de manière légitime, s'est intéressée à ce dossier, mais qui a entraîné une ambiance presque surréaliste. Le juge d'instruction ne pouvait plus sortir de son bureau ni du palais de justice, ne serait-ce que pour aller déjeuner. Une après-midi, il a fallu en toute urgence trouver des rideaux pour les accrocher aux fenêtres de son cabinet parce que des journalistes étaient postés sur les remparts de Boulogne pour filmer et photographier le juge d'instruction en train de travailler. À partir du moment où la presse est intervenue, disant parfois des choses vraies et disant parfois des choses fausses, il s'est créé une ambiance extrêmement lourde autour du dossier. J'ai le souvenir d'avoir vu des gens emmenés par les forces de police, avec trente ou quarante personnes hurlant : "À mort les pédophiles." Quand vous êtes juge des libertés et de la détention, voilà qui complique définitivement votre tâche »344. Nombre d'ordonnances du juge des libertés et de la détention font référence à la « médiatisation excessive » ou à « l'important déballage médiatique qui s'est instauré autour de cette affaire » lorsqu'elles invoquent le trouble à l'ordre public pour justifier le maintien en détention. Les journalistes entendus par la commission d'enquête n'ont pas estimé avoir une part de responsabilité à cet égard. Selon M. Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire à France 2, « les journalistes ne peuvent que s'étonner et regretter qu'à leur corps défendant la notion de trouble à l'ordre public évoquée par les juges cherche à les inclure dans une procédure à laquelle ils sont étrangers. Je rappelle que la remise en liberté d'Aurélie Grenon, aujourd'hui l'une des quatre personnes condamnées, n'a provoqué aucun commentaire de la presse ou de l'opinion publique ni suscité d'éditorial vengeur »345. De son côté, Mme Florence Aubenas, grand reporter à Libération, s'est déclarée « surprise » des déclarations d'un certain nombre de magistrats, n'ayant « vu aucune campagne de presse après la remise en liberté de cinq des accusés avant le procès, dont une reconnaissait pourtant sa propre culpabilité »346 . M. Stéphane Durand-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro, a constaté une « grande ambivalence dans le discours des magistrats. D'un côté, ils disent tenir à leur indépendance, ils affirment prendre leurs décisions dans le secret de leur conscience [...] et de l'autre, ils disent : "Imaginez le tollé si on avait remis en liberté"... Mais pourquoi n'ont-ils pas essayé, rien que pour voir ? » L'on peut également rappeler que les ordonnances du juge des libertés et de la détention continuaient d'utiliser cet argument, alors que la médiatisation de l'affaire, de grande ampleur en janvier-février 2002, est vite retombée ensuite, pour devenir quasiment inexistante jusqu'à l'ouverture du procès de Saint-Omer, ainsi que l'illustre le graphique suivant : Évolution de la couverture médiatique de l'affaire d'Outreau entre 2001 et 2004 (1) 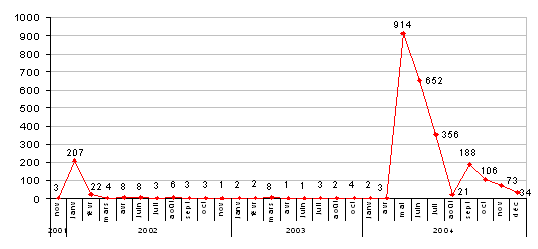 (1) Nombre d'« alertes » sur TF1, France 2, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Europe 1, France Inter et RTL. Source : TNS média intelligence. C. LE RETOURNEMENT DES MÉDIAS AU PROCÈS DE SAINT-OMER À l'approche du procès devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, certains articles comportent encore des titres caricaturaux : « Association de pédophiles » (Le Nouvel Observateur, 29 avril 2004) ; « Les pervers d'Outreau » (L'Express, 3 mai 2004). Le Point publie, le 29 avril 2004, un article prémonitoire : « On évoquait un important réseau pédophile entre la France et la Belgique, un trafic de vente de cassettes via des sex-shops, des actes de zoophilie, la mort d'une fillette [...] Non seulement le procès de l'affaire d'Outreau ne révèlera rien de toutes ces horreurs, mais il pourrait se conclure par l'acquittement de quelques personnes peut-être trop vite mises en cause et trop longtemps gardées en prison ». Cet article est signé par l'auteur de l'article du 23 novembre 2001, intitulé « la maison de l'horreur », qui relatait, sans employer le conditionnel, le démantèlement d'un réseau pédophile, en précisant que « la vérité avait éclaté ». Au fil des audiences, les médias qui avaient présenté les personnes mises en examen comme des « notables » avides de déviances, ont porté un autre regard sur l'affaire. Ainsi que le soulignait Mme Florence Aubenas, lors de son audition : « C'est à Saint-Omer qu'il y a eu ce fameux revirement de la presse, dont je voudrais vous parler. Au début, les bancs de la presse étaient divisés. Pour la moitié des journalistes présents, il s'agissait d'une affaire Dutroux à la française, d'un dossier très bétonné, avec la Belgique, un curé, des bergers allemands, des enfants violés à la pleine lune. Mais de l'autre côté, quelques-uns pensaient que ce n'était pas si bétonné que ça. Le procès commence. On vous a souvent dit que la lumière s'était faite tout à coup et que la presse s'était retournée d'un bloc. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Le fameux "miracle de l'audience" dont on vous a parlé s'est pourtant déroulé sous nos yeux. À l'audience, tout est étalé devant vous, chacun abat son jeu. Nous n'étions plus dans les suppositions, à base de coups de fil passés en secret aux rédactions sans révéler ses sources. Le doute a commencé quand les accusés se sont levés successivement. Ils étaient tous assis sur leurs bancs, ils se méfiaient les uns les autres, ils faisaient en sorte de ne pas se toucher, de ne pas se côtoyer, de ne pas avoir l'air de former un réseau. [..._ Chacun se croyait le seul innocent, il y avait entre eux une suspicion généralisée, tout le monde croyait dur comme fer à la réalité du dossier. Ils se sont tous levés, donc, l'un après l'autre, ils ont clamé leur innocence, en pleurant, et chaque journaliste vous dira que c'est Untel ou Untel qui l'a fait chavirer [...] De l'autre côté, il y avait trois accusateurs. Quant à Thierry Delay, qui avait d'abord nié totalement, il s'est mis à reconnaître sa culpabilité, tout en mettant les autres hors de cause. Ce jour-là, les avocats lui ont demandé : "Combien étiez-vous ? " Il a répondu : "Quatre et seulement quatre." Ils lui ont alors demandé, tour à tour : "Et le mien, il y était." Il répondait "Non", et chacune des personnes concernées s'effondrait en larmes. Le deuxième choc a été la rétractation de Myriam Badaoui. Ce jour-là, nous avons tous été extrêmement choqués. Elle s'est levée, elle a pointé les gens les uns après les autres, en disant à chaque fois : "Il n'y était pas." Le troisième choc a été le témoignage des enfants. [...] À ce moment-là, concernant tous les accusés qui paraissaient avoir des vies très réglées, ne collant pas avec les faits qui leur étaient reprochés, et compte tenu de la rétractation de Myriam Badaoui, tout prenait son sens. »347 Les médias s'emparent des rebondissements au cours du procès. Après la rétractation de Mme Myriam Badaoui, TF1 parle de la « vie brisée » des treize accusés à tort (journal de 20 heures, 19 mai 2004), France 2 annonce un « coup de théâtre » dans le procès, que les débats « ont innocenté treize accusés désignés dont la vie est brisée » (journal de 13 heures, 19 mai 2004). Les chaînes de télévision donnent alors abondamment la parole aux avocats de la défense, aux « innocentés » et à leurs familles. En voici une illustration : « Le 19 mai 2004, devant des dizaines de caméras, dont celle du journal de 20 heures de TF1, l'huissier de justice Alain Marécaux s'écroule en pleurs à la sortie du tribunal de Saint-Omer. Le moment est bouleversant : "J'ai tout perdu dans cette affaire. Vous savez... on a volé mes enfants. Ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude... vendre ma maison... J'ai plus rien... Comment voulez-vous..." Le revirement à l'audience de sa principale accusatrice transforme soudain cet homme en héros, victime, selon la presse unanime, de la "faillite du système judiciaire", d'experts psychologues "partiaux", d'assistantes maternelles "irresponsables", et même de la parole des enfants "manipulés". À ce moment précis, qui se souvient encore que, deux ans plus tôt, le 11 janvier 2002, un 20 heures de TF1 accusateur montrait à 9 millions de téléspectateurs la maison de ce même Alain Marécaux et de sa femme, incarcérés à la suite de ce qui, à l'époque, était présenté comme une affaire de pédophilie monstrueuse ? »348 Le 20 mai 2004, on peut lire à la une du Monde : « Justice : les vies brisées des 13 innocents d'Outreau », alors que trois semaines auparavant, le 7 mai, le journal publiait encore un article sur le déroulement du deuxième jour d'audience au « procès du réseau pédophile d'Outreau ». Le même jour, sous le titre « Treize innocents couverts d'opprobre » paraît un article dans Le Figaro qui débute ainsi : « Ils sont treize, neuf hommes et quatre femmes, accusés de viols et de sévices sur enfants que leur principale accusatrice a disculpés en plein procès. Treize vies jetées en pâture à l'opinion pendant trois ans, broyées par l'opprobre, les mois passés en prison et l'interdiction de voir leurs propres enfants. Des suspects hâtivement baptisés « notables » comme pour ajouter un peu plus à l'infamie. Un quatorzième n'a pas supporté l'épreuve : François Mourmand est mort d'une surdose de médicaments en prison. Pour les autres, le cauchemar pourrait s'achever bientôt. » Puis l'article s'apitoie sur le sort des « victimes de Myriam Delay ». On peut y lire, à propos de M. Pierre Martel, qu'on « l'a accusé d'avoir conduit des enfants en Belgique pour des séances pédophiles dans une ferme » et, à propos des Legrand, que le père « avait été présenté un temps comme le patron d'un sex-shop, voire le cerveau du réseau pédophile ». Or, c'est dans l'article précité du Figaro, daté du 1er janvier 2002, que le lecteur était informé que « le chauffeur de taxi conduisait les petites victimes dans une ferme en Belgique, près d'Ypres où se déroulaient les soirées spéciales enregistrées par deux propriétaires d'un sex-shop d'Ostende ». Le 24 mai 2004, L'Express publie un article intitulé « Outreau : un désastre judiciaire » évoquant un « étrange procès où le 3 mai, les dix-sept accusés semblaient tous condamnés d'avance et où le doute s'est incrusté au fil des audiences » [...] Les coupables étaient tout trouvés. Des " notables ", a-t-on dit. [...] Dans le fait divers, notable signifie vicelard. Alors on en crée ». Ce terme de « notables » avait été utilisé par le même hebdomadaire trois semaines auparavant, dans l'article du 3 mai 2004 intitulé « Les pervers d'Outreau ». Comme par enchantement, les « notables » sont redevenus, sous la plume des journalistes, chauffeur de taxi, prêtre-ouvrier, boulangère ambulante... Interrogé par le rapporteur sur les raisons de ce revirement des médias, M. Gilles Balbastre a déclaré : « Le fait qu'on gagne à tous les coups, au "tirage" de la dénonciation comme au " grattage " de la compassion : les ventes augmentent dans les deux cas ! Après le revirement de Myriam Badaoui, tous les médias, entre le 19 mai 2004 et juillet 2004, ont dit : " Ils sont innocents ", avant même que la justice indépendante rende son verdict - vous imaginez dans quel état d'esprit les jurés ont siégé... La messe était dite, mais ce n'est pas aux journalistes de la dire. »349 Après s'être emparée d'un fait divers « vendeur », la presse se penche désormais sur un « Tchernobyl judiciaire », tout aussi attrayant pour le lecteur. Le 21 mai 2004, Libération revient sur sept années d'accusations, de rétractations et de défaillances judiciaires sous le titre « Outreau : comment la justice a failli ». Le même jour, paraît dans Le Monde un article intitulé : « En dépit des mises en garde, les dérives de l'affaire n'ont été corrigées à aucun stade de la procédure ». Le Nouvel Observateur publie, le 27 mai, sous le titre : « Outreau : la justice en confusion », un article sur les failles de l'instruction, le respect absolu de la parole des enfants, la crédibilité de Myriam Badaoui. L'Express publie, le 31 mai, un dossier spécial : « Faut-il avoir peur de la justice ? », Le Point fustige une « instruction dévastatrice » (3 juin 2004). * * * Les dysfonctionnements précédemment évoqués ne sont le fait ni d'un seul homme, ni de la seule institution judiciaire. Ils ont jalonné toute l'affaire d'Outreau et apparaissent en définitive dissociables des verdicts rendus. En d'autres termes, quand bien même ces derniers auraient été différents, ces dysfonctionnements n'en auraient pas moins été patents. Ce constat a amené la commission d'enquête à se demander quelles seraient les réformes susceptibles de rendre notre justice plus humaine, plus équitable et plus responsable. À cet effet, elle a formulé des propositions de réformes concernant tant la procédure pénale que les autres domaines affectés par les errements qu'elle a identifiés. DEUXIÈME PARTIE : Pour rétablir la confiance des Français dans leur justice, la commission d'enquête préconise plusieurs thèmes d'actions déclinés en quinze chapitres, portant sur les champs suivants : la réforme de la procédure pénale ; la protection des intérêts des enfants ; la responsabilité des magistrats ; les droits et les devoirs des médias dans le traitement des affaires judiciaires et l'engagement par les pouvoirs publics d'une action en faveur de la justice plus vigoureuse que celle qui a pu être menée dans le passé. En renforçant les droits de la défense en garde à vue et le contradictoire pour les enquêtes du parquet ainsi que pour la procédure d'instruction, en limitant la détention provisoire et l'exercice des fonctions judiciaires solitaires, en garantissant l'accès au dossier et la création d'une collégialité de l'instruction, ces propositions mettraient en œuvre les principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l'article préliminaire du code de procédure pénale : « I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. » S'agissant des enfants, les leçons de l'affaire d'Outreau conduisent la commission à recommander une meilleure protection de leurs intérêts et une redéfinition des conditions du recueil de leurs déclarations. En suggérant de voir engagée la responsabilité des magistrats, lorsque ceux-ci méconnaissent manifestement les principes directeurs de la procédure, la commission n'a pas occulté cette question et a parallèlement plaidé pour une meilleure gestion des carrières des magistrats. L'amélioration des voies de droit existantes et l'élaboration d'un code de déontologie pourraient aider les médias à traiter l'information judiciaire avec plus de prudence et de rigueur. Enfin il lui est apparu nécessaire d'appeler à un effort financier accru en faveur de la justice et à un devoir d'information du Parlement sur la justice pénale, afin de rendre plus attentive la représentation nationale au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. I. RÉFORMER LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Alain Marécaux a précisément décrit les différentes techniques de pression qui avaient été exercées à son encontre afin de lui faire reconnaître les faits. Ces pratiques n'ont pas un caractère exceptionnel, comme l'a rappelé devant la commission d'enquête le juge David de Pas : « La garde à vue est une phase plus ou moins longue de retenue policière dont la finalité théorique consiste à connaître la position d'un mis en cause face à une accusation. Mais, en pratique, sans doute à cause de notre obsession de l'aveu, c'est devenu une phase de pressions psychologiques exercées au moment de l'interpellation, dans le processus d'isolement de l'individu et surtout par le fait que le mis en cause ignore tout de l'étendue et de la réalité des charges qui pèsent sur lui. Ce système assez vieillot est générateur d'inégalités puisque les personnes les plus fragiles sont les moins protégées. [...] Le délinquant chevronné supportera beaucoup mieux la pression et sera beaucoup moins sensible aux effets de voix des enquêteurs. »350 C'est pourquoi, afin d'améliorer le droit des personnes placées en garde à vue tout en préservant la nécessaire efficacité des enquêtes, la commission propose de réformer en profondeur le régime de la garde à vue. Participent de cette réforme la notification des faits au gardé à vue ; la motivation des raisons du soupçon ; l'enregistrement obligatoire de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue ; l'intervention de l'avocat avec l'accès au dossier lorsque la garde à vue est prolongée ainsi que le renforcement du contrôle du procureur de la République sur les mesures et les locaux de garde à vue. Le droit en vigueur (article 63-1 du code de procédure pénale) prévoit simplement que la personne placée en garde à vue est informée « de la nature de l'infraction » sur laquelle porte l'enquête. Or, compte tenu du caractère privatif de liberté de la garde à vue, il paraît souhaitable que la personne soit informée plus précisément par la voie d'une notification par procès-verbal des faits qui lui sont reprochés. B. MOTIVER LES RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPÇONNER QUE LA PERSONNE A COMMIS OU TENTÉ DE COMMETTRE UNE INFRACTION La motivation par l'officier de police judiciaire des « raisons plausibles de soupçonner » que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction qui sont, rappelons-le, les critères autorisant le placement en garde à vue tels que définis à l'article 63 du code de procédure pénale, pourrait être désormais introduite. Cette obligation de motiver serait applicable quel que soit le cadre procédural des investigations menées par les policiers, que celles-ci interviennent lors de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire. La conséquence pratique de cette motivation devrait être, ainsi que le souhaite la commission, de retarder le placement en garde à vue qui interviendrait davantage dans la phase conclusive de l'enquête et non, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, au début des investigations. En effet, comme l'a reconnu sans ambages M. Olivier Damien, secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale (SCHFPN), « dans de nombreux cas, la garde à vue n'est pas nécessaire, mais ce sont les pratiques qu'il faut faire évoluer »351. Or, en tant que mesure privative de liberté, même de courte durée, la garde à vue doit être strictement nécessaire, proportionnée et limitée dans le temps, afin de ne pas constituer une mesure de confort, voire un critère d'évaluation de l'activité des services de la police. Ce faisant, le système proposé par la commission se rapprocherait de celui en vigueur en Allemagne où la garde à vue, dénommée « rétention provisoire », ne peut être ordonnée que lorsque le mis en cause est très sérieusement soupçonné d'avoir commis une infraction et qu'il existe un risque majeur d'entrave à l'enquête, tel que la fuite de l'intéressé ou la destruction des preuves. Comme l'a indiqué le magistrat de liaison français en Allemagne, M. Frédéric Baab, interrogé par votre rapporteur, « la rétention est donc un temps procédural important qui sera bien évidemment mis à profit pour interroger le mis en cause. Mais elle ne remplit certainement pas cette fonction de première heure de vérité comme en France puisqu'il existe déjà des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de la personne retenue. [...] Ultime préliminaire avant l'incarcération, la rétention allemande se distingue donc assez nettement de la garde à vue française qui se situe plus en amont de la procédure, à un moment où l'intéressé n'est qu'un simple suspect. Le dénouement d'une mesure de rétention est en quelque sorte connu d'avance. Car, sauf exception, le mis en cause sera présenté le jour suivant à un juge des enquêtes qui statuera sur son placement en détention provisoire. »352 Par ailleurs, la commission a déploré que la procédure de prolongation de la garde à vue puisse faire l'objet d'abus pour des raisons de confort. Selon M. Laurent Laclau-Lacrouts, secrétaire national adjoint du syndicat de policiers Alliance : « Dans toutes les grandes villes où la justice est débordée, l'on assiste à des prolongations de confort : des magistrats imposent des prolongations car ils n'ont pas le temps de recevoir le gardé à vue le soir même, allant parfois jusqu'à suggérer à la police d'organiser n'importe quelle perquisition pour justifier la mesure. Les policiers ne sont pas responsables de tels dysfonctionnements. »353 Les magistrats entendus par la commission ont reconnu, tout en la regrettant, l'existence de cette pratique. Mme Agnès Herzog, vice-présidente du syndicat de la magistrature a fourni l'explication suivante : « Bien qu'elles soient inadmissibles, nous ne contestons pas qu'il existe des prolongations de garde à vue de confort, tout simplement parce que l'autorité judiciaire n'est plus en mesure d'effectuer un contrôle effectif » analyse que partage M. Nicolas Blot secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats : « L'expression « de confort » me choque, car c'est de la misère des moyens de la police et de la justice qu'il est question. »354 La motivation des critères de placement en garde à vue devrait faire échec à ces pratiques. C. ENREGISTRER LES INTERROGATOIRES PENDANT LA GARDE À VUE Afin que l'obligation de l'enregistrement obligatoire de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue soit respectée et non pas contournée comme cela peut être le cas aujourd'hui pour les auditions de mineurs, sa méconnaissance serait une cause de nullité de la procédure. Cet enregistrement vaudrait quelle que soit la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, qu'il s'agisse d'un délit de droit commun ou relevant de la criminalité organisée telle que définie par la loi à l'article 706-73 du code de procédure pénale. En cas de contestation sur les modalités de déroulement de la garde à vue, cet enregistrement pourrait être visionné par le juge compétent à la demande de l'avocat de la personne en ayant fait l'objet. Bien évidemment, les interrogatoires de garde à vue feraient toujours l'objet d'un procès-verbal écrit versé à la procédure, même si l'on pourrait voir dans l'enregistrement un moyen de réduire « le poids du papier dans le procès pénal » comme l'a relevé M. Étienne Blanc lors de l'audition du Premier président de la Cour de cassation M. Guy Canivet355. En cas de contestation par le gardé à vue, ou son avocat, de la retranscription par le procès-verbal des propos tenus, le magistrat compétent pourrait, là encore, consulter l'enregistrement afin de clarifier les points litigieux, l'enregistrement faisant foi. Dans ces conditions, l'enregistrement des interrogatoires protégerait également les policiers des accusations sans fondements proférées à leur endroit. Évoquée par certains officiers de police auditionnés par la commission d'enquête, cette proposition a soulevé certaines objections. Ainsi, Mme Chantal Pons-Mesouaki, secrétaire nationale du syndicat national des officiers de police, a considéré que : « Dans les conditions matérielles actuelles, nous n'y sommes pas favorables. Il serait nécessaire de donner aux services de police les moyens matériels adéquats, c'est-à-dire d'aménager des salles d'audition uniquement dévolues à cet usage. Se poserait aussi le problème de la transcription des bandes audio et vidéo. Qu'est-ce qu'un procès-verbal d'audition ? Les mis en cause ne sont que rarement des personnes polies et cultivées dont les propos peuvent être consignés tels quels. Dans l'immense majorité des cas, le policier doit effectuer un travail de quasi-traduction et de mise en forme grammaticale de façon à rendre l'entretien compréhensible par les magistrats. [...] Coupler enregistrement et procès-verbal obligerait à une identité parfaite entre ces deux supports, ce qui rendrait les PV illisibles et allongerait encore le temps total de réalisation d'une audition. [...] Bref, un enregistrement audio et vidéo des interrogatoires n'a absolument aucun sens ni aucun intérêt en dehors d'une refonte totale de notre système procédural et judiciaire. »356 Cet avis n'est cependant pas unanimement partagé par les syndicats de police. Ainsi, M. Nicolas Comte, secrétaire général du syndicat général de la police - Force ouvrière a estimé que : « L'enregistrement audiovisuel de toutes les auditions, par exemple, présenterait le double avantage d'assurer la transparence de la garde à vue - nos collègues en ont assez d'être régulièrement mis en cause sur les circonstances de cette dernière - et surtout de pouvoir faire traiter le travail de rédaction par d'autres agents : le policier mènerait ses auditions et un agent ayant prêté serment effectuerait le travail de retranscription. Cela éviterait également que le mis en examen revienne sur ses déclarations une fois présenté au juge d'instruction et que celui-ci ait à le réentendre : le juge n'aurait plus qu'à approfondir ces déclarations et à les mettre en perspective avec les autres preuves. »357 De même, le SCHFPN, par la voix de M. Denis Collas s'est déclaré favorable à un tel enregistrement « du moins audio car un enregistrement audiovisuel serait assez pesant. C'est vrai que nous le faisons pour les mineurs, mais les locaux sont adaptés. Il faudrait, à tout le moins, adapter nos locaux »358. En outre, comme l'a souligné le professeur Jean Pradel la sécurité juridique de la procédure de garde à vue serait renforcée par l'institution de cette mesure : « l'enregistrement des auditions en audio, voire en vidéo, est un procédé certes lourd et coûteux, mais qui fonctionne déjà pour les mineurs et qui peut assurer une bonne garantie pour les justiciables. On tarirait ainsi dans une large mesure les requêtes en nullité de la garde à vue que présentent très souvent les intéressés, que ce soit à l'instruction ou à l'audience de jugement. »359 D. AUTORISER L'AVOCAT À ACCÉDER AU DOSSIER LORS DE LA PROLONGATION DE LA GARDE À VUE Il convient de rappeler brièvement que le droit en vigueur pour les infractions de droit commun prévoit l'intervention de l'avocat, certes dès le début de la garde à vue, mais ce dernier n'a pas accès au dossier de la procédure, ne peut assister aux interrogatoires de son client et ne peut s'entretenir avec lui que pendant une durée limitée ne pouvant excéder trente minutes, comme le précise l'article 63-4 du code de procédure pénale. Comme l'a affirmé Me Jean-Louis Pelletier, le droit en vigueur fait des avocats des « visiteurs de gardés à vue » et non de véritables conseils360, M. Gérard Tcholakian, membre du conseil national des barreaux estimant, pour sa part, que la présence de l'avocat se bornait aujourd'hui « à de l'assistanat »361. Afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité de garantir l'efficacité des enquêtes policières et le renforcement des droits de la personne placée en garde à vue, et donc privée de liberté, l'avocat de l'intéressée aurait accès au dossier de la procédure et pourrait assister aux interrogatoires de son client à l'issue des premières vingt-quatre heures. Cependant, compte tenu de leur spécificité et de leur structure souvent ramifiée, cette procédure ne serait pas applicable aux crimes et délits relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui inclut, notamment, les actes de terrorisme, le trafic de stupéfiants en bande organisée, le vol en bande organisée ou encore le proxénétisme aggravé. Cette exception pour les infractions relevant de la criminalité organisée fait perdre de sa pertinence à l'argument qu'avait avancé devant la commission d'enquête M. Laurent Laclau-Lacrouts, secrétaire national adjoint d'Alliance pour justifier l'opposition de son syndicat à cette disposition : « Je suis totalement hostile à l'accès de l'avocat au dossier. Dans les affaires de grand banditisme, les avocats connaissent bien leurs clients et, s'ils ont immédiatement accès à la totalité du dossier, la police craint que la confidentialité ne soit pas respectée. »362 M. Denis Collas s'est montré, au nom du syndicat des commissaires de police (SCHFPN), tout aussi réservé, exprimant à son tour la crainte que « si l'on démantèle un réseau de stupéfiants et que l'on communique toute la procédure à l'avocat, il y aura toujours le risque qu'il en fasse un mauvais usage »363. Toutefois, les membres socialistes de la commission considèrent qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans l'implication de la défense au cours de la garde à vue. C'est pourquoi ils préconisent que l'avocat puisse assister à tous les interrogatoires effectués pendant la garde à vue, dès le début de la mesure. Cependant, afin de ne pas entraver les enquêtes, le dossier de la procédure ne lui serait communiqué qu'à partir du moment où la garde à vue ferait l'objet d'une prolongation, rejoignant ici les propositions de votre rapporteur. La proposition de la commission d'enquête permettrait de mieux inscrire la procédure de garde à vue dans les normes européennes de défense des droits de l'homme. Il a été ainsi rappelé par M. Jacques Martin, président de la commission pénale de la Conférence des bâtonniers, la nécessité « que la France se replace au rang des autres pays européens. Nous avons à cet égard beaucoup de leçons à prendre de l'Allemagne, de l'Autriche ou de l'Espagne. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe Álvaro Gil Roblés, dans son récent rapport, écrivait : « Je considère essentiel que les avocats voient leur rôle renforcé dans l'intérêt du respect des droits fondamentaux du gardé à vue de par la reconnaissance du droit à assister leurs clients lors des interrogatoires qui ont lieu au cours de la garde à vue. » Assister nos clients suppose que nous accédions aux dossiers, que nous puissions nous entretenir avec eux sans limite de temps, que nous puissions évidemment les assister durant l'interrogatoire et que la garde à vue soit enregistrée, afin que personne ne puisse la mettre en cause »364. Les éléments de droit comparé dont a pu disposer la commission montrent, par exemple, qu'en Espagne aucun interrogatoire du gardé à vue ne peut avoir lieu sans avocat. Même en cas de terrorisme, ce principe est maintenu, sous réserve que l'avocat soit alors désigné d'office par l'Ordre des avocats et ne puisse être choisi par le gardé à vue. Cet avantage donné à la défense est, dans la procédure pénale espagnole, équilibré par le maintien strict du secret de la procédure. Celle-ci n'est communiquée à l'avocat qu'au moment de la comparution devant le juge d'instruction. Des dispositions particulières donnent droit au juge de maintenir le secret, opposable aussi à l'avocat, pendant un délai d'un mois365. E. RENFORCER LE CONTRÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES MESURES ET LES LOCAUX DE GARDE À VUE Au cours de leurs auditions, les acquittés ont dénoncé les conditions matérielles et humaines dans lesquelles se sont déroulées leurs gardes à vue. Les détails livrés à cette occasion - saleté des locaux dans lesquels les personnes sont retenues, attitude de certains fonctionnaires peu respectueuse de la dignité des personnes - confirment une situation régulièrement dénoncée par ailleurs. À ce titre, l'amélioration des locaux de garde à vue devrait être poursuivie et amplifiée, ce programme d'amélioration devant être planifié sur plusieurs années. Dans une instruction en date du 11 mars 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a ainsi constaté que « trop souvent encore, les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes en terme de respect de la dignité des personnes qui font, conformément à la loi, l'objet de ces mesures » et a rappelé, en particulier, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme relatives « au droit intangible et impératif au respect de son intégrité physique et morale pour toute personne ». L'instruction précitée demande que les mesures de sécurité soient adaptées et que les conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les gardes à vue soient améliorées. Aux termes de l'article 41 du code de procédure pénale, il revient au procureur de la République de contrôler les mesures de garde à vue et de visiter « les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux ». La commission d'enquête propose que ces visites fassent l'objet d'un rapport détaillé consignant les commentaires du procureur sur les mesures de garde à vue et décrivant l'état de chaque local de garde à vue de son ressort. Ce rapport, transmis au procureur général, serait communiqué au garde des Sceaux qui en rendrait compte au Parlement366. L'obligation de rendre compte devant la représentation nationale rendrait plus exigeante l'application de l'article 41 du code de procédure pénale en incitant les procureurs à se rendre plus fréquemment dans les locaux de garde à vue. Ces visites restent en effet « rarissimes », comme l'a indiqué le professeur Jean Pradel devant la commission d'enquête367. II. RENDRE LES ENQUÊTES DU PARQUET PLUS CONTRADICTOIRES On le sait, le juge d'instruction n'est saisi que de 5 % des affaires pénales, les 95 % restantes faisant l'objet d'un traitement procédural différent par le parquet. Certes, l'affaire d'Outreau est intervenue dans le cadre d'une information judiciaire qui, rappelons-le, est obligatoire en matière criminelle mais la commission n'a pu se désintéresser des modalités de traitement de l'écrasante majorité des affaires pénales. En termes statistiques, il convient de rappeler que, sur les 5 millions d'affaires traitées par les parquets en 2004, 3,5 millions d'entre elles n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du défaut d'élucidation (3,1 millions de cas) ou de charges insuffisantes (400 000). Sur les 1,45 millions d'affaires poursuivables, 366 000 ont fait l'objet d'un classement sans suite et 388 900 de procédures alternatives aux poursuites, telles que la réparation, le rappel à la loi ou la médiation pénale (article 41-1 du code de procédure pénale). Le parquet n'a saisi le tribunal correctionnel que pour 462 661 affaires. Si l'on souhaite connaître les modalités de saisine du tribunal correctionnel, il convient de se référer, non plus à l'activité des parquets, mais à celle des juridictions. Ainsi, en 2004, les tribunaux correctionnels ont rendu 440 944 décisions, dont 98 530 sur citation directe ou comparution volontaire, 222 511 sur convocation par procès-verbal de l'OPJ (COPJ) et 14 000 sur convocation par procès-verbal du procureur de la République (+ 45 % en un an). Pour sa part, la comparution immédiate a été utilisée à 41 600 reprises. Or, dans un certain nombre d'affaires dont le tribunal correctionnel est saisi par COPJ ou par citation du procureur de la République, force est de reconnaître que l'enquête de police est incomplète, ce qui oblige le tribunal à renvoyer l'affaire ou à tenter de démêler à l'audience l'écheveau de l'espèce. Outre son caractère inachevé l'enquête policière est surtout marquée par l'absence de contradictoire. Certes, si la personne a été placée en garde à vue, elle a pu s'entretenir avec un avocat, mais on le sait, celui-ci n'a pas accès au dossier de la procédure. Si, à l'issue de cette garde à vue, le procureur décide de citer à comparaître le prévenu, ce dernier n'aura jamais été en mesure de consulter le dossier et le découvrira, bien souvent, à l'audience. L'article 394 du code de procédure pénale dispose que lorsque le procureur défère le prévenu devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, son avocat peut « à tout moment » consulter le dossier. C'est pourquoi afin de renforcer le caractère contradictoire des enquêtes, préalablement à la saisine du tribunal correctionnel par le parquet, la commission préconise un accès au dossier facilité et la reconnaissance à l'avocat du droit de présenter des observations et des demandes d'investigations complémentaires. Cette promotion des procédures contradictoires est inséparable d'une exigence accrue de transparence dans les informations fournies au parquet. A. FACILITER L'ACCÈS AU DOSSIER Lorsque le procureur de la République envisage de saisir le tribunal correctionnel, donc préalablement à sa décision, il devrait le notifier à la personne concernée et lui signifier que le dossier de la procédure est mis à la disposition de son avocat. Cette proposition constituerait un progrès indéniable par rapport au droit en vigueur qui conditionne l'accès au dossier au défèrement devant le tribunal. L'avocat pourrait ainsi analyser son contenu, analyser l'orientation de l'enquête et, par voie de conséquence, améliorer l'efficacité de la défense de son client. Cependant, cette mise à disposition ne serait pas applicable dans deux hypothèses : celle de la comparution immédiate qui, en raison même de sa rapidité, la rend inapplicable, et celle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). En effet, dans cette dernière hypothèse, il convient de rappeler que l'article 495-8 du code de procédure pénale dispose que les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits sont recueillies par le procureur de la République en la présence obligatoire de l'avocat de l'intéressé qui ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. En outre, l'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier et s'entretenir librement avec son client hors la présence du procureur. Enfin, la personne concernée peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse les peines proposées par le procureur. Il résulte clairement de ce qui précède que la CRPC est une procédure dans le cadre de laquelle le respect du contradictoire est d'ores et déjà assuré. Compte tenu de ces deux exceptions, cette nouvelle obligation porterait sur les saisines du tribunal correctionnel par COPJ ou par le procureur de la République et concernerait près de 240 000 affaires par an, ce qui ne semble pas hors de portée. B. RECONNAÎTRE À L'AVOCAT LE DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS ET DES DEMANDES D'INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES La possibilité pour l'avocat de la personne dont la comparution devant le tribunal correctionnel est envisagée par le procureur, de présenter des observations et des demandes d'investigations complémentaires participerait également du renforcement de la procédure contradictoire. Disposant désormais du dossier dans un délai suffisant lui permettant d'en prendre connaissance dans des conditions satisfaisantes, l'avocat devrait être en mesure d'en tirer certaines conclusions, telles que la nécessité de procéder à des investigations complémentaires ou encore la formulation d'observations sur les éléments de preuve collectés au cours de l'enquête. Ces observations ou demandes d'investigations complémentaires seraient annexées au dossier de la procédure. Deux hypothèses seraient alors envisagées : - soit le procureur fait droit à la demande d'investigation complémentaire présentée par l'avocat, ce qui entraîne la poursuite de l'enquête préliminaire ; - soit le procureur ne fait pas droit à la demande de l'avocat, et il devrait alors indiquer les raisons de son refus dans une décision motivée. Afin de ne pas alourdir la procédure, cette décision ne serait pas susceptible de recours devant le procureur général. Ce faisant, lorsque le tribunal correctionnel viendrait à être saisi, il serait mieux éclairé sur les éventuelles failles ou critiques portées sur l'enquête et les éléments de preuve ainsi rapportés, ce qui devrait éviter le renvoi d'un certain nombre d'affaires tout en favorisant la prise en considération des observations de la défense. Le renforcement de la procédure contradictoire est également inséparable d'une exigence accrue de transparence. C. EMPÊCHER DE FONDER DES POURSUITES SUR DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES ANONYMEMENT AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Que l'on évoque les pages les plus sombres de notre histoire ou que l'on songe à certaines affaires récentes, les méfaits des dénonciations anonymes ne sont plus à démontrer. La commission estime qu'il est grand temps de rompre avec cette tolérance pour la délation anonyme qui n'honore ni notre système judiciaire ni nos mœurs nationales. De surcroît, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que toute personne accusée d'une infraction a le droit « d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ». Selon une jurisprudence bien établie de la CEDH, le mode de présentation des preuves est étroitement lié à l'exercice des droits de la défense. La convention exige le respect d'une complète égalité en matière de témoignages entre accusation et défense. Pour ce qui est des preuves produites par l'accusation, les droits de la défense commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au plus tard au moment de la déposition368. Or, comment respecter cette obligation qui s'impose à notre droit si les dénonciations anonymes sont toujours reçues en procédure, soit comme élément justifiant l'engagement de poursuites, soit comme élément de preuve devant le juge pénal pour lequel la preuve est libre ? Ce sont les raisons pour lesquelles la commission suggère que les éléments apportés anonymement à la connaissance du procureur de la République ne puissent plus fonder l'engagement des poursuites prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et que, par voie de conséquence, le juge du siège, qu'il s'agisse de la juridiction de jugement ou de la juridiction d'instruction, ne puisse plus recevoir de tels éléments en tant que preuve d'une infraction. Cette interdiction serait sans préjudice des dispositions des articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale, qui organisent la protection du témoin dont la révélation de l'identité est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ainsi que celles de sa famille ou de ses proches. En effet, dans ces hypothèses, il appartient au JLD, saisi par le procureur ou le juge d'instruction, d'autoriser le recueil des déclarations de ce témoin sans que son nom n'apparaisse dans la procédure. Il ne s'agit toutefois pas d'une dénonciation anonyme puisque les magistrats ayant sollicité cette protection connaissent l'identité du témoin et que, à la demande de la défense de l'accusé mais avec l'accord de l'intéressé, celle-ci peut être révélée. Enfin, l'article 706-61 du même code prévoit que la personne mise en examen, ou renvoyée devant la juridiction de jugement, peut demander à être confrontée au témoin « anonyme » par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant son audition à distance et son questionnement par l'avocat du requérant, la voix du témoin étant alors « rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés ». Les socialistes se sont cependant déclarés favorables au maintien en l'état de la possibilité d'engager des poursuites sur la base de déclarations anonymes en matière de maltraitance à enfants et de criminalité organisée. III. LIMITER LA DÉTENTION PROVISOIRE Si l'on souhaitait caractériser le droit actuel de la détention provisoire, on serait tenté de le faire par deux traits : la volonté affichée de donner la priorité à la liberté et aux solutions alternatives et l'application d'un encadrement légal qui ne correspond pas aux objectifs poursuivis. A. UNE PRIORITÉ À LA LIBERTÉ QUI N'EST PAS RESPECTÉE 1. Des solutions alternatives insuffisamment exploitées Le contraste entre la réalité de la détention provisoire et ce qu'elle devrait être en droit est frappant à la lecture de l'article 137 de notre code de procédure pénale, lequel énonce : « La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. » Par ailleurs, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher soit une pression sur les témoins ou sur les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, ou bien encore l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, ou bien enfin l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé (article 144 du code de procédure pénale). Juridiquement, la liberté devrait, par application du respect de la présomption d'innocence, rester le principe dans l'attente du jugement. L'exception apportée à ce principe en cas de nécessité devrait être le contrôle judiciaire. La détention provisoire ne devrait intervenir qu'en dernier recours, comme exception de l'exception, lorsque le contrôle judiciaire s'avère insuffisant. Avant de rappeler les grands principes juridiques relatifs à la détention provisoire, il n'est donc pas inutile de présenter ceux régissant le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention, lorsque ce dernier refuse la mise en détention. Il n'est possible que si la personne encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (article 138 du code de procédure pénale). Le contrôle judiciaire astreint la personne mise en examen à se soumettre, selon la décision prise, à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138 précité. Cette liste offre un grand nombre de possibilités, parmi lesquelles : - ne pas sortir de certaines limites territoriales ; - ne s'absenter de son domicile, qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge ; - ne pas se rendre dans certains lieux ; - se présenter périodiquement à des autorités ou services désignés (ce sont les « pointages » périodiques de présence) ; - remettre aux autorités habilitées son passeport ou son permis de conduire ; - s'abstenir de rencontrer certaines personnes ou d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; - ne pas exercer certaines activités professionnelles ou sociales ; Il convient de rappeler que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, l'obligation de rester à domicile dans le cadre d'un contrôle judiciaire peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé, sous le régime du placement sous surveillance électronique. S'il y a manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins du placement en détention provisoire de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article 141-2 du code de procédure pénale. Ces solutions alternatives à la détention provisoire sont prévues par la loi ; le juge ne doit pas hésiter à y recourir, renonçant à la solution de facilité que constitue trop souvent la mise en détention provisoire. 2. Un encadrement légal de la détention provisoire qui ne correspond pas aux objectifs affichés La détention provisoire s'inscrit également dans un cadre légal précisément défini (notamment aux articles 137, 137-1, 3, 4, 5, 143-1 à 150 du code de procédure pénale ; des règles particulières sont applicables aux mineurs). - Quelles sont les modalités de la détention provisoire ? La détention provisoire consiste en l'incarcération de la personne mise en examen, pouvant durer pendant l'instruction préparatoire, et même jusqu'au jugement devenu définitif. L'incarcération a lieu dans une maison d'arrêt (article 714 du code de procédure pénale) en principe dans une cellule individuelle (article 716 du code de procédure pénale) mais la pratique méconnaît souvent ce principe, comme les témoignages des acquittés l'ont confirmé. Le détenu provisoire peut être « mis au secret » (sauf la visite de son avocat) pour une période de dix jours, renouvelable une seule fois. Hors la mise au secret, le détenu provisoire peut recevoir des visites, avec l'autorisation du juge d'instruction. Après un mois d'incarcération, les visites familiales ne peuvent être interdites que par décision écrite et spécialement motivée du juge d'instruction, susceptible de recours devant le président de la chambre de l'instruction (article 145-4 du code de procédure pénale). - À qui s'applique la détention provisoire et quelle est sa durée ? La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ou si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire (article 143-1 du code de procédure pénale). La détention provisoire ne peut, d'une façon générale, excéder une « durée raisonnable », au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité (article 144-1, alinéa 1er du code de procédure pénale). En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut À titre exceptionnel, et toujours en application de l'article 145-2, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la libération de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger ces délais pour une durée de quatre mois supplémentaires, cette décision pouvant être renouvelée une fois sous les mêmes conditions. L'ensemble de ces dispositions est applicable jusqu'à l'ordonnance de règlement (article 145-2, dernier alinéa du code de procédure pénale). Ces règles sont donc complexes, le principe de durée maximale d'un an étant assorti de nombreuses possibilités de prolongations et dérogations qui le rendent illusoire. En pratique, le « délai-butoir » - avant l'ordonnance de règlement - est de trois ans pour des personnes placées en détention provisoire et soupçonnées de viols sur mineurs de quinze ans, comme dans l'affaire d'Outreau. Il aurait pu être porté à quatre ans, par exemple, si l'accusation initiale de viols commis également en Belgique avait été retenue. De plus, étant observé que ces maxima sont applicables jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation et que l'intéressé peut, en outre, être maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement, les « délais butoirs » sont en fait rallongés d'autant. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, ce « délai d'audiencement » ne doit pas dépasser un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, mais des prolongations sont possibles. En matière correctionnelle, les règles relatives à la durée maximale de la détention provisoire sont également diverses. Le principe de durée maximale de quatre mois est également théorique, car assorti d'exceptions, pouvant la porter à un an, voire à deux ans dans des cas particuliers (lorsqu'un des faits a été commis en dehors du territoire national ou encore pour trafic de stupéfiants, terrorisme, etc. si la peine encourue est supérieure à dix ans). Cette durée de deux ans peut également être prolongée à titre exceptionnel. Ces règles sont détaillées à l'article 145-1 du code de procédure pénale. De plus, là encore, se rajoute le délai d'audiencement à compter de l'ordonnance de renvoi : deux mois pouvant être portés à quatre ou six mois dans les conditions précisées à l'article 179 du code de procédure pénale. - Dans quelles conditions une demande de mise en liberté ou une ordonnance de règlement peuvent-elles faire cesser la détention provisoire ? En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République (article 147, alinéa 1er du code de procédure pénale). Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction peut alors soit ordonner la mise en liberté de la personne, soit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans le délai de trois jours ouvrables (article 147, alinéa 2 du code de procédure pénale). La personne placée en détention provisoire - ou son avocat - peut aussi, à tout moment, demander sa mise en liberté auprès du juge d'instruction qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le juge d'instruction doit soit donner une suite favorable à cette demande, soit dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention qui statue dans un délai de trois jours ouvrables. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures d'un contrôle judiciaire. À l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction (article 148-4 du code de procédure pénale). La fin de la détention provisoire dépend de l'ordonnance de règlement : si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, les personnes mises en examen et provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance de non-lieu met également fin au contrôle judiciaire (article 177 du code de procédure pénale). Si le juge d'instruction considère que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi (ce qui était le cas dans l'affaire d'Outreau), il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets. Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises. L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an (délai d'audiencement). Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel et en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois et cette prolongation peut être renouvelée une fois. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis en liberté (article 181 du code de procédure pénale). En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la durée de la détention provisoire doit être déduite de la durée de la peine prononcée. Le drame d'Outreau, chacun le reconnaît, c'est le scandale de la détention provisoire. Au-delà du changement de culture de la magistrature, la commission considère que l'urgence est de réformer les dispositions existantes en encadrant très précisément le recours à la détention provisoire. B. RÉFORMER LA DÉTENTION PROVISOIRE Pour répondre à cette attente, la réforme doit porter sur plusieurs variables, notamment : la durée maximale de la détention provisoire, la justification de l'impossibilité de recourir à une mesure alternative et la redéfinition des critères du placement en détention provisoire. 1. Limiter les durées maximales de détention provisoire Lors de son audition par la commission d'enquête, le Premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet a marqué très clairement les termes du débat : « Ne faut-il pas, enfin, envisager d'enfermer la durée de la détention dans des limites plus rigoureuses tant en matière de délit que de crime, en tout cas de manière plus nette qu'actuellement ? Je vous engage, à ce sujet, à relire les dispositions compliquées de l'article 145-2 du code de procédure pénale résultant de lois successivement votées entre 1993 et 2000. Au bout d'un temps raisonnable, il faut choisir : soit de juger en l'état des preuves recueillies, soit de remettre en liberté et de poursuivre l'instruction. Autrement dit, il faut faire du facteur temps une contrainte primordiale de l'instruction lorsqu'elle impose des placements en détention. La détention provisoire est, à mon sens, une question de culture judiciaire davantage qu'une question de procédure. Il faudrait, une fois pour toutes, admettre qu'une personne accusée d'un crime, même grave, puisse se trouver en liberté en attendant son jugement si toutes les précautions sont prises par ailleurs. »369 La première phrase de l'article 145-2 du code de procédure pénale - « En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an » - ne correspond qu'à une situation théorique. En effet, les multiples exceptions prévues dans la suite de l'article, ajoutées aux délais d'audiencement, aboutissent à ce que, dans les faits, les exceptions deviennent le principe. Aussi la commission d'enquête souhaite une nouvelle rédaction dégageant un principe clair. Une telle réforme doit s'accompagner de la nécessaire modernisation des moyens de notre justice, laquelle devra notamment permettre de raccourcir les délais dans lesquels peuvent intervenir les jugements. Dans l'affaire d'Outreau, sept personnes finalement acquittées ont subi des détentions provisoires supérieures à trente mois. Par ailleurs, la durée moyenne des détentions provisoires criminelles hors affaires pour lesquelles un acquittement, une relaxe ou un non-lieu ont été prononcées, s'établit déjà, à elle seule, à plus de 24,3 mois. Rappelons également que des solutions alternatives à la détention provisoire en maison d'arrêt existent et pourraient être développées, notamment après clôture des investigations (contrôle judiciaire strict imposant si nécessaire un maintien à domicile, placement sous surveillance électronique notamment). La commission d'enquête propose que la durée maximale de la détention avant l'audience de jugement soit fixée à deux ans en matière criminelle, sauf dans les domaines relevant de la criminalité organisée au sens de la loi, ce qui inclut notamment le terrorisme. Elle considère que les prévenus ayant déjà été condamnés et se trouvant en état de récidive légale doivent être exclus du bénéfice de cette nouvelle disposition. En matière correctionnelle, la durée de la détention subie avant l'audience de jugement doit être limitée à un an, à l'exception également des domaines relevant de la criminalité organisée au sens de la loi, notamment le terrorisme. De même, les prévenus ayant déjà été condamnés et se trouvant en état de récidive légale seraient exclus du champ d'application de cette disposition. 2. Justifier de l'impossibilité de recourir à une mesure alternative L'article 137 du code de procédure pénale pose clairement le principe d'une détention provisoire prononcée en dernier ressort, en l'absence de possibilité de laisser la personne en liberté ou de l'astreindre à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire (lequel peut consister également en un placement sous surveillance électronique). Les dispositions de l'article 137-3 prévoyant que le JLD, lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, doit rendre une ordonnance comportant « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 » se sont avérées à l'expérience inadaptées pour garantir un examen prioritaire des possibilités de mise en place de mesures alternatives à la détention. Au surplus, selon la jurisprudence, l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 cesse d'être applicable, lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement. La volonté de la commission est d'éviter que soit écartée d'un trait de plume la possibilité de recourir à une mesure alternative, par une formule lapidaire telle que : « Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale »370, sans qu'il soit précisé davantage dans la décision les raisons pour lesquelles un contrôle judiciaire serait en l'espèce insuffisant. Dans l'affaire d'Outreau, la possibilité de mise sous contrôle judiciaire ne fut pas véritablement étudiée. Ainsi, rappelons-le, Mme Roselyne Godard fut remise en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction le 13 août 2002, avec possibilité de résider chez son frère, alors que quatre mois plus tôt, le 11 avril 2002, la même juridiction (composée de magistrats différents) avait refusé de la remettre en liberté. Il apparaît, à travers l'affaire d'Outreau, que l'initiative de proposer et de justifier une mesure alternative à la détention provisoire est en fait largement laissée à l'intéressé. En témoigne l'extrait de cette audition de magistrats de la chambre de l'instruction : « M. le Rapporteur : À propos de contrôle judiciaire, je voudrais poser une question, qui concerne aussi M. Testut. Le 11 avril 2002, la chambre de l'instruction refuse la mise en liberté de Roselyne Godard. [...] Le 13 août 2002, Mme Roselyne Godard est remise en liberté par la chambre de l'instruction, où vous-même et M. Testut siégiez, et on lui permet de résider chez son frère. Que s'était-il donc passé ? La possibilité de résider chez son frère existait sans doute déjà le 11 avril. La chambre de l'instruction était composée différemment le 11 avril et le 13 août. Pouvez-vous nous expliquer ce changement de position - si toutefois vous pouvez répondre sans porter atteinte au secret du délibéré ? M. Claude Testut : Il s'agissait de la possibilité de résider chez un frère loin du lieu où les faits s'étaient déroulés. M. le Rapporteur : Mais son frère, elle l'avait déjà trois mois plus tôt. M. Claude Testut : Lorsque l'on examine une « possibilité d'hébergement », on s'inquiète de la certitude de cette « possibilité d'hébergement ». On demande que nous soient fournis des éléments concrets. Il faut s'assurer d'un certain nombre de faits objectifs. M. le Rapporteur : Vous pensez donc que, trois mois auparavant, Mme Roselyne Godard n'avait pas justifié de cette possibilité d'hébergement, et qu'elle l'aurait fait trois mois après ? M. Claude Testut : Est-ce que, dans l'arrêt d'avril, elle se prévalait d'une possibilité d'hébergement ? Je n'en sais rien. Et il peut y avoir, à quelques mois d'intervalle, des changements d'appréciation en fonction des modifications objectives d'un certain nombre d'éléments présentés devant la formation de la chambre de l'instruction. Mme Claire Montpied : On n'a pas toujours de garanties. Et les gens ne nous disent pas toujours où ils peuvent être hébergés ; or ce n'est pas à nous de le décider pour eux. » 371 La juridiction compétente devrait, dans sa décision de placement ou de maintien en détention provisoire, justifier de l'impossibilité de recourir à une mesure alternative, en la motivant au cas par cas, après avoir elle-même interrogé la personne concernée sur ce point. Il doit y avoir là un renversement de la « charge de la preuve » de la possibilité ou non d'une solution alternative. Cette inversion des rôles serait conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 137 du code de procédure pénale, qui a fait du maintien en liberté et du contrôle judiciaire des principes au regard desquels le placement en détention provisoire doit rester l'exception, s'agissant de personnes présumées innocentes. Attendre, en quelque sorte, que l'initiative vienne des personnes placées en détention provisoire interdit, de fait, à la plupart d'entre elles la possibilité de présenter une solution alternative, par ignorance ou en raison de leur isolement. Comme l'a souligné M. Jean-Marie Delarue, Président de la Commission de suivi de la détention provisoire, dans son audition : « Je crois qu'il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles se fait le contrôle judiciaire, et à des formules innovantes, par lesquelles l'intéressé consentirait lui-même à échafauder avec les personnes les plus compétentes de son entourage le contrôle judiciaire qui conviendra le mieux compte tenu de l'infraction commise. Il y a là un champ d'investigation : le contrôle judiciaire est l'alternative normale de la détention provisoire. »372 Cette réflexion débouche sur la question des critères du placement. 3. Préciser les critères du placement et du maintien en détention provisoire et limiter le recours à la notion d'ordre public La rédaction actuelle de l'article 144 du code de procédure pénale doit être revue, afin d'éviter les dérives constatées dans son utilisation. a) Éviter des références abusives aux risques de pression ou de concertation - L'article 144, 1° prévoit notamment que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée si elle constitue l'unique moyen « d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices » ; cette formulation vient souvent, sans autres précisions, à l'appui de rejets de demandes de mise en liberté (cf. supra, chapitre VI de la première partie). Il convient qu'à l'avenir ces risques de pression ou de concertation soient explicités afin d'éviter les motivations stéréotypées. Cette nécessité impliquerait un examen au fond de la demande de remise en liberté présentée ; elle conduirait à prendre en compte l'évolution d'une situation depuis l'examen d'une précédente requête et elle faciliterait l'exercice des droits de la défense. L'accent serait mis sur l'obligation de motivation de la décision impliquant une privation de liberté. b) Reconnaître un droit à la déclaration d'innocence - L'article 144, 2° du code de procédure pénale autorise le placement en détention provisoire afin de maintenir la personne à la disposition de la justice. Or, il a été très souvent considéré, presque sous forme de « litanie » dans l'affaire d'Outreau, que « compte tenu du regard porté sur les faits » par les intéressés, c'est-à-dire en clair compte tenu de leur refus de reconnaître des faits qu'ils n'avaient pas commis, ils ne présentaient pas une garantie suffisante de maintien à la disposition de la justice. Les membres de la commission d'enquête ont été particulièrement choqués de constater que les déclarations d'innocence des personnes en cause aient pu de cette façon se retourner contre elles et justifier leur maintien en détention provisoire. Si la déclaration d'innocence n'est évidemment jamais une preuve d'innocence, elle pourrait inciter au doute et ne pas être utilisée de façon négative à l'encontre de son auteur, notamment pour rejeter une demande de mise en liberté. À cet effet, il apparaît essentiel aux membres de la commission qu'un véritable droit à la déclaration d'innocence soit désormais reconnu par la loi. À cette fin la rédaction de l'article 144, 2° du code de procédure pénale pourrait être ainsi complétée : « l'absence de garantie du maintien à la disposition de la justice ne peut toutefois être déduite du refus de reconnaître les faits. » c) Supprimer le recours à la notion d'ordre public en matière correctionnelle et l'encadrer davantage en matière criminelle - L'article 144, 3° du code de procédure pénale permettant de justifier les placements en détention provisoire en recourant à la notion d'ordre public est rédigé de façon trop imprécise et ne permet pas d'éviter les utilisations abusives. La suppression pure et simple du critère de l'ordre public est parfois demandée. Cette solution peut paraître trop radicale dans la mesure où, comme le note la Commission de suivi de la détention provisoire, ce critère peut, dans certaines circonstances, se révéler utile. Certes, le droit comparé montre que dans certains systèmes voisins du nôtre, ce critère n'existe pas. C'est le cas notamment en Italie. De même, en droit allemand, les critères légaux de placement en détention provisoire sont assez proches de ceux prévus en droit français (fuite, risque de fuite, risques de destruction de preuves ou de pressions sur les personnes, risque de réitération de l'infraction notamment dans les cas d'agressions sexuelles) mais le motif tiré du trouble à l'ordre public n'est pas expressément prévu. Toutefois, le code de procédure pénale allemand dispose que la détention provisoire peut également être ordonnée, en dehors des cas précités prévus par la loi, pour un certain nombre d'infractions particulièrement graves. Si l'on s'en tient au texte (la jurisprudence en fait une lecture différente), la gravité des faits justifierait, en elle-même, un placement en détention provisoire, sans qu'il soit besoin de relever l'existence de l'un des motifs visés plus haut. Ce qui, en réalité, constitue un renvoi implicite à cette notion de trouble à l'ordre public qui est expressément prévue en droit français373. Les auditions auxquelles a procédé la commission d'enquête ont mis en évidence des réticences réelles à la suppression pure et simple du critère de l'ordre public, qui dans certaines hypothèses paraît le seul support possible d'une détention provisoire par ailleurs difficilement contournable. L'exemple d'un crime commis dans un lieu public a été notamment cité par Mme Françoise Barbier-Chassaing, Vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil374 : un homme tue sa femme en plein restaurant et il s'agit d'un crime passionnel. Il n'existe, dans une telle hypothèse aucun risque de dissimulation de preuves, pressions ou concertation, le meurtrier n'a pas cherché à échapper à la justice et il n'y a pas non plus risque de réitération. Pourtant il paraît impossible de ne pas arrêter et placer sur le champ en détention provisoire le meurtrier. Or, aucun critère autre que celui du trouble à l'ordre public ne le permettrait. Dès lors, est-il possible de limiter ou d'encadrer davantage le recours au critère du trouble à l'ordre public ? S'il semble difficile de faire disparaître complètement cette notion, il est apparu à la commission qu'elle pouvait être supprimée en matière correctionnelle. En cela, la commission rejoint la démarche du ministre de la justice. M. Pascal Clément qui, à la fin de son audition par la commission d'enquête, a déclaré : « Pour conclure sur la question de la détention provisoire, je voudrais ajouter que je suis décidé à envisager la suppression du critère du trouble à l'ordre public en matière correctionnelle pour ne plus le retenir qu'en matière criminelle, _..._ »375 Cette modification irait plus loin que celle qui avait été introduite par la loi du 15 juin 2000 (disposition abrogée par la loi du 9 septembre 2002) qui maintenait, en matière correctionnelle, la possibilité de justifier par l'ordre public une détention provisoire, sauf en cas de prolongation si la peine correctionnelle encourue était supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Par ailleurs, cette notion serait davantage encadrée en matière criminelle, pour les décisions initiales et pour les prolongations de détention provisoire. Une telle modification irait également plus loin que celle introduite en la matière par la loi précitée du 15 juin 2000 (règle également abrogée par la loi du 9 septembre 2002) qui réservait la possibilité de justifier par l'ordre public la décision initiale comme la prolongation d'une détention provisoire en matière criminelle. Pour la commission, le recours à la notion d'ordre public en matière criminelle devrait à l'avenir être motivé de façon très précise et justifié par l'impossibilité de recourir, dans le cas examiné, à une autre solution que l'incarcération. Il faut qu'il apparaisse clairement, dans la décision de la juridiction saisie, a fortiori s'il s'agit d'une prolongation de décision de détention provisoire, qu'il y a pour telle ou telle raison un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. La notion de l'ordre public ne doit pas être une « notion fourre-tout » à laquelle le juge se réfère faute de mieux, et qu'il utilise à titre complémentaire au cas où une autre motivation invoquée ne serait peut-être pas tout à fait suffisante. En effet, bien que le ministère de la justice ne dispose pas d'éléments statistiques sur l'emploi des critères de l'article 144 du code de procédure pénale, une dizaine de parquets généraux ont été récemment interrogés sur l'utilisation du critère du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et ce sondage a montré qu'il est quasi-systématiquement combiné à d'autres critères de l'article 144. Ce fut d'ailleurs le cas dans l'affaire d'Outreau. Une telle logique ne semble pas cohérente. Soit les autres critères se suffisent à eux-mêmes et point n'est alors besoin d'invoquer l'ordre public : la rédaction de l'article 144 n'exige pas en effet de cumul des critères, il suffit qu'un seul soit rempli. Soit aucun des autres critères ne peut être invoqué en l'espèce mais il y a bien persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public : la décision de refus de mise en liberté devra alors être très précisément justifiée et donner les raisons pour lesquelles la détention provisoire est le seul moyen d'y mettre fin. À cette occasion, l'impossibilité de motiver le trouble à l'ordre public par simple référence à la médiatisation de l'affaire devrait être clairement affirmée. Les membres de la commission d'enquête (cf. supra chapitre VI, première partie) ont été surpris du nombre de décisions où, pour justifier la prolongation de leur détention provisoire, la médiatisation de l'affaire d'Outreau s'est retournée contre les personnes en cause, alors qu'elles n'étaient évidemment pas responsables de cette publicité dont elles se seraient volontiers passées. Une telle confusion entre ordre public et médiatisation, sans autre explication du trouble à l'ordre public redouté, est à éviter. Une nouvelle rédaction de l'article 144, 3° intégrant ces différents objectifs de limitation du recours à la notion d'ordre public en matière de détention provisoire, pourrait être la suivante : « 3°: De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. En matière criminelle, la décision de placement ou de maintien en détention provisoire doit indiquer précisément les motifs qui, en l'espèce, rendent impossible le recours à un contrôle judiciaire ou à une autre mesure alternative. Le trouble à l'ordre public ne peut être fondé sur la seule médiatisation de l'affaire. » Si la commission s'est ralliée à cette proposition, qui supprime le critère de l'ordre public en matière correctionnelle et l'encadre davantage en matière criminelle, le Président André Vallini s'est déclaré favorable à une suppression totale du critère de l'ordre public. IV. LIMITER L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES ISOLÉES Les auditions de la commission ont clairement démontré que, au titre des dysfonctionnements observés dans l'affaire d'Outreau, la solitude du juge avait compté pour une part substantielle, ce constat s'adressant tout autant au juge d'instruction qu'au juge des libertés et de la détention (JLD). Prenant appui sur cette constatation, nombre d'intervenants ont plaidé en faveur de la suppression de ces fonctions judiciaires solitaires, sans pour autant être unanimes sur les dispositifs devant s'y substituer. Faut-il introduire la collégialité de l'instruction ou, à l'inverse, changer la nature de notre système judiciaire en introduisant une procédure de nature accusatoire ? Faut-il conserver le JLD, le rendre collégial ou bien attribuer ses compétences à une collégialité chargée de l'instruction et du placement en détention ? Telles sont les interrogations auxquelles votre rapporteur aimerait apporter des éléments de réponse. A. FAUT-IL SUPPRIMER LE JUGE D'INSTRUCTION ? « Les Français ont le génie de se disputer pour des mots, sans, pour autant, que l'on soit bien certain qu'ils en comprennent le sens. Parmi ces querelles linguistiques, celle qui oppose les tenants de la " procédure accusatoire " et les partisans de la " procédure inquisitoire " est bien caractéristique de cette faiblesse de notre tempérament national » écrivait M. Jean-François Burgelin, alors procureur général près la Cour de cassation376. La commission n'a pas échappé à ce travers. En effet, la question du maintien du juge d'instruction ou de sa suppression au profit de la mise en place d'un système « accusatoire » a traversé nombre de ses débats et partagé ses membres au-delà des clivages partisans. Quels sont donc les arguments en présence ? 1. Faut-il introduire la procédure accusatoire ? Les tenants de la procédure accusatoire font valoir les arguments suivants : - les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau ne seraient pas un épisode malheureux d'un système globalement performant mais le produit logique des défauts structurels l'affectant. Le juge d'instruction, censé instruire « à charge et à décharge » se trouverait dans une position intenable, car il serait humainement et juridiquement impossible d'être simultanément enquêteur et juge impartial, sauf à faire preuve de « schizophrénie ». De nombreux travaux sont venus à l'appui de cette thèse, dont le plus célèbre est le rapport déposé en 1990 par la commission « Justice pénale et Droits de l'homme » présidée par le professeur Mme Mireille Delmas-Marty. Cette incompatibilité entre l'exercice de fonctions juridictionnelles et de fonctions d'investigations serait à l'origine de la pratique judiciaire actuelle qui ferait que les informations judiciaires seraient quasi exclusivement menées « à charge » ; - la dissociation des fonctions d'enquête et de jugement serait donc nécessaire et représenterait une amélioration des droits de la défense puisque celle-ci pourrait, d'une part, produire ses propres preuves devant le juge et, d'autre part, requérir de la police la réalisation d'actes ou d'investigations à décharge. Chaque partie présenterait ainsi devant un juge du siège indépendant, le juge de l'instruction, ses éléments de preuve et il appartiendrait à ce magistrat, totalement étranger à l'enquête et à la production de ces preuves d'en évaluer la force. Ainsi que la commission l'a constaté lors de l'audition de Mme Mireille Delmas-Marty, cette thèse semble toujours aussi séduisante et cohérente : « Au ministère public, les fonctions d'investigations, élargies par rapport à celles dont il dispose déjà. Au juge, les pouvoirs juridictionnels renforcés en matière de garantie des libertés, et le contrôle des investigations, celui-ci pouvant aller jusqu'au dessaisissement du ministère public par la chambre d'accusation. Enfin, aux parties privées, défense et partie civile, de nouvelles prérogatives. »377 Comme l'observe M. Jean-François Burgelin dans l'article précité, « cette procédure est dite accusatoire parce qu'elle est fondée sur un concept quasiment sportif : chaque partie "accuse" l'autre d'avoir commis une faute ou de s'être trompée. Le jury et le juge restent très neutres jusqu'à la décision finale que le juge assortit souvent de considérations d'ordre moral ou social »378 Puisque, dans le système accusatoire, la justice relève peu de l'État mais davantage des parties, qui orientent pour une large part l'enquête, il est logique que celle-ci puisse faire l'objet de transactions entre elles, d'où l'usage très répandu du « plea-bargaining », forme de marchandage proposé par l'accusation à la défense pour aboutir à un gentlemen agreement, économe du temps judiciaire ; - la plupart des pays européens ont adopté le modèle accusatoire et la France ne saurait demeurer éternellement, et contre tous, attachée à son modèle du juge d'instruction. Comme l'a indiqué à la commission le professeur Geneviève Giudicelli-Delage, deux explications peuvent être données à la suppression du juge d'instruction dans certains systèmes379 : « Le juge d'instruction apparaît comme le symbole du modèle inquisitoire. Or, le modèle inquisitoire passe pour être autoritaire, peu soucieux des libertés individuelles, à la différence du modèle accusatoire que la lutte, entre autres, du jury anglais contre l'arbitraire royal, a imposé comme le symbole de la garantie des libertés individuelles. Cette vision explique notamment l'attrait des procédures accusatoires dans les pays qui se libèrent d'un pouvoir arbitraire. La deuxième explication joue certainement un rôle plus important dans les démocraties européennes. Elle tient à la recomposition des fonctions des acteurs de la procédure et à l'influence de nouveaux standards qui ont conduit à rendre plus complexes, voire plus illisibles, les procédures. Dans le système français du code d'instruction criminelle, qui a servi de modèle aux procédures continentales européennes, depuis le début du XIXe siècle, le personnage clé de la phase préparatoire était le juge d'instruction, alors que le procureur était cantonné dans le seul rôle de poursuivant et d'accusateur. Or, la nécessité d'une simplification et d'une accélération des procédures a conduit partout à une montée en puissance du procureur de la République, qui s'appuyant sur la police, se chargeait de plus en plus des enquêtes dans les affaires à l'origine simples. Cette évolution a eu des conséquences considérables, et tout d'abord pratiques. La part des affaires confiées au juge d'instruction n'a cessé de décroître, faisant du ministère public le principal maître d'œuvre de la phase avant jugement, et faisant dès lors naître l'idée que l'éclatement des procédures préparatoires n'était plus justifié et qu'il convenait de revenir à une unité en confiant toutes les fonctions d'investigation au ministère public. Conséquences théoriques ensuite : le principe fondamental qui gouvernait la phase préparatoire du procès dans le code d'instruction criminelle était la stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, interdisant au procureur de faire quelque acte d'investigation, si léger fût-il. "Si celui qui a poursuivi pouvait instruire", disait Cambacérès, "ce serait un petit tyran". L'évolution, tout au contraire, a fait basculer les actes d'investigation toujours plus en amont de la procédure, avant le déclenchement de l'action publique, et a conduit à en confier la direction ou le contrôle au ministère public, modifiant la finalité de ces actes, et relativisant, par là même, l'importance du principe de la séparation des fonctions d'instruction et de poursuite. » 2. Ni accusatoire ni inquisitoire, instituer une procédure contradictoire Aux promoteurs du système accusatoire, votre rapporteur tient à apporter les éléments de réponse suivants : - au fil des réformes de la procédure pénale, le juge d'instruction est devenu de plus en plus un enquêteur et de moins en moins un juge puisqu'il a été dépossédé d'importantes prérogatives, à l'instar de celle d'ordonner le placement en détention provisoire des personnes mises en examen. Par ailleurs, sur les 34 839 affaires terminées en 2003 par les juges d'instruction380, 8 294 l'ont été par une décision de non-lieu, soit 20 % du total. Dès lors, il est inexact d'affirmer que les instructions seraient exclusivement menées à charge ; - si le juge d'instruction cessait d'être un enquêteur, il faudrait confier cette mission au ministère public et aux officiers de police judiciaire. Or, en quoi ce transfert de compétence prémunirait-il les justiciables des errements qui ont pu être observés dans l'affaire d'Outreau ? En effet, rien ne permet de postuler que les critiques adressées au juge d'instruction quant à la partialité de ses investigations ne soient pas applicables aux enquêtes dirigées par le parquet et les services de police. Qu'ils aient choisi la procédure accusatoire (pays anglo-saxons, Italie) ou adopté un système mixte (Allemagne), les systèmes judiciaires étrangers ne sont pas à l'abri d'erreurs judiciaires de grande ampleur. On songe ici à la relaxe en 1997 en Allemagne de 25 prévenus - restés pour certains d'entre eux près de deux ans en détention provisoire - accusés de viols sur 16 mineurs. Faut-il faire état également des cas qui défrayèrent la chronique judiciaire canadienne des dix dernières années ? Celui de Guy Paul Morin, condamné pour meurtre à la prison à vie en 1992 et innocenté en 1996 grâce aux tests ADN ; celui de David Milgaard, condamné à la prison à vie pour meurtre et l'agression d'une aide-soignante, libéré après vingt ans de prison et disculpé grâce à des tests ADN en 1997 ; celui de Thomas Sophonow condamné à la prison à vie pour meurtre en 1983 et acquitté en 2001381 . Dans un livre nuancé sur la procédure inquisitoire et la procédure accusatoire, Me Dominique Inchauspé ne dissimule pas non plus « la série noire d'erreurs judiciaires ("miscarriages of justice") qui déshonore la justice anglaise depuis plusieurs décennies »382. Pour s'en tenir aux seuls condamnés à tort en liaison avec le terrorisme irlandais, des innocents ont été emprisonnés pour des meurtres multiples dont ils n'étaient pas les auteurs, certains venant même à décéder en détention ; - notre système judiciaire comprend d'ores et déjà des éléments relevant du système accusatoire en la personne du juge des libertés et de la détention. En effet, ce juge du siège, qui ne dirige pas les enquêtes, est saisi par le juge enquêteur qu'est le juge d'instruction aux fins du placement en détention provisoire du prévenu. En outre, le JLD est compétent pour autoriser, dans le cadre des enquêtes préliminaires menées par le parquet sur des faits relevant de la criminalité organisée des perquisitions, des visites domiciliaires de nuit lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, ou encore des écoutes téléphoniques pour une durée maximale d'un mois. Or, s'il est une fonction qui a fait l'objet de critiques quasi-unanimes devant la commission, c'est bien celle du JLD auquel on a pu reprocher sa méconnaissance du dossier et son acceptation quasi-intégrale des demandes qui lui étaient soumises ; - la possibilité pour la défense de mener une « contre-enquête » dans le cadre du système accusatoire peut être particulièrement sélective socialement, puisque les personnes les plus démunies auront le plus grand mal à financer ces coûteuses investigations. Comme l'a rappelé le juge d'instruction Gilbert Thiel lors de son audition devant la commission, l'affaire du bagagiste de Roissy, accusé à tort par certains membres de sa famille d'être un terroriste, n'aurait peut-être pas connu la même issue dans un système accusatoire où il aurait appartenu à la défense de produire les preuves de l'innocence de son client383. À cet égard, personne n'a pu apporter la preuve que le système accusatoire était, par nature, moins faillible et générateur d'erreurs judiciaires que notre propre système, qui est un subtil mélange d'inquisitoire et d'accusatoire ; - le passage à un système accusatoire exige de transformer le statut des magistrats du parquet afin de les rendre totalement indépendants du pouvoir exécutif. En effet, il n'est pas envisageable que le magistrat conduisant l'enquête soit soumis au pouvoir exécutif. Or, ce choix, étranger à notre tradition juridique et politique, conduirait à restreindre, voire à supprimer dans les faits, la capacité du garde des Sceaux, pourtant membre d'un Gouvernement responsable devant les élus représentants du peuple français, à mener une politique pénale homogène sur l'ensemble du territoire national. Comme l'a expliqué devant la commission M. Claude Choquet, président de l'association française des magistrats instructeurs, « Qui ne perçoit pas le risque de voir se constituer des féodalités locales définissant leurs propres priorités, induisant une incohérence de l'action publique source d'inégalité de traitement des citoyens devant la loi ? »384 ; - le passage brutal d'un système judiciaire à l'autre semble particulièrement hasardeux, voire périlleux et l'exemple de l'Italie devrait inciter les uns et les autres à la prudence. En effet, ce pays a, en 1989, décidé d'abandonner le système inquisitoire au profit de l'accusatoire mais, comme le font observer les magistrats de liaison français en Italie et italien en France interrogés par votre rapporteur : « On peut certainement constater, après quinze années d'expérience, qu'adopter en l'adaptant un système provenant d'une autre culture juridique n'est pas chose aisée. Tout d'abord, la transposition en droit écrit de principes inventés par des pays de Common Law a souvent constitué une difficulté. [...] Ensuite les procédures alternatives n'assurent pas suffisamment l'effet déflationniste des audiences qui devrait être le leur, ce qui est sans doute le signe d'une impossibilité objective de transposer complètement ce système de la Common Law, sans doute pour des raisons de tradition juridique. [...] Par ailleurs, il existe de nombreuses voix en Italie pour dire que les modifications trop fréquentes, presque permanentes, apportées au procès pénal depuis 1989 pour tenter de corriger tel ou tel de ses aspects lui ont fait perdre de sa cohérence initiale et qu'il conviendrait de remettre à plat l'ensemble. Voilà qui pourrait constituer un signe supplémentaire de la difficulté d'inventer un nouveau système, même lorsque son processus d'élaboration a été long et minutieux. »385 Par pragmatisme, votre rapporteur, conscient de l'importance des traditions juridiques, ne croit pas à l'efficacité, et donc à l'opportunité, d'un « grand soir » procédural. En effet, il ressort de l'analyse du dossier d'Outreau que nombre des dysfonctionnements relevés tiennent à la solitude du juge, qu'il s'agisse du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à cet isolement qui mène à la défaillance de la prise en considération de la contradiction dans le processus d'élaboration de la décision juridictionnelle. C'est la raison pour laquelle, votre rapporteur est favorable, plus qu'à la suppression du juge d'instruction au nom d'une doctrine juridique, certes cohérente mais inapplicable dans notre pays, aux vertus de la collégialité et du contradictoire. Par voie de conséquence, si votre rapporteur souscrit à la suppression du juge unique qu'est le juge d'instruction, il n'est pas pour autant favorable à la suppression du principe de l'instruction, dès lors que cette dernière serait exercée collégialement. B. FAUT-IL SUPPRIMER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ? La logique ayant présidé à la création du JLD se fondait sur les mérites supposés du « double regard », celui du juge d'instruction d'abord, conduisant l'enquête et donc à même d'apprécier la nécessité de demander le placement en détention provisoire du prévenu, celui du JLD ensuite, juge du siège indépendant, décidant ou non d'ordonner le placement au vu des éléments du dossier. Or, il apparaît que le JLD est un juge isolé qui n'est pas en mesure d'assumer son rôle dans des conditions satisfaisantes. Sa création n'a d'ailleurs pas contribué à la limitation du recours à la détention provisoire, alors même que c'était l'un des objectifs ayant présidé à son introduction dans notre système judiciaire par la loi du 15 juin 2000. Dès lors, il pourrait être tentant de considérer que si cette expérience semble avoir échoué, c'est peut-être parce que le JLD ne dispose pas des moyens suffisants, tant procéduraux que matériels, et qu'il suffirait de les renforcer pour parvenir à un résultat satisfaisant. Ce faisant, on peut se tourner vers le droit allemand qui connaît un « juge des enquêtes » susceptible d'être comparé à ce que pourrait être un « JLD renforcé ». 1. Le juge des enquêtes allemand est-il un JLD renforcé ? Le droit allemand ne connaît pas d'institution comparable au juge d'instruction français, mais l'équivalent d'un juge des libertés et de la détention français, avec des compétences en réalité plus larges : le juge des enquêtes (« Ermittlungsrichter »)386. Quelle que soit la gravité des infractions poursuivies, la seule autorité judiciaire compétente pour la conduite des enquêtes est le parquet, local ou fédéral selon les cas. Si l'exécution des mesures d'investigation est le plus souvent confiée aux services de police, il arrive que les parquetiers effectuent eux-mêmes certains actes dans les dossiers les plus importants. Maître de l'action publique, le procureur est donc la seule autorité (avec la police) qui soit investie d'un pouvoir d'initiative au cours de l'enquête, et c'est lui qui décidera in fine de renvoyer ou non l'affaire devant le tribunal. En contrepartie de ces prérogatives, toutes les mesures portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne, au premier rang desquels bien entendu la détention provisoire et le contrôle judiciaire, relèvent de la compétence du juge des enquêtes. Ce magistrat du siège agit, sauf exception, uniquement sur saisine du parquet, chaque fois que ce dernier envisage une telle mesure. Il est compétent également en matière de perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques, expertises. En sa qualité d'organe de contrôle de la légalité des mesures d'investigation les plus graves, il n'est donc pas un juge de l'instruction chargé d'arbitrer le contentieux entre l'accusation et la défense. L'intensité du contrôle exercé par ce juge des enquêtes varie néanmoins en pratique, selon qu'il est saisi d'une demande de placement en détention provisoire ou d'une simple demande d'acte. Car s'il est juge de la légalité en toute hypothèse, il est investi de pouvoirs élargis dans le domaine de la détention provisoire où il statue aussi en opportunité. Comme un JLD en France, il pourra ordonner un contrôle judiciaire à la place de l'incarcération, s'il estime la mesure suffisante pour prévenir les risques invoqués par le parquet. Indépendant par nature et garant de la liberté individuelle, le juge de enquêtes a juridiquement les moyens de faire contrepoids au parquet. Une détention provisoire ou une perquisition par exemple, pourront être refusées par lui si elles sont insuffisamment motivées et ce refus sera d'autant plus simple à opposer que ce juge n'est pas directement impliqué dans la conduite de l'enquête. Par ailleurs, le juge des enquêtes peut décider d'organiser un interrogatoire du mis en cause. La présence de l'avocat du mis en cause et du parquet au cours de l'interrogatoire est expressément autorisée par la loi. En outre, le mis en cause, son avocat et le parquet peuvent assister à l'audition d'un témoin ou d'un expert, sauf « s'il est à craindre que le témoin ne dise pas la vérité en leur présence » (article 168 du code de procédure pénale allemand). Ces dispositions confèrent apparemment au juge des enquêtes allemand un rôle très supérieur à celui de son « homologue » le JLD français, lequel ne peut se substituer à son collègue le juge d'instruction, chargé de diriger les interrogatoires et auditions, auxquels il n'est pas appelé à assister. Le juge des enquêtes allemand doit également procéder d'office tous les trois mois à un réexamen de la situation de la personne placée en détention provisoire, sauf dans le cas où le détenu est assisté d'un avocat. Ce contrôle d'office s'ajoute au contrôle exercé à la demande du détenu (règles posées par l'article 117 du code de procédure pénale allemand) : a) Le contrôle exercé à la demande de la personne détenue Toute personne en détention provisoire a le droit de demander au juge, à tout moment, de contrôler le bien-fondé de son maintien en détention (« Haftprüfung ») (article 117 du code de procédure pénale). Le juge peut alors ordonner toute mesure d'investigation utile pour évaluer la situation du détenu avant de rendre sa décision. L'assistance d'un avocat est également prévue par la loi qui dispose que « dans le cas où le mis en cause n'a pas encore d'avocat, le juge en fait désigner un d'office, lorsque la détention dure déjà depuis plus de trois mois et que le parquet, le mis en cause lui-même ou son représentant légal en a fait la demande. La personne détenue doit être informée de ses droits. » Notons, à cet égard, que l'article 145 du code de procédure pénale allemand contient des dispositions très précises sur les carences éventuelles du conseil à l'audience. Cet article est libellé de la manière suivante : (1) Lorsque l'avocat ne se présente pas à l'audience ou qu'il la quitte prématurément, ou qu'il refuse d'assurer la défense de son client dans une affaire où l'assistance d'un avocat est nécessaire, le juge doit en faire désigner un autre sur-le-champ, à moins qu'il ne décide de renvoyer l'audience à une date ultérieure. (2) [...] (3) Le juge ordonne une suspension de l'audience ou le renvoi de l'affaire, lorsque le nouvel avocat désigné d'office fait valoir qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour préparer la défense de son client. (4) Lorsque le renvoi a dû être ordonné par la faute de l'avocat, les frais de procédure occasionnés par la décision restent à sa charge. Le juge rend sa décision après avoir entendu les observations orales du détenu et, le cas échéant, de son avocat (article 118 du code de procédure pénale). b) Le contrôle exercé d'office Le juge des enquêtes est tenu d'exercer un contrôle d'office sur les détentions provisoires tous les trois mois, sauf dans le cas où le détenu est assisté d'un avocat (article 117 du code de procédure pénale allemand). 2. Quelles sont les limites au rôle du juge des enquêtes en Allemagne ? En pratique, le rôle du juge des enquêtes allemand rencontre certaines limites qui ne sont pas sans rappeler celles du JLD français, alors même qu'il bénéficie d'une indépendance plus réelle, un dossier ne lui arrivant jamais « ficelé » dans les mains, comme c'est le cas lorsqu'en France le juge d'instruction demande un placement en détention provisoire. En n'intervenant que ponctuellement dans un dossier, qui par définition n'est pas le sien et qu'il devra chaque fois se réapproprier si tant est qu'il l'ait suivi depuis le début, le juge des enquêtes n'aura souvent qu'une vision incomplète et superficielle de l'affaire. Toute la difficulté de la mission réside là, dans le fait que, bien qu'il soit investi d'un pouvoir de contrôle particulièrement large, le juge des enquêtes allemand n'en reste pas moins confiné à un rôle accessoire par rapport au parquet. Dans la pratique, il limitera donc souvent son examen à un contrôle de légalité purement formel, avec le risque que, par esprit de routine, il en vienne parfois à rendre des décisions qui seront, soit préjudiciables aux intérêts de la défense, soit à contre-courant de la progression de l'enquête. Le risque est d'autant plus grand qu'il n'a pas toujours le temps de procéder à un examen attentif de chaque demande, car il doit souvent statuer dans l'urgence. Un juge des enquêtes est de permanence toute l'année. C'est un juge qui travaille au rythme du parquet et des affaires pénales, ce qui lui laisse peu de temps pour assurer pleinement son rôle de contrepouvoir. Le véritable contrôle sera exercé, en amont, par le procureur qui lui connaît le dossier. Car, même si le risque d'une censure par le juge est très hypothétique, il n'en produit pas moins un effet certain sur l'autorité de poursuite qui se disciplinera elle-même pour éviter tout contretemps fâcheux dans le déroulement de l'enquête. S'agissant du contrôle de la détention, s'il est incontestable que le rôle du juge des enquêtes allemand est très supérieur à celui du JLD français, en particulier grâce au contrôle d'office, il faut souligner, qu'en cette matière, c'est surtout la cour d'appel qui joue un rôle primordial. En effet, le contrôle exercé par la cour d'appel donne lieu à un examen particulièrement méticuleux du dossier. Les critères retenus en la matière sont extrêmement stricts, et la détention ne sera prolongée que si elle paraît justifiée au fond, au regard des éléments versés au dossier. Non seulement les motifs de la détention provisoire seront examinés, mais également les diligences accomplies par le parquet durant les six premiers mois de l'enquête. Tout retard dans la conduite des investigations devra donc être justifié devant la cour d'appel. À défaut, la personne détenue sera remise en liberté. Bien évidemment, il est impossible de ne pas faire le rapprochement avec ce que pourrait devenir le rôle de la chambre de l'instruction française, si ce rôle était exercé par des magistrats dédiés et qu'une « clause de rendez-vous » systématique pour un réel réexamen au fond de la situation de la personne détenue était introduite dans notre législation comme l'a recommandé le rapport rédigé par M. Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon. La rigueur de ce contrôle de la détention provisoire exercé en Allemagne ressort d'ailleurs clairement des statistiques sur la durée moyenne des détentions provisoires dans ce pays, très inférieure à la moyenne française. Les statistiques disponibles pour l'année 2003 font apparaître les chiffres suivants :
Ces données statistiques prouvent que le nombre des détentions provisoires en Allemagne diminue très nettement passé le délai de six mois à partir duquel sera effectué le contrôle d'office de la cour d'appel. L'efficacité de ce contrôle d'office est d'autant plus manifeste qu'aucune limite à la durée de la détention provisoire n'est fixée par le code de procédure pénale allemand. La durée moyenne de la détention provisoire en France était, pour la même année 2003, de 24 mois en matière criminelle et de 4 mois en matière délictuelle. Néanmoins, même s'il s'agit d'une évidence, rappelons que la durée des détentions provisoires dépend aussi de la durée des procédures. Or, celles-ci sont relativement courtes en Allemagne pour deux raisons : - la première, c'est que l'enquête n'est pas le temps de la contradiction. Le code de procédure pénale français ouvre la possibilité d'un débat contradictoire entre les parties et le juge d'instruction ; ce débat peut être porté ensuite en appel, ce qui n'est pas sans conséquence sur la durée des informations judiciaires. Le droit allemand, en revanche, ne lui donne toute sa place qu'au moment du procès, qui est certes plus long qu'en France, mais qui n'en reste pas moins cantonné dans des limites raisonnables, le tribunal pouvant y mettre un terme, lorsqu'il s'estime suffisamment informé ; - la seconde raison tient au fait que les parquets et les services enquêteurs disposent d'effectifs et de moyens matériels leur permettant de progresser rapidement dans leurs investigations. En 2003, la durée moyenne des enquêtes, entre la date d'enregistrement au parquet et la clôture (renvoi ou classement sans suite) était ainsi de 1,9 mois pour un total de 4 766 070 procédures traitées. Quant à la durée moyenne des procédures devant les tribunaux répressifs, les statistiques établies par le ministère fédéral de la justice font apparaître une moyenne de 3,9 mois devant les tribunaux d'instance (« Amtsgericht ») et une moyenne de 6,1 mois devant les tribunaux de grande instance (« Landsgericht »). La durée moyenne de la procédure en cas d'appel est de 4 mois, de 1,2 mois en cassation. En France, le délai moyen entre l'infraction et le jugement par le tribunal correctionnel était de 10 mois en 2004 auxquels s'ajoutent 14 mois si le condamné interjette appel. S'agissant du jugement des crimes devant la cour d'assises, le délai entre la commission de l'infraction et le jugement en premier ressort était, pour la même année, de 34 mois auxquels il convient, là aussi, d'ajouter 16 mois pour l'examen devant la cour d'assises d'appel. Dans l'affaire d'Outreau, le parquet a été saisi le 5 décembre 2000, le premier avis de fin d'information est daté du 7 août 2002 et l'ordonnance de mise en accusation est datée du 13 mars 2003. Enfin, le système allemand malgré sa supériorité sur le système français en matière de contrôle des détentions provisoires et en dépit des compétences élargies de cet « équivalent JLD », n'a pu empêcher - faut-il le rappeler - une affaire semblable à celle d'Outreau, en 1997 à Worms. En l'espèce, trois procès retentissants s'étaient soldés par la relaxe de vingt-cinq prévenus soupçonnés d'avoir violé seize mineurs, certains d'entre eux étant demeurés près de deux ans en détention provisoire. C. FAUT-IL MAINTENIR LE JLD EN CAS DE CRÉATION DE COLLÈGES D'INSTRUCTION ? L'affaire d'Outreau en particulier et la pratique judiciaire en général ont fait litière des vertus supposées du « double regard » introduit par la loi du 15 juin 2000. S'il n'est qu'une donnée en attestant, ce serait le taux de confirmation par le JLD des demandes présentées par le juge d'instruction qui atteignait 92 % en 2001, 91,1 % en 2002, 89,9 % en 2003 et 89,7 % en 2004. Ce constat a conduit un certain nombre de personnes auditionnées, à l'instar de M. Yves Bot, procureur général près la cour d'appel de Paris, à prôner la suppression du JLD, tout en estimant que l'examen de la détention devrait donner lieu à une séance publique collégiale avec un débat portant sur les charges, la détention et la nécessité de la détention par rapport aux charges. « Il n'y a pas d'autre solution que de réécrire un certain nombre de choses et de repenser le système de la procédure pénale française. Vous pourriez envisager déjà de supprimer le JLD. C'était une idée qui paraissait bonne mais, aujourd'hui, on peut dire que c'est une fausse bonne idée, ne serait-ce que parce qu'elle a abouti à une dilution des responsabilités. _..._ Je pense effectivement que l'examen de la détention doit donner lieu à une séance publique. Cette séance publique devrait être collégiale. Où ? Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel ou devant une chambre du tribunal correctionnel - composée des vice-présidents en cas de suppression du JLD - qui examinerait les charges en même temps qu'elle statuerait sur la liberté. Le débat porterait sur les charges, la détention, la nécessité de la détention par rapport aux charges. Mais il ne faudrait pas venir nous dire après qu'en organisant les débats, on a bousculé la présomption d'innocence. »387 M. André Ride, Président de la Conférence nationale des procureurs généraux a souligné, pour sa part, l'opportunité que pourrait présenter la création de pôles pour mettre fin à l'institution du JLD isolé : « Le juge des libertés et de la détention ne doit plus être non plus une personne seule. La collégialité doit être instaurée au moins pour les compétences qu'il a dans le cadre de l'information judiciaire. Cela ne serait pas si compliqué, dès lors que nous serions dans le cadre de pôles, c'est-à-dire de grandes juridictions, au sein desquelles la totalité de ce contentieux, y compris la question de la mise en détention, serait confiée à une chambre spécialisée. »388 Au cours de son audition, M. Pascal Clément, ministre de la justice, garde des Sceaux389, a envisagé l'idée d'une collégialité de JLD, pour les prolongations de détentions provisoires et demandes de mise en liberté : « Je demeure pourtant convaincu de la nécessité d'un regard collégial sur la détention provisoire. J'envisage donc de présenter à la représentation nationale une réforme qui ne me semble pas obérer le fonctionnement des juridictions tout en augmentant considérablement les garanties apportées aux justiciables. Tout en continuant à soumettre, par souci de réalisme, le placement initial en détention provisoire à la décision d'un juge unique, il m'apparaît envisageable qu'une partie au moins du contentieux de la détention provisoire - demandes de mise en liberté, et en tout cas la première d'entre elles, décisions de prolongation - puisse être traitée par une formation présidée par le JLD. Cette formation pourrait être composée de citoyens-jurés, sélectionnés sur le modèle des jurés de cour d'assises, et siégeant au cours d'audiences périodiques suivant les règles de procédure auxquelles nous travaillons actuellement. Cette réforme présenterait deux intérêts principaux. Les questions de détention provisoire sont des questions de bon sens que les citoyens de bonne volonté, aidés par un magistrat en mesure de leur apporter les éléments techniques nécessaires, peuvent traiter avec le regard extérieur dont l'affaire d'Outreau a bien montré qu'il était nécessaire. Je vous ai dit, en introduction, que nous avions, tous ensemble, l'obligation de ne pas décevoir l'immense intérêt pour la Justice qui s'est révélé chez nos concitoyens. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de nous acquitter de cette obligation que de les associer de façon plus étroite à l'œuvre de justice. Mes services sont en train de s'assurer de la faisabilité tant juridique que technique de ce projet. »390 L'idée de pallier les carences du JLD actuel, non en le supprimant, mais en créant une collégialité de JLD à temps plein, pourrait sembler séduisante et a, effectivement, retenu un temps l'attention de la commission d'enquête. Elle semble complexe à mettre en œuvre. En raison de son coût d'abord, puisque cette collégialité viendrait se superposer à la collégialité des pôles d'instruction, que l'on évoquera plus loin. En raison du risque de dilution des responsabilités découlant de la multiplication des structures ensuite. En effet, il n'est pas certain que le tandem pôle d'instruction/pôle de JLD ne serait pas exposé aux mêmes inconvénients que ceux auxquels est confronté aujourd'hui le binôme du magistrat instructeur et du JLD, avec un pôle d'instruction maîtrisant bien davantage le dossier de la procédure que le pôle des JLD. Par ailleurs, faut-il se ranger à l'idée, envisagée par le ministre lors de son audition, de l'échevinage de la fonction de JLD par l'adjonction de citoyens-jurés ? Si un argument financier plaide en sa faveur, cette option n'est pas pour autant juridiquement irréprochable. Il semble, en effet, constitutionnellement incertain de trop étendre à des non professionnels l'exercice d'attributions normalement dévolues aux seules autorités judiciaires. Dans sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en consacrant l'existence d'une « autorité judiciaire » composée de magistrats professionnels sous statut, le constituant avait entendu réserver à ces magistrats des compétences propres au titre desquelles figurait notamment, en application de l'article 66 de la Constitution, le jugement des infractions punies par des peines privatives de liberté. Certes, la haute instance a souligné à plusieurs reprises que le constituant n'avait pas interdit à des juges non professionnels d'exercer des fonctions juridictionnelles, dès lors que ces dernières ne constituaient qu'une part limitée de celles normalement dévolues aux magistrats de carrière. Toutefois, la « part limitée » serait ici vraisemblablement trop importante, puisque, d'une part, il ne s'agirait plus d'insérer un effectif réduit de juges non professionnels dans une juridiction ordinaire et que, d'autre part, ceux-ci seraient amenés par définition à se prononcer sur la liberté individuelle. Enfin, aux risques précités s'ajoute l'argument selon lequel le traitement du contentieux de la détention suppose une stabilité et une disponibilité qu'il serait illusoire d'exiger de la part de juges non professionnels. Par conséquent, à l'instar de ses conclusions relatives au juge d'instruction, la commission est favorable à la suppression du JLD juge seul, exerçant occasionnellement cette fonction, appelé à se prononcer en bout de chaîne, tardivement et confirmant plus de 90 % des demandes qui lui sont adressées. À ce juge, la commission préfère un examen collégial du contentieux de la détention provisoire par un collège de l'instruction dont elle propose la création. Pour leur part, les commissaires socialistes souhaitent le maintien du JLD, estimant qu'il a constitué une grande avancée de la loi du 15 juin 2000 en permettant d'instaurer un « double regard » sur la mise en détention provisoire. Ils soulignent qu'à Paris, où la fonction de JLD est exercée par des juges dédiés, elle donne la pleine mesure de son utilité car les magistrats ont le temps et les moyens d'exercer leurs missions. V. CRÉER LA COLLÉGIALITÉ DE L'INSTRUCTION Parce que les membres de la commission d'enquête se sont rendu compte que la magistrature pêchait souvent par l'individualisme de ses membres et souffrait d'un certain repli sur elle-même, ils ont jugé souhaitable de recommander le développement de la collégialité. À travers son organisation, ses fonctions et ses modalités, la collégialité de l'instruction doit être analysée à trois niveaux. Ce nouveau fonctionnement de l'instruction ne serait pas par ailleurs sans conséquences sur le secret de l'instruction. Si la commission d'enquête s'est accordée à reconnaître la nécessité de mettre l'accent sur l'exercice collégial des fonctions de magistrat, cette structure lui est apparue particulièrement s'imposer pour les magistrats instructeurs. Deux facteurs essentiellement l'en ont convaincue : la jeunesse des magistrats à l'issue de leur scolarité et le caractère souvent très individualiste de leurs méthodes de travail, dénoncé souvent même sans complaisance par ces derniers. Pour comprendre les enjeux de ce problème, il convient de dresser un tableau du recrutement des magistrats. Le directeur de l'École nationale de la magistrature (ENM), M. Michel Dobkine, a présenté clairement aux députés lors de leur visite à Bordeaux le 27 mars la composition et l'âge des promotions des auditeurs de justice ainsi que les conditions de recrutement dans cette école : « Qui entre à l'ENM et comment y entre-t-on ? La promotion 2006 comprend 250 auditeurs de justice. Il y a 197 femmes et 53 hommes, soit 79 % de femmes et 21 % d'hommes. Deux cent vingt-quatre candidats ont réussi le premier concours, dix-neuf le second, sept le troisième. La moyenne d'âge de la promotion est de 25 ans, comme dans toutes les autres écoles françaises. L'auditrice la plus jeune a 22 ans, la plus âgée 40 ans. Soixante-six pour cent des admis ont un niveau " bac + 5 " ; 21 % sont diplômés d'un IEP. C'est donc le concours étudiant, dit « concours externe », qui assure le gros des entrées dans la magistrature. Il est ouvert aux étudiants âgés de 27 ans au plus, titulaires d'un diplôme " bac + 4 " ou délivré par un IEP. Le second concours est ouvert aux fonctionnaires âgés de 46 ans au plus et justifiant de quatre années de service public : il existe un cycle préparatoire d'une ou deux années selon que le fonctionnaire est, ou non, titulaire de diplômes juridiques. Le troisième concours, ouvert aux personnes qui justifient de huit années au total d'une ou plusieurs activités, ne permet que peu de recrutements car les épreuves, qui doivent être du même niveau que celui des deux autres concours sont difficiles. Il existe aussi des modes de recrutements directs pour les docteurs en droit, les personnes justifiant de sept années d'activité professionnelle après un diplôme de niveau " bac +4 " et âgés de 35 ans au moins et enfin un concours complémentaire ouvert aux personnes âgées de 35 ans au moins, titulaires d'un diplôme de niveau " bac +4 " et justifiant de dix années au moins d'expériences professionnelles dans les domaines juridique, administratif, économique et social. » Si le renforcement de la collégialité que la commission d'enquête appelle de ses vœux pourrait s'appliquer tout particulièrement à l'instruction, ses implications ne seraient pas minces. Cette collégialité pourrait également servir de cadre à la diffusion de bonnes pratiques. 1. Les alternatives à l'emploi des jeunes magistrats instructeurs en début de carrière Comme le reconnaît l'Association française des magistrats instructeurs dans un courrier adressé aux membres de la commission d'enquête , les traits d'individualisme sont sans doute encore plus fréquents chez les magistrats instructeurs que chez leurs autres collègues magistrats : « La force de caractère et l'autorité qui sont inhérentes à l'exercice de telles fonctions et le poids de la tradition conduisent parfois à un mode de fonctionnement individualiste, aggravé par le nombre ou la lourdeur des procédures qui laissent peu de temps pour le débat et l'échange avec les collègues. » Il est vrai que comme le soulignait avec force le Premier président Guy Canivet devant la commission d'enquête, l'organisation actuelle de la justice présente ce paradoxe « que ce sont les magistrats les plus jeunes donc les moins expérimentés qui exercent les fonctions à juge unique, donc de plus grande responsabilité »391. Afin de mieux situer les termes de ce débat, on rappellera en préambule quelques données statistiques sur les magistrats instructeurs. L'effectif à ce jour des juges d'instruction en poste est de 630 dont 587 juges d'instruction, premiers juges d'instruction, vice-présidents ou premiers vice-présidents chargés de l'instruction dans les TGI et 43 présidents de chambre de l'instruction dans les cours d'appel. En moyenne, ces 630 magistrats sont âgés de 51 ans et 5 mois et occupent leur poste actuel depuis 5 ans et 6 mois. Au grade de base, c'est-à-dire au second grade, les 330 juges d'instruction sont âgés en moyenne de 37 ans et 1 mois et occupent leur poste actuel depuis 3 ans. Au grade d'avancement, c'est-à-dire au premier grade, les 256 vice-présidents chargés de l'instruction ou premiers juges d'instruction sont âgés en moyenne de 50 ans et occupent leur poste actuel depuis 5 ans et 3 mois. Enfin en hors hiérarchie, les 43 présidents de chambre de l'instruction des cours d'appel sont âgés en moyenne de 62 ans et 8 mois et occupent leur poste actuel depuis 10 ans et 3 mois. Par ailleurs, une étude statistique sur l'ensemble des nominations en premier poste ou en mutation intervenues depuis le 1er janvier 2004 dans les fonctions de juge d'instruction du second grade montre que la moyenne d'âge sur ces bases est de 36 ans environ. Les moins de 30 ans sont 49 sur un total de 169, soit 29 % de l'effectif considéré. Si, par conséquent, les opinions généralement courantes sur l'âge des magistrats instructeurs doivent être relativisées et si l'âge ne saurait être le critère déterminant pour expliquer des méthodes et des choix professionnels, il convient néanmoins de s'interroger sur les affectations des auditeurs de justice à l'issue de leur scolarité à l'ENM qui, rappelons-le, est de 31 mois dont 14 en juridiction. Plusieurs variables peuvent être envisagées : exiger un âge minimum pour exercer les fonctions de magistrat instructeur ; imposer un stage probatoire pour tous les magistrats ; ne permettre d'exercer certaines fonctions qu'après un temps passé en juridiction ; organiser un tutorat sur les magistrats les moins expérimentés et mettre en place une collégialité. a) Exiger un âge minimum pour entrer dans la magistrature ? Faudrait-il exiger un âge minimum pour l'exercice de certaines professions et en particulier celle de juge d'instruction ? Quel serait cet âge optimal, sachant que l'un des deux juges d'instruction dans l'affaire de pédophilie d'Angers citée comme exemple pour la qualité de son instruction, avait pratiquement le même âge que le juge Fabrice Burgaud ? On peut ajouter que le jeune juge d'instruction fraîchement émoulu de sa scolarité peut arriver dans une petite juridiction où son collègue dans un autre cabinet d'instruction ne sera guère plus âgé que lui. Comme l'a relevé M. Michel Dobkine, en France « on espère que l'âge du capitaine empêchera toute défaillance ». Faisant part de son expérience en cour d'appel, il a ajouté « il y avait tous les âges... Raisonnons en termes d'organisation, de structures et non en termes de subjectivité »392. Le Premier président Guy Canivet s'est interrogé également sur la pertinence du critère de l'âge en ces termes : « À première vue, un juge ancien a plus d'expérience qu'un nouveau juge ! Mais on peut aussi être ancien et médiocre, être ancien et inexpérimenté ou inadapté aux fonctions d'instruction. En revanche, certains juges d'instruction, bien formés, parfaitement équilibrés et ayant une saine conception de la fonction, sont remarquables. »393 Dès lors modifier les règles actuelles en matière d'âge à l'entrée de l'ENM ne semble pas nécessaire. b) Envisager un stage probatoire pour tous les magistrats ? Comme l'a rappelé le Président André Vallini devant les élèves de l'ENM, en Allemagne un juge ne peut être définitivement intégré dans la magistrature, qu'à l'issue d'une période probatoire qui varie de trois à cinq ans selon le Land concerné (Articles 10 et 12 de la loi sur les juges allemands - « deutsches Richtergesetz »). Le magistrat peut être révoqué durant cette période « s'il apparaît qu'il n'est pas apte à exercer les fonctions de magistrat ou s'il a commis une faute passible de poursuites disciplinaires » (article 22). Ce n'est qu'au terme de cette période probatoire que les magistrats sont nommés à vie (« auf Lebenszeit »), ce qui permet, en théorie du moins d'exclure ceux dont l'inaptitude aux fonctions de juge est avérée. Cette période est encore le temps de la formation car les juges en probation (« Richter auf Probe ») ne sont pas inamovibles394. On peut toutefois penser que cet objectif de période probatoire peut être atteint par la collégialité, que l'on évoquera plus loin. c) Instaurer une période d'apprentissage préalable en juridiction pour les magistrats instructeurs ? On pourrait également concevoir de ne confier les fonctions de magistrat-instructeur qu'à l'issue non d'une période probatoire mais d'un certain temps passé en juridiction. Ainsi au Conseil d'État les fonctions de commissaire du gouvernement ne sont assumées que par des maîtres des requêtes en fonctions depuis huit ans dans la juridiction et ne sont pas dévolues à des auditeurs sortant de l'ENA. En Allemagne aussi on ne peut être juge aux affaires familiales qu'avec une année au moins d'expérience professionnelle. Mme Marylise Lebranchu, ancienne garde des Sceaux, a plaidé devant la commission d'enquête pour que les jeunes magistrats fassent leurs premières armes dans les cours d'appel ou à la Cour de cassation, « afin d'apprendre par l'étude de ces dossiers, comment les procès se déroulent et se forment au contact de collègues plus anciens »395. Ces réflexions rejoignent celles du Premier président Guy Canivet. Celui-ci a souhaité qu'à la sortie de l'École, les auditeurs optant pour le siège, soient systématiquement nommés d'abord dans des fonctions collégiales dans les cours d'appel : « Ils y apprendraient, tout à la fois, la pratique de la décision collégiale, l'appartenance à une institution organisée et collective et l'analyse critique des décisions de première instance. Pour ces jeunes magistrats, il n'y aurait pas de meilleure formation et les magistrats des cours d'appel bénéficieraient, sans aucun doute, de l'apport dynamique de ces jeunes collègues, de leur fraîcheur d'esprit et de leur science récente. Dans une collégialité, il faut le savoir, les rapports intergénérationnels sont indispensables. L'apport des conseillers référendaires à la Cour de cassation en est d'ailleurs une démonstration permanente. »396 M. Michel Dobkine partage ce point de vue, puisqu'il a évoqué, de son côté, devant les députés, la possibilité « d'un début de carrière en cour d'appel non pas comme conseiller mais au contact de magistrats plus anciens, en se colletant au droit social, au droit commercial, branches du droit auxquelles on n'a guère affaire en début de carrière, et ce pendant quelques mois, voire deux ou trois ans »397. Mais doit-on déduire de ce critère de l'expérience des conclusions définitives pour l'affectation des magistrats ? Faut-il voir systématiquement dans l'ancienneté ou un préalable professionnel la garantie d'un bon choix qui serait exercé par toute autorité hiérarchique ? On rappellera qu'à propos de la nomination des juges de proximité, le Conseil constitutionnel a fait valoir que « si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats (aux fonctions de juge de proximité) ni leur exercice professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions. »398 Lors de ces auditions, l'idée a été également émise d'instituer une sorte de compagnonnage ou de tutorat des magistrats expérimentés sur les magistrats plus jeunes auxquels il ne faut pas, par principe, interdire l'accès aux fonctions d'instruction dès lors qu'elles seraient exercées collégialement. Plusieurs formes plus ou moins contraignantes de cette notion à connotation pédagogique peuvent être envisagées. Celle, apparemment la plus légère et ne s'apparentant pas à proprement parler à un tutorat, est suggérée par le « rapport Viout ». Celui-ci émet l'idée de désigner au sein de la chambre de l'instruction un magistrat référent identifié pour chacun des juges d'instruction. Ce référent serait en charge d'assurer le suivi du cabinet du juge d'instruction et de répondre « au besoin de concertation qu'il pourrait ressentir ». Le président de la Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel, M. Michel Jeannoutot a fait état de l'expérience canadienne en la matière : « Au niveau de l'École, on peut enrichir la formation, apprendre aux futurs magistrats à détecter et à gérer les situations à risque, à connaître leurs propres réactions et à les maîtriser. J'ai fait plusieurs missions au Canada, notamment il y deux ans. Les Canadiens ont un système très intéressant d'accompagnement du magistrat débutant : celui-ci, qui est toujours un ancien avocat, de trente cinq ans environ, se choisit un tuteur, qui suit ses premiers pas, assiste à ses audiences, examine ses décisions, et évalue avec lui la qualité de ses prestations, au regard non seulement des normes de droit, mais encore de la compréhension du justiciable. Ce tutorat peut être de nature à prévenir aussi les situations à risque. J'ai évoqué cette idée devant des juges des enfants dont une m'a répondu : "Oui, nous avons des situations de souffrance et nous aurions besoin d'un référent, mais comment le choisir ?" Il y a bien le Premier président ou les vice-présidents, mais ils ont un pouvoir hiérarchique d'évaluation, qui s'accommode mal de ce besoin d'accompagnement en cas de difficultés. »399 On ne peut occulter cependant le fait que le tutorat dans les petites juridictions est susceptible de soulever des difficultés d'application justifiant le regroupement des plus petites d'entre elles. Par ailleurs, le tutorat doit pouvoir se conjuguer avec l'indépendance de la justice, « indissociable de l'exercice des fonctions judiciaires »400, ce qui, là non plus, n'est pas sans poser problème. Dans ce contexte, on comprendra aisément que la collégialité de l'instruction permette de concilier ces exigences et satisfasse en particulier au nécessaire concours de compétences et d'expériences diverses, sans mettre en cause les principes d'indépendance de la justice et l'exercice de l'autorité hiérarchique. Une telle idée répondrait à cette préoccupation mise en exergue par l'avocat général Yves Jannier lors de son audition : « Il ne faut pas mettre quelqu'un de jeune et d'inexpérimenté dans un tribunal où il se retrouvera tout seul, ou avec deux autres collègues de son âge, et qui n'auraient pas plus d'expérience que lui, sans personne à qui demander conseil. »401 À l'issue des auditions qu'il avait lui-même organisées, le groupe de travail présidé par le procureur général Viout avait relevé « qu'un véritable changement de mentalités était perceptible au sein de l'institution judiciaire et que les juges d'instruction étaient eux-mêmes en recherche d'un mode d'exercice moins solitaire de leurs fonctions qui préserve leur indépendance (même si, en dépit d'un large consensus, un certain scepticisme demeure présent) »402. 2. Les implications de l'instruction collégiale L'organisation de cette collégialité peut toutefois revêtir des formes plus ou moins élaborées. Après avoir relevé que les réserves exprimées par le jury de l'examen de classement quant à la capacité du futur magistrat d'exercer des fonctions à l'instruction sont dorénavant prises en compte par l'autorité de nomination, le « rapport Viout » préconise de cantonner aux juridictions comptant plusieurs cabinets d'instruction la nomination des magistrats instructeurs occupant pour la première fois ces fonctions. En se prononçant pour la création de pôles de l'instruction avec une base départementale, le garde des Sceaux est allé plus loin devant la commission d'enquête : « Mon intention est de regrouper au tribunal du chef lieu l'ensemble des juges d'instruction de ce département. Toutefois, en fonction de leur population, certains départements n'auraient plus de juge d'instruction tandis que d'autres pourraient comporter plusieurs pôles, la phase de jugement se déroulant devant le tribunal correctionnel territorialement compétent. Outre qu'elle permettrait de rendre effective la cosaisine, cette évolution aurait pour mérite de mettre un terme à la solitude des juges et d'assurer un bon équilibre au sein de chaque pôle entre de jeunes juges en phase d'apprentissage de leur métier et des juges expérimentés. En l'état de nos réflexions, mais elles ne sont pas définitives, il pourrait y avoir 125 pôles de l'instruction dont 76 seraient composés d'au moins 3 juges d'instruction. »403 D'après les estimations de la Chancellerie, l'application immédiate d'une telle réforme supposerait, en l'absence de mutations, la création d'une soixantaine d'emplois de juge d'instruction et de 58 emplois de greffier. Par ailleurs, la circulaire du 2 novembre 2004 a mis en place des secrétariats communs de l'instruction dans les juridictions comportant au moins quatre juges d'instruction, afin d'alléger la charge de travail des greffiers. Ces secrétariats sont théoriquement confiés à un greffier et à un ou plusieurs agents de catégorie C ; douze juridictions connaîtraient ainsi la création d'un secrétariat commun. Ce mouvement s'inscrirait au demeurant dans la rationalisation des moyens de l'instruction engagée depuis la fin des années quatre vingt dix avec la mise en place des pôles économiques et financiers à Bastia, Lyon, Marseille et Paris. Ceux-ci permettent d'affecter des moyens humains et matériels importants à une juridiction spécialisée en matière économique et financière. Poursuivant cette spécialisation, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a institué un nouvel échelon judiciaire spécialisé interrégional, compétent pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale ainsi que des infractions économiques et financières prévues à l'article 704 du même code, lorsque les affaires sont ou apparaîtraient « d'une très grande complexité », celle-ci pouvant se caractériser par « le grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou le ressort géographique sur lequel les affaires s'étendent ». Par décret n° 2004-984 du 16 septembre 2004, huit juridictions interrégionales spécialisées compétentes tant en matière économique et financière que pour la criminalité organisée ont été créées. Il en va de même avec les pôles « santé 3 » créés par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui sont constitués d'équipes multidisciplinaires compétentes en matière sanitaire et qui existent à Paris et à Marseille. En imposant systématiquement des pôles de l'instruction composés de trois magistrats, la commission propose de franchir une étape supplémentaire. Plaçant la réforme du statut du juge d'instruction dans une perspective plus large que la précédente, dans la mesure où elle confierait à un seul collège au premier degré les fonctions de magistrat instructeur et de juge de la détention, cette nouvelle organisation de l'instruction ne serait pas sans conséquences sur le statut du magistrat instructeur, sur la carte judiciaire et sur les effectifs des juges d'instruction. a) Le nouveau statut du magistrat instructeur S'agissant du statut du magistrat instructeur, on rappellera que d'ores et déjà l'article 83 du code de procédure pénale permet au président du tribunal de grande instance d'adjoindre au juge d'instruction un ou plusieurs juges d'instruction, « lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie ». Si cette décision est prise dès l'ouverture de l'information judiciaire, l'avis du juge d'instruction n'est pas nécessaire. Il en va différemment si cela intervient en cours de procédure, l'absence d'accord du juge empêchant la cosaisine. Comme l'a relevé le procureur général Jean-Olivier Viout, lorsqu'il a été entendu par la commission : « le texte est rédigé de telle façon que dès que l'information judiciaire est ouverte, nul ne peut imposer cette cosaisine : même si chacun est persuadé de sa nécessité, il faut son consentement. »404 La circulaire d'application du 1er mars 1993 considère que « le critère de complexité de l'affaire devrait permettre aux magistrats chargés de l'instruction de recourir aux mêmes méthodes de partage des tâches que les équipes d'avocats qui interviennent dans certains dossiers à caractère purement technique ». La procédure proposée par la commission va cependant au-delà de la simple cosaisine. Elle aurait pour effet d'instituer une véritable collégialité. On ne saurait voir dans cette idée la manifestation d'une quelconque revanche sur une réforme qui n'a pas fait ses preuves ou un mouvement de balancier supplémentaire dans l'histoire mouvementée de notre procédure pénale. Dans la mesure où tous les praticiens s'accordent à reconnaître que la collégialité est une garantie puisque la vérité judiciaire a plus à gagner à l'échange d'arguments qu'au monologue, la collégialité doit être comprise comme la volonté d'instituer le plus en amont possible de la procédure pénale un travail d'équipe, pour faire échec le plus tôt possible à tout risque d'erreur. Plusieurs avantages peuvent être prêtés à cette collégialité : la possibilité d'avoir des regards croisés sur les orientations des enquêtes et d'instituer des débats sur l'opportunité des mesures privatives de liberté ; la consécration de l'autorité des équipes à l'égard des services d'enquête et une plus grande facilité à réorienter les investigations ; la dépersonnalisation des dossiers et un accès plus commode au dossier pour la défense en raison de la création de secrétariats communs. En dehors de ces intérêts multiples pour la procédure, on pourrait attendre d'une telle réforme, en termes d'administration de la justice, plus de continuité dans la prise en charge des procédures, une gestion plus rationnelle des formations, une synergie des compétences et la possibilité de dégager plus facilement des solutions en cas de divergences au sein du collège que dans le cas de la seule cosaisine. Les familiers de la procédure pénale reconnaîtront dans cette proposition, qui entraînerait une modification de l'article 83 du code de procédure pénale, une parenté avec le dispositif adopté par le Parlement en 1985 à l'initiative du garde des Sceaux de l'époque, M. Robert Badinter. L'article 49 du code de procédure pénale issu de l'article 2 de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale créait en effet auprès de chaque tribunal d'instance une ou plusieurs chambres d'instruction composées de trois magistrats du siège titulaires dont deux au moins étaient juges d'instruction, ainsi que deux magistrats du siège suppléants. Pour des raisons essentiellement budgétaires, cette réforme n'a pu voir le jour et a été abrogée par l'article 23 de la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987. Plus de vingt ans après, son promoteur la perçoit encore comme l'alternative à un « modèle anglo-saxon amélioré »405. Le dispositif proposé se séparerait toutefois de celui adopté en 1985 sur deux points : d'une part, il veillerait tout particulièrement à constituer des équipes avec des magistrats instructeurs éprouvés et des magistrats disposant de moins d'expérience. N'est-ce pas le même garde des Sceaux qui affirmait : « regrouper les juges d'instruction par équipes de trois permettrait de mieux les former auprès de leurs aînés, de briser leur solitude, de faire prendre les décisions par une collégialité ? »406 Des avocats font leur cette affirmation, puisqu'elle rejoint une proposition émise devant la commission d'enquête par Me Jean-Louis Pelletier : « Admettez qu'on institue une collégialité au niveau du tribunal, que l'instruction soit assurée par trois juges, dirigés par un magistrat chevronné. La création d'un premier juge d'instruction ou un super-juge d'instruction ayant rang de conseiller à la cour serait d'ailleurs, sans doute, de nature à revaloriser l'institution. Son expérience pourrait profiter aux jeunes magistrats qui feraient partie de ce collège. Les décisions importantes seraient prises sous forme collégiale. Je pense que c'est une piste que l'on pourrait suivre. »407 L'idée serait de confier la direction de ce collège à un magistrat du premier grade, c'est-à-dire ayant au moins sept années d'ancienneté depuis son entrée dans les cadres. Il aurait été inscrit au préalable sur la liste d'aptitude à exercer ces fonctions sous réserve que cette liste d'aptitude supprimée par voie réglementaire en 2001 ait été rétablie. Il serait entouré d'un magistrat instructeur issu de l'ENM et d'un troisième magistrat du second grade, également inscrit sur la liste d'aptitude. Par ailleurs, ce collège ne serait pas systématiquement intégré dans chaque tribunal de grande instance mais s'inscrirait dans une réforme de la carte judiciaire, fondée sur des pôles de compétences à l'échelon des cours d'appel. Dans ce schéma, en attribuant la décision de la mise en détention au collège de l'instruction qui, par nature, est celui qui connaît mieux le dossier on reviendrait donc sur la dissociation des pouvoirs d'investigation du juge d'instruction et de ses pouvoirs de coercition, introduite par la loi du 15 juin 2000. On ferait ainsi l'économie de l'institution du juge des libertés et de la détention qui n'a pas fait ses preuves et dont le maintien comme on l'a vu n'a été revendiqué par aucun magistrat entendu par la commission d'enquête. Comme l'a observé le Premier président Guy Canivet : « si l'on instaure un tribunal départemental de l'instruction et une collégialité de l'instruction, on peut restituer à ce tribunal la décision de mise en détention, s'il y a un véritable recours, un recours rapide , devant la chambre de l'instruction. »408 Si la collégialité trouve à s'exercer, elle devra veiller à satisfaire le principe constitutionnel d'indépendance de la justice. Ainsi conçue, cette collégialité serait en effet respectueuse du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 64 de la Constitution. Dans plusieurs décisions, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'indépendance des membres des juridictions était indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles409. On notera que la décision n° 2003-466 DC fait reposer les exigences d'impartialité et d'indépendance du juge sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'intérêt de cette référence tient à ce que l'article 16 de la Déclaration porte, en droit interne, les exigences du procès équitable énoncées par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Plus généralement cette référence à l'article 16 permet d'ancrer le droit positif constitutionnel dans de nombreuses composantes de la notion de sécurité juridique410. Il ressort de cette jurisprudence rendue notamment à propos du statut des juges de proximité que ce principe d'indépendance n'est pas méconnu si des garanties appropriées sont prévues. Or, les membres du collège de l'instruction continueraient à être soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats411. Les mécanismes de délégation notamment l'encadrement des retraits de délégations, qui empêche de mettre fin unilatéralement à la délégation confiée au délégataire en ayant pour objet de protéger ce dernier de toute ingérence, répondraient aux principes requis par le Conseil constitutionnel. En dehors de cette garantie, il conviendrait d'envisager que, dans le cadre de leur avancement, l'activité professionnelle des magistrats instructeurs délégataires ne soit pas évaluée par le magistrat instructeur directeur mais par le président de la juridiction. Il est clair qu'une telle réforme ne serait pas sans incidences sur l'organisation judiciaire, qu'il s'agisse de la carte judiciaire ou de l'effectif des magistrats instructeurs. b) Les effets de la réforme sur la carte judiciaire Aujourd'hui, la carte judiciaire est organisée de telle sorte qu'il existe au moins un tribunal de grande instance dans chaque département et que chaque tribunal de grande instance comprend au moins un juge d'instruction. Le nombre de cabinets de juges d'instruction par tribunal de grande instance est fonction du croisement des critères suivants : la démographie, le nombre d'ouvertures d'informations par an, la localisation des maisons d'arrêt et des cours d'assises et la localisation des pôles spécialisés en matière économique et financière et en matière sanitaire. Le regroupement des juges d'instruction en pôle aurait pour effet de supprimer des cabinets de juges d'instruction où ces derniers exercent seuls leur activité. D'après les chiffres communiqués par la Chancellerie, ces juges d'instruction sont aujourd'hui au nombre de 74. Ils sont attachés à des tribunaux de grande instance de villes moyennes comme Abbeville, Bernay, Guingamp ou Montluçon. Ces villes sont parfois des chefs lieux de département comme Guéret ou Aurillac. Le total des affaires traitées dans ces cabinets, qu'il s'agisse d'affaires nouvelles ou d'affaires en cours, représentait au 31 décembre 2004, 4,88 % de l'ensemble des instructions. Si l'on compare les mérites respectifs de la cosaisine et de la collégialité au regard de la carte judiciaire, il apparaît de plus que l'existence d'un seul juge d'instruction dans un quart des juridictions rend difficile la mise en place de la cosaisine. Même si elle n'affecte pas la répartition des tribunaux de grande instance, on ne saurait évoquer cette réorganisation des cabinets d'instruction sans poser la question plus globale de l'adaptation de la carte judiciaire aux besoins des justiciables. Comment justifier, par exemple, que Dinan et Saint-Malo distants de 35 kilomètres aient chacun un tribunal de grande instance ? La justice de proximité a des justifications que la raison ignore. Qualifiée d'ancienne et de lancinante par notre collègue Patrick Devedjian dans un rapport intitulé « Justice, Autopsie d'une réforme », présenté sous la précédente législature (Rapport n° 2137, 2000), la refonte de la carte judiciaire se heurte à de nombreuses résistances. Mais elle est inséparable de toute réforme de la justice. Depuis la tentative entreprise par Henri Nallet en 1991 pour départementaliser les tribunaux de grande instance, seuls quelques tribunaux de commerce ont été supprimés et cela non sans mal. Les premières décisions concernant la modification de la carte judiciaire des tribunaux de commerce ont été prises aux termes du décret n° 99-659 du 30 juillet 1999, qui a porté suppression à compter du 1er janvier 2000 de 36 tribunaux de commerce. Sept juridictions consulaires (l'Ile Rousse, Issoudun, Mayenne, Montélimar, Paimpol, Romorantin-Lanthenay et Salins-les-Bains) ont été supprimées à compter du 1er juin 2005 par décret n° 2005-624 du 27 mai 2005. Les réactions des magistrats sur le sujet sont contrastées. Certains réclament cette refonte. Témoignant ainsi du poids de l'histoire dans la répartition des tribunaux de grande instance, Mme Odile Mondineu-Hederer a rappelé opportunément que si le Pas-de-Calais comptait cinq TGI pour 1 440 000 habitants, l'Essonne n'en disposait que d'un pour 1 134 000 habitants412. Lors de l'audition des représentants de l'Union syndicale des magistrats (USM), M. Henri Ody a insisté sur les problèmes posés par l'impossibilité pour un juge d'instruction de siéger avec un juge des libertés et de la détention compte tenu de l'organisation actuelle des tribunaux : « le fait que le JLD ne puisse siéger dans l'affaire comme le juge d'instruction est incompatible avec le fonctionnement des petites juridictions. Je préside actuellement une petite juridiction et j'ai le plus grand mal à composer une audience correctionnelle. J'ai pour voisine une juridiction encore plus petite que la mienne et je suis obligé, à chaque audience correctionnelle collégiale, d'envoyer un magistrat de mon tribunal dans le tribunal voisin. On ne peut pas continuer comme cela. L'idée de réformer la carte judiciaire est évidente pour celui qui est sur le terrain. »413 Le 23 mars 2006, l'USM déclarait par la voix de son représentant, Mme Catherine Vandier, qu'elle « était favorable à une réforme de la carte judiciaire mais après une étude d'impact de coût, et en tenant compte des spécificités locales »414. Dans un document remis à la commission d'enquête le même jour au nom du syndicat majoritaire, ce magistrat, membre par ailleurs du bureau national de cette organisation, dressait cependant la liste de tous les obstacles que revêtait, à ses yeux, la départementalisation des services de l'instruction : « Cela supposerait une départementalisation des parquets, des greffes, des juges des libertés et de la détention et des juges du fond. En un mot la suppression sans le dire des petites juridictions et la mutualisation de la pénurie. Par ailleurs que va-t-il advenir des juridictions départementales à juge d'instruction unique comme Aurillac, Gap, Mende, Le Puy en Velay par exemple ? En outre on voit mal comment matériellement pourraient être accueillis dans des locaux judiciaires déjà exigus et souvent inadaptés des magistrats et fonctionnaires supplémentaires... Enfin des mesures sociales d'accompagnement seraient indispensables pour assurer la mise en place d'une telle réforme, tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires. » Il est un fait que derrière des déclarations officielles en faveur d'une refonte de la carte judiciaire se dissimulent de fortes résistances. Tel élu local s'opposera à la suppression de son TGI. Tel président n'acceptera pas de voir les pouvoirs de gestion qu'il exerce disparaître. Tel procureur de la République craindra de ne pouvoir conserver ce titre dans un plus grand tribunal. Tel vice-président ne pourra espérer un quelconque avancement dans une structure plus importante. Le barreau a également eu l'occasion d'exprimer ses réticences à l'endroit d'une réforme de la carte judiciaire, Me Franck Natali, Président de la Conférence des Bâtonniers déclarant lors de cette même table ronde du 23 mars 2006 que « l'idée d'une départementalisation de l'instruction est à proscrire car le juge est alors éloigné des justiciables et des auxiliaires de justice alors qu'il doit rester accessible ».Il est vrai que de petits barreaux sont attachés à certains tribunaux de grande instance, si l'on songe par exemple à celui de Briey qui compte 12 avocats ou à celui de Lure avec ses 8 avocats. Faut-il abdiquer pour autant toute réforme en la matière et céder devant les corporatismes ? Non seulement les justiciables désireux d'avoir une justice de qualité ne le comprendraient pas mais c'est oublier que nombre de services publics ont modifié ces dernières années leur organisation territoriale. Ainsi des institutions aussi vénérables que la Banque de France ont su adapter leur réseau, en retenant le département comme élément de leur maillage territorial et en supprimant à cet effet 113 implantations. En matière de sécurité, le décret n° 2002-889 du 15 mai 2002, qui fixe les attributions du Ministre de l'Intérieur est parvenu à organiser le rattachement pour emploi de la Gendarmerie nationale auprès du Ministère de l'Intérieur et à faire en sorte que le préfet coordonne à l'échelon départemental l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Faut-il rappeler également l'ampleur de la réduction du nombre de recettes des finances entreprise depuis 2003 (fermeture de 13 d'entre elles en 2003, 11 en 2004 et 7 en 2005), seuls 21 départements devant conserver à terme une recette ? Faut-il ignorer la fermeture de nombreuses structures infra-départementales de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes et la restructuration du réseau de la Direction générale de la comptabilité publique ? Dans ces conditions, les juridictions devraient-elles rester à l'écart de tout mouvement de rationalisation et de réorganisation du service public ? Il est évident néanmoins que, compte tenu du caractère sensible du sujet, une telle réforme ne pourra être imposée unilatéralement. Elle devra s'attacher d'abord à une évaluation des besoins et de la mutualisation des moyens et ne pourra être réalisée que de manière pragmatique, avec pédagogie et après une concertation avec les autorités locales et tous les professionnels concernés. Elle devra également s'étaler dans le temps, un plan de cinq ans apparaissant raisonnable. Dans une première étape, il serait proposé de créer des pôles d'instruction, composés d'un ou plusieurs collèges de trois magistrats, à l'échelon des cours d'appel et répartis sur la base de critères démographiques, un seuil de 500 000 habitants par collège apparaissant être un critère objectif et réaliste. Ce critère n'empêcherait pas une certaine souplesse dans son emploi et l'exercice d'un pouvoir d'appréciation au niveau des cours d'appel, afin d'éviter tout effet de seuil trop rigide. Dans les ressorts des cours d'appel les plus importantes, il pourrait exister ainsi un pôle d'instruction avec plusieurs collèges. Cette réorganisation devrait avoir également des conséquences sur les effectifs des juges d'instruction. c) Les effets sur les effectifs des juges d'instruction Si, d'après les calculs de la Chancellerie, la cosaisine devrait générer une soixantaine de créations d'emplois de juge d'instruction, la collégialité instituée à l'échelle des cours d'appel, compte tenu des gains enregistrés par ailleurs avec la suppression du JLD devrait entraîner la création d'une cinquantaine de postes supplémentaires par application d'une règle de trois. Comme le coût annuel d'un juge d'instruction débutant pour le budget de l'État, avec pension et primes, est de 58 525 euros, on peut estimer à 6,3 millions d'euros le coût de cette proposition, la première année. Elle reste d'un montant plus modeste que celui de la réforme de 1985 qui étendait, rappelons-le, la collégialité de l'instruction à chaque TGI. Cette dépense ne préjuge pas des crédits qu'il faudrait dégager pour recruter des greffiers et pour organiser une carrière de l'instruction jusqu'au grade de premier vice-président chargé de l'instruction, l'accès au grade de la hors hiérarchie étant possible pour le parquet et non pour l'instruction à l'exception du pôle antiterroriste. Il ne faut pas se dissimuler non plus les effets induits d'une telle réforme, en termes de coût de transfèrement des détenus aux pôles de l'instruction, sachant toutefois que ce surcoût pourrait être atténué si les transfèrements sont plus espacés que jusqu'à maintenant et ne sont organisés que lors des « fenêtres » de l'instruction et si la vidéoconférence se développe (cf. infra chapitre XV). 3. La collégialité, cadre pour la diffusion des bonnes pratiques La collégialité ne saurait être perçue sous le seul angle de l'institution de la réforme du statut du magistrat instructeur mais doit être conçue comme une culture. Or, parce qu'elle n'est pas non plus toujours répandue au sein du parquet comme on l'a vu (cf. supra chapitre VI, première partie) , la diffusion de bonnes pratiques mérite d'être encouragée. Celle-ci pourrait revêtir plusieurs formes ; lors de son audition le 16 mars 2006, Mme Aïda Chouk, présidente du Syndicat de la magistrature, a appelé de ses vœux « une réflexion sur la création d'espaces, d'échanges non hiérarchisés sur les pratiques professionnelles et sur les problématiques auxquelles les magistrats sont confrontés ». Le Procureur général Jean-Amédée Lathoud a regretté que les bonnes pratiques ne soient transmises que « par les hasards de l'expérience ou par les conseils personnels des plus anciens ». Il a déploré que le parquet n'ait pas connaissance de recommandations professionnelles applicables aux magistrats du ministère public comme le font les professionnels de santé dans le cadre de conférences de consensus. Évoquant le cas d'autres professions, il a cité le référentiel des bonnes pratiques des commissaires aux comptes définies par un décret du 16 novembre 2005 pris en application de la loi du 1er août 2003415 et les « guide lines » des experts-comptables416. Ces exemples sont autant de modèles dont la magistrature serait bienvenue de s'inspirer. Au-delà de ces questions d'organisation, il convient de s'interroger sur les fonctions et les modalités de fonctionnement de ces nouveaux collèges de l'instruction, qui pourraient voir le jour. B. DÉFINIR LES FONCTIONS DE LA COLLÉGIALITÉ L'introduction de la collégialité dans la conduite de l'instruction a-t-elle des conséquences sur la nature des actes susceptibles d'être réalisés et qui relèvent actuellement de la compétence du seul juge d'instruction ? Selon quelles modalités juridiques le collège est-il saisi ? Puisque le collège se verrait conférer la compétence pour ordonner le placement en détention provisoire du prévenu, qu'adviendrait-il des autres compétences actuellement dévolues au JLD, par exemple en matière de contentieux des étrangers ou de criminalité organisée ? Afin de clarifier les réponses à ces questions essentielles, votre commission souhaite les aborder dans l'ordre de la procédure, en distinguant la conduite de l'instruction, le placement en détention, le contrôle de l'état d'avancement des informations judiciaires et les modalités de leur clôture. Les présentes propositions relatives à la conduite de l'instruction doivent être examinées sous deux angles : celui de la saisine du collège et celui de l'exercice des droits de la défense. a) Une saisine par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile À l'image du juge d'instruction aujourd'hui, le collège devrait être saisi soit par l'intermédiaire d'un réquisitoire introductif du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile. Une fois saisi, le collège procéderait, conformément à la loi, « à tous les actes d'information qu'il jugerait utile à la manifestation de la vérité » et instruirait « à charge et à décharge » pour reprendre les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale. En effet, en dépit des critiques qui ont été adressées dans l'affaire d'Outreau à la conduite de l'information judiciaire par le juge d'instruction, la commission demeure attachée à l'inscription dans la loi de ce devoir de neutralité et d'équité dans l'appréciation des éléments de preuve. Dans ce cadre, le collège, sous réserve d'éventuelles délégations à un ou plusieurs de ses membres, pourrait procéder directement aux différents actes aujourd'hui réalisés par le juge d'instruction tels que des interrogatoires, confrontations, perquisitions et saisies. En outre, il pourrait délivrer commission rogatoire aux OPJ selon les modalités prévues par l'article 152 du code de procédure pénale. Cependant, la réalisation de ces actes accorderait davantage de place aux droits de la défense et au principe du débat contradictoire. b) Des actes réalisés en garantissant davantage l'exercice des droits de la défense Comme chacun sait, dans l'affaire d'Outreau, les modalités d'organisation des confrontations ont toujours été les mêmes, à savoir groupées, et les demandes des avocats des personnes mises en examen tendant à l'organisation de confrontations séparées ont toujours été rejetées, tant par le magistrat instructeur que par la chambre de l'instruction, au motif que les confrontations « avaient déjà eu lieu » et que les intéressés s'étaient donc déjà pleinement exprimés. De surcroît, à plusieurs reprises, des personnes mises en examen ont participé à de telles confrontations sans avocat, le droit en vigueur se contentant d'exiger du juge d'instruction qu'il notifie la date de la confrontation à l'avocat dans un certain délai. Il ne s'agit donc, pour le magistrat instructeur, que d'une obligation de moyen mais non de résultat. Par ailleurs, la retranscription des propos échangés dans le cabinet du juge d'instruction a fait l'objet de nombreuses contestations devant la commission qui ont révélé l'ambiguïté du rôle du greffier et l'écart existant entre le droit, qui le considère comme le garant de la procédure, et la pratique, qui en fait, bien souvent, un simple secrétaire du juge, retranscrivant uniquement sous sa dictée. Enfin, dans l'affaire d'Outreau, la décision de disjonction par le juge d'instruction de l'affaire du prétendu meurtre de la fillette belge, alors qu'il avait pourtant été saisi de ces faits par l'intermédiaire d'un réquisitoire supplétif du procureur, a soulevé des interrogations. En effet, cette décision étant, en l'état actuel du droit, considérée comme une simple mesure d'administration judiciaire, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours, quand bien même, et ce fut le cas en l'espèce, elle porterait préjudice aux intérêts de la défense des mis en examen qui clamaient leur innocence. Afin de mieux assurer l'équilibre des armes dans la procédure pénale et devant le collège de l'instruction, la commission est favorable : · à prévoir qu'une confrontation ou un interrogatoire ne peuvent avoir lieu sans avocat. Toutefois, dans l'hypothèse où l'avocat du mis en examen ne se présenterait pas tout en ayant été régulièrement convoqué, le collège aurait le choix, soit de reporter la confrontation ou l'interrogatoire, soit de faire désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office, ce qui permettrait de prévenir la tentation de certains conseils de se livrer à des manœuvres dilatoires en ne se présentant pas à la confrontation ou à l'interrogatoire régulièrement prévus. Ce faisant, notre droit se rapprocherait de celui en vigueur en Allemagne où l'article 145 du code de procédure pénale dispose que lorsque l'avocat « ne se présente pas à l'audience ou qu'il la quitte prématurément, ou qu'il refuse d'assurer la défense de son client dans une affaire où l'assistance d'un avocat est nécessaire, le juge doit en désigner un autre sur-le-champ, à moins qu'il ne décide de renvoyer l'audience à une date ultérieure » ; · à prescrire l'enregistrement, au moins sonore, des interrogatoires et des confrontations organisés par le collège de l'instruction et conservés sous la responsabilité des greffiers. Dès lors, toute contestation sur les propos tenus, leur retranscription, le caractère inductif des questions - comme cela a été le cas dans l'affaire d'Outreau - pourrait être aisément tranchée par la consultation de cet enregistrement soit, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, soit par la juridiction de jugement. Ce faisant, et comme en a convenu le juge Fabrice Burgaud lui-même lors de son audition par la commission, « cela permettrait de lever toute ambiguïté. Cela dit, dans la pratique, cela me semble difficile, sauf à exploiter au cas par cas, en fonction des difficultés qui pourraient apparaître. Cela permettrait au moins de savoir ce qui s'est passé, oui »417. Par ailleurs, il serait souhaitable que la prise de note par les greffiers soit généralisée ; · à faire de la modalité d'organisation de la confrontation une demande d'acte en tant que telle. Ainsi, le simple fait qu'une confrontation, éventuellement collective, ait préalablement eu lieu ne serait plus considéré comme un élément permettant de rejeter une demande d'acte tendant à l'organisation d'une confrontation obéissant à d'autres modalités. Il convient d'indiquer que cette proposition a également été avancée dans le rapport de M. Jean-Olivier Viout ; · à considérer toute décision de disjonction de l'un des aspects du dossier initialement confié au collège de l'instruction comme une décision juridictionnelle, donc susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. La chambre pourrait être saisie par le procureur de la République mais aussi par la défense de l'un des mis en examen qui estimerait que cette décision lui fait grief. 2. Une décision collégiale pour ordonner le placement en détention provisoire assortie d'un réexamen automatique de la situation du détenu après trois mois Le placement en détention provisoire ferait l'objet d'une décision collégiale après un débat contradictoire et sa prolongation serait sujette à un réexamen automatique. a) Un véritable débat contradictoire pour une décision collégiale de placement en détention provisoire L'attribution au collège de l'instruction de la compétence pour ordonner le placement en détention provisoire conduirait à substituer un « triple regard », collégial, au « double regard » que le JLD était censé porter. Ainsi, la décision de placement en détention provisoire serait prise à l'issue d'un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu, et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d'un avocat commis d'office, à peine de nullité. À la demande de la défense, ce débat pourrait être public, sauf si cette publicité était de nature entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à nuire à la dignité des personnes, aux intérêts des mineurs ou si l'instruction porte sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale. En aucun cas, le débat contradictoire devant le collège de l'instruction ne pourrait avoir lieu sans que le prévenu soit assisté d'un avocat, à la différence de ce qui se produisit à trois reprises pour Mme Sandrine Lavier dans l'affaire d'Outreau. Contrairement au débat contradictoire actuellement organisé devant le JLD qui a été qualifié de « tronqué » par M. Maurice Marlière qui fut JLD dans l'affaire d'Outreau ou « d'artificiel » par le procureur de la République, M. Gérald Lesigne, celui organisé devant le collège serait, d'une part, nourri par la possibilité pour les avocats de déposer un mémoire en défense et, d'autre part, porterait sur le fond de l'affaire et non sur les seuls critères de détention. Afin de permettre à ce débat contradictoire d'avoir une véritable substance, le collège de l'instruction siégerait, chaque semaine, à des dates fixes, comme une véritable juridiction. Ce faisant, il ne serait pas, à la différence du JLD, saisi « en bout de chaîne », tardivement et dans l'urgence. Cependant, lorsque, en raison des circonstances de l'espèce, une incarcération devrait être prononcée sans délai, à un moment où le collège ne siégerait pas, son président pourrait, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération provisoire du prévenu pour une durée qui ne pourrait excéder quatre jours ouvrables. Il convient d'indiquer que l'article 145 du code de procédure pénale prévoit une disposition comparable devant le JLD, lorsque la personne mise en examen, ou son avocat, demande à bénéficier d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Dans cette hypothèse, semble-t-il rarement mise en œuvre, le JLD peut, en effet, ordonner une incarcération provisoire pour cette même durée. b) Un réexamen automatique par le collège de la situation des prévenus incarcérés Une fois placé en détention par une décision motivée du collège, le prévenu verrait, en sa présence, sa situation automatiquement réexaminée par ce même collège à l'expiration d'un délai de trois mois. Ce réexamen serait de droit, même en l'absence de toute demande en ce sens présentée par le prévenu ou son avocat. À cette occasion, le dossier de la procédure serait réexaminé ainsi que la question de l'opportunité du maintien en détention. Cette proposition doit être mise en perspective avec celle tendant à ce que la chambre de l'instruction examine en audience publique, tous les six mois, les procédures dans lesquelles des personnes sont placées en détention provisoire afin d'évaluer la nécessité de prolonger cette mesure tout en se livrant à un examen du fond du dossier (cf. infra chapitre VI). Un nouveau débat contradictoire aurait lieu devant le collège permettant d'assurer pleinement la défense du prévenu. Là encore, et sous les réserves précédemment indiquées, ce débat pourrait être public. Le maintien en détention provisoire ne pourrait être ordonné que si le parquet le requiert en expliquant pourquoi le recours à une solution alternative à l'incarcération lui paraît, en l'espèce, toujours impossible. Ce faisant, le premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale disposant que « la procédure pénale doit être équitable et respecter l'équilibre des parties » serait davantage respecté. L'attribution au collège de l'instruction de la compétence pour ordonner le placement en détention provisoire, actuellement dévolue au JLD, soulève la question du devenir des autres compétences relevant actuellement du JLD. En effet, sans prétendre à l'exhaustivité, ce juge est également compétent pour autoriser : - la prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures et jusqu'à 96 heures d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction relevant de la criminalité organisée (article 706-88 du code de procédure pénale). Cette décision écrite et motivée du JLD est rendue à la requête du procureur de la République ; - la mise en œuvre « d'écoutes téléphoniques » dans le cadre de l'enquête de flagrance ou préliminaire portant sur des faits relevant de la criminalité organisée, à la requête du procureur de la République (article 706-95) ; - la perquisition, dans le cadre de l'enquête de flagrance, entre 21 heures et 6 heures du matin au domicile sur réquisitions du procureur de la République (article 706-89). En outre, et dans le cadre de l'enquête préliminaire, des perquisitions peuvent également être autorisées par le JLD selon les mêmes modalités si les lieux concernés ne sont pas des locaux d'habitation (article 706-90) ; - la sonorisation, qui consiste à mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement de l'intéressé, la captation, la fixation la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés » (article 706-96) lorsque la pose des instruments techniques requis concerne un lieu d'habitation et doit se dérouler entre 21 heures et 6 heures du matin. Ces importantes compétences devraient être transférées à un magistrat du siège d'expérience. C'est pourquoi, la commission préconise que les attributions du JLD autres que celles relevant du contentieux de la détention provisoire soient transférées au président du tribunal de grande instance ou à un vice-président délégué par lui. À cet égard, votre rapporteur tient à faire état ici d'une proposition avancée par son collègue M. François Vannson tendant à faire présider le collège de l'instruction par le président du tribunal ou le vice-président délégué par lui, afin d'exercer les fonctions actuellement attribuées au JLD. Ce faisant, un regard d'expérience, extérieur aux juges d'instruction composant le collège, serait introduit. Certes, le collège serait alors composé de quatre membres, ce qui conduit nécessairement à conférer une voix prépondérante au président ou au vice-président précité. En outre, et par pragmatisme, ce président ou vice-président n'interviendrait que pour présider les audiences du collège consacrées au contentieux de la détention provisoire. Cette disposition serait applicable, dès lors que les audiences du collège de l'instruction sont, ainsi qu'il a été indiqué, prévues à l'avance, les urgences étant traitées selon les modalités précédemment décrites. Pour leur part, tout en souscrivant à l'introduction de la collégialité dans la conduite de l'instruction, les membres socialistes de la commission considèrent qu'il n'est pas souhaitable de conférer au dit collège la compétence d'ordonner le placement en détention provisoire. Soulignant qu'il est intellectuellement et humainement impossible de demander à un collège en charge de l'instruction de décider objectivement de la détention provisoire d'une personne mise en examen par lui-même, les commissaires socialistes préconisent le maintien du JLD, garant de l'existence d'un authentique « double regard ». Toutefois, afin de s'assurer de son implication dans le contentieux de la détention provisoire, ces mêmes commissaires se déclarent favorables à ce que le JLD devienne un juge à plein-temps, exerçant exclusivement ces fonctions, à la différence des pratiques judiciaires actuelles. La décision de placement en détention par ce JLD « renforcé », saisi par le procureur, aurait lieu à l'issue d'un débat contradictoire public au cours duquel, d'une part, le procureur devrait produire des réquisitions écrites et, d'autre part, les avocats pourraient présenter des mémoires en défense. Ce débat pourrait être public à la demande de la défense. La décision de placement en détention provisoire ordonnée par le JLD devrait pouvoir faire l'objet d'un appel dans des délais particulièrement brefs devant la chambre de l'instruction, ce qu'approuve votre rapporteur. 3. Une clause de rendez-vous annuel afin d'examiner l'état d'avancement des informations judiciaires Outre le réexamen de droit de la situation du prévenu incarcéré précédemment présenté, la commission préconise que le collège, au moins une fois par an, se réunisse pour examiner l'état d'avancement de l'ensemble des dossiers dont il est saisi. Cette clause de rendez-vous annuel aurait pour objet d'inciter le collège à évaluer les diligences effectuées ou constater que certaines ne l'ont pas été et ce, quel que soit le dossier au fond, qu'il y ait des personnes placées en détention ou non. En effet, trop souvent, des informations s'éternisent dans les cabinets d'instruction pendant plusieurs années sans qu'aucune diligence ne soit véritablement effectuée, ce qui n'est pas satisfaisant. Là encore, ce réexamen annuel aurait lieu en présence des parties, le cas échéant, du ou des mis en examen, ainsi que du représentant du parquet. À la demande de la défense, cette réunion du collège pourrait avoir lieu publiquement. Cette disposition constitue une double amélioration par rapport au droit en vigueur, d'une part, parce qu'elle ouvre une nouvelle fenêtre de publicité devant un organisme collégial et, d'autre part, parce qu'elle introduit une périodicité plus rapprochée que celle de deux années prévue à l'article 175-2 du code de procédure pénale. Rappelons ici que cet article dispose que, si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée « expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. » 4. Une clôture de l'information plus contradictoire et équitable L'affaire d'Outreau a révélé au grand jour la généralisation d'une pratique fâcheuse, celle tendant à la reprise quasi-intégrale du réquisitoire définitif du procureur de la République par le juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation. Cette pratique n'est pas satisfaisante car elle conduit à une confusion des rôles entre le magistrat soutenant l'accusation qu'est le procureur, et le juge d'instruction, magistrat du siège indépendant, instruisant, en théorie, « à charge et à décharge ». Comme l'a reconnu devant la commission Mme Odile Mondineu-Hederer, présidente de la cour d'assises d'appel de Paris dans l'affaire d'Outreau, « l'ordonnance de renvoi est le copié-collé du réquisitoire. Mais il en est ainsi dans 95 % des cas, depuis le moment où le législateur a décidé que ce serait le juge d'instruction qui rendrait l'ordonnance de renvoi. Pour remédier à cela, je pense qu'on devrait obliger le juge d'instruction à faire une synthèse de son travail au moment [où il notifie la fin de l'information aux parties]. Il ferait ainsi une évaluation de son travail en reprenant les éléments à charge et à décharge et inviterait les parties - accusation, parties civiles et défense -, à se positionner par rapport à cela. Les demandes d'actes pourraient avoir lieu à ce moment-là. S'il n'y avait pas de demandes d'actes, le parquet ferait alors son réquisitoire. On verrait peut-être l'inverse : la synthèse du juge d'instruction devenir réquisitions du parquet. Et ce serait, à mon sens, davantage à charge et à décharge »418. Le procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, a abondé en ce sens en plaidant pour la réintroduction d'un « récapitulatif, auquel le magistrat instructeur, dans les affaires lourdes, procède avant de clôturer son instruction, afin de vérifier si des éléments ne lui ont pas échappé et de compléter le dossier s'il y a lieu. Si, dans cette affaire dont je n'ai pas eu à connaître, il n'y a pas eu ces recoupements, c'est évidemment regrettable, mais pour qu'on ne se mette pas dans cette situation, il existe un seul outil : c'est le récapitulatif - à condition que le parquet, auquel il doit être transmis, ne soit pas une chambre d'enregistrement, mais un deuxième regard, un contrôle. Unité du corps ne veut pas dire confusion des rôles. Chaque acte ne doit pas être une fin en soi »419. Enfin, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, M. Jean-Olivier Viout, a considéré que l'introduction de ce récapitulatif suffirait « pour se mettre à l'abri de la critique selon laquelle le juge d'instruction serait inspiré par le parquet »420. Afin de rétablir la logique initiale de notre procédure et de s'assurer que l'évaluation des éléments à charge et à décharge précède l'acte d'accusation du procureur, la commission préconise : · d'obliger le collège qui considère son instruction comme étant achevée à communiquer au procureur et aux parties un document récapitulant les éléments à charge et à décharge du dossier ; · de fonder les réquisitions du procureur sur ce document récapitulatif dans un délai déterminé par la loi ; · d'autoriser les parties à déposer des observations sur ce document dans un délai identique ; · de prévoir que le collège de l'instruction ne peut ordonner le non-lieu ou le renvoi devant la juridiction de jugement qu'après avoir débattu, collégialement et publiquement, des termes du réquisitoire du procureur et des mémoires des parties. En cas de désaccord entre les membres du collège, lors de la délivrance de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, le magistrat refusant de considérer le dossier comme clos devrait indiquer ses motifs dans une ordonnance de constat de désaccord, précisant les actes qu'il estimerait devoir être accomplis. Il reviendrait alors à la chambre de l'instruction d'examiner les arguments des magistrats co-saisis et de statuer sur la nécessité d'actes complémentaires. C. DÉTERMINER LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COLLÉGIALITÉ La création de la collégialité de l'instruction doit aller au-delà d'un simple regroupement de moyens et être conçue comme une méthode pour favoriser des regards croisés sur les orientations de l'enquête et sur la nécessité de recourir à des mesures privatives de liberté. Cependant, par pragmatisme et par souci d'efficacité, la collégialité de l'instruction ne devrait pas trouver à s'appliquer à toutes les décisions concernant l'ensemble des informations judiciaires, certaines d'entre elles, de par leur relative simplicité, ne nécessitant pas la mobilisation continue de trois juges. C'est pourquoi, la création de la collégialité de l'instruction doit s'accompagner de la mise en place de mécanismes de délégation dont le champ d'application devrait être déterminé par la loi. 1. La nécessaire organisation de la délégation Puisque chaque collège serait composé de trois magistrats, dont un du premier grade qui en serait le « coordonnateur », il incomberait à ce dernier de traiter, en particulier, des affaires urgentes. Cette hypothèse recouvre, notamment, l'ouverture d'une information par le parquet suivie immédiatement du défèrement d'une personne placée en garde à vue aux fins de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire ainsi qu'il a déjà été indiqué. Par ailleurs, la réalisation de certains actes d'instruction, tels que les interrogatoires, voire même certaines confrontations dans des affaires ne présentant pas de complexité particulière, pourrait être déléguée par le coordonnateur à un ou deux juges d'instruction co-saisis, membres du collège. Bien évidemment, le coordonnateur du collège de l'instruction devrait être informé du déroulement de l'instruction et, le cas échéant, y participer lorsque l'affaire se révélerait complexe. La délégation devrait être explicite, écrite et précise quant à l'identité du délégataire et la portée de la délégation qui ne devrait pas être totale. Non seulement ces délégations pourraient être individuelles ou être rattachées à une cosaisine mais il conviendrait de bien s'assurer que la délégation couvre toute la durée de l'instruction, qu'elle ne puisse être retirée qu'avec l'accord des membres du collège. L'un des critères pouvant être retenu par la loi afin de distinguer les actes susceptibles d'être délégués et ceux ne pouvant l'être, pourrait être celui des mesures restrictives de liberté, celles-ci constituant un critère objectif incontestable justifiant la collégialité. En revanche, les actes d'investigation, directement liés à la recherche de la vérité, comme la mise en œuvre d'écoutes téléphoniques, pourraient être, le cas échéant, délégués. 2. Une collégialité obligatoire pour les mesures restrictives de liberté et pour les moments clés de l'instruction La collégialité trouverait toute sa justification pour décider de la mise en examen, du recours à des mesures restrictives de liberté à l'encontre des personnes mises en examen, qu'il s'agisse du placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, du prononcé du huis clos. Par voie de conséquence, la collégialité serait de droit pour le réexamen de la situation des prévenus incarcérés depuis trois mois comme il a été indiqué précédemment. Il en serait de même pour l'examen annuel de l'état d'avancement des informations. L'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement relèveraient également de la collégialité, avec la possibilité d'y introduire un constat de désaccord de l'un des membres du collège. Enfin, et il s'agit d'une suggestion avancée par notre collègue Gérard Vignoble, le collège pourrait, à la demande de la personne concernée, être réuni en audience publique lorsqu'il prononce un non-lieu. En effet, autant les décisions de relaxe ou d'acquittement sont actuellement prononcées par les juridictions de jugement en audience publique, autant les décisions de non-lieu, prises par ordonnances du juge d'instruction, ne font l'objet d'aucune mesure de publicité. Or, la décision de mise en examen est parfois largement diffusée, dans la presse notamment, avec l'opprobre qui s'y attache, alors même que le non-lieu, intervenant des mois voire des années après, passe inaperçu. Afin de réparer, du moins symboliquement, le tort ainsi porté à une personne reconnue innocente, celle-ci se verrait offrir la possibilité d'obtenir lecture, en audience publique et devant le collège qui l'a mise en examen, de la décision de non-lieu la concernant. Ainsi conçu, le « collège de l'instruction » présente l'avantage de ne pas constituer une fausse collégialité avec un juge unique de fait, comme peut l'être parfois la cosaisine aujourd'hui421. En faisant intervenir un « juge directeur » ce schéma se différencierait en effet de l'option, qui consisterait à avoir une simple juxtaposition de deux juges d'instruction, comme l'a décrit le Procureur général Viout, en réponse à une question de M. Georges Fenech422. Au surplus, cette collégialité telle que proposée par votre commission, n'aurait pas l'effet pervers que pourrait risquer de produire une confrontation entre un juge des libertés et de la détention renforcé et un collège de l'instruction. En effet, un juge des libertés et de la détention même renforcé, saisi de demandes de placement en détention provisoire par quatre magistrats, pourrait être encore davantage incité à les confirmer qu'il ne le fait aujourd'hui. D. AMÉNAGER LE SECRET DE L'INSTRUCTION « Ce qui est en cause, aujourd'hui, avec le secret de l'instruction, c'est la divulgation à des tiers, en fait à des journalistes, non pas des faits à l'origine de la procédure, faits qui appartiennent à tout le monde, mais des éléments de la procédure, que l'on retrouve dans la presse, parfois in extenso, sous couvert d'un soi-disant journalisme d'investigation qui cache le plus souvent un journalisme de délation » affirment, avec force, les professeurs Guinchard et Buisson423: Mais quelle est la portée exacte du secret de l'instruction dont le principe est prévu à l'article 11 du code de procédure pénale « sans préjudice des droits de la défense » ? Si l'on entend par secrète, une procédure qui se déroulerait à l'insu des personnes poursuivies et de la victime, comme ce que prévoyait le code d'instruction criminelle de 1808, le juge d'instruction n'ayant pas l'obligation de notifier les charges, ni de tenir les parties informées de ses investigations, alors la procédure actuelle n'est pas secrète puisque les parties ont accès au dossier. En revanche, l'instruction demeure secrète pour tous les autres individus et, en théorie, pour le public. Ainsi que l'expliquent les professeurs Merle et Vitu, « l'exigence du secret de l'instruction est justifiée par un triple souci : faciliter l'œuvre répressive en évitant d'étaler en public le travail de recherche et de décantation des preuves, et en évitant les pressions de l'opinion publique sur une magistrature qui doit être indépendante et libre, - mettre l'inculpé à l'abri de la calomnie, dont un non-lieu n'effacera pas toujours les effets, - protéger enfin le public contre les abus d'une presse qui cultive trop aisément le goût du scandale et des affaires pénales à sensation »424. Cependant, l'exception à la règle du secret au profit des droits de la défense a conduit la jurisprudence à admettre que ni le mis en examen, ni la victime, ni même l'avocat, dès lors que son client l'a délié de son secret professionnel, n'étaient tenus au secret de l'article 11. Prenant en considération l'existence de ces multiples sources déliées du secret de l'instruction, dont l'actualité la plus récente a démontré l'exploitation que peut en faire la presse, le législateur du 15 juin 2000 a tenté d'y apporter une réponse en donnant au procureur de la République, « afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public », la faculté, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties, « de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » Cela étant rappelé, trois des propositions de la commission d'enquête sont susceptibles d'avoir des conséquences sur le secret de l'instruction. Il s'agit : de l'audience du collège de l'instruction tendant au réexamen de la situation du détenu à l'issue d'un délai de trois mois d'incarcération, du réexamen annuel de l'état d'avancement de l'ensemble des informations et de la mise en œuvre d'une « clause de rendez-vous » semestriel devant la chambre de l'instruction dans les procédures dans le cadre desquelles des personnes sont placées en détention provisoire. En effet, la défense du détenu pouvant demander la publicité de ces débats contradictoires devant le collège de l'instruction - la publicité devenant le régime de droit devant la chambre de l'instruction - le secret de l'instruction s'en trouverait de facto levé, du moins pour partie. En effet, ni la conduite des auditions, ni celle des confrontations menées dans le cabinet du collège de l'instruction, donc à huis clos, ne seraient concernées par ces trois hypothèses d'audiences publiques. L'introduction de ces fenêtres de publicité ne signifie donc nullement la suppression du secret de l'instruction, mais simplement son aménagement. Cependant, l'éventuelle levée du secret de l'instruction au bout de trois ou six mois de détention, ce qui est un délai particulièrement bref, serait susceptible d'entraver les enquêtes, et par voie de conséquence, d'amoindrir l'efficacité de la réponse pénale. En effet, si à l'occasion de ce débat, la stratégie de l'instruction venait à être explicitée, des informations permettant aux éventuels complices de faire disparaître des éléments de preuve venaient à être révélées, son introduction s'avérerait contre-productive, voire dommageable. C'est la raison pour laquelle la publicité des débats contradictoires devant le collège de l'instruction ou la chambre éponyme devrait pouvoir être refusée dans les hypothèses suivantes : - lorsque l'enquête porte sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de la loi, ce qui inclut, notamment, le trafic de stupéfiants ou le terrorisme ; - lorsque cette publicité serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, mineur en particulier. Il convient d'indiquer que ces critères reprennent ceux de l'article 199 du code de procédure pénale qui permettent à la chambre de l'instruction de s'opposer à une demande de publicité de l'audience. La décision de refus de la publicité serait prise collégialement, tant devant le collège de l'instruction que devant la chambre de l'instruction. Ces décisions seraient susceptibles de recours, en appel devant la chambre de l'instruction, s'il s'agit d'une décision du collège de l'instruction, en cassation devant la Cour du même nom, si le rejet émane de la chambre de l'instruction. L'introduction de ces « fenêtres de publicité » régulières, devant le collège de l'instruction, devant la chambre de l'instruction, invite, par voie de conséquence, au renforcement du respect du secret de l'instruction lorsque celui-ci est applicable. Dès 1989, les professeurs Merle et Vitu déjà cités plaidaient en ce sens en considérant « à tous égards préférable de maintenir le secret en le protégeant mieux, et en frappant de peines plus sévères (lourdes amendes, emprisonnement, interdiction du journal où auraient paru les indiscrétions judiciaires) les agissements de ceux qui, au prétexte d'informer l'opinion publique, font œuvre immorale et souvent criminogène »425. Sans préconiser des mesures aussi radicales, la commission est néanmoins favorable à : - l'aggravation des sanctions pénales réprimant la violation du secret professionnel et du secret de l'instruction. L'article 226-13 du code pénal punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession. Cette peine devrait être portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En outre, l'article 114-1 du code de procédure pénale réprime d'une amende de 3 750 euros le fait pour une partie, mais sous réserve des besoins de la défense, de diffuser auprès d'un tiers une reproduction des pièces de la procédure. Là encore, l'augmentation du montant de l'amende encourue à hauteur de 7 000 euros devrait être envisagée ; - l'introduction d'une amende civile de 15 000 euros en raison du préjudice causé par l'atteinte à la présomption d'innocence. En effet, le secret de l'instruction a été conçu, certes, pour garantir l'efficacité des enquêtes, mais aussi pour préserver la présomption d'innocence. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de créer un nouveau délit d'atteinte à la présomption d'innocence, la commission est favorable à l'introduction, dans l'article 9-1 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence », d'une amende civile au montant préfixé de 15 000 euros. VI. REFONDER LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Plusieurs hauts magistrats entendus par la commission d'enquête ont insisté sur la nécessité de renforcer l'autorité et la place de la chambre de l'instruction. M. Bernard Daeschler, Premier président de la cour d'appel de Reims considère « qu'il serait sans nul doute extrêmement utile de faire de la chambre de l'instruction un centre de suivi des informations pénales. Cela supposerait que la cour d'appel lui confère des moyens beaucoup plus importants et qu'elle puisse constituer des équipes de conseillers référendaires, d'assistants de justice, qui pourraient suivre un dossier tout au long de son évolution, ce qui pourrait être un gage d'efficacité lorsqu'il y a , par exemple, un nombre considérable de demandes de mise en liberté, requérant chaque fois le transfert physique du dossier et son examen par des magistrats qui ne siègent pas toujours dans la même formation »426. On retrouve une préoccupation similaire chez les représentants du parquet par la voix du président de la Conférence des procureurs généraux, M. André Ride : « Il faut donner à la chambre de l'instruction les moyens de fonctionner pour que chacun puisse exercer pleinement la collégialité et se pencher vraiment sur le dossier, et il faut qu'il y ait autant de chambres que nécessaire. »427 Les réformes qui seraient à engager en la matière pourraient porter sur la composition de la chambre de l'instruction, sur le respect des droits de la défense, sur la publicité des audiences et sur les fonctions mêmes de cette formation de jugement. A. GARANTIR LA STABILITÉ DE SES MEMBRES Le fonctionnement de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a révélé une rotation fréquente de ses membres, préjudiciable à un suivi effectif du dossier, le seul membre permanent de la juridiction étant son président. Par exemple, sur 33 arrêts rendus entre le 7 mai 2001 et le 3 mai 2002, les membres de la chambre de l'instruction, en dehors du président, n'ont jamais été plus de quatre fois ensemble. Il est donc apparu souhaitable à la commission que les effectifs de ces chambres soient renforcés, afin de permettre aux magistrats d'exercer ces fonctions à plein temps et de suivre ainsi l'ensemble des activités des cabinets d'instruction. Une étude réalisée par la Chancellerie auprès des différentes cours d'appel fait état d'un besoin d'une cinquantaine de postes de magistrats du 1er grade et hors hiérarchie pour atteindre cet objectif. Il conviendrait d'y adjoindre un fonctionnaire par chambre de l'instruction, soit une cinquantaine d'emplois. Parallèlement, la commission ne peut que rejoindre les conclusions du groupe de travail animé par M. Viout, qui suggérait que le président de la chambre ou l'un de ses conseillers soit le « véritable référent permanent du juge d'instruction ». « On pourrait en particulier imaginer qu'au lieu d'envoyer par la poste la notice semestrielle dans laquelle il fait le point de l'avancement de ses dossiers, le juge d'instruction vienne personnellement l'apporter au magistrat chargé du suivi pour qu'il y ait un véritable dialogue sur les difficultés de tel ou tel dossier. On ferait ainsi un grand pas dans la lutte contre la solitude du juge d'instruction. »428 Si cette recommandation est moins justifiée dans l'hypothèse où la collégialité de l'instruction voit le jour, elle n'est pas sans intérêt pour contribuer à l'information de la chambre de l'instruction et corriger cette image de censeur éloigné qui est accolée à cette institution. B. MIEUX RESPECTER L'EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE « Observations sommaires » et « chambre de confirmation », tel a été le leitmotiv des avocats à l'endroit de la chambre de l'instruction. Le pouvoir de filtrage du président qui peut, discrétionnairement, décider de ne pas présenter la demande qui lui est présentée devant la collégialité tout comme la procédure des observations sommaires ont été vivement contestés devant la commission. Afin d'améliorer l'exercice des droits de la défense, la commission propose de répondre à cette double série de griefs. On sait que le droit en vigueur permet au président de la chambre de l'instruction d'exercer un filtrage par déclaration de non admission d'un appel ou par constat du désistement de l'appel et un filtrage stricto sensu au fond de l'appel des ordonnances de refus d'actes. Or, comme l'a souligné Me Philippe Lescène : « Dans la plupart des autres dossiers, nous essuyons des refus presque systématiquement et je ne me souviens pas que la chambre de l'instruction ait jamais examiné un seul appel car le président de la chambre de l'instruction exerce préalablement un filtre et considère en toutes circonstances qu'"il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction", point final. »429 On peut légitimement penser que le filtrage n'a pas lieu d'être lorsque sont en cause les demandes d'actes dépourvues de tout caractère répétitif. Sans revenir sur des remarques déjà présentées dans le chapitre V de la première partie consacré aux droits de la défense, on rappellera également plusieurs critiques de la défense à l'encontre du bien-fondé des observations sommaires et la revendication de leur remplacement par de véritables plaidoiries : « Comment défendre un homme, comment expliquer que la justice est en train de se tromper quand on vous rappelle que vous ne devez faire que des "observations sommaires" ? »430 « Il faudrait qu'à la chambre de l'instruction on ne se contente plus de formuler des observations mais on puisse plaider vraiment. Contrairement à ce que prévoit la loi, les chambres de l'instruction, à de rares exceptions près, ne sont pas de vraies juridictions d'appel des magistrats instructeurs ; elles exercent une sorte de contrôle restreint ou de contrôle manifeste de l'erreur d'appréciation. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le sentiment que les faits ont déjà été jugés, à charge et à décharge. »431 « L'article 199 du code de procédure pénale dispose que, devant une chambre de l'instruction, les avocats procèdent par voie d'observations : ils ne plaident pas. Alors que nous allons devant les juges de la cour d'appel pour parler de mise en liberté, ce qui est fondamental, nous sommes très rapidement interrompus : "Vous ne devez faire que des observations, cela suffit ! Vous ne nous intéressez pas, nous savons !" Cette disposition est symbolique quant au rôle de la défense en matière pénale. »432 Fidèle à sa démarche tendant à renforcer le rôle de la chambre de l'instruction, la commission propose de retirer aux observations présentées devant la chambre de l'instruction le qualificatif de « sommaires » au profit d'un authentique débat contradictoire. C. ASSURER LA PUBLICITÉ DE SES AUDIENCES Devant la commission d'enquête, M. Michel Jeannoutot, président de la Conférence nationale des premiers présidents des cours d'appel, a clairement mis en exergue les mérites de la publicité des audiences au regard du droit actuel. « Si l'on veut faire de la chambre de l'instruction une véritable chambre de contrôle de l'instruction, il faut que ses audiences deviennent de véritables audiences, qu'elle soit une véritable formation "de jugement", que la défense y ait toute sa place, et que l'on ménage des espaces de publicité pour permettre le contrôle démocratique. Nous sommes loin du compte ! »433 Il faut savoir que le principe veut que l'audience ne soit pas publique. Toutefois depuis la loi du 15 juin 2000, la personne mise en examen ou sa défense ont la faculté de demander, dès l'ouverture des débats, la publicité de ces derniers. Celle-ci est accordée sauf si elle est de nature à entraver les investigations ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Il est vrai que cette faculté est peu utilisée. Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, M. Didier Guérin, entendu par la commission d'enquête, a convenu qu'« elle n'est pas véritablement une demande des parties mises en examen » et qu'il ne l'avait vu demander qu'à deux reprises434. Cette suggestion de publicité des audiences devant la chambre de l'instruction a rencontré l'adhésion du Procureur général Yves Bot435. L'intérêt de la publicité des audiences devant la chambre de l'instruction a été également mis en valeur par les journalistes de La Voix du Nord entendus par la commission : « Quand Laurent Renault a la chance d'assister à des débats contradictoires devant la chambre de l'instruction, nous apprenons beaucoup de choses et nos lecteurs commencent à prendre connaissance d'incertitudes. En matière criminelle, il est fondamental que nous ayons très rapidement accès à une vraie information contradictoire pour pouvoir en rendre compte à nos lecteurs. »436 Au surplus, à partir du moment où les compétences de la chambre de l'instruction seraient étendues en procédant à un examen au fond, la publicité de l'audience constituerait une nécessité au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, il a été jugé a contrario que la chambre d'accusation437 en statuant en chambre du conseil ne méconnaissait pas l'exigence de publicité de l'article 6 § 1 qui ne concerne que les procédures portant sur « le bien-fondé de toute accusation en matière pénale » (Crim., 2 mars 1988, Bull. crim. n° 112). Si l'on s'accorde sur la nécessité de la publicité des audiences devant la chambre de l'instruction, cette proposition n'épuise pas pour autant tous les problèmes, dans la mesure où il reste à en définir la périodicité. Les différents délais s'articuleraient avec ceux du collège de l'instruction décrits dans le chapitre précédent, qu'il y ait ou non détention provisoire .En toute hypothèse, le point de départ de l'intervention du collège serait l'ouverture de l'information judiciaire. Un rendez-vous serait ensuite institué devant le collège au bout de douze mois pour faire le point avec l'ensemble des parties. Vingt quatre mois après se tiendrait un rendez-vous devant la chambre de l'instruction, sur l'affaire et sur le respect du délai raisonnable de l'instruction. Dans l'hypothèse où il y aurait une détention, le point de départ des « fenêtres de publicité » serait la mise en détention par le collège. Au bout de trois mois le détenu présent verrait sa situation examinée par le collège, en présence du parquet et de la défense qui pourrait demander la publicité du débat. Au bout de six mois, l'audience d'examen de la situation du détenu devant la chambre de l'instruction serait obligatoirement publique puis à partir du 9e mois, le collège de l'instruction serait à nouveau l'instance saisie. Il y aurait ainsi une alternance tous les trois mois des interventions du collège et de la chambre de l'instruction. Au surplus, la chambre de l'instruction pourrait être autorisée à la demande d'une partie, deux ans après l'ouverture de l'instruction, à vérifier l'état d'avancement de l'instruction. Si elle estime que le délai raisonnable est dépassé, elle évoquerait l'affaire et rendrait un jugement de règlement dans les six mois. Dans le cas contraire, elle renverrait l'affaire au collège de l'instruction afin qu'il poursuive ses investigations. Ces délais permettraient d'accélérer les jugements, étant entendu que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie traditionnellement suivant les circonstances de l'espèce et en particulier au regard de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (Cedh, 31 juillet 2001, Lannouti c. France), l'enjeu du litige pour l'intéressé entrant également en ligne de compte (Cedh, 23 avril 1998, Doustaly c. France). Ce calendrier s'appliquerait également sans préjudice des demandes de mise en liberté qui pourraient intervenir à tout moment comme c'est le cas actuellement. Faut-il espacer les demandes de mise en liberté en instituant un délai minimal d'un mois entre deux demandes, « sauf élément nouveau, afin d'éviter l'encombrement des rôles », comme l'a recommandé Mme Brigitte Roussel, membre de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ?438 Il est à craindre qu'un tel dispositif ne se heurte au principe du droit au recours garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Au demeurant de telles dispositions ne semblent pas s'appliquer en droit étranger. Par exemple, l'article 117 du code de procédure pénale allemand n'impose aucun délai minimum entre deux demandes de mise en liberté, les seules limites opposées en la matière concernant la tenue de l'audience (« mündliche Verhandlung »). Le code de procédure pénale italien n'interdit pas non plus la réitération des demandes de mise en liberté même si une demande est en cours. À travers le renforcement de la publicité des audiences devant la chambre de l'instruction se pose la question de la redéfinition des fonctions de la chambre de l'instruction. Si l'on a l'ambition de donner toute son efficacité au rôle de la chambre de l'instruction, il convient de revoir ses compétences. Fort de son expérience, le Président Didier Guérin a fait part à la commission de ses interrogations sur le fonctionnement actuel de la chambre de l'instruction : « Il m'est depuis longtemps difficile à admettre, il est intolérable, que l'on examine la détention provisoire sans avoir à se préoccuper du fond. Peut-on imaginer de laisser en prison une personne contre laquelle les indices sont faibles, voire inexistants ? La chambre de l'instruction devrait ainsi recevoir compétence pour examiner, sur demande de la défense, à l'occasion de tout contentieux de détention provisoire et de contrôle judiciaire, le bien-fondé de la mise en examen. Lorsque le contentieux est ainsi rendu plus complexe, la chambre devrait avoir un délai supplémentaire d'au moins cinq jours pour statuer. »439 En prolongeant cette question, on rejoint la problématique de la comparution à l'audience de la chambre de l'instruction des mis en examen et des parties civiles. On rappellera qu'aujourd'hui en matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit si la personne concernée ou son avocat en fait la demande par requête et est présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté (article 199 du code de procédure pénale). Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, le président de la chambre a la faculté de rejeter une demande de comparution personnelle, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté si la personne a personnellement comparu devant la chambre depuis moins de quatre mois. Dans cette hypothèse, le président rend une ordonnance de non comparution motivée qui est insusceptible de recours. Pour traiter le contentieux de la détention provisoire, tout en évitant les déplacements des prévenus, il pourrait en revanche être recouru à la vidéoconférence. Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Didier Guérin, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, a relevé une lacune législative en la matière : « Il serait important de repenser de manière approfondie les conditions de l'utilisation de la vidéoconférence devant la chambre de l'instruction. Actuellement, celle-ci n'est possible que pour les demandes de mise en liberté. Il serait de toute évidence normal que la vidéoconférence puisse être utilisée pour tous les contentieux de la détention provisoire soumis à la chambre de l'instruction. Il y a quelques mois, un système de vidéoconférence a été installé à la cour d'appel de Versailles, qui nous permet de nous connecter à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. Mais le législateur a adopté un texte trop restrictif, de sorte que nous ne pouvons pas l'utiliser. »440 Pour surmonter cet obstacle, il conviendrait que l'article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale ne fasse plus référence « à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement » mais « au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, à l'examen des demandes de mise en liberté par la juridiction de jugement ». Cet aménagement de texte aurait pour effet d'inclure dans le champ de la vidéo-conférence le contentieux de la détention provisoire, quelle que soit sa nature, et serait sans incidence sur le régime des fenêtres de publicité, celle-ci ne constituant qu'une modalité technique de la présentation de la personne. Comme l'a suggéré le Président Didier Guérin, la comparution à l'audience de la chambre de l'instruction de « ceux qui en font la demande devrait être de droit. Actuellement, les personnes détenues peuvent venir nous voir lorsqu'il est fait appel d'un refus de mise en liberté, mais n'ont pas voix au chapitre pour faire valoir leur point de vue sur le dossier. C'est tout de même assez contradictoire »441. La comparution personnelle de droit pourrait être reconnue, tout en maintenant la règle de l'intervalle des quatre mois introduite en 2002. Selon le procureur général Jean-Olivier Viout lors de son audition, la chambre de l'instruction aurait également tout à gagner à l'ouverture d'un espace où, selon son expression, « l'on puisse faire le point, aller en profondeur ». De fait, les leçons de l'affaire d'Outreau ont convaincu le groupe de travail animé par M. Jean-Olivier Viout de la nécessité d'instaurer tous les six mois dans les procédures donnant lieu à détention provisoire une audience de la chambre de l'instruction portant sur l'examen de l'état d'avancement et la poursuite de l'information. « On y examinerait où en sont les éléments à charge et à décharge, on débattrait contradictoirement des mesures d'instruction demandées par les avocats et qui n'ont pas été suivies d'effet. Surtout, on examinerait l'opportunité de la poursuite de la détention provisoire : en dehors de tout contentieux de la liberté que l'on ait ou non fait une demande de mise en liberté, que l'avocat soit pressant ou non, tous les mis en examen seraient logés à la même enseigne. Cette audience ouvrirait une fenêtre fort utile de publicité dans le cadre de l'information judiciaire et offrirait une garantie importante. »442 Aujourd'hui, si l'on exclut ses compétences sur les questions de réhabilitation, d'amnistie et de discipline des personnes disposant de pouvoirs de police judiciaire, la chambre de l'instruction a reçu les attributions suivantes : elle est juridiction d'appel des ordonnances du juge d'instruction et est juridiction d'instruction des crimes à titre facultatif, puisqu'à ce titre il lui faut être saisie intégralement de la procédure, soit par le procureur général pour redresser une qualification retenue par le juge d'instruction ou rouvrir l'information pour charges nouvelles, soit indirectement lorsqu'elle exerce un pouvoir d'évocation. La réforme proposée confierait à la chambre de l'instruction le contrôle du collège de l'instruction, l'appel de ses actes et l'examen systématique de la nécessité de maintenir la personne en détention et du fond du dossier tous les six mois. Au total, la régularité de ces fenêtres, le renforcement de la procédure contradictoire, l'allocation de moyens humains supplémentaires devraient non seulement se conjuguer pour conforter la défense mais présenteraient deux mérites. D'abord cette réforme devrait avoir pour effet de limiter les demandes de mise en liberté répétées qui sont contreproductives pour le demandeur et ne donnent lieu qu'à un examen superficiel de la part de la juridiction d'instruction du second degré. Cette réforme ferait échec à une pratique qu'a dénoncée le Premier président Guy Canivet devant la commission : « les contrôles effectués par la chambre de l'instruction sont à répétition au gré du détenu qui multiplie les demandes, espérant qu'un jour ou l'autre il obtiendra sa mise en liberté. Pour une détention injustifiée, c'est finalement la seule manière d'exprimer sa détresse : 117 demandes pour l'un des détenus d'Outreau, a-t-on pu lire. Mais ce sont toujours les mêmes demandes et, si la situation n'a pas changé, les mêmes réponses. D'autant plus qu'à la longue, on ne fait plus comparaître le détenu et que son avocat ne se déplace pas toujours. La répétition des demandes et des recours est un facteur d'illusion pour le détenu, une perte de temps, d'espoir, d'énergie et de moyens inutiles pour tout le monde. C'est évidemment cet enchaînement qu'il faut briser. »443 Ensuite, cette réforme serait, au demeurant, plus en phase avec les règles prévalant dans des procédures pénales étrangères voisines. Ainsi les articles 121 et 122 du code de procédure pénale allemand prévoient que les détentions provisoires de plus de six mois font l'objet d'un contrôle systématique. L'article 121 est ainsi rédigé : « 1 / Aussi longtemps qu'un jugement ordonnant une peine d'emprisonnement ou une mesure de sûreté n'a pas été rendu, le maintien en détention provisoire au-delà d'une période de six mois ne peut être ordonné que dans les cas où le nombre important ou la difficulté particulière des mesures d'investigation nécessaires à l'enquête, ou à tout autre motif grave, le justifie. 2 / La personne détenue doit être immédiatement remise en liberté à l'expiration de ce délai de six mois, sauf dans le cas où la cour d'appel ordonne son maintien en détention. » Aux termes de l'article 122 : « Dans le cas visé à l'article 121, le tribunal communique le dossier à la cour d'appel par l'intermédiaire du parquet, lorsqu'il estime nécessaire de maintenir la personne en détention ou lorsque le procureur le requiert. » Ce contrôle exercé par la cour d'appel n'est pas de pure forme et donne lieu à un examen approfondi du dossier. Les critères retenus en la matière sont extrêmement stricts ; la détention n'est prolongée que si celle-ci paraît justifiée au regard des éléments versés au dossier. Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les motifs de la détention provisoire qui sont examinés mais plus largement les diligences accomplies par le parquet durant les six derniers mois. Tout retard dans la conduite des investigations doit être justifié et, à défaut, la personne est remise en liberté. En Belgique, la chambre des mises en accusation qui est une chambre de la cour d'appel composée de trois membres contrôle d'office les instructions. Elle connaît de toutes les affaires dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive. Elle est appelée à statuer sur le maintien en détention de trois mois en trois mois444 . En Espagne, les décisions portant placement en détention provisoire ou prolongation de cette mesure peuvent faire l'objet de recours de la part de l'intéressé devant le juge qui a rendu la décision et en cas de confirmation de la décision devant la chambre pénale du tribunal dans les 30 jours. En Italie, la demande de réexamen de la décision de détention est formée devant le tribunal de la liberté qui siège dans la cour d'appel concernée. Le contrôle de la détention en République tchèque est opéré tous les trois mois. Le procureur de la République procède au réexamen des conditions motivant la détention et décide du maintien de celle-ci. Cette décision est susceptible d'appel devant le juge du premier degré445. VII. GARANTIR L'ACCÈS AU DOSSIER Afin de permettre à l'avocat de la personne mise en examen d'exercer pleinement sa mission de défense, l'article 114 du code de procédure pénale prévoit, d'une part, que la procédure est mise à la disposition des avocats des parties quatre jours ouvrables au plus tard avant une confrontation ou un interrogatoire et, d'autre part, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables et « sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ». En outre, ce même article prévoit que les avocats peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Matériellement, il appartient au greffier du cabinet d'instruction d'effectuer les copies requises par les avocats. Enfin, la personne mise en examen peut, à son tour, avoir communication des pièces dont la copie a été délivrée à l'avocat mais ce droit n'est pas absolu. En effet, l'article 114 du code de procédure pénale prévoit que l'avocat doit préalablement informer le juge d'instruction des pièces qu'il entend communiquer à son client. Le juge dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces pièces par une ordonnance spécialement motivée « au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. » On le voit, l'exercice de la défense s'organise donc autour de deux droits : celui de consulter sur place le dossier et celui d'en obtenir une copie, y compris à destination de la personne mise en examen. Or, dans le cadre de l'affaire d'Outreau, la mise en œuvre de ces droits s'est heurtée à de sérieux obstacles qui découlent, pour partie, de l'insuffisance des moyens que nous accordons à notre justice. Ainsi Me Julien Delarue déclara qu'il lui avait « fallu attendre plus de sept mois pour obtenir la copie intégrale du dossier de la procédure. C'est ahurissant »446. Ce retard dans la délivrance des copies fut d'ailleurs l'une des raisons qui conduisit deux avocats, Mes Frank Berton et Hubert Delarue à demander, le 8 février 2002, le dépaysement de l'affaire d'Outreau, c'est-à-dire sa prise en charge par une autre juridiction, mieux équipée et organisée. Comme en a témoigné Me Frank Berton, « Il a été impossible, pendant de nombreux mois, d'obtenir des copies du dossier pénal, nonobstant les demandes qui étaient présentées par écrit au juge d'instruction. Nous avons obtenu une copie, à la fin du mois de janvier 2002, de parties du dossier. D'autres demandes de copie ont été émaillées d'incidents. Nous avons obtenu, de manière définitive, une copie du dossier, à raison de l'intervention du parquet général de Douai suite à notre requête, à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2002 »447. Cette impossibilité pour les avocats d'obtenir la copie du dossier était d'autant plus regrettable que le juge d'instruction procédait à de nombreux actes, en particulier des interrogatoires ou des confrontations, pour lesquels il était déterminant que la défense ait préalablement en sa possession la copie des actes ainsi réalisés. Certes, l'article 114 du code de procédure pénale dispose d'ores et déjà que la procédure est mise à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire, mais cela suppose donc que l'avocat vienne consulter sur place le dossier, ce qui ne va pas de soi lorsque les avocats sont inscrits dans un autre barreau que celui de la juridiction saisie, comme ce fut le cas dans l'affaire d'Outreau où certains avocats venaient de Lille ou d'Amiens. C'est pourquoi, afin de garantir l'accès au dossier, tant pour l'avocat que pour le mis en examen, la commission préconise trois séries de mesures : les premières subordonnent la réalisation des actes d'instruction à l'accès pour la défense à une copie du dossier avant la prise desdits actes ; les deuxièmes garantissent l'accès au dossier des mis en examen et les troisièmes consacrent le droit d'accès au dossier des personnes placées en détention provisoire. A. ASSURER L'ACCÈS AU DOSSIER POUR LA DÉFENSE Il serait désormais impossible de procéder à un interrogatoire ou une confrontation, si les avocats des personnes concernées n'ont pas en leur possession une copie à jour du dossier cinq jours ouvrables avant cet acte. Ce faisant, il s'agit de donner à la défense les moyens et le temps nécessaire à l'étude du dossier afin de conforter le caractère équitable de la procédure et l'égalité des armes entre le magistrat instructeur, le parquet et l'avocat. Par sa portée, cette proposition va bien au-delà du droit en vigueur qui se limite à organiser l'accès au dossier dans le cabinet du juge d'instruction, avec les difficultés que les avocats peuvent rencontrer selon la localisation de leur cabinet ou la personnalité du juge. Toutefois, cette obligation de mise à jour des copies ne vaudrait pas pour les actes en cours, comme c'est le cas aujourd'hui. Matériellement, le respect de cette obligation devrait entraîner une modernisation des méthodes de travail des greffes, et en particulier une accélération de leur recours à l'informatique. En effet, il est aujourd'hui beaucoup plus aisé et rapide de procéder à une ou plusieurs copies numériques d'un document que d'en assurer manuellement la reprographie. En outre, certains logiciels ou procédés informatiques garantissent désormais l'intégrité du document ainsi copié, ce qui devrait contribuer à lever d'éventuelles réticences liées à la crainte d'une falsification des documents. La commission souhaite donc que l'effort initié par la Chancellerie dans le cadre du programme d'action du « tribunal du futur » soit amplifié, afin de diffuser plus largement l'outil informatique, gage de gains de productivité, de célérité de la Justice et d'amélioration des conditions d'exercice des droits de la défense (cf. infra chapitre XV). B. PRÉVOIR L'ACCÈS DIRECT AU DOSSIER DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la personne mise en examen dispose d'un « droit indirect » d'accès à son dossier puisqu'il incombe à son avocat de solliciter l'autorisation du juge de lui communiquer tout ou partie des pièces. La commission estime, pour sa part, que la personne mise en examen, qui est, faut-il le rappeler, concernée au premier chef par l'issue de la procédure judiciaire, devrait bénéficier du droit d'accéder à son dossier sans restriction aucune. Toutefois, ce serait faire montre d'angélisme que d'ignorer les éventuelles pressions qui peuvent être exercées à l'encontre des victimes ou d'autres personnes mises en examen. C'est pourquoi, ce droit d'accès pourrait être limité par une décision spécialement motivée du collège de l'instruction lorsque l'instruction porte sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de la loi et que des pressions seraient susceptibles d'être exercées. Ce droit d'accès direct au dossier prend un relief particulier lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire. C. ORGANISER POUR LES PERSONNES PLACÉES EN DÉTENTION PROVISOIRE LA COMMUNICATION DE LEUR DOSSIER Il convient de garantir aux personnes placées en détention provisoire le droit d'avoir communication de leur dossier dans des conditions de confidentialité satisfaisantes. Les acquittés ont fait état de grandes difficultés à obtenir la communication des pièces de la procédure et à les consulter dans des conditions de confidentialité satisfaisantes, le témoignage apporté par Mme Odile Marécaux en étant la plus parfaite illustration. En effet, compte tenu de la promiscuité prévalant dans les maisons d'arrêt, il y est particulièrement difficile de conserver des pièces à l'abri de tout regard indiscret. Or, chacun connaît le traitement réservé en détention par leurs co-détenus aux personnes suspectées d'avoir commis des infractions sexuelles, qui sont désignées comme des « pointeurs » et sont soumises à des pressions, intimidations voire violences de toute nature. Dans ces conditions, il importe de préserver autant que faire se peut la confidentialité des pièces de la procédure communiquées au détenu, à défaut de quoi les droits de la défense ne sont plus respectés. Certains avocats ont, lors de leur audition, relayé cette préoccupation, à l'instar de Me Stéphane Dhonte : « Il faudrait également que le justiciable ait la possibilité d'avoir accès à son dossier. Il faut préciser que lorsqu'on envoie un dossier en maison d'arrêt, avec l'autorisation du juge, il n'y a pas de salle réservée pour le consulter. Or, l'intéressé ne va pas ouvrir un dossier de pédophilie dans sa cellule. Il faut donc lui aménager une possibilité de prendre connaissance de son dossier et des accusations qu'on porte contre lui. »448 La commission d'enquête souhaite donc que soient juridiquement et matériellement organisés au sein des maisons d'arrêt : - la communication au détenu des pièces du dossier de la procédure le concernant ; - l'aménagement de salles dédiées à leur consultation en toute confidentialité ; - la mise en place de lieux de dépôt sécurisé de ces documents situés en dehors des cellules et placés sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Enfin, certains membres de la commission, comme M. Étienne Blanc, ont suggéré la mise en place d'un registre dans les établissements pénitentiaires recensant les visites effectuées aux détenus par leurs avocats449. L'objectif poursuivi par cette proposition est d'améliorer l'implication des avocats dans les dossiers afin d'éviter que certains prévenus, comme M. Thierry Dausque dans l'affaire d'Outreau, ne bénéficient quasiment d'aucune visite de leur conseil en cours de détention. Cependant, la mise en place par l'administration pénitentiaire d'un tel registre soulève des objections sérieuses, puisqu'elle tendrait à faire de cette dernière l'organe de contrôle de l'activité des avocats. Puisque l'implication des avocats dans les dossiers relève de l'évaluation des pratiques professionnelles, il pourrait être envisagé d'inciter les bâtonniers et les ordres professionnels à y veiller davantage, le cas échéant sous la forme d'une obligation de vérification. VIII. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EXPERTISES La commission d'enquête s'est particulièrement préoccupée des expertises psychologiques et psychiatriques. L'amélioration de leur qualité devrait s'appuyer sur des dispositions propres à ce type d'expertises ainsi que sur des mesures d'ordre général sur le statut des experts. En tout état de cause, le renforcement des droits de la défense demeure la seule garantie de disposer d'expertises qui seront d'autant plus incontestables qu'elles auront été contestées. A. REDÉFINIR LE RÔLE DES EXPERTS PSYCHOLOGUES Le rôle d'auxiliaire occasionnel de justice que l'institution judiciaire confie aux psychologues suscite de nombreuses interrogations au vu des résultats de l'enquête menée par la commission parlementaire. Force est de constater que le verdict sévère que dressait le philosophe des sciences Georges Canguilhem en 1958, peut aujourd'hui encore être partagé : « [...] faute de pouvoir répondre exactement sur ce qu'il est, il est rendu bien difficile [au psychologue] de répondre de ce qu'il fait. [...] Il ne peut alors chercher que dans une efficacité toujours discutable la justification de son importance de spécialiste [...]. En fait, de bien des travaux de psychologie, on retire l'impression qu'ils mélangent à une philosophie sans rigueur une éthique sans exigence et une médecine sans contrôle. »450 Plusieurs éléments peuvent concourir à le nécessaire redéfinition du rôle du psychologue : l'introduction de règles de bonnes pratiques ; une meilleure appréhension de leurs missions par rapport à celles qui relèvent en particulier de l'expertise psychiatrique et la définition de missions-types. 1. Organiser une conférence de consensus et proposer des règles de bonnes pratiques Tirant les conséquences d'un constat valable encore près de cinquante ans après, la commission d'enquête estime nécessaire que les professionnels prennent l'initiative de mettre en place des éléments de référence. L'organisation d'une conférence de consensus, sur le modèle des conférences de consensus de la Fédération française de psychiatrie, devrait dans une première étape fournir l'occasion de procéder à une évaluation des méthodes et des concepts en usage dans les expertises psychologiques. Par exemple, des moyens d'analyse régulièrement utilisés comme le test de Rorschach et la grille d'analyse SVA pourraient voir leur méthodologie précisée. Cette conférence pourrait aussi avoir pour objet de mieux expliciter la spécificité de la psychologie légale. Tous les intervenants ont, en effet, été d'accord pour dire que l'expertise psychologique ne portait jamais sur les faits instruits par la procédure judiciaire - la commission d'un acte ne se déduisant pas mécaniquement de la personnalité de son auteur. Mme Colette Duflot expert psychologue honoraire a ainsi expliqué pendant son audition que : « L'expert peut décrire une personnalité immature et égocentrique, une intolérance grave à la frustration et une tendance à l'impulsivité, mais il ne peut jamais assurer que c'est bien ce sujet-là qui a commis les actes qui lui sont reprochés. Il peut seulement parler de " potentialités de violence ", mais il ne peut dire que la personne qu'il a examinée est celle qui a commis le meurtre pour lequel elle est mise en examen et dont elle nie être l'auteur. Il ne peut le dire pour une raison juridique, puisqu'il n'a pas à apporter de lumières sur la culpabilité du prévenu ; et il ne peut le dire pour une raison technique, car de la description d'une réalité psychique intérieure on ne peut faire le saut dans la réalité extérieure, de l'ordre des faits. »451 Les données psychologiques qu'est à même d'établir le psychologue éclairent ainsi une réalité qui n'est pas la même que celle sur laquelle sont interrogés les autres experts. Contrairement aux expertises réalisées par ces derniers, les conclusions des psychologues ne peuvent, par conséquent, constituer un élément de preuve et contribuer à la formation de la conviction intime du juge. Cette particularité de l'examen psychologique et la prise en compte des confusions dont elle fait souvent l'objet pourraient amener la Conférence de consensus à s'interroger sur la nature expertale de ces examens réalisés dans le cadre judiciaire. Il pourrait être envisagé de considérer que les missions confiées aux psychologues conduisent à dresser des bilans psychologiques qui, distingués des expertises, se verraient plus clairement identifiés dans leur contenu comme dans leur fonction. La rédaction d'un code de bonnes pratiques clarifierait, en outre, les devoirs de l'expert psychologue devant l'institution judiciaire. Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les missions d'expertise, les précautions qu'il convient de prendre pour que la connaissance du fond du dossier judiciaire n'oriente pas l'analyse de la personnalité examinée, le rappel de la nature interprétative des conclusions des expertises devraient en particulier faire l'objet de formulations explicites. Ces règles de bonnes pratiques pourraient s'inspirer des dispositions du code de déontologie médicale relatives à l'exercice de la médecine d'expertise - désormais intégrées dans le code de la santé publique - en particulier de son article R. 4127-106 qui dispose en effet : « Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. » 2. Mieux distinguer les missions relevant de la psychiatrie, de la psychologie et de la criminologie Ces missions se recouvrent en partie. Certaines questions posées aux uns peuvent l'être aux autres. Experts psychiatres et experts psychologues sont à l'occasion désignés conjointement, comme par exemple au procès d'Angers. Les différences de formation peuvent certes être une source de complémentarité mais aussi d'incompréhension. Dans une note remise à l'occasion de son audition devant la commission d'enquête, le docteur Bernard Cordier, expert psychiatre, suggère l'organisation « d'une conférence de consensus relative à l'établissement d'un référentiel commun aux expertises pénales psychiatriques et psychologiques ». Ayant pu constater au travers des auditions de plusieurs experts relevant de ces deux spécialités, ainsi que des expertises réalisées dans le cadre de l'affaire d'Outreau, l'écart dans la pratique comme dans les résultats qui sépare ces spécialités, la commission d'enquête invite ces deux professions à définir des positions communes sur le rôle qu'il convient de reconnaître à chacun et sur le sens des notions utilisées en commun. Par ailleurs, comme l'indique le docteur Bernard Cordier, ni les psychiatres ni les psychologues ne sont des criminologues. Des questions de criminologie leur sont toutefois posées, comme la question du passage à l'acte ou de la détermination d'un profil d'agresseur. Afin que chaque spécialiste œuvre dans un champ de compétence bien distinct et que l'institution judiciaire définisse des missions correspondantes, il conviendrait de mieux identifier les connaissances de chacun et les titres qui les attestent. 3. Proposer une mission-type aux experts psychologues et psychiatres Dans le but d'éviter que le contenu de la mission confiée à l'expert, qu'il soit psychologue ou psychiatre, ne l'entraîne à formuler des conclusions ne relevant pas de sa compétence, afin aussi de prendre en compte le fait que la psychologie se distingue notoirement des sciences exactes et de combattre les illusions que peut entretenir l'institution judiciaire quant aux pouvoirs explicatifs de cette discipline, il est proposé que toute mission d'expertise soit définie sur la base d'une liste close de questions types. En seraient exclues, entre autres, la question de l'imputation des faits, la question de la crédibilité, source de trop de confusions, la question portant sur les traits caractéristiques des abuseurs sexuels, rejetée par la conférence de consensus des experts psychiatres en 2003 et la question portant sur le sens moral, dont la formulation est particulièrement peu pertinente. Le « rapport Viout » a proposé un projet de mission-type. La possibilité donnée à l'expert de faire part au magistrat de toute information ou observation utile à la manifestation de la vérité devrait être conservée dans la mission-type. Elle invite, en effet, l'expert à aider à la lecture de son rapport en communiquant au magistrat des explications de méthode et d'éventuelles réserves d'interprétation. Il conviendrait que la mission-type, comme l'a suggéré Mme Geneviève Cédile, expert psychologue, soit le « fruit d'une réflexion commune des magistrats, des experts et des avocats. »452 Pour que la mission-type ne soit pas une simple recommandation, il est suggéré que soit créée, auprès du garde des Sceaux, une commission composée de magistrats, d'avocats et de représentants des psychologues et psychiatres agréés qui aurait pour mission de définir la liste close de questions types et de la faire évoluer en fonction des progrès des connaissances. Cette liste ferait l'objet ensuite d'un décret simple. B. AMÉLIORER LE STATUT DES EXPERTS Si les travaux de la commission d'enquête ont fourni l'occasion de mesurer l'ampleur de la réflexion à ouvrir sur le statut de l'expert, deux actions semblent devoir être engagées en priorité. Elles portent sur l'impartialité de l'expert et sur sa rémunération. 1. Renforcer le contrôle de l'impartialité Les dispositions relatives aux experts de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et celles du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 ont renforcé le contrôle des inscriptions sur les listes d'experts. Une période probatoire de deux ans a été instaurée pour les inscriptions sur les listes des cours d'appel, à l'issue de laquelle l'expert, sur présentation d'une nouvelle candidature, peut solliciter une réinscription pour une durée de cinq ans. L'inscription sur la liste nationale est d'une durée de sept ans et a pour condition l'inscription pendant trois années consécutives sur une liste de cour d'appel. Une échelle de sanctions disciplinaires a été définie. Elle comporte l'avertissement, la radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans et la radiation ou le retrait de l'honorariat. L'impact de ces mesures récentes ne peut pas encore être évalué. Les pratiques contestables de certains experts dans l'affaire d'Outreau conduisent néanmoins la commission d'enquête à proposer que le nouveau dispositif mis en place en 2004 soit précisé sur deux points. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifié par la loi du 11 février 2004, la réinscription de l'expert sur les listes de cours d'appel, à l'issue de la période probatoire de deux ans, est liée à l'avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. Chargée d'évaluer l'expérience de l'intéressé et sa connaissance des principes et des règles de procédure, cette commission est composée de dix magistrats, d'un membre des juridictions commerciales, d'un membre des conseils de prud'hommes et de cinq experts. La présence de représentants d'avocats n'est pas prévue. De fait, l'absence d'avocats dans cette commission a pour conséquence que les candidats ne font pas l'objet d'une estimation croisée. Évalués par des représentants de l'institution judiciaire et par leurs pairs, les experts ne le sont pas par les conseils des parties dont le sort judiciaire est pourtant souvent lié aux résultats de leurs travaux. Il conviendrait également de prendre en compte le rôle accru du conseil dans une procédure d'expertise amenée à s'inscrire de plus en plus dans une démarche contradictoire ; l'avocat acquérant les moyens procéduraux d'exercer un contrôle sur les expertises, il devrait aussi en disposer pour contrôler la qualité des experts. La commission d'enquête propose d'associer des représentants des avocats aux travaux de la commission chargée de rendre un avis sur les réinscriptions des experts sur les listes de cour d'appel. Leur nombre ne saurait être inférieur à celui des experts. La commission d'enquête a, par ailleurs, constaté les difficultés d'apprécier l'impartialité d'un expert dont l'engagement dans des activités associatives est susceptible de créer un conflit d'intérêt avec l'affaire dans laquelle il est commis. Elle partage la préconisation faite par le « rapport Viout » d'instaurer « une obligation de déclaration d'appartenance à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale » lorsque l'affaire porte « sur des faits pour lesquels cette association peut se porter partie civile »453. Afin que l'engagement associatif de l'expert puisse être apprécié, au regard de son impartialité, par tous les participants au procès, il conviendrait que la déclaration fasse l'objet d'une notification à toutes les parties. 2. Réviser les critères de rémunération L'amélioration de la qualité des expertises ne peut être envisagée sans une revalorisation de leurs tarifs. Les bases forfaitaires fixées aux articles R. 116 à R. 120-2 du code de procédure pénale conduisent à des évaluations d'actes insuffisantes : le montant de l'expertise psychologique est de 172,80 euros, celui des expertises psychiatriques est de 205,80 et de 222,95 euros pour les expertises psychiatriques pratiquées en matière d'infractions sexuelles. Une meilleure rémunération des expertises psychiatriques contribuerait en particulier à lutter contre la désaffection des psychiatres pour cette activité. En 1996, il y avait 15,32 % de psychiatres en plus qu'en 2006 et 18,46 % de psychologues en moins. Le nombre d'experts psychiatres en 2006 est de 630 pour 13 000 psychiatres recensés en 2003, une baisse importante de leur nombre étant probable dans les prochaines années454. Le nombre d'experts psychologues est en 2006 de 469 pour 32 000 professionnels recensés. Comme l'a souligné au sujet des experts psychiatres la commission Santé-Justice dans son rapport remis en juillet 2005 : « Dans ces conditions, les magistrats sont souvent amenés à solliciter les mêmes praticiens, qui deviennent ainsi, de fait, spécialisés dans la fonction expertale [...] Le recours à des " experts en série " risque [...] d'engendrer, au fil des années, une diminution de la compétence de ces derniers et un manque de recul par rapport à leur mission. » Afin de rendre plus attractive la fonction d'expert et ainsi de diversifier les désignations, en particulier des psychiatres, il conviendrait non seulement de relever les bases forfaitaires mais aussi de mieux prendre en compte la complexité de certaines expertises, en adaptant la rémunération au travail effectivement fourni455. Une meilleure rémunération des travaux d'expertise justifierait néanmoins un contrôle plus strict des délais de remise des rapports. Les retards constatés devraient donner lieu à des pénalités. Il convient, par ailleurs, de replacer toute réforme du paiement des expertises par rapport à l'évolution importante des frais de justice. La dépense en cette matière a augmenté de près de 48 % de 2000 à 2004456. Le montant des sommes consacrées aux frais d'expertises psychiatriques et psychologiques a connu une augmentation moindre mais qui demeure conséquente : 13 % depuis 2003. Ce montant s'est élevé en 2005 à 17,68 millions d'euros pour toutes les juridictions soit 22 % des sommes versées pour les dépenses de médecine légale et 3,7 % des sommes payées au titre des frais de justice. Un système plus souple de fixation des montants d'expertises devra faire l'objet d'un strict contrôle. Le système d'expertise professionnelle mis en place en Italie dans lequel l'expert fixe lui-même un certain nombre de vacations suscite en ce sens des interrogations, le montant de l'expertise psychologique étant facturé à Rome environ 950 euros. En Allemagne, le montant pour une expertise psychologique ou psychiatrique complexe s'élève à 85 euros l'heure ; cependant ce coût ne reste à la charge du ministère de la justice que dans le cas où le tribunal ordonne la relaxe du prévenu. Le troisième axe de la réforme à mener sur le terrain de l'expertise porte sur les droits de la défense dans la procédure d'expertise. C. CONSOLIDER LES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA PROCÉDURE D'EXPERTISE L'absence de discussion contradictoire des expertises dans l'affaire d'Outreau, la place faite au juge d'instruction dans la procédure, la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et le précédent de la réforme de 1957 sont autant d'éléments de réflexion conduisant à préconiser le renforcement des droits de la défense dans la procédure d'expertise. 1. Les conséquences d'une procédure expertale conduite sans contradiction Dans l'affaire d'Outreau, les experts désignés l'ont été sur la base d'une réputation locale ou nationale qui paraissait indiscutable du seul point de vue du magistrat instructeur. Des expertises diligentées, il pouvait, en outre, difficilement ressortir des opinions divergentes, la nomination des experts s'étant portée sur un groupe restreint de psychiatres et de psychologues et ces derniers ayant été de surcroît nommés plusieurs fois - jusqu'à trois reprises pour l'un d'entre eux. Les contenus des examens ont été déterminés par des choix méthodologiques univoques et les conditions de rédaction des rapports ont été laissées à la seule conscience professionnelle de leurs auteurs. Après le dépôt des conclusions des experts, toutes les demandes de contre-expertises formulées par les mis en examen et leurs conseils ont été rejetées par le magistrat instructeur. La saisine de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a été, à une occasion, refusée par son président. Les appels des rejets des contre-expertises sur lesquels a statué la chambre de l'instruction ont été rejetés. Il en est résulté que la vérité psychologique reconnue pendant toute la durée de l'instruction a été figée : les enfants étaient crédibles dans leurs accusations et les adultes étaient dotés de personnalités en accord avec les charges qui pesaient sur eux. Seuls les interrogatoires des experts auxquels ont pu procéder les avocats des mis en examen pendant le procès d'assises ont permis de leur porter la contradiction, trois ans après les premières expertises, et de faire émerger une réalité différente. L'affaire d'Outreau semble ainsi avoir réuni toutes les conséquences négatives possibles des spécificités procédurales des expertises réalisées en matière pénale. Le magistrat instructeur s'est contenté d'un choix restreint d'experts. L'absence de contrôle de la procédure de l'expertise a donné aux experts une liberté, dans la façon d'accomplir leur mission, dont ils ont pu abuser. L'absence de contre-expertise a repoussé l'exercice effectif des droits de la défense à l'audience de jugement. 2. Une procédure sous le contrôle exclusif du juge Le bilan précédemment tiré suscite d'autant plus d'interrogations que les dispositions légales en vigueur, déclinées par les articles 156 à 169 du code de procédure pénale, offrent de nombreuses possibilités - renforcées par les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 - de faire participer les parties à la procédure de contrôle de l'expertise. Ainsi, la partie peut, dans sa demande d'expertise, préciser au juge d'instruction le contenu de la mission qu'elle souhaite voir réaliser par l'expert et, au cours de l'expertise, demander qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne susceptible de lui fournir des renseignements techniques ; l'expert peut, pour l'accomplissement de sa mission, recevoir des déclarations des parties. Une fois le rapport de l'expert rendu, la partie est destinataire d'une notification de dépôt ; dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, elle a la possibilité de faire des observations ou de former une demande de complément d'expertise, de contre-expertise ou de nouvelle expertise. Le juge d'instruction a l'obligation de motiver tout rejet de demande d'expertise. La partie peut faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Néanmoins, à l'exception des dispositions portant sur l'audience de jugement, l'intervention des parties dans l'expertise est liée, à chacune de ces étapes, à l'accord du juge d'instruction et à l'appréciation de la chambre de l'instruction éventuellement saisie en appel. En dépit des aménagements apportés par les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004, la phase expertale demeure donc insérée dans le mécanisme unilatéral de l'instruction. Seule l'audience de jugement permet de discuter contradictoirement des expertises. Aux termes des articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale, l'avocat peut interroger l'expert déposant à la barre, lui opposer par conséquent l'avis d'un autre expert appelé comme témoin et, selon les dispositions de l'article 169 du code précité, faire prendre en considération par le président d'audience la mise en évidence d'éventuelles contradictions. 3. Les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme Deux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme permettent d'apprécier la procédure expertale en droit français au regard des principes de la convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêt Mantovanelli, rendu le 18 mars 1997 (1997, II), a condamné la France pour avoir jugé que la possibilité de discuter contradictoirement des conclusions d'une expertise devant le tribunal constituait une garantie suffisante pour le justiciable. La Cour a estimé que les conclusions des experts « étaient susceptibles d'influencer de manière prépondérante[l]'appréciation des faits [par le juge] ». En conséquence, le requérant n'ayant pas eu, en l'espèce, la possibilité de discuter contradictoirement d'une expertise avant l'audience de jugement, alors que la question à laquelle l'expert était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal, celui-ci s'est trouvé dans une position d'inégalité que n'a pas été à même d'équilibrer la possibilité de discuter les conclusions devant ce même tribunal. Au vu de cet arrêt, il apparaît que la phase de l'expertise technique ne saurait constituer un moment neutre dans la procédure, une étape au cours de laquelle l'intérêt des parties n'apparaît pas. La Cour rappelle ainsi que : « l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6-1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. » L'arrêt G.B. c/ France, en date du 2 octobre 2001 (X, 4 4069 98), a condamné un refus de contre-expertise qu'un plaignant avait demandée suite à une volte-face, pendant l'audience de jugement, de l'expert psychiatre qui l'avait examiné. La Cour a considéré qu'à cette occasion, il avait été « porté atteinte aux règles du procès équitable et au respect des droits de la défense. » Elle a précisé en particulier que « le principe de l'égalité des armes [...] - l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. » La cour européenne a ainsi mis en avant la valeur prépondérante que peut présenter l'expertise dans l'appréciation des faits par le juge et en a tiré des conséquences au regard de l'article 6 de la convention, en jugeant que l'absence de contrôle des parties pendant la réalisation de l'expertise pouvait rendre l'acte contraire au principe de la discussion contradictoire des faits et que les mauvaises conditions de production des conclusions de l'expertise pouvaient rendre la procédure contraire au principe de l'égalité des armes. Il apparaît par conséquent que, selon la jurisprudence de la Cour, l'expert fait plus qu'« éclairer » le juge, selon les termes de l'article 232 du code de procédure civile. Quand la reconstitution des faits à juger procède de l'œuvre quasi exclusive de l'expert ou que l'appréciation des circonstances par l'expert peut présenter un caractère déterminant, le principe général de procès équitable posé par l'article 6 de la Convention ouvre un droit à contester les éléments d'appréciation ainsi réunis. En droit interne, la question du contradictoire en matière d'expertise est ancienne. Tirant le bilan de nombreux projets antérieurs, le législateur de 1956, dans son « audace réformatrice », avait proposé un dispositif, précisé en 1957, dont le but était « de provoquer toutes les contradictions au moment de l'expertise et non au cours de toutes les phases du procès au gré des incidents de procédure »457. Les dispositions les plus novatrices de cette réforme figuraient à l'article 159 du code de procédure pénale et portaient sur la phase de désignation de l'expert. « Art. 159 - Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties et préciser les nom et qualités de l'expert ainsi que le libellé de la mission qui lui est donnée. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné. Dans le même délai, et si la décision émane d'un juge d'instruction, l'inculpé ou son conseil pourra, en outre, choisir un autre expert qui sera alors également désigné par le juge d'instruction. S'il y a plusieurs inculpés, ils devront se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement en cas d'opposition d'intérêts, pourra porter sur deux experts au plus. Lorsqu'un expert est choisi hors des listes prévues à l'article 157, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, refuser de le désigner. Cette ordonnance est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles 185 et 186. [...] » Ce dispositif initiait une procédure contradictoire sur deux phases de l'expertise. D'une part, il prévoyait que le choix de l'expert et la nature de la mission que lui fixe le juge d'instruction pouvaient faire l'objet d'observations des parties. D'autre part, la procédure de l'expertise était de droit soumise au contrôle d'un expert choisi par les parties. L'expertise devenait ainsi un acte de procédure qui n'était plus la chose du juge. Ces dispositions ont été supprimées par l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958. 5. Des expertises discutées contradictoirement et ouvrant un droit à la contre-expertise Forte de tous ces éléments et compte tenu de l'expérience de l'affaire d'Outreau, la commission d'enquête propose que la procédure d'expertise soit conforme au principe posé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, aux termes duquel « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». Il convient, en conséquence, que les conseils des parties puissent débattre de la désignation de l'expert, du contenu de sa mission et des conclusions de son rapport. Si le conseil estime que le processus de l'expertise ne s'est pas fait avec objectivité ou en conformité avec les règles régissant les connaissances de l'expert, il pourrait formuler une demande de contre-expertise qui serait de droit. Les avocats des parties interviendraient ainsi dans la phase préparatoire et dans la phase conclusive de l'expertise. Dans un second temps, la partie intéressée aurait la possibilité de procéder à une évaluation contradictoire du contenu de l'expertise réalisée en faisant appel à un autre expert qui procèderait à un nouvel examen. Le collège de l'instruction serait ainsi amené à notifier aux parties le nom de l'expert qu'il entend désigner et le contenu de la mission qu'il lui demande de réaliser. Les observations des parties pourraient être prises en compte par le magistrat instructeur et figureraient, en tout état de cause, dans le rapport final d'expertise. Les conclusions de l'expertise seraient consignées dans un pré-rapport transmis aux parties. Ce pré-rapport serait l'objet d'un débat contradictoire devant le collège de l'instruction, si la partie le demande, ou d'observations écrites. Le procès verbal du débat contradictoire ou les dires des parties seraient joints au rapport final. À l'issue de cette procédure, la partie à laquelle il apparaît que les opérations menées par l'expert ont été défaillantes pourrait demander une contre-expertise dont la réalisation serait de droit. Le collège de l'instruction désignerait l'expert choisi par la partie sur les listes des experts agréés. En cas d'opposition d'intérêts entre les parties, il pourrait être procédé, comme le prévoyaient les dispositions de 1957, à la nomination au plus de deux experts. Il reviendrait ainsi au collège de l'instruction de décider de l'opportunité de l'expertise, de désigner l'expert et de fixer sa mission. La partie interviendrait de droit avant comme après la réalisation de l'acte, sous forme d'observations et de dires joints au rapport final ; en cas de désaccord, ce rapport contenant les arguments échangés ne pourrait présenter de caractère péremptoire. La contre-expertise apporterait les éléments d'une discussion contradictoire du contenu de l'analyse ; ne porter la contradiction sur le fond de l'acte qu'en un second temps préserverait la possibilité pour les parties de s'estimer satisfaites des résultats de la première expertise ou de considérer suffisantes les observations qu'elles ont formulées à cette occasion. IX. MIEUX PROTÉGER LES INTÉRÊTS DES ENFANTS L'amélioration de la protection des intérêts des enfants pourrait être articulée autour de six axes complémentaires : la transmission des informations et la coordination des services concernés en cas de soupçon de maltraitance ; l'élargissement des possibilités de saisine du juge des enfants ; l'amélioration de l'information des services sociaux sur les recours possibles en cas de classement sans suite des signalements ; l'assouplissement de l'obligation de l'adhésion de la famille et du maintien du lien familial dans des cas extrêmes ; l'articulation des rapports entre juges compétents et enfin l'attribution au Défenseur des enfants du suivi des enfants des personnes en détention provisoire. A. TRANSMETTRE LES INFORMATIONS ET COORDONNER LES DIFFÉRENTS ACTEURS CONCERNÉS EN CAS DE SOUPÇONS DE MALTRAITANCE La façon dont les soupçons ou indices de maltraitance concernant les enfants Delay ont pu s'accumuler, durant de longs mois avant l'ouverture d'une information judiciaire, a fait clairement apparaître la persistance dans notre pays de certains cloisonnements dans la transmission des informations. Les services directement habilités à les recevoir étaient insuffisamment coordonnés. Or, comme le montrent certains exemples étrangers, une telle situation n'a rien d'inéluctable. À cet égard, l'approche multidisciplinaire menée au Québec pourrait constituer une référence intéressante458. Récemment, une « Entente multisectorielle » relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant leur santé physique a remplacé les deux ententes de 1989 et 1992 entre le réseau social et celui de l'éducation dans les affaires d'agressions sexuelles. Cinq ministères sont signataires de cette entente : Éducation, Sécurité publique, Justice, Famille et Enfance ainsi que Santé Services sociaux. L'élargissement de ces ententes a visé à intégrer l'ensemble des intervenants du système pénal (police et justice), afin de faciliter la coordination entre la procédure d'assistance éducative et la procédure pénale. L'objectif était également d'intégrer les services de garderie de la petite enfance qui ne dépendent pas du circuit scolaire. Cette entente couvre cinq étapes : le signalement, la liaison, l'enquête et l'évaluation, la prise de décision et l'action. Elle instaure l'obligation, pour tout citoyen, d'effectuer un signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), dès qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un mineur est victime d'abus sexuels. Cette obligation pèse également sur tout professionnel : policier, professeur, médecin, psychologue... Dès que le DPJ est saisi, une concertation a lieu, y compris en cas d'urgence par conférence téléphonique, avec la police et le procureur, pour envisager les différentes mesures à prendre, pour arrêter une stratégie sur l'évaluation de la situation et pour coordonner les différentes enquêtes administratives (par l'école ou le service de garderie...), pour prévenir les autres familles, les médias, pour démarrer l'enquête policière et l'enquête de la DPJ. Si des mesures urgentes ont été prises par un des partenaires, il doit immédiatement en faire part aux autres. Les conditions d'audition du mineur sont définies en concertation entre les policiers, la DPJ et, le cas échéant, le responsable de l'institution dont dépendait le mineur au moment des faits. Cette audition peut se faire dans des locaux aménagés dans les commissariats de police. La collaboration des policiers et des travailleurs sociaux a considérablement amélioré la qualité de l'audition des mineurs et l'enregistrement vidéo évite à ces derniers de répéter leur histoire et de revivre ainsi les traumatismes qui y sont liés. La collaboration entre services enquêteurs, travailleurs sociaux et procureurs a également permis de valider les procédures d'enquête et donc de mieux préparer les dossiers judiciaires, tout en assurant au plus vite la protection des victimes. L'étape de la prise de décision vise à favoriser l'émergence d'un consensus entre les différents intervenants sur la stratégie à adopter et sur les décisions à prendre : pour protéger la victime, pour soutenir les parents, pour engager une procédure criminelle, pour éviter le renouvellement des faits... Tout au long du processus, le DPJ doit désigner un intervenant qui suivra le mineur et sa famille pour leur apporter aide et soutien et pour les informer des décisions prises. Tous les intervenants interrogés reconnaissent que la mise en œuvre de cette entente a été difficile et a exigé du temps. Mais ils expriment leur satisfaction devant l'amélioration sensible de la prise en charge des mineurs victimes d'abus sexuels. Le résultat positif de cette expérience a amené le gouvernement québécois à étendre les mêmes procédures aux cas de maltraitance. Dans notre pays également, comme l'a souligné M. Bernard Derosier, membre de la commission d'enquête, il serait nécessaire d'imposer la coordination de l'ensemble des acteurs intervenant dans la vie des enfants susceptibles d'être victimes de maltraitances. Au-delà de l'amélioration des échanges des signaux d'alerte, la commission d'enquête estime nécessaire d'améliorer la réactivité des différents acteurs concernés, face à la réception voire - comme ce fut le cas dans l'affaire d'Outreau - à l'accumulation de tels signaux d'alerte. Aussi la commission souligne-t-elle la nécessité d'assurer le décloisonnement des services sociaux, la concertation des personnels compétents médicaux et sociaux et la création d'un centre de signalement départemental. 1. Décloisonner les services sociaux Les cloisonnements entre les différents services sociaux chargés de suivre une même famille ou un même enfant doivent disparaître : les services des conseils généraux chargés de l'aide sociale à l'enfance devraient être systématiquement destinataires des rapports et notes établis par la Protection judiciaire de la jeunesse et réciproquement. L'organisation de réunions communes au niveau local entre les différents acteurs de terrain (Unité territoriale d'action sanitaire et sociale - UTASS - et Comité d'action éducative - CAE - dans le cas d'Outreau) doit permettre le suivi des familles à risques. 2. Favoriser la concertation des personnels médicaux et sociaux De même, l'organisation de réunions, en milieu hospitalier, entre personnel médical et représentants des services sociaux, devrait être systématisée, afin que puissent être effectués les recoupements permettant de conforter des soupçons de maltraitance ou d'abus sexuels. Dans le cadre du suivi de la fratrie Delay, de tels échanges auraient été très utiles. 3. Créer un centre de signalement départemental La création dans chaque département d'un centre de signalement, chargé de recenser, centraliser et traiter des suspicions de maltraitance, devrait être réalisée. Les signalements au parquet requièrent, en effet, des preuves plus tangibles qu'il n'est pas toujours possible de réunir, y compris pour des médecins459. Cette possibilité de s'adresser à un centre de signalement pourrait être ouverte aux autres professionnels de l'enfance, voire à tout citoyen. Rappelons que les instituteurs s'étaient inquiétés du comportement des enfants Delay dès la maternelle, notamment dès 1996 à propos de Jean, qui se mettait sans cesse en danger, agressait les autres et présentait un retard scolaire très important alors que dans les informations transmises ne figurait pas encore d'élément à connotation sexuelle. Une telle structure apporterait une valeur ajoutée par rapport au numéro d'appel 119 de l'enfance maltraitée, dans la mesure où elle centraliserait et traiterait l'information, en signalant les phénomènes de maltraitance. Cette proposition rejoint le dispositif présenté par le Gouvernement à l'article 5 du projet de loi réformant la protection de l'enfance, déposé au Sénat par le ministre de la santé et des solidarités460. Ce texte prévoit l'établissement de protocoles entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire, en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle et l'évaluation de ces informations. Après évaluation, les informations individuelles doivent faire, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au-delà de cette action sur le seul terrain administratif, le juge des enfants doit également voir son rôle renforcé. B. ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS DE SAISINE DU JUGE DES ENFANTS En application de l'article 375 alinéa premier du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. » L'élargissement des possibilités de saisine du juge des enfants peut emprunter plusieurs formes. Celui-ci pourrait être saisi directement par les médecins. Sa saisine par les services sociaux gagnerait à être clarifiée. Son auto-saisine devrait être facilitée en cas de danger pour l'enfant. Enfin sa saisine systématique en cas de procédure engagée par le parquet pour violences familiales contre un mineur devrait être prévue. 1. Ouvrir aux médecins une possibilité de saisine directe du juge des enfants Les personnes ou autorités habilitées à saisir le juge des enfants en vue d'une assistance éducative sont limitativement énumérées par l'article 375 précité du code civil. Sans ouvrir trop largement cette liste, ce qui risquerait d'accroître de façon substantielle le nombre de dossiers d'assistance éducative à gérer dans chaque cabinet (600 à 700 dossiers à Boulogne-sur-Mer), il pourrait être envisagé de l'étendre aux médecins. Ainsi pourrait être apportée une réponse au souci exprimé par l'un d'eux lors de son audition461. Cette disposition leur permettrait de saisir l'autorité judiciaire, en l'absence d'éléments de preuve certains justifiant la saisine directe du parquet. Le juge des enfants pourrait ainsi recouper, le cas échéant, ces signalements d'origine médicale avec ceux émanant des services sociaux. Il conviendrait évidemment de veiller à ce que cette disposition ne soit pas détournée de son objet et utilisée sur demande d'un parent, dans le cadre d'une procédure de divorce, le nombre d'allégations d'atteintes sexuelles sur l'enfant de la part du conjoint s'étant multiplié dans ce cadre au cours des dernières années. Toutefois, les médecins qui seraient sollicités de façon douteuse dans un tel contexte ayant la possibilité de renvoyer le parent accusateur à son propre droit de saisine directe du juge des enfants, ce risque de détournement pourrait être facilement évité. 2. Clarifier les possibilités de saisine du juge des enfants par les services sociaux La possibilité pour les services sociaux de saisir le juge des enfants devrait être clarifiée. Dans la rédaction actuelle de l'article 375, une saisine à la requête « de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié », qui se trouve donc « gardien » de l'enfant est possible. La jurisprudence considère que la qualité de gardien peut être reconnue au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Les services sociaux locaux doivent donc en déférer à leur service départemental, pour que ce dernier transmette éventuellement un signalement au juge des enfants. Bien qu'acteurs de terrain au contact des enfants et alors que le responsable départemental n'est pas amené à les rencontrer, ils n'ont pas de possibilité de saisine directe. Mais surtout ce responsable n'est, si l'on s'en tient au texte, habilité à saisir le juge des enfants que lorsque l'enfant est déjà confié à l'ASE. Dans le cas d'une fratrie comme les enfants Delay, les rapports de suivi d'un enfant déjà pris en charge peuvent servir de support à la transmission d'informations sur l'évolution de la famille ; le juge peut être ainsi amené à prendre des mesures d'assistance éducative pour le reste de la fratrie. Mais ce système a ses limites. D'une part, cette possibilité indirecte de transmission d'informations, largement utilisée par les services sociaux et la responsable de l'ASE dans le cas de la famille Delay, n'a pas suffi à attirer l'attention et à déclencher une réaction rapide du juge des enfants. D'autre part, les services sociaux ne disposent pas, en application de l'article 375, de ce moyen de saisine dans le cas de soupçons de maltraitance sur un enfant qui n'appartient pas à une fratrie déjà suivie par l'ASE ou qui ne lui a pas été déjà lui-même confié. Cela serait sans importance si le juge pouvait se saisir facilement lui-même, quelle que soit sa source d'information. Tel n'est pas le cas. 3. Faciliter l'auto-saisine du juge des enfants en cas de danger pour l'enfant L'auto-saisine du juge des enfants est déjà légalement prévue : le premier alinéa de l'article 375 dispose en effet in fine : « Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. » Plusieurs personnes auditionnées se sont référées à cette possibilité en précisant toutes qu'elle n'était cependant quasiment jamais appliquée. Mme Claire Beugnet, responsable de l'ASE, l'a confirmé, en précisant que chaque juge appréciait ce texte à sa façon. Mme Hélène Sigala, juge des enfants, a estimé que le parquet devait continuer à jouer un rôle de filtre. M. Érik Tamion, juge des enfants, a indiqué que cette possibilité était en pratique utilisée uniquement lorsque plusieurs enfants étaient déjà suivis et qu'un autre venait à naître, alors que la problématique de la famille restait la même. Il apparaît donc que maintenir dans les textes le caractère exceptionnel de l'auto-saisine du juge des enfants, sans autre précision, n'est pas de nature à favoriser une réaction rapide, face à une situation préoccupante. Une telle rédaction peut s'avérer déresponsabilisante pour le juge et l'inciter à attendre une accumulation d'informations à caractère inquiétant avant de décider d'une mesure d'assistance éducative. Le filtre parfois exercé par le parquet, qui peut prendre la décision de classer sans suite un ou plusieurs signalements judiciaires dans le cadre du suivi d'une famille, n'est pas non plus de nature à inciter le juge des enfants à réagir différemment, lorsqu'arrivent dans son cabinet d'autres informations préoccupantes concernant la même famille. Dans le suivi de la famille Badaoui-Delay, les informations se sont ainsi « empilées » jusqu'au placement en urgence du 25 février 2000, sur demande d'ailleurs de la mère. Enfin, un juge des enfants peut avoir eu accès à des informations qui le conduisent à penser que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises, sans avoir pour autant été saisi par les personnes expressément habilitées à le faire en application de l'article 375. C'est pourquoi il pourrait être envisagé de remplacer la rédaction : « le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel » par les mots : « le juge peut se saisir d'office en cas de danger pour l'enfant. » Une telle disposition ne porterait pas atteinte au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, puisque lorsqu'il intervient dans ce cadre, le juge des enfants statue seul et n'inflige aucune peine. Il ordonne simplement une mesure d'assistance éducative. 4. Saisir systématiquement le juge des enfants en cas de procédure du parquet pour violences familiales contre un mineur Une saisine systématique du juge des enfants en assistance éducative doit être prévue, dès lors qu'une procédure est ouverte par le procureur en cas de violences, sexuelles ou non, d'origine intra-familiale commises contre un mineur. Il s'agit là d'une proposition développée dans le « rapport Viout »462. Le rapport précise à juste titre que des suspicions d'actes de cette nature, intervenant dans un tel contexte, exigent qu'un juge des enfants intervienne sans attendre le résultat des investigations pénales. Il recommande d'informer systématiquement le juge des enfants des suites données à ces investigations, y compris s'il s'agit d'un classement sans suite. Cette préconisation présente un intérêt d'ordre général, même si elle n'aurait pas eu d'impact particulier dans le suivi de la famille Badaoui-Delay. En effet, le signalement auprès du parquet, en décembre 1998, de l'agression sexuelle dont aurait été victime le jeune Jean au cours de l'été 1997, classé sans suite, faisait état d'une agression commise par un tiers ; il n'y eut donc pas, à cette occasion, d'allégations de maltraitances physiques ou sexuelles d'origine intra-familiale. Par ailleurs, cet enfant faisait, déjà à cette époque, l'objet d'une mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants en juin 1998. Dans une telle hypothèse, l'article 706-49 du code de procédure pénale est donc applicable, dispositif dont le « rapport Viout » a souligné l'intérêt : « Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime d'une agression sexuelle et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction. » Si une implication plus forte du juge des enfants doit être envisagée, on ne saurait négliger l'action des services sociaux en cas de classement sans suite de leurs signalements. C. AMÉLIORER L'INFORMATION DES SERVICES SOCIAUX SUR LES RECOURS POSSIBLES EN CAS DE CLASSEMENT SANS SUITE DE LEURS SIGNALEMENTS L'examen des notes établies par les services sociaux a mis en évidence le caractère tardif de la réaction aux informations transmises : à plusieurs reprises, la Commission d'enquête s'est demandée si, au vu de tels signalements, un placement d'autorité des enfants Delay n'aurait pu être envisagé plus tôt et s'est interrogée surtout sur la marge de manœuvre des services sociaux dans de tels cas. Ainsi, lorsque le rapporteur a demandé aux représentants de l'UTASS s'ils avaient ressenti un motif d'inquiétude pour la sécurité des trois enfants Delay avant le 25 février 2000, et si en conséquence un placement d'autorité avait été à un moment ou un autre envisagé auparavant, l'une des assistantes sociales a expliqué : « Ce n'était pas à nous de le demander, mais en mai 1996, nous avions envoyé un signalement qui a été classé sans suite. La seule solution, dans ces conditions, était de continuer à suivre la famille, en mobilisant les partenaires du centre médico-psychologique. »463 Le chef de service socio-éducatif local a, pour sa part, précisé qu'il aurait souhaité une réaction plus rapide et plus ferme. Le rapport de l'UTASS joint à ce signalement, soulignant les difficultés rencontrées sur le terrain pour collaborer avec la famille Delay, enlevait toute portée à l'explication fournie à cette époque à la responsable de l'Aide sociale à l'enfance pour justifier ce classement sans suite, à savoir l'absence de danger du fait de la collaboration de la famille. Il est manifeste qu'à ce niveau, l'échange d'informations a mal fonctionné : la décision de classement a été prise en l'espace de trois jours, sans consultation des acteurs de terrain ni même apparemment de leur rapport. Elle n'a fait l'objet d'aucune remise en cause, alors qu'il eût été facile de la contester. Cet écueil aurait pu être évité si le parquet avait dû véritablement motiver son classement sans suite et si celui-ci avait pu ensuite être frappé d'appel. Le chef du service socio-éducatif local a estimé que le seul acte positif possible aurait été l'appel, que la responsable de l'ASE aurait seule été habilitée à former. La responsable de l'ASE a, pour sa part, indiqué que les décisions du parquet et du juge des enfants s'imposaient aux services sociaux et qu'en l'état des textes, il ne lui semblait pas possible d'agir lorsque le parquet procédait à un classement sans suite. Les textes ayant évolué depuis l'époque où les faits se sont déroulés, mais n'ayant pas été nécessairement portés à la connaissance des acteurs concernés, la commission préconise que soit développée auprès d'eux l'information sur la disposition issue de la loi du 9 mars 2004 instituant une possibilité d'appel contre un classement sans suite, et que l'applicabilité de cette disposition aux signalements relatifs à l'enfance en danger soit clairement affirmée à cette occasion. Cette disposition, qui figure aujourd'hui à l'article 40-3 du code de procédure pénale, prévoit que « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation ». De même, il devrait être précisé que le dispositif du nouvel article 40-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, disposant que lorsque le procureur décide d'un classement sans suite, celui-ci indique les raisons juridiques ou d'opportunité justifiant sa décision, s'applique également aux signalements des services sociaux concernant des enfants en danger. S'agissant non des signalements judiciaires auprès du procureur, mais des mesures d'assistance éducative relevant du juge des enfants, il convient de rappeler qu'en application d'une disposition qui, cette fois, n'est pas nouvelle (article 375-1, premier alinéa), le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative « à charge d'appel » et qu'une jurisprudence déjà ancienne considère que le service départemental de l'ASE, gardien des mineurs qui lui ont été confiés par le juge des enfants, est à ce titre recevable à interjeter appel des décisions rendues par ce magistrat. Pour autant, ne sont là encore visés que les mineurs déjà confiés. C'est pourquoi pourrait être inscrite dans la loi la possibilité d'un appel contre une décision de refus, y compris implicite, de mise en place d'une mesure d'assistance éducative en faveur d'un mineur, même non confié. S'inscrit également dans ce cadre la réflexion à mener sur la recherche à tout prix de l'adhésion de la famille et de la préservation du lien familial. D. ASSOUPLIR L'OBLIGATION LÉGALE DE RECHERCHE SYSTÉMATIQUE DE L'ADHÉSION DE LA FAMILLE ET DU MAINTIEN DU LIEN FAMILIAL DANS DES CAS EXTRÊMES Il ressort du rappel des faits et des extraits précités de rapports des services sociaux que, tant la recherche systématique de l'adhésion de la famille aux mesures d'assistance éducative, que la volonté de privilégier à tout prix le maintien du lien parents-enfants, ont considérablement retardé la protection effective des enfants Delay. La collaboration de leurs parents n'était qu'affichée, jamais réelle, sauf de façon très épisodique, et le souci de maintenir le lien parents-enfants a abouti à un placement généralisé très tardif, en février 2000, doublé d'un maintien du droit d'hébergement et de visite jusqu'à fin 2000, malgré les mauvais traitements dont faisaient état les enfants lors de leurs retours au domicile familial. Il convient dès lors de s'interroger sur l'interprétation susceptible d'être donnée par le juge des enfants aux dispositions des articles 375-1, second alinéa, et 375-2 du code civil. Le second alinéa de l'article 375-1 précise en effet que le juge des enfants « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Sa rédaction devrait être assouplie en précisant que le juge des enfants « doit s'efforcer » et non « doit toujours s'efforcer » de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée, afin de laisser à ce magistrat une marge d'appréciation plus grande. De même à la formulation de l'article 375-2 : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » devrait être substituée la formule plus souple suivante : « Chaque fois qu'il est possible, sauf cas de maltraitances, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». Une telle rédaction aurait en effet permis la suspension du droit de visite et d'hébergement des parents Delay dès le début de l'année 2000, alors que la maltraitance ne faisait plus de doutes, même si les abus sexuels n'étaient pas encore invoqués. Plus fondamentalement, il convient de poser la question des rapports entre les différents partenaires judiciaires : juge des enfants, parquet et magistrat instructeur. E. MIEUX ARTICULER LES RAPPORTS ENTRE LE JUGE DES ENFANTS, LE SUBSTITUT CHARGÉ DES MINEURS ET LES MAGISTRATS CHARGÉS DE L'INSTRUCTION La Commission d'enquête se doit de souligner la nécessité de veiller au respect de certaines procédures fondamentales même si elles ne relèvent pas pour autant de mesures législatives. Lors du remplacement d'un juge des enfants par un autre, un délai minimum de « passage de témoin » devrait être respecté. Il n'est pas satisfaisant que M. Erik Tamion ait dû prendre la succession de Mme Hélène Sigala en l'espace d'une demi-journée. Il résulte des témoignages apportés lors des auditions que de telles situations sont malheureusement assez courantes. Un passage de relais d'au moins dix jours devrait être systématiquement prévu afin de permettre au juge partant de transmettre à son successeur un minimum d'informations sur les dossiers les plus complexes, à défaut évidemment de pouvoir appréhender les quelque 600 dossiers en cours. De même, un substitut des mineurs récemment arrivé au parquet devrait recevoir un minimum d'informations sur certains des dossiers en cours et à tout le moins pouvoir consulter des archives. Mme Véronique Carré a indiqué avoir pris ses fonctions de substitut du procureur chargé des mineurs, à la suite du départ d'un collègue, en septembre 2000, et n'avoir pas eu connaissance des signalements reçus antérieurement par le parquet au sujet des enfants Delay. En réponse à une interrogation sur l'existence d'archives auxquelles elle aurait pu se référer, elle a indiqué que les signalements devaient certainement se trouver dans le dossier du juge des enfants. Il aurait été utile, lorsque le dossier d'Outreau a pris une nouvelle dimension fin décembre 2000, avec les déclarations d'abus sexuels, qu'elle fût en mesure de consulter tous les rapports relatifs au suivi de la famille établis au cours des années antérieures. Cela aurait pu être profitable également au procureur qui a repris l'affaire au milieu de l'année 2001, lorsque s'est profilée la fameuse thèse du « réseau ». La consultation de telles archives aurait certainement permis de mieux cerner dans quel contexte familial, perturbé de longue date, s'inscrivaient les premières déclarations d'abus sexuels, et partant, d'accueillir avec prudence les premiers « débordements » de la parole tant des enfants que de leur mère. La même réflexion vaut également pour le juge d'instruction. Mme Hélène Sigala, qui avait quitté ses fonctions en septembre 2000, a déclaré ne pas avoir été interrogée par ce magistrat sur la famille Delay et ne pas savoir s'il avait demandé communication de son dossier d'assistance éducative. M. Erik Tamion qui lui a succédé et était donc en poste en 2001, a simplement indiqué, sur ce point, qu'un juge d'instruction pouvait se faire communiquer les dossiers à sa demande, l'inverse n'étant pas possible. Il apparaît donc qu'en pratique, si un magistrat instructeur peut avoir connaissance du dossier détenu par le juge des enfants, cette transmission n'est pas pour autant obligatoire, ce qui est regrettable. En l'espèce, il n'est pas possible de déterminer si réellement et à quelle date le juge Burgaud a pris connaissance du dossier concernant la famille Badaoui-Delay et notamment des notes de l'UTASS et de la DDPJJ établies entre 1995 et 2000. Elles semblaient pourtant de nature, si elles avaient été consultées par le juge dès le début de la procédure, à l'inciter à accueillir avec une certaine prudence les accusations portées par Myriam Badaoui. F. CONFIER AU DÉFENSEUR DES ENFANTS LE SUIVI DES ENFANTS DES PERSONNES PLACÉES EN DÉTENTION PROVISOIRE Les auditions auxquelles a procédé la commission d'enquête ont mis en évidence la solitude et la détresse des parents qui ne savent plus à qui s'adresser, pendant leur détention provisoire et après leur acquittement, pour toute question concernant le sort de leurs enfants. La possibilité de s'adresser au Défenseur des enfants devrait désormais leur être signifiée dès le placement en détention provisoire. Il n'apparaît pas admissible en effet, s'agissant de personnes bénéficiant de la présomption d'innocence et non déchues de leur autorité parentale, de les laisser plusieurs semaines voire plusieurs mois dans l'ignorance du sort de leurs enfants ou sans tenir compte de leur souhait de privilégier un placement dans leur famille, dès lors que celui-ci semble réalisable. L'accès à cette autorité devrait être ouvert en outre aux parents soumis à un contrôle judiciaire les mettant dans l'impossibilité de rencontrer leurs enfants ou de s'assurer eux-mêmes de leur bonne prise en charge, comme le cas s'est présenté dans l'affaire d'Outreau. Sans qu'il soit nécessaire de modifier la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 qui l'institue, le Défenseur des enfants serait par exemple compétent pour : - répondre à toute demande d'information des parents incarcérés ou ayant interdiction de rencontrer leurs enfants sur ce qu'il advient de ces derniers ; - intervenir afin d'éviter le placement systématique en famille d'accueil, en faisant vérifier dans les meilleurs délais si une solution qui aurait la préférence des parents (accueil par des grands-parents volontaires par exemple) ne peut être mise en place ; - traiter toute réclamation relative à l'insuffisance des informations sur l'évolution des enfants ou à l'insuffisance des correspondances échangées ; - étudier toute réclamation relative à un transfert dans une maison d'arrêt trop éloignée pour permettre au parent placé en détention provisoire de recevoir des visites familiales ; Mme Sandrine Lavier a cité comme exemple l'absence de réponse du bâtonnier à la réclamation suivant son transfert de Loos à Rouen ; - prendre tous contacts nécessaires pour s'assurer que l'enfant dont le parent est placé en détention provisoire continue à suivre sa scolarité ; M. Alain Marécaux a évoqué, par exemple, la déscolarisation d'un de ses enfants ; - intervenir pour éviter toute mesure inutile ou préjudiciable aux intérêts de l'enfant ; Mme Odile Marécaux a mentionné ainsi la non-restitution des carnets de santé de ses enfants ; - exercer un rôle de médiation en cas de problèmes rencontrés par les parents acquittés pour rétablir une vie familiale normale : accélération de la mise en place des mesures d'assistance éducative lorsqu'elles sont sollicitées et tardent à être mises en place (exemple de la famille Marécaux) ; concertation avec les services concernés lorsque sont, au contraire, invoquées des obligations de suivi psychologique trop lourdes (exemple de la famille Lavier) ; étude du cas particulier des enfants toujours placés. X. REDÉFINIR LES CONDITIONS DU RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES ENFANTS Redéfinir les conditions du recueil des déclarations des enfants suppose d'agir sur plusieurs registres à la fois : la formation des assistants familiaux ; l'enquête sur les circonstances de la révélation du mineur ; le recueil proprement dit des déclarations des enfants ; le recours à l'enregistrement audiovisuel du mineur victime et son utilisation ; le rôle des associations parties civiles et des avocats. A. COMPLÉTER LA FORMATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX La famille d'accueil de l'enfant victime constitue le milieu dans lequel le mineur placé est le plus susceptible de se confier. L'affaire d'Outreau a montré quelles pouvaient être les conséquences de cette première écoute de l'enfant lorsque celle-ci se faisait sans règle ni méthode. L'émotion de la personne qui recueille de graves révélations, l'empathie qui se crée entre l'adulte et le mineur, les initiatives maladroites qui peuvent être prises pour faire préciser à l'enfant ce qu'il essaie de dire, constituent autant de sources de déformation des propos de l'enfant qui en rendent l'exploitation ultérieure difficile et parfois trompeuse. Les règles de prudence données aux assistantes maternelles dans le cadre de l'affaire d'Outreau se sont révélées manifestement insuffisantes ; elles se limitaient à recommander la prise de notes des propos spontanés des enfants, sans l'inscrire dans une démarche réglementée reposant sur une formation précise. Ce manque de formation porte également sur le repérage des états traumatiques. Mme Dominique Frémy, psychiatre exerçant au centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles et de maltraitance (CAVASEM) de Besançon, a souligné devant la commission d'enquête que « la personne qui recueille le dévoilement ne doit pas rester seule, mais prendre rapidement l'avis d'un collègue, d'un professionnel, si possible en dehors de la présence de l'enfant. Il est important également de former les professionnels, y compris les enseignants, à reconnaître la pathologie post-traumatique - je pense surtout aux assistantes maternelles et aux familles d'accueil, souvent mal formées à un tel repérage, et qui ne connaissent qu'une faible partie de l'histoire de l'enfant. La formation initiale doit associer des professionnels de champ différent, en mettant l'accent sur les prérogatives des différents intervenants - éducateurs, travailleurs sociaux, etc. »464. Les exigences de formation des personnes en charge d'accueillir des mineurs dans le cadre d'un dispositif de protection de l'enfance ont certes été accrues par les dispositions récentes issues de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. La distinction entre assistantes maternelles et familiales a permis de mieux différencier les missions d'accueil des mineurs, seules les assistantes familiales étant susceptibles d'être employées par les services départementaux d'aide sociale à l'enfance. Dans ce cadre, les assistantes familiales agréées suivent, dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant, un stage préparatoire de 60 heures auquel doit succéder une formation continue d'adaptation à l'emploi d'une durée de 240 heures dans le délai de trois ans après le premier contrat (décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005). Les assistantes familiales sont, en outre, intégrées à un projet de service de l'aide sociale à l'enfance élaboré dans chaque département (article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles). On constate cependant qu'aucune de ces dispositions ne souligne la nécessité de connaître et de savoir mettre en œuvre des règles encadrant le recueil de la parole de l'enfant. La commission d'enquête propose que cet apprentissage soit assuré dans le cadre de la formation continue d'adaptation à l'emploi. Il conviendrait, en outre, que le projet de service de l'aide sociale à l'enfance prévoie de former des équipes pluridisciplinaires aptes à accompagner les assistants familiaux qui accueillent des enfants engagés dans des procédures judiciaires. Les services judiciaires et de police devraient y être associés, aussi bien au niveau de la formation qu'à celui des projets élaborés par les départements. Cette première étape de formation générale franchie, il conviendrait d'analyser le regard de l'enquête policière sur les révélations de l'enfant. B. RENDRE OBLIGATOIRES LES ENQUÊTES SUR LES CIRCONSTANCES DE LA RÉVÉLATION DU MINEUR S'attacher à situer la parole d'un enfant par rapport au contexte qui est le sien au moment où il fait sa révélation est une phase indispensable de l'enquête. Comme l'a expliqué devant la commission d'enquête Mme Yvette Bertrand, commissaire divisionnaire, chef de la brigade de protection des mineurs de Paris : « Cette phase de l'enquête permet de mieux cerner les circonstances de la révélation du mineur mais aussi de mettre à jour l'éventuelle " pré-enquête " qui aurait pu être faite en toute bonne foi par un travailleur social ou par un membre de la famille. »465 Enquêter sur la pré-enquête ne relève cependant actuellement que de la technique policière et n'est pas assis sur une obligation légale. Constatant l'importance de cette phase de l'enquête, il est proposé d'en faire un élément de procédure obligatoire. Quelle que soit la voie par laquelle la révélation du mineur sera portée à la connaissance de l'autorité judiciaire, il reviendra au service enquêteur d'établir les conditions précises dans lesquelles est intervenue la révélation, à savoir les circonstances dans lesquelles elle a été faite et le contexte dans lequel elle s'inscrit. Il a, par ailleurs, été constaté dans l'affaire d'Outreau que les assistantes maternelles auditionnées par les policiers n'avaient pas fait l'objet d'interrogatoires. Comme en attestent les procès-verbaux, elles ont rapporté les propos des enfants sans qu'il ne leur ait été demandé la moindre précision sur la façon dont elles avaient procédé auprès de l'enfant. Au vu de l'importance de cette phase initiale de l'enquête, il conviendra, comme le préconise le « rapport Viout », que la personne qui a recueilli en premier la révélation du mineur soit auditionnée par le service enquêteur. Mais ces précautions seraient sans effet si, parallèlement, aucun effort n'était entrepris pour rénover les conditions de recueil des déclarations des enfants. C. AMÉLIORER LES CONDITIONS DU RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES ENFANTS Participent de cette amélioration la formation des enquêteurs, l'attribution du recueil des auditions des mineurs à des enquêteurs spécialisés et le renforcement des moyens d'enregistrements audiovisuels. 1. Améliorer la formation des enquêteurs La nécessité de ne confier les auditions d'enfants qu'à des enquêteurs formés à cet effet est une évidence qu'a rappelée, devant la commission d'enquête, Mme Yvette Bertrand : « Tous les fonctionnaires doivent impérativement partir en formation. Chaque année, je manque de places de formation pour les nouvelles recrues. On les fait patienter, ils partent en fonction des places qui se dégagent. »466 De fait, le Centre national d'études et de formation de la police nationale n'a qu'une capacité de formation de 60 enquêteurs par an467, pour 696 commissariats de police. Au sein de la gendarmerie, le stage « audition de mineur », organisé au Centre national de formation de la police judiciaire, forme 160 enquêteurs par an pour plus de 1 800 unités fonctionnelles élémentaires de gendarmerie en France (communautés de brigade, brigades autonomes et brigades de recherche). Ces capacités de formation sont manifestement insuffisantes et demandent à être sensiblement accrues. Il apparaît également indispensable de compléter cette formation par des stages accomplis dans des unités spécialisées à l'expérience reconnue. 2. Réserver les auditions des mineurs à des enquêteurs spécialisés La circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces en date du 2 mai 2005 envoyée aux procureurs et aux présidents de cour préconise de prendre les dispositions suivantes : « Vous veillerez à ce que les parquets de votre ressort désignent systématiquement les services spécialisés de la police et de la gendarmerie pour l'accueil de l'enfant et le recueil de sa parole. À défaut, les procureurs de la République se feront transmettre par les directeurs départementaux de la sécurité publique et les commandants de groupement la liste des enquêteurs de leur ressort ayant suivi une formation. Cette liste devra être régulièrement actualisée. » Confier le recueil des déclarations des mineurs victimes à des fonctionnaires formés à cette fin constitue un premier progrès. Il conviendrait, néanmoins, de réserver ces auditions à des services spécialisés, seuls à même de disposer d'équipes expérimentées. Mme Yvette Bertrand a précisé en ce sens que dans son service « Les dossiers sont conduits en équipe, ce qui permet des regards croisés sur des affaires particulièrement délicates. »468 C'est pourquoi les auditions des mineurs victimes en dehors des services spécialisés ne devraient revêtir qu'un caractère exceptionnel. En tout état de cause, le fonctionnaire qui serait chargé de l'audition réalisée en urgence devrait pouvoir bénéficier de l'aide du service spécialisé territorialement le plus proche. 3. Augmenter les moyens consacrés aux enregistrements audiovisuels La mauvaise dotation en équipement du commissariat de Boulogne-sur-Mer qui avait en charge l'audition de tous les enfants concernés par l'affaire d'Outreau ne revêt pas un caractère exceptionnel. Selon une enquête réalisée par les auditeurs de justice de l'École nationale de la Magistrature en 2004, si les brigades de gendarmerie de prévention de la délinquance juvénile seraient correctement dotées, l'équipement des services de police apparaît en revanche très inégal. Le matériel installé depuis la loi du 15 juin 2000 qui fait obligation de procéder à un enregistrement audiovisuel des mineurs en garde en vue n'est pas adapté pour les mineurs victimes ; rares sont les commissariats qui disposent d'un local aménagé pour les auditions. La pratique de la brigade de protection des mineurs de Paris constitue, à cet égard, une exception notoire et un modèle. Mme Yvette Bertrand a expliqué devant la commission d'enquête que sa « brigade mène ces auditions, sous forme d'entretiens vidéo depuis 1997, dans une salle spécialement aménagée qui permet d'entendre les mineurs de tous âges dans de très bonnes conditions [...] Nous avons installé des portes capitonnées pour qu'il y ait le moins de bruit extérieur possible susceptible de perturber l'enfant, le fonctionnaire, et de nuire à la qualité de l'audition »469. Elle remarque que les enregistrements réalisés en province, dont elle peut avoir connaissance quand l'enquête du mis en cause se poursuit à Paris, « sont de qualité très inégale, du point de vue de la technique d'abord car, par manque de moyens, des collègues utilisent le dispositif prévu pour enregistrer les mineurs placés en garde à vue - bruits de fond, fax, téléphones qui sonnent »470. Cependant, elle souligne que le matériel dont sa brigade dispose est devenu obsolète et qu'il conviendrait de disposer rapidement des moyens nécessaires pour enregistrer les entretiens sur un support DVD. Des structures correctement aménagées existent par ailleurs en milieu hospitalier. La Chancellerie a cependant rappelé, dans une circulaire en date du 2 mai 2005, qu'il revient aux procureurs de la République d'harmoniser les pratiques d'auditions dans ce cadre. Selon les informations fournies par les services de la Chancellerie, les tribunaux ont été dotés en 1999 de 178 équipements de matériels audiovisuels installés dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel pour un montant total de 2 795 183 francs (426 123 €). Le ministère de la justice doit acquérir 250 nouveaux équipements plus simples d'utilisation. Une expérience en cours en 2006 dans six cabinets d'instruction doit permettre de définir le type de matériel le plus adapté et d'évaluer le coût du renouvellement de l'ensemble des équipements. Il convient, à l'évidence, de faire porter les engagements financiers sur cette phase initiale de la procédure judiciaire, le recueil défaillant de révélations d'enfants pouvant être la cause de procédures complexes et onéreuses. La commission d'enquête demande, par conséquent, que soit engagé au plus tôt l'investissement financier nécessaire à l'achat de matériels adaptés et à l'aménagement de locaux dédiés à l'enregistrement des dépositions des mineurs. Si les propositions précédentes sont d'ordre matériel, l'obligation d'un enregistrement des auditions des mineurs ressort à la compétence du législateur. D. SUPPRIMER LES EXCEPTIONS À L'OBLIGATION DE PROCÉDER À L'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DU MINEUR PRÉSUMÉ VICTIME Afin d'apprécier la portée d'une telle réforme, il convient au préalable de rappeler le droit en vigueur, la pratique, la perception du problème par les professionnels et d'évoquer les contributions de certaines expériences étrangères (Italie, Royaume-Uni). 1. Les dispositions en vigueur L'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi du n° 98-468 du 17 juin 1998, définit ainsi l'obligation de procéder à l'enregistrement de certains mineurs victimes : « Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande. Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée. » Les infractions visées sont les tentatives de meurtre ou d'assassinat d'un mineur accompagné de viol, de tortures ou d'actes de barbarie, les viols, les agressions sexuelles, les exhibitions sexuelles, la corruption de mineur, la pornographie enfantine et les atteintes sexuelles sur mineur. Aux termes de ces dispositions, l'enregistrement du mineur victime constitue une exigence légale et non une faculté. L'objectif est d'éviter les répétitions des auditions de la victime qui risqueraient « d'aggraver son traumatisme car, selon la formule classique, redire c'est revivre. »471 Une deuxième raison apportée à cette obligation est donnée par la circulaire d'application du 20 avril 1999, qui précise qu'un tel enregistrement est aussi de nature « à faciliter l'expression de l'enfant tout en permettant d'y déceler les éléments non verbalisés et de les mémoriser pour la suite de la procédure ». La loi apporte cependant trois tempéraments à cette disposition, explicités dans la circulaire précitée. Il y a lieu d'abord de recueillir l'accord du mineur ou de son représentant légal. En effet, « toutes les expériences passées ou en cours, en France comme à l'étranger, ont démontré que le consentement de l'enfant ne peut jamais être éludé, car il est totalement impossible d'entendre un enfant qui refuse de parler s'il sait que ses propos seront enregistrés ». Le magistrat peut, par ailleurs, apprécier en raison des circonstances résultant « soit de l'incapacité de communication de l'enfant à raison de son âge ou de son état physique ou mental, soit de l'urgence ». Sa décision de ne pas procéder à l'enregistrement peut aussi être justifiée par la nature de l'affaire, en particulier si l'enfant a été victime d'une agression sexuelle filmée par l'auteur des faits. Sa décision peut enfin résulter d'une considération d'opportunité au vu de laquelle le juge préfère différer l'enregistrement de l'audition. Enfin, l'enregistrement sonore se présente comme une modalité subsidiaire. En outre, la méconnaissance de l'obligation d'enregistrement n'est pas assortie de sanction : « L'obligation d'enregistrement ne peut en effet être considérée comme une formalité substantielle, et elle est édictée dans le seul intérêt de la victime. »472 2. Des dispositions détournées dans la pratique L'affaire d'Outreau a montré comment, dans une procédure qui s'inscrivait pourtant dans ce cadre légal, n'ont été réalisés que sept enregistrements sur une centaine d'auditions. Le « rapport Viout » cite l'exemple d'une direction de la sécurité publique d'un important département de la région parisienne dans laquelle sur 336 mineurs entendus en 2003 dans des locaux de police, pour violences sexuelles, 328 auraient opposé un refus473. Par ailleurs, des motivations d'opportunité peuvent être systématiquement avancées par le magistrat pour ne pas procéder à l'enregistrement du mineur. Dans l'affaire d'Outreau, aucune audition devant le juge d'instruction n'a été enregistrée. L'enquête précitée menée par les auditeurs de justice montre que plus des trois-quarts des 22 juges d'instruction interrogés ne procédaient pas « ou exceptionnellement » à l'enregistrement des auditions des mineurs victimes. La circulaire de la Chancellerie en date du 2 mai 2005 reconnaît que ces pratiques traduisent « un détournement de l'esprit de la loi du 17 juin 1998 ». Mais au-delà des textes, on ne peut faire abstraction de la perception de cette question par les professionnels. 3. Une nouvelle approche des déclarations de l'enfant et une meilleure prise en considération de l'intérêt de toutes les parties Au cours de son audition devant la commission d'enquête, Mme Nathalie Becache, vice-procureur, chef de la section des mineurs du tribunal de grande instance de Paris, a évoqué ce sujet dans les termes suivants : « Je tiens à souligner que le terme "recueil de la parole de l'enfant" m'est étranger, à la fois parce qu'il est étranger au code de procédure pénale et parce que je l'estime impropre, en ce qu'il porte une trop lourde charge symbolique. Une enquête judiciaire n'est pas le moment du recueil d'une parole sacralisée, sorte d'émanation aussi volatile que spontanée, et définitivement figée. La réalité est autre : des confidences sont faites à des tiers, puis ont lieu les auditions des enfants, qui ne sont pas passives mais dirigées pour permettre la manifestation de la vérité. Il s'agit d'une quête de vérité qui n'est pas forcément favorable à l'enfant, auquel il faudra parfois expliquer que l'on doit classer la procédure, non qu'il ait menti mais parce que l'on n'est pas parvenu à établir la réalité de ce qu'il a indiqué. »474 Étape dans la quête de la vérité, l'audition de l'enfant présente, par ailleurs, les difficultés que M. Paul Bensussan, expert-psychiatre, a soulevées devant la commission d'enquête. La parole de l'enfant « n'est pas toujours une parole et elle n'émane pas toujours de l'enfant. En effet, la révélation est parfois non verbale, s'exprimant par une modification du comportement ou par des symptômes non spécifiques. D'autre part, dans un grand nombre de dossiers, c'est un adulte proche de l'enfant qui révèle une confidence que celui-ci lui aurait faite. Il est essentiel de savoir dans quelles conditions cette révélation a surgi, et davantage encore lorsque l'enfant ne la confirme pas »475. L'enregistrement de l'audition de l'enfant constitue ainsi un moyen d'apprécier du point de vue de la quête de la vérité judiciaire ce que le mineur déclare par ses mots et son comportement. De ce fait, la préservation de l'intérêt de la victime - lui éviter de subir de nombreuses auditions répétitives - ne peut plus être considérée comme constituant la seule motivation des dispositions introduites par l'article 706-52 du code de procédure pénale. Le caractère probatoire que peuvent avoir les propos des enfants rend déterminantes pour l'appréciation des faits les conditions de leur recueil; il convient, par conséquent, d'apprécier la procédure de l'enregistrement du mineur victime au regard de l'intérêt de toutes les parties au procès. La commission d'enquête propose que l'obligation de procéder à l'enregistrement du mineur victime soit absolue et ce, dans l'intérêt de toutes les parties. Ne plus avoir à solliciter le consentement du mineur ne semble pas présenter d'obstacle pour les psychologues. Mme Dominique Frémy, médecin- psychiatre, a ainsi souligné que les refus d'enregistrement étaient exceptionnels dès lors « que l'enfant a compris la raison parce qu'on la lui a expliquée »476. Par ailleurs, Me Vanina Padovani, avocate de l'association « Enfant bleu-Enfance maltraitée » a estimé qu'il fallait renforcer les dispositions de la loi du 17 juin 1998 « peut-être même en enregistrant les enfants systématiquement, sans leur demander s'ils y consentent ». Enfin, Me Célia Rofidal, conseil des enfants au nom du conseil général dans l'affaire d'Outreau, a elle aussi partagé cette suggestion : « [...] mieux vaudrait que l'enregistrement soit systématique, sans qu'il y ait besoin de demander le consentement de qui que ce soit » et a précisé qu'il faudrait « que, dans la mesure du possible, l'enfant ne voie pas qu'il est filmé, ce qui rendrait sa parole plus spontanée. »477 La mise en place de dispositifs discrets d'enregistrement contribuerait à lever d'éventuelles réticences. Cette proposition de la commission tendrait à instituer un dispositif qui rejoindrait partiellement ceux déjà mis en œuvre en Grande-Bretagne et en Italie. 4. Les exemples britannique et italien Le système britannique ne fait pas du consentement de l'enfant ou de son représentant une obligation préalable à la réalisation de l'enregistrement. Préconisé depuis 1992, l'enregistrement vidéo se fait dans des locaux aménagés qui, si possible, doivent disposer d'une seconde caméra filmant l'ensemble de la pièce de manière à identifier les personnes présentes. L'audition de l'enfant est préparée par l'équipe d'enquête aidée de psychologues. En plus de la personne qui mène l'audition, un observateur, policier ou non, placé derrière un miroir sans tain, en contrôle le déroulement ; il a la possibilité de conseiller celui qui questionne grâce à une oreillette. L'enfant peut être assisté d'un avocat. La pratique consiste à ne pas procéder à d'autre audition pendant l'enquête et à attendre l'audience de jugement. La loi italienne prévoit de même l'enregistrement obligatoire de l'enfant par moyen vidéo ; comme dans la procédure britannique, le consentement du mineur n'est pas sollicité. La police n'entend jamais l'enfant. Avant d'être auditionné, l'enfant est examiné par un expert, en général un pédopsychiatre, qui apprécie l'aptitude de l'enfant à témoigner. L'audition est conçue comme une audience organisée selon une procédure contradictoire et prenant en compte la protection du mineur. Le juge de l'enquête et les parties y participent en adressant leurs demandes par l'intermédiaire d'un psychologue. Ce dernier est placé dans une pièce isolée aux côtés de l'enfant interrogé. L'enregistrement vidéo et sa retranscription sont versés au dossier du ministère public et ont la même valeur que la preuve recueillie au procès478. E. MIEUX UTILISER LES ENREGISTREMENTS Il est cependant clair que l'obligation absolue de procéder à l'enregistrement des mineurs n'a de sens que si ces pièces de procédure sont exploitées. Ces enregistrements n'ont pratiquement pas été utilisés dans l'affaire d'Outreau. Me Laurence Gottscheck a souligné devant la commission d'enquête, qu'à Paris : « les greffiers n'ont ni la formation adéquate, ni le matériel nécessaire pour le visionnage des enregistrements, lesquels ne rencontrent de toute façon pas grand succès auprès des magistrats instructeurs. »479 Le procès d'Angers au cours duquel plus de quarante heures d'auditions ont été projetées aux membres du jury fait figure d'exception. M. Éric Maréchal, qui avait présidé ce procès, a expliqué les réticences du magistrat instructeur par le fait qu'« il ne souhaite pas qu'on porte un autre regard sur son travail que celui qui est porté sur la procédure écrite qu'il produit »480. La commission préconise que la formation des magistrats, à l'École nationale de la magistrature comme dans le cadre d'une formation continue, fasse entrer dans la pratique et dans la culture judiciaire l'exploitation des pièces audiovisuelles. Dans le cadre touchant à la parole de l'enfant, il appartient également de redéfinir la place des associations parties civiles. F. PRÉCISER LE RÔLE DES ASSOCIATIONS PARTIES CIVILES L'habilitation donnée par la loi à certaines associations de mener une action collective par voie d'intervention leur ouvre la possibilité de se constituer partie civile à tout moment au cours de l'instruction et, s'il y a eu renvoi, devant la juridiction de jugement. Certaines associations peuvent ainsi intervenir très tardivement dans une procédure et, comme il l'a été dit par le président de l'association « Enfant bleu-Enfance maltraitée », M. Yves Crespin, profiter de l'écho médiatique que peut avoir le débat public à l'audience pour engager une campagne de communication. Afin d'éviter qu'un procès pénal puisse offrir un tel effet d'aubaine, la commission d'enquête propose que les associations dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de maltraitance ne puissent plus se constituer partie civile après la clôture de l'instruction. Les associations intervenant au moment du procès auront ainsi eu accès au dossier et connaissance de son évolution ; elles pourront apprécier en toute connaissance de cause les rapports entre les intérêts qu'elles représentent et les intérêts particuliers en jeu dans l'affaire. Les audiences de rendez-vous semestrielles devant la chambre de l'instruction préconisées par le présent rapport devraient contribuer à la bonne information des associations qui envisagent d'être représentées dans une affaire. Il convient de rappeler que ces associations bénéficient déjà du droit En outre, le législateur a considéré, aux termes de l'article 2-3 du code de procédure pénale, qu'il convenait de placer les associations citées dans une position de retrait par rapport aux autres en ne leur donnant pas l'initiative des poursuites. Enfin, mieux circonscrire l'intervention des ces associations ne saurait être compris comme une atteinte à la défense de l'intérêt des enfants en cause dans une affaire ; de ces enfants, ces associations ne sont en effet pas les avocats, comme l'ont souligné ouvertement les représentants de celles-ci devant la commission d'enquête481. Il paraît nécessaire également de mieux garantir à l'enfant une défense qui demeure au plus près de ses intérêts propres en étant mieux individualisée et mieux formée. G. GÉNÉRALISER LA DÉSIGNATION D'AVOCATS SPÉCIALISÉS DANS LA DÉFENSE DES MINEURS La commission d'enquête recommande qu'il soit fait appel à des avocats spécialisés dans la défense de mineurs victimes. À cette fin, il conviendrait que les barreaux créent des sections spécialisées, cette suggestion s'inscrivant là encore dans la réforme de la carte judiciaire, préconisée par la Commission. L'administrateur ad hoc pourrait ainsi orienter plus facilement son choix vers des conseils expérimentés. Il reviendrait à chaque barreau de proposer un nombre suffisant de conseils pour garantir que chaque mineur aura son propre avocat. Pour prolonger la portée de ce dispositif, l'avocat pourrait être impliqué le plus en amont possible de la procédure, au cours de l'enquête. H. PRÉVOIR L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT DÈS LE DÉBUT DE L'ENQUÊTE POUR LE MINEUR PRÉSUMÉ VICTIME D'UNE AGRESSION SEXUELLE Lors de son audition devant la commission d'enquête, M. Jean-Claude Monier, président de la cour d'assises de Saint-Omer, s'est inquiété que le mineur présumé victime d'une agression sexuelle ne soit assisté d'un avocat que tardivement dans le cours de la procédure : « Alors que pour tout adulte, l'avocat intervient dès le début de la garde à vue, pour les enfants présumés victimes, a fortiori dans les milieux défavorisés, l'avocat n'apparaît souvent dans la procédure qu'un an, voire dix-huit mois après le début de l'enquête ; or les premières auditions sont déterminantes. Une avancée législative et une prise de conscience des barreaux sont nécessaires pour que chaque enfant ait un avocat, et le plus tôt possible. »482 Certes, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, a conduit à mieux garantir la défense des intérêts de l'enfant en généralisant le rôle de l'administrateur ad hoc et en permettant ainsi une intervention plus systématique de l'avocat de l'enfant. L'article 706-50 du code de procédure pénale, introduit par cette loi, prévoit en outre qu'en cas de constitution de partie civile « le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. » La circulaire de la Chancellerie du 2 mai 2005 préconise, au surplus, que la nomination de l'administrateur ad hoc se fasse le plus en amont possible « afin que son intervention présente une réelle utilité pour l'accompagnement du mineur dans un processus judiciaire qui sera long et éprouvant. » Cependant, dans la phase de la procédure qui précède la constitution de partie civile, le mineur victime n'est pas assisté d'un avocat. Or, les auditions au cours desquelles l'enfant procède au dévoilement des agressions ont lieu précisément dans cette phase initiale ; les conditions de leur déroulement se font ainsi en dehors de tout contrôle contradictoire. Reprenant une proposition faite par le Sénat pendant la discussion de la loi du 17 juin 1998483, la commission d'enquête propose que, comme le prévoit l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour le mineur poursuivi, le mineur présumé victime d'une agression sexuelle soit assisté par un avocat dès le début de l'enquête. Il reviendra, selon le cas, au procureur de la République ou au collège de l'instruction d'en faire désigner un d'office par le bâtonnier. XI. REPENSER LA GESTION DES CARRIÈRES DES MAGISTRATS Les progrès à attendre d'une meilleure gestion du corps des magistrats peuvent emprunter quatre directions : l'organisation de formations communes avec les avocats ; la clarification de fonctions du siège et du parquet ; l'institution d'une gestion des ressources humaines et l'ouverture du corps sur l'extérieur. A. FAVORISER DES FORMATIONS COMMUNES AVEC LES AVOCATS La commission a reçu de nombreux témoignages de dégradation des relations entre des magistrats et des avocats. Sans qu'il soit possible de généraliser ce climat à l'ensemble des membres des deux professions, on constate que ces dissensions sont loin d'être spécifiques à l'affaire d'Outreau et sont répandues dans nombre de juridictions. Le procureur général près la cour d'appel de Douai est sans doute, comme on l'a vu, le magistrat qui a reconnu avec le plus de franchise ces problèmes dans l'affaire d'Outreau484. Me Paul-Albert Iweins, Président du Conseil national des barreaux explique ces tensions par la montée en puissance des exigences de sécurité au sein des tribunaux : « Il y a, enfin, une nouvelle conception, perverse, des palais de justice : au nom de la sécurité, la convivialité qui permet de rencontrer les magistrats, de discuter avec eux, est en train de disparaître. On parle au greffier à travers un hygiaphone, on a de plus en plus de mal à obtenir des rendez-vous compatibles avec des horaires d'avocat, à rencontrer les magistrats qui sont dans une sorte de bunker. »485 En dehors de ces obstacles matériels qui sont une réalité, la commission est bien consciente de la détérioration des rapports entre les deux professions. Aussi est-elle persuadée que l'un des moyens de prévenir l'extension de ce phénomène est d'encourager le développement d'une formation commune entre magistrats et avocats. À l'instar de l'ordre des avocats de Paris486, certaines personnes devant votre commission ont été jusqu'à réclamer la suppression de l'ENM487. D'abord parce que la création d'une école commune soulèverait des difficultés pratiques en raison du fait qu'il existe près de six fois plus d'avocats que de magistrats (44 054 avocats inscrits au barreau contre 7 902 magistrats), cette piste de réflexion ne saurait prospérer. Ensuite, le Premier président Guy Canivet qui de par ses fonctions de Premier président de la Cour de cassation est président du conseil d'administration de l'ENM a mis en garde les membres de la commission contre cette tentation en invoquant deux arguments : « La formation des magistrats impose un travail pédagogique précis dans des groupes restreints » ; « On reviendrait à la période d'avant 1958, où n'étaient recrutés que les candidats qui pouvaient bénéficier du soutien financier de leur famille pendant plusieurs années après leurs études de droit. »488 En revanche, même s'ils exercent les uns et les autres des métiers foncièrement différents, ils sont appelés à se côtoyer quotidiennement et à partager nombre d'éléments d'une culture commune. N'est-ce pas le Procureur général Viout, qui déclarait devant la commission d'enquête : « Quand je vois les incompréhensions qui naissent précisément parce qu'il y a des deux côtés une méconnaissance de cette culture commune, je me dis que c'est en réaffirmant que nous avons des repères communs que nous parviendrons à combler ce fossé. Car la justice se porterait extrêmement mal, qui verrait la magistrature et les barreaux camper sur leur Aventin dans une superbe ignorance, voire dans une détestation réciproque. Or, nous, responsables des barreaux comme de l'évolution des corps de magistrats, sommes comptables de l'évolution de la justice. »489 De ce fait, la mise en place d'un tronc commun pourrait aider à combler ce fossé entre les deux professions. Cette idée a circulé à plusieurs reprises parmi les magistrats et les avocats. Elle a notamment été défendue par le Procureur général Viout : « Je suis de ceux qui militent depuis longtemps pour des plages de formation commune entre les magistrats et les avocats. »490 ; par Mme Delou Bouvier, secrétaire générale adjointe du syndicat de la magistrature491 ainsi que par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, M. Yves Repiquet492. Pour concrétiser cette proposition, votre commission a souscrit à une suggestion du bâtonnier Iweins. Celui-ci a rappelé à la commission qu'« actuellement, il y a deux mois de stage dans un cabinet d'avocat, ce qui ne permet pas de donner grand-chose à faire d'intéressant aux stagiaires. Si l'on veut que les magistrats sachent ce qu'est la vie d'un avocat - car ils n'en ont souvent aucune idée -, qu'ils comprennent la difficulté qu'il y a à constituer un dossier, à recevoir des clients qui vous racontent parfois des histoires, il faudrait porter ce stage à six mois, voire à un an »493. La lecture du programme de formation initiale à l'ENM apprend que lors de son stage d'avocat qui est rangé dans la catégorie des « stages complémentaires », l'auditeur de justice se voit confier la rédaction des pièces de procédure et conclusions qui seront établies sous le contrôle de l'avocat494. Conformément à l'article 19 du statut de la magistrature, les auditeurs de justice n'ont pas pendant cette période délégation de signature et exercent leur activité à titre bénévole. L'auditeur de justice substitue à l'audience son maître de stage sous son contrôle comme le prévoit l'article 63 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La commission propose de porter la durée de ce stage de deux mois à un an avec un exercice plein et entier des fonctions d'avocat tout en demeurant rémunéré par l'ENM ; il serait au surplus intégré dans le « tronc commun » de la formation dispensée à l'ENM et perdrait son caractère « complémentaire ». Pour être complet, on ajoutera que les nouvelles orientations imprimées à la formation initiale par la direction actuelle de l'École nationale de la magistrature s'inscrivent d'ores et déjà dans cette perspective de rapprochement du barreau. Ainsi à titre expérimental des élèves avocats sont venus rejoindre les directions d'études de l'ENM. Dix-huit élèves avocats - quatre élèves parisiens et des élèves de l'école d'avocats de Bordeaux - sont appelés à être aux côtés des auditeurs de justice pendant huit mois495. De son côté, le directeur de l'ENM, Michel Dobkine, a fait part aux députés, lors de leur visite à l'école, de son intention de mettre en place « une direction d'études consacrée aux droits de la défense » dont l'enseignement sera assuré par plusieurs avocats496. B. CLARIFIER LES FONCTIONS DU SIÈGE ET DU PARQUET En dehors de la pratique du « copié-collé », d'autres sources de confusion entre le parquet et le siège apparues au cours des auditions justifient que l'on s'interroge sur la pertinence des passages des magistrats du parquet au siège et inversement. Il faut savoir que les changements de « filière » représentent une part assez stable des mouvements judiciaires ; sur les trois dernières années, ces changements ont constitué entre 14,5 % et 16,5 % des mouvements, les passages du parquet vers le siège s'élevant à 9,3 % de l'ensemble et ceux du siège vers le parquet à 6,1 %. Même si ces déplacements ne sont pas considérables, ils ne sont pas sans créer des difficultés, relevées par plusieurs acteurs de la vie judiciaire entendus par la commission d'enquête. Ainsi Me Eric Dupont-Moretti a cité le cas d'une jeune magistrate, substitut dans une juridiction donnée, sous les ordres d'un procureur, qui avait changé de juridiction et était devenue juge du siège alors qu'elle avait été cinq ans sous ses ordres. « A Douai, d'anciens magistrats du parquet sont devenus juges du siège devant la Cour. Pendant des années, ils ont été les accusateurs. Ils sont aujourd'hui les juges du siège, avec une proximité humaine et une alchimie à laquelle les avocats sont totalement étrangers. »497 Mme Odile Mondineu-Hederer partage cette analyse : « Il me semble aberrant qu'un substitut puisse être nommé dans le même tribunal comme juge d'instruction voire dans la même cour d'appel. Le CSM l'exclut aujourd'hui à l'intérieur d'un même tribunal. Mais ce devrait être la même chose à l'intérieur d'une même cour d'appel. Or, par exemple, j'ai siégé, hier encore, aux côtés d'un avocat général qui vient d'être promu à la cour d'appel de Paris. »498 Au nom de la Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel, M. Bernard Daeschler, Premier Président de la cour d'appel de Reims a attiré l'attention de la commission d'enquête sur les conséquences de la gestion dyarchique des juridictions, qui était désormais imposée et a fait prévaloir une approche institutionnelle du problème : « Dans un monde de communication, il n'est pas possible que l'institution judiciaire communique par la seule voix du parquet, dont la mission est l'accusation. Il n'est pas possible que l'image d'une affaire soit donnée par l'accusation. Cela ne veut pas dire qu'il soit nécessaire que le siège s'exprime dès l'origine, ou au cours du procès, mais que l'opinion publique doit savoir qui communique, et quel est le rôle de celui qui communique. [...] Il n'est pas souhaitable que le parquet soit maître du rôle des juridictions et intervienne de façon systématique dans ce rôle. [...] Les politiques publiques, pour légitimes qu'elles soient, ne peuvent avoir pour vecteurs que les seuls magistrats du parquet. »499 Le Premier président Guy Canivet a, quant à lui, livré une description d'ensemble de l'ambiguïté des rapports entre le parquet et le siège, encore plus critique : « Les magistrats peuvent exercer, de la base au sommet, alternativement les fonctions du siège et du parquet, parfois dans la même juridiction et au sein d'un même palais de justice, cohabitent, travaillent ensemble, dans une relation quotidienne de proximité - on n'hésite pas à parler de collaboration - ceux qui sont chargés de juger les affaires en toute impartialité et ceux dont la mission est de soutenir la thèse de l'accusation. L'organisation des juridictions est totalement fondée sur cette relation. Il faudrait, je vous l'assure, beaucoup de vertu pour assumer un tel système. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons . Ces magistrats du siège et du parquet participent ensemble aux assemblées délibérantes qui déterminent l'organisation de la juridiction et la répartition des moyens. Depuis quelques temps, s'est en outre développé, au ministère de la justice, un dogme nouveau, celui dit de la « dyarchie », qui fait que le président de la juridiction et le chef du parquet, procureur ou procureur général, n'exercent plus séparément l'administration et la gestion de leurs structures respectives, siège d'un côté, parquet de l'autre, mais qu'ils administrent ensemble une entité unique et en gèrent conjointement les crédits, crédits pour lesquels ils sont ensemble ordonnateurs délégués. On semble vouloir qu'une juridiction soit une institution à deux têtes, dont l'une et l'autre ne poursuivent pas le même objectif. À cette confusion administrative s'est ajoutée une confusion fonctionnelle, introduite par les lois nouvelles, qui fait que , dans de nombreux cas - amendes transactionnelles, médiation et composition pénale, comparution sur reconnaissance de culpabilité - le procureur dispose d'un pouvoir plus ou moins direct d'infliger des sanctions. Dans la pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et visible entre parquet et siège, qui brouille l'idée d'une justice impartiale et place la défense en position de déséquilibre. »500 Dans une interview, en réponse à une question sur l'opportunité d'une séparation plus nette entre le parquet et le siège, le Premier président Guy Canivet a été encore plus affirmatif, en se réclamant de la situation respective des magistrats du parquet et des magistrats du siège : « Le procureur de la République a pour objectif de faire condamner l'auteur d'une infraction. Un juge lui, n'a pas d'a priori. Il écoute les deux parties et pèse chacun des arguments. Un juge c'est une éthique, une culture de la neutralité. C'est une posture qui s'entretient tous les jours. Je ne pense donc pas qu'il soit possible de passer de manière neutre d'une fonction à l'autre. »501 Toutefois la plupart des magistrats interrogés se sont montrés attachés au maintien du système actuel, le Procureur général près la Cour de cassation ayant qualifié même le risque de « collusion » entre les deux filières de « secondaire », l'important devant être que les magistrats du parquet restent des magistrats502. Si le Président de l'USM ne se pose pas la question de l'opportunité ou non de la pérennité de ces passerelles entre le siège et le parquet (« En quoi faudrait-il modifier le système et prévoir une séparation du siège et du parquet ? Ce n'est absolument pas nécessaire »503), les arguments avancés ici et là en faveur de l'unité du corps des magistrats apparaissent d'ordre psychologique, professionnel et déontologique. Mme Clarisse Taron, vice-procureur au Tribunal de grande instance de Nancy considère qu'« une formation commune, un passage possible d'une fonction à l'autre et un statut de magistrat, est le seul moyen de nous permettre d'agir dans la plus grande sérénité possible »504. Même si elles ne sont pas ouvertement mises en avant, les motivations professionnelles, liées au fait que l'unité du corps assure une plus grande diversité d'emplois, sont sans doute essentielles dans les réactions des magistrats pour justifier le statu quo. M. Jean-Louis Nadal a demandé « pourquoi empêcherait-on le juge d'instance de Bonneville de devenir substitut à Montpellier s'il présente les qualités requises ? »505 Le Président de la Conférence des procureurs généraux, André Ride, reçu par la commission d'enquête le 4 avril 2006 a fait valoir, de son côté, la nécessité de préserver l'unité du corps des magistrats en ces termes : « ... Pourquoi créer deux magistratures dès lors que les magistrats de l'une et de l'autre ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire la recherche de la vérité et la garantie des libertés individuelles, et qu'ils sont, les uns et les autres, soumis à la même déontologie ? Qui plus est, avec un tel système, il y aurait très rapidement d'un côté la vraie magistrature, celle du siège, et de l'autre une magistrature dévaluée, celle du parquet, qui ne serait plus à même d'accomplir les missions qui sont les siennes, notamment de tenir son rôle d'interface entre les juges et la société civile, de direction de la police judiciaire et de protection des libertés individuelles. Quitte à choquer, j'ajouterai qu'interdire, au bout de quelques années, le passage d'une magistrature à une autre reviendrait, à terme, aux mêmes résultats que de scinder la magistrature en deux. Outre qu'on peut se demander pourquoi on priverait les magistrats d'une source d'enrichissement intellectuel et de la possibilité de porter un regard croisé sur les affaires, on voit mal quelle objection on peut opposer à un tel changement de fonction. »506 Dans le même ordre d'idées, pour M. Eric Alt, vice-président du syndicat de la magistrature, « la scission du corps irait dans le sens d'une fonctionnarisation du parquet »507. Ces mêmes considérations déontologiques ont été formulées sous une autre forme par ce magistrat : « Il est important de souligner que magistrats du siège et magistrats du parquet doivent défendre les mêmes valeurs. C'est pourquoi nous sommes pour l'unicité du corps. Il appartient au parquet de protéger les libertés individuelles : contrôle des gardes à vue, décision de prolonger une garde à vue. Il appartient aussi au parquet de défendre l'intérêt de la société, l'intérêt général. L'accusation n'a pas pour mission d'obtenir coûte que coûte la condamnation du prévenu. Pendant toute la procédure, le parquet doit l'aider à examiner les choses à charge et à décharge. Il doit veiller à l'égalité des citoyens devant la loi. Il est très important aussi qu'il n'y ait pas d'immixtion illégitime dans la décision du parquet. La recherche de la vérité fait partie de ses missions. Il y a donc des valeurs communes, une mission commune même si, chacun, à sa place, doit assumer le rôle qui est le sien. Mais au nom de ces missions et de ces valeurs, je pense que nous avons de puissants arguments qui militent en faveur de l'unicité du corps. » Si au nom des arguments fonctionnels et administratifs invoqués par le Premier président Guy Canivet, l'on souhaite une réforme de l'organisation actuelle dans le sens d'une plus grande séparation du parquet et du siège deux options sont possibles : une simple clarification des rôles de chacun ou une nette séparation. On peut ranger parmi les tenants de la clarification les premiers présidents des cours d'appel, qui militent en faveur d'une déconnection des rapports entre le siège et le parquet, les deux ayant une place radicalement différente dans le procès, sans toutefois renoncer à l'unicité du corps508. En prônant une séparation fonctionnelle et organisationnelle du siège et du parquet, le Premier président Guy Canivet fait franchir une étape supplémentaire à cette clarification. Comme il l'a fait valoir devant les membres de la commission d'enquête, « ce schéma passe par une nette séparation des hommes, des structures, des administrations et des moyens budgétaires et une claire distinction de leurs fonctions propres sans remettre en cause l'unité du corps judiciaire. Une telle séparation implique que soient prises des décisions sur l'organisation des juridictions, d'une part, et sur la hiérarchisation du parquet, d'autre part »509; la direction de l'administration et de la gestion de l'ensemble de l'institution judiciaire serait confiée au chef de la juridiction supérieure sur le modèle de la justice administrative et des juridictions financières. Pour sa part, attachée à dissiper ces facteurs de confusion entre le siège et le parquet relevés par les plus hauts magistrats, la commission propose que les fonctions de magistrat du parquet et du siège soient séparées à l'expiration d'un délai maximal de dix ans à l'issue de la sortie de l'ENM, afin que les magistrats choisissent à cette date leur filière. Cette séparation entre siège et parquet nécessite de repenser les carrières des magistrats et donc la gestion des ressources humaines. C. INSTITUER UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Le manque d'expérience des jeunes magistrats appelés à exercer de lourdes responsabilités, une forte inclination à l'individualisme ne sauraient expliquer, à eux seuls, des erreurs judiciaires. Si ces facteurs sont réels, ils n'ont pu jouer cependant que parce que la gestion des ressources humaines au sein de la magistrature est, comme il est apparu assez rapidement au cours des auditions, défaillante et par trop négligée dans cette institution. Cette lacune se mesure particulièrement en termes de formation et plus généralement en termes de gestion. La gestion des ressources humaines est singulièrement absente des programmes de formation initiale de l'ENM, comme l'a relevé le vice-président de la commission d'enquête M. Jean-Paul Garraud, lors du débat général, qui s'est tenu au sein de la commission le 2 mai. Cette dimension de formation n'apparaît que dans le cadre de la formation continue. Or, un jeune substitut ou un jeune juge d'instruction peuvent être amenés à gérer du personnel dans leur première affectation. À titre de comparaison, les élèves de la promotion de l'ENA « République » disposeront entre septembre et novembre 2006 de 22 heures de formation sur la gestion des ressources humaines. M. Michel Dobkine a constaté cette lacune à la sortie de l'école pour la reconnaissance des aptitudes des magistrats à exercer certaines fonctions. Il a admis : « Nous n'avons pas de gestion des ressources humaines. Nous pouvons déceler, par exemple, qu'un auditeur a de grandes compétences pour un poste de juge aux affaires familiales, mais nous n'avons pas le pouvoir de lui faire obtenir un tel poste. Et le pire, c'est que quelques années plus tard, au moment de son premier changement de poste, il risque d'être trop tard car il aura perdu les compétences acquises, faute de les avoir exercées. » Au cours de cette même journée à Bordeaux, il a précisé que certes « le jury de l'examen de classement peut assortir la note finale de recommandations sur l'aptitude d'un auditeur à exercer telle ou telle fonction mais statutairement ces recommandations ne sont pas opposables au CSM ». Il a ajouté : « La loi n'a pas donné à l'école le pouvoir de remplir une fonction de "ressources humaines" comme dans le privé. Cela ne me choquerait pas qu'il y ait un entretien de motivation, en interne, à la sortie, en y associant le cas échéant des compétences extérieures, y compris celle d'un psychologue, à l'École... À l'entrée à l'École des commissaires de police, il y avait une épreuve psychologique qui était éliminatoire il y a deux ans encore. Elle ne l'est plus aujourd'hui, mais elle permet de repérer des pathologies. J'ai interrogé ma direction, le sujet n'est pas tabou, mais cela ne serait pas forcément injonctif, contraignant. Les entretiens dans le privé, y compris à l'entrée des écoles de commerce sont redoutables. Nous sommes très en deçà. La question, donc, n'est pas taboue, mais sous réserve et à certaines conditions. »510 Sans aller forcément jusqu'à l'introduction dans le concours d'entrée d'une épreuve psychologique dont la valeur ajoutée reste à démontrer, on ne peut que recommander, en revanche, la création d'une direction d'études sur la gestion des ressources humaines pendant la scolarité. L'autre versant de cette problématique est la gestion des ressources humaines au cours de la carrière. Or, pas plus qu'en amont avant l'entrée dans le corps cette question n'est traitée comme elle devrait l'être. L'avancement des magistrats du second au premier grade est subordonné à l'inscription au tableau d'avancement par une commission dont seize membres sur vingt sont élus par des magistrats de plusieurs collèges et quatre sont désignés ès qualités (Premier président de la Cour de cassation et Procureur général près celle-ci, Inspecteur général des services judiciaires, Directeur général des services judiciaires). Ce tableau est dressé par la commission d'avancement qui se prononce à partir du dossier individuel de chaque magistrat et des notes qui lui ont été attribuées par son supérieur hiérarchique. La décision de présentation d'un magistrat au tableau d'avancement est une prérogative du chef de cour relevant de sa seule appréciation. Le tableau est communiqué à chaque magistrat et affiché au siège de chaque juridiction ; le magistrat qui n'aurait pas été proposé pouvant adresser au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription et ensuite former un recours auprès du garde des Sceaux s'il n'est pas présenté. Par application de l'article 24 du décret statutaire du 7 janvier 1993 modifié, les présentations accompagnées de l'ensemble de documents d'évaluation correspondants établis par ordre de mérite sont adressées par les autorités chargées de l'évaluation au ministère de la justice. Le garde des Sceaux pourvoit de fait à la nomination du plus grand nombre de magistrats à partir du tableau, ces affectations étant réalisées concrètement par le bureau des mouvements des magistrats de la sous-direction de la magistrature de la direction des services judiciaires. Cependant parce que l'ancienneté constitue un critère commode pour départager les concurrents, cette structure chargée annuellement de gérer en moyenne 1 300 mouvements n'a pas la capacité de pratiquer une véritable gestion des ressources humaines tenant compte des aptitudes de chacun. Aussi serait-il opportun de refaire une place au choix en rétablissant les listes d'aptitude supprimées par l'article 27 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001, telles qu'elles figuraient aux articles 29 et 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. Le rétablissement des listes d'aptitude constituerait le prolongement des dispositifs d'évaluation des magistrats institués par ce même décret et donnerait tout son sens à ce processus d'évaluation. La gestion des ressources humaines qu'appelle de ses vœux le Premier président de la Cour de cassation semble donc être bien loin de la réalité : « Il faudrait alors que les mouvements ne se décident qu'au mérite et que l'on fasse prévaloir les considérations techniques sur toute autre. Que l'on recherche activement les magistrats aptes à certaines fonctions plutôt que de gérer passivement des candidatures selon un critère d'ancienneté. Ainsi ne seraient nommés juges d'instruction que des magistrats qui ont acquis une expérience collégiale dans les formations pénales des cours d'appel, notamment des chambres d'instruction , et qui seraient estimés aptes à le faire. De la même manière, seraient sélectionnés les juges des enfants, les juges d'instance et les juges de l'application des peines. »511 Le Procureur général Jean-Louis Nadal s'en est inquiété également ce jour-là devant les députés : « Il reste à mettre en œuvre une véritable gestion des ressources humaines, actuellement bien difficile pour de multiples raisons, certaines culturelles, d'autres d'ordre pratique. Mais à terme, nous ne pourrons pas faire l'économie d'un suivi des carrières et des profils, comme cela se fait dans d'autres administrations et dans le secteur privé. Il s'agit de mieux répondre, non seulement aux attentes des magistrats, mais surtout aux besoins du service de la justice. »512 Plus concrètement, si l'on part du principe que l'on peut être un bon parquetier mais un mauvais juge aux affaires familiales, il serait souhaitable, comme l'a recommandé le Procureur général Jean-Amédée Lathoud qu'existe « à l'intérieur des cours d'appel, un dialogue plus construit avec les collègues sur les perspectives de carrière, sur l'évaluation et même sur des contrats d'objectifs »513 . Une telle organisation qui répondrait au souci de « valorisation des parcours des magistrats » exprimé par M. Dominique Barella, président de l'USM514, conduit à suggérer d'instituer à l'intérieur de chaque cour d'appel, structure territoriale de la LOLF, une cellule professionnelle des ressources humaines, afin de mieux croiser les besoins des juridictions avec les profils des magistrats. On peut recommander également, dans le même ordre d'idées, la constitution d'une direction des ressources humaines à l'échelon de l'administration centrale. D. FAVORISER L'ÉMERGENCE D'UNE MAGISTRATURE PLUS OUVERTE SUR L'EXTÉRIEUR Cette ouverture sur l'extérieur peut se développer lors du recrutement des magistrats et pendant leur carrière. 1. Développer les recrutements sur titres En dehors du recrutement reposant sur trois concours distincts, l'admission à l'ENM est possible sur titres. Aux termes de l'article 18-1 du statut, les personnes pouvant prétendre à être recrutées sur titres sans avoir à passer le concours d'entrée doivent répondre à l'une des conditions suivantes : - être titulaires d'une maîtrise en droit et avoir exercé pendant quatre années des activités dans le domaine juridique, économique et social qui les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; - être docteur en droit en ayant outre les diplômes requis pour un doctorat un autre diplôme d'enseignement supérieur ; - avoir exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement public d'enseignement supérieur mais à la double condition d'avoir exercé cette fonction pendant au moins trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et posséder un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique. Les candidats qui doivent être âgés de vingt-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours sont nommés après avis de la commission d'avancement. Aujourd'hui, le nombre de candidats admis ne peut excéder le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours de la promotion à laquelle ils appartiennent. Dans un souci d'élargissement de ce recrutement, il a semblé opportun de suggérer que ce seuil soit relevé au tiers de la promotion. Les reproches de repli, de manque d'ouverture des magistrats pendant leur carrière sont revenus fréquemment au cours des auditions devant la commission d'enquête. Aujourd'hui le nombre de magistrats en détachement est de 218 sur un effectif réel de 7 801. En vertu de l'article 76-2 du statut, les magistrats peuvent sur leur demande être détachés, intégrés après détachement ou nommés au tour extérieur dans un corps recruté par la voie de l'ENA dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps. Le décret relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'ENA applicable aux magistrats est le décret n° 2004-708 du 17 juillet 2004. Son article 2 dispose que la mobilité des membres recrutés par la voie de l'ENA est accomplie auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger. Pendant ce détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'origine, il est rémunéré par son corps d'accueil et est soumis aux règles régissant l'emploi qu'il occupe dans ce dernier. Mais la différence entre le régime applicable aux magistrats et celui applicable aux hauts fonctionnaires tient au fait que la mobilité des premiers n'est aujourd'hui qu'une faculté, alors que la mobilité des seconds est obligatoire et inhérente à leur statut. Le directeur de l'ENM, Michel Dobkine, a plaidé à titre personnel pour une mobilité statutaire obligatoire pour les magistrats : « qui conduirait les magistrats à quitter, deux fois trois ans , le corps judiciaire pour exercer leurs talents ailleurs et s'enrichir au contact d'autres réalités sociales, économiques, associatives, administratives. Ce serait une réforme aux conséquences considérables. Comme d'autres, les magistrats passeraient un certain temps qui dans un conseil général, qui dans un Samu, qui dans l'enseignement, qui à l'APHP... »515 On ne peut que se ranger à cette idée, qui nécessite de modifier les règles du détachement issues de l'article 76-2 du statut. Le détachement pourrait avoir lieu après six ans d'exercice de la profession de magistrat et être d'une durée de deux ans. XII. RESPONSABILISER LES MAGISTRATS Le renforcement du régime de responsabilité des magistrats passe par la définition de règles précises propres à favoriser l'engagement de cette responsabilité. Ces réformes supposent que l'on agisse sur trois registres : la prévention des fautes, leur détection et leur sanction. La définition de règles déontologiques propres à la profession de magistrat doit constituer l'une des priorités de toute action fondée sur la prévention de leurs fautes. Les fonctions occupées par les magistrats impliquent de leur part des obligations allant au-delà de celles auxquelles sont soumises les fonctionnaires. En effet, la conduite du juge dans son activité professionnelle est perçue par les justiciables comme un facteur essentiel de crédibilité de la justice. Comme le relève M. Daniel Ludet, Avocat général près la cour d'appel de Paris : « Loin d'être entièrement déterminé par les prescriptions des textes, par des dispositions précises, le comportement professionnel des magistrats obéit aussi à leur éthique. Cette éthique pourrait s'analyser comme la conscience permanente, de la part du magistrat, de ce que, dans le silence des textes, son comportement n'est pas laissé à sa discrétion ou à sa fantaisie mais doit se référer aux exigences fondamentales de sa fonction. »516 Or, les règles déontologiques s'imposant aux magistrats sont définies aujourd'hui avec parcimonie, comme le constate ce haut magistrat : « Sur les devoirs du magistrat, les textes sont vagues, généraux ou lorsqu'ils sont précis, partiels, lacunaires. »517 Leur statut leur interdit de troubler le bon fonctionnement du service public de la justice en se mettant en grève (article 10, alinéa 3 du statut) et prohibe l'expression de positions politiques en leur qualité de magistrat (article 10, alinéa 2). Ils ne peuvent également exercer d'activité professionnelle extérieure à leurs fonctions (article 8). Lors de leur nomination à leur premier poste et avant d'entrer en fonctions, les magistrats sont tenus de prêter serment, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat (article 6). » En les frappant d'une incapacité de juger lorsqu'un doute risque de planer sur leur indépendance, des dispositions du code de l'organisation judiciaire (article R. 721-1 et R. 721-3) et du nouveau code de procédure civile (article 341) leur imposent également un devoir d'impartialité. Là s'arrêtent cependant leurs obligations. Il est vrai que pour être exhaustif, il faut savoir que la formation des auditeurs de justice à l'ENM contient un module obligatoire sur l'éthique et la déontologie avec des conférences et des directions d'études, axées en particulier sur les qualités des magistrats, leur loyauté, la dignité et le devoir de réserve ainsi que la diligence et la responsabilité. Ces enseignements sont complétés par des spécialisations. Toutefois, alors que les professions réglementées (médecins, architectes, commissaires aux comptes), que les agents de police municipale et nationale sont dotés chacun d'un code de déontologie, celui-ci fait défaut pour les magistrats. Cette absence est d'autant plus frappante que plusieurs systèmes judiciaires étrangers ont fait le choix d'un code de déontologie ou de règles similaires. C'est le cas au Canada, aux États-unis, en Italie et dans plusieurs pays d'Europe centrale, notamment518. Cette comparaison montre au demeurant que la gestion de ce corps reste en dehors du mouvement de réforme engagé dans de nombreuses démocraties. Des principes d'éthique distincts des règles disciplinaires ont été publiés au Canada en 1998, à l'initiative de l'Association des juges des cours supérieures et du Conseil canadien de la magistrature. Ces principes ne constituent pas véritablement un code de déontologie pour les juges mais un cadre de référence de normes que les juges doivent respecter. Ces principes sont répartis en cinq catégories : - l'indépendance : les juges doivent être libres de juger sans pression extérieure ; - l'intégrité : les juges doivent s'appliquer à avoir une attitude intègre pour promouvoir la confiance du public dans l'administration de la justice ; - la diligence : celle-ci doit caractériser toutes leurs activités professionnelles et traduit l'adhésion des juges au fonctionnement et aux valeurs de l'institution ; - l'égalité de traitement entre les justiciables et l'absence de discrimination ; - l'impartialité, droit constitutionnellement garanti aux justiciables, elle exclut notamment toute activité partisane de la part des magistrats et oblige ces derniers à se récuser en cas de conflit d'intérêts. La publication de ces principes a été accompagnée de la création d'un Comité consultatif, chargé de conseiller les magistrats sur leur application. Celui-ci réunit dix juges représentant chaque province du Canada et fonctionne de façon informelle. Ses membres sont nommés par un comité conjoint du Conseil canadien de la magistrature et de l'Association canadienne des juges des Cours supérieures et sont donc uniquement des juges professionnels. Le comité n'est responsable devant aucun de ces organismes ; il agit de façon indépendante. Il remplit une fonction d'organe consultatif sur des questions déontologiques. L'une de ses activités essentielles est de fournir, sur une base confidentielle, des avis ponctuels sur des questions déontologiques soulevées individuellement par des juges. Ces avis sont ensuite rendus anonymes puis mis à la disposition de tous les juges, qui peuvent les consulter pour se renseigner sur des questions particulières. C'est ainsi que peu à peu s'est élaborée une jurisprudence. Les membres du comité fournissent ainsi des références à leurs collègues sur toutes les questions portant sur la déontologie. En revanche, les procédures de plaintes contre les juges relèvent exclusivement de la compétence du Conseil canadien de la magistrature, que l'on évoquera plus loin. Aux États-Unis, il existe depuis 1973 un code fédéral de conduite des juges (Code of conduct for United States Judges) et dont se sont inspirés de nombreux États. Il fixe notamment les obligations principales imparties à tout juge et sert de base à l'engagement de la procédure disciplinaire. Ce code édicte sept règles essentielles parmi lesquelles figurent l'intégrité, l'indépendance, l'impartialité, la diligence et l'abstention de toute activité politique. L'Italie s'est engagée aussi sur cette voie en 1994. Le gouvernement ayant par décret en 1993 imposé à toutes les branches de l'administration de l'État de se doter de codes d'éthique ayant pour but « d'assurer des standards de haut niveau pour les services rendus aux citoyens », l'Association nationale des magistrats, créée en 1909 et qui regroupe pratiquement tous les magistrats a alors adopté un « Code éthique des magistrats ». Celui-ci comprend trois parties articulées d'abord autour de principes généraux puis de l'indépendance, de l'impartialité et de la correction et traite enfin de la conduite des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Il traduit la tentative de définir le profil d'un bon magistrat et a influencé la loi du 20 juillet 2005, qui définit de façon précise les fautes devant donner lieu à sanction disciplinaire. La loi italienne décline les comportements dans l'exercice des fonctions et à l'extérieur de celles-ci. Sans en reprendre la liste exhaustive, on peut citer quelques-uns de ces comportements dans l'exercice des fonctions, qui sont particulièrement saillants : attitudes habituellement incorrectes à l'égard des parties, de leurs défenseurs, des témoins ; grave violation de la loi par ignorance ou négligence inexcusable ; relations avec des organes de presse en dehors des modalités prévues par la loi ; omission de communication de la part des chefs de juridiction de faits relevant du disciplinaire commis par des magistrats placés sous leur autorité ; adoption par négligence grave et inexcusable d'une mesure restrictive de la liberté personnelle en dehors des cas prévus par la loi. Des pays tels que l'Estonie, la Lituanie, la Moldavie, la Slovénie, la République Tchèque et la Slovaquie ont, pour des raisons historiques évidentes, également introduit récemment un « Code d'éthique judiciaire » ou des « Principes de conduite », adoptés par des assemblées représentatives de juges et distincts des règles disciplinaires. Cette préoccupation a trouvé également un écho dans les instances internationales européennes. Dans un avis à l'attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe519, le Conseil consultatif des juges européens a appelé de ses vœux l'introduction de principes déontologiques pour guider l'action des juges. À cet effet, il a souhaité que des principes proposent aux juges des lignes de conduite, leur permettant de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés au regard de leur indépendance et de leur impartialité, ces principes devant émaner des juges eux-mêmes et rester distincts de leur régime disciplinaire. Ce contexte explique que le garde des Sceaux de l'époque, M. Dominique Perben ait demandé en 2003 à une commission de réflexion sur l'éthique dans la magistrature (« Commission Cabannes ») de faire des propositions de réforme. Celles-ci ont été soumises en 2004 à la consultation des magistrats, qui a été à l'origine de la part de la commission de dix nouvelles recommandations. Deux d'entre elles retiennent surtout l'attention : la reformulation du serment et l'élaboration d'un recueil des principes déontologiques. Il était suggéré que l'éthique et la déontologie des magistrats reposent exclusivement sur sept principes fondateurs : l'impartialité, la diligence, la loyauté, l'intégrité, la dignité ainsi que le respect du secret professionnel et du devoir de réserve. L'énoncé de ces principes devait être contenu dans le serment et leur violation était constitutive d'une faute disciplinaire. Comme on le verra, lorsque l'on analysera les obligations disciplinaires des magistrats italiens, nées de la loi du 20 juillet 2005, les propositions de la « Commission Cabannes » sont cependant d'une extrême modestie. Cela ne les a pas empêché toutefois d'être mal accueillies par le Conseil supérieur de la magistrature, qui les a jugées en même temps insuffisantes car ne prenant pas en compte la jurisprudence (Avis du CSM du 20 mai 2005) et par les organisations professionnelles de magistrats. C'est ainsi que l'USM a estimé qu'un « code de déontologie trop général ne ferait que poser des règles tautologiques en la matière. Un catalogue régentant la vie quotidienne des magistrats aurait pour effet de les soumettre à des pressions constantes et à des tentatives évidentes de déstabilisation »520. De son côté le Syndicat de la magistrature a observé devant la commission d'enquête que la déontologie « ne saurait servir comme le prévoyait le rapport Cabannes sur le sujet, à constituer un corpus disciplinaire »521. En écartant tout recours à un véritable code de déontologie qui, au demeurant, exigerait une loi organique modifiant le statut de la magistrature au profit d'un recueil annuel de principes, la « Commission Cabannes » avait également fait le choix d'un instrument bien peu contraignant. En d'autres termes, l'ambition de la « Commission Cabannes » revenait à recommander en quelque sorte un code Dalloz aux dimensions au demeurant réduites, puisque les principes éthiques et les précédents jurisprudentiels en la matière sont peu nombreux et qu'il n'était pas envisagé de publier la jurisprudence afférente à l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire relative aux dysfonctionnements de la justice. Il était proposé que ce document à vocation pédagogique sur l'éthique des magistrats soit « élaboré et mis à jour périodiquement par un groupe de travail composé du Premier président de la Cour de cassation, du Procureur général près la Cour de cassation, du Directeur de l'École nationale de la magistrature ou de leur représentant, ainsi que de deux membres du CSM (l'un représentant la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Le secrétariat en serait assuré par l'ENM ». Lorsque l'on sait que la proposition de confection d'un recueil sur la déontologie des magistrats remonte à 1999 et émane du CSM, d'aucuns pourront estimer que cette recommandation de la « Commission Cabannes » n'avait, en outre, qu'une nouveauté relative. On relève cependant que cette suggestion a reçu sa première application cette année, puisqu'un recueil des décisions rendues en matière disciplinaire depuis 1959 a été élaboré conjointement avec le concours de la Cour de cassation et a été publié en mai 2006522. Si cet outil est appelé à pallier une grave lacune, il ne saurait toutefois être considéré comme un code d'éthique, qui conformément aux exigences d'une démocratie moderne, devrait résulter de la loi. Il doit plutôt être appréhendé comme un document de travail propre à éclairer les chefs de juridiction et le CSM. En réalité, alors que de nombreuses professions réglementées disposent d'ores et déjà d'un code de déontologie, on comprend difficilement les raisons qui s'opposent réellement à l'édiction d'un tel corpus de règles par voie législative pour les magistrats. En se présentant comme un élément d'information et de clarification de leurs responsabilités, il rendrait service à l'ensemble de l'institution judiciaire et devrait juridiquement être intégré dans leur statut et de ce fait avoir valeur de loi organique. Afin de s'assurer de son application, la « Commission Cabannes » proposait également d'instituer une commission chargée de donner des conseils et des avis en matière de déontologie. Il est à noter que, là encore, cette initiative s'est heurtée à une forte résistance syndicale. Pour l'USM, « la création d'une commission de déontologie saisie directement par les justiciables aurait pour effet de bloquer le fonctionnement de la justice par la multiplication des recours dilatoires »523. Dans un premier temps, la « Commission Cabannes » s'était prononcée pour que le Conseil supérieur de la magistrature désigne en son sein un groupe de travail spécialisé, ses membres ne devant pas siéger dans les formations disciplinaires au cas où celles-ci auraient à connaître des situations particulières sur lesquelles ils seraient déjà intervenus à titre consultatif. Après avoir constaté que cette suggestion entraînait une révision de la Constitution, le rapport final de la Commission élaboré après consultation des magistrats, avait proposé de faire appel à trois anciens membres du CSM pour remplir cette fonction. On peut toutefois se demander ce qu'il adviendrait si le garde des Sceaux ou le CSM ne partageaient pas l'avis de cette formation. Pour cette raison, il paraît sage que si des règles déontologiques voient le jour, seul le CSM soit le gardien de la déontologie des magistrats, soit en prononçant des sanctions à l'égard des magistrats du siège, soit en émettant des avis pour les sanctions des magistrats du parquet prononcées par le garde des Sceaux, comme c'est le cas aujourd'hui. En conclusion, il est apparu clairement que dans la mesure où le comportement du magistrat ne pouvait être seulement défini avec parcimonie par des textes ou par la jurisprudence disciplinaire, un code de déontologie devait être introduit dans le statut de la magistrature. La rédaction de ce code pourrait s'inspirer avec profit des principes posés dans le code italien et faire également référence à l'obligation pour les juges de respecter les principes directeurs de la procédure civile et de la procédure pénale, comme on le verra ultérieurement. Il appartiendrait à un CSM rénové pour les magistrats du siège et au garde des Sceaux pour les magistrats du parquet de veiller à son application. B. MIEUX IDENTIFIER LES FAUTES La détection doit constituer le second axe de réflexion à mener sur le terrain de la responsabilité des magistrats. Mieux détecter les fautes suppose de mieux évaluer les magistrats, de favoriser une culture de contrôle interne et de développer les contrôles externes. 1. Améliorer l'évaluation des magistrats Bien conçue, une évaluation des qualités professionnelles des magistrats est nécessaire à une bonne gestion des ressources humaines, constitue un rempart contre l'arbitraire et une garantie de leur indépendance. L'article 12-1 de leur statut prévoit que l'évaluation des magistrats a lieu tous les deux ans. Toutefois, le Conseil d'État a considéré qu'en fixant à deux ans le rythme de cette obligation, la loi instituait des exigences minimales qui ne font pas obstacle à ce qu'il soit procédé à une autre évaluation lorsque des circonstances particulières touchant à l'intérêt du service le justifient (CE, 5 juillet 1999, n° 197660). L'évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef de service dans lequel il exerce ses fonctions. La procédure d'évaluation issue du décret n° 93-21 du 7 mai 1993 modifié intègre quatre thèmes : les aptitudes professionnelles générales ; les aptitudes professionnelles juridiques et techniques ; l'aptitude à l'organisation et à l'animation et l'engagement professionnel. Au départ, le CSM avait une opinion très positive de ce dispositif d'évaluation : « La multiplicité des critères d'appréciation des aptitudes, la diversité des avis préalables à l'évaluation, la position hiérarchique des autorités qui en sont chargées comme la faculté offerte aux magistrats d'y concourir grâce au caractère contradictoire de la procédure, confèrent une réelle efficacité à ce mode d'appréciation de l'activité des magistrats. »524 Cinq ans après le CSM n'avait plus tout à fait la même approche des mérites de cette pratique : « Ses avantages évidents (proximité, connaissance directe des magistrats évalués, de leur activité et de son contexte, pertinence du dialogue entre l'évaluateur et l'évalué) comportent quelques inconvénients symétriques (poids de la relation hiérarchique, éventuelles situations conflictuelles entre l'évalué et l'évaluateur ou, à l'inverse, difficulté ou gêne pour celui-ci de dire ou écrire tout ce qu'il pense de celui-là). »525 Poser le problème de l'évaluation revient en fait à soulever deux questions : quel doit être son contenu et qui doit s'en charger ? Si le contenu et la procédure d'évaluation ont été précisés respectivement par l'ordonnance organique modifiée du 22 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1993, d'aucuns s'interrogent sur son adéquation aux besoins. C'est ainsi que Me Éric Dupont-Moretti a estimé devant la commission d'enquête que la grille des critères était exclusivement centrée sur les qualités des magistrats sans aucune prise en compte des besoins et des intérêts des justiciables526. Cette observation n'est pas totalement exacte, dans la mesure où le critère de « capacité d'écoute et d'échange » recouvre l'attention et le respect portés à autrui et notamment au justiciable. La justice par définition ayant pour effet dans une affaire de mécontenter une personne sur deux, on peut craindre que l'élaboration d'un indice de satisfaction des justiciables soit un exercice quelque peu vain. Il paraît difficilement envisageable en effet de prévoir des enquêtes de satisfaction à la sortie des cabinets des juges d'instruction ou des prétoires. En revanche, l'absence parmi ces éléments d'évaluation de critères relatifs aux relations professionnelles avec les collègues du magistrat dans la rubrique « engagement professionnel » vient illustrer une fois de plus la culture exclusivement individualiste de ce corps. Dans son livre, Mme Laurence Vichnievsky, magistrate faisant autorité et Présidente du tribunal de grande instance de Chartres, dresse un réquisitoire sévère contre les procédures actuelles d'évaluation : « La relative rigidité du mode de fonctionnement du CSM qui ne me paraît pas prendre suffisamment en compte les critères qualitatifs, est accentuée par les carences de la Chancellerie dans l'évaluation de l'activité et des qualités comparées des magistrats, dans l'identification des meilleurs professionnels et la définition des profils de carrière. En étant un peu réducteur on peut faire le constat que tous les magistrats sont censés se valoir, que pour l'institution judiciaire, un magistrat vaut un magistrat, quelle que soit sa compétence ou son efficacité. Nous nous situons tous entre "très bon" et "excellent". Il faut oser cocher la case "insuffisant" dans les grilles de notation sauf à ne plus accorder aucune signification à la croix inscrite dans la case "bon" ou "exceptionnel" et à ne plus pouvoir reconnaître les siens... Pour une meilleure adéquation des talents et des fonctions exercées, nous devrions pouvoir nous inspirer avantageusement des dispositifs mis en place dans de grandes entreprises privées pour la gestion des ressources humaines. »527 Interrogé par un journaliste, le président d'un tribunal de grande instance du Sud-Ouest reconnaissait, par ailleurs, que le recours au compliment n'était pas toujours l'expression d'une grande sincérité mais pouvait être le moyen de favoriser la promotion et donc le départ de l'intéressé : « Il est exact qu'on a tendance à promouvoir les mauvais pour s'en débarrasser. »528 Devant la commission d'enquête, Mme Dominique Commaret, Avocat général près la Cour de cassation, a souligné de son côté la différence prévalant entre les textes et l'application qui en était faite, montrant par là même que la réalité de l'évaluation n'était pas éloignée de celle en vigueur dans la fonction publique : « Les magistrats sont notés, et ils le sont même parfois à travers une évaluation croisée. Celle d'un juge d'instruction, par exemple, résulte d'un entretien avec le chef de juridiction, de l'évaluation globale du chef de cour, ainsi que des évaluations successives du président de la chambre de l'instruction, du président de la cour d'assises, du président de la chambre des appels correctionnels. Tout cela devrait conduire à une bonne connaissance des aptitudes et des comportements du magistrat concerné. En réalité, les notateurs ont parfois un discours peu courageux, qui laisse dans le moyen ou le passable ce qui devrait susciter des réactions plus ciblées, qui permettraient d'ailleurs au magistrat de connaître les progrès qu'il a à faire. L'évaluation demande un certain courage. »529 Faut-il alors confier cette évaluation à un organisme collégial comme c'est le cas dans certains pays étrangers, d'après les études menées par le CSM dans son rapport 2004 ? Tout en considérant que cette méthode est peu conforme aux traditions françaises, le CSM recommande, en effet, une « évaluation plus collective reposant sur la combinaison d'appréciations des différentes personnes ayant eu à connaître l'activité du magistrat ». Si elle se conçoit effectivement en théorie, cette proposition risque toutefois d'être difficile à mettre en œuvre, faute de pouvoir identifier très nettement les membres de ce collège. Certains pays étrangers se sont livrés cependant à cet exercice. Ainsi, l'institution judiciaire hollandaise a opté pour une formule d'évaluation, qui n'est pas une évaluation hiérarchique et dont le secrétaire général du Syndicat de la magistrature, M. Côme Jacqmin s'est fait l'écho devant la commission d'enquête : « l'"intervision" hollandaise est destinée à permettre aux acteurs de voir quels sont leurs difficultés, leurs faiblesses et les points sur lesquels il faut qu'ils travaillent. Dans ce système très libre, on choisit un interlocuteur, souvent un pair qui va voir comment on travaille, avec lequel on discute ensuite. »530 Aux États-Unis, l'État du New-Hampshire a institué un système d'évaluation professionnelle des juges « Performance Review », qui obéit à une logique similaire. Outre des entretiens réguliers des juges avec le président du tribunal, son originalité réside dans le fait qu'un questionnaire sur la conduite et la qualité des juges est distribué aux procureurs, témoins, avocats pendant la période d'évaluation à laquelle est soumise le juge. La Cour suprême de l'État rend ainsi compte chaque année au gouvernement de la mise en œuvre de ce programme.531 L'idée d'un développement du contrôle horizontal avec des échanges techniques et des discussions entre magistrats, voire l'assistance muette aux audiences des collègues pour leur faire part de remarques sur leur comportement fait donc son chemin532. Elle mériterait d'être appliquée chaque fois que cela est possible, lorsque la collégialité notamment le permet. On sait, par ailleurs, que la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 subordonne l'allocation des crédits budgétaires à la performance, les juridictions devant montrer qu'elles ont réparti leurs crédits à partir des besoins qu'elles ont évalués et en fonction d'objectifs. Cette nouvelle culture budgétaire est accueillie avec beaucoup d'appréhension voire souvent critiquée par les magistrats, comme ont pu le constater les membres de la commission d'enquête à de nombreuses reprises. On rappellera, à ce titre, que les objectifs et indicateurs de performance retenus dans la loi de finances pour 2006 et applicables à la justice pénale sont au nombre de quatre : rendre des décisions de qualité dans des délais raisonnables ; amplifier et diversifier la réponse pénale ; améliorer l'exécution des décisions pénales et maîtriser la croissance des frais de justice pénale. Or, il est évident qu'une meilleure gestion des ressources peut, par exemple, réduire les délais de jugement. Si la magistrature éprouve des réticences à intégrer la culture de l'évaluation de la qualité de la justice à travers l'outil de la LOLF, qui bouscule certaines habitudes, il faut savoir cependant que nombre de pays ont adopté des systèmes d'évaluation des performances des juridictions qui sont, à la différence de la France, effectués par des organismes indépendants : au Danemark, cette tâche est remplie par une institution administrative, la Danish Court Administration ; en Espagne, le Conseil général du pouvoir judiciaire a élaboré des critères quantitatifs, tant pour suivre la charge de travail des juridictions que pour déterminer le rendement de chaque magistrat. Les États-Unis ont mis au point des Trial Courts performance standards pour évaluer la qualité des tribunaux de première instance. Les Pays-Bas ont assigné cette mission au Conseil de justice. Par conséquent, cette évolution s'inscrit dans un mouvement général engagé dans de nombreux pays. Dans son étude parue en 2004 sur l'évaluation des magistrats, qui emprunte ses réflexions à ces expériences étrangères, le CSM établit une distinction entre les pays marqués par l'existence d'un corps de magistrats régi par une organisation de carrière et ceux dont les systèmes judiciaires ne connaissent pas d'évaluation individuelle des magistrats (Irlande, Royaume-Uni, Scandinavie). Il souligne que la « distinction entre les systèmes d'évaluation basés sur le déroulement de carrière et ceux orientés vers l'amélioration de la qualité de la justice tend à s'estomper ». On comprend très bien que pour être équitable l'évaluation des magistrats tienne compte de leur environnement professionnel et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer à atteindre leurs objectifs, en raison d'un manque de moyens humains ou matériels, notamment. Mais l'évaluation de la qualité de la justice engagée dans le cadre de la LOLF ne saurait avoir pour effet de faire disparaître la procédure d'évaluation individuelle et si l'on convient que les deux types d'évaluation sont nécessaires, on peut rejoindre Mme Aïda Chouk, présidente du Syndicat de la magistrature, pour considérer qu'ils devraient être concomitants533. Non seulement les deux modes d'évaluation ne sont pas incompatibles entre eux et se rejoignent mais l'organisation de la magistrature française fondée sur le déroulement des carrières justifie l'amélioration des règles d'évaluation individuelle. La LOLF doit aboutir à créer un lien plus explicite entre la performance et les modalités classiques de reconnaissance des qualités professionnelles. Aujourd'hui celle-ci prend plusieurs formes : le remerciement, l'avancement de grade, l'avancement accéléré d'échelon, la modulation indemnitaire. Ces modes de rémunération ne sont pas cependant des modes de rémunération de la performance, dans la mesure où ils récompensent plus le mérite et l'effort que l'atteinte du résultat, pour s'en tenir au cas de la fonction publique534. La LOLF devrait aboutir, à terme, à instituer un rapport direct dans la rémunération entre les objectifs et les résultats. D'une certaine manière, la nouvelle politique indemnitaire en faveur des magistrats depuis 2003 s'inscrit dans cette logique. Alors que certains avaient voulu y voir une atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil d'État a considéré que la création de primes modulables ne méconnaissait pas ce principe535 et a rappelé que la prime au mérite ne devait prendre en compte que la qualité et la quantité de travail536. Sans parler de la nouvelle bonification indiciaire en faveur des magistrats exerçant des fonctions de responsabilité, le dispositif en vigueur vise principalement à instituer une majoration de la prime forfaitaire au bénéfice des magistrats exerçant dans certaines juridictions connaissant un déficit de candidatures de nature à compromettre leur fonctionnement. Il prévoit le versement d'une prime pour travaux supplémentaires aux magistrats connaissant un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats par redistribution du reliquat de crédits indemnitaires non consommés ; il instaure enfin une modulation partielle du régime indemnitaire des magistrats, qui a été revalorisée à 9 % par des arrêtés du 8 septembre 2005, avec un taux d'attribution individuel pouvant varier de 0 % à 15 %. Ce taux moyen de la prime modulable s'applique notamment aux magistrats des premier et second degrés exerçant leurs fonctions en juridiction. Ce qui est sûr, c'est que l'évaluation des magistrats doit être comprise comme un moyen d'apprécier leurs mérites et comme un outil destiné à vérifier leurs aptitudes. Le Procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Louis Nadal, l'a admis bien volontiers devant les membres de la commission : « Je pense que la mesure de l'aptitude aux fonctions devrait devenir un élément essentiel de l'évolution des carrières. Nous avons des progrès à faire en ce domaine : il est de la responsabilité de toute la chaîne hiérarchique d'évaluer sincèrement les magistrats, pour le bien de la justice et des justiciables. Quand je parle d'évaluation, je ne parle pas seulement de notation et d'avancement, je parle d'appréciation de l'aptitude... »537 Comme l'y invitait récemment un conseiller référendaire à la Cour de cassation, « la grille d'évaluation devrait être modifiée pour intégrer des éléments d'appréciation plus précis sur le comportement du magistrat »538. L'évaluation a d'autant plus vocation à s'orienter dans cette direction si l'accent désormais est mis à l'ENM et dans les juridictions sur la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, l'évaluation est appelée à revêtir à terme une dimension déontologique en comprenant une rubrique en ce sens. En effet, à partir du moment où un code de déontologie définira des principes éthiques applicables aux magistrats, ceux-ci auront vocation à être déclinés dans la grille d'évaluation. Enfin cette évaluation pourrait servir de base pour l'établissement de listes d'aptitude sous réserve que celles-ci soient rétablies. 2. Favoriser une culture de contrôle interne Pas plus la définition de règles de déontologie que la réforme des critères d'évaluation des magistrats ne sauraient cependant, à elles seules, garantir un engagement plus efficace de la responsabilité des magistrats. Le développement des contrôles internes doit également être favorisé. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci peut être saisi pour dénonciation de faits motivant des poursuites disciplinaires par les premiers présidents des cours d'appel. Jusque là, cette faculté était exclusivement ouverte au garde des Sceaux. Copie des pièces est adressée à ce dernier, qui peut demander une enquête à l'Inspection générale des services judiciaires. Ce droit est toutefois encore peu pratiqué. On recense, en effet, un cas entre le 5 juin 2002 et le 31 août 2003, cette saisine s'étant effectuée conjointement avec le garde des Sceaux ; trois cas entre le 31 août et le 31 décembre 2003 ; quatre cas en 2004 et un cas en 2005. Cette timidité des premiers présidents de cour d'appel n'empêche pas toutefois certains hauts magistrats entendus par la commission d'enquête de revendiquer l'extension de cette saisine à tous les chefs de juridiction. C'est ainsi qu'en invoquant leurs responsabilités, M. Jean-Claude Magendie, Président du tribunal de grande instance de Paris, a plaidé pour cet élargissement de la saisine devant la commission d'enquête : « La responsabilité qui pèse sur les chefs de juridiction, leur consécration en tant que managers, n'implique-t-elle pas un rôle accru de ceux-ci dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ? La saisine du CSM ne pourrait-elle pas leur être également ouverte, au moyen d'une transmission par la voie hiérarchique ? »539 On ne peut que souscrire à cette proposition. Mais à quoi servirait cette extension si ce droit n'était pas exercé ? Les représentants de la Conférence des Premiers présidents de cour d'appel reçus par la commission d'enquête ont justifié l'usage modéré de la saisine du CSM par l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient pour détecter les fautes éventuelles des magistrats susceptibles de poursuites disciplinaires. Ils ont fait valoir que l'Inspection générale des services judiciaires était plus qualifiée qu'eux pour remplir cette tâche et ont milité pour une saisine de cette inspection par eux-mêmes. Ces considérations appellent deux séries d'observations. D'abord, on peut se demander si cette réticence à saisir le CSM n'est pas plus fondamentalement une affaire de culture qu'une question de texte. Force est de reconnaître, en effet, que d'ores et déjà l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire attribue aux premiers présidents la qualité d'autorité hiérarchique, avec les conséquences que cela entraîne en termes de gestion de personnel. Il dispose en effet que « Le Premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des Sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites ». C'est d'ailleurs à ce titre que le Premier président dispose du pouvoir d'évaluation dans les conditions fixées par l'article 19 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié et qu'il peut infliger des avertissements aux magistrats placés sous son autorité conformément à l'article 44 du statut. C'est enfin à l'administration employeur d'apporter traditionnellement la preuve de la faute imputable à l'agent, dans le contentieux de la fonction publique, comme le Conseil d'État l'a jugé, à propos d'une décision d'exclusion d'épreuves de sélection prise à l'encontre d'un militaire540. Par conséquent, les présidents de cour d'appel disposent déjà des moyens d'entreprendre les enquêtes administratives préalables à des procédures disciplinaires, lorsque des charges pèsent contre des magistrats du siège de leur ressort. Ils ne sauraient se retrancher derrière les pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle dévolus par l'article 5 du décret n° 65-2 du 5 janvier 1965 à l'Inspection générale des services judicaires, pour ne pas assumer leurs responsabilités disciplinaires. L'exercice de ces pouvoirs, sans qu'il soit besoin de changer le texte, s'inscrit parfaitement de plus dans la logique de responsabilisation et de gestion des ressources voulue par la LOLF. Faut-il au demeurant élargir la saisine de l'Inspection générale des services judiciaires ? Placé sous l'autorité du garde des Sceaux, l'Inspecteur général des services judiciaires, a reçu du décret précédemment cité du 5 janvier 1965 une mission permanente d'inspection sur les juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation exceptée, et sur l'ensemble des services et organismes relevant du Ministère de la justice. Des missions particulières peuvent, en outre, lui être confiées en dehors du programme annuel. La place de l'inspection dans la hiérarchie administrative est identique à celle occupée par les autres inspections générales ministérielles, qui sont directement placées également sous l'autorité directe de leur ministre respectif541. Modifier, par conséquent, les conditions de saisine de l'Inspection générale des services judiciaires pour en faire un prestataire de service à la demande des juridictions nuirait à une certaine cohérence d'ensemble de l'administration concernée en changeant de nature l'inspection et ce précédent devrait alors logiquement être étendu aux autres ministères. D'aucuns ont avancé l'idée d'un rattachement de l'Inspection générale des services judiciaires au CSM. Cette suggestion a été formulée par le Syndicat de la magistrature542 et par l'USM543. Cependant, d'une part, ce rattachement présenterait les mêmes défauts que ceux que l'on a relevés ; d'autre part, le risque est que ce système malgré toutes les précautions institutionnelles que l'on pourrait prendre pour séparer l'enquête de la poursuite, ne fasse du CSM un organe qui soit à la fois juge et partie et méconnaisse, par là même, les exigences d'impartialité requises par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, on est en droit de penser que d'ores et déjà les outils de détection de comportements contraires à l'éthique professionnelle existent et peuvent être employés dans le cadre d'une gestion des ressources humaines répondant aux besoins de l'institution et du justiciable. 3. Développer les contrôles externes Si le renforcement de la responsabilité des magistrats passe par le développement d'une culture de contrôles internes, il doit faire appel également à des contrôles externes plus fréquents. Comme l'a relevé Mme Dominique Commaret, Avocat général près la cour de cassation : « Qu'elles soient adressées au magistrat interpellé, à la hiérarchie judiciaire au ministère de la justice, qu'elles concernent l'institution elle-même ou ses auxiliaires, il n'est pas certain qu'elles fassent toujours et partout l'objet d'une réponse adaptée . Ceci cristallise les aigreurs et fabrique des "grands brûlés" de la justice qui assiègent leur vie durant les antichambres et les prétoires pour réclamer justice. Ces plaintes constituent de plus l'un des indicateurs de l'évolution de leurs préoccupations et de leur perception du fonctionnement de la justice au quotidien, voire le révélateur de dysfonctionnements ignorés de la hiérarchie judiciaire. »544 Même si l'outil statistique sur cette question est défaillant, cette préoccupation, sous une apparente nouveauté, est ancienne. Elle avait, en effet, fait l'objet d'un avant-projet de loi en 1999, qui avait institué un dispositif d'examen des plaintes des justiciables. À cette fin, il avait été prévu de créer une Commission nationale qui aurait été saisie des plaintes des justiciables s'estimant lésés par un dysfonctionnement du service de la justice ou par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un juge dans l'exercice de ses fonctions. Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie de la Cour en était le président. Étaient adjointes à celui-ci une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République et une personnalité qualifiée, désignée conjointement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Cette chambre des requêtes aurait rendu une décision insusceptible de recours par laquelle elle aurait décidé de ne pas donner suite ou de la transmettre au ministre de la justice ou aux chefs de cour concernés. Le plaignant était avisé dans tous les cas de la suite donnée à sa plainte et la commission présentait un rapport annuel. Cette proposition a suscité, en son temps, les plus vives critiques de la part du CSM et des organisations professionnelles de magistrats et n'a pas débouché en raison également de la suspension du processus de réforme de la Constitution sous la précédente législature. Parce qu'il n'a pas trouvé de solution depuis lors, à en juger par la multitude de lettres relatives à des problèmes judiciaires, adressées au Chef de l'État, au garde des Sceaux, aux parlementaires et au Médiateur de la République, pour ne citer qu'eux, le problème reste cependant toujours entier. La Chancellerie est par exemple destinataire d'une abondante correspondance qui, faute de véritable définition de méthode de traitement ne bénéficie que d'un suivi très relatif. Mme Marylise Lebranchu a fait état ainsi de 25 000 courriers concernant des affaires en cours et émanant de personnes se considérant mal traitées ou mal jugées, qui parviendraient tous les ans au ministère de la justice545. Sur 6 445 dossiers instruits en 2005 par les services centraux du Médiateur, 22,5 % avaient trait à des questions de justice. La commission d'enquête, à elle seule, a été destinataire de plus de 700 courriers. Pour traiter ces réclamations on peut imaginer deux solutions : la saisine directe du CSM ou la saisine d'une structure de filtrage de ce dernier. Pour tenter d'apprécier l'opportunité de la première option, on peut se reporter à quelques expériences étrangères. Il est, en effet, des pays où un droit de recours devant l'instance disciplinaire est ouvert au justiciable selon des modalités variables, puisqu'il existe parfois un filtrage préalable546. Au Canada, un Conseil composé uniquement des juges en chef des cours fédérales et des cours provinciales peut procéder à des enquêtes sur la conduite des juges à l'initiative de tout citoyen y compris le ministre de la Justice. Ces enquêtes ne peuvent porter sur une décision du juge mais sur la conduite d'un juge fédéral. Les plaintes sont instruites par un « Comité sur la conduite des juges », qui rejette les plaintes manifestement infondées. La décision d'ouvrir une enquête formelle est prise par l'assemblée plénière du Conseil canadien de la magistrature. Un comité d'enquête est alors créé, formé de deux membres du Conseil canadien de la magistrature et d'un avocat indépendant désigné par le ministre fédéral de la justice pour défendre l'intérêt général. Ce comité a des pouvoirs quasi juridictionnels, peut convoquer des témoins, recueillir leur témoignage et exiger la production de documents. Le juge concerné peut être assisté par un avocat et auditionné s'il le souhaite. Les audiences du comité d'enquête sont publiques. Le rapport peut conclure à l'opportunité de révoquer le magistrat pour inaptitude à remplir utilement ses fonctions. Lorsque la plainte émane du ministre de la justice, une enquête formelle est obligatoire. À l'issue de l'enquête, le juge encourt une lettre de réprobation ou une révocation. C'est le Conseil canadien de la magistrature en séance publique, qui décide de recommander ou non au ministre de la justice la révocation du magistrat. Le conseil a reçu 180 nouvelles plaintes en 2001-2002, 170 en 2002-2003, 138 en 2003-2004 et 149 en 2004-2005 mais la révocation n'a été proposée qu'une fois et jamais prononcée. En Espagne, un particulier sur simple plainte, le ministère public, le Conseil général du pouvoir judiciaire d'office ou sur demande d'un organe officiel, peuvent être à l'origine d'une procédure disciplinaire. Si celle-ci a vocation à s'appliquer, quelle que soit la personne à l'origine de la plainte, il est intéressant d'en rappeler l'économie générale qui est extrêmement précise. Toute plainte sur le fonctionnement de la justice en général ou l'activité d'un ou plusieurs juges ou magistrats fait l'objet, dans le mois de sa réception, d'une étude et d'un rapport d'un membre du service de l'Inspection judiciaire, qui peut proposer son classement, pour défaut de fondement par exemple, des vérifications complémentaires (« diligencias informativas ») contradictoires ou l'ouverture d'une procédure disciplinaire. L'ouverture d'une procédure est notifiée au plaignant, qui ne peut plus saisir la voie administrative pour sa plainte. En revanche, une décision de classement peut faire l'objet d'un recours administratif de la part des plaignants. Un avertissement peut être prononcé après simple audition du juge ou magistrat, décision qui peut également faire l'objet d'un recours administratif de la part du sanctionné. Toutefois les autres sanctions supposent qu'ait été suivie la procédure disciplinaire imposant la désignation d'un instructeur de rang au moins égal à celui de la personne poursuivie, lequel sera chargé de rechercher les éléments permettant d'établir les faits dénoncés et les responsabilités qui en découlent. Le ministère public et la personne poursuivie, assistée d'un avocat sont parties à l'enquête clôturée par un récapitulatif des faits et des charges et indique les sanctions applicables. Cette procédure ne peut excéder six mois. La décision motivée qui met fin à la procédure disciplinaire est notifiée à l'intéressé, au parquet et au plaignant, qui peuvent intenter contre elle un recours administratif. Après épuisement de ce recours, la sanction devient exécutoire et figure au dossier personnel de l'intéressé pour une durée variant avec la gravité de la sanction. La Commission de discipline du Conseil général du Pouvoir judiciaire peut, de sa propre initiative, une fois l'instructeur de l'affaire entendu ou sur sa proposition, après audition du juge ou du magistrat et du ministère public, ordonner la suspension provisoire de l'intéressé poursuivi disciplinairement pour une durée maximum de six mois, lorsqu'il existe des indices objectifs de commission d'une faute particulièrement grave. Le « Judicial Conduct and Disability Act » américain de 1980 dispose que toute personne peut déposer une plainte contre un juge, si elle estime qu'il a eu un comportement préjudiciable ou qu'il est incapable de remplir ses fonctions pour des raisons de déficience mentale ou physique. La plainte doit être déposée auprès de l'administrateur de la Cour, lequel doit en aviser immédiatement le Président, qui doit décider si la plainte est recevable et si l'engagement d'une enquête disciplinaire est opportun. Sans aller jusqu'à cette saisine directe qui ne manquerait pas de submerger le CSM et qui au demeurant à en juger par le faible nombre de sanctions est d'une efficacité limitée, une autre option consisterait à faire appel à une structure de filtrage préalable, dans la mesure où toutes les plaintes ne seraient pas recevables et où toutes ne relèveraient pas, par nature, du contentieux disciplinaire. a) Saisir le Médiateur de la République Là encore le législateur peut hésiter entre plusieurs possibilités : créer une commission ad hoc ou élargir les compétences d'autorités déjà existantes. La première structure s'apparenterait à celle en vigueur au Canada mais aurait une vocation beaucoup plus large. Celle-ci pourrait être en effet habilitée à faire le partage entre ce qui relève des voies de recours traditionnelles, ce qui est de la seule compétence disciplinaire et ce qui ressort de la compétence exclusive des auxiliaires de justice concernés comme les avocats. Ce sont ces réclamations qu'une commission ad hoc pourrait traiter avec une distance suffisante par rapport aux justiciables, aux instances judiciaires et disciplinaires, sans être conçue comme un censeur. Leur nature très variée dépassant le seul contentieux du dysfonctionnement de la justice relevant de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire justifierait cette création, qui serait conçue comme un « poste d'aiguillage » en quelque sorte. Le fonctionnement de cette chambre des requêtes s'apparenterait à celui de la commission des requêtes instituée auprès de la Cour de justice de la République par l'article 68-2 de la Constitution pour statuer sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement. C'est à cette commission, rappelons-le, que revient le soin d'ordonner soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisir la Cour de justice de la République. Cette commission est composée de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, désignés pour cinq ans. En faisant référence à un « dispositif reposant, avec les précautions et les filtres qui s'imposent, sur la saisine directe du CSM, non pour le voir entrer automatiquement dans une voie disciplinaire, mais pour donner la possibilité à une émanation de ce Conseil d'inviter le magistrat concerné à s'expliquer sur son comportement », M. Jean-Louis Nadal a évoqué de tels filtrages préalables547. Le même jour, M. Guy Canivet s'est déclaré aussi partisan de la création d'un mode de saisine par les justiciables, qui auraient à se plaindre de manquements par les juges à leurs obligations professionnelles. À cet effet, il a prôné l'installation d'une commission des requêtes, adjointe à l'organe disciplinaire, pour examiner les demandes et saisir le CSM en le chargeant d'y répondre si elles étaient fondées. Le recours à un organe indépendant pour instruire des plaintes figure également parmi les propositions du Syndicat de la magistrature, qui admet la nécessité « d'un contrôle externe de la justice sous réserve qu'il permette d'embrasser le fonctionnement général de la justice et ne concerne pas seulement les magistrats de l'ordre judiciaire »548. Même si la formulation du point 5.3 de la Charte européenne sur le statut des juges du Conseil de l'Europe de 1998 est très générale et touche plutôt aux dysfonctionnements de la justice, elle mérite d'être rapprochée de ces différents points de vue. Elle reconnaît, en effet, le droit à toute personne « d'avoir la possibilité de soumettre sans formalisme particulier sa réclamation relative au dysfonctionnement de la justice dans une affaire donnée à un organisme indépendant. Cet organisme a la faculté, si un examen prudent et attentif fait incontestablement apparaître un manquement (à l'un des devoirs expressément définis par le statut) de la part d'un juge ou d'une juge, d'en saisir l'instance disciplinaire ou à tout le moins d'en recommander une telle saisine à une autorité ayant normalement compétence, suivant le statut, pour l'effectuer ». Cette réforme nécessiterait une modification du statut des magistrats et donc une loi organique, qui aurait pour mission de définir les attributions de cette commission de filtrage et sa composition, sachant que l'on pourrait imaginer de faire appel au concours de cinq magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, placés en détachement pour exercer ces fonctions. Il conviendrait au surplus de modifier la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM. Une autre solution qui aurait le mérite de la simplicité, sous réserve d'aménagements de son statut actuel et à laquelle s'est ralliée votre commission, consisterait à s'appuyer sur le Médiateur de la République. Comme il s'en est ouvert devant la commission d'enquête, cette alternative a les faveurs du garde des Sceaux : « Je crois qu'à côté du garde des Sceaux et des chefs de cour [...] il faudrait envisager une possibilité de saisine par les citoyens après filtrage par un organisme tiers. Je suis toujours très réticent en ce qui concerne la création de nouveaux organismes qui s'apparentent à des comités Théodule. Je crois que la raison voudrait donc que ce travail de filtre puisse être fait par le Médiateur de la République. »549 Sans qu'il convienne de rechercher la paternité de cette proposition, elle a été présentée également au cours des auditions par Mme Dominique Commaret. Celle-ci a soutenu, en effet, qu'une possibilité résidait dans « la désignation du Médiateur de la République ou la création d'une autorité administrative indépendante nationale, disposant des modes et pouvoirs de saisine, d'investigation, d'avis et de recommandations de ce dernier ou de la Commission nationale de déontologie de la sécurité... Que l'on opte pour le Médiateur de la République ou pour une autorité indépendante, l'un ou l'autre de ces organes aurait pour tâche de séparer les expressions de l'animosité personnelle ou de la volonté de nuire, les réclamations irrecevables parce que critiquant des décisions juridictionnelles, celles qui manifestent une incompréhension des procédures et ne demandent qu'une explication didactique, de celles qui sont révélatrices de comportements non traités parce qu'ignorés et qui justifient le recueil des observations du magistrat personnellement mis en cause et la vérification sur pièces de leur bien-fondé ou non. Cet organe disposerait du pouvoir de transmettre ses constatations aux autorités chargées de saisir en opportunité, l'instance disciplinaire »550. Le recours au Médiateur se situe au-delà de la suggestion de l'institution d'un simple « numéro vert » à l'adresse des justiciables ou de l'aménagement d'un « bureau de réception des plaintes au sein de l'inspection des services », qui sont parfois mis sur le même plan que le Médiateur551. Le recours au Médiateur de la République peut, en effet, se concevoir, dans la mesure où, de par la loi n°73-6 du 3 janvier 1973, il lui revient de traiter les réclamations des administrés relatives aux administrations publiques. Des pays étrangers ont, de plus, attribué cette compétence à leur propre Médiateur national ou à une institution équivalente. Si l'on songe aux fonctions assumées par le «Defensor del Pueblo » espagnol, le recours au Médiateur de la République ne serait pas en effet sans précédent. On rappellera que prévu par l'article 54 de la Constitution espagnole, le Défenseur du peuple est élu par la Chambre des Députés et par le Sénat pour une période de cinq ans à la majorité des trois cinquièmes pour veiller à la défense des droits fondamentaux des citoyens. En vertu de la loi organique du 6 avril 1981, il peut engager et poursuivre d'office ou à la demande d'une personne physique ou morale toute enquête visant à éclaircir des actes et des décisions de l'administration publique, le champ de cette dernière recouvrant « l'administration judiciaire » (article 13 de la loi). Une procédure contradictoire est engagée avec le responsable du dysfonctionnement et quand les faits sont apparemment délictueux, le Défenseur du Peuple en informe le Procureur général de l'État. Au Royaume-Uni, depuis une loi du 3 Avril 2006, les particuliers peuvent adresser des plaintes auprès du Lord Chief Justice, au Lord Chancellor, ministre de la justice, au secrétariat des plaintes ou à l'Ombudsman. S'agissant des plaintes les moins importantes le secrétariat décide des suites à donner. Il peut rejeter la demande au nom du Lord Chief Justice et du Lord Chancellor. Dans les cas les plus graves, les dossiers sont transmis à ces deux autorités qui peuvent demander des investigations supplémentaires. Une instance d'appel (« Review body ») a été mise en place. Elle peut être saisie par le Lord Chancellor ou le Lord Chief Justice, si le plaignant estime que l'enquête du secrétariat des plaintes n'est pas satisfaisante, le juge concerné pouvant demander lui-même que cette instance soit saisie552. Il ne faut pas perdre de vue cependant que le Médiateur de la République a été saisi de 59 974 affaires en 2005, ce qui représente une charge considérable et que l'article 11 de son statut lui interdit d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction et de remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle. Par conséquent, l'adjonction de nouvelles compétences dans son champ d'intervention, pour contester le fonctionnement du service de la justice, ne serait possible qu'après une modification de la loi du 3 janvier 1973. Sa saisine dans ce cas s'effectuerait sans filtrage par les parlementaires, les requêtes devant être déposées devant ses délégués départementaux. Parallèlement, la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM devrait accueillir la saisine du CSM par le Médiateur. Il reviendrait à ce dernier d'aiguiller les justiciables vers les autorités compétentes et de saisir le CSM, afin qu'il se prononce éventuellement sur le terrain disciplinaire. b) Saisir le CSM à la suite de la constatation de dysfonctionnements de la justice Le recours au Médiateur de la République pour instruire ces réclamations pourrait être imaginé sans préjudice d'une autre réforme, consistant à autoriser le juge, saisi au titre de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux de la justice, de transmettre systématiquement le dossier définitivement jugé au CSM, qui statuerait éventuellement sur son volet disciplinaire. Plusieurs hauts magistrats ainsi que le doyen Serge Guinchard ont, en effet, attiré l'attention de la commission d'enquête sur la nécessité de mieux articuler responsabilité civile et responsabilité disciplinaire. Il faut savoir d'abord que les actions en responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose : « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire » se chiffreraient aujourd'hui à près de six cents. Le nombre de dossiers ouverts annuellement au titre de cet article est en progression régulière : 56 en 1997, 72 en 1998, 171 en 1999, 122 en 2000, 142 en 2001, 193 en 2002, 182 en 2003, 180 en 2004 et 214 en 2005. Par conséquent, avec le développement de ce contentieux, les données qui justifiaient la création d'une commission autonome des plaintes à la fin des années quatre-vingt-dix ont sensiblement évolué. M. Jean-Claude Magendie a défendu l'idée - appliquée par le tribunal de grande instance de Paris - de transmettre toute décision définitive ayant condamné l'État, au garde des Sceaux et aux chefs de cour concernés. Selon lui, « cette transmission permettrait l'introduction d'une procédure disciplinaire si elle venait à révéler, de la part d'un magistrat, un manquement grave à ses obligations professionnelles. Quant aux chefs de juridiction, ils seront à même de veiller à ne pas laisser à un poste particulier un magistrat qui s'est montré défaillant »553. Mme Dominique Commaret et le doyen Serge Guinchard sont également acquis à cette procédure, qui se combinerait avec l'extension de la saisine du CSM aux chefs de juridiction. Mme Dominique Commaret a notamment fait valoir qu'« elle permettrait la pleine information des titulaires du pouvoir administratif et du pouvoir disciplinaire et la mise en place des moyens, outils et garde-fous nécessaires à la diminution des risques, qu'ils relèvent de la responsabilité du service ou de la responsabilité personnelle »554. Comme l'a rappelé M. Jean-Claude Magendie, encore conviendrait-il de veiller à ce que les magistrats nommément désignés ou identifiables bénéficient de garanties de procédure, dans la mesure où aujourd'hui « l'agent judiciaire du Trésor qui est assigné en défense n'entre pas en contact avec les magistrats ou fonctionnaires du greffe concernés »555. En ne faisant statuer éventuellement sur le contentieux disciplinaire qu'après que la justice se soit prononcée sur l'existence d'un dysfonctionnement de la justice, cette formule complèterait le dispositif existant de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans le prolongement de cette réflexion, la commission a abordé la question des sanctions. C. SANCTIONNER LA MÉCONNAISSANCE MANIFESTE DES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE CIVILE ET PÉNALE Parce qu'il constitue l'une des garanties les plus sûres de leur indépendance, les magistrats bénéficient d'un régime de responsabilité très protecteur, accentué par la pratique. Si l'on fait abstraction de leur responsabilité pénale, qui relève du droit commun, pour ne s'intéresser qu'à leur responsabilité civile et disciplinaire, les données tant juridiques que factuelles du problème illustrent les difficultés d'une réforme visant à sanctionner les fautes grossières des magistrats tout en respectant les actes juridictionnels. Une telle réforme n'est pas incompatible avec une rénovation des statuts du Conseil supérieur de la magistrature. 1. Le terrain de la responsabilité civile Si l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire ne prévoit une réparation de la responsabilité au titre des dysfonctionnements de la justice que pour faute lourde, la Cour de cassation a, depuis un arrêt d'assemblée du 23 février 2001, une interprétation souple de cette dernière notion : « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». Cet assouplissement explique sans doute que l'on assiste à cette augmentation des actions en responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 781-1, que l'on a évoquée. L'article 11-1 du statut de la magistrature dispose de son côté que « la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État ». Cependant, ces dispositions sont sans véritable portée pratique. D'une part, le champ de la responsabilité est défini étroitement, puisqu'une faute qui ne se détacherait pas du service public de la justice ne pourrait pas donner lieu à une action directe de la victime à l'encontre du magistrat auteur de l'acte. En cela, cette définition de la faute personnelle est plus étroite que celle admise par le contentieux administratif, qui fait référence à la « faute personnelle non dépourvue ou non dénuée de lien avec le service ». D'autre part, la victime doit d'abord adresser une demande d'indemnité à l'État, c'est-à-dire à l'Agent judiciaire du Trésor et, en cas de rejet, au juge judiciaire, sur le fondement de l'article L. 781-1, l'action récursoire de l'État contre le magistrat devant être engagée devant une chambre civile de la Cour de cassation. Cette action constitue une application du droit classique de l'administration à agir contre ses agents pour les dommages qu'elle a subis de leur part mais ne connaît aucun exemple depuis 1958. Comme l'a relevé devant la commission d'enquête M. Jean-Claude Magendie : « La définition de la faute personnelle permet de comprendre pourquoi l'action récursoire ne s'exerce pas dans la pratique. Même en cas de faute personnelle du juge, la victime ne dispose pas d'une action directe contre le magistrat lui-même. C'est en effet l'État qui est garant du dommage causé. C'est à l'État et à lui seul, lorsqu'il a été condamné pour dysfonctionnement du service public de la justice, qu'il appartient d'exercer, à l'encontre du magistrat concerné, une action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a été contraint de régler par la faute de ce magistrat. »556 Il est à noter que ce système de l'action récursoire est communément prévu à l'étranger. Ainsi il est garanti par l'article 34 de la Loi Fondamentale allemande et joue en cas de faute intentionnelle (« Vorsatz ») ou de négligence grave (« grabe Fahrlässigkeit ») mais n'est que très rarement mis en pratique. Il en va de même en Italie comme on le verra plus loin. Les difficultés auxquelles est susceptible de se heurter le législateur pour réformer ces règles ne sont donc pas négligeables ; il faut au surplus tenir compte de principes à valeur constitutionnelle comme l'indépendance de la magistrature, de principes généraux du droit comme le secret du délibéré, de la collégialité et de l'autorité de la chose jugée. Ces principes sont toutefois d'une force inégale. C'est ainsi que l'indépendance de la magistrature ne saurait faire oublier en même temps que la justice est un service public et qu'au nom de cette indépendance la responsabilité du juge ne doit pas se retrancher systématiquement derrière celle de l'État. L'autorité de la chose jugée ne saurait constituer non plus automatiquement un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'État, lorsque le contenu d'une décision juridictionnelle est en jeu, même si les décisions, en ce sens - on l'admettra volontiers - sont rares. Dans une décision d'assemblée du 27 décembre 1978, Darmont (req. n° 96004), le Conseil d'État a fait valoir que « l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait définitive ». Par conséquent, le juge administratif admet un engagement de la responsabilité de l'État du fait de l'activité défectueuse des juridictions si la décision n'est pas ou plus assortie de l'autorité de la chose jugée et si l'on peut invoquer une faute lourde ne résultant pas du contenu même de la décision. S'agissant du juge judiciaire, des juridictions ont reconnu la responsabilité de l'État, alors que des décisions juridictionnelles définitives étaient en cause. On peut citer, à cet effet, le cas de l'omission d'information du juge aux affaires familiales par le parquet sur l'état d'une mère considérée comme dangereuse et à qui avait été confiée la garde d'un enfant qu'elle tua ultérieurement (Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000). Parce qu'il est, par définition, accompli dans le service, parce qu'il est souvent le fait de la collégialité, parce qu'interviennent au procès non seulement des magistrats mais également des enquêteurs, des experts, des greffiers, l'acte juridictionnel s'accommode mal d'une responsabilité personnelle du magistrat. M. Daniel Ludet n'a-t-il pas rappelé aux membres de la commission que « dans notre système comme dans la plupart des pays étrangers, l'acte juridictionnel est un sanctuaire : il ne peut donner lieu ni à une responsabilité pénale ni à une responsabilité civile personnelle ni à une responsabilité disciplinaire » ?557 L'Union syndicale des magistrats, par la voix de son secrétaire national, dresse le même constat : « Vouloir entrer dans un système de mise en cause de la responsabilité du magistrat pour ses décisions juridictionnelles serait une régression institutionnelle inédite et aboutirait à une mise en cause anarchique des décisions de justice et à une rapide paralysie de la justice. »558 En Allemagne, la responsabilité personnelle du juge ne peut se concevoir que pour les décisions rendues par un juge unique, les décisions collégiales ne pouvant donner lieu à une action en responsabilité contre tel ou tel membre de la juridiction concernée. On relève cependant que dans un pays comme l'Italie où les principes juridiques et les institutions judiciaires sont très proches des nôtres, la collégialité ne constitue pas un obstacle à une action en responsabilité contre un juge559. En effet la loi n°117 du 13 avril 1988 offre la faculté aux magistrats participant à une formation collégiale de déposer une opinion dissidente dans une enveloppe scellée conservée par le greffe. Le magistrat peut invoquer cette opinion divergente si sa responsabilité vient à être recherchée en raison de la décision rendue. Récemment, le ministre de la justice s'est fondé sur ce mécanisme de l'opinion dissidente pour engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un collège de magistrats, à l'occasion d'une décision de remise en liberté conditionnelle d'un meurtrier ayant immédiatement après sa libération commis un nouveau meurtre. Considérant que la possibilité d'une opinion dissidente était ouverte au magistrat, le ministre a en effet jugé qu'il était également possible d'engager la responsabilité disciplinaire de chaque membre d'un collège. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas encore statué sur ce cas. En réalité, la difficulté de l'exercice pour le législateur est double : - D'une part, elle réside dans l'imbrication des responsabilités et dans la fragilité d'une définition de la ligne de partage entre faute personnelle et faute de service. Ce recouvrement de la responsabilité personnelle avec l'activité juridictionnelle touche au demeurant tant la réparation civile que l'action disciplinaire. Mme Dominique Commaret a évoqué ainsi le cas d'un conseiller rapporteur d'une cour d'appel qui avait violé ouvertement le secret du délibéré dans la motivation de la décision qu'il avait rédigée, parce qu'il avait été mis en minorité et qui avait commis incontestablement une faute déontologique au regard de son serment. « Au-delà de la censure de la décision par la chambre criminelle de la Cour de cassation, peut-il et doit-il être sanctionné ? »560 À l'appui de cet exemple, on peut également citer une décision du Conseil d'État du 20 juin 2003 (req. n° 248242), rendue à propos d'une sanction disciplinaire contre un magistrat du parquet : « La circonstance qu'un agissement imputable à un magistrat peut apparaître ultérieurement comme ayant joué un rôle dans un enchaînement de faits dont l'aboutissement révèle un mauvais fonctionnement du service public de la justice, n'établit pas, par elle-même, la gravité de la faute qui peut être reprochée à ce magistrat. » La Haute juridiction ne faisait que suivre en cela son commissaire du gouvernement, qui avait fait observer que « quand l'accumulation d'erreurs d'appréciation, de négligences - D'autre part, les considérations pratiques liées à la mise en œuvre de la responsabilité des magistrats dans l'exercice des décisions juridictionnelles ne doivent pas être occultées. Comme l'a fait remarquer le Premier président Guy Canivet, lors de son audition par la commission d'enquête : « toute décision judiciaire, qu'il s'agisse de retrait d'un enfant à sa famille ou de sa restitution d'une mesure de tutelle, d'une décision relative à la garde d'un enfant... est une prise de risque. Si la responsabilité du juge peut être directement recherchée pour de telles décisions, il développera des réactions d'aversion au risque qui paralysent ses décisions au bénéfice du fait acquis, en tout cas les retarderont considérablement par des vérifications ou des mesures d'expertise à l'infini. » Le Président de la Conférence nationale des procureurs généraux n'a pas dissimulé, de son côté, les risques auxquels s'exposerait le législateur à vouloir mettre en jeu la responsabilité personnelle des magistrats : « c'est tout le mécanisme de l'appel et du pourvoi et donc le fondement même de l'indépendance de l'autorité judiciaire dans la décision qu'elle rend que vous risquez de bouleverser, ce qui serait grave pour le fonctionnement de l'institution. »561 Cette position revient à exprimer sous une forme différente la position constante du CSM en matière disciplinaire : « Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige. » (Décision du 6 novembre 1996) En analysant le contenu des décisions juridictionnelles, le Premier président de la Cour de cassation a cependant opéré une distinction qui, de fait, commande l'engagement ou non de la responsabilité du magistrat : « Dans un jugement, il faut distinguer deux éléments : la décision elle-même, et le mécanisme par lequel on parvient à cette décision. Si un juge rend une décision sans délibérer, en escamotant le débat, je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela mette en jeu sa responsabilité, civile ou disciplinaire. En revanche, s'agissant du corps de la décision, dès lors qu'elle ne contient pas une motivation répréhensible, il ne me paraît pas possible, au regard du principe d'indépendance, d'introduire une responsabilité. »562 Faut-il s'interdire pour autant toute réflexion sur la responsabilité des magistrats, alors que l'institution judiciaire met de plus en plus en cause la responsabilité des décideurs publics et privés ? Faut-il ignorer que consécutivement à cette évolution, le champ des immunités se réduit progressivement ? Faut-il oublier que des « professionnels comme ceux de la santé (et singulièrement les chirurgiens) voient leur responsabilité mise en cause et les actions des victimes favorablement accueillies par les tribunaux, sans que l'intérêt général soit moindre (sous entendu que celui de l'activité juridictionnelle) ?563 Faut-il s'abstenir de constater que « les réclamations des usagers, qui sont l'un des indicateurs de l'évolution de leurs préoccupations et de leur perception du fonctionnement de la justice au quotidien, voire le révélateur de dysfonctionnements ignorés de la hiérarchie judiciaire sont mal traitées » ?564 Au surplus, certains pays comme l'Espagne ont mis en place des régimes de responsabilité civile des magistrats pour les dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit toutefois d'une faute lourde, les magistrats souscrivant une assurance civile professionnelle, qui les garantit des condamnations civiles pouvant être prononcées contre eux et est de l'ordre de 200 euros par an. Ainsi l'article 411 de la loi organique du pouvoir judiciaire du 1er juillet 1985 dispose que « les juges et magistrats répondent civilement des dommages et préjudices qu'ils ont causés dans l'exercice de leurs fonctions en cas de dol ou de faute », alors que l'article 903 de la loi de procédure civile limite cette mise en cause de la responsabilité civile aux préjudices réels et effectifs, évaluables en argent, causés par « négligence ou ignorance inexcusable », ce qui exige une faute lourde. Cependant dans la pratique, c'est ce dernier texte qui a prévalu. De fait, les cas de mise en jeu de la responsabilité civile des magistrats espagnols sont extrêmement rares565. La responsabilité civile des magistrats italiens peut également être engagée, si une personne a subi injustement un dommage à la suite d'un dol, d'une faute grave ou d'un déni de justice. Ni l'interprétation de la loi, ni l'interprétation du fait et des preuves ne peuvent donner lieu à responsabilité. La personne qui estime qu'elle peut obtenir une réparation civile d'un magistrat doit saisir la cour d'appel, laquelle vérifie si les conditions sont réunies et autorise à assigner l'État et le juge dont le comportement professionnel est critiqué, l'État disposant d'une action récursoire contre ce dernier. En réalité, la responsabilité civile des magistrats est rarement mise en œuvre, même si la plupart sont assurés par un contrat de groupe souscrit par l'Association nationale des magistrats à hauteur de 300 euros par an566. Sans prétendre répondre à toutes les questions que soulève la mise en place d'un régime de responsabilité des magistrats, les options qui s'offrent au législateur pour renforcer les règles de responsabilité civile peuvent être ramenées à deux, à savoir le choix d'un régime de responsabilité sans faute et la mise en œuvre d'une responsabilité de l'État sans exercice de l'action récursoire. S'il est délicat d'imputer des fautes à un magistrat au long de la procédure judiciaire en raison de la dispersion des responsabilités, on peut légitimement se demander, en effet, s'il ne serait pas plus opportun de définir pour eux un régime de responsabilité sans faute. Mais peut-on assimiler l'acte juridictionnel à la réalisation d'un risque, à l'instar en procédure pénale de la réparation à raison d'une détention ? Peut-on transposer aux magistrats les régimes de responsabilité applicables aux explosifs, aux armes, engins, ouvrages publics dangereux, à la transfusion sanguine ou au traitement des malades mentaux, issus du droit administratif ? À la lecture de ces cas de responsabilité pour risque, on voit bien qu'ils ont pour point commun de se rattacher à des activités dangereuses ou très spécifiques et sont sans rapport avec l'acte de juger. Au surplus, on peut rejoindre le Président Jean-Claude Magendie, pour considérer que l'introduction d'un régime de responsabilité sans faute irait à l'encontre de l'objectif que s'assignerait le législateur pour sanctionner les fautes des magistrats : « Outre que le passage à une responsabilité sans faute ne facilitera pas le travail des juridictions saisies de ces dossiers, l'image renvoyée à la société sera celle d'une société frileuse, qui cherche à protéger ses magistrats en ne caractérisant aucune faute de leur part, leur permettant ainsi d'échapper à d'éventuelles poursuites disciplinaires en raison de leurs manquements. »567 Une deuxième option consisterait à recommander un système d'indemnisation des victimes sans mise en cause de la responsabilité civile personnelle du juge. Cette voie a été brillamment défendue devant la commission d'enquête par le Professeur Serge Guinchard, Recteur de l'Académie de Rennes. Considérant qu'il serait nécessaire de déconnecter la question de l'indemnisation des victimes d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice de la responsabilité personnelle du juge, le Professeur Serge Guinchard a suggéré à la commission « que la responsabilité de l'État du fait de jugements erronés puisse donner lieu à une indemnisation, à condition qu'ils portent tort et que le préjudice n'ait pas été réparé par l'exercice des voies de recours »568. Cette mise en jeu de la responsabilité de l'État ne donnerait pas lieu de sa part à une action récursoire. À l'appui de sa démonstration, le Professeur Serge Guinchard a cité les exemples belge et luxembourgeois. La Cour de cassation belge dans un arrêt du 19 décembre 1991 a retenu la faute lourde dans l'activité juridictionnelle sous certaines conditions : violation d'une norme juridique sous réserve que la décision juridictionnelle fautive ait été au préalable réformée par l'exercice d'une voie de recours lui ôtant ainsi toute autorité de chose jugée ; comportement du magistrat qui n'aurait pas été normalement soigneux et prudent ; démonstration par le plaideur que le dommage dont il se plaint n'a pu être réparé par le seul exercice de la voie de recours ayant abouti à l'anéantissement de la décision régulière569. La loi luxembourgeoise du 1er septembre 1988 a adopté une solution identique, à condition que l'action en responsabilité ne remette pas en cause l'autorité de la chose jugée. La législation luxembourgeoise se contente même d'une faute simple du juge, d'une simple erreur d'appréciation. Au surplus, le Professeur Guinchard a invoqué un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 30 septembre 2003, Köbler contre Autriche570, en vertu duquel la violation manifeste du droit communautaire par une juridiction nationale en dernier ressort est de nature à obliger l'État membre à réparer les dommages causés aux particuliers. Il en a déduit qu'il devrait désormais être très difficile pour le juge français de ne pas faire application de cette jurisprudence. Pour séduisante qu'elle soit, cette option reviendrait cependant en réalité à cantonner la responsabilité individuelle du magistrat fautif au contentieux disciplinaire. Mais c'est prêter une efficacité aux poursuites disciplinaires qu'elles n'ont pas. Celui-ci constitue un autre volet de la responsabilité des magistrats. L'article 43 du statut de la magistrature dispose que tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet par le garde des Sceaux, les sanctions disciplinaires s'échelonnant de la réprimande avec inscription au dossier à la révocation avec ou sans suspension des droits à pension, à raison de sept sanctions de portée croissante, l'audience devant la formation disciplinaire n'étant publique que depuis la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 (articles 57 et 65 du statut respectivement pour les magistrats du siège et du parquet). L'Union syndicale des magistrats a coutume de faire valoir que la responsabilité disciplinaire des magistrats est de plus en plus fréquemment mise en jeu devant le CSM. Le Secrétaire national de ce syndicat n'a pas manqué de développer cet argument devant la commission d'enquête571. Le CSM soutenait également cette position dans son rapport annuel de 1999. Si l'on s'appuie cependant sur la pratique, les données statistiques et les comparaisons internationales, se dégage une réalité beaucoup plus nuancée. Dans toute institution, dans tout corps, les critiques revêtent encore plus de force lorsqu'elles émanent des membres de ces derniers et prennent ainsi appui sur une expérience professionnelle quotidienne. Or, dans son livre déjà cité, Mme Laurence Vichnievsky, n'hésite pas à évoquer l'absence de sanctions de certains comportements préjudiciables à la magistrature, sans recourir à la litote ou à la périphrase : « On peut regretter la frilosité de notre hiérarchie qui hésite à stigmatiser l'un des siens et qui préfère, dans la plupart des cas, s'accommoder de situations effarantes - il m'est arrivé de rencontrer des "cas" tel ce membre du parquet n'hésitant pas à faire part à l'audience de ses convictions religieuses extrêmes ou cet autre collègue s'endormant systématiquement à l'audience, de trop de sommeil ou de trop d'alcool... Tout au plus cherchera-t-on à limiter les risques pour une mise à l'écart discrète de l'intéressé qui sera maintenu dans ses fonctions sans avoir nécessairement à les exercer. L'institution s'applique encore à elle-même le principe du "pas de vagues" souvent mis en œuvre dans la gestion des dossiers. »572 Les statistiques viennent confirmer ce constat. En 1970, on recensait quatre saisines du CSM, sur le terrain disciplinaire, en 1989 on ne relevait aucune saisine, en 2004 on en comptait onze ; en 2005, dix (sept pour le siège, dont une par un Premier président, et trois pour le parquet, dont une par un Procureur général)573. Sur 34 ans, on conviendra que cette évolution ne représente qu'une augmentation modeste. Sur une plus longue période les chiffres montrent que les sanctions disciplinaires sont en réalité très peu appliquées. Comme on l'a vu, pour réfuter l'idée qu'une certaine complaisance prévaudrait de sa part à l'égard de comportements déviants de magistrats, le CSM a pris le parti de présenter un recueil des décisions disciplinaires depuis 1959. Ce document publié au début du mois de mai 2006 fait état de 201 décisions disciplinaires. En réalité, un examen attentif des décisions qui y figurent montre que ce total recouvre des réalités très disparates et que le nombre effectif de décisions disciplinaires stricto sensu pour les magistrats du siège s'élève à 92 sanctions dont 19 sanctions doubles, soit 73 personnes sanctionnées, c'est-à-dire moins de deux sanctions par an pour les seuls magistrats du siège en près de cinquante ans et 50 avis pour les magistrats du parquet. Le recueil inclut, en effet, dans les décisions disciplinaires pour le siège des actes des plus divers qui ne relèvent pas des sanctions entendues au sens de l'article 45 du statut : une expertise médicale en date du 28 juin 1978 ; une décision sur demande de récusation des membres du CSM du 6 février 1981 ; une demande de publicité des débats devant le CSM à la date du 7 février 1981 ; deux rejets de demande de publicité des débats ; une enquête complémentaire confiée à un conseiller rapporteur le 27 juin 1991 ; un constat de défaut d'objet d'une requête dressé le 23 juin 1992 ; une ordonnance de remplacement du secrétaire du CSM le 24 juin 1992 ; des retraits de dénonciation du garde des Sceaux ; un constat de l'extinction de l'action disciplinaire en raison du décès du magistrat remontant au 30 septembre 1993 ; un rejet de la demande de renvoi pour cause de récusation émis le 20 juillet 1994 ; un refus d'émettre un avis informel sollicité par le garde des Sceaux pris le 11 septembre 1996. Par ailleurs, force est de constater que les sanctions qui sont appliquées aux magistrats du siège ne sont pas d'une extrême sévérité. Sur ces 92 sanctions effectives appliquées aux magistrats du siège dont 19 doubles sanctions, on relève 9 réprimandes avec inscription au dossier (sanction la plus faible), 38 déplacements d'office (deuxième sanction dans l'échelle des sanctions), 19 retraits de certaines fonctions (troisième sanction dans l'échelle des sanctions) ; 4 abaissements d'échelon (quatrième sanction dans l'échelle des sanctions) ; aucune exclusion temporaire pour une durée maximum d'un an avec privation totale ou partielle du traitement ; 1 rétrogradation (sixième sanction dans l'échelle des sanctions) ; 11 mises à la retraite d'office ou admissions à cesser des fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite (septième sanction dans l'échelle des sanctions) et 10 révocations avec ou sans suspension des droits à pension. Il faut y ajouter 3 retraits et 2 refus d'honorariat. S'agissant des magistrats du parquet, on arrive à un total de 50 avis au garde des Sceaux dont 7 doubles sanctions et 5 interdictions temporaires, ces dernières n'étant pas à proprement parler des sanctions disciplinaires au sens de l'article 45 de l'ordonnance organique mais des mesures de suspension provisoire. Si l'on retire les 6 non-lieux à sanction, les sanctions sont ainsi réparties : 7 réprimandes avec inscription au dossier ; 22 déplacements d'office ; 2 abaissements d'échelon ; 2 rétrogradations ; 6 mises à la retraite d'office, 4 retraits de fonctions, 4 révocations et 1 retrait d'honorariat. D'aucuns considèreront que sur un total de 7 000 magistrats, ces chiffres constituent la preuve de la qualité des membres de ce corps. D'autres ne dissimuleront pas leur inquiétude et supputeront que ces chiffres révèlent l'absence d'une réelle politique disciplinaire. On citera également un échantillon de trois exemples ayant débouché sur un simple déplacement d'office : - le cas d'une magistrate alcoolique à l'origine d'incidents publics graves et répétés au sein de la cour d'appel où elle venait de prendre ses fonctions (13 juillet 2001) ; - le cas d'un magistrat qui prenait des photos de modèle dévêtus dans la salle d'audience du tribunal de grande instance et faisait de même avec des mineures chez lui (28 février 2002) ; - le cas d'un magistrat ivre ayant provoqué un accident de la circulation ayant entraîné des blessures, qui s'était rendu coupable de délit de fuite et s'était refusé après à suivre les gendarmes (18 juillet 2003). Les comparaisons internationales ne plaident pas non plus en faveur de notre pays. Une étude de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, éditée en 2002 par le Conseil de l'Europe fait état des procédures disciplinaires et des sanctions prononcées à l'encontre de juges. Le tableau recense 10 procédures disciplinaires et 9 sanctions à l'encontre des juges français contre respectivement 33 procédures et 18 sanctions en Autriche, 57 procédures au Danemark, 52 procédures et 17 sanctions en Espagne, 107 procédures et 22 sanctions en Italie. Pour 1 000 juges, le taux de sanction applicable en France est le plus bas avec celui de l'Angleterre et du Pays de Galles. Si l'on prend un pays comme l'Italie, qui compte 8 865 magistrats professionnels, on a recensé en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 respectivement 26, 24, 27, 31 et 22 décisions de condamnations prononcées par la Section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Cette situation ne doit pas décourager pour autant de conduire une réflexion sur le renforcement de la responsabilité disciplinaire des magistrats. Deux axes sont possibles : soit mettre en cause le comportement du magistrat, soit mettre en cause ses qualités intellectuelles dans l'acte juridictionnel. En insistant sur la nécessité de faire référence au « comportement » du magistrat et non au « contenu de la décision », M. Jean-Louis Nadal s'est inscrit dans la première démarche. On serait tenté de rapprocher de cette hypothèse la décision du CSM du 8 février 1981 rendue à propos du juge Bidalou. Le CSM avait estimé dans cette décision que le magistrat avait manqué gravement à ses devoirs en dépit d'avertissements et bien que dessaisi, avait statué au mépris de ce dessaisissement et des règles de saisine du juge : « Il avait outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'avait accompli malgré les apparences qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle ». Selon le mot d'un commentateur, c'est l'image d'un magistrat « hors de lui »574. Devant les membres de la commission d'enquête, Mme Dominique Commaret a, quant à elle, suggéré l'idée d'une réparation civile « au mal jugé intermédiaire, celui qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée mais qui exprime une erreur de droit manifeste et grossière ou une grave méconnaissance des données factuelles de la procédure à travers les pièces cotées et qui, par le caractère exécutoire ou provisoire de la décision critiquée est à l'origine d'un dommage constaté »575. Le garde des Sceaux, M. Pascal Clément, a également évoqué la piste de l'erreur grossière devant les députés576 : « Il est des cas où les décisions d'un magistrat sont tellement aberrantes qu'elles ne peuvent laisser sans réaction et les voies de recours ne sont pas toujours suffisantes. Prenons un exemple, bien sûr construit de toute pièce. Imaginons qu'un juge des enfants soit saisi de la situation d'un très jeune enfant présentant de graves signes de maltraitance et qui a été provisoirement retiré à ses parents. Imaginons que tous les examens, toutes les investigations demandées par le juge conduisent effectivement à confirmer la réalité de cette maltraitance. Imaginons qu'en dépit de tout cela le juge restitue l'enfant à ses parents. Imaginons pour les nécessités de l'exemple, que le juge oublie de notifier sa décision de restitution au parquet et donc que celui-ci ne soit pas en mesure d'en faire appel. Et imaginons enfin que quelques jours plus tard, cet enfant, restitué à ses parents dans ces conditions, soit victime de nouvelles et graves violences et décède ou reste durablement diminué577. On peut effectivement se dire : c'est une décision juridictionnelle. Le juge qui l'a rendue bénéficie d'une immunité. On peut donc ne rien faire. On peut aussi se demander s'il n'est pas de notre responsabilité à tous de constater que ce magistrat n'est pas fait pour ces fonctions et qu'il faut, surtout, éviter que des faits aussi graves ne se reproduisent. Je ne dis pas qu'il faut engager des poursuites disciplinaires contre un tel magistrat. Je me demande en revanche s'il ne serait pas souhaitable que l'autorité de nomination, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature en tire toutes les conséquences et par exemple l'oriente vers d'autres fonctions. Je serais heureux d'avoir sur cette très importante question l'avis de votre commission d'enquête. » Cette dernière proposition est loin cependant de faire l'unanimité au sein des magistrats. C'est ainsi que le Syndicat de la magistrature estime que cette qualification « favoriserait une autocensure des pratiques judiciaires et pèserait sur celles qui comportent inéluctablement une "prise de risque" plus importante telle que la remise en liberté ou encore le retour d'un enfant dans sa famille. La solution de facilité serait alors pour le magistrat de ne prendre que des risques minimaux, au détriment des libertés individuelles et du "pari" que nous sommes souvent amenés à faire sur l'évolution positive d'une personne, au nom de l'espoir et de la confiance en l'être humain »578. De son côté, M. Daniel Ludet a mis en garde la commission d'enquête contre les risques auxquels pouvait conduire à ses yeux l'introduction de cette notion d'erreur manifeste ou grossière : « On sait que la Chancellerie a réfléchi, ces derniers mois, à la possibilité de modifier les règles de mise en jeu de la responsabilité personnelle des magistrats, sur le terrain disciplinaire semble-t-il, afin de permettre qu'elle puisse être engagée en cas d'erreur manifeste ou grossière. L'introduction de cette notion d'erreur manifeste ou grossière est délicate. Elle risquerait de remettre en cause le caractère sanctuarisé de l'acte juridictionnel. En outre, je me demande quel profit on tirerait de l'introduction de cette notion. L'erreur manifeste, en droit administratif, c'est l'erreur si grossière que même un non-spécialiste s'en rendrait compte. On est donc là sur un terrain qui sort de l'ordinaire des fonctions judiciaires. Un comportement qui sort de l'ordinaire des fonctions judiciaires ne donne-t-il pas déjà lieu, d'une façon ou d'une autre, à la responsabilité ? Le profit de l'introduction de cette notion nouvelle serait donc nul. Supposons qu'une libération conditionnelle soit décidée après qu'a été vérifiée la réunion de toutes les conditions prévues par le législateur, et alors qu'aucun des avis donnés ne donne à penser qu'il existe un risque sérieux que la personne bénéficiaire soit récidiviste. S'il y a récidive, y aura-t-il erreur grossière ou manifeste ? Plus directement, lorsqu'une même situation aura été examinée par plusieurs dizaines de magistrats, pourra-t-on analyser ce qui s'est produit comme une erreur grossière ou manifeste ? »579 La commission d'enquête ne sous-estime pas la double difficulté que recèle cette proposition : - faute de pouvoir cerner ses contours, il appartiendra au juge de l'apprécier au cas par cas. Au surplus, le juge de cassation confiera toujours au pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation de savoir si l'intéressé a commis une erreur manifeste (CE, 15 février 2006, Mordant de Massiac, à propos d'une décision d'interdiction temporaire prise par le Conseil supérieur de la Magistrature) ; - elle n'est pas très éloignée de la faute lourde, « celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entraîné » (Cass. civ., 1ère civ., 3 octobre 1953, Bull. n° 224). En étant très attachée à préserver les actes juridictionnels, qui échapperaient à toute mise en cause possible, votre commission, quant à elle, propose que la méconnaissance manifeste par les juges des principes directeurs de la procédure civile et pénale puisse engager leur responsabilité. À cette fin, ces principes directeurs recevraient un ancrage législatif dans le code de déontologie appelé à figurer dans le statut. Afin de compléter cette réforme, il est apparu nécessaire à votre commission d'enquête de modifier la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature. On rappellera que celui-ci est présidé par le Président de la République, le garde des Sceaux, ministre de la justice en étant le vice- président. Il comprend en outre seize membres. Quatre d'entre eux, qui ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire, siègent dans les deux formations du Conseil. Les douze magistrats de l'ordre judiciaire se répartissent en nombre égal dans chaque formation, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité qui doit n'appartenir ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, l'assemblée générale du Conseil d'État élisant un conseiller d'État. Ces quatre personnalités siègent dans les formations compétentes à l'égard des magistrats du parquet et du siège. La formation du siège comprend un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par ses pairs, un Premier président de cour d'appel et un président de tribunal élu dans les mêmes conditions, ainsi que deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux élus par l'ensembles des autres magistrats. Parallèlement, la formation du parquet comprend un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par ses pairs, un procureur général, un procureur de la République, élus dans les mêmes conditions ainsi que deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et des tribunaux élus par l'ensemble des autres magistrats. À en croire les responsables du syndicat majoritaire des magistrats, l'USM, cette organisation professionnelle ne jouerait qu'un rôle effacé au sein du CSM580. Pourtant certains magistrats faisant autorité ne partagent pas cette même opinion et mettent en avant la tentation du corporatisme à laquelle serait exposé le CSM : « La gestion des carrières des magistrats est pour une grande part dépendante de considérations syndicales et corporatistes. L'influence des syndicats et notamment de l'Union syndicale des magistrats, formation majoritaire au sein du Conseil supérieur de la magistrature, autorité chargée de désigner ou de donner un avis sur les candidats aux postes à pourvoir, est sans doute excessive à cet égard. Ce poids syndical conduit notamment à donner la priorité, dans la plupart des cas au critère de l'ancienneté dans le déroulement des carrières et l'accès à des postes de responsabilité. Il serait souhaitable que des personnalités indépendantes et extérieures au corps judiciaire figurent en plus grand nombre au CSM. » 581 Pour répondre à cette critique le législateur pourrait attribuer la prééminence aux membres du CSM n'appartenant pas à la magistrature. Même si le contexte politique et social était fondamentalement différent et même si le législateur n'a nullement l'intention de s'inspirer de ce précédent, on rappellera pour mémoire que la représentation politique était prépondérante au sein de cette instance sous la ive République. Le débat sur cette question est d'ailleurs plus ouvert qu'il n'y paraît de prime abord. Si le syndicat majoritaire des magistrats est par principe farouchement opposé à une représentation minoritaire des magistrats au sein du CSM582, le Syndicat de la magistrature, en revanche, n'y est pas hostile. Pour justifier cette position, il considère « qu'il est temps de donner de la justice une image beaucoup moins corporatiste. La modification de la composition du CSM serait à cet égard une réponse forte et symbolique. Nous acceptons qu'il soit majoritairement composé par des membres de la société civile »583. Souscrivant à cette idée au nom du principe qui veut que la justice soit rendue au nom du peuple, Mme Dominique Commaret est entrée dans les détails pour décrire la composition possible d'un CSM rénové : « la présence d'un professeur de faculté désigné par la Conférence des présidents d'université, d'un magistrat de la Cour des comptes, d'un avocat désigné par le Conseil national des barreaux me paraît opportune, de telles adjonctions étant naturellement mieux acceptées de l'intérieur si elles sont accompagnées de mesures de réciprocité. »584 Jugeant que « la confiance des citoyens en serait renforcée », Mme Marylise Lebranchu, ancienne garde des Sceaux, s'est, elle aussi, prononcée pour que les magistrats ne soient plus majoritaires dans cette structure585. Faut-il rappeler également qu'en introduisant une majorité de membres n'appartenant pas à la magistrature, le projet de loi constitutionnel déposé devant l'Assemblée nationale le 15 avril 1998 (n° 835, xie législature) avait profondément modifié l'équilibre qui avait prévalu jusque-là dans cette institution ? Il était effectivement prévu que sur les onze personnes extérieures au corps judiciaire, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil économique et social en désignent deux, les membres nommés par le Président du Conseil économique et social devant être extérieurs à celui-ci. Le Vice-président du Conseil d'État et le Premier président de la Cour de cassation devaient désigner conjointement deux personnalités, sachant qu'un conseiller d'État continuait à être choisi par ses pairs. Votre commission s'est cependant ralliée à une autre solution. Elle propose, en effet, d'établir une parité entre les magistrats et les non magistrats et de faire élire directement les magistrats par leurs pairs. a) Établir la parité au sein du CSM D'abord si l'on regarde les exemples étrangers, la plupart du temps la composante « magistrats » est majoritaire586. En Espagne, la Commission disciplinaire du Conseil général du pouvoir judiciaire est composée de cinq conseillers élus par leurs pairs et de deux personnalités extérieures. En Italie, depuis la réforme de 2002, le CSM comprend, en dehors de ses membres de droit, 16 magistrats élus par leurs pairs à travers un collège national et 8 membres nommés par le Parlement. On les désigne sous le terme de « laïques » par opposition aux magistrats professionnels qui portent la toge. Ils sont élus par le Congrès parmi des professeurs ou des avocats d'une certaine ancienneté587. Au Portugal, en revanche, les textes n'attribuent pas de majorité aux magistrats, puisque si son Président est le président de la Cour suprême de justice et s'il comprend sept membres élus par et parmi les magistrats judiciaires, deux de ses membres sont nommés par le Président de la République et sept de ses membres sont élus par l'Assemblée de la République588. L'Avis n° 3 adopté au sein du Conseil de l'Europe par le Conseil consultatif de juges européens, sur l'éthique et la responsabilité des juges, que l'on a déjà cité se déclare en faveur d'une « représentation substantielle » des magistrats au sein de l'instance disciplinaire de la profession mais souligne que l'appel à des personnalités extérieures évite de s'exposer au reproche de corporatisme, à condition qu'elles n'appartiennent pas au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ou à l'administration (§ 71 de l'avis). Les vœux de votre commission d'enquête rejoignent les pistes tracées en la matière par le Chef de l'État au début de l'année 2006 et par le CSM lui-même dans son rapport d'activité pour la période 2004-2005 remis au Président de la République le 19 mai dernier. En dehors du Président de la République qui conserverait la présidence, on pourrait imaginer que les fonctions de vice-président soient exercées alternativement tous les deux ans par une personnalité appartenant au collège des magistrats et une autre appartenant au collège des non magistrats. Dans un souci d'ouverture vers la société civile, le collège des non magistrats serait composé de personnalités qualifiées n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire. L'Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique et social et le Conseil national des barreaux pourraient désigner en nombre égal ces personnalités dans chaque formation « siège » et « parquet ». b) Élire directement les magistrats au sein du CSM Le modèle actuel de désignation des magistrats dans cette institution invite également à la réflexion. L'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature prévoit un système électoral avec deux collèges : un collège de magistrats du siège et un collège de magistrats du parquet. Dans chaque collège, les électeurs procèdent d'abord à l'élection à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel des électeurs qui désigneront les magistrats du siège et du parquet appelés à siéger au CSM. Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Ce même seuil de représentativité est exigé pour l'élection suivante au cours de laquelle les électeurs du premier collège désignent les membres du CSM. Or, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de cette clause, qui a pour effet de faire échec à l'émergence de nouveaux courants d'idées et d'opinions au sein de la magistrature, qui peuvent s'avérer profitables à l'institution judiciaire. Il est un fait que la commission a écouté avec beaucoup d'intérêt par exemple les expériences et les propositions constructives de la délégation de magistrats conduite par Mme Simone Gaboriau, présidente de chambre à la cour d'appel à Versailles. Or, même si elle représentait près de 700 magistrats, une telle délégation ne peut, faute de structure, participer à l'élection des membres du CSM organisée par la loi organique. Des considérations juridiques et des considérations inspirées par un souci de démocratie justifient que l'on s'interroge sur l'opportunité de la pérennité de ce seuil et de ce système de double collège. S'agissant du premier point, faut-il rappeler que dans une décision 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a censuré un dispositif réservant l'aide publique aux formations politiques sur lesquelles s'étaient portés 5 % des suffrages exprimés, au motif que le seuil choisi était de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions ?589 Faut-il considérer qu'un abaissement de ce seuil, voire sa suppression serait susceptible de provoquer un éparpillement des voix tel qu'il mettrait en danger la stabilité de la représentation du corps des magistrats, alors même que le syndicat majoritaire représente près de 64 % des voix ? On peut sérieusement en douter. Sans doute, parce que comme l'observe le syndicat de la magistrature : « Il est temps de donner de la justice une image beaucoup moins corporatiste »590, cette même organisation professionnelle a souhaité par la voix de sa présidente, Mme Aïda Chouk que « les représentants des magistrats soient élus au scrutin proportionnel direct. »591 Par conséquent, la composition paritaire du CSM et l'élection directe à la proportionnelle des membres du CSM par collège, sans critère de représentativité syndicale et sans seuil, éviteraient que le fonctionnement de cette institution soit régulièrement exposé au reproche de corporatisme et renforceraient par voie de conséquence sa légitimité. Par ailleurs, la commission a suggéré de confier la vice-présidence du CSM alternativement à un membre du collège magistrats et à un membre du collège non magistrats pour une durée de deux ans chacun. Ces trois propositions qui ont des implications constitutionnelles, organiques et réglementaires ont été adoptées par la commission d'enquête. Le Président André Vallini a manifesté toutefois son désaccord, à titre personnel, sur le principe de l'élection directe des magistrats au sein du CSM. XIII. RESPONSABILISER LES MÉDIAS La responsabilisation des médias gagnerait à une amélioration des voies de droit existantes et à l'élaboration d'un code de déontologie. A. AMÉLIORER LES VOIES DE DROIT EXISTANTES Avant de suggérer deux pistes de réflexion relatives à l'action civile et à l'exercice du droit de réponse dans le secteur audiovisuel, il convient au préalable de rappeler l'état du droit en vigueur. Les abus de la liberté d'expression peuvent faire l'objet de recours sur le fondement de dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : - l'article 13 organise un droit de réponse au bénéfice de toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique. Le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans les trois jours de sa réception, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Ainsi, l'exercice du droit de réponse n'exclut pas une action en diffamation, en injure ou en responsabilité civile indépendante de celle-ci ; - l'article 32 sanctionne la diffamation commise envers les particuliers d'une amende de 12 000 euros, la diffamation étant définie par l'article 29 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne » à laquelle le fait est imputé ; - l'article 33 sanctionne l'injure commise envers les particuliers d'une amende de 12 000 euros, l'injure étant définie par l'article 29 comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». Le droit de réponse dans le secteur audiovisuel est organisé par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. La mise en œuvre de ces moyens se heurte cependant à des obstacles juridiques en raison de règles de procédure très spécifiques qui, bien souvent, empêchent l'action d'aboutir. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 détermine un délai de prescription particulièrement court, de trois mois, qui s'applique quelle que soit la nature ou la gravité de l'infraction. Cette prescription s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile en réparation fondée sur un délit de presse. L'article 65-1 fixe également à trois mois le délai de prescription des actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commises par voie de presse. S'il paraît difficile d'allonger ce délai, tant il est considéré comme un corollaire de la liberté de la presse, les règles procédurales très particulières édictées par la loi du 29 juillet 1881 pourraient être revues. Par ailleurs, le droit de réponse en matière audiovisuelle pourrait être réformé afin d'accroître son effectivité. 1. Faciliter l'exercice de l'action civile La recevabilité des poursuites engagées contre des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 est subordonnée à des règles exceptionnelles figurant dans son article 53. Aux termes du premier alinéa de cet article, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ». Il appartient donc au plaignant de déterminer lui-même et dès ce moment là, très précisément et définitivement la nature de l'infraction poursuivie. Les qualifications alternatives ou cumulatives sont prohibées. Cette règle a été rappelée à de nombreuses reprises, à propos des qualifications de diffamation ou d'injure par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En outre, il faut une absolue concordance entre la qualification et le texte visé par l'acte initial de procédure, la juridiction de jugement ne pouvant prononcer aucun changement de qualification. De surcroît, le deuxième alinéa de l'article 53 exige une élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et fait obligation au plaignant de notifier la citation tant au prévenu qu'au ministère public. Tout oubli ou imprécision en la matière aura de graves conséquences puisque, comme le précise le dernier alinéa de l'article, « toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ». D'autres règles de procédure, inscrites dans les articles 54 à 56 de la loi du 29 juillet 1881 paraissent extrêmement contraignantes. Ainsi, l'article 55 relatif à l'offre de preuve de la vérité du fait relevé comme diffamatoire impose au prévenu de notifier, dans un délai de dix jours, au ministère public ou au plaignant, suivant le cas, « les faits articulés et qualifiés dans la citation, dont le prévenu entend prouver la vérité, la copie des pièces, les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve », étant précisé que « cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve ». Réciproquement, l'article 56 oblige le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, à faire signifier au prévenu dans les cinq jours suivants, « les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit ». N'est-ce pas là trop privilégier la forme sur le fond, au détriment de la poursuite et de la recherche des infractions et au seul bénéfice des médias, qui échappent ainsi à la mise en jeu de leur responsabilité ? Cette question est d'autant plus importante que, dans le silence des textes, la jurisprudence a imposé au fil des années le respect de ces règles de procédure particulières de la loi du 29 juillet 1881 à toutes les actions civiles, y compris quand elles sont introduites devant la seule juridiction civile, dès lors qu'une quelconque relation peut être établie entre l'une des infractions définies par la loi sur la liberté de la presse et la faute ou le dommage subi. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'« aucune disposition législative n'écarte l'application de l'article 55 de la loi de 1881 dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile » (Cass. 2e civ., 22 juin 1994). Trois ans plus tard, elle a jugé que l'article 53 qui détermine les conditions de la citation devait s'appliquer aux procédures civiles (Cass. 2e civ., 19 février 1997). Cette évolution jurisprudentielle a pour effet de rendre inopérants de nombreux recours. Aussi, la commission d'enquête propose-t-elle que les règles de procédures très particulières prévues par la loi de 1881 ne s'appliquent plus à l'action civile. 2. Réformer le droit de réponse dans le secteur audiovisuel Institué en 1982, le droit de réponse dans le secteur audiovisuel est enserré dans des conditions restrictives. Si le délai prévu pour son exercice est passé de huit jours à trois mois depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, il reste soumis à des particularités qui paraissent peu justifiées. Ainsi, à la différence du droit de réponse organisé par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, le droit de réponse prévu par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ne peut être demandé par l'intéressé qu'en cas d'« imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ». Il ne peut donc s'exercer que lorsque des propos diffamatoires, injurieux ou outrageants ont été tenus. À défaut de diffusion du message demandé, l'intéressé peut saisir le juge des référés qui peut ordonner la diffusion de la réponse sous astreinte. Cependant, l'obligation de mettre en œuvre le droit de réponse n'est assortie d'aucune sanction pénale, alors qu'en matière de presse écrite, le refus d'insertion est un délit puni d'une amende de 3 750 euros. La commission d'enquête suggère, en conséquence, d'harmoniser les dispositions applicables en matière de droit de réponse quel que soit le support utilisé. Elle estime également nécessaire d'améliorer les conditions d'exercice du droit de réponse dans le secteur audiovisuel. Celui-ci est, en effet, rarement utilisé car « le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre » sans pour autant disposer forcément de l'enregistrement de l'émission ou du journal télévisé qui le met en cause. Ainsi, il peut arriver qu'une personne placée en détention provisoire apprenne qu'elle a été présentée comme coupable d'un fait au cours d'une émission radiodiffusée ou télédiffusée qu'elle n'a pas entendu ou vu elle-même ou qu'elle n'a pas pu enregistrer. Aussi pourrait-on prévoir que toute personne mise en cause ait le droit d'exiger une copie de l'enregistrement de l'émission de radio ou de télévision litigieuse, auprès du directeur de la publication ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En dehors de ces propositions procédurales, on est en droit de penser que les médias souffrent surtout de l'absence d'un code de déontologie. B. INCITER LES MÉDIAS À ÉLABORER UN CODE DE DÉONTOLOGIE La déontologie de l'information reste aujourd'hui en effet une référence assez théorique. Faute de dispositions contraignantes, le juge judiciaire est en réalité le principal, sinon l'unique, instrument de contrôle déontologique des pratiques journalistiques. Ce rôle déontologique du juge se manifeste notamment à travers l'application, en matière de presse, de l'article 1382 du code civil, dont le caractère très général permet de considérer que tout manquement à la déontologie peut être assimilé à une faute civile, dès lors qu'il cause un préjudice à autrui. Les décisions rendues font très souvent référence aux « devoirs élémentaires de la profession » et spécialement aux exigences d'exactitude, d'objectivité et de prudence qui s'imposent aux journalistes. Le rôle déontologique du juge se manifeste également à travers l'interprétation de certaines dispositions répressives. C'est notamment le cas lorsque le juge apprécie la bonne foi de l'auteur d'un article concernant des propos diffamatoires. En précisant les contours de cette bonne foi, la jurisprudence a imposé aux journalistes le respect d'un certain nombre de devoirs : souci exclusif d'information du public, vérification des informations, enquête sérieuse et objective, prudence dans la recherche et la présentation des informations. À titre d'exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « la brièveté d'un article de presse n'autorise pas le journaliste à s'affranchir de son devoir de vérifier, par une enquête préalable, l'information qu'il publie pas plus qu'elle ne le dispense de faire preuve de prudence dans l'expression de la pensée » (Cass. crim., 16 mars 2004). Ces exigences qui ne figurent pas dans la loi du 29 juillet 1881, correspondent aux principes énoncés dans les chartes syndicales : Charte des devoirs professionnels des journalistes français de juillet 1918, révisée en janvier 1938, Déclaration des droits des journalistes, adoptée à Munich en 1971. Cependant, ces chartes, rédigées en termes très généraux, n'ont qu'une valeur déclarative. De plus, chaque organe de presse a son propre code ou sa propre charte, de sorte que « la déontologie est à géométrie variable selon les rédactions », elle est « à la fois un grand mot et la petite cuisine de chacun », comme l'a souligné Mme Florence Aubenas lors de son audition592. On peut rappeler également que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à la liberté d'expression, précise que ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Il admet expressément que l'exercice de ces libertés « comportant des devoirs et des responsabilités », peut être soumis « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi » afin de protéger « la réputation et les droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité ou l'impartialité du pouvoir judiciaire ». La Cour a eu l'occasion à la fois de préciser l'étendue de la liberté d'expression mais également les devoirs et responsabilités des journalistes. S'agissant du premier point, elle a rappelé que « les médias ne doivent pas franchir les bornes fixées en vue de la protection de la réputation des particuliers » (1999, III, 20 mai 1999, Bladet Tromso & Stensaas : Nor, GC). Dans une affaire Fressoz et Roire du 21 janvier 1999 (1999 - I), elle a affirmé que « Quiconque, y compris un journaliste, exerce sa liberté d'expression assume des "devoirs et responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé... Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse, dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l'article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun ». Aussi la commission d'enquête propose-t-elle que la presse aussi bien écrite qu'audiovisuelle dispose d'un code de déontologie. Ce texte de référence élaboré par la profession définirait les « bonnes pratiques » et les règles générales destinées à assurer la qualité et l'honnêteté de l'information dans la presse écrite et audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ayant qu'un rôle marginal en ce domaine. Le futur code pourrait s'inspirer des règles et usages professionnels de la presse quotidienne régionale publiés en décembre 1995 ou du code de déontologie (« Pressekodex ») élaboré en 1973 par le Conseil allemand de la presse . Il pourrait notamment contenir les engagements suivants : - vérifier l'exactitude des informations, avant leur publication ; - rectifier toute information inexacte, sans délai et en accordant à la rectification la même place qu'à l'information initiale ; - faire preuve de prudence et de mesure dans l'expression ; - recueillir des points de vue émanant de sources différentes, selon le principe du contradictoire ; - divulguer l'identité des personnes avec discernement ; - respecter la dignité humaine et la vie privée ; - respecter la présomption d'innocence ; - faciliter l'exercice du droit de réponse. Le code de déontologie pourrait également mettre l'accent sur le droit des journalistes de refuser de divulguer leurs sources d'information. À cet égard, l'on peut s'interroger sur la pertinence du maintien du recel de violation du secret de l'instruction au regard du principe de la protection des sources. XIV. RENDRE COMPTE DE LA POLITIQUE PÉNALE DEVANT LE PARLEMENT La justice étant rendue au nom du peuple français, la commission d'enquête estime nécessaire que la représentation nationale soit informée chaque année de l'orientation de la politique pénale mise en œuvre par le garde des Sceaux au nom du Gouvernement. Le rapport présenté à cette occasion devrait non seulement décrire les lignes directrices de la politique pénale mais aussi retracer précisément l'état des moyens de la justice. La commission d'enquête souligne, en particulier, la nécessité de disposer d'un descriptif précis de l'état des locaux de garde à vue dans l'ensemble des ressorts ; des bilans portant sur l'état des greffes et sur les équipements en matériel audiovisuel devraient être également dressés. Cet événement pourrait être aussi l'occasion de présenter des statistiques exhaustives sur la détention provisoire. La présentation de ce rapport devrait être l'occasion d'un débat, à l'instar de ce qui a été retenu pour le rapport annuel de la Cour des comptes (article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances issu de l'article 11 de la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005). XV. DOTER LA JUSTICE DE MOYENS DIGNES DE SA MISSION Décliner des propositions de réforme en faisant abstraction des moyens budgétaires susceptibles d'être engagés pour les réaliser serait une démarche irresponsable. Sans prétendre se livrer à un exercice budgétaire exhaustif, votre commission s'est attachée à chiffrer les dépenses relevant du ministère de la justice engendrées par ses propositions. Le budget de la justice s'élevait à 4 542 millions d'euros en 2002 et à 5 959 millions d'euros en 2006, la part de la justice à périmètre constant s'établissant à 2,13 % du budget de l'État contre 1,81 % en 2002. Pour s'en tenir aux seules dépenses de personnel, si l'on comptait 6 925 magistrats gérés en 2000, leurs effectifs sont passés à 7 902 en 2005. Les effectifs des greffiers en chef et des greffiers ont augmenté de près de 18 % entre 1993 et 2005 pour les cadres A et de près de 84 % sur la même période pour les cadres B. Pourtant, malgré les efforts fournis ces dernières années pour augmenter les moyens de la justice, à en croire une étude du Conseil de l'Europe sur le budget des tribunaux par habitant, la France se situerait au 17e rang des pays membres593. Si, par exemple, l'on rapporte les effectifs budgétaires des magistrats allemands à la France, cette comparaison ne plaide pas pour notre pays. Il y avait, en effet, en Allemagne en 2002, 15 456 magistrats du siège et 5 150 magistrats du parquet dans les juridictions de droit commun, auxquels il faut ajouter les 1 154 magistrats des juridictions du travail et les 1 274 magistrats des juridictions sociales, sans compter les juridictions administratives et financières. Au total, on recensait donc 23 034 magistrats professionnels de l'ordre judiciaire pour une population de 82,5 millions d'habitants. Rapporté à la population française, leur nombre serait encore de 17 200 environ, soit un peu plus du double des effectifs de la magistrature française594. On mesure donc l'ampleur du chemin à parcourir. En poursuivant l'effort amorcé les années passées et en se fixant des objectifs à la fois lisibles et ambitieux tenant compte en même temps de notre handicap, on pourrait, sur la base des paramètres précités du Conseil de l'Europe, suggérer de faire passer le budget français de la justice par habitant de 28,35 euros à 40 euros. Ce chiffre situerait notre pays encore derrière les Pays-Bas (41,01 euros), l'Italie (45,98 euros), le Portugal (46,98 euros) et l'Allemagne (53,15 euros) mais constituerait un progrès substantiel. Hisser la part de la justice à 3 % du budget de l'État reviendrait à accorder une augmentation des crédits de ce ministère de plus de 34 % d'une année sur l'autre. Il est donc évident que si un effort financier est nécessaire, celui-ci devra être étalé dans le temps. À plus court terme, s'agissant des dépenses de personnel, la réforme proposée suppose, comme on l'a vu, la création d'environ 110 postes pour les collèges de l'instruction et de 50 autres postes pour les chambres de l'instruction. Le coût annuel de ces 110 recrutements s'élèverait à 6,4 millions d'euros, auxquels il conviendrait d'ajouter environ 4 millions d'euros pour les 50 emplois nouveaux dans les chambres de l'instruction. À titre d'exemple, le coût total de ces seuls emplois de magistrats serait, quoi qu'il en soit, inférieur au coût de l'aller et retour du porte avion Clemenceau (Toulon - Inde - Brest), qui s'est monté à 12 millions d'euros, sans même évoquer les 40 millions d'euros nécessaires pour les opérations de désamiantage du navire. Pour les emplois de greffiers, 110 postes environ devraient être également créés. Si l'on raisonne sur la base de 27 600 euros par an hors charges sociales en moyenne pour un équivalent temps plein de greffier, on peut évaluer le coût total de ces nouveaux postes de jeunes greffiers à 4 millions d'euros, soit un total à court terme d'un peu moins de 14,5 millions d'euros pour les seules dépenses de personnel. L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires recommandé par le présent rapport devrait faire l'objet d'un investissement financier conséquent. On a déjà indiqué que 426 123 euros avaient été dépensés pour les équipements nécessaires au recueil de la parole des enfants victimes d'abus sexuels après l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles et la protection des mineurs. À titre de comparaison et pour un champ d'application plus large, le ministère de la justice italien a dépensé en 2005 près de 30 millions d'euros pour procéder à l'enregistrement et à la retranscription des interrogatoires des personnes détenues. 7 millions d'euros avaient été investis pour équiper l'ensemble des tribunaux italiens. Par ailleurs, d'autres dépenses source d'investissements au départ devraient générer des économies à terme. Ainsi non seulement on peut attendre beaucoup de l'impact des nouvelles technologies sur le déroulement de la procédure pénale, en termes de rapidité et d'efficacité de la réponse judiciaire mais également en termes de diminution des coûts de transfèrement des détenus et de photocopies pour s'en tenir à ces seuls chefs de dépenses. L'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit que les juridictions de jugement peuvent recourir à la visioconférence pour procéder à des interrogatoires et aux dépositions des témoins, des parties civiles et des experts. Des expériences sont d'ores et déjà menées dans le ressort de plusieurs cours d'appel (Colmar, Dijon, Douai, Metz, Nancy, Versailles) et sont appelées à se développer. La Commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice (COMIRCE) a conduit, dans cet esprit, des travaux sur l'entrée des nouvelles technologies dans le monde judiciaire dans le cadre du « Tribunal du futur ». Des solutions technologiques sécurisées ont été proposées pour s'intégrer dans ce schéma : recours à une borne interactive d'aide à la préparation des plaintes ; gestion informatique interne des données et transmission à d'autres services ; usages variés de la visioconférence pendant les phases policières et judiciaires ; usage de téléphones sécurisés au bénéfice des relations avocats clients et gestion multimédia des notes d'audience. Par ailleurs, au regard de l'instruction de l'affaire d'Outreau, la confection à l'avenir d'un dossier électronique devrait avoir le mérite d'être d'un accès plus facile. Saisi une seule fois, le dossier électronique suit la vie du dossier papier et s'enrichit au fur et à mesure des documents signés numérisés. ______________ réformer le régime de la garde à vue 1. Notifier à la personne placée en garde à vue les « faits » qui lui sont reprochés. 2. Obliger l'officier de police judiciaire à motiver la décision de placement en garde à vue, en indiquant quelles sont les « raisons plausibles de soupçonner » que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. 3. Rendre obligatoire l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue, la méconnaissance de cette obligation étant une cause de nullité de procédure. Cet enregistrement vaudrait quelle que soit la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, qu'il s'agisse d'un délit de droit commun ou relevant de la criminalité organisée qui concerne notamment les actes de terrorisme, le trafic de stupéfiants en bande organisée, le vol en bande organisée ou encore le proxénétisme aggravé. 4. Autoriser l'avocat à avoir accès au dossier de la procédure dès lors que la garde à vue est prolongée. L'avocat de l'intéressé aurait accès au dossier de la procédure au-delà des premières 24 heures et pourrait assister aux interrogatoires de son client. Cette procédure ne serait pas applicable aux crimes et délits relevant de la criminalité organisée. Option des membres socialistes de la commission : Les membres socialistes de la commission préconisent que l'avocat puisse être présent à tous les interrogatoires effectués pendant la garde à vue, dès le début de la mesure. Mais le dossier de la procédure ne lui serait communiqué qu'à partir du moment où la garde à vue ferait l'objet d'une prolongation. 5. Renforcer le contrôle du procureur de la République sur les mesures et les locaux de garde à vue en prévoyant la rédaction d'un rapport destiné au procureur général. Ce dernier en rendrait compte au garde des Sceaux qui en ferait état lors du débat annuel devant le Parlement. 6. Poursuivre et amplifier l'amélioration de l'état des locaux de garde à vue et, en raison de leur nombre, planifier cet effort sur les prochaines années. rendre les enquêtes du parquet plus contradictoires 7. Mettre à disposition de l'avocat de la personne que le procureur envisage de déférer devant le tribunal correctionnel le dossier de la procédure. Cette mise à disposition interviendrait à la suite d'une notification. L'avocat aurait la faculté de présenter des observations et des demandes d'investigations complémentaires au parquet, annexées au dossier de la procédure. Ces dispositions ne seraient pas applicables dans deux hypothèses : celle de la comparution immédiate et celle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 8. Prévoir que le procureur pourrait, soit faire droit à la demande de l'avocat, ce qui entraînerait la poursuite de l'enquête préliminaire, soit rejeter cette demande par une décision motivée non susceptible de recours, mais annexée au dossier dont serait saisi le tribunal correctionnel. 9. Interdire l'engagement des poursuites fondées sur des informations communiquées anonymement au procureur de la République. limiter la détention provisoire 10. Instaurer des durées butoirs pour la détention provisoire, sans renouvellement possible. Celles-ci seraient fixées à un an en matière correctionnelle et à deux ans en matière criminelle, avant l'audience de jugement, sauf pour les infractions relevant de la criminalité organisée comme le terrorisme et pour les personnes ayant déjà été condamnées en état de récidive. 11. Examiner la possibilité de recourir à une mesure alternative, avant d'envisager toute mesure de détention provisoire et motiver la décision au cas par cas. 12. Préciser les critères du placement ou du maintien en détention provisoire, afin que les décisions ne soient pas motivées par des références imprécises à des risques de pressions ou de concertation et afin d'éviter que le refus de reconnaître les faits puisse influer sur ces décisions. 13. Supprimer le recours à la notion de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle et l'encadrer davantage en matière criminelle par l'exigence d'une motivation précise, avec impossibilité de fonder le trouble à l'ordre public sur la seule médiatisation de l'affaire. supprimer le juge d'instruction seul et confier l'instruction à un collège de magistrats · L'organisation du collège de l'instruction 14. Créer, à l'échelon de chaque cour d'appel, des pôles de l'instruction composés d'un ou plusieurs collèges de trois magistrats, répartis, le cas échéant, dans le ressort de la cour, sur la base d'un critère démographique de 500 000 habitants. 15. Instituer une collégialité composée d'un magistrat du premier grade (au moins sept années d'ancienneté), d'un magistrat du second grade, ces deux magistrats étant inscrits sur une liste d'aptitude, et d'un magistrat sortant de l'École nationale de la magistrature lui-même déclaré apte à exercer cette fonction. 16. Confier la direction de la collégialité au magistrat du premier grade. 17. Permettre, pour certains actes, un mécanisme de délégation. 18. Entreprendre à partir d'une évaluation de la situation une réforme de la carte judiciaire permettant dans un premier temps de mutualiser les moyens nécessaires à la création des pôles d'instruction. · Le fonctionnement de la collégialité de l'instruction - Procédures communes à toutes les instructions : 19. Introduire une clause de rendez-vous annuel, entre les parties concernées, afin d'examiner l'état d'avancement des informations judiciaires au moins une fois par an. 20. Prévoir des modalités de clôture de l'information plus contradictoires et équitables : - Obliger le collège qui considère son instruction comme étant achevée à communiquer au procureur et aux parties, un document récapitulant les éléments à charge et à décharge. - Fonder les réquisitions du procureur sur ce document récapitulatif dans un délai déterminé par la loi. - Autoriser les parties à déposer des observations sur ce document dans un délai identique. - Prévoir que le collège de l'instruction ne peut ordonner le non-lieu ou le renvoi devant la juridiction de jugement qu'après avoir débattu, collégialement et publiquement, des termes du réquisitoire du procureur et des mémoires des parties. 21. Organiser, à la demande de la personne concernée, une audience publique devant le collège de l'instruction, lorsqu'un non-lieu est prononcé. 22. Déterminer les modalités de fonctionnement de la collégialité en organisant la nécessaire délégation entre les magistrats membres du collège. - Contentieux de la détention : 23. Rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d'un avocat commis d'office, à peine de nullité. Afin de permettre à ce débat contradictoire d'avoir une véritable substance et que son organisation soit prévisible, le collège de l'instruction siégerait, chaque semaine, à des dates fixes, comme une véritable juridiction. À la demande de la défense, le débat pourrait être public. 24. Organiser un réexamen obligatoire et automatique par le collège de l'instruction de la situation des prévenus incarcérés depuis trois mois. À la demande de la défense, le débat pourrait être public. Option des membres socialistes de la commission : Tout en souscrivant à l'introduction de la collégialité dans la conduite de l'instruction, les membres socialistes de la commission considèrent qu'il n'est pas souhaitable de conférer au dit collège la compétence d'ordonner le placement en détention provisoire. C'est pourquoi ils se déclarent en faveur du maintien du juge des libertés et de la détention. Néanmoins, à la différence de la situation prévalant actuellement, celui-ci devrait être dédié à ces seules fonctions. · Aménager le secret de l'instruction 25. Celui-ci s'applique actuellement « sans préjudice des droits de la défense ». Le principe demeurerait celui du secret de l'instruction, mais il pourrait être levé à la demande de la défense au bout de trois mois de détention du prévenu. Cette demande pourrait être refusée lorsque : - l'enquête porte sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de la loi, ce qui inclut notamment le trafic de stupéfiants ou le terrorisme ; - la publicité demandée serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, mineur en particulier. En contrepartie de l'introduction de ces « fenêtres de publicité », les sanctions pénales réprimant la violation du secret professionnel et du secret de l'instruction seraient portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. Une amende civile de 15 000 euros en raison du préjudice causé par l'atteinte à la présomption d'innocence protégée par l'article 9-1 du code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence » serait introduite. renforcer l'exercice des droits de la défense 26. Prévoir qu'une confrontation ou un interrogatoire ne peuvent avoir lieu sans avocat. Toutefois, dans l'hypothèse où l'avocat du mis en examen ne se présenterait pas tout en ayant été régulièrement convoqué, le collège aurait le choix, soit de reporter la confrontation ou l'interrogatoire, soit de faire désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office. 27. Prescrire l'enregistrement, au moins sonore, des interrogatoires et des confrontations organisés par le collège de l'instruction. Ces enregistrements seraient conservés sous la responsabilité du greffier. Toute contestation sur les propos tenus, leur retranscription, le caractère inductif des questions pourrait être tranchée par la consultation de cet enregistrement soit, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, soit par la juridiction de jugement. 28. Modifier la procédure des expertises pour donner à la défense la possibilité de faire des observations sur la mission et le rapport d'expertise. 29. Faire de la demande de contre-expertise un droit. 30. Faire de la modalité d'organisation de la confrontation un acte d'instruction en tant que tel, afin d'ouvrir une possibilité d'appel contre un rejet de demande de confrontation séparée. 31. Considérer toute décision de disjonction de l'un des aspects du dossier initialement confié au collège de l'instruction comme une décision juridictionnelle, donc susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. refonder la chambre de l'instruction · Organisation et missions : 32. Affecter des magistrats à plein temps aux chambres de l'instruction, en renforçant leurs effectifs. 33. Supprimer le pouvoir de « filtrage » dont dispose le président de la chambre de l'instruction. 34. Supprimer l'obligation faite aux avocats de ne présenter que des observations sommaires. 35. Consacrer le principe de la publicité des audiences. 36. Conforter les fonctions de la chambre de l'instruction en lui confiant : - l'appel des décisions des collèges de l'instruction ; - le contrôle des collèges de l'instruction ; - la vérification, 24 mois après l'ouverture de l'information, à la demande d'une partie, que l'instruction respecte le principe du délai raisonnable. Dans la négative, la chambre de l'instruction évoque l'affaire et rend, dans un délai de 6 mois, un arrêt de règlement clôturant l'instruction. · Contentieux de la détention : 37. Examen systématique tous les six mois de la nécessité de maintenir la personne en détention et du fond du dossier. Récapitulatif du calendrier des interventions du collège de · Instruction de l'affaire : - Douze mois après l'ouverture de l'information, clause de rendez-vous devant le collège de l'instruction avec toutes les parties pour faire le point sur le dossier. Cette clause de rendez-vous pourrait être publique à la demande de la défense. - Vingt-quatre mois après l'ouverture de l'information et à la demande de la défense, la chambre de l'instruction fait le point sur le dossier et apprécie le respect du principe du délai raisonnable. · Contentieux de la détention : - Placement en détention par le collège de l'instruction, à l'issue d'un débat pouvant être public à la demande de la défense ; - Trois mois après, devant le collège de l'instruction, examen systématique de la situation de la personne en détention provisoire, en sa présence, accompagnée obligatoirement de son avocat et en présence du parquet, l'audience pouvant être publique à la demande de la défense ; - Six mois après la mise en détention, devant la chambre de l'instruction, examen systématique de la situation de la personne en détention provisoire, en sa présence, accompagnée obligatoirement de son avocat et en présence du parquet, l'audience étant publique ; - Neuf mois après la mise en détention, devant le collège de l'instruction, examen systématique de la situation de la personne en détention provisoire, en sa présence, accompagnée obligatoirement de son avocat et en présence du parquet, l'audience étant publique. - Puis alternance trimestrielle de l'évocation de la situation de la personne en détention provisoire devant la chambre de l'instruction et devant le collège de l'instruction, dans les limites de la nouvelle durée maximale de la détention provisoire fixée par la loi. - Ces examens à intervalles réguliers sont sans préjudice du droit des personnes à présenter, à tout moment, une demande de mise en liberté. garantir l'accès au dossier 38. Interdire la réalisation d'un interrogatoire ou d'une confrontation, lorsque les avocats des personnes concernées n'ont pas en leur possession une copie à jour du dossier, cinq jours ouvrables avant ces actes. 39. Garantir à la personne mise en examen le droit d'accéder directement au dossier de la procédure. Ce droit d'accès pourrait être limité par une décision spécialement motivée du collège de l'instruction, lorsque l'instruction porte sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de la loi ou que des pressions seraient susceptibles d'être exercées à l'encontre des victimes ou d'autres personnes mises en examen. 40. Garantir aux personnes placées en détention provisoire la communication de leur dossier dans des conditions de confidentialité satisfaisantes. améliorer la qualité des expertises 41. Organiser la tenue d'une conférence de consensus permettant de définir les méthodes des experts psychologues et d'élaborer un code de bonnes pratiques. 42. Préconiser l'élaboration de critères de distinction entre les missions d'expertise relevant de la psychologie, de la psychiatrie et de la criminologie. 43. Élaborer des missions-types pour les expertises psychologiques et psychiatriques. 44. Renforcer le contrôle des experts, en nommant des avocats dans la commission en charge de donner son avis sur l'inscription sur les listes d'agrément. 45. Obliger l'expert à déclarer son appartenance à une association habilitée à se porter partie civile pour des faits sur lesquels il est commis. 46. Réviser les critères de rémunération des experts en tenant compte de la complexité du dossier et du temps consacré à l'expertise. mieux protéger les intérêts des enfants 47. Améliorer la transmission des informations et la coordination en cas de soupçons de maltraitance : - en décloisonnant les services sociaux ; - en favorisant la concertation des personnels médicaux et sociaux ; - en créant un centre de signalement départemental. 48. Élargir les possibilités de saisine du juge des enfants : - en ouvrant aux médecins la possibilité de le saisir ; - en clarifiant les possibilités de saisine par les services sociaux ; - en facilitant son auto-saisine en cas de danger pour l'enfant ; - en prévoyant sa saisine systématique en cas de procédure du parquet pour violences familiales contre un mineur. 49. Améliorer l'information des services sociaux sur les recours possibles en cas de classement sans suite de leurs signalements. 50. Assouplir l'obligation légale de recherche systématique de l'adhésion de la famille et du maintien du lien familial dans des cas extrêmes. 51. Mieux articuler les rapports entre le juge des enfants, le substitut chargé des mineurs et les magistrats en charge de l'instruction. 52. Confier au Défenseur des enfants le suivi des enfants des personnes placées en détention provisoire. redéfinir les conditions du recueil des déclarations des enfants 53. Intégrer dans la formation des assistants familiaux l'apprentissage de bonnes pratiques dans le recueil des révélations que peuvent leur faire les enfants dont ils ont la charge et les faire bénéficier du soutien d'équipes pluridisciplinaires. 54. Rendre obligatoire une enquête sur les circonstances de la révélation faite par le mineur et sur le contexte dans lequel elle s'inscrit ; procéder systématiquement à un interrogatoire de la personne qui a recueilli la révélation du mineur. 55. Améliorer la formation des enquêteurs, en augmentant les capacités de stage des centres de formation et en organisant des stages dans les unités spécialisées. 56. Réserver à des unités spécialisées, exerçant en équipe, la tâche de procéder aux auditions des mineurs victimes. 57. Aménager des locaux dédiés aux auditions des mineurs ; les équiper de matériels d'enregistrement audiovisuel performants et adaptés. 58. Procéder à l'enregistrement systématique du mineur sans solliciter son consentement ni celui de son représentant et sans dérogation possible. 59. Faire de l'enregistrement de l'audition du mineur victime une pièce de procédure. 60. Mieux former les magistrats à l'exploitation des enregistrements audiovisuels. 61. Encadrer les conditions dans lesquelles les associations habilitées peuvent se constituer parties civiles dans des affaires portant sur des atteintes à l'intégrité de la personne d'un mineur. 62. Inciter les barreaux à généraliser la constitution de pôles d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs victimes. 63. Rendre obligatoire la présence d'un avocat à toute audition du mineur victime. repenser la gestion des carrières des magistrats 64. Favoriser des formations communes avec les avocats en prévoyant pour les auditeurs de justice un stage d'un an dans un cabinet d'avocat impliquant l'exercice effectif de la profession. 65. Séparer les fonctions de magistrat du parquet et du siège, à l'expiration d'un délai maximal de dix ans à l'issue de la sortie de l'École nationale de la magistrature. 66. Instituer une gestion des ressources humaines aux niveaux des cours d'appel et de la Chancellerie et rétablir les listes d'aptitude aux postes. 67. Ouvrir la magistrature sur l'extérieur en développant les recrutements sur titre (un tiers de la promotion) et en imposant une mobilité sous forme de détachement de deux ans, après six ans d'exercice. responsabiliser les magistrats 68. Introduire un code de déontologie dans le statut des magistrats qui ferait référence notamment aux principes directeurs de la procédure civile et pénale, et dont la méconnaissance manifeste serait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire. 69. Améliorer l'évaluation des magistrats pour en faire un moyen d'apprécier leurs qualités professionnelles et un outil de vérification de leurs aptitudes. 70. Développer une culture de contrôle interne en incitant les premiers présidents et les procureurs généraux à exercer leurs responsabilités hiérarchiques et leur pouvoir d'évaluation. 71. Développer les contrôles externes en permettant à tout justiciable contestant le fonctionnement du service de la justice de déposer des requêtes auprès des délégués du Médiateur de la République, ce dernier saisissant, le cas échéant, le Conseil supérieur de la magistrature, instance disciplinaire. 72. Permettre aux juridictions ayant condamné définitivement l'État pour dysfonctionnement de la justice de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. 73. Faire sanctionner par le CSM la méconnaissance des principes directeurs de la procédure civile et pénale. 74. Rénover le CSM en établissant une composition paritaire entre magistrats et non magistrats et en procédant à l'élection directe des représentants des magistrats. Confier la vice-présidence du CSM alternativement à un membre du collège magistrats et à un membre du collège non magistrats. responsabiliser les médias 75. Faciliter l'exercice de l'action civile, en ne subordonnant plus la recevabilité des poursuites aux règles très contraignantes de procédure qui rendent actuellement inopérants de nombreux recours engagés en cas d'abus de la liberté d'expression. 76. Améliorer le droit de réponse dans le secteur audiovisuel, en l'harmonisant avec les dispositions applicables à la presse écrite et en ouvrant à toute personne mise en cause dans une émission de radio ou de télévision le droit d'exiger une copie de l'émission litigieuse. 77. Inciter les professionnels des médias à élaborer un code de déontologie applicable à la presse écrite et audiovisuelle. rendre compte de la politique pénale en france devant le parlement 78. Organiser chaque année un débat sur l'orientation de la politique pénale mise en œuvre par le garde des Sceaux au nom du Gouvernement sur la base d'un rapport qui serait présenté devant le Parlement. doter la justice de moyens dignes de sa mission 79. Engager les moyens nécessaires pour l'accompagnement de la réforme proposée en mettant l'accent en priorité sur les dépenses d'équipements liées aux enregistrements audiovisuels, ainsi que les dépenses de personnel entraînées par la collégialité de l'instruction et l'affectation de magistrats à plein temps à la chambre de l'instruction. 80. Mettre en œuvre une loi de programme visant à hisser la part du budget de la justice à 3 % du budget de l'État et à faire passer le budget de la justice par habitant de 28,35 euros à 40 euros. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 MAI 2006 Présidence de M. André VALLINI M. le Président : Cette séance est consacrée aux interventions des députés qui souhaiteraient faire part à leurs collègues de la réforme ou des réformes qu'ils souhaitent voir examinées en priorité par notre commission dans la perspective du rapport que nous devrons remettre d'ici le 7 juin. M. Étienne BLANC : Beaucoup de choses ont été dites et les travaux de notre commission ont considérablement évolué au cours du temps. Ils nous ont permis de présenter devant les Français une vision d'ensemble de notre système judiciaire, dans le cadre d'un débat national qui a été l'occasion de faire de la pédagogie. Je remarquerai, en premier lieu, qu'en France, lorsqu'on constate un dysfonctionnement dans une institution, il y a toujours un coupable, et l'on recherche une responsabilité personnelle. Le jugement qui a été porté, notamment sur le juge Burgaud, était impulsif, à l'emporte-pièce, alors même que les auditions avaient démontré qu'il avait respecté les règles de notre code de procédure pénale et qu'il ne saurait supporter seul les conséquences de cette tragique affaire. Je souhaiterais poser la question du juge des libertés et de la détention. Sa création, en l'an 2000, relève, selon un grand nombre de magistrats et d'observateurs, d'une réforme ponctuelle, d'une réforme alibi destinée à donner bonne conscience. J'ai été frappé, en lisant un document qui nous a été récemment adressé par l'Association française des magistrats instructeurs, des qualifications données aux fonctions de JLD : « Juge fragile car sans statut, juge aveugle, juge intermittent, il n'a pas toujours l'expérience du pénal ni de la conduite de l'enquête, sauf dans les très grandes juridictions. » La leçon que l'on peut tirer des différentes auditions est celle de la suppression pure et simple du JLD. On nous dira sans doute que cette réforme a été imparfaite, qu'elle aurait dû être complétée par d'autres. Pour ma part, je considère que c'est une réforme alibi : parce qu'on ne voulait pas poser totalement, en 2000, la question de la détention provisoire, ni celle du juge d'instruction et de sa position dans le code de procédure pénale, on a créé un nouveau magistrat censé gommer les imperfections de notre système. Nous pensons que cela a ajouté à la confusion et qu'en tout état de cause, il n'a pas permis de gommer certains dysfonctionnements de notre système judiciaire. Il faut donc que nous nous posions la question du JLD et de son remplacement. La deuxième question que nous devons poser est celle du fonctionnement de l'instruction. On a proposé à de multiples reprises de créer des pôles départementaux de l'instruction. Ils auraient le mérite, d'une part, de rompre l'isolement du juge d'instruction, d'autre part, de favoriser la cosaisine, évoquée à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du rapport Viout. Ma troisième observation porte sur l'enregistrement, au moment de la garde à vue, des auditions effectuées par la gendarmerie et par la police. Ce serait une bonne réponse pour un meilleur contrôle de la phase préliminaire de l'enquête préliminaire. Ce serait une réponse utile, plus utile que la présence systématique d'un avocat dès les premières heures de la garde à vue. En effet, une telle réforme, souvent sollicitée, se heurterait à des problèmes majeurs d'efficacité. Comment imaginer que dans tous les commissariats, ou dans toutes les gendarmeries puissent être systématiquement présents des représentants du Barreau ? Aujourd'hui déjà, même si la présence de l'avocat est très limitée, on connaît d'énormes difficultés à faire en sorte qu'il soit présent. Cela dit, l'enregistrement peut être à l'origine de déviations et de difficultés. Imaginons une audition contestée. On sera souvent tenté de transcrire sur un document papier le contenu intégral de l'audition devant un policier ou un officier de gendarmerie. Cela risque d'alourdir considérablement le poids du dossier papier. Je m'étais permis de poser la question à M. le Premier président de la Cour de cassation, qui m'a répondu que l'idée était sans doute bonne, mais qu'il fallait que ce soit encadré, sans quoi cela risquerait de rendre le système beaucoup plus complexe qu'il ne l'est aujourd'hui. Ma quatrième observation porte sur le sentiment que, lorsqu'une personne est placée en détention par un JLD, le système judiciaire ne prend pas suffisamment en compte les conséquences de ce placement en détention. Je vais vous en donner un exemple : lorsque l'huissier de justice mis en cause dans l'affaire d'Outreau a été placé en détention, aucun système mécanique n'avait été mis en place pour que son étude soit administrée. À qui cela incombe-t-il ? À sa famille, à ses associés, à telle personne qui s'intéresse au fonctionnement de l'étude ? Le système y gagnerait si, lorsqu'il y a placement en détention, les conséquences de ce placement en détention étaient mieux prises en compte par le JLD. Dans cette affaire, le juge d'instruction aurait dû avoir eu pour obligation de saisir la chambre des huissiers pour que l'étude soit administrée sans attendre que des proches ou la famille s'en chargent. Ma cinquième observation sera une suggestion : faire en sorte que notre code pénal nous permette de nous assurer que toute personne placée en détention disposera d'un conseil. Le fait qu'une des personnes acquittées n'ait pas été contactée régulièrement par un avocat alors qu'elle était en détention, et ce pendant quatorze mois, n'est pas admissible ! J'ai lu avec attention la lettre qui nous a été adressée par M. le bâtonnier de Boulogne-sur-Mer. Il écrit que le système a bien fonctionné et que des avocats ont bien été désignés et qu'ils étaient en charge de la défense des personnes mises en examen. Or ce n'est pas la réalité du dossier : le système n'a pas bien fonctionné et les avocats en charge, pour des raisons sur lesquelles on n'a pas à s'appesantir, n'ont pas assuré ces visites. Dans un pays comme le nôtre, s'assurer qu'un avocat rencontre régulièrement une personne mise en examen à la maison d'arrêt est essentiel. Il faudrait également s'assurer que dans chaque maison d'arrêt soit tenu un registre distinct de celui qui constate la visite des familles ou des proches. On pourrait s'assurer que, tous les deux ou trois mois, l'avocat a contacté la personne qu'il a la charge de défendre. On devrait faire en sorte que notre code apporte cette garantie. Ce serait une évolution très importante de notre système judiciaire. M. Jean-Paul GARRAUD : Il est difficile de se garder de la charge émotionnelle provoquée par cette affaire et qui a submergé nos concitoyens. Mais plutôt que de s'en garder, il convient de l'intégrer dans le travail général d'analyse pour ne pas rester à la surface des choses. Le climat ambiant pousse à la recherche d'un responsable sur lequel on peut rapidement mettre un nom et un visage, afin de l'immoler. En l'espèce, c'est le juge d'instruction qu'on pourrait faire disparaître du système procédural français. Il suffirait d'aller dans ce sens et la représentation nationale donnerait à la presse et à l'opinion publique l'impression qu'elle a agi dans l'intérêt commun. Mais serait-ce vraiment le cas ? Certes, la question de la place, de l'utilité et du maintien du juge d'instruction dans notre système judiciaire doit être examinée avec attention. Mais elle ne doit pas nous servir de chiffon rouge pour nous faire oublier tout ce qui, dans cette affaire, a contribué à la survenance du désastre. Les causes de responsabilité sont multiples. À titre préliminaire, il faut d'abord noter que l'affaire d'Outreau n'est pas la seule à avoir connu des errements judiciaires de grande ampleur. Souvenez-vous de l'affaire de Bruay-en-Artois et de l'affaire Grégory, qui avaient eu un grand écho et concernaient elles aussi de jeunes victimes. Certes, dans l'affaire d'Outreau, l'enquête judiciaire a complètement dérapé. Mais il serait réducteur d'en rendre responsable le seul juge d'instruction. Remplacer le juge d'instruction par un juge de l'instruction ou un juge de l'enquête, sorte de juge arbitre à l'américaine, serait à mon sens une fausse bonne idée, qui ne correspond ni à notre culture judiciaire, ni à notre système judiciaire, et aurait des effets pervers bien plus redoutables qu'il n'y paraît à première vue. Il faudrait déjà un parquet totalement indépendant, ce qui mettrait en jeu la cohérence d'une politique pénale nationale. Cela créerait des inégalités dans le traitement des affaires en fonction des moyens financiers des intéressés. Il y aurait alors une justice différente pour les riches, et une autre pour les pauvres, et la fameuse égalité des armes accusation/défense ne serait que fictive. Cela allongerait de façon interminable le traitement des affaires, à l'image de la procédure devant le Tribunal pénal international où le délai raisonnable de jugement est très largement dépassé. Et que dire de la critique de la « religion de l'aveu », aveu qu'on accuse le juge d'instruction de vouloir extorquer ? Mais n'est-ce pas dans les pays d'influence de droit anglo-saxon que l'on plaide, même pour les faits les plus graves, coupable ou non coupable ? Cela signifie que, dès que le suspect reconnaît sa culpabilité, on ne s'occupe plus des faits mais uniquement du quantum de la peine. L'aveu emporte ainsi dans ces pays bien plus de conséquences qu'en France. Il est à noter que bon nombre de pays aux procédures pénales de type accusatoire modifient leur législation dans un sens inquisitoire. Plus généralement, le mode de fonctionnement des cabinets d'instruction doit faire l'objet d'un examen particulier. Il est à noter que les impératifs de la LOLF semblent apporter un surcroît de travail aux cabinets d'instruction qui sont soumis au régime des 35 heures. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucune réforme ne soit possible ni souhaitable, mais bien plutôt que le législateur doit prendre lui aussi toute sa responsabilité dans ce désastre. Lorsqu'il élabore la loi, le législateur ne doit pas le faire à vif, sous le coup de l'émotion. Il doit prendre le temps de réfléchir et de se pencher sérieusement sur un certain nombre de notions, de mécanismes et de conséquences, par exemple sur la notion de prise de décisions. Lorsque le législateur, par la loi du 15 juin 2000, a retiré au juge d'instruction le pouvoir de placer en détention provisoire, il l'a fait au motif que l'instauration d'un juge des libertés et de la détention éviterait des incarcérations abusives. On a vu ce qu'il en est advenu dans cette affaire. En séparant la responsabilité de l'enquête de celle de la mise en détention, on a fait partager la responsabilité. Mais ne l'a-t-on pas diluée ? En fait, le JLD a prouvé son inefficacité. Il doit être supprimé. En revanche, il est indispensable de renforcer les capacités d'intervention de la chambre de l'instruction, de réfléchir à l'accroissement de ses prérogatives de contrôle, de renforcer les moyens reprographiques des juridictions, d'organiser des débats contradictoires réguliers devant la chambre de l'instruction, même en l'absence de toute demande. Autre notion sur laquelle il est urgent de réfléchir : la collégialité. Une décision prise à trois est supposée présenter davantage de garanties qu'une décision prise seul. Est-ce toujours le cas ? Lorsqu'une détention a été de multiples fois confirmée par de nombreuses collégialités, quelle marge d'appréciation reste-t-il à un juge seul comme le juge d'instruction pour s'y opposer ? Dans ce cas la collégialité est-elle une garantie ou une excuse, voire un piège ? Que signifient les règles de procédure qui enserrent l'examen du dossier par un collège de trois juges dans des délais incompressibles, que la procédure fasse seulement quelques pages ou qu'elle compte cinquante tomes ? Les délais sont intenables et la collégialité n'est qu'une façade. Plus généralement, il y aura à s'interroger sur l'état de la procédure pénale, de plus en plus complexe et dont le respect scrupuleux et méthodique laisse de moins en moins de temps pour se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire le fond du dossier. Il faut s'interroger aussi sur la garde à vue et ne pas oublier que les premiers éléments recueillis lors d'une enquête sont déterminants pour la suite. L'égalité des armes doit recevoir sa signification quand on se trouve devant un magistrat. Au stade policier, l'identification des éléments de preuve nécessite une certaine confidentialité. Sinon, il sera impossible de remonter les réseaux criminels. En revanche, il est tout à fait possible d'enregistrer les auditions lors des gardes à vue et de les conserver sur CD. La consultation des enregistrements pourrait être effectuée par la chambre de l'instruction en cas de contestation sur les conditions de garde à vue. Au-delà, la commission doit faire porter sa réflexion sur bien d'autres aspects, par exemple sur la formation des magistrats. Il faudrait qu'elle se demande quels moyens l'École nationale de la magistrature peut mettre en œuvre pour assurer une aide au jour le jour aux magistrats et quels dispositifs elle pourrait développer pour leur permettre de confronter et de mutualiser quotidiennement leurs pratiques. Il faut envisager la question de la gestion des ressources humaines au ministère de la justice. La magistrature est une profession qui regroupe de nombreux métiers qui supposent des qualités diverses et impliquent des conditions de fonctionnement très variables, allant du travail en équipe à l'exercice le plus solitaire. Or il n'existe pas, en l'état, au ministère de la justice, de cellule de GRH. Il n'existe qu'un « bureau des mouvements », qui gère les demandes de mutation sans véritables moyens et sans se préoccuper de la notion de profil de poste. Parvenir à nommer la bonne personne au bon endroit peut être plus qu'une énième réforme de procédure et mériterait d'être attentivement examinée. Lors d'une première nomination, l'ENM dispose de tous les éléments d'appréciation sur un jeune magistrat. Il serait important de mettre mieux en concordance le profil professionnel de l'intéressé avec le profil du poste. Notre déplacement à Bordeaux a été riche d'enseignements sur la réalité de la formation des futurs magistrats, qui est d'excellente qualité. Nombre de collègues m'ont dit que la vision qu'ils avaient de cette école avait été transformée par cette journée passée sur place. Il faudrait néanmoins envisager certaines réformes la concernant : modifier les coefficients et les programmes des concours - il existe encore au programme des concours des matières complètement périmées ; améliorer le fond commun de formation avec les autres professionnels de la justice, pour mieux se comprendre et travailler ensemble ; surtout, arriver à concilier la culture du doute, qui doit habiter chaque magistrat, mais qui ne doit pas l'empêcher de trancher : douter, mais décider. Cela paraît contradictoire, mais c'est essentiel. Je dirai un mot de la formation commune des magistrats du siège et du parquet : même recrutement, même formation, même évolution de carrière. L'unité du corps judiciaire, le brassage parquet-siège au cours de cette carrière sont une source formidable d'enrichissement du corps et de remise en cause permanente. La vision d'un magistrat qui a occupé plusieurs fonctions différentes est une vision d'ouverture. Il ne faut surtout pas spécialiser à outrance. Faire du parquet un corps à part, c'est ouvrir la voie à la fonctionnarisation dans le plus mauvais sens du terme. Là aussi, il faut concilier ce qui est apparemment inconciliable : la compétence avec les changements radicaux de fonctions dans la carrière. L'ENM a un rôle majeur à jouer dans ces reconversions. De multiples autres questions mériteront la même attention : le rôle des experts, avec l'indispensable revalorisation de leur mission ; celui des avocats, avec le renforcement des droits de la défense - il faut concilier la défense de l'intérêt général de la société, domaine d'intervention des magistrats, avec la défense des particuliers, domaine d'intervention des avocats ; les droits des associations d'aide aux victimes ; la place et l'influence des médias. Tous les juges d'instruction le savent, lorsqu'une affaire est médiatisée, il devient quasiment impossible d'obtenir une déclaration qui ne soit pas influencée par l'écho médiatique. Il serait donc urgent de traiter des rapports de la justice et de la presse et de s'interroger sur le traitement médiatique des affaires judiciaires en cours. La liste des questions est loin d'être exhaustive. Les majorités de droite et de gauche ont successivement élaboré des réformes de procédure tout aussi complexes les unes que les autres et contribué en cela à la confusion. Le temps n'est pas aux règlements de compte mais à la réflexion et à l'action constructive. Avec l'affaire d'Outreau, l'institution judiciaire est tombée au fond de l'eau. Il faut désormais l'aider à remonter à la surface. Le moment est propice pour que la commission parlementaire, en se gardant des fausses évidences et des solutions toutes faites, parvienne, à partir de ce qu'il y a de pire, à savoir la souffrance des innocents, à tirer le meilleur. M. Christophe CARESCHE : Dans le cataclysme que représente l'affaire d'Outreau, qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle et du dysfonctionnement personnel, et qu'est-ce qui relève de la responsabilité du système ? Comme ceux qui sont intervenus avant moi, je considère que nous sommes face à un système qui a dysfonctionné au stade de l'instruction, et dont les rouages n'ont fait que confirmer les éléments en faveur de l'accusation. Comment se fait-il que le système judiciaire, dans cette phase particulière de l'instruction, alors qu'un certain nombre de contrôles existent, ait pu aboutir à un tel résultat ? Je ne crois pas qu'on puisse améliorer la situation en collant quelques rustines, même si je pense que le fait d'aller vers plus de contradictoire et d'améliorer les dispositifs qui existent va dans le bon sens. Il faut essayer de réformer le système lui-même. Sur ce plan, deux auditions m'ont beaucoup marqué, qui tracent des évolutions possibles mais différentes. La première est celle de Mme Delmas-Marty et de M. Pierre Truche. En l'occurrence, ils ne préconisent pas de supprimer le juge d'instruction, mais de faire évoluer son rôle, de lui donner une fonction plus juridictionnelle et un rôle d'arbitre entre l'accusation et la défense. Un tel système est séduisant, dans la mesure où il permet de clarifier les rôles, de donner des lisibilités fortes au stade de l'instruction, notamment aux personnes mises en cause. Pour autant, il implique certaines conditions : l'autonomie du parquet et donc l'interdiction de donner des instructions en matière individuelle ; l'attribution de moyens à l'aide juridictionnelle pour que la défense puisse jouer un rôle effectif. Ces conditions ne sont pas hors de portée. La seconde évolution possible a été suggérée par le président Guy Canivet, qui revendique le système inquisitoire actuel. Elle consisterait à clarifier les choses entre le parquet et le siège, entre les procureurs et les juges, en supprimant notamment la dyarchie au niveau du fonctionnement des juridictions. C'est une piste. Cela permettrait d'éviter que l'accusation, qui est portée par le parquet, ne soit pas omniprésente au cours de l'instruction. Nous devrons, sinon nous mettre d'accord sur l'évolution de ces deux systèmes, du moins mettre sur la table les différents éléments d'évolution du système pénal lui-même. Ce dernier a en effet montré ses insuffisances. M. Michel HUNAULT : Je voudrais d'emblée vous rendre hommage, monsieur le président, ainsi qu'à M. le rapporteur, pour la façon dont vous êtes intervenus au cours de ces semaines. Vous avez fait honneur au Parlement. J'en veux pour preuve l'esprit dans lequel chacun a pu travailler, et ce dans la plus grande transparence. Avant toute réforme, il me semble qu'il faudra adopter une loi d'orientation de la justice et une loi pénitentiaire. Le rapporteur a une tâche difficile, celle de faire la synthèse et de proposer des pistes pour éviter que ne se reproduisent les dysfonctionnements. Mais rien ne se fera si, au préalable, la justice ne dispose pas de moyens financiers. Il faudrait que, dans le cadre de cette loi d'orientation pour la justice, il y ait une place pour une loi pénitentiaire. Nous avons en effet constaté des atteintes à la présomption d'innocence et à la dignité de la personne. Nous avons une responsabilité collective dans ces dysfonctionnements : au fil des semaines, certains nous ont dit qu'ils n'avaient fait qu'appliquer la loi. Il faut donc changer la loi. Nous avons également un défi à relever : redonner de l'humanité à la justice. Cela passe par la responsabilité et le respect des différents acteurs de la justice. Il faut aussi favoriser l'accès au droit dans chaque département en faveur des justiciables. Cette réforme devra être guidée par des principes essentiels : celui de la présomption d'innocence et celui de la limitation stricte de la détention provisoire. Mme Elisabeth Guigou, lorsqu'elle était garde des Sceaux, avait essayé déjà d'agir en ce sens s'agissant de la présomption d'innocence. Les réformes qui ont eu lieu depuis ont porté atteinte à cette présomption d'innocence. Il faut s'interroger sur la mise en examen elle-même, sur les lieux de garde à vue qui ne doivent pas rester des zones de non-droit. On doit pouvoir filmer. Les auditions doivent être réglementées et l'avocat doit avoir un rôle important à ce stade. J'ai regretté que nous n'ayons pas eu davantage de temps pour auditionner les représentants de la police judiciaire. Celle-ci devrait être sous contrôle conjoint du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice. Là encore, il faut éviter les zones de non-droit au moment de l'arrestation et pendant la garde à vue, qui sont des moments essentiels. On peut s'accorder sur la création de pôles de l'instruction rattachés auprès de chaque TGI, afin de lutter contre l'isolement des jeunes juges. Il faut responsabiliser et sanctionner les défaillances et les abus. Je ne prendrai qu'un exemple : certaines victimes ont dit qu'elles avaient été giflées et tutoyées pendant leur garde à vue, que leur détention provisoire avait été prolongée pour les besoins de l'instruction alors qu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu. Enfin, je pense qu'il faut limiter la détention provisoire aux délits les plus graves en matière criminelle et envisager des mesures alternatives à la prison. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire en vous remerciant à nouveau, monsieur le président, monsieur le rapporteur. M. François CALVET : Nous aurons tous été touchés dans nos fibres les plus sensibles, dans nos fibres citoyennes, avec ce sentiment fort que le temple des valeurs républicaines que constitue notre justice doit être réaffirmé dans sa vocation de toujours : écoute et proximité avec les citoyens. Cela motive, à mon sens, une infatigable recherche de la vérité, à travers une meilleure transparence dans le fonctionnement interne de la justice et le souci de son rapprochement avec les justiciables. Les droits de la défense doivent être affirmés et encouragés à tous les stades de la procédure. La collégialité et la motivation des décisions me semblent aussi devoir être valorisées dans leur caractère de principes fondamentaux de fonctionnement de la justice. Il pourrait être envisagé, au niveau de l'instruction, la création d'une chambre collégiale des libertés et de la détention composée de trois membres : un vice-président rôdé aux rouages de l'instruction et deux assesseurs, dont l'un serait également expérimenté et l'autre sortant de l'ENM. Il serait sans doute judicieux aussi de prévoir la mise en place de pôles d'instruction départementaux. Mais l'affaire d'Outreau, c'est d'abord la détention provisoire, qui ne devrait être retenue que lorsque les charges s'avèrent très lourdes et non pas simplement « suffisantes ». Cela éviterait que la détention provisoire soit utilisée comme moyen de pression. Il conviendrait également de prévoir la généralisation du port du bracelet électronique. La collégialité est à promouvoir aussi au niveau des juridictions de jugement. Il serait raisonnable de limiter la compétence du juge unique aux délits pour lesquels l'emprisonnement n'est pas en cause. La collégialité apparaît comme le gage d'une minoration du risque d'erreur. Elle pourrait être appliquée au secteur civil et familial. On créerait une chambre des affaires familiales au civil et au pénal, compétente notamment pour l'ensemble des questions concernant les placements et les gardes d'enfants - je vous rappelle que 25 enfants ont été placés dans cette affaire d'Outreau. Collégialité au début de la chaîne de décision et motivation à ce stade final de la décision : voilà, à mes yeux, deux moyens privilégiés de sécuriser, au bénéfice entier du justiciable, toutes les phases de la procédure en harmonie avec l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Corollaire de ce principe de collégialité : le système de l'échevinage. Les procédés de semi-échevinage avec d'autres juristes, tels que les juges de proximité sont à encourager, de même qu'un échevinage pur avec l'implication de non-professionnels choisis sur des listes de citoyens volontaires. Il conviendrait de créer une unité mobile et psychologique, spécialement chargée de recueillir la parole de l'enfant. Il nous apparaît également très important de favoriser le dépôt des rapports d'expertise en fin d'information, au vu de l'ensemble des éléments et non au milieu comme actuellement. Un débat contradictoire devrait alors se tenir devant la chambre collégiale de l'instruction avec les experts. La recherche de la vérité doit être guidée par la quête inlassable de la dignité humaine. Il faut faire désormais des cellules de garde à vue des lieux corrects, conformes aux règles sanitaires élémentaires, mettre de vrais repas à la disposition des gardés à vue, rendre obligatoire la visualisation des locaux de garde à vue par le parquet, notamment par l'installation, dans chaque canton, de salles de visioconférence avec caméras. L'exigence de transparence doit s'accompagner d'une exigence de respect vis-à-vis du justiciable. Cela suppose une meilleure appréhension du profil de magistrat. Une part plus importante devra être réservée à ses aptitudes psychologiques et à ses capacités relationnelles au niveau même du cursus à l'ENM. Nous devons aussi nous interroger sur la possibilité de passerelles entre la formation du futur avocat et celle du futur magistrat. Un magistrat pourrait également mener une expérience sur le terrain dans telle ou telle collectivité locale, avec réintégration dans le corps d'origine. La justice aura aussi, plus en aval, à gérer son image. Les journées « portes ouvertes » dans les palais de justice devraient être multipliées pour faire comprendre les conditions de fonctionnement de la justice et permettre un contact direct, toujours très fructueux, avec les magistrats et les fonctionnaires. Il convient aussi de prévoir la présentation de bilans annuels de l'action judiciaire. Une autre proposition consisterait à rendre obligatoires, sauf nécessités de l'enquête, les possibilités ouvertes à l'article 11 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure. Ne pourrait-on envisager un regroupement régional de l'organisation judiciaire, adapté aux besoins et moyens des petits tribunaux et variant en fonction de la configuration des départements et des régions ? On pourrait privilégier, dans ce cadre, la possibilité de vidéo-audiences, c'est-à-dire de plaidoiries à distance. Ne pourrait-on aussi prévoir la mise en place de fenêtres de publicité ? Certaines phases de l'instruction seraient ainsi le cadre d'un dialogue avec les avocats, le parquet, le ou les mis en examen et les parties civiles. Il semble parallèlement qu'il nous faille réfléchir à un traitement plus rapide des dossiers, et donc plus conforme aux attentes des justiciables. Il faudrait notamment recourir à un règlement alternatif des litiges pour parvenir à une justice de compromis - conciliations, transactions et arbitrages. Voilà, monsieur le président, monsieur le rapporteur, ce que j'avais à cœur de vous dire afin d'apporter ma modeste contribution aux travaux de cette commission d'enquête à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je voudrais enfin m'associer aux propos de mon collègue et vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer. J'ai bien conscience que cette contribution n'est qu'une goutte d'eau dans ce vaste processus de changement qu'appellent de leurs vœux les magistrats eux-mêmes. Mais cette contribution a été nourrie des attentes exprimées par nombre de mes concitoyens. Car, au fond, comme l'écrivait Albert Camus : « que serait la justice sans la chance du bonheur ? ». M. Guy LENGAGNE : Je m'associe aux félicitations adressées au président et au rapporteur. Je remarque d'abord que l'on n'échappera pas, quelle que soit la réforme envisagée, à l'accroissement considérable des moyens financiers de la justice. Au-delà, je ferai quelques remarques ponctuelles, à la suite des auditions et des discussions que j'ai pu avoir, essentiellement dans ma circonscription. Manifestement, lorsque des enfants sont en cause, les débats devraient se dérouler ailleurs que dans une salle d'audience avec ses dorures. Je ne sais pas comment on peut faire, mais il semble bien que les enfants soient traumatisés dans un tel cadre ; cela m'a été confirmé par des parents ou des assistantes maternelles. S'agissant toujours des enfants, nous avons écouté des spécialistes, des experts. Il serait plus sage de mettre en place une cellule spécialisée qui interviendrait dès le début pour recueillir leur parole. On a évoqué la question des journalistes. Certains ont été entendus. Mais il me semble qu'il serait bon qu'il existe, pour les journalistes, l'équivalent du Conseil de l'Ordre. Dès que quelqu'un considérerait qu'on a mis son honneur en cause, il pourrait s'adresser à une telle institution, afin qu'on rappelle à l'ordre le journaliste qui aurait quelque peu excédé son pouvoir. Par ailleurs, les accusés ont eu l'impression qu'ils étaient mis de côté et que la justice se faisait sans eux. Il serait bon qu'ils aient eux-mêmes accès à leur dossier. J'aborderai maintenant un aspect qui n'a pas été évoqué : les jurés, que nous n'avons pas pu entendre parce qu'ils étaient soumis au secret. En discutant avec eux, il m'est apparu que leur indépendance était, d'une certaine façon, mise en cause. Un avocat avait d'ailleurs déclaré que les jurés avaient fait du « copié-collé » par rapport à ce qui avait été proposé. Ce n'est pas l'honnêteté des jurés qui est en cause, mais le fonctionnement du système : les magistrats ont sans doute un rôle beaucoup trop important en cours d'assises. Par ailleurs, il faudrait se pencher de près sur le système du vote et sur la façon dont les décisions se prennent en cour d'assises. Très souvent, le magistrat suit presque aveuglément - parce qu'il n'a pas d'autre solution - l'avis de l'expert. Lorsqu'il s'agit d'affaires importantes et graves comme celle d'Outreau, il serait bon qu'il y ait un débat contradictoire entre les experts. Je n'attaquerai pas l'honorable profession des avocats. Reste que je suis choqué. Quelqu'un est traîné devant un tribunal, que ce soit à tort ou à raison : il y a un procureur et des magistrats, qui sont fonctionnaires. Et que l'on soit puissant ou misérable, ce seront les mêmes. Ce n'est pas la même chose s'agissant de l'avocat. Une personne financièrement à l'aise peut se payer un très bon avocat. Pas une personne au RMI, comme l'a fait remarquer la sœur d'un accusé, celui qui est mort. C'est un problème de fond, qui est très préoccupant. Notre collège Blanc, qui est avocat lui-même, a évoqué une situation qui n'est pas spécifique à l'affaire d'Outreau, mais qui n'en n'est pas moins choquante : des personnes emprisonnées laissées seules par leur avocat. J'imagine leur détresse profonde, surtout quand elles sont innocentes ! On nous a rétorqué que ces personnes pouvaient écrire. Mais si aucun d'entre nous n'a de problème pour écrire, ce peut être extrêmement difficile pour elles ; certaines étaient même à la limite de l'analphabétisme. C'est pourquoi notre collègue avait suggéré qu'il soit obligatoire de rendre régulièrement visite aux personnes en la maison d'arrêt. J'irai plus loin. J'ai eu l'occasion de parler de ce qui se passe au Canada. Je pense qu'il serait plus sage, dans des affaires comme celle-là, qu'il y ait des avocats fonctionnaires. En début de carrière, ces avocats seraient totalement à la disposition du tribunal, notamment dans les affaires criminelles. Ils seraient là comme peut l'être un juge d'instruction ou comme un procureur, pour défendre les accusés. Je terminerai en rappelant que je suis député d'Outreau. On a tenté de réparer le mal qui a été fait aux innocentés. Mais on a peu parlé de la ville d'Outreau. Je souhaiterais que, dans les conclusions de notre commission, nous demandions au Gouvernement d'apporter une réparation à cette ville. Cette ville a beaucoup souffert sur le plan économique. Elle a vu disparaître pratiquement toutes ses entreprises. Mais elle a toujours gardé sa fierté, et le fait qu'elle soit jetée en pâture aux chiens me choque beaucoup. Nous devrions demander au Gouvernement de faire un geste, non seulement symbolique mais matériel, pour la commune d'Outreau. M. Georges COLOMBIER : Aujourd'hui, notre commission entre dans la phase décisive de son travail : rédiger et proposer des pistes de réforme et d'amélioration pour notre système judiciaire. Pendant des dizaines et des dizaines d'heures, nous avons auditionné tous les acteurs du séisme qu'a constitué ce qu'on a nommé « l'affaire d'Outreau ». Les auditions ont été riches et intenses, parfois empreintes de beaucoup d'émotion, notamment lorsque se sont exprimés, avec beaucoup de dignité, sans hargne et sans haine, les acquittés. Nous savons que l'attente des Français et des acteurs judiciaires est grande en la matière. Notre rapport et nos conclusions sont attendus. Face à l'onde de choc de cette affaire, on ne peut se contenter du raisonnement qui consiste à dire : puisqu'il y a eu des acquittés, tout va bien. Même s'il faut éviter de regarder et de considérer la justice à travers le seul prisme de cette affaire, un certain discrédit a été jeté sur l'institution judiciaire. Le lien de confiance entre les citoyens et la justice est entamé. Or, sans confiance, la justice ne peut pas bien fonctionner. Le garde des Sceaux l'a rappelé, « la justice ne peut être acceptée que si elle est comprise ». Si la crédibilité de la justice s'effondre, c'est tout un pan du pacte républicain qui s'écroule. Au-delà de l'impact émotionnel, nous devons donc tirer les enseignements des dysfonctionnements révélés. Il nous incombe d'empêcher qu'une telle affaire ne se reproduise et ne rende ainsi irréversible la fracture qui se creuse entre les citoyens et la justice. Les différentes auditions ont permis de croiser un ensemble de points de vue très divers : justiciables, magistrats, experts, enquêteurs, médias, etc. L'ampleur de notre tâche est importante et c'est avec beaucoup d'humilité que nous devons l'aborder car malheureusement, malgré toutes les modifications, même profondes, que nous pourrons apporter, la justice relève avant tout des hommes et demeure par conséquent faillible. Des changements sont devenus cependant indispensables dans trois domaines : la détention provisoire, la responsabilité et la formation des magistrats, les moyens accordés à la justice. La durée de la détention provisoire est désastreuse. Les témoignages des acquittés ont été à ce titre accablants. C'est le scandale permanent de notre justice : la détention provisoire fait purger une peine avant même que les gens ne soient condamnés. Nous devons réfléchir à cette « pré-peine » et trouver un point d'équilibre entre le souci d'efficacité de la procédure et l'attention qui doit être portée aux victimes et aux droits de la défense. Il faut supprimer le critère fourre-tout de « trouble à l'ordre public », parfois source d'abus et, pourquoi pas, instaurer des dates butoir au-delà desquelles la détention ne pourrait être prolongée. Les conséquences humaines des détentions provisoires excessives sont inacceptables. On a tous à l'esprit ces vies brisées, ces familles qui ont explosé. Je voudrais rappeler aujourd'hui le cas de François Mourmand, décédé en détention. L'affaire d'Outreau en a été une illustration criante, mais il ne faut pas oublier les cas isolés du même ordre, qui ne bénéficient pas de la même publicité. Il nous faut donc aujourd'hui donner un signe fort dans cette direction. Deuxième axe de réflexion : la responsabilité et la formation des magistrats. Il ne s'agit pas de se lancer dans une chasse aux sorcières, et mon propos n'est pas de désigner des boucs émissaires après chaque décision de justice. Cependant, nous devons nous interroger sur la manière dont certains magistrats exercent leurs fonctions. Les pouvoirs des magistrats sont importants, ce qui est tout à fait normal. Leur travail est extrêmement complexe et les contraintes très fortes. Mais il serait anormal que les magistrats ayant commis une erreur grossière et manifeste ne soient pas sanctionnés. Je ne parle pas ici de l'affaire d'Outreau, mais de ce qui pourrait se produire dans l'avenir. Il faut briser la solitude des magistrats et instaurer une dose de collégialité dans l'instruction. Certains rétorqueront que ce raisonnement quantitatif s'applique vainement à une matière qui appartient au qualitatif. Néanmoins, je suis persuadé que le regard de deux, voire de trois magistrats sur un dossier est à même de limiter les dérives, notamment dans les affaires très complexes et sensibles où la pression sur les épaules d'un seul homme peut se révéler écrasante. Elle permettrait aussi de pallier le manque d'expérience de certains magistrats qui, au-delà des compétences purement techniques, ne possèdent pas, à l'évidence, au sortir de l'École, l'expérience nécessaire pour instruire ce type de dossier. Un minimum d'ancienneté est indispensable. En effet, la crainte ressentie par les Français d'être un jour confrontés à une machine sourde et aveugle gérée par un seul homme est réelle. On touche là un point auquel je suis très sensible : la culture du doute. À l'évidence, la formation dispensée aux magistrats est sur ce point insatisfaisante. Elle doit être renforcée et bénéficier, autant que faire se peut, aux personnes mises en examen. Troisième axe de réflexion : les moyens de la justice. Au-delà des défaillances d'un système procédural sans conteste perfectible, l'affaire d'Outreau a révélé une nouvelle fois le manque de moyens de notre institution judiciaire. Force est de constater que la faiblesse du budget du ministère de la justice participe à la genèse des catastrophes. Le manque de moyens financiers, humains, matériels est évident. Je ne suis pas un spécialiste, et c'est ce qui m'a le plus surpris lors de ces auditions. Ce manque de moyens s'est ressenti de bout en bout de l'instruction de cette affaire : dans le déroulement des expertises, dans l'aide juridictionnelle et les difficultés du barreau à assurer correctement la défense des plus faibles, dans les conditions de recueil de la parole des enfants et des gardés à vue - s'agissant notamment des enregistrements sonores ou audiovisuels. Le budget du ministère de la justice pour 2006 représente 2,13 % du budget de l'État, contre 1,89 % en 2004 et 1,81 % en 2001. Il faut saluer cette progression notable, mais il faut l'intensifier. Je suis convaincu que malgré les contraintes pesant sur nos finances publiques, l'affaire d'Outreau constitue une chance pour faire accepter par les Français le fait que la justice pénale est l'affaire de chacun et que nos libertés justifient des efforts conséquents, y compris financiers. En conclusion, l'onde de choc et l'émoi suscité par cette affaire ont été considérables. Notre rapport ne doit pas être un énième rapport qui terminera dans un tiroir, comme nous avons la fâcheuse habitude d'en produire dans notre pays. Il devra être un des chantiers prioritaires de la majorité, quelle qu'elle soit, qui sortira des urnes l'année prochaine. La réforme devra s'inscrire dans la sérénité et le temps, car il n'y aurait rien de pire que la précipitation pour traiter d'un sujet aussi sérieux et fondamental. Elle devra faire l'objet d'un grand consensus. Aux yeux des Français, les décisions que l'on prendra ensemble seront mieux reçues. Pourquoi ne pas mettre à profit les prochains mois pour organiser un grand débat national sur la justice ? L'intérêt avec lequel nos concitoyens ont suivi nos travaux a démontré qu'il existe une demande en ce sens. Enfin, lors des débats, des remontrances ont été adressées au législateur et à la justice. Or, les dysfonctionnements majeurs qui ont été analysés au cours de ces derniers mois ne concernent pas seulement le législateur et les affaires judiciaires. Ils concernent également chacun d'entre nous, en tant que citoyens. Ils concernent enfin les médias et la façon dont ils traitent l'information. Aussi suis-je convaincu que si nous acceptons tous de nous remettre en cause, tous les espoirs sont permis. M. Jacques FLOCH : Nous effectuons aujourd'hui un premier tour de table, car selon moi le débat sur la réforme de la justice devra avoir lieu au cours des prochains mois, à l'occasion de la grande rencontre que nous allons avoir avec le peuple français. Lors de l'affaire d'Outreau, les dysfonctionnements que l'on a constatés se sont opérés dans le cadre de la loi : en effet, il n'y a eu ni erreur judiciaire ni faute de procédure, et c'est donc bien en faisant usage des dispositions législatives en vigueur qu'on en est arrivé à vingt-cinq années de détention provisoire, vingt-cinq enfants placés hors de leur famille, un mort en prison, et plus de douze personnes dont la vie est définitivement brisée. On peut disserter sur la manière dont il faudrait réformer notre système judiciaire : doit-on garder ou pas le juge d'instruction ? Changer son appellation ? Surtout, je crois qu'il faut renforcer notre système contradictoire en matière pénale en donnant à l'accusation comme à la défense les mêmes possibilités de débattre. En l'état actuel, c'est l'accusation qui a la main, tandis que la défense se borne à constater. Pour ma part, je suis pour que l'avocat soit présent et qu'il ait accès au dossier dès la première heure de la garde à vue. De ce point de vue, les problèmes qu'a soulevés M. Jean-Paul Garraud ne sont pas insurmontables. Bien sûr, il faut avant tout assurer la sécurité de nos concitoyens, mais sans jamais faire fi de la défense de nos libertés. Or, quand on est en garde à vue pendant 24, 48 ou 96 heures, on est privé de liberté, de même que lorsqu'on est en détention provisoire. Certes, la loi prévoit que cette privation n'est que temporaire, mais elle marque définitivement, surtout ceux qui sont innocents, quel que soit le nombre de jours qu'ils ont pu passer en détention provisoire, d'autant que les conditions sont plus difficiles à supporter qu'après une condamnation, puisqu'on est enfermé 22 heures sur 24 alors que les condamnés ont accès à un certain nombre d'activités et peuvent donc sortir de leurs cellules. Il faut commencer par réviser les conditions de la mise en détention provisoire, en même temps que celles de la mise hors détention. C'est aussi pour ces raisons que ce ne doit plus être un seul homme ou une seule femme qui décide de cette mise en détention : dans la mesure où il s'agit d'une privation de liberté, un tribunal doit en décider. Nous sommes dans un État démocratique et libre, dans une nation qui s'est battue pendant des siècles pour acquérir des libertés, il s'agit quand même d'un des articles de la déclaration des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de confier à un seul individu la possibilité de mettre autrui en détention, ne serait-ce que pour quelques heures ou pour quelques jours. On dit souvent que si l'accusation est gratuite la défense est payante et notre collègue Guy Lengagne, observant l'énorme problème que pose la différence de moyens financiers et de pouvoir économique entre les personnes, a proposé que les avocats en début de carrière soient mis à la disposition des tribunaux pour assurer la défense des plus démunis. Mais ce serait une autre injustice ! Pour être avocat de grande qualité, il faut une grande expérience. Pourquoi mettrait-on à la disposition des plus pauvres de nos concitoyens quelqu'un qui n'en a pas ? La solution est donc, dans un simple souci de justice, de renforcer les moyens mis à la disposition des barreaux afin d'assurer la défense de ceux qui ne sont pas en capacité de le faire. Je crois, par ailleurs, que notre système d'instruction se méfie par trop du doute et qu'il faut lui redonner la possibilité de faire parler ce doute. On a bien vu dans l'affaire d'Outreau que le juge Burgaud, s'il n'a, je l'ai dit, commis aucune faute de procédure ni aucune erreur judiciaire, n'a douté de rien. S'il y avait eu à ses côtés un procureur ou des membres de la chambre de l'instruction pour introduire la notion de doute, nous n'aurions pas connu cette catastrophe judiciaire. Je nourris aujourd'hui la crainte que, par souci d'unanimisme, nous ne tombions d'accord que sur des propositions à l'eau tiède alors qu'elles devraient être révolutionnaires, au sens le plus noble du terme. Nous devons aussi veiller à en mentionner à chaque fois le coût : parler d'un doublement du budget de la justice, très bien, mais nous devons impérativement dire pour quoi faire. La première réforme que nous devrions imposer est celle d'une carte judiciaire fondée uniquement sur des critères démographiques : un tribunal d'instance pour 200 000 habitants, un TGI pour 500 000, une cour d'appel pour 5 millions. Ainsi pourrait-on regrouper, en particulier au sein des cours d'appel, des équipes de magistrats afin qu'aient lieu ces rencontres permanentes dont nous avons tant besoin. Il est scandaleux que tant de cours d'appel n'aient pas assez de magistrats pour les faire travailler collectivement ! Si notre contribution est importante, si elle marque une vraie réforme de notre système judiciaire, alors je pense que nous pourrions, pour répondre au souhait de notre collègue Guy Lengagne, l'appeler tout simplement « réforme Outreau ». M. Jacques-Alain BÉNISTI : Je parlerai, pour ma part, de la position de la presse dans cette affaire. En effet, elle a non seulement bafoué les dispositions législatives sur le respect de la présomption d'innocence, mais surtout méprisé ses propres règles de déontologie et d'éthique, comme des journalistes eux-mêmes l'ont observé lors de leur audition. La prudence, la vigilance, la rigueur exemplaire qui sont inscrites dans la charte de bonne conduite de tous les journalistes ont disparu du comportement de tous ceux qui ont fait l'information dès le début de cette triste affaire. Alors que cette charte mentionne explicitement la faculté d'une réponse, le respect d'une information sans condamnation arbitraire, l'équité dans le traitement de l'information, tout cela a été purement et simplement balayé. Ainsi des êtres humains ont été lynchés par des médias peu scrupuleux du respect des droits des citoyens et de la déontologie, au mépris total de la présomption d'innocence. Que faire pour éviter désormais un tel carnage et une telle atteinte à l'intégrité de l'individu et à sa dignité ? Je propose, en particulier, que soit établi officiellement et concrètement un vrai code de déontologie de la profession, et que l'on crée une sorte de conseil de l'ordre de la presse écrite et audiovisuelle, appelé à garantir l'application scrupuleuse de ce code et apte à prendre des sanctions allant jusqu'à la suppression de la carte de presse. Ce conseil serait composé uniquement de journalistes, qui pourraient ainsi sanctionner leurs propres confrères en cas de dérapage ou de manquement aux règles. Je propose également que l'on modifie la loi de 1982 sur le droit de réponse, qui pourrait devenir immédiat, par le jeu d'un référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance, en cas de non-respect de la présomption d'innocence mais aussi du principe du contradictoire, c'est-à-dire quand on ne laisserait pas s'exprimer dans un reportage les personnes mises en cause par ailleurs, et quand la liberté de communication de celui qui est atteint dans sa dignité serait bafouée. Enfin, une loi pourrait sanctionner très durement la violation du secret de l'instruction, non pas uniquement pour les journalistes mais pour tous les acteurs du processus judiciaire : avocats, policiers ou de magistrats. L'ensemble de ces mesures permettrait de faire que, si la liberté de la presse reste prédominante dans notre société, elle ne puisse désormais franchir les limites de l'atteinte à la liberté et à dignité des citoyens. M. Bernard DEROSIER : Notre commission d'enquête est chargée non seulement de rechercher les causes les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau, mais de formuler des propositions et c'est dans cette seconde phase que nous entrons aujourd'hui. Je souhaite, pour ma part, que l'on n'oublie pas la prévention, c'est-à-dire ce qui se situe en amont des faits générateurs d'une instruction et d'un procès. Certes, il existe déjà un cadre juridique fixé par les lois de janvier et juillet 1983 sur la décentralisation de ce qui touche à la protection de l'enfance, mais les événements d'Outreau ont mis en lumière la nécessité que ce cadre soit précisé. Je suggère donc, en premier lieu, que nous systématisions la mutualisation et la coordination de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la vie d'un enfant dont on présume qu'il est victime de maltraitance. Cela concerne l'éducation nationale, les services de police et de gendarmerie, la justice et surtout le juge des enfants, ainsi, bien entendu, que les travailleurs sociaux. Cela suppose aussi des moyens accrus puisqu'en l'état actuel du système, la prévention et l'observation ne sont pas suffisamment prises en compte. Au-delà, se pose le problème de l'enfant et du recueil de sa parole, dont on a beaucoup parlé. Quelques images et quelques procès-verbaux nous ont montré toute la difficulté de cet exercice : j'ai été marqué par cette petite fille qui se trémoussait sur sa chaise et qui était incapable de répondre à l'officier de police qui l'interrogeait. Nous avons entendu aussi nombre de commentaires contradictoires d'experts sur la crédibilité de la parole de l'enfant. Mais on raisonne comme si l'enfant parlait toujours. Or, il n'a pas que la parole pour exprimer la douleur qu'il a ressentie, et le recueil de la parole d'un enfant ne saurait être comparé à celui de la parole d'un adulte. Il faut donc attacher plus d'importance aux conditions dans lesquelles la parole l'enfant est prononcée : à qui, quand et dans quel contexte elle est dite. L'examen du corps de la victime doit aussi être appréhendé dans une globalité. Or nous avons vu que l'on se concentre surtout sur l'examen gynécologique, en oubliant qu'un enfant agressé sexuellement n'a pas forcément été l'objet d'une pénétration, que l'agression a pu prendre d'autres formes. L'examen du corps doit donc être réalisé dans une logique de soins et de réparation d'une atteinte à ce corps. Pour mieux appréhender les faits et mieux prendre en compte les enfants, ma deuxième proposition vise à ce qu'on remplace le recueil de la parole de l'enfant avec expertise de crédibilité et expertise gynécologique par une évaluation et un examen pédiatrique globaux, faisant le point sur sa santé physique, psychologique et sur son environnement socio-éducatif, menés par une équipe pluridisciplinaire qui permettraient de traduire le cas échéant les mots émis par l'enfant, mais aussi de décrypter son langage non verbal. Dès qu'un signalement est transmis à l'autorité judiciaire, l'enfant doit faire l'objet d'un placement dans un lieu qui garantisse une observation et une évaluation par des professionnels qui le connaissent : enseignants, médecin de famille, personnel des crèches ou assistantes familiales, éducateurs et pédopsychiatres de la structure d'accueil. Ces équipes seraient ainsi aptes à évaluer le danger, à s'interroger sur la problématique familiale, sur les besoins de l'enfant et de la famille, à formuler des hypothèses au regard de l'histoire de la famille. Ce sont ces adultes que la police et la justice devraient entendre d'abord pour avoir une approche plus rationnelle. Un renforcement de la formation me paraît également nécessaire, notamment pour les assistants familiaux auxquels seraient confiés les enfants ayant fait l'objet d'un signalement. Au sein des 300 heures de formation de ces professionnels, un module doit porter sur la façon de recueillir les préoccupations des enfants. De même, une formation à la prévention de maltraitance doit être dispensée aux enseignants dans les IUFM. Après les images caricaturales dont je viens de parler, chacun a également présente à l'esprit la nécessité que les fonctionnaires de police soient bien formés. M. Jean-François CHOSSY : Si cela n'avait pas déjà été fait, j'aurais pu à mon tour exprimer ma satisfaction devant la manière dont notre rapporteur a mené les débats et dont notre président a dirigé nos travaux. J'aurais pu également parler de la garde à vue, de la détention provisoire, du recueil et de l'expertise de la parole de l'enfant, de l'accompagnement du mineur victime, du juge des libertés et de la détention, de la collégialité. J'aurais aimé parler de l'échevinage, mot dont la consonance moyenâgeuse traduit mal une bonne idée, parler des droits de la défense, de la formation, du recrutement, de la responsabilité des magistrats et de l'immunité par rapport à la décision juridictionnelle. Il m'aurait aussi intéressé de traiter de la relation que nous pouvons avoir avec les médias, ce qui nous aurait permis d'ouvrir un grand débat. Mais tout cela, nous aurons à le dire au cours de travaux qui fonderont nos propositions et qui seront ans doute moins médiatiques que ceux qui ont été les nôtres jusqu'à aujourd'hui. Je me contenterai donc de deux observations. La première porte sur un sujet que vous évoquez souvent, Monsieur le président, c'est la création d'un pôle de l'instruction. Si j'en ai parfaitement compris l'utilité et même la nécessité, je ne voudrais pas qu'au nom de l'efficacité de la justice on déshabille des territoires entiers. Il faut tenir compte de l'évolution démographique, Jacques Floch l'a dit, mais aussi de l'éloignement géographique de tel ou tel point du territoire, avant de décider de créer un pôle de l'instruction au chef-lieu de département comme l'a proposé le garde des Sceaux. Je ne conteste pas l'utilité d'un tel pôle, mais j'invite à ne pas oublier l'importance de la justice de proximité. Ma seconde observation porte sur l'expertise. Celle-ci doit être un avis donné au juge, or, j'ai constaté dans l'affaire d'Outreau qu'il s'agissait pratiquement d'une expertise scientifique. Ne conviendrait-il donc pas que toute expertise pénale soit réalisée de façon contradictoire avec l'ensemble des parties ? Ne pourrait-on également ouvrir à la défense la possibilité de discuter le choix d'un expert par le juge ? Il faut, par ailleurs, que la qualité de l'expert soit contrôlée régulièrement et que les listes soient mieux tenues à jour, afin qu'on n'y trouve le plus les noms de professionnels ayant cessé leur activité depuis longtemps. Mais faut-il, comme l'a suggéré le garde des Sceaux, que les expertises soient réalisées par un collège ? Certes, l'idée de collégialité a été très présente au cours de nos travaux. Dans l'affaire d'Outreau, une expertise semble avoir orienté les débats et il me semble que nous devons y réfléchir, c'est celle de la crédibilité. Demandée par le juge, elle a servi de référence. Ce qu'on recherche cependant, c'est la vérité et la crédibilité, ce n'est pas la vérité. Peut-être faudra-t-il renoncer à cette notion, qui n'apparaît d'ailleurs dans aucun texte législatif mais uniquement dans une circulaire et qu'on utilise pourtant comme référence. C'est en tout cas ce que préconise le rapport Viout : « La notion de crédibilité a connu un glissement sémantique porteur de confusion. Il ne saurait être prétendu qu'il existe une automaticité de l'adéquation entre crédibilité médico-légale et vérité judiciaire ». M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC : Je rejoins très largement les conclusions de mon collègue Jacques Floch. Pour moi, le premier intérêt de nos travaux est peut-être que, pour la première fois, l'opinion publique a pu appréhender une partie de ce qu'est sa justice. Et il est en effet heureux que la justice soit un élément essentiel dans les grands débats démocratiques qui s'annoncent. À défaut, notre commission n'aurait servi à rien et l'affaire d'Outreau, avec ses souffrances et ses victimes, passerait par pertes et profits. Je l'ai déjà dit, dans cette affaire, nous n'avons pas assisté à un dysfonctionnement mais à un paroxysme des difficultés du fonctionnement ordinaire de notre justice, qui touchent tous les dossiers, y compris les plus petits, même si j'affirme par ailleurs que, quotidiennement, la justice est bien rendue, et avec humanité. À la fin de centaines d'heures d'auditions, si nous nous constatons que la procédure pénale a été respectée mais que nous nous trouvons quand même face à une catastrophe, cela signifie soit que la procédure pénale est à revoir de fond en comble, soit que ceux qui la mettent en œuvre ont oublié quelque chose. Je pense, pour ma part, que ce qui a été oublié par la quasi-totalité des acteurs, c'est le sens de la loi et de la procédure pénale, c'est-à-dire avant tout le respect de chaque individu, qu'il soit accusé ou victime : donner la prééminence à l'un par rapport à l'autre est toujours une erreur. Il faut donc rappeler à chacun qu'il existe dans le code de procédure pénale un article préliminaire qui indique ce qu'est cette procédure et ce qu'est un procès pénal, et qui doit s'imposer à tous ceux qui concourent à l'acte de justice : policiers ou gendarmes enquêteurs, acteurs sociaux, protecteurs de l'enfant, juges d'instruction, avocats, magistrats du siège et du parquet. Nul ne saurait ignorer ce qui fonde les droits, en particulier la présomption d'innocence. L'une de mes propositions est donc que l'on permette à toutes les parties dans une instruction et dans une procédure d'invoquer le bénéfice de l'article préliminaire du code de procédure pénale pour que soit remis en cause ou réexaminé tout acte ou toute situation qui paraît porter préjudice au respect des droits fondamentaux. Et il ne s'agit pas ici de théorie : si un juge d'instruction refuse d'entendre une personne parce que son avocat n'est pas là et dit que l'entendre quand même serait porter atteinte aux droits de la défense, il se situe bien dans la logique des droits fondamentaux. De même, au nom de ces principes, le bâtonnier doit pouvoir stigmatiser le comportement d'un avocat qui, six mois après, n'est pas allé voir son client en détention. S'agissant de la garde à vue, il faut cesser de croire que nous sommes seuls à avoir raison contre tous en considérant que la présence de l'avocat dans un commissariat signifie que les malfaiteurs ont gagné la partie. La présence de l'avocat dès la première heure, sa capacité à consulter le dossier ne portent en rien atteinte aux nécessités de la sécurité publique, de l'instruction, de la recherche de la vérité et des coupables. La conservation par enregistrement des auditions apparaît, par ailleurs, comme une nécessité, qui lèverait toute ambiguïté sur les circonstances de la garde à vue. Nous sommes également tous d'accord pour dire que les conditions de la garde à vue sont scandaleuses pour ceux qui sont placés en garde à vue mais aussi pour les policiers. En ce qui concerne la détention provisoire, la collégialité de la décision est indispensable : aucune décision qui porte atteinte à la liberté des personnes ne saurait être prise autrement que collégialement. Il faut ensuite supprimer la référence à l'ordre public et faire obligation au parquet qui prend la réquisition, au juge qui demande la mise en détention et à la collégialité qui la décide de la motiver, de dire quels sont les éléments de fait, de droit, de situation qui la justifient. Par ailleurs, la privation de liberté ne devrait être qu'une sanction, il paraît donc indispensable que la situation des détenus provisoires soit clairement distincte de celle de ceux qui effectuent des peines. Cela vaut pour le lieu de la détention comme pour les conditions dans lesquelles elle s'exerce et pour les droits personnels et familiaux du détenu provisoire, pour le droit à la plénitude de sa vie d'homme ou de femme. Au cours de la détention provisoire, la personne ne doit donc pas être regardée comme privée de liberté mais comme placée dans une situation permettant la poursuite de l'investigation, sans qu'il soit porté atteinte à sa dignité. Je suis également partisan de la collégialité pour les juges des libertés et de la détention et de la cosaisine pour les juges d'instruction, qui devraient par ailleurs être obligés de fixer le délai de leur propre démarche d'investigation. Par ailleurs, sauf à vouloir dissimuler dans l'oubli ce qui a été dit quelques instants plus tôt, je ne comprends pas pourquoi toute personne quittant le bureau du juge d'instruction n'est pas porteuse du procès-verbal de son audition, ce qui réglerait en outre bien des problèmes de copie. S'agissant de l'organisation judiciaire, il faudra bien mener le combat vis-à-vis du public, des élus et des professionnels, sur la carte judiciaire. Tout le monde a intérêt à la mise en place de pôles d'instruction territoriaux compétents et efficaces. Les nouvelles techniques d'investigation, les possibilités de visioconférence devraient éviter que le juge d'instruction n'hésite à convoquer plusieurs fois des personnes et à mener de nouvelles confrontations. L'affaire d'Outreau montre aussi que les problèmes ne sont pas réglés entre le parquet et le siège. Je pense même qu'ils se sont aggravés ces dernières années. Si on peut comprendre que la nécessité de mûrir son parcours autorise pendant un temps le passage de l'un de l'autre, il faut ensuite que cela cesse pour que l'on ne voie plus de juge d'instruction passer au parquet avant de revenir en traiter les appels en correctionnelle. Je suis également persuadé qu'il faut reprendre la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui est restée au milieu du gué. Enfin, les fonctions exercées doivent être détachées du grade, de l'ancienneté et de la rémunération : il est aussi important d'être un bon magistrat instructeur, un bon juge d'instance qu'un bon juge assesseur dans une cour d'appel. Les justiciables ont besoin de bons juges, expérimentés, bien payés, pour faire le travail du quotidien de la justice. M. Georges FENECH : Je m'associe à l'hommage qui a été rendu au président et au rapporteur de notre commission, mais on me permettra aussi de rendre hommage à la magistrature, en particulier aux juges d'instruction, fonction que je connais bien. Je veux également rappeler la mémoire de certains collègues juge d'instructions qui ont disparu : François Renaud, assassiné en 1975, Pierre Michel assassiné en 1981, Gilles Boulouque, qui n'a pas résisté aux pressions et qui s'est donné la mort. Je salue aussi des collègues courageux qui ont dû quitter la magistrature comme Éva Joly ou Éric Halphen. Je rappelle enfin les carrières brisées d'Henri Pascal, de Jean-Michel Lambert, peut-être demain de Fabrice Burgaud. Que se passe-t-il donc avec cette fonction ? Est-elle frappée d'une malédiction égyptienne pour que toujours, dans notre magistrature, ce soient les juges d'instruction qui paient les pots cassés des procédures ? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et je veux dire à Jean-Paul Garraud, qui connaît aussi bien que moi cette fonction pour l'avoir exercée, qu'il ne saurait y avoir ici de position dominante, que la sienne n'est pas plus légitime que la mienne : nous sommes dans un vrai débat et nous devons nous respecter les uns et les autres. Nous cherchons à trouver un système qui permette que l'erreur judiciaire ne se produise pas car il s'en produit bien plus qu'on ne veut bien le dire, les statistiques le montrent. Et pour réparer tous les dégâts liés à une erreur judiciaire, il ne suffit pas d'accorder des dommages et intérêts ou de publier un non-lieu dans la presse. Pour éviter l'erreur, il faut équilibrer notre système afin qu'un présumé innocent reste véritablement innocent jusqu'à son éventuelle condamnation. Cessons de nous gargariser de mots comme « les droits de la défense » ou « la présomption d'innocence », agissons ! S'il s'agit aujourd'hui, à travers la commission Outreau, de faire le procès de la justice - procès qui a profondément blessé la magistrature, certaines réactions nous l'ont montré, qui se sont ensuite atténuées parce qu'on a compris que notre travail était effectué en faveur de la justice et non pas contre les juges -, je vous mets en garde : il y aura demain un autre procès, le nôtre, celui de la classe politique, si, au bout de ce travail exemplaire et sans précédent, nous ne sortons pas de cette commission avec les vraies réformes attendues par le pays, si nous ne répondons pas aux exigences des Français qui ont suivi nos travaux. Et si nous nous contentons de répondre qu'il faut multiplier par trois le nombre des juges d'instruction, nous auront apporté une fausse bonne réponse. M. Jean-Olivier Viout nous a bien dit que la cosaisine ne correspondait le plus souvent à aucune réalité concrète. Et le juge Van Ruymbeke, qui est une référence en matière d'instruction, saisi dans l'affaire Elf avec Eva Joly et Laurence Vichnievsky, a déclaré : « Plus cela allait, plus les choses étaient difficiles, car nous avions des visions divergentes du dossier et des façons de travailler très différentes. Cela s'est arrangé lorsque mes collègues sont parties. » On le voit, la collégialité ça marche quand il s'agit de prendre une décision à la majorité, de prononcer une condamnation, de décider d'une détention, mais ça ne marche pas quand il s'agit de diriger une enquête, car on a besoin que quelqu'un montre la direction : un bateau ne saurait naviguer avec trois capitaines à égalité de voix, c'est une question de bon sens ! Je suis, par ailleurs, convaincu que le système inquisitoire à la française a vécu, qu'il est condamné et que nous allons rejoindre tôt ou tard l'ensemble des grandes démocraties qui font usage, comme d'ailleurs les institutions judiciaires internationales, d'un système contradictoire que certains ici essaient de caricaturer. Je n'ai jamais défendu le système accusatoire à l'américaine ! Nous devons faire preuve d'imagination, inventer un système français qui repose sur l'action publique menée par le parquet, un parquet qui fasse l'enquête. Déjà aujourd'hui, 95 % des affaires sont instruites par le parquet et 5 % par l'instruction. Et on prétend que passer à 100 % serait le « grand soir » de l'institution judiciaire... Il s'agit simplement de remettre chaque acteur de la justice à sa place : un parquet qui mène l'enquête à charge et à décharge, une défense digne de ce nom, présente depuis le début de la garde à vue et qui assiste aux auditions - là aussi, nous sommes les derniers à conserver un système napoléonien, vieux de deux cents ans et fondé sur le secret et sur l'écrit. Faisons en sorte que, tout en haut de cette pyramide, il y ait un juge de l'enquête, un juge de l'instruction qui arbitre, à équidistance entre l'accusation et la défense, et qui demande des actes. Si le parquet les refusait, il le dessaisirait et confierait l'enquête à la chambre de l'instruction. L'aspect économique de la défense est également très important : il faut que notre pays fasse l'effort budgétaire nécessaire pour que l'aide juridictionnelle remplisse véritablement son rôle. Quand on aura ainsi remis les acteurs de la justice à leur place, on aura éliminé au maximum les risques d'erreur judiciaire. Car comment demander à un homme seul d'être à la fois commissaire et juge, de prendre toutes les décisions ? Ce qu'il faut, c'est une réforme non pas homéopathique mais chirurgicale. Il faut séparer le parquet et le siège. À qui veut-on faire croire que le siège est indépendant du parquet quand vous les voyez entrer et sortir par la même porte, siéger à la même estrade, porter la même robe, faire la même carrière, partager les mêmes bureaux ? Ces magistrats ne sont pas indépendants les uns des autres. Souvenez-vous de ce que nous ont dit les plus hauts magistrats de notre pays, Pierre Truche, Guy Canivet, Jean-François Burgelin et tant d'autres. Si nous n'en tenions pas compte, nous serions à côté de ce qu'attendent les Français. Faisons donc en sorte que les procureurs de la République aient un statut autonome. Réfléchissons aussi à la nécessité de maintenir des instructions individuelles. Il n'y en a guère que cinq ou dix chaque année. Pourquoi un membre de l'exécutif interviendrait-il dans un dossier judiciaire individuel ? Pourquoi ne pas créer, comme les Allemands l'ont fait, un procureur général de la Nation, qui unifierait la jurisprudence de l'action publique, qui ferait le contact entre le ministre de la justice et l'ensemble des procureurs généraux ? Nous aurions ainsi une véritable égalité devant la justice. Ce sont ces réformes chirurgicales qu'il faut mener au lieu de nous contenter de placebos. Songeons aux quarante réformes intervenues depuis quarante ans ! Saisissons la chance historique qui nous est offerte de poser le socle d'une véritable réforme de la justice. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, c'est vraiment à désespérer. M. Christian PHILIP : Bien des points qui m'ont apparu mériter des évolutions ont déjà été abordés, en particulier tout ce qui touche à la détention provisoire et au recueil de la parole de l'enfant. En défendant ses convictions, Georges Fenech a également soulevé des questions essentielles. Mais, en tant qu'universitaire, je souhaite insister plus particulièrement sur la formation des magistrats. Bien sûr, tout ne dépend pas de cela, mais sans une bonne formation, aucun professionnel ne saurait bien exercer sa fonction. Pour autant, je ne crois ni à l'origine unique ni au monopole de la formation des magistrats, aussi bonne soit-elle. L'unicité signifie toujours l'uniformité, qui présente des dangers. Il faut donc prévoir, dans des proportions plus importantes qu'aujourd'hui, des voies d'accès diversifiées à la magistrature, en dehors de l'École nationale de la magistrature, en développant à chaque fois une formation adaptée au profil des entrants. S'agissant de l'ENM, j'ai été intéressé par notre journée à Bordeaux. J'y ai trouvé des gens motivés, qui réfléchissent à la formation qu'on leur dispense. Mais je crois qu'en dépit de certaines évolutions cette formation est trop refermée sur elle-même. Il faut développer des formations communes avec d'autres métiers liés au fonctionnement de la justice. Et même si cela n'est pas possible avec les avocats, en raison du nombre de personnes concernées, il faut prévoir davantage d'activités communes. Il conviendrait aussi de faire évoluer les liens entre l'école et l'université : certes, les élèves de l'ENM ont suivi un cursus dans nos facultés de droit, mais pourquoi ne pas créer un véritable réseau ? Pourquoi ne pas développer des activités de recherche et enseignement communes ? Il conviendrait aussi de créer, comme l'ont fait beaucoup d'écoles, une année européenne afin que tout magistrat passe au moins un semestre dans la magistrature d'un autre État et puisse ainsi mener une réflexion comparative. Il faut aussi insister sur la formation continue, qui ne devrait pas être dispensée uniquement par des magistrats. Enfin, afin d'assurer un lien plus étroit entre la justice et la société civile, je souhaiterais que l'on crée, sur le modèle de l'IHEDN, une institution analogue en matière judiciaire. M. Thierry LAZARO : Si le tandem président-rapporteur a plutôt bien fonctionné, je souhaite également remercier le personnel de la commission d'enquête, qui a répondu à chacune de nos sollicitations. Il me paraît utile, dans une société où on infantilise et où on déresponsabilise tout, d'insister sur la responsabilité des magistrats. Je suis donc favorable à ce qu'on donne au médiateur de la République, sans même passer par le filtre d'un parlementaire ou du garde des Sceaux, la possibilité d'engager une action devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le citoyen s'estimant victime d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de la part d'ailleurs d'un magistrat, d'un officier ministériel comme d'un avocat, pourrait ainsi bénéficier d'une voie de recours. Le médiateur pourrait peut-être aussi assumer la fonction de contrôleur général des prisons. Je suis, pour ma part, hostile à la création de tout nouveau comité « Théodule », de toute autorité administrative plus ou moins indépendante et de tout « comité de sages », qui n'ont jamais permis d'apporter une véritable solution à quoi que ce soit. Je plaide également pour la possibilité d'une action récursoire à l'encontre d'un magistrat ayant commis une faute grave : je ne trouverais pas anormal qu'il en fût responsable sur ses propres deniers. Je serai, par ailleurs, très attentif à la réforme de la carte judiciaire. Notre pays compte 35 cours d'appel, 181 tribunaux de grande instance, 471 tribunaux d'instance. Il s'agit d'une réforme non seulement politique et administrative, mais aussi d'aménagement du territoire. Certes, nous sommes des élus locaux, mais nous pouvons comprendre l'importance d'une réflexion de fond à ce propos pour l'exercice des missions régaliennes de l'État. J'ai passé au sein de cette commission des moments humains assez extraordinaires, et j'ai rencontré des gens remarquables. J'en ai aussi rencontré de remarquablement affligeants : quelques experts, quelques professeurs émérites, quelques personnes imbues d'elles-mêmes. Mais toutes les autres avaient le sens de l'intérêt général, étaient empreintes d'humanité et de bonne volonté et voulaient avant tout, comme nous, que des erreurs comme celles de l'affaire d'Outreau ne puissent pas se reproduire. Pour tous ceux qui veulent ainsi avancer, pour les acquittés, pour ceux qui vivent aujourd'hui d'autres Outreau, pour tous nos concitoyens, nous n'avons pas le droit de courber l'échine, de céder à des intérêts tant corporatistes que politiques. Nous sommes parvenus à travailler ensemble en bonne intelligence, mais je sais bien que la politique va reprendre ses droits. Pour ma part, je fais partie d'une formation politique mais c'est en tant qu'homme libre et responsable que je me déterminerai. M. Alain MARSAUD : Prenons la procédure pénale par ordre chronologique. Les droits de la défense doivent être assurés lors de la garde à vue, grâce à l'intervention de l'avocat non à la première heure mais dès la prolongation, avec accès au dossier, ce qui lui permettrait de préparer, auprès de son client, une défense, en cas de défèrement devant un magistrat. Nous devrions, par ailleurs, restituer le procureur de la République dans ses droits et devoirs de gardien exigeant de la légalité. Par une simple circulaire, le garde des Sceaux pourrait ainsi rappeler que dans toute procédure, il appartient au procureur de la République, à tous les stades, de vérifier avec rigueur que les faits concernés relèvent bien d'une qualification légale stricte et non plus d'une interprétation plus ou moins arbitraire, plus ou moins personnelle. C'est ainsi que certains d'entre nous ont appris le métier de magistrat. Nous, députés, devons cesser de fabriquer à longueur d'années des « infractions caoutchouc » qui peuvent s'étirer en longueur et en largeur, permettant n'importe quelle appréciation. Je n'en citerai que deux exemples. La mise en danger délibérée de la personne d'autrui peut permettre, à terme, de condamner tous les fumeurs de cigarettes sur plainte des fumeurs passifs, tandis que le blanchiment et ses avatars du code pénal peuvent servir de base à la poursuite de tous les employés de banque, surtout de bonne foi. Quant au juge d'instruction, nous devrions réhabiliter sa fonction de chef enquêteur. Le juge d'instruction est avant tout un enquêteur solitaire dont nous avons voulu faire une juridiction. Ce fut une erreur. Se pose alors la question de la décision et de la gestion de la détention provisoire. Il faudrait supprimer le juge des libertés et de la détention, qui, en l'espèce, a posé plus de problème qu'il n'en a résolu, pour le remplacer par une juridiction collégiale, de type tribunal correctionnel, éventuellement composée par échevinage. Le juge d'instruction ne statuerait sur la détention provisoire que dans l'urgence, laissant à la juridiction collégiale le soin de la décision définitive, dans un délai par exemple de 24 ou de 48 heures. À défaut d'une telle réforme, il faudra sans doute se résoudre à faire travailler le juge d'instruction en collégialité, en pôle départemental ou régional, au risque qu'en réalité, un seul membre de la collégialité n'instruise, et que la justice ne s'éloigne encore davantage du justiciable. Mais comme cette idée est « politiquement correcte », je m'y rallierai. Nous devons également nous montrer fermes sur les délais de détention provisoire, et prévoir qu'elle ne pourra durer plus d'un an en matière correctionnelle, et plus de deux ans en matière criminelle. Une telle mesure obligerait le juge d'instruction à faire le choix de l'urgence dans certaines procédures. La formation et le recrutement de la magistrature doivent être ouverts sur l'extérieur, et nous devrions mettre en place un recrutement parallèle. Nous devrions également repousser l'âge maximal d'entrée à l'ENM à quarante ans, et imposer une période de mobilité de deux ans dans tous les autres corps. Il faut, par ailleurs, savoir demander des comptes aux magistrats, quand ils commettent des fautes graves. Sans doute pourrions-nous créer une sorte de chambre des requêtes au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Nous devrions nous inspirer de la conception anglo-saxonne de la procédure pénale, et notamment du principe du doute raisonnable, qui amène le procureur anglo-saxon à abandonner la poursuite et le juge à ne pas condamner. Cette notion pourrait se substituer dans notre droit à celles de charges constitutives d'infractions et d'intime conviction. Enfin, mettons un terme à l'hypocrisie que constitue l'article préliminaire du code de procédure pénale, véritable défi à l'intelligence, voire à l'intégrité intellectuelle de ceux qui font fonction de justice. Dans l'affaire d'Outreau, chacun des alinéas de cet article qui se veut fondateur de la nouvelle justice a été violé. Abrogeons cet article dès demain, nous nous en porterons mieux. M. Xavier de ROUX : Je tiens également à vous féliciter, Monsieur le président, de la manière dont vous avez mené ces débats. Je serai bref, car beaucoup a déjà été dit. Au cœur de cette affaire se pose le problème, non de l'erreur judiciaire, car il n'y en a pas eu, mais de la détention provisoire, de la privation sans fondement de la liberté d'accusés pendant de très longs mois. La question de la présomption d'innocence se pose également, de même que celle de l'existence d'un débat contradictoire entre l'avocat, le juge et le parquet. Malheureusement, dans cette affaire, le débat contradictoire n'a pas existé, le juge d'instruction n'accordant pas d'actes à la défense, et se trouvant sur la même position que le parquet. Nous avons en vérité à faire à deux poursuivants conjoints, le juge d'instruction et le procureur - l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire du parquet sont ainsi identiques, à quelques mots près. Le juge d'instruction n'a pas joué son rôle d'arbitre et encore moins son rôle de juridiction. Quant à la détention provisoire, vieux problème de notre pays, elle a été plusieurs fois réformée par le législateur ces dernières années. Nous avons connu le référé-liberté, puis le juge des libertés et de la détention, théoriquement indépendant du juge d'instruction, mais qui, faute de bien connaître le dossier, ne le contredit que rarement. La chambre de l'instruction ne connaît d'ailleurs pas davantage le dossier que le juge des libertés ! Je pense que tout le monde s'accorde sur la nécessité de supprimer le juge des libertés. En fait, nous devons revoir en profondeur notre code de procédure pénale pour donner des armes égales à l'accusation et à la défense, sous l'arbitrage du juge d'instruction, qui mènera l'instruction, non en tant qu'investigateur, mais en tant qu'arbitre entre l'accusation et la défense. Dans ce contexte, nous pourrions rendre à ce juge tous ses pouvoirs, notamment en matière d'incarcération. Il s'agit là d'un vrai débat sur le fond qui tient à notre conception de la procédure pénale et de l'aveu. Les plus hauts magistrats de ce pays, et notamment le président Canivet, nous ont demandé de trouver un équilibre entre une véritable accusation et une véritable défense. Nous devons à cette fin nous inspirer de la procédure des juridictions internationales, qui assurent en particulier aux personnes la possibilité d'être assistées par des avocats correctement payés et compétents. Je trouve choquant que de jeunes avocats sans expérience, mal payés, viennent défendre, mal, des personnes poursuivies pour des faits très graves. Je termine par la question de la collégialité, à laquelle je suis opposé. Ce n'est pas parce que vous ferez travailler trois magistrats ensemble que vous améliorerez la procédure. Georges Fenech a cité l'affaire Elf. Trois grands magistrats ont été nommés, et ce fut un vrai pataquès car ils ne s'entendaient pas du tout entre eux. Finalement, l'un des trois l'a emporté et a bouclé seul l'affaire ! M. Jacques REMILLER : À mon tour de vous féliciter, Monsieur le président, pour la manière dont vous avez conduit ces travaux avec M. le rapporteur. Cette commission aura également permis de réconcilier les Français avec la fonction parlementaire. Ce week-end, on me disait encore, « Enfin, on vous voit travailler ! » Ce n'est pas une seule, mais plusieurs défaillances qu'a connues le système, depuis la police jusqu'aux magistrats, en passant par les experts. Les auditeurs de justice, que nous avons entendus à Bordeaux, nous ont demandé de fixer, dans le cadre de cette réforme, une direction claire. Nous devrons réformer pour que les demandes des citoyens, des justiciables, soient examinées sans retard par la justice, pour que les plaintes des victimes ne soient plus, comme c'est trop souvent le cas, classées sans suite, pour que les principes de présomption d'innocence et de liberté individuelle soient pleinement respectés. Par ailleurs, la médiatisation des affaires, comme nous l'avons vu avec Outreau, porte des atteintes irréparables à la réputation des personnes présumées innocentes. Parce que la substitution de la mise en examen à l'inculpation n'a rien changé, nous devons nous interroger, dans certains cas, sur l'opportunité de mettre en examen des mis en cause, d'autant que le statut de témoin assisté offre les mêmes avantages. S'agissant de la détention provisoire, sans qu'il soit question de la supprimer totalement, nous devons prévoir des durées maximales. Plutôt que de supprimer la fonction de juge d'instruction, je pense qu'il vaudrait mieux la réaménager car aujourd'hui, ces juges décident du sort d'une personne qu'ils n'ont souvent jamais vue. L'incapacité pour les avocats des mis en cause à se faire entendre nous a frappés. L'avocat doit être présent tout au long de la garde à vue, et avoir accès au dossier. Quant au juge d'instruction, il faut mettre fin à son isolement et mettre en place un service, une équipe. Notre commission devra fixer les modalités de ce travail en équipe. Il est risqué de toucher à la carte judiciaire. En tant qu'élu, j'avoue que je ne sais pas faire. Enfin, nous avons été interpellés à de nombreuses reprises sur le manque de moyens humains et matériels des tribunaux. M. Jean-Yves HUGON : Je tiens également à remercier le président et le rapporteur pour le travail qu'ils ont accompli, mais également les collaborateurs de la commission qui nous ont permis de travailler dans les meilleures conditions. Je voudrais revenir sur la question du renforcement des droits de la défense. Nous avons vécu de nombreux moments forts, notamment lors de l'audition des personnes acquittées. Elles nous ont dit en particulier que la vérité aurait pu éclater bien plus tôt si elles avaient pu obtenir des confrontations individuelles. La défense doit pouvoir obtenir les confrontations individuelles ou les contre-expertises qu'elle demande. Par ailleurs, il n'y aurait pas eu d'affaire Outreau sans le problème de la détention provisoire. Notre commission devra formuler des propositions fortes en la matière car nous sommes attendus sur ce terrain. J'ai vécu avec beaucoup d'émotion cette aventure, et j'ai ressenti le besoin d'aller à Outreau. Je remercie d'ailleurs mes deux collègues du Pas-de-Calais qui ont facilité ma visite. Alors que je m'attendais à trouver un univers glauque, à la limite du Zola, j'ai découvert un quartier agréable, une zone pavillonnaire avec des espaces de verdure et de jeux, au centre desquels se dressaient quatre tours blanches. D'une certaine manière, j'étais parti sur une fausse idée. Je suis entré dans les immeubles, et si les logements ne sont pas forcément ceux dont nous rêvons, ils sont parfaitement vivables. Par ailleurs, M. Georges Fenech a parlé d'un moment historique. Nous ne devons pas le rater, car nous sommes attendus. Nous, députés membres de la commission, avons été sollicités par nos électeurs, qui se sont approprié leur justice, et ont beaucoup suivi nos travaux. Nous devons faire preuve de courage, et d'abord au niveau de nos propositions qui doivent être ambitieuses. Mais nous devons aussi faire preuve de courage politique. Grâce à cette commission, nous avons redoré le blason des députés. Pour la première fois, nos concitoyens ont vu des parlementaires travailler ensemble, gommer leurs divergences politiciennes, et nous devons continuer dans cette voie. Mme Arlette GROSSKOST : Je souhaite m'associer bien évidemment à tous les remerciements qui vont ont été adressés, Monsieur le président, avant de vous exposer quelques pistes de réflexion. Il convient tout d'abord de simplifier la justice, en créant des pôles de compétences ou d'instruction à l'échelon départemental ou régional, en unifiant les procédures - et notamment en alignant tous les délais de procédure sur les plus courts -, en limitant le recours à la détention provisoire à des faits criminels. Il faudra, par ailleurs, conforter le contradictoire, en organisant le plus en amont possible une confrontation générale de tous les acteurs au procès, et en restreignant peut-être le champ des parties civiles - j'ai été quelque peu choquée par le nombre de parties civiles au procès d'Outreau. Sans doute devrons-nous favoriser la cosaisine des magistrats. « L'humanité ne s'apprend pas, mais l'expérience se partage », a si bien dit l'une des personnes que nous avons auditionnées. Si la cosaisine n'est pas possible, qu'au moins les juges dont c'est la première affectation instruisent en co-pilotage. Concernant la formation des magistrats, nous devons l'ouvrir sur l'extérieur, repousser l'âge maximum d'entrée à l'ENM, instaurer un recrutement parallèle et rendre obligatoire une formation continue diversifiée et de qualité. Enfin, nous devrons mettre en œuvre l'arsenal juridique existant pour prévenir autant que possible les dérives médiatiques. M. Marcel BONNOT : Pour nombre de Français, et de professionnels de la justice, Outreau a signé la faillite technique d'un système pénal qui ne peut perdurer parce qu'il génère chaque jour des catastrophes techniques du même genre, dont les justiciables font les frais. Nous savons que les principes fondamentaux de la présomption d'innocence et de la culture du doute ont vécu et sont aujourd'hui relégués dans les tiroirs, y compris de ceux du juge d'instruction. Notre commission a fait naître de grandes espérances que nous n'avons pas le droit de décevoir. Nous devons faire preuve d'un courage sans précédent. Je me contenterai de vous livrer quelques réflexions, car beaucoup a déjà été dit. S'agissant de la garde à vue, le fait pour un homme ou une femme de passer le pas de la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie ne doit pas lui faire perdre sa dignité. En l'espèce, nous devons revoir notre copie. La détention provisoire, qui est quasiment la règle aujourd'hui, ne devrait être que l'exception, et ne s'appliquer qu'à certaines infractions. Pour ce qui est de l'instruction, le juge d'instruction, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a vécu. Le juge Van Ruymbeke lui-même se dit favorable à sa suppression, dans la mesure où ce juge revêt la double casquette d'enquêteur et d'arbitre. Il déclare encore avoir longtemps hésité entre le système de la cosaisine et le remplacement du juge d'instruction par un juge de l'instruction, mais d'une instruction où la défense tiendrait toute sa place, quelle que soit la qualité de l'avocat. Et d'ajouter que si la cosaisine peut parfois s'avérer nécessaire, il n'a pas gardé un bon souvenir de celle de l'affaire Elf. La collégialité ne saurait être la panacée. Concernant les avocats, je rappelle que j'étais de ceux qui, lors de l'institution de l'aide judiciaire, estimaient que l'on mettait en place une mauvaise sécurité sociale pour l'avocat. S'il est légitime que le justiciable puisse recourir à un avocat sans bourse délier, compte tenu de la nature de ses finances, il faut tout de même permettre à l'avocat d'exercer dignement sa mission, ce qui passe par des moyens matériels à la hauteur de sa tâche. M. Gérard VIGNOBLE : J'ai vécu cette commission en deux temps, à commencer par le choc humain de la rencontre avec les victimes, qui nous ont tenu un discours effrayant. Le second temps, ce furent des heures et des heures d'audition de personnes venues nous expliquer qu'aucune faute n'avait été commise, mais que les moyens manquaient pour faire face à l'afflux des dossiers, et que dans l'ensemble, tout s'était passé normalement. Nous avons beaucoup parlé de la justice cet après-midi, et j'espère que le rapport permettra de changer la justice selon le vœu des Français : des coupables condamnés, des innocents libérés et blanchis. Notre rapport ne sera pas complet, si nous ne trouvons pas une formule pour blanchir, purifier les victimes. Si une personne mise en examen est coupable, elle doit être condamnée. Si elle est innocente, au lieu qu'elle tombe dans une machine à broyer, nous devons trouver un moyen de la blanchir. Je vous propose par conséquent de mettre en place une audience d'honneur pour toute personne mise en examen, mais qui finalement est acquittée ou bénéficie d'un non-lieu. On parle des victimes d'Outreau, mais combien y en a-t-il d'autres ? Mme Elisabeth GUIGOU : Je tiens moi aussi à vous remercier, Monsieur le président, pour la qualité des travaux, ainsi que les administrateurs qui nous ont permis de travailler dans les meilleures conditions. Je suis heureuse que cette réunion se tienne, car je ne crois pas qu'après des mois de travaux et d'auditions, nous puissions tirer le rideau. Notre tâche est très importante car, quand la confiance dans la justice s'érode, c'est la confiance dans la démocratie qui est atteinte. Nous devrons faire des propositions à la hauteur du drame d'Outreau et des attentes de nos concitoyens. Permettez-moi de formuler quelques remarques préliminaires. La présomption d'innocence, principe cardinal de la procédure pénale, ne doit pas rester un principe abstrait mais devenir une réalité, respectée par tous les acteurs du système pénal. Quatorze innocents ont passé vingt-six ans en détention provisoire, l'un d'entre eux y est mort. Nous ne devrons jamais les oublier. Leur vie en restera à jamais marquée, ainsi que celle de leurs enfants. Nous avons été émus, choqués, parce qu'ils étaient innocents, mais même coupables, rien ne justifiait de les traiter ainsi, aussi bien en garde à vue qu'en détention provisoire. Rien ne justifiait que les lois en vigueur soient bafouées, car la présomption d'innocence n'existe pas seulement pour ceux qui seront finalement reconnus innocents, mais pour protéger les droits de tous, et la qualité de l'enquête. C'est grâce au respect du droit que l'on obtient des dossiers « bien ficelés ». À travers nos travaux, les Français ont découvert la dureté de notre procédure pénale. Ceux d'entre nous qui étaient des professionnels de la justice en avaient déjà conscience. Je l'ai découverte pour ma part en 1997, et je me souviens l'avoir décrite à la tribune de l'Assemblée, lors de la présentation de la loi du 15 juin 2000. Nous devons nous interroger sur ce qui justifie les gardes à vue, les interpellations, les incarcérations. Bien sûr, il faut trouver le coupable et punir les crimes, mais n'oublions pas que l'honneur de la démocratie et la crédibilité de la justice tiennent dans le respect du droit. La Cour européenne des droits de l'Homme a trop souvent condamné notre pays pour ne pas avoir respecté ces droits. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette affaire ? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire. Les deux procès ont fait éclater la vérité. Le drame est ailleurs, avant le jugement, dans des fautes qui se sont accumulées, et qui sont le fait de tous les acteurs, de la police aux avocats, aux magistrats, aux assistantes maternelles etc. Pourquoi ? Le climat était tendu. Au-delà de l'affaire Dutroux, la présomption d'innocence a été l'otage d'un débat politicien et électoral à la fin de l'année 2001 et au début de l'année 2002. Ayons le courage de le reconnaître. Par ailleurs, il aurait fallu appliquer effectivement les garanties de la procédure. Nous l'avons dit, nous sommes tous favorables, au sein de cette commission, à l'égalité des armes entre les parties, et au respect du contradictoire. Quelles propositions pouvons-nous faire ? Je ne crois pas à un « grand soir » de papier, qui ensuite ne se traduit jamais dans les faits. Nous devons partir de nos acquis pour améliorer notre procédure. Il nous faut renforcer nos lois sur le traitement des victimes, en particulier d'abus sexuels, car il est rare, dans ces cas, de disposer d'éléments matériels. Or, c'est justement lorsque l'on se fonde uniquement sur la parole que tous les défauts de notre procédure, de nos habitudes éclatent. C'est parce que nous avons la religion de l'aveu, et qu'en l'espèce, il n'y avait rien d'autre que des paroles. Par ailleurs, nous devrons nous donner les moyens d'appliquer les lois. Enfin, nous devrons responsabiliser les acteurs. S'agissant du recueil de la parole des enfants, nous devrons compléter la loi de 1998, afin de rendre obligatoire l'enregistrement des auditions des enfants victimes, qu'il faudrait organiser, autant que possible, dans un cadre hospitalier, afin de ne pas effrayer les enfants. Nous devrons donner les moyens nécessaires, et sanctionner en cas de non respect de cette obligation. Plus personne ne doit pouvoir se réfugier derrière l'absence de moyens. Pour ce qui est de la garde à vue, je suis favorable à l'enregistrement obligatoire de tous les interrogatoires, mais aussi à la présence de l'avocat. Les barreaux devront s'organiser, et nous devrons rémunérer correctement les avocats. Certains avocats, mal payés, surchargés de travail, ne se déplacent même pas ! C'est vrai, ce sera difficile à mettre en place, car certains policiers pourraient prendre cette mesure pour de l'ingérence, mais le ministre de l'intérieur devra s'engager, avec le garde des Sceaux, à convaincre les policiers de la nécessité de cette mesure. S'agissant de la détention provisoire, renforçons la fonction du juge des libertés et de la détention. Revenons à la règle selon laquelle seul le président ou le vice-président du tribunal peut exercer cette fonction, et suivons les propositions du président Canivet pour que le JLD organise des audiences publiques dignes de ce nom, en présence des avocats. Nous devons, par ailleurs, davantage utiliser les dispositifs prévus par la loi, notamment le bracelet électronique, en remplacement de la détention provisoire. Si nous voulons nous orienter dans cette voie, il nous faudra supprimer les mesures récemment votées qui vont dans le sens inverse. Si nous posons ainsi que la liberté est la règle, nous ne devons plus obliger le JLD à motiver sa décision de remettre en liberté. Seule la décision de placer ou de maintenir en détention provisoire devrait être motivée. Supprimons de la même manière le référé-détention, qui permet au parquet de suspendre la mise en liberté. Rétablissons l'interdiction d'utiliser la notion de trouble à l'ordre public pour des délits punis de peines inférieures à dix ans. Mais avant tout, nous devons renforcer les moyens de l'ensemble de la chaîne pénale. Nous devons rationaliser la carte judiciaire. Pour avoir mené la première réforme de la carte judiciaire depuis deux cents ans - réforme bien modeste, celle des tribunaux de commerce -, je pense qu'il est temps d'aller plus loin, en créant au niveau départemental des pôles de juges d'instruction spécialisés, et d'en rationaliser l'organisation. À partir de ce moment, nous aurons convaincu nos concitoyens de l'absence de gaspillage, et nous pourrons augmenter les moyens des policiers, des magistrats, des avocats commis d'office, des prisons - il est en effet scandaleux que ceux qui n'ont pas encore été jugés soient détenus dans les conditions les plus inhumaines dans les maisons d'arrêt. Je note cependant que dans cette affaire, seule l'administration pénitentiaire a échappé aux critiques des innocents. Je terminerai par le problème de la responsabilité. Dès lors que l'on donne les moyens suffisants, tous les acteurs doivent être responsables. Donnons à tous les magistrats, y compris ceux du parquet, une réelle indépendance, et créons une commission des réclamations au sein du CSM - avec toutefois un filtre. Je suis d'ailleurs très heureuse que M. Pascal Clément se soit rallié à cette idée. Nous avons besoin de cohérence, et j'espère que nous parviendrons à un consensus. Je ferai tout mon possible pour y parvenir. En tout cas, l'ensemble des responsables politiques, et pas seulement le garde des Sceaux, devront s'engager à mener à bien cette réforme. M. Gilles COCQUEMPOT : Je joins ma voix à celles de mes collègues pour souligner la remarquable qualité des administrateurs qui ont préparé et accompagné les travaux de notre commission d'enquête. À mesure que les auditions se sont succédé, j'ai pris conscience de ce que la justice pouvait avoir de dur et même de brutal. Si nous parvenons maintenant à rédiger un rapport reprenant les propositions formulées par MM. Canivet et Nadal tout en tenant compte de l'excellente plaidoirie de notre collègue Georges Fenech et des déclinaisons qu'elle a suscitées ici même, le texte sera suffisamment complet pour réunir un consensus. Il le faut, car ce n'est pas une réformette qui serait le prélude à une grande réforme que veulent nos concitoyens et, si nous décevons leurs attentes, ils nous le feront savoir. Pour moi, les priorités permanentes de l'État doivent être la santé, l'éducation et la recherche, et la justice. Il est donc de notre devoir de donner à la justice les moyens de fonctionner. D'autre part, l'échevinage, qui me tient particulièrement à cœur, devrait être de règle aussi bien dans les tribunaux correctionnels que dans les cours d'appel. Ainsi n'aurait-on plus l'impression que « les carottes sont parfois cuites » avant même le procès, le justiciable étant en quelque sorte « pré-jugé ». Enfin, je ne suis pas entièrement d'accord avec l'idée selon laquelle un avocat ne pourrait pas remplir son rôle parce qu'il est jeune et commis d'office. Me Caroline Matrat nous a d'ailleurs montré qu'un jeune avocat commis d'office sait se battre. Je serais donc favorable à la constitution, autour de chaque bâtonnier, d'un pool de jeunes avocats appelés à être commis d'office pendant trois ans. Après quoi, ils pourraient intégrer un cabinet. Actuellement, ce sont bien souvent des avocats stagiaires que les cabinets désignent pour cette tâche lorsqu'un juge les requiert, ou des conseils qui, on l'a vu, n'assistent pas l'accusé qu'ils sont pourtant chargés de défendre. Créer des pools d'avocats appelés à être commis d'office, à temps plein, pendant une durée donnée, n'aurait pas pour effet de fonctionnariser les jeunes avocats considérés mais bien plutôt de contribuer à leur formation. M. Léonce DEPREZ : Tout ce qui a été dit aujourd'hui appelle un très grand effort de réflexion. Aussi, comme ils ont déjà été abondamment félicités, c'est maintenant d'encouragements que notre président et notre rapporteur ont le plus grand besoin. Je les encourage donc, en notant que beaucoup des propositions qui ont été faites convergent - et Jean Moulin ne disait-il pas, avec justesse, que « l'essentiel, c'est ce qui nous rapproche » ? Notre commission s'honorera de préserver l'esprit qui nous a rassemblés tout au long de nos travaux en présentant, sans attendre la campagne pour l'élection présidentielle, des propositions de réforme dès 2006, car l'opinion publique souhaite qu'elle dépasse les clivages partisans. Pour que la justice mérite son nom, il vous revient de déterminer ce qui peut être proposé aux Français sans les faire attendre. J'insisterai sur un sujet brûlant, et pourtant bien peu évoqué : la cause première du drame d'Outreau, c'est la pauvreté économique, la tragédie du chômage qui engendre l'oisiveté et la dégradation des comportements car les énergies ne sont pas mobilisées par le travail. Quelles que soient nos convictions politiques, nous devons nous rassembler pour vaincre la pauvreté économique, sans attendre les échéances politiques. Par ailleurs, les parlementaires doivent comprendre que, depuis plus de vingt ans, la justice n'a pas la part du budget national qui devrait lui revenir, si bien qu'elle ne dispose ni des effectifs ni des moyens techniques qui permettraient la bonne application des textes. J'assiste chaque année à la cérémonie qui marque la rentrée solennelle du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, et tous les ans, depuis dix ou quinze ans, son président tient devant moi le même langage, qui me fait honte, car il explique que les moyens qui lui sont alloués ne sont pas suffisants. C'est ainsi que s'expliquent l'inefficacité du recueil de la parole des enfants dont il a été si souvent question et l'impossibilité d'enregistrer leurs auditions. Pour qu'une bonne justice puisse s'exercer, il faudra décider de lui en donner les moyens. Il nous faudra aussi exiger le respect des personnes à toutes les étapes de la procédure pénale. J'ai été frappé de constater à quel point le principe de la présomption d'innocence n'est pas appliqué, non plus que celui du contradictoire. Le rapport devra mettre en exergue le rappel de ces principes fondamentaux. Enfin, la justice, qui souffre d'un enfermement sur elle-même, doit s'ouvrir. Il faut en finir, aussi, avec une compartimentation telle qu'elle interdit la coopération et même la communication. Dans l'affaire qui nous occupe, le dialogue et l'esprit d'équipe ont largement fait défaut. Nous vous faisons donc confiance, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président, pour les intégrer dans vos propositions. M. le Président : Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez, mais je vous rappelle que cette séance publique, décidée sur proposition de Mme Elisabeth Guigou, ne marque pas la fin de notre travail collectif. Nous allons continuer de travailler aux propositions que nous sommes chargés de formuler. CONTRIBUTIONS DES GROUPES ET DES MEMBRES ___________________ CONTRIBUTION DES MEMBRES DU GROUPE UMP 595 ___________________ Nos concitoyens oscillent en permanence entre deux exigences : un besoin de sécurité et une aspiration à des garanties respectueuses des libertés. L'opinion publique est entretenue dans l'idée d'un débat simple et binaire où la sécurité ne pourrait être assurée qu'au détriment des libertés. Dans l'affaire d'Outreau, l'exercice entravé des droits de la défense, le recours systématique à la détention provisoire, le refus régulier des demandes de mise en liberté par le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction, l'implication très inégale du barreau pour assister les mis en examen ont mis en lumière des dysfonctionnements de l'institution judiciaire portant atteinte in fine à l'exercice des libertés individuelles, qui constituent le fondement même de notre démocratie. Parce que l'équité, le contradictoire et l'équilibre des droits des parties doivent en toute hypothèse être garantis, la commission d'enquête a fondé sa réflexion sur ces principes directeurs consacrés par l'article préliminaire du code de procédure pénale. Ils ont inspiré les propositions des membres UMP de la commission. Participe en effet de cette démarche la réforme de la garde à vue qui vise à rendre obligatoire tant l'enregistrement que l'accès par l'avocat au dossier, dès lors que la garde à vue est prolongée. S'inscrit également dans cette perspective la recommandation tendant à instaurer des durées butoirs pour la détention provisoire sans renouvellement possible ; celles-ci seraient fixées à un an en matière correctionnelle et à deux ans en matière criminelle avant l'audience de jugement. Les députés UMP, membres de la commission, adhèrent aussi à la suppression du recours à la notion de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle et à son encadrement en matière criminelle. Constatant que les fonctions de l'instruction ne peuvent plus être assumées par un seul juge isolé, considérant que le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est le plus souvent qu'un trompe l'œil avalisant dans plus de 90 % des cas les positions du juge d'instruction et du parquet, ayant relevé qu'aucun professionnel de la justice auditionné n'avait au demeurant revendiqué le maintien du JLD, les députés UMP ont proposé de supprimer le juge d'instruction seul et le JLD. Ils plaident pour la constitution de pôles de l'instruction pour 500 000 habitants, composés de collèges de trois magistrats avec une expérience et une ancienneté différentes. Ce collège aurait la charge d'instruire et de placer le cas échéant en détention. Afin de faire échec à des décisions unilatérales, secrètes et hors de la présence de défense, les décisions du collège et de la chambre de l'instruction seraient désormais régulières, publiques et contradictoires. Les députés UMP se félicitent ainsi, par exemple, que trois mois après une détention, la situation d'une personne placée en détention provisoire soit examinée systématiquement par le collège en présence du parquet, du mis en examen et de son avocat qui pourrait solliciter une audience publique. Les députés UMP font leur la proposition consistant à garantir à la personne mise en examen le droit d'accéder à son dossier. Les leçons de la mauvaise qualité des expertises dans l'affaire d'Outreau justifient désormais l'élaboration de missions types pour les expertises psychologiques et psychiatriques. L'élargissement des possibilités de saisine du juge des enfants et la dévolution au Défenseur des enfants du suivi des enfants des personnes placées en détention provisoire constituent des avancées notables en faveur de la protection des intérêts des enfants. L'attribution d'un caractère obligatoire à l'enquête sur les circonstances des révélations du mineur, l'enregistrement systématique de l'audition de l'enfant sans son consentement dans un local dédié sont à mettre à l'actif des travaux de la commission. Parallèlement les députés UMP souscrivent aux propositions destinées à repenser la carrière des magistrats et à développer une culture de contrôle interne et externe au sein de la magistrature. À cet effet, ils militent pour que le Médiateur de la République puisse être saisi par tout justiciable d'une requête contestant le fonctionnement du service de la justice, toute juridiction ayant condamné définitivement l'État pour dysfonctionnement de la justice étant habilitée par ailleurs à saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Le souci de mettre fin au corporatisme dont souffre cette dernière institution explique que les députés UMP soutiennent également la recommandation tendant à établir dans sa composition une parité entre magistrats et non magistrats et préconisent l'élection directe des membres du collège « magistrats ». Enfin parce que le rôle des médias dans l'affaire d'Outreau ne saurait être occulté, les députés UMP plaident pour une amélioration du régime du droit de réponse dans l'audiovisuel et l'élaboration par les professionnels d'un code de déontologie applicable à la presse écrite et audiovisuelle. Cette réforme engendrerait incontestablement des dépenses qu'il conviendra d'assumer en faisant passer la part du budget de la justice à 3 % du budget de l'État. À court terme, en revanche, la mise en place des collèges de l'instruction et de chambres de l'instruction dédiées revêt un coût raisonnable. De par leur ampleur et de leur volonté de remédier à des défaillances qui se sont produites tout au long de la chaîne judiciaire, ces recommandations sont ambitieuses et cohérentes. Elles correspondent à notre culture judiciaire et à la nécessité de garantir à tous les justiciables l'égalité devant la justice. Parce qu'elles répondent au souci de construire une justice plus humaine, plus efficace et plus responsable, ces propositions ont été approuvées par les membres UMP de la commission d'enquête. CONTRIBUTION DES MEMBRES ___________________ Les commissaires socialistes sont conscients de l'importance de l'attente de l'ensemble de nos concitoyens qui ont suivi avec la plus grande attention les travaux de la commission. Les Françaises et les Français ont découvert l'importance et la qualité que peut revêtir le travail parlementaire sur le fonctionnement d'une des institutions majeures de la République : la Justice. Ils ont constaté que les lois ne suffisent pas pour rendre une bonne justice et qu'une addition de dysfonctionnements, d'absence de contrôles hiérarchiques, d'insuffisances professionnelles peut mettre gravement et durablement en danger les libertés individuelles de ceux qui résident dans notre pays. Ils attendent des propositions concrètes les mettant à l'abri d'interprétations douteuses de la loi, de dérèglements des procédures, de méthodes judiciaires et policières d'un autre âge. Les commissaires socialistes, particulièrement soucieux de répondre aux attentes des Français, ont apporté leurs contributions à l'élaboration des propositions que contient le rapport afin que le législateur les prenne en compte dans des nouvelles lois pénales et de procédure pénale. Toutefois, ils précisent leur volonté de réforme par des options qui ont été reprises et présentées, mais ils ajoutent qu'ils ne peuvent donner leur aval à certains choix et en préconisent d'autres, à savoir : 1. En ce qui concerne la détention provisoire, la durée ne saurait excéder 6 mois en matière délictuelle et un an en matière criminelle. 2. Sur le secret de l'instruction, ils préconisent sa suppression et le renforcement de la présomption d'innocence par une pénalisation de sa violation. Le parquet en présence de toutes les parties ouvrira des fenêtres d'information sur les affaires judiciaires qui auront troublé l'opinion publique. 3. Dans le rapport, c'est une conception de la justice qui s'exprime et qui ne peut être totalement la nôtre. Par exemple, un parquet subordonné au pouvoir et un Conseil supérieur de la magistrature manquant d'indépendance. Ainsi, les lois Perben ont transféré du juge d'instruction au parquet plusieurs pouvoirs d'enquête (perquisition, écoutes téléphoniques, saisies). Le Conseil constitutionnel a jugé ces mesures constitutionnelles en considérant que le juge de la liberté et de la détention les contrôlait. 4. Pour cette première raison, le juge des libertés et de la détention est absolument nécessaire, et doit être renforcé sous une forme collégiale par des audiences publiques et doit être dédié exclusivement à cette fonction. Le maintien d'un double regard en matière de détention provisoire nécessite donc de renforcer la fonction du juge des libertés et de la détention et de créer un tribunal de la détention provisoire qui tienne des audiences publiques et qui soit distinct du pôle de l'instruction. Ce double regard est important tant que le juge d'instruction existe, y compris sous une forme collégiale. C'est lui qui dirige la procédure, et qui cherche les preuves ; c'est lui qui agit, c'est lui clôture, c'est lui qui renvoie, c'est lui qui demande la détention provisoire. Il faut donc un contre-pouvoir à ce pouvoir et le double regard est, de surcroît, un principe qui s'impose aujourd'hui dans le droit européen et international. 5. L'indépendance des magistrats est liée à leur responsabilité : les membres du parquet doivent être nommés comme les magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui rend nécessaire la non-parité du Conseil supérieur de la magistrature, les non-magistrats devant y être majoritaires. 6. La cohérence politique nous oblige à envisager la suppression de toutes les remises en cause de la loi du 15 juin 2000 par les lois de 2002 et 2004. 7. Les moyens doivent être donnés à la justice pour permettre à la France d'accéder au premier rang européen dans tous les domaines du fonctionnement de la justice, y compris pour l'aide juridictionnelle. Pour cela, une étude d'impact budgétaire de toutes les mesures préconisées est un préalable incontournable sur le budget de la justice et le budget de l'intérieur. En conclusion, nous constatons que le travail de la commission doit être porteur d'une ambition législative d'une grande ampleur pour les enjeux évoqués à l'occasion de l'affaire d'Outreau qui concentrent aujourd'hui le mécontentement et la suspicion de nos concitoyens à l'égard de notre justice. CONTRIBUTION DE MME ÉLISABETH GUIGOU, ___________________ J'aurais souhaité plusieurs amendements au texte du rapport pour que celui-ci reflète plus objectivement la diversité des auditions et des positions prises par les commissaires. Le rapporteur n'a pas souhaité intégrer ces amendements dans son rapport, dont la rédaction relève de sa responsabilité. Je présente donc mes demandes d'amendements sous forme de contribution personnelle. Celle-ci s'ajoute à la contribution des commissaires socialistes à laquelle je souscris, bien sûr, totalement. 1) sur le JLD - Dans le chapitre V : ajouter, au paragraphe B intitulé « devant le Juge des Libertés et de la Détention » la phrase suivante : « Les dysfonctionnements observés lors de l'affaire d'Outreau ne se répètent pas, heureusement, dans toutes les juridictions. Dans de nombreux tribunaux, la fonction de JLD est organisée et correctement exercée. Les dysfonctionnements observés dans l'affaire d'Outreau ne doivent pas aboutir à une condamnation de la fonction de JLD mais au contraire au renforcement de celle-ci. » - Dans le chapitre VI-A, paragraphe 2 intitulé « les dérives d'une pratique générale », ajouter à la fin du premier tiret concernant la part des personnes placées en détention provisoire: « la détention provisoire a baissé de façon spectaculaire comme le montrent les tableaux insérés dans ce paragraphe, le nombre de détentions provisoires est passé de 25 800 en 1997 à 16 800 en 2001, soit 9 000 détenus provisoires de moins. » - Dans le chapitre VI-B, dans le paragraphe b, au troisième paragraphe il faut ajouter une phrase disant que la loi du 15 juin 2000 a bien réalisé son objectif puisque le nombre de détentions provisoires a fortement baissé pendant les débats parlementaires et après le vote de la loi, et ce jusqu'en 2002 comme le montre le tableau inséré dans le paragraphe précédent. - Dans le paragraphe 2 intitulé « Un juge qui n'est pas en mesure de maîtriser le dossier ». Ajouter après ce titre une phrase : « Certains JLD maîtrisent très bien leurs fonctions et leurs dossiers. » Supprimer la phrase suivante sous le paragraphe a : « le tableau dressé par le rapport Viout sur le JLD est sans appel ». Cette phrase laisse penser que le rapport Viout critique l'institution du JLD alors que c'est l'utilisation qui en est faite, notamment depuis la loi du 9 mars 2004, qui est critiquée par le rapport. - Dans le chapitre IV, A, 2, cinquième paragraphe, supprimer la phrase : « Or s'il est une fonction qui a fait l'objet de critiques quasi-unanimes devant la commission, c'est bien celle de JLD ». Les auditions ont montré que certains JLD exerçaient leurs fonctions de manière très satisfaisantes et que de nombreux responsables, y compris le Garde des Sceaux et plusieurs hauts magistrats souhaitaient le maintien de cette fonction. - Dans le chapitre IV, B, deuxième paragraphe : supprimer la phrase « la création du JLD n'a d'ailleurs pas contribué à la limitation du recours à la détention provisoire, alors même que c'était l'un des objectifs ayant présidé à son introduction. » - Dans le chapitre IV, C intitulé « Faut-il maintenir le JLD ? », supprimer la première phrase : « l'affaire d'Outreau, en particulier, et la pratique judiciaire en général, ont fait litière des vertus supposées du double regard imposé par la loi du 15 juin 2000 » 2) Sur les modifications par les lois de septembre 2002 et de mars 2004 de la loi du 15 juin 2000 - Dans le chapitre VI, B, 1, paragraphe a) avant le paragraphe sur le Conseil Constitutionnel, qui fait référence à la loi du 9 mars 2004, indiquer que les lois de septembre 2002 et de mars 2004 ont modifié la loi du 15 juin 2000, restreint les prérogatives du JLD, et n'ont pu imposer que cette fonction soit exercée par le président ou un vice-président du tribunal. - Dans le chapitre V, A, 2, paragraphe b), « les effets de la réforme de la carte judiciaire », cinquième paragraphe : remplacer la phrase « seuls quelques tribunaux de commerce ont été supprimés, et cela non sans mal », par la phrase suivante : « au premier janvier 2000, 36 tribunaux de commerce ont été supprimés ce qui était la première réforme de la carte judiciaire depuis 200 ans. » Dans un souci d'équilibre, citer les noms des 36 tribunaux de commerce supprimés sous la précédente législature comme on cite ceux des 7 juridictions consulaires supprimées en 2005. CONTRIBUTION DU GROUPE DES DÉPUTÉ-E-S ________________ Présentée par M. Patrick BRAOUEZEC, membre de la commission d'enquête parlementaire chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la Justice dans l'affaire dite d'Outreau, au nom du groupe communiste et républicain. Le rapport présenté par la commission parlementaire à propos de l'affaire dite d'Outreau répond, pour partie, aux demandes, exprimées par les personnes concernées et auditionnées, visant à mettre fin à certains dysfonctionnements de notre institution judiciaire révélés par cette affaire. Néanmoins, si ce rapport marque certaines avancées, il n'en demeure pas moins que pour le groupe communiste et républicain, il demeure en deçà de ce que devraient être de véritables transformations. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste et républicain soumet à la commission les propositions suivantes. I. (*) Réformer le régime de garde à vue · Présence de l'avocat, dès la première heure de la procédure (auditions, confrontations, présentations à témoins et toute autre investigation). · Garantir le droit d'accès au dossier de la procédure pour l'avocat du gardé à vue. · Limitation de la durée de la garde à vue à 24 heures, renouvelable une fois pour les infractions les plus graves. III- Limiter la détention provisoire B) Réformer la détention provisoire · La mise en détention provisoire ne doit être demandée que dans les cas d'atteinte aux personnes, et non plus dans les cas d'atteinte aux biens. ___evenir à la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin 2000, pour les durées maximales de détention provisoire et les conditions liées aux peines encourues (les lois Perben I et II sont ici directement visées : elles renforcent les possibilités de placement et de maintien en détention : cf. articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale sur la possibilité de proroger la détention provisoire ; article 181 sur la possibilité de prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an, dans l'attente de l'audiencement de la cour d'assises ; article 148-1-1 sur la procédure du référé détention ; article137-4 qui prévoit la possibilité pour le parquet de saisir directement le JLD ; possibilité de placer en détention provisoire en matière délictuelle un mineur de 13 à 16 ans en cas de non-respect d'un placement en centre éducatif fermé). · Supprimer le critère de trouble à l'ordre public qui permet de justifier le placement en détention provisoire. La proposition de la commission de limiter le recours à ce critère n'est pas suffisante. V- Créer la collégialité de l'Instruction A) Organiser la collégialité La carte judiciaire est un des préalables à l'organisation de la collégialité. · Refonte donnant priorité à l'intérêt général et dépassant les résistances particulières : pour cela, penser la réforme non simplement sous un angle géographique mais en fonction des contentieux. · Plus grande proximité de la justice à atteindre en rapprochant des justiciables certains contentieux (famille, instance...), et plus grande efficacité en regroupant d'autres contentieux (grande criminalité par exemple). · Nécessité pour le judiciaire d'investir pleinement les maisons de la justice et du droit. Elles ont un rôle important à jouer dans le maillage social. B) Définir les conditions de la collégialité 2-b Réexamen automatique par le collège de la situation des prévenus incarcérés · Instauration d'une audience publique dont l'objectif serait un examen approfondi du dossier d'instruction et de ses perspectives. Elle devra être systématique à partir du 6e mois à compter du jour de la première mise en détention (renouvelable tous les 6 mois tant que le mis en examen demeure placé sous mandat de dépôt). Cette audience aurait pour objet d'examiner contradictoirement l'état d'avancement et les perspectives de l'information. En outre, les parties pourraient y demander tous les actes leur paraissant concourir à la manifestation de la vérité, même ceux qui auraient fait l'objet d'une décision de non admission du président de la chambre de l'instruction. IX. Mieux protéger les intérêts de l'enfant La protection de l'enfance en danger s'inscrit nécessairement sur le long terme en dehors de la logique pénale. La mission protectrice du juge des enfants ne saurait être invalidée par l'issue d'un procès pénal, quelle qu'elle soit. Il conviendrait également de garantir une formation spécifique pour les magistrats spécialisés que sont les juges des enfants. XI. Repenser la gestion des carrières des magistrats A) Favoriser des formations communes avec des avocats · Ouverture des auditeurs ou des magistrats en formation continue, aux disciplines relevant des sciences sociales et humaines. · Désignation de chargés de formation, autres que les magistrats. · Allongement de la durée des stages rendue obligatoire pour les auditeurs de justice auprès d'avocats ainsi que d'autres auxiliaires de justice. · Nomination du directeur de l'ENM subordonnée à l'avis conforme du CSM. D) Favoriser l'émergence d'une magistrature plus ouverte sur l'extérieur 1- Développer le recrutement sur titre, à condition de garantir la transparence de ce recrutement. · Améliorer la diversité sociale et culturelle du corps de la magistrature en augmentant sensiblement le nombre de postes réservés aux deuxième et troisième concours (respectivement concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics contractuels ayant quatre années d'études et concours externe ouvert aux personnes avec huit années d'expérience professionnelle dans le secteur privé ou au sein des assemblées territoriales). · Modifier le caractère exclusivement juridique de l'examen en introduisant dans les épreuves du concours une épreuve de criminologie. 2- En ce qui concerne la mobilité · Séparer la fonction du grade afin de permettre aux magistrats de rester plusieurs années au même poste sans être pour autant pénalisés dans leur avancement, car la conjonction fonction/grade rend impossible une spécialisation : ce qui est incontestablement un manque à gagner pour l'efficacité et la bonne marche de la justice. XII. Responsabiliser les magistrats B) Mieux identifier les fautes 3- Contrôle externe · Confier au CSM rénové la gestion des services judiciaires et l'inspection des magistrats. Cette inspection pourrait être assurée par un service d'inspection créé auprès du CSM, mais dont le chef et les membres seraient choisis hors du CSM (par les membres du CSM). Ce service serait chargé d'examiner les plaintes des justiciables mettant en cause la responsabilité d'un magistrat et de la saisine du CSM s'il estime, après avoir mené les investigations nécessaires, que les plaintes sont sérieuses. D) Rénover le CSM · Election directe des magistrats, au sein du CSM par leurs pairs : Propositions complémentaires : · Supprimer des membres du CSM, le président de la République et le garde des Sceaux. · Présidence tournante du CSM avec un président, identifié, élu pour 2 ans (président choisi alternativement parmi ses membres magistrats et ses membres non magistrats), de façon à garantir l'autonomie et la légitimité démocratique de cette institution. XIV. Rendre compte de la politique pénale devant le Parlement · Un rapport des procureurs généraux sur l'application de la politique d'action publique devra être présenté, chaque année, devant le Parlement afin qu'il puisse examiner la politique pénale menée par le Gouvernement. La démocratisation de la justice exige que les citoyens, par l'intermédiaire de la représentation nationale, aient connaissance de cette politique pénale. Propositions complémentaires absentes du rapport présenté par la commission 1- En ce qui concerne le parquet · Nécessité d'une plus grande indépendance du parquet, puisque d'ores et déjà il supervise une grande majorité des enquêtes pénales, contrôle l'enquête, fait le choix de la procédure et exerce des pouvoirs quasi-juridictionnels. Dans ce contexte, le parquet ne peut rester totalement soumis au pouvoir exécutif. · Garantir l'indépendance du statut personnel du parquetier. · Distinguer son statut fonctionnel et son statut personnel, ce qui garantirait l'équilibre nécessaire entre une politique pénale unitaire sur l'ensemble du territoire et une indépendance permettant aux magistrats du parquet de résister aux pressions du pouvoir exécutif. Son statut fonctionnel le lierait directement au pouvoir exécutif pour la politique pénale et ses missions d'administration. Son statut personnel, calqué sur le statut des magistrats du siège et lié au CSM, lui assurerait une indépendance loin de toute contingence politique. · Nomination des magistrats du parquet avec avis conforme du CSM. · Supprimer toute possibilité d'instructions particulières du garde des Sceaux. Les consignes particulières données par le ministre dans le cadre d'affaires spécifiques ne relèvent pas, en effet, d'une politique pénale légitime. Elles s'apparentent, au contraire, à des pressions exercées sur l'autorité judiciaire. 2- L'aide juridictionnelle Pour garantir une égalité entre les justiciables, il est nécessaire de réformer l'aide juridictionnelle. Une défense de qualité ne peut être le privilège de quelques-uns. D'ores et déjà, nous observons des inégalités entre les accusés en fonction de leur situation financière et sociale. · Abaisser significativement le seuil d'admission au bénéfice de cette aide et accroître la rémunération par l'État des avocats des clients bénéficiant de l'aide juridictionnelle. · Créer des services d'avocats de défense sociale, dont la rémunération serait garantie par l'État. · Retenir la proposition de Maître Soulez-Larivière concernant la création d'une sorte d'internat du barreau où les jeunes avocats, motivés par la défense pénale, seraient payés à plein temps pour leur travail (comme les magistrats, avec le même budget que les magistrats de même âge et d'ancienneté). 3- Saisine constitutionnelle Une réforme de fond de la justice ne peut s'imaginer sans une réforme du mode de saisine du Conseil constitutionnel. En effet, le droit de saisine du Conseil constitutionnel reste trop restreint et ne peut être exercé qu'à priori, c'est-à-dire avant la promulgation d'une loi ou la ratification d'un traité. Les citoyens ne peuvent donc pas demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays. · La saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens doit devenir possible à l'occasion des litiges qui les concernent. Le Conseil Constitutionnel deviendrait alors une Cour constitutionnelle. · Une position de repli constituant néanmoins un pas en avant considérable, serait de rendre possible la saisine du Conseil par les tribunaux (judiciaires ou administratifs). Il s'agirait donc d'une saisine indirecte des citoyens par l'intermédiaire des juges. 4- Police judiciaire Il est paradoxal que les officiers de police judiciaire, dont dépend la qualité de l'enquête pénale, soient sous la seule tutelle du ministère de l'Intérieur ou de la Défense. Celle-ci pèse lourdement sur l'indépendance et les marges d'action de ces officiers. · Permettre à l'autorité judiciaire d'exercer une direction et un contrôle effectifs sur la police judiciaire. · Rattacher les officiers de police judiciaire aux juridictions. · Renforcer un contrôle indépendant pour une plus grande démocratisation, ce qui pourrait être assuré par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante (chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République). Cependant, il faut que lui soient donnés les moyens d'exercice de sa mission. · Nomination de son président par décret du Président de la République et choisi parmi des personnalités ayant autorité morale. CONTRIBUTION DE M. LÉONCE DEPREZ, _______________ J'avais indiqué que je ferais part de ma réflexion pour le secret de l'instruction. Voici la conclusion. J'approuve la proposition du Président de ne pas vouloir rétablir l'exigence d'un secret de l'instruction qui n'existe plus dans la réalité de la vie que nous connaissons depuis plusieurs années. En effet, il y a aujourd'hui trop de possibilités de faculté d'expression de certains de ceux qui ont accès au dossier et aussi de possibilités de fuites. En conséquence, il est préférable de permettre de diffuser une information fiable à travers les fenêtres d'information périodique permettant à un magistrat chargé de la communication, chargé du futur collège d'instruction que nous proposons, de faire un point objectif sur les éléments recueillis et sur l'avancement de l'enquête. Cette information sera certainement préférable aux extrapolations approximatives que nous constatons aujourd'hui à partir d'éléments épars et non identifiés. Mais il nous faut proposer aussi de cesser d'invoquer un secret fictif et d'affirmer d'autant plus fort que la liberté d'information ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence, celle-ci devant garder toute sa force tant que le procès n'est pas achevé. Je demande de faire part de cette proposition que je suis prêt à défendre sur ces bases en espérant qu'elle contribuera à votre rédaction finale des propositions de notre commission d'enquête. Supprimer purement et simplement le secret de l'instruction en sauvegardant réellement (et non « quand même ») la présomption d'innocence. Cette option repose sur le postulat qu'il n'y a plus de respect du secret de l'instruction depuis longtemps dans la presse écrite et audiovisuelle et que ce secret prive la presse des sources objectives d'information (les magistrats et les enquêteurs concourant à la procédure), situation qui est propice à la diffusion d'informations erronées dans des conditions préjudiciables à la personne poursuivie elle-même. La difficulté provient de ce que le fait de rendre publique la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction risque de remettre obligatoirement en cause la présomption d'innocence, les deux étant intrinsèquement liés dans leur fondement et dans leur application. Ne s'agit-il pas d'un « bricolage » législatif ? Afin de sauvegarder efficacement la présomption d'innocence en supprimant le secret de l'instruction, il faudrait nécessairement étendre les conditions d'application de l'article 9-1 du Code civil sur le droit à la présomption d'innocence (créé par la loi du 15 juin 2000) selon lequel : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification d'innocence ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. » En l'état actuel, c'est à la victime d'initier cette action, ce qui est la plupart du temps dissuasif pour la mise en cause. Il me semble d'ailleurs que cet article n'est à ce jour quasiment pas appliqué. Il devrait donc impérativement être prévu, à l'instar de la procédure instaurée à l'article 442-6-III du Code de commerce596 en matière de pratiques restrictives de concurrence, d'étendre cette action non seulement aux parties mises en cause mais aussi au Ministère public, au Juge d'instruction, aux associations de défense, etc., ainsi que la possibilité pour le Juge de prononcer une amende civile dissuasive contre les contrevenants597. * * * CONTRIBUTION DE M. GEORGES FENECH, DÉPUTÉ DU RHÔNE, _____________ POUR L'INSTITUTION D'UN JUGE DE L'INSTRUCTION Un certain nombre de propositions adoptées, avec un large consensus, par la commission d'enquête vont incontestablement améliorer le déroulement de la phase préparatoire au procès qu'il s'agisse de la garde à vue, de la détention provisoire, de l'expertise ou du recueil de la parole de l'enfant. Elles constituent des avancées notables tant en ce qui concerne le respect de la présomption d'innocence et l'exercice réel des droits de la défense que de la responsabilisation des différents acteurs du procès. Toutefois, en renonçant à s'attaquer aux racines de l'affaire d'Outreau, la commission passe à côté d'une chance historique de faire bénéficier la France, à la suite de ses grands voisins européens, d'une procédure fondée sur l'échange contradictoire des preuves, sous le contrôle d'un juge ayant le rôle d'arbitre indépendant, seule à même de garantir pleinement l'impartialité, l'équité et l'efficacité des enquêtes pénales. Notre système inquisitoire date d'un autre temps Quels que soient les mécanismes institués par des lois successives pour améliorer les droits de la défense, la phase préparatoire au procès pénal conserve sa logique inquisitoriale, inscrite dès 1810 dans le code d'instruction criminelle, fondée sur l'institution d'un juge-enquêteur qui, tout à la fois, recherche les preuves des infractions et se prononce ensuite, comme juge, sur leur valeur ainsi que sur la pertinence des critiques présentées par la défense à l'encontre de son travail d'investigation. Dans ce système vieillissant, le juge d'instruction ne peut être ni un véritable enquêteur, ni un véritable juge. En premier lieu, il ne peut être un véritable enquêteur car ce qui était concevable en 1810 ne l'est plus aujourd'hui. Les affaires qui sont confiées aux juges d'instruction sont les plus complexes. Elles requièrent des moyens humains et techniques importants et une science de l'enquête qui ne s'apprend pas à l'École nationale de la magistrature. La réussite des investigations dépend avant tout de l'organisation des unités de police judiciaire et des qualités du directeur d'enquête. Certes, le juge d'instruction délègue à la police judiciaire, par commission rogatoire, la quasi-totalité des actes d'enquête. Mais le ou les services de police judiciaire saisis sont dans une nette position d'infériorité par rapport au « super-enquêteur » qu'est le juge d'instruction puisque celui-ci est seul autorisé à interroger les personnes mises en examen, à pouvoir organiser les confrontations et seul également à bénéficier d'une vision d'ensemble du dossier. De son côté, le juge d'instruction qui, pour l'essentiel, conduit les investigations depuis son cabinet, est privé de tout ce que peut apporter l'enquête sur le terrain alors que le contact direct avec la matière vivante du dossier peut donner des informations particulièrement éclairantes. C'est ainsi que dans l'affaire d'Outreau, l'officier de police directeur d'enquête avait émis de sérieuses réserves sur les accusations portées contre ceux qui devaient ultérieurement être acquittés. Il n'a pas été écouté avec les conséquences que l'on connaît. L'intervention d'un juge d'instruction se justifie d'autant moins que - la plupart des observateurs en conviennent, y compris parmi les magistrats - la plus-value apportée par le travail personnel du juge d'instruction est quasi inexistante. Même le travail de synthèse est réalisé par le parquet dans son réquisitoire définitif, généralement repris par copié-collé dans l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur. Par contre, la moins-value est considérable en termes d'allongement des délais. C'est essentiellement durant l'instruction préparatoire que se creusent les délais de procédure qui font qu'en 2003, 2004 et 2005 la France a été le pays d'Europe le plus souvent condamné par la Cour européenne des droits de l'Homme pour non respect du délai raisonnable. Il convient d'ajouter que les dossiers d'instruction présentent de plus en plus fréquemment de graves lacunes. Le président d'une cour d'assises proche de Paris faisait récemment observer que, dans près de la moitié des dossiers d'instruction, il était contraint de procéder en urgence à un supplément d'information avant le passage aux assises. Il notait également que, devant sa cour, le nombre des acquittements avait doublé entre 2001 et 2004. En second lieu, le juge d'instruction n'est pas un véritable juge car il lui manque une qualité fondamentale, l'impartialité. Impliqué dans la recherche des preuves, il ne jouit plus de la distance indispensable à celui qui exerce des fonctions juridictionnelles. À cet égard, les auditions devant la commission d'enquête ont montré qu'une confusion s'est installée chez les défenseurs du juge d'instruction. Pour beaucoup, le statut du juge d'instruction, c'est à dire sa formation par l'École nationale de la magistrature, son évolution de carrière garantie par des instances exclusivement ou majoritairement composées de magistrats, les protections particulières dont il bénéficie à l'égard du pouvoir exécutif, représenterait la première garantie d'une justice bien rendue. En réalité, l'indépendance à l'égard des pouvoirs et l'impartialité dans la procédure sont deux choses différentes. Même si les juges d'instruction ont, sans nul doute, le sentiment d'exercer loyalement leur métier, ils ne sont pas placés dans la procédure de façon telle qu'ils puissent être considérés objectivement - au sens du droit européen - comme impartiaux. La meilleure garantie contre les erreurs d'appréciation telles que celles commises dans l'affaire d'Outreau est que la solidité des preuves soit éprouvée tout au long de la phase préparatoire au procès. Cela suppose le retour à l'essence du débat judiciaire, c'est à dire à l'expression libre, complète et forte de points de vue qui s'opposent, expression qui seule permet ensuite au juge, au terme d'une démarche dialectique, d'approcher, autant qu'il est possible, la vérité. Dans le cadre de cette démarche, l'avocat concourt, tout comme le juge, à la manifestation de la vérité. Cette conception du rôle de l'avocat est, précisément, loin d'être aujourd'hui partagée par tous les magistrats. Ajoutons que notre système inquisitoire génère une conception archaïque de la preuve pénale, tournée vers la recherche de l'aveu. L'affaire d'Outreau a confirmé que l'institution du juge des libertés et de la détention n'avait pas fait cesser l'usage de la détention provisoire comme moyen de pression pour obtenir des aveux. Dès lors que la détention provisoire sera, selon les propositions de la commission d'enquête, de nouveau confiée aux juges d'instruction, fussent-ils organisés en collégialité, comment ne pas deviner que de tels travers perdureront voire s'aggraveront ? La collégialité des juges d'instruction : une fausse solution, un vrai danger Force est de constater qu'en instituant un collège de juges d'instruction, les défauts majeurs du système français évoqués ci-dessus ne seront pas corrigés. Il doit, tout d'abord, être observé que ce n'est pas la quantité de juges qui permet de rendre un système plus performant. La question du travail en collégialité a été posée à l'un des acquittés d'Outreau qui a répondu avec bon sens que, s'il avait été en face de « deux juges Burgaud », sa situation n'aurait pas été réellement meilleure. De même, l'encadrement d'un jeune magistrat par un magistrat plus ancien n'est pas de nature à apporter une réelle garantie. D'une part, le passé a montré qu'un juge d'instruction ancien pouvait ne pas disposer des qualités nécessaires à sa fonction, d'autre part, compte tenu de la règle de la majorité dans une formation collégiale, le juge d'instruction expérimenté pourra être mis en minorité par ses deux collègues. En revanche, la collégialité de l'instruction montrera vite soit qu'elle institue une concertation de façade entre les magistrats chargés de l'instruction, soit qu'elle est susceptible de créer un nouveau contentieux, celui qui opposera les juges entre eux. À cet égard, la commission d'enquête a disposé d'un retour sur le travail en commun des juges d'instruction, à travers les premières expériences de co-saisine de deux ou trois juges d'instruction. Le rapport du groupe de travail dirigé par le procureur général Viout, chargé de tirer les enseignements de l'affaire d'Outreau après le premier procès de Saint-Omer, a relevé qu'en pratique, il était constaté que la co-saisine ne correspondait parfois « à aucune réalité concrète », le magistrat initialement saisi ne confiant que des tâches subalternes à celui ou ceux qui lui étaient adjoints. L'articulation prévue dans notre rapport final entre les fonctions du collège de l'instruction et celles confiées au magistrat instructeur délégué officialise cette pratique puisque, pour tous les actes courants et « les urgences », le juge délégué agira seul. Compte tenu des présentations en fin de journée ou le week-end ou encore pendant les périodes de congés, on peut concevoir que la réunion du collège sera assez souvent impossible, que des permanences devront être instituées et que le juge d'instruction délégué procédera seul, en urgence, à la mise en examen puis, le cas échéant, au placement en détention ou sous contrôle judiciaire des personnes présentées. Dans la suite de l'information, le juge d'instruction en charge du dossier exercera naturellement une influence déterminante sur ses collègues au moment de la prise de décision sur les mises en examen, la détention et l'ordonnance de règlement. Car comment imaginer que les juges d'instruction non délégués soient en mesure d'assimiler, en plus de leurs dossiers personnels, ceux de leurs deux collègues, sachant que certains dossiers comprennent plusieurs milliers de cotes ? En outre, les modalités de travail pourraient, en pratique, s'avérer complexes. Au moment du défèrement des personnes mises en cause, les trois juges d'instruction du collège devront successivement prendre connaissance du dossier et délibérer avant de notifier la mise en examen ou se prononcer sur la détention. Il est loisible d'imaginer les difficultés qui surgiront lorsque les deux autres magistrats formant le collège seront occupés à d'autres rendez-vous dans leur cabinet respectif. Par ailleurs, en instituant un contrôle des juges d'instruction par eux-mêmes, le système proposé par la commission est susceptible de produire des effets pervers. Quelle sera l'indépendance d'esprit des membres du collège à l'égard du juge d'instruction qui souhaite, par exemple, un placement en détention provisoire dans le dossier qui lui est délégué, sachant que les deux autres membres du collège pourront se trouver, le lendemain, dans la position inverse de demandeur d'une mesure ? Si, au contraire, chacun des magistrats entend exercer pleinement ses prérogatives, la question se posera vite de savoir qui dirige véritablement l'instruction, le juge délégué ou le collège des juges d'instruction. Lorsque deux magistrats refuseront les mesures souhaitées par leur collègue ou le dessaisiront d'un dossier, on imagine sans peine les conséquences qui en découleront dans les relations de travail des juges du même collège. L'expérience des co-saisines au sein du pôle financier de Paris montre que la mésentente des juges d'instruction peut avoir des conséquences sur le traitement des dossiers dont ils ont la charge. Faudra-t-il faire arbitrer ces conflits et soumettre à la chambre de l'instruction, comme le suggérait le rapport Viout, les conflits entre juges d'instruction ? En clair, il est prévisible que la création du collège de l'instruction conduira à un alourdissement de la procédure d'instruction et engendrera, dans certaines situations, des conflits entre juges nuisibles à la bonne marche de la justice. Est-ce raisonnable si l'on songe qu'en moyenne la durée des instructions a doublé en 25 ans pour s'établir en 2004, à 18,9 mois et que près de 5 ans s'écoulent entre un crime et son examen en premier ressort par une cour d'assises ? L'institution d'un juge de l'instruction ou le choix d'une clarification des rôles dans la mise en état des affaires pénales Nous suggérons, pour notre part, de supprimer le juge d'instruction et, non pas de copier un quelconque système étranger, mais de tirer des autres systèmes de droit des enseignements permettant de construire un dispositif spécifiquement français. Loin d'être révolutionnaire, la proposition que nous faisons tend à achever une évolution engagée par les magistrats eux-mêmes. Depuis 20 ans en effet, le nombre des ouvertures d'information n'a cessé de diminuer pour ne plus concerner aujourd'hui que 5 % des affaires donnant lieu à poursuites. Le législateur a accompagné cette évolution en augmentant progressivement les moyens d'action du parquet qui peut désormais faire procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à des actes qui autrefois exigeaient une ouverture d'information. La suppression du juge d'instruction aurait pour première conséquence de clarifier et valoriser le rôle des différents acteurs de la procédure pénale : - au parquet, doté d'un statut et d'une organisation rénovés, représentant, selon notre tradition, la société et non l'accusation, de diriger l'enquête, à charge et à décharge, dans le cadre de bureaux d'enquête déjà créés dans les juridictions les plus importantes ; - au juge de l'instruction (ou juge de l'enquête), soumis à appel devant la chambre de l'instruction : · d'autoriser ou refuser les actes portant atteinte aux libertés individuelles tels que la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, les perquisitions, les écoutes téléphoniques, etc., · de veiller à l'équité des investigations et d'imposer, le cas échéant, au parquet de diligenter les investigations proposées par la défense lorsque la demande lui paraît fondée et, si nécessaire, d'imposer des délais, · d'autoriser le parquet à renvoyer une personne devant la juridiction de jugement dans les termes d'un acte d'accusation rédigé par l'autorité de poursuite, le juge de l'instruction ne devant à aucun moment s'immiscer dans le travail d'enquête ou se départir de sa position d'arbitre ; - à l'avocat, dans le cadre d'une défense revalorisée, d'exercer pleinement ses droits devant un juge ayant précisément pour fonction assignée d'en faire assurer le respect. Dans le système que nous soutenons, le ministère public sera appelé à présenter publiquement ses demandes au juge de l'instruction, le secret ne pouvant être invoqué que lorsque les nécessités de l'enquête l'exigeront ou que la publicité sera de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. De manière générale, la transparence de l'action du parquet nous paraît être la meilleure garantie d'une justice indépendante et impartiale. Au contraire, au sein du collège de juges d'instruction, les magistrats continueront d'officier dans leur cabinet, à l'abri des regards, protecteurs d'un secret de l'instruction, dont on sait qu'il est parfois mis au service de stratégies étrangères à l'intérêt de la justice, à l'abri aussi de toute responsabilité personnelle puisque la responsabilité de chaque magistrat sera diluée dans l'anonymat d'une collégialité. * * * Plutôt que de s'ingénier à renforcer la logique d'un système dépassé et de créer de véritables bunkers de l'instruction, au prétexte de ne pas déchirer les forces du corporatisme ou de ne pas contrarier une prétendue « culture judiciaire » à la française, inscrite dans le marbre, mieux aurait valu remettre les acteurs judiciaires à leur place et, selon la formule d'un avocat des acquittés d'Outreau, « réécrire la partition judiciaire » avec cet objectif simple : aux enquêteurs d'enquêter, au parquet de diriger la police judiciaire et d'exercer les poursuites, au juge de juger. Pour n'avoir pas voulu sortir du mythe du juge d'instruction, le travail, pourtant sans précédent, de la commission d'enquête parlementaire ne refermera pas les blessures de l'affaire d'Outreau. CONTRIBUTION DE M. JEAN-PAUL GARRAUD, ________________ Sans remettre en cause mon accord de principe sur le projet de rapport de la commission d'enquête, je vous informe des réserves que je souhaite voir figurer sur deux points : 1) Je suis en total désaccord avec la proposition visant à séparer les fonctions du Parquet et du Siège à l'expiration d'un délai minimal de 10 ans à l'issue de la sortie de l'ENM. En effet, loin de constituer une cause de dysfonctionnement du corps judiciaire, je considère que la possibilité dans la carrière d'un magistrat de passer du Parquet au Siège ou inversement constitue une source réelle d'enrichissement pour l'intéressé et donc pour le corps auquel il appartient. La proposition que vous formulez, et qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les causes du fiasco judiciaire d'Outreau, m'apparaît pleine de dangers, à l'image des expériences menées dans un certain nombre de pays étrangers. En effet : · Cela conduit à terme à créer deux catégories de magistrats et à accentuer les clivages entre le Siège et le Parquet. · Cela conduit à terme à une « fonctionnarisation » du Parquet qui devient, de fait, une sorte de sous-catégorie de magistrats ; la matière noble, celle de juger, étant ainsi réservée au Siège. · Cela entraîne une spécialisation à outrance de l'accusation qui peut devenir une réelle cause de dysfonctionnement. C'est méconnaître le travail de parquetier que de croire que celui-ci ne recherche, quels que soient les cas, que poursuite et condamnation. J'ai connu bon nombre de magistrats du Ministère public qui, en proie au doute, osaient l'affirmer et demandaient à en tirer toutes les conséquences. Le fait d'avoir exercé des fonctions au Siège encourage d'ailleurs cette saine démarche. Le fait d'avoir suivi une formation commune aussi. Mettre en place des spécialistes de l'accusation alimentera des effets pervers, l'accusateur laissant au seul Juge le rôle de s'interroger sur la culpabilité. · Cela accentuera les difficultés déjà identifiées dans la gestion des ressources humaines du corps judiciaire. Cette séparation Parquet - Siège rendra plus difficile, car plus rigide, la gestion de la carrière du magistrat. · Et enfin, pourquoi interdire à des magistrats qui ont passé le même concours, qui ont suivi la même formation, qui ont bénéficié de stages de reconversion à chaque changement de fonction, d'aller à un moment donné de leur carrière vers le Parquet ou le Siège ? C'est au contraire la spécialisation qui peut induire un manque d'ouverture et donc de clairvoyance dans l'exercice du métier de magistrat. J'insiste donc sur la nécessité de retirer cette proposition qui ne présente aucun intérêt. De plus, rien n'empêche en l'état un magistrat d'accomplir tout ou partie de sa carrière au Siège ou au Parquet. Plutôt que d'interdire alors que cela présente des risques, laissons cette liberté de choix qui dénote de la part de celui qui l'exerce une réelle remise en cause tout à fait bénéfique pour le fonctionnement du système judiciaire. 2) Limiter la détention provisoire, (sauf en matière de criminalité organisée, de terrorisme ou en cas de récidive légale) à 2 ans en matière criminelle et à 1 an en matière correctionnelle constituera une totale impossibilité dans de nombreux cas et aboutira à des remises en liberté parfaitement choquantes. Intégrer dans cette durée les délais d'audiencement représente déjà une totale ineptie à budget constant. Même dans les cas où les faits seraient simples à instruire, ce qui n'est pas si fréquent en matière criminelle, les seules investigations concernant la personnalité, le curriculum vitae de l'accusé supposent des expertises, commissions rogatoires et vérifications diverses qui prennent nécessairement du temps. Serait-il sincèrement admissible qu'un assassin d'enfant soit remis en liberté quand son instruction n'a pu être clôturée dans des délais aussi courts ? Dans de tels cas, qui ne sont malheureusement pas si rares, instruire les faits, enquêter sur le mis en examen, son entourage, son passé, son état physique et mental mais aussi procéder à toutes les investigations concernant la victime afin que la Cour d'Assises soit totalement éclairée, est impossible en quelques mois. Ou alors il s'agira d'instructions bâclées génératrices de graves dysfonctionnements de l'appareil judiciaire dont le législateur serait responsable. Un tel accusé, passible d'une condamnation à perpétuité, ne risque-t-il pas de se soustraire à l'action de la justice, de récidiver, s'il est libéré ? À la catastrophe judiciaire qui consiste à faire subir de longs mois de détention provisoire à des innocents, il ne faudrait pas ajouter des libérations anticipées de coupables, surtout en matière de crimes commis avec violences sur des personnes vulnérables. Ce serait aussi de graves dysfonctionnements, ne l'oublions pas. Il m'apparaît donc indispensable de modifier la proposition de la commission d'enquête soit en augmentant ce délai d'un an en matière criminelle et correctionnelle soit en excluant de ce délai d'autres infractions qui s'ajouteraient à celles déjà visées de criminalité organisée et de terrorisme. Je pense en particulier à toutes les atteintes graves et les violences aux personnes, en particulier les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les femmes enceintes. Je comprends parfaitement les bons sentiments qui ont animé les membres de la commission pour limiter la durée de la détention provisoire. Cependant, je suis réservé sur des dispositions qui, si elles étaient appliquées, conduiraient à la remise en liberté anticipée de dangereux criminels. Enfin je tiens à vous signaler que, sous certaines conditions, l'accès au dossier de l'avocat du gardé à vue entraînera, de fait, une augmentation des mises en examen. La « judiciarisation » ainsi effectuée de la garde à vue conduira enquêteurs et juges à procéder à la mise en examen à l'issue des 24 heures de garde à vue. Pourquoi, en effet, attendre et répéter devant le juge d'instruction ce qui s'est passé, sous les mêmes formes, devant le policier ou le gendarme ? Même si la mise en examen est juridiquement une garantie pour l'intéressé, elle n'est en aucune façon ressentie comme telle par ceux qui la subissent et par l'opinion publique. C'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. CONTRIBUTION DE M. MICHEL HUNAULT, _______________ Les travaux de la commission d'enquête parlementaire, les auditions des victimes et des professionnels ont révélé les dysfonctionnements qui ont pu conduire au désastre judiciaire d'Outreau. La publicité des débats, le respect, l'écoute, le dialogue... qui ont caractérisés les travaux de la commission d'enquête, sont à porter à l'honneur du Parlement et de notre démocratie. Ils ont aussi révélé l'ardente nécessité de redonner de l'humanité à notre justice. * * * Aucune réforme ne sera efficace, s'il n'est pas donné des moyens à la justice dans le cadre d'une grande loi d'orientation et de programmation, afin de doubler les crédits qui permettront de financer les moyens humains et matériels indispensables pour un fonctionnement amélioré de la justice. Une nouvelle fois, le déroulement des auditions a révélé que trop souvent les lieux de garde à vue et la prison sont des zones de non-droit qui portent atteinte à la dignité de la personne. C'est pourquoi en complément de la loi d'orientation, il conviendra de transposer rapidement en « loi pénitentiaire », la charte pénitentiaire européenne. * * * Le rapport de la commission d'enquête doit être axé sur deux exigences : la présomption d'innocence et la détention provisoire exceptionnelle. La garde à vue Concernant la garde à vue, l'accès à l'avocat doit être la règle, les auditions et les lieux de garde à vue filmés. La détention provisoire La détention provisoire doit être réservée aux seuls auteurs des crimes et délits les plus graves et parallèlement les mesures alternatives à l'incarcération doivent être développées : contrôle judiciaire renforcé, bracelet électronique... Une échelle des peines rendant exceptionnelle une incarcération dans l'attente d'un jugement doit donc être mise en place. L'instruction Je suis favorable au maintien du juge d'instruction. Cependant des conditions d'âge, d'expérience, doivent être clairement posées afin d'éviter le traitement d'affaires complexes et délicates par des magistrats inexpérimentés. Un regroupement des juges d'instruction à travers des « pôles de l'instruction » doit être favorisé, afin de donner des moyens véritables pour la recherche et l'accès à la vérité, ce qui impliquera nécessairement une refonte de la carte judiciaire. Responsabiliser les « acteurs » au procès Aucune réforme législative ne peut être efficace sans responsabiliser les acteurs au procès. Une réflexion pourrait s'engager utilement sur le rattachement de la police judiciaire à la fois au ministère de la justice et au ministère de l'intérieur. La suppression même du mot « mis en examen » qui s'apparente trop souvent à une mise en accusation doit être évoquée, ainsi que l'élaboration d'un code déontologique de la presse. La violation du secret de l'instruction étant souvent la source de dysfonctionnements, son maintien ou sa suppression doit donner lieu à un débat guidé par le souci de préserver la présomption d'innocence. La responsabilité des magistrats La responsabilité des magistrats doit être engagée dans le seul cas où la responsabilité pour faute lourde de l'État est engagée. L'accès au droit L'accès au droit est une priorité. Des « maisons du droit » dans chaque département doivent être envisagées au service des justiciables. Contrôle du Parlement Le Parlement pourrait utilement, à travers une « conférence annuelle de la justice », débattre de l'institution judiciaire. * * * Les travaux de la commission d'enquête ont suscité une prise de conscience, mais aussi un espoir. Aucune réforme ne pourra être établie sans remettre en cause certaines dispositions législatives récentes qui, sous prétexte de lutter contre les nouvelles formes de criminalité, ont, quelquefois, servi de cadre légal à un recul de la présomption d'innocence et des libertés les plus essentielles. La commission d'enquête a aussi révélé les difficultés et l'ampleur des drames causés par les crimes sexuels. La parole de l'enfant, l'écoute et la prévention nécessitent des moyens humains et financiers, non seulement dans la recherche de la vérité, mais aussi l'écoute et le traitement des victimes, et dans l'ardente nécessité de prévention de tels crimes. La présente contribution se veut être une réflexion pour redonner de l'humanité à la justice. CONTRIBUTION DE M. ALAIN MARSAUD, ______________ Séisme ou naufrage de l'Institution, que de mots forts pour qualifier ce qui est en réalité une énorme erreur judiciaire, pas la première, et pas la dernière hélas. Elle fut seulement plus exposée que les autres, compte tenu de l'exploitation médiatique qui en fut faite, mais chronologiquement, à charge et à décharge respectivement, ne l'oublions pas. Dans la formulation des propositions, nous avons hélas une contrainte qui est celle du calendrier politique. De grandes réformes de notre institution judiciaire requièrent une plage de temps législatif, or celui-ci nous est compté. Doit-on, dès lors, imaginer des modifications constitutionnelles, des propositions relevant de la loi organique, de la loi simple ou du seul règlement ? Je vais faire comme s'il n'existait aucune contrainte de temps en souhaitant que l'alternance politique, quelle qu'elle soit, ait à cœur de répondre à une exigence démocratique, puisqu'elle est celle de nos concitoyens, n'en doutons pas, inquiets tant pour l'exercice de leurs libertés mais aussi pour la protection qui leur est due dans le cadre du pacte social. Prenons l'ordre chronologique de la procédure pénale, puisque c'est avant tout de cela dont il s'agit. 1) Déclenchons réellement les droits de la défense lors de la garde à vue, en faisant intervenir l'avocat non à la première heure mais dès la prolongation, car celle-ci est la constatation de charges sérieuses. L'avocat aurait accès au dossier des charges et préparerait, auprès de son client, les arguments de défense en cas de défèrement devant un magistrat. On assisterait, dès lors, à une accélération du débat judiciaire puisque la première comparution permettrait une avancée fondamentale de la procédure. Dans les cas de criminalité organisée ou de terrorisme, on peut envisager d'en rester à la législation actuelle. Je ne suis pas favorable à l'enregistrement audiovisuel à ce stade de la procédure, où il s'agit avant tout de faire progresser des investigations souvent dans le cadre d'une enquête préliminaire pour l'établissement de preuves. 2) Ensuite, quel rôle donner au Procureur de la République ? Sans doute le restituer dans ses droits et devoirs de gardien exigeant de la légalité. Par une simple circulaire, le garde des Sceaux pourrait déjà rappeler que dans toute procédure, il appartient au Procureur de la République tant au stade de l'ouverture d'une information et des réquisitions supplétives que du renvoi, de vérifier avec rigueur que les faits concernés relèvent bien d'une qualification légale stricte et non plus d'une interprétation plus ou moins arbitraire, plus ou moins personnelle. Cela relève tout simplement de la formation que l'on doit dispenser au profit des auditeurs de justice à l'ENM, et j'allais dire que, s'il doit n'y en avoir qu'une seule, ce doit être celle-là. C'est ainsi que certain d'entre nous ont appris leur métier de magistrat. Mais nous devons alors en finir, nous députés, concepteurs et rédacteurs de la loi, de fabriquer à longueur d'années, des « infractions caoutchouc » qui peuvent s'étirer en longueur et en largeur, permettant n'importe quelle appréciation. En voici deux exemples : - la mise en danger délibérée de la personne d'autrui des articles 121-3 et 223-3 du code pénal qui devrait entraîner à terme la condamnation de tous fumeurs de cigarettes sur plainte des fumeurs passifs que nous sommes ; - le blanchiment et ses avatars des articles 324-1 et suivants du code pénal qui permettent de poursuivre tous les employés de banque, surtout de bonne foi. Rappelons que ces infractions relèvent du « politiquement correct » et non de l'exigence de l'ordre public ou de l'intérêt des victimes. Pour ces différentes raisons, nous avons besoin d'un procureur fort, bien formé aux qualifications, hiérarchisé, car il accuse et défend au nom de la société. J'allais dire qu'il est le seul et dernier recours des plus faibles et des plus démunis. 3) Que faire du juge d'instruction ? Le faire disparaître créerait un vide difficile à remplir dans nos institutions, car on ne perçoit guère qui pourrait le remplacer en l'état. Je pense en particulier à sa fonction de chef enquêteur qu'il faut sans doute réhabiliter. Le juge d'instruction était d'abord, et avant tout, un enquêteur solitaire dont on a voulu faire une juridiction. C'est l'erreur que nous payons aujourd'hui. Le juge d'instruction aurait dû rester le chef d'enquête qui supervise l'action de la police et de la gendarmerie et d'une certaine manière la sacralise, et qui déclenche les droits de la défense après l'inculpation ou la mise en examen. Il délivre et contrôle les mesures coercitives, telles que les perquisitions, saisies, etc. Doit-il en rester là ? Se pose, dès lors, la question de la décision et de la gestion de la détention provisoire qui est au centre de l'affaire d'Outreau. Doit-on conserver la fonction du juge des libertés et de la détention qui, nonobstant la bonne volonté de ces magistrats, a alourdi notablement la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires ? Sans doute doit-on faire l'économie de cette fonction, qui peut être confiée à une collégialité de type tribunal correctionnel, statuant publiquement sur la détention provisoire, sur sa prolongation et sur la demande de mise en liberté. Cette juridiction, comme d'autres, gagnerait à être composée par échevinage, tant pour ces mesures particulières que pour l'audience et le jugement sur le fond. Mais j'ai conscience qu'il s'agit là d'une révolution intellectuelle à laquelle il faudra bien procéder comme cela s'est fait en Angleterre avec le juge de paix, forme évoluée du juge citoyen. Le juge d'instruction ne statuerait sur la détention provisoire que dans l'urgence laissant à la juridiction collégiale le soin de la décision définitive, sous un délai par exemple de 24 ou de 48 heures. Ainsi, on réduirait le rôle dévolu à la chambre de l'instruction qui serait déchargée d'une bonne part du contentieux de la détention, bien que restant juge du second degré des décisions privatives de liberté. À défaut d'une telle réforme, il faudrait sans doute se résoudre à faire travailler le juge d'instruction en collégialité, en pôle départemental ou régional, spécialisé ou non. Mais, cette idée intellectuellement attrayante car rationnelle, pose quatre questions : - on éloigne le juge du justiciable ; - on oblige des individualités à travailler en groupe avec le risque qu'en réalité un seul membre de la collégialité n'instruise ; - on dévalorise en partie la fonction en la déresponsabilisant et en la banalisant ; - on rend la décision de ce « juge multiple » quasi incontournable car prise collectivement. Mais il nous faut bien reconnaître que l'évolution historique de toutes les institutions régaliennes va vers le travail de groupe ou en réseau. On peut éventuellement envisager un enregistrement audio des interrogatoires et auditions dans le cabinet du juge d'instruction. 4) Il faut être ferme sur les délais de détention provisoire et prévoir que celle-ci ne pourra être supérieure à un an en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle. Une telle mesure obligerait le juge d'instruction à faire le choix de l'urgence dans certaines procédures. Une exception à ces délais contraignants pourrait concerner le terrorisme et le crime organisé. Par le respect de ces délais de justice, la France éviterait sans doute les condamnations répétées qu'elle subit et qui font d'elle le mauvais exemple de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, en termes de délai raisonnable des procédures et des détentions. 5) La formation et le recrutement des magistrats doivent être ouverts sur l'extérieur. Il est temps de permettre à la société civile formée et spécialisée d'être recrutée dans le corps : elle ne peut qu'y apporter un sang neuf et une vision moins corporatiste. Le monopole de l'ENM dans le recrutement doit être révisé par la mise en place d'un recrutement parallèle. J'ai conscience que le corps judiciaire est loin d'être mûr pour une telle réforme, tant il perçoit tout apport extérieur comme une menace sur un monopole voire une ingérence. Là encore, une révolution intellectuelle est à réaliser. Chaque magistrat de l'ordre judiciaire devra effectuer une période dite de mobilité obligatoire de deux ans, dans l'administration, l'entreprise, à l'étranger... comme cela est le cas dans la plupart des grands corps. Cela est un gage d'ouverture et de curiosité, l'âge maximal d'entrée à l'ENM devrait être repoussé à 40 ans. 6) Par quel moyen les justiciables peuvent-ils demander des comptes à l'institution judiciaire en cas de dysfonctionnement grave de celle-ci ? On ne peut rester en l'état dans un système de quasi irresponsabilité disciplinaire des magistrats auxquels seule leur hiérarchie peut réclamer des comptes, ce dont elle se prive bien souvent d'ailleurs. Organisons une procédure de traitement des réclamations des justiciables, par la création d'une sorte de chambre des requêtes au sein du Conseil supérieur de la magistrature. L'expérience du système de filtre de la Cour de Justice de la République peut inspirer une telle procédure. Mais on ne pourra faire l'économie de la réforme constitutionnelle du CSM dont la composition doit être au moins égalitaire entre magistrats et personnalités extérieures. 7) La réforme de la justice ne peut se réaliser in vitro sans tenir compte de l'influence européenne. Si l'Europe de la justice doit se réaliser un jour, elle sera forcément unifiée sur le plan des pratiques. Or, ce n'est certainement pas le modèle français actuel qui sera retenu, compte tenu de sa complexité, mais aussi peut-être de ses échecs, que ce soit celui d'Outreau ou d'ailleurs. De plus, le système inquisitoire ou mixte n'est plus le standard judiciaire mondial. Quoi que l'on en pense, on adoptera comme cela se fait déjà en Europe de l'Est une conception anglo-saxonne de la procédure pénale au moins dans quelques grands principes. Il en est un qui, dès à présent, pourrait nous inspirer : c'est celui du doute raisonnable. Le doute raisonnable amène le procureur anglo-saxon à abandonner la poursuite et le juge à ne pas condamner. Cette notion de doute raisonnable, qui bénéficie à la personne poursuivie ou susceptible de l'être, pourrait se substituer dans notre droit à celle de charges constitutives d'infraction de l'article 176 du code de procédure pénale d'une part, et d'intime conviction des articles 353 et 427 du même code d'autre part. Elle induirait, en quelque sorte, un renversement du raisonnement du juge d'instruction ou du fond, puisqu'il faudra éliminer cette notion de doute avant toute prise de décision, de renvoi ou de condamnation. La notion même de doute doit faire l'objet d'enseignement spécialisé à l'École nationale de la magistrature. 8) Enfin, mettons fin à l'hypocrisie que constitue l'article préliminaire du code de procédure pénale, véritable défi à l'intelligence, voire à l'intégrité intellectuelle de ceux qui font fonction de justice. On se rend compte que, dans l'affaire dite « d'Outreau », chacun des alinéas de cet article qui se veut fondateur de la nouvelle justice a été violé. Abrogeons cet article, dès aujourd'hui, nous n'en vivrons que mieux. Conclusions Ces propositions ne peuvent être mises en œuvre que si on introduit plus de contradictoire dans la procédure au niveau de l'enquête, de l'instruction, de l'expertise. Il faut réfléchir à une sorte de partenariat entre défense d'une part, et accusation, instruction et jugement d'autre part, plus qu'à une situation d'affrontement ou de rapport de force qui prévaut dans notre système actuel non rénové. Ayons cependant toujours présent à l'esprit réformateur qui doit être le nôtre que plus on crée de la procédure moins on crée de droits. Mais nous savons tous que rien ne pourra être mis en œuvre, sauf quelques réformettes inutiles ou cache misère, si nous ne faisons pas, dès cette année, un effort budgétaire important, qui ne produira ses effets qu'à moyen terme d'ailleurs. En avons-nous les moyens, y sommes-nous prêts, nos concitoyens considèrent-ils la réforme de la justice comme une priorité ? La réponse est politique et nous appartient. La commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 6 juin 2006. Elle l'a adopté à l'unanimité. Elle a ensuite décidé qu'il serait remis à M. le Président de l'Assemblée nationale afin d'être imprimé et distribué. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA ________ Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des Les réunions qui ont eu lieu à huis clos sont indiquées par un astérisque. * Audition de M. Henri VILLENEUVE, Mmes Monique DUMONT, Agnès SÉNESCHAL et Sabine JOLY, de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) d'Outreau (Procès-verbal de la séance du 10 janvier 2006) * Audition de Mme Claire BEUGNET, de la Maison de la famille et de la solidarité (Conseil général du Pas-de-Calais) (Procès-verbal de la séance du 10 janvier 2006) * Audition de M. Erik TAMION, ancien juge des enfants au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 10 janvier 2006) * Audition de M. Claude REGUET, ancien médecin du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de M. Jean-François LEMAITRE, médecin du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 11 janvier 2006) * Audition de MM. Didier WALLET, capitaine de police et Daniel DELEDALLE, adjudant-chef retraité du commissariat central de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 11 janvier 2006) * Audition de M. François-Xavier MASSON, commissaire au service régional de police judiciaire de Lille (Procès-verbal de la séance du 11 janvier 2006) * Audition en visioconférence de M. Romuald MULLER, commissaire divisionnaire et ancien chef de la division criminelle au service régional de police judiciaire de Lille (Procès-verbal de la séance du 11 janvier 2006) Audition de Mme Jeanine COUVELARD, M. Thierry DAUSQUE, Mme Karine DUCHOCHOIS, Mme Odile MARÉCAUX, M. Alain MARÉCAUX, M. Pierre MARTEL et M. Dominique WIEL (Procès-verbal de la séance du 18 janvier 2006) Audition de M. David BRUNET, Mme Lydia CAZIN-MOURMAND, M. Christian GODARD, Mme Roselyne GODARD, MM. Daniel LEGRAND (père) et Daniel LEGRAND (fils) (Procès-verbal de la séance du 18 janvier 2006) Audition de Maîtres Frank BERTON, avocat de M. Franck LAVIER et de Mme Odile MARÉCAUX, Hubert DELARUE, avocat de M. Alain MARÉCAUX, Antoine DEGUINES, avocat de M. Franck LAVIER, Aurélie DESWARTE, avocate de Mme Odile MARÉCAUX, Caroline MATRAT-MAENHOUT, avocate de M. Thierry DAUSQUE et Jean-Louis PELLETIER, avocat de M. Dominique WIEL (Procès-verbal de la séance du 19 janvier 2006) Audition de Maîtres Emmanuelle OSMONT, avocate de Mme Karine DUCHOCHOIS, Hervé CORBANESI, avocat de M. Pierre MARTEL, Stéphane DHONTE, avocat de M. David BRUNET et Jean-Marie VIALA, avocat de M. Pierre MARTEL (Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2006) Audition de Maîtres Olivier RANGEON, avocat de M. Daniel LEGRAND (fils), Bénédicte HAGNÈRE, avocate de M. David BRUNET, Raphaël TACHON, avocat de M. Christian GODARD, Thierry NORMAND et Célia ROFIDAL, avocats du Conseil général du Pas-de-Calais (Procès-verbal de la séance du 25 janvier 2006) Audition de Maîtres Thierry MAREMBERT, avocat de M. Thierry DAUSQUE, William JULIÉ, avocat de Mme Karine DUCHOCHOIS, Philippe LESCÈNE, avocat de Mme Sandrine LAVIER, Blandine LEJEUNE, avocate de M. Dominique WIEL (Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2006) Audition de Mme Sandrine LAVIER et M. Franck LAVIER (Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2006) Audition de Maîtres Éric DUPONT-MORETTI, avocat de Mme Roselyne GODARD et Julien DELARUE, avocat de M. Daniel LEGRAND (père) (Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2006) Audition de Maîtres Marie-France PÊTRE-RENAUD, avocate de l'association « Enfance et Partage », Anne MANNESSIER, avocate de l'association « Équipe d'action contre le proxénétisme », Vanina PADOVANI, avocate de l'association « Enfant bleu - Enfance maltraitée », Yves CRESPIN, président et avocat en première instance de l'association « Enfant bleu - Enfance maltraitée », Isabelle STEYER, avocate de l'association « La voix de l'enfant », Jacqueline LEDUC-NOVI, avocate de l'association « Enfance Majuscule », et Sylvie MOLUSSON-DAVID, avocate de l'association de défense de l'enfance et des parents séparés (ADEPS) (Procès-verbal de la séance du 1er février 2006) Audition de Maître Pascale POUILLE-DELDICQUE, avocate de Mme Myriam BADAOUI (Procès-verbal de la séance du 1er février 2006) Audition de Maîtres Bachira HAMANI-YEKKEN, avocate de Mlle Aurélie GRENON, Fabienne ROY-NANSION, avocate de M. David DELPLANQUE et Olivier DA SILVA, avocat de M. Thierry DELAY (Procès-verbal de la séance du 2 février 2006) * Audition de Mme Murielle MOINE, greffier du juge d'instruction Fabrice BURGAUD (Procès-verbal de la séance du mardi 7 février 2006) * Audition de Mme Nicole FRÉMY-WALCZAK, greffier du juge d'instruction Fabrice BURGAUD (Procès-verbal de la séance du 7 février 2006) * Audition de M. Patrick DUVAL, greffier du juge d'instruction Fabrice BURGAUD (Procès-verbal de la séance du 7 février 2006) * Audition de M. Philippe DEMAREST, greffier du juge d'instruction Fabrice BURGAUD (Procès-verbal de la séance du 7 février 2006) Audition de M. Fabrice BURGAUD, ancien juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 8 février 2006) * Audition de Mme Véronique CARRÉ, ancien substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 9 février 2006) Audition de M. Gérald LESIGNE, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 9 février 2006) Audition, en visioconférence, de Mme Hélène SIGALA, Vice-Procureur près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, ancien juge des enfants au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Procès-verbal de la séance du 21 février 2006) Audition de M. Maurice MARLIÈRE, Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, ancien juge des libertés et de la détention (Procès-verbal de la séance du 21 février 2006) Audition de Mme Jocelyne RUBANTEL, Vice-Président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, ancien juge des libertés et de la détention (Procès-verbal de la séance du 21 février 2006) Audition de M. Didier BEAUVAIS, conseiller à la cour de cassation, ancien président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, de Mme Aude LEFEBVRE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, ancien membre de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et de Mme Sabine MARIETTE, conseillère à la cour d'appel de Douai, membre de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai (Procès-verbal de la séance du 22 février 2006) Audition de M. Claude TESTUT, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, ancien membre de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai (par visioconférence), Mme Pascale FONTAINE, conseillère référendaire à la cour de cassation, ancien membre de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et Mme Claire MONTPIED, conseillère à la cour d'appel de Douai, ancien membre de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai (Procès-verbal de la séance du 22 février 2006) * Audition de M. Michel EMIRZÉ, psychologue, expert auprès de la cour d'appel de Douai, Mme Aude COUSAERT, psychologue, M. Serge RAYMOND, psychologue, expert auprès de la cour d'appel de Paris, et Mme Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART, expert psychologue (Procès-verbal de la séance du 23 février 2006) Audition de Mme Brigitte BONNAFFÉ, psychologue, du docteur Jean-louis POURPOINT et du docteur Jérôme PRIZAC, experts ayant expertisé les adultes mis en examen lors de l'affaire Outreau (Procès-verbal de la séance du 23 février 2006) * Audition de M. Yves JANNIER, avocat général près la cour d'assises de Paris (Procès-verbal de la séance du 28 février 2006) * Audition de Mmes Brigitte ROUSSEL, Simone HANNECART, présidentes de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et Sylvie KARAS, conseillère à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, au moment de l'instruction (Procès-verbal de la séance du 28 février 2006) Audition de M. Jean-Claude MONIER, président de la cour d'assises de première instance de Saint-Omer (Procès-verbal de la séance du 1er mars 2006) Audition de Mme Odile MONDINEU-HEDERER, présidente de la cour d'assises de Paris (Procès-verbal de la séance du 1er mars 2006) * Audition de M. Cyril LACOMBE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (à partir de septembre 2002) (Procès-verbal de la séance du 2 mars 2006) * Audition de Mmes Charlotte TRINELLE, Christine POUVELLE-CONDAMIN et Annie SANCTORUM, psychologues, et de MM. Alain LEULIET et Paul MESSERSCHMITT, psychiatres (Procès-verbal de la séance du 7 mars 2006) Audition de M. Jean-Luc VIAUX, psychologue (Procès-verbal de la séance du 7 mars 2006) Audition de M. Yves BOT, procureur général près la Cour d'appel de Paris (Procès-verbal du mercredi 8 mars 2006) Audition de MM. Jean-Michel BRETONNIER, rédacteur en chef de La Voix du Nord, Laurent RENAULT et Éric DUSSART, journalistes à La Voix du Nord (Procès-verbal de la séance du 9 mars 2006) Audition de M. François-Xavier MASSON, commissaire au Service régional de police judiciaire de Lille (Procès-verbal de la séance du 9 mars 2006) Audition de M. Jean-Amédée LATHOUD, procureur général près la cour d'appel de Versailles, ancien procureur général près la cour d'appel de Douai (Procès-verbal de la séance du 14 mars 2006) Audition de M. Michel CHICHE, ancien rédacteur en chef de FR3 Nord-Pas-de-Calais, M. Hervé ARDUIN, ancien journaliste à FR3 Nord-Pas-de-Calais, Mme Corinne PEHAU et M. Bernard SEITZ, journalistes à FR3 Nord-Pas-de-Calais et M. Georges HUERCANO-HIDALGO, journaliste à la Radio Télévision belge de la communauté française Wallonie-Bruxelles (RTBF) (Procès-verbal de la séance du 14 mars 2006) Audition de Mmes Florence AUBENAS, grand reporter à Libération, auteur du livre La Méprise, l'affaire d'Outreau, et Haydée SABERAN, journaliste à Libération, MM. Stéphane ALBOUY, ancien journaliste au Parisien, François VIGNOLLE, journaliste au Parisien, et Stéphane DURAND-SOUFFLAND, chroniqueur judiciaire au Figaro (Procès-verbal de la séance du mardi 14 mars 2006) Audition de M. Jean-Olivier VIOUT, procureur général près la cour d'appel de Lyon (Procès-verbal de la séance du 15 mars 2006) Audition de Maîtres Marc PANTALONI et Didier LEICK, avocats de la partie civile (Procès-verbal de la séance du 15 mars 2006) Table ronde intitulée : « Quel traitement rédactionnel pour les affaires de mœurs ? » réunissant : Mme Florence RAULT, avocate et co-auteur du livre La dictature de l'émotion, MM. Acacio PEREIRA, ancien chroniqueur judiciaire au Monde, Gilles MARINET, journaliste à France 2, Dominique VERDEILHAN, chroniqueur judiciaire à France 2, et Jean-Pierre BERTHET, ancien chroniqueur judiciaire à TF1, président d'honneur de l'association de la presse judiciaire (Procès-verbal de la séance du 15 mars 2006) Audition de M. Dominique BARELLA, président de l'Union syndicale des magistrats (USM), Mmes Catherine AYACHE et Sabine ORSEL, MM. Thomas BRIDE, Jean-Michel MALATRASI et Henry ODY, membres du même syndicat (Procès-verbal de la séance du 16 mars 2006) Audition de Mme Aïda CHOUK, présidente, M. Côme JACQMIN, secrétaire général, Mmes Délou BOUVIER, secrétaire générale adjointe, Agnès HERZOG, Hélène FRANCO et M. Eric ALT, vice-présidents du Syndicat de la magistrature (Procès-verbal de la séance du 16 mars 2006) Table ronde intitulée : « L'état de la réflexion sur la réforme de l'instruction » réunissant : Mme Michèle-Laure RASSAT et M. Jean PRADEL, professeurs émérites des facultés de droit, M. Didier GUÉRIN, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, M. Gilbert THIEL, premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, et Me Daniel SOULEZ-LARIVIÈRE, avocat (Procès-verbal de la séance du 21 mars 2006) Audition de Mmes Sylvie VÉRAN, journaliste au Nouvel Observateur, Delphine SAUBABER, journaliste à L'Express, MM. Jean-Marie PONTAUT, rédacteur en chef du service investigations de L'Express, Gilles BALBASTRE, ancien journaliste au Monde diplomatique, et Jean-Michel DÉCUGIS, journaliste au Point (Procès-verbal de la séance du 21 mars 2006) Audition de Mme Naïma RUDLOFF, secrétaire générale du Syndicat national FO des magistrats (Procès-verbal de la séance du 22 mars 2006) Audition de Mme Marylise LEBRANCHU, députée du Finistère, ancienne garde des Sceaux (Procès-verbal de la séance du 22 mars 2006) Audition de M. Dominique PERBEN, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ancien garde des Sceaux (Procès-verbal de la séance du 22 mars 2006) Audition de MM. Olivier DAMIEN, secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale (SCHFPN) et Denis COLLAS, commissaire principal de la préfecture de police, direction de la police judiciaire (Procès-verbal de la séance du 22 mars 2006) Table ronde intitulée : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations professionnelles - le regard du droit comparé » réunissant : Mme Catherine VANDIER, membre du bureau de l'Union syndicale des magistrats, M. Christophe REGNARD, vice-président du conseil national de l'Union syndicale des magistrats, M. Luc FONTAINE, procureur-adjoint au tribunal de grande instance de Grenoble, Mme Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, professeur à l'université Paris-I, Mme Délou BOUVIER, secrétaire générale adjointe du Syndicat de la magistrature, M. Ollivier JOULIN, membre du Syndicat de la magistrature, M. Claude CHOQUET, président de l'Association française des magistrats instructeurs, M. Frank NATALI, président de la Conférence des bâtonniers, M. Paul-Albert IWEINS, président du Conseil national des barreaux, M. Yves REPIQUET, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris (Procès-verbal de la séance du 23 mars 2006) Audition de M. Michel DOBKINE, directeur de l'École nationale de la magistrature (Procès-verbal de la séance du 27 mars 2006, à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux) Table ronde à l'École nationale de la magistrature (ENM), à Bordeaux, intitulée : « Comment améliorer la formation des auditeurs de justice et des magistrats ? » réunissant : M. Michel DOBKINE, directeur de l'École nationale de la magistrature, M. Michel ALLAIX, directeur adjoint, directeur de la formation initiale et des recrutements, M. Philippe VIGIER, chargé de formation dans les fonctions « application des peines », Mme Françoise ANDRO-COHEN, chargée de formation dans les fonctions « enfants », M. Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, chargé de formation dans les fonctions « instance », M. Thierry PONS, chargé de formation dans les fonctions « instruction », Mme Isabelle RAYNAUD, chargée de formation dans les fonctions « parquet », Mme Véronique VENNETIER, chargée de formation dans les fonctions « siège civil », Mme Sylvie ACHARD-DALLES, chargée de formation dans le service de la formation continue des magistrats (Procès-verbal de la séance du 27 mars 2006) Audition de Mme Mireille DELMAS-MARTY, professeur au Collège de France et M. Pierre TRUCHE, président de la commission nationale de déontologie de la sécurité, Premier président honoraire de la Cour de cassation (Procès-verbal de la séance du 28 mars 2006) Audition de M. Jean-Marie DELARUE, conseiller d'État, président de la commission de suivi de la détention provisoire (Procès-verbal de la séance du 28 mars 2006) Audition d'une délégation de magistrats : Mmes Simone GABORIAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, Françoise BARBIER-CHASSAING, vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil, Anne CARON-DÉGLISE, présidente du tribunal d'instance de Besançon, Dominique LEGRAND, présidente de chambre au tribunal de grande instance de Rennes, Vanessa LEPEU, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Senlis, Fabienne NICOLAS, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, Clarisse TARON, vice-procureur au tribunal de grande instance de Nancy, MM. Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE, magistrat honoraire, Gilles STRAEHLI, président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Nancy (Procès-verbal de la séance du 29 mars 2006) Table ronde intitulée : « Faut-il réformer l'enquête policière ? » réunissant : M. Nicolas COMTE, secrétaire général du Syndicat général de la police (SGP), M. Jean-Yves BUGELLI, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance, M. Laurent LACLAU-LACROUTS, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance, M. Bruno BESCHIZZA, secrétaire général du syndicat Synergie officiers, M. Patrick MAUDUIT, conseiller technique du syndicat Synergie officiers, M. Jean-René DOCO, secrétaire national du Syndicat national des officiers de police (SNOP), Mme Chantal PONS-MESOUAKI, secrétaire nationale du SNOP, M. Nicolas BLOT, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM), M. François THEVENOT, membre de l'USM, M. Gérard TCHOLAKIAN, membre du Conseil national des barreaux, M. Jacques MARTIN, président de la commission pénale de la Conférence des bâtonniers, Mme Agnès HERZOG, vice-présidente du Syndicat de la magistrature, M. David de PAS, membre du Syndicat de la magistrature (Procès-verbal de la séance du 29 mars 2006) Audition de M. André RIDE, président de la Conférence nationale des procureurs généraux (Procès-verbal de la séance du 4 avril 2006) Table ronde intitulée : « La responsabilité des magistrats » réunissant : Mme Dominique COMMARET, avocat général près la Cour de cassation, M. Serge GUINCHARD, recteur de l'académie de Rennes, professeur à l'université de Paris II, directeur honoraire de l'Institut d'études judiciaires Pierre-Raynaud et doyen honoraire de la faculté de droit de Lyon, M. Jean-Claude MAGENDIE, président du tribunal de grande instance de Paris, M. Daniel LUDET, avocat général près la cour d'appel de Paris, M. Bruno THOUZELLIER, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats, M. Michel LE POGAM, membre du bureau de l'Union syndicale des magistrats, M. Côme JACQMIN, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, Mme Gracieuse LACOSTE, membre du Syndicat de la magistrature (Procès-verbal de la séance du 4 avril 2006) Audition de MM. Vincent DELMAS, président du COSAL, « Contre Ordre-Syndicat des avocats libres », Pierre CONIL, président du Syndicat des avocats de France et Alain GUIDI, président de la Fédération nationale des jeunes avocats (Procès-verbal de la séance du 4 avril 2006) Audition de M. Michel JEANNOUTOT, président de la Conférence nationale des premiers présidents des cours d'appel, premier président de la cour d'appel de Dijon, M. Alain NUÉE, premier président de la cour d'appel de Colmar et M. Bernard DAESCHLER, premier président de la cour d'appel de Reims (Procès-verbal de la séance du 5 avril 2006) Table ronde intitulée : « Quelle place pour les experts dans le procès pénal ? » réunissant : Mme Colette DUFLOT, expert psychologue honoraire ; Mme Geneviève CÉDILE, expert-psychologue près la cour d'appel de Paris et les docteurs Paul BENSUSSAN, Bernard CORDIER et Roland COUTANCEAU, psychiatres-experts près la cour d'appel de Versailles (Procès-verbal de la séance du 5 avril 2006) Table ronde intitulée : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » réunissant : Mme Dominique FRÉMY, psychiatre, représentante du Centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles et de maltraitance (CAVASEM) de Besançon, Mme Nathalie BECACHE, vice-procureur, chef de section des mineurs du tribunal de grande instance de Paris, Mme Yvette BERTRAND, commissaire divisionnaire de la brigade de protection des mineurs de Paris, Mme Laurence GOTTSCHECK, avocate, M. Eric MARÉCHAL, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président de la cour d'assises de Maine-et-Loire siégeant à Angers, lors du procès d'Angers en 2005 (Procès-verbal de la séance du 5 avril 2006) Audition de M. Dominique BAUDIS, président, et de M. Francis BECK, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (Procès-verbal de la séance du 6 avril 2006) Audition de M. Guy CANIVET, Premier président de la Cour de cassation (Procès-verbal de la séance du 11 avril 2006) Audition de M. Jean-Louis NADAL, procureur général près la Cour de cassation (Procès-verbal de la séance du 11 avril 2006) Audition de M. Pascal CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre de la justice (Procès-verbal de la séance du 12 avril 2006) ---------------------- N° 3125 Rapport de M. Philippe Houillon au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement (tome 1 - rapport) 1 « Une information judiciaire en recherche des causes de la mort de M. François Mourmand, mis en examen, décédé le 9 juin 2002 en détention provisoire à la maison d'arrêt de Douai n'est pas close » (lettre du garde des Sceaux au président de la commission d'enquête du 5 décembre 2005). Interrogé à nouveau par le président et le rapporteur le 2 mars 2006, le garde des Sceaux, dans une lettre du 11 mai 2006, indique que « le procureur général près la cour d'appel de Douai est sensibilisé à la nécessité que cette information ne souffre d'aucun retard ». 2 Le principe selon lequel les juridictions statuent au nom du peuple français découle du principe de souveraineté nationale affirmé tant par l'article 3 de la Déclaration de 1789 que par l'article 3 de la Constitution (98-399 DC, 5 mai 1998). 3 Ce rappel des faits s'appuie sur le rapport de synthèse de police du 15 juillet 2002. 4 Les chiffres clés de la justice, ministère de la justice, octobre 2005. 5 Aux termes du verdict de la cour d'assises de Saint-Omer du 14 avril 2006, les trois frères D. et les trois sœurs V. ont été condamnés dans cette affaire à deux ans de prison, le parquet général de la cour d'appel de Douai ayant fait appel de cette condamnation. 6 Audition du 10 janvier 2006. 7 Audition du 7 mars 2006. 8 Audition du 21 février 2006. 9 Audition du 10 janvier 2006. 10 Audition du 10 janvier 2006. 11 Audition du 11 janvier 2006. 12 Audition du 11 janvier 2006. 13 D 508. 14 D 1055. 15 D 915. 16 D 274. 17 D 902. 18 Note de l'UTASS du 10 janvier 2001. 19 D 675. 20 Audition du 10 janvier 2006. 21 D 1055. 22 Audition du 19 janvier 2006. 23 D 452. 24 Audition du 7 mars 2006. 25 Audition du 18 janvier 2006. 26 D 966. 27 D 689. 28 D 700. 29 Audition du 18 janvier 2006. 30 Cote Fh9. 31 Cote Fh6. 32 Audition du 11 janvier 2006. 33 Audition du 26 janvier 2006. 34 D 916 et D 915. 35 D 1858 et D 1960. 36 Audition du 19 janvier 2006. 37 D 1501. 38 Par exemple deux auditions du 8 mars 2001, D 249 et D 250 et une audition du 14 novembre 2001, D 722. 39 D 211. 40 D 915 et D 916. 41 Audition du 26 janvier 2006. 42 Des dépositions d'enfants au procès de Saint-Omer ont été enregistrées conformément à l'article 208 du code de procédure pénale. Une d'entre elles a été projetée pendant le procès d'assises de Paris. Comme l'a souligné Me Vanina Padovani, il s'est avéré que le document était inexploitable, la cassette diffusée étant celle d'un « téléfilm allemand » (audition du 1er février 2006). 43 Audition du 5 avril 2006. 44 Audition du 10 janvier 2006. 45 Audition du 31 janvier 2006. 46 Audition du 14 mars 2006. 47 Audition du 1er février 2006. 48 Audition du 1er février 2006. 49 Audition du 1er février 2006. 50 Cotes D 1858 et D 1960. 51 Audition du 10 janvier 2006. 52 Audition du 9 février 2006. 53 Audition du 10 janvier 2006. 54 Audition du 31 janvier 2006. 55 Audition du 31 janvier 2006. 56 Audition du 21 février 2006. 57 Audition du 31 janvier 2006. 58 Audition du 18 janvier 2006. 59 Audition du 19 janvier 2006. 60 Audition du 18 janvier 2006. 61 Audition du 10 janvier 2006. 62 Audition du 10 janvier 2006. 63 Audition du 18 janvier 2006. 64 Audition du 18 janvier 2006. 65 Audition du 18 janvier 2006. 66 Audition du 18 janvier 2006. 67 Audition du 18 janvier 2006. 68 Audition du 10 janvier 2006. 69 Le 21 décembre 2000. 70 Le 20 février 2001. 71 Interrogatoire du 2 mai 2001, p. 2, cote D 379. 72 Confrontation du 17 janvier 2002, D 1123. 73 Source : rapport de synthèse du SRPJ de Lille du 15 juillet 2002, cote D. 2228, p. 10 et 11. 74 14 sur les 17 confrontations que contient cette procédure. 75 Audition du 8 février 2006. 76 Confrontation du 17 janvier 2002 entre Mme Badaoui, Mlle Aurélie Grenon et MM. David Delplanque, Thierry Dausque et Daniel Legrand fils. 77 Tel fut le cas, notamment, de M. Thierry Dausque. 78 D 1262. 79 D 456. 80 Confrontation du 17 janvier 2002, p. 3. 81 Le 27 février 2002. 82 Le 8 janvier 2002. 83 Les 14 et 20 août 2002. 84 Les 21 et 28 janvier, le 26 août 2002. 85 Les 5 mars, 2 juillet, 24 août 2002. 86 Audition du 25 janvier 2006. 87 Arrêt du 19 juin 2002. 88 Le 19 avril 2002. 89 Le 4 décembre 2001, le 5 mars 2002, le 2 juillet 2002. 90 Le 8 janvier 2002. 91 Le 26 août 2002. 92 Exemple de mission confiée à Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, le 15 février 2002. 93 Rapport non daté, en réponse à la mission du 15 février 2002 précitée, page 9. 94 Table ronde : « Quelle place pour les experts dans le procès pénal ? » du 5 avril 2006. 95 Audition du 19 janvier 2006. 96 D 617, p. 2, 3 et 5. 97 D 1124 et D 1376. 98 Décision du JLD du 14 août 2001, confirmée par la chambre de l'instruction le 12 septembre 2001. 99 D 379. 100 D 565. 101 Audition du 25 janvier 2006. 102 D 2755. 103 Audition du 11 janvier 2006. 104 D 1947. 105 Audition du 31 janvier 2006. 106 Audition du 18 janvier 2006. 107 Extrait de la lettre enregistrée au cabinet d'instruction le 26 mars 2001, cote D. 245. 108 Extrait de la lettre enregistrée au cabinet d'instruction le 11 juin 2001, cote D. 427. 109 Autre extrait de la lettre précitée. 110 Extrait de lettre enregistrée au cabinet d'instruction le 15 juin 2001, cote D 431. 111 Extrait de la lettre enregistrée au cabinet d'instruction le 22 juin 2001, cote D 446. 112 Audition du 1er février 2006. 113 Audition du 9 février 2006. 114 Interrogatoire du 13 novembre 2001, D. 715. 115 D 1123. 116 D 841, p. 2. 117 Comme l'affirme Mme Badaoui le 17 janvier 2002. 118 D 1605. 119 Audition du 18 janvier 2006. 120 Audition du 9 mars 2006. 121 D 548. 122 Audition du 8 février 2006. 123 Audition du 7 février 2006. 124 Audition du 7 février 2006. 125 Audition du 11 janvier 2006. 126 Cote A 306. 127 Me Aurélie Deswarte, avocate de Mme Odile Marécaux a également témoigné des tensions présidant à la retranscription des propos tenus dans le cabinet du juge d'instruction, cf. audition du 19 janvier 2006. 128 Audition du 8 février 2006. 129 p. 10. 130 p. 82. 131 Audition du 31 janvier 2006. 132 Audition du 7 février 2006. 133 Audition du 7 février 2006. 134 D 283. 135 D 379. 136 D 429. 137 D 533. 138 D 565. 139 D 1123. 140 D 212 et D 282. 141 D 2167. 142 Audition du 11 janvier 2006. 143 D 526. 144 D 2757. 145 Audition du 9 mars 2006. 146 D 2228, p. 7. 147 D 27. 148 D 53. 149 D 548. 150 Docteur Mac Cann, cité dans le mémoire précité de Me Berton adressé au garde des Sceaux le 22 septembre 2004. 151 D 523. 152 Confrontation du 17 janvier 2002. 153 Le 6 mai 2002. 154 Audition du 24 janvier 2006. 155 Tant par le juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation que par la chambre de l'instruction dans son arrêt de renvoi. 156 D 1171. 157 D 146. 158 Audition du 18 janvier 2006. 159 D 461. 160 En application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. 161 D 3053, page 84 162 Audition du 9 février 2006. 163 Par exemple, suite à de nouvelles accusations émanant d'un mineur à l'encontre d'un mis en examen (D 968) ou encore dans l'affaire du prétendu meurtre de la fillette belge (D. 1095). 164 Audition du 7 février 2006. 165 Audition du 9 février 2006. 166 Audition du 9 février 2006. 167 Audition du 14 mars 2006. 168 Audition du 14 mars 2006. 169 Petite ville à proximité d'Outreau. 170 D 452, 25 juin 2001. 171 D 1041. 172 Réquisitoire du 6 mars 2003, p. 59 et 60. 173 Ordonnance du 13 mars, p. 52. 174 Audition du 9 février 2006. 175 Article 81 du code de procédure pénale. 176 p. 87 de l'ordonnance de mise en accusation du 13 mars 2003, p. 90 du réquisitoire définitif. 177 Audition du 2 mars 2006. 178 Audition du 6 mars 2006. 179 Audition du 19 janvier 2006. 180 D 1092. 181 Audition du 9 mars 2006. 182 Interrogatoire du 9 janvier 2002. 183 Le 19 février 2002 cote D 1178. 184 D 1605, envoyé par le procureur du Roi à Ypres le 18 mars 2002. 185 Audition du 26 janvier 2006. 186 Audition du 25 janvier 2006. 187 Audition du 26 janvier 2006. 188 Audition du 8 février 2006. 189 Cette expression étant tantôt attribuée à Napoléon, tantôt à Honoré de Balzac. 190 Audition du 8 février 2006. 191 Audition du 14 mars 2006. 192 Audition du 21 février 2006. 193 Audition du 2 février 2006. 194 Audition du 11 janvier 2006. 195 Audition du 23 février 2006. 196 Notamment l'article 706-47-1 du code de procédure pénale relatif à l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en cas d'infractions de nature sexuelle et l'article 122-1 du code pénal relatif à l'accessibilité de la personne à la sanction pénale. 197 Extrait de l'expertise d'un enfant réalisée par Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart. 198 Audition du 7 mars 2006. 199 Cette formule signifie que chaque expert ne se voit attribuer qu'une seule expertise. 200 Conclusions de l'expertise du 26 avril 2004. 201 Audition du 23 février 2006. 202 Audition du 8 février 2006. 203 Audition du 7 mars 2006. 204 Audition du 23 février 2006. 205 Audition du 23 février 2006. 206 Audition du 7 mars 2006. 207 Lettre de M. Dominique Wiel au juge d'instruction, le 25 mai 2002, rédigée au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. 208 Audition du 7 mars 2006. 209 Auditions des 23 février et 7 mars 2006. 210 Audition du 23 février 2006. 211 Audition du 23 février 2006. 212 Audition du 23 février 2006. 213 D 1262. 214 Extrait du procès-verbal de la cour d'assises du Pas-de-Calais. 215 Audition du 23 février 2006. 216 Arrêt n° 683 du 31 mars 2004 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. 217 Arrêt n° 1911 du 25 octobre 2002. 218 Réquisitoire définitif du 6 mars 2003. 219 On ne peut considérer comme ayant été satisfaites quatre demandes d'expertise, dont celle concernant Daniel Legrand fils, que le juge d'instruction a certes acceptées mais qui portaient sur des actes déjà en cours et dont les conclusions n'avaient pas encore été rendues. Aucune expertise n'a été initiée à la seule demande d'un avocat. 220 Ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue le 11 avril 2002. 221 Ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue le 21 juin 2002. 222 Ordonnance d'irrecevabilité et de refus d'instruction complémentaire du 14 août 2002. 223 Audition du 23 février 2006. 224 Audition du 31 janvier 2006. 225 Déclaration de Me Jean-Louis Pelletier, audition du 19 janvier 2006. 226 Audition du 24 janvier 2006. 227 Audition du 26 janvier 2006. 228 D 841. 229 D 844. 230 Audition du 11 janvier 2006. 231 Audition du 19 janvier 2006. 232 Traité théorique et pratique de police judiciaire, à l'usage des commissaires de police et des autres officiers de police judiciaire, 2e édition 1947, édition Desvigne, p. 251. 233 Audition du 18 janvier 2006. 234 Audition du 29 mars 2006. 235 Audition du 19 janvier 2006. 236 6835 x 28 x 5 = 956 900. 237 Audition du 31 janvier 2006. 238 Audition du 19 janvier 2006. 239 Audition du 19 janvier 2006. 240 Pour la justice, septembre 2004, p. 81 à 83. 241 Il en est ainsi, à titre d'illustration, de la demande présentée le 27 mars 2002 par l'avocat de M. Godard aux fins d'audition de Mme X, laquelle avait été entendue dès le 21 février 2002 (D 1466). 242 Audition du 14 mars 2006. 243 Audition du 14 mars 2006. 244 Audition du 9 février 2006. 245 Audition du 31 janvier 2006. 246 Audition du 26 janvier 2006. 247 Audition du 26 janvier 2006. 248 D 548. 249 Audition du 19 janvier 2006. 250 D 2172. 251 D 2806. 252 Soit 56. 253 Contre 165 après la clôture de l'information, soit un total de 323 demandes. 254 Audition du 26 janvier 2006. 255 Audition du 4 avril 2006. 256 Audition du 1er février 2006. 257 Audition du 21 février 2006. 258 Audition du 29 mars 2006. 259 Cette structure du « débat contradictoire » se retrouve, à titre d'illustration, pour M. Lavier (Ci 5) et son épouse (Cj 5). 260 PV du débat contradictoire devant le JLD du 8 novembre 2002, Cn 65. 261 PV du débat contradictoire devant le JLD du 29 mai 2001, Cj 5. 262 Audition du 21 février 2006. 263 Cote Cn 64. 264 Audition du 19 janvier 2006. 265 Une seule demande d'acte peut comporter plusieurs demandes d'investigations supplémentaires adressées au juge par l'avocat : ainsi, les 11 appels de rejet de demandes d'actes concernent 27 mesures d'investigations additionnelles sollicitées par les avocats. 266 Ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 21 mars 2002. 267 Ordonnance du 7 mai 2002. 268 Ordonnance du 31 octobre 2002. 269 Article 198 du code de procédure pénale. 270 M. Alain Marécaux présenta 11 demandes au total et fut libéré par la chambre de l'instruction le 7 octobre 2003. 271 Audition du 22 février 2006. 272 Audition du 19 janvier 2006. 273 Audition du 26 janvier 2006. 274 Audition du 26 janvier 2006. 275 Audition du 22 février 2006 276 Audition du 22 février 2006. 277 Audition du 31 janvier 2006. 278 Audition du 18 janvier 2006. 279 Annuaire statistique de la justice. Édition 2005, p. 2005. La Documentation française. 280 Rapport de la Commission de suivi de la détention provisoire, 2005, p. 21. 281 Audition du 28 mars 2006. 282 Audition du 28 mars 2006. 283 Chiffres extraits de l'ouvrage de M. Jean Larguier, Procédure pénale, Dalloz, 20e édition, p. 194. 284 Audition du 18 janvier 2006. 285 Audition du 18 janvier 2006. 286 Audition du 21 février 2006. 287 Audition du 21 février 2006. 288 Audition du 29 mars 2006. 289 Audition du 21 février 2006. 290 Audition du 29 mars 2006. 291 Audition du 21 février 2006. 292 Audition du 21 février 2006. 293 Audition du 21 février 2006. 294 Audition du 21 février 2006. 295 Audition du 21 février 2006. 296 Audition du 21 février 2006. 297 Audition du 29 mars 2006. 298 Audition du 15 mars 2006. 299 Audition du 18 janvier 2006. 300 Audition du 22 février 2006. 301 Audition du 22 février 2006. 302 Audition du 28 février 2006. 303 Audition du 28 février 2006. 304 Audition du 11 avril 2006. 305 Audition du 29 mars 2006. 306 Audition du 28 février 2006. 307 Audition du 31 janvier 2006. 308 Audition du 29 mars 2006. 309 Audition du 2 mars 2006. 310 L. Greisalmer et D. Schneidermann, Fayard, 2002, p. 171 et 172. 311 Audition du 1er mars 2006. 312 Audition du 31 janvier 2006. 313 Audition du 19 janvier 2006. 314 Audition de Me Berton du 19 janvier 2006. 315 Audition de Me Lescène du 26 janvier 2006. 316 Commission de suivi de la détention provisoire, Rapport 2005, p. 131. 317 Audition du 29 mars 2006. 318 Idem. 319 Audition du 1er mars 2006. 320 Audition du 29 mars 2006. 321 Audition du 14 mars 2006. 322 Audition du 14 mars 2006. 323 Audition du 31 janvier 2006. 324 Audition du 28 février 2006. 325 Audition du 21 février 2006. 326 Audition du 28 février 2006. 327 Audition du 15 mars 2006. 328 Audition du 9 mars 2006. 329 Audition du 9 mars 2006. 330 Audition du 14 mars 2006. 331 Audition du 14 mars 2006. 332 Audition du 18 janvier 2006. 333 Audition du 14 mars 2006. 334 Audition du 18 janvier 2006. 335 Audition du 18 janvier 2006. 336 Audition du 14 mars 2006. 337 Audition du 14 mars 2006. 338 D 915. 339 D 916. 340 Audition du 26 janvier 2006. 341 In La méprise : l'affaire d'Outreau, éditions du Seuil, octobre 2005, p. 187 et 188. 342 Audition du 28 février 2006. 343 D 1340. 344 Audition du 21 février 2006. 345 Audition du 15 mars 2006. 346 Audition du 14 mars 2006. 347 Audition du 14 mars 2006. 348 Extrait de l'article de M. Gilles Balbastre, Les faits divers, ou le tribunal implacable des médias (Le Monde diplomatique, décembre 2004). 349 Audition du 21 mars 2006. 350 Audition du 29 mars 2006. 351 Audition du 22 mars 2006. 352 Source : réponse au questionnaire du président et du rapporteur au magistrat de liaison en Allemagne. 353 Audition du 29 mars 2006. 354 Audition du 29 mars 2006. 355 Audition du 11 avril 2006. 356 Audition du 29 mars 2006. 357 Audition du 29 mars 2006. 358 Audition du 22 mars 2006. 359 Audition du 21 mars 2006. 360 Audition du 19 janvier 2006. 361 Audition du 29 mars 2006. 362 Audition du 29 mars 2006. 363 Audition du 22 mars 2006. 364 Audition du 29 mars 2006. 365 Source : réponse au questionnaire du président et du rapporteur au magistrat de liaison en Espagne. 366 Cf. infra chapitre XIV. 367 Audition du 21 mars 2006. 368 Extraits du commentaire de l'article 6 § 3 d), Michèle de Salvia, Compendium de la Cedh, Vol. 1, Éditions N.P. Engel, 2003. 369 Audition du 11 avril 2006. 370 Ordonnance de rejet de demande en liberté du 10 mars 2003 concernant l'abbé Wiel. 371 Audition du 22 février 2006. 372 Audition du 28 mars 2006. 373 Source : réponse aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison en Allemagne, en Italie ainsi qu'au magistrat de liaison italien en France. 374 Audition du 29 mars 2006. 375 Audition du 11 avril 2006. 376 Dans la revue, Regards sur l'actualité, n° 300, avril 2004, page 49. 377 Audition du 28 mars 2006. 378 Opus cité, p. 50. 379 Audition du 23 mars 2006. 380 Source : annuaire statistique de la Justice, édition 2005, page 115. 381 Source : réponse aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison en Allemagne et au Canada. 382 Dominique Inchauspé, L'innocence judiciaire, Litec 2001, p. 253. 383 Table ronde : « L'état de la réflexion sur la réforme de l'instruction » du 21 mars 2006. 384 Table ronde : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations syndicales » du 23 mars 2006. 385 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison en Italie et en France, p. 31. 386 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au magistrat de liaison en Allemagne, p. 10 et s. 387 Audition du 8 mars 2006. 388 Audition du 4 avril 2006. 389 Audition du 12 avril 2006. 390 Audition du 12 avril 2006. 391 Audition du 11 avril 2006. 392 Audition du 27 mars 2006. 393 Audition du 11 avril 2006. 394 Source : réponse au questionnaire du président et du rapporteur au magistrat de liaison en Allemagne. 395 Audition du 22 mars 2006. 396 Audition du 11 avril 2006. 397 Audition du 27 mars 2006. 398 2003-466 DC, 20 février 2003. 399 Audition du 5 avril 2006. 400 98-396 DC du 19 février 1998 ; 2002-461 DC du 29 août 2002 ; 2003-466 DC du 20 février 2003 ; 2004-510 DC du 20 janvier 2005. 401 Audition du 28 février 2006. 402 Rapport p. 32. 403 Audition du 12 avril 2006. 404 Audition du 15 mars 2006. 405 La Croix, 5 décembre 2005. 406 La Croix, 3 mars 2006. 407 Audition du 19 janvier 2006. 408 Audition du 11 avril 2006. 409 98-396 DC du 19 février 1998 ; 2002-461 DC du 29 août 2002 ; 2003-466 DC du 20 février 2003 ; 2004-510 DC du 20 janvier 2005. 410 Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 14, p. 26. 411 2003-466 DC, 20 février 2003. 412 Audition du 1er mars 2006. 413 Audition du 16 mars 2006. 414 Table ronde : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations professionnelles » du 23 mars 2006. 415 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. 416 Audition du 14 mars 2006. 417 Audition du 8 février 2006. 418 Audition du 1er mars 2006. 419 Audition du 11 avril 2006. 420 Audition du 15 mars 2006. 421 Audition de M. Dominique Barella du 16 mars 2006. 422 Audition du 15 mars 2006. 423 Procédure pénale, Litec, 3e édition, 2005, p. 751. 424 Traité de droit criminel, procédure pénale, édition Cujas, 4e édition, 1989, p. 387. 425 Traité de droit criminel, procédure pénale, édition Cujas, 4e édition, 1989, p. 388. 426 Audition du 5 avril 2006. 427 Audition du 4 avril 2006. 428 Audition du 15 mars 2006. 429 Audition du 26 janvier 2006. 430 Audition de Me Hubert Delarue du 19 janvier 2006. 431 Audition de Me Thierry Marembert du 26 janvier 2006. 432 Audition du 26 janvier 2006. 433 Audition du 5 avril 2006. 434 Audition du 21 mars 2006. 435 Audition du 8 mars 2006. 436 Audition du 9 mars 2006. 437 La chambre de l'instruction a remplacé la chambre de l'accusation lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. 438 Audition du 28 février 2006. 439 Table ronde : « L'état de la réflexion sur la réforme de l'instruction » du 21 mars 2006. 440 Table ronde : « L'état de la réflexion sur la réforme de l'instruction » du 21 mars 2006. 441 Table ronde : « L'état de la réflexion sur la réforme de l'instruction » du 21 mars 2006. 442 Audition du 15 mars 2006. 443 Audition du 11 avril 2006. 444 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au Sénat belge. 445 Sources : réponses aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison en Espagne, en Italie et en République tchèque. 446 Audition du 31 janvier 2006. 447 Audition du 19 janvier 2006. 448 Audition du 24 janvier 2006. 449 Audition du 4 avril 2006. 450 Revue de métaphysique et de morale, n° 1, 1958. 451 Table ronde : « Quelle place pour les experts dans le procès pénal ? » du 5 avril 2006. 452 Table ronde : « Quelle place pour les experts dans le procès pénal ? » du 5 avril 2006. 453 Rapport Viout, p. 21. 454 Selon une analyse de la direction de la recherche des études et de l'évaluation statistique (N°443, novembre 2005), à numerus clausus et comportements constants, le nombre de psychiatres entre 2002 et 2025 pourrait connaître une diminution de 36 %. 455 La partie supplémentaire de la rémunération pourrait être fixée par le juge, selon la procédure en cours en matière civile « en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni » (article 284 du nouveau code de procédure civile). 456 Les deux principaux postes de dépense ont été les frais de réquisitions téléphoniques et les frais criminels d'expertises médicales, notamment génétiques. 457 M. Jacques Isorni, rapporteur du projet, Assemblée nationale, séance du 24 juillet 1957, p. 2781 du compte rendu intégral. 458 Source : réponse au questionnaire du président et du rapporteur aux magistrats de liaison au Canada. 459 Audition des médecins du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer du 11 janvier 2006. 460 Projet de loi, Sénat, n° 330, annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2006. 461 Audition du Dr Claude Reguet du 11 janvier 2006. 462 Rapport Viout, p. 45 et 46. 463 Audition du 10 janvier 2006. 464 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 465 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 466 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 467 Rapport Viout. 468 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 469 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 470 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 471 Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, n° 228, 23 septembre 1997, p. 95. 472 Circulaire du 20 avril 1999. 473 Rapport Viout, p. 13. 474 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 475 Table ronde : « Quelle place pour les experts dans le procès pénal ? » du 5 avril 2006. 476 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 477 Audition du 25 janvier 2006. 478 Source : réponse aux questionnaires du président et du rapporteur aux magistrats de liaison en Italie et au Royaume-Uni. 479 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 480 Table ronde : « Le recueil de la parole de l'enfant et sa défense » du 5 avril 2006. 481 Cf. chapitre II, première partie. 482 Audition du 1er mars 2006. 483 Rapport de M. Charles Jolibois, n°49, session ordinaire 1997-1998, p. 46. 484 Audition de M. Jean-Amédée Lathoud du 14 mars 2006. 485 Table ronde : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations professionnelles ; le regard du droit comparé » du 23 mars 2006. 486 Ordre des avocats de Paris, Commission pénale « Ensemble pour une meilleure justice », 14 mars 2006. 487 Audition de Me Éric Dupont-Moretti du 31 janvier 2006. 488 Audition du 11 avril 2006. 489 Audition du 15 mars 2006. 490 Audition du 15 mars 2006. 491 Table ronde : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations professionnelles, le regard du droit comparé » du 23 mars 2006. 492 Table ronde : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations professionnelles, le regard du droit comparé » du 23 mars 2006. 493 Table ronde : « La réforme de l'instruction : l'avis des organisations professionnelles, le regard du droit comparé » du 23 mars 2006. 494 Programme de formation initiale 2005, École nationale de la magistrature, p. 50. 495 De futurs avocats chez les élèves magistrats, Le Figaro, 3 mai 2006. 496 Audition du 27 mars 2006. 497 Audition du 31 janvier 2006. 498 Audition du 1er mars 2006. 499 Audition du 5 avril 2006. 500 Audition du 11 avril 2006. 501 Radio Notre Dame, interview reproduite dans La Croix, 19 mai 2006. 502 Audition du 5 avril 2006. 503 Audition du 16 mars 2006. 504 Audition du 29 mars 2006. 505 Audition du 11 avril 2006. 506 Audition du 4 avril 2006. 507 Audition du 16 mars 2006. 508 Audition du 5 avril 2006. 509 Audition du 11 avril 2006. 510 Audition du 27 mars 2006. 511 Audition du 11 avril 2006. 512 Audition du 11 avril 2006. 513 Audition du 14 mars 2006. 514 Audition du 16 mars 2006. 515 Audition du 27 mars 2006. 516 Les juges, Pouvoirs 74, 1995, Seuil, p. 135. 517 Idem p. 135. 518 Source : réponse aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison au Canada, aux États-Unis et en Italie. 519 Avis n° 3 (2002) sur les principes et les règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements et l'impartialité. 520 Note à la Commission d'éthique de juin 2003. 521 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 522 CSM, Recueil des décisions disciplinaires, 1959-2005, 2e trimestre 2006, Imprimerie administrative de Melun. 523 Note à la Commission d'éthique de juin 2003. 524 Rapport annuel 1999. 525 Rapport annuel 2004. 526 Audition du 31 janvier 2006. 527 Laurence Vichnievsky, Sans instructions, Stock, 2002, p. 182 et 183. 528 Le Figaro, 8 février 2006. 529 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 530 Audition du 16 mars 2006. 531 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au magistrat de liaison aux États-Unis. 532 Jérôme Betoulle, L'attitude à l'égard des magistrats dont le comportement est affecté par une maladie. Synthèse des contributions des cours d'appel, Bulletin d'information de la Cour de cassation, 15 octobre 2005. 533 Audition du 16 mars 2006. 534 Yves Chevalier, La gestion des ressources humaines dans le contexte de la LOLF, Les Cahiers de la fonction publique, avril 2006, p. 8 et s. 535 CE, 4 février 2005, Syndicat de la magistrature, req. 264843. 536 CE, 8 juillet 2005, M. de Montgolfier, req. 272283D. 537 Audition du 11 avril 2006. 538 Jérôme Betoulle, déjà cité. 539 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 540 CE, 17 juin 1998, Dages. 541 Article 1er du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ; article 1er du décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ; article 1er du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales. 542 Audition du 16 mars 2006. 543 Note de synthèse déontologie du 4 avril 2005. 544 Texte remis lors de la table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 545 Audition du 22 mars 2006. 546 Source : réponse aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison au Canada, en Espagne et aux États-Unis. 547 Audition du 11 avril 2006. 548 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 549 Audition du 12 avril 2006. 550 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 551 Audition de M. Dominique Barella, président de l'Union Syndicale des magistrats le 16 mars 2006. 552 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au magistrat de liaison au Royaume-Uni. 553 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 554 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 555 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 556 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 557 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 558 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 559 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au magistrat de liaison en Italie. 560 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 561 Audition de M. André Ride du 4 avril 2006. 562 Audition du 11 avril 2006. 563 M. Serge Guinchard, De l'irresponsabilité des juges d'instruction : pour combien de temps encore ? in Mélanges offerts au Professeur Pradel, Cujas, à paraître en 2006. 564 Mme Dominique Commaret, table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 565 Source : réponse aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison en Espagne et en Italie. 566 Source : réponse aux questionnaires envoyés par le président et le rapporteur aux magistrats de liaison en Espagne et en Italie. 567 M. Jean-Claude Magendie, La responsabilité des magistrats : contribution à une réflexion apaisée, Recueil Dalloz, 2005, n° 35, p. 2418. 568 M. Serge Guinchard, table ronde du 4 avril 2006. 569 M. Serge Guinchard, Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, n° 20, Dalloz, Répertoire de procédure civile, 2005. 570 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ République d'Autriche, aff. C-224/01, § 59, JCP 2003, éd. Adm. et collectivités territoriales, p. 1943, note O. Dubos ; Procédures, novembre 2003, n° 240, obs. C. Nourissat ; Europe, novembre 2003, chrono. D. Simon, p. 3 ; AJDA 2003, 2146, chron. J.M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; ibid. 2004, étude J. Courtial, p. 423, spéc. 427 et s. ; Gaz. Pal. 4 mars 2004, chron. I. Pingel ; V. aussi les conclusions Ph. Léger sur l'arrêt, Procédures 2003, n° 170. 571 M. Bruno Thouzellier, secrétaire national de l'USM, table ronde du 4 avril 2006. 572 Laurence Vichnievsky, opus cité, p. 181. 573 Ces chiffres sont ceux communiqués par la Chancellerie. Le CSM fait état, quant à lui, de 9 saisines disciplinaires (6 pour le siège, 3 pour le parquet) du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005. 574 M-A Frison-Roche, la responsabilité des magistrats : l'évolution d'une idée, Jurisclasseur périodique, n°42, 20 octobre 1999. 575 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 576 Audition du 12 avril 2006. 577 Ce cas est très voisin de celui cité supra p. 485 (cour d'appel de Paris, 25 octobre 2000). 578 Syndicat de la magistrature, 4 avril 2006, Commission parlementaire Un service public de la justice responsable. 579 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 580 Audition du 16 mars 2006. 581 Laurence Vichnievsky, opus cité, p. 181. 582 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 583 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 584 Table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 585 Audition du 22 mars 2006. 586 Sauf en Belgique, au sein du Conseil supérieur de la justice. 587 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au magistrat de liaison en Italie. 588 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur à l'Assemblée de la République portugaise. 589 Depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, l'aide publique est attribuée aux partis politiques ayant présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. 590 Mme Gracieuse Lacoste, table ronde : « La responsabilité des magistrats » du 4 avril 2006. 591 Audition du 16 mars 2006. 592 Audition du 14 mars 2006. 593 Systèmes judiciaires européens 2002, Commission européenne pour l'efficacité de la justice, Éditions du Conseil de l'Europe, p. 20. 594 Source : réponse au questionnaire envoyé par le président et le rapporteur au magistrat de liaison en Allemagne. 595 Sans préjudice des contributions personnelles de certains de ses membres. * Les numérotations renvoient aux chapitres correspondants de la seconde partie du rapport. 596 « L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 597 Une infraction pénale « d'atteinte à la présomption d'innoncence » pourrait également se substituer à l'actuelle « violation du secret de l'instruction ». © Assemblée nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
