

TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2009
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) (1)
sur le coût des opérations militaires extérieures,
notamment sous mandat international
et prÉsentÉ
par M. Louis GISCARD D’ESTAING et Mme Françoise OLIVIER-COUPEAU
Députés
___
MM. Georges TRON et David HABIB
Présidents.
____
La mission d’évaluation et de contrôle est composée de : MM. Georges Tron, David Habib, Présidents ; M. Didier Migaud, Président de la commission des Finances de l’économie générale et du Plan, M. Gilles Carrez, Rapporteur général ; MM. Pierre Bourguignon, Jean-Pierre Brard, Alain Claeys, Charles de Courson, Richard Dell’Agnola, Yves Deniaud, Jean-Louis Dumont, Jean-Michel Fourgous, Laurent Hénart, Jean Launay, François de Rugy, Philippe Vigier.
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE : LE COÛT DES OPEX, DE L’ÉVALUATION À LA MAÎTRISE 9
I.– L’OPEX : UN MODE D’OPÉRATION DEVENU CLASSIQUE POUR LES ARMÉES 9
A.– UNE ACTIVITÉ EN FORTE HAUSSE DEPUIS VINGT ANS 9
1.– Une importante participation humaine aux Opex 9
2.– Des retombées limitées pour l’économie française 10
B.– UN COÛT FINANCIER CROISSANT 11
1.– Une hausse continue et rapide du coût des Opex 11
2.– Un coût principalement lié aux frais de personnel 14
3.– Un coût évident en matériel 16
4.– Les effets d’équipement du personnel 16
5.– Les programmes d’urgence 17
C.– LE COÛT HUMAIN DES OPEX 19
1.– Une rotation de plus en plus importante 19
2.– Un coût croissant en vies humaines 19
II.– LA DIFFICULTÉ DE CALCULER LE COÛT DES OPEX 23
A.– UNE CHARGE NETTEMENT SOUS-ÉVALUÉE 23
1.– La controverse entre le ministère de la Défense et celui du Budget 23
2.– D’importantes différences par rapport à nos alliés 24
3.– Trop de coûts structurels ne sont pas pris en compte 25
4.– Une sous-budgétisation initiale chronique 26
5.– Des conséquences financières lourdes 27
6.– Le rôle du Centre de préparation et de conduite des opérations (CPCO) 27
B.– DÉFENSE OU AIDE AU DÉVELOPPEMENT ? 28
1.– L’aide médicale aux populations 28
2.– Les actions civilo-militaires 28
3.– Le soutien aux autres armées 29
III.– LA COMPLEXITÉ DES OPÉRATIONS MULTILATÉRALES 30
A.– L’ONU, UNE ADMINISTRATION PROCÉDURIÈRE 30
1.– Des procédures variables 30
2.– Un barème précis et contractualisé 30
3.– Une organisation administrative qui exerce des contrôles rigoureux 32
4.– Une procédure de remboursement longue dont le suivi est complexe 32
5.– Le remboursement ne couvre pas toutes les dépenses 33
B.– L’UNION EUROPÉENNE ET L’OTAN 33
1.– Les financements à l’Otan 34
2.– Le dispositif Athéna de l’Union européenne 35
3.– La délicate transition entre l’Union européenne et l’ONU au Tchad 35
4.– Il est temps de mettre en œuvre Euro recamp 36
IV.– LES PISTES DE RÉFLEXION POUR RÉDUIRE LES COÛTS 38
A.– QUELQUES PROPOSITIONS CONCRÈTES 38
1.– Améliorer la budgétisation initiale des Opex et leur suivi 38
2.– Standardiser et bâtir en « dur » le plus tôt possible 39
3.– Établir des relations plus « réalistes » avec nos partenaires 40
4.– Substituer, lorsque cela est plus économique, l’achat à la location 41
5.– En matière de piraterie, impliquer les assureurs 42
6.– Pouvoir utiliser le matériel pris à l’adversaire 43
B.– L’EXTERNALISATION, SOURCE D’ÉCONOMIE ? 43
1.– La problématique de l’externalisation en Opex 43
2.– Les risques politiques liés à l’externalisation 44
3.– Les conséquences de l’externalisation sur la main-d’œuvre locale 45
4.– Un bénéfice financier pas toujours certain 45
SECONDE PARTIE : LES CINQ OPEX MAJEURES 46
I.– L’OPÉRATION LICORNE EN CÔTE D’IVOIRE 46
A.– HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 46
1.– Une opération menée sous l’égide des Nations unies 46
2.– Des moyens adaptés à une menace réelle 46
B.– UN TRIPLE SUCCÈS 47
1.– Le conflit a été interrompu avant qu’il ne dégénère 47
2.– L’activité économique du pays a été préservée 47
3.– Les ressortissants français ont été efficacement protégés 47
C.– LE SOUCI DE MAÎTRISER LA DÉPENSE 48
1.– Un ajustement constant des moyens 48
2.– Un rapport coût/résultat très satisfaisant 48
D.– LES AVANTAGES QU’EN RETIRENT LES POPULATIONS LOCALES 49
1.– Les retombées économiques 49
2.– L’assistance humanitaire 49
II.– L’OPÉRATION DAMAN AU LIBAN 50
A.– HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 50
1.– Les règles posées par l’ONU 50
2.– La résolution 1701 du 11 août 2006 50
B.– L’ORGANISATION 51
1.– Des effectifs substantiels 51
2.– L’organisation tactique 51
C.– LA PLACE ÉMINENTE DE LA FRANCE DANS LE DISPOSITIF ONUSIEN 52
1.– Une large palette de compétences 52
2.– Le groupement tactique interarmes et de la Force de réaction rapide 52
III.– L’OPÉRATION TRIDENT AU KOSOVO 53
A.– UNE OPÉRATION INTERNATIONALE EN PASSE DE RÉUSSIR 53
1.– Des effectifs confortables, compte tenu de la superficie du théâtre 53
2.– Un coût qui apparaît comme modéré 54
B.– LE DÉSENGAGEMENT EST ENTAMÉ EN DÉPIT D’INCERTITUDES 54
1.– Des interrogations subsistent 54
2.– Vers un retrait progressif 55
IV.– LE TCHAD ET LE CENTRAFRIQUE 56
A.– UNE JUXTAPOSITION D’OPÉRATIONS MULTINATIONALES 56
1.– Des opérations nationales depuis les années 80 56
2.– L’opération Eufor mise en place en 2008 56
3.– La Minurcat n’est pas au rendez-vous 57
B.– DES MOYENS MILITAIRES SUBSTANTIELS 57
1.– Eufor a bénéficié de la logistique d’Épervier 57
2.– Un coût important en raison de l’enclavement du théâtre 58
V.– L’AFGHANISTAN 60
A.– UNE OPÉRATION MULTINATIONALE COMPLEXE 60
1.– Deux opérations distinctes : Enduring freedom et Pamir 60
2.– Un nombre important de pays impliqués à des degrés divers 61
3.– Des pertes élevées 61
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA MEC 65
EXAMEN EN COMMISSION 69
ANNEXES 77
Depuis près de deux décennies, la France projette en permanence 10 000 à 12 000 de ses militaires, qui participent à des opérations extérieures souvent périlleuses, en plus de ceux prépositionnés dans des pays avec lesquels la France a signé des accords.
Ces opérations ont un coût élevé, en augmentation continue. Évalué à 852 millions d’euros en 2008 (830 millions d’euros hors gendarmerie) et probablement sous-estimé, ce coût ne devrait guère se réduire compte tenu de l’implication croissante de notre pays sur un théâtre particulièrement onéreux : l’Afghanistan.
Outre la croissance préoccupante des coûts se pose la question du contrôle de la dépense, l’expérience montrant que la budgétisation des opérations en loi de finances initiale, amorcée voici cinq ans, reste inachevée.
La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a, en la matière, renforcé l’information du Parlement ainsi que son rôle décisionnel. Lorsqu’une opération extérieure est décidée, le Gouvernement doit en informer l’Assemblée nationale et le Sénat dans les trois jours ; lorsque l’opération se prolonge au-delà de quatre mois, l’autorisation du Parlement est alors requise.
Cette plus grande implication du Parlement sur le plan politique et opérationnel a conduit ses représentants à s’intéresser également à l’aspect financier des opérations extérieures, devenues désormais un mode de fonctionnement classique des armées. C’est pourquoi la question du coût de ces opérations a été inscrite au programme de la Mission d’évaluation et de contrôle, la MEC. Ont été désignés comme Rapporteurs M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur spécial sur le budget opérationnel de la défense, membre du groupe UMP, et Mme Françoise Olivier-Coupeau, membre de la commission de la Défense nationale et des forces armées, appartenant au groupe SRC.
La banalisation des opérations extérieures a conduit les Rapporteurs à abandonner la notion de « surcoût », qui fait apparaître l’Opex comme un coût supplémentaire par rapport à un usage plus traditionnel de protection du territoire national par nos armées. C’est donc la notion de « coût » qui sera étudiée dans le présent rapport : l’opération extérieure est devenue un élément constitutif du mode de fonctionnement de nos forces ainsi qu’une contrainte de la condition militaire intégrée par les recrues dès la signature de leur contrat d’engagement, avec ses risques, ses inconvénients matériels et ses avantages pécuniaires.
Mais les Opex, pour être devenues une dimension durable du fonctionnement des armées ne doivent être banalisées et financées sur le budget de fonctionnement initial de la mission Défense. Outre leur relative imprévisibilité, le budget de la défense est bâti de manière à répondre à la mission assignée aux armées : le respect du contrat opérationnel tel que décrit par le Livre blanc sur la défense et confirmé par la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014. Les opérations extérieures doivent donc continuer d’être distinguées, au sein de la mission Défense, par un budget opérationnel de programme (BOP) spécifique, inscrit en loi de finances initiale, et éventuellement ajusté en cours d’exercice en fonction des circonstances.
*
* *
L’intervention de la MEC a principalement été motivée par une exigence de contrôle démocratique sur un poste majeur de dépenses de l’État. Il ne pouvait s’agir en aucune façon d’empiéter sur les compétences constitutionnelles du chef de l’État ni du Gouvernement s’agissant des décisions d’engager les forces armées et de définir leurs missions. L’objet n’était pas davantage de soumettre la défense à une approche strictement financière. La démarche de la MEC, dans ce domaine comme dans les autres, aura été inspirée par la recherche de l’efficience de la dépense publique. Les Rapporteurs ont donc souhaité examiner l’optimisation des moyens mis au service de la politique militaire extérieure de la France. Les Opex doivent être menées au meilleur coût, et non au moindre coût.
Parallèlement, il importe que le budget et les procédures budgétaires permettent aux armées de remplir leur contrat et d’appliquer au mieux les décisions politiques.
Pour mener à bien ses travaux, la mission a procédé à une série d’auditions dont la liste est jointe en annexe. Les Rapporteurs se sont rendus sur trois théâtres d’Opex aux caractéristiques contrastées : le Kosovo, le Tchad et l’Afghanistan. La mission a, en outre, bénéficié, dans un esprit de coopération exemplaire, de l’expertise des magistrats de la deuxième chambre de la Cour des comptes qui, eux-mêmes, conduisaient un contrôle sur les Opex qui vient de s’achever.
Au terme de quatre mois de travail, la mission d’évaluation et de contrôle, conformément à sa vocation, présente vingt propositions visant à améliorer la connaissance du coût des opérations extérieures et en assurer la maîtrise. Ces propositions, non seulement ne devraient rien coûter au contribuable, mais ont été choisies pour leur contribution à la réduction de la dépense publique.
PREMIÈRE PARTIE : LE COÛT DES OPEX, DE L’ÉVALUATION À LA MAÎTRISE
La France présente la caractéristique de participer à cinq opérations extérieures majeures, à l’inverse de pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas qui sont présents, parfois en force, sur un nombre réduit de théâtres. Cette dispersion génère un coût financier important en matière de logistique, de transport, de service de santé, d’états-majors…
Les Opex comprennent en général deux phases successives : une phase d’intervention suivie d’une phase de stabilisation et de développement. En France, les acteurs agissent en ordre dispersé (ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, au titre des missions budgétaires Action extérieure de l’État et Aide publique au développement) à l’inverse d’autres pays qui présentent un interlocuteur unique. Au cœur du débat sur le coût des opérations extérieures apparaît l’imprécise articulation entre militaires et civils pour gérer la sortie de crise qui est la phase la plus longue et la plus coûteuse.
I.– L’OPEX : UN MODE D’OPÉRATION DEVENU CLASSIQUE POUR LES ARMÉES
A.– UNE ACTIVITÉ EN FORTE HAUSSE DEPUIS VINGT ANS
1.– Une importante participation humaine aux Opex
Avec environ 12 000 hommes et femmes (effectif moyen annuel) en opérations extérieures participant à trente opérations – d’inégale importance – de gestion de crise à travers le monde, la France est aujourd’hui l’une des puissances les plus engagées dans ce type d’opérations internationales. Parmi les pays comparables, seul le Royaume-Uni atteint un niveau équivalent au nôtre avec environ 15 000 militaires déployés à l’étranger, principalement en Irak et en Afghanistan.
La Cour des comptes, qui a travaillé en même temps que l’Assemblée nationale sur le coût des opérations extérieures(2), a calculé que le déploiement permanent de 12 000 militaires hors de nos frontières nécessitait, compte tenu de la durée des séjours individuels, la rotation d’environ 40 000 militaires. En 2003, année d’activité particulièrement intense, ce sont 51 097 hommes et femmes qui ont servi en Opex, à tour de rôle.
La quasi-totalité des forces déployées et des ressources financières consacrées par la France aux opérations extérieures est concentrée sur les cinq théâtres les plus importants :
– en Afghanistan, depuis 2001, à la fois sur une base d’une coalition ad hoc (opération Enduring freedom) et au titre de l’OTAN (opération Pamir), la France déploie au total 3 400 hommes dans ces deux opérations ainsi que dans les détachements air basés au Kirghizstan et au Tadjikistan et dans l’opération navale Héraclès ;
– au Kosovo, la France participe à hauteur d’environ 1 600 personnels à la KFOR (Kosovo force) de l’OTAN et de 160 hommes à la mission EULEX de l’Union européenne ;
– au Liban, le contingent français de 1 500 militaires est le deuxième en volume de l’opération des Nations unies (FINUL), derrière le contingent italien ;
– aux confins du Darfour, où la France déploie 1 600 soldats au Tchad et au Centrafrique dans la mission Eufor de l’Union européenne depuis janvier 2008. 1 140 hommes sont également déployés au Tchad dans le dispositif Épervier depuis 1986 tandis que 230 hommes sont présents au Centrafrique dans le cadre de l’opération Boali depuis 2003 ;
– en Côte d’Ivoire où la France, engagée dans l’opération Licorne, déploie 1 810 militaires auxquels s’ajoutent 200 autres au titre de la contribution française à l’ONUCI.
Depuis le début des années 2000, le volume moyen de nos forces déployées est relativement constant, la diminution des besoins humains sur certains théâtres stabilisés étant compensée par l’augmentation parallèle des exigences sur les nouveaux théâtres de crise.
2.– Des retombées limitées pour l’économie française
Certains pays, confrontés comme la France à la hausse continue du coût des Opex essaient de compenser en faisant participer largement leurs entreprises nationales aux travaux de reconstruction. C’est le cas de la plupart des pays anglo-saxons, mais aussi de l’Allemagne, voire de la Turquie, très présente sur les théâtres afghan, libanais ou kosovar. Ces nations utilisent notamment des réservistes issus de grandes entreprises qui profitent de leur présence sur le terrain dans des structures militaires et de leurs carnets d’adresses pour prospecter les marchés dont beaucoup sont financés par des fonds onusiens ou européens.
Les Français ne partagent pas cet état d’esprit et privilégient plutôt les entreprises locales pour deux raisons :
– d’une part, en raison de l’absence des entreprises françaises, peu intéressées par les théâtres supposés instables et qui négligent le rôle d’information voire de prospective qui pourrait être joué par des réservistes issus de leurs rangs. Si l’absence des entreprises française est flagrante sur un théâtre aussi lointain que l’Afghanistan, il l’est malheureusement presque autant au Tchad, pays francophone et dont les liens avec notre pays sont particulièrement anciens et étroits ;
– d’autre part, en raison de la volonté de privilégier les entreprises et la main-d’œuvre locales, pour stabiliser l’économie des régions en crise.
Sans remettre en cause la louable volonté d’impliquer les entreprises locales à la reconstruction de leur pays, les rapporteurs déplorent le faible engagement des entreprises françaises dans les opérations de reconstruction et de soutien de nos armées. L’engagement de notre pays au service de la paix, coûteux à la fois sur le plan humain et sur le plan financier, ainsi que la présence de nos forces armées sur la plupart des théâtres d’opérations extérieures légitiment entièrement la participation des entreprises françaises aux marchés attribués sur des fonds internationaux.
B.– UN COÛT FINANCIER CROISSANT
1.– Une hausse continue et rapide du coût des Opex
On constate depuis quelques années une évolution très nette à la hausse des coûts générés par les opérations extérieures. Ainsi, entre 2006 et 2008, à effectifs déployés quasi constants, les surcoûts ont augmenté de près de 250 millions d’euros, soit une hausse de plus de 40 %. Globalement, l’augmentation du coût des opérations extérieures depuis le début des années 2000 est liée au renchérissement du soutien logistique de nos troupes sur des théâtres désormais plus lointains, à des dépenses de munitions croissantes dans des engagements de plus en plus violents et à l’accroissement important des contributions financières versées à l’Otan et à l’Union européenne.
Le coût budgétaire pour la France des opérations extérieures comprend :
– d’une part les contributions aux organismes internationaux pour le financement des opérations de maintien de la paix, versées à partir du budget du ministère des Affaires étrangères et européennes. Ces contributions se sont élevées à 380 millions d’euros en 2008 ;
– d’autre part les coûts des opérations à la charge du ministère de la Défense. Pour 2008, cette charge financière a été estimée à 852 millions d’euros (3).
Hormis pour ce qui concerne les opérations conduites sous l’égide de l’ONU, le caractère multilatéral d’une opération n’apporte guère d’allègement du fardeau financier, la règle à l’Otan et à l’Union européenne étant que les nations contributrices assument l’essentiel des coûts des opérations qu’elles conduisent dans le cadre de ces deux structures.
EFFECTIFS EN OPEX EN 2007
Zone |
Opération |
Effectifs Opex 2007 |
Total par zone | |||||
Terre |
Air |
Mer |
Gendarmerie |
DCSSA |
DCSEA | |||
Tchad |
Epervier |
733 |
331 |
9 |
5 |
23 |
13 |
1 525 |
Boali |
392 |
0 |
0 |
5 |
12 |
2 | ||
Asie |
Heracles |
21 |
392 |
588 |
1 |
0 |
2 270 | |
Pamir |
1 032 |
156 |
1 |
5 |
30 |
5 | ||
Epidote |
37 |
1 |
1 |
0 |
||||
R.C.I |
Licorne |
2 608 |
147 |
23 |
160 |
66 |
21 |
3 218 |
Onuci |
178 |
2 |
1 |
10 |
2 |
0 | ||
Liban |
Daman |
1 553 |
0 |
5 |
5 |
23 |
0 |
1 763 |
Baliste |
0 |
177 |
0 |
0 |
||||
Balkans |
Trident |
1 671 |
17 |
15 |
179 |
61 |
20 |
2 297 |
Astrée |
284 |
12 |
4 |
25 |
6 |
3 | ||
Autres |
100 |
63 |
147 |
44 |
0 |
354 | ||
Total |
8 609 |
1 121 |
971 |
439 |
223 |
64 |
11 427 | |
NB : sous l’appellation « Asie » sont regroupés les militaires déployés en Afghanistan, mais aussi ceux présents à Manas (Kirghizstan) et à Douchanbé (Tadjikistan)
PRÉVISIONS DES EFFECTIFS EN OPEX EN 2008
Zone |
Opération |
Effectifs moyens 2008 (hors relèves et renforts temporaires) |
Total par opération |
Total par zone | ||||||
Terre |
Air |
Mer |
Gendarmerie |
DCSSA |
DCSEA |
DRM | ||||
Tchad |
Epervier |
790 |
312 |
10 |
5 |
23 |
13 |
5 |
1 158 |
2 780 |
Eufor |
1 171 |
160 |
10 |
3 |
16 |
2 |
1 362 |
|||
Boali |
255 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
260 |
|||
Asie |
Heracles |
21 |
230 |
311 |
15 |
1 |
578 |
|||
Pamir |
1 685 |
303 |
64 |
12 |
30 |
5 |
12 |
2 111 |
2 726 | |
Epidote |
35 |
1 |
1 |
37 |
||||||
R.C.I |
Licorne |
1 651 |
90 |
26 |
108 |
51 |
20 |
7 |
1 953 |
2 333 |
Onuci |
181 |
2 |
2 |
10 |
195 |
|||||
Corymbe |
185 |
185 |
||||||||
Liban |
Daman |
1 525 |
11 |
248 |
5 |
22 |
1 |
4 |
1 816 |
1 816 |
Balkans |
Trident |
1 726 |
19 |
15 |
162 |
62 |
20 |
11 |
2 015 |
2 131 |
Astree |
80 |
1 |
4 |
23 |
3 |
3 |
2 |
116 |
||
Autres |
Divers |
127 |
50 |
4 |
24 |
205 |
205 | |||
Total |
9 247 |
1 179 |
880 |
370 |
207 |
66 |
42 |
11 991 |
11 991 | |
Source : ministère de la Défense
EFFECTIFS PRÉVISIONNELS 2009 (HORS RELÈVES ET RENFORTS) | ||||||||||||||
Opérations |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Sept |
Oct |
Nov |
Déc |
Moyenne | |
Afrique Centrale |
EUFOR |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
1 200 |
ÉPERVIER |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 | |
BOALI |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 | |
Total |
3 001 |
3 001 |
3 001 |
3 001 |
3 001 |
3 001 |
2 001 |
2 001 |
2 001 |
2 001 |
2 001 |
2 001 |
2 501 | |
Asie |
HERACLES |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
602 |
3 402 |
3 402 |
1 069 |
PAMIR |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
2 607 | |
EPIDOTE |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 | |
Total |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
3 247 |
6 047 |
6 047 |
3 714 | |
Afrique de l’Ouest |
LICORNE |
1 719 |
1 719 |
1 719 |
1 719 |
1 719 |
1 719 |
819 |
819 |
819 |
819 |
819 |
819 |
1 269 |
ONUCI |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 | |
CORYMBE |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 | |
Total |
2 012 |
2 012 |
2 012 |
2 012 |
2 012 |
2 012 |
918 |
918 |
918 |
918 |
918 |
918 |
1 465 | |
Afrique de l’Est |
ATALANTE |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Liban |
DAMAN |
2 074 |
1 974 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 749 |
Balkans |
TRIDENT |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 623 |
ASTREE |
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 | |
Total |
1 863 |
1 863 |
1 863 |
1 773 |
1 773 |
1 773 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 473 |
1 646 | |
Autres |
DIVERS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
TOTAL |
12 457 |
12 357 |
12 077 |
11 987 |
11 987 |
11 987 |
9 593 |
9 593 |
9 593 |
9 593 |
12 393 |
12 393 |
11 335 | |
Source : ministère de la Défense
VENTILATION DU COÛT DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (Y COMPRIS GENDARMERIE)
(en millions d’euros)
Titres |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Rémunérations (T2) |
326 |
410 |
375 |
369 |
336 |
332 |
354 |
376 |
Alimentation |
27 |
33 |
39 |
41 |
39 |
41 |
36 |
24 |
Fonctionnement |
52 |
66 |
77 |
62 |
55 |
46 |
74 |
151 |
Transports |
13 |
29 |
68 |
67 |
60 |
75 |
73 |
74 |
Carburants |
22 |
31 |
26 |
27 |
30 |
43 |
48 |
41 |
MCO à partir de 2006 |
|
|
|
|
|
30 |
50 |
48 |
Total fonctionnement (T3) |
115 |
160 |
210 |
196 |
185 |
236 |
280 |
338 |
Total titres 2 et 3 |
441 |
570 |
585 |
565 |
520 |
569 |
634 |
714 |
MCO (1) (jusqu’en 2006) |
19 |
72 |
37 |
44 |
21 |
0 |
0 |
|
Fabrications |
33 |
9 |
10 |
9 |
5 |
1 |
4 |
17 |
Munitions |
5 |
7 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
Infrastructures |
28 |
20 |
21 |
12 |
4 |
2 |
12 |
12 |
Total investissement (T5) |
85 |
108 |
69 |
68 |
33 |
4 |
16 |
30 |
Intervention (T6) |
|
|
|
|
|
31 |
34 |
108 |
TOTAL GÉNÉRAL |
525 |
678 |
654 |
633 |
553 |
603 |
685 |
852 |
(1) Maintien en condition opérationnelle
Source : ministère de la Défense
2.– Un coût principalement lié aux frais de personnel
Les rémunérations et cotisations sociales constituent le premier poste de dépenses d’une opération extérieure (près de 50 %), loin devant les frais de fonctionnement, d’investissement ou d’intervention.
Cette situation est liée à la conception française du revenu versé aux militaires. Outre la solde brute, chaque militaire perçoit, quelle que soit son affectation organique et géographique, une indemnité pour charge militaire (ICM) destinée à compenser les contraintes du métier des armes : disponibilité, mobilité, risque… Cette prime, d’un coût modéré, varie de 152 euros pour un militaire du rang à 851 euros pour un officier général.
Une autre indemnité, l’ISSE (indemnité de sujétions pour service à l'étranger), est versée en sus aux soldats servant en opération extérieure. D’un montant beaucoup plus élevé (de 1 988 à 7 644 euros par mois selon le grade), elle est destinée à compenser l’éloignement du militaire de sa famille pendant plusieurs mois, avec toutes les contraintes humaines, matérielles et financières que cela induit : garde des enfants, gestion du foyer au quotidien… Cette indemnité conduit à plus que doubler le revenu du militaire en opération.
D’autres pays, comme le Royaume-Uni, ont adopté une logique différente : considérant l’opération extérieure comme le mode de fonctionnement classique de leur armée, les Britanniques versent à leurs militaires une solde de base bien plus élevée que celle attribuée aux soldats français. En revanche, le service sur un théâtre étranger ne donne lieu – depuis peu – qu’à une faible indemnité forfaitaire.
COMPARAISON ENTRE LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES EN OPEX PAR LES ARMÉES FRANÇAISE ET BRITANNIQUE
Soldes françaises (en euros) | |||||||
Grades |
Solde brute |
ICM et prime de qualification minimum par mois |
ISSE |
Total |
Total sur 6 mois sans Opex |
Total sur 12 mois dont 6 en Opex |
Total sur 12 mois sans Opex |
Général de brigade |
5 096 |
851 |
7 644 |
72 090 |
31 043 |
103 133 |
62 087 |
Colonel |
3 578 |
851 |
5 368 |
52 026 |
23 119 |
75 145 |
46 239 |
Lieutenant-colonel |
2 993 |
851 |
4 490 |
44 292 |
20 066 |
64 358 |
40 131 |
Commandant |
2 655 |
851 |
3 983 |
39 846 |
18 301 |
58 147 |
36 603 |
Capitaine |
2 216 |
698 |
3 325 |
33 246 |
15 211 |
48 457 |
30 422 |
Lieutenant |
1 828 |
636 |
2 742 |
27 797 |
12 862 |
40 659 |
25 724 |
Adjudant-chef |
1 942 |
270 |
2 913 |
27 324 |
11 547 |
38 871 |
23 093 |
Adjudant |
1 773 |
261 |
2 660 |
25 050 |
10 617 |
35 667 |
21 235 |
Sergent-chef |
1 444 |
224 |
2 166 |
20 514 |
8 707 |
29 221 |
17 414 |
Sergent |
1 357 |
219 |
2 036 |
19 350 |
8 227 |
27 577 |
16 453 |
Caporal-chef |
1 407 |
152 |
2 111 |
19 638 |
8 138 |
27 776 |
16 276 |
Caporal |
1 325 |
152 |
1 988 |
18 558 |
7 710 |
26 268 |
15 420 |
Militaire du rang |
1 325 |
152 |
1 988 |
18 558 |
7 710 |
26 268 |
15 420 |
Soldes britanniques (en euros) | |||||||
Grades |
Solde de base |
Longer separated service allowance |
Operational allowance |
Total |
Total sur 6 mois sans Opex |
Total sur 12 mois dont 6 en Opex |
Total sur 12 mois sans Opex |
Somme forfaitaire allouée pour un séjour de 6 mois | |||||||
Général de brigade |
8 591 |
1 213 |
2 652 |
55 411 |
51 546 |
106 957 |
103 092 |
Colonel |
7 199 |
1 213 |
2 652 |
47 059 |
43 194 |
90 253 |
86 388 |
Lieutenant-colonel |
5 933 |
1 213 |
2 652 |
39 463 |
35 598 |
75 061 |
71 196 |
Commandant |
4 227 |
1 213 |
2 652 |
29 227 |
25 362 |
54 589 |
50 724 |
Capitaine |
3 357 |
1 213 |
2 652 |
24 007 |
20 142 |
44 149 |
40 284 |
Lieutenant |
2 081 |
1 213 |
2 652 |
22 933 |
19 068 |
42 001 |
38 136 |
Adjudant-chef |
3 726 |
1 213 |
2 652 |
26 221 |
22 356 |
48 577 |
44 712 |
Adjudant |
3 701 |
1 213 |
2 652 |
26 071 |
22 206 |
48 277 |
44 412 |
Sergent-chef |
3 271 |
1 213 |
2 652 |
23 491 |
19 626 |
43 117 |
39 525 |
Sergent |
2 900 |
1 213 |
2 652 |
21 265 |
17 400 |
38 665 |
34 800 |
Caporal-chef |
2 442 |
1 213 |
2 652 |
18 517 |
14 652 |
33 169 |
29 304 |
Caporal |
2 139 |
1 213 |
2 652 |
16 699 |
12 834 |
29 533 |
25 668 |
Militaire du rang |
1 506 |
1 213 |
2 652 |
12 901 |
9 036 |
21 937 |
18 072 |
Source : ministère de la Défense
Les tableaux qui précèdent peuvent donner le sentiment que, sur une période d’un an dont six mois en Opex, les soldes versées par les deux armées sont comparables, voire légèrement supérieures pour les Britanniques ; cette impression mérite d’être nuancée dans la mesure où les primes, françaises comme britanniques, ne sont pas imposables. Or, le montant de l’ISSE française étant largement supérieur au cumul des primes britanniques, du moins chez les officiers, la situation financière de nos militaires les plus gradés est bien plus avantageuse que celle de leurs homologues.
3.– Un coût évident en matériel
Les opérations extérieures ne se caractérisent pas seulement par leurs coûts en rémunérations, mais également par un coût en matériel difficile à évaluer mais bien réel en raison de l’usure prématurée des équipements, très sollicités.
À titre d’exemple, un véhicule de l’avant blindé (VAB) parcourt 3 000 kilomètres par mois sur les mauvaises pistes libanaises, alors qu’il roule trois fois moins lorsqu’il est stationné dans son régiment, en France.
Sur les routes caillouteuses et abruptes du Sud Liban ou d’Afghanistan, les chenilles des véhicules blindés s’usent infiniment plus vite qu’en France d’autant que ces engins sont alourdis par les deux tonnes de surblindage qui leur est ajouté sur ces théâtres spécifiques. Les semelles, ces parties en caoutchouc qui protègent les patins métalliques des chenilles, doivent être changées en moyenne toutes les trois semaines, sous peine de voir les chenilles se détériorer. Sur le seul théâtre libanais, 5 500 semelles pour AMX 10P sont consommées en une année.
Les systèmes de roulement ne sont pas les seuls à souffrir : les boîtes de vitesses, éléments de suspension et autres organes sollicités sont changés plus fréquemment qu’à l’accoutumée sur un théâtre extérieur.
Le soutien de ces matériels s’avère donc particulièrement lourd et coûteux sur un théâtre d’opération situé à plusieurs milliers de kilomètres de la France et ravitaillé par voie maritime ou aérienne. Pour autant, il n’est pas question de transiger sur l’entretien du matériel. En effet, la disponibilité et le bon entretien des matériels constituent d’abord un gage de sécurité pour les militaires… et aussi une condition sine qua non du remboursement onusien le cas échéant.
4.– Les effets d’équipement du personnel
Au cours des opérations extérieures, les effets d’habillement s’usent beaucoup plus vite qu’en France métropolitaine : les treillis sont portés sept jours sur sept, du matin au soir, alors qu’en métropole, les militaires alternent l’usage du treillis et de l’uniforme. Par ailleurs, lorsqu’ils ne sont pas en opération, les militaires bénéficient de repos hebdomadaires pendant lesquels ils s’habillent en civil, ce qui n’est pas le cas sur un théâtre extérieur.
De la même manière, les bottes et rangers sont davantage sollicitées, s’usent plus vite sur des terrains rocailleux et doivent être renouvelées plus souvent. Un type de bottes spécifique a dû être mis au point pour le théâtre afghan qui se caractérise par ses vastes surfaces empierrées. Mais tous nos soldats n’en sont pas encore équipés.
En opérations extérieures, les militaires ne se séparent pas de leurs armes légères, ce qui induit, outre une usure plus importante, un certain nombre de pertes ou de vols qui finissent par peser d’un coût non négligeable, surtout lorsque les forces spéciales sont amenées à racheter discrètement les armes dérobées pour éviter qu’elles ne se retrouvent dans de mauvaises mains.
Enfin, au-delà des coûts supportés par la Nation, il convient de ne pas négliger le coût supporté par les militaires eux-mêmes qui acquièrent parfois sur leurs propres deniers des équipements jugés utiles, bien que non fournis par le ministère de la Défense. Sans qu’il soit toujours facile de discerner ce qui relève de l’essentiel de ce qui tient plutôt de l’effet de mode, et nonobstant l’interdiction de tels achats faite par le chef d’état-major des armées, les rapporteurs ont rencontré des soldats ayant acheté eux-mêmes des effets d’habillement (gilets légers), des accessoires tels que des lampes à fixer sur le Famas, des gants spéciaux pour tireurs d’élite… Les rapporteurs ont pu constater, notamment en Afghanistan, les réels efforts consentis par les armées pour améliorer cet aspect de l’équipement de nos militaires.
Certaines opérations extérieures mettent en évidence des besoins en matériels qui n’avaient pas été pris en considération à l’origine. Il s’agit généralement de petits programmes ou de programmes dits de « cohérence », très utiles dans l’accomplissement quotidien des missions, notamment sur le plan de la sécurité des forces, mais qui n’ayant pas un caractère emblématique, sont les premiers à être sacrifiés lorsque surviennent les difficultés budgétaires.
C’est sur le théâtre afghan, le plus dangereux, que se sont fait ressentir les besoins les plus criants. Citons notamment :
– les gilets pare-balle de type 4, plus protecteurs mais aussi plus ergonomiques que ceux de la précédente génération. Tous les soldats français engagés en Afghanistan en sont désormais dotés ;
– les véhicules articulés chenillés (VAC) et les véhicules à haute mobilité (VHM), particulièrement bien adaptés au difficile relief afghan. Réclamés depuis plusieurs années par l’état-major de l’armée de terre, les choix budgétaires n’avaient pas permis de les acquérir jusqu’à présent. C’est dans l’urgence qu’ils ont été commandés aux sociétés qui les commercialisent : l’entreprise finlandaise Hagglünds et la firme singapourienne Bronco ;
– les tourelleaux téléopérés qui sont en cours d’installation sur les véhicules de l’avant blindés (VAB). Ces appareils permettent de manipuler la mitrailleuse, le projecteur et les caméras depuis l’intérieur du véhicule, alors que les opérateurs devaient, jusqu’à présent, sortir la tête hors du blindé, s’exposant dangereusement ;
– les brouilleurs installés sur les véhicules blindés et destinés à intercepter le signal qui déclanche l’explosion des engins explosifs improvisés déposés sur le bord des routes ;
– les engins de détection d’explosifs improvisés de type Buffalo. Ces gros camions blindés, acquis à seulement quelques exemplaires, permettent de manipuler à distance, grâce à un bras téléguidé, les engins suspects se trouvant sur le bord de la route et susceptibles de contenir des explosifs. C’est l’exemple le plus typique de l’achat d’urgence inévitable, les engins explosifs improvisés étant apparus sur le théâtre afghan.
Proposition n° 1 – Mettre en place un indicateur de performance destiné à mesurer le montant des achats réalisés en urgence et le délai entre l’expression du besoin et la délivrance des équipements aux armées sur le théâtre.
Si certains achats réalisés en urgence, comme les chenillettes, auraient pu être anticipés, la plupart des besoins justifiant ces programmes apparaissent en cours d’opération rendant un processus d’acquisition dans l’urgence inévitable.
Les programmes d’achat réalisés dans l’urgence ne permettent pas de réaliser des appels d’offres très élaborés, avec un cahier des charges. L’acheteur est tenu de prendre ce qu’il trouve sur le marché avec une marge de négociation particulièrement réduite compte tenu la nécessité de recevoir l’équipement au plus vite. En 2008, le coût des programmes d’urgence a été estimé à environ 100 millions d’euros. Cette somme n’est pas prise en compte dans le calcul du coût des opérations car le ministère du Budget considère que les équipements en question ont une durée de vie supérieure à l’opération concernée et seront rapatriés à la fin de l’opération pour être réutilisés. Cette conception ne reflète que partiellement la réalité : compte tenu de la durée croissante des opérations extérieures et de l’usure prématurée du matériel qu’elles entraînent, une grande partie des équipements achetés en urgence et fortement sollicités sur des théâtres difficiles ne pourront être redéployés en métropole ou sur un autre théâtre.
Proposition n° 2 – Inclure dans le coût budgétaire des Opex les programmes d’achat de matériel en urgence liés à la situation d’un ou plusieurs théâtres d’opération.
1.– Une rotation de plus en plus importante
Les opérations extérieures participent de l’essence même du métier militaire. Pour un certain nombre de soldats, ces missions constituent l’un des attraits de leur engagement : outre les compléments de rémunérations qu’elles apportent, les Opex permettent aux militaires de mettre leur vocation au service des populations civiles qu’ils protègent et des régions qu’ils stabilisent. Elles entretiennent également le sentiment d’aventure et de voyage, consubstantiel au métier des armes.
Pour autant, les opérations extérieures sont acceptées et appréciées à condition qu’elles ne se répètent pas trop souvent. Au-delà d’une trop grande sollicitation, certains peuvent éprouver une lassitude qui peut conduire à une démotivation. C’est la raison pour laquelle le ministère de la Défense limite à quatre mois la durée des opérations extérieures et s’engage, en principe, à ce qu’un militaire ne parte pas plus de quatre mois sur un cycle de seize mois.
Ces principes connaissent toutefois une exception avec le régime instauré pour le seul théâtre afghan : compte tenu des spécificités de ce théâtre (coût du transport, dangerosité nécessitant un entraînement spécifique et une adaptation plus longue), l’état-major des armées a décidé de porter de quatre à six mois la durée de service sur place, hors cas particulier des équipages aériens qui doivent passer des qualifications régulières ou du service de santé des armées. En contrepartie l’état-major s’engage, dans la mesure du possible, à ne pas envoyer les intéressés dans une nouvelle Opex au cours de l’année qui suit.
En Opex, les militaires ne bénéficient de fait, en fonction de leur grade, que d’une ou deux demi-journées de repos par semaine. Aucune permission n’est possible pendant l’opération. Cette durée de six mois est déjà celle adoptée par des armées comparables comme l’armée britannique. Les États-Unis, pour leur part, ont adopté une durée de service de 12 mois (15 mois en Irak).
En revanche, les Rapporteurs ont été surpris d’apprendre que le nombre de réservistes employés en opérations extérieures n’avaient cessé de décroître depuis une décennie, passant de 4 806 en 1999 à 1 843 en 2003, puis à seulement 100 en 2006. Leur nombre diminue alors que, ainsi que le rappelle très justement la Cour des comptes, des mesures législatives ont été adoptées pour assouplir leurs conditions d’emploi en Opex. Les Rapporteurs regrettent la trop faible place accordée à ces personnels généralement très compétents et parfois indispensables, s’agissant notamment des spécialistes de langues rares.
2.– Un coût croissant en vies humaines
Les Rapporteurs ne sauraient passer sous silence le nombre important de militaires français morts en opérations. Les neuf soldats morts à Bouaké en novembre 2004 ou les dix tués dans l’embuscade d’Ouzbin le 18 août 2008 ont marqué les esprits. Mais, rien qu’en Afghanistan, ce sont au total 27 militaires français qui ont payé de leur vie leur engagement depuis le début des opérations ainsi que plusieurs dizaines de leurs camarades sur d’autres sols étrangers.
Proposition n° 3 – Mettre en place les indicateurs de performance suivants destinés à mesurer l’adaptation des armées aux Opex :
– taux de militaires partant en Opex plus fréquemment que la norme fixée par l’armée de terre à quatre mois sur seize ;
– évolution du taux de renouvellement des contrats des militaires ayant servi en Opex, par comparaison à l’ensemble des militaires.
Les Rapporteurs insistent sur l’importance de ces indicateurs qui sont également souhaités par la Cour des comptes.
SURCOÛTS DES OPEX EN 2008 (HORS GENDARMERIE)
Zones |
Opérations |
Totaux par zone |
Transport stratégique |
CAPES |
Contributions |
Crédits actions civilo-militaire |
Soutien au stationnement |
Totaux | ||||
T2 |
T3 |
T5 |
Totaux | |||||||||
Afrique |
Tchad |
Épervier |
36,67 |
31,32 |
0,97 |
68,95 |
1,00 |
24,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,48 |
Eufor-tchad |
40,69 |
10,57 |
0,00 |
51,26 |
12,50 |
0,00 |
46,05 |
0,00 |
0,00 |
109,81 | ||
Gabon |
DET 13 |
1,93 |
1,93 |
0,00 |
3,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,86 | |
RCA |
Boali |
9,87 |
2,10 |
1,15 |
13,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,12 | |
Côte d’Ivoire |
Licorne |
58,88 |
34,61 |
3,29 |
96,78 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102,28 | |
Calao Onuci |
5,32 |
0,35 |
0,02 |
5,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,69 | ||
Moyen-orient |
Liban |
Daman/Baliste |
51,93 |
22,09 |
5,39 |
79,41 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81,61 |
Asie |
Afghanistan |
Heracles |
22,67 |
20,25 |
0,99 |
43,91 |
40,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,30 |
87,71 |
Epidote |
1,07 |
0,08 |
0,00 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,15 | ||
Pamir |
66,66 |
69,67 |
13,82 |
150,15 |
5,00 |
0,00 |
4,08 |
0,00 |
3,00 |
162,24 | ||
Balkans |
Bosnie |
Astree |
3,06 |
1,36 |
0,04 |
4,47 |
0,50 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
5,17 |
Kosovo |
Trident |
54,24 |
14,12 |
7,69 |
76,05 |
1,70 |
18,56 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
97,42 | |
Petites opérations et autres surcoûts |
5,30 |
1,51 |
0,09 |
6,89 |
1,10 |
7,51 |
49,80 |
0,71 |
0,00 |
66,02 | ||
Totaux |
358,28 |
209,97 |
33,46 |
601,71 |
70,00 |
50,60 |
101,25 |
0,71 |
6,30 |
830,57 | ||
Source : ministère de la Défense
PRÉVISIONS SURCOÛTS OPEX 2009 (HORS GENDARMERIE)
APRÈS DÉBAT PARLEMENTAIRE
Zones |
Opérations |
Totaux par zone |
Transport stratégique |
CAPES |
Contributions |
Crédits actions civilo-militaire |
Soutien au stationnement |
Totaux par OPEX | ||||
T2 |
T3 |
Ex Post |
Totaux | |||||||||
Afrique |
Tchad |
Épervier |
36,94 |
13,11 |
22,41 |
72,46 |
1,00 |
23,50 |
0,00 |
0,06 |
0,92 |
97,94 |
Eufor-tchad |
35,80 |
0,74 |
5,89 |
42,44 |
10,00 |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
84,44 | ||
Gabon |
Furet et Griffon |
2,75 |
0,48 |
2,10 |
5,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,32 | |
Djibouti |
Atalanta |
4,00 |
0,26 |
2,00 |
6,26 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
8,26 | |
RCA |
Boali - Birao |
6,88 |
1,86 |
0,20 |
8,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,23 |
9,19 | |
Côte d’Ivoire |
Licorne - Corymbe |
44,00 |
16,36 |
14,69 |
75,05 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
80,14 | |
Calao Onuci |
2,60 |
0,20 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,80 | ||
Moyen-orient |
Liban |
Daman / Baliste |
49,73 |
6,12 |
20,73 |
76,58 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
2,10 |
80,76 |
Asie |
Afghanistan |
Heracles |
39,67 |
10,00 |
12,72 |
62,39 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
7,56 |
109,96 |
Epidote |
1,37 |
0,15 |
0,00 |
1,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,52 | ||
Pamir |
79,57 |
44,04 |
39,54 |
163,15 |
5,00 |
0,00 |
38,00 |
0,40 |
12,54 |
219,10 | ||
Balkans |
Bosnie |
Astree |
0,50 |
0,37 |
0,51 |
1,37 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
1,97 |
Kosovo |
Trident |
48,00 |
9,11 |
7,19 |
64,31 |
1,00 |
20,00 |
6,00 |
0,06 |
1,10 |
92,47 | |
Petites opérations et autres surcoûts |
3,33 |
1,59 |
0,50 |
5,42 |
1,00 |
4,00 |
22,00 |
0,07 |
0,00 |
32,49 | ||
Totaux |
355,15 |
104,37 |
128,49 |
588,01 |
65,50 |
47,50 |
100,00 |
0,80 |
24,55 |
826,36 | ||
II.– LA DIFFICULTÉ DE CALCULER LE COÛT DES OPEX
L’enjeu de la détermination du coût des opérations extérieures est fondamental puisque c’est sur sa base qu’est calculé l’ajustement du remboursement opéré en fin d’exercice budgétaire par le ministère du Budget. Ce n’est donc pas sans arrière-pensées que le ministère de la Défense et Bercy négocient les modalités de prise en compte de ces coûts.
A.– UNE CHARGE NETTEMENT SOUS-ÉVALUÉE
1.– La controverse entre le ministère de la Défense et celui du Budget
Le chef d’état-major des armées développe une vision large du coût des opérations extérieures qui, à ses yeux, doit intégrer les éléments suivants :
– le financement des rémunérations supplémentaires versées aux militaires, à commencer par la fameuse indemnité de sujétion pour service à l’étranger (ISSE) qui permet aux soldats servant en Opex de multiplier leur revenu par plus de deux ;
– le surcoût lié à l’usure prématuré des équipements. Cet élément est évidemment difficile à évaluer, mais le ministère de la Défense invoque des barèmes utilisés par l’Otan et l’ONU ;
– les munitions et équipements détruits par faits de guerre. D’un montant faible jusqu’à ces dernières années, ce poste est devenu plus important avec l’engagement croissant de nos forces sur le théâtre afghan ;
– le coût des transports, particulièrement élevé lorsque nos armées interviennent dans des pays lointains et enclavés comme le Tchad ou l’Afghanistan ; ce poste représente 80 à 100 millions d’euros par an contre 20 à 25 millions d’euros il y a quelques années, avent l’implication de la France en Afghanistan et avant la crise du Darfour ;
– les dépenses en infrastructures, indispensables à la protection de nos forces dans les pays où des attentats ou des attaques à la roquette sont à redouter (Liban, Afghanistan). Ce poste représente environ 15 millions d’euros par an.
Le ministère du Budget, pour sa part, s’en tient à une définition plus restrictive du coût des opérations extérieures, considérées principalement sous l’angle des rémunérations et des frais de fonctionnement. Les dépenses d’équipement, considérées comme durables, sont exclues du champ puisque les matériels acquis à l’occasion d’une Opex sont censés être réutilisés ultérieurement à l’opération.
L’instruction n° 29748 du 25 mai 1984 relative au suivi des dépenses supplémentaires entraînées par les OPEX fixe les règles en matière de calcul et de remboursement des surcoûts. Adoptée à une époque où les opérations extérieures ne connaissaient pas l’ampleur qu’elles ont prise aujourd’hui, cette instruction apparaît beaucoup trop restrictive. Sa modification, à l’ordre du jour depuis plusieurs années mais sans cesse reportée, doit aboutir.
Proposition n° 4 – Poursuivre les consultations entre le ministère du Budget et celui de la Défense pour aboutir à une mise en jour de l’instruction du 25 mai 1984 qui prenne en compte, de la manière la plus exhaustive possible, le coût des opérations extérieures.
2.– D’importantes différences par rapport à nos alliés
L’approche française de la détermination du coût des Opex s’avère plus restrictive que celle de nos principaux alliés. C’est ainsi que Britanniques et Allemands incluent dans leur raisonnement le coût de l’usure prématurée du matériel ainsi que de certains matériels qui sont achetés spécifiquement pour certains théâtres. Les Italiens poussent plus loin la logique : bénéficiant d’un budget annuel particulièrement faible, l’armée italienne obtient des financements spécifiques pour les opérations extérieures, ce qui lui permet de s’équiper en conséquence, y compris en matériels lourds.
Le rapport de la Cour de comptes sur le coût des opérations extérieures s’est particulièrement intéressé au Royaume-Uni et a constaté que « l’approche budgétaire britannique prend en compte la consommation des stocks et l’amortissement des matériels utilisés ainsi que les dépenses en capital, notamment les achats en urgence qui correspondent, dans 87 % des cas, à des équipements destinés à assurer la protection des forces ».
La Cour constate que « la comparaison des dépenses recensées sur le théâtre afghan où opèrent des troupes françaises et anglaises, bien que les volumes et les lieux de l’engagement ne soient pas identiques, montre les différences d’approche. En 2005/2006, les postes « consommation de stocks » et « achats en urgence » représentent plus de 39 % des dépenses pour les Britanniques alors qu’ils restaient inférieurs à 1 % pour les Français. La conception britannique des « surcoûts » obéit à une approche en réalité très éloignée de l’approche française et conduit à une estimation des surcoûts des Opex plus élevée ».
S’inspirant de cette analyse de la Cour des comptes, la mission préconise une prise en compte la plus exhaustive possible du coût des opérations extérieures ainsi qu’une meilleure publicité donnée à ce coût et aux éléments qui pourraient l’atténuer.
Proposition n° 5 – Publier chaque année, dans les PAP et dans les RAP, la prévision du coût des Opex par théâtre, ainsi que la réalité de la dépense. Présenter un tableau prévisionnel des remboursements attendus d’organismes internationaux (ONU, Otan)
Proposition n° 6 – Établir un tableau consolidé de l’ensemble des contributions versées ou affectées tant par le ministère de la Défense que par celui des Affaires étrangères ou par d’autres voies sur le plan multilatéral ou national, aux opérations de maintien de la paix et aux Opex.
3.– Trop de coûts structurels ne sont pas pris en compte
Seuls les coûts directs sont pris considération jusqu’à présent, principalement les rémunérations et charges sociales, le fonctionnement des forces envoyées en opérations et les éventuels investissements réalisés sur le terrain. Certains coûts pourtant structurels, mais qui ne relèvent pas de ces catégories, ne sont pas pris en compte alors qu’ils sont directement engendrés par les opérations extérieures. Il s’agit principalement des coûts suivants :
– les dépenses de long terme liées aux carrières des militaires ayant servi en Opex : les bonifications des retraites liées aux états de service, les rentes ou pensions d’invalidité, les pensions versées aux veuves et ayants droit ;
– l’usure prématurée du matériel, qui rend l’entretien plus onéreux. Le maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements induit un surcoût d’autant plus important que les théâtres sont éloignés des bases métropolitaines et que l’approvisionnement en pièce de rechange est compliqué. Ce surcoût, qui n’est pas pris en compte au titre des opérations extérieures est évalué par les armées à 25 à 30 millions d’euros par an ;
– la formation renforcée des personnels en partance pour l’Afghanistan. Les militaires envoyés sur ce théâtre spécifique se trouvent en situation de guerre, avec le stress, les dangers et les pertes que cela suppose. Pour cette raison, la préparation des personnels est renforcée : la mise en condition de projection (MCP) dure six mois, comprend un stage en centre d’aguerrissement en montagne pour un niveau jamais atteint auparavant. 7 500 personnes sont formées à ce standard chaque année. Cette formation, jugée indispensable, induit un surcoût évident que l’état-major des armées n’a toutefois pas évalué.
– de nombreuses opérations d’infrastructure ne sont pas comptabilisées. Par exemple, la reconstruction de l’hôpital militaire de N’Djamena, financé par les différentes armées (armée de terre, armée de l’air, service de santé…) n’est pas prise en compte dans le Bop Opex.
Proposition n° 7 – Prendre en compte dans le coût des Opex la totalité des dépenses, y compris :
– les dépenses de long terme liées aux carrières (bonifications de retraites, les rentes et pensions d’invalidité...) ;
– les dépenses liées au renforcement de la préparation des personnels envoyés en opérations extérieures ;
– le coût des matériels et équipements perdus en action.
4.– Une sous-budgétisation initiale chronique
Pendant longtemps, le coût des opérations extérieures n’a pas été inscrit en loi de finances initiale car il était considéré comme un événement exceptionnel et imprévisible. La règle voulait que les dépenses engagées en opérations extérieures soient alors gagées par des annulations de crédits d’un montant équivalent en dépenses d’équipement.
Le principe de l’inscription en loi de finances initiale du coût estimé des Opex est une revendication ancienne du Parlement qui a trouvé une première application, certes symbolique, dans le budget 2003, lorsque 24 millions d’euros ont été provisionnés pour des opérations dont le coût réel s’est élevé, cette année-là, à environ 630 millions d’euros.
Le principe de cette inscription a été réaffirmé par la loi de programmation militaire 2003-2008, par le Président de la République lors du conseil de défense de juillet 2004, puis par la Cour des comptes dans son relevé de constatations provisoire sur l'exécution du budget 2005. Enfin, la budgétisation complète des surcoûts Opex en loi de finances initiale reste un objectif repris dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2008.
La budgétisation des opérations extérieures, qui n’atteignait pas 4 % du coût réel en 2003, s’est approchée de la réalité à un rythme très lent (19 % en 2005, 30 % en 2006), pour plafonner à 54-55 % en 2007 et 2008 (460 millions d’euros), ce qui ne répond que très imparfaitement au principe de sincérité sur lequel repose la construction du budget de la Nation.
L’incomplète budgétisation du coût des opérations extérieures
(en millions d’euros)
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Coûts des Opex |
630 |
605 |
528 |
579 |
663 |
831 |
826 |
Provision |
24 |
24 |
100 |
175 |
360 |
460 |
510 |
Taux de couverture |
3,8 % |
4,0 % |
18,9 % |
30,2 % |
54,3 % |
55,2 % |
62,2 % |
Dans le cadre du budget pluriannuel 2009-2011, cette provision a été augmentée de 50 millions d’euros, ce qui la porte à 510 millions d’euros. Mais compte tenu du niveau atteint par l’engagement extérieur de la France, cette somme ne suffira même pas à couvrir les deux tiers des dépenses attendues cette année.
Une distinction doit toutefois être faite en fonction des types de coûts : il s’avère que 86 % des coûts de titre 2 (rémunérations), les plus faciles à prévoir a priori sont couverts par cette dotation. En revanche, le taux de budgétisation chute à 32 % s’agissant des coûts hors titre 2. En effet, les achats de certains types de matériels en urgence (surblindage, nouveaux gilets pare-éclats, brouilleurs…) ou encore les commandes de munitions liées à l’intensité des combats, sont décidés en fonction des besoins opérationnels du moment et, par conséquent, plus difficiles à prévoir dans le cadre d’une séquence budgétaire annuelle.
5.– Des conséquences financières lourdes
Les surcoûts non provisionnés ont été, jusqu’ici, le plus souvent compensés en cours d’exercice par l’annulation de crédits d’équipements parfois partiellement restaurés à l’occasion de la loi de finances rectificative de fin d’exercice. En tout état de cause, cette procédure s’est montrée préjudiciable au bon déroulement des programmes d’équipement et a conduit à un respect très approximatif des dernières lois de programmation. Les armées étant tenues d’avancer la trésorerie des Opex, cette manière de procéder a contribué à augmenter les reports de crédits d’un exercice sur l’autre tout en augmentant les intérêts moratoires dus aux fournisseurs payés avec retard.
Ainsi, selon l’état-major des armées, la part des surcoûts restés à la charge du ministère de la Défense et financée par les crédits d'équipements depuis 1998 s’élèverait à un total près de trois milliards d’euros, l’équivalent de trois sous-marins nucléaires d’attaque, d’un second porte-avions, d’un millier de VBCI ou encore d’une quarantaine de rafales…
6.– Le rôle du Centre de préparation et de conduite des opérations (CPCO)
Les opérations extérieures sont gérées à l’état-major des armées, par le centre de préparation et de conduite des opérations qui prépare, planifie et gère les Opex, y compris sur leur aspect financier.
Le nombre de militaires affectés à cette structure s a paru insuffisant à la Cour des comptes qui a proposé d’en augmenter les effectifs. Les rapporteurs souscrivent entièrement à ce constat et partagent la proposition de la Cour : le bureau « finances », par exemple, ne compte que trois personnes pour assurer le suivi des dépenses du BOP Opex et établir des projections sur le coût d’opérations envisagées. Les effectifs de l’état-major des armées ayant été augmentés de façon substantielle ces dernières années, un redéploiement de personnel à coût constant est réalisable.
Proposition n° 8 – Étoffer les effectifs du centre de préparation et de conduite des opérations par un redéploiement interne à l’état-major des armées.
B.– DÉFENSE OU AIDE AU DÉVELOPPEMENT ?
Lorsqu’elles se trouvent en opération à l’étranger dans des pays déshérités, les forces françaises font profiter les populations locales d’un certain nombre d’actions qui s’apparentent davantage à de l’aide au développement qu’à de la défense, même si le coût est considéré comme relevant des Opex.
1.– L’aide médicale aux populations
Les armées françaises, en opérations extérieures comme sur le territoire national, bénéficient du soutien du service de santé des armées. Des centres médicochirurgicaux sont installés sur les théâtres et des médecins et chirurgiens sont présents en permanence de manière à être prêt à toute éventualité et à pouvoir apporter un secours rapide et de qualité aux militaires qui pourraient en avoir besoin.
D’une manière générale, les opérations extérieures connaissent de longues périodes relativement calmes au cours desquelles le personnel médical n’est pas accaparé par le soutien aux forces. Les personnels médicaux interviennent alors au profit des populations locales déshéritées, dans des pays où le système de soins est défaillant. Cette aide médicale aux populations, entièrement gratuite et trop peu mise en valeur, s’élève à 4,5 millions d’euros par an, tous théâtres confondus.
L’hôpital militaire français de N’Djamena est particulièrement bien équipé : blocs opératoires, salle de réveil, cabinet dentaire moderne... Il est doté du seul scanner disponible au Tchad. On comprend dès lors l’afflux de patients qui souhaitent s’y faire soigner. Que ce soit à N’Djamena, à Faya Largeau ou à Abéché, les médecins militaires travaillent à 90 % au profit des populations autochtones. L’aide médicale est très appréciée des autorités locales et, en particulier, du président Idriss Déby, notamment en période d’affrontement, comme ce fut le cas en février 2008 ou mai 2009.
Des infrastructures similaires existent au Liban, au Kosovo à Plana, et en Afghanistan ou un hôpital multinational ultramoderne vient d’entrer en service à Kaia nord. En revanche, compte tenu du progressif désengagement de nos forces, l’hôpital militaire de Tomboukro, en Côte d’Ivoire, a été fermé
2.– Les actions civilo-militaires
Afin de mieux faire accepter par la population sa présence sur les territoires où elle stationne, l’armée française procède à des opérations civilo-militaires : il s’agit de mener, si possible avec l’aide des autochtones et pour un budget limité, des opérations au profit des populations locales : rénovation d’un pont, d’un bâtiment public, d’un dispensaire, d’une pompe à eau…
Au Liban, des générateurs ont été offerts à des municipalités, ainsi que des groupes électrogènes et des camions de ramassage des ordures ménagères. Des réseaux d’eau et d’électricité ont été rétablis, des terrains de sport ont été réhabilités.
Les actions civilo-militaires françaises sont toujours menées au profit de collectivités, contrairement à d’autres pays qui choisissent parfois d’aider certaines familles sur des critères qui leur sont propres, notamment religieux. Chaque réalisation menée par les forces françaises fait l’objet d’une inauguration officielle où sont invitées les autorités locales ainsi que la presse locale.
3.– Le soutien aux autres armées
Sur décision politique prise au plus haut niveau de l’État, la France assure depuis plusieurs années le soutien total ou partiel de contingents étrangers au sein des coalitions auxquelles elle participe. C’est ainsi que, depuis 2000, elle assure le soutien (hébergement, logement, alimentation…) du contingent marocain stationné à Novo Selo, au Kosovo, et principalement utilisé à la garde du camp. Ce bataillon, qui comptait 450 soldats à l’origine avait été réduit, début 2009, à 220 hommes.
L’« arrangement technique » du 25 mars 2000 signé entre les deux pays prévoit un montant mensuel de dépenses limité à 149 400 euros. Le coût cumulé depuis 2000 du soutien de ce bataillon s’est élevé à 21,3 millions d’euros. Ces crédits sont entièrement prélevés sur le budget consacré aux opex.
Au Tchad, l’armée française a fourni gratuitement au contingent polonais du matériel divers pour 2,43 millions d’euros dont un système d’hébergement pour 150 hommes ; aux 60 Albanais d’Abéché qu’elle nourrit gratuitement, elle a prêté des véhicules qui sont destinés à leur permettre de mener à bien leur mission de garde des camps, ainsi que des effets d’habillement tropicaux plus adaptés que ceux apportés d’Europe. Aux Ukrainiens, elle fournit gratuitement 350 m3 de carburant aéronautique par mois, ainsi que de l’alimentation pour 18 militaires, pour un coût de 8,45 millions d’euros. À la Russie, elle fournit également un module destiné à loger 150 personnes, pour un coût de 0,2 million d’euros. Le coût total de cette aide aux contingents étrangers est évalué, pour le théâtre tchadien, à 12,68 millions d’euros en 2008.
Enfin, en Afghanistan, l’armée française, au même titre que les armées américaine, britannique, néerlandaise ou allemande contribue gratuitement à la formation de l’armée nationale afghane. Cet effort, dont le coût ne semble pas être précisément chiffré, est imputé lui aussi sur le budget des opérations extérieures du ministère de la Défense alors qu’à bien des égards, il s’apparente à une action de coopération.
Proposition n° 9 – Bien distinguer dans le coût des opérations extérieures les dépenses qui relèvent réellement de la défense et celles ressortissant à la coopération ou à l’aide au développement.
III.– LA COMPLEXITÉ DES OPÉRATIONS MULTILATÉRALES
C’est dans une logique égalitaire que l’Organisation des Nations unies rembourse les frais engagés par les États. Si chaque pays participant devait financer sa contribution à ce type d’opérations, seuls les plus riches y participeraient. La prise en charge financière par la collectivité permet à certains États aux moyens financiers limités de participer à des opérations multinationales et de s’aguerrir au contact d’autres armées plus expérimentées. Une meilleure connaissance réciproque, toujours bénéfique, en découle.
A.– L’ONU, UNE ADMINISTRATION PROCÉDURIÈRE
L’ONU propose aux États qui participent à la FINUL de choisir entre deux formules : dans un premier cas, le pays n’apporte que ses soldats tandis que les Nations unies fournissent le matériel et en assurent l’entretien ; dans le second cas, le pays arrive avec ses propres matériels et reçoit une indemnisation de la part de l’ONU.
La seconde solution est préférée par les grandes nations, ce qui évite d’avoir à former les hommes sur de nouveaux matériels et permet d’aguerrir les équipements nationaux, voire de les mettre en valeur. Par ailleurs, fournir des chars de combat, des canons de longue portée ou des radars de contrebatterie pourrait être rédhibitoire pour cette grande administration civile qu’est l’ONU.
En revanche, la première solution est généralement retenue par les pays plus modestes qui sont dépourvus de matériel et des moyens de les amener sur un théâtre lointain. Ces pays reçoivent alors essentiellement des engins de transport, des matériels de combat légers et surtout des équipements logistiques.
Par ailleurs, en fonction de l’importance des opérations et des moyens apportés, les nations peuvent passer deux types de contrats distincts :
– la « letter of assist » (LoA), pour des opérations ponctuelles dont le remboursement forfaitaire est déterminé à l'avance ;
– le « memorandum of understanding » (MoU), pour des opérations plus longues et dont la signature est plus complexe.
2.– Un barème précis et contractualisé
Pour un pays arrivant avec son matériel, le remboursement est réalisé sur la base suivante :
– les dépenses de personnels sont remboursées sur la base forfaitaire de 1 028 dollars (environ 734 euros (4)) par homme et par mois auxquels s’ajoutent les frais de paquetage (68 dollars par homme et par mois) et d’armement individuel (5 dollars par homme et par mois) et, éventuellement, une prime de spécialité de 300 dollars par homme et par mois versée à hauteur de 10 % du contingent.
– le matériel est considéré comme loué par l’ONU au pays participant et fait l’objet d’un paiement en fonction d’une classification, (lourds, légers et autosuffisance, consommables en rapport avec le soutien du personnel ou du matériel).
Les matériels qui sont fournis par les différents pays font l’objet d’une contractualisation d’autant plus précise qu’ils ne sont pas exactement les mêmes d’un pays à l’autre. À titre d’exemple, au Liban, chaque AMX 10 P fourni par la France est indemnisé 78 000 dollars (56 600 euros) par an. La dotation en munitions (12 millions d’euros par an au Liban) est également fixée par le contrat signé avec l’ONU. Les Nations unies remboursent de manière forfaitaire la peinture blanche qui doit être apposée sur les matériels militaires placés sous son autorité. Les opérations de remise aux couleurs nationales sont également remboursées.
Les matériels militaires ne sont pas les seuls dont la présence est contractualisée. Les matériels nécessaires au soutien du personnel le sont également. Il s’agit des remorques de douche, des cabines sanitaires, des conteneurs frigorifiques, cuisines, lave-linge, citernes à eau, conteneurs mortuaires… L’ONU rembourse également la France pour le soutien sanitaire que le service de santé des armées apporte à l’ensemble du dispositif. L’ONU peut également prendre en charge l’évacuation sanitaire d’un militaire gravement blessé sous réserve d’un accord préalable.
Presque toutes les fournitures dont peuvent avoir besoin les militaires font l’objet d’une contractualisation. Certaines sont fournies d’office par l’ONU, mais avec un niveau qualitatif parfois variable. Ce qui satisfait les États les plus modestes, ne donne pas toujours satisfaction aux pays un peu plus regardant. C’est ainsi que la consommation d’eau n’est pas remboursée aux États membres de la FINUL dans la mesure où l’ONU a décidé d’approvisionner les forces en élément liquide. Les Français font toutefois remarquer qu’ils doivent acheter de l’eau en bouteilles et forer leurs propres puits, l’eau fournie n’étant pas toujours potable.
Toujours au Liban, l’ONU a fourni à la France des cantonnements censés être entièrement équipés et qui avaient été occupés par les soldats d’autres nations auparavant. Mais lorsqu’elle en a pris possession, la France a dû refaire à ses frais les installations électriques, jugées dangereuses, pour un montant de 550 000 euros. Le renforcement des protections pour les personnels, qui n’a pas été jugé utile par l’ONU, a été financé par le ministère français de la Défense. Les hangars démontables destinés à protéger les Leclerc et AMX 10 P ont également été acquis sur des fonds nationaux, l’ONU ne les ayant pas jugés indispensables.
3.– Une organisation administrative qui exerce des contrôles rigoureux
Un contrôle lourd et complet est réalisé tous les trois mois par des inspecteurs de l’ONU qui vérifient type de matériel par type de matériel la présence sur le théâtre mais aussi la disponibilité opérationnelle. Cette disponibilité, prévue par le contrat, doit impérativement être au moins égale à 90 %, taux particulièrement élevé et difficile à atteindre. Certains pays, désireux de ne pas prendre de risques en matière de disponibilité, ont préféré emmener plus de matériel que prévu par le contrat, de manière à atteindre plus facilement le nombre de véhicules disponibles.
Ces vérifications particulièrement rigoureuses ont pour conséquence d’immobiliser pendant plusieurs jours les matériels des différents contingents, ce qui ne facilite pas la continuité des missions opérationnelles et peut être source de tension entre militaires français et fonctionnaires de l’ONU.
Les relations tumultueuses entre les services des Nations unies et les forces françaises sont parfois décrites comme un choc entre deux cultures : d’une part, la culture militaire française qui se veut efficace et réactive et, d’autre part, la culture anglo-saxonne qui règne à l’ONU et qui est beaucoup plus procédurière, moins réactive et qui s’inscrit dans la durée.
4.– Une procédure de remboursement longue dont le suivi est complexe
Dans les faits, un décalage important est constaté entre la dépense supportée par les armées et le remboursement réalisé par les Nations unies.
Un paiement par virement est effectué par l’ONU auprès de la mission permanente de la France auprès des Nations unies, qui le transmet à l’état-major des armées.
Les remboursements étant fonction des ressources du budget de l’ONU, les virements concernant les opérations dans lesquelles la France est engagée ont toujours été réalisés, mais avec des délais variant entre six mois et un an après la réalisation de la dépense. En outre, le remboursement est plus rapide dans le cas d'une LoA, car il s’agit d’un forfait, que dans celui d’un MoU qui nécessite une vérification mensuelle des matériels sur place.
En 2007, 14,7 millions d’euros ont été remboursés par l’ONU. Ce chiffre a atteint les 40,5 millions d’euros en 2008, alors que 54 millions d’euros étaient attendus : le solde, soit 13,8 millions d’euros devrait être perçu en 2009, exercice au cours duquel le ministère de la Défense pourrait percevoir 71,6 millions d’euros en provenance des Nations unies.
REMBOURSEMENT DE L’ONU EN 2008 ET PRÉVISIONS POUR 2009
(en euros)
Mission |
Pays |
2008 |
2009 |
Report exercice antérieur |
13 800 000 | ||
FINUL |
Liban |
34 752 980 |
54 000 000 |
ONUCI |
Côte d’Ivoire |
5 569 986 |
3 500 000 |
MONUC |
Congo |
261 648 |
300 000 |
MINUSTAH |
Haïti |
1 386 |
2 000 |
MINUL |
Liberia |
844 |
1 000 |
Total |
40 586 844 |
71 600 000 |
5.– Le remboursement ne couvre pas toutes les dépenses
Les sommes versées par l’ONU augmentent régulièrement et atteignent des montants non négligeables. Elles ont vocation à continuer de croître avec la mise en place, au Tchad et au Centrafrique, de la Minurcat, à laquelle la France participe. Pour autant, les sommes récupérées sont évidemment loin de couvrir les dépenses réelles des opérations. Plusieurs raisons l’expliquent :
– les soldes versées aux militaires en opérations extérieures sont bien plus élevées que les 1 028 dollars mensuels versés de manière égalitaire par l’ONU à tous les pays participants ;
– la France, ainsi que les rapporteurs ont pu le constater, n’hésite pas à réaliser les aménagements nécessaires à la sécurité de ses soldats, même lorsqu’ils sont jugés superflus et donc non remboursés par l’ONU ;
– tous les remboursements étant calculés et réalisés en dollars, les fluctuations de change pénalisent les pays de la zone euro.
Si l’ONU adresse ses remboursements aux représentations permanentes des grandes puissances, elle préfère verser directement aux militaires des États les plus modestes les 1 028 dollars mensuels qui leur reviennent par contrat. L’expérience a montré que de telles sommes pouvaient se perdre dans les arcanes administratifs de certains pays… et qu’il n’est jamais bon de compter dans ses rangs des soldats qui n’ont pas été payés.
B.– L’UNION EUROPÉENNE ET L’OTAN
L’ONU rembourse les frais engagés par les puissances contributives car les pays qui la composent sont très divers et les plus pauvres d’entre eux ne pourraient pas participer aux opérations de maintien de la paix sans cette aide.
La logique est évidemment toute autre pour l’Otan et l’Union européenne qui regroupent des pays plus homogènes sur le plan du développement économique. Ces deux instances n’ont donc pas jugé utile de mettre sur pied un dispositif aussi lourd que celui de l’ONU, d’autant que la plupart des pays qui composent ces deux entités arrivent sur un théâtre d’opération avec leur propre matériel. Les pays aux moyens limités n’envoient que des détachements de fantassins auxquels sont confiées des missions de bases telles, par exemple, que la garde des camps. À l'inverse du dispositif onusien, aucune procédure de prêt de matériel n’existe entre les États membres.
En conséquence, les échanges financiers sont réduits à leur plus simple expression, exception faite des services rendus (comme le transport, par exemple) entre nations, qui peuvent donner lieu à remboursement entre membres. Le seul cas dans lequel l’Union européenne ou l’Otan acceptent de rémunérer un État membre, c’est lorsque ce dernier parvient à convaincre l’organisation qu’il fournit une capacité indispensable qu’il est seul à pouvoir apporter. Ce cas est assez rare et les montants financiers en jeu sont peu significatifs.
La France est le quatrième pays contributeur de l’Otan. Sur un budget civil et militaire qui a dépassé 2 milliards d’euros en 2008, sa part a atteint 178 millions d’euros. Ces contributions s’ajoutent aux coûts nationaux enregistrés par les unités françaises en Opex.
La conjugaison de la règle selon laquelle les pays qui conduisent des opérations sont responsables des coûts qu’ils engagent et d’une clé de répartition des dépenses communes supportée principalement par les cinq grands contributeurs (75 % des ressources des budgets de l’Otan proviennent des États-Unis, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie) conduit à faire peser sur les « grands contributeurs » l’essentiel de la solidarité.
La croissance des différents budgets militaires de l’Otan est récente mais sensible. Compte tenu du nombre d’opérations menées simultanément et de l’éloignement de la principale d’entre elles, l’Afghanistan, les coûts pris en charge de manière commune se sont fortement accrus. Les dépenses communes au titre de la force internationale d’assistance et de stabilisation (FIAS) en Afghanistan sont ainsi passées de 118 millions d’euros en 2005 à 417 millions d’euros à 2008. dans le même laps de temps, la contribution française à ces dépenses communes est passée de 25 à 66 millions d’euros.
Proposition n° 10 – Compte tenu de la part importante de la France au budget général de l’Otan, le périmètre des dépenses communes doit rester limité aux seules dépenses réellement indivises, chaque pays devant continuer à financer ses dépenses propres.
2.– Le dispositif Athéna de l’Union européenne
La multiplication des opérations de l’UE et la nécessité d’agir rapidement dans la crise ont conduit à adapter les modes de financement de ces actions en instituant, en 2004, un mécanisme dénommé « Athéna ».
La finalité pratique d’Athéna est similaire à celle des budgets militaires pour opérations de l’Otan, puisque, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de mutualiser un certain nombres de coûts d’opération, même si le traité sur l’Union européenne pose le principe et l’objectif d’un financement en commun des opérations militaires selon une clé de répartition reposant sur le PNB des pays membres. Le Danemark, qui a obtenu une dérogation, est dispensé de toute contribution au mécanisme Athéna.
Dans les opérations menées par l’Union européenne, la mutualisation des coûts communs demeure encore limitée. La Cour des comptes fait justement remarquer que l’extension du périmètre des coûts communs, s’y heurte aux mêmes objections politiques et financières, mais cette fois à fronts renversés : la France, réservée à l’Otan sur l’extension des coûts communs, plaide la plus grande solidarité à Bruxelles. D’autres partenaires, et notamment les Britanniques, affichent une position inverse.
Outre des considérations budgétaires le Royaume-Uni ne souhaite pas donner trop d’autonomie aux moyens de gestion de crise de l’Union par rapport à ceux de l’Otan. Désireux de promouvoir l’Europe de la défense, notre pays adopte une position diamétralement opposée.
En 2007, le budget d’Athéna est resté limité à 35,6 millions d'euros. En 2008, le mécanisme de prise en charge des coûts est resté très partiel et n’a pas dépassé 20 % des surcoûts exposés : ainsi dans le cas de l’opération Eufor au Tchad, seuls 120 millions d’euros ont été financés en commun, environ 600 millions d’euros restant à la charge des pays membres participants.
3.– La délicate transition entre l’Union européenne et l’ONU au Tchad
Outre les difficultés liées au retard pris par la Minurcat pour succéder à l’Eufor, obligeant les forces de l’Union européenne à prolonger leur présence dans l’est du Tchad, le passage de relais entre l’Europe et les Nations unies achoppe également sur une question financière.
L’Eufor s’est installée au début de l’année 2008 à Abéché dans l’attente du déploiement Onusien devant intervenir en mars 2009. Pendant ce mandat d’un an, l’Union européenne a financé l’installation d’une immense infrastructure en bordure de l’aéroport, le Camp des étoiles, destiné à héberger les soldats d’abord de l’Eufor, ensuite de la Minurcat.
Pour un mandat d’un an, l’Eufor aurait pu s’installer de manière sommaire. Au lieu de cela, elle a intelligemment intégré la mission de l’ONU qui devait lui succéder et a commencé à bâtir un camp destiné à durer plusieurs années. L’expérience prouve, en effet, que la durée des opérations de maintien de la paix se compte davantage en années, voire en décennies, qu’en mois. Il en est résulté une facture de 72 millions d’euros pour un camp largement opérationnel et correctement bâti.
Or, quelques jours avant la rétrocession de ces installations à la Minurcat, l’ONU, arguant de travaux réalisés mais non contractualisés, accepte de ne payer que 14 millions d’euros pour la reprise du camp bâti par l’Union européenne. Ce litige, qui vient s’ajouter au retard pris par le déploiement des casques bleus, constitue une source de tensions entre les deux organisations supranationales. Les rapporteurs considèrent que si une certaine décote peut être appliquée pour un camp ayant déjà servi près d’un an, la différence entre le coût des installations et le prix qu’accepte de payer l’Organisation des Nations unies n’est pas justifiée.
4.– Il est temps de mettre en œuvre Euro recamp
En 1998, la France a imaginé et mis en œuvre avec ses principaux partenaires africains le processus Recamp (Renforcement des capacités africaine au maintien de la paix) destiné à aider matériellement et humainement quelques nations cadres africaines à assurer par elles-mêmes des opérations de maintien de la paix sur leur continent. Devenu européen en 2007 sous le nouveau sigle d’Euro Recamp, ce processus regroupe désormais quarante pays et est censé être devenu un instrument de la PESD au service de la paix en Afrique. Les résultats obtenus inclinent toutefois à la modestie.
Proposition n° 11 – Impliquer chaque fois que possible les partenaires européens de la France pour mettre en place des opérations à l’échelle de l’Union européenne, plutôt qu’à l’échelle nationale. Dans le cas de l’Afrique, impliquer chaque fois que possible les pays membres d’Euro Recamp dans les opérations de maintien de la paix.
L’imbroglio juridique des Opex multilatérales
Un Rapporteur de la mission d’évaluation et de contrôle sur le coût des Opex se trouvait au Camp des étoiles, à Abéché, le 7 avril 2009, lorsque s’est produit un événement aussi dramatique qu’exceptionnel : un légionnaire de nationalité brésilienne servant l’armée française dans le cadre de l’Eufor, donc sous le commandement de l’Union européenne, a été pris d’un accès de folie. Il a tué avec son arme de service deux autres militaires (un binational franco-guinéen et un citoyen roumain), servant, comme lui, au 2ème Régiment étranger d’infanterie. Pour s’enfuir, l’individu a ensuite tué une sentinelle togolaise servant, elle, sous le commandement de l’ONU. Une fois à l’extérieur du camp, le légionnaire a commis un quatrième meurtre, tuant un citoyen tchadien. Le chevauchement des compétences, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, illustre le caractère très particulier sur le plan juridique des opérations multinationales.
En vertu de accord diplomatique préalable à tout déploiement de forces françaises à l’étranger (le SOFA : status of forces agreement), les autorités tchadiennes qui l’ont arrêté ont remis cet homme à la justice française. Mais les conséquences juridiques à l’égard des pays tiers restent néanmoins complexes.
Les flux financiers liés au financement des Opex
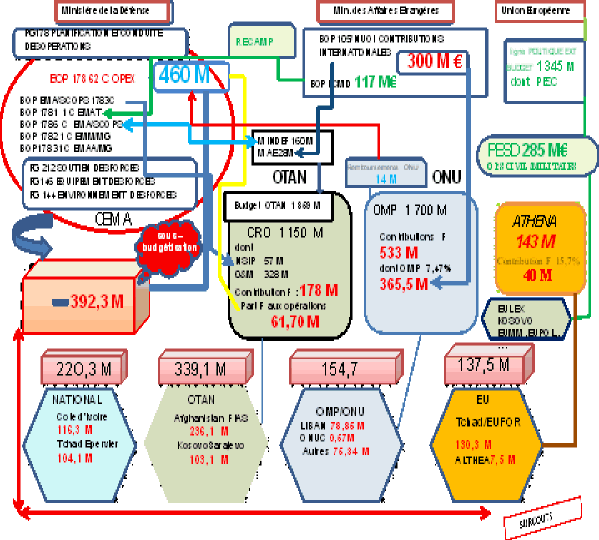 Source : Rapport de la Cour des Comptes sur les opérations extérieures.
Source : Rapport de la Cour des Comptes sur les opérations extérieures.
IV.– LES PISTES DE RÉFLEXION POUR RÉDUIRE LES COÛTS
Depuis quelques années, le ministère de la Défense s’attache à décrire avec davantage de rigueur et d’exhaustivité les dépenses relatives aux opérations extérieures, même si les règles imposées par le ministère du Budget ne permettent pas, ainsi que nous l’avons vu, de tout prendre en compte. Paradoxalement, une connaissance plus exhaustive des coûts va donner une impression de renchérissement des Opex, dans la mesure où un certain nombre de dépenses n’étaient pas prises en compte jusqu’à présent.
A.– QUELQUES PROPOSITIONS CONCRÈTES
1.– Améliorer la budgétisation initiale des Opex et leur suivi
En 2008, les crédits obtenus par décret d’avance pour financer la partie non provisionnée des Opex n’ont pas été entièrement gagés par des annulations de crédits de la mission Défense. Ainsi, 48 millions d’euros sur 221 millions ont été apportés par la réserve interministérielle. Sur les 173 millions d’euros restant, « seuls » 100 millions d’euros ont été prélevés sur les crédits d’équipement.
Pour les années à venir, l’augmentation de la provision initiale et un recours accru à la réserve interministérielle doivent permettre de préserver les crédits d’équipements des armées.
Le relevé de décision de la réunion interministérielle du 28 juillet 2008 tenue au cabinet du Premier ministre précise que « les dépenses liées aux Opex qui dépasseraient les enveloppes fixées dans le cadre du budget triennal 2009-2011 ne seront pas financées, même temporairement, par des crédits dévolus aux équipements ».
Dans cet esprit, un dispositif a été adopté pour les années 2009 à 2011 : le montant de la provision au titre des surcoûts Opex, porté à 510 millions d’euros en 2009, est augmenté de 60 millions d’euros en 2010, puis à nouveau de 60 millions d’euros en 2011. Ce niveau d’engagement devrait ensuite être maintenu jusqu’en 2014. Ces deux efforts de 60 millions d’euros sont financés pour moitié par le ministère de la Défense et pour moitié par la réserve de budgétisation. En cours d’exercice, les éventuels surcoûts nets, hors titre 5 et hors remboursement des organisations internationales ONU, Otan ou UE, seront financés par la réserve de précaution interministérielle, ce qui constitue, pour les rapporteurs, un progrès considérable par rapport à la situation antérieure.
Proposition n° 12 – Poursuivre l’amélioration du financement en loi de finances initiale de la totalité du coût prévisionnel des Opex.
Proposition n° 13 – Lorsqu’il présente au Parlement une demande d’autorisation de renouvellement d’opérations extérieures, le Gouvernement communique, pour chaque théâtre, une actualisation des coûts ainsi qu’une étude d’impact.
2.– Standardiser et bâtir en « dur » le plus tôt possible
Les théâtres d’opérations sur lesquels sont déployées nos armées présentent des caractéristiques souvent similaires en matière de camp militaire. Standardiser les installations de nos forces, à l’instar de ce que fait l’Otan, peut constituer une source d’économies.
Lorsqu’une opération extérieure est entreprise, les troupes déployées sont d’abord hébergées dans des logements provisoires, généralement sous des tentes. Puis, l’opération s’installant dans la durée, des logements préfabriqués (de type Algeco, Corimec…) sont achetés, acheminés et installés. Dans un troisième temps, au bout d’un certain nombre d’années, la fabrication d’éléments en « dur » est décidée.
L’expérience nous montre que les opérations extérieures, sauf cas très particuliers comme celui de l’Ituri, doivent s’envisager dans la longue durée : l’Opex en Bosnie-Herzégovine s’est achevée au bout de 15 années, celles au Kosovo, en Côte d’Ivoire, au Tchad, en Afghanistan se prolongent depuis respectivement 10, 7, 23 et 8 ans, sans réelle perspective de désengagement à court terme, sauf peut-être pour le Kosovo.
La solution la plus rationnelle semble être la construction de bâtiments durables pour loger nos troupes aussitôt que possible, avec des schémas standardisés dans la mesure où la sécurité impose, plus que le climat ou l’architecture locale, des types de constructions sécurisées bien définies. Le coût de la main-d’œuvre et des matériaux dans les pays où la France intervient rend la construction moins onéreuse que l’achat et l’acheminement de préfabriqués qui, bien que censés être mobiles, ne pourront que très difficilement être réutilisés.
Outre les économies financières réalisées sur le long terme, les constructions présentent les avantages suivants :
– elles assurent une bien meilleure protection contre les roquettes, les explosions d’engins improvisés et tout autre type d’attentat ;
– elles procurent un meilleur confort pour les personnels qui doivent y loger pendant plusieurs mois dans une promiscuité certaine ;
– elles assurent du travail à la main-d’œuvre locale ;
– elles peuvent être rétrocédées aux autorités locales lors du retrait de nos troupes. En cas de changement de secteur géographique avec un autre membre de la coalition, elles peuvent être louées ou vendues à cet État membre, ce qui est une pratique fréquente au sein de l’Otan.
Une installation de ce type présente l’inconvénient de donner d’emblée le signal fort d’une installation dans la durée. Mais ce qui peut constituer un inconvénient peut aussi s’avérer bénéfique, s’agissant de montrer la détermination de notre pays.
Proposition n° 14 – Lorsqu’une opération extérieure est lancée, s’il n’est pas expressément décidé que sa durée sera limitée à quelques mois, les armées ont intérêt à bâtir aussitôt que possible des installations pérennes aussi standardisées que possible qui, outre les avantages sécuritaires, feront réaliser, sur la durée, des économies substantielles en matière d’infrastructures.
3.– Établir des relations plus « réalistes » avec nos partenaires
Au sein de coalitions comme l’Otan ou l’Union européenne, les services rendus de nation à nation comme l’alimentation ou le transport font l’objet d’une facturation. Il semblerait, aux dires mêmes des responsables du commissariat, que la France ne facture pas à ses alliés les prestations qu’elle leur fournit de la même manière qu’elle s’acquitte de ses factures. Notre pays facture généralement ses prestations à coût coûtant, c'est-à-dire au prix marginal de la prestation qui semble être le prix de revient mais ne l’est pas vraiment. Les autres nations, en revanche, facturent un coût global qui intègre la notion d’amortissement.
C’est ainsi que la journée d’alimentation d’un militaire français soutenu en Afghanistan par l’armée néerlandaise nous est facturée 50 euros, alors que la France en réclame beaucoup moins aux armées dont elle nourrit les soldats. Et nous savons que dans certains cas, elle ne présente même pas de facture. La qualité et la diversité de la cuisine française n’expliquent pas à elles seules l’afflux de militaires étrangers qui viennent se restaurer dans les restaurants de l’Économat des armées.
Un interprète afghan recruté à Kaboul par les forces françaises est rémunéré environ 600 euros par mois. Lorsque la France doit exceptionnellement faire appel à un interprète fourni par une autre nation de la coalition, ce service lui est facturé 2 500 euros par mois !
Cette forme de candeur aboutit à ce que, pour l’année 2009, la France doit 7,45 millions d’euros à ses alliés quand ceux-ci ne lui doivent que 4,91 millions d’euros. À cela s’ajoute le fait que notre pays règle ses factures dans les délais prescrits quand d’autres pays comme la Turquie ou les États-Unis sont connus pour leurs délais de paiement très extensibles.
Autre exemple : au Tchad, ce sont les géographes de l’armée française qui ont réalisé, pour le compte de l’Eufor, la cartographie complète et précise de l’est du pays. Rien n’existait auparavant et la Minurcat est arrivée sans la moindre carte. Les données cartographiques appartenant à l’armée française ont été cédées à l’ONU pour une somme qualifiée sur place par nos militaires de « dérisoire », à peine plus que le prix du papier sur lequel elles sont imprimées.
Proposition n° 15 – Facturer les prestations rendues par la France aux armées alliées selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées pour facturer à nos forces les prestations équivalentes. Prendre en compte la notion de coût global et non de coût marginal.
4.– Substituer, lorsque cela est plus économique, l’achat à la location
Les armées utilisent sur la plupart des théâtres des véhicules civils, blindés ou pas, parfois achetés mais généralement loués. C’est le cas en Afghanistan où 28 véhicules tout-terrain, dont une bonne partie blindés, sont loués par nos forces.
Si le prix de location d’une voiture civile non blindée reste acceptable (600 euros par mois), le coût de location d’un véhicule civil blindé est onze fois plus élevé : 6 600 euros par mois. Il est vrai que le marché reste étroit et le nombre de prestataires faible, ce qui ne favorise pas une saine concurrence, gage de maîtrise des prix.
Le ministère de la Défense développe le raisonnement suivant : une voiture blindée coûte à l’achat 120 000 euros ; son entretient est évalué à 10 000 euros la première année, 20 000 la deuxième et 30 000 la troisième année. Par ailleurs son acheminement par voie aérienne est évalué à 20 000 euros par véhicule, ce qui nous conduit à un total de 200 000 euros sur 3 ans. Le même véhicule, loué sur la même période, reviendrait à 6 600 euros x 36 = 237 600 euros, un chiffre jugé comparable. Priorité est donc donnée à la location, considérée plus souple.
Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ce raisonnement qui oublie qu’au bout de trois ans, une voiture même blindée se revend sur le marché de l’occasion : les loueurs le savent bien, eux qui protègent le tableau de bord de véhicules loués aux forces françaises afin d’éviter toute dégradation dans l’optique de la revente ! Sceptiques devant les 60 000 euros d’entretien calculés sur trois ans, les rapporteurs constatent que l’achat d’un véhicule blindé dans un pays limitrophe de l’Afghanistan, puisqu’il semblerait qu’on n’en trouve pas à Kaboul, pourrait réduire sensiblement les frais d’acheminement sur le théâtre, en évitant un transport par voie aérienne. Enfin, même si la différence n’était que de 37 600 euros en faveur de l’acquisition patrimoniale, ils estiment qu’une telle somme devrait conduire à ce que soit repensée la politique de location de ces véhicules.
Proposition n° 16 – Lorsqu’il apparaît que le coût de location d’un matériel, notamment d’un véhicule, est supérieur, sur la durée d’utilisation envisagée, au coût d’achat, privilégier l’acquisition patrimoniale.
Un autre raisonnement consiste à mettre en avant le fait que la location est une dépense de fonctionnement (titre 3), inscrite dans le coût des Opex et faisant l’objet d’un remboursement en fin d’exercice, en collectif budgétaire, alors qu’un achat de voiture constitue une dépense de titre 5, non éligible au remboursement au titre des surcoûts Opex. Dans ces conditions, acquérir des véhicules civils blindés conduit à empiéter sur les crédits dévolus à l’équipement des armées.
Dans le cas précis des Opex, la logique vertueuse de la LOLF, qui autorise la fongibilité asymétrique des crédits, c’est-à-dire l’affectation en titre 5 de crédits non utilisés en titre 3, n’est donc pas suffisante. Permettre le remboursement au titre des surcoûts liés aux Opex de ce genre de dépenses, même s’il s’agit de dépenses d’équipement, pourrait pourtant permettre d’éviter au contribuable de payer, en frais de location, largement plus que le coût d’acquisition des véhicules en question.
Proposition n° 17 – Les crédits d’équipement (titre 5) provenant du titre 2 ou du titre 3 par le jeu de la fongibilité des crédits et utilisés pour des dépenses d’équipement directement liées aux opérations extérieures font l’objet d’un remboursement en loi de finances rectificative au titre du surcoût Opex.
5.– En matière de piraterie, impliquer les assureurs
Depuis quelques années, la piraterie maritime se développe à une grande échelle, notamment dans le golfe d’Aden ainsi que dans une partie de l’océan Indien. Malgré les mises en garde répétées des autorités françaises, nombre de navires battant pavillon national, notamment des plaisanciers, continuent à fréquenter ces eaux dangereuses.
Certains de nos compatriotes ont été victimes d’enlèvements. Pour les libérer, les armées ont dû mettre en place des dispositifs lourds et coûteux. La vie de nos soldats a été mise en danger à l’occasion de chacune de ces opérations. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur efficacité et les Rapporteurs tiennent à saluer le professionnalisme et le courage des militaires.
Ces missions de sauvetage, conduites à plusieurs milliers de kilomètres du territoire national, ont un coût élevé. Si la décision de les mener pour sauver des vies humaines ne se discute pas, il n’en demeure pas moins que ces missions permettent également de récupérer les navires détournés. Ce sauvetage de biens matériels est réalisé au profit de propriétaires et d’assureurs à qui il ne vient parfois même pas l’idée d’écrire une lettre de remerciement au chef d’état-major des armées ou à celui de la marine.
Il n’y a aucune raison pour que le sauvetage d’un navire – pas celui d’un otage – ne fasse pas l’objet d’une facturation adressée au propriétaire ou à l’assureur du bâtiment en question. En toute logique, les sommes ainsi récoltées pourraient aller abonder la provision destinée à financer le surcoût des opérations extérieures, par analogie avec les règles qui ont été édictées en matière d’aliénation de biens immobiliers.
Outre le dédommagement que le ministère de la Défense recevrait, la menace de cette sanction financière aurait une vertu pédagogique et pourrait conduire les armateurs et plaisanciers à mieux respecter les mises en garde des autorités françaises.
Proposition n° 18 – Se réserver la possibilité que toute intervention militaire aboutissant à la récupération d’un navire, en particulier commercial, mis en difficulté par un acte de piraterie fasse l’objet d’une facturation adressée au propriétaire ou à son assureur.
6.– Pouvoir utiliser le matériel pris à l’adversaire
Le budget contraint de la mission Défense ne permet pas toujours aux forces de disposer de tout le matériel dont elles peuvent avoir besoin. Or, les opérations permettent parfois de réaliser des prises qui pourraient utilement être réutilisées par les armées. C’est le cas des embarcations rapides, surnommées « go fast », utilisées par les narcotrafiquants aux Antilles ou en Méditerranée.
Les Rapporteurs proposent que soit modifié la législation en vigueur pour permettre aux armées, notamment aux commandos de la marine, d’utiliser ces embarcations saisies qui leur font parfois défaut dans l’accomplissement de leur mission ou, au moins, de pouvoir les utiliser comme réserves de pièces de rechange.
Proposition n° 19 – Permettre aux armées de réutiliser pour leur propre compte le matériel saisi en opération, en particulier les embarcations rapides saisies lors d’arrestations de narcotrafiquants. Modifier, si nécessaire, la législation en vigueur.
B.– L’EXTERNALISATION, SOURCE D’ÉCONOMIE ?
Aux yeux des rapporteurs, l’externalisation ne constituera pas une solution miraculeuse pour réduire le coût des Opex et comporte, par ailleurs, certains inconvénients. Mise en œuvre à grande échelle par le ministère de la Défense, elle mérite néanmoins d’être examinée.
1.– La problématique de l’externalisation en Opex
L’externalisation des soutiens, d’une manière générale, est décrite comme une nécessité pour les raisons suivantes :
– la réduction du format des armées et la volonté de favoriser les forces opérationnelles au détriment du soutien conduit à demander à des sociétés extérieures de réaliser ce que le ministère de la Défense n’a plus les moyens de réaliser en interne ;
– la professionnalisation a fait perdre aux armées les compétences variées et gratuites des appelés ;
– la raréfaction de certaines compétences rend nécessaire le recours à des intervenants extérieurs, qu’il s’agisse d’armements ou de connaissance des langues étrangères.
La volonté de recentrer les forces sur leur cœur de métier a conduit l’état-major des armées à développer le projet Capes France (capacité additionnelle par l’externalisation du soutien des forces françaises en opérations extérieures).Cette externalisation n’est réalisable que sur des théâtres stabilisés. L’état-major des armées assure la maîtrise d’ouvrage, les armées pilotes du soutien assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée tandis que la maîtrise d’œuvre est assurée par l’économat des armées, un établissement public industriel et commercial (ÉPIC) dépendant du ministère de la Défense et directement géré par le secrétariat général pour l’administration de ce ministère.
Chacun s’accorde pourtant à reconnaître que l’externalisation n’est pas possible partout : dans une situation potentiellement dangereuse, confier des tâches à des sociétés privées (la restauration, par exemple) reviendrait à exposer des employés civils aux dangers de la guerre et constituerait un poids pour les militaires qui devraient, en plus de leur mission, assurer leur protection.
C’est au Kosovo que le processus Capes France a été expérimenté en 2007, le théâtre ayant été jugé suffisamment calme. Cette nouvelle organisation a permis le rapatriement d’un certain nombre de soldats et donc la baisse des effectifs militaires.
2.– Les risques politiques liés à l’externalisation
Le recours à des entreprises privées reste indispensable dans un certain nombre de domaines qui ne relèvent pas du cœur de métier des armées : constructions ou agrandissement de bases, fourniture d’eau, de groupes électrogènes, de produits alimentaires, activités liées aux loisirs des militaires…
Toutefois, la répartition des marchés accordés aux entreprises peut faire peser un risque politique aux forces. C’est ainsi que selon les statistiques du ministère de la Défense, 96 % des entreprises travaillant pour l’Eufor au Tchad sont des multinationales, souvent européennes, seulement 4 % des marchés étant récupérés par les entreprises tchadiennes ; il est vrai peu nombreuses, surtout aux confins du Darfour. Il n’est pas rare de voir les autorités locales manifester leur insatisfaction devant la place faite aux entreprises de leur pays. C’est une des raisons pour lesquelles les militaires français tentent de favoriser, au Tchad comme en Afghanistan, les entreprises locales. Mais cette philosophie n’est pas partagée par tous les partenaires de la France.
3.– Les conséquences de l’externalisation sur la main-d’œuvre locale
L’économat des armées recrute des personnels locaux. Au Kosovo, 400 personnes ont été recrutées dans la zone Nord où sont déployées les forces françaises. Certaines d’entre elles ont ensuite été appelées à servir en Afghanistan où le recrutement de personnels locaux s’est avéré plus problématique.
Compte tenu des rémunérations versées par les forces françaises, il est fréquent qu’un interprète, un personnel de restauration voire un employé de maison soit mieux rémunéré qu’un policier ou un professeur. En Côte d’Ivoire ou au Tchad, une personne employée auprès des forces françaises dans le cadre de l’externalisation fait bénéficier de son salaire plusieurs de ses parents.
Bien rémunérer les personnels locaux permet de s’assurer de leur dévouement et de leur loyauté et d’éviter ainsi qu’ils se mettent également au service d’autres intérêts moins recommandables. Mais le risque existe de voir des personnels particulièrement qualifiés (universitaires, chirurgiens) abandonner leur métier d’origine et priver leur pays de leurs compétences dans la mesure où, pour des raisons financières, ils préfèrent servir comme interprète.
4.– Un bénéfice financier pas toujours certain
L’externalisation de services se traduit par la passation de contrats qui ne sont pas toujours d’une grande souplesse. Or l’un des soucis principaux des armées est de pouvoir s’adapter. Ainsi, l’une des raisons du coût élevé des opérations menées au Tchad tient à ce que les contrats passés avec le secteur privé pour la construction et le fonctionnement du camp des étoiles, à Abéché, l’ont été pour 2 000 soldats. Or, au cours de l’année 2008, ce camp a plutôt hébergé une moyenne de 1 000 à 1 500 personnes. Mais les prestataires ont argué de leurs investissements pour facturer un montant de prestations correspondant à 2 000 occupants. Si ce camp avait été géré avec des moyens purement militaires, l’adaptation aurait été plus facile, regrettent certains officiers.
De la même manière, lorsqu’une unité est envoyée inopinément en opération extérieure, les fonctions qui ont été externalisées dans son cantonnement d’origine continuent à être facturées par les prestataires, même si la caserne est à moitié vide.
Enfin, il arrive, dans certaines régions déshéritées de théâtres difficiles (Tchad, Afghanistan) que l’économat des armées ne trouve pas de prestataire de services où qu’il en trouve un seul. Dans ce cas, le bénéfice financier de l’externalisation est loin d’être évident.
Proposition n° 20 – Créer une mission d’évaluation et de contrôle sur le coût et les bénéfices attendus de l’externalisation au sein du ministère de la Défense.
SECONDE PARTIE : LES CINQ OPEX MAJEURES
La diversité des opérations extérieures appelle des commentaires particuliers pour chacune des opérations de grande envergure dans lesquelles les forces françaises sont engagées
I.– L’OPÉRATION LICORNE EN CÔTE D’IVOIRE
D’abord lancée dans l’urgence dans un cadre strictement national puis intégrée à un dispositif onusien, l’opération Licorne en Côte d’Ivoire apparaît comme un concentré des Opex menées de par le monde, avec ses difficultés, ses indéniables succès, mais aussi la difficulté d’y mettre un terme.
1.– Une opération menée sous l’égide des Nations unies
L’opération Licorne a été déclenchée le 22 septembre 2002, trois jours après une tentative de coup d’État qui a rapidement évolué en début de guerre civile et qui a abouti à la scission de fait du pays en deux zones : une zone rebelle au nord et une zone loyaliste au sud. Dans un premier temps, la mission de l’opération Licorne fut de protéger et d’évacuer les ressortissants européens en danger, puis de contrôler le cessez-le-feu signé le 17 octobre 2002.
Craignant d’être accusée de partialité si elle intervenait seule, la France parvint très rapidement à obtenir la participation d’autres pays dans sa mission d’interposition : la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (CÉDÉAO) mit sur pied une force d’interposition qui revêtit le casque bleu de l’ONU le 13 mai 2003 lors de la création de la mission des Nations unies en Côte d’Ivoire (MINUCI).
Depuis cette date, les forces françaises de l’opération Licorne sont chargées du soutien et de la protection de la MINUCI, qui compte 8 000 soldats et 1 000 policiers internationaux issus principalement du Bénin, du Togo, du Bangladesh, du Pakistan, du Ghana, du Maroc, du Niger, du Sénégal et de Jordanie.
2.– Des moyens adaptés à une menace réelle
S’interposer entre deux belligérants n’est pas sans danger. En novembre 2004, un raid de l’aviation gouvernementale ivoirienne sur une implantation militaire française de Bouaké a fait neuf morts et 31 blessés dans les rangs de nos forces. L’ensemble des moyens aériens du pays a été détruit par les forces de Licorne dans les heures qui ont suivi.
Au début de l’année 2009, l’opération Licorne mobilisait encore 1 800 militaires français sur le sol ivoirien, 200 véhicules blindés légers (VBA, Sagaie), 400 véhicules à roues (véhicules tout-terrain P4, camions), 70 véhicules logistiques (tractopelles, véhicules de dépannage, de transport…), une quinzaine d’hélicoptères ainsi que deux avions de transport Transall.
1.– Le conflit a été interrompu avant qu’il ne dégénère
Par la rapidité de son intervention, la force Licorne a très probablement évité que ne se déroulent des massacres interethniques de grande ampleur comme ceux qu’ont connus le Liberia et la Sierra Leone voisins, deux pays où la communauté internationale a tardé à réagir lorsqu’ont éclaté des guerres civiles.
2.– L’activité économique du pays a été préservée
L’interposition entre les combattants loyalistes et rebelles a permis d’éviter un effondrement économique complet de la Côte d’Ivoire d’autant plus dommageable que ce pays représentait, avant les événements, 40 % du poids économique de la CÉDÉAO, Nigeria compris.
Si l’activité économique de la Côte d’Ivoire a certes été ralentie, la plupart des entreprises ont continué à fonctionner, les infrastructures routières continuent à être entretenues tandis que les travaux du prolongement de l’autoroute reliant Abidjan à Yamoussoukro se poursuivent ; le réseau électrique, moderne et bien entretenu, continue à alimenter la plupart des villages ; en l’absence de vrai pouvoir administratif dans la partie rebelle, l’électricité et l’eau sont distribuées gratuitement aux habitants qui résident au nord de la ligne de démarcation. Les liaisons par téléphones portables sont assurées dans la plus grande partie du pays ; enfin, le port d’Abidjan continue à être actif tandis que le trafic de l’unique ligne ferroviaire qui traverse le pays du sud au nord jusqu’au Burkina Faso semble reprendre.
3.– Les ressortissants français ont été efficacement protégés
Enfin, la force Licorne a rempli sa mission première de protection de nos ressortissants et a facilité l’évacuation d’environ 10 000 d’entre eux depuis 2002, ainsi que de plusieurs centaines d’autres étrangers présents en Côte d’Ivoire. Grâce à l’action de nos soldats, aucun ressortissant français n’a perdu la vie au cours des troubles ; 8 500 Français résident encore dans ce pays qui abrite en outre 400 PME tenues par nos compatriotes.
C.– LE SOUCI DE MAÎTRISER LA DÉPENSE
1.– Un ajustement constant des moyens
La maîtrise de la dépense publique se traduit par la volonté d’ajuster les effectifs stationnés en Côte d’Ivoire aux stricts besoins imposés par les conditions du moment. Ainsi, les effectifs français qui avaient atteint environ 4 500 militaires à la suite des tragiques événements de l’automne 2004 ont été réduits progressivement à 3 500 hommes en janvier 2007. Entre janvier et septembre 2007, en neuf mois, ils ont encore été réduits de plus de 1 000 personnes pour atteindre le chiffre d’environ 2 400. Début 2009, ce chiffre avoisinait 2 000 militaires.
Les moyens matériels ont également été réduits : c’est ainsi que les engins chenillés AMX 10 P qui étaient déployés en Côte d’Ivoire, dans l’éventualité de combats de haute intensité, n’ont plus été jugés nécessaires compte tenu de l’apaisement de la situation et ont été rapatriés.
2.– Un rapport coût/résultat très satisfaisant
Si l’on divise le coût estimé des opérations en Côte d’Ivoire en 2008 (108 millions d’euros) par le nombre de militaires français dans le pays au cours de la même année, aussi bien sous la bannière nationale de Licorne que sous celle onusienne de la MINUCI, (environ 2 300 au total), nous obtenons un coût annuel par soldat d’environ 47 000 euros, soit un peu moins de 130 euros par jour, ce qui reste relativement modeste pour une opération de cette envergure menée si loin de la France.
Sur cette somme, près de 60 % des coûts relèvent des rémunérations, contre 32 % pour le fonctionnement, 5 % pour le transport stratégique et 3 % pour l’investissement (construction d’abris, amélioration des casernements…).
Bien que les deux opérations soient de natures très différentes, il n’est pas inutile de rappeler que la présence de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan a coûté environ 190 milliards de dollars (5) (soit 135 milliards d’euros) en 2008 aux contribuables des États-Unis. L’opération Licorne coûte donc en une année l’équivalent d’une dizaine d’heures de présence américaine en Irak et en Afghanistan.
D.– LES AVANTAGES QU’EN RETIRENT LES POPULATIONS LOCALES
Au total, l’opération Licorne injecte environ 50 millions d’euros par an dans l’économie ivoirienne. 38 marchés de sous-traitance ont été répertoriés pour un montant de 2,2 millions d’euros par an : gestion des espaces verts, des déchets, lavage, location et entretien de véhicules civils… 80 % des achats ordinaires de produits alimentaires sont achetés localement.
À lui seul, le 43ème BIMa, qui était jusqu’en 2008 l’unité installée de manière permanente en Côte d’Ivoire, engendrait 12 millions d’euros de dépenses annuelles. Compte tenu du niveau de vie local, cela représentait l’équivalent de 11 000 emplois annuels. Le départ de cette unité, décidé dans le cadre de la restructuration de notre dispositif prépositionné risque d’être douloureusement ressenti.
Environ 250 personnels civils de recrutement local servent au profit de la force Licorne pour un coût de 700 000 euros par an. Ces personnels, qui perçoivent un salaire aligné sur le niveau de vie local, bénéficient toutefois du droit du travail français en matière, par exemple, de congés ou d’arrêts maladie. Les cotisations sociales patronales sont acquittées auprès des autorités ivoiriennes, à l’exception de celles relatives aux personnes employées dans la zone rebelle, en raison de la désorganisation de l’administration au nord de la ligne de démarcation.
Compte tenu des risques inhérents à la mission de la force Licorne, le service de santé des armées est fortement présent aux côtés des soldats des différentes armées. Même si la situation semble s’être calmée, une brusque dégradation n’est jamais à écarter : rappelons que l’attaque soudaine par l’aviation loyaliste d’un cantonnement français à Bouaké, en novembre 2004, avait causé la mort de neuf de nos soldats tandis que 31 blessés avaient dû être soignés dans l’urgence.
Toutefois, en l’absence d’activité au profit des forces, les médecins et chirurgiens de Licorne œuvrent au profit des populations locales. C’est ainsi que ce personnel réalise chaque année environ 40 000 consultations (62 % des consultations de l’ensemble du pays), et près d’un millier d’interventions chirurgicales au bénéfice de la population ivoirienne (6 % des interventions réalisées dans le pays).
La stabilisation de la situation dans le pays et la réduction des effectifs français déployés ont toutefois conduit au rapatriement, en 2008, du groupe médicochirurgical de Tomboukro, l’un des plus actifs.
II.– L’OPÉRATION DAMAN AU LIBAN
Opération difficile réalisée dans le cadre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), Daman est l’une des rares dont les frais sont en partie remboursés à la France par l’Organisation des Nations unies.
Si l’ONU est présente depuis plusieurs décennies dans le sud du pays, sa force et ses prérogatives ont été renforcées à la suite de l’invasion israélienne de l’été 2006.
1.– Les règles posées par l’ONU
Le mandat donné à la FINUL s’appuie sur plusieurs résolutions de l’ONU : les résolutions 425 et 426 du 19 mars 1978 et la résolution 511 du 18 juin 1982 fixent la mission globale de l’ONU au Sud Liban et exigent un strict respect de la souveraineté du territoire libanais à l’intérieur de ses frontières internationales.
La résolution 1701 du 11 août 2006 fixe les nouvelles missions et attributions de la FINUL « renforcée » au lendemain de la guerre de l’été 2006. La résolution 1773 prolonge le mandat jusqu’au 31 août 2008 et met l’accent sur la coopération de la force internationale avec les forces armées libanaises.
L’ONU agit dans le cadre du chapitre VI de sa charte, c’est-à-dire dans le cadre d’un accord librement accepté par les parties prenantes pour le règlement pacifique de leur différent (le Liban et Israël), mais s’est dotée de règles d’engagement solides de manière à permettre à ses forces de remplir efficacement leurs missions tout en garantissant la sécurité de ses soldats. Ainsi, les casques bleus ont le droit de recourir à la force non seulement pour se défendre mais également pour faire respecter les résolutions de l’ONU.
2.– La résolution 1701 du 11 août 2006
La résolution 1701 confie à la FINUL les principales missions suivantes :
– contrôler la cessation des hostilités ;
– accompagner le déploiement de l’armée libanaise dans le sud du pays où elle était absente depuis plusieurs décennies au profit du Hezbollah ;
– contrôler le désarmement des milices (Hezbollah, Amal…) au Sud Liban, c’est-à-dire entre la frontière israélienne et le fleuve Litani ;
– prendre toutes mesures pour empêcher toute activité hostile de quelque nature que ce soit, au Sud Liban ;
– fournir une assistance humanitaire et permettre le retour volontaire des personnes déplacées ;
– aider le gouvernement libanais à sécuriser ses frontières et à empêcher tout trafic d’armement.
1.– Des effectifs substantiels
À la suite de la guerre de l’été 2006 et de l’adoption de la résolution 1701, les effectifs de la FINUL ont été portés de 2 000 à 12 400 soldats de 25 nationalités différentes placés sous un commandement italien. Début 2009, la contribution française s’élève à environ 1 500 militaires.
L’EUROMARFOR, force maritime européenne, a pris le commandement du volet naval de la FINUL le 1er mars 2008. C’est la première fois que cette force navale, créée en 1995, a opéré sous mandat des Nations unies. Composée principalement d’une frégate et d’une corvette italienne ainsi que d’une frégate française, cette force était complétée par des navires allemands, grecs ou turcs. Devant la modestie des résultats obtenus, cette force cette force a été dissoute fin 2008 a été redéployée en mer Rouge sous le nom d’opération Atalante dans le but de lutter contre la piraterie maritime.
La FINUL est organisée en deux secteurs commandés respectivement à l’ouest par les Italiens et à l’est par les Espagnols. Le bataillon français est implanté en secteur ouest, aux côtés de deux bataillons italiens, d’un bataillon sud-coréen et d’un bataillon ghanéen. Le secteur oriental est occupé par un bataillon espagnol, un bataillon indien, un bataillon indonésien et un bataillon népalais, ainsi que par une compagnie malaisienne.
La France assure en outre la sécurité de l’ensemble de la FINUL grâce à son escadron de chars Leclerc et à ses moyens d’artillerie sol-sol et sol-air qui composent une force de réaction rapide installée au centre géographique du dispositif.
Cette organisation est complétée par d’importants moyens logistiques et du génie, par des hélicoptères ainsi que deux hôpitaux militaires, l’un franco-belge à Tibnin, l’autre chinois à Marjayoun.
C.– LA PLACE ÉMINENTE DE LA FRANCE DANS LE DISPOSITIF ONUSIEN
1.– Une large palette de compétences
Avec environ 1 500 militaires, notre pays est l’un des principaux contributeur en troupes de la FINUL. Les effectifs français se répartissent de la manière suivante :
– 1 083 militaires intégrés dans un groupement tactique interarmes (GTIA) ont une double mission de contrôle de zone, mais aussi de force de réaction rapide au profit de l’ensemble du dispositif ;
– 231 militaires sont insérés soit au sein du PC de la FINUL, à Naqoura, soit au sein de l’état-major du secteur ouest, à Tibnin, soit auprès du général qui représente la France au sein de la FINUL ;
– 152 militaires sont rattachés directement auprès de l’état-major de la FINUL pour des missions de déminage, de dépollution et de travaux divers.
2.– Le groupement tactique interarmes et de la Force de réaction rapide
Le groupement tactique interarmes (GTIA) est un ensemble cohérent disposant de moyens nécessaires à sa double mission de contrôle d’une zone géographique et de protection de l’ensemble du dispositif de la FINUL. Dans la zone qui lui a été assignée en secteur ouest, au contact de la frontière israélienne, le GTIA dont le camp principal est déployé à Al Tiri, remplit une mission de surveillance de l’application de la résolution 1701 de l’ONU. Il contrôle la zone qui lui a été dévolue, noue des contacts avec la population afin d’expliquer la présence de la FINUL et de jauger l’état d’esprit des habitants. Il mène des actions civilo-militaires au profit de la population locale.
Évoluant dans un cadre multinational très marqué, il se coordonne avec les unités voisines de la FINUL (Italiens, Ghanéens, Belges, Indonésiens et Népalais). Conformément à l’esprit de la résolution 1701, les contacts avec l’armée libanaise sont quotidiens. Des exercices de tirs sont menés conjointement.
Le GTIA assure également, avec des moyens lourds, une mission de protection dans le cadre de la force de réaction rapide. Cette force, installée sur les hauteurs de Dayr Kifa, est en mesure d’intervenir rapidement en tout lieu de la zone d’action de l’Onu. Ses canons AUF 1 de 155 mm, d’une portée d’environ 40 kilomètres, seraient en mesure de tirer sur l’ensemble de la zone sans se déplacer. Ses radars de contrebatterie Cobra permettent de suivre la totalité du trafic aérien de la zone FINUL, mais également les éventuels tirs de missiles ou de roquettes et de déterminer les lieux de mise à feu ainsi que les points de chute.
Les 13 chars Leclerc, qui constituent le moyen principal de réaction et de coercition en cas de crise grave, effectuent quotidiennement des patrouilles le long de la frontière israélienne.
III.– L’OPÉRATION TRIDENT AU KOSOVO
L’armée française est présente dans les Balkans depuis la partition de la Yougoslavie. Elle est intervenue d’abord en Bosnie-Herzégovine en 1992, puis au Kosovo en 1999. L’apaisement de la situation en Bosnie a permis une évacuation quasi complète de ce pays par les forces de l’Otan au cours de ces derniers mois. En revanche, la présence militaire internationale reste forte au Kosovo, même si une réduction des effectifs est à l’ordre du jour.
A.– UNE OPÉRATION INTERNATIONALE EN PASSE DE RÉUSSIR
1.– Des effectifs confortables, compte tenu de la superficie du théâtre
Le Kosovo est un engagement ancien pour la France. Sur ce théâtre européen, notre pays joue un rôle de premier plan dans la KFOR, force de l’Otan déployée depuis 1999 : troisième contributeur, la France a la responsabilité de la zone Nord, la plus sensible du point de vue sécuritaire, et assure le commandement de la KFOR par rotation triennale avec l’Italie et l’Allemagne.
Notre pays est également très engagé dans la mission civile l’Union européenne, Eulex, qui doit créer sur le plan de la police et de la justice les conditions permettant la réduction progressive de la présence militaire internationale.
À travers sa présence au Kosovo, la France a montré sa capacité à tenir un rôle de premier rang dans la gestion de la sortie de crise. L’efficacité de sa contribution à la stabilité de la zone a été reconnue par ses partenaires.
En mars 2009, lorsque vos rapporteurs se sont rendus sur place, les effectifs globaux de la Kfor s’élevaient à 15 000 militaires, dont 1 577 Français. Au plus fort de l’opération, en 2000, la France comptait 5 684 militaires sur un total de 50 000. La forte réduction de la présence militaire internationale opérée depuis 2000 ainsi que la poursuite du désengagement témoignent de l’efficacité et de la réussite de la mission.
Sur les 33 pays qui participent à la force multinationale, 28 sont membres de l’Otan tandis que 8 ne font pas partie de l’alliance. Seuls quatre pays fournissent plus de 1 000 soldats : l’Allemagne (2 662), l’Italie (2 043), la France (1 577) et les États-Unis (1 464).
LISTE DES PAYS DONT LES CONTINGENTS SONT INFÉRIEURS À 1 000 MILITAIRES
Autriche |
786 |
Pologne |
285 |
Arménie |
70 |
Espagne |
628 |
Suède |
246 |
Bulgarie |
47 |
Grèce |
607 |
Maroc |
238 |
Lituanie |
36 |
Slovénie |
516 |
Irlande |
232 |
Estonie |
30 |
Turquie |
499 |
Belgique |
208 |
Luxembourg |
22 |
Finlande |
442 |
Suisse |
204 |
Lettonie |
17 |
Rép. tchèque |
412 |
Ukraine |
186 |
Pays-Bas |
9 |
Hongrie |
380 |
Royaume-Uni |
152 |
Norvège |
8 |
Danemark |
359 |
Roumanie |
149 |
Canada |
6 |
Portugal |
292 |
Slovaquie |
143 |
2.– Un coût qui apparaît comme modéré
En 2008, l’opération Trident a coûté 97,2 millions d’euros à la France, ce qui ne représente que 11 % du coût total des opérations extérieures. Ce coût se divise en 54,2 millions d’euros de frais de rémunérations et environ 43 millions d’euros de fonctionnement, investissement et interventions.
Le premier poste de fonctionnement concerne les moyens consacrés à l’externalisation (18,6 millions d’euros), devant l’entretien programmé du matériel et les carburant (15 millions d’euros). Les frais d’infrastructures s’élèvent à 7,7 millions d’euros, les coûts de transport (hors externalisation) à 1,7 million d’euros et les frais d’intervention (contribution aux frais généraux de la Kfor) à 1,1 million d’euros.
Même s’il est loin d’être négligeable, le coût de cette opération reste relativement modéré par rapport aux autres opérations extérieures, en raison de la proximité géographique du théâtre. L’approvisionnement se fait à la fois par voie maritime depuis le port grec de Thessalonique ainsi que par voie routière, en trois jours depuis la France. L’absence de moyens aériens (hors ALAT et drones) contribue également à la maîtrise des coûts.
B.– LE DÉSENGAGEMENT EST ENTAMÉ EN DÉPIT D’INCERTITUDES
1.– Des interrogations subsistent
Même si la tension est moins palpable que par le passé et le retour à de violents affrontements assez improbable, plusieurs éléments continuent à faire peser des incertitudes et des risques quant à la sécurité du pays :
– l’absence de reconnaissance claire de l’indépendance du Kosovo par la communauté internationale : la Serbie, bien sûr, n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo, alors qu’elle l’a fait pour la Bosnie-Herzégovine. Mais d’autres grands pays comme l’Espagne où la Russie, allié traditionnel de Belgrade, n’ont pas reconnu non plus la nouvelle entité. Seuls 22 des 27 pays membres de l’Union européenne ont reconnu le Kosovo qui ne peut, en conséquence, prétendre devenir membre de l’ONU ;
– l’incertitude sur le devenir de la région de Mitrovica, qui ne reconnaît pas le pouvoir de Pristina et où Serbes et Albanais ne semblent pas manifester de volonté de cohabiter et de travailler ensemble ;
– l’incertitude sur le devenir des enclaves serbes, souvent peuplées de personnes âgées, dépendantes de l’aide extérieure pour leur survie, qui ne sont pas prêtes à cohabiter avec les Albanais et qui généralement, ne parlent que le Serbe ;
– une situation économique particulièrement difficile, avec un taux de chômage élevé, compliquée par un environnement juridique instable.
2.– Vers un retrait progressif
Malgré ces éléments négatifs, la situation sécuritaire semble apaisée au Kosovo : les heurts, affrontements ethniques et autres meurtres, particulièrement fréquents au cours des mois et des années ayant suivi l’intervention de 1999, ont très fortement régressé et un modus vivendi semble avoir été trouvé, même si Albanais et Serbes donnent plus l’impression de vivre côte à côte plutôt qu’ensemble.
Dans ces conditions, l’Otan échafaude des scénarios de désengagement progressif du Kosovo, le plus probable conduisant au passage d’une présence de masse à une simple « présence dissuasive » vers 2010 ou 2011, puis à une « présence minimale », quelques années plus tard. Pour la seule zone nord, la première évolution conduirait à une réduction de 60 à 70 % des forces (de 6 000 à 1 600 militaires), la seconde induisant une nouvelle baisse de 50 % des effectifs (800). Il s’agit du plan Discreet enterprise.
Compte tenu de ces éléments, et considérant que la France fournit plus d’éléments qu’il ne lui en est demandé, notre pays a entrepris de réduire, au cours de ce printemps 2009, ses effectifs d’environ 250 militaires. Le passage à la « présence dissuasive » pourrait conduire la France à ne conserver sur place que 600 militaires au lieu des 1 577 actuels.
IV.– LE TCHAD ET LE CENTRAFRIQUE
L’armée française est présente au Tchad de manière permanente depuis les années 1980, époque à laquelle elle était intervenue pour préserver l’intégrité du pays face à des menaces étrangères apparues sur la frontière nord. Il s’agit de l’opération extérieure la plus ancienne.
A.– UNE JUXTAPOSITION D’OPÉRATIONS MULTINATIONALES
1.– Des opérations nationales depuis les années 80
Les revendications libyennes sur la bande d’Aozou, au début des années 80, ont provoqué une crise internationale. La Libye intervenant grâce à l’emploi de l’arme aérienne dont ne disposaient pas les forces tchadiennes, N’Djamena a demandé l’aide de la France qui déclencha l’opération Manta.
En 1984, un accord signé avec la Libye permit à la France de retirer ses troupes du pays. Mais, le 16 février 1986, l’activité des forces libyennes au-delà du seizième parallèle conduisit le Président François Mitterrand à déclencher l’opération Épervier : de nouvelles forces furent envoyées au Tchad pour garantir l’intégrité territoriale de ce pays. Des combats se déroulèrent en 1987 entre forces françaises et libyennes. Ni le retrait libyen de la fin des années 80, ni la reconnaissance par Tripoli de l’appartenance de la bande d’Aozou au Tchad ne mirent un terme à la présence françaises et à l’opération Épervier qui perdure aujourd’hui encore.
2.– L’opération Eufor mise en place en 2008
Depuis 2005, la dégradation de la situation au Darfour, dans l’ouest du Soudan, a provoqué au Tchad un afflux de réfugiés : 250 000 personnes ont été accueillies et réparties dans douze camps de l’est du pays. Pour sécuriser cette zone, par ailleurs marquée par la présence de forces rebelles soutenues par à Khartoum, l’Union européenne a décidé, en janvier 2008, à l’initiative de la France, de mettre en place une force de sécurisation européenne, l’Eufor.
Le mandat de l’Eufor devant devait s’achever le 15 mars 2009 et laisser la place à une force des Nations unies, la Minurcat (Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad) censée compléter la mission de police de l’ONU. Lorsque la mission d’évaluation et de contrôle s’est rendue sur place, en avril 2009, le retard pris par la mission de l’ONU contraignait l’Eufor à conserver une forte présence sur place.
3.– La Minurcat n’est pas au rendez-vous
La Minurcat aurait dû être opérationnelle le 15 mars 2009, date à laquelle il était prévu qu’elle prenne le relais de l’Eufor. Les lenteurs de la machine onusienne ainsi que les difficultés à acheminer dans une des régions les plus enclavées de la planète des contingents issus de pays divers et éloignés (Népal, Ghana, Uruguay, Togo) retardent toujours la mise en place de cette force.
Pour les responsables français du ministère de la Défense que les rapporteurs ont rencontrés, l’ONU n’est pas au rendez-vous de la succession de l’Eufor car « elle souffre de procédures trop lourdes qui nuisent à la souplesse nécessaire sur des théâtres aussi éloignés et rudes que le Tchad » où tout doit être importé à grand frais.
B.– DES MOYENS MILITAIRES SUBSTANTIELS
1.– Eufor a bénéficié de la logistique d’Épervier
Au 1er avril 2009, le dispositif national Épervier mettait en œuvre un détachement de 1 142 militaires français dont 751 pour le groupement terre et 392 pour le groupement air. Le dispositif est articulé autour de trois sites : N’Djamena la capitale, Faya Largeau au nord et Abéché dans l’est du pays.
Les forces françaises du dispositif Épervier bénéficiaient des principaux moyens suivants : 6 Mirage F1, 3 avions de transport Transall, un avion ravitailleur C 135, 3 hélicoptères Puma et 12 blindés légers ERC 90.
L’Eufor, pour sa part, a compté jusqu’à 3 300 militaires européens au plus fort de son déploiement. En mars 2009, au moment de son – théorique – retrait, les effectifs étaient les suivants :
LISTE DES PAYS PARTICIPANT À L’EUFOR (MARS 2009)
France |
1 640 |
Belgique |
59 |
Irlande |
423 |
Croatie |
15 |
Pologne |
387 |
Slovénie |
14 |
Autriche |
159 |
Royaume-Uni |
3 |
Russie |
98 |
Suède |
3 |
Italie |
93 |
Luxembourg |
2 |
Espagne |
85 |
Bulgarie |
1 |
Finlande |
67 |
Grèce |
1 |
Pays-Bas |
67 |
Roumanie |
1 |
Albanie |
63 |
Rép. tchèque |
1 |
Comme on le constate, notre pays a fourni plus de la moitié des effectifs et s’est largement appuyé sur les moyens logistiques du dispositif national Épervier pour soutenir l’opération européenne. À ces forces européennes s’est joint un contingent russe composé de 120 personnes et de quatre hélicoptères lourds MI 8.
2.– Un coût important en raison de l’enclavement du théâtre
En 2008, au plus fort de la crise, jusqu’à 3 300 militaires français ont été présents au Tchad simultanément. C’est la raison pour laquelle le théâtre tchadien a coûté en 2008 autant que le théâtre afghan. Une autre particularité que partagent ces deux théâtres est leur enclavement.
Le ravitaillement du Tchad n’est possible que de deux manières : par voie aérienne, la liaison avec la France prend un minimum de cinq heures et s’avère particulièrement coûteuse ; par voie maritime, les porte-conteneurs mettent une quinzaine de jours à acheminer leurs marchandises au Cameroun. Compte tenu de l’état des routes, il faut ensuite compter encore deux semaines pour acheminer les conteneurs par camion jusqu’à N’Djamena, soit un mois au total. Les forces stationnées dans l’est du pays doivent encore patienter une semaine supplémentaire pour recevoir les marchandises acheminées par voie routière de la capitale à Abéché, puis jusqu’à leur destination finale. L’approvisionnement en eau potable, qui constitue l’une des préoccupations principales des forces, se fait par vols quotidiens de Transall, depuis N’Djamena vers Abéché et le Centrafrique.
La zone d’opération de l’Eufor est particulièrement vaste : elle s’étend sur 760 kilomètres du nord au sud et sur 450 kilomètres d’est en ouest.
Le coût de l’opération Épervier, en augmentation constante, s’est élevé à 74 millions d’euros en 2005, 77 millions d’euros en 2006, 93 millions d’euros en 2007 et 104 millions d’euros en 2008.
Le mécanisme Athéna, qui détermine le financement des opérations extérieures menées par l’Union européenne, limite la contribution de l’Union aux coûts communs et confie aux différents pays le soin de financer la participation de leur contingent. C’est la raison pour laquelle la contribution européenne à l’opération Eufor ne s’est élevée qu’à 119 millions d’euros pour l’année 2008. Sur ce total, la France a pris en charge 15,57 % du total, soit 18,5 millions d’euros, auxquels se sont ajoutés 130 millions d’euros directement imputés sur le budget national.
C.– L’ENGAGEMENT FRANÇAIS AU CENTRAFRIQUE
L’opération Boali en République centrafricaine a commencé en 2003. Son objectif consistait à participer à la reconstruction des forces armées centrafricaines, à assurer le soutien de la Micopax, la mission multinationale et multidimensionnelle de consolidation de la paix de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CÉÉAC). Les effectifs engagés sont stables et numériquement peu importants : 230 hommes pour un coût de 18 millions d’euros.
Cet engagement est fondé sur l’accord de défense signé avec le Centrafrique en 1960. Il vise également à soutenir une opération sous-régionale conduite par la CEEAC, sans date limite définie.
Le renforcement des forces armées centrafricaines doit conduire à une meilleure sécurisation du pays par ses propres moyens et à la stabilité de la région. L’opération permet également aux forces françaises de sécuriser une zone permettant de faciliter une éventuelle évacuation de ressortissants.
Si l’opération Épervier a permis, depuis les années 80, de préserver l’intégrité territoriale ainsi qu’une relative stabilité du pays, l’intervention européenne aux confins du Darfour a également obtenu, sur le plan opérationnel, des résultats incontestables en matière de sécurité des populations réfugiés :
– le nombre d’attaques contre les organisations non gouvernementales a fortement diminué, grâce à la mise en place d’escortes pour les ONG qui le souhaitent ;
– le nombre de retours des réfugiés et déplacés dans leur localité d’origine a augmenté, même si ce nombre reste faible et difficile à évaluer, et même si les retours ne sont pas toujours définitifs ;
– l’est du Tchad a été en grande partie sécurisé par les patrouilles régulières de l’Eufor.
En revanche, le dispositif européen n’a pas empêché – mais ce n’était pas son mandat – les deux attaques de rebelles tchadiens qui se sont développées depuis le Soudan et avaient pour objectif la prise de N’Djamena, en février 2008 et en mai 2009.
Par ailleurs, l’Eufor n’ayant pas reçu mandat du conseil de sécurité des Nations unies d’intervenir dans les camps de réfugiés et de déplacés, des problèmes subsistent en matière de lutte contre le banditisme et le recrutement des enfants soldats. La sécurisation dans les camps incombe à la mission de police des Nations unies mais n’est pas encore pleinement exercée, faute de déploiement suffisant de la Minurcat.
Sur le plan politique, l’Eufor qui est la plus importante opération militaire jamais menée par l’Union européenne a permis de renforcer la crédibilité opérationnelle de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Toutefois, l’effet d’entraînement sur les partenaires européens de la France n’a pas été à la hauteur des attentes, notre pays ayant dû participer pour plus de la moitié des effectifs de la force.
Déstabilisé par l’intervention de l’armée soviétique entre décembre 1979 et février 1989, ce pays, parmi les plus défavorisés de la planète, a connu jusqu’en 2001 une guerre civile qui s’est achevée par la mise en place d’un régime islamique extrémiste, celui des talibans.
A.– UNE OPÉRATION MULTINATIONALE COMPLEXE
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, une coalition internationale largement dominée par les États-Unis a renversé le régime des talibans, dominé et piloté par l’organisation terroriste Al-Qaïda. Prolongeant cette intervention initiale, une force internationale s’est déployée en Afghanistan sous l’égide de l’Otan dans le but de stabiliser le pays par l’appui aux autorités légitimes.
1.– Deux opérations distinctes : Enduring freedom et Pamir
L’intervention française en Afghanistan repose sur deux opérations distinctes, elles-mêmes subdivisées :
– la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) a pour mission la stabilisation du pays par l’appui aux autorités légitimes. Les effectifs de cette force étaient, au 15 mars 2009, de 58 640 soldats dont 26 460 Américains. 41 pays participent à cette force. Le contingent français, dénommé Pamir, compte 2 925 militaires. Principalement déployée dans les régions centre et est, cette force compte 451 engins blindés, 6 hélicoptères (3 Caracal et 3 Gazelle), 6 drones SDTI de l’armée de terre, 2 drones SIDM de l’armée de l’air et six avions de chasse basés à Bagram (3 Mirage 2000D et 3 Rafale). C’est au sein de la FIAS que sont comptés les 405 militaires servant dans des OMLT, ces équipes de liaison chargées de conseiller et de superviser les unités de l’armée afghane ;
– l’opération Enduring freedom de lutte contre le terrorisme et pour la formation de l’armée afghane. Elle compte 13 700 militaires dont 12 000 Américains et 1 030 Français répartis de la manière suivante : 66 au sein de l’opération Epidote de formation des cadres de l’armée afghane, 41 dans le dispositif Héraclès terre, 268 dans le dispositif Héraclès air (2 Transall à Douchanbé, un ravitailleur C135 FR à Manas) et 655 dans le cadre de l’opération Héraclès mer de lutte contre le terrorisme en océan Indien (5 bâtiments de surface, un sous-marin nucléaire d’attaque et un avion de reconnaissance Atlantique 2).
L’effectif français engagé, au mois de mai 2009, s’élevait donc à 3 955 hommes et femmes. En 2008, le budget de l’opération Pamir s’est élevé à 146 millions d’euros, celui d’Héraclès à 89 millions d’euros et celui d’Epidote à 1 million d’euros.
2.– Un nombre important de pays impliqués à des degrés divers
Quarante et un pays participent aux opérations en Afghanistan, principalement au sein de la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS). Sans surprise, les États-Unis constituent la force la plus imposante, avec 23 500 soldats, soit 42 % des effectifs globaux (56 400), loin devant le Royaume-Uni (9 050), l’Allemagne (3 376), la France (3 168), le Canada (2 780), l’Italie (2 350), les Pays-Bas (1 769), la Pologne (1 591) et l’Australie (1 088) et 32 autres nations dont la contribution est inférieure à un millier de soldats.
LISTE DES PAYS DONT LES CONTINGENTS SONT INFÉRIEURS À 1 000 MILITAIRES
Roumanie |
873 |
Slovaquie |
227 |
Azerbaïdjan |
45 |
Espagne |
778 |
Lituanie |
201 |
Arménie |
25 |
Turquie |
732 |
Macédoine |
168 |
Singapour |
21 |
Danemark |
700 |
Lettonie |
165 |
Luxembourg |
9 |
Rép. tchèque |
580 |
Nlle-Zélande |
152 |
Islande |
8 |
Belgique |
500 |
Grèce |
145 |
Irlande |
7 |
Norvège |
494 |
Albanie |
138 |
Jordanie |
7 |
Bulgarie |
473 |
Estonie |
138 |
Autriche |
3 |
Suède |
430 |
Finlande |
90 |
Ukraine |
3 |
Croatie |
296 |
Slovénie |
73 |
Géorgie |
1 |
Hongrie |
240 |
Portugal |
52 |
En mars 2009, le total des pertes enregistrées par la coalition (combats et accidents) en Afghanistan depuis 2001 s’élevait à 1 109 militaires dont près de la moitié survenues au cours des deux dernières années. Ces pertes sont sans commune mesure avec les autres théâtres sur lesquels opèrent les armées françaises. Le tableau suivant établit le bilan des pertes humaines par pays :
TOTAL CUMULÉ DES PERTES MILITAIRES EN AFGHANISTAN ENTRE 2001 ET MARS 2009
États-Unis |
666 |
Espagne |
25 |
Royaume-Uni |
152 |
Danemark |
21 |
Canada |
112 |
Pays-bas |
18 |
Allemagne |
29 |
Italie |
13 |
France |
27 |
autres |
46 |
NB : pour l’Espagne, les 62 soldats morts dans un accident d’avion survenu lors d’un transit en Turquie ne sont pas pris en compte.
B.– LES ÉVOLUTIONS DE CES DERNIERS MOIS
Depuis l’été 2008, le dispositif français a été renforcé par les moyens suivants :
– en juillet 2008, un bataillon de 700 hommes a été déployé dans la Kapisa, sous commandement américain ;
– en juillet 2008 également, 350 militaires supplémentaires ont été déployés dans le cadre de la prise de commandement de la région centre par la France pour une durée d’un an et trois mois. Durant son mandat, la France est chargée, en liaison avec ses partenaires turcs et italiens, de transférer les responsabilités sécuritaires de la région de Kaboul aux forces afghanes ;
– en août 2008, une OMLT de 72 hommes a été déployée dans la région d’Ourouzgan sous commandement néerlandais (région sud) ;
– en octobre 2008, pour améliorer la cohérence de son dispositif, la France a décidé le déploiement de capacités supplémentaires : des moyens d’acquisition de renseignement (drones et guerre électronique), des appuis feux (mortiers de 120 mm) et des moyens aéromobiles (un caracal et trois gazelle). Ce renforcement représente une centaine d’hommes ;
– en janvier 2009, l’armée de l’air a déployé trois drones SIDM (système intérimaire de drone Male – moyenne altitude longue endurance) sur la base aérienne de Bagram afin de renforcer les capacités de renseignement de la coalition.
Le déploiement à Kaboul de trois hélicoptères d’attaque Tigre reste envisagé, même s’il n’est pas encore décidé.
C.– UNE ENVOLÉE DU COÛT DE L’OPÉRATION
En 2008, le coût des opérations menées en Afghanistan a été évalué à 236 millions d’euros, soit 30 % du coût global des opérations extérieures de l’année. Avec un effectif moyen de 2 726 militaires, le titre II (rémunérations et charges sociales) s’est élevé à 90 millions d’euros contre 160 millions d’euros pour les autres dépenses. Les frais de fonctionnement se sont élevés à 90 millions d’euros, le transport stratégique à 45 millions d’euros, les frais d’infrastructure à 15 millions d’euros, les transferts au profit de l’Otan à 4 millions d’euros, etc.
En 2009, le montant total du coût des opérations en Afghanistan est estimé à 330 millions d’euros (+ 40 %) ce qui représente 39 % du coût de l’ensemble des opérations menées par les forces françaises. Compte tenu de la hausse des effectifs présents (3 247 militaires en moyenne), le titre 2 est désormais évalué à 120 millions d’euros. Les frais de fonctionnement s’élèvent à 55 millions d’euros, le transport stratégique à 45 millions d’euros, le maintien en condition opérationnelle des matériels à 52 euros…
Ce coût élevé résulte en grande partie de l’éloignement du théâtre afghan, atteignable depuis la France par voie aérienne seulement. Il est également lié à des équipements personnels spécifiques et plus coûteux (gilets pare-balles de dernière génération, bottes de montagne spécifiques…). Enfin, le maintien en condition opérationnelle des matériels malmenés sur les pistes de montagne, est beaucoup plus onéreux qu’ailleurs. Et encore, ainsi que nous l’avons vu, les coûts présentés n’intègrent pas les programmes réalisés dans l’urgence, particulièrement coûteux, tels que l’achat de véhicules spécifiques (VAC, VHM, Buffalo…), l’installation de tourelleaux téléopérés sur les VAB ou encore l’achat de brouilleurs.
De l’utilité d’un billet d’un euro
Sur les théâtres d’opérations extérieures, nos forces ont besoin de disposer de liquidités financières. D’importants efforts sont pourtant consentis pour réduire les transactions en numéraires : les employés locaux sont tenus d’ouvrir un compte bancaire où leur sont virés leurs salaires ; les paiements par virement sont également privilégiés pour les entreprises locales… Malgré cela, un certain nombre de transactions continuent à être réalisées en nature (achats dans l’urgence, petites dépenses, négociations des forces spéciales…).
Rien que sur le théâtre afghan, nos forces acheminent 120 kg de billets et de pièces par voie aérienne chaque trimestre, pour les paiements en nature, ce qui pose des problèmes de logistique et de poids. Les autres armées européennes sont confrontées aux mêmes difficultés. La création d’un billet d’un euro, à l’instar de ce qui existe aux États-Unis avec le billet d’un dollar, présenterait l’avantage de réduire sensiblement le poids des sommes transportées. En outre, ce billet serait apprécié des personnels locaux qui ne peuvent échanger les pièces, seules les coupures étant traditionnellement acceptées par les bureaux de change.
Il existe au moins un théâtre sur lequel la question du change ne se pose pas : c’est le Kosovo, qui a adopté de manière unilatérale, dès 2002, l’euro comme monnaie nationale.
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA MEC
Proposition n° 1 – Mettre en place un indicateur de performance destiné à mesurer le montant des achats réalisés en urgence et le délai entre l’expression du besoin et la délivrance des équipements aux armées sur le théâtre.
Proposition n° 2 – Inclure dans le coût des Opex les programmes d’achat de matériel en urgence liés à la situation d’un ou plusieurs théâtres d’opération.
Proposition n° 3 – Mettre en place les indicateurs de performance suivants destinés à mesurer l’adaptation des armées aux Opex :
– taux de militaires partant en Opex plus fréquemment que la norme fixée par l’armée de terre à quatre mois sur seize ;
– évolution du taux de renouvellement des contrats des militaires ayant servi en Opex, par comparaison à l’ensemble des militaires.
Proposition n° 4 – Poursuivre les consultations entre le ministère du Budget et celui de la Défense pour aboutir à une mise en jour de l’instruction de 1984 qui prenne en compte, de la manière la plus exhaustive possible, le coût des opérations extérieures.
Proposition n° 5 – Publier chaque année, dans les PAP et dans les RAP, la prévision du coût des Opex par théâtre, ainsi que la réalité de la dépense. Présenter un tableau prévisionnel des remboursements attendus d’organismes internationaux (ONU, Otan)
Proposition n° 6 – Établir un tableau consolidé de l’ensemble des contributions versées ou affectées tant par le ministère de la Défense que par celui des Affaires étrangères ou par d’autres voies sur le plan multilatéral ou national, aux opérations de maintien de la paix et aux Opex.
Proposition n° 7 – Prendre en compte dans le coût des Opex la totalité des dépenses, y compris :
– les dépenses de long terme liées aux carrières (bonifications de retraites, les rentes et pensions d’invalidité...) ;
– les dépenses liées au renforcement de la préparation des personnels envoyés en opérations extérieures ;
– le coût des matériels et équipements perdus en action.
Proposition n° 8 – Étoffer les effectifs du centre de préparation et de conduite des opérations par un redéploiement interne à l’état-major des armées.
Proposition n° 9 – Bien distinguer dans le coût des opérations extérieures les dépenses qui relèvent réellement de la défense et celles ressortissant à la coopération ou à l’aide au développement.
Proposition n° 10 – Compte tenu de la part importante de la France au budget général de l’Otan, le périmètre des dépenses communes doit rester limité aux seules dépenses réellement indivises, chaque pays devant continuer à financer ses dépenses propres.
Proposition n° 11 – Impliquer chaque fois que possible les partenaires européens de la France pour mettre en place des opérations à l’échelle de l’Union européenne, plutôt qu’à l’échelle nationale. Dans le cas de l’Afrique, impliquer chaque fois que possible les pays membres d’Euro Recamp dans les opérations de maintien de la paix.
Proposition n° 12 – Poursuivre l’amélioration du financement en loi de finances initiale de la totalité du coût prévisionnel des Opex.
Proposition n° 13 – Lorsqu’il présente au Parlement une demande d’autorisation de renouvellement d’opérations extérieures, le Gouvernement communique, pour chaque théâtre, une actualisation des coûts ainsi qu’une étude d’impact.
Proposition n° 14 – Lorsqu’une opération extérieure est lancée, s’il n’est pas expressément décidé que sa durée sera limitée à quelques mois, les armées ont intérêt à bâtir aussitôt que possible des installations pérennes aussi standardisées que possible qui, outre les avantages sécuritaires, feront réaliser, sur la durée, des économies substantielles en matière d’infrastructures.
Proposition n° 15 – Facturer les prestations rendues par la France aux armées alliées selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées pour facturer à nos forces les prestations équivalentes. Prendre en compte la notion de coût global et non de coût marginal.
Proposition n° 16 – Lorsqu’il apparaît que le coût de location d’un matériel, notamment d’un véhicule, est supérieur, sur la durée d’utilisation envisagée, au coût d’achat, privilégier l’acquisition patrimoniale.
Proposition n° 17 – Les crédits d’équipement (titre 5) provenant du titre 2 ou du titre 3 par le jeu de la fongibilité des crédits et utilisés pour des dépenses d’équipement directement liées aux opérations extérieures font l’objet d’un remboursement en loi de finances rectificative au titre du surcoût Opex.
Proposition n° 18 – Se réserver la possibilité que toute intervention militaire aboutissant à la récupération d’un navire, en particulier commercial, mis en difficulté par un acte de piraterie fasse l’objet d’une facturation adressée au propriétaire ou à son assureur.
Proposition n° 19 – Permettre aux armées de réutiliser pour leur propre compte le matériel saisi en opération, en particulier les embarcations rapides saisies lors d’arrestations de narcotrafiquants. Modifier, si nécessaire, la législation en vigueur.
Proposition n° 20 – Créer une mission d’évaluation et de contrôle sur le coût et les bénéfices attendus de l’externalisation au sein du ministère de la Défense.
Au cours de la séance du 1er juillet 2009 à 11 heures, la Commission des Finances a examiné le présent rapport.
Après l’exposé des rapporteurs, un débat s’est engagé.
M. le président Didier Migaud. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je vous remercie pour la grande qualité de votre travail qui montre une fois de plus toute la pertinence des missions d’évaluation et de contrôle. Je me félicite que la commission des Finances et les autres commissions travaillent de conserve, car nos propositions seront d’autant mieux entendues que d’autres commissions auront été associés à leur élaboration.
J’adhère aux propositions formulées, mais il me semble que la proposition n° 18 gagnerait à être précisée. Je comprends la logique qui la sous-tend, et il est effectivement choquant que ceux qui ont bénéficié du secours de la force publique n’aient même pas l’idée d’envoyer un mot de remerciement. Toutefois, il faut distinguer sociétés commerciales et personnes privées. L’État a un devoir d’assistance à l’égard de nos concitoyens, et bien des imprudences sont commises sans que leurs auteurs reçoivent une facture. Pour autant, si une société pétrolière continue de faire emprunter à ses navires des itinéraires qui leur ont été fortement déconseillés, il faut, bien sûr, envisager une sanction financière.
M. Georges Tron, président de la mission d’évaluation et de contrôle. Cette mission a été des plus intéressantes, mais nous avons été frappés, au cours des auditions, par une absence de bon sens un peu trop bien partagée.
Elle s’est manifestée en premier lieu dans la nature des relations entre le ministère du Budget et celui de la Défense. Nous avons entendu des personnalités venir régler leurs comptes devant nous ; il était flagrant que la communication ne passait plus et que l’on demandait à la mission de jouer un rôle de médiation. Il convient d’insister auprès des ministres concernés sur ce que cette situation a de choquant.
Nous avons eu le sentiment que les relations entre les trois armées manquaient également de liant. Là encore, il conviendrait d’inciter le ministre à intervenir.
J’en viens à la budgétisation. Certes, 24 millions ont été inscrits au budget de 2003 au titre des Opex, et pour la première fois. Seulement, cette somme ne représentait qu’une infime partie du coût total de ces opérations, et l’on voit bien que la France ne bénéficie pas des économies d’échelle que devraient permettre des opérations européennes. Là encore, le bon sens fait gravement défaut.
Je comprends le point de vue exprimé par le président Didier Migaud : il paraît effectivement difficile d’envoyer la facture des secours à des plaisanciers qui ont été victimes d’actes de piraterie. Toutefois, le dispositif actuel est très déresponsabilisant. Nous devons donc nous doter des moyens juridiques qui permettront de récupérer les sommes dépensées auprès de ceux qui ont les moyens de les rembourser. Peut-être, en effet, la sanction financière ne doit-elle pas être automatique, mais quand notre marine est contrainte de mener des opérations de police, alors que ce n’est pas son rôle, parce que des sociétés commerciales ignorent sciemment les mises en garde qui leur ont été faites, il faut pouvoir sanctionner ces comportements irresponsables.
La proposition n° 19 me laisse dubitatif. Dans tous les cas, la réutilisation par nos armées du matériel saisi en opération ne peut être entreprise sans garanties juridiques très protectrices.
Je remercie les rapporteurs, grâce auxquels nous avons fait des découvertes passionnantes.
M. Jean Launay. Je m’associe aux remerciements adressés aux deux rapporteurs.
J’aimerais savoir si les déclarations faites par le ministre de la Défense, le 8 juin dernier, lors du débat sur la loi de programmation militaire, soulignant la nécessité d’un soutien financier régulier pour assurer la disponibilité des matériels ont été suivies d’effets. Cette disponibilité est la condition première de la sécurité de nos hommes et de l’opérationnalité réelle.
J’aimerais aussi savoir sur quelle base est calculé le remboursement onusien et comment il est comptabilisé dans le budget du ministère de la Défense.
Enfin, la nature des Opex a beaucoup changé depuis 1984, à mesure que notre présence se renforçait en Asie centrale – en Afghanistan en particulier. Il faut donc imposer aux deux ministères concernés un dialogue approfondi à ce sujet, dialogue manifestement inexistant à ce jour.
M. François Goulard. Le rapport qui nous a été soumis est d’un intérêt soutenu. Il est rare que des dysfonctionnements et des sources de gaspillage sautent aussi clairement aux yeux. À ce sujet, la Cour des comptes a-t-elle menée un travail aussi approfondi que la mission ? Les aberrations décrites me semblent pour certaines être passibles de la Cour de discipline budgétaire. N’est-ce pas une perversion de préférer louer des matériels, parce que, contrairement aux crédits d’équipement, les crédits de fonctionnement sont réinscrits, plutôt que d’en acheter ? Qu’en dit la Cour des comptes?
D’autre part, la sous-évaluation en loi de finances initiale du coût des Opex est permanente. En fait, la dotation devrait être supérieure à un milliard d’euros – chacun conviendra que ce montant n’a rien d’anecdotique. Il est inacceptable que ce procédé perdure. Puisque ces crédits n’ont plus rien d’exceptionnel, les dotations doivent apparaître dans la loi de finances initiale, pour permettre un réel contrôle du Parlement, obliger le ministre à justifier des inscriptions budgétaires et mettre en évidence les aberrations éventuelles. La lisibilité du budget en serait grandement améliorée.
M. Jean-Louis Dumont. Je félicite nos deux rapporteurs qui contribuent à faire la clarté sur les comptes de la Nation.
J’aimerais en savoir plus sur l’état réel de nos matériels, particulièrement les hélicoptères.
J’aimerais aussi savoir si nos hommes, dont on sait l’engagement remarquable dans les pires conditions, sont, eux aussi, convenablement équipés.
D’autre part, une préparation psychologique est-elle prévue pour ces soldats qui passent d’un théâtre d’opération à un autre et qui sont tenus de s’adapter à des situations très différentes dans des pays eux-mêmes très différents ?
Enfin, je crains que l’on ne tende à externaliser certains services au seul motif que d’autres armées ont elles-mêmes externalisé des opérations militaires.
La base aussi bien que les officiers généraux ayant fait état de multiples difficultés, la commission des Finances a largement matière à continuer de vérifier, avec la commission de la Défense, que les finances publiques sont correctement utilisées. Le culte du secret a fait son temps et la transparence doit prévaloir.
M. Laurent Hénart. Je remercie à mon tour les rapporteurs pour la qualité de leur travail.
Au Kosovo, où je suis allé avec la 4ème brigade aéromobile, dont l’état-major se trouvait à Nancy, deux choses m’avaient plus particulièrement marqué.
D’abord, l’importance de l’action humanitaire en direction des civils. Il ne faudrait surtout pas faire cesser ces opérations civiles et de coopération car d’après ce que nous avaient dit les militaires sur place à l’époque, elles contribuent grandement à la qualité de leur intervention et à leur propre sécurité. Il conviendrait en revanche de mettre en place une comptabilité analytique afin de bien distinguer ce qui relève de la mission militaire et ce qui relève plutôt de la coopération. L’a-t-on fait, de manière expérimentale, sur quelque théâtre d’opération?
M’avaient aussi marqué à l’époque les étapes successives de l’installation des troupes, dans des tentes d’abord, puis des locaux trouvés sur place, éventuellement pris en location chez l’habitant, ensuite des ébauches de constructions… – au point qu’on en est venu à se poser la question de l’installation de camps modèles standardisés qui pourraient être partout rapidement construits. Cela a-t-il été fait quelque part ? L’intérêt de cette installation d’emblée dans des locaux en dur a-t-il pu être évalué ?
M. Thierry Carcenac. Je m’associe aux félicitations adressées aux rapporteurs par tous les orateurs qui m’ont précédé.
Ce qui me frappe, moi, c’est la faiblesse des retombées économiques pour les entreprises françaises de nos opérations militaires extérieures. Les rapporteurs déplorent le faible engagement de nos entreprises dans les opérations de soutien de nos armées comme de reconstruction. Leurs propositions en ce domaine ne pourraient-elles pas aller plus loin encore ?
Enfin, la remarque sur l’utilité de la création d’un billet de 1 euro n’a pas manqué de m’intéresser.
M. le président Didier Migaud. La commission des Finances insiste encore et toujours sur la sous-évaluation des crédits Opex. Des progrès ont été réalisés. Le ministre actuel est sensible au problème et a veillé à ce que la dotation inscrite en loi de finances initiale soit plus élevée. Un pas supplémentaire devra être franchi, dans la mesure où on sait encore pertinemment que les crédits réellement utilisés seront supérieurs à ceux budgétés, ce qui met en cause la sincérité des estimations budgétaires. Il ne me choque pas que des ajustements puissent avoir lieu en cours d’année mais ils doivent pouvoir être justifiés.
L’intérêt de ce rapport est aussi de proposer des économies potentielles, certains gaspillages, François Goulard l’a dit, résultant de comportements anormaux, dont il faudrait toutefois être certain qu’ils ne sont pas la conséquence d’une application rigide de principes eux-mêmes trop rigides. La LOLF a essayé d’apporter des solutions. Certaines règles devront peut-être être rappelées.
Ne doutant pas que la Commission autorisera la publication de ce rapport, j’invite les rapporteurs à communiquer le plus largement possible à son sujet et à le diffuser auprès de la presse. Fruit d’un important travail, les propositions très intéressantes contenues dans ce rapport méritent d’être connues.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, rapporteure. En ce qui concerne la piraterie, il ne s’agit pas de facturer systématiquement l’intervention de nos forces mais de faire savoir que le ministère de la Défense peut, dans certains cas, être amené à exiger le remboursement des frais engagés. Cela aurait tout d’abord une vertu pédagogique. Si les plaisanciers savaient que, le cas échéant, tout ou partie de ces frais pourraient leur être facturés, cela les inciterait sans doute à s’assurer, beaucoup d’entre eux ne l’étant pas encore. Pour le reste, soyez assurés que nous faisons bien la différence entre les catégories de navires.
S’agissant de notre proposition que les armées puissent réutiliser pour leur propre compte les matériels saisis en opération, je suis, comme vous, consciente des difficultés juridiques que cela peut poser. Nous n’avons fait qu’ouvrir une piste sur laquelle il faut, ensemble, continuer d’avancer. Nos policiers et nos gendarmes déplorent eux aussi de ne pas pouvoir utiliser les véhicules très rapides saisis auprès de certains malfaiteurs, qui leur seraient bien utiles pour d’autres opérations. Mais, bien évidemment, un encadrement juridique très strict doit être prévu.
Pour ce qui est des matériels, vous avez demandé si ceux utilisés dans les Opex sont parfaitement adaptés et en bon état. Les armées ne diront jamais le contraire. Je pense, pour ma part, que l’on met à disposition des troupes les matériels nécessaires… dans la limite de ceux possédés. L’aéromobilité, par exemple, est très déficiente. Ce n’est, hélas, qu’après l’embuscade d’Ouzbin que nos troupes ont pu obtenir un troisième hélicoptère Caracal en Afghanistan, alors même que ces appareils, utilisés notamment pour aller récupérer des blessés, volent nécessairement par deux. Nous n’en avions auparavant que deux sur place, c’est-à-dire aucun si l’un était en panne. Il n’y a là aucune mauvaise volonté politique. Nos armées n’ont tout simplement pas tant de matériels que cela. Nul ne doute que si elles possédaient les matériels nécessaires, elles les mettraient à disposition ! Par ailleurs, le report de la livraison de l’A400M va coûter très cher au budget de la Défense en matière de transport.
De même, sur un plan plus modeste, tous nos soldats en Afghanistan ne sont-ils pas encore équipés de chaussures de montagne. Il est prévu de le faire, comme on les a équipés progressivement d’un nouveau gilet pare-balles, plus protecteur et entravant moins leur mobilité. Mais il a fallu un an pour que tous soient équipés. Ce sous-équipement conduit aux achats dans l’urgence, souvent décriés, et pousse parfois nos militaires à s’acheter eux-mêmes leur équipement – cela a notamment été le cas des chaussures de montagne en Afghanistan –, ce que le chef d’état-major des armées interdit pourtant formellement. Toutes ces difficultés ne tiennent pas seulement à des raisons budgétaires, mais aussi au fait qu’on ne dispose pas des matériels et de l’équipement ad hoc.
Je laisserai Louis Giscard d’Estaing vous répondre plus précisément sur notre collaboration avec la Cour des comptes.
M. Louis Giscard d’Estaing, rapporteur. La Cour des comptes travaille en effet sur le coût des Opex depuis plus d’un an. Son rapport ne sera, hélas, disponible que le 8 juillet. Les lourdeurs de ses procédures internes expliquent les trop longs délais entre le moment où la Cour se saisit d’un sujet et celui où ses conclusions sont disponibles.
M. le président Didier Migaud. Le Premier Président de la Cour des comptes est conscient de ces lourdeurs et de la longueur des délais. La Cour a fait beaucoup de progrès et est désormais beaucoup plus réactive.
M. Louis Giscard d’Estaing, rapporteur. Georges Tron a regretté un manque de bon sens financier dans l’établissement des bases de calcul. Il faut savoir qu’il n’existait pas, jusqu’à il y a peu, de comptabilité analytique au ministère de la défense. L’état-major des armées s’est maintenant doté d’un bureau budget-finances de bon niveau mais qui n’est pas encore en mesure de connaître exactement tous les frais réels engagés par les armées. Cela étant, d’une manière générale, il est difficile d’évaluer le surcoût strictement lié aux Opex. En effet, quel est-il par rapport aux coûts ordinaires d’entraînement et de fonctionnement d’un régiment en matière de munitions, de carburant, d’usure des matériels… ? Des études sont actuellement menées sur le carburant.
L’armée de l’air est confrontée à un problème particulier supplémentaire, à savoir que les pilotes envoyés en Opex effectuent en peu de temps un très grand nombre d’heures de vol, si bien que, de retour à leur base, ils n’ont plus le droit de voler, ce qui pose le problème du maintien en condition opérationnelle de certains personnels très spécialisés – je pense aux pilotes de Caracal qui, selon la doctrine d’emploi de nos armées, volent à moins de cinq mètres du sol. Au bout de deux mois en Afghanistan, ils ont épuisé leur « crédit » d’heures de vol. Tous ces éléments font qu’il est difficile d’évaluer le surcoût d’une Opex.
Pour ce qui est d’une comptabilité analytique, un effort a été fait, mais notre travail doit inciter les responsables à le poursuivre. Bercy doit demander les justificatifs nécessaires au ministère de la Défense et celui-ci mieux préciser ce qu’il retient dans ses bases de calcul.
S’agissant des matériels, Jean Launay a raison. Nous l’avons parfaitement mis en évidence lors de l’examen du projet de loi de programmation militaire, la vétusté de certains d’entre eux obère leur disponibilité opérationnelle. Nos Transall sont à bout de souffle, nos Puma, pourtant indispensables au Tchad pour l’opération Épervier, arrivent en fin de vie… En ce qui concerne la gestion des parcs, des progrès ont été accomplis. Alors qu’auparavant les chars Leclerc, déployés par exemple au Liban, étaient systématiquement rapatriés en France au moment de la relève des unités, ce qui était exagérément coûteux, ils restent désormais sur place, seuls les équipages se relayant.
Concernant les remboursements de l’ONU, la France, il faut l’avouer, peut-être par sens de sa responsabilité en tant que grande puissance, n’était pas très prompte à les solliciter, contrairement à d’autres pays pour lesquels cela améliore significativement la situation de leurs militaires. L’ONU rembourse en effet sur la base d’un barème forfaitaire, peu intéressant pour l’armée française. Mais les choses ont changé. Une véritable prise de conscience s’est opérée au ministère de la Défense et à l’état-major des armées où l’on considère désormais légitime de se faire rembourser lorsqu’on intervient sous mandat international. Toutefois, au Liban par exemple, seul théâtre où l’ONU a remboursé les matériels, les chars Leclerc étaient hors barème ; il faut savoir que certains pays y arrivent sans matériel, l’ONU le leur fournissant …
M. le président Didier Migaud. Cela peut se comprendre pour certains petits pays.
M. Louis Giscard d’Estaing, rapporteur. Tout à fait. Nos véhicules de combat AMX-10 P entraient, eux, dans le barème.
L’ONU rembourse 1 028 dollars, soit 735 euros, par mois et par soldat, ce qui est supérieur à la solde des militaires de nombreux pays, mais inférieur à celle des nôtres.
Oui, monsieur Goulard, nous nous sommes attachés à mettre en évidence les dysfonctionnements, aidés en cette tâche par les magistrats de la Cour des comptes avec lesquels nous avons travaillé, Mme Saliou et M. d’Aboville, qui nous ont mis sur quelques pistes. Sous-budgétisation ou sous-évaluation des crédits des Opex ? J’ai déjà pointé la difficulté d’évaluer les surcoûts exacts liés aux Opex, sachant que les armées ont de toute façon un coût de fonctionnement. Sous-budgétisation, assurément : le président Migaud a raison. On est encore très en-dessous de l’objectif qui paraîtrait légitime de 80% des dépenses inscrites en loi de finances initiale.
Monsieur Dumont, le maintien en condition opérationnelle et la disponibilité opérationnelle sont excellents pour les Opex. Mais pour que les matériels envoyés en Opex soient en parfait état, on « cannibalise » ceux restant en métropole. Le problème aujourd’hui pour certains régiments est de disposer d’assez de matériels pour s’entraîner avant de partir… Certains équipements des hommes peuvent n’être pas parfaitement adaptés. Si notre armée de l’air dispose de treillis couleur sable pour pays chauds, ce n’est pas le cas de notre armée de terre, dont les treillis sont les mêmes sur tous les théâtres d’intervention. Ainsi en Afghanistan, nos soldats d’infanterie sont-ils équipés de treillis de couleur verte, ce qui n’est pas la couleur dominante des paysages afghans… Les achats en urgence ou sur étagère s’expliquent ainsi du fait que nos unités ne disposent pas toujours de l’équipement idoine.
Pour ce qui est de l’externalisation, nous souhaitons poursuivre notre réflexion. Les États-Unis ont externalisé la restauration du corps des marines, qui a d’ailleurs été confiée à une entreprise française, Sodexo. Mais cela ne vaut que sur le sol américain. Sur les théâtres extérieurs, c’est l’armée américaine qui assure la restauration de ses troupes.
Vous avez raison, monsieur Carcenac, les grands groupes français de travaux publics, du traitement de l’eau, des fournitures électriques… sont très peu présents sur le théâtre des Opex. Presque aucune entreprise française ne soumissionne aux marchés, importants, lancés par l’OTAN ou par l’ONU. Il y a là un vrai sujet de réflexion. Peut-être pourrions-nous mobiliser les entreprises sur le sujet par le biais des officiers de réserve, à l’instar de l’Allemagne, dont beaucoup de réservistes travaillent pour de grandes entreprises quand ils ne sont pas en opération. Si ce lien était mieux assuré, peut-être nos entreprises pourraient-elles participer davantage aux reconstructions ou réaliser des infrastructures, notamment dans des pays où nous intervenons en stabilisation ou pour le maintien de la paix. Le cas du Tchad, pays traditionnel de la zone d’influence française, nous a paru éloquent, trop peu d’entreprises françaises y étant présentes.
Monsieur Hénart, une expérimentation d’installation en dur est en cours en Afghanistan pour nos bases opérationnelles avancées. Nous avons visité celle de Tora, où cette construction présente le double avantage de faire travailler les entreprises locales et de pouvoir laisser à l’armée afghane, lorsque nous nous retirerons, une installation en dur, plus sûre. La prise en compte de la sécurité des troupes est en effet un élément déterminant. La garnison soviétique qui, du temps de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, occupait cette position, d’où est d’ailleurs partie notre patrouille tombée dans l’embuscade d’Ouzbin l’été dernier, a été exterminée. Les Soviétiques n’étaient qu’une soixantaine à cet endroit alors que nous y avons 350 hommes. Surtout, ils n’avaient pas occupé le promontoire situé en face, d’où ils ont été pilonnés, alors que nous y avons, nous, installé un poste pour une section de façon à sécuriser notre position.
Enfin, s’agissant de l’utilité le billet de 1 euro, la question n’est pas aussi anecdotique qu’il y paraît. Les trésoriers doivent faire transporter sur le théâtre des opérations des valises de pièces pouvant peser jusqu’à 120 kg, ce qui coûte très cher, notamment quand ce transport a lieu par voie aérienne. De plus, les pièces présentent l’inconvénient de ne pouvoir être changées en monnaie locale, tandis que le billet de 1 dollar, qui représente 70 centimes d’euro, plus maniable, facile à utiliser et surtout convertible, est extrêmement utilisé sur le théâtre des Opex. Notre plus petite coupure, le billet de cinq euros, représente, elle, huit dollars. Un billet de 1 euro ne serait donc pas inutile, sans compter qu’il est un théâtre où l’euro est devenue la monnaie locale, le Kosovo l’utilisant depuis plusieurs années.
M. le président Didier Migaud. Je vous remercie de ces réponses. Je souhaite que le rapporteur suive la mise en œuvre des propositions de ce rapport et que la MEC, sur des sujets aussi importants que celui-ci ou le financement des SDIS, dont nous traiterons la semaine prochaine, qui dépassent largement les clivages politiques, puisse faire un point à échéance d’un an. Il nous appartient d’assurer au mieux le suivi des propositions, très intéressantes, parfois de simple bon sens, que nous formulons.
Je propose maintenant à la commission des Finances d’autoriser la publication de ce rapport.
La Commission autorise la publication du rapport, en application de l’article 145 du règlement.
*
* *
Les Présidents et les Rapporteurs de la mission d’évaluation et de contrôle tiennent à remercier particulièrement M. Alain Hespel, président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, Mme Françoise Saliou, présidente de section, et M. Benoît d’Aboville, conseiller-maître en service extraordinaire, pour l’assistance exemplaire qu’ils ont apportée aux travaux de la MEC.
I.– LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
– le 5 mars 2009, M. Hugues Bied-Charreton, directeur des affaires financières du ministère de la Défense ;
– le 5 mars 2009, M. Éric Querenet de Breville, sous-directeur à la direction du Budget du ministère du Budget ;
– le 26 mars 2009, Audition conjointe du vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule, sous-chef d’état-major « opérations » à l’état-major des armées, responsable du budget opérationnel de programme Opex, du général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot, chef de la division « Plans, programmes et évaluation » de l’état-major des armées, et du commissaire-colonel Éric Rémy-Néris, chef du bureau Finances du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l’état-major des armées ;
– le 29 avril 2009, Mme Sylvie Bermann, directrice des Nations unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères ;
– le 29 avril 2009, le général Pierre-Yves Durbise, directeur de l’Économat des armées.
– le 30 avril 2009, le général d’armée aérienne Stéphane Abrial, chef d’état-major de l’armée de l’air ;
– le 30 avril 2009, le général de brigade Bertrand Clément-Bollée, sous-chef d’état-major « Emploi et soutien » à l’état-major de l’armée de terre ;
– le 30 avril 2009, le vice-amiral Xavier Magne, sous-chef d’état-major « opérations – aéronautique navale » à l’état-major de la marine ;
– le 14 mai 2009, monsieur Hervé Morin, ministre de la défense.
Les Rapporteurs de la mission d’évaluation et de contrôle ont, par ailleurs, effectué les déplacements suivants :
– les 9 et 10 mars 2009 auprès des forces françaises au Kosovo ;
– du 5 au 8 avril 2009 auprès des forces françaises au Tchad ;
– du 10 au 12 mai 2009 auprès des forces françaises en Afghanistan.
II.– COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition du 5 mars 2009
À 9 heures : M. Hugues Bied-Charreton, directeur des affaires financières au ministère de la Défense
Présidence de M. Georges Tron, Président de la MEC
M. Georges Tron, Président. Mes chers collègues, pour cette première audition de la mission d’évaluation et de contrôle relative aux opérations militaires extérieures, notamment sous mandat international, nous recevons M. Hugues Bied-Charreton, directeur des affaires financières au ministère de la Défense. Il est accompagné de Mme Agnès-Christine Tomas-Lacoste, chef du service des synthèses et du pilotage budgétaire, de son adjoint, le commissaire colonel Guy Lautrédou, ainsi que de M. Pierre Hougard, adjoint au chef du bureau de l’exécution budgétaire.
Madame, messieurs, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. La mission d’évaluation et de contrôle, la MEC, attache une importance particulière à l’évaluation de la politique de défense, d’abord en raison de son poids important dans les finances publiques – un dixième des crédits du budget général, un cinquième des emplois de l’État et la moitié de ses dépenses d’équipement. L’évolution de ces dépenses nous conduit plus encore à vouloir contrôler leur pertinence.
L’an dernier, la MEC a ainsi pu mesurer, en matière d’équipement naval militaire, le volume de la « bosse » de la programmation à financer au cours des prochaines années. Elle a également constaté des défauts d’harmonisation entre les lois de programmation militaire et les budgets annuels.
S’agissant plus particulièrement des opérations extérieures, les Opex, le Rapporteur spécial de la commission des Finances pour les crédits de la défense, M. Louis Giscard d’Estaing, est particulièrement attentif à leur croissance tendancielle. Ces coûts sont-ils réellement maîtrisés ? Quelles en sont les principales composantes ? Est-il possible de les optimiser ? Ces questions seront au cœur de notre réflexion.
Je m’empresse de rappeler que notre démarche ne consiste ni à assujettir la défense de la France à des priorités purement budgétaires et comptables, ni à empiéter sur les compétences de la commission de la Défense ou de l’exécutif. La commission des Finances, par l’intermédiaire de la MEC, souhaite simplement veiller au bon emploi des deniers publics. Il ne s’agit pas d’altérer les choix stratégiques, mais au contraire d’en clarifier toutes les implications.
Conformément aux usages de la MEC, nos travaux seront animés par deux rapporteurs, l’un représentant la commission des Finances, l’autre la commission de la Défense, et issus pour l’un de la majorité, pour l’autre de l’opposition. Ainsi, je suis heureux de saluer la première participation à nos auditions de Mme Françoise Olivier-Coupeau, députée du Morbihan, membre de la commission de la Défense et du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Je remercie également de leur présence, habituelle et précieuse, les représentants de la Cour des comptes : M. Alain Hespel, président de la deuxième chambre, Mme Françoise Saliou, conseiller-maître, et M. Benoît d’Aboville, conseiller-maître en service extraordinaire, qui fut l’ambassadeur représentant permanent de la France à l’OTAN.
Monsieur le directeur, je vous propose de commencer par un bref propos introductif.
M. Hugues Bied-Charreton, directeur des affaires financières au ministère de la Défense. Considérant que vous auditionnerez également l’état-major des armées, je centrerai mon propos sur la manière dont la direction des affaires financières envisage le financement et la maîtrise des coûts des opérations extérieures.
Depuis 2006, le coût des opérations extérieures s’alourdit, en raison des opérations au Tchad et en Afghanistan. Le ministère de la Défense cherche cependant, dans un souci de transparence et de sincérité budgétaires, à accroître la budgétisation initiale de ces « surcoûts », en prévoyant dans la loi de finance initiale une provision pour les opérations extérieures. Par le passé, le ministère privilégiait un financement des surcoûts en gestion, par une loi de finances rectificative, plutôt que de les intégrer dans la construction budgétaire initiale. Ce temps étant révolu, il nous faut, pour inscrire les crédits nécessaires dans la LFI, d’une part améliorer notre capacité à prévoir les surcoûts, d’autre part les évaluer de manière extrêmement rigoureuse. C’est ce à quoi nous travaillons.
Des progrès importants ont déjà été accomplis, la budgétisation initiale couvrant aujourd’hui plus de la moitié des surcoûts identifiés. Dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire, le Gouvernement a proposé un mécanisme clair pour l’augmenter encore : la provision de 510 millions inscrite dans la loi de finances pour 2009 sera majorée de 60 millions en 2010, puis à nouveau de 60 millions en 2011. Nous arriverons ainsi à un socle de ressources de 630 millions d’euros qui nous permettra, si l’on se réfère à nos estimations actuelles, de couvrir plus de 70 % des surcoûts.
Ceux-ci ne devraient pas augmenter inexorablement, le Président de la République et le Gouvernement ayant exprimé leur volonté de recentrer les opérations extérieures sur quelques priorités stratégiques. L’état-major y reviendra certainement lors de son audition.
Par ailleurs, nous souhaitons mieux identifier ces surcoûts. En effet un certain nombre ne sont pas intégrés dans notre comptabilisation, par exemple les pertes de matériels ou leur usure accélérée, comme en Afghanistan. Nous sommes ouverts à une discussion sur la modification du périmètre des surcoûts, qui ne manquerait pas toutefois d’avoir des conséquences en termes de financement.
Nous travaillons également à améliorer la « traçabilité » et les modalités d’évaluation des surcoûts. Ce travail interne au ministère a vocation à être partagé avec le ministère du Budget. J’ai proposé récemment à ses représentants de nous rencontrer afin de dépasser nos incompréhensions actuelles et de parvenir à une méthode commune d’identification et de calcul des surcoûts, de manière à ce que le Gouvernement parle d’une seule et même voix devant la représentation nationale. J’espère que nous pourrons, avant la fin de l’été, nous mettre d’accord sur le périmètre, la méthode d’évaluation et la façon d’assurer la bonne traçabilité de ces dépenses dans les comptes du ministère – mais le sujet n’est pas simple, notamment en ce qui concerne le maintien en condition opérationnelle des matériels.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Dispose-t-on d’outils comptables pour déterminer le montant des surcoûts ?
M. Hugues Bied-Charreton. Cela dépend de la nature des dépenses.
La moitié environ des surcoûts correspond à des dépenses de personnel, parfaitement identifiables et traçables, qui sont essentiellement liées à l’indemnité de sujétion pour services à l’étranger (ISSE).
S’agissant des dépenses de fonctionnement et d’intervention, 70 % d’entre elles sont imputées sur le budget opérationnel de programme des Opex (BOP Opex), correspondant à l’action 6 du programme 178 Préparation et emploi des forces. Les factures imputées sur ce budget sont directement traçables ; c’est un net progrès par rapport aux années antérieures.
Les 30 % restants correspondent à des dépenses communes. Ainsi, le maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels ne fait pas l’objet d’un suivi identifié pour les Opex ; le calcul est réalisé a posteriori pour reconstituer les stocks. De même, les dépenses de combustible et d’alimentation de la marine ne sont pas traçables a priori : quand un bateau part en mer, il est impossible de définir précisément ab initio la dépense qui va ressortir à telle zone géographique ; là encore, on fait un calcul a posteriori.
Concernant les dépenses d’équipement, on peut utiliser les outils de la comptabilité générale. En juillet dernier, nous avons ainsi proposé à la Cour des comptes, dans le cadre de notre comité technique comptable commun, un mode de comptabilisation des provisions pour dépréciation et de l’amortissement accéléré du matériel.
C’est donc sur les 30 % de dépenses de fonctionnement qui font l’objet d’un calcul a posteriori qu’il faut concentrer nos efforts d’évaluation.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. La définition des surcoûts vous semble-t-elle bonne ? Par exemple, des dépenses à long terme, comme le raccourcissement des carrières, la bonification des retraites, les rentes ou les pensions d’invalidité, sont-elles prises en compte dans leur calcul ?
M. Hugues Bied-Charreton. Vous avez raison, un certain nombre de surcoûts ne sont pas pris en compte : c’est le cas des dépenses à long terme que vous avez citées, de celles liées à l’obsolescence accélérée ou aux pertes de matériels, ou encore des achats en urgence – il a fallu en consentir pour plus de 100 millions d’euros en Afghanistan en 2008.
Il faut distinguer le souci de transparence, qui, afin de rendre compte de la globalité des surcoûts des opérations extérieures, peut conduire à élargir leur périmètre de comptabilisation, et la problématique du financement. Jusqu’à présent, notre évaluation des surcoûts était relativement restrictive car, sachant qu’il était difficile d’obtenir le remboursement des dépenses, le ministère ne jugeait pas utile de se lancer dans des exercices jugés trop compliqués pour les bénéfices escomptés. Les dépenses d’équipement, par exemple, étaient autofinancées, l’annulation de crédits d’équipement permettant de gager les surcoûts des Opex dans le décret d’avance ; le ministère estimait donc qu’il n’avait pas besoin de faire des efforts supplémentaires pour évaluer ces surcoûts.
S’agissant du financement, nous disposerons bientôt, je l’ai dit, de quelque 630 millions d’euros de ressources identifiées ; mais nous ne sommes pas naïfs : étant donné les contraintes qui pèsent sur les finances publiques, il paraît douteux que nous puissions, à l’avenir, obtenir davantage. Le rapport annexé au Livre blanc précise qu’au-delà de cette somme, on fera appel à la solidarité interministérielle, via la réserve de précaution. Nous espérons que ce sera bien le cas, mais cela restera un financement en gestion.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Pourquoi « en gestion » ?
M. Hugues Bied-Charreton. Au-delà des 630 millions d’euros auxquels nous arriverons en 2011, dont une part sera prélevée sur la réserve générale de budgétisation prévue dans le budget pluriannuel, il sera fait appel à la réserve de précaution, c’est-à-dire à la fraction des crédits qui sont « gelés » en début de gestion par le Gouvernement, conformément à l’information donnée au Parlement. Il s’agit donc d’un financement en gestion, qui peut passer par des décrets d’avance gagés par des annulations de crédits sur la réserve de précaution interministérielle, par des décrets portant virement de crédits, ou par une loi de finances rectificative. La direction du Budget serait plus à même de vous préciser les mécanismes.
M. Georges Tron, Président. Vous avez parlé dans votre propos introductif d’améliorer la concertation entre le ministère de la Défense et celui du Budget, ce qui veut dire qu’elle n’est pas très bonne. De fait, nous avons constaté, dans plusieurs documents, des divergences quant aux montants programmés. Qu’en est-il ? Quelles améliorations espérez-vous et quels sont vos projets en ce domaine ?
M. Hugues Bied-Charreton. Il existe en effet entre nos deux ministères une certaine incompréhension, qui tient à des divergences de méthode. Le ministère du Budget reproche au nôtre une opacité dans l’évaluation des surcoûts et fait montre de méfiance par rapport aux factures que nous présentons. S’il imagine que nous majorons délibérément les surcoûts, il commet un contresens : quand nous aurons clarifié les méthodes, il faudra malheureusement dresser le constat inverse ! Je précise que, comparés à ceux des autres pays, les surcoûts français restent somme toute modestes.
Pour l’évaluation et la facturation des surcoûts, nous nous fondons sur une instruction de 1984, qui est obsolète et qu’il faut refondre. Nous en avons engagé les travaux de réécriture. Dans ce cadre, un dialogue technique est conduit en interne, avec les états-majors, visant à clarifier, homogénéiser et solidifier l’évaluation des surcoûts. Déterminés à travailler dans la transparence, nous transmettrons notre projet d’instruction à la direction du Budget, afin de parvenir à une méthodologie commune, tant sur la définition que sur l’évaluation des Opex, et de mettre ainsi fin aux malentendus. Nous avions déjà fait une première proposition en juillet 2004, mais nous n’avons jamais obtenu de réponse de la direction du Budget ; c’est pourquoi nous voulons reprendre l’initiative.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Les dépenses du titre 6 relatives aux contributions internationales ont augmenté très rapidement entre 2007 et 2008, passant de 34 à 108 millions d’euros. Ces contributions constituent la principale cause de l’augmentation des surcoûts Opex. Quelle est votre analyse sur ce point ? Cette brutale augmentation est-elle liée à un théâtre d’opérations en particulier ?
Par ailleurs, le directeur du Budget a souligné devant la commission des Affaires étrangères du Sénat, le 20 janvier dernier, la nécessité de minorer de 64 millions le coût des opérations extérieures pour 2008, en raison de remboursements reçus de l’ONU et de l’OTAN. Les remboursements en provenance de l’ONU concernent-ils les seules Opex de l’année en cours ou également des opérations passées, du fait du cycle budgétaire biennal des Nations unies ? Quant à ceux de l’OTAN, correspondent-ils à des remboursements de pays alliés pour services échangés, par exemple pour des livraisons de carburant en Afghanistan ou au Kosovo, ou proviennent-ils de l’OTAN elle-même, au titre de la rectification des dépenses exposées pour les coûts communs, dont le périmètre a tendance à s’étendre rapidement ?
M. Hugues Bied-Charreton. L’augmentation de nos dépenses au titre des contributions internationales est essentiellement due à l’opération EUFOR Tchad, qui représente 74 des 108 millions d’euros. Comment maîtriser leur évolution ? C’est un vrai sujet de préoccupation. Il revient au comité militaire de l’OTAN et, pour l’Union européenne, au comité ATHENA de s’accorder sur le socle des dépenses partagées. Cela suppose un consensus, ce qui limite les possibilités d’amélioration ; et de fait, notamment en matière de dépenses de rémunération, nous supportons directement l’essentiel du fardeau.
En ce qui concerne les remboursements, ce que vous dites m’étonne, car nous n’en percevons aucun de la part de l’OTAN. Les seuls que nous enregistrons proviennent de l’ONU : environ 41 millions en 2008 et, a priori, quelque 71 millions en 2009, principalement au titre des opérations au Liban et en Côte-d’Ivoire. Le chiffre de 64 millions que vous évoquez me paraît être l’addition, d’une part, des 30 millions de dépenses de titre 5 que le ministère a supportés directement sur son budget en 2008, considérés comme venant en réduction du surcoût brut, et d’autre part, des remboursements de l’ONU pour l’exercice 2008, que nous avions évalués à 34 millions – mais qui s’établissent finalement à 41 millions. Nous vous transmettrons un décompte détaillé.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Inversement, lorsque les pays alliés nous rendent des services – nourriture, logement, transport –, ceux-ci sont-ils facturés à la France, et si oui, selon quelles modalités ?
M. le commissaire colonel Guy Lautrédou, adjoint au chef du service des synthèses et du pilotage budgétaire. Les remboursements sont effectués directement, sur chacun des théâtres d’opérations. La nation qui effectue la prestation présente la facture à l’ordonnateur militaire du théâtre. Il s’agit de dépenses directes locales, prises sur les crédits du BOP Opex. De même, nous nous faisons rembourser sur place pour les prestations que nous assurons.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Quelles que soient les améliorations de notre méthodologie concernant les dépenses Opex, la méthode employée aux Nations unies, à l’Union européenne et à l’OTAN pour calculer les surcoûts échappe à notre compétence. Il demeurera donc deux méthodologies différentes, l’une découlant de nos propres décisions, l’autre nous étant en quelque sorte imposée par les contributions internationales. À votre avis, quelles sont les perspectives d’évolution des coûts communs ?
M. Hugues Bied-Charreton. Nous sommes en effet, en la matière, tributaires de règles fixées par les instances internationales. Celles de l’OTAN et de l’Union européenne sont extrêmement rigides et reposent sur la règle du consensus. Il est donc très difficile de les faire évoluer, d’autant que l’assiette des coûts prise en compte est forfaitaire – on fait référence à des matériels dans la nomenclature OTAN, sur la base de coûts forfaitaires fixés par l’OTAN, qui s’appliquent de manière uniforme à tous les États participants. Les pays qui, comme la France, s’impliquent plus que d’autres sur certains théâtres d’opérations versent de fait une contribution supérieure. Vous devriez poser cette question à l’état-major, chargé des négociations au sein du comité militaire de l’OTAN et du comité ATHENA.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Grâce aux données recueillies dans le cadre de votre veille méthodologique, pourriez-vous nous donner des prévisions par titre et, éventuellement, par théâtre, pour l’année 2009 ?
M. Hugues Bied-Charreton. Pour 2009, nous sommes en train de réviser nos prévisions, à la suite de l’annonce par le Gouvernement d’un recentrage de nos opérations extérieures et d’un désengagement partiel de la France sur certains théâtres d’opérations, comme le Tchad, la Côte-d’Ivoire ou le Kosovo. Cette décision générera des économies, peut-être pas dès 2009, mais à terme. Pour l’heure, il m’est difficile de vous donner des chiffres précis, mais en 2009, le surcoût des Opex pourrait représenter, toutes choses égales d’ailleurs, quelque 820 millions d’euros, contre 852 millions en 2008 – sauf éventuelle décision concernant l’Afghanistan, qui est un théâtre d’opérations particulièrement lourd. Nous sommes en train de finaliser la révision, nous vous transmettrons les chiffres dès que possible.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. On nous annonce la création, auprès du sous-chef d’état-major Opérations, d’un centre ayant une responsabilité budgétaire interarmées, ainsi que la création d’un centre interarmées d’administration des opérations. Comment ces deux centres vont-ils s’articuler ? Leur création va-t-elle provoquer la disparition d’autres structures ? En quoi cela permettra-t-il de fiabiliser le recueil des surcoûts ?
M. Hugues Bied-Charreton. L’état-major sera mieux placé que moi pour répondre précisément à ces questions. Je vais néanmoins vous donner quelques éclairages.
Le centre interarmées d’administration des opérations (CIAO) devrait être créé à l’été 2009. Il a vocation à centraliser l’ensemble des opérations budgétaires sur les Opex, aujourd’hui partagées entre plusieurs services du ministère, comme le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) – dont le bureau budgétaire gère notamment le BOP Opex –, les bureaux des finances des états-majors et ceux de services soutiens. Il travaillera en liaison directe avec les commandements des théâtres d’opérations, qui dans le système d’information Chorus sont considérés comme des unités opérationnelles. Par ailleurs, le centre interarmées de coordination de la logistique des opérations (CICLO), sans avoir de compétence budgétaire, devrait contribuer à rationaliser la répartition des moyens entre les différents théâtres d’opérations.
Mme Françoise Hostalier. Existe-t-il, sur certains théâtres d’opérations, une clef de répartition des contributions entre les opérations extérieures propres à la France et celles s’inscrivant dans un cadre international ? Par exemple, qu’en est-il pour le Tchad, où des actions financées par la France dans le cadre de l’opération Épervier sont menées pour le compte de l’EUFOR ? Y a-t-il un remboursement ?
M. Hugues Bied-Charreton. Par définition, les opérations financées dans un cadre multilatéral s’effectuent sur la base d’un mandat extrêmement précis, qui résulte d’un consensus entre les États ; si la France souhaite apporter un soutien complémentaire, comme au Tchad, cela suppose un financement national. Toutefois, en pratique, les situations peuvent varier suivant le théâtre d’opérations, en fonction du mandat international en vigueur et de la position de la France. L’état-major sera plus à même de préciser ces éléments.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. En rencontrant le chef d’état-major, j’ai été fort surprise d’apprendre qu’un certain nombre d’opérations ne faisaient pas l’objet de remboursements. Ainsi – même si cet exemple ne concerne pas les Opex –, lors du naufrage de l’Erika au large des côtes bretonnes, ni l’armateur ni les assurances n’ont remboursé un centime au ministère de la Défense. De même, dernièrement, lorsque le Carré d’As, bateau de plaisance parti dans des eaux dangereuses en dépit des sept avertissements qui lui avaient été donnés, s’est fait arraisonner par des pirates, nos commandos de marine ont dû intervenir : cela a coûté de l’argent au budget de la Défense, et on n’a rien demandé, ni à l’assureur, ni à l’armateur. Cela me paraît choquant. Peut-on faire évoluer cette situation ? Le ministère de la Défense ne pourrait-il pas s’inspirer de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), qui demande un remboursement lorsqu’elle doit assurer le sauvetage d’un plaisancier qui s’est mis en danger lui-même, en dépit des avertissements ?
M. Hugues Bied-Charreton. C’est un problème délicat. Il faudrait pouvoir clairement distinguer les opérations qui relèvent des missions légitimes du ministère, lequel doit pouvoir intervenir à tout moment pour venir soutenir et protéger nos ressortissants partout dans le monde, et celles qui vont au-delà de ces missions et que l’on pourrait facturer comme des prestations de services. La même question se pose pour la protection, au large des côtes africaines, de transports effectués par les compagnies pétrolières, menacés d’actes de piraterie.
Là encore, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à une question éminemment politique, qui renvoie à la conception qu’a la France de la protection de ses ressortissants. En tant que fonctionnaire chargé des affaires financières du ministère de la Défense, je ne suis pas opposé à l’introduction d’un critère qui permettrait de distinguer les situations dans lesquelles l’intervention des forces n’aurait pas été totalement légitime, parce que les ressortissants se seraient mis d’eux-mêmes dans une situation dangereuse, en dépit des avertissements. J’avais d’ailleurs, en prenant mes fonctions, soulevé cette question auprès de l’état-major de la marine. Mais il faut préalablement avoir clairement défini le champ de l’intervention naturelle, ou légitime, du ministère au titre de la protection de nos ressortissants.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Une intervention est toujours légitime ; la question est de savoir si elle peut être facturée.
M. le commissaire colonel Guy Lautrédou. S’agissant de la participation des armées à des activités non spécifiques, la réglementation passe par des conventions ou des protocoles. Lorsqu’il est fait appel aux armées pour une manifestation d’ordre privé ou associatif, comme la Foulée blanche, une convention doit être signée, et les coûts supplémentaires sont remboursés par le prestataire. Lorsque la participation des armées est réclamée par une autre administration, il y a signature d’un protocole. Cela dit, à la suite d’une marée noire sur la côte atlantique, antérieure au naufrage de l’Erika, nous étions allés présenter les protocoles aux préfets concernés, et ils ont refusé de les signer.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Il ne s’agit pas de faire payer les préfets, mais l’assureur. Il me semble qu’en cas de tempête ou d’inondations, il est de la mission de l’armée d’intervenir. En revanche, quand un bateau est assuré, tout le monde se fait rembourser – y compris les collectivités territoriales –, sauf le ministère de la Défense. Cela me surprend.
M. le commissaire colonel Guy Lautrédou. S’il y avait remboursement, ce serait au bénéfice de l’État, non du ministère.
M. Hugues Bied-Charreton. En ce qui concerne l’Erika, il a été procédé à une évaluation globale des sommes exposées par l’État, qui a ensuite fait l’objet d’une négociation extrêmement complexe avec l’assureur. J’en ignore le détail, et notamment si l’État a pris en compte une partie des coûts supportés par le ministère de la Défense. Si cela a été le cas, le remboursement aura de toute façon été versé au budget général.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Nous avons analysé des services rendus par les armées qui, au sens de la LOLF, s’apparentent à d’autres types de missions que celles qui relèvent des Opex au sens strict. Je pense en particulier à l’assistance sanitaire aux populations civiles situées dans le périmètre des opérations extérieures, comme au Darfour ou à l’hôpital de Tomboukro, en Côte-d’Ivoire. Y a-t-il moyen de faire basculer ce type de prestations sur les crédits correspondants, qu’il s’agisse de la coopération, de l’aide au développement ou du développement solidaire ?
M. Hugues Bied-Charreton. Je ne peux pas répondre à cette question, n’en ayant discuté ni en interne, ni avec les ministères concernés.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Cette réflexion peut-elle cependant voir le jour au sein du ministère de la Défense, sous forme d’une sorte de comptabilité analytique ? Par exemple, sur les différents théâtres d’opérations, vous savez précisément quelle est la part des prestations du service de santé des armées qui n’est pas effectuée au profit des militaires.
Mme Françoise Hostalier. Pour aller dans le même sens, beaucoup d’opérations civilo-militaires sont aujourd’hui, sinon contestées, du moins perçues comme un mélange des genres, en particulier par rapport à l’action des organisations non gouvernementales. Il serait donc utile d’analyser précisément leur coût afin d’envisager certains transferts.
M. Hugues Bied-Charreton. On sait identifier ces dépenses et évaluer leur coût. C’est aujourd’hui le ministère de la Défense qui en supporte l’essentiel, parce qu’il considère que ces opérations font partie de ses missions, dans la mesure où elles participent à la stabilisation des théâtres d’opération et peuvent contribuer au renseignement. Toutefois, s’il fallait ouvrir une discussion interministérielle pour en partager les coûts, nous en serions tout à fait d’accord !
M. Georges Tron, Président. Merci, madame, messieurs, de nous avoir éclairés et, au-delà, de nous inciter à poser diverses questions à l’occasion de nos futures auditions. Peut-être serons-nous conduits, en fonction des réponses que nous aurons obtenues, à vous envoyer un questionnaire complémentaire.
Audition du 5 mars 2009
À 10 heures 30 : M. Éric Querenet de Breville, sous-directeur à la direction du Budget, accompagné de M. Benoît Guérin, adjoint au sous-directeur à la direction du Budget
Présidence de M. Georges Tron, Président de la MEC
M. Georges Tron, Président. Monsieur le directeur, vous connaissez les principes de fonctionnement de la MEC, pour avoir participé l’année dernière à une audition sur les programmes d’équipement naval. Nous nous efforçons de vérifier la bonne utilisation des fonds publics, à travers des échanges très ouverts, en présence et avec le concours de membres de la Cour des comptes. Aux députés de la commission des Finances s’associent des membres d’autres commissions ; sur le sujet qui nous occupe aujourd’hui, il s’agit de la commission de la Défense. De même, il est de tradition d’associer un rapporteur appartenant à la majorité et un autre appartenant à l’opposition, qui cosignent le rapport.
Je vous donne la parole pour un propos introductif, puis j’inviterai nos rapporteurs à vous poser des questions.
M. Éric Querenet de Breville, sous-directeur à la direction du Budget. La budgétisation et le financement des opérations militaires extérieures, les « Opex », sont un exercice difficile, qui s’apparente à un exercice de tir sur une cible mobile, se déformant dans le temps, dont la position nous est notifiée par le ministère de la Défense sans qu’on puisse la vérifier, et, enfin, dont la taille est approximative, puisqu’il s’agit d’une dépense évaluative.
Pour tirer sur cette cible, nous arrivons de loin, puisque jusqu’en 2005, il n’y avait quasiment aucune budgétisation des Opex en loi de finances initiale. Le progrès a été tardif, mais rapide car aujourd’hui, cette budgétisation initiale atteint 60 % du surcoût net des Opex, exclusion faite – parce qu’on raisonne uniquement sur la mission Défense – des contributions du ministère des Affaires étrangères aux opérations de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies. Si l’on retenait une approche interministérielle, et compte tenu des « rebasages » qui ont été opérés par amendement à la loi de finances pour 2008 et, à hauteur de 50 millions d’euros, par celle pour 2009, on arriverait à un niveau de budgétisation de l’ordre de 73 %.
Si la cible est mobile, c’est d’abord parce que le coût des Opex a augmenté de plus de 50 % ces dernières années. C’est ensuite parce que, alors que nous avions d’abord fixé pour objectif d’atteindre un niveau de budgétisation avoisinant 80 % de la dépense moyenne des trois dernières années, on raisonne aujourd’hui par rapport aux dernières dépenses connues.
La cible se déforme : comme le montre, dans le document que je vous ai communiqué, le graphique de la page trois, le ratio entre les surcoûts déclarés et les effectifs en Opex augmente très fortement depuis 2006. Les dépenses du titre 2 – dépenses de personnel –, qui représentaient 60 % des surcoûts il y a trois ans, n’en constituent plus que 40 % ; à l’inverse, on constate une forte augmentation des dépenses de fonctionnement ainsi que des nation born costs, appels de fonds réalisés dans le cadre de l’OTAN et de l’Union européenne.
Le problème de la position de la cible, enfin, est celui de la « traçabilité » de la facture. Nous sommes les notaires de ce qui nous est présenté par le ministère de la Défense, sans pièces justificatives, lors des décrets d’avance ; concernant l’exécution, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel de la Défense n’est pas en mesure de « tracer » les dépenses autres que les dépenses de personnel – indemnité de sujétion pour service à l’étranger (ISSE). Le reste n’est ni « traçable » ni « auditable ». Les dépenses d’Opex ne relèvent pas du circuit budgétaire et comptable prévu par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, mais de procédures dérogatoires ; nous nous employons, avec le ministère de la Défense, à les réformer.
Plus généralement, pour faire progresser cette situation, plusieurs pistes doivent être explorées.
La première, c’est de mieux connaître la position de la cible. À cet égard, le tableau de la page 7 retrace les causes du manque de transparence et de fiabilité des surcoûts qui nous sont présentés. La facture, en totalité, est déclarative et non « auditable ».
Les dépenses correspondant au versement de l’ISSE, tout d’abord, sont « traçables », mais elles ne sont pas « auditables » : n’ayant pas accès au fichier de paye, nous ne pouvons pas vérifier les « dates de valeur », c’est-à-dire l’adéquation des versements avec les dates d’arrivée en théâtre d’opération et de retour en métropole ; nous faisons confiance au ministère de la Défense pour respecter les montants unitaires de primes tels qu’ils sont prévus par les textes réglementaires, mais le contrôle ne nous est pas possible.
Les dépenses imputées sur le BOP (budget opérationnel de programme) Opex et l’action 6 (Surcoûts liés aux opérations extérieures) du programme 178 Préparation et emploi des forces, ensuite, sont partiellement « traçables », mais on ne sait pas toujours s’il s’agit de « coûts » ou de « surcoûts » : s’il est clair que les dépenses de transports viennent en sus de ce qui serait dépensé en métropole, pour d’autres types de dépenses de fonctionnement il ne nous est pas possible, sans connaître les conventions précises utilisées par l’état-major des armées, de savoir si l’on est en présence d’un surcoût – d’un coût marginal –, ou d’un coût qui existerait même sans Opex.
La troisième et dernière catégorie de surcoûts Opex déclarés par la Défense regroupe des charges calculées, non imputées sur l’action 6 du programme 178, notamment les charges de maintien en condition opérationnelle ; on nous dit que ces dernières augmentent fortement du fait des Opex, mais nous ne connaissons pas les conventions retenues à ce sujet par le ministère de la Défense.
Afin de savoir exactement ce qui est dépensé sur place par les trésoriers des armées, nous avons proposé au ministère de la Défense de créer, dans le cadre des fonds d’avances pour les Opex, une réserve centrale unique. Aujourd’hui, en effet, le trésorier accompagnant les troupes informe le comptable du Trésor public dont il dépend territorialement en métropole – lequel, au demeurant, ne reçoit pas de pièces justificatives. Plutôt, donc, qu’une multitude de comptables du Trésor ayant un simple pouvoir d’évocation, il faudrait un comptable assignataire unique, couvrant la dépense consolidée, et qui pourrait être soit le contrôleur budgétaire et comptable actuel du ministère de la Défense, soit le trésorier payeur général de l’Essonne qui, par tradition, est le trésorier payeur des armées. Il serait bon de convaincre de l’intérêt de cette solution l’état-major des armées, qui a exprimé certaines réticences.
D’autre part, il a été décidé fin 2008 de créer un groupe de travail interministériel sur les Opex, afin de réformer l’instruction de 1984 et de nous permettre de connaître les conventions de calcul des charges indirectes imputées aux Opex. Il devait se calquer sur le groupe de réflexion que présidait M. Jean-Claude Mallet pour l’élaboration du Livre blanc, en réunissant le ministère du Budget, la direction des affaires financières du ministère de la Défense et l’état-major des armées. Malgré nos demandes, il n’est toujours pas constitué, le ministère de la Défense souhaitant préalablement harmoniser les conventions de calcul entre les armées et assurer leur validation par l’état-major. Pour notre part, nous souhaitons qu’il puisse se réunir au plus vite.
La deuxième piste, sur laquelle je n’ai pas à m’étendre puisqu’il s’agit de considérations stratégiques, c’est la revue des Opex selon un bilan coûts-avantages. La page 11 du document que je vous ai donné montre la très forte concentration des opérations : EUFOR Tchad, l’opération Épervier au Tchad et l’Afghanistan représentent 55 % des surcoûts ; à l’inverse, une vingtaine d’opérations ne pèsent que pour 10 % – et leur coût décroît.
La troisième piste concerne les mécanismes de financement et de remboursement. Selon que l’on est sous mandat de l’ONU, de l’OTAN ou de l’Union européenne, ce ne sont pas les mêmes. Il est clair que le système européen ATHENA n’est pas satisfaisant, le périmètre des dépenses financées en commun, selon les clés de contribution des États membres, étant très restreint. La France, qui participe très largement à l’opération EUFOR Tchad, se voit ainsi facturer des dépenses au prorata de ses troupes, sans pouvoir se faire rembourser. Il en va différemment dans le système de l’ONU, même si, comparé aux coûts réels, le forfait peut paraître un peu faible pour les pays développés, et au contraire trop élevé pour d’autres.
Il est évidemment difficile de réformer le système ATHENA, puisque cela ne peut se faire qu’à l’unanimité. La France peut néanmoins se décider à mettre le sujet sur la table, ou alors tirer les conséquences du système quant à sa participation aux opérations. Nous sommes dans une situation inverse dans le cadre de l’OTAN : nous participons très peu aux opérations, hormis en Afghanistan, et par rapport à l’ensemble de ces opérations, notre contribution financière est inférieure aux quelque 12 % qui nous sont demandés au titre de la contribution aux coûts communs ; notre intérêt serait donc de diminuer la contribution aux coûts communs. Le mieux me paraît donc être de s’en tenir à la situation actuelle en ce qui concerne l’OTAN, et de tenter de faire évoluer le système ATHENA, qui n’est pas cohérent.
La première piste, consistant à tracer et auditer la dépense, vérifier la facture présentée et assurer la transparence des conventions de calcul, est la plus prometteuse à court terme.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Nous pourrions avoir un long débat sur votre proposition d’analyser les Opex selon une approche coûts-avantages, mais je m’en tiendrai pour l’instant à une première question : le ministère de la Défense et celui du Budget ont-ils une définition commune des surcoûts ?
M. Éric Querenet de Breville. Depuis deux ans, nous sommes d’accord sur le fait que la facture qui nous est présentée doit être nette, et non pas brute. C’est un progrès : auparavant, les remboursements de l’ONU nous étaient facturés… Quant aux conventions de calcul, nous ne les connaissons pas, et c’est pourquoi je souhaite que le groupe de travail soit constitué au plus vite. En ce qui concerne les surcoûts directs – et non pas calculés –, d’alimentation par exemple, il n’y a pas de désaccord sur la définition, mais en revanche nous voulons pouvoir tracer et auditer les factures qui nous sont présentées.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Comment considérez-vous les dépenses à long terme, telles que raccourcissements de carrière, bonifications de retraite, rentes ou pensions d’invalidité ?
M. Éric Querenet de Breville. Pour le moment elles sont considérées comme des coûts dérivés, mais dans une approche en « coût complet » il faudrait en effet les prendre en compte. Elles pèsent notamment sur la mission Anciens combattants. De toute façon, les montants en cause ne sont pas considérables par rapport à l’ensemble de la facture.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Je voudrais revenir sur nos intérêts contradictoires dans le cadre de l’OTAN et dans celui du système ATHENA. Tout d’abord, les ordres de grandeur sont différents. Les coûts communs de l’OTAN progressent très rapidement, et la situation en Afghanistan laisse penser que leur périmètre va encore s’étendre, pour accroître la solidarité entre alliés. Au sein d’ATHENA, nous souhaitons que cette solidarité s’exerce davantage ; mais comme il s’agit en partie des mêmes nations, on nous répond que ce que nous voulons pour ATHENA, nous devons l’accepter aussi à l’OTAN. En voulant renforcer la solidarité dans le cadre d’ATHENA, ne risque-t-on pas un violent retour de bâton à l’OTAN ?
M. Éric Querenet de Breville. Il faut évidemment y prendre garde. Il faudrait faire des simulations sur le gain à attendre d’un renforcement de la solidarité dans le cadre d’ATHENA et sur la perte corrélative qui résulterait de l’adoption des mêmes principes à l’OTAN. Comme elles sont fonction du drapeau sous lequel se font les engagements de la France, ce serait là encore au groupe de travail de les réaliser, sur la base de différents scénarios. Néanmoins, il me paraît plus facile de plaider la solidarité au sein de l’Union européenne que de plaider le « chacun pour soi » à l’OTAN.
M. Georges Tron, Président. En dépit des incertitudes, vous disposez d’éléments objectifs qui devraient vous permettre de faire des projections sur ce que nous pourrions perdre ou gagner.
M. Éric Querenet de Breville. Nous avons établi en vue de cette audition le tableau de la page 10, qui réunit des informations que nous n’avons pu obtenir que récemment sur l’année 2008. Il effectue une décomposition entre coûts nationaux et contribution aux coûts communs, dans le cadre de l’ONU, de l’OTAN et de l’Union européenne. En retirant la quote-part ONU, qui n’est pas à imputer sur le ministère de la Défense, et en ajoutant les opérations nationales, on arrive aux 850 millions d’euros bruts que représente le surcoût des Opex en 2008.
Dans le cadre de l’OTAN, nos coûts nationaux sont élevés en valeur absolue – environ 200 millions – et notre contribution au titre des coûts communs est de 41 millions. Dans le cadre d’ATHENA, cette contribution est réduite à la portion congrue puisqu’elle est de 14 millions, tandis que l’addition des coûts nationaux, financés selon nos procédures nationales, et des coûts administrés par l’Union européenne mais restant à notre charge atteint environ 115 millions d’euros. L’évolution de la situation dépend essentiellement de l’avenir de l’opération EUFOR Tchad, qui représente 90 % de l’engagement français sous bannière européenne.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Notre travail consiste à analyser les dépenses présentées par le ministère de la Défense comme étant des surcoûts. Le vôtre de vérifier qu’elles peuvent être imputées au budget au-delà de ce qui a été inscrit en loi de finances initiale – qui diminue d’autant ce qui, dans le système antérieur, était constaté en loi de finances rectificative et abondé par le budget général. Est-ce bien cela ?
M. Éric Querenet de Breville. Quand il n’y avait pas de budgétisation, il pouvait y avoir une ouverture en loi de finances rectificative, qui remboursait le gage généralement pris sur les dépenses d’équipement militaire – sorte d’auto-assurance du ministère de la Défense. Mais dans la facture qui nous est présentée, il y a des charges calculées analytiquement, dont on veut vérifier qu’elles ne recoupent pas ce qui figure déjà ailleurs dans le budget de la Défense ; et il y a des surcoûts directs, dont on veut vérifier la réalité – mais ce n’est pas tant le souci de la direction du Budget que du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Nous sommes d’accord sur l’objectif. Il nous faut parvenir à distinguer les coûts réellement supplémentaires dus aux Opex, ou coûts marginaux, des coûts fixes qui resteraient attachés aux unités si elles n’étaient pas déployées en opérations.
En ce qui concerne l’ISSE, vous nous dites ne pas avoir accès au fichier de paye, mais vous connaissez le montant global des sommes versées sur une année.
M. Georges Tron, Président. Pourquoi, d’ailleurs, n’avez-vous pas accès au fichier de paye ? Je suis très frappé par l’incompréhension, ou la difficulté de communication, ou la concurrence, je ne sais, entre le ministère de la Défense et celui du Budget. Nous avons davantage l’habitude des difficultés entre services d’un même ministère… Pensez-vous que la situation puisse évoluer ?
M. Éric Querenet de Breville. Tout ce que j’ai dit est factuel ; le ministère de la Défense ne devrait pas le contester car nous sommes d’accord sur le constat, ainsi d’ailleurs que sur une bonne partie des propositions que j’ai faites ici. Une rupture s’est produite dans le cadre de la préparation du Livre blanc, qui a été l’occasion d’une coopération et d’un échange d’informations inédits entre les deux ministères. Pour la première fois, nous avons fait un travail de projection à douze ans, dont la loi de programmation militaire n’est que la première étape. Il y a quelques mois, sans cette rupture, j’aurais été incapable de vous présenter autre chose que le montant de la facture et la façon dont elle a été financée en gestion ou en LFI ; les autres informations qui figurent dans les tableaux que je vous ai fournis nous ont été données dans les trois derniers mois. Je suis donc très optimiste sur l’avenir.
Nous mettons en place avec le ministère de la Défense un comité financier pour suivre la question des équipements. S’agissant des Opex, la décision a été prise de constituer un groupe de travail et je souhaite simplement qu’il se réunisse au plus vite, afin de nous associer aux travaux ab initio. Je suis sûr que nous allons aboutir, et que nous allons réformer l’instruction de 1984 avant la fin de l’année 2009.
M. Georges Tron, Président. Quels outils vous manque-t-il pour mesurer l’incidence d’une évolution des systèmes ATHENA et de l’OTAN ?
M. Éric Querenet de Breville. Tant que nous n’avions pas les informations qui figurent à la page 10 du document, il aurait été difficile de faire des simulations. Maintenant, il nous faut vérifier les chiffres.
Par ailleurs, la direction financière du ministère, qui est notre correspondant, dépend de l’état-major des armées. Le Livre blanc prévoit le renforcement de la fonction financière : il relève en effet au premier chef d’une direction financière de traiter de comptabilité analytique ou de circuits budgétaro-comptables ; mais aujourd’hui, ces tâches sont effectuées à l’état-major des armées.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Nous pourrions, si vous nous y autorisez, servir en quelque sorte de « casques bleus » dans cette affaire, pour présider à l’installation du groupe de travail commun aux deux ministères, laquelle pourrait être l’aboutissement aussi heureux que prochain du rapport que nous présenterons à l’issue de cette mission d’évaluation et de contrôle !
Au-delà de ce sujet, quels sont les points sur lesquels vous souhaitez particulièrement attirer notre attention ? Je remarque par exemple qu’à la page 4, vous parlez de « déformation curieuse » du rapport entre les surcoûts relevant du titre 2 et les autres : pouvez-vous nous apporter des précisions ?
M. Éric Querenet de Breville. En ce qui concerne les surcoûts hors titre 2, nous n’avons pas les moyens de vérifier les factures qui nous sont présentées, et pour une part il s’agit de charges calculées. Le ministère de la Défense nous a expliqué la déformation du rapport entre titre 2 – relatif aux charges de personnel – et hors titre 2 en 2008 par les opérations en Afghanistan. Certes, les dépenses de fonctionnement (titre 3) ont augmenté de 46 millions en Afghanistan, mais le tableau de la page 4 montre aussi que la hausse des surcoûts hors titre 2 est liée au premier chef à l’opération EUFOR Tchad, et en leur sein, au titre 6, c’est-à-dire aux appels de fonds au prorata des troupes dans le cadre du système ATHENA. Dans les autres opérations que le Tchad et l’Afghanistan, on ne retrouve pas cette déformation entre le titre 2 et le hors titre 2 : les dépenses baissent de manière à peu près parallèle.
Le remboursement des dépenses sur la base des factures déclarées n’incite pas le ministère de la Défense à produire des justifications. Cela étant, plus on trace la dépense, plus on peut budgétiser en loi de finances initiale ; aujourd’hui, 86 % des dépenses de masse salariale de l’ISSE y sont ainsi inscrites. J’insiste sur ce lien entre transparence et taux de budgétisation : au cours des trois prochaines années, nous nous sommes engagés à améliorer la budgétisation du hors titre 2, mais en contrepartie nous devons pouvoir effectuer les vérifications nécessaires.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. En ce qui concerne la hausse de 66 millions, en 2008, des surcoûts du titre 6 imputables à l’opération EUFOR Tchad, devons-nous comprendre que vous n’avez pas plus de précisions ?
M. Éric Querenet de Breville. Oui.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. L’importance de la somme est-elle liée au système ATHENA ?
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Le chef d’état-major nous a expliqué que les contrats d’alimentation, pluriannuels, étaient négociés pour un certain effectif de soldats et que, si celui-ci diminuait, on continuait à payer pour l’effectif initialement fixé.
M. Éric Querenet de Breville. Par ailleurs, je ne sais pas si le coût par homme est supérieur quand la France paie directement ou quand le financement passe par le système ATHENA. Pour le moment, notre seul constat est que, contrairement à ce que nous avons pu entendre, ce ne sont pas les opérations en Afghanistan qui expliquent la dérive, mais l’opération EUFOR Tchad.
Dernière remarque sur ces surcoûts : M. Hervé Morin, lors de la présentation du projet de loi de finances, a évoqué le chiffre de 100 millions d’euros de dépenses d’investissement urgentes faites en 2008 dans le cadre des Opex, en raison notamment du type de terrain rencontré en Afghanistan ; on ne retrouve pas ce chiffre dans le tableau des surcoûts car, tout en répondant à ce qui relève ainsi de la surprise tactique, il est normal de faire évoluer l’équipement de nos armées, lequel doit notamment pouvoir servir en Opex. Par convention avec le ministère de la Défense, les surcoûts Opex en termes d’investissement ne sont pas remboursés.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Concernant la progression de la budgétisation, quelles sont vos estimations pour 2010 et 2011 ? Pour le reste, pouvez-vous préciser le mécanisme que vous visez par l’expression « financement en gestion » ? Et avez-vous déjà des prévisions pour 2010, compte tenu des modifications de format envisagées ?
M. Éric Querenet de Breville. Sur le dernier point, la réponse est non.
En ce qui concerne la budgétisation, le progrès qui a pu être observé ces trois dernières années va se poursuivre.
Enfin, l’écart entre le surcoût réel des Opex et le surcoût voté en loi de finances initiale va être financé par un système à trois étages : le premier consiste en un redéploiement au sein de la mission Défense, qui sera au maximum de 30 millions d’euros en 2010 et de 60 millions en 2011 et les années suivantes ; le deuxième est un droit de tirage sur la réserve de budgétisation, à hauteur du montant autofinancé par la Défense, soit 30 millions en 2010 et 60 millions en 2011 et les années suivantes ; au-delà – c’est-à-dire si le coût des Opex dépasse, à partir de 2011, 630 millions, montant auquel on arrive en ajoutant aux 510 millions actuels les deux premiers étages –, il y aura une taxation interministérielle. La clé de répartition entre les ministères n’est pas fixée ; elle n’exclura pas le ministère de la Défense, non plus que celui des Affaires étrangères. Mais quoi qu’il en soit, le ministère de la Défense est assuré désormais de ne pas avoir à débourser par redéploiement plus de 60 millions avant « taxation interministérielle » éventuelle, alors qu’en 2008, il a subi 180 millions d’euros d’annulations – liées pour 80 millions, certes, à la décision prise sur le deuxième porte-avions. C’est pour lui un réel progrès.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Lorsqu’on veut éviter de déployer des troupes, on réalise en général des dépenses de prévention et on essaie de faire intervenir les acteurs locaux. Actuellement, ces dépenses sont partagées entre le ministère des Affaires étrangères, au titre de la coopération militaire, et l’état-major. Avez-vous intégré ces éléments dans les projections à long terme ?
M. Éric Querenet de Breville. Pour le moment, non.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. De fait, le calcul de dépenses ayant permis d’éviter le recours à la force – resté virtuel – paraît compliqué.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Pour prendre un exemple, si l’on considère que la stratégie de sortie de l’Afghanistan est la formation de l’armée afghane, celle-ci peut être assurée par divers systèmes de financement ; pour le moment, on prend sur les crédits du ministère de la Défense, mais on peut imaginer d’autres formules.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Si la police et la gendarmerie participaient aux actions de formation, la dépense serait-elle intégrée dans les surcoûts Opex ?
M. Éric Querenet de Breville. S’agissant de la gendarmerie, 15 millions d’euros sont inscrites en LFI, pour une dépense qui s’est élevée à 20 millions en 2008. Pour la police, il n’y a pas actuellement de budgétisation au titre des Opex. Si les dépenses étaient amenées à augmenter, il faudrait examiner la capacité contributive des programmes Police nationale et Gendarmerie nationale et mettre au point un système de taxation interministérielle.
M. Georges Tron, Président. Merci infiniment pour les informations que vous nous avez apportées. Peut-être aurez-vous suscité de nouvelles questions de nos rapporteurs pour nos futures auditions.

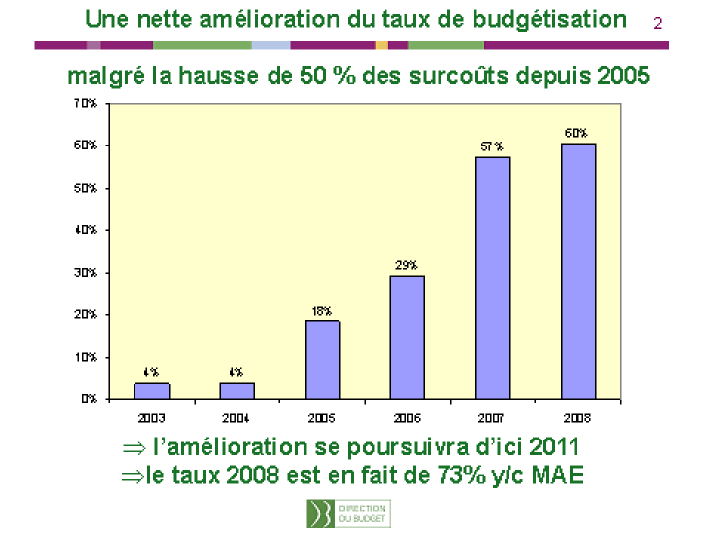
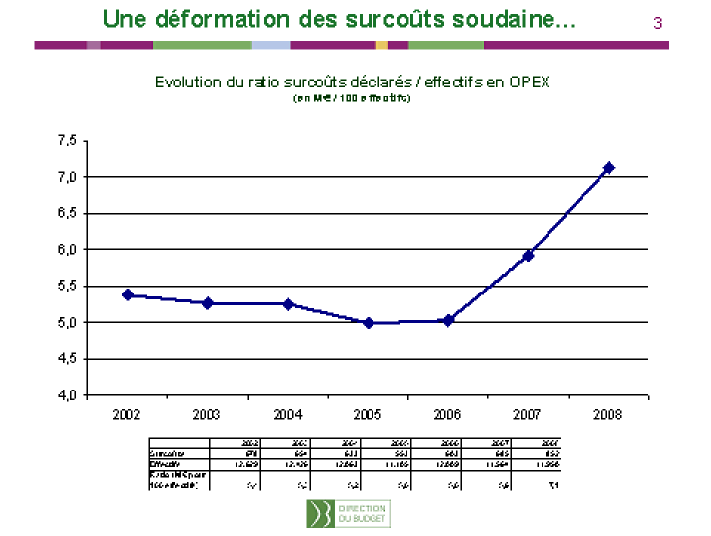
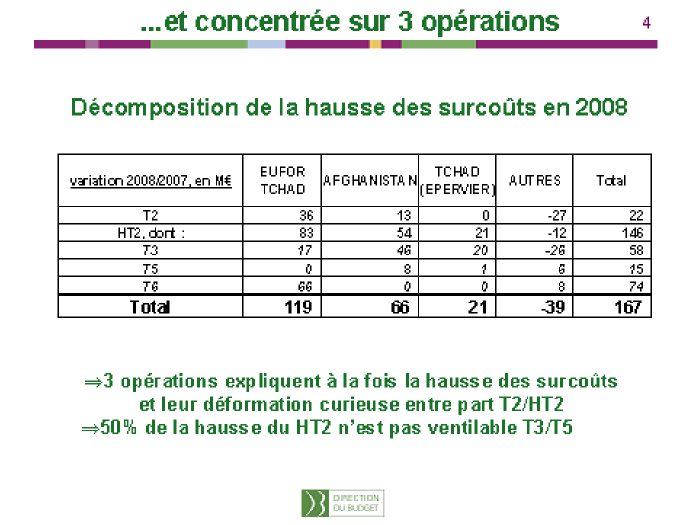
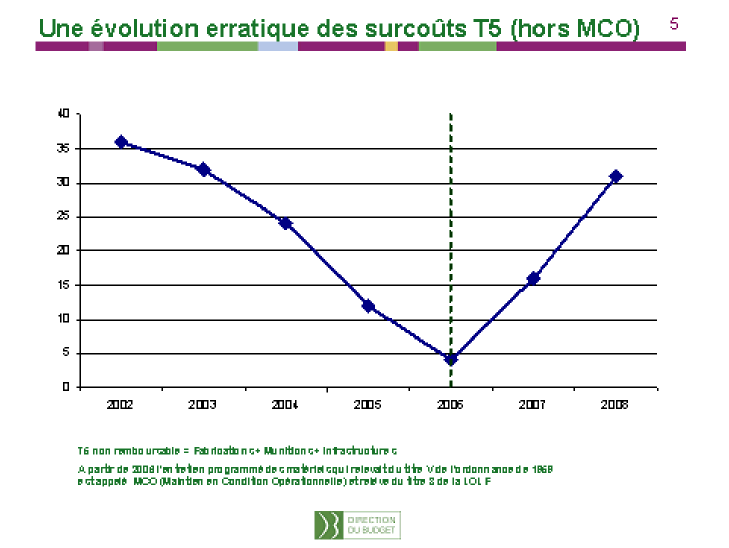
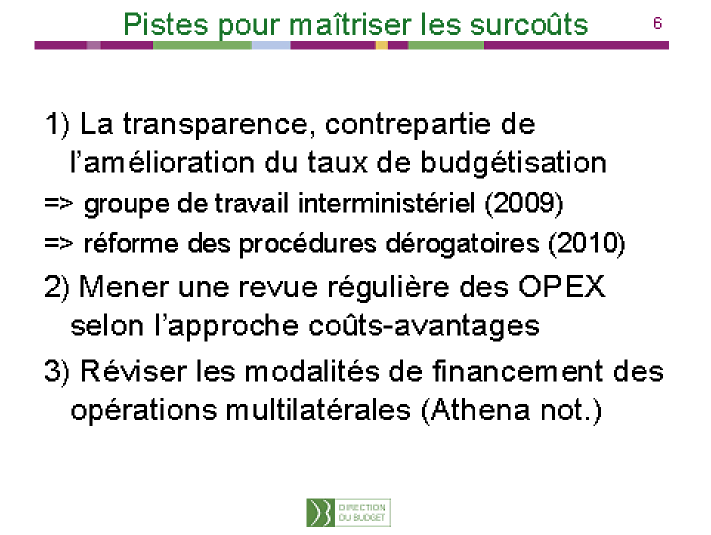
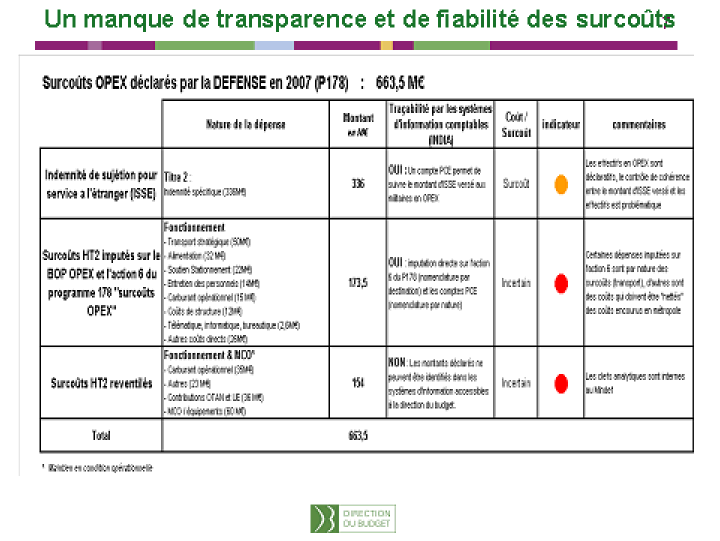
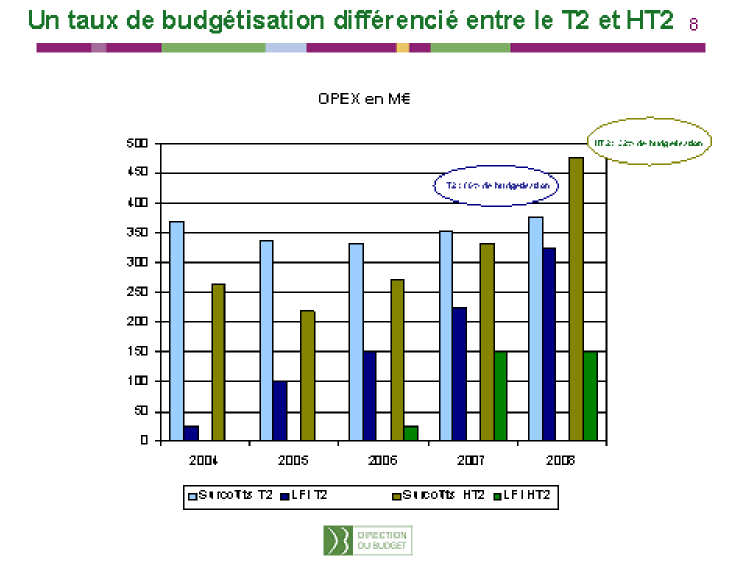
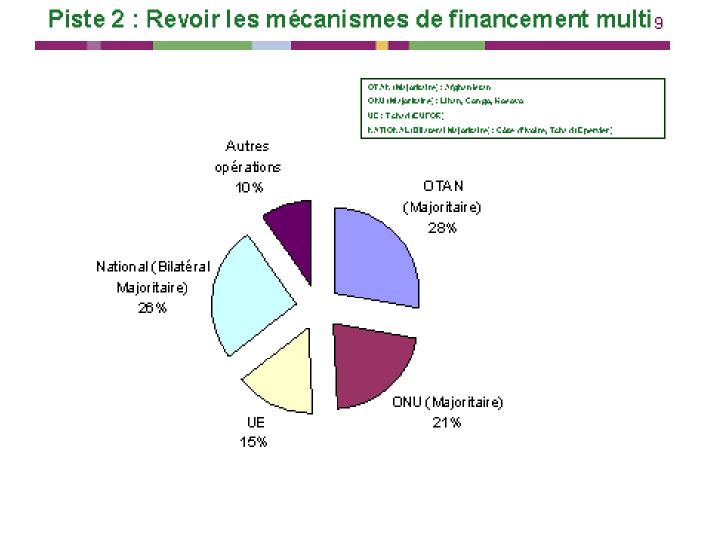
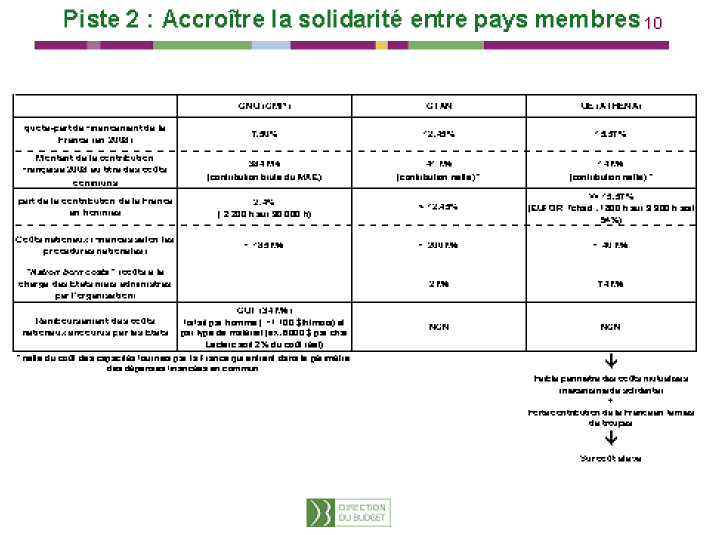
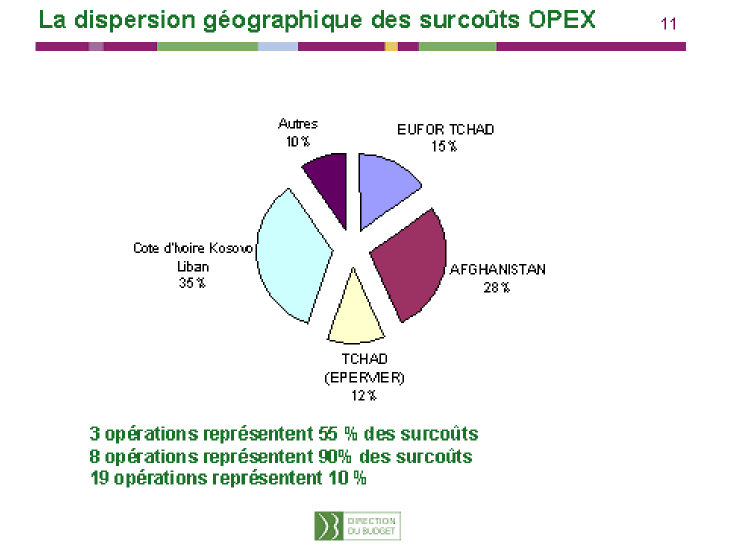
Audition du 26 mars 2009
À 9 heures 30 : Audition conjointe du vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule, sous-chef d’état-major « opérations » à l’état-major des armées, responsable du budget opérationnel de programme Opex, du général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot, chef de la division « Plans, programmes et évaluation » de l’état-major des armées, et du commissaire-colonel Éric Rémy-Néris, chef du bureau Finances du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l’état-major des armées
Présidence de M. David Habib
M. David Habib, Président. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième matinée d’auditions de la Mission d’évaluation et de contrôle consacrées aux opérations militaires extérieures, notamment sous mandat international.
Lors de la première matinée d’auditions, nous avions entendu les responsables de la direction des Affaires financières du ministère de la Défense et de la sous-direction compétente à la direction du Budget. Nous recevons aujourd’hui les responsables des opérations militaires extérieures à l’état-major des armées.
Nous avions prévu, messieurs, de vous entendre successivement, mais vous avez préféré une audition commune. Nous n’y voyons aucun inconvénient ; au contraire, cela rendra nos débats encore plus vivants.
Nos deux rapporteurs représentent, l’un, la commission des Finances, l’autre, la commission de la Défense, et sont issus, l’un, de la majorité, l’autre, de l’opposition, ce qui montre que la Mission d’évaluation et de contrôle travaille dans un esprit non partisan, de manière à aboutir à un rapport final consensuel. Je précise que le compte rendu de votre audition vous sera adressé avant toute publication.
Je remercie de leur présence, habituelle et précieuse, les représentants de la Cour des comptes : M. Alain Hespel, président de la deuxième chambre, Mme Françoise Saliou, conseiller-maître, et M. Benoît d'Aboville, conseiller-maître en service extraordinaire.
Nous souhaiterions, messieurs, que nos échanges soient les plus directs possibles. J’espère que vous ne vous en formaliserez pas.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Pour commencer, messieurs, pourriez-vous nous présenter brièvement vos fonctions et votre rôle par rapport aux opérations militaires extérieures, les « Opex » ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule, sous-chef d’état-major « opérations » à l’état-major des armées. Je suis, depuis le 1er septembre, le sous-chef d’état-major « opérations », après avoir été durant deux ans le chef du Centre de planification et de conduite des opérations à l’état-major des armées. Mon rôle consiste à assister le chef d’état-major des armées pour toutes les questions relatives à la préparation et à l’emploi des forces, c’est-à-dire les opérations au sens large : cela va du concept à la conduite des opérations, en passant par la préparation opérationnelle et les exercices interarmées. Les structures dont j’ai plus particulièrement la charge sont le CICDE, Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations, la division « Emploi » – qui, en particulier, fixe les contrats opérationnels et organise l’entraînement interarmées –, le CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, chargé de la préparation des conseils restreints, de la planification et de la conduite des opérations, la division « Forces nucléaires », pour tout ce qui concerne les activités opérationnelles, et le Bureau géographique interarmées, qui conçoit et édite les documents utilisés, chaque jour, sur le terrain.
M. le général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot, chef de la division « Plans, programmes et évaluation » de l’état-major des armées. Au sein du pôle « Plans » de l’état-major, la division « Plans, programmes et évaluation » ou « PPE » réalise plus particulièrement la maîtrise d’ouvrage des exercices de planification et de programmation, et veille à la cohérence physico-financière de la programmation. La loi de programmation militaire et les exercices annuels d’actualisation des différents programmes sont typiquement au cœur des attributions de la division PPE. Par ailleurs, la division PPE exerce pour le compte du chef d’état-major des armées les attributions de responsable du programme 178, Préparation et emploi des forces, et de co-responsable du programme 146, Équipement des forces. C’est ainsi qu’une section de la division supervise, avec le reste du programme 178, la programmation des crédits du budget opérationnel de programme (BOP) Opex – sa gestion étant désormais assurée par le CPCO.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris, chef du bureau Finances, affaires juridiques de l’état-major des armées. En tant que chef du bureau Finances du CPCO, j’assiste l’amiral Teule pour les questions relatives à la centralisation de l’information sur les dépenses dédiées aux opérations, qu’il s’agisse de celles réalisées sur le BOP Opex ou sur les BOP d’armées. Par ailleurs, comme l’a signalé le général Morizot, j’exerce depuis un an la responsabilité de la conduite et de la gestion du BOP Opex.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. La durée du séjour de nos troupes en Afghanistan a été portée à six mois. Est-il envisagé de généraliser cette durée à toutes les Opex ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. La durée du séjour de nos militaires en Afghanistan a été portée à 6 mois car ils mènent un combat difficile et ont besoin de s’approprier le terrain : ils doivent montrer leur efficacité durant un temps suffisant avant de préparer la relève. Pour le moment, il n’est pas envisagé de généraliser la durée de six mois aux autres théâtres d’opérations.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. On nous a dit que le coût des Opex s’élevait à 850 millions d’euros pour 2008, avec une très forte croissance des contributions internationales et des dépenses de fonctionnement. Ce chiffre est-il définitif ? Quelles sont vos prévisions pour 2009, en fonction des formats déployés, des retours de contingents et des surcoûts sur chacun des théâtres ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Pour 2009, les prévisions s’établissent actuellement à une dépense d’environ 826 millions d’euros pour un effectif moyen de 11 330 hommes en opérations extérieures. Les options stratégiques à l’étude couplées aux décisions du Conseil restreint, validées récemment par l’Assemblée nationale – c’est-à-dire un désengagement de l’EUFOR au Tchad, un désengagement partiel en Côte-d’Ivoire, le retrait de nos éléments maritimes des côtes du Liban, une réduction de nos effectifs au Kosovo, un retrait de nos forces de Bosnie, et un éventuel déploiement de deux mois du groupe aéronaval dans l’Océan indien –, permettront une économie brute de 50 à 70 millions d’euros, sans laquelle le surcoût aurait atteint la somme de 880 millions d’euros en 2009, soit 50 millions de plus qu’en 2008. Toutefois, cette économie ne portera ses effets que sur une demi-année budgétaire ; l’application des mesures de réduction ne débutant qu’à la fin du premier semestre, il est vraisemblable que l’objectif annoncé de 100 à 150 millions d’économies sur le budget des Opex ne sera atteint que dans quelques années. Pour 2010, si les choses restent en l’état, on peut évaluer à 130 millions d’euros l’économie par rapport au budget de 2008.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Afin d’éviter toute ambiguïté, je précise que le chiffre de 850 millions cité par M. le rapporteur correspond à l’ensemble du périmètre de la mission Défense, gendarmes inclus, alors que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le chiffre donné par l’amiral Teule : d’où la différence de 20 millions d’euros.
Pour l’exercice 2008, la dépense nette a été finalisée à 831 millions d’euros, hors gendarmerie, somme à comparer aux 880 ou 885 millions d’euros qui auraient pu être engagés en 2009, toujours hors gendarmerie. Cette distinction est importante : dans la présentation des surcoûts, le programme 152 Gendarmerie nationale était adjoint au programme 178.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Sachant que l’on envisage l’envoi de gendarmes en Afghanistan, ce n’est pas sans incidence !
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Certes, mais il ne nous appartiendra plus de restituer la dépense.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Que pense l’état-major de la demande du SHAPE d’étendre le périmètre des coûts communs de l’OTAN, s’agissant de la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Les extensions des coûts communs relèvent de deux procédés.
Si des éléments jugés critiques pour les opérations sur le théâtre ne sont pas réalisés, on peut faire appel à la sous-traitance. Pour la FIAS, par exemple, des hélicoptères sont loués par l’OTAN afin d’assurer du transport logistique en Afghanistan. La décision d’extension est prise au niveau du Comité militaire, qui avalise par consensus la dépense.
D’autres extensions peuvent paraître inappropriées. Ainsi, nous ne sommes pas favorables à l’éligibilité aux coûts communs d’un déploiement d’Awacs au-dessus de l’Afghanistan, car nous considérons que d’autres besoins sont prioritaires. S’il existe une opposition forte au sein du Comité militaire, ou s’il y a un changement fondamental concernant les capacités à projeter, la décision se prend au niveau du Conseil de l’Atlantique Nord. C’est une décision politique, qui doit également être prise par consensus.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Nous ne participons pas à la flotte d’Awacs de l’OTAN car nous disposons de nos propres appareils – comme d’ailleurs les Britanniques. C’est en fait une question de principe : participerons-nous à des dépenses qui relèvent d’un programme auquel nous n’étions pas associés ? Le même problème se pose pour le transport stratégique, certains pays ayant accepté de le mutualiser dans le cadre de l’OTAN, ce qui risque de créer un précédent.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Pour que les Awacs puissent être acceptés comme éligibles aux coûts communs, ils doivent figurer au « catalogue capacitaire » du théâtre, c’est-à-dire inclus sur la liste des matériels considérés comme critiques pour la communauté. Tant que la France refusera de voter l’inscription de cette capacité au catalogue, les Awacs, qu’ils soient de l’OTAN ou d’une nation, ne pourront pas être éligibles aux coûts communs. Or nous sommes plusieurs pays à ne pas accepter cette inscription, non parce que nous estimons ne pas en avoir besoin, mais parce que nous considérons qu’il y a actuellement d’autres priorités opérationnelles à inscrire en coûts communs.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. La question des contributions internationales nous préoccupe particulièrement. On constate que, dans un certain nombre de cas, nous effectuons des interventions au bénéfice d’autres pays. Ainsi, le soutien aux contingents étrangers dans le cadre d’EUFOR Tchad représente un coût de 12 millions d’euros, la plus forte contribution étant la fourniture de carburant pour l’Ukraine, à hauteur de 8 millions d’euros. À Novo Selo, au Kosovo, un contingent marocain est imbriqué avec nos propres unités. Dans quelle mesure ces contributions au soutien d’unités non françaises sont-elles inscrites au budget pour 2009 ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Ces coopérations sur le terrain nous apportent beaucoup. Par exemple, lorsque nous avons voulu nous réorganiser en Afghanistan afin de renforcer notre efficacité et notre sécurité, nous avons souhaité nous désengager de la garde du camp de Warehouse. Nous avions obtenu des Géorgiens qu’ils nous remplacent, à condition de leur apporter un soutien, dans la limite d’une enveloppe validée par le ministre. Il s’agissait d’une forme de cession : le ministre nous autorisait à conclure un accord avec la Géorgie à condition que le coût ne dépasse pas une certaine somme. En raison des événements de l’été dernier, les Géorgiens ont renoncé. Une compagnie du 3e RPIMA a été obligée d’assurer la garde du camp, alors que ce n’est ni sa spécialité, ni sa vocation, réduisant d’autant la capacité de manœuvre du bataillon.
Certains pays nous sollicitent pour partager nos savoir-faire, nos entraînements et nos capacités. Par exemple, nous travaillons en ce moment avec les Émiriens, qui nous avaient accompagnés au Kosovo, il y a plusieurs années. Nous recevons également des demandes de la part de la Mongolie, mais ses prétentions sont pour l’instant exorbitantes.
De telles coopérations sont donc importantes au point de vue à la fois militaire et financier, car elles nous permettent, globalement, de faire des économies – les dépenses étant encadrées par le ministre, qui accepte, ou non, de les engager.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. La coopération avec les Marocains est ancienne, puisqu’il y avait déjà en Bosnie un bataillon complet de 450 hommes, chargé notamment de la garde de nos dispositifs militaires. Elle revêt aussi une dimension diplomatique, en raison des liens très forts existant entre la France et le Maroc. D’ailleurs, la décision venait à l’époque de la Présidence de la République.
Ces coopérations ne sont pas budgétées, sinon par un plafond d’autorisation de dépenses du ministre. Aucune enveloppe spécifique n’est prise en compte dans la loi de finances initiale. Tout avait été prévu pour les Géorgiens, les demandes avaient été envoyées au cabinet et, in fine, ils ne sont pas venus : cela prouve bien qu’il s’agit d’adaptations financières en cours de conduite, en général pour des raisons opérationnelles. De même, pour l’EUFOR, le plafond autorisé s’est élevé à 12,5 millions d'euros tandis que la dépense réellement exécutée n’a pas dépassé 4,5 millions d'euros.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Les dépenses figurent donc dans le BOP 178 62C ?
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Parfois, il s’agit de soutien pur, c’est-à-dire que la dépense sera, en effet, exécutée dans le cadre du programme 178. Parfois, il s’agit d’allocations en matériel. Ainsi, au Tchad, nous avons prêté aux Russes un « module 150 », c’est-à-dire un équipement global permettant de loger une compagnie de 150 personnes. La dépense n’est donc pas toujours exécutée dans le cadre du BOP Opex.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Ne peut-on pas considérer ces opérations comme des actions de coopération, qui devraient être financées par le ministère des Affaires étrangères au titre de la Coopération plutôt que par celui de la défense ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Nous serions très heureux si ce pouvait être le cas, madame la Rapporteure ! Toutefois, la plupart de ces coopérations résultent de considérations tactiques : la dimension opérationnelle est prépondérante. Il n’existe pas à ma connaissance d’oukases nous imposant de faire appel à un contingent étranger, quel que soit le prix demandé. Il risquerait d’y avoir des problèmes relationnels sur le terrain, ce qui paralyserait nos militaires au lieu de leur donner davantage de capacité.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Avec nos partenaires européens, dans le cadre de RECAMP (renforcement des capacités africaines au maintien de la paix) ou d’EURORECAMP, nous envisageons d’équiper des armées africaines, de manière à nous épargner un certain nombre d’interventions. Cela inclut des opérations de formation, mais aussi des dotations en matériel. Quelles formes celles-ci prendront-elles ?
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. L’objectif d’EURORECAMP, c’est l’entraînement ; cela n’inclut aucune fourniture de matériel. La dotation britannique y est très importante : elle s’élevait l’année dernière à 500 000 £. C’est dans le cadre de RECAMP, essentiellement français, que l’on fournit du matériel.
Les dotations prévues sont effectivement utilisées pour les Opex. Ainsi, certains contingents africains déployés ces dernières années, généralement dans le cadre de missions de l’ONU, ont été équipés, là encore sur décision politique, de matériels RECAMP, lesquels sont positionnés dans trois pays.
Dans ce cas, soit l’on complète cet équipement avec du matériel supplémentaire, soit l’on n’a plus que le transport à payer. Or, à l’ONU, le système des letters of assist nous permet de nous faire rembourser le transport. Cela ne nous coûte donc aucune dépense supplémentaire – hormis le coût de RECAMP, qui ne dépend pas du BOP Opex.
M. le général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot. La dépense de RECAMP est programmée dans le BOP Emploi, toujours dans le programme 178.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Il existe un débat entre le ministère de la Défense et celui du Budget sur l’établissement, la vérification et l’utilisation des chiffres. Progresse-t-on dans un esprit de coopération et de confiance ? Où en est la réforme de l’instruction de 1984, que chacun appelle de ses vœux ? Le groupe de travail s’est-t-il réuni récemment ? Le ministère du Budget nous a indiqué qu’il regrettait de ne pas avoir accès au fichier Payes du ministère de la Défense, afin de pouvoir vérifier, par exemple, les rémunérations versées dans le cadre des Opex. Les choses vont-elles changer, et si oui, quand ?
M. le général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot. Comme l’a rappelé le directeur des Affaires financières, nous avons entrepris depuis l’été 2007 des travaux visant à améliorer l’estimation des surcoûts et leur évaluation. Le chantier est en cours, notamment au sein de l’état-major, en liaison avec le SGA pour la méthodologie. À l’été 2008, les premières conclusions ont été transmises et des études complémentaires sont en cours.
Ces travaux ont pour objectif de préciser à la fois ce que recouvre une Opex et ses implications juridiques et financières. Il s’agit donc bien de réviser l’instruction de 1984. Notre objectif est d’aboutir, si possible avant l’été, à une méthodologie et à une vision commune avec la direction du Budget qui a été contactée.
Le travail est cependant complexe. Les surcoûts comprennent à la fois les coûts directs, désormais imputés sur le BOP Opex et faciles à tracer, et les coûts indirects, c’est-à-dire les retours des armées, qui, eux, sont plus difficiles à restituer. Au-delà de ce travail de clarification la réflexion porte sur deux volets : le souci de rendre compte de la totalité des coûts des Opex, qu’il faut distinguer de la problématique de la sélection des dépenses pour lesquelles un remboursement sera demandé. Nous travaillons dans ces deux directions.
Améliorer la restitution de l’ensemble des surcoûts suppose par exemple de progresser dans l’évaluation des surcoûts de maintien en condition opérationnelle ou prendre en compte la totalité de ceux liés à la consommation de munitions. On sait que des coûts ne sont pas déclarés car non remboursés.
Il faut également améliorer, en liaison avec la direction du Budget, la méthode de calcul des surcoûts liés aux dépenses qui font l’objet d’une moindre dépense sur le territoire. C’est sur ce point qu’il y a le plus de litiges et que nous devons poursuivre les travaux.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Les éventuels litiges portent sur les dépenses ex post, qui nous sont rapportées après avoir été engagées sur d’autres BOP que le BOP Opex, et qui ne représentent actuellement que 15 % de la dépense. Pour ma part, je considère qu’il ne s’agit pas de litiges, mais bien souvent de simples malentendus qui seront nécessairement résolus.
Depuis le 1er janvier 2009, nous avons décidé, sur recommandation du ministère du Budget et du Parlement, d’imputer l’essentiel de la dépense sur le BOP Opex plutôt que de la répartir sur une multiplicité de BOP, de manière à améliorer la traçabilité. En outre, nous avons abandonné le régime des « dépenses à bon compte » pour revenir à un système de dépenses budgétaires classique, avec, dans un premier temps, l’exécution d’une dépense sur la réserve centralisée des armées, qui est ensuite mandatée et contrebalancée par des crédits du BOP Opex. Cela fait suite à un décret conjoint du ministère du Budget et du ministère de la Défense, à paraître.
Par ailleurs, dans le nouveau schéma comptable mis en œuvre depuis le 1er janvier 2009, en ce qui concerne les soldes, le droit d’évocation du comptable assignataire est de 100 %.
Le contrôle de la dépense en opérations extérieures est donc total, comme pour la métropole. Il est erroné de dire que la dépense n’est ni traçable, ni vérifiable, car elle est contrôlée par les représentants du ministère du Budget – quoique pas forcément par la direction du Budget.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Lors de son audition, M. Éric Querenet de Breville a évoqué un droit de tirage sur la réserve de budgétisation de 30 millions d’euros en 2010 et de 60 millions en 2011. Or la loi de programmation militaire prévoit une augmentation du montant de la provision au titre des surcoûts des opérations extérieures de 60 millions en 2010 et de 60 millions en 2011. Pourquoi cette différence ?
M. le général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot. Afin d’augmenter le montant de la provision au titre des Opex jusqu’à 630 millions d’euros, le montant a été porté à 510 millions cette année, il sera augmenté de 30 millions l’année prochaine. De son côté, le ministère du Budget mettra à disposition 30 millions d’euros au titre de la réserve de budgétisation, ce qui représente une augmentation totale de 60 millions d’euros en 2010. À partir de ce niveau, une marche supplémentaire similaire est prévue en 2011. Si cela s’avère insuffisant en gestion, il serait fait appel à la réserve de précaution interministérielle.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Le rapport annexé au projet de loi de programmation militaire (LPM) parle pourtant, non de 30, mais de 60 millions en 2010. Il s’agit peut-être d’une bonne surprise !
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. On nous a indiqué qu’une nouvelle structure serait mise en place auprès du sous-chef « opérations » : le Centre de responsabilité budgétaire interarmées. On a également évoqué la création d’un Centre interarmées d’administration des opérations. Quelles seront les fonctions de ces deux organismes ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Le Centre de responsabilité Opex relève du commissaire-colonel Éric Rémy-Néris, qui assure la direction et le cadrage financier des opérations. Le Centre interarmées d’administration des opérations, le CIAO, sera l’organe d’exécution.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. L’état-major s’est réorganisé, et nous nous trouvons aujourd’hui dans une période transitoire. Il y a le responsable du programme, le CEMA, dont la fonction financière est tenue et exécutée par la division PPE, et le responsable du BOP, le sous-chef « opérations », dont le bureau exécutif est le bureau Finances du CPCO de l’état-major des armées.
Par ailleurs, on a souhaité, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), regrouper des organismes qui concouraient à l’exécution de la dépense publique en Opex. De même que, dans le cadre de la LOLF et de l’application du décret de 2005 sur les attributions du chef d’état-major, l’exécution de la dépense a été recentrée sur l’état-major des armées, on a décidé de mettre en place un organisme chargé de l’interface entre les théâtres d’opérations et l’état-major stratégique.
Auparavant, la dépense étant exécutée sur les BOP d’armées, ces attributions étaient exercées par les armées : il paraissait logique que les états-majors opérationnels d’armées, les bureaux « finances » des états-majors d’armées et les directions centrales de service – notamment du commissariat qui était service gestionnaire – s’en occupent.
Un service interarmées du commissariat va être créé, sous l’autorité de l’état-major des armées, à l’été prochain. Dans ce cadre, un organisme unique sera chargé de faire l’interface, en matière d’administration et de finances, entre les théâtres d’opérations et mon bureau : ce sera le Centre interarmées d’administration des opérations, qui sera notre opérateur Chorus. Concrètement, il déléguera les crédits que le responsable de BOP aura arrêtés pour les Opex.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Vous avez rappelé qu’une distinction fondamentale devait être faite entre les coûts remboursés et le coût pour les armées de la projection et de la mobilité. Disposez-vous d’une estimation, même approximative, du coût total de la projection en Opex, qui ne soit pas nécessairement encadrée par les normes de remboursement ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Nous vous transmettrons ultérieurement des données précises.
M. le général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot. Actuellement, la dépense relative à l’utilisation d’un avion de l’armée de l’air pour transporter des troupes vers un théâtre d’opérations extérieures entre dans le calcul des surcoûts.
Réaliser des opérations extérieures fait partie de notre métier. Par la méthode des surcoûts, notre démarche a été d’identifier uniquement les dépenses supplémentaires, plutôt que de chercher à évaluer le coût total des Opex. De surcroît, c’est un exercice plutôt compliqué – surtout pour l’armée de l’air et la marine. Un navire, par exemple, peut être en mission dans l’Océan indien, puis être dérouté vers les côtes, entrer dans la zone d’opérations, en ressortir : comment calcule-t-on alors la dépense imputable aux Opex ? De même, on ne comptera pas le coût du carburant utilisé par un avion de l’armée de l’air pour aller en Afghanistan ; en revanche, s’il fait le plein sur place et qu’il y a une différence de prix avec la France, elle sera comptabilisée.
Ce type de questions est au cœur des travaux actuels de méthodologie. C’est déjà assez complexe, et ne représente effectivement qu’une partie du coût global d’une Opex.
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Pour ne donner qu’un seul exemple, la projection de la Task Force 700 l’été dernier dans la Kapisa nous a coûté 22 millions d’euros en location de transports stratégiques – des Antonov. Il s’agit donc du coût direct. Il aurait pu être plus élevé si nous n’avions pas nos bateaux rouliers, les « RO-RO » ou roll on-roll off, qui sont des navires affrétés à l’année et qui nous ont permis de prépositionner la majorité des matériels lourds aux Émirats avant de les projeter sur la Kapisa.
M. le général de brigade aérienne Jean-Robert Morizot. Les opérations devenant de plus en plus difficiles, les matériels doivent être maintenus dans un état opérationnel parfait, ce qui induit une charge financière importante. Les opérations extérieures entament fortement le potentiel des matériels : il faut en tenir compte si l’on veut évaluer avec sincérité le coût des Opex. Il est toutefois difficile d’évaluer sur le long terme leurs effets sur le coût du maintien en condition opérationnelle. Nous y travaillons actuellement avec l’armée de terre.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Comptabilisez-vous le coût du matériel perdu ou détruit en Opex ? La formation des militaires afghans est-elle incluse dans le coût des Opex, bien qu’elle semble plutôt ressortir à la coopération ? Et enfin, les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre des Opex peuvent-elles être remboursées par le ministère du Budget ?
M. le général de brigade Jean-Robert Morizot. Les dépenses d’investissement, qui se sont élevées à 104 millions en 2008, n’ont jamais fait l’objet de demande de remboursement : il est vrai qu’auparavant, le remboursement des surcoûts se traduisait souvent par une annulation de crédits d’équipements justement . Il n’y avait aucun intérêt à faire une telle demande. Le changement de mode de financement basé sur une provision plus importante destinée à préserver les crédits d’équipements permet d’envisager de présenter également ces surcoûts dûment justifiés. Il sera en effet très facile de détailler ces dépenses, qui sont particulièrement bien identifiées : elles répondent à des demandes très précises, généralement sur des équipements particuliers manquants. Ces dépenses sont toujours limitées au strict nécessaire, parce qu’elles se font au détriment d’autres équipements. Si le financement est accordé, c’est que le besoin est classé avéré et urgent.
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Ces matériels étaient jusqu’à présent financés sur le programme 146. Comme on n’affichait que les surcoûts des Opex, qui avaient une contrepartie sur le titre 5, on ne présentait pas ces dépenses.
Pour ce qui est du matériel perdu ou détruit en Opex, nous ne le comptabilisons pas. Lorsqu’il faut le racheter, cela entre dans la programmation d’achat de matériel. En revanche, certains matériels subissent une usure importante à cause de leur utilisation en Opex – cas du matériel de campement au Tchad par exemple, à cause de la chaleur. Nous pouvons donc faire figurer dans les surcoûts de l’année des dépenses d’entretien supérieures à la normale, retracées au titre 3. Il est vrai qu’il n’existe pas de parallélisme des formes pour les dépenses exécutées dans le cadre d’une même Opex, entre les dépenses du titre 5 et celles du titre 3, pour les raisons techniques dont nous avons déjà parlé : celles afférentes au titre 5 ne sont pas présentées pour remboursement dans le cadre du décret d’avance.
Quant à la formation des Afghans, ce sont plutôt d’autres nations que nous qui s’en occupent et nous ne faisons pas partie des trust funds mis en place par l’OTAN. Nous menons cependant une mission de formation – la mission Epidote –, qui était cofinancée par le ministère des Affaires étrangères au titre de la coopération et par le ministère de la Défense. Depuis cette année, par entente de nos deux ministres et faute de crédits des Affaires étrangères, cette dépense a basculé entièrement vers le ministère de la Défense. Nos seules dépenses directes pour les Afghans vont donc à la commando school et à la mission Epidote, qui recouvre aussi maintenant une école de logistique à laquelle nous participons avec les Allemands.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Disposez-vous de comparaisons avec vos grands alliés qui sont plus généreusement dotés par leur parlement, comme les Italiens ou les Anglais ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Tout est lié au processus de décision. Les Italiens votent un budget pour chaque opération. Les Allemands ne partent pas tant qu’ils ne disposent pas de l’effectif exact du personnel concerné, des règles d’engagement et d’un budget validé au Bundestag à l’euro près !
Pour ce qui nous concerne, lorsque le conseil restreint se réunit, il dispose d’évaluations budgétaires pour chacune des options stratégiques envisageables mais la décision porte sur notre participation, pas sur le budget. Comme l’a dit M. Woerth devant la commission de la Défense, la France n’a jamais reculé devant une opération utile parce que le budget n’était pas préparé. Même si nous devons aller vers une comptabilité plus précise, ce système nous garantit une réactivité très utile sur le terrain.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Lorsque nous intervenons sur des théâtres nouveaux, on peut concevoir la nécessité d’achats en urgence. Mais qu’en est-il lorsque l’opération perdure ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Les achats en urgence ont représenté 2 millions en 2005, puis 80 en 2006, 5 millions en 2007 et 104 en 2008. Cela dépend de l’évolution de la situation sur le terrain.
Ainsi, la lutte contre les engins explosifs improvisés s’est beaucoup développée sur le théâtre afghan, et nous savions aussi qu’elle serait importante lorsque nous nous sommes engagés au Liban. Lorsque nous avons modifié notre engagement en Afghanistan, en allant dans la Kapisa, il a fallu développer nos moyens de protection des individus, soit dans les véhicules – avec les tourelles télé-opérées des véhicules de l’avant blindé (VAB) par exemple – soit débarqués – vêtements personnels, moyens radio. Ce développement des moyens de protection a représenté plus de la moitié de nos investissements en urgence opérationnelle en 2008, mais cela peut changer. Aujourd’hui, les insurgés considèrent que ce sont les engins explosifs improvisés, dirigés contre les troupes ou contre la population, qui font le plus mal aux Occidentaux. Ils vont probablement continuer, et nous aurons donc peut-être moins de besoins nouveaux pour les combats durs sur le terrain.
Par ailleurs, des achats en urgence opérationnelle peuvent aussi résulter d’un besoin d’interopérabilité nouveau, notamment dans le domaine des liaisons nécessaires pour l’appui aérien à terre. Lorsque nous nous sommes engagés de manière plus active sur le terrain, nous avons eu besoin de moyens de radio compatibles avec les différents avions de la coalition – il s’agit des fameux PRC 117 que nous avons « achetés sur étagère ».
M. le général de brigade Jean-Robert Morizot. Le projet de LPM comporte une opération – l’opération d’armement Carape – qui permet de provisionner de l’argent pour faire face à ce type de dépenses. Lorsqu’il y a urgence, que le besoin est avéré, une partie des urgences opérations pourront être couvertes par des crédits de l’opération Carape, qui est plutôt dédiée à la lutte contre les engins explosifs improvisés et à l’achat de petits matériels complémentaires.
Par ailleurs, la protection des troupes étant une des priorités essentielles du Livre blanc, de nombreuses dépenses dans ce domaine – pour les engins blindés par exemple – sont prévues dans la future loi de programmation militaire.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Tous nos soldats en Afghanistan ont-ils reçu les nouveaux gilets pare-balles, plus légers ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Je poserai la question à l’armée de terre et je vous communiquerai la réponse.
Pour ce qui est de nos alliés, j’attire votre attention sur le fait que les comparaisons sont malaisées parce que les périmètres sont très différents. Ainsi, pour ce qui est de l’approvisionnement de l’armée britannique en matériel, il y a deux fois plus d’urgences opérationnelles que de programmation. Nous avons constitué un groupe de travail pour creuser la question.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Les prévisions de surcoûts Opex pour 2009 sont de 100 millions d’euros pour les contributions OTAN et Union européenne au titre 6, dont 32 millions pour EUFOR Tchad et 38 millions pour Pamir en Afghanistan. Où apparaissent les remboursements ? Peut-on les identifier ?
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Je voudrais d’abord éclaircir une petite confusion qui se produit souvent dans ce domaine : ces montants ne recouvrent pas les mêmes périmètres selon les organisations et la comparaison entre ONU, OTAN et Union européenne est donc faussée.
Le système de l’OTAN est fondé sur le principe costs lie where they fall : les coûts échoient aux unités qui se déploient. Il existe une exception : le financement en coût commun, qui se développe, soit que les nations n’arrivent plus à subvenir à la demande de l’OTAN, soit qu’elles n’en aient pas la capacité. Ainsi, toutes nos armées étant confrontées à une attrition de leur flotte de transport aérien – parce que nous attendons tous l’A400M –, l’OTAN accepte de rendre les dépenses résultant de cette situation éligibles au remboursement commun : les common costs ont plus que triplé entre 2005 et 2009, passant de 120 millions à plus de 400.
Dans le cas de l’Union européenne, les coûts communs sont à peu près de même nature qu’à l’OTAN – mais je rappelle qu’ils dépendent en tout état de cause de textes internationaux signés par la France : à partir du moment où la décision politique est prise de s’engager dans une opération, on n’a aucune latitude pour choisir ce qu’on paye ou non. La différence est qu’à l’OTAN on vote un budget annuel, quitte à accorder un petit financement complémentaire au coup par coup, alors que l’Union européenne vote opération par opération : on discute dans chaque cas des common costs devant le comité Athéna. Mais l’Union accorde une facilité de caisse aux nations qui participent à ses opérations extérieures. C’est le système des nation borne costs : chacun contribue à un pot commun qui sert à faire des avances ; dès qu’il est utilisé, chaque nation rembourse la dépense faite pour son compte. Un exemple : on a mis l’année dernière 40 millions d’euros au pot commun pour l’opération EUFOR, qui ont été utilisés comme une avance de fonctionnement par le commandant des opérations. Au fur et à mesure que cet argent a été utilisé, on a abondé le compte bancaire de l’Union.
Les common costs et les nation borne costs relevant de l’Union européenne sont inscrits au titre 6. Dans le système de l’OTAN voire de l’ONU, ces dépenses nucléaires, biologiques et chimiques NBC seraient inscrites au titre 3. La comparaison entre UE et OTAN ne recouvre donc pas les mêmes périmètres. La différence est importante, puisque les nation borne costs représentent deux tiers de la dépense ! La mutualisation de la dépense est un système très intéressant puisque, alors que le budget de l’EUFOR était 119,6 millions d’euros, nous n’en avons payé que 16,75 % ; si nous avions agi dans le cadre national, et même en restreignant nos dépenses d’investissement, le total aurait été bien plus élevé.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Les remboursements, par exemple des Nations unies pour le Liban, apparaissent-ils en déduction quelque part ?
M. le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris. Ils n’apparaissent pas en déduction du budget. Vous savez qu’à l’origine, le BOP est toujours sous-doté : la loi de finances initiale pour 2009 ne prévoit par exemple que 510 millions. Toutefois, depuis trois ans, les remboursements des organisations internationales – c’est-à-dire essentiellement l’ONU – viennent compléter la dotation en loi de finances initiale. En fait, le mécanisme est totalement transparent : le montant du décret d’avance que nous demandons en cours d’année est égal au montant des dépenses prévisionnelles diminué du montant de la dotation prévue en loi de finances initiale et de celui des abondements internationaux. C’est un grand progrès en termes de sincérité parce l’on peut retracer ainsi l’ensemble de la dépense, et l’ensemble des abondements.
Je pourrai vous fournir un tableau qui détaille les remboursements opération par opération et même selon leur nature, puisque l’ONU les distingue en deux parties.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Nous sommes preneurs.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Nous avons été très étonnés d’apprendre que les actions menées contre la piraterie maritime, comme dans l’affaire du Carré d’As, ne donnent lieu à aucune demande de remboursement auprès de l’armateur ni de l’assureur. La Société nationale de sauvetage en mer pratique pourtant de telles demandes de remboursement – je ne parle bien sûr que du sauvetage des biens, et non des personnes. Imaginez-vous de faire de même, même si ces remboursements vont au budget général de l’État ?
M. le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Teule. Lorsque nous sommes allés sauver les deux otages du Carré d’As, le bateau n’était pas en détresse. Il est d’ailleurs rentré au port par ses propres moyens, avec son skippeur. J’imagine qu’il y a toujours matière à plaider pour un avocat, mais dans l’état actuel des textes, c’est difficile. En outre, dans ce cas précis, les propriétaires étaient difficiles à identifier. Toutefois, personne n’aurait apprécié que le bateau reste sur place, où il aurait d’ailleurs pu être utilisé à d’autres actions contre lesquelles nous luttons.
Nous réfléchissons malgré tout au moyen de faire évoluer les choses. Nous y réfléchissons aussi au niveau européen, dans le cadre de l’opération Atalanta, mais sans avoir encore de résultat. Il est beaucoup plus simple de faire participer les armateurs si l’on doit les protéger – parce qu’on rend alors un service – que si l’on vient extraire d’une situation difficile un bâtiment appartenant à leur flotte.
M. David Habib, Président. Merci beaucoup, à tous, de votre contribution à nos travaux.
Audition du 29 avril 2009
À 16 heures 15 : Audition de Mme Sylvie Bermann, directrice des Nations unies, des Organisations internationales, des droits de l'Homme et de la francophonie au ministère des affaires étrangères et européennes
Présidence de M. Georges Tron
M. Georges Tron, Président. Je souhaite la bienvenue aux représentants du ministère des Affaires étrangères et européennes, Mme Sylvie Bermann, directrice des Nations unies, des Organisations internationales, des droits de l'Homme et de la francophonie au ministère des affaires étrangères et européennes, M. Olivier Guerot, sous-directeur pour les affaires institutionnelles et les contributions internationales à la direction des Nations unies, et M. Nicolas Lacôte, secrétaire des affaires étrangères.
Travaillant sans esprit partisan, la MEC tend à dégager des propositions de consensus afin d’améliorer les politiques publiques. Il s’agit aujourd’hui d’identifier les facteurs de la croissance tendancielle des dépenses liées aux opérations extérieures (OPEX). L’usage de la MEC est d’être accompagnée de représentants de la Cour des comptes, aujourd'hui représentée par Mme Françoise Saliou, présidente de section, et par M. Benoît d’Aboville, conseiller maître en service extraordinaire.
Les rapporteurs – Mme Françoise Olivier-Coupeau et M. Louis Giscard d’Estaing, respectivement membres des commissions de la Défense et des Finances – tiennent à recueillir le point de vue du ministère des Affaires étrangères sur les aspects propres aux opérations de maintien de la paix sous mandat international (OMP). Ils souhaitent également pouvoir approfondir leur réflexion sur la transition entre les opérations militaires et l’aide au développement.
Mme Sylvie Bermann. Les opérations de maintien de la paix sont des instruments essentiels pour la France. Nombreuses au milieu des années 1990, elles ont subi une certaine désaffection après les échecs au Rwanda, en Bosnie et en Somalie. Leur nombre a augmenté de nouveau à partir de 2002, lorsque sept nouvelles opérations requérant des effectifs importants ont été lancées. On compte aujourd’hui seize OMP, réunissant 130 000 personnels – dont 30 000 civils –, situées pour la plupart en zone subsaharienne.
Dans cette partie du monde qui intéresse plus particulièrement la France, les Nations unies sont intervenues à notre demande, soit en relève d’une opération française, comme en Côte d’Ivoire, soit en substitution, comme au Tchad.
Le mandat du Conseil de sécurité donne un cadre légitime et universel aux opérations. Ainsi, une intervention de l’OTAN au Liban aurait pu être ressentie comme une opération de croisés dans le monde musulman. C’est donc tout l’intérêt de la France que d’intervenir dans ce cadre, qui, en outre, offre des garanties sur le plan militaire. Enfin, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la France se doit d’exercer ses responsabilités.
Les 383 millions d’euros que représentent les OMP en 2008 sont à rapprocher des 850 millions d’euros dépensés la même année par le ministère de la Défense au titre des OPEX. Le coût d’un casque bleu – environ 40 000 euros par an – est bien inférieur à celui d’un soldat envoyé par la France dans le cadre d’une intervention bilatérale, européenne ou sous l’égide de l’OTAN. Il conviendrait également de comparer le coût d’une OMP à celui
– inchiffrable – d’une non-intervention.
Autrefois, les OMP prenaient fin le jour des élections dans le pays concerné, avec l’arrivée de la démocratie. C’est ce qui s’est passé à Haïti, où nous avons dû cependant revenir dix ans après, alors que la situation s’était beaucoup dégradée. Désormais, les opérations sont plus complexes et visent, par le maintien d’une présence sécuritaire, à l’instauration d’une paix durable. À cet effet ont été lancés, d’une part un nouvel instrument, la Commission de consolidation de la paix – émanation du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, destinée à aider les pays à effectuer la transition difficile de la guerre à la paix –, d’autre part une réforme des activités opérationnelles des Nations unies pour favoriser une meilleure synergie avec les agences comme le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ou le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui viennent en relais des opérations, et enfin des changements dans le secteur de la sécurité, tous éléments qui permettent de mieux gérer l’après-crise.
Une fois le mandat défini par le Conseil de sécurité, le budget consacré à l’opération est examiné par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) – organe subsidiaire de l’Assemblée générale – puis par la Cinquième commission (administrative et budgétaire).
Il serait illusoire de penser que le nombre d’OMP ira décroissant. Le déploiement au Soudan de la Mission des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) n’est effectué qu’à moitié et la relève de la force européenne déployée depuis un an au Tchad et en Centrafrique (EUFOR Tchad/RCA) est en cours.
Nous avons beaucoup travaillé pour renforcer la professionnalisation des OMP, sur les plans tant militaire, afin de disposer des instruments de planification qui nous manquaient, que logistique et budgétaire. Parallèlement au département des opérations de maintien de la paix (DOMP) qui est un département – dirigé par Alain Le Roy – du Secrétariat des Nations unies, un département de l’appui aux missions (DAM), dirigé par Mme Suzanne Malcorra, a été créé dans le but d’accroître la transparence ainsi que l’efficacité et la rapidité des déploiements. Un séminaire a été organisé au mois de janvier, portant sur tous les aspects des OMP et le Conseil de sécurité.
Enfin, dans une optique de complémentarité, les Nations unies coopèrent avec les organisations régionales, telles l’Union européenne et l’Union africaine.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. À quoi tient la différence de coût entre un casque bleu et un soldat français envoyé dans le cadre d’une OPEX ?
Mme Sylvie Bermann. Dans la mesure où les Nations unies remboursent les États contributeurs, il revient moins cher pour la France d’envoyer un casque bleu qu’un soldat, dont la charge revient entièrement au ministère de la Défense. Par ailleurs, le niveau d’équipement n’est pas le même.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Les 383 millions d’euros consacrés aux OMP pèsent très lourdement sur le budget du ministère des Affaires étrangères et européennes. Comment financez-vous cette impasse ?
Mme Sylvie Bermann. Le budget des OMP est prélevé sur le budget de fonctionnement du ministère, ce qui pose problème. Pour échapper à cette contrainte, il avait été envisagé de créer un programme budgétaire spécifique, mais cette solution n’a pas été retenue.
M. Olivier Guerot, sous-directeur pour les affaires institutionnelles et les contributions internationales. La sous-dotation qui existait au début des années 2000 a pu être résorbée grâce à un effort budgétaire et à une baisse des coûts. L’équilibre a à peu près été atteint en 2002-2003, mais à partir de 2004 les moyens alloués ont été stabilisés alors que le coût, principalement des OMP, repartait à la hausse avec le lancement de nouvelles opérations. Le rebasage effectué en 2006 n’a pas permis de compenser la montée des coûts. La sous-dotation actuelle est financée par la levée de la réserve légale de crédits gelés et par des crédits dotés en loi de finances rectificative.
Mme Sylvie Bermann. Nos futures dépenses pourraient être contrôlées. Par exemple, compte tenu des conditions actuelles de sécurité, la France ne juge pas souhaitable de lancer une OMP en Somalie. Pour autant, d’autres crises peuvent éclater.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Il est parfois difficile de faire la part des coûts correspondant aux OMP – c'est-à-dire la contribution de la France aux Nations unies et ses engagements en tant que pays contributaire – de ce qui relève des OPEX. Les dispositifs peuvent en effet soit être superposés soit engendrer des surcoûts au titre des OPEX – je pense notamment aux 70 millions d’euros à imputer à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
Mme Sylvie Bermann. La part de la contribution française aux OMP a été fixée à 7,4 %, ce qui représente 646 millions de dollars pour 2009. Le barème devrait être révisé à la fin de l’année, ce qui nous laisse espérer une diminution de notre quote-part. Par ailleurs, nous participons à hauteur de 6,3 % au budget global des Nations unies.
Le remboursement par les Nations unies est forfaitaire et correspond à un coût moyen des personnels et de l’équipement. Si la France décide de déployer du matériel sophistiqué, comme cela a été le cas des chars Leclerc au Liban, elle doit assumer le surcoût correspondant.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. L’évolution de la contribution française aux OMP laisse attendre un pic impressionnant en 2010.
Mme Sylvie Bermann. D’ordinaire, une partie des appels de l’année N porte sur l’année N–1. Le barème étant révisé fin 2009, les appels 2009 ne porteront que sur 2009. Cela explique la baisse de 2009, compensée en 2010. À ce report technique, il faut ajouter la hausse des coûts liée aux opérations lancées au Tchad et au Darfour ainsi qu’au soutien logistique accordé à l’opération de l’Union africaine en Somalie (AMISOM).
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. S’agissant du Tchad, la Mission des Nations unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) prend le relais de l’EUFOR Tchad/RCA. Dans quelle mesure le budget qui lui est consacré va-t-il augmenter ?
M. Olivier Guerot. Les prévisions pour 2009 sont de 48 millions de dollars, contre 29 millions de dollars en 2008. Pour la France, cette augmentation sera compensée par la diminution du coût de l’EUFOR.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Pourtant, c’est le ministère de la Défense qui finance l’EUFOR. Or c’est au ministère des Affaires étrangères que sera imputée cette augmentation.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Le financement des OMP trouve en effet son origine dans le budget du ministère des Affaires étrangères et les coûts des OPEX sont supportés par le ministère de la Défense. Mais c’est ce dernier qui reçoit les remboursements forfaitaires des Nations unies.
M. Olivier Guerot. Lorsqu’un déploiement français s’effectue, la première dépense est supportée par le ministère de la Défense. Les Nations unies remboursent ensuite forfaitairement les contributeurs de troupes, sur la base des crédits obtenus de l’ensemble des membres.
Mme Sylvie Bermann. Ce système de financement commun est plus avantageux pour la France. Notons qu’un tel système aurait pu être adopté dans le cadre européen, mais que les Britanniques l’ont refusé.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Suite à une remarque de la Cour des comptes, les remboursements des Nations unies apparaissent depuis 2008 dans le budget du ministère de la Défense, considéré comme l’opérateur « technique ». Auparavant, ils étaient inscrits au budget général.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Le système instauré par les Nations unies vous paraît-il satisfaisant ?
Mme Sylvie Bermann. C’est un système équitable. Il est normal que les pays riches, mieux dotés sur le plan militaire, aient à supporter un surcoût.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. En Afrique, la France est en première ligne pour ce qui est des opérations multilatérales. Or il semble que nous éprouvions quelque difficulté à convaincre d’autres nations – européennes ou africaines – d’intervenir à nos côtés. Quel regard portez-vous sur l’attitude réticente de nos partenaires ?
Mme Sylvie Bermann. Les opérations en Côte d’Ivoire et au Tchad ont été voulues par la France. La première était au départ bilatérale ; lorsqu’elle s’est multilatéralisée, nous nous sommes efforcés de convaincre nos partenaires. Un certain nombre de pays africains participent aujourd’hui à cette mission.
Nous avons réussi à rallier des États membres pour une opération européenne au Tchad, puis nous avons réussi à obtenir des Nations unies qu’elles relèvent cette opération au bout d’une année. Des pays africains – Togo, Bénin, Maroc – participent à la MINURCAT, qui a pris le relais de l’EUFOR le 15 mars.
Dans les années 1990, la France et ses partenaires européens étaient les premiers contributeurs de troupes. La situation est aujourd’hui différente, la FINUL faisant figure d’exception. Les effectifs des troupes européennes se réduisent de plus en plus, et avec eux, l’expertise militaire.
Les contingents africains sont nombreux sur le papier, mais ils manquent de matériel et de formation. Un programme européen, EURORECAMP, a pris le relais du programme français RECAMP (Renforcement des capacités africaines au maintien de la paix) afin de renforcer l’expertise, d’unifier les normes de commandement, de former les soldats aux notions d’État de droit ou de droits de l’Homme. Il nous faut à la fois encourager les capacités africaines de maintien de la paix et la participation directe des nations qui possèdent l’expertise.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. D’après les informations que nous tenons de la Cour des comptes, sur les 88 000 soldats envoyés dans ce cadre, 13 000 sont européens. Ce sont surtout l’Italie, la France et l’Espagne qui sont contributaires – au contraire de la Suède, sans parler de la Grande-Bretagne –, les États membres engagés en Irak et en Afghanistan n’ayant pas souhaité participer à ces opérations.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. EURORECAMP est un programme utile ; cependant, les crédits consacrés à la coopération militaire diminuent.
Mme Sylvie Bermann. C’est le cas, malheureusement, de tous les budgets. Les contributions volontaires à l’ensemble du système ont également diminué de moitié.
La coopération dans le domaine militaire dépend de la direction de la Coopération, de la sécurité et de la défense (DCSD) du ministère. Parallèlement, le ministère de la Défense apporte un appui sur le terrain, notamment grâce aux hôpitaux de campagne, destinés aux troupes mais ouverts aux populations civiles.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Précisément, dans les OPEX, l’activité du service de santé des armées est consacrée à 90 % aux populations civiles. Ne serait-il pas conforme à la logique de la LOLF de considérer ces actions comme relevant de la coopération, avec un financement adéquat ?
Mme Sylvie Bermann. Certes, l’activité est tournée vers les populations civiles. Mais elle n’existerait pas sans opération sur le terrain. C’est donc bien une dépense liée à une OPEX.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Prenons un exemple. L’hôpital militaire de Tomboukro, en Côte d’Ivoire, démonté depuis, n’était visiblement pas calibré pour recevoir les contingents de l’opération Licorne, mais pour accueillir la population civile. Il n’y avait aucune raison de disposer d’un hôpital militaire de campagne de cette dimension par rapport aux risques purement militaires encourus par le contingent français. Une partie des activités du service de santé des armées est ainsi clairement destinée à apporter un soutien aux populations civiles. Les Britanniques ont une approche interministérielle de ces fonds, dédiés à la stabilisation, qu’ils distinguent des dépenses militaires pures.
Mme Sylvie Bermann. Une fraction de ces activités est comptabilisée comme aide publique au développement (APD). Par ailleurs, la DCSD mène des actions complémentaires dans le domaine de la santé.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Ces activités, parallèlement aux actions civiques menées par l’armée, concourent en effet à la stabilisation du pays. La Grande-Bretagne les a rassemblées dans une zone grise – budgétaire et conceptuelle. Toute la question est d’imaginer un dispositif – interministériel par exemple – suffisamment solide pour les inclure.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. C’est une question d’affichage. Si ces actions relevaient de l’APD, le pourcentage du PNB que nous y consacrons s’en trouverait relevé. Lorsque l’on se rend en Afrique, il est frappant de constater combien les médecins militaires français soignant les populations locales sont plus nombreux que les médecins venus du Danemark ou de Norvège, deux pays affichant pourtant un ratio APD/PNB bien supérieur au nôtre.
Mme Sylvie Bermann. Leur PNB étant inférieur, il est normal que leur action soit moins visible.
Mais il est vrai que les activités militaires destinées aux populations civiles appartiennent à une zone grise. Malgré l’intérêt que représente leur développement en termes d’affichage, trop peu de fonds y sont consacrés. Je reviens de Géorgie, où la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ne dispose d’aucun crédit pour cela.
Une réflexion est en cours aux Nations unies pour renforcer cette dimension civile des opérations. Les critères du CAD de l’OCDE ont été révisés afin de comptabiliser certains aspects des activités dites « civilo-militaires » (ACM), comme la réforme du secteur de la sécurité ou la réinsertion des enfants soldats, dans un forfait représentant 7 % des OMP.
M. Olivier Guerot. Le ministère de la Défense établit une comptabilisation partielle des activités des hôpitaux militaires au titre de l’Aide publique au développement ; le ministère des Finances transmet ces données à l’OCDE.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Ce n’est pas tant le volume de l’aide civile, même s’il est dérisoire, qui pose problème, que son affectation. En Afghanistan, on constate d’importantes négligences dans l’organisation des actions. De manière générale, il y a dévaluation de la notion d’aide.
Mme Sylvie Bermann. Le département des opérations de maintien de la paix réfléchit à l’élaboration d’une nouvelle démarche qui tiendrait compte de ces éléments. En Haïti, la sécurité n’est pas encore rétablie, mais les demandes de la population portent plus sur le développement que sur la sécurité. Cela relève-t-il des missions du PNUD et des agences de développement, ou cela dépend-il aussi des questions de sécurité ?
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. La Commission de consolidation de la paix est justement censée fédérer et coordonner les initiatives visant la sécurité aussi bien que le développement en sortie de crise, comme à Haïti. Quelle est la contribution française à cet organe ?
Mme Sylvie Bermann. Pour la France, qui a souhaité sa création, c’est un outil indispensable à la continuité des actions qui a manqué à Haïti. Créée par l’Assemblée générale et par le Conseil de sécurité, la Commission de consolidation de la paix compte la France parmi ses membres de droit. Une année a été nécessaire à sa mise en place. Il a été décidé d’inscrire à son programme deux pays chaque année. Le Burundi, la Sierra Leone et le Liberia, qui se trouvent plutôt dans une logique de stabilisation, font partie des premiers. La France milite pour l’inscription d’Haïti et de la République Démocratique du Congo (RDC). Mais la cohabitation sur le terrain entre un bureau de la Commission et une OMP est considérée comme risquée.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Les soldats français envoyés à l’étranger sont soumis à l’obligation de visa, notamment en Côte d’Ivoire, au Tchad, au Liban et en Afghanistan. Cela contraint les intéressés à acquérir un passeport, les armées à organiser la collecte et la redistribution des documents, et ôte toute souplesse à l’organisation en rendant difficiles les remplacements de dernière minute.
Ces visas sont-ils payants ? Le ministère pourrait-il négocier l’exemption pour ces militaires, dont la carte d’identité pourrait être considérée comme suffisante ?
Mme Sylvie Bermann. Les soldats n’achètent pas leurs passeports : ils leur sont fournis soit par le ministère de la Défense soit par les Nations unies.
Les Français ne peuvent obtenir d’exemption dans le cadre d’une opération multilatérale, qui concerne des casques bleus de toutes les nationalités, originaires de pays où la carte d’identité, parfois, n’existe pas. Par ailleurs, ils doivent transiter par différents pays qui exigent un passeport ; il est inimaginable que seuls les Français ne soient pas soumis à cette obligation. Cela dit, je n’ai jamais entendu parler de difficultés qu’aurait pu éprouver, notamment, le ministère de la Défense dans la gestion de ces affaires.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Quel regard portez-vous sur la Mission européenne de police et de justice (EULEX), qui a pour objet de mettre sur pied un système juridique et policier au Kosovo ?
Mme Sylvie Bermann. C’est un programme européen qui a pris le relais des forces des Nations unies au Kosovo. Le pays n’étant pas reconnu de tous, il a été jugé préférable de laisser l’Europe intervenir dans le cadre d’une opération civile, relevant davantage des besoins du pays.
Nous suivons indirectement ce programme, dans la mesure où la coopération est nécessaire lors des phases de transition. Il est parfois frappant de constater combien les problèmes peuvent être inversés : en Géorgie, la MONUG dispose d’une imposante flotte de voitures, mais manque de moniteurs ; la mission de surveillance de l’UE en Géorgie (MSUE) a suffisamment de moniteurs et pas assez de voitures !
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Êtes-vous au courant du contentieux qui existe entre l’EUFOR et les Nations unies sur la reprise du Camp des étoiles à Abéché ?
Mme Sylvie Bermann. Comparé aux opérations européennes, qui s’organisent très vite, le déploiement des Nations unies est lent, contraint notamment par les modalités de passation de contrats. Nous nous efforçons de raccourcir ces délais. Le contentieux du Camp des étoiles, qui porte sur le stockage et le stationnement, est donc lié à des méthodes de planification différentes.
M. Georges Tron, Président. Nous vous remercions.
Audition du 29 avril 2009
À 17 heures 15 : Commissaire général Pierre-Yves Durbise, directeur général de l’économat des armées.
Présidence de M. Georges Tron
M. Georges Tron, Président. Nous avons le plaisir d’accueillir le commissaire général Pierre-Yves Durbise, directeur général de l’économat des armées.
Nos deux rapporteurs, Mme Françoise Olivier-Coupeau et M. Louis Giscard d'Estaing, ont souhaité vous entendre, monsieur le commissaire général, sur la réforme de l’établissement que vous dirigez et sur sa contribution éventuelle à la maîtrise des coûts des opérations extérieures.
Deux membres de la Cour des comptes, M. Benoît d’Aboville et Mme Monique Saliou, nous accompagnent dans nos travaux.
M. le commissaire général Pierre-Yves Durbise, directeur général de l’économat des armées. Après avoir fait carrière dans le corps des commissaires de l’air pendant une trentaine d’années, j’ai été placé en détachement auprès de l’économat des armées (EdA), dont je suis le directeur général depuis le 1er janvier 2007.
Initialement créé sous le nom d’« économat de l’armée » en 1959, l’EdA est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est de contribuer au soutien des forces sur le territoire national, mais aussi à l’étranger dans le cadre des opérations extérieures.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. J’aimerais tout d’abord savoir quelle est la part du soutien aux Opex dans votre chiffre d’affaires, et quels types de biens et de services vous délivrez.
M. Pierre-Yves Durbise. Au cours des trois dernières années, les activités réalisées au titre des Opex ont représenté 50 % de notre chiffre d’affaires, dont le total s’élève à 313,8 millions d’euros. Toutefois, si l’on met de côté le soutien exceptionnel de 54 millions d’euros apporté à l’opération EUFOR au Tchad et en république Centrafricaine, le soutien aux forces en Opex ne constitue plus que 36 % de notre chiffre d’affaires.
À côté des opérations d’approvisionnement, qui sont le cœur historique de notre mission, nous sommes de plus en plus sollicités pour des marchés de transport et pour la gestion des camps militaires à l’extérieur du territoire, dans le cadre du processus d’externalisation lancé par le ministère de la Défense.
Les marchés de transport concernent essentiellement l’acheminement des biens. Mais ce type de prestations implique également de réaliser des opérations de douane et d’autres opérations administratives connexes, d’assurer le suivi des flux et, dans certains cas, de prendre en charge l’allocation des moyens.
De façon générale, la gestion des camps militaires consiste à apporter un soutien à la vie courante : nous sommes notamment chargés de gérer le personnel civil recruté localement, de coordonner les prestataires extérieurs, de réaliser les opérations de facturation, d’assurer leur suivi financier, mais aussi de gérer la restauration collective. À ce titre, nous nous occupons des approvisionnements, de la gestion des restaurants et de la sécurité sanitaire. D’autres prestations concernent plus directement la condition du personnel en opération, notamment l’accès à Internet et à la téléphonie, le fonctionnement des salles de sport, l’hébergement, l’entretien des locaux et des infrastructures, la fourniture de l’eau, la protection de l’environnement, la mise à disposition de libres services, ou encore l’organisation de la restauration de loisir quand les conditions s’y prêtent.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Votre établissement agit en tant que centrale d’achat. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet ?
M. Pierre-Yves Durbise. En tant qu’établissement public industriel et commercial, nous étions déjà un pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics. Depuis une réforme intervenue en 2004, nous avons également le statut de centrale d’achat.
Nous partageons avec l’UGAP, l’Union des groupements d’achats publics, l’exclusivité de cette qualification juridique dans la sphère publique, mais l’UGAP a une vocation interministérielle, alors que nos clients sont tous rattachés au ministère de la Défense.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions sur votre implantation géographique, ainsi que sur l’organisation de vos services ?
M. Pierre-Yves Durbise. Notre direction générale, qui compte environ 160 personnes, est localisée à Pantin.
Je suis épaulé dans mes fonctions par un directeur général adjoint, lui-même commissaire général de la marine nationale et un secrétaire général, commissaire colonel de l’armée de terre. Comme je suis moi-même commissaire général de division aérienne, les trois armées, qui sont nos principaux clients avec la gendarmerie, sont donc actuellement représentées à la tête de l’économat. Cela favorise un mariage des cultures qui me semble d’autant plus utile que l’EdA est un établissement interarmées.
Notre management se compose également d’une division pilotage et contrôle de gestion, ainsi que d’un vétérinaire biologiste, mis à la disposition par le service de santé des armées. Il a naturellement la haute main sur toutes les questions de traçabilité des denrées et de sécurité alimentaire.
Le reste des services se divise en deux branches. La première est formée de plusieurs directions : des achats, des opérations, commerciale, financière et comptable – nous avons d’ailleurs la chance d’avoir un agent comptable résident –, des systèmes d’information, des ressources humaines, et une division infrastructures et moyens généraux.
La deuxième branche de l’économat est constituée d’implantations extérieures. Nous avons tout d’abord deux « comptoirs », l’un en Guyane, en voie d’extinction, l’autre en Allemagne, où l’une de nos succursales devrait bientôt fermer ses portes compte tenu du nouveau schéma d’implantation des formations lié à la révision générale des politiques publiques.
Les autres implantations extérieures sont des missions locales, présentes au plus près des forces françaises participant aux Opex, en Afghanistan, au Kosovo ou encore au Tchad, où nous intervenons en soutien de trois opérations imbriquées : le dispositif « Epervier », l’EUFOR Tchad/Centrafrique et la MINURCAT. Il y a également une mission en phase de décroissance en Côte d’Ivoire, ainsi qu’un bureau de représentation aux Émirats arabes unis, où une base navale française sera prochainement inaugurée par le Président de la République. Notre établissement a en effet été choisi par l’état-major des armées pour apporter son concours au déploiement de l’implantation militaire française dans ce pays.
Au total, nos effectifs s’élèvent à 1 170 personnes, dont 800 font l’objet d’un recrutement local, essentiellement en Afghanistan, au Kosovo et au Tchad. Le reste est composé de personnels d’encadrement (145 personnes), de personnels affectés à la direction générale (160) et de personnels en poste dans les comptoirs (45 en Allemagne et 15 en Guyane).
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Lorsque vous apportez votre soutien à des Opex, intervenez-vous également pour le compte d’armées étrangères ?
M. Pierre-Yves Durbise. Sauf exception, nous ne sommes en prise directe qu’avec les formations militaires françaises. C’est à elles que nous présentons nos factures. Il leur revient ensuite de conclure des accords techniques bilatéraux en vue de refacturer certains coûts, mais cela ne relève pas de notre compétence.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Vous arrive-t-il d’être mis en concurrence avec des opérateurs privés ?
M. Pierre-Yves Durbise. Nous pourrions l’être, car nous sommes le seul établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Défense qui ne reçoit aucune subvention de l’État. D’autre part, nous payons les mêmes impôts et les mêmes taxes que les opérateurs appartenant au secteur privé.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Payez-vous également un loyer pour votre implantation à Pantin ?
M. Pierre-Yves Durbise. Si nous n’en payons pas, c’est parce que nous sommes propriétaires des locaux.
En revanche, nous payons des impôts fonciers, ainsi que la taxe professionnelle, l’impôt sur les bénéfices et toutes les impositions relatives aux activités commerciales. D’un point de vue juridique et technique, nous pouvons donc être mis en concurrence. Toutefois, ce n’est pas le cas, puisque nos activités entrent dans le cadre des prestations dites « intégrées » au sens de l’article 3 du code des marchés publics et de la jurisprudence communautaire.
Bien que notre établissement jouisse d’une personnalité morale distincte de celle de l’État, il est en effet considéré comme un prolongement de ce dernier : dans 90 % des cas, nos clients relèvent du ministère de la Défense, lequel règle la quasi-totalité de nos factures et fournit ainsi l’essentiel de nos recettes ; le ministère dirige également l’établissement par l’intermédiaire du conseil d’administration, qui est présidé par M. Gérard Gibot, directeur adjoint du secrétaire général pour l’administration du ministère, et composé de représentants de nos principaux clients, à savoir les états-majors des armées, la direction générale de la Gendarmerie et la direction centrale du Service de santé des armées ; nous sommes également soumis au contrôle de la Cour des comptes et nous dépendons du contrôle économique et financier de l’État.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Dans ces conditions, quel est l’intérêt de faire appel à un établissement public tel que le vôtre ?
M. Pierre-Yves Durbise. Si le ministère a créé l’EdA, c’était d’abord pour contribuer au soutien des forces à l’extérieur du territoire métropolitain, car les services fonctionnant en régie directe, notamment ceux des commissariats aux armées, ne disposaient pas des savoir-faire et des structures nécessaires pour ce type d’activités.
La réforme engagée en 2002 a ensuite étendu notre champ d’intervention au territoire métropolitain, où nous effectuons désormais des opérations de ravitaillement en denrées alimentaires, lesquelles représentent 40 % de notre chiffre d’affaires.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. D’un point de vue financier, ne serait-il pas plus intéressant pour l’État d’assurer directement les prestations qui vous sont actuellement confiées ? Comme vous venez de l’expliquer, vous acquittez des impôts et des taxes.
M. Pierre-Yves Durbise. Il m’est difficile de me prononcer sur cette question, car je ne suis pas donneur d’ordres mais seulement exécutant.
Ce que je peux vous dire, en revanche, c’est qu’il est très difficile d’évaluer des activités exercées en régie, car il y a beaucoup de coûts masqués. En faisant appel à un établissement public tel que l’EdA, qui est soumis à une comptabilité de type commercial, on peut au contraire connaître les coûts complets.
Le fait que nous soyons un établissement interarmées a également permis au ministère de rationaliser et de regrouper des interventions jusque-là réparties entre l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale et la gendarmerie. D’importantes économies d’échelle en ont résulté, notamment dans le cadre du dispositif « Vivres Métropole ».
En matière de restauration, par exemple, il n’y avait autrefois aucune donnée agrégée au plan national. Pour se faire une idée des coûts, il fallait s’adresser aux différentes structures de restauration collective, les unes après les autres. Grâce à notre système d’approvisionnement, qui est comparable à celui qu’utilisent les grandes entreprises du secteur privé, nous sommes maintenant en mesure d’indiquer avec précision le coût et la consommation des produits ainsi que le coût des services logistiques, lesquels ont été externalisés auprès d’un consortium, le groupement d’intérêt économique STEF-TFE/GEODIS.
Cette meilleure connaissance des coûts et des consommations nous a permis de réduire les fourchettes de nos appels d’offre, désormais comprises entre 1 et 1,5 contre 1 à 4 auparavant. Nos fournisseurs sont donc moins exposés à des risques de variation de leur activité, ce qui nous vaut des prix plus avantageux. En outre, nos partenaires préfèrent travailler avec un seul interlocuteur, l’EdA, au lieu d’intervenir dans le cadre d’une multitude de marchés non coordonnés.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Payez-vous des impôts sur les activités que vous réalisez à l’étranger ?
M. Pierre-Yves Durbise. Nous ne payons pas d’impôt à l’étranger, mais en France (impôt sur les sociétés) sur la totalité de nos activités en France et à l’étranger.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. L’EdA est-il également assujetti à la TVA ?
M. Pierre-Yves Durbise. C’est le cas pour nos activités en France, mais nous sommes exemptés de taxes à l’export.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. En matière d’externalisation, quel bilan établissez-vous, théâtre par théâtre, de l’expérimentation CAPES France (capacité additionnelle par l’externalisation du soutien aux forces françaises) ?
M. Pierre-Yves Durbise. Dans le contexte de la réduction du format des armées, les autorités de commandement se sont aperçues qu’il était très coûteux de conserver des capacités d’action simplement « au cas où ». Comme d’autres pays, la France s’est donc engagée, depuis 2007, dans une démarche expérimentale qui consiste à s’appuyer, pour le renforcement de ses capacités, sur des partenaires extérieurs, en l’occurrence l’EdA.
Pour notre part, nous n’intervenons pas dès le début des opérations extérieures. Ce n’est pas notre vocation, puisque nous employons du personnel civil. Dans un premier temps, les forces françaises doivent donc compter sur leurs propres moyens, puis nous prenons le relais une fois que la situation locale est stabilisée.
En application d’une convention générale conclue avec l’état-major des armées et les états-majors d’armées, nous recevons des ordres d’intervention précis pour chaque théâtre d’opération. Dans l’hypothèse où nous ne réaliserions pas nous-mêmes les prestations, il nous revient ensuite de faire jouer la concurrence ; en revanche, il n’y a pas lieu de lancer un appel d’offres avant de nous solliciter, car nous sommes une centrale d’achat.
Pour ce qui est du bilan, on constate des différences notables selon les théâtres d’intervention. Au Kosovo, par exemple, la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à l’armée de terre, que nous connaissons très bien pour avoir travaillé en symbiose avec elle depuis longtemps. D’autre part, nous étions déjà implantés sur place quand l’expérimentation CAPES France a été engagée, si bien qu’il nous a suffi d’élargir notre périmètre d’intervention. Nous n’avons donc pas rencontré de difficultés particulières et nos prestations sont très bien notées par l’armée de terre – je rappelle qu’une partie de notre rémunération dépend en effet de nos performances.
Au Tchad, en revanche, nous n’avions pas de relations préalables avec l’armée de l’air, hormis dans le cadre de l’approvisionnement en vivres sur le territoire métropolitain. En outre, il a fallu créer de toutes pièces une nouvelle mission, ce qui n’est pas allé sans quelques difficultés, l’armée de l’air étant assez réticente car elle avait l’impression que nous venions prendre sa place. Ensuite, quand la situation a commencé à s’améliorer, les événements survenus en février 2008 ont perturbé notre intervention, même si nos personnels n’ont pas exercé leur droit de retrait. En ce sens, nous avons réussi un test « grandeur nature ». Puis, il a fallu que nous nous adaptions au déploiement de l’opération EUFOR Tchad/RCA, qui est venue se greffer sur le dispositif initial.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Lorsque les administrations font appel à des réservistes pour participer à des opérations extérieures, ils reçoivent un grade d’affectation et sont soumis à un statut militaire. Est-il exact que ce n’est pas le cas des personnels employés par l’EdA ?
M. Pierre-Yves Durbise. En effet. Toutefois, sans être des militaires ou des réservistes, nos personnels bénéficient d’une couverture comparable. Ils ont en effet le statut de personnels civils placés « à la suite des forces ».
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Si je comprends bien, ils bénéficient de contrats de travail de droit privé ?
M. Pierre-Yves Durbise. Oui, ce sont d’ailleurs des contrats à durée déterminée, car les opérations extérieures évoluent souvent de façon très imprévisible.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. La fourniture d’énergie, notamment de groupes électrogènes, fait-elle partie de vos compétences ?
M. Pierre-Yves Durbise. Tout dépend des situations locales. Nous n’assurons pas ce type de prestations au Tchad, car l’armée de l’air a souhaité conserver intégralement ses compétences dans le domaine de l’énergie. Au Kosovo, il nous a été demandé d’externaliser l’activité entretien des groupes électrogènes, à titre expérimental mais notre appel d’offres a été infructueux : la seule proposition n’était pas compatible avec les contraintes budgétaires fixées par l’état-major. Cette activité reste pour le moment exercée en régie directe.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Coopérez-vous avec le service des essences des armées ?
M. Pierre-Yves Durbise. Ce service est implanté dans les camps militaires où nous intervenons, mais nous ne sommes pas en contact direct avec lui. D’autre part, les pompes à essence ne dépendent en aucun cas de nous.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. En septembre dernier, j’ai constaté qu’Internet ne fonctionnait pas dans le camp international de Warehouse, en Afghanistan, pays où nous retournerons d’ailleurs la semaine prochaine. Où en est la situation ?
M. Pierre-Yves Durbise. EADS, qui est notre prestataire sur place, rencontre effectivement des problèmes pour différentes raisons : il y a des interférences, mais aussi des difficultés avec le logiciel de facturation employé pour les cartes prépayées. Ce logiciel ayant été changé la semaine dernière, la situation devrait s’améliorer. Au demeurant, l’accès à Internet n’était pas totalement impossible, même s’il n’était pas toujours satisfaisant. Il va de soi que nous consentons systématiquement des gestes commerciaux en faveur des clients concernés par les difficultés d’accès.
D’autre part, l’état-major des armées a décidé de lancer un programme de subventions en la matière, considérant que le budget de la défense pouvait prendre en charge une partie des dépenses au titre de l’amélioration de la condition militaire. Il reste à voir de quelle façon cette décision se traduira concrètement. Nous réfléchissons à un dispositif qui permettrait d’accéder gratuitement à Internet, pendant une durée déterminée, sans recours aux cartes prépayées.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Il y a des inégalités flagrantes : certains personnels ont gratuitement accès à Internet en permanence et d’autres pas. La question se complique également du fait de la présence de forces étrangères au camp de Warehouse. Comment comptez-vous vous y prendre techniquement ?
M. Pierre-Yves Durbise. C’est une question qu’il faudra étudier avec notre prestataire de services. Pour le moment, il me semble que le maintien d’un système de cartes prépayées n’est pas incompatible avec l’instauration d’un dispositif permettant un accès gratuit à Internet pendant une durée limitée. En effet, le commandement a l’intention de financer dans une certaines limite des cartes prépayées qui seraient ainsi accordées mensuellement au personnel militaire présent sur chaque site.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. La condition militaire dépend de petits détails, qui ne coûtent pas forcément très cher, mais qui ont un grand impact psychologique. Je pense aussi à la question des colis, gratuits pour les soldats américains et payants pour les soldats français.
M. Pierre-Yves Durbise. En tant que prestataires de service, nous ne demandons pas mieux que l’instauration d’une telle gratuité, qui faciliterait également notre gestion.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. De façon plus générale, quel bilan faites-vous du fonctionnement du camp de Warehouse ?
M. Pierre-Yves Durbise. De nombreuses adaptations, parfois délicates, ont été nécessaires dans un premier temps. Il a notamment fallu plusieurs mois, en 2006, pour nous entendre sur la répartition des coûts. En matière de restauration par exemple, les frais fixes font désormais l’objet d’une forfaitisation, les dépenses variables d’un coût homme/jour. Il me semble que nous ne nous heurtons plus aujourd’hui à des problèmes particuliers.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Le projet de loi de programmation militaire prévoit que les partenariats public-privé seront également privilégiés en matière d’achats. Qu’en pensez-vous ?
M. Pierre-Yves Durbise. Ces partenariats sont des opérations complexes, s’inscrivant dans de très longues durées. Ils peuvent donc se justifier pour des opérations d’investissement mais pas pour des prestations de services, en particulier dans des théâtres d’intervention extérieure. Compte tenu des risques économiques, il me semble impossible de trouver des prestataires de services qui accepteraient de s’engager dans ces opérations, sur de longues années et à des conditions économiques qui seraient pertinentes pour les deux parties.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. En Afghanistan, l’OTAN a pourtant négocié avec Thalès un contrat pour la fourniture d’un système de communications. Ne peut-on pas envisager que l’EdA assure ce type de prestations ?
M. Pierre-Yves Durbise. Ce n’est pas notre cœur de métier. Nous sommes spécialisés dans la restauration collective, l’entretien des infrastructures et la gestion des camps militaires. Nous ne pouvons pas prendre en charge des investissements dans des infrastructures aussi lourdes.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Il reste que la plupart des camps militaires utilisent de plus en plus des infrastructures « semi-lourdes », telles que les Algeco. Cela contribue-t-il à changer la situation ?
M. Pierre-Yves Durbise. Nous pouvons tout à fait servir d’intermédiaire pour l’installation des Algeco, mais cela ne saurait être considéré, à mon sens, comme un investissement dans une infrastructure lourde.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Qu’en est-il en matière de sécurité, Par exemple pour l’installation des caméras et des détecteurs ?
M. Pierre-Yves Durbise. Ces dispositifs très spécifiques font souvent partie de systèmes intégrés. Or l’EdA n’a ni les compétences nécessaires pour concevoir de tels dispositifs ni la vocation d’assurer la sécurité des forces armées en Opex.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Dans ce cas, pourquoi ne pas créer un département spécialisé ? Les questions de sécurité ne sont-elles pas liées à la gestion des camps militaires que vous assurez ?
M. Pierre-Yves Durbise. Ce ne serait envisageable que si le ministère souhaitait externaliser ce type d’opérations. À défaut, il y aurait une redondance qui ne me semble pas souhaitable.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Pouvez-vous nous expliquer le mode de facturation de vos prestations ? J’aimerais également en savoir plus sur vos délais de paiement : la loi de modernisation de l’économie a-t-elle eu un impact dans ce domaine ? Enfin, existe-t-il un accord d’intéressement ou un plan de participation dans votre établissement ?
M. Pierre-Yves Durbise. Nous avons effectivement un plan d’intéressement pour la période 2007-2010. Il s’applique, dans la limite de 4 % de la masse salariale, si notre excédent brut d’exploitation est positif, et si nous avons respecté les objectifs budgétaires fixés par le conseil d’administration.
S’agissant des modes de facturation, nous avons recours à trois systèmes différents selon les types de prestations considérés. Pour un montant représentant 75 % de notre chiffre d’affaires, nous utilisons une facturation de nature commerciale, en particulier pour les activités réalisées dans le cadre du dispositif « Vivres Métropole », pour les approvisionnements, pour les activités de libre-service, pour les marchés de transport, hors CAPES France, et pour les activités des comptoirs. Près de 22 % du chiffre d’affaires sont concernés par le système dit costs and fees, qui consiste à facturer toutes les charges, internes comme externes et à percevoir une rémunération assise sur un pourcentage, fixe ou variable, du chiffre d’affaires. Il existe enfin un système de facturation forfaitaire, qui est notamment appliqué aux activités de restauration dans la base de Warehouse.
La combinaison de ces modes de facturation conduit parfois à des solutions assez complexes. Dans le cadre de l’opération EUFOR Tchad/RCA, nous utilisons ainsi une facturation de type commercial pour les coûts communs – infrastructures, dépenses de protection ou encore location de véhicule – et une facturation à l’euro/l’euro pour le reste, les coûts d’intervention de l’EdA étant pris en charge par la France.
On se plaint parfois que l’EdA présente ses factures avec un peu de retard, mais vous imaginez sans difficulté la complexité du système comptable. Dans le cadre de la facturation de type costs and fees, il faut présenter toutes les pièces justificatives de dépenses. Par exemple, en 2008, nous avons délivré près de 2 000 factures récapitulatives au titre de l’opération CAPES France soit 40 000 pièces justificatives de dépenses au total.
On nous a également reproché un défaut de contrôle interne sur des montants estimés à environ deux millions d’euros en 2008. Or, cela représente à peine 0,6 % de notre chiffre d’affaires, ce qui est loin d’être catastrophique. D’autre part, nos difficultés sont essentiellement liées à la croissance rapide de notre activité, qui est passée de 162 à 313 millions d’euros en deux ans. Comme toutes les PME, nous nous heurtons à des obstacles dans le domaine des systèmes d’information. Nous avons prévu une mise à niveau, mais elle va prendre quelque temps.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. En sens inverse, les délais de paiement de vos clients sont-ils raisonnables ? Y a-t-il des restes à payer en fin d’exercice ?
M. Pierre-Yves Durbise. Il n’y en a pas, sauf dans l’hypothèse où les factures n’auraient pas été présentées à temps, essentiellement quand les dépenses sont engagées à la fin de l’exercice.
M. Louis Giscard d'Estaing, Rapporteur. Avez-vous des besoins en fonds de roulement ?
M. Pierre-Yves Durbise. Nous n’avons pas beaucoup de marges de manœuvre, mais nous n’avons jamais été obligés de faire appel à des lignes de crédit pour payer nos fournisseurs depuis que je suis à la tête de l’EdA.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Il nous reste à vous remercier d’avoir répondu avec précision à toutes nos questions.
Audition du 30 avril 2009
À 8 heures 30 : Audition du général d’armée aérienne Stéphane Abrial, chef d’état-major de l’armée de l’air
Présidence de M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Monsieur le chef d’état-major, mesdames, messieurs, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de la mission d’évaluation et de contrôle, la MEC, pour cette matinée d’auditions consacrées aux opérations militaires extérieures (Opex), notamment sous mandat international.
Le Président Georges Tron, retenu par d’autres activités au sein de l’Assemblée, m’a demandé de le suppléer dans l’attente de son arrivée. Il vous prie d’excuser son retard.
La MEC travaille dans un esprit non partisan. Ses deux rapporteurs, Mme Françoise Olivier-Coupeau et moi-même, sommes issus, l’un de la commission de la Défense, l’autre de la commission des Finances, et représentons des sensibilités politiques différentes.
Notre démarche procède de la constatation d’une croissance tendancielle de la dépense consacrée aux Opex. Afin d’en analyser les mécanismes, nous avons déjà procédé à plusieurs auditions et nous nous sommes rendus au Kosovo et au Tchad, avant d’aller, en début de semaine prochaine, en Afghanistan.
En outre, nous bénéficions de l’expertise précieuse de la Cour des comptes : je salue la présence aujourd’hui de M. Alain Hespel, président de la deuxième chambre, de Mme Françoise Saliou, présidente de section à la deuxième chambre, et de M. Benoît d'Aboville, conseiller-maître en service extraordinaire.
Cette matinée sera consacrée à recueillir le point de vue des différentes armées. Nous commençons par l’armée de l’air, avec son chef d’état-major, le général Stéphane Abrial.
Je vous propose, monsieur le chef d’état-major, de nous indiquer à titre liminaire comment se présente pour vous la question des Opex et quel est votre rôle en la matière, après quoi nous vous poserons une série de questions.
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial, chef d’état-major de l’armée de l’air. La budgétisation des Opex a débuté avec la loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2008, la responsabilité du BOP Opex relevant du chef d’état-major des armées. Le budget de l’armée de l’air ne supporte qu’occasionnellement des surcoûts liés aux Opex, pour le titre 3 : il s’agit de dépenses de carburant opérationnel et d’entretien programmé du personnel et du matériel.
Quelque 3 500 aviateurs se trouvent en permanence hors de métropole : un tiers au titre des forces de souveraineté ; un tiers au titre des forces de présence, dans les pays avec lesquels nous avons des accords particuliers ; et un tiers au titre des opérations extérieures stricto sensu.
Mon rôle est de préparer les forces ; dès lors qu’elles sont engagées, elles relèvent de l’autorité directe du chef d’état-major des armées.
Sur la trentaine d’opérations en cours impliquant les armées françaises, l’armée de l’air contribue à quinze. L’effectif, d’environ 1 300 personnes, est concentré sur deux théâtres principaux, l’Afghanistan et le Tchad, qui mobilisent quelque 550 personnes chacun, soit plus de 85 % du total. La moitié de nos engagements sont de très faible volume, d’une à dix personnes.
La grande majorité des opérations auxquelles nous participons ont un caractère multinational, ce qui nous apporte de la souplesse et nous permet de nous insérer dans des dispositifs beaucoup plus vastes. C’est un gage d’efficacité opérationnelle et une source de réduction de coûts.
La caractéristique de l’armée de l’air française est d’être une force compacte, extrêmement réactive, capable de projeter dans de brefs délais des moyens cohérents, de manière à pouvoir remplir toute mission qui lui serait confiée. Dans les contrats opérationnels, la capacité de projection, qu’il s’agisse de projection de force ou de projection de puissance, est l’élément dimensionnant à partir duquel nous bâtissons notre modèle, à la fois en termes de personnel, d’entraînement, d’équipement et de délai de réaction.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Quelles sont les spécialités le plus souvent projetées ? Les Opex créent-elles des tensions ? Certaines spécialités sont-elles déficitaires ? Si oui, quelles mesures sont prises pour y remédier ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Les deux centres de gravité actuels de nos opérations sont situés au Tchad et en Afghanistan. Il s’agit de deux types de déploiement diamétralement opposés.
En Afghanistan, nous nous trouvons majoritairement sur des implantations partagées avec d’autres membres de la coalition, et nous nous concentrons sur les spécialités opérationnelles, de préférence à celles de soutien. Par exemple, à Kandahar, les spécialités opérationnelles représentent plus de 70 % de la totalité du détachement français, qui s’insère dans une base multinationale gigantesque, où les tâches de soutien et de support sont partagées entre les différents membres de la coalition.
Au Tchad, au contraire, nous sommes responsables de la base aérienne de N’Djamena, et du soutien pour l’ensemble des forces sur place : nous y comptons logiquement beaucoup de personnel de soutien.
En fonction du type d’opération, nous déployons donc un éventail très différent de spécialités. Dans la majorité des cas toutefois, les deux piliers sont constitués, d’une part, par le personnel navigant et les spécialistes de la maintenance aéronautique, d’autre part, par les commandos au sol : intégrés aux forces terrestres, ces « contrôleurs avancés » sont chargés de faire la liaison entre les forces de surface et les forces aériennes, de manière à ce qu’un appui aérien puisse être apporté aux forces terrestres en cas de besoin.
Les spécialités du commandement et du contrôle sont également très importantes, afin que la volonté de la France soit entendue à tous les niveaux responsables de la direction d’une opération.
De même, nous avons besoin de responsables des systèmes d’information et de communication : aujourd’hui, les transmissions sont un secteur clef de toutes les opérations militaires, et pas seulement aériennes. Plus on est loin du territoire national, plus on en a besoin.
Nous observons également la montée en puissance des spécialistes des drones. À Bagram, en Afghanistan, nous avons déployé au début de l’année des drones de moyenne altitude et de longue endurance (MALE), utilisés pour la surveillance des théâtres d’opérations. Malheureusement, les retards industriels nous ont fait perdre cinq années par rapport à nos homologues européens ou américains. Il s’agit, je le pense, d’une spécialité qui est appelée à prendre de l’importance, dans la mesure où le concept de « permanence de la surveillance » s’est imposé dans le domaine aérien.
Citons également les spécialistes de guerre électronique, qui doivent en permanence mettre à jour les systèmes, ainsi que les juristes, conseillers légaux et commissaires, qui nous accompagnent dans les situations de conflits asymétriques et les opérations de maintien de la paix. Enfin, lorsque nous sommes responsables de la plate-forme, s’y ajoute le personnel de contrôle aérien.
Les opérations extérieures génèrent-elles des tensions au sein de l’armée de l’air ? Non, car le volume des forces en opérations extérieures n’est pas très important : seulement 1 300 personnes sur un total de 65 000 environ. Certes, il y a une rotation : les personnels ne passent pas une année entière sur le théâtre d’opérations, mais assurent une présence de deux à dix mois, suivant leur spécialité. Ceux qui exercent loin du corps opérationnel ou sont immergés dans les forces de l’armée de terre restent le plus longtemps, de quatre à six mois. Les équipages et le personnel de maintenance restent le moins longtemps : deux mois ; d’une part, cela leur permet d’effectuer régulièrement leur entraînement normal et de ne pas perdre leurs qualifications dans les domaines qu’ils n’ont pas à exercer en opération ; d’autre part, on vole énormément en opération, ce qui signifie qu’en quatre ou cinq mois, ils auraient consommé la totalité de leur contingent annuel d’heures de vol, voire davantage, et n’auraient plus la possibilité de voler à leur retour en métropole – ce qui est incompatible avec notre mode de fonctionnement.
Les tensions proviennent plutôt du fait que nos personnels doivent assurer un nombre très important d’activités, entre les opérations à l’extérieur, les opérations en métropole et l’entraînement. Nous essayons en effet de leur donner un entraînement de qualité, afin de les préparer à toute demande provenant des coalitions d’aujourd’hui ou de demain. Leur emploi du temps sur l’année est donc extrêmement lourd, et compte de nombreux jours d’absence. Mais, en général, nous n’éprouvons pas de difficultés à armer les forces déployées.
Je vous citerais deux exemples de spécialités déficitaires : les pompiers et les forces de protection.
Nous avons besoin, sur chaque base aérienne, de pompiers et de personnels chargés du sauvetage et de la sécurité incendie. Si nous ne rencontrons pas de problème de recrutement, nous avons du mal à les retenir car une fois qu’ils sont qualifiés, le secteur civil entreprend de les récupérer. Or dans leur statut figure pour nous l’obligation, dès qu’ils ont les qualifications adéquates, de leur permettre de partir quasiment sur l’instant si un poste les attend à l’extérieur.
En ce qui concerne les forces de protection, je dois reconnaître que passer des heures devant les grilles des bases aériennes à vérifier qu’il n’y a pas d’intrusion n’est pas une activité très attractive. Or les besoins en personnel sont importants, car les bases, qui sont encore trente-sept en métropole, sont très étendues et abritent des équipements extrêmement sensibles. Il me faut donc un réservoir de personnel, à partir duquel je sélectionne ensuite les commandos – pour lesquels ne se pose aucune difficulté de recrutement.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Je crois savoir que les pilotes d’hélicoptères sont eux aussi très convoités par le privé ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Oui, mais nous maîtrisons mieux les flux. Pour l’instant, il n’y a pas de déficit de personnel dans ce secteur.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Notre ambition est d’identifier et d’évaluer les coûts spécifiques des Opex ; suivant les cas, il s’agit de coûts ou de surcoûts.
Quelles sont les dépenses supportées par l’armée de l’air ? Sont-elles directement imputées sur le BOP Opex ou le BOP Air en prend-il en charge une partie ? Dans cette hypothèse, dans quelles proportions et suivant quels circuits sont-elles remboursées ?
Par ailleurs, vous avez dit que l’armée de l’air pouvait assumer le rôle d’armée pilote du soutien, par exemple au Tchad. Quelles sont les conséquences de cette position ? Les textes réglementaires ont-ils été pris ?
Enfin, en dehors de l’indemnité de sujétions pour services à l’étranger (ISSE), les différentes catégories de personnels de l’armée de l’air perçoivent-elles des primes particulières lorsqu’elles servent en Opex ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Pour toutes les opérations extérieures, nous essayons de faire le relevé des coûts et des surcoûts. Il n’est pas toujours facile de les distinguer et, surtout, d’évaluer le volume de surcoûts à imputer.
Pour l’armée de l’air, les surcoûts, ce sont typiquement les soldes spécifiques, c’est-à-dire l’ISSE – il n’existe pas d’autre prime particulière. S’y ajoutent le différentiel de prix pour les carburants opérationnels, parfois élevé, celui lié au maintien en condition opérationnelle, ainsi que les dépenses afférant à l’entretien permanent du personnel, aux consommations ou aux tenues spécifiques. Pour le maintien en condition opérationnelle, par exemple, nous estimons le surcoût à environ 10 %, mais il est extrêmement difficile d’évaluer avec précision la différence de coût d’une heure de vol suivant qu’elle est effectuée au Tchad ou en France.
La précédente loi de programmation militaire a fixé des objectifs chiffrés à l’activité aérienne de chaque pilote, qu’il s’agisse de vols d’entraînement ou d’opérations militaires : les heures effectuées en Afghanistan ou au Tchad font donc partie de leur quota annuel d’heures. Nous essayons de quantifier les surcoûts induits par le fait que ces heures sont effectuées hors métropole. Il faut aussi inclure les munitions tirées, qui sont nombreuses en Afghanistan en ce moment.
Le BOP Opex prend en charge l’ISSE et tout ce qui relève du titre 2, le BOP Air supportant la solde normale du personnel et les dépenses du titre 3. Le BOP Air avance les sommes et se fait rembourser en fin d’année sur le BOP Opex, suivant la procédure du décret d’avance. Cela n’a aucun effet sur le titre 5.
Quant aux coûts, il s’agit principalement des dépenses liées à l’alimentation, au fonctionnement courant des sites et aux transferts de personnels jusqu’au théâtre d’opérations. En la matière, le BOP Air ne prend quasiment rien en charge ; il n’avance que les surcoûts.
S’agissant de l’armée pilote du soutien, mes adjoints, les colonels Patricia Costa et Michel Lene, vont vous répondre.
Mme le colonel Patricia Costa. À mon niveau, je ne rencontre pas de difficultés particulières. Les coûts que nous prenons en charge au Tchad nous sont remboursés a posteriori.
M. le colonel Michel Lene. Du point de vue opérationnel, la difficulté au Tchad était de suivre et contrôler le processus qui avait été lancé. Il s’agit d’un processus itératif, comprenant un pilotage permanent des ressources consenties à notre prestataire unique, l’économat des armées, dans le cadre de CAPES France (capacités additionnelles par l’externalisation du soutien des forces françaises).
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Au total, la part de l’armée de l’air recalculée dans le BOP Opex pour l’année 2008 s’élève à un peu moins de 68 millions d’euros, le BOP Air ayant avancé une somme légèrement inférieure à 47 millions d’euros. Pour 2009, nos estimations sont du même ordre de grandeur.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Ces données sont-elles disponibles théâtre par théâtre ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Nous sommes capables de décomposer les dépenses non seulement par théâtres, mais aussi par postes : rémunérations, alimentation, fonctionnement, carburant, etc.
Mme le colonel Patricia Costa. Nous communiquons chaque mois à l’état-major des armées, c’est-à-dire au responsable du BOP Opex, la situation des coûts et des surcoûts pour l’armée de l’air, avec la part imputée au BOP Opex et celle avancée par le BOP Air. Nous tenons une comptabilité très fine – un effort particulier sera d’ailleurs réalisé cette année en matière de carburant opérationnel.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Lorsque l’on est stationné dans un pays riche en pétrole, comme Abou Dhabi, le kérosène est-il acheté à un prix préférentiel ? Cette nouvelle base est-elle utilisée librement ou la France paie-t-elle un droit ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. La base aérienne Al-Dhafra d’Abou Dhabi est opérationnelle depuis le 1er septembre 2008. Trois Mirage 2000 de défense aérienne y sont déployés et soixante-six personnels de l’armée de l’air implantés en permanence. Il ne s’agit cependant pas d’une opération extérieure, mais d’une présence dans un pays auquel nous sommes liés par des accords particuliers.
Nous ne payons pas de redevance : nous sommes invités par les Émirats arabes unis, qui mettent en outre à notre disposition les infrastructures dont nous avons besoin, qu’elles soient déjà existantes, à aménager ou à construire.
Nous bénéficions d’un tarif préférentiel pour le carburant, qui nous est concédé au même prix qu’aux forces aériennes locales. Toutefois, l’économie, de l’ordre de 3 à 4 %, n’est pas très importante et ne compense pas le surcoût lié au fait d’opérer hors du territoire national.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. En ce qui concerne le transport, le retard de l’A 400 M va-t-il pénaliser l’armée de l’air ? Le recours à des avions de type Antonov est-il un palliatif acceptable du point de vue financier ? D’autres solutions sont-elles envisagées ?
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Dans l’attente de l’A 400 M, votre matériel vous semble-t-il adapté à vos missions ? Sur certains théâtres d’opérations, faudra-t-il faire appel à des aéronefs loués ou utilisés temporairement ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. S’agissant de l’aviation de transport, le retard de l’A 400 M constitue pour nous un problème majeur. L’industrie rencontre de toute évidence des difficultés qu’elle n’avait pas anticipées. Or l’armée de l’air a été configurée dans l’attente de ces A 400 M, qui est un programme à la fois raisonnable et ambitieux sur lequel les armées de l’air européennes travaillent depuis une quinzaine d’années. Cet appareil a l’avantage de pouvoir accomplir l’ensemble du spectre des missions tactiques et stratégiques, c’est-à-dire d’être capable à la fois de déposer des troupes dans une clairière au milieu d’une forêt la nuit, à basse altitude, dans les nuages, et de transporter à longue distance beaucoup de personnes et de matériels. La France en avait commandé cinquante exemplaires. Cela nous permettait de faire des économies, puisque, selon une autre hypothèse, il aurait fallu commander à la fois des C130, pour la partie tactique, et des C17, pour la partie haute du spectre tactique et surtout pour la partie stratégique, soit au total 62 appareils plus onéreux et construits à l’étranger.
Nous nous étions organisés dans la perspective que l’armée de l’air recevrait ses deux premiers appareils A 400 M au deuxième semestre 2009, avec ensuite une cadence de livraison de cinq appareils par an, ce qui permettait une transition assez rapide. Nous avions donc entamé la gestion de fin de vie de nos Transall, de manière à ne pas engager de dépenses inutiles pour en régénérer le potentiel.
Or, la première conséquence du retard de l’A 400 M, c’est précisément la nécessité de régénérer ce potentiel, avec un coût bien plus élevé que si nous l’avions anticipé. La flotte des Transall est ancienne : les premiers appareils ont commencé à voler il y a plus de quarante ans. Quoi que l’on fasse, leur nombre diminue d’année en année. Il pèse donc une très forte menace sur ma capacité à remplir le contrat de projection qui me lie au chef d’état-major des armées.
Le retard de l’A 400 M, évalué aujourd’hui à quatre ans, pose en définitive des problèmes de capacité à la fois dans le domaine tactique et dans le domaine stratégique, ainsi qu’un problème d’organisation des ressources humaines.
S’il est le moins visible, celui-ci est aussi le plus grave. Il faut un peu plus d’un an pour former un pilote capable de réaliser les missions de base. Pour un pilote expérimenté, capable d’être le commandant de bord et, au-delà, de commander un dispositif complexe, mettant en œuvre de nombreux appareils, la nuit, à très longue distance, huit années de formation sont nécessaires. La flotte d’appareils disponibles diminuant, il ne reste que deux possibilités : soit faire voler tout le monde moins souvent et diminuer le niveau d’entraînement des équipages, avec les risques que cela comporte, soit diminuer le volume d’équipages, ce que nous avons commencé à faire – le risque étant que, lorsque les A 400 M seront prêts, il n’y ait pas assez d’équipages disposant du niveau d’entraînement suffisant pour les utiliser.
On peut essayer de réduire le problème par la coopération. Je cherche donc d’autres armées de l’air dans le monde avec lesquelles il serait raisonnable de travailler, et dont la flotte serait suffisamment importante pour pouvoir absorber quelques équipages, ce qui permettrait d’entraîner nos personnels dans des conditions acceptables, moyennant finances, voire échanges d’heures de vol ou de services. Cela permettrait à la fois d’afficher une coopération avec certains pays et de trouver une solution de transition à moindre coût.
En parallèle, il faut anticiper l’évolution des différents segments de la flotte de projection. Nous possédons des Casa 235, cargos légers dont le rayon d’action et la charge ne sont pas très élevés, mais qui sont indispensables, tant pour les mouvements à l’intérieur d’un théâtre d’opérations que pour l’entraînement des équipages et les missions de routine, comme le transport de nos camarades de l’armée de terre pour l’entraînement parachutiste. Je souhaite que cette flotte soit redimensionnée, avec l’acquisition, en propriété ou en location, d’appareils supplémentaires, qui permettraient de mieux remplir les missions du bas du spectre, de soulager la flotte la flotte des Transall et des Hercules en leur confiant les missions à poids et distance relativement faibles, et d’accroître le nombre des appareils disponibles pour l’entraînement des équipages.
À l’autre extrémité du spectre, pour le transport stratégique pur, nous envisageons l’acquisition de deux à trois avions de type A 330, qui nous permettront d’emmener des personnels et des matériels à longue distance.
En ce qui concerne le transport tactique, comme je l’ai dit, la flotte de Transall, vieillissante, est en constante diminution. Malgré l’achat il y a quelques années d’un petit nombre d’avions Hercules, nos moyens sont insuffisants pour répondre à la demande. Une solution de transition serait d’acquérir, sous une forme à déterminer, les seuls équipements disponibles sur le marché, à savoir des C 130 et des C 17 américains. Le souci, c’est que cela engendrerait des microflottes, donc des difficultés logistiques et techniques, ainsi que des coûts importants. Si un Hercules possède entre la moitié et le tiers des capacités d’un A 400 M, son coût est proportionnellement beaucoup plus élevé, à l’achat comme à l’entretien. Le C 17, avion remarquable, coûte également très cher à l’achat et à l’entretien.
Quelle que soit la solution retenue, j’étudie donc les possibilités de coopération. Ainsi, pour les C 17, j’examine s’il serait envisageable de travailler avec les Britanniques, qui possèdent déjà ce type d’appareils, ou avec certains pays de l’OTAN, qui ont constitué une flotte de C 17 au sein d’une agence de l’OTAN. Toute initiative qui permettrait d’éviter la gestion d’une microflotte sera la bienvenue.
En parallèle, nous continuerons à affréter des avions civils. Dans le cadre du programme Salis, nous louons ainsi de très gros porteurs, en majorité ukrainiens, afin de transporter des équipements très lourds ou très volumineux, comme des batteries de missiles sol-air. Le contrat a d’ores et déjà été prolongé pour deux ans, mais nous aurons du mal à nous en passer tant que nous ne posséderons pas une flotte complète d’A 400 M. Toutefois, comme ces appareils ne peuvent pas se poser partout – puisqu’ils nécessitent une infrastructure aéroportuaire très lourde – et qu’ils ne sont pas protégés, nous ne pouvons pas les utiliser sur des plateformes où le niveau de menaces est élevé.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Ces coûts supplémentaires seront-ils imputés, d’une façon ou d’une autre, à l’industriel ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Cette décision est du ressort du chef d’état-major des armées. Les coûts supplémentaires consécutifs au retard de livraison ont été estimés, et différents scénarios de transition sont à l’étude.
La négociation avec l’industriel sera certainement difficile. Le gel du programme, qui a débuté le 1er avril, est précisément destiné à provoquer des discussions entre l’industriel et les États, à travers l’OCCAR. Quant à leurs suites, je les ignore. J’ai le sentiment que la plupart des acteurs souhaitent que le programme continue, principalement en Europe continentale. Nos voisins d’outre-Manche sont peut-être le maillon le plus fragile, dans la mesure où ils connaissent actuellement d’énormes problèmes budgétaires, que leur engagement en Irak et en Afghanistan est très important, et qu’ils privilégieront la solution la plus rapide ; s’ils se désolidarisaient, le programme serait vraiment en danger.
La presse faisait état hier d’énormes pénalités qu’EADS pourrait avoir à payer. Je considère de telles annonces comme des fuites destinées à préparer la négociation. D’aucuns s’offusquent de ce qu’un industriel nous mette dans une situation délicate et que la plupart des solutions de transition soient à son bénéfice, mais si nous exigions de lui le dédommagement prévu par contrat, il n’aurait plus qu’à mettre un terme au programme ! Cela étant, je ne suis pas négociateur.
Quoi qu’il en soit, de mon point de vue, ce retard entraînera nécessairement un surcoût pour le budget de la défense, non dans les quatre ou cinq prochaines années – les tranches du budget d’équipement ainsi libérées pouvant être utilisées pour mettre en œuvre des solutions de transition –, mais d’ici à une quinzaine d’années.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Cela aura-t-il des conséquences positives sur le plan de charge de l’Atelier industriel de l’aéronautique, notamment à Clermont-Ferrand ?
Par ailleurs, l’armée de l’air est présente sur des bases au Kirghizstan et au Tadjikistan. Pouvez-vous préciser quels sont les appareils et les personnels qui y sont stationnés, ainsi que les incidences financières de ces implantations ? Quelles conséquences aurait une éventuelle fermeture de la base au Kirghizstan ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. La régénération du potentiel d’avions Transall et l’augmentation de leur durée de vie accroissent en effet le plan de charge de l’Atelier industriel de l’aéronautique, y compris à Clermont-Ferrand. Nous envisageons la prolongation de vie d’une dizaine d’appareils, ce qui représente un nombre élevé d’heures de travail.
Nous sommes déployés en Asie centrale sur plusieurs sites : le ravitailleur est stationné à Manas, au Kirghizstan – un second vient parfois le renforcer durant l’été, période durant laquelle les opérations contre les talibans se multiplient ; la flotte de transport tactique et le hub de l’Asie centrale pour les forces françaises se trouvent à Douchanbé, au Tadjikistan ; et nous sommes également présents à Kandahar, avec notre aviation de combat, à Bagram, avec nos drones, à Kaboul, avec les hélicoptères. Nous comptons en outre du personnel dans toutes les structures de commandement. En dépit d’une impression d’éparpillement, ces implantations répondent à des impératifs techniques, opérationnels et financiers précis.
Manas a ainsi été choisi pour trois raisons. Premièrement, nous ne souhaitions pas être trop éloignés du théâtre d’opérations, sans nous trouver pour autant sur le théâtre lui-même, les ravitailleurs étant des gros-porteurs assez lents, du moins dans les phases de décollage et d’atterrissage, et donc vulnérables. Deuxièmement, il nous fallait un pays hôte susceptible de nous accueillir, et un environnement géographique permettant aux avions de décoller à pleine charge, pour une efficacité maximale. Enfin, Manas abrite déjà le détachement des ravitailleurs américains, soit douze appareils en permanence sur place. Cela nous permet de nous insérer dans la base existante et de bénéficier du soutien américain en matière de nourriture, de protection, de technique et de logistique : nous faisons appel à eux quand nous rencontrons un problème, ils nous fournissent les pièces nécessaires, et nous les remboursons a posteriori. Nous améliorons ainsi à la fois nos coûts et notre disponibilité. Revers de la médaille, nous ne pouvons déployer que trente-sept personnes, ce qui représente une empreinte au sol très faible.
Il plane en ce moment un risque sur notre présence à Manas, le gouvernement kirghiz ayant officiellement demandé aux autorités américaines et françaises de quitter la base sous six mois. Nous avons donc jusqu’au 1er octobre pour trouver une solution – sachant qu’en parallèle, les négociations vont bon train entre les gouvernements kirghiz et américain. Je ne suis donc pas totalement pessimiste.
Si nous devions partir, où irions-nous ? La difficulté est de trouver un autre bon compromis entre proximité du théâtre, efficacité de la mission et coûts réduits. Il existe deux options : soit rejoindre nos amis américains à l’endroit où ils se redéploieront, quel qu’il soit, pourvu qu’il s’agisse d’un stationnement acceptable pour la France ; soit positionner nos ravitailleurs à Abou Dhabi, avec les avions de combat, ce qui leur permettrait d’effectuer à la fois des missions opérationnelles en Afghanistan et des missions d’entraînement au profit des forces françaises et émiriennes de la base d’Al-Dhafra.
Aujourd’hui, les appareils implantés à Manas effectuent environ 80 % de leurs missions au profit de la coalition, le reste étant consacré à des missions franco-françaises. Nous payons 500 000 euros de taxe aéroportuaire, auxquels s’ajoutent 600 000 euros de frais de fonctionnement, soit un total de 1,1 million d’euros par an.
À Douchanbé se trouvent notre base arrière et notre point d’entrée et de sortie de l’Asie centrale. Y sont stationnés en permanence des Transall et, lorsque l’activité s’accroît, un Hercules complémentaire. Nous bénéficions d’un excellent accord avec le gouvernement tadjik : nous ne payons pas de redevance, mais nous leur fournissons une assistance dans le domaine des infrastructures, grâce au déploiement régulier d’éléments du 25e régiment du génie de l’air, qui est un régiment de l’armée de terre placé organiquement au sein de l’armée de l’air et spécialisé dans les infrastructures aéroportuaires. À titre de réciprocité, nous effectuons donc des travaux sur l’aéroport de Douchanbé, au bénéfice du gouvernement tadjik : réfection de parkings, des voies de roulement, de la piste, projet de réfection de la tour de contrôle.
Nous souhaitons conserver cette base car nous refusons de courir le risque qu’un gros-porteur soit atteint par des tirs sol-air en Afghanistan. Or les plateformes de Kandahar et de Kaboul ne sont pas sûres. Nos équipages, notre personnel et nos appareils stationnés à Kandahar subissent entre un et dix tirs de mortier ou de roquettes par semaine. Par chance, nous n’avons pas encore déploré de blessés, ni de dégâts importants, mais cela pourrait survenir à tout moment. Il y a quelques jours encore, une roquette est tombée au milieu du camp français à l’aéroport de Kaboul – dont l’usage tend de surcroît à être de plus en plus strictement civil. Je pense donc qu’il est préférable que des gros-porteurs non protégés ne stationnent pas en permanence en plein cœur du théâtre afghan. Nous continuerons donc à utiliser la base de Douchanbé comme relais à partir duquel les moyens sont déployés par avions tactiques.
Le trafic de la base de Douchanbé s’élevait en 2008 à 20 000 passagers et 2 500 tonnes de fret. Son budget de fonctionnement annuel est de 1,8 million d’euros. Nous estimons le montant global des travaux effectués depuis notre arrivée au bénéfice du gouvernement tadjik à environ 18 millions d’euros, ce qui est extrêmement raisonnable comparé à ce que doivent payer pour chaque décollage et atterrissage nos camarades allemands stationnés à Koundouz.
À Kandahar sont stationnés nos avions de combat : actuellement, trois Mirage 2000 et trois Rafale. Ces derniers seront remplacés à la mi-mai par des Mirage 2000, puis, à l’été, par des Mirage F1 de reconnaissance. Nos troupes représentent à peine 1 % du personnel déployé sur la base de Kandahar, base gigantesque de presque 18 000 personnes, située sous le feu ennemi, et d’où partent de nombreuses opérations. Nos troupes sont totalement imbriquées avec celles de la coalition, ce qui permet un partage des tâches de soutien et explique que plus de 70 % des forces françaises déployées soient des personnels opérationnels. Notre activité aérienne de combat y est de ce fait très importante et très visible.
Un tel déploiement au cœur du théâtre d’opérations procure d’importants avantages, dans la mesure où nos soldats y côtoient leurs camarades des armées des autres pays et voient tous les jours revenir des avions et des convois de mission, ce qui contribue à leur donner conscience de l’enjeu et du danger de leur mission. Cela nous permet également de gagner en réactivité.
Notre activité au sol croît chaque année, avec une augmentation saisonnière durant l’été. La perspective d’une solution au conflit paraît donc lointaine. La contribution française est très visible et très appréciée, dans la mesure où nous agissons au bénéfice de tous les membres de la coalition, quels qu’ils soient, ainsi que des forces afghanes. Nous avons réalisé un nombre important de vols – environ 5 500 heures au départ de Kandahar l’an dernier –, la plupart se traduisant par des engagements au bénéfice de forces terrestres prises sous le feu, sans nécessairement tir de munitions, une démonstration de force suffisant dans beaucoup de cas à mettre fin à une embuscade. Toutefois, le nombre de munitions tirées est en augmentation constante.
À Bagram sont installés les drones, qui ont commencé à être utilisés il y a quelques semaines. J’attends le retour d’expérience. Je constate toutefois que nous nous sommes insérés sans difficultés dans le dispositif global de surveillance depuis la troisième dimension, et que les équipements que nous avons choisis paraissent extrêmement efficaces et sont très appréciés.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Vous avez souligné qu’il y avait imbrication des forces dans la coalition, ce qui suppose une interopérabilité maximale. De ce fait, vous avez dû acquérir, notamment en optronique, des équipements qui n’étaient pas prévus au départ. Le coût de ces équipements achetés en urgence est-il inclus dans les surcoûts Opex, ou relèvent-ils du titre 5 ?
M. le général d’armée aérienne Stéphane Abrial. Le concept d’interopérabilité est fondamental. En effet, nous ne cherchons pas à disposer du même volume ou de la même qualité d’équipements entre membres de la coalition, mais à être interopérables, c’est-à-dire que nos équipements et nos équipages doivent pouvoir en permanence échanger de l’information avec ceux de n’importe quel autre membre de la coalition. Il s’agit d’un combat de tous les instants, car, dans le contexte actuel, les équipements évoluent très vite.
Nous pouvons donc déplorer des manques. J’évoquais dernièrement l’exemple d’un dispositif permettant d’échanger en temps réel de la vidéo entre les forces au sol et les appareils. Ce système, inimaginable il y a dix ans, a commencé à apparaître il y a trois ou quatre ans, et nous n’avons pas réalisé que, sur le terrain, une fois que l’on était passé de la photo à la vidéo, on ne pouvait plus revenir en arrière. Il faut donc acquérir en urgence ces équipements, qui ne sont disponibles que chez certains fournisseurs – qui, hélas, ne sont pas Français ! –, ce qui prend du temps. Une telle acquisition entre dans le cadre des procédures d’acquisition en urgence opérationnelle, qui ne sont pas des compléments de budget, mais qui font l’objet d’arbitrages, et qui sont comptabilisées depuis 2008 dans les surcoûts Opex.
Pour terminer, je voudrais compléter ma réponse sur l’armée pilote de soutien : pour nous, ce concept est un miroir de ce que sont aujourd’hui les bases de défense et de la manière dont elles sont appelées à évoluer. Nous ne rencontrons pas de difficultés majeures en la matière. Je n’ai pas en main les éléments financiers que vous souhaitiez, mais je vous les ferai parvenir afin d’apporter un éclairage sur la question de la disparition – d’un point de vue budgétaire – de la notion d’APS.
M. Georges Tron, Président. Monsieur le chef d’état-major, je vous prie d’excuser mon retard, mais le programme de l’Assemblée étant particulièrement chargé aujourd’hui, j’ai dû me partager entre l’hémicycle, la commission des Finances et la MEC. Je remercie nos rapporteurs d’avoir mené à bien cette audition, et je vous sais gré, monsieur le chef d’état-major, d’avoir répondu à leurs questions.
Audition du 30 avril 2009
À 9 heures 30 : Audition du général de brigade Bertrand Clément-Bollée, sous-chef d’état-major « Emploi et soutien » à l’état-major de l’armée de terre
Présidence de M. Georges Tron, Président de la MEC
M. Georges Tron, Président. Je souhaite la bienvenue, au nom de la MEC, au général Bertrand Clément-Bollée et à la délégation qui l’accompagne. Je salue également les membres de la Cour des comptes qui nous apportent leur expertise : M. Alain Hespel, Président de la deuxième chambre, Mme Françoise Saliou et M. Benoît d’Aboville.
M. le général Bertrand Clément-Bollée, sous-chef d’état-major « Emploi et soutien » à l’état-major de l’armée de terre. Permettez-moi tout d’abord de vous présenter les officiers qui m’accompagnent : le colonel Lillo, chef du bureau « Planification-finances-budget » de l’état-major de l’armée de terre, le lieutenant-colonel Pasco, un de ses subordonnés, le lieutenant-colonel Rivet, qui, dans ce même bureau, est chargé des relations avec le Parlement, et le colonel Bienfait, chef du bureau « Maintien en condition opérationnelle » au sein de l’état-major de l’armée de terre.
Je suis depuis le 1er août 2008 sous-chef « Emploi et soutien » à l’état-major de l’armée de terre, fonction intitulée « sous-chef Opérations-logistique » avant l’entrée en vigueur du décret n° 2005-520, qui a rétabli en droit la responsabilité de fait de l’état-major des armées dans les opérations au sens large. Il est évident que l’armée de terre, qui fournit 80 % des troupes déployées, ne pouvait se désintéresser des opérations. Mon rôle est donc d’assister le chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) dans son rôle de conseil auprès du chef d’état-major des armées, s’agissant de l’emploi des troupes en opérations. Je suis l’interface du CEMAT pour le représenter auprès de l’état-major des armées, en externe, et auprès des commandements de l’armée de terre, en interne.
La partie « emploi » de ma fonction concerne le volet organique de la préparation, de la montée en puissance et de la conduite des opérations. La partie « soutien » concerne le soutien de l’homme, les munitions, transports et transits. Le maintien des matériels en condition opérationnelle relève du bureau « MCO » du colonel Bienfait, et la maintenance du matériel relève de la direction centrale, sous le commandement du général Verna.
Le volet logistique me concerne dès lors que l’état-major des armées nous confie le rôle d’armée pilote du soutien. Mes attributions sont alors élargies au-delà de ce que je viens de décrire.
Il m’appartient de relayer la préoccupation du CEMAT, qui est de fournir à nos troupes, aujourd’hui et demain, le matériel le mieux adapté à la nature de nos engagements les plus probables, sans pour autant sacrifier l’avenir. Il en résulte, en matière d’organisation budgétaire et de financement des besoins, une double ambition :
– assurer un soutien optimum de nos troupes en opération à partir du budget opérationnel de programme (BOP) « Opex » ;
– fournir les équipements et matériels les mieux adaptés à la nature très spécifique de nos engagements à partir du BOP « Terre » et du programme 146 « Équipement des forces », pour les opérations d’urgence. L’urgence opérationnelle ne doit pas être financée par la seule partie terre du programme 146, qui est interarmées.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Les auditions de ce jour ont pour objet d’examiner les coûts et surcoûts des opérations militaires extérieures, ou Opex. Je souhaite poser au général Clément-Bollée deux premières séries de questions.
S’agissant tout d’abord des ressources humaines nécessaires aux Opex, pourriez-vous nous préciser les rythmes de rotation des troupes, leur influence sur le recrutement ainsi que les mesures prises en matière de rémunération ?
S’agissant ensuite des besoins spécifiques des troupes en Opex, il n’est un secret pour personne que de nombreux militaires achètent sur leurs propres deniers une partie de leur équipement (gants, lunettes de soleil pare-éclats, gilets, lampes, vêtements polaires…). Quelle est la part d’équipements achetés par vraie nécessité et celle achetée par effet de mode ou par confort ? Quels sont les manques avérés en matière d’équipement individuel ?
M. le général Bertrand Clément-Bollée. La première question appelle une réponse en trois temps.
En ce qui concerne le rythme des rotations de troupes projetées en Opex, la France observe une pratique quasi-constante, reposant sur des rotations de 4 mois. Certaines opérations conduites sous l’égide de l’Organisation des Nations-Unies, notamment au Cambodge, reposaient toutefois sur des rotations de 6 mois.
Tel est également le cas des troupes françaises en Afghanistan. Cela s’explique par un souci d’efficacité opérationnelle. La nature spécifique des opérations conduites en Afghanistan, ainsi que la nécessaire acculturation de nos troupes, impliquent un délai de rotation suffisamment long. Le retour sur expérience de l’opération « Dinner out », conduite sous la responsabilité du colonel Nicolas Le Nen, pendant 10 jours, a confirmé la pertinence du délai de rotation de 6 mois. Menée après 3 mois de présence des troupes sur le sol afghan, cette opération ne pourrait être répétée si le délai de rotation était ramené à 4 mois.
La présence des troupes pendant 6 mois est continue, sans permission. L’instauration d’une permission nécessiterait un accroissement de plus de 20 % des effectifs mobilisés, ce qui n’est pas envisageable. La durée du délai de rotation et l’absence de permission ont justifié des mesures d’accompagnement.
D’une part, le contrat moral avec nos soldats est que les troupes présentes pendant 6 mois en Afghanistan ne sont pas projetées vers un théâtre d’opérations extérieures pendant les 12 mois qui suivent leur retour en France. D’autre part, des mesures d’accompagnement psychologique ont été prises. Ainsi, sera expérimenté en juin un « sas de désengagement », dont l’objet est de permettre aux troupes quittant l’Afghanistan de se réhabituer à un rythme de vie classique, sans menace permanente pour leur sécurité. L’expérimentation de juin consistera à faire transiter par Chypre, pour 48 heures, 80 personnes en provenance des OMLT (Operational Mentoring Liaison Team) d’Afghanistan.
Deuxième aspect de votre question, l’impact des opérations extérieures sur les recrutements ne suscite pas d’inquiétude. Un équilibre s’est établi entre le caractère dissuasif des pertes enregistrées, notamment lors de l’accrochage d’OUZBIN en août 2008, et l’intérêt de connaître les réalités d’un théâtre d’opérations. Parmi les partants, les non-renouvellements d’engagements sont souvent dus aux contraintes de la vie militaire, en particulier la mobilité géographique et la disponibilité. Ce dernier point est important puisqu’il n’existe pas de volontariat pour les opérations extérieures : une fois choisi ce métier, on ne choisit pas ses missions, principe sans cesse rappelé à nos militaires.
Les suppléments de rémunérations sont les mêmes pour toutes les opérations extérieures, quel qu’en soit le lieu. Il ne saurait y avoir, ici, le théâtre des seigneurs de la guerre, et, là, celui des valets d’armes. En Afghanistan, les conditions d’engagement sont d’une intensité majeure. Mais celles subies au Tchad en février 2008 l’étaient tout autant. La solde est donc la même sur tous les théâtres d’opérations extérieures. En tout état de cause, le traitement d’un militaire français en Opex est largement supérieur à celui d’un militaire britannique : dans le cas d’un général de brigade, sur six mois après retenues diverses, 72 090 euros pour le français et 55 463 euros pour le Britannique ; pour un militaire du rang, 18 558 euros pour le français et 12 901 euros pour le Britannique. En métropole la comparaison de la solde est par contre largement en faveur du Britannique.
La situation des rémunérations en opérations extérieures dans l’armée de terre française est donc bonne. D’ailleurs, on ne trouve pas, sur le blog du CEMAT, de courriers portant sur les rémunérations en opérations extérieures. En revanche, les personnels estiment que les opérations extérieures apportent une expérience professionnelle enrichissante et irremplaçable, qui permet de « bien vivre son métier ». Le gain financier apparaît comme la juste prise en compte des exigences du service, car il faut aussi « vivre de son métier ».
Enfin, les achats de matériels faits directement par les personnels, un problème récurrent dans les armées, correspondent à plusieurs types de situation. Il peut s’agir d’une initiative individuelle pour améliorer son équipement, voire pour disposer d’un équipement valorisant, comme celui des forces spéciales françaises ou celui d’unités américaines côtoyées sur le terrain.
L’autre cas est celui de l’abus de pouvoir, à savoir une obligation d’achat imposée par le commandement quel que soit son niveau. L’état-major de l’armée de terre interdit et combat en permanence cette pratique. Il revient en effet à la République d’équiper ses soldats.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Plusieurs problèmes précis se sont posés récemment : les gants, les genouillères et les lunettes pare-éclats.
M. le général Bertrand Clément-Bollée. Des vagues d’achat ont pu avoir lieu récemment en Afghanistan à l’occasion de la montée en puissance du dispositif des OMLT, militaires placés dans des formations afghanes. L’isolement de ces personnels a pu amplifier le phénomène d’achats individuels.
D’ailleurs, il est vrai qu’au début du programme OMLT, il n’y avait pas de lunettes pare-éclats dans les équipements de l’armée de terre. Sur la base des demandes du terrain, des achats ont été faits : 2 167 masques balistiques, ce qui a permis d’équiper tous nos personnels ; 1 968 lunettes de combat envoyées récemment. L’armée de terre fournit à ses soldats tous les équipements qui contribuent à l’efficacité opérationnelle, ce qui n’empêche pas des achats supplémentaires à titre individuel.
S’agissant des gilets pare-balles, les personnels, sur les théâtres d’opérations extérieures, ont d’abord été tous équipés d’un gilet S3, d’un coût unitaire de 950 euros, conçu pour les gardes statiques et la protection contre les snipers en Bosnie, avec une bonne protection du cou et du bas du corps. D’autres types de gilets, dits « de classe 4 », mieux adaptés aux situations de combat et d’assaut et d’un coût unitaire de 3 200 euros, ont d’abord équipé les forces spéciales. Tout le personnel en Afghanistan en est aujourd’hui équipé. Il en sera de même, sous peu, au Liban compte tenu de ce qui s’est passé à Gaza. Résistant aux balles blindées les plus courantes et gênant moins les mouvements, les gilets de classe 4 ont toutefois l’inconvénient d’offrir une protection moins étendue que ceux de classe 3.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Merci pour vos réponses sur les équipements. S’agissant des matériels, lors d’une mission parlementaire en Afghanistan en septembre 2008, nous avions noté des retards pour la mise à disposition d’hélicoptères Caracal, de drones et de véhicules blindés légers. Le Premier ministre nous a reçus à notre retour. Nous l’avons saisi de ces carences. Depuis lors, les deux premiers types de matériel ont été livrés. Qu’en est-il des véhicules, dont certains n’étaient pas blindés ? Des carences existent-elles sur d’autres théâtres ?
M. le général Bertrand Clément-Bollée. Une remarque sur nos drones, que nous utilisons à des fins tactiques, alors que l’armée de l’air les met en œuvre au niveau opératif, ils dépassent nos attentes.
Les deux types de véhicules légers sont les véhicules blindés légers (VBL), qui ont été surblindés, et les véhicules de l’avant blindé (VAB) qui ont été revalorisés et surblindés. En outre, nous remplaçons sur 60 VAB les tourelleaux anciens qui forcent à une exposition du servant de l’arme, par des tourelleaux téléopérés depuis l’intérieur du véhicule.
Par ailleurs, la logistique du bataillon déployé dans la Kapisa a été réalisée par de petites équipes intégrées sous VAB. D’autres véhicules équipent nos forces en Afghanistan, comme des camions blindés. De plus, des kits de blindage jouant le rôle de « peau blindée » sont utilisés pour recouvrir les parties où se trouvent les équipages de ces camions.
Aujourd’hui, il n’y a pas de véhicule s’engageant à l’extérieur d’une base avancée FOB (Forward Operating Base), qui n’ait été revalorisé en matière de protection balistique.
Par ailleurs, il faut distinguer les dispositifs de protection passifs (blindage par plaques) et les protections actives (par brouilleur). L’armée de terre détient 356 brouilleurs pour les VAB plus 90 pour les VBL, dont respectivement 325 et 74 sont opérationnels. La différence s’explique par la nécessité de recalage mensuel, avec achats de filtres, destinés à assurer une compatibilité avec l’utilisation des postes radio.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Quelles sont les incidences des principaux programmes d’urgence en termes budgétaires et par rapport aux besoins ? Je vise en particulier les chenillettes déployées dans les zones montagneuses afghanes et qui avaient été demandées par le précédent chef d’état-major de l’armée de terre, sans réponse positive de l’état-major des armées. Je pense également aux matériels roulants blindés et protégés contre les mines (Buffalo et Aravis).
M. le général Bertrand Clément-Bollée. On peut certes s’interroger sur la raison d’être d’une phase d’acquisition alors que nous sommes en intervention… Il ne s’agit pas d’une carence d’anticipation, même si les programmes d’armement sont longs à mettre en œuvre. La raison en est que l’environnement change. La plupart de nos matériels ont été conçus pendant la période du Pacte de Varsovie où il fallait faire face à une menace statique de 45 000 chars placés derrière la frontière, avec la perspective d’une intervention limitée à huit jours. Or les opérations actuelles durent. Elles sont déployées dans des théâtres où les menaces sont moindres mais où l’adversaire utilise des moyens de contournement de puissance sur nos vulnérabilités, par voie médiatique ou en agissant sur le moral. Nos matériels se retrouvent inadaptés aux problèmes de l’engagement actuel, par exemple en Afghanistan, et au contexte de cet engagement, avec les besoins d’interopérabilité multinationale. Ils doivent donc être améliorés. C’est le cas de l’achat en 2008 de 50 PRC117, petits appareils radio qui permettent de communiquer avec les avions de l’Alliance, pour un coût global de 4 millions d’euros.
L’Afghanistan nous a montré que la pratique des itinéraires est délicate car ils sont en mauvais état. Certains endroits sont des points de passage obligés et l’adversaire les exploite en y plaçant ses explosifs improvisés, ou IED (improvised explosive devices), qui font des dégâts considérables. Nous avons donc développé un principe d’incertitude sur notre attitude dans les axes, avec des véhicules qui permettent de s’affranchir de ces points de passage obligés. Les véhicules les plus adaptés sont ceux qui équipaient déjà la 27ème brigade d’infanterie de montagne et le 3ème régiment étranger d’infanterie, pour la protection du pas de tir d’Ariane en Guyane : les véhicules articulés chenillés (VAC) et les véhicules haute mobilité (VHM), le deuxième étant un peu plus blindé que le premier. 8 VHM ancienne génération (BV 206S) et 4 VAC (BV 206) ont été déployés en Afghanistan avec la relève du bataillon de chasseurs alpins. Il existe dans l’armée de terre 52 VAC et 12 VHM ancienne génération. Nous avons donc demandé auprès de l’état-major à confirmer ce programme. 53 véhicules seront commandés en 2009, pour une cible totale de 129 unités. Le choix de l’industriel n’a pas été encore effectué.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Quel est l’industriel qui fabrique ce matériel ?
M. le général Bertrand Clément-Bollée. Il s’agit du Finlandais Hagglünds et du Singapourien Bronco qui fabrique un matériel beaucoup plus volumineux. Il faut compléter les véhicules d’appareillages qui leur font défaut (grilles de protection pour le déclenchement des charges creuses avant le blindage proprement dit, brouilleurs).
Une semaine après la première utilisation de ces véhicules, nous avons constaté que leur agilité était littéralement « testée » – avec succès pour nous – par les talibans, qui avaient disposé un explosif visible sur un axe et ont pu voir le véhicule quitter la route et contourner l’obstacle. Cela nous a incités à l’adaptation réactive de notre doctrine d’emploi. Nous avons cependant peu d’unités équipées de ces matériels, et le bataillon les réserve plus particulièrement à l’hiver, avec le maintien du principe d’incertitude en été.
L’usure de nos VAB est le deuxième souci majeur que nous avons pour les véhicules blindés en Afghanistan. Véritable mule de l’armée de terre, il s’use deux fois plus vite dans ce pays. Après différentes attaques par IED, ce matériel a montré qu’il est assez résistant et présente un bon équilibre entre son blindage et sa légèreté relative (en comparaison du MRAP des État-Unis). Le chef d’état-major de l’armée de terre se bat actuellement pour obtenir le lancement du programme VBMR (véhicule blindé multirôle) de remplacement du VAB avant la fin de la loi de programmation militaire dont le projet de loi est en cours d’examen devant votre assemblée. Pour l’armée de terre, c’est un élément stratégique pour la cohérence de l’opération Scorpion, qui est la mise en conformité de l’engagement opérationnel haute intensité du groupement tactique interarmes (numérisation de l’espace de bataille, mobilité, protection sous blindage). Il faut absolument anticiper ce programme, car le vieillissement du VAB est avéré et sa durée initialement prévue à 2025 ne pourra pas être tenue.
M. le Colonel Lillo. Des photos vous montrent l’état de vieillissement de ces engins, qui vont être réparés, avec des coûts forcément très importants. Elles vous permettent de mieux comprendre l’inquiétude du CEMAT et son insistance pour que la réalisation du VBMR soit conforme à ce qui est indiqué dans le projet de loi de programmation militaire.
Mme François Olivier-Coupeau, Rapporteure. J’aimerais savoir sur quel support budgétaire sont imputés les coûts et surcoûts d’équipement que vous subissez, notamment pour répondre à l’usure rapide des véhicules en Afghanistan. Est-ce le BOP Opex ? le BOP Armée de Terre en supporte-t-il une partie et si oui selon quelles modalités ?
M. le Général Bertrand Clément-Bollée. À titre global, l’équipement collectif a représenté 108,5 millions d’euros pour l’adaptation réactive.
M. le Colonel Lillo. Les coûts d’entretien du matériel de l’armée de terre inspirent une véritable inquiétude. L’on finançait auparavant l’ensemble de l’entretien des matériels présents en métropole et sur les théâtres extérieurs sur l’enveloppe annuelle globale de 350 millions d’euros. Cependant, à la suite d’éléments déclenchants majeurs, au Liban d’abord, en Afghanistan ensuite, les coûts de maintien en condition opérationnelle sur ces deux théâtres ont explosé. Or il faut procéder à l’entretien à enveloppe constante, ce qui a pour conséquence de contraindre très fortement le coût d’entretien des matériels en métropole. La pression qui en résulte va devenir intenable sur le plan budgétaire ainsi que pour la gestion des matériels.
Ceci malgré les aménagements d’entretien intervenus dans le cadre de la nouvelle politique d’emploi et de gestion des parcs (PEGP). La réponse à votre question est que ces coûts ne font pas l’objet d’une prise en compte particulière sur le BOP Opex et ne font pas l’objet d’un remboursement intégral ; un remboursement de 14 millions d’euros a eu lieu en fin d’année 2008, mais il ne représentait qu’une part limitée des surcoûts.
Les surcoûts de maintien en condition opérationnelle devraient être pris en compte dès le début d’année de gestion car ils s’apparentent à de l’achat de flux ; c’est d’ailleurs la recommandation qu’a faite la Cour des comptes. La dotation prévisionnelle des Opex qui devrait être augmentée de 120 millions d’euros pour les prochaines années, doit en tenir compte. Ces coûts sont estimés à 25 à 30 millions d’euros par an sur la base des activités actuelles de l’armée de terre en Afghanistan.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. De quelle manière le matériel est-il réparti et utilisé sur les théâtres d’opérations extérieurs et en métropole ?
M. le Général Bertrand Clément-Bollée. Auparavant, les unités partaient se déployer sur un théâtre d’opérations avec leur propre parc, livré sur place, ce qui représentait un coût mais comportait aussi des avantages en termes de visibilité de la présence militaire. Ainsi par exemple, en Côte d’Ivoire lors de l’opération Licorne, les importants convois de logistique liés au remplacement des unités, intervenant tous les quatre mois, rappelaient à la population et à l’opinion la présence militaire, ce qui pouvait contribuer à maintenir la stabilité de la région et le règlement des affaires de manière apaisée. Aujourd’hui, l’armée s’adapte et participe à l’économie générale des moyens : nous avons adopté la politique d’emploi et de gestion des parcs, et le matériel est désormais sectorisé sur les théâtres d’opération.
Auparavant, une unité comme le 1er régiment étranger de cavalerie, quand j’en étais chef de corps, pouvait disposer des 48 véhicules AMX 10 RC pour son entraînement, ce qui serait inconcevable aujourd’hui. Désormais, le parc en service permanent permet l’entraînement courant des unités au niveau « compagnie plus », qui est celui de la compagnie ou de l’escadron, complété de quelques éléments d’infanterie, mais pas au-delà, et un régiment ne pourrait s’entraîner en garnison avec tous ses matériels.
Le parc total en OPEX est important (il compte 2 500 véhicules dont 900 blindés) ; quelque 500 VAB sont stationnés en Afghanistan. Pour éviter l’éventualité d’une destruction totale du matériel, des mandats ont été donnés à une mission d’audit menée par la direction centrale du matériel de l’armée de terre, la DCMAT, de faire le tour des théâtres, afin de prendre les décisions nécessaires de relève du matériel. Les décisions de relève sont prises au cas par cas, en fonction du taux d’usure du matériel, afin d’éviter de se trouver dans la situation de ne pas pouvoir maintenir ce matériel en condition opérationnelle. On s’impose un taux de 90 % de disponibilité en dessous duquel on ne doit pas descendre pour les engagements en opération. La situation des parcs majeurs est transmise chaque matin au CEMAT, qui prend les décisions nécessaires. Nous sommes globalement au-dessus de ce taux de 90 % sauf cas particulier comme au Tchad, où on a appliqué ponctuellement un taux inférieur pour un type de véhicule.
En Afghanistan, nous avons rencontré une situation dans laquelle la menace de mines était particulièrement avérée et la capacité de protection de nos équipes NEDEX (neutralisation, enlèvement et destruction d’explosifs) n’était pas assurée. Le Buffalo, véhicule doté d’un bras télé-opéré, est le seul engin qui répond parfaitement à ces situations. Cinq de ces véhicules ont été achetés directement aux États-Unis dont trois se trouvent en Afghanistan. Ils sont pour le moment sur le théâtre d’opérations en « acculturation du concept d’emploi ». En effet, on a préparé les personnels mais il faut respecter une période d’adaptation aux réalités du terrain avant de l’engager dans des opérations lourdes, ce qui suppose un temps de montée en puissance. Les spécialistes du déminage pourront ainsi intervenir en étant totalement protégés par le bras télé-opéré et pourront s’approcher au plus près des charges explosives.
À côté du Buffalo, il faut une autre équipe, qui utilise actuellement le véhicule d’accompagnement VAB, dont le degré de protection n’est pas du tout le même, c’est pourquoi on veut l’équiper d’un type de blindage plus performant. Une commande de 15 véhicules Aravis a été passée à Nexter pour le remplacer. Dans l’intervalle, c’est encore le VAB qui est utilisé. Nous avons demandé le prêt sur zone de matériel américain MRAP, qui permet de rester dans le concept d’emploi, mais cette démarche, pour le moment, n’a pas abouti.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. L’entraînement des troupes pour l’Afghanistan suppose une préparation renforcée, en centre d’aguerrissement en montagne notamment. Le surcoût lié à cette préparation est-il calculé et comptabilisé dans les surcoûts Opex ?
M. le Général Bertrand Clément-Bollée. Non, ce surcoût n’en est pas comptabilisé dans les surcoûts Opex. C’est pourquoi nous avons, en la matière aussi, adopté le principe de différenciation dans la préparation opérationnelle, en définissant trois couches de préparation incontournables : la formation individuelle des personnels, l’acquisition des missions communes de l’armée de terre et enfin l’acquisition du métier de base dans le cœur de métier – fantassins, blindés, ou autres.
Ensuite, au lieu de placer tout le monde dans la même situation moyenne supérieure d’intervention, on adapte la préparation des personnels en fonction de leur lieu futur de déploiement et de la durée de leur mission. Le standard d’exigence opérationnelle de la mise en condition de projection (MCP) des personnels, laquelle dure six mois, a été élevé, pour les personnels destinés à partir en Afghanistan, à un niveau qui n’a jamais été atteint auparavant
Ce sont donc 7 500 personnels qui sont formés sur ce standard chaque année à cette fin, et il s’agit d’un investissement car ces compétences élevées demeureront. On investit en même temps pour remplir les engagements du Livre blanc, soit 30 000 hommes formés pour une entrée en premier sur un théâtre. Cela justifie que ce coût ne soit pas imputé directement sur les coûts Opex. Il pourrait être intéressant pour votre mission de voir la manière dont la mise en condition de projection est effectuée dans le camp de Canjuers lorsque le module de MCP y sera complètement développé.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Deux questions « d’intendance ». La première sur l’armée pilote de soutien : avez-vous, dans le cas où vous êtes armée pilote de soutien, pris des dispositions réglementaires qui gèrent cette disposition ?
Ma deuxième question est relative à l’externalisation : quel est le regard de l’armée de terre sur le programme CAPES-France (Capacités additionnelles par l’externalisation du soutien des forces françaises) dans les différents théâtres tels le Kosovo ou le Tchad, avec les opérations Épervier et Eufor ?
M. le Général Bertrand Clément-Bollée. Les dispositions réglementaires pour l’armée pilote de soutien s’organisent de la façon suivante : lors du lancement d’une opération, l’état-major des armées désigne une armée pilote de soutien. Cette désignation fait l’objet d’une directive administrative et logistique (DAL). Le sous-chef « Emploi et soutien » fait rédiger par l’état-major opérationnel terre un autre document, l’ordre administratif et logistique (OAL) qui s’appuie sur la circulaire 23-50. À noter que cette circulaire nécessitera d’être totalement refondue pour tenir compte des évolutions prochaines, notamment de l’état-major des armées puisque le centre de responsabilité budgétaire inter-armées (CRBIA) sera bientôt adossé au centre interarmées d’administration des opérations (CIAO) qui n’est pas encore opératoire. Dans l’OAL Licorne, par exemple, est définie l’organisation administrative et budgétaire de ce qui va se passer sur le terrain. Les évolutions sont essentiellement des évolutions interarmées et surtout le fait que l’EMA prenne bien en compte que le BOP Opex est un BOP de plein emploi. Toute la responsabilité lui revient.
La directive 2009 du sous-chef opérations à l’EMA, indique effectivement que la notion d’« armée de soutien » disparaît au sens budgétaire du terme, mais cette directive indique également que les armées doivent rester totalement investies dans le soutien. Il reste des modèles d’organisation qui relèvent d’une culture propre à chaque armée. Par exemple, l’armée de l’air est pilote de soutien au Tchad, pour l’opération Épervier. Elle a mis en place une base située à N’Djamena, un satellite à Abéché et c’est à peu près tout : les moyens au sol sont très concentrés.
L’armée de terre est pilote de soutien en Afghanistan et en Côte d’Ivoire. Dans ce pays, par exemple, le dispositif est étendu sur de longues distances. Au début des opérations, les régiments pouvaient être distants les uns les autres de 600 ou 800 kilomètres, ils pouvaient avoir des escadrons à 300 kilomètres, puis des pelotons à 150 kilomètres. L’armée de terre a une nécessité d’entretien des compétences pour faire face aux urgences. J’aurais pu citer un exemple très particulier sur ce qui s’est passé à la mise en place de notre bataillon dans la Kapisa l’année dernière. Nous avons été obligés de monter dans l’urgence une escale intermédiaire aux Émirats arabes unis avant le déploiement des troupes, avec l’obligation de s’affranchir d’une organisation type et de répondre à un besoin réel de mobilisation de ressources financières.
M. Georges Tron, Président. Je vous prie de m’excuser mon général, mais vous allez comprendre la notion d’urgence appliquée au Parlement. Nous sommes appelés dans l’hémicycle immédiatement pour participer à un scrutin. Je voulais vous dire tous nos remerciements, car les échanges ont été à la fois passionnants et enrichissants. Les Rapporteurs auront peut-être à vous adresser par écrit des questions complémentaires.
Audition du 30 avril 2009
À 10 heures 30 : M. le Vice-amiral Xavier Magne, sous-chef d’état-major « opérations – aéronautique navale » à l’état-major de la marine
Présidence de M. Georges Tron, Président
M. Georges Tron, Président. Amiral, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de la mission d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’au capitaine de vaisseau Christophe Caillet. Vous connaissez le principe des auditions de la MEC : il s’agit d’avoir un dialogue le plus interactif possible avec vous sur les sujets, aujourd’hui les Opex, qui font l’objet des investigations de la mission.
Nos deux rapporteurs sont Madame Françoise Olivier-Coupeau et Monsieur Louis Giscard d’Estaing. Monsieur Louis Giscard d’Estaing, ayant dû regagner sa circonscription, vous demande de bien vouloir l’excuser. Conformément à la tradition de la MEC, leurs travaux sont conduits dans un esprit non partisan. Les deux rapporteurs représentent l’opposition et la majorité, mais également les deux commissions compétentes : celle des Finances, dont la MEC est une émanation, et la commission de la Défense. Nous bénéficions de l’expertise de la Cour des comptes, en la personne du président Alain Hespel, président de la deuxième chambre, de Madame Françoise Saliou, président de section et de Monsieur Benoît d’Aboville, conseiller maître.
Peut-être pourriez-vous, Amiral, à titre liminaire, nous indiquer comment se présente, pour la marine, la question des Opex et quel est plus particulièrement votre rôle en la matière. Après quoi, Madame Olivier-Coupeau vous posera des questions.
Vous avez la parole.
M. le vice-amiral Xavier Magne, sous-chef d’état-major « opérations – aéronautique navale » à l’état-major de la marine. Merci, monsieur le président. Tout d’abord, je suis un peu gêné pour parler d’opérations extérieures, car contrairement à l’armée de terre ou à l’armée de l’air, cette notion n’a pas vraiment de sens pour la marine. Initialement, ces deux armées ont en effet été conçues pour défendre le territoire national et sont, de ce fait, structurellement sédentaires. Cela ne signifie pas qu’elles le soient aujourd’hui, mais elles ont été organisées pour cela. Dans l’armée de terre, les troupes de marine rassemblaient les unités ayant vocation à être projetées, c’était le corps expéditionnaire. Aujourd’hui ce n’est plus vrai : c’est l’ensemble de l’armée de terre qui se projette. À l’inverse, de tout temps, la marine a eu pour mission d’opérer sur les mers, donc par définition à l’extérieur du territoire national. C’est la raison pour laquelle nous sommes embarrassés par la notion d’opérations extérieures, en particulier, s’agissant de l’aspect financier de ces opérations dites « extérieures », car pour la marine sont des opérations normales.
La construction financière de la marine avait été conçue pour tenir compte de l’éloignement et d’un certain nombre d’autres considérations. Nous avons notamment un système de majorations lorsque les personnels sont embarqués. Est prise en compte la dimension de diplomatie navale avec la question des « pertes au change », lorsque les bâtiments sont en escale. Ces dispositions, qui avaient été bâties pour la marine depuis des années et qui fonctionnaient bien, ont été bouleversées par l’apparition de la notion d’opérations extérieures.
Le précédent chef d’état-major de la marine ne voulait d’ailleurs pas rentrer, au début, dans la logique des opérations extérieures, considérant qu’un bâtiment avait vocation à se déployer hors de son port base, et que cela faisait partie des coûts normaux de fonctionnement de la marine. C’est pourquoi nous avons toujours essayé de planifier notre activité, y compris en tenant compte des opérations imprévues ou ordonnées avec peu de préavis.
L’indemnité de sujétion pour service extérieur (ISSE) a probablement fait l’objet d’un certain nombre de confusions et constitue une des difficultés sur lesquelles nous butons : beaucoup la confondent avec une prime de risque ou de danger, ce qu’elle n’est évidemment pas. L’ISSE est une prime de résidence, ou l’alignement d’une prime de résidence sur une sorte de socle commun. L’ISSE n’est pas non plus un moyen de compenser l’érosion du pouvoir d’achat. Ces confusions ont causé beaucoup de tort.
La raison pour laquelle le précédent chef d’état-major de la marine s’était senti obligé d’entrer dans la logique de l’ISSE est liée au fait qu’entre le système ancien de primes et l’attribution de l’ISSE, existent des différences qui apparaissent inéquitables. Prenons l’exemple du Nivôse, bâtiment qui navigue actuellement dans l’océan Indien. Qu’il travaille pour l’opération internationale Atalanta, liée à la lutte contre la piraterie, ou pour le compte d’une opération nationale, il n’y a pas fondamentalement de différence pour l’équipage : le bâtiment est éloigné de son port base pour une longue durée. Il faut donc donner aux familles les moyens de gérer convenablement l’absence du chef de famille ; c’était là l’objet des primes d’éloignement et d’embarquement.
Cela explique pourquoi la notion récente d’Opex nous met mal à l’aise. C’est presque une prime au mauvais élève, une incitation à ne pas déployer les forces. Je constate, après trente–trois ans d’expérience dans les armées, que nous n’avons pas la possibilité de définir des indicateurs de performance. Nous ne produisons rien en réalité, si ce n’est de la sécurité et de la paix. Et cela ne se mesure pas, ou alors en négatif, en cas d’échec. Si par hasard nous ne sécurisons pas le détroit de Bab el Mandeb ou une route maritime, l’effet négatif sur l’économie ou sur l’industrie se ressent immédiatement. A contrario, l’on ne verra pas l’effet de quarante ou soixante ans de paix, ce qui est d’ailleurs une des difficultés de lisibilité de la dissuasion nucléaire.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. En termes comptables, pouvez-vous nous préciser quand les coûts d’une opération sont imputés sur le BOP Opex ou sur le BOP Marine ? Existe-t-il une différence ? En ce qui concerne le personnel, un marin croisant dans l’Atlantique ou un marin au large du Pakistan ont-ils la même solde ? Lequel bénéficie de l’ISSE ? Une mission Opex débute-t-elle dès le départ du port ou à l’entrée dans une zone prédéfinie ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Une mission Opex fait référence à une zone géographique. C’est le cas de la zone Enduring Freedom qui part de Suez, prend une partie de la mer d’Arabie, le golfe d’Aden et le golfe Persique. Très concrètement, lorsqu’un bâtiment se déploie pour une mission Opex, un « cliquet » s’enclenche en fonction des zones traversées. Cela a été le cas du groupe aéronaval pour lequel un décompte a commencé à l’entrée dans le golfe de Suez et a pris fin lorsqu’il a franchi Suez au retour de la métropole. Pratiquement, ce n’était pas à l’appareillage de Toulon. Cela correspond bien au caractère dual de notre marine : un bâtiment peut, par définition, basculer à tout moment d’une mission à une autre. Un bateau prépositionné dans le golfe de Guinée pour être prêt à réaliser une éventuelle évacuation de ressortissants peut, à tout moment, être appelé par exemple à participer à une opération de lutte contre des narcotrafiquants au large du Libéria.
Une des particularités de la marine réside dans le fait que, contrairement aux autres armées, un bateau qui se déplace peut changer de contrôleur opérationnel en fonction de la mission attribuée. Lorsque l’on est déployé en Opex pour une opération extérieure identifiée réglementairement par l’état-major des armées, il y a un moment où l’on entre dans cette zone et où l’on commence la mission. Puis, il y a un moment où l’on en sort, la mission Opex est alors terminée. Certaines modalités peuvent sembler un peu surprenantes : si l’opération dure moins de quinze jours, l’équipage ne perçoit pas l’ISSE, ce qui conduit à s’interroger sur l’opportunité de cette restriction. Lors de l’opération de libération des otages du Ponant, les commandos sont restés moins de quinze jours sur place. Pour autant, ils sont réellement partis en mission opérationnelle loin de chez eux.
Les primes de majoration et de perte de change avaient l’avantage d’être indexées sur l’éloignement, sur la durée, sur le type de pays dans lequel se déroulait la mission. Elles étaient liées à une activité et à une durée d’éloignement de la famille. Un marin déployé dans l’Atlantique et un marin déployé dans l’océan Indien peuvent avoir des statuts différents : le second aura peut-être un statut Opex, ou, tout comme le premier, un statut « régime des bâtiments navigant à l’extérieur ». La zone géographique de ce régime est délimitée par deux méridiens : le 12-Ouest et le 19-Est. À l’intérieur de ces méridiens est définie la zone 1. Dans cette zone, que l’on soit au pôle nord ou au pôle sud, la solde n’est pas ou peu modifiée. À l’extérieur de ces méridiens, dans la zone 2, la solde change substantiellement.
Madame Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Concrètement, un marin déployé en zone 2 dont le bateau entre simultanément en zone Opex, cumule-t-il la majoration liée à la zone 2 avec la prime ISSE liée à l’Opex ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Il n’y a pas de cumul : on est soit dans un régime, soit dans un autre. Bien sûr, il existe la tentation de basculer dans le régime ISSE parce qu’il est plus favorable. Le régime des bâtiments navigant à l’extérieur dépend de l’activité du bateau. Pour l’équipage du porte-avions, qui effectue rarement des escales, il est plus rémunérateur d’être placé en régime Opex et de percevoir l’ISSE. C’est pour cela que je disais précédemment que c’est un peu une prime au mauvais élève. Cela n’incite pas forcément à la vertu.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Les moyens engagés dans l’opération FINUL maritime ont-ils été redéployés ? A-t-on réalisé des économies ? Si oui, ont-elles été chiffrées ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Les moyens dégagés de la FINUL maritime sont entièrement réemployés. D’une façon générale, je n’ai pas de moyens inemployés. Quand un bâtiment est dégagé d’une opération, il est vite affecté à une nouvelle mission. Nous sommes sortis de la FINUL maritime car il ne pouvait plus y avoir de financement de l’ONU pour la présence de notre bateau. En outre, notre intégration à la FINUL maritime gênait nos activités bilatérales avec nos partenaires libanais. Notre coopération de marine à marine n’est pas forcément compatible avec la logique onusienne ni avec l’agenda des autres pays participant à la FINUL. Nous avons choisi des créneaux de présence en « national » pour mener une activité beaucoup plus dense, construite et suivie dans le temps. Cela permet d’assister la marine libanaise dans sa progression, car nous considérons que la surveillance de la zone devra, à terme, lui revenir. Pour transmettre le savoir-faire aux Libanais, nous avons donc extrait notre navire de la FINUL. Il est resté quelque temps sur zone pour faire de la coopération, puis a été redéployé. Un autre bâtiment se rendra au Liban dans des créneaux bien identifiés pour parfaire méthodiquement cette coopération.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Nous avons quelques inquiétudes en ce qui concerne l’immobilisation imprévue du porte-avions Charles de Gaulle. Quelles en sont les conséquences, notamment financières ? Qui va payer ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Le problème posé par l’immobilisation du bâtiment est la transmission du savoir. En ce domaine nous avons une capacité de pointe grâce à quarante ans de savoir-faire accumulés par l’utilisation intensive des porte-avions Foch et Clemenceau. L’interruption d’activité liée à l’immobilisation nécessaire pour le changement des cœurs des réacteurs a réduit les possibilités d’entraînement, ce qui a compromis la transmission du savoir par les pilotes les plus anciens. Or, nous avons besoin de temps pour que les pilotes retrouvent le niveau initial. Il faut maintenant identifier le savoir perdu. Compte tenu de la crise économique et de la situation difficile des compagnies aériennes civiles, nous ne sommes pas trop inquiets quant au risque de départ vers le civil des pilotes les plus anciens et les mieux formés, mais ce ne sera plus le cas lors de la reprise économique. Un tel savoir-faire s’entretient en étant utilisé lors des déploiements de nos porte-avions sur des théâtres d’opération.
S’agissant des questions financières, nous connaissons, grâce à la commission d’enquête, les pièces qui sont à l’origine de l’immobilisation du navire, mais nous n’avons pas encore parfaitement identifié la cause des problèmes rencontrés. Les experts trancheront. Ce sont des pièces de haute précision qui nécessitent plusieurs mois d’usinage et de traitement thermique. Nous avons heureusement requalifié le bateau pour ce qui concerne le cœur de sa capacité, à savoir les pilotes qui ont déjà été formés à bord et qui peuvent opérer en toutes circonstances. S’agissant des plus jeunes pilotes, nous les qualifierons lorsque le bateau reprendra la mer. Le pire serait une interruption significative dans leur progression.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Je voudrais évoquer les frégates multi – missions (FREMM). Le Livre blanc a prévu que l’on en commande 11 au lieu des 17 prévues au départ. Le délai de construction est passé de 7 mois à 1 an. Il devrait encore s’allonger en cas de ventes à l’étranger. Vous aurez moins de bateaux, moins de renouvellement. Comment allez vous gérer cette situation ? Quelles sont les conséquences financières ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. L’allongement du temps de construction entraîne une hausse des coûts. Nous nous battons pour placer à l’export les frégates qui sont retirées du programme pour maintenir ainsi les délais prévus et éviter une explosion des coûts, puisque les hypothèses de coût du programme ont été établies sur une cible de 17 navires.
En ce qui concerne l’utilisation des bâtiments, il faut savoir que nous sommes en situation de déficit quantitatif. Nous avons notamment beaucoup de bâtiments retenus dans l’océan Indien pour lutter contre la piraterie. De nombreux pays participent à la sécurisation de la zone mais, dès que le temps est clément, le nombre d’actes de piraterie augmente fortement. Malgré les interceptions réalisées au large de la Somalie, le crime organisé s’avère très lucratif et se répand. Il est nécessaire de changer notre mode d’action.
Actuellement, nous ne parvenons pas à fournir suffisamment de bateaux pour les différentes missions confiées à la marine. Certes, les avisos A 69, qui ont été déclassés, peuvent encore être parfois utilisés comme les frégates. Toutefois, cette solution n’est pas durable car les systèmes d’armes ne peuvent plus être entretenus et, de surcroît, ces bateaux ne disposent pas d’hélicoptères. Notre capacité à agir s’érode à tel point que parfois l’arbitrage remonte jusqu’à l’Élysée pour l’emploi d’un bâtiment.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Les FREMM, qui sont par ailleurs de magnifiques bâtiments, sont-elles bien adaptées pour la lutte contre la piraterie ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Oui, absolument. Le combat contre la piraterie, tout comme la surveillance des pêches, constitue une action de police pour laquelle on fait appel à un savoir-faire militaire. La difficulté réside dans la dualité de la marine. Les bateaux utilisent tous les jours des savoir-faire développés pour le combat et indispensables lorsqu’on se trouve en situation de combat. Mais les frégates de surveillance sont très peu armées. Et si elles donnent l’illusion que l’on dispose d’une flotte de combat, elles risquent de s’avérer sous-équipées pour un véritable combat naval, le moment venu.
Compte tenu de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d’afficher des performances, nous sommes toujours jaugés selon le critère budgétaire pur. Et, dans ces conditions, nous sommes toujours considérés trop chers. C’est contre cela que nous nous battons.
M. le capitaine de vaisseau Christophe Caillet. La marine a procédé à une évaluation des coûts résultant de la réduction et du décalage du programme de construction des FREMM, et notamment, du maintien au service actif des bâtiments anciens que ces frégates sont destinées à remplacer. Il apparaît que la prolongation de la vie de bâtiments obsolètes devient de plus en plus coûteuse et que la programmation exige un équilibre pertinent entre la mise en œuvre des programmes de bâtiments nouveaux et l’entretien de l’existant.
M. Georges Tron, Président. On peut faire valoir que la diminution du nombre de FREMM a été compensée par le gain d’un troisième bâtiment de projection et de commandement (BPC). Qu’en pensez-vous ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Il est inexact de parler de compensation et de gain puisque la décision de lancer la construction du troisième BPC a seulement été anticipée, et qu’en tout état de cause cette construction est financée sur l’enveloppe budgétaire globale dévolue à la marine, ce qui pèsera en conséquence sur d’autres programmes. Depuis trente-trois ans que je suis ces questions, je n’ai constaté aucun « cadeau budgétaire » pour la marine nationale.
De surcroît, il est prévu de désarmer de façon concomitante le transport de chalands de débarquement (TCD) Foudre. Ce désarmement anticipé comporte des inconvénients, puisque la capacité d’emport en radier des TCD est plus importante que celle des nouveaux BPC, dont le radier est sensiblement plus petit.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. S’agissant de la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, je tiens à saluer les succès de notre marine et notamment l’efficacité de ses commandos. Je saisis cette occasion pour me réjouir des bonnes nouvelles reçues sur le sort du commandant de Gaullier, qui avait disparu au large de la Guyane.
Avec M. Louis Giscard d’Estaing, je souhaite attirer une nouvelle fois l’attention sur la prise en charge du coût des opérations tendant à secourir les navires Carré d’As et Ponant. Est-il vrai que la marine n’a présenté aucune facture aux propriétaires ni aux assureurs ? Si le sauvetage de vies humaines n’a pas lieu d’être remboursé, il n’en est pas de même de la récupération de navires, qui pourrait justifier la participation financière des armateurs et assureurs. Serait-il judicieux et faisable de présenter les factures aux assureurs pour les opérations de sauvetage des navires ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Le chiffrage des surcoûts engendrés par les opérations de sauvetage est réalisable.
Est-il opportun de solliciter une participation financière des assureurs ? Rappelons que l’activité de la marine nationale s’inscrit dans une logique de service public : le sauvetage des vies humaines est gratuit, mais il est habituel de facturer aux armateurs les activités d’assistance et de sauvetage des biens par les bâtiments de la marine nationale.
S’agissant du Ponant, l’armateur de ce navire s’est signalé par une démarche que l’on peut qualifier d’habile. Selon une pratique habituelle à cette profession, il a adressé un chèque destiné à gratifier les participants à l’opération. Cette attitude nous a posé problème à plusieurs titres : la somme à partager était fort modique si elle devait être répartie entre tous les acteurs mobilisés pour le sauvetage du Ponant : pas moins de trois équipages de navires et les commandos qui ont réalisé l’intervention. Cette apparente générosité mettait l’intéressé à l’abri d’une facture en bonne et due forme que nous aurions pu lui présenter en règlement de l’assistance apportée. En ce qui concerne le Carré d’As, la question n’a pas été posée.
M. le capitaine de vaisseau Christophe Caillet. En tout état de cause, le système de comptabilité analytique de la Marine nationale permet de retracer le coût d’un sauvetage.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. La facturation pourrait avoir un effet pédagogique. S’agissant du voilier Tanit, la mort du skipper est dramatique, mais il conviendrait de s’interroger sur la mise en cause de la responsabilité des particuliers lorsqu’ils s’aventurent dans des zones à risques nonobstant les avertissements multiples qui leur ont été adressés, mettant en jeu la vie de nos soldats.
M. Georges Tron, Président. Je rappelle que ces questions de prise en charge des secours se posent dans d’autres cadres, par exemple en matière de protection civile, pour le secours en montagne. Tout n’a pas lieu d’être gratuit.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. En cas d’évacuation de ressortissants étrangers, la marine nationale facture-t-elle ses interventions auprès des États en cause ? Ainsi, outre des Français et des bi-nationaux, des étrangers ont été ainsi évacués du Liban à l’été 2006.
M. le vice-amiral Xavier Magne. Je ne pense pas que, lors des opérations d’évacuation à partir du Liban, il y ait eu des remboursements par des États étrangers lors des opérations, alors que les ressortissants de 61 États ont été pris en charge. La marine n’a cependant pas véritablement supporté de surcoût pour ce qui s’analyse comme un cas particulier d’emploi opérationnel de ses moyens.
Cette question devrait plutôt être posée au ministère des Affaires étrangères et européennes qui a supporté des coûts imprévus de transport au profit de personnes évacuées à partir de Chypre, pour lesquelles il lui a fallu affréter des aéronefs.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. J’observe que la marine nationale retient une approche de ses interventions à l’extérieur très différente de celles des autres armées et fixe une ligne de partage beaucoup plus nette de ce qui relève des Opex et de ce qui n’en relève pas.
N’y a-t-il pas un risque de céder à la facilité en faisant l’impasse sur l’ISSE et de continuer à payer l’indemnité maritime, ce qui aboutit à minorer les surcoûts remboursés au titre des Opex ?
Le vice-amiral Xavier Magne. Au contraire, la facilité serait de basculer le maximum de coûts sur l’ISSE, ce qui se traduirait au plan budgétaire par une majoration des dépenses supportées par le BOP Opex. Une telle facilité serait cependant susceptible de générer des effets pervers : en effet, le financement des Opex en gestion est gagé par une diminution des autres dépenses du budget de la Défense nationale, qui est une enveloppe fixe. Ainsi, le maintien en condition opérationnelle des matériels (MCO) est très tendu pour toutes les armées, tandis que les crédits d’investissement sont fréquemment mis à contribution pour financer ces Opex. De surcroît, les gestionnaires succombent à la tentation constante de favoriser les personnels, donc de recourir plus largement à l’ISSE. Nous-mêmes avons dû entrer dans cette logique. En effet, nos marins comparent toujours leur situation avec celles de leurs homologues de l’armée de terre et de l’armée de l’air, qui sont favorisés.
Il faudrait s’interroger sur le fondement même des régimes indemnitaires : l’ISSE, qui est, rappelons-le, une indemnité de sujétion pour services extérieurs qui a pour but de compenser non pas tant la sujétion des militaires que celle de leur famille qui, en l’absence du chef de famille, doivent continuer à vivre de façon décente. Je pense au cas récent d’un officier-marinier dont l’épouse avait dû changer, en son absence, le chauffe-eau en panne : s’il n’avait pas été en mer, il aurait pu effectuer lui-même la réparation et réaliser ainsi de substantielles économies.
Il convient d’observer que le régime de rémunération des militaires aux États-Unis et au Royaume-Uni est singulièrement différent du nôtre puisqu’il n’y a pas d’écart significatif de rémunération, pour les militaires restés au pays et ceux qui sont projetés en opérations extérieures. En contrepartie, la solde normale est surévaluée. La France a choisi la « prime aux bons élèves ».
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. La marine a été « armée pilote de soutien » lors du tsunami. Depuis cet événement, a-t-elle été amenée à remplir à nouveau ce rôle ?
M. le capitaine de vaisseau Christophe Caillet. Oui. La marine est « armée pilote de soutien » pour l’opération Atalanta de lutte contre la piraterie, mais ce rôle est largement fictif puisqu’elle est seule présente sur zone. Par ailleurs, nous sommes également « armée pilote de soutien », non pas dans le cadre d’une opération, mais dans le cadre d’une implantation permanente, à Abou Dhabi, où nous soutenons le fonctionnement des autres armées.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Quel est le surcoût associé à ce rôle ?
M. le vice-amiral Xavier Magne. Ce type d’opérations ne génère aucun surcoût. En effet, le système logistique de la marine est dimensionné pour assurer de telles opérations. J’ignore si les armées de terre et de l’air sont dans la même situation, mais à ma connaissance, en ce qui concerne la marine, aucun problème majeur n’est à signaler.
Je me permettrais de faire une remarque complémentaire concernant la gestion budgétaire. D’après mon expérience – ces propos n’engagent que moi – le principe d’annualité budgétaire peut s’avérer problématique. En effet, de longue date, nous faisons des efforts pour gérer nos budgets de la façon la plus serrée possible. Or Bercy – tel un boa constrictor – ne tient pas compte de ces efforts et resserre systématiquement la contrainte budgétaire, sitôt que notre effort d’économies permet de dégager des marges de manœuvre. Ceci est pervers et incite à la débauche de moyens, puisque nous n’avons pas la possibilité, en prévision de difficultés ultérieures, de « stocker » puis d’utiliser les économies précédemment réalisées. Je pense ainsi à la question du carburant, dont la flambée des cours a été source de réelles difficultés l’an dernier. Tout se passe comme si nous étions invités à dépenser systématiquement la totalité des financements qui nous sont alloués, ce qui n’est pas satisfaisant.
Si l’on souhaite s’inscrire dans une logique de gestion vertueuse, il faut donner une vraie marge de manœuvre. Ainsi, il y a quelques années, un système de transferts et de reports d’une année sur l’autre avait été institué sur les bases aéronavales. Il a été supprimé, ce que je trouve dommage, puisqu’il permettait cette conciliation entre une logique vertueuse de réduction des dépenses et une certaine souplesse de gestion en autorisant l’éventuelle utilisation ultérieure des économies réalisées.
M. Georges Tron, Président. Je vous remercie.
Audition du 14 mai 2009
À10 heures 15 : M. Hervé Morin, ministre de la Défense
Présidence de M. David Habib, Président
M. David Habib, Président. Monsieur le ministre, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette dernière séance de la mission d’évaluation et de contrôle consacrée aux opérations militaires extérieures, notamment sous mandat international. Comme vous le savez, nous avons demandé à deux parlementaires issus de deux commissions et de deux groupes différents de bien vouloir procéder à cette évaluation, comme nous l’avions fait l’an dernier pour les programmes d’armement de la marine, sur lequel les deux parlementaires alors chargés du rapport avaient formulé des préconisations portant notamment sur l’articulation entre programmation militaire et budget.
Nos deux rapporteurs, Mme Françoise Olivier-Coupeau et M. Louis Giscard d’Estaing, connaissent très bien ces questions et sont rentrés hier d’un déplacement en Afghanistan, après être allés au Tchad et au Kosovo.
Je salue en outre les trois représentants de la Cour des comptes qui accompagnent nos travaux : M. Alain Hespel, Président de la deuxième chambre, Mme Françoise Saliou, et M. Benoît d’Aboville.
Il ne s’agit nullement ici, à l’heure où le Parlement se penche sur son règlement, d’empiéter sur les prérogatives de la commission de la Défense. Il ne s’agit pas davantage de subordonner la politique de la défense à des préoccupations budgétaires, mais bien plutôt de s’assurer de la bonne utilisation des fonds publics, dans le cadre de la LOLF et du rôle imparti à la Mission d’évaluation et de contrôle par le bureau de la commission des Finances et son Président, M. Didier Migaud.
M. Hervé Morin, ministre de la Défense. Les opérations extérieures connaissent aujourd’hui deux innovations majeures. L’une, d’ordre institutionnel, est le fait que Parlement doive désormais autoriser la prolongation d’une intervention au-delà de quatre mois. Outre l’expression démocratique qu’elle permet, cette mesure est un aiguillon utile pour l’exécutif, et particulièrement le ministère de la Défense, car elle oblige à vérifier en permanence l’adéquation de notre présence aux besoins opérationnels et à la situation du pays concerné et à procéder aux ajustements nécessaires.
L’autre innovation, qui fait suite au Livre blanc, concerne le traitement budgétaire des opérations extérieures. Ce que réclamaient les parlementaires depuis des années va enfin trouver sa traduction dans la loi de programmation militaire. La provision en loi de finances initiale, destinée à financer le surcoût des Opex, qui n’était encore en 2004 que de 24 millions d’euros, est passée à 100 millions d’euros en 2005, 175 en 2006 et 360 en 2007, et depuis l’entrée en fonctions du Président de la République et de l’actuel gouvernement, à 460 millions d’euros en 2008 et 510 en 2009. Mais à cette dotation très fortement revalorisée, le projet de loi de programmation militaire prévoit d’ajouter 60 millions d’euros en 2010 et à nouveau 60 millions en 2011, dont 30 millions pris sur le budget global du ministère de la Défense et 30 millions d’euros sur la réserve de budgétisation. Et surtout, dès 2009, au-delà de cette provision ainsi revalorisée, nous bénéficierons de la réserve de précaution, ce qui assurera enfin la sincérité budgétaire que demandait en vain la représentation nationale depuis fort longtemps.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier tout d’abord de l’effort réalisé par le ministère de la Défense pour parvenir à la sincérité budgétaire que le Parlement appelait en effet depuis longtemps de ses vœux. Je tiens également à remercier votre ministère et tous les militaires qui ont parfaitement répondu à toutes nos attentes au cours des missions que nous avons effectuées. Je salue en particulier le commissaire-colonel Éric Rémy-Néris, ici présent, qui, avec l’ensemble de l’équipe du Commissariat, a considéré que notre mission ne faisait que conforter l’effort engagé par l’ensemble des militaires en opérations en matière de justification des dépenses engagées et de refacturations entre nations participantes.
Nous sommes bien conscients que le calcul des coûts liés aux Opex n’est pas chose facile. Malgré la volonté du ministère de retracer ces dépenses avec précision, de nombreux coûts ne sont pas pris en compte. Désireux d’examiner le financement des opérations extérieures dans sa globalité, nous souhaitons pour notre part ne pas nous limiter à la notion de surcoûts. Nous nous intéressons donc notamment aux bonifications de carrière, aux pensions d’invalidité, à la hausse du coût de l’entretien – le MCO, maintien en condition opérationnelle –, à l’usure prématurée, voire à la perte, des matériels sur place, au soutien de militaires étrangers, ainsi qu’aux coûts spécifiques de formation préalable à l’envoi en opérations. Comptez-vous approfondir le travail de clarification engagé, afin que nous ayons la vision la plus complète possible du coût des Opex ?
Vous avez en partie répondu à la question que je voulais vous poser sur la justification des 60 millions d’euros supplémentaires prévus en 2010 puis en 2011. Néanmoins, qu’en est-il de la diminution des coûts en Côte d’Ivoire et au Tchad, avec le passage de relais de l’EUFOR à la MINURCAT ?
Enfin, où en est la réforme de l’instruction de 1984, que chacun dit appeler de ses vœux mais qui n’avance guère ? Des désaccords subsistent-ils entre les ministères du Budget et de la Défense sur les notions de coût et de surcoût des opérations extérieures et sur leur imputation budgétaire, voire leur remboursement par la loi de finances rectificative ?
M. le ministre. Nous sommes en effet en train de réviser l’instruction commune des ministères chargés des finances et de la défense et faisons nôtres les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur ce point.
Le coût du MCO augmente considérablement en opération extérieure. Ainsi, le coût d’entretien programmé des chars Leclerc au Liban représente à lui seul de 10 % à 15 % de l’ensemble du MCO pour ces matériels. La difficulté, que saisira aisément le député du Puy-de-Dôme, avec qui j’ai visité hier des ateliers aéronautiques à Clermont-Ferrand, est que, si nous tendons à généraliser les contrats globaux destinés à intégrer le coût d’acquisition des programmes et celui de leur utilisation, voire de leur destruction, l’externalisation d’une partie de l’entretien programmé du matériel rend cette intégration problématique. En matière de personnel, par ailleurs, l’intégration des surcoûts est méthodologiquement très difficile.
Du reste, les armées ayant vocation à se projeter pour assurer la sécurité et la stabilité de théâtres de crise dans le cadre de la politique étrangère de la France, il ne me semble pas choquant que certains surcoûts ne soient pas clairement identifiés dans la loi de finances et qu’un reliquat demeure à la charge du ministère de la Défense, la sincérité et la transparence de la loi de finances dussent-elles en souffrir un peu.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Sur des terrains d’opérations enclavés, comme l’Afghanistan ou le Tchad, la logistique reste un facteur de coûts très important. Le fait que les unités ne se rendent plus sur ces théâtres avec leur matériel, mais trouvent sur place les véhicules qu’elles utiliseront impose à ces derniers, destinés à rester plus d’un an sur place, un vieillissement accéléré. Quelle est votre politique de MCO pour l’ensemble de l’armée de terre, compte tenu du fait que ce matériel n’est pas disponible pour les unités demeurées en métropole ?
M. le ministre. La politique d’emploi et de gestion des parcs que nous mettons en place – et qui est loin d’être achevée – obéit à un motif géostratégique : après la disparition du Pacte de Varsovie, s’il est cohérent que, comme le prévoit le Livre blanc, nous disposions d’un niveau d’équipement nous permettant de répondre à une crise majeure, une partie de ce parc est en quelque sorte mise en réserve, sans être physiquement « sous cocon », c’est-à-dire que nous limitons l’utilisation de nos équipements à nos besoins en vue d’opérations extérieures et pour l’entraînement de nos forces. Il faut donc avoir à l’esprit l’idée, qui peut paraître choquante mais qui est cohérente, dont j’ai vu l’illustration en visitant le camp de blindés de Mourmelon : il y a des équipements dont nous n’assurons pas le MCO, parce que nous ne sommes pas dans une situation nécessitant de projeter 30 000 hommes. En outre, compte tenu du coût du transport, il serait incomparablement plus cher de déployer nos forces avec leur matériel que d’assumer l’usure rapide de certains équipements.
M. Jean-Louis Dumont. La question qui se pose me paraît être surtout celle de l’utilité des équipements. On peut se demander si, pour l’armée de terre, ce débat n’est pas tranché au nom d’objectifs financiers plutôt qu’en termes stratégiques. Au regard des observations du Livre blanc, en particulier sur les régiments projetables, la forme d’utilisation des blindés ne devrait-il pas être fondée sur les critères de réussite des missions et de sécurité des hommes ?
M. le ministre. Les objectifs fixés par le Livre blanc – la capacité de projeter 30 000 hommes sur un théâtre majeur pour une durée de six mois et 5 000 hommes sur un théâtre secondaire, avec 320 blindés en parc et 254 opérationnels – n’ont aucunement été dictés par des considérations financières. Mon souci est plutôt que chaque régiment de blindés dispose d’un potentiel un peu plus important, ce à quoi nous réfléchissons dans le cadre de la politique d’emploi et de gestion des parcs et des discussions menées avec Nexter pour réduire le coût du MCO des blindés. Dans la réalité, en effet, des militaires du rang qui ont été recrutés pour être conducteurs de char n’ont parfois guère l’occasion de conduire un char. Malgré les camps d’entraînement intensif auxquels participent les troupes, il conviendrait que l’entraînement quotidien sur blindés atteigne un niveau propre à assurer la fidélisation et la motivation de nos unités. Dans le contexte de la politique d’emploi et de gestion des parcs, on pourrait s’interroger sur le choix de spécialisation des régiments qui a été fait voilà une quinzaine d’années, et imaginer des régiments davantage mixtes. Nous travaillons, avec le chef d’état-major, à relever le potentiel des régiments de chars. Le déploiement de chars Leclerc au Liban exprime d’ailleurs une capacité de réaction et de forces très bien perçue par nos camarades de la FINUL. Cette capacité peut sembler coûteuse lorsque les temps sont paisibles, mais elle est un élément de présence et de puissance fort utile lorsque la situation se tend au sud du Litani.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Comment justifier l’achat en urgence d’équipements destinés à des Opex qui durent déjà depuis plusieurs années, notamment en Afghanistan ? Les matériels dont nos forces ont besoin n’auraient-ils pas dû être achetés au cours des exercices budgétaires passés, dans le cadre de procédures classiques, beaucoup moins onéreuses ? Je pense notamment, aux chenillettes finlandaises d’Hägglunds demandées par le général Thorette, alors chef d’état-major de l’armée de terre, refusées par la ministre de l’époque et par le DGA, et qui doivent aujourd’hui être achetées en urgence.
Par ailleurs, les responsables que nous avons rencontrés à Kaboul nous ont indiqué que le parc de voitures civiles que nos militaires utilisent en Afghanistan est loué et non acheté. Si le prix de location d’une voiture civile non blindée, de l’ordre de 600 euros par mois, reste acceptable, celui d’un véhicule civil blindé est de 6 600 euros par mois, soit onze fois plus. Le marché est étroit et le nombre de prestataires est faible, ce qui fait de nos forces une clientèle captive. Le coût d’un véhicule blindé neuf étant compris entre 80 000 à 100 000 euros, un achat serait rentabilisé en 12 à 15 mois. Or la durée de vie d’un tel engin en Afghanistan est estimée à trois ans au moins. Pourquoi, donc, choisit-on de louer plutôt que d’acheter ? Les militaires nous ont répondu que la location était une dépense de fonctionnement de titre 3, donc inscrite dans le coût des Opex et faisant l’objet d’un remboursement en fin d’exercice, dans le cadre du collectif budgétaire, alors qu’une acquisition patrimoniale constituait une dépense de titre 5, non éligible au remboursement au titre des surcoûts des Opex. De ce fait, en termes comptables, acquérir 20 à 25 véhicules civils blindés équivaut à renoncer à l’achat d’un VBCI ou d’un canon Caesar. Ainsi, pour des raisons d’ordre administratif, le contribuable paie beaucoup plus cher.
M. le ministre. Le coût d’un VBCI est de 4 millions d’euros.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Soit, mais le raisonnement reste valide. À ma connaissance, la LOLF autorise la « fongibilité asymétrique » des crédits, c’est-à-dire l’affectation en titre 5 de crédits non utilisés en titre 3, en vue d’encourager les comportements vertueux. Ne pourrait-on recourir à cette fongibilité pour passer de la location à l’achat ? Je vous serais reconnaissante de bien vouloir demander à vos services de vérifier ces informations et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires.
M. le ministre. Les informations qui vous ont été fournies ne correspondent pas à la réalité administrative. La France étant engagée au sein d’une coalition, c’est cette dernière qui loue les véhicules. Cela dit, la fongibilité permet en effet d’acheter du matériel avec des crédits destinés aux Opex.
Je rappelle par ailleurs que ma décision d’acquisition de matériel a été prise lorsque le Président de la République a décidé d’engager des troupes en région Est, en vallée de Kapisa, c’est-à-dire avant la perte de dix de nos soldats, le 18 août, à Ouzbin. Ces achats représentaient environ 100 millions d’euros. Nos troupes, longtemps engagées dans la zone la plus tranquille d’Afghanistan, n’avaient alors pas les mêmes besoins que celles qui étaient engagées dans le Sud ou l’Est du pays et il nous a donc fallu adapter l’équipement aux nouvelles conditions d’engagement.
Se pose en outre une question de fond : alors que les programmes à effet majeur sont toujours assez préservés en cas de régulation budgétaire, les programmes de cohérence opérationnelle, de moindre ampleur mais d’une très grande importance au quotidien pour nos troupes sur le terrain, sont les premiers sacrifiés. Aussi, dès que la situation l’exige, nous leur restituons toute la place qu’ils méritent. Les parlementaires sont en effet prompts à protester quand on renonce à deux Caracal supplémentaires, mais je n’en ai jamais entendu un déplorer la suppression d’un programme de cohérence opérationnelle. Je vous invite d’ailleurs à assurer sur le sujet votre vigilance démocratique.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Pour assurer l’hébergement de nos militaires en opérations extérieures, il existe actuellement trois possibilités : la tente, le module préfabriqué du type Corimec ou Algeco, et la construction en dur.
À Abéché, lors de la relève de l’EUFOR par la MINURCAT, l’ONU a refusé de racheter pour une trentaine de millions d’euros les installations du camp des Étoiles. Les préfabriqués auraient-ils vocation à être démontés et rapatriés à l’issue des opérations extérieures ? Cela semble impraticable pour des raisons de coût.
Nous avons donc été favorablement impressionnés par les bâtiments en dur construits sur la base opérationnelle avancée de Tora, en Afghanistan. Les réalisations de ce type supposent une dépense initiale élevée, mais elles permettent d’assurer une meilleure protection des troupes, de donner du travail aux entreprises locales et, à l’issue de la période de stationnement de nos troupes, de laisser les bâtiments à la disposition de l’armée nationale ou de leur donner une affectation civile.
Quelle est votre stratégie dans ce domaine, Monsieur le ministre ?
M. le ministre. En Afghanistan, le choix de construire des installations en dur répond d’abord à la volonté d’assurer la sécurité de nos troupes. De surcroît, cela nous permettra en effet de céder aux autorités locales des infrastructures pérennes à l’issue de notre mission.
Lors de ma première visite au Liban, j’ai été scandalisé par les conditions dans lesquelles nos soldats étaient hébergés. Depuis 1978, ils vivaient sous la tente et dans la poussière, alors que, cent mètres plus loin, les Qatarotes bénéficiaient de modules climatisés. À ma demande, le chef d’état-major a fait réaliser les travaux d’aménagement nécessaires.
En général, au départ de nos troupes, nous cédons les modules préfabriqués. Le problème, au Tchad, est que l’ONU refuse de verser la somme demandée.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Monsieur le ministre, j’aimerais avoir votre sentiment sur les opérations d’externalisation, et en particulier sur l’opération CAPES France ? Est-elle vraiment de nature à engendrer des économies ? Quelles sont vos perspectives en la matière ? L’externalisation est-elle compatible avec la dangerosité de certaines opérations, en particulier en Afghanistan ?
Nous sommes par ailleurs très déçus que les entreprises françaises ne soient pas davantage présentes en Afghanistan.
M. le ministre. J’ai défini, il y a un mois et demi, le cadre de la politique d’externalisation du ministère. Comme libéral, j’ai toujours pensé qu’il était bon d’expérimenter avant de généraliser. J’ai donc commandé deux études, l’une sur la base de Creil, l’autre sur une base de défense expérimentale, afin d’examiner jusqu’où l’externalisation peut être poussée et d’en évaluer les conséquences, notamment financières.
Par ailleurs, la révolution culturelle et structurelle engagée au sein du ministère, avec la création des bases de défense, avec la mutualisation et « l’interarmisation » des fonctions de soutien et de l’administration générale, va déjà provoquer la suppression de 54 000 postes, les crédits libérés étant dédiés à l’équipement des forces. Par conséquent, je souhaite que le processus d’externalisation soit progressif : on ne peut pas tout faire en même temps.
J’ai fixé plusieurs critères.
En premier lieu, il faut tenir compte des nécessités opérationnelles et des impératifs de sécurité. Certains services doivent impérativement être conservés en interne. Toutefois, j’ai demandé à mon cabinet de vérifier, dans le détail, le bien-fondé de ces exigences, d’autres pays ayant fait d’autres choix que les nôtres. Ainsi, en Afghanistan, la maintenance et la mise en œuvre des drones britanniques sont assurées par Thalès. L’armée allemande, quant à elle, a lancé avec Siemens, et avec l’appui d’IBM, l’ambitieux programme Héraclès sur les systèmes d’information et de communication, tandis que pour notre part, en choisissant la voie interne, nous avons rencontré de nombreux problèmes de compatibilité et d’interopérabilité.
Ensuite, nous devons avoir l’assurance que, à moyen et long terme, l’opération d’externalisation sera rentable – au niveau de l’État et non du seul ministère de la Défense : certaines opérations neutres pour le ministère peuvent en effet être rentables pour l’État grâce aux recettes de la TVA.
Il faut aussi vérifier que ces opérations d’externalisation ne conduisent pas à une relation déséquilibrée entre l’État et un oligopole, comme cela s’est produit pour les collectivités locales dans le domaine de la collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, il convient que les entreprises bénéficiaires des contrats aient l’obligation de faire une offre d’embauche au personnel concerné.
Enfin, les marchés d’externalisation ne doivent pas bénéficier seulement à quelques grands groupes avec lesquels on passerait des contrats nationaux globaux, mais irriguer le réseau des PME.
Ce mouvement d’externalisation, que nous mènerons à partir de 2010, s’appliquera à plusieurs domaines.
En ce qui concerne les systèmes d’information et de communication, il y a d’abord un gros travail à mener en amont. Le directeur général des SIC, qui n’avait jusqu’à présent aucune autorité sur les états-majors, va avoir la responsabilité du budget et des commandes. Auparavant, les états-majors choisissaient leurs systèmes sans se concerter ; le résultat, c’est que, par exemple, pour mutualiser la gestion des ressources humaines, nous devons commencer par rendre les systèmes d’information compatibles. Concernant la bureautique, nous devons faire comme les collectivités, c’est-à-dire passer des contrats globaux de fourniture et de maintenance, prévoyant un renouvellement régulier des matériels, de manière à uniformiser l’ensemble de notre parc, qui est gigantesque.
Concernant les infrastructures, nous conserverons des compétences en interne pour des réalisations spécifiques, mais pour construire des logements ou des gymnases, il faut évidemment faire appel à des maîtres d’œuvre privés.
S’agissant de l’alimentation, je souhaite que le processus soit plus progressif, eu égard à l’importance des effectifs concernés. Il faut que nous puissions proposer des alternatives au personnel civil touché par les mesures de rationalisation.
Enfin, en matière d’habillement, je souhaite mettre fin à la politique actuelle consistant à constituer des stocks de treillis et de chaussures de diverses tailles, et demander aux entreprises de livrer, à date fixe, des vêtements pour chaque unité, aux tailles correspondant exactement à leurs besoins.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Pour les opérations extérieures, deux éléments sont très importants : la sécurité, mais aussi les conditions de vie. Or, sur la FOB Tora, nous avons mangé une nourriture délicieuse, confectionnée par des Turcs, mais selon les soldats, le menu est le même tous les jours.
M. le ministre. Excusez-moi, madame la rapporteure, mais ce genre de problème n’est pas du ressort du ministre : c’est au commandant d’unité de faire le nécessaire ! Je pourrais moi aussi vous rapporter des anecdotes. Par exemple, alors qu’il existe une vingtaine de menus différents dans les rations de combat, le capitaine d’une OMLT m’a raconté qu’il avait reçu, pour nourrir ses cinquante hommes durant six mois, une palette de rations toutes identiques…
M. Jean-Louis Dumont. En ce qui concerne l’externalisation, faites-vous une différence entre les régiments stationnés en métropole et les Opex ? Avez-vous tiré des enseignements des opérations menées en coopération avec d’autres pays ?
M. le ministre. Non, je ne fais pas de différence selon le lieu de stationnement.
S’agissant de CAPES France, l’expérimentation a été lancée après le retrait de l’essentiel des forces françaises en Allemagne. Les premiers résultats financiers montrent qu’à périmètre constant, le système est plus onéreux qu’une gestion en régie. En effet, les tâches concédées à l’économat des armées étaient pour la plupart déjà exécutées par des personnels civils recrutés localement, donc moins bien rémunérés. Les effectifs militaires économisés ayant été redéployés ailleurs, il n’y a eu aucune économie salariale en interne. Enfin, le coût de l’intervention de l’opérateur représente entre 8 et 10 % du chiffre d’affaires.
M. Louis Giscard d’Estaing, Rapporteur. Ne pensez-vous pas que dans la stricte logique de la LOLF, un certain nombre de dépenses actuellement prises en charge par le ministère de la Défense dans le cadre des missions de stabilisation et de maintien de la paix ou des actions civilo-militaires devraient être imputées sur le budget d’autres ministères, au titre soit de la coopération, soit de l’aide au développement, soit de l’aide à la formation des cadres locaux ?
De même, l’action du service de santé des armées en Opex est de toute évidence dimensionnée non seulement pour assurer le soutien médical de nos troupes, mais aussi, et même surtout, pour apporter des soins aux populations civiles locales. Comment pourrait-on traduire cela sur le plan budgétaire ?
M. le ministre. Il vaut mieux que ces actions restent financées par le ministère de la Défense car s’engager dans des discussions interministérielles nous ferait perdre de l’autonomie, de la flexibilité et de la réactivité.
La coopération civilo-militaire a une très grande importance. Certes, on n’y consacre pas assez de moyens, mais les officiers qui s’en occupent réalisent des prouesses, notamment en ayant recours à des financements européens complémentaires. En outre, ces activités, ainsi que l’action des équipes de santé, permettent de renforcer les liens entre nos soldats et les populations locales.
Quant à la formation des cadres, on peut souhaiter qu’elle ait un caractère plus interministériel, mais l’autonomie de gestion a ses avantages.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Les cinq premiers gendarmes français sont arrivés en Afghanistan. Quel est le cadre budgétaire de cette opération ?
M. le ministre. Il s’agit d’une provision sur le programme 152 Gendarmerie.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Comment cela se passera-t-il sur le terrain ?
M. le ministre. Nous avons demandé à la gendarmerie de mettre les crédits à la disposition du directeur du commissariat de la FIAS.
Mme Françoise Olivier-Coupeau, Rapporteure. Nous avons visité l’hôpital médico-chirurgical « Rôle 2 » à Kaia Nord, près de Kaboul. Sa construction s’achève et il devrait bientôt entrer en service. Hôpital international dépendant de l’OTAN, il sera servi principalement par des personnels français. Louis Giscard d’Estaing et moi-même souhaiterions, si c’est possible, qu’il porte le nom du sergent Rodolphe Penon, mort de manière héroïque le 18 août 2008 à Ouzbin. Ce serait une façon de rendre hommage à l’ensemble des soldats tombés sur ce théâtre. Nous vous adresserons un courrier officiel à l’appui de cette demande.
M. le ministre. Je vous répondrai, mais des morts susceptibles d’être honorés, il y en a eu malheureusement bien d’autres en Afghanistan. Les Canadiens ont perdu 120 hommes, les Anglais 150, les Américains 700. Cela étant, j’ai parfaitement en mémoire l’action héroïque du sergent Penon, qui a trouvé la mort en portant secours à ses camarades malgré ses blessures. Par ailleurs, nous allons en effet avoir la responsabilité du fonctionnement de l’hôpital au début, mais il y aura des rotations annuelles.
M. David Habib, Président. Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses.
Je précise que le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle sur les opérations militaires extérieures devrait être présenté à la fin du mois de juin.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Les opérations militaires extérieures de la France, Cour des comptes, 8 juillet 2009.
3 () Hors gendarmerie, ce chiffre s’élève à 830 millions d’euros. Mais en 2008, les crédits de la gendarmerie étaient inclus dans la mission Défense
4 () La conversion en euros a été effectuée à la date du 30 juin 2009 au taux de 1 euros = 1,40 dollars
5 () Cette somme est à ajouter au budget du ministère américain de la défense qui s’élèvera, pour l’année fiscale 2008, à 480 milliards de dollars (environ 343 milliards d’euros).
© Assemblée nationale
