

N° 1811
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique
des personnes majeures placées sous main de justice
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Étienne BLANC
Député
en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par
M. Jean-Luc WARSMANN1
Député.
——
La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, président ; Mme Delphine Batho, M. Christian Vanneste, vice-présidents ; M. Étienne Blanc, Mme Michèle Tabarot2, rapporteurs ; MM. Jacques-Alain Bénisti, Serge Blisko, Marcel Bonnot, Mme Monique Boulestin3, MM. François Calvet, Christophe Caresche1, Éric Diard, Nicolas Dupont Aignan1, Guy Geoffroy, Claude Goasguen, Philippe Houillon, Paul Jeanneteau2, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Lambert, Bruno Le Roux, Arnaud Montebourg1, Bertrand Pancher1, Dominique Raimbourg, Jacques Valax, Manuel Valls, François Vannson, Michel Vaxès, Philippe Vuilque.
INTRODUCTION 11
PREMIÈRE PARTIE : AMÉLIORER L’ARTICULATION ENTRE SANTÉ ET JUSTICE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES 15
I. FACE AUX IMPORTANTS BESOINS DE SANTÉ DES DÉTENUS, D’INDÉNIABLES PROGRÈS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS 15
A. LA POPULATION PÉNALE PRÉSENTE À CE JOUR UN ÉTAT SANITAIRE GLOBALEMENT DÉGRADÉ 15
1. La santé des personnes détenues en prison : un état somatique jugé bon, mais des besoins qui restent importants 15
a) Une insuffisante connaissance de l’évolution de la santé des prisonniers 17
b) Une population surexposée au VIH et aux hépatites 17
c) Une population à la santé bucco-dentaire profondément dégradée 19
d) Une population fortement touchée par différentes formes d’addiction 20
2. Les troubles psychiatriques en détention : une place croissante et de plus en plus préoccupante 20
a) Un recours aux soins de santé mentale dix fois supérieur à celui observé en population générale 20
b) Un taux de pathologie mentale vingt fois supérieur à celui observé en population générale 21
c) Un taux de suicide en prison qui diminue ces dernières années, mais qui demeure important comparé à la situation au sein de la population générale 23
B. L’OFFRE DE SOINS SOMATIQUES ET PSYCHIATRIQUES AUX DÉTENUS : DES GRANDS PRINCIPES FIXÉS AU MILIEU DES ANNÉES 1990 23
1. La réforme mise en place par la loi du 18 janvier 1994 a permis d’incontestables progrès en matière de soins somatiques 24
a) Premier volet de la loi du 18 janvier 1994 : les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) 24
b) Deuxième volet de la loi du 18 janvier 1994 : les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) 26
2. La santé mentale des personnes détenues : un dispositif de soins spécifique reposant essentiellement sur les soins ambulatoires 28
a) Les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) : des secteurs psychiatriques à part entière 28
b) Seules les unités pour malades difficiles (UMD) offrent aujourd’hui un cadre sécurisé aux personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux. 29
c) Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) : répondre aux difficultés rencontrées lors de l’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux 30
3. Les moyens humains et financiers alloués à la prise en charge sanitaire des personnes détenues 31
a) Les moyens financiers 31
b) Les moyens humains 32
II. CERTAINES DIFFICULTÉS FONT AUJOURD’HUI OBSTACLE À UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET COHÉRENTE 34
A. L’OFFRE DE SOINS SOUFFRE ACTUELLEMENT D’UN MANQUE DE PILOTAGE STRATÉGIQUE AU NIVEAU NATIONAL COMME RÉGIONAL 34
1. Une offre de soins inégalement répartie et ne répondant pas à l’ensemble des besoins 34
a) Une hétérogénéité de moyens entre établissements pénitentiaires 34
b) Une offre de soins ne répondant pas à l’ensemble des besoins, notamment en psychiatrie 35
2. Santé et Justice : un pilotage déficient empreint de défiance 36
a) Au niveau national 36
b) Au niveau régional et local 38
B. LA COOPÉRATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS INTERVENANT EN PRISON EST TROP SOUVENT DÉFAILLANTE 40
1. Les relations entre les UCSA et les SMPR sont marquées par des logiques de territoire 40
2. Les relations entre les services médicaux et l’administration pénitentiaire sont marquées par la méfiance et l’incompréhension 42
a) Une prise en charge sanitaire des personnes détenues reposant sur l’intervention d’un grand nombre d’acteurs 42
b) Une nécessaire, mais difficile coopération entre médecins et administration pénitentiaire en matière sanitaire 43
c) Le délicat équilibre entre priorités afférentes à la vie carcérale et priorités sanitaires 45
d) L’organisation des extractions médicales demeure un point de blocage majeur 46
C. ASSURER LA CONTINUITÉ DES SOINS, NOTAMMENT PSYCHIATRIQUES, APRES LA SORTIE DE PRISON 48
1. Éviter que la libération ne signifie l’interruption brutale des soins 48
2. Repenser le suivi des soins psychiatriques après la sortie de prison dans une véritable démarche de réinsertion 49
D. LE SECRET MÉDICAL : UN FAUX-PROBLÈME ? 52
1. Le secret médical cristallise les tensions entre personnels soignants et administration pénitentiaire 52
2. Les réponses apportées par le législateur, à l’instar de l’échange d’informations opérationnelles, restent trop souvent méconnues 53
a) Le secret médical, composante du secret professionnel, s’inscrit dans un cadre juridique clairement défini par le code de la santé publique et le code pénal 53
b) « L’échange d’informations opérationnelles » prévu par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté 55
DEUXIÈME PARTIE : REDYNAMISER LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE POUR UNE PRÉVENTION PLUS EFFICACE DE LA RÉCIDIVE 59
I. LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, UNE MESURE SINGULIÈRE ET PORTEUSE D’EFFICACITÉ POUR LUTTER CONTRE LA RÉCIDIVE 59
A. LA MISE EN PLACE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE D’ÉLARGISSEMENT DES SOINS PÉNALEMENT ORDONNÉS 59
1. Une mesure présentant un caractère sui generis, intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté 59
2. Initialement réservé aux infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a été étendu à l’essentiel des infractions violentes 60
3. En 2007, le législateur a décidé de généraliser l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire 61
a) Les obligations du suivi socio-judiciaire 61
b) La généralisation de l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire 62
B. LES CONDAMNATIONS À UNE MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE : UN BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 17 JUIN 1998 64
1. Le suivi socio-judiciaire a été ordonné dans 11 % des cas où le prononcé d’une telle mesure était possible 64
a) Après un recours très restreint au suivi socio-judiciaire, la montée en charge de cette mesure s’est accélérée à partir de 2000 64
b) Bien qu’encore marginale, la mesure de suivi socio-judiciaire est d’un ordre de grandeur comparable à la réclusion criminelle 64
c) Une mesure davantage destinée aux auteurs de crimes 65
d) Une mesure réservée aux condamnés majeurs 65
2. Une mesure appliquée en priorité aux crimes et délits sexuels sur mineurs 66
a) 96 % des condamnés à un suivi socio-judiciaire en 2007 ont commis une infraction sexuelle 66
b) Les condamnés à un suivi socio-judiciaire pour crime ont majoritairement commis un viol 67
c) Les condamnés à un suivi socio-judiciaire : une population différente des autres délinquants sexuels 68
3. Plus des trois quarts des condamnés à un suivi socio-judiciaire sont également condamnés à une peine de prison ferme 69
a) Le suivi socio-judiciaire prononcé pour crime complète systématiquement une peine de prison ferme 69
b) La durée moyenne d’une peine de suivi socio-judiciaire est actuellement de près de 6 ans 70
II. LA PRATIQUE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE RÉVÈLE L’EXISTENCE DE FAIBLESSES IMPORTANTES AUXQUELLES IL EST ESSENTIEL DE REMÉDIER RAPIDEMENT 72
A. L’EXTENSION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, MOTIVÉE PAR L’INTÉRÊT CONSTANT QUE PORTE LE LÉGISLATEUR À UNE PEINE RÉPUTÉE POUR SON EFFICACITÉ, POSE QUESTION 72
1. L’application du suivi socio-judiciaire se heurte actuellement à des difficultés importantes 72
a) Le manque de médecins coordonnateurs 72
b) Les faiblesses du dispositif de l’injonction de soins 76
2. Le risque de voir le suivi socio-judiciaire se banaliser et perdre toute son efficacité n’est pas négligeable 77
B. SIMPLIFIER ET CLARIFIER LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE POUR UNE MESURE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE PLUS LISIBLE ET PLUS EFFICACE 79
1. Une nécessaire clarification des textes en vigueur 79
a) Fixer plus clairement l’obligation de compte rendu du médecin coordonnateur 79
b) Clarifier le recours à l’injonction de soins et à l’obligation de soins pour rendre cohérent le dispositif de soins pénalement ordonnés 80
c) Simplifier le corpus des obligations du suivi socio-judiciaire 84
d) Abroger ou modifier les textes inappliqués ou peu appliqués 86
2. Un suivi socio-judiciaire qui devrait être engagé dès le début de l’incarcération et être plus souple dans ses modalités d’exécution 88
a) Pour un suivi socio-judiciaire actif dès le début de l’incarcération 88
b) Pour un suivi socio-judiciaire plus souple, seul capable de faire face à la montée en charge du dispositif 89
TROISIÈME PARTIE : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE ET LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS LIÉES À L’ALCOOL 91
I. UNE POPULATION SOUS MAIN DE JUSTICE FORTEMENT TOUCHÉE PAR LES PROBLÈMES D’ADDICTION À L’ALCOOL 91
A. UNE PRÉVALENCE DE LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL PLUS FORTE CHEZ LES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE QU’EN POPULATION GÉNÉRALE 91
1. La consommation d’alcool en France : un impact élevé sur la santé publique 91
a) Chez les jeunes, comme chez les adultes, l’alcool est la substance psychoactive la plus consommée en France 91
b) L’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France 93
2. La population carcérale est particulièrement touchée par les problèmes d’addiction à l’alcool 94
a) La dépendance à l’alcool chez les entrants de prisons 94
b) La dépendance à l’alcool chez les détenus accueillis par les SMPR 94
B. ALCOOL ET INFRACTIONS : CONDUITES À RISQUE ET PASSAGES À L’ACTE FACILITÉS 95
1. Alcool et violence entretiennent des relations complexes et dangereuses 95
2. La prévalence de l’alcool varie suivant le type d’infractions considéré, mais reste globalement marquée 96
a) Une forte prévalence de l’alcool lors de la commission des différentes infractions 97
b) Les infractions directement liées à l’usage d’alcool 99
c) Les infractions indirectement liées à l’usage d’alcool 102
II. MIEUX SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE LORS DES RENCONTRES AVEC LA JUSTICE 103
A. LA RENCONTRE AVEC LA JUSTICE : DES « OCCASIONS MANQUÉES » POUR PRÉVENIR LES INFRACTIONS LIÉES À L’ALCOOL ? 103
1. En pré-sentenciel : des opportunités de soins manquées, notamment pour les conducteurs en état alcoolique 103
a) En pré-sentenciel : un recours accru, mais encore insuffisant, aux alternatives aux poursuites 103
b) Seul un conducteur verbalisé pour une alcoolémie délictuelle sur quatre est incité à se soigner ou à maîtriser sa consommation 106
2. Au niveau de la condamnation : l’alcool est désormais, pour certaines infractions, une circonstance aggravante 107
3. En post-sentenciel : un dispositif de soins pénalement ordonnés étoffé, mais pour partie inappliqué 109
a) Les soins pénalement ordonnés permettent une réponse diversifiée, mais insuffisante, au niveau de l’application et de l’exécution des peines 109
b) Injonction thérapeutique et médecin relais : une mesure restée « lettre morte » depuis plus de deux ans 111
4. Une prise en charge de l’alcoolisme en détention très disparate suivant les établissements pénitentiaires 116
a) Les interventions alcoologiques spécifiques proposées aux détenus 116
b) La prise en charge interne menée par les services médicaux de l’établissement : dispositif interne et préparation à la sortie 117
B. FAIRE DE LA RENCONTRE AVEC LA JUSTICE UNE OCCASION RÉUSSIE DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE 119
1. Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues 2008-2011 apporte des premiers éléments de réponse 119
a) Prévenir la récidive de l’usage et du trafic de drogues chez les publics sous main de justice 119
b) Mieux sanctionner les infractions liées à l’usage 121
c) Améliorer la prise en charge et la continuité des soins délivrés aux usagers de drogues et d’alcool incarcérés 121
2. Donner sa pleine mesure à l’injonction thérapeutique et au médecin relais 123
a) Prendre sans délai les actes réglementaires d’application de l’injonction thérapeutique et du médecin relais 123
b) Étendre la possibilité d’injonctions thérapeutiques pour les infractions liées à l’alcool à tous les stades de la procédure 123
c) Étendre le stage de sensibilisation aux dangers de la drogue aux risques d’une consommation habituelle et excessive d’alcool 125
3. Délivrer de plus amples informations et de plus fortes incitations aux soins aux personnes placées sous main de justice 128
a) Expérimenter les entretiens alcoologiques en garde à vue à destination des personnes sous l’emprise d’un état alcoolique 128
b) Faire de tout passage devant la justice l’occasion d’une action de sensibilisation et de mise en relation avec un professionnel de santé 130
4. Accroître les mesures de soins alternatifs aux poursuites et ne recourir aux interventions pénales classiques qu’en cas d’échec ou de refus 132
a) Conduite en état d’alcoolisation : agir auprès des primo délinquants grâce au développement des interventions en groupe 132
b) Ivresse publique et manifeste : créer une exemption automatique du paiement de l’amende forfaitaire en contrepartie d’une mise en relation avec un professionnel de santé 133
c) Auteurs de violences sous l’effet de l’alcool : développer l’orientation vers les CSAPA en pré-sentenciel et en post-sentenciel 134
5. Améliorer la prise en charge des détenus présentant une dépendance à l’alcool ou ayant une consommation abusive 135
6. Renforcer la formation en addictologie de l’ensemble des acteurs pour une meilleure articulation entre action judiciaire et dispositif de santé 137
a) Renforcer la formation initiale et continue en addictologie 137
b) Parvenir à une meilleure articulation entre action judiciaire et prise en charge sanitaire grâce à une collaboration étroite de l’ensemble des acteurs 138
III. PROMOUVOIR UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN DIRECTION DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE PRÉSENTANT UNE ADDICTION À L’ALCOOL 139
A. LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE DE L’ADDICTION À L’ALCOOL SE HEURTE ACTUELLEMENT À D’IMPORTANTES DIFFICULTÉS 139
1. La délicate mise en place des CSAPA au détriment de la prise en charge de l’alcoolisme 140
a) La mise en place des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) rencontre des difficultés 141
b) Les CSAPA, lorsqu’ils sont créés, privilégient parfois la prise en charge de la toxicomanie au détriment de celle de l’alcoolisme 143
2. Une prise en charge sanitaire très inégale en raison d’une grande hétérogénéité de moyens 146
a) Une importante disparité quant au choix de la réponse pénale d’un parquet à l’autre 146
b) Une grande hétérogénéité des moyens selon les établissements pénitentiaires 146
c) Une forte disparité des moyens sanitaires à l’extérieur des prisons 147
3. Des difficultés de financement récurrentes compromettant la pérennité des actions engagées 148
B. POUR UNE RÉPONSE SANITAIRE CIBLÉE ET ADAPTÉE ASSOCIANT DÉPARTEMENTS ET NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT 152
1. Le département : un échelon pertinent pour développer une politique de prévention adaptée aux bassins de vie 152
2. Dégager de nouvelles ressources financières : une condition indispensable à la pérennité de toute politique publique de prise en charge et de prévention du risque lié à l’alcool 154
EXAMEN EN COMMISSION 157
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 173
GLOSSAIRE 181
LEXIQUE 183
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 189
LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS 195
ANNEXES 197
Pour la session parlementaire 2008-2009, la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale a décidé de prolonger ses travaux en se consacrant à la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice. À la rencontre de la santé et de la justice, cette prise en charge poursuit un double objectif : parvenir à la réinsertion sociale des personnes détenues et lutter contre la récidive. Dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 relative à la loi sur la rétention de sûreté, le Conseil constitutionnel a exprimé la même préoccupation, en rappelant qu’une personne peut être placée en rétention de sûreté uniquement lorsqu’elle « a pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d’une prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n’ont pu produire des résultats suffisants, en raison soit de l’état de l’intéressé soit de son refus de se soigner ». Cette décision du Conseil ne peut qu’être un catalyseur d’énergies au service d’un partenariat riche et ambitieux entre santé et justice au quotidien.
Face à l’ampleur d’une telle problématique, l’ambition constante de votre Rapporteur, tout au long de cette mission, a été d’analyser les conditions dans lesquelles le soin et la peine interagissent afin de lutter efficacement contre les différentes pathologies et addictions à l’origine de la récidive. Pour ce faire, trois thèmes ont donné lieu à un examen spécifique.
En premier lieu, votre Rapporteur a choisi de s’intéresser à la santé, notamment mentale, des personnes détenues. En effet, les règles pénitentiaires européennes affirment solennellement que « les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde » (4). À cette fin, « chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre » (5). Si la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a constitué un progrès majeur dans la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées, la première partie de ce rapport vise à rappeler que la qualité et la continuité des soins dispensés en prison ne sont pas toujours équivalentes à celles de l’ensemble de la population, alors même que les besoins qui restent encore à satisfaire représentent un enjeu majeur de réinsertion de ces publics fragiles et in fine de prévention de la récidive. En effet, sans prise en charge sanitaire digne de ce nom en détention, aucune réinsertion sociale durable des détenus n’est raisonnablement envisageable et la lutte contre la récidive perd alors de son efficacité.
En deuxième lieu, votre Rapporteur s’est penché sur la question des soins pénalement ordonnés. En effet, depuis son introduction, il y a un demi-siècle, la pratique des soins pénalement ordonnés ne cesse de s’étendre tant en France qu’en Europe. Que ce soit sous la forme de l’obligation de soins à l’occasion de sanctions ou de mesures probatoires, de l’injonction thérapeutique en application de la loi du 31 décembre 1970 ou de l’injonction de soins introduite par la loi du 17 juin 1998, ces mesures imposent un partenariat délicat en raison d’une articulation originale de logiques différentes, celle de l’exécution des décisions, de l’application des peines, de l’incitation aux soins, du traitement thérapeutique, du travail social et du suivi éducatif. Le double respect des dispositions légales et des exigences déontologiques, que les soins pénalement ordonnés commandent, rend indispensable d’adopter une juste position tant à l’égard du justiciable que de l’ensemble des partenaires (judiciaires, sanitaires et sociaux). Partant également du constat que le dispositif législatif prévu pour contrôler les criminels dangereux, lors de leur sortie de prison, et ainsi limiter tout risque de récidive, s’est étoffé, au fil des années, de dispositions successives qui se complètent et s’articulent entre elles, votre Rapporteur a tout particulièrement souhaité procéder dans la deuxième partie de ce rapport à une évaluation aussi précise que possible du suivi socio-judiciaire et de l’injonction de soins, dix ans après le vote par le législateur de ces deux mesures (6).
Enfin, dans la dernière partie de ce rapport, votre Rapporteur a souhaité revenir plus longuement sur la relation existant entre alcool et infractions. En effet, deuxième cause de mort évitable en France, l’alcool fait aujourd’hui l’objet de consommations problématiques chez plus d’un tiers des adultes. Autre fait préoccupant, les ivresses répétées chez les jeunes se multiplient, induisant une série de complications très graves (comas, violences, accidents de la route, difficultés d’apprentissage scolaire, dépendances…). Estimé à plus de 37 milliards d’euros par an, le coût pour la collectivité des conséquences de ces abus d’alcool est très important qu’il s’agisse bien évidemment des dépenses occasionnées en matière de soins ou celles rendues nécessaires pour lutter contre les troubles liés à ces consommations en matière d’ordre et de tranquillité publics. Quelques chiffres permettent d’illustrer le rôle joué par l’alcool dans le passage à l’acte délictuel ou criminel : 40 % des personnes ayant participé à une bagarre dans un lieu public ont consommé de l’alcool dans les deux heures précédentes, alors que 25 % des auteurs d’agressions hors de la famille et 35 % des auteurs d’agressions au sein de la famille ont également consommé de l’alcool avant de passer à l’acte. S’agissant des autres formes de délinquance, 32 % des destructions intentionnelles et 20 % des vols sont précédés d’une consommation d’alcool. En 2004, l’alcool était également présent dans 70 % des homicides et dans la moitié des cas d’incestes. Ces quelques chiffres soulignent l’importance qu’il y a à saisir les opportunités de prévention et de prise en charge de l’alcoolisme lors des différentes rencontres avec la justice dans un louable souci de prévention de la récidive. Tant en pré-sentenciel qu’en post-sentenciel, des opportunités de soins, notamment pour les conducteurs en état alcoolique, sont manquées, laissant ainsi la voie libre à la récidive. Les succès remportés ces dernières années par la politique de restriction de l’usage du tabac ou la lutte contre la violence routière montrent qu’il n’y a pas de fatalité et qu’on peut prévenir les consommations problématiques d’alcool pour peu que l’on s’en donne tous les moyens.
PREMIÈRE PARTIE : AMÉLIORER L’ARTICULATION ENTRE SANTÉ ET JUSTICE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
La loi du 18 janvier 1994 et le décret du 27 octobre 1994 (7), dont l’application est précisée par la circulaire interministérielle du 8 décembre 1994 modifiée par les circulaires du 17 février 1998 et du 10 janvier 2005, constituent les textes essentiels de la réforme de la santé en milieu pénitentiaire. Les dispositifs d’accès aux soins progressivement mis en place depuis 1994 ont eu pour ambition d’intégrer les personnes détenues dans le système général de santé, d’une part en leur accordant, ainsi qu’à leurs ayants droit, une couverture sociale, d’autre part en leur permettant d’accéder à des soins comparables à ceux dispensés en milieu libre, au travers du service public hospitalier. Dans son avis sur la santé en prison du 4 novembre 2008, l’Académie nationale de médecine a souligné que, « si les dispositions réglementaires établies par la loi du 18 janvier 1994 […] constituaient un progrès important, certaines d’entre elles n’avaient reçu que des applications insuffisantes en contradiction avec l’obligation légale qu’en milieu carcéral la dignité soit préservée en toutes circonstances, en particulier que la qualité et la continuité des soins dispensés aux détenus soient équivalents à ceux de l’ensemble de la population. » C’est pourquoi, la première partie de ce rapport ambitionne-t-elle de rappeler aussi bien les indéniables progrès qui ont été accomplis depuis une quinzaine d’années que les besoins qui restent encore à satisfaire en matière de prise en charge sanitaire des personnes détenues.
I. FACE AUX IMPORTANTS BESOINS DE SANTÉ DES DÉTENUS, D’INDÉNIABLES PROGRÈS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS
A. LA POPULATION PÉNALE PRÉSENTE À CE JOUR UN ÉTAT SANITAIRE GLOBALEMENT DÉGRADÉ
En janvier 1993, le rapport du Haut comité de la santé publique avait présenté l’échec de la gestion de la santé des détenus par l’administration pénitentiaire en se fondant sur la prévalence largement supérieure de certaines maladies en milieu carcéral par rapport à la population générale.
1. La santé des personnes détenues en prison : un état somatique jugé bon, mais des besoins qui restent importants
Force est de reconnaître que « la prison est un lieu de maladies », comme le note le comité consultatif national d’éthique (8). Même si l’état général est jugé bon à l’examen clinique d’entrée pour huit nouveaux détenus sur dix (9), la prévalence des maladies demeure plus élevée qu’au sein de la population générale.
APPRÉCIATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES ENTRANTS EN PRISON
En %
1997 |
2003 | |
Population d’entrants dont l’état général est jugé Bon Moyen Mauvais Total |
77,1 21,2 1,7 100 |
80,3 18 1,7 100 |
Proportion d’entrants dont l’état bucco-dentaire est jugé Bon Nécessitant des soins à programmer Nécessitant des soins en urgence Total |
49,7 47,7 2,6 100 |
47,3 50 2,7 100 |
Proportion d’entrants déclarant avoir eu au moins un contact avec le système de soins dans les 12 mois précédant l’incarcération Total (10) Dont : Consultation ou visite médicale ou suivi gynécologique Hospitalisation d’au moins quatre jours pour traumatisme Autre hospitalisation sauf en psychiatrie Suivi régulier ou hospitalisation en psychiatrie - dont proportion avec traitement en cours par des psychotropes |
Gf vgf bgfb bgf 58,3 53,7 7,3 8,9 8,8 5,1 |
Gf vgf bgfb bgf 56,2 52,7 6,5 7,7 9,1 5,8 |
Proportion d’entrants déclarant un traitement en cours par Antituberculeux Anticomitiaux Trithérapies ou autres antirétroviraux Traitement antiviral (anti-VHC, anti-VHB…) Autre traitement au long cours (hors contraception) |
0,1 1,3 0,8 0,3 — |
0 2 0,5 0,2 5,5 |
Proportion d’entrants déclarant avoir Fait une tentative de suicide dans les 12 mois précédant l’incarcération |
— |
5,9 |
Champ : France entière Source : Enquête « Fiche Santé entrant de l’état de liberté », Drees | ||
a) Une insuffisante connaissance de l’évolution de la santé des prisonniers
La prise en charge sanitaire des détenus nécessite une connaissance régulière de l’état de santé des personnes aussi bien lorsqu’elles arrivent en prison que lorsqu’elles en sortent. Or, comme le note M. Nicolas About dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire (11), « les enquêtes sur la santé des détenus sont menées lors de l’entretien d’entrée et non au cours de l’incarcération ou à la sortie. Si la santé des entrants est relativement bien connue, on ne peut que regretter l’absence de données sur l’évolution de la santé des prisonniers ». En outre, les dernières études réalisées par le ministère de la Santé, via la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, sur la santé des personnes incarcérées remontent à 2003.
Votre Rapporteur estime donc nécessaire un suivi plus régulier et prenant en compte les différents moments du parcours pénitentiaire de l’état de santé des personnes détenues dans les prisons françaises. Ce suivi permettra ainsi de disposer de données statistiques fiables et actualisées sur l’état de santé des personnes détenues et ainsi d’offrir une réponse adaptée à des besoins clairement identifiés.
Proposition n° 1
Mettre en œuvre dans les meilleurs délais un suivi de la santé des personnes détenues dans les prisons françaises, à la fois plus régulier et prenant en compte les différents moments clés du parcours pénitentiaire, de l’entrée à la sortie de prison, afin de mieux adapter les moyens disponibles aux besoins désormais clairement identifiés.
b) Une population surexposée au VIH et aux hépatites
S’agissant des maladies infectieuses d’origine virale, les différentes données statistiques disponibles mettent toutes en évidence leur plus grande prévalence en milieu carcéral qu’au sein de la population générale.
Les résultats de la dernière enquête de prévalence réalisée en 2003 ont ainsi montré une prévalence de l’infection par le VIH de l’ordre de 1,04 % – contre 0,21 % dans la population générale – et de l’hépatite C de 4,1 % – contre 0,84 % dans la population générale.
S’agissant des personnes entrant en prison, la dernière enquête réalisée par la direction des recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques en 2003 indique que 0,6 % des entrants se déclarait être séropositif pour le VIH (contre 0,9 % en 1997), 0,3 % être co-infectés (VIH/VHC ou VIH/VHB). En 2003, le dépistage du VHC a été proposé par le médecin lors de l’examen d’entrée à 66 % des nouvelles personnes détenues.
Comme le souligne M. Nicolas About (12), « les succès de la politique de prévention en matière de Sida se traduisent par une réduction du nombre de personnes contaminées par le VIH en prison. En 1993, la prévalence du VIH était dix fois supérieure en prison. Elle l’est un peu plus de trois fois aujourd’hui (1,56 contre 0,5 %) et semble en voie de réduction progressive » (13). Une attention particulière doit cependant être portée à la tuberculose. En effet, les données épidémiologiques disponibles montrent que la prévalence de la tuberculose en 2004 parmi les personnes en établissement pénitentiaire est d’environ 90 cas pour 100 000, soit 10 fois plus élevée qu’en population générale (14). De surcroît, à l’inverse du VIH, la prévalence de la tuberculose s’est accrue depuis quinze ans, dans la mesure où elle était seulement trois fois plus fréquente en détention qu’en population générale en 1993 (15).
LES MALADIES INFECTIEUSES CHRONIQUES DES ENTRANTS EN PRISON
En %
1997 |
2003 | |
Proportion d’entrants déclarant avoir eu des tests de dépistage du SIDA, de l’hépatite B et/ou de l’hépatite C avant l’incarcération Les trois tests Deux tests SIDA et hépatite B SIDA et hépatite C Hépatite B et hépatite C Un seul test SIDA Hépatite B Hépatite C |
E ferf vfger df fef 17,1 7,9 5,7 1,6 0,6 24,1 22,1 1,6 0,4 |
ferf vfger df fef 17 11,2 1,8 8,6 0,8 14,5 12,6 0,9 1 |
Proportion d’entrants déclarant une séropositivité VIH, VHB et/ou VHC au moment de l’incarcération Les trois séropositivités Deux séropositivités SIDA et VHB SIDA et VHC VHB et VHC Une seule séropositivité VIH VHB VHC |
E ferf vfger df fef 0,3 1,2 0,1 0,3 0,8 5 0,9 1,1 3 |
E ferf vfger df fef 0,1 0,6 0,1 0,2 0,3 3,5 0,6 0,4 2,5 |
Champ : France entière – Source : Enquête « Fiche Santé entrant de l’état de liberté », Drees | ||
c) Une population à la santé bucco-dentaire profondément dégradée
Bien qu’elles soient le plus souvent fragmentaires, les données disponibles sur l’état de santé des prisonniers soulignent toutes le mauvais état de santé bucco-dentaire des personnes détenues.
Ainsi, le rapport du Haut comité de la santé publique sur la santé en milieu carcéral publié en janvier 1993 soulignait déjà l’importance des besoins en soins dentaires des personnes détenues. En 2003, la moitié des entrants en détention nécessitait des soins bucco-dentaires et 2,7 % des soins urgents. Diverses études locales ou régionales, notamment l’enquête conduite en 2006-2007 par le service médical de l’assurance maladie dans les établissements pénitentiaires de Bretagne, confirment la forte prévalence des pathologies bucco-dentaires dans cette population : caries, parodontites, séquelles de traumatismes dentaires, nombreuses dents absentes.
Cette situation a une double explication. En premier lieu, les détenus viennent très majoritairement de milieux sociaux défavorisés. Aussi, leur mauvais état bucco-dentaire est d’abord le reflet de cette réalité sociologique et la conséquence des facteurs de risque qui l’accompagnent : pratiques d’hygiène bucco-dentaire moins largement diffusées que dans la population générale ; moindre recours à la prévention par les fluorures ; moindre recours aux soins pour de multiples raisons, comme le coût financier conséquent de l’accès aux soins. En second lieu, au cours du séjour en détention, il existe des facteurs d’aggravation de cet état : alimentation déséquilibrée (prises répétées de produits sucrés et de sodas) ; stress, états dépressifs et prise de psychotropes (d’où sécheresse buccale favorisant la carie) ; tabac ; alcool ; autres toxiques.
Ce mauvais état de santé bucco-dentaire n’est pas sans conséquence sur l’état général (douleur, infection) et peut entraîner des complications, en particulier en cas de pathologies associées (VIH, diabète, maladies cardio-vasculaires). En outre, un très mauvais état dentaire peut être un handicap dans la vie sociale et même constituer un véritable marqueur de marginalité. La restauration d’un bon état de santé bucco-dentaire, au-delà de son enjeu de santé, contribue donc également à une meilleure image de soi, et, par là, à de meilleures chances de réinsertion.
La période de détention permet, dans certains cas, d’entreprendre le traitement des pathologies préexistantes et d’informer les détenus sur les comportements (hygiène, alimentation, sevrage alcoolo-tabagique,…) favorables à la santé bucco-dentaire. Mais la santé bucco-dentaire est souvent sous-estimée dans la prise en charge sanitaire des personnes détenues et les moyens matériels, humains et organisationnels affectés à la prise en charge de la santé bucco-dentaire en milieu carcéral ne permettent pas toujours de répondre de manière satisfaisante à la situation. Les besoins en soins restent importants compte tenu, d’une part, du nombre croissant de personnes incarcérées (62 744 écroués détenus au 1er février 2009, dont 2 120 femmes et 694 mineurs), d’autre part, des pathologies rencontrées.
À la demande de la direction générale de la santé, un groupe de travail sur ce sujet a été constitué en 2007 et une étude sur la prise en charge de la santé bucco-dentaire des détenus est en cours d’analyse. Elle devrait déboucher, en 2009, sur des propositions de mesures d’amélioration.
d) Une population fortement touchée par différentes formes d’addiction
Les addictions, sous leurs différentes formes, sont particulièrement présentes en détention, dans la mesure où certaines d’entre elles sont liées par nature à des activités délictuelles ou criminelles.
D’après les données recueillies par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, un tiers des détenus sont des usagers de substances illicites, la plupart consommant du cannabis et 7 % à 8 % des entrants souffrant d’une addiction à l’héroïne ou à la cocaïne. De manière générale, environ 6,5 % des entrants en prison déclarent avoir consommé une drogue par voie intraveineuse au moins une fois au cours de leur vie. Par ailleurs, on estime à un tiers la part des entrants en prison ayant une consommation excessive d’alcool et à 78 % celle d’entre eux qui sont fumeurs.
2. Les troubles psychiatriques en détention : une place croissante et de plus en plus préoccupante
Comme le note M. Nicols About, « la prison est également un lieu où se manifestent de manière particulièrement importante les troubles psychiatriques et psychologiques. On estime ainsi que le taux de pathologie y est vingt fois supérieur à la population générale (16) ».
a) Un recours aux soins de santé mentale dix fois supérieur à celui observé en population générale
En 2003 et 2004, une étude épidémiologique sur l’état de santé mentale des personnes détenues a été réalisée par la direction des recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques. Elle a permis de montrer qu’en 2003, plus de 67 000 détenus, soit 40 % de la population carcérale (17), ont été vus au moins une fois par une équipe de psychiatrie, sachant que 80 % d’entre eux – soit 54 250 – l’ont été par l’équipe soignante des SMPR. Parmi ces derniers, plus du tiers – soit 38 % – n’ont été vus qu’une seule fois dans l’année.
En excluant ces monoconsultants de la file active totale, on obtient un taux de recours aux soins de santé mentale de 271 pour 1 000 détenus. Ce taux est dix fois supérieur à celui observé en population générale auprès des seuls secteurs de psychiatrie (25 pour 1 000).
Ce surplus de recours aux soins psychiatriques tient en partie aux caractéristiques démographiques et sociales de la population incarcérée, qui cumule les risques de vulnérabilité, et au sein de laquelle, les conduites addictives sont très répandues. Ainsi, plus de la moitié des entrants (54 %) en détention en 2003 déclarent consommer au moins une substance psycho-active : psychotropes, alcool, drogues illicites. D’autre part, l’incarcération elle-même génère ou augmente certains risques (isolement affectif, promiscuité, inactivité…).
La probabilité pour un détenu de recourir aux soins de santé mentale varie également fortement selon l’établissement d’incarcération. Ainsi, 430 détenus sur 1 000 incarcérés dans un établissement pénitentiaire disposant d’un service médico-psychologique régional (SMPR) ou d’une antenne SMPR ont bénéficié en 2003 d’une prise en charge psychiatrique contre 144 pour les établissements non dotés d’un SMPR. Ainsi, le recours aux soins de santé mentale est trois fois supérieur dans les établissements pénitentiaires dotés d’un SMPR. La vocation régionale des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, dans les faits limitée, ne permet pas d’expliquer la différence observée. C’est donc également la possibilité qu’ont les détenus d’accéder à des soins de proximité, qui semble influer sur leur recours aux soins psychiatriques.
b) Un taux de pathologie mentale vingt fois supérieur à celui observé en population générale
Près de la moitié des détenus – soit 40,3 % des personnes incarcérées – présentent un état dépressif majeur, soit huit à dix fois le taux observé dans la population générale. De la même manière, un peu moins du tiers des détenus souffrent d’anxiété généralisée.
Par ailleurs, un quart des détenus est aujourd’hui atteint de troubles psychotiques, au nombre desquels on trouve la schizophrénie. Cette dernière touche 7,3 % de la population carcérale française, soit environ huit fois plus qu’en population générale.
ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES ACTUELS DANS LA POPULATION CARCÉRALE FRANÇAISE MASCULINE
Estimation de la prévalence « population carcérale masculine française » (18) | |
Troubles de l’humeur |
|
État dépressif |
40,3 % |
Mélancolie |
7,5 % |
État dépressif chronique |
7,4 % |
Manie/hypomanie |
6,2 % |
Troubles bipolaires |
4,7 % |
Troubles anxieux |
|
Attaques de panique |
7,6 % |
Agoraphobie |
16,7 % |
Phobie sociale |
16,3 % |
Névrose obsessionnelle |
9,2 % |
Anxiété généralisée |
32,7 % |
Dépendance aux substances |
|
Dépendance à l’alcool |
31,2 % |
Dépendance aux substances |
37,9 % |
Troubles psychotiques |
|
Schizophrénie |
7,3 % |
Bouffée délirante aiguë |
0,1 % |
Schizophrénie dysthymique |
2,6 % |
Psychose chronique non schizophrénique (paranoïa…) |
7,3 % |
Ce constat est d’autant plus préoccupant que, lors de l’enquête épidémiologique conduite par MM. Frédéric Rouillon et Bruno Falissard, 35 % des personnes détenues ont été considérées comme manifestement, gravement ou très gravement malades. Cette étude a également permis de mettre en évidence les lourds antécédents médicaux et socio-judiciaires, qui caractérisent le plus souvent la population carcérale. Ainsi, 16 % des détenus ont été hospitalisés pour raisons psychiatriques avant leur incarcération.
Si l’on se réfère enfin aux comparaisons internationales, l’étude des docteurs Seena Fazel et John Danesh (19) réalisée en 2002 pose une prévalence des psychoses schizophréniques de 4 % dans les établissements pénitentiaires des pays ayant publié des données épidémiologiques sur les troubles mentaux en détention.
c) Un taux de suicide en prison qui diminue ces dernières années, mais qui demeure important comparé à la situation au sein de la population générale
Le taux de suicide en prison est sept à dix fois supérieur à celui constaté dans la population générale. Comme le souligne, M. Nicolas About (20), « malgré le nombre particulièrement important de suicides en prison en 2008 (115 soit 20 % de plus qu’en 2007), le taux de suicide en prison a eu tendance à diminuer en moyenne au cours des dernières années ». Tandis qu’il était de 188,7 pour 100 000 en 1992, le taux de suicide s’est établi à environ 180,8 pour 100 000 en 2008.
Comme le notait également M. Nicolas About, sénateur, dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire, « l’implication de l’administration pénitentiaire et des équipes médicales dans la prévention du suicide est réelle et porte ses fruits dans un contexte pourtant particulièrement propice à la dépression suicidaire. » En effet, la proportion de nouveaux détenus ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide dans les douze mois précédant l’incarcération est ainsi 22 fois plus élevée qu’en population générale. Les risques de suicide sont également majorés à certains moments du parcours pénitentiaire : lors des premières semaines de détention, de placement en quartier disciplinaire, avant un jugement…
Bien que le taux de suicide en milieu pénitentiaire diminue ces dernières années, il demeure important comparé à la situation au sein de la population générale et nécessite de consolider notre politique de prévention par un meilleur repérage et une prise en charge adaptée de la crise suicidaire.
Proposition n° 2
Consolider la politique de prévention du suicide en prison grâce à un meilleur repérage des entrants et une prise en charge adaptée de la crise suicidaire.
B. L’OFFRE DE SOINS SOMATIQUES ET PSYCHIATRIQUES AUX DÉTENUS : DES GRANDS PRINCIPES FIXÉS AU MILIEU DES ANNÉES 1990
Initialement, les soins aux détenus étaient dispensés par les services infirmiers et médicaux de l’administration pénitentiaire. Seules relevaient alors du ministère de la Santé les actions de prévention et de dépistage de certaines maladies infectieuses.
Le rapprochement des services des ministères de la Justice et de la Santé a été initié dans les années 1980 par, d’une part, l’organisation du contrôle sanitaire des établissements pénitentiaires, alors confié à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ainsi qu’aux services déconcentrés du ministère de la Santé (1984) et, d’autre part, par la création de services de psychiatrie en milieu pénitentiaire par les établissements hospitaliers, à savoir les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) en 1986.
Néanmoins, l’architecture de l’offre de soins en milieu carcéral et post-carcéral a été profondément repensée au cours des années 1990, notamment sous l’impulsion de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
1. La réforme mise en place par la loi du 18 janvier 1994 a permis d’incontestables progrès en matière de soins somatiques
Une profonde réforme de la santé en milieu carcéral a été opérée par le législateur en 1994, comportant deux volets bien distincts : le premier relatif à la création des unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et le second relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI). Actuellement, les activités de soins courants sont dispensées par les équipes hospitalières dans le cadre des unités de consultations et de soins ambulatoires. Lorsque des hospitalisations s’avèrent nécessaires, elles sont réalisées en milieu hospitalier, soit dans des chambres sécurisées (pour des durées inférieures à 48 heures), soit dans des unités spécialisées – les unités hospitalières spécialisées interrégionales –, qui disposent d’une garde statique assurée par les services de police ou la gendarmerie
a) Premier volet de la loi du 18 janvier 1994 : les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
En 1994, s’est opérée une véritable rupture dans l’offre de soins en milieu carcéral. En effet, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a permis l’entrée de l’hôpital dans les prisons françaises grâce à la mise en place d’un système de conventions entre les hôpitaux et les prisons. Cette réforme a également conduit à mieux structurer la filière de soins en milieu carcéral, puisque chaque établissement pénitentiaire est aujourd’hui lié à un établissement hospitalier qui est responsable de la prise en charge sanitaire des détenus.
Parmi les principales innovations de la loi du 18 janvier 1994, on compte la mise en place des unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) : ces unités sont des services hospitaliers implantées en milieu pénitentiaire et placées sous la responsabilité d’un chef de service. Au nombre de 194, correspondant aux 194 établissements pénitentiaires, elles assurent les soins somatiques et psychiatriques incluant la prévention, l’organisation des soins en milieu hospitalier ainsi que la continuité de soins à la sortie de détention.
NOMBRE DE CONSULTATIONS EFFECTUÉES EN 2007 AUPRÈS DES PERSONNES INCARCÉRÉES DANS CHAQUE RÉGION DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
Région |
Nombre de consultations médicales à l’UCSA hors psychiatrie |
Nombre de consultations médicales hors UCSA |
Alsace |
11 314 |
738 |
Aquitaine |
27 788 |
2 605 |
Auvergne |
7 080 |
811 |
Bourgogne |
16 658 |
1 485 |
Bretagne |
23 365 |
1 555 |
Centre |
39 596 |
1 329 |
Champagne Ardenne |
16 414 |
648 |
Corse |
3 157 |
810 |
Franche Comté |
10 444 |
101 |
Île-de-France |
105 405 |
11 848 |
Languedoc Roussillon |
41 198 |
1 356 |
Limousin |
3 485 |
208 |
Lorraine |
35 701 |
4 400 |
Midi Pyrénées |
24 557 |
1 591 |
Nord Pas de Calais |
69 158 |
2 983 |
Basse Normandie |
15 547 |
1 391 |
Haute Normandie |
15 764 |
1 201 |
PACA |
40 001 |
1 622 |
Pays de la Loire |
16 584 |
923 |
Picardie |
13 249 |
708 |
Poitou Charentes |
17 103 |
1 531 |
Rhône Alpes |
43 729 |
1 995 |
Total |
597 297 |
41 839 |
L’article D. 368 du code de procédure pénale (art. 90 et 96 du décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 (21)) dispose que « les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultation et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. » Au titre de ces missions, près de 600 000 consultations (hors psychiatrie) ont été dispensées dans les UCSA en 2007 et 42 000 extractions effectuées pour des consultations en dehors de l’UCSA.
LES MISSIONS DES UNITÉS DE CONSULTATIONS ET DE SOINS AMBULATOIRES
Les missions des UCSA s’organisent autour de quatre grands axes.
1) Les soins en milieu pénitentiaire, qui comprennent l’ensemble des prestations de médecine générale (visites et consultations médicales, notamment la visite médicale d’entrée), la fourniture des produits à usage médical, ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l’établissement de santé, l’activité de soins infirmiers, incluant la distribution des médicaments, les soins dentaires, les consultations spécialisées techniquement réalisables sur place : gastro-entérologie, radiologie, dermatologie, cardiologie, psychiatrie, psychologie, kinésithérapie, les examens de laboratoire, effectués sur place ou par l’établissement de santé et la permanence des soins en dehors des heures de présence du personnel soignant.
2) L’organisation de l’accueil et de la prise en charge par l’établissement de santé de proximité pour des consultations ou examens nécessitant le recours à son plateau technique, ainsi que pour des hospitalisations urgentes ou d’une durée inférieure à 48 heures.
3) La préparation du suivi sanitaire à la sortie, en liaison avec le service socio-éducatif de l’établissement pénitentiaire.
4) La coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé et l’élaboration, en accord avec les partenaires concernés (établissements pénitentiaires, services de l’État, conseil général, autres collectivités, organismes d’assurance maladie, associations), d’un programme annuel et pluriannuel de prévention et d’éducation pour la santé
b) Deuxième volet de la loi du 18 janvier 1994 : les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)
La réforme amorcée en 1994 a connu un deuxième volet d’application avec le schéma national d’hospitalisation des personnes détenues. Officialisé par l’arrêté interministériel du 24 août 2000 (22), il prévoit la création d’unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) dans huit pôles, avec une capacité d’accueil de 182 lits d’hospitalisation : Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Rennes, Toulouse, Marseille ainsi que Paris. La première des huit UHSI a été ouverte le 16 février 2004 à Nancy.
Véritables structures hospitalières implantées dans des centres hospitalo-universitaires (CHU), les UHSI reçoivent les détenus souffrant de pathologies somatiques (non psychiatriques) pour des séjours d’une durée supérieure à 48 heures, l’hôpital de proximité restant compétent dans les autres cas. Les personnes détenues y sont encadrées par des personnels pénitentiaires et prises en charge médicalement par des personnels hospitaliers. La sécurité de ces unités est également assurée par les forces de l’ordre.
La mise en place des UHSI vise à faciliter l’accès aux soins des personnes détenues et à optimiser la gestion des personnes affectées à leur escorte et à leur garde en milieu hospitalier. Leur fonctionnement repose sur l’étroite collaboration entre personnels hospitaliers, policiers et gendarmes. En outre, ces structures répondent pleinement à l’objectif assigné par la règle pénitentiaire européenne 46.1 qui dispose que « les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison. »
OUVERTURE ET CAPACITÉ D’ACCUEIL DES UHSI
Sites |
Capacité |
Ouverture |
UHSI de Nancy |
17 lits |
Février 2004 |
UHSI de Lille |
21 lits |
Décembre 2004 |
UHSI de Lyon |
23 lits |
Février 2005 |
UHSI de Bordeaux |
16 lits |
Mai 2006 |
UHSI de Toulouse |
16 lits |
Décembre 2006 |
UHSI de Marseille |
45 lits |
Décembre 2006 |
UHSI de Paris |
25 lits |
Décembre 2006 |
UHSI de Rennes |
19 lits |
Mars 2010 |
Avec l’ouverture du site de Rennes, prévue en mars 2010, le programme initial de création de huit UHSI sera achevé, offrant une capacité d’accueil de 182 lits, loin des 303 places qui avaient été annoncées au départ. Toutefois, un projet de création d’une UHSI d’une capacité de 80 lits est envisagé sur le site du nouveau centre hospitalier Sud Francilien, afin de tenir compte de la fermeture de l’établissement public de santé national de Fresnes en 2012.
ACTIVITÉ DES UHSI EN 2008
UHSI |
Nombre de lits |
Nombre d’admissions |
Nombre de journées d’hospitalisation |
Durée moyenne du séjour |
Taux d’occupation |
Bordeaux |
16 |
342 |
4 882 |
14 |
83,6 % |
Lille |
21 |
486 |
4 614 |
9 |
60,2 % |
Lyon |
23 |
365 |
6 608 |
18 |
78,71 % |
Marseille |
16 |
457 |
5 058 |
11 |
86,61 % |
Nancy |
17 |
475 |
4 752 |
10 |
76,58 % |
Toulouse |
16 |
410 |
2 881 |
7 |
49,33 % |
Total |
109 |
2 535 |
28 795 |
11 |
72,38 % |
2. La santé mentale des personnes détenues : un dispositif de soins spécifique reposant essentiellement sur les soins ambulatoires
En ambulatoire, les actions de prévention et les soins psychiatriques courants sont assurés soit par les secteurs de psychiatrie générale présents au sein des unités de consultations et de soins ambulatoires, soit par l’un des 26 services médico-psychologiques régionaux quand les établissements pénitentiaires en sont dotés. En revanche, les soins plus spécialisés – de type hospitalisation de jour ou centre d’accueil thérapeutique à temps partiel – sont assurés uniquement dans les SMPR. Au total, ce sont un peu plus de 165 000 consultations qui ont été réalisées en psychiatrie en 2007.
S’agissant des modalités d’hospitalisation des détenus présentant des troubles mentaux, il convient de distinguer suivant qu’elles sont effectuées avec ou sans le consentement du prisonnier. Lorsque ce dernier a consenti à l’hospitalisation, celle-ci est assurée au sein des SMPR. En revanche, les hospitalisations sans consentement, sous le régime de l’article D. 398 du code de procédure pénale, sont effectuées dans les services des établissements de santé sans garde statique.
ARTICLE D. 398 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 331 du code de la santé publique.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
a) Les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) : des secteurs psychiatriques à part entière
À l’heure actuelle, les soins psychiatriques aux personnes détenues sont organisés par le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 qui confie le dispositif de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire au service public hospitalier et qui a créé les services médico-psychologiques régionaux (SMPR). Au nombre de vingt-six, il s’agit en réalité de services d’un établissement de santé installés en établissement pénitentiaire. Ils assurent les soins psychiatriques courants au bénéfice des personnes détenues dans l’établissement pénitentiaire d’implantation.
Ils sont chargés de dépister les pathologies mentales, d’œuvrer à la prévention des suicides, de dispenser aux détenus des soins d’une qualité équivalente à ceux prodigués à la population générale, de favoriser l’accès aux soins pour certains détenus qui ont habituellement, en milieu libre, peu ou pas de recours au dispositif de soins psychiatriques et aussi d’organiser la continuité des soins à l’occasion des transferts et à l’issue de l’incarcération.
LES SERVICES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES RÉGIONAUX
Les services médico-psychologiques régionaux sont des secteurs psychiatriques à part entière. Ils sont détachés d’un hôpital psychiatrique ou général au sein d’un établissement pénitentiaire, plus souvent maison d’arrêt qu’établissement pour peine. Ils sont aujourd’hui 26 en France pour 194 établissements pénitentiaires.
Leur personnel est constitué de psychiatres, de psychologues, d’infirmiers, d’assistants sociaux ou de secrétaires. Ils ont pour mission d’organiser l’accueil des arrivants afin de dépister les pathologies mentales, d’assurer les soins psychiatriques, d’organiser le suivi psychiatrique de la population post-carcérale. Ils assurent également une mission de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Enfin, ils coordonnent les soins psychiatriques au sein des établissements pénitentiaires alentour.
Les prisons qui ne sont pas dotées de SMPR dépendent du secteur psychiatrique sur lequel elles sont implantées. Le chef de service du secteur a alors la responsabilité d’organiser des consultations dans l’établissement concerné. De ce fait, le temps médical est moindre et les prises en charge souvent plus ponctuelles.
Même si ce dispositif a considérablement amélioré la prise en compte des pathologies et troubles mentaux, il se révèle encore insuffisant du fait de l’ampleur des besoins en prison. Les principales difficultés sont les suivantes :
— la possibilité réduite des services médico-psychologiques régionaux (SMPR), qui n’existent que dans 26 établissements pénitentiaires, d’accueillir les patients en hospitalisation complète du fait du défaut de présence sanitaire, ainsi que de difficultés d’accès aux établissements hospitaliers durant la nuit ;
— les réticences des établissements de santé à recevoir des personnes détenues en hospitalisation d’office en l’absence de garde statique par les forces de l’ordre ;
— le manque de psychiatres intervenant en établissements pénitentiaires.
D’une façon générale, l’évolution des méthodes en psychiatrie a consacré les services ouverts au détriment des services fermés, rendant plus difficile l’accueil des personnes détenues au regard de la sécurité et des risques d’évasion notamment. Une telle situation conduit souvent à des séjours plus courts et à un confinement de fait en chambre d’isolement, ce qui n’est pas sans affecter la qualité des soins.
b) Seules les unités pour malades difficiles (UMD) offrent aujourd’hui un cadre sécurisé aux personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux.
Si l’ouverture et l’humanisation des structures psychiatriques ont eu incontestablement des effets bénéfiques, le dispositif actuel ne répond pas de manière satisfaisante à la situation particulière des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux. Seules les unités pour malades difficiles (UMD) peuvent aujourd’hui procurer un cadre sécurisé pour accueillir ce type de public.
En effet, les détenus les plus gravement atteints sont quant à eux envoyés dans des unités pour malades difficiles (UMD) qui, implantées dans des centres hospitaliers spécialisés, assurent l’hospitalisation des patients qui présentent un tel danger pour autrui que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.
Mais, au nombre de quatre, elles n’offrent que des capacités d’accueil limitées (416 lits) et donc impliquent souvent des délais d’internement particulièrement longs. Les quatre UMD, existant actuellement, sont implantées à Cadillac (Gironde), Villejuif (Val-de-Marne), Sarreguemines (Moselle) et Montfavet (Vaucluse).
NOMBRE DE DÉTENUS FAISANT L’OBJET D’UNE HOSPITALISATION D’OFFICE
EN UNITÉS POUR MALADES DIFFICILES ENTRE 2005 ET 2008
Année |
Nombre de détenus |
2005 |
129 |
2006 |
94 |
2007 |
129 |
2008 |
199 |
Taux d’évolution 2005-2008 |
+ 54 % |
c) Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) : répondre aux difficultés rencontrées lors de l’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
L’hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux rencontre des difficultés majeures. Les SMPR n’admettent dans leur service que les personnes détenues hospitalisées avec leur consentement tandis que les hospitalisations sans consentement sont réalisées dans les établissements de santé sous le régime de l’hospitalisation d’office.
Pour remédier à cette situation, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice de 2002 a prévu la mise en place d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour l’hospitalisation complète des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Les UHSA constitueront une amélioration de l’offre d’accès aux soins au bénéfice de ces patients détenus. Il sera alors mis fin à l’hospitalisation complète en SMPR, et toute personne détenue atteinte de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète sera hospitalisée dans les UHSA, avec ou sans son consentement.
C’est pourquoi, la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a prévu, à son article 48 (article L. 3214-1 du code de la santé publique), que « l’hospitalisation avec ou sans son consentement d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée ». Un schéma de prise en charge cohérent va être mis en place, permettant d’une part aux services médico-psychologiques régionaux (SMPR) de recentrer leur activité sur les prises en charge psychiatriques en ambulatoire et, d’autre part, d’offrir aux personnes détenues, via les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), une palette de prise en charge hospitalière adaptée (hospitalisation avec et sans consentement des personnes détenues).
La mise en place de ces structures hospitalières spécialisées répond en outre à l’objectif assigné par la règle pénitentiaire européenne 47.1 qui dispose que « des institutions ou sections spécialement placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l’observation et le traitement de détenus atteints d’affections ou de troubles mentaux. »
Le projet de mise en place des UHSA prévoit la création de 705 lits d’hospitalisation répartis dans 17 UHSA. Les premières d’entre elles entreront en service en 2009 à Lyon (60 places) et à Rennes (40 places), celle de Lyon devant être plus spécifiquement consacrée à la prise en charge des délinquants pédophiles dans le cadre de mesures prises pour lutter contre ce type de récidive. Au total, le programme d’implantation des UHSA comportera deux tranches (2008-2010 et 2010-2011) permettant respectivement la création de 440 et 265 places. Il convient toutefois de souligner la lenteur prise par l’administration dans la mise en place des UHSA, puisque l’ouverture des premières d’entre elles interviendra neuf ans après leur création par la loi du 9 septembre 2002.
Cependant, dans son étude sur le projet de loi pénitentiaire, la commission nationale consultative des droits de l’Homme souligne que, de l’avis de certains psychiatres, les UHSA « ne constitueront qu’une réponse partielle à l’exigence d’une prise en charge particulière des malades mentaux et vont dans les faits accueillir la population que les SMPR ne prendront pas en charge, c’est-à-dire celle qui n’a pas consenti aux soins ».
3. Les moyens humains et financiers alloués à la prise en charge sanitaire des personnes détenues
S’agissant des moyens financiers alloués aux soins, aussi bien somatiques que psychiatriques, en prison, il ressort des données transmises par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) que plus de 192 millions d’euros ont été consacrés en 2007 à la prise en charge sanitaire des personnes détenues.
Les UCSA sont les premières bénéficiaires de ces fonds, puisqu’elles sont destinataires de plus de 70 % des sommes allouées en 2007 (soit près de 140 millions d’euros). En revanche, la DHOS n’est pas en mesure de définir le montant total des sommes allouées aux vingt-six SMPR présents sur l’ensemble du territoire : elle ne dispose en effet pour 2007 que des montants perçus par vingt-quatre d’entre eux.
MONTANTS ALLOUÉS À LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES DÉTENUS EN 2007
Structures |
Montants alloués (en millions d’euros) |
En % |
Unités de consultations et de soins ambulatoires |
136,6 |
71 % |
Unités hospitalières sécurisées interrégionales |
26,9 |
14 % |
Chambres sécurisées |
0,8 |
N.S. (23) |
Services médico-psychologiques régionaux (24) |
27,7 |
15 % |
Total |
192 |
100 % |
D’après les enquêtes annuelles réalisées par la DHOS, le nombre de postes à temps plein de personnels médicaux affectés au sein des unités de soins en prison a augmenté de près de 50 % en dix ans pour s’établir à un peu plus de 469 équivalents temps plein en 2007. Parallèlement, le nombre des autres personnels soignants a augmenté d’environ 84 % sur la même période pour atteindre près de 1 897 équivalents temps plein.
De prime abord, ces taux d’augmentation dépassent largement l’accroissement du nombre de places en prison qui s’est établi, entre 1997 et 2007, à un peu plus de 17 %. Le nombre de soignants, médecins et autres, a donc progressivement augmenté par rapport à la population carcérale. En 2007, il y avait ainsi 0,92 médecin pour cent places de détention (0,6 médecin de soins somatiques et 0,32 médecin de soins psychiatriques) et 3,75 autres personnels soignants. À la même époque, la densité totale de médecins en France (toutes spécialités confondues) s’établit d’après l’Insee à 0,338 pour cent habitants (dont 0,165 omnipraticien et 0,022 psychiatre) (25).
Nombre de places en détention |
ETP médicaux pourvus pour 100 places |
ETP médicaux psy pourvus pour 100 places |
ETP non médicaux (26) pourvus pour 100 places | |
1997 |
43 226 |
0,46 |
0,26 |
2,39 |
2001 |
47 286 |
0,54 |
0,31 |
3,11 |
2006 |
50 928 |
0,53 |
0,29 |
3,38 |
2007 |
50 588 |
0,60 |
0,32 |
3,75 |
Taux d’évolution 1997-2007 |
17 % |
30 % |
23 % |
57 % |
Comme le souligne M. Nicolas About dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire, le taux de couverture médicale des prisonniers semble à première vue très satisfaisant dans la mesure où il est près de trois fois supérieur à la moyenne nationale. Or, ce constat doit être nuancé. En premier lieu, « l’effort fait sur la médecine carcérale implique de comparer le taux de couverture médicale à celui des régions les mieux dotées : l’Île-de-France compte 0,43 médecin pour cent habitants » (27).
En deuxième lieu, le nombre de postes de personnels soignants ne peut être rapporté, comme le fait la DHOS, au regard du nombre de places théoriques en prison. Au 1er décembre 2007, les prisons françaises accueillaient 62 009 détenus pour 50 588 places théoriques « soit, à cette date, un rapport réel de 0,76 médecin et 3,06 autres personnels soignants pour cent détenus » (28). De plus, depuis 2007, le nombre de détenus n’a cessé d’augmenter. A l’instar de M. Nicolas About, « on peut donc estimer que le ratio de médecins et autres personnels soignants a régressé au cours de cette année » (29).
Enfin, ces chiffres doivent être interprétés non seulement à la lumière des facilités potentielles d’accès aux soins mais aussi au regard des besoins de la population carcérale qui se trouve dans une situation sanitaire particulièrement dégradée comparativement à la population générale. Ainsi, comme l’a rapporté M. Nicolas About dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire, « à la prison de Bois-d’Arcy, l’UCSA reçoit en moyenne cent trente visites par jour sur une population de huit cents détenus (pour cinq cents places théoriques) dont cinq cents sont par ailleurs suivis par le SMPR, un traitement utilisant des psychotropes ayant été prescrit à près de trois cents d’entre eux » (30).
|
ETP médicaux somatiques pourvus |
ETP médicaux psy pourvus |
Total ETP médicaux |
ETP non médicaux |
1997 |
200 |
114 |
314 |
1 031 |
2001 |
257 |
146 |
403 |
1 472 |
2006 |
268 |
149 |
417 |
1 721 |
2007 |
306 |
163 |
469 |
1 897 |
Taux d’évolution 1997-2007 |
53 % |
43 % |
49 % |
84 % |
II. CERTAINES DIFFICULTÉS FONT AUJOURD’HUI OBSTACLE À UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET COHÉRENTE
Dans leur rapport d’évaluation de juin 2001 sur « l’organisation des soins aux détenus », l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ) ont souligné que « l’inégalité qui caractérise les établissements pénitentiaires est une donnée indéniable du paysage carcéral français. »
Ainsi, si la loi du 18 janvier 1994 a constitué, dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, « un progrès majeur dans l’accès aux soins des détenus », force est de constater aujourd’hui que « cette amélioration des procédures et surtout l’apport de moyens n’ont pas été uniformes selon les établissements pénitentiaires ».
A. L’OFFRE DE SOINS SOUFFRE ACTUELLEMENT D’UN MANQUE DE PILOTAGE STRATÉGIQUE AU NIVEAU NATIONAL COMME RÉGIONAL
1. Une offre de soins inégalement répartie et ne répondant pas à l’ensemble des besoins
a) Une hétérogénéité de moyens entre établissements pénitentiaires
Aux termes de l’article D. 370 du code de procédure pénale, « l’administration pénitentiaire met à disposition de l’unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur ».
Dans son rapport sur les « situations pathologiques pouvant relever d’une suspension de peine, pour raison médicale, des personnes condamnées », l’Académie nationale de médecine soulignait qu’ « il y a à l’évidence une grande disparité des moyens de cette prise en charge selon les établissements concernant les budgets, les locaux et les équipements. Les personnels médicaux et paramédicaux sont particulièrement insuffisants pour répondre aux besoins, et pour certains d’entre eux insuffisamment formés à leur fonction très particulière » (31). Dans un avis en date du 4 novembre 2008, l’Académie de médecine a de nouveau mis l’accent sur « la prise en charge psychiatrique insuffisante ou inadaptée à une demande croissante ».
Ainsi, le rapport précité de l’IGAS et de l’IGSJ a mis en exergue l’existence d’importantes disparités selon les régions en termes d’effectifs : de un à cinq pour la présence de médecins généralistes et pour les chirurgiens dentistes, de un à trente pour les médecins spécialistes (hors psychiatres) et de un à deux pour les infirmiers et préparateurs en pharmacie. S’agissant de l’activité, qui se définit par le nombre de consultations, des écarts importants ont également été observés : de un à deux pour les consultations généralistes, de un à huit pour les consultations de spécialistes et de un à trois pour les consultations de dentistes. En outre, s’agissant des moyens financiers dégagés par les hôpitaux pour les soins en détention, les comparaisons entre les différents établissements tendent également à montrer des situations différentes. De manière générale, les moyens humains dédiés à la prise en charge sanitaire des détenus sont très inégaux, notamment en psychiatrie. Ainsi, dans les SMPR, les effectifs de psychiatres rapportés au nombre des détenus varient de 1 à 5,5. Le même constat peut être fait pour les UCSA.
Par ailleurs, les établissements pénitentiaires sont inégalement couverts par les équipes de santé mentale selon qu’ils sont sièges d’un SMPR ou pas. Les établissements d’implantation des SMPR concentrent ainsi 41 % de la population pénale et disposent de 56 % des effectifs soignants exerçant en milieu pénitentiaire. Dans les secteurs de psychiatrie générale intervenant en détention, les disparités sont en outre très importantes, l’investissement de certains secteurs se limitant à quelques vacations hebdomadaires.
Les modes de fonctionnement des structures psychiatriques en milieu carcéral sont en outre très hétérogènes, qu’il s’agisse des SMPR mais aussi des UCSA. L’implantation des SMPR n’est pas toujours adéquate : 80 % sont implantés dans des maisons d’arrêt et 80 % des patients pris en charge sont incarcérés dans cet établissement. Certains SMPR sont également implantés dans des établissements de petite taille.
b) Une offre de soins ne répondant pas à l’ensemble des besoins, notamment en psychiatrie
À première vue, les moyens consacrés à la psychiatrie en milieu pénitentiaire semblent nettement plus importants qu’en direction de la population générale. En effet, l’étude réalisée en 2003 par le ministère de la Santé sur la prise en charge de la santé mentale des détenus a montré que les personnels médicaux intervenant en milieu pénitentiaire étaient vingt-huit fois plus nombreux que ceux exerçant dans les secteurs de psychiatrie générale et les personnels non médicaux (infirmiers, assistants sociaux, etc.) dix fois plus nombreux.
Cependant, compte tenu de l’importance des flux d’entrants – environ 85 000 chaque année – et de l’ampleur de la morbidité psychiatrique en prison, ce constat doit être nuancé. En effet, si la taille de la population à couvrir par l’ensemble des SMPR est globalement proche de celle d’un secteur moyen de psychiatrie générale, la proportion de détenus utilisant le système de soins psychiatriques s’avère beaucoup plus importante. Les taux de recours aux soins psychiatriques en milieu pénitentiaire sont en effet dix fois supérieurs à ceux observés en population générale.
Au regard du nombre de patients pris en charge en détention, les moyens en personnels mobilisés par les SMPR apparaissent donc finalement inférieurs à ceux observés en psychiatrie générale, et ce, pour toutes les catégories de personnel. À titre d’exemple, le schéma régional d’organisation sanitaire de la région Centre (cf. annexe n° 1) rappelle dans sa partie consacrée à la prise en charge des personnes détenues que « le service médico-psychologique régional ne dispose que d’un psychiatre pour un effectif budgété de 2,5 postes » en raison du « manque d’attractivité induit, notamment, par sa situation géographique », cette insuffisance de moyens retentissant de facto sur la qualité et la sécurité des soins délivrés. Or, nombreux sont les organes internationaux et nationaux de contrôle qui relèvent depuis des années les carences de la psychiatrie en milieu pénitentiaire. Ainsi, dans son étude sur le projet de loi pénitentiaire, la commission nationale consultative des droits de l’Homme a recommandé aux autorités françaises d’ « augmenter les moyens alloués à l’organisation des soins […] psychiatriques ». Ce problème de l’insuffisance des moyens en matière de prise en charge de la santé mentale des personnes détenues devrait se poser avec une acuité accrue dans les années à venir en raison, d’une part, du vieillissement de la population carcérale – les plus de 50 ans ont augmenté deux fois plus vite en milieu pénitentiaire qu’en population générale – et, d’autre part, du profil démographique des psychiatres qui risque d’accentuer la pénurie de praticiens.
2. Santé et Justice : un pilotage déficient empreint de défiance
La coordination des politiques de prise en charge sanitaire des personnes détenues est assurée au niveau national par une commission interministérielle « santé et justice » : elle réunit, au minimum deux fois par an, les directeurs d’administration centrale du ministère de la Justice – direction de l’administration pénitentiaire – ainsi que du ministère de la Santé – direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, direction générale de la santé, direction des affaires sociales.
Cette organisation a été renforcée par la nomination au sein du ministère de la Santé et du ministère de la Justice de directeurs de projet. Ils sont chargés, d’une part, de coordonner les actions menées en matière de prise en charge de la santé des personnes détenues et, d’autre part, d’assurer les liens entre le monde de la santé et celui de la justice.
Lors de son audition par votre Rapporteur, la direction de l’administration pénitentiaire a estimé qu’était indispensable la tenue de réunions techniques, d’une part, entre les services de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, de la direction de la sécurité sociale, de la direction générale de la santé et, d’autre part, de la direction de l’administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, afin de traiter plusieurs problématiques, parmi lesquelles on trouve :
— l’accès aux droits sociaux des personnes détenues avec, notamment, l’affiliation des personnes détenues au régime d’assurance maladie auprès des caisses primaires d’assurance maladie ;
— la généralisation de la couverture maladie universelle complémentaire aux personnes détenues pour la prise en charge des dépassements d’honoraires en matière de dispositifs médicaux (lunettes, prothèses auditives, appareillage médical individuel) au cours de la détention et tout particulièrement lors de leur libération ;
— l’application aux personnes détenues de l’exonération du ticket modérateur en cas d’affection pour longue maladie (ALD) afin qu’elle bénéficie de ce droit lors de leur libération ;
— la clarification des règles de facturation des actes médicaux aux établissements pénitentiaires (forfait et ticket modérateur) dans le cadre de la législation en vigueur.
Or, bien qu’envisagées, ces réunions de travail n’ont pas encore eu lieu, le ministère de la Santé n’ayant toujours pas donné son accord. De manière plus générale, votre Rapporteur a pu constater, lors des différentes auditions, qu’en dépit des progrès déjà réalisés et de l’implication massive des acteurs tant sanitaires que judiciaires, le pilotage national n’était pas optimal.
Le ministère de la Santé se perçoit en effet comme un simple prestataire de services au profit de l’administration pénitentiaire. Une certaine forme d’incompréhension et de méfiance réciproques semble s’être installée, rendant d’autant plus difficile la définition d’une politique partagée et portée par tous en matière de prise en charge sanitaire des personnes détenues.
C’est pourquoi, votre Rapporteur propose de renforcer le pilotage national des actions « santé et justice » en milieu pénitentiaire, grâce à la mise en place d’un comité de pilotage restreint, qui serait placé sous l’autorité directe du Premier ministre et présidé par lui. Ce comité de pilotage aurait pour responsabilité, d’une part, d’arbitrer les éventuels différends intervenus entre les ministères de la Justice et de Santé et, d’autre part, de présenter les solutions retenues aux ministres concernés pour validation.
De manière générale, ce comité de pilotage, qui pourrait comprendre en son sein des personnalités qualifiées, extérieures à l’administration (à l’instar du contrôleur général des lieux de privation de liberté), se verrait assigner une double mission, consistant non seulement à coordonner l’ensemble des actions « santé et justice » au niveau national (c’est-à-dire l’action des différentes directions d’administration centrale concernées (32)), mais également de définir et d’impulser une véritable politique sanitaire, aux contours clairement précisés et aux contraintes mieux partagées par les différents acteurs.
Proposition n° 3
Instituer au niveau national un comité de pilotage restreint, placé sous l’autorité directe du Premier ministre et présidé par lui. Ce comité, qui pourrait comprendre des personnalités qualifiées, extérieures à l’administration (à l’instar du contrôleur général des lieux de privation de liberté) aura la responsabilité d’impulser une véritable politique sanitaire en prison, aux objectifs clairement précisés et aux contraintes mieux partagées par tous.
b) Au niveau régional et local
Le système de pilotage mis en œuvre au niveau national a été récemment relayé à l’échelon régional et local, tant du côté pénitentiaire que sanitaire, par la nomination de référents « santé en prison » au sein des services déconcentrés (agences régionales d’hospitalisation et directions interrégionales des services pénitentiaires) ainsi que dans les établissements pénitentiaires et les établissements de santé.
Ainsi, lors de son audition par votre Rapporteur, la direction de l’administration pénitentiaire a rappelé que, dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), un chargé de l’action sanitaire coordonne actuellement l’accès aux soins avec les responsables médicaux des établissements de santé (UCSA ou SMPR), les directions des établissements de santé, les agences régionales de l’hospitalisation en vue d’améliorer la prise en charge des personnes détenues (adéquation entre les effectifs hospitaliers théoriques et réels, demande de création de postes hospitaliers, étude concernant l’adaptation des locaux médicaux aux besoins sanitaires…).
Cependant, le pilotage sanitaire de l’offre de soins en milieu pénitentiaire pâtit actuellement d’un manque de visibilité et donc d’efficacité au niveau régional. En effet, alors que seize thématiques ont été arrêtées comme devant obligatoirement être traitées dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) pour la période 2006-2011, les soins aux personnes détenues n’y figurent pas en tant que tels.
Ainsi, seuls quatre schémas régionaux d’organisation sanitaire – ceux de la Réunion, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la région Centre et de la région Aquitaine – présentent une approche innovante sur le thème de la prise en charge de la santé des personnes détenues. Ainsi, le SROS de la région Centre (cf. annexe n° 1), dans sa partie dédiée à la prise en charge des personnes détenues, définit les orientations stratégiques retenues en la matière, à savoir l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins (mise à niveau des moyens des structures existantes, sécurisation des transports des détenus, renforcement de l’articulation entre les différentes institutions), la promotion d’une UHSA en région Centre ou bien encore la mise en œuvre d’un observatoire régional de la santé des détenus. De la même manière, le SROS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (cf. annexe n° 1) rappelle, dans son volet consacré à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, la nécessité de « définir une politique régionale de santé mentale en milieu pénitentiaire et de poursuivre le travail de coordination régionale engagé ». Cette ambition se décline en plusieurs axes : renforcement de la visibilité des soins aux personnes détenues, amélioration de l’hospitalisation dans les établissements de santé ou bien encore organisation de la continuité des soins et des relais sanitaires et sociaux.
Cependant, votre Rapporteur propose de renforcer le pilotage de la prise en charge des personnes détenues au niveau régional, afin que la politique sanitaire définie et impulsée au niveau national tienne compte des bassins de vie et de leurs spécificités.
C’est pourquoi, il convient de confier explicitement aux futures agences régionales de santé (ARS) la double mission d’identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et de réguler l’offre de soins en milieu pénitentiaire. Cette direction stratégique confiée aux ARS devrait se traduire par l’inscription dans tous les schémas régionaux d’organisation sanitaire d’un volet « santé en prison », concernant aussi bien les aspects somatiques que psychiatriques.
Par ailleurs, les directeurs d’ARS animeraient et présideraient, au niveau de la région sanitaire, un comité de pilotage restreint – simple déclinaison du comité de pilotage créé au niveau national – qui regrouperait les référents « santé en prison » nommés au sein des services déconcentrés ainsi que dans les établissements pénitentiaires et les établissements de santé.
Ces comités de pilotage régionaux, présidés par les directeurs d’ARS, auraient ainsi pour mission de coordonner l’action de l’ensemble des référents « santé en prison » en région et pourraient bénéficier en retour de leur appui technique pour décliner au plus près des besoins locaux la politique sanitaire des personnes détenues définie au niveau national.
Proposition n° 4
Confier aux futures agences régionales de santé la double mission d’identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et de réguler l’offre de soins en milieu pénitentiaire. Pour ce faire, il convient de prévoir l’inscription dans l’ensemble des schémas régionaux d’organisation sanitaire d’un volet thématique sur la « santé en prison », concernant aussi bien les soins somatiques que psychiatriques.
Proposition n° 5
Instituer au niveau régional un comité de pilotage restreint, composé de l’ensemble des référents « santé en prison » et présidé par le directeur de l’agence régionale de santé, afin de décliner au plus près des besoins locaux les grands objectifs nationaux de la politique sanitaire des personnes détenues.
En outre, il serait opportun d’organiser, sous l’autorité du comité de pilotage national présidé par le Premier ministre, une conférence annuelle rassemblant l’ensemble des référents « santé en prison », afin de permettre une remontée des informations utiles et de définir une politique sanitaire en prison cohérente sur l’ensemble du territoire, tout en tenant compte des spécificités régionales.
Proposition n° 6
Organiser, sous l’autorité du comité de pilotage national présidé par le Premier ministre, une conférence annuelle rassemblant l’ensemble des référents « santé en prison », afin de permettre une adaptation continue et progressive de la politique sanitaire en milieu pénitentiaire.
B. LA COOPÉRATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS INTERVENANT EN PRISON EST TROP SOUVENT DÉFAILLANTE
1. Les relations entre les UCSA et les SMPR sont marquées par des logiques de territoire
Le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues (33) souligne l’importance de l’articulation entre les personnels des SMPR et des UCSA dans leurs missions de soin et de prévention « pour assurer une prise en charge globale du patient ». L’enjeu est donc bien de mettre en place un travail de concertation qui peut revêtir plusieurs aspects : dossier médical commun, prescriptions de médicaments, étude en commun des cas difficiles, notamment celui des patients du quartier disciplinaire ou du quartier d’isolement, mise en place du programme d’éducation à la santé ou bien encore participation aux réunions institutionnelles.
Or, plusieurs difficultés font aujourd’hui obstacle à une articulation adéquate entre les personnels des UCSA et des SMPR. Le rapport sur l’organisation des soins aux détenus, réalisé par l’IGAS et l’IGSJ en juin 2001, indiquait notamment que « les relations entre les personnels des UCSA et des SMPR sont […] difficiles, oscillant la plupart du temps entre une absence de contacts autre que purement formels et des situations d’hostilité manifeste ». Votre Rapporteur, lors de ses différents déplacements et auditions, a également pu constater que, dans certains établissements pénitentiaires, les relations entre UCSA et SMPR étaient relativement conflictuelles. Deux constats permettent d’illustrer la logique de territoire qui préside aux relations entre UCSA et SMPR.
En premier lieu, la circulation de l’information entre les personnels des UCSA et des SMPR est défaillante. Ainsi, bien qu’encouragée, la mise en œuvre de dossiers médicaux communs aux SMPR et à l’UCSA n’est pas répandue dans tous les établissements pénitentiaires. Ces derniers ayant développé leurs propres applications, la mise en œuvre d’un dossier unique sous format informatique est rendue d’autant plus difficile que l’ensemble des UCSA et SMPR ne dispose pas à ce jour de l’équipement et du câblage nécessaires. Par ailleurs, les demandes des personnels des UCSA, médecins et infirmiers, quant à l’état psychiatrique d’un détenu reste trop souvent sans réponse, même pour échanger des informations d’ordre général. De la même manière, les réunions communes ne sont pas la règle et, lorsqu’elles ont lieu, elles sont rarement porteuses d’un projet commun.
En second lieu, on note parfois une absence de positions communes sur certains dossiers majeurs, qui font plus particulièrement l’objet de discussions fréquentes entre UCSA et SMPR. Tout d’abord, comme le notait le rapport précité de l’IGAS et de l’IGSJ, « la gestion de l’urgence psychiatrique est insuffisamment coordonnée dans beaucoup d’établissements, certains SMPR niant l’existence d’urgences psychiatriques, d’autres assumant au contraire leurs responsabilités en la matière. Dès lors, les médecins comme les infirmiers des UCSA ressentent mal une absence de réponse face à des situations jugées problématiques ». Ensuite, la distribution des médicaments soulève parfois des difficultés dans les établissements où ce sont les infirmières de l’UCSA qui distribuent l’ensemble des médicaments, y compris ceux prescrits par le SMPR.
Parmi les raisons pouvant être évoquées afin d’expliquer une telle situation, il convient de noter que la collaboration entre UCSA et SMPR se heurte dans les faits à l’éloignement géographique des locaux. Les services somatiques et psychiatriques sont souvent situés à des endroits distincts et mal reliés au sein des établissements pénitentiaires, ce qui en retour ne favorise pas une communication directe au quotidien. En outre, les SMPR et les UCSA au sein d’un même établissement pénitentiaire peuvent être rattachés à des établissements de santé différents. À titre d’exemple, l’UCSA de la maison d’arrêt de Rouen est rattachée au centre hospitalier universitaire de Rouen, tandis que le SMPR de ce même établissement pénitentiaire dépend, pour sa part, du centre hospitalier de Rouvray. De manière plus générale, les particularités de la prise en charge psychiatrique en détention peuvent justifier une vigilance très forte sur le respect du secret médical. Cependant, ce raisonnement aboutit trop souvent à un isolement du SMPR qui cultive son territoire et ses prérogatives et qui n’entend alors pas participer à un quelconque dialogue avec d’autres intervenants.
Afin de remédier à ces difficultés préjudiciables à la prise en charge des détenus, votre Rapporteur propose d’améliorer la coordination entre les UCSA et les SMPR, grâce à la tenue systématique de réunions de coordination hebdomadaires les obligeant à faire le point sur les différents dossiers qu’ils gèrent en commun. Ces réunions hebdomadaires de coordination existent d’ores et déjà dans certains établissements. Ainsi, le protocole qui lie la maison d’arrêt de Rouen au centre hospitalier universitaire de Rouen prévoit à son article 6-1 une réunion des équipes de l’UCSA et du SMPR, tous les lundis, de 11 heures 30 à 12 heures 30, « ayant pour objectifs principaux la prise en charge des patients ».
Proposition n° 7
Améliorer la coordination entre les UCSA et les SMPR, grâce à la mise en place systématique de réunions de coordination hebdomadaires, obligeant ainsi UCSA et SMPR à échanger et à examiner ensemble les différents dossiers qu’ils gèrent en commun.
2. Les relations entre les services médicaux et l’administration pénitentiaire sont marquées par la méfiance et l’incompréhension
a) Une prise en charge sanitaire des personnes détenues reposant sur l’intervention d’un grand nombre d’acteurs
La prise en charge sanitaire des personnes détenues implique un nombre important d’acteurs administratifs qui entretiennent entre eux des rapports complexes.
Du côté du ministère de la Justice, interviennent les autorités judiciaires, elles-mêmes diverses, les différents échelons de l’administration pénitentiaire ainsi que les services pénitentiaires d’insertion et de probation.
Du côté du ministère de la Santé, les acteurs sont également nombreux : chefs de service des hôpitaux de rattachement des UCSA et des SMPR, direction des hôpitaux concernés, agences régionales d’hospitalisation, autorité préfectorale, direction départementale de l’action sanitaire et sociale ainsi que les caisses primaires d’assurance maladie.
Du côté de la sécurité publique, il faut également mentionner le rôle majeur joué par la police et la gendarmerie dans l’organisation des extractions médicales.
Ainsi, comme le soulignait le rapport précité de l’IGAS et de l’IGSJ, « dès lors, toute volonté de faire progresser la prise en charge passe par une large concertation, trop souvent bloquée par des logiques institutionnelles ou par la simple ignorance des modes de fonctionnement respectifs de chacun des acteurs ».
b) Une nécessaire, mais difficile coopération entre médecins et administration pénitentiaire en matière sanitaire
La coordination des soins en milieu pénitentiaire dépend actuellement pour l’essentiel de la capacité des acteurs locaux à travailler en bonne intelligence.
Se pose en effet avec acuité le problème des relations entre les personnels pénitentiaires et les médecins, quelle que soit la structure d’exercice de ceux-ci. Il convient tout d’abord de noter que les relations entre personnels pénitentiaires et médecins voient s’affronter deux cultures professionnelles différentes.
« Alors que les médecins doivent avoir pour souci prioritaire la santé de leur patient, le respect de son consentement et de son autonomie dans une optique tant curative que d’éducation à la santé, les personnels pénitentiaires, au premier rang desquels se trouvent les surveillants, ont pour mission d’assurer la surveillance de détenus présentant des degrés de dangerosité divers » (34). Ils ne peuvent ainsi que constater et subir les problèmes de santé des détenus, éprouvant maintes difficultés à communiquer avec les médecins.
Au choc de cultures professionnelles différentes vient s’ajouter le fait que le secret médical interdit de révéler la nature exacte de la pathologie dont souffre le détenu, quand bien même elle est source d’inquiétude, le VIH, les hépatites et la tuberculose représentant un risque pour les personnels.
« De plus, les traitements ont pour but de soigner, et non nécessairement de limiter le trouble éventuel que cause un détenu atteint par exemple d’une pathologie mentale, ce qui peut également être facteur de tension. Théoriquement exclus de la consultation médicale, privés d’information sur la maladie et du pouvoir de suggérer un infléchissement du traitement, les surveillants se trouvent placés dans une situation d’autant plus difficile qu’ils doivent continuer d’assurer le bon fonctionnement de la prison, en luttant contre les trafics de médicaments désormais remis en doses hebdomadaires ou mensuelles, mais également la sécurité des détenus dont l’état de santé est cause de troubles, ainsi que celle des personnels médicaux. À ces charges accrues de surveillance s’ajoute l’obligation de signaler les symptômes inquiétants, voire d’appeler les secours en cas d’absence des médecins » (35).
Afin de pacifier et d’aplanir les relations parfois difficiles entre personnels pénitentiaires et médicaux, les directeurs d’établissements pénitentiaires, avec l’aide des médecins et parfois à leur demande mettent en place des dispositifs de concertation et de dialogue.
« En effet, s’il ne peut être question de transformer la prison en hôpital et s’il est impératif d’éviter toute instrumentalisation des médecins par l’administration pénitentiaire qui aboutirait à faire d’eux la caution médicale de la peine et des éventuelles sanctions disciplinaires, un dialogue et des échanges d’information constants sont nécessaires » (36).
En outre, l’articulation et la collaboration entre les services de santé et l’administration pénitentiaire sont encadrées et organisées, sur le plan institutionnel, par la signature de protocoles locaux, qui prévoient des instances de concertation et de résolution des conflits éventuels (cf. annexe n° 2).
LES PROTOCOLES RELATIFS À LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES DÉTENUS
• Protocole entre le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et le centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire :
Article 7 – L’UCSA s’associe pleinement à la direction du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan dans la promotion des règles pénitentiaires européennes et notamment dans la volonté de développer une véritable prise en charge pluridisciplinaire des détenus, permettant un suivi individualisé et adapté au profil de chaque détenu.
L’approche partagée de chaque détenu se fera par un échange d’informations et d’analyses, dans le respect des obligations et prérogatives de chaque partenaire, en particulier du secret professionnel. L’UCSA s’engage donc à participer à la commission pluridisciplinaire unique, au rapport de détention dans le cadre de la prévention des suicides et à consigner ses observations dans le cahier électronique de liaison.
Cette connaissance pluridisciplinaire de la population pénale se réalise dans le cadre du partage opérationnel d’information. Au-delà de ces instances, l’échange d’informations sera favorisé en toutes circonstances.
• Protocole entre le centre hospitalier universitaire de Nantes et le centre pénitentiaire de Nantes relatif à la prise en charge sanitaire des détenus :
Article 14 – Les responsables du centre hospitalier universitaire et de l’administration pénitentiaire se concertent au tant que de besoin et se réunissent au moins une fois par an à l’occasion de la remise du rapport annuel d’activité.
À cette occasion est réuni un comité de suivi incluant, outre le directeur général du CHU ou son représentant et le directeur du centre pénitentiaire ou son représentant, le chef de service de l’urgence accueil, le responsable médical de l’UCSA, la surveillante-chef de l’urgence accueil, le cadre soignant UCSA-SMPR, le chef de service du SMPR, le directeur de la DDASS ou son représentant, le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant.
Cependant, même si les protocoles d’accord et les instances de coordination qu’ils prévoient permettent d’aplanir les difficultés que la collaboration quotidienne entre médecins et administration pénitentiaire n’a pas permis de régler, des difficultés de fonctionnement persistent, renforcées par les conditions d’exercice en milieu pénitentiaire, particulièrement dans les établissements présentant une forte surpopulation carcérale ou ceux éloignés des grands centres urbains, qui doivent faire face à des vacances de postes médicaux et soignants. En définitive, les bonnes relations et la collaboration entre personnels médicaux et pénitentiaires dépend très fortement de l’implication des acteurs en présence.
c) Le délicat équilibre entre priorités afférentes à la vie carcérale et priorités sanitaires
Au cours des auditions réalisées par votre Rapporteur, il est apparu à plusieurs reprises que le personnel médical avait parfois le sentiment d’être considéré par l’institution pénitentiaire comme un « intervenant extérieur », après avoir bénéficié jusqu’à récemment d’un statut d’intrus toléré. Par ailleurs, entre ces institutions, deux logiques cohabitent difficilement : celle de la garde et de la sécurité et celle des soins. Ainsi, les mesures de sécurité (menottes, escortes, garde policière, etc.) compliquent et retardent les prises en charge sanitaires quand elles ne les empêchent pas totalement faute de moyens matériels.
De manière générale, il est difficile de coordonner l’application du règlement de l’établissement pénitentiaire et l’intervention du médecin. Ainsi, les consultations à l’UCSA sont préparées à l’avance et, le jour venu, les détenus ne sont pas amenés individuellement à leur consultation, mais par groupe de dix ou quinze. Certaines personnes auditionnées par votre Rapporteur ont souligné que, perdant patience en salle d’attente, les détenus ont tendance à s’énerver et, anticipant cette situation, à refuser les soins, dont ils auraient pourtant besoin. De la même manière, les consultations psychiatriques sont données en détention dans un contexte jugé peu satisfaisant, l’expression de la demande de soins du détenu ne se réalisant pas dans de bonnes conditions. En effet, la procédure permettant d’obtenir une consultation au SMPR est une procédure écrite – alors que 40 % de la population carcérale est illettrée – et ne présente pas toutes les garanties de confidentialité à l’égard aussi bien des surveillants que des codétenus. Au final, les délais pour obtenir une consultation sont très longs, la procédure s’avérant inadaptée à la population carcérale.
Par ailleurs, les acteurs médicaux ont parfois le sentiment que l’indépendance dans lesquelles ils exercent leurs missions est remise en cause par les personnels de l’administration pénitentiaire qui cherchent en retour à « instrumentaliser » le médecin à des fins autres que sanitaires. Aussi leur est-il régulièrement demandé des certificats médicaux pour l’obtention d’une couverture ou d’un balai ergonomique ou bien encore pour statuer sur la « compatibilité » avec le placement en quartier disciplinaire. Ces demandes contraignent le praticien à s’inscrire dans une logique qui n’est pas la sienne : donner un avis sur une sanction.
Nombreux sont les médecins rencontrés par votre Rapporteur qui ont souligné les difficultés de toute prise en charge sanitaire au regard des contraintes de l’univers carcéral. Ainsi, la nécessité pour la demande de soins de transiter, dans un très grand nombre de cas, par un intermédiaire, le surveillant, est souvent perçue comme une difficulté. Cependant, cette demande peut, dans certains établissements, se faire directement, lors du passage de l’infirmière qui distribue les médicaments. Au quotidien, il est par ailleurs fréquent que le détenu ne se rende pas à une consultation pour différentes raisons – parloir, promenade, transfert – sur lesquelles le médecin n’a pas de prise, et dont il est peu informé, ou trop tardivement. La pratique des transfèrements successifs de détenus entre établissements pénitentiaires est également dénoncée par les médecins, parce qu’elle empêche toute prise en charge suivie, que ce soit sur le plan somatique et psychiatrique.
d) L’organisation des extractions médicales demeure un point de blocage majeur
Conformément aux règles pénitentiaires européennes, qui prévoient que « les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison » (37), la règle en détention est que les consultations de spécialistes impossibles à organiser en prison et les hospitalisations de prisonniers s’effectuent au sein des structures hospitalières de rattachement ou des unités spécialisées.
Or, ces extractions médicales – environ 55 000 chaque année – s’avèrent particulièrement coûteuses – 1 300 euros en moyenne en Île-de-France (38) – et restent un point de blocage persistant entre l’administration pénitentiaire et les personnels médicaux. En effet, du côté de l’administration pénitentiaire, la gestion des extractions mobilise un nombre important d’agents. La circulaire n° 2004-07 du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale prévoit que l’escorte pénitentiaire est composée au minimum de deux agents et d’un chauffeur, qui peut également être un personnel pénitentiaire. Ainsi, le plus souvent, trois agents sont nécessaires pour organiser l’extraction médicale d’un seul détenu.
Les sorties médicales sont également difficiles à organiser puisqu’elles relèvent de plus en plus de la responsabilité unique de l’administration pénitentiaire conformément au programme transfert en trois ans (2007-2009) à l’administration pénitentiaire de la mission de garde et d’escorte des détenus hospitalisés, autrefois dévolue à la police et à la gendarmerie nationales. Cependant, les escortes impliquent encore ces services selon des modalités variables localement. Le rapport de la mission d’audit et de modernisation de juillet 2007, consacré à la mission de garde et d’escorte des détenus hospitalisés, estimait le coût total des sorties pour hospitalisation à au moins 41 millions d’euros dont 17 supportés par l’administration pénitentiaire. « Une demande de sortie par un médecin de l’UCSA ou du SMPR fait donc toujours l’objet d’une négociation avec le directeur de la prison. C’est à nouveau la qualité de la relation de travail tissée entre responsables médicaux et pénitentiaires qui détermine la plus ou moins grande facilité pour les détenus de l’accès aux soins extérieurs et la rapidité de la réponse aux situations d’urgence » (39).
Ainsi, les différents examens (scanner, IRM, etc.) sont reportés faute d’escortes et de disponibilités des établissements hospitaliers. On estime que les mesures d’extraction sont annulées à la demande des autorités pénitentiaires dans 5 à 25 % des cas. Pour les personnels médicaux des UCSA, la limitation des extractions constitue un frein majeur à tout développement de la qualité des soins et les conduit à entrer dans une logique de sélection des extractions contraires à la déontologie médicale. Face à cette limitation qui prend parfois la forme de quotas journaliers ou hebdomadaires d’extractions médicales, les médecins sont nécessairement conduits à opérer un tri entre les consultations, actes de soins, ou hospitalisations plus ou moins urgentes, ce qui ne peut être jugé comme satisfaisant.
Alors que la limitation des extractions médicales constitue un point de blocage entre les différentes administrations, votre Rapporteur propose de densifier la prise en charge sanitaire dans les UCSA grâce au recours plus systématique à la télémédecine et à la vidéo-consultation. Ainsi, comme le notait M. Nicolas About dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire, « la télémédecine reste à développer, et notamment dans l’optique d’améliorer les soins en prison en raison de la difficulté des extractions pour consultation à l’hôpital. Ainsi, le coût initial d’investissement dans les dispositifs de télémédecine devrait être rapidement compensé par la réduction rapide des frais liés aux sorties, tant pour l’administration pénitentiaire que pour l’hôpital. » La télémédecine peut prendre une vraie place dans deux cas : la lecture des radios et la transmission des résultats de sérologie d’une part, les consultations à distance (cardiologie, dermatologie…) d’autre part.
Proposition n° 8
Densifier la prise en charge sanitaire dans les UCSA grâce au recours plus systématique à la télémédecine et à la vidéo-consultation, afin de lever certaines des difficultés liées aux extractions médicales.
C. ASSURER LA CONTINUITÉ DES SOINS, NOTAMMENT PSYCHIATRIQUES, APRÈS LA SORTIE DE PRISON
1. Éviter que la libération ne signifie l’interruption brutale des soins
La prise en charge médicale des personnes détenues prend tout son sens si elle s’inscrit dans la durée, c’est-à-dire au-delà du séjour en prison. En outre, comme le rappelait M. Nicolas About, dans son avis précité sur le projet de loi pénitentiaire, « l’incarcération devant s’inscrire dans une démarche de réinsertion, soigner et tenter de maintenir en bonne santé les détenus une fois leur peine purgée font intégralement partie des missions assignées aux médecins exerçant en prison. » Cet objectif suppose notamment une politique de prévention et une éducation à la santé à destination des détenus. Elle se traduit également parfois par l’engagement dans une thérapie dont l’efficacité repose sur la continuité, dont le respect dépend de l’organisation des soins au moment de la sortie.
Les chiffres fournis par l’administration pénitentiaire indiquent que la durée moyenne d’incarcération des détenus est d’un peu plus de huit mois. Pendant cette période, tout détenu effectue dès le premier jour une visite médicale au sein de l’UCSA de la prison où il se trouve ; il commence éventuellement un traitement de type somatique allant de la vaccination à la commande de prothèses dentaires, et parfois un traitement de type psychiatrique, en addictologie notamment.
Cette démarche de soins peut prendre fin du jour au lendemain dès que la décision de sortie est prononcée. Une mauvaise communication entre la direction de la prison et les médecins, ou une décision de remise en liberté prononcée par un juge hors de la période de permanence des soins (un vendredi soir par exemple), entraîne une sortie sans attendre la prothèse commandée, les résultats d’analyses ou même une ordonnance permettant la poursuite du traitement entamé. On ne peut certes envisager de maintenir en détention pour des raisons d’organisation des soins une personne que la justice a libérée, mais une brusque interruption du suivi est contraire à l’objectif de santé publique que fixe la loi de 1994 et elle est potentiellement dangereuse tant pour l’ancien détenu que pour la société, ne serait-ce que dans le cas d’une interruption d’un traitement à la méthadone. L’étude faite par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur les traitements de substitution en prison note ainsi que le principal obstacle relevé par 40 % des médecins des UCSA et SMPR concerne « la difficulté à connaître la date de sortie du patient compte tenu notamment des aménagements de peine » (40).
Or, si le temps de l’incarcération doit permettre d’améliorer certaines situations sociales et de mettre au point un projet médico-social de sortie, il convient cependant de souligner que la libération est le plus souvent synonyme de retour à la précarité, ce qui, en soi, constitue un obstacle au suivi médical et thérapeutique prévu à la sortie de prison.
Le manque de coordination entre les structures médicales et les SPIP explique en partie ce constat. Ainsi, lors de son audition par votre Rapporteur, M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a déploré l’absence de lien, à ce jour, entre les acteurs médicaux, d’une part, et les juges de l’application des peines ainsi que les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), d’autre part.
Les SPIP sont confrontés aux récidives multiples des détenus ainsi qu’à une certaine insuffisance de moyens et de personnels. Comme l’avait souligné le premier rapport de la mission, « l’augmentation du nombre de mesures de milieu ouvert, passé de 125 000 en 2005 à 146 000 en 2007, les moyens consacrés à la préparation des projets d’insertion et d’aménagement de peine en milieu fermé, l’exécution d’un nombre considérable de mesures en attente ainsi que les nouvelles tâches confiées aux SPIP ont absorbé l’essentiel des nouveaux moyens qui leur ont été alloués, sans permettre d’améliorer ni les conditions de travail des agents, ni la qualité du suivi mis en place » (41). En définitive, le contraste est aujourd’hui grand entre l’amélioration de la prise en charge médicale intervenue en milieu carcéral d’une part, et l’absence d’une véritable continuité des soins chez les sortants de prison, d’autre part.
2. Repenser le suivi des soins psychiatriques après la sortie de prison dans une véritable démarche de réinsertion
Afin de favoriser leur réinsertion et de ne pas les stigmatiser, aucun système de prise en charge spécifique dédié aux sortants de prison n’a été prévu. Ainsi, ils sont orientés vers les dispositifs de droit commun, aussi bien en matière de soins somatiques que psychiatriques.
Le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues (42), dans sa partie dédiée à l’organisation du suivi médical après la libération, rappelle toutefois qu’ « avant sa libération, la personne détenue qui fait l’objet d’un suivi, est reçue par un médecin de l’UCSA », qui lui rédige une lettre pour le médecin de son choix (hospitalier ou libéral), comportant le nom et les coordonnées du médecin traitant en milieu pénitentiaire. Il y est également précisé que « la préparation à la sortie des personnes détenues nécessite une étroite coopération avec les personnels pénitentiaires pour éviter que le caractère inopiné d’une libération » ne compromette le suivi des soins après la sortie de prison.
Lors de son audition par votre Rapporteur, Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, a estimé que cette organisation n’était pas satisfaisante et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, les conditions de libération peuvent, dans certains cas, faire obstacle à l’organisation du suivi médical après la libération. Ainsi, l’équipe soignante n’est pas toujours informée de la libération des personnes dans des délais permettant d’organiser la continuité des soins. En deuxième lieu, la libération peut intervenir dans une autre zone géographique que celle où la personne souhaite s’installer, ce qui rend plus difficile en retour la communication entre les équipes de soins. Enfin, les services de psychiatrie générale, dont l’activité est actuellement soumise à de fortes tensions, sont parfois en difficulté pour répondre aux spécificités de ce public particulier. Ainsi, les relations des centres médico-psychologiques avec la justice sont parfois difficiles, les premiers étant parfois réticents à prendre en charge le public que lui adresse le second. Certains services pénitentiaires d’insertion et de probation ont à ce titre souligné qu’il est parfois difficile de faire reconnaître le public incarcéré comme relevant du dispositif de droit commun.
C’est tout particulièrement en matière de soins psychiatriques que la question de la continuité des soins se pose avec acuité. En effet, la sectorisation psychiatrique en fonction du lieu de domicile est en partie inadaptée aux sortants de prison. Lors de son audition par votre Rapporteur, Mme Christiane de Beaurepaire a souligné que les détenus qui, à leur sortie de prison, souffrent d’un trouble psychiatrique, ne bénéficient pas toujours d’un secteur de psychiatrie : ne disposant pas le plus souvent d’une adresse et donc d’un domicile, le détenu ne relève alors d’aucun secteur psychiatrique et ne peut donc être suivi à ce titre, ce qui constitue une indéniable rupture dans la prise en charge psychiatrique. Aussi le traitement commencé en détention s’arrête-t-il une fois le seuil de la prison franchi.
Afin de remédier à ces difficultés, Mme Christiane de Beaurepaire, en qualité de chef du SMPR de la maison d’arrêt de Fresnes, a décidé en 2002 de mettre en place à l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif une consultation post-pénale en milieu ouvert, destinée à assurer le suivi des soins psychiatriques après la détention. La création d’une consultation externe de ce type est en effet possible dans le cadre des textes réglementaires existants. Ainsi, les articles 11 et 12 de l’arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant l’organisation des SMPR invitent statutairement les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire à intervenir dans le cadre de consultations post-pénales, en vue d’assurer la continuité des soins des ex-détenus.
Réservée à l’origine aux personnes bénéficiant soit d’une libération conditionnelle, soit d’une semi-liberté avec obligation de soins ainsi qu’à celles qui en faisaient la demande, cette consultation « extra-pénitentiaire » a par la suite accueilli de nouveaux publics : ex-détenus, suivis en détention par l’équipe du SMPR, désireux de poursuivre les soins avec leur thérapeute ; ex-détenus dépourvus de sectorisation psychiatrique à leur libération et désireux de poursuivre les soins ; ex-détenus sous obligation de soins ; condamnés à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et prévenus placés sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins. Cette consultation post-pénale est donc progressivement devenue une consultation médico-légale, les juges d’application des peines et les SPIP ayant très vite utilisé cette consultation comme appui médical.
Depuis 2002, cette consultation post-pénale, qui a le statut d’unité fonctionnelle du SMPR de la maison d’arrêt de Fresnes, a permis de voir 600 personnes. Elle bénéficie pour ce faire de trois médecins, de trois psychologues ainsi que de deux infirmiers, soit 0,8 ETP de psychiatre, 0,6 ETP de psychologue et 0,3 ETP d’infirmier. Elle assure actuellement le suivi de 300 personnes, dont 295 d’entre eux sont sous obligation des soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un contrôle judiciaire avant jugement. La prise en charge s’effectue suivant plusieurs étapes : fiche de renseignement remplie avec l’intéressé, première consultation avec le médecin afin de réaliser une évaluation et suivi médical régulier (de une à quatre séances par mois selon la thérapie et le patient).
De surcroît, les résultats de la consultation post-pénale en matière de prévention de la récidive sont remarquables, montrant ainsi la pertinence de ce type de prise en charge. Aucune récidive judiciaire n’a été constatée chez les deux cents personnes suivies à la consultation depuis cinq ans dans le cadre d’une obligation de soins relative à une infraction sexuelle.
En effet, cette consultation présente un triple intérêt. Le premier est de poursuivre les soins à la sortie de prison avec les mêmes équipes médicales que celles qui assuraient la prise en charge psychiatrique en détention (SMPR). Le deuxième est d’être une référence et un point de sécurisation pour les personnes sortant de prison : les médecins intervenant en consultation post-pénale étant ceux qui intervenaient en détention (SMPR), la relation de confiance établie en détention entre le médecin et le patient peut se poursuivre à la sortie de prison. Le troisième est d’entreprendre une véritable psychothérapie.
Il convient toutefois de noter que cette consultation post-pénale fonctionne depuis 2002 à moyens constants – dans un préfabriqué mis à disposition par l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif – et grâce au dévouement sans pareil des praticiens qui y interviennent sur la base du volontariat et sur leur temps de travail. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une expérience isolée, puisque, par exemple, une consultation externe a été mise en place dès 1991 par le Docteur Roland Coutanceau au centre médico-psychologique de la Garenne Colombes (Hauts de Seine).
En raison de l’efficacité de cette prise en charge afin de prévenir la récidive et face à l’inadaptation de la sectorisation en fonction du lieu de domicile pour les sortants de prison, votre Rapporteur propose donc de généraliser, sur le modèle de ce qui a été fait à l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif, les consultations post-pénales.
Proposition n° 9
Afin d’assurer la continuité des soins psychiatriques à la sortie de prison et de prévenir au mieux la récidive, généraliser les consultations post-pénales, qui présentent le double intérêt de poursuivre les soins entrepris en détention et d’être un point de sécurisation pour les personnes sortant de prison.
D. LE SECRET MÉDICAL : UN FAUX-PROBLÈME ?
Aujourd’hui, de nombreux médecins n’hésitent pas, dans la pratique quotidienne de leurs missions, à signaler à l’administration pénitentiaire les risques éventuels liés à l’évolution de l’état de santé – psychiatrique, principalement – d’un détenu. Cependant, cette pratique n’est pas systématique et dépend pour une large part de la qualité des relations entre le personnel médical et l’administration pénitentiaire.
Comme votre Rapporteur en a eu le témoignage, certains médecins comprennent le secret médical comme une interdiction absolue de communiquer tout élément lié à la possible dangerosité d’une personne incarcérée. Or, une telle interprétation peut avoir les conséquences les plus graves.
1. Le secret médical cristallise les tensions entre personnels soignants et administration pénitentiaire
Comme le rappelaient l’IGAS et l’IGSJ dans leur rapport sur l’organisation des soins aux détenus, « la gestion du secret médical est le motif le plus fréquent de conflits entre l’administration pénitentiaire et le personnel médical ». Le code de déontologie médical affirme que « le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». En raison de la promiscuité, la prison est un lieu où tout se sait et dans lequel le secret médical est difficile à préserver. Le passage obligé par un surveillant pour toute convocation, médicale ou non, l’étroitesse et l’insonorisation relative des locaux de soins, les jours de consultation et le nom du médecin qui assure la consultation spécialisée, la prise des traitements en présence des codétenus, sont quelques-uns des éléments qui concourent à la rupture de la confidentialité.
Certaines pathologies, en raison de préjugés fortement ancrés, en particulier l’infection par le VIH, peuvent devenir le prétexte à des réactions d’intolérance majeure entre détenus conduisant à l’exclusion. C’est pourquoi le corps médical est fortement attaché au secret médical, qui constitue dans le même temps une protection indéniable des patients en milieu carcéral.
Cependant, comme l’a rappelé Mme Christiane de Beaurepaire lors de son audition par votre Rapporteur, un des obstacles majeurs à une prise en charge sanitaire et psychiatrique optimale reste le cloisonnement prégnant entre les divers intervenants en milieu carcéral. Ainsi, « les informations indispensables ne passent pas ». Il est donc important de « reconstituer un filet de sécurité autour de la personne pour qu’elle ne soit pas coupée symboliquement en morceaux », ce qui implique, selon elle, la mise en place du secret professionnel partagé (entre les services pénitentiaires, les UCSA, les SMPR et les SPIP), afin que les différents intervenants se parlent.
Bien que n’ayant aucune base légale ou réglementaire, le secret professionnel partagé est une réalité dans beaucoup d’établissements pénitentiaires, comme en atteste la rédaction de l’article 7 du protocole entre le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et le centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour la dispensation des soins et la coordination des actions de préventions en milieu pénitentiaire (cf. annexe n° 2). En effet, le partage de l’information entre professionnels de santé et personnels pénitentiaires s’est imposé dans la pratique quotidienne de la détention, afin d’assurer la continuité des soins et d’améliorer leur qualité dans l’intérêt des patients, des personnels soignants et des personnels pénitentiaires. Le secret professionnel partagé poursuit donc un but : prévenir tout risque susceptible d’apparaître en détention, tant pour le détenu que le médecin et les personnels de l’administration pénitentiaire. C’est donc une même exigence de sécurité des conditions de vie et de travail en détention qui préside aujourd’hui et au cas par cas à la mise en place du secret professionnel partagé.
2. Les réponses apportées par le législateur, à l’instar de l’échange d’informations opérationnelles, restent trop souvent méconnues
a) Le secret médical, composante du secret professionnel, s’inscrit dans un cadre juridique clairement défini par le code de la santé publique et le code pénal
Le secret médical, qui constitue un des fondements de la médecine, est aujourd’hui défini à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique et à l’article 4 du code de déontologie des médecins : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi qu’il a vu, entendu ou compris ».
L’obligation au secret apparaît de prime abord d’une extrême simplicité puisqu’il s’agit de la traduction professionnelle de l’obligation générale de discrétion et de respect de la personne d’autrui. La réalité est moins simple et les frontières du secret sont souvent difficiles à définir dans la mesure où l’exigence de discrétion se heurte à des impératifs tels que l’intérêt du malade.
L’obligation au secret s’impose à toute personne amenée à suivre l’état de santé du malade : le médecin, mais aussi les autres membres des professions de santé. Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé. Il concerne à ce titre toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l’exercice médical. Sont ainsi couverts par le secret médical : les déclarations d’un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi les conversations surprises au domicile lors d’une visite, les confidences des familles.
Toute divulgation, en dehors des circonstances autorisées ou permises par la loi, peut être sanctionnée. En effet, le délit de violation du secret professionnel est constitué dès lors que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est effective, intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique et, de surcroît, même si elle n’entraîne aucun préjudice pour celui qu’elle concerne. Sur le plan pénal, c’est l’article 226-13 du code pénal qui définit les sanctions encourues en cas de violation du secret médical qui, outre les sanctions pénales, peut donner lieu à des sanctions civiles et professionnelles. L’article 226-13 du code pénal prévoit ainsi que : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
L’infraction de violation du secret professionnel repose sur l’existence de trois éléments constitutifs, à savoir :
— Une information à caractère secret : il ne s’agit pas uniquement du secret expressément confié, mais de tout ce que le professionnel a vu, entendu, surpris, compris ou deviné ;
— Une personne dépositaire d’une telle information à caractère secret : il s’agit d’une personne dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ;
— La révélation de cette information à caractère secret : dans un certain nombre de situations, révéler une information ou un fait se justifie.
L’article 226-14 du code pénal prévoit ainsi trois cas, dans lesquels le professionnel peut révéler une information à caractère secret.
ARTICLE 226-14 DU CODE PÉNAL
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Il s’agit bien d’une autorisation à divulguer sans encourir de poursuite et non d’une obligation. Cette rédaction traduit le désir du législateur de ne pas entamer le caractère absolu du secret. En revanche, si la personne tenue au secret se tait sur ce qu’elle a pu connaître, cela ne la dispense pas de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de porter secours à personne en péril. En effet, l’article 223-6 dispose que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de la faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
b) « L’échange d’informations opérationnelles » prévu par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté
La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met en place « l’échange d’informations opérationnelles » entre l’administration pénitentiaire et les personnels soignants. Deux innovations législatives ont, pour ce faire, été introduites :
• L’échange d’informations opérationnelles des personnels pénitentiaires vers les personnels de santé autour de la dangerosité en détention
L’article 1er de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a modifié l’article 717-1 du code de procédure pénale, qui prévoit désormais que les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé qui dispensent des soins aux détenus les « informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes ». Cette disposition est à mettre en parallèle des dispositions de l’article 8 de la loi du 25 février 2008 précitée qui a complété l’article L. 6141-5 du code de la santé publique pour prévoir, en sens inverse, un échange d’information des médecins vers le directeur de l’établissement pénitentiaire.
La « protection des personnes » doit s’entendre comme s’appliquant aux personnels pénitentiaires et aux personnels médicaux, qui peuvent faire l’objet d’agressions dans l’exercice de leur mission, mais aussi aux détenus eux-mêmes (prévention des suicides, prévention des agressions sur les codétenus). Pour bien assurer cette protection, les médecins qui interviennent en détention doivent disposer de certaines informations que pourraient détenir les personnels pénitentiaires : motif de l’incarcération, comportement dans un précédent centre de détention, projets à la sortie de la détention, notamment.
Si, au moment de l’adoption de la loi précitée, ce genre d’échanges se pratiquait dans de nombreux établissements où les équipes avaient pris l’habitude de travailler ensemble, il est apparu au législateur que la généralisation de cette pratique, souhaitable dans l’intérêt de tous, ne pouvait passer que par une disposition législative qui l’a transformée en règle.
• L’échange d’informations opérationnelles des personnels de santé vers les personnels pénitentiaires
L’article 8 de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a modifié l’article L. 6141-5 du code de la santé publique, qui dispose désormais que les personnels de santé intervenant dans les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées et des personnes placées en rétention de sûreté doivent, dans le respect du secret médical, signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement pénitentiaire tout « risque sérieux pour la sécurité des personnes » au sein de cet établissement « en transmettant les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection ». Il précise en outre que les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires.
Cette innovation législative ne remet pas en cause le principe du secret médical, qui reste entièrement préservé, mais invite les praticiens à opérer un transfert d’informations opérationnelles à destination de l’administration en charge des lieux de détention ou de rétention dont le seul objet est de garantir la sécurité des personnes (personnels et personnes privées de liberté).
Le législateur a voulu inscrire dans la loi cet « échange d’informations opérationnelles », car nombreuses sont les affaires, qui ont régulièrement mis en exergue la nécessité de réfléchir à la meilleure manière de concilier le principe du secret médical avec la nécessaire information des personnels intervenant en détention sur la dangerosité des personnes détenues. L’article 6141-5 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction définit de nouvelles modalités d’échanges d’informations entre l’administration pénitentiaire et les praticiens, afin de permettre à la première d’obtenir des seconds, sans trahir le secret médical, les informations opérationnelles nécessaires pour évaluer la dangerosité d’un détenu.
M. Didier Houssin, directeur général de la santé, avait souligné lors de son audition par votre Rapporteur, que le médecin, sans rien divulguer du diagnostic ni du traitement engagé, doit, dans un dialogue constructif avec les personnels pénitentiaires, évoquer les risques qui pèsent sur l’individu en termes de dangerosité (risque de suicide, risque d’agression sur des personnels ou sur des codétenus). Il a assimilé cette obligation à celle du code de déontologie des médecins (43) qui leur demande de protéger la santé publique.
Lors des auditions et des déplacements de la mission, votre Rapporteur a pu constater à quel point le secret médical faisait l’objet d’une appréciation divergente. Ainsi, si le secret médical ne constitue pas un problème majeur, les équipes médicales et pénitentiaires parvenant le plus souvent à travailler en bonne intelligence, il peut en revanche cristalliser les conflits entre les différents intervenants. Là encore, l’implication des acteurs est déterminante pour une gestion optimale du secret médical en milieu carcéral.
S’agissant de la nécessité de légiférer sur le secret médical en prison, M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté a rappelé, lors de son audition par votre Rapporteur, qu’il convient de partager le maximum d’informations dans le cadre réglementaire existant, cette meilleure circulation de l’information ne devant pas s’accompagner d’une remise en cause du secret médical. Or, les dispositions relatives au partage d’informations opérationnelles sont trop souvent méconnues sur le terrain. C’est pourquoi, votre Rapporteur estime que la clarification du niveau de confidentialité des informations passe par une sensibilisation accrue des acteurs médicaux et pénitentiaires à la nécessité d’échanger le maximum d’informations dans le cadre réglementaire et législatif existant. Une telle action de sensibilisation doit être envisagée suivant deux leviers d’action. En premier lieu, il revient aux ministères de la Santé et de la Justice de rédiger et diffuser un guide des bonnes pratiques, destiné à harmoniser dans l’ensemble des établissements pénitentiaires les usages en matière de secret médical et d’échanges d’informations. En second lieu, chaque ministère doit engager à destination de l’ensemble des personnels intervenant en détention (médecins, surveillants, directeurs d’établissements) des actions de formation conjointes et répétées sur le thème du secret médical et du partage d’informations.
Proposition n° 10
Sensibiliser les acteurs médicaux et pénitentiaires à la nécessité d’échanger le maximum d’informations dans le cadre réglementaire et législatif existant : la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a mis en place « l’échange d’informations opérationnelles », souvent méconnu sur le terrain. Des actions de formation ciblées et répétées, doublées de la rédaction et de la diffusion d’un guide des bonnes pratiques sur le thème du secret médical et de l’échange d’informations en détention, doivent donc être menées sur le terrain sous l’autorité conjointe des ministères de la Santé et de la Justice, afin de porter à la connaissance de l’ensemble des acteurs concernés (médecins, surveillants, directeurs d’établissement) les dispositions actuellement en vigueur et les potentialités qu’il recouvre en terme de partage d’informations.
DEUXIÈME PARTIE : REDYNAMISER LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE POUR UNE PRÉVENTION PLUS EFFICACE DE LA RÉCIDIVE
L’arsenal législatif prévu pour contrôler les criminels dangereux, lors de leur sortie de prison, et ainsi limiter les risques de récidive, s’est développé, au fil des années, par strates de dispositions successives qui se complètent et se combinent entre elles. En effet, en sus de la libération conditionnelle qui tendait déjà « à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive » (article 729 du code de procédure pénale), le législateur est intervenu, à de nombreuses reprises, notamment par la loi du 17 juin 1998 instituant le suivi socio-judiciaire. Alors que la loi du 25 février 2008 est venue compléter le dispositif de prévention de la récidive grâce à la mise en place de la surveillance et de la rétention de sûreté, il est apparu nécessaire à votre Rapporteur de procéder à une évaluation objective du suivi socio-judiciaire dix ans après le vote de cette mesure.
I. LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, UNE MESURE SINGULIÈRE ET PORTEUSE D’EFFICACITÉ POUR LUTTER CONTRE LA RÉCIDIVE
A. LA MISE EN PLACE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE D’ÉLARGISSEMENT DES SOINS PÉNALEMENT ORDONNÉS
1. Une mesure présentant un caractère sui generis, intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté
Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Il peut soit être prononcé par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit, soit être décidé postérieurement par le juge de l’application des peines, au titre de mesure de sûreté. Le suivi socio-judiciaire s’accompagne d’obligations sociales ou médicales réalisées sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Selon la doctrine, il présente un caractère sui generis intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté. Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de « peine complémentaire » (44) et estimé, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, qu’il ne pouvait s’appliquer pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi.
Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d’assistance et de surveillance destinées à prévenir la récidive. Si la mesure est prononcée en même temps qu’une peine privative de liberté, elle ne commencera à courir qu’à compter de la libération du condamné. Ainsi, dès lors qu’il est prononcé en même temps qu’une peine privative de liberté, le suivi socio-judiciaire permet d’exercer un contrôle post-carcéral du condamné.
2. Initialement réservé aux infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a été étendu à l’essentiel des infractions violentes
Le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi. Alors qu’il avait été initialement créé à destination des auteurs d’infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a été progressivement étendu à l’essentiel des infractions violentes, ce qui lui donne aujourd’hui une place centrale dans le dispositif de prévention de la récidive des infractions violentes.
Ainsi, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a élargi le champ du suivi socio-judiciaire : sont désormais visées, outre les infractions sexuelles qui constituaient le champ d’application initial de la mesure, toutes les atteintes criminelles à la vie (article 221-9-1 du code pénal), tous les enlèvements et séquestrations (articles 224-1 à 225-2 du code pénal), les actes de torture et de barbarie (articles 222-48-1 du code pénal) et la destruction volontaire de biens par explosif ou incendie (article 322-18 du code pénal).
En outre, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a étendu la peine de suivi socio-judiciaire aux actes de violence contre les personnes commis par le conjoint ou ex-conjoint ou le concubin ou ex-concubin de la victime ou le partenaire ou ex-partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (article L. 222-48-1 du code pénal).
Enfin, depuis cette même loi, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle si les violences sont commises de manière habituelle, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou de décision spécialement motivée par le tribunal. En matière criminelle, la cour d’assises délibère spécialement sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a néanmoins fixé cette durée à trente ans lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle. Elle a également permis à la cour d’assises de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire s’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
INFRACTIONS POUR LESQUELLES LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE EST ENCOURU
Crimes |
Loi du 17 juin 1998 |
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (article 222-48-1 du code pénal) - viol simple ou aggravé (art. 222-48-1 du code pénal). |
Loi du 12 décembre 2005 |
- meurtre et assassinat (article 221-9-1 du code pénal) - torture ou acte de barbarie (article 222-48-1 du code pénal) - enlèvement ou séquestration (article 224-10 du code pénal). | |
Délits |
Loi du 17 juin 1998 |
- agression sexuelle et exhibition sexuelle (article 222-48-1 du code pénal) - corruption de mineur : fixation, enregistrement, diffusion de l’image pornographique d’un mineur, diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur (article 227-31 du code pénal) |
Loi du 12 décembre 2005 |
- destruction ou dégradation d’un bien sous l’effet d’un incendie ou d’une substance explosive (article 322-18 du code pénal). | |
Loi du 5 mars 2007 |
- violences commises au sein du couple (article 222-48-1 du code pénal) |
3. En 2007, le législateur a décidé de généraliser l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire
a) Les obligations du suivi socio-judiciaire
Les obligations du suivi socio-judiciaire qui doivent être initialement fixées par la juridiction de jugement renvoient, d’une part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve (aide sociale et, le cas échéant, aide matérielle) et comportent, d’autre part, des dispositions spécifiques (interdiction de paraître dans certains lieux ; interdiction de rencontrer certaines personnes ; interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs…).
Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre une injonction de soins. L’inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale doit être initialement fixée par la juridiction de jugement et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime. Il appartient au juge de l’application des peines d’ordonner, en tout ou partie, l’exécution de cet emprisonnement.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a étendu le contenu du suivi, en permettant que le placement sous surveillance électronique mobile puisse en constituer une des composantes.
b) La généralisation de l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire
Par ailleurs, la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a généralisé l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire : alors que ce n’était jusqu’à présent qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du juge, après expertise médicale, le législateur a voulu qu’au stade de la condamnation, tout suivi socio-judiciaire s’accompagne désormais d’une injonction de soins, à la double condition que l’expertise préalable y ait conclu favorablement et que le juge ne décide pas d’y renoncer.
En cas de condamnation à une mesure de suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, la juridiction de l’application des peines désigne sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur chargé de la mise en œuvre de l’injonction de soins.
Le médecin coordonnateur doit, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, inviter le condamné à choisir un médecin traitant pour l’accomplissement des soins, conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande et transmettre à la juridiction de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins. Jouant un véritable rôle d’interface, il assure ainsi la liaison entre la juridiction de l’application des peines et le médecin traitant.
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers afin de permettre au condamné de justifier auprès de la juridiction de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) l’accomplissement de son injonction de soins.
L’INJONCTION DE SOINS
Aux termes de l’article 131-36-4 du code pénal, le suivi socio-judiciaire « peut comprendre une injonction de soins ». L’injonction, prononcée par la juridiction de jugement, demeure subordonnée à une expertise médicale établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
L’injonction de soins prend tous ses effets à la libération du condamné. Le juge de l’application des peines doit alors désigner un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République (art. L. 3711-1 du code de la santé publique). Le médecin coordonnateur assume une triple fonction : il invite le condamné à choisir son médecin traitant ; il conseille le médecin traitant (considéré comme étant le médecin référent) à la demande de celui-ci ; il transmet au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction des soins.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive a été complétée afin de permettre au médecin traitant de prescrire à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire des médicaments entraînant une diminution de la libido. Cette prescription est subordonnée à l’accord de la personne sous la forme d’un consentement secret et renouvelé au moins une fois par an.
La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a prévu que l’injonction de soins pourrait aussi s’appliquer dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, de la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, à la condition qu’une expertise établisse la possibilité d’un traitement.
La part des suivis socio-judiciaires assortis d’une injonction de soins n’est pas appréhendée par les statistiques du ministère de la Justice. Il semble cependant qu’elle demeure faible. En réalité, le dispositif d’injonction de soins souffre d’une triple faiblesse que la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le traitement de la récidive avait mise en évidence en 2004.
Tout d’abord, la pénurie de psychiatres dans le secteur public – quelque 800 postes vacants – explique que certains tribunaux de grande instance soient dépourvus de médecins coordonnateurs. Ensuite, certains estiment que « la prise en compte thérapeutique de la délinquance sexuelle est limitée, d’une part, par l’insuffisante formation des médecins psychiatres dans ce domaine et, d’autre part, par le fait que les auteurs de ces actes sont considérés, par une majorité de psychiatres, comme des « pervers » au sens clinique et à ce titre non susceptibles – à la différence des schizophrènes – d’un traitement » (45).
Enfin, le nombre de médecins traitants apparaît insuffisant au regard des besoins. Afin de remédier à cette difficulté, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a prévu d’élargir le « vivier » des responsables du traitement thérapeutique aux titulaires d’un diplôme de troisième cycle en psychologie clinique.
Source : Rapport d’information n° 420 fait au nom de la Commission des Lois du Sénat portant sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.
B. LES CONDAMNATIONS À UNE MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE : UN BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 17 JUIN 1998
1. Le suivi socio-judiciaire a été ordonné dans 11 % des cas où le prononcé d’une telle mesure était possible
a) Après un recours très restreint au suivi socio-judiciaire, la montée en charge de cette mesure s’est accélérée à partir de 2000
Après un recours très restreint à cette mesure dès lors qu’elle a été applicable, la montée en charge s’est accélérée à partir de 2000 avec 265 mesures prononcées sur l’année. L’année 2004 a également marqué une étape dans la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire, avec un peu plus de 1 000 mesures prononcées. En 2007, ce sont près de 1 300 mesures de suivi socio-judiciaire qui ont été prononcées par les juridictions françaises, soit quatre fois plus qu’en 2000.
b) Bien qu’encore marginale, la mesure de suivi socio-judiciaire est d’un ordre de grandeur comparable à la réclusion criminelle
Avec 1 285 mesures prononcées en 2007, le suivi socio-judiciaire reste marginal au regard du nombre total de condamnations annuel (0,2 % de l’ensemble). Il est cependant d’un ordre de grandeur comparable à la réclusion criminelle, qui représentait 1 317 condamnations en 2007.
Elle est prononcée en premier ressort dans 86 % des cas, et après appel ou opposition dans 14 % des cas. En 2007, un peu moins de la moitié des suivis socio-judiciaires sont prononcés par les tribunaux correctionnels, 41 % par les cours d’assises, 7 % par les cours d’assises d’appel, et moins de 3 % par les tribunaux pour enfants.
ÉVOLUTION DES CONDAMNATIONS À UNE MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE PAR TYPE DE JURIDICTION
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
Cour d’assises |
32 |
132 |
232 |
339 |
409 |
433 |
461 |
488 |
Cour d’assises pour mineurs |
6 |
10 |
17 |
22 |
38 |
40 |
28 |
39 |
Cour d’appel |
25 |
44 |
49 |
81 |
89 |
92 |
85 |
88 |
Cour d’appel pour mineurs |
— |
— |
2 |
— |
6 |
2 |
1 |
6 |
TGI |
199 |
225 |
332 |
395 |
496 |
544 |
598 |
630 |
Tribunaux pour enfants |
3 |
10 |
10 |
16 |
17 |
24 |
36 |
34 |
Toutes juridictions |
265 |
421 |
642 |
853 |
1 055 |
1 136 |
1 209 |
1 285 |
Ce constat s’explique par le fait qu’il s’agit d’une mesure davantage destinée aux auteurs de crimes : si globalement un suivi socio-judiciaire a été prononcé en 2007 dans 11 % des condamnations où cela était possible, le taux de recours à cette mesure est beaucoup plus élevé en matière criminelle (36 %) qu’en matière délictuelle (7,7 %).
Or, ces données ont été calculées par rapport au champ des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire était encouru avant 2005 (principalement le viol). La sous-direction des statistiques et des études du ministère de la Justice a procédé au même calcul en utilisant le champ du suivi socio-judiciaire élargi aux nouvelles infractions incluses par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Il ressort alors que le taux de recours au suivi socio-judiciaire est de 3,7 % pour l’ensemble, 24 % pour les crimes et 2,3 % pour les délits.
En définitive, si le champ des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire peut être encouru s’est considérablement élargi, le prononcé de la mesure n’a pas à ce jour suivi cette évolution.
c) Une mesure davantage destinée aux auteurs de crimes
De manière générale, le suivi socio-judiciaire reste une mesure davantage destinée aux auteurs de crimes que de délits. En effet, comme votre Rapporteur l’a déjà indiqué, si le suivi socio-judiciaire a été prononcé dans 11 % des condamnations où cela était possible, le taux de recours à cette mesure est beaucoup plus élevé en matière criminelle (36 %) qu’en matière délictuelle (7,7 %).
Ainsi, sur l’ensemble des condamnations pour crime où le suivi socio-judiciaire pouvait s’appliquer en 2007, c’est effectivement un suivi socio-judiciaire (accompagnant une peine ferme) ou un sursis probatoire qui a été prononcé pour 62 % d’entre elles et une peine privative de liberté ferme seule pour 37 % d’entre elles.
À l’inverse, sur l’ensemble des condamnations pour délit où le suivi socio-judiciaire pouvait s’appliquer en 2007, le sursis probatoire (30 %) et le sursis simple (26 %) sont les sanctions les plus prononcées. L’emprisonnement ferme ou partiel est prononcé dans 23 % des cas et le suivi socio-judiciaire seul dans 1,5 %. En revanche, il accompagne une peine ferme ou partielle dans 29 % des cas.
d) Une mesure réservée aux condamnés majeurs
L’âge au moment de l’infraction est un élément déterminant dans la fréquence du recours au suivi socio-judiciaire. Cette mesure n’est en effet que très rarement utilisée pour les condamnés mineurs au moment de l’infraction (pour 0,7 % des condamnations du champ) et reste limitée même lorsque l’infraction principale est un crime : le recours au suivi socio-judiciaire passe alors à 5,4 %, alors qu’il est de 24 % pour les majeurs.
Pour les mineurs condamnés suite à un crime sexuel, la décision la plus fréquente consiste en effet en une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, partiel (33 %) ou total (32 %). La part de ceux qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement au moins partiellement ferme, sans suivi socio-judiciaire, ni sursis probatoire, est également de 10 %.
Le recours au suivi socio-judiciaire est encore plus rare en cas de délit sexuel commis par un mineur. Il n’est alors quasiment pas utilisé, les décisions les plus fréquentes étant dans ce cas une mesure éducative (37 %), une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire total (31 %) ou une peine d’emprisonnement avec sursis total simple (20 %).
Parmi les condamnés majeurs pour crime au moment des faits, on constate que le taux de recours au suivi socio-judiciaire varie également selon l’âge au moment de la condamnation : il est un peu plus fréquent pour les âges intermédiaires (27 % pour les 30 à 60 ans) que pour les plus jeunes (19 % pour les moins de 30 ans) ou pour les condamnés les plus âgés (16 % pour les plus de 60 ans). En cas de délit, le recours est plus élevé pour les condamnés plus âgés (5,2 % contre 2,3 % pour l’ensemble).
Comme le bilan (46) du suivi socio-judiciaire réalisé en 2004 par le ministère de la Justice l’avait montré, « le suivi socio-judiciaire apparaît donc comme une mesure lourde, réservée aux infractions les plus graves (crimes), commises par des majeurs ».
2. Une mesure appliquée en priorité aux crimes et délits sexuels sur mineurs
a) 96 % des condamnés à un suivi socio-judiciaire en 2007 ont commis une infraction sexuelle
De manière générale, les 1 285 condamnés à une mesure de suivi socio-judiciaire en 2007 ont commis à 96 % une infraction sexuelle et plus de la moitié des suivis socio-judiciaires pour délit sont prononcés pour une atteinte ou une agression sexuelle sur mineur.
Suivant le classement réalisé par Mme Valérie Carrasco dans son étude précitée sur le suivi socio-judiciaire, les atteintes aux mœurs délictuelles sont déclinées en quatre catégories : les atteintes et agressions sexuelles, les exhibitions sexuelles, les infractions concernant l’image à caractère pornographique d’un mineur et les infractions concernant l’incitation d’un mineur à un délit, à la violence ou la pornographie, qu’il convient d’appeler « corruption de mineur ».
Une très grande majorité (70 %) des condamnés pour délit à une peine comportant un suivi socio-judiciaire en 2007 ont été reconnus coupables d’une agression ou d’une atteinte sexuelle, et un peu plus de la moitié (56 %) a commis au moins une agression sur un mineur. Parmi toutes les agressions sexuelles commises par ces condamnés, les plus fréquentes sont les « agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans » (34 %), puis les « agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité » (31 %) et les « agressions sexuelles » simples, c’est-à-dire sans circonstance aggravante (21 %).
En dehors des agressions ou atteintes sexuelles, les infractions le plus souvent sanctionnées d’un suivi socio-judiciaire sont les exhibitions sexuelles (12 % des cas), les infractions liées à la corruption de mineur (3 %) et les infractions concernant l’image à caractère pornographique d’un mineur (11 % des cas). Ce dernier contentieux représentait seulement 4 % en 2004.
Outre le (ou les) délit(s) sexuel(s) à l’origine du suivi socio-judiciaire, 2 % des condamnés ont également commis un délit ne portant pas atteinte aux mœurs (coups et violences volontaires ou autres atteintes à la personne, destructions ou dégradations du bien d’autrui).
RÉPARTITION DES CONDAMNÉS POUR DÉLIT À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE EN 2007 SELON LA NATURE DE L’INFRACTION
Nombre de suivis socio-judiciaires |
Proportions (en %) | |
Agression sexuelle sur mineur + autre |
193 |
26 % |
Agression sexuelle sur mineur |
164 |
22 % |
Agression sexuelle seule |
104 |
14 % |
Image pornographique |
97 |
13 % |
Exhibition sexuelle |
89 |
12 % |
Agression sexuelle + autre |
60 |
8 % |
Corruption de mineur |
22 |
3 % |
Autres |
15 |
2 % |
Total |
744 |
100 % |
b) Les condamnés à un suivi socio-judiciaire pour crime ont majoritairement commis un viol
Jusqu’en 2005, les criminels condamnés à une mesure de suivi socio-judiciaire avaient commis soit un viol, soit un crime d’une autre nature et un délit sexuel. En 2007, les condamnés ayant commis un viol représentent une très large majorité (98 %) des condamnés pour crime à un suivi socio-judiciaire.
Mais la plupart des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ayant commis un viol (64 %) sont également poursuivis pour une autre infraction (crime ou délit). Il s’agit rarement d’un autre crime, seuls 4 % des condamnés étant dans ce cas. Par contre, plus de la moitié d’entre eux (53 %) ont également commis une agression ou une atteinte sexuelle, très souvent sur mineur (46 % des condamnés). Enfin, 6 % sont condamnés pour un viol et un autre type de délit à l’occasion de toute atteinte aux mœurs.
Parmi les viols, 4 sur 5 sont commis avec circonstances aggravantes. Il s’agit le plus souvent de « viol sur mineur de 15 ans » (26 % des viols) ou de « viols avec plusieurs circonstances aggravantes » (30 %), suivis des « viols commis sous la menace d’une arme » (7 %). Les « viols commis par ascendant ou personne ayant autorité » représentent pour leur part 4 % des condamnés pour crime à un suivi socio-judiciaire en 2007, contre 12 % en 2004.
Les autres crimes ayant donné lieu au prononcé d’un suivi socio-judiciaire sont des assassinats, des meurtres, des arrestations, enlèvements, séquestrations et torture ou acte de barbarie. Ils forment un peu plus de 2 % des condamnés pour crime à un suivi socio-judiciaire en 2007.
RÉPARTITION DES CONDAMNÉS POUR CRIME À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE EN 2007 SELON LA NATURE DE L’INFRACTION
Catégories |
Nombre de suivis socio-judiciaires |
Proportions (en %) |
Viol aggravé |
249 |
46 % |
Viol sur mineur ou personne vulnérable |
162 |
30 % |
Viol seul |
119 |
22 % |
Autres cas |
11 |
2 % |
Total |
541 |
100 % |
c) Les condamnés à un suivi socio-judiciaire : une population différente des autres délinquants sexuels
Le suivi socio-judiciaire apparaît donc comme une mesure lourde, réservée aux infractions les plus graves (crimes), commises par des majeurs, et moins utilisée lorsque le condamné a plus de 60 ans. Les condamnés à un suivi socio-judiciaire forment dès lors une population aux caractéristiques très différentes de celles des autres auteurs d’infractions sexuelles : 42 % d’entre eux ont commis un crime, contre seulement 10 % des autres condamnés, les deux tiers d’entre eux ont entre 30 et 55 ans, contre la moitié des autres condamnés ayant commis une infraction sexuelle. À l’inverse, les mineurs ne représentent que 1,2 % des condamnés à un suivi socio-judiciaire, mais 14 % de l’ensemble des autres condamnés ayant commis une infraction sexuelle. La part des femmes est encore plus faible que parmi l’ensemble des auteurs d’infractions sexuelles (1,3 % contre 1,9 %).
3. Plus des trois quarts des condamnés à un suivi socio-judiciaire sont également condamnés à une peine de prison ferme
a) Le suivi socio-judiciaire prononcé pour crime complète systématiquement une peine de prison ferme
Le tableau ci-dessous montre qu’entre 2000 et 2007, le suivi socio-judiciaire a été prononcé à titre de peine complémentaire dans 88 % des cas.
NOMBRE DE MESURES DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE PRONONCÉES ENTRE 2000 ET 2007 SELON LA NATURE DE LA PEINE (PEINE PRINCIPALE ET PEINE COMPLÉMENTAIRE)
Année |
Total |
Dont à titre principal |
En % |
Dont à titre complémentaire |
En % |
2000 |
265 |
48 |
18 % |
217 |
82 % |
2001 |
421 |
54 |
13 % |
367 |
87 % |
2002 |
642 |
78 |
12 % |
564 |
88 % |
2003 |
853 |
77 |
9 % |
776 |
91 % |
2004 |
1 055 |
136 |
13 % |
919 |
87 % |
2005 |
1 136 |
102 |
9 % |
1 034 |
91 % |
2006 |
1 209 |
122 |
10 % |
1 087 |
90 % |
2007 |
1 285 |
143 |
11 % |
1 142 |
89 % |
Total |
6 866 |
760 |
12 % |
6 106 |
88 % |
En cas de crime, le suivi socio-judiciaire ne peut être la seule peine prononcée. La peine principale est alors toujours une peine d’emprisonnement, au moins partiellement ferme. Dans 70 % des cas, c’est la seule peine, en dehors du suivi socio-judiciaire. Dans 24 % des cas, une troisième mesure est décidée, mais très rarement plus. La mesure le plus souvent associée est la privation des droits civils, civiques et de famille, en général avec le suivi socio-judiciaire et la peine d’emprisonnement (19 %) et, dans 3 % des cas, accompagnée en plus d’une mesure d’interdiction.
Par contre, en cas de délit, le suivi socio-judiciaire est l’unique peine dans 19 % des cas. Dans 72 % des cas, une peine d’emprisonnement est également prononcée, la plupart du temps sans autre mesure (59 % des délits), mais dans 17 % des cas assortie d’une ou plusieurs autres mesures, essentiellement la privation des droits civiques, civils et de famille (9 %) ou l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole (6 %). Enfin, dans seulement 2 % des cas, la peine de suivi socio-judiciaire est accompagnée d’une amende ou d’une peine de substitution.
De manière générale, plus des trois quarts des condamnés à un suivi socio-judiciaire sont donc également condamnés à une peine de prison ferme. En 2004, l’étude précitée de Mme Valérie Carrasco montrait que la durée moyenne du suivi socio-judiciaire augmentait avec la durée de la peine privative de liberté : pour les délits, elle passait de 4,2 ans – quand il n’y avait pas de peine de prison ferme ou que la peine était inférieure à 6 mois – à 7 ans quand l’emprisonnement dépassait 5 ans. Pour les crimes, la durée du suivi socio-judiciaire passait de 5,8 ans pour une peine de prison ferme inférieure à 5 ans à 9,3 ans quand la peine de prison dépassait 15 ans.
Les durées de suivi socio-judiciaire les plus longues s’ajoutent ainsi aux peines d’emprisonnement les plus longues. Pour les auteurs de crime condamnés à une peine de prison ferme d’au moins 15 ans, la durée moyenne de la peine de prison était en 2004 ainsi de 17 ans, à laquelle s’ajoutait un suivi socio-judiciaire de 9 ans en moyenne.
b) La durée moyenne d’une peine de suivi socio-judiciaire est actuellement de près de 6 ans
La durée du suivi socio-judiciaire est fixée par la juridiction de jugement qui ordonne la mesure. Elle peut atteindre au maximum 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes. En pratique, les juridictions ont prononcé en 2007 des mesures d’une durée moyenne de 5,3 ans pour les délits et de 6,9 ans pour les crimes. Ces durées moyennes sont stables depuis 2004.
Il n’y a pratiquement pas de suivi socio-judiciaire d’une durée inférieure à deux ans. La durée la plus fréquente est de 5 ans : c’est le cas de 48 % des suivis prononcés suite à un délit et de 39 % de ceux prononcés suite à un crime. Le deuxième pic est atteint pour la durée de 10 ans, prononcée dans 18 % de l’ensemble des suivis, 14 % de ceux sanctionnant un délit et 23 % de ceux sanctionnant un crime.
Une durée supérieure à 10 ans, qui n’est possible qu’en cas de crime, reste rare : on en dénombre 34 en 2007 sur les 541 suivis socio-judiciaires prononcés pour crime (soit 6 %) et ce sont alors les durées de 15 et 20 ans qui sont essentiellement prononcées.
La durée moyenne des suivis socio-judiciaires s’élève quand l’âge au moment de l’infraction augmente en cas de délit et en revanche, elle diminue avec l’âge en cas de crime. De manière générale, on estime que 44 % des suivis socio-judiciaires ont été ordonnés pour 5 ans et 18 % pour 10 ans.
DURÉE DES SUIVIS SOCIO-JUDICIAIRES PRONONCÉS EN 2007
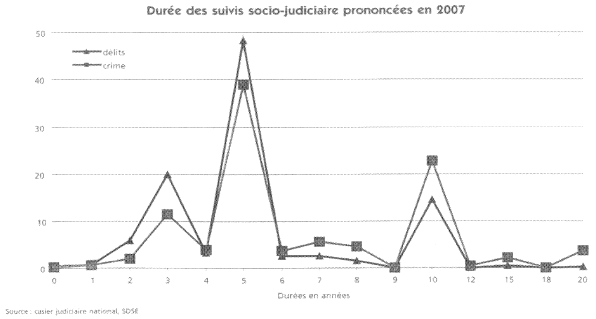
Source : Actualité juridique pénale – février 2009 – p. 60.
DURÉE MOYENNE (EN MOIS) DES SUIVIS SOCIO-JUDICIAIRES PAR JURIDICTION
1998 |
1999 |
2 000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
Cours d’assises majeurs |
— |
84 |
40,5 |
19,3 |
16 |
12,2 |
11,5 |
10,2 |
13,1 |
10,7 |
Tribunaux correctionnels majeurs |
22,8 |
24,1 |
12,7 |
12,2 |
10,9 |
10,1 |
9,7 |
8,7 |
9,9 |
9,5 |
Cours d’assises mineurs |
— |
— |
80 |
49,2 |
22,6 |
28,9 |
27,5 |
28,2 |
29,6 |
40 |
Tribunaux pour enfants |
— |
— |
40 |
50,9 |
32 |
28,9 |
42,8 |
40,6 |
25,1 |
29,6 |
Tribunal militaire |
— |
— |
— |
— |
— |
60 |
— |
60 |
— |
— |
Toutes juridictions |
22,8 |
27,3 |
17,9 |
16,2 |
13,4 |
11,8 |
11,8 |
10,8 |
12 |
11,5 |
II. LA PRATIQUE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE RÉVÈLE L’EXISTENCE DE FAIBLESSES IMPORTANTES AUXQUELLES IL EST ESSENTIEL DE REMÉDIER RAPIDEMENT
A. L’EXTENSION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, MOTIVÉE PAR L’INTÉRÊT CONSTANT QUE PORTE LE LÉGISLATEUR À UNE PEINE RÉPUTÉE POUR SON EFFICACITÉ, POSE QUESTION
1. L’application du suivi socio-judiciaire se heurte actuellement à des difficultés importantes
a) Le manque de médecins coordonnateurs
Lorsque l’injonction de soins est prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire, se met en place une interface santé-justice originale : le médecin coordonnateur, qui intervient afin de mieux renseigner le juge d’application des peines quant au déroulement effectif des soins engagés entre le condamné et son médecin traitant. En effet, pour la mise en œuvre de l’injonction de soins, dans le cadre notamment d’un suivi socio-judiciaire, l’article L. 3711-1 du code de la santé publique prévoit que le juge de l’application des peines doit désigner sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur.
Au regard des textes en vigueur, les missions du médecin coordonnateur sont de trois ordres. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3711-12 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur, après avoir pris connaissance des expertises réalisées au cours de la procédure ou de l’exécution de la peine privative de liberté, doit convoquer la personne condamnée à une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire pour un entretien au cours duquel il lui explique les modalités d’exécution de cette mesure et l’invite à choisir un médecin traitant
En deuxième lieu, c’est au médecin coordonnateur qu’il revient de conseiller le médecin traitant si ce dernier en fait la demande. Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir un psychologue traitant soit à la place, soit en plus du médecin traitant. Pour ce faire, le psychologue doit avoir exercé pendant au moins cinq ans.
Enfin, le médecin coordonnateur doit transmettre au juge de l’application des peines ou au conseiller d’insertion et de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins. En liaison, avec le médecin traitant, il informe le condamné de la possibilité de poursuivre le traitement à l’issue de l’exécution de la peine en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire, en lui précisant notamment les modalités et la durée du traitement qu’il estime nécessaire et raisonnable.
L’efficacité et la pertinence du suivi socio-judiciaire en matière de lutte contre la récidive résident notamment dans le rôle spécifique d’interface qui revient au médecin coordonnateur. En effet, aux termes de l’article L. 3711-2 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur peut communiquer au médecin traitant, si celui-ci en fait la demande, les rapports d’expertise concernant le condamné ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif ou l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou l’arrêt de mise en accusation et le jugement ou l’arrêt de condamnation. L’article L. 3711-3 du code de la santé publique prévoit également que le médecin traitant peut également informer le médecin coordonnateur de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement, le médecin coordonnateur étant habilité à en informer le juge de l’application des peines ou le travailleur social.
Or, le rôle d’interface originale que le médecin coordonnateur assure entre santé et justice est aujourd’hui le plus souvent virtuel en raison de la pénurie de médecins coordonnateurs. En 2008, l’ANJAP a mené une enquête sur la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire et de l’injonction de soins. Les réponses ainsi recueillies portaient sur 40 départements ou territoires d’outre-mer et 62 tribunaux de grande instance et ont permis de mettre en évidence que les mesures d’injonctions de soins ne pouvaient être correctement suivies dans plus de la moitié des tribunaux (39 au total) en raison du trop faible nombre de médecins coordonnateurs.
Si l’on se réfère à la liste des médecins coordonnateurs diffusée par le ministère de la Justice, ce sont 40 tribunaux de grande instance et 17 départements qui sont dépourvus en 2009 de médecins coordonnateurs et qui sont donc dans l’impossibilité de mettre en œuvre de manière satisfaisante les injonctions de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
BILAN SUR LES MÉDECINS COORDONNATEURS EN 2009
Nombre de médecins coordonnateurs |
213 |
Dont un en Nouvelle-Calédonie |
Nombre de départements dépourvus de médecins coordonnateurs |
17 |
Soit 14 départements métropolitains sur les 96 (47) Soit 3 DOM sur les 6 (48) |
Nombre de TGI dépourvus de médecins coordonnateurs |
40 |
Dont 37 métropolitains Dont 3 dans les DOM |
Enfin, l’étude de la liste des médecins coordonnateurs diffusée par la direction des affaires criminelles et des grâces montre que près de soixante-dix médecins coordonnateurs sont inscrits sur plusieurs listes départementales, ce qui réduit d’autant le nombre de mesures pouvant être mises en œuvre. À cet égard, la région Île-de-France constitue un exemple frappant : pour les quatre départements des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les juges de l’application des peines ne peuvent faire appel qu’à une vingtaine de médecins coordonnateurs, ce qui n’autorise en réalité la mise en œuvre que d’environ 400 mesures de suivi socio-judiciaire. Ces médecins, souvent aussi experts judiciaires, assument leur rôle de coordonnateur, en sus de leur activité de praticien et de leurs missions d’expertise, laquelle leur interdit, au demeurant, d’être médecin coordonnateur dans le même dossier. Le rapport (49) de M. Vincent Lamanda, premier président de la cour de cassation, a ainsi rappelé qu’« on peut raisonnablement estimer que les injonctions de soins ne peuvent être mises en place, de façon satisfaisante, dans plus de la moitié des juridictions ».
En outre, alors que les médecins coordonnateurs n’ont le droit de suivre que 20 condamnés à un suivi socio-judiciaire, ce numerus clausus est loin d’être respecté, faute d’un nombre suffisant de médecins. Ainsi, l’ANJAP, lors de son audition, a indiqué à votre Rapporteur qu’aux tribunaux de grande instance de Meaux et de Melun, un médecin coordonnateur suit respectivement 42 et 37 dossiers.
Afin de remédier au manque de médecins coordonnateurs, plusieurs mesures réglementaires ont été prises au cours de ces dernières années. À titre liminaire, il convient de saluer la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales qui a prévu qu’un psychologue pouvait être adjoint ou remplacer le médecin traitant (article L. 3711-4-1 du code de la santé publique). En outre, l’insuffisance criante du nombre de médecins coordonnateurs a conduit à la publication du décret du 24 janvier 2008 qui, d’une part, a revalorisé l’indemnité allouée aux médecins coordonnateurs (50) et, d’autre part, a augmenté de quinze à vingt, le nombre de dossiers pouvant être pris en charge par chacun d’eux, augmentant ainsi les potentialités de prise en charge.
D’autres mesures, dont les effets ne seront pas immédiats, sont intervenues ou interviendront dans les mois qui viennent. Tout d’abord, les conditions pour pouvoir recruter des médecins coordonnateurs autres que des psychiatres ont été précisées. Si l’article L. 3711-1 du code de la santé publique ouvre sans condition de formation aux médecins psychiatres la possibilité d’exercer la fonction de médecin coordonnateur, il prévoit également que des médecins autres que les psychiatres peuvent exercer cette fonction sous réserve de satisfaire à des conditions de formation (51). Afin de donner toute leur effectivité à ces dispositions, un arrêté élaboré après consultation de médecins experts intervenant dans l’injonction de soins est actuellement en cours de publication. Ces experts se sont notamment accordés à l’unanimité sur la nécessité d’une formation minimale de cent heures, afin que des médecins coordonnateurs autres que des psychiatres soient en mesure d’exercer des missions exigeant un savoir très spécifique (contexte juridique de l’injonction de soins, connaissances médicales sur le passage à l’acte, le diagnostic et la thérapeutique des auteurs de violences, notamment sexuelles). Afin de faciliter l’acquisition de ces données, l’arrêté permettra de comptabiliser des formations délivrées par plusieurs universités ou organismes agréés de formation médicale continue.
S’agissant des autres dispositions visant à faciliter le recrutement de médecins coordonnateurs, le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté a permis aux actuels médecins coordonnateurs non psychiatres de continuer à exercer cette fonction pendant cinq ans à compter de sa publication. Ce décret a également modifié les dispositions de l’article R. 3711-3 du code de la santé publique pour permettre aux médecins psychiatres qui ne sont plus en activité de demander leur inscription sur la liste des médecins coordonnateurs sans autre condition spécifique que celle d’avoir exercé en qualité de spécialiste pendant au moins cinq ans.
Néanmoins, il subsiste quelques départements où, le nombre de psychiatres étant très insuffisant, il est difficile de trouver des médecins coordonnateurs possédant les compétences thérapeutiques adaptées au profil des condamnés. Afin de remédier à la pénurie de médecins coordonnateurs, votre Rapporteur estime que trois solutions peuvent être utilement envisagées.
En premier lieu, dans un contexte marqué de pénurie, le maintien d’un numerus clausus qui limite à 20 le nombre de condamnés que peut suivre annuellement un médecin coordonnateur apparaît totalement paradoxal. Cette difficulté, bien que soulignée par de nombreux rapports, demeure. Il apparaît aussi urgent qu’essentiel de supprimer ce numerus clausus qui constitue un frein considérable au bon fonctionnement de la peine de suivi socio-judiciaire. À la rigueur, ce seuil de 20 dossiers pourrait constituer une simple recommandation de « bonne pratique » à l’instar de ce que préconisait le rapport de M. Jean-François Burgelin, procureur général de la cour de cassation (52).
Proposition n° 11
Supprimer le numerus clausus qui limite à vingt le nombre de condamnés que peut suivre un médecin coordonnateur.
En second lieu, l’expert, missionné par le tribunal ou le juge d’instruction et qui a étudié un dossier devrait pouvoir être ensuite nommé médecin coordonnateur dans le même dossier. Pour l’instant, une telle désignation est exclue par le code de la santé publique à son article R. 3711-8. Le dispositif actuel nécessite la présence de trois médecins : expert, médecin coordonnateur et médecin traitant. Or, le cumul des fonctions d’expert et de médecin coordonnateur ne posent pas a priori de problème majeur. C’est pourquoi votre Rapporteur propose que l’expert puisse être ultérieurement nommé médecin coordonnateur pour la mise en œuvre d’une injonction de soins.
Proposition n° 12
Permettre que l’expert qui a étudié un dossier puisse ensuite être nommé médecin coordonnateur dans le même dossier.
Enfin, votre Rapporteur estime qu’en dépit des efforts d’ores et déjà entrepris, il serait nécessaire de rendre les fonctions de médecin coordonnateur plus attractives. Une revalorisation des indemnités qui leur sont accordées serait opportune. Il apparaît également essentiel de poursuivre les efforts de communication et de formation engagés à l’égard des professionnels de santé, afin de favoriser le recrutement de nouveaux médecins coordonnateurs. Toutefois, la question de la revalorisation des fonctions de médecin coordonnateur ne doit pas faire illusion : l’enjeu est plus vaste puisqu’il s’agit en réalité de la pleine et entière reconnaissance qu’il convient aujourd’hui d’accorder à l’ensemble des personnels médicaux intervenant auprès des personnes placées sous main de justice (au cours de la détention, mais également en milieu ouvert dans le cadre des obligations et injonctions de soins). Au-delà des seuls aspects financiers (essentiellement la rémunération), la reconnaissance de ces médecins passe, d’une part, par une reconnaissance universitaire de leur spécialité et, d’autre part, par une action forte du ministère de la Justice à qui il incombe de favoriser et d’améliorer les conditions de travail et d’intervention des médecins en prison et plus généralement auprès des personnes placées sous main de justice.
Proposition n° 13
Augmenter les effectifs des médecins coordonnateurs grâce à une revalorisation de leurs indemnités ainsi qu’à une poursuite des efforts de communication et de formation engagés à l’égard des professionnels de santé. Ces efforts doivent impérativement être relayés par une action forte et concertée entre les ministères de la Santé et de la Justice destinée à améliorer les conditions de travail et d’intervention des médecins en prison.
b) Les faiblesses du dispositif de l’injonction de soins
La loi précitée du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a généralisé l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire : alors que ce n’était jusqu’à présent qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du juge, après expertise médicale, le législateur a voulu qu’au stade de la condamnation, tout suivi socio-judiciaire s’accompagne désormais d’une injonction de soins, à la double condition que l’expertise préalable y ait conclu favorablement et que le juge ne décide pas d’y renoncer.
Or, sur le terrain, le dispositif de l’injonction de soins souffre d’une double faiblesse que les divers rapports parlementaires ont unanimement mise en évidence.
En premier lieu, la mise en œuvre de l’injonction de soins se heurte à la pénurie de psychiatres dans le secteur public ou quelque 800 postes sont actuellement vacants. Cette carence entraîne des conséquences importantes, puisque l’injonction de soins est de plus en plus difficile à mettre en œuvre, en particulier lorsque le condamné est incarcéré. Cette insuffisance de psychiatres explique également en partie le fait qu’il n’y ait pas suffisamment de médecins coordonnateurs, certains tribunaux de grande instance en étant complètement dépourvus.
En second lieu, la faiblesse de l’injonction de soins réside dans le fait que la prise en compte thérapeutique de la délinquance sexuelle est entravée par l’insuffisante formation des médecins psychiatres dans ce domaine. Il existe en effet une discussion importante au sein de la profession médicale, certains psychiatres considérant les auteurs d’infractions condamnés à un suivi socio-judiciaire comme des « pervers » au sens clinique du terme, non susceptibles à ce titre d’un traitement psychiatrique (53).
Le rapport précité de M. Jean-François Burgelin sur la dangerosité et pour une meilleure prévention de la récidive constatait déjà en 2005 combien « la mise en œuvre de l’injonction de soins est disparate en raison de l’implantation inégale des psychiatres sur le territoire national et de la rareté des médecins disponibles. Peu de praticiens ont une compétence spécifique dans le traitement des conduites sexuelles et semblent prêts à s’investir dans le champ expertal, la coordination et les soins ».
2. Le risque de voir le suivi socio-judiciaire se banaliser et perdre toute son efficacité n’est pas négligeable
Le suivi socio-judiciaire, par l’articulation qu’il exige de tous les acteurs, suppose un temps de suivi plus important que tout autre mesure. Or, l’extension du suivi socio-judiciaire intervenue ces dernières années est source de tensions et fragilise la délicate articulation entre les acteurs de la santé et de la justice.
Lors de son audition par votre Rapporteur, l’association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP) a estimé que « la montée en puissance du suivi socio-judiciaire constitue une source d’inquiétude grandissante pour les juges de l’application des peines ». En raison de l’insuffisance du nombre de médecins coordonnateurs, le dispositif de prévention de la récidive qu’est le suivi socio-judiciaire est aujourd’hui « saturé ou en voie de l’être ». En effet, l’élargissement du champ du suivi socio-judiciaire vient s’ajouter à la montée en puissance du dispositif, qui s’explique par la libération des personnes condamnées à la fin des années 1990 et au début des années 2000 à une peine de prison ainsi qu’à une peine de suivi socio-judiciaire, ce dernier ne prenant son sens qu’à la fin de la détention. Or, ce double phénomène de montée en charge et d’extension rend de plus en plus difficile, voire improbable, une prise en charge rapide et efficace des personnes condamnées, à titre principal ou complémentaire, à un suivi socio-judiciaire.
En effet, l’élargissement des infractions, aussi bien délictuelles que criminelles, susceptibles de donner lieu au prononcé d’une peine de suivi socio-judiciaire se traduit dans les juridictions françaises par une hausse considérable des suivis socio-judiciaires prononcés chaque année. Ainsi, au tribunal de grande instance de Rennes, le nombre de suivis socio-judiciaires prononcés a été multiplié par presque quatre entre 2006 et 2007, passant ainsi de 6 à 22 mesures prononcées annuellement. De la même manière, le nombre de suivis socio-judiciaires a quadruplé entre 2006 et 2007 au tribunal de grande instance de Laval.
Alors même que cette mesure avait été instaurée en 1998 par le législateur pour prévenir la récidive des infractions sexuelles, l’extension du suivi socio-judiciaire, aux destructions et dégradations d’un bien sous l’effet d’un incendie ou d’une substance explosive ou bien encore aux violences commises au sein du couple, risque d’altérer l’efficacité d’une mesure destinée à prévenir la réitération des infractions les plus graves. Le suivi socio-judiciaire est en effet une mesure pénale, qui reste lourde sur le plan procédural et dont la mise en œuvre implique l’étroite collaboration d’un grand nombre d’acteurs autour du condamné (juges de l’application des peines, conseillers d’insertion et de probation et médecins coordonnateurs). Les dossiers de suivis socio-judiciaires font en effet l’objet d’une prise en charge prioritaire tant par les juges de l’application des peines que par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Ainsi, compte tenu de l’attention particulière dont ces dossiers font aujourd’hui l’objet, l’efficacité de cette mesure réside plus que jamais dans la qualité du suivi et de la vigilance de chaque acteur concerné.
Or, l’extension du suivi socio-judiciaire, au regard des moyens actuellement limités, risque de conduire au mieux à une dilution de l’efficacité de cette mesure, au pire à une peine qui, bien que prononcée par les juridictions, restera inappliquée et altérera de facto la confiance des Français dans le système judiciaire. En outre, il apparaît à bien des égards tout à fait regrettable que le contenu du suivi socio-judiciaire ait été étendu à nombre d’infractions sans évaluation préalable de l’effet de la mesure à périmètre constant.
Au regard du souci constant que doit être la prévention de la récidive, votre Rapporteur estime qu’il convient de réserver cette peine lourde à mettre en œuvre et qui mobilise d’importants moyens aux infractions les plus graves. C’est pourquoi, un suivi socio-judiciaire rénové et redynamisé ne saurait à l’avenir s’appliquer systématiquement à deux catégories de délits, qui nécessitent une réponse pénale graduée et bien souvent plus souple que ne l’est le suivi socio-judiciaire : les violences conjugales et les destructions ou dégradations incendiaires. C’est pourquoi, sans remettre en cause le champ des infractions concernées par le suivi socio-judiciaire, votre Rapporteur estime nécessaire que les directives de politique pénale privilégient à l’avenir l’obligation de soins (dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve) au suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour ces deux types de délits. En raison de sa lourdeur sur le plan procédural et du grand nombre d’acteurs qu’il implique autour du condamné, le suivi socio-judiciaire ne doit en effet être prononcé qu’à titre exceptionnel pour les cas de violences conjugales et de destructions ou dégradations incendiaires les plus graves.
Proposition n° 14
Dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, prévoir que le suivi socio-judiciaire ne puisse être prononcé à l’avenir qu’à titre exceptionnel pour les cas de violences conjugales et délits d’incendiaires les plus graves, l’obligation de soins étant privilégiée le reste du temps.
B. SIMPLIFIER ET CLARIFIER LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE POUR UNE MESURE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE PLUS LISIBLE ET PLUS EFFICACE
1. Une nécessaire clarification des textes en vigueur
a) Fixer plus clairement l’obligation de compte rendu du médecin coordonnateur
Au regard des pratiques très disparates des médecins coordonnateurs en matière d’injonctions de soins, votre Rapporteur estime qu’il serait utile de fixer plus clairement dans la loi l’obligation de compte rendu du médecin coordonnateur auprès du juge de l’application des peines.
En effet, l’article L. 3711-1 du code de santé publique dispose seulement que le médecin coordonnateur « est chargé de transmettre au juge d’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins ». Ainsi, il pourrait être pertinent de prévoir que ce dernier a l’obligation de fournir un rapport sur la prise en charge médicale une fois, voire, deux fois par an, au moins au juge de l’application des peines.
À cet égard, les divers exemples qui ont été portés à la connaissance de votre Rapporteur ont mis en exergue les dérives possibles en l’absence de dispositions législatives encadrant plus strictement l’obligation de compte rendu du médecin coordonnateur. Ainsi, M. Ludovic Fossey, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Créteil, a indiqué à votre Rapporteur que, dans le ressort de son tribunal, sur 35 mesures de suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, on dénombrait à la fin du mois de mars 2009 huit dossiers – soit 20 % des suivis socio-judiciaires – dans lesquels le médecin coordonnateur n’avait rendu aucun rapport dans le délai d’un an.
À titre d’exemple, un suivi socio-judiciaire, d’une durée de cinq ans, avait été prononcé en 2006 à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. La mesure prenant effet au mois de février 2007, un médecin coordonnateur avait été désigné par le juge de l’application des peines à la fin du mois de mars 2006, soit un an avant le début de la mesure. Or, en mars 2009, soit deux ans après le début de la mesure, le médecin coordonnateur n’avait remis au juge de l’application des peines concerné aucun rapport lui permettant de contrôler la mise en œuvre effective de l’injonction de soins. Afin de donner aux juges de l’application des peines un véritable levier d’action pour contrôler l’effectivité des injonctions de soins qu’ils ordonnent dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, votre Rapporteur propose qu’à l’avenir, les médecins coordonnateurs devront remettre au juge de l’application des peines une fois, voire deux fois par an, un compte rendu détaillé sur la prise en charge médicale.
Modifier l’article L. 3711-1 du code de santé publique afin de mettre à la charge du médecin coordonnateur une obligation de remettre au juge de l’application une fois, voire deux fois par an, un compte rendu lui permettant de contrôler la mise en œuvre effective des injonctions de soins prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
b) Clarifier le recours à l’injonction de soins et à l’obligation de soins pour rendre cohérent le dispositif de soins pénalement ordonnés
Il serait également utile de simplifier le régime juridique du suivi socio-judiciaire. Il existe en effet une confusion récurrente entre l’obligation et l’injonction de soins.
Ainsi, il arrive parfois que les cours d’assises ou les tribunaux correctionnels prononcent ces deux obligations simultanément dans un souci de « sécurité ». Une clarification des conditions de recours, tantôt à l’obligation de soins, tantôt à l’injonction de soins, s’avère d’autant plus nécessaire, que chacune de ces mesures emporte des conséquences très différentes, comme le souligne le tableau ci-dessous.
L’OBLIGATION DE SOINS ET L’INJONCTION DE SOINS EN DROIT PÉNAL
OBLIGATION DE SOINS |
INJONCTION DE SOINS | |
Base juridique |
Article 132-45 du code pénal |
Articles 131-36-4 et 132-45-1du code pénal Articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale Articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique |
Juridiction compétente |
La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines |
La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines, si une expertise médicale établit que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. |
Procédure |
L’obligation de soins est mise en œuvre sans procédure particulière. |
Le juge de l’application des peines désigne un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée. Le médecin coordonnateur assume une triple fonction : il invite le condamné à choisir son médecin traitant (considéré comme étant le médecin référent) ; il conseille ce dernier à sa demande ; il transmet au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction des soins. |
Contenu de mesure |
Elle consiste pour le condamné à « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». |
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l’application des peines de l’accomplissement de son injonction de soins. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive autorise le médecin traitant à prescrire à la personne condamnée à une injonction de soins des médicaments entraînant une diminution de la libido, cette prescription étant subordonnée à l’accord de la personne sous la forme d’un consentement secret et renouvelé au moins une fois par an. |
En outre, comme l’a souligné l’ANJAP lors de son audition par votre Rapporteur, la juridiction de condamnation a la possibilité pour certaines peines de prononcer, soit une obligation de soins, soit une injonction de soins, ce qui ne manque pas en retour d’ajouter à la confusion qui existe entre ces deux dispositifs de soins pénalement ordonnés. Ainsi, trois peines – emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, peine mixte avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, libération conditionnelle – peuvent donner lieu soit à une obligation de soins, soit à une injonction de soins.
LE DISPOSITIF DE SOINS PÉNALEMENT ORDONNÉS
MESURE |
OBLIGATION DE SOINS et/ou INJONCTION DE SOINS |
SANCTION POUR INOBSERVATION |
Emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et Peine mixte avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve |
Obligation de soins Durée de 1 à 3 ans, portée à 5 ans en cas de récidive et à 7 ans en cas de nouvelle récidive. ou Injonction de soins Article 8 de la loi du 10 août 2007 |
Révocation du sursis possible en cas de non-respect de l’obligation de soins Révocation du sursis possible en cas de non-respect de l’injonction de soins. |
Emprisonnement assorti d’un sursis avec obligation d’effectuer un T.I.G. Articles 747-1 et suivants du code de procédure pénale |
Obligation de soins L’obligation peut perdurer au-delà de l’accomplissement du T.I.G. |
Révocation du sursis possible en cas de non-respect de l’obligation de soins |
Suivi socio-judiciaire Articles 763-1 et suivants du code de procédure pénale |
Injonction de soins Loi du 17 juin 1998 et article 7 de la loi du 10 août 2007 |
Pendant l’incarcération, le condamné est incité aux soins et tout refus de soins entraîne refus des réductions supplémentaires de peines. Après remise en liberté, tout manquement à l’injonction de soins peut entraîner le prononcé de la peine d’emprisonnement encourue dans le cadre du suivi socio-judiciaire. |
Libération conditionnelle Articles 729 et suivants du code de procédure pénale |
Obligation de soins Durée pouvant aller jusqu’à un an après la fin de la peine ou Injonction de soins Article 11 de la loi du 10 août 2007 |
Révocation de la libération conditionnelle possible en cas de non-respect de l’obligation de soins ou de l’injonction de soins. Une libération conditionnelle ne peut être accordée à la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru si elle refuse de suivre en détention le traitement qui lui est proposé. |
Placement sous surveillance électronique Articles 723-7 et suivants du code de procédure pénale |
Obligation de soins D’une durée égale à celle de la mesure |
Révocation du placement sous surveillance électronique possible en cas de non-respect de l’obligation. |
Semi-liberté Articles 712-6 et suivants du code de procédure pénale |
Obligation de soins D’une durée égale à celle de la mesure |
Révocation de la semi-liberté possible en cas de non-respect de l’obligation. |
Placement extérieur Articles 723 et suivants du code de procédure pénale |
Obligation de soins D’une durée égale à celle de la mesure |
Révocation du placement extérieur possible en cas de non-respect de l’obligation. |
Surveillance judiciaire Articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale |
Injonction de soins Sauf décision contraire du JAP, lorsqu’une expertise médicale conclut à la possibilité de soins. |
Retrait de réductions de peines (et donc réincarcération) possible en cas de non-respect de l’injonction de soins (article 723-35 du code de procédure pénale). |
Surveillance de sûreté Article 706-53-19 du code de procédure pénale |
Injonction de soins D’une durée d’un an renouvelable |
Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par un risque très élevé de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale (assassinat, meurtre, torture ou acte de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration), le président de la juridiction peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai de 3 mois par la juridiction régionale après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut il est mis fin d’office à la rétention. |
Afin de mettre fin à la confusion qui règne entre obligation de soins et injonction de soins, votre Rapporteur propose que l’injonction de soins, plus lourde à mettre en œuvre sur le plan procédural, soit à l’avenir réservée aux peines les plus graves, à savoir le suivi socio-judiciaire, la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté. Par conséquent, l’obligation de soins, qui reste un dispositif de soins pénalement ordonnés plus souple que ne l’est l’injonction de soins, ne pourra plus être prononcée dans le cadre de la libération conditionnelle et, inversement, le sursis avec mise à l’épreuve ne pourra plus comporter d’injonctions de soins. Cette proposition vise à rendre plus cohérent et lisible le dispositif français de soins pénalement ordonnés.
Proposition n° 16
Rendre plus cohérente la distinction entre obligation de soins et injonction de soins, en réservant cette dernière aux mesures les plus importantes, à savoir le suivi socio-judiciaire, la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté.
c) Simplifier le corpus des obligations du suivi socio-judiciaire
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut être soumise à trois types de mesures de surveillance, qui sont successivement détaillées par l’article 131-36-2 du code pénal.
En premier lieu, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut être soumise à certaines mesures de surveillance, elles-mêmes visées à l’article 132-44 du code pénal et applicables au sursis avec mise à l’épreuve. Il s’agit notamment de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social ou bien de prévenir ce dernier de ses changements d’emploi.
En deuxième lieu, le condamné peut également être soumis par la juridiction de condamnation ou par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article 132-45 du code pénal et applicables au sursis avec mise à l’épreuve. Ces obligations comprennent notamment celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ainsi de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile.
La personne condamnée peut enfin être soumise à une ou plusieurs des trois obligations énumérées par l’article 131-36-2 du code pénal et applicables au seul suivi socio-judiciaire, à savoir : s’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant les mineurs ; s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction.
MESURES DE SURVEILLANCE DANS LE CADRE DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Article 132-44 du code pénal également applicable au sursis avec mise à l’épreuve |
Article 132-45 du code pénal également applicable au sursis avec mise à l’épreuve (54) |
Article 131-36-2 du code pénal applicable au seul suivi socio-judiciaire |
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné. Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations. Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi. Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour. Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence. |
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile. Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation. Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction. Ne pas détenir ou porter une arme. |
S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs. S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction. Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. |
En définitive, le régime des mesures de surveillance qui peuvent être imposées à une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est éclaté entre, d’une part, celles visées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal et également applicables au sursis avec mise à l’épreuve et, d’autre part, celles détaillées à l’article 131-36-2 du code pénal et applicables au seul suivi socio-judiciaire.
Dans un souci de simplification, votre Rapporteur propose que les trois obligations prévues à l’article 131-36-2 du code pénal intègrent la liste des obligations de droit commun prévues à l’article 132-45 du même code. De cette manière, les mesures de surveillance susceptibles d’être ordonnées tant dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve que d’un suivi socio-judiciaire obéiraient ainsi à un régime unifié et donc plus lisible.
Proposition n° 17
Modifier les articles 131-36-2 et 132-45 du code pénal afin de simplifier et d’unifier les mesures de surveillance susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve.
d) Abroger ou modifier les textes inappliqués ou peu appliqués
L’article 763-7 du code de procédure pénale dispose que le juge de l’application des peines doit informer la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, si elle doit également subir une peine privative de liberté, qu’elle peut entreprendre son traitement en détention. Si elle n’y consent pas, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois par le juge de l’application des peines.
Cette dernière disposition est très contraignante, en particulier au sein des maisons d’arrêt où il est difficile pour l’administration pénitentiaire de repérer et suivre les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour satisfaire à cette obligation. L’intérêt de ces rappels a de surcroît un effet limité alors que ces formalités sont extrêmement lourdes à gérer. Votre Rapporteur propose de supprimer ces dispositions en les remplaçant par un rappel solennel et unique en début de peine. Toutefois, il est nécessaire que le juge de l’application des peines rappelle à tout détenu condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, six mois avant que ne prenne fin sa peine de prison, qu’il peut toujours entreprendre un traitement en détention, tout particulièrement en vue de la préparation de sa sortie de prison. À cette occasion, le juge rappellera également au détenu que, s’il n’a pas entrepris de soins en détention, il devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté.
Proposition n° 18
Modifier l’article 763-7 du code de procédure pénale afin que le juge de l’application des peines :
— rappelle en début de peine à toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ainsi qu’à une peine privative de liberté qu’elle peut entreprendre un traitement en détention ;
— rappelle à tout détenu condamné à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, six mois avant que ne prenne fin sa peine de prison, qu’il peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, il devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté.
L’article 717-1 du code de procédure pénale dispose que les condamnés ayant commis des faits pour lesquels un suivi socio-judiciaire est encouru doivent être affectés dans un établissement pénitentiaire leur permettant de bénéficier de soins adaptés. Les articles 763-7 et R. 57-5 du code de procédure pénale prévoient également que « lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins subit une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire […] permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
Or, en raison de la pénurie de personnels soignants en détention, ces dispositions sont trop souvent inappliquées. De nombreux condamnés sollicitent des soins, mais ne peuvent être reçus par des soignants débordés. Ainsi, la situation devient paradoxale, puisque le juge enjoint aux condamnés de suivre des soins sans leur permettre effectivement d’y accéder. À défaut de moyens permettant l’effectivité de ces dispositions, il est nécessaire de prévoir que les condamnés qui purgent une peine de suivi socio-judiciaire assortie d’une injonction de soins seront reçus en priorité par le personnel soignant de l’établissement.
Ce traitement prioritaire des condamnés à une injonction de soins en détention permettrait ainsi d’assurer la cohérence des textes avec la réalité du terrain : la personne doit suivre des soins pour espérer obtenir des réductions de peines et votre Rapporteur propose pour ce faire qu’elle accède prioritairement aux soins lorsqu’elle les sollicite. En outre, cette prise en charge prioritaire des détenus condamnés à un suivi socio-judiciaire est complémentaire de la précédente proposition de votre Rapporteur. Une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ainsi qu’à une peine de prison se verrait rappeler par le juge de l’application des peines en début de peine qu’elle peut entreprendre un traitement en détention. Lors de son arrivée en prison, elle bénéficierait d’une prise en charge sanitaire et psychiatrique prioritaire, lui permettant éventuellement de nouer des relations de confiance avec le personnel médical. Or, cette confiance entre le médecin et son patient est une condition essentielle pour que le détenu s’engage dès la détention dans une démarche personnelle de soins. Par ailleurs, cette prise en charge prioritaire pourrait également être étendue aux condamnés purgeant une peine pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
Proposition n° 19
Modifier l’article 717-1 du code pénal, afin que les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru accèdent prioritairement aux soins en détention, notamment psychiatriques, lorsqu’elles les sollicitent.
2. Un suivi socio-judiciaire qui devrait être engagé dès le début de l’incarcération et être plus souple dans ses modalités d’exécution
a) Pour un suivi socio-judiciaire actif dès le début de l’incarcération
Un des paradoxes de la peine de suivi socio-judiciaire réside dans le fait que cette peine ne commence réellement à s’appliquer qu’à la fin de l’emprisonnement, ce dernier étant le plus souvent particulièrement long lorsqu’il est prononcé.
Les textes permettent pourtant, mais de manière sans doute peu claire, de désigner le médecin coordonnateur pendant l’incarcération. Ainsi, l’article R. 3711-17 du code de la santé publique dispose que le médecin coordonnateur peut être désigné – et donc intervenir – avant la libération du condamné. De la même manière, l’article 717-1 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions du code de la santé publique relatives au médecin coordonnateur sont « applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines ».
Votre Rapporteur propose de clarifier ces dispositions en encourageant la désignation des médecins coordonnateurs dès le début de l’incarcération. En effet, l’intervention du médecin coordonnateur à ce stade de la peine présente un double avantage : mieux connaître le condamné et dynamiser les suivis en détention. Les informations qui pourront ainsi être recueillies en détention seraient précieuses dans le cadre de l’examen des réductions de peines supplémentaires ainsi que dans la perspective de l’octroi des futurs aménagements de peines.
L’objectif poursuivi est également de renforcer la continuité du suivi à la sortie de prison, car le détenu, une fois libéré, ne serait plus un patient dont on ne sait quasiment rien, mais une personne dont on a suivi le parcours tout au long de la détention. Le médecin coordonnateur qui suivra le détenu en milieu ouvert après sa libération ne sera pas systématiquement celui qui intervenait en détention, ne serait-ce que parce que le condamné peut décider de se domicilier dans un autre ressort. La connaissance accumulée, consignée au sein du dossier du médecin coordonnateur, sera alors précieuse pour engager immédiatement un suivi pertinent et adapté, assurant ainsi une continuité optimale du suivi dans le temps.
Proposition n° 20
Modifier l’article 717-1 du code de procédure pénale afin d’encourager à la désignation systématique des médecins coordonnateurs dès le début de l’incarcération dans le double objectif d’approfondir la connaissance du condamné et de dynamiser les suivis en détention.
b) Pour un suivi socio-judiciaire plus souple, seul capable de faire face à la montée en charge du dispositif
Le suivi socio-judiciaire se trouve aujourd’hui confronté à un double enjeu : la montée en charge du dispositif liée à la libération des personnes condamnées à la fin des années 1990 et au début des années 2000 et l’extension continue de son champ d’application.
Dans le double souci de préserver l’efficacité de cette mesure en matière de prévention de la récidive et de faire face à la montée en charge du dispositif, votre Rapporteur souhaite simplifier certaines des règles procédurales présidant actuellement à la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire. Deux mesures peuvent être envisagées en vue de rendre le suivi socio-judiciaire plus souple.
En premier lieu, il serait utile que le juge de l’application des peines puisse mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire, y compris lorsqu’il est prononcé à titre de peine principale, à la double condition que le reclassement du condamné, sur rapport du conseiller d’insertion et de probation, soit acquis et que les soins pénalement ordonnés, sur rapport du médecin coordonnateur, ne soient plus nécessaires. En effet, le suivi socio-judiciaire est en général prononcé pour des durées relativement longues (six ans en moyenne), alors même que les efforts entrepris par la personne condamnée en vue de sa réinsertion sociale peuvent avoir produit leurs effets avant même la fin de la mesure. Il semble paradoxal de continuer à soumettre une personne à un ensemble d’obligations qui perdent toute signification, dès lors que l’objectif initial de prévention de la récidive semble acquis. En outre, afin que les conseillers d’insertion et de probation puissent porter l’appréciation la plus fine possible sur le reclassement du condamné à un suivi socio-judiciaire, il serait opportun qu’à l’avenir, ils aient un accès direct au casier judiciaire.
Proposition n° 21
Modifier l’article 131-36-1 du code pénal afin que le juge de l’application des peines puisse, après audition du condamné, mettre fin de manière anticipée à un suivi socio-judiciaire, y compris lorsqu’il est prononcé à titre de peine principale, à la double condition que le reclassement du condamné, sur rapport du conseiller d’insertion et de probation, soit acquis et que les soins pénalement ordonnés, sur rapport du médecin coordonnateur, ne soient plus nécessaires.
Proposition n° 22
Autoriser les conseillers d’insertion et de probation à avoir un accès direct au casier judiciaire afin qu’ils apprécient au plus près le reclassement du condamné à un suivi socio-judiciaire.
En second lieu, si aux termes de l’article 763-3 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines, pendant la durée du suivi socio-judiciaire, « peut après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter » les obligations imposées au condamné, il ne peut en revanche pas lever l’injonction de soins, qui doit donc s’appliquer pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire, alors même que les soins peuvent ne plus s’avérer nécessaires. Ainsi, un conseiller d’insertion et de probation, rencontré par votre Rapporteur lors de son déplacement au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis, a indiqué qu’il suivait actuellement une personne condamnée, à titre principal, à un suivi socio-judiciaire d’une durée de dix ans pour attouchement sexuel sur mineur. Ce suivi comporte une injonction de soins, qui conduit le condamné à rencontrer une fois par semaine son psychiatre. Or, la thérapie engagée dans le cadre de l’injonction de soins a permis d’établir que les soins n’étaient aujourd’hui plus nécessaires. Cependant, l’injonction ne pouvant être levée avant la fin du suivi socio-judiciaire, la personne condamnée continue, à la suite d’un « arrangement » conclu entre le juge de l’application des peines et le conseiller d’insertion et de probation, de faire l’objet d’une prise en charge médicale « très formelle et très allégée ». Afin de lever cette difficulté, votre Rapporteur propose que le juge de l’application des peines, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, puisse mettre fin de manière anticipée à l’injonction de soins ordonnée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Proposition n° 23
Modifier l’article 763-3 du code de procédure pénale afin que le juge de l’application des peines puisse, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, mettre fin de manière anticipée à l’injonction de soins ordonnée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
TROISIÈME PARTIE : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE ET LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS LIÉES À L’ALCOOL
L’alcool, dont la consommation moyenne a pourtant baissé, fait l’objet de consommations problématiques, au moins ponctuellement, chez plus d’un tiers des adultes. Fait préoccupant, les ivresses répétées chez les jeunes se multiplient, induisant une série de complications très graves (comas, violences, accidents de la route, difficultés d’apprentissage scolaire, dépendances…).
Le coût pour la collectivité des conséquences de ces abus d’alcool est très important qu’il s’agisse bien évidemment des dépenses occasionnées en matière de soins ou celles rendues nécessaires pour lutter contre les troubles liés à ces consommations en matière d’ordre et de tranquillité publics.
Les succès remportés ces dernières années par la politique de restriction de l’usage du tabac ou la lutte contre la violence routière montrent qu’il n’y a pas de fatalité de l’échec et qu’on peut prévenir le mésusage (55) de l’alcool si l’on s’en donne tous les moyens.
I. UNE POPULATION SOUS MAIN DE JUSTICE FORTEMENT TOUCHÉE PAR LES PROBLÈMES D’ADDICTION À L’ALCOOL
A. UNE PRÉVALENCE DE LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL PLUS FORTE CHEZ LES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE QU’EN POPULATION GÉNÉRALE
1. La consommation d’alcool en France : un impact élevé sur la santé publique
a) Chez les jeunes, comme chez les adultes, l’alcool est la substance psychoactive la plus consommée en France
La consommation d’alcool en France diminue régulièrement depuis plusieurs décennies, en moyenne de 1 % par an depuis la fin des années soixante. Toutefois, le niveau de la consommation moyenne d’alcool par habitant demeure une caractéristique française. Avec 12,9 litres d’alcool pur consommé par an et par habitant, la France se situe au onzième rang mondial.
En outre, les usages problématiques d’alcool ne sont pas orientés à la baisse. Entre 2000 et 2005, ni la proportion des ivresses, ni celle des buveurs excessifs – soit au-delà du seuil fixé par l’OMS de deux verres par jour pour les femmes et trois verres par jour pour les hommes – n’ont diminué. En outre, les ivresses répétées des jeunes (entre 15 et 25 ans) concentrées en fin de semaine dans un contexte festif sont en augmentation depuis 2003.
Sur l’ensemble des personnes de 15 à 75 ans – soit environ 50 millions de personnes – on estime à 8 millions – soit 15 % – les personnes exposées au risque « alcool » ainsi qu’aux dommages induits. Sur ces huit millions, environ 3 millions de personnes présentent des alcoolisations à risque et près de 5 millions sont en difficulté avec l’alcool. Sur ces cinq millions, 3 à 3,5 millions de personnes présentent un usage nocif de l’alcool et 1,5 à 2 millions de personnes sont devenues malades alcoolo-dépendants (soit 4 % des consommateurs).
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS SUR LA « PYRAMIDE » DU RISQUE ALCOOL
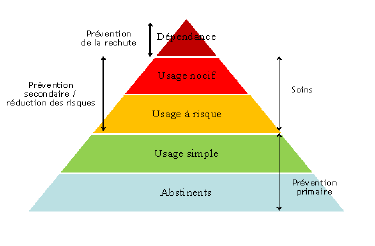
Mais un des phénomènes les plus inquiétants au cours de ces dernières années est l’évolution des comportements d’alcoolisation chez les jeunes français, avec une banalisation des ivresses répétées. Aux termes de la dernière enquête ESCAPAD (56) réalisée par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, près de six jeunes de dix-sept ans sur dix déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie, dont un peu moins de la moitié pendant l’année en cours et plus d’un quart l’ayant été au moins trois fois au cours de l’année. Ainsi, lors de son audition par votre Rapporteur, M. Pascal Mélihan-Cheinin, chef du bureau des pratiques addictives au ministère de la Santé, a souligné que « ce phénomène d’ivresses répétées, déjà bien installé dans les pays du nord de l’Europe, semble gagner du terrain en France ». En outre, la consommation ponctuelle de quantités importantes d’alcool, plus connue sous le nom de binge drinking (57), n’est rare dès l’âge de dix-sept ans : près de la moitié des jeunes interrogés ayant bu au cours des trente derniers jours dit avoir pratiqué au moins une fois ce type d’ « hyperalcoolisation ».
b) L’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France
Au final, l’impact de la consommation excessive d’alcool sur la santé publique en France est élevé, en termes de mortalité, de morbidité et de dommages sociaux. Aussi l’Institut Gustave Roussy estime-t-il à 45 000 par an le nombre de décès attribuables à l’alcool, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité évitable de notre pays (après le tabac).
Parmi les 45 000 décès annuels attribuables à l’alcool, on dénombre 10 000 décès par cancer, environ 6 800 décès par cirrhose ou autres pathologies digestives, 3 000 décès par psychose et dépendance alcoolique et 2 300 décès par accidents de la route. En moyenne, la consommation excessive d’alcool est à l’origine de 16 % des décès masculins (et 3 % des décès féminins). La France connaît la plus forte surmortalité masculine liée à l’alcool, de 30 % supérieure à la moyenne européenne.
L’alcool agit aussi comme « facteur associé » dans l’apparition de nombreuses pathologies. Pendant la grossesse, l’alcool est la première cause non génétique de handicap mental chez l’enfant. Sur la route, l’alcool est à l’origine de plus d’un accident sur quatre. Sa consommation est par ailleurs liée à l’apparition de certains troubles mentaux et à des violences de tous types (homicides, violences conjugales, etc.). S’agissant de l’alcoolisation des jeunes, les conséquences sanitaires sont également majeures, puisque les hospitalisations pour intoxication alcoolique aiguë ont augmenté de 50 % entre 2004 et 2007 aussi bien chez les mineurs de moins de quinze ans (passant de 700 à 1 100) que chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans (passant de 8 200 à 12 300). En outre, l’alcool est la cause de 42 % des accidents de la route mortels touchant les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans pendant l’été.
En définitive, avec 45 000 décès chaque année qui lui sont attribuables, l’alcool représente aujourd’hui la troisième cause de mortalité en France, la première cause de mortalité prématurée avant 65 ans, la deuxième cause de mortalité évitable en France et la première cause de décès chez les jeunes, notamment sur la route.
LE COÛT SOCIAL DE L’ALCOOL EN FRANCE
Le coût social de l’alcool est estimé pour l’année 2000 à plus de 37 milliards d’euros, soit 2,37 % du PIB et une dépense de près de 600 euros par habitant. La part la plus importante du coût social de l’alcool tient principalement aux pertes de productivité (16 milliards d’euros pour les entreprises), aux pertes de revenus des individus (7 milliards d’euros) ainsi qu’aux dépenses des assurances en charge des indemnisations en cas d’accident (3,5 milliards d’euros).
Quant aux dépenses de santé engendrées par l’alcool, elles représentent plus de 6 milliards d’euros répartis en soins hospitaliers (4,3 milliards d’euros) et en médecine de ville (1,8 milliard d’euros).
Ces estimations ne tiennent pas compte des crimes et délits commis sous l’emprise de l’alcool et peuvent donc être considérées comme une estimation basse. À titre de comparaison, les mêmes estimations conduisent à un coût social du tabac approchant les 48 milliards d’euros et un coût social des drogues illicites inférieur à 3 milliards d’euros.
Source : Les états généraux de l’alcool (2006)
2. La population carcérale est particulièrement touchée par les problèmes d’addiction à l’alcool
a) La dépendance à l’alcool chez les entrants de prisons
Réalisées sur l’ensemble des maisons d’arrêt en 1997 et en 2003 par les équipes médicales chargées des visites d’entrée, les études de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère de la Santé estiment qu’environ 30 % des entrants en prison cumulent les consommations à risque (alcool, tabac, drogues, psychotropes).
S’agissant plus particulièrement de l’alcool, dans les deux enquêtes menées par la Drees sur la santé des entrants en prison, un tiers des entrants en prison déclare une consommation excessive d’alcool (58). Deux tendances se profilent entre 1997 et 2003. Par rapport à 1997, la proportion d’entrants en prison se déclarant être des buveurs excessifs a légèrement diminué : 31 % en 2003 contre 33 % en 1997. Parallèlement, la prise en charge de l’alcoolisation excessive est un peu plus fréquente en 2003 : 6 % des entrants en prison se sont vus prescrire une consultation spécialisée en alcoologie en 2003 contre 4 % en 1997.
S’agissant plus particulièrement des mineurs, les deux enquêtes révèlent que la proportion de buveurs excessifs augmente avec l’âge et que le type de consommation évolue avec l’âge. Avant 25 ans, il s’agit très majoritairement d’une consommation discontinue. Ainsi, près d’un mineur nouvellement incarcéré sur cinq déclare une consommation excessive d’alcool en 2003, qui, pour 80 % d’entre eux, se rapporte à un mode discontinu de consommation. Ensuite, la consommation régulière devient prédominante, une consommation discontinue lui étant toutefois associée dans 40 % des cas.
b) La dépendance à l’alcool chez les détenus accueillis par les SMPR
L’enquête sur la santé mentale et le suivi psychiatrique des détenus accueillis par les services médico-psychologiques régionaux (SMPR), réalisée par la Drees en 2002, a concerné 23 établissements pénitentiaires, sur les 26 disposant d’un SMPR sur l’ensemble du territoire.
Parmi les entrants dans les établissements disposant d’un SMPR, environ 12 % avaient déjà bénéficié d’une prise en charge spécialisée en matière de toxicomanie ou d’alcool. Lors de l’entretien d’accueil réalisé par le psychiatre du SMPR, au moins un trouble psychiatrique avait été repéré chez 55 % des entrants. Parmi ces personnes présentant un trouble psychiatrique, 54 % présentaient des tendances addictives ou une consommation d’alcool importante.
Parmi les détenus suivis par les SMPR, 20 % avaient bénéficié d’une prise en charge spécialisée en matière de toxicomanie ou d’alcool. Un quart des détenus suivis souffrait de troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives, dont 29 % relatifs à une dépendance à l’alcool. Le diagnostic de dépendance aux substances psychoactives était équivalent chez les femmes (26 %, dont un quart dépendantes à l’alcool) et chez les hommes (un quart, dont 30 % dépendants à l’alcool) suivis par les SMPR.
De la même manière, lors de son déplacement à la consultation post-pénale mise en place par le Docteur Christiane de Beaurepaire à l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif, votre Rapporteur a pu constater que, sur les trois cents personnes prises en charge en 2007 par cette structure, près de 70 % présentaient une consommation excessive d’alcool, voire une alcoolo-dépendance.
B. ALCOOL ET INFRACTIONS : CONDUITES À RISQUE ET PASSAGES À L’ACTE FACILITÉS
1. Alcool et violence entretiennent des relations complexes et dangereuses
Diverses recherches internationales indiquent que l’alcool représente la substance psychoactive la plus fréquemment associée aux violences entre les personnes. Son poids est plus important que tous les autres produits psychoactifs cumulés, qu’ils soient légaux ou illégaux.
Si la direction générale de la santé ne dispose pas de données chiffrées sur la prévalence du risque alcool dans les différentes infractions, une étude menée à son initiative par le Professeur Laurent Bègue de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble et présentée en septembre 2008 confirme que l’alcool constitue un « facteur de risque important » en matière de violences. Cette étude, intitulée « violence alcool multi-méthodes », avait pour but de mettre en exergue pour la première fois la relation qui existe en France entre consommation d’alcool et violence en population générale.
Cette étude a été réalisée à l’été 2006 auprès de quelque 2 000 personnes du Nord et de l’Île-de-France. Les résultats ont notamment permis de mettre en évidence que 40 % des sujets ayant participé à une bagarre dans un lieu public avaient consommé de l’alcool dans les deux heures qui précédaient, avec un impact d’autant plus important que le niveau d’études était bas. De la même manière, 25 % des auteurs d’agressions hors de la famille et 35 % des auteurs d’agressions dans la famille avaient consommé de l’alcool dans les deux heures précédentes. En ce qui concerne les autres formes de délinquance, 32 % des destructions intentionnelles étaient précédées d’une consommation d’alcool. S’agissant des vols, de l’alcool avait été consommé dans 20 % des cas.
Les auteurs de l’étude ont mené une expérimentation après alcoolisation en laboratoire, pour essayer d’établir s’il existait un lien causal entre alcool et violence ou s’il ne s’agissait en réalité que d’un facteur de risque. Les résultats ont permis d’établir que l’alcool « perturbe le fonctionnement cognitif », tel que l’attention, le raisonnement abstrait, l’organisation des informations, la flexibilité mentale. Il existe donc bien un lien causal entre alcool et violence, à tout le moins en phase ascendante de l’alcoolémie. Cependant, le rôle que joue l’environnement du sujet dans le passage à l’acte est essentiel. La consommation d’alcool joue ainsi le rôle d’ « aide planifiée à l’agression ».
De manière plus générale, les deux travaux de synthèse sur cette question « alcool et violence » qui font référence – l’expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (59) et la revue de littérature réalisée à la demande de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (60) – font ressortir les enseignements suivants des études épidémiologiques : ainsi, une consommation abusive d’alcool augmente les risques de violences conjugales, lorsqu’elles sont associées à des difficultés économiques, augmente la gravité de certains délits, notamment les agressions physiques et sexuelles et augmente le risque d’incivilités et d’agressions à la sortie des bars.
Les différentes études épidémiologiques identifient également des facteurs de risque communs à l’ensemble des produits psychoactifs qui sont aussi valables pour l’alcool : la précocité et la diversité des usages de produits psychoactifs d’une part, et une consommation qui s’inscrit dans un faisceau de difficultés personnelles ou sociales d’autre part. De nombreux travaux établissent la réciprocité du lien entre produits psychoactifs (dont l’alcool) et délinquance : d’un côté, la consommation de produits psychoactifs peut retarder la sortie de la délinquance, de l’autre côté, l’inscription dans une trajectoire de délinquance de longue durée renforce une consommation problématique.
2. La prévalence de l’alcool varie suivant le type d’infractions considéré, mais reste globalement marquée
Par ces effets sur les fonctions supérieures (altération des fonctions cognitives, désinhibition comportementale), l’alcoolisation potentialise les conduites à risque. Sans qu’on puisse clairement le quantifier (sauf dans le cas de l’accidentologie routière), la prise de boissons alcooliques ou alcoolisées faciliterait le passage à l’acte et donc la commission d’infractions (conduites en état alcoolique, blessures ou homicides involontaires, violences à la sortie des discothèques, dans les stades, etc.).
a) Une forte prévalence de l’alcool lors de la commission des différentes infractions
Les mesures judiciaires sont de nature et de qualité différentes selon qu’il s’agit d’infractions directement ou indirectement corrélées à la consommation d’alcool. Peu d’enquêtes sont réalisées en France et les seules disponibles portent généralement sur des populations sélectionnées aux diverses étapes du processus pénal. Cependant, en 1969, une enquête a été réalisée en France sur des infractions, ayant fait l’objet de condamnations, dont au moins un des protagonistes relevait d’une alcoolisation chronique ou aiguë. Cette étude a permis de mettre en évidence, il y a quarante ans, une prévalence élevée de l’alcool lors d’homicides et d’incendies volontaires.
PRÉVALENCE D’ALCOOLISATION CHRONIQUE OU AIGUË DES IMPLIQUÉS (61) POUR CERTAINS GROUPES D’INFRACTIONS EN FRANCE (62)
Groupes d’infractions |
Pourcentage d’influence alcoolique |
Homicides volontaires |
69 % |
Crimes et délits contre les enfants |
38 % |
Coups mortels, coups et blessures volontaires |
29 % |
Homicides et blessures involontaires |
14 % |
Crimes et délits sexuels |
27 % |
Incendies volontaires |
58 % |
Rébellion et outrages |
34 % |
Dégradation d’objets d’utilité publique |
30 % |
Vols |
14 % |
Vagabondage et mendicité |
28 % |
Violation de domicile, bris de clôture |
35 % |
Toutes infractions confondues |
19 % |
En pratique, et bien que l’imprégnation alcoolique au moment des faits ne soit pas systématiquement dépistée, il est possible de distinguer (63) :
— un groupe restreint de sujets qui se caractérise par la fréquence de l’alcoolisation de l’auteur lors des faits et aussi par un mésusage. Dans plus des deux tiers de viols et d’agressions sexuelles sur majeurs, l’auteur est alcoolisé lors des faits et/ou mésusager ;
— un groupe plus hétérogène de sujets présentant un mésusage d’alcool et étant sous l’empire de l’alcool au moment des faits qui rassemble près de 50 % des viols et agressions sexuelles (64) sur mineurs et près de 50 % des violences entre conjoints ;
— un groupe encore plus hétérogène de sujets présentant un mésusage d’alcool dans un peu plus d’un quart des faits de maltraitance à enfants et étant sous l’empire de l’alcool au moment des faits dans 30 % des faits de violences générales. Ainsi, dans respectivement 29 % et 30 % des cas, les affaires de ces deux contentieux pourraient être considérées comme associées à l’alcool.
MOTIF DES POURSUITES |
CONSOMMATION LORS DES FAITS |
MÉSUSAGE D’ALCOOL : DÉPENDANCE OU CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE |
MÉSUSAGE D’ALCOOL ET TROUBLES PSYCHIATRIQUES |
VIOLENCES CONJUGALES |
46 % |
45 % |
13 % |
MALTRAITANCE ENFANTS |
14 % |
29 % |
5 % |
VIOLENCES GÉNÉRALES ITT > 8 JOURS |
30 % |
18 % |
6 % |
VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES SUR MAJEURS |
64 % |
72 % |
36 % |
VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS |
32 % |
52 % |
23 % |
Les auteurs sont en grande majorité des hommes jeunes appartenant à des milieux sociaux défavorisés et fragilisés pour moitié d’entre eux par la précarité sur le plan de l’emploi. La plupart ont connu des antécédents de violences physiques et parfois sexuelles.
En outre, comme l’a souligné M. Étienne Apaire, président de la Mildt, lors de son audition par votre Rapporteur, les parquets n’ont pas fait remonter d’éléments permettant d’affirmer que l’hyperalcoolisation des jeunes a généré une forme spécifique de délinquance. L’explication tient sans doute au fait que la sensation recherchée n’est pas l’ivresse mais une forme de « coma ». Par l’objectif même visé par ce type de comportements, les buveurs sont rapidement « neutralisés ». Il n’en demeure pas moins qu’avant d’atteindre le coma, ces consommateurs d’alcool peuvent commettre des infractions de toutes natures liées à des regroupements (le plus souvent bruyants) sur la voie publique : ivresse publique et manifeste, conduite en état alcoolique, vols, violences, viols, etc. En définitive, il convient de distinguer, suivant les catégories juridiques du droit pénal français, deux types d’infractions : celles directement corrélées à l’usage d’alcool et celles qui ne sont qu’indirectement liées à sa consommation.
b) Les infractions directement liées à l’usage d’alcool
Au regard du droit pénal, les infractions directement corrélées à l’usage d’alcool sont celles pour lesquelles la consommation d’alcool constitue un élément de l’infraction et pour lesquelles la mesure du taux d’alcoolémie est prévue lors de la constatation des faits. Les infractions directement liées à l’usage d’alcool concernent des formes de consommation alcoolique le plus souvent associées à certaines circonstances : conduite d’engins motorisés, dommages aux personnes et aux biens à l’occasion de la conduite, ivresse publique. Deux infractions sont en lien direct avec l’alcool : la conduite sous l’emprise de l’alcool (65) et l’ivresse publique et manifeste. Dans ces deux cas, c’est la consommation d’alcool qui est directement constitutive de l’infraction.
Tout d’abord, les délinquants routiers interpellés pour conduite sous l’emprise de l’alcool qu’ils soient ou non auteurs d’accidents représentent la première catégorie d’infractions directement liées à l’usage d’alcool. En 2008, le nombre de conducteurs conduisant avec une alcoolémie supérieure au taux maximal autorisé représente entre 1,2 et 3,5 % des conducteurs.
En outre, l’alcool est présent dans 10 à 16 % des accidents corporels, 30 à 37 % des accidents mortels et plus de 50 % des accidents mortels au cours des nuits de week-end. En 2006, les tribunaux ont prononcé environ 130 000 condamnations pour conduite en état alcoolique, 2 430 pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et 271 pour homicide par conducteur en état alcoolique.
Par ailleurs, les condamnations pour conduite en état alcoolique représentent plus de la moitié du total des condamnations pour délit en matière de circulation routière et près des trois-quarts des conduites sous l’emprise de l’alcool sont imputables à des consommateurs non dépendants – c’est-à-dire « non malades » de l’alcool – s’adonnant à des consommations à risque et/ou excessives, de manière épisodique ou répétée.
CONDAMNATIONS POUR DÉLITS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
2004 |
2005 |
2006 | ||||
Conduite en état alcoolique |
110 868 |
69,4 % |
118 252 |
57,1 % |
130 231 |
54,6 % |
Délit de fuite |
7 061 |
4,4 % |
5 998 |
2,9 % |
5 336 |
2,2 % |
Refus d’obtempérer |
8 310 |
5,2 % |
8 330 |
4 % |
8 757 |
3,7 % |
Refus de vérification d’état alcoolique |
1 572 |
1 % |
1 582 |
0,8 % |
1 639 |
0,7 % |
Conduite malgré suspension de permis |
8 293 |
5,2 % |
10 847 |
5,2 % |
13 563 |
5,7 % |
Défaut de plaques ou fausses plaques |
915 |
0,6 % |
774 |
0,4 % |
769 |
0,3 % |
Conduite sans permis |
11 887 |
7,4 % |
25 860 |
12,5 % |
34 972 |
14,7 % |
Défaut d’assurance (depuis le 12-03-2004) |
9 855 |
6,2 % |
31 937 |
15,4 % |
39 192 |
16,4 % |
Conduite en ayant fait l’usage de stupéfiant |
735 |
0,5 % |
2 920 |
1,4 % |
3 699 |
1,6 % |
Autres |
306 |
0,2 % |
456 |
0,2 % |
460 |
0,2 % |
Circulation routière |
159 802 |
100 % |
206 956 |
100 % |
238 618 |
100 % |
Source : annuaire statistique de la Justice (édition 2008).
Pour ce qui est des infractions en matière de sécurité routière, l’étude épidémiologique « Stupéfiants et accidents mortels », menée par une équipe de scientifiques sous la houlette de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, a montré que conduire sous l’effet du cannabis double le risque d’être responsable d’un accident mortel et que l’alcool multiplie ce risque par dix. Une étude complémentaire initiée en 2006 a cependant montré qu’aucun sur-risque d’accident mortel en cas d’alcoolémie faible (c’est-à-dire inférieur au seuil légal) ne pouvait être identifié.
Ensuite, les auteurs d’ivresses publiques et manifestes – ébriétés sur la voie publique – représentent la deuxième catégorie d’infractions en lien direct avec l’alcool : chaque année, ce sont environ 70 000 personnes impliquées qui font l’objet de 50 000 visites médicales préalablement à leur conduite au poste de police pour dégrisement. Bien qu’elle puisse faire l’objet d’une rétention, l’ivresse publique et manifeste n’est pas un délit mais une contravention de deuxième classe de 150 euros. En 2004, ce sont 42 065 amendes qui ont été infligées pour ivresse publique manifeste.
En définitive, comme l’indique le tableau ci-dessous, les infractions directement liées à l’usage d’alcool représentent en 2007 près du quart de toutes les condamnations prononcées par les juridictions pénales.
PART DES CONDAMNATIONS EN LIEN AVEC L’ALCOOL PARMI TOUTES LES CONDAMNATIONS (66)
Condamnation infraction principale |
Pourcentage | ||
2003 |
Autres condamnations |
438 868 |
79,3 % |
Condamnations pour « conduite en état alcoolique » (67) |
114 729 |
20,7 % | |
Condamnations pour « autres ivresses » (68) |
10 |
0 % | |
Total |
553 607 |
100 % | |
2004 |
Autres condamnations |
481 462 |
80,7 % |
Condamnations pour « conduite en état alcoolique » |
115 031 |
19,3 % | |
Condamnations pour « autres ivresses » |
21 |
0 % | |
Total |
596 514 |
100 % | |
2005 |
Autres condamnations |
506 697 |
79,6 % |
Condamnations pour « conduite en état alcoolique » |
129 651 |
20,4 % | |
Condamnations pour « autres ivresses » |
17 |
0 % | |
Total |
636 365 |
100 % | |
2006 |
Autres condamnations |
525 370 |
77,3 % |
Condamnations pour « conduite en état alcoolique » |
154 037 |
22,7 % | |
Condamnations pour « autres ivresses » |
25 |
0 % | |
Total |
679 432 |
100 % | |
2007 |
Autres condamnations |
577 577 |
77,5 % |
Condamnations pour « conduite en état alcoolique » |
167 108 |
22,4 % | |
Condamnations pour « autres ivresses » |
147 |
0 % | |
Total |
744 832 |
100 % |
c) Les infractions indirectement liées à l’usage d’alcool
La consommation d’alcool peut également être associée de manière indirecte à d’autres types d’infractions, notamment aux violences commises à l’égard des personnes : il s’agit des infractions commises concomitamment avec une consommation d’alcool sans que celle-ci ne constitue un élément de leur définition sur le plan juridique. Ainsi, l’usage d’alcool n’est pas nécessairement délictueux par lui-même et le passage à l’acte n’est pas nécessairement lié à la consommation d’alcool. Beaucoup de délits relèvent de cette catégorie, notamment les actes de violence où l’usage d’alcool peut être facilitateur sans pouvoir être tenu pour la cause unique et/ou principale. Or, en dehors des flagrants délits, il est rare que le taux d’alcoolémie puisse être connu au moment des faits.
Les travaux menés à partir des données judiciaires font apparaître que les problèmes d’alcool sont fréquemment mentionnés chez les auteurs de violences conjugales sans qu’il soit possible d’en préciser le degré de causalité. Sur environ 700 affaires judiciaires de violences conjugales enregistrées dans un parquet de la région parisienne, il était indiqué que plus d’un tiers des auteurs avaient bu au moment des faits et que dans 28 % des cas, l’auteur consommait régulièrement des quantités importantes d’alcool (69).
L’étude « Violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale » (70), réalisée par Mmes Claudine Pérez-Diaz et Marie-Sylvie Huré, a permis de dégager quelques conclusions sur les relations existant entre consommation d’alcool, violences et délinquance. En premier lieu, l’alcoolisation occasionnelle ou chronique est un facteur retrouvé chez plus d’un tiers des auteurs de violences. En deuxième lieu, les auteurs de ces violences, qui font l’objet de contentieux judiciaires, sont majoritairement des hommes jeunes, appartenant aux classes populaires (ouvriers et employés). En effet, dans les milieux sociaux les plus favorisés, les auteurs de violences auraient davantage de capacité à négocier avec l’environnement familial et les diverses institutions de prise en charge, largement en amont d’un débouché judiciaire. Enfin, en matière de violences sexuelles, le facteur alcool est encore plus prédominant : il est ainsi plus fortement présent dans les violences sexuelles entre partenaires occasionnels qu’entre conjoints. Chez certains auteurs, des problèmes d’ordre psychiatrique sont également patents. Le traitement judiciaire de ces affaires de violences sexuelles (classement ou bien poursuite et jugement) fait intervenir essentiellement trois critères : les antécédents de violences repérés par la justice, la gravité des blessures infligées et le degré d’alcoolisation de l’auteur (sobre versus alcoolisé au moment des faits).
De manière générale, une forte prévalence de l’alcool est observée chez les auteurs de violences (violences conjugales, violences familiales, agressions physiques et sexuelles, etc.). Ainsi, 40 % des sujets ayant participé à une bagarre dans un lieu public avaient consommé de l’alcool dans les deux heures qui précédaient, avec un impact d’autant plus important que le niveau d’études était bas. De la même manière, 25 % des auteurs d’agressions hors de la famille et 35 % des auteurs d’agressions au sein la famille avaient consommé de l’alcool dans les deux heures précédentes. En ce qui concerne d’autres formes de délinquance, 32 % des destructions intentionnelles étaient précédées d’une consommation d’alcool. S’agissant des vols, de l’alcool avait été consommé dans 20 % des cas. Enfin, l’alcool était présent en 2004 dans près de 70 % des homicides et dans la moitié des cas d’inceste.
II. MIEUX SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE LORS DES RENCONTRES AVEC LA JUSTICE
A. LA RENCONTRE AVEC LA JUSTICE : DES « OCCASIONS MANQUÉES » POUR PRÉVENIR LES INFRACTIONS LIÉES À L’ALCOOL ?
L’organisation de la prise en charge dépend essentiellement du degré de gravité de l’infraction commise. Autrement dit, c’est la décision judiciaire qui compte tenu des faits et de leur gravité, va déterminer les contours de la prise en charge. En effet, la réponse pénale apportée diffère en fonction des stades de procédure ou du parcours judiciaire emprunté.
1. En pré-sentenciel : des opportunités de soins manquées, notamment pour les conducteurs en état alcoolique
a) En pré-sentenciel : un recours accru, mais encore insuffisant, aux alternatives aux poursuites
Les alternatives aux poursuites, qui sont à la disposition du parquet, sont principalement utilisées pour les infractions directement liées à l’usage d’alcool, comme les conduites sous l’empire d’un état alcoolique. En effet, l’augmentation des infractions au code de la route a imposé une réorientation des modalités de poursuites : augmentation du recours aux ordonnances pénales, à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et aux alternatives aux poursuites qui a ainsi permis de faire face à l’ampleur de ce contentieux (Dinan, Lorient, Nantes, Marseille, cour d’appel d’Amiens, Marseille, Colmar, Lille, Vienne, Bressuire).
Dans le cadre des alternatives aux poursuites, des stages de sensibilisation à la sécurité routière sont fréquemment prononcés (Mulhouse, Annecy, Dijon, Cambrai, Lille, Limoges, Metz, Les Sables d’Olonne, Rouen, Bordeaux, Grasse, Clermont-Ferrand, Nouméa). Ces stages peuvent également être proposés par les parquets à titre de peine principale ou complémentaire, afin de mieux prévenir la récidive conformément aux orientations de la circulaire du 28 juillet 2004 relative au renforcement de la lutte contre la délinquance routière (Chambéry, Limoges, Thonon, Strasbourg, Fort de France, Grenoble, Mende, Les Sables d’Olonne, Aix en Provence, Meaux).
Certains parquets innovent en la matière en proposant un stage de sensibilisation à la sécurité routière avec pose d’un appareil éthylométrique contrôlant la mise en route du véhicule. Ce stage, organisé par la prévention routière, est basé sur le volontariat, le candidat étant retenu après examen médical (Annecy).
Ces alternatives aux poursuites, lorsqu’elles sont utilisées, ont une efficacité qui est fonction du stade de l’addiction lors de la première interpellation. Ainsi, lorsque l’individu est peu ou pas dépendant, le premier avertissement peut servir de révélateur d’un comportement mettant les autres en danger. Les alternatives aux poursuites prennent alors toute leur signification et présentent une efficacité réelle pour prévenir le risque de récidive. À l’inverse, en cas d’addiction avérée, la problématique est plus complexe et les alternatives aux poursuites peuvent s’avérer insuffisantes.
Lors de son audition par votre Rapporteur, M. Étienne Apaire, président de la Mildt, a souligné qu’il y avait « une sévérité de plus en plus grande » des parquets à l’encontre des infractions commises sous l’emprise de l’alcool (notamment les conduites en état alcoolique).
LES ALTERNATIVES AUX POURSUITES
Article 41-1 du code de procédure pénale
Le parquet dispose, entre le classement sans suite et le mise en mouvement de l’action publique, d’une autre forme de réponse pénale, plus adaptée à des infractions dont la gravité n’est pas telle qu’elle justifie l’engagement d’une procédure longue et complexe : les alternatives aux poursuites. Ces mesures dites de la « troisième voie » offrent ainsi au parquet un élément de souplesse très appréciable.
L’article 41-1 du code de procédure pénale fournit ainsi au procureur de la République un éventail de mesures issues le plus souvent de pratiques de classement « sous condition » mises en œuvre d’abord empiriquement par le ministère public.
Ainsi, s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le Procureur peut :
— procéder au rappel des obligations résultant de la loi,
— orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle,
— demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi,
— lui demander de réparer le dommage résultant des faits,
— ou faire procéder à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, avec leur accord. Dans ce dernier cas, le médiateur, qui doit être un tiers neutre, a pour mission de rapprocher les points de vue et d’amener l’auteur des faits à proposer une réparation des dommages causés. En cas d’accord, le procureur classe le dossier ; sinon, il peut prendre la décision de poursuivre l’auteur de faits ou de mettre en œuvre une composition pénale.
Ces mesures présentent de nombreux avantages : pragmatisme, efficacité, souplesse et désengorgement des tribunaux, pour des faits de moindre gravité, dont les auteurs admettent la réalité et qu’ils ont le désir de réparer.
En dépit de cette sévérité accrue, la récidive en matière de conduite en état alcoolique reste importante, puisqu’elle représente 13 % des condamnations pour simple conduite en état alcoolique. Ce taux de récidive, qui s’accroît chaque année en raison de l’intensité accrue de la répression de l’alcool au volant, traduit aussi l’importance du phénomène – plus général – des mésusages d’alcool et en particulier du fait de consommateurs habituels.
Or, les alternatives aux poursuites ont un rôle majeur à jouer en matière de prévention des infractions commises sous l’effet de l’alcool – tout particulièrement en matière de conduites en état alcoolique – dans la mesure où elles peuvent permettre d’orienter le prévenu vers une structure sanitaire et de l’inciter aux soins, via des stages de sensibilisation à la sécurité routière. En 2004, ce sont 12 599 personnes qui ont ainsi pu bénéficier d’un stage dans le cadre d’alternatives aux poursuites pour alcoolisation au volant. Or, comme l’a souligné le rapport (71) du groupe « expertise alcool » du comité des experts de la sécurité routière, « le contenu de ces stages est variable et souvent mal connu ». En outre, ces stages ne suivent pas tous les programmes définis par les conventions départementales d’objectifs « santé et justice ». En effet, l’évaluation de ces conventions a permis d’estimer le taux de prise en charge de populations interpellées ayant un problème d’alcool à 3 % et celui de personnes condamnées ayant un problème de drogue ou d’alcool à 7 %. Dans les deux cas, ce taux est faible, attestant l’idée d’une action pénale faiblement orientée vers les soins.
Or, c’est au cours de la phase pré-sentencielle que l’intervention du procureur de la République est primordiale. En effet, il est le seul habilité à solliciter des organismes extérieurs pour la mise en place de stages à destination des personnes interpellées pour conduite sous l’emprise de l’alcool.
Ainsi, en phase pré-sentencielle, les comités de l’ANPAA présents dans chaque département mènent des actions en étroite collaboration avec les procureurs de la République (convention d’intervention dans le cadre de la composition pénale), mais également, en fonction des particularités des dispositifs, avec les services de la préfecture, de la police judiciaire, de la gendarmerie, de la DDASS et des associations œuvrant dans le champ du contrôle judiciaire. Les conventions d’intervention signées entre le procureur de la République et les comités de l’ANPAA définissent les niveaux d’informations et les modes d’engagement dans une démarche de soins.
A titre d’exemple, les comités de l’ANPAA ont mis en place des stages collectifs, regroupant entre 10 à 15 personnes. Ils ont généralement lieu une fois par semaine ou une fois par mois à raison d’une journée ou de deux demi-journées. Parallèlement à ces stages, certains comités ont préféré développer des séances informatives et préventives avant l’ouverture des audiences correctionnelles en direction des personnes comparaissant pour conduite en état alcoolique (ANPAA du Lot et de Seine-et-Marne). À l’issue de ces stages, une évaluation est effectuée qui peut être suivie d’une enquête sociale rapide trois ou six mois après, laquelle permet de savoir si les personnes en difficulté avec l’alcool ont entrepris une démarche de soins dans un centre de cure ambulatoire en alcoologie.
b) Seul un conducteur verbalisé pour une alcoolémie délictuelle sur quatre est incité à se soigner ou à maîtriser sa consommation
Dans son article « L’alcool au volant : prise en charge pénale et sanitaire », Mme Claudine Pérez-Diaz s’intéresse à la question de savoir si la réponse pénale tient compte des problèmes de santé des conducteurs verbalisés ou condamnées pour délit d’alcoolisation au volant.
À partir des données statistiques publiées par le ministère de la Justice, elle a procédé à une estimation des possibilités de prise en charge sanitaire des conducteurs verbalisés pour délit d’alcoolisation au volant. Afin d’y parvenir, il convient d’identifier quelles sont les possibilités d’accéder aux soins pour les personnes interpellées et condamnées pour conduite en état alcoolique. En premier lieu, « des opportunités de soins sont offertes à des conducteurs verbalisés, soit en alternative aux poursuites, soit dans le cadre d’uns sursis avec mise à l’épreuve assorti d’une obligation de soins ». En second lieu, lorsque les personnes interpellées pour conduite en état alcoolique sont condamnées à une peine de prison, elles peuvent se voir proposer des soins en détention, « à condition qu’une structure adaptée existe concrètement dans [l’établissement considéré], que le personnel nécessaire soit disponible et que l’encombrement de ce service leur permette d’y accéder. »
Ainsi, Mme Claudine Pérez-Diaz rappelle qu’en 2006, ce sont 162 429 conducteurs en état alcoolique qui ont bénéficié d’une alternative aux poursuites ou qui ont été condamnés. Or, seulement 41 402 d’entre eux se sont vus proposer une prise en charge sanitaire en pré-sentenciel – 12 490 stages en alternatives aux poursuites – ou en post-sentenciel – 5 517 stagiaires « justice » au contenu imprécis, 16 402 sursis avec mise à l’épreuve potentiellement assorti d’une obligation de soins et 6 993 peines de prison ferme. En définitive, « les trois-quarts des conducteurs ayant un problème d’alcool avéré ne font l’objet d’aucune offre de soins ».
L’OFFRE DE SOINS AUX CONDUCTEURS VERBALISÉS POUR CONDUITE EN ÉTAT ALCOOLIQUE EN 2006 (72)
NOMBRE DE MESURES |
EN % | |
PERSONNES INTERPELLÉES OU CONDAMNÉES POUR CEA AYANT L’OBJET D’UNE OFFRE DE SOINS |
41 402 |
25 % |
DONT EN PRÉ-SENTENCIEL |
||
— ALTERNATIVES AUX POURSUITES |
12 490 |
7,7 % |
DONT EN POST-SENTENCIEL |
||
— SURSIS AVEC MISE À L’ÉPREUVE |
16 402 |
10 % |
— PEINE DE PRISON FERME |
6 993 |
4,3 % |
— STAGE « JUSTICE » |
5 517 |
3 % |
PERSONNES INTERPELLÉES OU CONDAMNÉES POUR CEA N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE OFFRE DE SOINS |
121 327 |
75 % |
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES INTERPELLÉES OU CONDAMNÉES POUR CEA |
162 429 |
100 % |
Alors que le contentieux des délits de conduite en état alcoolique devrait permettre de repérer des individus ayant, pour la plupart, des problèmes caractérisés avec l’alcool et ainsi constituer une réelle opportunité de prise en charge sanitaire, force est de constater que seul un conducteur verbalisé pour une alcoolémie délictuelle sur quatre est éventuellement incité à se soigner ou à maîtriser sa consommation. Ainsi, « les offres de soins, en alternatives aux poursuites ou après condamnation, sont […] très sous dimensionnées au vu de l’intensité et de l’extension des problèmes de ces conducteurs avec l’alcool » (73).
2. Au niveau de la condamnation : l’alcool est désormais, pour certaines infractions, une circonstance aggravante
Avec la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le fait de commettre une infraction en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants devient une circonstance aggravante. Lors des travaux préparatoires, le Garde des Sceaux avait justifié cette innovation par le fait que « l’usage de stupéfiants ou l’abus d’alcool ne doit plus jamais constituer une excuse lorsqu’il aboutit à la commission d’une infraction. Trop souvent, l’état second d’une personne, dû à la consommation de drogues, lorsqu’elle commet une infraction, suscite la compassion. Cette période de tolérance est révolue. Commettre une infraction sous l’emprise d’un produit stupéfiant ou en état d’ivresse manifeste constituera désormais une circonstance aggravante ».
PEINES ENCOURUES POUR LES INFRACTIONS COMMISES EN ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE
Infraction commise |
Peine encourue en l’absence d’ivresse manifeste |
Peine encourue en cas d’ivresse manifeste |
Base juridique |
Délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours |
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Article 222-12 du code pénal |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail |
Contravention de la 4ème ou 5ème classe |
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
Article 222-13 du code pénal |
Atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
Article 227-26 du code pénal |
Agressions sexuelles autres que le viol |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
Article 222-28 du code pénal |
Agressions sexuelles autres que le viol imposées à des mineurs de moins de quinze ans ou à des personnes particulièrement vulnérables |
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
Article 222-30 du code pénal |
Viol |
Quinze ans de réclusion criminelle |
Vingt ans de réclusion criminelle |
Article 222-24 du code pénal |
Blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois |
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
Article 222-20-1 du code pénal |
Blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois |
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Article 222-19-1 du code pénal |
Homicide commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur |
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
Article 221-6-1 du code pénal |
Au regard des premiers éléments recueillis par le ministère de la Justice, il est possible de dresser un premier bilan statistique de l’innovation introduite par la loi du 5 mars 2007 pour les infractions commises en état d’ivresse manifeste. En 2007, plus de 180 infractions ayant donné lieu à condamnation ont été commises avec circonstances aggravantes, à savoir par des personnes en état d’ivresse manifeste. Près de la moitié de ces infractions était constituée par des violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et plus du tiers par des violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité.
NOMBRE D’INFRACTIONS EN 2007 POUR LESQUELLES L’ALCOOL ÉTAIT UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Infractions ayant donné lieu à condamnation |
En pourcentage | |
Agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste |
2 |
1 % |
Agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par une personne en état d’ivresse manifeste |
1 |
0,5 % |
Violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité |
69 |
38 % |
Violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours |
89 |
49 % |
Violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours |
21 |
11,5 % |
Total |
182 |
100 % |
3. En post-sentenciel : un dispositif de soins pénalement ordonnés étoffé, mais pour partie inappliqué
a) Les soins pénalement ordonnés permettent une réponse diversifiée, mais insuffisante, au niveau de l’application et de l’exécution des peines
Pour sanctionner et prévenir les infractions liées à l’alcool, le législateur a créé au fil du temps plusieurs dispositifs qui permettent une prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice présentant des problèmes avec l’alcool : à l’obligation de soins sont venues s’ajouter, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l’injonction thérapeutique et l’injonction de soins.
L’obligation de soins et l’injonction thérapeutique intervenaient jusqu’à la loi du 5 mars 2007 dans des cadres différents : l’injonction thérapeutique ne pouvait être prononcée qu’en matière de lutte contre la toxicomanie alors que l’obligation de soins, plus générale, pouvait être prononcée dès lors qu’une infraction en lien avec l’alcool était commise. La loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité de prononcer une injonction thérapeutique pour la personne qui fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, soit dans le cadre de mesure alternative aux poursuites – composition pénale – et au stade de la condamnation dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. Lors de son audition par votre Rapporteur, Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environnement au ministère de la Justice, a souligné qu’à ce jour l’articulation entre l’obligation de soins et l’injonction thérapeutique « ne peut pas encore être analysée du fait de l’absence de mise en œuvre de l’injonction thérapeutique telle que prévue par la loi du 5 mars 2007 ». Par conséquent, pour les infractions liées à une consommation habituelle ou excessive d’alcool, seule l’obligation de soins peut être actuellement prononcée par les juridictions.
S’agissant de l’injonction de soins, depuis la loi du 5 mars 2007, elle peut être ordonnée en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou supérieure à huit jours (articles 222-12 et 222-13 du code pénal), quand l’auteur des faits est en état d’ivresse manifeste. Il est trop tôt encore pour porter une appréciation sur son extension aux infractions de violences de plus et moins de huit jours.
Cependant, une limite majeure à l’appréciation de l’efficacité du dispositif de soins pénalement ordonnés tient au fait que le ministère de la Justice ne dispose pas d’un système statistique lui permettant de recenser précisément les obligations et injonctions de soins ordonnées dans le cadre d’infractions liées à l’alcool. Ainsi, alors même qu’il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique et de prévention de la récidive, le législateur ne peut en l’état actuel évaluer la pertinence des soins pénalement ordonnés pour les infractions liées à l’alcool. Aussi apparaît-il souhaitable que le nouvel « info centre » du ministère de la Justice, qui entrera en vigueur à la fin de l’année 2009, permette à l’avenir un recensement et un suivi statistiques des soins pénalement ordonnés. Afin d’être le plus précis et le plus opérationnel, ce recensement devra tenir compte de la nature des infractions pour lesquelles ces soins sont ordonnés (infractions liées à l’alcool, à l’usage de stupéfiants, etc.).
Proposition n° 24
Mettre en œuvre dans les meilleurs délais un recensement et un suivi statistiques, réguliers et exhaustifs, des soins pénalement ordonnés, prenant en compte le type d’infractions auxquelles ils se rattachent, afin de mieux apprécier l’efficacité de ces soins en matière de santé publique et de prévention de la récidive.
Les seules données disponibles ne permettent donc de dresser qu’un bilan fort imprécis et incomplet du recours aux soins pénalement ordonnés pour les infractions liées à l’alcool. Ainsi, le tableau statistique sur les condamnations intervenues en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, qui figure à l’annexe n° 3, fait seulement état du nombre de sursis avec mise à l’épreuve prononcés en 2006 (13 832). En outre, lorsqu’un sursis avec mise à l’épreuve est prononcé en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il comporte le plus souvent une obligation de soins (74). Mais, en l’absence de données statistiques plus précises, on en reste à de simples conjectures, qui ne sont pas à la hauteur de l’enjeu sanitaire et judiciaire.
De manière générale, votre Rapporteur estime nécessaire que soit mis en place un suivi régulier des infractions liées à l’alcool, tant en matière de prévention que de prise en charge. Sans évaluation régulière, il est de facto impossible d’adapter la réponse pénale et les moyens afférents : seule une connaissance précise du phénomène et une identification exhaustive des besoins et de l’offre de soins en alcoologie pour les personnes placées sous main de justice permettront à la Justice d’avoir une réponse adaptée et d’orienter à bon escient les justiciables vers des structures de soins à tous les stades de la procédure. Pour ce faire, il convient d’envisager la création d’une mission de contrôle permanente, associant de manière conjointe l’IGAS et à l’IGSJ et qui serait chargée de publier tous les ans un rapport sur la prévention et la prise en charge des infractions liées à l’alcool.
Créer une mission de contrôle permanente, associant de manière conjointe l’IGAS et à l’IGSJ, chargée de publier tous les ans un rapport sur la prévention et la prise en charge des infractions liées à l’alcool. L’objectif de cette mission sera de procéder à une évaluation régulière des dispositifs de prévention et de prise en charge des infractions liées à des consommations problématiques d’alcool, afin de mieux cibler la réponse pénale et les moyens afférents.
b) Injonction thérapeutique et médecin relais : une mesure restée « lettre morte » depuis plus de deux ans
La loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 a étoffé le dispositif de lutte contre l’usage illicite de stupéfiants et la consommation excessive d’alcool. Elle a pour ce faire opéré une réforme importante des dispositions relatives aux injonctions thérapeutiques.
• L’injonction thérapeutique avant la loi du 5 mars 2007
L’injonction thérapeutique, qui prévoyait que le procureur pouvait enjoindre à la personne, usant de stupéfiants, de se soumettre à une prise en charge sanitaire en échange d’une suspension des poursuites pénales, avait été instituée par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie. L’autorité sanitaire compétente, à savoir la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, était en charge du suivi des injonctions thérapeutiques ainsi prononcées.
Le fonctionnement de ce dispositif était jugé insatisfaisant par nombre d’acteurs. Le dispositif souffrait d’un manque de visibilité et d’efficacité, en raison des pratiques hétérogènes mises en œuvre par les parquets et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Ces dysfonctionnements ont conduit à un faible recours à la mesure : seules 4 568 injonctions thérapeutiques ont été décidées par les procureurs de la République en 2004, alors que ce nombre était de 8 052 en 1997. Ce chiffre apparaissait d’ailleurs déjà très faible au regard des 58 000 interpellations pour usage de stupéfiants réalisées à la même période. En définitive, l’injonction thérapeutique n’était prononcée que par 10 % des tribunaux de grande instance.
Le rapport de politique pénale pour 2006 avait ainsi rappelé que cette mesure était peu utilisée, le plus souvent par manque de moyens sanitaires et sociaux (75). Elle était également concurrencée par le développement de dispositifs associatifs et publics sur le plan sanitaire et social qui assuraient la prise en charge médico-sociale des consommateurs de produits stupéfiants.
• L’injonction thérapeutique instaurée par la loi du 5 mars 2007
La loi du 5 mars 2007, à ses articles 47 et 49, vise à améliorer le recours à l’injonction thérapeutique, en opérant quelques modifications. Il s’agit toujours d’une mesure de soins ou de surveillance médicale préconisée à l’encontre des personnes ayant fait usage illicite de stupéfiants. L’objectif du nouveau système est de renforcer l’efficacité des mesures d’injonctions thérapeutiques, désormais mobilisables à tous les stades de la procédure pénale, en mettant en place un dispositif reposant sur le médecin relais. Elle peut désormais être décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites, de la composition pénale à l’égard de l’usager majeur comme du mineur de treize ans au moins, comme modalité d’exécution d’une peine et notamment dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve. Elle peut être également ordonnée par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que par la juridiction de jugement (articles L. 3143-1 à L. 3413-4 et L. 3425-1 du code de la santé publique et article 132-45 du code pénal).
Par ailleurs, dans le cadre des obligations pouvant être imposées spécifiquement au condamné soit par le parquet dans le cadre de mesure alternative aux poursuites (composition pénale), soit par la juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, le champ de l’injonction thérapeutique, initialement réservé aux personnes faisant usage illicite de stupéfiants, a été étendu aux personnes ayant commis une infraction dont les circonstances révèlent une addiction à l’alcool. En outre, le médecin relais devient désormais, l’interface entre le patient et l’autorité judiciaire en lieu et place de la DDASS. Il est chargé de mettre en œuvre la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi effectif sur le plan sanitaire. À ce titre, il procède à l’examen des personnes, contrôle la mise en œuvre effective de la mesure, assure l’articulation entre le dispositif de prise en charge sanitaire et l’autorité judiciaire qui a prononcé l’injonction thérapeutique. Il accompagne sa collaboration d’un avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.
LE MÉDECIN RELAIS DANS LE CADRE DE L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE
Le décret n° 2008-364 du 16 avril 2008 relatif au suivi des mesures d’injonction thérapeutique et aux médecins relais modifie les dispositions du code de la santé publique relatives aux modalités de mise en œuvre de l’injonction thérapeutique (articles R. 3413-1 à R. 3413-8 du code de la santé publique) pour clarifier les relations entre les différents acteurs concernés : procureur de la République, autorité sanitaire départementale, médecin relais qui notifie l’injonction et médecin traitant. Il précise leur rôle, leurs obligations, ainsi que les délais dans lesquels les étapes de cette mesure doivent intervenir afin d’accroître l’efficacité et la rapidité de sa mise en œuvre.
— La désignation :
Après dépôt d’un dossier auprès du préfet, les médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d’injonctions thérapeutiques, doivent être inscrits sur une liste départementale établie par ce dernier, après avis du procureur général près de la cour d’appel. Le décret organise des incompatibilités avec la fonction de médecin relais, notamment en cas de lien de parenté ou d’alliance avec la personne enjointe, ou lorsqu’il est déjà désigné comme médecin traitant de celle-ci.
— La rémunération :
Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. D’ailleurs, à ce titre, l’arrêté fixant la rémunération des médecins relais à 132 euros par an et par personne suivie est en cours de signature. Il sera accompagné de la publication d’une circulaire.
— Le déroulement de la procédure d’injonction thérapeutique :
Le médecin relais est chargé de mettre en œuvre la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi effectif sur le plan sanitaire. À ce titre, il procède à l’examen des personnes, contrôle la mise en œuvre effective de la mesure, assure l’articulation entre le dispositif de prise en charge et l’autorité judiciaire qui a prononcé l’injonction thérapeutique à qui il fait connaître son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure.
Le préfet communique sans délai les pièces adressées par l’autorité judiciaire (procédure, enquête de personnalité, ordonnance, jugement de condamnation) au médecin relais lequel procède à l’examen médical initial dans le mois suivant la réception de ces pièces. À ce stade, il fait connaître son avis motivé à l’autorité judiciaire et, s’il estime la mesure médicalement opportune, il informe l’intéressé des modalités d’exécution de l’injonction thérapeutique en l’invitant à lui indiquer, au plus tard dans les dix jours, le nom du médecin soignant qu’il a choisi. Si le consommateur ne connaît pas de médecin susceptible de le prendre en charge, le médecin relais lui indiquera une liste de médecins ou un centre de prise en charge et de soins spécialisés dans la toxicomanie. Pour éviter que la mesure prononcée ne fasse l’objet d’un avis de non-opportunité après le premier examen médical par le médecin relais, il faut impérativement que la décision soit prise à l’appui des éléments figurant dans la procédure et dans l’enquête de personnalité du consommateur de produits stupéfiants.
Le médecin désigné par l’intéressé est informé par le médecin relais du cadre juridique de la mesure. Il doit confirmer par écrit son accord au médecin relais dans un délai de quinze jours. Pour les personnes mineures, le choix du médecin soignant est effectué par ses représentants légaux et l’accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
Le médecin relais procède ensuite aux examens médicaux au troisième et sixième mois de la mesure. À l’issue de chaque examen, il établit un rapport, adressé à l’autorité judiciaire ayant ordonné la mesure, par lequel il décrit l’évolution de la situation médicale de l’intéressé, sous réserve du secret médical, de la régularité du suivi et du type de mesure de soins ou de surveillance mis en place. Si l’autorité judiciaire décide de mettre fin à une injonction thérapeutique, elle doit alors en informer le préfet et le médecin relais.
L’alinéa 2 de l’article L. 3423-1 du code de la santé publique dispose que la durée de la mesure de l’injonction thérapeutique est d’une durée de six mois renouvelable trois fois, soit 24 mois au plus. Si cet article traite de l’injonction thérapeutique par le procureur de la République, il apparaît que la loi du 5 mars 2007 visait à développer l’injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure mais sans créer plusieurs régimes d’injonction. Nonobstant sa place dans le code de la santé publique et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, il convient de considérer que ce délai vaut pour tous les cadres procéduraux dans lesquels la mesure d’injonction est décidée.
• Les difficultés rencontrées par la mise en place des médecins relais
Une des difficultés de mise en œuvre de l’injonction thérapeutique tient au problème de la démographie médicale : certains départements, voire certaines régions, souffrent d’une pénurie manifeste de médecins (le Limousin…). Cette difficulté était déjà fort prégnante avant la réforme intervenue le 5 mars 2007. Ainsi, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat pour le projet de loi de prévention de la délinquance reprochait déjà en 2006 au système antérieur d’injonction thérapeutique de pâtir d’un manque de professionnels (médecins, psychologues et structures sanitaires).
En effet, il demeure très difficile de trouver un médecin soignant en matière de toxicomanie. Dans le département du Nord, l’injonction thérapeutique, telle que prévue par la loi du 31 décembre 1970, n’est pas mise en œuvre faute de trouver un médecin spécialisé. À Paris en revanche, l’injonction thérapeutique en matière de toxicomanie est mise en place avec un certain succès. Il semble en outre plus aisé de trouver un médecin soignant en alcoologie.
Cependant, au-delà du seul enjeu lié à la démographie médicale, le réel problème, qui fait aujourd’hui obstacle à une mise en œuvre effective de l’injonction thérapeutique telle qu’elle a été votée par le Parlement en mars 2007, réside dans le fait que le médecin relais n’est pas encore mis en place et ce dans aucun département, l’arrêté fixant la rémunération de ce médecin relais n’ayant toujours pas été pris.
Il semble que le texte soit toujours en discussion entre le ministère de la Santé et le ministère du Budget. Outre l’obstacle lié à l’absence de fixation de la rémunération du médecin relais, l’injonction thérapeutique en matière de consommation excessive d’alcool rencontre des limites spécifiques.
• Les limites de l’injonction thérapeutique en matière de consommation habituelle et excessive d’alcool
La loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité de prononcer une injonction thérapeutique pour la personne qui fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques soit dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites (composition pénale, article 41-2 du code de procédure pénale) et au stade de la condamnation dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (art 132-45 du code pénal).
Ce dispositif en leur permettant de faire l’objet d’une mesure d’injonction thérapeutique jusque-là réservée aux usagers de drogues améliore ainsi la prise en charge des auteurs de violences conjugales, qu’ils soient consommateurs abusifs, occasionnels ou d’habitude, voire alcoolo-dépendants avérés.
En revanche, l’injonction thérapeutique prononcée par le parquet à titre de mesure alternative aux poursuites pure et simple (article L. 3423-1 du code de la santé publique) ou par le juge d’instruction, le juge des enfants et le juge des libertés et de la détention (article L. 3424-1 du code de la santé publique) n’est pas possible pour une personne qui fait une consommation habituelle ou excessive d’alcool.
• L’injonction thérapeutique pour la consommation habituelle et excessive d’alcool : une mesure inappliquée depuis deux ans
Deux ans après le vote et la promulgation de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est impossible de dresser un bilan et encore moins d’apporter une appréciation générale sur l’injonction thérapeutique telle que redéfinie par la loi du 5 mars 2007. En effet, le nouveau dispositif n’est pas encore entré en vigueur. Ainsi, sur le point de savoir si l’injonction thérapeutique est adaptée à la prévention des infractions liées à l’alcool, il est impossible de répondre au regard de l’absence totale d’application de la nouvelle législation.
On peut toutefois considérer que la mise en place des médecins relais, lorsqu’elle sera effective, apportera une réponse adaptée et équilibrée aux traitements des addictions dans le respect du secret médical. Le médecin relais a été institué pour faire l’interface entre l’autorité judiciaire et le médecin soignant en charge de la mesure.
Le médecin relais donnera aux magistrats une information qui ne se limitera pas à l’attestation d’un simple suivi médical. Il apportera sa propre évaluation, au terme de deux visites, au début et à l’issue de la mesure (six mois d’intervalle). Le secret médical entre le médecin soignant et le toxicomane ou la personne ayant une consommation habituelle et excessive d’alcool demeurera intact.
La plus-value du médecin relais sera de donner son avis sur le point de savoir si la mesure est adaptée ou pas. Cela devrait permettre de limiter ou de mettre fin à une mesure qui s’avère inefficace. La mesure en effet peut se révéler inopérante, soit parce que la personne ne collabore pas, soit parce que la personne n’est pas « malade », aucune addiction n’étant décelée. Le secret médical sera respecté car le médecin relais n’aura aucune obligation de donner la raison pour laquelle l’injonction thérapeutique n’est pas efficace et surtout car il ne connaîtra rien de la relation entre le médecin soignant et le patient.
4. Une prise en charge de l’alcoolisme en détention très disparate suivant les établissements pénitentiaires
Bien que l’alcool soit interdit en prison, des détenus parviennent à en produire de façon artisanale, en laissant fermenter un mélange de jus de fruits, de mie de pain et de sucre. D’autres encore se font apporter par leurs familles des serviettes de toilette parfumées à l’anis, ces dernières ayant été préalablement imprégnées d’alcool anisé que le détenu pourra aisément récupérer après distillation.
L’alcool circulant et étant consommé clandestinement en prison, se pose avec acuité la question de la prise en charge des troubles addictifs liés à l’alcool chez les détenus. Les chiffres cités pour rendre compte de l’offre de soins en alcoologie en milieu pénitentiaire sont extraits de l’étude réalisée par Mme Agnès Dumas et M. Philippe Michaud en avril 2006 sur ce thème. Cette étude portait sur 185 établissements pénitentiaires (76).
a) Les interventions alcoologiques spécifiques proposées aux détenus
Parmi les 185 établissements recensés dans l’étude précitée, 30 établissements ne proposent aucune intervention, soit 16 % de l’ensemble des établissements pénitentiaires. Sur ces 30 établissements, la moitié n’ont aucun projet d’intervention sur l’alcool en préparation. En revanche, 11 établissements ont déclaré travailler sur un projet de mise en place d’une intervention sur l’alcool.
Un seul établissement pénitentiaire pouvant accueillir plusieurs interventions alcoologiques, l’enquête recense davantage d’interventions que d’établissements pénitentiaires, soit un total de 266 interventions (toutes catégories confondues), réparties sur 155 établissements pénitentiaires.
CRITÈRES DE DISTINCTION ENTRE LES TYPES D’INTERVENTIONS ALCOOLOGIQUES
TRAVAIL BÉNÉVOLE |
TRAVAIL SALARIÉ | |
MODE INDIVIDUEL |
« VISITEURS DE PRISON » |
« INTERVENTION INDIVIDUELLE PROFESSIONNELLE » |
MODE GROUPAL |
« RÉUNIONS DES ASSOCIATIONS NÉPHALISTES (77) » |
« INTERVENTION GROUPALE PROFESSIONNELLE » |
Sur les 155 établissements pénitentiaires accueillant une ou plusieurs interventions alcoologiques : 112 établissements accueillent une intervention individuelle professionnelle ; 66 une intervention groupale professionnelle ; 46 établissements reçoivent des réunions d’associations néphalistes bénévoles ; 34 établissements reçoivent des visiteurs de prison bénévoles.
Il convient en premier lieu de noter que l’intervention professionnelle (travail salarié) est majoritaire : elle est deux fois plus importante que l’intervention bénévole. À cet égard, l’intervention individuelle professionnelle (travail salarié) constitue très largement le type d’intervention le plus répandu : elle représente 60 % de l’ensemble des établissements pénitentiaires recensés (185) et 72 % de l’ensemble des établissements accueillant une ou plusieurs interventions alcoologiques (155). Au contraire, les visiteurs de prison représentent la forme d’intervention la moins courante, soit 18 % de l’ensemble des établissements pénitentiaires recensés et 22 % des établissements concernés par une ou plusieurs interventions.
En second lieu, seuls quatre établissements offrent les quatre types d’intervention alcoologiques : ce sont les établissements de Belfort, Angoulême, Ensisheim et Liancourt. En revanche, dans 76 établissements, soit près de la moitié des établissements accueillant des interventions alcoologiques, il n’existe qu’un seul type d’intervention.
En définitive, si on rapporte le temps de travail hebdomadaire total de tous les intervenants confondus (estimé à 451 heures) à l’ensemble de la population carcérale connaissant un problème de dépendance (15 500 détenus), il apparaît que trois minutes d’offre de soins spécialisés sont disponibles, par semaine, pour chaque personne alcoolo-dépendante incarcérée.
b) La prise en charge interne menée par les services médicaux de l’établissement : dispositif interne et préparation à la sortie
• Le dispositif interne à chaque établissement pénitentiaire
S’agissant de l’existence d’un protocole de sevrage, dans 65 établissements (35 % des 185 établissements recensés dans l’enquête), on déclare utiliser un protocole spécifique pour le sevrage des détenus, alors que dans 108 établissements (58 %), le sevrage des détenus ne suit aucun protocole particulier. La majorité des interlocuteurs est même surprise par cette question, dans la mesure où les détenus « arrivent déjà sevrés » après la garde à vue, et sont sevrés de fait, « puisqu’ils ne boivent plus ».
S’agissant de la présence d’un référent en alcoologie au sein de l’UCSA ou du SMPR, il s’agit d’identifier la présence d’un soignant s’occupant plus spécifiquement des problèmes liés à l’alcool dans l’établissement pénitentiaire. Dans 132 établissements (soit 71 % des 185 établissements pénitentiaires inclus dans l’enquête), aucun référent ne semble avoir été désigné.
Dans le reste des établissements (soit 26 %), le référent peut être soit un infirmier, un médecin ou un psychologue, sans qu’une catégorie professionnelle soit plus représentée que les autres. Enfin, dans 5 établissements, soit l’établissement comporte une antenne d’alcoologie (Fleury-Mérogis et la Santé), soit plusieurs professionnels spécialisés en alcoologie travaillent au sein de l’UCSA et/ou du SMPR.
S’agissant de la collaboration entre intervenants externes et services internes à l’établissement pénitentiaire, Mme Agnès Dumas et M. Philippe Michaud ont demandé aux responsables d’intervention (les intervenants professionnels, réalisant une intervention individuelle ou groupale) de déterminer la qualité de la collaboration entretenue avec les différents services de l’établissement (UCSA, SPIP, SMPR, personnels de détention). 74 % des intervenants déclarent collaborer souvent avec l’UCSA. La collaboration avec le SMPR et le SPIP alterne entre collaboration très régulière et régulière, tandis que la collaboration avec le personnel de détention est presque inutile (72 % des intervenants déclaraient ne jamais collaborer avec eux).
• La préparation à la sortie
Afin de préparer la sortie des détenus, les professionnels intervenant en milieu pénitentiaire ont déclaré effectuer plusieurs types d’actions : donner simplement une liste d’adresses ou de numéros de téléphone (respectivement 176 et 131 établissements) ; donner les coordonnées complètes de professionnels ou d’associations (respectivement 153 et 75 établissements) ; prendre rendez-vous depuis la prison dans une structure de soins (112 établissements) ; organiser des visites à la prison pour permettre au détenu de rencontrer les futurs professionnels qui s’occuperont de lui à l’extérieur (102 établissements) ; accorder des permissions de sortir au détenu afin qu’il prenne contact avec une structure de soins (69 établissements) ; adresser une lettre au correspondant qui va prendre le relais de la prise en charge (55 établissements) ; confier une lettre au patient afin qu’il la remette au correspondant qui va prendre le relais de la prise en charge (54 établissements) ; organiser un séjour en service spécialisé (3 établissements).
La très grande majorité des professionnels ne fait que donner des coordonnées au détenu sortant (adresses, coordonnées complètes, téléphone). Dans 60 % des 185 établissements, il peut arriver qu’un rendez-vous à l’extérieur soit pris depuis la prison et dans 55 % des cas, des visites peuvent être organisées dans la prison.
Dans seulement un tiers des établissements, un courrier peut être rédigé à l’attention d’un correspondant extérieur afin de transmettre des informations sur le suivi du détenu pendant son incarcération, soit en confiant une lettre au patient, soit en l’adressant directement au correspondant.
Les professionnels intervenant en milieu pénitentiaire ont également été interrogés sur l’existence d’un lien privilégié avec un intervenant ou une structure extérieurs à la prison pour recevoir les sortants de prison. Les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), qu’ils soient privés ou qu’ils dépendent de l’ANPAA, constituent des interlocuteurs privilégiés pour recevoir les sortants de prison (98 établissements, soit 53 % des 185 établissements inclus dans l’enquête). L’absence de partenariat relative à la préparation à la sortie des détenus reste cependant notable, puisque 38 établissements, soit 20 % des 185 établissements, déclarent ne pas orienter les détenus vers une structure particulière.
B. FAIRE DE LA RENCONTRE AVEC LA JUSTICE UNE OCCASION RÉUSSIE DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN CHARGE
1. Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues 2008-2011 apporte des premiers éléments de réponse
a) Prévenir la récidive de l’usage et du trafic de drogues chez les publics sous main de justice
Comme le rappelle le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies, « parmi les faits donnant lieu à des poursuites et à des condamnations, la problématique des addictions en lien avec le passage à l’acte est souvent mise en avant en particulier pour l’alcool ». Or, les personnes sous main de justice les plus fragilisées restent « celles qui sont les moins bénéficiaires d’actions de sensibilisation et de prévention ». Afin d’apporter aux professionnels qui les prennent en charge des outils de travail novateurs et aux publics ciblés une possibilité plus grande de resocialisation et de responsabilisation, le plan gouvernemental propose deux mesures.
La première d’entre elles consiste à « expérimenter des groupes de parole auprès des personnes placées sous main de justice en complément de la prise en charge par entretiens individuels qui, pour certains faits, trouvent leurs limites », l’objectif étant de « susciter une réflexion de la part des condamnés en ce qui concerne leur passage à l’acte en vue de prévenir la récidive et permettre dans un second temps, le cas échéant, l’émergence d’une demande de soins ». Aujourd’hui, cette expérimentation est complètement réalisée avec la mise en place des programmes de prévention de la récidive. Il était prévu que pour la fin de l’année 2008 une cinquantaine de projets de prise en charge collective de personnes placées sous main de justice soit mise en place par des services pénitentiaires volontaires respectant le cadre ci-dessous présenté. Fin 2009, la direction de l’administration pénitentiaire aura réalisé environ quatre-vingt dix projets.
La mise en place de ces programmes de prévention de la récidive a débuté dans les années 1990 à l’initiative de quelques services pénitentiaires d’insertion et de probation qui ont ressenti le besoin de faire évoluer leurs méthodes d’intervention jusqu’alors exclusivement fondées sur l’entretien individuel avec la personne prise en charge.
Cette démarche criminologique s’inspire de nombreux exemples étrangers (Canada, Grande-Bretagne, Espagne…) et s’inscrit clairement dans une dimension européenne. En effet, dès 2000, les recommandations du Conseil de l’Europe ont préconisé la mise en œuvre de « programmes d’intervention qui consistent à apprendre aux délinquants à réfléchir aux conséquences de leur conduite criminelle, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître et à éviter les situations qui précèdent le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-sociaux ».
LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT
Les programmes de prévention de la récidive (PPR) ont fait l’objet d’une expérimentation au cours de l’année 2008 sous la forme de groupes de paroles se caractérisant par les éléments suivants :
— une approche criminologique consistant en un travail axé sur le passage à l’acte délictueux et fondé sur une méthode cognito-comportementale ;
— une implication forte des personnels d’insertion et de probation qui seront chargés de mettre en œuvre et d’animer les PPR en lien avec les personnels de surveillance et de direction exerçant en établissements pénitentiaires. Ainsi, un PPR nécessite deux conseillers d’insertion et de probation.
Les PPR se caractérisent par une approche avant tout criminologique des faits, se distinguant en cela de la prise en charge thérapeutique assurée par les équipes médicales en milieu fermé ou en milieu ouvert.
Les thèmes travaillés ont porté sur les infractions de nature sexuelle, les violences – notamment familiales et conjugales –, la délinquance routière et les passages à l’acte faisant apparaître une difficulté en matière d’addiction et notamment d’addiction à l’alcool.
Au cours de l’année 2008, cinquante projets répartis sur l’ensemble des directions interrégionales pénitentiaires ont été expérimentés. Les PPR ont connu un important développement au cours de l’année 2009, puisque quatre-vingt-dix PPR sont prévus, impliquant près d’une quarantaine de SPIP. Parmi ces PPR, plus d’une dizaine portent sur les violences en état alcoolique (violences routières, violences conjugales…).
En complément, la direction de l’administration pénitentiaire a lancé un projet de prise en charge de personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement adapté à leurs besoins. Il s’agit des programmes courtes peines (PCP) qui se dérouleront dans des quartiers dédiés, les quartiers courtes peines (QCP). Ces programmes s’articulent autour de deux axes : l’axe prévention de la récidive et l’axe réinsertion.
La deuxième mesure vise à « développer des actions de prévention spécifiques dans une approche globale des risques en direction des publics sous main de justice […] en favorisant la territorialisation de projets de prévention des conduites à risque portés par des équipes pluriprofessionnelles, associant des acteurs locaux des secteurs répressifs, sanitaires, sociaux, éducatifs… ». Ainsi, pour l’année 2009, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction de l’administration pénitentiaire doivent solliciter leurs services déconcentrés afin de faire remonter les actions de prévention mises en œuvre. L’objectif recherché est de déployer sur l’ensemble du territoire des actions de prévention adaptées aux différents publics et territoires.
b) Mieux sanctionner les infractions liées à l’usage
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies (2008-2011) replace cette action dans une problématique plus large, rappelant ainsi que « l’usage des drogues […] licites, aux conséquences graves en termes de santé publique et de troubles à l’ordre public, demeure une préoccupation majeure des pouvoirs publics », la sanction de l’abus devant « tenir compte de ces deux réalités et proposer des réponses à la fois répressives, éducatives et sanitaires ».
Afin de mettre en œuvre ces principes, plusieurs propositions ont été mises en avant, dont trois concernent tout particulièrement l’alcool.
En premier lieu, il est prévu de simplifier et d’harmoniser les modalités de prélèvements biologiques (dépistage et vérification d’alcoolémie), dans les cas où la loi le prévoit ou l’autorise.
En deuxième lieu, une des propositions vise à expérimenter, dans le ressort d’une cour d’appel, le contrôle à distance du taux d’alcoolémie de personnes placées sous main de justice, dans le cadre de mesures post-sentencielles. Concernant ce projet, le bureau de l’exécution des peines et des grâces travaille actuellement avec l’administration pénitentiaire à sa mise en œuvre. S’inscrivant dans le cadre plus général de la lutte contre la récidive ainsi que du développement des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération, cette expérimentation consistera à contrôler à distance le taux d’alcoolémie par l’expiration dans un boîtier prenant en simultané un cliché photographique, un signalement immédiat étant envoyé vers un pôle centralisateur et des tests planifiés, aléatoires ou sur simple requête, pouvant également être réalisés. Cette expérimentation sera limitée géographiquement au ressort d’une cour d’appel et d’une durée comprise entre 6 et 12 mois. Elle ne pourrait concerner que les personnes volontaires.
Enfin, il est prévu de développer des réponses pénales pédagogiques à l’usage simple pour les publics majeurs et mineurs et notamment par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs, comme le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants.
c) Améliorer la prise en charge et la continuité des soins délivrés aux usagers de drogues et d’alcool incarcérés
S’agissant de cette action qui s’adresse à un public bien ciblé, l’enjeu est majeur, puisque la population incarcérée est particulièrement touchée par les addictions. Comme le rappelle le plan gouvernemental, « les moyens du dispositif actuel sont insuffisants pour assurer la prise en charge de ces problèmes », des « difficultés d’hébergement et de continuité des soins à la sortie de prison » subsistant, alors qu’en 2003, ce sont 20 % des entrants en maison d’arrêt qui étaient dépendants à l’alcool et 30 % qui déclaraient un cumul de consommations à risque (alcool, tabac, drogues, psychotropes).
Afin de répondre à cette problématique, le plan gouvernemental fixe plusieurs pistes d’évolution possibles, dont quatre intéressent plus particulièrement l’alcool. Il s’agit tout d’abord de « confier par modification réglementaire le pilotage de la prise en charge des addictions aux unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans le cadre d’une coordination avec les autres services concernés, notamment psychiatriques », tout en définissant précisément les « objectifs à atteindre en termes de soins aux personnes dépendantes ». Cette mesure a fait l’objet d’une réunion de travail entre la direction générale de la santé, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la Mildt, les représentants du ministère ayant évoqué l’hypothèse d’une circulaire.
Une des pistes d’évolution envisagées afin d’améliorer la prise en charge et la continuité des soins délivrés aux usagers de drogues et d’alcool incarcérés consiste à « mettre en place une stratégie d’action coordonnée de prévention et de prise en charge des addictions en prison prévoyant en particulier la création de cent nouvelles consultations d’addictologie orientées alcoologie ». Lors des différentes auditions réalisées par votre Rapporteur, il est apparu que le financement (par l’ONDAM sanitaire) de ces cent nouvelles consultations d’addictologie orientées alcoologie avait été prévu dès 2009 en mesures nouvelles et que la mise en place de ces consultations était en cours.
Une autre mesure, concernant l’alcoologie avancée par le plan gouvernemental est la création « par appel à projets national des programmes d’accueil courts et d’accès rapide pour les sortants de prisons au sein de structures sociales et médico-sociales existantes (avec hébergement), en lien avec l’hôpital de rattachement de la prison ». Le 23 février 2009, la circulaire (78) regroupant les appels à projets et les cahiers des charges pour la mise en œuvre des mesures du plan gouvernemental du domaine médico-social a été publiée :
— Un premier appel à projets pour quatre programmes d’accueil courts et d’accès rapide pour les personnes sortant de prison au sein de structures médico-sociales existantes – deux doivent ouvrir en 2009 et deux en 2010 – a été lancé. Il s’agit dans ce cas d’ouvrir des unités d’hébergement collectif d’environ 10 places, qui constituent un lieu d’accueil immédiat à la sortie de prison, sans temps de latence entre le jour de la sortie et celui de la mise en place des relais médico-sociaux et d’insertion.
— Un autre appel à projets prévoit la mise en œuvre de consultations avancées de dix CSAPA au sein de structures d’hébergement du dispositif « accueil hébergement insertion » pour favoriser l’hébergement de personnes dépendantes sortant de prison.
La remontée de ces deux appels à projets à la Mildt et à la direction générale de la santé (après avis des services déconcentrés) est prévue pour le 15 octobre 2009 et une délégation de crédits avant la fin de l’année est actuellement en cours.
2. Donner sa pleine mesure à l’injonction thérapeutique et au médecin relais
a) Prendre sans délai les actes réglementaires d’application de l’injonction thérapeutique et du médecin relais
Le décret n° 2008-364 du 16 avril 2008 relatif au suivi des mesures d’injonction thérapeutique et aux médecins relais a inséré dans la partie réglementaire du code la fonction publique un nouvel article R. 3413-8 qui dispose que « les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé ».
Or, comme votre Rapporteur l’a souligné plus haut, la mise en œuvre de ce dispositif, voté il y a plus de deux ans par le législateur, n’est toujours pas effective, puisque aucun médecin relais ne peut aujourd’hui être rémunéré, en l’absence de publication d’arrêté fixant cette rémunération.
Votre Rapporteur estime que cette situation ne peut plus perdurer tant les enjeux en matière de santé publique et de prévention de la délinquance sont importants. C’est pourquoi, il est indispensable que soit pris sans délai l’arrêté fixant la rémunération des médecins relais dans le cadre des mesures d’injonctions thérapeutiques.
Proposition n° 26
Publier sans délai l’arrêté fixant les modalités de rémunération du médecin relais afin de donner sa pleine effectivité à l’injonction thérapeutique, telle qu’elle a été réformée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
b) Étendre la possibilité d’injonctions thérapeutiques pour les infractions liées à l’alcool à tous les stades de la procédure
L’injonction thérapeutique, telle qu’elle résulte de la loi du 5 mars 2007, obéit à deux régimes distincts, selon qu’elle s’adresse aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou bien à celles ayant une consommation habituelle et excessive d’alcool.
En matière d’usage illicite de stupéfiants, l’injonction thérapeutique peut être décidée à tous les stades de la procédure. Elle peut ainsi être décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites : par le procureur de la République dans le cadre des alternatives aux poursuites, de l’ordonnance pénale ou de la composition pénale ; par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire ; par les juridictions de jugement, notamment dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve.
La loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité de prononcer une injonction thérapeutique pour les infractions dont les circonstances révèlent une addiction aux boissons alcooliques. Toutefois, l’injonction thérapeutique ne peut alors être prononcée que dans le cadre de la composition pénale – en pré-sentenciel – et du sursis avec mise à l’épreuve – en post-sentenciel.
POSSIBILITÉS DE RECOURS À L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DEPUIS LA LOI DU 5 MARS 2007 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POUR USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS |
INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POUR CONSOMMATION HABITUELLE ET EXCESSIVE D’ALCOOL |
— PRONONCÉE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DANS LE CADRE DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES, DE L’ORDONNANCE PÉNALE OU DE LA COMPOSITION PÉNALE (ARTICLE L. 3423-1À L. 3423-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) ; |
— PRONONCÉE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA COMPOSITION PÉNALE (ARTICLE 41-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; |
— PRONONCÉE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION ET LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE D’UNE INFORMATION JUDICIAIRE (ARTICLE L. 3424-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) ; |
— PRONONCÉE PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT DANS LE CADRE DU SURSIS AVEC MISE À L’ÉPREUVE (ARTICLE 132-45 DU CODE PÉNAL). |
— PRONONCÉE PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT, NOTAMMENT DANS LE CADRE DU SURSIS AVEC MISE À L’ÉPREUVE (ARTICLE L. 3425-1À L. 3425-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE). |
Afin de renforcer la prise en charge de l’alcoolisme après la commission d’une infraction, votre Rapporteur propose d’étendre la possibilité d’injonctions thérapeutiques pour les infractions liées à une consommation habituelle et excessive d’alcool à tous les stades de la procédure : alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République, ordonnance pénale, composition pénale, obligation ordonnée par le juge d’instruction (dans le cadre d’un contrôle judiciaire) ou comme modalité d’exécution d’une peine. Cette mesure permettra en outre d’unifier le régime de l’injonction thérapeutique, qui pourra être utilisée à tous les stades de la procédure judiciaire, qu’il s’agisse d’un usage illicite de stupéfiants ou d’une consommation habituelle et excessive d’alcool.
Proposition n° 27
Étendre la possibilité d’injonctions thérapeutiques pour les infractions liées à une consommation excessive et habituelle d’alcool à tous les stades de la procédure : alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République, ordonnance pénale, composition pénale, obligation ordonnée par le juge d’instruction (dans le cadre d’un contrôle judiciaire) ou comme modalité d’exécution d’une peine.
c) Étendre le stage de sensibilisation aux dangers de la drogue aux risques d’une consommation habituelle et excessive d’alcool
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit une nouvelle peine complémentaire au sein du code pénal que peuvent encourir les personnes coupables de certaines infractions : le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, qui a pour objet, aux termes de l’article R. 131-46 du code pénal, « de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l’usage de tels produits ». A la différence du stage de sécurité routière, celui-ci n’est aux frais du condamné que si la juridiction le décide, ces frais ne pouvant toutefois excéder le montant maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la 3ème classe (79).
Ce stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants peut être encouru, à titre de peine complémentaire, pour les infractions en matière d’usage ou de trafic de stupéfiants ou commises sous l’emprise de la drogue : les atteintes à la vie de la personne (article 221-8 du code pénal), la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence (article 223-18 du code pénal), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (article 222-44 du code pénal), y compris celles liées au trafic de stupéfiants, l’extorsion (article 321-13), les destructions, dégradations et détériorations (article 322-15), le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants (article 227-18), le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants (article 227-18-1), le fait de conduire un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants (article L. 235-1 du code de la route), le refus de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (article L. 235-3 du code de la route).
Le champ d’application de ce stage est extrêmement large, puisqu’il peut être prononcée à tous les stades de la procédure : par le procureur de la République dans le cadre des alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale), de la composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale) ou de l’ordonnance pénale (article 495 du code de procédure pénale), par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire (article 131-35-1 du code pénal) ou par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention au stade de l’instruction préparatoire.
ÉVALUATION DES STAGES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE LA DROGUE ET DES INJONCTIONS THÉRAPEUTIQUES EN MATIÈRE D’USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS
Au 16 mars 2009
Dans le prolongement de la circulaire en date du 9 mai 2008 relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances, a été mis en œuvre par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice un dispositif de collecte statistique informatisé relatif à l’évaluation du prononcé des injonctions thérapeutiques (80) et des stages de sensibilisation.
Il a été demandé au magistrat ou greffier référent au parquet d’intégrer les données de sa juridiction avant le 15 de chaque mois suivant chaque trimestre échu, et ce à compter du 15 juillet 2008 pour les mesures ordonnées au cours du second trimestre 2008.
Les parquets des pôles de l’instruction doivent renseigner un tableau sous format électronique portant sur : le nombre de procédures reçues au parquet relatives à des usages de stupéfiants ; le nombre de mesures d’injonctions thérapeutiques et de stages de sensibilisation ordonnées en fonction du cadre juridique (composition pénale, alternative aux poursuites, ordonnance pénale, sursis avec mise à l’épreuve, à titre de peine complémentaire) et en fonction de la minorité ou de la majorité de la personne ; la prise en charge du coût du stage.
Seules 81 juridictions ont communiqué les renseignements sollicités (soit 44,8 % de l’ensemble des juridictions). Le dispositif étant trimestriel, ces données ne concernent que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008.
Sur 22 465 procédures rendues en matière d’usage de stupéfiants ont été prononcées les mesures suivantes : 1 825 stages de sensibilisation répartis entre 37 juridictions et 3 171 injonctions thérapeutiques réparties entre 43 juridictions.
Ces mesures d’injonction thérapeutiques et de stages de sensibilisation ont été décidées dans 95,5 % des cas dans le cadre d’alternatives aux poursuites (dont 25,6 % des cas dans le cadre d’une composition pénale). 332 stages de sensibilisation ont concerné des mineurs et 1 493 des majeurs. Par ailleurs, 413 injonctions thérapeutiques ont concerné des mineurs et 2 758 des majeurs.
De ces éléments chiffrés se dégage un constat. Il existe actuellement des réponses très diversifiées d’une juridiction à l’autre démontrant que certains tribunaux sont très impliqués dans la mise en œuvre des injonctions thérapeutiques et des stages de sensibilisation, s’appuyant sur un réseau associatif dynamique dans leur ressort. Ainsi, cinq tribunaux de grande instance ont développé activement les stages de sensibilisation : les TGI de Meaux, Bobigny, Bordeaux, Coutances, et Dax. En matière d’injonction thérapeutique, un nombre élevé de mesures est constaté dans les TGI de Paris, Toulouse, Evry, Bordeaux, Créteil et Meaux.
Le stage de sensibilisation, créé par la loi du 5 mars 2007 à titre de peine complémentaire, ne concerne à ce jour que les seuls produits stupéfiants et non la consommation habituelle et excessive d’alcool. Or, les personnes placées sous main de justice sont le plus souvent touchées par des poly-addictions, associant produits stupéfiants et alcool.
C’est pourquoi, votre Rapporteur propose de faire de ce stage un stage de sensibilisation aux dangers de la drogue et de l’alcool. Pouvant toujours être prononcé à titre de peine complémentaire pour les infractions précitées, ce stage rénové, qui se verrait désormais assigner une double dimension (stupéfiants et alcool), serait également encouru, comme peine complémentaire, au titre des infractions pour lesquelles l’état d’ivresse manifeste au moment des faits constitue, au sens du droit pénal français, une circonstance aggravante.
STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE STUPÉFIANTS ET D’UNE CONSOMMATION HABITUELLE ET EXCESSIVE D’ALCOOL | |
INFRACTIONS POUR LESQUELLES LE STAGE DE SENSIBILISATION PEUT ÊTRE PRONONCÉ DEPUIS LA LOI N° 2007-297 DU 5 MARS 2007 |
INFRACTIONS POUR LESQUELLES L’ÉTAT D’IVRESSE MANIFESTE AU MOMENT DES FAITS CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE |
— ATTEINTES À LA VIE DE LA PERSONNE (ARTICLE 221-8 DU CODE PÉNAL) ; |
— DÉLIT DE VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS (ARTICLE 222-12 DU CODE PÉNAL) ; |
— VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE (ARTICLE 223-18 DU CODE PÉNAL) ; |
— VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL INFÉRIEURE OU ÉGALE À HUIT JOURS OU N’AYANT ENTRAÎNÉ AUCUNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL (ARTICLE 222-13 DU CODE PÉNAL) ; |
— ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE (ARTICLE 222-44 DU CODE PÉNAL) ; |
— ATTEINTE SEXUELLE SUR MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26 DU CODE PÉNAL) ; |
— EXTORSION (ARTICLE 321-13) ; |
— AGRESSION SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL (ARTICLE 222-24 DU CODE PÉNAL) ; |
— DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-15) ; |
— AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL IMPOSÉES À DES MINEURS DE QUINZE ANS OU À DES PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES (ARTICLE 222-28 DU CODE PÉNAL) ; |
— FAIT DE PROVOQUER DIRECTEMENT UN MINEUR À FAIRE UN USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS (ARTICLE 227-18) ; |
— BLESSURES INVOLONTAIRES COMMISES PAR LE CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR ET AYANT ENTRAÎNÉ UNE ITT INFÉRIEURE OU ÉGALE À TROIS MOIS (ARTICLE 222-30 DU CODE PÉNAL) ; |
— FAIT DE PROVOQUER DIRECTEMENT UN MINEUR À TRANSPORTER, DÉTENIR, OFFRIR OU CÉDER DES STUPÉFIANTS (ARTICLE 227-18-1) ; |
— BLESSURES INVOLONTAIRES COMMISES PAR LE CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR ET AYANT ENTRAÎNÉ UNE ITT SUPÉRIEURE À TROIS MOIS (ARTICLE 222-20-1 DU CODE PÉNAL) ; |
— FAIT DE CONDUIRE UN VÉHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE STUPÉFIANTS OU SOUS L’EMPIRE D’UN ÉTAT ALCOOLIQUE (ARTICLE L. 235-1 DU CODE DE LA ROUTE) ; |
— HOMICIDE COMMIS PAR LE CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR (ARTICLE 222-19-1 DU CODE PÉNAL) ; |
— REFUS DE DÉPISTAGE EN VUE D’ÉTABLIR SI CETTE PERSONNE CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE DE STUPÉFIANTS (ARTICLE L. 235-3 DU CODE DE LA ROUTE). |
— REFUS DE DÉPISTAGE PERMETTANT D’ÉTABLIR L’EXISTENCE D’UN ÉTAT ALCOOLIQUE D’UN CONDUCTEUR (ARTICLE L. 234-8 DU CODE DE LA ROUTE). |
Proposition n° 28
Étendre le stage de sensibilisation aux dangers de la drogue institué par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance aux risques liés à une consommation habituelle et excessive d’alcool.
Proposition n° 29
Étendre le stage de sensibilisation aux dangers de la drogue et d’une consommation habituelle et excessive d’alcool aux infractions pour lesquelles l’état d’ivresse manifeste au moment des faits constitue une circonstance aggravante.
3. Délivrer de plus amples informations et de plus fortes incitations aux soins aux personnes placées sous main de justice
a) Expérimenter les entretiens alcoologiques en garde à vue à destination des personnes sous l’emprise d’un état alcoolique
Lors des auditions réalisées par votre Rapporteur, il a été fait état d’une expérimentation très intéressante en matière de prise en charge des problèmes de mésusage d’alcool après la commission d’une infraction : la réalisation d’entretiens d’alcoologie en garde à vue.
En effet, depuis décembre 2007, le commissariat central du Havre a mis en œuvre, en partenariat avec l’association ASSOCHA, spécialisée dans le traitement de la dépendance alcoolique, une action de prévention des comportements à risque et de la récidive. Avec le soutien du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la ville du Havre, sont proposés aux personnes placées en garde à vue à la suite de la commission d’infractions sous l’emprise de l’alcool des entretiens d’alcoologie, réalisés par des intervenants spécialisés de l’association ASSOCHA.
Cette action menée aujourd’hui à titre expérimental s’adresse aux mis en cause dans des affaires en lien avec une consommation d’alcool et poursuit un double objectif : d’une part, permettre aux prévenus, au cours de cet entretien, de revenir sur leurs actes et, d’autre part, les sensibiliser à une démarche personnelle de prise en charge de leurs conduites addictives, au besoin avec le soutien d’un thérapeute.
S’inscrivant dans une logique de prévention et de réduction des risques en alcoologie, cette action est mise en œuvre auprès des gardés à vue au sein des locaux de l’hôtel de police du Havre, par le Docteur Patrick Fouilland et les thérapeutes Catherine Bellet et Catherine Legent, depuis le 12 décembre 2007, à raison de trois fois par semaine.
PRÉSENTATION DES ENTRETIENS D’ALCOOLOGIE PROPOSÉS EN GARDE À VUE À L’HÔTEL DE POLICE DU HAVRE
— Modalités de l’action :
Les entretiens se déroulent en toute confidentialité, dans un local adapté et sécurisé de l’Hôtel de Police du Havre. Les personnes visées sont les auteurs d’infractions commises sous l’emprise de l’alcool et les personnes placées en garde à vue pour ivresse publique et manifeste. Les conjoints ou la famille proche peuvent également se voir proposer un entretien, le personnel de l’association étant également compétent en terme d’accompagnement dans le cadre conjugal et familial.
Les services d’accueil des victimes et de traitement judiciaire sont sensibilisés à la détection des problèmes d’alcool, notamment lorsque des proches seraient amenés à se manifester ou à être reçus dans le cadre de la procédure. Des plaquettes d’information sont disponibles dans tous les services du commissariat accueillant du public.
Une notice explicative de la démarche est remise aux personnes refusant l’entretien, afin de mettre en exergue l’aspect de soutien psychologique que peut leur apporter la démarche. Dans le cas où il serait impossible de présenter des personnes susceptibles de bénéficier de l’entretien, le secrétariat du Quart sera chargé de prévenir l’intervenant.
— Evaluation des intervenants en alcoologie :
Les intervenants en alcoologie de l’association ASSOCHA ont noté la coopération active des fonctionnaires de police qui témoignent de l’intérêt pour l’action ainsi que l’accueil des personnes en garde à vue, qui, ouvertes au dialogue et réceptives aux informations proposées, acceptent très facilement les documents proposés. Il semble également que la confiance et l’écoute soient très rapidement présentes lors des entretiens. Les entretiens alcoologiques proposés aux « impliqués » dans les violences familiales permettent un espace d’expression et d’écoute, propice à la prise de conscience et à l’expression de leur souffrance, ce qui constitue une aide importante dans la reconstruction de leur dignité.
— Impact de l’action au sein des services de police :
Un changement sensible a également été noté dans la prise en charge des personnes alcoolisées depuis le lancement de l’action. Un retour sur les notions basiques auprès des effectifs de l’accueil, du service de Quart et des surveillants des locaux de garde à vue, leur a permis d’envisager les problèmes d’alcoolisation sous l’angle plus général de l’addiction, et de mieux en saisir la problématique. Depuis lors, ces fonctionnaires s’engagent plus facilement dans la communication sur les problèmes liés à l’alcool dans le cadre de leurs fonctions. C’est pourquoi, la mise en place d’un temps de formation aux notions d’addictologie est envisagée pour les effectifs concernés par l’accueil et le contact avec les mis en cause.
Source : Compte-rendu de l’évaluation de l’action « entretiens alcoologiques » - Association ASSOCHA Le Havre – Février 2008.
Une première évaluation de cette action a d’ores et déjà été réalisée. Sur les quarante séances organisées entre décembre 2007 et février 2008, permettant potentiellement de recevoir trente-huit personnes en entretien selon le dispositif prévu, seules vingt-cinq personnes ont effectivement été vues. Sur l’ensemble des entretiens réalisés sur cette période, quatorze concernaient des conduites en état alcoolique, dix des violences conjugales et un des dégradations. L’équipe, chargée de réaliser ces entretiens, a souligné que certains refus des personnes en garde à vue s’expliquaient par la stigmatisation née d’un entretien d’alcoologie ainsi que le déni de problèmes liés au mésusage d’alcool. A cela s’ajoutent des difficultés liées au fait que l’intervention ne tient pas toujours compte de la durée de la garde à vue.
Afin d’apprécier plus largement l’efficacité de ce dispositif sur la prévention de la récidive des infractions liées à une consommation habituelle et excessive d’alcool, votre Rapporteur propose que les entretiens d’alcoologie en garde à vue, à destination des auteurs d’infractions sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits, soient expérimentés pour une durée de deux ans dans plusieurs départements volontaires. Au terme de cette expérimentation, qui fera l’objet d’une évaluation précise, la décision pourra alors être prise, au regard des résultats obtenus, de généraliser ou non ces entretiens en garde à vue.
Proposition n° 30
Expérimenter dans les départements volontaires et pour une durée de deux ans les entretiens d’alcoologie en garde à vue, à destination des auteurs d’infractions liées à une consommation habituelle ou excessive d’alcool, afin de renforcer la prévention des infractions en lien avec un mésusage d’alcool.
b) Faire de tout passage devant la justice l’occasion d’une action de sensibilisation et de mise en relation avec un professionnel de santé
La personne poursuivie pour une infraction en relation avec une consommation alcoolique s’entend, pour la première fois, à l’occasion de son passage devant la justice, accusé d’avoir une relation non maîtrisée à l’alcool, la famille n’osant pas le plus souvent franchir ce pas. La justice joue donc un rôle très important, puisqu’elle est la première à oser nommer le phénomène d’alcoolisation. Ainsi, comme l’ont souligné le Docteur Alain Rigaud, président de l’ANPAA, et Mme Delphine Jarraud, adjointe à la direction des activités, « le passage devant la justice doit constituer l’occasion d’une action d’information, de sensibilisation, de mise en relation avec un professionnel de santé et, le cas échéant, d’un accès aux soins ».
Plusieurs moments de la procédure – alternatives aux poursuites, application et exécution des peines – « sont propices à ce que le passage devant la justice puisse se transformer en prise de conscience, dont on sait […] qu’elle est une étape importante dans une éventuelle prise en charge » (81).
Au stade de l’alternative aux poursuites et en dehors des cas précisés par le code de procédure pénale, le procureur de la République peut utiliser d’autres procédures comme l’ajournement du prononcé de la peine. C’est dans ce cadre que s’est inscrite l’expérience EVACAPA (évaluation d’une action auprès des conducteurs ayant un problème d’alcool). Cette expérience menée à Besançon visait pour le prévenu qui acceptait de s’y soumettre à bénéficier d’un ajournement de peine pendant un an à l’issue duquel le juge se prononçait au vu notamment de la participation au programme. Le tribunal correctionnel de Pontoise a mené un programme similaire. M. Pierre Pelissier, magistrat, estime ainsi que « le développement de telles actions, voire leur généralisation, serait certainement de nature à remplacer efficacement la simple invitation qu’envoient, pas toujours de façon systématique et avec un taux de réponse très faible, les services d’action sanitaire destinataires d’un des volets de la fiche de contrôle d’alcoolémie quand elle existe » (82). Or, cette mesure de l’ajournement de peine est aujourd’hui rarement mise en œuvre en raison de l’alourdissement de la procédure judiciaire qu’elle induit en aval.
Lorsque le passage devant le tribunal n’a pu être évité ou n’a pas permis de saisir l’opportunité d’une éventuelle prise en charge, l’exécution et l’application de la peine doivent être mises à profit pour tirer tout le bénéfice qui peut être attendu d’une sanction pénale. Ainsi, les tribunaux utilisent largement le sursis avec mise à l’épreuve, le plus souvent assorti d’une obligation de soins. Bien que celle-ci ne concerne pas uniquement les problèmes de consommation alcoolique, une obligation de soins pour un problème de relation à l’alcool « nécessite que celui-ci ait été détecté par la juridiction, ce qui peut être évident pour un récidiviste, mais l’est beaucoup moins pour une infraction isolée dans laquelle la composante alcool n’est pas identifiée comme élément de l’infraction » (83). Même si elle constitue un cadre contraignant, tant pour le probationnaire que pour le soignant, il n’en demeure pas moins que « l’obligation de soins peut dans bon nombre de cas offrir au sujet devenu délinquant l’occasion d’une prise de conscience suffisamment décisive et constituer un puissant levier thérapeutique » (84) en offrant un motif et un moteur de changement. Pour ce faire, les délais d’attente pour obtenir une consultation dans un centre de cure ambulatoire en alcoologie ne doivent pas être trop longs, afin de ne pas perdre le bénéfice du choc du passage devant la justice.
L’enjeu est donc bien de faire en sorte que tous les auteurs de crimes ou délits liés à l’alcool qui passent devant la justice – en pré-sentenciel comme en post-sentenciel – ne soient pas seulement sanctionnés, mais aussi informés sensibilisés, soignés ou simplement mis en relation avec un soignant.
4. Accroître les mesures de soins alternatifs aux poursuites et ne recourir aux interventions pénales classiques qu’en cas d’échec ou de refus
a) Conduite en état d’alcoolisation : agir auprès des primo délinquants grâce au développement des interventions en groupe
Dans le cadre de l’étude précitée EVACAPA (85) réalisée par le comité de l’ANPAA du Doubs entre 1998 et 2003, le tribunal correctionnel de Besançon proposait, aux primo délinquants routiers, de bénéficier, dans le cadre d’un ajournement de peine d’un an, d’un programme d’intervention spécifique.
Cette étude a démontré l’efficacité et la pertinence d’une intervention groupale, sous forme de stages, par rapport à trois autres types de stratégie (absence d’intervention, information minimale, stratégie individuelle). En effet, la stratégie collective a permis une division par quatre de la récidive à trois ans des conducteurs en état d’alcoolémie primo délinquants, hors auteurs de blessures ou homicides involontaires, avec un taux d’alcoolémie situé entre 0,8 et 2,5 grammes par litre de sang.
Ainsi, au regard de l’efficacité de ce dispositif en matière de prévention de la récidive des conduites en état alcoolique, votre Rapporteur préconise, dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, un recours plus important aux ajournements de peines avec mise à l’épreuve pour les primo délinquants routiers ainsi que le développement, dans le cadre de ces ajournements de peines, des interventions groupales, sous forme de stages. Ce mode d’intervention semble d’autant plus adapté aux primo délinquants routiers que 75 % d’entre eux ne sont pas alcoolo-dépendants, mais ont une consommation d’alcool nocive ou à risque. Ce stage, qui repose sur l’étroite association de l’ensemble des acteurs concernés (justice, sécurité routière, prévention de l’alcoolisme) présente également l’avantage non négligeable de débanaliser chez le justiciable sa primo conduite en état d’alcoolisation et in fine de prévenir la réitération de ces conduites à risque.
Proposition n° 31
Dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, privilégier les ajournements de peines avec mise à l’épreuve pour les primo délinquants routiers et développer de manière significative, dans le cadre de ces ajournements, les interventions groupales, sous formes de stages, afin de réduire la récidive des conduites en état alcoolique.
b) Ivresse publique et manifeste : créer une exemption automatique du paiement de l’amende forfaitaire en contrepartie d’une mise en relation avec un professionnel de santé
L’ivresse publique et manifeste (IPM) est, depuis une loi de 1873, une infraction, aujourd’hui régie par le code de la santé publique, qui, à son article L. 3341-1, dispose qu’« une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ». L’article R. 3353-1 du même code précise en outre que « le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe », soit, aux termes de l’article 131-13 du code pénal, 150 euros au plus.
La procédure d’ivresse publique et manifeste comporte actuellement trois temps : un temps policier (interpellation, conduite à l’hôpital, placement en chambre de dégrisement, audition), un temps hospitalier qui s’est imposé au fil des ans (examen médical et délivrance d’un « bulletin de non hospitalisation » lorsque l’état de la personne est compatible avec la rétention) et enfin, un temps judiciaire (réquisition de l’officier du ministère public, décision du juge de proximité). Chaque année, les mesures d’ivresses publiques et manifestes concernent en moyenne 70 000 personnes par an et représentent environ 50 000 visites médicales.
Le champ de procédure de l’ivresse publique et manifeste est important par la gravité potentielle du phénomène pour les personnes impliquées : entre 80 et 90 % des manifestations d’IPM sont à relier à des pathologies chroniques de l’alcool. Ces usagers présentent donc une forte probabilité de faire l’objet d’une interpellation pour IPM et de récidiver. Le champ de l’IPM est également important pour la société : le lien entre l’alcool, notamment l’état d’ivresse, et la violence est établi. Bien souvent l’IPM s’accompagne d’infractions connexes plus ou moins graves (tapage, rébellion, violences). Elle représente donc un enjeu d’autant plus important en termes de prévention de la délinquance que la récidive d’IPM paraît fréquente.
Si, comme le rappellent les circulaires de 1973 (86) et 1975 (87), lorsqu’ils examinent des sujets en IPM avant la mise en dégrisement, les médecins ont vocation, d’une part, à déceler les pathologies alcooliques et, d’autre part, à organiser la prise en charge médicale de la personne, cette recommandation n’est pas opérationnelle dans la pratique. En effet, le médecin urgentiste n’a pas vocation à effectuer le suivi d’un patient et la personne examinée pour IPM est rarement dans un état lui permettant de recueillir et de suivre des conseils. De surcroît, moins de 10 % des personnes interpellées conduites à l’hôpital par les forces de sécurité sont hospitalisées. L’orientation de la personne après l’IPM vers une prise en charge dans le cadre d’un CSAPA apparaît à cet égard une mesure plus propice à une prise en charge des problèmes d’alcool de la personne.
L’ivresse publique et manifeste n’est passible que d’une contravention de deuxième classe, qui ne fait pas l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Le contrevenant peut ainsi accumuler un très grand nombre d’IPM, sans qu’il soit possible de constater, à partir du casier judiciaire, la situation de récidive et donc sans que ne puissent être envisagées l’aggravation de la peine ainsi que l’obligation de soins. C’est pourquoi, comme le préconise le rapport d’évaluation de la procédure d’IPM (88), votre Rapporteur propose d’adopter la procédure de l’amende forfaitaire tout en l’aménageant pour favoriser une prise en charge sanitaire adaptée : cet aménagement pourrait consister en la création d’une exemption automatique du paiement de l’amende forfaitaire, à condition que le contrevenant justifie auprès de l’agent verbalisateur avoir pris contact avec une structure spécialisée en addictologie, en premier lieu les CSAPA. Si le contrevenant justifie avoir satisfait à la visite, l’action publique sera éteinte. Cette visite sera l’occasion pour le contrevenant d’une prise de conscience d’un éventuel mésusage d’alcool et pourra donner lieu, si le contrevenant le souhaite, à une prise en charge adaptée et volontaire.
Proposition n° 32
Appliquer à la répression des ivresses publiques et manifestes la procédure de l’amende forfaitaire et prévoir que le contrevenant sera exempté du paiement de cette amende forfaitaire s’il justifie auprès de l’agent verbalisateur, dans un délai bref, fixé par le législateur, s’être rendu dans une structure spécialisée.
c) Auteurs de violences sous l’effet de l’alcool : développer l’orientation vers les CSAPA en pré-sentenciel et en post-sentenciel
« L’état actuel des connaissances ne permet pas de présumer l’occurrence des violences chez les consommateurs d’alcool, quelles que soient leur habitude et les quantités absorbées. En revanche, en présence de violences physiques avérées, même très légères, l’usage éventuel d’alcool devrait donner lieu à des prises en charge effectives de l’intégralité de la personne, tant ces problèmes sont imbriqués dans des interactions complexes. En effet, il se pourrait qu’une fois la barrière de l’interdit d’une agression physique franchie, la réitération et l’aggravation puissent éventuellement s’ensuivre. Une prise en charge précoce pourrait donc obtenir des résultats favorables sur l’ensemble des violences, y compris les plus graves. »
S’associant à cette conclusion de l’expertise collective INSERM « Alcool, dommages sociaux, abus et dépendance » réalisée en février 2003, votre Rapporteur préconise le développement des orientations vers les CSAPA des auteurs de violences, en pré-sentenciel comme en post-sentenciel, afin de permettre une intervention la plus précoce possible.
Proposition n° 33
Développer les orientations vers les CSAPA des auteurs de violences, en pré-sentenciel comme en post-sentenciel, afin de permettre une intervention la plus précoce possible.
5. Améliorer la prise en charge des détenus présentant une dépendance à l’alcool ou ayant une consommation abusive
Face à multiplicité des services concernés par la prise en charge sanitaire et sociale des personnes présentant un usage nocif sévère ou une dépendance à l’alcool (UCSA, SMPR, secteurs de psychiatrie, SPIP, personnels de direction et de surveillance, partenaires sanitaires et sociaux), votre Rapporteur estime nécessaire d’améliorer la coordination des acteurs tant en détention qu’à la sortie de prison.
Une enquête sur la prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation abusive a été menée en 2003 sur la base d’un questionnaire conçu par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Concernant 157 établissements pénitentiaires, elle a notamment permis de souligner que, parmi les problèmes les plus fréquemment rencontrés pour plus des deux tiers des établissements, le manque de coordination entre services arrive en tête (63 %). En outre, le contexte de prise en charge identifié comme le plus problématique a été, par ordre décroissant : la sortie de prison (dans la majorité des établissements) et l’offre de soins en matière de dépendance au tabac et à l’alcool, pointée, dans les deux cas, dans un tiers des établissements. En effet, l’enquête a mis en exergue le fait que « l’offre de soins n’est pas à la hauteur de l’enjeu : dans certains établissements […], un détenu sur deux déclare une consommation problématique d’alcool et près d’un sur quatre répond aux critères de l’alcoolo-dépendance ; or l’intervention en milieu carcéral de consultations extérieures en alcoologie reste encore limitée et soumise à des délais d’attente rédhibitoires, parfois supérieurs à la durée de l’incarcération » (89).
Afin de répondre à cette problématique, il convient en premier lieu de confier aux unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) la coordination et le pilotage de la prise en charge des addictions, notamment à l’alcool. C’est d’ailleurs ce que prévoit le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies (2008-2011), qui propose de « confier par modification réglementaire le pilotage de la prise en charge des addictions aux unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans le cadre d’une coordination avec les autres services concernés, notamment psychiatriques » et de définir les « objectifs à atteindre en termes de soins aux personnes dépendantes ».
En second lieu, votre Rapporteur estime que la création d’antennes spécialisées en alcoologie au sein des établissements pénitentiaires n’est pas souhaitable dans la mesure où elle risque de renforcer les difficultés de coordination entre services. C’est pourquoi, il convient au contraire de privilégier et de renforcer les consultations d’addictologie réalisées en détention par des intervenants extérieurs (le plus souvent des CSAPA). Le plan gouvernemental précité va d’ailleurs dans ce sens puisqu’il prévoit de « mettre en place une stratégie d’actions coordonnées de prévention et de prise en charge des addictions en prison prévoyant en particulier la création de cent nouvelles consultations d’addictologie orientées alcoologie ». La circulaire du 28 février 2008 (90) relative à la mise en place des CSAPA ne dit d’ailleurs pas autre chose, quand elle dispose que « l’intervention des CSAPA en prison doit permettre la continuité de la prise en charge aussi bien pendant l’incarcération qu’après la sortie. Par ailleurs, si un patient du CSAPA est incarcéré, le centre doit veiller à ce que la continuité des soins soit assurée. »
En définitive, afin d’améliorer la prise en charge et la continuité des soins délivrés aux usagers d’alcool incarcérés, votre Rapporteur propose de confier le pilotage de la prise en charge des addictions – notamment à l’alcool – en détention aux unités de consultations et de soins ambulatoires, qui, sous leur autorité, auront la charge de favoriser et de renforcer l’intervention des CSAPA pour la réalisation de consultations d’addictologie en détention. Du fait de leurs missions et de leur intégration dans les réseaux sanitaires et sociaux, les CSAPA intervenant en détention seront une passerelle permanente entre milieu ouvert et milieu fermé : à ce titre, ils seront en mesure d’assurer le lien entre la personne sortant de prison et les professionnels de santé chargés du suivi à la sortie et ainsi de favoriser la permanence ainsi que la continuité des soins.
Confier le pilotage de la prise en charge des addictions – notamment à l’alcool – en détention aux unités de consultations et de soins ambulatoires, qui, sous leur autorité, auront la charge de favoriser et de renforcer l’intervention des CSAPA pour la réalisation de consultations d’addictologie.
Par ailleurs, l’enquête précitée réalisée en 2003 avait également souligné que le repérage à l’entrée en prison des situations d’abus ou de dépendance, quel que soit le produit psycho-actif, n’était pas encore systématique. Or, comme le note M. Pierre Pelissier (91), « le passage en prison pourrait aussi être une occasion à saisir » pour opérer chez les condamnés une prise de conscience, étape importante pour entamer une véritable démarche personnelle de soins. En effet, lors de son audition par votre Rapporteur, le Docteur Philippe Michaud a précisé que, parmi les entrants en prison chaque année, de 20 à 30 000 personnes ont des problèmes avec l’alcool et, parmi les entrants en maison d’arrêt, environ un homme sur six est physiquement dépendant de l’alcool.
L’entrée en détention est donc un moment crucial pour repérer et recenser les condamnés qui nécessitent une prise en charge sanitaire adaptée. Or, comme le souligne M. Pierre Pelissier, « la détection est loin d’être systématique et, même en cas de repérage, le suivi qui peut être mis en place est insuffisant dans la plupart des cas, vraisemblablement par manque de moyens, mais aussi de volonté et de choix clairement affichés ». C’est pourquoi, votre Rapporteur propose que les UCSA, en charge du pilotage de la prise en charge des addictions, mettent en œuvre de manière systématique à l’entrée en prison un repérage des addictions.
Proposition n° 35
S’assurer que les UCSA, en charge du pilotage de la prise en charge des addictions, mettent en œuvre de manière systématique à l’entrée en prison un repérage des addictions.
6. Renforcer la formation en addictologie de l’ensemble des acteurs pour une meilleure articulation entre action judiciaire et dispositif de santé
Pour améliorer les relations entre magistrats, conseillers d’insertion et de probation et professionnels de santé (travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, médecins intervenants en addictologie), deux leviers d’action doivent à l’avenir être privilégiés : la formation en addictologie et une collaboration plus étroite de l’ensemble des acteurs, tant sanitaires que judiciaires.
a) Renforcer la formation initiale et continue en addictologie
Comme votre Rapporteur l’a souligné plus haut, une obligation de soins prononcée pour un problème de consommation habituelle ou excessive d’alcool chez le prévenu « nécessite que celui-ci ait été détecté par la juridiction, ce qui peut être évident pour un récidiviste, mais l’est beaucoup moins pour une infraction isolée dans laquelle la composante alcool n’est pas identifiée comme élément de l’infraction » (92).
Afin d’aider les magistrats et les conseillers d’insertion et de probation à repérer un mésusage d’alcool chez le prévenu ou le probationnaire et à mettre en œuvre à bon escient une obligation de soins, il convient de renforcer la formation initiale et continue en addictologie des magistrats – d’abord à l’École nationale de la magistrature, ensuite au niveau des tribunaux de grande instance – et des travailleurs socio-judiciaires (conseillers d’insertion et de probation et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse).
Il convient toutefois de noter que l’École nationale de la magistrature accorde déjà une place à l’addictologie ainsi qu’aux infractions liées à l’alcool dans l’organisation tant de la formation initiale que continue. Au stade de la formation initiale, les auditeurs de justice ayant choisi de devenir juges de l’application des peines ont pu bénéficier d’un module d’enseignement intitulé « conduites addictives, troubles psychiatriques et obligation de soins », dont l’objectif était de présenter la procédure de l’obligation de soins et de clarifier les interactions existant dans ce domaine entre santé et justice. Au stade la formation continue (cf. annexe n° 4), les magistrats se sont vus proposer une session de formation de cinq jours sur les soins pénalement ordonnés : ce module de formation, faisant intervenir des magistrats, des psychologues, des psychiatres et des personnes pénitentiaires (milieu ouvert et fermé) a permis d’aborder le thème des soins ordonnés aux auteurs d’infractions sexuelles et aux justiciables souffrant de troubles addictifs.
Proposition n° 36
Renforcer la formation initiale et continue en addictologie des magistrats et des travailleurs socio-judiciaires, pour que les obligations de soins soient mises en oeuvre à bon escient.
b) Parvenir à une meilleure articulation entre action judiciaire et prise en charge sanitaire grâce à une collaboration étroite de l’ensemble des acteurs
Afin de renforcer l’articulation entre santé et justice en matière de prévention et de prise en charge des infractions liées à l’alcool, deux axes d’amélioration doivent être envisagés.
En premier lieu, il convient de renforcer la collaboration entre travailleurs socio-judiciaires et personnels soignants. En effet, les relations entre les intervenants des services pénitentiaires d’insertion et de probation et les professionnels de santé des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie sont parfois difficiles.
Afin de répondre à cette difficulté, votre Rapporteur propose que soient mis en place un référent « addiction » dans chaque service pénitentiaire d’insertion et de probation (comme par exemple dans l’Orne et la Nièvre) et un référent « justice » au niveau de chaque centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie. Ainsi, comme l’ont souligné le Docteur Alain Rigaud et Mme Delphine Jarraud, lors de leur audition par votre Rapporteur, « le référent de chaque partie sera l’interlocuteur privilégié pour partager les éventuelles difficultés de fonctionnement, notamment dans l’accompagnement des obligations de soins ».
Proposition n° 37
Renforcer la collaboration entre travailleurs socio-judiciaires et personnels soignants, grâce à la mise en place d’un référent « addiction » au niveau de chaque service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un référent « justice » au niveau de chaque centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie.
En second lieu, afin de renforcer l’articulation entre santé et justice en matière de prévention et de prise en charge des infractions liées à l’alcool, il convient d’assurer la mise en place de rencontres régulières, au niveau de chaque tribunal de grande instance, entre acteurs judiciaires – procureur, juge des libertés et de la détention, directeur de SPIP et de la protection judiciaire de la jeunesse – et équipes spécialisées en addictologie.
Ces réunions permettraient à tous de renforcer l’articulation entre justice et santé via deux canaux : le partage d’une culture commune quant aux missions, aux obligations et aux compétences de chacun ; le développement d’échanges de bonnes pratiques permettant d’améliorer le partenariat santé-justice dans le cadre des conventions départementales d’objectifs et, plus largement, des suivis des obligations de soins ainsi que des injonctions thérapeutiques.
Mettre en place au niveau de chaque tribunal de grande instance des rencontres régulières entre acteurs judiciaires – procureur, juge des libertés et de la détention, directeur de SPIP et de la protection judiciaire de la jeunesse – et équipes spécialisées en addictologie.
III. PROMOUVOIR UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN DIRECTION DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE PRÉSENTANT UNE ADDICTION À L’ALCOOL
A. LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE DE L’ADDICTION À L’ALCOOL SE HEURTE ACTUELLEMENT À D’IMPORTANTES DIFFICULTÉS
Une fois la phase judiciaire achevée, les personnes placées sous main de justice, présentant une dépendance à l’alcool, bénéficient d’une prise en charge sanitaire différenciée suivant qu’elle s’effectue en détention ou hors détention.
Ainsi, en détention, la prise en charge des problèmes liés à un mésusage d’alcool est réalisée aussi bien par les services sanitaires présents en prison (unités de consultations et de soins en ambulatoire, les services médico-psychologiques régionaux ou les secteurs de psychiatrie) que par des professionnels extérieurs intervenant en détention. Les interventions de ces derniers peuvent être individuelles ou groupales. En outre, certaines associations d’entraide (Vie libre, notamment) interviennent également en détention afin d’animer des groupes de parole.
Hors détention, la prise en charge du problème de l’alcool se fait par le biais des professionnels des centres médico-sociaux spécialisés : les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) qui deviendront prochainement les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Les mouvements d’entraide – les Amis de la santé, Vie libre, la Croix d’or – peuvent aussi intervenir pour accompagner les sortants de prison sur demande des travailleurs sociaux de l’établissement pénitentiaire.
1. La délicate mise en place des CSAPA au détriment de la prise en charge de l’alcoolisme
Lorsque la phase judiciaire s’achève, la prise en charge sanitaire, qui s’articule essentiellement autour des centres de cure ambulatoire en alcoologie (futurs CSAPA), prend alors le relais afin d’apporter les soins nécessaires aux personnes placées sous main de justice présentant un mésusage, voire une dépendance, à l’alcool.
D’après l’analyse des rapports d’activité de ces établissements médico-sociaux spécialisés réalisée par l’OFDT et la direction générale de la santé, environ un patient sur quatre vient consulter dans ces centres à la suite d’une mesure judiciaire ou administrative. Pour le reste, près d’un tiers des demandes de consultation sont faites à l’initiative du patient ou des proches et environ un tiers des patients est adressé par des partenaires sanitaires, parmi lesquels les médecins de ville sont les plus représentés.
La répartition suivant l’origine de la demande de consultation n’est pas la même que dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). En effet, les patients viennent beaucoup moins dans les CCAA de leur propre initiative (29 % contre 47 % dans les CSST) mais sont plus fréquemment envoyés par les partenaires sanitaires du secteur hospitalier (16 % contre 6 % dans les CSST) et par les services judiciaires ou administratifs (28 % contre 21 %).
RÉPARTITION (EN %) DE L’ENSEMBLE DES PATIENTS SUIVANT L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE CONSULTATION ENTRE 2004 ET 2006
2004 |
2005 |
2006 | |
Initiative du patient ou des proches |
27,4 % |
29,6 % |
28,6 % |
Médecin de ville |
13,9 % |
13,9 % |
13 % |
Autre structure spécialisée |
4,2 % |
4,5 % |
4,5 % |
Équipe de liaison |
5,9 % |
5,3 % |
5,8 % |
Autre hôpital/autre sanitaire |
10,9 % |
10,1 % |
10,1 % |
Services sociaux |
6,7 % |
7 % |
6,1 % |
Justice, classement avec orientation |
1,7 % |
1,6 % |
1,2 % |
Justice, injonction thérapeutique |
1,9 % |
2,8 % |
1,7 % |
Justice, obligation de soins |
12,5 % |
11,5 % |
13,4 % |
Autres mesures administratives |
9,7 % |
9,4 % |
11,4 % |
Milieu scolaire et universitaire |
0,2 % |
0,1 % |
0,4 % |
Autres |
4,8 % |
4,2 % |
3,7 % |
Total |
100 % |
100 % |
100 % |
Source : exploitation des rapports d’activité type des CSST/CCAA 2006, DGS/OFDT
LE DISPOSITIF MÉDICO-SOCIAL SPÉCIALISÉ EN MATIÈRE D’ALCOOLISME
Le dispositif spécialisé s’est progressivement mis en place à compter des années 1970, sur la base de circulaires prises en 1970, 1975 et 1983. Centré sur des missions de prévention, de soin et d’accompagnement social et agissant en articulation avec les autres partenaires du domaine sanitaire et social, le dispositif spécialisé de lutte contre l’alcoolisme est composé de comités départementaux de prévention de l’alcoolisme (CDPA), dont 90 % dépendent directement de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) et de 230 centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA).
En trente ans, ces structures pluridisciplinaires ont développé un savoir-faire incontestable. Les CCAA sont financés par l’assurance maladie depuis 1999. Les moyens consacrés à ces structures ont plus que doublé, passant d’un montant de 34 millions d’euros en 2001 à 59 millions d’euros en 2005. La file active représente près de 100 000 personnes accueillies et suivies chaque année. On estime à 500 000 personnes par an le nombre de personnes touchées directement par les actions de prévention (informations, formations, manifestations…).
a) La mise en place des centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) rencontre des difficultés
Les CSAPA, visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ont été créés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Le cadre juridique des CSAPA a vocation à fusionner celui des centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA). La réforme des CSAPA consiste donc en la mise en place d’une réglementation commune et donc de missions communes aux anciens CCAA et CSST avec toutefois la possibilité de conserver leur spécialisation. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une fusion des établissements, les décrets (93) instaurant les CSAPA engageant avant tout la constitution d’un statut juridique commun pour les CCAA et CSST appelés ainsi à devenir CSAPA. C’est dans un second temps que doit se poser la question de la fusion des établissements, d’abord pour réduire le nombre de gestionnaires notamment associatifs en les regroupant pour constituer une masse critique suffisante, ensuite pour rapprocher autour de leurs points communs les activités spécialisées en alcoologie et en toxicomanie.
Comme le souligne une circulaire du ministère de la Santé de 2006 (94), le projet de réforme prévoit un noyau commun de missions qui incomberaient à chaque CSAPA et une possibilité de spécialisation. Ainsi, tous les CSAPA seraient dans l’obligation d’assurer l’accueil, l’information, l’évaluation clinique et l’orientation de toute personne dépendante aux substances psychoactives. Concernant la prise en charge médicale, psychosociale et éducative, les CSAPA auraient la possibilité de spécialiser leur activité sur le versant toxicomanie et/ou le versant alcool. La transformation des CSST et des CCAA en CSAPA est actuellement en cours sur le plan réglementaire (95), les arbitrages sur l’organisation au plan régional n’étant pas encore tous rendus.
Cependant, certaines difficultés, principalement liées à la réorganisation, sont d’ores et déjà apparues dans la mise en place de ces structures. Ainsi dans certains départements ou régions, il peut être demandé des rapprochements, voire des fusions entre le CCAA et le CSST qui étaient jusqu’ici gérés par des personnes morales différentes, avec des équipes différentes et des modalités de travail elle aussi différentes. De même, une clarification tend à s’opérer entre les consultations hospitalières d’addictologie et les centres jusqu’ici gérés par des établissements hospitaliers, ce qui se fait au détriment de l’un des deux établissements.
Actuellement, on dénombre 270 CSST et 230 CCAA. Potentiellement il pourra donc y avoir 500 CSAPA, si aucun regroupement n’est opéré. Comme l’a rappelé la direction générale de la santé, « il est difficile de savoir à l’heure actuelle combien de CSAPA seront créés car cela est lié aux orientations données au niveau local et à la volonté ou non des structures de se rapprocher. De plus, les instructions sur les demandes d’autorisation auront lieu jusqu’au premier semestre 2010 ». Comme les CCAA et les CSST, les CSAPA seront financés à hauteur d’environ 269 millions d’euros (96) – dont 235 millions d’euros pour les seuls CSAPA – par l’assurance-maladie sur l’ONDAM médico-social.
Par ailleurs, lors de son audition par votre Rapporteur, le Docteur Alain Rigaud, président de l’ANPAA a indiqué que « la transformation des actuels CCAA et CSST en CSAPA se passait plutôt mal actuellement ». Il a notamment regretté le fait que cette réorganisation s’engage avant même que les schémas régionaux d’organisation médico-sociale en addictologie n’aient été finalisés dans toutes les régions. De la même manière, il a estimé qu’au final, cette mise en place des CSAPA se faisait « avec des mesures nouvelles relativement faibles au regard des besoins malgré l’élan impulsé par le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies (2008-2011) si bien que l’impact attendu en termes de maillage territorial et de services rendus aux populations vulnérables, notamment aux détenus, sera sans doute faible ».
b) Les CSAPA, lorsqu’ils sont créés, privilégient parfois la prise en charge de la toxicomanie au détriment de celle de l’alcoolisme
Aux termes de la circulaire du 23 février 2008 sur la mise en place des CSAPA (97), les CSAPA constituent un guichet unique pour l’alcool et les drogues. Ils peuvent toutefois choisir d’être spécialisés (alcool ou drogues) ou bien d’être généralistes. Des CSAPA mis en place à partir d’un CSST peuvent donc choisir de rester spécialisés en toxicomanie : s’ils veulent être généralistes, un temps de formation préalable des professionnels sera nécessaire. Cette situation existe aussi pour les actuels CCAA, qui peuvent eux aussi rester spécialisés ou devenir généralistes.
Cependant, lorsqu’un CSAPA accueille un patient qu’il ne peut prendre en charge du fait de sa spécialisation, il a obligation de l’orienter vers une structure plus adaptée. Par ailleurs, quelle que soit la spécialisation du CSAPA, il doit prendre en charge l’ensemble des consommations de ses patients. En définitive, les CSAPA peuvent conserver une spécialisation pour ce qui est de la prise en charge soit sur le versant drogues, soit sur le versant alcool. Aucune orientation de la part du ministère de la Santé n’a été donnée pour privilégier la prise en charge de la toxicomanie, chaque CCAA ou CSST pouvant devenir CSAPA en gardant sa spécialisation.
S’il n’y a pas a priori de raisons particulières de privilégier la prise en charge de la toxicomanie, certaines des personnes auditionnées par votre Rapporteur ont indiqué que, dans les faits, les fusions s’opéraient au détriment des gestionnaires des anciens CCAA. En effet, les CSST étant actuellement plus nombreux et disposant de budgets plus conséquents que les CCAA, en cas de fusion, les structures gestionnaires des CSST tendent à devenir gestionnaires du CSAPA ayant absorbé la compétence du CCAA. Cependant, si les structures qui géraient initialement des CSST peuvent donc être privilégiées en tant que gestionnaires, la prise en charge devra être assurée, par ce gestionnaire, aussi bien pour l’alcool que pour les drogues illicites.
De surcroît, la mise en place des CSAPA tend à se faire au détriment de la prise en charge des addictions liées à l’alcool pour des raisons historiques. En effet, le développement sur l’ensemble du territoire des CCAA et des CSST à partir des années 1970 s’est fait de manière non seulement cloisonnée entre volet alcool et volet drogues mais également disparate en termes de répartition des moyens alloués. Lors de son audition par votre Rapporteur, M. Alain Rigaud, président de l’ANPAA, a ainsi rappelé que « pour la répartition entre les deux versants, le secteur toxicomanie (et donc les CSST) a toujours bénéficié de moyens plus importants que le secteur alcool », car il a appuyé son développement non seulement sur des centres ambulatoires mais aussi sur des centres d’hébergement thérapeutiques qui demandent des effectifs trois fois plus importants pour assurer un fonctionnement sans discontinu.
Si l’écart important entre les deux secteurs s’est partiellement réduit depuis 1999 (notamment sous l’effet de mesures nouvelles orientées entre 2000 et 2006 vers l’alcoologie), force est de constater qu’historiquement le secteur toxicomanie pèse plus lourd en termes d’effectifs et de budget.
COMPARAISON DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE SOINS DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL ASSURANT LA PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS (2007)
Côté besoins (98) |
Côté offre (99) |
Alcool : — 5 millions de personnes en difficulté avec l’alcool, dont 2 millions alcoolo-dépendants ; — 100 000 décès évitables imputés à l’association de l’alcool et du tabac. |
Alcool : — 230 centres de cure ambulatoire en alcoologie. |
Toxicomanie : — 150 000 héroïnomanes actifs ou substitués ; — 200 000 consommateurs de cannabis à problème. |
Toxicomanie : — 270 CSST, avec une part de leurs publics ayant pour premier produit dommageable l’alcool ; — 4 communautés thérapeutiques dédiées essentiellement aux usagers de drogues illicites (héroïne, cocaïne/crack) ; — 40 centres thérapeutiques résidentiels, destinés principalement aux usagers de drogues (puisque historiquement les CCAA ne pouvaient être qu’ambulatoires alors que les CSST pouvaient développer de l’hébergement thérapeutique. D’où des moyens financiers médico-sociaux très importants, les structures résidentielles 24/24 étant mieux dotées que les structures ambulatoires) ; — des appartements thérapeutiques, des réseaux de familles d’accueil et des appartements de coordination thérapeutiques (ACT) accueillant des personnes présentant une addiction grave aux drogues et/ou une ou plusieurs maladies chroniques (VIH, VHC, maladies mentales…). |
Lors de son audition par votre Rapporteur, le Docteur Alain Rigaud, président de l’ANPAA a également souligné que « cet écart lié à l’histoire sera demain dilué dans le dispositif commun des CSAPA et risque d’être longtemps méconnu tant les usagers de drogues illicites entendent exprimer leur besoins et demandes quand les personnes en difficulté avec l’alcool se laissent engloutir en cherchant à se faire oublier, sauf lorsque la commission d’une infraction rappelle leur existence à la société ».
La mise en place des CSAPA étant fortement tributaire de cet héritage, on peut penser qu’à terme, les CSAPA spécialisés en toxicomanie seront plus nombreux et bénéficieront d’effectifs plus importants que les CSAPA spécialisés en alcoologie.
Afin que la mise en place des CSAPA ne se fasse pas au détriment de la prise en charge des addictions liées à l’alcool, votre Rapporteur propose que les CSAPA généralistes issus du secteur toxicomanie développent de nouvelles compétences sur le volet alcool, grâce à la mise en œuvre rapide d’importants efforts de formation en alcoologie.
Proposition n° 39
S’assurer que les CSAPA généralistes issus du secteur de la toxicomanie développent de nouvelles compétences sur le volet alcool, grâce à la mise en œuvre rapide d’importants efforts de formation en alcoologie.
2. Une prise en charge sanitaire très inégale en raison d’une grande hétérogénéité de moyens
a) Une importante disparité quant au choix de la réponse pénale d’un parquet à l’autre
Il est à regretter que les circulaires du ministère de la Justice du 8 avril 2005 et du 9 mai 2008 relatives à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances ne traitent pas des infractions en lien avec l’alcool. Pourtant, les instructions sont claires et proposent une réponse pénale graduée, guidée par la personnalité et le profil de l’usager.
Dans la pratique, on observe d’importantes variations d’un Parquet à l’autre, notamment quant au choix de la réponse pénale selon le type d’infractions et la perception qu’ont les magistrats du rapport de la personne poursuivie à l’alcool. Lors de son audition par votre Rapporteur, le Docteur Alain Rigaud, président de l’ANPAA, a regretté que cette perception se fonde essentiellement sur la gravité des dommages causés par l’infraction, méconnaissant parfois l’intérêt d’une évaluation médico-psychologique du rapport à l’alcool.
Deux raisons peuvent être utilement invoquées pour expliquer cette situation : d’une part, les appréciations contrastées des magistrats en la matière, qui ne se réfèrent pas nécessairement à des connaissances alcoologiques et addictologiques précises et, d’autre part, la possibilité ou non de bénéficier d’une aide médicale à la décision telle celle instaurée sous la forme de permanences d’orientation sanitaire et sociale (POSS) auprès de certains tribunaux dans le cadre du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2002).
b) Une grande hétérogénéité des moyens selon les établissements pénitentiaires
Comme votre Rapporteur l’a souligné plus haut, il existe une grande hétérogénéité de moyens, notamment humains, selon les établissements pénitentiaires, tant en matière de prise en charge que de prévention de l’alcoolisme dans un contexte global d’insuffisance des moyens.
Selon l’enquête déjà mentionnée de la fédération des acteurs de l’alcoologie et de l’addictologie (avril 2006), on dénombrait en 2004 treize ETP dédiés à la prise en charge des problèmes d’alcool pour l’ensemble des établissements pénitentiaires, le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévoyant la création de dix ETP supplémentaire en 2009.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’hétérogénéité de la prise en charge d’un établissement pénitentiaire à l’autre : le lieu d’implantation de l’établissement (100), la taille de l’établissement, les problèmes de locaux, la démographie médicale, les missions en termes de durée de peine (101), les moyens alloués par les autorités aux unités de santé pénitentiaire (UCSA et éventuel SMPR) et aux intervenants extérieurs spécialisés en addictologie (notamment CSAPA), les relations de partenariat entre unités de santé pénitentiaire (UCSA et éventuel SMPR) et intervenants extérieurs spécialisés en addictologie (notamment CSAPA), la facilitation de l’accès à l’établissement pour ces intervenants extérieurs.
c) Une forte disparité des moyens sanitaires à l’extérieur des prisons
On retrouve également cette disparité des moyens sanitaires à l’extérieur des prisons dans la mesure où la prise en charge et la prévention en milieu carcéral s’appuient majoritairement sur les personnels des CCAA et des CSAPA. Or, là encore, il existe une diversité de couverture départementale du territoire national par ces structures.
Le tableau figurant en annexe n° 5 détaille les différents partenariats mis en œuvre par les services pénitentiaires d’insertion et de probation avec des CCAA ou des associations. Alors que le SPIP des Yvelines souligne la qualité du partenariat avec les centres d’alcoologie, malgré un délai de prise en charge de deux mois jugé trop long, le SPIP de l’Ille-et-Vilaine estime, pour sa part, que le partenariat avec les CCAA est très variable et parfois difficile, le délai de prise en charge étant très aléatoire. En outre, lorsque les personnes sous main de justice, soumises à une obligation de soins, sont orientées par les SPIP vers des centres d’alcoologie, les délais de prise en charge sont très hétérogènes : alors que la prise en charge se fait en Savoie dans le mois qui suit le premier entretien au SPIP, les probationnaires de Haute-Savoie doivent attendre au minimum trois mois avant d’être pris en charge. De manière plus générale, les délais de prise en charge dans les centres d’alcoologie sont très variables et dépendent fortement du contexte local, des situations personnelles (si la personne est condamnée dans le cadre d’une obligation de soins ou non) ainsi que de la présence de structures d’accueil en nombre suffisant. Les délais les plus courts sont de quelques semaines et les plus longs de huit ou neuf mois, le délai moyen constaté se situant, quant à lui, autour de trois mois.
En définitive, les partenariats sont très divers d’un département à l’autre, mais ils reposent le plus souvent sur les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), dont l’ANPAA est gestionnaire dans 69 départements, mais aussi sur les centres médico-psychologique (CMP), des services hospitaliers, des centres de cures avec hébergement, des associations, des médecins généralistes ou spécialisés ou encore des psychologues. Certains SPIP ont mis en place des dispositifs particuliers. Afin de désengorger les files d’attente des centres d’alcoologie, le SPIP de Haute-Savoie a développé une prise en charge collective, les personnes condamnées étant inscrites dans un cycle de groupes de parole. Le SPIP de Seine-et-Marne a, pour sa part, mis en œuvre, dans le cadre de l’obligation de soins, des stages collectifs de sensibilisation autour des conséquences de l’abus caractérisé des boissons alcoolisées.
Par ailleurs, les structures du dispositif médico-social répondent à des modes de gestion variés. En effet, conformément à l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements médico-sociaux peuvent être gérés par une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé. Les CCAA et les CSST sont essentiellement gérés par des associations et par des établissements de santé et plus rarement par des services municipaux (102). D’après l’analyse des rapports d’activité 2006 de ces structures, les gestionnaires sont des CCAA et CSST sont les suivants :
Structures gérées par une association |
Structures gérées par un hôpital |
Structures gérées par un service municipal | ||||
Nombre |
En % |
Nombre |
En % |
Nombre |
En % | |
CSST ambulatoire |
123 |
65 % |
65 |
35 % |
0 |
0 % |
CSST avec hébergement |
42 |
100 % |
0 |
0 % |
0 |
0 % |
CSST pénitentiaire |
0 |
0 % |
16 |
100 % |
0 |
0 % |
CSST (tout confondu) |
165 |
67 % |
81 |
33 % |
0 |
0 % |
CCAA |
121 |
59 % |
77 |
38 % |
6 |
3 % |
3. Des difficultés de financement récurrentes compromettant la pérennité des actions engagées
La majorité des actions « santé et justice » sont actuellement financées par les conventions départementales d’objectifs.
LES CONVENTIONS DÉPARTEMENTALES D’OBJECTIFS
Les conventions départementales d’objectifs (CDO) ont été mises en place en 1993 (par une circulaire interministérielle du 14 janvier 1993), afin d’améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes sous main de justice.
Ces conventions proposent des réponses adaptées aux besoins identifiés dans les départements par les autorités judiciaires et les services du ministère de la Justice, conjointement avec les autorités sanitaires et en liaison étroite avec le chef de projet départemental de la Mildt. En 1999, les conventions départementales d’objectif ont été généralisées et étendues à la prise en charge des personnes placées sous main de justice rencontrant des difficultés avec l’alcool.
Ces conventions sont signées par les préfets de département et par les procureurs de la République. Les chefs de projet Mildt, présents dans chaque département, sont chargés de la coordination et de l’animation du dispositif.
Les conventions, dont la durée peut aller d’un à trois ans, doivent intégrer les données suivantes : la durée de la conservation ; le type de prestations dispensées par la ou les associations partenaires ; le nombre de personnes prises en charge ; les modalités d’accueil du public ; la répartition des responsabilités entre les acteurs sanitaires et sociaux et les autorités judiciaires ; le montant des crédits octroyés et les différents financeurs (ministère de la Santé, de la justice, Mildt, assurance-maladie…) ; les modalités d’évaluation du dispositif.
Dans son évaluation des CDO réalisée en 2003, l’OFDT avait regretté, malgré certains progrès, une insuffisante prise en compte de la problématique de l’alcool, le dispositif restant essentiellement centré sur la prise en charge des usagers de drogues.
En matière d’actions « santé et justice » dédiées à l’alcool, le tableau ci-après retrace les crédits de la Mildt finançant les CDO pour les trois dernières années. Les actions financées dans le cadre de ces conventions peuvent intervenir en milieu libre ou en prison, et concerner la prévention ou la prise en charge. À titre d’exemples, il existe des actions de prévention de la récidive de la conduite en état d’ivresse, dont des stages de sensibilisation aux dangers de l’alcool au volant, des entretiens individuels ainsi que des groupes de parole. En définitive, il existe là aussi une grande diversité de projets dans le cadre des conventions départementales d’objectifs selon les départements.
En 2008, les bénéficiaires des crédits alloués par la Mildt dans le cadre des conventions départementales d’objectifs sont en majorité des structures médico-sociales spécialisées, qui représentent plus des deux tiers des destinataires de ces crédits (103) : 102 centres de soins spécialisés aux toxicomanes (soit plus du tiers de l’ensemble des bénéficiaires), 77 centres de cure ambulatoire en alcoologie (soit un peu plus d’un quart de l’ensemble des bénéficiaires), 12 centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (soit un peu mois de 5 % de l’ensemble des bénéficiaires) et 8 centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (soit un peu moins de 3 % de l’ensemble des bénéficiaires).
MONTANT DES CRÉDITS MILDT DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DÉPARTEMENTALES D’OBJECTIFS
2006 |
2007 |
2008 |
ÉVOLUTION 2006-2008 | |
BUDGET MILDT DÉDIÉ AUX ACTIONS « SANTÉ ET JUSTICE » |
5 795 696 |
5 544 148 |
4 962 035 |
- 14,4 % |
DONT ACTIONS « ALCOOL » AVEC FINANCEMENT MILDT |
1 196 902 |
1 061 432 |
832 793 |
- 30,4 % |
Au regard des données disponibles, il apparaît très clairement que le financement alloué par la Mildt aux actions « santé et justice » a baissé sur les trois dernières années, cette baisse étant beaucoup plus prononcée pour les actions dédiées à la prise en charge des problèmes liés à l’alcool. En effet, alors que le budget de la Mildt dédié aux actions « santé et justice » dans le cadre des CDO a baissé de près de 15 % ces trois dernières années, les crédits finançant, à l’intérieur de cette enveloppe, les actions « alcool » dans le cadre de ces mêmes conventions ont chuté de près d’un tiers entre 2006 et 2008.
Or, ces difficultés de financement des actions « santé et justice » en matière de prévention et de prise en charge de l’alcoolisme après la commission d’une infraction sont un problème récurrent, très souvent mis en exergue par les personnes rencontrées par votre Rapporteur lors de ses différents déplacements et auditions. Ainsi, les professionnels de santé des équipes pluridisciplinaires des CCAA et des CSAPA, qui, le plus souvent gérés par des opérateurs associatifs, sont principalement financés par l’enveloppe médico-sociale de l’ONDAM et accessoirement par des crédits étatiques dans le cadre de conventions départementales d’objectifs, sont actuellement confrontés à d’importantes difficultés de financement. Lors de son audition, M. Étienne Apaire, président de la Mildt a estimé que ces problèmes de financement étaient en partie liés à la difficulté d’identifier des financeurs ainsi qu’à l’absence de pérennité dans les budgets. Ainsi, parmi les missions des CSAPA, la prévention est facultative : dès lors que l’association qui gère le CSAPA veut mener des actions de prévention, elle doit trouver des financements propres, qui ne peuvent être pris sur le budget de fonctionnement assurance-maladie.
Lors de son audition, le Docteur Alain Rigaud, président de l’ANPAA a souligné que « d’une manière générale, les moyens alloués au secteur médico-social en addictologie sont loin d’être à la hauteur des besoins connus, notamment pour les personnes sous main de justice et pour le développement des dispositifs d’hébergement thérapeutique pour les sortants de prison ». Il a notamment rappelé que, pour les professionnels de santé (CSAPA et CCAA), « la dotation annuelle de fonctionnement ne prévoyait à ce jour aucun financement des actions menées auprès des personnes sous main de justice, et notamment pour les interventions en milieu carcéral qui sont très chronophages », étant donné que le financement des actions auprès du public judiciaire est assuré par la Mildt dans le cadre des CDO.
Or, dans le cadre du recentrage des missions de la Mildt et de la préparation du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies (2008-2011), il a été décidé en juillet 2008 que les actions « santé et justice » pérennes, aujourd’hui financées sur crédits déconcentrés de la Mildt dans le cadre des CDO, seront prises en charge à partir de 2010 par l’ONDAM médico-social pour un montant estimé à environ quatre millions d’euros. Les actions, actuellement financées par la Mildt, mais qui ne relèvent pas de l’assurance maladie et qui concernent des dispositifs pérennes relevant essentiellement du ministère de la Justice et/ou de la direction générale de l’action sociale, devront, pour leur part, être reprises par les ministères concernés, un travail de concertation avec ces services ayant d’ores et déjà été entrepris.
Ce transfert des crédits alloués dans le cadre des CDO à l’assurance maladie ne laisse pas d’inquiéter les structures médico-sociales spécialisées et les associations quant aux perspectives de financement des actions « santé et justice » qu’elles mènent sur le terrain en matière de prévention et de prise en charge des problèmes d’alcool chez les personnes sous main de justice. En effet, certaines actions, auparavant financées par la Mildt, ont d’ores et déjà vu leur financement repris par d’autres institutions (groupements régionaux de santé publique et fonds interministériel de prévention de la délinquance). La reprise du financement par l’assurance-maladie des actions actuellement financées dans le cadre des CDO et relevant de l’ONDAM médico-social pourrait engendrer de leur part un désengagement, comme cela a pu être observé lors du transfert en 2003 du financement des CSST et des CAARRUD à l’ONDAM.
En outre, comme votre Rapporteur l’a souligné plus haut, les financements de la Mildt dédiés aux actions « santé et justice » dans le cadre des CDO ont fortement baissé sur les dernières années : par conséquent, la reprise de financement par l’assurance-maladie risque de ne pas tenir compte des baisses déjà intervenues, la compensation des crédits s’opérant a minima. C’est pourquoi, lors de son audition, le Docteur Alain Rigaud a exprimé sa vive inquiétude sur le fait que les actions « santé et justice » généralement mises en œuvre par le dispositif médico-social en addictologie dans le cadres des CDO et depuis longtemps financées ou cofinancées par la Mildt, « fassent l’objet à partir de 2010 d’un désengagement total de cette dernière ». Il a estimé que « le désengagement de la Mildt après son action d’incitation exige le transfert intégral de ce financement vers l’ONDAM médico-social », car se pose, selon lui, avec acuité la question de « savoir comment les CSAPA, dont un tiers de la file active est constitué de personnes sous main de justice, pourront continuer à assurer ces missions, certes facultatives, et notamment la prévention de la récidive des conduites en état d’alcoolisation (CEA), l’accompagnement des personnes détenues ou sortant de prison ».
En effet, les établissements médico-sociaux menant ce type d’actions regrettent de ne disposer à ce jour d’aucune garantie sur le fait que ces financements seront intégralement compensés par des mesures nouvelles dans le cadre de l’ONDAM. La direction générale de la santé a indiqué à votre Rapporteur que les actions « santé et justice », aujourd’hui financées sur crédits de la Mildt dans le cadre des CDO, seront prises en charge à partir de 2010 par l’ONDAM médico-social pour un montant estimé à environ quatre millions d’euros, alors même que le budget de la Mildt dédié aux actions « santé et justice » ainsi qu’aux actions « alcool » ressort en 2008 à près de cinq millions d’euros (104).
Afin de permettre ce transfert budgétaire dans les meilleures conditions, la Mildt a mis en place une remontée d’informations auprès de ses chefs de projet, avec l’appui des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, afin d’identifier les dispositifs de prévention, de prise en charge et de réinsertion qui peuvent être concernés. L’objectif est de préciser les dispositifs qui bénéficient ou bénéficiaient depuis plusieurs années de budgets déconcentrés de la Mildt pour des actions de collaboration entre la justice et la santé, dont les actions relevant des CDO. Le travail d’analyse de ces remontées est actuellement en cours, les premiers éléments adressés par les chefs de projet Mildt ayant permis de dresser un état des lieux provisoire, qu’il convient d’approfondir. Lorsque le montant des crédits des CDO devant être transférés à l’ONDAM médico-social sera définitivement arrêté, une demande de mesures nouvelles sera établie dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
B. POUR UNE RÉPONSE SANITAIRE CIBLÉE ET ADAPTÉE ASSOCIANT DÉPARTEMENTS ET NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT
1. Le département : un échelon pertinent pour développer une politique de prévention adaptée aux bassins de vie
Les départements, dans l’exercice de leurs compétences sociales, sont très largement confrontés à des situations individuelles révélant des conduites addictives, certains ayant même d’ores et déjà décidé de s’associer à la prévention des dangers liés à une consommation excessive d’alcool.
Actuellement, la prise en charge de l’alcoolisme, tant dans sa dimension curative que préventive, est considérée comme une politique de santé publique relevant des prérogatives de l’État. Or, comme l’avait souligné M. Etienne Apaire, président de la Mildt, lors de son audition par votre Rapporteur, si les conseils généraux n’ont pas de compétence en matière de santé publique et si de nombreux départements n’interviennent pas dans le domaine de la prévention de l’alcoolisme, certains d’entre eux ont dans les faits adopté une démarche résolument volontaire et extralégale, en général en réaction à une situation locale de crise : régions productrices de vin (la Loire-Atlantique par exemple) et régions de forte consommation d’alcool (le département de la Seine-Saint-Denis). Cet engagement volontaire peut aujourd’hui prendre la forme d’une convention conclue entre le préfet, les communes et les conseils généraux dans le cadre d’un groupement régional de santé publique (très actif par exemple en Île-de-France).
Quelques exemples dynamiques peuvent être cités en la matière : sites Internet de conseils généraux détaillant les adresses utiles (Vaucluse, Martinique) ; mise en place d’un numéro de téléphone « écoute alcool » (Bas-Rhin) ; organisation d’une campagne par l’ordre des pharmaciens et l’ANPAA sur le site du conseil général (Tarn) ; signature d’un plan départemental de prévention et de lutte contre l’alcoolisme entre le préfet, le président du conseil général et le président de l’association des maires de France (Pas-de-Calais, Loire-Atlantique) ; conseils généraux des jeunes sur le thème de l’alcool (Haute-Saône) ; création de bars sans alcool – il en existe plus de 250 – en partenariat avec la DDASS et les collectivités locales (communes et conseils généraux) ; mise en place de centres mobiles de santé avec véhicule départemental (Vaucluse).
En outre, par leurs compétences élargies, les départements sont concernés au premier chef par la prévention qu’il s’agisse des conduites addictives entraînant des handicaps, des liens entre grande précarité et consommation d’alcool (faible revenu, RMI, allocation parent isolé, aide sociale à l’enfance) ou de la réforme de la protection des majeurs du 5 mars 2007 (gestion des biens avec des mesures sociales dans un contexte d’alcoolisation). Ainsi une partie non négligeable des dépenses départementales d’actions sociales – qui s’élèvent en 2008 à plus de 20 milliards d’euros – est consacrée à réparer les dommages sociaux causés par les mésusages et autres addictions à l’alcool.
Si les départements s’engageaient au cas par cas et suivant les contextes locaux dans une démarche volontariste de prévention des dangers de l’alcoolisation, les dépenses sociales destinées à réparer en aval les dommages sociaux de l’alcool pourraient être utilement réaffectées en amont à la prévention.
Pour ce faire, votre Rapporteur propose que, la santé restant une compétence de l’État, à qui il revient de fixer la ligne opérationnelle, les départements prennent, sur la base du volontariat, des initiatives complémentaires. En effet, si le rapport de M. Edouard Balladur sur la réforme des collectivités territoriales propose de recentrer le département sur ses compétences, rien n’empêche en retour une intervention volontariste et concertée des conseils généraux avec les préfets en matière de prévention. Cette intervention serait d’autant plus adaptée et pertinente que les départements demeurent un échelon pertinent pour mener des actions de prévention tenant compte des situations locales et des bassins de vie.
Proposition n° 40
Encourager et inciter l’ensemble des départements à s’engager dans une démarche volontaire de prévention des risques liés à l’alcool, en complément de la politique de santé publique fixée par l’État au niveau national. L’objectif est de parvenir à la mise en place d’actions départementales de prévention, adaptées aux situations locales et aux bassins de vie, grâce à l’intervention concertée des préfets et des conseils généraux.
2. Dégager de nouvelles ressources financières : une condition indispensable à la pérennité de toute politique publique de prise en charge et de prévention du risque lié à l’alcool
La pérennisation des financements des professionnels de santé menant des actions « santé et justice » auprès des personnes placées sous main de justice est aujourd’hui un enjeu réel qui appelle une réponse forte et adaptée. Dans un contexte budgétaire fortement contraint, il convient de trouver une ressource budgétaire nouvelle, répondant à un objectif clair de santé publique et ne pénalisant pas l’activité économique du pays. En effet, le problème de financement qui se pose actuellement aux professionnels de santé menant des actions de prévention et de prise en charge de l’alcoolisme après la commission d’une infraction est double.
En premier lieu, comme votre Rapporteur l’a souligné plus haut, les dispositifs médico-sociaux, aujourd’hui financés sur les crédits déconcentrés de la Mildt, seront transférés à partir de 2010 vers l’ONDAM dont ils relèvent. Afin que les professionnels de santé intervenant en matière de santé et justice puissent poursuivre dans les meilleures conditions possibles leurs actions de prévention et de prise en charge à destination des personnes sous main de justice présentant une consommation problématique d’alcool, le transfert de ce financement par la Mildt vers l’ONDAM médico-social doit être intégralement compensé. Or, étant donné que les financements de la Mildt dédiés aux actions « santé et justice » dans le cadre des CDO ont fortement baissé sur les dernières années, votre Rapporteur propose que la reprise de financement par l’assurance-maladie tienne compte des baisses déjà intervenues, la compensation des crédits s’opérant sur la base de la moyenne constatée ces trois dernières années, à savoir près de 5,5 millions d’euros (105).
Proposition n° 41
S’assurer que les financements de la Mildt dédiés aux actions « santé et justice » dans le cadre des conventions départementales d’objectifs qui doivent être transférés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 vers l’ONDAM médico-social soient intégralement compensés sur la base de la moyenne constatée sur les trois dernières années, à savoir près de 5,5 millions d’euros.
En second lieu, la dotation annuelle de fonctionnement des professionnels de santé (CSAPA, CCAA et CSST) ne prévoit actuellement aucun financement des actions spécifiques menées auprès des personnes sous main de justice, et notamment pour les interventions en milieu carcéral, alors même qu’un tiers de la file active des CSAPA est constitué de personnes sous main de justice. Afin d’y remédier, votre Rapporteur propose que ces actions soient désormais financées par leur budget de fonctionnement, ce qui nécessite de facto une augmentation notable des moyens budgétaires alloués.
Pour ce faire, votre Rapporteur estime qu’il convient d’augmenter les droits perçus sur les alcools de plus de 25 % en volume, dont la consommation est la plus nuisible, notamment chez les jeunes. En effet, aux termes de l’article L. 245-7 et suivants du code de la sécurité sociale, le tarif de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques de plus de 25 % en volume était fixé jusqu’en 2008 à 0,13 euro par décilitre. Ce montant était resté inchangé depuis sa création par l’article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, alors même que la hausse de l’indice des prix à la consommation hors tabac depuis 1983 a été de l’ordre de 90 %.
Le montant de cette cotisation n’ayant pas été actualisé depuis 1983, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a augmenté la taxe sur les alcools forts de 23 %, afin de « rattraper environ le quart de l’inflation constatée depuis vingt-cinq ans » (106) et de dégager environ 80 millions d’euros. Observant que le rattrapage de l’inflation depuis 1983 n’a été que partiel, votre Rapporteur demande au gouvernement d’augmenter de 5 % la cotisation perçue sur les alcools forts, permettant ainsi de dégager 20 millions d’euros. La cotisation perçue sur les boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 25 % vol passerait ainsi de 1,60 euro à 1,68 euro par litre : force est de constater qu’avec une augmentation de la taxe sur les alcools forts de moins de 10 centimes par litre, d’importants moyens financiers pourraient être dégagés afin de financer de manière pérenne – via la dotation annuelle de fonctionnement – les actions « santé et justice » menées par les professionnels de santé (CCAA, CSST, CSAPA) auprès des personnes sous main de justice.
En contrepartie de cet effort budgétaire, cette pérennisation des financements implique un fort contrôle de l’État ainsi qu’une évaluation régulière des actions menées par les professionnels de santé auprès des personnes placées sous main de justice, afin de s’assurer de la bonne allocation des ressources au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
Proposition n° 42
Augmenter de 5 % la cotisation perçue sur les alcools forts de plus de 25 % en volume (soit moins de 10 centimes par litre), permettant ainsi de dégager 20 millions d’euros qui serviront à financer de manière pérenne – via la dotation annuelle de fonctionnement – les actions « santé et justice » menées par les professionnels de santé (CCAA et CSAPA) auprès des personnes sous main de justice.
En outre, il convient d’engager au niveau européen une large concertation sur la possibilité de taxer davantage les boissons énergisantes (type Redbull®, Darkdog®, Burn®), dont la consommation explose, généralement chez les jeunes, en association avec des alcools forts dits « blancs » pour confectionner des cocktails souvent bus massivement et de ce fait particulièrement dangereux. La France ne peut prendre seule l’initiative d’augmenter unilatéralement les taxes sur ces boissons énergisantes. En effet, une telle mesure risquerait de fausser la libre concurrence sur le marché communautaire et serait à ce titre assimilé par la commission européenne à une taxe d’effet équivalent à des droits de douanes, incompatible avec la libre circulation des biens.
Proposition n° 43
Engager au niveau européen une large concertation sur la possibilité de taxer davantage les boissons énergisantes (type Redbull®, Darkdog®, Burn®), dont la consommation explose chez les jeunes en association avec les alcools forts.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours de la réunion du mercredi 8 juillet 2009, la Commission examine le rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice (M. Étienne Blanc, rapporteur).
M. Étienne Blanc, rapporteur. Lorsque la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale m’a confié ce rapport d’information sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice, je dois avouer que je ne m’attendais pas à découvrir un sujet aussi vaste, mais combien passionnant. Face à l’ampleur d’une telle problématique, mon ambition, tout au long de cette mission, a été d’analyser les conditions dans lesquelles le soin et la peine interagissent afin de lutter efficacement contre les différentes pathologies et addictions à l’origine de la récidive. J’ai, pour ce faire, décidé de m’intéresser plus spécifiquement à trois thèmes.
Dans la première partie de mon rapport, j’ai souhaité porter un regard concret et objectif sur la question de la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées. Nombreux sont les faits divers à rappeler l’urgence sanitaire en prison. Ainsi, en janvier 2007, un prisonnier atteint de troubles mentaux avait tué son codétenu à la maison d'arrêt de Rouen avant de dévorer certains de ses organes. En septembre 2008, c’est dans cette même maison d’arrêt qu’un autre prisonnier a également tué son codétenu, relançant le débat, d’une part, sur la présence des pathologies psychiatriques en prison et, d’autre part, sur la collaboration entre personnels pénitentiaires et équipes médicales, afin de sécuriser les conditions de vie et de travail de chacun en détention. Au-delà de l’émotion et de la passion que peut susciter un tel débat, mon souci a été double : rappeler les indéniables progrès qui ont été accomplis depuis une quinzaine d’années ainsi que les difficultés qui font aujourd’hui obstacle à une prise en charge sanitaire globale et cohérente en prison.
Avant toutes choses, force est de reconnaître que la prison est un lieu de maladies. Le constat est sans appel. Sur le plan somatique, la population carcérale française reste une population surexposée au VIH, aux hépatites et à la tuberculose, une population fortement touchée par différentes formes d’addiction (alcool, cannabis, héroïne, cocaïne) et à la santé bucco-dentaire profondément dégradée. Sur le plan psychiatrique, le taux de pathologie est vingt fois supérieur en détention à celui observé en population générale et le recours aux soins de santé mentale y est dix fois supérieur. Quelques chiffres permettent d’illustrer une telle affirmation : près de la moitié des détenus présentent un état dépressif majeur et un quart des personnes incarcérées est aujourd’hui atteint de troubles psychotiques (schizophrénie, bouffée délirante aiguë, paranoïa…).
Face à cette situation, d’importants progrès ont d’ores et déjà été accomplis : la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a permis l’entrée de l’hôpital dans les prisons grâce à la mise en place d’un système de conventions entre hôpitaux et prisons, afin que la qualité et la continuité des soins dispensés aux détenus soient équivalentes à ceux de l’ensemble de la population. La loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a prévu la création des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, afin d’améliorer sensiblement les conditions d’hospitalisation complète des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Les difficultés faisant obstacle à une prise en charge globale et cohérente en détention persistent toutefois. Quatre points de blocage me semblent devoir être signalés.
Première difficulté : l’offre de soins en milieu carcéral souffre tout d’abord d’un manque de pilotage stratégique tant au niveau national que régional. Alors que seize thématiques ont été arrêtées comme devant obligatoirement être traitées dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux d’organisation sanitaire, les soins aux personnes détenues n’y figurent pas en tant que tels. C’est pourquoi, je propose de confier aux futures agences régionales de santé, les ARS, la double mission d’identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et de réguler l’offre de soins en milieu pénitentiaire. Pour ce faire, il convient de prévoir l’inscription dans l’ensemble des schémas régionaux d’organisation sanitaire d’un volet thématique sur la « santé en prison ».
Deuxième difficulté : la coopération entre les différents acteurs intervenant en prison trop souvent défaillante. Les relations entre les services médicaux et l’administration pénitentiaire restent fréquemment marquées par la méfiance et l’incompréhension, l’implication et la bonne volonté des acteurs étant déterminantes.
Troisième difficulté : la continuité des soins, notamment psychiatriques, à la sortie de prison, qui demeure un des points de blocage majeur que nous avons identifié, le plus souvent à cause du manque de coordination entre les équipes médicales d’une part, et les services pénitentiaires d’insertion et de probation ainsi que les juges de l’application des peines d’autre part. Pour éviter que la libération ne signifie l’interruption brutale des soins psychiatriques, je propose que les consultations post-pénales en milieu ouvert soient généralisées. En effet, les expériences menées, notamment à l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif à l’initiative de Mme Christiane de Beaurepaire, présentent des résultats remarquables en matière de prévention de la récidive et permettent de combler les lacunes de la sectorisation psychiatrique en fonction du lieu de domicile, largement inadaptée aux sortants de prison.
Quatrième difficulté et non des moindres : le secret médical qui cristallise les tensions entre personnels soignants et administration pénitentiaire. La prison est un lieu où tout se sait et dans lequel le secret médical est difficile à préserver. En effet, le secret médical est le motif le plus fréquent de conflits entre administration pénitentiaire et le personnel médical. Au cours des divers déplacements et des auditions, j’ai toutefois pu constater que le partage de l’information entre professionnels de santé et personnels pénitentiaires s’est imposé dans la pratique quotidienne de la détention. Bien que n’ayant aucune base légale ou réglementaire, le secret professionnel partagé est une réalité dans beaucoup d’établissements pénitentiaires, permettant ainsi d’assurer une meilleure continuité des soins et de sécuriser les conditions de vie et de travail en détention.
Après la santé en détention, j’ai souhaité dans la deuxième partie de ce rapport m’intéresser aux soins pénalement ordonnés et plus particulièrement au dispositif de suivi socio-judiciaire. En effet, l’arsenal législatif prévu pour contrôler les criminels dangereux, lors de leur sortie de prison, et ainsi limiter les risques de récidive, s’est développé au fil des années : parmi ces mesures successives, le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soins, instaurés par la loi du 17 juin 1998, occupent une place centrale.
Mesure originale et porteuse d’efficacité pour lutter contre la récidive, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire, qui consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, à des mesures d’assistance et de surveillance. Au nombre de ces mesures, la juridiction peut prononcer une injonction de soins : se met alors en place une interface santé-justice originale : le médecin coordonnateur, qui intervient afin de mieux renseigner le juge de l’application des peines quant au déroulement des soins engagés entre le condamné et son médecin traitant.
Or, l’application du suivi socio-judiciaire, avec injonction de soins, se heurte actuellement à une difficulté de taille : le manque de médecins coordonnateurs. En effet, 40 tribunaux de grande instance et 17 départements en sont actuellement dépourvus. Au final, le rôle d’interface original que le médecin coordonnateur assure entre santé et justice est aujourd’hui le plus souvent virtuel en raison de la pénurie de médecins et les injonctions de soins ne peuvent être mises en œuvre, de façon satisfaisante, dans plus de la moitié des juridictions françaises. Face à cette pénurie de médecins, j’avance dans mon rapport quelques propositions, comme la suppression du numerus clausus qui limite à vingt le nombre de condamnés que peut suivre chaque médecin coordonnateur et la possibilité pour l’expert qui, missionné par le tribunal ou par le juge d’instruction, a étudié un dossier, de pouvoir être ensuite nommé médecin coordonnateur dans le même dossier.
Autre source d’inquiétude : l’extension du suivi socio-judiciaire, motivée par l’intérêt constant que porte le législateur à cette peine, qui risque de lui faire perdre une grande partie de son efficacité, faute de moyens adéquats. Alors qu’il avait été initialement créé à destination des auteurs d’infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a progressivement été étendu à l’essentiel des infractions violentes (meurtres, assassinats, viols, enlèvement ou séquestration). Or, le suivi socio-judiciaire, par l’articulation qu’il exige de tous les acteurs, suppose un temps de suivi plus important que tout autre mesure. Afin que ce dispositif ne soit pas saturé et ne perde de son efficacité, je propose donc que, dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, le suivi socio-judiciaire ne puisse être prononcé qu’à titre exceptionnel pour les cas de violences conjugales et délits d’incendiaires les plus graves, l’obligation de soins devant être privilégiée le reste du temps.
Je souhaite également un suivi socio-judiciaire plus souple et plus réactif, seul capable de faire face à la montée en charge du dispositif. Le suivi socio-judiciaire est en général prononcé pour des durées relativement longues (six ans en moyenne), alors même que les efforts entrepris par la personne condamnée en vue de sa réinsertion sociale peuvent avoir produit leurs effets avant la fin de la mesure. Il faut donc permettre au juge de l’application des peines, après audition du condamné, de mettre fin de manière anticipée à un suivi socio-judiciaire, y compris lorsqu’il est prononcé à titre de peine principale. Une double condition devra pour ce faire être remplie : le reclassement du condamné devra être acquis sur rapport du conseiller d’insertion et de probation et les soins pénalement ordonnés ne devront plus être nécessaires, sur rapport du médecin coordonnateur. De même, alors que le juge de l’application des peines peut actuellement modifier ou compléter les obligations imposées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, il ne peut en revanche lever l’injonction de soins, quand bien même les soins ne s’avéreraient plus nécessaires. C’est pourquoi, le juge de l’application des peines doit pouvoir, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, mettre fin de manière anticipée à l’injonction de soins ordonnée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Enfin, dans la troisième partie de mon rapport, j’ai souhaité traiter un thème fondamental, celui de la prise en charge des infractions liées à l’alcool. Troisième cause de mortalité en France et première cause de décès chez les jeunes, l’alcool fait aujourd’hui l’objet de consommations problématiques chez plus d’un tiers des adultes. Or, le coût social de l’alcool était estimé à 37 milliards d’euros en 2000, soit près de 3 % de la richesse nationale. Il s’agit pourtant là d’une estimation basse, ne tenant pas compte des crimes et délits commis sous l’emprise de l’alcool. Or, force est de constater que la prévalence de l’alcool, si elle varie fortement suivant le type d’infractions, reste globalement marquée. Quelques chiffres : l’alcoolisation occasionnelle ou chronique est un facteur retrouvé chez plus d’un tiers des auteurs de violences. Un quart des auteurs d’agressions hors de la famille et plus du tiers des auteurs d’agressions au sein la famille avaient consommé de l’alcool dans les deux heures précédentes. En ce qui concerne d’autres formes de délinquance, un tiers des destructions intentionnelles étaient précédées d’une consommation d’alcool.
Or, si l’alcool est souvent associé à la commission d’infractions, les rencontres avec la justice constituent autant d’occasions manquées de prévenir et de prendre en charge les troubles liés à l’alcool. Prenons l’exemple de l’injonction thérapeutique. Initialement réservée aux personnes faisant usage illicite de stupéfiants, elle a été étendue, par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, aux personnes ayant commis une infraction dont les circonstances révèlent une addiction à l’alcool. Or, parce que les actes réglementaires nécessaires n’ont toujours pas été publiés à ce jour, l’injonction thérapeutique est restée « lettre morte » depuis deux ans pour les infractions liées à l’alcool, alors même que les besoins sont immenses.
Trois axes de réformes me semblent devoir être privilégiés pour faire de la rencontre avec la justice une opportunité réussie de prévention et de prise en charge des troubles liés à un mésusage d’alcool.
Premier axe de réforme : donner sa pleine mesure à l’injonction thérapeutique. Pour ce faire, il revient tout d’abord au Gouvernement de prendre sans délai les actes réglementaires d’application de l’injonction thérapeutique, telle que réformée par la loi du 5 mars 2007. Je suis également favorable à ce que l’injonction thérapeutique pour les infractions liées à l’alcool puisse être mobilisée à tous les stades de la procédure judiciaire, tant en pré-sentenciel (alternatives aux poursuites, composition pénale, obligation ordonnée par le juge d’instruction) qu’en post-sentenciel (comme modalité d’exécution d’une peine).
Deuxième axe de réforme : délivrer de plus amples informations et de plus fortes incitations aux soins aux personnes placées sous main de justice. Plusieurs moments de la procédure judiciaire – alternatives aux poursuites, application et exécution des peines – sont propices à ce que le passage devant la justice puisse se transformer en prise de conscience, dont on sait qu’elle est une étape importante dans une éventuelle prise en charge. Lors des auditions de la mission, il a notamment été fait état d’une expérimentation très originale menée au Havre en matière de prise en charge des problèmes de mésusage d’alcool après la commission d’une infraction : la réalisation d’entretiens d’alcoologie en garde à vue. Cette action s’adresse aux personnes mises en cause dans des affaires en lien avec une consommation d’alcool et poursuit un double objectif : d’une part, permettre aux prévenus, au cours de cet entretien, de revenir sur leurs actes et, d’autre part, les sensibiliser à une démarche personnelle de prise en charge de leurs conduites addictives, au besoin avec le soutien d’un thérapeute. Afin d’apprécier plus largement l’efficacité de ce dispositif sur la prévention de la récidive des infractions liées à une consommation habituelle et excessive d’alcool, je propose que ces entretiens d’alcoologie en garde à vue, à destination des auteurs d’infractions sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits, soient expérimentés pour une durée de deux ans dans plusieurs départements volontaires. Au terme de cette expérimentation, qui fera l’objet d’une évaluation précise, la décision pourra alors être prise, au regard des résultats obtenus, de généraliser ou non ces entretiens en garde à vue.
Troisième axe de réforme : accroître les mesures de soins alternatifs aux poursuites et ne recourir aux interventions pénales classiques qu’en cas d’échec ou de refus, notamment pour les conduites en état alcoolique. Dans cette perspective, je souhaite mentionner l’expérience innovante qu’a menée le tribunal correctionnel de Besançon entre 1998 et 2003 : les primo délinquants routiers pouvaient bénéficier, dans le cadre d’un ajournement de peine d’un an, d’un programme d’intervention spécifique, sous forme de stages. Cette stratégie – intervention groupale, sous forme de stages – a permis une division par quatre de la récidive à trois ans des conducteurs en état d’alcoolémie primo délinquants. Au regard de l’efficacité de ce dispositif en matière de prévention de la récidive des conduites en état alcoolique, je préconise un recours plus important aux ajournements de peines avec mise à l’épreuve pour les primo délinquants routiers ainsi que le développement, dans le cadre de ces ajournements de peines, des interventions groupales sous forme de stages. L’objectif est double : débanaliser chez le justiciable sa primo conduite en état d’alcoolisation et prévenir la réitération de ces conduites à risque.
À côté des conduites en état alcoolique, il est également important d’agir sur les ivresses publiques et manifestes ou IPM. Chaque année, les mesures d’ivresses publiques et manifestes concernent en moyenne 70 000 personnes par an et représentent environ 50 000 visites médicales. Le champ de procédure de l’ivresse publique et manifeste est également important par la gravité potentielle du phénomène pour les personnes impliquées, puisqu’entre 80 et 90 % des manifestations d’IPM sont à relier à des pathologies chroniques de l’alcool.
Actuellement, l’ivresse publique et manifeste n’est passible que d’une contravention de deuxième classe, qui ne fait pas l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Le contrevenant peut ainsi accumuler un très grand nombre d’IPM, sans qu’il soit possible de constater, à partir du casier judiciaire, la situation de récidive et donc sans que ne puissent être envisagées l’aggravation de la peine ainsi que l’obligation de soins. C’est pourquoi, je propose d’adopter la procédure de l’amende forfaitaire tout en l’aménageant pour favoriser une prise en charge sanitaire adaptée : cet aménagement pourrait consister en la création d’une exemption automatique du paiement de l’amende forfaitaire, à condition que le contrevenant justifie auprès de l’agent verbalisateur avoir pris contact avec une structure spécialisée en addictologie. Si le contrevenant justifie avoir satisfait à la visite, l’action publique sera alors éteinte. Cette visite sera l’occasion pour le contrevenant d’une prise de conscience d’un éventuel mésusage d’alcool et pourra donner lieu, si le contrevenant le souhaite, à une prise en charge adaptée et volontaire.
Mais, ces propositions n’ont un sens et une portée que si elles s’inscrivent dans le cadre plus global d’une véritable politique de santé publique en direction des personnes sous main de justice présentant une addiction à l’alcool. En effet, une fois la phase judiciaire achevée, les personnes placées sous main de justice, présentant une dépendance à l’alcool, bénéficient d’une prise en charge sanitaire, qui se heurte à d’importantes difficultés. En premier lieu, l’actuelle mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie – les CSAPA – qui doivent fusionner les centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) tend à privilégier la prise en charge de la toxicomanie au détriment de l’alcool. En deuxième lieu, la prise en charge sanitaire est très inégale sur l’ensemble du territoire en raison d’une grande hétérogénéité de moyens. Ainsi, les délais de prise en charge par les structures médico-sociales adaptées vont de quelques semaines pour les plus courts à huit ou neuf mois, voire un an, pour les plus longs. Enfin, les structures de soins et les associations rencontrent d’importantes difficultés de financement pour mener à bien leurs actions « alcool et justice ».
Afin de remédier à ces obstacles, je préconise la promotion d’une réponse sanitaire ciblée et adaptée associant départements et nouvelles sources de financement.
Les départements tout d’abord. Par leurs compétences élargies, ils sont concernés au premier chef par la prévention qu’il s’agisse des conduites addictives entraînant des handicaps, des liens entre grande précarité et consommation d’alcool (faible revenu, RMI, allocation parent isolé, aide sociale à l’enfance). Ainsi une partie non négligeable des dépenses départementales d’actions sociales – qui s’élèvent en 2008 à plus de 20 milliards d’euros – est consacrée à réparer les dommages sociaux causés par les mésusages et autres addictions à l’alcool. Si les départements s’engageaient au cas par cas et suivant les contextes locaux dans une démarche volontariste de prévention des dangers de l’alcoolisation, les dépenses sociales destinées à réparer en aval les dommages sociaux de l’alcool pourraient être utilement réaffectées en amont à la prévention. C’est pourquoi, je propose que, la santé restant une compétence de l’État, à qui il revient de fixer la ligne opérationnelle, les départements prennent, sur la base du volontariat, des initiatives complémentaires dans ce domaine.
Nouvelles sources de financement ensuite. La pérennisation des financements des professionnels de santé menant des actions « alcool et justice » auprès des personnes placées sous main de justice est aujourd’hui un enjeu réel qui appelle une réponse forte et adaptée. En effet, la fragilité des financements est aujourd’hui un véritable handicap à un suivi de long terme des personnes présentant une addiction à l’alcool. Dans un contexte budgétaire fortement contraint, il convient de trouver une ressource budgétaire nouvelle, répondant à un objectif clair de santé publique et ne pénalisant pas l’activité économique du pays. Afin d’assurer la pérennité de toute politique publique de prise en charge et de prévention du risque lié à l’alcool, je préconise d’augmenter les droits perçus sur les alcools de plus de 25 % en volume, dont la consommation est la plus nuisible, notamment chez les jeunes. Ainsi, une hausse de seulement dix centimes d’euros par litre (soit une augmentation de 5 %) permettrait de dégager 20 millions d’euros. C’est pourquoi, j’ai l’intention, avec votre accord, de demander au Gouvernement d’inscrire cette mesure dans le prochain PLFSS. En contrepartie de cet effort budgétaire, la pérennisation des financements implique un fort contrôle de l’État ainsi qu’une évaluation régulière des actions menées par les professionnels de santé auprès des personnes placées sous main de justice, l’objectif étant de s’assurer de la bonne allocation des ressources au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
Pour conclure, je suis convaincu que la réinsertion et la prévention de la récidive sont des enjeux tels pour la liberté et la sécurité de nos concitoyens que, si nous voulons lutter plus efficacement contre les pathologies et addictions à l’origine de la récidive, nous devons mettre en place un partenariat ambitieux et durable entre Santé et Justice.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Je voudrais féliciter le rapporteur pour la qualité de ce rapport qui honore notre Commission. Il s’agit en effet d’un travail sans complaisance. Au moment de commencer à étudier cette question, nous nous doutions qu’il s’agissait d’une carence lourde du système : le rapport montre que c’est effectivement le cas et il fait de nombreuses propositions très justifiées, dont beaucoup n’appellent pas des modifications législatives, mais plutôt des changements dans l’organisation. Enfin, je trouve remarquable, en ces temps de contrainte budgétaire, que la mission d’information propose une recette nouvelle pour financer les dépenses qu’elle suggère.
M. Manuel Valls. Je laisserai mes collègues, notamment Serge Blisko, aborder le fond de ce rapport très intéressant sur un vrai sujet de société.
Mon intervention a trait à l’organisation de nos travaux. Je dénonce en effet une distorsion dans l’application du règlement : alors que la matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions, un texte fondamental sur le travail dominical est examiné en séance publique. Cela crée une difficulté pour l’organisation de notre travail qui augure mal de la suite de la mise en œuvre du nouveau règlement. J’émets donc les plus vives protestations sur cette organisation et je souhaite que vous en fassiez part au président de l’Assemblée nationale.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Je ne peux que constater la situation que vous dénoncez, mais celle-ci n’est pas de mon fait. En effet, les travaux de commission ont normalement lieu le mercredi matin. La réunion de la séance publique au même moment résulte d’une décision de la conférence des présidents. Comme vous l’avez demandé, je ferai part de vos remarques au Président de l’Assemblée nationale.
M. Manuel Valls. J’observe qu’en réponse à nos rappels au règlement, la présidence a indiqué que cette organisation avait été décidée avec l’accord des présidents de commission.
M. Bernard Derosier. Avez-vous voté contre cette décision en conférence des présidents, M. le président ? En effet, on nous dit que cette décision a été prise à l’unanimité.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Lorsque cette question a été abordée, il est vrai que personne n’a fait de remarque, ni les présidents de commission, ni les présidents de groupe d’ailleurs !
M. Bernard Derosier. Il nous a également été indiqué que c’était aux présidents de commission de tenir compte de l’organisation de la séance publique.
Le Président Jean-Luc Warsmann. Ce n’est pas mon analyse : cette réunion sur un sujet important était programmée depuis longtemps. La situation n’est pas parfaite, mais il fallait tenir compte de la demande de votre président de groupe d’un temps législatif programmé exceptionnel de 50 heures.
M. Serge Blisko. Quant à moi, j’ai choisi d’être avec vous plutôt qu’en séance pour écouter l’excellent rapport de la mission d’information.
Le rapport aborde de nombreux manques et insuffisances que nous pressentions. J’insisterai principalement sur deux points. Tout d’abord, je regrette la faible implication du ministère de la santé dans ces questions, notamment en termes d’allocation de moyens.
Ensuite, le rapport insiste à juste titre sur l’insuffisance de la psychiatrie en prison et sur la nécessité d’un suivi très sérieux à la sortie de prison, comme cela est pratiqué à Fresnes avec la mise en place d’une consultation post-pénale. En effet, la rupture de la chaîne de soins ne peut qu’aboutir à un retour en prison et alimenter un cercle vicieux, coûteux et désespérant ! Cette question pose, comme l’a dit le rapporteur, le problème de la sectorisation psychiatrique en fonction du lieu de domicile, en partie inadaptée aux sortants de prison.
La loi de 1998 sur le suivi socio-judiciaire est une excellente loi mais elle est mal appliquée, à cause d’un manque de médecins coordonnateurs. J’hésite sur les solutions préconisées par le rapporteur pour y remédier. Il suggère de permettre de désigner comme médecin coordonnateur l’expert qui a étudié le dossier : je ne suis pas convaincu par cette idée, même si nous serons peut-être contraints de suivre cette voie. De même, le rapporteur propose de supprimer le numerus clausus qui limite à 20 le nombre de condamnés que peut suivre un médecin coordonnateur : il s’agirait un peu d’un constat d’échec, si on augmente le nombre de patients suivis par un même médecin, le suivi sera moins bon !
À cet égard, je rappelle que Mme Dati avait multiplié les promesses sur le sujet, annonçant la création au 1er janvier 2009 de 250 à 300 postes de médecins coordonnateurs que nous attendons toujours.
Par ailleurs, il est impératif d’inciter les psychiatres à s’intéresser davantage à ces populations souffrantes. Par rapport au reste de l’Europe, la France a un ratio de psychiatres par habitant très élevé. Dans ces conditions, il n’est pas normal que tant de personnes ne soient pas suivies ; il y a manifestement là une mauvaise adéquation des moyens, à laquelle il nous faudra trouver des solutions.
Il y a dans le rapport une comparaison sur la prise en charge des personnes dépendantes à l’alcool et aux drogues. Je remarque que l’alcoolisme touche beaucoup plus de monde que la toxicomanie alors que cette addiction est beaucoup moins bien accompagnée. Pourtant, l’alcoolisme est une forme de « toxicomanie » : il s’agit d’une addiction lourde, destructrice et au total très coûteuse pour la société. J’appelle à un effort de réflexion sur ce sujet.
Enfin, il me semble indispensable que la commission assure un suivi de la mise en œuvre des propositions du rapport.
M. Pascal Terrasse. J’estime que notre pays fait fausse route sur sa politique carcérale et de santé mentale. À chaque fait divers, comme à Pau ou plus récemment à Aubenas, on insiste surtout sur la nécessité d’enfermer ceux qui ont commis ces actes. Pourtant, il est indispensable de ne pas mélanger politique d’incarcération et politique de santé mentale.
La Mission d’appui en santé mentale insiste sur le problème de la démographie médicale en santé mentale, qui se manifeste notamment dans le domaine des urgences psychiatriques. Face à cette situation, aucune réponse satisfaisante n’est apportée. Il ne faudrait pas que nous nous retrouvions dans la situation de l’Italie qui a décidé, il y a cinq ans, de ne plus prendre en charge les personnes atteintes de troubles mentaux, lesquels se retrouvent aujourd’hui « dans la nature ».
Le nombre de personnes incarcérées atteintes de troubles psychiatriques est très important, il peut même atteindre 40 % dans certains établissements : il est vrai que le coût de l’internement en hôpital psychiatrique est quatre fois supérieur à celui de l’emprisonnement… Or, pour des problèmes de démographie médicale, la présence psychiatrique est totalement insuffisante en prison. Le secteur libéral, par exemple, ne répond pas aux demandes des directeurs de prison.
Je voudrais insister sur la proposition n°6 qui suggère l’organisation de conférences nationales rassemblant l’ensemble des référents « santé en prison ». Cela sera sûrement très utile, mais cette démarche devrait également être suivie au plan local où une multitude d’acteurs — ARS, Conseil général, Justice, administration pénitentiaire — interviennent sans véritable articulation. En tant que président de conseil général, je peux vous dire qu’il est difficile d’assurer le suivi médico-social des personnes incarcérées, qui ne sont pas le plus souvent issues du département mais viennent d’autres prisons.
M. Dominique Raimbourg. Permettez-moi tout d’abord de souligner la qualité du travail du rapporteur, qui m’inspire quatre considérations.
Tout d’abord, le rapport met en évidence que la course à l’aggravation de la réponse pénale est parfois contre-productive. C’est ainsi que le suivi socio-judiciaire s’applique bien souvent à des cas qui ne le méritent pas, ce qui ne doit pas manquer d’interpeller le législateur.
Ensuite, les expériences menées à Besançon et au Havre démontrent que la lutte contre la récidive passe par un contrôle et un suivi le plus en amont possible.
Par ailleurs, le document illustre l’importance de l’alcool dans la commission d’actes violents, ce que l’on a trop tendance à passer sous silence. À ce titre, un tel rappel est bienvenu.
Enfin, l’idée de taxer les alcools de plus de 25° me semble une idée pertinente mais elle gagnerait à s’appliquer à d’autres alcools qui, telles les bières à 8,5° en cannettes par exemple, causent des ravages tout aussi notables.
M. Jean-Jacques Urvoas. Je souhaite moi aussi saluer le travail du rapporteur, qui doit nourrir notre réflexion dans la perspective, encore incertaine si j’en juge le silence évocateur du Président de la République à ce sujet lors de son intervention devant le Parlement réuni en Congrès, du futur examen du projet de loi pénitentiaire.
M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je saisis l’opportunité de l’évocation de ce texte important pour indiquer à notre commission que son examen pourrait intervenir en octobre prochain.
M. Jean-Jacques Urvoas. Très bien ; ainsi, notre collègue Jean-Paul Garraud ne restera pas indéfiniment le rapporteur de notre commission détenant le record de la nomination la plus ancienne.
Pour en revenir au rapport d’information qui vient de nous être présenté, j’observe que les indications qu’il présente corroborent le ressenti de nombreux parlementaires à l’occasion des visites qu’ils réalisent de maisons d’arrêt ou d’établissements pénitentiaires. Il fait apparaître des besoins criants, auxquels sont apportées des réponses bien lentes.
J’ai personnellement été effaré par les chiffres évoqués, notamment ceux qui font état de 40 % de détenus en état dépressif et de 20 % souffrant de pathologies mentales. Je suis également surpris par l’appréciation du rapporteur sur l’évolution des suicides, dans la mesure où j’ai le sentiment inverse de la diminution qu’il annonce. Enfin, il est question de difficultés liées au respect du secret médical et, dès lors que des règles déontologiques s’imposent au corps médical, il me semble que le problème s’apparente avant tout à un dysfonctionnement de la médecine. En tout état de cause, j’aimerais avoir des précisions sur ce point ainsi que sur les préconisations faites pour y apporter une réponse.
M. Marcel Bonnot. Cet excellent rapport fait référence à une expérimentation menée par le tribunal correctionnel de Besançon au sujet de la lutte contre la récidive concernant les infractions routières sous l’emprise de l’alcool. En ma qualité d’élu local, j’ai suivi de près cette expérience et je pense être à même d’en tirer des conclusions avisées.
Pour mémoire, le tribunal passait un contrat avec chaque primo délinquant débouchant sur une reconnaissance puis une déclaration de culpabilité. L’intéressé devait s’engager à faire l’objet d’un suivi et à réaliser des stages de sensibilisation et de désintoxication. Au terme de ceux-ci, il comparaissait de nouveau devant le tribunal qui prononçait des peines adaptées. Une évaluation de cette démarche a montré qu’elle diminuait très sensiblement les cas de récidive. Pour autant, elle a été abandonnée en raison de son coût supposé, avant même que des solutions, en partenariat avec les collectivités territoriales, puissent être envisagées, ce que je regrette.
Je ne peux donc qu’être heureux que le rapporteur reprenne à son compte ce dispositif qui a fait ses preuves.
M. André Vallini. Le rapport qui vient de nous être présenté est intéressant et concrétise un travail considérable. Je forme le vœu qu’à la différence de bien d’autres documents consensuels ayant trait à la justice et aux questions pénitentiaires, il trouve une traduction politique et budgétaire concrète. Je crains malheureusement que cela ne soit pas le cas.
Les cinq propositions les plus opérantes, portant les n°s 1, 2, 8, 9 et 13 nécessitent toutes des crédits. Pour juger de leur mise en œuvre, notre commission doit d’ores et déjà prendre rendez-vous lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. C’est à ce moment-là que nous verrons si le Gouvernement a pris en considération ces propositions et entend les appliquer.
Encore une fois, on peut en douter. Il y a trop longtemps que la justice est le parent pauvre de l’État.
M. Michel Hunault. À mon tour, je souhaite saluer le travail du rapporteur. Comme cela a été dit, il conviendra de veiller à l’articulation de ses propositions avec le contenu du projet de loi pénitentiaire et avec les moyens alloués à l’administration pénitentiaire.
Je pense que nous sommes tous d’accord sur le constat de la surpopulation carcérale dans les prisons. La santé mentale des détenus, qui affecte également les conditions de travail des gardiens surveillants, est naturellement une source de difficultés supplémentaires.
Pour autant, il me semble que la question ne se résume pas obligatoirement à plus de crédits. À cet égard, nous aurons certainement à demander des comptes, lors du prochain budget, à l’administration pénitentiaire sur l’usage des crédits qui lui sont alloués, lesquels, je le rappelle, ont augmenté de 10 % ces cinq dernières années.
M. Jérôme Lambert. Ce rapport est utile et intéressant. Ayant moi-même activement participé aux travaux d’une mission d’information sur la récidive il y a quelques années, je suis bien obligé de constater qu’un certain nombre de sujets et de préconisations ne sont pas nouveaux. C’est dire que le consensus trouvé alors, appelé à se renouveler aujourd’hui, n’a pas produit les résultats escomptés.
Deux propositions du rapport appellent plus particulièrement des observations de ma part.
La première, figurant sous le n° 12, consiste à permettre que l’expert qui a étudié un dossier puisse ensuite être nommé médecin coordonnateur dans le même dossier. Je crains que cela ne conduise la personne condamnée à voir dans cet expert un intervenant partial et ne soulève, par la suite, bien des problèmes.
La seconde proposition, figurant sous le n° 42, vise à créer une taxe sur les alcools forts. Sans contester que ceux-ci provoquent parfois des addictions, je ne suis pas certain qu’ils engendrent les cas d’alcoolisme les plus fréquents. Ne pourrait-on donc pas taxer les alcools qui, tels la bière ou le vin, entrent dans les addictions habituelles des personnes alcooliques ?
M. le Président Jean-Luc Warsmann. Avant que le rapporteur ne réponde, je tiens à préciser que le précédent rapport d’information de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures a donné lieu à l’adoption de dispositions de nature législative. Il en ira de même pour les préconisations de nature législative du rapport présenté aujourd’hui.
Il reste que certaines propositions ne sont pas de nature législative, ce qui amoindrit naturellement la prise que le législateur a sur leur mise en œuvre. Notre commission ne se dessaisira pas pour autant de son travail, l’examen du projet de loi de finances pour 2010 ainsi que celui d’autres textes d’initiative gouvernementale nous offrant l’occasion d’interroger les ministres en charge de ces questions.
M. Étienne Blanc, rapporteur. Bien qu’il soit difficile de répondre à l’ensemble des remarques qui viennent d’être faites, je souhaiterais faire quatre observations.
En premier lieu, la prison est aujourd’hui devenue, dans certains cas, un hôpital psychiatrique, où on enferme nombre de personnes. Lorsque nous nous sommes rendus en prison lors des déplacements de la mission, nous avons pu constater les cris et les comportements des surveillants à l’égard des détenus. Alors que nous étions présents, un détenu, au moment du portage des repas, a frappé un de ses gardiens. Ces derniers nous ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas de le sanctionner, dans la mesure où il s’agissait de faits itératifs et habituels de la part de ce détenu, faits sur lesquels il ne leur était pas possible d’agir. Nous estimons que la présence de ces détenus en prison doit être l’occasion de se faire rencontrer santé et justice. Or, le partenariat en détention entre ces deux administrations ne fonctionne pas ou de manière très imparfaite. À titre d’exemple, alors qu’un médecin, chargé de suivre les questions sanitaires en prison, est présent au ministère de la justice, aucun haut fonctionnaire de la justice n’a été détaché auprès du ministère de la santé, le poids des habitudes de travail étant déterminant. Ce manque de coordination entre santé et justice peut notamment expliquer l’absence dans les SROS d’un volet spécifiquement dédié à la question de la médecine en prison, volet qui permettrait de poser un constat partagé et d’identifier les moyens adéquats. En définitive, nous avons deux administrations, santé et justice, qui s’ignorent et peinent à travailler ensemble. Il faut qu’à l’avenir, le ministère de la santé soit plus impliqué sur la question de la santé en prison. Nous avons d’ailleurs fait dans ce rapport des propositions afin que santé et justice prennent l’habitude de travailler ensemble.
En deuxième lieu, s’agissant des infractions liées à l’alcool, nous savons que, sur le plan statistique, 70 % des crimes de sang sont commis sous l’emprise de l’alcool. Mon sentiment est qu’il s’agit là d’un sujet sensible, qui touche aussi bien à l’aménagement du territoire qu’à des pans entiers de notre activité agricole. En matière d’alcool, nous devons mettre en place une véritable politique publique de prévention et d’accompagnement. Actuellement, lorsque sont commis des faits délictuels ou contraventionnels (comme les ivresses publiques et manifestes) qui révèlent un problème d’alcool, le système de santé et d’accompagnement est nettement insuffisant et présente certains dysfonctionnements. Il intervient notamment trop tardivement, alors qu’il devrait être actif dès lors que les infractions sont constatées. Plus la prise en charge (groupes de parole, psychiatres, psychologues) est précoce, plus la prévention de la récidive est aisée. Comme l’a souligné Marcel Bonnot, l’expérience du recours, en pré-sentenciel, aux ajournements de peines, couplés à des interventions groupales sous forme de stages, au tribunal correctionnel de Besançon entre 1998 et 2003, a permis de diminuer très sensiblement la récidive des conduites en état alcoolique. En définitive, les problèmes d’alcool doivent bénéficier d’une intervention précoce en pré-sentenciel et d’un accompagnement plus adapté par les centres d’alcoologie. À ce stade, les départements, en raison de leur rôle déterminant en matière de prévention, doivent également accompagner ce dispositif.
En troisième lieu, s’agissant du secret médical, nous avons constaté l’existence de divergences de fond. Si certains experts psychiatres estiment que le secret médical ne pose pas problème, des pratiques s’étant mises en place au cas par cas, d’autres en revanche jugent nécessaire l’adoption d’une nouvelle législation en la matière. Ma conviction est qu’il n’est nul besoin d’un texte nouveau sur le secret médical. Il existe des échanges de bon sens, qui se pratiquent d’ores et déjà au quotidien : lorsqu’un détenu va mal, il doit pouvoir en parler avec le psychiatre, ce dernier, après avoir traité les informations, devant pouvoir échanger librement avec l’administration pénitentiaire. Les équipes médicales et les personnels pénitentiaires ont trouvé d’eux-mêmes les limites du secret médical. Aussi n’est-il pas nécessaire de légiférer.
S’agissant enfin du rôle joué par le médecin coordonnateur, il présente l’avantage de lever le problème du secret médical. En effet, il informe le juge de l’application des peines des éléments qui sont à sa disposition et qui relèveraient théoriquement du secret médical, s’il était le médecin traitant de la personne suivie. Parmi les mesures pour remédier au manque de médecins coordonnateurs, rien ne fait obstacle à ce qu’un expert soit nommé médecin coordonnateur dans le même dossier. En effet, le médecin coordonnateur n’est pas un médecin traitant, mais un simple relais entre le soin et l’institution judiciaire. Ainsi, dans certains départements, les juridictions disposent d’experts, mais pas de médecins coordonnateurs : si les premiers pouvaient également exercer les fonctions des seconds, le problème de la pénurie serait en partie résolu.
En conclusion, je partage les analyses faites par mes collègues sur le budget de la Justice. Nous constatons cependant qu’il est en progression régulière chaque année. Notre rapport vise également à souligner que la réponse à apporter à ces problèmes ne réside pas uniquement dans le budget de la justice, mais également dans celui de la santé et des départements.
Mme Aurélie Filippetti. Je souhaiterais savoir si vous vous êtes intéressé au suivi des enfants nés en milieu carcéral ainsi que de leurs mères et si vous avez formulé des préconisations à ce sujet.
M. Étienne Blanc, rapporteur. Dans mon rapport, je n’ai pas abordé ce thème qui devrait l’être dans le cadre du rapport sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes mineures placées sous main de justice.
Conformément à l’article 145 du Règlement, la Commission autorise le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
Améliorer l’articulation entre santé et justice pour une meilleure prise en charge des personnes détenues
Proposition n° 1
Mettre en œuvre dans les meilleurs délais un suivi de la santé des personnes détenues dans les prisons françaises, à la fois plus régulier et prenant en compte les différents moments clés du parcours pénitentiaire, de l’entrée à la sortie de prison, afin de mieux adapter les moyens disponibles aux besoins désormais clairement identifiés.
Proposition n° 2
Consolider la politique de prévention du suicide en prison grâce à un meilleur repérage des entrants et une prise en charge adaptée de la crise suicidaire.
Proposition n° 3
Instituer au niveau national un comité de pilotage restreint, placé sous l’autorité directe du Premier ministre et présidé par lui. Ce comité, qui pourrait comprendre des personnalités qualifiées, extérieures à l’administration (à l’instar du contrôleur général des lieux de privation de liberté) aura la responsabilité d’impulser une véritable politique sanitaire en prison, aux objectifs clairement précisés et aux contraintes mieux partagées par tous.
Proposition n° 4
Confier aux futures agences régionales de santé la double mission d’identifier les besoins sanitaires des personnes en détention et de réguler l’offre de soins en milieu pénitentiaire. Pour ce faire, il convient de prévoir l’inscription dans l’ensemble des schémas régionaux d’organisation sanitaire d’un volet thématique sur la « santé en prison », concernant aussi bien les soins somatiques que psychiatriques.
Proposition n° 5
Instituer au niveau régional un comité de pilotage restreint, composé de l’ensemble des référents « santé en prison » et présidé par le directeur de l’agence régionale de santé, afin de décliner au plus près des besoins locaux les grands objectifs nationaux de la politique sanitaire des personnes détenues.
Proposition n° 6
Organiser, sous l’autorité du comité de pilotage national présidé par le Premier ministre, une conférence annuelle rassemblant l’ensemble des référents « santé en prison », afin de permettre une adaptation continue et progressive de la politique sanitaire en milieu pénitentiaire.
Proposition n° 7
Améliorer la coordination entre les UCSA et les SMPR, grâce à la mise en place systématique de réunions de coordination hebdomadaires, obligeant ainsi UCSA et SMPR à échanger et à examiner ensemble les différents dossiers qu’ils gèrent en commun.
Proposition n° 8
Densifier la prise en charge sanitaire dans les UCSA grâce au recours plus systématique à la télémédecine et à la vidéo-consultation, afin de lever certaines des difficultés liées aux extractions médicales.
Proposition n° 9
Afin d’assurer la continuité des soins psychiatriques à la sortie de prison et de prévenir au mieux la récidive, généraliser les consultations post-pénales, qui présentent le double intérêt de poursuivre les soins entrepris en détention et d’être un point de sécurisation pour les personnes sortant de prison.
Proposition n° 10
Sensibiliser les acteurs médicaux et pénitentiaires à la nécessité d’échanger le maximum d’informations dans le cadre réglementaire et législatif existant : la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a mis en place « l’échange d’informations opérationnelles », souvent méconnu sur le terrain. Des actions de formation ciblées et répétées, doublées de la rédaction et de la diffusion d’un guide des bonnes pratiques sur le thème du secret médical et de l’échange d’informations en détention, doivent donc être menées sur le terrain sous l’autorité conjointe des ministères de la Santé et de la Justice, afin de porter à la connaissance de l’ensemble des acteurs concernés (médecins, surveillants, directeurs d’établissement) les dispositions actuellement en vigueur et les potentialités qu’il recouvre en terme de partage d’informations.
Redynamiser le suivi socio-judiciaire pour une prévention plus efficace de la récidive
Proposition n° 11
Supprimer le numerus clausus qui limite à vingt le nombre de condamnés que peut suivre un médecin coordonnateur.
Proposition n° 12
Permettre que l’expert qui a étudié un dossier puisse ensuite être nommé médecin coordonnateur dans le même dossier.
Proposition n° 13
Augmenter les effectifs des médecins coordonnateurs grâce à une revalorisation de leurs indemnités ainsi qu’à une poursuite des efforts de communication et de formation engagés à l’égard des professionnels de santé. Ces efforts doivent impérativement être relayés par une action forte et concertée entre les ministères de la Santé et de la Justice destinée à améliorer les conditions de travail et d’intervention des médecins en prison.
Proposition n° 14
Dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, prévoir que le suivi socio-judiciaire ne puisse être prononcé à l’avenir qu’à titre exceptionnel pour les cas de violences conjugales et délits d’incendiaires les plus graves, l’obligation de soins étant privilégiée le reste du temps.
Proposition n° 15
Modifier l’article L. 3711-1 du code de santé publique afin de mettre à la charge du médecin coordonnateur une obligation de remettre au juge de l’application une fois, voire deux fois par an, un compte rendu lui permettant de contrôler la mise en œuvre effective des injonctions de soins prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (mesure législative).
Proposition n° 16
Rendre plus cohérente la distinction entre obligation de soins et injonction de soins, en réservant cette dernière aux mesures les plus importantes, à savoir le suivi socio-judiciaire, la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté (mesure législative).
Proposition n° 17
Modifier les articles 131-36-2 et 132-45 du code pénal afin de simplifier et d’unifier les mesures de surveillance susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve (mesure législative).
Proposition n° 18
Modifier l’article 763-7 du code de procédure pénale afin que le juge de l’application des peines (mesure législative) :
— rappelle en début de peine à toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ainsi qu’à une peine privative de liberté qu’elle peut entreprendre un traitement en détention ;
— rappelle à tout détenu condamné à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, six mois avant que ne prenne fin sa peine de prison, qu’il peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, il devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté.
Proposition n° 19
Modifier l’article 717-1 du code pénal, afin que les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru accèdent prioritairement aux soins en détention, notamment psychiatriques, lorsqu’elles les sollicitent (mesure législative).
Proposition n° 20
Modifier l’article 717-1 du code de procédure pénale afin d’encourager à la désignation systématique des médecins coordonnateurs dès le début de l’incarcération dans le double objectif d’approfondir la connaissance du condamné et de dynamiser les suivis en détention (mesure législative).
Proposition n° 21
Modifier l’article 131-36-1 du code pénal afin que le juge de l’application des peines puisse, après audition du condamné, mettre fin de manière anticipée à un suivi socio-judiciaire, y compris lorsqu’il est prononcé à titre de peine principale, à la double condition que le reclassement du condamné, sur rapport du conseiller d’insertion et de probation, soit acquis et que les soins pénalement ordonnés, sur rapport du médecin coordonnateur, ne soient plus nécessaires (mesure législative).
Proposition n° 22
Autoriser les conseillers d’insertion et de probation à avoir un accès direct au casier judiciaire afin qu’ils apprécient au plus près le reclassement du condamné à un suivi socio-judiciaire.
Proposition n° 23
Modifier l’article 763-3 du code de procédure pénale afin que le juge de l’application des peines puisse, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, mettre fin de manière anticipée à l’injonction de soins ordonnée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (mesure législative).
Renforcer la prise en charge et la prévention des infractions liées à l’alcool
Proposition n° 24
Mettre en œuvre dans les meilleurs délais un recensement et un suivi statistiques, réguliers et exhaustifs, des soins pénalement ordonnés, prenant en compte le type d’infractions auxquelles ils se rattachent, afin de mieux apprécier l’efficacité de ces soins en matière de santé publique et de prévention de la récidive.
Proposition n° 25
Créer une mission de contrôle permanente, associant de manière conjointe l’IGAS et à l’IGSJ, chargée de publier tous les ans un rapport sur la prévention et la prise en charge des infractions liées à l’alcool. L’objectif de cette mission sera de procéder à une évaluation régulière des dispositifs de prévention et de prise en charge des infractions liées à des consommations problématiques d’alcool, afin de mieux cibler la réponse pénale et les moyens afférents.
Proposition n° 26
Publier sans délai l’arrêté fixant les modalités de rémunération du médecin relais afin de donner sa pleine effectivité à l’injonction thérapeutique, telle qu’elle a été réformée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Proposition n° 27
Étendre la possibilité d’injonctions thérapeutiques pour les infractions liées à une consommation excessive et habituelle d’alcool à tous les stades de la procédure : alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République, ordonnance pénale, composition pénale, obligation ordonnée par le juge d’instruction (dans le cadre d’un contrôle judiciaire) ou comme modalité d’exécution d’une peine (mesure législative).
Proposition n° 28
Étendre le stage de sensibilisation aux dangers de la drogue institué par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance aux risques liés à une consommation habituelle et excessive d’alcool (mesure législative).
Proposition n° 29
Étendre le stage de sensibilisation aux dangers de la drogue et d’une consommation habituelle et excessive d’alcool aux infractions pour lesquelles l’état d’ivresse manifeste au moment des faits constitue une circonstance aggravante (mesure législative).
Proposition n° 30
Expérimenter dans les départements volontaires et pour une durée de deux ans les entretiens d’alcoologie en garde à vue, à destination des auteurs d’infractions liées à une consommation habituelle ou excessive d’alcool, afin de renforcer la prévention des infractions en lien avec un mésusage d’alcool.
Proposition n° 31
Dans le cadre des orientations et directives de politique pénale, privilégier les ajournements de peines avec mise à l’épreuve pour les primo délinquants routiers et développer de manière significative, dans le cadre de ces ajournements, les interventions groupales, sous formes de stages, afin de réduire la récidive des conduites en état alcoolique.
Proposition n° 32
Appliquer à la répression des ivresses publiques et manifestes la procédure de l’amende forfaitaire et prévoir que le contrevenant sera exempté du paiement de cette amende forfaitaire s’il justifie auprès de l’agent verbalisateur, dans un délai bref, fixé par le législateur, s’être rendu dans une structure spécialisée (mesure législative).
Proposition n° 33
Développer les orientations vers les CSAPA des auteurs de violences, en pré-sentenciel comme en post-sentenciel, afin de permettre une intervention la plus précoce possible.
Proposition n° 34
Confier le pilotage de la prise en charge des addictions – notamment à l’alcool – en détention aux unités de consultations et de soins ambulatoires, qui, sous leur autorité, auront la charge de favoriser et de renforcer l’intervention des CSAPA pour la réalisation de consultations d’addictologie.
Proposition n° 35
S’assurer que les UCSA, en charge du pilotage de la prise en charge des addictions, mettent en œuvre de manière systématique à l’entrée en prison un repérage des addictions.
Proposition n° 36
Renforcer la formation initiale et continue en addictologie des magistrats et des travailleurs socio-judiciaires, pour que les obligations de soins soient mises en œuvre à bon escient.
Proposition n° 37
Renforcer la collaboration entre travailleurs socio-judiciaires et personnels soignants, grâce à la mise en place d’un référent « addiction » au niveau de chaque service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un référent « justice » au niveau de chaque centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie.
Proposition n° 38
Mettre en place au niveau de chaque tribunal de grande instance des rencontres régulières entre acteurs judiciaires – procureur, juge des libertés et de la détention, directeur de SPIP et de la protection judiciaire de la jeunesse – et équipes spécialisées en addictologie.
Proposition n° 39
S’assurer que les CSAPA généralistes issus du secteur de la toxicomanie développent de nouvelles compétences sur le volet alcool, grâce à la mise en œuvre rapide d’importants efforts de formation en alcoologie.
Proposition n° 40
Encourager et inciter l’ensemble des départements à s’engager dans une démarche volontaire de prévention des risques liés à l’alcool, en complément de la politique de santé publique fixée par l’État au niveau national. L’objectif est de parvenir à la mise en place d’actions départementales de prévention, adaptées aux situations locales et aux bassins de vie, grâce à l’intervention concertée des préfets et des conseils généraux.
Proposition n° 41
S’assurer que les financements de la Mildt dédiés aux actions « santé et justice » dans le cadre des conventions départementales d’objectifs qui doivent être transférés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 vers l’ONDAM médico-social soient intégralement compensés sur la base de la moyenne constatée sur les trois dernières années, à savoir près de 5,4 millions d’euros.
Proposition n° 42
Augmenter de 5 % la cotisation perçue sur les alcools forts de plus de 25 % en volume (soit moins de 10 centimes par litre), permettant ainsi de dégager 20 millions d’euros qui serviront à financer de manière pérenne – via la dotation annuelle de fonctionnement – les actions « santé et justice » menées par les professionnels de santé (CCAA et CSAPA) auprès des personnes sous main de justice (mesure relevant d’une loi de financement de la sécurité sociale).
Proposition n° 43
Engager au niveau européen une large concertation sur la possibilité de taxer davantage les boissons énergisantes (type Redbull®, Darkdog®, Burn®), dont la consommation explose chez les jeunes en association avec les alcools forts.
ANJAP Association nationale des juges de l’application des peines
ANPAA Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
CAARRUD Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues
CCAA Centre de cure ambulatoire en alcoologie
COD Convention départementale d’objectifs
CSAPA Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en alcoologie
CSST Centre spécialisé de soins aux toxicomanes
DAP Direction de l’administration pénitentiaire
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DGS Direction générale de la santé
DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
ENM Ecole nationale de la magistrature
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGSJ Inspection générale des services judiciaires
IPM Ivresse publique et manifeste
MILDT Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies
ONDAM Objectif national des dépenses de l’assurance maladie
SMPR Service médico-psychologique régional
SPIP Service pénitentiaire d’insertion et de probation
SROS Schéma régional d’organisation sanitaire
UCSA Unité de consultation et de soins ambulatoires
UHSA Unité hospitalière spécialement aménagée
UHSI Unité hospitalière sécurisée interrégionale
UMD Unité pour malades difficiles
LEXIQUE
Conventions departementales d’objectifs
Les conventions départementales d’objectifs (CDO) ont été mises en place en 1993 (par une circulaire interministérielle du 14 janvier 1993), afin d’améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes sous main de justice.
Ces conventions proposent des réponses adaptées aux besoins identifiés dans les départements par les autorités judiciaires et les services du ministère de la Justice, conjointement avec les autorités sanitaires et en liaison étroite avec le chef de projet départemental de la MILDT. En 1999, les conventions départementales d’objectif ont été généralisées et étendues à la prise en charge des personnes placées sous main de justice rencontrant des difficultés avec l’alcool.
Ces conventions sont signées par les préfets de département et par les procureurs de la République. Les chefs de projet MILDT, présents dans chaque département, sont chargés de la coordination et de l’animation du dispositif.
Les conventions, dont la durée peut aller d’un à trois ans, doivent intégrer les données suivantes : la durée de la conservation ; le type de prestations dispensées par la ou les associations partenaires ; le nombre de personnes prises en charge ; les modalités d’accueil du public ; la répartition des responsabilités entre les acteurs sanitaires et sociaux et les autorités judiciaires ; le montant des crédits octroyés et les différents financeurs (ministère de la Santé, de la justice, MILDT, assurance-maladie…) ; les modalités d’évaluation du dispositif.
Centre de soins, d’accompagnement et de prevention en addictologie (CSAPA)
Les CSAPA, visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ont été créés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Le cadre juridique des CSAPA a vocation à fusionner celui des centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA). Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une fusion des établissements, les décrets (107) instaurant les CSAPA engageant avant tout la constitution d’un statut juridique commun pour les CCAA et CSST appelés ainsi à devenir CSAPA. C’est dans un second temps que doit se poser la question de la fusion des établissements, d’abord pour réduire le nombre de gestionnaires notamment associatifs en les regroupant pour constituer une masse critique suffisante, ensuite pour rapprocher autour de leurs points communs les activités spécialisées en alcoologie et en toxicomanie.
Comme le souligne une circulaire du ministère de la Santé de 2006 (108), le projet de réforme prévoit un noyau commun de missions qui incomberaient à chaque CSAPA et une possibilité de spécialisation. Ainsi, tous les CSAPA seraient dans l’obligation d’assurer l’accueil, l’information, l’évaluation clinique et l’orientation de toute personne dépendante aux substances psychoactives. Concernant la prise en charge médicale, psychosociale et éducative, les CSAPA auraient la possibilité de spécialiser leur activité sur le versant toxicomanie et/ou le versant alcool.
Injonction de soins
Prévue aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, l’injonction de soins est une mesure prononcée, s’il est établi après une expertise médicale que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement : d’une part, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ; d’autre part, d’une surveillance judiciaire, d’une libération conditionnelle ou d’un contrôle judiciaire, à l’encontre d’une personne ayant commis une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne, mais si celle-ci refuse les soins proposés elle encourt, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, une peine d’emprisonnement. L’injonction de soins, de facultative, est devenue automatique, sauf décision contraire de l’expert ou du juge, avec la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (article 131-36-4 du code pénal).
Pour sa mise en oeuvre, le juge de l’application des peines désigne un médecin coordonnateur qui, en liaison avec le médecin traitant, s’assure de son déroulement et en réfère au magistrat.
Ivresse publique et manifeste
L’ivresse publique et manifeste est, depuis une loi de 1873, une infraction, aujourd’hui régie par le code de la santé publique, qui, à son article L. 3341-1, dispose qu’« une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ». L’article R. 3353-1 du même code précise en outre que « le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe », soit, aux termes de l’article 131-13 du code pénal, 150 euros au plus.
Obligation de soins
Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, l’obligation de soins est une mesure prononcée, selon les cas, par la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines, avec ou sans expertise médicale préalable, qui impose à un condamné de se soumettre à des soins et à un suivi médical pendant un temps déterminé (article 132-45 du code pénal).
Personnes placées sous main de justice
La population des personnes placées sous main de justice comprend d’une part les détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ainsi que les personnes condamnées en milieu ouvert (travail d’intérêt général, libération conditionnelle…) ou bénéficiant d’un aménagement de peine. Ces dernières sont suivies par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), si elles sont majeures, ou par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), si elles sont mineures.
Services médico-psychologiques régionaux (SMPR)
Institués par le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique, les services médico-psychologiques régionaux, implantés soit dans des maisons d’arrêt, soit dans des centres pénitentiaires et rattaché à un établissement hospitalier, assurent les soins psychiatriques des personnes détenues.
Ces services constituent des secteurs de psychiatrie rattachés à un établissement hospitalier (CHU, centre hospitalier régional ou hôpital psychiatrique). Ils sont animés par une équipe pluridisciplinaire associant psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux et travailleurs éducatifs. Ils exercent principalement trois missions : recevoir systématiquement toutes les personnes arrivant dans l’établissement pénitentiaire d’implantation, assurer le suivi au cours de l’incarcération et préparer la mise en place du suivi postpénal.
Au nombre de 26, les SMPR comportent 380 lits, ce qui permet d’assurer essentiellement une prise en charge médicale de jour. Seuls deux SMPR, ceux des établissements pénitentiaires de Fresnes et des Baumettes à Marseille, disposent d’une couverture paramédicale nocturne au sein d’unités psychiatriques hospitalières (respectivement quarante-sept et trente-deux places).
Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)
Créé par le décret n° 99-276 du 13 avril 1999, modifiant le code de procédure pénale et visé aux articles D. 572 et suivants du même code, le service d’insertion et de probation (SPIP) est un service déconcentré de l’administration pénitentiaire dans chaque département, placé sous l’autorité du directeur régional des services pénitentiaires. Il assure le contrôle et le suivi des peines exécutées en milieu ouvert et en milieu fermé. Il est à ce titre le garant de la cohérence de la prise en charge et du suivi des personnes placées sous main de justice, puisqu’elles sont suivies par le même service, quelle que soit leur situation pénale. Service à compétence départementale, il est organisé différemment selon la taille du département et le nombre de juridictions et d’établissements pénitentiaires. Dans les départements les plus importants, le service se démultiplie auprès des juridictions et des établissements pénitentiaires sous la forme d’«antennes».
Le SPIP exerce plusieurs missions : accueil des personnes placées sous main de justice, incarcérées ou non, suivi de leur situation, contrôle des obligations auxquelles elles doivent se soumettre, information des autorités judiciaires sur le déroulement des mesures ; aide à la décision judiciaire : l’autorité judiciaire doit être destinataire de toutes les données qui lui permettent de mieux individualiser la peine et de prononcer des aménagements de peine les plus adaptés à la situation de la personne ; développement et coordination d’un réseau de partenaires institutionnels, associatifs et privés afin de donner aux personnes placées sous main de justice toutes les opportunités d’insertion en les orientant vers les dispositifs de droit commun : accès aux droits sociaux, aux soins, à l’éducation pour la santé, à la formation professionnelle, à l’action culturelle, au sport, au travail, à l’enseignement. Un accent particulier est apporté à la lutte contre l’indigence, contre l’illettrisme et contre la toxicomanie. Pour les personnes incarcérées, la préparation à la sortie de prison est l’objectif prioritaire.
Pour assurer ses missions, le SPIP est en relation étroite avec les autorités judiciaires, le directeur de l’établissement pénitentiaire, mais aussi avec tous les chefs de service du département dont l’action est coordonnée par le préfet, avec les collectivités territoriales, les associations et les réseaux d’employeurs.
Suivi socio-judiciaire
Institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire, prévu aux articles 131-36-1 et suivants du code pénal et 763-1 et suivants du code de procédure pénale, est une peine qui peut être prononcée par les juridictions répressives à l’encontre des personnes condamnées pour certaines catégories d’infractions. Il est le plus souvent prononcé en sus d’une peine privative de liberté.
La mesure de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi. Initialement encourue pour les infractions à caractère sexuel, elle peut désormais être appliquée, depuis la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, aux autres infractions les plus graves (actes de torture et de barbarie, meurtres, pyromanie…).
Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d’assistance et de surveillance qui s’appliquent à compter de la libération de la personne. Avant 2007, la juridiction avait la possibilité d’assortir ce suivi d’une injonction de soins, dans l’hypothèse où une expertise préalable de la personne poursuivie avait conclu que celle-ci était susceptible de faire l’objet d’un traitement. Alors que ce n’était jusqu’à présent qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du juge, après expertise médicale, la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs prévoit désormais qu’au stade de la condamnation, tout suivi socio-judiciaire s’accompagne d’une injonction de soins, à la double condition que l’expertise préalable y ait conclu favorablement et que le juge ne décide pas d’y renoncer.
Les obligations fixées par la décision de condamnation au suivi socio-judiciaire s’appliquent à compter de la libération de la personne pour une durée également fixée par la juridiction de jugement qui ne peut, en principe, dépasser dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle.
Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
La loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a mis en place les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) : ces unités sont des services hospitaliers implantés en milieu pénitentiaire et placés sous la responsabilité d’un chef de service. Elles assurent les soins somatiques et psychiatriques incluant la prévention, l’organisation des soins en milieu hospitalier ainsi que la continuité de soins à la sortie de détention.
L’article D. 368 du code de procédure pénale (décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998, art. 90 et 96, Journal Officiel du 9 décembre 1998) dispose à ce titre que « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. »
Unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)
Instituées en application de l’article 48 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, les unités hospitalières spécialement aménagées, implantées dans des établissements de santé et sécurisées par l’administration pénitentiaire, assurent l’hospitalisation avec ou sans consentement des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Il était initialement prévu que les neuf premiers de ces établissements ouvrent entre 2008 et 2010, pour une capacité globale de 450 places. Selon les informations communiquées par l’administration pénitentiaire, la mise en service de ces établissements devrait, en fait, s’échelonner de novembre 2009, pour le premier, implanté à Lyon, à janvier 2011.
Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)
Prévues par la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et par le schéma national d’hospitalisation des personnes détenues, lui-même officialisé par l’arrêté interministériel du 24 août 2000, les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) assurent une prise en charge spécifique des personnes détenues, qui doivent faire l’objet d’une hospitalisation.
Véritables structures hospitalières implantées dans des centres hospitalo-universitaires (CHU), les UHSI reçoivent les détenus souffrant de pathologies somatiques (non psychiatriques) pour des séjours d’une durée supérieure à 48 heures, l’hôpital de proximité restant compétent dans les autres cas. Les personnes détenues y sont encadrées par des personnels pénitentiaires et prises en charge médicalement par des personnels hospitaliers. La sécurité de ces unités est également assurée par les forces de l’ordre.
Unités pour malades difficiles (UMD)
Structure à vocation interrégionale, implantée dans un centre hospitalier spécialisé, réservée, aux termes de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles, à l’hospitalisation à temps complet des patients qui présentent pour autrui un danger certain et imminent tel qu’ils nécessitent des protocoles thérapeutiques adaptés et des mesures de sécurité particulières, et ne peuvent demeurer dans une unité de soins classique. L’originalité de ces structures est qu’elles ne sont pas réservées aux détenus. Elles sont en effet appelées à recevoir l’ensemble des malades dont le comportement est considéré comme dangereux pour autrui, y compris des personnes non détenues. Les patients sont tous hospitalisés sous le régime de l’hospitalisation d’office.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Ministère de la Justice
- Direction des affaires criminelles et des grâces
§ M. Cyril LACOMBE, chef du pôle d’évaluation des politiques pénales ;
§ Mme Marie LIEBERHERR, chef du bureau « exécution des peines et des grâces » ;
§ Mme Françoise BAÏSSUS, chef du bureau « santé publique, droit social et environnement ».
- Direction de l’administration pénitentiaire
§ M. Jean-François BEYNEL, chef de service, adjoint du directeur ;
§ Mme Cécile BRUNET-LUDET, chef du bureau « Politiques sociales et insertion » ;
§ Mme Dominique de GALARD, conseiller santé en milieu pénitentiaire.
- Ecole nationale de la magistrature
§ M. Jean-François THONY, directeur ;
§ M. Denis BAILLARD, sous-directeur des études ;
§ Mme Isabelle SCHMELCK, sous-directrice de la formation continue.
- Ecole nationale de l’administration pénitentiaire
§ Mme Valérie DECROIX, directrice.
- Inspection générale des services judiciaires
§ M. Dominique LUCIANI, inspecteur des services judiciaires.
Ministère de la Santé
- Direction générale de la santé
§ M. Didier HOUSSIN, directeur général ;
§ M. Pascal MÉLIHAN-CHEININ, chef du bureau « Pratiques addictives ».
- Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
§ Mme Annie PODEUR, directrice ;
§ Mme Christine BRONNECH, chef du bureau de l’offre régionale de soins et des populations spécifiques (O2).
- Inspection générale des affaires sociales
§ M. André NUTTE, chef de l’inspection.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
§ M. Jean-Marie DELARUE.
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
§ M. Etienne APAIRE, président ;
§ Mme Ruth GOZLAN, médecin.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
§ Mme Thanh Le LUONG, directrice ;
Inspection générale de l’administration
§ M. Yvan BLOT, inspecteur général de l’administration ;
§ M. Ramiro RIERA, inspecteur général de l’administration.
Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire
§ Docteur Catherine PAULET, présidente (SMPR de Marseille) ;
§ Docteur Françoise HUCK, vice-présidente (SMPR de Strasbourg) ;
§ Docteur Gérard LAURENCIN, trésorier (SMPR de Toulouse).
Association des professionnels de santé exerçant en prison et syndicat des médecins exerçant en prison
§ Docteur Valérie KANOUI (UCSA de Fleury-Mérogis) ;
§ Docteur Patrick SERRE (UCSA du Mans) ;
§ Mme Laura HARCOUËT, pharmacienne (UCSA de la Santé).
Association nationale des juges de l’application des peines
§ Mme Martine LEBRUN, présidente ;
§ M. Ludovic FOSSEY, secrétaire général.
Observatoire international des prisons
§ M. François BES, coordinateur national ;
§ M. Hugues de SUREMAIN, juriste ;
§ M. Philippe CARRIÈRE, médecin psychiatre.
Première table ronde sur la prévention et la prise en charge des infractions liées à l’alcool (mercredi 17 décembre 2008)
§ Docteur Alain RIGAUD, président de l’ANPAA ;
§ Mme Delphine JARRAUD, adjointe à la direction des activités de l’ANPAA ;
§ Docteur Patrick FOUILLAND, président de la fédération des acteurs de l’alcoologie et d’addictologie ;
§ Docteur Patrick FASSEUR, psychiatre ;
§ Docteur Michel BURGER, psychiatre ;
§ Mme Agnès DUMAS, sociologue.
Deuxième table ronde sur la prévention et la prise en charge des infractions liées à l’alcool (mardi 31 mars 2009)
§ Mme Catherine LEBRUN-LEGENT, intervenant en alcoologie au Havre ;
§ Mme Marie GRANDJEAN, commissaire de police au Havre;
§ Docteur Danielle CASANOVA, médecin coordonnateur au comité de l’ANPAA 84 (Vaucluse) ;
§ Mme Sylvie CATTO, conseillère en alcoologie dans le département de Saône et Loire (71) ;
Table ronde avec les syndicats de magistrats
- Union syndicale des magistrats
§ M. Laurent BEDOUET, secrétaire général ;
§ Mme Virginie VALTON, secrétaire nationale.
- Syndicat de la magistrature
§ Mme Emmanuelle PERREUX, présidente.
- Syndicat national des magistrats
§ Mme Naïma RUDLOFF, secrétaire générale.
Table ronde avec les syndicats des personnels de l’administration pénitentiaire
- Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire
§ Mme Sophie DESBRUYERES, secrétaire générale ;
§ M. Sylvain ROUSSILLOUX, secrétaire national.
- Union fédérale autonome pénitentiaire
§ M. Jean-François FORGET, secrétaire général.
- Union générale des syndicats pénitentiaires - CGT
§ M. Jérôme MARTHOURET, référent national pour les travailleurs sociaux pénitentiaires.
- Syndicat national pénitentiaire FO des personnels de surveillance
§ M. Christophe MARQUES, secrétaire général ;
§ M. René SANCHEZ, secrétaire général adjoint.
- Syndicat national pénitentiaire FO des personnels techniques
§ M. Adhérald HOURNON, secrétaire général adjoint.
- Syndicat national pénitentiaire FO des personnels d'administration et d'intendance
§ Mme Annie SCOTTON, secrétaire générale.
Personnalités qualifiées auditionnées sur le thème de la psychiatrie en milieu pénitentiaire
§ Mme Christiane de BEAUREPAIRE, ex-chef de service du SMPR de la maison d’arrêt de Fresnes ;
§ Mme Catherine HERSZBERG, journaliste, auteur du livre « Fresnes, histoires de fous » ;
§ M. Pascal FORISSIER, expert psychiatre près la cour d’appel de Paris ;
§ Docteur Roland COUTANCEAU, psychiatre, président de la ligue française de santé mentale, fondateur d’une consultation post-pénale pour les personnes sous main de justice ;
§ Docteur Louis ALBRAND, auteur d’un rapport sur la prévention des suicides en prison ;
§ M. Edouard COUTY, conseiller maître à la Cour des comptes, auteur d’un rapport sur les missions et l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie ;
§ M. Pierre LAMOTHE, chef du SMPR de Lyon et futur chef de l’UHSA de Lyon.
Personnalités qualifiées auditionnées sur le thème « alcool et infractions »
§ Professeur Michel REYNAUD, chef du service de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse (Villejuif), président de la fédération française d’addictologie ;
§ Mme Claudine PÉREZ-DIAZ, chercheure au CNRS.
LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS
Maison d’arrêt de Fresnes (jeudi 15 janvier 2009)
§ M. Bruno HAURON, directeur de la maison d’arrêt ;
§ Les équipes soignantes de l’UCSA et du SMPR.
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (jeudi 5 février 2009)
§ M. Paul LOUCHOUARN, directeur de la maison d’arrêt ;
§ Docteur Michel FIX, médecin chef de l’UCSA ;
§ Les équipes soignantes de l’UCSA et du SMPR.
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie du Blanc-Mesnil (mercredi 6 mai 2009)
§ Docteur Anne TOULOUSE, médecin généraliste alcoologue ;
§ Docteur Pierre-Etienne MANUELLAN, médecin, directeur de la division santé ;
§ Mme Annabelle RODRIGUES, secrétaire médicale.
Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis (mardi 26 mai 2009)
§ Mme Bernadette LAURENT, directrice ;
§ Mme Noëlle BALLAY, directrice d’insertion et de probation pour le milieu ouvert ;
§ Mme Corinne GIRARD, chef de service à la maison d’arrêt de Villepinte.
Consultation post-pénale de l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif (mercredi 27 mai 2009)
§ Mme Christiane de BEAUREPAIRE, fondatrice de la consultation ;
§ Mme Magali BODON-BRUZEL, chef du SMPR de Fresnes ;
§ M. Jacques BERARD, adjoint au directeur de la stratégie et de la communication ;
§ Mme Dominique JOUANNEAU, cadre infirmier ;
§ M. Frédéric MOREAU, cadre infirmier.
ANNEXES
Annexe 1 : Exemples de SROS présentant une approche innovante en matière de prise en charge sanitaire des personnes incarcérées 199
Annexe 2 : Exemples de protocoles locaux conclus entre établissements pénitentiaires et centres hospitaliers 207
Annexe 3 : Tableaux statistiques sur les condamnations en lien avec l’alcool 229
Annexe 4 : Exemples de sessions de formation continue à l’École nationale de la magistrature en matière d’addictions 237
Annexe 5 : Tableau sur les partenariats entre services pénitentiaires d’insertion et de probation et centres d’alcoologie 243
ANNEXE 1 : EXEMPLES DE SROS PRÉSENTANT UNE APPROCHE INNOVANTE EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INCARCÉRÉES
Schéma régional d’organisation sanitaire de la région PACA


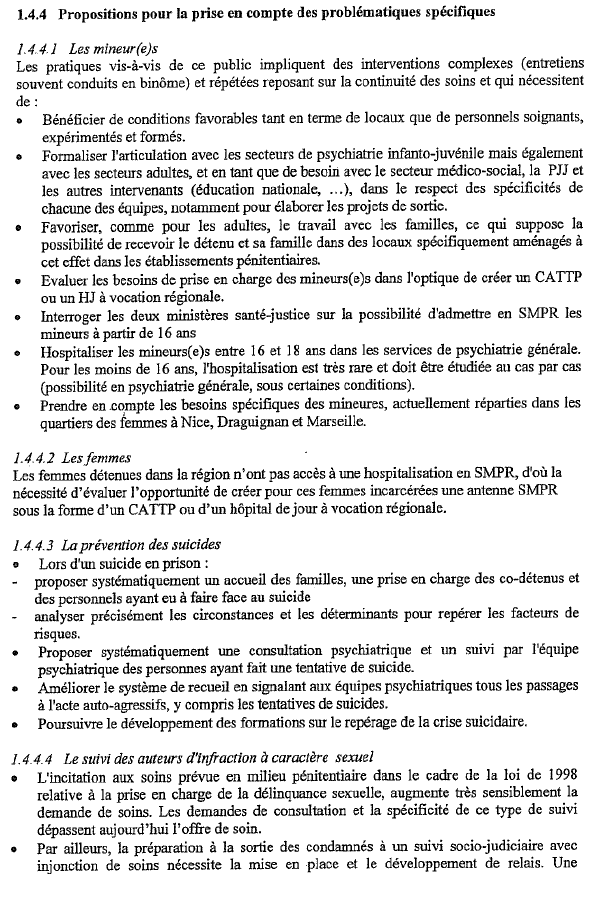

Schéma régional d’organisation sanitaire de la région Centre
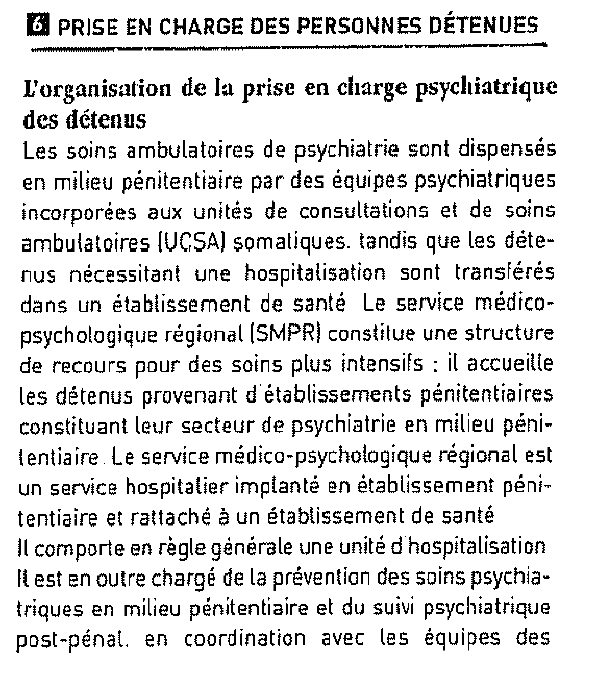
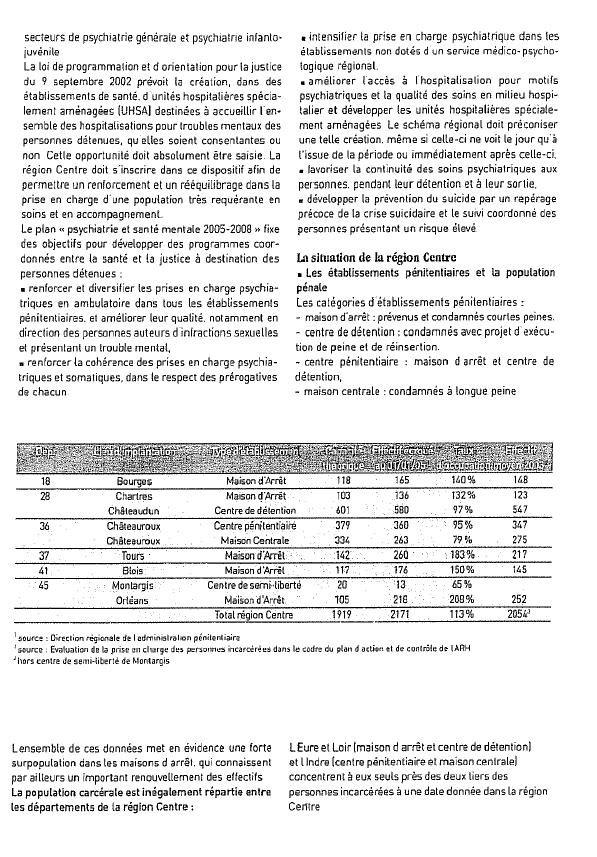
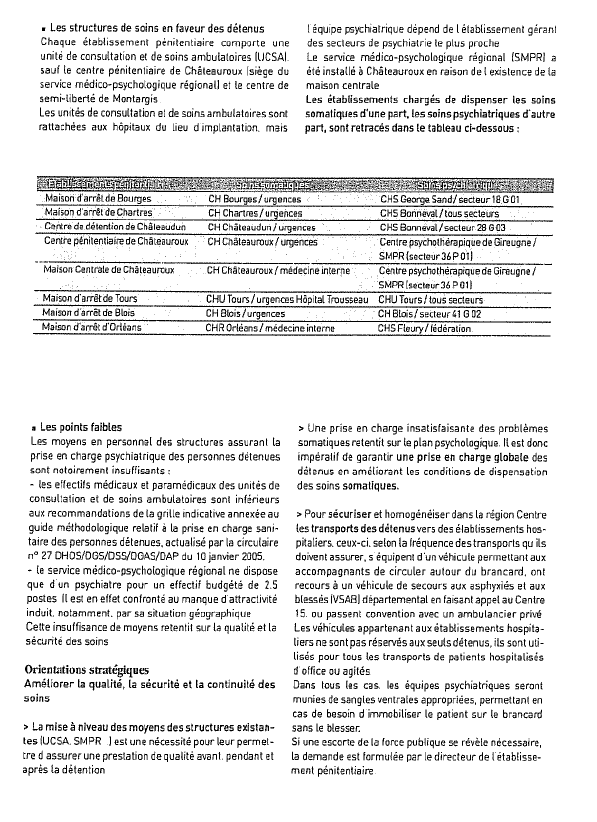
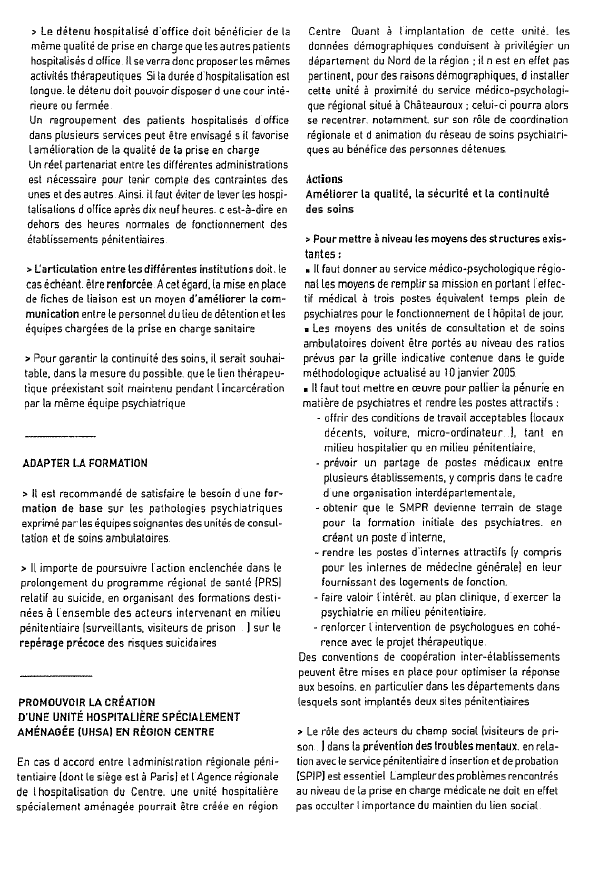

ANNEXE 2 : EXEMPLES DE PROTOCOLES LOCAUX CONCLUS ENTRE ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET CENTRES HOSPITALIERS
Protocole entre le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
et le centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire

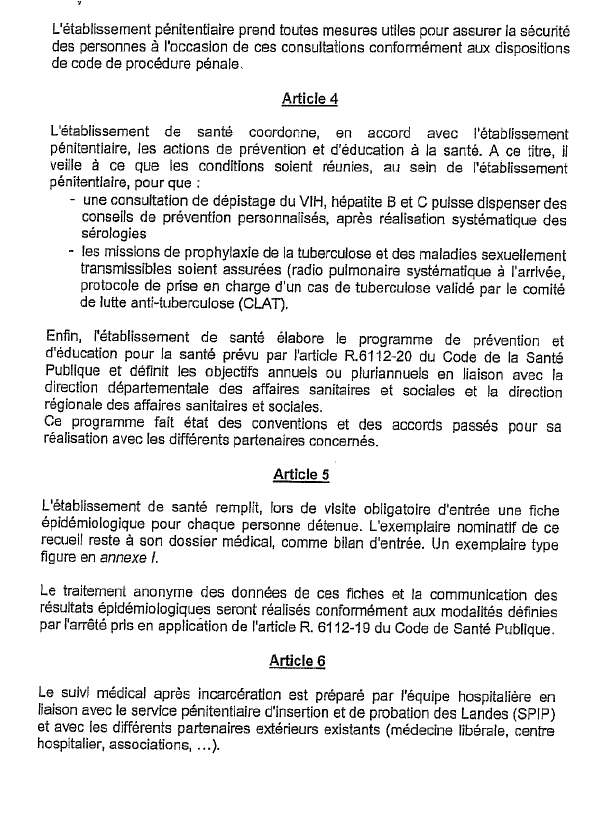

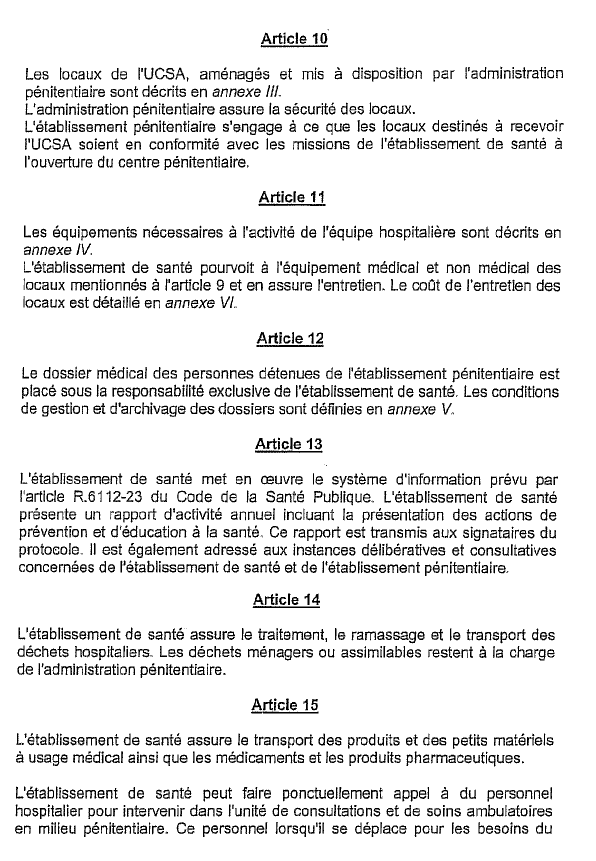
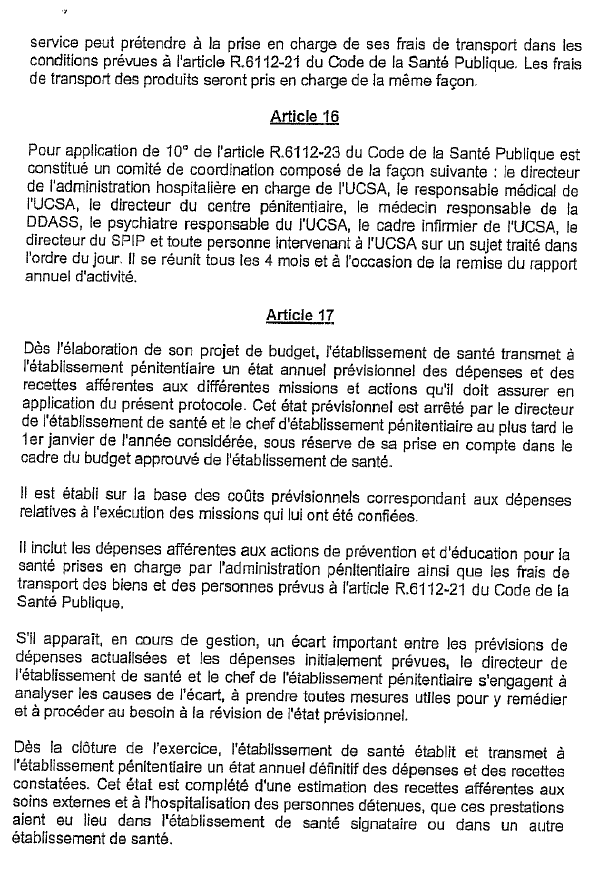

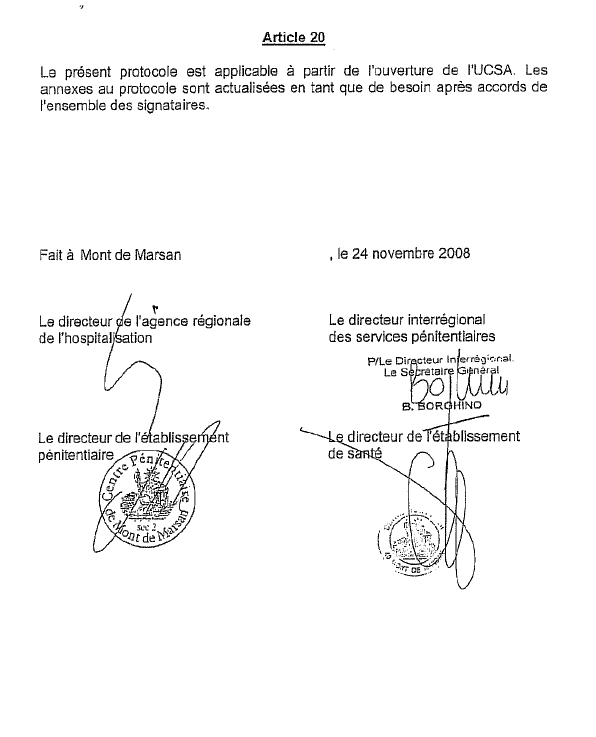
Protocole entre le centre hospitalier universitaire de Nantes et le centre pénitentiaire de Nantes

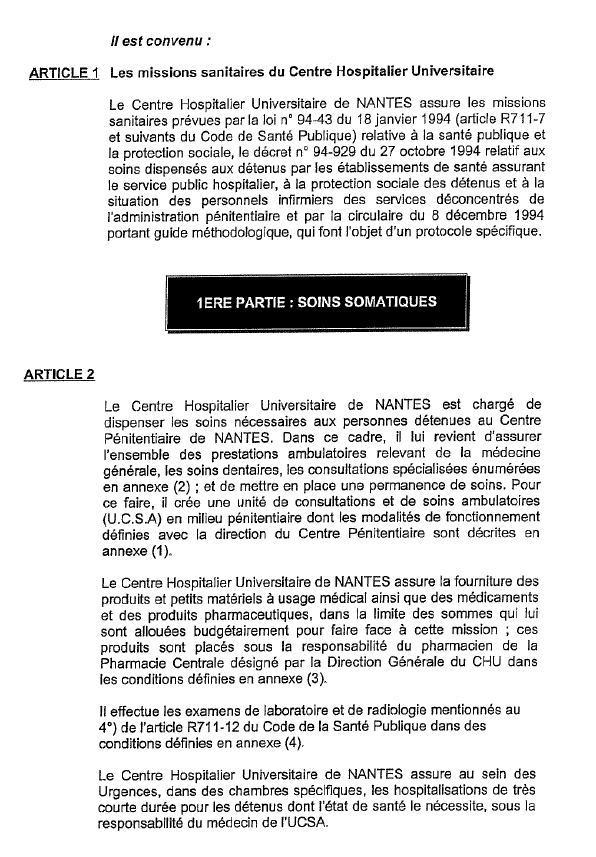
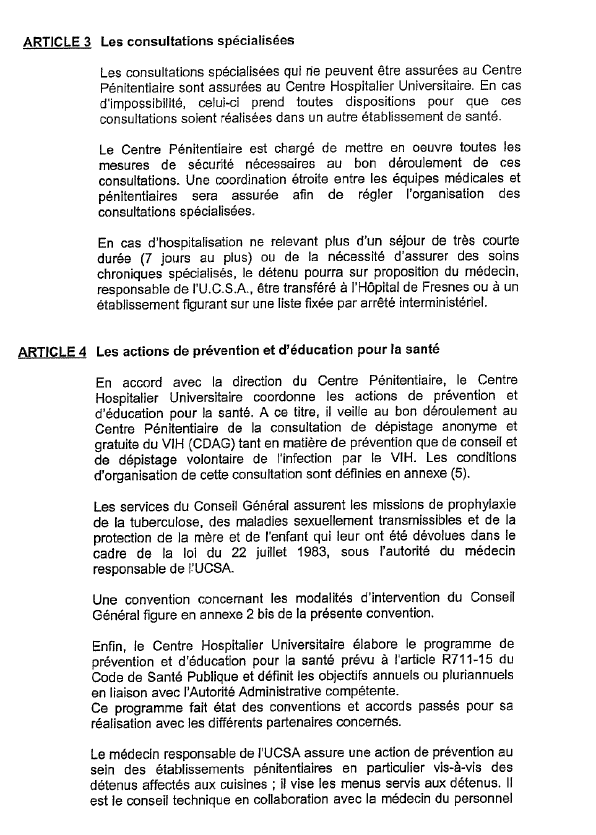

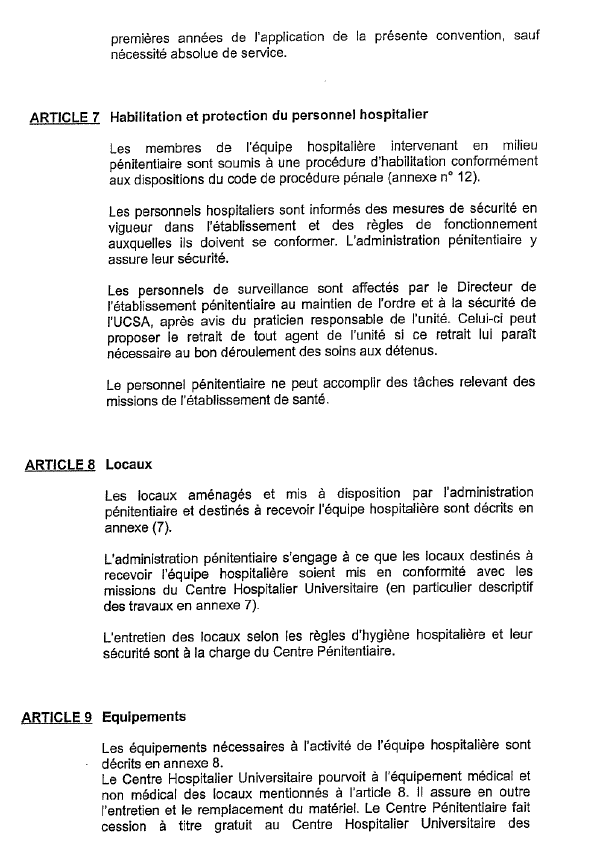
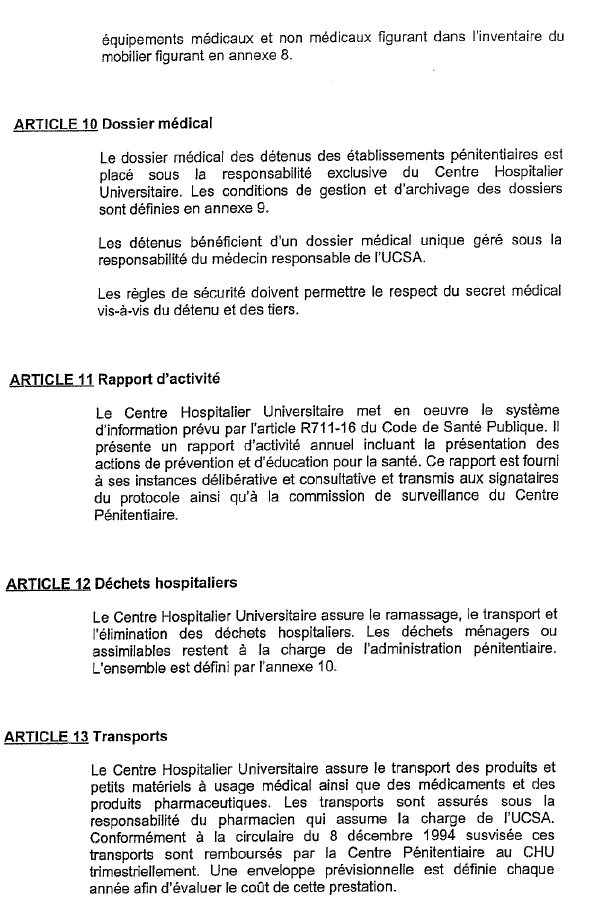

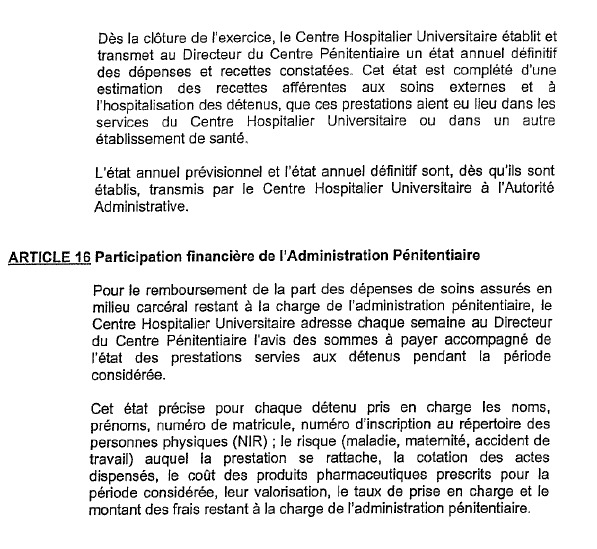
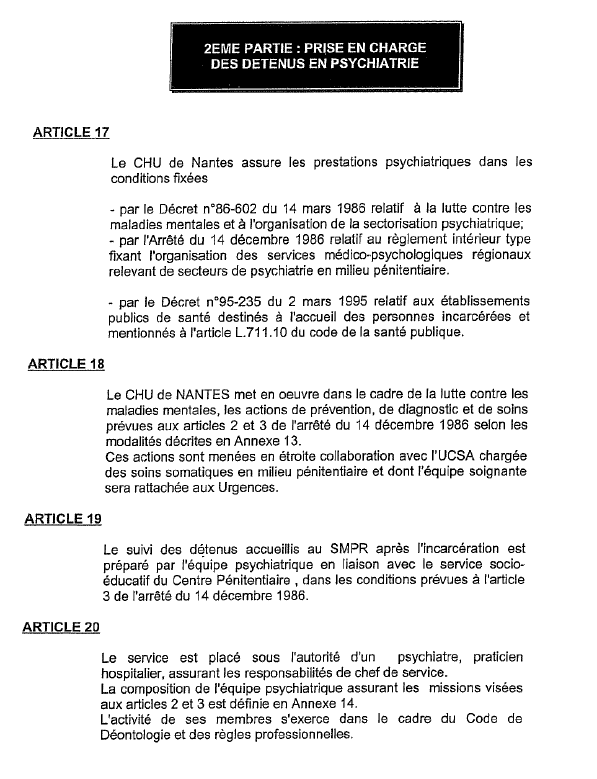
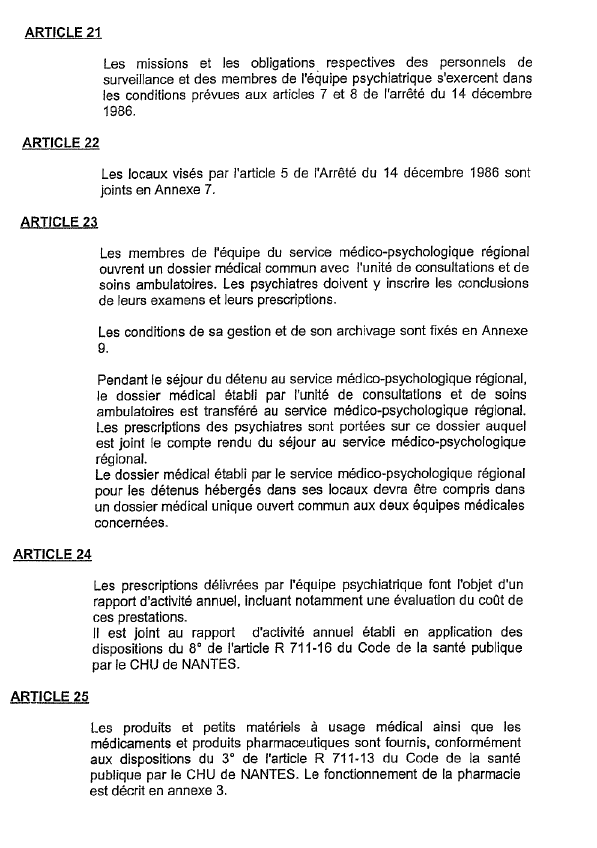
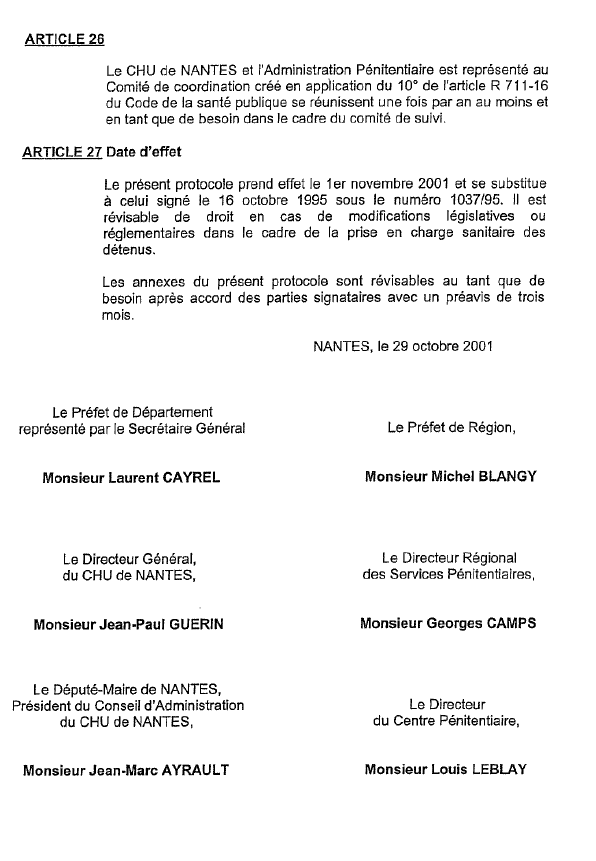
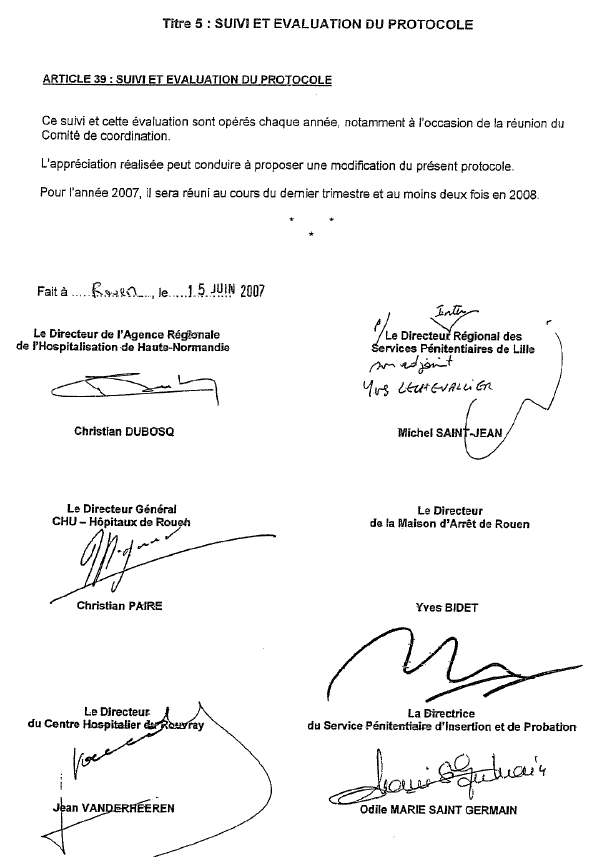
ANNEXE 3 : TABLEAUX STATISTIQUES SUR LES CONDAMNATIONS EN LIEN AVEC L’ALCOOL

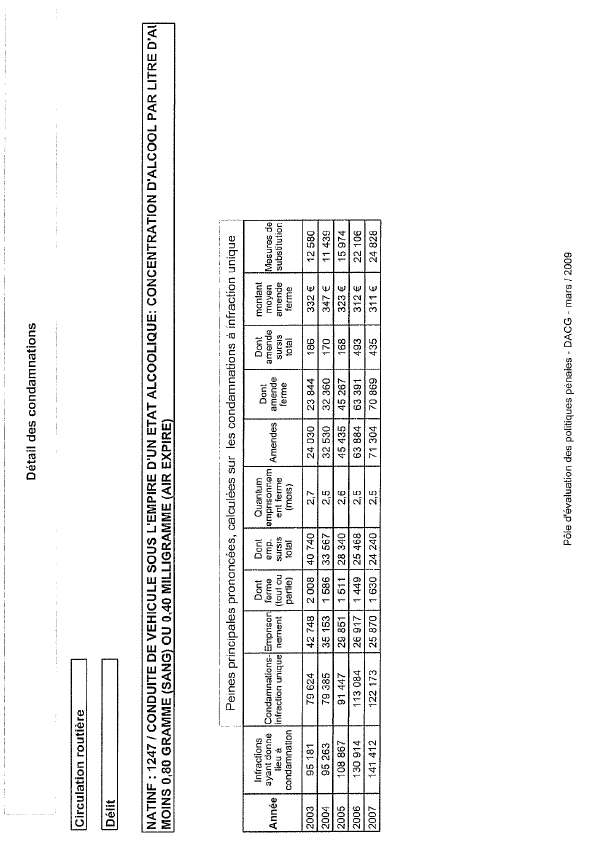

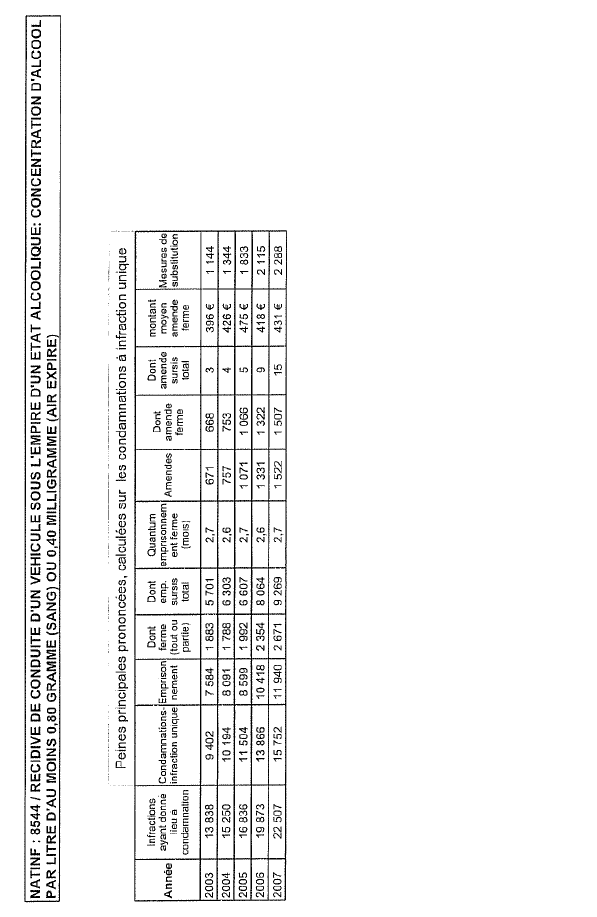
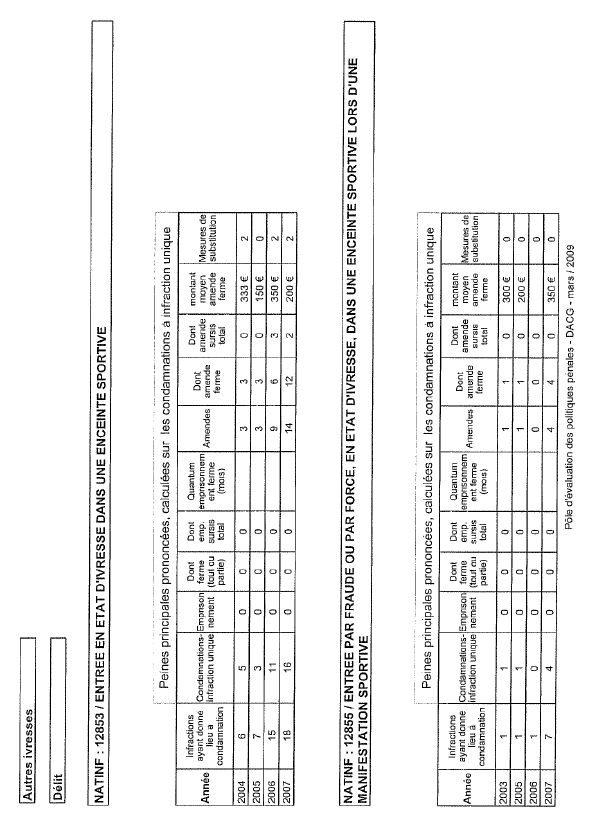
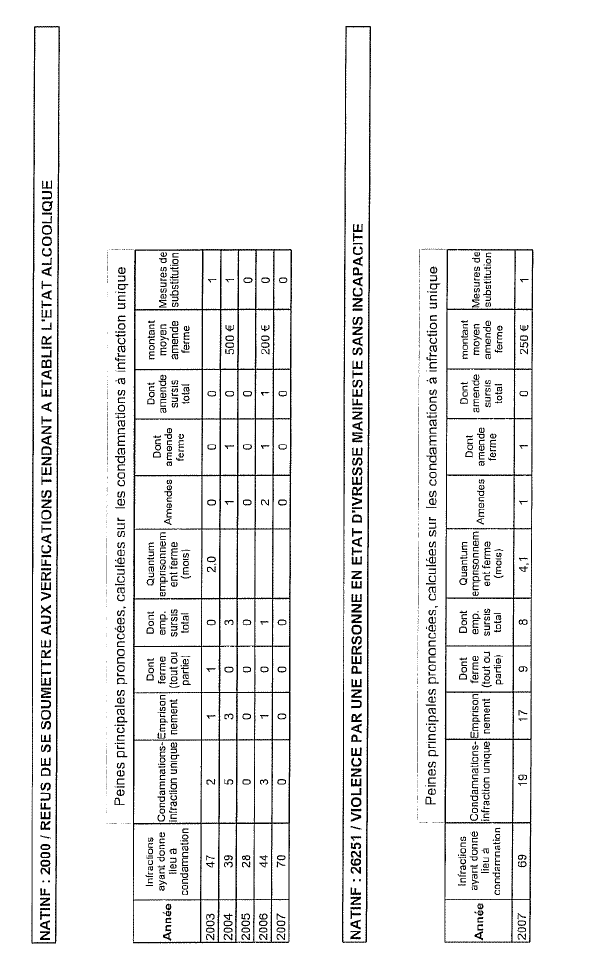
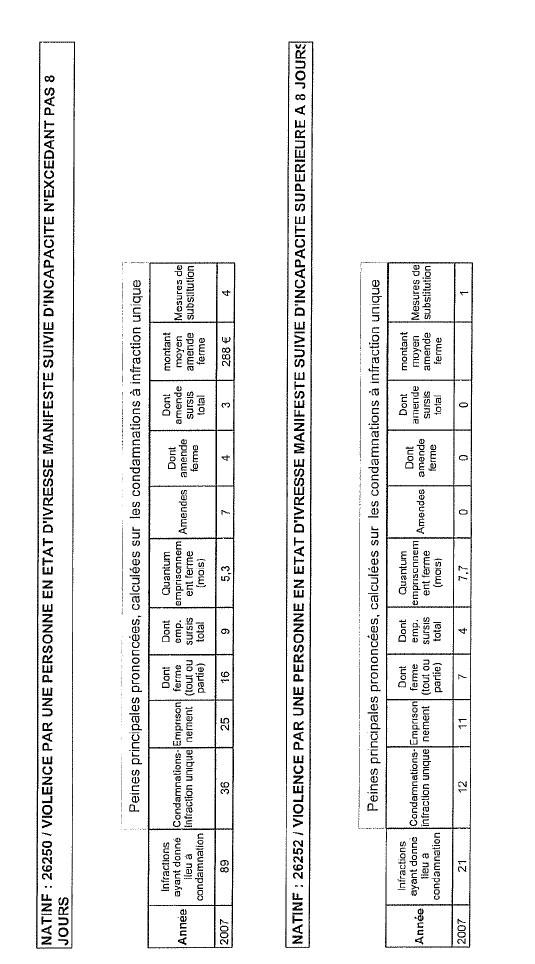
ANNEXE 4 : EXEMPLES DE SESSIONS DE FORMATION CONTINUE À L’ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE EN MATIÈRE D’ADDICTIONS
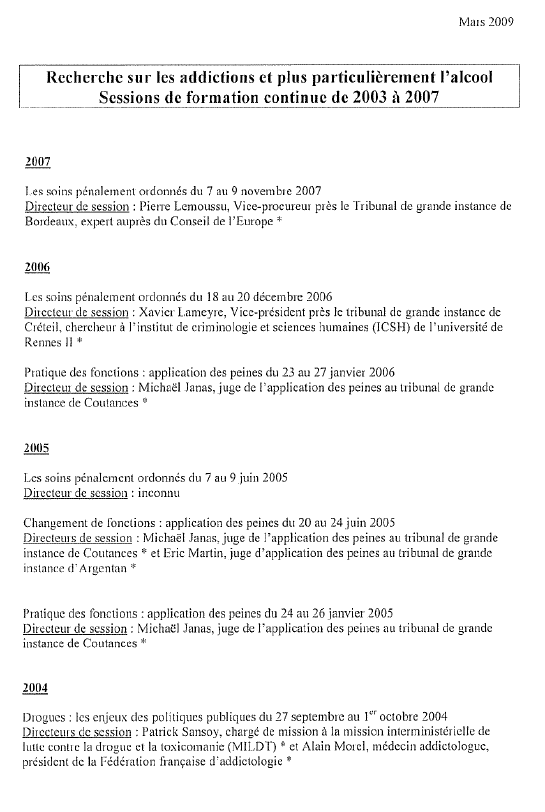
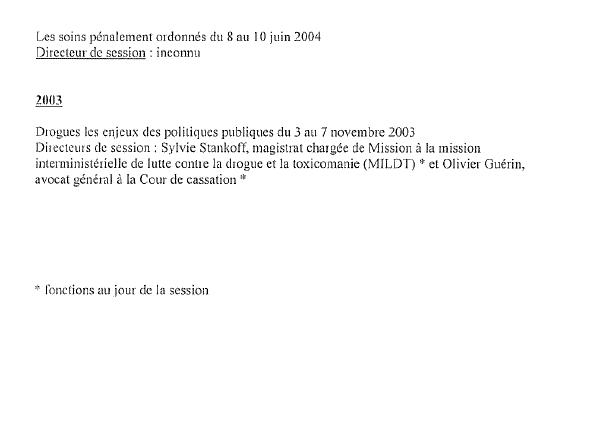
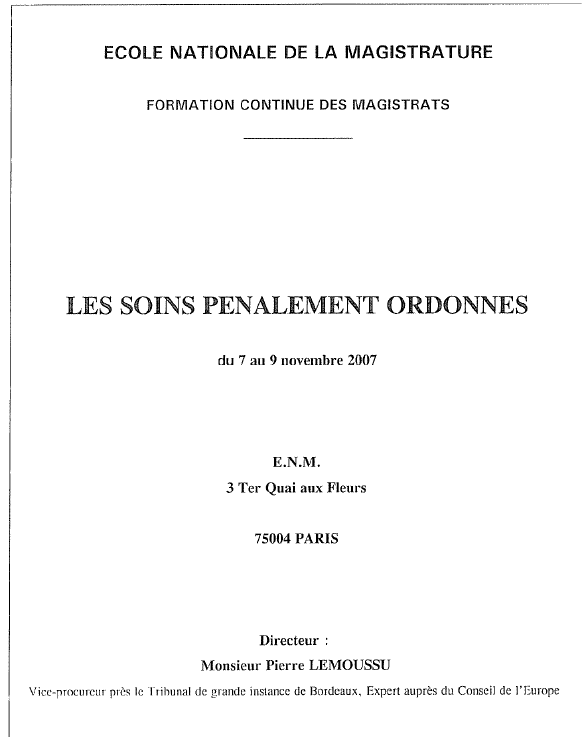


ANNEXE 5 : TABLEAU SUR LES PARTENARIATS ENTRE SERVICES PÉNITENTIAIRES D’INSERTION ET DE PROBATION ET CENTRES D’ALCOOLOGIE
Service pénitentiaire d’insertion et de probation |
Partenariats pour la prise en charge en centre alcoologie |
Délais d’attente pour la pris en charge en centre d’alcoologie |
Difficultés rencontrées pour la recherche, la mise en place et l’exécution des partenariats |
YVELINES |
• Partenariat de qualité mais problème du délai d’attente (environ 2 mois). |
• Délai d’attente de deux mois. Ensuite les condamnés ont une consultation par mois. |
• Délais longs et peu de consultations dans les centres d’alcoologie. Projet de passer un accord avec un centre d’alcoologie. |
SAVOIE |
• Partenariats avec le CCAA de Chambéry, l’ANPAA, le CCAA d’Albertville, le CCST « le pélican ». • Accord de travail avec l’ANPAA et « le pélican ». Travail également avec les unités d’alcoologie hospitalières et certains médecins généralistes. |
• Prise en charge dans le mois qui suit le premier entretien au SPIP. |
• Démarches chronophages et reposent pour l’essentiel sur l’encadrement du SPIP. |
HAUTE-SAVOIE |
• Nombre important de condamnés qui ne sont pris en charge que si une place est disponible. • Les centres d’alcoologie de l’ANPAA ont mis en place pour réduire les files d’attentes des prises en charge collective : les condamnés sont inscrits dans un cycle de groupe de parole. Cette modalité qui se substitue à la prise en charge individuelle est acceptée par les juges de l’application des peines. |
• Délai minimum de trois mois avant d’être pris en charge. |
— |
CREUSE ET HAUTE-VIENNE |
• Partenariat avec des structures associatives (ANPAA notamment) et parfois orientation vers les services hospitaliers ou praticiens spécialisés. |
• Délai d’un à deux mois avec une effectivité est très variable. |
• Problème de collaboration de certains praticiens à la mise en œuvre de l’obligation de soins. |
INDRE |
• Prise en charge des centres d’alcoologie : collaboration avec l’ANPAA 36. Orientations faites par le SPIP et condamné reçu par l’ANPAA. |
• Délai de deux mois avant d’être reçu par l’ANPAA. |
• Pas de grandes difficultés dans le cadre du développement du partenariat, le réseau répondant globalement aux besoins. Néanmoins il conviendrait de développer le réseau afin de le diversifier. |
GUADELOUPE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : par le COREDAF, les CMP et le réseau d’addiction de la Guadeloupe. |
• Les réponses des organismes sont rapides, le délai moyen se situant entre 15 jours et un mois. |
• Le tissu associatif est insuffisant ou peu orienté dans la prise en charge des personnes sortant de prison. |
CÔTES D’ARMOR |
• Protocoles de fonctionnement avec les trois CCAA du département et un CMP spécialisé dans l’addictologie. Relations régulières et faciles. |
• La création du BEX et de l’application de l’article D 474 du CPP a réduit le délai de prise en charge. Lorsque cette mesure est appliquée, la personne est reçue dans le mois suivant sa condamnation. |
• Il est parfois difficile de faire reconnaître le public incarcéré comme un public relevant du droit commun. |
AUBE ET HAUTE-MARNE |
• La convention départementale d’objectif permet la prise en charge par l’ANPAA de l’Aube. Il en est de même dans la Haute-Marne. Partenariat également avec des associations : pour placement extérieur et de PSE. |
• Le SPIP ne peut pas obliger une personne à engager des soins auprès d’une structure déterminée. Néanmoins la mise en place d’un premier rendez-vous se fait généralement dans le mois qui suit l’orientation par le CIP et les rendez vous sont ensuite espacés de trois mois. |
• Partenaires inquiets de l’augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles du comportement ou psychiatriques. • De plus en plus difficile de mobiliser les partenaires et de trouver les solutions. Les structures hospitalières et les pompiers se désengagent, les communes sont plus réticentes. • Tendance à considérer que les personnes condamnées relèvent de l’État et que dès lors, il lui appartient de trouver des solutions. |
VENDÉE |
• Partenariat avec l’ANPAA et soutien de financement de temps supplémentaires de psychologues par le FIPD. |
• Centres d’alcoologie : pas d’information. |
— |
TARN-ET-GARONNE ET GERS |
• L’ANPAA, les alcooliques anonymes et l’association Vie Libre rencontrent les personnes sous main de justice. |
• Les délais sont variables et parfois rapides. |
• Essoufflement de certaines structures partenaires sollicitées depuis de nombreuses années. • Absence de lieux d’accueil spécifique avec encadrement psychosocial. • Absence totale de structures d’accueil sur certaines zones rural du département. Le SPIP se heurte au refus des collectivités territoriales et à l’inexistence de partenaires associatifs. • Manque de mobilité des personnes sous main de justice et absence corrélative de transports collectifs. • Pour les partenariats : manque de structures, nombre important d’associations qui ont des difficultés financières, insuffisance des budgets. |
CORRÈZE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : collaboration avec l’ANPAA. |
• Centre d’alcoologie : dès le premier entretien avec le CIP, l’intéressé est orienté vers la structure qui le convoque dans les deux mois qui suivent. |
— |
ILLE-ET-VILAINE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : le partenariat avec les CCAA est très variable et parfois difficile. |
• Délai très aléatoire. |
• Pour les CCAA : problème du secret médical qui empêche le suivi. |
LOIRET |
• Prise en charge centre alcoologie : structures ambulatoires et établissements de cure avec hébergement. |
Délais variables en fonction des délais de saisine des magistrats. |
— |
LE VAL-D’OISE |
• Partenariat avec l’ANPAA (et notamment les CCAA), services hospitaliers ayant créé leur propre service d’alcoologie dans les communes qui ne disposent pas de centre. |
• Le délai est assez long : les rendez vous sont fixés à trois mois voir plus. Mais le dispositif CIPA (conduite sous influence de produits psycho actifs) créé par le SPIP, une personne condamnée pour CEA obtient un rendez vous dans les 15 jours. |
• Parfois les partenaires ne sont pas adaptés à la gestion de « détenus difficiles ». • Pas assez de travailleurs sociaux et surtout pas assez de cadres administratifs formés. |
VAUCLUSE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : ANPAA avec les CCAA. Réunions collectives avec l’ANPAA. |
• Prise en charge environ un mois après orientation du SPIP. |
— |
VAL-DE-MARNE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : pas d’information réelle si ce n’est que les partenariats sont bons. • Prise en charge dans les structures de santé mentale : les relations avec les CMP sont difficiles. |
• Pour les mesures individuelles : la mesure est rapide car elle fait l’objet d’une affectation prioritaire à un CIP dès saisine du SPIP. Le délai de mise à exécution matérielle peut néanmoins varier de quelques semaines à un mois. • Pour les mesures collectives : elles sont mises en place sur les dates définies en accord avec les partenaires. Elles passent par la constitution d’un groupe de 10 personnes en moyenne et le petit nombre de stage proposé sur une année peut entraîner des délais longs. |
• Une des difficultés réside dans le caractère non pérenne des budgets d’une année sur l’autre. Il est ainsi impossible de prévoir une programmation pluri annuelle. • Caractère ponctuel de ces actions lié à l’insuffisance des budgets et des ressources humaines accroît la surcharge de travail et nécessite une mobilisation importante des moyens humains pour l’accompagnement des partenaires. |
PYRÉNÉES ORIENTALES |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : ANPAA, AFCO et une association (AREA). |
• Les délais sont de trois semaines. |
• Manque de ressources humaines et principalement au niveau de l’encadrement intermédiaire en milieu ouvert. |
DORDOGNE |
• Partenariat financé par la CDO. Parfois travail avec les médecins traitants faute de permanence décentralisée et compte tenu des difficultés de mobilité des personnes prises en charge. |
• Prise en charge dans les deux mois qui suivent la saisine. |
• Pour les centres d’alcoologie : pas de permanence décentralisée. Département très étendu et rural. Défaut de mobilité. • Manque de ressources humaines suffisantes pour développer de nouvelles actions ainsi que le réseau partenarial et assurer une prise en charge rapide et adaptée. • Baisse de financement CDO et baisse de l’activité des partenaires dans le champ des addictions. • Difficulté de l’accomplissement des missions. |
SEINE-ET-MARNE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : CCAA de l’ANPAA. • Dans le cadre d’une obligation de soins, stage collectifs de sensibilisation. • Orientation vers les CMP. |
• Les délais moyens de mise en œuvre sont relativement longs et dépendent des moyens et des effectifs dont dispose le SPIP. Ainsi, certains dossiers ne sont pris en charge que 8 à 9 mois après saisine. S’agissant des soins, les personnes sous main de justice ne sont pas prioritaires pour les partenaires. Les structures spécialisées sont insuffisantes et dès lors les délais sont longs. |
• Les associations partenaires demandent au personnel du SPIP de prendre contact avec les associations ou institutions. • Les autres partenaires de droit commun demandent un financement particulier. • Réticences de certains psychiatres qui estiment qui n’est pas possible d’envisager des soins sous contrainte. |
CÔTE D’OR |
• Partenariat avec le CCAA du département mais aussi avec des médecins généralistes. |
• La réponse est rapide : les personnes sont reçues immédiatement et un rendez vous leur est donné dans le mois. |
• Les CCAA n’irriguent pas tout le département. • Problème de la prise en charge par des médecins généralistes qui ne sont pas formés. • Principe du libre choix de son praticien peut être un frein au suivi et à la qualité de l’obligation de soins. |
GARD ET LOZÈRE |
• Prise en charge dans les centres d’alcoologie : partenariat avec les services d’alcoologie et d’addictologie d’hôpitaux, avec l’ANPAA, le CMP et des médecins (généralistes, psychiatres) ainsi que des psychologues. • Par ailleurs en matière de drogues et de séropositivité des partenariats ont été mis en place avec des associations mais aussi avec le MLDT, le FIPD et le DISP (Gard uniquement). En Lozère ce dernier partenariat se fait avec des médecins. |
• Délais très variables. Cependant le premier contact pour un suivi personnalisé se fait en général dans les 2 à 3 mois suivant la condamnation. |
• Les structures spécialisées devraient pouvoir mobiliser plus de personnels. • De même, les partenariats devraient être davantage travaillés afin de définir des objectifs communs avec le SPIP et d’évoluer vers des échanges plus soutenus. |
1 La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 Jusqu’au 1er juillet 2009.
3 Désignés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour participer aux travaux de la mission d’information.
4 () Règle pénitentiaire européenne n° 39.
5 () Règle pénitentiaire européenne n° 40.5
6 () Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
7 () Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
8 () Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la santé, Avis 94 « La santé et la médecine en prison », novembre 2006.
9 () Enquête de la direction des recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) sur la santé des entrants 1997 et 2003 publiée dans Etudes et Résultats, n° 386, mars 2005.
10 () Le total est inférieur à la somme des lignes, un même entrant ayant pu avoir plusieurs contacts avec le système de soins.
11 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
12 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
13 () Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 33 du 5 septembre 2006 et n° 7-8 du 19 février 2008, étude VIH/IST en milieu carcéral en Île-de-France, septembre 2007.
14 () D. Che, D. Bitar, Les cas de tuberculose déclarés en France en 2004, BEH n° 18-2006.
15 () Amandine Cochet, Hubert Isnard, Tuberculose dans les maisons d’arrêt en Île-de-France, InVS, septembre 2007.
16 () Frédéric Rouillon, Anne Duburcq, Francis Fagnani, Bruno Falissard, Etude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, Inserm, 2004 et Avis 94 du CCNE, précité.
17 () Présents au 1er janvier 2003 (55 407) et entrants (80 000) dans l’année (transferts et état de liberté). Un détenu transféré dans différents établissements au cours de l’année sera comptabilisé à chaque fois comme un nouvel entrant, de même qu’un détenu vu dans plusieurs SMPR ou secteurs de psychiatrie générale sera comptabilisé dans l’activité de chaque structure.
18 () Frédéric Rouillon, Anne Duburcq, Francis Fagnani, Bruno Falissard – Etude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison –Inserm – 2004.
19 () Prevalence of epilepsy in prisoners: systematic review – Seena Fazel, research fellow (département de psychiatrie, Université d’Oxford, hospital de Warneford), Evangelos Vassos, senior house officer (département de psychiatrie, Université d’Oxford, hospital de Warneford), John Danesh, professor of epidemiology and medicine (département de santé publique et des premiers soins, Institut de médecine, Université de Cambridge) – Février 2002.
20 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
21 () Journal Officiel du 9 décembre 1998
22 () Arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées.
23 () Non significatif
24 () Il s’agit en réalité des dépenses afférentes à l’activité de 24 SMPR sur les 26 présents sur l’ensemble du territoire.
25 () Source : avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
26 () Les ETP non médicaux comprennent le personnel soignant, composé d’infirmiers, d’aides-soignants et de psychologues ainsi que les emplois administratifs.
27 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
28 () Ibid.
29 () Ibid.
30 () Ibid.
31 () Académie nationale de médecine, Situations pathologiques pouvant relever d’une suspension de peine, pour raison médicale, des personnes condamnées, suite à l’article 720-1-1 du code civil de procédure pénal, Rapport au ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, décembre 2003.
32 () Direction générale de la santé (DGS), direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), direction de la sécurité sociale (DSS), direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).
33 () Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues – Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sport et Ministère de la Justice – Septembre 2004.
34 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
35 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
36 () Ibid.
37 () Règle pénitentiaire européenne n° 46.1.
38 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
39 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
40 () Ivana Obradovic, Tiphaine Canarelli, Primoprescription de méthadone en établissement de santé, Tendances, n° 60, avril 2008, p. 3.
41 () Rapport d’information n° 505, page 79.
42 () Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues – Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sport et Ministère de la Justice – Septembre 2004.
43 () Article 2 du code de déontologie des médecins (article R.4127-2 du code de la santé publique) : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ».
44 () Arrêt n° 04-80518 du 2 septembre 2004.
45 () Rapport d’information n° 420 du Sénat (2005-2006) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par la mission d’information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.
46 () Valérie Carrasco – Les condamnations à une mesure de suivi socio-judiciaire – Analyse statistique à partir des données extraites du casier judiciaire – Février 2007.
47 () Aisne, Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Ardèche, Drôme, Eure, Finistère, Haute Loire, Morbihan, Saône et Loire, Deux-Sèvres, Vaucluse, Vienne, Corse du Sud.
48 () Saint Pierre et Miquelon, Mayotte et la Guyane.
49 () Rapport de M. Vincent Lamanda, premier président de la cour de cassation – Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux – 30 mai 2008.
50 () Un arrêté du 28 janvier 2008 a procédé à une revalorisation substantielle de l’indemnité perçue par ces médecins pour chaque personne suivie au titre de l’injonction de soins. Cette indemnité est passée de 427 euros bruts à 700 euros bruts à compter du 1er mars 2008.
51 () En effet, l’article R. 3711-3 du code de la santé publique, tel qu’il résulte du décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, énumère les conditions requises pour qu’un médecin puisse être inscrit sur la liste des médecins coordonnateurs établie par le procureur de la République : « Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves, les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
52 () Rapport de M. Jean-François Burgelin – Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive – Rapport de la commission Santé-Justice – Juillet 2005.
53 () Rapport d’information n° 420 du Sénat (2005-2006) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par la mission d’information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.
54 () Liste non exhaustive.
55 () Le mésusage d’alcool recouvre toutes les conduites d’alcoolisation problématiques, qui s’inscrivent dans le continuum suivant : les usages à risque (ils définissent les consommateurs « à risque »), l’usage nocif (il définit les consommateurs « à problèmes ») et l’usage avec dépendance (il définit les consommateurs « dépendants »).
56 () Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la défense.
57 () Le binge drinking des anglo-saxons n’a pas de traduction littérale en français. Il s’agit d’un mode de consommation qui consiste à absorber une grande quantité d’alcool en un court laps de temps afin de rechercher une ivresse rapide. La transposition de cette notion relevant de la psychopathologie à l’épidémiologie ne fait pas encore l’objet d’un consensus, notamment quant au choix du seuil (en nombre de verres). L’enquête ESCAPAD précitée s’est alignée sur un seuil représentant une « consommation de 5 verres et plus en une même occasion ».
58 () La consommation excessive d’alcool est définie comme supérieure ou égale à cinq verres par jours les hommes et trois verres pour les femmes quand la consommation est régulière, et supérieure ou égale à cinq verres consécutifs au moins une fois par mois quand elle est discontinue.
59 () Inserm, Alcool : dommages sociaux, abus et dépendance. Coll. Expertise collective. 2003, Paris : INSERM. 536 p.
60 () Sansfacon D. et al., Drogues et dommages sociaux. Revue de littérature internationale. 2005, OFDT : Saint-Denis. p. 456.
61 () Auteurs ou victimes
62 () Bombet Jean-Pierre, 1970, Alcoolisme et coût du crime, Paris, Service d’études pénales et criminologiques (SEPC), Paris Ministère de la Justice.
63 () Perez-Diaz C. et Huré M.-S. M. Violences, alcool et santé mentale. Alcoologie et addictologie. 2006 ; 28 (4 suppl.) : 39 S-48S.
64 () S’agissant des viols et agressions sexuelles sur mineurs, l’enfant est en général incapable de repérer l’alcoolisation de l’auteur lors des faits, d’où les faibles fréquences observées de consommation lors des faits (32 %). Les mésusagers fourniraient alors une approximation convenable de l’association des phénomènes « alcool » et « violence », soit 52 %.
65 () La conduite en état alcoolique est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 Euros. Elle se caractérise par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gr/1000, ou par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,4 gr/litre.
66 () Hors contraventions de classe 1 à 4.
67 () Les condamnations relatives à la circulation routière comprennent la conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, les homicides involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste, les homicides involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique ainsi que la récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique.
68 () Les condamnations pour « autres ivresses » regroupent les entrées en état d’ivresse dans une enceinte sportive, les entrées par fraude ou par force, en état d’ivresse, dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive, le refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, les violences par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, les violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, les violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivies d’une incapacité supérieure à huit jours et les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours commises en état d’ivresse dans une enceinte sportive.
69 () Les informations recueillies sur le comportement d’alcoolisation restent peu précises et ne permettent pas de mesurer le lien entre violences conjugales et alcoolisation. Elles permettent cependant de présumer que ce lien existe, la prévalence des problèmes d’alcoolisation chronique se situant autour de 10 % en population générale.
70 () Cette recherche porte sur l’examen de 2 207 affaires pénales enregistrées pendant un an (1999-2000) par le parquet d’un tribunal de grande instance de la région parisienne. Deux axes ont sous-tendu la conduite de cette investigation : a) l’analyse des co-occurrences entre la commission de divers actes de violences et la présence d’une alcoolisation de l’auteur (habituelle ou au moments des faits) en y incluant les données disponibles sur les victimes, la gravité des actes, les caractéristiques sociodémographiques et les antécédents (judiciaires et de santé) ; b) la prise en compte de l’alcoolisation des auteurs dans les décisions judiciaires tout au long de la chaîne pénale.
71 () L’alcool sur la route : état des lieux et propositions, juillet 2007.
72 () L’alcool au volant : prise en charge pénale et sanitaire – Mme Claudine Pérez-Diaz, chargée de recherche CNRS.
73 () Ibid.
74 () 40 % des sursis avec mise à l’épreuve comportent une obligation de soins.
75 () Le nombre d’injonctions thérapeutiques décidées par les procureurs de la République en 2006 dans le cadre des alternatives aux poursuites (5 189) est cependant en légère augmentation depuis 2004 (4 068).
76 () L’offre de soins en alcoologie dans les établissements pénitentiaires de France – Mme Agnès DUMAS et M. Philippe MICHAUD – Avril 2006 – Fédération des Acteurs de l’Alcoologie et de l’Addictologie.
77 () Néphaliste : se dit d’une personne qui pratique l’abstinence absolue de tout alcool. Les associations néphalistes sont des associations d’anciennes personnes alcooliques, désormais abstinentes (La Croix d’Or, Vie libre, Alcooliques anonymes).
78 () Circulaire interministérielle DGS/MC2/Mildt n° 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à projet pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie.
79 () Les contraventions de 3ème classe s’élèvent à 450 euros au plus.
80 () Il s’agit des injonctions thérapeutiques telles qu’elles existaient avant la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la récidive.
81 () « Justice et alcool : une relation ambiguë » de M. Pierre Pelissier. Revue Alcoologie et Addictologie 2006 ; 28(4 suppl.) 6S-10S
82 () Ibid.
83 () Ibid.
84 () Rigaud A., Les conduites addictives et la justice pré-sentencielle. Communication aux Journées de l’Association des Structures Publiques de Soins aux Toxicomanes et aux Alcooliques (ASPSTA) sur le thème "Soigner ou punir" à Limoges les 20 et 21 octobre 2005. In : Rigaud A., Les conduites addictives et la justice pré-sentencielle. Psychotropes, 12, n°2, 33-48.
85 () Gache P., Acinas M.J., Otthoffer F., Martin I., Léger-Billot A., Liégeon A., Grappe R., Baverel J., Pioche A., Petetin D. et Michaud P. Prévenir la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool. Alcoologie et addictologie, 2006, (4 suppl) : 54-64.
86 () Circulaire DGS/2731/MS-1 du 9 octobre 1975 relative à l’admission des sujets en état d’ivresse dans les services hospitaliers et modèle de certificat de non admission.
87 () Circulaire DGS/1312/MS-1 du 16 juillet 1973 relative à l’admission des sujets en état d’ivresse dans les services hospitaliers.
88 () Rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste – IGA, IGAS, IGSJ, IGN – Février 2008.
89 () « Addictions en milieu carcéral » OFDT, Tendances n° 41, janvier 2005.
90 () Circulaire N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux médicosociaux d’addictologie.
91 () « Justice et alcool : une relation ambiguë » de M. Pierre Pelissier. Revue Alcoologie et Addictologie 2006 ; 28(4 suppl.) 6S-10S
92 () Ibid.
93 () Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et décret n° 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.
94 () Circulaire DGS/SD 6B n° 2006-119 du 10 mars 2006 relative au renouvellement des autorisations des centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
95 () Selon la loi de financement de la sécurité sociale 2007, les gestionnaires des CSST et des CCAA ont un délai de trois ans à compter du 23 décembre 2006, date de publication de ladite loi, pour solliciter l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de la transformation de ces établissements en CSAPA. Les CCAA et les CSST ont donc jusqu’au 22 décembre 2009 pour déposer, auprès du préfet de département, un dossier de demande d’autorisation en tant que CSAPA.
96 () Si l’on inclut les établissements médico-sociaux de réduction des risques, à savoir les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues.
97 () Circulaire n° DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie.
98 () Annexe 1 de la circulaire DGS/DHOS du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en addictologie
99 () Annexe 2 de la circulaire DGS/DHOS du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en addictologie
100 () Certains établissements se trouvant en pleine campagne et étant difficiles d’accès
101 () La durée de l’incarcération conditionne la gestion d’un mésusage d’alcool ainsi que la durée des soins.
102 () Dans seulement trois départements (Seine-Saint-Denis, Nord et Pas-de-Calais).
103 () Parmi les 291 bénéficiaires des crédits alloués par la Mildt dans le cadre des CDO, on dénombre 199 structures médico-sociales spécialisées (CSAPA, CCAA, CSST, CAARUD). Le destinataire est dans 23 cas une association socio-judiciaire, alors qu’une association autre est le porteur de projet dans 53 cas, qui se décomposent en associations d’insertion (11 cas), associations de prévention (7 cas), associations de formation (2 cas), associations néphalistes (2 cas), autres associations (31 cas). Le bénéficiaire est un centre d’hébergement et de réinsertion sociale dans 10 cas. Les autres types de bénéficiaires sont peu représentés : point accueil écoute jeunes (3 cas), prévention routière (1 cas), hôpital (1 cas), réseau de santé (1 cas).
104 () Le budget de la Mildt dédié aux actions « santé et justice » ainsi qu’aux actions « alcool » ressort en 2008 à 4 962 035 €.
105 () Le budget de la Mildt dédié aux actions « santé et justice » ainsi qu’aux actions « alcool » ressort en moyenne sur la période 2006-2008 à 5 433 959,67 €.
106 () Rapport n° 1211 fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, Tome I, Recettes et équilibre général, par M. Yves Bur, député, p. 165.
107 () Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et décret n° 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.
108 () Circulaire DGS/SD 6B n° 2006-119 du 10 mars 2006 relative au renouvellement des autorisations des centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
© Assemblée nationale