

![]()
N° 2853
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés
TOME I. – RAPPORT
par MM. François GOULARD et François PUPPONI,
Députés.
___
INTRODUCTION 9
RÉSUMÉ DU RAPPORT 17
SYNTHÈSE DES TRAVAUX 21
PREMIÈRE PARTIE : QUELS MOYENS ET ACTIONS POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ? 29
I.– PHOTOGRAPHIE CRITIQUE DES MOYENS ET ACTIONS MIS EN œUVRE EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 29
A.– LES MOYENS BUDGÉTAIRES NATIONAUX ACTUELLEMENT DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE 29
1.– Les crédits d’intervention de l’État spécifiquement en faveur de la politique de la ville : le programme 147 30
a) La structure tripartite du programme 147 : une administration centrale concentrée sur le pilotage, des opérateurs gérant l’essentiel des crédits d’intervention, le financement de certaines exonérations de charges sociales 30
b) L’activité de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) 32
c) Le remboursement aux régimes de sécurité sociale de certaines exonérations de cotisations sociales 52
2.– Le financement public de la rénovation urbaine : le rôle levier de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) 54
a) La rénovation urbaine : engagements, réalisations et évolution des sources de financement 54
b) Le réel effet de levier du programme national de rénovation urbaine (PNRU) 59
3.– Les dépenses fiscales et les allégements de charges sociales rattachés à la politique de la ville 61
a) Les aides à l’activité économique dans les ZFU et les ZRU 65
b) Les mesures en faveur du logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 70
4.– Les dotations aux collectivités territoriales liées à la mise en œuvre de la politique de la ville 72
a) De profondes inégalités de ressources et de charges entre collectivités territoriales 72
b) Les dispositifs de péréquation existant en faveur des communes urbaines connaissant des difficultés économiques et sociales 75
5.– L’Épide, l’Épareca et la Caisse des dépôts et consignations 88
a) L’établissement public d’insertion de la défense (Épide) 88
b) L’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Épareca) 89
c) La Caisse des dépôts et consignations (CDC) 90
B.– ÉVOLUTIONS PASSÉES ET À VENIR DES CRÉDITS NATIONAUX DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE 92
1.– Éléments sur les évolutions récentes 92
a) Les crédits affectés à la politique de la ville ont très inégalement mais considérablement augmenté durant la période 2005-2009 92
b) La politique de la ville à l’aune du Plan de relance et de l’emprunt national pour les investissement d’avenir 95
2.– Éléments sur certaines évolutions à venir 100
a) Les crédits budgétaires spécifiques 100
b) Le financement de l’Anru 102
c) Les dépenses fiscales et les exonérations de charges sociales 104
d) Les dispositifs de péréquation 104
II.– LA DIFFICILE MESURE DE LA MOBILISATION DES MOYENS NATIONAUX DE DROIT COMMUN ET DES MOYENS LOCAUX EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 111
A.– LES CRÉDITS NATIONAUX DE DROIT COMMUN DE L’ÉTAT EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : UN AFFICHAGE AMBITIEUX POUR UNE RÉALITÉ PLUS CONTRASTÉE 113
1. Certains programmes budgétaires concourent à la politique de la ville sans mention des crédits correspondants 114
2. La contribution de l’Éducation nationale à la politique de la ville 119
a) L’éducation prioritaire: objets, organisation, moyens 120
b) Éducation prioritaire et politique de la ville ne sont pas totalement superposables 125
c) Les autres contributions de l’éducation nationale à la politique de la ville 128
3. La contribution du ministère chargé de l’emploi à la politique de la ville 132
a) Les contrats aidés attribués aux personnes résidant dans les zones urbaines sensibles 134
b) Le contrat d’autonomie 137
4. La contribution du ministère chargé du logement à la politique de la ville 141
5. Les contributions des autres ministères à la politique de la ville 143
a) Sécurité et défense: les programmes 176 « Police nationale », 152 « Gendarmerie nationale » et 178 « Préparation et emploi des forces » 143
b) Ministère de la justice : les programmes 101 « Accès au droit et à la justice », 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » et 107 « Administration pénitentiaire » 147
c) Autres programmes : programmes 219 « Sport », 163 « Jeunesse et vie associative », 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables », 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », 204 « Prévention et sécurité sanitaire » et 307 « Administration territoriale » 149
6. Quelle synthèse concernant les apports du droit commun en matière de politique de la ville ? 153
B.– LES CRÉDITS LOCAUX AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : UNE APPROCHE ENCORE TRÈS LACUNAIRE 157
DEUXIÈME PARTIE : QUELS CADRES GÉOGRAPHIQUES ET QUELLES MODALITÉS DE GOUVERNANCE POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ? 160
I.– LES GÉOGRAPHIES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 160
A.– LA POLITIQUE DE LA VILLE S’INSCRIT DANS UNE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE DÉSORMAIS MULTIFORME 160
1.– La « zone urbaine sensible » (ZUS) n’a pas suffi pour déterminer la géographie prioritaire de la politique de la ville 160
a) La cartographie des ZUS ne s’appuie pas sur des critères objectifs 160
b) De l’objectivité au sein des ZUS : les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU) 161
c) Compléter la géographie prioritaire définie par les ZUS : les quartiers Cucs 164
d) Les quartiers de la rénovation urbaine et les quartiers de la dynamique « espoir banlieues » 167
e) La géographie prioritaire de la politique de la ville et sa population 169
2.– La géographie prioritaire actuelle et les problèmes urbains sociaux 169
a) Les ZUS les plus en difficulté, complétées par certains quartiers Cucs, constituent une géographie représentative des problèmes urbains sociaux les plus lourds 169
b) Certains quartiers urbains très en difficulté ne sont intégrés dans aucune des formes de géographie prioritaire en vigueur 171
c) Une meilleure géographie prioritaire est-elle possible ? 172
B.– UNE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE, POUR QUOI FAIRE ? 174
1.– Un zonage national de référence au service d’une contractualisation renforcée 174
2.– Les effets pour certains dispositifs d’une réforme du zonage actuel 178
a) La reconversion des dispositifs fiscaux et sociaux applicables dans les ZFU 178
b) Le sort de certains dispositifs en vigueur dans les ZUS 179
II.– LES MODALITÉS DE GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 182
A.– LA GOUVERNANCE NATIONALE : FORTEMENT DÉPENDANTE DES CHOIX POLITIQUES NATIONAUX, SON EFFICACITÉ INTRINSÈQUE SEMBLE S’AMÉLIORER 182
1.- La place de la « ville » : un choix politique qui influe sur la capacité d’action de l’administration centrale concernée 182
a) La « ville » dans les gouvernements depuis le début des années 1990 182
b) L’administration centrale en charge de la ville : le Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG-CIV) 184
c) Les effets de la faiblesse de l’interministérialité sur le plan politique : l’exemple de la dynamique « espoir banlieues » 187
2.– L’Anru et l’Acsé : un duo déséquilibré et problématique 190
a) Le succès reconnu de l’Anru, parfois accompagné de quelques critiques, conduit les pouvoirs publics à lui confier de nouvelles missions 190
b) L’Acsé, chargée d’une mission difficile, doit encore surmonter une période d’instabilité concernant ses missions et ses effectifs 195
c) La dichotomie entre l’« urbain » et le « social » demeure un problème et doit être aménagée 197
B.– LA GOUVERNANCE LOCALE : UN ÉTAT EN DIFFICULTÉ ET UNE COMPÉTENCE OPÉRATIONELLE EXERCÉE PAR LE MAIRE 200
1.– L’État local dans la politique de la ville : l’impossible proximité ? 200
a) Rôle du préfet et malaise de l’État local 200
b) Les tentatives de représentation directe de l’État local dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 201
2.– La gestion décentralisée de la politique de la ville : un flou juridique relatif compensé par le « leadership » du maire 205
TROISIÈME PARTIE : DES ÉVALUATIONS DIFFICILES À RÉALISER ET QUI DEMEURENT PARTIELLES 211
I.– LES DIFFICULTÉS DE L’ÉVALUATION 211
A.– UN EXEMPLE DE DIFFICULTÉ MÉTHODOLOGIQUE : ENSEIGNEMENTS ET LIMITES D’UNE APPROCHE NATIONALE PAR LES CRÉDITS 211
1.– Les crédits nationaux dédiés à la politique de la ville en « euros par habitant » : des comparaisons « externes » difficiles à exploiter 211
2.– Quelle intensité de l’aide publique en faveur des quartiers défavorisés en fonction de certaines catégories de quartiers ? 214
3.– Une approche de l’intensité de l’aide en faveur des quartiers en difficulté, dispositif par dispositif ? 216
B.– L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : LES OUTILS MIS EN œUVRE DEPUIS 2003 N’ONT PAS PERMIS DE SURMONTER TOUTES LES DIFFICULTÉS DE L’EXERCICE 218
1.– Avant 2003 : une évaluation toujours requise et souvent décevante 218
2.– Le tournant de la loi du 1er août 2003 220
a) Une redéfinition des objectifs de la politique de la ville et des moyens d’en mesurer l’efficacité et les impacts : la création de l’ONZUS 220
b) L’amélioration de la qualité de l’information statistique n’a pas supprimé toutes les difficultés de l’exercice évaluatif 221
c) La nécessité d’un diagnostic prudent sur les effets propres de la politique de la ville et d’un approfondissement des connaissances 223
II.– QUELS CONSTATS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES, QUELS EFFETS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ? 225
A.– LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DANS LES ZUS : DES ÉCARTS DÉFAVORABLES SE MAINTENANT À DES NIVEAUX PRÉOCCUPANTS 226
1.– Les revenus dans les ZUS : une pauvreté qui se maintient à des niveaux élevés 226
a) Le niveau relatif des revenus dans les ZUS : pas d’évolution entre 2002 et 2006 226
b) Le taux de pauvreté relatif dans les ZUS semble augmenter 227
2.– La faiblesse des patrimoines dans les ZUS 228
B.– L’EMPLOI : PAS D’AMÉLIORATION NOTABLE DE LA SITUATION RELATIVE DES ZUS EN CINQ ANS 229
1.– Une situation structurelle très défavorable et un échec patent s’agissant de la réduction des écarts des taux de chômage 229
2.– L’autre objectif quantitatif de la loi du 1er août 2003 n’a pas été atteint 230
3.– Les objectifs « qualitatifs » de la loi de 2003 230
a) L’évolution des taux de chômage pour les faibles niveaux de qualification a été analogue en ZUS et hors ZUS 230
b) La mise en œuvre dans les ZUS de dispositifs spécifiques pour les faibles niveaux de qualification : le contrat d’autonomie et les clauses d’insertion de l’Anru 231
3.– Une organisation des politiques publiques jugée peu efficiente 236
a) Les restructurations des services nationaux ont au moins conjoncturellement des effets négatifs au plan local 236
b) Un paysage local des acteurs de l’emploi trop complexe pour être efficient 237
c) Une amélioration dans la priorité donnée au public des quartiers prioritaires pour les contrats aidés ? 238
C.– LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : DES RÉSULTATS RÉELS QUI N’ÉPUISENT PAS LA QUESTION DE LA PERTINENCE DES MOYENS EMPLOYÉS 239
1.– Les zones franches urbaine (ZFU) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) : taux d’installation des entreprises et évolution des embauches exonérées 239
a) Un impact substantiel des mesures d’exonération applicables en ZFU 239
b) Un impact réel mais plus modéré des mesures applicables dans les ZRU 241
2.– Quels impacts des dispositifs ZFU et ZRU et à quel prix ? 242
a) le taux d’installation des entreprises dans les ZUS : la preuve des effets propres aux dispositifs applicables en ZFU et en ZRU ? 242
b) La question des impacts ultimes du dispositif propre aux ZFU 243
c) Le coût élevé du dispositif ZFU 245
D.– AMÉLIORER L’HABITAT ET L’ENVIRONNEMENT URBAIN 246
1.– La programmation du Programme national de rénovation urbaine (PNRU) et son exécution 246
2.– Éléments d’appréciation qualitative du PNRU 248
a) La restructuration des quartiers et la rénovation de l’habitat sont les objectifs centraux et partagés du PNRU 248
b) Le PNRU semble avoir un impact relativement limité en termes de « mixité sociale » 253
c) Malgré certaines difficultés, les habitants des quartiers en rénovation urbaine apparaissent satisfaits de l’action menée 256
d) Quels visages pour les quartiers rénovés ? 259
E.– LA SANTÉ : UNE PRÉSENCE FAIBLE DES PROFESSIONS MÉDICALES DANS LES ZUS ET UNE THÉMATIQUE ÉMERGENTE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA VILLE 262
1.– Une présence relativement faible des professions médicales dans les ZUS, partiellement rattrapée dans leur périmètre extérieur immédiat 262
a) Les données relatives aux médecins 262
b) Les données relatives aux autres professions médicales 263
2.– Une problématique sous-estimée mais émergente ? 264
a) Des réponses très ténues aux problèmes de la démographie médicale 264
b) Les Cucs ont peu traité de la question de la santé publique 264
F.– AMÉLIORER LA RÉUSSITE SCOLAIRE 266
1.– Des résultats relatifs défavorables en ZUS, sans rattrapage notable par rapport au reste du territoire depuis 4 ans 266
a) Les résultats en ZUS demeurent insuffisants dans des proportions globalement inchangées depuis quatre ans et semblent même faire apparaître un « effet ZUS » négatif 266
b) Les limites techniques d’une approche par les résultats scolaires 269
2.– Une appréciation qualitative plus nuancée : peut-on parler d’un succès du PRE ? 270
G.– SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES 272
1.– Une situation contrastée dans les ZUS pour le nombre des crimes et délits constatés 272
2.– Un sentiment plus fort d’insécurité dans les ZUS 275
H.– LES IMPACTS TRANSVERSAUX DES ACTIONS MISES EN œUVRE DANS LE CADRE DES CUCS : DES RAISONS D’ESPÉRER ? 276
AUDITION DE Mme FADELA AMARA, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 279
RÉUNION DU COMITÉ DU 21 OCTOBRE 2010 : EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT D’INFORMATION 297
ANNEXE : TRAVAUX DE LA MISSION 309
Le présent rapport constitue l’une des premières évaluations de politique publique, au sens de l’article 24 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (1), réalisé pour le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale.
Le Comité avait inscrit ce thème de travail à son programme annuel le jeudi 8 octobre 2009. Conformément aux dispositions de l’article 146-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, les commissions permanentes ont fait part de leur souhait d’associer aux travaux leurs membres respectifs suivants :
– commission des Affaires culturelles et de l’éducation : Mme Geneviève Levy (UMP) et Mme Martine Martinel (SRC),
– commission des Affaires sociales : M. Pierre Cardo (2) (UMP) et Mme Monique Iborra (SRC) ;
– commission des Affaires économiques : M. Michel Piron (UMP), rapporteur pour avis sur les crédits de la « Ville », et M. François Pupponi (SRC) ;
– commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire : M. François Goulard (UMP), rapporteur spécial sur les crédits de la « Ville », et M. Claude Bartolone (SRC).
Parmi ces huit députés, émanant à parité de la majorité et de l’opposition, le Comité nous a fait l’honneur, le 5 novembre 2009, de nous désigner rapporteurs, pour la majorité et pour l’opposition, conformément aux dispositions de l’article 146-3 précité.
*
* *
Le choix du Comité de proposer l’évaluation des aides en faveur des quartiers défavorisés est intervenu à un moment charnière pour la politique de la ville (qui est l’expression usuelle par laquelle sont nommées ces aides).
Entre 2003 et 2007, beaucoup des instruments de cette politique ont été renouvelés ou modifiés dans leur objet et leurs modalités de fonctionnement, tout en maintenant certains dispositifs historiques d’une action engagée il y a maintenant trente ans.
La loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a fixé des objectifs sur cinq ans (et des indicateurs de résultat associés), par grande thématique « classique » de la politique de la ville (emploi, développement économique, éducation, santé, cadre de vie, habitat…), dans le cadre d’un objectif général de réduction des écarts de développement et des inégalités sociales entre les quartiers urbains en difficulté et le reste du pays.
Différents dispositifs ont été mis en œuvre afin d’atteindre ces objectifs :
– la loi du 1er août 2003 a prévu le lancement du programme national de rénovation urbaine (PNRU), vaste dispositif devant aboutir à la restructuration de plusieurs centaines de quartiers marqués par la dégradation de l’habitat ;
– la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a mis en œuvre les programmes de réussite éducative (PRE), qui constituent désormais, en matière sociale dans une acception large, l’un des principaux dispositifs en direction des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
– la loi du 18 janvier 2005 a prévu une augmentation pluri-annuelle substantielle de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS), principal outil de péréquation axé sur la compensation des charges induites par les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
– les lois du 1er août 2003 et du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ont plus que doublé le nombre des zones franches urbaines (ZFU), dans lesquelles les entreprises bénéficient d’importantes exonérations d’impôt et de charges sociales ;
– en 2006 et 2007, ont été élaborés et signés les contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) pour une période de trois ans (prorogée d’un an en 2010 puis en 2011), forme nouvelle de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville, succédant aux contrats de ville.
Ces réformes ont été accompagnées d’une profonde modification des modalités nationales de gouvernance des aides en faveur des quartiers défavorisés ; deux agences, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) ont successivement été créées, afin respectivement de contribuer à la mise en œuvre du PNRU et de gérer les crédits d’intervention affectés au financement des opérateurs locaux de la politique de la ville, notamment les associations. L’administration centrale (le secrétariat général du comité interministériel des villes – SG-CIV, qui a succédé à la délégation interministérielle à la ville – DIV) a ainsi été recentrée sur une mission de pilotage stratégique et d’animation de l’interministérialité de l’action en faveur des quartiers prioritaires.
Juger des effets et impacts des aides en faveur des quartiers défavorisés nécessite d’interroger l’efficacité de ce dispositif de gouvernance, à la fois son fonctionnement interne et sa capacité à mobiliser, dans les autres ministères, les « moyens de droit commun » sur lesquels la politique de la ville est censée s’appuyer. Car si celle-ci dispose de moyens et de dispositifs dédiés, l’efficacité des actions en faveur des quartiers propriétaires a toujours été envisagée comme conditionnée par une qualité accrue de l’action publique dans son ensemble, en privilégiant la transversalité, c’est-à-dire, aux niveaux de l’État central et déconcentré, le dépassement des barrières ministérielles et administratives.
Classiquement, la politique de la ville est par ailleurs censée associer transversalité et proximité. Car elle a pour caractéristique historique de cibler des quartiers « prioritaires » et d’associer à sa mise en oeuvre les collectivités territoriales, notamment parmi elles les communes, dans le ressort desquelles ces quartiers sont situés. Évaluer la politique de la ville conduit ainsi à interroger les modalités de la détermination des « zones » dans lesquelles elle a vocation à être mise en oeuvre, ainsi que le principe même d’une telle « sélection » ; il s’agit aussi d’examiner les moyens et la réalité du travail en commun, notamment sous sa forme contractuelle, de l’État et des collectivités territoriales.
La nécessité d’interroger la réalité pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de la loi du 1er août 2003 ont été atteints, en observant à cet effet les impacts des principaux dispositifs mis en œuvre et le rôle d’une gouvernance nationale et locale atypique et récemment renouvelée, aurait suffi à justifier le choix du Comité d’évaluer la politique de la ville.
Les enjeux fondamentaux pour notre pays qui se jouent dans ces quartiers s’agissant de l’avenir de notre jeunesse, des inégalités sociales, de l’accueil et de l’intégration des populations immigrés, ainsi que l’ampleur des « émeutes urbaines » d’octobre et novembre 2005 dans certains quartiers urbains sensibles de l’ensemble du pays (puis de façon plus sporadique et ponctuelle, dans certaines villes), constituaient autant de motifs supplémentaires de réaliser un certain nombre d’investigations sur la mise en œuvre et les résultats de cette politique.
Enfin, il apparaît utile de contribuer à certaines réflexions portant sur l’avenir de certains dispositifs propres à cette politique : déjà prorogés deux fois pour un an, les Cucs seront à terme remplacés par une nouvelle génération de contrat de politique de la ville dont il convient de dessiner dès aujourd’hui les contenus concrets, les contours financiers et les modalités de fonctionnement. Les dispositifs d’exonération fiscaux et sociaux applicables dans les ZFU commenceront à s’éteindre à compter du début de l’année 2012. La péréquation est en chantier pour les années à venir, suite notamment à la suppression de la taxe professionnelle.
*
* *
Au plan méthodologique, le sujet qui nous a été confié présentait de nombreuses difficultés, qui n’auront sans doute pas pu être toutes surmontées.
En premier lieu, il n’échappera à personne que la politique de la Ville, dans ses diverses acceptions et ses périmètres variés, menée tant au niveau national par des acteurs publics multiples, que par les nombreuses collectivités territoriales concernées, ne constitue pas, loin s’en faut, une terra incognita.
Bien au contraire, ce sujet a déjà fait l’objet de nombre d’études, de travaux de contrôle ou d’évaluation, qu’ils soient administratifs ou universitaires, ou bien encore réalisés par des corps de contrôle, des cabinets d’études spécialisés, par des parlementaires en mission auprès du Gouvernement, ou par des missions des commissions permanentes compétentes, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
Compte tenu du caractère potentiellement foisonnant du sujet lui-même, de la multiplicité et de la diversité de ses points d’application au niveau géographique, comme de la riche documentation existante, vos rapporteurs ont souhaité, dans les limites du délai et des moyens disponibles, s’appuyer autant que possible sur le « stock » des travaux déjà effectués et des connaissances acquises, tout en les complétant là où cela pouvait paraître nécessaire.
Il a ainsi été procédé, en recherchant des modalités de travail complémentaires, à :
– des auditions des responsables des administrations centrales (3) et des établissements publics directement concernés (4), d’acteurs impliqués notamment dans la politique du logement social (5), de corps de contrôle (6), d’universitaires spécialistes de la question de la politique de la ville ou des finances publiques, et de techniciens de l’évaluation de cette politique ;
– l’envoi de questionnaires écrits, adressés en particulier aux structures dont les représentants avaient été auditionnés ;
– de visites de sites sensibles représentant des types bien distincts :
Ÿ à Clichy-sous-Bois / Montfermeil, site d’Île-de-France faisant l’objet de l’une des principales opérations de rénovation urbaine, en voie d’achèvement, connaissant des difficultés aigues (importance de la population en zone urbaine sensible au regard de l’ensemble de la population et des ressources communales pour Clichy ; localisation de la zone urbaine sensible sur deux communes voisines aux caractéristiques différentes ; présence de nombreux immeubles fortement dégradés mais en copropriété privée, enclavement, etc.) ;
Ÿ à Orléans, grande ville de province, pour ses deux zones urbaines sensibles faisant chacune l’objet d’un programme de rénovation urbaine, dont l’un est en voie d’achèvement ;
Ÿ à Bron et Vénissieux, pour leurs sites sensibles inclus dans la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon).
Chacune de ces missions a fait l’objet d’une demande préalable d’informations auprès des services de la commune et de la préfecture concernées, que vos rapporteurs remercient pour leur concours et leur aide précieuse pour l’organisation des visites, de même qu’ils remercient les élus pour leur présence et la qualité des échanges qui ont ainsi pu avoir lieu ;
– d’un déplacement à l’étranger, dans un pays de l’Union européenne ayant développé une politique de la ville susceptible d’être comparée à la pratique française, en l’espèce les Pays-Bas. Vos rapporteurs remercient à cet égard les représentants du poste diplomatique de La Haye, qui ont su organiser à la fois des rencontres avec les acteurs publics concernés, y compris nos collègues parlementaires, et des visites de sites urbains sensibles, en compagnie d’acteurs de terrain de la politique de la ville.
Pour compléter ces travaux, il nous a en outre paru souhaitable de disposer d’études de synthèse portant sur deux types de matériaux particulièrement riches :
– la production de travaux universitaires, au sens large ;
– les évaluations des actions menées au niveau local.
Dans cette perspective, et ainsi que le permet l’article 146-3 du Règlement de l’Assemblée nationale qui prévoit que « les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée », deux études ont été confiées, à notre demande, à des structures externes à l’Assemblée nationale, sélectionnées, conformément aux procédures réglementaires applicables à des marchés publics de ce type, parmi les candidats ayant répondu aux deux appels d’offres correspondant.
La première étude visant à présenter une synthèse des travaux, notamment universitaires, publiés dans le domaine de l’évaluation de la politique de la ville mise en œuvre en France (incluant les politiques sociales, les politiques éducatives, la rénovation urbaine, le développement économique et les politiques de l’emploi, la prévention et la lutte contre la délinquance, etc.) a été confiée à MM. Thomas Kirszbaum et Renaud Epstein, universitaires, eux-mêmes auteurs de nombreuses publications en la matière. Cette synthèse particulièrement riche et complète a porté sur plusieurs centaines d’articles ou de références bibliographiques.
La seconde étude, consistant à réaliser une synthèse des évaluations d’une sélection de contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) en cours – qui constituent le cadre d’intervention partenariale de l’État et de la commune pour les actions menées au titre de la politique de la ville – complétée par des investigations menées directement auprès des structures porteuses de ces contrats, a été confiée au cabinet ECs, spécialisé dans l’évaluation de la politique de la ville. Cette étude a porté sur 22 Cucs.
Il s’agissait en l’espèce de disposer d’éléments de synthèse sur l’appréciation de l’efficacité des différents instruments de la politique de la ville, répondant notamment aux questions suivantes :
– peut-on mettre en évidence l’efficacité ou l’échec de certains dispositifs, et à quelles conditions, pour différentes thématiques (habitat et logement, éducation, sécurité et prévention de la délinquance, accès aux soins, emploi et insertion professionnelle, soutien au tissu associatif, soutien à l’activité économique, transports, autres) ?
– peut-on identifier les difficultés de mise en œuvre, les particularités des actions ou du contexte liés ou susceptibles d’être liés à leur efficacité ou inefficacité, les enjeux financiers de ces différentes actions ? Ces éléments sont-ils communs, totalement ou partiellement, aux Cucs ou bien spécifiques au sein de chacune de leurs grandes thématiques?
Ces deux études figurent en annexe au présent rapport. Elles ont contribué à éclairer les réflexions de vos rapporteurs, en procédant à des travaux de synthèse complétant très utilement ceux que nous étions en mesure de mener nous-mêmes.
Les rapporteurs en remercient leurs auteurs, en particulier compte tenu du court délai imposé pour leur réalisation par le calendrier de la mission.
*
* *
La première partie du présent rapport établit un état des lieux des aides en faveur des quartiers défavorisés, par la description des actions mises en œuvre et des moyens qui leur sont consacrés. Sont successivement abordés les principaux dispositifs « classiques » de la politique de la ville (programme de réussite éducative, contrats adultes-relais, programme ville, vie, vacances…), le Programme national de rénovation urbaine (PNRU), les dépenses fiscales et sociales liées à la politique de la ville, certains dispositifs de péréquation, ainsi que l’action spécifique des établissements publics principalement concernés. Pour chacun de ces sujets, sont ensuite décrites les principales évolutions récemment intervenues et les orientations probables à venir. Ce panorama des aides nationales dédiées en faveur des quartiers défavorisés est suivi d’une analyse des actions et moyens de droit commun des ministères qui ont vocation à contribuer à la politique de la ville, ainsi que d’une mise en perspective de la question du concours que les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, apportent à ces aides nationales.
La deuxième partie décrit l’ensemble des zonages dans lesquels s’inscrivent les actions en faveur des quartiers défavorisés. Sont abordées les questions de l’adéquation de ces zonages, qui ont vocation à couvrir de façon à la fois exhaustive et exclusive ces quartiers, et du principe de l’usage de cadres géographiques précis en la matière, dans la perspective d’une réforme de cette géographie prioritaire et des modalités de contractualisation de la politique de la ville. Est ensuite dressé un état des lieux de la gouvernance de la politique de la ville ; au niveau national, avec la question de la réalité de l’interministérialité et de la séparation fonctionnelle des agences respectivement chargées de la rénovation urbaine et des interventions sociales au sens large ; au niveau local, avec l’analyse des capacités structurelles d’action respectives de l’État local et des collectivités territoriales.
La troisième partie, suite à la description des difficultés et des réserves méthodologiques inhérentes à l’exercice d’évaluation en matière de politique de la ville, aborde la question de la situation des quartiers en difficulté, ainsi que des résultats et impacts des actions qui y sont menées. Sont ainsi successivement évoqués, comme y invite la loi du 1er août 2003 qui fixe des objectifs généraux et thématiques de réduction des inégalités sociales et des écarts de développement, les thèmes des revenus et des patrimoines, de l’emploi, du développement économique, du cadre de vie, de la santé, de l’éducation, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ainsi que des impacts transversaux de la politique de la ville.
Les moyens et les actions en faveur des quartiers en difficulté
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) gère la quasi-totalité des crédits d’intervention du programme budgétaire 147 « Politique de la ville » (406 millions d’euros en 2009, soit 0,11 % des crédits de paiement du budget général dans la loi de finances pour 2009). L’Acsé, qui finance de nombreux opérateurs locaux, notamment associatifs dans les quartiers défavorisés, agit dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) qui lient l’État et les collectivités territoriales. Elle finance ainsi les principaux dispositifs historiques de la politique de la ville (le programme de réussite éducative, les contrats d’adultes relais, les ateliers santé ville, le programme ville, vie, vacances…), qui, pour la plupart d’entre eux, sont antérieurs à la création de l’agence.
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), créée en 2003, contribue à la réalisation du Programme national de rénovation urbaine (PNRU), qui prévoit la restructuration de plusieurs centaines de quartiers dans l’ensemble du pays. Si une incertitude demeure quant à son financement au niveau national dans les prochaines années, le PNRU est aujourd’hui presque totalement programmé et engagé (environ 1 milliard d’euros par an sur un peu plus de dix ans). Les crédits gérés par l’Anru jouent un rôle de levier effectif : le PNRU est majoritairement financé par les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.
La politique de la ville s’appuie aussi sur certaines dépenses fiscales et sociales (693 millions d’euros en 2009, soit environ 0,4 % de l’ensemble des dépenses fiscales et sociales applicables aux entreprises). D’importantes exonérations de charges sociales et d’impôts sur l’activité économique sont applicables dans les zones franches urbaines (ZFU), afin d’y densifier le tissu d’entreprises et d’y créer des emplois. D’autres dépenses fiscales ont pour objet d’inciter à l’accession à la propriété dans les quartiers en rénovation urbaine et de soutenir les bailleurs sociaux dans les zones urbaines sensibles (ZUS).
Des dispositifs de péréquation aident les communes qui ont des quartiers prioritaires sur leur territoire à compenser les charges correspondantes et la faiblesse de leurs ressources (1399 millions d’euros en 2009). Il s’agit notamment de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS – 1 163,7 millions d’euros en 2009, soit environ 5 % de la DGF du bloc communal), de la dotation de développement urbain (DDU) et du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
Ces moyens nationaux sont censés venir en complément d’une mobilisation des différents ministères de « droit commun » (notamment l’Éducation nationale, le logement, l’emploi, la sécurité publique…) en faveur des quartiers prioritaires. Leur investissement dans la politique de la ville et ces quartiers est très hétérogène, ce qui limite l’intérêt et la portée d’un chiffrage global traduisant cet engagement (3,62 milliards d’euros en 2009, soit 0,96 % des crédits de paiement du budget général dans la loi de finances pour 2009), dont l’établissement se heurte à d’importantes difficultés techniques.
Ces moyens nationaux dédiés ont par ailleurs vocation à mobiliser les crédits locaux, notamment des collectivités territoriales, dans le cadre territorialisé des Cucs. L’ampleur de cet « effet levier » est aujourd’hui mal connue.
Le zonage et la gouvernance
Les zones urbaines sensibles (ZUS) avaient vocation à constituer l’assise territoriale de mise en œuvre des aides en faveur des quartiers défavorisés. Au fil du temps, d’autres « géographies prioritaires » se sont ajoutées aux ZUS, en leur sein (les zones de redynamisation urbaine – ZRU, les ZFU) ou, le cas échéant, en couvrant des zones nouvelles (les quartiers concernés par les Cucs, les quartiers Anru). La géographie prioritaire, devenue complexe, n’en est pas pour autant satisfaisante. Elle laisse sans doute des quartiers très défavorisés hors de tout zonage et en inclut d’autres dont les difficultés économiques et sociales sont moindres. Surtout, le zonage, comme ressort des aides en faveur des quartiers défavorisés, ne va pas sans stigmatisation, parfois implicite, à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone concernée ; il peut aussi conduire à des « effets de frontière » dans une même zone, attribuant une priorité à un lieu et pas à un autre, pourtant analogue au premier.
Le zonage doit avoir pour objet la connaissance des quartiers en difficulté, c’est-à-dire d’en dresser la liste et de définir, sur la base de critères objectifs, la nature et l’intensité des problèmes économiques et sociaux qu’y subissent leurs habitants. Cette connaissance doit être mise au service d’une contractualisation renouvelée entre l’État et les collectivités territoriales, notamment les communes et les EPCI, dont les ressorts territoriaux doivent être les cadres d’action des politiques en faveur des quartiers défavorisés.
Une telle démarche implique un pilotage efficace au niveau national, qui puisse promouvoir une réelle interministérialité et dépasser une dichotomie aujourd’hui trop prononcée entre l’action sur le bâti (par l’Anru) et l’action sociale (par l’Acsé). Au niveau local, l’État doit par ailleurs réellement s’implanter dans les quartiers, par une représentation effective et opérationnelle dont il est dépourvu aujourd’hui. Il pourra alors engager un partenariat exigeant avec les élus locaux, qui sont les maîtres d’œuvre des aides en faveur des quartiers défavorisés. Si, à cette fin, les élus locaux doivent pouvoir exercer, au moins à titre expérimental, des compétences étendues à la mesure des problèmes à traiter (éducation, police, emploi…), l’État aurait pour tâche, dans un tel contexte, d’aider à l’émergence d’un projet local de territoire (dont la politique de la ville serait une dimension) et d’organiser le débat public local sur l’évolution des quartiers prioritaires.
Quelle situation dans les quartiers, quels effets des actions de la politique de la ville ?
Évaluer la politique de la ville est un exercice complexe ; deux études synthétisant respectivement les résultats d’évaluation de 22 Cucs et les travaux universitaires d’évaluation en matière de la politique de la ville ont été réalisées dans le cadre de la présente mission. Celle-ci a donné lieu à de nombreuses auditions de responsables administratifs, d’élus et d’acteurs de la politique de la ville ; trois visites sur des sites de la politique de la ville ont été organisées à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, à Orléans et dans la communauté urbaine de Lyon ; un déplacement aux Pays-Bas a permis d’y observer les actions mises en œuvre en la matière.
La connaissance de la situation objective des quartiers prioritaires, de la territorialisation des actions et des moyens mis en œuvre demeure néanmoins lacunaire, malgré des progrès statistiques incontestables en la matière depuis quelques années. Le risque peut être d’imputer à la politique de la ville des constats dont les facteurs d’explication dépassent de loin la portée de ces actions et ces moyens.
Les objectifs de la politique de la ville ont-ils au demeurant été bien définis ? S’il s’agit de « réduire les écarts », cela passe-t-il par une « mixité sociale » accrue s’appuyant sur un « brassage » organisé des populations ou faut-il s’appuyer sur une distribution des moyens privilégiant les populations les moins bien dotées ? La politique de la ville consiste-t-elle à intensifier l’aide en direction de zones de concentration de la pauvreté ou doit-elle contribuer à briser cette « concentration », source endogène de problèmes accrus ?
Si l’on considère les objectifs de la loi du 1er août 2003, formulés en termes de réduction des inégalités sociales et des écarts de développement, il faut admettre que la situation actuelle n’est dans l’ensemble pas meilleure qu’en 2003. La pauvreté et le chômage demeurent dans les quartiers sensibles à des niveaux élevés, sans amélioration réelle par rapport au reste du pays. Les résultats scolaires en ZUS accusent un retard important par rapport aux moyennes nationales, qui n’a pas été pas comblé, même partiellement, ces dernières années ; certaines données peuvent même être interprétées comme la preuve d’un « effet quartier » négatif : pour un environnement social et culturel donné, un élève résidant en ZUS aurait moins de chance de réussir qu’un élève résidant hors ZUS. Par ailleurs, les écarts de « pouvoir d’achat » entre les communes, exprimés en termes de potentiel financier, n’ont pas été réduits ces dernières années et ont même connu un léger accroissement.
Certains résultats paraissent plus favorables : quelques signes de reflux du chômage et de la pauvreté dans les ZFU auraient pour origine les exonérations de charges et d’impôt qui y sont applicables ; ces signes demeurent cependant fragiles et l’interprétation de ces éléments comme des impacts du dispositif fiscal et social des ZFU demeurent discutée.
S’agissant de la rénovation urbaine, l’amélioration est aisément vérifiable en termes de dignité de l’habitat et de restructuration des quartiers. La satisfaction des habitants, largement observée, ne va pas cependant sans certaines difficultés concrètes (évolution du taux d’effort financier des ménages locataires, conditions du relogement sur les marchés tendus…) et sans interrogations sur l’avenir (maintien de l’acquis sur le bâti, retard ou absence de certains équipements structurants en matière de transport…).
Pourraient ainsi être mis à l’actif de la politique de la ville, dans un contexte assez sombre de maintien à des niveaux préoccupants de la pauvreté, du chômage et du retard scolaire dans les quartiers urbains sensibles, quelques évolutions et résultats en matière de développement économique et de rénovation urbaine ; on peut aussi lui attribuer par ailleurs une amélioration du « lien social » au sens large dans ces quartiers, par une pratique renouvelée de l’action publique et associative auprès et avec la participation des habitants.
Dans le cadre de la mission que le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques nous a confiée sur « les aides en faveur des quartiers défavorisés: combien pour quels résultats ? », nous avons en premier lieu dressé un panorama de l’ensemble des dispositifs concernés, notamment en entendant et questionnant les administrations centrales spécifiquement chargées de les mettre en oeuvre.
Le Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG-CIV), ainsi que les deux établissements publics sur lesquels il exerce sa tutelle (l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances - Acsé et l’Agence nationale pour le rénovation urbaine - Anru) ont contribué à ce que nous puissions dresser un état des lieux en la matière. À l’occasion de ces échanges, ils nous ont par ailleurs transmis leurs travaux évaluatifs en matière de politique de la ville. De façon générale, nous avons toujours pu compter sur les collaborateurs de ces organismes pour répondre aux questions que nous leur posions.
Nos travaux et notre réflexion se sont appuyés sur de nombreuses auditions, souvent doublées d’un questionnaire à l’attention des personnes entendues, se poursuivant le cas échéant par de nouveaux échanges. Nous avons souhaité la réalisation d’une étude synthétisant les travaux universitaires évaluatifs en matière de politique de la ville ; nous avons aussi souhaité disposer, auprès d’un bureau d’étude spécialisé, d’une synthèse des évaluations sur un échantillon de contrats urbains de cohésion sociale (Cucs). Nous nous sommes rendus sur le terrain, pour rencontrer les élus locaux, les représentants de l’État, les associations et les habitants de certains quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous avons choisi de nous rendre aux Pays-Bas qui met en œuvre une politique de la ville semblable à la nôtre dans ses thématiques, selon une organisation différente de la nôtre. Nous avons fait part de nos impressions sur l’ensemble de ces travaux à un certain nombre d’élus nationaux et locaux et d’experts pour qu’ils nous éclairent par leur point de vue et leur expérience.
Les éléments actuels d’évaluation, notamment issus des rapports annuels de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), conduisent à constater que les écarts en termes de pauvreté, de chômage, d’accès aux soins et de résultats scolaires ne se sont pas réduits depuis la loi du 1er août 2003, qui avait fixé des objectifs en la matière et qu’ils demeurent à des niveaux parfois très préoccupants, les situations et évolutions étant hétérogènes selon les quartiers. Au demeurant, ces éléments, scientifiquement établis et crédibles, demeurent assez rares, ce qui peut étonner s’agissant d’un domaine, la politique de la ville, soumis à de nombreuses évaluations locales.
*
* *
L’organisation des administrations centrales, très récente encore dans sa forme actuelle puisque la DIV a été remplacée par le SG-CIV il y a un peu plus d’un an, ménage aujourd’hui l’autonomie de chaque acteur. La tutelle du Secrétariat général sur les deux agences ne peut être que légère ; il n’est qu’une composante de leur conseil d’administration respectif. À l’Anru comme à l’Acsé, la direction générale et les personnels qui l’entourent assurent effectivement la gestion opérationnelle et quotidienne de leur agence.
Les ressemblances entre les deux agences s’arrêtent là. L’Anru, après environ sept années d’existence, ne semble plus avoir qu’un seul problème d’importance, qui n’est d’ailleurs pas vraiment le sien : le financement des engagements pris avec les porteurs locaux des projets de rénovation urbaine. Cette hypothèque est étrangement bien vécue, car les praticiens nationaux de la rénovation urbaine ne doutent pas que la solidarité nationale se manifestera, le moment venu, malgré l’incertitude du moment. Comment en effet les pouvoirs publics pourraient-ils laisser ces engagements ne pas être honorés, alors que l’élaboration du Plan national de rénovation urbaine (PNRU) a mobilisé à travers tout le pays beaucoup d’élus locaux et le mouvement « HLM », et que les travaux, ou leur poursuite, sont attendus par les populations ? Comment pourrait-on inviter ces acteurs à désormais patienter, eux qui furent sommés d’élaborer des projets, parfois dans l’urgence, sous peine de ne pas avoir accès à l’enveloppe de la rénovation urbaine ? Il convient effectivement de donner à l’Anru les moyens de ne pas être victime de son succès, elle qui a su faire l’effort, de son côté, de limiter, certes parfois de façon encore insuffisante, les inconvénients liés à son caractère centralisé et parisien en « banalisant » un peu plus l’épreuve de son comité d’engagement pour les porteurs de projet et en réduisant ses délais de paiement.
Si la question du financement du PNRU reste à régler, et si les impacts globaux et particuliers de ce plan demeureront à évaluer puisqu’une très grande partie des chantiers ne sont pas achevés, son opportunité nous semble indiscutable. Nous avons entendu des questions et critiques légitimes à son égard. A-t-il permis la sélection des meilleurs projets, alors que les élus et bailleurs locaux ont parfois été tenus de faire vite, contraints par la menace de rater « un train » qui ne repasserait plus ? Satisfait-il à son objectif légal de mixité sociale, alors qu’il peut être une occasion pour les plus mobiles et sans doute les plus aisés des habitants d’un quartier jusqu’alors stigmatisé de le quitter ? Inversement, quels seront les résultats effectifs des dispositifs tendant à attirer dans les quartiers rénovés des populations plus aisées que celles qui y résidaient jusqu’alors ? Plus généralement, ne se satisfait-on pas à bon compte de la réalisation, qui n’est pas la plus complexe pourvu qu’il soit financé, d’un plan de travaux urbains quand la question de départ était de mettre fin à la relégation de ces quartiers sur les plans économique et social ?
Il faut faire justice à l’intérêt de ces questions et rien ne doit empêcher à l’avenir de tenter d’y répondre sereinement. Il convient cependant, selon nous, de saluer un plan ambitieux, mais qui n’est que la moindre des choses. Nous considérons que redonner une dignité à l’habitat des quartiers urbains populaires était une obligation matérielle et morale. L’intérêt du PNRU va bien au-delà de l’amélioration de l’image des quartiers pour ses habitants ; certaines familles de ces quartiers vivaient et vivent encore dans des conditions et un environnement humainement inacceptables, ce dont certaines de nos visites sur place nous permettent de témoigner. Le PNRU, tout critiquable et interrogeable qu’il soit, a le mérite primordial de leur apporter une réponse réelle. Par ailleurs, si on considère économiquement légitime de mener une politique de grands travaux, le PNRU en constitue sans discussion une forme socialement utile. En conséquence, compte tenu du fait que le PNRU ne traite qu’une part, certes substantielle, des besoins en matière de rénovation urbaine, nous sommes favorables à un « PNRU II » à l’issue du plan actuel, pour la renforcer et l’achever.
*
* *
Aussi indispensable qu’il soit, le PNRU n’est en tout état de cause pas la panacée. La politique de la ville doit s’appuyer à la fois sur la nécessaire rénovation urbaine et sur une politique spécifique d’interventions sociales au sens large. Car au-delà de la dignité de l’habitat, se jouent dans ces quartiers l’effectivité de la promesse républicaine et donc une partie de l’avenir du pays ; être né, avoir grandi, vivre quelque part sur le territoire national ne saurait sceller un destin social. Si chacun a droit à la dignité aujourd’hui, il doit aussi avoir la chance effective de faire valoir ses mérites et de tenter de satisfaire ses ambitions. C’est pourquoi, dans nos quartiers urbains difficiles, là où se concentrent la pauvreté, le chômage, l’échec scolaire et là, où, sans doute, il est plus difficile d’échapper à l’horizon du territoire, il est légitime d’y organiser « sur mesure » l’action des pouvoirs publics et d’y apporter des moyens supplémentaires et suffisants pour l’éducation, l’emploi, le développement économique et la santé.
Face à un tel enjeu qui, s’appuyant sur la mesure des écarts, consiste à donner à chaque personne la chance d’avoir une prise sur son sort et celui de ses enfants, il est évidemment nécessaire de mobiliser harmonieusement toutes les forces thématiques de l’État, mises en musique par un pilotage fort exerçant une réelle autorité. Nous avons l’impression que l’organisation actuelle n’est pas à la hauteur de ces exigences.
Comment peut-il en être autrement alors que l’agence qui a en charge les moyens d’intervention de la politique de la ville n’a inspiré à peu près aucun des dispositifs et des actions qu’elle est chargée de mettre en œuvre ? Alors qu’elle n’a pas vraiment achevé la tâche primordiale de savoir à quoi et où précisément les fonds publics nationaux de la politique de la ville sont affectés ? Alors que l’instrument contractuel de mobilisation des moyens nationaux et locaux, le contrat urbain de cohésion sociale (Cucs), n’a pas relevé de son initiative, pas plus que sa mise en œuvre ne relève de sa compétence ? Alors que cet outil contractuel, qui devait être basé sur un diagnostic approfondi et circonstancié d’une situation urbaine locale, a consisté, dans un nombre de cas non négligeable, en un exercice de style sous contrainte de temps, destiné à « ouvrir » les financements, souvent en reconduisant ceux qui étaient pratiqués antérieurement ? Alors qu’un tel théâtre d’ombres conduit inévitablement sur le terrain à la routine et à la démotivation ?
La loi du 1er août 2003, en érigeant légitimement la rénovation urbaine en priorité nationale, a par ailleurs sans doute renforcé le questionnement sur l’utilité et l’efficacité du volet « social » de la politique de la ville. Il y a pu avoir une tentation à la facilité, consistant à cantonner désormais la politique de la ville au nombre de logements sociaux démolis, reconstruits, résidentialisés ou rénovés. Or, tenter d’oublier les situations de précarité sociale et de santé, la relégation économique, l’isolement géographique, c’est prendre le risque de mettre en danger les acquis réels de la rénovation urbaine. Tous les praticiens de la politique de la ville, y compris les plus impliqués dans la rénovation urbaine, l’ont confié à vos rapporteurs : l’investissement que la France a consenti pour rénover ses quartiers urbains difficiles ne sera rentabilisé que si les questions « sociales » au sens large y sont mieux traitées qu’aujourd’hui.
*
* *
Ce tableau contrasté des forces et faiblesses de l’organisation nationale de la politique de la ville doit être complété par un panorama des modalités et de l’intensité de l’implication des ministères de « droit commun ». Vos rapporteurs ont entendu et questionné à ce titre les responsables administratifs de l’éducation nationale, de l’emploi, du logement, de la police nationale et des collectivités territoriales. Quand le document de politique transversale sur la politique de la ville affiche plus de trois milliards d’euros de contributions interministérielles aussi nombreuses que diverses en faveur des quartiers prioritaires, qu’en est-il dans les faits ?
Vos rapporteurs n’insisteront pas sur les modalités de calcul de ces contributions, parfois obscures, souvent approximatives parce que forfaitaires, dont l’hétérogénéité et l’imprécision, privent de sens toute tentative d’en faire la somme.
Le cadre d’action premier des ministères de droit commun est qu’un élève en difficulté, un demandeur d’emploi, une famille à la recherche d’un logement ou la victime d’un délit appellent légitimement une réponse en terme d’action publique, partout sur le territoire. La prise en compte de la géographie prioritaire de la politique de la ville constitue dans ce contexte une approche parmi d’autres dans la mise en oeuvre d’une politique nationale.
Vos rapporteurs ont ressenti la proximité naturelle de certaines politiques de droit commun avec la politique de la ville. L’éducation prioritaire partage le même esprit et la même philosophie que la politique de la ville, sans que leurs cadres territoriaux respectifs d’action se recoupent totalement. Le champ d’action en matière de sécurité publique contre le trafic de stupéfiants, l’économie souterraine et certaines incivilités recoupe largement aussi les territoires urbains concernés par la politique de la ville.
Au demeurant, si le SG-CIV ne ménage pas sa peine en matière d’organisation de l’interministérialité de la politique de la ville, il n’a d’influence qu’à l’aune de la capacité d’influence de ses autorités politiques de tutelle, qui elle-mêmes sont tributaires des équilibres et priorités politiques de tout un gouvernement. Nous avons entendu Mme Fadela Amara, dont nous avons apprécié l’engagement personnel et la lucidité, y compris dans l’examen de la réalité de ses marges de manoeuvre politiques. Le rapport de force politique et institutionnel, peu en faveur des instances nationales pour lesquelles la politique de la ville est la priorité d’action, n’a pas été modifié par la dynamique « espoir banlieues » (dont il est trop tôt pour évaluer les impacts) : les ministères de droit commun sont responsables des principaux dispositifs, dans un cadre interministériel dont il est difficile de voir la réalité.
*
* *
Nous considérons que ce contexte national, conjoncturel, peu favorable à la prise en compte prioritaire de la politique de la ville, se double aujourd’hui d’une déficience structurelle de l’État déconcentré. Représentant de l’État et de l’ensemble du Gouvernement, délégué territorial de l’Anru et de l’Acsé, le préfet, en charge de toutes les politiques publiques de l’État, ne peut être en mesure, dans chaque quartier prioritaire, d’avoir la proximité suffisante pour traiter efficacement des réalités et des enjeux. Les créations successives des sous-préfets à la ville, des préfets délégués à l’égalité des chances, ou, plus récemment, des délégués du préfet en sont d’ailleurs le témoignage. Les délégués du préfet constituent sans doute un « format » de représentation de l’État adapté car propre à chaque quartier prioritaire. Mais ce « symbole » de la présence de l’État ne peut gagner en épaisseur et en efficacité que s’il dispose, dans le contexte d’un rôle accru des collectivités territoriales, de prérogatives réelles, de services et d’une place effective dans le fonctionnement de l’État. Nous avons constaté que l’on est loin du compte en la matière.
Nous avons eu l’impression lors de certains de nos déplacements d’un État appauvri, secoué par les différentes vagues de RGPP, en difficulté pour faire entendre son rôle, ses réalisations et les principes dont il est le garant. En crise d’identité et de légitimité, l’État déconcentré semble justifier son existence par, au mieux, le rappel des crédits nationaux versés dans le cadre des Cucs et, le cas échéant, une tendance au contrôle tatillon et formaliste. Alors que nous avons besoin d’un État local garant de l’éthique et des principes républicains, facilitateur des initiatives locales, présent, avec ses personnels, au sein même de nos quartiers urbains difficiles, au service d’une politique nationale de la ville pilotée par les collectivités territoriales.
*
* *
Car nous avons la conviction que le maire est la seule autorité locale susceptible de traiter des problèmes territoriaux urbains dans leur globalité, en s’appuyant, le cas échéant, sur une approche et des solidarités intercommunales. Nos déplacements à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, à Orléans et à Lyon, Bron et Vénissieux nous ont confirmé que relèvent du maire et de son équipe municipale l’engagement quotidien, l’enthousiasme, l’attachement intime à la ville dans toutes ses facettes, ainsi que la connaissance et la vision de l’ensemble urbain et de ses détails ; le maire est la clé de voûte d’une possible réussite de la politique de la ville.
Encore faut-il qu’il dispose des moyens adéquats. Nous considérons que malgré les efforts réels de ces dernières années concernant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et la dotation de développement urbain (DDU), le compte n’y est pas. La réalité aujourd’hui est encore pour certaines communes le cumul de faibles ressources et des charges et difficultés urbaines les plus lourdes. L’invention des dispositifs de péréquation postérieurs à la suppression de la taxe professionnelle doit être l’occasion d’une évaluation rationnelle et globale des besoins de péréquation et de la mise en œuvre pérenne des dispositifs correspondants, y compris, si nécessaire, en allant plus loin qu’aujourd’hui dans la remise en cause des situations acquises en matière de dotations nationales, afin de concentrer les moyens là où ils sont indispensables et y atteindre le seuil critique d’efficacité, plutôt que d’effectuer un saupoudrage qui ne satisfait personne.
Les moyens à imaginer demain sont certes financiers ; en la matière, il convient selon nous d’au moins stabiliser les crédits d’intervention à la disposition de l’Acsé pour les actions et initiatives locales ; de maintenir demain une aide spécifique à l’activité économique et de soutien à l’emploi à hauteur du coût actuel des exonérations applicables dans les ZFU, peut-être sous une autre forme ou dans un autre cadre géographique (car si le coût d’un emploi dans ces quartiers peut être élevé comme l’indique l’une des rares évaluations sur le dispositif des ZFU, certains de ses emplois n’ont pas de prix pour la vie des quartiers concernés, notamment dans les petits commerces) ; de permettre une péréquation à hauteur des enjeux ; et, bien entendu, de financer le PNRU au rythme de l’avancée des travaux dans les quartiers. Nous ne pensons pas que la politique de la ville dispose aujourd’hui de trop de moyens ; nous ne sommes d’ailleurs pas certains que leur niveau actuel ne devrait pas être augmenté, s’agissant des crédits d’intervention. Il est vraisemblable qu’ils ne sont pas suffisamment concentrés sur un nombre restreint de territoires délimités de façon objective.
Mais nous pensons aussi que les moyens à prévoir pour demain sont d’un autre ordre ; nous sommes favorables à mettre dans les mains du maire, dans un premier temps à titre expérimental, sur une base contractuelle et dans le cadre de la politique de la ville, d’autres leviers et facultés : signer les conventions d’emploi aidé en lieu et place de l’État ; organiser l’emploi et l’implantation des forces de sécurité publique ; affecter les effectifs de l’éducation nationale … Il ne peut y avoir de mauvaises idées qu’une fois les avoir réellement envisagées, et de préférence après les avoir testées. L’État, dans une décentralisation approfondie qui fait réellement confiance aux acteurs locaux, aurait alors un rôle effectif et primordial à jouer : élaboration conjointe avec la commune ou l’intercommunalité concernée du projet de territoire préalable à la contractualisation envisageant l’exercice local de nouvelles compétences ; rôle de garant en dernier recours des principes républicains et de la sécurité publique ; mesure et évaluation des résultats localisés à une échelle très fine à l’intérieur du quartier, dans un cadre national ayant, pourquoi pas, une fonction d’émulation des acteurs locaux (par exemple par l’organisation annuelle d’un débat public local sur le fondement des éléments d’évaluation actualisés disponibles).
Nous avons été surpris lors de notre visite aux Pays-Bas par la liberté et la simplicité avec laquelle les moyens de la politique de la ville sont pensés et organisés au service d’un projet local global, au plus près des quartiers, des commerçants et des habitants ; sans référence obligée et contraignante à des principes abstraits et théoriques sur les compétences des uns et des autres. Aujourd’hui en France, imaginer qu’un agent public puisse être concrètement à la fois sous l’autorité du maire et de l’État implique un parcours juridique dont le promoteur n’est pas certain de sortir gagnant, obligé qu’il est de justifier juridiquement et en opportunité une telle initiative.
*
* *
L’ensemble de nos travaux nous a amenés par ailleurs à nous poser certaines questions plus larges sur les objectifs de la politique de la ville. Nous sommes convaincus qu’il existera demain comme aujourd’hui des quartiers populaires. Si on vit mal aujourd’hui en France dans un certain nombre d’entre eux, il nous semble qu’une politique de la ville ambitieuse peut se donner l’objectif simple que leurs habitants y vivent mieux demain ; pour autant, nous semble-t-il, que chacun puisse y résider de façon digne et apaisée et qu’il n’y ait pas, sur le chemin que chaque personne conçoit pour sa propre vie et pour celles de ses enfants, d’obstacles liés au lieu de résidence, par le peu de ressources concrètes dont on y disposerait ou par la discrimination dont ce lieu serait à l’origine. Il s’agit simplement de permettre, dans ces quartiers comme ailleurs, l’accès à l’emploi, à un habitat digne et à un parcours scolaire qui valorise les capacités et le mérite ; à vrai dire, c’est bien ainsi que l’on pourra constater statistiquement, in fine, la réduction des « écarts à la moyenne », en matière de revenus notamment, ou de chômage, dont l’ampleur actuelle mériterait sans doute d’être plus largement rendue publique tant nous avons l’intuition que chacun n’en a pas pris l’exacte mesure.
Nous ne souhaitons pas remettre en cause certains moyens mis en oeuvre dans un objectif de mixité sociale, y compris dans les communes et quartiers plus aisés. Il serait d’ailleurs judicieux d’éviter sur ce point une certaine contradiction des politiques nationales ; les quartiers urbains dans lesquels se concentre la précarité sociale en France n’ont pas bien entendu pas vocation à être le lieu d’accueil prioritaire des bénéficiaires du droit au logement opposable. Nous pensons cependant que l’objectif d’une amélioration des conditions et perspectives de vie des habitants de nos quartiers urbains les plus en difficulté est primordial, même si cet objectif est plus modeste que celui d’une « mixité sociale » qu’il serait possible de susciter par une politique ambitieuse des peuplements.
Que l’atteinte d’un objectif centré sur l’amélioration des situations des habitants des quartiers prioritaires se traduise par des mobilités résidentielles et professionnelles allant ou en provenance de ces quartiers, est alors plus accessoire, même si l’étude de ces mobilités reste à faire, notamment pour conforter l’hypothèse que ces quartiers assureraient, dans certains cas, une fonction bénéfique de « sas » dans une trajectoire sociale « ascendante », ce qui reste d’ailleurs à prouver. Dans la même perspective, devient plus secondaire la bonne manière d’envisager une réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville, même si cette réforme est nécessaire et doit s’appuyer sur des critères plus objectifs et plus précis qu’aujourd’hui, s’agissant notamment des ZUS, en resserrant sans doute leur nombre et leurs contours autour des quartiers urbains qui concentrent les plus grandes difficultés économiques et sociales.
Il est un dernier point, en guise de conclusion, que vos rapporteurs souhaiteraient aborder : chaque acteur, chaque praticien de la politique de la ville sait que le « public » de la politique de la ville est composé plus qu’ailleurs de personnes étrangères, de compatriotes d’origine étrangère et de jeunes « issus des minorités visibles », pour employer une expression un peu étrange, qui doit nous interroger sur notre incapacité collective à dire ce qu’il en est de la diversité des couleurs qui composent aujourd’hui le visage de la France. Une République ambitieuse pour ses quartiers urbains en difficulté n’a rien à perdre à parler franchement et à assumer clairement cette réalité. Au-delà des moyens humains, techniques et juridiques mis en œuvre pour réussir la politique de la ville, ce serait sans doute un atout pour l’exercice d’une parole publique républicaine efficace contre les racismes, les discriminations et les communautarismes.
PREMIÈRE PARTIE : QUELS MOYENS ET ACTIONS POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
I.– PHOTOGRAPHIE CRITIQUE DES MOYENS ET ACTIONS MIS EN œUVRE EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
A.– LES MOYENS BUDGÉTAIRES NATIONAUX ACTUELLEMENT DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le tableau suivant retrace pour 2009, dernier exercice budgétaire achevé, les consommations de l’ensemble des moyens budgétaires nationaux que l’on peut estimer être spécifiquement dédiés à la politique de la ville.
CONSOMMATIONS EN 2009 DES MOYENS BUDGÉTAIRES NATIONAUX
DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE
(en millions d’euros)
Programme 147 « Politique de la ville » |
465,55 |
Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) |
995,59 |
Dépenses fiscales et « sociales » |
693,00 |
Dotations de péréquation (Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : DSU-CS ; dotation de développement urbain : DDU ; et fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France : FSRIF) |
1 399,00 |
Établissement public d’insertion de la défense (Épide) et Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Épareca) |
25,20
|
Caisse des dépôts et consignations |
80,00 |
Total |
3 700,84 |
La lecture de ce tableau nécessite les précisions suivantes :
– les crédits consommés au titre du programme 147 « Politique de la ville » s’élèvent en fait en 2009 à 788,398 millions d’euros. Ont été retranchés de ce montant, pour la construction des lignes correspondantes du tableau précédent, le remboursement des dépenses « sociales » aux organismes de sécurité sociale et la subvention à l’établissement public d’insertion de la défense (Épide), présentés de manière distincte ;
– pour l’Épide, le montant retenu est celui de la subvention qu’il reçoit du programme 147 et non son budget total, considérant que son activité est rattachable à la politique de la ville seulement pour la part financée par ce programme. A contrario, le montant retenu pour l’Épareca est celui de son budget total, étant entendu que l’activité de cet établissement public concerne exclusivement les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
1.– Les crédits d’intervention de l’État spécifiquement en faveur de la politique de la ville : le programme 147
a) La structure tripartite du programme 147 : une administration centrale concentrée sur le pilotage, des opérateurs gérant l’essentiel des crédits d’intervention, le financement de certaines exonérations de charges sociales
Le programme 147 « Politique de la ville » retrace les crédits du budget de l’État spécifiquement dédiés à la politique en faveur des quartiers urbains défavorisés et principalement gérés par le SG-CIV. Parmi ces crédits, dont le montant total s’est élevé en exécution en 2009 à 788,398 millions d’euros, on peut distinguer :
– des crédits d’intervention dont bénéficient certaines administrations et certains opérateurs, pour un montant de 490,768 millions d’euros (7) ;
– des crédits permettant le remboursement aux régimes de sécurité sociale des exonérations de cotisations de sécurité sociale au titre de dispositions spécifiques applicables dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et, surtout, les zones franches urbaines (ZFU), pour un montant de 297,6 millions d’euros.
Ces deux grandes catégories de crédits seront successivement retracées dans la présente partie, les chiffres indiqués étant a priori ceux de l’exécution 2009.
S’agissant des crédits d’intervention dont bénéficient certaines administrations et certains opérateurs, 7,64 % de ces crédits (soit 37,520 millions d’euros sur 490,768 millions d’euros) ont été confiés en gestion au Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG-CIV), qui a succédé à la délégation interministérielle à la ville (DIV) en tant que principale administration centrale chargée de la politique de la ville. Parmi les opérations ayant ainsi directement relevé du SG-CIV en 2009, on peut distinguer :
– la délégation de crédits dans certaines collectivités d’outre-mer au titre d’actions financées classiquement par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) dans les départements et les régions d’outre-mer et métropolitains(8). Les crédits de paiement correspondants, qui ont concerné la Polynésie française, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, se sont élevés en 2009 à 3,48 millions d’euros ;
– le SG-CIV a procédé au financement de 43 associations nationales pour 2,34 millions d’euros. Le transfert à l’Acsé des crédits correspondants devrait être progressivement mis en œuvre au cours des exercices postérieurs à 2009 ;
– 20,37 millions d’euros de crédits de paiement ont permis de financer des engagements antérieurs au Plan national de rénovation urbaine (PNRU), pris au titre, d’une part, de l’ancien fonds interministériel pour la ville (FIV) pour la partie investissement de certains anciens contrats de ville et, d’autre part, des grands projets de ville (GPV) et opérations de renouvellement urbain (ORU) ;
– 3,88 millions d’euros de crédits de paiement ont été affectés au fonctionnement du SG-CIV et plus particulièrement à celui de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) et du Conseil national des villes (CNV), dont les secrétariats sont assurés par le SG-CIV ;
– 2,05 millions d’euros au titre du fonctionnement des services déconcentrés, dont une partie substantielle a permis des actions de formation des délégués du préfet et le financement des dépenses de fonctionnement courantes liées à l’exercice de leurs activités (dotation de 1 800 euros par délégué du préfet). On peut rappeler à ce stade que les délégués du préfet ont vocation à incarner la présence de l’État dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
– 2,24 millions d’euros consacrés au financement de dix-huit centres de ressources régionaux, qui, sous la forme d’associations ou de groupements d’intérêt public (GIP) réunissant notamment des collectivités territoriales, contribuent à la diffusion de l’information, à la formation et à la capitalisation des expériences en matière de politique de la ville. L’activité de ces centres de ressources régionaux est encadrée par un cahier des charges national établi par le SG-CIV ;
– 2,43 millions d’euros au titre du financement d’actions d’animation régionale de la politique de la ville. Ces crédits pourraient, s’agissant des exercices postérieurs à 2009, être transférés à l’Acsé ;
– la distribution par le SG-CIV de 0,37 millions d’euros pour financer 70 petites associations dans le cadre de la réserve parlementaire.
Une part non négligeable de ces différents crédits correspond à des emplois qui n’ont pas relevé de décisions de gestion du SG-CIV. Si sont retranchés de ces crédits consommés les montants relevant du fonctionnement centralisé ou déconcentré de l’État, d’engagements antérieurs en matière de rénovation urbaine et de la réserve parlementaire, sont demeurés à la disposition du SG-CIV, au titre de décisions de gestion, environ 10,5 millions d’euros pour le financement d’actions dans certaines collectivités d’outre-mer, d’associations nationales et d’opérations d’ingénierie et d’animation en matière de politique de la ville (centres de ressources et animation régionale). Certains de ces crédits réellement à la disposition du SG-CIV en 2009 ont vocation, par ailleurs, à être très prochainement gérés par l’Acsé. Le recentrage des missions du SG-CIV sur des fonctions stratégiques correspond d’ailleurs à la définition récente de ses missions opérationnelles : l’article 6 du décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville précise ainsi que le SG-CIV « contribue à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre interministérielles de la politique de la ville », sans que soit évoquée une fonction de pure gestion au titre de cette politique.
En tout état de cause, si ces crédits confiés en gestion au SG-CIV sont retranchés du montant de 490,768 millions d’euros de crédits d’intervention du programme 147, ce sont 453,248 millions d’euros, soit 92,35 % de ces crédits, qui ont permis le financement de certains des principaux opérateurs nationaux de la politique de la ville :
– 423,208 millions d’euros ont été affectés à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), tant pour le financement de ses interventions (402,109 millions d’euros) que pour le financement de son fonctionnement et de ses dépenses de personnel (21,099 millions d’euros). Le poids du financement de l’Acsé dans le programme 147 (53,7 % de l’ensemble des crédits du programme 147 lui ont été transférés en 2009 – soit 86,23 % des crédits d’intervention du même programme hors les crédits destinés au financement des exonérations de cotisations en ZFU et en ZRU) et le caractère central de cet établissement public dans la mise en œuvre de la politique de la ville conduiront à consacrer une partie substantielle des développements suivants à cette « agence » ;
– 4,821 millions d’euros ont été affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) au titre de certaines de ses dépenses de personnel et de fonctionnement (il s’agit donc d’une subvention pour charges de service public et non d’une contribution au financement des subventions d’investissement de l’agence) ;
– 25,219 millions d’euros ont été affectés à l’établissement public d’insertion de la défense (Épide). Cet établissement, qui dépend à titre principal de la mission « Travail et emploi », est chargé d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes volontaires sans qualification ni emploi ou en voie de marginalisation sociale, en s’adressant notamment aux populations des zones urbaines sensibles. En 2009, les 20 sites de l’Épide sur le territoire national ont ainsi permis d’accueillir 2 000 jeunes.
b) L’activité de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé)
Ÿ Les sources de financement de l’Acsé
Plus de la moitié des crédits du programme 147 est aujourd’hui consacrée au financement de l’Acsé. En 2009, ce programme a permis le financement de l’agence à hauteur de 423,208 millions d’euros. Ce financement avait deux fonctions : les interventions de l’agence au titre de la politique de la ville pour 402,109 millions d’euros et certaines de ses dépenses liées à son fonctionnement et à ses personnels pour 21,099 millions d’euros.
Cependant, les ressources de l’Acsé n’ont pas uniquement pour origine les crédits du programme 147. En effet, l’établissement public a en outre bénéficié en 2009 des ressources suivantes, au titre de subventions de l’État, pour un montant global de 70,247 millions d’euros :
– le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » permet le financement de l’Acsé à hauteur de 14,387 millions d’euros. Il s’agissait en 2009 d’assurer la transition du transfert, prévu, au titre de l’exercice 2009, par l’article 67 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de certaines missions relatives à l’accueil des migrants. Une convention signée entre l’Acsé et la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC) a explicité les modalités concrètes de cet aménagement budgétaire transitoire, qui a prévu la gestion par l’Acsé de certaines formations linguistiques en direction des migrants pendant le premier semestre 2009 et le financement d’aides au logement versées aux foyers de travailleurs migrants au titre de l’exercice 2009 ;
– le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) est « localisé » au sein de l’Acsé par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, pour un montant en exécution 2009 de 35 millions d’euros (9). Le même article prévoit que le FIPD finance des actions « dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles [c’est-à-dire les contrats urbains de cohésion sociale] ». Les orientations d’emploi des fonds attribués au FIPD sont fixées par le Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) (10). Le même article prévoit qu’« en application de ces orientations, le conseil d’administration de l’agence approuve les programmes d’intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l’État dans le département ». L’Acsé est donc l’organisme payeur des crédits du FIPD mais n’a qu’une marge de manœuvre limitée s’agissant de l’emploi de ces crédits. Ceux-ci ne sont en tout état de cause pas fongibles avec ceux de la politique de la ville, les circulaires annuelles qui fixent les orientations pour l’emploi des crédits du FIPD rappelant par ailleurs que leurs emplois ne sont soumis à aucun zonage administratif. Ces crédits sont composés d’une part du produit des amendes de la circulation arrêté chaque fin d’année en loi de finances rectificative et, le cas échéant, d’une enveloppe supplémentaire. L’investissement en matériels de vidéoprotection constitue, de façon croissante ces dernières années, l’orientation majeure de l’emploi des fonds du FIPD ;
– l’Acsé a consommé en 2009, au titre du Plan de relance, 6,897 millions d’euros pour des mesures en faveur de l’emploi et 1,526 million d’euros au titre de mesures de développement de la vidéoprotection. Les crédits de paiement dont l’Acsé a bénéficié en 2009 au titre de ces deux catégories de mesures se sont élevés à, respectivement, 8 millions d’euros et 2 millions d’euros. En 2010, hors reports, des crédits de paiement de 12 millions d’euros et de 2 millions d’euros seront ouverts au bénéfice de l’agence au titre de ces mêmes mesures, respectivement, en faveur de l’emploi et de la vidéoprotection ;
– le Haut commissariat à la jeunesse et à la vie associative a versé à l’Acsé en 2009 9,321 millions d’euros, au titre, notamment, du financement du service civil volontaire ;
– enfin, 1,538 million d’euros ont été versés à l’Acsé par d’autres ministères, aux termes de conventions ponctuelles.
Ces ressources ont été complétées en 2009 par 23,187 millions d’euros du Fonds social européen (FSE). Enfin, l’établissement public a bénéficié d’autres ressources, dont des ressources propres, à hauteur de 19,046 millions d’euros (11).
Ainsi, les sommes dont a pu bénéficier l’Acsé en 2009, soit 535,688 millions d’euros au total, n’ont pour origine le programme 147 qu’à hauteur de 79 %.
Au demeurant, s’agissant de la destination des crédits consommés, l’Acsé précise que 406,765 millions d’euros ont en 2009 été consacrés spécifiquement à la politique de la ville (12), soit 78,67 % de l’ensemble des crédits consommés par l’établissement public.
Ÿ L’usage des crédits de l’Acsé
Comment comprendre concrètement quels sont les usages des crédits consacrés par l’Acsé à la politique de la ville ? Il faut pour cela à la fois avoir à l’esprit la méthode de travail de l’agence et les programmes qu’elle met en œuvre.
S’agissant de sa méthode de travail, l’une des activités fondamentales de l’Acsé consiste à enregistrer des demandes de subventions, notamment de la part d’associations mais aussi d’autres structures, parfois publiques, et à instruire ces demandes. Au vu de la compatibilité de ces demandes avec l’objet des programmes qu’elle est chargée de mettre en œuvre et avec les capacités financières dont elle dispose, l’Acsé procède ou non au paiement d’une subvention correspondant au moins partiellement aux montants pour lesquels elle a été sollicitée. Plusieurs points doivent sur ce sujet être précisés :
– la répartition annuelle des disponibilités financières de l’agence pour chaque niveau territorial (national, régional et départemental) et, pour les niveaux déconcentrés, pour chaque département ou région, est déterminée au préalable par délibération de son conseil d’administration. Le directeur général de l’agence met en œuvre ces orientations financières (13) ;
– les demandes de subventions peuvent être faites aux trois niveaux national, régional et départemental. Au niveau national, les services centraux de l’agence opèrent le traitement de l’ensemble de la procédure relative à ces demandes, alors que cette tâche revient aux agents de l’État aux niveaux déconcentrés, sous l’autorité du préfet de région ou du département, délégué territorial de l’agence (14). L’agence « dispose » ainsi de 126 délégués territoriaux de rang préfectoral (pour les 100 départements et les 26 régions), qui sont autant d’ordonnateurs secondaires, et d’environ 600 agents travaillant, souvent à titre partiel, à son service sous l’autorité des délégués territoriaux ;
– à l’intérieur des enveloppes fixées pour la politique de la ville par département, par région et au niveau national, les crédits sont dans une certaine mesure fongibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent avoir pour objet de financer tout dispositif dont l’agence a la charge ou toute action qu’elle estime éligible à ses subventions. Cette fongibilité ne concerne pas, cependant, les crédits « sanctuarisés » destinés au programme de réussite éducative, aux actions financées en matière d’emploi et de vidéoprotection dans le cadre du Plan de relance et aux adultes-relais.
Ainsi l’agence dispose d’une procédure financière et comptable claire et complète. La question de la compatibilité d’une demande de subvention avec les capacités financières de l’agence n’est donc pas problématique, quel que soit le niveau ou le lieu de l’action envisagée par le demandeur de la subvention. La question de la compatibilité de cette demande avec les orientations que l’agence est chargée de mettre en œuvre est plus problématique. Autrement dit, comprendre quelles sont les actions financées par l’agence est beaucoup plus complexe que de savoir comment elles le sont. Au demeurant, la création de l’Acsé avait au moins en partie pour origine, en 2006, la volonté de mieux savoir à quoi était consacrés, dans le détail, les crédits de la politique de la ville, en rationalisant au préalable leurs modalités d’attribution. En effet, la gestion du Fonds interministériel des villes (FIV), que l’Acsé a d’une certaine façon remplacé, ne permettait que très partiellement de savoir à quoi étaient employés les crédits correspondants.
Ÿ Les missions de l’Acsé
Le premier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’Acsé « contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle ». Cet objectif est marqué par l’idée que l’agence s’adresse à des personnes rencontrant certaines difficultés, sans référence à leur lieu de résidence. Le deuxième alinéa du même article confirme, dans ses deux premières phrases, l’objectif relatif à la lutte contre les difficultés d’insertion sociale et professionnelle : « [l’agence] concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l’illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire ».
La troisième phrase du même alinéa lui attribue par ailleurs une mission territorialisée, dans le cadre de la politique de la ville : « elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Le dernier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles éclaire la mise en œuvre de cette mission : « [l’agence] participe […] au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l’Etat pour la mise en œuvre d’actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa (15) ».
L’Acsé est donc légalement chargée de deux types de mission, l’une portant sur des personnes rencontrant certaines difficultés, l’autre portant sur les habitants des quartiers défavorisés, au titre de leur lieu de résidence ; cette seconde catégorie de mission passant le cas échéant par la participation au financement d’actions entreprises dans le cadre de contrats passés entre l’État et les collectivités territoriales. Autrement dit, il est légalement loisible à l’Acsé, selon les orientations prises par son conseil d’administration, de financer des actions entreprises hors les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; elle a également la faculté, lorsqu’elle contribue au financement d’une action dans un de ces quartiers, de le faire hors du cadre des contrats urbains de cohésion sociale (Cucs). L’Acsé précise ainsi qu’en 2009, les 406,765 millions d’euros consommés au titre de la politique de la ville peuvent être répartis de la façon suivante, montrant ainsi que certains crédits ne relèvent pas de la programmation prévus par les Cucs et que d’autres, pour des montants qui demeurent assez faibles, ne relèvent pas même de la géographie prioritaire de la politique de la ville :
– 234 millions d’euros relèvent d’opérations menées dans le cadre de la programmation d’un seul Cucs ;
– 51,4 millions d’euros relèvent d’opérations menées dans plusieurs Cucs d’un même département, d’une même région ou de l’ensemble de la France ;
– 31,4 millions d’euros relèvent d’opérations menées sur le territoire d’un Cucs mais en dehors de la programmation qu’il définit ;
– 5,7 millions d’euros relèvent d’opérations menées en dehors de toute programmation des Cucs, pour lesquelles la décision de subvention a été autorisée par les délégués départementaux de l’agence ;
– 83,9 millions d’euros relèvent du programme adultes-relais, pour lequel les paiements correspondants sont effectués par l’Agence de service et des paiements (ASP) (16), et non par l’Acsé ou par ses ordonnateurs secondaires.
L’autre enseignement que l’on peut tirer des dispositions législatives régissant les missions de l’agence, est le flou relatif de la définition des actions que l’Acsé est susceptible de financer. L’agence, créée par l’article 38 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, effectivement mise en place à compter du 30 juillet 2006 par le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006, ne fut pleinement opérationnelle qu’au cours du début de l’année 2007. Il n’est pas faux de dire que la création de l’agence n’a pas correspondu à la mise en œuvre d’une politique de la ville nouvelle, tant, en la matière, elle a été chargée de gérer des actions existantes et éparses, issues de strates chronologiques antérieures et différentes, dans l’optique, certes modeste mais cependant primordiale, de mieux savoir, au moins d’un point de vue financier, ce que l’État faisait pour la politique de la ville (17).
Le programme de réussite éducative (PRE), le programme adultes-relais, le programme Ville, Vie, Vacances, gérés aujourd’hui par l’Acsé, dont les fonctionnements et objectifs sont retracés ci-après, illustrent ainsi le fait que l’agence a la charge de gérer des actions qui lui sont, parfois de beaucoup, antérieures.
Ÿ Le programme de réussite éducative (PRE)
Le PRE a été financé par l’Acsé en 2009 à hauteur de 78,067 millions d’euros. Sa définition et sa mise en œuvre sont cependant antérieures à la création de l’agence ; ainsi, les dispositifs de réussite éducative ont, en premier lieu, constitué l’un des axes du Plan de cohésion sociale (18) présenté en Conseil des ministres par M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, le 30 juin 2004.
Ÿ Objectifs du PRE
Le programme n° 15 du Plan de cohésion sociale, intitulé « Accompagner les enfants en fragilité » y est ainsi présenté (19) :
« Les quartiers défavorisés cumulent les handicaps : environnement dégradé, taux de chômage plus élevé que la moyenne, familles particulièrement touchées par les “accidents de la vie”. L’éducation des enfants y est beaucoup plus difficile, les risques de décrochage scolaire, les attitudes agressives, les situations de stress ou le repli sur soi sont plus fréquents.
« La prévention précoce peut permettre d’agir sur les difficultés rencontrées par certains enfants, au moment où se construit leur personnalité. Accompagner dès le plus jeune âge les enfants en difficulté, c’est faciliter leur insertion sociale, leur développement personnel et leur réussite scolaire. C’est un investissement pour notre cohésion sociale et un facteur d’égalité des chances. »
Plusieurs grands principes du PRE ont ainsi été affirmés à ce stade : sont visés des territoires – les « quartiers défavorisés – au titre de leurs caractéristiques structurelles et, dans ces territoires, plus précisément « certains enfants », au titre de leurs difficultés éducatives et scolaires, mais aussi au titre de difficultés comportementales plus générales. Logiquement, le dispositif de réussite éducative relève donc de la prévention, dans un champ comprenant notamment la scolarité mais qui, en même temps, la dépasse ; la « réussite scolaire » n’a donc pas été le seul objectif du PRE dès son origine, l’« insertion sociale » et le « développement personnel » constituant par ailleurs aussi des objectifs à part entière de ce programme.
Plus loin, après une énumération de certaines expériences internationales en la matière, la présentation du programme n° 15 du Plan de cohésion sociale se poursuit ainsi (20) :
« Pour rendre plus effective l’égalité des chances entre les enfants, le plan prévoit la création d’équipes de réussite éducative.
« Ces équipes mobilisent, autour de l’enfant et des parents, tous les professionnels spécialistes de la petite enfance : enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres et rééducateurs (kinésithérapeutes, orthophonistes).
« Créées à l’initiative des chefs d’établissements, des communes et de leurs groupements, des départements, des CAF [caisses d’allocations familiales] et de l’État, ces équipes permettent un accompagnement collectif ou individuel des enfants et de leur famille, notamment de ceux qui sont signalés comme étant en grande difficulté. Elles s’appuieront sur une structure juridique souple (groupement d’intérêt public, par exemple, ou caisse des écoles au statut rénové). Les activités proposées mêlent soutien scolaire, écoute de l’enfant et activités récréatives ; elles s’inscrivent dans le cadre d’un contrat, passé entre la famille et l’équipe de réussite éducative. »
Ainsi, d’autres éléments fondamentaux du PRE sont affirmés : les enfants concernés, ainsi que leurs parents, sont pris en charge, sur une base contractuelle, par une équipe pluridisciplinaire réunie à l’initiative d’acteurs locaux compétents dans les domaines éducatif et social. La structure institutionnelle encadrant ces équipes se veut souple. Les activités proposées relèvent elles aussi d’une approche à la fois scolaire et sociale.
Le programme n° 16 du Plan de cohésion sociale, intitulé « Accompagner les collégiens en difficulté et rénover l’éducation prioritaire » constitue en quelque sorte une déclinaison dans l’enseignement secondaire du programme n° 15. Ce programme n° 16 est ainsi présenté (21) :
« Des moyens spécifiques pour mettre en œuvre un accompagnement social, médical et éducatif des collégiens des quartiers les plus défavorisés : 150 plates-formes de réussite éducative sont créées, en lien avec la communauté éducative ; elles réunissent les services sociaux et sanitaires de l’éducation nationale, ceux de l’aide sociale à l’enfance et les centres de pédopsychiatrie et permettent d’offrir aux collégiens à la dérive un soutien complet et adapté. »
On retrouve dans cette description les éléments fondamentaux du programme de réussite éducative : ciblage sur les collégiens les plus en difficulté dans les quartiers eux-mêmes en difficulté, dimensions à la fois éducative, sanitaire et sociale du dispositif. Par ailleurs, le programme n° 16 prévoit aussi la création d’internats de réussite éducative ; ils avaient vocation à accueillir « les collégiens repérés par les enseignants comme étant en grande difficulté, du fait de leur comportement ou de leur environnement. Ils comporteront, à parts égales, un enseignement général, un enseignement pré-professionnel et des activités ludiques et culturelles. »
Le PRE a ensuite fait l’objet d’une mise en œuvre législative dans le cadre de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, loi dont l’objet était de décliner le volet législatif du Plan de cohésion sociale. L’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dispose que :
« Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d’accompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
« […]
« Les dispositifs de réussite éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire. »
Les articles 129 à 131 de la loi de programmation pour la cohésion sociale ont prévu que les structures supports des dispositifs de réussite éducative peuvent être un établissement public local de coopération éducative (constitué entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et l’État), une caisse des écoles aux compétences étendues à cet effet ou un groupement d’intérêt public. Enfin l’article 132 de la même loi prévoyait la programmation pluriannuelle des crédits consacrés par l’État aux dispositifs de réussite éducative. Au total, 1 469 millions d’euros « valeur 2004 » devaient ainsi être consacrés au programme de réussite éducative, dont 62 et 174 millions d’euros respectivement en 2005 et 2006, puis 411 millions d’euros pour chacune des années 2007 à 2009. On note cependant à quel point cette programmation budgétaire n’a pas correspondu à la réalité (78,067 millions d’euros consommés en 2009 sur le programme 147), quand bien même on tiendrait compte de certains crédits de droit commun, hors les crédits de l’Acsé, pour comptabiliser l’ensemble des ressources affectées au PRE.
Ÿ Modalités pratiques du PRE
Des circulaires ont ensuite décliné les modalités pratiques du PRE. Une circulaire du 13 juin 2005 (22) explique ainsi que :
– l’organisation du dispositif est centrée sur les enfants et adolescents en fragilité, dont il revient aux adultes d’une communauté éducative élargie et aux professionnels de les repérer ;
– le partenariat institutionnel, organisé par la préfecture, doit, autant que faire se peut, réunir le porteur du projet (c’est-à-dire le maire ou le président de l’intercommunalité), des représentants du Conseil général, l’inspecteur d’académie, des représentants de la caisse d’allocations familiales et des associations de parents d’élèves. La structure support du partenariat est destinataire des crédits versés par l’État au titre des programmes de réussite éducative. Cette structure locale a, au préalable, proposé un projet qui a fait l’objet d’une instruction par l’administration centrale chargée de la politique de la ville (à l’époque la délégation interministérielle à la ville).
– la mise en œuvre effective du programme de réussite éducative relève d’équipes pluridisciplinaires réunissant des professionnels de l’éducation, des travailleurs sociaux et des médecins, ainsi que des associations « dont le professionnalisme est reconnu ».
Il faut noter que la circulaire prévoyait un dispositif d’évaluation du PRE, dont la définition relevait des responsables locaux des projets, avec, par ailleurs, l’obligation de renseigner obligatoirement certains indicateurs, qualitatifs et quantitatifs, pour une « lecture nationale » du fonctionnement de ce dispositif. Enfin, la circulaire du 13 juin 2005 prévoyait la mise en place d’un comité national de suivi du programme de réussite éducative, regroupant des associations d’élus, des administrations centrales, des associations professionnelles, la Caisse nationale d’allocations familiales et une représentation des parents d’élèves, afin, notamment, d’analyser la mise en œuvre du dispositif.
Une circulaire du 14 février 2006 (23) a fait suite à la décision prise par le Gouvernement, au cours des émeutes urbaines qui se sont produites en différents lieux du territoire national du 27 octobre au 17 novembre 2005, d’accélérer et d’amplifier la mise en œuvre du programme de réussite éducative. Cette circulaire précise notamment que le PRE doit privilégier l’action individualisée, sur la durée, en faveur des enfants les plus fragilisés, et leur famille, résidant en ZUS ou scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire.
Une autre circulaire interministérielle du 11 décembre 2006 (24), relative à l’ensemble du volet éducatif des Cucs, permet de mieux cerner l’esprit et la philosophie du PRE. La circulaire précise que « la réussite éducative inclut la réussite scolaire qui en est une condition essentielle. De nombreuses autres actions organisées hors de l’école, parfois en collaboration avec elle, y contribuent. Il est donc nécessaire de rechercher une continuité et une complémentarité de l’action éducative entre les temps familiaux, scolaires et de loisirs ». Cette mise en perspective du « niveau éducatif » comprenant, entre autres, le « niveau scolaire » est complété par un diagnostic portant sur l’importance de ce qui ne relève pas du « niveau scolaire » au sein du « niveau éducatif » pour expliquer l’échec scolaire et par une définition de l’objet du PRE dans ce contexte : « les difficultés scolaires que rencontrent beaucoup d’enfants et d’adolescents résultent bien souvent de facteurs liés à leur environnement social, culturel et familial ou à des difficultés de santé qui peuvent entraîner le décrochage et l’absentéisme scolaires, le repli sur soi et, parfois, des problèmes de comportement. Le programme “réussite éducative” mis en œuvre dans le cadre du plan de cohésion sociale a pour ambition de traiter l’ensemble de ces difficultés ». Cette circulaire met l’accent sur deux points, qui dessinent en creux les premières difficultés de mise en œuvre du PRE :
– l’importance des « interventions dans les domaines sanitaires et sociaux », afin que ne soient pas mises en œuvre uniquement des « actions plus habituelles et focalisées sur les activités scolaires » ;
– la priorité à accorder à « l’individualisation des parcours et [au] soutien personnalisé », en contrepoint des actions collectives proposées à des groupes d’élèves.
In fine, ces éléments permettent de constater que la mise en œuvre du PRE a donné lieu, dans des cas nombreux, à des actions relevant du soutien scolaire en formation collective, elles-mêmes « héritières » d’actions plus anciennes mises en œuvre ponctuellement sur le terrain par certaines associations ou organismes. L’Acsé tente depuis sa création d’orienter la mise en œuvre du PRE vers des actions conduites dans le cadre d’un parcours individualisé, en privilégiant de façon accrue les domaines sanitaire, social et culturel. Dans son rapport 2009 sur le programme de réussite éducative, l’Acsé fait part de progrès en la matière :
– en moyenne, entre 2005 et 2008, 22 % des enfants concernés par le PRE ont bénéficié d’un parcours individualisé. Ce taux s’est élevé à 35 % en 2009 (25) ;
– alors qu’en 2007, 60 % des PRE déclaraient que la réussite scolaire constituait leur première thématique d’actions, ce taux s’est élevé à 46 % en 2009 (26).
Au total, pour 2009, l’Acsé fait le bilan quantitatif suivant (27) :
– 365 143 enfants ont bénéficié depuis 2005 du PRE ;
– il existe 531 PRE locaux dans 718 communes comprenant 1 361 quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
– 1 214 équipes pluridisciplinaires de soutien rassemblent désormais environ 10 000 professionnels.
Le programme adultes-relais
Ce programme, décidé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 dans l’optique d’une généralisation et d’une institutionnalisation de l’expérience des « femmes-relais » en Seine-Saint-Denis, a été précisé au plan législatif par l’article 149 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Confié en gestion à l’Acsé à compter du 1er janvier 2007 (28), le programme est aujourd’hui codifié aux articles L. 5134-100 à L. 5134-109 du code du travail.
L’article L. 5134-100 précise que le dispositif repose sur un contrat de travail dont l’objet est « d’améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs ». L’article D. 5134-145 du même code définit plus précisément les missions dont les titulaires d’un emploi d’adulte-relais sont susceptibles d’être chargés (29) :
« Les adultes-relais […] assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :
« 1° Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ;
« 2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
« 3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
« 4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
« 5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
« 6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d’initiative et de projet dans le quartier et la ville. »
Ce contrat de travail de droit privé est signé entre l’une des collectivités publiques ou l’un des organismes privés énumérés à l’article L. 5134-101 du même code et une personne d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiaire d’un contrat aidé dans les conditions prévues par l’article L. 5134-102 du même code, et résidant en zone urbaine sensible ou dans un quartier concerné par les « contrats de ville », c’est-à-dire, désormais, les Cucs (30). Pour chaque poste d’adulte-relais, une convention est signée entre l’employeur et le préfet, représentant de l’État dans le département, et, aux termes de l’article D. 5134-149 du même code, « en présence de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, représentée par son délégué départemental », c’est-à-dire le préfet. La convention est signée pour une durée de trois ans, renouvelable avec l’accord exprès des parties, au terme de l’article D. 5134-150 du même code.
Aux termes de l’article L. 5134-108, les employeurs des salariés bénéficiant d’un contrat d’emploi d’adulte-relais perçoivent une aide de l’État. L’article D. 5134-157 précise que cette aide forfaitaire est versée par l’Acsé, qui a confié la gestion de cette aide à l’ASP, comme l’y autorise le même article. Le montant de l’aide est fixé par décret, aux termes de l’article D. 5134-160 du même code. Cette aide s’élève à 80 % du salaire minimum de croissance, soit 17 736,10 euros au 1er juillet 2009.
Concrètement, aujourd’hui, il existe environ 4 000 postes d’adultes-relais, ayant représenté un coût pour l’Acsé s’élevant à 79,9 millions d’euros en 2009. Environ 80 % des employeurs d’adultes-relais sont aujourd’hui des associations. Il faut noter que l’ampleur du programme est aujourd’hui moindre que ce que les projections faites au moment du lancement du programme et de sa relance en 2006 prévoyaient qu’elle serait :
– le Comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 avait prévu le recrutement de 10 000 adultes-relais dans les trois ans ;
– le Comité interministériel des villes du 9 mars 2006 avait envisagé le doublement rapide du nombre des postes d’adultes-relais, pour atteindre le nombre de 6 000.
Au demeurant, il faut souligner que le programme adultes-relais a toujours eu un double objectif. Il s’agissait en premier lieu de renforcer la capacité de médiation locale en créant un dispositif spécifique sous la forme d’un contrat de travail aidé notablement plus long que les contrats aidés existants mais il s’agissait aussi d’offrir aux bénéficiaires du contrat une expérience professionnelle susceptible de faciliter leur évolution positive sur le marché du travail ou d’inciter leur employeur à pérenniser leur emploi.
Le programme Ville, Vie, Vacances
Dès sa mise en place, l’Acsé a été chargée d’assurer la gestion du programme Ville, Vie, Vacances (VVV). Ce programme, initialement nommé « opérations anti été chaud », est né en 1982, à la suite des évènements ayant eu lieu dans le quartier des Minguettes à Vénissieux au cours des mois de juillet et août 1981 et dans d’autres villes de l’agglomération lyonnaise, évènements considérés comme étant les premières émeutes urbaines contemporaines ayant eu lieu sur le territoire national. À compter de 1983, le programme est intitulé « opérations prévention été » et sa mise en œuvre fait l’objet chaque année d’une circulaire du Premier ministre (31) décrivant ses grandes orientations.
En 1995, le dispositif est étendu à l’ensemble des vacances scolaires tout au long de l’année ; à cette période, 39 départements sont éligibles à ce dispositif alors que 11 départements seulement avaient été sélectionnés en 1982. Une étape décisive s’agissant de la généralisation géographique du dispositif est franchie en 1996, puisque 91 départements sont concernés par la circulaire annuelle du Premier ministre, au titre de l’existence d’au moins une ZUS sur leur territoire ; c’est aussi en 1996 que le dispositif acquiert son nom actuel « Ville, Vie, Vacances ». La généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire national est décidée en 2000.
Le dispositif VVV a été conçu à l’origine comme une offre d’activités à la jeunesse des quartiers défavorisés, devant permettre de prévenir des actes de délinquance que le désœuvrement lié aux vacances scolaires encouragerait du fait du non-départ en vacances d’une partie importante des jeunes habitants de ces quartiers. Il s’agit ainsi de prévenir la délinquance par un accompagnement social et éducatif durant les périodes de vacances scolaires.
Alors que l’Acsé pilote aujourd’hui le dispositif au niveau national, une cellule interministériel l’anime au niveau du département, dans laquelle siègent, le cas échéant, des acteurs institutionnels, comme la CAF, le conseil général, et des acteurs associatifs. Le dispositif consiste, pour ces cellules départementales, à contribuer au financement des projets portés par des acteurs sociaux et éducatifs locaux (parmi lesquels beaucoup d’associations et de collectivités territoriales notamment à travers les centres communaux d’action sociale), en vérifiant bien entendu l’adéquation de ces projets aux directives nationales établies annuellement. Dispositif désormais ancien, le programme VVV ne semble pas avoir échappé à une logique de reconduction annuelle, considérée comme allant de soi notamment par les opérateurs, d’opérations devenues traditionnelles. En tout état de cause, l’Acsé a consacré 11,1 millions d’euros en 2009 au financement d’actions dans le cadre du dispositif VVV.
*
* *
À sa création, l’Acsé a donc été tenu de « reprendre » la gestion d’un existant, aux contours parfois flous, tant dans son périmètre général que dans ses différents compartiments.
On peut notamment considérer que l’agence a d’une certaine manière « subi » le Cucs, qui constitue aussi une tentative d’organisation de cet existant dans le cadre d’un projet local porté par les collectivités territoriales ; en effet, l’agence n’a pas été partie prenante de l’élaboration des Cucs, qui ont d’ailleurs été préparés et signés, au moins pour certains d’entre eux, avant que l’agence soit opérationnelle, par les préfets et les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La contractualisation en matière de politique de la ville n’a donc pas été une politique publique pilotée par l’Acsé et demeure d’ailleurs sous le contrôle direct de l’État. À ce titre, la circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des Cucs (32) est instructive : l’Acsé n’y est envisagée que comme une agence chargée des paiements, dont le caractère pluriannuel constitue un engagement de l’État mis en œuvre par l’agence ; ainsi la circulaire dispose que les crédits contractualisés dans le cadre des Cucs « seront principalement mobilisés à travers l’opérateur de l’État qu’est l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. Ils feront l’objet d’un engagement pluriannuel de l’agence, qui se matérialise par le visa de son représentant sur le contrat, validant l’enveloppe prévisionnelle globale qui sera affectée au projet. » (33)
Non seulement l’agence finance dans un cadre pluriannuel contraint des actions qui lui sont antérieures tant dans leur définition que dans leur ampleur budgétaire, mais, par ailleurs, la modalité principale d’organisation territoriale d’une partie de ces actions, le Cucs, lui a échappé dans la confection de son architecture. La circulaire du 24 mai 2006 prévoit ainsi une architecture indicative des Cucs sur le plan thématique, architecture qui constituait déjà un effort d’organisation, antérieur à la création de l’Acsé, des actions entreprises au titre de la politique de la ville :
« […] Programmes d’actions
« Objectif transversal : égalité des chances, intégration, lutte contre les discriminations.
« A) Habitat et cadre de vie :
« – Rappel du programme de rénovation urbaine.
« – Programmation de logements sociaux et autres questions d’hébergement.
« – Transports publics.
« – Gestion urbaine de proximité ...
« B) Emploi et développement économique :
« – Accès à l’emploi Maisons de l’emploi, accueil des jeunes de ZUS par l’ANPE et les Missions locales, accompagnement des jeunes diplômés, autres actions concertées services public de l’emploi.
« – Insertion par l’économique.
« – Soutien à la création d’activité.
« Engagement pour les personnes les plus éloignées de l’emploi (CAV, CAF)...
« C) Réussite éducative:
« – Suivi individualisé des enfants les plus en difficulté (équipe de réussite éducative).
« – Lutte contre l’illettrisme.
« – Accès aux savoirs de base.
« – Activités éducatives hors temps scolaire (actions culturelles et artistiques, actions sportives).
« – Soutien aux parcours d’excellence (tutorat ...).
« D) Santé: prévention et accès aux soins.
« E) Citoyenneté et prévention de la délinquance: soutien à la parentalité, accès au droit, aide aux victimes, accompagnement et suivi des personnes sous main de justice, actions culturelles et artistiques en faveur de l’intégration républicaine, service civil volontaire ...
« F) Actions transversales : accompagnement social, participation des habitants... […] ».
*
* *
L’Acsé a cependant produit un effort important, depuis sa création, pour cette mission primordiale consistant à mieux connaître l’activité de l’État s’agissant de la politique de la ville. S’appuyant sur un système d’information territorialisé permettant le traitement de chaque demande de subvention, l’Acsé centralise ces données en les traitant selon une nomenclature qu’elle a élaborée. Elle obtient ainsi une image relativement fine et complète de l’effort de l’État pour chacune des thématiques comprises dans cette nomenclature. S’agissant de la politique de la ville aux termes de cette nomenclature, les consommations de crédits constatées pour 2009 se répartissent de la manière suivante :
CRÉDITS ENGAGÉS PAR L’ACSÉ EN 2009
SELON SA NOMENCLATURE
THÉMATIQUE COMMUNE |
TOTAL DES ENGAGEMENTS 2009 |
OBJECTIFS |
|
1- ÉDUCATION ET ACCÈS AUX SAVOIRS DE BASE |
109 016 865 |
11- Éducation |
103 922 694 |
111- Réussite éducative |
78 067 845 |
112- Accès à l’éducation |
25 854 849 |
12- maîtrise de la langue et lutte contre l’illettrisme |
5 094 171 |
121- Apprentissage de la langue |
0 |
122- Ateliers de savoirs socio linguistiques |
1 900 187 |
123- Lutte contre l’illettrisme et accès aux savoirs de base |
2 917 923 |
125- Lutte contre la fracture numérique |
276 061 |
2- EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE |
42 860 265 |
21- emploi |
39 248 898 |
210- Accueil, information, accompagnement de 1er niveau |
2 383 720 |
211- Accompagnement renforcé |
28 898 710 |
212- Mise en relation demandeurs/entreprises |
1 020 922 |
213- École de la deuxième chance |
2 227 695 |
214- Actions ciblées sur les freins d’accès à l’emploi |
2 045 459 |
215- Mise en place de la clause d’insertion dans les marchés publics |
486 308 |
216- Mobilité des quartiers vers l’emploi |
2 186 084 |
22- developpement economique |
3 611 367 |
221- Création et reprise d’entreprises |
2 769 924 |
222- Développement économique |
825 314 |
223- Soutien au commerce |
16 129 |
3- LOGEMENT ET HABITAT |
8 109 195 |
31- logement et habitat |
8 109 195 |
311- Amélioration du cadre de vie |
6 050 387 |
312- Transformer les foyers de travailleurs migrants en résidences sociales |
12 057 |
313- Accompagner le changement des foyers de travailleurs migrants |
121 972 |
314- Favoriser l’exercice du droit au logement |
1 924 779 |
4- SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS |
14 479 374 |
41- sante et accès aux soins |
14 479 374 |
411- Ateliers santé ville |
6 458 692 |
412- Accès à la prévention et aux soins |
7 049 720 |
413- Prévention de la toxicomanie et des conduites addictives |
970 962 |
5- CULTURE ET EXPRESSION ARTISTIQUE |
24 867 237 |
51- culture et expression artistique |
24 867 237 |
511- Pratiques artistiques et culturelles |
16 252 079 |
512- Histoire et mémoire des territoires et des habitants |
1 804 001 |
513- Valoriser la diversité culturelle |
6 811 157 |
6- LIEN SOCIAL, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE PUBLIQUE |
140 353 359 |
61- lien social et citoyenneté |
37 548 993 |
611- Accès à la citoyenneté et partage des valeurs de la République |
9 841 022 |
612- Initiatives de proximité qui favorisent le lien social |
20 910 463 |
613- Soutien à la parentalité et accompagnement des jeunes |
6 797 508 |
62- médiation sociale, adultes-relais |
83 893 399 |
621- Adultes-relais |
81 097 527 |
622- Médiation hors adultes-relais |
2 795 872 |
63- service civil volontaire |
0 |
631- Service civil volontaire |
0 |
64- structuration des associations |
7 788 728 |
641- Soutenir l’initiative associative |
7 788 728 |
65- Ville-Vie-Vacances |
11 122 239 |
651- Ville vie vacances |
11 122 239 |
7- ACCÈS AUX DROITS ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS |
18 153 504 |
71- accès aux droits et aux services publics |
9 580 346 |
711- Accès aux services publics |
1 394 368 |
712- Connaissance des droits et soutien juridique |
7 085 667 |
713- Exercice des droits personnels à l’émancipation |
1 100 311 |
72- lutte contre les discriminations |
8 573 158 |
721- Faire connaître les discriminations |
3 915 151 |
722- Lutter contre les discriminations |
4 658 006 |
8- PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET JUSTICE |
16 112 098 |
81- prevention de la delinquance et justice |
16 112 098 |
811- Prévention de la délinquance |
6 431 922 |
812- Prévention de la récidive |
1 056 075 |
813- Aide aux victimes et accès à la justice |
2 890 248 |
814- Prévention des violences sur les personnes vulnérables |
1 029 953 |
815- Prévention situationnelle |
0 |
816- Autres mesures en lien avec la loi de la prévention de la délinquance |
0 |
817- Mesures du Comité interministériel des villes « justice prévention » |
4 703 900 |
9- PILOTAGE, RESSOURCES ET ÉVALUATION |
19 828 128 |
91- pilotage et évaluation |
19 828 128 |
911- Capitalisation et diffusion des expériences |
2 306 549 |
912- Évaluation, études, diagnostics et audits |
4 226 488 |
913- Formation et qualification des acteurs |
2 079 409 |
914- Ingénierie et animation politique ville |
11 215 681 |
10 - STRUCTURES MUTUALISATRICES |
12 985 207 |
1A- Structures mutualisatrices |
12 985 207 |
01- Structures mutualisatrices |
12 985 207 |
TOTAL GÉNÉRAL |
406 765 234 |
Plusieurs commentaires doivent être faits pour la lecture de ce document :
1° la nomenclature de l’Acsé est partagée entre deux logiques :
– l’identification budgétaire de certains dispositifs dont la gestion incombe à l’Acsé. Selon le rapport annuel de performance 2009 (34), ces dispositifs sont au nombre de cinq : le programme de réussite éducative, les ateliers santé-ville, les adultes-relais, le programme ville, vie, vacances, ainsi que l’ingénierie et l’animation de la politique de la ville. Ces cinq dispositifs représentent 186,69 millions d’euros de crédits engagés en 2009, soit 45,89 % de l’ensemble des crédits engagés par l’agence pour cet exercice ;
– la classification sous certaines appellations thématiques génériques d’actions ne relevant pas d’un dispositif en particulier. Le financement de l’ensemble de ces actions a représenté 55,11 % des crédits consommés par l’agence en 2009.
2° Certaines lignes non dotées (ou très faiblement) au titre de la politique de la ville, l’ont été au titre d’autres catégories d’engagements budgétaires à la disposition de l’Acsé. Il s’agit notamment de :
– la ligne 121 « Apprentissage de la langue » pour laquelle l’Acsé a engagé 7,569 millions d’euros sur la base des crédits confiés en gestion à l’agence par le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » ;
– la ligne 312 « Transformer les foyers de travailleurs migrants en résidences sociales », pour laquelle l’Acsé a engagé 5 millions d’euros sur la base des mêmes crédits confiés en gestion à l’agence par le programme 104 ;
– la ligne 631 « Service civil volontaire », pour laquelle l’Acsé a engagé un total de 29,179 millions d’euros sur la base de crédits issus du Haut commissariat à la jeunesse et aux solidarités actives et de reports de crédits ;
– les lignes correspondant à la thématique n° 8 « Prévention de la délinquance et justice » (pour 31,572 millions d’euros) et, notamment, la ligne 816 « prévention situationnelle » (pour 14,665 millions d’euros) relative à la vidéoprotection, sur la base des crédits délégués à l’agence par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
3° La thématique n° 10 « structures mutualisatrices » correspond aux subventions des groupements d’intérêt public (GIP) créés pour procéder au financement des partenaires de certains Cucs. Bien entendu, cette modalité d’organisation financière par intermédiation d’un GIP masque l’objet des actions effectivement financées. En effet, les 12,9 millions d’euros concernés auraient normalement plutôt vocation à être répartis selon la logique des neuf autres thématiques de la nomenclature de l’Acsé.
4° L’Acsé dispose en fait d’un niveau encore plus fin dans cette nomenclature (chaque ligne identifiée par un nombre à trois chiffres est ainsi renseigné par un quatrième niveau de sous-rubriques qui n’apparaissent pas dans le tableau précédent). Par ailleurs, l’Acsé utilise en 2010 une nomenclature toujours organisée sur la base de quatre sous-rubriques, mais plus fine encore dans les distinctions entre catégories d’actions.
*
* *
Il demeure néanmoins une impression d’imprécision quant à l’appréhension concrète des actions effectivement financées par l’agence. La nomenclature élaborée par l’Acsé constitue certes un progrès en la matière, mais elle demeure globalisante et l’énoncé des entrées thématiques reste parfois allusif, s’agissant notamment des montants qui ne relèvent pas d’un dispositif clairement défini. Le rapport annuel de performance 2009 relatif à la mission « Ville et logement » (35), dans ses commentaires sur la base de cette nomenclature quant aux actions financées par l’agence, ne détaille celles-ci que ponctuellement et surtout quand il s’agit des actions mises en œuvre au titre de la dynamique « espoir banlieues ».
Approcher de façon plus concrète le contenu des actions financées par l’Acsé nécessiterait une exploitation systématique du système d’information de l’Acsé par l’intermédiaire duquel est effectué le recueil de l’objet des projets envisagés par les opérateurs locaux qui sollicitent une aide financière de la part de l’agence (36); il faut noter que ces renseignements « par action » sont nécessairement complétés ex post, une fois ces projets achevés, par le bénéficiaire de la subvention, qui est ainsi tenu de justifier de son emploi, sous peine, après rappel de cette formalité substantielle, de l’émission automatisée d’un titre de recettes pour remboursement de la subvention. La base documentaire d’une approche synthétique plus fine des actions et activités financées par l’Acsé existe donc. Au demeurant, les présentes observations ne constituent pas une critique du fait qu’une part majoritaire des crédits accordés par l’Acsé en faveur d’intervenants en matière de politique ne relèvent pas d’un programme national bien répertorié. La politique de la ville a toujours reposé sur une part d’initiatives locales, peu ou pas encadrées, qu’il doit être possible de subventionner au cas par cas. L’enjeu ici consiste plutôt à faire coexister cette souplesse avec une vision claire des actions financées.
Au-delà de ces considérations relatives au contenu des actions financées, le traitement statistique par l’Acsé des informations relatives à sa gestion permet aujourd’hui, beaucoup mieux qu’hier, de savoir combien d’actions sont financées, pour quels montants et pour quels opérateurs.
Ainsi, en 2009, l’Acsé a subventionné 11 636 organismes :
– 68 % d’entre eux sont des associations, ce taux se décomposant ainsi selon l’Acsé : 63 % de petites associations et 5 % de grandes ;
– 15 % d’« opérateurs locaux » comme les centres sociaux ou culturels (6 %), les centres communaux d’action sociale (3 %) ou encore les missions locales et maisons de d’emploi (2 %) ;
– 9 % de collectivités territoriales, ce taux se décomposant en 7 % de communes et 2 % d’intercommunalités (ainsi que 0,1 % de conseils généraux) ;
– 6 % d’administrations ou d’organismes publics, dont une majorité d’établissements scolaires ou universitaires ;
– 1 % d’établissements privés commerciaux ;
– 0,5 % de groupements d’intérêt public.
40 % des montants de subvention accordés par l’Acsé sont versés aux associations, 60 % à l’ensemble des autres partenaires de l’agence, dont, parmi eux, une part importante aux communes, caisses des écoles et centres communaux d’action sociale. Pour l’ensemble de ces organismes, le montant médian des subventions s’élève à 4 000 euros. Compte tenu du fait que 44 % de ces organismes obtiennent souvent plusieurs subventions de la part de l’agence (37), le montant médian annuel dont chacun d’entre eux bénéficie à ce titre s’élève en réalité à 8 500 euros. Pour 2009, l’Acsé considère qu’il existe une forte stabilité des organismes subventionnés : seuls 20 % d’entre eux ne l’avaient pas été ni en 2007 et en 2008. Cette stabilité est encore plus forte si l’on considère les montants accordés : le montant médian accordé à un de ces nouveaux organismes pour une subvention a été inférieur de 1 000 euros au montant médian moyen de l’ensemble des subventions versées par l’agence ; par ailleurs, seuls 16 % de ces nouveaux organismes ont bénéficié de plus d’une subvention contre 56 % de ceux qui avaient déjà bénéficié de l’aide de l’agence au moins une fois en 2007 ou 2008.
Au total, si la création de l’Acsé a incontestablement permis de progresser en matière d’informations, on peut considérer, à ce stade, que certains éléments demeurent perfectibles :
– le système d’information de l’agence permet de territorialiser les crédits consentis par Cucs, mais ne permet pas d’obtenir une information plus fine par quartier prioritaire (plusieurs quartiers prioritaires pouvant faire partie d’un même Cucs) ;
– le système d’information de l’Acsé ne permet pas de savoir quels sont précisément les financements apportés par l’agence aux actions financées dans le cadre des Cucs ; ainsi, alors que certains postes d’adultes-relais sont financés dans le cadre de ces contrats, ils ne sont pas pris en compte comme tels par l’agence, du fait de leur gestion comptable par l’Agence de service des paiements hors le système d’information de l’agence.
c) Le remboursement aux régimes de sécurité sociale de certaines exonérations de cotisations sociales
Sont inscrits dans le programme 147 les crédits de remboursement aux régimes de sécurité sociale des exonérations portant sur certaines cotisations et contributions sociales, exonérations en vigueur dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU ; article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale) et dans les zones franches urbaines (ZFU ; article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville) (38).
En exécution pour 2009, ces crédits se sont élevés à 297,6 millions d’euros (dont 287 millions d’euros pour les seules ZFU). Ce dispositif de remboursement a pour base légale l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, dont le premier alinéa dispose que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application ».
Il faut relever que, s’agissant des ZFU, la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a modifié les modalités de calcul de l’exonération, qui porte sur les cotisations obligatoires à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur le versement de transport et sur les cotisations et contributions dont bénéficient le Fonds national d’aide au logement (FNAL). En effet, alors que le dispositif initial prévoyait, pendant cinq ans, l’exonération de ces prélèvements sociaux sur la masse salariale globale de l’entreprise dans l’unique limite du produit du nombre d’heures rémunérées et du montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le nouveau dispositif prévoit que l’exonération, toujours applicable pendant une durée de cinq ans, s’apprécie aussi par salarié :
– cette exonération est totale si le salaire versé est inférieur au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
– elle est ensuite dégressive et devient nulle lorsque la rémunération atteint un niveau que la loi a prévu de minorer progressivement : ce niveau était égal à 2,4 fois le salaire minimum de croissance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, il est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 et il sera égal à 2 fois ce montant de salaire à compter du 1er janvier 2011.
Les principales règles qui régissent les dépenses fiscales décrites infra dans les ZFU sont aussi applicables en matière d’exonération de charges sociales : les entreprises concernées emploient 50 salariés au plus et doivent obéir à certaines règles relatives à la composition de leur capital et à la nature de leurs activités. Par ailleurs, les créations d’activité éligibles à cette exonération doivent s’être implantées en ZFU avant le 31 décembre 2011
Auparavant, de façon analogue, l’article 133 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 avait, s’agissant des exonérations sociales applicables pour les établissements implantés dans les ZRU, substitué au dispositif s’appliquant à la masse salariale globale des entreprises, un dispositif concernant chaque rémunération versée, l’exonération étant totale jusqu’à 1,5 fois le salaire minimum de croissance puis devenant dégressive pour devenir nulle entre 1,5 fois et 2,4 fois le salaire minimum de croissance.
2.– Le financement public de la rénovation urbaine : le rôle levier de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru)
a) La rénovation urbaine : engagements, réalisations et évolution des sources de financement
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), établissement public à caractère industriel et commercial, a été créée par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Sa mission consiste, aux termes du même article, à « contribuer dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine [PNRU] ». Le PNRU, selon l’article 6 de la même loi, « vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, dans les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues ». La loi a donc prévu que le PNRU soit mis en œuvre dans les ZUS mais aussi, de façon dérogatoire et sous certaines conditions, dans d’autres quartiers similaires. Le tableau suivant retrace au 31 décembre 2008 les effectifs de ces catégories de quartiers.
QUARTIERS EN RÉNOVATION URBAINE AU 31 DÉCEMBRE 2008
Types de quartier |
Quartiers prioritaires |
Quartiers non prioritaires |
Total |
Article 6 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 |
0 |
57 |
57 |
Article 6 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 GPV-ORU |
3 |
79 |
82 |
ZUS |
177 |
177 |
354 |
TOTAL |
180 |
313 |
493 |
Source : Anru, base de clôture de l’exercice 2008.
La lecture de ce tableau appelle les précisions suivantes :
– les quartiers prioritaires et non prioritaires, tels qu’ils sont retracés dans ce tableau, ont été déterminés ab initio (avant la signature éventuelle des conventions correspondantes) par le conseil d’administration de l’agence (39), sur la base de certains critères sociaux et urbains. Les quartiers prioritaires devaient concentrer, toujours selon le conseil d’administration de l’agence, 70 % des crédits de l’Anru ;
– les quartiers « GPV-ORU » sont ceux qui ont bénéficié, avant la mise en œuvre du Plan national de rénovation urbaine, d’un grand projet de ville ou d’une opération de rénovation urbaine.
L’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 définit des catégories d’opérations concourant à la réalisation du PNRU, ainsi que des projections chiffrées relatives à certaines de ces catégories :
« [Le PNRU] comprend des opérations d’aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.
« Pour la période 2004-2013, il prévoit une offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux et, la résidentialisation d’un nombre équivalent de logements sociaux et en cas de nécessité liée à la vétusté, à l’inadaptation à la demande ou à la mise en œuvre du projet urbain, la démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des quartiers concernés. »
Le PNRU constitue donc une programmation théoriquement indépendante de l’Anru elle-même, mais dont la mise en œuvre a dépendu en pratique, dès sa conception, des concours financiers de l’agence et des conditions techniques qu’elle a imposés en matière de rénovation urbaine. L’article 10 de la loi du 1er août 2003 précise que ces concours « sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous les quartiers visés à l’article 6 ». On constate ainsi que toutes les opérations définies à l’article 6 de la loi comme contribuant au PNRU peuvent bénéficier des concours financiers de l’agence, hormis la démolition d’équipements publics.
S’agissant des moyens financiers nationaux consacrés au PNRU, l’article 7 de la loi du 1er août 2003 précise qu’ils sont fixés, pour l’ensemble du programme entre 2004 et 2013, à 12 milliards d’euros, étant entendu qu’il s’agit des moyens publics nationaux qui ont vocation à être complétés par d’autres financements, le cas échéant également publics. Au 1er septembre 2010, 11,402 milliards d’euros de subventions de la part de l’Anru sur ces 12 milliards d’euros avaient été engagés par l’agence au titre de 382 conventions de rénovation urbaine signées concernant 480 quartiers. La phase d’élaboration des projets de rénovation urbaine est donc en grande partie achevée, d’autant plus qu’à ces 382 conventions devraient logiquement s’ajouter 8 autres projets ayant d’ores et déjà fait, au 1er septembre 2010, l’objet d’une présentation par leurs porteurs devant le comité d’engagement de l’Anru, pour un montant prévisionnel de subvention de 114 millions d’euros.
S’agissant de l’état d’avancement financier du PNRU, les décaissements opérés au titre du PNRU par l’Anru se sont élevés, selon la direction du budget, chaque année depuis la création de l’agence, aux montants suivants :
PAIEMENTS OPÉRÉS PAR L’ANRU
(En milliers d’euros)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
PNRU |
9 207 |
99 185 |
228 000 |
405 339 |
618 886 |
861 832 |
2 222 449 |
Plan de relance |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
133 756 |
133 756 | |
Total |
9 207 |
99 185 |
228 000 |
405 339 |
618 886 |
995 588 |
2 356 205 |
Source : direction du budget.
S.O. : sans objet
Ainsi, sur un peu plus de 11 milliards d’euros engagés par l’Anru aux termes des conventions qu’elle a signées avec les porteurs des projets de rénovation urbaine, l’agence avait décaissé 2,222 milliards d’euros au 31 décembre 2009, auxquels s’ajoutent 133,756 millions d’euros en 2009 au titre du Plan de relance dans le cadre des crédits de l’État prévus sur le programme 317 « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité ». Largement engagé et programmé, le PNRU n’a donc, à ce jour, été réalisé que partiellement.
S’agissant des sources de financement de l’Anru, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a sensiblement modifié l’équilibre initial fixé par la loi du 1er août 2003 en s’appuyant sur un effort paritaire entre l’État et les partenaires sociaux gérant la participation des employeurs à l’effort de construction (communément appelé le « 1 % logement »). L’article 7 de la loi du 1er août 2003, dans sa version en vigueur issue de l’article 7 de la loi du 25 mars 2009, ne prévoit plus de montants minimaux annuels de crédits de paiement ouverts par les lois de finances, contrairement à toutes les versions antérieures de l’article 7 de la loi du 1er août 2003. Le contenu de ces versions antérieures successives et de la version en vigueur de cet article 7 est retracé dans le tableau suivant :
VERSIONS SUCCESSIVES DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N °2003-710 DU 1er AOÛT 2003
CONCERNANT LE FINANCEMENT PUBLIC DU PROGRAMME NATIONAL
DE RÉNOVATION URBAINE
(En milliards d’euros)
Version en vigueur |
Du 1.8. 2003 |
Du 19.1.2005 |
Du 16.7.2006 |
Du 6.3.2007 |
Depuis le 28.3.2009 |
Texte de référence |
Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 |
Art. 91 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale |
Art. 63 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement |
Art. 18 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale |
|
Durée envisagée de l’engagement financier de l’État en faveur du PNRU |
2004-2008 |
2004-2011 |
2004-2013 |
2004-2013 |
2004-2013 |
Crédits globaux consacrés par l’État |
2,5 |
4 |
5 |
6 |
– |
Montant minimum annuel légal censé être prévu en loi de finances |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
– |
Moyens financiers publics consacrés au PNRU |
5 |
8 |
10 |
12 |
12 |
Toujours dans sa version en vigueur issu de l’article 7 de la loi du 25 mars 2009, l’article 7 de la loi du 1er août 2003 précise que les 12 milliards d’euros de moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du PNRU sont composés de « contributions versées, notamment, par l’État et l’Union d’économie sociale du logement (40) ». Ainsi, si la loi du 25 mars 2009 prévoit toujours une participation partagée de l’État et des partenaires sociaux au financement national du PNRU, elle a effacé tout engagement précis de la part de l’État en la matière et a de fait correspondu à la fin de l’effort budgétaire annuel de l’État (fin acquise dès la loi de finances pour 2009) et à une réévaluation de l’effort auquel l’UESL est tenue en la matière. Le tableau suivant, établi par la direction du budget, retrace les autorisations d’engagement et crédits de paiement issus du budget de l’État en faveur du PNRU :
HISTORIQUE DES VERSEMENTS DU BUDGET GÉNÉRAL À L’ANRU
(en milliers d’euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
TOTAL |
AE non couvertes | ||
PNRU |
AE |
465,0 |
413,4 |
365,0 |
380,1 |
362,0 |
4,7 |
5,0 |
1 995,3 |
1 638,4 |
CP |
35,0 |
172,2 |
100,0 |
39,9 |
4,7 |
5,0 |
356,8 |
|||
Plan de relance |
AE |
350,0 |
350,0 |
|||||||
CP |
200,0 |
150,0 |
350,0 |
AE = autorisations d’engagement et CP = crédits de paiement
Source : direction du budget
Les constats suivants peuvent être tirés de ce tableau :
– depuis 2009, la contribution du budget général au financement de l’Anru se limite, hors le Plan de relance, au financement d’une partie des dépenses de fonctionnement et de personnel de l’agence (4,75 millions d’euros pour 2009 et 5 millions d’euros pour 2010), au titre du programme 147 ;
– auparavant, entre 2004 et 2008, les crédits de paiement réellement attribués à l’Anru au titre du budget général sont demeurés, en tout état de cause, d’un montant global assez modeste (356,8 millions d’euros) au regard des autorisations d’engagement correspondantes ouvertes (1 995,3 millions d’euros) ;
– du point de vue des seules autorisations d’engagement, hormis pour l’année 2004, les montants prévus par le budget général ont été systématiquement inférieurs à l’engagement général prévu par l’article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, fixé à 465 millions d’euros par an.
L’exercice budgétaire 2009 et la loi du 25 mars 2009 ont par ailleurs conduit à la fois à un encadrement accru de l’emploi de ses ressources par l’UESL et, dans ce contexte, à une augmentation de la participation de l’UESL au financement de l’Anru. Ainsi, le dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation précise que, désormais, « pour chaque catégorie d’emplois [de la participation des employeurs à l’effort de construction], la nature des emplois correspondants et leurs règles d’utilisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’Union d’économie sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction entre chacune des catégories d’emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l’Union d’économie sociale du logement ».
En application de cette disposition, l’article 1er du décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction précise que l’enveloppe financière consacrée par l’UESL au financement du PNRU s’établit chaque année entre 2009 et 2011 à 770 millions d’euros (41), alors que l’UESL devait, aux termes de l’équilibre initial établi dans le contexte de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, verser chaque année autant que l’État pour le financement du PNRU, soit 465 millions d’euros par an.
Ce retrait de l’État, bien réel, du financement de droit commun du PNRU doit bien entendu être apprécié dans le contexte suivant :
– si la loi ne prévoit plus d’engagements minimaux annuels de la part de l’État pour le financement du PNRU, elle préserve explicitement cette faculté ;
– l’Anru doit bénéficier sur les années 2009 et 2010, de la part du budget de l’État, dans le cadre du Plan de relance, à hauteur de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
b) Le réel effet de levier du programme national de rénovation urbaine (PNRU)
L’Anru indique que, s’agissant des 382 conventions signées au 1er octobre 2010, les subventions versées par l’agence, soit en prévision 11,409 milliards d’euros, devraient constituer 27,18 % du montant total des opérations correspondantes, puisque ce montant devrait s’élever à terme à 42,057 milliards d’euros pour l’ensemble de la durée du PNRU.
Le rapport de l’ONZUS de 2009 (42) permet de mieux cerner le fonctionnement de l’effet levier des subventions de l’Anru au titre du PNRU. Il précise que le coût total du PNRU était réparti au 31 décembre 2008, aux termes des 302 conventions signées à cette date, notamment selon les modalités suivantes :
– 29,8 % à la charge de l’Anru ;
– 42,2 % à la charge des bailleurs sociaux, dont 40 % sous forme de prêts consentis notamment par la Caisse des dépôts et consignations et 2,2 % sur leurs fonds propres. Les bailleurs sociaux constituent donc les premiers contributeurs au financement du PNRU, et ce grâce à la capacité d’emprunt que leur confère le plan lui-même et, dans son cadre, le financement public garanti par l’Anru ;
– 21,4 % à la charge des collectivités territoriales, dont 12,1 % pour les communes et établissements de coopération intercommunale, 5,5 % pour les régions et 3,8 % pour les départements ;
– 6,4 % à la charge d’autres contributeurs, dont 0,7 % à la charge du Feder (43), 0,4 % à la charge de la Caisse des dépôts et consignations en plus des prêts qu’elle consent dans le cadre du PNRU aux bailleurs sociaux et collectivités territoriales et 0,3 % à la charge directement de l’État.
Il importe dans l’observation de cet effet levier de noter le rôle indirect mais très significatif de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en tant que prêteur. En effet, les prêts que les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux contractent afin de financer leurs contributions dans les projets de rénovation urbaine sont en partie – très substantielle dans certains cas – consentis par la CDC. La CDC attribue deux types de prêts accompagnant les opérations de rénovation urbaine :
– les « prêts renouvellement urbain » (PRU) sont adossés au taux du livret A. Leur taux était supérieur de 25 points de base jusqu’au 1er février 2009 à celui du livret A, date à laquelle la CDC a cessé de les bonifier pour les contrats de prêt ne portant pas sur l’enveloppe 2006-2008 (pour laquelle la bonification relevait d’une convention avec l’UESL). Le taux des PRU est désormais de 60 points de base supérieur à celui du livret A. Les PRU accordés en 2009 devaient atteindre un niveau de 1 100 millions d’euros en prévision et il est probable que ce montant a en fait avoisiné les 1 260 millions d’euros. Les bénéficiaires des PRU sont à 92 % des bailleurs sociaux (y compris les SEM) et à 8 % des collectivités territoriales, en harmonie avec la doctrine d’emploi des PRU, issue d’une convention passée entre l’État, l’UESL et la CDC, qui rend prioritaire le logement pour le bénéfice des PRU bonifiés de la CDC ;
– les « prêts projets urbains » (PPU) sont adossés au taux du livret d’épargne populaire (LEP). Le taux des PPU est supérieur au taux du LEP de 20 points de base. Alors que le montant des PPU consentis par la CDC devait atteindre 80 millions d’euros en 2009, il est possible que ce montant ait atteint plus de 130 millions d’euros. Les bénéficiaires des PPU sont des collectivités territoriales à 73 %, des bailleurs sociaux (y compris les SEM) à hauteur de 24 % et certains organismes de droit privé pour 3 %. Les PPU ont vocation à financer les opérations d’aménagement dans le cadre des conventions de rénovation urbaine, hors opérations portant sur le logement.
Si l’on considère les paiements de l’Anru en 2009, qui s’élèvent à 995 millions d’euros en 2009 et que l’on fait l’hypothèse que pour un euro dépensé par l’Anru, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales en dépensent deux, on observe que le montant des PRU et PPU consentis par la CDC au titre du PNRU en 2009 couvre sans doute une part non négligeable des besoins de financement des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales : ce montant a pu s’élever à presque 1 400 millions d’euros pour un besoin de financement, en 2009, sans doute proche de 2 000 millions d’euros.
3.– Les dépenses fiscales et les allégements de charges sociales rattachés à la politique de la ville
Selon les informations transmises par la direction du budget, le montant des dépenses fiscales rattachées à la politique de la ville s’est établi en 2009 à 393 millions d’euros. S’ajoutent à ce montant, dans la même perspective, environ 300 millions d’euros de dépenses « sociales », correspondant à des exonérations de certaines charges sociales. Ces exonérations de charges poursuivent en effet le même objectif d’aide à l’activité économique que certaines des dépenses fiscales applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Si les dépenses fiscales stricto sensu sont de fait prises en charge par le budget de l’État par leur impact direct sur le solde budgétaire, les dépenses « sociales » qui leur sont liées font l’objet, comme il a été précisé supra, d’un remboursement aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Les crédits correspondants sont inscrits au programme 147. Le tableau suivant récapitule l’ensemble des dépenses fiscales rattachées à la politique de la ville et rappelle les dépenses sociales qui leur sont liées.
DÉPENSES FISCALES ET SOCIALES RATTACHÉES
À LA POLITIQUE DE LA VILLE EN 2009
Référence légale |
Nombre de contribuables concernés en 2009 |
Coût en 2009 | |
AIDES À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Dans les ZFU Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés . Exonération plafonnée à 61 000 euros de bénéfices pour les entreprises qui exercent une activité en ZFU |
Art. 44 octies (CGI) |
15 300 |
|
. Exonération plafonnée à 100 000 euros du bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une ZFU de 3ème génération ou qui créent une activité dans une ZFU entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 |
Art. 44 octies (CGI) |
6 600 |
|
Total impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
165 | ||
Taxe professionnelle . Exonération en faveur des établissements existants ou créés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans la première ou deuxième ou troisième génération de ZFU |
Art. 1466 A (I sexies) (CGI) |
10 200 |
19 |
. Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 2003 |
Art. 1466 A (I quinquies) (CGI) |
9 100 |
16 |
. Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZFU créées en 1996 |
Art. 1466 A (I quater) (CGI) |
6 600 |
24 |
Total taxe professionnelle |
59 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties . Exonération en faveur des établissements existants ou créés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans la première ou deuxième ou troisième génération de ZFU |
Art. 1383 C bis (CGI) |
2 100 |
4 |
. Exonération en faveur des immeubles situés dans les ZFU créées en 2003 |
Art. 1383 C (CGI) |
|
2 |
. Exonération en faveur des immeubles situés dans les ZFU créées en 1996 |
Art. 1383 B (CGI) |
|
|
Total taxe sur les propriétés bâties |
9 | ||
Imposition forfaitaire annuelle . Exonération de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés exonérées d’impôt sur les sociétés qui exercent la totalité de leur activité dans les ZFU ou en Corse Total imposition forfaitaire annuelle |
Art. 223 nonies (CGI) |
nd |
|
Dépenses « sociales » (exonération de cotisations) |
287 | ||
Total dépenses fiscales et sociales en ZFU |
523 | ||
Dans les ZRU Taxe professionnelle . Exonération en faveur des établissements existants ou créés dans les ZRU Total taxe professionnelle |
Art. 1466 A (I ter) (CGI) |
nd |
|
Dépenses « sociales » (exonération de cotisations) |
12,5 | ||
Total dépenses fiscales et sociales en ZRU |
19 | ||
Dans les ZUS Taxe d’aide au commerce et à l’artisanat . Abattement de 1 500 euros sur le montant de la taxe aux établissements situés dans les ZUS |
Art. 68 loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 |
|
AIDES EN FAVEUR DU LOGEMENT Taxe foncière sur la valeur ajoutée Taux de TVA à 5,5 % applicable aux logements en accession sociale à la propriété dans les quartiers en rénovation urbaine Total taxe sur la valeur ajoutée |
Art. 278 sexies (6 du I) |
nd |
|
Taxe foncière sur les propriétés bâties Abattement en faveur des immeubles en ZUS Total taxe foncière sur les propriétés bâties |
Art. 1388 bis (CGI) |
| |
total depenses fiscales et sociales rattachées à la politique de la ville (2009) |
693 |
a) Les aides à l’activité économique dans les ZFU et les ZRU
Les entreprises exerçant leurs activités en ZFU bénéficient d’avantages fiscaux s’agissant de l’imposition des bénéfices des entreprises, de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ÿ L’exonération d’imposition sur les bénéfices des entreprises (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ; 170 millions d’euros dans les ZFU en 2009)
L’article 44 octies A du code général des impôts, dont le coût pour les finances publiques a été évalué à 55 millions d’euros au titre de 2009, dispose que les entreprises qui créent des activités à compter du 1er janvier 2006 dans les ZFU (quelle que soit la date de création de la ZFU considérée) sont exonérées totalement d’imposition sur leurs bénéfices pendant cinq ans (44), puis sont exonérées selon un dispositif de sortie « en sifflet », suivant cette période de cinq ans d’exonération totale, à hauteur de :
– 60 % durant les première à cinquième années suivant la période de cinq ans d’exonération totale ;
– 40 % durant les sixième et septième années suivant la période initiale d’exonération totale ;
– 20 % durant les huitième et neuvième années suivant cette période initiale.
Le même article précise que l’exonération totale s’applique jusqu’au 31 décembre 2010 aux activités existantes au 1er janvier 2006 dans les ZFU créées par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (ZFU dite de « troisième génération »). Dans ce cas de figure, le dispositif de sortie « en sifflet » décrit ci-dessus s’applique à compter de 2011.
Dans tous les cas prévus par l’article 44 octies A du code général des impôts, le bénéfice exonéré est limité à 100 000 euros, « majoré de 5 000 euros par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois » (45). L’exonération est par ailleurs soumise à des conditions relatives aux effectifs de l’entreprise, à son volume d’affaires, à la composition de son capital et à la nature de ses activités (46).
L’article 44 octies A du code général des impôts constitue en partie une prorogation et un renouvellement des dispositions de l’article 44 octies du même code applicables aux ZFU de première et deuxième générations (créées respectivement suite aux lois du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).
L’article 44 octies du même code, toujours en vigueur pour partie, a constitué un coût de 115 millions d’euros pour le budget de l’État en 2009. Il prévoit une exonération totale d’imposition de cinq ans sur les bénéfices, suivie d’une exonération dégressive sur trois ans, les taux d’exonération s’établissant respectivement pour chacune de ces trois années à 60 %, 40 % et 20 %. Ce dispositif de sortie « en sifflet » est amélioré pour les entreprises de moins de cinq salariés, les périodes d’application de ces taux après la période initiale d’exonération totale étant dans ce cas identiques à celles prévues par l’article 44 octies A du même code. L’exonération prévue par l’article 44 octies du même code n’est, en règle générale, pas soumise à des conditions concernant les effectifs de l’entreprise, son volume d’affaires, la composition de son capital ou la nature de ses activités. Applicable sous un plafond de 61 000 euros de bénéfice, elle a été appliquée et s’applique encore dans les conditions suivantes :
– jusqu’au 31 décembre 2001 pour les activités créées ou exercées dans les ZFU de première génération ;
– du 1er janvier 2002 à la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances pour les activités créées dans les ZFU de première génération ;
– du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 pour les activités exercées dans les ZFU de deuxième génération. L’entreprise concernée doit satisfaire à des conditions relatives à ses effectifs, son volume d’affaires, la composition de son capital et la nature de ses activités. Ces conditions sont cependant différentes de celles prévues par l’article 44 octies A du code général des impôts (47) ;
– du 1er janvier 2004 à la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances pour les activités créées dans les ZFU de deuxième génération. L’entreprise concernée doit satisfaire aux mêmes conditions que celles requises dans le cas immédiatement précédent.
Ÿ L’exonération de taxe professionnelle (2009 : 59 millions d’euros dans les ZFU et 6 millions d’euros dans les ZRU)
Au total, en 2009, dernière année de mise en œuvre de la taxe professionnelle pour les entreprises, les différents dispositifs d’exonération totale pendant cinq ans (48) en faveur des établissements implantés dans les ZFU ont constitué un coût pour les finances publiques de 59 millions d’euros. Ces dispositifs, tous applicables aux entreprises de cinquante salariés au plus et prévus à l’article 1466 A du code général des impôts, étaient les suivants :
– le I sexies de cet article s’appliquait (49) aux établissements créés ou faisant l’objet d’une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans toutes les ZFU (quelle que soit leur date de création) et aux établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération. Les entreprises concernées devaient satisfaire à des conditions relatives à leur volume d’affaires et à la composition de leur capital (50) ;
– le I quinquies du même article s’appliquait (51) aux établissements créés ou faisant l’objet d’une extension dans les ZFU de deuxième génération entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et aux établissements existant au 1er janvier 2004 dans ces ZFU. Les entreprises concernées devaient satisfaire à des conditions relatives à leur volume d’affaires et à la composition de leur capital, partiellement différentes de celles prévues par le I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts ;
– le I quater du même article s’appliquait (52), dans les ZFU de première génération, aux établissements créés entre le 1er janvier 1997 et la date de publication de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, faisant l’objet d’une extension entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ou existant au 1er janvier 1997.
Le I ter de l’article 1466 A du code général des impôts prévoyait par ailleurs une exonération de taxe professionnelle en faveur des établissements employant moins de cent cinquante salariés existant au 1er janvier 1997 dans une ZRU ou créés dans une telle zone, y faisant l’objet d’une extension ou d’un changement d’exploitant entre cette date et le 1er janvier 2008 (53).
Les exonérations évoquées dans les I ter à I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts s’appliquaient a priori, « sauf délibération contraire » de la collectivité territoriale concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunale considéré. Le système inverse était prévu s’agissant de l’exonération de taxe professionnelle en faveur des établissements implantés dans les ZUS situées dans le ressort de la collectivité territoriale concernée ou de l’EPCI considéré : l’exonération résultait d’une délibération en ce sens de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.
En tout état de cause, la suppression de la taxe professionnelle prévue par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a conduit à la suppression de l’ensemble des dépenses fiscales rattachées à cette imposition et, ainsi, à la suppression de celles d’entre elles qui concernaient la politique de la ville. La création de la cotisation foncière des entreprises (54) a cependant partiellement donné lieu à la création de dépenses fiscales analogues :
– la faculté pour une collectivité territoriale ou un EPCI d’exonérer de cotisation foncière les établissements implantés dans les ZUS situées dans son ressort territorial est désormais prévue par le I de l’article 1466 A du code général des impôts, sur le modèle du dispositif analogue antérieur en matière de taxe professionnelle ;
– le I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts prévoit une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements créés ou faisant l’objet d’une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans toutes les ZFU (quelle que soit leur date de création) et aux établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération. Les entreprises doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles qui étaient prévues pour la mise en œuvre du dispositif analogue en matière de taxe professionnelle prévue par ce même I sexies dans sa version antérieure à la suppression de cette imposition.
Ÿ Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (9 millions d’euros en 2009 dans les ZFU)
En 2009, l’exonération totale pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles rattachés à un établissement susceptible de bénéficier d’un des dispositifs de taxe professionnelle de cotisation foncière dans les ZFU prévues par l’article 1466 A du code général des impôts, a constitué un coût de 9 millions d’euros pour les finances publiques. Trois dispositifs (55) en vigueur composent désormais cette exonération :
– l’article 1383 C du code général des impôts s’applique aux immeubles situés dans toutes les ZFU (quelle que soit leur date de création) et qui sont rattachés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 à un établissement susceptible de bénéficier de l’exonération, applicable dans les ZFU, de cotisation foncière des entreprises ;
– l’article 1383 B bis du même code s’applique aux immeubles situés dans les ZFU de la deuxième génération et qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, à une activité susceptible de bénéficier de l’exonération, applicable dans les ZFU, de cotisation foncière des entreprises ;
– l’article 1383 B du même code s’applique aux immeubles situés dans les ZFU de la première génération et qui sont affectés, entre le 1er janvier 1997 et la date de publication de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, à une activité susceptible de bénéficier de l’exonération, applicable dans les ZFU, de cotisation foncière des entreprises. Pour la période s’étendant du 1er janvier 2002 à la date de publication de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, seules les activités nouvelles sont susceptibles d’ouvrir le bénéfice de l’exonération aux immeubles qui leur sont rattachés.
Ÿ L’exonération d’imposition forfaitaire annuelle (coût en 2009 dans les ZFU : 3 millions d’euros)
L’imposition forfaitaire annuelle est due par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, selon un barème qui associe un montant d’imposition forfaitaire au montant de chiffre d’affaires majoré des produits financiers du contribuable considéré (56). La spécificité de l’IFA est qu’elle est due même quand le montant d’impôt sur les sociétés du contribuable qui en est passible est nul.
Cette règle connaît quelques exceptions prévues notamment par l’article 223 nonies du code général des impôts. Son troisième alinéa prévoit en effet que sont exonérées du paiement de l’IFA les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés au titre des exonérations d’imposition sur les bénéfices prévues par les articles 44 octies et 44 octies A du même code, c’est-à-dire les entreprises exerçant leurs activités dans les ZFU. L’exonération du paiement de l’IFA s’applique uniquement lorsque les entreprises concernées « exercent l’ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines ».
Si la direction du budget et le document de politique transversale « Ville » évalue le coût pour les finances publiques de cette exonération à 3 millions d’euros en 2009, il n’est pas certain que ce montant, limité, corresponde uniquement à la dépense fiscale propre aux ZFU ; en effet, l’article 223 nonies du code général des impôts prévoit d’autres exonérations en matière de paiement de l’IFA, que ce montant inclut le cas échéant. En tout état de cause, l’article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a prévu la suppression échelonnée de l’IFA, l’achèvement de cette suppression étant prévu à compter du 1er janvier 2011. En conséquence, les exonérations associées à cette imposition, dont celle relative aux entreprises exerçant leurs activités dans les ZFU, seront aussi supprimées à compter de cette même date.
Ÿ Abattement de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements situés dans les ZUS
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés prévoit qu’une taxe sur les surfaces commerciales est due au titre de toute « surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. »
Le troisième alinéa du même article 3 dispose que « les établissements situés à l’intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d’une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables ». Aucune évaluation du coût, sans doute assez modeste, de cet abattement pour les finances publiques ne semble disponible.
b) Les mesures en faveur du logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Ÿ Taux réduit de TVA pour l’achat d’un logement destiné à la résidence principale dans et autour des quartiers concernés par le PNRU (en 2009, 70 millions d’euros)
Le 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts dispose que le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique à certaines livraisons d’immeubles ou à certains travaux portant sur des logements « dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale » dans les conditions suivantes :
– les acheteurs personnes physiques disposent de ressources inférieures aux plafonds majorés de 11 % déterminant l’ouverture des droits à l’aide personnalisée au logement pour les logements conventionnés du parc locatif social ;
– l’immeuble ou le logement est, soit situé dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine dans le cadre du PNRU, soit entièrement situé à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
Cette dépense fiscale, prévue initialement par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, a pour objet d’inciter des ménages plus favorisés que les ménages résidant dans les quartiers concernés par le PNRU à acquérir leur logement dans ces quartiers, à l’occasion de la rénovation urbaine. Sans qu’il soit possible de disposer d’éléments quantitatifs plus précis quant au fonctionnement de ce dispositif et encore moins quant à ses impacts réels sur le panel des ménages résidant dans les quartiers concernés, la direction du budget a estimé le coût, non négligeable, de ce dispositif pour les finances publiques à 70 millions d’euros en 2009.
Ÿ L’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux situés en ZUS (en 2009, 83 millions d’euros)
L’article 1388 bis du code général des impôts dispose que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux ayant fait l’objet d’un conventionnement avec l’État, lorsque ces logements sont la propriété d’organismes d’habitation à loyer modéré « fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logement sont situés en zones urbaines sensibles […] ». La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions a prorogé ce dispositif aux impositions établies en 2010, alors qu’il devait s’éteindre en 2009.
Ce dispositif est par ailleurs applicable aux impositions établies au titre des années 2006 à 2013 pour les logements faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale. Chaque organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de signer une convention d’utilité sociale, en application de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version issue de l’article 1er de la loi du 25 mars 2009, avec le représentant de l’État, avant le 31 décembre 2010. Cette disposition n’a pas de lien explicite avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le dispositif d’abattement de 30 % de la base d’imposition en faveur des logements locatifs sociaux conventionnés situés en ZUS au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui étrangement ne figure pas dans le DPT « Ville » comme une des dépenses fiscales rattachées à la politique de la ville, a représenté en 2009, selon la direction du budget, un coût de 83 millions d’euros pour les finances publiques.
4.– Les dotations aux collectivités territoriales liées à la mise en œuvre de la politique de la ville
a) De profondes inégalités de ressources et de charges entre collectivités territoriales
Au-delà d’être une exigence constitutionnelle (57), la péréquation des moyens financiers dont disposent les collectivités territoriales, et notamment les communes, apparaît comme une exigence fondamentale au regard de la politique de la ville. En 2009, les écarts de « pouvoir d’achat » (58) variaient du simple au double pour les régions, du simple au quadruple pour les départements, de un à 7 pour les communautés d’agglomération et de un à 1 000 pour les communes (s’agissant des communes urbaines de plus de 10 000 habitants, l’écart varie de un à 22). Au total, les 1 % des communes les plus riches disposaient en 2009 de 45 fois plus de pouvoir d’achat que les 1 % des communes les plus pauvres ; les 10 % des communes les plus riches disposaient de 30 % du pouvoir d’achat des communes, tandis que les 10 % des communes les plus pauvres disposaient de 1 % de ce pouvoir d’achat.
Du point de vue de la politique de la ville, on constate que nombre des communes les plus aux prises avec les problématiques des quartiers en difficulté sont aussi celles qui disposent de moyens contraints. Ce sont bien entendu ces communes, qui cumulent les handicaps en termes de ressources et de charges, qui doivent être les principales bénéficiaires des dispositifs de péréquation ; leur situation doit être distinguée de celle des communes dont les ressources potentielles sont plus élevées et qui peuvent réellement traiter les difficultés propres à leurs quartiers prioritaires et de celle des communes dont les ressources relativement limitées sont néanmoins suffisantes pour faire face à leurs charges ; sans parler bien entendu de certaines communes parmi les plus « riches » qui ne sont en aucune façon confrontées aux problématiques de quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le potentiel fiscal des collectivités territoriales constitue un outil permettant d’approcher une mesure de ces écarts de ressources potentielles. Le potentiel fiscal d’une commune est obtenu en appliquant aux bases d’imposition aux 4 taxes directes locales classiques (taxe d’habitation, taxe professionnelle et les deux taxes foncières) (59) les taux moyens nationaux d’imposition constatés pour chacune de ces taxes. Il s’agit donc de mesurer effectivement le potentiel fiscal net des choix de taux d’une commune, d’autant plus que les bases d’imposition prises en compte sont corrigées des choix de la commune considérée en matière d’exonérations ou d’abattements. Le potentiel fiscal par habitant permet ainsi de contribuer à répondre à la question suivante : quelles sont les ressources financières mobilisables par chaque commune pour un taux moyen de fiscalité directe déterminé sans référence aux choix de cette commune en la matière ?
Comparer les extrêmes n’apporte que des enseignements limités à des cas particuliers, mais il n’est pas inintéressant d’observer qu’en 2010, s’agissant des communes de plus de 10 000 habitants, le potentiel fiscal par habitant varie quasiment de un à seize, de 267,81 euros à 4 210,54 euros. Cependant, sur les 967 communes de cette strate démographique, on observe que 721 d’entre elles disposent d’un potentiel fiscal compris entre 500 euros et 1 000 euros, soit 75 % environ de l’effectif de la strate. Au demeurant, cette approche plus prudente révèle néanmoins des disparités assez fortes puisque la fourchette choisie constitue en soi une variation du simple au double de la mesure de la richesse fiscale potentielle et que, hors de cette fourchette, on observe que 179 communes disposent d’un potentiel fiscal par habitant supérieur à 1 000 euros alors que 68 autres disposent d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à 500 euros. Le graphique suivant illustre ces observations en faisant apparaître en abscisse les communes de plus de 10 000 habitants classées selon l’ordre croissant de leur potentiel fiscal, dont le montant apparaît en ordonnée :
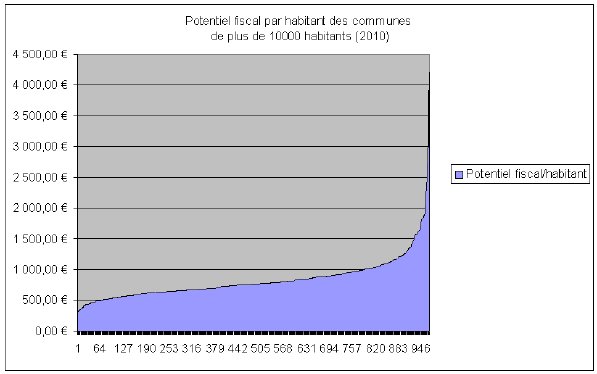
Source : Direction générale des collectivités territoriales
Il convient bien entendu d’utiliser et d’interpréter la notion de potentiel fiscal avec prudence. En premier lieu, la suppression de la taxe professionnelle conduira nécessairement à l’élaboration d’un nouvel outil de mesure de la richesse potentielle des collectivités territoriales, compte tenu par ailleurs de la création de la cotisation foncière des entreprises. Autrement dit, toute référence au potentiel fiscal est en quelque sorte désormais caduque ; sa structure actuelle ne préjuge pas, en effet, des situations comparées des niveaux de richesse potentielle des communes au terme de la nouvelle donne fiscale issue de la suppression de la taxe professionnelle.
Par ailleurs, le potentiel fiscal ne constitue pas un instrument à lui seul efficace pour définir des dispositifs de péréquation, car ceux-ci doivent aussi tenir compte des différences de charges entre collectivités territoriales. S’il fallait convaincre qu’il faut prêter au moins autant attention à la question des ressources qu’à celles des charges des collectivités territoriales, on peut facilement montrer, par exemple, qu’il n’y a pas pour les communes de corrélation déterminante entre le potentiel fiscal et la part de la population en ZUS. Le graphique suivant répartit chacune des communes de plus de 10 000 habitants selon ces deux éléments.
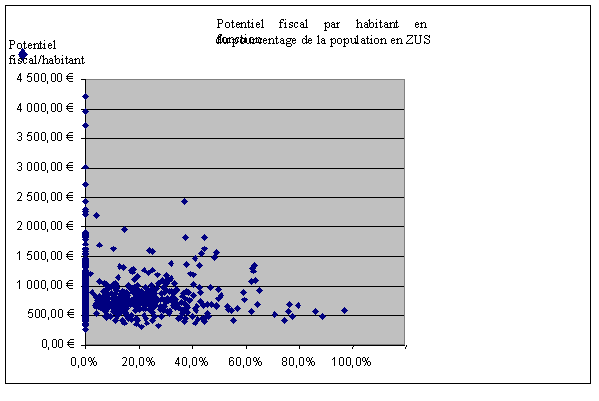
Au sein des communes de plus de 10 000 habitants ayant une fraction de population en ZUS, la part de celles ayant un potentiel fiscal supérieur à 1 000 euros par habitant s’élève à 18,5 %, soit un niveau identique à celui de la part des communes ayant un tel potentiel fiscal dans l’ensemble de la strate. Si on compare ces effectifs de communes pour des niveaux de potentiel fiscal par habitant plus élevé, on observe certes une très légère corrélation entre ce potentiel et la part de la population en ZUS des communes concernées : ainsi 0,5 % des communes ayant une population en ZUS disposent d’un potentiel fiscal supérieur à 2 000 euros par habitant contre 1,13 % pour l’ensemble des communes de cette strate démographique. Si l’on situe la référence à 1 500 euros par habitant de potentiel fiscal par habitant, ces taux s’établissent respectivement à 3,55 % et 4,34 %.
La faible corrélation négative entre richesse potentielle fiscale de la commune et présence d’une ZUS dans le ressort de la commune est confirmée par un autre constat : la moyenne des potentiels fiscaux par habitant des communes qui n’ont pas de ZUS s’élève à 850,73 euros, cette moyenne s’élevant à 800,45 euros pour les communes qui ont au moins une ZUS sur leur territoire. Mais cette corrélation est en tout état de cause fragile : le potentiel fiscal par habitant des communes dont plus d’un tiers de la population est en ZUS (soit 88 communes de plus de 10 000 habitants) s’élève ainsi à 826,48 euros.
Le rapport entre richesse d’une commune en tant que collectivité territoriale et la part de ses habitants concernée par la politique de la ville, envisagée comme un indice de charges, n’est donc pas établi.
Ce constat n’est pas particulièrement surprenant : comme il a déjà été relevé par vos rapporteurs, le potentiel fiscal d’une commune est fortement corrélé aux poids des bases d’imposition à la taxe professionnelle. Une commune dont les habitants disposent de revenus faibles peut accueillir sur son territoire de nombreuses entreprises pourvoyeuses d’importants montants de taxe professionnelle, selon un profil relativement fréquent de communes dans les bassins industriels français.
Au total, il convient que la péréquation repose sur les deux piliers structurants que sont la mesure des inégalités de ressources et la prise en compte des inégalités de charges entre les collectivités territoriales. Autrement dit, il s’agit de cibler très précisément les communes qui cumulent de faibles ressources fiscales mobilisables et des problèmes sociaux et économiques lourds (et parfois, par ailleurs, une absence de solidarité financière intercommunale). Si nombre de ces communes sont franciliennes, certaines d’entre elles, de taille peut-être plus modeste, sont situées en province. Ce sont en tout état de cause ces communes qui doivent être les principales bénéficiaires d’une péréquation financière à la hauteur de leurs difficultés.
b) Les dispositifs de péréquation existant en faveur des communes urbaines connaissant des difficultés économiques et sociales
On peut considérer que trois dispositifs nationaux de péréquation répondent, ou répondaient jusqu’à la suppression de la taxe professionnelle, à la nécessité d’une péréquation en faveur des communes urbaines connaissant des difficultés économiques et sociales importantes. Dans le ressort national, il s’agit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et de la dotation de développement urbain (DDU) ; il s’agit, par ailleurs, pour la région Île-de-France, du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
Le tableau suivant présente l’évolution des montants de ces trois dispositifs sur les dernières années :
![]()
DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE (DSU) ET
DOTATION DE DÉVELOPPEMENT URBAIN (DDU)
en millions d’euros
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
DSU * |
550,6 |
549,6 |
566,3 |
586,7 |
606,9 |
759,6 |
879,6 |
999,6 |
1 093,7 |
1 163,7 |
1 233,7 |
DDU ** |
50,0 |
50,0 |
* DSU mise en répartition par le Comité des finances locales
** DDU inscrite en loi de finances.
Source : Direction générale des collectivités locales
FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (FSRIF)
en millions d’euros
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
Abondements des collectivités contributrices |
170,2 |
173,4 |
184,9 |
176,7 |
185,5 |
173,8 |
Reversements opérés |
170,2 |
172,4 |
184,7 |
174,0 |
185,3 |
173,8 |
Source : Direction générale des collectivités locales
Il convient par ailleurs de mentionner les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Ces fonds, prorogés en 2010, malgré la suppression de la taxe professionnelle, selon des modalités prévues par l’article 1648 A du code général des impôts, traitaient directement le problème des inégalités de bases d’imposition de taxe professionnelle entre communes : celles qui disposaient sur leur territoire d’un établissement exceptionnel du point de vue de ces bases d’imposition étaient contributrices au FDPTP au bénéfice des autres communes du département. Pour les motifs évoqués infra concernant le FSRIF, il n’est pas sans intérêt de garder en mémoire le dispositif des FDPTP, dispositif de péréquation horizontale entre communes.
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS)
L’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales précise que la DSU-CS « a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées ». Pour déterminer quelles sont ces communes, l’article L. 2334-16 du même code fixe en premier lieu leur nombre. Sont ainsi concernés :
– les trois premiers quarts des communes de plus de 10 000 habitants, soit, en 2010, 726 des 967 communes de cette strate démographique ;
– le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, soit, en 2009, 110 des 1 108 communes de cette strate démographique.
Le nombre des communes concernées étant ainsi fixé, leur identité est déterminé par le résultat de deux classements qui concernent respectivement toutes les communes de plus de 10 000 habitants et toutes celles de 5 000 à 9 999 habitants. Ces classements sont élaborés en utilisant un indice synthétique décrit à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et mesurant, dans un ordre décroissant, leur « pauvreté » respective au sens où celle-ci, comme l’énonce l’article L. 2334-15 du même code, est définie par la faiblesse de leurs ressources et par l’importance de leurs charges. Cet indice est composé, pour chaque commune, des éléments suivants rapportés à la moyenne de la strate démographique correspondante :
– son potentiel financier. L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales dispose que le potentiel financier d’une commune est égal à son « potentiel fiscal majoré du montant de la dotation forfaitaire [de la dotation globale de fonctionnement] perçu par la commune ». Le potentiel financier d’une commune est donc censé être un instrument plus fin que le potentiel fiscal de la mesure de la richesse potentielle, hors tout choix politique, d’une collectivité territoriale, puisqu’il prend en compte la mesure d’une partie fondamentale des ressources des communes, c’est-à-dire la part dite « forfaitaire » de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Le potentiel financier constitue cependant un concept imparfait du fait même de la structure de la dotation forfaitaire de la DGF. En effet, cette dotation est en partie constituée d’une dotation dite « de garantie », permettant à la commune concernée, dans une certaine mesure, le maintien, après la réforme de 2004 de la DGF, du montant de DGF dont elle bénéficiait antérieurement à cette date (Cf. le 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales). Or, cet élément, contrairement à toutes les autres composantes de la dotation forfaitaire de la DGF (60), n’est pas sans conserver la trace de choix politiques locaux, parfois très anciens, portant sur des éléments de fiscalité locale disparus et auxquels se sont peu à peu substituées des dotations versées par l’État ;
– la proportion des logements sociaux. Selon la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), ce critère n’est pas sans poser certaines difficultés : « le critère du logement social demeure toujours problématique : la fiabilité de cette donnée dépend de la réponse des bailleurs sociaux sollicités dans le cadre de l’enquête EPLS [enquête sur le parc locatif social] menée annuellement par les directions régionales de l’équipement. L’absence de réponse de certains bailleurs, notamment en Île-de-France, fragilise la répartition de la dotation. […] En raison du problème récurrent du recensement des logements sociaux, le groupe de travail du Comité des finances locales avait ainsi exprimé au cours de l’année 2009 le souhait d’une diminution au sein de l’indice du poids du critère “ logements sociaux ” de 15 à 10 % et en contrepartie une progression de 5 % du critère « revenu par habitant ».
La DGCL considère cependant que des progrès pourraient être constatés à l’avenir s’agissant de la fiabilité des informations permettant de renseigner ce critère : « dans un souci de fiabilisation du recensement des logements sociaux, le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS), instauré par l’article 112 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, remplacera l’enquête EPLS à partir du 1er janvier 2011. Les résultats de ce nouvel outil statistique pourront être pris en compte dans leur intégralité à compter de la répartition 2013 de la dotation, le premier recensement mené en 2011 ne concernant que les propriétaires de plus de 1 000 logements ». Au-delà de cette difficulté liée à la fiabilité des informations permettant la mise en œuvre de ce critère, la DGCL considère que le principe même de son usage est discutable : « le critère “ bénéficiaires de prestations logement ” semblait, dans les travaux conduits au cours de l’année 2008 sur la réforme de la DSU, mieux refléter les difficultés d’une population que le critère du logement social ». Il convient effectivement de relever que dans les zones urbaines les plus en difficulté, les difficultés socio-économiques les plus lourdes peuvent se concentrer dans de grands ensembles de propriétés privées, communément appelés « copropriétés privées dégradées », qui ne sont pas des logements sociaux ;
– la proportion des bénéficiaires des aides au logement. Il s’agit de l’aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation), de l’allocation de logement (article L. 542-1 du code de la sécurité sociale) et de l’allocation de logement sociale (article L. 831-1 du code de la sécurité sociale) ;
– le revenu des habitants sur la base du revenu imposable moyen par habitant.
Les quatre composantes de cet indice sont respectivement pondérées, selon l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, « le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l’ensemble des communes bénéficiaires d’au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État ». En pratique, les taux de pondération en vigueur sont les taux directement prévus par la loi.
À ce stade, au-delà des réserves évoquées sur certains éléments de cet indice synthétique, il apparaît qu’il aurait sans doute été plus logique de concevoir la DSU-CS d’abord par un classement des communes selon un indice synthétique afin d’identifier celles pour lesquelles le versement de cette dotation semble opportun. En commençant par fixer le nombre des communes bénéficiaires, le risque a été pris qu’une partie de la DSU-CS soit versée sans réel objet, surtout pour les communes de plus de 10 000 habitants parmi lesquelles les trois quarts d’entre elles sont de jure éligibles à son versement. Peut-on considérer d’office pour toutes ces communes qu’elles sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportent des charges élevées, pour reprendre les termes de l’article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales ?
En tout état de cause, une fois les communes bénéficiaires de la DSU-CS identifiées grâce aux classements évoqués, son produit est ainsi réparti :
– la dotation par commune est dans un premier temps établie en effectuant le produit du nombre d’habitants et de la valeur de l’indice synthétique évoquée ;
– ce produit est corrigé par la mesure de l’effort fiscal des communes, étant entendu que plus les taux pratiqués sur les quatre taxes directes locales y sont élevés, plus le versement de DSU-CS est élevé (les taux d’effort fiscal supérieurs à 1,3 fois la moyenne sont ramenés au plafond de 1,3 pour le calcul de la DSU-CS). Cette disposition part de l’hypothèse que les communes les plus en difficulté ont, en règle générale, au cours du temps adopté des taux élevés d’imposition, parce que nécessairement confrontées à de faibles ressources pour des charges supérieures à la moyenne. Sur le principe, cette hypothèse, qui n’est pas sans fondement, ne fait pas justice aux décideurs locaux qui, dans la difficulté, ont le cas échéant choisi une politique de modération fiscale. Par ailleurs, dans un contexte où trois communes sur quatre de plus de 10 000 habitants sont concernées, la règle tend à avantager des communes pratiquant des taux élevés sur un potentiel fiscal élevé. Par ailleurs, les effets de la correction suivant l’effort fiscal doivent être examinés précisément pour les prochaines années : l’augmentation des taux constatée au niveau national depuis plusieurs années sur les taxes directes locales pourrait, mécaniquement, baisser la mesure de l’effort fiscal de certaines communes pratiquant des taux élevés, qui pourraient être ainsi conduites à devoir choisir entre enregistrer une baisse de leur montant de DSU-CS ou augmenter leurs taux d’imposition afin de maintenir ce montant ;
– le produit ainsi obtenu est modifié par un coefficient logarithmique qui avantage financièrement les communes les « mieux classées », c’est-à-dire les plus défavorisées ;
– enfin, le produit est augmenté, le cas échéant, de deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles (ZUS) et la population totale de la commune, et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines (ZFU) et la population totale de la commune. En 2010, 387 des 967 communes de 10 000 habitants et plus avaient sur leur territoire une ou plusieurs ZUS.
La pertinence du critère relatif à la part de la population de la commune située en ZUS ou ZFU a été discutée. Si l’on considère les critères prévus par l’article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales, il est incontestable que la présence d’une ou plusieurs ZUS dans une commune ne signifie pas qu’elle est nécessairement confrontée à une insuffisance de ses ressources mobilisables, si le potentiel fiscal est utilisé pour en faire la mesure (cf. supra). Par contre, sauf à nier toute pertinence à une politique de la ville ciblant certains quartiers connaissant des difficultés économiques et sociales lourdes, même en considérant que la délimitation des ZUS n’est pas ou n’est plus aujourd’hui satisfaisante, il apparaît difficile de nier que la présence d’une telle zone, a fortiori d’une ZFU (61), constitue un surcroît de charges pour la commune concernée.
L’impact de la DSU-CS sur les ressources des communes qui en bénéficient le plus est significatif. Alors que la moyenne des montants de DGF par habitant versés en 2010 aux 967 communes de plus de 10 000 habitants s’élève à 262,67 euros, 66 communes de cette strate démographique ont bénéficié, au sein de la DGF, de plus de 100 euros par habitant au titre de la DSU-CS et 212 communes de la même strate ont bénéficié de plus de 50 euros par habitant de DSU-CS. Les 66 communes qui ont bénéficié de plus de 100 euros de DSU-CS par habitant ont ainsi reçu en moyenne 437,72 euros par habitant de DGF, soit significativement plus que la moyenne (ces 66 communes ont bénéficié en moyenne de 153,91 euros par habitant de DSU-CS). Pour ces 66 communes, la part de la DSU-CS représente en règle générale plus de 25 % de l’ensemble de la DGF perçue, ce taux s’établissant à 54,27 % pour la commune pour lequel il est le plus élevé. Si l’on considère que l’indice synthétique évoqué constitue une mesure pertinente de la faiblesse des ressources de ces communes et de l’importance de leurs charges, la DSU-CS dont elles bénéficient, constitue ainsi une réponse effective, bien qu’encore insuffisante aux yeux de vos rapporteurs, à leurs difficultés.
Par contre, 200 communes bénéficient en 2010 d’un montant de DSU-CS inférieur à 20 euros par habitant. Pour ces communes, ce montant est, sauf quelques exceptions, inférieur à 10 % du total de la DGF perçue par la commune. Du point de vue de ces collectivités territoriales, un tel appoint n’est bien entendu pas négligeable. Cependant, il n’est pas certain que ces versements satisfont réellement l’objectif national de la DSU-CS fixé par l’article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales. Il a donc semblé légitime au Parlement, pour les exercices 2009 et 2010, de réserver l’augmentation de l’enveloppe annuelle de la DSU-CS aux premières communes de 10 000 habitants et plus classées selon l’indice synthétique évoqué (les 150 premières en 2009 et les 250 premières en 2010) et aux 20 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants classées selon le même indice (62).
Ce ciblage de l’augmentation de la DSU-CS sur 2009 et 2010 a été mis en œuvre dans le contexte d’une évolution assez dynamique de cette dotation, au regard notamment des composantes de la part forfaitaire de la DGF. Cette évolution, mise en œuvre par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont l’article 135 a inséré à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales le principe selon lequel, entre 2005 et 2009, « la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d’euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale […] ».
Cette augmentation a été fixée à 70 millions d’euros pour les exercices 2009 et 2010, à titre dérogatoire, par les articles 171 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2009 de finances pour 2009 et 127 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. D’une certaine façon, la création de la dotation de développement urbain (DDU), pour un montant de 50 millions d’euros en 2009 et 2010, a constitué une contrepartie à l’augmentation moins sensible qu’initialement envisagée de la DSU-CS pour ces deux exercices.
Il convient enfin de replacer la DSU-CS dans le contexte de la DGF. La DGF des communes en 2010 s’élève ainsi à 16,61 milliards d’euros et la DGF des EPCI à 6,95 milliards d’euros. La DSU représente ainsi en 2010 7,4 % de la DGF des communes et 5,2 % de la DGF du bloc communal (c’est-à-dire les communes et les EPCI). Par ailleurs les dotations de péréquation (soit la DSU-CS, la dotation de solidarité rurale – DSR et la dotation nationale de péréquation – DNP) de la DGF des communes représentent en 2010 16,54 % de son total. La DSU-CS, ainsi que l’ensemble de la part « péréquation », constituent une proportion modeste de la DGF des communes, malgré une progression en volume sensible depuis 2005.
La dotation de développement urbain (DDU)
L’article 172 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2009 de finances pour 2009 a créé la DDU, pour un montant de 50 millions d’euros pour chacun des exercices 2009 et 2010. L’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales dispose que « peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d’un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier ». La partie réglementaire du même code précise ces dispositions (alors que leur équivalent en matière de DSU-CS relève de la loi). Ainsi, son article R. 2334-36 prévoit en premier lieu des critères de sélection des communes éligibles à la DDU :
– la commune doit être éligible à la DSU-CS au titre de l’exercice en cours ;
– elle doit avoir une part de sa population en ZUS supérieure à 20 % ;
– il existe sur son territoire une convention portant sur un projet de rénovation urbaine signée avec l’Anru.
On peut relever le faible apport du premier critère par rapport au deuxième : en 2010, seule une commune sur les 199 de plus de 10 000 habitants ayant une population en ZUS supérieure à 20 % n’était pas éligible à la DSU-CS (63). Le troisième facteur est plus discriminant puisque, toujours pour les 199 communes de plus de 10 000 habitants qui ont plus de 20 % de leur population en ZUS, environ 45 d’entre elles n’ont pas de convention portant projet de rénovation urbaine en 2010 en application sur leur territoire.
En tout état de cause, les communes comptant 5 000 à 9 999 habitants et les communes de plus de 10 000 habitants font respectivement l’objet d’un classement, pour autant qu’elles répondent à ces trois critères, et sont classées selon un indice synthétique composé de trois des éléments applicables pour l’indice synthétique propre à la DSU-CS et selon les mêmes conditions : le potentiel financier, la proportion de bénéficiaires d’aides légales au logement et le revenu moyen par habitant. Ces trois critères sont respectivement pondérés à hauteur de 45 %, 45 % et 10 %. On relève que cet indice synthétique ne contient pas les éléments les plus contestés de l’indice synthétique applicable en matière de DSU-CS ; en effet, il ne dépend pas du critère relatif aux logements sociaux et le taux de la population en ZUS est utilisé au préalable comme première sélection des communes éligibles, afin de cibler ab initio les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui « pèsent » le plus pour les villes dans lesquelles ils sont situés.
Les cent premières communes métropolitaines classées selon l’indice synthétique propre à la DDU sont bénéficiaires de cette subvention. Les règles de répartition de cette subvention sont les suivantes :
– Une quote-part est au préalable prélevée au bénéfice des communes des départements d’outre-mer (DOM) qui font l’objet d’une convention portant projet de rénovation urbaine avec l’Anru. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation la proportion, majorée de 33 %, de la population des DOM au regard de la population des départements métropolitains et des DOM ;
– Une enveloppe est attribuée ensuite à chaque département métropolitain, calculée sur la base du produit, pour chacune des communes bénéficiaires de la DDU dans le département considéré, de l’indice synthétique propre à cette subvention et de la population de la commune. En tout état de cause, le produit ainsi obtenu ne peut aboutir à ce que l’enveloppe d’un département soit créditée de plus d’un million d’euros par commune bénéficiaire dans le département ;
– L’obtention par une commune éligible d’une part de l’enveloppe départementale qui la concerne est conditionnée, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et la commune ou l’EPCI compétent. Selon le même alinéa, les crédits de la DDU « sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissement ou d’actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l’État dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d’objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. » ;
Le tableau suivant précise, pour 2010, le montant de chaque enveloppe départementale, ainsi que le nombre des communes bénéficiaires par département.
MONTANT DES ENVELOPPES DÉPARTEMENTALES DE DDU
Département |
Nombre de communes éligibles |
DDU 2010 |
Aisne |
2 |
1 461 915 |
Ardennes |
2 |
1 266 148 |
Aube |
1 |
248 522 |
Bouches-du-Rhône |
1 |
1 000 000 |
Calvados |
1 |
401 157 |
Charente |
1 |
195 723 |
Doubs |
1 |
145 784 |
Eure-et-loir |
2 |
814 930 |
Haute-Corse |
1 |
692 308 |
Gironde |
3 |
1 073 525 |
Hérault |
1 |
1 000 000 |
Isère |
2 |
438 487 |
Maine-et-Loire |
1 |
200 718 |
Marne |
1 |
269 686 |
Meurthe-et-Moselle |
5 |
1 307 831 |
Moselle |
4 |
854 625 |
Nord |
16 |
6 098 702 |
Oise |
4 |
1 604 149 |
Orne |
1 |
486 284 |
Pas-de-Calais |
5 |
2 367 583 |
Haut-Rhin |
1 |
1 000 000 |
Rhône |
4 |
2 556 310 |
Sarthe |
2 |
353 636 |
Seine-maritime |
4 |
1 581 816 |
Seine-et-Marne |
5 |
2 442 349 |
Yvelines |
4 |
2 133 897 |
Vaucluse |
1 |
1 000 000 |
Vosges |
1 |
360 091 |
Essonne |
4 |
2 161 473 |
Hauts-de-Seine |
1 |
396 179 |
Seine-st-Denis |
12 |
8 624 206 |
Val-d’Oise |
6 |
3 593 033 |
Guadeloupe |
2 |
237 495 |
Martinique |
1 |
274 863 |
Guyane |
3 |
328 320 |
Réunion |
5 |
1 028 255 |
TOTAL |
111 |
50 000 000 |
On relève que deux départements, le Nord et la Seine-Saint-Denis, rassemblent plus du quart des communes métropolitaines bénéficiaires. L’intensité de l’aide que constitue cette subvention peut être appréciée notamment selon les constats suivants :
– la DDU constitue une aide potentielle d’un peu plus de 11 euros par habitant pour l’ensemble des communes bénéficiaires de cette dotation ;
– si on retranche de ce ratio la ville bénéficiaire la plus peuplée (64), qui seule commune bénéficiaire de son département, peut recevoir à ce titre un million d’euros au maximum, le ratio d’aide pour toutes les autres communes bénéficiaires s’élève à environ 13,5 euros par habitant.
Le dispositif de la DDU constitue un élément important dans le panorama des aides en faveur des quartiers urbains défavorisés :
– l’ensemble des critères d’éligibilité à cette dotation conduit à une cartographie très resserrée mais opportune des communes dans lesquelles se concentrent aujourd’hui les difficultés urbaines les plus lourdes dans notre pays, réserve faite de certaines communes, souvent de petite taille, qui ne sont pas concernées par le PNRU et qui subissent néanmoins ce type de difficultés ;
– le versement conventionné des dotations constitue un dispositif susceptible d’aboutir au meilleur comme au pire : un tel système peut ainsi conduire à une décentralisation réelle et exigeante comme à une recentralisation elle aussi bien réelle et rampante. Certains des maires concernés rencontrés par les rapporteurs, tout en saluant la démarche de projet, semblent regretter la rapidité avec laquelle ils sont tenus de facto de déterminer les projets au titre desquels leur commune peut effectivement bénéficier de la DDU.
Le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF)
Le FSRIF a été créé par les articles 14 et 15 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes. Il est aujourd’hui régi par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales, malgré la suppression de la taxe professionnelle, imposition sur laquelle le fonctionnement du FSRIF était jusqu’à présent assis directement ou indirectement par l’usage du potentiel financier.
L’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales prévoit deux prélèvements sur les recettes fiscales des communes au titre du FSRIF. Le premier prélèvement est basé sur un barème comparant le potentiel financier d’une commune à la moyenne des potentiels financiers des communes de la région et en associant à cette comparaison un pourcentage de prélèvement sur le potentiel financier de la commune contributrice. Ainsi :
– quand le potentiel financier d’une commune est compris entre 1,25 fois et 2 fois la moyenne régionale, le prélèvement est égal à 8 % du potentiel financier ;
– pour un potentiel financier compris entre 2 et 3 fois la moyenne régionale, le prélèvement s’établit à 9 % ;
– il atteint 10 % quand le potentiel financier de la commune considérée est supérieur à 3 fois la moyenne régionale.
Les communes éligibles à la DSU-CS et les communes éligibles au versement du FSRIF sont exonérées de ce premier prélèvement. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent l’avant-dernier exercice.
Un deuxième prélèvement est appliqué pour les communes dont les bases d’imposition à la taxe professionnelle par habitant excèdent 3 fois la moyenne constatée au niveau national. Les communes franciliennes concernées subissent un prélèvement égal au produit du taux qu’elles pratiquent en matière de taxe professionnelle et de la fraction de leurs bases d’imposition dépassant le seuil les rendant contributrices au prélèvement. Des dispositifs de plafonnement sont prévus pour ce deuxième prélèvement. Ils sont relatifs aux éléments suivants :
– si le revenu moyen par habitant de la commune contributrice est inférieur à 90 % de la moyenne francilienne, le second prélèvement est plafonné au montant du premier ;
– si les bases d’imposition à la taxe professionnelle de la commune contributrice sont inférieures à 3 fois la moyenne régionale, le second prélèvement est plafonné à 1,1 fois le montant du premier prélèvement.
Les EPCI à taxe professionnelle unique franciliens sont aussi potentiellement contributeurs d’un prélèvement dont les modalités de mise en œuvre sont très proches de celles prévues pour le second prélèvement des communes.
Pour l’ensemble des deux prélèvements, deux règles s’appliquent par ailleurs :
– les prélèvements ne peuvent excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement des communes et EPCI concernés constatées dans le compte administratif ;
– lorsqu’une commune ou EPCI est tenu de contribuer au titre du FSRIF, sa contribution est minorée le cas échéant de la contribution versée l’année précédente à un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
S’agissant des versements du FSRIF, les communes bénéficiaires sont déterminées selon une méthode très proche de celle décrite supra pour la DSU-CS. Deux strates démographiques de communes sont classées selon un indice synthétique :
– la première moitié des communes, aux termes du classement propre aux communes de 10 000 habitants, obtient un versement ;
– 18 % des communes les mieux classées aux termes du classement des communes ayant une population comprise entre 5 000 et 9 999 habitants obtiennent un versement.
L’indice synthétique propre au FSRIF est composé des mêmes éléments que celui propre à la DSU-CS, c’est-à-dire, en rapportant pour chaque commune chacun de ces éléments aux moyennes observées pour les communes de la même strate démographique dans la région : le potentiel financier, la part des logements sociaux dans l’ensemble des logements, la part des bénéficiaires d’aides légales au logement au regard du nombre des logements et le revenu moyen par habitant. Chacun de ces quatre critères est respectivement pondéré, en ce qui concerne le FSRIF, par les taux de 55 %, 15 %, 20 % et 10 %. Le montant du versement est égal, pour une commune considérée, au produit de la valeur de l’indice synthétique, de sa population et, selon un dispositif analogue à celui de la DSUCS, de l’effort fiscal de la commune dans la limite de 1,3.
Le FSRIF, dès la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, avait un objet proche de celui de la DSU-CS, axé sur la prise en compte de la faiblesse des ressources et du poids des charges liées à des problèmes économiques et sociaux en zones urbaines : « Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ».
Le FSRIF est par ailleurs remarquable car il a constitué un système de péréquation horizontale efficace. Il est probable que les dotations d’État, y compris celles dont l’objet est la péréquation, ne pourront pas à l’avenir connaître une évolution dynamique aussi forte que celle, par exemple, observée entre 2005 et 2010 pour la DSU-CS. Un travail d’avenir pourrait donc consister en l’élaboration, par exemple à l’échelle régionale, de dispositifs péréquateurs horizontaux sur le modèle du FSRIF, compte tenu bien entendu de la nouvelle donne issue de la suppression de la taxe professionnelle, s’agissant des profondes modifications que cette suppression implique dans les modalités de l’imposition territorialisée des entreprises, dans la répartition des impôts « ménages » et « entreprises » selon les catégories de collectivités territoriales et dans le poids respectif de ces impôts « ménages » et « entreprises » dans les ressources des collectivités territoriales.
5.– L’Épide, l’Épareca et la Caisse des dépôts et consignations
Dans deux domaines très différents, deux établissements publics nationaux mettent en œuvre des dispositifs partiellement rattachés à la politique de la ville.
a) L’établissement public d’insertion de la défense (Épide)
L’article L. 3414-1 du code de la défense précise que l’Épide, établissement public national à caractère administratif placé sous la triple tutelle des ministres chargés de la défense, de l’emploi et de la ville, « a pour objet l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale ». Le même article dispose notamment qu’à cet effet l’Épide « organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s’inspirant du modèle militaire [et] accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ».
Si la loi n’impose pas que l’Épide recrute son public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la direction du budget précise qu’« en 2009, 21,7 % des volontaires admis étaient issus des ZUS, et 11,8 % provenaient d’autres quartiers de la politique de la ville. L’accroissement de la part des volontaires issus des quartiers prioritaires constitue l’un des objectifs du COMP [contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels] de l’établissement ». L’objectif semble, à terme, consister à réserver 50 % des flux d’entrées dans le dispositif des volontaires d’insertion à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Du point de vue budgétaire, la direction du budget précise par ailleurs que l’établissement « a un budget annuel de 85 millions d’euros et reçoit des subventions issues de deux missions : de la mission “Travail et emploi” (programme 102 : “Accès et retour à l’emploi” : 50 millions d’euros soit 59 % du budget annuel) et de la mission “Ville et logement” (programme 147 “Politique de la ville” : 26 millions d’euros soit 31 % du budget annuel). »
Disposant d’un siège à Paris et d’une vingtaine de centres répartis en France, l’Épide gérait en 2008 environ 1 900 volontaires d’insertion. Ces effectifs sont certes assez éloignés des ambitions initiales fixées en 2005 (65), lors de la création de l’établissement, à l’accueil de 40 000 jeunes à l’horizon 2007. Mais cet objectif était sans doute hors d’atteinte ab initio, de surcroît dans une période de lancement du dispositif.
La période actuelle (66) est mise à profit pour rationaliser le fonctionnement et la gestion de l’établissement public, s’agissant notamment de la mise en place d’une procédure budgétaire et de grilles salariales, de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, de l’élaboration d’une politique des achats et d’une adaptation des ressources humaines aux besoins réels de l’établissement public. Il s’agit aussi, in fine, d’améliorer le service rendu aux volontaires d’insertion qui, pour près de la moitié d’entre eux, connaissent des difficultés à mener à son terme le parcours d’insertion qui leur est proposé dans le cadre de l’Épide.
b) L’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Épareca)
L’article L. 325-1 du code de l’urbanisme précise que l’Épareca, établissement public à caractère industriel et commercial, « a pour objet de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles […] et les territoires faisant l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale ou retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ». Le même article dispose que l’Épareca, à cet effet, « assure […] la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones », avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
En pratique, l’Épareca procède, sur demande locale, à l’acquisition, le cas échéant par l’usage de prérogatives de puissance publique (déclaration d’utilité publique, expropriation), d’ensembles commerciaux dégradés et souvent non profitables. L’établissement réalise ensuite classiquement la restructuration de ces ensembles puis assure leur gestion économique jusqu’au retour au droit commun par la revente des locaux commerciaux. L’Épareca a donc vocation, à terme, à assurer son autofinancement par les gains réalisés à l’occasion de ces reventes.
Si l’Épareca a été créé par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, on peut considérer qu’il est né une seconde fois suite au comité interministériel des villes du 9 mars 2006 qui a amorcé une phase nouvelle de fonctionnement : alors que l’activité de mise en production de centres commerciaux a été faible de 1998 à 2003 et quasi nulle en 2004 et 2005, l’établissement a de nouveau commencé à fonctionner dans le cadre de son contrat d’objectifs et de moyens 2005-2008. Six opérations par an ont ainsi été effectivement lancées de 2006 à 2008. Le nouveau contrat d’objectifs et de moyens 2009-2011 prévoit le lancement de 10 opérations en moyenne par an sur cette période, selon un rythme croissant. Ce contrat d’objectifs et de moyens précise qu’« à compter de 2015, jusqu’en 2020 environ, Épareca devrait, sauf missions ou périmètres nouveaux […] se retrouver en période de déstockage par montée en puissance des reventes, avec retours financiers progressifs à l’État, pour une fin de cycle complet vers 2020 ».
S’agissant de ses modalités de financement actuelles, alors que l’Épareca est tourné en très grande partie vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il ne bénéficie d’aucune subvention de la part du programme 147 « Politique de la ville ». Seul le programme 134 « Développement des entreprises et de l’emploi », par l’intermédiaire du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), finance l’Épareca au titre du budget de l’État. À hauteur de 10,5 millions d’euros en 2009, ce montant devrait être reconduit au titre des exercices 2010 et 2011 (67). En 2009, le budget global de l’établissement s’est élevé à 42 millions d’euros.
Le « modèle économique » de l’Épareca est original et sans doute adapté à certains problèmes commerciaux propres aux quartiers prioritaires de la politique de la ville : sans perdre de vue la nécessité à terme d’une pratique commerciale privée et rentable en matière de commerces de détail, il convient sans doute en effet de passer, dans un certain nombre de cas, par l’action d’un opérateur susceptible de travailler dans un premier temps à perte sur l’aménagement et la restructuration d’un ensemble commercial, en s’appuyant le cas échéant sur des prérogatives de puissance publique.
La question de la présence de commerces suffisamment nombreux et diversifiés n’est, en tout état de cause, pas secondaire pour la qualité de vie, l’équilibre et l’image des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces considérations sont d’ailleurs valables pour la présence de locaux commerciaux dans ces quartiers. Sur ce point, il conviendrait que l’Épareca use peut-être plus souvent de sa compétence en matière d’aménagement et de restructuration des espaces artisanaux ; le projet de réalisation de locaux d’activité artisanale par l’Épareca, sur le site de Bruay-sur-l’Escaut, dans l’agglomération de Valenciennes, constitue sans doute une première intéressante en la matière.
c) La Caisse des dépôts et consignations (CDC)
L’article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précise le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans la mise en œuvre du Plan national de rénovation urbaine :
« La Caisse des dépôts et consignations participe au financement du programme national de rénovation urbaine par l’octroi de prêts sur les fonds d’épargne dont elle assure la gestion en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier et par la mobilisation de ses ressources propres.
« Ces ressources financent des avances aux investisseurs, des prises de participation dans les opérations de rénovation urbaine et des aides à l’ingénierie.
« Une convention conclue entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations assure la cohérence de ces interventions avec les orientations du programme national de rénovation urbaine et détermine le montant annuel des subventions à verser à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
Dans la partie supra relative à l’Anru, a été indiqué avec quels instruments et pour quels montants la Caisse des dépôts et consignations était le premier prêteur des bailleurs de logements locatifs sociaux et des collectivités territoriales dans le cadre de leurs contributions au financement du PNRU. S’agissant de ses ressources propres, la convention signée entre la CDC et l’État le 30 décembre 2008 au titre des années 2008 à 2013 précise que la Caisse s’engage à mobiliser 600 millions d’euros en faveur notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce montant a vocation a être réparti selon deux enveloppes distinctes.
En premier lieu, comme le précise la loi, la CDC contribue au financement du PNRU pour 150 millions d’euros sur la période 2008 à 2013. Aux termes d’une convention signée avec l’Anru le 8 juin 2009, la CDC s’engage à verser sur cette période (68) :
– 126 millions d’euros pour des actions d’ingénierie dans le cadre du PNRU. Une partie importante de ces crédits a d’ores et déjà été consommée et il n’est pas exclu que l’Anru et la CDC prévoient en la matière certains financements complémentaires avant 2013, notamment afin de permettre aux équipes de conduite de projet en activité sur les chantiers les plus complexes et les plus longs de poursuivre et développer leurs activités ;
– 24 millions d’euros au titre des dépenses de fonctionnement de l’Anru.
En deuxième lieu, la CDC s’est engagée sur la période courant de 2008 à 2013 à consacrer 450 millions d’euros sur ses fonds propres à une série de programmes en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
– s’agissant du développement économique, les crédits de la CDC ont pour objet le développement du commerce, de locaux commerciaux et d’affaires et d’entreprises ; en la matière, la CDC est parfois un partenaire de l’Épareca. L’enveloppe pour cette catégorie d’opérations a été fixée à 100 millions d’euros ;
– la CDC soutient par ailleurs certains investissements fonciers et immobiliers dans ces quartiers, par exemple par la création d’une offre de logements locatifs familiaux à loyers modérés. Un montant de 200 millions d’euros sur la période 2008 à 2013 a été prévu initialement et 130 millions d’euros auraient déjà été consommés sur ce poste ;
– d’autres crédits doivent contribuer au montage de partenariats public-privé dans ces quartiers, pour des opérations concernant, par exemple, les transports et les équipements publics. Les 70 millions d’euros prévus pour cette catégorie d’opération n’ont pas été consommés à ce jour ;
– la CDC propose un certain nombre de services aux collectivités territoriales afin de les aider dans l’élaboration d’un projet de territoire intégrant ces catégories de quartiers, dans une perspective de développement économique et d’attractivité des territoires. Des services d’accompagnement pour la création d’entreprises (y compris dans la phase de maturation des projets) sont par ailleurs proposés et mis en place par la CDC, parfois en partenariat avec certaines collectivités territoriales. Ces opérations devraient, sur la période 2008 à 2013, bénéficier de 40 millions d’euros de crédits ;
– enfin, dans le cadre d’une politique d’accès de tous à la technologie numérique, la CDC participe, pour une enveloppe de 40 millions d’euros sur six ans, au financement d’espaces cyber-base, c’est-à-dire des espaces numériques ouverts à tous. Au 30 juin 2009, 291 des 852 espaces cyber-base opérationnels étaient situés dans des quartiers Cucs ou Anru.
Au total, la CDC avait prévu, en 2009, un montant d’intervention pour ces actions sur fonds propres d’environ 80 millions d’euros. Du fait d’un changement de règles comptables concernant la prise en compte des crédits d’ingénierie concernant le PNRU, ce montant s’est élevé en 2009 à 136 millions d’euros.
B.– ÉVOLUTIONS PASSÉES ET À VENIR DES CRÉDITS NATIONAUX DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE
La présente partie a pour objet d’examiner les évolutions des principaux compartiments des crédits nationaux dédiés à la politique de la ville, en considérant en premier lieu la période 2005 à 2009, ainsi que leur place et leur poids dans les deux « évènements » budgétaires récents que sont le Plan de relance et l’emprunt national pour les investissements d’avenir. En deuxième lieu, sont envisagées les perspectives pour 2010 et les années postérieures.
1.– Éléments sur les évolutions récentes
a) Les crédits affectés à la politique de la ville ont très inégalement mais considérablement augmenté durant la période 2005-2009
Selon la direction du budget, les crédits du programme 147 ont connu depuis 2005 une évolution en exécution assez nettement positive. En 2005, avant la création de l’Acsé, les crédits consommés au titre de ce programme se sont élevés à 351,1 millions d’euros, ce montant s’étant élevé à 490,8 millions d’euros en 2009 en exécution (69).
Cette augmentation substantielle des crédits d’intervention au titre de la politique de la ville sur ces dernières années est bien réelle ; en effet, la seule modification notable de périmètre du programme 147 ayant eu lieu entre 2005 et 2009 est le transfert, en provenance de l’ancien programme 202 « Rénovation urbaine », des paiements relativement limités relatifs à certains engagements en matière de rénovation urbaine datant d’avant le lancement du PNRU et prévus notamment par les contrats de ville portant sur la période 2000-2006. Les crédits de paiement correspondants se sont élevés en 2009 en exécution à 14,28 millions d’euros et ont été budgétés à hauteur de 5,5 millions d’euros au titre de 2010. Ce dernier montant est faible au regard des besoins en la matière, évalués au 31 décembre 2009 à 40,2 millions d’euros ; mais l’usage de certains crédits reportés (23 millions d’euros) devrait permettre d’« aboutir à l’extinction de cette dette fin 2012 » (70).
S’agissant de l’historique des crédits du programme 147, il convient de préciser qu’en 2005, c’est-à-dire l’année des émeutes urbaines ayant eu lieu sur l’ensemble du territoire national du 27 octobre au 17 novembre 2005, leur montant a atteint un point bas, faisant suite à plusieurs années consécutives de baisse des crédits d’intervention de la politique de la ville ; ainsi, en 2001, les crédits consommés au titre du programme 147 se sont élevés à 474,6 millions d’euros, hors dépenses « sociales » liées aux dispositifs applicables en ZFU et en ZRU, soit un montant analogue, voire supérieur en euros de l’époque, au montant consommé en 2009. La période d’augmentation des crédits 2005-2009 a donc en réalité suivi d’une période de baisse marquée des mêmes crédits entre 2001 et 2005.
En ce qui concerne les crédits consommés par l’Anru, la période 2005-2009 constitue la phase d’amorçage du PNRU, le rythme actuel de paiement des travaux n’ayant été atteint que dans le courant de l’année 2009 à hauteur d’environ 100 millions d’euros par mois. Passant de 99 millions d’euros en 2005 à 995 millions d’euros en 2009, les crédits annuels consommés par l’Anru ont donc été multipliés par 10 durant cette période.
S’agissant des dépenses fiscales et « sociales », leur coût pour les finances publiques a crû assez considérablement entre 2005 et 2009, passant de 465 millions d’euros à 693 millions d’euros. Cette évolution doit s’apprécier compte tenu des éléments suivants :
– le montant du remboursement des dépenses « sociales » imputé sur le programme 147 au titre des exonérations de charges sociales applicables dans les ZFU et dans les ZRU n’a que peu augmenté sur la période, passant de 290 millions d’euros à 297,6 millions d’euros. Cette relative stabilité masque cependant une évolution à la hausse très sensible en 2008 (358,5 millions d’euros de crédits consommés par remboursement), à laquelle a répondu, d’une certaine façon, la réforme évoquée supra du dispositif propre aux ZFU (article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009), dont les effets en termes d’économies budgétaires ont pu être constatés dès l’exercice budgétaire 2009 ;
– s’agissant des dépenses fiscales proprement dites, leur montant a considérablement augmenté entre 2005 et 2009, passant sur cette période de 175 millions d’euros à 393 millions d’euros. L’évolution constatée entre 2005 et 2009 a en grande partie pour origine la création de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements sociaux situés dans les ZUS et la montée en puissance de la mesure d’exonération des bénéfices à l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés dans les ZFU.
S’agissant des dotations de péréquation aux collectivités territoriales, leur montant passe de 929,8 millions d’euros en 2005 à 1 399 millions d’euros en 2009. Cette augmentation est due en quasi-totalité à l’augmentation régulière de la DSU-CS pour chacune de ces années, à hauteur de 120 millions d’euros pour les exercices 2006 et 2007, de 100 millions d’euros pour l’exercice 2008 et de 70 millions d’euros en 2009 ; ainsi qu’à la création de la DDU pour un montant de 50 millions d’euros en 2009.
Au total, si l’on considère ces quatre « postes » principaux de ressources nationales dédiées à la politique de la ville, on observe globalement une forte progression des crédits que l’État a affectés directement à la politique de la ville entre 2005 et 2009, de l’ordre de 92,6%. Le tableau suivant retrace cette évolution globale, l’évolution propre à chaque « poste », ainsi que la part revenant à chaque « poste » dans cette évolution globale.
![]()
ÉVOLUTION DES CRÉDITS CONSOMMÉS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
ENTRE 2005 ET 2009
2005 |
2009 |
|||||
en millions d’euros |
en % |
en millions d’euros |
en % |
Évolution 2005/2009 |
Part en % dans l’évolution globale | |
Programme 147 « politique de la ville » |
351,1 |
19,0 |
490,8 |
13,7 |
+ 39,8 |
8,1 |
Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) |
99,0 |
5,4 |
995,6 |
27,8 |
+ 905,6 |
51,7 |
Dépenses fiscales et sociales |
465,0 |
25,2 |
693,0 |
19,4 |
+ 49,0 |
13,2 |
Dotation de péréquation (DSU-CS, DDU et FSRIF) |
929,8 |
50,4 |
1 399,0 |
39,1 |
+ 50,5 |
27,1 |
TOTAL |
1 844,9 |
100,0 |
3 578,4 |
100,0 |
+ 94,0 |
100,0 |
Source : Direction du budget.
On observe ainsi, sur cette période, les effets financiers de la loi du 1er août 2003 qui a prévu le PNRU et de la loi du 18 janvier 2005 constituant le volet législatif du Plan de cohésion sociale, dont deux des mesures concernaient respectivement le relèvement pluriannuel de la DSU-CS et le contenu et la programmation financière du programme de réussite éducative.
Il apparaît clairement que la politique de la ville, sur les cinq exercices budgétaires 2005 à 2009, a fait l’objet d’un effort national très substantiel. Cet effort a profondément modifié le poids de chacune des grandes composantes budgétaires de la politique de la ville, notamment au profit de la rénovation urbaine et, dans une mesure moindre mais néanmoins substantielle, au profit des dotations de péréquation en faveur des communes les plus touchées par les difficultés urbaines économiques et sociales.
b) La politique de la ville à l’aune du Plan de relance et de l’emprunt national pour les investissement d’avenir
En loi de finances initiale pour 2010, les crédits de paiement ouverts sur le programme 147 (704,848 millions d’euros) représentaient un peu moins de 0,19 % des crédits de paiement ouverts sur l’ensemble du budget général de l’État (soit 379,420 milliards d’euros). Ce ratio doit être apprécié en soulignant que les crédits du programme 147 constituent, comme il est décrit supra, une partie très minoritaire des crédits nationaux dédiés à la politique de la ville, qui comprennent par ailleurs des dépenses fiscales et « sociales », les crédits consommés par l’Anru, ainsi que les montants attribués aux communes au titre de la DSU-CS, de la DDU et du FSRIF (soit, au total, 3 758,4 millions d’euros en 2009). La présente partie a pour objet d’appréhender ces éléments au regard de la place, modeste, de la politique de la ville dans le cadre des deux dispositifs budgétaires que constituent le Plan de relance et le Grand emprunt.
Ÿ Politique de la ville et Plan de relance
Selon la direction du budget, les trois programmes de la mission « Plan de relance de l’économie » consacrent une part de leurs crédits à la politique de la ville.
Le programme 315 « Programme exceptionnel d’investissement public » a ainsi prévu le renforcement des moyens du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). En conséquence, une subvention de 4 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 2 millions d’euros en crédits de paiement pour 2009 a été attribuée à l’Acsé. La convention passée à ce titre entre l’État et l’Acsé vise à renforcer les actions mises en œuvre en matière de développement de la vidéo-protection, en particulier l’aide à l’installation, l’extension et le raccordement des réseaux existants. En exécution, selon la direction du budget, 2 millions d’euros avaient été délégués en région à la fin septembre 2009. À la date du 31 décembre 2009, 14 départements avaient proposé au total 45 projets pour lesquels 1,6 million d’euros avait été engagé et 1,3 million d’euros avait été mandaté. L’Acsé confirme un niveau d’engagement, à la fin de 2009, de 1,526 million d’euros pour cette action.
En 2010, 2 millions d’euros de crédits de paiement sont ouverts en faveur de l’Acsé au titre de la même action.
Vos rapporteurs considèrent cependant qu’il n’est pas complètement justifié de rattacher celle-ci à la politique de la ville. En effet, le champ d’intervention géographique du FIPD ne s’appuie sur aucun zonage. Par ailleurs, le renforcement de la vidéo-protection ne constitue pas une action dédiée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Dans le cadre du programme 316 « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi », certains crédits ont été confiés à l’Acsé pour la mise en œuvre d’actions visant à renforcer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes des quartiers prioritaires, à hauteur de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement pour la période 2009-2010 et de 8 millions d’euros en crédits de paiement en 2009. Selon la direction du budget, « le second versement [de 12 millions d’euros] au titre de 2010 interviendra au regard de l’exécution constatée ». Selon l’Acsé, au 31 décembre 2009, 6,897 millions d’euros, au titre de 648 projets sélectionnés par les préfectures, avait été engagés au titre de la subvention 2009 de 8 millions d’euros. À la même date, 5,8 millions d’euros avaient fait l’objet d’un mandatement au titre de ces engagements.
En outre, toujours sur le même programme 316, le DPT « Ville » rattache à la politique de la ville certaines dépenses liées au renforcement et à la création de certains contrats aidés dans le cadre du Plan de relance, soit, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, des montants de 113,5 millions d’euros en 2009 et de 325,3 millions d’euros en 2010 (71). Ces crédits ont été calculés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les contrats aidés hors Plan de relance dans le cadre du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Ainsi, 13,6 % des crédits du programme 316 relatifs aux contrats aidés sont rattachés à la politique de la ville, ce taux correspondant à la proportion des entrants en contrats aidés en 2008 qui résidaient en ZUS. Les dispositifs concernés sont les suivants :
– la majoration de l’aide de l’État portant sur les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) à 90 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée pour les CAE signés en 2009 à compter du 1er avril 2009 ;
– la majoration de l’aide de l’État portant sur les contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI–CAE) à 90 % en moyenne du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée en 2010. Le CUI-CAE est la déclinaison pour le secteur non marchand du contrat unique d’insertion applicable à compter du 1er janvier 2010 ;
– la mise en place de 30 000 CAE « passerelles », ce dispositif constituant une version du CAE spécifique aux jeunes de 16 à 25 ans. Parmi les trois critères non-cumulatifs susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du CAE « passerelle », figure la résidence en ZUS ;
– la mise en place de 50 000 contrats initiative emploi (CIE) supplémentaires dans les secteurs considérés comme « en tension ». Le CIE est un contrat aidé offert dans le secteur marchand ;
– la mise en place du contrat d’accompagnement formation. Ce contrat est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, qu’ils soient sortis récemment d’une formation initiale de l’enseignement secondaire ou supérieur (jusqu’au niveau 2), qu’ils soient en rupture de contrat d’alternance, qu’ils n’aient pas atteint un niveau de formation suffisant pour s’insérer durablement dans l’emploi ou accéder aux contrats en alternance ou qu’ils soient diplômés dans un domaine ne correspondant pas ou plus aux secteurs porteurs du marché du travail.
Le programme 317 « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité » a prévu l’ouverture sur la période 2009-2010 de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement au bénéfice de l’Anru, afin, selon la direction du budget, « de débloquer des opérations prêtes à démarrer restées en suspend en raison de leurs coûts plus élevés. Des opérations nouvelles confortant le programme ou l’améliorant ont également été prises en compte par le comité d’engagement de l’Anru », au titre de cette enveloppe. L’enveloppe des crédits de paiement est, selon le DPT « Ville » annexé au PLF pour 2010, ainsi répartie : 200 millions d’euros en 2009 et 150 millions d’euros en 2010.
Selon la direction du budget, 133 millions d’euros ont été effectivement consommés en 2009 par l’Anru au titre de cette enveloppe. 236 communes bénéficient ou bénéficieront d’opérations de rénovation urbaine mises en œuvre dans ce cadre, pour un montant total de travaux de 4 milliards d’euros.
Enfin, selon la direction du budget, « le DPT ne mentionne pas l’action 3 “Lutte contre l’habitat indigne et rénovation thermique du parc privé” du programme 317 “Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité” sur laquelle 200 millions d’euros ont été ouverts (en autorisations d’engagement) et 133,3 millions d’euros (en crédits de paiement) en 2009. Ces crédits ont été confiés à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour lutter contre la précarité énergétique et résorber l’habitat indigne. En 2009, 79 886 logements ont été améliorés au bénéfice de propriétaires bailleurs et occupants, et de copropriétés pour un montant total de 177,53 millions d’euros. Ces crédits bénéficieront pour une grande partie aux habitants résidant dans les quartiers prioritaires. »
La direction du budget semble hésiter à réellement associer ces crédits du Plan de relance à la politique de la ville. Au demeurant, vos rapporteurs considèrent que pour réellement évaluer ces crédits, il convient de retrancher également :
– les crédits dont bénéficie l’Acsé pour la vidéoprotection, car ils sont en fait sans rapport direct avec la politique de la ville du fait notamment de l’absence de territorialisation de l’action du FIPD ;
– les crédits relatifs aux emplois aidés propres au Plan de relance. Ils ne sont en effet pas directement rattachables aux crédits nationaux dédiés à la politique de la ville (72).
Au total, nous considérons que seuls les crédits suivants du Plan de relance peuvent être directement rattachés aux crédits nationaux dédiés à la politique de la ville :
– les crédits dont bénéficie l’Acsé pour l’emploi, soit 20 millions d’euros pour la période 2009-2010 (dont 8 millions d’euros en 2009 et 12 millions d’euros en 2010) ;
– les crédits dont bénéficie l’Anru, soit 350 millions d’euros pour la période 2009-2010 (dont 200 millions d’euros en 2009 et 150 millions d’euros en 2010).
Les deux tableaux suivants synthétisent ces éléments en appréciant pour le premier la part de la politique de la ville dans le Plan de relance (en crédits de paiement ouverts pour 2009) et en mesurant pour le second la part du Plan de relance dans la politique de la ville (en crédits effectivement consommés en 2009). Dans un cas comme dans l’autre, la proportion est de l’ordre de 4 %.
POLITIQUE DE LA VILLE ET PLAN DE RELANCE :
ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE POUR 2009
Crédits de la mission « Plan de relance » | |||
Total |
Part rattachable à la politique de la ville | ||
Autorisations d’engagement |
8 975,5 |
370 |
4,12 % |
Crédits de paiement |
8 041,8 |
208 |
2,58 % |
Crédits consommés au titre de la politique de la ville (total P 147, Anru, dépenses fiscales et « sociales », dotations de péréquation) |
3 758,4 |
Dont crédits consommés au titre du Plan de relance |
140,653 |
3,74 % |
Source : Direction du budget.
On constate ainsi que le Plan de relance a concerné et concerne très modestement la politique de la ville, son apport se limitant, en très grande partie, à la rénovation urbaine. Ce choix est justifié dans la mesure où le Plan de relance avait vocation, dans une perspective macro-économique, à soutenir des activités économiques assez « traditionnelles », comme le bâtiment, qui étaient les plus susceptibles d’être touchées par la crise économique.
Ÿ Politique de la ville et emprunt national pour les dépenses d’avenir
La loi de finances rectificative pour 2010, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a ouvert 34,584 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre de l’emprunt national pour les dépenses d’avenir, composé, selon les termes de la direction du budget d’« investissements structurels ciblés sur des projets rentables dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation des petites et moyennes entreprises, du développement durable et de l’économie numérique ».
Deux programmes prévoient des actions qui peuvent être retenues comme directement rattachables à la politique de la ville :
Il s’agit, en premier lieu, du programme 324 « Internats d’excellence et égalité des chances », intégré dans la mission « Enseignement scolaire », à hauteur de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Deux actions, qui seront gérées par l’Anru dans le cadre d’une enveloppe non fongible avec ses autres ressources, sont concernées :
– 200 millions d’euros sont destinés à subventionner la création d’une dizaine de nouveaux internats d’excellence, des extensions au sein d’internats existants afin d’ouvrir des places supplémentaires, et des travaux de réhabilitation, rénovation, mise aux normes et premier équipement dans des internats existants afin d’en faire des places d’internat d’excellence. Des développements infra relatifs à l’action de l’éducation nationale précisent le sens et la portée de ce dispositif, qui n’est pas spécifiquement dédié aux élèves de quartiers prioritaires de la politique de la ville, même si, selon la direction du budget, « les internes devraient pour la plupart en être issus ». Dans la convention d’objectifs et de performances de l’Anru (73), il est précisé que « ce programme vise la création de 20 000 places en internats d’excellence d’ici 2020. Il a pour ambition d’offrir une voie nouvelle d’ascension sociale à une proportion significative d’élèves de milieu économiquement défavorisés (dont certains issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville) » ;
– 300 millions d’euros doivent financer diverses actions ministérielles ou interministérielles favorisant la mixité sociale, l’égalité des chances et le développement de l’accès à la culture scientifique, en particulier pour les jeunes de condition sociale modeste. La discussion parlementaire sur le projet de loi de finances rectificative relatif au grand emprunt avait porté un éclairage assez cru sur le flou concernant l’objet de ces crédits (74). Dans la convention d’objectifs et de performances de l’Anru, il est ainsi fait mention une seule fois de cette action : « La mise en œuvre des projets qui seront financés sur l’action […] “ développement de la culture scientifique et égalité des chances, notamment dans les quartiers de la politique de la ville ” donnera lieu, en tant que de besoin, à des conventions particulières entre l’État, l’Anru et les partenaires de ces projets. »
En deuxième lieu, au titre du programme « Croissance des petites et moyennes entreprises » de la mission « Économie », 100 millions d’euros ont été ouverts (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement) sur une action portant sur le financement de l’économie sociale et solidaire. Ils sont destinés à subventionner les organismes de l’économie sociale (coopératives, mutuelles et associations) présentant des spécificités juridiques et fiscales qui rendent plus difficile leur accès à des fonds propres suffisants. Il est donc prévu de mettre en place un fonds destiné à financer ces entreprises, abondé par l’État à hauteur de 100 millions d’euros et qui pourrait également être abondé par d’autres acteurs (collectivités territoriales et investisseurs privés notamment). Il sera géré par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. À l’instar du programme relatif aux internats d’excellence, la direction du budget considère que ce fonds bénéficiera « directement et en priorité aux habitants des quartiers éligibles à la politique de la ville »
Ces deux mesures, d’un montant total de 600 millions d’euros, représentent 1,7 % du montant total des crédits de l’emprunt national pour les investissements d’avenir.
2.– Éléments sur certaines évolutions à venir
a) Les crédits budgétaires spécifiques
S’agissant du programme 147, l’année 2010 constitue une année d’inflexion puisque les crédits disponibles s’établissent à 451,5 millions d’euros en loi de finances initiale hors remboursements des dépenses « sociales » applicables dans les ZFU, alors que 490,8 millions d’euros ont été consommés sur ce programme en 2009. Cette évolution à la baisse est, selon la direction du budget, à nuancer en considérant les points suivants :
– l’année 2010 est celle du transfert des agents des directions régionales de l’Acsé aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Ce mouvement induit une économie de 10 millions d’euros entre 2009 et 2010, du fait de cette décision prise dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Il s’agit donc bien d’une réduction des moyens de l’Acsé, dont vos rapporteurs ne discutent pas ici l’opportunité, mais qui « coûte » à l’Acsé sans doute bien plus que sa traduction budgétaire, tant l’agence, s’appuyant désormais pour le travail d’instruction des demandes de subvention sur des agents des préfectures, doit les sensibiliser à un métier nouveau dont l’esprit et la pratique sont parfois différents de l’activité habituelle de ces agents ;
– le rôle de l’Acsé en 2010 dans la gestion du service civil volontaire (devenu le service civique) s’estompe encore un peu plus ; ceci induit un transfert pour le programme 147 d’environ 10 millions d’euros au bénéfice des crédits gérés par le ministère de la jeunesse et des solidarités actives. La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique a créé l’Agence du service civique, groupement d’intérêt public (GIP), dont l’Acsé est légalement l’un des membres constitutifs (75). En conséquence, la même loi a prévu, en modifiant l’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles, que l’agence concourait désormais à la mise en œuvre du service civique dans le cadre de ce GIP, alors qu’elle était antérieurement directement chargée d’attribuer les agréments pour les organismes souhaitant accueillir des jeunes dans le cadre de l’ancien service civil volontaire ;
– les « dettes » restant à payer au titre du Fonds interministériel des villes géré en son temps par la DIV (avant la création de l’Acsé) nécessitent moins de crédits chaque année. En 2010, l’économie correspondante est évaluée par la direction du budget à 20 millions d’euros.
Ces précisions étant apportées, et compte tenu des 12 millions d’euros de crédits dont l’Acsé bénéficie au titre du Plan de relance en 2010, la direction du budget considère que la baisse des moyens par rapport à 2009 pour les dépenses d’intervention de la politique de la ville financées sur le programme 147 s’élève à 14 millions d’euros.
Si cette baisse des moyens est effectivement plus modérée que ce qu’une analyse des chiffres globaux pourrait conduire à penser, il n’en demeure pas moins que cette évolution est une première sur la période postérieure à 2005. Dans le cadre des règles d’évolution des dépenses de l’État que le Gouvernement applique et que les gouvernements qui lui succéderont ne manqueront sans doute pas de mettre en œuvre, il est hautement probable que le programme 147 ne voit pas, dans le meilleur des cas, ses moyens augmenter substantiellement à moyen terme.
Au demeurant, sans faire de procès d’intention à quiconque, vos rapporteurs notent qu’en évoquant le suivi budgétaire des crédits gérés par l’Acsé (qu’il est effectivement bien difficile de réaliser), la direction du budget précise que « parmi les subventions octroyées, l’Acsé n’est à ce stade pas en mesure de définir la part des crédits destinés au financement de la masse salariale, et donc le degré de rigidité des financements apportés aux associations ». Il est difficile de ne pas voir dans cette remarque, au-delà du souhait légitime de la direction du budget d’obtenir de la part des opérateurs de l’État l’information la plus complète possible, une réflexion sur l’existence de certaines marges de manœuvre budgétaires « à la baisse » dans le programme 147, là ou le « degré de rigidité » serait moins marqué qu’ailleurs.
Lors de leurs visites sur le terrain, il a été fait état auprès de vos rapporteurs de projets à l’étude sur les modalités futures de financement des programmes de réussite éducative, dont une part reviendrait en tout état de cause, à l’avenir, aux collectivités territoriales, alors que, dans certains cas, l’Acsé finance aujourd’hui la totalité du dispositif. Sans prétendre que ces informations préjugent d’orientations futures réelles, il est difficile d’imaginer qu’elles ne révèlent pas, à tout le moins, la volonté de l’État de ne pas augmenter à court et moyen termes les crédits nationaux d’intervention de la politique de la ville.
L’année 2010 devrait marquer une nouvelle progression des crédits de paiement consommés au titre du PNRU. Selon la direction générale de l’agence, les besoins de financement de l’Anru s’établissent désormais à environ 100 millions d’euros par mois ; soit, pour l’année 2010, un montant de crédits consommés qui devrait s’élever à un peu plus de 1 200 millions d’euros, ce qui est en ligne avec l’hypothèse basse envisagée lors de la discussion du projet de loi de finance pour 2010 (76). Compte tenu du fait que le PNRU est aujourd’hui quasiment entièrement programmé, il est probable que ce niveau de besoin de financement annuel soit dépassé dans les années à venir, sans doute au moins jusqu’en 2014.
La question de la satisfaction des besoins de financement à venir de l’Anru est lancinante, notamment depuis que l’État n’a plus accordé de crédits de paiement à l’Anru au titre du financement du PNRU et qu’il a, par ailleurs, planifié la contribution d’Action Logement, pour les trois exercices 2009 à 2011, à 770 millions d’euros (cf. supra). Dans ces conditions, si on les imaginait être prorogées pour une période ultérieure, la direction du budget, s’appuyant sur « l’hypothèse de ressources tendancielles constituées notamment de 770 millions d’euros apportés par Action Logement », considère que « sans financement complémentaire, la trésorerie de l’agence est réduite à 0 euro courant septembre 2012 ». Le scénario envisagé par la direction générale de l’Anru est un peu plus sombre, puisque selon elle, dans les conditions actuelles, l’année 2011 sera difficile à terminer du point de vue financier.
En faisant l’hypothèse que l’Anru puisse satisfaire ses engagements jusqu’à la fin de l’année 2011, il est probable qu’à cette date demeureront à financer jusqu’à la fin du PNRU un peu plus de 7 milliards d’euros. Pour les dirigeants d’Action Logement, il n’est pas envisageable de financer une telle somme uniquement par une ou des contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction. Au demeurant, les mêmes dirigeants considèrent que les emplois fixés par décret pour la période 2009-2011 s’agissant de cette participation laisseront Action Logement, dès le terme de cette période, dans une situation de trésorerie très dégradée. En conséquence, le maintien de la contribution d’Action Logement au PNRU à 770 millions d’euros après 2011 :
– conduirait à des besoins importants de financement pour Action Logement dès la fin de l’année 2011, si le reste de ses obligations contributives demeuraient inchangées à compter de 2012 (77) ;
– ne permettrait pas le financement du PNRU à hauteur des besoins de financement de l’Anru à compter de 2012.
Dans ces conditions, il est difficile de ne pas envisager le scénario d’un retour du budget de l’État dans le financement du PNRU dans les années à venir. Est-il d’ailleurs souhaitable de tenter d’achever un tel projet public sans que l’État n’en finance plus jusqu’à son terme le moindre euro ? Le Plan de relance, qui permet à l’Anru de bénéficier de 350 millions d’euros en 2009 et 2010, a montré à quel point l’intervention de l’État en la matière pouvait être décisive.
Il est évident que l’État ferait œuvre utile en poursuivant sur ce chemin, en contribuant à une politique d’amélioration des conditions de logement concernant des millions de personnes, en soutenant l’activité l’économique et, ce n’est pas un détail, en renforçant la confiance dans la parole de l’État. En effet, une solution ne saurait bien entendu consister à retarder, d’une façon ou d’une autre, les paiements dus aux entreprises au titre des engagements publics qui constituent le PNRU ; alors que, de surcroît, l’Anru a opportunément travaillé ces dernières années pour limiter raisonnablement ses délais de paiement.
Nous voulons croire que les éléments suivants, tirés de la convention d’objectifs et de performance entre l’État et l’Anru pour la période 2010-2012, augurent pour l’avenir d’un financement du PNRU par l’État autant que nécessaire et sans retard provoqué :
« Après 2010, la trésorerie accumulée par l’Anru au cours de ses premières années de fonctionnement aura été entièrement consommée.
« La mise en perspective à plus long terme des hypothèses d’engagement et de paiement des conventions signées conduit à évaluer les besoins de financement sur les 3 exercices qui suivent (2012-2014), à un niveau compris entre 1,3 et 1,6 milliards d’euros par an selon les hypothèses qui seront précisées au moment de l’exécution du programme.
« Il est entendu que l’État s’engage à faire en sorte que les engagements pris dans les conventions pluriannuelles soient honorées. »
c) Les dépenses fiscales et les exonérations de charges sociales
La baisse de leur montant prévue pour 2010 (651 millions d’euros, au regard des 693 millions d’euros consommés en 2009) a pour principale origine la réforme des exonérations de charges sociales applicables dans les ZFU. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années ultérieures, puisque 2011 devrait être, à législation inchangée, la dernière année au cours de laquelle des activités créées dans les ZFU pourront bénéficier pendant cinq ans des exonérations totales de cotisations sociales et de fiscalité (imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises). À partir du 1er janvier 2012, aucune nouvelle activité professionnelle ne sera éligible aux dispositifs propres aux ZFU ; et toutes celles qui à cette date bénéficieront encore de ces dispositifs auront vocation à en sortir en application, notamment, des nombreux dispositifs de sortie « en sifflet » décrits supra.
Il est donc temps de s’interroger sur la pertinence de ces dispositifs et le présent rapport contient quelques éléments infra sur ce sujet.
d) Les dispositifs de péréquation
L’année 2010 est marquée par les évolutions suivantes :
– comme en 2009, la DSU-CS a été relevée de 70 millions d’euros au bénéfice des 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et aux 20 premières communes comprenant entre 5 000 et 9 999 habitants, classées selon l’indice synthétique propre à cette dotation. La DSU-CS répartie en 2010 s’élève ainsi à 1233,7 millions d’euros ;
– la DDU est reconduite en 2010, pour un montant de 50 millions d’euros ;
– malgré la suppression de la taxe professionnelle, le FSRIF est maintenu dans ses modalités de fonctionnement en 2010, pour un montant équivalent à celui constaté pour 2009.
Les orientations retenues par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2011 sont les suivantes :
– l’article 81 du PLF pour 2011 prévoit un relèvement de la DSU-CS en 2011 de 77 millions d’euros, au bénéfice des 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et aux 20 premières communes comprenant entre 5 000 et 9 999 habitants, classées selon l’indice synthétique propre à cette dotation ;
– le même article propose la reconduction de la DDU en 2011 pour un montant de 50 millions d’euros ;
– l’article 86 du PLF pour 2011 propose la prorogation en 2011 du FSRIF, en précisant le mode de calcul en 2011 du potentiel fiscal des communes dans le contexte de la suppression de la taxe professionnelle.
Au-delà de 2011, le dynamisme propre à l’évolution de la DSU-CS ces dernières années pourrait être remis en cause. La « contrainte budgétaire » des prochaines années pourrait peser, le moment venu, sur cet outil de péréquation. Ainsi, selon les éléments de conclusion de la synthèse d’un récent rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration (78) :
– « la situation difficile du budget de l’État limite les perspectives d’évolution de la péréquation par la voie budgétaire. La péréquation entre collectivités sera donc la source principale de progrès de la réduction des inégalités entre celles-ci. […] ;
– « pour le secteur communal, de nouveaux instruments doivent être mis en place pour remplacer les mécanismes existants, dont le fonctionnement est bouleversé par la réforme [c’est-à-dire la suppression de la taxe professionnelle]. Ils pourraient s’inspirer du fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) ».
S’agissant des communes, le même rapport montre que la suppression de la taxe professionnelle et la création de la cotisation foncière des entreprises auraient un effet péréquateur au sein du bloc communal, à un niveau cependant assez limité (notamment par l’effet « naturellement » contre péréquateur du Fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR, qui tend à neutraliser les conséquences financières de la réforme pour chacune des collectivités territoriales concernées). Le rapport explore par ailleurs un ensemble de pistes permettant, en premier lieu, la création de dispositifs permettant une péréquation à la hauteur des dispositifs actuels appelés à disparaître (c’est-à-dire le FSRIF et une partie substantielle des FDPTP, pour un montant global d’environ 600 millions d’euros) et, en deuxième lieu, le respect du principe accompagnant la suppression de la taxe professionnelle et portant sur la garantie des ressources pour chaque collectivité territoriale.
Ce rapport choisit d’évoquer plus précisément (79) l’hypothèse d’un système fondé sur :
– un fonds de péréquation national pour lequel contribueraient les communes disposant d’un potentiel fiscal supérieur à 1,5 fois la moyenne nationale. Les communes bénéficiaires seraient celles disposant d’un potentiel fiscal inférieur à 0,75 fois la même moyenne. S’il était mis en œuvre dès 2011, ce fonds pourrait redistribuer 395 millions d’euros en 2015 ;
– sur des fonds de péréquation régionaux pour lesquels contribueraient les communes disposant d’un potentiel fiscal supérieur à 1,25 fois la moyenne régionale. Les communes bénéficiaires seraient celles disposant d’un potentiel fiscal inférieur à 0,75 fois la même moyenne. S’ils étaient mis en œuvre dès 2011, ces fonds pourraient redistribuer 575 millions d’euros en 2015, dont 252 millions d’euros pour la seule région d’Île-de-France.
Un tel système amplifierait assez substantiellement, selon le même rapport, la péréquation des écarts de richesse fiscale potentielle entre communes, largement au-delà de l’effet « naturel » de la réforme relative à la suppression de la taxe professionnelle.
Le rapport considère que les réformes à venir gagneraient à s’appuyer sur les principes suivants :
– fixer, au préalable et comme objectif politique, une cible de réduction des inégalités de ressources entre communes à échéance donnée et en déduire les principales modalités d’organisation d’un système de péréquation ;
– prendre en compte non seulement les inégalités de ressources, mais aussi celles de charges. Il s’agit de savoir mesurer la réalité selon laquelle la disparité des richesses entre communes peut être légitime au regard d’éléments objectifs, en considérant, par exemple, un indice de charges qui reste à construire (80). Vos rapporteurs considèrent que la question de la mesure des charges est tout aussi décisive que la question des inégalités de ressources. Au demeurant, la mesure des charges est un exercice complexe ; les choix portant sur la définition des critères de charges et sur leur pondération sont toujours discutées, alors qu’un outil comme le potentiel fiscal semble pouvoir mesurer assez objectivement les écarts de ressources entre collectivités territoriales ;
– prendre en compte l’ensemble des ressources fiscales des communes. En effet, la suppression de la taxe professionnelle est accompagnée du transfert de certaines fractions de la fiscalité pesant sur les ménages au bloc communal. Une bonne évaluation de la richesse fiscale potentielle des communes doit prendre en compte ce transfert, car il a des effets différenciés selon le profil des communes ;
– prendre en compte la richesse fiscale potentielle d’un territoire dans sa globalité, c’est-à-dire en considérant à la fois la commune et, le cas échéant, l’intercommunalité ;
– favoriser l’intégration intercommunale. Il s’agit d’une suggestion du rapport, qui évoque un dispositif où les contributeurs des éventuels fonds de péréquation seraient des communes et des EPCI et les bénéficiaires uniquement des EPCI ;
– concilier une péréquation nationale, très efficace mais qui induit des transferts massifs de richesse en provenance notamment de la région Île-de-France, et une péréquation régionale, moins redistributive, mais qui s’appuie sur un ensemble cohérent de communes rassemblées sur un même territoire (à l’instar du FSRIF).
Vos rapporteurs considèrent effectivement indispensable de repenser rapidement des dispositifs de péréquation en substitution des dispositifs qui disparaîtront avec la suppression de la taxe professionnelle (81). Il est par ailleurs nécessaire d’imaginer de nouveaux dispositifs allant au-delà de l’objectif tendant à retrouver un volume de péréquation équivalent au FSRIF et aux FDPTP et complétant le maintien de l’augmentation de la DSU-CS à un rythme suffisamment dynamique et selon une méthode suffisamment ciblée.
En effet, comme le relève l’observatoire des finances locales (OFL) (82), qui met en perspective dans son rapport 2010 les dotations de péréquation dans l’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, « on constate […] un certain recul du pouvoir de péréquation de l’ensemble des dotations ces dernières années, malgré une progression des masses financières consacrées à la péréquation. Le surcroît des montants consacrés à la péréquation permet uniquement de stabiliser l’effet péréquateur des dotations » (83). Selon l’OFL, ce constat s’explique pour les communes par « l’augmentation ces dernières années du nombre et du poids des dotations de compensation dans l’ensemble des dotations, notamment sous l’effet de l’intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la dotation forfaitaire en 2004. De même, les nombreuses garanties prévues pour les dotations d’intercommunalités contribuent à grever la performance péréquatrice des dotations de compensation du bloc communal. »
Vos rapporteurs notent que la nécessité d’amplifier l’effort de péréquation dans le cadre d’une démarche globale et pérenne, notamment pour surmonter cette stagnation du pouvoir péréquateur des dotations de l’État, a été récemment relevée par de nombreux observateurs. La mise en œuvre d’une dotation globale de péréquation constitue ainsi la principale orientation du rapport publié en février 2010 par nos collègues sénateurs Jacques Mézard et Rémy Pointereau (84).
Ce rapport tend par ailleurs à la définition d’un niveau optimal de péréquation, question que l’on peut sans doute rapprocher de la suggestion du Conseil des prélèvements obligatoires de définir une limite aux écarts de richesse entre collectivités territoriales, qui induirait un niveau minimal de péréquation (85).
Par ailleurs, le rapport du groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales, présidé par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et par M. Michel Thénault dans le cadre de la conférence sur les déficits publics, insiste sur « la nécessité d’approfondir la péréquation […] aussi bien verticale, c’est-à-dire de l’État vers les collectivités locales, qu’horizontale, c’est-à-dire à l’intérieur d’une même catégorie de collectivité » (86). Le rapport de ce groupe de travail évoque les effets vertueux de la péréquation sur les situations et pratiques financières des collectivités territoriales en ces termes : « une meilleure péréquation permettrait de réduire les dépenses supplémentaires autorisées par l’abondance de recettes des collectivités les mieux dotées et de limiter l’endettement ou les difficultés budgétaires des plus pauvres. »
L’article 63 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit la création, à compter de 2012, d’un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, afin de prendre en compte, selon l’exposé des motifs de cet article, les préconisations de certaines de ces réflexions. Selon le II de cet article, « l’objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015 ». Il est difficile de déterminer à ce stade la portée exacte de ce nouveau fonds, notamment parce que, comme le précise le V de cet article, ses principales modalités techniques d’application seraient déterminées au cours de l’année 2011, suite à la remise avant le 1er septembre 2011 d’un rapport spécifique du Gouvernement au Parlement accompagné de l’avis du Comité des finances locales.
II.– LA DIFFICILE MESURE DE LA MOBILISATION DES MOYENS NATIONAUX DE DROIT COMMUN ET DES MOYENS LOCAUX EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
La politique de la ville n’est jamais envisagée comme se limitant à l’usage de crédits spécifiques nationaux dédiés au financement de sa mise en œuvre. Il est clair pour ses acteurs et parties prenantes que la politique de la ville s’appuie en premier lieu sur la mobilisation et l’organisation de ce qu’il est convenu d’appeler les moyens de « droit commun », c’est-à-dire les crédits de l’État qui, précisément, ne sont pas initialement dédiés à cette politique et les crédits que les collectivités territoriales, notamment, lui consacrent.
Le troisième alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale des familles précise que l’Acsé « […] accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d’engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. »
Ce principe est décliné s’agissant de la mise en œuvre des Cucs. Ainsi, la circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale (87) précise, dans sa partie 1 « objet du contrat urbain de cohésion sociale », que le Cucs comporte « des programmes d’actions pluriannuels déclinant ce projet sur des champs et des quartiers prioritaires, avec des objectifs précis, lisibles et directement évaluables et précisant les engagements de chacun des partenaires, tant dans le cadre de leurs politiques de droit commun que des moyens spécifiques dédiés à ces quartiers » (88).
Dans sa partie 2 « géographie d’intervention », la circulaire du 24 mai 2006 précise que les quartiers et communes concernés sont à déterminer par les préfets de département en envisageant l’opportunité d’ajouter des crédits spécifiques aux crédits de droit commun déjà mobilisés, ce qui tend à faire des crédits de droit commun la base toujours nécessaire de la mise en œuvre de la politique de la ville (89) :
« Trois catégories de communes pourront être concernées :
« 1.– Les communes qui ont des quartiers dans lesquels une intervention massive et coordonnée de l’ensemble des moyens disponibles est absolument indispensable. L’essentiel des crédits spécifiques seront mobilisés sur ces territoires, en prenant en compte les charges et les ressources des collectivités contractantes.
« 2.– Les communes qui ont des quartiers dans lesquels les difficultés sociales et économiques sont moindres mais pour lesquels la mobilisation de moyens spécifiques au-delà des moyens de droits commun est néanmoins nécessaire.
« 3.– Les autres communes qui ont des quartiers où les actions à mettre en œuvre relèvent davantage de la prévention ou de la coordination des moyens de droit commun. »
Dans sa partie 3 « élaboration du contrat », la circulaire du 24 mai 2006 invite les préfets à définir « avec l’ensemble des services de l’État concernés […] les modalités d’intervention de l’État ainsi que les priorités et les moyens à arrêter dans le cadre des politiques de droit commun qu’ils mettent en œuvre pour répondre au mieux aux enjeux du territoire. » (90).
La partie 4 « engagements » est organisée, de façon explicite, en un premier chapitre intitulé « une priorité à l’engagement des crédits de droit commun » et un second intitulé « un meilleur ciblage des crédits spécifiques ». La première phrase de ce second chapitre illustre très clairement les positionnements respectifs des différentes catégories de crédits : « La mobilisation des moyens de droit commun doit constituer le socle des engagements des partenaires. Elle doit permettre de mieux cibler les crédits spécifiques sur des actions prolongeant ou renforçant les politiques de droit commun vers les quartiers en difficulté ». S’agissant de ce que recouvre la notion de crédits de droit commun, il est utile de reproduire le deuxième alinéa du premier chapitre de cette partie 4 :
« Ainsi l’État devra-t-il mobiliser ses moyens budgétaires de droit commun et orienter ou redéployer, chaque fois que possible, ses moyens en personnels en lien avec les priorités du projet de cohésion sociale (service public de l’emploi, inspection académique, juridictions et services déconcentrés du ministère de la justice, police, DDASS, DDJS ). La procédure d’élaboration des contrats et le renforcement de l’animation interministérielle réalisée par la DIV (91), à travers des CIV (92) «techniques» trimestriels ainsi qu’au moyen du document de politique transversal “ Ville ”, doit permettre de garantir l’engagement de l’État sur ces moyens. »
Il ressort de cet extrait que la « mobilisation du droit commun », en ce qui concerne l’État, relève, d’une part,de la procédure d’élaboration des Cucs, au cœur de laquelle le préfet est censé mobiliser l’ensemble des services de l’État, et d’autre part, de l’animation interministérielle de l’administration centrale en charge de la politique de la ville, le SG-CIV, sur la base de réunions interministérielles techniques qu’elle conduit et de la réalisation d’un document budgétaire, dit de politique transversale (le DPT « Ville »). Une partie des développements de la présente partie a précisément pour fondement ce document, afin d’évaluer l’ampleur et la réalité de la mobilisation des moyens nationaux de droit commun en faveur de la politique de la ville.
En matière de mobilisation des crédits de droit commun, l’État affiche ainsi des ambitions précises qu’il convient de mesurer à l’aune notamment de la réalité de l’implication réelle des administrations centrales s’agissant de la politique de la ville. Pour leur part, les acteurs locaux et, notamment parmi eux, les communes concernées par les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont bien entendu appelés à concourir à cette politique. La contractualisation constitue par définition le recueil des engagements réciproques en la matière ; dans cette perspective, il s’agit pour l’État d’apporter une aide additionnelle aux moyens locaux mis en œuvre en faveur des territoires les plus en difficulté socialement et économiquement, dans le cadre d’une politique menée de façon décentralisée par les élus concernés. Le rôle de l’État, par ses moyens dédiés ou de droit commun, est donc de susciter et d’appuyer une action portée et élaborée localement.
Il est néanmoins patent qu’il est bien difficile d’opérer une mesure des moyens locaux mobilisés en la matière.
A.– LES CRÉDITS NATIONAUX DE DROIT COMMUN DE L’ÉTAT EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : UN AFFICHAGE AMBITIEUX POUR UNE RÉALITÉ PLUS CONTRASTÉE
L’organisation, le recensement et la mobilisation des moyens nationaux de droit commun en faveur de la politique de la ville constituent l’une des principales missions du SG-CIV ; le quatrième alinéa de l’article 6 du décret n° 2009-539 relatif aux instances en charge de la politique de la ville précise ainsi que le SG-CIV contribue « à la mise en œuvre interministérielle de la politique de la ville ». L’élaboration et le contenu du document de politique transversale (DPT) « Ville », prévu par le 8° du I de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 constitue pour le SG-CIV un élément contribuant à la mise en œuvre de cette mission, autant qu’il en illustre les résultats.
En 2009, les crédits de paiement du programme 147 « Politique de la ville » (794,572 millions d’euros) constituaient 22 % de l’ensemble des crédits de paiement concourant à la politique de la ville pour l’ensemble des programmes concernés (3 615,666 millions d’euros). Cette proportion est, selon la direction du budget, depuis 2005 « relativement constante et relativement faible (20 %) ».
Par les commentaires qui suivent, vos rapporteurs n’ont pas l’intention de critiquer les auteurs de ce document d’information à destination de la représentation nationale, même si certains points méritent sans doute d’être améliorés.
Il s’agit en premier lieu, en considérant les chiffres mais aussi au-delà d’eux, de mesurer l’implication de chacun en matière de la politique de la ville ; vos rapporteurs ont entendu un certain nombre de responsables administratifs (93), pour lesquels la question des quartiers défavorisés constitue un sujet plus ou moins fondamental.
Il s’agit aussi de tenter de dresser un panorama de l’ensemble des dispositifs rattachés à la politique de la ville.
Il s’agit enfin d’analyser de manière approfondie et critique l’opération consistant à additionner toutes les contributions recensées en la matière et à considérer cette somme sous le label « crédits de droit commun en faveur de la politique de la ville ». La pluralité et la fragilité des modalités de calcul de ces contributions, leur hétérogénéité quant à leur nature invitent, en effet singulièrement, à la prudence en la matière.
Concrètement, Le DPT « Ville » (94) annexé au projet de loi de finances pour 2010 dresse une liste de 31 programmes budgétaires du budget général censés contribuer à la politique de la ville. Un peu plus d’un quart des programmes du budget général est donc concerné, puisque celui-ci est composé, aux termes du projet de loi de finances pour 2010, de 130 programmes rassemblés dans 33 missions.
Parmi ces 31 programmes, qui relèvent de 23 missions, on compte bien entendu le programme 147 « Politique de la ville », qui a fait l’objet de développements supra. L’étude des crédits de droit commun du budget général de l’État contribuant à la politique de la ville concerne donc les 30 autres programmes.
1. Certains programmes budgétaires concourent à la politique de la ville sans mention des crédits correspondants
Le DPT « Ville » expose pour chacun de ces 30 programmes les éléments qui justifient sa contribution à la politique transversale « Ville » (95). On constate que le même document n’identifie, parmi ces 30 programmes, que 21 programmes pour lesquels est évaluée la part de leurs crédits qu’ils consacrent à la politique de la ville. Interrogé sur ce sujet au titre de sa fonction de maître d’œuvre de l’élaboration de ce document, le SG-CIV a dressé une typologie des 9 programmes censés concourir à la politique de la ville sans identification concomitante de la part de leurs crédits consacrés à cette politique transversale, ainsi que certaines explications complémentaires. Les développements suivants reprennent cette typologie et ces explications (en italique). Les explications sont, le cas échéant, suivies de commentaires des rapporteurs (en romain).
« – impossibilité d’individualiser les crédits de la politique de la ville dans la masse globale des crédits :
« 1° Programme 123 “conditions de vie Outre-mer” ; »
Le dernier paragraphe de la présentation de l’apport de ce programme à la politique de la ville (96) contient pourtant une mesure chiffrée de l’apport du ministère chargé de l’outre-mer à la rénovation urbaine, soit 61,8 millions d’euros au titre de conventions signées avec l’Anru, financés sur la « ligne budgétaire unique » (LBU) dont l’objet est le financement des opérations portant sur les logements sociaux dans les départements d’outre-mer. Il devrait être possible d’annualiser le montant de cette contribution à la politique de la ville.
« 2° Programme 103 “Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi”, en partie dans la mesure où l’action mobilisée relève principalement d’exonérations fiscales qui n’ont pas lieu de figurer dans l’annexe financière ; »
Dans le cadre de la présentation de ce programme, le DPT évoque le dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises » (NACRE), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, qui doit permettre d’apporter un financement à 20 000 créateurs d’entreprises par an, dont 5 000 « dans les ZUS » (97) au titre de la dynamique « espoir banlieues ». Il y a lieu de noter qu’au cours de l’accompagnement « NACRE », le créateur ou le repreneur de l’entreprise peut bénéficier d’un prêt à taux zéro, dispositif dont le financement a été confié à la Caisse des dépôts et consignations sur ses fonds d’épargne. Il doit par ailleurs, sous réserve d’en organiser la collecte, identifier la part des créations d’entreprises localisées dans les ZUS.
« – concours à la politique de la ville davantage en termes d’animation et de coordination que de crédits :
« 1° Programme 129 “Coordination du travail gouvernemental” ; la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie indiquant cependant l’édition, en 2009, d’une plaquette d’information pour un coût de 42 500 € (page 29 du DPT) ;
« 2° Programme 150 “Formations supérieures et recherche universitaire” ;
Le DPT (98) précise que le programme 150 du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche contribue à deux mesures de la dynamique espoir banlieues :
– l’encouragement à la préparation au diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ;
– le soutien aux initiatives d’établissements d’enseignement en matière d’égalité des chances, comme la création de classes préparatoires à l’enseignement supérieur.
Il devrait donc être possible d’identifier les crédits correspondants au sein de ce programme. Au demeurant, les informations transmises à vos rapporteurs par la direction du budget n’indiquent pas de participation de ce ministère aux mesures de la dynamique espoir banlieues.
« 3° Programme 231 “ Vie étudiante ”, à l’exception de la gestion par la direction générale de l’administration de la fonction publique des crédits relatifs à l’allocation diversité pour un montant de 2 millions d’euros comme indiqué dans la présentation du programme (page 34 du DPT). »
Il convient de relever que l’allocation pour la diversité dans la fonction publique est considérée comme rattachée à la politique de la ville, et constitue ainsi une mesure de la dynamique « espoir banlieues », dans la mesure où un parcours scolaire antérieur effectué dans un établissement de l’éducation prioritaire au titre de l’Éducation nationale peut être un critère de sélection pour bénéficier de l’allocation. Par ailleurs, s’agissant du programme 231, le DPT (99) indique sa participation au financement de deux autres mesures de la dynamique espoir banlieues : d’une part, l’atteinte d’un taux de 30 % de boursiers dans l’effectif des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et, d’autre part, les « cordées de la réussite » qui constituent une forme de parrainage et d’accompagnement de lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville en association avec des établissements de l’enseignement supérieur. Il devrait être possible pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche d’identifier des crédits affectés à cette dernière opération puisque, selon la direction du budget, le ministère chargé de l’Éducation nationale a déclaré avoir financé l’accès aux classes préparatoires de ces lycéens, y compris au titre des cordées de la réussite, à hauteur de 24,1 millions d’euros en 2009.
« – une absence d’actualisation du mode de calcul depuis plus de trois ans :
« 1° Programme 106 “Actions en faveur des familles vulnérables”, le mode de calcul des crédits consacrés au réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP ; 4,3 millions d’euros) n’a pas été actualisé depuis 2007 (page 35 du DPT). »
Le DPT constate en effet que le financement de ces réseaux s’élève pour 2010 à 12,6 millions d’euros et que, en 2007, « environ » 33 % des actions ont été menées par eux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« – crédits extra-budgétaires :
« 1° Programme 203 “Infrastructures et services de transport”, les crédits mobilisés par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) figurent non pas dans l’annexe financière elle-même mais en annotation sous cette annexe à l’instar des autres crédits extra-budgétaires de la Caisse des dépôts et de l’Anru »
Le DPT indique en effet qu’au titre de l’exercice 2010 (100), « la contribution du MEEDDM (101) et de l’AFITF (102) à la mise en œuvre du volet “transports” de la dynamique “espoir banlieues” » devrait s’élever à 125 millions d’euros en autorisations d’engagement et à 32 millions d’euros en crédits de paiement. On peut cependant relever que si le MEEDDM contribue directement au financement de telles opérations d’infrastructures de transport, il ne s’agit pas, par définition, de contributions extra-budgétaires. Au demeurant, le DPT confirme par ailleurs que des crédits budgétaires de droit commun sont requis pour financer ces opérations : après la description concrète de ces opérations, le DPT (103) précise que « cette politique mobilisera, d’une part, les moyens du budget général et ceux de l’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFTIF) et, d’autre part, des participations des collectivités locales et des autorités organisatrices de transport ». Par ailleurs, comme l’indique le DPT lui-même, une part importante des crédits gérés par l’AFITF est reversée à l’État sous forme de fonds de concours (104).
« – crédits n’ayant pas lieu de figurer dans l’annexe financière :
« 1.– Programme 134 “Développement des entreprises et de l’emploi”, pour les actions mises en œuvre par l’Épareca et le FISAC dont les moyens mobilisés figurent dans l’annexe relative au commerce et à l’artisanat dans les quartiers de la politique de la ville (page 105). »
Les ressources de l’Épareca ne relèvent certes pas complètement de l’État. Une partie de ces ressources, soit 10,5 millions d’euros par an aux termes du contrat d’objectifs et de moyens avec lequel l’Épareca est lié avec l’État pour la période 2009-2011, relèvent cependant de crédits étatiques, par l’intermédiaire d’une dotation en faveur du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) issue du programme 134, le fonds reversant à l’Épareca une dotation équivalente à ce montant.
« – un “oubli” :
« 1.– Programme 124 “Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales” qui porte, à compter de l’année 2010, les crédits de personnel et d’animation du SG-CIV ainsi que les crédits pour compensation des emplois de délégués du préfet, et antérieurement portés par le programme 135 relevant du MEEDDM. Toutefois, les montants de crédits afférents à ces actions figurent dans la présentation du Programme 124 (page 39). »
Cet « oubli » porte sur des éléments non négligeables. Il s’agit en effet :
– des dépenses de personnel du SG-CIV pour 4,717 millions d’euros ;
– des crédits de personnel afférents aux emplois de délégués du préfet, par remboursement des coûts correspondants et versement d’une compensation, à leurs ministères d’origine, à hauteur de 22,794 millions d’euros ;
– des dépenses de personnel et de fonctionnement des services préfectoraux au titre des missions qu’ils assument auprès des préfets dans leur mission de délégués territoriaux de l’Acsé, pour un montant de 9,940 millions d’euros.
*
* *
Au-delà des justifications techniques apportées par le SG-CIV sur ces carences s’agissant de l’identification des crédits de l’État en faveur de la politique de la ville, l’exercice DPT « Ville » est en tout état de cause complexe, ainsi qu’en convient d’ailleurs la directrice du budget chargée de publier le document :
– en effet, afin d’y procéder, le responsable d’un programme budgétaire doit être en mesure de territorialiser les actions conduites sur la base de ce programme, dans un contexte où la géographie prioritaire de la politique de la ville mêle désormais de nombreux zonages différents et largement enchevêtrés ; vos rapporteurs constatent effectivement que l’Acsé, malgré l’effort qu’elle a produit depuis sa création, n’est elle-même pas en mesure de territorialiser ses financements par quartier couvert par un Cucs ;
– par ailleurs, selon la direction du budget « l’existence d’un très grand nombre de dispositifs cofinancés rend difficile l’évaluation de la participation financière des ministères ». Cette remarque peut sembler paradoxale : même si elles sont nombreuses, les mesures en faveur des quartiers défavorisés cofinancées par plusieurs ministères doivent permettre l’exercice consistant à savoir quels sont les ministères qui interviennent et dans quelles proportions. Curieusement, la lecture du DPT « Ville » confirme cependant que certaines mesures cofinancées ne sont pas évaluées dans leur montant et que, par ailleurs, les ministères qui ne sont pas en mesure de territorialiser leurs actions en fonction de la géographie des quartiers prioritaires, tentent néanmoins de procéder à l’évaluation des crédits correspondants.
Il faut bien entendu prendre en compte, par ailleurs, les difficultés liées à l’implication des ministères concernés. Le SG-CIV, avec l’appui de sa tutelle ministérielle, ne semble que difficilement en mesure de la cultiver. Il s’agit, il est vrai, d’un exercice qui, sans culture partagée de la politique de la ville, constitue sans doute, dans un certain nombre de ministères, une forme de pensum estival. La direction du budget a confié à vos rapporteurs les réponses que lui ont adressées certains ministères à la question de savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas en mesure, dans le DPT, d’identifier les financements qu’ils mobilisent en faveur de la politique de la ville : l’un d’eux, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, s’est contenté, en réponse, d’adresser les passages du DPT qui justifie sa participation à la politique de la ville, alors même que l’insuffisance et la pauvreté de ces passages sont à l’origine de la demande de précision qui lui était adressée.
2. La contribution de l’Éducation nationale à la politique de la ville
La contribution des programmes budgétaires liés à l’Éducation nationale est quantitativement, de loin, la plus importante si l’on juge de cette contribution par ministère concerné. Ainsi, s’agissant des crédits de paiement envisagés pour le PLF 2010, les trois programmes suivants consacrent 1,205 milliard d’euros à la politique transversale « Ville » :
– le programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » pour 460,749 millions d’euros. Ce montant représente 2,61 % des crédits inscrits sur ce programme en loi de finances initiale pour 2010 ;
– le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » pour 469,998 millions d’euros. Ce montant représente 1,61 % des crédits inscrits sur ce programme en loi de finances initiale pour 2010 ;
– le programme 230 « Vie de l’élève » pour 274,114 millions d’euros. Ce montant représente 7,30 % des crédits inscrits sur ce programme en loi de finances initiale pour 2010.
Ces montants représentent 32,2 % des crédits du budget général de l’État consacrés à la politique transversale « Ville » selon la DPT. Ils font bien entendu du ministère chargé de l’Éducation nationale le premier ministère contributeur à la politique de la ville, avant même le secrétariat d’État en charge de cette politique. Cette approche quantitative corrobore d’ailleurs largement l’impression de vos rapporteurs, qui ont pu constaté l’énergie et le volontarisme des responsables administratifs nationaux de l’Éducation nationale sur le sujet des aides en faveur des quartiers prioritaires. Mais une autre question est de savoir à quoi correspondent ces moyens et jusqu’à quel point il est légitime de les considérer comme contribuant à la politique de la ville.
a) L’éducation prioritaire: objets, organisation, moyens
La plus grande partie des crédits du ministère de l’Éducation nationale qu’il considère comme contribuant à la politique transversale « Ville » correspond au coût global de l’éducation prioritaire.
Depuis 1981 et la création des zones d’éducation prioritaire, cette politique a été réformée à plusieurs reprises. La dernière « relance » de l’éducation prioritaire en 2006 s’est appuyée sur le rapport de Mme Anne Armand et Mme Béatrice Gille publié au mois d’octobre 2006 et intitulé : « La contribution de l’éducation prioritaire à l’égalité des chances des élèves ». Selon le ministère de l’Éducation nationale, ce rapport souligne que « la politique de l’éducation prioritaire a, dans sa mise en place et dans ses développements, bénéficié de nombreux atouts: volonté politique, large consensus, validité des objectifs, articulation avec la politique de la ville, innovations. Mais [les auteurs] constatent aussi qu’elle n’a pas produit les résultats attendus et ses acteurs ont connu un certain essoufflement [et affirment] que cette politique conserve une forte légitimité en tant qu’outil privilégié de l’égalité des chances dans le système éducatif, même si sa poursuite nécessite des infléchissements ». De façon générale, comme l’évoque la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) dans ses réponses à vos rapporteurs en commentant globalement les évaluations des résultats scolaires des élèves concernés par l’éducation prioritaire, « le constat général est que les écarts de réussite entre les élèves de l’éducation prioritaire et les autres sont restés relativement constants dans le temps ».
En réponse à ces constats, la circulaire n° 2006-058 du 30 mars 2006 affirme l’objectif de la réussite de tous les élèves de l’éducation prioritaire dans le cadre d’un niveau commun d’exigence, en s’appuyant notamment sur l’acquisition du socle commun de connaissance défini par la loi. La circulaire définit des indicateurs mesurant les écarts de réussite entre les élèves scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire et les autres élèves. S’agissant des moyens et de l’organisation, la circulaire du 30 mars 2006 a structuré l’éducation prioritaire en deux catégories de réseaux, afin de mieux concentrer l’action de l’éducation prioritaire sur un nombre restreint d’établissements :
– les réseaux « ambitions réussite » (RAR), qui regroupent des établissements qui scolarisent les élèves présentant des difficultés sociales et scolaires majeures, rassemblaient, pour la rentrée de l’année scolaire 2008/2009, 254 collèges et 1 710 écoles du premier degré ;
– les réseaux de réussite scolaire (RRS), qui concernent des établissements dont les difficultés sont moindres, rassemblaient, pour la rentrée de la même année scolaire 2008/2009, 851 collèges et 5 259 écoles du premier degré.
Ainsi, si cette réforme n’a pas réellement permis de restructurer fondamentalement la géographie de l’éducation prioritaire, elle s’est appuyée sur une identification des difficultés sociales et éducatives les plus lourdes (concentrées dans les RAR), avec pour objectif de consacrer à leur traitement une partie à tout le moins substantielle des moyens. Cette considération relative à la concentration des moyens sur une base objective doit être un tant soit peu relativisée : en pratique, si des critères objectifs et sociaux ont permis de déterminer les établissements des RAR, une prise en compte des « réalités locales », par concertation avec les académies, a substantiellement complété la constitution de la carte de l’éducation prioritaire. Ainsi, selon la Dgesco, « une première liste de 164 collèges a été établie, à l’échelon national […]. Ces collèges avaient été repérés en raison des caractéristiques suivantes :
« – l’accueil de 67 % d’élèves provenant de catégories sociales défavorisées ;
« – et, soit 10 % ou plus d’élèves de 6e en retard d’au moins deux ans, soit un score à l’évaluation à l’entrée en 6e inférieur ou égal à 47 % ;
« […] Un contingent supplémentaire de collèges a été déterminé sur la base des taux de RMI et de chômage. Chaque recteur a été destinataire de la liste de ces établissements pouvant compléter la première liste des collèges RAR. La liste définitive devait comporter 220 collèges.
« Deux critères devaient être pris en compte :
« – le pourcentage d’élèves boursiers de collèges bénéficiant du troisième taux de bourse ;
« – le pourcentage d’élèves non francophones.
« Après les retours académiques, 249 collèges ont été finalement retenus pour la constitution des RAR. Il est à noter que s’ajoutent à cette liste 11 collèges privés retenus selon les mêmes critères et après concertation avec les recteurs des académies concernées […].
« Pour la constitution du réseau en tant que tel, le principe est d’intégrer les écoles viviers du collège. Ce sont les recteurs qui ont rattaché, ou pas, les écoles du secteur au collège tête du réseau ambition réussite. »
S’agissant des moyens, pour 2009, l’Éducation nationale identifie, au titre de l’éducation prioritaire, les coûts suivants :
– 804,6 millions d’euros correspondant au coût de l’amélioration de l’encadrement dans les établissements concernés par ces réseaux. Ces financements correspondent à 14 398 équivalents-temps plein supplémentaires, dont 7 400 dans le premier degré, 6 514 dans le second degré, ainsi que 484 conseillers principaux d’éducation ;
– 121,9 millions d’euros correspondant à des avantages indemnitaires dont le bénéfice est lié, pour les personnels concernés, à l’exercice de leurs fonctions dans les établissements constituant les réseaux de l’éducation prioritaire ou accueillant les élèves les plus difficiles. Il s’agit principalement de l’indemnité de sujétion spécifique « ZEP » due à tous les personnels exerçant dans les ZEP pour 101,8 millions d’euros.
Pour illustrer plus concrètement la déclinaison pratique des coûts associés à l’éducation prioritaire, les deux tableaux suivants décrivent, par académie, dans le premier degré et dans le second degré, les taux d’encadrement constatés à la fois dans les RAR, les RSS, au total dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire (« EP »), ainsi que dans les établissements qui n’en relèvent pas (« hors EP »).
TAUX D’ENCADREMENT PAR ACADÉMIE ET NIVEAU D’ENSEIGNEMENT
Année scolaire 2008-2009
Premier degré
RATIO D’ENFANTS PAR CLASSE (NOMBRE D’ÉLÈVES SUR NOMBRE DE CLASSES)
DANS LES ÉCOLES
RAR |
RRS |
EP(moyenne pondérée des RAR et RRS) |
Hors EP |
Écart RAR – hors EP | |
Aix-Marseille |
22,13 |
22,19 |
22,16 |
23,33 |
1,20 |
Amiens |
21,39 |
22,28 |
21,84 |
23,37 |
1,98 |
Besançon |
21,54 |
21,09 |
21,20 |
23,03 |
1,49 |
Bordeaux |
20,87 |
22,01 |
21,91 |
23,50 |
2,63 |
Caen |
20,86 |
21,60 |
21,40 |
23,28 |
2,42 |
Clermont-Ferrand |
22,01 |
20,69 |
21,21 |
22,32 |
0,31 |
Corse |
20,54 |
22,51 |
22,19 |
21,49 |
0,95 |
Créteil |
21,16 |
21,34 |
21,30 |
25,50 |
4,36 |
Dijon |
20,71 |
20,38 |
20,42 |
22,28 |
1,57 |
Grenoble |
22,00 |
22,85 |
22,81 |
23,86 |
1,86 |
Guadeloupe |
21,99 |
22,15 |
22,10 |
24,26 |
2,27 |
Guyane |
22,92 |
20,21 |
20,58 |
25,61 |
2,69 |
Lille |
22,75 |
22,87 |
22,84 |
24,42 |
1,67 |
Limoges |
21,54 |
22,34 |
22,12 |
22,42 |
0,88 |
Lyon |
21,53 |
21,60 |
21,58 |
24,48 |
2,95 |
Martinique |
21,79 |
21,85 |
21,83 |
21,73 |
- 0,6 |
Montpellier |
20,11 |
20,93 |
20,48 |
23,53 |
3,42 |
Nancy-Metz |
21,62 |
21,52 |
21,55 |
22,45 |
0,93 |
Nantes |
23,30 |
23,45 |
23,43 |
24,21 |
0,91 |
Nice |
21,26 |
21,87 |
21,60 |
23,88 |
2,62 |
Orléans-Tours |
20,94 |
20,79 |
20,81 |
23,56 |
2,62 |
Paris |
22,18 |
22,11 |
22,12 |
25,36 |
3,18 |
Poitiers |
20,23 |
20,96 |
20,75 |
23,67 |
3,44 |
Reims |
22,13 |
22,06 |
22,09 |
22,56 |
0,43 |
Rennes |
20,58 |
21,19 |
20,95 |
24,11 |
3,53 |
Réunion |
22,75 |
23,17 |
23,08 |
26,06 |
3,31 |
Rouen |
21,49 |
21,98 |
21,83 |
23,64 |
2,13 |
Strasbourg |
19,33 |
21,09 |
20,21 |
23,62 |
4,29 |
Toulouse |
22,07 |
22,51 |
22,23 |
23,08 |
1,01 |
Versailles |
21,74 |
22,22 |
21,97 |
24,80 |
3,08 |
Total |
21,65 |
22,07 |
21,95 |
23,87 |
2,22 |
source : DGESCO
Second degré
RATIO D’ENFANTS PAR CLASSE (NOMBRE D’ÉLÈVES SUR NOMBRE DE CLASSES)
DANS LES COLLÈGES
RAR |
RRS |
EP(moyenne pondérée des RAR et RRS) |
Hors EP |
Écart RAR – hors EP | |
Aix-Marseille |
21,81 |
23,52 |
22,80 |
25,53 |
3,72 |
Amiens |
19,55 |
21,69 |
20,95 |
24,16 |
4,61 |
Besançon |
20,64 |
22,46 |
22,22 |
24,35 |
3,71 |
Bordeaux |
21,33 |
21,95 |
21,87 |
25,56 |
4,23 |
Caen |
20,64 |
20,82 |
20,78 |
23,51 |
2,87 |
Clermont-Ferrand |
20,53 |
21,78 |
22,95 |
24,19 |
3,66 |
Corse |
24,65 |
23,62 |
23,39 |
24,70 |
0,05 |
Créteil |
20,75 |
21,92 |
21,56 |
24,17 |
3,42 |
Dijon |
21,38 |
22,65 |
22,57 |
24,46 |
3,08 |
Grenoble |
18,63 |
22,36 |
22,18 |
25,04 |
6,41 |
Guadeloupe |
23,16 |
22,89 |
22,95 |
24,82 |
1,66 |
Guyane |
22,09 |
23,15 |
22,09 |
23,61 |
1,52 |
Lille |
18,81 |
20,91 |
20,38 |
24,23 |
5,42 |
Limoges |
21,38 |
20,39 |
20,53 |
24,25 |
2,87 |
Lyon |
20,93 |
22,51 |
22,27 |
25,02 |
4,09 |
Martinique |
21,64 |
22,15 |
21,92 |
23,19 |
1,55 |
Montpellier |
21,01 |
22,94 |
22,55 |
25,26 |
4,25 |
Nancy-Metz |
20,41 |
22,08 |
21,83 |
24,56 |
4,15 |
Nantes |
19,44 |
20,85 |
21,51 |
24,40 |
4,96 |
Nice |
20,75 |
22,33 |
21,73 |
24,87 |
4,12 |
Orléans-Tours |
19,54 |
21,92 |
21,43 |
23,87 |
4,33 |
Paris |
20,51 |
23,46 |
23,07 |
26,31 |
5,80 |
Poitiers |
21,33 |
22,26 |
22,15 |
24,95 |
3,62 |
Reims |
19,74 |
21,11 |
20,86 |
23,58 |
3,84 |
Rennes |
20,62 |
22,07 |
21,93 |
24,78 |
4,16 |
Réunion |
22,56 |
24,20 |
23,33 |
25,29 |
2,73 |
Rouen |
20,43 |
22,07 |
21,80 |
24,11 |
3,68 |
Strasbourg |
20,34 |
20,56 |
20,05 |
25,07 |
4,73 |
Toulouse |
20,12 |
23,19 |
22,19 |
26,06 |
5,94 |
Versailles |
21,26 |
22,49 |
22,24 |
25,76 |
4,50 |
Total |
20,93 |
22,24 |
21,90 |
24,83 |
3,90 |
source : DGESCO
La politique de concentration des moyens en faveur de l’éducation prioritaire semble connaître certaines difficultés dans certaines des 30 académies :
– dans 8 académies, le taux d’encadrement en RAR est moins favorable qu’en RSS dans le premier degré. C’est aussi le cas dans 3 académies pour le second degré ;
– le taux d’encadrement en RAR dans 17 académies dans le premier degré est moins favorable que le taux d’encadrement hors éducation prioritaire dans l’académie où ce taux est le plus faible (21,49 pour l’académie de Corse). Dans le second degré, on observe la même situation pour une académie ;
– dans 2 académies, le taux d’encadrement dans l’éducation prioritaire dans le premier degré est moins favorable que hors éducation prioritaire ;
– pour 14 académies, la différence dans le premier degré entre le taux d’encadrement hors EP et en RAR est inférieure à deux élèves par classe, ce qui constitue concrètement une différence peu significative. Cette différence est même négative pour une de ces quatorze académies. Une différence inférieure à deux élèves par classe hors EP et en RAR est constatée pour 4 académies dans le second degré. Cette différence est quasi nulle pour l’une de ces académies.
De façon générale, les situations des académies en terme de différence entre l’encadrement hors éducation prioritaire et en RAR sont très hétérogènes. La situation comparée des premier et second degrés est elle-même très contrastée.
La mobilisation et la concentration des moyens ne constituent pas les seules modalités de la relance de l’éducation prioritaire de 2006. La circulaire du 30 mars 2006 souligne l’importance des parcours et de l’accompagnement individuels, de l’encouragement des talents et de la lutte contre la censure que les élèves de l’éducation prioritaire s’appliqueraient à eux-mêmes en s’interdisant de penser pour eux-mêmes à certains cursus ou certaines filières. L’éducation prioritaire doit ainsi envisager son action s’agissant des élèves qu’elle prend en charge avec pour horizon l’ensemble d’une scolarité, y compris les études supérieures, et ce dès le collège.
Si cette approche intégrée, tenant compte de l’ensemble de la scolarité et de certains éléments psychologiques comme l’image de soi, correspond largement à la philosophie du programme de réussite éducative aujourd’hui piloté par l’Acsé ou de certaines mesures de la dynamique « espoir banlieues », et ce, en premier lieu, du fait de l’objectif commun de réussite des élèves qui bénéficient de moins d’atouts au départ, faut-il considérer pour autant que tous les moyens de l’éducation prioritaire peuvent légitimement être considérés comme contribuant à la politique de la ville ?
b) Éducation prioritaire et politique de la ville ne sont pas totalement superposables
Comme le précise la Cour des comptes dans son « enquête sur l’articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation nationale dans les quartiers sensibles » (105), « les modalités de calcul de la contribution de l’éducation nationale à la politique de la ville se limitent à l’évaluation des moyens supplémentaires mis en œuvre dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire et aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la dynamique espoir banlieues ». Or, la même enquête montre, sur la base d’éléments statistiques fournis par l’Éducation nationale, que tous les établissements relevant de l’éducation prioritaire ne relèvent pas de zones urbaines sensibles du point de vue de la politique de la ville :
– 724 des 1 106 collèges situés en 2009 dans un RAR ou dans un RRS ne sont pas situé en ZUS. Cette proportion, des deux tiers, est encore plus forte si l’on prend en compte les effectifs : 75 % des collégiens scolarisés relevant de l’éducation prioritaire le sont dans un collège qui n’est pas situé dans une ZUS ;
– inversement, 93 collèges situés en ZUS ne relèvent pas de l’éducation prioritaire, soit près de 20 % des 485 collèges situés en ZUS.
Ce dernier constat peut certes être expliqué par la qualité des zonages. Comme le relève l’étude de la Cour des comptes, la lettre de mission du Premier ministre du 2 avril 2009 à nos collègues MM. Pierre André, sénateur, et Gérard Hamel, député, relative à la définition d’une méthode opérationnelle de révision de la géographie des zones urbaines sensibles, admet que l’actuelle définition des ZUS « ne repose sur aucun critère objectif », cette définition ayant par ailleurs aujourd’hui presque 15 ans. Il est assez logique que certains collèges établis en ZUS ne relèvent pas de l’éducation prioritaire, dont les réseaux reposent pour leur part, comme il a été vu supra, en assez grande partie sur des critères objectifs. Il n’est pas impossible d’imaginer qu’une réforme de la géographie prioritaire s’appuyant sur des critères objectifs sociaux donnerait lieu à une proportion plus faible qu’aujourd’hui de collèges en ZUS qui ne relèveraient pas de l’éducation prioritaire.
Mais la question fondamentale n’est pas celle de la qualité de la conception des zonages. Le fait que trois collèges sur quatre relevant de l’éducation prioritaire ne soient pas situés en ZUS a un rapport avec cette conception. Dans ses réponses à vos rapporteurs, le ministère de l’Éducation nationale précise ainsi que « depuis sa création, la politique de la ville a eu pour objectif la prise en compte de territoires urbains en difficulté. Les mesures mises en oeuvre s’inscrivent toujours dans une logique de zonage […]. Les publics bénéficiaires de cette politique sont déterminés à partir de leur adresse d’habitation et de leur inclusion, ou non, dans le périmètre (quartier, zone, ville) préalablement défini.
« L’éducation prioritaire vise des écoles et des collèges qui concentrent difficultés sociales et scolaires et l’ensemble des élèves qui y sont scolarisés indépendamment de leur lieu de résidence. L’appartenance ou non, à une zone géographiquement définie n’a jamais été une caractéristique retenue. […]
« Ces deux politiques prioritaires concourent donc à un objectif commun de réduction des inégalités mais avec des logiques de ciblages différents :
« – Une logique de développement d’un territoire urbain défavorisé et de prise en compte de ses habitants [c’est-à-dire la politique de la ville] ;
« – Une logique de réseau et de parcours de réussite scolaire, et ce sur l’ensemble du territoire français, rural et départements d’outre-mer compris [c’est-à-dire l’éducation prioritaire]. »
Ces différences d’approche rendent effectivement complexe le calcul de la part de l’éducation prioritaire que l’on peut considérer comme concourant effectivement à la politique de la ville : en effet, en toute rigueur, les moyens supplémentaires dont bénéficient un collège en ZUS au titre de son appartenance à un réseau ambition réussite pourraient n’être pris en compte qu’au prorata du nombre d’élèves qui y sont scolarisés et dont les adresses de résidence sont effectivement localisées en ZUS. Inversement, un collège dans un tel réseau situé hors ZUS accueille le cas échéant des élèves qui résident dans une zone urbaine sensible.
Il n’est pas possible de mesurer le concours de l’Éducation nationale à la politique de la ville par l’éducation prioritaire avec un tel degré de finesse. En effet, comme le regrette l’ONZUS, il n’est pas aujourd’hui possible de disposer, par établissement scolaire, d’informations relatives à l’adresse des élèves de façon à procéder à une exploitation statistique permettant, par exemple, de constater les résultats scolaires des élèves résidant en ZUS selon qu’ils sont ou non scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ou selon que cet établissement est situé ou non en ZUS. Il n’en demeure pas moins qu’il apparaît abusif de considérer, comme le fait le DPT « Ville », que l’ensemble des coûts liés à l’éducation prioritaire constituent un concours à la politique de la ville, notamment au regard du constat selon lequel les trois quarts des établissements situés dans un RAR ou un RSS ne sont pas situés en ZUS. Alors que l’éducation prioritaire constitue une politique très proche dans sa philosophie et ses objectifs de la politique de la ville, il doit être possible de trouver une modalité, même approximative, de mesurer la part de la première qui sert la seconde, notamment en excluant du calcul de la contribution les établissements scolaires dont l’appartenance à un RAR ou un RSS n’a manifestement pas pour origine des difficultés analogues à celles qui caractérisent classiquement les zones urbaines sensibles. Compte tenu des montants en jeu, l’absence de toute proratisation aujourd’hui constitue une limite forte de la crédibilité de l’ensemble du DPT.
c) Les autres contributions de l’éducation nationale à la politique de la ville
Au-delà de l’éducation prioritaire stricto sensu, l’Éducation nationale met en œuvre un certain nombre de dispositifs qu’elle considère contribuer à la politique de la ville. Il en est ainsi de l’opération « école ouverte », mise en oeuvre depuis 1991, qui consiste, selon l’éducation nationale, « à ouvrir les collèges et les lycées pendant les vacances scolaires, ainsi que les mercredis et samedis durant l’année scolaire, pour accueillir des enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances ». L’Éducation nationale considère que l’opération « école ouverte » doit avant tout bénéficier aux établissements situés en RAR. En 2009, 9,8 millions d’euros ont été consacrés à cette opération par le ministère de l’Éducation nationale, au titre, notamment, des dépenses de fonctionnement et de personnel consacrées à cette opération.
Dans son étude communiquée à la commission des Finances du Sénat sur l’articulation des dispositifs (106), la Cour des comptes souligne une certaine proximité, à tout le moins une complémentarité, entre le dispositif « école ouverte », piloté par l’Éducation nationale, et le programme « Ville, vie, vacances », mis en œuvre par l’Acsé. Celle-ci finance par ailleurs aussi le dispositif « école ouverte », pour un montant de 2,457 millions d’euros en 2009.
Beaucoup d’autres mesures prises par l’Éducation nationale en faveur des quartiers défavorisés relèvent de la dynamique « espoir banlieues » (DEB). La circulaire n° 2009-061 du 28 avril 2009 (107) dresse une liste de neuf mesures, pour lesquelles l’implication du ministère en matière organisationnelle est toujours nécessaire mais n’implique pas nécessairement de participations financières :
– la lutte contre le décrochage scolaire, menée notamment dans les 215 quartiers de la dynamique « espoir banlieues » (DEB), s’appuie sur un dispositif local de prévention défini dans une circulaire n° 2008-174 du 18 décembre 2008 (108) sur le modèle des instances en charge du programme de réussite éducative. La circulaire n° 2009-061 du 28 avril 2009 précise qu’« une attention particulière sera portée aux élèves lors de leur passage de troisième en seconde, notamment professionnelle. Les élèves se trouvant dans des situations d’absentéisme lourd, qui compromettent durablement leur réussite, feront également l’objet d’une grande vigilance. La coordination locale, qui rassemble tous les acteurs impliqués à l’échelle du quartier, notamment les chefs d’établissement, assure le repérage régulier des jeunes décrocheurs et leur prise en charge rapide par le biais de solutions individuelles adaptées ». La circulaire n° 2008-174 a fixé des objectifs chiffrés en matière de recul du décrochage scolaire, en précisant qu’il s’agit de « réduire le nombre de décrocheurs des 215 quartiers prioritaires [de la dynamique espoir banlieues] de 10 % et, à l’inverse, d’augmenter dans les mêmes proportions le volume de ceux qui auront reçu une solution d’orientation positive ». Selon les informations transmises par la direction du budget, ce dispositif a coûté au ministère de l’Éducation nationale 4 millions d’euros en 2009, auxquels s’ajoutent, selon l’Acsé, 914 770 euros versés par l’agence (109) ;
– les internats d’excellence, qui s’appuient sur un premier site d’ores et déjà en activité à Sourdun (Seine-et-Marne) et qui comptent 11 unités supplémentaires à compter de la rentrée scolaire 2010/2011 (110). Selon la circulaire 2009-061 du 28 avril 2009, le dispositif « est proposé à des collégiens et des lycéens scolarisés dans des établissements de l’éducation prioritaire et des zones urbaines sensibles qui ne disposent pas des conditions matérielles favorables leur permettant d’exprimer tout leur potentiel ». Du point de vue du financement (111), la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-237 du 9 mars 2010 a créé, dans le cadre du Grand emprunt, un nouveau programme « Internats d’excellence et égalité des chances » au sein de la mission « Enseignement scolaire », doté de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ; 200 millions d’euros, gérés par l’Anru, doivent être consacrés à la création de nouveaux internats d’excellence et à l’agrandissement ou à la rénovation d’internats existants et 300 millions d’euros doivent financer diverses actions ministérielles ou interministérielles favorisant la mixité sociale et l’égalité des chances permettant de développer l’accès à la culture scientifique, en particulier pour les jeunes de condition sociale modeste ;
– l’ouverture sociale des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), en visant à la fois l’objectif d’un taux d’au moins 5 % des élèves de terminale dans chaque lycée présentant un dossier d’admission en CPGE et l’objectif, à compter de 2010, de 30 % d’élèves boursiers dans les effectifs des CPGE ;
– l’extension de la faculté de proposer le dispositif de l’accompagnement éducatif dans toutes les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire, alors que la prise en charge correspondante (deux heures par jour quatre jours par semaine pour une aide au travail scolaire et à la pratique d’activités artistiques, culturelles ou sportives) était, avant cette extension, uniquement proposée dans les collèges.
Le coût de ce dispositif, qui n’est pas sans rappeler le programme de réussite éducative géré par l’Acsé, semble difficile à cerner : selon la direction du budget qui a interrogé le ministère de l’Éducation nationale, il est évalué en 2009 à 273 millions d’euros ; ce ministère, répondant cette fois à vos rapporteurs s’agissant de l’explicitation des éléments contenus dans le DPT « Ville », évalue ce coût à 136,5 millions d’euros toujours pour 2009. La Cour des comptes relève pour sa part que « dans le cadre de sa généralisation, 323 millions d’euros sont consacrés à ce nouveau dispositif » (112). Ces écarts s’expliquent sans doute par la prise en compte du coût soit de l’accompagnement éducatif dans son ensemble, soit de son extension aux écoles élémentaires relevant de l’éducation prioritaire (extension qui constitue la mesure relevant de la dynamique « espoir banlieues »).
Même en considérant uniquement la mesure « DEB », les limites de la superposition entre l’éducation prioritaire et la politique de la ville évoquées supra doivent, là aussi, être soulignées : l’accompagnement éducatif dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire est ainsi mis en œuvre dans des établissements hors de tout zonage propre à la politique de la ville, ce qui n’est pas sans conduire à interroger sur la portée que l’on a souhaité donner à la dynamique « espoir banlieues », qui, en l’espèce, contient une mesure partiellement sans rapport avec les cadres géographiques classiques de la politique de la ville. En tout état de cause, la prépondérance du financement par le ministère de l’éducation nationale est manifeste puisque l’Acsé n’a financé l’accompagnement scolaire en 2009 qu’à hauteur de 4,6 millions d’euros (113) ;
– l’expérimentation de la mixité choisie, dite « busing », qui consiste à déplacer des classes situées dans une école souffrant d’une trop faible mixité sociale dans un établissement scolaire de la même commune, sur la base du volontariat du maire, des enseignants qui accompagnent la classe « délocalisée » et des parents des élèves concernés par le déplacement (114). La participation de l’éducation nationale, selon les informations de la direction du budget, semble se limiter à des consignes relevant de l’organisation. L’Acsé, pour sa part, précise qu’elle a consacré 376 023 euros en 2009 à cette expérimentation, pour assurer notamment le transport d’environ 280 élèves dans leur nouvel établissement. Il est assez difficile de savoir où en est effectivement cette expérimentation, la circulaire du 28 avril 2009 précisant que le « busing » a été expérimenté dans sept communes (115) durant l’année scolaire 2008/2009, ce chiffre devant être doublé pour l’année scolaire 2009/2010. Initialement, 50 écoles situées dans des communes relevant des territoires de la politique de la ville devaient être concernées dès la rentrée de l’année scolaire 2008/2009 ;
– les sites d’excellence, dispositif consistant, pour 30 lycées localisés dans des zones relevant de la politique de la ville et concentrant, s’agissant de leurs élèves, des difficultés scolaires et sociales très lourdes, à valoriser leurs spécificités afin d’améliorer les résultats scolaires et aux examens de ces élèves et, partant, de renforcer leur attractivité. Le projet d’établissement, obligatoire au titre de l’article L. 401-1 du code de l’éducation, doit être le vecteur privilégié de la mise en œuvre de cette stratégie, par l’intermédiaire, le cas échéant, des expérimentations rendues possibles par le troisième alinéa de cet article (116). Aucun financement spécifique par l’éducation nationale ou l’Acsé n’est identifiable en faveur de cette mesure ;
– les 200 (117) dispositifs expérimentaux de réussite scolaire en lycée, dont l’objet est ainsi défini par la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2008-075 du 5 juin 2008 : « complément des enseignements, ce dispositif a pour objet d’apporter un appui individualisé aux élèves en fonction de leurs besoins, afin de favoriser la réussite scolaire, prévenir les redoublements, limiter les abandons de cursus, notamment en lycée professionnel, et préparer la poursuite d’études supérieures ». Sont notamment prévus pour les élèves volontaires une aide au travail scolaire, un entraînement aux épreuves des examens, l’élaboration et l’approfondissement du projet d’orientation et une préparation à la poursuite d’études supérieures. S’agissant du financement, la circulaire n° 2008-075 du 5 juin 2008 évoque notamment les rémunérations de 1 500 assistants d’éducation supplémentaires, évaluées, en 2009, dans les documents fournis par la direction du budget, à 36,1 millions d’euros ;
– les banques de stages, mises en œuvre dans chaque académie, afin, dans un souci d’équité, de rendre l’offre de stages plus accessible aux élèves de troisième, aux lycéens et aux étudiants des sections de techniciens supérieurs des quartiers défavorisés. La note de service n° 2009-127 du 17 septembre 2009 du directeur général de l’enseignement scolaire contient en annexe un « cahier des charges national pour la mise en place des banques académiques de stages ». Ce cahier des charges précises ainsi que la « participation [du dispositif] à la dynamique “espoir banlieues” implique de veiller à ce qu’elle bénéficie en particulier aux élèves habitant dans les quartiers de la politique de la ville ». Aucun moyen supplémentaire ne semble prévu en faveur de cette action, la note de service du 17 septembre 2009 indiquant que « la banque académique de stages sera mise en place, grâce à une mise en réseau informatique des ressources disponibles dans [l’] académie. » ;
– la fermeture des collèges les plus dégradés pour laquelle une enveloppe de 40 millions d’euros gérés par l’Anru au titre des années 2010 et 2011 a été prévue. Selon l’Anru, les critères de sélection des collèges concernés sont relatifs à un bâti dégradé, au manque de mixité sociale, à la persistance de la faiblesse des résultats scolaires et à la désaffection des élèves et des enseignants. Trente collèges doivent être « sélectionnés » dans le cadre de cette opération.
3. La contribution du ministère chargé de l’emploi à la politique de la ville
Le problème de l’emploi dans les zones urbaines sensibles présente une acuité particulièrement préoccupante que les tableaux suivants, extraits du rapport 2009 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) (118), illustrent clairement.
TAUX DE CHÔMAGE MOYEN PAR AN ( %) DES 15-59 ANS SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE
Année |
France métropolitaine |
ZUS |
Quartiers Cucs |
ZFU |
ZRU |
Quartiers hors ZUS des unités urbaines possédant des ZUS |
2003 |
8,1 |
17,2 |
15,3 |
18,4 |
19,4 |
8,7 |
2004 |
8,6 |
18,9 |
14,3 |
20,2 |
21,5 |
9,3 |
2005 |
8,7 |
20,0 |
14,1 |
20,1 |
24,9 |
9,6 |
2006 |
8,9 |
19,5 |
14,6 |
21,4 |
23,4 |
9,4 |
2007 |
8,1 |
17,8 |
13,6 |
19,0 |
20,5 |
8,6 |
2008 |
7,5 |
16,9 |
12,4 |
16,5 |
21,4 |
7,7 |
Source : enquêtes emploi en continu 2003 à 2008 de l’INSEE-Calculs ONZUS
ÉVOLUTION ENTRE 2006 ET 2008 DU TAUX DE CHÔMAGE PAR ÂGE ET SEXE
ZUS |
Quartiers hors ZUS des unités urbaines ayant une ZUS | |||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Hommes |
||||||
15-24 ans |
36,6 |
31,4 |
41,7 |
21,1 |
19,0 |
19,1 |
25-49 ans |
17,2 |
16,8 |
14,6 |
7,7 |
7,3 |
6,4 |
50-59 ans |
13,0 |
13,5 |
12,9 |
7,3 |
6,2 |
5,8 |
15-59 ans |
19,1 |
18,4 |
18,1 |
9,2 |
8,4 |
7,7 |
Femmes |
||||||
15-24 ans |
35,6 |
31,1 |
29,6 |
21,5 |
18,8 |
16,1 |
25-49 ans |
19,8 |
16,3 |
15,1 |
8,8 |
8,3 |
7,3 |
50-59 ans |
10,0 |
9,9 |
8,5 |
6,0 |
5,7 |
4,7 |
15-59 ans |
20,0 |
17,0 |
15,6 |
9,6 |
8,9 |
7,7 |
Ensemble 15-59 ans |
19,5 |
17,8 |
16,9 |
9,4 |
8,6 |
7,7 |
Source : enquêtes emploi en continu 2003 à 2008 de l’INSEE-Calculs ONZUS
De façon générale, on observe que les taux de personnes sans emploi en ZUS sont systématiquement un peu plus de deux fois plus élevés que dans les quartiers hors ZUS des unités urbaines ayant une ZUS, l’écart étant encore un peu plus marqué si l’on considère l’ensemble du territoire métropolitain. Cette situation caractérisée par un chômage plus de deux fois plus élevé en ZUS qu’ailleurs est vérifié pour les deux sexes et quelle que soit la tranche d’âge considérée. Cet écart est relativement stable depuis 2005 et le dernier rapport de l’ONZUS, constatant l’inflexion de la courbe du chômage au milieu de l’année 2008 jusqu’à fin 2009 du fait de la crise économique, signale que ses effets sur l’emploi n’ont pas semblé plus forts sur cette période en ZUS qu’ailleurs.
Dans ce contexte, Le DPT « Ville » associé au PLF 2010 précise que le programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » concoure à la politique transversale « Ville » à hauteur de 276,974 millions d’euros en crédits de paiement et ce uniquement au titre de l’action relative à l’amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi de personnes les plus éloignées du marché du travail (119). Ces montants recouvrent à la fois le coût des contrats aidés dont bénéficient les personnes résidant en ZUS et les crédits réservés au financement du contrat d’autonomie, principale mesure en matière d’emploi de la dynamique « espoir banlieues ».
a) Les contrats aidés attribués aux personnes résidant dans les zones urbaines sensibles
Selon le rapport de l’ONZUS, les habitants des ZUS représentent entre 12 % et 13 % de l’ensemble des demandeurs d’emplois (120). Ce constat est corroboré par les éléments transmis à vos rapporteurs par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Selon cette dernière, « en 2008, les résidents des ZUS de France métropolitaine représentent 13,6 % (121) des entrants dans les trois principaux contrats aidés issus du Plan de cohésion sociale (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’avenir et contrat initiative emploi) contre 12,7 % en 2007 […] ». Le rapport de l’ONZUS précise, pour sa part, qu’en 2008 :
– 106 232 contrats d’avenir (CAV – ouvert, dans le secteur non marchand, aux bénéficiaires de minima sociaux) ont été signés, dont 15,1 % avec des habitants en ZUS. Ce taux s’élève à 16,6 % pour la tranche d’âge des moins de 26 ans ;
– 168 915 contrats d’accompagnent dans l’emploi (CAE – ouvert, dans le secteur non marchand, aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles) ont été signés, dont 12,9 % avec des habitants en ZUS. Ce taux s’élève à 16,6 % pour la tranche d’âge des moins de 26 ans ;
– 35 536 contrats initiative emploi (CIE – offert, dans le secteur marchand, aux personnes rencontrant des difficultés importantes d’accès à l’emploi) ont été signés, dont 12,2 % avec des habitants en ZUS. Ce taux s’établit à 14,6 % pour la tranche d’âge des moins de 26 ans ;
Pour une population représentant environ 12 % des demandeurs d’emplois, les habitants des ZUS ont donc bénéficié en 2008 d’entrées en contrats aidés pour un taux légèrement supérieur, soit 13,6 %.
Deux modalités de présentation, qui ne sont pas théoriquement incompatibles, du « traitement social » du chômage dans les ZUS peuvent être considérées dans cette perspective :
– le coût global de tous les contrats aidés, de droit commun, attribués à des habitant des ZUS est considéré comme concourant à la politique de la ville. C’est le choix opéré par le DPT « Ville » ;
– Seul est pris en compte le coût de la différence entre la proportion des contrats aidés attribués aux résidents des ZUS et la proportion des mêmes résidents dans l’ensemble des demandeurs d’emplois, en tant que cette différence constituerait l’effort supplémentaire de cette partie de la politique nationale de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ainsi, selon la DGEFP, compte tenu de ce que cette différence apparaît faible, « la part des résidents en ZUS dans les contrats aidés est conforme à leur poids » dans la catégorie des demandeurs d’emplois. Au-delà de cette approche statistique et budgétaire de la mise en œuvre du « traitement social » du chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il apparaît que les résidents en ZUS ont constitué et constituent encore le cas échéant une catégorie prioritaire dans les publics concernés par l’attribution des contrats aidés.
Il faut en premier lieu évoquer de nouveau le dispositif des contrats d’adultes relais (environ 4 000 contrats mis en œuvre actuellement), qui constituent une forme de contrats aidés réservés aux résidents de ces quartiers prioritaires et qui ont pour particularité d’être relativement longs (trois ans renouvelables), alors que la durée d’un CAE ou d’un CIE varie, en règle générale, de six à vingt-quatre mois (122). S’agissant des CIE et CAE, on peut relever que :
– dans une circulaire n° 2006/44 du 15 décembre 2006 du ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement (123), le ministre précise à ses interlocuteurs qu’ils doivent, au titre de l’année 2007, « veiller […] au renforcement des politiques territoriales en faveur des ZUS et des quartiers sensibles, et plus particulièrement à favoriser l’accès des habitants de ces quartiers à l’ensemble des dispositifs (notamment aux contrats aidés et aux mesures d’aide à la création d’entreprises), en articulation avec les contrats urbains de cohésion sociale » ;
– dans une circulaire n° 2008-02 du 17 janvier 2008 du ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi (124), le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle précise à ses interlocuteurs que l’un des objectifs du service public de l’emploi pour 2008 est « la réduction des écarts de chômage entre les zones urbaines sensibles et les territoires environnants ». Il n’est pas cependant précisé que les résidents en ZUS doivent plus particulièrement bénéficier des contrats aidés dont les modalités de répartition et d’attribution sont décrites dans la circulaire.
Cette attention spécifique portée aux résidents des ZUS, notamment en matière de contrats aidés, a disparu à compter de 2009 des instructions ministérielles portant sur la programmation des politiques de l’emploi. Selon la DGEFP, « depuis 2009 et la dégradation de la situation économique, cette mention n’a plus été explicite dans les circulaires nationales en raison de l’élargissement des publics éligibles » aux dispositifs relatifs au « traitement social » du chômage. Néanmoins, dans les arrêtés pris par les préfets de région pour 2010 en application des instructions nationales, on observe que les résidents des ZUS ou des quartiers Cucs constituent des publics prioritaires s’agissant des modalités d’attribution des aides financières de l’État associées à la mise en œuvre d’un contrat aidé :
– quatre régions (Aquitaine, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Picardie) ont mis en œuvre une majoration – d’ampleur limitée – de l’aide de l’État associée au CAE pour tous les résidents des ZUS ou des quartiers Cucs. Cette majoration consiste à porter l’aide à 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, au lieu, en règle générale, de 90 % pour les publics éligibles non spécifiquement prioritaires ;
– trois régions (Bretagne, Centre et Lorraine) ont mis en œuvre une majoration de l’aide d’État associée au CAE réservée aux « jeunes » résidents des ZUS ou des quartiers Cucs. Là aussi, la majoration consiste à porter l’aide à 95 % de la rémunération du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, contre 90 % pour les publics éligibles mais non spécifiquement prioritaires ;
– une région (Île-de-France) prévoit une majoration de l’aide de l’État associée au CIE pour tous les résidents des ZUS. Cette majoration consiste à porter l’aide de 35 % à 45 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée ;
– trois régions (Bourgogne, Languedoc-Roussillon et Pays-de-la-Loire) prévoient une majoration de l’aide de l’État associée au CIE réservée aux « jeunes » résidents en ZUS. Cette majoration consiste à mettre en œuvre une aide correspondant à 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, contre 40 % pour certaines autres catégories de publics éligibles.
Les résidents des ZUS, particulièrement les jeunes, constituent ainsi, de façon effective mais limitée, un public prioritaire des contrats aidés de droit commun, qui constituent la principale modalité du « traitement social » du chômage.
Cette priorité est d’ailleurs relativement faiblement pondérée : la différence entre le financement à 90 % ou à 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée s’agissant des CAE, demeure ainsi objectivement limitée. Ce constat est, lui aussi, de nature à relativiser la présentation faite par le DPT « Ville » du concours des politiques de « traitement social » du chômage à la politique de ville, tant cette présentation s’appuie sur la prise en compte de tous les contrats aidés attribués aux résidents des ZUS et non sur ce que représente ce « coup de pouce », qui ne constitue qu’une fraction assez limitée de cet ensemble de contrats aidés. Au demeurant, ce constat d’une attention supplémentaire assez ténue en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville corrobore celui de vos rapporteurs quant à l’impression que leur ont laissée en la matière les responsables nationaux de la politique de l’emploi. Ce constat ne constitue pas une critique tant la gravité de la situation de l’emploi dans l’ensemble du pays rend difficile de distinguer des publics plus prioritaires que les autres.
Le contrat d’autonomie, réservés aux jeunes de 16 à 25 ans, est la principale disposition en faveur de l’emploi des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville de la dynamique « espoir banlieues ». Vos rapporteurs reviendront ultérieurement sur le sens et la portée consistant à confier sa mise en œuvre à la DGEFP et non aux administrations en charge de la politique de la ville. Les présents développements ont uniquement pour objet de présenter ce dispositif, ainsi que quelques éléments concernant sa mise en œuvre.
Le cahier des charges des appels d’offres prévoyait que les prestataires s’engagent, selon la DGEFP, sur les éléments suivants :
« – promouvoir la prestation auprès du public cible par tout moyen : publicité, réunions locales, démarchage individuel ou collectif… et s’efforcer en priorité de prospecter et d’accueillir de façon personnalisée les jeunes non suivis à ce jour par le service public de l’emploi ;
« – mettre en œuvre un accompagnement personnalisé et intensif avec un conseiller pour 50 jeunes et au minimum un entretien hebdomadaire ;
« – Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre rapidement aux besoins du bénéficiaire dans le cadre de son parcours, notamment : problèmes de mobilité réguliers ou ponctuels (achat de cartes de bus, de billets de train, aide au financement du permis…), achat de vêtements ou matériels pour le travail ;
« – Verser au bénéficiaire une bourse de trois cents euros par mois pendant six mois maximum sous réserve du respect par le bénéficiaire des termes du contrat d’autonomie. »
La période pendant laquelle le prestataire est lié au jeune pris en charge est de six mois maximum, renouvelable une seule fois. Au terme de cette période, l’objectif est que le jeune pris en charge sorte du dispositif de façon « positive », c’est-à-dire qu’il soit titulaire d’un emploi durable, bénéficiaire d’une formation qualifiante ou ait créé son entreprise. En cas de sortie « négative » du dispositif pour le jeune (consécutivement à un abandon de la démarche ou à l’absence d’issue positive au terme de la période de prise en charge), le prestataire ne perçoit que 40 % du montant du prix unitaire par jeune prévu par le marché dont il est titulaire. Ce système d’intéressement est complété par la clause selon laquelle les 25 % du solde dû au titre de ce prix unitaire sont versés six mois après une sortie positive du dispositif uniquement si, au terme de ces six mois consécutifs à la sortie du dispositif, le jeune concerné est encore en emploi ou en formation qualifiante.
Selon le SG-CIV, son coût en année pleine s’est élevé en 2009 à 46 millions d’euros en crédits de paiement (101,02 millions d’euros ont été ouverts en autorisations d’engagement pour le même exercice budgétaire). Le DPT « Ville » associé au PLF 2010 précise qu’au sein des 276,974 millions d’euros (125) du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » considérés comme concourant à la politique de la ville, 65 millions d’euros (126) sont prévus pour le financement du contrat d’autonomie.
Mis en œuvre à compter du second semestre de l’année 2008 et pour une durée de trois ans, le contrat d’autonomie a fait l’objet d’un appel d’offre constitué de 35 lots répartis sur 35 départements (2 lots ont été attribués dans le Nord et un seul pour les départements du Puy-de-dôme et de la Haute-Loire) concernant au total 45 000 (127) contrats d’autonomie (170 offres au total ont été recueillies). Le tableau suivant permet d’observer les départements concernés, les prestataires associés au terme de l’attribution de chaque lot du marché, ainsi que le nombre des contrats d’autonomie que chacun d’entre eux est autorisé à mettre en œuvre :
LISTE DES OPÉRATEURS DU CONTRAT D’AUTONOMIE
PAR ORDRE DÉCROISSANT DU PLAFOND DU NOMBRE DE CONTRATS
Département |
Opérateur |
Nombre maximum de contrats d’autonomie |
Nord (Lille) |
Ingeus |
4 500 |
Bouches-du-Rhône |
Adrep |
3 200 |
Seine-Saint-Denis |
C3 Consultant |
3 000 |
Rhône |
Ingeus |
2 300 |
Pas-de-Calais |
ID Formation |
2 200 |
Seine-Maritime |
USG Restart |
1 900 |
Val-d’Oise |
USG Restart |
1 900 |
Yvelines |
C3 Consultant |
1 500 |
Essonne |
Ingeus |
1 400 |
Gironde |
Insermedia |
1 300 |
Hauts-de-Seine |
C3 Consultant |
1 300 |
Val-de-Marne |
Ingeus |
1 200 |
Bas-Rhin |
BPI |
1 200 |
Moselle |
Sodie |
1 200 |
Nord (Valenciennes) |
Ingeus |
1 100 |
Hérault |
Védior |
1 000 |
Marne |
Afec |
1 000 |
Loire-Atlantique |
CFP Presqu’île |
1 000 |
Haute-Garonne |
AFU |
900 |
Oise |
C3 Consultant |
900 |
Seine-et-Marne |
UPROMI |
900 |
Haut-Rhin |
Sémaphore Mulhouse Sud |
900 |
Doubs |
A4e |
800 |
Aisne |
Infrep |
800 |
Paris |
Aide au choix de vie |
800 |
Gard |
Carrière Formation |
800 |
Somme |
Retravailler Picardie |
700 |
Maine-et-Loire |
Retravailler |
700 |
Isère |
Adecco |
700 |
Ille-et-Vilaine |
C3 Consultant |
600 |
Eure-et-Loir |
Afec |
600 |
Sarthe |
RWF |
600 |
Meuthe-et-Moselle |
AFPA |
600 |
Puy-de-Dôme/Haute-Loire |
ADELFA entreprendre |
600 |
La Réunion |
Mission Intercommunale de l’Ouest |
900 |
Total |
45 000 |
Source : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
Selon les éléments transmis par la DGEFP, le dispositif du contrat d’autonomie a acquis sa vitesse de croisière à compter des mois de mai et de juin 2009 ; en 2008, seuls 3 000 des 4 500 contrats programmés avaient été signés. À la fin de 2009, 21 000 contrats d’autonomie avaient été signés, sur un rythme pour le second semestre de cette année laissant présager l’atteinte de l’objectif de 45 000 contrats signés sur trois ans. Les difficultés initiales de la mise en œuvre du dispositif s’expliqueraient par son caractère innovant : s’appuyant sur le constat que les acteurs classiques des politiques de l’emploi ne parviennent pas réellement à amorcer la décrue du chômage des jeunes dans les quartiers de la politique de la ville et que, au surplus, ces acteurs n’ont plus la confiance des jeunes en la matière, le dispositif du contrat d’autonomie a fait le pari de solliciter la participation d’une catégorie nouvelle d’acteurs devant organiser une prise en charge très volontariste des jeunes privés d’emplois. En conséquence, les prestataires ont visiblement eu besoin d’un certains temps pour, à la fois, s’intégrer dans un paysage institutionnel en matière d’aides à l’emploi déjà très dense et réussir leur rencontre avec des jeunes peu rompus dans l’ensemble au suivi scrupuleux des engagements réciproques.
Selon la DGEFP, « le public du contrat d’autonomie est conforme à la cible. Il s’agit majoritairement de jeunes hommes non qualifiés. Il s’agit du public qui rencontre le plus de difficultés d’insertion ». Un communiqué de presse de Mme Fadela Amara, secrétaire d’État chargé de la politique de la ville en date du 25 mars 2010, a précisé que 50 % des jeunes concernés n’ont aucune qualification. Un autre élément relevé par la DGEFP montre que les opérateurs du contrat d’autonomie agissent en s’appuyant désormais plus sur leurs propres ressources : « on assiste à la baisse parmi les entrants de la part des jeunes orientés par le service public de l’emploi [SPE] au profit de jeunes contactés directement par l’opérateur ou qui se présentent spontanément. Sur le premier trimestre 2010, l’orientation par le SPE ne représente plus que 30 % des bénéficiaires contre plus de 50 % en janvier 2009. »
S’agissant des résultats du dispositif, la DGEFP tirait le bilan suivant au 28 mars 2010 :
– sur 12 500 jeunes sortis du dispositif, 4 470, soit un taux de 36 %, ont bénéficié d’une sortie « positive » (68 % dans un emploi durable, 30 % pour une formation qualifiante et 2 % pour une création d’entreprise) ;
– le taux des sorties positives est en amélioration sur la durée : s’établissant à 26 % en septembre 2009, il s’élève à environ 40 % sur les trois premiers mois de l’année 2010 ;
– s’agissant des sorties « négatives », qui représentent donc 64 % des contrats d’autonomie mis en œuvre, une grosse moitié a pour origine l’abandon de la démarche d’accompagnement et une petite moitié a pour origine l’absence de solutions positives au terme de cette démarche.
4. La contribution du ministère chargé du logement à la politique de la ville
Selon le DPT « Ville » associé au PLF 2010, le programme 109 « Aide à l’accès au logement » devait contribuer de façon substantielle à la politique de la ville, à hauteur de 737,673 millions d’euros tant en crédits de paiement qu’en autorisations d’engagement (128), au titre de la seule action « Aides personnelles », qui prévoit le financement :
– de l’aide personnalisée au logement (APL), versée sous conditions de ressources aux ménages logés dans un logement social ou dans un logement conventionné au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (1 % logement) ;
– de l’allocation de logement social (ALS), versée sous conditions de ressources aux ménages logés dans un logement qui ne les rend pas éligibles au bénéfice de l’APL.
Pour calculer la quote-part de ces aides attribuées aux résidents des ZUS, le DPT « Ville » indique que « la part des ménages bénéficiant d’une aide personnelle au logement (APL et ALS) résidant en ZUS est estimée à 13,76 % » (129). Cette clé est ainsi appliquée au montant des aides attribuées sur l’ensemble du territoire. Comme l’indique d’ailleurs le DPT « Ville », ce taux, appliqué pour l’exercice 2010, est identique à celui appliqué pour les exercices 2008 et 2009. Interrogé par vos rapporteurs sur son application uniforme dans le temps ainsi que sur les modalités de son calcul, la direction de l’urbanisme, de l’habitat et des paysages (DHUP) a fait la réponse suivante :
« Le taux de 13,76 % résulte d’un calcul réalisé en 2006. Faute de données disponibles, cette estimation n’a pas été actualisée depuis et ce pourcentage a été appliqué depuis lors aux montants des crédits APL et ALS actualisés chaque année. En matière d’aides au logement, le ministère chargé du logement ne tient en effet aucune statistique spécifique aux ZUS compte tenu de l’absence totale de particularités liées à ces zones », au regard du calcul et des conditions d’octroi de ces aides.
On observe que, s’agissant du programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables », le SG-CIV justifie l’absence d’estimation chiffrée de son concours à la politique de la ville par l’« absence d’actualisation du mode de calcul depuis plus de trois ans ». Cette situation, effectivement regrettable, n’a donc pas conduit aux mêmes effets que pour le programme 109 « Aides à l’accès au logement ».
On note aussi que le concours de ce programme à la politique de la ville relève d’une stricte application du droit commun. La DHUP précise ainsi qu’« il s’agit en fait de l’application du seul droit commun, les aides personnelles au logement ne présentant pas de spécificités en ZUS ». S’agissant de ces aides, la DHUP précise d’ailleurs que « les barèmes et les modalités de calcul des aides sont identiques en ZUS et hors ZUS ». Ce constat d’une absence d’apports spécifiques aux quartiers prioritaires de la politique de la ville est donc encore plus marqué que pour la politique relative au « traitement social » du chômage, puisque, pour cette dernière, les résidents en ZUS ou en quartiers Cucs constituent au moins partiellement un public prioritaire dans l’ensemble des publics éligibles aux contrats aidés de droit commun.
Dans la partie du DPT « Ville » qui décrit l’apport concret du programme 109 « Aides à l’accès au logement » à la politique de la ville, « l’accompagnement des publics en difficulté » est considéré comme l’une des actions mobilisées à ce titre, en plus des aides personnelles au logement. Or, seules ces dernières font l’objet d’une estimation chiffrée quant à la part de leur coût total qui peut être considérée comme concourant à la politique de la ville. En conséquence, l’estimation de l’apport budgétaire du programme 109 à la politique de la ville, au-delà des réserves que l’on peut émettre s’agissant du principe et de l’obsolescence des règles permettant son calcul, ne prend pas en compte toutes les actions mobilisées pour la politique transversale.
L’approche de l’apport de la politique nationale des aides au logement à la politique de la ville doit bien entendu, en outre, tenir compte du Plan national de rénovation urbaine (PNRU), dont le financement relève :
– des ressources de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), constituées en premier lieu d’une part de la contribution des employeurs à l’effort de construction, selon des modalités décrites supra ;
– d’une contribution budgétaire de l’État au titre du Plan de relance, par l’intermédiaire du programme 317 « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité ». Son action « Accélération de la rénovation urbaine » a permis l’ouverture de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement en 2009, qui ont permis l’attribution à l’Anru de 200 millions d’euros puis de 150 millions d’euros en crédits de paiement respectivement en 2009 et 2010.
Enfin, le programme 135 « Développement et amélioration de l’offre de logement » continue, de façon marginale, à contribuer à la politique nationale de rénovation urbaine, au titre « d’opérations engagées en ZUS avant la création de l’Anru en 2004 », pour un montant de 54,315 millions d’euros en 2009 et, selon les prévisions du DPT « Ville », de 39,457 millions d’euros en 2010. Il est aussi prévu qu’en 2010 le programme 135 contribue à la politique de la ville en matière de financement d’études, pour un montant de 195 000 euros.
En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre le DPT « Ville » (page 83), le programme 135 n’est plus, à compter de 2010, la source du financement des dépenses de personnel du SG-CIV, des délégués du préfet et de certains des personnels des services déconcentrés de l’État. Ce financement relève désormais du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », ce dont le DPT « Ville » associé au PLF 2010 n’a pas non plus tiré les conséquences dans l’annexe relative à l’évaluation des crédits consacrés à la politique transversale, puisqu’elle ne mentionne pas cette nouvelle modalité de financement (cf. supra sur « l’oubli » évoqué par le SG-CIV dans ses réponses sur les programmes censés concourir à la politique de la ville sans identification des crédits correspondants).
5. Les contributions des autres ministères à la politique de la ville
Le DPT « Ville » associé au PLF 2010 énumère (pages 80 et 81) un certain nombre de programmes budgétaires concourant à la politique de la ville, hors ceux déjà évoqués supra (concernant, y compris dans le cadre du Plan de relance, l’éducation nationale, l’emploi et le logement). Ces « autres » programmes, en termes de crédits consacrés à la politique de la ville, ne représentent que 7,14 % (266,829 millions d’euros) de l’ensemble des crédits du budget général repris dans l’annexe relative à l’évaluation des crédits consacrés à la politique de la ville ; la moitié de ces crédits relève du seul programme 176 « Police nationale » pour 135,508 millions d’euros. Les développements suivants sont consacrés à ces crédits, afin d’évoquer tout autant la grande variété des actions considérées comme concourant à la politique de la ville que celle des modalités de calcul des concours budgétaires correspondants.
a) Sécurité et défense: les programmes 176 « Police nationale », 152 « Gendarmerie nationale » et 178 « Préparation et emploi des forces »
Le DPT « Ville » associé au PLF pour 2010 ne cache pas qu’il est difficile de justifier le calcul des 135,508 millions d’euros du programme 176 « Police nationale », au titre du concours apporté à la politique de la ville. Ainsi, selon ce document (130), « les systèmes d’information [de la police nationale] ne permettent pas de territorialiser les indicateurs aux quartiers de la politique de la ville », ce qui corrobore les observations du secrétariat de l’ONZUS faites à vos rapporteurs sur l’impossibilité de mesurer l’intensité des moyens mis en œuvre par la police nationale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette difficulté est encore rappelée un peu plus loin, quand le DPT « Ville » évoque la modification des modalités de calcul, à compter de 2010, de cette contribution de la police nationale à la politique de la ville. Le passage de la prise en compte du coût des actions menées en faveur des quartiers prioritaires en 2009 à l’identification des équivalents temps plein travaillé (ETPT) en 2010 a été mis en œuvre « dans la limite des systèmes d’informations employés en police nationale ». Cette modification conduit d’ailleurs à un relèvement « technique » du montant de la contribution du programme 176 à la politique de la ville d’un peu plus de 25 millions d’euros.
Ces difficultés, qu’il ne s’agit pas de négliger, rendent cependant assez mal compte de l’enjeu de la sécurité publique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des moyens dont disposent les services chargés de l’assurer. S’agissant de la situation dans ces quartiers, les rapports successifs de l’ONZUS montrent une mesure de la délinquance un peu plus faible dans les ZUS dont la police nationale a la charge que dans les unités urbaines auxquelles ces ZUS appartiennent. Mais le niveau de la victimisation et de l’insécurité, dont la mesure est réalisée par sondage, y est plus élevé que dans le reste du territoire. Au demeurant, tous les acteurs locaux rencontrés sur le terrain par vos rapporteurs soulignent l’importance de la sécurité publique s’agissant des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; la mesure de l’activité des forces de sécurité publique que constitue l’état 4001 (131) ne rend sans doute pas fidèlement compte des faits de délinquance que la population peut constater ; il est certainement difficile pour cette population d’en faire part aux forces de l’ordre.
La direction générale de la police nationale (DGPN) considère, pour sa part, qu’un certain nombre de quartiers parmi les plus difficiles, situés notamment en Île-de-France, sont marqués par des faits spécifiques de violence et une dérive délinquante en grande partie liée au trafic de cannabis (qui constitue l’assise de ce qu’il est convenu d’appeler « l’économie souterraine ») ; sans parler de « zones de non droit », la DGPN évoque des « zones de faible droit ». Si le nombre des délinquants, parfois jeunes et multi-récidivistes, y est faible au regard de la population, ceux-ci exercent néanmoins une pression négative forte sur les quartiers concernés.
Les mesures que le DPT « Ville » considère comme relevant d’un concours de la police nationale à la politique de la ville (132) sont, par exemple, le financement de certaines opérations du programme « Ville, vie, vacances » géré par l’Acsé ou la présence dans certains commissariats d’associations d’aide aux victimes d’infraction pénale, de travailleurs sociaux ou de psychologues. Dans le cadre de la dynamique « espoir banlieues », il faut bien entendu relever la création des unités territoriales de quartier (Uteq), dont l’objet est de « recentrer l’action des policiers autour de la dissuasion, de l’identification et de l’interpellation des délinquants, tout en resserrant les liens et la communication avec la population […] grâce à des effectifs disponibles, expérimentés et mieux intégrés dans leur environnement par une connaissance partagée du terrain avec les acteurs publics et privés de sécurité » (133). Vos rapporteurs ont pu constater à quel point les Uteq, ainsi que la motivation et la compétence des personnels qui les composent, sont appréciées sur le terrain. Instituées dans 34 quartiers, les Uteq deviendront bientôt des brigades spéciales de terrain (BST). Leur déploiement dans certains quartiers devrait se poursuivre en partie selon le rythme et la localisation initialement prévus s’agissant des Uteq.
Le DGPN, auditionné par vos rapporteurs, a par ailleurs énuméré un certain nombre d’autres dispositifs qu’il considère rattachés à la politique de la ville. Il en est ainsi des dispositifs de fidélisation des policiers dans les quartiers urbains sensibles :
– en septembre 2010, a lieu le premier concours de gardiens de la paix « fléché » Île-de-France, pour lequel les lauréats s’engagent à servir pendant au moins huit ans dans cette région. Selon la DGPN, le recrutement de « locaux » est un moyen efficace pour fidéliser les personnels en charge de la sécurité publique ;
– s’agissant des incitations financières, peut également être évoquée la prime de fidélisation, dont le montant atteindra 1 205 euros en 2013 pour une période de cinq ans de présence continue dans les zones les plus difficiles de la région Île-de-France. À ce dispositif, s’ajoute celui de l’indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques, pour les gradés et gardiens exerçant dans certaines zones d’Île-de-France (départements de la petite couronne et certaines zones difficiles dans d’autres départements), d’un montant pouvant atteindre 1 740 euros par an ;
– enfin, il est possible pour certains gardiens de la paix exerçant en Seine-Saint-Denis de devenir brigadier au terme d’une période moitié plus courte (de l’ordre de 3 à 4 ans) qu’en moyenne dans le reste du pays, dès lors que le policier concerné s’engage à continuer son activité dans ce département.
La DGPN considère par ailleurs que le recrutement de personnels de police dans les quartiers urbains difficiles constitue, peut-être à long à terme, une politique permettant le resserrement des liens entre la population et les forces de l’ordre. Au-delà du constat visuellement constatable, selon lui, de la diversification du recrutement des gardiens de la paix faisant plus de place aux minorités visibles, il évoque plus concrètement le dispositif des classes préparatoires intégrées, dont les bénéficiaires sont des élèves issus de milieux défavorisés, mis en œuvre à l’École nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse (ENSOP ; une telle classe préparatoire existe aussi auprès de l’école nationale supérieure des commissaires – ENSC – de Saint-Cyr-Mont d’or). Le DGPN précise par ailleurs que le recrutement des adjoints de sécurité est plus particulièrement entrepris dans les quartiers urbains difficiles ; ces personnels en contrat à durée déterminée feront à l’avenir l’objet d’un accompagnement sur le marché du travail à l’issue de leur contrat, y compris par la sensibilisation des organismes publics et des entreprises naturellement susceptibles de recruter des personnes formées aux métiers de la sécurité et disposant d’une expérience professionnelle en la matière.
S’agissant du concours à politique de la ville du programme 152 « Gendarmerie nationale », d’un montant prévisionnel de 20,142 millions d’euros en crédits de paiement au titre de 2010, le DPT « Ville » précise qu’il s’agit de prendre en compte :
– le coût des 34 brigades de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) « unités spécifiques se consacrant exclusivement à des missions dans les quartiers en difficulté » (134), sans préciser si ces quartiers appartiennent tous à l’un des zonages définissant les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La gendarmerie nationale explicite ainsi les missions des BPDJ : « prévenir, renseigner, faciliter et accompagner l’intervention » ;
– le coût des unités de droit commun au prorata de leur activité dans les zones urbaines sensibles dont la gendarmerie nationale a la charge (70 ZUS sur 751 sont dans les territoires où la sécurité publique est assurée par la gendarmerie nationale).
S’agissant de la contribution du programme 178 « Préparation et emploi des forces », le DPT « Ville » ne présente pas de justification du montant de 2,7 millions d’euros considéré comme concourant à la politique de la ville. Le même document énumère cependant trois mesures participant à la dynamique « espoir banlieues » :
– l’élargissement de l’accès aux lycées militaires par une politique de plus large information de leur objet notamment en direction des jeunes résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la création en leur sein de classes-relais dont les effectifs ont vocation à être composés au moins en partie de ces mêmes jeunes ;
– des mesures de tutorat des lycéens résidents des mêmes quartiers pour élargir le recrutement des grandes écoles militaires ;
– le dispositif des cadets de la défense, mis en œuvre dans le cadre de l’école nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent, qui propose la découverte de l’environnement et des métiers de la défense à quelques dizaines de jeunes chaque année. Le recrutement de ces jeunes semble régional et assez déconnecté de la géographie prioritaire de la politique de la ville.
b) Ministère de la justice : les programmes 101 « Accès au droit et à la justice », 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » et 107 « Administration pénitentiaire »
Le DPT « Ville » associé au PLF 2010 précise que ces trois missions contribuent à hauteur de 34,921 millions d’euros à la politique de la ville.
S’agissant du programme 101 « Accès au droit et à la justice », qui contribue à hauteur de 17,326 millions d’euros à la politique de la ville, sont pris en compte :
– 75 % des crédits d’intervention délégués au conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD), groupements d’intérêt public partenariaux présidés par les présidents des tribunaux de grande instance (qui comprennent 1 000 points d’accès au droit [PAD] et 50 antennes de justice), ainsi qu’aux maisons de justice et de droit (MJD). Sans justifier très précisément ce taux de 75 %, le DPT « Ville » précise qu’une « part importante » de ces points et antennes se trouvent en ZUS et que « 90 % des MJD sont implantées au sein des quartiers en ZUS » (135) ;
– 80 % des crédits de personnels affectés à l’action « Développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de proximité », notamment dans les PAD, MJD et antennes de justice. Le taux de 80 % est comparable à celui (75 %) des crédits d’intervention délégués dans les mêmes structures considérés comme contribuant à la politique de la ville ;
– 35 % des crédits délégués aux associations locales de médiation familiale, aux espaces de rencontre entre parents et enfants et aux structures mixtes assurant ces deux catégories d’actions ;
– 70 % des crédits délégués aux associations locales d’aide aux victimes, dont les juristes sont parfois associés à des fonctionnaires au sein de bureaux d’aide aux victimes qui, à titre expérimental, ont vocation à accueillir des victimes dans treize tribunaux de grande instance s’agissant du suivi de l’exécution par la personne reconnue coupable de sa peine. Si le taux de 70 % n’est étayé par aucune justification, il est en tout état de cause prévu qu’en 2010 ce dispositif expérimental soit étendu aux « départements où le taux de délinquance est élevé et/ou qui connaissent une augmentation importante des agressions aux personnes en particulier les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Il est également prévu de mettre en place [de tels] guichets uniques au sein des MJD » dans 25 quartiers dits « prioritaires » (136).
Le programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » recouvre des actions importantes du point de vue de la politique de la ville. Le DPT « Ville » (137)précise ainsi que « la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a pour mission la mise en œuvre des décisions de justice relatives aux mineurs délinquants, aux mineurs en danger et aux jeunes majeurs. Le traitement de la délinquance juvénile constitue la priorité de son action. L’accompagnement éducatif des mesures judiciaires s’inscrit dans le champ de l’action sociale et de l’insertion.
« À ce titre, la protection judiciaire de la jeunesse est un acteur important de la politique de la ville, et notamment des politiques partenariales territoriales de prévention de la délinquance, d’accès aux droits et devoirs des jeunes, et d’accès à la citoyenneté. »
Le programme 182 concourt à hauteur de 14,848 millions d’euros à la politique de la ville, notamment par la prise en compte, « forfaitairement », de 2,5 % de « l’activité des services éducatifs en milieu ouvert » représentant « le temps passé dans les diverses réunions et actions partenariales » par les personnels des services des directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ). S’agissant de la fonction « soutien », un taux forfaitaire de 10 % est retenu pour calculer la part de l’activité de ces services relevant de la politique de la ville. En tout état de cause, ces taux ne sont pas précisément justifiés, la méthode forfaitaire elle-même étant par ailleurs, d’une certaine manière, mise en cause par le DPT, puisqu’elle conduit de 2008 à 2010 à observer une baisse des crédits de la protection judiciaire de la jeunesse concourant à la politique de la ville du fait de la baisse du montant global des crédits consacrés à la PJJ sur cette période, alors que, selon le DPT « Ville » (138), cette baisse globale « ne devrait pas se traduire par une baisse corrélative de la participation de la PJJ à cette politique ».
Toujours pour le programme 182, est par ailleurs pris en compte le coût de certains personnels éducatifs dans les maisons de justice et de droit (MJD).
Enfin, le programme 182 concourt à trois mesures de la dynamique « espoir banlieues », pour un montant de 2,119 millions d’euros en 2009 :
– 33 % des 1 000 contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) signés chaque année entre 2009 et 2011 en faveur de jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse issus des 215 quartiers de la DEB. En 2009, si l’objectif a été numériquement atteint avec 429 contrats signés avec des jeunes issus de ces quartiers, la proportion (26,1 %) a été moindre qu’envisagée puisqu’au total 1 637 contrats ont été signés ;
– 50 % des 500 contrats de parrainage signés chaque année entre 2009 et 2011 en faveur de jeunes pris en charge par la PJJ issus des 215 quartiers de la DEB. Sans préciser si cette proportion a été atteinte, le DPT « Ville » considère que l’objectif n’a pas été atteint en 2009 puisque seuls 238 contrats ont été signés (139) ;
– 20 % des 25 jeunes issus des quartiers en difficulté formés chaque année dans le cadre de la classe préparatoire intégrée de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) issus des 215 quartiers de la DEB. Dans le cadre de la préparation au concours d’éducateur, cet objectif a été atteint.
S’agissant du programme 107 « administration pénitentiaire », 10 % de la masse salariale correspondant aux 374 agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) est forfaitairement retenue comme contribuant à la politique de la ville. Cette contribution recouvre la participation aux points d’accès au droit en milieu pénitentiaire (PAD), la collaboration avec les associations nationales et locales mettant en œuvre certaines activités en direction des personnes sous main de justice (organisation des aménagements de peine, des alternatives à l’incarcération, préparation à la sortie des personnes détenues), ou encore la mise en œuvre de certains CIVIS. « Dans la lignée » (140) de la dynamique « espoir banlieues », l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) a ouvert une classe préparatoire intégrée à la rentrée 2008 « au bénéfice d’étudiants modestes issus, notamment, des quartiers en difficulté ».
c) Autres programmes : programmes 219 « Sport », 163 « Jeunesse et vie associative », 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables », 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », 204 « Prévention et sécurité sanitaire » et 307 « Administration territoriale »
Le programme 219 « Sport » devait concourir à la politique de la ville à hauteur de 4,805 millions d’euros en 2010, le DPT « Ville » précisant que le Centre national pour le développement du sport a contribué par ailleurs à cette politique transversale à hauteur de 35,7 millions d’euros en 2008, montant qui devait être maintenu en 2009 et 2010. Aucune justification particulière n’est précisée dans le DPT « Ville » s’agissant des modalités de calcul de ces contributions. Ce document précise néanmoins que les actions mobilisées au titre de la politique de la ville sont le soutien aux actions des associations sportives et aux emplois associés, le soutien à la réalisation, la rénovation et l’aménagement d’équipements sportifs, ainsi que le programme « parcours animation sports » (PAS) qui proposent un accompagnement vers l’emploi, par l’intermédiaire d’un contrat aidé, associé à une pratique sportive, ce programme s’adressant « en particulier aux jeunes issus des zones urbaines sensibles » (141).
Le programme 163 « Jeunesse et vie associative » concourt à la politique de la ville, pour un montant total de 15,732 millions d’euros, selon les modalités financières suivantes :
– 25 % des crédits du volontariat associatif ;
– 30 % des crédits accordés au Conseil du développement de la vie associative (CDVA) au titre du financement de la formation des bénévoles du monde associatif ;
– 20 % des crédits consacrés aux projets éducatifs locaux ;
– 20 % des crédits alloués aux associations locales de jeunesse, ce taux ressortant « d’une enquête de 2007 qui avait permis d’estimer à 20 % la part des contrats ou projets concernant le volet éducatif des Cucs » (142) dans cette catégorie de crédits. Cette justification est la seule produite dans le DPT « Ville » s’agissant des modalités de calcul du concours à la politique de la ville du programme 163 ;
– 20 % des crédits alloués de façon déconcentrée aux associations locales d’éducation populaire ;
– 20 % des crédits alloués aux Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) destinés à l’aide à l’emploi associatif ;
– 30 % des bourses individuelles accordées au titre de la préparation aux diplômes non professionnels d’animation, notamment le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ;
– 60 % des crédits destinés au financement des « parcours animation sport » (PAS). On peut noter que si ce taux n’est pas précisément justifié, même si le DPT « Ville » précise que ce programme s’adresse à des « jeunes notamment des zones urbaines sensibles » (143), il est ainsi fixé, et ce contrairement au cas du programme 219 « Sport » s’agissant pourtant du même dispositif ;
– 2 millions d’euros au titre de subventions accordées aux associations nationales de jeunesse et d’éducation populaire. Ces crédits sont reconduits depuis 2006 dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs et de conventions annuelles, qui précisent depuis cette date leur destination « en direction des quartiers sensibles » (144).
Enfin, dans le cadre de la dynamique « espoir banlieues » et du programme 163, les associations intervenant dans le champ de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport dans les 215 quartiers prioritaires ont été répertoriées et, le cas échéant, mises en réseau ou assistées. Certaines de leurs actions, relatives à la thématique du lien social, ont été « labellisées ». Au-delà de cette procédure de labellisation, « un soutien financier a pu être accordé à certaines actions ; toutefois aucun crédit spécifique n’ayant été délégué, celui-ci a été assuré soit dans le cadre de la poursuite d’un soutien existant, soit par redéploiement des crédits existants. » (145)
Le programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » concourt à la politique de la ville, pour un montant total de 6,744 millions d’euros, selon les modalités financières suivantes :
– 15 % des crédits alloués aux points d’accueil et d’information des jeunes (PAEJ), selon une estimation du nombre de ces points situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
– 20 % des crédits d’aide alimentaire de l’État, selon une estimation du montant de ces crédits effectivement utilisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
– financement de 370 postes associatifs par l’intermédiaire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP), postes dont la gestion est déléguée à l’Acsé.
Le DPT « Ville » indique (146) que l’évaluation des crédits du programme 177 est « incomplète, du fait des difficultés liées à la localisation à un niveau infra-départemental des dépenses d’action sociale de l’État », ce qui conduit notamment à ne prendre en compte que la partie des crédits de l’aide alimentaire à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » concourt à la politique de la ville, pour un montant total de 11,509 millions d’euros, par application à certaines de ses actions (soutien à l’éducation artistique et culturelle et actions en faveur de l’accès à la culture) d’un taux de 14 %. Ce taux « correspond à la part de la population des quartiers de la politique de la ville dans la population nationale » (147). En effet, « le ministère de la culture ne dispose pas, pour le moment, de moyens permettant d’identifier au sein [de ces actions] ceux des crédits consacrés à la politique de la ville » (148).
Ce taux constitue ainsi, d’une certaine façon, une référence, qui permet d’ailleurs de mieux considérer d’autres taux permettant le calcul de contributions d’autres programmes ; en effet, comme il a été constaté supra, beaucoup de ces taux sont supérieurs à 14 %. Ce constat peut constituer une base de travail pour distinguer dans ces contributions ce qui relève du strict droit commun et ce qui relève d’un effort supplémentaire en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le droit commun. En l’espèce, il constitue néanmoins une méthode sans doute un peu trop approximative pour le calcul de la contribution du programme considéré.
Le programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire » contribue à la politique de la ville, pour un total de 16,7 millions d’euros, au titre d’une estimation du nombre et du coût des actions menées par les groupements régionaux de santé publique (GRSP) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au titre de 2008, 1 208 des 8 352 actions (soit 14,46 %) menées par ces groupements l’ont été dans une ZUS, un site relevant de l’éducation prioritaire (ce qui, en toute rigueur, ne relève pas nécessairement de la politique de la ville, comme il a été vu supra dans les développements relatifs à l’éducation nationale), un quartier Cucs ou dans le cadre d’un atelier santé-ville (ASV).
Cette modalité de calcul n’est pas sans intérêt, car elle est assez fine et, à ce titre, relativement exemplaire. Elle permet aussi de constater que le poids des sites de la politique de la ville dans l’action des GRSP n’est pas beaucoup plus élevé que le poids de leur population dans la population nationale (13 à 14 %), ce qui infirme l’idée d’une prise en compte plus particulière des habitants des sites urbains défavorisés dans la politique de la santé publique. Ce constat, fait au titre d’une catégorie d’actions en matière de santé publique, doit peut-être être replacé dans le contexte plus général du programme 204, dont le DPT précise, par ailleurs (page 38), que « l’ensemble [de ses actions] concourt pour partie à la politique de la ville ». Le même document identifie d’ailleurs certaines problématiques de santé publique propres aux populations défavorisées des sites urbains (taux d’enfants obèses, problèmes de santé mentale des populations les plus précarisées) et décrit une implication actuelle et à venir (directions déconcentrées sanitaires et sociales, agences régionales de santé) des services relevant du programme 204 que le calcul de la contribution financière évoquée ne reflète sans doute pas dans sa totalité, raison pour laquelle il serait sans doute nécessaire de la préciser.
Le programme 307 « Administration territoriale » concourt à la politique de la ville à hauteur de 18,068 millions d’euros, selon une estimation des moyens des préfectures que celles-ci consacrent à l’animation et au suivi de la politique de la ville.
Ce montant représente 7 % des crédits totaux de l’action « Pilotage territorial des politiques gouvernementales ». L’interprétation de ce taux n’est pas sans difficulté ; en effet, s’il peut apparaître comme révélant une implication des services déconcentrés de l’État plus faible que le poids de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans la population nationale (13 à 14 %), l’effort correspondant n’existe qu’associé à la mise en œuvre de la politique de la ville et peut être considéré, sous cet angle, comme une contribution supplémentaire en faveur de ces quartiers, au-delà de la stricte mise en œuvre du droit commun.
6. Quelle synthèse concernant les apports du droit commun en matière de politique de la ville ?
Le DPT « Ville » offre ainsi un panorama riche des modalités d’évaluation des apports budgétaires de l’État à la politique de la ville en termes de « droit commun » :
– un certain nombre de programmes budgétaires sont considérés comme concourant à la politique de la ville sans aucune précision d’éléments financiers permettant d’appréhender l’ampleur de cette contribution ;
– l’évaluation de cette contribution pour de nombreux autres programmes budgétaires s’appuie sur une proratisation du poids des quartiers en difficulté s’agissant des mesures de droit commun qu’ils financent. Le prorata choisi est rarement justifié, même quand il s’éloigne de la simple prise en compte du poids de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans la population nationale. La difficulté à « territorialiser » pour les quartiers en difficulté l’action de l’État, qu’il s’agisse de versements de subventions ou de rémunérations, est d’ailleurs évoquée à de nombreuses reprises dans le DPT « Ville ». Ce que l’Acsé ne fait aujourd’hui que de façon lacunaire n’est, en tout état de cause, pas mieux accompli par les « ministères de droit commun » ;
– mis à part le cas spécifique de l’éducation prioritaire mise en œuvre par l’éducation nationale, et dont la philosophie et les objectifs sont assez proches de ceux de la politique de la ville, le concours des autres ministères à la politique de la ville ne s’appuie pas, en règle générale, sur des mesures spécifiques en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce jugement doit être relativisé pour certaines mesures (par exemple celles du programme 101 « Accès au droit et à la justice » ou le dispositif parcours animation sport - PAS), pour lesquelles les taux de proratisation choisis laissent penser qu’il s’agit de dispositifs en très grande partie mis en œuvre dans ces quartiers.
Au total, il apparaît assez illusoire d’opérer la somme de toutes ces contributions. S’agissant de l’éducation nationale, on prend ainsi en compte toute l’éducation prioritaire, y compris quand elle n’est pas mise en œuvre dans un contexte urbain difficile, sans s’appuyer sur le coût de la politique de l’éducation nationale dans son ensemble dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, alors que la prise en compte du strict droit commun « proratisé » à ces quartiers constitue, en règle générale, la seule modalité d’évaluation du concours des autres ministères à la politique de la ville. Or l’appréciation ainsi faite sur la réalité des concours de l’Éducation nationale à la politique de la ville dépasse sensiblement le montant de nombre de programmes ou de parties de programmes d’autres ministères, de volume beaucoup plus modeste. L’addition de l’ensemble devient alors très imprécise et perd une grande partie de son sens.
Ainsi, si l’Éducation nationale calculait sa contribution à la politique de la ville selon la méthode des responsables de la politique de l’emploi, l’ensemble des moyens de droit commun accordés aux établissements scolaires des premier et second degrés situés en ZUS devraient être pris en compte, plus les moyens dont ces établissements bénéficient au titre de leur appartenance à l’éducation prioritaire. À titre d’exemple, il est possible d’indiquer, sur la base du travail de la Cour des comptes (149), que 6,62 % des collégiens pour l’année scolaire 2008/2009 étaient inscrits dans un établissement en ZUS. Si on applique ce taux en considérant qu’il est valable pour les lycéens scolarisés dans un établissement situé en ZUS, au montant des crédits inscrits pour le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » dans la loi de finances initiale pour 2010, on obtient 1,922 milliard d’euros. Ce montant est plus de quatre fois plus élevé que celui de la contribution aujourd’hui présentée dans le DPT « Ville » pour le même programme ; au demeurant, il ne prend pas en compte le montant de droit commun que l’Éducation nationale consacre aux établissements du premier degré situés en ZUS, ainsi que, pour tous les établissements des premier et second degrés situés en ZUS, l’apport supplémentaire que constitue leur intégration dans le dispositif de l’éducation prioritaire.
Au demeurant, peut-on réellement parler d’un « concours » ou d’une « contribution » à la politique de la ville quand, s’agissant de ce droit commun « proratisé », les montants identifiés seraient en tout état de cause dépensés dans les conditions dans lesquelles ils le sont aujourd’hui et en faveur des mêmes publics, même si la politique de la ville n’existait pas ?
Ces questions ont conduit, de façon opportune, le SG-CIV (la DIV à l’époque), à proposer à l’ensemble de ses interlocuteurs ministériels (extraits des réponses de cette administration à vos rapporteurs) « un modèle afin de distinguer les crédits de droit commun selon les trois critères suivants :
« – 1) le droit commun de “base” qui correspond à la contribution uniforme des ministères sur l’ensemble du territoire national (il s’agit en quelque sorte de raisonner comme si la politique de la ville n’existait pas) ;
« – 2) l’adaptation du droit commun qui correspond à un effort supplémentaire réalisé par les ministères sur les territoires de la politique de la ville (ce pourrait être, par exemple, le surcoût consécutif à un taux de surencadrement/taux d’affectation complémentaire rapporté à une moyenne nationale) ;
« – 3) les dispositifs spécifiques destinés aux territoires de la politique de la ville (par exemple les maisons de justice et du droit pour le ministère de la justice). […]
« Pour le DPT 2010, il a été demandé d’affiner la présentation des crédits inscrits dans l’annexe financière [du DPT] selon le modèle suivant :
«
DROIT COMMUN DE BASE (contribution uniforme sur tout le territoire national) |
Adaptation du droit commun sur les ZUS (effort supplémentaire au droit commun) |
Dispositifs spécifiques des ministères sur les quartiers de la politique de la ville | ||
En personnel |
Au titre d’une Action |
Autre intervention |
||
xxx € |
xxx € |
xxx € |
xxx € |
xxx € |
« Cependant, hormis la protection judiciaire de la jeunesse [c’est-à-dire le programme 182], aucun autre ministère ne s’est inscrit dans cette démarche, soit faute de volonté, soit faute de moyens techniques permettant d’identifier les crédits mobilisés à l’aune de ces trois critères. »
La direction du budget, évoquant cette initiative du SG-CIV, « considère qu’une telle classification ne peut être envisagée tant qu’il n’est pas possible de suivre de manière fiable l’ensemble des crédits de la politique de la ville ». La même direction considère par ailleurs que les principes qui régiraient une telle classification sont, au moins en partie, critiquables :
– certains dispositifs que le SG-CIV considèrent comme relevant d’un effort spécifique en faveur de la politique de la ville ne correspondent pas strictement à une telle définition. La direction du budget précise ainsi que 25 % des maisons de justice et de droit ne sont pas situées en ZUS, alors que le SG-CIV semble les appréhender comme un dispositif spécifique en faveur exclusivement des territoires de la politique de la ville ;
– certaines politiques considérées par le SG-CIV comme relevant de la stricte application du droit commun ont une vocation « naturelle » à répondre aux problématiques de la politique de la ville. La direction du budget relève ainsi que les conditions de ressources permettant de bénéficier de l’aide personnalisée au logement sont très proches du montant du revenu moyen par unité de consommation constaté en ZUS.
Au total, la direction du budget « s’il faut néanmoins classifier, […] suggère donc une classification légèrement différente, plus proche de celle du rapport de 2007 de la Cour des comptes […] ». Dans cette logique, seraient en premier lieu répertoriées les interventions de droit commun, à l’intérieur desquelles pourraient être distinguées :
– des dépenses attribuées automatiquement à leurs bénéficiaires et dont la logique et les modalités de répartition conduisent à constater que ceux-ci sont assez naturellement des habitants des quartiers prioritaires ou des acteurs de la politique de la ville. Sont évoquées à cet égard les aides au logement, certaines dépenses de l’éducation prioritaire, les subventions aux bailleurs sociaux, certaines aides aux créateurs d’entreprises. La direction du budget considère que « si les critères de définition des quartiers prioritaires sont pertinents, ces dépenses seront “naturellement” ciblées en faveur des ces quartiers, et il n’y a pas lieu de chercher un effort supplémentaire de l’État sur les dispositifs afférents » ;
– des dépenses discrétionnaires relevant de programmes portant des dispositifs spécifiques et dont les bénéficiaires sont en règle générale des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. La direction du budget évoque certaines mesures de la dynamique « espoir banlieues » comme sa partie investissements dans les transports, le contrat d’autonomie, la création de 30 points d’accès au droit dans les 215 quartiers plus précisément concernés par la DEB.
Seraient en deuxième lieu répertoriés les « dispositifs spécifiques de la politique de la ville, dont les dépenses sont actuellement imputées soit sur le programme 147 “Politique de la ville”, soit sur d’autres programmes (exemple : contrats d’autonomie qui représentent 65 millions d’euros dans le programme 102 “Accès et retour à l’emploi”) ». On relève d’ailleurs la difficulté de l’exercice, puisque la direction du budget elle-même semble hésiter à classer le contrat d’autonomie dans cette catégorie ou dans la précédente.
B.– LES CRÉDITS LOCAUX AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : UNE APPROCHE ENCORE TRÈS LACUNAIRE
Si, dans le DPT « Ville », l’État affiche avec précision son volontarisme en matière de concours à la politique de la ville issus de ses crédits de droit commun, ces constats à l’euro près contrastent sévèrement avec les informations qu’il est possible de recueillir sur la participation des collectivités territoriales en la matière. Il fut une époque, dans les années 90, où le « jaune budgétaire » consacré à la politique de la ville présentait une estimation des crédits des régions consacrés à la politique de la ville, sur la base des engagements des contrats de plan État-région. A contrario, il apparaît clairement aujourd’hui que les Cucs, nombreux et extrêmement hétérogènes s’agissant des informations qu’ils rassemblent et de la forme prise par les engagements dont ils sont l’objet, ne permettent pas une telle analyse.
Ainsi, le rapport du bureau d’étude sollicité par vos rapporteurs, s’essayant à une telle analyse pour un échantillon de 22 Cucs à partir des travaux d’évaluation relatifs à leur mise en œuvre, n’a pu réellement travailler que pour 9 d’entre eux, l’information pour les autres étant manifestement insuffisante. Avec toutes les précautions méthodologiques qui s’imposent, les travaux du bureau d’étude sur ces 9 Cucs montrent que les crédits Acsé ne constituent jamais plus de 50 % des actions financées et que les taux de financement de ces actions par les crédits Acsé sont inférieurs à 20 % pour 4 de ces 9 Cucs. Au demeurant, ces constats, déjà fragiles au regard de la représentativité de l’échantillon de Cucs exploités, ne distinguent pas les catégories d’actions rassemblées par thématique ni, s’agissant des crédits hors Acsé, les crédits relevant des collectivités territoriales, des ministères de droit commun ou de tous autres organismes susceptibles de contribuer au financement des actions concernées.
Ces constats sont d’ailleurs « en ligne » avec les informations recueillies par l’Acsé sur la base du traitement des demandes de subventions qu’elle effectue en s’appuyant sur son système d’informations. Dans le rapport annuel de performance de 2009 sur la mission interministérielle « Ville et logement », il est ainsi précisé que 238 millions de subventions versées par l’Acsé en 2009 ont permis la réalisation d’actions cofinancées par ailleurs à hauteur de 671 millions d’euros. Sur le terrain, vos rapporteurs ont pu aussi constater que les financements de l’Acsé sont souvent très minoritaires dans les crédits mobilisés par les associations, voire ont un caractère résiduel.
Le constat semble différent pour le programme de réussite éducative (PRE), pour lequel l’Acsé a élaboré un tableau de bord rendant compte des cofinancements induits par les subventions de l’agence en la matière. Selon l’Acsé, en 2008, 42,407 millions d’euros de financements complémentaires se sont ajoutés au financement par l’État, qui a délégué des crédits pour un montant de 79,036 millions d’euros en 2008 au titre du PRE. Le montant de financements complémentaires est composé de 25,838 millions d’euros en contributions financières directes et 16,568 millions d’euros en « valorisation », c’est-à-dire la mise à disposition de moyens en nature. Les cofinancements sont donc en l’espèce minoritaires ; il faut noter que le PRE fait dans certains cas l’objet d’un financement à 100 % de la part de l’Acsé.
Il convient par ailleurs de relever l’apport non négligeable, en tant que cofinanceur des actions en faveur de la politique de la ville, de l’Union européenne, à travers ses dispositifs de fonds structurels à destination des régions. Selon le DPT « Ville », « l’analyse des programmes régionaux 2007-2013 permet d’envisager un niveau de mobilisation annuel du FEDER [Fonds européen de développement régional] de l’ordre de :
« – 40 millions d’euros au titre des programmes “convergence” pour les quatre DOM ;
« – 90 millions d’euros au titre des programmes “compétitivité régionale”, pour l’ensemble des régions métropolitaines. » (150)
En tout état de cause l’Acsé est consciente de la faible qualité des informations d’ensemble dont elle dispose sur le sujet. C’est pourquoi elle a récemment lancé un marché pour disposer d’une « enquête sur les cofinancements de la politique de la ville au sein des contrats urbains de cohésion sociale ». Le préambule du cahier des clauses particulières propre à ce marché fait un point complet sur ce dont dispose l’Acsé aujourd’hui en la matière et sur les marges importantes de progression qu’il s’agit, par ce marché, de tenter d’explorer. Ainsi, après avoir évoqué les crédits dédiés à la politique de la ville et gérés par l’Acsé, les crédits nationaux des ministères de droit commun et les crédits locaux des collectivités territoriales et autres organismes publics, l’Acsé dresse le constat suivant sur les informations mobilisables en l’état :
« Si les contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) identifient et recensent l’ensemble de ces différents moyens, ils ne sont pas toujours en capacité de les mesurer avec exactitude : les moyens de droit commun, ne faisant pas l’objet de dotations en crédits mais relevant plutôt de la mise à disposition (locaux, personnels, mesures générales, etc.), ne font l’objet d’aucune estimation précise. Ne sont donc actuellement disponibles que les données relatives aux interventions bénéficiant de financements directs. Pour cela, quatre sources d’informations existent :
« – chaque demande de subvention instruite en préfecture et transmise à l’Acsé via son logiciel de gestion des subventions (GIS) est assortie d’un budget prévisionnel mentionnant ou non des cofinancements ;
« – chaque subvention accordée doit être justifiée au plus tard six mois après la réalisation de l’action auprès de la préfecture pour le compte de l’Acsé ; cette justification précise s’il y a eu ou non des cofinancements, de la part de quelles institutions et pour quels montants ;
« – les préfectures effectuent, selon des modalités variables, un suivi financier des Cucs ;
« – les principales collectivités signataires du Cucs assurent également un suivi financier selon des modalités propres à chacune.
« Ces différentes sources ne font actuellement l’objet d’aucune exploitation et consolidation nationales. Leur qualité propre et leur cohérence n’ont jamais été vérifiées ou expertisées. Il en résulte une absence de visibilité nationale sur la réalité des crédits engagés au titre des Cucs.
« En l’état, pour le suivi financier de la politique de la ville, il n’existe à un niveau national que le suivi de ses crédits par l’Acsé : la question des cofinancements reste donc en suspens. »
Au demeurant, les renseignements qu’un meilleur système d’informations permettrait de collecter demain en la matière auraient sans doute un intérêt pour le pilotage de la politique nationale en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il serait sans doute utile en effet que l’Acsé puisse élaborer une doctrine de cofinancement des actions qu’elle subventionne, compte tenu de l’importance de l’action envisagée et des capacités financières des autres financeurs potentiels ; il s’agirait ainsi d’aller un peu plus loin que la « doctrine » consistant à réserver une très grande partie des financements de l’Acsé aux quartiers Cucs classés en catégorie 1.
Agissant ainsi sur une réalité qu’elle connaîtrait mieux et sur laquelle elle aurait plus de prise, l’Acsé serait ainsi mieux armée pour répondre aux interrogations théoriques sur la réalité de l’effet de levier de ses interventions ; de même qu’aux interrogations sur les risques que ses interventions se substituent aux interventions de droit commun ou qu’elles ne soient qu’un financement complémentaire d’actions qui seraient en tout état de cause menées dans les mêmes conditions avec ou sans son apport.
DEUXIÈME PARTIE : QUELS CADRES GÉOGRAPHIQUES ET QUELLES MODALITÉS DE GOUVERNANCE
POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
I.– LES GÉOGRAPHIES PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
A.– LA POLITIQUE DE LA VILLE S’INSCRIT DANS UNE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE DÉSORMAIS MULTIFORME
1.– La « zone urbaine sensible » (ZUS) n’a pas suffi pour déterminer la géographie prioritaire de la politique de la ville
a) La cartographie des ZUS ne s’appuie pas sur des critères objectifs
Dans sa version modifiée par l’article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et par la loi n° 2007-1822 du 27 décembre 2007 de finances pour 2008, le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire définit ainsi les ZUS :
« 3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. […] La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret. Elle fait l’objet d’une actualisation tous les cinq ans. »
L’article 1er du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 dispose que ces zones sont celles figurant dans la liste annexée au décret. Cette liste contient trois colonnes permettant d’identifier le département, la commune et le nom du quartier ou du grand ensemble formant la ZUS considérée. 750 ZUS sont ainsi définies ; cette liste n’a jamais été modifiée depuis l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire le 31 décembre 1996, si ce n’est par le décret n° 2000-796 du 24 août 2000 qu’il a complétée par une ZUS supplémentaire située dans le département du Nord. Il y a donc aujourd’hui 751 ZUS.
L’article 1er du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 dispose par ailleurs que les ZUS « sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1 / 25 000 annexés au présent décret ». Une note au même article précise que « ces plans pourront être consultés au secrétariat général du comité interministériel des villes, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La Plaine, et auprès des préfectures concernées ». Le SG-CIV est ainsi dépositaire officiel auprès du public de la cartographie précise des ZUS.
Le processus administratif et politique de délimitation des ZUS a été mené selon une méthode de discussions locales décentralisées et déconcentrées, sans appui sur des critères objectifs nationaux.
On remarque en outre que la loi a été construite sur une vision « traditionnelle » des quartiers en difficulté ; elle fait ainsi référence aux « grands ensembles » urbains et à la dégradation de l’habitat. Du point de vue « social », c’est le déséquilibre entre l’habitat et l’emploi qui est évoqué, et non pas le chômage proprement dit, le niveau des revenus ou certains autres indicateurs aujourd’hui classiques dans l’analyse des quartiers urbains défavorisés comme la proportion de jeunes ou de bénéficiaires de la couverture maladie universelle (151). D’ailleurs, la notion de « déséquilibre accentué entre l’emploi et l’habitat » renvoie peut-être à une autre facette de la vision traditionnelle de ces quartiers, appréhendés comme des « cités dortoirs », plus qu’à une réalité sociale dûment mesurée.
La délimitation des ZUS a très vite été considérée comme insuffisamment pertinente, puisque dès 1996 et progressivement jusqu’en 2006, ont été définies en leur sein de nouvelles zones censées y délimiter les problèmes économiques et sociaux les plus importants (les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines) et ayant en conséquence vocation à accueillir de nouvelles activités économiques. Par ailleurs, la définition des quartiers Cucs en 2006 et 2007 a marqué une nouvelle étape de la définition de la géographie prioritaire, qui a mis en lumière des insuffisances du zonage ZUS dans la prise en compte des territoires éligibles à la politique de la ville. Enfin, la définition des quartiers concernés par le PNRU, puis des quartiers qui font plus particulièrement l’objet de la « dynamique espoir banlieues », a dessiné des géographies prioritaires encore différentes de celles des ZUS.
b) De l’objectivité au sein des ZUS : les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU)
Dans sa version modifiée par l’article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, le A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 définit ainsi les zones de redynamisation urbaine :
« A.-Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l’agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d’un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d’habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
« Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d’outre-mer et de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret. »
Les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 définissent le périmètre de 416 ZRU respectivement en métropole et dans les départements d’outre-mer. Le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996 définit l’indice synthétique prévu par la loi et qui a contribué à déterminer les ZRU parmi les ZUS. Cet indice, aux termes de l’article 1er de ce décret est composé des critères suivants dans chaque ZUS :
– le taux de chômage ;
– la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans dans la population qui « est définie par rapport à l’âge atteint au cours de l’année 1990 » ;
– la proportion de personnes sans diplôme dans la population des 15 ans et plus ayant achevé ses études ;
– le potentiel fiscal de la commune concernée.
La valeur de l’indice est obtenue par le produit de la population de la ZUS et des taux relatifs au trois premiers critères. Ce produit est ensuite divisé par le potentiel fiscal par habitant. Les ZUS ont donc fait l’objet d’un classement selon cet indice synthétique et, après appréciation des autres critères prévus par la loi que sont la situation dans l’agglomération et leurs caractéristiques économiques et commerciales, 416 d’entre elles, dans un premier temps, ont acquis le statut de ZRU. L’usage de l’indice synthétique a donc été accompagné de la prise en compte d’éléments, certes définis par la loi, mais relevant plus de l’appréciation du contexte local. Par ailleurs, le nombre des ZRU n’était pas fixé ab initio ; le choix en la matière a donc relevé d’une décision politique. Au final, comme le précisait la DIV en mars 2009, « une appréciation qualitative [est restée] de rigueur » (152).
Aux termes de certaines corrections et de certains ajouts, les ZRU sont aujourd’hui au nombre de 435. Leur périmètre est entièrement inclus dans les ZUS.
On note que le décret du 26 décembre 1996 définissant l’indice synthétique de sélections des ZRU vise le décret n° 90-1172 du 22 octobre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population. Le périmètre actuel des ZRU s’appuie donc sur des données anciennes, sans doute éloignées pour certaines d’entre elles des valeurs que l’on pourrait constater aujourd’hui. La vocation des ZRU a, dès le départ, été tournée vers des considérations économiques ; certains des critères qui les définissent, comme les caractéristiques économiques et commerciales et le taux de chômage, n’avaient d’ailleurs pas été utilisés pour définir les ZUS. De fait, les ZRU ont bénéficié, comme il a été vu supra, d’avantages fiscaux et sociaux particuliers, en lien avec l’activité économique.
Dans sa version modifiée par l’article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et par l’article 26 de la loi n° 2006-396 du 2 avril 2006, le B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 définit les zones franches urbaines :
« B.– Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d’État, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d’ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe.
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent B.
« Les zones franches urbaines des communes des départements d’outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d’État, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques. »
La délimitation des ZFU a été opérée en trois étapes :
– les 44 ZFU de première génération ont été définies par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 respectivement en métropole et dans les départements d’outre-mer ;
– 41 nouvelles ZFU de deuxième génération ont été définies, suite à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 ;
– Enfin, 15 autres ZFU de troisième génération ont été délimitées, suite à la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, par le décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006.
Au total, il existe donc aujourd’hui 100 ZFU. Les critères qui ont été pris en compte pour leur délimitation sont légalement les mêmes que ceux utilisés pour définir les ZRU, soit l’indice synthétique défini par le décret du 29 décembre 1996 et les autres éléments légaux relatifs à la délimitation des ZRU (les caractéristiques économiques et commerciales et la situation dans l’agglomération).
S’est ajoutée à ces critères, pour la délimitation des ZFU, la prise en « compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques », ce qui accentue l’orientation économique des ZFU par rapport aux ZRU et, surtout, par rapport aux ZUS. Comme pour les ZRU, le nombre des ZFU n’était pas fixé par la loi. Enfin, comme le prévoit la loi pour autant que cela soit « de nature à servir le projet de développement d’ensemble [du] quartier », certaines ZFU, en très petit nombre, s’étendent au-delà du territoire de la ZUS qui leur est sous-jacente.
Au total, pour la délimitation des ZFU comme pour celle des ZRU, une appréciation « qualitative » a donc également été portée au regard des éléments objectifs s’appuyant sur des critères énumérés par la loi.
c) Compléter la géographie prioritaire définie par les ZUS : les quartiers Cucs
La circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale (Cucs), adressée aux préfets, a précisé que l’exercice de contractualisation devait être l’occasion d’un complément apporté à la géographie prioritaire définie par les ZUS, sans remettre en cause leur périmètre et leur nombre : « La mise en place de ces nouveaux contrats doit être l’occasion de préciser la géographie prioritaire de la politique de la ville dans votre département et de prendre en compte l’évolution des territoires. »
S’agissant de la méthode retenue pour « préciser » la géographie prioritaire, la DIV a opéré un exercice statistique portant sur l’ensemble des quartiers urbains français, sans exclusive et sans référence à un zonage antérieur, en utilisant la brique de base statistique élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), c’est-à-dire les îlots regroupés pour l’information statistique (IRIS). Tous les IRIS urbains du territoire, c’est-à-dire tous les quartiers urbains, ont ainsi été classés selon leur écart à la moyenne nationale en termes de revenu médian des ménages (153).
La DIV a proposé, pour base de la concertation locale, que deux premières catégories de quartiers établies en s’appuyant sur ce classement soient considérées comme éligibles aux Cucs. Une troisième catégorie de quartiers était par ailleurs prévue, mais sans que la DIV ne fasse de recensement national des quartiers concernés. La circulaire du 24 mai 2006 rattachait à ces catégories des modalités générales d’intervention de la politique de la ville devant structurer les futurs contrats et ouvrait la voie à un remodelage de chacune de ces catégories par la concertation locale :
« Trois catégories de communes pourront être concernées :
« 1.– Les communes qui ont des quartiers dans lesquels une intervention massive et coordonnée de l’ensemble des moyens disponibles est absolument indispensable. L’essentiel des crédits spécifiques seront mobilisés sur ces territoires, en prenant en compte les charges et les ressources des collectivités contractantes.
« 2.– Les communes qui ont des quartiers dans lesquels les difficultés sociales et économiques sont moindres mais pour lesquels la mobilisation de moyens spécifiques au-delà des moyens de droits commun est néanmoins nécessaire.
« 3.– Les autres communes qui ont des quartiers où les actions à mettre en œuvre relèvent davantage de la prévention ou de la coordination des moyens de droit commun.
« Sur le fondement du travail d’analyse des difficultés sociales des territoires [effectué par la DIV], des priorités du programme national de rénovation urbaine et du bilan des contrats de ville, il vous appartient de classer, en lien avec les élus, la DIV et les préfets de région, les quartiers prioritaires et les communes concernées, en nombre limité, sur lesquels les contrats et les financements spécifiques seront centrés. »
Au terme de cette concertation, 2 493 quartiers ont été sélectionnés, regroupé dans 490 Cucs (dont 30 dans les départements d’outre-mer). Cette concertation, selon la DIV, « a été nettement inflationniste » (154) au regard de ses propositions initiales. La DIV tire le bilan suivant des déplacements entre catégories et de l’apparition de nouveaux quartiers au sein de l’une d’entre elles, à l’issue de cette concertation :
« Les 388 priorités 1 de la DIV sont majoritairement reprises en priorité 1 par l’échelon local (354). Mais l’on constate également des “déclassements” en priorité 2 (22) et même en priorité 3 (12).
« L’échelon local retient également en priorité 1, 208 quartiers classés en priorité 2 et 60 classés en priorité 3 par la DIV. Viennent s’ajouter 277 quartiers non identifiés par la DIV comme prioritaires. »
Pour expliquer le nombre important, au final, des quartiers Cucs et les choix opérés à l’échelon local, la DIV évoque les hypothèses suivantes :
– l’intégration dans la géographie prioritaire de quartiers non ZUS mais concernés par les contrats de ville ou par des formes régionales antérieures de contractualisation de la politique de la ville ;
– la prise en compte de quartiers différents du profil typique des ZUS définies comme « grands ensembles », comme les quartiers anciens dégradés et certains quartiers Anru hors ZUS ;
– au terme d’une étude statistique réalisée a posteriori sur les quartiers Cucs retenus au regard de l’ensemble des IRIS urbains, la DIV relève que « la présence de grands ensembles a vraisemblablement pesé dans la décision de classement » (155). On retrouve ainsi un élément qui fut déterminant dans la définition des ZUS. Il est probable que le profil « paysager » de ces quartiers conduit à faire penser à beaucoup que les « problèmes » y sont sérieux, tant est marquante sans doute l’impression visuelle qui s’en dégage ;
Jusqu’à quel point la définition des quartiers Cucs a-t-elle confirmé et complété la géographie prioritaire définie par les ZUS ? On observe que :
– 9 ZUS sur 751 ne relèvent pas d’un quartier Cucs, soit à peine plus de 1 % de l’effectif des ZUS. Il est cependant surprenant de constater que ces 9 ZUS n’ont pas même été considérées comme relevant de la priorité 3. En 2000, toutes les ZUS étaient concernées par les contrats de ville. Il est légitime de penser que ces 9 ZUS connaissaient en 2007 des difficultés très atténuées par rapport à l’effectif global des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le constat d’une certaine obsolescence du zonage ZUS est encore renforcé par le classement de 32 d’entre elles dans la catégorie 3 des quartiers Cucs ;
– 60 % des quartiers Cucs de priorité 1 sont des ZUS ; par ailleurs, les ZUS de priorité 1 constituent 64 % des ZUS. Ces constats témoignent de la robustesse d’une grande partie du zonage ZUS. A contrario, le zonage ZUS ne couvre pas 481 quartiers Cucs de priorité 1, ce qui n’est pas négligeable.
Les quartiers Cucs ont en tout état de cause profondément modifié et étendu la géographie prioritaire de la politique de la ville. En considérant la population 2006, on peut constater en effet qu’en France métropolitaine la population en ZUS s’établissait à 4 412 178 habitants et dans les quartiers Cucs hors ZUS à 3 969 394.
Le tableau suivant croise, pour la France métropolitaine, les effectifs de population dans chaque forme de géographie prioritaire associée aux ZUS et aux quartiers Cucs et dans chaque catégorie de priorité propre aux Cucs.
POPULATION 2006
FRANCE MÉTROPOLITAINE
(en millions de personnes)
Cucs priorité 1 |
Cucs priorité 2 |
Cucs priorité 3 |
TOTAL | |
ZUS |
3,4 |
0,7 |
0,1 |
4,2 |
ZUS support de ZFU |
1,4 |
0,1 |
0,0 |
1,5 |
ZRU |
2,6 |
0,2 |
0,0 |
2,8 |
Hors ZUS |
1,4 |
1,2 |
1,1 |
3,7 |
Ensemble |
4,8 |
1,9 |
1,2 |
7,9 |
En % du total |
61 % |
24 % |
15 % |
100 % |
Source : SG-CIV
On constate ainsi que 61 % de la population en quartiers Cucs relève de la priorité 1, chiffre duquel il faut rapprocher l’objectif consistant à réserver au moins 75 % des crédits Cucs aux quartiers relevant de cette priorité.
d) Les quartiers de la rénovation urbaine et les quartiers de la dynamique « espoir banlieues »
Comme il a été vu supra, l’article 6 de la loi du 1er août 2003 définit deux catégories de quartiers susceptibles d’être éligibles au Plan national de rénovation urbaine :
– les ZUS ;
– « et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues », communément appelés les quartiers « article 6 ».
Tous ces quartiers, les ZUS comme les quartiers « article 6 », sont classés par le conseil d’administration de l’Anru selon deux catégories, les quartiers prioritaires et les quartiers supplémentaires au titre du PNRU. Il n’est pas aisé de savoir comment sont composées ces deux catégories de quartiers du fait de la procédure d’appel à projets de l’Anru. Le conseil d’administration a défini ab initio en 2005 et 2006 des listes de quartiers prioritaires et complémentaires ou supplémentaires, avant que soient signées les conventions correspondantes. Il y a donc visiblement un décalage aujourd’hui entre la composition, initialement fixée par le conseil d’administration, des catégories de quartier et la réalité des conventions signées, sans compter que le conseil d’administration de l’Anru a par la suite modifié ponctuellement ses listes initiales.
Il ressort néanmoins des informations disponibles que :
– le nombre des « quartiers prioritaires Anru » sous convention signée s’établissait à 196 au 1er septembre 2010 ; sur ces 196 quartiers, moins de 5 ne sont pas en ZUS ;
– le nombre des « quartiers supplémentaires Anru » sous convention à cette date s’élevait à 284, dont une majorité de quartiers en ZUS.
Les priorités initialement définies par le conseil d’administration de l’Anru, approuvant en cela d’ailleurs largement es orientations du Gouvernement, ont des conséquences financières importantes. Le conseil d’administration de l’Anru du 9 février 2005 a en effet décidé, sur incitation du Gouvernement, de consacrer au moins 70 % de son budget aux quartiers prioritaires (189 à l’époque) (156).
Les ZUS sont donc au cœur de la démarche du PNRU, puisqu’une très grande majorité des « quartiers Anru » sont des ZUS et que la presque totalité des « quartiers prioritaires Anru », qui bénéficient d’une grande partie des fonds publics nationaux finançant le PNRU, sont aussi des ZUS. On observe cependant qu’il a été jugé opportun qu’environ la moitié des ZUS ne soit pas concernée par la rénovation urbaine et de sélectionner par ailleurs environ 140 quartiers au titre du PNRU en dehors du zonage des ZUS.
Selon le communiqué de presse du Premier ministre faisant suite au Comité interministériel des villes du 8 juin 2008 qui a prévu les mesures de la « dynamique espoir banlieues » (DEB), « ces mesures fortes et inscrites dans la durée s’appliqueront en priorité aux 215 quartiers qui correspondent aux quartiers prioritaires au titre de la politique de rénovation urbaine ». Ces quartiers sont précisément ceux que le conseil d’administration de l’Anru du 9 février 2005 a considéré comme prioritaires au titre du PNRU (157). Ils sont composés de 212 ZUS et de 3 quartiers « article 6 ».
La géographie de la DEB, en s’appuyant sur les quartiers prioritaires de l’Anru, est assez fidèle au zonage ZUS. Mais moins de 30 % des quartiers ZUS sont dans la géographie DEB. Cet élément confirme les observations précédentes sur les caractéristiques des autres zonages réalisés suite à la création des ZUS : tout en confirmant l’opportunité du classement en ZUS d’un certain nombre de quartiers pour élaborer la géographie prioritaire de la politique de la ville, l’intégration en ZUS d’un nombre non négligeable de quartiers semble aujourd’hui pour le moins discutable et un certain nombre de quartiers hors ZUS présentent un profil analogue à celui des ZUS les plus en difficulté (sans pour autant pouvoir bénéficier des dispositifs prévus en ZUS).
e) La géographie prioritaire de la politique de la ville et sa population
Le tableau suivant récapitule les populations associées à chaque catégorie de géographie prioritaire en vigueur :
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES GÉOGRAPHIES PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (POPULATION RECENSEMENT 1999)
Géographies |
Nombre de quartiers concernés |
Nombre de communes concernées |
Population concernée (en millions) |
ZUS |
751 |
509 |
4,4 |
ZRU |
435 |
337 |
2,8 |
ZFU |
100 |
147 |
1,6 |
Anru |
542 |
370 |
3,4 |
Cucs dont Cucs hors ZUS |
2 493 1 596 |
934 443 |
8,3 3,9 |
DEB |
215 |
163 |
2,2 |
Source : SG-CIV et mission André-Hamel.
La définition des quartiers Cucs a donc opéré un quasi-doublement de la population habitant dans un quartier relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville. En 1999, la population française totale s’élevait à 60,185 millions d’habitant. Sur cette base, 13,8 % de la population française résident dans un quartier Cucs et 7,3 % dans une ZUS.
2.– La géographie prioritaire actuelle et les problèmes urbains sociaux
a) Les ZUS les plus en difficulté, complétées par certains quartiers Cucs, constituent une géographie représentative des problèmes urbains sociaux les plus lourds
La DIV, comparant en 2009 la représentativité des ZUS et des quartiers Cucs au titre des difficultés urbaines les plus lourdes, constatait dans ces quartiers Cucs « une disparité plus accentuée que dans les ZUS avec, toutefois, pour certains d’entre eux, des difficultés au moins équivalentes à celles des ZUS » (158). En matière de chômage, la DIV précise que le taux de personnes sans emploi dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville s’établissait à 19,2 % de la population active en 2005, ce taux s’élevant à 22,1 % pour les seules ZUS. Pour la même année, les quartiers dans lesquels ce taux était supérieur à 30 % étaient une soixantaine en ZUS, mais aussi une quarantaine en quartiers Cucs non ZUS.
De façon générale, les ZUS sont de taille plus importante que les quartiers Cucs non ZUS : en moyenne, en métropole, une ZUS compte 2 550 logements par quartier et un quartier Cucs 1 115 logements. La DIV précise d’ailleurs que « les Cucs ont conduit à intégrer plus largement les petites agglomérations dans le champ de la politique de la ville » (159). Or, selon la DIV, il apparaît statistiquement qu’« il y a une corrélation entre la taille du quartier et les difficultés de celui-ci » (160). Pour illustrer son propos, la DIV montre que les quartiers prioritaires Anru sont beaucoup plus grands que les quartiers supplémentaires, ce que confirment d’ailleurs les informations fournies par l’Anru : la population des 196 quartiers prioritaires Anru sous convention au 1er septembre 2010 était de 2,15 millions d’habitants, contre 1,13 million d’habitants pour les 284 quartiers supplémentaires Anru sous convention à la même date.
Le SG-CIV a transmis à vos rapporteurs quelques anomalies du classement actuel en ZUS. Elles montrent en premier lieu que la définition des quartiers Cucs a « apporté » à la géographie prioritaire un certain nombre de territoires au moins autant en difficulté que les ZUS les plus paupérisées.
Le SG-CIV énumère ainsi trois quartiers Cucs non ZUS de la petite couronne parisienne dont le revenu médian moyen était compris en 2005, par unité de consommation (161), entre 7 664 euros et 9 770 euros. La moyenne nationale en 2005 s’établissait à 16 357 euros. Les habitants du plus défavorisé de ces trois quartiers disposaient ainsi en moyenne d’un revenu par unité de consommation très inférieure au seuil de 50 % de la moyenne nationale, qui constitue, selon certains standards (162), la définition du seuil de pauvreté relative.
Le SG-CIV évoque, par ailleurs, pour chacune des trois autres grandes agglomérations françaises un exemple analogue sur la base des statistiques de 2005 :
– dans l’agglomération lyonnaise, un quartier Cucs non ZUS pour lequel le revenu médian s’élève à 9 478 euros par unité de consommation ;
– dans l’agglomération lilloise, un quartier Cucs non ZUS dans lequel le revenu médian s’élève à 8 398 euros par unité de consommation ;
– à Marseille, un quartier Cucs non ZUS dans lequel le revenu médian s’élève à 5 196 euros par unité de consommation, soit à peine plus de 30 % de la moyenne nationale.
A contrario, il apparaît que le revenu médian de certaines ZUS est proche de la moyenne nationale, voire la dépasse dans certains cas. Le SG-CIV fournit cinq exemples dans la petite couronne parisienne, pour lesquels le revenu médian moyen s’élève de 13 588 euros à 19 092 euros. Ces ZUS sont de taille importante puisqu’elles rassemblent 13 500 à 32 800 habitants. On note par ailleurs, sans prétendre à une approche parfaitement scientifique, qu’un nombre non négligeable des communes concernées figurent parmi les 20 communes ayant une ZUS mais qui ne bénéficient pas de la DSU-CS.
b) Certains quartiers urbains très en difficulté ne sont intégrés dans aucune des formes de géographie prioritaire en vigueur
La DIV a montré (163) qu’en 2005, les habitants de 1 % des 16 161 IRIS urbains (pour lesquels les données étaient disponibles pour cette période) disposaient d’un revenu médian en moyenne inférieur à 6 297 euros par unité de consommation, soit environ 38 % de la moyenne nationale. Parmi les 162 IRIS concernés, 14, soit 9 % de l’effectif, ne relevaient d’aucune des formes de géographie prioritaire de la politique de la ville.
Si l’on considère les 5 % des IRIS présentant les chiffres les plus bas, soit un revenu médian moyen en tout état de cause inférieur à 9 114 euros par unité de consommation, plus de 19 % (126 IRIS sur 647) d’entre eux ne relèvent d’aucun zonage de la politique de la ville.
A contrario, dans 12 IRIS en ZUS, le revenu médian moyen s’élevait en 2005 à au moins 19 583 euros par unité de consommation, soit un niveau très supérieur à la moyenne nationale et qui les situent dans les 25 % des IRIS du territoire les plus privilégiés sur la base de ce critère.
Ces études montrent ainsi que si les ZUS et les quartiers Cucs « couvrent » une très grande partie de la pauvreté financière en France, le zonage ne semble pas être exhaustif, si l’on raisonne en fonction du seul critère du revenu médian moyen.
Les travaux portant sur le revenu médian, qui semblent les plus complets car portant sur le plus grand nombre d’IRIS, sont corroborés par d’autres travaux de la DIV concernant le taux de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) sur la base d’informations fournies par la Caisse nationale d’assurance maladie pour 2006. On constate ainsi que dans 1 % des IRIS urbains étudiés, la part de la population couverte par la CMUc s’élève à au moins 41,1 % (le taux médian national s’établissant à 6,6 %). 20 IRIS parmi les 130 IRIS concernés, soit 15 % de l’effectif, ne sont concernés par aucune des formes de géographie prioritaire de la politique de la ville.
c) Une meilleure géographie prioritaire est-elle possible ?
On le voit, les ZUS actuelles présentent deux défauts majeurs quant à leur représentativité des problèmes urbains sociaux et économiques les plus aigus :
– il faut ajouter aux ZUS certains quartiers Cucs non ZUS pour couvrir la très grande partie de ces problèmes ;
– certaines ZUS ne relèvent sans doute plus, aujourd’hui, de ces difficultés les plus fortes.
Une meilleure lisibilité de la politique de la ville nécessite donc de réviser la géographie prioritaire de la politique de la ville, autour, selon vos rapporteurs, des principes suivants :
– l’usage d’un indice synthétique rassemblant des critères objectifs, dont le classement ferait in fine éventuellement l’objet, dans des proportions limitées et fixées ex ante, d’ajustements issus d’observations locales ;
– un resserrement du nombre des ZUS et de la population concernée, afin de faire des nouvelles ZUS la brique de base d’une politique de la ville recentrée sur les difficultés urbaines les plus graves.
On note que dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), le Comité de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 4 avril 2008 avait émis le souhait que « les moyens de la politique de la ville [fassent] l’objet d’une plus grande concentration géographique et temporelle dans les quartiers les plus en difficulté où la solidarité locale est insuffisante », ce qui nécessitait une géographie prioritaire plus objective et plus concentrée.
L’article 140 de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 avait, avant cette orientation de la RGPP, intégré à l’article 42 de la loi du 4 février 1995 qui définit les ZUS le principe que leur liste « fait l’objet d’une actualisation tous les cinq ans ». Le même article 140 de la loi de finances pour 2008 précisait que « la première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009 », ce qui n’a pas été réalisé et ne le sera sans doute pas désormais avant 2011.
Quelle pourrait être la méthode mise en œuvre pour procéder à cette réforme de la géographie prioritaire ? Des simulations ont été effectuées par le Gouvernement. La base de travail pourrait consister à imaginer quatre strates démographiques d’agglomérations urbaines, auxquelles seraient rattachés les quartiers qui les composent. Ces strates pourraient être les suivantes :
– la strate 1, pour les quartiers situés dans une unité urbaine de plus de 5 millions d’habitants (c’est-à-dire l’agglomération parisienne), rassemblerait 28 % de la population intégrée dans les quatre strates ;
– la strate 2, pour les quartiers situés dans une unité urbaine comprenant entre 500 000 et 5 millions d’habitants (c’est-à-dire les grandes agglomérations : Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes…), rassemblerait 23 % de la population urbaine prise en compte dans l’ensemble du classement ;
– la strate 3, pour les quartiers situés dans une unité urbaine comprenant entre 50 000 et 500 000 habitants, concernerait 38 % de la population urbaine de référence ;
– la strate 4, pour les quartiers situés dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, couvrirait 11 % de la population urbaine prise en compte.
Les quartiers seraient classés dans chacune de leur strate selon des critères qui pourraient être assez « classiques » en matière de politique de la ville : revenu médian, taux d’emploi, potentiel financier, part des logements sociaux, part des jeunes de moins de 18 ans et taille du quartier ; si la part des logements sociaux devait être effectivement retenue, se poserait sans doute la question de la pondération de ce critère afin, bien entendu, de ne pas pénaliser les quartiers comprenant des copropriétés dégradées et qui, pour certains d’entre eux, rassemblent de fait les difficultés sociales les plus aiguës. Par ailleurs, l’usage du potentiel financier ne devrait peut-être intervenir que dans un deuxième temps, afin de déterminer les bases financières d’une éventuelle négociation contractuelle avec la commune intéressée, et non pas ab initio à un stade où il s’agit de caractériser la situation sociale d’un quartier, qui ne constitue d’ailleurs pas le périmètre de référence de ce critère.
La question technique des modalités de conception du classement ne serait pas complètement secondaire. On peut noter la préférence exprimée par la DIV pour une technique récente, tendant, pour chaque critère à établir le classement des quartiers urbains, en attribuant à chacun d’eux la « valeur » de leur rang au titre du classement et non pas la « valeur » de la mesure du critère considéré. En d’autres termes, si un quartier sur cent classés a le plus fort taux de chômage (qui s’élèverait à 40 %), il disposerait de la valeur « 100 » (et chaque autre quartier une valeur de 99 à 1) et non de la valeur « 40 % ». Dans une telle optique, le rang multicritère est la somme des rangs obtenus sur chaque critère (éventuellement pondéré) et non la combinaison de « statistiques exprimées dans des unités de mesure, par essence, non comparables » (164). Toujours, selon la DIV, une telle méthode « permet en particulier de centrer l’arbitrage politique sur la seule question du poids accordé à chacun des critères sans que l’indice résultant ne soit perturbé par des effets non souhaités liés à l’inégale répartition des variables. »
Le résultat final serait déterminé par deux choix politiques portant sur des questions démographiques :
– dans le cas de figure d’un travail s’appuyant sur les quatre strates démographiques définies plus haut, quel pourcentage de population serait a priori retenu pour le classement en ZUS pour chacune de ces strates ?
– quel niveau global de population souhaite-t-on voir être intégré dans les ZUS ? Autrement dit, jusqu’à quel point souhaite-t-on resserrer la géographie des ZUS, qui concerne aujourd’hui 4,4 millions d’habitants ?
Selon les informations recueillies par vos Rapporteurs, il n’est pas exclu que, dans le cas de figure où la population en ZUS serait ramenée à un peu plus de 3 millions d’habitants, le nombre des ZUS soit abaissée d’environ 20 % et que les ZUS actuelles ne constituent qu’environ 66 % de la liste nouvelle des ZUS ; sous réserve bien entendu du choix des critères de classement, de leur pondération et des modalités de conception de l’indice synthétique qui en découlerait.
B.– UNE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE, POUR QUOI FAIRE ?
Vos rapporteurs considèrent que l’État doit déterminer une géographie prioritaire des quartiers urbains les plus défavorisés qui soit fiable et resserrée, tout en accentuant le caractère décentralisé de la politique de la ville par une contractualisation renouvelée entre le maire et l’État.
Autrement dit, nous approuvons l’essentiel des orientations de nos collègues Pierre André, sénateur, et Gérard Hamel, député, exprimées dans leur rapport fait à la demande du Premier ministre sur la révision de la géographie prioritaire et la contractualisation de la politique de la ville (165) ; mais nous pensons qu’un référentiel national public des quartiers urbains les plus en difficulté est nécessaire, afin de calibrer l’implication, notamment financière, de l’État dans une contractualisation approfondie, de suivre avec attention des évolutions qui recouvrent des situations humaines que l’État se doit de considérer et d’évaluer les résultats de l’action contractuelle.
1.– Un zonage national de référence au service d’une contractualisation renforcée
Le point de départ de l’analyse de nos collègues Pierre André et Gérard Hamel s’appuie sur un constat robuste : « aujourd’hui, force est de constater que [l’] action par zonage n’a pas fait la preuve de son efficacité. Malgré la multiplication des actions conduites dans les territoires prioritaires, les écarts avec le reste de la ville ne se sont pas véritablement réduits, notamment dans le domaine clé de l’emploi » (166). Vos rapporteurs ont précisé supra la situation effectivement préoccupante du chômage dans les ZUS, qui demeure, depuis une période longue, à un niveau un peu plus de deux fois plus élevé que dans le pays.
Le zonage pourrait, selon nos deux collègues, avoir des effets pervers « psychologiques », comme la stigmatisation du quartier prioritaire identifié par les autres habitants de la commune ou l’entretien d’un entre-soi chez les habitants du quartier, peu enclins à dépasser ne serait-ce que physiquement son horizon. De façon générale, le zonage aurait nécessairement des effets d’exclusion et d’inclusion, plus sensiblement vécus quand on se rapproche des lignes du tracé : « l’intervention par zonages stricts produit des effets pervers bien connus comme la création d’effets de frontière. Ces derniers illustrent bien l’iniquité qu’il y a à zoner strictement les interventions publiques tout particulièrement s’agissant des mesures d’accompagnement social. »
Ils considèrent par ailleurs que la logique des ZFU n’est pas bonne : créer des activités locales dans les quartiers défavorisés ne créeraient pas nécessairement de richesses pour les « locaux ». En conséquence, « pour contribuer plus efficacement au développement des territoires en difficultés, [il faut] pouvoir contribuer au renforcement global des pôles les plus dynamiques de la ville et augmenter les possibilités d’accès des habitants les plus défavorisés à ces sources de richesse » (167).
Une association citée par le rapport de la mission André-Hamel conclut en notant que si la logique de zonage « permet d’avoir une certaine connaissance du territoire et d’avoir connaissance des secteurs les plus en difficulté, la logique du zonage présente plus d’inconvénients en ce sens qu’elle circonscrit l’action publique, l’enferme. De plus, elle est contradictoire avec les notions de mobilité, de mixité et de développement territorial dont les outils (transport, emploi, par exemple) se travaillent nécessairement à une échelle différente que celle du territoire prioritaire strict » (168). Il ne s’agit donc pas de condamner l’existence d’un zonage, dont on reconnaît qu’il peut être utile (ici par la connaissance qu’il donne), mais de le critiquer comme fondement et ressort territorial des politiques publiques conçues au niveau national. Le rapport montre bien que les exonérations applicables en ZFU ne fondent pas une politique partenariale locale de développement économique mais relève d’une logique de guichet qui n’engage personne et surtout pas les bénéficiaires à rendre compte d’éventuels efforts en matière de recrutement local en contrepartie des aides publiques perçues.
Vos Rapporteurs partagent globalement ces constats. Le zonage doit être un élément de référence nationale, permettant un dialogue précontractuel entre l’État et les collectivités territoriales fondé sur des éléments objectifs. S’agissant du stade précontractuel, vos rapporteurs relèvent que la démarche, présentée supra, que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre pour réformer la liste des ZUS et celle proposée par le rapport André-Hamel sont proches ; il s’agit dans les deux cas :
– d’utiliser des indicateurs de difficultés socio-économiques, qui pour le rapport Hamel-André, serait le taux de chômage, la part des jeunes de moins de 26 ans non scolarisés et sans qualification professionnelle, la part de logements sociaux parmi les résidences principales, la part de bénéficiaires de minima sociaux dans la population et la part de bénéficiaires d’allocations de logement dans la population ;
– d’utiliser un indicateur des ressources dont peut disposer la commune, en l’espèce, pour le rapport Hamel-André, le potentiel financier. Il s’agit, de façon très pertinente aux yeux de vos rapporteurs, d’engager le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales compte tenu de la capacité ou non de celles-ci à financer elles-mêmes le nécessaire effort de solidarité qui découle du classement issu des indicateurs de difficultés urbaines socio-économiques. Autrement dit, il s’agit de concentrer de façon accrue l’effort de la solidarité nationale sur les territoires dans lesquels tant les habitants que les collectivités territoriales qui les administrent disposent de faibles ressources (169).
La principale différence de méthode entre ce que pourrait être la démarche du Gouvernement et les propositions du rapport André-Hamel concerne l’aire d’usage des indicateurs de difficultés socio-économiques. Il est légitime que la connaissance des quartiers s’appuie sur un classement qui les concerne ; par contre, dans la logique de la contractualisation, il est logique de proposer de classer des communes. Le risque du classement des communes est de laisser sans solidarité nationale un certain nombre de quartiers très défavorisés et très isolés socialement dans des communes disposant de ressources importantes. On note que dans une formule justifiant l’éligibilité envisagée au niveau de la commune (formule qui gagnerait à être précisée et illustrée) le rapport de la mission André-Hamel semble cependant écarter un tel risque « il convient de préciser que les travaux réalisés à la demande de la mission on permis d’aboutir à des résultats cohérents » (170). Cette formule semble signifier qu’un classement des communes n’aboutirait pas, en règle générale, à exclure des quartiers très défavorisés de la contractualisation telle qu’envisagée par la mission André-Hamel.
Vos rapporteurs souscrivent pleinement aux observations suivantes de la mission André-Hamel : « la mission propose de s’engager dans une nouvelle dynamique contractuelle s’inspirant à la fois des contrats de projets État/région pour leur dimension stratégique et des conventions Anru pour leur capacité opérationnelle “ force de frappe ” à mobiliser des partenariats élargis sur quelques priorités fortes tout en s’adaptant à la capacité contributive des collectivités concernées » (171). Il s’agit en effet d’établir au préalable un projet de territoire, fondant un contrat efficace recentré sur quelques axes et adapté aux ressources de la collectivité considérée. L’idée de faire coïncider la durée du contrat avec le mandat municipal, avec un décalage (172) permettant à une nouvelle équipe municipale de travailler à son projet, est aussi à retenir selon vos rapporteurs.
La mission André-Hamel considère que les nouveaux contrats devraient couvrir les crédits actuellement délégués par l’Acsé, la DDU, « l’accompagnement social des populations bénéficiant des actions de rénovation urbaine » (173), les dispositifs notamment fiscaux et sociaux d’exonération applicables aujourd’hui selon un des zonages de la politique de la ville, ainsi que certaines « aides sociales » de l’État dans les domaines de l’éducation nationale, la santé, l’insertion et l’emploi.
Sur la question du champ couvert par les nouveaux contrats, vos rapporteurs considèrent :
– qu’il faut envisager d’intégrer, au moins en partie, la DSU-CS dans l’enveloppe associée au contrat (174). Ce choix aurait l’avantage de cibler cette dotation réellement sur les « communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées » (175). Il serait par ailleurs surprenant que l’aide la plus proche de la logique prônée par la mission André-Hamel, c’est-à-dire une aide aux communes au titre de leurs quartiers urbains difficiles, ne soit pas intégrée à la méthode contractuelle ;
– qu’il est ainsi proposé de maintenir une dichotomie des contrats de rénovation urbaine et des contrats « sociaux » de la politique de la ville, ces derniers ayant uniquement vocation à gérer « l’accompagnement social » de la rénovation urbaine. On peut comprendre qu’il apparaisse hasardeux de remettre en cause le fonctionnement d’un élément de la politique de la ville – peut-être le seul – qui donne satisfaction à ses parties prenantes, c’est-à-dire la contractualisation en matière de rénovation urbaine. La DIV a considéré que si un contrat portant sur la politique de la ville était global et s’appuyait sur un projet de territoire, « il conviendrait d’en tirer les conséquences sur la place des programmes de rénovation urbaine et des projets de réussite éducative notamment au sein des contrats, leur pilotage, leur suivi » (176). Certains nouveaux contrats pourraient, à titre expérimental, contenir un volet rénovation urbaine par l’intégration d’un contrat en cours de rénovation urbaine ;
– que l’enjeu de la réforme proposée, tout autant qu’une nouvelle contractualisation efficace, est sans doute de donner aux élus locaux des capacités d’action nouvelles, qui peuvent passer par des dérogations législatives à la définition des compétences de l’État et des collectivités territoriales. Pourquoi ne pas imaginer que le maire, confronté dans sa commune à des difficultés économiques et sociales graves, se substitue à l’État dans l’attribution des contrats aidés et dispose d’un pouvoir de décision dans l’affectation des postes d’enseignants ou dans l’emploi des forces chargées de la sécurité publique ? Des expérimentations pourraient être menées dans ces domaines dans un premier temps.
2.– Les effets pour certains dispositifs d’une réforme du zonage actuel
a) La reconversion des dispositifs fiscaux et sociaux applicables dans les ZFU
Les effets les plus importants d’une réforme mise en œuvre en s’appuyant sur les propositions de la mission André-Hamel concernent les dispositifs d’exonération de charges sociales et d’impôt sur l’activité économique dans les ZRU et dans les ZFU. Il s’agirait d’introduire l’équivalent en crédits de ces aides dans les « nouveaux » contrats de politique de la ville. Cette mission envisage ce « transfert » de la façon suivante :
– « le maintien jusqu’à leur terme et dans les conditions en vigueur des zones franches urbaines existantes. Une telle disposition est indispensable pour permettre aux établissements installés en ZFU d’anticiper le retour au droit commun » (177). Aucune intervention législative fondamentale ne serait nécessaire puisqu’il s’agit de laisser s’éteindre le dispositif selon les modalités aujourd’hui prévues par la loi ;
– « de nouvelles exonérations, se substituant progressivement aux anciennes, seront accordées dans des “ périmètres de projet ” définis contractuellement entre les communes éligibles et l’État dans le contrat. [Cette] possibilité […] devra être concentrée sur un nombre restreint de communes, les plus en difficulté […] ». La limitation du nombre des communes concernées doit permettre, selon la mission André-Hamel, de déroger dans des limites acceptables au principe d’égalité, de maîtriser les coûts du dispositif et d’en assurer la « recevabilité » communautaire.
b) Le sort de certains dispositifs en vigueur dans les ZUS
La mission André-Hamel propose que l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans les ZUS pour les logements locatifs sociaux des bailleurs sociaux demeure applicable dans les communes concernées (178) par les nouveaux contrats de politique de la ville et s’éteigne progressivement dans les ZUS actuelles qui ne serait pas à l’avenir couverte par un tel contrat.
La mission André-Hamel est d’avis de maintenir sur le territoire des communes éligibles aux nouveaux contrats de politique de la ville certains autres dispositifs aujourd’hui applicables en ZUS, parce que leur mise en œuvre encourage la mixité sociale (179) :
– la faculté pour un bailleur social de louer les locaux situés au rez-de-chaussée de ses immeubles locatifs en vue d’y exercer une activité commerciale (cf. article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation) ;
– l’exonération du paiement par le locataire d’un logement locatif social du paiement d’un supplément de loyer de solidarité « surloyer », même quand les ressources du foyer dépasse de 20 % les plafonds définissant l’ouverture du droit à bénéficier d’un tel logement (cf. article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation) ;
– la majoration de 50 % du plafond de l’avance remboursable sans intérêt (« prêt à taux zéro ») dont une personne physique peut bénéficier au titre de l’acquisition d’un premier logement à titre de résidence principal (cf. article 244 quater J du code général des impôts) (180) ;
– la faculté pour les préfets de déroger aux règles relatives aux plafonds de ressources en matière d’accès aux logements locatifs sociaux « pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles » et les ZUS (cf. article R. 441-1-1 du code de la construction et de l’habitation).
La mission André-Hamel estime par ailleurs que les dispositifs actuellement applicables en ZUS s’agissant des fonctionnaires et agents publics devraient être supprimés car ils n’auraient « pas fait la preuve de leur efficacité alors que la capacité des pouvoirs publics à attirer les agents publics les plus expérimentés dans les quartiers difficiles est un enjeu majeur » (181).
Les avantages dont bénéficient les fonctionnaires et agents publics exerçant en ZUS sont les suivants :
– dans la plupart des ministères, les fonctions exercées à titre principal dans les ZUS peuvent donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville. Le coût pour l’État de ces dispositions est évalué à 20 millions d’euros, par an, ce qui n’est pas négligeable ;
– les fonctionnaires territoriaux qui exercent à titre principal dans les ZUS bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Celle-ci peut, de surcroît, êtremajorée « lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d’actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l’organisation du service par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement après avis du comité technique paritaire » (cf. articles 1er et 2 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006) ;
– les agents contractuels de droit public de Pôle emploi affectés dans les unités desservant les ZUS bénéficient d’une prime (article 7 du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004).
Par ailleurs, il existe un certain nombre d’autres dispositifs, dont le sort resterait à régler en cas de disparition des ZUS comme ressort de politiques publiques nationales. Il s’agit :
– de la majoration des taux plafond des aides aux commerçants accordées sous forme de subvention par le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) dans les ZUS et les ZFU (cf. article 8 du décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008) ;
– de la majoration du plafond de revenu d’activité qu’un pensionné des régimes de retraite peut gagner quand il est domicilié en ZUS (article D. 634-11-2 du code de la sécurité sociale) ;
– de la disposition facilitant l’ouverture d’une officine de pharmacie dans les ZUS (article L. 5215-11 du code de la santé publique) ;
– de la faculté dans les ZFU de modifier sans autorisation préalable l’affectation des locaux d’habitation (articles L. 631-7 et L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation) ;
– de la faculté pour une commune de voir sa population en ZUS être comptée double afin d’être « surclassée » géographiquement, ce qui lui permet des recrutements supplémentaires s’agissant des cadres de la fonction publique territoriale et des membres du cabinet du maire (article 1er du décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004) ;
– du bénéfice pour les habitants des ZUS des contrats d’adultes-relais (article D. 5134-102 du code du travail) ;
– de la majoration dans les ZUS de l’aide sous forme d’avance pour l’accession à la propriété d’une résidence principale (article R. 317-8 du code de la construction et de l’habitation) ;
– de la présence d’un représentant des ZUS dans la commission départementale de présence postale territoriale (article 1er du décret n° 2007-448 du 25 mars 2007) ;
– de la prise en compte des ZUS dans le calcul des dotations départementales du fonds postal national de péréquation territoriale (article 4 du décret n° 2007-310 du 5 mars 2007) ;
– de l’organisation d’opérations pilotes dans les ZUS portant sur l’incorporation de composants oxygénés, notamment d’origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile (article L. 224-3 du code de l’environnement).
II.– LES MODALITÉS DE GOUVERNANCE DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE
A.– LA GOUVERNANCE NATIONALE : FORTEMENT DÉPENDANTE DES CHOIX POLITIQUES NATIONAUX, SON EFFICACITÉ INTRINSÈQUE SEMBLE S’AMÉLIORER
1.- La place de la « ville » : un choix politique qui influe sur la capacité d’action de l’administration centrale concernée
a) La « ville » dans les gouvernements depuis le début des années 1990
Depuis que M. Michel Delebarre est devenu ministre d’État, ministre de la Ville, le 21 décembre 1990, la politique de la ville a connu des modalités diverses de prise en compte au sein des Gouvernements successifs.
Depuis cette « première », un ministre de plein exercice autre que M. Michel Delebarre a vu la « ville » constituer la totalité de son portefeuille, sans avoir le rang de ministre d’État ; il s’agit de M. Bernard Tapie du 2 avril 1992 au 28 mars 1993 (182) dans le Gouvernement de Pierre Bérégovoy.
Certains ministres de plein exercice ont vu la « ville » constituer une partie de leur portefeuille, sans que leur soit adjoint un autre membre du Gouvernement spécifiquement chargé de cette responsabilité :
– Mme Simone Veil fut ministre d’État, ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville du 29 mars 1993 au 16 mai 1995 dans le Gouvernement de M. Édouard Balladur ;
– Mme Martine Aubry fut ministre des Affaires sociales et de la solidarité du 2 juin 1997 au 18 octobre 2000 dans le Gouvernement de M. Lionel Jospin, sans que la « ville » n’apparaisse dans l’énoncé de ses fonctions ministérielles (183).
Des ministres délégués ont été en charge de la ville auprès d’autres ministres :
– M. Éric Raoult fut ministre délégué chargé de la ville et de l’intégration du 7 novembre 1995 au 2 juin 1997 (auprès de M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration), dans le second Gouvernement de M. Alain Juppé ;
– M. Claude Bartolone fut ministre délégué à la ville du 30 mars 1998 au 6 mai 2002 (auprès successivement de Mme Martine Aubry, puis de Mme Élisabeth Guigou à compter du 18 octobre 2000, ministres de l’Emploi et de la solidarité), dans le Gouvernement de M. Lionel Jospin ;
– M. Jean-Louis Borloo fut ministre délégué à la Ville et à la rénovation urbaine du 6 mai 2002 au 30 mars 2004 (184) (auprès de M. François Fillon, ministre des Affaires sociales, du travail et de la solidarité), dans les premier et deuxième gouvernements de M. Jean-Pierre Raffarin ;
– M. Marc-Philippe Daubresse fut ministre délégué au Logement et à la ville du 15 novembre 2004 au 11 juillet 2005 (auprès de M. Jean-Louis Borloo, devenu ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale), dans le troisième Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin ;
– Mme Catherine Vautrin fut ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la parité du 11 juillet 2005 au 17 mai 2007 (auprès de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement), dans le Gouvernement de M. Dominique de Villepin.
Cinq secrétaires d’État ont également été en charge de la ville auprès d’autres membres du Gouvernement :
– M. André Laignel fut secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire et de la ville du 15 mai 1991 au 2 avril 1992 (auprès de M. Michel Delebarre, ministre de l’Aménagement du territoire et de la ville), dans le Gouvernement de Mme Édith Cresson ;
– M. François Loncle fut secrétaire d’État chargé de la ville du 3 juin 1992 au 26 décembre 1992, auprès du Premier ministre M. Pierre Bérégovoy ;
– Mme Françoise de Veyrinas fut secrétaire d’État chargée des quartiers en difficulté du 17 mai 1995 au 7 novembre 1995 (auprès de M. Éric Raoult, ministre de l’Intégration et de la lutte contre l’exclusion), dans le premier Gouvernement de M. Alain Juppé ;
– Mme Catherine Vautrin fut secrétaire d’État chargée de l’intégration et de l’égalité des chances du 30 mars 2004 au 15 novembre 2004 (auprès de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale), dans le troisième Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin ;
Mme Fadela Amara est secrétaire d’État en exercice chargée de la politique de la ville depuis le 18 juin 2007. Elle a successivement exercé ses fonctions du 18 juin 2007 au 15 janvier 2009 auprès de Mme Christine Boutin, ministre du Logement et de la ville, du 15 janvier 2009 au 23 juin 2009 auprès de M. Brice Hortefeux, ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du 23 juin 2009 au 22 mars 2010 auprès de M. Xavier Darcos, ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et depuis le 22 mars 2010, auprès de M. Éric Woerth, ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique.
La longévité de Mme Fadela Amara dans ses fonctions gouvernementales contraste avec l’instabilité de sa tutelle ministérielle depuis 2007, puisque 4 ministres ont été en charge de la ville depuis le début de l’actuelle législature et que cette tutelle a dans un premier temps relevé du logement et dans un second temps des affaires sociales (185).
Si l’on considère les périodes décisives pour la politique de la ville (mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, lancement des contrats de ville, lancement des grands projets de ville – GPV, puis du PNRU), celles-ci correspondent sensiblement à l’exercice des attributions correspondantes par un ministre délégué qui en était chargé à titre spécifique et exclusif. De surcroît, ces périodes ont été marquées par une certaine longévité de l’exercice de leurs attributions par les ministres concernés. Deux autres modèles d’exercice des fonctions ministérielles semblent plus problématiques :
– la dilution de la ville dans un grand ministère « social », où, nécessairement, ce thème n’est pas prioritaire et risque d’être marginalisé dans l’action du ministre ;
– la mise en place d’un secrétariat d’État, qui, sans mettre en cause la volonté et les qualités des personnes concernées, signifie nécessairement une certaine marginalisation au sein du Gouvernement ne serait-ce que parce que les secrétaires d’État n’assistent habituellement pas aux Conseil des ministres lorsqu’ils ne sont pas concernés ; le sort de beaucoup d’enjeux dépend pourtant de la capacité d’influence interministérielle du titulaire du poste.
b) L’administration centrale en charge de la ville : le Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG-CIV)
Le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 (186) avait mis en place une architecture de la gouvernance nationale de la politique de la ville s’appuyant sur trois éléments :
– un Conseil national des villes et du développement urbain, organe consultatif avec le concours duquel est élaborée la politique de la ville. Présidé par le Premier ministre et placé auprès de lui, il était composé d’élus nationaux et locaux, de personnalités qualifiées et de certains ministres et secrétaires d’État (187). Il se substituait à la Commission nationale pour le développement social des quartiers et au conseil national de prévention de la délinquance ;
– un Comité interministériel des villes et du développement social urbain, qui avait pour rôle de définir, animer et coordonner « les actions de l’État dans le cadre de la politique nationale des villes » avec le concours du Conseil national des villes. Présidé par le Premier ministre, il était composé des membres du Gouvernement membres du conseil national des villes ;
– une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (la DIV), placée sous l’autorité d’un délégué interministériel, constituait l’administration centrale en charge de la mise en œuvre des décisions du comité interministériel. Le délégué interministériel assurait le secrétariat du Conseil national et préparait les délibérations du comité interministériel.
Cette architecture a été maintenue dans ses grandes lignes par le décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville actuellement en vigueur. L’article 7 de ce décret définit les missions du secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV), qui se substitue à la DIV, et de son secrétaire général :
« Il est créé, auprès du Premier ministre, un secrétariat général du comité interministériel des villes.
« Il est dirigé par un secrétaire général nommé par décret.
« Le secrétaire général prépare les travaux et délibérations du comité interministériel, auquel il assiste et dont il assure le secrétariat permanent.
« Le secrétariat général contribue à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre interministérielles de la politique de la ville.
« Il assiste le ministre chargé de la politique de la ville dans l’exercice de ses attributions de tutelle des établissements publics.
« Dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel, il assure l’évaluation de la politique de la ville. À ce titre, il exerce la fonction de secrétariat permanent de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles [ONZUS]. »
Avant cette date, la création de l’Acsé en 2006 avait correspondu à un recentrage des missions de la DIV sur le pilotage stratégique de la politique de la ville ; le Fonds interministériel des villes (FIV), qui rassemblait les crédits nationaux d’intervention de la politique de la ville notamment engagés dans le cadre des contrats de ville, était en effet avant cette date géré par la DIV. En 2009, le SG-CIV n’a plus géré lui-même que 7,6 ²% des crédits d’intervention du programme 147 et cette proportion pourrait encore baisser en 2010 et lors des exercices suivants (188).
Cette fonction de pilotage stratégique prend appui sur les deux leviers que sont l’assistance apportée au ministre chargé de la politique de la ville dans l’exercice de ses attributions de tutelle (notamment l’Anru et l’Acsé, mais aussi l’Épide et l’Épareca) et la capacité de mobilisation de l’interministérialité en faveur de la politique de la ville.
S’agissant du rôle d’assistance auprès du ministre dans l’exercice de la tutelle sur certains établissements publics, on note que le SG-CIV est effectivement présent dans les conseils d’administration de l’Anru et de l’Acsé, mais dans des proportions très minoritaires :
– 5 des 36 membres du conseil d’administration de l’Anru représentent le SG-CIV (189). Les représentants du SG-CIV constituent ainsi un peu plus du quart des 18 représentants de l’État. Le président actuel du conseil d’administration, notre collègue député Gérard Hamel, a été nommé (190) parmi les personnalités qualifiées membres du conseil ;
– le secrétaire général du comité interministériel des villes est membre du conseil d’administration de l’Acsé et y dispose de 4 voix, pour un total de 36 voix réparties entre les 31 membres du conseil, dont 18 voix pour les treize représentants de l’État (191). La présidente actuelle du conseil d’administration, Mme Jeannette Bougrab, nommée ultérieurement présidente de la HALDE, a été choisie parmi les personnalités qualifiées membres du conseil (192).
Au-delà de ces constatations concernant l’organisation administrative, la négociation et la mise en œuvre des contrats d’objectifs et de performance (COP) peuvent constituer des modalités sans doute plus effectives de l’accomplissement par le SG-CIV de sa mission d’assistance auprès du ministre chargé de la ville dans l’exercice de sa tutelle sur les agences.
Le projet de COP de l’Acsé (193) précise que le secrétaire général du CIV est chargé, avec le directeur général de l’agence, de l’exécution du contrat. Ce point est décliné dans de nombreux articles du contrat (par exemple s’agissant des obligations et engagements financiers et comptables de l’agence et de son fonctionnement administratif (194)), pour lequel le SG-CIV apparaît effectivement comme le représentant opérationnel de l’État.
Le projet de COP de l’Anru prévoit une répartition du rôle d’interlocuteur au nom de l’État partagé entre le SG-CIV et la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), placée sous l’autorité du ministre chargé du logement (195). Aux termes de ce projet de contrat, cette répartition serait le mode de gestion applicable à la fois pour le dialogue entre l’agence et l’État relatif à la mise en œuvre du PNRU et pour l’exécution du contrat lui-même.
S’agissant de la mobilisation de l’interministérialité en faveur de la politique de la ville, l’article 9 du décret du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville précise que « le secrétaire général [du CIV] réunit, en tant que de besoin, les directeurs d’administration centrale concernés par la politique de la ville […] ou les dirigeants d’organismes publics intéressés ». Cette capacité théorique de mobilisation est bien entendu tributaire du poids du sujet de la ville dans la politique mise en œuvre par le Gouvernement et de la capacité d’action du membre du Gouvernement en charge de la politique de la ville auprès de ses collègues.
Vos rapporteurs considèrent que la dynamique « espoir banlieues », qu’il ne s’agit pas ici d’évaluer dans ses impacts compte tenu de la mise en œuvre récente des dispositifs qui la composent, illustre le fait que l’action administrative interministérielle ne peut se développer qu’en s’appuyant sur un contexte politique gouvernemental favorable à la politique de la ville.
c) Les effets de la faiblesse de l’interministérialité sur le plan politique : l’exemple de la dynamique « espoir banlieues »
La dynamique « espoir banlieues » (DEB) a été initiée par M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, le 8 février 2008, lors d’un discours tenu au Palais de l’Élysée. Un comité interministériel des villes (CIV) s’est ensuite tenu à Meaux le 20 juin 2008, sous la présidence du Premier ministre. Il a conduit à fixer les mesures de la DEB, dont une partie importante relevait dès l’origine des programmes triennaux que les ministères concernés avaient respectivement élaborés et que le CIV du 20 juin 2008 a validés. Afin de suivre précisément leur mise en œuvre, il était prévu que le CIV se réunirait désormais deux fois par an, selon un dispositif susceptible de mettre en valeur, entre chacune de ces réunions, la vocation interministérielle du SG-CIV. Si un CIV consacré à l’état d’avancement de la DEB a bien eu lieu le 20 janvier 2009, il n’a pas été réuni depuis cette date, malgré des annonces répétées en la matière.
Dès le départ, l’implication budgétaire attendue des ministères de droit commun dans la mise en œuvre de la DEB était forte et nécessitait en conséquence un pilotage interministériel effectif. Le tableau suivant retrace, pour la période 2009-2011, le montant des dépenses clairement identifiées comme relevant de la DEB au moment de son lancement en 2008, ainsi que la part de ces crédits dont le financement devait relever de l’Acsé.
CRÉDITS RELEVANT DE LA DYNAMIQUE « ESPOIR BANLIEUES » IDENTIFIÉS EN 2008
(en millions d’euros)
2009 |
2010 |
2011 | |
Total DEB |
330,1 |
331,1 |
336,1 |
dont crédits Acsé |
22,1 |
26,1 |
27,1 |
dont crédits Acsé |
6,7 % |
7,9 % |
8,1 % |
Source : direction du budget et SG-CIV
La part du financement de la DEB qui initialement devait relever de crédits de l’Acsé était donc faible et, en conséquence, il était nécessaire de prévoir un suivi interministériel régulier au niveau du CIV, afin d’appuyer l’action quotidienne du SG-CIV dans ses relations avec les ministères de droit commun. À la demande de vos rapporteurs, la direction du budget a enquêté auprès de ces ministères pour dresser un état des lieux de la mise en œuvre effective de la DEB et des projections budgétaires associées (196). Le tableau suivant retrace les crédits de paiement constatés (197) entrant dans le cadre de la DEB pour la période 2008-2010 par ministère contributeur.
CRÉDITS CONSTATÉS AU TITRE DE LA DYNAMIQUE « ESPOIR BANLIEUES »
PAR MINISTÈRE
(en millions d’euros)
2008 |
2009 |
2010 | |
Ministère de l’Éducation nationale |
133,6 |
338,3 |
510,2 |
Ministère du Travail, de la solidarité et des relations sociales |
2,1 |
137,8 |
208,5 |
Ministère de la Culture et de la communication |
2,3 |
4,6 |
4,4 |
Ministère de la Justice |
1,2 |
0,8 |
0,1 |
Ministère de la Santé |
0,4 |
2,2 |
10,0 |
Ministère de l’Intérieur |
116,0 |
130,0 |
156,0 |
Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
10,0 |
104,5 |
403,1 |
TOTAL |
265,5 |
718,1 |
1 292,3 |
Source : direction du budget.
On constate qu’au titre de la seule année 2010, le montant des crédits dépasserait celui des crédits initialement identifiés comme relevant clairement de la DEB sur toute la période 2009-2011. Il semble que le volontarisme des ministères de droit commun en faveur de la DEB les ait conduit à y intégrer des dispositifs ou des parties de dispositif non retenus initialement. Au moins deux exemples peuvent être évoqués :
– le ministère de l’Éducation nationale semble considérer désormais que le coût global du dispositif d’accompagnement éducatif relève de la DEB, soit 273 millions d’euros en 2009. Or, la mesure DEB consistait en l’extension du dispositif aux écoles primaires relevant de l’éducation prioritaire, celui-ci s’appliquant depuis la rentrée 2008 dans tous les collèges hors du cadre de la DEB. D’après les documents transmis à vos rapporteurs, le coût de la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif dans les écoles primaires relevant de l’éducation prioritaire est connu (41,1 millions d’euros en 2009). Est ainsi mise au crédit de la DEB, de façon abusive, la mise en œuvre de l’accompagnement scolaire dans les collèges, alors qu’une très grande majorité d’entre eux ne relèvent pas de l’éducation prioritaire (sans compter les réserves déjà exprimées par vos rapporteurs supra s’agissant de l’assimilation pure et simple de l’éducation prioritaire et de la politique de la ville) ;
– le ministère chargé du travail attribue à la DEB l’ensemble des crédits de l’État affectés à l’Épide, soit environ 76 millions d’euros en 2009 et 2010. S’agissant d’un établissement créé avant le lancement de la DEB, et quand bien même son esprit est rattachable aux dispositifs « deuxième chance » qui composent une partie de son volet éducatif, ce rattachement global semble également excessif. Le « public » de l’Épide n’est d’ailleurs pas exclusivement composé de jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
A contrario, des retards sont repérables s’agissant de certaines actions initialement prévues comme relevant de la DEB dès son lancement. Ainsi, des actions relatives aux modes de garde des enfants, à la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires, aux « parcours d’insertion » et aux « parcours d’autonomie » semblent ne pas avoir été mises en œuvre en 2009. Ces actions avaient pourtant été budgétées pour un montant de 375 millions d’euros pour la période 2009 à 2011, soit plus du tiers des crédits consacrés à la DEB identifiés en 2008.
Le tableau suivant retrace pour 2009, par grande thématique, les crédits initialement envisagés et les crédits effectivement constatés au titre de la DEB. On note que pour chaque thématique, l’écart est considérable entre la prévision et la réalisation. Au total, toutes thématiques confondues, cet écart représente un supplément de 196 millions d’euros, soit 38 % au regard de la prévision globale initiale.
LA DYNAMIQUE « ESPOIR BANLIEUES » EN 2009 : CRÉDITS PRÉVUS ET CONSTATÉS
(en millions d’euros)
Mesures |
Crédits prévus |
dont Acsé |
Crédits constatés |
dont Acsé |
Différence | |
en millions |
en % | |||||
Total éducation |
32,0 |
10,1 |
342,4 |
4,1 |
+ 310,4 |
+ 969 |
Total emploi et accès au travail |
261,7 |
3,0 |
127,8 |
2,9 |
- 133,9 |
- 51 |
Total médiation sociale et sécurité |
22,6 |
0 |
141,6 |
0 |
+ 119,3 |
+ 528 |
Total transports, désenclavement et gestion urbaine |
169,0 |
9,0 |
98,8 |
5,9 |
- 70,2 |
- 42 |
Total santé |
37 |
0 |
2,2 |
0 |
- 34,8 |
- 94 |
Total accès à la culture |
0 |
0 |
4,6 |
0 |
+ 4,6 |
s.o. |
Total accès au droit et à la justice |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
+ 0,8 |
s.o. |
TOTAL |
521,9 |
22,1 |
718,2 |
12,9 |
+ 196,2 |
+ 38 |
s.o. : sans objet
Source : Direction du budget
La direction du budget constate ainsi que « les actions considérées comme “ relevant de la DEB ” par les administrations ne sont pas toujours identiques aux mesures prévues initialement ». Elle considère s’être heurtée « à la complexité de la mise en œuvre de ce plan que les différents départements ministériels concernés peinent à identifier », notamment parce que certains d’entre eux « ne sont pas réellement mobilisés ». Ainsi, faute d’un pilotage interministériel imposant une méthodologie commune en matière de prise en compte des dispositifs et des crédits ainsi qu’un suivi centralisé et transparent de leur mise en œuvre, la DEB semble livrée au bon vouloir et à l’imagination des ministères de droit commun. Un plan pourtant emblématique de la politique de la ville est ainsi « conduit » sans suivi politique cohérent et hors du contrôle de l’administration qui devrait normalement en assurer le pilotage.
2.– L’Anru et l’Acsé : un duo déséquilibré et problématique
a) Le succès reconnu de l’Anru, parfois accompagné de quelques critiques, conduit les pouvoirs publics à lui confier de nouvelles missions
On constate, auprès notamment des élus locaux et des organismes bailleurs de logements locatifs sociaux, une satisfaction générale s’agissant du PNRU, en tant qu’instrument d’une réelle rénovation de l’habitat au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. Selon les parties prenantes locales, les habitants auraient le sentiment d’être considérés, pour une fois, à la hauteur de leurs légitimes attentes par une politique publique claire dans ses objectifs et efficiente dans sa mise en œuvre. L’Anru, dans ce contexte, est considérée en règle générale comme un instrument efficace, qui a eu le mérite de donner la parole et les clés de la rénovation urbaine aux porteurs locaux des projets, c’est-à-dire, en règle générale, les maires. Ont ainsi été dessinés les contours d’une décentralisation réelle, qui associe, par la méthode contractuelle, un État fort et le cas échéant exigeant avec les collectivités territoriales, et des marges de manoeuvre nouvelles attribuées à des acteurs locaux responsabilisés et réellement maîtres d’œuvre de leur projet urbain.
Si cette opinion est largement majoritaire parmi les nombreux acteurs locaux rencontrés par vos rapporteurs, elle est ponctuellement accompagnée par des appréciations moins favorables, voire par certaines critiques. Sur le principe du PNRU, certains observateurs ou acteurs considèrent que la procédure de l’appel à projet dans un temps et une enveloppe limités a conduit à des comportements locaux pas toujours les plus efficients. Des projets de rénovation urbaine auraient ainsi pâti d’une certaine précipitation dans leur conception ; afin d’être rapidement prêts à passer l’épreuve du comité national d’engagement de l’Anru, certains maires auraient privilégié des « projets de bailleurs », plus orientés par la sauvegarde, la valorisation ou le remplacement de leur patrimoine que par les intérêts globaux d’une aire urbaine comprenant un quartier défavorisé à rénover.
Sous un autre angle, certains observateurs regrettent que le PNRU ait donné à certains porteurs de projet l’opportunité de remodeler leurs quartiers de « grands ensembles » selon leur bon vouloir ; la démolition, pas toujours opportune du point de vue de la rénovation urbaine, de certaines tours a ainsi eu lieu, appuyée par l’Anru qui a pu, au moins au début de son activité, considérer prioritaire ce type de traitement radical afin de donner au plus vite une visibilité à l’ensemble du PNRU.
D’autres critiques plus techniques sont également évoqués par certains acteurs ou observateurs de la rénovation urbaine. Il fut ainsi une époque où l’Anru imposait aux maîtres d’œuvre et opérateurs des projets de rénovation urbaine des délais de paiement très longs (198). Sur ce point, l’Anru a su modifier et améliorer ses méthodes de travail ; les délais de paiement seraient passés de plus de 220 jours en moyenne en 2008 à environ 100 jours aujourd’hui. Afin d’améliorer l’ensemble de la procédure des paiements, l’Anru considère pouvoir désormais s’appuyer sur l’usage du système d’information « Agora », qui serait désormais opérationnel, et envisage d’expérimenter un dispositif de paiement a priori sur simple déclaration de l’opérateur, les pièces justificatives étant contrôlées dans un second temps.
De façon générale, la centralisation des procédures de l’Anru est souvent considérée commun son principal point faible (199). Le résumé d’un récent rapport de la mission d’audit et de conseil de la direction générale des finances publiques, du contrôle général économique et financier et du conseil général de l’environnement et du développement durable, en octobre 2009 (200) illustre que le succès de l’Anru est pondéré par des éléments techniques liés à son fonctionnement centralisé et, aussi, par un questionnement quant à sa capacité à faire face à la phase de réalisation physique du PNRU :
« L’Anru est une réussite qu’il faut conforter. Alors que les principes gouvernant l’éligibilité des projets ont fait l’objet d’un large consensus et que la quasi-totalité de l’enveloppe financière du programme national de rénovation urbaine est affectée, la réussite de la deuxième phase de la mission de l’Anru se mesurera principalement en termes d’effectivité de la réalisation physique des projets dans les quartiers. Aussi, l’audit a-t-il eu pour objectif de s’assurer des conditions de performance de la gestion des projets urbains approuvés et financés par l’Anru et d’améliorer la qualité, la rigueur et la sécurité des procédures financières et de remontée de l’information mises en oeuvre par cet établissement. Ses préconisations s’articulent autour de trois axes. Le premier consiste à raccourcir le circuit d’exécution financière des conventions parallèlement à l’introduction de procédures formalisées de contrôle interne comptable; le deuxième d’augmenter l’étendue de la délégation accordée aux délégués territoriaux pour conclure les avenants dits simplifiés; le troisième de réorganiser le fonctionnement en réseau et de renforcer au besoin les ressources humaines. »
Dans leur synthèse (201), les auditeurs considéraient en premier lieu, s’agissant de la procédure centralisée des paiements, que « la redondance actuelle entre l’instruction réalisée localement des demandes de paiement et le contrôle qui est fait à la direction financière [à Paris] avant transmission à l’agence comptable est consommatrice de temps et de ressources pour un faible niveau de sécurité supplémentaire. La mission propose que les dépenses soient ordonnancées directement par les délégués territoriaux [c’est-à-dire les préfets], y compris les soldes ».
Les auditeurs constataient en deuxième lieu, s’agissant de la procédure de négociation des avenants aux conventions pluriannuelles, que celles-ci « doivent nécessairement être adaptées au cours de leur durée d’exécution. Pour ne pas noyer les partenaires nationaux de l’Anru sous des masses d’avenants qui ne remettent pas en cause les choix qui ont présidé à la conclusion des conventions, le niveau départemental apparaît comme le plus adapté à constater les nécessités d’évolution, les négocier et les contractualiser.
« Les auditeurs proposent de donner un champ élargi aux avenants simplifiés, applicable partout en France et pour toutes les conventions. L’adaptation aux forces et faiblesses locales se fera par les mécanismes de contrôle et d’appui portés par l’Anru. »
Sur ce point, le rapport d’audit invite l’Anru à faire preuve d’une réelle confiance à l’attention de ses délégués territoriaux, en considérant que « l’importance des enjeux, financiers et sociaux, sur les opérations les plus prioritaires ne doit certainement pas conduire à les réserver à un pilotage national exclusif, même si des directives et un soutien spécifiques peuvent être donnés par l’Anru aux délégués territoriaux pour ces opérations. En effet, les atouts de la proximité existent aussi sur ces opérations, la complication introduite par une telle dualité irait à l’encontre de l’efficacité recherchée, et, enfin, ce n’est pas en disant aux acteurs locaux qu’ils sont juste bons à s’occuper des dossiers secondaires qu’on les motivera.
« La responsabilisation locale sur les avenants est indissociable de la démarche consistant à fixer au bénéfice des délégués territoriaux un principe général et durable de “ droit au retour ” d’une partie des économies que la passation des avenants simplifiés génère ».
Enfin en troisième lieu, s’agissant des moyens nécessaires à l’agence pour faire face à la phase de réalisation physique du PNRU, les auditeurs estimaient que « la montée en rythme de l’exécution du PNRU va entraîner une augmentation massive de la quantité d’actes financiers à traiter. Une marge importante dans la productivité des acteurs […] existe, mais ne pourra suffire à absorber entièrement l’augmentation des volumes. Des renforts d’effectifs devront être accordés. »
En annexe du rapport d’audit, sont présentées les observations de l’Anru concernant les préconisations de l’audit, ainsi que les réponses des auditeurs à ces observations. Vos rapporteurs constatent que l’Anru semble s’engager à tenir compte de ces préconisations, les auditeurs considérant néanmoins ponctuellement que les mesures envisagées par l’Anru en la matière nécessitent des éclaircissements ou des améliorations.
Ces considérations techniques, qu’il ne s’agit pas de minorer ou d’ignorer, n’auront pas empêché, dans les mois et les années qui viennent, l’achèvement d’un nombre croissant de chantiers de rénovation urbaine. Ainsi, malgré les retards initiaux, les critiques de fond et les réserves techniques, le PNRU est en voie de réalisation dans l’ensemble du pays.
Ce succès opérationnel, bien qu’encore potentiel à ce stade et portant sur des éléments quantitatifs, a conduit de nombreux acteurs locaux à d’ores et déjà préconiser un deuxième plan de rénovation urbaine à l’issue du premier. Il s’agirait d’achever ainsi la rénovation urbaine, celle-ci n’étant que partiellement réalisée dans certaines aires urbaines ; vos rapporteurs peuvent témoigner qu’une telle situation, constatée lors d’un déplacement à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, ne sera pas tolérable à terme au regard de l’inégalité objective de traitement des habitants d’un quartier à l’autre, voire d’une rue à l’autre, et conduirait inévitablement à fragiliser les opérations menées à leur terme.
Le succès pressenti du PNRU a par ailleurs conduit les pouvoirs publics à attribuer à l’Anru une série de missions nouvelles. Le projet de convention d’objectifs et performance liant l’Anru et l’État pour les années 2010 à 2012 (acté par le conseil d’administration de l’agence du 7 juillet 2010) en témoigne. Trois nouvelles missions ont ainsi été attribuées au fil du temps à l’Anru.
En premier lieu, l’agence contribuera à la mise en œuvre et au financement du Plan national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) prévu et défini par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion. Le financement public du PNRQAD devrait s’élever à 380 millions d’euros répartis entre l’Anru (150 millions d’euros), l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH – 150 millions d’euros) et le ministère du logement au titre de ses crédits de droit commun (80 millions d’euros).
La part revenant à l’Anru sera financée par un prélèvement sur le produit de la participation des employeurs à l’effort de construction recouvrée par Action Logement (202). Le PNRQAD devrait, par effet de levier concernant notamment la mobilisation des capacités financières des collectivités territoriales et des bailleurs, conduire à la réalisation de travaux pour un total de 1,5 milliard d’euros sur 3 ans. Le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixe la liste des quartiers bénéficiaires du PNRQAD (203).
En deuxième lieu, l’agence est l’opérateur de la mesure de fermeture de certains collèges dégradés présentée supra (204). Ces opérations seront mises en œuvre par l’Anru dans le cadre du PNRU et financées par une dotation budgétaire spécifique du programme 147 de 40 millions d’euros pour l’ensemble de la période 2010-2011. Un premier appel à projets au cours du premier semestre 2010 n’a pas permis d’affecter la totalité de ce montant ; un second appel à projets devait être lancé cet été. Un collège n’est éligible que si le maire de la commune concernée, le président du conseil général, les autorités académiques et le préfet sont unanimes sur son sort.
En troisième lieu, l’agence est l’opérateur retenu pour mettre en œuvre le programme « Internats d’excellence et égalité des chances », présenté supra, dans le cadre de l’emprunt national pour les dépenses d’avenir. Ce programme comporte une action sur le bâti, puisqu’il porte au total sur une centaine de sites et 20 000 places d’internat, dont 12 000 pourraient être entièrement nouvelles. Il comporte aussi une action aux contours a priori plus « sociaux », portant sur diverses actions ministérielles ou interministérielles favorisant la mixité sociale, l’égalité des chances et le développement de l’accès à la culture scientifique, en particulier pour les jeunes de condition sociale modeste.
Ce dernier point illustre la tentation d’attribuer à l’Anru des missions qui ne relèvent pas de son cœur de métier portant sur l’urbain bâti. Cette contrepartie à son succès témoigne aussi de la difficulté à maintenir une séparation administrative et pratique entre l’« urbain » et l’« humain » en matière de politique de la ville.
b) L’Acsé, chargée d’une mission difficile, doit encore surmonter une période d’instabilité concernant ses missions et ses effectifs
En contrepoint de la situation de l’Anru, l’exercice par l’Acsé de son activité est rendu difficile par différents éléments déjà évoqués supra :
– alors que l’Anru a été créée pour la mise en œuvre d’un plan national identifié, l’Acsé gère une série de dispositifs hétérogènes, antérieurs pour la plupart à la création de cette agence et constituant tout un pan de l’histoire de la politique de la ville depuis plus de 30 ans, dont les strates successives de mesures ne sont pas toujours caractérisées par leur cohérence d’ensemble ;
– si l’Anru dispose d’interlocuteurs identifiés (les élus porteurs des projets de rénovation urbaine) avec lesquels elle négocie et contracte « en direct », le « public » de l’Acsé est constitué de milliers d’intervenants de la politique de la ville avec lesquels l’agence n’entretient pas de relations contractuelles. A contrario, l’Acsé n’est pas signataire des Cucs au nom de l’État et n’est donc pas l’interlocuteur des responsables locaux de la politique de la ville. Elle doit pourtant les mettre en œuvre à travers les financements qu’elle consent.
Au-delà de ce contexte objectivement difficile concernant le « métier » de l’Acsé, vos rapporteurs ont déjà évoqué les « chocs » administratifs successifs subis par celle-ci dans le cadre de sa création, de la redéfinition de ses missions et de la révision générale des politiques publiques :
– le support administratif sous-jacent de l’Acsé est l’ancien Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), établissement public qui avait vocation à financer certaines des opérations mises en œuvre par des associations d’aide aux migrants. Les personnels du Fasild ont donc été tenus d’acquérir, en 2006, dans une certaine précipitation, la culture de la politique de la ville et d’envisager leur action dans le contexte contractuel propre à cette politique, tout en continuant à s’acquitter des missions antérieures d’aide aux migrants. Le transfert de ces dispositifs au ministère chargé de l’immigration en 2009 a sans doute accentué pour ces personnels le changement culturel auquel a correspondu la création de l’Acsé, sans compter que ce transfert s’est accompagné d’une baisse du plafond d’emplois de l’Acsé de 60 équivalents temps plein ;
– les directions régionales de l’Acsé ont été supprimées à compter du 1er janvier 2010. Ainsi, 142 équivalents temps plein ont été transférés aux nouvelles directions régionales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), créées à compter de cette date. L’Acsé doit ainsi actuellement travailler à nouer des liens nouveaux avec certains agents de l’État au niveau déconcentré, qui, souvent, ne sont pas uniquement chargés de tâches relatives à la politique de la ville ;
– les mesures issues de la RGPP concernant la réorganisation des services des préfectures de département semblent aussi avoir un impact sur l’activité de l’Acsé. La RGPP a laissé à chacune de ces préfectures le choix, en fonction des besoins locaux, de disposer ou non d’une direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), dont les personnels ont vocation à instruire les demandes de subvention financées sur les crédits délégués par l’Acsé. En l’absence de DDCS, c’est une direction départementale interministérielle qui assure cette mission pour le compte de l’Acsé. Si chaque département a opéré aujourd’hui ce choix de gestion et doit avoir organisé ses services en conséquence depuis le 1er janvier 2010, la réorganisation administrative sur le terrain semble difficile ; en conséquence, on observe pour le début de l’année 2010 une consommation des crédits délégués par l’Acsé aux départements en recul substantiel par rapport à 2009, alors que des progrès importants par rapport à 2007 et 2008 avaient pu être mis au crédit de l’agence en 2009 en la matière (205).
Ce contexte général n’a pas contribué à susciter une confiance réelle envers l’agence de la part des décideurs et acteurs publics. Très peu sollicitée au titre du Plan de relance, l’Acsé n’a pas non plus été choisie comme opérateur des dépenses d’avenir relatives aux « diverses actions ministérielles ou interministérielles favorisant la mixité sociale, l’égalité des chances et le développement de l’accès à la culture scientifique, en particulier pour les jeunes de condition sociale modeste » du programme « Internats d’excellence et égalité des chances ».
Au terme de cette période difficile pour l’Acsé, et dans le cadre d’une activité qui ne l’est pas moins, certains éléments positifs semblent pouvoir être mis à son crédit. Ainsi, un audit de l’agence réalisé dans le cadre de la RGPP (206) a récemment considéré d’une part que « les équipes ont absorbé l’essentiel des restructurations intervenues depuis trois ans » et d’autre part que « les premiers résultats sont encourageants » s’agissant de certains résultats concrets des dispositifs gérés par l’agence et de la rapidité et de la sécurisation des procédures financières. En conséquence, « la mission [d’audit] ne s’est pas orientée vers une nouvelle modification de l’architecture de l’institution : elle insiste au contraire sur l’intérêt de rentabiliser l’effort consenti pour ces restructurations, dont les effets ne se sont pas encore tous produits, et de s’attacher dans ce but à des mesures fines de réglage de la stratégie, du pilotage des dispositifs et des moyens de l’Acsé. » (207)
Le point d’arrivée de cette mission d’audit est le contrat d’objectifs et de performance (COP) entre l’Acsé et l’État, couvrant la période 2010 à 2013, actuellement en cours de signature. Dans son introduction, ce document précise qu’« après une période de restructuration de ses missions et de ses moyens, le contrat d’objectifs et de performance vise à stabiliser l’établissement ». Vos rapporteurs considèrent que cet objectif peut être prochainement atteint, notamment du fait du recentrage de l’action de l’Acsé sur la politique de la ville.
c) La dichotomie entre l’« urbain » et le « social » demeure un problème et doit être aménagée
La perception d’un déséquilibre des moyens et des résultats entre l’Anru et l’Acsé est fréquente. Vos rapporteurs ont tenté d’établir supra des constats factuels sur la situation propre à chacune de ces agences.
Mais l’existence même de deux agences distinctes demeure une question à part entière. Sans contester le progrès majeur qu’a constitué le lancement du PNRU et la création de l’Anru, certains interlocuteurs de vos rapporteurs ont exprimé un certain « regret » de l’époque où les opérations de rénovation urbaine constituaient la partie « investissement » des contrats de ville. La cohérence des politiques nationale et locales de la politique de la ville en était, selon eux, plus forte qu’aujourd’hui. Dans un développement déjà évoqué supra par vos rapporteurs, la DIV a posé récemment une nouvelle fois la question de la cohérence des contrats, en retenant l’idée que si un nouveau contrat de politique de la ville plus large devait être imaginé sur la base d’une géographie prioritaire renouvelée, des conséquences devraient en être tirées s’agissant, entre autres, des conventions de rénovation urbaine (208).
Or, la cohérence est une condition de la réussite. Vos rapporteurs on pu constater que la présidence et la direction exécutive de l’Anru exprimaient des inquiétudes quant au succès à long terme du PNRU, notamment en évoquant une certaine carence dans l’accompagnement social des opérations de rénovation urbaine. Les quartiers qui connaissent les difficultés sociales et économiques les plus graves sont aussi ceux dans lesquels l’investissement public dans le cadre du PNRU a été le plus fort. Il est effectivement à craindre que, si la pauvreté et le chômage y demeurent à leur niveau actuel et que, de manière générale, le lien social et la confiance dans l’action des pouvoirs publics n’y sont pas renforcés, et les comportements durablement modifiés pour respecter les nouveau bâtis, « l’acquis du bâti » y soit réduit à n’être que le décor amélioré de futures crises sociales et sociétales.
L’accompagnement social du PNRU doit devenir une priorité politique et, dans ce contexte, vos rapporteurs ont exprimé supra leur souhait que soient menées des expérimentations tendant à intégrer certaines conventions de rénovation urbaine dans de nouveaux contrats de ville.
Vos rapporteurs saluent aussi l’initiative prise par l’Anru et l’Acsé d’établir un accord-cadre afin de formaliser leur future coopération.
Dans l’introduction du plan détaillé de cet accord encore en cours d’élaboration, les agences constateraient que « les territoires couverts par un projet de rénovation urbaine (PNRU) sont tous dans le champ d’intervention de l’Acsé et identifiés dans des dispositifs contractuels avec les collectivités territoriales. […]La distinction nette de leurs métiers ne fait pas obstacle à une coopération accrue et institutionnalisée entre les deux opérateurs. »
Évoquant l’objectif central de l’accord-cadre qui consisterait à « formaliser la coopération entre les deux agences », celles-ci considèrent qu’un des moyens permettant de l’atteindre serait d’identifier « les principaux thèmes à l’interface des actions des deux agences, pour contribuer à l’émergence et à la mise en œuvre de projets de territoire ». Il serait ainsi admis que de tels projets, qui formeraient le socle de nouveaux contrats de la politique de la ville, n’émergent que si, à tout le moins, une telle interface existe. Autrement dit, il est ainsi admis que la dichotomie entre les deux agences nuit à l’émergence des projets de territoire.
Le plan détaillé de l’accord-cadre prévoit par ailleurs des « interventions complémentaires articulées sur des sujets communs » :
– en matière de relogement, une clarification des compétences de chaque agence est opportunément envisagée : « le besoin d’accompagnement social pendant le relogement […] relève de l’Anru », alors que « le besoin d’accompagnement de certains habitants après le relogement, notamment en termes de conseils en économie sociale et familiale, et pour l’occupation du nouveau logement et des espaces communs […] relève de l’Acsé et des politiques de droit commun ». Il serait prévu qu’en matière de relogement « les deux agences [conduisent] une expérimentation ciblée » ;
– pour l’accès à l’emploi, le projet d’accord-cadre prévoit « la mobilisation de l’ingénierie des deux agences et leur soutien à l’ingénierie locale pour développer l’accompagnement dans les parcours vers l’emploi en renforçant la mise en oeuvre de la clause d’insertion […] » ;
– deux actions sont prévues s’agissant de l’activité économique et du commerce : d’une part « identifier dans les projets de rénovation urbaine les conditions du développement des activités et des commerces », ce qui illustre une faiblesse actuelle des conventions de rénovation urbaine ; d’autre part, « apporter une expertise et mettre en place une ingénierie d’accompagnement des créateurs d’activités ou d’appui aux commerces sur des sites choisis en commun » ;
– en matière de gestion urbaine de proximité, une clarification des activités respectives des deux agences est envisagée ; par ailleurs une plus grande cohérence des actions de l’Acsé autour des dispositifs mis en œuvre par l’Anru dans le cadre des conventions de rénovation urbaine est recherchée sous les formes suivantes : « préparer la sortie des projets de rénovation urbaine et la transition vers l’arrêt des financements de l’Anru et le “ régime de droit commun ” dans le cadre d’une nouvelle contractualisation. S’assurer, notamment à partir des diagnostics dits “ en marchant ”, de l’association pérenne des habitants à l’usage et au respect de leur environnement quotidien ; et renforcer la coordination locale pour la mise en œuvre et les suivis des conventions de gestion urbaine de proximité » ;
– une mobilisation des ressources de l’Acsé autour des opérations de rénovation urbaine est envisagée en matière de sécurité et de tranquillité : « mobiliser l’expertise de l’Acsé par les délégués territoriaux (au titre des Cucs) et par l’Anru pour apporter un appui aux maîtres d’ouvrage d’opérations inscrites dans les projets de rénovation urbaine en matière de prévention de la délinquance, notamment en termes de prévention sociale et situationnelle et de sécurisation des lieux ». Ce projet illustre là aussi un point faible constaté des conventions de rénovation urbaine ;
– en matière éducative, est prévu, dans le cadre du programme des internats d’excellence pour lequel l’Anru est l’opérateur principal, l’apport de « l’expertise de l’Acsé sur la qualité des projets d’internats d’excellence dans le cadre des instances prévues par la future convention État-Anru » ;
– enfin, s’agissant de la santé, le projet d’accord-cadre prévoit une meilleure prise « en compte de la problématique de la santé dans le cadre des projets de rénovation urbaine, [en favorisant] localement le rapprochement des équipes en charge du volet “ santé ” des Cucs et celles de la rénovation urbaine, par une participation respective des membres de ces équipes aux comités de suivi du relogement et aux instances de travail des ateliers santé-ville (ASV) ».
Le projet d’accord-cadre prévoit par ailleurs des axes de coopération relatifs à l’association de l’Acsé aux points d’étape des projets de rénovation urbaine, à la formation professionnelle – le cas échéant conjointe – des personnels des deux agences, à la sortie des conventions de rénovation urbaine, à la communication et à l’évènementiel, à la coopération internationale et aux échanges de données.
D’aucuns considéreront qu’un tel programme constituerait un pas supplémentaire dans la mise à disposition des moyens de l’Acsé en faveur du PNRU et de l’Anru. Il faudra veiller en conséquence à ce que soient préservés les moyens que l’Acsé déploient hors des zones concernées par le PNRU. Ce rapprochement envisagé prouve en tout état de cause, ne serait-ce que par les sujets abordés par le projet d’accord-cadre, que les thématiques qui sont au cœur de l’activité de l’Acsé et des Cucs doivent être développées, plus qu’aujourd’hui, dans le cadre de la rénovation urbaine, au moment où les premières opérations du PNRU arrivent à leur terme.
B.– LA GOUVERNANCE LOCALE : UN ÉTAT EN DIFFICULTÉ ET UNE COMPÉTENCE OPÉRATIONELLE EXERCÉE PAR LE MAIRE
1.– L’État local dans la politique de la ville : l’impossible proximité ?
a) Rôle du préfet et malaise de l’État local
En matière de politique de la ville, le préfet du département est à la fois le représentant du ou des membres du Gouvernement chargés de la politique de la ville et le délégué territorial de l’Acsé et de l’Anru. Par ailleurs signataire de tous les Cucs du département, il doit y assurer la cohérence globale de l’action de l’État ; il est tenu par ailleurs de veiller à ce que l’action de l’État dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville soit caractérisée par la même cohérence. Au demeurant, la politique de la ville n’est que l’une des nombreuses missions du préfet : elle s’inscrit ainsi dans une action déconcentrée globale dont elle ne constitue qu’une partie limitée puisque les préfets de région et de département, aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, « représentent le Premier ministre et chacun des ministres » et « dirigent, sous l’autorité des ministres (…), les services déconcentrés des administrations civiles de l’État ».
S’agissant de la politique de la ville, vos rapporteurs considèrent qu’une telle mission ne peut être menée de façon réellement efficace, malgré leur compétence, par les préfets et les services placés sous leur autorité. Cette vision théorique d’une représentation personnalisée et administrative de l’État et du Gouvernement dans un ressort territorial (où résident souvent plusieurs centaines de milliers d’habitants) ne saurait masquer l’éloignement concret entre le préfet et ses services d’un côté et les problèmes quotidiens auxquels est confrontée l’action publique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pourtant, cette vision semble encore être invoquée pour envisager la réalité de l’organisation de la présence et de l’action de l’État local.
Ainsi, vos rapporteurs, constatant la multiplicité des acteurs locaux (209) de la politique de l’emploi et la gravité persistante du problème du chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ont posé la question à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) de la gouvernance concrète des dispositifs mis en œuvre en la matière dans les quartiers prioritaires. La DGEFP répond en premier lieu par la formule suivante : « le préfet de région s’assure de la cohérence de l’action de l’État dans la région ». Cet extrait ne fait pas justice de la précision de la réponse apportée à vos rapporteurs à cette occasion, la DGEFP précisant ainsi que l’action du préfet s’appuie sur la convention annuelle régionale liant l’État et Pôle emploi, ainsi que sur la déclinaison à l’échelle régionale de l’accord national de co-traitance signé entre l’État, pôle emploi et les missions locales.
Mais là encore, évoquant cet « accord national de co-traitance », la formule de la DGEFP semble relever d’une vision théorique du rôle du préfet, sans rapport avec l’importance des difficultés propres à un quartier en particulier : « il revient aux préfets de région et services déconcentrés d’organiser la coordination des objectifs de l’accord avec ceux des autres outils dédiés aux jeunes en région », leur énumération ne faisant d’ailleurs que renforcer l’impression d’une multitude d’acteurs contractant chacun avec chaque autre dans un ensemble rendu encore plus complexe par ces initiatives contractuelles : « contrats d’objectifs et de moyens pour l’insertion professionnelle des jeunes [signés entre l’État et les conseils régionaux], protocoles régionaux conclues avec les collectivités territoriales, […] convention annuelle régionale signée [par les collectivités territoriales] avec Pôle emploi et les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens conclues avec les missions locales ».
Au-delà de la mission théorique du préfet, qui relève en fait d’une fiction républicaine, vos rapporteurs peuvent témoigner d’une forte inquiétude des représentants de l’État local quant à son rôle, ses moyens, voire quant aux modalités de son existence à moyen terme. Confrontée à une raréfaction des moyens plus rapide encore que celle des missions, l’État local peut être conduit à employer son énergie à masquer son incapacité à tenir les engagements qu’il a pris. Dans ce contexte, la RGPP a ouvert par ailleurs une période difficile de réorganisation, dont certains effets directs sur la politique de la ville ont été évoqués supra.
b) Les tentatives de représentation directe de l’État local dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
L’histoire de la politique de la ville a été jalonnée d’initiatives tendant à rapprocher l’État local des quartiers prioritaires ou à adapter son organisation à leurs problématiques, ce qui illustre d’ailleurs l’inadaptation du modèle préfectoral traditionnel pour la mise en œuvre de la politique de la ville.
Treize sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville auprès de certains préfets de département et de régions ont été nommés par un décret du 28 janvier 1991 du Président de la République (210). Des sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville sont aujourd’hui en fonction dans 25 départements.
Par ailleurs, l’article 1er du décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 relatif aux préfets délégués pour l’égalité des chances dispose que « dans les départements dont la liste est fixée par décret, un préfet délégué pour l’égalité des chances est nommé auprès du préfet de département.
« Le préfet délégué pour l’égalité des chances assiste le préfet de département pour toutes les missions concourant à la coordination et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de cohésion sociale, d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations. À ce titre, il participe à la mise en oeuvre des actions visant à l’intégration des populations immigrées résidant en France. »
Le champ de compétence des préfets délégués à l’égalité des chances est plus large que la politique de la ville ; celle-ci est néanmoins sous-jacente à chacun des trois items qui composent ce champ (cohésion sociale, égalité des chances et lutte contre les discriminations).
En application de l’article 1er du décret n° 2005-1646 du 27 décembre 2005, des préfets délégués à l’égalité des chances ont été nommée et sont aujourd’hui en fonction dans six départements, qui regroupent une part importante des zones prioritaires de la politique de la ville : les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, le Nord, le Rhône, la Seine-saint-Denis et le Val-d’Oise. 191 ZUS, soit 25 % de l’effectif, sont situées dans ces six départements (211).
Aucun département n’est à la fois doté d’un sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville et d’un préfet délégué pour l’égalité des chances. Il convient d’ajouter que les sous-préfets des sous-préfectures sont aussi chargés de la politique de la ville au niveau territorial infra-départemental. Vos rapporteurs relèvent que la parole de l’État, lors de leurs trois déplacements sur le terrain, a été portée, en complément des propos du préfet de région ou de département, respectivement par un sous-préfet territorial, un sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville et un préfet délégué pour l’égalité des chances.
Dans le cadre de la dynamique « espoir banlieues », le Gouvernement a, par ailleurs, souhaité récemment accentuer la territorialisation de la présence de l’État dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par la mise en place de « délégués du préfet ». Il s’agit d’une initiative d’une nature différente des précédentes. En effet, les sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville et les préfets délégués pour l’égalité des chances demeurent compétents pour l’ensemble d’un département ; Du point de vue de la politique de la ville, le bénéfice était ainsi censé avoir son origine dans la spécialisation thématique. Si cet aspect n’est pas étranger au concept du délégué du préfet, la caractéristique de ce dernier est d’être territorialement compétent pour un seul quartier. Ce point constitue a priori un progrès, car la politique de la ville nécessite, selon vos rapporteurs, une présence physique des services de l’État dans les quartiers prioritaires.
La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2008 (212) met l’accent sur l’aspect symbolique de la mise en place des délégués du préfet : « la présence de l’État dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doit être réaffirmée ». Dans un courrier adressé aux délégués du préfet le 16 mars 2009, les membres du Gouvernement chargés de la ville évoquaient cet aspect en ces termes : « votre nomination incarne la volonté du Gouvernement d’affirmer la présence physique et permanente de l’État dans ces quartiers […] » (213).
La circulaire du 30 juillet 2008 définit ainsi la mission opérationnelle du délégué du préfet, ainsi que les modalités hiérarchiques selon lesquelles il doit la mener : il a « pour mission de coordonner l’action des services de l’État dans les quartiers, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, du préfet délégué pour l’égalité des chances ou du sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville. Il exercera son action en lien étroit avec le sous-préfet d’arrondissement auquel il rendra compte ». Le courrier du 16 mars 2009 précise cette mission opérationnelle par rapport aux services de l’État et aux autres acteurs de la politique de la ville, notamment les collectivités territoriales : « vous devez être particulièrement attentifs aux difficultés que vous constaterez dans le fonctionnement des services de l’État ou de la conduite de la politique de la ville dans le quartier, afin qu’elles puissent être aplanies dans les meilleurs délais. Vous êtes à ce titre les interlocuteurs techniques des collectivités territoriales, des associations et des autres acteurs locaux. »
La circulaire du 30 juillet 2008 précise les moyens à la disposition du délégué du préfet pour mener à bien ses missions : du point de vue symbolique, le préfet du département doit veiller à ce qu’il bénéficie « de la légitimité et de la reconnaissance » nécessaires et doit leur « donner une place dans les manifestations publiques relatives à la politique de la ville » ; du point de vue opérationnelle, le préfet doit les associer « aux décisions concernant la mise en œuvre de la politique de la ville » et mettre en place « une animation régulière qui permettra de les constituer en réseau ».
La circulaire du 30 juillet 2008 précise le profil administratif et les compétences requises des délégués du préfet : il s’agit d’agents de catégorie A ou B qui doivent « disposer d’une expérience du fonctionnement de l’administration, d’une maîtrise des procédures administratives et financières, d’une bonne connaissance du secteur associatif et d’une grande disponibilité. »
La même circulaire précise que chacun des 215 quartiers de la DEB devrait être doté d’un délégué du préfet, 135 postes supplémentaires devant être affectés à la discrétion des préfets de département « dans les quartiers de priorité n° 1 des contrats urbains de cohésion sociale » (214).
La mise en place des délégués du préfet a cependant été émaillée de nombreuses difficultés. La circulaire du 21 décembre 2009 de la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville distingue deux catégories de problèmes (215) :
– concernant le « positionnement des délégués du préfet », la circulaire rappelle qu’ils doivent être rattachés directement à un préfet, un sous-préfet ou un secrétaire général, et non à une direction départementale, afin de garantir leur « fonction interministérielle, qui est attendue d’eux et qui fonde leur existence ». La circulaire, illustrant en creux, là aussi, une tendance à la marginalisation administrative des délégués du préfet et une difficulté pour eux à saisir le sens et la portée de leur mission, rappelle que les préfets doivent notamment veiller à « la qualité de l’encadrement et de l’accompagnement des délégués » ;
– s’agissant de la « gestion administrative des délégués du préfet », la circulaire précise les modalités techniques, effectivement complexes, de la prise en charge des rémunérations des délégués du préfet : leur administration d’origine continue à les rémunérer et le ministère effectivement payeur (initialement le ministère chargé de l’écologie puis, depuis le 1er janvier 2010, le ministère chargé du travail) compense cette rémunération en faveur de l’administration d’origine, étant entendu que le paiement de certaines primes dont bénéficient les délégués du préfet fait l’objet d’une procédure financière différente, mais tout aussi complexe.
Sur ce dernier point, des difficultés semblent subsister. la direction du budget a précisé à vos rapporteurs que « le pilotage et la gestion du dispositif des délégués du préfet demeurent très complexes et très lourds. La direction du budget a réparti clairement les rôles entre SG-CIV et le ministère du travail, de la solidarité, et de la fonction publique, portant depuis 2010 sur son programme support 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », les crédits nécessaires au financement de ces emplois issus de la DEB. Un groupe de travail a été créé à la demande du cabinet du Premier ministre destiné à prévenir les erreurs dans l’identification des ETP mis à disposition par les différents ministères contributeurs et une publication tardive des décrets de transfert. »
Vos rapporteurs considèrent, malgré ces difficultés, que l’idée d’implanter une délégation préfectorale dans les quartiers prioritaires les plus en difficulté doit être maintenue et sa réalisation poursuivie. Il s’agit moins d’assurer une présence symbolique que de réellement rapprocher les services techniques de l’État des territoires où ils sont effectivement utiles. Le délégué du préfet, ou une fonction qui lui succéderait, doit devenir à terme le chef d’un service susceptible de donner à l’État la capacité d’agir « sur mesure » face aux difficultés propres à chaque quartier. En la matière, il apparaît assez évident que le chemin est encore long, tant vos rapporteurs on pu constater que les délégués du préfet occupent une place encore marginale au sein des services de l’État, les confinant parfois à un certain mutisme, ce qui ne contribue pas à renforcer leur crédibilité, notamment aux yeux des élus locaux, certains d’entre eux ayant observé que des délégués du préfet avaient pensé trouver leur utilité dans un contrôle malvenu de l’action décentralisée.
2.– La gestion décentralisée de la politique de la ville : un flou juridique relatif compensé par le « leadership » du maire
L’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales précise qu’une communauté urbaine « exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres » certaines compétences « en matière de politique de la ville dans la communauté ». Ces compétences sont les suivantes :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ».
L’article L. 5216-5 du même code comporte une disposition analogue pour les communautés d’agglomération. Par contre, aucune disposition portant sur une compétence en matière de la politique de la ville n’est applicable s’agissant des communautés de communes ; celles-ci sont donc compétentes pour autant que l’intérêt communautaire défini par les communes membres le prévoit.
Le sens à donner à cette compétence de droit commun des communautés urbaines et d’agglomération a donné lieu à des interprétations variables. Selon la DIV (216), la compétence de « maîtrise d’œuvre » de l’intercommunalité en matière contractuelle consiste à identifier et coordonner « les différentes maîtrises d’ouvrage en présence ». Ainsi, l’EPCI est chargée d’une « compétence de pilotage » destinée à l’exercice d’une « fonction stratégique », ce qui n’empêche pas, lors de la définition de l’intérêt communautaire par les communes membres, le cas échéant, de déléguer à l’intercommunalité une maîtrise d’ouvrage en matière de politique de la ville.
Cette fonction stratégique a d’ailleurs vocation à être exercée à un niveau supérieur, englobant ainsi la politique de la ville dans un projet de territoire intercommunal. La DIV considère que « la loi contraint [l’EPCI] à un travail d’animation et de cohérence dans de nombreux domaines qui se conjuguent avec la politique de la ville ». Selon la DIV, le projet urbain intercommunal, qui est l’objet de ce travail, contribue à la mise en œuvre de la politique de la ville dans l’agglomération en répartissant les fonctions urbaines sur l’ensemble du territoire intercommunal et les recettes fiscales entre les communes participant à l’intercommunalité.
In fine, la DIV considère que « se pose la question d’un pilotage obligatoire des prochains dispositifs contractuels au titre de la politique de la ville par les EPCI ; il pourrait être en sus fortement recommandé que les compétences nécessaires à la mise en oeuvre d’un projet de territoire cohérent et solidaire soient transférées à l’EPCI. »
Cette proposition trouve sans doute un écho dans le projet d’achèvement de la carte de l’intercommunalité programmé par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, actuellement en discussion devant le Parlement. Son article 18, dans son texte tel qu’il résulte des délibérations de l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 16 septembre 2010, prévoit qu’entrerait en vigueur le 30 juin 2013 la faculté pour le préfet d’intégrer par arrêté dans un EPCI à fiscalité propre une commune n’appartenant « à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou [créant], au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale » (217). L’application de cette disposition aurait lieu au terme d’une période consacrée, en premier lieu, à l’adoption de schémas départementaux de l’intercommunalité (au plus tard le 31 décembre 2011) (218) et, en second lieu, à la mise en œuvre effective par l’État et les communes de ces schémas à compter du 1er janvier 2012.
Le même projet de loi, dans son article 5 tel qu’il résulte des délibérations de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit que les compétences en matière de politique de la ville d’une métropole (219), nouvelle catégorie d’EPCI à fiscalité propre susceptible de se substituer le cas échéant aux EPCI actuels regroupant plus de 500 000 habitants (220), seraient identiques à celles en vigueur pour les communautés urbaines et les communautés d’agglomération (221).
Si 263 Cucs ont été signés par une commune seule et 30 autres par plusieurs communes, 19 Cucs ont été signés par un EPCI seul, 86 Cucs par une commune seule et un EPCI et 97 Cucs par plusieurs communes et un EPCI. Ainsi, 202 Cucs ont été signés par un EPCI, soit 41 % des Cucs. Cette proportion était équivalente s’agissant des contrats de ville en 2000. L’hétérogénéité des situations témoigne, selon la DIV, d’une « lecture locale de la notion de la compétence “ politique de la ville ” des EPCI ; elle traduit aussi une approche principalement sociale, donc communale des Cucs ». L’hétérogénéité est encore renforcée si l’on considère les autres catégories de collectivités territoriales : 54 conseils généraux et 9 conseils régionaux sont signataires de Cucs.
En tout état de cause, vos rapporteurs ont constaté lors de leurs déplacements, que le pilote réel de la politique de la ville est le maire dans sa commune. Il ne fait pas de doute qu’il est le seul à disposer à la fois de la vision globale et de la connaissance des détails sur lesquels s’élabore un projet et s’exerce une pratique quotidienne en matière de politique de la ville ; sans compter l’apport symbolique et pratique que lui confère la légitimité apportée par le suffrage universel et l’attachement intime qui le lie à sa commune. C’est à son niveau que peut efficacement être exercée une forme cohérente d’« interministérialité » ; l’exercice par la maire de compétences portant sur des thématiques diverses peut constituer une réelle plus-value dans la conduite des politiques publiques territorialisées. Ces constats conduisent vos rapporteurs à proposer, dans le cadre d’une contractualisation locale renouvelée en matière de politique de la ville, d’attribuer à titre expérimental aux maires de nouvelles compétences de « maîtrise d’ouvrage » portant sur les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la sécurité.
Si le maire nous semble le garant d’une proximité opérationnelle efficace, le code général des collectivités territoriales prévoit opportunément que le projet urbain dans lequel s’intègre la politique de la ville relève de l’intercommunalité. C’est à ce niveau que doit être assurée la cohérence entre les Cucs, les conventions de rénovation urbaine, mais aussi, par exemple, le programme local de l’habitat ou le plan local d’urbanisme. La cohérence stratégique gagne d’ailleurs à être déclinée au plan opérationnel ; ainsi, dans la communauté urbaine de Lyon, chaque directeur technique, entouré d’une équipe de projet, est responsable, au titre d’un territoire « politique de la ville », du projet de rénovation urbaine et de la convention communale d’application du Cucs unique d’agglomération, les personnels concernés étant mandatés et rémunérés à ce titre à la fois par l’État, la communauté urbaine et la commune.
On note qu’un tel dispositif ne peut fonctionner que sur la base d’une entente entre maires d’un EPCI. Sur ce point, une élection des conseillers communautaires au suffrage universel de listes pourrait constituer un élément « clivant » susceptible de nuire à cette entente d’intérêt général. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en envisageant une identification des futurs délégués communautaires sur les listes présentées aux élections municipales en lieu et place de leur élection par le conseil municipal, semble ménager les fondements d’une telle entente.
L’étude réalisée par le cabinet retenu par vos rapporteurs après appel à concurrence, a établi, à l’issue de l’examen des modalités institutionnelles et opérationnelles de mise en œuvre des 22 Cucs de l’échantillon objet de l’étude, une représentation schématique des niveaux de qualité de la stratégie d’ensemble de la politique de la ville et de l’intégration de celle-ci dans un projet urbain et de territoire plus global.
SCHÉMA DE SYNTHÈSE : LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE STRATÉGIE OBSERVÉS
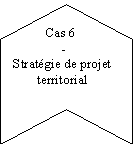
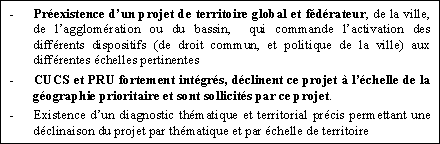





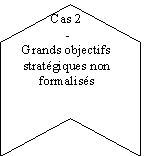


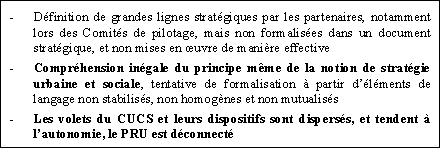
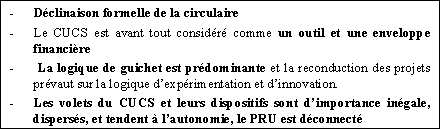
Le cabinet d’étude estime que chaque niveau de qualité ainsi défini est représenté dans l’échantillon étudié, ce qui souligne la marge de progression en la matière d’un nombre non négligeable de territoires qui pourraient être concernés à l’avenir par un nouveau contrat de politique de la ville.
Il relèverait d’ailleurs du rôle de l’État d’inciter les communes, et de surcroît les EPCI, à élaborer une stratégie globale territoriale intégrant la politique de la ville, le cas échéant en leur apportant l’ingénierie nécessaire. Le temps nécessaire à l’élaboration d’un tel projet a sans doute manqué en 2006 lors de la signature des Cucs. Toute forme de contractualisation à venir en matière de politique de la ville, sous forme d’avenants aux Cucs actuels ou par l’élaboration de nouveaux contrats de politique de la ville, doit ménager le temps nécessaire à la maturation d’un projet territorial global, sans céder à l’exercice de style formel contraint par le temps et la « nécessité de faire » pour assurer l’ouverture des crédits.
Par ailleurs, le rôle de l’État, au-delà du dernier recours qu’il constitue en matière de sécurité publique et de respect de l’éthique et des principes républicains, serait valorisé en matière de politique de la ville par l’organisation d’un rendez-vous public annuel propre à chaque quartier prioritaire. Y seraient officiellement examinés, notamment en présence du maire, les constats statistiques et factuels les plus récents réalisés par l’État, à la lumière des évolutions nationales en la matière. Un tel dispositif serait de nature à donner localement de la visibilité à la politique de la ville et à exercer une fonction d’émulation sur ses maîtres d’œuvre locaux, c’est-à-dire les maires. Vos rapporteurs témoignent de l’intérêt, aux Pays-Bas, des élus locaux pour une mise en perspective régulière et publique de la situation de leurs quartiers en difficulté.
TROISIÈME PARTIE : DES ÉVALUATIONS DIFFICILES À RÉALISER ET QUI DEMEURENT PARTIELLES
I.– LES DIFFICULTÉS DE L’ÉVALUATION
A.– UN EXEMPLE DE DIFFICULTÉ MÉTHODOLOGIQUE : ENSEIGNEMENTS ET LIMITES D’UNE APPROCHE NATIONALE PAR LES CRÉDITS
1.– Les crédits nationaux dédiés à la politique de la ville en « euros par habitant » : des comparaisons « externes » difficiles à exploiter
Les développements précédents ont eu pour objet de tenter de répondre aux questions préalables à l’évaluation des aides en faveur des quartiers défavorisés : en quoi consistent ces aides ? Quels montants de crédits publics leur sont consacrés ? Quelles sont les populations concernées ? Quelles sont les modalités de leur mise en œuvre ?
Sur cette base, deux tableaux, dont les principaux éléments ont présentés infra, peuvent constituer les fondements d’une approche quantitative de l’intensité des aides en faveur des quartiers défavorisés. Il s’agit, d’une part, de l’évaluation de crédits consommés en 2009 au titre des principaux moyens budgétaires nationaux dédiés à la politique de la ville et, d’autre part, de la population résidant dans chaque forme de géographie prioritaire.
CONSOMMATIONS EN 2009 DES MOYENS BUDGÉTAIRES NATIONAUX
DÉDIÉS À LA POLITIQUE DE LA VILLE
(en millions d’euros)
Programme 147 « Politique de la ville » |
490,70 |
Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) |
995,59 |
Dépenses fiscales et « sociales » |
693,00 |
Dotations de péréquation (Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : DSU-CS ; dotation de développement urbain : DDU ; et fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France : FSRIF) |
1 399,00 |
Total |
3 578,29 |
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES GÉOGRAPHIES PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (POPULATION RECENSEMENT 1999)
Géographies |
Nombre de quartiers concernés |
Nombre de communes concernées |
Population concernée (en millions) |
ZUS |
751 |
509 |
4,4 |
ZRU |
435 |
337 |
2,8 |
ZFU |
100 |
147 |
1,6 |
Anru |
542 |
370 |
3,4 |
Cucs dont Cucs hors ZUS |
2 493 1 596 |
934 443 |
8,3 3,9 |
DEB |
215 |
163 |
2,2 |
Source : SG-CIV et mission André-Hamel.
Une opération simple peut consister à calculer à combien d’euros par habitant correspondent les aides nationales en faveur des quartiers défavorisés. Si l’on prend pour référence celle des géographies prioritaires la plus large, c’est-à-dire les quartiers Cucs (8,3 millions d’habitants), ce montant s’élève à 431 euros par habitant.
Un usage de ce chiffre peut consister à le comparer à d’autres dispositifs nationaux d’aide en faveur des personnes défavorisées afin de tenter de donner une idée de ce qu’il peut représenter, en termes d’intensité de l’aide publique. On peut relever, par exemple, la proximité de ce chiffre avec le montant du revenu de solidarité active mensuel en 2010 pour une personne célibataire, sans enfant et sans revenu, soit 460,09 euros.
Cela a-t-il cependant un sens de comparer à cette prestation personnalisée de solidarité sous forme monétaire une aide dont les formes concrètes sont très hétérogènes (rémunérations de personnels associatifs, achats de prestations de service ou de travaux publics, aide aux entreprises, dotations libres d’emplois en faveur des collectivités territoriales) et dont les effets, constatés ou attendus, sont parfois difficilement tangibles ? Une telle comparaison peut néanmoins permettre de constater que les dépenses nationales spécifiquement dédiées aux quartiers défavorisés ne sont pas extravagantes, quand on les rapporte à l’ensemble des populations qu’elles concernent.
Une autre méthode peut viser à comparer les données nationales avec une estimation du montant des aides en faveur des quartiers défavorises dans un pays menant une politique analogue à celle mise en œuvre en France. Aux Pays-Bas, l’État a mis en œuvre jusqu’en 2009 deux programmes que l’on pourrait assimiler à notre politique de la ville :
– une « politique des grandes villes », consistant à attribuer jusqu’en 2009 à 31 communes (de fait les plus grandes des Pays-Bas) des dotations d’État, au titre des difficultés urbaines qui y sont constatées. Les communes sont libres de l’emploi des fonds dont elles bénéficient (222), aux termes d’une contractualisation qui fixent des objectifs et indicateurs associés. En 2009, dernière année d’application de ce dispositif, 816 millions d’euros ont été attribués aux communes concernées ;
– une « politique des quartiers », concernant 40 quartiers (soit 800 000 habitants) recensés comme rassemblant les difficultés économiques et sociales les plus graves. Il n’est pas simple de déterminer le montant du financement de l’État pour ce programme, néanmoins si l’on fait la somme des crédits des ministères de droit commun qui lui sont affectés à titre supplémentaire, des dotations supplémentaires de l’État aux communes et des crédits spécifiques de l’État, on peut évaluer ce montant à 175 millions d’euros (223) par an pendant 10 ans entre 2007 et 2017.
Cette « politique des quartiers » aux Pays-Bas, considérée isolément, représenterait une aide de 219 euros par habitant des 40 quartiers concernés de. Si l’on considère qu’il faut y ajouter la « politique des grandes villes », deux difficultés apparaissent :
– une partie de la « politique des grandes villes » néerlandaise, menée dans 31 communes, ne concerne pas les 40 quartiers de la « politique des quartiers », ceux-ci étant rassemblés dans 18 communes ;
– plus fondamentalement, la « politique des grandes villes » n’est pas expressément une politique en faveur de quartiers prioritaires et les dotations de l’État correspondantes sont libres d’emploi dans le ressort territorial d’une commune. Ce dispositif s’apparente ainsi à une dotation de péréquation à la libre des dispositions des communes concernées.
Compte tenu de la disparition de la « politique des grandes villes » proprement dite en 2009 (même si les communes bénéficient après cette date de ressources équivalentes), une autre option méthodologique peut être de comparer la seule « politique des quartiers » des Pays-Bas aux crédits nationaux dédiés en France à la politique de la ville, en retranchant ceux d’entre eux analogues, en France, au crédits de la « politique des grandes villes » aux Pays-Bas ; soit, en France, la DSU-CS et le FSRIF. Dans ces conditions (c’est-à-dire pour un total d’aides publiques de 2 229 millions d’euros), toujours en retenant la géographie prioritaire la plus large (les 8,3 millions d’habitants des quartiers Cucs), l’aide nationale en France s’élèverait à environ 269 euros par habitant à comparer au montant estimé de l’aide de la « politique des quartiers » aux Pays-Bas : de 219 euros par habitant.
L’intérêt de ce type d’approche doit cependant être relativisé. Si ces deux montants sont comparables, avec une aide française un peu supérieure à celle constatée aux Pays-Bas, ils ne disent rien sur les besoins respectifs des quartiers français et néerlandais, le niveau des difficultés que l’on y constate ou l’efficacité des actions entreprises.
2.– Quelle intensité de l’aide publique en faveur des quartiers défavorisés en fonction de certaines catégories de quartiers ?
Une approche globale nationale ne permet pas de juger, en France, de l’intensité constatée de l’aide dans certains quartiers dans lesquels les dispositifs sont cumulés. Établir une moyenne d’aide en euros par habitant masque ainsi de fortes disparités selon les catégories de quartiers, qu’il convient d’essayer d’évaluer.
Si l’on tente de cerner l’intensité de l’aide nationale en faveur des ZFU les plus prioritaires, c’est-à-dire qui sont par ailleurs des quartiers Cucs de priorité 1 (1,4 millions d’habitants, soit environ 90 % de la population en ZFU) (224), les hypothèses suivantes peuvent être avancées concernant le montant des aides dont bénéficient ces ZFU (225) :
– 90 % des montants consommés au titre du dispositif propre aux ZFU (exonérations d’impôt et de charges sociales, soit 523 millions d’euros) pourraient être pris en compte, soit, en 2009, 471 millions d’euros ;
– pour les crédits relatifs à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux, si l’on considère la part de la population des ZFU en quartiers Cucs de priorité 1 dans la population des ZUS (soit 33 % environ), un tiers du montant de la dépense fiscale correspondante (81 millions d’euros) pourrait être retenu, soit 27 millions d’euros ;
– s’agissant des crédits de l’Acsé au titre de la politique de la ville (soit 406 millions d’euros), en considérant que 75 % de ces crédits bénéficient aux quartiers Cucs en priorité 1 et que la population des ZFU constitue 29 % de la population de ces quartiers Cucs, 88 millions d’euros pourraient être retenus ;
– pour le PNRU, les hypothèses sont plus difficiles à établir. Combien de ZFU sont concernées par le PNRU, et à quel niveau de priorité ? En comparant de façon rapide la liste des ZFU et la liste des quartiers Anru pour lesquels une opération est en cours (226), 90 % des ZFU pourraient au moins partiellement être concernées par une opération Anru (227). Il reste à savoir si ce taux est transposable aux populations : peut-on considérer que 90 % de la population en ZFU en quartier Cucs de priorité 1 (soit environ 1,26 millions d’habitants) est concernée par le PNRU (population totale concernée : 3,31 millions d’habitants au 1er septembre 2010) ? Peut-on en déduire que 38 % (228) des crédits Anru sont engagés dans des ZFU ? En s’appuyant sur cette hypothèse et en considérant, à l’instar des ZUS, qu’il y a autant de ZFU en quartiers prioritaires qu’en quartiers supplémentaires dans le zonage du PNRU (229), on pourrait donc retenir 378 millions d’euros en 2009 au titre du PNRU en faveur des habitants des ZFU (230) ;
– Par ailleurs, si est appliquée la même quote-part (38 %) s’agissant de l’application de la TVA à 5,50 % pour l’accession à la propriété dans les zones Anru et autour de leur périmètre, il faut prendre en compte 27 millions d’euros.
Si on effectue la somme de ces éléments, on peut constater que l’aide dans les ZFU en priorité n° 1 au titre des quartiers Cucs s’élevait en 2009 à environ 991 millions d’euros, soit 47 % du montant total de référence (2 094 millions d’euros) (231).
On peut établir sur cette base les constats suivants :
– 47 % des aides auraient bénéficié à 18 % de la population des quartiers prioritaires ;
– ce montant d’aide pour les ZFU qui sont des quartiers Cucs de priorité 1 s’élèverait à 700 euros par habitant, soit nettement plus du double que la moyenne de référence (283 euros par habitant) ;
– cela signifie que 53 % des aides seraient allés à 82 % de la population des quartiers prioritaires, ce qui conduit, pour les 6,5 millions d’habitants correspondants, à une aide de 161 euros par habitant, soit 4,5 fois moins que pour les quartiers ZFU zone de priorité 1.
Qu’en est-il pour les quartiers prioritaires les moins en difficulté ? En s’appuyant sur l’hypothèse que les quartiers Cucs de priorité n° 3 situés hors ZUS sont très marginalement concernés par le PNRU, on peut estimer que le 1,1 million d’habitants de ces quartiers (pour 1,2 million d’habitants dans l’ensemble des quartiers Cucs de priorité 3, soit 92 % de l’effectif) sont concernés par les aides nationales en faveur de la politique de la ville, uniquement à hauteur des crédits que l’Acsé consomme au titre de leur degré de priorité, soit environ 4,5 % du total de ses crédits. L’aide s’élèverait ainsi à 16 euros par habitant, ce qui ne peut manquer d’interroger sur le risque de saupoudrage des aides en matière de politique de la ville, même si le montant total dont il s’agit ici n’est pas négligeable puisqu’il s’élève à 18 millions d’euros environ.
Le tableau suivant fait la synthèse des trois catégories de quartiers prioritaires établis aux termes des développements précédents et des montants d’aide par habitant qui leur correspondent.
ÉVALUATION DES MONTANTS D’AIDES EN FAVEUR DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS
EN 2009 SELON CERTAINES CATÉGORIES DE QUARTIERS
Population |
Montant global d’aides |
Montant d’aides par habitant (en euros) | |||
En millions d’habitants |
En % |
En millions d’euros |
En % | ||
ZFU dans les quartiers Cucs de priorité 1 |
1,4 |
18 |
991 |
47 |
708 |
Quartiers Cucs de priorité 3 |
1,1 |
14 |
18 |
1 |
16 |
Autres quartiers prioritaires |
5,4 |
68 |
1 085 |
52 |
198 |
Total |
7,9 |
100 |
2 094 |
100 |
265 |
Sous les nombreuses réserves méthodologiques inhérentes à la construction de ce tableau et en considérant les problèmes de principe que pose l’exercice lui-même, on peut conclure à l’existence d’une efficacité certaine des dispositifs de « priorisation » propres aux aides en faveur des quartiers en difficulté, au bénéfice de ceux d’entre eux regroupant objectivement les difficultés économiques et sociales les plus graves ; sans pour autant que soit évitée une tendance au saupoudrage de ces aides.
3.– Une approche de l’intensité de l’aide en faveur des quartiers en difficulté, dispositif par dispositif ?
Il est courant d’admettre que le PNRU constitue un effort massif en faveur des quartiers concernés par la rénovation urbaine, presque sans commune mesure avec les aides « classiques » de la politique de la ville, c’est-à-dire les crédits consommés par l’Acsé à ce titre. Qu’en est-il réellement ?
Le PNRU est un plan qui mobilise 12 milliards d’euros de crédits publics nationaux dans des quartiers où résident 3,3 millions d’habitants. Il s’agit donc d’un programme national d’aide de 3 636 euros par habitant. Si on distingue par type de quartier et en considérant que, conformément à l’objectif fixé initialement, 70 % des fonds versés par l’Anru bénéficieront aux quartiers prioritaires Anru, ce montant s’élève à 3 871 euros par habitant dans ces quartiers et 3 158 euros par habitant dans les quartiers supplémentaires Anru.
Pour comparer ces montants à l’aide issue des crédits consommés par l’Acsé au titre de la politique de la ville, il ne peut y avoir d’autre méthode que l’annualisation des références ; le PNRU est légalement un dispositif mis en œuvre sur la période 2004-2013, soit pendant 10 ans. Il est probable que le PNRU conduise à des paiements de la part de l’Anru pendant environ 15 ans, jusqu’en 2018 ou 2019. Afin de tenir compte de la durée légale du PNRU et du fait que les montants consommés par l’Anru au début et en fin de programme ont été et seront limités, on peut faire l’hypothèse que le PNRU conduit à un financement national sur 12 ans. Les crédits de l’Anru correspondraient ainsi à un montant de 323 euros par habitant et par an dans les quartiers prioritaires Anru et de 263 euros par habitant et par an dans les quartiers supplémentaires.
Les crédits consommés par l’Acsé en 2009 au titre de la politique de la ville se sont élevés à 406 millions d’euros. Si l’on fait l’hypothèse que les objectifs de répartition des crédits selon les trois degrés de priorité sont atteints (75 % des crédits pour les quartiers Cucs en priorité 1, 20 % des crédits pour les quartiers Cucs en priorité 2 et 5 % pour les quartiers en priorité 3) (232) et que tous les crédits consommés par l’Acsé sont rattachables à la mise en œuvre d’un Cucs, le tableau suivant permet d’approcher l’intensité de l’aide correspondant aux crédits versés par l’Acsé :
INTENSITÉ DE L’AIDE CORRESPONDANT AUX CRÉDITS VERSÉS PAR L’ACSÉ EN 2009
Quartiers Cucs |
Population (France métropolitaine) |
Montant des crédits Acsé | |||
En millions d’habitants |
En % |
En millions d’euros |
En % |
En euros par habitant | |
Priorité 1 |
4,8 |
61 |
304,5 |
75 |
63,43 |
Priorité 2 |
1,9 |
24 |
81,2 |
20 |
42,73 |
Priorité 3 |
1,2 |
15 |
20,3 |
5 |
17,0 |
Total |
7,9 |
100 |
406,0 |
100 |
51,39 |
L’intensité de l’aide des crédits Anru est donc effectivement d’un autre ordre de grandeur que celle apportée par les crédits de l’Acsé, même en considérant les aides que l’Acsé réserve aux quartiers Cucs de priorité 1. On note aussi, pour les crédits de l’Acsé, la relative proximité des montants par habitant pour les quartiers Cucs de priorité 1 et 2, qui relativise l’ampleur des objectifs affichés en matière de répartition des crédits par degré de priorité des quartiers concernés.
Par contre, l’ordre de grandeur de l’intensité de l’aide apportée par le PNRU dans les quartiers prioritaires Anru (323 euros par habitant) est équivalent à celui de l’intensité de l’aide issue des dispositifs fiscaux et sociaux applicables dans les ZFU (350 euros par habitant environ).
Cette mise en perspective ne doit cependant pas masquer que les dispositifs financés par l’Acsé se prêtent sans doute assez mal à une répartition par habitant des crédits correspondants. L’exemple du programme de réussite éducative (PRE) est assez éclairant. Dans son rapport 2009 sur le programme de réussite éducative, l’Acsé précise, sur la même page, que le PRE a constitué en 2008 « un coût par enfant [pris en charge] de 608 euros pour l’État » et que son « montant moyen par habitant vivant en quartier prioritaire de la politique de la ville […] est de 9,43 euros ». Il semble légitime d’accorder au premier de ces ratios une plus grande signification opérationnelle, en considérant ainsi les crédits au plus près de leur « public ».
De la même manière, faut-il réellement considérer les effets du dispositif des adultes-relais en regard du montant des crédits correspondants consommés par l’Acsé en le rapportant à la population résidant dans tous les quartiers Cucs ? Il n’est pas certain que ce ratio, d’environ 10 euros par habitant, permette d’appréhender correctement la contribution des adultes-relais à la qualité de la vie dans un quartier ou d’évaluer si ces contrats constituent un tremplin réel pour leurs bénéficiaires sur le marché du travail.
B.– L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : LES OUTILS MIS EN œUVRE DEPUIS 2003 N’ONT PAS PERMIS DE SURMONTER TOUTES LES DIFFICULTÉS DE L’EXERCICE
1.– Avant 2003 : une évaluation toujours requise et souvent décevante
Les universitaires auxquels vos rapporteurs ont demandé de réaliser une synthèse des travaux disponibles en matière d’évaluation de la politique de la ville (233), éclairent les rapports entre la politique de la ville et l’évaluation par cette formule : « l’histoire de la politique de la ville et de son évaluation peut se lire comme un paradoxe : celui d’une politique qui ne peut se concevoir sans évaluation, mais qui semble résister de manière persistante à cette pratique visant à “ apprécier l’efficacité d’une politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mise en œuvre ” », en citant ainsi l’article 1er du décret n° 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l’évaluation des politiques publiques.
Du point de vue de la pratique de l’évaluation, en s’appuyant sur une étude, ils montrent ainsi que « la politique de la ville a été un terrain privilégié pour l’expérimentation des premières démarches évaluatives engagées en France ».
Ils soulignent le lien entre le caractère novateur et hétérodoxe de la politique de la ville en termes de pratiques publiques et l’intérêt qu’elle a suscité dans de nombreux domaines des sciences sociales dans les années 1990 : « les politistes, sociologues des organisations ainsi que les juristes versés dans les sciences administratives se sont penchés en nombre sur cette politique insolite […]. Par sa méthode d’action inédite, fondée sur le diagnostic territorial, le projet transversal, le contrat global, la participation des habitants et l’évaluation, la politique de la ville invitait en effet les appareils administratifs concernés par la “ crise des banlieues ” à rompre avec la logique d’action sectorisée et standardisée du passé, à s’engager dans des coopérations inter-institutionnelles et à s’ouvrir à la société civile. »
Considérant les démarches évaluatives portant sur les contrats de ville des périodes 1994-2000 et surtout 2000-2006, les universitaires relèvent leur « succès quantitatif » dans le cadre d’une approche locale de l’évaluation : « il a été maintes fois remarqué que la politique de la ville était de toutes les politiques publiques celle qui a fait l’objet du plus grand nombre d’évaluations ». L’échec qualitatif de ces démarches fut cependant patent, les universitaires se fondant sur les enseignements tirés « sans détour » par la DIV en la matière ; la DIV a considéré que l’« évaluation [était] quantitativement satisfaisante mais qualitativement décevante [et que] la profusion d’études réalisées n’a[vait] pas rendu possible la formulation d’un jugement collectif sur la portée de la politique menée, car ces études sont le plus souvent restées incomplètes. Certaines évaluations fournissaient des éléments de connaissance, mais n’en tiraient aucun jugement, d’autres énonçaient des jugements sans que le fondement de ceux-ci soit clairement explicité. »
En conclusion sur cette séquence historique, le constat critique des universitaires porte, sur la base de certaines études, à la fois sur la qualité des évaluations et sur leur lien avec l’action publique : « sauf exception, [les évaluations] n’ont pas réussi à faire émerger des scènes de débat local sur la stratégie poursuivie, ses réalisations et ses effets » et « les nombreuses réorientations qu’a connues la politique de la ville ont été très rarement fondées sur les recommandations tirées des évaluations ».
2.– Le tournant de la loi du 1er août 2003
a) Une redéfinition des objectifs de la politique de la ville et des moyens d’en mesurer l’efficacité et les impacts : la création de l’ONZUS
Pour les universitaires précités, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine marque une césure dans l’organisation de l’évaluation en matière de politique de la ville. Selon eux, cette loi répond en tout point aux préconisations méthodologiques du rapport de la Cour des comptes de 2002 sur la politique de la ville (234), qu’ils résument ainsi : « clarification des objectifs ; déclinaison de ces objectifs dans des indicateurs de résultats ; identification plus précise des programmes y contribuant et des moyens qui leur sont consacrés ; amélioration des systèmes statistiques d’observation des quartiers ».
Il est effectivement patent que l’annexe 1 à cette loi est composée d’un ensemble d’objectifs thématiques s’appuyant sur la mise en œuvre de programmes d’action, ces objectifs étant déclinés par des séries d’indicateurs de résultat. Sur le plan de l’organisation du travail statistique et évaluatif, l’article 3 de la loi du 1er août 2003 prévoit la création d’un « Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé de mesurer l’évolution des inégalités sociales et des écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d’en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l’annexe 1 de la présente loi. »
Selon les universitaires, cette direction impliquant la mesure des effets et des impacts de la politique de la ville correspond à une clarification des objectifs de cette politique, définis très clairement par l’article 1er de la loi du 1er août 2003 et selon lequel il s’agit : « de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires ».
En tout état de cause, ils estiment que le tournant de la loi du 1er août 2003 a été, sur le plan de la qualité du travail statistique, suivi d’effets positifs : « les travaux de l’ONZUS ont permis des avancées notables sur le plan de l’observation nationale. L’observatoire publie chaque année un rapport sur l’évolution des écarts entre les ZUS et le reste de leur agglomération, sur la base d’indicateurs spécifiques (chômage, développement économique, réussite scolaire, accès au système de santé, sécurité...). Outre l’analyse de l’évolution des indicateurs définis dans la loi du 1er août sur chacun des grands champs d’action de la politique de la ville, ces rapports présentent des études plus approfondies sur les thèmes retenus par le conseil d’orientation de l’observatoire. »
b) L’amélioration de la qualité de l’information statistique n’a pas supprimé toutes les difficultés de l’exercice évaluatif
Deux limites importantes à la rationalisation du travail évaluatif à laquelle la création de l’ONZUS correspond sont évoquées par les universitaires, sur la base de plusieurs études :
– les statistiques de l’ONZUS « consistent en une agrégation nationale de données locales. Elles donnent donc à voir des évolutions moyennes qui peuvent masquer des dynamiques locales très différenciées, lesquelles revêtent des significations multiples, par définition non agrégeables » ; ainsi, « à ce jour, la création de l’ONZUS a surtout eu pour effet d’améliorer la connaissance nationale des quartiers beaucoup plus qu’il n’a alimenté l’observation locale ». Selon vos rapporteurs, cette critique technique, pertinente même si elle ne retire rien à l’intérêt de statistiques nationales, constitue aussi une difficulté dans le pilotage de la politique de la ville : les données locales, propres à chaque ZUS, devraient pouvoir devenir le support d’un rendez-vous annuel public portant sur l’évolution de la situation de chaque ZUS ;
– « l’évaluation d’une politique publique ne consiste […] pas seulement à mesurer des évolutions et la contribution de cette politique aux évolutions mesurées. Elle doit aussi aboutir à la formulation d’un jugement partagé sur la valeur de cette politique, et de propositions pour son amélioration. Or, l’ONZUS n’est pas une instance d’évaluation. Ses rapports fournissent une matière indispensable à l’évaluation, mais ses responsables ont jusqu’à présent fait preuve d’une grande prudence, s’interdisant de prolonger leurs analyses statistiques par un jugement sur la valeur des différents programmes de la politique de la ville ». Selon vos rapporteurs, il ne saurait être fait grief à des techniciens de ne pas trancher sur le sens et la portée des résultats observés s’agissant de la mise en œuvre d’une politique publique ; le jugement de valeur évaluatif ne peut relever en la matière que du débat public et politique. Il apparaît en revanche que ce débat n’est aujourd’hui pas à la hauteur ni du matériau que l’ONZUS élabore, ni des enjeux sociétaux sur lesquels il porte. Le fait que « le débat d’orientation devant chacune des assemblées » sur le rapport annuel de l’ONZUS, prévu par l’article 5 de la loi du 1er août 2003, n’ait pas lieu en est une des manifestations.
Au-delà de ces considérations sur le niveau territorial adéquat des résultats statistiques et sur la tenue des débats locaux et nationaux susceptibles de leur donner un sens politique, les universitaires observent que détenir des statistiques ne signifie pas pouvoir en déduire des conclusions sur les « impacts » de la politique de la ville : « malgré la profusion d’outils d’observation et d’analyses, le savoir sur cette politique achoppe presque toujours sur l’identification de ses effets propres sur les quartiers et populations concernés ».
Cette absence de visibilité des résultats « nets » des dispositifs propres à la politique de la ville conduit, selon les universitaires, dans le cas des Cucs, à un scepticisme de la part des acteurs locaux de la politique de la ville quant à l’exercice consistant à collecter des renseignements statistiques : « si des chiffres sont produits, c’est que l’État local les exige. Mais du point de vue des opérateurs, leur production est vécue comme un exercice obligé, pour ne pas dire inutile, et dans tous les cas très coûteuse en temps, au détriment précisément de l’action auprès des bénéficiaires ». On note que cet élément est largement corroboré par les observations du cabinet d’étude auquel vos rapporteurs ont confié la mission (235) de réaliser une synthèse des évaluations portant sur un échantillon de 22 Cucs : « les équipes opérationnelles […] consacrent un temps important à “ reporter ” les réalisations, les résultats bruts et les financements effectués. […] Il en découle une certaine hétérogénéité des modes de suivi, et beaucoup de lassitude à l’endroit de cette tâche très administrative ». Les universitaires ont relevé que cette logique du « reporting » pouvait être contre-productive et aboutir à un appauvrissement de l’exercice évaluatif, par une : « tendance consistant à rabattre l’évaluation sur une démarche de suivi des réalisations ».
Le rapport des universitaires relève, par ailleurs, que l’évaluation en matière de politique de la ville se heurte à des difficultés propres à certains secteurs ou dispositifs :
– l’appareil évaluatif n’a pas toujours été élaboré sur des fondements susceptibles de contribuer à une mesure des impacts. S’agissant du programme de réussite éducative mis en œuvre en 2005, les universitaires considèrent que « la contribution propre des projets de réussite éducative (PRE) à la réussite scolaire est […] indétectable dans les évaluations engagées depuis lors (ce qui ne veut pas dire qu’elle n’existe pas) » ;
– les objectifs assignés aux politiques publiques peuvent être fondées sur des concepts peu clairs. Ainsi, indiquent-ils « le cas de la rénovation urbaine [qui] illustre mieux que tout autre la difficulté de mesurer les impacts d’un programme de la politique de la ville, en l’absence de clarification préalable de la chaîne d’intentions ». Relevant les objectifs explicitement assignés par l’article 6 de la loi du 1er août 2003 au PNRU, soit la mixité sociale et le développement durable, ils observent, sur la base de nombreuses études, que « le “ concept ” même de mixité sociale […], aux yeux de maints chercheurs (mais également de maints praticiens locaux), n’en est pas un, et de ce fait ne se prête à aucune mesure objective. »
D’autres sujets « techniques » sur la production des statistiques rendent difficile la mobilisation des connaissances sur laquelle peut se fonder l’évaluation :
– certaines données qui pourraient être utiles ne sont pas disponibles, malgré les efforts de l’ONZUS depuis sa création pour les récolter ou sensibiliser certaines administrations de droit commun à leur production ; les universitaires en concluent que « leur indisponibilité ne résulte pas seulement des réticences de telle ou telle administration pour communiquer ses chiffres dans des jeux de pouvoir ou d’auto-protection. Ces données n’ont tout simplement pas été construites à des fins d’observation des écarts entre les territoires prioritaires de la politique de la ville et leur environnement ». La direction du budget explique les difficultés concernant le renseignement de certains indicateurs de performance propres à la politique de la ville par le fait que « les bases de données, et notamment les bases de données “ territorialisées ” sont insuffisantes » ;
– ainsi que l’indique également la direction du budget en commentant les difficultés de la mesure nationale de la performance, « le traitement statistique de l’information relative à certains indicateurs est long, ce qui induit un décalage entre réalisation et évaluation de l’action ». Cette difficulté n’est pas seulement technique ; peut-on réellement procéder à l’évaluation d’un dispositif comme le programme de réussite éducative avant que les premières générations qui en ont bénéficié sortent du système scolaire, soit de nombreuses années après sa mise en oeuvre ? Le rapport du bureau d’étude, présentant les difficultés des évaluateurs des Cucs à identifier de tels impacts, relève que ceux-ci peuvent apparaître après un temps long, selon les domaines : « l’appréciation des résultats doit s’opérer en outre à la lumière d’un facteur temps qui joue fortement et de manière contrastée. La politique de la ville combine dans l’espace des interventions multiples mais elle les combine également dans le temps. »
c) La nécessité d’un diagnostic prudent sur les effets propres de la politique de la ville et d’un approfondissement des connaissances
Le risque est ainsi, pour les universitaires, d’un jugement de valeur faussé sur la politique de la ville. Si, au niveau national et en s’appuyant sur une observation des ZUS, les écarts de développement et les inégalités sociales ne se réduisent pas, faut-il en conclure que les Cucs ou le PNRU, par exemple, sont en échec, voire sans objet ?
S’agissant des Cucs, les universitaires notent que les praticiens de la politique de la ville « sont généralement conscients du fait que les seuls crédits spécifiques que mobilise cette procédure ne sont pas de nature à changer la donne au sein des quartiers eux-mêmes ». Le risque serait d’attribuer à la politique de la ville les maux engendrés par certaines autres politiques publiques, la maîtrise de celles-ci demeurant hors de portée des acteurs de la politique de la ville : « comme les Cucs sont dans l’incapacité assez générale de mobiliser les politiques de droit commun, on comprend que ses acteurs puissent s’insurger contre les analyses aussi rapides qu’hasardeuses de ces indicateurs, qui concluent à l’échec des Cucs dès lors que les écarts territoriaux se sont accrus depuis la signature du contrat. »
Le bureau d’étude sollicité par vos rapporteurs aboutit à des enseignements analogues. Il relève que certains opérateurs locaux des Cucs refusent la logique de la « mise en chiffres » des résultats des actions menées ; il estime que ce refus « s’appuie […] de manière rarement exprimée, en tout cas non écrite, sur la conviction partagée par beaucoup d’acteurs de la politique de la ville de la non pertinence d’objectifs par définition irréalistes : la politique de la ville ne pourra pas opérer le “ rattrapage ” de nombreux quartiers et de leurs habitants, le “ raccrochage ” de ces quartiers à leur ville que la mesure suivie des écarts à l’unité urbaine est supposée décrire ». De façon générale, le bureau d’étude interroge l’« instrument Cucs » lui-même, en notant les risques d’un écart entre ce qu’il permet de faire effectivement et les objectifs qui lui seraient assignés : « [Les Cucs] ne peuvent que présenter des objectifs formulés en termes positifs, mais lorsque ceux-ci paraissent incantatoires, ils n’entraînent pas l’adhésion ni la mobilisation des acteurs et des opérateurs. Au mieux, simplement ignoré, le contrat est une déclaration d’intention et non une feuille de route pour l’action. Au pire, il démotive par l’écart entre les “ belles intentions ” et l’impossibilité de les mettre en œuvre. »
Pour répondre à la problématique de l’identification des impacts propres à la politique de la ville et tenter d’apporter des réponses à la question (posée par les universitaires) : « que se serait-il passé si, toutes choses égales d’ailleurs, la politique [de la ville] n’avait pas été mise en œuvre ? », des progrès méthodologiques pourraient être explorés à l’avenir. Des études pourraient ainsi comparer les résultats d’un dispositif pour des individus ou des territoires « cibles » à des observations sur des individus ou territoires « témoins », non concernés par ce dispositif et présentant des caractéristiques idéalement identiques à celles du groupe « cible ». Ces constats recoupent ceux de la direction du budget qui précise que « des études économétriques plus poussées sont nécessaires pour mesurer la valeur ajoutée réelle d’un dispositif. Il faut en effet disposer d’un “ contrefactuel ”, c’est-à-dire d’un groupe de contrôle “ fictif ” ou “ réel ” non traité mais dans lequel les individus possèdent les mêmes caractéristiques que ceux du groupe traité ». De telles études présentent cependant des difficultés certaines liées à la nécessité de considérer certains territoires comme des points de comparaison exclus des efforts menés ailleurs, uniquement à des fins d’études.
On note aussi qu’en matière de politique de la ville, sont désormais envisagés, afin de s’affranchir des seuls résultats « instantanés » observés au titre d’un territoire, des dispositifs évaluatifs permettant, pour un constat territorial donné, de suivre des individus dans le temps et, ainsi, notamment de mesurer jusqu’à quel point un quartier prioritaire pourrait constituer, pour certains de ses habitants, un « sas » dans une trajectoire « positive » résidentielle, professionnelle ou sociale. Dans son avant-propos au rapport annuel de l’ONZUS en 2009, Mme Bernadette Malgorn, présidente du conseil d’orientation de l’ONZUS, annonçait ainsi la mise en œuvre d’« études de cohorte » d’habitants des ZUS en ces termes : « l’observatoire élabore une enquête consistant à suivre, pendant plusieurs années, des ménages résidant initialement en zone urbaine sensible. Les membres de ces ménages continueront d’être suivis s’ils déménagent. La première vague de collecte de cette enquête interviendra en 2010. » (236). Cette orientation doit être vivement encouragée, même si elle ne produit de résultats qu’à moyen terme, car il s’agirait d’un complément crucial aux informations aujourd’hui disponibles, susceptible d’éclairer réellement les décideurs politiques, nationaux et locaux, sur les effets des mesures prises dans le domaine de la politique de la ville.
II.– QUELS CONSTATS SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES,
QUELS EFFETS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
La présente partie a pour objet d’établir un panorama de la situation des dispositifs spécifiques qui sont mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Si la question générale porte sur la réduction ou non des écarts, souvent défavorables, à la moyenne nationale dans les ZUS pour chacun des thèmes visés par l’annexe 1 à la loi du 1er août 2003 (en se basant notamment sur les rapports annuels de l’ONZUS), il sera également fait part d’éléments plus qualitatifs sur certains sujets, notamment sur la base des études, évoquées supra, que vos rapporteurs ont sollicitées de la part d’universitaires et d’un bureau d’étude.
Vos rapporteurs reconnaissent les limites d’un tel exercice. En premier lieu, se placer dans une telle perspective revient à attribuer une validité certaine à l’objectif de la politique de la ville tel qu’il est défini par l’article 1 de cette loi, soit la réduction des « inégalités sociales » et des « écarts de développement » qui caractériseraient les quartiers prioritaires. Or, il y aura effectivement toujours des quartiers populaires, identifiables par des écarts et des inégalités de ce type ; et les quartiers sensibles d’aujourd’hui sont sans doute, au moins à moyen terme, ceux de demain. Vos rapporteurs considèrent néanmoins que la pauvreté, au niveau de concentration qu’elle atteint dans nos quartiers prioritaires les plus en difficulté, constitue en soi un problème. Parce qu’elle produit sans doute des effets endogènes, c’est-à-dire qu’on peut faire la preuve dans certains domaines, notamment dans le domaine déterminant de l’éducation, d’un « effet quartier » défavorable à ses habitants d’autant plus prononcé que les problèmes sociaux y sont plus aigus.
L’objectif de « mixité sociale » peut certes constituer une réponse partielle à l’« effet quartier ». En tout état de cause, l’objectif ultime de la politique de la ville est de faire en sorte qu’être né, grandir, habiter, vivre quelque part ne constitue pas en soi une limite à vivre dignement, à faire valoir ses mérites et à tenter de satisfaire ses ambitions légitimes. La réduction des écarts et des inégalités nous semble constituer un objectif intermédiaire pragmatique mieux à même de contribuer à cet objectif ultime, que les moyens employés relèvent ou non de la « mixité sociale ».
En second lieu, entreprendre une telle analyse, c’est prendre le risque de « condamner » la politique de la ville, en lui faisant supporter un fardeau qui ne serait pas le sien. Car chacun sait bien que dans des domaines cruciaux comme la pauvreté, l’emploi ou l’éducation, les écarts ne se sont pas réduits et qu’il existe même des signes d’aggravation de la situation relative de certains quartiers. Ces constats, observables sur de longues périodes, ne sont bien entendu pas directement imputables à la politique de la ville et l’ont même historiquement légitimée.
Nous pensons néanmoins que, conformément à la mission que le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques nous a confiée, cet exercice d’établissement de l’état des lieux est utile. Il n’est d’ailleurs pas exempt d’éléments encourageants dans certains domaines, qui permettent de nuancer un constat général il est vrai assez sombre ; ces éléments démontrent que la politique de la ville n’est pas inutile et que, a contrario, certaines des actions qui la composent ne sont pas mises en œuvre de façon suffisamment intense et ciblée. Au demeurant, cet exercice ne doit pas interdire de penser que certains impacts positifs des dispositifs mis en œuvre peuvent aussi se révéler ultérieurement.
Il n’est en tout état de cause pas sans intérêt de tenter de restituer la réalité, aussi crue ou désagréable soit-elle, dans un domaine où, au demeurant, le Parlement a opportunément élaboré un référentiel, l’annexe 1 à la loi du 1er août 2003, permettant de réaliser un suivi de l’action publique. Les développements qui suivent s’inspirent largement de l’ordre qui structure cette annexe ; seront ainsi successivement évoqués les revenus et le patrimoine (A), l’emploi (B), le développement économique (C), l’habitat et le cadre de vie (D), la santé (E), l’éducation (F), la sécurité et la tranquillité publiques (G), ainsi que certains impacts transversaux repérés à l’occasion de la mise en œuvre de la politique de la ville (H).
A.– LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DANS LES ZUS : DES ÉCARTS DÉFAVORABLES SE MAINTENANT À DES NIVEAUX PRÉOCCUPANTS
La réduction des écarts de revenus ou de patrimoines n’est pas à proprement parler prévue par la loi du 1er août 2003. Faire état de ces écarts constitue cependant une illustration édifiante des inégalités sociales qui sont l’objet même de cette loi. Il paraît légitime pour vos rapporteurs de les rappeler, à titre liminaire, afin de mieux saisir la réalité sociale de ces quartiers.
1.– Les revenus dans les ZUS : une pauvreté qui se maintient à des niveaux élevés
a) Le niveau relatif des revenus dans les ZUS : pas d’évolution entre 2002 et 2006
Le rapport 2009 de l’ONZUS le précise sans ambage : « entre 2002 et 2006, les écarts de revenus entre la population des ZUS et celle de leur unité urbaine n’ont pratiquement pas évolué » (237). Ainsi, entre 2002 et 2006, le rapport entre le revenu moyen par unité de consommation (238), dans 567 ZUS suivies sur l’ensemble de la période, par rapport à leur unité urbaine de référence est passé de 0,57 à 0,56, soit une très légère dégradation du ratio. Le tableau suivant synthétise ces éléments.
ÉVOLUTION DU REVENU MOYEN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION
(en euros 2006)
Dans 567 ZUS |
Dans les unités urbaines abritant les ZUS |
Ratio ZUS/unités urbaines abritant les ZUS | |
2002 |
11 563 |
19 118 |
0,57 |
2006 |
11 754 |
19 992 |
0,56 |
Source : rapport ONZUS 2009.
Cette quasi-stabilité masque cependant des situations contrastées selon les ZUS : si on classe les ZUS par décile en fonction du revenu fiscal médian par unité de consommation, le décile le moins favorisé présente une moyenne s’établissant à 7 164 euros par unité de consommation et le plus favorisé une moyenne de 13 522 euros.
Ce contraste est aussi constaté s’agissant des évolutions enregistrées entre 2002 et 2006 : dans 681 ZUS analysées sur cette période, les taux d’évolution du revenu fiscal médian par unité de consommation s’échelonnent de – 20 % à + 30 %. Une tendance favorable à la réduction des écarts au sein des ZUS elles-mêmes peut être observée. Le rapport de l’ONZUS précise ainsi que « les évolutions ont été plus favorables parmi les catégories de ZUS identifiées comme étant les plus en difficulté : cela signifie que les disparités de revenu entre les ZUS se sont réduites sur la période » (239).
b) Le taux de pauvreté relatif dans les ZUS semble augmenter
Selon l’ONZUS, « en 2007 [par rapport à 2006], le taux de pauvreté a augmenté en ZUS, ainsi que les écarts avec le reste du territoire » (240). Le taux de pauvreté est estimé, dans le rapport 2009 de l’ONZUS, en calculant les proportions des habitants des ZUS qui disposent d’un revenu inférieur respectivement à 60 % et à 40 % du revenu médian national. Ces proportions s’élevaient en 2007 à 33,1 % et 7,6%. Elles se situaient ainsi à des niveaux assez supérieurs à celles de 2006. Par ailleurs, le rapport des taux de pauvreté en ZUS par rapport aux taux de pauvreté constatés hors ZUS a augmenté sur la même période. Le tableau suivant présente ces éléments.
TAUX DE PAUVRETÉ DANS LES ZUS ET HORS ZUS (MÉTROPOLE)
(en %)
Taux de pauvreté | ||
Seuil de 60 % |
Seuil de 40 % | |
ZUS |
||
2006 |
30,5 |
6,6 |
2007 |
33,1 |
7,6 |
Hors ZUS |
||
2006 |
12,0 |
2,9 |
2007 |
12,0 |
2,8 |
Rapport ZUS/hors ZUS |
||
2006 |
2,5 |
2,3 |
2007 |
2,8 |
2,7 |
Source : rapport 2009 de l’ONZUS.
Selon l’ONZUS, cette évolution négative sur un an trouve son origine pour une part plus importante dans la redéfinition annuelle du taux de pauvreté liée à son mode de calcul (compte tenu de la progression du revenu médian sur un an) que dans l’évolution du niveau de vie des habitants en ZUS lui-même. Néanmoins, selon l’ONZUS, « il y a bien eu [en moyenne] une baisse absolue des niveaux de vie des habitants de ces quartiers ». À ce constat s’ajoute celui, tout aussi préoccupant, des niveaux de vie des personnes vivant sous le seuil de pauvreté : il est plus faible en ZUS que hors ZUS. Au total, les personnes pauvres qui vivent en ZUS sont beaucoup plus nombreuses, en proportion de la population, que hors ZUS, et elles sont de surcroît plus pauvres que les personnes pauvres qui vivent hors ZUS.
2.– La faiblesse des patrimoines dans les ZUS
Selon le rapport de l’ONZUS, on constate « des patrimoines très modestes en ZUS en 2006 » (241). Dans les 584 ZUS analysées, la part des salaires dans les revenus fiscaux des ménages en 2006 est plus élevée que dans les unités urbaines ayant une ZUS (72,7 % contre 66,0 %). Cette différence de la structure des revenus fiscaux en ZUS par rapport aux unités urbaines de référence a une double « contrepartie » :
– la part des revenus des professions non salariées est nettement plus faible en ZUS que dans leur unité urbaine de référence (2,2 % cotre 5,6 %) ;
– la part des « autres revenus », soit, selon l’ONZUS, celle correspondant « aux fruits imposables du patrimoine », est très nettement plus faible en ZUS que dans leur unité urbaine de référence (1,7 % contre 5,8 %).
À ces éléments sur les revenus du patrimoine, on peut ajouter que les ZUS sont sans doute, beaucoup plus qu’ailleurs, des quartiers de locataires plus que de propriétaires et que les résidents des ZUS possèdent dans une plus faible proportion qu’ailleurs un véhicule automobile (65 % des ménages en ZUS possèdent un véhicule automobile contre 81 % pour les « autres ménages de citadins » (242)).
B.– L’EMPLOI : PAS D’AMÉLIORATION NOTABLE DE LA SITUATION RELATIVE DES ZUS EN CINQ ANS
1.– Une situation structurelle très défavorable et un échec patent s’agissant de la réduction des écarts des taux de chômage
Le tableau suivant, déjà présenté supra, présente les évolutions du taux de chômage dans les principales catégories de quartiers prioritaires de la politique de la ville, en France métropolitaine et dans les quartiers hors ZUS des unités urbaines possédant des ZUS.
TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPALES CATÉGORIES
DE QUARTIERS PRIORITAIRE
(en %)
Année |
France métropolitaine |
ZUS |
Quartiers Cucs |
ZFU |
ZRU |
Quartiers hors ZUS des unités urbaines possédant des ZUS |
2003 |
8,1 |
17,2 |
15,3 |
18,4 |
19,4 |
8,7 |
2004 |
8,6 |
18,9 |
14,3 |
20,2 |
21,5 |
9,3 |
2005 |
8,7 |
20,0 |
14,1 |
20,1 |
24,9 |
9,6 |
2006 |
8,9 |
19,5 |
14,6 |
21,4 |
23,4 |
9,4 |
2007 |
8,1 |
17,8 |
13,6 |
19,0 |
20,5 |
8,6 |
2008 |
7,5 |
16,9 |
12,4 |
16,5 |
21,4 |
7,7 |
Source : rapport 2009 de l’ONZUS.
Comme l’ont déjà relevé vos rapporteurs, le taux de chômage en ZUS est un peu plus de deux fois plus élevé qu’ailleurs et ce ratio n’a pas été modifié entre 2003 et 2008. Il est vérifié pour tous les âges et pour les deux sexes.
Si l’on compare les taux de chômage en ZUS et dans les quartiers hors ZUS des unités urbaines comprenant des ZUS, ce ratio est passé entre 2003 et 2008 de 1,98 à 2,19 ; on constate ainsi que l’objectif de l’annexe 1 à la loi du 1er août 2001 consistant à « rapprocher le taux de chômage de l’ensemble de chaque ZUS de celui de l’ensemble de leur agglomération de référence » n’a non seulement pas été atteint, mais que la tendance sur ce point a été négative.
Sans préjuger des évolutions comparées pour 2009 des taux de chômage en ZUS et dans les quartiers hors ZUS des unités urbaines comprenant des ZUS, la forte augmentation du chômage en 2009 partout en France a sans doute eu pour effet de gommer au moins en partie les évolutions globales positives enregistrées depuis 2005 et 2006 sur l’ensemble du territoire et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
2.– L’autre objectif quantitatif de la loi du 1er août 2003 n’a pas été atteint
En matière d’emploi, l’annexe 1 à la loi du 1er août 2003 prévoyait que soit réduit « d’un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans ».
Si on considère la période 2004-2008, le nombre des demandeurs d’emplois de catégorie 1 en ZUS au 31 décembre 2004 s’élevait à 326 527 (243). Ce chiffre s’élevait à 275 779 au 31 décembre 2008, soit une baisse, non négligeable, du nombre des chômeurs de 15,5 %. Ce taux demeure néanmoins assez éloigné de l’objectif prévu par la loi ; pour l’atteindre, il aurait été nécessaire sur cette période que le différentiel des taux de chômage en ZUS et hors ZUS soit substantiellement réduit, ce qui, on l’a vu, n’a pas été le cas. Par ailleurs, en toute rigueur, une comparaison sur cinq ans nécessite de comparer les chiffres au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2009. L’année 2009 ayant vu le taux de chômage augmenter substantiellement partout en France, l’atteinte de l’objectif de réduction d’un tiers en ZUS du nombre des chômeurs s’est sans doute éloignée.
3.– Les objectifs « qualitatifs » de la loi de 2003
a) L’évolution des taux de chômage pour les faibles niveaux de qualification a été analogue en ZUS et hors ZUS
L’annexe 1 à la loi du 1er août 2003 prévoyait par ailleurs que soient menées « des politiques prioritaires de formation professionnelle des habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification ». Pour déterminer si on peut considérer cet objectif atteint, on peut observer en premier lieu les évolutions comparées du taux de chômage des personnes ayant les niveaux de formation les plus faibles, en ZUS et dans leur agglomération de référence.
Le tableau suivant regroupe certaines des informations pertinentes en la matière du rapport 2009 de l’ONZUS (244).
ÉVOLUTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI (CATÉGORIE 1)
POUR LES NIVEAUX DE FORMATION LES PLUS FAIBLES ET POUR LES OUVRIERS
(en %)
ZUS |
Agglomérations comportant une Zus | |||||
Évolution 2005/2006 |
Évolution 2006/2007 |
Évolution 2007/2008 |
Évolution 2005/2006 |
Évolution 2006/2007 |
Évolution 2007/2008 | |
Niveau VI (Sortie avant la 3ème) |
- 12,1 |
- 13,1 |
+ 4,3 |
- 12,8 |
- 12,8 |
+ 6,1 |
Niveau V bis CEP ou SES |
- 9,4 |
- 9,5 |
nd |
- 8,9 |
- 9,1 |
nd |
Niveau V CAP ou BEP ou BEPC |
- 9,3 |
- 9,2 |
nd |
- 9,0 |
- 8,5 |
nd |
Manœuvres, ouvriers spécialisés |
- 11,6 |
- 11,8 |
+12,6 |
- 11,1 |
- 10,8 |
+ 16,1 |
Ouvriers qualifiés |
- 11,4 |
- 11,2 |
+ 20,5 |
- 11,1 |
- 10,4 |
+ 22,8 |
Source : ANPE-Insee, DEFM 2005-2008.
On constate que les évolutions annuelles sont à peu près comparables en ZUS et dans les agglomérations comportant une ZUS ; elles sont cependant à peu près systématiquement et très légèrement plus favorables en ZUS. Ce dernier constat est-il pour autant significatif ? L’ONZUS considère, s’agissant de l’évolution négative globale nationale constatée en 2008 tous niveaux de formation considérés (y compris ceux qui ne figurent pas dans le tableau précédent) que « les ZUS connaissent, par niveau de formation, des augmentations similaires à celles de leurs unités urbaines ». L’observatoire a une formule analogue s’agissant des niveaux de qualification : « les évolutions par qualification sont comparables en ZUS et ailleurs. »
b) La mise en œuvre dans les ZUS de dispositifs spécifiques pour les faibles niveaux de qualification : le contrat d’autonomie et les clauses d’insertion de l’Anru
Peut-on par ailleurs considérer que des politiques prioritaires de formation professionnelle des habitants des ZUS ont effectivement été mises en place, a fortiori pour les bas niveaux de qualification ?
Le contrat d’autonomie
Vos rapporteurs ont déjà évoqué supra le contrat d’autonomie, qui a le mérite de répondre assez précisément dans sa conception à l’objectif prévu en la matière par la loi du 1er août 2003 en matière de mise en œuvre de politiques prioritaires en faveur des bas niveaux de qualification dans les ZUS. Le contrat d’autonomie est un dispositif en faveur des jeunes de 16 à 25 ans résidant en ZUS, dans le cadre duquel ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé renforcé vers l’emploi ou une formation qualifiante par l’un des prestataires privés sélectionnés aux termes d’un ensemble d’appels d’offres organisés en 2008.
Le prestataire est intéressé financièrement à ce que chaque jeune sorte de façon « positive » de la période d’accompagnement et, a fortiori, à ce qu’il se maintienne dans l’emploi ou dans une formation qualifiante. Le bénéficiaire du contrat d’autonomie bénéficie pour sa part d’une bourse de 300 euros par mois pendant l’accompagnement.
L’objectif de faire bénéficier du contrat d’autonomie 45 000 jeunes en trois ans devrait être atteint (245). Vos rapporteurs ont déjà évoqué supra de premiers résultats quantitatifs disponibles à la fin du mois de mars 2010 :
– plus de 50 % des jeunes concernés n’ont aucune qualification ;
– sur 12 500 jeunes sortis du dispositif, 4 470, soit un taux de 36 %, ont bénéficié d’une sortie « positive » (68 % dans un emploi durable, 30 % pour une formation qualifiante et 2 % pour une création d’entreprise) ;
– le taux des sorties positives est en amélioration sur la durée : s’établissant à 26 % en septembre 2009, il s’élève à environ 40 % sur les trois premiers mois de l’année 2010 ;
– s’agissant des sorties « négatives », qui représentent donc 64 % des contrats d’autonomie mis en œuvre, un peu plus de la moitié a pour origine l’abandon de la démarche d’accompagnement et un peu moins de la moitié l’absence de solutions positives au terme de cette démarche.
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact du dispositif sur le chômage des jeunes en ZUS. On peut observer qu’il s’agit d’un plan réellement ambitieux, avec des moyens financiers considérables, à hauteur de 250 millions d’euros sur trois ans pour 45 000 contrats d’autonomie (soit 5 600 euros par contrat et beaucoup plus par sortie « positive » (246)).
Les clauses d’insertion dans le cadre du PNRU
Le quatrième objectif en matière d’emploi dans l’annexe 1 à la loi du 1er août 2003 prévoyait le « renforcement des politiques d’insertion par l’emploi des populations à faible qualification et de celles durablement exclues du marché de l’emploi ». L’article 10 de la même loi déclinait cet objectif dans le cadre de l’Anru en prévoyant que celle-ci « élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d’insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d’insertion professionnelle et sociale des habitants des zones urbaines sensibles ».
Le conseil d’administration de l’Anru a adopté une charte d’insertion au mois de mai 2005 « applicable aux porteurs de projets et aux maîtres d’ouvrage contractant avec l’Anru ». Selon cette charte, l’insertion professionnelle des habitants des quartiers Anru constitue un moyen d’atteindre l’objectif légal de développement durable dans le cadre duquel le PNRU est mis en œuvre (cf. l’article 6 de la loi du 1er août 2003). À cette fin, l’Anru incite les porteurs de projet de rénovation urbaine à exploiter les clauses en vigueur « disponibles » dans les dispositions relatives à la commande publique permettant « aux personnes en recherche d’emploi des zones urbaines sensibles d’accéder à des emplois durables de qualité ».
Ces clauses correspondent à certains des articles du code des marchés publics :
– l’article 14 de ce code prévoit que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.
« Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »
Selon l’Anru, la promotion de l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion est au nombre des éléments à caractère social qui peuvent constituer des conditions d’exécution du marché ;
– l’article 15 dispose que « certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail […], lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. » ;
– l’article 30 prévoit les modalités de passation de certains marchés et accords-cadres de prestations de service, notamment ceux ayant pour objet la qualification et l’insertion professionnelle. Selon l’Anru, ces prestations peuvent porter sur « des travaux de démolition, du nettoyage ou de l’entretien [et] certains travaux de second œuvre » (247) ;
– l’article 53 précise que le pouvoir adjudicateur, dans sa tâche d’attribution du « marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse » peut fonder son choix « sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché », parmi lesquels « les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ».
La charte nationale d’insertion de l’Anru prévoit pour sa part que le porteur de projet doit mobiliser les acteurs locaux de l’emploi afin d’établir un plan local d’application de cette charte qui doit notamment prévoir deux objectifs d’insertion respectivement égaux au minimum à (248) :
– « 5 % du nombre total d’heures travaillées dans le cadre des travaux d’investissement des projets financés par l’Anru réservées aux habitants des zones urbaines sensibles ;
– « 10% des embauches directes ou indirectes (notamment à travers des structures du type régie de quartier ou associations d’insertion) effectuées dans le cadre de la gestion urbaine de proximité et de la gestion des équipements faisant l’objet d’aides de l’Anru, réservées aux habitants des ZUS. »
La charte nationale d’insertion précise par ailleurs que « le respect de [ces] objectifs constitue l’un des éléments qui conditionnent l’appui financier de l’Agence aux projets ». On note que les opérations engagées avant l’élaboration de la charte n’ont pas fait l’objet de clauses d’insertion (249). Les universitaires apportent par ailleurs un éclairage qualitatif sur ces objectifs d’insertion ; ils soulignent que « les acteurs locaux s’accordent à considérer que l’introduction d’une clause d’insertion dans les marchés Anru dégage un nombre d’heures de travail somme toute marginal en regard de la population active et de l’intensité du chômage –des jeunes en particulier– dans les quartiers. Leurs interrogations, reprises par le [comité d’évaluation et de suivi] de l’Anru, portent sur les seuils de 5 et 10 % d’heures travaillées qui peuvent apparaître restrictifs […] ». Selon l’Anru, 12 % des plans locaux d’application de la charte fixent un objectif supérieur au plancher de 5 % (en l’espèce compris entre 5 % et 15 %), en ce qui concerne la réservation des heures travaillées aux habitants des ZUS dans le cadre des travaux subventionnés par l’agence (250).
Au total, au 30 juin 2009, 4 810 000 heures avaient été travaillées au titre de l’objectif de 5 % du nombre d’heures travaillées dans le cadre des travaux d’investissement réservées aux habitants des ZUS, soit 34 % des heures programmées au titre de l’ensemble des plans locaux d’application de la charte au titre du PNRU. Le nombre d’heures travaillées dans ce cadre a doublé en un an.
Les heures effectivement travaillées au 30 juin 2009 ont concerné 12 560 personnes au titre de 15 840 contrats. Il s’agit à 94 % d’hommes et à 39 % de personnes de moins de 26 ans sans expérience (10 %) ou sans qualification (30 %). Les autres grandes catégories de publics sont les demandeurs d’emploi de longue durée (25 %) et les bénéficiaires du RMI (27 %). Si on considère les bénéficiaires selon leur niveau de qualification, 31 % relèvent du niveau VI (abandon sans diplôme à la fin de la scolarité obligatoire), 21 % du niveau V bis (poursuite d’études pendant au moins un an vers un diplôme de niveau V) et 39 % du niveau V (certificat d’aptitude professionnelle – CAP ou brevet d’études professionnelle – BEP).
Les contrats au titre desquels les heures d’insertion sont travaillées relèvent à 50 % de l’intérim ; 18 % sont des CDD, 11 % des contrats d’alternance et 6 % des CDI. 57 % des heures d’insertion ont été accomplies par des petites et moyennes entreprises, 28 % par des grandes entreprises, 5 % par des entreprises d’insertion et 4 % par des artisans.
Ces heures travaillées ont été ainsi réparties selon les catégories d’opération financées par l’Anru : 11 % au titre des démolitions, 32 % au titre de la reconstitution de l’offre, 25 % au titre des réhabilitations et 15 % au titre des aménagements. L’Anru observe que « le poids des constructions augmente par rapport à 2008 et celui des démolitions diminue : cette évolution suit celle de la mise en œuvre des opérations » (251).
S’agissant des perspectives professionnelles des bénéficiaires des contrats d’insertion, « […] 65 % de ceux dont la situation est connue sont en situation de travail ou de formation 12 mois après leur premier contrat » (252). Ces chiffres sont moins favorables qu’en 2008, la crise économique ne facilitant pas les parcours d’insertion professionnelle amorcés suite au bénéfice d’un contrat d’insertion. On note que 25 % des intéressés disposent d’un CDI ou d’un CDD 12 mois après avoir bénéficié d’un contrat d’insertion.
S’agissant des résultats sur le second objectif de la charte nationale d’insertion, c’est-à-dire les 10 % d’embauches au titre de la gestion urbaine de proximité et de la gestion des équipements, 1 300 personnes avaient été recrutées au 30 juin 2009, dont 23 % au titre d’un CDI, 31 % au titre d’un CDD et 38 % au titre d’un contrat aidé. Sans préciser si l’objectif de 10 % est atteint à cette date ou s’il est envisageable qu’il le soit à l’avenir, l’Anru précise que « les résultats progressent mais restent faibles. » (253)
On note que l’Acsé et l’Anru ont élaboré un « programme national insertion/rénovation » en septembre 2009, au titre duquel l’Acsé finance des chantiers d’insertion afin de les « préparer » à bénéficier des clauses d’insertion mises en œuvre dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de la charte nationale d’insertion de l’Anru. Les crédits consacrés par l’Acsé à ce dispositif sont ceux qui lui ont été délégués au titre du Plan de relance dans son volet « emploi ».
S’agissant plus largement de la connexion entre la charte nationale d’insertion de l’Anru et les mesures mises en œuvre dans le cadre des Cucs, le cabinet d’étude, choisi au terme d’un appel d’offres, afin de réaliser une synthèse des éléments d’évaluation portant sur 22 Cucs dans le cadre de la mission confiée à vos rapporteurs, précise que « l’objectif de mobilisation des clauses d’insertion dans les marchés Anru et autres marchés publics fait dans la réalité l’objet d’une attention croissante au sein des équipes en charge des Cucs ». Par ailleurs, les universitaires relèvent un impact positif de la clause d’insertion propre à la rénovation urbaine : « dans certains cas, le PNRU a pu aussi exercer un effet levier, la clause d’insertion ayant été appliquée à des appels d’offres de marchés publics hors rénovation urbaine, dans des villes qui faisaient peu usage, jusque-là, de cette faculté ouverte par l’article 14 du code de marchés publics. »
3.– Une organisation des politiques publiques jugée peu efficiente
a) Les restructurations des services nationaux ont au moins conjoncturellement des effets négatifs au plan local
Certains peuvent craindre que la localisation des implantations du service public de l’emploi dans les ZUS ne contribue à une forme de ghettoïsation accrue de leurs résidents. Cependant, vos rapporteurs ont constaté lors de leur déplacement une présence excessivement inégale de Pôle emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et, parfois, une absence totale d’implantation locale de l’établissement public dans des zones où sa présence apparaît singulièrement justifiée (par exemple à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil).
La DGEFP, en réponse à vos rapporteurs s’agissant de l’implantation des agences de Pôle emploi en ZUS, souligne que la convention tripartite entre l’État, Pôle emploi et l’Unedic pour la période 2009-2011 pose seulement le principe que « l’évolution du réseau de Pôle emploi ne conduise pas à la réduction du nombre d’implantations dans les ZUS ». Il convient bien entendu, comme l’évoque la DGEFP, de porter « une attention particulière à bien respecter l’engagement pris de ne pas se désengager des ZUS ». Mais cet engagement a minima doit être accompagné d’une réflexion approfondie sur la pertinence de l’ensemble des implantations de l’établissement public, au regard de la territorialisation des difficultés notamment en ZUS ; cette réflexion doit pouvoir être menée dans le cadre de l’actuelle élaboration du schéma d’implantation territoriale de Pôle emploi.
Le cabinet d’étude missionné dans le cadre de ce rapport confirme, au moins à titre conjoncturel, les constatations de vos rapporteurs : « le contexte institutionnel, marqué par la réforme générale des politiques publiques, a pour sa part contribué à freiner la dynamique partenariale sur les territoires. De 2008 à 2010, les incertitudes liées à la fusion de l’ASSEDIC et de l’ANPE en Pôle Emploi et la refonte générale des services déconcentrés de l’État, ont bien souvent mis l’État en retrait dans le pilotage des politiques locales de l’emploi. À ce jour, le rôle des services de l’État dans leur configuration nouvelle reste à être précisé, et la nouvelle gouvernance locale à se structurer ».
b) Un paysage local des acteurs de l’emploi trop complexe pour être efficient
Ces difficultés, que l’on espère réellement conjoncturelles, s’ajoutent, selon vos rapporteurs à celles inhérentes à un panorama très éclaté des acteurs locaux de l’emploi : en plus des services déconcentrés de l’État et de Pôle emploi, on peut énumérer les missions locales, les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), les maisons de l’emploi, ainsi que les autres organismes de placement dont, notamment, les titulaires des lots attribués dans le cadre de l’appel d’offre relatif à la mise en œuvre du contrat d’autonomie.
Le cabinet d’étude confirme les difficultés associées à une telle complexité : la thématique de l’emploi est ainsi celle qui mobilise « le plus d’institutions partenaires impliquées tant dans la définition des orientations que dans la mise en œuvre des actions. En découlent globalement une grande complexité du paysage institutionnel local, une dilution de la stratégie et une difficulté d’impulser un portage global. De fait, entre l’État et les différentes collectivités, intervenant dans la définition de nombreux dispositifs, rares sont les cas pour lesquels il est abouti à une stratégie partagée et à un accord global sur la répartition des missions et l’articulation des différents dispositifs. »
Les constats globaux établis par le cabinet d’étude soulignent la déficience de la stratégie locale en matière d’emploi, dans un domaine pourtant crucial où il a été montré supra une situation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville très dégradée et sans amélioration notable depuis cinq ans : « de manière générale, les objectifs, les actions, les dispositifs et les modes d’organisation des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du volet emploi/insertion/économie sont faiblement articulés à un cadre stratégique global et structuré. Ainsi le Cucs n’est que rarement parvenu à constituer le centre de la définition d’une stratégie partagée à destination des publics des quartiers prioritaires, déterminant les conditions de mobilisation des politiques de droit commun et positionnant clairement les interventions de la politique de la ville en cohérence avec celles-ci. L’illisibilité des limites respectives des politiques de droit commun et de la politique de la ville constitue le constat le plus prégnant concernant cette thématique ».
On note que les universitaires considèrent que les insuffisances en matière d’organisation de la gouvernance des politiques de l’emploi dans le cadre de la politique de la ville concernent aussi les ZFU : « le modèle dominant paraît être celui d’une dissociation assez poussée entre les dispositifs d’animation des ZFU et les acteurs du service public de l’emploi […] ».
Toutefois, le cabinet d’étude considère que le désordre institutionnel est partiellement compensé par la qualité des acteurs et leur implication pratique auprès des demandeurs d’emplois : « si l’articulation des dispositifs fait défaut sur le plan formel et décisionnel, il semble que la cohérence soit tout de même recherchée au niveau technique, dans la mise en œuvre concrète des actions et dispositifs. En l’absence de stratégie partagée et de claire répartition des missions, les marges de manœuvre sont utilisées par les équipes, souvent au cas par cas, par une application souple des critères et procédures d’inscription des personnes dans les dispositifs, pour retrouver cette cohérence au niveau individuel, celui des personnes accompagnées, en fonction des besoins et suivant une logique de parcours. »
Le cabinet d’étude considère ainsi que les actions conduites dans le cadre des Cucs permettent, malgré les difficultés évoquées, la mise en œuvre d’une approche ciblée sur le public des quartiers prioritaires, par une proximité renouvelée. Le financement des Cucs a ainsi souvent permis « l’ouverture de points d’accueil situés au sein des quartiers, permettant de recevoir des personnes en recherche d’emploi dans des conditions plus souples que dans les structures de droit commun, et de trouver des solutions adaptées à la situation globale de la personne reçue ». De façon générale, le cabinet d’étude considère qu’« indéniablement le Cucs a permis la concentration des acteurs et des moyens sur les publics des quartiers prioritaires, et suscité une pro activité (aller au devant des publics et non les attendre derrière un guichet) peu naturelle au service public de l’emploi. »
c) Une amélioration dans la priorité donnée au public des quartiers prioritaires pour les contrats aidés ?
Les universitaires qui, dans le cadre de la mission de vos rapporteurs et aux termes d’un appel d’offre, ont réalisé une synthèse des travaux universitaires d’évaluation de la politique de la ville évoquent, en s’appuyant sur deux études de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), le « sort » réservé en 2005 et 2006 aux jeunes résidant en ZUS s’agissant des contrats aidés respectivement marchands et non marchands. Ces études montrent que les jeunes des ZUS bénéficient plus que leurs homologues hors ZUS de contrats aidés non marchands et moins de contrats aidés dans le secteur marchand. Les universitaires en concluent que les jeunes résidant en ZUS sont plus mal lotis au regard de leur chance de retrouver un emploi marchand, en faisant l’hypothèse, a priori pertinente, qu’un contrat aidé dans le secteur marchand constitue une chance supérieure de retour positif sur le marché du travail que le bénéfice d’un contrat aidé dans le secteur non marchand (dans le secteur associatif ou autre).
Ce constat, établi pour les années 2005 et 2006, semble devoir être aujourd’hui révisé, peut-être par l’effet d’une prise en compte réellement prioritaire des jeunes résidant en ZUS depuis 2006 au titre des contrats aidés. Le rapport 2009 de l’ONZUS montre que, toutes choses égales par ailleurs, en 2008, un jeune de moins de 26 ans résidant en ZUS a (un peu) plus de chance de bénéficier d’un contrat initiative emploi (CIE) qu’un jeune de moins de 26 ans résidant hors ZUS. L’ONZUS considère ainsi que « les jeunes, et parmi eux ceux des quartiers sensibles, ont donc été “ privilégiés ”, comme le recommandait la DGEFP » (254). Le résultat est cependant inverse pour les personnes âgées de plus de 50 ans résidant en ZUS : « les chances d’accès d’un senior habitant en zone urbaine sensible à un contrat initiative emploi sont plus faibles que pour une même personne résidant hors ZUS ».
Ce double constat est analogue pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE – secteur non marchand) : l’ONZUS précise que « résider en ZUS diminue très significativement la probabilité d’accès pour les seniors; au contraire, les jeunes de moins de 26 ans résidant en ZUS présentent, toutes choses égales par ailleurs, une probabilité nettement plus élevée d’entrer dans ce dispositif ». En revanche, la probabilité d’accès au contrat d’avenir (CAV – secteur non marchand, ciblé sur les bénéficiaires de minima sociaux) des jeunes de moins de 26 ans et des seniors qui résident en ZUS est plus faible que pour leurs homologues résidant hors ZUS.
C.– LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : DES RÉSULTATS RÉELS QUI N’ÉPUISENT PAS LA QUESTION DE LA PERTINENCE DES MOYENS EMPLOYÉS
1.– Les zones franches urbaine (ZFU) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) : taux d’installation des entreprises et évolution des embauches exonérées
a) Un impact substantiel des mesures d’exonération applicables en ZFU
Le rapport 2009 de l’ONZUS constate qu’entre 2002 et 2008, les taux d’installation d’établissements en ZFU de 1ère génération ont toujours été nettement supérieurs à ceux constatés dans leurs unités urbaines de référence. La croissance du stock d’entreprises, qui est la différence entre ces installations et les disparitions d’entreprises (un peu plus fréquentes en ZFU qu’ailleurs), est plus forte dans ces ZFU que dans leurs unités urbaines de référence. L’ONZUS en conclut qu’« en matière d’implantation de nouveaux établissements, les ZFU de 1ère génération continuent de rattraper leur retard sur leurs unités urbaines de référence […] » (255). Ces constats sont vérifiés pour les ZFU de 2ème et 3ème générations : « le rattrapage des ZFU de 2ème et 3ème générations par rapport à leurs unités urbaines de référence se poursuit […] en 2008 » (256).
Les universitaires font néanmoins le constat suivant s’agissant des écarts défavorables persistants pour les ZFU en la matière : « en dépit de cette croissance, le tissu économique des ZFU demeure peu développé : la comparaison du nombre d’établissements pour 1 000 habitants entre les ZFU et leur agglomération révélait en 2006 un écart persistant de 41 points pour la première génération, de 39 points pour la seconde génération et de 33,5 points pour la troisième génération. »
Il y a donc néanmoins un impact réel et significatif des mesures d’exonération de charges sociales et d’impôt sur la densité du tissu économique implanté en ZFU. S’agissant de la composition de ce tissu, l’ONZUS estime que « les ZFU concentrent davantage d’établissements ayant des activités liées à la construction, et plus précisément au bâtiment, que leurs unités urbaines de référence. Cette surreprésentation s’opère au détriment d’activités plus tertiaires telles que les services aux entreprises ou aux particuliers. »
Cet impact est aussi observable s’agissant des embauches. Le tableau suivant permet de constater le dynamisme des flux d’embauches en ZFU depuis 2002, ainsi que l’évolution du nombre des salariés pour lesquels les entreprises bénéficient de l’exonération en vigueur dans les ZFU.
ÉVOLUTION DES EMBAUCHES EXONÉRÉES DANS LES ZFU
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
(FRANCE MÉTROPOLITAINE)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Nombre d’établissements bénéficiant de l’exonération de charges patronales en ZFU |
13 660 |
14 583 |
16 336 |
17 965 |
18 673 |
Nombre total de salariés dans les établissements bénéficiant de l’exonération |
85 943 |
88 046 |
95 566 |
105 320 |
107 050 |
Nombre de salariés embauchés bénéficiant de l’exonération |
11 930 |
13 527 |
15 825 |
18 452 |
16 578 |
Évolution par rapport à l’année précédente |
+ 42 % |
+ 13 % |
+ 17 % |
+ 17 % |
+ 10 % |
Source : rapport 2009 de l’ONZUS.
L’ONZUS constate que le nombre des embauches annuelles dans les ZFU, jusqu’en 2007 inclus, n’a cessé d’augmenter. L’ONZUS considère que « cette augmentation est en partie le fruit de la création des nouvelles ZFU de 2ème et 3ème générations qui structurellement permet un accroissement des embauches exonérées. Elle traduit malgré tout l’attractivité du dispositif d’exonérations en ZFU qui facilite certainement l’implantation de nouveaux établissements dans ces zones prioritaires » (257).
L’ONZUS souligne cependant que l’année 2008 a constitué à plusieurs égards un tournant au terme d’une période courrant sur plusieurs années pendant lesquelles a été constatée d’une année sur l’autre une amplification des effets du dispositif :
– en 2008, les taux d’installation des entreprises dans chaque génération de ZFU ont été inférieurs à ceux constatés l’année précédente. S’il s’agit d’une tendance identifiable également pour les unités urbaines de référence des ZFU, le mouvement de reflux des taux d’installation a été plus prononcé pour chacune des générations de ZFU que pour leurs unités urbaines de référence ;
– pour la première fois en 2008, le nombre des embauches en ZFU a diminué par rapport à l’année précédente. L’ONZUS s’interroge en ces termes à ce sujet : « cette baisse est-elle “ accidentelle ” ou présage-t-elle d’un certain essoufflement du dispositif combiné avec les premiers effets de la crise économique dans les zones prioritaires ? Les prochains chiffres concernant le nombre de salariés embauchés en ZFU donnant droit à une exonération seront à suivre avec une grande vigilance. » (258)
Les universitaires, s’appuyant sur une étude, évoquent un facteur structurel explicatif de ce reflux de l’attractivité des ZFU ; il s’agit des « limites physiques à l’accueil des entreprises, sachant que le taux de remplissage des locaux d’activités approche souvent les 100 % dans ces zones ». Par ailleurs, les mesures législatives récentes évoquées supra tendant à affaiblir l’avantage comparatif de l’installation en ZFU (suppression de la taxe professionnelle, modification de la partie du dispositif relative aux allègements de charges) ne peuvent avoir pour effet, à terme, que de confirmer cette tendance.
b) Un impact réel mais plus modéré des mesures applicables dans les ZRU
Tous les constats établis s’agissant des ZFU sont valables pour les ZRU, mais dans des proportions parfois différentes. Ainsi, s’agissant des taux d’installation des entreprises constatés en ZRU, on constate que :
– ils sont systématiquement supérieurs à ceux constatés dans les unités urbaines de référence. Cet écart est néanmoins beaucoup moins fort que celui constaté pour chacune des générations de ZFU ;
– en 2008, le taux d’installation en ZRU a reflué, comme pour les ZFU. Ce reflux pour les ZRU a été plus fort que dans les unités urbaines de référence.
En revanche, le nombre des embauches exonérées en ZRU n’a cessé de chuter depuis 2001, comme le montre le tableau suivant :
EMBAUCHES EXONÉRÉES AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DE 2001 À 2008
DANS LES ZRU, HORS ZFU
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Nombre de salariés embauchés |
4 282 |
3 518 |
3 217 |
2 535 |
2 381 |
2 031 |
2 023 |
1 811 |
Évolution par rapport à l’année précédente |
- 18 % |
- 9 % |
- 21 % |
- 6 % |
- 15 % |
0 % |
- 10 % |
L’ONZUS considère que cette évolution est due « en partie à la création de ZFU plus récentes (2ème et 3ème générations) qui a conduit à la transformation d’une cinquantaine de ZRU en ZFU. Cela étant, les conditions d’exonération plus avantageuses en ZFU diminuent nécessairement l’attractivité des ZRU et expliquent également certainement une partie des baisses du nombre d’embauches enregistrées jusqu’ici dans ces quartiers. »
2.– Quels impacts des dispositifs ZFU et ZRU et à quel prix ?
a) le taux d’installation des entreprises dans les ZUS : la preuve des effets propres aux dispositifs applicables en ZFU et en ZRU ?
L’ONZUS considère qu’en termes de taux d’installation des entreprises dans les ZUS (hors ZFU et ZRU), « la différence avec les unités urbaines qui les entourent est à présent assez ténue » (259). Cette différence n’a d’ailleurs jamais été considérable depuis 2004 et, en tout état de cause, a été et demeure beaucoup moins sensible que dans les ZRU et, a fortiori, dans les ZFU.
Ce constat, dans le cadre duquel les ZUS hors ZRU et ZFU apparaissent presque comme le « groupe témoin » permettant de mesurer l’efficacité, ainsi confirmée, des dispositifs ciblés sur les ZRU et ZFU, a peut-être conduit à des impacts plus structurants sur le niveau de vie dans les ZFU, au-delà de la densité du tissu économique et de l’évolution correspondante des embauches.
On peut relever que le taux de chômage dans les ZFU était en 2008 inférieur à celui des ZUS (16,5 % contre 16,9 %), alors que l’écart était inversé en 2003 (18,4 % contre 17,2 %) (260). L’ONZUS semble désormais considérer que les dispositifs d’exonération qui sont mis en œuvre dans les ZFU ont contribué à cette évolution positive : pour illustrer l’idée que « plus l’action menée est concentrée, plus elle est efficace », l’ONZUS fait référence à cette évolution en ZFU, « quartiers où l’intensité de la dépense en matière de développement économique est la plus intense » (261).
Un deuxième point peut être évoqué : s’agissant de l’évolution des revenus fiscaux médians par unité de consommation entre 2002 et 2006, l’ONZUS observe que « les évolutions ont été plus favorables parmi les catégories de ZUS identifiées comme étant les plus en difficulté; cela signifie que les disparités de revenu entre les ZUS se sont réduites sur la période » (262). L’ONZUS constate que les évolutions les plus positives ont été enregistrées pour les ZFU de 1ère et de 3ème générations et, dans une mesure moindre, pour « les ZRU et les quartiers Anru de priorité 1, les ZUS support d’une ZFU de 2ème génération et les quartiers Anru de priorité 2 ». Ainsi, au total, « les ZUS non ZRU et non ZFU présentent […] les évolutions les plus défavorables »
Sur ce point aussi, L’ONZUS semble désormais considérer que le dispositif ZFU a contribué à l’évolution des revenus fiscaux médians dans les ZFU de 1ère génération (263). L’ONZUS constate que l’augmentation du revenu fiscal médian est la plus solidement établie s’agissant des ZFU de 1ère génération (c’est-à-dire les plus anciennes), et qu’au sein de cette catégorie, ce résultat est relativement homogène.
Sur la question de l’hypothèse de l’apparition d’impacts structurants du dispositif ZFU sur l’emploi et le niveau de vie des habitants de ces zones, on note que les universitaires, sur la base de plusieurs études, estiment qu’elle « ne semble pas confirmée ».
b) La question des impacts ultimes du dispositif propre aux ZFU
Certains observateurs et acteurs de la politique de la ville ont fait part à vos rapporteurs de leur scepticisme quant à l’impact des dispositifs d’exonération applicables en ZFU sur l’emploi des résidents des ZFU et des ZUS qui leur sont sous-jacentes. Le dispositif propre aux ZFU, dont l’impact global sur la densité du tissu économique n’est pas contesté, relèverait plutôt de l’« aménagement du territoire », au sens où cette disposition avait pour objet d’avantager certains territoires pour l’implantation d’activités économiques. À ce titre, les transferts d’activité peuvent être appréciables, par exemple en termes d’extension de l’offre commerciale de proximité aux habitants des ZFU, comme le soulignent les universitaires sur la base d’une étude : « les relocalisations [en ZFU] concernent en particulier certaines activités libérales, notamment médicales, ce qui peut avoir un impact positif sur des quartiers relativement dépourvus de ce type de services »
Mais ce surcroît d’activités économiques dans les ZFU, s’il peut contribuer à leur attractivité et à leur rayonnement territoriaux, n’aurait pas bénéficié à leurs résidents, surtout les moins diplômés et les moins qualifiés d’entre eux, en difficulté sur le marché du travail quelle que soit la localisation des activités économiques. L’avantage direct pour les habitants des ZFU se limiterait ainsi à résider dans un territoire à l’image éventuellement améliorée et à bénéficier, le cas échéant, d’emplois induits mais peu qualifiés dans le secteur des services.
Certains praticiens de la politique de la ville considèrent que le dispositif des ZRU, moins ambitieux mais concentré sur le commerce de proximité et de détail, était, du point de vue de l’emploi, relativement plus adapté aux résidents des quartiers prioritaires.
Cette vision d’un dispositif ZFU qui bénéficierait aux territoires plus qu’à ses habitants doit être nuancée :
– l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville subordonne le maintien de l’exonération de charges sociales à la condition que les embauches exonérées à partir de la troisième conduisent à ce que le tiers de l’effectif de l’entreprise réside dans l’une des ZFU ou des ZUS de l’unité urbaine considérée ;
– on note qu’il existe une disposition à l’article 44 octies A du code général des impôts, tendant à majorer le plafond du bénéfice exonéré d’imposition dans les ZFU, au titre de chaque « nouveau salarié embauché […] domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois » (264). Vos rapporteurs ne disposent pas d’informations sur l’impact de cette mesure ;
– la surreprésentation dans le tissu économique des ZFU du secteur de la construction laisse penser que les emplois qui s’y sont implantés sont accessibles à des niveaux de qualification peu élevés, eux aussi surreprésentés dans les ZFU ;
– l’ONZUS croit pouvoir désormais associer les exonérations applicables dans les ZFU à des résultats positifs enregistrés en matière d’emploi et de revenu pour les habitants des ZFU. Ce constat semble néanmoins encore discuté.
Une autre critique déjà évoquée du dispositif des ZFU porte sur un certain « isolement » de la mesure. Comme le soulignent les universitaires, « l’articulation entre les ZFU et les autres volets d’une politique globale de développement des quartiers n’a pas été pensée à l’échelon central ». Ils indiquent que, selon une étude citée, ce défaut d’articulation est également vérifié pour le PNRU : « l’articulation entre ZFU et PRU n’est guère visible sur le plan du pilotage des deux dispositifs. Il y a pourtant un enjeu concret à anticiper les besoins fonciers et immobiliers des entreprises qui s’implantent dans les ZUS. »
Cette déconnexion est considérée comme patente entre le dispositif ZFU et l’action des collectivités territoriales, alors qu’il semble prouvé que la synergie en la matière conduirait à des résultats non négligeables. L’analyse d’une étude citée conduit les universitaires à relever que « des exemples montrent que des stratégies globales (construction d’espaces et structures d’accueil d’entreprises, restructuration des centres commerciaux, changements d’usage, synergie avec des équipements publics attractifs…) peuvent être efficaces. Mais dans la plupart des cas, les entreprises sont confinées dans des zones et parcs d’activités localisés en périphérie des quartiers, à l’écart des lieux de vie, ce qui n’améliore pas la mixité fonctionnelle de ces derniers » et que « l’action des collectivités locales peut s’avérer déterminante selon qu’elles élaborent ou non, en amont, une stratégie de maîtrise des implantations d’entreprises, suivant une logique de filière ou de cluster qui privilégie les entreprises ayant des besoins en main d’œuvre correspondant au potentiel local »
La difficulté est aussi identifiée s’agissant du volet « emploi, insertion et développement économique » des Cucs, pourtant susceptible d’intégrer la ZFU dans une approche territoriale plus globale. Quand l’animation politique et administrative du Cucs est déficiente, le cabinet d’étude missionné dans le cadre du présent rapport a pu observer « des ZFU rendues inopérantes par cette situation ». Au demeurant, le cabinet d’étude constate que la présence d’une ZFU n’a pas toujours constitué un facteur de renforcement de ce volet, en général peu efficace, du Cucs : « la faiblesse de ce volet […] est son déphasage des politiques et dispositifs de développement économique ainsi que de l’entreprise et des institutions consulaires. Symptôme supplémentaire de l’enclavement de la politique de la ville dans ces quartiers, aggravé par la répartition des compétences entre EPCI et région d’une part, communes d’autre part, et la division des délégations en leur sein propre, les Cucs se sont trouvés en grande difficulté d’intéresser à leurs quartiers les acteurs du développement économique. Et ce, parfois même lorsqu’ils comprennent une ZFU. »
c) Le coût élevé du dispositif ZFU
Une étude parue en décembre 2007 (265) a tenté de cerner l’impact en termes de flux d’implantations d’entreprises et d’emplois du passage en ZFU (de deuxième génération) en 2004 de certaines ZRU. Cette étude a le mérite de s’appuyer sur deux contrefactuels « disponibles » permettant d’appréhender le résultat « net » du passage au statut de ZFU : les nouvelles ZFU pouvaient être comparées aux ZRU qui le sont restées, et ce en tentant d’identifier d’éventuelles différences ex ante entre les ZRU futures ZFU et les ZRU demeurées ZRU. Par ailleurs, les ZFU de 2ème génération ont été comparées dans leurs effets aux ZFU de 3ème génération apparues à compter de 2007.
Plusieurs résultats important sont établis par les auteurs de cette étude :
– « pour les flux bruts d’établissement et le ratio flux sur stock, l’impact du passage de ZRU en ZFU est significatif et positif pour la première année mais pas pour les suivantes. […] Cela peut s’interpréter comme un choc modifiant durablement le niveau du flux brut (hausse de 17%), sans en modifier la tendance » (266) ;
– « en ce qui concerne les variables d’emplois, l’impact du passage de ZRU en ZFU est significatif et positif pour la première année mais pas pour les suivantes pour le nombre de postes. Pour le nombre d’heures, il faut attendre un an pour avoir un effet, du même ordre que pour le nombre de postes. […] Nos résultats suggèrent qu’il s’agit d’un saut en niveau plutôt que d’un changement de tendance » (267) ;
– « il ressort de la comparaison entre cette dernière estimation et celle du contrefactuel ZRU […] que la ZFU ne semble pas se développer au détriment du voisinage immédiat, pas plus d’ailleurs qu’elle n’induit sur lui un effet d’entraînement. » (268) ;
– « on peut conclure que l’augmentation des flux bruts [d’établissements] la première année du passage de ZRU à ZFU semble davantage liée à une augmentation des transferts qu’aux créations brutes. » (269). Ces transferts représenteraient les deux tiers de l’augmentation des flux bruts d’établissements.
Au total, les auteurs de l’étude concluent avoir « montré qu’il existe un effet économique pur du dispositif ZFU à la fin de deux premières années de mise en place. Ces effets sont cependant faibles, surtout lorsqu’ils sont mis en regard des coûts. Nous avons identifié que le maintien de 4 000 emplois et de 600 établissements était associé à un coût de l’ordre de 125 millions d’euros » (270), soit une moyenne de 25 000 euros par emploi. Les universitaires complètent ce constat en comparant ce coût et celui des baisses de charges de droit commun sur les bas salaires ; ils notent que « ces dernières coûtent de 11 000 à 29 000 euros par emploi, alors que le coût d’un emploi en ZFU varie de 11 000 à 73 000 euros (en intégrant les exonérations fiscales) ».
Au-delà de cette conclusion sur l’impact économique du dispositif ZFU, réel mais relativement faible, a fortiori quand il est comparé à son coût, les auteurs de l’étude parue en décembre 2007 constatent, sans pouvoir l’expliquer, l’hétérogénéité des résultats selon les zones franches étudiées. Les auteurs soulignent par ailleurs qu’il existe d’autres facteurs contribuant au « succès » des zones franches : « les exonérations interviennent souvent en concomitance avec des actions locales d’acteurs divers (conseils généraux, service public de l’emploi, municipalités ou associations). Le succès ou l’échec au niveau local est certainement lié à la coordination des actions de ces différents acteurs, coordination que cette [étude] ne permet pas de mesurer » (271).
Il n’est pas exclu que ces facteurs expliquent au moins en partie l’hétérogénéité des résultats. Ce qui corrobore d’ailleurs les observations du bureau d’étude et des universitaires sur le lien entre la gouvernance locale de la politique de la ville (pour le PRU, le Cucs, l’action des collectivités territoriales) et la mise en valeur d’une ZFU.
Vos rapporteurs relèvent également que certaines propositions de la mission André-Hamel (272) consistent nécessairement à « réintégrer » les moyens affectés aux exonérations applicables en ZFU dans l’« enveloppe » de futurs contrats de politique de la ville, ce qui conduit à proposer une gouvernance plus intégrée du volet relatif au développement économique de la politique de la ville.
D.– AMÉLIORER L’HABITAT ET L’ENVIRONNEMENT URBAIN
1.– La programmation du Programme national de rénovation urbaine (PNRU) et son exécution
Le tableau suivant présente l’état de programmation du PNRU au 1er septembre 2010 pour les logements sociaux.
PROGRAMMATIONS DU PNRU PRÉVUE PAR LA LOI ET LES ENGAGEMENTS DE L’ANRU
Programmation selon l’article 6 de la loi du 1er août 2003 dans sa version issue de la loi du 18 janvier 2005 |
Programmation sur la base des projets de rénovation urbaine présentés au Comité national d’engagement de l’Anru le 1er sept. 2010 (en nombre et en pourcentage du total) |
| |||
Production de logements sociaux |
250 000 |
19,2 % |
128 864 |
14,1 % |
51,5 % |
Déconstruction (démolition) |
250 000 |
19,2 % |
135 463 |
14,8 % |
54,2 % |
Réhabilitation |
400 000 |
30,8 % |
315 980 |
34,6 % |
79,0 % |
Résidentialisation |
400 000 |
30,8 % |
332 516 |
36,4 % |
83,1 % |
TOTAL |
1 300 000 |
100,0 % |
912 823 |
100,0 % |
70,2 % |
Il faut noter que les éléments de la programmation légale du PNRU, repris dans ce tableau, sont issus de l’article 91 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui, pour chacune des catégories d’opérations propres aux logements sociaux, a relevé le nombre des logements concernés initialement fixés par la loi du 1er août 2003. L’article 6 de cette loi, dans sa version initiale, prévoyait de fixer à 200 000 le nombre des logements sociaux concernés par chaque catégorie d’opérations.
On observe que la programmation légale en vigueur, en l’état de la programmation réelle, ne serait atteinte que pour à peine plus de la moitié s’agissant de la production de logements sociaux neufs et de la démolition de logements sociaux. Pour ces catégories d’opérations, même en considérant les projections initiales de la loi du 1er août 2003, les réalisations seraient donc sensiblement inférieures à la programmation légale. Il y aurait au demeurant presque autant de constructions que de démolitions ; le taux national de remplacement du parc démoli devrait s’élever à 95 %. Le « manque à loger » induit, qui s’élève à plus de 6 000 logements sociaux, reste limité mais n’est pas pour autant complètement négligeable.
Le constat n’est pas identique s’agissant des réhabilitations et des résidentialisations : la programmation réelle à ce jour est moins éloignée de la programmation légale et dépasse très sensiblement les projections initiales de la loi du 1er août 2003. Globalement, le PNRU concernerait donc 913 000 logements environ, soit un nombre assez significativement inférieur à la programmation légale en vigueur (1 300 000 logements) mais plus élevé que la projection initiale (800 000 logements).
Il faut rappeler que dans le même temps, la programmation budgétaire du PNRU a été sensiblement relevée et que les crédits nationaux dédiés à ce plan et délégués à l’Anru s’élèvent désormais à 12 milliards d’euros (273) contre seulement 5 milliards d’euros prévus initialement par la loi du 1er août 2003.
2.– Éléments d’appréciation qualitative du PNRU
a) La restructuration des quartiers et la rénovation de l’habitat sont les objectifs centraux et partagés du PNRU
Ÿ La problématique des objectifs du PNRU
Les universitaires ayant réalisé une synthèse des travaux universitaires d’évaluation en matière de politique de la ville proposent, au terme d’une analyse structurée, l’interprétation suivante des objectifs du PNRU, fondée sur la lettre même de l’article 6 de la loi du 1er août 2003 : les objectifs explicites sont la « mixité sociale » et le « développement durable ». Dans le libellé de cet article, il est ainsi incontestable que le PNRU, programme institutionnel, et la restructuration des quartiers, traduction pratique du plan national, s’apparentent à des moyens au service de ces deux objectifs.
S’agissant du développement durable, les universitaires considèrent que « jusqu’au Grenelle de l’environnement, cet objectif est demeuré très secondaire pour l’Anru, qui ne l’a jamais traduit dans ses aides, ni conditionné celles-ci à la durabilité des projets de rénovation urbaine. Aussi la prise en compte des principes du développement durable reste-t-elle rare et difficile dans les projets de rénovation urbaine ». Vos rapporteurs relèvent que l’Anru considère que sa charte nationale d’insertion et les obligations qu’elle impose aux porteurs de projet en matière d’heures travaillées par les habitants des quartiers concernés par la rénovation urbaine constituent une contribution au développement durable de ces quartiers par « la complémentarité des interventions […] sur le cadre urbain avec les actions de développement économique et social des quartiers. » (274)
S’agissant de la mixité sociale, les universitaires montrent en premier lieu qu’il s’agit d’une notion imprécise, ambiguë, qui, aux termes de nombreux travaux scientifiques globalement très critiques sur l’opportunité de lui donner rang d’objectif dans les politiques publiques, semble se définir « pour l’essentiel en négatif, comme l’absence de “ concentration ” ». Les universitaires ont établi par ailleurs une « chaîne d’intentions » du PNRU, axée sur la mixité sociale comme condition de la cohésion sociale, qu’ils présentent sous la forme suivante :
– « l’article 6 de la loi de 2003 fait des opérations visant le parc de logements (démolitions, réhabilitations, résidentialisations et constructions) les leviers permettant d’atteindre l’objectif de mixité sociale. Ces opérations qui, combinées, doivent aboutir à une diversification de l’habitat, mobilisent pratiquement les deux tiers des crédits de l’Anru » ;
– « parmi les différents leviers de diversification de l’habitat, les démolitions sont l’instrument principal, car elles libèrent du foncier […] » ;
– « la reconstitution de l’offre de logements sociaux en dehors des ZUS constitue le second volet de la chaîne d’intentions qui structure cette politique de mixité sociale. Chaque démolition de logement social doit s’accompagner de sa reconstruction suivant la règle du “ un pour un ” édictée par l’Anru et l’Agence insiste sur la nécessité de reconstituer prioritairement l’offre hors du quartier visé. La reconstitution doit donc contribuer au rééquilibrage de la répartition du parc HLM à l’échelle communale ou de l’agglomération […] » ;
– « si l’on passe maintenant des effets (la mixité sociale) aux impacts attendus des opérations de démolition-reconstruction, l’hypothèse structurante du PNRU (et plus largement de l’ensemble des politiques urbaines qui ont affiché un objectif de mixité sociale) est que la mixité sociale dans les ZUS renforcera la cohésion sociale dans ces territoires. »
Vos rapporteurs considèrent que cette chaîne d’intentions témoigne effectivement d’une partie des raisonnements des pouvoirs publics nationaux et de certains élus locaux s’agissant du PNRU et illustre certaines de leurs intentions. Elle n’épuise cependant pas la question des objectifs du PNRU (275).
Ÿ Le débat parlementaire
Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ne contenait pas de références à la mixité sociale et au développement durable pour définir l’objet et les moyens du PNRU. Le premier alinéa de l’article 6 de ce projet précisait que (276)« le programme national de rénovation urbaine a pour objectif central la restructuration en profondeur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au travers d’actions visant à l’aménagement des espaces publics, la réhabilitation ou la création d’équipements publics, la réorganisation des réseaux de voiries et la rénovation du parc de logements de ces quartiers. »
L’objectif « central » de la rénovation urbaine était donc, à ce stade, la restructuration des quartiers, sans référence ni à la mixité sociale, ni au développement durable. Doit-on considérer que le débat parlementaire aurait abouti à une modification aussi substantielle de l’objet du PNRU, par la relégation de l’objectif initial au seul rang d’un moyen permettant l’atteinte d’objectifs nouveaux ?
L’introduction des notions de mixité sociale et de développement durable a pour origine un amendement de la commission des Affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée nationale (saisie au fond) et défendu en séance publique par son rapporteur M. Philippe Pemezec. Dans son rapport, le rapporteur considèrait que cet amendement avait pour objet d’améliorer « la rédaction proposée, insérant dans les objectifs du programme national de rénovation urbaine (PNRU) une référence à la notion de développement durable ainsi qu’à l’objectif de mixité sociale » (277). L’intention du rapporteur était donc de compléter des objectifs existants par des « références », l’une d’entre elles concernant la mixité sociale.
Plus avant dans son rapport, il précisait que « l’objectif central du projet de loi étant l’amélioration du cadre de vie des citoyens dans les quartiers dégradés, les actions de rénovation urbaine font l’objet d’un programme national spécifique » (278) ; rien ne laissait donc apparaître dans le rapport que cet objectif « central » soit contesté par le rapporteur.
Le rapport émettait aussi certaines réserves sur le projet de loi lui-même (279) : « votre rapporteur, s’il considère que le projet de loi dans son ensemble répond correctement à un certain nombre de difficultés de la politique de la ville, estime qu’il aurait pu également aborder deux autres sujets connexes importants : la mixité sociale, et le pouvoir du maire dans l’attribution des logements HLM ». Le rapporteur précisait que la mixité sociale « apparaît comme un des moyens d’assurer progressivement un rééquilibrage du niveau économique des populations vivant dans les quartiers défavorisés ».
Au total, la mixité sociale, successivement désigné comme « objectif », « moyen » et « sujet » (qui ne serait pas traité par le projet de loi), a conduit à l’adoption d’un amendement dont la portée relevait au moins en partie de l’amélioration rédactionnelle, et sans que soit remis en cause l’objectif central initialement affiché par le Gouvernement de restructuration des quartiers en difficulté.
Au demeurant, en séance publique, pour seule argumentation, le rapporteur a assimilé la mixité sociale à une « notion », comme il l’avait fait dans son rapport pour le « développement durable » : « cet amendement fait référence aux notions de mixité sociale et de développement durable ». Le Gouvernement s’est déclaré favorable à cet amendement sans autre justification ou argumentation. La discussion parlementaire à l’Assemblée nationale ne paraît donc pas démontrer que le Gouvernement, par son approbation à un amendement à la formulation non dénuée d’ambiguïté, aurait ainsi accepté de renoncer à conférer à la restructuration des quartiers prioritaires le rang d’objectif et lui attribuer, sans débat, celui uniquement d’un des moyens permettant d’atteindre des objectifs complètement reformulés.
On note que le Sénat, lors de l’examen de ce projet de loi, a considéré que l’« apport » de l’Assemblée nationale relevait d’un complément donné aux objectifs du PNRU, qui en aurait ainsi plusieurs ; dans son rapport, M. Pierre André, rapporteur de la commission des Affaires économiques et du plan, saisie au fond, précisait que la modification du texte à l’Assemblée nationale a consisté à « insérer, dans les objectifs du PNRU, les références au “ développement durable ” et à la “ mixité sociale ” […] » (280). On note aussi que le rapporteur de la commission des affaires économiques, commentant l’ensemble du projet tel que modifié par l’Assemblée nationale, indiquait que la commission « approuve la démarche qui consiste à retenir pour objectifs principaux l’amélioration du cadre de vie et du quotidien des habitants des ZUS grâce au volet logement et rénovation urbaine » (281).
Ÿ La restructuration des quartiers et la rénovation de l’habitat, objectif central du PNRU
En conclusion, vos rapporteurs estiment qu’au terme du débat parlementaire, l’objectif central du PNRU n’a pas été modifié et est demeuré la restructuration physique des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la rénovation de l’habitat dans ces quartiers. Cet objectif central et « matériel » s’est vu adjoindre des objectifs plus généraux, moins concrets, relevant de notions auxquelles le législateur a jugé opportun de se référer, c’est-à-dire la « mixité sociale » et le « développement durable ».
Dans ce contexte d’un objectif central et d’objectifs « supplémentaires » du PNRU, la mixité sociale a été sans doute recherchée à la mesure de la volonté des acteurs de se donner les moyens de l’atteindre. Dans la chaîne d’intentions précitée, décrite par les universitaires, contribuant à atteindre l’objectif de mixité sociale, l’Anru a effectivement adopté une démarche volontariste en la matière, privilégiant, au moins dans un premier temps, les démolitions, afin de libérer le foncier et promouvoir la diversification de l’habitat dans l’objectif de diversifier les classes sociales résidant dans certains quartiers.
La mixité sociale n’a cependant pas été envisagée avec la même intensité sur tous les sites de la rénovation urbaine. De nombreux maires ont pensé dès le départ, comme le traduisent les universitaires dans un passage relatif à l’échec de l’association Foncière Logement, que « faire reposer la diversification du peuplement sur l’arrivée de ménages extérieurs très différents, par leur profil, des populations locales [était] irréaliste » (282).
Lors de nos déplacements, nous avons constaté que la « mixité sociale » avait souvent le rang d’un objectif supplémentaire ou secondaire, dans le cadre de programmes avant tout orientés vers la rénovation de l’habitat. Sur le « plateau » de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, le PRU devrait aboutir à une augmentation substantielle de l’offre de logements sur le site, devant permettre à la fois le relogement sur place de tous les ménages initialement présents et l’arrivée en nombre de nouveaux ménages. Les maires ne nous ont pas semblé anticiper, à l’occasion du PRU, une modification profonde du profil socio-économique des ménages sur le site.
À Orléans et à Vénissieux, la mixité sociale, au sens où des ménages plus aisés seraient incités à s’installer dans les quartiers rénovés, a certes été poursuivie, et ce plutôt en plein centre des quartiers concernés qu’à leur périphérie. Les programmes correspondants d’accession sociale à la propriété ou de logements locatifs à loyer libre sont d’ampleur assez limitée, l’objectif central demeurant la rénovation du parc social et la restructuration du quartier. Ces programmes nouveaux semblent cependant avoir rencontré un succès rapide, d’ailleurs parfois à la surprise des acteurs locaux qui les ont mis en œuvre.
Après ce réexamen de la définition et de la hiérarchie des objectifs du PNRU, il convient de tenter de dresser un état des impacts, dans la mesure cependant où ce plan national n’a abouti qu’à un nombre assez limité de réalisations achevées à ce jour.
b) Le PNRU semble avoir un impact relativement limité en termes de « mixité sociale »
Ÿ Une offre de logements orientée de fait vers les habitants des quartiers
Dans son rapport 2009 (283), l’ONZUS précise, sur la base de l’enquête sur les livraisons de l’Anru, qu’au 31 décembre 2008, 9 712 logements avaient été livrés au titre de la diversification de l’habitat dans les quartiers concernés par la rénovation urbaine. On compte parmi eux une majorité de logements en accession à la propriété et assez peu de logements locatifs libres. Ce chiffre est à comparer à la production de logements sociaux à la même date au titre du PNRU, soit 18 756 logements. Le tiers des logements livrés à cette date au titre de la rénovation urbaine n’était donc pas des logements sociaux « classiques ».
Au regard de certaines études relatives au renouvellement en volume du parc de logements des quartiers considérés, et en appréciant aussi la nature des logements nouveaux, l’étude de synthèse des travaux universitaires conclut que l’évolution du parc de logement des quartiers Anru pourrait être assez modeste. Ce renouvellement limité aurait pour origine le nombre des démolitions, en retrait in fine par rapport aux projections légales initiales, ce qui aurait réduit d’autant les réserves foncières initialement prévues. Certaines opérations privées de renouvellement du parc de logement auraient par ailleurs été abandonnées parfois avant même d’être mises en œuvre, en raison d’un contexte économique peu porteur et, comme le soulignent les universitaires, par crainte de l’échec d’une démarche de recherche de la mixité sociale jugée peu crédible.
S’agissant du « public » concerné par les opérations de diversification de l’habitat, les universitaires pensent que « ce sont bien les habitants des quartiers, ou d’autres quartiers similaires, et non des ménages extérieurs dont le profil se distinguerait de celui des ménages des ZUS, qui apparaissent comme les premiers clients des produits de la diversification, et notamment de l’accession à la propriété », ce qui tendrait à valider partiellement l’idée que le PNRU peut constituer une proposition de parcours résidentiel positif pour les habitants des quartiers prioritaires. Ce constat a pu aboutir, selon les universitaires à une réorientation « pragmatique » en « interne » d’opérations en accession à la propriété (284) ou portant sur des logements locatifs libres, dès lors que « l’équation posée dans le PNRU entre logements privés et attraction de ménages extérieurs ne se vérifie pas, ou doit être fortement nuancée » (285).
Le bureau d’étude, pour sa part, estime plutôt que la recherche de la mixité a rencontré un certain succès : « le PRU est […] largement mis en avant comme ayant eu des impacts très importants, […] sur le plan de la mixité sociale […] ». Dans le cas de cette étude, le témoignage du « succès » est le reflet de ce que les acteurs locaux attendaient sur leur site respectif de la recherche de la « mixité sociale », sans référence à une politique nationale menée en la matière ou à une définition globale du concept.
Selon les universitaires, le scénario « apaisé » d’une répartition en interne des logements nouveaux issus de la rénovation urbaine, parmi les habitants du quartier et selon des trajectoires résidentielles « positives », se heurte cependant à des hypothèques sérieuses. Ces logements peuvent être affectés au relogement de ménages concernés par une autre opération de rénovation urbaine dans un autre quartier, « notamment dans les marchés tendus, comme celui de l’Île-de-France, où la vacance du parc n’est pas suffisante pour absorber l’ensemble de ces relogements ». Les mêmes logements pourraient d’ailleurs être potentiellement réservés aux ménages prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO). Beaucoup d’élus locaux ont confié à vos rapporteurs leur crainte de voir les logements nouveaux de leur quartier rénové être réservés par l’État à ce titre, au détriment le cas échéant du relogement des habitants du quartier et en contradiction, le cas échéant, avec les engagements pris, par le même État, au nom de la mixité sociale dans le cadre du PRU. Il convient pour vos rapporteurs d’orienter autant que faire se peut les ménages prioritaires au titre du DALO sur des quartiers qui ne font pas l’objet d’un projet de rénovation urbaine, par exemple vers les logements sociaux nouveaux contribuant dans certaines communes à atteindre le seuil de 20 % de logements sociaux fixé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (286).
Ÿ Un risque de « concentration » accrue des difficultés ?
Les universitaires considèrent que le scénario positif en interne pourrait être par ailleurs « concurrencé » par un scénario inverse : « on peut aussi faire l’hypothèse que le processus de relogement aboutit à l’effet inverse du résultat recherché puisqu’à l’annonce des démolitions et, au fur et à mesure de l’avancement des relogement, ce sont les ménages les plus mobiles et solvables qui partent les premiers, tandis que les difficultés à reloger les ménages les moins solvables contribuent au contraire à fixer ces derniers dans le quartier ». S’appuyant sur une autre étude, ils soulignent assez logiquement que « le grand paradoxe du relogement est qu’il facilite la mobilité de ceux que les villes et les bailleurs aimeraient voir rester […] »
Plus généralement, à l’aune de la recherche d’une plus grande mixité sociale, le constat dressé par les universitaires est sévère : « toutes les études appuyées sur les données, même fragiles, concernant les quartiers de destination des ménages relogés convergent pour décrire un processus de reformation des “ concentrations ” […] », à l’intérieur des quartiers rénovés, ou à l’extérieur le cas échéant. Cette analyse est partagée par le cabinet d’étude, sur la base des travaux réalisées auprès des sites étudiés : « toutefois, un effet pervers du PRU a été évoqué plusieurs fois : il apparaît que les difficultés résorbées sur un quartier grâce au PRU ont tendance à se déplacer dans les autres quartiers prioritaires non couverts par le PRU, et notamment les plus dégradés, puisque ceux-ci perdent en attractivité relative vis-à-vis du quartier rénové, ce qui peut provoquer une baisse des prix des loyers et donc la concentration accrue des populations les plus précaires. Dans ce cas, les acteurs locaux appellent à une nouvelle génération de PRU destiné à ces quartiers ».
De nombreux acteurs locaux ont saisi à plusieurs reprises vos rapporteurs de la question du traitement des quartiers dégradés exclus du PNRU ; le cas du « Bas Clichy » (quartier du Chêne pointu) à Clichy-sous-Bois, écarté de la rénovation urbaine, entre autres, en tant que quartiers de copropriétés privées, en constitue un exemple certes extrême, mais qui illustre que le PNRU ne couvre pas tous les quartiers urbains pour lesquels la rénovation de l’habitat et la restructuration du quartier sont nécessaires. Il apparaît en conséquence incontournable de préparer et de mettre en œuvre un « PNRU II » dans ces quartiers.
Selon les universitaires, à l’intérieur des quartiers, « les premiers résultats observés en France tendent à montrer [que la rénovation urbaine] favorise la constitution d’“ isolats ” de mixité dans un environnement largement inchangé, au prix d’une accentuation de la ségrégation au sein même des ZUS ». Ils pensent pouvoir déduire de certaines études que « les effets de cette mixité résidentielle spatialement très ciblée vont à l’encontre de l’objectif de renforcement de la cohésion sociale par la mixité », du fait notamment de l’absence de réflexion en amont quant aux modalités pratiques d’organisation de la coexistence de « groupes hétérogènes ».
Pour vos rapporteurs, constater que la mixité sociale est absente ou qu’elle est limitée n’est pas de nature à les surprendre puisqu’il s’agissait d’un objectif poursuivi de façon très inégale selon les porteurs de projet. D’ailleurs, les difficultés sociétales ou de coexistence de groupes, « produites » par les efforts de mixité sociale, si elles s’avéraient scientifiquement établies et étaient dûment constatées, conforteraient d’une certaine façon le choix de certains acteurs de la rénovation urbaine de ne pas en faire un objectif et de cibler le PRU essentiellement sur la rénovation de l’habitat et la restructuration du quartier.
Ÿ Le cas de l’école
Cela étant, vos rapporteurs sont sensibles aux propos des universitaires quant à la question de l’école, clairement sous-estimée dans le PNRU et qui subit sans doute, dans certains cas, une « ghettoïsation » plus poussée encore que les quartiers dans lesquels les établissements scolaires sont localisés (287). Selon eux, en considérant certaines études, « les éléments d’évaluation existant sur les effets scolaires de la rénovation urbaine laissent à penser que ces effets sont quasi nuls sur la mixité des publics scolaires, laquelle est pourtant l’un des rares champs de la vie sociale où l’effet d’entraînement de la mixité est démontré ». Ils constatent que « sauf exception, les écoles – et moins encore les collèges ou les lycées sur lesquels l’impact de la rénovation urbaine est encore plus marginal– sont très peu prises en compte dans les PRU comme des éléments centraux d’une stratégie de mixité ».
Ils concluent sur ce point que « la quasi-suppression de la carte scolaire prend la rénovation urbaine à contre-pied. Plus gênant, il semble que des élus s’accommodent de la libéralisation de la carte scolaire, des inscriptions dans le privé ou de la création d’écoles séparées pour les nouveaux habitants pour “ sauver ” leurs objectifs de mixité résidentielle. »
c) Malgré certaines difficultés, les habitants des quartiers en rénovation urbaine apparaissent satisfaits de l’action menée
Ÿ Quelle offre nouvelle de logements ?
S’agissant du relogement des familles concernées par les démolitions, le cas échéant à l’extérieur du quartier concerné par la rénovation urbaine, les universitaires considèrent que « ses effets paraissent très limités à cet égard ». S’appuyant sur une étude du comité d’évaluation et de suivi de l’Anru (CES de l’Anru), ils constatent que « cette situation correspond aux souhaits majoritaires des ménages relogés qui, dans beaucoup de cas aspirent à être relogés soit dans le même quartier, soit à proximité dans la même commune ». Ce constat, qui corrobore les observations de vos rapporteurs, a d’ailleurs sans doute conduit de nombreux porteurs de projet à envisager la rénovation urbaine avant tout comme une « prestation » en faveur des habitants des quartiers ayant vocation à demeurer sur place, et non comme un moyen de modifier la population des quartiers.
Les universitaires soulignent aussi que « la démolition précède souvent la reconstruction dans les opérations de rénovation urbaine », entraînant des difficultés frictionnelles lourdes en matière de capacité de logement et de relogement, notamment sur les marchés déjà tendus comme celui de l’Île-de-France. Ce constat est largement corroboré par l’ONZUS dans son rapport 2009, s’appuyant sur l’enquête Anru sur les réalisations du PNRU.
Au 31 décembre 2008, 52 262 démolitions de logement avaient été réalisées dans les quartiers Anru, contre 18 756 livraisons de logement (auxquels il faut ajouter 9 712 logements au titre de la diversification de l’habitat) (288). Analysant notamment une étude du CES de l’Anru, les universitaires, précisent qu’« il n’est […] pas exceptionnel de trouver des projets de rénovation urbaine où l’offre reconstituée est inférieure à l’offre démolie, au prétexte d’une demande de logement social faible. En revanche, rares sont les projets dans lesquels la règle du “ 1 pour 1 ” est dépassée, même dans des zones où le nombre de logements sociaux est notoirement insuffisant ». Il ressort de la programmation globale du PNRU, comme vos rapporteurs l’ont précisé supra, que cette règle sera appliquée globalement à hauteur de 95 %.
Un autre élément fondamental aux yeux de vos rapporteurs est analysé par les universitaires, qui soulignent « que les logements reconstitués ne le sont pas dans les mêmes typologies de taille et de prix ». Ainsi, analysant une étude du CES de l’Anru, ils précisent que « l’ampleur de la réduction de la typologie des logements sociaux est telle que c’est le relogement des grandes familles aux revenus modestes qui pose désormais problème ». Le risque serait alors qu’« avec les démolitions, le quartier ne [puisse] plus remplir sa fonction d’accueil de nouvelles populations, qui se reportent sur d’autres quartiers et, de plus en plus, dans des quartiers composés de logements privés dégradés », étant entendu que ces populations sont souvent composées de ménages à bas revenus ou immigrés.
S’agissant du coût des nouveaux logements, les universitaires synthétisent ainsi les résultats de deux études : « alors même que la révision du règlement général de l’Anru de janvier 2007 a posé la règle du “ reste à charge constant ”, déménager se traduit pour la moitié des ménages relogés par une hausse de loyer, même si les dispositifs d’aide mis en place par de nombreuses collectivités pour atténuer le différentiel font qu’un tiers “ seulement ” voit leur taux d’effort augmenter sensiblement ». Le rapport réalisé par le bureau d’étude sur l’évaluation des Cucs précise que les actions des collectivités territoriales en matière de stabilisation des taux d’effort des locataires ont été appuyées dans le cadre des Cucs, afin que les hausses de loyer et les baisses de charges (souvent constatées elles aussi) se neutralisent effectivement : « des effets positifs sont constatés dans l’accès au logement et la réduction des charges sur les sites, relativement nombreux, qui ont mis en place via le Cucs des services d’accompagnement social et juridique sur ces deux sujets ». Il conviendrait en tout état de cause que l’Anru puisse dresser un état précis en la matière, afin de déterminer les moyens permettant de faire appliquer uniformément son règlement général.
Ÿ La satisfaction des habitants
S’agissant de la satisfaction des habitants, les universitaires, s’appuyant sur certaines études, considèrent que « si les ménages relogés dans des programmes neufs expriment fréquemment leur satisfaction, le fait que le PNRU n’améliore pas de façon décisive la vie des habitants, ni n’assure leur promotion socio-économique, au-delà du changement de logement, est un fait généralement admis ». Au-delà de l’indétermination de ce qui pourrait être « décisif », il est naturel qu’un programme de rénovation urbaine ne puisse à lui seul « changer la vie » des ménages. C’est d’ailleurs le sens des propos de vos rapporteurs sur la priorité qu’il convient désormais de donner à l’accompagnement social de la rénovation urbaine, le cas échéant sous la forme d’une contractualisation nouvelle au titre de la politique de la ville qui pourrait englober la ou les conventions de rénovation urbaine. Les universitaires ont bien entendu relevé ce point, qui est d’ailleurs, comme cela a été souligné par vos rapporteurs supra, largement partagé par les équipes dirigeantes de l’Anru : « l’investissement physique a peu ou pas d’effets sur l’intégration sociale des habitants s’il ne s’accompagne pas d’un investissement équivalent dans ce que l’Anru appelle “ l’humain ” et qui incombe, en principe à l’Acsé. »
Il est patent que les habitants sont en règle générale satisfaits du point de vue des objectifs relatifs à la restructuration des quartiers et à l’amélioration de l’habitat. Ces objectifs, qui furent dès le lancement du PNRU les plus clairement établis et affichés, sont globalement atteints et il n’est pas difficile de le constater. Le bureau d’étude se fait l’écho de ce point : « le PRU est […] largement mis en avant comme ayant eu des impacts très importants, […] sur le cadre de vie et l’image des quartiers ». Il existe d’ailleurs en la matière un groupe « témoin » que de nombreux élus locaux connaissent : beaucoup d’habitants des quartiers sensibles qui ne sont pas concernés par le PNRU sont clairement mécontents de leur sort, ce qui d’ailleurs constitue l’une des raisons légitime d’entreprendre un PNRU II à l’issue du premier.
Les universitaires abordent un autre sujet de réflexion, celui de la participation des habitants, en constatant que « les projets sont décidés par les seules institutions, au nom de l’intérêt général ». Vos rapporteurs relèvent que les « institutions » ne sont pas sans lien avec les habitants, le suffrage universel n’étant pas une forme de participation qu’il serait légitime de galvauder ; ce n’est pas le plus mauvais des systèmes pour tenter de définir l’intérêt général dans un cadre participatif. Ceci étant dit, il existe sans doute en France une tendance particulière à assimiler les souhaits et les choix des élus à ceux de leurs administrés. Il est incontestable que la rénovation urbaine, aussi satisfaisante soit-elle pour les habitants, a été mise en œuvre dans le cadre d’un dialogue assez exclusif entre un État fort et des élus locaux légitimés parce que directement sollicités pour élaborer leur projet.
d) Quels visages pour les quartiers rénovés ?
Ÿ Évolution de l’urbanisme et des configurations urbaines
Les observations des universitaires corroborent largement les observations de vos rapporteurs lors de leurs déplacements : « à en juger par les choix urbanistiques qui président aux projets d’aménagement, la rupture avec l’urbanisme uniforme des grands ensembles paraît consommée. La diversification morphologique de l’habitat est un objectif partagé par la plupart des projets de rénovation urbaine. Elle se concrétise par des programmes de logements résidentialisés et segmentés par petites unités qui dépassent rarement 50 logements et cinq étages ». Le choix de limiter la place des grands ensembles correspond d’ailleurs à la demande des ménages, tel qu’il ressort d’études analysées par les universitaires : « la demande des ménages se porterait majoritairement sur des logements individuels. »
S’agissant des structures des quartiers rénovés, les universitaires résument ainsi une étude du CES de l’Anru : celui-ci « considère que l’action sur le foncier est la dimension la mieux aboutie du processus de banalisation urbaine, grâce à la clarification de la domanialité qui autorise les mutations futures des quartiers. Le plan d’alignement, la reconfiguration des réseaux engendrée par la construction de nouvelles voiries et la résidentialisation des logements permettraient une plus grande réversibilité des constructions, en donnant la possibilité de densifier au fil du temps les parcelles construites, et de construire de nouveaux bâtiments sur des réserves foncières. La constitution de réserves foncières participerait aussi de leur mutabilité en permettant d’attirer, à terme, des promoteurs, des entreprises et des commerces ».
Ÿ De nouveaux équipements commerciaux, culturels, sportifs et de transport ?
Cependant, ce constat est partiellement relativisé par les universitaires s’agissant du commerce et de l’activité économique : « la principale faiblesse du processus de diversification fonctionnelle concerne en fait l’action sur les commerces et, plus encore, sur le développement d’activités économiques au sens large. Près de la moitié des conventions de rénovation urbaine ne traitent pas des commerces, lesquels sont pourtant considérés comme un enjeu crucial tant par les habitants que par les acteurs locaux ». Ils ajoutent que « beaucoup d’acteurs locaux pensent en fait que le quartier n’est pas la meilleure échelle pour traiter les enjeux économiques, lesquels doivent l’être au niveau intercommunal ».
Sur ce sujet, vos rapporteurs considèrent qu’il faut distinguer le commerce de proximité et l’activité économique. Un effort renouvelé doit être mis en œuvre pour assurer partout un ensemble complet de petits commerces attractifs ; le rapport 2009 de l’ONZUS énumère un certain nombre de commerces dits « incontournables » : le bureau de poste, le café-bar-PMU, la tabac-presse-loto, le salon de coiffure, la boulangerie-pâtisserie et la pharmacie. Il convient sans doute d’y ajouter une petite ou moyenne surface alimentaire. Vos rapporteurs témoignent du soin apporté à ce thème par les praticiens de la politique de la ville aux Pays-Bas, qui proposent des conseils aux commerçants afin que leur offre soit susceptible de répondre à l’ensemble de la demande existante.
S’agissant de l’activité économique, la mission André-Hamel considère effectivement que ces questions ne relèvent pas du niveau du quartier et qu’en conséquence, le dispositif ZFU doit être repensé dans un cadre contractuel au moins au niveau communal. Il reste un an jusqu’à la fin de l’année 2011 pour mûrir cette réflexion, compte tenu de l’acquis partiellement insatisfaisant mais néanmoins réel du dispositif des ZFU pour les quartiers concernés.
En ce qui concerne plus généralement équipements des quartiers, les universitaires, sur la base de diverses études, considèrent que « la plus-value de la rénovation urbaine réside […] au moins autant dans l’amélioration des conditions d’accueil et la mise aux normes des bâtiments existants que dans l’adjonction de nouvelles fonctions aux quartiers. Il faut ajouter que la capacité à mobiliser ultérieurement les financements nécessaires pour faire vivre ces équipements se pose de façon aigue dans des villes démunies qui concentrent une population très défavorisée ». Les PRU devraient pourtant être l’occasion d’un rattrapage des écarts défavorables en matière de taux d’équipement des ZUS. Le rapport 2009 de l’ONZUS souligne en effet la sous dotation globale des ZUS par rapport aux unités urbaines les environnant pour les équipements de services de proximité, les équipements de commerce et les équipements sanitaires et sociaux (289). Le même rapport observe néanmoins un léger rattrapage en faveur des ZUS entre 2006 et 2008.
Vos rapporteurs ont pu constater lors de leurs déplacements que les porteurs de projet de la rénovation urbaine se sont effectivement attachés à traiter des équipements existants et que, dans certains cas, celle-ci a permis la construction d’équipements culturels neufs à vocation à tout le moins communale (Orléans la Source, Bron). La question des coûts de fonctionnement des équipements neufs est réelle, pour des communes souvent défavorisées en termes de ressources ; elle constitue un encouragement à trouver rapidement les modalités d’une péréquation efficace à la hauteur des inégalités de ressources et de charges entre communes.
S’agissant du désenclavement de certains quartiers concernés par la rénovation urbaine, les universitaires relèvent, en s’appuyant notamment sur une étude, que « les initiatives en faveur du désenclavement sont généralement menées en parallèle des PRU, selon une temporalité qui dépasse la durée des conventions. Le rythme de révision d’un plan de déplacement urbain (PDU), de réalisation d’un plan local de déplacement en Île-de-France ou la construction de lignes de transport commun en site propre ne sont d’ailleurs pas compatibles avec le temps d’émergence des PRU ». Deux sites visités par vos rapporteurs présentent la particularité d’avoir pu bénéficier d’un programme de tramway en même temps que la mise en œuvre du PRU (Orléans la Source, Vénissieux les Minguettes). Il est crucial et urgent que le PRU de Clichy-sous-Bois et Montfermeil soit valorisé à son tour par le projet de tram « T4 », dont le lancement effectif n’a que trop tardé alors qu’il constitue une condition sine qua non de l’évolution en profondeur du site.
Ÿ Entretenir et valoriser l’acquis de la rénovation urbaine
Les universitaires posent aussi la question du maintien des acquis qualitatifs de la rénovation urbaine : « les retards pris dans la “ gestion urbaine de proximité ” (GUP), qui vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants (par l’entretien des espaces publics, la gestion des espaces verts, l’éclairage public, l’enlèvement des ordures et des encombrants, la qualité de service rendu aux locataires par les bailleurs, l’animation et la vie du quartier…), est un autre sujet d’inquiétude. »
Le plan détaillé du futur accord-cadre entre l’Anru et l’Acsé, présenté supra par vos rapporteurs, prévoit une action plus complète et cohérente en la matière, y compris par la recherche d’une participation accrue des habitants. Le cabinet d’étude, même s’il relève la faiblesse du poids financier du volet habitat et cadre de vie dans les Cucs (surtout quand il y a un PRU en cours), signale néanmoins dans son rapport des éléments existants de synergie en la matière : « lorsque le Cucs n’a financé aucune ou très peu d’actions sur ce volet par volonté de développer cette thématique dans le cadre du volet social du PRU en priorité, on considère en général que les acteurs du Cucs ont largement contribué par leur expertise au développement des actions d’accompagnement de relogement et de GUSP (290) (la mobilisation des clauses d’insertion est davantage reliée au volet emploi). Sur les sites de petite ou moyenne taille, le chef de projet Cucs a parfois la charge du volet social du PRU par exemple. Sur les sites de plus grande taille, la personne en charge du volet social du PRU est généralement mobilisée prioritairement dans la réflexion concernant le volet habitat du Cucs. Ces pratiques sont significatives d’une bonne articulation, voire de synergies entre le Cucs et le PRU ».
Le cabinet d’étude précise néanmoins que ces cas de figure sont liés aux modalités et à la qualité de la gouvernance locale : ils sont moins fréquents quand les compétences habitat et politique de la ville sont exercées séparément par la ville et l’EPCI et quand, dans la commune, les services compétents sont différents et, a fortiori, cloisonnés. Le cabinet d’étude propose une autre explication à l’hétérogénéité des résultats, cette fois-ci du point de vue de la participation des habitants : « une explication des écarts, notamment entre quartiers, réside dans la différence de qualité et de densité des relais associatifs préexistants. Sur ce point, les quartiers historiquement au cœur de la politique de la ville ont bénéficié d’un accompagnement qui a progressivement permis l’émergence d’un tissu associatif professionnel et bénévole dense, qui constitue un avantage pour le développement d’une dynamique collective autour de la GUSP ».
Par ailleurs, selon les universitaires, la mise en garde concernant la GUSP vaut « pour la gestion des équipements créés ou réhabilités dans le cadre de la rénovation urbaine ». Ce point témoigne de ce que la rénovation urbaine ne saurait se limiter à une aide nécessaire au bâti et à la restructuration des quartiers. Une fois les travaux achevés, la politique de la ville consistera demain à vérifier que cet effort de solidarité nationale est entretenu et valorisé sur le long terme.
E.– LA SANTÉ : UNE PRÉSENCE FAIBLE DES PROFESSIONS MÉDICALES DANS LES ZUS ET UNE THÉMATIQUE ÉMERGENTE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA VILLE
1.– Une présence relativement faible des professions médicales dans les ZUS, partiellement rattrapée dans leur périmètre extérieur immédiat
a) Les données relatives aux médecins
Les rapports 2008 et 2009 de l’ONZUS ont étudié la démographie des professions de santé dans les ZUS au 1er janvier 2007. S’agissant des médecins, le rapport 2008 de l’ONZUS souligne que « la densité médicale serait […] deux fois moindre en ZUS que dans le reste du territoire ; elle serait même trois fois moindre que celle des unités urbaines qui abritent ces quartiers » (291). L’ONZUS ajoute que « ces disparités seraient moins importantes parmi les médecins généralistes dont la densité en ZUS s’élèverait respectivement à 53 % et 65 % de celle observée dans les unités urbaines qui les abritent et en France métropolitaine. En revanche, la densité des médecins spécialistes représenterait respectivement 26 % et 40 % de celle mesurée dans ces unités urbaines et sur le territoire national ».
La seule catégorie dont la démographie en ZUS est comparable à celle des unités urbaines qui les abritent (et supérieure à celle de l’ensemble du territoire métropolitain) est constituée des médecins exerçant dans les centres de santé.
Si on « inclut » dans les ZUS un périmètre supplémentaire de 150 mètres autour de leur délimitation, l’ensemble de la démographie des médecins est multiplié par deux. Ce constat est déjà significatif (35 % de démographie médicale supplémentaire) à 10 mètres autour des ZUS. Il concerne avant tout les spécialistes et, parmi eux, les moins présents dans les ZUS. Il est cependant atténué par le fait que le public naturel des médecins exerçant à proximité des ZUS est aussi composé d’habitants de quartiers qui ne sont pas situés en ZUS.
L’accroissement de la démographie médicale (pour les médecins) dans le périmètre immédiat des ZUS a en partie pour origine la présence d’un centre hospitalier à l’abord immédiat d’un petit nombre de ZUS. L’ONZUS constate aussi qu’un nombre significatif de médecins exerçant en cabinet sont installés en bordure de ZUS. Malgré ce « rattrapage par la périphérie », certaines spécialités demeurent sous-représentées dans les ZUS et autour d’elles ; il s’agit notamment des dermatologues-vénéréologues et des ophtalmologistes.
En conclusion, l’ONZUS considère que « si les résultats indiquent que les médecins sont, de façon générale, effectivement peu enclins à exercer sur ces territoires – ce qui est un résultat important, ils sont cependant assez nombreux à s’installer en bordure ou à proximité de ces quartiers (notamment le secteur hospitalier, les spécialistes), ce qui contribue à réduire les écarts d’accessibilité aux soins médicaux entre les ZUS et le reste du territoire » (292). Par ailleurs, la comparaison des données 2004 et 2007 semble montrer une légère progression du nombre des médecins exerçant en ZUS par rapport au territoire métropolitain, mais dans une proportion comprise dans la marge d’incertitude statistique propre aux fichiers étudiés.
b) Les données relatives aux autres professions médicales
Pour les professions médicales hors les médecins, les constats sont globalement les mêmes que pour les médecins. Le rapport 2009 de l’ONZUS précise que « les ZUS présentent dans leur ensemble des densités de professionnels de santé par habitant bien moindres que celles observées dans les unités urbaines les abritant ou sur le territoire national » (293). Si les pharmaciens sont un peu plus présents en ZUS que les autres professions médicales, l’ONZUS attribue ce constat à la réglementation nationale en vigueur pour l’implantation des officines, avec une officine pour environ 3 000 habitants. Les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers et les infirmiers psychiatriques sont en revanche présents en ZUS à hauteur de moins de 30 % de leur présence dans les unités urbaines contenant des ZUS.
Comme pour les médecins, « les effectifs de professionnels de santé en ZUS sont approximativement multipliés par deux lorsque l’on inclut les professionnels exerçant à moins de 150 mètres d’une ZUS » (294). Les mêmes réserves que pour les médecins sont formulées pour les professionnels de santé ici considérés : le « rattrapage par la périphérie » est en partie le fait de la présence de certains centres hospitaliers à proximité immédiate de certaines ZUS en petit nombre et il n’est total pour aucune des professions médicales. Il est par ailleurs atténué par le fait que les praticiens installés autour des ZUS ont pour patients et clients naturels des personnes qui ne résident pas en ZUS.
2.– Une problématique sous-estimée mais émergente ?
a) Des réponses très ténues aux problèmes de la démographie médicale
S’agissant de la démographie médicale, le débat public a souvent privilégié la problématique de l’accès aux soins dans les zones rurales. En tout état de cause, le principe de la liberté d’installation des médecins n’est pas substantiellement remis en cause par les dispositifs suivants, qui peuvent le cas échéant concerner un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins prévue par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, l’article L. 1434-8 du même code précise que doivent être déterminées « les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé ». Ces carences dans l’offre de soins peuvent, après une longue procédure, conduire à la signature d’un « contrat santé solidarité » entre l’agence régionale de santé et les praticiens, afin de définir leurs obligations d’activité dans les zones sous dotées ; ce dispositif est le cas échéant assorti d’une contribution forfaitaire annuelle pour « les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux ». Il semble cependant que le Gouvernement ait décidé de ne pas appliquer cette mesure, étant entendu qu’il aurait fallu, pour qu’il s’applique à une zone urbaine sensible, que le schéma régional la considère comme sous dotée.
L’article L. 632-6 du code de l’éducation prévoit qu’à compter de l’année universitaire 2009-2010, un arrêté interministériel fixe le nombre des étudiants en médecine, ayant passé avec succès le stade de la première année, susceptibles de signer avec l’État un contrat d’engagement de service public. Ce contrat ouvre droit à une rémunération supplémentaire pour l’étudiant, en contrepartie de son engagement à choisir, à la fin des études, son lieu d’exercice dans une zone dans laquelle le « schéma [régional d’organisation des soins] indique que l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de l’accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale […] et les zones urbaines sensibles […] ». Compte tenu de la durée des études médicales, ce dispositif novateur mettra cependant un certain temps à produire ses effets.
Dans le cadre de l’échantillon des Cucs ayant fait l’objet de ses travaux, le cabinet d’étude souligne que les contrats n’ont « pas permis de développer l’offre de soins dans les quartiers prioritaires ou à disposition des habitants des quartiers. Aucune évaluation [de Cucs] ne souligne de travail réalisé pour attirer du personnel de santé dans les quartiers. »
b) Les Cucs ont peu traité de la question de la santé publique
Le cabinet d’étude souligne que « la particularité du volet santé du Cucs réside dans le fait qu’il s’agit d’une thématique nouvelle et très peu investie jusqu’à récemment par les collectivités responsables de la mise en œuvre du contrat. […] Ainsi, le Cucs et les ateliers santé ville (ASV) (295)peinent à devenir le centre de définition d’une politique locale de santé. En conséquence, la majorité des Cucs de l’échantillon laisse davantage apparaître un ensemble d’actions relativement isolées, sans grande cohérence d’ensemble. Sur certains sites toutefois, une dynamique a été impulsée dans ce sens grâce au Cucs et aux ASV, mais trop récemment pour aboutir à une politique structurée et lisible. »
Le rapport de ce cabinet souligne que ce faible investissement des Cucs dans la question de la santé a pour origine le maintien d’un certain cloisonnement entre des associations investies sur les questions de santé publique et les acteurs institutionnels, cloisonnement « que la politique de la ville a vocation à dépasser ». Le cabinet considère que « schématiquement, à la lecture des évaluations [produites par les Cucs], on peut conclure que ce cloisonnement tend à se réduire sur les sites qui ont mis en place un ASV conjointement au volet santé du Cucs. L’ASV favorise dans ce cas le développement d’une culture commune entre ces acteurs [associatifs et institutionnels], fonctionnant comme une plateforme de coordination, de diagnostic partagé et de définition conjointe de priorités d’actions ».
Le développement des ASV est de fait assez récent. L’Acsé précise qu’au 31 décembre 2008, on comptait 237 ASV, dont 60 % avait été créés en 2007 ou en 2008. La création d’un volet relatif à la santé dans les Cucs a contribué à l’essaimage des ASV. Souvent dirigés par un coordonnateur et s’appuyant le cas échéant sur du personnel médical rémunéré sous forme de vacation, les ASV ont pour objet d’établir un diagnostic sur les problèmes de santé publique constatés sur un territoire (souvent plus grand que le quartier Cucs), puis de mobiliser les acteurs locaux de la santé et les institutions publiques dans le cadre d’actions relevant notamment de l’accès à l’information, de campagnes de prévention, de l’accès aux soins et aux droits. On note que les actions portant sur le maintien ou l’installation des professions de santé sont très minoritaires.
Selon l’Acsé, six thématiques ont été principalement abordées à travers les actions menées par les ASV en 2008 : la nutrition, les conduites addictives, la souffrance psychique et mentale, l’hygiène bucco-dentaire, le surpoids et l’obsésité, ainsi que les conduites à risque autres qu’addictives.
Les actions repérées par le bureau d’étude au titre du volet santé du Cucs ont permis, en matière d’accès aux soins, de « favoriser le repérage et l’orientation des personnes ayant besoin de soins ». En matière de prévention, c’est la question des addictions qui semble avoir donné lieu aux réalisations les plus nombreuses.
En 2009, l’Acsé a accordé 14,5 millions d’euros au titre des actions relatives à la santé, dont 6,5 millions d’euros au titre du financement des ASV. Comparés aux 406 millions d’euros consommés par l’Acsé, les crédits relatifs à la santé semblent ainsi très limités. Certains acteurs de la politique de la ville considèrent que cette thématique a été jusqu’à présent sous-estimée. La création des agences régionales de santé et le développement des ASV doivent permettre, avec des moyens suffisants, de porter un regard renouvelé sur la santé publique dans les quartiers urbains défavorisés, en définissant des axes pertinents de prévention et d’offre de soins.
F.– AMÉLIORER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
1.– Des résultats relatifs défavorables en ZUS, sans rattrapage notable par rapport au reste du territoire depuis 4 ans
a) Les résultats en ZUS demeurent insuffisants dans des proportions globalement inchangées depuis quatre ans et semblent même faire apparaître un « effet ZUS » négatif
L’annexe 1 à la loi du 1er août 2003 dispose qu’en matière de réussite scolaire, « l’objectif à atteindre d’ici à cinq ans est une augmentation significative de la réussite scolaire dans les établissements des réseaux d’éducation prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs résultats de ceux des autres établissements scolaires ». Les tableaux suivants synthétisent les résultats présentés dans le rapport 2009 de l’ONZUS (les résultats du baccalauréat 2005 sont issus du rapport 2006 de l’ONZUS).
PART DES ÉLÈVES EN RETARD DE DEUX ANS ET PLUS
EN CLASSE DE 6ème
(en %)
Année scolaire |
ZUS |
Hors ZUS |
Rapport ZUS/ |
2004-2005 |
5,8 |
2,9 |
2,0 |
2007-2008 |
3,7 |
1,7 |
2,18 |
Source : Rapport 2009 de l’ONZUS
PART DES ÉLÈVES EN RETARD DE DEUX ANS ET PLUS
EN CLASSE DE 3ème
(en %)
Année scolaire |
ZUS |
Hors ZUS |
Rapport ZUS/ |
2004-2005 |
9,3 |
5,0 |
1,86 |
2007-2008 |
7,4 |
4,2 |
1,76 |
Source : Rapport 2009 de l’ONZUS
TAUX DE RÉUSSITE AU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
DANS LES COLLÈGES
(en %)
Année scolaire |
ZUS |
Hors ZUS |
Rapport ZUS/ |
2004-2005 |
68,3 |
80,9 |
0,84 |
2007-2008 |
71,9 |
84,0 |
0,86 |
Source : Rapport 2009 de l’ONZUS
TAUX DE RÉUSSITE AU BACCALAURÉAT DANS LES LYCÉES
(en %)
ZUS |
France |
ZUS/France | ||
Bac L |
2004-2005 2007-2008 |
79,4 82,3 |
81,2 86,2 |
0,98 0,95 |
Bac S |
2004-2005 2007-2008 |
81,1 85,1 |
84,8 89,2 |
0,96 0,95 |
Bac ES |
2004-2005 2007-2008 |
79,5 82,1 |
84,2 86,8 |
0,94 0,95 |
Bac STI |
2004-2005 2007-2008 |
72,6 77,0 |
76,4 78,2 |
0,95 0,98 |
Bac STL |
2004-2005 2007-2008 |
77,7 82,7 |
83,2 85,8 |
0,93 0,96 |
Bac STG |
2004-2005 2007-2008 |
71,4 77,7 |
75,1 80,2 |
0,95 0,97 |
Bac service |
2004-2005 2007-2008 |
71,4 75,0 |
73,9 76,3 |
0,97 0,98 |
Bac production |
2004-2005 2007-2008 |
67,8 74,7 |
75,6 79,1 |
0,90 0,94 |
Source : Rapport 2009 de l’ONZUS
Si les résultats scolaires en quatre ans se sont améliorés, parfois dans des proportions significatives, dans les établissements scolaires situés en ZUS, le rapprochement avec ceux obtenus dans les autres établissements scolaires n’a globalement pas eu lieu. Certains résultats illustrent même un écart grandissant depuis quatre ans : il en est ainsi de la part des élèves en retard de deux ans ou plus en 6ème et des résultats au baccalauréat dans les deux filières générales L et S. On note en revanche un rattrapage partiel pour l’ensemble des baccalauréats dans les filières « ST » (sciences et technologies industrielles – STI, sciences et technologies de laboratoire – STL et sciences et technologies de la gestion – STG) et dans les filières professionnelles (production et service).
Le rapport 2009 de l’ONZUS propose par ailleurs une comparaison des résultats au baccalauréat, par filière, constatés dans les lycées implantés en ZUS et des résultats « attendus » pour ces mêmes lycées. Le taux attendu de réussite au bac, calculé depuis plusieurs années par le ministère de l’éducation nationale, est une « simulation de ce que serait le taux de réussite de chaque lycée si ses élèves connaissaient le même succès au baccalauréat que l’ensemble des candidats ayant les mêmes caractéristiques propres (âge, catégories sociales, sexe, niveau scolaire à l’entrée de seconde) dans des établissements ayant les mêmes caractéristiques (taux d’élèves en retard, taux d’élèves selon chaque catégorie professionnelle, taux de filles) » (296).
Les résultats obtenus sont plutôt défavorables aux lycées implantés en ZUS : dans toutes les filières hormis la série L, « plus de la moitié des lycées [en ZUS] ont un taux de réussite inférieur […] au taux de réussite des élèves ayant les mêmes âges et origines sociales dans des lycées aux caractéristiques comparables sur l’ensemble du territoire » (297). Toutes choses égales par ailleurs, la « valeur ajoutée » moyenne des lycées implantés en ZUS est plutôt négative, mais souvent dans de faibles proportions, hormis pour la filière professionnelle « production », pour laquelle le « décrochage » est prononcé. Enfin, les élèves d’un quart des lycées implantés en ZUS obtiennent des résultats meilleurs que les résultats « attendus » dans des proportions allant de 3 à 7 points de pourcentage.
Le rapport 2009 de l’ONZUS étudie plus particulièrement le retard des élèves en classe de 6ème, en considérant non pas l’implantation de leur collège mais leur lieu de résidence. Lors de la rentrée scolaire 2008, 29,3 % des élèves de 6ème résidant en ZUS avaient un retard scolaire d’au moins un an, contre 15,9 % des élèves résidant en France hors les quartiers Cucs et ZUS. Les critères sociodémographiques les plus corrélés au retard scolaire, dans l’ensemble du pays, sont la nationalité des élèves et la catégorie sociale des parents : 35 % des enfants étrangers avaient en 2008 un retard scolaire d’au moins un an en 6ème ; ce taux s’établissait à 29,9 % pour les enfants dont les parents relèvent de la catégorie sociale « très défavorisée ». C’est la surreprésentation de ces deux critères en ZUS qui explique très largement le ratio propre aux élèves de 6ème résidant en ZUS.
Le rapport 2009 de l’ONZUS constate aussi qu’« indépendamment de certains facteurs explicatifs du retard scolaire (nationalité, catégorie sociale), [et] à un degré moindre que la nationalité et la profession des parents, la résidence dans une zone urbaine sensible est positivement associée au risque de retard scolaire ». Cet effet « ZUS », déjà illustré par les résultats « attendus » pour les lycées des ZUS mais ici plus précisément cerné par une approche s’appuyant sur le lieu de résidence des élèves sans référence à leur établissement scolaire, est ainsi formulé : « […] parmi les élèves français dont les parents sont de classe moyenne, la probabilité d’être en retard scolaire pour un enfant résidant en ZUS est de 24 %, contre 19 % pour les autres jeunes ». Ce constat statistique significatif ne dit pas cependant quels sont ses déterminants réels mais laisse supposer une influence sur les résultats scolaires de l’environnement de vie des élèves, c’est-à-dire leur établissement scolaire et peut-être aussi leur lieu de résidence.
b) Les limites techniques d’une approche par les résultats scolaires
Le rapport 2009 de l’ONZUS présente (298), comme les années précédentes, un encadré présentant les indicateurs non renseignés et qui auraient pu être utiles à l’analyse de la situation des ZUS en termes de résultats scolaires. On note parmi eux les « indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en ZUS » et le « nombre d’enseignants pour cent élèves dans les écoles », qui permettraient effectivement à la fois de déterminer le degré réel de priorité accordé par l’éducation nationale aux établissements situés en ZUS, dans le cadre notamment de l’éducation prioritaire (sachant que tous les établissements situés en ZUS ne sont pas concernés par l’éducation prioritaire). Le rapport 2009 de l’ONZUS précise que manquent par ailleurs « des données relatives aux écoles primaires, indisponibles à l’échelon national en raison d’une grève administrative des directeurs et des directrices d’école ».
Il est pourtant crucial d’aller plus loin dans la connaissance des résultats scolaires des élèves résidant en ZUS et des éléments explicatifs de ces résultats. La réussite scolaire détermine bien entendu beaucoup d’autres éléments décisifs pour l’avenir des élèves, notamment la faculté de s’insérer avec succès sur le marché du travail. Dans ce contexte, le manque d’informations sur l’effort en moyens consentis en faveur des établissements scolaires des quartiers prioritaires doit être comblé. Sans ces informations, on ne peut juger du rapport entre les moyens et les résultats et toutes décisions nouvelles concernant ces moyens verraient leur efficacité et leur pertinence discutées, faute de référentiel suffisant sur l’existant.
La réussite d’un parcours scolaire est déterminée de façon non négligeable, voir de façon décisive, par le parcours à l’école primaire ; le manque d’informations à ce niveau est donc regrettable, pour les élèves bien entendu, mais aussi pour les enseignants qui ne peuvent pas faire valoir à quels niveaux de difficulté ils sont confrontés dès le début de la scolarité obligatoire.
Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer les études basées sur le géoréférencement des élèves et de poursuivre leur exploitation et leur interprétation. Les informations existantes montrent que toutes choses égales par ailleurs, un élève résidant en ZUS a des résultats scolaires inférieurs à un élève qui ne réside pas en ZUS. Dans un domaine aussi crucial que l’éducation, il est nécessaire de mieux cerner, quantifier et interpréter ce résultat. La politique de la ville n’est pas la même si elle répond à des difficultés sociales et économiques analogues à celles observées par ailleurs mais plus concentrées dans certains espaces urbains ; ou si elle doit affronter non seulement des difficultés en grand nombre mais aussi un phénomène « endogène » d’aggravation des problèmes du fait même de cette concentration.
2.– Une appréciation qualitative plus nuancée : peut-on parler d’un succès du PRE ?
Le programme de réussite éducative (PRE), qui a été présenté supra par vos rapporteurs, est le principal dispositif relatif à l’éducation des élèves mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville. Selon l’Acsé, les crédits nationaux consacrés aux PRE se sont élevés en 2009 à 78 millions d’euros, soit 75 % des crédits consommés par l’Acsé au titre de l’éducation.
Selon le rapport des universitaires, le rapport au Parlement prévu par l’article 141 de la loi de finances pour 2008 sur le bilan de la mise en œuvre du dispositif de réussite éducative, déposé en juillet 2008 et actualisé en septembre 2009, « n’apporte pas […] d’informations précises sur les sur les résultats de la réussite éducative ». Il présente des « résultats » assez positifs, tirés notamment d’une enquête portant sur les témoignages d’enseignants exerçant dans le cadre d’environ 20 PRE : plus des trois quarts d’entre eux auraient indiqué une amélioration des résultats scolaires (299).
Ces enseignements sont pour le moins nuancés par le rapport 2009 de l’Acsé sur le programme de réussite éducative (300), qui s’appuie notamment sur une étude qu’elle a financée, portant sur 30 PRE (parmi les 531 PRE existant en 2008). Pour un peu plus de la moitié des PRE de l’échantillon, les résultats obtenus au terme des parcours proposés sont satisfaisants pour la quasi-totalité des bénéficiaires, au regard des objectifs initiaux. S’agissant des domaines pour lesquels les parcours proposés dans le cadre de ces 30 PRE ont permis des résultats conformes aux objectifs, la quasi-totalité des équipes des PRE cite « l’ouverture, le développement culturel, sportif », les trois quarts mentionnent « l’amélioration du comportement de l’enfant » et une petite majorité évoque « l’accès aux soins ». Le nombre des sites mentionnant « un meilleur dialogue entre les parents et les enfants » et la « réussite scolaire » est légèrement minoritaire.
Par ailleurs, la « réussite scolaire » est considérée par plus d’une équipe de PRE sur trois comme étant un domaine dans lequel ce dispositif ne permet pas d’obtenir des résultats conformes aux objectifs. Pour cette question portant sur les « échecs » des PRE, aucun autre domaine n’est plus cité que la réussite scolaire. L’Acsé en conclut que « ce constat démontre l’intérêt à ce que les résultats scolaires fassent partie de la culture commune [des] professionnels » mettant en œuvre le PRE, ce qui sous-entend que la réussite scolaire n’a pas constitué un objectif partagé par toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des PRE, certaines d’entre elles ayant sans doute privilégié une approche très large de l’« éducatif », entendu avant tout comme relatif au « social » et au « sanitaire ».
En tout état de cause, quoique intéressant, ces éléments ne constituent pas une approche, même qualitative, de l’efficience ou des impacts des PRE ; même si l’amélioration des résultats scolaires n’est pas l’unique objectif d’un programme éducatif au sens large, il est effectivement incontournable de mesurer l’apport du dispositif en la matière. L’Acsé indique qu’« un travail a été d’ores et déjà engagé, avec les réseaux de professionnels concernés, afin de créer un référentiel national d’évaluation commun à l’ensemble des PRE, avant la fin 2009, et ainsi mieux connaître notamment les impacts sur les résultats scolaires » (301).
Le bureau d’étude missionné dans le cadre de la présente étude a relevé aussi le manque d’éléments quantitatifs permettant de cerner les actions mises en œuvre dans le cadre des Cucs et relevant de l’éducation (dont les PRE mais pas uniquement) : « aucun site ne propose d’indicateur quantitatif […] peu d’entre eux font état dans les évaluations de l’évolution des résultats scolaires, et encore moins à l’échelle des quartiers Cucs […] ».
Le même bureau d’étude précise qu’« en l’absence de mesure des résultats sur la situation des enfants et adolescents accompagnés, qui nécessiterait un suivi à long terme malaisé à mettre en place au niveau local, les résultats sont plutôt conçus en termes de réponse à la demande dans une logique de couverture des territoires et des publics. Sur ce plan, le PRE notamment, ainsi que le Cucs via les structures de proximité telles que les centres sociaux ou grandes associations professionnelles, ont contribué à toucher un public de plus en plus nombreux dans les quartiers prioritaires […] et ainsi à approfondir la connaissance des publics et des problématiques sociales pouvant constituer un frein à la réussite éducative des enfants et adolescents ». Pour les actions relatives aux actions socio-éducatives et à la parentalité, le cabinet d’étude ne peut aller plus loin que l’énumération des thèmes des actions mises en œuvre, les maîtres d’œuvre semblant considérer que leur impact est positif, mais sans autre précision.
Cette impression que les PRE « résistent » à la connaissance de leurs impacts réels et même à une description des actions mises en œuvre en leur nom rencontre un écho dans une étude de 2006 citée dans le rapport des universitaires : « […], on est frappé (...) de voir que rien n’est dit nulle part sur le contenu des actions, leur orientation, leur pertinence au regard de la "fragilité" identifiée, du type de prise en charge et du suivi. Tout au plus, on mentionne : "accompagnement scolaire", "appui à la parentalité", autrement dit des noms génériques d’actions, parfois expérimentées de longue date. Or, on sait très bien que sous ces appellations coexistent des pratiques extrêmement différentes, qui sont loin d’être toutes aussi fécondes (...). Nulle part on ne se demande finement ce qu’il faut pour qu’un enfant "fragilisé" s’en sorte, quelles en sont les conditions en termes d’accompagnement, d’appui, de cadrage, etc. (...) On fait comme si le problème était celui de l’identification, du repérage, du diagnostic, et de la coopération inter-institutionnelle pour le diagnostic et la mise sur pied du suivi individualisé. Mais que fait-on au juste et exactement avec le jeune, en quoi ce qu’on lui propose est-il susceptible de l’aider, on ne le sait guère ». Les universitaires considèrent que cette connaissance lacunaire a peut-être progressé localement mais estiment que « les questions essentielles posées […] en 2006 quant au contenu et aux effets du processus d’individualisation, restent pour l’heure sans réponse bien assurée »
Le bureau d’étude apporte une précision supplémentaire quant à l’organisation nationale des PRE : « du point de vue de la couverture du territoire, […] certains sites constatent que certains quartiers sont mieux dotés que d’autres, soulevant ainsi un enjeu d’équilibre territorial, difficile à maitriser lorsque les actions ne sont pas pérennisées ». Ce constat fait écho, s’agissant du PRE, à certaines observations faites par l’Acsé concernant l’objectif d’une meilleure répartition des financements nationaux : « mis en place selon la logique des appels à projets, le financement par l’État des projets locaux a été dès l’origine variable et les disparités se sont accrues au fil des années. Dans l’ensemble, les PRE validés en 2005/2006 sont mieux dotés que les suivants. L’ambition et l’amplitude des actions locales s’en ressentent et l’adaptation des budgets aux nouvelles donnes (mesures de l’Éducation nationale, renforcement de l’individualisation…) n’ont pas compensé ces disparités. » (302)
Le bureau d’étude conclut pour sa part de façon optimiste sur le PRE et, plus largement, sur le volet éducatif des Cucs, même si, ce faisant, en évoquant des progrès à réaliser concernant la mesure des impacts, il souligne les faiblesses actuelles en la matière : « le volet éducatif du Cucs, à forte effectivité, a indéniablement, de l’avis de nombreux acteurs, produit des résultats positifs, et il est à gager qu’une évaluation apte à suivre des cohortes de bénéficiaires observerait demain des impacts positifs ». Vos rapporteurs ne peuvent qu’encourager une telle démarche qui permettra une approche plus fine des résultats sur une population donnée suivie dans le temps.
G.– SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
1.– Une situation contrastée dans les ZUS pour le nombre des crimes et délits constatés
Le tableau suivant retrace l’évolution en 2007-2008 des faits constatés au titre de l’état 4001 dans les ZUS relevant de la police nationale et dans les circonscriptions de sécurité publique qui les abritent.
ÉVOLUTIONS COMPARÉES DU NOMBRE DE FAITS PORTÉS DANS L’ÉTAT 4001
DANS LES ZUS RELEVANT DE LA POLICE NATIONALE
ET DANS LEURS CIRCONSCRIPTIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (CSP)
(Nombre de faits pour 1 000 hab.)
ZUS |
CSP |
ZUS/CSP | ||||||
2008 |
2007 |
Évolution 2007-2008 en % |
2008 |
2007 |
Évolution 2007-2008 en % |
2008 |
2007 | |
Atteintes aux biens |
43,43 |
46,46 |
- 6,5 |
50,65 |
53,94 |
- 6,1 |
0,86 |
0,86 |
Atteintes aux personnes |
12,21 |
12,43 |
- 1,7 |
11,38 |
11,38 |
0,0 |
1,07 |
1,09 |
Total 34 index |
52,52 |
55,50 |
- 5,4 |
58,89 |
61,99 |
- 5,0 |
0,89 |
0,90 |
Source : Rapport 2009 de l’ONZUS
Plusieurs précisions méthodologiques doivent être apportées :
– les chiffres collectés sont valables pour 672 ZUS de France métropolitaine et des DOM, représentant 94 % de la population des ZUS. Ils excluent cependant les ZUS de Paris intra muros, sous l’autorité de la préfecture de police de Paris, pour lesquelles les méthodes de recueil des faits constatés ne sont pas compatibles avec celles de la police nationale hors Paris (303). Ils excluent aussi les 70 ZUS situées dans les zones de compétence de la gendarmerie nationale, pour lesquelles les données ne sont disponibles qu’à l’échelle des communes ;
– le « total » est toujours inférieur à la somme des atteintes aux biens et aux personnes, car certains délits relèvent des deux catégories : il s’agit des violences physiques crapuleuses qui regroupent les vols violents avec ou sans arme ;
– les évolutions par rapport à 2007 et aux années antérieures sont difficiles à établir et à analyser car 28 index de l’état 4001 étaient renseignés pour ces années, contre 34 à compter de 2008 ;
– l’état 4001 inclut l’ensemble des crimes et délits portés pour la première fois à la connaissance des services de police et des unités de gendarmerie et consignés dans une procédure transmise à l’autorité judiciaire. En sont donc exclues les infractions douanières, fiscales, relatives au droit du travail ou au droit de la concurrence, ainsi que les contraventions et délits routiers ;
– c’est le lieu d’enregistrement de la plainte qui détermine son rattachement ou non, en l’espèce, à une ZUS. Ce lieu peut être le cas échéant différent du lieu de commission de l’infraction, ne serait-ce que par la géographie propre aux lieux où le dépôt des plaintes est possible ;
– l’état 4001 est sujet à des questions complexes quant à sa signification. Une augmentation de l’activité des services de police peut conduire tout aussi bien à un relèvement (par une meilleure couverture des délits commis) ou à une baisse (par l’efficacité de la présence policière) du nombre des faits recueillis. Par ailleurs, le dépôt des plaintes dépend d’une décision des victimes, qui peut être influencée par divers éléments, dont certains peuvent être liés au lieu de résidence (proximité d’un lieu de dépôt de plainte, pression de proximité exercée par les délinquants…).
Sous ces réserves, certains enseignements peuvent néanmoins être tirés des statistiques issues de l’état 4001 et publiées dans le rapport de l’ONZUS :
– pour les atteintes aux biens, moins nombreuses en ZUS que dans leurs circonscriptions de sécurité publique du fait notamment d’un moins grand nombre de vols, certaines catégories de délits sont surreprésentées en ZUS : il s’agit des incendies volontaires de biens privés et des autres destructions et dégradations de biens publics et privés ;
– pour les atteintes aux personnes, plus nombreuses en ZUS que dans leurs circonscriptions de sécurité publique, les catégories de délits surreprésentés en ZUS sont les violences physiques non crapuleuses, parmi lesquelles notamment tous les différents de voisinage tels que les rixes, les violences aux abords des établissements scolaires et dans les transports, les violences au sein de la cellule familiale…
Sans prétendre à une description scientifique des ZUS du point de vue des crimes et délits, ces éléments semblent attester d’un environnement ou d’un contexte quotidien plus rude pour les habitants des ZUS, marqué par un plus grand nombre de destructions de biens et une violence plus aigue dans les rapports entre personnes.
Ces éléments doivent par ailleurs être appréciés à l’aune de situations très contrastées suivant les ZUS. Pour les 34 index utilisés par l’ONZUS, si la moyenne s’établit en ZUS à 52,5 faits pour 1 000 habitants, elle s’élève à moins de 17 faits pour 1 000 habitants dans les 10 % des ZUS les moins touchées et à au moins 80 faits pour 1 000 habitants dans les 10 % des ZUS les plus concernées.
L’annexe 1 à la loi du 1er août 2003 a fixé comme objectif « de réduire le niveau de délinquance et d’améliorer la tranquillité et la sécurité publiques en ZUS afin de rétablir le sentiment de sécurité et la qualité de vie dans les quartiers en ZUS ». Du point quantitatif, l’évolution statistique sur la base de l’état 4001 montre une baisse des faits constatés en ZUS depuis quelques années, plus accentuée que dans leurs circonscriptions de sécurité publique. Le tableau suivant retrace ces évolutions.
ÉVOLUTIONS ANNUELLES DES FAITS PORTÉS DANS L’ÉTAT 4001
(en %)
Atteintes aux biens |
Atteintes |
Total | ||||
ZUS |
CSP |
ZUS |
CSP |
ZUS |
CSP | |
2004-2005 |
nd |
nd |
nd |
nd |
+ 0,3 |
+1,1 |
2005-2006 |
- 1,9 |
- 3,7 |
+ 7,6 |
+ 6,3 |
- 0,6 |
- 2,4 |
2006-2007 |
- 10,0 |
- 7,7 |
- 5,4 |
- 0,7 |
- 8,5 |
- 6,3 |
2007-2008 |
- 6,5 |
- 6,1 |
- 1,7 |
0 |
- 5,4 |
- 5,0 |
L’évolution en ZUS a été plus défavorable que dans leurs circonscriptions de sécurité publique pour une seule des quatre comparaisons annuelles du tableau (la comparaison 2005-2006).
2.– Un sentiment plus fort d’insécurité dans les ZUS
Le rapport 2009 de l’ONZUS complète les informations issues de l’état 4001 par certains résultats de l’enquête « cadre de vie et sécurité », menée par l’INSEE afin de collecter « des informations […] auprès des ménages de France métropolitaine sur la qualité de leur cadre de vie (existence de nuisances, problèmes ressentis par les habitants, équipements du quartier) et sur les faits dont ils ont pu être victimes au cours des deux dernières années (cambriolages, autres vols, agressions et violences). Des questions sont également posées sur le sentiment d’insécurité éprouvé par les habitants à leur domicile ou dans leur quartier » (304).
Le tableau suivant synthétise certains résultats en ZUS et dans les quartiers autres que les ZUS des unités urbaines comprenant des ZUS en 2006 et 2009.
POURCENTAGE DE RÉPONSES POSITIVES À LA QUESTION « VOTRE QUARTIER EST-IL CONCERNÉ PAR LES PROBLÈMES SUIVANTS ? »
ZUS |
Autres quartiers des unités urbaines contenant des ZUS | ||
Mauvaise image du quartier |
janvier 2006 |
59 |
13 |
janvier 2009 |
56 |
12 | |
Délinquance |
janvier 2006 |
58 |
30 |
janvier 2009 |
54 |
26 |
Source : Rapport 2009 de l’ONZUS
Le problème de la délinquance est moins évoqué par les habitants des ZUS que celui de la mauvaise image de leur quartier ; mais les proportions d’habitants des ZUS qui les citent sont dans les deux cas supérieures à 50 %. Par ailleurs, l’enquête propose aux personnes ayant cité plus d’un problème caractérisant leur quartier de citer parmi ces problèmes celui qu’elles considèrent comme étant le principal. La délinquance est alors citée comme la première des difficultés pour 25 % des personnes interrogées en janvier 2009, contre 19 % pour la mauvaise image du quartier. Ces taux s’élevaient respectivement à 28 % et 18 % en janvier 2006.
De façon générale, on observe que la délinquance demeure une difficulté de la vie quotidienne beaucoup plus importante en ZUS qu’ailleurs selon les déclarations de leurs habitants, mais que durant la période 2006-2009, le sentiment d’insécurité ressenti par les personnes résidant en ZUS a baissé relativement nettement. Cette évolution va dans le même sens que celle du nombre des faits délictueux portés à l’état 4001, en baisse depuis quelques années de façon plus marquée en ZUS.
Demeure néanmoins sans réponse statistique définitive la question de savoir pourquoi les habitants des ZUS éprouvent un sentiment d’insécurité beaucoup plus fort qu’ailleurs, alors que moins de faits délictueux y sont enregistrés. Il est probable qu’il existe en ZUS une sous déclaration de ces faits, précisément en raison de la pression délinquante. Par ailleurs, comme le relève le cabinet d’étude la pratique délinquante « a tendance à se déplacer à l’extérieur du quartier, dans les centre-ville ou centres commerciaux par exemple », phénomène auquel la faiblesse des patrimoines des ménages résidant en ZUS n’est sans doute pas étrangère.
H.– LES IMPACTS TRANSVERSAUX DES ACTIONS MISES EN œUVRE DANS LE CADRE DES CUCS : DES RAISONS D’ESPÉRER ?
Le cabinet d’étude a tenté d’établir un relevé des impacts des actions mises en œuvre dans le cadre des Cucs et, plus largement, des actions de la politique de la ville. Au-delà des objectifs opérationnels et quantifiables de ces actions, d’autres objectifs stratégiques, plus globaux et structurants, ont-ils pu être atteints et la politique de la ville s’en trouve-t-elle ainsi légitimée ?
Le cabinet d’étude est prudent sur ces questions, car il souligne que l’élaboration des Cucs n’a pas donné lieu, dans la plupart des cas, à la définition de tels objectifs stratégiques ; les éléments recueillis en la matière relèvent ainsi de l’observation ou du ressenti, qui plus est sur la base d’un échantillon limité de 22 Cucs, même si leur choix s’est inscrit dans la recherche d’une typologie couvrant les différents cas possibles. Le cabinet d’étude considère néanmoins que « des impacts sont sensibles, perceptibles et perçus par les acteurs. […] ils ne peuvent être méconnus ». Le cabinet d’étude précise que « de manière générale, lorsque des améliorations sont perçues par les acteurs locaux et par les habitants, celles-ci correspondent à une amélioration de la cohésion et de la dynamique sociale dans les quartiers, plutôt qu’à une amélioration de la situation socio-économique des habitants. »
Selon le cabinet d’étude, « la très grande majorité des sites relève un effet particulièrement positif des actions menées dans le cadre du Cucs, mais aussi plus largement dans le cadre de la politique de la ville, sur le lien social […] ». Sans faire part de miracles en la matière, le cabinet d’étude relève que de nombreux sites observent une participation non négligeable des habitants aux actions financées dans le cadre des Cucs et, plus encore, autour du PRU. Toujours sur la thématique du lien social, certains sites « relèvent un impact favorable du Cucs et plus largement de la politique de la ville sur les relations des publics issus de l’immigration entre eux et avec les autres habitants de la ville et du quartier », même si le « renouveau du fait religieux » semble plutôt freiner le développement de cet impact. Les liens entre quartiers auraient par ailleurs été renforcés, notamment autour de la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine. Enfin, « les actions d’animation sociale de proximité permettent un accès pour des personnes relativement isolées socialement et/ou à faibles revenus à des activités collectives […]. »
Le cabinet d’étude note que « les évaluations et les acteurs consultés font observer un effet positif du Cucs et des actions de la politique de la ville sur le sentiment d’insécurité dans certains de leurs quartiers prioritaires », parfois même dans des sites où les chiffres de la délinquance sont en augmentation. Dans ce cadre, « les acteurs mettent en avant le rôle primordial du renforcement de la présence de proximité et notamment des médiateurs sociaux sur les quartiers ». Le cabinet d’étude observe par ailleurs que « le sentiment d’amélioration repose aussi en grande majorité sur l’aménagement des espaces extérieurs, espaces verts et de loisirs, travaux de voirie », modifications que le PRU a été en mesure d’aider à concevoir puis de mettre en œuvre.
En matière d’« image du quartier », le cabinet d’étude souligne que les actions mises en œuvre dans le cadre de la politique de la ville « ont permis une valorisation de l’identité du quartier et sa reconnaissance des habitants extérieurs ».
Les impacts concernant le lien social, le sentiment d’insécurité et l’image du quartier engendreraient par ailleurs un effet positif sur le sentiment d’appartenance au quartier et son appropriation par les habitants. Là aussi, le PRU constituerait un élément moteur contribuant à l’émergence de cet impact.
Certains sites croient pouvoir observer une modification des comportements individuels, dans deux directions : d’une part « le développement des liens sociaux au sein du quartier et l’implication croissante d’une partie des habitants dans la vie de leur quartier favorisent le respect des lieux et des personnes » ; d’autre part « les acteurs observent une évolution positive des publics entre le moment où ils intègrent une action et le moment où ils la quittent, en termes de comportement, d’autonomie, de confiance, de réussite. »
S’agissant de ce que le cabinet d’étude appelle « l’amélioration de la dynamique associative », des éléments positifs sont relevés concernant la consolidation des structures, l’émergence de nouveaux projets, la mise en œuvre de pratiques plus « proactives » à la rencontre des publics, une professionnalisation des intervenants et la rencontre entre acteurs associatifs dans le cadre des Cucs qui donne lieu à l’échange de leurs pratiques.
Enfin, le cabinet d’étude considère que peuvent être détectés des impacts en terme de renouvellement de la dynamique d’action publique. La présence renforcée des institutions publiques dans les quartiers prioritaires permettrait « une plus grande lisibilité des actions et une meilleure orientation des publics vers les structures de droit commun ». Par ailleurs, « les évaluations et acteurs consultés soulignent également un impact des actions du Cucs sur la restauration du lien de confiance entre les acteurs publics et les usagers ».
AUDITION DE Mme FADELA AMARA, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le Comité a procédé, le mardi 1er juin 2010, à l’audition de Mme Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville auprès du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
M. François Goulard, co-rapporteur. Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, nous a chargés, François Pupponi et moi-même, de rédiger un rapport sur les aides aux quartiers défavorisés. Depuis le mois de novembre, enchaînant auditions et déplacements sur le terrain, notamment aux Pays-Bas, nous tentons de passer au crible les politiques publiques mises en œuvre dans ce domaine. Nous disposons désormais d’un panorama assez large, qui dépasse la somme de nos expériences personnelles.
Notre tâche consiste à évaluer. Aussi, madame la secrétaire d’État, nous souhaiterions savoir quel était le jugement que vous portiez sur les politiques menées depuis trente ans dans ce domaine au moment de votre nomination au Gouvernement. Quelles conclusions avez-vous tirées du bilan de vos prédécesseurs, quels sont les échecs auxquels vous avez voulu remédier, quels succès avez-vous souhaité pérenniser ?
Mme Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville auprès du ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique. Je me considère comme le produit de la politique de la ville et je suis de ceux qui pensent qu’elle est primordiale pour les quartiers prioritaires et leurs habitants.
Pour ma génération, celle des « beurs », qui exigeaient de la République l’égalité de traitement, la décision prise par François Mitterrand de créer un ministère d’État à la ville fut un événement. Pour la première fois, on actait que les habitants des quartiers avaient été délaissés, même si, après les années passées en bidonville, ils disposaient désormais d’un logement HLM – et de la fameuse baignoire qui allait avec et qui représentait tant. Pour la première fois, on reconnaissait le malaise et on entendait le traiter. Pour la première fois, on sentait une volonté politique, celle d’accompagner vers plus d’égalité les habitants des quartiers en transformation. Les premières décisions furent considérables : ainsi, la création de la carte de séjour de dix ans, qui permettait à nos parents de rester sur le territoire de façon pérenne, les délivra de l’obligation de se rendre chaque année au commissariat, et donc des humiliations qu’ils y subissaient parfois.
Ces politiques, bon an mal an, ont permis de freiner le processus de décomposition sociale. Pour autant, elles n’ont pas entraîné une transformation sociale. Très vite, le sentiment s’est imposé que seul le « dur » - les mesures destinées au bâti – primait et que la politique sociale n’était pas suffisante pour mettre fin au mal-être persistant – Harlem Désir rappelait alors qu’il ne suffisait pas de repeindre les cages d’escalier.
L’économie parallèle s’est développée, les islamistes radicaux se sont installés, changeant parfois la perception locale de la République, de la laïcité et des droits des femmes. Le gouvernement Jospin n’a pas saisi l’opportunité de la reprise économique pour traiter le chômage structurel des quartiers, se contentant du dispositif emplois-jeunes. Qu’elles aient été de droite ou de gauche, les politiques menées n’ont pas permis de mettre fin à l’exclusion de certaines catégories de population de la sphère républicaine. La question de la discrimination a mis longtemps à venir sur le devant de la scène, malgré la lutte menée par les associations anti-racistes et un contexte européen favorable. Un arsenal législatif a commencé de se construire sous la législature de Lionel Jospin. Il a ensuite été renforcé sous la présidence de Jacques Chirac, en même temps qu’était créée la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).
Puis les émeutes ont éclaté. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que rien n’a été fait entre 1980 et 2005 ; mais malgré les politiques menées, malgré le travail d’écoute et d’accompagnement, le malaise et le mal-être ont persisté. Jamais la politique de la ville n’a été à la hauteur des besoins et des ambitions qu’on lui prêtait.
M. François Goulard. Sur le plan financier ?
Mme la secrétaire d’État. Cette absence de volonté politique se traduit dans les budgets attribués à la politique de la ville. Mais pas seulement. La politique de la ville n’a jamais été un chantier national. Et je refuse d’en comprendre les raisons.
Les populations qui ne votent pas – le droit de vote dans les élections locales demeure exclu pour les populations étrangères non ressortissantes de l’Union européenne – ont été concentrées dans les mêmes endroits et abandonnées. La République les a accompagnées, mais jamais autant que ce qu’elle aurait dû. Des familles d’origine française, dans le nord de la France par exemple, vivent une souffrance sociale et un processus de paupérisation identiques.
Pour moi, l’objectif de la politique de la ville est simple, c’est celui que visaient mes prédécesseurs et que poursuivent aujourd’hui les acteurs locaux : il s’agit de réduire les écarts territoriaux pour réduire les inégalités sociales.
Cela ne signifie pas que la politique de la ville doive se substituer aux politiques de droit commun. Elle doit, au contraire, venir en sus. Hélas, les rapports, notamment celui de la Cour des comptes, le montrent : la méthodologie est à revoir. Les mesures s’empilent et sont de moins en moins visibles ; les procédures se contredisent ou viennent combler les lacunes des politiques de droit commun.
En prenant mes fonctions, j’ai voulu dresser un état des lieux : j’ai consulté, rencontré les acteurs sociaux afin de me faire une idée et mesurer ce qui nous restait à faire dans le cadre de la dynamique « Espoir Banlieues ». J’ai été déçue de voir que la politique de la ville n’était pas prise au sérieux. Mais je suis une femme très optimiste ! Si nous n’avons pas peur de bousculer les choses, si nous ne craignons pas les crispations, je suis persuadée que nous pouvons parvenir à éradiquer le malaise des banlieues, pour peu que nous nous en donnions les moyens.
Ce que nous faisons est nécessaire et indispensable, mais n’est pas à la hauteur de ce que nous devons faire. Même si je suis attachée en tant que citoyenne à la maîtrise des déficits budgétaires, je refuse que, dans un contexte de crise, la politique de la ville devienne une variable d’ajustement.
Il nous faut conduire des réformes structurantes, telles que la géographie prioritaire et la péréquation, mais aussi mobiliser le droit commun, au-delà des axes prioritaires de l’emploi, de l’éducation et de la formation. À cet égard, j’aurais préféré que les expérimentations qu’a annoncées le Premier ministre, qui permettront de sacraliser le droit commun dans le contrat urbain de cohésion sociale (Cucs), débutent dès cette année.
Il faut aussi un portage politique de la politique de la ville. Celle-ci devrait faire l’objet d’un ministère à part entière, bénéficiant d’un budget conséquent, ou bien d’un secrétariat d’État rattaché soit à un ministère très cohérent, comme celui, actuellement, de Jean-Louis Borloo (305), soit au Premier ministre, qui dispose de l’autorité politique nécessaire pour conduire des mesures interministérielles.
Nous savons ce qu’il faut faire et comment il faut le faire. Mais nous nous heurtons à l’absence de volonté et à l’inertie de quelques-uns. Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Lorsque j’ai proposé de créer des délégués du préfet, j’espérais que les fonctionnaires, mis à disposition à 100 % de leur temps, seraient à pied d’œuvre dans les quatre mois. Je péchais par naïveté ! Il a d’abord été proposé que ceux-ci ne consacrent que 10 % de leur temps à ces tâches. Ensuite, « l’usine à gaz » a été telle qu’en décembre 2008, au lieu des 350 délégués prévus, nous n’en comptions que 10 ! Et pourtant, le dispositif s’est révélé efficace. Désormais, les habitants, les élus locaux et les responsables associatifs ont un interlocuteur face à eux, ce qui amenuise le sentiment d’exclusion.
D’aucuns pensent que la politique de la ville est du gaspillage, que tous ces milliards sont dépensés en pure perte. Je me réjouis au contraire qu’elle ait existé ces trente dernières années, tout en regrettant son manque d’ambition. Nous devons améliorer son efficacité et conduire des réformes pour la simplifier : c’est ce que nous avons fait dans le cadre de la dynamique « Espoir Banlieues » et de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Mais nous devons aussi la rendre plus visible, notamment lorsqu’il s’agit de son versant social. Il est plus facile aux caméras de montrer la démolition de tours et la reconstruction de logements sociaux que de détailler les subtilités de l’accompagnement social.
M. François Goulard. Précisément, quel jugement portez-vous sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ? Est-ce le bon moyen d’action, ou existe-t-il des lacunes ? Un deuxième programme national de rénovation urbaine (PNRU) est-il nécessaire ? Quid des quartiers imparfaitement traités ?
Mme la secrétaire d’État. Lorsque j’étais responsable associative, je me suis souvent plainte auprès de Jean-Louis Borloo de l’état des logements, délaissés et insalubres, et des conséquences sanitaires qui en résultaient, parfois catastrophiques chez les enfants. Nous avons été beaucoup à applaudir la grande loi de cohésion sociale de 2003 et la création de l’Anru.
Permettez-moi de rappeler quelques chiffres : 12 milliards d’euros d’engagements, avec pour résultat 42 milliards de travaux ; 46 000 logements démolis, 78 000 logements réhabilités et 48 000 logements « résidentialisés ». Il existe aussi des résultats difficiles à mesurer, mais tout aussi importants : ce sont les conséquences des réhabilitations sur les familles et les jeunes. Ces derniers se sont sentis davantage investis et sont devenus les acteurs de leur quartier ; ils se sont inscrits dans le projet et ont noué un nouveau lien, celui de l’appartenance à la nation.
Les conventions courent jusqu’en 2013 et les derniers travaux s’achèveront en 2017. Les investissements ont été renforcés grâce au plan de relance, avec 350 millions d’euros de dotations supplémentaires. Répondant aux critiques des élus locaux, qui se plaignaient d’un système kafkaïen, le directeur général de l’Anru, M. Pierre Sallenave, a considérablement amélioré le circuit financier. En travaillant sur l’efficacité et la pertinence, nous avons essayé de rendre le programme plus opérationnel.
Le 1 % logement prend en charge une grande partie du financement.
M. François Goulard. Voire la totalité !
Mme la secrétaire d’État. Je ne méconnais pas les critiques sur ce mode de financement. Je ne considère pas qu’il soit anormal que les salariés participent à la rénovation et à la réhabilitation de quartiers ayant subi autant de dégâts, alors même que leurs habitants s’acquittaient de leurs loyers et de leurs charges. Nous entrerons prochainement en négociation avec M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme, et les représentants du « 1 % logement » afin d’examiner la façon dont celui-ci peut poursuivre cette belle aventure.
Il faut terminer le travail, aller jusqu’au bout de ce chantier. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à un PNRU II. Pour les avoir vécues de près, je sais que les politiques qui se limitaient à repeindre les cages d’escalier et à remplacer les boîtes aux lettres en saupoudrant les moyens n’ont jamais empêché les dégradations. La République se doit de garantir l’égalité de traitement à l’ensemble des citoyens : c’est l’une des missions du PNRU. Elle doit se poursuivre ; j’espère que les arbitrages interviendront prochainement.
M. François Pupponi, co-rapporteur. Nous sommes arrivés au constat que les politiques menées depuis trente ans n’ont jamais été évaluées sérieusement : leurs résultats n’ont été vérifiés ni sur le plan local ni sur le plan national. Dans le cadre de la préparation des deux réformes fondamentales que sont celle de la péréquation et celle de la géographie prioritaire, vous avez fait des propositions au Premier ministre. Celles-ci s’appuient-elles sur des critères précis ? Sur quelles bases déciderez-vous de l’entrée d’un quartier dans le dispositif, de la sortie d’un autre ? Comptez-vous mettre en place des outils d’évaluation et de contrôle ?
Mme la secrétaire d’État. Rien n’est encore arbitré. Il est fondamental que la politique de la ville réponde exactement aux besoins de chacun des territoires concernés et de ses habitants. Je n’ai jamais cru aux vertus d’un plan Marshall et à aucun des plans « banlieue ». Il serait vain de décider à Paris de quatre mesures uniformes et de les décalquer, tant les territoires diffèrent les uns des autres. Jean-Louis Borloo l’a bien compris, puisqu’avec le PNRU, on part de la redynamisation d’un territoire pour concevoir des politiques publiques et un accompagnement de l’État adaptés.
Il convient de réunir autour de la table tous les acteurs d’un quartier, maire inclus. Le projet ne doit pas se construire isolément de la ville, même si la logique de « cohérence », du type des contrats de ville, par exemple, n’a pas démontré son efficacité. Pour mesurer l’impact des politiques, il faut partir du territoire.
M. François Pupponi. Précisément, procédez-vous à l’évaluation de ces politiques ?
Mme la secrétaire d’État. C’est bien le problème de la politique de la ville : les critères d’évaluation n’ont jamais été mis en place. Nous avons renforcé l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) dans ses prérogatives. Plus indépendant, il devrait pouvoir travailler, en liaison avec des équipes territoriales, à la mesure de l’impact des politiques. Dans le cadre de la RGPP, le poste de délégué territorial de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) a été supprimé. C’est désormais le préfet qui représente l’Acsé, en même temps que l’Anru.
M. François Goulard. Si nous ne disposons pas d’une vision objective de la situation des quartiers, sur quoi rebâtir une géographie prioritaire ?
La priorité n’est-elle pas de disposer d’une évaluation objective de chaque quartier pris en compte par la politique de la ville, indiquant les actions menées et celles restant à conduire, et susceptible de permettre la détermination des quartiers les plus en difficulté ?
Mme la secrétaire d’État. Quelle que soit l’obscurité des critères, certains des quartiers dits « ghettos » ne remplissent plus les conditions pour figurer en zone urbaine sensible (ZUS). Je le sais pour les avoir visités.
M. François Goulard. Des éléments objectifs permettraient-ils d’expliquer les raisons pour lesquelles un quartier cesserait d’être prioritaire ? Des tableaux de bord par quartier ont-ils été établis ?
Mme la secrétaire d’État. Non. Outre l’Insee, notre seule structure d’information sur les ZUS est l’Onzus.
M. François Pupponi. Des critères – réussite scolaire, taux de chômage, faiblesse des ressources de la collectivité, par exemple – ont-ils été définis pour déterminer les quartiers qui resteraient traités par la politique de la ville ? Des tableaux de bord ont-ils été établis pour vérifier les résultats de la politique conduite ? Je découvre que, là où des programmes de réussite éducative ont été institués, leur influence sur l’amélioration des résultats scolaires des jeunes n’a jamais été vérifiée. Pour moi, depuis trente ans, l’obstacle sur lequel bute la politique de la ville est l’absence de vérification de ses effets.
Mme la secrétaire d’État. Pour la révision de la géographie prioritaire, nous avons en effet établi de nouveaux critères, choisis à partir d’une concertation. L’avis du Conseil national des villes (CNV) a été demandé, ainsi que celui de grandes associations. Les services ont travaillé sur la base des contributions qui nous ont été remises : ont notamment été considérés le taux d’emploi, le potentiel financier, la part des moins de dix-huit ans – la présence d’un fort taux de jeunes dans un quartier crée des charges supplémentaires – la taille du quartier, la part de logements sociaux, le revenu médian des ménages. Ces critères vont nous aider à disposer d’une perception correcte pour déterminer si le quartier peut réunir les conditions de prise en charge par la politique de la ville.
Pour conduire des évaluations aussi pertinentes que possible, nous voulons travailler à établir des critères objectifs et pertinents d’évaluation des politiques. Nous sollicitons non seulement l’Onzus mais aussi le CNV et d’autres partenaires. Ce travail prend cependant du temps.
M. François Goulard. Les critères précis que vous avez cités ont-ils été établis ? Si oui, sont-ils accessibles ? Dans quels documents ? Autrement, à quelle échéance seront-ils disponibles ?
Mme la secrétaire d’État. Quelques-uns figurent sur le site de l’Insee. Nous attendons un arbitrage, dans le cadre d’un comité interministériel des villes (CIV).
M. François Pupponi. Nous avons pour mission d’évaluer la politique de la ville. Nous constatons qu’aucune évaluation, ou presque, n’a jamais été conduite.
Mme la secrétaire d’État. C’est vrai.
M. François Pupponi. Nous revenons d’un déplacement aux Pays-Bas. Les instruments permettent d’y connaître, presque par cage d’escalier, le taux de chômage ou de réussite scolaire. Tel n’est pas le cas en France. Le Gouvernement, qui nous annonce une réforme d’ampleur de la politique de la ville, a-t-il pris conscience de ces lacunes ? La réforme en tient-elle compte ?
Pourrions-nous avoir connaissance des propositions faites au Premier ministre ? Nous ne connaissons ni les propositions, ni les arbitrages rendus, ni les critères de sélection. Nous nous méfions aussi des effets pervers. Nous étions hier à Orléans, ville où la politique sociale dans les quartiers et celle de l’Anru sont plutôt des réussites. Or, les acteurs de terrain nous ont expliqué que, sans les 5 millions d’euros perçus au titre de la DSU, ils ne pouvaient plus entretenir les rénovations déjà effectuées dans les quartiers de l’Argonne et de La Source. Les éléments ont-ils été quantifiés ? Les sorties du dispositif sont-elles accompagnées ? Nous ne le savons pas.
M. François Goulard. Lorsqu’un ministère demande l’arbitrage du Premier ministre, ses dossiers sont prêts. Disposez-vous aujourd’hui d’une vision suffisamment claire des quartiers ? Avez-vous établi pour chacun d’eux une feuille de route précisant la situation de départ, les améliorations qui restent à conduire et la manière d’en assurer le suivi ? Comment autrement donner un sens à une réforme de la géographie prioritaire ? Allez-vous proposer au Premier ministre un dispositif sérieux, s’appuyant sur des données précises, comparant les quartiers entre eux, et proposant des priorités et surtout un suivi des actions ? Nous sommes frappés par le caractère partiel des politiques lancées – elles laissent de côté sans motif connu des territoires ou des actions – et enfin par l’absence d’un véritable dispositif qui permettrait de vérifier, après cinq ou dix ans, la réalité d’une amélioration. Les données de l’Onzus, établies sur le plan national, n’ont qu’un intérêt somme toute limité pour orienter l’action à un niveau local.
Mme la secrétaire d’État. J’en suis d’accord, nous ne sommes pas assez performants en matière d’outils d’évaluation des politiques et de critères. Nous devons beaucoup travailler pour nous rapprocher des résultats des Pays-Bas. Compte tenu de votre témoignage, je ne tarderai pas à m’y rendre pour vérifier leur expérience, et essayer d’importer leurs bonnes pratiques en France.
Néanmoins, des outils interministériels existent. Nous recueillons des données d’origines diverses. Nous disposons aussi de rapports d’audits de l’Acsé sur les politiques menées dans les territoires en difficulté. Les services de l’État nous informent. En revanche, je ne dispose pas d’une photographie parfaite de l’impact des politiques publiques quartier par quartier. Nos outils ne nous permettent pas de savoir, cage d’escalier par cage d’escalier, où en est telle ou telle famille
M. François Goulard. Une ventilation par quartier suffirait.
M. François Pupponi. Exactement.
Mme la secrétaire d’État. Les bailleurs sociaux nous fournissent aussi des données.
Cependant, améliorer les outils d’évaluation est l’un des enjeux de nos discussions avec nos partenaires. Ces outils devraient nous permettre de rectifier, d’améliorer ou même de supprimer des dispositifs qui fonctionneraient mal ou pas du tout.
Sur la base des critères que nous avons estimés les plus pertinents et les plus justes, et le cas échéant grâce à des simulations, nous avons effectué des propositions. Elles prennent d’abord en compte la distinction, que je vous ai déjà présentée, entre villes pauvres et villes riches comportant des quartiers pauvres. Cette distinction impose des réponses différenciées. Elle pose aussi la question de la nature de la solidarité, verticale ou horizontale.
À partir de nos résultats, nous voulons d’abord créer une nouvelle géographie prioritaire, aussi pertinente que possible. Nous proposons ensuite de concentrer l’action de l’État sur les territoires les plus en difficulté. Les ZUS qui sortiraient du dispositif seraient accompagnées sur deux ans, de façon à pouvoir s’adapter, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale rénovés. Les communes perdant une ZUS ne doivent pas être trop pénalisées. En revanche, pour accélérer la réduction des écarts, nous souhaitons mettre fin au saupoudrage et concentrer les aides.
M. François Pupponi. Les sorties du dispositif effectuées sur la base de critères objectifs donneront-elles lieu à des négociations avec les collectivités ?
Les villes ont certes besoin de l’accompagnement de l’État pour l’amélioration des quartiers. Cependant, nous ne sommes pas très éloignés d’une situation où, dans certains territoires où l’État accroîtrait ses moyens de financement, les communes concernées ne pourraient pas le suivre. La situation de certaines d’entre elles est dramatique.
Les objectifs de la péréquation sont-ils fixés à partir d’une évaluation des inégalités de ressources et de charges entre communes réalisée sur la base de critères objectifs, que la péréquation devrait tendre à réduire – de 20 % à 60 % par exemple ? Nous donnons-nous les moyens de mettre en place un tableau de suivi annuel de la réduction des inégalités ainsi opérée ?
Mme la secrétaire d’État. L’outil n’existe pas. Il est à créer.
M. François Goulard. Pour la réforme de la géographie prioritaire, vous n’êtes donc pas en mesure de prendre en compte la pauvreté relative des collectivités ?
Mme la secrétaire d’État. Les critères de potentiel financier dont nous disposons nous en donnent une idée.
M. François Pupponi. Lorsqu’il est décidé de faire entrer une commune dans le nouveau dispositif de la géographie prioritaire pour cause de potentiel financier trop faible ou de niveau de charges trop élevé, un objectif de diminution à cinq ans de l’écart avec la référence d’une ville plus riche doit être fixé.
Mme la secrétaire d’État. Monsieur le député, nous sommes d’accord sur le fond. Mes propositions, pour lesquelles j’espère un prochain arbitrage favorable, consistent à concentrer l’aide sur les territoires prioritaires et de réformer DSU et péréquation. Même si l’État continuera à accompagner les villes riches comportant des poches de pauvreté, l’enjeu, c’est d’abord la sortie des villes pauvres du marasme. Leur situation, très difficile, peut dégénérer à tout moment.
La politique de la ville a été victime du saupoudrage. Comment dénommer autrement le partage d’une DSU de 1,2 milliard d’euros environ entre 800 communes ?
Pour avoir visité l’ensemble des quartiers en difficulté, je peux assurer que certains, eu égard à la situation des communes dont ils relèvent, doivent sortir du dispositif de la politique de la ville.
M. François Pupponi. Des critères précis sont-ils utilisés pour la prise des décisions de procéder à des sorties ou à de nouvelles entrées ?
Mme la secrétaire d’État. Jusqu’à présent, le zonage actuel n’a pas été fondé sur des critères solides.
Aujourd’hui cependant, nous nous efforçons de construire une politique de la ville aussi cohérente que possible, élaborée sur mesure. À cet effet, nous essayons d’y introduire de vrais outils d’évaluation, permettant de mesurer l’impact des politiques publiques que nous y menons.
Par ailleurs, outre les crédits spécifiques de la politique de la ville, 3,7 milliards d’euros de crédits de droit commun sont consacrés à des actions urbaines. J’ai besoin que, dans les Cucs de nouvelle génération, les crédits de droit commun soient « sacralisés ». C’est l’essence même de la politique de la ville. Tout était dit dans le rapport de 1983, bien connu, intitulé « Ensemble, refaire la ville ».
La géographie prioritaire sera réformée, je l’espère, sur la base des critères que nous avons proposés à cet effet. La philosophie de notre action est fondée sur un clivage non pas politique, entre la gauche et la droite, mais entre les villes pauvres et les villes riches comportant des poches de pauvreté, où l’intervention de l’État ne sera pas aussi développée. Pour reprendre les propos du Président de la République, il s’agit de donner plus à ceux qui ont moins.
M. François Goulard. Ce travail est-il conduit en liaison avec le ministère de l’Intérieur, en charge du financement des collectivités locales par le biais à la fois de la DSU et, si nécessaire, de la péréquation ? Si tel n’est pas le cas, nous pouvons légitimement douter de sa réussite.
Mme la secrétaire d’État. Vous avez raison ; la réussite ne dépend pas seulement de nous mais aussi du ministère de l’Intérieur assisté par le Comité des finances locales. Les partenaires sont nombreux. En matière de péréquation, si nous avons suscité le débat, et en dressons le cadre, nous ne sommes pas invités dans les instances qui mènent la réflexion jusqu’à son terme.
M. Pierre Cardo. Les villes riches dont certaines populations sont pauvres doivent être incitées à intervenir de façon sectorielle. Il faut y favoriser des financements par actions. L’intervention de la DSU à leur profit est une anomalie qu’il faut rectifier.
Il faut ainsi mettre fin au saupoudrage de la DSU : il gêne l’intervention au profit des communes en difficulté.
Par ailleurs, tant que, en France les populations les plus défavorisées resteront obligées d’habiter les mêmes quartiers, avant de déménager dès que leur situation s’améliore, l’évaluation des résultats risque de rester difficile ; s’il faut bien sûr l’améliorer, nous devrons rester prudents dans nos conclusions et être attentifs aux effets pervers.
M. François Pupponi. Il est aussi possible d’évaluer en même temps les situations des familles qui sortent d’une ZUS et de celles qui y entrent. L’Onzus commence à mettre en place le suivi de « cohortes ». L’idéal serait que chaque ville concernée par la politique de la ville reçoive chaque année une fiche la concernant, comprenant l’évaluation de sa situation, critère par critère. Cette fiche pourrait servir de base à un débat avec l’État – le préfet – sur les raisons de l’amélioration ou non de tel ou tel point.
L’établissement de cohortes permettra aussi de constater que parmi les populations qui remplacent celles qui partent figurent souvent des familles bénéficiaires de logements attribués par le préfet au titre de la loi instituant un droit au logement opposable (DALO). Si une ville se paupérise du fait de l’attribution de nombreux logement au titre de la loi DALO par le préfet, il faut pouvoir le constater et en débattre avec lui.
La politique de la ville, c’est aussi beaucoup d’individualisation, un suivi très attentif de chaque situation, un pilotage très fin. Sans outils rigoureux et précis, elle continuera à être menée à l’aveugle.
Mme la secrétaire d’État. Pour mener des politiques aussi cohérentes et adaptées que possible, nous devons en effet créer les outils capables de nous donner une photographie d’un territoire et de la situation de ses populations. Cette démarche fait partie des propositions que nous allons faire. L’Onzus va travailler sur les cohortes.
M. François Pupponi. Alors que la politique de la ville est censée être une priorité nationale depuis trente ans, les représentants de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) nous ont exposé qu’ils ne développaient ni statistiques ni actions dédiées aux ZUS, hormis le contrat d’autonomie. Le ministère de l’intérieur ne dispose pas non plus de statistiques par ZUS. Le Premier ministre devrait imposer à chaque ministère de procéder à un suivi spécifique. Les outils ne sont pas très difficiles à élaborer. Une synthèse par quartier pourrait ensuite être établie à l’échelon national.
Mme la secrétaire d’État. Chaque ministère a établi des critères, plus ou moins précis, pour la détermination de dotations budgétaires. C’est leur mise en œuvre qui aboutit au montant de 3,7 milliards d’euros que j’ai évoqué.
M. François Pupponi. Le seul ministère qui établit des données par zone prioritaire est celui de l’éducation nationale, pour la réussite scolaire par exemple.
Mme la secrétaire d’État. C’est vrai. Nous disposons de ces chiffres.
Eu égard à l’ampleur du taux de chômage qu’on y constate, je demande depuis plusieurs années la territorialisation dans les quartiers du traitement social du chômage et des contrats aidés. Il nous faut flécher les dispositifs.
M. François Goulard. Pourquoi n’est-ce pas fait ?
Mme la secrétaire d’État. Un arbitrage doit être rendu en Comité interministériel des villes.
La gouvernance de la politique de la ville a été très critiquée. Nous l’avons en conséquence restructurée, et lui avons donné plus de visibilité. Certes, l’effort doit être poursuivi. Cependant, aujourd’hui, la Délégation interministérielle à la ville (DIV) assure le secrétariat général du CIV. La mission est désormais claire. Les missions de l’Acsé, de l’Anru, et de l’Onzus sont connues.
Si des améliorations doivent encore être apportées, nous reconstruisons avec ces outils une politique de la ville plus efficace et performante. Notre objectif est que, à terme, cette politique ne soit plus nécessaire et que les territoires dont nous sommes chargés, ainsi que leurs habitants, relèvent, comme chacun, du droit commun.
M. François Goulard. Votre constat est le même que le nôtre : le ministère chargé de l’emploi ne s’intéresse pas spécifiquement aux quartiers relevant de la politique de la ville.
Mme la secrétaire d’État. Non. J’ai simplement dit que nous avions besoin de la territorialisation.
M. François Goulard. Pourquoi une demande aussi simple n’aboutit-elle pas ?
Mme la secrétaire d’État. Laurent Wauquiez s’y est engagé. Son administration doit maintenant se mettre en mouvement.
M. François Goulard. Nous sommes entrés dans la deuxième partie de la législature. Pour agir, la période devient tardive.
Mme la secrétaire d’État. Nous avons créé pour les jeunes habitants des ZUS un dispositif très efficace et visible, le contrat autonomie.
M. François Goulard. Certes, mais là n’est pas la réponse.
Nous constatons que sur un point élémentaire et assez fondamental, le suivi de la situation d’une ZUS en matière d’emploi,…
Mme la secrétaire d’État. Et de formation.
M. François Goulard. …vous n’arrivez pas à obtenir du ministère chargé de l’emploi les données les plus élémentaires. Pourquoi ces difficultés ?
Mme la secrétaire d’État. Si les chiffres sont bien établis par ville, il est possible de les obtenir par ZUS sur demande, grâce à un travail spécifique. C’est ainsi que nous procédons. Il est vrai que c’est dès le départ que nous devrions en disposer.
M. François Pupponi. L’exemple des contrats aidés est très révélateur. Malgré un taux de chômage plus élevé dans les ZUS qu’ailleurs, nous sommes très surpris que le ministère de l’emploi ne décide pas de consacrer un pourcentage donné de ces emplois à ces territoires. N’importe quel ministre peut prendre une telle décision sans attendre une réunion du CIV ! Le ministre chargé de l’emploi peut décider de demander aux structures de Pôle emploi de réserver un pourcentage donné des contrats aidés à ces quartiers. C’est une décision politique. Pourquoi une telle action n’est-elle pas conduite ?
Mme la secrétaire d’État. C’est une bonne question. Nous allons organiser très prochainement en préfecture de Seine-Saint-Denis une réunion avec l’ensemble des partenaires pour cibler en la matière les quartiers touchés par un chômage important et leur proposer des réponses.
M. François Goulard. En matière d’emploi d’insertion – pourtant l’un des volets essentiels de la politique de la ville –, les réussites des opérations de rénovation urbaine sont très diverses. Dans certaines zones de rénovation urbaine, plusieurs dizaines d’emplois d’insertion sont créées. Dans d’autres, presque pas. Ces disparités considérables appellent-t-elles des réactions de votre part ?
Mme la secrétaire d’État. Lorsque la charte d’insertion n’est pas respectée, les préfets, qui sont chargés de sa bonne application, nous le font savoir. L’Anru prend alors les mesures nécessaires.
Cependant, il peut arriver, exceptionnellement, qu’une entreprise ayant remporté un marché n’arrive pas à trouver pour le chantier, dans une ZUS, des jeunes sans qualification, ou encore que le jeune ne réussisse pas à respecter les engagements pris. Dans ce cas, nous ne pouvons pas faire respecter la charte.
Nous avons donc essayé de faire en sorte que le contrat d’autonomie, qui permet l’accompagnement du jeune dans le cadre d’un tutorat suivi, puisse être effectué en lien direct avec les entreprises retenues par l’Anru. Le jeune pourra ainsi être préparé à une situation d’emploi et à la culture de l’entreprise. Formé dans les métiers du bâtiment, frotté à la culture de l’entreprise, le jeune, une fois achevé son contrat autonomie, peut être opérationnel directement chez un employeur, avec un contrat de travail. Ces liens concrets sont créés sur la base des dispositifs de la dynamique « Espoir Banlieues ». Ceux-ci sont mis en place localement, pilotés par le préfet et gérés par des organismes privés, associations et opérateurs ayant remporté les marchés du contrat d’autonomie.
En coopération avec les missions locales et le service public de l’emploi, nous essayons donc de créer des parcours permettant aux jeunes des quartiers de suivre ensuite une formation qualifiante ou de décrocher un contrat d’autonomie.
Inversement, lorsque le patron d’un jeune embauché dans le cadre d’un chantier de rénovation urbaine au titre d’une charte d’insertion nous fait part à la fois du potentiel de celui-ci mais aussi de ses nombreuses lacunes, nous l’orientons vers le contrat d’autonomie ; il peut ainsi se former correctement et sortir de formation avec un bagage. Nous avons alors la certitude que l’entreprise, qui a déjà travaillé avec lui, le reprendra en stage pratique voire sous contrat, à durée déterminée ou indéterminée, selon le volume des travaux nécessités par les chantiers qu’elle aura remportés. Ainsi, nous essayons de créer des parcours sécurisés.
Dans le cadre des Cucs de prochaine génération, nous souhaitons que soit créé chaque fois un observatoire local, un Onzus local, à partir des équipes en place. Un tel organisme permettra de mutualiser toutes les forces et de centraliser toutes les informations, et sera capable de travailler sur toutes les thématiques. Les nouveaux Cucs auront pour objectif la mise en place, à travers les négociations avec les maires, de vrais projets redynamisants sur des thématiques – chômage, formation, éducation – choisies en fonction des besoins de chaque territoire et de ses populations. En effet, intervenir sur tout ne serait pas très efficace ; Il faut donc concentrer, sur des thématiques sélectionnées, l’action non seulement de l’État mais aussi des collectivités territoriales, dans leurs domaines de compétence, et aussi du monde de l’entreprise, partie prenante de la transformation de la dynamique.
M. François Pupponi. Si j’ai bien analysé la déclaration du Premier ministre, les réformes de la géographie prioritaire et de la péréquation ne seront examinées par le Parlement qu’en 2011, pour une application probablement fin 2012.
Il ne s’agit pas forcément des meilleures dates pour la mise en œuvre d’une politique prioritaire et exemplaire. Entre le 1er janvier et la fin juin 2012, les services de l’État, les collectivités locales et les élus me semblent plutôt susceptibles d’être mobilisés sur d’autres thématiques politiques.
Mme la secrétaire d’État. La loi pourrait entrer en vigueur début 2012.
M. François Pupponi. Les dispositions relatives à la péréquation seront insérées dans le projet de loi de finances pour 2012, lequel ne s’appliquera effectivement qu’à partir du 1er janvier 2012.
Mme la secrétaire d’État. Pour que la politique de la ville contribue à régler le malaise des banlieues, deux points sont à régler.
D’abord il n’est pas possible de continuer à concentrer dans certains territoires des populations qui accumulent tous les handicaps. Le respect de la loi SRU est donc essentiel ; il faut construire des logements sociaux en dehors de ces territoires, qui concentrent déjà entre 20 % et 60 % de logements sociaux.
Ensuite, quelle que soit la légitimité de la loi DALO, je suis favorable à ce qu’elle ne soit pas appliquée dans les ZUS. Il ne me paraît ni judicieux ni responsable d’ajouter des pauvres aux pauvres.
M. François Pupponi. Nous ne pouvons que constater que, malgré de solennelles déclarations d’intentions, chaque ministère poursuit dans les faits sa propre logique. Nous avions dénoncé le risque d’accentuation des ghettos par la loi DALO. Sa mise en œuvre par certains préfets est édifiante.
Par ailleurs, si l’article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales est voté, la suppression des financements croisés – et donc du cumul de financements entre départements et régions – et l’interdiction du partage des compétences exclusives des communes limiteront fortement la possibilité de conclure de nouveaux contrats : or, l’intérêt de ceux-ci est justement de permettre les cofinancements et les financements croisés. En particulier, dans les départements qui comptent le plus de villes en difficulté, notamment en Île-de-France, limiter les cofinancements soit à la région, soit au département aboutira à la cessation des cofinancements par les départements.
En matière de politique de la ville, nous constatons aussi la cohabitation de l’affichage d’une volonté forte avec un arbitrage du Premier ministre qui tarde et des actes législatifs ou des décisions ministérielles un peu contraires aux annonces. Comment gérez-vous ces contradictions ? Comment améliorer la cohérence de l’action ?
Mme la secrétaire d’État. D’abord, la politique de la ville est conduite dans le bateau « France » ; elle doit tenir compte de l’ensemble des actions qui s’y mènent.
Si la mise en œuvre des réformes annoncées par le Premier ministre, M. François Fillon, peut paraître lente, c’est aussi parce que nous avons pris le temps nécessaire à une concertation approfondie, fortement demandée depuis longtemps.
Je ne saurais nier les conséquences de la réforme de l’organisation territoriale sur la politique de la ville. Peut-être aurais-je souhaité un arbitrage plus rapide du Premier ministre, qui a des ambitions pour elle. Construire la politique de la ville et les Cucs – au sein desquels chacun doit se retrouver pour se mobiliser pour ces territoires en difficulté – est néanmoins impossible sans une clarification préalable de l’organisation locale et des compétences des diverses collectivités.
En matière de politique de la ville, tous les Gouvernements, de quelque bord que ce soit, ont connu des contradictions dans les décisions prises par leurs membres chacun dans leur domaine de compétence exclusive, sur des questions à leurs yeux primordiales.
La politique de la ville n’est pas non plus pensée identiquement par tous. Je me bats pour que les Cucs soient la traduction d’engagements en faveur non pas seulement d’objectifs, mais aussi de moyens financiers, et sans retours en arrière, de façon à éviter de revivre des incohérences qui parfois bousculent la politique de la ville ; il reste que celle-ci aussi bouscule le droit commun.
M. François Goulard. Madame la secrétaire d’État, pour vous, les Cucs sont-ils d’abord la traduction d’un engagement financier ? Celui-ci n’est pas très significatif : là où une ville s’engage pour 5 millions d’euros, l’État signe pour 300 000 euros. Nous avons pu vérifier un ratio de ce type hier à Orléans. L’engagement de l’État n’est donc pas à la hauteur des disparités financières entre collectivités.
Sinon, traduisent-ils un engagement de l’État à apporter des moyens dans des domaines ne relevant pas de la compétence des collectivités locales – éducation nationale ou police par exemple ? Tel n’est pas l’objet d’un Cucs. Ces préoccupations sont vraiment situées sur leur marge.
S’agit-il alors d’une expertise apportée par l’État ? Permettez-nous d’en douter. Les préoccupations du ou des directeurs départementaux compétents qui se rendaient dans les quartiers étaient généralement assez éloignées des problématiques de ceux-ci. Lors de leur audition, les responsables de l’Acsé n’ont du reste pas prétendu disposer d’une expertise ni d’une ingénierie particulières.
Dès lors, les Cucs ont-t-il réellement un objet ? Leur utilité ne serait-elle pas finalement celle de véritables outils de pilotage local, permettant, en réunissant l’ensemble des parties concernées, de procéder à l’état des lieux, de définir des objectifs et d’en assurer un suivi régulier et opérationnel, de sorte, par exemple, qu’un service de l’État résolve une difficulté locale de sa compétence signalée aux élus ?
Autrement, un élu résumait ainsi le reste du dispositif : un peu d’argent et beaucoup de papiers à remplir !
Mme la secrétaire d’État. Depuis longtemps, je considère que les Cucs doivent pouvoir rassembler l’ensemble des acteurs. S’il y faut de l’argent, leur objet n’est pas d’abord financier. Ils doivent être le lieu de la redéfinition par leurs membres, le maire mais aussi les représentants du département et de la région, de la redynamisation des territoires en difficulté. Au-delà d’un financement, un Cucs est aussi un projet construit en commun, avec la définition d’objectifs d’intervention thématiques, une répartition des tâches, la détermination de moyens et l’élaboration d’un dispositif de mesure de l’efficacité du dispositif – c’est pour cette raison que j’évoquais tout à l’heure l’intégration au sein des Cucs d’un observatoire local.
Il est essentiel que l’ensemble des partenaires s’y engage. Nous avons entamé les discussions avec tous mes collègues du Gouvernement pour que chaque ministère soit pleinement présent dans les Cucs.
Chacun le sait plus ou moins confusément, un territoire en difficulté manque de services d’éducation, de justice, de santé – la santé est aussi une priorité essentielle de la dynamique « Espoir Banlieues ». En conséquence, non seulement le maire – en tant que meilleur connaisseur du territoire, c’est lui le pilote – le préfet, mais aussi chaque ministère, et, lorsque la clarification sera effectuée, chaque collectivité territoriale dans son domaine de compétence, doit intervenir dans la construction du projet de redynamisation et d’apport d’objectifs.
Le Cucs suppose aussi la mobilisation du monde économique local. Seul l’engagement de tous permettra de rendre du sens à la politique de la ville et de répondre aux besoins des territoires qui vont mal, ainsi qu’à ceux de leurs habitants. L’intervention des maires, des services de tel ou tel ministère, de telle collectivité partenaire – et hésitante – n’y suffira pas.
Ces réflexions n’enlèvent rien à la nécessité d’une meilleure visibilité de la politique de la ville au sein de l’État. La révision générale des politiques publiques a fait du préfet le représentant à la fois de l’Anru et de l’Acsé sur les territoires. Je l’ai souhaité. J’ai connu la situation où les délégués de l’Acsé, ex-Fasild (Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations), n’étaient pas intégrés dans le processus d’information et de décision de l’État : nous ne connaissions pas les actions des autres organismes. Il faut que la réorganisation de l’État instaure une visibilité de la politique de la ville à travers celle de groupes de travail perçus comme des animateurs de celle-ci, notamment dans les territoires les plus en difficulté.
Pendant longtemps, la politique de la ville a souffert d’un manque d’évaluation. Nous devons aujourd’hui nous reposer sur des photographies territoriales, disposer d’outils et de critères, promouvoir une culture des résultats, connaître plus précisément les lacunes en termes d’accès au droit, à la santé et à l’emploi. Pour cela, nous devons lutter contre certaines pratiques bien établies.
Poursuivre l’objectif de réduction des inégalités suppose de penser à long terme, mais aussi de garder à l’esprit que la politique de la ville a une fin, qu’elle a vocation à disparaître un jour.
M. François Goulard. Ce n’est pas la façon la plus commune de penser. Nous avons plutôt l’impression d’être dans un mouvement perpétuel !
Mme la secrétaire d’État. Je suis née dans une ZUS ! Il faudra bien un jour fixer clairement un terme à la politique de la ville, à quinze ou vingt ans : cela nous permettra de tenir le cap. Dans le même ordre d’idée, il faudrait que les contrats urbains de cohésion sociale soient calés sur le mandat du maire.
M. François Goulard. C’est une réflexion fondée !
M. François Pupponi. Nous aimerions avoir accès aux travaux préparatoires que vos services ont réalisés dans le cadre des projets de réformes de la géographie prioritaire et de la péréquation. Disposez-vous notamment de simulations ? Ces questions sont au cœur de notre réflexion.
Mme la secrétaire d’État. Je vous ferai parvenir tous les documents que vous jugerez nécessaires, ainsi que nos propositions d’expérimentations.
Fixer un terme à la politique de la ville permet aussi de combattre les mauvaises habitudes prises ces trente dernières années. Je pense notamment au financement d’associations qui n’existent quasiment plus sur le terrain, mais qui se voient reconduites d’année en année. Je préfère de loin le dispositif qui permet de financer, à hauteur de 500 euros, des petits projets, et qui, par son succès, démontre la soif de s’investir des jeunes.
Il nous faut également lutter contre la mentalité du « On nous doit tout » et les postures victimaires. Je ne cesse de rappeler que la République ne doit rien, si ce n’est l’égalité de traitement, et je m’efforce de faire en sorte que les habitants entrent à nouveau dans une démarche citoyenne et deviennent les acteurs de leur ville. C’est une gageure pour ces jeunes dont les ascendants ont immigré sur une base concrète, celle du travail, et qui aujourd’hui se sentent exclus.
C’est pourquoi il faut insister sur la nécessaire concertation territoriale, en invitant tous les habitants à participer. Je tiens à organiser un rendez-vous annuel dans le cadre de la dynamique « Espoir Banlieues » afin de leur donner la parole. Je refuse que les décisions soient prises sans lien avec les réalités locales ; il faut donner aux habitants une plus grande place encore et c’est en ce sens que j’ai saisi le nouveau Conseil national des villes.
M. François Goulard. Madame la secrétaire d’État, nous vous remercions.
RÉUNION DU COMITÉ DU 21 OCTOBRE 2010 :
EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT D’INFORMATION
Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques s’est réuni le jeudi 21 octobre 2010 pour examiner le projet de rapport d’information.
M. le Président Bernard Accoyer. Nous allons examiner le projet de rapport d’information sur l’évaluation de la politique d’aide aux quartiers défavorisés, pour lequel nous avons désigné comme rapporteurs François Goulard, membre de la commission des finances et rapporteur spécial des crédits de la ville, et François Pupponi, membre de la commission des affaires sociales. Tous les deux ont un mandat de maire, et des zones urbaines sensibles dans leur circonscription.
Il s’agit d’un sujet important qui, je le rappelle, avait été proposé par le groupe UMP. Nos deux rapporteurs nous ont déjà présenté deux points d’étape. Ils vont aujourd’hui nous soumettre les conclusions de près d’un an de travaux, conclusions dont nous avons déjà abordé les grandes lignes lors d’un déjeuner. Je me suis moi-même rendu au printemps sur le site de Clichy-Montfermeil, que nos deux rapporteurs ont également visité.
Le projet de rapport, son résumé factuel et sa synthèse vous ont été transmis il y a quelques jours et figurent au dossier. Vous trouverez également des exemplaires des deux études commandées, après appel d’offres, à des experts extérieurs, comme le permet notre règlement. La première, réalisée par deux chercheurs reconnus, M. Thomas Kirszbaum et M. Renaud Epstein, est une synthèse des nombreuses études et publications universitaires sur l’évaluation de la politique de la ville parues depuis plus de vingt ans. La seconde, effectuée par le cabinet spécialisé ECs, regroupe des évaluations de mesures locales portant sur un échantillon de plus de vingt communes bénéficiant d’un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
M. François Goulard, rapporteur. En préambule, je souhaite remercier le secrétariat du Comité d’évaluation et de contrôle, dont le travail d’une qualité exceptionnelle a représenté pour nous une aide considérable.
Nous avons effectivement travaillé pendant près d’un an, avec l’appui d’experts extérieurs. Nous avons rencontré de nombreux élus locaux, mais aussi tout ce que notre pays compte d’administrations plus ou moins concernées par la politique de la ville. Nous avons également effectué plusieurs déplacements, dont l’un à Clichy-Montfermeil, qui concentre de nombreuses difficultés, ainsi qu’un autre à Orléans, dont la politique de la ville est citée en exemple. Après une étude sur documents des différentes politiques menées en Europe, nous nous sommes également rendus aux Pays-Bas.
Pour simplifier – et au risque d’être brutal –, je commencerai par observer que les analyses de l’ONZUS, l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, ne révèlent pas, au niveau national, de véritable amélioration de la situation de nos quartiers, et ce en dépit des politiques menées depuis près de trente ans. Quel que soit l’indicateur retenu – emploi, éducation, sécurité ,… –, on ne peut pas dire que les politiques de la ville soient parvenues à changer la vie de nos concitoyens dans ces quartiers.
Toutefois, l’ONZUS n’élabore des statistiques qu’à l’échelle nationale, alors que les politiques sont conduites quartier par quartier. Il manque en France cette approche très pragmatique, que nous avons observée aux Pays-bas, consistant à observer la situation dans un secteur géographique précis : on préfère agréger des données au risque de leur faire perdre leur signification, la situation étant plus contrastée qu’il n’y paraît.
Les dispositifs s’accumulent depuis des dizaines d’années, alors que l’État et les collectivités leur ont consacré beaucoup d’argent – même si on peut toujours relativiser l’effort consenti. Au regard de l’ampleur de la dépense, l’absence de résultats probants conduit donc à se poser des questions.
Selon nous, ces multiples dispositifs souffrent de plusieurs défauts. Tout d’abord, peu d’entre eux s’inscrivent dans la durée : plutôt que des politiques conduites sur le long terme, on observe une succession de politiques. Ensuite, ils sont en général décidés au niveau national, et répondent rarement à une demande exprimée par les personnes directement concernées. De plus, ils sont uniformes, alors que les problèmes à résoudre sont extrêmement divers et peuvent varier d’un quartier à l’autre. Leur suivi est également insuffisant et très formaliste, sans tenir compte des réalités locales. Paradoxalement, alors que la politique de la ville a toujours affirmé la nécessité d’une évaluation – et la loi de 2003 n’y faisait pas exception –, celle-ci est rarement effectuée d’une manière pleinement satisfaisante : on préfère souvent changer de politique plutôt que d’évaluer sérieusement celle qui a été menée jusqu’alors. Enfin, dans les comparaisons internationales, la France se distingue par la faible implication des habitants concernés.
Cela étant, le tableau est plus contrasté qu’il n’y paraît, et certaines villes réussissent en matière de politique de la ville – même si cette réussite n’est jamais absolue. Trois conditions nous apparaissent nécessaires pour obtenir ces succès. La première, déterminante, est que les élus locaux fassent preuve d’une volonté politique forte – or celle-ci n’est pas toujours au rendez-vous. Ensuite, l’approche doit être globale : on ne peut pas traiter des difficultés des villes morceau par morceau. Il faut agir à la fois sur le bâti, sur les questions sociales, sur l’emploi, sur l’éducation, sur la sécurité. Enfin, il faut de l’argent. Certes, l’État en apporte, mais force est de constater que certaines villes, sans être nécessairement très riches, ont les moyens de travailler, tandis que d’autres sont trop pauvres pour réussir.
Il faut souligner également que la solidarité entre collectivités n’est pas la même partout. Une intercommunalité forte représente un avantage – nous l’avons vu à Lyon. De même, l’engagement des départements ou des régions peut constituer un atout supplémentaire. À cet égard, la situation est très disparate sur le territoire : dans certaines zones, cette solidarité existe, mais dans d’autres, elle est infiniment plus ténue.
En dépit des critiques qui ont pu être formulées à son encontre, et qui étaient sans doute justifiées à ses débuts, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, peut être considérée comme un moteur efficace, même s’il n’est pas suffisant. On ne peut résumer la politique en faveur des quartiers difficiles aux seules démolitions et reconstructions, mais cette politique massive fonctionne pour l’essentiel. En revanche, nous avons décelé des faiblesses évidentes de la part d’autres institutions. Ainsi, l’ACSÉ, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, est un organisme qui fonctionne mal, non pas à cause de ses agents, mais parce que la mission qui lui a été attribuée n’a jamais été suffisamment claire. De même, il y aurait beaucoup à dire sur le caractère virtuel du CUCS, le contrat urbain de cohésion sociale, passé entre les collectivités et l’État. Quant à l’échelon local de l’État, il ne nous a pas paru le plus pertinent pour traiter les difficultés des quartiers défavorisés. Or, bien que les services déconcentrés soient beaucoup moins en prise que les élus avec la réalité de ces quartiers, la politique de la ville s’appuie beaucoup sur eux.
Nous avons par ailleurs observé de grandes différences entre les ministères. Certains, qui devraient être directement concernés par la politique de la ville, se disent pourtant peu influencés par la géographie prioritaire. C’est notamment le cas du ministère de l’emploi : non seulement le délégué général à l’emploi nous a avoué ne pas tenir compte de l’existence des zones urbaines sensibles, mais nous avons constaté des aberrations dans la répartition des agences de Pôle emploi sur le territoire. D’autres administrations, comme l’éducation nationale, prennent au contraire bien en compte cette géographie.
Sans vouloir ériger ce pays en modèle, nous avons été marqués par le pragmatisme dont fait preuve l’action administrative aux Pays-Bas. Devant l’existence de quartiers difficiles, il faudrait tout d’abord établir un diagnostic, constater les écarts par rapport à la moyenne – bref, voir où le bât blesse. Or on ne le fait jamais en France. Ensuite, il faudrait se demander comme améliorer les choses ; faire la liste des actions à mener ; suivre, mois par mois, l’avancement de ces actions ; le cas échéant, les corriger si elles ne donnent pas de résultats ; et enfin, les évaluer au bout d’un certain temps. Tout cela, on ne le fait jamais dans notre pays.
Malgré l’urgence d’améliorer la situation de certains quartiers, malgré les moyens qui y sont consacrés, nous restons incapables de prendre à bras-le-corps ce problème qui concerne pourtant un grand nombre de nos concitoyens et donne de notre pays une image peu reluisante. On pourrait faire tellement mieux que ce qui est fait aujourd’hui !
M. François Pupponi, rapporteur. Je souhaiterais apporter quelques précisions au constat édifiant que vient de dresser François Goulard. À la question des moyens mis en œuvre dans les quartiers dits « défavorisés », vos rapporteurs n’ont pas été en mesure d’apporter une réponse précise. Nous ne savons pas, en effet, combien le pays investit dans ces territoires. Certes, grâce à l’ANRU, nous pouvons apprécier le coût du renouvellement urbain ; nous connaissons également le montant du budget du ministère de la ville ; mais s’agissant des autres ministères impliqués, l’examen des documents budgétaires ne donne que peu d’informations vraiment fiables. Alors même que la politique de la ville est une priorité de l’État depuis trente ans, les grands ministères ne savent pas exactement ce qu’ils font dans ce domaine. Ainsi, comme l’a dit François Goulard, le ministère de l’emploi ne met en œuvre aucune politique particulière dans les zones urbaines sensibles, qui comptent pourtant plus de deux fois plus de demandeurs d’emploi qu’ailleurs. La volonté, affirmée au niveau national, d’agir prioritairement en faveur de ces quartiers n’a donc pas été mise en pratique. De même, de nombreux établissements intercommunaux, départements ou régions consentent des efforts importants dans le domaine de la politique de la ville, sans qu’aucun document ne retrace leur action. Nous ne savons donc pas combien ils ont investi dans ces quartiers.
On l’a dit, les résultats de la politique de la ville ne sont pas bons. Les évaluations de l’ONZUS montrent que non seulement la situation ne s’améliore pas, mais qu’elle s’aggrave dans certains domaines – on peut citer l’exemple du développement de l’économie souterraine.
Par ailleurs, la France n’a pas été capable d’élaborer une politique structurée et cohérente, alliant rénovation urbaine, action sociale et créations d’emplois, ni de mettre en œuvre une véritable politique de péréquation. Certes, grâce à l’ANRU, des quartiers entiers sont rénovés, mais un certain nombre de communes n’auront même pas les moyens de les entretenir. Pire encore : au moment où l’Agence fonctionne à plein régime, on supprime le seul dispositif qui a réellement permis de créer des emplois, celui des zones franches urbaines. Notre pays fait preuve d’incohérence, pour ne pas dire de schizophrénie.
De même, nous n’avons pas été capables de distinguer les villes comprenant des quartiers en difficulté de celles qui peuvent y être assimilées dans leur entier. En effet, quand la plus grande partie du territoire de la commune est classée en ZUS, c’est la ville elle-même qui est en difficulté. La situation n’est pas la même à Clichy-sous-Bois, dont 80 % du territoire communal est une zone urbaine sensible, et au Mirail, quartier en difficulté inclus dans l’agglomération de Toulouse. Quand une ville est classée à 80 % en ZUS, il est absurde de laisser les 20 % restants hors du dispositif, d’autant qu’y résident souvent des classes moyennes surtaxées et ne bénéficiant, elles, d’aucune aide. En outre, comment expliquer aux habitants de quartiers dégradés, mais situés hors du zonage de l’ANRU, que celle-ci – qui par ailleurs mène une action plutôt efficace – ne fera rien pour eux, alors qu’elle a rénové les bâtiments situés de l’autre côté de la rue ?
Nous n’avons donc pas su faire preuve de cohérence, ce qui impliquerait de se donner des objectifs, de vérifier s’ils sont atteints et, dans le cas contraire, de rechercher des dispositifs plus efficaces. Dans un rapport publié en 2002, la Cour des comptes faisait d’ailleurs à peu près le même constat. La loi de 2003 en avait tenu compte en fixant des objectifs, mais personne n’a vérifié qu’ils étaient atteints ! En fin de compte, cette loi n’a pas été correctement appliquée. Par exemple, alors que le Gouvernement devait remettre chaque année un rapport au Parlement sur l’évolution de ces politiques en vue d’un débat d’orientation ; celui-ci n’a jamais eu lieu. Très vite, les mauvaises habitudes sont revenues. Le résultat, c’est que nous n’avons pas été capables, en trente ans, de réduire les inégalités et de sortir les quartiers de l’état de relégation dans lequel ils se trouvent. Leur situation est même encore plus dramatique dans la mesure où l’économie souterraine les gangrène de plus en plus.
L’autre échec concerne la péréquation. Malgré la réforme de la DSU, les écarts de richesse entre collectivités se sont aggravés. Ainsi, entre régions, l’écart entre les potentiels fiscaux va de un à deux, et pour les départements, de un à quatre. Mais alors que, dans certaines communes, ce potentiel est de 32 euros par habitant, dans d’autres, il atteint 34 000 euros, soit mille fois plus ! Si nous ne réduisons pas ces écarts, certains territoires ne seront jamais en mesure de sortir de leur état de relégation.
Tel est le constat que nous avons fait. Il est dur, au point de nous avoir inspiré l’idée de ce titre choc : « Quartiers défavorisés ou ghettos inavoués : la République impuissante ».
M. René Dosière. Ce rapport montre tout l’intérêt de notre comité d’évaluation, de même qu’il en révèle peut-être quelques faiblesses, liées au caractère récent de cette structure.
En effet, comme l’ont montré les rapporteurs, on n’a pratiquement jamais fait d’évaluation complète en matière de politique de la ville. Même les études réalisées récemment par l’ONZUS montrent à quel point nous manquons d’éléments. Un gros travail a été réalisé par les rapporteurs pour recenser les aides financières, et même si on ne connaît pas la totalité des sommes engagées, on peut constater que beaucoup d’argent a été consacré à cette politique. Or l’analyse qualitative faite par nos rapporteurs – qui est un peu en deçà de ce qu’il faudrait, mais pour des raisons que l’on peut aisément comprendre – montre qu’en dépit de tous ces efforts, les écarts en termes d’éducation ou d’emploi n’ont pas été réduits.
On comprend aussi, grâce à ce rapport, l’intérêt de recourir à des experts extérieurs. Le travail effectué par les universitaires, en particulier, a beaucoup servi pour élaborer la partie consacrée à l’évaluation de la politique de la ville – ou plutôt à l’insuffisance de cette évaluation.
Je relève que les instruments de cette politique sont inadaptés. Au niveau national, une structure est chargée du bâti, et une autre de la vie courante : elles suivent ainsi des voies parallèles qui ne se rencontrent jamais. Au niveau local, les services publics ne sont pas présents, et les différents intervenants se marchent mutuellement sur les pieds.
Je note que le rapport évoque la question de la délinquance, des voitures brûlées ou des atteintes aux personnes, mais pas celle de la drogue. J’avais pourtant le sentiment qu’elle posait, dans ces quartiers, un véritable problème.
Il est maintenant indispensable de donner une suite à ce travail. Il serait sans doute utile qu’un débat sur la politique de la ville ait lieu en séance publique dans le cadre d’une semaine de contrôle. De même, nos rapporteurs ont peut-être des propositions à formuler – par exemple sur la péréquation ou sur le rôle joué par les collectivités – qui nous permettraient d’avancer dans ce domaine.
M. Daniel Goldberg. Même si, en matière de rénovation urbaine, les résultats sont indéniables, force est de constater qu’ils ne changent pas l’ambiance qui règne dans ces quartiers. Cette difficulté, pointée par Yazid Sabeg dans son rapport au nom du comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU, conduit à se poser la question du sens de ces opérations. Certes, elles améliorent la qualité de vie des habitants, mais elles sont également à l’origine d’un phénomène de turn-over.
Ce que nous apprend également le rapport, c’est qu’il est impossible de connaître la réalité de l’effort supplémentaire consenti en faveur de ces quartiers – dans le domaine de l’éducation, par exemple.
On constate aussi qu’un certain nombre de nos structures sont inadaptées. S’agissant de Pôle emploi, je vous engage à lire le livre de Florence Aubenas dans lequel la journaliste décrit sa confrontation avec cet organisme : il est éclairant.
J’en viens aux différences de ressources entre collectivités territoriales. Comment expliquer qu’une ville peut offrir à ses enfants des séjours linguistiques, des séjours à la montagne ou à la mer, leur donner un accès aux nouvelles techniques de l’information et de la communication, ou une ouverture aux arts et à la culture, tandis que dans d’autres communes, ces possibilités sont réduites, voire inexistantes ? Cette inégalité vaut également pour le cadre strictement scolaire : par exemple, certaines collectivités ont les moyens de décharger les directeurs d’école de leur obligation d’enseigner en remboursant le salaire d’un professeur à l’éducation nationale. Compte tenu du rôle important joué par un directeur, notamment dans l’enseignement primaire, ce n’est pas négligeable.
La place donnée aux habitants des quartiers concernés – notamment des adultes – est également un élément déterminant. Leur parole est-elle entendue ? Comment sont-ils associés aux opérations menées ? Songeons à l’exemple de l’empowerment aux États-Unis.
J’aurais souhaité que les phénomènes de discrimination fassent l’objet de plus longs développements dans le rapport, de même que les questions des représentations liées à l’origine, de la place des femmes, ou de la représentation et de l’accès à l’emploi des jeunes hommes issus des quartiers populaires. Toutefois, j’ai cru comprendre que nous pourrions trouver un accord sur un dispositif de lutte contre la discrimination « à l’adresse ». J’avais déposé un amendement sur ce sujet ignoré par le code du travail.
Le pilotage des politiques fait sans aucun doute question. Au bout de trois ans de mandat, j’ai encore du mal à savoir à quel ministre ou haut-commissaire je dois m’adresser lorsque j’ai une question à poser. Il faudrait parvenir à plus grande clarté, y compris sur le point de savoir qui est responsable de la politique de droit commun dans les quartiers en difficulté. Le problème se pose également lors de l’examen de la loi de finances, car le budget de la politique de la ville ne contient pas tout. Il serait donc utile d’obtenir des budgets consolidés sur les moyens consacrés à cette politique par l’État et les collectivités territoriales.
Enfin, parler de quartiers défavorisés ou sensibles peut laisser penser, a contrario, qu’il existe des quartiers favorisés ou « insensibles ». La solution ne peut être que globale : on n’améliorera pas la vie de ces quartiers si on n’adopte pas une vision d’ensemble, mais selon une échelle adaptée au territoire concerné – urbain, périurbain, rural, etc.
M. Jean-François Copé, président du groupe UMP. Je salue la synthèse brillante rédigée par nos rapporteurs sur un sujet d’une telle ampleur Ce travail est donc pour le Comité une première réussie en termes d’investigations, d’observations du terrain.
M. le Président Bernard Accoyer. N’oublions cependant pas le rapport sur le principe de précaution.
M. Jean-François Copé. En effet. La seule faiblesse de ce rapport – mais ses auteurs n’y sont pour rien – tient à l’insuffisance des outils d’évaluation eux-mêmes. Il conviendra à l’avenir de se doter d’outils supplémentaires, quitte à recourir à des cabinets extérieurs pour obtenir certains éléments techniques. Ainsi, en matière de la politique de la ville, il manque certains indicateurs tels que les résultats obtenus en matière de lutte contre la délinquance. S’agissant d’une politique publique qui dure depuis vingt-cinq ans, le fait que le Gouvernement ne dispose pas de tels outils est d’ailleurs attristant.
Même si le diagnostic porté par les rapporteurs est sans doute le bon, je ne pense pas que l’on puisse dire, comme c’était encore le cas il y a dix ans, que la politique de la ville est un échec total. En fait, elle fonctionne lorsque les trois conditions évoquées par François Goulard – volonté politique, approche globale, financement – sont réunies. Cela tient même du miracle : des quartiers comme le Val-Fourré à Mantes-la-Jolie ou Beauval à Meaux sont désormais méconnaissables. Nous connaissons donc la recette à appliquer : lorsque les actions sont menées en même temps et dans tous les domaines, elles produisent des résultats. Mais il faut que le projet soit prêt, et qu’il ait été conçu localement, en impliquant les habitants.
Il est vrai que certaines villes sont trop pauvres pour réussir toutes seules, de même qu’il est en effet nécessaire d’anticiper les contraintes liées à l’entretien des bâtiments rénovés ou reconstruits. Mais pour être tout à fait juste, reconnaissons que si la situation de certains quartiers est toujours aussi mauvaise, c’est aussi, parfois, parce que l’équipe municipale n’a pas fait son travail.
Par ailleurs, la mixité sociale doit faire partie des objectifs à atteindre. Dans un quartier comptant 95 %, voire 100 %, de logements sociaux, si on détruit une tour pour la remplacer par des immeubles de faible hauteur, il est nécessaire de prévoir un programme d’accession à la propriété afin de recréer un marché immobilier. Ainsi, peu à peu, des enfants de propriétaires fréquentent l’école, des personnes n’ayant pas la même origine sociale ou géographique commencent à se côtoyer, et une évolution favorable peut s’engager.
Pierre Méhaignerie souhaite suggérer au Comité de travailler sur les performances comparées des politiques sociales en Europe. L’idée est intéressante, et il serait sans doute utile de faire un lien entre ce travail et celui qui nous occupe aujourd’hui. Cela relève du droit de suite qu’a évoqué René Dosière, et qui est en effet capital.
Enfin, je souscris à la conclusion de nos rapporteurs : la politique de la ville nécessite un nouvel élan. Il faut lancer un deuxième plan national de rénovation urbaine et y consacrer l’argent nécessaire. Le savoir-faire existe, et nous avons désormais les outils. Il reste à remettre du carburant, et à travailler avec des maires qui ont élaboré des projets clairs et cohérents.
M. Patrick Ollier, président de la commission des Affaires économiques. Par son caractère transversal, ce rapport remarquable confirme pleinement l’utilité du Comité d’évaluation et de contrôle. Lorsque ma commission – qui est compétente en matière de politique de la ville – auditionne un représentant du secrétariat d’État, et qu’elle l’interroge sur la prévention de la délinquance, sur les problèmes sociaux ou les questions d’éducation, ce dernier répond que cela n’est pas de son ressort – ce qui est d’ailleurs exact. L’absence de transversalité, dans ce domaine, entraîne une absence de responsabilité. Nos rapporteurs ont mis le doigt sur ce problème.
On parle de Rueil-Malmaison, la ville dont je suis le maire, comme d’une ville riche, mais ce n’est pas ainsi que je ressens les choses. Sur 80 000 habitants, 25 000 vivent dans des cités, Nanterre étant toute proche. En essayant de mettre en place une politique de la ville, je me suis heurté à l’impossibilité d’avoir un interlocuteur unique, à même de coordonner les opérations que souhaite conduire la mairie. Il y a fractionnement, et donc dispersion des outils. Et si l’on veut les regrouper, on se heurte alors à la dichotomie dont souffre l’administration française entre administration de gestion – comme Pôle emploi ou le ministère des affaires sociales – et administration de mission – comme l’ANRU. Elles agissent en parallèle, sans se rencontrer. Or il est nécessaire de regrouper les administrations et d’organiser un commandement à l’échelon national – afin de traiter en même temps tous les aspects de la politique de la ville – et à l’échelon local, pour régler les problèmes. Ouvrir des gymnases le soir afin que les jeunes fassent du sport plutôt que d’occuper les halls d’immeubles, ou organiser un comité de coordination pour décider d’un nom de rue en association avec les habitants, constituent des décisions qui relèvent du maire, pas de l’État. Lorsque la volonté locale s’exerce, la coordination marche mieux.
Une politique de la ville bien organisée ne peut pas se contenter d’un outil d’urbanisme comme l’ANRU, si important soit-il. Quant aux CSPD, aux CUCS, etc, ce sont de bons outils, mais qui souffrent aussi d’un manque de coordination. On a évoqué les zones franches urbaines : il s’agit d’un dispositif économique, qui ne relève ni des spécialistes du social, ni de ceux qui se préoccupent de la prévention de la délinquance, mais qui concerne pourtant la politique de la ville. Or le secrétariat chargé de cette politique est un ministère « baladeur »: plutôt que d’être identifié à travers une politique voulue et conçue par le Gouvernement et qui s’organise toujours selon la même méthode, il se promène successivement entre les différents ministères auxquels il est raccroché.
De même, la volonté de coordination doit s’exprimer au niveau local. Ainsi, il ne faut pas que les élus se désintéressent de la lutte contre l’économie souterraine et le trafic de stupéfiants sous prétexte qu’elle relève d’une compétence régalienne de l’État. Ils doivent aussi s’en occuper. Il faut donc que la prévention de la délinquance soit mise au même niveau que les efforts consentis en matière d’éducation, en matière sociale, etc.
Enfin, il faudrait convaincre tous les élus de voter des délibérations prévoyant un certain quota de logements sociaux dans tous les nouveaux projets immobiliers. Ainsi à Rueil, nous imposons 30 % de logements sociaux pour tout projet de plus de 900 mètres carrés de SHON. C’est ainsi que l’on crée la mixité sociale. Quelle que soit la couleur politique, en effet, une partie de l’effort doit être effectuée au niveau local. Quant au ministère, il doit être capable de donner des instructions et de casser la dichotomie entre administration de gestion et administration de mission.
M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des Affaires sociales. Quelle formidable leçon nous donne le rapport de François Goulard et de François Pupponi ! Je dis toujours qu’il y a quelque chose de brejnévien dans nos politiques : tout vient d’en haut, et on ne s’adapte jamais à la différence de situations. Ainsi, alors que nous avons lancé un fonds d’expérimentation, tout a été fait pour qu’il ne soit jamais utilisé. Je vous renvoie au titre d’un de mes livres : Aux Français qui ne veulent plus être gouvernés d’en haut. Il n’a pas eu beaucoup de succès, car nous vivons dans un système étatico-corporatiste – trop de loi, trop de complexité, pas assez d’expérimentation.
Les remarques des rapporteurs ne s’appliquent d’ailleurs pas seulement à la politique de la ville. Les politiques publiques ne souffrent pas en France d’une insuffisance de moyens, mais d’un empilement des structures et d’une complexité des procédures. Tant que nous ne voudrons pas les modifier de fond en comble, nous connaîtrons des difficultés dans de nombreux secteurs. Comme le dit Gerhard Schröder, l’État-providence tout-puissant, omniprésent, qui retire à la population son pouvoir de décision et décide de tout à sa place, non seulement n’est pas viable financièrement mais est de surcroît inefficace et antihumain.
J’ai déjà souligné la nécessité d’un fonds global d’expérimentation permettant de travailler avec la population et les élus. J’ajouterai que si nous voulons redonner de l’espoir aux populations de ces quartiers, il faut absolument montrer qu’il y a des jeunes qui réussissent dans le domaine économique. Le fonds d’investissement Citizen Capital, que je connais bien, permet justement de procurer des moyens financiers à de jeunes entrepreneurs qui serviront de références et d’exemples.
M. Guy Geoffroy, vice-président de la commission des Lois, suppléant le président de cette commission. J’adhère aussi bien aux conclusions des rapporteurs qu’aux propos complémentaires tenus par les orateurs suivants : il est clair que ce Comité est un outil plein de ressources.
Lorsque j’étais enfant, je voyais avec bonheur la construction de tours, car je savais qu’elles permettraient de reloger les habitants des bidonvilles. Aujourd’hui, on démolit ces constructions devenues synonymes de malheurs. Je me pose donc cette question naïve : qu’est-ce qui peut faire que le bonheur se transforme ainsi en malheur ? C’est un véritable gâchis : cinquante ans après, non seulement on démolit ces bâtiments, mais on en vient à se dire qu’on n’aurait jamais dû les construire. Pourtant, heureusement que cela a été fait !
Il est vrai qu’un « ministère baladeur » ne constitue pas un bon signal. Les appellations ont d’ailleurs beaucoup d’importance : il faudrait non un secrétariat d’État, mais un ministère de la ville, rattaché au Premier ministre. Il n’y a en effet qu’à ce niveau que l’on peut pratiquer une politique véritablement transversale et procéder à des arbitrages interministériels.
De même, il est indispensable de favoriser la mixité sociale. La vente du patrimoine à ses occupants non seulement permet de renouveler le tissu urbain, mais elle fait des locataires des propriétaires, là où ils sont heureux de vivre. Toutefois, je m’interroge sur les pratiques en matière d’attribution de logements sociaux. Comment a-t-on pu basculer, dans certains immeubles, de la mixité sociale à l’unicité asociale ? À partir de quel moment ne fait-on plus attention au mode de peuplement ? Et qui en est véritablement responsable : l’État ? Les organismes HLM ? Les élus ? Nous n’avons pas suffisamment fait porter notre regard sur ce basculement.
M. François Goulard, rapporteur. Nous avons conscience que ce travail, auquel nous avons consacré presque un an, reste très imparfait, et qu’il y a des méthodologies à développer. Nous devons aller plus loin, mais il fallait d’abord défricher, connaître parfaitement le sujet pour déterminer ce qu’il est pertinent d’observer.
S’agissant des questions de sécurité, de drogue, de prévention de la délinquance, nous avons eu du mal à obtenir du ministère de l’intérieur des données précises. La géographie prioritaire semble ne pas correspondre à son organisation des données statistiques. Néanmoins, le problème de la drogue est mentionné dans notre rapport, notamment dans la partie relative à la contribution de la police et de la gendarmerie nationales à la politique de la ville.
Comme plusieurs d’entre vous l’ont noté, sans une volonté politique forte des élus, on n’arrive à rien, que l’on ait ou non de l’argent.
En ce qui concerne les discriminations, nous n’avons pas traité ce sujet en tant que tel faute de données objectives. Mais nous évoquons dans nos conclusions un thème qui le rejoint, celui du communautarisme. L’absence de mixité sociale, c’est bien sûr le grand nombre de pauvres, mais aussi, dans certains quartiers, l’afflux de personnes d’une certaine origine, qui deviennent numériquement dominants, et adoptent des comportements particuliers. Même si ce phénomène n’est pas reconnu par notre droit – la République est supposée une et indivisible –, il existe bel et bien. Ne pas prendre en compte cette réalité, si délicate soit-elle, serait donc négliger une dimension essentielle de la vie de certains quartiers.
Par ailleurs, l’application du droit au logement opposable a conduit à des absurdités, comme lorsqu’un préfet installe des familles dans des logements promis depuis très longtemps à d’autres dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine.
Enfin, pour répondre à Jean-François Copé, il est vrai qu’il y a des endroits où cette politique fonctionne. On peut transformer un quartier. Et s’agissant des indicateurs, ceux qui sont utilisés aux Pays-Bas sont parfaitement au point, et permettent de suivre en temps réel la situation d’un quartier précis. Cela aussi est possible, par conséquent.
M. François Pupponi, rapporteur. Il est vrai qu’en matière d’évaluation, je suis un peu resté sur ma faim. Mais encore faut-il disposer de données pour ce faire. Or le ministère de l’emploi ou celui de l’intérieur n’ont pas de statistiques très approfondies sur les zones urbaines sensibles. Aux Pays-Bas, on dispose de données quasiment pour chaque immeuble : si l’évolution est favorable, la politique est poursuivie ; dans le cas contraire, elle est modifiée. Nous n’avons pas cette culture en France. En forçant un peu le trait, on pourrait dire que certains ministères savent à peine ce qu’est une ZUS.
Quant au processus d’uniformisation évoqué par Guy Geoffroy, on en connaît le mécanisme. Ainsi, les grands ensembles construits à Sarcelles par la Caisse des dépôts ont été, pendant vingt ans, le symbole de la mixité sociale. Mais à la fin des années quatre-vingt, le propriétaire a voulu profiter des subventions afin de tout rénover et de relever sensiblement le niveau des loyers. Quitte à payer un tel prix, les habitants appartenant aux classes moyennes ont préféré déménager. Pour garantir ses loyers, la Caisse des dépôts les a donc remplacés par des ménages solvabilisées par l’aide personnalisée au logement, c’est-à-dire par des ménages plus modestes encore. C’est ainsi que l’on a fait d’une ville modèle un ghetto social et ethnique.
Il en est de même avec l’application du droit au logement opposable : les préfets chargés de reloger les populations les plus défavorisées doivent recourir à leur propre contingent, qui comprend des logements situés dans les grands ensembles. Ainsi, tout en parlant de mixité sociale, on contribue à accentuer encore les phénomènes de ghettos.
Il est possible de mieux organiser les choses dans les villes moyennes, mais un vrai problème se pose en région Île-de-France – le plus compliqué étant de favoriser la mixité sociale dans les quartiers entièrement composés de logements sociaux. À Sarcelles, il faudrait demander à 20 000 habitants de vivre ailleurs… Il arrive que les classes moyennes s’installent dans ces quartiers, dans de beaux lofts, par exemple. Mais alors, c’est la situation dans les écoles qui les fait fuir. Il existe ainsi environ 150 villes en France où il sera extrêmement difficile de favoriser la mixité sociale : elles réclament un traitement particulier.
M. le président Bernard Accoyer. Merci pour cet excellent rapport et ces échanges très instructifs. Je sais que la Commission des affaires sociales est débordée, mais il ne serait sans doute pas inutile qu’elle procède à une évaluation de la loi sur le droit au logement opposable.
À ce stade, je propose les décisions suivantes. Tout d’abord, le CEC pourrait autoriser la publication du rapport d’information de nos deux rapporteurs, incluant en annexe les deux études effectuées à leur demande.
Je transmettrai bien entendu le rapport au Premier ministre et aux ministres concernés.
Pour la suite, l’article 146-3 du Règlement prévoit que nos rapporteurs présenteront un rapport de suivi qui identifiera les mesures effectivement prises, et les points qui restent à traiter.
En tout état de cause, je vous propose de prévoir un débat sur les aides aux quartiers défavorisés lors de la plus prochaine semaine de contrôle et, six ou huit mois après, une audition du Gouvernement sur les suites données à ce rapport.
*
* *
Conformément aux dispositions de l’article 146-3 du Règlement, le Comité autorise la publication du rapport d’information, incluant en annexe les deux études effectuées à la demande des rapporteurs. Le rapport sera distribué et publié sur le site internet. Il sera transmis au Premier ministre et aux ministres concernés.
En application de l’article 146-7 du Règlement, le Comité décide de proposer à la Conférence des présidents l’inscription d’un débat en séance publique durant la prochaine semaine de contrôle sur le thème traité par le rapport.
ANNEXE : TRAVAUX DE LA MISSION
1) Auditions du groupe de travail
– M. Pascal FLORENTIN, secrétaire général adjoint du Secrétariat général du comité interministériel des villes, et M. Patrick SILLARD, sous-directeur (24 novembre 2009).
– M. Rémi FRENTZ, directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), Mme Blanche GUILLEMOT, directrice générale adjointe, M. Michel VILLAC, secrétaire général chargé de l’administration générale et M. Emmanuel DUPONT, responsable du département évaluation (8 décembre 2009).
– M. Gérard HAMEL, président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), M. Pierre SALLENAVE, directeur général, et Mme Anne PEYRICOT, directrice des relations institutionnelles (15 décembre 2009).
– Mme Christine LELÉVRIER, sociologue, chercheur au Centre de recherche sur l’espace, les transports, l’environnement et les institutions locales (PARIS XII) (19 janvier 2010).
– M. Jean-Michel BLANQUER, M. Pierre-Laurent SIMONI et M. Michel QUÉRÉ, Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) et direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’éducation nationale (26 janvier 2010).
– M. Bertrand MARTINOT, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, et M. Alain FOURNA, chargé de mission (9 février 2010)
– M. Éric JALON, directeur général des collectivités locales, du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, accompagné de Mme Juliette TRIGNAT, adjointe au chef du bureau des concours financiers de l’État (23 février 2010).
– M. Étienne CRÉPON, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (16 mars 2010).
– M. Hervé MASUREL, secrétaire général du comité interministériel des villes, accompagné de Mme Marie REY, responsable du département Acsé et contractualisation, et de M. Patrick SILLARD, sous-directeur des études statistiques, de l’évaluation et de la prospective au SG-CIV (6 avril 2010).
– Mme Dominique DUJOLS, directrice des relations institutionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, et Mme Béatrix MORA, directrice adjointe à l’action professionnelle (11 mai 2010).
– M. Frédéric PÉCHENARD, directeur général de la police nationale, M. Mathias VICHERAT, sous-préfet, chef du pôle territorial auprès du directeur général de la police nationale, et M. Thierry COUTURE, contrôleur général, chef du pôle judiciaire et prévention auprès du directeur général de la police nationale (18 mai 2010).
– M. Bernard GÉRARD, président de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux (Epareca) (25 mai 2010).
– Mme Fadela AMARA, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville auprès du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique (1er juin 2010).
– M. Jean-Luc BERHO, vice-président d’Action logement, et M. Antoine DUBOUT, président du directoire (8 juin 2010).
● Réunions de travail des rapporteurs avec :
– Mme Claire BAZY-MALAURIE, présidente de chambre à la Cour des comptes (18 novembre 2009).
– M. Patrick SILLARD, sous-directeur, et M. Anthony BRIANT, responsable de l’évaluation, à l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) (2 février 2010)
– Mme Annie FOUQUET et M. Guy CAUQUIL, Société française de l’évaluation (9 février 2010).
– MM. Alain LECONTE, Patrick LAPORTE, Didier CAUVILLE et Mme Michelle JOIGNY, Conseil général de l’environnement et du développement durable (16 février 2010).
– M. Laurent MACHUREAU, sous-directeur de la 4e sous-direction du budget, M. Fabrice PERRIN, chef du bureau 4 BVLT et Mme Lorraine PINTO, administratrice de l’INSEE (27 avril 2010).
– Mme Marie REY, responsable du département Acsé au Secrétariat général du comité interministériel des villes, et M. Olivier MONTÈS, chargé de mission (27 avril 2010).
– M. Alain GUENGANT, directeur de recherche au CNRS et professeur de finances publiques à l’université de Rennes I (6 juillet 2010).
● Réunion du groupe de travail pour examen des conclusions du rapport (6 octobre 2010).
● Déplacements :
– Clichy-sous-Bois et Montfermeil (29 mars 2010).
– Pays-Bas (25 et 26 avril 2010).
– Orléans (31 mai 2010).
– Visite sur place au siège de l’Acsé (21 juin 2010).
– Lyon (6 septembre 2010).
1 () « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »
2 () Le mandat de député de M. Pierre Cardo a pris fin le 5 juin 2010.
3 () Secrétariat général du Comité interministériel des villes – SG-CIV ; direction générale de la police nationale ; délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; direction générale de l’enseignement scolaire et direction de l’évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale ; direction générale des collectivités territoriales ; direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ; direction du budget.
4 () Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ; Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) ; Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux (Éparéca).
5 () Union sociale pour l’habitat ; Action logement.
6 () Cour des comptes, Conseil général de l’environnement et du développement durable.
7 () La loi de finances initiale pour 2010 a prévu que ce montant s’élèverait pour l’exercice 2010 à 465,78 millions d’euros.
8 () Comme il est indiqué infra, la loi prévoit que les délégués territoriaux de l’ACSÉ sont les préfets de région et de départements. Les représentants de l’État dans certaines collectivités d’outre-mer n’étant pas expressément des préfets, le SG-CIV est donc compétent pour y déléguer les crédits que l’agence délègue en règle générale par ailleurs sur le territoire national.
9 () Ce montant s’élève à 49,1 millions d’euros en 2010.
10 () Le ministre en charge de la ville ne fait pas partie des membres de droit du CIPD, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-52 du 17 janvier 2006 instituant un comité interministériel de prévention de la délinquance.
11 () Ce montant est composé des éléments suivants : l'annulation de mandats sur exercices antérieurs pour 15,958 millions d’euros, des produits financiers pour 0,646 million d’euros, des produits exceptionnels pour 0,123 million d’euros, des reprises sur amortissements et provisions pour 2,420 millions d’euros et des revenus d'immeubles pour 0,081 million d’euros.
12 () Ce montant est conforme aux informations disponibles dans le rapport annuel de performance de la mission « Ville et logement », page 113. Le Gouvernement y précise néanmoins que les mandatements correspondants sur l’exercice se sont élevés à 403,086 millions d’euros, car 3,679 millions d’euros considérés comme consommés en 2009 ont fait l’objet de mandatements en 2010, au titre d’achats de prestations telles que des évaluations, des audits, des formations ou des diagnostics.
13 () Cf. pour l’ensemble de ces points, les septième et huitième alinéas de l’article R. 121-17 du code de l’action sociale et des familles :
« 6° [Le conseil d’administration] détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;
« 7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ; »
Cf. aussi le sixième alinéa de l’article R. 121-20 du même code :
« [Le directeur général] délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration. »
14 () Cf. les trois premiers alinéas de l’article R. 121-21 du code de l’action sociale et des familles :
« Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse et dans les départements d'outre-mer, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
« Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.
« Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet. »
15 () C’est-à-dire les quartiers prioritaires de la politique de la ville, même si cette référence au « troisième alinéa » est erronée du fait d’une omission législative de coordination suite aux modifications de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Il faut lire « deuxième alinéa ».
16 () L’article R. 313-15 du code rural dispose que l’État peut confier à l’Agence des services et des paiements, établissement public qui s’est substitué depuis le 1er avril 2009 au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), par voie de convention, « le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi ».
17 () Sans compter que la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 avait initialement attribué à l’ACSÉ la mise en œuvre d’actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Cette mission a été retranchée des missions de l’ACSÉ par l’article 67 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et transférée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), établissement public administratif de l’État régi par les articles L. 121-13 du code de l’actions sociale et des familles et L. 5223-1 et suivants du code du travail.
18 () Cf. Plan de cohésion sociale, ministère de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale.
19 () Idem, page 34.
20 () Idem, page 34.
21 () Idem, page 35.
22 () Circulaire du 27 avril 2005 de la déléguée interministérielle à la ville à Mmes et MM. les préfets de départements (pour exécution) et Mmes et MM. les préfets de région (pour information et mise en œuvre de l’animation régionale), objet : mise en œuvre des programmes 15 et 16 du plan de cohésion sociale. Programme de réussite éducative.
23 () Circulaire du 14 février 2006 de la déléguée interministérielle à la ville à Mmes et MM. les préfets de région (pour information) et Mmes et MM. les préfets de département (pour attribution), objet : mise en œuvre du programme de réussite éducative.
24 () Circulaire du 11 décembre 2006 du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la Jeunesse, des sports et de la vie associative, de la ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la parité et du ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapés et à la famille à MM. les préfets de région, Mmes et MM. les préfets de département et Mmes et MM. les recteurs, objet : définition et mise en œuvre du volet éducatif des contrats urbains de cohésion sociale (Cucs).
25 () Cf. Rapport 2009 Programme de réussite éducative, l’Acsé, page 30.
26 () Idem, page 37.
27 () Idem, page 7.
28 () Cf. la circulaire du 18 décembre 2006 du délégué interministériel à la ville et du directeur général de l’ACSÉ à l’attention de MM. les préfets de région (pour information) et à Mesdames et Messieurs les Préfets de département (pour exécution), objet : gestion du dispositif adultes-relais – médiateurs de ville.
29 () L’article D. 5134-146 du même code précise qu’un adulte-relais « ne peut accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public », ne peut être employé à des fonctions relevant uniquement des services à domicile et ne peut accomplir des tâches relavant de l’activité normale des personnes morales qui les emploient.
30 () Le 5° de l’article D. 5134-151 du même code prévoit que cette condition portant sur le lieu de résidence du salarié peut faire l’objet d’une dérogation sous l’autorité du préfet.
31 () À partir de 1997, le Premier ministre ne signera plus la circulaire annuelle. Cette responsabilité incombera à compter de cette date au ministre chargé de la politique de la ville.
32 () Circulaire, du 24 mai 2006, du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité à Mme et MM. les préfets de région et Mmes et MM. les préfets de département, relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale.
33 () Idem, page 6.
34 () Rapport annuel de performances 2009, annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour 200, mission interministérielle « Ville et logement », page 113.
35 () Idem, pages 113 à 119.
36 () Ces renseignements sur le contenu des actions envisagées constituent d’ailleurs le fondement de l’instruction des dossiers de demande de subvention par les agents des préfectures chargés de cette mission pour le compte de l’ACSÉ.
37 () 32 % des intervenants subventionnés par l’ACSÉ obtiennent 2 à 4 subventions par an de la part de l’agence ; 10 % cumulent 5 à 9 subventions et 3 % 10 subventions ou plus. Les catégories d’intervenants les plus représentées dans les organismes qui cumulent plus d’une subvention sont les communes (77 % des communes bénéficiaires disposent de plus d’une subvention). Cette pratique est moins observée s’agissant des petites associations (38 %).
38 () Un dispositif analogue d’exonérations sociales est prévu, respectivement par les articles 12-1 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, s’agissant des rémunérations versées par les associations implantées dans les ZUS et dans les ZFU et s’agissant des personnes exerçant une activité non salariée non agricole dans les ZUS.
39 () Cf. notamment le conseil d’administration de l’agence du 9 février 2005 pour la définition des quartiers prioritaires et la fixation de la part des crédits dont ils bénéficient, ainsi que le conseil d’administration de l’agence du 12 juillet 2006 pour la définition des quartiers supplémentaires sur la base des besoins locaux recensés par les préfets de région.
40 () L’Union d’économie sociale pour le logement (UESL) est une société anonyme coopérative à directoire et à conseil de surveillance, paritaire entre organisations patronales et organisations syndicales représentatives des salariés. L’UESL, dont l’appellation publique est « Action Logement » depuis juillet 2009, collecte et gère la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), cotisation patronale obligatoire prélevée à hauteur de 0,45 % sur la masse salariale des entreprises de plus de vingt salariés, encore appelée communément « 1 % logement ».
41 () L’arrêté du 10 août 2009 relatif à l'échéancier de versement des subventions de l'Union d'économie sociale du logement à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine précise les dates limites des versements correspondants. Ces dates sont les suivantes :
– au titre de l'année 2009, versements de 205 millions d’euros dans les quinze jours suivant la publication de l’arrêté du 10 août 2009, de 390 millions d’euros avant le 15 octobre 2009 ; de 135 millions d’euros avant le 15 janvier 2010 et de 40 millions d’euros avant le 15 avril 2010 ;
– au titre de l'année 2010 versements de 310 millions d’euros avant le 15 avril 2010 ; de 300 millions d’euros avant le 15 juillet 2010 et de 160 millions d’euros avant le 15 octobre 2010 ;
– au titre de l'année 2011, versements de 155 millions d’euros avant le 15 octobre 2010 ; de 235 millions d’euros avant le 15 janvier 2011 ; de 350 millions d’euros avant le 15 avril 2011 et de 30 millions d’euros avant le 15 juillet 2011.
42 () Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du Comité interministériel des villes, pages 131 et 132.
43 () Fonds européen de développement régional. Il s’agit de l’une des modalités d’intervention des fonds structurels européens au bénéfice de certaines régions européennes en difficulté.
44 () Il est vrai cependant que les premières années sont rarement bénéficiaires pour les entreprises ou activités nouvellement créées.
45 () Cf. l’avant-dernier alinéa de l’article 44 octies A du code général des impôts.
46 () Les troisième à sixième alinéas de l’article 44 octies A du code général des impôts précisent que :
« Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
« b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
« d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. »
47 () Cf. les deuxième à sixième alinéas du VI de l’article 44 octies du code général des impôts.
48 () Suivis d’une sortie « en sifflet » pendant neuf ans sur le modèle du dispositif applicable en matière d’imposition sur les bénéfices pour les entreprises de moins de cinq salariés.
49 () Dans la limite du montant de base nette imposable fixé en 2006 à 337 713 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
50 () Ces conditions étaient identiques à celles précisées supra s’agissant de l’article 44 octies A du code général des impôts. Par contre, les conditions relatives à la nature de l’activité prévues par cet article n’étaient pas applicables s’agissant de l’exonération de taxe professionnelle.
51 () Dans une limite analogue à celle prévue pour le dispositif prévu par le I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts.
52 () Dans une limite analogue à celle prévue pour le dispositif prévu par le I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts.
53 () Ce dispositif était aussi assorti d’une fin « en sifflet ».
54 () Alors que la taxe professionnelle était assise, en règle générale, sur la valeur locative des immobilisations corporelles des entreprises, la cotisation foncière des entreprises est un impôt assis sur la valeur locative des biens des entreprises soumises à une taxe foncière. Cf. l’article 1467 du code général des impôts dans sa version en vigueur et dans sa version antérieure à la suppression de la taxe professionnelle par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
55 () La lecture de ces dispositifs n’est pas aisée car ils sont liés dans leur mise en œuvre aux dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, qui, d’une certaine façon s’est partiellement substituée à la taxe professionnelle. Or, en l’espèce, toutes les conséquences liées à la suppression de cette imposition n’ont, à ce jour, pas encore été tirées s’agissant des dispositifs d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les ZFU.
56 () Cf. l’article 223 septies du code général des impôts.
57 () Depuis la révision issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution dispose que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».
58 () Ce « pouvoir d’achat » est ici exprimé en termes de potentiel fiscal, qui constitue une mesure des ressources potentielles des collectivités territoriales associant la fiscalité directe locale et la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.
59 () Il convient bien entendu de souligner que l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle. En conséquence, il sera prochainement nécessaire de repenser un outil de mesure de la richesse fiscale potentielle des collectivités territoriales, compte tenu par ailleurs des taxes créées à l’occasion de cette suppression, c’est-à-dire notamment la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui composent la contribution économique territoriale des entreprises en application du nouvel article 1447-0 du code général des impôts.
60 () Les autres composantes de la dotation forfaitaire de la DGF sont une dotation de base calculée en fonction du nombre d’habitants de la commune et de la strate démographique à laquelle elle appartient, une dotation proportionnelle à la superficie de la commune et modulée selon que la commune est située ou pas en zone de montagnes, une dotation « de compensations » de la suppression de certaines bases de fiscalité locale (notamment la part salaires de la taxe professionnelle) et une dotation au titre de l’appartenance de la commune au cœur d’un parc national. Cf. respectivement les 1° à 3° et 5° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
61 () D’autant plus, comme il est précisé infra, que les ZFU ont été délimitées selon des critères objectifs.
62 () Cf. l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales.
63 () Dans cette strate démographique, 15 communes ont une population en ZUS sans être éligibles à la DSU-CS et, donc, une seule d’entre ces 15 communes a une population en ZUS supérieure à 20 % de sa population totale.
64 () La population de cette commune représente presque 20 % de la population totale des communes éligibles à la DDU, y compris les communes des DOM.
65 () L’établissement public a été créé par le décret n° 2005-887 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
66 () Le rapport sur l’audit de l’établissement public d’insertion de la défense réalisé par le contrôle général des armées, le contrôle général économique et financier et l’inspection générale des affaires sociales a été transmis à vos rapporteurs dans le cadre de leur mission. À ce rapport était jointe une note de la direction générale de l’Épide datant de fin 2009 sur les travaux entreprise suite à l’audit.
67 () Le contrat d’objectifs et de moyens 2009-2011 de l’Épareca, signé par quatre ministres et le président du conseil d’administration de l’Épareca, prévoit que « la dotation 2011, prévue à hauteur de 10,5 millions d’euros à ce stade, fera l’objet d’une recherche de partenariat financier entre les trois tutelles principales de l’établissement ».
68 () L’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 prévoit expressément que les subventions de la CDC sont une des composantes des ressources de l’ANRU.
69 () Ce chiffrage 2009 contient la subvention versée au titre du programme 147 à l’Épide mais ne tient pas compte des paiements opérés en 2009.
70 () Cf. rapport annuel de performance 2009, mission interministérielle « Ville et logement », page 102.
71 () Ces montants sont ceux transmis par la direction du budget. Le DPT « Ville » annexé au projet de loi de finances pour 2010 prévoit des montants légèrement différents pour les crédits de paiement en 2009 (121,5 millions d’euros) et en 2010 (337 millions d’euros), ce qui ne modifie d’ailleurs pas le total des crédits de paiement et autorisations d’engagement pour l’ensemble de la période 2009-2010.
72 () Étant entendu qu’ils concourent à la politique de la ville, dans l’« esprit » du DPT « Ville ».
73 () Contrat d’objectifs et de performance entre l’État et l’agence nationale pour la rénovation urbaine 2010-2012, acté par son conseil d’administration le 7 juillet 2010.
74 () Dans le rapport (n° 2268, 27 janvier 2010) fait par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et présenté par notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, est évoquée l’imprécision des actions censées être concernées par ces crédits (page 30). Pour sa part, la commission des Finances du Sénat avait proposé en séance publique la suppression de ces crédits, faute de réponse satisfaisante du Gouvernement sur leur modalité de gestion et leur objet (cf. le rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat par Philippe Marini, [2009-2010], 9 février 2010, n° 278, pages 124 et 125). Il est vrai qu’à l’époque, leur gestion par l’ANRU n’avait pas encore été actée. Il n’est pas certain pour autant que leur objet soit aujourd’hui mieux défini qu’au moment de la discussion du projet de loi de finances rectificative.
75 () Cf. l’article L. 120-2 du code du service national. Les autres membres légalement constitutifs de l’Agence du service civique sont l’État, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires.
76 () Cf. le rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n° 1946), par M. Gilles Carrez, rapporteur général ; annexe n° 47, Ville et logement – Ville, rapporteur spécial M. François Goulard, pages 19 et 20. L’hypothèse haute fixait les besoins de financement de l’ANRU en 2010 à presque 1 400 millions d’euros.
77 () Le décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction prévoit notamment une contribution d’Action Logement au financement de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) à hauteur de 480 millions d’euros pour chaque année 2009 à 2011.
78 () Rapport sur l’évaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité locale et sur les entreprises, établi sous la supervision de M. Bruno Durieux, inspecteur général des finances et de M. Pascal Subremon, inspecteur général de l’administration (Mai 2010).
79 () Idem, page 48.
80 () Tous les dispositifs de péréquation actuels en matière de politique de la ville s’appuient sur un tel indice de charges, par exemple en prenant en compte la part des personnes bénéficiant d’une aide légale au logement ou encore la présence d’une ZUS ou d’une ZFU dans la commune considérée. L’enjeu ici serait de trouver des critères peut-être moins exclusivement rattachés aux charges qui sont celles des communes qui ont des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou, à tout le moins, d’associer à ceux-ci d’autres critères prenant en compte d’autres catégories de charges.
81 () Le PLF pour 2011 prévoit des modalités particulières de prorogation des FDPTP en 2011 (article 18) et du FSRIF (article 86).
82 () Le Comité des finances locales a pour mission, au terme de l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, d’établir « un rapport sur la situation financière des collectivités locales ». Le même article précise que cette mission, ainsi que les autres missions qu’il prévoit, « peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité. »
83 () Cf. les finances des collectivités locales en 2010 : état des lieux, par l’observatoire des finances locales, page 219. Ce constat est issu d’une évaluation de l’efficacité péréquatrice des dotations basée sur une « méthodologie développée par les professeurs Guy Gilbert et Alain Guengant sous l’égide du Commissariat général du Plan [permettant] de mesurer le taux de correction, grâce aux dotations de l’État, des inégalités de ressources des collectivités territoriales corrigées en fonction de leurs charges. » ; Cf. le même rapport, page 219. À titre d’illustration chiffrée des travaux des professeurs Guy Gilbert et Alain Guengant, ils ont établi que le taux de correction des inégalités de pouvoir d’achat (du fait des transferts financiers de l’État) entre communes a baissé entre 2001 et 2006 de 36,9 % à 39,2 %.
84 () Cf. le rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur la péréquation (vers une dotation globale de péréquation ? À la recherche d’une solidarité territoriale) par MM. Jacques Mézard et Rémy Pointereau, n° 309 (session ordinaire de 2009-2010), enregistré à la présidence du Sénat le 23 février 2010.
85 () Cf. le rapport sur la fiscalité locale, fait par le Conseil des prélèvements obligatoires, mai 2010, notamment pages 51 et 52.
86 () Cf. la Conférence sur les déficits publics, rapport du groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales, présidée par Gilles Carrez et Michel Thénault, 20 mai 2010, notamment pages 17 et 18.
87 () Circulaire, du 24 mai 2006, du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité à Mme et MM. les préfets de région et Mmes et MM. les préfets de département, relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale.
88 () Idem, page 2.
89 () Idem, page 2.
90 () Cf. la même circulaire du 24 mai 2006, page 3.
91 () Délégation interministérielle à la ville, dont les moyens ont été répartis entre le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV) et l’ACSÉ au moment de la création de cet établissement public.
92 () Comité interministériel des villes.
93 () Notamment : le directeur général de l’enseignement scolaire, le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général des collectivités territoriales, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, et le directeur général de la police nationale.
94 () Document de politique transversale, projet de loi de finances pour 2010, Ville, pages 7 et 8.
95 () Idem, pages 14 à 39.
96 () Idem, page 17.
97 () Sans qu’il soit précisé s’il s’agit de privilégier des personnes résidentes en ZUS ou si l’entreprise créée ou reprise doit y être implantée.
98 () Document de politique transversale, projet de loi de finances pour 2010, Ville, page 32.
99 () Idem, page 33.
100 () Idem, page 81.
101 () Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.
102 () L’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public administratif régi par le décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004.
103 () Document de politique transversale, projet de loi de finances pour 2010, Ville, page 20.
104 () Sur ce point, le rapport annuel de la Cour des comptes de 2009, dans un développement intitulé « L’AFITF : une agence de financement aux ambitions limitées, privée de ses moyens, désormais inutile », relève ce « circuit financier surprenant : En effet, environ 65 % des ressources de l’agence proviennent d’une subvention inscrite au budget général de l’État et y retournent sous forme de versements de fonds de concours. ». Cf. le rapport annuel de la Cour des comptes de 2009, page 201.
105 () Réalisée à la demande de la commission des Finances du Sénat en application du 2° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, cette étude a fait l’objet d’une communication adressée à cette commission et a été publiée en annexe au rapport d’information sur l’articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’Éducation nationale dans les quartiers sensible, fait au nom de cette commission par MM. Philippe Dallier et Gérard Longuet n° 81 (2009-2010, enregistré à la présidence du Sénat le 3 novembre 2009) ; cf. ici, page 34 de la communication de la Cour des comptes adressée à la commission des Finances du Sénat.
106 () Annexe au rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat par MM. Philippe Dallier et Gérard Longuet n° 81 (2009-2010, enregistré à la présidence du Sénat le 3 novembre 2009), page 4.
107 () Circulaire n° 2009-061 du 28 avril 2009 du ministre de l’éducation nationale et par délégation du directeur général de l’enseignement scolaire – deuxième phase du volet éducation de la dynamique « Espoir banlieues ».
108 () Circulaire n° 2008-174 du 18 décembre 2008 du ministre de l'éducation nationale et de la secrétaire d'État chargée de la Politique de la ville – décrochage scolaire : mise en œuvre des décisions du Comité interministériel des villes du 20 juin 2008.
109 () Cf. la ligne n° 1128 « Mesures de lutte contre l'absenthéisme et le décrochage scolaire » de la nomenclature ACSÉ, financée en totalité sur les crédits dont elle a bénéficié au titre du plan de relance dans son volet « emploi ».
110 () Dans les communes de Barcelonette (Alpes-de-Haute-Provence), Cachan (Val-de-Marne), Douai (Nord), Langres (Haute-Marne), le Havre (Seine-Maritime), Maripasoula (Guyane), Marly-le-Roi (Yvelines), Metz (Moselle), Montpellier (Hérault), Nice (Alpes-Maritimes) et Noyon (Oise).
111 () En 2009, la ligne n° 1126 « Internats d'excellence » de la nomenclature de l’ACSÉ indique une participation de l’agence pour un montant de 2,681 millions d’euros, financés en quasi-totalité sur les crédits dont elle a bénéficié au titre du plan de relance dans son volet « emploi ».
112 () Annexe au rapport d’information fait au nom de la commission des Finances du Sénat par MM. Philippe Dallier et Gérard Longuet déjà citée.
113 () Cf. la ligne n° 1122 « Accompagnement scolaire » de la nomenclature ACSÉ, financée en totalité sur les crédits dont elle a bénéficié au titre de la politique de la ville.
114 () Cf. pour les détails de la mise en œuvre de cette expérimentation la circulaire du 21 mai 2008 du ministre de l’éducation nationale et de la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, relative à l’expérimentation de la mixité scolaire choisie, dite busing, au sein des communes volontaires, pour y contribuer à l’égalité des chances.
115 () Dont Oullins, Rillieux-la-Pape, Courcouronnes, Bergerac, Asnières-sur-Seine et Dugny.
116 () 7 lycées polyvalents, 10 lycées professionnels et 13 lycées généraux et technologiques ont été choisis pour constituer les 30 sites d’excellence dans quatorze académies de la France métropolitaine en 2009.
117 () Une circulaire n° 2009-152 du 27 octobre 2009 du directeur général de l’enseignement scolaire (pour le ministre de l’éducation nationale), a modifié la liste des lycées concernés, amenant le nombre des établissements concernés à 206.
118 () Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du Comité interministériel des villes.
119 () Document de politique transversale, projet de loi de finances pour 2010, Ville, page 80. Il faut par ailleurs noter l’apport très substantiel du programme 316 « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi » qui, pour 2009 et 2010, devrait concourir à la politique de la ville à hauteur de 458 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ce concours est de même nature que celui du programme 102 : il s’agit du coût de contrats aidés. Les modalités de calcul de la part censée concourir à la politique de la ville sont analogues s’agissant de ces deux programmes 102 et 316.
120 () Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du Comité interministériel des villes, pages 38 et 39.
121 () Ce taux s’élève à 16,2 % pour la tranche d’âge des moins de 26 ans
122 () Cf. les articles L. 5134-25-1 et L. 5134-69-1 du code du travail, qui prévoient que cette durée peut être portée jusqu’à cinq ans si les bénéficiaire sont des « salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, [ou des] personnes reconnues travailleurs handicapés ».
123 () Circulaire DGEFP n° 2006/39 du 15 décembre 2006 du ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, programmation territorialisée des politiques de l’emploi 2007.
124 () Circulaire DGEFP n° 2008-02 du 17 janvier 2008 du ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi relative à la programmation territorialisée des politiques de l’emploi en 2008.
125 () En autorisations d’engagement comme en crédits de paiement.
126 () Même remarque.
127 () Cet objectif n’est pas négligeable, compte tenu du fait que le contrat d’autonomie n’est proposé que dans 35 départements, même en considérant qu’il s’agit des départements les plus concernés par le problème de l’emploi de jeunes en milieu urbain ; selon le rapport de l’ONZUS pour 2009, 20 % des chômeurs de catégorie 1 dans les ZUS ont moins de 25 ans, ce qui constitue un effectif de chômeurs de moins de 25 ans dans les ZUS de 55 155. Si le taux de 20 % est appliqué s’agissant des chômeurs de toutes les catégories, l’effectif des chômeurs de moins de 25 ans en ZUS s’élève à 85 764.
128 () Document de politique transversale, projet de loi de finances pour 2010, Ville, page 80. Ce document est celui auquel renvoient les notes de bas de page suivantes.
129 () Idem, page 83.
130 () Idem, page 81.
131 () L’état 4001 est la source administrative relevant les délits et crimes constatés par les services de police, de gendarmerie et la préfecture de police de Paris (selon une nomenclature différente pour la capitale), c’est-à-dire les crimes ou délits portés à la connaissance de ces services ou découverts par ceux-ci. L’État 4001 concerne exclusivement les faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire transmise au parquet (à la suite d’une plainte ou d’une enquête de police pour les faits les plus graves). Il exclut donc : les contraventions de toute nature et les délits routiers qui, tout en étant portés à la connaissance des services, ne sont pas enregistrés dans l’outil de statistique officiel ; l’intégralité des infractions au séjour des étrangers et des faits portés sur la main courante ; les infractions constatées par d’autres institutions (douanes, inspections du travail, répression des fraudes).
132 () Idem page 28.
133 () Idem page 28.
134 () Idem, page 83.
135 () Idem, page 24.
136 () Idem, page 24.
137 () Idem, page 25.
138 () Idem, page 82.
139 () Idem, page 26.
140 () Idem, page 27.
141 () Idem, page 36.
142 () Idem, page 83.
143 () Idem, page 37.
144 () Idem, page 37.
145 () Idem, page 37.
146 () Idem, pages 34 et 84.
147 () Sur la base du recensement 2006 et en prenant en compte les habitants résidant en ZUS ou dans les quartiers CUCS non ZUS en France et dans les départements d’outre-mer, ce taux s’élève à 12,9 %.
148 () Idem, page 84.
149 () Annexe au rapport d’information fait au nom de la commission des Finances du Sénat par MM. Philippe Dallier et Gérard Longuet n° 81 (2009-2010, enregistré à la présidence du Sénat le 3 novembre 2009).
150 () Document de politique transversale, projet de loi de finances pour 2010, Ville, page 108.
151 () Qui, il est vrai, n’existait pas à l’époque puisqu’elle a été instituée en 1999.
152 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 6.
153 () C’est-à-dire le revenu au-dessus et en dessous duquel se situent 50 % des revenus en France par unité de consommation. Le revenu médian annuel par unité de consommation s’établissait en 2006 à 17 600 euros.
154 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 26. Le même document, page 7, précise que les contrats de ville 2000-2006 concernaient 1 500 quartiers.
155 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 9.
156 () Le taux constaté aujourd’hui s’élèverait à 72 %, selon des informations fournies par l’ANRU, étant entendu que l’objectif demeure un taux à 70 % une fois le PNRU achevé.
157 () Il faut préciser qu’à cette époque le conseil d’administration de l’ANRU a regroupé certaines de ces ZUS contiguës afin de constituer des quartiers ayant un nombre suffisant d’habitants pour prétendre être prioritaires. Ceci explique que ces 215 quartiers soient devenus 189 à la suite de ce conseil d’administration.
158 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 10.
159 () Idem, page 15.
160 () Idem, page 14.
161 () Les « unités de consommation » sont un concept statistique permettant d’individualiser les informations relatives à la richesse des ménages, compte tenu des effets d’échelle propres au nombre des personnes qui les composent. Selon l’OCDE, le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation, les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3. Ainsi un ménage constitué d’un couple et deux enfants de moins de 14 ans « correspond » à 2,1 unités de consommation. Le revenu par unité de consommation, identique pour chacun des quatre membres du ménage, est obtenu en divisant son revenu fiscal par 2,1.
162 () Le seuil de 50 % est traditionnellement utilisé en France, notamment par l’INSEE. L’analyse est désormais souvent complétée par des données correspondant à un seuil de 60 % du revenu médian moyen, référence utilisée par Eurostat et beaucoup de pays européens.
163 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 65.
164 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 29.
165 () Rapport fait à la demande de M. François Fillon, Premier ministre, sur la révision de la géographie prioritaire et la contractualisation de la politique de la ville « une conception rénovée de la politique de la ville : d’une logique de zonage à une logique de contractualisation » par M. Gérard Hamel, député d’Eure-et-Loir et M. Pierre André, sénateur de l’Aisne, avec l’appui de l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales, septembre 2009.
166 () Cf. le même rapport, page 9.
167 () Idem, page 21.
168 () Cf. le même rapport, page 23. Il s’agit d’une citation de l’association « Question de ville », qui représente les directeurs des centres de ressources de la politique de la ville.
169 () Le rapport de la mission André-Hamel précise que « concrètement, le niveau d’intervention de l’État varierait selon un barème en plusieurs tranches, sur le modèle de l’ANRU. Des marges de manœuvre devraient toutefois être laissées aux préfets afin qu’ils puissent faire varier le montant engagé par l’État dans des limites précises tenant compte du contexte local ». Cf. le même rapport, page 39.
170 () Cf. le même rapport, page 26.
171 () Cf. le même rapport, page 34.
172 () Ce décalage pourrait être de neuf mois selon la mission André-Hamel. Cf. le même rapport page 35.
173 () Cf. le même rapport, page 35.
174 () Le rapport de la mission André-Hamel est très prudent sur ce point et semble pencher pour l’exclusion de la DSU-CS du contrat. Cf. le même rapport pages 34 et 45.
175 () Cf. l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.
176 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 37.
177 () Rapport fait à la demande de M. François Fillon, Premier ministre, sur la révision de la géographie prioritaire et la contractualisation de la politique de la ville « Une conception rénovée de la politique de la ville : d’une logique de zonage à une logique de contractualisation » par M. Gérard Hamel, député d’Eure-et-Loir et M. Pierre André, sénateur de l’Aisne, avec l’appui de l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales, septembre 2009, page 41.
178 () Le cas des logements sociaux qui ne sont pas aujourd’hui situés en ZUS, et qui donc n’ouvrent pas droit à cet abattement, mais qui sont implantés sur le territoire d’une commune qui bénéficierait d’un nouveau contrat de politique de la ville, ne semble pas complètement éclairci par le rapport de la mission André-Hamel.
179 () Pour ces dispositifs, la question de leur extension au territoire de toute la commune signataire d’un nouveau contrat de politique de la ville est également posée. Il est difficile cependant de mettre fin à une logique associant le zonage et les dispositifs sans, dans le même temps, envisager une telle extension. Ce point nécessiterait sans doute une réflexion approfondie.
180 () Pour chaque avance remboursable consenti par un établissement bancaire, celui-ci bénéficie d’un crédit d’impôt.
181 () Rapport de Pierre André et Gérard Hamel, page 44.
182 () Avec un intermède du 3 juin 1992 au 26 décembre 1992, pendant lequel M. François Loncle fut secrétaire d’État chargé de la ville auprès du Premier ministre.
183 () Comme précisé infra, un ministre délégué chargé de la ville, M. Claude Bartolone, lui a été adjoint à compter du 30 mars 1998
184 () À compter du 17 juin 2002 pour l’attribution relative à la rénovation urbaine.
185 () Ce changement, en janvier 2009, a correspondu au début du premier exercice budgétaire pour lequel le budget de l’État n’a plus contribué aux dépenses d’investissement de l’ANRU.
186 () Ce décret porte création d’un Conseil national et d’un Comité interministériel des villes et du développement social urbain et d’une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.
187 () L’article 2 du décret n° 94-615 du 12 juillet 1994 a supprimé la participation des membres du Gouvernement au Conseil national des villes.
188 () Le secrétaire général du Comité interministériel des villes demeure néanmoins le responsable administratif du programme 147.
189 () Cf. l’article 2 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
190 () Par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre en charge de la politique de la ville. Cf. l’article 3 du décret du 9 février 2004.
191 () Cf. l’article R. 121-14 du code de l’action sociale et des familles.
192 () Par décret, sur proposition des ministres de tutelle. Le président du conseil d’administration est nécessairement l’une des personnalités qualifiées membres du conseil. Cf. l’article R 121-15 du code de l’action sociale et des familles.
193 () En cours de signature, ce projet, qui couvrirait la période allant jusqu’au 31 décembre 2013, devrait être paraphé par M. Éric Woerth, ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique et par Mme Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville.
194 () Le projet de COP de l’ACSÉ, évoquant le rôle du SG-CIV dans sa tâche d’assistance auprès du ministre chargé de la ville, devrait ainsi préciser que « le SG–CIV assure […] la préparation du budget de l’Acsé et en négocie les éléments à l’occasion des conférences budgétaires à la préparation desquelles l’Acsé est associée ; il instruit l’ensemble des dossiers soumis au conseil d’administration de l’ACSÉ, notamment les décisions budgétaires, en lien avec le contrôle économique et financier de l’établissement, et le programme annuel d’intervention ; il valide les délibérations du conseil d’administration. »
195 () D’ailleurs, le projet de COP de l’ANRU, qui devrait couvrit la période allant jusqu’au 31 décembre 2012, devrait être signé non seulement par M. Éric Woerth et Mme Fadela Amara, mais aussi par M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et par M. Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme auprès de M. Jean-Louis Borloo. M. François Baroin, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État devrait aussi signer ce COP.
196 () La direction du budget, au terme d’un travail important et minutieux, considère néanmoins que « la faible crédibilité des données utilisées incite à relativiser les résultats obtenus ».
197 () Sauf pour la partie transport de la DEB, qui est intégrée dans la ligne concernant le ministère de l’écologie. Il s’agit dans ce domaine d’autorisations d’engagement.
198 () Le rapport d’information de notre collègue sénateur M. Philippe Dallier sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la politique de la ville montre bien à quel point la question des délais de paiement a été et semble encore aiguë pour un certain nombre d’opérateurs. Cf. le rapport fait au nom de la commission des Finances du Sénat, n° 514, session ordinaire de 2009-2010, enregistré à la présidence du Sénat le 1er juin 2010, notamment pages 28 et 29.
199 () Ce point avait déjà été étudié par M. Philippe Pémezec dans le rapport d’information déposé par la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, n° 3752, douzième législature, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2007. Voir notamment les pages 13 et 25 à 32.
200 () Audit de la procédure de l’Agence nationale pour la rénovation urbain, réalisé par MM. Stéphane Poulain, Pierre Ponroy, Patrick Laporte, Henry Alexandre et Mme Virgine Duboy-Fernandes, édition du Conseil général de l’environnement et du développement durable, 26 octobre 2009.
201 () Cf. le même rapport d’audit, pages 8 et 9.
202 () Cf. le e de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et le I de l’article R. 313-19-5 du même code qui, respectivement, prévoient le principe du versement d’une contribution d’Action Logement au financement du PNRQAD et le versement de cette contribution à l’ANRU. Cf. aussi l’article 1er du décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction qui fixe cette contribution à 10 millions d’euros en 2009, 45 millions d’euros en 2010 et 95 millions d’euros en 2011.
203 () Ce décret fixe une première liste de 36 quartiers pour lesquels le PNRQAD permet le financement d’opérations d’investissement. Il fixe une seconde liste de 17 quartiers pour lesquels le PNRQAD porte « sur la réalisation d’études et sur l’ingénierie ». L’ANRU, selon son projet de COP la liant à l’État, devrait participer au financement des opérations concernant les quartiers de la seule première liste.
204 () On rappelle ici les critères d’éligibilité des collèges concernés : bâti dégradé, manque de mixité sociale, persistance de la faiblesse des résultats scolaires et désaffection des élèves et des enseignants.
205 () Au surplus, en l’absence de DDCS, certains agents de la direction départementale interministérielle affectés à l’instruction des demandes de subvention pour l’ACSÉ sont aussi affectés à des tâches pour le compte du ministère de l’Intérieur. Pour des raisons de confidentialité tenant à ces tâches, ces agents doivent travailler sur deux postes informatiques différents, le ministère de l’Intérieur n’ayant pas souhaité que l’application propre au traitement des demandes de subvention en matière de politique de la ville soit installée sur le poste sur lequel sont installées les applications relatives aux tâches effectuées pour ce ministère.
206 () Révision générale des politiques publiques, audit de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, rapport final de la mission (composée de M. Gildas le Coz, inspecteur général des affaires sociales, Mme Nathalie Infante, inspecteur de l’administration, M. Michel Legendre, contrôleur économique et financier et Mme Marguerite Moleux, inspecteur des affaires sociales), octobre 2009. Cf. notamment les pages 20 à 23.
207 () Cf. le même rapport d’audit page 2.
208 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 37.
209 () À titre illustratif, on peut évoquer les services déconcentrés de l’État, les services de Pôle emploi, les missions locales, les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), les maisons de l’emploi, les autres organismes de placement dont, notamment, les titulaires des lots attribués dans le cadre de l’appel d’offre relatif à la mise en œuvre du contrat d’autonomie.
210 () Cf. décret du 28 janvier 1991 du Président de la République portant nomination (administration préfectorale) ; NOR: INTA9020019D.
211 () 30 ZFU sur les 100 de l’effectif sont situées dans ces départements.
212 () Circulaire du Premier ministre n° 5319/SG du 30 juillet 2008 à mesdames et messieurs les préfets de région et mesdames et messieurs les préfets de département, relative à la mise en place des délégués du préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
213 () Courrier conjoint du 16 mars 2009 de M. Brice Hortefeux, ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de Mme Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville.
214 () La liste de ces quartiers a fait l’objet d’une publication par un arrêté du 11 décembre 2008 de la ministre du logement et de la ville et de la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville.
215 () Circulaire du 21 décembre 2009 de la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville à mesdames et messieurs les préfets de région et mesdames et messieurs les préfets de département sur les délégués du préfet.
216 () Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation, document pour la concertation, mars 2009, délégation interministérielle à la ville, page 35.
217 () Cette disposition ne serait pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
218 () L’article 16 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, voté conforme par le Sénat en deuxième lecture, dispose que ces schémas peuvent prévoir « la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres ». Il prévoit aussi que l’une des orientations que les schémas prennent en compte est « l’accroissement de la solidarité financière ». Il conviendra, sans préjudice bien entendu des autres orientations fixées par le législateur, que l’élaboration de ces schémas envisage des regroupements d’EPCI existants, situés dans les mêmes bassins de vie et d’emplois, et dont les créations distinctes n’ont parfois pour origine que la volonté de limiter la solidarité financière à la portion congrue.
219 () Le texte prévoit que la métropole « est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ». L’« apport » d’une métropole par rapport à une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération serait le transfert, de plein droit ou par convention, au nouvel EPCI de certaines compétences des départements et des régions.
220 () Le texte permet par ailleurs d’ouvrir cette faculté pour la communauté urbaine de Strasbourg, qui compte aujourd’hui 474 000 habitants.
221 () Il s’agit donc des communautés urbaines de Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Nice. Le projet de loi ne modifierait pas les compétences en matière de politique de la ville des communautés urbaines et d’agglomération dans leur rédaction en vigueur.
222 () Il existait néanmoins trois enveloppes thématiques non fongibles pour chaque commune portant respectivement sur l’aménagement urbain, le social et l’intégration et le développement économique.
223 () Auxquels s’ajoutent de 250 millions d’euros par an apportés par les « corporations » de logement, organismes analogues aux organismes de logements sociaux français.
224 () Malgré toutes les imperfections des divers zonages de politique de la ville, on peut estimer que, dans ces quartiers, sont concentrées les difficultés économiques et sociales les plus lourdes.
225 () Il paraît légitime de continuer à raisonner ici compte non tenu de la DSU-CS et du FSRIF ; les crédits correspondants à ces dotations sont en effet difficilement assignables à un quartier en particulier.
226 () C’est-à-dire pour lesquels un dossier a été soumis au comité national d’engagement de l’ANRU.
227 () Même avec la réserve que seules les ZFU en quartier CUCS de priorité n° 1 sont prises en compte ici, ce taux demeure réaliste.
228 () C’est-à-dire le rapport entre les 1,26 million d’habitants en ZFU considérés comme concernés par le PNRU et la population totale concernée par le PNRU.
229 () Cette hypothèse minore sans doute l’estimation : il est probable qu’une grande proportion des ZFU concernées par le PNRU soient des quartiers prioritaires au titre du PNRU.
230 () Nous prenons comme base de ce calcul les crédits consommés par l’ANRU en 2009 (995 millions d’euros). Ce montant constaté n’est pas aberrant du point de vue de l’ensemble du PNRU : si 12 milliards d’euros sont effectivement dépensés sur des crédits nationaux au titre du PNRU et que l’on considère qu’ils le seront effectivement sur une période d’environ 12 ans (2004-2016), l’aide publique annuelle lissée sur la période ne devrait s’élever qu’à environ 1 milliard d’euros par an.
231 () Ce montant est donc composé, pour 2009, des crédits consommés par l’ACSÉ au titre de la politique de la ville, des crédits ANRU consommés, et du coût des dépenses fiscales et sociales. En sont donc exclus, par rapport au total de référence ayant permis supra la comparaison avec la « politique des quartiers » menée aux Pays-Bas et eu égard à leur montant limité et aux difficultés à déterminer leur proportion allant dans les ZFU, la subvention à l’Épide du programme 147, les crédits directement gérés par le SG-CIV et la DDU.
232 () Ce choix ne reflète pas complètement la réalité constatée dans le rapport annuel de performance 2009 de la mission interministérielle « Ville et logement », page 90, compte tenu des renseignements donnés par l’indicateur « Part des crédits consacrés aux quartiers prioritaires (hors compensation des allègements de charges sociales) ». Ces renseignements sont cependant difficiles à exploiter puisqu’ils ne tiennent pas compte des CUCS contenant des quartiers prioritaires de niveaux de priorité différents. Au demeurant, s’appuyer en l’espèce sur les objectifs de l’ACSÉ en matière de répartition de ses crédits permet d’observer des ordres de grandeur crédibles.
233 () Dans le cadre d’un appel d’offres.
234 () Cour des comptes, rapport au Président de la République sur la politique de la ville suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés, février 2002.
235 () Également dans le cadre d’un marché public sur appel d’offres.
236 () Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 5.
237 () Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 96.
238 () Les « unités de consommation » sont un concept statistique permettant d’individualiser les informations relatives à la richesse des ménages, compte tenu des effets d’échelle propres au nombre des personnes qui les composent. Selon l’OCDE, le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation, les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3. Ainsi un ménage constitué d’un couple et deux enfants de moins de 14 ans « correspond » à 2,1 unités de consommation. Le revenu par unité de consommation, identique pour chacun des quatre membres du ménage, est obtenu en divisant son revenu fiscal par 2,1.
239 () Cf. le même rapport, page 103.
240 () Cf. le même rapport, page 112.
241 () Cf. le même rapport, page 97.
242 () Cf. le même rapport page 249.
243 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2005, les éditions de la DIV, page 24.
244 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 42.
245 () Selon le projet annuel de performances de la mission interministérielle « Ville et logement » annexé au projet de loi de finances pour 2011, 28 832 jeunes étaient « entrés » dans le dispositif au 30 juin 2010. Cf. ce document, page 148.
246 () Si le taux des sorties positives s’établissait in fine à 40 % pour 45 000 contrats ayant effectivement coûté 250 millions d’euros, chaque sortie positive aurait presque coûté 14 000 euros.
247 () Cf. Insertion, les chiffres au 30 juin 2009, Agence nationale pour la rénovation urbaine, page 33.
248 () Cf. la Charte nationale d’insertion applicable aux porteurs de projets et aux maîtres d’ouvrage contractant avec l’ANRU.
249 () Cf. Insertion, les chiffres au 30 juin 2009, Agence nationale pour la rénovation urbaine, page 19.
250 () Cf. Insertion, les chiffres au 30 juin 2009, Agence nationale pour la rénovation urbaine, page 17.
251 () Cf. Insertion, les chiffres au 30 juin 2009, Agence nationale pour la rénovation urbaine, page 28.
252 () Cf. Insertion, les chiffres au 30 juin 2009, Agence nationale pour la rénovation urbaine, page 23.
253 () Cf. Insertion, les chiffres au 30 juin 2009, Agence nationale pour la rénovation urbaine, page 29.
254 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, pages 54 et 55.
255 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, pages 65.
256 () Idem.
257 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 71.
258 () Idem.
259 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 78.
260 () Ce constat est différent s’agissant des ZRU : l’écart déjà défavorable en 2003 par rapport à la fois aux ZUS et aux ZFU est aggravé, dans des proportions non négligeables, en 2008.
261 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 8.
262 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 103.
263 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 8.
264 () Cette majoration est de 5 000 euros par salarié pour un plafond du bénéfice exonéré s’élevant à 100 000 euros.
265 () Zones franches urbaines : quels effets sur l’emploi salarié et les créations d’établissement ? Roland Rathelot et Patrick Sillard, décembre 2007, Institut national de la statistique et des études économiques.
266 () Cf. cette étude, page 24.
267 () Cf. cette étude, page 25.
268 () Cf. cette étude, page 30.
269 () Cf. cette étude, page 31.
270 () Cf. cette étude, page 34.
271 () Cf. cette étude, page 35.
272 () Rapport fait à la demande de M. François Fillon, Premier Ministre, sur la révision de la géographie prioritaire et la contractualisation de la politique de la ville « une conception rénovée de la politique de la ville : d’une logique de zonage à une logique de contractualisation » par M. Gérard Hamel, député d’Eure-et-Loir et M. Pierre André, sénateur de l’Aisne, avec l’appui de l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales, septembre 2009. Cf. notamment page 42.
273 () Au 1er septembre 2010, 11,4 milliards d’euros avaient été engagés par l’ANRU au titre des conventions signées, soit 95 % de l’« enveloppe » dont l’ANRU doit bénéficier au titre de l’article 6 de la loi du 1er août 2003 dans sa rédaction actuellement en vigueur pour la mise en œuvre du PNRU.
274 () Cf. la Charte nationale d’insertion applicable aux porteurs de projets et aux maîtres d’ouvrage contractant avec l’ANRU.
275 () Sans faire référence ici au « développement durable ».
276 () Projet de loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2003, 12ème législature, n° 950. Page 21.
277 () Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire par M. Philippe Pemezec, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2003, 12ème législature, page 42.
278 () Cf. le même rapport, page 9.
279 () Cf. le même rapport, page 17.
280 () Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du plan fait par M. Pierre André, session extraordinaire de 2002-2003, n° 401, page 45.
281 () Cf. le même rapport, page 32.
282 () Et pas seulement « rétrospectivement » comme les universitaires le précisent opportunément s’agissant plus, sans doute, des acteurs nationaux de la rénovation urbaine.
283 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 141 et 142.
284 () Sur la question de l’accession sociale à la propriété et, plus précisément, de sa mise en œuvre et de son impact dans les quartiers concernés par la rénovation urbaine, il convient de se reporter aux diagnostics et propositions présentés par notre collègue Olivier Carré, dans le rapport d’information déposé par la commission des affaires économiques, de l’environnement et des territoires sur l’accession sociale à la propriété dans le parc HLM, n° 1449, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2009.
285 () Les universitaires considèrent qu’il s’agit là du principal enseignement de plusieurs études sur le sujet.
286 () Cf. l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
287 () Ce constat semble reconnu par les responsables de l’éducation nationale. Ils estiment néanmoins que dans certains cas, la fuite des collèges les plus difficiles en Île-de-France conduit à une baisse très forte des effectifs dont la communauté éducative a su parfois tirer profit pour obtenir dans certains cas des résultats positifs surprenants.
288 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, pages 141 et 142.
289 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 163. En revanche, les ZUS sont aussi bien dotées que les unités urbaines les environnant s’agissant des équipements d’éducation.
290 () Gestion urbaine et sociale de proximité.
291 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2008, les éditions de la DIV, page 134.
292 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2008, les éditions de la DIV, page 138.
293 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 178.
294 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 181.
295 () Les ateliers santé ville sont des structures partenariales locales, financées par les acteurs locaux classiques de la politique de la ville (État et collectivités territoriales notamment), qui ont pour objet de contribuer à la mise en œuvre de diagnostics et d’actions territorialisés en matière de santé publique.
296 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 209.
297 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 209.
298 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 210.
299 () Le principal problème méthodologique de cette étude est qu’elle concernait un échantillon réduit de PRE, tous néanmoins portés juridiquement par un établissement public local d’enseignement (EPLE), ce qui est le cas de moins de 10 % des PRE. Non représentatif, l’échantillon avait par ailleurs pour caractéristique de s’appuyer sur des témoignages de personnes disposant d’importants soutiens financiers.
300 () Cf Rapport 2009 programme de réussite éducative, l’ACSÉ, pages 32 à 34.
301 () Cf Rapport 2009 programme de réussite éducative, l’ACSÉ, page 10.
302 () Cf. Rapport 2009 programme de réussite éducative, l’ACSÉ, page 11.
303 () Depuis le 14 septembre 2009, en application du décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009, la direction générale de la police nationale n’est plus compétente pour les missions de sécurité publique assurées dans les départements de la petite couronne en Île-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). C’est la préfecture de police de Paris, placée directement sous l’autorité du ministre de l’intérieur, qui est désormais compétente pour ces trois départements (qui comptent à eux seuls 75 ZUS).
304 () Cf. Observatoire national des zones urbaines sensibles, rapport 2009, les éditions du CIV, page 243.
305 () M. Jean-Louis Borloo est ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
© Assemblée nationale