

![]()
N° 2853
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés
TOME II – ÉTUDES
par MM. François GOULARD et François PUPPONI,
Députés.
___
TOME II – ÉTUDES
La présente annexe est composée de deux études réalisées à l’appui du rapport.
– SYNTHÈSE DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET D’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, par MM. Thomas KIRSZBAUM et Renaud EPSTEIN (p. 5)
– ÉTUDE PORTANT SUR LES RÉSULTATS D’ACTIONS D’ÉVALUATION RÉALISÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, par le cabinet ECs, sous la direction de M. Arnaud de CHAMPRIS (p. 199)
SYNTHÈSE DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET D’ÉVALUATION
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Rapport final
Octobre 2010
——
Thomas Kirszbaum
REPS, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique,
École normale supérieure de Cachan
Renaud Epstein
maître de conférences à l’Université de Nantes
Remerciements
Les auteurs expriment leur gratitude envers les personnes qui les ont aidés à rassembler le corpus documentaire de cette étude : Pascal Bavoux (Trajectoires), Jenny Collin (Ressources et territoires), Michel Didier (SG-CIV), Luc Faraldi (SG-CIV), Mart Grisel (Nicis), Damien Kacza (CES de l'ANRU), Bénédicte Madelin (Profession banlieue), Murielle Maffessoli (ORIV), Jean-Claude Mas (Pôle ressources du Val d'Oise), Fabrice Peigney (CES de l'ANRU), Morgane Petit (IREV), Patrick Sillard (ONZUS).
TABLE DES MATIÈRES
A. UNE POLITIQUE SURÉVALUÉE MAIS INÉVALUABLE ? 13
1. Politique de la ville et évaluation : un lien originel 13
a) Les premières évaluations nationales 13
b) Une fonction de légitimation de la politique de la ville 14
c) Une implication forte du milieu de la recherche 15
2. Le « renvoi » de l’évaluation au local : un échec relatif 15
a) De l’évaluation nationale au soutien national aux évaluations locales 15
b) Un succès quantitatif, une qualité décevante 16
3. Rendre la politique de la ville évaluable : la loi du 1er août 2003 18
a) Le réquisitoire et les préconisations de la Cour des comptes 19
b) Une refonte complète de la politique de la ville dans un souci d’évaluabilité 20
c) Des réformes en cohérence avec les principes de la LOLF 21
B. UNE ÉVALUATION QUI RESTE À FAIRE 22
1. Des progrès substantiels de l’observation nationale, une difficulté persistante à formuler un jugement 22
a) L’ONZUS : une avancée dans la connaissance nationale qui ne débouche pas sur un jugement évaluatif 23
b) Un paysage fragmenté de l’évaluation nationale 24
c) Vers une approche technocratique de l’évaluation 25
2. Des évaluations locales plus formelles que substantielles 27
a) Une logique de reporting du local vers le national 27
b) Les acteurs des CUCS aux prises avec l’évaluation managériale 29
c) Des appareils statistiques inadaptés à l’observation locale des écarts territoriaux 30
3. L’impact, point aveugle des évaluations 32
a) Des Contrats de ville aux CUCS : une difficulté non surmontée 32
b) Une dimension négligée des programmes sectoriels 33
c) Les risques d’une lecture erronée de l’« impact » de la politique de la ville 38
d) Les conditions d’une mesure scientifique de l’effet propre : groupes et quartiers-témoins 40
II - LES EFFETS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LA GESTION PUBLIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES 43
A. LES ORIENTATIONS SUCCESSIVES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 43
1. Reconnaissance : la valorisation des quartiers populaires 44
a) Les prémices d’un « empowerment » à la française ? 44
b) Des quartiers « laboratoires » où s’inventent des solidarités 45
c) Un éloge sous condition des quartiers ethniques 47
2. Transformation : agir sur les processus inégalitaires 48
a) Favoriser l’innovation dans l’action publique 48
b) À la recherche de l’échelle pertinente 50
c) Les ambiguïtés de la lutte contre les « ghettos » 52
3. Normalisation : remettre les quartiers à niveau 55
a) La mixité sociale et fonctionnelle pour priorités 56
b) Des quartiers handicapés 58
c) Une stratégie sélective de mixité contestée par les chercheurs 60
B. LES QUESTIONS TRANSVERSALES D’ÉVALUATION 62
1. Une politique territoriale ? 62
a) La politique de la ville, une politique des villes ? 63
b) Des intercommunalités déstabilisées ? 65
c) Vers des contractualisations verticales ? 68
d) Logique de projet ou routine administrative ? 71
Encadré : Qui pilote la "Politique des grandes villes" aux Pays-Bas? 73
2. Une politique intégrée ? 75
a) L’interministérialité a-t-elle jamais fonctionné ? 75
b) Les contractualisations locales : cohérence ou fragmentation ? 77
c) Les maires en dernier rempart de l’approche intégrée ? 80
d) Enrichir les territoires ou promouvoir les habitants ? 82
Encadré : Le programme "Soziale Stadt" en Allemagne: un modèle de politique intégrée? 85
3. Une politique prioritaire ? 89
a) Quelle pertinence des instruments de la géographie prioritaire ? 89
b) Quel effet levier des crédits spécifiques sur les crédits de droit commun ? 94
c) Entre droit commun et exception, peut-on parler de quartiers à l’abandon ? 98
d) Entre appels à projet et péréquations fiscales, quelle justice spatiale ? 107
Encadré : Que peut-on attendre de la concentration des moyens sur des quartiers ciblés ? Les leçons du New Deal for Communities en Grande-Bretagne 111
III - LES RÉALISATIONS ET RÉSULTATS DE TROIS PROGRAMMES : RÉNOVATION URBAINE, ZONES FRANCHES ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE 113
A. LE PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE 113
1. La chaîne d’intentions du PNRU 113
a) La cohésion par la mixité sociale 114
b) L’intégration par la banalisation urbaine 116
c) Des parcours résidentiels facilités 117
2. Des quartiers plus mixtes au plan social ? 118
a) Le scénario de la mixité « exogène » en échec 118
b) Un déplacement des zones de « concentration », des interactions limitées entre anciens et nouveaux habitants 122
c) La mixité « par le bas » entravée 125
3. Des parcours « positifs » pour les ménages relogés ? 127
a) Derrière le relogement, des mobilités différenciées 127
b) Des tensions aggravées sur l’offre de logements bon marché 128
c) Entre institutions et habitants : le malentendu 131
4. Des quartiers réintégrés, des comportements normalisés ? 133
a) Un habitat segmenté, une diversification fonctionnelle limitée 133
b) La révolution du désenclavement n’a pas eu lieu 136
c) Le social au prisme de l’aménagement physique 137
Encadré : À qui profite la rénovation urbaine ? Les résultats contrastés du Programme Hope VI aux États-Unis 141
B. LE PROGRAMME DES ZONES FRANCHES URBAINES 144
1. Quels effets sur l’activité économique ? 145
a) Une dynamique à relativiser 146
b) Une contribution limitée à la mixité fonctionnelle 147
2. Quels effets sur l’emploi ? 148
a) Un programme plus efficace qu’efficient 148
b) Un lien incertain avec l’insertion professionnelle des habitants 150
Encadré : Les Entreprise Zones ont-elles un impact ? Les enseignements contradictoires des évaluations anglo-saxonnes 153
C. LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 155
1. Quels effets de l’approche individualisée ? 156
a) De fortes réticences initiales 156
b) Le parcours individualisé : une rupture à relativiser avec les pratiques antérieures 160
2. Quels effets de l’approche globale ? 162
a) Un fort tropisme scolaire 162
b) Des effets non démontrés sur les performances des élèves 164
Encadré : La réussite éducative peut-elle faire sortir l’école de son extra-territorialité ? L’exemple des relations école-communauté au Québec 166
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 169
La politique de la ville est l’objet de critiques récurrentes qui portent notamment sur la multiplicité de ses objectifs, l’instabilité de ses programmes, la complexité de ses procédures et de sa géographie prioritaire, et la faiblesse présumée de ses effets sur la situation des quartiers prioritaires et de leurs habitants. Sept ans après le vote de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, qui devait conjurer ces critiques, la politique de la ville est de nouveau sur la sellette et les appels à une réforme de son organisation, de sa géographie et de ses méthodes se multiplient.
À l’aube d’une possible nouvelle refonte de cette politique, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale apporte sa contribution aux débats en cours. Suivant un procédé classique des démarches d’évaluation, il a souhaité disposer d’un bilan informationnel, recensant les travaux académiques sur le sujet, et présentant les résultats des recherches et études disponibles sous la forme d’une synthèse bibliographique. Plus précisément, la commande du CEC portait sur la réalisation d’un « inventaire commenté des évaluations universitaires en matière de politiques de la ville », soulignant ainsi implicitement que les jugements portés sur cette politique s’appuient rarement sur des données fiables et des démonstrations rigoureuses, conformes aux méthodes éprouvées des sciences sociales.
Aussi louable soit cette ambition, elle a nécessité une reformulation partielle. Si l’on entend par « évaluations universitaires » les recherches et études réalisées par des équipes de recherche dans le cadre de commandes publiques d’évaluation, il s’agit là d’un modèle historiquement daté. Des chercheurs ont été étroitement associés à l’évaluation de la politique de la ville jusqu’au milieu des années 1990, mais le lien s’est distendu depuis lors, les organismes d’études publics (agences d’urbanisme, ONZUS…) et les bureaux d’études privés produisant désormais la quasi-totalité des connaissances mobilisées dans le cadre des multiples démarches évaluatives de la politique de la ville. Aussi, si l’on devait procéder à l’inventaire des seuls travaux académiques sur la politique de la ville réalisés à des fins d’évaluation, le corpus mobilisable serait sans doute bien trop restreint – ou du moins trop concentré sur la période antérieure à 1995.
Cela ne signifie pas que les chercheurs en sciences sociales ont renoncé à analyser les objectifs, les modes d’action ou certains des programmes de la politique de la ville. Mais leurs travaux se déployant en dehors du cadre évaluatif, ils se développent à partir d’hypothèses et de questionnements qui ne sont pas toujours ceux des responsables politiques et administratifs en charge de la politique (et de son évaluation). Ces travaux de recherche ont toutefois été intégrés au corpus bibliographique de l’étude, dès lors qu’ils nous semblaient de nature à alimenter la réflexion du CEC sur la valeur de la politique de la ville, notamment sur les registres de sa pertinence et de sa cohérence. De la même façon, des études et recherches rigoureuses, produites hors de l’université (ou du CNRS) ont été prises en compte dans la présente synthèse. Enfin, le choix a été fait d’inclure dans le corpus analysé divers rapports officiels.
Cette synthèse bibliographique mêle donc des travaux de différentes natures. Sans doute cela atténue-t-il la portée « scientifique » de cet état des lieux des connaissances car, au final, les travaux académiques au sens strict (articles publiés dans des revues à comité de lecture, ouvrages parus dans des maisons d’édition universitaires, thèses soutenues devant un jury de chercheurs…) sont sans doute minoritaires dans l’ensemble du corpus traité. Mais son élargissement à des productions d’une autre nature a semblé indispensable si l’on voulait couvrir, comme le souhaitait le CEC de l’Assemblée nationale, un vaste champ de questions relatives à la politique de la ville et aux résultats de ses programmes récents.
Le CEC a également voulu enrichir ce travail par des éclairages ponctuels sur des politiques mises en oeuvre dans d’autres pays. Les problèmes qui affectent les quartiers de minorités pauvres des villes françaises ne sont pas sans équivalents à l’étranger, ni les solutions qui y sont déployées. Ainsi, s’il faut se prémunir contre l’écueil consistant à minimiser le poids des traditions et des contextes nationaux, un bon usage des expériences étrangères est possible s’il permet de souligner les convergences, mais aussi de mettre indirectement en lumière certaines spécificités hexagonales. Cependant, même s’il s’agit à nos yeux d’une dimension essentielle à toute démarche d’évaluation nationale de la politique de la ville, le temps imparti à la réalisation de cette étude (environ deux mois) n’a pas permis d’approfondir l’analyse de ces expériences étrangères. Nous avons donc choisi de les présenter sous forme d’encadrés extraits de travaux existants.
Il convient d’insister sur les limites du présent travail. Outre les délais de réalisation, celui-ci ne pouvait prétendre à l’exhaustivité, ni dans le nombre des questions et des thématiques abordées, ni même à l’intérieur de chacun d’eux. D’autres l’ont dit avant nous, la politique de la ville se présente à certains égards comme une gigantesque opération discursive, plus encore si l’on met en regard les ressources qu’elle mobilise et la masse d’écrits qu’elle a suscités. Cette profusion de discours s’explique en grande partie par le caractère global de cette politique, située au carrefour d’enjeux urbains, sociaux, économiques, démocratiques, et de bien d’autres encore. Cela suffit à rendre tout à fait vaine n’importe quelle entreprise de constitution d’un état des savoirs qui voudrait en embrasser tous les champs, même en optant pour le format le plus synthétique.
Aussi avons-nous dû opérer des choix, forcément réducteurs, quant aux contours du corpus exploité et aux questions et thématiques abordées. Le corpus ne pouvait rendre justice à tous les travaux dignes de figurer dans une revue de la littérature, y compris les travaux obéissant à de stricts critères scientifiques. Notre position personnelle de chercheurs versés dans l’étude de la politique de la ville depuis près de vingt ans nous a également conduits à accorder une place sans aucun doute disproportionnée à nos propres productions. Ce biais était sans doute évitable, mais dans le temps très court qui a été le nôtre, il n’a pas été possible d’atteindre le niveau d’exigence requis pour une revue de littérature destinée à une publication scientifique.
Le choix des questions et des thèmes traités a été principalement orienté par la nature des interrogations du CEC de l’Assemblée nationale, même s’il n’a pas été matériellement possible de répondre à toutes. Nous avons donc commencé par poser la question de « ce qu’évaluer veut dire » dans la politique de la ville. Car évaluer n’a pas toujours voulu dire la même chose au fil de son histoire. Il nous a paru utile de revenir rapidement sur les démarches d’évaluation de la politique de la ville menées depuis une trentaine d’années, retour qui permet tout à la fois de rappeler quels ont été les buts poursuivis par cette politique et les difficultés rencontrées pour en mesurer les effets (I- Trente ans de politique de la ville au prisme de l’évaluation). Les deux parties suivantes sont justement consacrées aux effets de la politique de la ville, en considérant successivement la plus-value apportée par cette politique territorialisée, transversale et exceptionnelle aux politiques de droit commun (II - Les effets de la politique de la ville sur la gestion publique des quartiers prioritaires) puis, plus directement, ses effets sur les quartiers visés et leurs habitants en nous limitant à trois des principaux programmes de la politique nationale de la ville (III - Les réalisations et résultats de trois programmes : rénovation urbaine, zones franches et réussite educative).
I - TRENTE ANS DE POLITIQUE DE LA VILLE AU PRISME DE L’ÉVALUATION
L’histoire de la politique de la ville et de son évaluation peut se lire comme un paradoxe : celui d’une politique qui ne peut se concevoir sans évaluation, mais qui semble résister de manière persistante à cette pratique visant à « apprécier l’efficacité d’une politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mise en œuvre »1. Un retour sur trois décennies d’évaluation permet de prendre la mesure de ce paradoxe : de toutes les politiques publiques, la politique de la ville est celle qui a fait l’objet du plus grand nombre d’évaluation, alors même que son évaluabilité est longtemps restée problématique (A). Malgré la réforme radicale opérée en 2003, qui devait garantir cette évaluabilité, les conditions de la formulation d’un jugement raisonné sur sa valeur ne paraissent toujours pas réunies (B).
A. UNE POLITIQUE SURÉVALUÉE MAIS INÉVALUABLE ?
1. Politique de la ville et évaluation : un lien originel
La politique de la ville a été un terrain privilégié pour l’expérimentation des premières démarches évaluatives engagées en France (Ion et al., 1996). Ce lien intime avec l’évaluation s’est affirmé dès la signature, en 1977, des premières conventions « Habitat et vie sociale » (HVS). Des agences d’urbanisme et bureaux d’études ont alors été missionnés pour réaliser des études monographiques afin « d’évaluer les effets d’une telle opération sur la vie collective et le cadre de vie » (Toubon, 1980). L’expérience a été renouvelée dans plusieurs dizaines de quartiers visés par les opérations de Développement social des quartiers (DSQ) qui ont pris la relève du programme HVS à partir de 1982.
a) Les premières évaluations nationales
Une première capitalisation des évaluations locales avait eu lieu, en 1981, à la demande du Commissariat général du plan, qui dressait un bilan mitigé des opérations HVS (Figeat, 1981). Cette expérience s’est prolongée en 1987 par une première évaluation nationale des DSQ, réalisée dans le cadre d’un groupe de travail du Plan présidé par François Levy et appuyée sur seize monographies commandées à des experts, dont quatre portaient sur des sites témoins qui n’avaient pas bénéficié de DSQ (Levy, 1988). Les procédures HVS et DSQ ont ainsi fourni au Commissariat général du plan, lieu de fertilisation croisée de la recherche en sciences sociales et des activités gouvernementale, un terrain d’expérimentation privilégié des réflexions théoriques qu’il entamait dans les années 1980 sur l’évaluation des politiques publiques (Deleau et al., 1986).
L’évaluation de la politique de la ville allait connaître un développement plus substantiel au début des années 90. Peu après la nomination, en décembre 1990, de Michel Delebarre comme ministre exclusivement chargé de cette politique, avec rang de ministre d’État, le conseil des ministres décidait de lancer une évaluation interministérielle. Un Comité national d’évaluation de la politique de la ville était créé sous l’égide du Conseil national des villes, instance de concertation et de proposition rattachée au Premier ministre. Présidé par Jean-Michel Belorgey, président de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et « père » du RMI, ce comité était chargé « d’apprécier le contenu, les conditions de mises en oeuvre et les effets de la politique de la ville, au regard des objectifs qu’elle poursuit ». Cette instance dédiée regroupait élus, chercheurs, hauts fonctionnaires et représentants de la société civile ; s’y ajoutait un groupe inter-administratif d’évaluation chargé de faciliter les relations avec les services de l’État, ainsi qu’un groupe scientifique d’animation réunissant dans un séminaire régulier tous les chercheurs et consultants travaillant pour le Comité, autour de ses deux rapporteurs, Jacques Donzelot et Philippe Estèbe. Pour la conduite de ses travaux, ce comité a confié à diverses équipes universitaires et bureaux d’études la réalisation de pas moins de trente-trois enquêtes thématiques et territoriales (Linhart, 1996).
b) Une fonction de légitimation de la politique de la ville
Plus encore que l’analyse de la politique de la ville, la visée première de ces évaluations nationales était la légitimation de cette nouvelle politique publique qu’était la politique de la ville. Cela était manifeste avec la commission Levy dont le jugement était extrêmement flatteur. Établi par un groupe comprenant plusieurs « militants » de la politique de la ville, le rapport Levy insistait sur le caractère novateur et l’apport des expérimentations locales, du point de vue des réalisations comme des procédures partenariales, mais aussi du point de vue de l’efficience de la politique menée qui avait « un coût financier relativement modéré pour l’État » (Levy, 1988). Cette première évaluation a ouvert la voie à la pérennisation d’une politique expérimentale dont la légitimité était, déjà, contestée. Cependant, elle n’a pas été entendue sur un point essentiel, celui du nombre de quartiers bénéficiant d’opérations de DSQ. « Pour garder à la procédure son caractère exceptionnel, le chiffre total de 150 sites paraît une limite à ne pas dépasser », demandait la commission Levy. Or, la poursuite de cette politique au cours du Xème Plan (1989-1993) s’est traduite par un triplement du nombre de quartiers prioritaires, passés de 148 à 450.
La vague de commandes du Comité national d’évaluation a ouvert la voie à des progrès substantiels sur le plan de la connaissance des quartiers visés par la politique de la ville, des mécanismes à l’origine de leurs difficultés et, surtout, des modalités de l’intervention publique en leur direction. Si la procédure d’évaluation interministérielle respectait les exigences formelles de scientificité formulées par le Conseil scientifique de l’évaluation qui venait d’être mis en place (CSE, 1991), les travaux du Comité national cherchaient au moins autant, sinon davantage, à fournir un cadre théorique aux transformations de la ville et de l’action publique, qu’à mesurer les effets de la seconde sur la première (Donzelot, Estèbe, 1994). Alors que son institutionnalisation était déjà bien avancée (Bachmann, Le Guennec, 1996), cette évaluation nationale a donc eu pour l’essentiel une fonction de légitimation des concepts de la politique de la ville. Même s’il était sans doute assez décalé avec la réalité, comme n’ont pas manqué de le souligner certains chercheurs impliqués dans cette évaluation (Damamme, Jobert, 1995), le modèle de « l’État animateur » proposé par les deux rapporteurs du Comité a été fort utile aux acteurs de la politique, en les aidant à construire un discours de justification de cette politique, en précisant ses objectifs politiques, ses modes d’action et ce qui pouvait en être attendu. Cependant, les dissensions apparues au sein du Comité national d’évaluation, qui ont conduit à la publication d’un rapport signé par son président mais non validé par le comité (Belorgey, 1993), puis d’un livre rédigé par ses rapporteurs qui aboutissaient à des conclusions contradictoires, a incontestablement fragilisé l’ensemble de la démarche (Epstein, 2009).
c) Une implication forte du milieu de la recherche
En multipliant les commandes d’études, le Comité national d’évaluation a fait de la politique de la ville un des objets privilégiés des sciences sociales dans la première moitié des années 1990. Les politistes, sociologues des organisations ainsi que les juristes versés dans les sciences administratives se sont penchés en nombre sur cette politique insolite (cf. par exemple, Grémion, Mouhanna, 1995 ; Lafore, 1995 ; Le Galès, 1995 ; Warin, 1996 ; Gaudin, 1997) dont les objectifs n’étaient pas formulés en termes d’effets directs sur ses objets (les quartiers défavorisés et leurs habitants) mais d’effet levier sur les politiques et institutions publiques. Par sa méthode d’action inédite, fondée sur le diagnostic territorial, le projet transversal, le contrat global, la participation des habitants et l’évaluation, la politique de la ville invitait en effet les appareils administratifs concernés par la « crise des banlieues » à rompre avec la logique d’action sectorisée et standardisée du passé, à s’engager dans des coopérations inter-institutionnelles et à s’ouvrir à la société civile.
Tandis que des chercheurs avaient trouvé dans la politique de la ville un terrain pour observer le processus de modernisation de l’action publique française, d’autres s’y sont inscrits pour étudier les quartiers de sa géographie comme des révélateurs de changements plus larges à l’œuvre dans la société. Tout un courant d’analyse sociologique, composé d’élèves d’Alain Touraine et/ou de proches de la revue Esprit, a vu alors dans la situation des « banlieues » la manifestation d’une « nouvelle question sociale ». La ville devenait le principe de lecture privilégié du nouveau paradigme de l’« exclusion » (Donzelot 1991 ; Touraine 1991 ; Dubet, Lapeyronnie, 1992). Les « Entretiens de la ville », cycle de conférences organisé de 1990 à 1993 par la revue Esprit et la Délégation interministérielle à la ville (Esprit 1991 ; Roman 1993), furent le point d’orgue de cette contribution des intellectuels à l’élaboration d’une doctrine dans laquelle les pouvoirs publics ont largement puisé (Tissot, 2007).
2. Le « renvoi » de l’évaluation au local : un échec relatif
Qu’il s’agisse de la politique de la ville comme levier de la réforme de l’État ou comme symptôme de nouveaux problèmes socio-urbains, la cohérence fut très forte entre les analyses scientifiques alors dominantes et les orientations de la politique de la ville du début des années 1990. Cette proximité s’est rapidement défaite à partir de l’alternance de 1993, en même temps que la responsabilité de l’évaluation de la politique de la ville a été renvoyée aux acteurs locaux. La multiplication des évaluations locales a fait émerger un marché de l’évaluation de la politique de la ville sur lequel les chercheurs, jusque-là en première ligne, ont été supplantés par de nouveaux entrants (cabinets d’audits et bureaux d’études) plus prompts à répondre aux commandes des collectivités et des services déconcentrés de l’État (Epstein, 2009).
a) De l’évaluation nationale au soutien national aux évaluations locales
Expérimentés dans une dizaine de sites dans la période 1988-1993, les Contrats de ville ont été généralisés dans 214 villes et agglomérations au cours du XIème Plan (1994-1999) en tant que procédure unique de la politique de la ville. Le mandat de négociation adressé aux préfets les enjoignait à inscrire dans les Contrats de ville une clause prévoyant la réalisation de leur évaluation2. Les Contrats de ville constituant le volet « ville » des Contrats de plan État-Région (CPER), c’est sur les crédits contractualisés par l’État dans les CPER qu’une enveloppe financière conséquente (à hauteur de 6/10 000èmes de ces crédits) a été prélevée pour soutenir les démarches d’évaluation.
Ce renvoi vers le local se justifiait par la nature même de la politique de la ville, politique nationale dont les objectifs et les actions étaient définis régionalement et localement. La formation d’un jugement par les acteurs du territoire lui-même devenait l’élément décisif de la démarche évaluative (Bruston, 2004 ; Lamarque, 2004). Mais il s’agissait bien d’une politique nationale de promotion des évaluations locales (Epstein, 1999). Les acteurs locaux rencontraient d’ailleurs des difficultés telles pour donner une traduction opérationnelle à l’impératif d’évaluation que la Délégation interministérielle à la ville (DIV) établit un « Dossier-ressources pour l’évaluation des contrats de ville » censé leur apporter une aide méthodologique, tout en précisant les attentes nationales en la matière (DIV, 1995a).
L’impératif d’évaluation des procédures locales a été réaffirmé avec force par le pouvoir national, à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle génération de Contrats de ville pour la période 2000-2006. Pas moins de trois circulaires évoquaient la question de l’évaluation3, présentée comme « un impératif d’efficacité et une exigence démocratique » (circulaire du 13 novembre 2000) dont la réussite était conditionnée par la clarté des objectifs, la globalité de l’approche, le caractère partagé de la démarche, la participation des habitants et le recours à des experts. Réitérant la pratique qui avait été la sienne au cours du XIème Plan, la DIV a privilégié le soutien aux évaluations locales : publication des actes d’un séminaire des évaluateurs (DIV, 2002a), puis d’un nouveau guide méthodologique détaillant finement la procédure à suivre pour conduire l’évaluation locale (DIV, 2002b).
Si la DIV incitait à la conduite d’évaluations locales, elle a aussi engagé des démarches visant à aboutir à une évaluation nationale de la politique de la ville. Dans cette perspective, un Comité national d’évaluation a été installé en 2001, sous la présidence de René Vandierendonck, maire de Roubaix. Mais ce comité ne s’est réuni qu’à deux reprises et n’a plus été réactivé après l’alternance de 2002 (Bruston, 2004). La constitution d’un référentiel national d’évaluation des Grands projets de ville, engagée sur une cinquantaine de sites, était amorcée en parallèle avec l’aide d’universitaires (LARES, 2001), avant que cette démarche ne tourne court elle aussi (Kirszbaum, 2002). À défaut d’une évaluation nationale, la DIV a finalement commandité une synthèse nationale des évaluations à mi-parcours des Contrats de ville (Epstein, Kirszbaum, 2005), comme elle l’avait fait en 1998 à la fin du XIème Plan (Estèbe, Epstein, 1998)4.
b) Un succès quantitatif, une qualité décevante
Le renvoi de l’évaluation de la politique de la ville vers le local s’est traduit par un réel succès quantitatif, plus de la moitié des Contrats de ville ayant fait l’objet d’une évaluation finale au cours du XIème Plan et à mi-parcours pour la génération 2000-2006. Avec plusieurs centaines de rapports de travaux à son actif, il a été maintes fois remarqué que la politique de la ville était de toutes les politiques publiques celle qui a fait l’objet du plus grand nombre d’évaluations. Cette politique a non seulement joué un rôle-clé dans le développement de la pratique évaluative dans l’action publique française, mais elle a bénéficié en retour de la fonction pédagogique de cette pratique qui suscite des dynamiques d’apprentissage collectif (Spenlehauer, Warin, 2000 ; Méjean, 2002).
Ces avancées à mettre au crédit de l’évaluation de la politique de la ville ne peuvent cependant en masquer les limites. Les synthèses nationales des productions locales ont pointé l’indigence de nombre de rapports d’« experts », plus encore pour la seconde (Kirszbaum, Epstein, 2005) que pour la première génération de Contrats de ville (Estèbe, Epstein, 1998 ; Kirszbaum 1998). Les acteurs de l’évaluation réunis par la DIV dans un séminaire organisé à Arc et Senans, en décembre 2000, ont confirmé ce constat : « une évaluation quantitativement satisfaisante mais qualitativement décevante » (DIV, 2002a).
L’évaluation des politiques publiques est une activité à la fois cognitive (qui produit de la connaissance sur la politique menée), normative (qui permet de formuler un jugement sur cette politique) et instrumentale (qui rétroagit sur cette politique) (CSE, 1996). Sous ces trois aspects, les lacunes des évaluations des Contrats de ville étaient patentes.
Sur le plan cognitif, les bilans nationaux ont révélé la très grande hétérogénéité des dispositifs et objets d’enquête (de simples tableaux de bord, thématiques ou financiers, aux synthèses de paroles d’acteurs ou d’habitants, en passant par des audits organisationnels ou des études centrées sur quelques actions), de la rigueur des analyses développées et des enseignements qui en étaient tirés. La territorialisation de l’évaluation s’est donc accompagnée d’une fragmentation poussée de cette démarche. Seule une minorité de travaux se sont en fait inscrits dans les canons de l’évaluation d’une politique publique, tels que définis par le Conseil scientifique de l’évaluation ou par le « Dossier-Ressources de l’évaluation des Contrats de ville » proposé par la DIV en 1995 (Estèbe, Epstein, 1998). Le « Pilote de l'évaluation » élaboré par la DIV en 2002 n’a pas eu davantage d’impact sur la qualité des travaux locaux (Epstein, Kirszbaum, 2005). Reprenant les recommandations du Conseil scientifique de l’évaluation, ces guides méthodologiques insistaient sur le nécessaire travail de clarification a posteriori des objectifs contractuels – ces objectifs étant souvent posés de manière trop floue dans la phase de négociation locale des Contrats de ville – ce qui devait conditionner le travail ultérieur sur la formulation des questionnements évaluatifs et la définition des indicateurs permettant d’y répondre. Mais la DIV s'est montrée incapable d'accompagner la mise en oeuvre de tels principes (Gaultier, Huet, 2002). En pratique, rares sont les évaluations à s’être appuyées sur un référentiel explicitant les intentions locales, c'est-à-dire l'enchaînement entre les données du problème à résoudre, les objectifs visés par les responsables politiques, les réalisations prévues, et les effets et impacts attendus. À défaut, ces évaluations ont juxtaposé, dans leur grande majorité, des audits organisationnels traitant des jeux d’acteurs et des tableaux de bord bricolés à partir des rares statistiques infracommunales disponibles, sans interroger les finalités, ni les réalisations et encore moins les effets et impacts des Contrats de ville (Epstein, 2009).
Les carences de la dimension cognitive des évaluations ont mécaniquement affaibli la capacité des acteurs locaux à porter un jugement étayé sur la valeur de leur action (dimension normative de l’évaluation). Les actes du séminaire d’Arc et Senans l’ont posé sans détour : « La profusion d'études réalisées n'a pas rendu possible la formulation d'un jugement collectif sur la portée de la politique menée, car ces études sont le plus souvent restées incomplètes. Certaines évaluations fournissaient des éléments de connaissance, mais n'en tiraient aucun jugement, d'autres énonçaient des jugements sans que le fondement de ceux-ci soit clairement explicité » (DIV, 2002a). Car l’évaluation de l’action publique ne se résume pas à une activité de mesure. Elle doit aussi, suivant l’approche « démocratique » de l’évaluation préconisée par Patrick Viveret dans son rapport au Premier ministre de 1989, aboutir à la formulation d’un « jugement sur la valeur de cette action » (Viveret, 1989). Il ne s’agit nullement de confier cette prérogative à un tiers extérieur, mais de placer celui-ci au service des acteurs en charge de la politique à évaluer, pour les aider à construire ce jugement (Latz, 2009) ; il s’agit aussi d’associer les destinataires de ladite politique à la démarche d’évaluation et de s’assurer a minima d’une large publicité de ses résultats. Sur tous ces plans, les vertus démocratiques de l’évaluation des Contrats de ville n’ont guère été évidentes. Sauf exception, elles n’ont pas réussi à faire émerger des scènes de débat local sur la stratégie poursuivie, ses réalisations et ses effets. Dans bien des cas, les évaluateurs ont formulé eux-mêmes le jugement évaluatif qui aurait dû être le fruit d’une réflexion collective (Méjean, 2002). Quant à l’exigence de publicité des résultats, elle est restée le plus souvent purement théorique.
Enfin, l’échec est tout aussi avéré sur le plan instrumental : les nombreuses réorientations qu’a connues la politique de la ville ont été très rarement fondées sur les recommandations tirées des évaluations (Jacquier, 2004)5. S’agissant de la dernière vague des Contrats de ville, cette défaillance ne peut être toutefois imputée aux évaluateurs et à leurs commanditaires locaux. En effet, l’ambition des évaluations intermédiaires – alimenter une révision à mi-parcours des contrats – a été réduite à néant par le vote de la Loi d’orientation pour la politique de la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, laquelle a opéré une réforme radicale de la politique de la ville sans attendre le résultat des évaluations alors en cours de réalisation (Epstein, 2007a).
3. Rendre la politique de la ville évaluable : la loi du 1er août 2003
« Politique évaluée, politique inévaluable ? » : telle était la question posée par les participants au séminaire d’Arc et Senans en 2000 (DIV, 2002a). Les explications qu’ils apportaient à la mise en échec de l’évaluation tenaient largement à la nature de la politique de la ville, au caractère labile de ses objectifs, à la diversité de ses échelles d’intervention, ou encore à ses liens mal éclaircis avec les politiques connexes. Bref, c’est la complexité même de la politique de la ville qui était en cause. C’est à une conclusion comparable qu’est parvenue la Cour des comptes dans deux rapports successifs qu’elle a consacré à la politique de la ville (Cour des comptes 1995 et 2002). Dans le second de ces rapports, la Cour ne s’est pas arrêtée au constat de la complexité de la politique de la ville, mais s’est employée à fixer un véritable programme pour la réforme de cette politique, afin d’en garantir l’évaluabilité. L’analyse développée par les magistrats financiers en 2002 n’était pas nouvelle. Au cours des années 1990, l’Inspection des finances (Sardais, 1990) et la Cour des comptes elle-même (1995) avaient déjà exprimé des réserves très similaires sur la politique de la ville. Mais son rapport de 2002 a bénéficié d’un grand d’écho médiatique et politique, la loi du 1er août 2003 se chargeant de mettre en application ses recommandations.
a) Le réquisitoire et les préconisations de la Cour des comptes
Parmi les nombreux travers de la politique de la ville pointés par la Cour des comptes dans son rapport de 2002, le flou de ses objectifs figurait en bonne place. La juridiction administrative ne se contentait pas de dénoncer « des objectifs nationaux mal identifiés ». Elle déplorait aussi l’absence « d’objectifs quantitatifs affichés au niveau national, en matière de résultat ». Elle notait que ces imprécisions se répercutaient dans les contrats locaux, caractérisés eux aussi par « une absence quasi générale d’objectifs précis », et notamment par « l’absence d’objectifs de résultats ou de moyens », lesquels moyens étaient trop dilués du fait de l’extension continue de la géographie prioritaire. S’ajoutait une critique de la complexité des procédures nuisant à la « lisibilité » de la politique de la ville et compromettant « la compréhension des dispositifs et donc leur appropriation par les citoyens ». Parmi les causes de cette illisibilité, la Cour a notamment pointé la présentation budgétaire de la politique de la ville qui « ne permet pas de s’assurer de l’exactitude des informations données », malgré l’introduction, à partir de 1991, d’un « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances présentant le montant et l’utilisation de l’ensemble des crédits consacrés à la politique de la ville.
La Cour consacrait aussi des développements à l’évaluation. En dépit des nombreux travaux d’évaluation des Contrats de ville et du volet « politique de la ville » des Contrats de plan État-région, elle diagnostiquait « l’écart qui existe entre ces travaux et les objectifs "théoriques" d’une évaluation ». Parmi les causes de cette déficience figurait non seulement « l’imprécision des objectifs (qui) rend difficile l’appréciation de l’efficacité de la politique de la ville », mais aussi « la faiblesse des informations disponibles concernant les quartiers et les populations concernés », un élément considéré comme « indispensable » à la fois pour définir les actions à mener et pour en mesurer les effets. Pour évaluer une politique, il est nécessaire d’avoir « défini des objectifs et s’être donné les moyens de mesurer s’ils sont atteints », « aucune de ces deux conditions n’est actuellement remplie concernant la politique de la ville », concluaient les magistrats financiers.
Pour rendre possible l’évaluation de la politique de la ville, la Cour des comptes rappelait conséquemment les préconisations qu’ils avaient déjà formulées dans leur rapport annuel en 1995 : clarification des objectifs ; déclinaison de ces objectifs dans des indicateurs de résultats ; identification plus précise des programmes y contribuant et des moyens qui leur sont consacrés ; amélioration des systèmes statistiques d’observation des quartiers. Il n’en allait pas seulement de la détermination d’un programme pour l’évaluation, mais aussi d’un programme pour la politique de la ville elle-même puisque ses objectifs étaient énoncés dans des termes extrêmement précis par la Cour des comptes : « L’objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers et de "retour au droit commun", qui justifie la mise en place d’une politique territorialisée spécifique, devrait être prédominant dans les différents dispositifs ».
La définition de l’objectif de la politique de la ville en termes de réduction d’écarts territoriaux n’était pas une invention des magistrats financiers. Elle figurait déjà dans le mandat de négociation des Contrats de ville adressé aux préfets en 1993, dans les décisions du Conseil interministériel des villes du 22 février 1994, puis dans le cahier des charges pour l’élaboration des Grands projets de ville (GPV) de 1999. Mais cet objectif de réduction des écarts n’avait guère eu de portée pratique jusque-là, car les données sur les différentiels de chômage, d’échec scolaire ou de délinquance entre les quartiers et leur agglomération n’étaient guère disponibles à l’échelle des quartiers. Surtout, la notion de rattrapage territorial n’était que l’une des orientations possibles de la politique de la ville parmi ses différents « répertoires » d’action (Estèbe, 2004a). Au moment où les magistrats de la Cour des comptes rédigeaient leur rapport, un seul site, celui de Grigny/Viry-Châtillon avait inscrit, dans son Contrat de ville-GPV pour 2000-2006, des objectifs de résultat déclinés dans des indicateurs de réduction des écarts, cela dans les domaines de la réussite scolaire et de l’emploi6. La Cour des Comptes n’a pas manqué de saluer l’expérience grignoise (Kirszbaum, 2004a), qualifiée de « progrès remarquable » et qui allait être généralisée à la faveur la loi du 1er août 2003.
b) Une refonte complète de la politique de la ville dans un souci d’évaluabilité
Le législateur a fait droit avec diligence à l’analyse paradoxale développée par la Cour des comptes qui concluait à l’inefficacité de la politique de la ville, tout en constatant son impossible évaluation. La loi d’orientation et de programmation pour la politique de la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 (dite loi Borloo) peut s’analyser comme une véritable opération de « design institutionnel » redéfinissant tout à la fois le problème à traiter, les cibles visées, les objectifs poursuivis, ainsi que l’attribution des responsabilités au sein du système d’acteurs en charge de la mise en œuvre de la politique de la ville (Epstein, 2005). Tout dans la loi Borloo a été fait pour rendre la politique de la ville évaluable. Les outils de l’évaluation n’ont d’ailleurs pas été construits en fonction des objectifs impartis à cette politique ; au contraire, ce sont les enjeux et les objectifs de cette politique qui ont été redéfinis en fonction de l’exigence de mesure des résultats et des instruments administratifs disponibles pour ce faire (Epstein, 2010).
Reprenant à la lettre la formulation avancée par la Cour des comptes, la loi Borloo affirme que « la politique de la ville se justifie par l’objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de "retour au droit commun" ». Ainsi les cibles et objectifs de la politique de la ville, dont la définition relevait jusque-là de la responsabilité des acteurs locaux, sont-ils désormais fixés par le législateur en termes de réduction des écarts entre les 751 Zones urbaines sensibles (ZUS) et l’ensemble du territoire national. La loi du 1er août 2003 dispose dans son article premier que des programmes d’actions fixent, pour chaque ZUS des objectifs de résultats chiffrés dans un nombre précis de domaines énumérés par la loi. Ces programmes doivent faire l’objet d’évaluations périodiques sur la base de 65 indicateurs de moyens et de résultats spécifiés dans l’annexe 1 de la loi. Les rédacteurs de la loi Borloo se sont directement inspirés en cela de la National Strategy for Neighbourhood Renewal lancée deux plus tôt au Royaume-Uni, qui instituait un système de suivi des écarts entre les 88 quartiers les plus défavorisés du pays et la moyenne nationale dans une série de domaines (emploi, éducation, formation, délinquance, santé, logement) (SEU, 2001).
On mesure le chemin parcouru depuis 1994 : les objectifs de réduction des écarts fixés par le gouvernement se limitaient alors à trois indicateurs, sans que soient précisées les échelles de référence retenues pour la mesure de ces écarts, ni les instances en charge de la production de ces données qui étaient alors indisponibles à l’échelle infra-communale (Epstein, 2008a). La loi Borloo a cherché à remédier à cette dernière lacune en créant un Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS). Elle impose également aux communes et communautés d’agglomération l’établissement d’un « bilan annuel des actions menées dans les ZUS de leur territoire, des moyens qui y sont affectés et de l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités », lequel doit être présenté à l’occasion du débat sur les orientations générales de leur budget. Pour la première fois, l’exigence d’observation nationale et locale est donc affirmée par le législateur (DIV, FNAU, 2008).
Cette clarification des objectifs et de l’organe chargé de mesurer leur degré de réalisation se prolonge enfin sur le plan des moyens. L’incertitude qui prévalait jusque-là quant aux ressources dévolues à la politique de la ville laisse place à un système bien plus lisible, avec la création d’une Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), mutualisant l’ensemble des apports financiers de l’État, du 1 % logement, de la Caisse des dépôts et du mouvement HLM pour la mise en œuvre du Programme national de rénovation urbaine (PNRU) créé par la loi. La réforme du volet social de la politique de la ville est intervenue plus tard, avec la création de l’Agence nationale pour la cohésion sociale (ACSÉ) et l’égalité des chances en mars 2006 et le passage de la procédure des Contrats de ville à celle des Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) décidé la même année. Dans le droit fil de la loi de 2003, les CUCS doivent s’organiser autour d’objectifs de « réduction des écarts de développement entre des territoires prioritaires et leur environnement »7. Dans un même souci d’évaluabilité, il a été demandé aux signataires locaux de définir des critères d’évaluation dans la phase de conception de ces contrats8, en veillant à intégrer les indicateurs de résultats et de mise en œuvre listés dans l’annexe de la loi Borloo9 (Kirszbaum, 2010).
c) Des réformes en cohérence avec les principes de la LOLF
Cette réforme, qui devait garantir l’évaluabilité de la politique de la ville, ne repose pas seulement sur les préconisations de la Cour des comptes et l’importation d’instruments développés en Grande-Bretagne. Elle procède aussi d’une adaptation de la politique de la ville à la « révolution budgétaire » opérée par le vote de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) en 2001. Les principes et procédures promus par la loi organique pour améliorer la performance et l’évaluabilité des politiques publiques (Arkwright et al., 2007), ont inspiré les rédacteurs de la loi du 1er août 2003. Si la loi Borloo ne découle pas directement de la LOLF, la première a été façonnée pour se conformer par anticipation aux exigences de la « nouvelle constitution financière ». À bien des égards, le PNRU mis en place par la loi Borloo correspond au modèle néo-managérial promu par la LOLF : ses objectifs ont été définis avec précision par le législateur dans une loi d’orientation et de programmation ; la mise en œuvre des programmes pluriannuels, désormais structurés par des objectifs de résultats auxquels sont associés des indicateurs quantitatifs suivis par l’ONZUS, ne dépend plus des contributions de divers ministères, mais s’appuie sur des lignes parfaitement identifiées dans le budget de l’État ; enfin, les responsabilités de l’ANRU, agence ad hoc disposant d’une large délégation de gestion pour la mise en œuvre du PNRU, et de son administration de tutelle (la DIV devenue SG-CIV10) sont apparemment clairement distinguées (Epstein, 2010). Si, à notre connaissance, les volets économique et social de la politique de la ville n’ont pas encore été étudiés sous cet angle par les chercheurs (voir cependant Avide, 2008), ils relèvent assurément de cette même logique néo-managériale de renforcement conjoint des libertés et des responsabilités des opérateurs chargés de la mise en œuvre d’un programme étatique, sous la tutelle d’une administration qui leur fixe des objectifs précis dont elle doit elle-même rendre compte au Parlement.
La loi du 1er août 2003 et les réformes subséquentes de la politique de la ville s’inscrivent ainsi dans un contexte de réforme plus large procédant de l’introduction dans l’action publique française des recettes du New Public Management. Sans attendre la révision générale des politiques publiques (RGPP), le schéma organisationnel de la politique de la ville a été entièrement reformaté pour satisfaire les trois grands principes qui guident la transformation « néo-managériale » de l’État : la séparation nette entre les fonctions de stratégie, de pilotage et de contrôle d’un côté, les fonctions opérationnelles de mise en œuvre et d’exécution de l’autre ; la fragmentation des grandes bureaucraties verticales en unités administratives autonomes chargées d’une politique publique ; le renforcement des responsabilités et de l’autonomie des gestionnaires en charge de la mise en œuvre de ces politiques, auxquels sont fixés des objectifs de résultats (Bezès, 2008).
B. UNE ÉVALUATION QUI RESTE À FAIRE
1. Des progrès substantiels de l’observation nationale, une difficulté persistante à formuler un jugement
Le besoin d’observation statistique des quartiers concernés par la politique de la ville a émergé de façon relativement précoce, moins d’ailleurs pour en mesurer les résultats que pour déterminer de façon « rationnelle » les contours de sa géographie d’intervention. Dès le milieu des années 1980, des directions régionales de l’INSEE se sont mobilisées pour fournir des données aux préfectures. En 1991, le délégué interministériel à la Ville a sollicité l’INSEE pour les besoins d’une enquête sur l’ensemble des quartiers de la politique de la ville sur la base des résultats du recensement de 1990. Ainsi est venu le « temps des statisticiens » dans cette politique (Donzelot, 2004a). Leur rôle ne s’est pas limité à la description des quartiers prioritaires, mais à leur identification même (Tissot, 2004). En effet, la demande de statistiques nationales émanant de la DIV nécessitait une définition précise de leurs périmètres qui n’avait pas été effectuée jusqu’alors. Comme l’a montré P. Estèbe (2004a), les quartiers objets de conventions avec l’État avaient été choisis sur une base intuitive par les acteurs locaux, en fonction de leur réputation locale. Outre le travail de périmétrage, les statisticiens de l'INSEE ont dû choisir, parmi l'ensemble des variables proposées par les recensements généraux de la population, trois variables permettant de cerner le profil spécifique de ces territoires : la proportion de jeunes de moins de 25 ans, d'étrangers et de chômeurs de longue durée. Puis ces variables ont été rapportées à des valeurs moyennes (commune, agglomération, France entière).
Cette mesure d’écarts allait rapidement avoir un usage autre que la seule délimitation des quartiers. Elle fournira un principe de hiérarchisation des quartiers permettant de déterminer le degré d'effort consenti par la puissance publique pour l’octroi d’avantages fiscaux, selon la possibilité ouverte par la loi d'orientation pour l'Aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995. Cette faculté s’est concrétisée avec la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville (PRV), dont l’article premier prévoyait de compenser les handicaps de trois catégories zones emboîtées les unes dans les autres : les Zones urbaines sensibles (ZUS), Zones de redynamisation urbaine (ZRU) et Zones franches urbaines (ZFU). L’essentiel de l’effort dérogatoire du PRV consistait en exonérations fiscales bénéficiant aux entreprises localisées en ZRU et, surtout, en ZFU. Comme il fallait hiérarchiser les quartiers en fonction du degré de gravité de leur handicap, les statisticiens inventèrent un « indice synthétique d’exclusion » permettant d’affecter un coefficient unique à chaque quartier11 (Estèbe, 2004a).
Tout en coexistant avec d’autres périmètres de la géographie prioritaire de l’État, la catégorie de ZUS allait connaît une fortune particulière dans la statistique publique en devenant une catégorie ordinaire du travail de l’INSEE, au même titre ou presque que les autres découpages territoriaux. Elle a également facilité le virage progressif de l’évaluation vers une approche de plus en plus quantitative, à partir de 1995, alors que l’objectif de la politique de la ville commence à être formulé en termes de rattrapage des écarts statistiques (Bruston, 2004). Cette logique est portée à son apogée par la loi du 1er août 2003 qui concentre l’ensemble de l’effort de l’État sur les seules ZUS, ZRU et ZFU et se dote avec l’ONZUS de l’instrument idoine chargé de « mesurer l’évolution des inégalités sociales et des écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, suivre la mise en œuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, mesurer les moyens spécifiques mis en œuvre et en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats » définis dans l’annexe de la loi.
a) L’ONZUS : une avancée dans la connaissance nationale qui ne débouche pas sur un jugement évaluatif
Les travaux de l’ONZUS ont permis des avancées notables sur le plan de l’observation nationale. L’Observatoire publie chaque année un rapport sur l’évolution des écarts entre les ZUS et le reste de leur agglomération, sur la base d’indicateurs spécifiques (chômage, développement économique, réussite scolaire, accès au système de santé, sécurité...). Outre l’analyse de l’évolution des indicateurs définis dans la loi du 1er août 2003 sur chacun des grands champs d’action de la politique de la ville, ces rapports présentent des études plus approfondies sur les thèmes retenus par le conseil d’orientation de l’Observatoire. L’amélioration des systèmes d’observation à laquelle s’est attelé l’ONZUS, en collaboration avec l’ensemble des organismes de la statistique publique régulièrement sollicités pour la production de ses rapports annuels, a indéniablement fait progresser la connaissance des quartiers visés par la politique de la ville et de leurs dynamiques, ainsi que des moyens mobilisés par cette politique, en apportant des informations statistiques inédites. Son rapport 2009 propose un panorama renouvelé des quartiers de la politique de la ville en présentant des statistiques plus récentes, correspondant à l’année 2008 pour certaines d’entre elles, et en étendant pour la première fois l’observation aux quartiers de la géographie des Contrats urbains de cohésion sociale non classés Zones urbaines sensibles. Ce matériau nouveau a vocation à être mobilisé dans les travaux de suivi et d’évaluation des CUCS (ONZUS, 2004 à 2009).
Une limite importante des statistiques produites par l’ONZUS est qu’elles consistent en une agrégation nationale de données locales. Elles donnent donc à voir des évolutions moyennes qui peuvent masquer des dynamiques locales très différenciées, lesquelles revêtent des significations multiples, par définition non agrégeables (Méjean, 2003). Les responsables de l’Observatoire expriment toutefois leur optimisme, estimant que les statistiques infra-communales « permettent peu à peu de construire une vision nationale des réalités locales, et donc de tirer parti de l’hétérogénéité des évolutions locales pour identifier la part due aux stimuli de la politique de la ville »12.
L’évaluation d’une politique publique ne consiste toutefois pas seulement à mesurer des évolutions et la contribution de cette politique aux évolutions mesurées. Elle doit aussi aboutir à la formulation d’un jugement partagé sur la valeur de cette politique, et de propositions pour son amélioration (Perret, 2001). Or, l’ONZUS n’est pas une instance d’évaluation. Ses rapports fournissent une matière indispensable à l’évaluation, mais ses responsables ont jusqu’à présent fait preuve d’une grande prudence, s’interdisant de prolonger leurs analyses statistiques par un jugement sur la valeur des différents programmes de la politique de la ville (Epstein, 2010). On peut aussi rappeler que la loi du 1er août 2003 prévoyait que les rapports annuels de l’Observatoire donnent lieu chaque année non seulement à un débat d’orientation parlementaire, mais aussi à des débats locaux, au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par la politique de la ville. Jusqu’à présent, ces obligations légales ont été respectées de manière purement formelle au niveau national et totalement oubliées localement (Epstein, 2007a ; Guigou, 2008).
b) Un paysage fragmenté de l’évaluation nationale
La difficile émergence d’un jugement évaluatif sur la politique de la ville est accentuée aujourd'hui par la multiplication des lieux où s’énoncent des analyses globales ou sectorielles sur cette politique. Cette multiplication s’explique d’abord par le fait que chacun des programmes de la politique de la ville s’accompagne d’incitations fortes à la mise en place de dispositifs d’évaluation locale. Il n’est pas rare, dans un même site, de voir coexister plusieurs démarches d’évaluations portant sur le PRU, le CUCS, le PRE et parfois d’autres dispositifs de la politique de la ville. Si le SG-CIV missionne régulièrement des cabinets de consultants pour faire la synthèse des évaluations locales sur un programme donné ou sur un volet thématique des CUCS, il a cependant abandonné l’idée suivant laquelle ces synthèses pourraient servir de base à une évaluation nationale de la politique de la ville (Avide, 2008). La dernière initiative récente de capitalisation nationale – un questionnaire de la DIV adressé aux instances d’évaluation des CUCS au cours de l’été 2009 – visait d’ailleurs moins à alimenter l’évaluation nationale qu’à prendre connaissance de l’état d’avancement des démarches d’évaluation locale, et à faire remonter les avis des acteurs locaux sur l’instrument contractuel de façon à alimenter la réflexion nationale sur le devenir de la géographie prioritaire et des contractualisations (DIV, 2010).
La fragmentation de l’évaluation se retrouve au niveau national. Outre le SG-CIV, qui assure le secrétariat permanent de l’ONZUS, les deux agences nationales placées sous sa tutelle, l’ANRU et l’ACSÉ, disposent aussi de leur propre service d’étude et d’évaluation. S’ajoute dans le cas de l’ANRU, l’existence d’un Comité d'évaluation et de suivi (CES). Mais ce dernier n’est pas véritablement parvenu à s’imposer comme l’instance d’évaluation légitime du PNRU. Faute de mandat formel définissant son rôle et en l’absence de démarches préliminaires qui lui auraient permis de se doter d’un référentiel d’évaluation structurant ses travaux dans la durée, le CES s’est positionné dans un rôle de « commentateur chemin faisant » de la mise en œuvre du programme plutôt que d’évaluateur (Epstein, 2010), en se concentrant presque exclusivement sur les moyens dévolus à la rénovation urbaine et les conditions de son pilotage national et local (CES de l'ANRU, CGPC, 2007 ; CES de l'ANRU, 2007, 2008a, 2008b, 2008c), du moins jusqu’à son dernier rapport qui esquisse une analyse des impacts du PNRU (CES de l'ANRU, 2010). Plus encore, son existence et ses travaux ont été contestés à plusieurs reprises par des parlementaires du Sénat (Dallier, Karoutchi, 2006 ; Dallier, 2010).
L’intégration des travaux évaluatifs conduits par le SG-CIV, l’ANRU et l’ACSÉ, sous la houlette de l’ONZUS13 devrait permettre d’avancer vers une mutualisation des connaissances qui servirait le jugement collectif (Avide, 2008). Mais ce rapprochement ne réduit que partiellement la fragmentation évaluative. Après ses deux rapports publics particuliers de 1995 et 2002, la Cour des comptes – dont la mission d’évaluation des politiques publiques a été réaffirmée par la LOLF et la révision constitutionnelle de 2008 – a produit en octobre 2007 un nouveau rapport sur la gestion des crédits de la politique de la ville, à la demande de la commission des Finances du Sénat, qui l’avait saisie dans le cadre des dispositions de la LOLF, puis un autre en septembre 2009 sur l’articulation de la politique de la ville et des dispositifs de l’éducation prioritaire dans les quartiers sensibles (Cour des comptes, 2007 et 2009). Le Sénat s’est lui-même positionné, en 2005, sur l’évaluation de la politique de la ville en créant une « Mission commune d’information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années » (Türk, André, 2006). À la suite de la révision constitutionnelle de juillet 2008 donnant au Parlement une fonction d’évaluation les politiques publiques, au-delà de son rôle d’élaboration législative et de contrôle de l’action du Gouvernement, l’Assemblée nationale a mis en place le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, destinataire de la présente étude, qui a retenu la politique de la ville parmi ses premiers objets d’évaluation. À cela s’ajoutent une multitude de rapports d’information parlementaires qui, s’ils ne se présentent pas formellement comme des évaluations, portent des jugements sur cette politique au terme d’investigations plus ou moins fouillées. À titre d’exemple, P. André a rendu public un « rapport d’information sur l’avenir des contrats de ville » au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan du Sénat (André, 2005), avant de remettre au Premier ministre, en septembre 2009, un rapport cosigné avec le député G. Hamel, président de l’ANRU, prenant position et formulant des propositions sur la réforme de la géographie prioritaire et des contractualisations de la politique de la ville (Hamel, André, 2009).
Au total, faute de structure ad hoc de type « instance d’évaluation », la mise en débat des données nouvelles produites par l’ONZUS, comme par d’autres organismes, ne peut que basculer dans des forums politiques et médiatiques dont les règles de fonctionnement sont par nature fort éloignées de celles qui définissent un espace évaluatif (Epstein, 2007a). Comme cela a été relevé de longue date par D. Béhar (1997a), la politique de la ville « apparaît comme une gigantesque opération rhétorique » et « le foisonnement discursif sur cette politique, apte à épuiser par avance tout évaluateur en puissance, a pour corollaire une diversité extrême des avis qui en résultent […]Cette légitimité a priori de tous les points de vue formulés sur la politique de la ville produit un résultat simple : l'agrégation de ces points de vue, la construction d'un avis collectif, sont quasi impossibles ».
c) Vers une approche technocratique de l’évaluation
La loi du 1er août 2003 a entendu créer les conditions d’évaluabilité de la politique de la ville. Mais celles-ci n’ont pas encore permis le développement d’une évaluation « démocratique », au sens que lui a donnée le rapport Viveret (1989), c'est-à-dire comme moyen « d’accroître la qualité de la vie démocratique » en nourrissant le débat public par la formation d’un jugement collectif sur la valeur d’une politique publique. Dans le système institutionnel qui résultait des premières lois de décentralisation, caractérisé par la coexistence de multiples institutions politiques et administratives dont les compétences et interventions se chevauchent, l’évaluation s’efforçait d’instituer de tels espaces partenariaux de débat. La LOLF a opéré un net virage vers une évaluation d’inspiration plus technocratique, entièrement tournée vers la mesure de la réalisation d’objectifs précisément énoncés au niveau national, laissant un place résiduelle au débat, qu’il s’agisse de la mise en débat des indicateurs en fonction desquels s’opère la mesure ou du débat sur l’imputation des faits mesurés aux politiques menées (Trosa, Perret, 2005).
L’idée technocratique suivant laquelle il suffirait de parfaire le système d’objectifs et d’indicateurs de la LOLF pour accomplir le programme évaluatif du texte organique se heurte à des problèmes bien connus des sciences sociales. Il ne suffit pas de décliner les politiques publiques en programmes, assortis d’objectifs précis et d’indicateurs de résultats pour dépasser les blocages passés de l’évaluation. La littérature anglo-saxonne regorge d’exemples laissant penser que ce mode de conception et de pilotage des politiques publiques peut même aller à l’encontre de la transparence et de la performance recherchées (Beauvallet, 2009). Les systèmes articulant une profusion d’objectifs et d’indicateurs, des activités de reporting14 systématique et des procédures d’audits réguliers produisent d’importantes distorsions dans les politiques menées, incitant les opérateurs à se concentrer sur les activités les plus « rentables », car mesurables, et non vers des tâches plus qualitatives et plus complexes à mesurer ou simplement mal renseignées par les indicateurs définis par les bailleurs de fonds (Bevan, Hood, 2006 ; Salais, 2010). Comme l’écrit D. Lorrain (2006) à propos du rôle des indicateurs dans la politique de la ville : « Ces artefacts, dont le nombre et la sophistication statistique ne cessent de croître, sont d’une grande portée. Ils réduisent la complexité du monde réel ; ils apportent plus d’efficacité et permettent de légitimer les décisions : condition essentielle de l’agir en démocratie. Mais ils affectent aussi le sens donné à des situations. Premièrement, ces opérations d’enregistrement filtrent et simplifient ; parfois, dans les mailles de leur tamis, disparaissent des faits essentiels. Donc, le premier effet des instruments, en fonction de leurs propriétés, est de limiter la vision. Deuxièmement, et c’est un effet plus subtil, ils incorporent un point de vue cognitif sur les choses. Ils présupposent des catégorisations, des définitions de critères ; ils portent un jugement sur le réel ».
À propos du Programme national de rénovation urbaine, R. Epstein (2010) montre les limites de la réforme opérée en 2003, tant sur le plan de la mesure de la performance que du débat démocratique : l’instance dédiée à l’évaluation du PNRU, le Comité d'évaluation et de suivi de l’ANRU, s’est heurtée à l’absence d’informations cruciales, nécessaires pour juger de l’effectivité du programme et a fortiori pour juger de son efficacité. Quant au bel ordonnancement « lolfien » des responsabilités évaluatives, entre le Parlement, l’administration et l’Agence, il demeure purement théorique : en pratique, les rapports entre l’ANRU et le SIG-CIV relèvent plutôt d’une tutelle inversée, et l’ANRU a fortement pesé sur la formulation des objectifs et indicateurs présentés au Parlement, lui imposant en quelque sorte sa conception de la performance (Epstein, 2010).
Piloté par l’ACSÉ, le volet social de la politique de la ville n’est accompagné d’aucune instance d’évaluation nationale permettant de porter un regard global sur ce secteur. Le parti pris évaluatif de l’Agence consiste pour l’essentiel en une amélioration de la connaissance sur ses postes de dépenses les plus conséquents. L’ACSÉ a ainsi commandé des études sur les programmes de Réussite éducative (Trajectoires, 2008), les Adultes-relais (Équation Management, 2009), les Ateliers santé-ville (Kynos, 2009) ou les opérations Ville-vie-vacances (ARESS, 2008). L’approche se veut comparative pour éviter de tirer des conclusions sur la mise en œuvre des programmes à partir de moyennes nationales. Il s’agit alors d’identifier des écarts entre objectifs et réalisations en fonction des contextes territoriaux. L’approche de l’ACSÉ n’en reste pas moins étroitement indexée sur une entrée par des programmes spécifiques, c'est-à-dire sur une logique de suivi des réalisations plutôt que d’évaluation autorisant à porter un jugement global sur le volet social de la politique de la ville (Avide, 2008).
2. Des évaluations locales plus formelles que substantielles
Localement, l’engagement d’une démarche d’évaluation de la politique de la ville est d'abord tributaire des volontés politiques. Il importe en effet de distinguer entre l’État qui propose d’évaluer et les collectivités locales qui disposent (DIV, 2002a). Parmi les freins à l’évaluation locale, les réticences des élus ont souvent été signalées (Jacquier, 2004 ; Monnier, 2004). Car l’évaluation induit une idée de jugement (Sauvage, Gillio, 1993), laquelle heurte dans bien des cas les élus considérant que la meilleure évaluation est celle du suffrage universel (Latz, 2009). Cette réticence se vérifie en particulier dans le refus fréquent de donner une publicité aux rapports d’évaluation (Gaultier, Huet, 2002).
Si les élus locaux affichent le souci d’une utilisation rationnelle des deniers publics, cette exigence atteint rapidement ses limites à propos du PNRU qui représente pourtant le programme de la politique de la ville le plus coûteux pour la collectivité publique (Robert, 2005). Rares sont les sites en rénovation urbaine à avoir engagé une démarche d’évaluation ou qui projettent simplement de le faire (Harzo, Lauriac, 2009 ; Act consultants et al. 2009a), au-delà des bilans réalisés à l’occasion des « points d’étapes ». Une résistance proprement politique à l’évaluation de ces projets de démolition-reconstruction se manifesterait donc, les élus étant tentés de se réfugier derrière l’idée d’une rénovation urbaine qui profite mécaniquement à tous, dans un jeu à somme toujours positive, avec des gagnants de toutes parts (Kirszbaum, 2010). Le cas de la rénovation urbaine rappelle aussi que les difficultés de l’évaluation ne sont pas uniquement d'ordre technique, mais renvoient à des dimensions plus structurelles de l’action publique, notamment aux besoins de légitimation des responsables politiques, mais aussi des acteurs administratifs engagés dans une lutte pour l’obtention de ressources budgétaires rares (Epstein, 2010).
a) Une logique de reporting du local vers le national
Les obstacles à l’évaluation des projets de rénovation urbaine (PRU) ne sont pas seulement le fait des élus qui portent localement cette politique. L’ANRU ne les encourage guère dans cette voie. Les différentes acceptions données à l’évaluation par l’ANRU obéissent à une logique profondément a-territoriale, laquelle ne suppose à aucun moment la constitution d’un référentiel local d’évaluation. C’est que l’« évaluation » des PRU procède contractuellement de l’initiative de l’agence et porte sur des objets fixés par celle-ci. Les premières conventions de rénovation urbaine allaient jusqu’à préciser que le résultat de cette évaluation « pourra, dans des modalités à convenir, être porté à la connaissance des acteurs locaux ». Ce qui suggère qu’elles pouvaient ne pas l’être ! Depuis lors, ces conventions ont rendu obligatoire, à deux ans et quatre ans après leur signature, la production d’un « point d’étape » établi par des consultants choisis et financés par l’Agence nationale. Les thèmes d’investigation sont également précisés depuis le niveau national. L’objectif fondamental de ces points d’étape est de servir de point d’appui pour négocier d’éventuelles révisions des programmes dans le cadre d’avenants signés avec l’ANRU. S’ajoute aussi désormais l’obligation de procéder à une revue de projet annuelle. Si elles ont l’avantage d’ouvrir un espace de discussion entre partenaires locaux, ces revues de projet doivent avant tout « permettre de soulever les difficultés susceptibles de générer un retard de mise en œuvre du programme convenu et d’anticiper toutes mesures susceptibles d’y répondre ». Les points d’étape et revues de projet s’apparentent finalement à des modalités améliorées de remontées d’information vers le niveau national, venant s’ajouter aux autres obligations de reporting, notamment au suivi du planning (mise à jour annuelle des échéanciers physiques et financiers), lequel n’apporte de réponses qu’à la question de l’effectivité des réalisations prévues par les conventions et leurs avenants (Kirszbaum, 2010).
La logique de reporting est très similaire du côté de l’ACSÉ qui, en plus d’études ponctuelles sur ses programmes d’intervention, a mis en place un dispositif de suivi permettant d’identifier les moyens qu’elle y consacre. Ainsi, c’est dans une finalité première de suivi budgétaire qu’une nomenclature analytique a été créée à partir de 2007. Organisée en arborescence, elle identifie 9 thématiques, 16 sous-thèmes, 44 objectifs et 219 modalités d’action. Cette nomenclature a vocation à être instruite par les services déconcentrés de l’État grâce à un logiciel informatique (appelé GIS) permettant le suivi individuel de chaque dossier bénéficiant d’une subvention de l’Agence dans le cadre d’un CUCS (Avide, 2008). Les partenaires locaux des CUCS (collectivités locales et porteurs de projets) sont sollicités à leur tour par les préfectures pour renseigner cette base de données, mais la constitution d’un savoir national sur les CUCS et leurs opérateurs est d’une utilité toute relative pour les acteurs locaux – y compris les préfectures. Outre la dimension chronophage de l’exercice, les discordances apparues entre la nomenclature nationale et celles qu’utilisent les gestionnaires locaux des CUCS sont au cœur de beaucoup de critiques formulées par ces derniers (Kirszbaum, 2009a). Selon une enquête auprès des professionnels de la politique de la ville, l’injonction de l’État à recueillir des indicateurs « laisse le local très dubitatif face à ce qu’il considère comme une démarche déconnectée des intérêts locaux. (....) Cette situation a tendance naturellement à indexer les démarches locales sur les attendus de l’État dont les exigences en la matière ne cessent d’évoluer, empêchant ainsi bien souvent que ne se développent leurs propres initiatives. C’est donc majoritairement la logique nationale qui prime face aux intérêts locaux en matière d’évaluation. (...) Le risque est, dans la plupart des situations, que l’évaluation ne devienne un exercice qui échappe au sens du projet pour s’inscrire dans un processus au caractère technocratique très marqué. » (Aurès, 2009).
En 1995, M. Autès proposait de distinguer les politiques « territorialisées » des politiques « territoriales » pour rendre compte de la différence entre des approches descendantes, mobilisant le territoire comme lieu de mise en oeuvre, et des approches construites de manière ascendante depuis les territoires (Autès, 1995). On peut appliquer cette grille d’analyse à l’évaluation des programmes de la politique de la ville en distinguant des évaluations territorialisées et des évaluations territoriales, les secondes étant appropriées par les acteurs locaux (Berthet, 2008). Cette appropriation ne va guère de soi dans le contexte actuel. En effet, les instruments nationaux de suivi de cette politique absorbent une grande part des énergies qui pourraient être consacrées aux évaluations locales. On peut y voir aussi le signe d’une déconnexion croissante entre les sources d’information respectivement utiles aux niveaux national et local (Lamarque, 2004). Il y aurait une dissociation tendancielle entre, d’un côté les besoins nationaux de suivi des programmes, destinés à rendre des comptes au Parlement dans le contexte de la LOLF, et de l’autre les besoins de connaissance ancrés dans les spécificités et priorités propres à chaque territoire (Avide, 2008). Dans cette tension, ce sont les exigences de reporting des agences nationales qui prévalent, y compris aux dépens des préfectures de département et de région qui sortent affaiblies dans leur rôle de portage des préoccupations évaluatives (Guigou, 2008), alors qu’elles avaient joué un rôle non négligeable pour susciter des évaluations sous le XIème Plan, notamment en Île-de-France (Bravo, 1999). La fonction des préfectures était alors pensée comme celle d’un « échangeur », situé au point de jonction d'une politique nationale descendante et de projets locaux remontants (Donzelot, Estèbe, 1994). Les instruments nationaux de suivi de la politique de la ville servent aujourd'hui à constituer un savoir national sur le local, sans que les préfectures puissent l’utiliser comme une ressource pour construire une capacité d’action propre dans le jeu avec les collectivités locales (Kirszbaum, 2009a).
b) Les acteurs des CUCS aux prises avec l’évaluation managériale
À la différence des conventions de rénovation urbaine, les Contrats urbains de cohésion sociale prévoient systématiquement une évaluation au terme de trois années de mise en œuvre. La quasi-totalité (environ 97%) des sites ayant répondu au questionnaire national précité du SG-CIV déclarent réaliser une évaluation (DIV, 2010). Mais sous la dénomination d’évaluation, il s’agit dans bien des cas de réaliser une simple synthèse des bilans des actions financées par les CUCS, c'est-à-dire du « bilan amélioré » (Aurès, 2009). Et derrière ces actions, ce sont les porteurs de projets bénéficiant des crédits des CUCS qui se trouvent sur la sellette pour satisfaire aux exigences relatives à l’efficience de la politique de la ville. T. Kirszbaum (2010) fait l’hypothèse que le social et les organisations qui agissent dans ce champ sont mis en demeure de prouver leur utilité au nom d’une philosophie du mérite, encline à la suspicion envers les « pauvres non méritants », tandis que les interventions sur l’urbain (cadre bâti et espaces extérieurs) échapperaient à cette interrogation puisque la société tout entière est supposée tirer parti de l’investissement urbain qu’elle consent dans les quartiers défavorisés.
La tendance consistant à rabattre l’évaluation sur une démarche de suivi des réalisations était déjà pointée à propos des évaluations locales des Contrats de ville du XIème Plan. Le contrat était souvent considéré comme la somme des actions qui le compose, c'est-à-dire comme un simple guichet. Cette lecture conduisait à faire porter l’évaluation sur ces seules actions, ce qui pouvait certes éclairer les financeurs dans leur choix de reconduire ou non des projets, mais ne permettait en rien de produire une évaluation du Contrat de ville compris comme une politique publique locale, c'est-à-dire comportant des orientations politiques, des moyens et des modes d’action propres (Estèbe, Epstein, 1998 ; Epstein, 1999). Avec les Contrats urbains de cohésion sociale, cette perspective semble plus lointaine que jamais, car elle n’est plus guère encouragée à l’échelon national. La circulaire du 5 juillet 2007 sur l’évaluation des CUCS évoque « l’évolution des pratiques et du fonctionnement du contrat » au titre des objets d’évaluation, mais dans la seule perspective d’identifier des « bonnes pratiques ». Selon l’analyse qu’en propose Élise Avide (2008), en se focalisant pour l’essentiel sur les « bilans annuels de réalisation », « la mesure ou l’identification des résultats produits par les programmes d’action » et « l’évaluation de l’impact du contrat lui-même », cette circulaire consacrerait une conception largement managériale de l’évaluation, au sens où « tout ce qui relève du travail d’interrogation sur le sens même des projets est finalement bien peu mis en avant ». La logique de résultats que sous-tend cette circulaire a le mérite d’orienter les évaluations sur les effets concrets de l’argent public investis dans les CUCS, mais « elle occulte par là même le caractère multidimensionnel de la politique de la ville en ramenant toutes les actions qui y concourent à une appréciation en termes de coûts et avantages par secteur d’intervention ». La dimension transversale de la politique de la ville tend donc à disparaître de ces évaluations alors même que les évaluations réalisées depuis le début des années 1980 avaient souligné que la performance de cette politique dépend de « l’imbrication, voire l’agencement dans le temps, des diverses actions sectorielles. Ainsi, ce qui pourrait apparaître comme une contre performance dans le domaine du traitement du logement par exemple, peut être en réalité dû à un choix local de commencer par le social, pour aborder ultérieurement la réhabilitation dans des conditions de nature à en assurer la réussite. » (Levy, 1988)
Ceci ne signifie pas que les praticiens locaux des CUCS aient renoncé à considérer l’évaluation comme un espace de réflexion stratégique. L’évaluation au sens « du besoin d’éclairages, d’espaces de travail et d’espaces de confrontation » (Latz, 2009) rencontrait une adhésion forte chez les techniciens des Contrats de ville (Bruston, 2004). Cette approche est également très répandue chez ceux qui œuvrent dans le cadre des CUCS (Aurès, 2009). Mais les tâches chronophages liées à la gestion des programmes verticaux et morcelés de l’ACSÉ les empêchent de prendre collectivement du recul. Ils ont alors tendance à déléguer l’intégralité des missions évaluatives à des tiers extérieurs qui construisent des batteries d’indicateurs si complexes qu’elles ont plutôt pour effet de brouiller le regard des acteurs sur ce que produisent effectivement les CUCS, en même temps que tout questionnement stratégique se trouve éludé (Kirszbaum, 2009a, 2010). Il faut dire que ce dernier registre n’est guère valorisé par le « guide de l’évaluation des CUCS » proposé par la DIV (Argos, Cirese, 2007). Élaboré par des cabinets de consultants, il traite principalement de l’évaluabilité, non pas au sens de l’explicitation des intentions locales, comme le faisait le guide de 1995 élaboré par le cabinet Acadie (DIV, 1995a), mais au sens de la construction d’indicateurs censés donner une meilleure lisibilité aux actions mises en œuvre. L’analyse critique de ce second guide qu’a faite E. Avide (2008) conclut que « cette approche montre combien la méthode prônée par le guide relève bien plus largement du suivi de la politique menée que de son évaluation, (...) sans rechercher le jugement partagé ». Les indicateurs sont l’un des outils de l’évaluation, mais à condition d’être construits et interprétés dans une démarche collective permettant de répondre à des questions d’évaluation de nature à éclairer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience ou l’impact d’une politique publique (CSE, 1996). En l’absence de cette dimension, il ne faut pas sous-estimer les risques de rejet de l’approche managériale de l’évaluation, par les acteurs mêmes qui sont chargés de la mettre en œuvre. C’est ce que suggère A. Latz (2009), selon qui la « culture du résultat » se fait « au détriment du sens » et « appauvrit fortement les réalités » sur lesquelles travaillent les acteurs, produisant ainsi leur « insatisfaction ». L’enquête précitée auprès de professionnels de la politique de la ville indique que « les résistances sont nombreuses et la peur de voir s’immiscer dans le paysage culturel du développement social des démarches issues du monde de l’entreprise reste encore extrêmement présente au sein des équipes » (Aurès, 2009)
c) Des appareils statistiques inadaptés à l’observation locale des écarts territoriaux
La circulaire du 5 juillet 2007 demande que l’évaluation s’inscrive « dans une logique de résultats et pas seulement dans une logique de compte-rendu de réalisations ». Les CUCS doivent notamment faire la démonstration de leur capacité à atteindre l’objectif devenu central de réduction des écarts entre les ZUS et les autres territoires. Il s’agit en fait d’apprécier « les changements structurels induits sur un site par la mise en oeuvre du contrat », par exemple « améliorer l’attractivité économique ou l’image du quartier, générer davantage de mixité sociale, améliorer les conditions de vie quotidienne des habitants, etc. ». Pour organiser cette mesure, la circulaire suggère de se référer aux principaux « indicateurs de contexte » énoncés dans l’annexe 1 de la loi du 1er août 2003. Mais comme ces derniers sont principalement centrés sur l’analyse des ZUS, la DIV a précisé par la suite que chaque collectivité pouvait « en faire ou non le coeur de sa démarche d’observation » (DIV, FNAU, 2008).
Les deux types d’indicateurs identifiés par l’annexe de la loi Borloo portent la marque d’une ambiguïté constitutive (Gilli, Kirszbaum, 2008). L’objectif de « retour au droit commun » mis en avant par l’exécutif renvoie en fait à une double finalité : les « indicateurs de résultats » portent sur les caractéristiques socio-économiques des ZUS, et renseignent donc sur le retour de ces quartiers dans le droit commun; les « indicateurs de mise en œuvre » mesurent l’effort public en leur direction, et donc le retour du droit commun dans les quartiers. Cette seconde acception de la réduction des écarts est celle que privilégie une forte majorité de praticiens locaux qui font valoir une préoccupation d’égalité des chances dans l’accès aux ressources publiques. Mais le décalage est flagrant entre cette conception largement partagée du rattrapage territorial et sa mesure concrète dans les CUCS. Leur évaluation est censée « prendre en compte pour l’État, comme pour chacun des partenaires, la mesure des moyens de droit commun mis en œuvre »15, mais les acteurs des CUCS n’ont construit aucun instrument à même d’apprécier une éventuelle discrimination positive territoriale en faveur des territoires prioritaires et de leurs habitants (Kirszbaum, 2010).
La plupart des CUCS ont pris à bras le corps, en revanche, la question des indicateurs socio-économiques permettant de caractériser les territoires. Si le problème se pose de façon aigue, l’indisponibilité des données statistiques fait toutefois obstacle à ces démarches d’observation locale (ONZUS, 2005 ; DIV, 2010), s’agissant notamment des données relevant des domaines de compétence de l’État visés dans l’annexe de la loi Borloo. Cet obstacle tient pour beaucoup à l’histoire qui a vu se consolider un appareil statistique destiné à répondre aux besoins de connaissances de l’État et non à ceux des pouvoirs locaux (Desrosières, 1993). Or, les données utiles à l’observation socio-démographique et économique sont produites pour la plupart par des administrations et organismes dépendants de l’État. Leur indisponibilité ne résulte pas seulement des réticences de telle ou telle administration pour communiquer ses chiffres dans des jeux de pouvoir ou d’autoprotection. Ces données n’ont tout simplement pas été construites à des fins d’observation des écarts entre les territoires prioritaires de la politique de la ville et leur environnement.
Une première difficulté provient de l’obsolescence de beaucoup de données issues du recensement général de la population qui datent parfois de 1999 (Guigou, 2008). Une autre renvoie aux découpages territoriaux de la politique de la ville qui coïncident rarement avec ceux des administrations productrices de données statistiques. Les limites géographiques de la politique de la ville sont elles-mêmes sujettes à de grandes variations d’un dispositif à l’autre. Autant les ZUS bénéficient – jusqu’à présent – d’un périmètre stable et précis, autant les collectivités locales mobilisent des échelles d’intervention variables, y compris au sein d’un même dispositif. Les limites géographiques des « quartiers CUCS » reposent ainsi sur des critères diversifiés. Comme cela a été souligné par le « Livre vert » sur la géographie prioritaire de la politique de la ville, le tracé de certains quartiers CUCS s’appuie sur le maillage IRIS ou la commune entière, tandis que d’autres font référence à d’autres critères (réseau routier, occupation du sol, forme du bâti, périmètre des opérations de rénovation urbaine, etc.). Le même document rappelle aussi que la géographie d’intervention de l’État n’est pas elle-même homogène : outre les ZUS, il faut compter avec les ZFU, les ZRU, les quartiers ANRU et les quartiers de la dynamique « Espoir banlieues » (DIV, 2009a).
Au plan national, c’est l’échelle des ZUS qui a été fortement privilégiée comme périmètre de référence pour la collecte des données, notablement depuis la création de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles. Si la connaissance statistique des ZUS a été fortement améliorée grâce à l’Observatoire qui a su mobiliser différents organismes publics producteurs de données, il faut en nuancer le bénéfice pour les besoins d’observation des collectivités locales. Car la conception même de l’observation mise en oeuvre depuis 2003 procède d’une démarche stato-nationale, les collectivités locales étant seulement mises à contribution quand il s’agit de fournir à l’ONZUS les données qui ne peuvent être collectées par les administrations centrales (Guigou, 2008). Cet Observatoire devait initialement faciliter l’accès aux données infra-communales utiles à l’évaluation des contractualisations locales, mais le partenariat avec l’INSEE, nécessaire à la constitution d’un matériau statistique pertinent à cette échelle, a été long à se mettre en place. La possibilité de communiquer des informations sur les ZUS les plus petites est d’ailleurs soumise à des restrictions, variables d’une source à l’autre (ONZUS, 2005).
À ce jour, la création de l’ONZUS a surtout eu pour effet d’améliorer la connaissance nationale des quartiers beaucoup plus qu’il n’a alimenté l’observation locale. Des améliorations progressives ont néanmoins été apportées, notamment à la faveur de l’extension du champ des données accessibles via le Système d’information géographique de la DIV (SIGville). Créé en 2002, il met à la disposition des acteurs locaux des éléments statistiques et cartographiques au fur et à mesure de leur disponibilité. Pour compenser les carences de l’État, la DIV a également soutenu le développement d’observatoires locaux. Elle a ainsi fait appel à la Fédération nationale des agences d’urbanisme, depuis le début des années 2000, cette collaboration aboutissant à la publication de différents répertoires des observatoires locaux, puis d’un guide méthodologique de l’observation locale dans la politique de la ville, dont l’un des chapitre s’intitule significativement : « L’État au service de l’observation locale » (DIV, FNAU, 1998).
3. L’impact, point aveugle des évaluations
Au terme d’une décennie marquée par l’introduction dans la politique de la ville d’approches et d’instruments néo-managériaux qui devaient conjointement améliorer son efficacité et son évaluabilité, les doutes persistent sur sa capacité à peser sur les enjeux qui justifient son existence. Malgré la profusion d’outils d’observation et d’analyses, le savoir sur cette politique achoppe presque toujours sur l’identification de ses effets propres sur les quartiers et populations concernés (i.e. de son impact). Ce problème n’est pas propre à la politique de la ville. Il est inhérent à toute démarche d’évaluation d’une politique publique, comprise comme le fait de « reconnaître et mesurer ses effets propres » (Deleau et al., 1986) Dans son Petit guide de l’évaluation, le Conseil scientifique de l'évaluation avait consacré d’amples développements à cette question, soulignant que « l'identification et la mesure des effets de l'action publique constitue souvent, pour le commanditaire, l'enjeu principal de l'évaluation. C'est aussi, en général, la question la plus difficile à traiter. Toute action visant à modifier l'état de la société interfère avec les évolutions endogènes de celle-ci, et avec une multitude d'autres facteurs exogènes, y compris l'impact d'autres actions publiques. Dans la pratique de l'évaluation, on a souvent affaire à des systèmes complexes au sein desquels il est difficile de quantifier des relations de causalité » (CSE, 1996).
a) Des Contrats de ville aux CUCS : une difficulté non surmontée
Alors que l’évaluation des opérations de Développement social des quartiers des années laissait totalement dans l’ombre la question de leur impact pour se concentrer uniquement sur les conditions de leur mise en œuvre locale et sur leurs réalisations (Levy, 1988), cette question a commencé d’émerger, au cours des années 90, dans les évaluations des Contrats de ville. Ces évaluations n’avaient guère apporté de réponses convaincantes en dépit de la multiplicité des méthodes d’enquête mobilisées, que ce soit dans un souci d’objectivité (tableaux de bord d’indicateurs statistiques) ou pour faire droit aux perceptions des habitants (sondages, panels d’habitants, suivi de groupes témoins, entretiens approfondis…) (Estèbe, Epstein, 1998).
Ces initiatives locales restaient de toute façon décalées en regard de l’objectif central de la politique de la ville telle qu’il avait été défini par le Comité national d’évaluation du Xème Plan : exercer un « effet levier » sur les politiques ordinaires pour inciter à apporter des réponses plus efficaces aux situations d’exclusion socio-urbaine (Donzelot, Estèbe, 1994). L’enjeu du Contrat de ville s’exprimant en termes de plus-value apportée aux politiques sectorielles, l’enjeu méthodologique de l’évaluation revenait à porter un jugement sur sa capacité impulser les logiques du partenariat inter-institutionnel, de la territorialisation des politiques sectorielles, de la discrimination positive ou de l’expérimentation d’actions innovantes dans l’action publique ordinaire (Béhar, 1997a). Ce sont bien ces transformations – des effets indirects sur les politiques publiques plutôt que des effets directs – qu’ont donné à voir, dans le meilleur des cas, les évaluations finales des Contrats de ville du XIème Plan (1994-1999) et les évaluations intermédiaires des Contrats de ville du XIIème Plan (2000-2006). Dans le meilleur des cas, car ces évaluations ont parfois confondu les deux registres, les changements observés dans les quartiers étant imputés à la politique menée sans qu’aucune démonstration ne vienne prouver ce lien. Plus souvent, elles ont totalement négligé la question des effets et impacts (outcomes) pour se contenter de décrire des réalisations (outputs) (Epstein, Kirszbaum, 2005).
Le lancement des CUCS s’est accompagnée d’une incitation – voire d’une injonction – nationale à réorienter les évaluations locales vers la mesure d’impact. En l’absence de synthèse nationale du contenu des évaluations de ces CUCS, il est difficile de savoir si les évaluations locales ont effectivement mesuré les effets de cette procédure sur les conditions d’existence des habitants des quartiers prioritaires. Les réponses au questionnaire adressé par le SG-CIV aux instances d’évaluation des CUCS semblent témoigner d’une large prise en compte de cette préoccupation : quand l’évaluation est suffisamment avancée (dans les trois-quarts des CUCS), 84,6% des CUCS chercheraient à mesurer ses effets sur les bénéficiaires directs des programmes et actions (DIV, 2010). Une enquête ciblée sur trois CUCS (Argenteuil, Dreux, Lormont) montre néanmoins qu’il y a encore très loin de l’intention à la pratique, et que les opérateurs de quartier, notamment associatifs, sont encore loin d’avoir intégré la logique de performance promue au niveau national et relayée jusqu’à un certain point par leurs financeurs locaux (Kirszbaum, 2009a). Le moment-clé de leur « évaluation » repose en fait sur la production d’un bilan annuel faisant une large place à la description littéraire de l’action financée. Son impact sur les bénéficiaires – estimé par l’opérateur lui-même – apparaît en effet difficilement traduisible dans des indicateurs quantitatifs. Si des chiffres sont produits, c’est que l’État local les exige. Mais du point de vue des opérateurs, leur production est vécue comme un exercice obligé, pour ne pas dire inutile, et dans tous les cas très coûteuse en temps, au détriment précisément de l’action auprès des bénéficiaires. En outre, à l’encontre de ce que laissait entendre la phase d’élaboration des CUCS, les performances associatives mesurées sur la base de ces indicateurs ne servent nullement à juger du bien-fondé des projets et à réorienter les programmations locales en conséquence. Pointée de longue date, la logique de reconduction des mêmes opérations – et souvent des mêmes projets – d’une année sur l’autre reste le cas de figure très dominant. Il est d’autant moins aisé de mettre fin au financement de certaines actions, que les structures qui les portent sont généralement très dépendantes des crédits spécifiques de la politique de la ville pour assurer leur survie.
b) Une dimension négligée des programmes sectoriels
Les CUCS ont également pour fonction de décliner les programmes nationaux de l’ACSÉ relevant de différents secteurs thématiques. Les éléments d’évaluation disponibles au niveau national montrent, là aussi, que la mesure des effets propres de ces dispositifs sur leurs bénéficiaires reste massivement lacunaire.
C’est le cas du Programme de réussite éducative, issu du Plan de cohésion sociale de juin 2004, pour individualiser le suivi des élèves en difficulté et améliorer ainsi leurs performances scolaires. La contribution propre des projets de réussite éducative (PRE) à la réussite scolaire est pourtant indétectable dans les évaluations engagées depuis lors (ce qui ne veut pas dire qu’elle n’existe pas). Les universitaires chargés par la DIV de « mettre en perspective » les changements introduits par le Programme de réussite éducative redoutaient que, comme « très souvent, en matière de politique de la ville, (...) l’évaluation porte davantage sur les avancées partenariales qui ont été réalisées, sur les collaborations inédites qui ont été initiées, sur les relations de travail nouées entre des institutions ou des professionnels qui n’étaient pas habitués à travailler ensemble ou que séparaient encore radicalement des logiques et des identités professionnelles », et que l’« on néglige de se demander avec rigueur, c’est-à-dire au-delà d’un simple décompte des “bénéficiaires” et des moyens mis en oeuvre à leur profit, ce que le dispositif a réellement produit pour les gens qu’il visait » (Joly-Rissoan et al., 2006). À lire la « Synthèse du rapport Réussite éducative 2009 » de l’ACSÉ, qui tire ses informations d’une série d’enquêtes locales (ACSÉ, 2009), et le rapport de la Cour des comptes publié concomitamment sur l’articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation nationale, il semble que cette mise en garde n’ait pas vraiment porté. La Cour des comptes relève que le rapport de l’ACSÉ (obligatoire depuis la loi de finances pour 2008) donne « essentiellement un bilan quantitatif » de la mise en oeuvre du PRE et que l’analyse de l’efficacité des PRE pour la réussite des élèves « a été peu développée, en dépit de son caractère essentiel (...) : il n’existait toujours pas, à la mi-2009, d’étude d’impact portant sur un échantillon représentatif. Seules quelques études partielles et effectuées sur la base d’éléments déclaratifs ont été réalisées par l’ACSÉ. Dans tous les cas, une étude de suivi de cohorte permettrait de mieux apprécier l’impact effectif du dispositif : cette méthodologie de suivi était d’ailleurs prévue dès la première circulaire d’engagement du PRE. (...) Au total, même si les acteurs de terrain rencontrés au cours de l’enquête estiment que ce programme a un impact favorable pour les élèves pris en charge, aucune évaluation d’ensemble ne peut donc établir aujourd’hui de façon probante la valeur ajoutée du PRE pour les élèves concernés » (Cour des comptes, 2009). L’ACSÉ, qui cherche semble-t-il à combler cette lacune, prévoit, dans sa synthèse datée de septembre 2009, de créer un « référentiel commun de suivi de la performance locale et nationale, notamment par la construction d’indicateurs d’impacts sur les résultats scolaires en lien avec l’Éducation nationale » ; une étude d’impact sur une quinzaine de site devait également être lancée en partenariat avec l’ONZUS.
Un autre dispositif-phare de l’ACSÉ, celui des Ateliers santé-ville (ASV), apparaît également faiblement évalué sous l’angle des impacts directs sur ses bénéficiaires. Ce programme avait été promu par la politique de la ville antérieurement aux CUCS. L’évaluation devait alors comporter un volet qualitatif et quantitatif et, surtout, avoir un caractère « participatif », la participation des habitants permettant « d'apprécier l'impact des actions de santé dans le sens du concept de "santé bien-être" »16. Largement inscrite dans une perspective de réflexion sur la « plus-value » du projet partenarial (Bertolotto et al., 2003), cette évaluation est restée la plupart du temps négligée (Joubert, Mannoni, 2003). Les ASV ont été généralisés à partir de 2006. Désormais, les acteurs doivent mettre en place un « référentiel de tableau de bord »17, initialement élaboré en Seine-St-Denis avec les acteurs locaux des ASV de ce département18. En 2008, la DIV a organisé un séminaire sur les démarches locales de « réduction des inégalités sociales et territoriales de santé qui, selon le compte-rendu de l’un des ateliers, faisait apparaître « une nette primauté de fait des approches quantitatives sur les approches qualitatives », la « soif du chiffre » trouvant son origine dans « une demande récurrente des milieux politiques, y compris au niveau national, à laquelle il était impossible de se dérober ». Ce séminaire témoigne néanmoins d’une forte réticence des acteurs de la politique de la ville en charge de ce volet – fortement investis par le monde de la recherche – à faire porter aux ASV le poids de la réduction des inégalités territoriales en matière de santé publique, en même temps qu’ils dénonçaient le caractère trompeur des moyennes statistiques locales : « Un débat de fond a été amorcé sur ce que recouvre la notion "d’inégalité", conduisant les participants à se demander si les ASV ne se voyaient pas assigner des objectifs qui les dépassent. La question posée était de savoir si l’objectif ultime consiste à réduire les écarts sociaux de santé ou à améliorer ponctuellement une situation localisée, identifiée comme problématique, ces deux choses étant bien distinctes. (...) Car on sait par exemple que les politiques globales de promotion de la santé entraînent certains effets pervers : il a été ainsi établi qu’elles profitent d’abord aux groupes qui sont davantage en mesure de s’en saisir et qui ne sont pas forcément ceux qui en auraient le plus besoin. Ainsi, tout en contribuant à élever globalement le niveau de santé, une action de promotion de la santé peut-elle contribuer à creuser – et non à combler – des écarts sociaux. A donc été souligné l’intérêt de mener une réflexion collective approfondie sur la notion d’"inégalité", au travers notamment de collaborations avec le monde académique de la recherche qui, plus ou moins libéré des contingences matérielles et de l’évaluation des actions peut, mieux que les ASV, développer et construire des points de vue sur le monde social » (DIV, 2008).
Le monde de la prévention de la délinquance exprime d’autres formes de résistance « culturelle » à l’évaluation en général, et à sa composante quantifiée en particulier. Le problème est classique : « Si l’action est efficace, les problèmes, conflits et tensions disparaissent, ce qui renvoie à la difficulté de la mesure du non-événement » (Brabant-Delannoy, 2009). La pression s’accroît cependant sur les acteurs de la prévention, en particulier sur ceux de la médiation sociale, laquelle a connu un essor important dans le cadre de la politique de la ville avec le développement des programmes d’emplois aidés (notamment celui des Adultes-relais depuis 2000) qui lui servent le plus souvent de support financier. Les acteurs de la médiation sociale doivent aujourd'hui démontrer leur utilité dans un contexte concurrentiel qui les oblige à « vendre » leur savoir-faire aux collectivités locales et assurer ainsi leur pérennité. Un rapport d’évaluation de cinq structures locales de médiation s’est attelé à cette tâche, justifiée dans ces termes : « La difficulté majeure des structures reste le financement de ces dispositifs qui ont vécu dans un système d’aides à l’emploi qui ont pour défaut le caractère provisoire des financements et qui ne permettent pas de se projeter dans des objectifs à moyen terme et de préparer sereinement leur pérennisation. (...) Il leur faut pourtant justifier de la plus-value de leur activité pour la collectivité afin d’obtenir la reconduction de leurs financements. » (Duclos, Grésy, 2008). Aussi l’un des objectifs explicitement poursuivi par l’évaluation était-il de démontrer que ces structures permettent à la collectivité de réaliser de substantielles économies… au prix d’une approche très extensive de la mesure de l’impact propre de la médiation sociale : « Cette question est d’autant plus pertinente pour la médiation sociale que les médiateurs n’interviennent jamais seuls. (...) Pour évaluer l’utilité sociale de la médiation sociale, nous devions cependant chercher à identifier ses effets propres. Pour ce faire, nous avons mobilisé différentes méthodes. D’une part, nous travaillons sur 5 sites différents. Cela nous a permis de voir émerger des tendances, indépendamment des contextes spécifiques à chacune des structures. Par ailleurs, nous avons passé un nombre important de questionnaires pour atteindre des masses qui permettent de dépasser les cas particuliers. Quand cela était possible, nous avons cherché à comparer avec d’autres sites ne bénéficiant pas d’une structure de médiation. Enfin, nous avons questionné un nombre important d’acteurs sur les apports spécifiques de la médiation. Ils font généralement partie du réseau d’acteurs générant les changements observés. Nous avons accordé du crédit aux dires des acteurs du terrain quand ils se recoupaient sur différents sites » (Duclos, Grésy, 2008). Cette évaluation a été prolongée par la rédaction d’un « guide d’évaluation sur l’utilité sociale de la médiation sociale », à laquelle les acteurs de la médiation ont largement contribué à travers le réseau France médiation (DIV, 2009b).
Ce guide propose une méthodologie de l’auto-évaluation, faisant une large place à la production d’indicateurs d’impact inspirés de l’évaluation précitée. Il préconise en particulier de rapporter la démonstration de l’utilité sociale de la médiation sociale aux indicateurs de contexte permettant « de mesurer l’impact de l’action à l’instant t + n (...) parce que c’est souvent sur la base d’un ou deux de ces indicateurs que le commanditaire s’interroge sur la structure ». Parmi ces indicateurs de contexte figurent les statistiques produits par les services de police nationale (« l’état 4001 »), lesquelles reflètent au moins autant l’activité policière que la réalité de la délinquance (Ferret, Mouhanna, 2005 ; Zauberman et al., 2009), ce qui limite un peu plus la rigueur de la démonstration des effets propres de la médiation sociale.
Dans un autre domaine d’intervention de la politique de la ville, le développement économique, l’idée suivant laquelle la création d’activités dans les quartiers les plus touchés par le chômage de masse aurait des effets directs sur l’insertion professionnelle de leurs habitants a la force de l’évidence. Pourtant, après de quinze ans de mise en œuvre, l’effet propre du principal programme en la matière, celui des Zones franches urbaines, n’est pas connu avec précision. Les études produites depuis la fin des années 1990 permettent de répondre, avec plus ou moins de précision, aux questions relatives au nombre de créations d’emploi (Barilari et al., 1998 ; Buguet, 1998 ; Thélot, 2006 ; Bachelet, 2007 ; Ernst, 2008 ; Rathelot, Sillard, 2008 ; ECs, 2009a), mais non à la question de savoir dans quelle mesure ces emplois profitent aux résidents des ZUS. Sans doute est-ce là l’indice d’une intention publique ambiguë, partagée entre une finalité de diversification fonctionnelle des quartiers et une forme de discrimination positive en direction de leurs habitants.
Enfin, le cas de la rénovation urbaine illustre mieux que tout autre la difficulté de mesurer les impacts d’un programme de la politique de la ville, en l’absence de clarification préalable de la chaîne d’intentions. La loi du 1er août 2003 assigne deux objectifs explicites au PNRU : la mixité sociale et le développement durable (article 6). Les autres effets de la rénovation urbaine (diversification du parc d’habitat, banalisation des formes urbaines, etc.) ne sont évoqués qu’au titre de leviers intermédiaires pour atteindre ces objectifs ultimes. Mais les responsables de l’ANRU comme les ministres qui en avaient la tutelle ont entretenu une certaine confusion sur la nature des impacts recherchés, en communiquant intensément - et indistinctement - sur les réalisations programmées, les réalisations effectives et certains effets présentés comme autant de preuves de l’impact « visible » du programme. Deux ans après le terme initialement prévu du PNRU, celui-ci n’a toujours pas fait l’objet d’une évaluation d’ensemble permettant de mesurer son impact propre sur le développement de la mixité sociale dans les Zones urbaines sensibles qu’il cible (Epstein, 2010). Ce mélange des registres s’explique en grande partie par l’absence de référentiel d’évaluation – tant au niveau national que local. Ainsi, la mixité est-elle souvent évoquée comme un objectif de second rang, après la banalisation urbaine ou le changement d’image, par les acteurs locaux des PRU, peut-être en raison des déconvenues qu’ils redoutent sur l’impact du projet en termes de mixité sociale (Kirszbaum, 2010).
Les évaluateurs du CES de l'ANRU ont fait preuve d’une prudence de bon aloi sur le sujet. Comme le souligne l’une de ces études consacrée à la diversification de l’habitat (Act Consultants et al., 2009), « ce qui est recherché en effet à travers le PNRU et ces projets, il faut le rappeler, c’est une diversification de l’habitat pour créer de la mixité sociale ». La même étude s’estime toutefois désarmée pour prendre la mesure de cet impact, en raison du faible niveau d’information disponible dans les directions de projet, et s’en tient pour l’essentiel à soulever une série de questions : « Les projets visant une amélioration de la mixité sociale dans le périmètre opérationnel peuvent-ils conduire à une moindre mixité dans d’autres quartiers de la commune ? la mixité est-elle une mixité ou une juxtaposition ? ces projets, par leur ciblage urbain, aboutissent-ils à une dévalorisation d’autres secteurs du même périmètre susceptible de créer une fracture ? dans quels contextes une forte gentrification des sites peut-elle se produire ? »
En dehors d’une démarche évaluative de la rénovation urbaine au sens strict du terme, l’enjeu de la mixité sociale est l’un des plus discuté qui soit par le monde universitaire, souvent sur un mode critique. Une capitalisation des travaux scientifiques (voir Kirszbaum, 2008a) permet néanmoins de dégager des enseignements utiles pour une démarche évaluative. La première leçon vise le « concept » même de mixité sociale qui, aux yeux de maints chercheurs (mais également de maints praticiens locaux), n’en est pas un, et de ce fait ne se prête à aucune mesure objective (voir, par exemple, Jaillet, 2005 ; Vieillard-Baron, 2005). L’État a cherché un temps à objectiver les critères de la mixité sociale, en évoquant un « indice synthétique de mixité » qui aurait permis de qualifier l’ensemble des quartiers d’une aire urbaine à partir de trois critères : revenus imposables, taille des ménages et poids des différentes générations (Piron, 2001). Porté par l’ancienne secrétaire d’État au Logement, Marie-Noëlle Lienemann, qui souhaitait évaluer la mise en oeuvre de la loi Solidarité et renouvellement urbains, ce projet a vite été abandonné. Le caractère réducteur et relatif des critères retenus avait valu des critiques qui pointaient les impasses techniques, mais aussi les présupposés idéologiques d’une telle entreprise (Helluin 2002 ; Belmessous 2005). La plupart des chercheurs s’accordent sur le fait que la notion de mixité est d’essence négative, car son sens n’apparaîtrait qu’à travers ses antonymes que sont la « concentration », la « spécialisation », la « division » et, surtout, la « ségrégation » de l’espace (Deschamps, 1998). Mais la définition de la ségrégation n’est pas tellement plus assurée que celle de son envers, la mixité. Les méthodes de mesure de la ségrégation alimentent des discussions complexes entre chercheurs (Brun, Rhein 1994 ; Leloup 1999). Suivant les variables et les options méthodologiques retenues, les diagnostics peuvent diverger nettement (Préteceille, 2002). À la fin des années 90, les géographes américains N. Denton et D. Massey (1988) ne recensaient pas moins de vingt définitions différentes de la ségrégation qu’il était possible de croiser avec cinq autres variables pour décrire l’inégale distribution des groupes sociaux ou raciaux dans la ville. Le choix des unités spatiales, leur taille et leur découpage, soulève des questions théoriques et méthodologiques tout aussi importantes (Grafmeyer, 1994). Comme pour ses variables descriptives, la ségrégation varie fortement en fonction de l’échelle retenue : la diversité observée à l’échelle d’une agglomération ou d’une commune peut s’accompagner d’une ségrégation forte aux échelles inférieures (quartier, îlot, immeuble) (Davezies, 2003). Dans ces conditions, mesurer l’impact d’un programme tel que celui de la rénovation urbaine, supposait a minima l’adoption d’une définition conventionnelle de la mixité dans une référentiel d’évaluation. En son absence, son évaluation n’en est que plus incertaine.
c) Les risques d’une lecture erronée de l’« impact » de la politique de la ville
La tentation est forte d’imputer à la politique de la ville (ou à l’un de ses dispositifs) l’évolution de la situation d’un quartier de sa géographie prioritaire. Un tel raisonnement est pourtant erroné, cette évolution pouvant s’expliquer par de multiples facteurs, en premier lieu par les mobilités résidentielles, les transformations du contexte socio-économique et les effets territoriaux d’autres politiques sectorielles. Car la politique de la ville n’intervient jamais seule dans un quartier donné. Hormis le programme de rénovation urbaine qui mobilise des financements exceptionnels à l’aune des autres programmes de la politique de la ville19, les moyens financiers qui lui sont consacrés demeurent dérisoires en regard des politiques ordinaires (Béhar, 1997a). Dès lors, imputer directement à la politique de la ville l’évolution positive ou négative d’un indicateur socio-économique donné revient à se tromper d’objet, en évaluant le quartier plutôt que la politique qui y est menée (Epstein, 1999). Si la plupart des CUCS sont aujourd'hui engagés dans la collecte d’indicateurs relatifs à la situation des quartiers, dans une finalité de mesure des écarts territoriaux, leurs praticiens sont généralement conscients du fait que les seuls crédits spécifiques que mobilise cette procédure ne sont pas de nature à changer la donne au sein des quartiers eux-mêmes. Il leur est alors difficile d’« admettre que l’on puisse juger des politiques à l’échelle des quartiers sans avoir la charge de l’essentiel des moyens d’action engagés sur ces territoires » (Aurès, 2009). Comme les CUCS sont dans l’incapacité assez générale de mobiliser les politiques de droit commun, on comprend que ses acteurs puissent s’insurger contre les analyses aussi rapides qu’hasardeuses de ces indicateurs, qui concluent à l’échec des CUCS dès lors que les écarts territoriaux se sont accrus depuis la signature du contrat (Kirszbaum, 2010).
Les praticiens locaux établissent donc nettement la distinction entre l’observation (au sens de la connaissance des territoires) et l’évaluation (au sens d’un jugement rétrospectif sur la valeur de la politique menée). S’ils considèrent que les statistiques territoriales sont indispensables pour produire ou actualiser les diagnostics qui guident l’action, et plus encore pour attirer l’attention sur des territoires en mal de moyens publics, la plupart de ces praticiens expriment leur réticence à fonder l’évaluation sur ces seuls indicateurs. Tout en soulignant la complémentarité de l’observation et de l’évaluation, le guide méthodologique publié par la Délégation interministérielle à la ville et la Fédération nationale des agences d’urbanisme a souligné ce qui sépare les deux démarches : « La finalité de l’observation consiste à dresser un état des lieux et une analyse des dynamiques et des évolutions des territoires et de leurs habitants en lien avec le suivi des actions et des dispositifs mis en oeuvre. (...) L’évaluation vise en particulier à identifier les résultats et les impacts à moyen ou long terme des orientations stratégiques et des objectifs opérationnels, à comprendre les causes, les leviers et les facteurs qui expliquent les évolutions observées » (DIV, FNAU, 2008).
Illustré par ce guide, le débat actuel s’organise largement autour des difficultés techniques de mise en place de l’observation locale, la préoccupation essentielle étant d’améliorer la collecte et la diffusion des données. Les difficultés d’analyse des matériaux sont moins souvent évoquées, mais tout aussi réelles. Au niveau local, les acteurs n’ont pas toujours les moyens ni le temps pour analyser des évolutions des statistiques infra-communales. Les formations et dispositifs de qualification mis en place par les centres de ressources régionaux de la politique de la ville vont dans le sens d’une meilleure appropriation de l’observation par les acteurs locaux. Mais la mise en débat des données réunies dans les systèmes d’observation demeure un enjeu aussi fondamental que mal traité. Les débats prévus dans les conseils municipaux et d’agglomération, sur la base des données traitées par l’ONZUS, ont rarement été menés (Guigou, 2008). L’analyse de ces données a le plus souvent été externalisée, sous-traitée à une agence d’urbanisme ou à un bureau d’études dont les rapports n’ont pas plus fait l’objet de discussions dans les assemblées délibérantes. L’enjeu est pourtant de taille, les résultats des dispositifs d’observation des territoires devant servir de support pour la négociation de la géographie prioritaire des contrats qui prendront la suite des CUCS (DIV, 2009a).
La systématisation des dispositifs d’observation statistiques place les élus dans une position inconfortable. D’un côté, ils ont naturellement tendance à se prévaloir de bons chiffres pour mettre en valeur leur action, que les liens de causalité entre la politique menée sous leur direction et les évolutions mesurées soient établis ou non. De l’autre, ils ne souhaitent pas donner une publicité excessive à des chiffres qui risqueraient de leur faire perdre le bénéfice des crédits spécifiques de la politique de la ville (Kirszbaum, 2010). Le cas de figure inverse est aussi, voire plus fréquent, quand les chiffres sont mauvais et qu’ils ne servent plus à questionner la politique conduite, mais à alimenter de véritables « hit parade » territorialisés des difficultés, au risque de renforcer la stigmatisation des quartiers contre laquelle la politique de la ville cherche précisément à lutter (Epstein, 1999).
Au niveau national, la politique de la ville est sujette à ces lectures médiatiques et politiques qui prennent appui sur la dégradation de la situation sociale des ZUS par rapport à leur environnement, étayé par des éléments tirés des rapports de l’ONZUS, pour conclure hâtivement à l’échec de la politique de la ville. Le rapport 2009 de l’Observatoire a par exemple mis évidence qu’en 2007, 33,1% des habitants vivaient en dessous du seuil de pauvreté, contre 12 % dans le reste du territoire ; alors que cette proportion était restée stable hors ZUS, entre 2006 et 2007, elle a augmenté de 2.6 points en ZUS (ONZUS 2009). Peut-on en conclure mécaniquement que la politique de la ville n’aurait eu aucun impact sur les habitants des quartiers ? Il s’agit là d’un raccourci hasardeux car il ne tient pas compte d’un facteur sans doute beaucoup plus influent que la politique de la ville sur l’évolution des quartiers : la mobilité résidentielle de ses habitants. Une étude présentée dans le rapport 2005 de l’ONZUS sur les dynamiques de peuplement des ZUS est très éclairante à cet égard. Elle apprend que le renouvellement de la population des ZUS est particulièrement important : 53% des habitants âgés de 21 à 50 ans qui résidaient dans une ZUS donnée en 1990 n’y habitaient plus neuf ans plus tard ; ils ont été remplacés par de nouveaux habitants dont la situation socio-économique était plus défavorisée que celles qui s’y trouvaient déjà ou qui les avaient quittées20. L’étude montre aussi qu’un départ de ZUS semble lié à une amélioration de la situation professionnelle, même si la causalité (le départ est-il un moyen ou une conséquence de l’insertion ?) n’est pas établie. La dissymétrie entre les sortants et les entrants est donc avérée, avec des variations significatives selon leur âge, leur diplôme, leur origine immigrée, etc. La comparaison du profil des personnes qui demeurent en ZUS et de celles qui partent habiter ailleurs permet d’établir un double constat : sous l’effet des départs, le poids des situations défavorisées s’accroît dans les ZUS ; toutefois, le fait d’habiter en ZUS ne constitue pas un blocage dans la trajectoire résidentielle puisqu’il est possible d’en partir pour emménager dans d’autres quartiers. L’accès à un logement situé en ZUS ne constitue pas forcément une étape négative dans les trajectoires résidentielles : sur 10 entrants, 6 accèdent à un logement plus spacieux ou confortable (ONZUS, 2005 ; pour des résultats convergents à partir d’une autre méthode de calcul, voir Pan Ké Shon, 2009).
Les rapports annuels de l’ONZUS montrent que l’objectif de réduction des écarts défini par le législateur en 2003 n’a pas – loin s’en faut – été atteint. Mais les rédacteurs de ces rapports rappellent régulièrement que, d’une part, l’évolution moyenne des 751 ZUS françaises masque des dynamiques hétérogènes et que, d’autre part, l’augmentation des écarts résultant avant tout des changements de population induits par la mobilité résidentielle, elle peut parfaitement s’accompagner d’une amélioration des conditions de vie des populations présentes en début de période (Acadie, 2009). On ne peut donc conclure, sur la base des indicateurs réunis par l’ONZUS, que la politique de la ville menée depuis le début des années 1990 n’a pas eu d’impact. Dans l’attente d’un suivi longitudinal des habitants des ZUS permettant de déterminer si les actions de cette politique ont contribué à leur promotion sociale et à leur mobilité résidentielle, l’évaluation de cet impact demeure incertaine (Epstein, 2008a).
d) Les conditions d’une mesure scientifique de l’effet propre : groupes et quartiers-témoins
Pour l’ensemble des raisons développées ci avant, les liens de causalité entre l’évolution des indicateurs territoriaux et la politique menée sont quasiment impossibles à établir (Lamarque, 2004). Pour prouver et quantifier une relation de cause à effet entre une politique et certaines évolutions constatées de l'état de la société, il faudrait théoriquement pouvoir répondre à la question : que se serait-il passé si, toutes choses égales d'ailleurs, la politique n'avait pas été mise en œuvre ? Poser le problème en ces termes, soulignait le Conseil scientifique de l’évaluation (CSE, 1996), oriente immédiatement vers l'idée d'expérimentation, telle qu’elle est mise en œuvre dans les sciences de la nature pour vérifier une hypothèse : en toute rigueur, seule une expérience reproductible à l'identique mettant en parallèle deux situations qui ne diffèrent que sous l'angle du phénomène étudié permet de se prononcer sur l'« effet propre » d'une action sur la réalité. Le CSE rappelle que rien n'interdit de transposer cette démarche à l'évaluation d'un programme public. C’est d’ailleurs ainsi qu’ont été conduites les premières démarches d’évaluation aux États-Unis dans les années 1930. En pratique, on doit alors constituer deux échantillons de « cibles » du programme (personnes, quartiers...) définis de façon aléatoire pour éviter tout biais de recrutement, l'un d'entre eux étant soumis au « traitement » du programme considéré et l'autre non. Les paramètres représentatifs de l'effet attendu sont mesurés pour les deux échantillons avant et après le traitement, la comparaison des évolutions constatées de ces paramètres permettant de se prononcer sur l'effet propre du programme.
L'expérimentation avec groupe de contrôle comporte des limites, rappelées par le Conseil scientifique de l’évaluation. Il est rare que l'on puisse raisonner « toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire comparer deux situations sur lesquelles toutes les variables exogènes agissent exactement de la même manière. Il peut se poser aussi un problème éthique (a t-on le droit de faire jouer le hasard lorsque l'intérêt des individus est en jeu ?)21. Il est fréquent aussi que le bénéfice d'une aide soit accordé à des individus qui le demandent expressément, ce qui induit un biais de recrutement. Un autre problème est celui de la reproductibilité : la généralisation des résultats d'une « expérience sociale » à la mise en oeuvre « routinisée » d'un programme suppose que l'on contrôle l'effet du contexte particulier de cette expérience (le fait de participer à une expérience est un facteur de « surmotivation » des acteurs comme des bénéficiaires). L'expérimentation pose enfin des problèmes de délais de mise en place et de suivi, et donc de coût.
Cette modalité d’évaluation de programmes publics expérimentaux inspirée par les sciences de laboratoire est fréquemment utilisée aux États-Unis. Elle a, par exemple, été mise en oeuvre sous l’administration Clinton pour vérifier des hypothèses concernant l’impact du déménagement vers un quartier plus favorisé de ménages résidant dans un quartier très pauvre. Appelée Moving to Opportunity, ce programme fédéral a été conçu de façon à neutraliser au maximum les biais de sélection en répartissant de manière aléatoire 4610 familles entre trois groupes : un groupe expérimental bénéficiant d'allocations logement utilisables pour emménager uniquement dans un quartier à faible taux de pauvreté et bénéficiant d’un accompagnement à la mobilité résidentielle ; un groupe-témoin ne se voyant pas assigner de quartier particulier ; un second groupe-témoin resté sur place. Sept équipes d’évaluateurs ont suivi ces trois groupes dans plusieurs grandes villes retenues pour l’expérimentation (Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles et New York). Après sept ans d’observation longitudinale sur 90% du panel, des résultats en ont été tirés concernant la situation de l’emploi, des revenus, de l’éducation, de la santé et de la qualité de la vie sociale des participants (Feins, Goering 2003 ; Orr 2003). Comme il était attendu, le premier groupe a vu ses conditions de logement et la qualité de son environnement s’améliorer. Un progrès général a été aussi constaté sur la santé des participants et sur le niveau d’éducation des enfants, bien que variable selon les classes d’âges et les sites d’enquête. Les résultats étaient plus contrastés s’agissant du risque de délinquance juvénile, les filles semblant changer plus facilement de comportement que les garçons. Aucun effet significatif n’a été relevé en revanche sur l’emploi et les revenus des adultes. Malgré toutes les précautions prises, des biais méthodologiques ont affecté l’évaluation de Moving To Opportunity, à commencer par le caractère non représentatif du panel étudié. Ces difficultés ont été reconnues par les évaluateurs qui sont restés prudents quant à l’extrapolation des résultats.
Dans un autre registre, il n’est pas sans intérêt d’évoquer, pour le volet « sécurité » de la politique de la ville française qui enjoint désormais les maires à implanter des caméras de vidéosurveillance, l’expérience conduite par deux criminologues de l’université de Leicester (Gill, Spriggs, 2005). Cette expérimentation de grande ampleur a été menée sur trois ans dans treize sites de taille et de nature très diverses du Royaume-Uni ayant mis en place des systèmes de vidéosurveillance, qui ont été comparés à treize autres sites de contrôle possédant des caractéristiques similaires mais sans vidéosurveillance. Les protocoles d’évaluation permettent de mesurer et d’expliquer les effets de l’installation de la vidéosurveillance sur la délinquance et sur le sentiment d’insécurité. Les résultats, convergents avec ceux de la plupart des études et évaluations réalisées sur le sujet (Le Goff, 2008), sont les suivants : l’impact de la vidéosurveillance varie fortement en fonction des lieux et des type de délits. Ce dispositif apparaît relativement efficace dans les lieux fermés, contre les délits prémédités et concernant les atteintes aux biens ; en revanche, il est sans effet sur les délits impulsifs (notamment ceux qui sont commis sous l’emprise de l’alcool ou d’autres psychotropes) et, de manière plus générale, pour les atteintes aux personnes ; enfin, son impact sur le sentiment d'insécurité est faible (pour une présentation en français, voir INHES, 2008, Le Goff, 2008).
Cette approche évaluative a été récemment importée en France par une jeune génération d’économistes formés aux États-Unis, sous l’impulsion notamment d’Esther Duflo qui, au sein du Poverty Action Lab, s’est spécialisée dans l’évaluation des programmes de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. La méthode qu’elle a promu avec d’autres, intitulée « évaluation par assignation aléatoire » (Duflo, 2010), a bénéficié du soutien de Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, qui a systématisé son usage dans le cadre des programmes qu’il a lancés. L’expérimentation du Revenu de solidarité active s’est ainsi accompagnée d’une évaluation de la sorte (Goujar, L’Horty, 2010 ; Comité d’évaluation des expérimentations du revenu de solidarité active, 2009), tout comme les diverses opérations financées par le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. On mentionnera enfin la seule expérience de mesure d’impact avec groupe de contrôle menée – à notre connaissance – dans le domaine de la politique de la ville, en l’occurrence sur le programme des Zones franches urbaines. S’appuyant sur une méthodologie économétrique qui compare les zones créées en 2004 avec des territoires de caractéristiques semblables, avant et après la mise en place du dispositif, l’étude réalisée par R. Rathelot et P. Sillard (2008) a permis d’évaluer rigoureusement l’effet propre du dispositif sur le développement de l’emploi salarié et les créations d’établissements dans les zones concernées, nous y reviendrons. Cette étude est emblématique du rôle grandissant de l’économétrie dans la politique de la ville, davantage d’ailleurs pour analyser les phénomènes qui justifient cette politique (ségrégation, discriminations, etc.) que pour en évaluer les effets. Il semble pourtant que les conditions n’ont jamais été aussi propices à l’engagement d’évaluations appuyées sur des modes d’administration de la preuve scientifiquement rigoureux. Encore faudrait-il que ses promoteurs l’encouragent sincèrement sans en redouter le jugement.
II - LES EFFETS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
SUR LA GESTION PUBLIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES
On l’a vu, l’évaluation de la politique de la ville offre un visage contrasté. D’un côté, cette politique a été amplement évaluée. De l’autre, des interrogations subsistent quant à son impact malgré les efforts du législateur pour en garantir l’évaluabilité. Ces limites étant posées, il est possible de tirer quelques enseignements des travaux d’évaluation et de recherche, dont nombre ont cherché à analyser les effets de la politique de la ville sur la gestion publique des quartiers prioritaires. Mais cette politique, qui existe maintenant depuis plus de trente ans, a connu des transformations très sensibles au fil du temps. Il convient de revenir sur ses orientations successives (A), avant d’éclairer une série de questions relatives à ses modes d’action dans les quartiers (B).
A. LES ORIENTATIONS SUCCESSIVES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Trois grandes phases de la politique de la ville sont identifiables, qui recoupent à grands traits les décennies 1980, 1990 et 2000. Chacune de ces phases correspond à une lecture particulière des quartiers et suggère une réponse publique cohérente avec cette lecture. La succession chronologique de ces grandes orientations n’interdit pas leur coexistence au cours des mêmes périodes, même si l’une d’elles apparaît chaque fois dominante.
Inspirée d’une grille d’analyse proposée par Daniel Béhar (1995a), le « dossier-ressources » pour l’évaluation des Contrats de ville établi par la DIV la même année, valait reconnaissance officielle de cette pluralité stratégique. Selon le dossier-ressources, ces contrats reposaient sur la combinaison de « trois lignes stratégiques à la fois clairement distinctes et rarement isolables en tant que telles, puisque la plupart du temps mêlées dans les politiques locales. La première ligne se donne pour objectif la résorption de poches d’exclusion. Elle vise à réduire les handicaps liés à une concentration spatiale excessive de "cas difficiles". Elle prend appui sur des politiques spécifiques, adaptées, dans une logique de discrimination positive, pour rétablir la norme de l’égalité sociale et de l’homogénéité spatiale. La seconde ligne stratégique vise à prendre en compte l’existence de quartiers populaires. Elle cherche à valoriser les initiatives et les solidarités de voisinage (...). Pour ce faire, elle demande à l’action publique de soutenir les initiatives sociales, de favoriser la multiplication des innovations et des expérimentations locales. La dernière ligne stratégique cherche avant tout à restaurer les liens sociaux et urbains qui fondent la cohésion urbaine. (...) Elle interpelle les données du fonctionnement urbain qui sont à l’origine des processus d’exclusion socio-spatiale et s’attache principalement à la reformulation des politiques publiques sectorielles (...) » (DIV, 1995a).
Cette grille n’a pas été d’une grande utilité pour les instances de pilotage des Contrats de ville (Estèbe, Epstein, 1998), mais elle apparaît toujours aussi pertinente pour donner une intelligibilité aux différentes stratégies développées par la politique de la ville. La complexité de cette politique et l’instabilité de ses objectifs (Jaillet, 2000), qui font l’objet de critiques récurrentes, s’expliquent largement par la coexistence en son sein de ces trois lignes concurrentes et potentiellement contradictoires. Comment concilier en effet l’intention de remettre dans la norme des quartiers que l’on définit avant toute chose par leurs handicaps et déficits avec une stratégie qui cherche au contraire à en valoriser les ressources endogènes ? Quelle compatibilité entre ces deux orientations et celle qui consiste à réinterroger le fonctionnement social et urbain en élargissant le périmètre de l’action aux agglomérations, alors que les deux premières stratégies sont toutes deux focalisées sur l’échelle des quartiers ?
Cette faible cohérence stratégique tient pour partie à la nature même de la politique de la ville, qui relève de la catégorie des « politiques constitutives » qui ne disent « pas quelle est la définition du problème et quelles sont les modalités de son traitement opérationnel » (Duran, Thoenig, 1996). La coexistence de diverses orientations parfois en tension s’explique aussi par l’accumulation des procédures et des programmes dans cette politique marquée par une forte dimension symbolique : les effets de la politique de la ville étant difficiles à mesurer, les ministres successifs – dont la longévité à ce poste est réduite22– ont davantage intérêt à lancer de nouveaux programmes sur lesquels ils peuvent communiquer qu’à bâtir une politique de longue durée (Le Galès, 1995). Les nouvelles mesures n’effaçant pas entièrement celles qui précèdent, il en résulte une sédimentation qui renforce la pluralité stratégique de la politique de la ville, en même temps qu’elle suscite un accroissement de ses coûts de gestion et des problèmes de coordination, comme le soulignent les rapports successifs de la Cour des Comptes.
1. Reconnaissance : la valorisation des quartiers populaires
La première ligne stratégique, historiquement dominante dans la politique de la ville, est celle qui cherche à valoriser les ressources des quartiers, en prenant appui sur le potentiel d’engagement civique de leurs habitants. Cette approche, qu’on trouvait déjà dans le programme fondateur Habitat et vie sociale (HVS), a été réaffirmée avec force au début des années 80, par la Commission nationale pour le développement social des quartiers (CNDSQ). Il s’agissait alors de « démocratiser la ville », mais aussi et peut-être surtout d’impliquer les habitants dans la gestion des services locaux (Dubedout, 1983). Cette approche valorisant les ressources des quartiers populaires n’était pas exempte d’ambiguïtés, ne serait-ce que parce que la réintroduction d’une certaine mixité sociale était considérée comme la condition de possibilité de la participation dans ces quartiers (Donzelot, Mével, 2001).
a) Les prémices d’un « empowerment » à la française ?
Les premières conventions HVS ont été le cadre d’expérimentations engagées dans une cinquantaine de quartiers qui articulaient réhabilitation de l’habitat social, développement de services collectifs et mobilisation des forces vives réunies dans les associations de quartier. L’une des innovations majeures ce premier programme était de faire de la participation des habitants un critère essentiel de sélection des projets et, par conséquent, d'attribution des subventions : « Ne seront retenues que les opérations pour lesquelles la volonté d'agir de la municipalité et des gestionnaires est évidente, et seulement dans la mesure où ils acceptent une méthode d'élaboration concertée avec les habitants »23. Le contenu et la méthodologie de la concertation restaient toutefois assez vagues et les premières tentatives d’évaluation aboutissaient à un bilan critique sous cet angle (Figeat, 1981). Elles mettaient en avant les innovations rendues possibles par la déconcentration des moyens financiers et le changement d’image de certains quartiers, mais déploraient que la participation ait été presque toujours « octroyée » à des habitants qui n’en voyaient guère l’utilité (Blanc, 1999). Un ouvrage collectif, paru à cette époque, sous le titre Quand les habitants prennent la parole, présentait différentes actions exemplaires en la matière, en les qualifiant précisément « d’anti-HVS » (Mollet, 1981).
Cette critique a pris un tour plus officiel avec les travaux de la CNDSQ, dont la présidence était assurée par le maire de Grenoble, Hubert Dubedout, chantre de l'autogestion et de la démocratie participative. Il avait été lui-même l’instigateur des « Groupes d’action municipale » qui avaient essaimé dans toute la France au cours des années 1970, dont l’objectif était de démocratiser la gestion des villes en prenant appui sur le tissu associatif (Ducros et al., 1998). Considéré comme le texte fondateur de la politique de développement social des quartiers, son rapport (1983) se présentait comme un véritable manifeste pour une transformation démocratique de la gestion des villes, proposant de traiter les « causes profondes de la dégradation physique et sociale de certains quartiers populaires en s’appuyant sur une mobilisation collective de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont concernés par la vie de ces quartiers, à commencer par les habitants eux-mêmes ».
Parmi les modèles de participation évoqués par le rapport Dubedout figurait en bonne place l’opération expérimentale de gestion participative du quartier de l’Alma Gare, à Roubaix (Hatzfeld, 1986). Mais le cas de l’Alma Gare était assez exceptionnel, contrastant avec l’apathie générale des habitants observée dans la plupart des opérations HVS (Figeat, 1981). L’expérience se situait en fait dans le sillage des « luttes urbaines » (Castells, 1972) développées dans les années 1960 et 1970, animées par l’idéal d’autogestion populaire que ses partisans opposaient à la raison technocratique (Castells, 1973 ; Bachmann, Le Guennec, 1996). C’est l’héritage de ces « luttes » dont était porteur le rapport Dubedout.
La vision de la participation qu’il développait faisait finalement écho à la notion anglo-saxonne d’empowerment, que l’on peut traduire comme un processus de « capacitation » collective des habitants à des fins d’émancipation (Jouve et al., 2006). Bien que courantes dans les politiques urbaines d’autres pays, à commencer par les États-Unis (Donzelot et al., 2003 ; Kirszbaum, 2003 ; Bacqué 2005), cette approche a cependant été introduite en France sur un mode relativement édulcoré par la Commission nationale pour le développement social des quartiers. C’est qu’à la différence des luttes des années 70, où prévalait une forte « demande » de participation des associations, dont les classes moyennes étaient le fer de lance, il s’agissait cette fois d’une « offre » institutionnelle de participation, en réponse à une demande supposément évanescente dans les quartiers populaires (Donzelot, Mével, 2001 ; Carrel, 2004). Prétendre qu’il ne subsistait que des individus démunis dans des « banlieues délaissées » (Mollet, 1986), revenait à diminuer d’emblée l’existence de « ressources » internes à ces quartiers en portant sur eux un regard quelque peu misérabiliste. C’est cette vision qui deviendra par la suite largement dominante (voir par exemple le rapport Delarue, 1991).
b) Des quartiers « laboratoires » où s’inventent des solidarités
À défaut d’avoir véritablement insufflé un nouvel esprit démocratique dans les quartiers, la période du DSQ a vu éclore tout un champ d’activités ouvrant un espace pour l’implication des habitants dans la consolidation du « lien social ». Il ne s’agit plus alors de « réparer » des individus victimes d’exclusion, mais de les inviter à réparer eux-mêmes le tissu social (Doytcheva, 2007). Dans cette perspective, un rapport de la CNDSQ sur « la présence active des habitants » esquissait une critique du travail social traditionnel24, lequel entretiendrait la passivité et l’isolement, pour faire au contraire l’apologie des potentialités collectives qu’il s’agissait de mettre en valeur : « Une action sociale qui ne serait conduite qu’en termes d’assistance ou de multiplication des aides individuelles risquerait en fait de renforcer cette dislocation des solidarités. (…) Il serait insuffisant et erroné de n’aborder la vie sociale de ces ensembles que sous l’angle de la négativité. Le développement n’est pas seulement la lutte contre tel ou tel manque ou handicap collectif ; il est aussi promotion et valorisation des potentialités détenues par la population. (...) Il existe plusieurs formes de développement. Il peut être exogène et déstructurant. Il peut être endogène et fondé sur la valorisation des ressources et des potentialités locales. C’est à la stimulation de celle-ci et non à l’assistance que doit tendre l’effort de solidarité nationale qui se porte sur ces quartiers » (CNDSQ, 1982).
L’action culturelle allait devenir l’un des terrains de prédilection de cette démarche de valorisation du potentiel des habitants, ce qui passait par une reconnaissance de la légitimité de leurs pratiques culturelles comme alternative à la culture légitime (CNDSQ, 1986). Les initiatives sur l’« histoire » des quartiers et la « mémoire » de leurs habitants s’inscrivaient aussi dans ce registre visant à réhabiliter leur image en même temps que leur quartier se réhabilitait25. Dans cette quête du lien social, tout ce qui peut contribuer plus largement à valoriser l’initiative des habitants et l’image du quartier est à encourager, y compris les événements collectifs de type « fêtes de quartier ».
L’importance attachée au lien social a trouvé des justifications théoriques dans des analyses centrées sur l’exclusion sociale, interprétée comme une conséquence des mutations du système productif et de la condition salariale26. Pour certains, il valait mieux assurer la réintégration sociale des « exclus » à travers des fonctions socialement utiles, aptes à compenser les effets destructeurs du chômage de masse sur l’estime de soi et la civilité, que s’en remettre au paradigme de l’emploi salarié classique (Perret, Roustang, 1993 ; Eme, 1994). Ne s’inscrivant ni dans l’économie marchande, ni dans le cadre du secteur public, ces fonctions d’utilité sociale doivent conforter les solidarités primaires en cultivant des liens de réciprocité entre habitants (Laville, 1994). Ce registre « solidaire » s’est concrétisé de multiples façons, à travers les jardins collectifs, crèches parentales, restaurants associatifs et autres « lieux de vie » soutenus par la politique de la ville, avant de connaître un important développement dans le cadre des « métiers la ville » (Heurgon, Stathopoulos, 1999 ; Brévan, Picard, 2000).
S’il peut servir de « sas » temporaire avant la réintégration des individus dans la sphère de l’emploi marchand, ce champ d’activités relevant du « tiers secteur » ou de l’« économie solidaire », a également été envisagé comme un moyen de combler de façon plus durable les défaillances du service public incapable de répondre à toutes les demandes sociales (Laville, 1998). Il s'agit alors de favoriser la prise en charge par les habitants eux-mêmes de services que les organismes publics ne parviennent pas à assurer eux-mêmes. L’une des plus expérimentations les plus emblématique – et durable – est celle des « régies de quartier » auxquelles est déléguée une partie de l’entretien des immeubles et des espaces extérieurs des ensembles HLM (Plan urbain, 1994). D’autres expérimentations ont fleuri, à partir des années 80, dans l’optique d’une « co-production » des services publics avec les habitants dans des domaines comme l’école (APU, 1983), la justice (Dourlens, Vidal-Naquet, 1993) ou la santé (Joubert et al., 1993). Cette profusion d’initiatives valorisant la créativité des habitants participaient toutes, à un degré ou un autre, d’une conception des quartiers comme des territoires « où se réinvente la ville » (Ten, 1985), c'est-à-dire comme des « laboratoires » pour l’expérimentation de nouveaux modes de gestion des services urbains dont les effets et la pérennité ont été variables.
c) Un éloge sous condition des quartiers ethniques
La politique de Développement social des quartiers a bénéficié du renfort de chercheurs qui ont fourni les armes théoriques justifiant l’entreprise de confortation de l’identité « populaire » des quartiers (Laé, 1991 ; Simon, 1992 ; Bacqué, Sintomer, 2002), en insistant sur la dimension communautaire des mécanismes d’intégration sociale, certains poussant l’argument jusqu’à faire « l’éloge du ghetto » (Genestier, 1990). Il s’agissait surtout de rappeler l’existence et l’importance des solidarités de proximité dans les quartiers populaires, qu’il s’agisse des faubourgs ouvriers hier ou des grands ensembles HLM aujourd’hui, dans lesquels les proximités sont à la fois sociales et ethniques. La mise en avant de cette dernière dimension revenait à importer dans le débat français le modèle théorisé par les sociologues de l'école de Chicago (Grafmeyer, Joseph, 1990), dans lequel le quartier est envisagé comme une première « porte d’entrée » vers la société d’installation dans laquelle les immigrants puisent différentes ressources communautaires avant d’entamer un parcours conduisant à leur assimilation (Burgess, 1925). Les structures communautaires ou associatives du quartier ont alors à gérer l'adaptation des immigrants, tout en maintenant un équilibre entre leur passé et leur devenir (Remy, 1990). Mais pour qu’il y ait un devenir hors du quartier ethnique, encore faut-il que celui-ci ne soit pas espace trop fortement contraint par les discriminations ou les logiques d’attribution des bailleurs sociaux (Boumaza, 1996 ; Simon, 1996).
Si elles lui sont parfois postérieures, ces thèses étaient en cohérence avec la politique de DSQ en ce qu’elle semblait reconnaître et accepter ces « lieux de différences » que sont les quartiers, selon une expression du rapport Dubedout. Dans une société « multiraciale », écrivait la CNDSQ, on pouvait accepter « la constitution de groupements librement choisis sur la base d’affinités, d’un consensus sur le mode de vie (...). Il n’est pas exclu, d’ailleurs que certains quartiers trouvent ainsi leur identité à travers une dominante ethnique, à l’image de certains quartiers populaires du passé, composés de migrants d’une même région. (...) Le refus de tenir compte de cette réalité est stérile, voire dangereux. Les institutions doivent assumer la réalité populaire de ces quartiers ». Une condition était toutefois posée, celle de limiter ces groupements à deux ou trois immeubles au maximum. Jouant la transparence, la commission reconnaissait que cette question avait été âprement débattue en son sein.
Signe de ces tiraillements, le rapport Dubedout n’était pas hostile à la limitation volontariste des flux d’immigrés dans certains quartiers, mais à titre seulement transitoire et toujours dans des cas jugés exceptionnels. La volonté était également exprimée de « stopper la ségrégation », en instaurant une politique de répartition spatiale des immigrés (et d’autres populations en difficulté) dans l’ensemble des agglomérations afin d’éviter leur orientation exclusive vers certaines communes. Le tout au nom de la nécessaire « mixité sociale » qui permettrait de ressusciter des forces vives dans les quartiers – c'est-à-dire d’y faire revenir les classes moyennes qui y résidaient autrefois. Ainsi, la politique de DSQ était-elle marquée par un balancement : d’un côté, elle prétendait s’appuyer sur les potentialités de ces quartiers, tout en leur déniant, de l’autre, les qualités susceptibles de constituer ces mêmes quartiers en forces collectives (Bacqué, Denjean, 2006). D’aucuns y ont vu « l’aporie constitutive » de cette politique, lui interdisant de s’engager résolument dans la voie du « développement communautaire »27 (Donzelot, Mével, 2001).
2. Transformation : agir sur les processus inégalitaires
Si elle a longtemps eu les faveurs d’un grand nombre de sociologues, la lecture des « quartiers ressources » est discutée. Marco Oberti (2001) met par exemple en garde contre la « vision idéalisée du monde populaire », un monde dont la décomposition avait été analysée par François Dubet, dès le milieu des années 1980, dans son ouvrage sur La galère (1987). François Ascher (1998) considère qu’« une politique de la ville qui appellerait ces lieux de relégation des "quartiers populaires", qui prétendrait les consolider, qui s'efforcerait d'y conforter les relations sociales qui s'y déploient et leurs traits culturels spécifiques, risquerait d'accroître et de pérenniser la séparation entre les populations les plus défavorisées et le reste de la ville et de la société ». « Cette logique frôle "l'endogestion du ghetto" », estime de son côté Daniel Béhar (1995a). Avec Philippe Estèbe, il a développé une autre ligne critique mettant en cause « l’évacuation de la question institutionnelle et politique » au profit de « l'exemplarité, la production de concessions, d'espaces protégés, de laboratoires, (qui) fussent-ils fondés sur une identité sociale, ne constituent pas un moyen de transformation sociale (...), la production de normes alternatives s'accompagnant d'un quasi déni du rôle structurant joué par les institutions condamne ces tentatives à demeurer dans la sphère expérimentale » (Béhar, Estèbe 1995a).
La sortie de la logique expérimentale et le « passage au politique » du DSQ (Donzelot, Estèbe, 1992), telle était la grande affaire du tournant des années 1990. C’était aux yeux de ses partisans, la condition d’une action sur les causes de la relégation des quartiers et pas uniquement sur les manifestations localisées de cette exclusion. Cette analyse se retrouve en particulier dans le rapport de Jean-Marie Delarue (1991), publié peu avant sa nomination au poste de délégué interministériel à la Ville. À ses yeux, la mobilisation des acteurs impliqués dans les opérations de DSQ, aussi méritante fût-elle, n’était pas à hauteur des enjeux. Face à l’exclusion, il appelait à une vaste réforme des organisations publiques – à commencer par l’État – et à un changement dans les échelles spatiales du traitement des « quartiers de relégation ».
a) Favoriser l’innovation dans l’action publique
Formant jusque-là un conglomérat d’initiatives locales, la politique de la ville allait se muer, au tournant des 1990, en une véritable politique nationale. L’une des premières initiatives du gouvernement Rocard a été de « muscler » le dispositif national de la politique de la ville. Le Conseil interministériel des villes (CIV), créé en 1984 pour « définir, animer et coordonner les politiques relevant de la responsabilité de l’État »28, est secondé en 1988 par une Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (DIV) chargée de l'animation quotidienne de cette politique, et un Conseil national des villes (CNV), conçu comme une instance de réflexion et de proposition.
La mobilisation de l’appareil administratif de l’État autour de la politique de la ville allait connaître une nouvelle accélération, au début de l’année 1990, à la suite des émeutes de Vaulx-en-Velin, interprétées comme l’inquiétant signal d’un effort encore insuffisant de l’État. Deux mois plus tard, François Mitterrand prononçait à Bron un discours qui a fait date, annonçant la fin de l’ère expérimentale du DSQ et son remplacement par une politique nationale de la ville érigée en priorité de son second septennat29. Ce volontarisme se manifestait par la nomination d’un ministre de la Ville, ministre d’État occupant le cinquième rang dans la hiérarchie gouvernementale, et dont le rôle « consistera à être l’animateur, le pourfendeur, l’avocat, l’intervenant permanent » de la cause des quartiers, selon l’expression du Président de la République (Banlieue 89, 1991). Son action sera rapidement relayée, au niveau départemental, par une figure nouvelle de l’action publique : le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, mis en place dans un premier temps dans les treize départements les plus urbanisés (Grémion, Mouhanna, 1995).
L’État était sommé d’investir massivement les quartiers et d’impulser des transformations substantielles dans son fonctionnement. Jusque-là, l’attention au fonctionnement des services publics dans les quartiers s’était concentrée sur les services municipaux (CNDSQ, CNFPT, 1987), laissant de côté les services de l’État (Kirszbaum, 2004b). Le nouveau ministre avait besoin d’un état des lieux et de propositions. L’année 1991 fut marquée par une avalanche de rapports officiels qui formulaient les mêmes constats négatifs concernant la présence et le fonctionnement des services publics dans les quartiers (Delarue, 1991 ; Picard, 1991 ; Langlais et al., 1991) et la valorisation des agents de l’État qui y étaient en poste (Pêcheur, 1991). Faisant suite aux recommandations de ce dernier rapport Pêcheur, divers avantages (valorisation de carrière, nouvelle bonification indiciaire, priorité de mutation, développement de formations spécifiques) ont été accordés aux fonctionnaires de l’État travaillant dans les quartiers.
La politique de la ville ouvrait alors des perspectives nouvelles pour la politique de « renouveau du service public » initiée par Michel Rocard en 1989. Selon Jacques Donzelot et Philippe Estèbe, la politique de la ville apportait une légitimité nouvelle à ceux qui s’en sont saisi à l’intérieur des administrations en fournissant « aux groupes modernisateurs présents dans chaque administration une finalité irrécusable pour la conduite de leur combat », leur permettant de « répondre au reproche de servir la seule préoccupation du rendement au détriment de l’équité ».
Le processus de modernisation de l’État devait changer le rapport entre la politique de la ville et les autres politiques publiques dont les liens étaient jusque-là limités. Interpellés en CIV, les ministres étaient sommés d’intégrer la lutte contre l’exclusion territoriale dans leurs priorités et de rendre compte de leur action dans les quartiers. Ces interpellations ont ensuite été relayées en direction de chaque administration par la DIV pour favoriser l’introduction dans les différentes politiques sectorielles de nouveaux mots d’ordre (désenclavement, insertion par l’économique, médiation…), modes d’action (projets territoriaux, contrats avec les collectivités, effort prioritaire…) et actions innovantes expérimentées dans le cadre des DSQ (Donzelot, Estèbe, 1994). C’était le cas par exemple des opérations « école ouverte » pour l’Éducation nationale (Glasman et al., 1998), des « maisons de la justice et du droit » pour le ministère de la Justice (Peyrat, 2001), de l’îlotage pour la police (Monjardet, 1991) ou de l’insertion par l’économique pour le ministère du Travail (Jaillet, 1993). Les « emplois-jeunes » mis en place en place dans la plupart des ministères sont un autre signe du succès des expérimentations initiées dans le cadre de la politique de la ville (Heurgon, Stathopoulos, 1999)
La diffusion de l’innovation au sein des administrations de l’État ne s’est pas s’opérée uniquement à partir d’injonctions nationales. Localement, les Contrats de ville négociés en 1993 devaient faire de l’adaptation quantitative et qualitative des services publics leur thème d’action prioritaire (DIV, 1993). C’est dans ce cadre contractuel que les administrations ont trouvé les financements pour mettre en œuvre les actions qu’elles souhaitaient expérimenter à leur tour. Les actions innovantes développées par les acteurs locaux en réponse à ces incitations nationales se sont ensuite diffusées à l’intérieur des circuits de la politique de la ville, la capitalisation des actions et leur promotion étant assurée par la DIV et les centres de ressources dont elle a financé la mise en place dans les régions. Ces actions innovantes ont ainsi été démultipliées, reproduites d’un Contrat de ville à l’autre, au prix parfois d’une certaine standardisation (Acadie, 1999).
b) À la recherche de l’échelle pertinente
L’innovation dans les services publics s’est traduite dans bien des cas par un « souci du rapprochement » (Kirszbaum, 2004b) avec le public des quartiers sur le lieu même de leur résidence, que ce doit directement par l’implantation d’équipements et le regroupement de services dans des lieux polyvalents (Leroy, 1998), ou par le truchement de médiateurs (Hammouche, 1998). Cette préoccupation pour la proximité se retrouvait déjà dans le rapport Dubedout (1983), qui fixait l’objectif de « rapprocher les services du terrain et des populations », afin de résorber « l’éloignement spatial conjugué à l’éloignement social ». La sociologie critique des années 1960 et 1970, notamment celle de Pierre Bourdieu, qui avait insisté sur la distance sociale aux services publics, en particulier à l’école et aux équipements culturels, figure sur ce plan parmi les sources d’inspiration de la politique de la ville.
Les services publics municipaux ont certainement joué un rôle pilote dans le processus de rapprochement avec les populations (CNDSQ, CNFPT, 1987 ; CNFPT, DIV, 1992). À la fin des années 1990, le thème de la proximité a fini par s’imposer comme mot d’ordre pour les services de l’État eux-mêmes. La mise en avant de l’impératif de proximité s’inscrit dans une période de remise en cause plus générale de la « solution équipement » (Jeannot, 2001) au profit d’une « logique de services », où l’enjeu serait moins l’affirmation de la puissance publique dans les quartiers que la facilitation de la vie des habitants affectés par l’exclusion (Béhar, Estèbe, 1995b). Il s’agit alors d’effectuer un recentrage sur le « service rendu » ou le « service du public » (DIV, 1995b). Mais le rapprochement des services avec le terrain peut être sous-tendu par l’hypothèse contestable d’une proximité physique garante d’une meilleure accessibilité (Béhar, 1997b), une offre de services trop abondante dans les quartiers risquant d’accentuer le sentiment de captivité des habitants (Maguer, Berthet, 1997).
Depuis la fin des années 1980, la politique de la ville est aux prises avec une « querelle des échelles » (Genestier, 1999). Plusieurs rapports ont appelé à dépasser l'échelle du quartier, qui était celle du développement social du même nom, pour agir à l’échelle plus large des villes et des agglomérations, en particulier dans les domaines de l'habitat, des transports et du développement économique (Dubedout, 1983 ; Geindre, 1993 ; Sueur, 1998). L’appellation « politique de la ville », qui commence à apparaître à la fin des années 1980, témoigne de cette volonté de rompre avec une approche centrée sur les seuls quartiers. Politique de la ville voulait dire aussi que l’enjeu de solidarité devait être mis au centre des projets de développement des villes, contrairement aux DSQ qui leur demeuraient adjacents, venant atténuer en aval par des interventions essentiellement sociales, les effets ségrégatifs du développement (Jaillet, 2000). Cette volonté s’était concrétisée par l'expérimentation, à partir de 1989, de Contrats de ville expérimentaux appelés à se substituer aux conventions de quartier dans une dizaine de sites, avant d’être généralisés en 1994. La DIV avait posé l’enjeu dans ces termes : « Il ne s'agit plus seulement de retrouver du lien social à l'intérieur des quartiers en difficulté, mais de réintégrer à la fois physiquement et symboliquement ces quartiers dans la ville ».
Le changement d’échelle n’est pas seulement géographique. Il est aussi institutionnel, tant il est vrai que la ville dans laquelle les quartiers doivent être réintégrés dépasse les seules frontières communales. Si la préoccupation intercommunale n’était pas nouvelle, elle allait occuper une place de choix dans le rapport Demain, la ville remis en 1998 par Jean-Pierre Sueur à Martine Aubry, laquelle s’était ouvertement interrogée lors de se prise de fonction comme ministre de l’Emploi et de la solidarité sur l’utilité de conserver la politique de la ville comme politique spécifique. La proposition centrale de la commission Sueur visait l’avènement d’une « nouvelle gouvernance des agglomérations ». Elle se faisait en cela l’écho d’une inquiétude grandissante parmi les responsables publics et les experts de l’urbain, que condensait l’image de « la ville éclatée » (May et al., 1998). La ville ne « ferait plus société » (Donzelot, 1999), elle se fragmenterait sous l’effet de processus combinés de « relégation » et de « sécession » faisant courir le risque d'une « désolidarisation » (Jaillet, 1999 ; Donzelot, 2004b). Le rapport Sueur conditionnait la résolution de cette crise à des réformes institutionnelles et financières ambitieuses : création d'un pouvoir d'agglomération élu au suffrage universel direct, redistribution des compétences entre collectivités des différents niveaux, réforme de la fiscalité locale… L’approche proposée se distinguait ainsi de celle du rapport Delarue (1991), laquelle se concentrait sur la réforme de l’État. Le rapport Sueur dessinait en fait une nouvelle perspective qui verrait la politique de la ville perdre son identité propre pour se fondre dans les nouvelles structures politiques d’agglomération, dont elle serait le simple volet « solidarité territoriale ». S’il n’a pas été suivi sur l’élection au suffrage universel de ces instances et si la politique de la ville n’a pas disparu comme politique spécifique focalisée sur l’échelle des quartiers (Jaillet, 2000), ce rapport a eu une influence avérée sur l’adoption d’une série de lois en 1999 et 2000 : la loi Voynet30 qui instituait des Contrats d'agglomération dont les Contrats de ville devaient constituer le volet « cohésion sociale » ; loi Chevènement31 qui faisait de la politique de la ville et de l'équilibre social de l'habitat des compétences obligatoires des nouvelles Communautés d'agglomération ; et loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU)32 dont l’article 55 devait conduire à une solidarité intercommunale renforcée en matière de répartition du logement social (Méjean, 2003 ; Epstein, 2005).
Dans ce nouveau cadre législatif, la « nouvelle ambition pour la ville » affichée par Claude Bartolone, ministre délégué à la Ville, a posé le principe d’une articulation entre les Contrats de ville de la nouvelle génération (2000-2006) et ces trois grandes lois traitant de la question territoriale. L’ambition de faire de la politique de la ville le levier de la transformation des politiques sectorielles n’a pas été abandonnée puisque ces Contrats de ville avaient vocation à impulser le processus de « territorialisation » de l’ensemble des politiques publiques au service de la cohésion urbaine et sociale, du quartier jusqu’à l’agglomération. Comme le précisait la circulaire du Premier ministre de l’époque, « la politique de la ville n’est pas une politique sectorielle de plus, mais une dimension de toutes les politiques publiques ». Dans cette acceptation, la territorialisation ne se réduit pas au rapprochement des services publics avec le local, mais se conçoit comme un mode de régulation entre le global et le local (Béhar, 1999a)33. Le programme Bartolone s’inscrivait aussi en cela dans le droit fil des recommandations de la commission animée par George Cavallier pour la préparation des nouveaux Contrats de ville. Son rapport voulait que les Contrats de ville soient le lieu d’une interrogation sur « la place et le rôle des différents services publics dans l’armature urbaine d’ensemble », et notamment sur ce qui « dans le fonctionnement ordinaire des prestations de droit commun conduit aux évictions, aux mises à l'écart, au déni d’une prestation commune » (Cavallier, 1999).
En ce sens, la recherche d’une intervention à l’échelle des agglomérations apparaissait cohérente avec la logique de « transformation » telle qu’elle a prévalu dans la politique de la ville, au moins sur le plan des intentions, jusqu’au début des années 2000. Passer du « quartier à l’agglomération » n’était pas seulement affaire de désenclavement physique, mais visait la transformation en amont des mécanismes – liés à la nature du développement ou des pratiques institutionnelles locales – qui produisent ségrégation et exclusion en aval dans les grands ensembles d’habitat social. Cette double intention était parfaitement explicitée par D. Béhar et P. Estèbe dans leur texte précité de 1995 : il s’agit « à la fois de retrouver des liens sociaux et urbains, ce qui suppose que l'on insiste sur les différents itinéraires internes à la ville ; mais aussi de renégocier différents principes et normes du fonctionnement urbain qui produisent de l'exclusion socio-spatiale : fonctionnement des marchés locaux de l'habitat, du travail, accessibilité des fonctions urbaines (formation, culture, loisirs) » (Béhar, Estèbe, 1995a).
Cette perspective n’invalide pas nécessairement la précédente, celle des quartiers-ressources, mais elle conduit à déplacer le regard du symptôme vers les facteurs structurels qui en sont à l’origine34. Dans leur essai sur la politique de la ville, Jacques Donzelot et Philippe Estèbe (1994) avaient utilisé la métaphore de « quartiers épicentres d’une nouvelle question sociale » pour signifier que l’origine des problèmes qui affectent ces quartiers se situe largement en dehors d’eux-mêmes. Marie-Christine Jaillet (2000) adopte une même grille de lecture en évoquant le « quartier qui n'est plus seulement considéré comme un réceptacle contenant à lui seul l'ensemble des problèmes de la société urbaine, mais comme un révélateur de ses dysfonctionnements ».
c) Les ambiguïtés de la lutte contre les « ghettos »
De cette lecture qui resitue la question des quartiers dans celle des agglomérations et des interdépendances qui lient ces quartiers à d’autres territoires, découle une orientation relative à la mixité sociale. Elle s'appuie « sur un diptyque : reconnaissance du droit des plus démunis à être là où ils sont (...) ; possibilité accrue de mobilité sociale, géographique, résidentielle et professionnelle » (Béhar, Estèbe 1995a). Il s’agit en d’autres termes de « donner les moyens de partir », mais aussi « l'envie de rester », pour reprendre une formule de Daniel Béhar (1991) qui a fait florès. Cette analyse conduit à une reformulation de l’enjeu de la mixité sociale, découplant la question de la mixité dans les espaces résidentiels de celle de la mobilité et du brassage dans d’autres espaces de la ville – à commencer par l’école et les entreprises, mais aussi dans les lieux de culture, de loisirs, etc. Les auteurs qui avaient le plus contribué à la formulation des objectifs de la politique de la ville, au cours des années 90, proposent ainsi de « faciliter la mobilité plutôt qu’imposer la mixité » (Donzelot, 2006), en « privilégiant les liens plutôt que les lieux afin d’échapper à l’assignation sociale » (Béhar, 2004) et en veillant à ce que les habitants de ces quartiers aient accès aux « espaces publics partageables dans la ville » (Jaillet, 1998).
On ne repère pas la même cohérence stratégique du côté des responsables politiques qui ont conçu les principes d’intervention de la politique de la ville dans le registre « transformationnel ». La position des responsables nationaux du parti socialiste, au pouvoir à certaines périodes charnières de cette politique, a connu des variations sensibles35. La conception dominante de la mixité sociale, au sein de ce parti, a en effet épousé, sinon stimulé les bifurcations de la politique nationale. On l’a vu à propos de l’épisode de la CNDSQ, la politique de la ville a juxtaposé d’emblée des objectifs sensiblement contradictoires : d’un côté, il s’agissait d’attirer de nouveaux ménages dans les quartiers par la voie directe d’opérations de restructuration du parc de logement telles qu’elle avaient été amorcées dans les toutes premières opérations HVS (Tanter, Toubon, 1995) ; de l’autre, il y avait une reconnaissance de la spécificité ethnique de ces quartiers ; enfin, la CNDSQ suggérait la création d’instances d’agglomération garantissant la « solidarité » entre communes et organismes d’HLM à cette échelle. Des espoirs étaient alors fondés sur les Programmes locaux de l’habitat et les Chartes intercommunales institués par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, mais il ne s’agissait encore que de démarches facultatives (Deschamps, 1998).
Cette dernière approche s’est imposée au début des années 90, réservant l’objectif de mixité sociale aux territoires ou aux segments du parc HLM fermés aux populations défavorisées et/ou d’origine immigrée. Mais la loi Besson du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ne se résumait pas à la question de l’insertion dans le logement des plus défavorisés pour qui un nouveau droit social aurait été créé (Houard, 2008 ; Ballain, 2000). La loi Besson venait également consacrer les pratiques « sauvages » d’organismes HLM qui, en dehors de tout cadre réglementaire, développaient des politiques dites de « peuplement » afin d’« équilibrer » la composition sociale de leur parc en limitant l’accès de ces mêmes groupes sociaux (Dourlens, Vidal-Naquet, 1987 ; Dupuy, Giaccobe, 1988). Ainsi, sous couvert de droit au logement, le législateur cherchait aussi à « casser les ghettos »36 qu’étaient en train de devenir les quartiers de la politique de la ville. L’analyse des débats parlementaires sur la loi Besson a montré que si les élus de tous bords se rejoignaient dans cette dénonciation des « ghettos », ceux de droite voulaient avant tout limiter la présence « étrangère » dans les cités HLM, allant jusqu’à proposer des « quotas », tandis que ceux de gauche insistaient davantage sur le rééquilibrage de cette population entre les territoires (Houard, 2008)37.
C’est cette stratégie d’accessibilité qu’a paru privilégier le gouvernement Rocard, en cherchant à placer la politique de la ville à une autre échelle que celle des quartiers à forte concentration de minorités pauvres (Jaillet, 2000). L’efficacité de la loi Besson était cependant tributaire de l’existence d’une offre accessible dans d’autres territoires, dans un contexte marqué par une pénurie de logements abordables et de montée de la précarité sociale (Ascher et al. 1995 ; Benguigui et al. 1997). C’est dans cet esprit que le législateur a adopté la loi d’orientation pour la Ville (dite LOV) du 31 juillet 1991, en complément de la loi Besson. Présentée elle aussi comme une loi « anti-ghettos », la LOV invoquait néanmoins le « droit à la ville », cher au philosophe néo-marxiste Henri Lefebvre (1968), que le législateur définissait de façon quelque peu réductrice comme la « coexistence des diverses catégories sociales dans chaque agglomération ». Sa disposition-phare imposait la construction de logements HLM aux communes dans lesquelles leur proportion était inférieure au fameux seuil de 20% du parc de logements38.
L’ambiguïté des objectifs poursuivis par cette loi « anti-ghettos » a été amplement commentée dans le cadre d’un séminaire « chercheurs-décideurs » organisé par le ministère de l'Équipement, dont les travaux ont cheminé en parallèle de l’élaboration de la LOV (Garin-Ferraz, de Rudder, 1991). Cette administration, dont les responsables avaient des doutes sur la loi en cours d’élaboration, se trouvait prise « dans un engrenage où elle était obligée d’agir mais n’était pas convaincue de ce qu’elle faisait » (Fribourg, 1991 ; voir aussi Heymann-Doat, 1993). Le doute sur les intentions qui animaient les responsables politiques était d’autant plus de mise que se développait en parallèle un discours qui, loin d’affirmer un objectif de mobilité résidentielle des ménages défavorisés, énonçait une finalité concurrente, résumée dans cette formule contenue dans le titre du rapport rendu en 1990 par un haut fonctionnaire du ministère de l'Équipement : « Les grands ensembles : bientôt des quartiers comme les autres » (Piron, 1990). La logique de « banalisation » des grands ensembles qui inspirait ce rapport avait déjà été affirmée par la mission Banlieues 89, animée par les architectes Roland Castro et Michel Cantal-Dupart, dont le mot d’ordre « Pour en finir avec les grands ensembles » avait été celui des assises de la politique de la ville tenues à Bron en 1990, au cours desquels François Mitterrand avait annoncé le passage du développement social des quartiers à la politique de la ville (Mission Banlieues 89, 1991). L’ambition affichée d’en finir avec les grands ensembles a connu un début de concrétisation avec le lancement, en juillet 1991, de 13 Grands projets urbains (GPU) dont l’objectif était de réinsérer les quartiers visés dans leur agglomération, en s’appuyant sur des opérations lourdes de transformation urbaine conduites sur une période de dix à quinze ans.
Dans sa formulation initiale, l’idée d’en finir avec les grands ensembles n’était pas encore associée aux démolitions comme mode opératoire principal. Si les responsables socialistes de l’époque parlaient de « casser les ghettos », on pouvait le comprendre aussi dans le sens de l’introduction d’une mixité « fonctionnelle » et « urbaine » destinée à faire sortir les quartiers d’habitat social de leur mono-fonctionnalité résidentielle (Berland-Berthon, 2004). De même, le rapport Delarue mettait-il en garde contre l’illusion suivant laquelle les démolitions pourraient faire sortir les quartiers de leur « relégation » en y attirant une population nouvelle et demandait de « bannir les démolitions avec feu d’artifice et musique triomphale » (Delarue 1991). Cette réticence s’est vérifiée dans le « dossier-ressources pour l’élaboration des Contrats de ville du XIème Plan » : « Dans la conjoncture actuelle de pression sur le logement et, au-delà, dans un contexte durable où les logements en question ne sont pas toujours les plus mauvais d’une agglomération, ces intentions de démolition doivent être dissuadés », pouvant être justifiées seulement « à titre exceptionnel ». Le même document insistait sur la nécessaire conduite d’une politique « au niveau de l’agglomération, de façon à améliorer la diversité de l’offre de logements dans chacun de ces quartiers et à faciliter le maintien des populations à ressources modestes en centre-ville ou dans les quartiers valorisés » (DIV, 1993).
Ces réticences vis-à-vis d’opérations d’aménagement visant à transformer la structure sociale des quartiers ont disparu à la fin des années 1990. La question du « peuplement » du parc social est ainsi devenue centrale dans la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, laquelle ne se réfère pas moins de six fois à la « mixité » dans son seul article 56 relatif aux attributions de logements sociaux ! (Kirszbaum, Simon, 2001). Dans cette perspective de rétablissement de la mixité sociale, le recours aux démolitions a été banalisé par le programme national de renouvellement urbain lancé en 1998 qui décuplait le nombre de quartiers concernés (passage de 13 GPU à 50 GPV et 70 Opérations de renouvellement urbain). La conversion au principe de démolitions massives, désormais défendue par différents responsables nationaux socialistes, qui étaient aussi des élus locaux proches du mouvement HLM, semble totale à la fin des années 1990, comme l’illustre cette déclaration de la secrétaire d’État au logement du gouvernement Jospin, Marie-Nöelle Lienemann: « La France pourra renouer durablement avec le pacte républicain si l'on sait casser les "ghettos" et prévenir le basculement vers le ghetto de certains quartiers. Les Français ont aujourd'hui une image négative du logement social. Celle-ci peut être améliorée, voire transformée par un remodelage radical des espaces urbains dégradés. (…) La première priorité sera d'accélérer considérablement la démolition de certains immeubles ou parties d'immeubles pour remodeler l'habitat, la ville et les quartiers »39. Tout en banalisant l’instrument des démolitions, les Grands projets de ville devaient néanmoins faire jouer les solidarités entre villes, afin de « casser le ressort de la ségrégation », selon les termes de Claude Bartolone40. En conséquence de quoi les logements sociaux démolis ne devaient pas être intégralement reconstruits aux mêmes endroits, « afin d’éviter de reconstituer des ghettos », selon l’expression du ministre41. Il ne s’agissait pas officiellement d’organiser la dispersion des habitants, mais de freiner l’afflux de « populations fragiles » en amont, tout en facilitant les parcours résidentiels de ceux qui étaient déjà présents dans les quartiers, grâce au « rééquilibrage » du parc social à l’échelle des agglomérations dans le cadre de la loi SRU alors en cours d’adoption et qui durcissait, par son article 55, les obligations de construction des communes déficitaires (Kirszbaum, 2002).
3. Normalisation : remettre les quartiers à niveau
Cette dernière orientation stratégique a émergé dès les années 1980 avec la mission Banlieues 89, avant de s’incarner dans différents dispositifs (loi d'orientation pour la Ville, Grands projets urbains, Grands projets de ville), pour finir par devenir hégémonique avec la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 – laquelle s’inscrit à bien des égards dans le sillage du Pacte de relance pour la ville adopté en 1996. Par-delà leurs objectifs et instruments propres, ces différents programmes privilégient le levier urbain d’intervention et partagent une même finalité : la diversification sociale et fonctionnelle des grands ensembles qu’il s’agit de doter de l’ensemble des attributs constitutifs d’une vie urbaine et sociale « normale ». Derrière cet idéal normatif filtre également une intention chaque fois réaffirmée de façon plus ou moins explicite : restaurer un « pacte républicain » qui serait mis en péril par la concentration spatiale de populations d’origine immigrée.
Le consensus républicain sur cette question se vérifie dans les critiques très mesurées de l’opposition lors de la discussion parlementaire de la future loi Borloo. Tout s’est passé comme si le rétablissement de la mixité sociale à l’échelle même des quartiers de minorités était une cause exigeant l’unité des forces politiques nationales, parce qu’elle touche au cœur du « vivre ensemble » républicain. La proximité des discours des deux ministres successifs de la Ville, Claude Bartolone et Jean-Louis Borloo, rend compte de cette convergence :
C. Bartolone : « La politique de la ville que j’anime au sein du gouvernement a pour ambition de faire que la ville du XXIème siècle soit celle du vivre ensemble, une ville qui dépasse les fractures sociales et ethniques »42 ; « Chacun, quels que soient ses origines, son lieu de résidence et son statut social doit se sentir appartenir à la même communauté de vie et de destin »43 ; « Le renouvellement urbain doit renforcer la République, pour que chacun se sente concerné par les trois mots de la devise inscrite au fronton des mairies »44.
J-L Borloo : « Faire des quartiers en difficulté de vrais quartiers de ville, et de populations aujourd'hui marginalisées des citoyens à part entière, telles sont les ambitions du programme national de rénovation urbaine. (…) C’est dans cet esprit que l’État et l’ANRU agissent pour permettre aux élus locaux, qui sont en première ligne, de mener à bien une tâche lourde, exigeante mais exaltante, pour permettre un retour de ces quartiers dans la République »45.
a) La mixité sociale et fonctionnelle pour priorités
La priorité désormais accordée au volet urbain de la politique de la ville, accompagnée d’un recours quasi-systématique au levier des démolitions, a été relevée par maints observateurs (cf. entre autres, Jaillet, 2003 ; Lelévrier, 2004a ; Epstein, 2004 ; Kirszbaum, 2004c ; Vanoni, 2005 ; Donzelot, 2006 ; Deboulet, 2006 ; Baudin, Genestier, 2006). On l’a vu, le retour à la « norme » des quartiers dits « sensibles » par un traitement urbain n’était que l’une des directions possibles de cette politique avant 2003. L’indétermination nationale des objectifs nationaux laissait une certaine latitude aux acteurs locaux pour combiner de façon pragmatique cette approche et celle qui valorisait les quartiers populaires (option dominante des années 80) ou qui mettait l’accent sur la transformation des politiques publiques au service d’une fluidification des parcours à l’échelle des agglomérations (option dominante des années 90) (Estèbe 2004a). Ces objectifs ont disparu d’une politique qui se fixe pour objectif exclusif de remettre « à la moyenne » des quartiers considérés sous l’angle de leurs handicaps urbains (morphologie, niveau d’équipement, enclavement, mono-fonctionnalité) et sociaux (concentration des populations défavorisées) (Epstein, 2005).
En cela, la loi Borloo est venue parachever un mouvement amorcé au début des années 1990, faisant de la mixité sociale l’horizon central des politiques urbaines et du recours aux démolitions dans les quartiers d’habitat social l’instrument privilégié pour y parvenir (Brouant, 2003 ; Bonneville, 2005 ; Le Garrec, 2006). Le PNRU ne fait que prolonger le Programme national de renouvellement urbain engagé en 1999, dont il a repris les principaux objectifs : transformation durable des quartiers HLM les plus dévalorisés, amélioration des conditions de vie de leurs habitants, redynamisation économique. Cependant, si les GPV et les ORU ont banalisé les démolitions, leur nombre est resté limité jusqu’en 2003, ne dépassant jamais un millième du parc de logements sociaux en rythme annuel et concernant pour l’essentiel des bâtiments dont l’état de dégradation ne laissait pas entrevoir d’autre issue. La loi Borloo a marqué une rupture quantitative, en fixant un objectif de 200 000 logements sociaux à démolir en cinq ans, ce chiffre ayant été porté à 250 000 par la loi du 18 janvier 200546. Ce saut quantitatif s’est accompagné d’une extension sensible de la géographie prioritaire de la rénovation urbaine. À la différence du renouvellement urbain qui ne concernait qu’une centaine de quartiers « historiques » de la politique de la ville, les 751 ZUS françaises devenaient potentiellement éligibles au PNRU. L’article 6 de la loi du 1er août 2003 donnait également la possibilité d’accorder des dérogations pour inscrire dans le PNRU d’autres quartiers non classés en ZUS, mais « présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues ». Ainsi, le changement de magnitude opéré par la loi Borloo (objectifs quantitatifs et nombre de quartiers concernés) a-t-il contribué à faire des démolitions la solution générique – c'est-à-dire envisageable en première approche et non après le constat d’échec d’autres options possibles – pour traiter les problèmes de l’ensemble des quartiers d’habitat social (Epstein, 2008a).
Si la rénovation urbaine se distingue du renouvellement urbain, c’est moins sur le plan des objectifs que sur celui de l’organisation administrative, avec la création d’une Agence nationale qui mutualise des moyens financiers d’une importance jusque-là inégalée dans la politique de la ville, afin de « changer de braquet ». C’est sous cet angle que Jean-Louis Borloo a défendu son projet de loi devant le Parlement : continuité stratégique, renforcement des moyens financiers, simplification administrative pour lever les obstacles bureaucratiques qui freinaient l’avancement des GPV et ORU. En effet, quatre ans après leur lancement, nombre de ces opérations n’avaient pas passé le stade des études ou de la programmation, ce qui se traduisait budgétairement dans un fort décalage entre les crédits affichés et ceux effectivement consacrés à la réalisation de ces opérations (Cour des comptes, 2002 ; Epstein, 2005).
Sur le plan du développement économique, la loi du 1er août 2003 n’a fait que consacrer le retour des Zones franches urbaines, en ajoutant 41 nouvelles zones franches aux 44 créées en 1996, lesquelles avaient fait l’objet d’une prorogation de six ans quelques mois plus tôt ; 15 ZFU supplémentaires ont été ajoutées en 2006, portant leur nombre total à 100. Ces zones franches ne visent pas seulement à favoriser l’accès à l’emploi des résidents ; le caractère peu contraignant de la clause d’embauche locale et les lacunes en matière de contrôle du respect de leurs obligations par les employeurs ont d’ailleurs été rapidement soulignés (Barilari et al., 1998 ; Buguet, 1998). Il s’agissait aussi, pour les promoteurs de ce dispositif47, de « faire des quartiers comme les autres » en y introduisant des activités économiques, des commerces et d’autres fonctions qui devaient contribuer au changement de leur image (Kirszbaum, 2004c). Dans le même sens, le rapport d’information du sénateur Pierre André sur les zones franches, publié en 2002 et qui a justifié leur relance en les qualifiant de « succès » et d’« espérance », insistait sur « l'apparence des quartiers et les transformations radicales de l'environnement urbain », des « modifications de l'environnement » qui auraient « une incidence déterminante sur les conditions de vie des habitants » (André, 2002). Sans défendre les zones franches, un rapport au Premier ministre des députés socialistes Chantal Robin-Rodrigo et Pierre Bourguignon (1999) avait développé cette même conception du développement économique dans la politique de la ville comme vecteur de changement d’image, devant contribuer à faire des « morceaux de ville à part entière ».
La place centrale accordée par la loi de 2003 à ces deux programmes de mixité sociale et fonctionnelle que sont le PNRU et les ZFU dessinait, en creux, un net resserrement des priorités opérationnelles de la politique de la ville. Certes, son article 1er prévoyait l’élaboration et la mise en œuvre, dans chaque ZUS, de programmes d’actions traitant des autres thématiques couvertes par la politique de la ville. Mais l’idée sous-jacente était de transférer la charge de ces programmes aux collectivités locales. Peu après l’adoption de la loi d’orientation, Marie-Christine Jaillet (2003) diagnostiquait ainsi la fin de la politique de la ville telle qu’on la connaissait, c'est-à-dire comme politique s’efforçant de porter conjointement l'investissement sur le cadre bâti et les interventions à caractère social, au sens large : « Le cycle qui s'annonce avec la loi Borloo se caractérise (...) par une dissociation : ce qui sera du ressort de l'investissement sur le cadre bâti sera repris en main par l'État dans le cadre d'un dispositif procédural recentralisé ; ce qui sera du ressort de l'accompagnement social et économique relèvera désormais du droit commun ou sera laissé à la seule initiative des collectivités locales, dans le contexte de l'acte II d'une décentralisation qui leur reconnaît davantage de compétences. C'est en cela que l'on peut dire qu'elle signe la fin de la politique de la ville telle qu'elle s'est peu à peu construite au fil des ans, malgré la difficulté certaine à faire tenir avec la même force ces deux registres ».
Ce scénario du renvoi intégral du volet social de la politique de la ville aux collectivités ne s’est pas vérifié, même s’il a fallu attendre la fin des émeutes de l’automne 2005 pour que le Gouvernement précise, à l’occasion du Comité interministériel des villes du 9 mars 2006, la nature, le contenu et les moyens affectés aux « programmes d’action » prévus à l’article 1er de la loi de 2003. Ces programmes allaient prendre la forme des nouveaux Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), pilotés par une agence nationale, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ), dont la vocation était d’« être à l’humain ce que l’ANRU est à l’urbain », suivant la présentation qui en était faite dans les dossiers de presse gouvernementaux.
En faisant des ZUS les cibles exclusives de la politique de la ville, dans son article premier, la loi du 1er août 2003 adoptait le diagnostic sous-jacent à cette catégorie territoriale : celle de quartiers définis par leurs handicaps, mesurés en termes d’écart à la norme, ce qui conduit mécaniquement à formuler les objectifs en termes de remise « à la moyenne » (Estèbe, 2004a). La réactivation de la catégorie « ZUS » en 2003 était d’autant plus inattendue que la logique du zonage avait été vivement critiquée par des chercheurs (Béhar, Estèbe, 1996a), mais aussi par de nombreux élus locaux (cf. Delevoye, 1997 ; CNV, 1998 ; Sueur, 1998 ; Bravo, 1999). Le gouvernement Jospin avait d’ailleurs mis cette catégorie territoriale à distance à partir de 1998 : la géographie prioritaire des Contrats de ville 2000-2006 et celle du Programme national de renouvellement urbain de 1999 ne faisaient pas référence aux ZUS, tandis que les mesures du Pacte de relance pour la ville (PRV) avaient été progressivement remplacées par de nouvelles mesures faisant appel à d’autres critères. Ce fut notamment le cas du contrat « emploi-ville », contrat de travail pour les jeunes de 18-25 ans habitant dans les ZUS, dont la moitié du salaire était pris en charge par l’État, qui a été abrogé en 1997 au profit du contrat « emploi-jeune » (Epstein, 2008a).
Si la loi de 2003 a opéré un retour à l’échelle du quartier, celle-là même que privilégiait la première phase de la politique de la ville, il ne s’agissait nullement de mettre en valeur des ressources, les ZUS étant au contraire définies par un « cumul de handicaps » (Tissot, 2004). La référence à la mixité nourrit une représentation des quartiers populaires comme lieux à détruire plutôt que comme lieux à valoriser, dont la politique de rénovation urbaine serait exemplaire (Charmes, 2009). Il ne s’agissait pas d’expliquer la condition des quartiers et de leurs habitants par des processus exogènes, comme dans la période « transformationnelle » de la politique de la ville. Le recours à la catégorie ZUS induit au contraire une lecture qui fait la part belle aux mécanismes endogènes de production de la marginalité sociale et urbaine : les processus conduisant à ces situations prendraient naissance au sein même des quartiers, et non plus en dehors d’eux-mêmes. L’« handicapologie » qui est au principe des politiques sociales (Castel, 1995) se voit alors transposée dans le champ urbain : il s’agit de faire la démonstration d’incapacités ou de déficits divers, dont découlent des droits. C’est ainsi que le PRV indexait l’intensité de mesures dérogatoires – ou de discrimination positive – sur la gravité du handicap des zones, définie par un indice synthétique d’exclusion48 (Estèbe, 2004a).
L’idée suivant laquelle il faudrait donner des moyens supplémentaires aux quartiers à proportion de leur concentration de populations en difficulté sociale ne renvoie pas à un simple principe d’équité visant à compenser l’inégalité des chances d’accès à diverses ressources (emplois, services publics…). Dans l’optique de la « remise à niveau », il s’agit aussi de remédier au déficit considéré comme le plus fondamental de ces quartiers, celui de la mixité sociale. L’hypothèse est que son absence a des effets propres sur la situation sociale ou économique des individus composant le quartier (Gilli, Kirszbaum, 2008). À la dénonciation traditionnelle des « politiques qui ont abouti à concentrer les problèmes aux mêmes endroits », selon l’expression de l’actuel Président de la République, il faut désormais ajouter la mise en cause de « la banlieue (qui) ne doit plus être un ghetto urbain, culturel ou mental, mais (qui) doit, au contraire, devenir comme le reste du territoire » afin de « réinsérer tous les quartiers dans la République »49. L’évocation du ghetto « culturel » ou « mental » suggère une influence du milieu de vie sur les comportements, valeurs et aspirations des individus concernés. Elle conduit à des explications qui rappellent les controverses américaines sur l’isolement socio-spatial des Noirs pauvres et l’hypothèse d’une « culture de la pauvreté » ou d’une « underclass », c'est-à-dire de phénomènes de déviance et de marginalité auto-entretenus au fil des générations, et que l’ouvrage retentissant de William J. Wilson, publié en 1984 aux USA et traduit en français en 1994, attribue principalement au déficit de mixité sociale (Wilson, 1994). Ce débat, qui a fait irruption en France autour de l’hypothèse très discutée de la constitution d’éventuels « ghettos » dans le contexte national (Maurin, 2004 ; Wacquant, 2006 ; Lapeyronnie, 2008), est loin d’être tranché sur le plan scientifique, en particulier la question d’un possible « effet de quartier » sur les comportements individuels, appelé aussi « effet de pairs » ou de « contagion »50. Ce qui conduit des chercheurs à considérer qu’« il n'est sans doute pas nécessaire de s'acharner à faire des ZUS des quartiers "comme les autres" : ce sont des quartiers comme les autres. Aucune malédiction ne s'y attache, les gens qui y habitent n'ont ni plus ni moins de chances dans la vie que ceux qui, présentant les mêmes caractéristiques, n'y habitent pas (...). Bien sûr, il s'agit là d'un jugement moyen portant sur l'ensemble des ZUS : ici ou là, existent de véritables ghettos dont la vétusté et la misère exigent la rénovation profonde mais l'ensemble des ZUS est loin de ressembler à cela » (Estèbe, 2007).
c) Une stratégie sélective de mixité contestée par les chercheurs
Le cœur de la stratégie de « normalisation » mise en oeuvre depuis l’adoption de la loi du 1er août 2003 est bien celui de la déconcentration des populations « en difficulté ». En tant que telle, cette loi a été l’objet de très peu de commentaires « savants ». Les chercheurs ont en fait focalisé l’essentiel de leur attention sur un volet et un seul de la loi : le Programme national de rénovation urbaine. Au-delà des questions soulevées par sa mise en oeuvre, sur lesquelles nous reviendrons, c’est la finalité même de mixité sociale à l’échelle des quartiers de la politique de la ville qui a valu une déferlante de publications généralement fort critiques (voir dernièrement, Espaces et sociétés, 2010).
Beaucoup de ces critiques avaient déjà été formulées dans les années 1990, voire bien avant. Dans un article canonique publié en 1970, référence obligée pour tout chercheur travaillant sur la mixité sociale, Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire avaient déjà émis de sérieux doutes quant à la possibilité de résorber les distances sociales par la proximité spatiale (Chamboredon, Lemaire, 1970). Mais le poids tout à fait singulier qu’a acquis la stratégie de mixité dans la politique de la ville a redonné vigueur à bien des arguments qui avaient souvent été forgés par le passé51. On trouve notamment remise à l’honneur l’idée selon laquelle les pouvoirs publics poseraient une équation discutable entre ségrégation et quartiers de la politique de la ville (Gaudin et al., 1995). Discutable, car elle suggère une homogénéité sociale de ces quartiers qui seraient en quelque sorte le négatif du monde des « inclus ». Cette vision dualiste des divisions de l’espace, qui avait été suggérée par certains sociologiques au début des années 90 (par exemple, Dubet, Lapeyronnie, 1992), n’a pas résisté à la production des premiers travaux statistiques sur les quartiers de la politique de la ville, lesquels rendaient compte, au contraire, de la diversité de ces quartiers et de leur relative hétérogénéité interne (Tabard 1993 ; Champion, Marpsat 1996).
Certains chercheurs ont été jusqu’à affirmer que les quartiers de la politique de la ville sur lesquels pèse l'injonction à la mixité, sont en réalité plus « mixtes » que bien d'autres espaces urbains, que ce soit du point de vue générationnel, des statuts professionnels, des origines ethniques ou des trajectoires résidentielles (Jaillet, 1998). Les travaux statistiques montrent certes un appauvrissement tendanciel des quartiers de la politique de la ville, mais ils font état de tendances plus prononcées encore à l’homogénéisation sociale des quartiers habités par les couches sociales aisées (Préteceille 2006).
Si le volontarisme public en matière de mixité s’affiche avec bien plus d’éclat dans les quartiers populaires et ethniques que dans d’autres territoires, ce serait en raison de la prétention des pouvoirs publics à vouloir changer la condition et les manières d’être des individus par l’urbain (Baudin, 2006 ; Tissot, 2007). Pour d’autres, ou les mêmes, une telle ambition ne ferait que réactualiser « le projet de moralisation des catégories populaires dans des quartiers définis par le regard des classes supérieures », tel qu’on le voyait à l’œuvre au XIXème siècle (Avenel, 2005). La mixité sociale appartiendrait à « la catégorie des mythes dont les objectifs sont imprégnés du romantisme social "éducatif" » (Kesteloot, Mistiaen, 1998), traduisant « une volonté de normalisation comportementale et de domination culturelle des classes moyennes et par ce fait de déni de l'identité sociale des couches dominées » (Genestier, 2003), ou encore une tentative de « contrôle social et policier des espaces non conformes » (Lévy, 2006). Plus sobrement, d’autres sociologues mettent en cause la mixité conçue comme « une potion magique qui doit résoudre tout à la fois la question des inégalités et la question du désordre social » (Lelévrier, 2005a). Un autre registre de critiques porte sur le déficit de vérification scientifique des bienfaits de la mixité, le programme de rénovation urbaine interdisant en particulier « de discuter ou de vérifier d’une manière savante ce qui est affirmé sur le mode de la croyance, parce que (le principe de mixité) fusionne le savoir scientifique et la certitude de la foi » (Donzelot, 2006).
Les chercheurs qui développent des approches davantage en phase avec les orientations de la politique nationale sont plus rares. Plutôt que de sociologues, ces positions émanent alors de géographes (par exemple Ascher, 1998), de juristes (par exemple, Deschamps, 2003) ou d’économistes (par exemple, Fitoussi et al., 2004) qui, dans ce dernier cas, se défendent de toute considération normative pour envisager les seuls coûts sociaux (ou « externalités négatives ») des situations de non-mixité. Entre les sociologues et les pouvoirs publics, on aurait donc affaire à une « relative étanchéité entre les décideurs politiques et les acquis des recherches » (Simon, 2001), « tout semblant avoir été dit sur la mixité depuis trente ans sans véritable prise sur les orientations de l’action publique » (Lelévrier, 2005b).
B. LES QUESTIONS TRANSVERSALES D’ÉVALUATION
Le retour à grands traits sur les principales orientations stratégiques de la politique de la ville et leur succession historique met en évidence ses oscillations, entre une politique des villes et une politique de l’État, entre des démarches de quartier et l’inscription dans une démarche d'agglomération, entre une ambition participative et une ambition de modernisation des organisations publiques, entre reconnaissance des quartiers populaires et ethniques et préoccupation de mixité sociale, etc. Comme l’écrit Marie-Christine Jaillet, « la politique de la ville est constitutivement indécise quant à l'objet qu'elle se donne, aux perspectives qui sont les siennes, à son statut dans l'action publique » (Jaillet, 2003).
Par-delà ces hésitations, il est possible d’identifier plusieurs principes fondateurs, constituant en quelque sorte le socle commun aux différentes phases de cette politique. Si leur traduction dans les dispositifs et outils successifs de la politique de la ville s’avère très contrastée, ces principes n’en sont pas moins constitutifs de cette politique. Outre le principe d’évaluation déjà évoqué, trois principes structurants sont repérables :
1. Une politique territoriale : la politique de la ville cherche à mobiliser l’ensemble des acteurs publics d’un territoire (villes, services déconcentrés de l’État et diverses autres institutions publiques) autour d’un projet élaboré sur la base d’un diagnostic partagé des problèmes des quartiers visés.
2. Une politique intégrée : la politique de la ville s’affiche comme une démarche à la fois transversale et globale, assurant la mise en cohérence d’interventions relevant de différents secteurs de l’action publique.
3. Une politique prioritaire : la politique de la ville cherche à organiser une concentration de moyens publics dans sa géographie prioritaire, en sus des ressources publiques de droit commun.
Chacun des principes qui structure ainsi la politique de la ville (territorialisation, approche globale, discrimination positive) soulève des questionnements propres dans une perspective évaluative. Les réponses scientifiques (dans une acceptation large) apportées à ces questions peuvent contribuer à la formation d’un jugement évaluatif sur la politique de la ville comprise comme un mode de gestion spécifique des quartiers.
1. Une politique territoriale ?
L’idée selon laquelle la politique de la ville est une politique territoriale semble aller de soi à la lecture même de son intitulé qui indique à la fois un objet et un acteur – la ville – inscrit dans un territoire. Pour s’en tenir aux acteurs en charge du pilotage de cette politique, la réalité est moins simple. La seule question de savoir qui pilote la politique de la ville ne trouve pas de réponse univoque. Cette politique est-elle avant toute chose une politique des villes sachant que l’État en est l’initiateur et le financeur ? Le partenaire « État » lui-même n’est pas un ensemble monolithique. En particulier, on peut s’interroger sur les rapports internes entre État central et local, entre segments interministériels (DIV au niveau central, préfectures localement) et segments ministériels. Cette question, qui a fait l’objet d’importantes controverses académiques, retrouve une actualité nouvelle dans un contexte d’accélération et de radicalisation du mouvement de réforme de l’État. L’interrogation se prolonge du côté des villes : alors que la dynamique intercommunale connaît de substantiels développements depuis une dizaine d’années, comment ces institutions se sont-elles emparé de la politique de la ville et comment se répartissent les rôles avec l’échelon communal ?
Une autre interrogation porte sur le recours à l’instrument contractuel en tant que cadre formalisant les relations entre partenaires territoriaux, incluant éventuellement d’autres collectivités locales (régions, départements) ou organismes publics (CAF, HLM, Pôle Emploi…) que l’État, les villes ou les EPCI52. Si le recours aux contractualisations territoriales est aussi ancien que la politique de la ville elle-même, la nature même du contrat qui avait prévalu jusqu’au début des années 2000 apparaît déstabilisée par la montée en puissance de nouveaux instruments de gouvernement, au point que l’abandon des contractualisations territoriales a été officiellement envisagé comme un scénario possible pour l’avenir de la politique de la ville (DIV, 2009a).
La politique de la ville se définit enfin par la méthode du projet territorial. Mais sa capacité à s’inscrire dans une « logique de projet » n’a jamais été pleinement acquise. Qu’en est-il dans la période actuelle, alors que les réformes nationales des années 2000 étaient pour partie motivées par un souci de simplification administrative ?
a) La politique de la ville, une politique des villes ?
La politique de la ville est emblématique du paradoxe d’une politique impulsée par l’État mais qui ne peut se passer du concours des collectivités locales, non seulement pour sa mise en œuvre, mais aussi pour sa conception. La question s’était posée avant même les premières grandes lois de décentralisation (Figeat, 1981). Elle est devenue plus aigue après l’acte I de la décentralisation, l’État étant « désormais "condamné" (...) à l'obligation du partenariat et de la contractualisation avec des protagonistes qui peuvent poursuivre d'autres desseins que les siens » (Jaillet, 2003). Loin d’avoir permis à l’État de maintenir une forme de tutelle sur les collectivités locales, les contractualisations territoriales ont servi de cadre au processus d’autonomisation des villes vis-à-vis de l’État (Epstein, 2008b). Elles ont favorisé l’apprentissage de nouvelles formes d’action collective par les acteurs locaux (Gaudin, 1995) et donc la constitution des villes comme acteur collectif (Le Galès, 2003), guidées par des maires qui se sont imposés comme les véritables leaders de l’action publique locale (Lorrain, 1993).
Au début des années 1990, l’État a bien cherché à reprendre la main sur la politique de la ville, non tant pour concurrencer le pouvoir des maires, que pour faire valoir ses orientations propres et infléchir la politique de certaines municipalités qui avaient tendance à négliger les quartiers au profit exclusif de leurs objectifs de développement (Oblet, 2005). Le thème du « retour de l’État » fit alors son apparition (Barthélemy, 1995) avec le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville comme tête de file locale. Ce dernier devait être l’incarnation d’un nouvel « État animateur », capable de mobiliser l’ensemble des services de l’État concernés par la cause des quartiers et d’organiser une « interpellation réciproque » avec les villes sur les actions développées vis-à-vis des quartiers (Donzelot, Estèbe, 1994). Le caractère « illusoire » du retour de l’État n’a pas manqué d’être souligné (de Maillard, 2004), à commencer par ceux qui l’avaient prophétisé, dans une « réévaluation » de la politique de la ville marquée par le dépit (Donzelot, Estèbe, 1999). Comme en témoignaient les évaluations des Contrats de ville, la dynamique « d’interpellation réciproque » ne s’était pas vérifiée. Si tant est que l’État local ait eu un « point de vue » propre sur les enjeux territoriaux, la légitimité de ses représentants locaux pour les énoncer se voyait contestée par les maires, tandis que les sous-préfet à la ville, qui ont peiné à s’imposer au sein du corps préfectoral et vis-à-vis des services déconcentrés (Grémion, Mouhanna, 1995), brillaient généralement par leur discrétion. Et pas plus que les services déconcentrés n’acceptaient de voir mises en cause leurs priorités, les villes n’étaient disposées à débattre de leur projet politique pour les quartiers. Dans bien des cas, les partenaires des Contrats de ville ont préféré éviter les « sujets qui fâchent » pour se concentrer sur la programmation financière des interventions associatives (Estèbe, Epstein, 1998 ; Kirszbaum, 1998 ; de Maillard, 2004). L’ensemble de ces constats relatifs à la faible capacité d’animation interministérielle des préfets et sous-préfets à la ville ont été largement confirmés au milieu des années 2000 (Fourcade et al., 2005).
En parallèle, la gestion quotidienne des actions de la politique de la ville s’est affirmée comme une prérogative municipale. Le signe le plus tangible a été l’internalisation, au sein des services municipaux, des chefs de projet et des équipes de « maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale » (MOUS), pourtant cofinancés par l’État (de Maillard, 2000). Le phénomène de municipalisation de la politique de la ville ne s’est pas démenti dans les Contrats de ville de la période 2000-2006 (Epstein, Kirszbaum, 2005). Qu’en est-il avec les Contrats urbains de cohésion sociale ? Les préconisations de parlementaires ayant inspiré le changement de procédure n’ont guère été dans le sens d’une dé-municipalisation de la politique de la ville, même relative. Parmi les justifications du remplacement des Contrats de ville figurait en effet la volonté explicite de renforcer le pouvoir municipal. Ainsi, la commission sénatoriale d’information sur L’avenir des contrats de ville a-t-elle considéré que « pour des raisons de simplification, de clarification et de cohérence politique, (...) c’est à la ville ou à l’intercommunalité que doit revenir la pleine responsabilité de la mise en oeuvre des futures conventions »53. La commission s’est aussi interrogée sur « la légitimité de l’État à rentrer dans le détail de la gestion de compétences relevant des communes », dénonçant « la multiplication des équipes instructrices de l’État avec des critères différents, qui apparaît à certains élus comme une "usine à gaz ingérable" » (André, 2005). Ses vœux paraissent avoir été amplement exaucés sur ce dernier point, s’agissant du moins de la programmation des crédits ne relevant pas directement des programmes de l’ACSÉ (Réussite éducative, Atelier santé-ville, etc.). Il en ressort un net désinvestissement des services locaux de l’État, dans un contexte de grande fragilisation liée à la Révision générale des politiques publiques (RGPP), laissant les préfectures et sous-préfectures comme interlocutrices quasi uniques des villes. Faute de pouvoir constituer une expertise territoriale propre sur les projets qui leur sont soumis, ces dernières finissent aussi par demander aux municipalités d’assumer cette fonction (Kirszbaum, 2009a).
Renaud Epstein a décrit plus largement les effets de l’entrée en vigueur de la LOLF sur le rôle de l’État local dans la conduite de la politique de la ville. Il relève une déconnexion inédite entre les mouvements de décentralisation et de déconcentration. Leur approfondissement conjoint, dans les années 1980 et 1990, avait permis d’assurer un certain équilibre entre État local et collectivités locales, notamment dans les contrats territoriaux proposés par la politique de la ville. La combinaison de ce qu’il est convenu d’appeler l’Acte II de la décentralisation et de la LOLF brise aujourd'hui ce lien : d’un côté, l’accroissement des pouvoirs des collectivités locales s’opère par captation d’une partie des compétences et des ressources humaines des services déconcentrés ; de l’autre, l’entrée en application de la LOLF réduit – contrairement aux intentions du législateur – leur capacité d’adaptation locale des objectifs et des mesures définies à l’échelon central. Dans la politique de la ville, cette reconcentration s’effectue au travers de l’ANRU (et, dans une moindre mesure, de l’ACSÉ), qui privilégie les relations directes avec les maîtres d’ouvrage des opérations relevant des programmes dont elles ont la charge, sans recours à l’instrument du contrat horizontal entre État local et collectivités territoriales. La remontée vers ces guichets uniques nationaux des crédits (d’investissement pour l’ANRU et de fonctionnement pour l’ACSÉ) auparavant délégués aux services déconcentrés, tend à cantonner l’État local dans une simple fonction de reporting vis-à-vis du niveau central, lui permettant tout au plus de suivre, sans pouvoir l’infléchir, la mise en œuvre locale des programmes nationaux. La méthode des appels à projet nationaux – très développée dans le cas de l’ANRU, mais aussi par le SG-CIV qui met en œuvre la dynamique Espoir banlieues – ne peut que contribuer à ce court-circuitage de l’État local (Epstein, 2008a).
Dans le contexte de marginalisation de l’État local dans la politique de la ville, des « délégués du préfet » ont vocation à ré-incarner l’État dans les quartiers. Mis en place à la suite du plan Espoir banlieues, pour prendre la relève des délégués de l’État qui ne s’occupaient de politique de la ville que sur une fraction très limitée de leur temps, ces délégués n’ont pas encore fait l’objet – à notre connaissance – d’études ou de recherches. On peut tout au plus souligner que les incertitudes quant à leur rôle, leurs missions et leur capacité à parler au nom de l’État, sont sources d’interrogations chez les partenaires territoriaux de la politique de la ville, y compris chez une partie des délégués du préfet eux-mêmes (Kirszbaum, 2009a, 2010).
b) Des intercommunalités déstabilisées ?
En dépit des discours nationaux qui faisaient, déjà, de la dimension intercommunale une condition impérative du succès de la politique de la ville, 10 % à peine des Contrats de ville du XIème Plan, signés en 1994, engageaient une structure intercommunale (Bachelet, 2000). Au total, 40 % avaient une dimension intercommunale, mais dans la plupart des cas seulement parce que certains quartiers identifiés comme prioritaires étaient à cheval sur plusieurs communes (Sueur, 1998). Ces Contrats de ville se contentaient alors de donner un habillage intercommunal à des programmes communaux simplement juxtaposés qui, dans la continuité des opérations de développement social des quartiers, continuaient d’œuvrer à cette dernière échelle. On était loin de la conception d’espaces de définition d’une politique de solidarité interrogeant les enjeux d’agglomération qui sont à la source des difficultés de certains quartiers (Béhar, Epstein, 1998 ; Kirszbaum, 1998).
L’exigence de coopération intercommunale est allée croissante dans la seconde moitié des années 90, et la proportion de Contrats de ville 2000-2006 signés par plusieurs communes est montée à 70%. Le mérite en revenait sans doute moins aux circulaires nationales qu’aux conséquences mécaniques de la loi Chevènement54, laquelle a contribué à l’essor de l’intercommunalité entre 2000 et 2003 tout en faisant de la politique de la ville une compétence obligatoire de Communautés d'agglomération qu’elle créait. Les bilans établis à mi-parcours (Epstein, Kirszbaum, 2005) et au terme des Contrats de ville 2000-2006 (Conjuguer, 2007)55 montrent cependant que ces EPCI n’ont exercé que partiellement cette compétence, le pilotage effectif de la politique de la ville continuant le plus souvent de relever de l’échelle communale, avec des variations selon les thématiques (les volets urbain et économique étant plus souvent gérés à l’échelle intercommunale). Dans la majorité des cas, les explications avancées par les évaluations locales à ce succès en demi-teinte sont directement politiques. Il ressort de ces bilans que la prise de compétence « politique de la ville » par les agglomérations n’a pas été en elle-même un levier efficace de la structuration d’un pouvoir politique d’agglomération transcendant le pouvoir municipal.
L’autre vecteur de développement du rôle des structures intercommunales dans la politique de la ville a été la loi Voynet, dite LOADDT56, qui avait fait des Contrats de ville le « volet de cohésion sociale et territoriale » des Contrats d'agglomération. Le bilan est ici nettement moins flatteur car ces Contrats d’agglomération ont surtout porté sur des investissements, laissant de côté le registre de l’animation et de la gestion territoriale. De là découle l’absence manifeste au sein de ces contrats des enjeux liés à la politique de la ville dès lors qu’ils ne relèvent pas des seuls investissements (les opérations GPV, puis ANRU étant quant à elles reprises pour mémoire) (Acadie, 2006). D’aucuns en ont conclu à la victoire de la loi Chevènement – des agglomérations définies par leurs compétences – sur la loi Voynet –des agglomérations se construisant autour d’un projet (Epstein, Kirszbaum, 2005).
Les années 2000 restent néanmoins marquées par une montée en puissance rapide des EPCI, faisant dire à certains que la France s’était engagée dans une « révolution intercommunale » (Borraz, Le Galès, 2005). C’est dans ce contexte que l’on peut apprécier les effets des réformes de la politique de la ville engagées à partir de 2003. En 2007, la Cour des comptes avait déjà formulé un constat sans appel : « Un mouvement de balancier est intervenu sur la période récente pour définir le niveau adéquat du partenariat État-collectivités territoriales : des impulsions ont été successivement données au niveau intercommunal et à l’échelon communal. Ces changements sont source de confusion pour les acteurs de terrain » (Cour des comptes, 2007). De son côté, un rapport de l’ESSEC évoque « des remises en cause et des difficultés de réajustement auxquelles a donné lieu la conjonction entre la restructuration de la politique de la ville et la montée en puissance des coopérations intercommunales d’agglomération » (ESSEC, 2009).
Comme l’a relevé la Cour des comptes, une première initiative préjudiciable aux agglomérations a été le relèvement du montant de la Dotation de solidarité urbaine (DSU), après sa réforme en 2005, intervenue sans « réflexion préalable sur l’architecture d’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ». Or, cette composante de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) est versée par l’État aux communes, en favorisant celles dont une part importante de la population réside en ZUS ou en ZFU, ce qui a pu « induire une modification de l’équilibre des interventions de la commune et de l’intercommunalité dans le champ de la politique de la ville, au détriment des dernières ».
Second recul, l’exigence intercommunale a quasiment disparu de la circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des CUCS, restée « évasive quant à la bonne échelle d’intervention et aux rôles des différents acteurs institutionnels : échelle communale ou intercommunale, élaborations des CUCS par la commune ou par l’EPCI, signature par le maire et/ou le président de l’EPCI » (Conjuguer, 2007). Inquiète de ce repli communal, la DIV a tenté de corriger le tir dans une circulaire du 1er février 2007 invitant les préfets à se mobiliser pour lever « les difficultés rencontrées dans certaines agglomérations pour faire prendre en compte les CUCS par les EPCI concernés ». Elle n’a pas été suffisante pour éviter une reprise en main communale du pilotage des programmes relevant de trois thématiques essentielles de la politique de la ville : cohésion sociale, urbanisme et prévention-sécurité (Aures, 2007). Le repli des CUCS sur l’échelle communale est en effet spectaculaire : en lieu et place de 247 Contrats de ville, ce sont 495 CUCS qui ont été signés, dont plus de la moitié par une commune seule (53,1%), les autres s’inscrivant dans des configurations hétérogènes (signature par plusieurs communes sans signature d’EPCI, par une commune et un EPCI, par plusieurs communes et un EPCI) ; seuls 19 CUCS (soit 3,8 % de l’ensemble) étant signés par un EPCI seul (DIV, 2009a).
Le caractère fortement re-municipalisé des CUCS reflète sans doute une réticence plus générale des maires envers la constitution de véritables pouvoirs d’agglomération. Le rapport précité de la commission sénatoriale sur l’Avenir des contrats de ville avait ainsi souhaité faire des maires – et non des EPCI – les véritables leaders des futures conventions, celles-ci devant « constituer le socle des engagements du maire, une véritable plate-forme politique ». Le rapport proposait par exemple d’aligner la durée de ces conventions sur celle du mandat municipal (André, 2005). Il faut souligner un autre effet de cette position : la mise à l’écart des autres collectivités locales que sont les conseils régionaux et généraux. Le « partenariat simplifié et clarifié » qu’appelait de ses vœux le rapport André s’accompagnait de la dénonciation du « caractère souvent artificiel » de l'articulation des Contrats de ville aux Contrats de plan État-Région et préconisait en conséquence de « mettre fin à la multiplication des financements croisés » avec les conseils régionaux et généraux. Sur ce plan aussi, les CUCS ont marqué une réduction du périmètre partenarial, comme l’a relevé le Conseil national des villes dans son Avis sur la première étape de mise en œuvre des CUCS : « La volonté de simplification qui présidait dans les intentions des sénateurs, comme dans celle du gouvernement, via les circulaires, trouve un aboutissement à la première étape. Le CUCS est principalement signé entre le maire et l’État, ou l’intercommunalité et l’État. Le partenaire essentiel de la politique de cohésion sociale locale – le Département – est souvent absent du contrat. Il en va de même pour la Région » (CNV, 2007a). S’agissant des conseils généraux, il s’agit bel et bien du retournement d’une dynamique qui les avait vus prendre place dans les Contrats de ville 2000-2006 (Epstein, Kirszbaum, 2005) alors que leur engagement dans les contrats de la période précédente avait été qualifié de « marginal ou inexistant » (Sueur, 1998). Quant aux conseils régionaux, dont l’implication a toujours été plus forte du fait de l’inscription des Contrats de ville dans les Contrats de plan État-Région, il ne sont plus que 9 sur 22 à avoir signé un CUCS (DIV, 2009a).
L’autre réforme majeure de la dernière décennie, l’adoption du Programme national de rénovation urbaine, a également contribué à déstabiliser la dynamique d’agglomération. Les agglomérations comptant au rang de leurs compétences l’équilibre social de l’habitat, il aurait pu sembler naturel que les projets de rénovation urbaine soient conçus et portés à cette échelle. Un tel choix eut été cohérent avec la volonté affichée de déconcentrer le logement social dans les ZUS pour le reconstituer au moins pour moitié hors ZUS, dans le cadre de la règle du « 1 pour 1 »57. Cette stratégie est en effet fondée sur l’idée de complémentarité entre la démolition de logements sociaux d’un côté, et le développement d’une offre sociale dans les villes déficitaires au sens de l'article 55 de la loi SRU de l’autre (Driant, 2004). La gestion de la rénovation urbaine par les EPCI aurait été d’autant plus cohérente que les agglomérations se sont vues confier, par l’Acte II de la décentralisation58, le soin de définir les politiques locales de l’habitat et leur articulation avec les autres politiques relevant de leur compétence, en leur ouvrant la possibilité de prendre en charge, sous le contrôle de l’État, la programmation des aides à la pierre59. Or, un transfert parallèle d’une part significative des aides à la pierre à l’ANRU a été décidé à la veille de leur délégation aux intercommunalités, réduisant d’autant les responsabilités de ces dernières en matière de politique de l’habitat (CNH, 2007). Ensuite, l’ANRU a privilégié l’échelon communal pour la signature de ses conventions, érigeant les maires en leaders des opérations de rénovation urbaine. L’option communale a été justifiée par l’ANRU sur le registre de l’efficacité (sortir les Grands projets de ville de leur enlisement en confiant la responsabilité des opérations à un acteur clairement identifié), mais c’était sans doute aussi un moyen de contourner les préventions des maires des autres communes agglomérées face à des opérations risquant de modifier la répartition spatiale du parc HLM et d’organiser le transfert vers leur territoire de populations non désirées (Epstein, 2007b). Cela a été souvent relevé : la difficulté du changement d’échelle de la politique de la ville tient pour beaucoup à la frilosité des élus locaux lorsqu’il s’agit de s'engager dans l'exercice effectif d'une solidarité qui les conduirait à prendre en charge des populations pauvres et/ou immigrées (Jaillet, 2003).
c) Vers des contractualisations verticales ?
Expérimentées dès les années 70 sur un mode qui relevait encore de la tutelle des villes par l’État (Lorrain 1989), les contractualisations territoriales ont représenté par la suite « la décentralisation en actes », selon l’expression de Jean-Pierre Gaudin (1996), une fois les relations entre co-contractants devenues plus égalitaires du fait des compétences et de l’autonomie acquises par les collectivités locales (Boutet, 2003). Dans la période qui a suivi les lois de décentralisation de 1982-83, le recours au contrat a présenté de nombreux intérêts, notamment celui d’organiser le passage de normes et de règles définies par les administrations centrales à des objectifs et actions négociés localement sur la base de diagnostics et de projets élaborés sous la houlette des élus locaux (Epstein, 2005). Au cours des années 1990, les politistes ont cherché à conceptualiser ce changement de paradigme. Qu’ils y aient vu l’avènement d’une nouvelle « gouvernance urbaine » (Le Galès, 1995), d’un « modèle polycentrique » (Gaudin, 1993) ou une « institutionnalisation de l’action collective » (Duran, Thoenig, 1996), il s’agissait de décrire un mode de gestion publique fortement différencié selon la nature des enjeux territoriaux et des logiques d’acteurs.
Les contrats de la politique de la ville n’en étaient pas au sens juridique du terme. Comme l’ont signalé différents juristes, il s’agissait plutôt d’engagements politiques, en l’absence de mécanismes de sanction de ceux qui ne les respectaient pas (Marcou, 1994 ; Jégouzo, 2005). Au prix d’un détournement de sens, puisque « la valeur qui est reconnue au contrat n’est pas de produire des obligations, c’est de procéder d’une négociation et d’aboutir à un accord » (Marcou et al., 1997). Ils se distinguaient ainsi nettement des contractualisations territoriales qui avaient été expérimentées dans la politique d’aménagement du territoire de la décennie précédente, en ce qu’ils envisageaient moins le territoire comme surface d’application de programmes décidés au niveau national qu’ils ne visaient à constituer une capacité locale d’action collective pour répondre aux enjeux des territoires. La novation au regard de la rigidité de la planification descendante antérieure à la décentralisation était d’ouvrir des scènes locales qui seraient le théâtre d’un processus continu de délibération et d’adaptation de l’action aux conditions – problèmes à traiter et ressources mobilisables – forcément changeantes de l’environnement, en introduisant des démarches plus horizontales, itératives et incrémentales (Pinson, 2009). Pour le dire autrement, les contrats post-décentralisation ont eu une fonction « procédurale » plutôt que « substantielle », au sens où ils laissaient ouvert à la négociation des partenaires locaux le choix des finalités et des moyens pour les atteindre (Lascoumes, Le Bourhis, 1998).
Selon l’analyse proposée par Renaud Epstein (2008a), la phase de la politique de la ville inaugurée avec la loi du 1er août 2003 constitue une remise en cause radicale de cette méthodologie d’action fondée sur le couple projet territorial-contrat global. L’État n’a pas renoncé à agir par contrat, mais l’offre contractuelle proposée aux collectivités locales est désormais plus ciblée et encadrée Tandis que les contrats de la période précédentes faisaient primer une « approche transversale et remontante » des projets territoriaux, les nouvelles conventions (de rénovation urbaine, de délégation des aides à la pierre…) signées avec les villes et les agglomérations ont désormais pour objet « de décliner localement des programmes sectoriels nationaux ». Leur contenu consiste en programmes d’action définis dans le détail et assortis de dispositifs de reporting permettant de contrôler leur mise en œuvre par les acteurs locaux. Ce qui correspond à un vrai changement de la fonction de l’instrument contractuel : celui-ci n’est plus utilisé par l’État pour organiser la territorialisation de ses politiques, mais pour s’assurer d’une mise en œuvre performante de ses priorités et de ses programmes par les acteurs locaux.
R. Epstein analyse les implications de cette évolution de l’instrument contractuel en termes de redistribution du pouvoir entre les niveaux national et local. Avec la création d’un guichet unique, une ville dont le projet ne serait pas retenu par l’ANRU ne peut plus se tourner vers des financeurs alternatifs. S’ils veulent accéder aux ressources de l’agence nationale, les maires et les bailleurs sociaux n’ont d’autre choix que de concevoir un projet conforme à la doctrine urbanistique et sociale de l’ANRU (démolitions massives, diversification des formes urbaines, des fonctions et des types de produits-logements, privatisation des espaces publics, création de voiries traversantes, etc.). D’où la prolifération de projets faiblement différenciés de démolition-reconstruction dans toutes les villes de France placées en compétition pour être sélectionnées par l’ANRU (Epstein, 2008b)60.
Dans une mesure moindre, le volet social de la politique de la ville est également affecté par les transformations de l’outil contractuel. Il faut d'abord rappeler que la loi du 1er août 2003 a totalement passé sous silence les Contrats de ville 2000-2006 (Méjean, 2003). Leur dénonciation juridique fut envisagée, mais il manquait le budget qui aurait permis à l’État de solder ses engagements contractuels par anticipation. Les Contrats de ville sont donc allés à leur terme, mais avec des moyens de l’État en diminution car les crédits d’investissement qu’ils mobilisaient ont été transférés au niveau central pour aller alimenter les caisses de l’ANRU. Des ponctions ont ensuite porté sur le Fonds d'intervention sur la ville (FIV), fond unique destiné à financer les dépenses de fonctionnement61. Par un jeu de vases communicants, la baisse du FIV a été compensée par une augmentation du montant de la Dotation de solidarité urbaine, très sensible après la réforme en 2005. L’existence de cet instrument, créé par la loi du 13 mai 1991, a ainsi rendu possible la conception d’une politique de la ville en dehors du cadre contractuel préexistant (Epstein, 2008a).
En ajoutant le montant de la DSU aux crédits d’investissement mobilisés par le PNRU, les crédits d’intervention contractualisés ne représentent plus qu’une part minime des ressources mobilisées par l’État en faveur de la politique de la ville62. La finalité de ces crédits d’intervention a elle-même évolué. Ils servent en bonne part à la mise en œuvre des programmes nationaux de l’ACSÉ (Réussite éducative, Ateliers santé-ville, Adultes-relais, etc.), lesquels une fois retirés laissent peu de marges de manoeuvre aux préfectures pour allouer des ressources à d’autres actions initiées par les collectivités et les associations (Avide, 2008). Alors que le FIV se caractérisait par une fongibilité quasi-totale, la charte de gestion du programme LOLF « Équité sociale et territoriale et soutien » prévoit le recueil par les préfectures d’une autorisation centrale avant de pouvoir procéder à une fongibilité des crédits fléchés de certains dispositifs nationaux (notamment les Adultes-relais et la Réussite éducative) en faveur d’autres dépenses (Epstein, 2008a). Ce mode de gestion resserre fortement le périmètre de la « programmation » des CUCS, au sens où l’entendent les acteurs locaux, c'est-à-dire comme un instrument permettant d’opérer un choix dans l’allocation des ressources ; la liberté d’emploi des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance apparaît à cet égard particulièrement contrainte (Kirszbaum, 2009a).
Cet état de fait modifie sensiblement la fonction des CUCS, finalement signés au début de l’année 2007 pour prendre la relève des Contrats de ville. Leur mode d’élaboration était révélateur, en amont, d’un très fort cadrage national : la durée, l’objet, les orientations, le contenu et la présentation des CUCS ont été définis avec une extrême précision par la circulaire du 24 mai 2006, laquelle définit jusqu’au format et au nombre de pages de chacune de leurs parties ! (Epstein, 2008a) Si les rédacteurs se sont partiellement affranchis de ce cadrage, l'agencement interne des documents préconisé par la circulaire a été respecté dans ses grandes lignes (Amnyos, Pluricité, 2007). Mais certains chefs de projets, dont le Conseil national des villes s’est fait l’écho, ont eu le sentiment que le formatage autour de cinq priorités « obligatoires » définies par l’État, « relevait davantage de l’appel à projets que d’un travail commun de deux partenaires qui comprennent les besoins du territoire et mettent en place des réponses adaptées ». Le CNV note qu’« il peut exister un malentendu sur le fond, puisque les élus s’estiment porteurs d’un projet territorial et demandent à l’État, soit de soutenir ce projet territorial, soit de définir son propre projet territorial – mais adapté à chaque territoire – et de le mettre en débat avec la collectivité locale dans l’objectif de construire un projet de développement local partagé » (CNV, 2007a).
d) Logique de projet ou routine administrative ?
Pas plus que l’État local, les villes ne paraissent donc sortir gagnantes d’une logique de programmes qui fait prévaloir des critères nationaux d’allocation des ressources et s’oppose ainsi à la conception et la conduite de projets de territoire. Toutefois, évoquer le retournement de la logique de projet en logique de programme ne doit pas conduire à idéaliser la première telle qu’elle a pu se concrétiser dans les périodes antérieures. De nombreux observateurs ont jugé que la flexibilité des contrats territoriaux horizontaux, qui devait permettre une différenciation de l’action publique en fonction des contextes locaux, ne s’était pas vérifiée. Une tendance à la standardisation des projets et des contrats s’est observée que certains ont imputée aux services déconcentrés de l’État, tributaires des normes centrales et des décisions ministérielles (Leroy, 1999), et d’autres aux collectivités locales qui n’ont pas su se dégager des référentiels nationaux et se sont donc contentées de reproduire, à échelle réduite, les politiques de l’État central (Béhar, Estèbe, 2006).
Force est de constater que la généralisation des contractualisations a suscité la multiplication de contrats sans véritable démarche de projet (Donzelot, Estèbe, 1999 ; de Maillard, 2004). Les avancées notées dans les sites qui ont découvert la politique de la ville en 2000 confirment le caractère éphémère de la fonction innovatrice des contrats de ville. Tout se passe comme si l’inscription durable d’un site dans la politique de la ville estompait le souci de l’innovation derrière celui de la pérennisation des actions mises en place par un tissu associatif dépendant des subsides de cette politique (Epstein, Kirszbaum, 2005 ; Epstein, 2008a ; Kirszbaum, 2009a). La fonction innovatrice de la politique de la ville n’aurait donc pas survécu à son institutionnalisation et sa généralisation (de Maillard, 2004).
Un autre facteur joue contre la logique de projet : le temps très réduit dont disposent les acteurs locaux pour élaborer les contrats proposés par l’État. Le phénomène s’est réitéré à chaque génération de contrats locaux, à l’exception de la préparation des Contrats de ville 2000-2006 qui, à la suite de la remise du rapport Sueur (1998), avaient été précédés d’une phase de négociation dans seize sites-pilotes de préfiguration ; parallèlement, un groupe de travail national avait été chargé de formuler des recommandations pour la conception et la négociation des futurs contrats (Cavallier, 1999). La préparation des CUCS s’est faite à nouveau dans l’urgence. Si leur élaboration a permis de réinterroger le diagnostic territorial et de revisiter les actions mises en oeuvre sur certains sites, le calendrier très court imposé par l’État a fortement limité la possibilité d’opérer ce retour critique (CNV, 2007a), faisant dire à certains qu’il s’agissait d’une « occasion manquée » (Bonetti, 2009).
Le CNV a souligné aussi l’importance capitale du temps dans une démarche de projet : « Le temps est un élément essentiel de la maturation du projet. Plus profondément, une absence de réflexion amont des partenaires concernés perdure fréquemment, que ce soit sur la vision de ce que l’on veut pour le territoire (espace et communauté de gens), sur le sens politique des projets et sur leur contenu, ou sur la coalition des efforts à réunir pour faire face aux enjeux » (CNV 2007a). Or, la temporalité du projet territorial n’est pas celle des programmes nationaux et des agences chargées de leur mise en oeuvre. La pression qu’elles exercent sur les acteurs locaux pour qu’ils produisent les réalisations attendues, dans les délais prévus, fragilise les démarches de projet. Il faut souligner à cet égard le paradoxe d’une culture managériale qui visait à parer les critiques anciennes (Delarue, 1991) et néanmoins récurrentes (Cour des comptes, 1995, 2002 ; André, 2005 ; Hamel-André, 2009) sur la lourdeur et la complexité excessives de la politique de la ville, pour aboutir à les renforcer par d’autres biais, liés principalement aux exigences de reporting (Lelévrier, 2008 ; Joigny et al., 2008 ; Kirszbaum, 2009a), ce qui peut aussi limiter in fine la capacité des acteurs à atteindre… leurs objectifs.
Le rapport André avait dénoncé voici quelques années le « partenariat insatisfaisant aboutissant à des excès de "réunionite" », « l'élargissement du partenariat, l'augmentation des financements croisés et la nécessité de se concerter pour la moindre somme » qui « abouti à une lourdeur qualifiée "d'insupportable" » (André, 2005). Cette critique de la « réunionite », qui avait accompagné la diffusion de la méthode partenariale, paraît toutefois céder aujourd'hui, chez les praticiens locaux de la politique de la ville, devant celle de l’urgence érigée en principe permanent de gestion des programmes de l’État. Les exigences de réalisation des engagements contractuels et de reporting placent désormais les acteurs locaux sous une pression sans relâche, qui tire l’essentiel de leur temps vers des tâches d’ingénierie administrative et financière. La chronophagie n’est donc plus tant du côté des réunions avec les partenaires que des tâches bureaucratiques de production de comptes-rendus. Ces réunions partenariales ne sont plus guère dénoncées localement, mais paraissent au contraire appréciées dès lors qu’elles autorisent des temps de respiration pour des acteurs locaux passablement essoufflés (Kirszbaum, 2010).
L’une des ambitions de la simplification administrative est de redonner toute sa place au projet politique des maires (André, 2005 ; Hamel-André, 2009). Face à l’emballement de la machine technocratique, le politique ne pourrait faire valoir ses droits et ses choix. Ce désir de voir le politique reprendre l’ascendant sur la bureaucratie n’est pas vraiment neuf. C’est ainsi que a DIV avait tenté de clarifier, à la fin des années 1990, le rôle respectif des instances « politiques » et « techniques » (DIV, 1999 ; voir également Cavallier, 1999). Dans leur formule élargie ou restreinte, les comités politiques avaient vocation à fédérer les grands décideurs locaux sur la scène du contrat, à la fois pour signifier l’engagement de leur institution en faveur de la politique de la ville et pour tracer son horizon stratégique. De leur côté, les comités techniques devaient se cantonner à la préparation des décisions de la maîtrise d’ouvrage politique, dans le cadre d’un mandat explicite reçu de celle-ci. Or dans les Contrats de ville (de Maillard, 2004) comme dans les Contrats urbains de cohésion sociale, perdure une relative fluidité, sinon une confusion, entre rôles techniques et politiques ; l’un des paradoxes des réformes managériales de la politique de la ville étant de conforter le rôle-charnière des techniciens dans l’élaboration et le suivi de programmes qui requièrent une technicité accrue (Kirszbaum, 2009a).
La logique du projet pose plus fondamentalement la question de l’existence proprement dite d’un projet politique des élus. Il ne faudrait pas voir nécessairement dans l’autonomisation des villes, l’affirmation de projets cohérents par les collectivités locales. La gestion de la politique de la ville par les municipalités révèle au contraire les finalités incertaines, les conflits continuels entre services, mais aussi l’absence de leadership clair au sein des villes, ce qui ne valide pas forcément l’idée de « maire entrepreneur » (de Maillard, 2004). À cet égard, l’imposition par le pouvoir national d’une finalité centrale de réduction des écarts territoriaux n’est pas nécessairement un levier propice à la formulation d’un projet politique municipal. Ce type d'énoncé ne saurait tenir lieu de projet territorial, lequel n’est pas réductible aux situations et dynamiques très variées des quartiers, et de leur place dans l'offre urbaine des agglomérations (Méjean, 2003 ; Amnyos, Pluricité, 2007). Cette philosophie d’intervention, couplée à un besoin récurrent de ciblage géographique des périmètres éligibles, ferait obstacle à une vision prospective et à la constitution de véritables projets de développement (Bertrand, 2009).
Qui pilote la « Politique des grandes villes » aux Pays-Bas ?
La politique de la ville néerlandaise est souvent citée en exemple de « gouvernance multi-niveaux », ses procédures permettant de concilier les priorités de l’État et l’autonomie des collectivités locales. Des extraits d’articles (synthétisés et traduits par nos soins) montrent cependant que cet équilibre est menacé par les évolutions récentes de la « Politique des grandes villes » : initialement fondée sur des principes de contractualisation et de subsidiarité, cette politique paraît engagée dans la voie d’un pilotage plus centralisé, au nom d’une logique de performance qui rappelle à bien des égards l’évolution suivie par la politique de la ville française. L’expérience néerlandaise accrédite ainsi l’hypothèse d’une européanisation des politiques urbaines, qui verrait l’approfondissement de la décentralisation s’accompagner d’une restauration des capacités de pilotage de l’État central.
Marissing E. van et al. (2006), « Urban Governance and Social Cohesion. Effects of Urban Restructuring Policies in two Dutch Cities », Cities, vol. 23, n° 4.
Depuis 1994, la Politique des grandes villes (GroteStedenBeleid) est le principal instrument destiné à améliorer la situation des quartiers défavorisés. Cette politique repose sur trois volets : économique, physique et social. Initialement ciblée sur les quatre plus grandes villes (Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Utrecht), elle a été étendue par la suite à 26 autres villes de taille plus modeste, souvent appelées le G26. Elle a été décrite comme une politique intégrée, territorialisée, fondée sur la gouvernance locale et le contrat.
Musterd S., Ostendorf, W. (2008), « Integrated Urban Renewal in the Netherlands : a Critical Appraisal », Urban Research & Practice, vol. 1, n°1, March.
La création d’un ministère chargé de la Politique urbaine et de l’intégration, auquel a succédé un ministère du Logement, des quartiers et de l’intégration, ne doit pas être lue sous l’angle de la centralisation. Il s’agissait avant tout de faciliter la coordination et la mise en commun des ressources des différents ministères dans les contrats signés avec les villes. Ces contrats définissent une série d’objectifs territorialisés couvrant les trois volets économique, physique et social de la Politique des grandes villes. Les municipalités se portent garantes de l’intégration locale de ces volets, en associant étroitement les habitants et en coopérant avec les partenaires des secteurs public et privé. Cette approche décentralisée a permis à chaque ville de se focaliser sur les problèmes considérés par elles comme les plus importants, et de développer des projets singuliers. Le gouvernement central a également prêté son concours aux instances locales de pilotage pour les aider à concevoir leurs propres projets et stratégies. Ainsi les villes ont-elle pu choisir leurs priorités, mais dans le cadre d’objectifs élaborés en accord avec le gouvernement central.
Extraits de Kokx A., Kempen R. van (2010), « Dutch Urban Governance : Multi-level or Multi-scalar ? », European Urban and Regional Studies, vol. 17, n°4, October.
L’Union Européenne a promu un nouveau mode de conception et de mise en œuvre des politiques urbaines, dans lequel les relations hiérarchiques qui unissaient traditionnellement les États aux villes sont remplacées par un système de « gouvernance multi-niveaux » plus horizontal et subsidiaire. Cette gouvernance s’appuie sur des principes d’ouverture, de transparence, de participation, de responsabilité, d’effectivité et de cohérence, dont il est attendu tout à la fois une intégration verticale (entre niveaux de gouvernement) et horizontale (entre politiques sectorielles), l’implication et l’empowerment des citoyens.
Nous avons cherché à savoir comment ces principes de bonne gouvernance se traduisent en pratique dans la politique néerlandaise des grandes villes. Cette politique nationale est mise en œuvre au travers de « Programmes de développement à long terme » élaborés par les villes, qui font l’objet de conventions avec l’État. Depuis 2005, l’État ne se contente plus d’afficher de grands objectifs (pour la période 2005–2009 : améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité ; améliorer la qualité de l’environnement physique ; améliorer la qualité sociale de l’environnement ; maintenir les classes moyennes et supérieures dans les villes ; renforcer les villes sur le plan économique) ; il les a déclinés dans une cinquantaine d’indicateurs de performance qui précisent le cadre stratégique dans lequel doivent s’inscrire les projets des villes.
L’introduction d’instruments néo-managériaux de pilotage par la performance soulève plusieurs interrogations concernant la question du pouvoir et de l’autorité dans la Politique des grandes villes. En particulier, il est prévisible que dans un État unitaire décentralisé où les ressources des autorités locales dépendent à 80% des dotations centrales, le pilotage centralisé par les indicateurs conduise à l’affaiblissement du pouvoir des gouvernements locaux. De fait, à rebours de l’intention affichée par le gouvernement central de donner plus de latitude aux villes, ce mode de pilotage conduit, d’après les acteurs locaux, à un phénomène de centralisation, en incitant les projets locaux à se conformer aux objectifs du pouvoir national. La nouvelle méthode de pilotage a aussi des effets négatifs sur le plan de la démocratie participative : les gouvernements locaux étant à la fois responsables devant leurs administrés et devant le gouvernement central, la participation des habitants en souffre.
L’État a également fixé les principes suivants pour la période 2005–2009 : 1. pilotage par les résultats ; 2. moins de bureaucratie ; 3. plus de transparence ; 4. un ensemble de mesures pour faire en sorte que chaque ville fasse ses choix propres à partir d’une approche adaptée ; 5. une approche intégrée. On retrouve ici les principes européens de bonne gouvernance (pilotage par les résultats, moins de bureaucratie), d’ouverture (transparence publique), de cohérence (approche intégrée), de responsabilité (résultats mesurables), de participation et de subsidiarité (prendre en compte la spécificité des situations locales et renforcer la démocratie locale en permettant aux villes de faire leurs choix propres).
À écouter les acteurs locaux, les instruments de pilotage introduits dans la Politique des grandes villes en 2005, dont il était attendu un surcroît d’autonomie locale et de transparence dans l’utilisation de l’argent public, conduisent avant tout à renforcer le contrôle et la domination de l’État sur les municipalités. Ces instruments sont révélateurs de la défiance de l’État envers les villes, alors même que l’instauration d’une confiance mutuelle figurait dans les orientations nationales de la Politique des grandes villes. Faisant écho à la frustration des acteurs locaux, qui ont le sentiment d’être traités avec condescendance par les ministères, le ministre en charge de cette politique a critiqué les cadres rigides de sa mise en œuvre, la dimension chronophage du suivi par indicateurs et les biais qu’ils introduisent dans l’analyse des résultats, ainsi que le cloisonnement des administrations nationales. Cette analyse se retrouve dans un récent rapport de la Cour des comptes au Parlement, qui a fait état de moindres opportunités pour définir des priorités et des actions adaptées aux situations locales.
L’idée d’appliquer un traitement global au problème des « banlieues » a émergé dans les années 1970. Elle se fondait sur la conviction que ce problème avait un caractère multidimensionnel, ces dimensions se renforçant mutuellement. Aussi fallait-il substituer une méthode qui les prenne globalement en compte au lieu de les séparer artificiellement selon l’habitude des administrations sectorielles (Donzelot, Estèbe, 1994). Tel était tout du moins l’analyse des hauts fonctionnaires de l’Équipement, des Affaires sociales et de la Jeunesse dont les réflexions ont donné naissance au programme Habitat et vie sociale en 1977 (Damamme, Jobert, 1995). L’articulation entre des interventions sur l’habitat avec d’autres que l’on appelait alors d’« animation sociale » fut difficile. Les opérations HVS ont donné une claire priorité au traitement du bâti avec une visée, déjà, de mixité sociale (Tanter, Toubon, 1999). Le bilan critique des opérations HVS (Figeat, 1981) fut repris par le rapport Dubedout qui pointait la faiblesse des actions sociales et économiques visant les « causes de la dégradation », alors que « l’amélioration du cadre bâti, pour nécessaire qu’elle soit, serait vaine si des remèdes n’étaient pas simultanément apportés aux situations sociales existantes » (Dubedout, 1983).
Le décloisonnement des politiques sectorielles supposait, pour la Commission nationale pour le développement social des quartiers de faire primer une approche remontante, partant des problèmes identifiés localement. Une analyse similaire se retrouve dans les rapports établis à la même époque par Bertrand Schwartz (1981) et Gilbert Bonnemaison (1983), portant respectivement sur l’insertion des jeunes et la prévention de la délinquance. Les dispositifs mis en place dans le prolongement de ces trois rapports - opérations DSQ, Conseils communaux de prévention de la délinquance et Missions locales pour l’insertion des jeunes - devaient servir de cadre pour cette recherche de coordination entre acteurs issus d’horizons divers (élus locaux, administrations publiques, organismes HLM, associations…) autour d'un projet territorial. Depuis lors, l’approche transversale et globale de la politique de la ville a toujours recouvert deux dimensions considérées comme complémentaires : le partenariat inter-institutionnel et l’articulation des thématiques autour du triptyque « urbain, social, économique » (Delarue, 1991). Plus de trois décennies après l’énonciation de ce principe, il semble que l’approche intégrée constitue moins une solution qu’un problème encore largement irrésolu –sinon accentué dans la période récente– pour la politique de la ville.
a) L’interministérialité a-t-elle jamais fonctionné ?
L’approche globale suppose, du côté de l’État, une forme d’action interministérielle. C’est dans cette perspective qu’ont été mis en place au début des années 1990 un ministère de la Ville, secondé par une délégation interministérielle et relayé par les sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville. Très vite, il a été remarqué que la DIV se heurtait de façon persistante à la résistance de puissantes administrations centrales qui jouaient la carte du protectionnisme sectoriel (Damamme, Jobert, 1995). Les différents ministères n’ont pas refusé frontalement de participer à la politique de la ville, mais ont opté pour une stratégie de contournement en développant leurs propres programmes de lutte contre l’exclusion socio-urbaine, développant une offre contractuelle « maison » en direction des collectivités locales, ce qui a conduit à « un empilement de globalités partielles, reproduisant, au nom du combat contre la sectorisation, le cloisonnement qui était reproché au verticalisme » (Jobert, Damamme, 1995). La multiplication de ces contrats peut s’analyser comme un demi-succès –ou un demi-échec– pour la politique de la ville (Estèbe, 2004a) : d’un côté, la question de l’exclusion dans les banlieues se voyait reconnue comme un objet légitime de l’intervention de chaque ministère ; de l’autre, leurs réponses s’inscrivaient dans des relations bilatérales avec les municipalités, conduisant à une fragmentation de la politique de la ville.
Le déficit de coordination interministérielle en amont a conduit à renvoyer le problème vers l’aval, dans les territoires où les services déconcentrés de l’État proposaient une pléthore de contrats thématiques aux villes, chacun de ces contrats étant organisé autour de priorités, d’instances de pilotage, de calendriers et de financement propres. Pour ne prendre qu’un exemple, pas moins d’une demi-douzaine de contrats ont concerné le seul domaine éducatif et de la jeunesse : contrat éducatif local, contrat local d’accompagnement scolaire, contrat de réussite scolaire, contrat temps libre, contrat enfance, opération Ville-vie-vacance, etc. (Epstein, 2008a).
Il revenait dès lors aux préfets, ou aux « sous-préfets à la ville » passés de treize à trente en 1996, d’orchestrer le partenariat interministériel dans les territoires. Comme l’ont montré différentes études (Grémion, Mouhanna, 1995 ; Bachelet, Rangeon, 1996 ; Donzelot, Estèbe, 1999 ; Estèbe, 2004a), cette fonction d’animation inter-services a peiné à se concrétiser, du fait de la prégnance d’une culture du commandement dans la préfectorale, mais aussi en raison du déficit d’autorité effective des sous-préfets sur les services déconcentrés. Les résistances observées au plan national se sont donc reproduites localement avec des variations d’un département à l’autre. Le cas de figure le plus fréquent voyait les directions départementales des ministères désigner un « correspondant ville » pour participer aux réunions des « missions Ville », lesquelles constituaient le seul véritable soutien logistique (faiblement étoffé) des sous-préfets à la ville. Mais ces correspondants ville occupant rarement des postes élevés au sein de leur hiérarchie, ils pouvaient difficilement y relayer les préoccupations du sous-préfet de nature à contrecarrer les effets structurants des logiques verticales et sectorielles. Élément perturbant pour le système administratif local, à commencer par les préfectures elles-mêmes, le sous-préfet à la ville a donc été cantonné, sauf exception, dans la sphère du socioculturel et de la prévention de la délinquance où il pouvait répartir des subventions aux associations, en lien avec les municipalités, grâce au Fonds d'intervention pour la ville qu’il maîtrisait.
L’enjeu de coordination entre politiques sectorielles demeure toujours aussi prégnant pour la politique de la ville des années 2000. Le problème est même devenu plus aigu avec la création de l’ANRU, puis de l’ACSÉ, qui a nettement accentué le cloisonnement entre les volets « investissement » et « fonctionnement » de la politique de la ville. La création de l’ANRU a permis la mutualisation dans un « guichet unique » de l’ensemble des crédits d’investissement concourant au renouvellement urbain. Cette opération de mutualisation financière n’a pu être répliquée sur le volet social de la politique de la ville, en raison de la diversité des sources de financements (crédits européens, d’État, des collectivités locales, des CAF, des CPAM et d’autres organismes publics et privés) et de la réticence de ces financeurs à en perdre le contrôle63.
La création de ces deux agences chargées chacune d’un volet de la politique de la ville a déstabilisé la DIV, qui a vu nombre de ses agents et la quasi-totalité de ses crédits d’intervention transférés vers les agences. La délégation interministérielle a alors été repositionnée sur une mission d’animation interministérielle, alors même que l’enjeu de coordination s’était en grande partie déplacé vers l’animation inter-agences (Epstein, 2008a).
Les difficultés observées à l’échelon central, pour coordonner les deux agences, se retrouvent à l’échelon local. L’organisation locale de l’État a reproduit le cloisonnement national, avec d’un côté des missions Ville des préfectures recentrées sur la gestion des crédits d’intervention de l’ACSÉ, et de l’autre des DDEA64 cantonnées dans le seul suivi des projets de rénovation urbaine pour le compte de l’ANRU, sans toutefois contribuer activement à la définition et la conduite de ces opérations, comme l’a établi le Conseil général des ponts et chaussées dans un rapport pour le Comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU (CES de l'ANRU, CGPC, 2007). Eu regard à l’enjeu de transversalité, le phénomène le plus marquant a été le retrait des DDEA des Contrats de ville, confirmé dans les CUCS, dès lors que les crédits d’investissements étaient gérés hors de ces procédures. Le rattachement des missions Ville aux Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, dans le cadre de la RGPP, parachève cette évolution vers une dissociation quasi-totale au sein de l’État local entre le volet urbain et le volet social de la politique de la ville (Kirszbaum, 2010).
b) Les contractualisations locales : cohérence ou fragmentation ?
Avec les Contrats de ville, l’État avait cherché à résoudre les problèmes qu’il avait lui-même engendrés en multipliant les contrats sectoriels relevant, à un degré ou un autre de la politique de la ville, au risque d’un émiettement de l’action publique (Lefèvre, 1988). L’ambition coordinatrice était particulièrement affirmée avec les Contrats de ville 2000-2006, lesquels devaient servir de cadre à la mise en cohérence d’ensemble des procédures initiées par l’État, notamment les Grands projets de ville, Programmes locaux de l’habitat, Contrats locaux de sécurité, Contrats éducatifs locaux et Plans locaux d’insertion par l’économique, appelés chacun à devenir un volet des Contrats de ville, dont la vocation était de devenir la « procédure des procédures », selon l’expression du rapport Sueur (1998). La commission chargée de formuler des recommandations sur ces nouvelles contractualisations mettait en garde « contre le fait que (les conventions thématiques) ne doivent en aucun cas contribuer à une nouvelle sectorisation de l’action publique, découpant abusivement, en fonction des tropismes culturels et organisationnels des différentes administrations et services publics concernés, des approches qui gagnent à être de plus en plus globales » (Cavallier, 1999).
Les évaluations intermédiaires réalisées en 2003 ont permis de souligner l’écart entre cette ambition et les réalités locales (Epstein, Kirszbaum, 2005 ; Epstein, 2008a). Comme ceux de la génération précédente, les Contrats de ville 2000-2006 ont eu beaucoup de mal à jouer leur rôle attendu de « grand intégrateur ». Les diverses procédures contractuelles sont restées le plus souvent gérées de manière cloisonnée. Cependant, les évaluations n’ont pas conclu à l’inefficacité des Contrats de ville du point de vue de la mise en cohérence des interventions publiques. Car à défaut d’une coordination en amont, au stade de la conception des programmes et des actions, c’est par l’aval qu’ils ont produit des avancées, dans le cadre d’instances de coordination opérationnelle réunissant les agents de terrain de diverses institutions autour d’un problème ou d’un public précis : absentéisme scolaire (cellule de veille éducative), délinquance réitérante (groupe local de traitement de la délinquance), insertion économique des populations éloignées de l’emploi (plan local d’insertion par l’économique et/ou équipes emploi insertion), etc. Le fonctionnement de ces groupes, fondé sur le partage d’informations individuelles détenues par les acteurs de terrain, améliore le chaînage des interventions et des prestations en direction des publics visés, évitant ainsi les doublons et les ruptures dans le suivi. Engagés dans des « processus d’apprentissage collectif » (de Maillard, 2004), ces intervenants agissant au plus près des publics et des quartiers se sont donc approprié la méthode partenariale d’une politique de la ville qui montrait sa capacité à dépasser le formalisme des réunions inter-institutionnelles pour déboucher sur une dimension opérationnelle. Mais ces partenariats opérationnels révélaient en même temps la fragilité de coopérations forcément tributaires de l’implication de tel ou tel individu.
Pendant longtemps, la figure emblématique de la transversalité dans la politique de la ville a été celle du « chef de projet », qui a pu être rapprochée de celle du sous-préfet à la ville mais pour décrire alors le phénomène d’épuisement rapide de leur capacité d’innovation (Béhar, Estèbe, 1996b). Le profil des chefs de projet, qui capitalisaient à l’origine des compétences militantes et professionnelles (Peraldi, 1995) pour se positionner comme facilitateurs de rencontres entre des mondes qui s’ignoraient, a cédé la place, à mesure que leur institutionnalisation progressait (de Maillard, 2000), à des profils beaucoup plus managériaux et gestionnaires (Blanc et al., 2002). Si leur position dans les organisations municipales est extrêmement variable, avec des fragilités liées à la personnalisation de la fonction (Aures, 2009), leur capacité à s’affranchir des frontières sectorielles apparaît aujourd'hui bien entamée. Dans bien des villes, on n’a plus affaire au chef de projet « politique de la ville », chargé d’établir des liaisons entre les thématiques du contrat, mais à des chefs de projet, identifiés par une procédure (CUCS, rénovation urbaine, réussite éducative, atelier santé-ville…) et qui coexistent au sein de la même structure municipale (Kirszbaum, 2009a, 2010).
Cette évolution d’un métier qui était l’emblème de l’approche transversale dans l’action municipale, ne fait que reproduire localement des transformations qui affectent la politique de la ville au plan national. Depuis 2003, et plus encore avec la pleine entrée en application de la LOLF65, cette politique est constituée de programmes nationaux cloisonnés, ce qui ne peut qu’accentuer les difficultés de l’intégration horizontale, aussi bien au niveau central (entre les programmes portés par l’ANRU et l’ACSÉ) qu’au niveau local entre des agents chargés de la mise en oeuvre d’un programme spécifique.
Dans ce contexte, l’affichage du Contrat urbain de cohésion sociale comme « un contrat global et cohérent » qui « intégrera et mettra en cohérence l’ensemble des dispositifs existant sur le territoire concerné »66, apparaît largement décalé en regard de la réalité. La DIV l’a reconnu au détour d’une phrase figurant dans son Livre vert : « La conjonction de moyens distincts, d’une organisation administrative séparée et d’une géographie propre (des programmes et "dispositifs" spécifiques notamment les projets de rénovation urbaine, les projets de réussite éducative et les adultes relais, voire les actions des services dans le cadre de contrats locaux de sécurité) a conduit à dissocier ces programmes du CUCS. Celui-ci est, dès lors, souvent appréhendé comme un outil du seul développement social, voire comme un outil de programmation des aides aux associations et non plus comme un outil au service d’un projet de territoire » (DIV, 2009a). Peu après leur signature, une « analyse critique » des CUCS a été conduite par des cabinets de consultants dont les conclusions allaient dans le même sens : « Bien souvent la stratégie exprimée dans le CUCS n'est pas une, mais elle est quintuple –une par thématique– de même que le diagnostic se décompose en cinq chapitres thématiques. (...) Cette segmentation thématique risque (...) d'entériner une sectorisation figée des enjeux de la politique de la ville. Ce qui est en jeu derrière cette question, c'est la capacité du CUCS à offrir un cadre effectivement global et décloisonné à une stratégie contractualisée » (Amnyos, Pluricité, 2007).
La dissociation des programmes est plus marquée avec la rénovation urbaine qu’avec les autres thématiques qui s’inscrivent formellement dans les CUCS. Cela tient au pilotage des programmes par deux agences nationales distinctes, qui opèrent à partir de calendriers et de procédures tout aussi distincts. L’affichage du projet de rénovation urbaine comme déclinaison, dans le volet « Habitat et cadre de vie » du CUCS, de sa stratégie globale n’est qu’un habillage formel (Epstein, 2008a ; Harzo, Lauriac, 2009). L’analyse d’échantillons de CUCS montre que certains documents ne font d’ailleurs aucune référence aux PRU, ou qu’ils y renvoient sans plus de précision (Harzo, Lauriac, 2009 ; Kirszbaum, 2010). Sur la base de son questionnaire adressé aux responsables locaux des CUCS, la DIV a établi que parmi les collectivités bénéficiant d’un PRU, les sites ayant intégré ce dernier comme volet thématique du CUCS sont moins nombreux que les sites où les deux procédures fonctionnent en totale autonomie (19,4% contre 27,8%) (DIV, 2010).
L’analyse des documents contractuels est révélatrice du caractère incantatoire de l’« articulation » entre CUCS et PRU, dont les modalités opérationnelles n’ont pas été définies (Harzo, Lauriac, 2009). Tout se passe comme si les implications pourtant majeures de la création de deux agences n’avaient pas fait l’objet d’une réflexion des partenaires territoriaux sur les conditions de leur réception optimale ; l’idée même d’articulation, en passe de devenir un nouveau « mot-valise », est d’ailleurs absente d’un grand nombre de conventions de rénovation urbaine. Le plus souvent, les CUCS ont repris à leur compte les notions de complémentarité et d’accompagnement avancées dans le Titre IV des conventions de rénovation urbaine. Dans le registre de la complémentarité, PRU et CUCS obéissent à une division précise du travail entre « hard » et « soft », indiquant que chaque procédure poursuit ses objectifs dans son champ propre. Dans le registre de l’accompagnement, le CUCS est délibérément placé au service de la réussite du projet urbain. On passe alors de la juxtaposition à l’instrumentalisation d’une procédure par l’autre (Kirszbaum, 2010).
Tous les CUCS ne participent pas, en pratique, au financement du volet social des PRU (relogements, charte d’insertion, actions mémorielles, communication, gestion urbaine de proximité...). Ce cas de figure ne concernerait en fait qu’une moitié des CUCS (DIV, 2010). Ailleurs, la dissociation est complète. Là même où les CUCS sont mis à contribution pour accompagner les PRU, cela ne va pas sans provoquer quelques tensions, puisque dans ce schéma instrumental le PRU vient ponctionner le budget du CUCS sans que les acteurs de ce dernier soient généralement associés aux décisions sur les opérations d’accompagnement du projet urbain (pas plus qu’ils n’ont été associés à leur élaboration). L’articulation réciproque, qui verrait les financements du PRU utilisés pour soutenir des opérations de fonctionnement, est impossible du fait des règles de financement de l’ANRU qui autorisent tout au plus l’utilisation de ses crédits pour des dépenses d’ingénierie ou d’étude. Cette relation instrumentale peut être assumée dans les villes où les acteurs urbains et sociaux ont le sentiment d’œuvrer pour un seul et même projet de territoire, elle n’en demeure pas moins problématique pour nombre d’acteurs de la politique de la ville, ne serait-ce que parce que les ponctions opérées sur les crédits CUCS pour accompagner les PRU limitent les ressources mobilisables pour des actions relevant d’autres champs (Kirszbaum, 2010)
La primauté du projet de rénovation urbaine sur le projet de cohésion sociale tient aussi, voire surtout, aux moyens qui leur sont respectivement dévolus. La « gigantesque disparité entre les budgets des deux dispositifs » rend difficile la mise en oeuvre de relations équilibrées (Harzo, Lauriac, 2009). Le budget de l’ACSÉ est certes conséquent - 400 millions d'euros pour 2010 (en diminution par rapport à 2009) – mais il est à répartir entre 2 502 quartiers CUCS, voire au-delà puisqu’il finance des opérations non liées à la politique de la ville (en matière de prévention et lutte contre les discriminations, de service civil volontaire et de prévention de la délinquance) ; de son côté, l’ANRU avait approuvé 10,9 milliards d'euros de subventions dans 196 sites prioritaires représentant 474 quartiers, au 1er septembre 2009, pour un montant total de 39,8 milliards d'euros de travaux programmés (sans tenir compte des financements supplémentaires du Plan de relance)67.
La perception de cette dénivellation financière est aigue sur le terrain, les acteurs des PRU et des CUCS se rejoignant pour décrire une précarité persistante du volet social de la politique de la ville (Epstein, 2008a ; Harzo, Lauriac, 2009 ; Kirszbaum, 2010). Nombreux sont les acteurs des CUCS à exprimer aussi une forme d'amertume envers la rénovation urbaine. Ils sentent que le projet urbain a mobilisé toutes les énergies et aspiré l’essentiel des financements, ce qui leur renvoie en miroir l’image de leur propre faiblesse dans l’action publique locale. Si l’ACSÉ devait « être à l’humain ce que l’ANRU est à l’urbain », rares sont les acteurs locaux à souscrire à cette rationalisation d’une politique de la ville qui aurait été rétablie « sur ses deux jambes ». Ils sont plus enclins à évoquer un volet social qui persiste à courir après le volet urbain sans jamais le rattraper. S’ajoute l’incertitude, chronique depuis 2003, sur le devenir des contractualisations « globales », le discours gouvernemental laissant périodiquement entendre que ces procédures vont subir une révision complète de leur méthode et de leur géographie d’intervention. L’incertitude institutionnelle fait aussi écho, chez une partie des professionnels du social, aux angoisses concernant leur avenir personnel (Epstein ; 2008a ; Kirszbaum 2010).
c) Les maires en dernier rempart de l’approche intégrée ?
Au moment où s’affirme partout en Europe la nécessité de conduire des politiques « intégrées » en direction des quartiers défavorisés, la France a fait le choix quelque peu anachronique d’une réponse qui institutionnalise la séparation des volets urbain et social de la politique de la ville, sans stratégie lisible pour établir leur liaison en aval. Loin d’une dynamique de rapprochement, les observateurs identifient une sorte de pétrification des deux volets, à l’instar de Christian Harzo et Nathalie Lauriac qui ont réalisé l’« analyse critique » du volet Habitat et cadre de vie des CUCS pour la DIV : « Le rattachement des deux dispositifs à deux agences nationales différentes tend à figer cette dissociation en l’inscrivant dans le paysage institutionnel, marquant définitivement la séparation des logiques politiques, institutionnelles et professionnelles entre ces deux volets d’intervention sur les mêmes territoires » (Harzo, Lauriac, 2009).
Le Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU a rapidement attiré l’attention sur les dommages pouvant résulter de ce choix, en appui notamment des conclusions de la mission d’expertise précitée que le CES avait confiée au Conseil général des ponts et chaussées à la fin de l’année 2005. À l’issue d’une enquête dans dix sites, son rapport pointait d’inquiétants déséquilibres assortis d’un grave déficit d’articulation : si « le volet urbain du projet fait l’objet d’une attention soutenue par l’ensemble des acteurs, tant aux stades de la conception que de la mise en œuvre, (...) il n’en est pas de même sur les volets économiques et sociaux d’un grand nombre de ces sites. (...) Les volets urbain, économique et social de ces démarches de projet sont trop souvent dissociés ou conduits en parallèle, alors qu’il est nécessaire et urgent de les considérer comme les composantes d’une même démarche de projet. (...) La persistance de ce type de décalage risque de conduire à des blocages sur des champs aussi stratégiques que celui du relogement, voire à des échecs sur les questions centrales de la lutte contre la ségrégation et l’échec scolaire » ( CES de l'ANRU, CGPC, 2007).
Après la signature des Contrats urbains de cohésion sociale, le Conseil national des villes formulait de semblables critiques à la fin de l’année 2007. Le CNV allait plus loin en contestant le principe même de deux agences séparées et dotées de moyens d’intervention fort inégaux : « La décision de créer deux agences séparées, dont l’une finance la rénovation urbaine avec des crédits d’investissements importants, et l’autre une partie du volet social avec des crédits de fonctionnement très nettement moins importants, n’est pas adaptée à un projet global de territoire. (...) Outre le fait que les crédits de ces deux agences ne sauraient compenser l’absence des crédits de droit commun, le décalage très important, entre les crédits de l’ANRU et ceux de l’ACSÉ, minore l’investissement social et va à contre-sens de ce qui est nécessaire » (CNV, 2007a).
L’ANRU a tardivement reconnu ce risque de cloisonnement68 et les deux agences ont donné des signes de rapprochement69, qui laissent cependant les acteurs locaux très perplexes, comme l’a constaté Thomas Kirszbaum lors d’une enquête conduite auprès de 140 acteurs des PRU et des CUCS dans onze sites, au milieu de l’année 2009. À leurs yeux, la question est de savoir comment reconnecter « par le bas » ce qui a été dissocié « par le haut », non en réponse à une injonction nationale, mais plutôt en dépit de la politique nationale. Les programmes définis au niveau national n’étant pas conçus pour favoriser cette transversalité, il incombe aux territoires de la produire, de « refaire système » (Kirszbaum, 2010). Le « projet de territoire » tend à devenir aujourd'hui l’horizon fédérateur des acteurs locaux, plus encore ceux des villes que de l’État, à l’instar de l’Inter-réseau DSU qui s’en fait l’écho : « Les collectivités locales se trouvent désormais en première ligne pour construire de la cohérence et de la coopération entre les acteurs et mobiliser les ressources nécessaires. Dans ce contexte d’incertitudes, la construction d’un projet de territoire prend d’autant plus d’importance comme outil d’intelligence collective et de gouvernance locale, qui permette de donner une direction et des contenus opérationnels aux différents programmes de l’État, de l’Europe et aux politiques régionales ou départementales… » (Arnaud, Valette, 2006).
Cette affirmation est loin d’être nouvelle. Depuis les rapports fondateurs de la politique de la ville, le projet territorial est son instrument privilégié pour produire de la transversalité et la nécessité d’un leadership municipal dans la conception dudit projet et l’animation du partenariat local est régulièrement répétée (Schwartz, 1981 ; Bonnemaison, 1982 : Dubedout, 1983). Il a été rapidement reconnu que la réussite des DSQ en termes de coordination, variait fortement selon le degré d’implication des élus (Levy, 1988). L’État s’avérant incapable d’organiser la coordination de ses propres politiques, cette tâche est revenue aux maires qui se sont imposés, dans le contexte de la décentralisation, comme les responsables en chef de l’intégration de l’action publique sur le territoire (Lorrain, 1993 ; Gaudin, 1995).
À première vue, la loi du 1er août 2003 renforce le leadership mayoral. L’ANRU a réaffirmé avec constance la primauté des maires, seuls responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des PRU. On peut néanmoins s’interroger sur la capacité effective de ces derniers à se saisir des programmes de l’État comme autant d’outils mobilisables au service de leur projet politique. Selon l’enquête précitée de T. Kirszbaum, beaucoup dépend de l’organisation du pilotage des dispositifs qu’ils mettent en place. Parmi les variables d’une intégration réussie de l’urbain et du social, des adjoints au maire porteurs d’une double délégation « rénovation urbaine » et « politique de la ville », à même de garantir une transversalité interne aux services municipaux, est assurément un facteur favorable, surtout si elle est accompagnée de la désignation de techniciens PRU et CUCS situés aux mêmes niveaux de responsabilité hiérarchique70. Vient ensuite l’incorporation de l’équipe opérationnelle chargée de la rénovation urbaine au sein même de l’appareil municipal, une condition à satisfaire sans laquelle l’effet centrifuge –et donc l’autonomisation– de la rénovation urbaine devient très sensible, par exemple lorsque l’opération est confiée à un aménageur externe ou à une structure de type GIP71. La politique de ressources humaines s’avère aussi déterminante, une direction de projet PRU rassemblant des acteurs possédant une culture professionnelle urbaine et sociale (chez les mêmes individus ou au sein de l’équipe) facilitant à l’évidence les échanges transversaux. Enfin, le caractère intégré ou non du projet dépend très fortement des priorités politiques locales. Nombre de maires ont épousé fidèlement la doctrine de l’ANRU pour découvrir, au bout de quelques années, que la négligence envers les habitants originels des quartiers compromettait la réussite d’ensemble du projet (Kirszbaum, 2010).
Même les villes les mieux outillées en matière d’ingénierie, de ressources humaines et financières et qui bénéficient d’une antériorité dans le domaine de la politique de la ville et du renouvellement urbain, continuent de se heurter à d’importants obstacles pour concevoir et conduire des projets intégrés. La logique de l’État qui privilégie des entrées par ses propres programmes sectoriels plutôt que par le projet des villes, s’ajoutant à l’hypertrophie des projets de rénovation urbaine qui désorganisent les modes de coopération préexistants, sont de ceux-là (Harzo, Lauriac, 2009 ; Kirszbaum, 2010).
d) Enrichir les territoires ou promouvoir les habitants ?
La politique de la ville française obéit depuis ses origines à un mouvement de balancier qui a conduit les responsables nationaux à privilégier tantôt une approche urbaine, tantôt une approche sociale. Les diverses tentatives visant à s’assurer du croisement fertile des deux démarches n’ont guère été couronnées de succès avant 2003. On a évoqué sous cet angle le bilan critique des opérations HVS au début des années 1980. Au début des années 1990, le rapport Delarue (1991) regrettait encore la « dissymétrie » entre l’action sur le bâti et son volet d’« accompagnement social », comme il se disait déjà à l’époque. La coupure allait devenir plus visible encore dans les treize Grands projets urbains (GPU) lancés à partir de 1992. Le bilan-évaluation de ce programme, effectué par la mission GPU de la Délégation interministérielle à la ville (DIV) à la fin des années 1990, reconnaissait que « la "complicité" entre l’urbain et le social apparaît à la fois essentielle à gagner, et en même temps difficile à construire ». Faute de passerelles entre les budgets d’investissement et de fonctionnement, l’accélération des projets urbains impulsée par les GPU n’avait pas été relayée par une dynamique équivalente du volet social porté par les Contrats de ville. Le bilan des GPU l’expliquait notamment par la faiblesse intrinsèque de ces contrats, à savoir « le manque d’une définition stratégique du "volet social" du projet de territoire qui dépasse les énoncés "en vrac" de l’ordre du catalogue ou de l’inventaire et parvienne à poser des objectifs forts qui font levier et en particulier positionnent la place des habitants et résidents actuels dans le projet ». Le problème venait aussi de « l’entrée par l’urbain » et de la difficulté culturelle d’y associer les acteurs du social : « Les difficultés certaines à intégrer le projet social dans un système par lequel on entre par l’aménagement tiennent à ce que le social et l’aménagement sont deux mondes parallèles. On est manifestement face à des réseaux différenciés et structurés par des cultures professionnelles différentes, et à des dispositifs qui se rencontrent rarement, surtout si on les traite comme des procédures et non au service d’un projet stratégique » (DIV, 1998).
C’est fort de ces constats que le ministère Bartolone avait lancé 50 Grands projets de ville et 70 Opérations de renouvellement urbain à l’aube des années 2000. Le Programme national de renouvellement urbain dans lequel s’inscrivaient ces procédures avait généralisé la démarche des Grands projets urbains, mais en les complétant cette fois par une enveloppe de crédits de fonctionnement. Mieux encore, les GPV étaient présentés comme des « super Contrats de ville » (Kirszbaum, 2002). À partir d’un investissement lourd sur l’urbain, l’objectif était de provoquer un effet levier sur les politiques de droit commun dédiées au social. La force d’entraînement de l’urbain sur le social ne voulait pas dire que le social serait voué au simple « accompagnement » du projet urbain. Au contraire, assurait le ministre de l’époque, « le renouvellement urbain n’a de sens et d’efficacité qu’au service du projet social »72. La politique de renouvellement urbain faisait ainsi écho aux notions qui commençaient à être en vogue dans divers pays européens de « ville durable » ou de « ville compacte » (Holec, 1999). Sur le papier du moins, les GPV relevaient de la famille des politiques intégrées consistant à traiter de manière simultanée les enjeux urbanistiques, économiques, environnementaux, civiques et sociaux générateurs de ségrégation dans les villes (Jacquier, 2003). Les bilans furent toutefois décevants : les directions de projet du GPV et du Contrat de ville étaient rarement réunies et beaucoup de projets validés par la DIV et le ministère de l'Équipement ne comportaient en fait aucune dimension sociale (CNV, 2001 ; DIV, 2002c). S’ajoutait un obstacle supplémentaire : l’indexation des crédits de fonctionnement sur les crédits d’investissement (selon un ratio fixé à 20/80) avait limité l’utilisation des premiers car les seconds tardaient à être engagés (Kirszbaum, 2002). Les opérations effectivement engagées se focalisaient d’ailleurs sur les aspects immobiliers et de peuplement, de sorte que le renouvellement urbain français apparaissait nettement moins « intégré » que ses équivalents européens (Guigou et al., 2005).
Ce bref retour sur deux dispositifs-phares de la période précédant la mise en place du PNRU éclaire certaines caractéristiques de ce dernier : faute de mobiliser des crédits de fonctionnement sur un volet social –y compris le sien propre– la séparation est devenue beaucoup plus rigide entre interventions sur le cadre physique et d’autres types d’interventions visant le plus directement le bien-être des habitants ; même s’ils ont peu investi en direct sur leur volet social, l’intégration des GPV dans les Contrats de ville favorisait la prise en compte d’autres enjeux (Epstein, 2008a). Si développement de l’approche globale il y a dans le PNRU, il consiste en un élargissement de l’intervention physique à des dimensions (traitement des espaces publics, mixité fonctionnelle…) que les moyens nettement plus limités des GPV ne permettaient pas de traiter correctement (Guigou et al., 2009)
Autre phénomène notable, le mouvement pendulaire de la politique de la ville entre traitement urbain et traitement social semble s’être stabilisé depuis 2003. Une date à laquelle il a « occupé la scène à lui tout seul », car « au final, avec la rénovation, c'est le traitement des lieux qui prend le pas sur le traitement des situations sociales » (Jaillet, 2003). Certains voient dans le privilège accordé à l’urbain, dans un souci de mixité sociale, une tentative de « dissoudre les effets de la crise économique dans l’urbain » (Toubon 1992), de ne pas chercher à résorber la pauvreté, mais de « la rendre supportable à la collectivité » (Chanal, Uhry 2004) ou encore d’éviter de donner une visibilité à la question sociale « et donc au mode de fonctionnement inégalitaire de la société » (Laval-Reviglio 2005).
Plus simplement, on peut penser que la priorité donnée au traitement des « lieux » sur le traitement des « gens » s’explique par la visibilité immédiate des interventions urbaines, qui contraste avec les interventions sociales dont l’efficacité est aussi invisible qu’incertaine (Epstein, 2008a). Le consensus politique sur l’urbain et la mixité pourrait s’expliquer aussi parce que l’affichage d’une « trop forte priorité budgétaire au bénéfice des quartiers n'est souvent pas populaire, électoralement parlant », s’il s’agit par exemple « de mettre en place des dispositifs efficaces de discrimination positive, à l'école pour lutter contre l'échec scolaire, ou en matière de formation et d'emploi pour lutter contre le chômage des jeunes » (Jaillet, 2003). D’où le consensus autour de l’urbain : « Perçu comme un investissement et non comme une dépense, à l’inverse du social, il serait plus acceptable politiquement que le traitement préférentiel de certains habitants de la ville » (Kirszbaum, 2004a). Surtout dans la rénovation urbaine, où « les élus paraissent tentés de se réfugier derrière l’idée confortable qu’elle profite mécaniquement à tous. Cette politique serait un jeu à somme toujours positive, avec des gagnants de toutes parts : les habitants, les bailleurs, les promoteurs, les collectivités et la société dans son ensemble » (Kirszbaum, 2010).
De nombreux observateurs plaident pour un rééquilibrage des priorités qui passerait par des politiques de discrimination positive territoriale, là même où se concentrent les besoins sociaux (Simon, 2001), ce qui « supposerait de faire de la territorialisation des politiques sectorielles un vrai enjeu national et de la discrimination positive un objet de débat » (Lelévrier, 2004b). « Déplacer l’argent plutôt que déplacer les populations, n’est-ce donc pas la solution la plus juste et la plus respectueuse des habitants ? », demandent P. Tevanian et S. Tissot (2003) Au lieu d’organiser un « jeu de chaises musicales » hasardeux entre populations, il pourrait s’agir aussi de renforcer la péréquation fiscale pour donner aux communes les plus pauvres (fiscalement et socialement) les moyens de répondre aux besoins sociaux locaux, une solution paraissant plus équitable que la mixité contrainte dans une perspective d’égalité des chances (Sintomer, 2001).
De nombreux chercheurs estiment que l’objectif de mixité sociale inhibe en fait une éventuelle discrimination positive au bénéfice des habitants : « L’intangibilité de l’objectif de mixité empêche ainsi de prendre en considération des politiques qui pourraient traiter plus efficacement les problèmes posés par la ségrégation socio-spatiale. La référence constante à la mixité freine les politiques de redistribution ou les dénature » (Charmes, 2009) ; « Comment accorder un avantage préférentiel sur une base territoriale à des populations, quand on affiche dans le même temps l’intention de mettre fin à l’anomalie que constitue leur regroupement sur les territoires qui donneraient droit à cet avantage ? » (Kirszbaum, 2004c) ; « On peut se demander si la référence à la mixité n'a pas empêché de mener jusqu'au bout une politique d'intégration des habitants les plus pauvres et de gestion adaptée de quartiers qui accueillent des populations en difficulté » (Lelévrier, 2004b).
Poser l’équivalence d’une revalorisation des territoires et d’une amélioration concomitante de la condition des habitants paraît trompeuse à plus d’un chercheur. Par exemple à C. Lelévrier pour qui « les politiques font le pari que la revalorisation du quartier, par des politiques de reconstruction-démolition, ne peut être que bénéfique à ses habitants. Le postulat de la mixité comme facteur d'intégration individuelle y est sans doute pour quelque chose », alors que « les liens entre des situations de mixité, si tant est qu'on puisse les définir, et des chances d'intégration restent sociologiquement difficiles à établir » (Lelévrier, 2004b). La circulaire sur l’évaluation des CUCS reflète bien cette tension entre deux finalités non nécessairement convergentes que sont la remise à l’amélioration des quartiers et celle du bien-être de leurs habitants. Elle précise en effet que « les résultats recherchés s’apprécient en termes d’améliorations constatées au profit des territoires défavorisés et/ou de leurs habitants ». Ce « et/ou » rend compte –même si c’est sans doute de manière involontaire– de l’absence de convergence automatique entre l’évolution des territoires et l’évolution de la condition des habitants.
Ces questions peuvent être posées dans les termes souvent utilisés aux États-Unis pour rendre compte de la tension entre une logique de remise à niveau des lieux et de promotion des gens. Cette distinction entre « place-based policies » et « people-based policies » a été proposée, à la fin des années 60, par l’économiste John Kain qui réfléchissait aux stratégies les plus pertinentes pour rapprocher les habitants des ghettos des emplois (Kain, 1968). Il s’agissait d’arbitrer entre une politique consistant à attirer des entreprises dans les lieux même de pauvreté ou de favoriser à l’inverse la mobilité résidentielle des habitants pour les rapprocher des zones riches en emploi73. Ce débat dépasse celui des zones franches car on assisterait aujourd'hui en France à la montée en puissance de « l'injonction à être mobile ». Mais elle se heurte –à l’instar des échecs rencontrés par les politiques étasuniennes de mobilité résidentielle– à l'expérience des ménages pauvres qui, pour « s'en sortir », mobilisent aussi des ressources de proximité. Or, le « coût » de la mobilité est rarement pris en compte dans les recommandations politiques axées sur l'augmentation de la capacité des pauvres à se déplacer (Bacqué, Fol, 2007).
Pour sortir des contradictions entre stratégie « place » et « people », une troisième voie se dessine, celle d’une stratégie « people-place-based » qui consiste à prendre appui sur les gens, dans les quartiers où ils se trouvent, pour les inciter à s’engager collectivement dans la rénovation de leur quartier. C’est l’option du développement communautaire que Jacques Donzelot a contribué à familiariser en France, en même temps qu’il y introduisait les catégories place et people afin de montrer que la France privilégie davantage les lieux que les gens en recherchant une homogénéisation du territoire urbain (Donzelot et al., 2003). Dans la perspective du développement communautaire, il s’agit au contraire d’une démarche de valorisation concomitante des ressources des individus et des territoires où ils résident.
Le programme « Soziale Stadt » en Allemagne : un modèle de politique intégrée?
Le programme expérimental des « villes sociales » (Soziale Stadt) a été engagé en Allemagne de façon presque concomitante à celui des Grands projets de ville français. Il témoigne d’un engagement relativement tardif du gouvernement fédéral dans la politique de la ville. Si l’on met de côté la dimension participative, bien plus affirmée outre-Rhin, les deux politiques ne manquent pas de ressemblances s’agissant de l’affichage d’une dimension « intégrée » ou « globale ». Cependant, si les interventions de nature physique ont été dominantes et si la transversalité n’a pas toujours été de soi dans le programme Soziale Stadt, celui-ci s’est affirmé comme une véritable démarche « ascendante » de modernisation administrative, en appui sur la participation des habitants. Son volet social semble avoir pris de l’ampleur au fil de sa mise en œuvre, en cohérence avec sa finalité première : améliorer les conditions de vie et la situation personnelle des habitants, là où ils se trouvent. L’échelle d’intervention très étroite du programme Soziale Stadt en constitue sans doute la principale limite.
Haüsserman H. (2006), « The National "Social City Program". Findings from the Midterm Evaluation », German Politics and Society, vol. 24, n° 4, Winter.
En Allemagne comme dans d’autres pays européens, la concentration des problèmes sociaux dans certains quartiers des villes a commencé d’attirer l’attention au cours des années 1990, conduisant les länder de Rhénanie-Westphalie, Hambourg, Brème et Berlin à mettre en place des programmes urbains intégrés. Ces initiatives ont été relayées à l’échelon fédéral, en 1998, à la suite de l’arrivée au pouvoir de la coalition rouge-verte qui a lancé un programme national pour les « Quartiers avec des besoins spéciaux de développement » (Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf), communément appelé Soziale Stadt.
Le programme se voulait innovant en faisant de l’approche territorialisée le levier d’une intégration des différentes politiques sectorielles et d’une coopération des acteurs publics avec les acteurs associatifs et privés. L’ensemble devait canaliser des ressources nouvelles en faveur du développement de ces quartiers « avec des besoins spécifiques de développement ». L’expérimentation de nouvelles formes de gouvernance à la fois pluraliste, coopérative et ascendante devait s’accompagner d’une participation très active des habitants.
Bien que le programme Soziale Stadt ait été placé sous la responsabilité du ministère fédéral de la Construction, il n’a pas seulement recherché une transformation physique des quartiers, mais aussi à agir sur les processus sociaux, l’articulation entre les deux dimensions s’opérant dans le cadre de « projets d’action intégrés ». Par son approche territoriale, intégrée et globale, reposant sur une combinaison d’interventions urbaines et sociales, le programme Soziale Stadt rompait avec l’idée selon laquelle il serait possible de revitaliser des quartiers en améliorant simplement leur environnement physique. Rupture nécessaire, car beaucoup de quartiers concernés par le programme avaient déjà une longue histoire de politiques d’aménagement qui n’étaient pas parvenues à surmonter leurs problèmes.
En pratique –et même si elles ont cherché à appréhender les problèmes des quartiers de manière plus globale– la plupart des villes ont accordé la priorité aux interventions physiques, ce qui peut s’expliquer par le poids des services municipaux de l’aménagement et de l’urbanisme dans l’élaboration des projets locaux. Si l’évaluation intermédiaire du programme a pointé des avancées sur le plan de la transversalité, ces avancées se limitent souvent au périmètre des quartier visés, les politiques développées à cette échelle peinant à s’intégrer dans une politique de développement plus large à l’échelle de la ville.
Le pilotage et la mise en œuvre des projets s’organisent, dans la plupart des villes, autour de deux instances : un groupe de pilotage, chargé de la mobilisation et de la coordination des différentes administrations au niveau municipal, et un « forum de quartier » réunissant des institutions et associations, chargé de définir les orientations du projet et sa déclinaison en actions, en partant du point de vue du quartier. Des « Équipes de gestion des quartiers » (Quartiersmanagement) jouent un rôle de médiation et de coordination entre les acteurs, au sein et entre ces deux niveaux.
Pour favoriser l’expression et l’implication des habitants du quartier, qui peinaient à trouver leur place dans des forums institutionnels, des comités d’habitants ont été mis sur pied, auxquels ont été confiés des budgets participatifs (Empowerment Funds). C’est assurément la dimension la plus innovante du programme dont les avancées sont soulignées par les évaluateurs : outre leurs effets sur le plan de l’empowerment, ces budgets participatifs ont été dépensés de façon très rigoureuse et efficiente.
Böhme C. et al. (2008), The Programme “Social City” (Soziale Stadt). Status Report, Centre for Knowledge Transfer « Social City », German Institute of Urban Affairs, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs, July.
Dans le cadre du programme Soziale Stadt, quelque 500 quartiers localisés dans environ 320 villes se sont vus allouer plus de 2 milliards d’euros entre 1999 à 2007, dont un tiers à la charge du gouvernement fédéral, et le reste à la charge des Länder et des municipalités. Les principes fondamentaux du programme –approche territorialisée, action intégrée, participation active des habitants– ont représenté un défi pour les gouvernements locaux qui n’ont pas forcément perçu l’importance des transformations qu’impliquaient ces principes.
Les enquêtes et évaluations ont confirmé l’existence de telles transformations, le plus souvent positives, dans les quartiers où ce programme a été mis en œuvre. Cela vaut particulièrement pour la façon dont les habitants perçoivent la situation de leur quartier et son intégration dans la ville. Les changements les plus visibles concernent le cadre de vie, qui a bénéficié d’importants investissements. Au fil de l’avancement des projets, ces interventions sur les logements et les espaces extérieurs ont été complétées de façon croissante par des actions traitant plus directement de questions sociales. Ainsi le domaine de l’école et de l’éducation a-t-il continuellement gagné en importance, au travers d’actions allant de l’ouverture de l’école aux habitants du quartier à la mise en place de nouvelles méthodes d’apprentissage des savoirs, en passant par le soutien individualisé aux élèves.
Au cours des dernières années, l’intégration des immigrés a également pris de l’importance, avec des actions d’apprentissage de la langue allemande, de promotion de l’entreprenariat ethnique, d’implication des immigrés dans la vie collective du quartier et de sensibilisation des municipalités et services sociaux aux problématiques interculturelles.
La santé tient une place plus secondaire, bien que croissante depuis 2007. Des stratégies territorialisées de promotion de la santé ont vu le jour, avec le développement de réseaux de santé, le ciblage de certains groupes ou la création d’une infrastructure d’offres de soins sous des formes variées.
En progrès, elles aussi, les actions de développement économique local (soutien aux activités existantes, promotion de start-ups, formation et valorisation des initiatives économiques des habitants, soutien à l’économie ethnique) ont rencontré quelques difficultés dans le cadre du programme. Ces difficultés tiennent essentiellement l’échelle trop étroite du quartier pour appréhender ces enjeux.
En revanche, l’accès à la formation et au marché du travail est un élément très importants du programme. Ce volet vise particulièrement les chômeurs de longue durée et les jeunes. Un coup d’accélérateur a été donné avec différents programmes fédéraux lancés à partir de 2006 qui, pour la première fois, reposaient sur les mêmes concepts d’approche socio-spatiale et intégrée que le programme Soziale Stadt.
S’agissant de la coordination inter-administrative, les évaluateurs jugent là aussi que les résultats sont positifs. Ils pointent néanmoins des marges de progrès possibles concernant la territorialisation d’un certain nombre d’administrations municipales et l’accessibilité des services par certains groupes sociaux. De la même façon, ils jugent que des avancées restent à faire au niveau fédéral et des Länder, s’agissant de la priorisation des quartiers, de l’appropriation de la notion de « développement intégré » par les municipalités ou de la coopération avec les acteurs publics et privés du logement.
L’évaluation aboutit donc à un jugement positif du programme, même s’il n’est pas parvenu à résoudre des problèmes structurels comme ceux du chômage et de ses conséquences en termes de pauvreté, ce qui s’explique notamment par une échelle d’intervention restrictive. Mais les améliorations que le programme des « villes sociales » a permises en matière de cadre de vie, de formation, d’éducation et de participation des habitants en ont fait une référence pour les politiques urbaines, tant au plan national qu’européen. La Charte de Leipzig adoptée pendant la présidence allemande de l’Union européenne, au premier semestre 2007, a souligné l’importance des approches promues dans ce cadre, notamment celle du développement urbain intégré en conjonction avec la coopération inter-administrative et la mobilisation coordonnée des ressources financières.
3. Une politique prioritaire ?
Depuis la consécration du principe de « discrimination positive » par le Conseil d'État, la politique de la ville est souvent perçue comme un domaine d’application privilégié de cette catégorie particulière de « discriminations justifiées » par un objectif de réduction des inégalités (Conseil d'État, 1997). Comprise comme une « politique de rattrapage », la politique de la ville est censée « donner plus à ceux qui ont moins » conformément à la définition la plus courante de la discrimination positive (Calvès, 2004). Sans que l’expression y figure, la loi d’orientation pour l’Aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 avait validé le principe de « politiques renforcées et différenciées » permettant à des « zones caractérisées par des handicaps » de bénéficier de mesures dérogatoires. Le législateur voulait « assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire », en garantissant notamment « l'égal accès de chaque citoyen aux services publics » (article 1er). L’objectif visait autant les zones rurales qu’urbaines, mais il s’agissait surtout, dans les territoires urbains, d’ouvrir la voie aux zones franches qui allaient être instituées l’année suivante (Kirszbaum, 2004c).
Mettre en œuvre cette forme de politique préférentielle suppose de définir les contours des quartiers bénéficiaires. Tel est l’objet de la « géographie prioritaire » de l’État, progressivement affinée depuis les années 1990 (Estèbe, 2004a). Si la finalité–faire plus pour les quartiers désavantagés– n’est guère contestée, il en va différemment de l’instrument du zonage, dont le mode de construction et la conception même de la ville qu’il sous-tend, font l’objet de critiques académiques, administratives et politiques presque continues. Vingt après que la politique de la ville a été érigée en politique nationale prioritaire, est-il d’ailleurs si sûr que cette politique soit véritablement prioritaire ? S’ils sont très partiels, les éléments d’analyse disponibles sur la mobilisation des moyens de l’État permettent d’en douter.
a) Quelle pertinence des instruments de la géographie prioritaire ?
Le Pacte de relance pour la ville (PRV) de 1996 représente une étape décisive dans l’histoire de la géographie prioritaire. Le PRV a en effet ajouté à la géographie préexistante - celle définie dans les Contrats de ville – une autre fondée sur des zonages définis par l’État à l’échelon central. Cette dualité de périmètres d’intervention a alimenté des critiques constantes sur la complexité et l’« illisibilité » de la géographie de la politique de la ville, critiques que l’on retrouve par exemple dans le rapport de la commission Sueur sur une « opacité (...) qui a atteint un degré tel qu'elle reste compréhensible aux seuls initiés » (Sueur, 1998) ou, plus récemment, dans les rapports André (2005) et Hamel-André (2009). Il faut remarquer cependant que le caractère enchevêtré des géographies de la politique de la ville n’est pas seulement la conséquence du PRV, mais de la multiplicité de ses dispositifs contractuels organisés en fonction d’entrées thématiques. Déjà, en 1991, le rapport Delarue signalait le cas d'un quartier comptant pas moins vingt-quatre périmètres distincts liés aux procédures mises en oeuvre (Delarue, 1991).
Des observateurs ont fait remarquer que la profusion des dispositifs et des géographies ne devait pas forcément être considérée comme un problème en soi : dans les sites où existe un projet et un partenariat forts, les procédures et périmètres sont utilisés comme autant d’outils au service de ce projet (Estèbe, Epstein, 1998). En revanche, l’instrument du zonage n’a pas trouvé grâce aux yeux des chercheurs. Et à la différence de l’enjeu de la mixité sociale, à la source d’un divorce à peu près complet entre politiques et sociologues (Epstein, Kirszbaum, 2003), on les trouve cette fois réunis, avec l’appui des géographes, pour fustiger le concept de zonage et ses implications pratiques.
Le zonage découle de lecture « handicapologique » des quartiers74. Ses effets seraient limités si cet instrument ne faisait qu’offrir un principe de lecture des quartiers, permettant d’en identifier les caractéristiques et d’apprécier leur diversité en les comparant (sur cette fonction cognitive de la géographie prioritaire, voir Estèbe, 2004b). Le problème du zonage est qu’il est passé de la description d’un état de fait en principe d’action à partir du Pacte de relance (Estèbe, 2004a). Il ne s’agit plus seulement d’identifier les signes d’un problème dont les causes sont largement ailleurs, mais de considérer les racines du mal –la surconcentration localisée d’individus présentant les mêmes caractéristiques– comme le problème lui-même (Béhar et al., 1998).
En confondant l’espace du problème et celui de sa résolution, le zonage interdirait d’agir à l’échelle adéquate, celle qui permettrait d’infléchir les conséquences ségrégatives et inégalitaires du fonctionnement urbain. Cette critique se retrouve dans de nombreux rapports produits dans la seconde moitié des années 1990. L’idée que le PRV cantonnait la politique de la ville dans un registre strictement réparateur, en aval, sans prise sur les mécanismes plus globaux qui produisent en amont l’exclusion dans la ville, était par exemple avancée dans le rapport du Commissariat général du plan, Cohésion sociale et territoires, qui s’inquiétait de la tendance à renvoyer à des échelles toujours plus fines les conséquences sociales des processus économiques globaux, au risque de faire du quartier « l’espace de la réparation sociale et de la gestion de l’inemployabilité » (Delevoye, 1997). L’antinomie entre la méthode du zonage et la conduite de la politique de la ville à l’échelle des agglomérations, qui devait être, en principe, l’échelle privilégiée par les Contrats de ville, était centrale dans le rapport Sueur (1998).
Corollaire de cette critique, le zonage porte préjudice à l’instrument contractuel. Les Contrats de ville n’étaient pas sans faiblesses, mais il convenait de les améliorer au lieu de les ignorer, et de les affaiblir, disaient en écho différents rapports publiés à la fin des années 1990. Caisse de résonance des préoccupations des acteurs locaux, le Conseil national des villes avait fermement pris position en ce sens : « Au lieu d’aller vers ce perfectionnement du contrat, les mesures phares du PRV (...) renferment le risque de renverser les dynamiques qu’avait permises l’introduction de la contractualisation dans la politique de la ville. On peut en effet craindre qu’en elles-mêmes, ces mesures constituent une négation de la contractualisation » (CNV, 1998). Il est frappant de constater la permanence de cette critique dans le contexte des Contrats urbains de cohésion sociale. Ainsi, le rapport Hamel-André déplore-t-il que le zonage aille à l’encontre de « la responsabilisation des partenaires locaux » et soit « particulièrement défavorable à la mobilisation des acteurs et à l’entraînement des politiques publiques de droit commun des collectivités territoriales ou de l’État ». Pour les deux parlementaires, ces zonages fixés dans la loi, sans possibilité d’ajustement aux réalités locales, apparaissent antinomiques du « projet de territoire », soit la priorité donnée « aux initiatives de terrain sur les approches "descendantes", c'est-à-dire définies de manière uniforme sur tout le territoire » (Hamel, André, 2009).
Le caractère centralisateur du zonage s’accompagne d’un effet de « dépolitisation » qu’induit la création de dispositifs automatiques maîtrisés par l’État (Estèbe, 2004b). Des observateurs avaient relevé, au moment du PRV, la combinaison paradoxale de l’interventionnisme étatique et du libéralisme économique. Cependant, comme l’a relevé Daniel Béhar, si l’État est seul maître de la définition des handicaps territoriaux et des mesures de correction, « cette stratégie voulant afficher le volontarisme de l’État est paradoxale : en s’appuyant principalement sur des mesures d’exonération fiscale, elle tend à démontrer que la forme supérieure de l’intervention de l’État serait... de se retirer » (Béhar, 1997-1998). Le Conseil national des villes ne disait pas autre chose en 1997 : « La logique initiale de la politique de la ville était, foncièrement, de modifier les modes d’interventions de l’État, des agents de ces derniers, et des collectivités locales, alors que les mesures les plus centrales du PRV ne concernent pour ainsi dire pas l’État autrement que financièrement, du fait du manque à gagner fiscal prévu » (CNV, 1998). Cette mise en cause du retrait paradoxal de l’État instigateur des zonages, était d’autant plus de vigoureuse dans les années 1990 que le PRV prenait à contre-pied la logique de « transformation » qui inspirait les Contrats de ville75. Le rapport Sueur citait par exemple ce propos de l’urbaniste Philippe Méjean, qui avait porté la démarche des Contrats de ville au sein de la DIV : « S'agit-il de remettre aux normes quelques territoires affectés de "pathologies" spécifiques, menaçant l'ordre social ou bien d'inventer les voies d'une nouvelle équité dans l'accès de chacun à la ville ? (...) Faut-il un traitement dérogatoire, exorbitant du droit commun ou bien la rénovation en profondeur des politiques de droit commun ? » (Méjean, 1997).
La commission Sueur préconisait la « sortie » des zonages pour privilégier la « territorialisation », soit un retour aux Contrats de ville qui devait être renforcés au niveau du pilotage d’agglomération et localement par des grands projets urbains. À défaut de supprimer ce zonage, le gouvernement Jospin a fait le choix de le dissocier de la politique de la ville : la géographie prioritaire des Contrats de ville 2000-2006 n’y faisait pas référence et plusieurs mesures indexées sur les ZUS ont été remplacées par d’autres mesures non zonées, à l’image du remplacement des emplois-ville par les emplois-jeunes. Les ZUS sont alors redevenues ce qu’elles étaient à l’origine : un élément des nomenclatures statistiques, utilisé pour produire des connaissances sur les territoires (Epstein, 2008a). La loi du 1er août 2003 a réactivé le zonage comme instrument d’action, érigeant les ZUS en cible unique de la politique de la ville. Ce choix a été contesté avec autant de vigueur que dans la décennie précédente, tant dans la sphère savante (Estèbe, 2004a ; Lorrain, 2006 ; Tissot, 2004, 2007 ; Epstein, 2008a ; Acadie, 2009 ; Vieillard-Baron, 2009) qu’administrative (ONZUS, 2005 ; Cour des comptes, 2007) ou politique (André, 2005 : Hamel-André, 2009 ; Dallier, 2010). Le CNV, par exemple, y a vu un retour à la logique qu’il dénonçait dix ans plus tôt : « La réaffirmation du zonage de type ZUS est perçue comme un véritable "retour en arrière", notamment pour le développement économique ou la prévention de la délinquance qui ne se font pas "au pied de l’immeuble", mais a minima dans une coopération intercommunale et en articulant soigneusement l’échelle du quartier, de la commune, et de l’agglomération ou du bassin de vie » (CNV 2007a).
Si des sociologues ont dénoncé les présupposés idéologiques d’un instrument qui construirait le « problème des quartiers » autant qu’il prétend le décrire (Tissot, 2004), d’autres critiques ont porté sur ses inconvénients techniques, devenus plus flagrants encore qu’à l’époque du Pacte de relance en raison de l’obsolescence accrue de la catégorie ZUS. Déjà, la Commission Sueur avait relevé que les bases statistiques qui fondaient le PRV, celles du recensement de 199076, y compris pour la mesure du taux de chômage, figeaient le choix des quartiers, lesquels pouvaient connaître des évolutions rapides tout au long de la période inter-censitaire (Sueur, 1998). Ce problème crucial est pourtant passé inaperçu en 2003, la liste des ZUS établie en 1996 ayant été reprise, sans lui apporter la moindre modification, alors qu’elle se référait toujours au recensement de 1990 (Epstein, 2008a)
Les critiques portent également sur les critères retenus pour la détermination des zones prioritaires. Là non plus, elles ne sont pas nouvelles. Le rapport de la commission Sueur considérait que « les critères retenus pour délimiter les sites d'intervention modèlent de façon nécessairement discutable la géographie prioritaire », et que le choix d'autres indicateurs que ceux de l’« indice synthétique d’exclusion » aboutirait à des découpages assez différents et pas forcément moins pertinents (Sueur, 1998). De fait, la DIV avait été conduite, en 1996, à reclasser en ZRU et en ZFU de grands quartiers franciliens, emblématiques de la politique de la ville, qui n’apparaissaient qu’en milieu de liste dans le classement des ZUS établi suivant la valeur de leur indice synthétique (DIV, 2003 ; Estèbe, 2004a). Cette distorsion entre le classement statistique et la perception locale des quartiers tient largement au fait la géographie prioritaire ne revêt pas du tout le même sens pour l’État et pour les territoires. Du point de vue de l’État, il s’agit de traiter la ségrégation (au sens de la concentration spatiale d’individus partageant des caractéristiques communes) comme un phénomène « absolu », c'est-à-dire comme un cumul de handicaps rapporté à une moyenne nationale, alors que les acteurs territoriaux portent un regard qui n’a de signification qu’en référence à l’environnement du quartier (le territoire communal ou celui de l’agglomération) (Estèbe, 2004a). La précarité a en outre un caractère diffus et mobile, qui ne se laisse pas appréhender par des catégories figées comme le sont les ZUS (Acadie, 2009).
Compte tenu de ces diverses imperfections, les propositions de révision de la géographie des ZUS se sont succédé depuis plusieurs années, afin notamment de vérifier que les zonages concernent bien « les territoires aujourd’hui les plus prioritaires » (ONZUS, 2005 ; voir aussi André, 2005 ; CNV, 2007b ; Cour des comptes, 2007). La Cour des comptes a par exemple noté que la prise en compte du recensement 1999 et du potentiel fiscal 2003 permettrait de « déclasser » 62 ZRU, et de classer autant de ZUS dans cette catégorie. Un amendement parlementaire à la loi de finances pour 2008 a bien rendu obligatoire la révision de cette géographie, à intervalles de cinq ans. C’est dans ce même dessein que la DIV a lancé une concertation autour de son « Livre vert » (DIV, 2009a). Pourtant le processus de révision paraît bloqué. C’est ainsi que le Premier ministre a annoncé que cette révision ne se serait toujours pas à l’ordre du jour en 201077.
Le rapport d’information du Sénat sur l’Avenir des contrats de ville avait proposé de procéder à cette révision avant d’engager une nouvelle génération de contrats territoriaux (André, 2005). Cette étape ayant été escamotée, la DIV a voulu se saisir de l’opportunité des CUCS pour remédier aux imperfections du zonage étatique (Cour des comptes, 2007), dont il faut rappeler qu’il était devenu l’unique référence pour la politique de la ville, la loi de 2003 ne faisant aucune mention de quelque 600 quartiers considérés comme prioritaires par les acteurs des Contrats de ville (Epstein, 2005). Mais à la différence des Contrats de ville, la méthode d’identification des quartiers CUCS n’a pas été laissée aux seules mains des partenaires territoriaux. La DIV a fortement encadré la démarche pour s’assurer d’« une véritable priorisation des moyens sur les sites les plus en difficulté »78, tout en souhaitant prendre en compte « les situations locales mentionnées par les préfets, qui échappent parfois au strict traitement statistique ». Les préfets avaient donc la faculté de négocier avec les collectivités les contours définitifs des quartiers, mais sur la base d’une liste de quartiers préétablie par la DIV qui distinguait trois niveaux de quartiers prioritaires ; à la différence des zonages de Pacte de relance, cette liste combinait des indicateurs de fragilité « absolue » (écarts à la moyenne nationale) et « relative » (écarts à la moyenne de l’agglomération). La démarche a abouti à une expansion sans précédent du nombre de quartiers prioritaires (DIV, 2009a). Ce résultat n’a fait que redonner vigueur aux dénonciations, déjà anciennes (Levy, 1988 ; Sueur, 1998 : Cour des comptes, 2002), du caractère inflationniste de la géographie prioritaire, aboutissant à disperser les moyens publics (Hamel, André, 2009), au risque de contredire la notion même de priorité territoriale.
La dilatation de la géographie des CUCS ou celle des Zones franches urbaines semble donner rétrospectivement raison à Daniel Béhar qui écrivait en 1995 que « l'extension infinie de la géographie prioritaire de la Politique de la Ville ne signifie pas une dérive incontrôlée de l'objet de ladite politique, mais davantage la démonstration même de la véritable nature de l'enjeu à traiter : (...) les difficultés des banlieues ghettos tant décriées, ne tiennent pas à l'accumulation en leur sein de pathologies ou de handicaps endogènes (...). Elles ne constituent que le révélateur le plus visible de processus de recomposition plus globaux, complexes et souterrains qui affectent l'ensemble de la ville » (Béhar, 1995a). Les CUCS viennent également confirmer que l’objectivation statistique des quartiers prioritaires, organisée depuis le niveau national, atteint sa limite dans la phase de négociation entre préfets et municipalités (Avide, 2008). Si les élus ont à nouveau manifesté leur mécontentement, en 2006, face à « cette géographie prioritaire, imposée par l’État central », à partir d’indicateurs « élaborés sans concertation » (CNV, 2007a), ils n’en ont pas moins opéré des reclassements, en lien avec les préfets, et ajouté des quartiers non identifiés par la DIV (DIV, 2009a). Comme le remarque Dominique Lorrain, « la France est une société politique, et il subsiste des marchandages à la marge qui corrigent la carte des territoires » (Lorrain, 2006). Les processus de définition de la géographie des CUCS et des zonages du Pacte de relance révèlent à cet égard d’évidentes similitudes. Car le périmètre des ZUS, ZRU et ZFU avait pareillement donné lieu à un jeu d'allers-retours entre la DIV et les préfectures, eux mêmes en contact avec les élus. Le rapport Sueur avait fait état des « pressions politiques exercées avec succès » pour élargir le nombre et la taille des quartiers pris en compte. Philippe Estèbe a noté que même les élus opposés par principe aux dérogations fiscales s’étaient montrés « très combatifs pour l’extension maximale des périmètres » (Estèbe, 2004b).
Ces élus qui cherchaient à maximiser les avantages liés au PRV n’ont pas été en reste pour dénoncer, en parallèle, divers « effets pervers » qu’ils attribuaient et attribuent toujours aux zonages. Le premier est l’« effet de frontière », particulièrement mis en cause à propos des contrats « emploi-ville » qui avaient été proposés par le PRV aux seuls jeunes résidents des ZUS. Le CNV considérait comme « difficilement justifiable aux yeux des habitants d’autres quartiers, qui connaissent aussi un chômage aigu, qu’une telle différenciation s’applique directement aux personnes » (CNV 1998). Le rapport Sueur estimait en ce sens que les efforts de discrimination positive risquent « de susciter la jalousie des habitants de quartiers limitrophes où soit les difficultés sont semblables, soit elles sont méconnues » (Sueur, 1998). Des arguments parfaitement identiques ont été avancés une dizaine d’années plus tard par Gérard Hamel et Pierre André, parlant « d’iniquité » et « d’injustice » à propos des avantages réservés aux seules ZUS, ZRU et ZFU (Hamel, André, 1995). Comme leurs prédécesseurs, ils ont recours à un argument bien connu des controverses américaines sur l’affirmative action, à savoir l’existence d’une « discrimination à rebours » (reverse discrimination) dont seraient victimes les groupes non-bénéficiaires (Kirszbaum 2004c).
En parallèle, et de façon quelque peu contradictoire, l’effet de « stigmatisation » lié à la labellisation des quartiers est devenu une sorte de lieu commun des commentaires sur la géographie prioritaire. Ainsi lit-on dans le rapport Sueur qu’à « force de faire des "zonages", on stigmatise autant qu’on aide les "zones" concernées » ; au-delà des seuls zonages, « l'accumulation des "marquages" négatifs » liés à la multiplicité des procédures engagées dans les mêmes quartiers, créerait un effet de « labellisation négative » des quartiers dans leur ensemble (Sueur, 1998). Jean-Marie Delarue allait jusqu’à affirmer que « toute politique de quartier est, par construction, ségrégative » (Delarue, 1991). Cette hypothèse est confortée par certains chercheurs, par exemple Robert Castel qui parle à ce propos de « discrimination négative » (Castel, 2007) ou Hervé Vieillard-Baron pour qui « en spécifiant les limites des quartiers stigmatisés, la loi contribue à désigner leurs habitants » (Vieillard-Baron, 2009). Reste qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse, laquelle n’a jamais reçu de validation scientifique à propos de la politique de la ville, pas plus qu’elle n’a pu être vérifiée dans le cas des politiques de lutte contre les discriminations (Stavo-Debauge, 2007).
Un autre effet de la géographie prioritaire paraît, lui, assez incontestable, en même temps qu’il relativise l’argument de la stigmatisation. Il s’agit de ce que l’on pourrait appeler « l’inflation des ayants droit territoriaux » (Kirszbaum, 2004c). La plupart des rapports précités ont constaté que si des quartiers entraient assez facilement dans une catégorie prioritaire, il n'arrivait pratiquement jamais qu’ils en sortent (Sueur, 1998 ; Cour des comptes, 2002, Hamel, André, 2009). C’est que les divers avantages que procure la géographie prioritaire rendent ce classement attractif, et produisent un « effet de fixation dans le dispositif » qui rend très hypothétique le « retour au droit commun » (Cour des comptes, 2007). Gérard Hamel et Pierre André ont dénombré pas moins de trente avantages dérogatoires attachés aux seules ZUS, ZRU et ZFU (Hamel, André, 2009). L’indexation du montant de la Dotation de solidarité urbaine sur la présence d’une ZUS n’est pas le moindre, et pourrait expliquer, plus que tout autre facteur, le peu de concrétisation des appels à la révision de cette géographie prioritaire. Les critères de répartition de la réforme de 2005 qui orientent prioritairement la DSU sur les communes comportant une part importante de leur population en ZUS ou en ZFU, rendent le « coût de sortie » d’une zone plus élevé encore. L’allocation préférentielle des ressources de l’État sur les ZUS, depuis 2003, n’a pas seulement consolidé et amplifié les distorsions liées aux imperfections de la méthode de définition des ZUS dans les années 1990 : l’absence de révision des zonages en préalable à la réforme de 2005 a rendu cette révision plus délicate encore à effectuer en renforçant les avantages associés à ce label (Cour des comptes, 2007).
b) Quel effet levier des crédits spécifiques sur les crédits de droit commun ?
Le décalage entre les ambitions élevées de la politique de la ville et la limitation des moyens propres dont elle dispose a été maintes fois souligné. Le caractère prioritaire de la politique de la ville a été régulièrement réaffirmé par les chefs de gouvernement, mais la traduction budgétaire de cet affichage politique n’a pas convaincu les observateurs qui l’avaient chiffrée, avant l’entrée en application de la loi du 1er août 2003, aux environs de 0,2 % du budget de l’État (Chaline, 1997 ; Tréguer, 2001 ; Fitoussi et al. 2004). On ne peut cependant apprécier les ressources consacrées par l’État aux quartiers prioritaires de la politique de la ville en considérant ces seuls programmes. Laurent Davezies a montré que le poids financier des politiques sociales « implicites », celles qui sont liées aux mécanismes classiques de redistribution (fiscalité, protection sociale…), pesaient environ 500 milliards d’euros en 2002. Ces politiques sont « aveugles » aux territoires, puisqu’elles ciblent des individus. Et pourtant leur impact en termes de cohésion sociale et territoriale est incomparablement supérieur à celui d’une politique de la ville qui pesait de l’ordre d’1,5 milliards d’euros cette même année –si tant est que l’on puisse évaluer l’ensemble des budgets où elle émarge, précisait l’auteur (Davezies, 2004). On peut souligner aussi qu’à la différence des transferts de revenus organisés par l’État, la politique de la ville ne profite que de manière très indirecte aux ménages. Les premiers bénéficiaires des dépenses d’intervention de la politique de la ville mises en oeuvre au titre du programme 147 « Équité sociale et territoriale et soutien » (hors rénovation urbaine et DSU), appelées couramment « crédits spécifiques », sont… les entreprises (44 %), suivies par les collectivités territoriales (29 %), les associations et GIP (26 %) ; les dépenses bénéficiant directement aux ménages sont très marginales (1 %) (Cour des comptes, 2007).
Le décalage entre les ambitions affichées et les ressources budgétaires mobilisées par l’État est régulièrement justifié par la nature des crédits « spécifiques » de la politique de la ville, dont il est attendu un « effet levier » sur les politiques ordinaires de l’État, des collectivités et d’autres organismes publics. Depuis les années 1980, la mesure de cet effet levier est l’un des axes traditionnels de l’évaluation de la politique de la ville (Levy, 1988). À partir de 1991, l’État a lui-même cherché à donner une visibilité à son effort à travers un « jaune budgétaire » annexé à la loi de finances, lequel était construit autour de la distinction entre « crédits spécifiques » et « crédits de droit commun ». Mais ces financements de droit commun, qui représentent cinq fois le montant des crédits spécifiques en 200979, ont toujours été suspectés d’agréger des dépenses qui ne relevaient pas de la politique de la ville. Ce problème d’identification et de mesure des crédits de droit commun peut d’ailleurs être transposés en grande partie aux collectivités territoriales (Cour des Comptes, 1995, 2002).
La Cour des comptes s’est félicitée de l’avancée que représente le « document de politique transversal » (DPT) « ville », annexé au projet de loi de finances depuis 2005, tout en pointant là aussi ses limites. En effet, six programmes sur les vingt-cinq initialement rattachés au DPT ne comportaient pas d’évaluation des crédits contribuant à la politique de la ville, réduisant la portée du document. En outre, en dépit des améliorations apportées au « jaune », la fiabilité de la remontée d’informations permettant d’agréger les crédits de droit commun dévolus localement à la politique de la ville, reste incertaine car de nombreux ministères n’intègrent pas la géographie prioritaire de la politique de la ville dans la gestion de leurs dispositifs de droit commun (Cour des comptes, 2007)80.
Les différents rapports de la Cour des comptes l’ont chaque fois rappelé : les instruments de gestion budgétaire et d’observation statistique ne permettent pas de connaître l’utilisation des crédits de droit commun de l’État dans les quartiers d’intervention de la politique de la ville. Au-delà des seuls services de l’État, les tentatives de construction d’une comptabilité territorialisée des différents intervenants public à une échelle territoriale fine sont très rares à l’échelle des villes, et quasi inexistantes aux échelles infra-municipales. Aux difficultés conceptuelles liées à la définition même d’un « quartier », compte tenu de l’enchevêtrement de plusieurs géographies d’intervention de la politique de ville comme des politiques ordinaires, s’ajoutent des difficultés statistiques liées à l’insuffisance des sources de données. Les pratiques sociales ne cadrent pas non plus avec les échelles d’observation : la population d’un quartier ne fréquente pas seulement les équipements et services de ce quartier ; analyser les dépenses publiques bénéficiant à cette population nécessiterait en toute rigueur de mesurer aussi les dépenses engagées dans d’autres territoires (Tréguer, 2001).
À de rares exceptions, les tentatives locales de quantification de la mobilisation des crédits sont restées focalisées sur les seuls documents de programmation des contrats, en laissant de côté les interventions de droit commun des différentes institutions dès lors que celles-ci ne viennent pas directement financer des projets inscrits dans les programmations des procédures contractuelles de la politique de la ville. Sous cet angle, l’effet levier de la politique de la ville apparaît non seulement limité, mais des évaluations intermédiaires de Contrats de ville 2000-2006 avaient conclu à l’existence d’un effet de substitution des crédits spécifiques aux crédits de droit commun dans les actions en principe cofinancées avec ces derniers (Epstein, Kirszbaum, 2005). Ce cas de figure était déjà fréquemment mentionné dans les évaluations des Contrats de ville 1994-1999. Un effet pervers du FIV était alors mis en avant : cette ligne budgétaire étant alimentée à l’échelle nationale par des prélèvements sur les crédits d’intervention des différents ministères, les responsables de nombreux services déconcentrés avaient réorienté leurs interventions de droit commun vers d’autres territoires, considérant que leur ministère avait déjà versé son écot à la politique de la ville (Estèbe, Epstein, 1998 ; Kirszbaum, 1998).
À notre connaissance, seules deux démarches ont permis à ce jour d’évaluer avec rigueur la réalité des dépenses publiques dans les territoires prioritaires, au-delà des seules actions financées par la politique de la ville. Il s’agit de travaux académique (Tréguer, 2001) et d’inspection administrative (Fourcade et al., 2005), conduits hors du cadre évaluatif et qui portent sur les seules interventions de l’État –lesquelles sont loin d’épuiser la question du droit commun. La première recherche partait de l’hypothèse que l’on ne pouvait comprendre le rôle de l'État dans les quartiers en difficulté en se limitant à la seule description et évaluation des actions mises en oeuvre par la politique de la ville. Il fallait aussi inclure l’ensemble des autres politiques publiques affectant la population de ces quartiers, soit environ 99 % de fonds publics qui y sont dépensés. Comparant un quartier « pauvre » avec un quartier « banal » de référence d'une même commune du Val-de-Marne, Carine Tréguer a montré que ces dépenses étaient globalement défavorables au quartier pauvre dans les domaines de l’éducation et du logement. Quand bien même ces dépenses apparaissaient-elles plus favorables dans les domaines de la santé, du social et de la famille, c’était essentiellement par le jeu de la concentration de populations aux caractéristiques sanitaires, sociales et économiques défavorables, et non sous l’effet de politiques visant un objectif d’équité territoriale (Tréguer, 2001).
L’étude de l’Inspection générale des affaires sociales a également abordé cette question de l’équité, en s’attachant à vérifier si trois ZUS situées à Melun, à Sartrouville et à Vénissieux recevaient une part des crédits de droit commun des ministères sociaux et des DDE au moins égale au poids relatif de la précarité sur leur territoire, comparée à la précarité observée à l’échelle du département81. L’inspection précisait bien qu’elle n’avait pas cherché à savoir si l’engagement financier des services répondait effectivement aux besoins des quartiers au-delà du simple constat de proportionnalité à l’indice de précarité dans les ZUS. Son bilan indiquait que les DDE et le FASILD consacraient une part de leurs crédits égale ou supérieure à cet indice, en l’expliquant par la nature de l’habitat et de la population résidante. En revanche, il ressortait que les DDASS, les DDTEFP, les DDJS, les services de la Culture y consacraient une part parfois très fortement inférieure. Au total, la mission n'observait pas de signes d'un désengagement des services de l'État à l'égard des quartiers, mais une mobilisation jugée « globalement insuffisante », notamment dans l’une des trois ZUS (Fourcade et al., 2005).
Les inspecteurs généraux ont également cherché à identifier d’éventuels effets de substitution des crédits spécifiques aux crédits de droit commun dans la programmation des Contrat de ville et hors Contrats de ville. À partir de données cette fois très partielles, ils n’ont pas observé d'éviction massive et volontaire des crédits de droit commun, mais une tendance, dans certains cas, à mobiliser les crédits spécifiques pour remédier aux insuffisances du droit commun –soit une pratique assez éloignée de la recherche d’un effet levier. Dans l’une des trois ZUS, l’effet de substitution est apparu massif pour les DRAC, DDASS, DDJS et DDTEFP, et la faiblesse des cofinancements que ces administrations accordaient aux actions du Contrat de ville n’était pas compensée par des financements hors Contrat de ville en faveur de la ZUS (Fourcade et al., 2005).
Comme l’a signalé la Cour des comptes en 2007, cette analyse reste trop parcellaire pour fonder un constat fiable sur d’éventuels effets de substitution. La période étudiée par la Cour (2002-2006) avait été marquée, au niveau national, par une progression plus rapide des crédits spécifiques que des crédits de droit commun (en intégrant les subventions de l’État à l’ANRU), ce qui a eu pour effet de faire passer les premiers de 14 à 25 % de l’ensemble des financements étatiques de la politique de la ville. Tout en insistant sur la fiabilité très relative de ce décompte, les magistrats concluaient qu’« une telle proportion de crédits spécifiques apparaît peu conforme à un simple objectif de complémentarité ou d’effet de levier. S’il n’y a pas de substitution globale aux crédits de droit commun, le total des interventions directes de l’État au titre de la politique de la ville se déforme en faveur des crédits spécifiques, en contradiction avec l’objectif de faire des crédits de droit commun le principal levier d’action » (Cour des comptes, 2007).
Le passage des contrats de ville aux CUCS a-t-il permis d’obtenir l’effet levier attendu ? La circulaire sur l’élaboration des CUCS du 14 mai 2006 réitérait en effet l’exigence d’une « priorité à l’engagement des crédits de droit commun ». Or, toutes les études réalisées sur des échantillons de CUCS indiquent que les pratiques locales sont fort éloignées de cette injonction (Amnyos, Pluricité, 2007 ; Althing, 2009 ; ASDO, 2009 ; ECs, 2009b ; Cour des comptes, 2007, 2009 ; Kirszbaum, 2009a, 2010). Au stade des intentions, les CUCS affichent généralement la préoccupation d’une subsidiarité des crédits spécifiques par rapport au droit commun (Amnyos, Pluricité, 2007). Mais moins de 40 % des CUCS comportent une annexe financière précisant les engagements financiers des signataires (DIV, 2010). Et lorsque des engagements sont affichés, les chefs de projet expriment leur désarroi quant à la manière de les rendre effectifs, d’autant que lesdites intentions sont souvent vagues –« mobiliser les crédits de droit commun »– sans autre précision sur les finalités et les méthodes permettant d’atteindre un tel objectif (Amnyos, Pluricité, 2007). La Cour des comptes indique pour sa part que l’énergie considérable déployée par les acteurs des CUCS pour gérer des programmes spécifiques, marqués par une forte instabilité financière et juridique, peut expliquer que cet enjeu soit passé à l’arrière-plan des préoccupations locales. En même temps, cette focalisation sur les programmes de l’ACSÉ peut être comprise comme un palliatif à la recherche de crédits de droit commun de plus en plus difficiles à trouver (Cour des comptes, 2007).
Le contexte de renforcement des contraintes budgétaires, qui affecte l’ensemble des administrations de l’État, apparaît particulièrement peu propice à la mobilisation de ses crédits de droit commun, ce qui rend assez théorique l’objectif de « prise de relais » des expérimentations initiées par les CUCS ou les Contrats de ville. Compte tenu de la raréfaction des crédits d’intervention de l’État, une telle prise de relais équivaut à un transfert de charges aux collectivités, lesquelles préfèrent maintenir ces actions dans les CUCS pour conserver des cofinancements étatiques (Kirszbaum, 2009a). Peu après la signature de ces nouveaux contrats, le Conseil national des villes avait relayé la préoccupation des maires qui se plaignaient « de devoir compenser, par des actions développées grâce à la politique de la ville, le déficit ou l’absence des politiques de droit commun, notamment dans les domaines de l’éducation, de la police, de la justice, de la santé ». Le CNV indiquait aussi que les préfets ne parvenaient pas à « capter l’attention des administrations centrales » pour assurer le recensement, puis la redistribution des moyens de droit commun de l’État (CNV 2007a).
Le rapport précité de l’IGAS a fortement insisté sur les conséquences d’un déficit de pilotage, national et local, sur la mobilisation prioritaire des crédits de l’État. Au niveau central, le rapport a pointé la mise en sommeil du Comité interministériel des Villes pendant plusieurs années. Le rapport a constaté en outre que les circulaires invitant l’ensemble des administrations déconcentrées à se mobiliser au bénéfice des territoires de la politique de la ville étaient signées par le ministre de la Ville et le secrétaire d'État au Budget, et non par les ministères sectoriels ou le Premier ministre, ce qui ne pouvait qu’en affaiblir la portée. Localement, les systèmes de pilotage ne sont pas non plus favorables à une action volontariste en direction des ZUS. Le niveau de mobilisation des crédits des services de l'État n'est pas déterminé dans le cadre d'une procédure arrêtée et pilotée par le préfet. Ce dernier apparaît peu informé des mesures prises par les chefs de services déconcentrés. Il se voit ainsi privé d’un levier d'action pour infléchir les décisions financières des services sur lesquels il a formellement autorité (Fourcade et al., 2005).
c) Entre droit commun et exception, peut-on parler de quartiers à l’abandon ?
Dans un article paru voici quinze ans, alors que le thème du « plan Marshall pour les banlieues » faisait déjà recette, le politiste Patrick Le Galès prophétisait que la politique de la ville demeurerait « peu importante, peu cohérente et pas stabilisée », car « elle n’est pas fondamentale pour l’État », en l’absence de « groupes d’intérêt structurés pour imposer et maintenir ce type de demande sur l’agenda politique » (Le Galès, 1995). Cette analyse peut être étendue aux échelons infranationaux. Les vertus de la connaissance statistiques des inégalités territoriales et l’énonciation d’objectifs chiffrés de réduction des écarts n’ont pas suffit pour promouvoir un traitement préférentiel des quartiers pauvres par les services déconcentrés de l’État (Fourcade et al., 2005). Du côté des collectivités territoriales, les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont rarement réellement prioritaires, face à d’autres territoires ou d’autres politiques dont les intérêts sont portés par des groupes sociaux ou économiques bien mieux organisés (Pinson, 2009).
L’idée qu’il faille en passer par des mesures de discrimination positive territoriale pour lutter contre les inégalités ne suscite plus de controverses virulentes ; mais ce principe d’équité peine à se traduire dans les faits. Cependant, l’émergence du concept de discrimination positive territoriale, qui a concerné les services publics (Estèbe, 2004a ; Kirszbaum, 2004c) avant que les zones franches en soient les emblèmes dans la politique de la ville, n’est pas seulement liée à une préoccupation d’équité. Elle participe aussi, depuis l’origine, d’une conception « républicaine » de l’égalité territoriale qui, loin de contribuer à la mobilisation politique ou à l’émergence de groupes d’intérêt dans les quartiers, vise plutôt à les désamorcer par la mise à disposition, en tous lieux, d’« une offre de services la plus égale possible afin que nul ne puisse dire qu’il a subi une injustice dans le cadre de la République » (Donzelot et al., 2003). Dans cette perspective, la présence des services publics dans les quartiers remplit d'abord « une fonction symbolique », témoignant « du pacte républicain qui lie les individus, les groupes sociaux et la communauté nationale » (DIV, 1995b), avant toute préoccupation d’amélioration du service rendu (Bonetti, 1995 ; Béhar, Gorgeon, 1998). La discrimination positive territoriale peut s’inscrire aussi dans une finalité de mixité des fonctions urbaines. Derrière le slogan « faire des quartiers comme les autres », il ne s’agit pas de questionner les modes de fonctionnement et les prestations des services publics, mais d’homogénéiser l’offre sur les territoires. Au moment du Pacte de relance pour la ville, le gouvernement Juppé avait ainsi cherché à dresser un état des lieux exhaustif de la présence des services publics dans les quartiers, dans l’espoir de définir une norme d’équipement. Mais la base de données centrale n’a jamais été alimentée (Deschamps, 1998 ; Kirszbaum, 2004b, 2004c). Savoir quel est le seuil « normal » d’équipement d’un quartier soulève d’ailleurs de redoutables questions qui expliquent, au moins en partie, l’abandon de cette option (Béhar, 1995b ; Sueur, 1998).
La principale concrétisation de la discrimination positive territoriale, en matière de services publics, a été l’attribution d’avantages aux fonctionnaires qui exercent des missions dans les quartiers82 (Kirszbaum, 2001 ; Donzelot et al., 2003). Pour le reste, et à l’exception notable de l’Éducation nationale, la discrimination positive a consisté en un simple message incitatif à l’adresse des services publics afin qu’ils se renforcent en quantité, et peut-être surtout en qualité (Estèbe, 2004a). Au terme de la décennie 1990, pourtant riche en appels à la mobilisation des services de l’État, leur implication dans la politique de la ville est restée inégale, comme l’ont montré les évaluations des Contrats de ville (Estèbe, Epstein, 1998 ; Kirszbaum, 1998). Sur la base de différentes études, parfois produites par les ministères eux-mêmes, la commission Sueur avait dressé un état des lieux assez décourageant, évoquant « des situations de sous-dotation correspondant dans certains cas à une discrimination négative, constituées par un service rendu inférieur à la moyenne nationale ou aux niveaux constatés ailleurs », et, en tout état de cause, aux besoins » (Sueur, 1998).
Les effets de la politique de la ville sont loin d’avoir été nuls sur les services publics, mais sa géographie prioritaire n’a jamais véritablement guidé leur territorialisation - plus ou moins aboutie selon les cas. Éducation nationale, DDASS, DDE, DDTEFP, DDJS, police, justice, ont adopté chacun une lecture particulière des enjeux territoriaux, souvent très loin de cadrer avec l’échelle d’intervention de la politique de la ville, comme l’avait mis en évidence une évaluation d’envergure conduite dans les différents départements franciliens (Estèbe, 1998 ; Bravo, 1999). Dans les années 2000, la géographie prioritaire de la politique de la ville peine toujours à s’imposer aux différentes politiques publiques. Selon l’IGAS, « les services n’ont pas encore le réflexe du "zonage prioritaire", sous l’influence contradictoire des priorités départementales, des priorités thématiques, de l'approche par publics cibles, de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs non coordonnés entre ministères au niveau central, et de la contrainte budgétaire ». Pour les inspecteurs généraux, les systèmes locaux de pilotage des services et les priorités des administrations centrales empêcheraient structurellement un traitement préférentiel des ZUS. L’IGAS notait à cet égard que l’esquisse de partenariats « au sommet » entre la DIV et la DGAS83, la DGEFP84 ou l’ANPE, avaient « peu de retombées territoriales » au moment de l’enquête (Fourcade et al., 2005).
La police et la justice
Toutes les administrations n’envisagent pas la territorialisation de la même manière, et leurs conceptions peuvent varier dans le temps, au gré des orientations politiques nationales. Le cas de la police et de la justice est ici emblématique. La police nationale s’est longtemps montrée hermétique à la notion de géographie prioritaire, considérant que la délinquance est mobile par essence, ce qui ne justifierait pas de polariser son action sur des quartiers particuliers (Gorgeon, 1998). Surtout, les policiers s’inscrivent dans une ligne hiérarchique nationale qui réduit leurs dispositions à rendre des compte devant les sociétés locales où ils interviennent et à définir avec elles leur priorités (Monjardet, 1999 ; Douillet, de Maillard, 2008). L’idée de « coproduction de la sécurité », consacrée par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, a toutefois légitimé l’idée de coordination locale d’une pluralité d’acteurs de la sécurité, traduisant une « démonopolisation » du traitement de cette question (Roché, 2004 ; Gautron, 2006). L’aboutissement de ce processus, engagé dans les années 1980 à travers les Conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD), a été la mise en place des Contrats locaux de sécurité (CLS) à partir de 1997, lesquels consacraient le rôle des maires en matière de sécurité (Le Goff, 2002). Cependant la capacité des CLS à définir des stratégies à l’échelle des territoires a toujours été limitée par la représentation souvent très formelle des partenaires dans ces instances, la police et la justice refusant d’y mettre en débat leurs priorités et leurs pratiques. Ces instances négligeaient en outre d’associer les agents de terrain, même si des actions plus territorialisées ont été mises en œuvre, par exemple dans le cadre des Groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD) animés par des procureurs, ou des « cellules de veille » réunissant des intervenants de quartier (Gorgeon et al., 2000 ; Donzelot, Wyvekens, 2004).
Au tournant des années 2000, les conditions politiques existaient cependant pour progresser dans la voie d’une police et d’une justice de proximité. Le concept de « police urbaine de proximité » était au cœur de la stratégie du ministère de l’Intérieur (IHESI, 2000), tandis que le ministère de la Justice laissait les Parquets définir des politiques pénales fortement influencées par les contingences territoriales, tout en diffusant à une large échelle les Maisons de justice et du droit qui faisaient sortir les magistrats de leur « tour d’ivoire », et contribuaient à l’invention d’alternatives aux poursuites (Milburn, 2010). Les politiques de sécurité ont changé de cap après les élections de 2002. La suppression de la police de proximité a amorcé un mouvement de recentralisation des politiques de sécurité, qui va en s’accélérant depuis 2006. Les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui remplacent les CCPD en 2002, ne servent qu’à ajuster à la marge des politiques pénales et de sécurité dont les orientations et les actions sont étroitement cadrées par les administrations centrales, qu’il s’agisse de l’usage du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) (Gautron, 2010) ou des orientations de la politique pénale (Milburn, 2010). Les maires ont certes été investis de nouvelles missions dans le champ de la prévention de la délinquance, mais ils ont largement perdu en autonomie. Dans ce contexte, la politique de la ville –au sens CUCS du terme– n’a jamais paru aussi déconnectée des enjeux et des acteurs de la sécurité, se trouvant rabattue sur la seule prévention dite « sociale ». En effet, si les CLS sont officiellement des volets à part entière des CUCS, leur dissociation apparaît très grande (Althing, 2009). On voit mal dans ce contexte comment les CUCS pourraient continuer à jouer le rôle que jouaient principalement les Contrats de ville vis-à-vis des acteurs de la sécurité : leur apporter des moyens matériels pour leur permettre d’assurer leurs missions dans de meilleures conditions (Cour des comptes, 2002). La préoccupation sécuritaire n’est pas absente de la politique de la ville, mais elle entre en ligne de compte par d’autres biais, celui du FIPD, qui fait de la vidéosurveillance sa priorité centrale (avec 61, 2% de crédits à y affecter)85 et de l’urbanisme sécuritaire dans les opérations de rénovation urbaine, les deux s’inscrivant dans une démarche de « prévention situationnelle » (Oblet, 2008).
Les administrations sociales
Dans le champ sanitaire et social, la relation des DDASS aux territoires est sans doute plus ténue encore, même si la littérature est très limitée sur ce sujet. En vertu de sa vocation « généraliste », cette administration a toujours privilégié une approche par les publics plutôt que par les territoires, sans toutefois asseoir de présence de proximité compte tenu de ses moyens financiers limités depuis la décentralisation (Bertolotto, Joubert, 1998). Au milieu des années 2000, le rapport précité de l’IGAS indiquait que les DDASS n’étaient toujours pas organisées pour cibler leurs interventions sur les territoires de la politique de la ville et qu’elles ne recevaient aucune instruction ministérielle sur un éventuel fléchage de leurs crédits dans cette direction. Pour mettre en œuvre leurs orientations, les DDASS s’appuient sur des opérateurs associatifs, mais elles n’exigent de leur part aucune action prioritaire en direction des ZUS (Fourcade et al., 2005).
À l’inverse des DDASS, l’implication des Caisses d’allocations familiales dans le « développement social local » procède d’une orientation nationale (Damon, 2009). Au contact direct du public (Dubois, 1999), les CAF ont toujours joué un rôle très actif dans la politique de la ville. Dès la fin des années 1960, elles avaient cherché à renouveler les méthodes du travail social pour dépasser le cadre de la relation individuelle et mettre en œuvre des actions ayant une dimension collective en appui sur les ressources des habitants (Denieuil, Laroussi, 2005). Si les effets de la massification de la pauvreté ont happé une bonne partie de ses agents dans l’aide sociale individuelle, le développement de la politique de la ville a néanmoins ouvert des opportunités aux CAF pour financer des actions de développement social (Haurie, 2005). C’est ainsi qu’elles se sont impliquées, au début des années 2000, dans l’expérimentation des « Projets sociaux de territoire » conduits dans une vingtaine de sites (Recherche sociale, 2005). Outre la mise à disposition de personnels dans les équipements ou services des quartiers en politique de la ville (Avenel, Cathelain, 2009), les CAF participent au financement des centres sociaux (Vaucelle, 2008) et sont souvent pilotes locaux des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la fonction parentale (REAAP) (Voléry, 2003). Ses travailleurs sociaux jouent aussi un rôle important dans l’accompagnement social lié au relogement, dans les opérations de rénovation urbaine, avec le risque « d’être un instrument au service d’enjeux politiques locaux, et ce au détriment de la déontologie des CAF » (Kesteman et al. 2008). Outre le soutien à la recherche sur la politique de la ville (Minonzio, 2007), soulignons enfin que la CNAF est un important fournisseur de données socio-économiques à l’échelle des ZUS (Jaulent, 2007).
Le service public de l'emploi
Le service public de l'emploi (SPE) témoigne d’une prise en compte beaucoup plus lente des territoires. Les acteurs des politiques de l’emploi ont longtemps fait primer le principe d’universalité du service public, ciblé sur des publics et non sur des territoires (Pellegrin, 1996). Les quartiers prioritaires étaient si peu ciblés en tant que tels qu’un rapport officiel estimait au milieu des années 90 que« la discrimination n'est pas positive, mais négative, au moins pour toutes les actions ouvrant un accès direct à l'emploi » (IGAS, 1996). La territorialisation des politiques de l’emploi s’est opérée tardivement, par un double mouvement de rapprochement, dans une préoccupation de proximité et d’individualisation des mesures, et de prise de distance, dans un souci de coordination avec les politiques de formation, d’insertion et de développement économique à l’échelle plus large du bassin d’emploi. Le processus de territorialisation demeure néanmoins partiel, en raison de l’instabilité des partenariats territoriaux et des tensions entre une logique territoriale et une logique de performance dans la mise en œuvre des mesures individuelles à l’intérieur du service public de l’emploi (Berthet, 2005 ; Exertier, Gramain, 2006 ; Bel, Berthet, 2009).
L’attention portée au public des ZUS résulte moins de l’inscription du service public de l’emploi dans les partenariats locaux que des injonctions nationales devenues plus précises ces dernières années. Le rapport précité de l’IGAS faisait état, en 2005, d’une absence à peu près complète de prise en compte des territoires de la politique de la ville dans le pilotage des mesures du SPE qui privilégiait encore le ciblage de différentes catégories de publics définis par leur situation vis-à-vis de l’emploi ; quelques exceptions étaient toutefois mentionnées, le fait de résider en ZUS ou dans un autre quartier en difficulté étant devenu un critère d'éligibilité pour l’accès à certaines mesures (Contrats initiative emploi, Adultes-relais, programme TRACE86) (Fourcade et al., 2005). Sans aller jusqu’à instituer des mesures de discrimination positive, un tournant a été amorcé à partir de 2005 qui inscrit la logique du zonage dans l’action du service public de l'emploi (Sylla, 2008). Voyant s’approcher le terme des cinq ans, fixés par la loi du 1er août 2003, pour réduire d’un tiers le taux de chômage dans les ZUS, la DIV a passé une convention avec l’ANPE, le 12 avril 2005, visant à mettre en place des « objectifs de progrès » en termes d’accompagnement des demandeurs d’emploi des ZUS. Le Plan de cohésion sociale a poursuivi cette logique avec la circulaire du 23 décembre 2005 qui demandait la mobilisation, autour du service public de l'emploi, des services de l’État et des acteurs de terrain pour la mise au point d’un « plan d’action à destination, prioritaire mais non exclusive, des jeunes résidant en Zone Urbaine Sensible », l’objectif étant désormais de « réduire d’ici trois mois et de façon significative les écarts constatés, à partir des diagnostics locaux, entre la situation des jeunes ZUS au regard de l’insertion et de l’emploi et celle des autres jeunes ». Dans cette perspective, diverses mesures en faveur de l’accès à l’emploi du Plan de cohésion sociale étaient proposées de façon privilégiée à ces jeunes.
Les travaux de la DARES87 permettent d’apprécier les effets de ce recentrage sur la catégorie « jeune résidant en ZUS ». Il est intéressant de comparer deux de ces études, l’une portant sur la période précédant le « tournant de 2005 » et l’autre sur la mise en oeuvre des mesures du Plan de cohésion sociale. La première montrait qu’en 2004, une fois neutralisées les différences de structure dans la population des demandeurs d’emploi de plus de 25 ans, les résidents des ZUS avaient 30 % de « chance » supplémentaire qu’un demandeur d’emploi ayant les mêmes caractéristiques et résidant hors ZUS dans la même commune, d’entrer en Contrat emploi-solidarité, c'est-à-dire un contrat ne débouchant pas sur un emploi marchand ; s’ils avaient une chance égale d’accéder à un Contrat emploi consolidé (CEC), les résidents de ZUS avaient aussi 10 % de chances de moins d’entrer en Contrat initiative emploi (CEI) destiné à permettre un retour rapide à l’emploi durable dans le secteur marchand. Toujours à caractéristiques égales, les demandeurs d’emploi résidant en ZUS avaient 60 % de chances en moins de bénéficier d’une ACCRE88, 20 % de chances en moins d’entrer en SIFE individuel ou en Stage d’accès à l’entreprise (SAE) assorti d’une promesse d’embauche, mais 30 % de chances de plus d’entrer en SIFE89 collectif. S’agissant des jeunes de moins de 25 ans, on pouvait constater (cette fois sans neutralisation des effets de structure) que la probabilité d’accéder à un contrat en alternance ou à un contrat spécifiquement destiné aux jeunes90 était inférieure de 40 % pour les jeunes des ZUS (Bachelet et al., 2007).
Une nouvelle étude portant sur l’année 2006 a montré que, tous âges confondus, les habitants des ZUS avaient toujours 30 % de chances de plus d’accéder à un contrat du secteur non-marchand du Plan de cohésion sociale91 que leurs homologues résidant dans d’autres quartiers, et une chance inférieure de 20 % d’accéder à un contrat du secteur marchand92. En données brutes (non corrigées des effets de structure), la comparaison avec l’année 2004, pour des contrats équivalents93, révélait une dégradation du « rapport de chances ZUS/hors US » : +20 % de chances d’accès à un contrat du secteur non-marchand et –10% d’accéder à un contrat du secteur marchand. S’agissant des jeunes de moins de 26 ans, cible prioritaire des mesures du Plan de cohésion, les écarts cumulés étaient plus importants encore : en données brutes, le taux d’accès des jeunes des ZUS aux contrats du secteur non-marchand était de 50 % supérieur, mais de 10 % inférieur pour l’accès à un contrat du secteur marchand (Bachelet, 2008a). Au vu de ces chiffres, la mobilisation prioritaire du service public de l'emploi en faveur des résidents des ZUS ne semble pas produire les effets escomptés.
L’Éducation nationale
L’Éducation nationale est l’unique institution étatique à avoir adopté, de longue date, le principe d’une gestion différenciée de ses établissements dans un dessein affiché de discrimination positive (Bouveau, 1997). Mais les critères de classement des établissements en Zone d'éducation prioritaire (devenus Réseaux ambition réussite et Réseaux de réussite scolaire) sont propres au ministère. Ils ont conduit à la construction d’une géographie prioritaire qui ne recoupe que partiellement celle de la politique de la ville et des Zones urbaines sensibles en particulier : 20 % des collèges situés en ZUS ne sont pas classés en ZEP ou en REP (ONZUS, 2005). Alors que l’éducation prioritaire concerne aussi des établissements hors ZUS, les documents budgétaires de la politique de la ville présentent l’effort consenti en direction de l’ensemble des établissements bénéficiant de mesures de discrimination positive, comme la contribution financière de l’Éducation nationale (s’ajoutent les mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan Espoir banlieues). Cette présentation a été jugée discutable par la Cour des comptes dans un récent rapport consacré à l’articulation des deux politiques, car elle ne permet pas d’apprécier « l’effort de base » de l’éducation nationale en direction des quartiers sensibles. La Cour juge que le coût réel de l’éducation prioritaire reste mal connu, trente ans après sa mise en œuvre (Cour des comptes, 2009). Il existe en fait différentes approches de l’évaluation du coût de l’éducation prioritaire, dont le surcoût annuel a été estimé à 927 millions d’euros en 2005, correspondant principalement à des dépenses de personnel ; les surcoûts en crédits pédagogiques et en fonds sociaux sont en revanche marginaux (respectivement 16 et 8,5 euros par élève) (Armand, Gille., 2006).
Les moyens supplémentaires dont bénéficient les établissements prioritaires sont tributaires des modalités de répartition, par l’administration centrale et par les échelons déconcentrés, des crédits attribués à l’ensemble des établissements, qu’ils relèvent ou non de l’éducation prioritaire (Armand, Gille, 2006). Ce qui peut aboutir à des paradoxes : par exemple, il y a davantage d’élèves par classe (24 en moyenne) dans les écoles primaires classées en éducation prioritaire de l’académie de Créteil que dans la moyenne nationale des écoles primaires classées hors éducation prioritaire (23,5) ; le même phénomène est signalé à propos des moyens alloués aux collèges sous forme de dotation globale horaire (Cour des comptes, 2009).
S’il ne dispose pas d’éléments financiers pour mesurer l’impact financier de la politique d’éducation prioritaire, l’ONZUS a cherché, à partir de son rapport 2005, à identifier les efforts consentis en faveur des collèges situés en ZUS en termes de ressources humaines, en les comparant à la situation des collèges situés dans le reste de leur commune. Si la dotation horaire est en moyenne plus élevée en ZUS, ce n’est pas le cas de toutes les ZUS, l’écart pouvant être inversé au profit des collèges non-ZUS94. L’Observatoire constate aussi que la proportion d’enseignants de moins de trente ans ou arrivés dans leur établissement depuis moins de deux ans est plus forte en ZUS que dans le reste de leur commune –ce qui pèse négativement sur la scolarité des élèves (Trancart, 1998)– avec des écarts d’une ZUS à l’autre de l’ordre de 3 à 4 points, mais parfois beaucoup plus importants (de – 58 % à + 48 % s’agissant des enseignants récemment arrivés) (ONZUS, 2005). Le rapport 2009 de l’ONZUS montre d’ailleurs que la proportion d’enseignants en poste depuis moins de deux ans dans un même collège a sensiblement progressé en un an, quoiqu’un peu moins fortement que dans les établissements hors ZUS. La proportion d’enseignants âgés de moins de trente ans a en revanche tendance à diminuer dans les ZUS, mais c’est aussi le cas hors ZUS. Enfin, l’écart entre les dotations horaires des collèges en ZUS et hors ZUS croît légèrement, en faveur des premiers. Mais ce progrès est largement atténué par la forte dégradation du nombre d’élèves par structure pédagogique à la rentrée 2007, passé en un an de 18,6 à 20,1 élèves en ZUS, et de 21,6 à 22,4 hors ZUS (ONZUS, 2009), soit une réduction sensible de l’effet du classement en éducation prioritaire.
Une étude de Rolland Bénabou et al. (2004) portant sur la période 1982-1992 a montré que les dépenses supplémentaires en faveur des collèges en ZEP avaient consisté pour l’essentiel en primes accordées aux enseignants, alors que les moyens affectés directement aux élèves se réduisaient à quelques heures d’enseignement supplémentaires, ce qui n’autorisait qu’une faible et lente diminution du nombre d’élèves par classe. Ce léger avantage avait d’ailleurs été annulé par l’effet du classement en ZEP, lequel s’est traduit par une fuite d’élèves et une accentuation de l’homogénéité sociale des établissements –un constat préoccupant, sachant l’influence de la composition sociale des établissements et, en leur sein, des classes sur le destin scolaire des élèves (Duru-Bellat, 2003 ; 2009). Mais les auteurs ne savent pas s’il faut imputer ce phénomène aux stratégies d’évitement des parents et/ou au dépeuplement de certains quartiers –les deux effets pouvant se cumuler puisqu’une réputation dégradée des établissements scolaires locaux peut s’ajouter aux autres facteurs de désaffection d’un quartier. La prime versée aux personnels enseignants des ZEP ne permet pas non plus de les stabiliser, alors que c’est l’une des conditions reconnues de la réussite scolaire en ZEP (Moisan, Simon, 1997). À ce sujet, l’étude constate, comme d’autres (Meuret, 2000 ; Caille, 2001), que la mise en place des ZEP n’a pas d’effet significatif sur la réussite des élèves ; une absence d’effet attribuée par les auteurs à l’augmentation ténue des ressources financières autres que les crédits indemnitaires. Il s’agit cependant d’un effet moyen des ZEP, car la mise en oeuvre de projets éducatifs spécifiques peut produire d’autres effets (Chauveau, Rogovas-Chauveau, 1999). Derrière les moyennes nationales, il peut donc y avoir des gains dans certaines zones compensés par des détériorations dans d’autres (Bénabou et al., 2004).
Outre qu’elle porte sur une période déjà ancienne, la portée de cette étude est limitée parce qu’elle ne considère que les collèges alors que l’éducation prioritaire cible davantage les écoles primaires. Mais ses résultats confortent ceux d’une autre étude, conduite par Thomas Piketty et Mathieu Valdenaire (2006), dont la publication a rencontré plus d’écho. Comme la précédente, elle établit qu’un effet sensible de l’éducation prioritaire sur la réussite des élèves demanderait l’investissement de moyens beaucoup plus massifs. Ainsi, la réduction d'un élève par classe de CE1 conduit à une augmentation de 0,7 point du score obtenu par les élèves défavorisés aux évaluations de mathématiques de début de CE2. Inversement, une politique forte de ciblage conduisant à la réduction supplémentaire de cinq élèves par classe en ZEP, à moyens constants, produirait une diminution de 46 % de l'inégalité de réussite scolaire. En utilisant les mêmes méthodes pour les collèges et les lycées, cette étude met en évidence des effets statistiquement significatifs, mais quantitativement plus faibles que dans le primaire, ce qui plaide pour une concentration forte des moyens supplémentaires sur les jeunes élèves (Piketty, Valdenaire, 2006).
La dispersion des moyens est donc une critique centrale apportée à la politique d’éducation prioritaire. La mise en place d’un ciblage plus précis, avec depuis 2006 les collèges « ambition réussite » est censée y répondre. Mais tous les dispositifs « discriminants » seraient pris dans une tension : la concentration des moyens est a priori un gage d’efficacité, mais elle stigmatise aussi les personnes ciblées, avec à la clef des effets pervers d’étiquetage, provoquant des stratégies de fuite des enseignants comme des parents, amplifiée dans ce dernier cas par l’assouplissement du verrou de la carte scolaire (Duru-Bellat, 2009). Une autre réponse consiste à cibler des individus et non des zones, à l’instar des mesures d’accompagnement scolaire, mais leur efficacité se trouve là aussi questionnée, ce qui implique de trouver le bon dosage entre les deux démarches (Suchaut, 2005).
***
Le caractère très aléatoire d’une discrimination positive territoriale organisée au sein même des différents secteurs administratifs de l’État ne doit pas occulter les effets au long cours de la mobilisation publique en faveur des quartiers, qu’elle émane de l’État, des collectivités locales ou d’autres organismes (para)publics. Un retour sur la situation qui prévalait à la fin des années 1970 et au début des années 1980 permet d’en prendre la mesure. Le désintérêt de l’État pour les grands ensembles en voie de paupérisation était alors manifeste (Bachmann, Le Guennec, 1996). Les municipalités ne faisaient pas non plus preuve d’un grand volontarisme pour prendre en charge des quartiers édifiés parfois contre leur gré, et dont les habitants se mobilisaient peu pour exprimer des revendications. Enfin, l’investissement des organismes HLM était extrêmement limité, tant sur le plan financier que de la présence humaine (Zémor, Jullien, 1995).
On comprend dès lors la tonalité des premiers rapports officiels – Dubedout (1993) et surtout Delarue (1991) et Langlais (1991) – qui levaient un doigt plus ou moins accusateur sur l’État, coupable d’avoir abandonné à leur sort des quartiers qu’il avait créés de toutes pièces. Il paraît difficile de formuler un tel constat aujourd'hui, même si l’opinion selon laquelle ces quartiers soient laissés à l’abandon a encore cours. Des observateurs affirment au contraire qu’ils seraient plutôt surinvestis par les institutions (Wacquant, 2006 ; Avenel, 2007a). Les connaissances disponibles amènent à formuler un constat plus nuancé, à l’image des rapports de l’ONZUS qui aboutissent à des conclusions relativement contradictoires eu égard à la couverture de ces quartiers en équipements collectifs. Les résultats de l’enquête « Vie de quartier » de l’INSEE ont été présentés dans le premier rapport de l’ONZUS (2004). Fondée sur des entretiens avec un échantillon d’habitants représentatifs de différents territoires, cette enquête montrait que les habitants des ZUS déclaraient plus souvent que les autres disposer, à proximité de leur domicile, d’infrastructures culturelles ou sportives, mais aussi de bureaux de poste, de crèches, d’écoles maternelles ou d’arrêts de bus (INSEE, 2001). L’ONZUS a donc estimé que les ZUS se plaçaient en meilleure position que bien d’autres espaces, notamment périurbains, même si les informations recueillies sur la base des données Sirène apparaissaient nettement moins favorables s’agissant des commerces et de divers services marchands, y compris les médecins (ONZUS, 2004). Cinq ans plus tard, l’ONZUS a proposé un tableau bien moins flatteur, faisant état, à l’exception des équipements éducatifs qui sont assez uniformément répartis, de disparités très fortes selon les quartiers CUCS de priorité 1, 2 ou 3, et entre les ZUS elles-mêmes (ONZUS, 2009).
Une analyse comptable du niveau d’équipement et de services des quartiers renseigne en fait assez mal sur leur utilisation effective alors que de multiples facteurs peuvent limiter l’accès effectif de certains groupes sociaux à une offre qui leur est physiquement accessible (Levy, Dureau, 2002). Elle ne dit rien non plus de leur adéquation aux besoins effectifs des habitants. L’ONZUS l’a rappelé : la présence des équipements et des services doit être rapportée aux caractéristiques de la population locale (ONZUS, 2004, 2005). Ainsi, le nombre de places de crèches n’a-t-il de sens qu’au regard de la proportion d’enfants en bas âge du quartier, plus élevée dans les ZUS où la population est plus jeune qu’ailleurs. De même, la desserte de bus doit-elle être évaluée à l’aune des situations de dépendance envers ce mode de transport, sachant que les habitants ont un taux de possession de véhicule personnel plus faible qu’ailleurs (Mignot, 2004 ; Birchen, Crossonneau, 2005 ; Boquet, 2008). Le simple comptage des équipements risque enfin de masquer leurs difficultés à délivrer des prestations de qualité en termes d’accueil, d’écoute, d’orientation ou de qualification des agents au contact du public. Ainsi un état des lieux de la présence des services publics dans les quartiers, effectuée par les préfets à la fin des années 1990, avait-il conclu que les déficits étaient bien davantage d’ordre qualitatif que quantitatif (Bengaouer, Pestre-Mazières, 1999).
Si l’on peut difficilement parler d’une désertion des quartiers, la mobilisation institutionnelle à laquelle la politique de la ville a contribué, n’a certainement pas conduit à rétablir une égalité de traitement entre les habitants des villes. L’État n’est pas seul en cause. Positionnées en pilotes de la politique de la ville depuis plusieurs décennies, les municipalités voient leur responsabilité tout autant aussi. La façon dont elles ont fait usage de la politique de la ville apparaît d’ailleurs extrêmement contrastée (Béhar, 1999b ; Estèbe, 2004a ; Epstein, 2008a ; Aures, 2009). Certaines villes l’ont conçue comme un levier de transformation de leur organisation et d’adaptation de leurs interventions en direction des quartiers, et aussi comme un moyen d’interpeller leurs partenaires, entraînés dans un mouvement de territorialisation. À l’inverse, dans de nombreuses villes, la mobilisation institutionnelle s’est traduite par la consolidation d’une politique « à part » pour ces quartiers, dont le pilotage a été en quelque sorte « concédé » à ses dispositifs particuliers, le tissu associatif local se chargeant de sa mise en œuvre.
Ces différences d’approche renvoient à un débat qui structure depuis longtemps la politique de la ville, marquée par une tension quasi-constitutive entre la nécessité d’une politique spécifique, puisque ces quartiers ne trouvent pas naturellement leur place dans le droit commun, et la mobilisation tout aussi nécessaire des politiques de droit commun, si l’on veut éviter de particulariser davantage lesdits quartiers (Profession banlieue, 1998 ; Kirszbaum, 2004b : Avenel, 2007b). A défaut d’être fermement étayée par des analyses financières, la question d’un éventuel effet de substitution tend alors à déplacer le regard vers la fonction des associations qui sont « les véritables soutiers » de cette politique (Jaillet, 2003). Car le recours aux associations de proximité peut conduire à installer un filtre entre les institutions et les quartiers. Dans cette configuration, les habitants risquent de n’avoir qu’un accès limité à l’offre ordinaire de services localisée dans la ville et ces services ne sont guère encouragés à adapter leur action pour mieux s’assurer de l’accessibilité effective de cette offre. La question n’est pas nouvelle et elle a été abondamment débattue dans les années 1990, quand la politique de la ville se voulait l’aiguillon de la modernisation des services publics (Kirszbaum, 2001). Avec l’évolution très managériale d’une modernisation avant tout préoccupée de performance et de rentabilité, la capacité d’adaptation des services publics aux besoins des quartiers est encore plus fortement mise en doute (Siblot, 2005).
L’évaluation des effets du recours intensif au secteur associatif a fait l’objet de jugements contrastés (Epstein, Kirszbaum, 2005). D’un côté, les opérateurs associatifs sont crédités de nombreux avantages comparatifs par rapport aux services publics : capacité à toucher des publics éloignés de l’offre publique, souplesse et réactivité, disponibilité et écoute, etc. De l’autre, la qualité de leurs actions et prestations est souvent jugée médiocre, ce qui alimente les craintes d’un « service public à deux vitesses » –ou a minima une incertitude permanente sur ce que produit le vaste champ du « lien social », lequel continue d’absorber une part importante des financements CUCS qui restent mobilisables en dehors des programmes pilotés par l’ACSÉ (ASDO, 2009). Les associations ont toujours été envisagées comme le fer de lance de l’innovation, permettant d’expérimenter, puis de transférer dans le droit commun de nouvelles prestations ou modes d’intervention. Or, cette fonction d’innovation tend à s’épuiser avec le temps (Epstein, 2008a). Du moins sa capitalisation –et son financement– par le droit commun apparaît-elle très aléatoire. Le risque est alors de voir l’innovation se développer en vase clos, dans le cadre d’une politique de la ville constituée en filière administrative quasi-autonome (Augustin, Montané, 2004).
d) Entre appels à projet et péréquations fiscales, quelle justice spatiale ?
La dialectique des crédits spécifiques et des crédits de droit commun n’épuise pas la question des ressources financières mobilisables par la politique de la ville, ni des conditions d’une meilleure équité territoriale entre territoires riches et pauvres95.
Le développement des appels à projets nationaux constitue aujourd'hui une modalité importante de l’allocation des ressources de la politique de la ville. C’est au milieu des années 1990 que cette méthode a fait son apparition dans la politique de la ville. Le Pacte de relance pour la ville qui accordait une nette priorité aux zones franches avait néanmoins lancé plusieurs appels à projets relatifs aux services publics, concernant par exemple les transports ou les « maisons de service public ». De l’autre côté de la Manche, l’appel à projets national s’imposait déjà comme la méthode privilégiée par le gouvernement Major à travers son programme phare, intitulé City Challenge, lancé en 1991 pour soutenir des projets de régénération de quartiers pauvres (Donzelot, Jaillet, 1997).
Les propriétés de cet instrument ont été analysées par Patrick Le Galès et John Mawson (1995) à partir d’une comparaison entre ce programme et les Contrats de ville signés en 1994. Il ressortait de cette comparaison que l’appel à projets est un mode d’allocation des ressources extrêmement sélectif. Alors que le choix des sites bénéficiant des Contrats de ville était opéré sur la base des besoins plutôt que des projets, ceux du programme City Challenge s’effectuait en fonction des projets, lesquels étaient sélectionnés en fonction de leur conformité aux exigences du cahier des charges national. De fait, le montant cumulé des projets proposés dépassait largement l’enveloppe budgétaire disponible, conduisant à des choix drastiques96. Ce mode de sélection permet ainsi à l’État de concentrer des ressources limitées sur des projets répondant précisément à ses attentes. Au contraire, le mode de sélection des bénéficiaires des Contrats de ville apparaît plus équitable, mais moins performant si l’on envisage la performance comme la capacité à atteindre les résultats arrêtés à l’échelon central (Le Galès, Mawson, 1995).
C’est cet aspect inéquitable de la méthode de l’appel à projets, au sens où la démarche n’obéit principalement pas à une logique de satisfaction des besoins, qui a valu une critique en règle de cette dimension du PRV (comme des autres au demeurant) par le Conseil national des villes (1998). Informé de l’expérience britannique, le CNV disait craindre des effets similaires : « Les appels à projets comme la politique de City Challenge en Grande- Bretagne, ont été imaginés dans une optique de plus grande efficacité des aides que l’État distribue aux villes (...) Cette procédure présente certes l’avantage d’assurer d’une certaine pertinence des crédits accordés et de produire une certaine mobilisation locale. L’inconvénient, du point de vue du rôle de l’État qui est aussi d’assurer la solidarité nationale, c’est que les villes sélectionnées sont, a priori, celles qui disposent déjà des moyens d’élaborer rapidement un projet. Sont exclues d’office celles qui ne disposent pas de ces moyens, ne serait-ce qu’en termes de savoir-faire. L’inégalité de ce point de vue, sur un aspect crucial pour la politique de la ville, est donc plus probablement renforcée que combattue » (CNV, 1998).
Cette question revêt une actualité certaine dans le contexte présent car le budget de la rénovation urbaine est réparti pour l’essentiel sur la base d’un système d’appel à projets national qui place en concurrence l’ensemble des villes françaises (Epstein, 2008a) ; bien que portant sur des montants financiers beaucoup plus limités, cette même logique est à l’œuvre pour la distribution des ressources du plan Espoir banlieues. Il est frappant de constater la similitude entre les inquiétudes exprimée naguère par le CNV et aujourd'hui par les représentants de l’IR-DSU, le réseau des professionnels du développement social urbain : « La nouvelle logique vise plus d’efficacité, mais l’État (...) prend le parti de la concurrence entre les territoires. Risquent donc de n’avoir accès aux ressources que les collectivités les plus aptes à répondre rapidement aux appels à projet, celles qui sont les mieux dotées en ressources financières et humaines, et qui ont une volonté politique formalisée dans un véritable projet de territoire. (...) Le risque est grand de voir s’accroître les inégalités entre collectivités » (Arnaud, Valette, 2006).
Le mécanisme de péréquation fiscale de la Dotation de solidarité urbaine –qui a connu une montée en régime parallèle au développement des appels à projets de l’ANRU– vient compenser, en principe, de tels effets inégalitaires. En créant la DSU, le législateur a entendu corriger l’inégalité des charges socio-urbaines supportées par les villes, notamment celles qui ont un produit fiscal trop faible pour les assumer97. Aussi a-t-il prévu de faire jouer la solidarité entre villes bénéficiant d'une richesse fiscale importante avec des charges faibles et les villes correspondant à la situation inverse. La réforme des critères de répartition de l'enveloppe de la DSU, réalisée par la loi du 18 janvier 2005, a permis, grâce au doublement de cette enveloppe, puis par sa majoration de 120 millions d’euros par an98, d'opérer un certain rattrapage. Mais replacé dans le contexte général d’aggravation d’une ségrégation urbaine marquée par des écarts de richesse fortement accrus entre villes riches et pauvres –et, à l’intérieur des villes, entre quartiers riches et pauvres– on peut s’interroger sur la portée de cette réforme. Une analyse des revenus moyens des foyers fiscaux par commune de 1984 à 2004 met en évidence la croissance continue des disparités entre 1984 et 2004 (avec des pics durant les phases de rebond économique) qui s’est traduite par un accroissement de 40 % des disparités entre communes urbaines (l’écart entre communes rurales a au contraire diminué de 9 % dans la période). Ce phénomène est dû en partie à l’appauvrissement global des communes pauvres, mais surtout à l'enrichissement global des communes déjà les plus riches (Mignot, Bouzouina, 2007).
Alors que les collectivités territoriales françaises connaissent des inégalités de potentiel fiscal et de charges sans équivalent en Europe, on peut souligner aussi que les montants transférés par le biais de la DSU ne représentent finalement qu’une part extrêmement limitée des concours de l’État aux collectivités locales. Le poids de la DSU était estimé à 0,55 % de l’ensemble des dotations de l’État aux communes en 2001, sachant que ces dotations ne corrigeaient que 40 % des inégalités de « pouvoir d’achat » en services publics locaux des communes, sachant aussi que ces inégalités sont bien plus fortes en France que dans les autres pays européens, à cause de l’émiettement communal (Gilbert, Guengant, 2004 ; Guengant, 2007). Les chiffres de Gilbert et Guengant nous permettent ainsi estimer que la contribution propre de la DSU à la correction des inégalités de pouvoir d’achat entre communes était de 0,22 % avant la réforme de 2005.
Si la DSU pèse 1,16 milliards d’euros en 2009, les trois quarts des communes de plus de 10 000 habitants en bénéficient, ce qui atténue mécaniquement son effet péréquateur, même si son mode de calcul aboutit à des écarts significatifs de dotations moyennes (de 4,28 euros à 309,67 euros par habitant) et même si la création d’une Dotation de développement urbain (DDU), par la loi de finances pour 2009, permet de renforcer à la marge l’effort péréquateur en faveur des communes les plus en difficulté99. Cette dispersion est principalement liée à l’introduction dans la clé de répartition de la DSU de coefficients de majoration en faveur des communes dotées de ZUS et de ZFU, ce qui a eu pour effet de rendre un grand nombre de communes éligibles à la garantie de progression minimale (ONZUS, 2009). Le coefficient ZFU, en particulier, pèse lourd dans le calcul du montant de la DSU, mais il ne garantit pas un ciblage sur les communes les plus défavorisées (Cour des comptes, 2007).
Le Conseil national des villes a également souligné que nombre de communes percevant la DSU n’ont pas à supporter de charges particulièrement lourdes. Comme d’autres instances, le CNV souhaite rendre la DSU plus discriminante en rénovant ses critères d’éligibilité. En l’état, outre le problème de la référence à un zonage obsolète (voir supra), l’indicateur du revenu des ménages – le plus significatif pour rendre compte des charges socio-urbaines des communes – n’entre que pour 10 % dans la composition de l’indice synthétique de la DSU (CNV, 2007b).
On peut remarquer aussi que les villes percevant la DSU sont soumises à de très faibles contraintes concernant son utilisation au profit de leurs quartiers défavorisés –une question qui n’est pas seulement théorique pour les villes dont la part de la population résidant en ZUS est faible. Les maires sont bien tenus de présenter un rapport annuel retraçant les actions de développement social urbain entreprises au cours de l’exercice, mais sa transmission au préfet n’est pas prévue. Il n'est donc pas possible de savoir si les maires les ont tous établis, ni de connaître leur contenu puisqu’ils ne font pas l’objet d’une remontée systématique au niveau national (Cour des comptes, 2007).
Enfin, force est de constater que le mécanisme de la DSU ne contribue en rien au renforcement des solidarités intercommunales. Pour les communes riches qui voient leur DGF écrêtée au plan national, la compensation ne joue qu’à ce niveau (Derycke, 2007). Ce mécanisme national pourrait être corrigé par des solidarités territoriales plus étroites. En effet, si les disparités sont importantes entre régions et entre départements, elles le sont bien davantage entre communes (Guengant, Gilbert, 2004). Il n’y a pas d’évaluation nationale des péréquations intercommunales, mais seulement des données éparses mobilisées par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF). Il en ressort que les pratiques redistributives des intercommunalités sont très diverses. La mutualisation de la taxe professionnelle s’accompagne d’une redistribution des Communautés d’agglomération vers les communes membres, d’un niveau variable, qui peut aller jusqu’à un reversement intégral (Guengant, 2007). De façon générale, les EPCI traitent de façon égalitaire et non pas équitable l’ensemble des habitants de leur territoire, qu’il s’agisse de zones défavorisées ou favorisés. C’est principalement par le truchement de la gestion des charges transférées que les EPCI opèrent des redistributions de ressources sur ces territoires (Conjuguer, 2007).
Les pratiques intercommunales sont donc fort éloignées des intentions affichées par les promoteurs de la loi Chevènement (et de la loi SRU), qui érigeait la structuration intercommunale en ultime rempart contre la formation d’un« apartheid urbain ». P. Estèbe (2004c) a montré que la nature même des regroupements intercommunaux laisse peu de marges pour faire jouer les solidarités puisque la majeure partie de ces regroupements se font sous le régime de l’« homogamie », c'est-à-dire de l’entre-soi ou du « club » de communes socialement homogènes, qu’elles soient riches ou pauvres. Compte tenu de la nature de la fiscalité locale en France (avec une part élevée des ressources fiscales des collectivités tirées de la taxe professionnelle), la notion de commune pauvre ou de commune riche est d’ailleurs ambiguë si l’on ne distingue pas entre richesse (ou pauvreté) fiscale et richesse (ou pauvreté) sociale. Or, selon la présence d’activités économiques sur leur territoire, il existe des communes socialement riches et fiscalement pauvres, et réciproquement (Préteceille, 1993 ; Davezies, 2002). Dans ce contexte, la mutualisation intercommunale du produit de la taxe professionnelle peut avoir un effet anti-redistributif, notamment pour des communes socialement pauvres – abritant potentiellement une large population en ZUS – mais fiscalement riche : « Telle qu’elle est aujourd’hui conçue, et portant essentiellement sur la fiscalité directe des entreprises et pas sur celle des ménages, il n’est pas certain que la redistribution territoriale soit une bonne chose pour les populations les plus pauvres » (Estèbe, 2004c).
Que peut-on attendre de la concentration des moyens sur des quartiers ciblés ? Les leçons du New Deal for Communities en Grande-Bretagne
Le programme New Deal for Communities (NDC) peut être considéré comme le fleuron de la politique urbaine du New Labour en direction des quartiers défavorisés. Lancé en 1998, il est original à plus d’un titre. Tout d'abord parce qu’il a concentré des moyens exceptionnels sur un nombre limité de quartiers parmi les plus défavorisés du Royaume-Uni, à l’instar de ce qui est régulièrement proposé –mais non réellement suivi d’effets– de ce côté-ci de la Manche. Ensuite, l’un des objectifs du programme NDC a été formulé en termes de réduction des écarts entre ces quartiers et le reste du pays –une approche qui a directement inspiré la loi du 1er août 2003. Mais à la différence de son équivalent français, la démarche britannique s’est voulue résolument « holistique », en ne dissociant pas le traitement des lieux (place) de celui des (gens), et en faisant appel à une large mobilisation multi-partenariale dont les habitants sont l’une des composantes essentielle. Enfin, le programme a été intensivement évalué par le Centre for Regional Economic and Social Research de Sheffield Hallam University. Nous présentons quelques-uns seulement des très nombreux enseignements de cette évaluation, concernant l’intérêt et les limites d’un resserrement de la géographie prioritaire sur les quartiers « qui en ont le plus besoin ».
Batty E. et al. (2010), The New Deal for Communities Experience: A Final Assessment, The New Deal for Communities Evaluation Final Report, Volume 7, Centre for Regional Economic and Social Research, Sheffield Hallam University, Department for Communities and Local Government, March.
Depuis plus de quarante ans, les gouvernements britanniques ont tenté d’atténuer les désavantages de certains quartiers défavorisés, selon une méthode classique consistant à apporter un surcroît de ressources, souvent limitées et pour une durée déterminée, à des quartiers ciblés, afin de les engager dans un processus de régénération économique, sociale et/ou physique. S’il s’inscrit dans cette tradition, le programme New Deal for Communities (NDC) lancé en 1998 est l’une des politiques les plus volontariste et innovante jamais conduite outre-Manche.
À la différence des programmes antérieurs, qui avaient dispersé de faibles ressources sur un grand nombre de sites, le gouvernement Blair a choisi de concentrer les moyens exceptionnels du NDC sur 39 quartiers (comptant 9 900 habitants en moyenne) parmi les plus défavorisés du pays : 28 des 39 NDC appartenaient au dernier décile sur un indice multidimensionnel de pauvreté et 10 au second décile. Chacun de ces sites a reçu une dotation d’environ 50 millions de livres (environ 75 millions d’euros) du gouvernement, pour une période de dix ans.
Les partenaires locaux ont disposé d’une assez grande latitude pour concevoir leurs stratégies. Le gouvernement national a néanmoins fixé les grandes lignes du programme : transformer les 39 quartiers par une méthode « holistique », articulant des objectifs portant sur la transformation des lieux (place-related outcomes) et sur la promotion des gens (people-related outcomes). Dans le premier registre, les résultats attendus portaient sur la délinquance, la structuration d’une infrastructure collective dans les quartiers, et les logements et aménagements ; dans le second registre, le résultats concernaient les domaines de l’éducation, de la santé et du chômage. Le gouvernement a fixé, pour chacun de ces domaines, un objectif général de réduction des écarts entre les quartiers et le reste du pays. Il a par ailleurs invité les équipes locales à travailler en lien avec les services publics et incité les « communautés » (c'est-à-dire l’ensemble des acteurs du quartier, y compris et surtout les habitants) à figurer au cœur des processus de décision.
Les résultats du programme NDC sont satisfaisants sur le plan de la mobilisation institutionnelle. Au terme du programme, sept services publics (delivery agencies) différents étaient représentés, en moyenne, dans les comités de pilotage. Certains partenaires, comme les écoles, ont néanmoins éprouvé des difficultés à concilier les objectifs établis dans les NDC avec les objectifs fixés par leur administration centrale ; d’autres services publics ont été en proie à de constantes réorganisations internes, en raison de réformes nationales, ce qui a limité leur implication locale. C’est surtout la volonté de responsabiliser les acteurs du quartier –dont 40 % d’habitants, en moyenne, ont siégé dans les instances de pilotage– qui a été le trait distinctif du programme.
Trois postes ont absorbé les deux tiers des financements : le logement et les aménagements (32 %), l’infrastructure collective des quartiers, y compris les équipements (18 %) et l’éducation (17 %) ; viennent ensuite l’emploi (12 %), la santé (11 %) et la délinquance (10 %). Pour chacun de ces six thèmes, l’évaluation s’est attachée à mesurer l’évolution, entre 2002 et 2008, de six indicateurs, soit 36 indicateurs au total. Des améliorations ont été constatées sur 32 d’entre eux, les plus substantielles étant la perception par les habitants des transformations et du rôle du NDC dans ces changements. Comme beaucoup de ces indicateurs s’étaient améliorés dans le même temps à l’échelle du pays, l’évaluation a comparé la situation des quartiers avec d’autres quartiers défavorisés situés dans une aire géographique proche mais n’ayant pas bénéficié du programme. Cette comparaison, qui a porté sur 34 indicateurs, montre des évolutions plus favorables dans les quartiers visés par le NDC dans 21 cas, la plus importante étant la diminution, perçue par les habitants, des désordres liés aux incivilités. Mais les quartiers-témoins ont connu des progrès plus importants sur 13 autres indicateurs, en particulier ceux qui renvoyaient aux niveaux d’éducation.
L’impact des NDC est donc mitigé, ce que les évaluateurs ont expliqué par la faiblesse des ressources supplémentaires liées au programme, au regard de l’ensemble des dépenses publiques engagées dans les mêmes territoires : une étude menée sur un quartier NDC a montré que le programme équivalait à une dépense annuelle de 530 livres par habitant, contre 4 700 livres de dépenses publiques ordinaires annuelles. Les NDC n’ont d’ailleurs pas bénéficié de ressources additionnelles très importantes, avec un effet levier limité à 0.47 livre pour chaque livre investie au titre du programme.
Un second enseignement de l’évaluation mérite d’être souligné : les impacts sont plus faciles à obtenir sur les caractéristiques des quartiers (place-related outcomes) que sur celles des individus (people-related outcomes), ce qui laisse penser que l’amélioration de la situation du quartier n’a qu’un effet limité sur la situation sociale de ses habitants. Les évaluateurs invitent donc les pouvoirs publics à reconnaître l’impact limité inhérent à toute démarche même fortement ciblée. Ils invitent à la prudence le gouvernement britannique qui, en 2009, a publié un document intitulé « Transforming places, changing lives » réaffirmant la nécessité d’une priorisation des moyens sur les quartiers connaissant les difficultés les plus aigues. Si l’objectif est de réduire les écarts, l’expérience du programme NDC montre que c’est dans les quartiers les plus en difficulté, en particulier ceux dont la localisation géographique est la moins favorable, que l’impact de la politique de la ville risque d’être le moins sensible.
III - LES RÉALISATIONS ET RÉSULTATS DE TROIS PROGRAMMES :
RÉNOVATION URBAINE, ZONES FRANCHES ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Cette troisième partie met l’accent, non pas sur les modes d’action de la politique de la ville, mais sur ses actions et la façon dont elles affectent (ou non) les quartiers et habitants que cible cette politique. Aussi mentionnera-t-on les dispositifs organisationnels et les systèmes d’acteurs –qui restent au cœur de la plupart des évaluations locales– dans la mesure seulement où ils contribuent à expliquer les résultats observés. Parler, comme on le fait, de résultats plutôt que d’effets ou d’impacts paraît plus rigoureux car, ainsi qu’il a été vu100, la détermination des effets propres et de l’impact d’une politique publique sur la réalité sociale ou économique qu’elle vise nécessite un appareillage méthodologique qui n’a jamais été construit pour l’évaluation de la politique de la ville, à une exception près –et récente– concernant les Zones franches urbaines (Rathelot, Sillard, 2008).
Pour apprécier ces résultats, nous nous concentrerons sur trois programmes nationaux en cours : le Programme national de rénovation urbaine, les Zones franches urbaines et la Réussite éducative. À eux seuls, en particulier les deux premiers, ces programmes ont mobilisé une part très majoritaire des crédits « spécifiques » de l’État au cours des dernières années.
Les travaux qui renseignent sur leurs résultats sont hétérogènes. Certains sont académiques et d’autres administratifs ; ils peuvent avoir été produits dans un cadre évaluatif ou hors de celui-ci. Dans tous les cas, nous avons privilégié l’exploitation de travaux conduits à l’échelle nationale, les études locales n’étant mobilisées qu’à titre complémentaire. Pour chaque programme, nous rappellerons brièvement les objectifs poursuivis, avant de discuter, sur la base de travaux récents, la façon dont ces objectifs ont été ou non atteints.
A. LE PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE
Même si l'État s'en est financièrement désengagé depuis 2009, le PNRU reste le programme le plus coûteux jamais mis en oeuvre au titre de la politique de la ville. Sa programmation physique est quasi définitive depuis la fin de l’année 2009 (CES de l'ANRU, 2010) et une partie des projets locaux sont suffisamment avancés pour qu’il soit possible d’en tirer des enseignements, même si les connaissances disponibles à leur sujet demeurent très partielles.
1. La chaîne d’intentions du PNRU
L’objectif de la rénovation urbaine a été formulé en toute clarté par la loi du 1er août 2003, dont l’article 6 indique que « le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, (...) ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues ».
La référence au développement durable a été posée par le législateur dès 2003, mais jusqu’au Grenelle de l’environnement, cet objectif est demeuré très secondaire pour l’ANRU, qui ne l’a jamais traduit dans ses aides, ni conditionné celles-ci à la durabilité des projets de rénovation urbaine. Aussi la prise en compte des principes du développement durable reste-t-elle rare et difficile dans les projets de rénovation urbaine. À peine plus de la moitié des conventions y font référence, certaines dans une acception très large (sociale, économique, environnementale), d’autres de façon plus restrictive, sous l’angle de l’architecture et des formes urbaines, ou encore sous un angle purement technique (normes Haute qualité environnementale et Bâtiment basse consommation, recyclage des matériaux issus des démolitions, etc.) (Egis et al. 2009 ; CES de l'ANRU, 2010 ; Epstein, à paraître).
Il en va différemment de l’objectif de mixité sociale, érigé depuis l’origine en critère central de sélection des projets locaux par l’ANRU101. Afin de pouvoir tirer des enseignements des études disponibles quant aux effets et impacts du PNRU, il convient dans un premier temps d’expliciter la « chaîne d’intentions » qui sous-tend cette politique, qu’on peut résumer par deux énoncés : la cohésion par la mixité sociale et l’intégration par la banalisation urbaine (Epstein, 2008a). Un troisième objectif est apparu plus tardivement dans les textes réglementaires de l’ANRU : la promotion de parcours résidentiels « positifs ».
a) La cohésion par la mixité sociale
L’article 6 de la loi de 2003 fait des opérations visant le parc de logements (démolitions, réhabilitations, résidentialisations et constructions) les leviers permettant d’atteindre l’objectif de mixité sociale. Ces opérations qui, combinées, doivent aboutir à une diversification de l’habitat, mobilisent pratiquement les deux tiers des crédits de l’ANRU. La diversification de l’habitat est au centre de la stratégie de l’ANRU, comme l’indique clairement le règlement général de l’ANRU : « La diversification de l’offre de logement est l’outil principal d’amélioration de la mixité sociale lorsqu’elle donne au quartier une réelle attractivité pour des catégories de population différentes »102. Il est attendu de cette transformation du parc de logements une diversification du peuplement des ZUS, en organisant le départ d’anciens occupants des segments les plus paupérisés du parc social et l’attraction de populations plus fortunées dans les logements nouvellement construits.
Parmi les différents leviers de diversification de l’habitat, les démolitions sont l’instrument principal, car elles libèrent du foncier, dont une bonne part (entre 15 % et 35 %) est cédée à l’Association foncière logement (AFL, dit « la Foncière ») en contrepartie de ses apports financiers à l’ANRU (Brouant 2004). La Foncière y construit ou fait construire des logements locatifs du secteur libre, destinés à attirer des ménages ne répondant pas aux critères de ressources du logement social. S’ajoutent, sur ces espaces libérés par les démolitions, des logements en accession à la propriété et d’autres logements sociaux plus « haut de gamme » (logements sociaux intermédiaires) (Noyé, 2009).
L’importance accordée aux démolitions par l’ANRU se vérifie dans le fait qu’elle y consacre un quart de ses subventions, alors que cette famille d’opération ne représente que 9 % des investissements totaux du PNRU. La construction de logements sociaux, qui représente près de la moitié des investissements, est bénéficie de subventions nettement plus faibles de l’ANRU (CES de l'ANRU 2010). Ainsi les démolitions de logements sociaux vont-elles toucher entre 10 et 20 % des logements des ZUS concernées (Lelévrier, 2008). Si leur nombre avait été fixé à 200 000 par la loi du 1er août 2003, puis à 250 000 par la loi du 18 janvier 2005, le CES de l'ANRU indique que 130 000 logements sociaux seront finalement démolis au terme du PNRU. De même, le nombre de reconstructions de logements sociaux a été révisé à 120 000 et celui des réhabilitations à 300 000, contre respectivement 250 000 et 400 000 dans la loi de 2005 (CES de l'ANRU, 2010)103.
La reconstitution de l’offre de logements sociaux en dehors des ZUS constitue le second volet de la chaîne d’intentions qui structure cette politique de mixité sociale. Chaque démolition de logement social doit s’accompagner de sa reconstruction suivant la règle du « un pour un » édictée par l’ANRU et l’Agence insiste sur la nécessité de reconstituer prioritairement l’offre hors du quartier visé. La reconstitution doit donc contribuer au rééquilibrage de la répartition du parc HLM à l’échelle communale ou de l’agglomération et faciliter ainsi une dissémination des populations défavorisées en direction d’autres territoires marqués par une présence limitée de ces populations (Driant, 2004 ; Epstein, 2008a ; Kirszbaum, 2008b ; Avide et al., 2009). La complémentarité entre la loi SRU et la loi du 1er août 2003 renvoie à une philosophie de la mixité sociale largement partagée par les représentants des différentes sensibilités politiques, même si les majorités de droite ont tenté, à diverses reprises104, d’atténuer les contraintes de construction de logements sociaux dans les communes déficitaires au sens de la LOV, puis de la loi SRU (Subra, 2006 ; Epstein, Kirszbaum, 2006 ; Desponds, 2010). Cependant, l’un des points qui a le plus frappé les observateurs, à propos de la loi du 1er août 2003, est l’omission du cadre intercommunal et, plus largement, l’absence de stratégie de solidarité territoriale en matière de production de logements sociaux, alors même qu’il était prévu de reconstruire le parc d’habitat social à hauteur des démolitions programmées (voir par exemple CNH, 2007)105. Certains en ont déduit que c’était « à l'intérieur de la ZUS que la diversification de l'offre d'habitat devra se constituer par la réalisation de logements locatifs à loyers intermédiaires et par des logements destinés à l'accession à la propriété » (Méjean, 2003).
Si l’on passe maintenant des effets (la mixité sociale) aux impacts attendus des opérations de démolition-reconstruction, l’hypothèse structurante du PNRU (et plus largement de l’ensemble des politiques urbaines qui ont affiché un objectif de mixité sociale) est que la mixité sociale dans les ZUS renforcera la cohésion sociale dans ces territoires. Il faut cependant souligner que les deux notions de mixité et de cohésion demeurent très largement indéfinies dans les textes législatifs et réglementaires. La mixité se définit pour l’essentiel en négatif, comme l’absence de « concentration » (Lelévrier, 2001 ; Epstein, Kirszbaum, 2003). Le flou entourant le concept de cohésion sociale est tout aussi marqué (Donzelot, 2007). Les deux sont néanmoins liés à travers les discours assimilant les concentrations spatiales de minorités ethniques à une menace pour la République (Simon, 1996), et faisant donc du rétablissement de la mixité une condition du maintien de la cohésion nationale (Kirszbaum, 2004e).
Au-delà des discours sur « la réintégration des quartiers dans la République », les responsables nationaux et locaux de la rénovation urbaine juxtaposent différents registres explicatifs des effets négatifs d’une trop forte concentration territoriale des populations pauvres et/ou immigrées ou supposées telles. En retour, et bien qu’ils soient loin d’être confirmés par les sciences sociales (Authier et al., 2007 ; Epstein, 2008a ; Kirszbaum, 2008a), trois impacts sociaux principaux sont attendus d’une diversification du peuplement des quartiers : une amélioration de leur réputation permettant de réduire les discriminations liées au lieu de résidence ; la diffusion, grâce à la présence de groupes sociaux plus diversifiés et aux interactions de voisinage, de « modèles positifs » auxquels les populations défavorisées s’identifieraient, ce qui faciliterait l’adoption de normes comportementales et de valeurs jouant en faveur de leur intégration sociale ; enfin, la réduction, grâce à la déconcentration de la pauvreté, de la pression qui pèse sur les services publics locaux, notamment les services sociaux et scolaires, ce qui renforcerait leur performance sur le plan de l’insertion sociale de leurs publics.
b) L’intégration par la banalisation urbaine
Les grands ensembles ont fourni la solution à la crise du logement des décennies d’après-guerre ; ils sont désormais considérés comme le résultat d’une vaste erreur collective à l’origine des problèmes d’aujourd’hui (Lefèvre et al., 1992). La doctrine urbanistique qui a sous-tendu leur construction se caractérisait par l’uniformité interne des grands ensembles (Fortin, 1999) et par la production de « totalités autosuffisantes » en rupture avec le reste de la ville (Pinson, 1996 ; Oblet, 2005). Prenant le contre-pied systématique de cette approche, la doctrine urbanistique du PNRU peut se résumer par la formule de « l’intégration par la banalisation urbaine » (Epstein, 2007).
Divers effets et impacts sont attendus de la restructuration du parc de logements, de la réorganisation du foncier et des voiries, ainsi que de l’action sur les équipements, toutes ces interventions visant une meilleure « intégration » des quartiers et de leurs habitants dans la ville. Il s’agit en premier lieu de réintégrer les quartiers dans les marchés du logement. La rénovation urbaine s’inscrit à cet égard dans le prolongement de la politique de renouvellement urbain antérieure (Berland-Berthon, 2004 ; Bonneville, 2005). Diverses interventions doivent contribuer au changement d’image et à une demande extérieure accrue : rééquilibrage des statuts du parc de logements au profit du parc privé ; interventions sur le cadre bâti (démolitions, reconstructions et résidentialisations) pour diversifier les formes urbaines, ce qui passe notamment par la construction de « petits collectifs » ; amélioration de la gestion urbaine de proximité ; interventions sur les sols (redistribution du parcellaire, recomposition de la trame viaire), permettant de normaliser une structure foncière atypique et d’assurer la « mutabilité » des quartiers.
Il s’agit ensuite de réintégrer les grands ensembles dans les flux urbains, de les faire sortir d’un isolement qui favoriserait les « replis communautaires » (Kirszbaum, 2004e). L’action passe notamment par une reconfiguration de la trame viaire qui doit réorienter les flux de circulation. La création de voiries traversantes, là où n’existaient que des voies de contournement et des cul-de-sac, doit contribuer à en faire des morceaux de ville banalisés. Il s’agit aussi de donner à des populations extérieures des raisons de venir dans les quartiers, ce qui passe par la création ou la transformation d’équipements collectifs rayonnant à une échelle large (équipements dits « structurants ») et de locaux destinés aux activités économiques (Epstein, 2008a ; Guigou et al., 2009 ; CES de l'ANRU 2010 ; Kirszbaum, 2010).
Cette doctrine de banalisation urbaine de l’ANRU n’est jamais exprimée indépendamment de ses effets sociaux escomptés. Par ces opérations mettant fin à l’uniformité interne et l’autonomie externe des quartiers, la rénovation urbaine cherche à résoudre les problèmes sociaux qui s’y manifestent. Ainsi, les aménagements prévus visent à créer les conditions d’un contrôle social permanent de l’espace, permettant de diminuer la délinquance, ce qui correspond aux effets attendus de la résidentialisation (Vallet, 2007 ; Oblet, 2008) dans la continuité des théories américaines de l’« espace défendable » (Newman, 1972). La lutte contre les conduites déviantes passe aussi par le travail. La création de locaux d’activités et l’articulation avec les zones franches, relancées par la loi Borloo, ne relèvent pas seulement d’un objectif de mixité fonctionnelle, mais doivent aussi favoriser l’intégration professionnelle des habitants, sachant que le « chantier du siècle » suscite des milliers d’emplois directs dans le bâtiment et les travaux publics, potentiellement accessibles aux actifs des ZUS. C’est ainsi que l’ANRU s’est dotée d’une charte d’insertion (prévue par la loi Borloo), qui demande que 5 % des heures de travail générées par les travaux d’investissement financés par l’Agence soient réservées aux habitants des ZUS.
c) Des parcours résidentiels facilités
Ce dernier effet attendu de la rénovation urbaine n’a été formulé que plus tardivement par l’ANRU, même s’il pouvait figurer dans certaines chartes locales du relogement (DIV, PUCA, 2008). Celles-ci peuvent associer le parcours résidentiel à l’idée d’une « adaptation » du logement à la situation et aux aspirations des ménages, mais également à celle d’un « projet résidentiel », dans la perspective d’une « trajectoire ascendante ». Pour sa part, l’ANRU a introduit dans son règlement général de 2007 la notion de « qualité des parcours résidentiels » des ménages, tout en insistant sur « des conditions financières compatibles avec leurs ressources », dans le respect des « équilibres de peuplement ». Ainsi, le déplacement résidentiel contraint par la démolition pourrait participer d’une remise en mouvement des populations, réamorçant des parcours promotionnels. En ce sens, un minimum de trois propositions de logement doivent être faites aux locataires et des dérogations possibles pour ajuster le loyer du nouveau logement aux capacités des familles (Lelévrier, 2008). C’est également en 2007 que l’ANRU a établi la règle selon laquelle l’octroi d’un financement PLUS-CD est conditionné à l’engagement des bailleurs sociaux à reloger un nombre de ménages au moins égal à 50 % du nombre de logements financés en PLUS-CD, dans des logements sociaux neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans.
***
C’est à l’aune de cette chaîne d’intentions qu’une évaluation globale du PNRU aurait pu être menée. Elle n’a pas (encore ?) eu lieu. Aucune instance d’évaluation –y compris le Comité d'évaluation et de suivi de l’ANRU– n’a fait retour sur les intentions initiales du programme, dans le but de les clarifier et de poser les questions d’évaluation afférentes. On ne dispose du coup que de travaux certes relativement nombreux, mais partiels, engagés dans le cadre des activités du CES de l'ANRU ou en dehors de celles-ci, pour apprécier les effets et impacts du programme national. En comparaison de l’importance accordée à ces effets et impacts dans l’évaluation des politiques de rénovation urbaine d’autres pays – notamment anglo-saxons (Kirszbaum, 2008a, 2009b) – la situation française se caractérise donc par une certaine indigence.
2. Des quartiers plus mixtes au plan social ?
Si l’ANRU fait l’hypothèse que la diversification des statuts au sein du parc de logements est un vecteur d’attraction d’une population « différente », les données sur le peuplement des quartiers rénovés disponibles à l’échelon national et local–ne permettent pas d’en vérifier la validité. Quand des outils d’observation existent, ils ne concernent que le parc social, alors que c’est l’habitat privé qui a été pensé comme le levier essentiel d’une diversification de la population. Force est de constater, plus largement, le caractère lacunaire des travaux relatifs aux effets de la rénovation urbaine sur l’attractivité des quartiers, ou sur l’évolution du peuplement du parc social existant, réhabilité ou non (Act consultants et al., 2009).
Les données disponibles ne concernent pas les territoires, mais les ménages relogés dans le cadre des démolitions. Différentes études ont ainsi cherché à exploiter les statistiques tirées des dispositifs de suivi des relogements, mais il subsiste sur ce plan d’importants biais méthodologiques. Les statistiques sur le relogement sont « bricolées » par chaque bailleur social et chaque commune à partir de leurs sources propres, sans effort national d’homogénéisation de ces données. Un autre aspect problématique tient à la « déperdition » d’une partie des résidents des immeubles démolis qui n’ont pas recours aux procédures de relogement et qui échappent ainsi à l’observation (Lelévrier, 2005b, 2008).
a) Le scénario de la mixité « exogène » en échec
La diversification de l’habitat est au cœur de la stratégie de mixité de l’ANRU, mais comme l’a relevé le Comité d'évaluation et de suivi, les enquêtes annuelles de l’agence auprès des porteurs de projet et des maîtres d’ouvrage souffrent d’un manque de fiabilité : ces enquêtes restent facultatives et déclaratives, et c’est seulement en 2009 que l’ANRU y a intégré des indicateurs sur la diversification de l’habitat (CES de l'ANRU, 2010). À ces réserves près, les données de l’ANRU, retraitées par le CES et l’ONZUS, montrent qu’au 31 décembre 2008, 9 712 logements « non sociaux » participaient à l’effort de diversification ; ils représentaient environ le tiers de l’ensemble des logements reconstruits, sachant qu’une partie de ceux-ci sont reconstitués hors site (CES de l'ANRU, 2010). Une enquête spécifique conduite en 2008 en Île-de-France a analysé la programmation des logements dans 72 conventions de rénovation urbaine. Il en ressort un taux de renouvellement (parc privé neuf plus parc social neuf/total des logements du quartier) moyen de 16,9 %. Les variations sont importantes d’un site à l’autre. Ainsi, le taux de renouvellement est-il inférieur à 10 % dans près de la moitié des sites et n’atteint plus de 30 % que dans un cas sur six ; encore cette diversification est-elle, dans près de la moitié des cas, le fait de logements sociaux « haut de gamme » et non de logements privés. Sur la base des conventions, il apparaît donc que le parc de logements des quartiers ANRU connaîtra une évolution modeste, faisant passer la part du parc privé de 35 à 40 %, un chiffre qui apparaît néanmoins supérieur (+20 % de logements privés) à la lumière d’une investigation plus ciblée sur 22 sites franciliens qui prend en compte les programmations effectives au-delà des conventions initiales (Noyé, 2009). Dans une autre étude réalisée sur 12 sites, à l’échelle nationale, la tendance est aussi à la modification, à la hausse (mais dans certains sites à la baisse), du nombre de logements contribuant à la diversification de l’habitat. Mais l’étude conclut, là aussi, à un effet modeste, puisque le taux de diversification moyen du parc de logement s’établit à 9,1 %, y compris les programmes semi-publics (accession sociale et PLS) (Act consultants et al., 2009).
Les explications fournies renvoient à la baisse du nombre de démolitions programmées, qui a réduit d’autant le foncier mobilisable pour diversifier le parc existant (CES de l'ANRU, 2010). Des annulations de programmes privés interviennent aussi, justifiées par l’impossibilité, pour les promoteurs privés, d’équilibrer financièrement ces opérations (Act consultants et al., 2009). Pourtant, les équipes municipales ne ménagent pas leurs efforts pour attirer ces promoteurs, en leur offrant les terrains les plus intéressants, en cédant le foncier à des prix avantageux, etc. Malgré cela, « dire que la promotion privée ne s'est pas pleinement emparée de l'opportunité que constitue l'intervention en territoire de rénovation urbaine est un euphémisme », lit-on dans une étude portant sur cinq sites de province, dont le marché de l’habitat est, il est vrai, détendu (Avide et al., 2009). Cette étude invoque la crise immobilière, tout comme une autre conduite dans trois villes de la Marne (Fatmi et al., 2009) et comme celle menée en Île-de-France (Noyé, 2009). Mais la première étude ajoute qu’« il serait toutefois erroné de rendre le contexte économique actuel seul responsable du faible enthousiasme des promoteurs à investir dans ces quartiers dits sensibles », et se montre pessimiste quant à la capacité du processus de diversification à attirer une population plus aisée et extérieure au quartier. Il ressort de ces différents travaux que les promoteurs privés sont également peu enclins à investir dans les « zones tampons » situées dans un périmètre de 500 mètres autour des zones ANRU et bénéficiant, depuis la loi du 13 juillet 2006, d’une TVA à taux réduit (5,5 %) pour les opérations d’accession à la propriété.
La principale déconvenue vient en fait de l’engagement plus que timoré de l’Association foncière logement. L’AFL était considérée par l’ANRU comme l’outil majeur de la diversification. Elle devait avoir un rôle précurseur et entraîner derrière elle des opérateurs privés (Act consultants et al., 2009). En pratique, l’AFL se révèle être un acteur marginal de la diversification, n’y contribuant qu’à hauteur de 1,4 %, contre 53 % pour les promoteurs privés ou les bailleurs sociaux proposant une accession libre ou sociale à la propriété106. Le retrait de l’AFL peut s’expliquer par des facteurs de nature juridique ou technique. Mais il tient plus fondamentalement au fait que le pari initial des promoteurs nationaux de la rénovation urbaine –faire reposer la diversification du peuplement sur l’arrivée de ménages extérieurs très différents, par leur profil, des populations locales– apparaît rétrospectivement comme irréaliste. La Foncière propose en effet des produits locatifs plutôt haut de gamme, à des prix proches de ceux du marché, qui sont le plus souvent inaccessibles pour les résidents des ZUS. Elle ne peut donc puiser dans le potentiel de clientèle locale (Act consultants et al., 2009 ; Avide et al., 2009). D’où la position attentiste de la Foncière qui attend de voir s’engager d’autres investisseurs privés, avant de s’engager en première ligne. En outre, il faut souligner que l’AFL, qui intervient sans lien avec les Comités interprofessionnels du logement (qui gèrent localement le 1 % logement), est souvent considérée comme ayant été « imposée » aux acteurs locaux par le niveau national, sans débat ni prise en compte des enjeux propres à chaque site (Epstein, 2007 ; Avide et al., 2009 ; Fatmi et al., 2009).
À l’inverse de la Foncière, certains promoteurs privés jouent la carte de la primo-accession et d’une offre à prix maîtrisés susceptibles d’intéresser la population des quartiers (Act consultants et al., 2009), même si, en pratique, et contrairement aux attentes de l’ANRU, ce sont surtout les bailleurs sociaux qui se positionnent en véritables moteurs de la diversification de l’habitat. D’autant plus que le Plan de relance a conduit des promoteurs à céder aux bailleurs sociaux, sous forme de « Ventes en l'état futur d'achèvement » (VEFA), des programmes dont la commercialisation apparaissait compromise (Lagnaoui, 2009 ; Avide et al., 2009 ; Fatmi et al., 2009 ; CES de l'ANRU, 2010). Les bailleurs sociaux rencontrent eux-mêmes des difficultés pour commercialiser leurs programmes sociaux haut de gamme. C’est le cas des logements sociaux intermédiaires (prêt locatif intermédiaire, prêt locatif social), réservés à des ménages aux revenus moyens, qui participent à 13 % à l’effort de diversification (CES de l'ANRU, 2010), mais qui apparaissent, tout comme les logements locatifs libres de l’AFL, inadaptés au contexte local (Avide et al., 2009 ; Noyé, 2009).
En définitive, ce sont bien les habitants des quartiers, ou d’autres quartiers similaires, et non des ménages extérieurs dont le profil se distinguerait de celui des ménages des ZUS, qui apparaissent comme les premiers clients des produits de la diversification, et notamment de l’accession à la propriété. À l’encontre d’une lecture parfois misérabiliste de ces quartiers, il ressort en effet des différentes enquêtes précitées l’existence d’« un potentiel souvent insoupçonné et parfois important de ménages logés dans les quartiers, (qui) souhaitent accéder à la propriété et disposent d’un apport personnel significatif » (Noyé, 2009). Certains promoteurs privés l’ont d’ailleurs bien compris, qui partent à la conquête de cette clientèle qui n'a pas les moyens d'acheter dans des quartiers banals (Avide et al., 2009). Dans le même ordre d’idée, les opérations d’accession sociale, qui représentent 8 % des opérations livrées en diversification (ONZUS 2009), attirent de nombreuses familles locales, souvent en nombre supérieur à l’offre proposée (Noyé, 2009). C’est que les bailleurs sociaux –notamment les offices d’HLM– manquent souvent de savoir-faire pour monter et commercialiser ce type d’opérations, même s’ils sont de plus en plus nombreux à s’y engager (Act consultants et al., 2009). Leur réticence vient aussi d’une appréciation des risques de surendettement (Noyé, 2009), aiguisée par l’observation de ce qui se produit dans les copropriétés dégradées sur lesquelles l’ANRU intervient en complément des interventions de l’ANAH (CES de l'ANRU, 2010).
Le principal enseignement de ces travaux est donc le suivant : l’équation posée dans le PNRU entre logements privés et attraction de ménages extérieurs ne se vérifie pas, ou doit être fortement nuancée (Avide et al., 2009 ; CES de l'ANRU, 2010). L’hypothèse selon laquelle une offre privée allait attirer des ménages plus fortunés de l’extérieur serait le signe d’une vision « mécaniciste » qui envisage l’introduction de produits logements différents comme un gage suffisant du rééquilibrage social attendu (Act consultants et al., 2009). Elle se fonde sur un diagnostic en partie erroné car les quartiers ANRU comportent déjà une part importante de parc privé (Noyé, 2009).
Si les opérations de rénovation urbaine ne sont pas parvenues à susciter une mixité « exogène », elle ont pu contribuer à maintenir une mixité « endogène »107. Dans cette optique, et même si « cela n'est pas ce qu'escomptaient l’ANRU et certains maires », les opérations en accession peuvent être regardées comme des outils « de diversification sociale interne », permettant de garder des populations « plutôt que de les voir s'envoler pour les sphères souvent attirantes du pavillon périurbain » (Avide et al., 2009). Il s’agit dès lors de les « fixer » dans le quartier (Fatmi et al., 2009) en leur ouvrant « la possibilité de parcours résidentiels ascendants (...) qui peuvent à terme engendrer une mixité socioprofessionnelle endogène » (CES de l'ANRU, 2010). Devant « l'incapacité chronique de la plupart des projets à faire venir des populations extérieures », certains acteurs locaux en arrivent à reformuler la stratégie locale, non plus comme une politique de mixité sociale, mais de mixité du statut des logements, « remettant les populations du quartier sur les rails d'un parcours résidentiel classique » et contribuant « à une forme de banalisation du quartier impensée par l'ANRU » (Avide et al., 2009). Ainsi, la notion de mixité céderait le pas, dans certains sites, à celle de « parcours ascendant », et « si certains porteurs de projets partent d’une conception initiale plus ou moins fantasmatique (l’éternel retour des classes moyennes), ils en arrivent finalement, au cours du projet et de sa programmation, à des positions nettement plus pragmatiques, qui reposent en somme sur le constat que ces quartiers sont tout de même des quartiers populaires, et le resteront pour partie ou en majorité » (Act consultants et al., 2009).
Il faut toutefois nuancer l’ampleur de ce revirement stratégique et ses effets réels. Si certains avancent l’hypothèse d’une rénovation urbaine qui parviendrait à enrayer le processus de précarisation des quartiers grâce à des opérations d’accession qui enracineraient des ménages qui, sans elles, auraient quitté leur quartier, les mêmes reconnaissent que l’évolution du peuplement du quartier est également tributaire du profil des « entrants », que ce soit dans le parc social neuf ou réhabilité (Act consultants et al., 2009). Or, les stratégies volontaristes de réservations de logements sociaux neufs ou récemment réhabilités au profit de ménages extérieurs apparaissent fortement mises à mal par les nécessités du relogement (Kirszbaum, 2010), notamment dans les marchés tendus, comme celui de l’Île-de-France, où la vacance du parc n’est pas suffisante pour absorber l’ensemble de ces relogements (Acadie, 2005). S’ajoute la contrainte nouvelle que représente la loi DALO, qui aboutit dans certains sites à mobiliser une partie substantielle des logements neufs au profit de cette nouvelle catégorie de ménages prioritaires venant côtoyer l’autre catégorie prioritaire que sont les ménages à reloger (Kirszbaum, 2010).
Dans l’attente d’analyses statistiques de l’évolution du peuplement des quartiers en rénovation urbaine, on peut aussi faire l’hypothèse que le processus de relogement aboutit à l’effet inverse du résultat recherché puisqu’à l’annonce des démolitions et, au fur et à mesure de l’avancement des relogement, ce sont les ménages les plus mobiles et solvables qui partent les premiers, tandis que les difficultés à reloger les ménages les moins solvables contribue au contraire à fixer ces derniers dans le quartier. Comme l’avait remarqué Christine Lelévrier, « le risque est de favoriser, sans le vouloir, le départ des ménages les plus mobiles, ceux qu’on souhaiterait précisément maintenir sur place. En revanche, tout dans le processus de relogement conduit au maintien sur place des ménages les plus défavorisés et les moins mobiles » (Lelévrier, 2005b). Dans un article paru récemment, la même auteure infléchit cette lecture, considérant qu’« en France comme ailleurs, la rénovation associe (pour éviter le départ des habitants ayant un peu de revenus) mixité et amélioration de la "qualité des parcours résidentiels" ». Elle en veut pour preuve le fait que « la moitié des ménages déplacés par les démolitions devrait être relogée dans les logements sociaux neufs, condition posée par l’Agence de rénovation urbaine pour l’obtention de financements avantageux pour la construction neuve (PLUS-CD). Ainsi, la rénovation urbaine concrétise et facilite la mise en oeuvre de stratégies d’ancrage, de fidélisation résidentielle et territoriale des habitants qui ont un peu plus de revenus » (Lelévrier, 2010).
Une autre lecture de la rénovation urbaine a été proposée à partir d’enquêtes menées dans une douzaine de sites (Kirszbaum 2007, 2010). S’agissant tout d'abord de la règle de l’ANRU sur le financement des PLUS-CD, Thomas Kirszbaum montre, comme le CES de l'ANRU (2010), que seule une minorité d’habitants relogés, très faible dans certains sites, tire ou tirera un bénéfice effectif d’une offre neuve ou récemment réhabilitée. La règle de l’ANRU n’impose pas que la moitié des ménages déplacés soient relogés dans des logements neufs ou récemment réhabilités. Elle exige seulement que la moitié de ces logements soient attribués à des ménages relogés. Aussi, pour que la moitié des ménages relogés en bénéficie faudrait-il que la reconstitution du parc social détruit se fasse intégralement en PLUS-CD et que la moitié de ces nouveaux logements soient effectivement attribués à des ménages relogés, ce qui est très loin d’être le cas dans la pratique. Et même quand des villes reconstituent très majoritairement le parc social détruit avec des PLUS-CD, elles sont confrontées à diverses contraintes opérationnelles (montant des loyers, décalage temporel entre les relogements et la livraison des programmes neufs, difficulté de proposer deux relogements successifs à des dates très éloignées aux mêmes ménages) pour les attribuer à des ménages issus des bâtiments démolis.
L’idée selon laquelle la politique française de rénovation urbaine pourrait mise sur le même plan que d’autres expériences étrangères qui valorisent une mixité « endogène » peut être également discutée. D’autant qu’il existerait une spécificité française tenant à la réticence des élus à assumer l’existence durable de quartiers de minorités, fussent-ils des quartiers où se fixent des classes moyennes appartenant aux minorités visibles (Kirszbaum, 2008c). Bien que la stratégie de mixité « exogène » rencontre un succès des plus mitigé, on ne voit pas se dessiner de démarche complémentaire – voire alternative – à une stratégie qui accorde la primauté à l’attraction de ménages susceptibles de tirer la composition sociale de quartiers « vers le haut », et dont le profil ethnique permettait aussi un rééquilibrage du peuplement sous cet angle (Kirszbaum 2007, 2010). Sans forcément renoncer à l’idée d’attirer de nouveaux habitants, il s’agirait d’inverser l’ordre des priorités en s’attachant, sinon d’abord, du moins de façon concomitante, à stabiliser dans le quartier les ménages les mieux dotés en capital social, économique ou éducatif. Cela supposerait de les impliquer beaucoup plus fortement dans le processus de décision, au lieu de rabattre la « participation des habitants » sur de simples opérations de pédagogie et de communication (Donzelot, Epstein, 2006). Si la plupart des villes sont en voie d’abandonner pragmatiquement – ou de remettre à un futur hypothétique– leurs objectifs de mixité exogène (Act consultants et al. 2009), très rares sont celles qui ont développé des stratégies hétérodoxes au regard de celle que continue de préconiser l’ANRU (Epstein, 2008a) et qui reste fondée sur le couple « dispersion-attractivité ». Pourtant, nombre de praticiens locaux – et certains élus eux-mêmes – expriment individuellement leur scepticisme vis-à-vis de cette stratégie nationale. Mais la manière d’articuler mixités exogène et endogène n’est nulle part discutée collectivement dans les sphères politico-techniques, et encore moins avec les habitants (Kirszbaum, 2007). En amont, aucun diagnostic ne s’attache par exemple à comprendre les stratégies résidentielles des ménages présents au lancement des opérations afin de mieux calibrer les produits de diversification et les programmes sociaux en fonction de leur projet résidentiel. En aval, la pression exercée par l’ANRU sur le respect du calendrier des démolitions annihile d’éventuelles stratégies locales d’enracinement des ménages dits « structurants », en particulier les ménages les plus jeunes et les mieux insérés professionnellement, dont les démolitions précipitent au contraire le départ (Kirszbaum, 2010).
b) Un déplacement des zones de « concentration », des interactions limitées entre anciens et nouveaux habitants
Toutes les études appuyées sur les données, même fragiles, concernant les quartiers de destination des ménages relogés convergent pour décrire un processus de reformation des « concentrations » que la rénovation urbaine entendait dissoudre. Ainsi, 75 % des ménages seraient relogés en Zone urbaine sensible (USH, 2009) ou dans des environnements sociaux équivalents (Harzo et al., 2007) ; à partir de chiffres partiels de l’ANRU, le Comité d'évaluation et de suivi avance pour sa part le pourcentage de 68 % de ménages relogés en ZUS ou dans des quartiers équivalents (CES de l'ANRU, 2010). La tendance la plus marquante est la re-concentration des ménages les plus défavorisés dans les immeubles, là où se trouve une offre encore disponible de grands logements et/ou de logements à bas loyers (Lelévrier, 2010), que ce soit dans des secteurs du quartier d’origine, ou dans d’autres quartiers de la ville, non traités par la rénovation. Si les relogements sur place prédominent à peu près partout, dans une fourchette généralement comprise entre 50 à 90 % des ménages relogés (Lelévrier, 2008 ; USH, 2009 ; Lelévrier, 2010), une part également significative (25 %) des relogements hors site se font en ZUS ou dans des quartiers équivalents, aboutissant à « un effet de transfert des difficultés », de sorte que, au moins dans certains cas, « l’amélioration de la situation sociale du quartier en rénovation urbaine engendre la détérioration de cet autre quartier » (CES de l'ANRU, 2010). Ce phénomène de déplacement des poches de concentration a été relevé aussi à l’étranger (Atkinson, Kintrea, 2000 ;Hiscock, 2002 ; Kingsley et al. 2003).
Les effets de la rénovation urbaine en termes de mixité sociale doivent par conséquent être appréciés à différentes échelles. Les premiers résultats observés en France tendent à montrer qu’elle favorise la constitution d’«isolats » de mixité dans un environnement largement inchangé, au prix d’une accentuation de la ségrégation au sein même des ZUS. Ces résultats rejoignent ici aussi des constats effectués à l’étranger, par exemple en Grande-Bretagne, d’où il ressort une segmentation sociale et territoriale accrue par la diversification très localisée de l’habitat. Dans le cas britannique, de nouveaux clivages spatiaux apparaissent, qui recoupent la distinction entre des micro-secteurs dédiés à l’accession à la propriété et d’autres réservés au logement locatif social (Vamplew, Wood, 1999 ; Silverman et al., 2005). Côté français, la diversification de l’habitat semble davantage préoccupée par la mixité des statuts d’occupation privé-social, mais elle prend effet à des échelles trop réduites pour produire un rééquilibrage d’ensemble de la composition sociale des ZUS. Car le périmètre opérationnel du PRU ne coïncide par forcément avec celui de la ZUS. En outre, le mixage de logements publics-privés intervient dans la plupart des cas aux franges des quartiers, sans en attaquer le « cœur ». Cette focalisation de l’intervention aux échelles infra-ZUS produit par conséquent davantage de ségrégation si l’on considère les contrastes sociaux du point de vue global de la ZUS (Act consultants et al. 2009). Dans les grands quartiers en particulier, les communes et les bailleurs ont tendance à développer des stratégies de requalification des seuls secteurs destinés à accueillir les nouveaux programmes de construction de locatif privé ou d’accession, ou à être résidentialisés, ce qui engendre une relative séparation entre les secteurs rénovés et le reste du grand ensemble, où vont se reconcentrer les ménages les plus pauvres (Lelévrier, 2005b). Cette juxtaposition aboutit peut-être à une composition sociale plus diversifiée de certaines ZUS, mais il s’agit alors d’une « mixité par la fragmentation » opérant par le regroupement d’habitants ayant un peu plus de revenus dans des secteurs spécifiques du quartier (Lelévrier, 2010).
Les effets de cette mixité résidentielle spatialement très ciblée vont à l’encontre de l’objectif de renforcement de la cohésion sociale par la mixité. La création d’îlots regroupant des habitants plus fortunés suscite plus souvent des pratiques d’évitement et de repli qu’un développement des échanges de voisinage (Lelévrier, Guigou, 2005). Les ménages arrivés de l’extérieur, en particulier, fréquentent peu les équipements du quartier, dans un climat de méfiance persistant avec les anciens habitants (Fatmi et al., 2009). D’autant plus que la focalisation des efforts sur des segments du quartier alimente le ressentiment des habitants qui résident dans les secteurs non-traités. Les tensions et situations conflictuelles qui peuvent en découler sont rarement anticipées par les responsables locaux des projets de rénovation urbaine. Les modes d’appropriation différenciés des équipements et des espaces par des groupes hétérogènes n’ont pas davantage été anticipés en amont des projets, de sorte que la coexistence de groupes hétérogènes constitue une sorte d’impensé de la rénovation urbaine (Kirszbaum, 2010).
Très peu de travaux permettent d’apprécier les effets propres de la rénovation urbaine sur les échanges entre habitants. On peut se référer en revanche à d’autres travaux, conduits en dehors ou avant la rénovation urbaine. Ils tendent tous à montrer que l’hypothèse suivant laquelle la diversité du peuplement faciliterait le développement d’interactions de voisinage se trouve largement infirmée par la réalité des pratiques sociales (Authier, 2007 ; Epstein, 2008a). Certains auteurs vont plus loin et formulent l’hypothèse selon laquelle l’accentuation de la ségrégation, au cours des trente dernières années, témoignerait d’une volonté généralisée de chaque groupe social de se mettre à distance du groupe immédiatement inférieur (Donzelot et al., 2003 ; Maurin, 2004).
La question scolaire est un domaine particulièrement emblématique de ces logiques de l’entre-soi qui mettent en échec les hypothèses relatives aux effets d’entraînement de la mixité résidentielle sur la condition des plus défavorisés. Les éléments d’évaluation existant sur les effets scolaires de la rénovation urbaine laissent à penser que ces effets sont quasi nuls sur la mixité des publics scolaires, laquelle est pourtant l’un des rares champs de la vie sociale où l’effet d’entraînement de la mixité est démontré (Duru-Bellat, 2003, 2009). Sauf exception, les écoles – et moins encore les collèges ou les lycées sur lesquels l’impact de la rénovation urbaine est encore plus marginal – sont très peu prises en compte dans les PRU comme des éléments centraux d’une stratégie de mixité. Ils le sont davantage comme dimension d’une stratégie d’attractivité résidentielle, mais sans que les projets de rénovation urbaine aient été considérés comme une opportunité de reposer la question de la mixité dans les établissements, et moins encore dans les classes. Si tant est que la volonté existe localement de se servir de la recomposition de l’habitat pour tenter d’assurer une évolution parallèle de la composition sociale (et éventuellement ethnique) des écoles, la quasi-suppression de la carte scolaire prend la rénovation urbaine à contre-pied. Plus gênant, il semble que des élus s’accommodent de la libéralisation de la carte scolaire, des inscriptions dans le privé ou de la création d’écoles séparées pour les nouveaux habitants pour « sauver » leurs objectifs de mixité résidentielle (Kirszbaum, 2010). Ils savent en effet que l’école joue un rôle déterminant dans les choix de localisation résidentielle des ménages plus aisés, qui n’accepteront de venir dans ces quartiers qu’à la condition d’y trouver une école qui préserve les chances de succès scolaire de leurs enfants (Lelévrier, 2005b).
Au-delà du seul enjeu de la mixité à l’école, sur lequel les données de l’Éducation nationale sont particulièrement difficiles à obtenir (CES de l'ANRU, 2010), les rares études disponibles témoignent d’une faible prise en compte de l’enjeu scolaire dans les PRU, ne serait-ce que sous l’angle de la rénovation physique des équipements (Tetra, 2006, 2009). Une première étude du cabinet Tetra portait sur l’analyse de 84 conventions de rénovation urbaine. Elle montrait que seule la moitié d’entre elles prévoyait une intervention sur les équipements scolaires. La moyenne de ces interventions ne dépassait pas 2,4 % des engagements financiers et dans plus de 90 % des cas, elles ne visaient que les écoles maternelles ou primaires, les seules à être subventionnées par l’ANRU, alors que les collèges sont la clé de voûte de l’attractivité d’un quartier. Une seconde étude du même cabinet, réalisée trois ans plus tard sur un autre échantillon de conventions, indique que 40 % des projets de rénovation urbaine n’intègrent toujours pas d’interventions sur les établissements scolaires et que le montant moyen des investissements scolaires ne dépasse toujours pas 3 % du montant total des projets lorsque de tels investissements sont prévus. Cette seconde étude s’accompagne d’une investigation sur dix sites où de telles interventions ont été engagées. Elle rend compte d’une réflexion faible sur la place de l’école dans les projets urbains, qui s’explique assez largement par la focalisation des PRU sur la dimension logement, ce qui témoigne de la prégnance d’une culture de l’aménagement physique et de l’urbanisme défavorable à l’approche globale des projets. Dans une enquête menée en 2008 sur les PRU de l’Essonne, la Cour des comptes est parvenue à un même constat de non-articulation (Cour des comptes, 2009).
c) La mixité « par le bas » entravée
L’ambition de la rénovation urbaine ne se limite pas à l’objectif de mixité « par le haut » fondée sur l’attraction d’une « population nouvelle » dans les quartiers défavorisés. Elle nourrit aussi l’ambition de favoriser une mixité « par le bas », c'est-à-dire par la déconcentration de ces populations vers les territoires où elles sont sous-représentées. Ses effets paraissent très limités à cet égard. Non seulement les relogements sur sites sont majoritaires, mais les relogements hors sites se font le plus souvent à proximité, au sein du territoire communal. Des données fragmentaires sur les relogements indiquent en effet que la très grande majorité (85 %) de ceux-ci sont réalisés à l’échelle communale (dont 79 % dans la ZUS d’origine ou dans une autre ZUS de la commune) ; près du tiers des relogements effectués dans une autre commune le sont aussi dans une ZUS (CES de l'ANRU, 2010). Lelévrier aboutit à un résultat proche de 75,9 % de ménages restant dans la même commune, avec des variations de 65 à 98,9 %. (Lelévrier, 2010). Cette situation correspond aux souhaits majoritaires des ménages relogés qui, dans beaucoup de cas aspirent à être relogés soit dans le même quartier, soit à proximité dans la même commune (CES de l'ANRU, 2010). Les porteurs de projet et les bailleurs ont d’ailleurs tendance à réviser à la hausse leurs estimations initiales de relogement sur place à l’issue des enquêtes sociales, lesquelles font apparaître une forte demande de relogement de proximité (Act consultants et al., 2009 ; Lelévrier, 2010).
Si le processus de relogement est en grande partie dissocié de la reconstitution de l’offre détruite, pour des raisons de calendrier ou de préoccupations d’équilibres sociaux, la localisation des reconstructions ne favorise pas la dispersion des ménages à une large échelle. Les logements sociaux livrés au 31 décembre 2008 ont été reconstitués à 55 % hors site, dont plus de 20% dans une autre ZUS. En incluant l’ensemble des logements programmés fin 2008, la proportion de reconstructions hors site n’est plus que de 46 %108. L’un des obstacles tient à la disponibilité du foncier (CNH, 2007), mais aussi à l’articulation incertaine entre la programmation « habitat » des PRU et celle des Programme locaux de l'habitat (PLH). Le Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU note à cet égard que « la durée de réalisation des projets de rénovation urbaine (cinq ans) ne correspond pas au temps d’émergence d’une stratégie et de mise en oeuvre des politiques locales d’aménagement. Les PRU sont bien souvent perçus comme des politiques d’exception, qui n’entrent pas dans le droit commun local. Leur articulation avec les documents locaux d’aménagement se fait souvent dans l’urgence et parfois la confusion », et « sans contenu clairement identifiable » (CES de l'ANRU, 2010). L’articulation avec le PLH semble toutefois facilitée lorsqu’une intercommunalité forte s’implique dans le projet de rénovation urbaine (Act consultants et al., 2009). Mais le portage communal des PRU, privilégié par l’ANRU, ne favorise de réelle dynamique à cette échelle (CNH, 2007 ; Epstein, 2008a). Le constat d’une rénovation urbaine restant cantonnée aux limites communales vaut plus encore en Île-de-France que dans les agglomérations d’autres régions (CES de l'ANRU, 2008a ; Act consultants et al., 2009).
La reconstitution de l’offre hors site ne suffit pas à assurer une mobilité résidentielle effective des ménages relogés, en particulier vers d’autres communes. Encore faudrait-il que les bailleurs sociaux s’associent pour mutualiser l’offre existante au sein de leur patrimoine respectif. Les travaux disponibles témoignent d’une faiblesse générale des solidarités entre bailleurs, plus encore à l’échelle intercommunale. Sauf lorsqu’un partenariat « inter-bailleurs » ou d’agglomération préexiste à la rénovation urbaine, la gestion du relogement reste interne à la commune et au bailleur lui-même (Lelévrier, 2008, 2010). Comme l’explique Jean-Claude Driant, sans régulation par des outils tels que les conférences intercommunales du logement ou les accords départementaux sur les attributions, les solidarités ne peuvent rester qu’informelles. Cet auteur souligne que « le relogement des populations met en exergue d’une certaine façon les processus mêmes qui ont conduit à la concentration de ces populations dans les ZUS : c’est là que se localise une offre de grands logements à loyers réduits et c’est là que les populations immigrées et les populations à faibles ressources ont pu obtenir un logement social. De plus, accueillir ces ménages dans des fractions plus mixtes du logement social est évalué pour une partie des bailleurs et des villes en termes de risques, celui de "déstabiliser des équilibres" en amenant des populations "fragiles" » (Driant, Lelévrier, 2006).
Le relogement pose la question plus large des discriminations ethniques dans l’accès à certaines fractions du parc (Kirszbaum, Simon, 2001 ; Sala-Pala, 2006 ; Tissot, 2006). Si l’attachement des habitants à leur quartier est un fait massif, d’autres veulent saisir l’occasion du relogement pour s’éloigner de quartiers stigmatisés, mais leurs parcours s’avèrent fortement contraints car ils sont confrontés à des « effets d’endiguement » comme le montre une étude d’Acadie sur « la mobilité résidentielle des ménages immigrés ». Les ménages relogés sont certes prioritaires, mais ils restent « perçus comme une catégorie à risque, qui fait figure parfois d’épouvantail », y compris au sein des parcs HLM municipaux (Acadie, 2007). Plusieurs études font état de pratiques de « sélection » et de « tris » entre des familles « souhaitables » et d’autres qui le seraient moins, en particulier les grandes familles d’origine immigrée (Lelévrier, 2004a ; Kirszbaum, 2007 ; Cordier-Deutsch, Saint-Macary, 2010).
Jacques Donzelot reproche ainsi aux opérations de rénovation urbaine de ne pas chercher à faciliter l’accès de la population des « cités » à un parc social élargi (Donzelot, 2006). Les obstacles à la mobilité résidentielle des minorités visibles semblent en effet intéresser moins fortement les promoteurs et acteurs de la rénovation urbaine que leur regroupement spatial. Des lois ont bien été adoptées pour faciliter l’accès de « populations défavorisées » ou « démunies » aux logements sociaux et imposer la construction de ceux-ci aux communes qui n’atteignent pas le fameux seuil de 20%. Mais on n’a jamais vu que ces logements soient proposés prioritairement, même par une voie indirecte, à des « minorités visibles » dans une logique de discrimination positive (Kirszbaum, 2009c). Christine Lelévrier a ainsi remarqué qu’« une famille immigrée de plus de trois enfants qui aujourd'hui est logée dans un site de la politique de la ville n'a pratiquement aucune chance d'accéder à une fraction plus valorisée du parc social » (Lelévrier, 2004a). Une circulaire de juin 2008 sur « l'égalité des chances dans l'accès au logement » s’est affranchie de la pudeur habituelle des pouvoirs publics qui définissaient jusque-là les publics « prioritaires » par de seuls critères socio-économiques, en demandant que les populations « notamment étrangères » se voient proposer des opportunités de logement dans les segments du parc social où elles sont sous-représentées, notamment dans le cadre des relogements liés à la rénovation urbaine109. Cependant, outre le caractère très restrictif d’une catégorisation fondée sur la nationalité, l’action positive esquissée en direction de ces ménages est contrebalancée par une stigmatisation récurrente de leurs « concentrations territoriales », cette terminologie n’apparaissant pas moins de 25 fois dans la circulaire et son annexe ! (Kirszbaum, 2008c).
3. Des parcours « positifs » pour les ménages relogés ?
Les habitants du parc HLM sont loin de former un monde homogène (Jaillet, 1998 ; Acadie, 2007), y compris dans les quartiers prioritaires du PNRU (voir les rapports de l’ONZUS). Du coup, les démolitions ont inévitablement des effets contrastés selon qu’ils sont de simples « passants » séjournant dans le logement social pour une durée limitée avant d’en sortir, ou des « sédentaires » pour qui le logement social est une sorte d’aboutissement, selon une distinction classique (Chamboredon, Lemaire, 1970). Aussi convient-il de resituer les mobilités liées à la démolition dans les trajectoires résidentielles d’ensemble des ménages. Christine Lelévrier propose de distinguer quatre grands types de mobilités pouvant correspondre à quatre effets possibles de la démolition : une « mobilité-projet » pour les ménages les plus mobiles, une « mobilité-opportunité » pour des ménages qui peuvent négocier un logement de meilleur qualité ou une décohabitation, une « mobilité-subie » dont les effets sont neutres ou qui dégradent la situation du ménage, enfin une « mobilité-exclusion » pour des ménages expulsables faute d’être locataires en titre (Lelévrier, 2007).
a) Derrière le relogement, des mobilités différenciées
Le premier phénomène important, qui a déjà été mentionné, est celui des départs spontanés de la frange la plus aisée et mobile des ménages. Beaucoup de ces ménages, dont la proportion a été estimée à 17 % dans une étude portant sur neuf opérations, quittent la commune, voire le département ou la région. Leurs profils et trajectoires correspondraient à ceux des ménages qui avaient quitté les Zones urbaines sensibles entre 1990 et 1999 pour concrétiser des projets résidentiels ascendants (ONZUS, 2005). La démolition produirait une sorte de « sur-mobilité » de ces ménages voulant éviter le relogement contraint (Lelévrier, 2010).
Il existe aussi un groupe de ménages ouverts à la mobilité, mais qui passent par –et utilisent– les dispositifs de relogement pour satisfaire leurs aspirations à « sortir de la cité », ou du moins des secteurs les plus stigmatisés de la cité, avec laquelle ils entretiennent des rapports distants. Fuir peut correspondre aussi au souci de garantir un meilleur avenir à ses enfants (Acadie, 2007). Ce groupe, constitué de salariés vivant seul, en couple sans enfants, ou avec un ou deux enfants, est celui qui a le plus de chance de voir le bailleur social accéder à ses souhaits de sortir effectivement du quartier et/ou d’accéder à un logement neuf, à un logement plus conforme aux besoins du ménage, aux demandes de décohabitation, ou encore aux souhaits d’accéder à la propriété (Faure, 2006 ; CES de l'ANRU, 2008c). Ces ménages sont aussi plus facilement acceptés par d’autres bailleurs, étant donné leur plus grande solvabilité et leurs besoins en logements de taille modeste, lesquels sont plus disponibles (Lelévrier, 2010)
Ce premier groupe a une réelle capacité de négociation avec les bailleurs, tout comme un second groupe qui utilise cette capacité pour rester cette fois dans le quartier, ou à proximité immédiate de celui-ci. Il s’agit souvent ici de retraités ayant accédé au logement social de longue date et qui ont leurs habitudes dans le quartier où ils ont noué des relations sociales (Faure, 2006). La stabilité de leurs revenus, la taille réduite du ménage, et leur position « d’anciens » et de « bons payeurs » sont autant de ressources appréciées des bailleurs au moment du relogement (Lelévrier, 2010).
Ces deux groupes de ménages sont les principaux bénéficiaires du relogement. Ils se distinguent nettement d’autres groupes pour qui le relogement a soit des effets neutres, soit des effets négatifs. Le caractère neutre – ou mitigé – du relogement sur les parcours résidentiels semble correspondre à la majorité des expériences. Dans ce cas de figure, les caractéristiques du nouveau logement sont identiques, ou présentent des atouts et des inconvénients qui se compensent. Les ménages concernés sont souvent dans une situation personnelle difficile, et ont connu une trajectoire résidentielle subie davantage que maîtrisée. Qu’il s’agisse de familles nombreuses, monoparentales, démunies ou de personnes âgées isolées, elles ne sont pas en position de force dans la négociation avec les instances chargées du relogement. En situation de dépendance vis-à-vis d’elles, ces ménages revendiquent seulement le maintien dans un logement de même taille, qui n’aggrave pas leur situation financière, et se retrouvent fréquemment relogés dans un immeuble ancien du même quartier (Lelévrier, 2008).
Enfin, la démolition met à jour des situations d’hébergement ou de squats. Les bailleurs sociaux n’ont pas obligation de reloger les occupants sans titre et les personnes hébergées, même si certains le font, pour des raisons sociales ou pour ne pas retarder l’ensemble du processus de relogement et le moment de la démolition (Lelévrier, 2005b).
Le grand paradoxe du relogement est qu’il facilite la mobilité de ceux que les villes et les bailleurs aimeraient voir rester alors qu’il représente une mobilité contrainte pour ceux qui ne veulent pas quitter leur logement et que la volonté politique cherche à disperser (Lelévrier, 2005b). Car plus les familles éprouvent de difficultés sociales et économiques et plus elles ont un intérêt objectif à ce que leur situation résidentielle n’évolue pas, afin de ne pas déstabiliser davantage des conditions d’existence précaires (Faure, 2006). « Le "plus" peut ne pas être dans le changement mais dans le maintien de la situation antérieure », écrit C. Lelévrier (2008). Dans ce cas de figure, rester dans le quartier permet de continuer à bénéficier de la présence des services, des équipements et des réseaux sociaux qu’il procure.
La préférence pour rester concernerait notamment une partie des ménages d’origine immigrée qui redoutent un éloignement pouvant leur faire perdre des repères, des commodités, un capital social ou des liens d’entraide éventuellement de nature communautaire (Allen, 2003 ; Acadie, 2007). Partir pour un autre grand ensemble, tout aussi disqualifié socialement, mais où l’on ne connaît personne constitue une menace, qui peut toucher particulièrement les femmes au foyer, pour lesquelles le quartier, ses sociabilités, et le logement lui-même, sont des espaces fortement investis (Faure, 2006). Le risque serait encore plus élevé si le déménagement devait les conduire dans un quartier de classe moyenne, où les nouveaux arrivants se verraient imposer des normes qui ne sont pas les leurs. Autrement dit, la déségrégation peut avoir un coût élevé, dont des observateurs s’étonnent qu’il pèse de manière disproportionnée sur les plus pauvres (Charmes, 2009).
b) Des tensions aggravées sur l’offre de logements bon marché
On ne doit pas inférer de ce qui précède que les ménages disposant du maximum de ressources dans la négociation se voient offrir une vaste gamme de choix résidentiels. Ceux qui veulent partir ailleurs n’obtiennent pas toujours gain de cause et la fraction du parc social qui leur est accessible et ouverte est vite circonscrite (Lelévrier, 2010). Globalement, les souhaits de mobilité des ménages seraient rarement satisfaits : les relogements dans le quartier ne concernent pas nécessairement des ménages qui avaient émis le désir d’y rester et inversement (CES de l'ANRU, 2008c).
Si les contraintes pèsent moins fortement sur les options résidentielles des ménages dotés des ressources les plus élevées, ces derniers subissent eux aussi les tensions à l’œuvre dans les marchés du logement, leur relogement étant soumis et contribuant à l’exacerbation des concurrences qui s’y manifestent (Acadie, 2007). La première condition pour une satisfaction des souhaits de relogement formulés par les ménages est en effet celle de la disponibilité d’une offre de logements libres et en adéquation avec leurs besoins et leurs ressources. De ce point de vue, la rénovation urbaine aggrave les tensions, notamment dans les marchés les plus tendus, où la vacance et la mobilité se réduisent. Cette politique contribue à raréfier l’offre disponible, notamment dans les agglomérations où les PRU sont multiples. Car à la différence de la période du renouvellement urbain de la fin des années 1990, où l’on parlait de « construction-démolition », la démolition précède souvent la reconstruction dans les opérations de rénovation urbaine (Driant, Lelévrier, 2006). L’ANRU a délibérément cherché à lever la contrainte de reconstructions préalables, car elle ralentissait les opérations de démolitions en obligeant les acteurs locaux à multiplier des « opérations tiroirs » consistant à reloger les habitants des immeubles démolis dans d’autres immeubles eux-mêmes promis à la démolition (Epstein, 2008a).
Dans un contexte de crise du logement, le CES de l’ANRU s’est alarmé d’un déficit qui aggrave les tensions dans le secteur du logement social. Si la règle du « 1 pour 1 » semble devoir être quasiment respectée à l’échelle nationale, avec un taux de reconstitution de 97 %, le décalage temporel entre les opérations de démolition et de reconstruction de logements sociaux persiste et s’accroît même à l’examen des seuls engagements. Même si l’année 2008 montre pour la première fois un taux de reconstitution supérieur à 50 %, le total des logements démolis à la fin de l’année 2008 s’établissait à 52 262 unités contre seulement 18 756 logements reconstruits, soit un déficit d’environ 33 500 logements, alors que le déficit n’était « que » de 27 000 logements fin 2007. Le CES précise au demeurant que la règle du « 1 pour 1 » n’est pas systématiquement appliquée. Le règlement général de l’ANRU indique en effet que « la reconstitution de l’offre est appréciée selon la tension du marché local du logement, la vacance structurelle dans le parc, l’évolution du marché, la démographie de l’agglomération et l’étendue de la concentration de logements sociaux »110. Il n’est donc pas exceptionnel de trouver des projets de rénovation urbaine où l’offre reconstituée est inférieure à l’offre démolie, au prétexte d’une demande de logement social faible. En revanche, rares sont les projets dans lesquels la règle du « 1 pour 1 » est dépassée, même dans des zones où le nombre de logements sociaux est notoirement insuffisant (CES de l'ANRU, 2010).
On peut remarquer aussi que les logements reconstitués ne le sont pas dans les mêmes typologies de taille et de prix. Derrière l’application de la règle du « 1 pour 1 », la production d’une offre très sociale, sur site et hors site, est en réalité très minoritaire. Ainsi l’offre reconstituée de type PLAI, qui cible les populations les plus modestes, est rare (8,6 % des reconstructions de logements sociaux au 31 décembre 2008), ce dont pâtissent les familles nombreuses et les ménages à faibles revenus, ce qui n’a pas échappé à maints observateurs (Robert, 2005 ; HCLPD 2005 ; Genestier, 2006 ; Driant, Lelévrier, 2006 ; CNH, 2007 ; HALDE 2007 ; CES de l'ANRU, 2010).
L’effet des démolitions est très marqué sur le parc de grands logements, l’offre HLM reconstituée consistant aux deux tiers de logements de trois pièces et moins. La comparaison entre la typologie des logements démolis et celle des logements détruits révèle un décalage important, souligné par l’ONZUS : « On démolit davantage de logements de grande taille (47 % des logements démolis sont de type 4 ou plus) qu’on en reconstitue dans l’offre de logement (63 % de la reconstitution de l’offre concerne des logements de type 3 ou moins) » (ONZUS, 2008). Un des arguments avancés pour expliquer la construction de plus petits logements est la décohabitation de jeunes couples qui vivaient chez leurs parents. Le CES de l'ANRU estime néanmoins que l’ampleur de la réduction de la typologie des logements sociaux est telle que c’est le relogement des grandes familles aux revenus modestes qui pose désormais problème (CES de l'ANRU, 2010).
Les caractéristiques des ménages logés en ZUS laissent en effet supposer des besoins en grands logements à loyer réduit plus importants qu’ailleurs puisque y sont surreprésentées les familles de quatre enfants et plus (13,3 % de l’ensemble des familles en ZUS contre 5 % pour la France). Le logement social des ZUS accueille également beaucoup plus de ménages pauvres que le reste du parc social (32 % des locataires sont pauvres contre 18 % dans l’ensemble du logement social) (Driant, Lelévrier, 2006). À cet égard, le parc voué à la démolition présente des atouts certains, avec des logements assez grands en type et en surface. Il n’est donc pas surprenant que le relogement n’améliore la situation résidentielle du point de vue de la taille du logement que pour un ménage sur cinq (Lelévrier, 2008). De même, les logements les plus représentés dans les sites de la politique de la ville, et plus encore dans les programmes de démolition, sont aussi les moins chers du parc social. Or, le logement social neuf, même lorsqu’il s’agit de logements pour les plus modestes, est plus cher et plus difficilement accessible aux ménages les plus pauvres, le montant de l’aide au logement étant de surcroît calculé sur un loyer plafonné (Driant, Lelévrier, 2006). Même les loyers des nouveaux logements construits en PLAI sont supérieurs aux loyers des logements démolis (CES de l'ANRU, 2010). Alors même que la révision du règlement général de l’ANRU de janvier 2007 a posé la règle du « reste à charge constant », déménager se traduit pour la moitié des ménages relogés par une hausse de loyer, même si les dispositifs d’aide mis en place par de nombreuses collectivités pour atténuer le différentiel font qu’un tiers « seulement » voit leur taux d’effort augmenter sensiblement (Lelévrier, 2010 ; CES de l'ANRU, 2010).
Le parc de logements des ZUS joue un rôle important dans l’accueil des ménages à bas revenus et des populations immigrées (Driant, Lelévrier, 2006). Avec les démolitions, le quartier ne peut plus remplir sa fonction d’accueil de nouvelles populations, qui se reportent sur d’autres quartiers et, de plus en plus, dans des quartiers composés de logements privés dégradés (CES de l'ANRU, 2010). Les caractéristiques du parc voué à la démolition soulève d’autant plus de questions qu’à de rares exceptions près, les logements des quartiers visés ne présentent pas de signes d’obsolescence technique majeure ou de déficience au regard des normes de confort : l’essentiel du parc social vétuste a été démoli au cours des deux dernières décennies, et la plupart des immeubles visés par les démolitions dans le cadre du PNRU ont été réhabilités au cours de la même période (Lelévrier, 2005b ; Baudin, Genestier, 2006). La qualité esthétique et patrimoniale des immeubles voués à la démolition, parfois associés à des grands noms de l’architecture moderne, est un autre sujet d’interrogation (Bertrand, 2009).
Les démolitions ont enfin des effets systémiques qui dépassent le seul cadre des ZUS. Dans un contexte de fortes tensions sur le marché du logement et après plusieurs décennies de sous-production de logements sociaux, les impératifs de relogement liés aux opérations de rénovation urbaine déstabilisent des systèmes d’attribution et de réservation HLM déjà sous pression (Fondation Abbé Pierre, 2006). Compte tenu du volume de démolitions généré par les opérations ANRU à l’échelle des agglomérations, il existe un effet en chaîne sur l’ensemble du marché locatif, contribuant à renforcer les difficultés d’accès des demandeurs ordinaires de logement, et à accentuer en particulier l’immobilité des ménages les plus précaires (Acadie, 2006 ; Baudin, Genestier, 2006 : Lelévrier, 2008).
c) Entre institutions et habitants : le malentendu
Si les ménages relogés dans des programmes neufs expriment fréquemment leur satisfaction (Oblet, Villechaise, 2010), le fait que le PNRU n’améliore pas de façon décisive la vie des habitants, ni n’assure leur promotion socio-économique, au-delà du changement de logement, est un fait généralement admis (Lelévrier 2008 ; CES de l'ANRU, 2010). Localement, la dissociation entre des PRU réduits à des opérations d’aménagement et les projets sociaux des villes, nourrit le scepticisme des acteurs de la politique de la ville sur la possibilité de transformer le social par l’urbain (Kirszbaum, 2010). Cette focalisation de la rénovation urbaine sur des problématiques immobilières et d’aménagement se vérifie dans l’absence d’évaluations qui, au-delà du suivi des relogements, s’attacheraient à analyser ses effets à moyens et long termes sur les conditions de vie et trajectoires individuelles, résidentielles mais aussi socio-économiques, y compris lorsque le déménagement se fait vers un autre quartier. Il s’agirait ainsi d’évaluer la politique de la ville à l’aune des parcours individuels et pas seulement de la valorisation des territoires (Lelévrier, 2005b), par exemple à la manière des évaluations conduites aux États-Unis pour vérifier l’hypothèse centrale d’un effet du territoire sur les « chances de vie » (life chances) de ceux qui y résident (Authier et al 2007 ; Kirszbaum, 2008a, 2009b). Une enquête nationale sur un panel de 2 000 ménages relogés devait être engagée, en 2009, dans un cadre inter-institutionnel111, avant d’être abandonnée. L’ONZUS a néanmoins lancé en 2010 un suivi de cohorte pluriannuel portant sur 3 000 ménages représentatifs des habitants des quartiers de la politique de la ville, dont un sous-groupe de ménages relogés dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine (CES de l'ANRU, 2010).
La conception dominante de l’accompagnement des relogements est un autre signe de la polarisation très forte des PRU sur les enjeux immobiliers et d’aménagement. Les objectifs de cet accompagnement et les pratiques auxquelles il donne lieu sont certes variables selon les sites, en particulier selon que les villes s’en mêlent, laissent la main aux seuls bailleurs sociaux ou le confient à un prestataire. Mais le cas de figure le plus fréquent est celui d’un accompagnement dont la seule visée est la facilitation matérielle des déménagements et la gestion des inquiétudes et angoisses qu’ils soulèvent chez les personnes concernées (Acadie, 2007 ; Epstein, 2008a ; Kirszbaum, 2010). Or, comme l’avait relevé le Conseil général des ponts et chaussées, le déménagement est aussi « une occasion de poser des questions, d’envisager des solutions en vue d’améliorer la situation de ces familles et d’impulser chez elles une nouvelle dynamique, sur d’autres aspects que le seul logement » (CGPC, 2003). Dans cette optique faisant de la rénovation urbaine une opportunité pour la construction de parcours socio-résidentiels, et pas seulement résidentiels, il s’agirait de mobiliser les services existants, voire d’en créer de nouveaux pour aider les habitants à construire un projet personnel et à franchir les barrières qu’ils rencontrent dans son accomplissement, en déployant une approche globale qui puisse apporter des réponses aux problèmes de santé, d’emploi ou de discriminations, en donnant à voir aux individus que le maintien dans le quartier n’est pas leur seul horizon possible. Cette approche en termes d’empowerment individuel n’est pas inexistante localement, mais elle est assurément très rare (Acadie, 2007 ; Kirszbaum, 2010).
Le soin apporté par les municipalités et les bailleurs à l’accompagnement résidentiel stricto sensu est en revanche assez largement reconnu. Il s’agit pour l’essentiel de recueillir les « souhaits » des ménages, principalement sur la localisation du nouveau logement, et de faire ensuite jusqu’à trois propositions (parfois davantage) pour adapter le nouveau logement aux ressources et à la taille des ménages concernés. Ce peut être aussi l’occasion de répondre à des besoins nouveaux (décohabitation des jeunes ou des hébergés, émancipation des épouses de familles polygames…). On a donc affaire à un processus de « normalisation » des situations d’occupation, même s’il reste fondamentalement motivé par la nécessité de reloger pour démolir (Lelévrier 2008, 2010).
C’est à l’aune de cette attention apportée au déroulement du relogement que l’on peut considérer les appréciations globalement positives des ménages relogés mises en évidence par des enquêtes de satisfaction (Lelévrier, 2008 ; Oblet, Villechaise, 2010) ; il faut toutefois noter que ces appréciations positives varient fortement d’un site à l’autre et que les méthodologies d’enquête ne présentent pas toutes les garanties nécessaires (Kirszbaum, 2010). La satisfaction déclarée des ménages relogés apparaît avant tout tributaire de l’amélioration de la qualité du logement et de son confort, ce qui facilite l’acceptation d’une hausse de loyer ou de charges ; les malfaçons sont corrélativement les motifs les plus fréquents d’insatisfaction (Lelévrier, 2008). Ces enquêtes, parfois prolongées par des entretiens sociologiques, rendent compte également des appréciations contrastées des ménages sur la qualité du nouveau voisinage, oscillant entre sentiment de déclassement, de reclassement ou d’absence de changement. On trouve autant de ménages qui se reconnaissent dans leur nouveau voisinage que des ménages ayant l’impression d’un déclassement social ou d’un isolement plus grand (Lelévrier 2008, 2010). À cet égard, les perceptions sont corrélées aux ressources qui ont pu être mobilisée, au non, dans la phase de négociation du relogement, ainsi qu’avec les dispositions personnelles à la mobilité (Oblet, Villechaise, 2010).
Cette phase durant laquelle il faut faire accepter aux habitants l’idée de la démolition et ses conséquences en termes de mobilité résidentielle, apparaît nettement moins consensuelle que ce que laissent entrevoir les enquêtes de satisfaction. S’il est délicat d’en tirer un bilan national, tant les situations locales sont contrastées, de nombreux travaux donnent à voir des tensions, conflits et blocages qui émaillent l’annonce, puis la mise en oeuvre des projets de rénovation urbaine (Robert, 2005 ; Deboulet, 2006 ; Donzelot, Epstein, 2006 ; CES de l'ANRU, 2006 ; Gaudin, 2007 ; Kirszbaum, 2007 ; Windle, 2008 ;Mandouze, 2008 ; Noyer, Raoul, 2008 ; Kirszbaum, 2010). Cette question renvoie à l’approche de la « participation » des habitants dans la rénovation urbaine puisque les projets sont décidés par les seules institutions, au nom de l’intérêt général. Charge donc à ces institutions de faire accepter les projets par un travail de « communication », de « pédagogie » ou de « mémoire » destiné à limiter les remous et à apaiser les angoisses face à un avenir résidentiel marqué par des incertitudes prolongées. Si des réunions collectives d’information sont organisées, elles ne sont nullement destinées à mettre en débat les projets et à favoriser l’émergence d’une force de proposition chez les habitants, cette fois dans une démarche d’empowerment collectif (Donzelot, Epstein, 2006). Ce qui caractérise la conception de la « participation » dans la rénovation urbaine est son caractère fortement atomisé et atomisant, consistant à apporter des réponses individuelles –via les dispositifs d’accompagnement au relogement et les perspectives qu’ils offrent de « tirer son épingle du jeu »– à des préoccupations communes –donc collectives– des habitants. Après avoir demandé –en vain– que l’ANRU conditionne ses crédits à la participation effective des habitants (CES de l'ANRU, 2007), le Comité d'évaluation et de suivi écrit dans son dernier rapport que l’« on a considéré à tort que les citoyens ne sont pas aptes à traiter de la vision globale de l’avenir d’un territoire et des questions stratégiques et techniques qui dépassent leur compétence d’usage » (CES de l'ANRU, 2010).
Le « malentendu » entre institutions et habitants tient largement au décalage entre leurs perceptions et représentations respectives des quartiers. On l’a vu, la rénovation urbaine se fonde sur le postulat de quartiers « handicapés » notamment par leur supposé déficit de mixité sociale. Il a été remarqué depuis longtemps que l’enjeu de la mixité sociale avait été construit par le reste de la société, souvent en décalage avec les représentations que les habitants se font de leur quartier (Garin-Ferraz, de Rudder, 1991 ; Toubon, 1992). De sorte que les institutions ont semblé « découvrir », à l’occasion des relogements, un attachement souvent massif des habitants à leur quartier, qu’elles semblaient loin de soupçonner (Kirszbaum, 2010), en même temps que des résistances à la mobilité que ces mêmes institutions érigent en valeur suprême d’une vie « normale » (Baudin, Genestier, 2006 ; Bacqué, Fol, 2007). Si les quartiers-cibles de la rénovation urbaine ont pour trait commun d’être confrontés à un processus de dévalorisation qui a beaucoup à voir avec le regard porté sur eux par la société environnante, le regard des habitants qui y résident apparaît en fait très différencié. Selon leur position de « passants » ou de « sédentaires », selon les ressources dont ils disposent pour « maîtriser » leur destin résidentiel ou qu’ils doivent au contraire le « subir », selon leur perception du caractère plus ou moins « mixte » du quartier où ils résident, les habitants expriment un degré d’adhésion très variable aux projets de rénovation urbaine (Acadie, 2007 ; Lelévrier, 2010).
4. Des quartiers réintégrés, des comportements normalisés ?
Les opérations de rénovation urbaine aboutissent-elles à la réintégration des quartiers dans la ville ? Le remodelage de leur urbanisme entraîne-t-il une réduction de la stigmatisation de leurs habitants ? Observe-t-on dans les quartiers rénovés une transformations des comportements et des pratiques sociales de leurs habitants ? On ne dispose pas à ce jour d’enquêtes nationales permettant de répondre avec assurance à ces questions. On se contentera donc ici de présenter les enseignements de travaux épars et partiels, engagés sur un petit nombre de sites, qui donnent à voir des transformations, mais aussi leurs limites au regard de l’objectif de banalisation.
a) Un habitat segmenté, une diversification fonctionnelle limitée
À en juger par les choix urbanistiques qui président aux projets d’aménagement, la rupture avec l’urbanisme uniforme des grands ensembles paraît consommée. La diversification morphologique de l’habitat est un objectif partagé par la plupart des projets de rénovation urbaine. Elle se concrétise par des programmes de logements résidentialisés et segmentés par petites unités qui dépassent rarement 50 logements et cinq étages ; les programmes plus importants sont eux-mêmes scindés en plusieurs unités résidentielles. Si des maisons individuelles sont également réalisées, il s’agit d’un habitat qui reste collectif dans 80 % des cas. Cela n’exclut pas la production de forme intermédiaires (par exemple des maisons superposées) qui tentent de concilier contraintes foncières et souhaits des ménages –étant entendu que la demande des ménages se porterait majoritairement sur des logements individuels (Noyé, 2009 ; Act consultants et al. 2009 ; CES de l'ANRU, 2010). Compte tenu du faible nombre de livraisons de la promotion privée, l’évaluation des qualités architecturales de cette production est prématurée. Mais de la même façon que la promotion privée n’est pas motrice dans le processus de diversification (voir supra), il semble qu’elle ne soit pas non plus à la pointe de l’innovation architecturale, comparée à celle des bailleurs sociaux (verre, bois, façades enduites avec couleurs, etc.). Là où l’on peut en apprécier les réalisations, les constructions privées se réfèrent à des modèles architecturaux bien plus classiques (pierre en façade, toiture zinc, entrées en marbre ou imitation, etc.) (Noyé, 2009).
La segmentation spatiale des programmes neufs est l’aspect qui soulève le plus d’interrogations au regard de l’objectif de banalisation urbaine, laquelle véhicule l’idée de continuité du tissu d’habitat. Or, la diversification de l’habitat n’est pas mise en oeuvre à l’échelle d’un même immeuble, mais à l’échelle de petits programmes lancés par différents opérateurs au gré des opportunités foncières. Les opérations privées sont fréquemment localisées aux franges des quartiers, pour constituer des sous-secteurs plus valorisés, au risque de ne proposer qu’« une nouvelle "façade" au quartier grâce à une "vitrine" rénovée ». (Fatmi et al., 2009). Ce choix est assumé par les porteurs de projet, pour qui la venue de promoteurs est conditionnée à une localisation attractive, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être trop proche du coeur de quartier. Mais ces localisations périphériques organisent une segmentation des quartiers d’habitat social, distinguant nettement un ou des secteurs de logements renouvelés (qui mixent généralement habitat privé et social) et des secteurs anciens, réhabilités ou non. Ces logiques contribuent à fragmenter le grand ensemble en sous-quartiers et résidences différenciées architecturalement, dans leurs statuts et dans leur occupation sociale. Leur séparation peut aller jusqu’à la clôture physique des espaces, si bien que les acteurs locaux « avouent ne plus savoir s’ils font de la mixité ou de la ségrégation » (Act consultants et al., 2009 ; voir aussi Noyé, 2009 ; Lelévrier, 2010).
Le Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU considère que l’action sur le foncier est la dimension la mieux aboutie du processus de banalisation urbaine, grâce à la clarification de la domanialité qui autorise les mutations futures des quartiers. Le plan d’alignement, la reconfiguration des réseaux engendrée par la construction de nouvelles voiries et la résidentialisation des logements permettraient une plus grande réversibilité des constructions, en donnant la possibilité de densifier au fil du temps les parcelles construites, et de construire de nouveaux bâtiments sur des réserves foncières. La constitution de réserves foncières participerait aussi de leur mutabilité en permettant d’attirer, à terme, des promoteurs, des entreprises et des commerces (CES de l'ANRU, 2010).
Pour l’heure, le bilan de la diversification fonctionnelle des quartiers est mitigé. Cette préoccupation est présente dans une majorité des conventions de rénovation urbaine, même si elle « n’est clairement pas un axe central des projets » et qu’elle « parle peu » aux acteurs locaux, selon l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France (IAU) à qui le CES de l'ANRU a confié une mission d’étude sur le sujet. De fait, la programmation financière d’un échantillon de conventions indique que la mixité fonctionnelle ne représente que 8,9 % des financements totaux des PRU (et 10,2 % des subventions de l’ANRU) pour les opérations sur les équipements et locaux associatifs, et 1,6 % des financements totaux des PRU (et un même montant des subventions de l’ANRU) pour les opérations sur les aménagements des espaces commerciaux et artisanaux. À l’issue d’une enquête plus ciblée sur dix sites, l’IAU estime néanmoins que le processus de diversification des fonctions est à l’œuvre, au moins dans certains quartiers où les investissements contribuent à structurer l’espace, à conforter des pôles de centralité et à favoriser une ambiance urbaine à l’échelle du piéton (Guigou et al., 2009).
La principale faiblesse du processus de diversification fonctionnelle concerne en fait l’action sur les commerces et, plus encore, sur le développement d’activités économiques au sens large. Près de la moitié des conventions de rénovation urbaine ne traitent pas des commerces, lesquels sont pourtant considérés comme un enjeu crucial tant par les habitants que par les acteurs locaux. Si les conventions n’en parlent pas forcément, c’est dans la mise en oeuvre du projet que des interventions sur les commerces peuvent être conduites. Mais ces interventions sont complexes et la qualification des équipes projet sur les aspects opérationnels, financiers ou juridiques, apparaît insuffisante ; le montage et la gestion de cellules commerciales ne font pas partie de leur culture professionnelle. L’EPARECA a été créé en 1998 pour accompagner les collectivités locales, mais compte tenu de sa capacité financière réduite, cet établissement intervient sur un nombre d’opérations limitées. Il concentre ses interventions sur les grands centres commerciaux dans une logique de promotion immobilière visant une certaine rentabilité, les centres commerciaux étant ensuite vendus à des investisseurs privés. Les petits pôles commerciaux sont donc exclus de l’intervention de l’EPARECA, qui répond rarement aux sollicitations des acteurs de la rénovation urbaine, au grand regret des élus locaux et des équipes de projet (Guigou et al. 2009 ; CES de l'ANRU, 2010).
La réflexion sur le développement d’activités économiques et artisanales est « le parent pauvre » des projets, sauf dans quelques sites dont la Zone franche urbaine apparaît dynamique. L’étude de l’IAU montre que près des deux tiers des conventions de rénovation urbaine ne prévoient aucun financement pour développer des locaux tertiaires ou artisanaux. Cela s’explique dans certains cas par la proximité de zones d’activité. Mais beaucoup d’acteurs locaux pensent en fait que le quartier n’est pas la meilleure échelle pour traiter les enjeux économique, lesquels doivent l’être au niveau intercommunal. Dans leur esprit, la question économique n’est d’ailleurs qu’une seconde étape du développement des quartiers, après la question de l’habitat, cette hiérarchisation pouvant se justifier par le caractère peu attractif du quartier dans sa phase de travaux (Guigou et al. ; 2009 ; voir aussi Noyé, 2009 ; Kirszbaum, 2010).
Le CES de l'ANRU constate ainsi que le développement économique local « ne fait pas encore l’objet d’une véritable réflexion de l’ANRU, ni d’actions ambitieuses de la part des acteurs locaux au regard des enjeux » (CES de l'ANRU, 2008c). Hormis les groupes du BTP et, dans une bien moindre mesure, les promoteurs immobiliers privés, il faut remarquer l’absence assez générale des acteurs économiques dans la mise en oeuvre du PNRU. Ce constat confirme un diagnostic posé en 2003 par le Conseil national des villes à propos de la politique de renouvellement urbain initiée en 1999, laquelle avait été présentée comme une rupture par rapport aux politiques urbaines antérieures, sur le plan des relations entre acteurs publics et privés (Morlet, 2001 ; Berland-Berthon, 2004 ; Le Garrec, 2006). Or, le CNV avait pointé la place résiduelle du développement économique dans les stratégies locales de renouvellement urbain, le manque de concrétisation des partenariats public-privé, la faible culture économique des équipes de projet et l’insuffisante mobilisation des dispositifs de soutien à la création et au développement d’entreprises (CNV, 2003 ; voir aussi, Dormois et al. 2005 ; Bonneville, 2005). La place des acteurs économiques reste toujours aussi marginale dans la rénovation urbaine, ce qui distingue toujours fortement la France d’autres pays engagés dans des politiques comparables, aux Pays-Bas (Verhage, 2003) et plus encore en Grande-Bretagne (Le Garrec, 2006), où le partenariat public-privé est nettement plus développé (Epstein, 2008a).
Bien plus que le développement de commerces et d’activités économiques, l’action sur les équipements –domaine d’intervention plus classique des acteurs publics– est le principal levier de diversification fonctionnelle dans la rénovation urbaine. La quasi-totalité des conventions prévoit une intervention sur ce thème. Cependant, on ne peut parler d’un réel processus de diversification car il s’agit moins souvent de créer des équipements nouveaux que de procéder à la réhabilitation, restructuration, extension ou relocalisation des bâtiments existants, dans des quartiers déjà bien pourvus, voire mieux dotés que d’autres en équipements publics et collectifs112. Les équipements traités sont d’ailleurs, pour l’essentiel, de même nature que ceux qui préexistaient à la rénovation urbaine : sur plus de 600 équipements réhabilités ou construits entre 2004 et 2008, figurent principalement des équipements scolaires (168), sociaux (149) et sportifs (117) (ONZUS, 2009). Aussi la plus-value de la rénovation urbaine réside-t-elle au moins autant dans l’amélioration des conditions d’accueil et la mise aux normes des bâtiments existants que dans l’adjonction de nouvelles fonctions aux quartiers. Il faut ajouter que la capacité à mobiliser ultérieurement les financements nécessaires pour faire vivre ces équipements se pose de façon aigue dans des villes démunies qui concentrent une population très défavorisée (Guigou et al., 2009 ; Kirszbaum, 2010 ; CES de l'ANRU, 2010).
b) La révolution du désenclavement n’a pas eu lieu
L’objectif de banalisation ne se réduit pas à vouloir « faire des quartiers comme les autres », divers sur le plan social, urbanistique et fonctionnel. Il s’agit aussi de réintégrer les quartiers dans la ville, et donc dans les flux d’échanges avec d'autres territoires. C’est l’une des fonctions qui incombe en principe aux équipements. L’analyse d’échantillons de conventions de rénovation urbaine montre qu’une minorité font référence, soit aux « équipements structurants », soit à des équipements de rayonnement communal ou intercommunal destinés à drainer un public extérieur aux quartiers (Guigou et al., 2009 ; Kirszbaum, 2010). Si l’on en croit le Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU, les concrétisations sont rares, s’agissant en particulier d’implanter dans les quartiers des équipements phares des villes. Ce sont en fait les parcs et jardins qui remportent le plus de succès (Guigou et al., 2009 ; CES de l'ANRU, 2010).
Hormis quelques réalisations emblématiques, c’est donc la notion d’équipement de quartier qui prévaut, comme le montrent des études réalisées pour le Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU. Alors que les projets de rénovation urbaine devaient être porteurs d’un renouveau de la réflexion urbaine permettant d’extraire les équipements de la notion enfermante de « quartier », la rupture n’apparaît pas évidente avec les conceptions les plus traditionnelles de la politique de la ville (Kirszbaum, 2010). Une étude met ainsi en cause la tendance des projets ANRU « à vouloir faire du copier/coller de tissus urbains anciens », au risque de « renforcer l’isolement des habitants dans leurs quartiers. Disposant de leurs propres services, ils n’auraient certes plus à aller les chercher ailleurs, mais par la même occasion ils auraient encore moins l’occasion de rencontrer des résidents extérieurs au quartier » (Louvet, Jemelin, 2007).
Le CES de l’ANRU a rappelé que le désenclavement des quartiers ne consistait pas simplement à implanter davantage d’équipements et de services dans les quartiers pour « refaire la ville sur place », mais qu’il s’agissait aussi « de relier les habitants des quartiers pour qu’ils accèdent à des équipements et à des services collectifs en dehors des quartiers et plus largement aux fonctions économiques, sociales, de la vie publique et culturelle de la ville et de l’agglomération dans son ensemble » (CES de l'ANRU, 2008c). Mais force est de constater que la mixité des usages obéit à une conception plutôt univoque, dans les projets locaux, puisqu’il n’est quasiment jamais question de l’accès des habitants des ZUS au reste de la ville (Kirszbaum, 2010). C’est plus exactement l’aspect physique de la mobilité qui prime sur la problématique de l’accessibilité. En effet, les PRU se focalisent la plupart du temps sur la reconfiguration ou la création de voiries nouvelles, et sur leur raccordement aux infrastructures routières existantes, sans s’intéresser, sauf exception, aux divers facteurs sociaux et psychologiques qui entravent la mobilité des habitants des quartiers pauvres (taux de motorisation, freins financiers et cognitifs, etc.) (CES de l'ANRU, 2008c ; Egis et al. 2009).
Encore faut-il préciser que le désenclavement physique se trouve lui-même rarement pris en compte au moment de l’élaboration des PRU, ou alors sous la forme de purs « effets d’annonce » (Louvet, Jemelin, 2007). Si les opérations de type cheminements « doux » (cheminements piétons, pistes cyclables…) ou les voiries d’accès qui relient les quartiers à leur environnement immédiat sont financées par l’ANRU, ce n’est pas le cas des projets « lourds » d’infrastructures visant le désenclavement, qu’il s’agisse de tramways ou de raccordements autoroutiers. Les initiatives en faveur du désenclavement sont généralement menées en parallèle des PRU, selon une temporalité qui dépasse la durée des conventions. Le rythme de révision d’un plan de déplacement urbain (PDU), de réalisation d’un plan local de déplacement en Île-de-France ou la construction de lignes de transport commun en site propre ne sont d’ailleurs pas compatibles avec le temps d’émergence des PRU (Egis et al. 2009).
La faible prise en compte de l’enjeu du désenclavement dans les PRU tiendrait plus fondamentalement à une conception de l’intégration des quartiers focalisée sur la notion de « continuité urbaine », sans égard pour la notion de « discontinuité urbaine » qui justifierait de penser différemment –et à d’autres échelles– la question des mobilités. La priorité accordée aux aménagements en « modes doux » risque de « confiner » les habitants dans leur quartier, surtout lorsque ces aménagements se combinent avec une offre de services développée dans le quartier lui-même (Louvet, Jemelin, 2007). C’est finalement l’enjeu de l’offre de transports collectifs qui semble absente (CERTU, 2006). « L’impact de l’amélioration de la desserte des quartiers par des infrastructures lourdes est indéniable, mais encore faut-il que les lignes de transport mènent vers les aménités urbaines dont les habitants ont besoin (zones d’emploi en particulier) », écrit le CES de l'ANRU (2010). De fait, les politiques alternatives ou complémentaires à la création de nouvelles infrastructures ne sont abordées que dans 10 % des conventions et les autorités organisatrices de transport sont rarement associées aux instances de pilotage de la rénovation urbaine (Egis et al. 2009).
c) Le social au prisme de l’aménagement physique
Une dernière série d’interrogations porte sur d’éventuels effets de la rénovation des quartiers sur les comportements et pratiques sociales des habitants. Les études qui abordent cette question de front ne sont pas légion. Un enseignement transversal se dégage néanmoins des travaux conduits sur la résidentialisation, la gestion urbaine de proximité, les équipements ou la création d’emplois : l’investissement physique a peu ou pas d’effets sur l’intégration sociale des habitants s’il ne s’accompagne pas d’un investissement équivalent dans ce que l’ANRU appelle « l’humain » et qui incombe, en principe à l’ACSÉ. On a déjà indiqué les limites de cette articulation. Il faut ajouter le constat d’un manque assez général d’anticipation des enjeux liés à la gestion des quartiers une fois l’investissement physique réalisé. D’aucuns ont vu dans cette double difficulté –défaut d’articulation avec le volet social, manque d’anticipation des problèmes de gestion– le signe d’une rénovation urbaine restant prisonnière d’une culture de l’aménagement relativement hermétique aux enjeux et à la culture du développement social urbain.
Depuis la fin des années 1990, les opérations de résidentialisation se sont multipliées. Le PNRU y a grandement contribué avec un objectif initial de 200 000 logements locatifs sociaux à résidentialiser, porté à 400 000 logements en 2006. Ces opérations qui consistent à produire des unités résidentielles de petite taille, au sein desquelles les espaces sont soigneusement délimités et hiérarchisés, suscitent l’engouement des aménageurs et de nombreux bailleurs sociaux (Giffo-Levasseur, Pasquier, 2005). La résidentialisation n’est pas seulement censée banaliser les grands ensembles et en faciliter la gestion. Pour ses concepteurs, elle doit aussi développer la convivialité et le lien social, favoriser l’émergence d’actions collectives de proximité, renforcer l’appropriation du logement et responsabiliser les habitants en leur redonnant le contrôle de leur environnement. En permettant d’organiser le contrôle social des espaces, les concepteurs de la résidentialisation pensent aussi qu’elle contribue à la sécurité ou à la « tranquillité sociale » (Billard et al., 2005 ; Lelévrier, Guigou, 2005).
La résidentialisation a suscité une littérature importante (pour une synthèse, voir Cinget et al., 2009), mais les études de cas portent essentiellement sur des opérations initiées avant le PNRU. Leurs résultats tendent à montrer que les effets d’apaisement social et d’implication collective attendus sont rarement au rendez-vous. Outre l’élévation du montant des charges locatives, qui apparaît souvent comme un sujet de mécontentement chez les habitants (Trancart, 2006 ; Certu, 2007), il ressort de ces études que les aménagements réalisés dans le cadre de la résidentialisation peuvent être en eux-mêmes des facteurs de tension (Certu, 2007). La question de la liberté d’aller et de venir fait par exemple l’objet de conflits permanents entre voisins (Haumont, Morel, 2005). Loin de renforcer les liens sociaux et la convivialité, certains habitants vivraient la sécurisation des espaces comme un enfermement, nourrissant un sentiment d’inquiétude, des attitudes de retrait par rapport aux espaces collectifs et de rejet des habitants extérieurs à la résidence perçus comme une menace ; ces tensions recoupent souvent des clivages de nature ethnique (Lelévrier, Guigou, 2005). Enfin, la logique sécuritaire inhérente à la résidentialisation risque de n’avoir qu’un « effet plumeau », en déplaçant la délinquance vers d’autres immeubles ou espaces publics (Vallet, 2007). Ce constat rejoint celui qui a été fait dans les expériences américaines de « prévention situationnelle », lesquelles ont montré les limites d’une approche qui survalorise les solutions physiques et techniques au détriment de la dimension humaine de la prévention de la délinquance ; le « modèle » américain a d’ailleurs été nettement infléchi, dans les années 1990, pour articuler interventions sur l’espace bâti et actions plus directement tournées vers les habitants (Loudier, 2002 ; Levan, 2009)
Les retards pris dans la « gestion urbaine de proximité » (GUP), qui vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants (par l’entretien des espaces publics, la gestion des espaces verts, l’éclairage public, l’enlèvement des ordures et des encombrants, la qualité de service rendu aux locataires par les bailleurs, l’animation et la vie du quartier…), est un autre sujet d’inquiétude qui témoigne, là aussi, d’une certaine négligence envers les pratiques sociales des habitants. La mise en oeuvre de la GUP dépend beaucoup plus des acquis du passé (Kertudo, Vanoni, 2009) que des incitations de l’ANRU, qui semble avoir tardé à considérer la GUP comme un sujet prioritaire. La signature de conventions de gestion urbaine de proximité est certes obligatoire, elle n’a rien de systématique, et la GUP n’est parfois pas mise en oeuvre plusieurs années après le démarrage des projets de rénovation urbaine (CES de l'ANRU, 2010). L’ANRU ne finançant pas la GUP et n’en faisant pas une condition impérative d’attribution de ses subventions, celle-ci est tributaire de partenariats locaux plus ou moins effectifs ; à cet égard, le rôle d’impulsion des CUCS apparaît très relatif (Kirszbaum, 2010). Plus encore que les moyens, ce sont l’organisation et la coordination des acteurs qui seraient déficientes. Surtout, l’implication des habitants « reste l’exception », alors qu’ils ont une compétence d’usage en tant que premiers utilisateurs des espaces et des services (CES de l'ANRU, 2010).
Michel Bonetti, sociologue au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), a régulièrement alerté les pouvoirs publics sur l’enjeu de la GUP, en rappelant que les quartiers réhabilités dans les années 1980 s’étaient rapidement dégradés faute de gestion adaptée, ce qui risque de se reproduire dans les opérations de rénovation urbaine. Celles-ci mobilisent des fonds publics autrement plus importants que les réhabilitations du passé, mais le déficit de gestion urbaine de proximité pourrait finir « au bout de quelques années par recréer un univers paupérisé. (...) Car très souvent les améliorations des modes de gestion engagées dans le cadre de ces opérations ne sont pas à la mesure des problèmes qui se posent et des investissements engagés. Or ces investissements sont considérables, ils représentent souvent plusieurs centaines de millions d’euros pour des quartiers comportant 1 000 à 2 000 logements. Le déficit de gestion urbaine des quartiers rénovés menace en définitive la pérennité des investissements réalisés. (...) Il risque de ruiner l’effort considérable des pouvoirs publics en faveur de ces quartiers et de leurs habitants, et de rendre vaine l’énergie considérable déployée par les différents acteurs qui se sont mobilisés pour concevoir et réaliser ces projets » (Bonetti, 2007).
Les mêmes mises en garde valent pour la gestion des équipements créés ou réhabilités dans le cadre de la rénovation urbaine. La pérennisation des investissements supposerait de consulter les usagers, en amont, pour s’assurer de la pertinence des choix d’équipements, puis de prévoir une organisation adaptée pour faire vivre ces derniers une fois livrés. L’IAU considère à ce propos que « la prise en compte de la "maîtrise d’usage" (attentes et pratiques des usagers de l’équipement) reste généralement insuffisante et rarement perçue comme indispensable par la maîtrise d’ouvrage de l’équipement », avant d’ajouter que « d’une façon générale, les porteurs de projet n’expriment pas le besoin d’en savoir plus sur les pratiques et les attentes des habitants qui, pourtant, pourraient impacter la programmation des équipements » (Guigou et al., 2009). Le CES de l'ANRU abonde en ce sens : « La non prise en compte de l’expertise des habitants, de la spécificité de la composition sociale des quartiers (jeunes, personnes âgées, groupes ethniques particuliers), mais aussi des contraintes particulières de la population (horaires, langue…) est particulièrement problématique dans le cadre de la réflexion sur les équipements ». Plus inquiétants encore sont les phénomènes d’indifférence, voire de rejet par les habitants des améliorations apportées au quartier : « La faible participation des habitants et l’absence de prise en compte de leurs besoins réels peuvent engendrer un faible intérêt de l’opinion locale pour les nouvelles opérations réalisées, voire une totale non-adhésion et un rejet de celles-ci (vandalisme, insécurité) avec la persistance de problèmes de gestion urbaine » (CES de l'ANRU, 2010).
La mise en œuvre locale de la charte nationale d’insertion doit contribuer, en principe, à une meilleure appropriation par les habitants des changements physiques introduits dans leur quartier. Il s’agit de s’assurer que les habitants tirent un bénéfice concret d’une commande publique portant sur plus de 40 milliards d’euros de travaux engagés à l’horizon 2013. La charte nationale d’insertion incite ainsi les maîtres d’ouvrage, majoritairement les collectivités et bailleurs, à réserver aux résidents des ZUS 5 % de l’ensemble des heures travaillées sur chaque chantier de rénovation urbaine et 10 % des emplois créés pour la gestion urbaine de proximité la gestion des équipements construits/rénovés dans le cadre des PRU.
Il est très difficile, sur la base des travaux existants, de savoir si ce dispositif contribue efficacement à l’« appropriation » du projet urbain par les habitants. On ne dispose que de témoignages d’acteurs locaux faisant état d’un possible abaissement des tensions, pour lever en particulier les blocages de chantiers (Kirszbaum, 2010). La rénovation urbaine est en effet une source de tensions sociales en raison du montant d’investissements annoncé qui peut susciter des espoirs sans lendemain chez des habitants qui n’en voient pas la traduction sur leur situation financière personnelle. À cet égard, les acteurs locaux s’accordent à considérer que l’introduction d’une clause d’insertion dans les marchés ANRU dégage un nombre d’heures de travail somme toute marginal en regard de la population active et de l’intensité du chômage –des jeunes en particulier– dans les quartiers. Leurs interrogations, reprises par le CES de l'ANRU, portent sur les seuils de 5 et 10 % d’heures travaillées qui peuvent apparaître restrictifs, d’autant plus qu’ils ne concernent que le seul domaine du BTP et d’activités connexes (gardiennage, second oeuvre…), lesquels requièrent des profils relativement peu qualifiés et font très majoritairement appel à des compétences masculines ; d’autres activités induites par la rénovation urbaine pourraient faire l’objet d’opérations d’insertion, comme les marchés de maîtrise d’oeuvre, d’ingénierie, de définition et les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage De telles opportunités permettraient de solliciter davantage de femmes et de profils plus qualifiés, souligne le CES. Le Comité d’évaluation regrette aussi que la participation des entreprises locales aux chantiers de la rénovation urbaine ne soit pas une priorité des collectivités et de l’ANRU, l’agence n’ayant pas fixé d’objectifs de participation des petites et moyennes entreprises des ZUS aux chantiers de rénovation urbaine. L’agence a certes constitué un centre de ressources doté de cinq experts du développement économique pour assister les maîtres d’ouvrage. Mais le CES considère que l’effet des PRU sur le développement de l’entreprenariat local reste encore à démontrer (CES de l'ANRU, 2008c).
Concernant les effets sur l’emploi des habitants des plan locaux d’insertion, adoptés en application de la charte nationale, l’ANRU a tardé à mettre en place un instrument de suivi (ce qui l’a aussi privée du moyen d’exercer une pression sur les maîtres d’ouvrage et d’appliquer le cas échéant des sanctions). Les éléments de bilan disponibles renvoient donc à des pratiques locales très diversifiées qui rendent les comparaisons inter-sites délicates, d’autant plus que chaque bailleur et entreprise a établi ses propres critères de calcul du nombre d’heures d’insertion. À cette réserve près, des évaluations initiées par le CES de l’ANRU indiquent que les objectifs en termes d’heures d’insertion sont dans l’ensemble respectés, voire dépassés par les maîtres d’ouvrage, même si le pourcentage d’heures travaillées en insertion sur les chantiers de la rénovation urbaine varie d’un site à l’autre (il se situerait entre 5 % et 10 % en moyenne) ; dans certains cas, le PNRU a pu aussi exercer un effet levier, la clause d’insertion ayant été appliquée à des appels d’offres de marchés publics hors rénovation urbaine, dans des villes qui faisaient peu usage, jusque-là, de cette faculté ouverte par l’article 14 du Code de marchés publics. L’une des interrogations centrales concerne la capacité des clauses d’insertion, et des dispositifs d’accompagnement des demandeurs d’emploi, à assurer l’accès à des emplois durables ou à permettre à ses bénéficiaires de s’engager dans des parcours réellement qualifiants (CES de l'ANRU, 2008c ; Kirszbaum, 2010 ; CES de l'ANRU, 2010).
À qui profite la rénovation urbaine ? Les résultats contrastés du Programme Hope VI aux États-Unis
Plusieurs pays ont engagé des politiques de rénovation urbaine afin de renouveler en profondeur les segments les plus dépréciés d’un parc social construit selon les principes urbanistiques de l’après-guerre. Mis en oeuvre aux États-Unis depuis les années 1990, le programme Hope VI (Housing Opportunities for People Everywhere) est sans doute celui qui présente le plus de ressemblances avec le programme français. Dans les deux cas, l’accent est fortement mis sur les démolitions et la reconstitution d’une offre diversifiée, obéissant à de nouveaux préceptes urbanistiques très similaires et visant à créer des quartiers socialement mixtes –des « mixed-income housing » disent les Américains. Si le parc social des États-Unis est beaucoup plus réduit qu’en France et s’il n’est qu’un logement de « dernier ressort » proposé aux plus pauvres, l’orientation de la rénovation urbaine témoigne d’une même ambivalence, entre la volonté, d’une part, de réinscrire ces quartiers dépréciés dans le jeu du marché et d’y rétablir l’ordre public, et la préoccupation, d’autre part, d’offrir des opportunités nouvelles aux habitants originels. C’est ce dont rend compte un document de l’Urban Institute et de la Brookings Institution, publié en 2004, soit quelques années avant que le programme Hope VI soit réformé par l’administration Obama qui a décidé de remettre les habitants au cœur du processus de rénovation113.
Popkin S. J. et al. (2004), A Decade Of HOPE VI : Research Findings And Policy Challenges, The Urban Institute, The Brookings Institution, May
Lancé en 1992, le programme HOPE VI représente un tournant essentiel dans la politique américaine du logement social. C’est aussi l’un des programmes urbains les plus ambitieux jamais engagés aux États-Unis. Pendant des décennies, le logement social a été sous-financé par l’État fédéral et été parfois géré de manière déplorable par les autorités qui en avaient la charge (appelées « housing authorities »). Outre l’état de délabrement physique d’une partie du stock, notamment dans les plus grandes villes, la concentration de pauvreté, de chômage, d’échec scolaire, sur fond de criminalité violente et de trafics de drogue endémiques, ont fait de ce « public housing » des lieux de désespérance sociale. La part importante de logements vacants dans beaucoup de grands ensembles, a accéléré la spirale de déclin.
Les objectifs affichés par le programme Hope VI sont : l’amélioration du cadre de vie des habitants des ensembles les plus dégradés à travers des démolitions, réhabilitations, restructurations et reconstructions de logements ; la revitalisation des quartiers, qui doit également contribuer à améliorer la situation des quartiers environnants ; la production d’une offre de logement qui doit éviter, ou diminuer, la concentration de ménages très pauvres ; la création de quartiers « durables » (sustainable).
Au cours des années 1990, le programme HOPE VI a évolué d’une perspective initiale d’empowerment des habitants vers une visée de réintégration économique des quartiers dans les marchés résidentiels. HOPE VI a également coïncidé avec l’émergence d’une nouvelle doctrine urbanistique, le New Urbanism, qui appelle à produire de petites unités résidentielles, à redessiner les schémas viaires, à repenser les espaces publics et à introduire des commerces. Il s’agit aussi de promouvoir un « espace défendable » permettant aux habitants de mieux contrôler l’espace situé à proximité immédiate de leur lieu de résidence, par leur privatisation ou semi-privatisation.
En 2003, après dix ans de mise en œuvre, ce programme avait engagé 5 milliards de dollars de crédits fédéraux (et plus du double si l’on ajoute d’autres sources de financement), répartis entre 446 projets situés 166 villes ; 63 100 unités de logements avaient déjà été démolies et remplacées par des logements mixtes. Les logements reconstitués sur site sont généralement de trois types : logements au prix du marché, logements abordables et logements sociaux très bon marché. Mais l’intensité de cette diversification varie fortement selon les stratégies locales : certains projets sont exclusivement dédiés au relogement des ménages éligibles au logement social, tandis que d’autres ont délibérément visé une clientèle extérieure en relogeant une grande partie des ménages en dehors de leur quartier d’origine. Les études existantes montrent que cette diversification a réussi, dans certains sites, à attirer des habitants ayant des revenus plus élevés, y compris dans des logements au prix du marché.
Alors qu’une littérature considérable s’est focalisée sur les conséquences néfastes de la concentration de la pauvreté, les interrogations sont nombreuses concernant la façon dont les ménages pauvres tirent parti de ces situations de mixité. Des recherches menées dans les quartiers rénovés suggèrent que les interactions sont limitées ou superficielles entre ménages ayant des niveaux de revenus différents. Il n’existe pas non plus de preuve que la mixité résidentielle apporte des opportunités d’emploi aux ménages pauvres.
Le programme HOPE VI ne s’est pas limité à une revitalisation physique. Une intervention sociale a été prévue puisque 20 % de l’enveloppe de crédits fédéraux sont réservés à des services « communautaires » et aux aides personnalisées destinées remettre le pied à l’étrier d’une population souvent très marginalisée. Si le montant de cette enveloppe dédiée au « soft side » a été réduit après quelques années, parce qu’elle n’était pas dépensée en totalité, elle a permis de financer des actions de formation initiale ou professionnelle, des crèches, des équipements de quartier, etc. Mais le bénéfice est incertain pour les habitants originels car ces actions ont souvent été développées après que les relogements aient eu lieu, dans la majorité des cas en dehors du quartier. Certains sites ont néanmoins confié la gestion de ces fonds à des organisations dites « communautaires », animées par des habitants. Les situations locales sont en fait très diverses et il est difficile de tirer des conclusions d’ensemble sur le volet social du programme Hope VI.
Il en va de même de la participation des habitants. La réglementation fédérale a exigé des responsables locaux du programme qu’ils associent les habitants à la conception des futurs quartiers et logements, mais le contenu donné à cette participation est resté relativement vague dans les textes, de sorte que cet impératif a été interprété de façon très diverse d’un site à l’autre. Certains comités de résidents se sont sentis totalement exclus du processus de décision et ont été jusqu’à intenter des procès aux responsables des projets. Dans d’autres sites, les habitants ont été au contraire étroitement associés à l’ensemble des décisions.
De nature très flexible, le programme Hope VI a suivi des directions très différentes selon les sites. Il est donc difficile d’en tirer des enseignements nationaux, d’autant plus que le ministère du Logement n’a pas engagé d’évaluation globale pour en examiner l’ensemble des aspects. S’il a commandité des rapports d’évaluation aux différentes étapes de sa mise en œuvre, ce sont des études de cas souvent focalisées sur les réalisations et sur les sites eux-mêmes, qui apportent peu d’informations sur la façon dont Hope VI a impacté les habitants, en particulier ceux qui ont été relogés dans d’autres quartiers.
La question de ce qu’il est advenu des habitants originels est ainsi devenue un sujet hautement polémique. En 2003, près de 50 000 ménages avaient été relogés, mais le manque de données administratives fiables a pollué les débats. Du coup, les appréciations sur les impacts du programme HOPE VI ont varié du tout au tout : certains observateurs y ont vu un succès remarquable tandis que d’autres ont conclu à un échec dramatique.
Si les réalisations sont incontestables dans des centaines de quartiers profondément marqués par des années de négligence publique, de nombreux indices laissent à penser que les habitants de départ n’en ont pas forcément bénéficié. Cela tient probablement à leur trop faible implication dans l’élaboration des projets et à des relogements effectués à la hâte. Des études de suivis de cohorte laissent à penser qu’une partie des habitants initiaux n’ont pas vus leur situation résidentielle s’améliorer, quand ils ne se sont pas retrouvés dans des conditions plus précaires encore. La rénovation urbaine a été particulièrement préjudiciable, dans certains sites, aux ménages « difficiles à reloger » (hard-to-house), qu’il s’agisse de personnes à « handicaps multiples » (chômeurs de longue durée, malades…), de personnes âgées ou des familles nombreuses. Pour ces ménages, les principes d’autonomie et de mobilité mis en avant par le programme Hope VI sont manifestement inappropriés.
Les habitants les moins mobiles sont aussi les groupes les plus dépendants du logement social. Or, le programme Hope VI a eu des effets négatifs sur l’offre globale de logements très bon marché. Ainsi, sur 95 100 logements programmés au titre de la reconstitution de l’offre, en 2003, seuls 48 800 relevaient du logement social accessible aux ménages très pauvres. En outre, les reconstructions ont souvent pris du retard, alors que les démolitions ont été engagées avec célérité. Compte tenu des difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux pour acquérir du foncier, notamment dans les quartiers non-ségrégués comme les y oblige la réglementation fédérale, le ministère du Logement a suspendu l’application du « 1 pour 1 ». En contrepartie, les ménages relogés se sont vus proposer des « bons » (vouchers) pour se reloger dans le parc privé.
Plusieurs études longitudinales ont cherché à vérifier si le déménagement vers un autre quartier améliorait leurs conditions de vie. La perception du nouveau quartier par ceux qui ont bénéficié de ces vouchers apparaît bien meilleure que celle des habitants relogés dans un logement social « hors site ». Pour les premiers, l’effet de déconcentration de la pauvreté est impressionnant : les quartiers de destination affichent en moyenne un taux de pauvreté de 27 % contre 61 % dans les quartiers d’origine. La crainte de voir se reconstituer ailleurs des poches de pauvreté ne s’est donc pas vérifiée. Mais ceux qui ont été relogés dans un logement social l’ont souvent été à proximité de leur quartier d’origine, dans un environnement assez similaire. S’ils n’ont pas bénéficié d’une promotion résidentielle, ils ont pu néanmoins conserver leurs réseaux sociaux et familiaux, alors que les ménages partis au loin ont pu être handicapés par la perte de ces liens ou des services dont ils bénéficiaient auparavant.
Ces études montrent un impact beaucoup moins évident des relogements en termes de déségrégation ethno-raciale. Dans leur grande majorité, les ménages ont été relogés dans d’autres quartiers de minorités. Leurs préférences pour « l’entre-soi » ont pu jouer, mais les tensions sur le marché du logement et les barrières de la discrimination, sur le marché privé, ont sans doute pesé aussi.
Les résultats les plus probants en termes de déségrégation, qu’elle soit économique ou ethno-raciale, ont été obtenus là où une aide intensive à la mobilité a été fournie. Requis par le ministère du Logement, ce « mobility counseling » a donné lieu à des efforts très substantiels dans certaines villes où les personnes désirant quitter leur quartier ont été aidées dans toutes leurs démarches pour s’installer dans un quartier peu ségrégué. Mais le cas de figure le plus répandu semble avoir été celui de villes ayant fait le minimum –la prise en charge du coût du déménagement– sans aider plus avant les locataires à construire un parcours résidentiel.
B. LE PROGRAMME DES ZONES FRANCHES URBAINES
Créé par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville, le programme des Zones franches urbaines vise à favoriser le développement économique en accordant des allégements fiscaux très substantiels aux établissements qui s’implantent dans ces zones. Les entreprises (et associations) de moins de 50 employés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros bénéficient, pour leurs établissements en ZFU, d’importantes exonérations pour une durée initialement fixée à cinq ans114. En contrepartie de ces avantages, les entreprises doivent effectuer au moins un cinquième de leurs nouvelles embauches parmi les résidents de la zone franche, ce quota ayant été porté à un tiers à partir 1er janvier 2003, en même temps que le critère de résidence était étendu à toutes les ZUS de l’agglomération.
Les avantages accordés par le PRV, qui devaient prendre fin en 2002, ont été prolongés de cinq ans par la loi de finances rectificative de 2002. La loi du 1er août 2003 en a étendu le bénéfice à 41 nouvelles ZFU (dites de « deuxième génération ») qui se sont ajoutées aux 44 instituées par le PRU (ZFU « de première génération »). La loi du 31 mars 2006 a créé 15 ZFU supplémentaires (dites de « troisième génération »), en même temps qu’elle a prolongé la durée des ZFU de première et deuxième génération. Enfin, le périmètre de 31 de ces ZFU a été étendu en 2007. Du fait de l’augmentation de leur nombre, de l’extension de leur périmètre et de leur durée, le coût des ZFU est allé croissant dans le budget de l’État. L’ensemble des exonérations fiscales et sociales liées aux zonages de la politique de la ville, principalement aux ZFU, s’élevait à 599 millions d’euros en 2008 (ONZUS, 2009). Les 250 millions d’euros de compensation d’exonérations de charges sociales représentent plus du tiers des autorisations d’engagement figurant au programme 147 du PLF 2009, après avoir culminé à 333 millions d’euros en 2007.
La montée en puissance continue de ce programme est d’autant plus remarquable qu’il a fait l’objet de très nombreuses critiques. La relance des zones franches, opérée à partir de 2002, a fait suite à une succession de rapports mitigés, voire franchement négatifs sur les premières années de mise en oeuvre du programme (Sueur, 1998 ; Barilari et al., 1998 ; Buguet, 1998 ; Robin-Rodrigo, Bourguignon, 1999 ; Ministère délégué à la ville, 2001). Deux nouveaux rapports commandés après le changement de majorité de 2002 ont abouti à des conclusions opposées (Ministère délégué à la Ville, 2002 ; André, 2002). La controverse paraissait avoir une dimension partisane, l’alternance de rapports critiques et laudateurs sur les ZFU collant exactement aux alternances politiques. Elle avait aussi des fondements idéologiques, cette politique de redynamisation économique empruntant très directement aux Entreprise Zones lancées en 1981 par le gouvernement de Margaret Thatcher, au nom de la libération des forces du marché, avant de trouver un écho, quelques années, plus tard dans la politique de Ronald Reagan aux États-Unis (Papke, 1993).
Mais la controverse politique française sur les ZFU tenait aussi, et peut-être surtout, à l’absence d’évaluation fiable des résultats du programme, la loi de 1996 n’ayant pas prévu l’évaluation du programme des ZFU, ni même la mise en place de systèmes d’information permettant de suivre la mise en oeuvre et les effets du programme (Rathelot, Sillard, 2008 ; Gobillon et al., 2010). Ces rapports administratifs et parlementaires qui ont porté un jugement sur les ZFU l’ont donc fait sur la base de données très partielles qui en limitent la fiabilité. C’est bien ce qu’avait souligné la Cour des comptes dans son rapport particulier sur la politique de la ville de 2002. Ne tranchant pas le débat politique, elle considérait qu’« en l’absence de dispositif d’évaluation spécifique, il n’est pas possible de disposer d’informations sûres et homogènes permettant d’apprécier les résultats de cette politique au regard des objectifs initiaux. (…) La mise en place des mesures n’a pas été accompagnée d’objectifs de résultats (nombre d’emplois à créer) ni de coût (chiffrage du montant prévisionnel des exonérations liées à un objectif de création d’emplois par exemple). Aussi est-il difficile de s’assurer que les mesures ont bien atteint leur but, puisque celui-ci n’avait pas été clairement explicité » (Cour des comptes, 2002).
Cette clarification a été apportée ex post, au travers des projets annuels de performance. Celui qui se trouve annexé au projet de loi de finances pour 2009 mentionne un objectif unique assigné aux Zones franches urbaines, celui de « renforcer la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires », érigé au rang d’objectif n°1 du programme 147 : « L’enjeu est de revitaliser les zones urbaines sensibles en y restaurant une vie économique résidentielle et en favorisant le maintien et le développement des commerces et des services de proximité. Au-delà de cet effort de remise à niveau, l’ambition de la politique de la ville est, de manière plus transversale, de participer, par le développement économique de ces quartiers, à leur restructuration urbaine et à la transformation de leur image, ainsi qu’à leur ouverture sur le reste de l’agglomération en générant des flux de clients, de salariés et d’investissements ». Le même document précise toutefois que « les régimes spécifiques d’exonérations fiscales et sociales applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) visent à favoriser le maintien et le développement des activités économiques et de l’emploi dans des quartiers urbains très défavorisés connaissant les niveaux les plus élevés de handicaps économiques et sociaux ». Les deux indicateurs de performance retenus pour suivre la réalisation de l’objectif de mixité fonctionnelle portent donc sur le développement de l’activité économique et de l’emploi : un indicateur mesure l’« écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie, de commerce ou de services dans les ZFU et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes », et un second l’« écart entre l’évolution du nombre d’emplois salariés existants dans les ZFU et celui constaté dans les unités urbaines correspondantes ». On remarque que l’emploi des résidents n’a pas été retenu comme indicateur de performance, ce qui peut se comprendre dès lors que l’objectif central assigné (ex post) au programme est formulé en termes de mixité fonctionnelle et non d’accès à l’emploi des habitants des quartiers visés. Déjà, la loi du 1er août 2003 avait inscrit le programme des zones franches sous un titre II relatif au « développement économique des quartiers prioritaires ». Le « nombre d’embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en ZUS » ne figurait qu’en annexe, au titre d’indicateur de mise en oeuvre.
1. Quels effets sur l’activité économique ?
Toutes les études disponibles concordent pour décrire un dynamisme certain des ZFU. Ainsi, entre 1997 et 2001, le taux d’implantation d’établissements a-t-il augmenté trois fois plus dans les ZFU que dans le reste des agglomérations d’appartenance des ZUS (Ernst, 2008). L’attractivité des ZFU se confirme dans les années récentes, avec en 2008 des taux d’installation de nouveaux établissements de 21,4 %, 24,9 % et 24 % respectivement pour les ZFU des première, deuxième et troisième générations, contre 15,8 %, 15,7 % et 15, 7 % pour leurs unités urbaines de référence (ONZUS, 2009). Ces résultats très favorables peuvent être toutefois nuancés sur plusieurs points.
a) Une dynamique à relativiser
Tout d'abord, les dynamiques locales varient fortement selon les régions. Ensuite, la progression du nombre d’établissements dans les ZFU est d’autant plus forte que les bases de départ étaient faibles (Van de Walle, Britton, 2007). En dépit de cette croissance, le tissu économique des ZFU demeure peu développé : la comparaison du nombre d’établissements pour 1 000 habitants entre les ZFU et leur agglomération révélait en 2006 un écart persistant de 41 points pour la première génération, de 39 points pour la seconde génération et de 33,5 points pour la troisième génération. Le projet de loi de finances pour 2007 a fixé un objectif de disparition totale de ces écarts à l’horizon 2011. Avec un rythme de croissance annuel du nombre d’établissements supérieur de 6 points à celui de leurs unités urbaines de référence, il faudrait respectivement 22 ans, 18 ans et 14 ans aux ZFU des première, deuxième et troisième générations pour que cet objectif se réalise (ONZUS, 2007).
En outre, le rattrapage en termes de « taux d’installation » que mesure l’ONZUS n’est pas « net » des disparitions survenues dans l’année. Or, il a été montré que le taux de survie des entreprises en ZFU était inférieur, en moyenne, à celui de leurs unités urbaines de référence. Selon une étude de l’INSEE, citée par le Conseil économique, social et environnemental (Benatsou, 2009), sur 29 000 établissements implantés en ZFU de première génération de 1997 à 2001, les taux de survie à 4,5 ans étaient respectivement de 35,9 % et 39,7 % dans la ZFU et dans l’unité urbaine de référence ; à 9,5 ans, ces taux de survie étaient de 16,5 % en ZFU et de 21,8 % en unités urbaines. Le désavantage propre aux ZFU a donc tendance à s’accentuer dans la durée, même s’il n’y a pas de décrochage massif à l’échéance de cinq ans, ce que pouvait faire craindre la limitation à cette échéance de certains volets des exonérations115.
En matière d’implantation de nouveaux établissements, les ZFU de première génération continuent de rattraper leur retard sur leurs unités urbaines de référence, comme l’attestent des taux d’installation supérieurs dans le courant de l’année 2008 (21,5 % contre 15,8 % dans leur environnement). On remarque cependant que ces taux d’installation régressent pour la deuxième année consécutive dans les ZFU de la première génération. Il en va de même dans les ZFU des générations plus récentes : le taux d’installation diminue en 2008 (24,9 %, soit - 2 points dans les ZFU de la deuxième génération ; 24 %, soit - 4 points dans celle de la troisième génération) tout en restant à des niveaux très supérieurs à ceux des unités urbaines qui les entourent (15,7%) (ONZUS, 2009). La diminution tendancielle de la dynamique d’installation est sans doute liée à une réduction progressive de l’intérêt relatif des ZFU puisque les exonérations de charges sociales sont dégressives dans la durée. La suppression annoncée de la part de la taxe professionnelle, s’ajoutant à la suppression de certains avantages par la loi de Finances pour 2009, ne peuvent que réduire tendanciellement l’attractivité des ZFU (Hamel, André, 2009). S’ajoutent également les limites physiques à l’accueil des entreprises, sachant que le taux de remplissage des locaux d’activités approche souvent les 100 % dans ces zones (ECs, 2009a).
La question des effets propres des ZFU est longtemps restée un point aveugle des études et recherches sur ce dispositif, qui ne permettaient pas de distinguer ce qui, dans l’évolution du tissu économique et de l’emploi de ces zones, pouvait être imputé aux exonérations. L’étude réalisée par Roland Rathelot et Patrick Sillard en 2008 s’y est essayée en recourant à des techniques économétriques. De la comparaison de 41 Zones de redynamisation urbaine devenues ZFU en 2004 avec les ZRU qui le sont restées, il ressort que le passage de ZRU en ZFU augmente de 24 points le taux de croissance des flux bruts d’établissement l’année d’attribution du label, puis le taux de croissance retombe au niveau qui prévalait avant le passage en ZFU.
Sachant que le nombre moyen d’établissements créés (ou transférés) annuellement dans les ZFU de la deuxième génération est de l’ordre de 3 000, l’effet propre du dispositif ZFU correspond ainsi à la création (ou au transfert) d’environ 750 établissements par an. Les ZFU ont donc un impact sensible, mais il procède moins de la création d’activités que de transferts de proximité : les relocalisations d’établissements représentent les deux tiers des flux d’établissements supplémentaires dus au passage en ZFU (Rathelot, Sillard, 2008)116. Ce phénomène de transferts est également souligné par une étude qualitative portant sur un échantillon de quinze ZFU. Les relocalisations concernent en particulier certaines activités libérales, notamment médicales, ce qui peut avoir un impact positif sur des quartiers relativement dépourvus de ce type de services (ECs, 2009a).
b) Une contribution limitée à la mixité fonctionnelle
Les secteurs d’activités représentés dans les ZFU sont relativement diversifiés, de sorte qu’il est difficile d’en dresser le profil-type (ECs, 2009a). Les ZFU se caractérisent néanmoins par une nette sur-représentation des entreprises liées à la construction, et particulièrement au bâtiment, et dans une moindre mesure des établissements de santé. Inversement, les ZFU sont nettement moins pourvues que les territoires environnants en hôtels-restaurants, services personnels et domestiques ou activités culturelles.
Les commerces constituent la première activité économique dans les ZFU (21 % des établissements) (Ernst, 2008). Si tous types de dispositifs confondus (ZFU, ZRU, ZUS), le tissu commercial des quartiers prioritaires est largement sous-développé, avec moins de 12 établissements pour 10 000 habitants, contre 35 pour la France entière au recensement de 1999, les ZFU se trouvent en meilleure position relative. Car outre les exonérations, elles bénéficient d’un effet de taille qui offre un réservoir de clientèle plus large (Abalain, Jubien, 2009). Les ZFU continuent pourtant de souffrir de graves déficits en termes d’implantation commerciale. Une étude de la Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales portant sur 79 ZFU révèle que 61 n’ont pas de centre commercial et que les commerces alimentaires dominent très largement (70 %). Les incitations fiscales ne sont donc pas suffisantes pour régler des problèmes d’image ou de sécurité qui entravent le développement d’une offre commerciale (Rochefort, 2008). Une étude sur les commerces en Zones urbaines sensibles semble regretter le fait que les exonérations visent indistinctement tout type de secteur, sans ciblage particulier en faveur des commerces de proximité, alors que c’est une priorité majeure des pouvoirs publics dans la perspective d’une mixité fonctionnelle (Mordret, Maresca, 2009).
À lui seul, le dispositif ZFU ne suffit donc pas à produire une diversification fonctionnelle significative. À cet égard, la faible synergie entre développement économique et opérations de rénovation urbaine117 joue défavorablement. 80 % des territoires classés en ZFU font l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Or ces opérations peuvent être déstabilisatrices pour le tissu commercial existant dont l’équilibre économique repose sur le faible coût des loyers et le caractère captif d’une partie de la clientèle, deux éléments qui peuvent être remis en cause par la rénovation urbaine (Madry, 2007). L’articulation entre ZFU et PRU n’est guère visible sur le plan du pilotage des deux dispositifs. Il y a pourtant un enjeu concret à anticiper les besoins fonciers et immobiliers des entreprises qui s’implantent dans les ZUS (Benatsou, 2009). Des exemples montrent que des stratégies globales (construction d’espaces et structures d’accueil d’entreprises, restructuration des centres commerciaux, changements d’usage, synergie avec des équipements publics attractifs…) peuvent être efficaces. Mais dans la plupart des cas, les entreprises sont confinées dans des zones et parcs d’activités localisés en périphérie des quartiers, à l’écart des lieux de vie, ce qui n’améliore pas la mixité fonctionnelle de ces derniers (ECs, 2009a).
L’articulation entre les ZFU et les autres volets d’une politique globale de développement des quartiers n’a pas été pensée à l’échelon central. Le déficit d’intégration se vérifie aussi localement, où le dispositif est avant tout perçu comme un outil fiscal et rarement comme un outil stratégique intégré à un projet global de développement territorial. Ainsi, quand la ZFU est portée par un EPCI, elle est rarement considérée comme un levier majeur de développement économique de l’agglomération, mais davantage comme une politique de réparation localisée (ECs, 2009a).
Il semble que les ZFU ne relèvent ni vraiment d’une logique de développement exogène, ni vraiment non plus d’une logique endogène. Une stratégie exogène suppose de penser la place spécifique de ces zones dans le développement économique des agglomérations, en appui sur une analyse de leurs potentialités et des interactions à développer avec d’autres espaces économiques, ce que l’absence de portage intercommunal rend difficile (ECs, 2009a). Une stratégie endogène suppose de prendre appui sur les initiatives économiques des habitants, et pas seulement sur l’attraction d’entreprises extérieures. Elle supposerait donc un net renforcement des dispositifs de soutien à la création d’entreprise dans les ZFU, qu’il s’agisse du micro-crédit (Benatsou, 2009) ou de l’apport de conseils et de formation dédiés, dont l’importance est révélée par le taux de mortalité des établissements créés en ZFU, deux fois plus élevé que la moyenne (Dubrac, 2008).
2. Quels effets sur l’emploi ?
Différentes études s’attachent à mesurer les effets des exonérations sur l’emploi dans les ZFU, qui mettent en évidence une certaine efficacité du dispositif en même temps qu’elles conduisent à questionner son efficience.
a) Un programme plus efficace qu’efficient
Le nombre annuel d’embauches ouvrant droit aux exonérations a plus que doublé entre 2002 et 2007, passant de 7 923 en 2002 à 18 452 en 2007, avant de refluer à 16 578 en 2008, ce qui pourrait être un effet de la crise économique et/ou d’un essoufflement du dispositif. Au cours des années précédentes, la dynamique a été principalement portée par l’élargissement du dispositif, comme en témoigne l’augmentation de 42,4 % des embauches exonérées en 2004, à l’arrivée d’une seconde génération de zones franches. De fait, si les ZFU de la première génération concentraient encore 70 % des embauches en 2006, leur progression annuelle a ralenti (+6 %) au profit des ZFU de la seconde génération (+36 %) (Van de Walle, Britton, 2007 ; Bachelet, 2008b ; Benatsou, 2009 ; ONZUS, 2009).
Si les augmentations annuelles d’embauches exonérées sont significatives jusqu’en 2008, il convient d’en relativiser la portée sur l’emploi. Tout d'abord, le recours au temps partiel est devenu de plus en plus fréquent : il ne représentait que 16 % des embauches des ZFU de 1997, mais 22 % de celles de 2004 et 35 % de celles de 2006. Ensuite, la montée en puissance du dispositif ne suffit pas à rééquilibrer significativement le nombre d’emplois par actif de ces zones. On comptait environ 10 emplois pour 100 actifs en 1997, dans les 38 zones franches métropolitaines de la première génération. En 2003, ce ratio s’établissait à 13 emplois pour 100 actifs, 22 % de la hausse résultant de transferts (Gilli, 2006 ; Gobillon et al. 2010). Le rythme d’accroissement des embauches exonérées est bien trop lent pour combler l’écart avec d’autres territoires. Ainsi, dans les neuf ZFU d’Île-de-France, on comptait environ un emploi pour six habitants en 1999, contre un emploi pour deux résidents en moyenne régionale (Andrieux, Bonnefoi, 2004).
Les effets propres des exonérations sur la création (ou le transfert) d’emplois s’avèrent en réalité réduits, sachant que l’avantage comparatif des ZFU en matière d’exonérations de cotisations sociales patronales était de 48 euros par mois au niveau du SMIC en 2005, et de 126 euros par mois au niveau du salaire médian des nouveaux embauchés (Van de Walle, Britton, 2007). Dans leur comparaison des ZRU et des ZFU passées en ZFU, Roland Rathelot et Patrick Sillard montrent une évolution modeste de l’emploi créé ou transféré, comparée à leurs effets sur les flux d’établissements, avec un accroissement de 15 % du stock d’emplois dans l’année consécutive au lancement de la ZFU, suivi d’une stagnation dès l’année suivante. Ainsi la seconde génération de zones franches a-t-elle abouti à une création nette d’environ 6 000 emplois permanents, en incluant non seulement les emplois transférés, mais également les emplois préexistants qui n’ont pas été supprimés grâce au classement en ZFU (Rathelot, Sillard, 2008).
L’effet limité des ZFU sur l’emploi s’explique aussi par la taille des entreprises préexistantes ou nouvelles. Le nombre moyen de salariés par établissement employeur est de 11,6 en ZFU contre 14,4 dans les unités urbaines environnantes118 (Ernst, 2008). Une capacité d’accueil physique réduite, combinée avec l’absence d’incitations fiscales pour les entreprises ayant plus de 50 salariés, contribuent à limiter l’implantation d’entreprises de taille importante : les établissements de plus 50 salariés représentent 1,2 % du total des établissements contre 1,6 % dans les unités urbaines de référence (Van de Walle, Britton, 2007). Il convient d’ajouter que près du quart des établissements situés en ZFU n’emploient aucun salarié (ONZUS, 2005).
Le programme ZFU a pour particularité de subventionner des emplois bien au-delà des salariés résidents des quartiers prioritaires. À notre connaissance, aucune étude ne permet de savoir avec précision quelle est la proportion de ces salariés dans l’emploi total des zones franches. Les rares données existantes (qui émanent de la DARES) sont anciennes et difficiles à interpréter car elles n’indiquent que la part des salariés résidents dans les embauches réalisées au cours de l’année et ouvrant droit à des exonérations, conformément à l’indicateur défini dans la loi Borloo. La DARES ne précise pas la part des emplois occupés par les habitants au sein des établissements implantés en ZFU, ni même leur part dans l’ensemble des salariés ouvrant droit aux exonérations. Cette lacune semble liée à la difficulté de prendre en compte le lieu de résidence du salarié lors de son embauche, puis des changements éventuels de domicile (Benatsou, 2009).
Si l’on s’en tient à la part des habitants dans les embauches exonérées une année donnée, le chiffre le plus récent de la DARES remonte à l’année 2006 (Bachelet, 2008). Il indique que les résidents des ZFU représentaient 25,8 % des salariés recrutés dans les établissements implantés avant le 1er janvier 2002 et 24,8 % des salariés recrutés dans les établissements implantés après le 1er janvier 2002. Le paradoxe est que la part de l’emploi local dans ces recrutements a diminué (elle était respectivement de 27,4 % et 31,7% en 2003) alors que la clause locale d’embauche a été renforcée (un tiers des emplois donnant droit aux exonérations, au lieu d’un cinquième) et élargie à l’ensemble des quartiers prioritaires des unités urbaines de référence au lieu d’être réservée aux seuls résidents de la zone franche. Cette évolution semble en fait tenir à la régression continue des entreprises de plus de 10 salariés parmi les établissements embauchant en ZFU : 43,4 % des salariés embauchés en 2003 dans une des 93 ZFU métropolitaines l’étaient dans un établissement de 10 à 49 salariés ; ils n’étaient plus que 26,5 % dans ce cas en 2006 et seulement 10,2 % dans les ZFU de la troisième génération (Bachelet, 2008b). Or, les plus petites entreprises ne sont pas soumises à la clause d’embauche locale.
Si les ZFU ne sont pas dénuées d’effets sur l’emploi, la question de l’efficience du dispositif se trouve posée. R. Rathelot et P. Sillard ont comparé le coût budgétaire du dispositif à celui des baisses de charges sur les bas salaires. Ces dernières coûtent de 11 000 à 29 000 euros par emploi, alors que le coût d’un emploi en ZFU varie de 11 000 à 73 000 euros (en intégrant les exonérations fiscales). Les exonérations ZFU n’étant pas limitées aux salaires proches du SMIC, ils « génèrent vraisemblablement des effets d’aubaine qui sont sources d’inefficacité pour le dispositif », concluent les deux auteurs qui font néanmoins valoir un surcoût justifié par les difficultés sociales de ces territoires (Rathelot, Sillard, 2008).
Dans le même sens, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) considère que l’on ne peut apprécier de manière seulement comptable le retour sur investissement économique et financier des ZFU, mais qu’il faut aussi chiffrer ce que cela aurait coûté à l’État si rien n’avait été fait. Il faudrait pouvoir apprécier en particulier la contribution des zones franches au développement du lien social, de l’activité économique et sociale, l’émergence de nouveaux jeunes entrepreneurs issus des quartiers, la dynamisation du tissu associatif ou encore l’absence d’émeutes urbaines d’envergure (Benatsou, 2009). Le CESE a toutefois estimé, dans un précédent rapport, que le « coût indiscutablement élevé de ce dispositif » devait conduire à renforcer les contreparties en termes de création d’emplois et de soutien au recrutement des entreprises, ainsi qu’à « un examen particulièrement rigoureux des implantations d’entreprises qui doivent être physiquement sur les territoires des ZFU » (Le Gall, 2008).
b) Un lien incertain avec l’insertion professionnelle des habitants
Les effets du dispositif ZFU sur l’accès à l’emploi des habitants de ces zones sont difficiles à apprécier, d’autant plus que le taux de chômage y a augmenté de 2003 à 2006, passant de 18,4% à 21,4%, avant de décroître fortement en 2007 (19,0 %) et en 2008 (16,6 %). On peut d’ailleurs noter que l’ONZUS a porté des appréciations contradictoires sur l’impact du dispositif. Dans son rapport 2006, l’observatoire estimait que « les dispositifs ZRU et ZFU, conçus d’abord comme des aides au maintien et au renforcement du tissu économique des quartiers, semblent donc ne pas avoir un impact mécanique suffisant sur le chômage de leurs habitants pour compenser l’ampleur du handicap de départ affectant ces territoires » (ONZS, 2006). Trois ans plus tard, il estimait que la baisse enregistrée en 2007 et 2008 était liée à « l’intensité de la dépense en matière de développement économique » (ONZUS, 2009)119.
Cette hypothèse ne semble pas confirmée par une étude menée en Île-de-France par des économistes qui, contrairement à celle de Rathelot et Sillard (2008), s’intéressent à l’effet des ZFU sur le chômage et non sur l’emploi. Elle conclut à une quasi absence d’impact sur la durée du chômage dans les zones concernées (Gobillon et al., 2010). Ce résultat est conforme à ce que perçoivent les acteurs locaux, pour qui la contribution du dispositif à la réduction des écarts de chômage apparaît globalement faible (ECs, 2009a). L’appréciation de l’impact des ZFU sur le chômage s’avère d’autant plus incertaine qu’un nombre important d’habitants qui accèdent à un emploi dans la zone franche paraissent en déménager après avoir été recrutés (Lelévrier, 2004b).
La faiblesse de l’impact du dispositif sur le niveau de chômage dans les quartiers peut s’expliquer par divers facteurs, en particulier par la forte proportion de très petites entreprises dont les capacités d’embauche sont limitées, et par le décalage entre le profil des postes offerts et celui des personnes qui y vivent (Andrieux, Bonnefoi, 2004)120. Enfin, l’identification insuffisante des potentialités du territoire freine l’ajustement entre l’offre et la demande d’emploi. On constate en effet de manière récurrente une absence de diagnostic fin sur les compétences et qualifications des demandeurs d’emploi dans la ZFU, les acteurs locaux s’arrêtant le plus souvent au constat d’un faible niveau de qualification et de problèmes d’employabilité des habitants. Certains sites ont toutefois mis en place une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). L’action des collectivités locales peut s’avérer déterminante selon qu’elles élaborent ou non, en amont, une stratégie de maîtrise des implantations d’entreprises, suivant une logique de filière ou de cluster qui privilégie les entreprises ayant des besoins en main d’œuvre correspondant au potentiel local (ECs, 2009a). Certains exemples, notamment en Île-de-France, montrent qu’il est possible, dans le cadre d’une ZFU, d’engager avec les employeurs une négociation sur les recrutements (Bureau, 2006), ou de les amener à repenser leurs normes de recrutement selon un « modèle coopératif d’insertion » (Wuhl, 1996). À la question posée par Marie-Claude Bureau, « dans quelle mesure l’indéniable effet de revitalisation économique induit par les ZFU (...) profite-t-il réellement aux habitants qui en ont le plus besoin ? », la réponse n’est pas aisée : d’un côté, la clause d’embauche des résidents paraît respectée, mais de l’autre les salariés embauchés sont de plus en plus qualifiés au fil du temps (Thélot, 2005), signe que la logique de tri sélectif tend à reprendre le dessus (Bureau, 2006).
Le modèle dominant paraît être celui d’une dissociation assez poussée entre les dispositifs d’animation des ZFU et les acteurs su service public de l’emploi, même si la mise en place d’un Groupe solidarité emploi (GSE) a parfois favorisé les coopérations. En termes de pilotage, la division des compétences entre les municipalités et les EPCI ne favorise pas l’articulation de l’économique et du social, la compétence économique étant le plus souvent communautaire, tandis que la compétence emploi/insertion est, au moins partiellement, communale. Cette dissociation renvoie aussi à des cultures professionnelles hétérogènes, dont les cloisonnements sont renforcés par « les organigrammes en tuyaux des administrations » et une faible expérience de la coordination. Il en résulte par exemple une prise en compte trop rare des ZFU dans le volet « emploi-insertion-économie » des CUCS (ECs, 2009a). Ces constats rejoignent ceux qui avaient été faits dans les évaluations intermédiaires des Contrats de ville 2000-2006 (Epstein, Kirszbaum, 2005) et confirment une tendance, déjà observée dans les zones franches des années 1990, à l’autonomisation du développement économique par rapport au développement social (Guelton, Chignier-Riboulon, 2000). Le rapport Hamel-André ne dit pas autre chose : « Malgré la proximité physique et la mise en place d’une obligation de recruter localement, les emplois créés dans les ZFU sont trop souvent en décalage au regard de la qualification des habitants de ces quartiers. Sur le fond, ces résultats ne sont pas surprenants car il est désormais bien établi qu’il puisse exister un "divorce" entre la richesse en termes d’activité d’un territoire et le niveau de vie de ses habitants. Ceci s’explique, en particulier, par le retour insuffisant des richesses produites dans les quartiers, les bénéficiaires ne les utilisant pas sur place » (Hamel, André, 2009).
Les Zones franches urbaines viennent finalement souligner les limites d’une stratégie visant à créer un « marché du travail de proximité » et qui repose sur le pari mécaniste d’une proximité géographique des entreprises garante de l’effacement des distances sociales aux emplois (Ghorra-Gobin, Kirszbaum, 2001). Le diagnostic sous-jacent à cette stratégie de rapprochement des emplois n’est pas très assuré, s’il s’agit d’importer dans le contexte français l’hypothèse américaine d’un spatial mismatch121 (Bacqué, Fol, 2007). Il a été montré que l’accessibilité des emplois ne dépendait pas seulement de leur proximité géographique, mais aussi voire surtout des réseaux d’inter-personnels dans lesquels s’inscrivent les individus (Granovetter, 1995), réseaux dont l’importance était plus cruciale encore pour les personnes les moins qualifiées, les jeunes et les minorités ethniques que pour d’autres groupes (Holzer, 1988). L’une des rares études conduites en France sur cette question montre, à propos des quartiers ségrégués d’Île-de-France, que la dimension des réseaux sociaux influence davantage la probabilité de sortie du chômage que la distance physique des emplois, même s’il est vrai que l’accessibilité physique aux emplois n’est pas uniforme dans tous les quartiers (Gobillon, Selod, 2007).
Une autre étude économétrique, menée plus récemment en Île-de-France, a testé les effets respectifs sur le chômage de la distance domicile-emploi, de la sous-qualification des travailleurs et des caractéristiques du voisinage social. Elle montre que les trois effets jouent sur le retour à l’emploi. L’étude va plus loin en proposant une simulation à partir de différents scénarios de politiques publiques : amélioration de l’accessibilité physique aux emplois par les transports, action sur la formation, création d’emplois de proximité, augmentation de la part des logements sociaux dans les communes déficitaires, développement des politiques locales d’emploi, augmentation du revenu des ménages. Il en ressort que les politiques de création d’emplois au niveau de la commune, d’augmentation de la part de logements HLM dans les communes déficitaires et, dans une moindre mesure, d’augmentation de la part des emplois aidés ont des effets très faibles –voire nuls– sur la durée du chômage. Les politiques les plus efficaces sont celles qui tendent à réduire le « skill mismatch », c'est-à-dire l’inadéquation des compétences des chômeurs aux besoins des entreprises, et celles qui réduisent la distance moyenne domicile-travail par une meilleure accessibilité en termes de transports (Georges et al., 2010).
Ces conclusions sont convergentes avec une troisième étude économétrique qui met en regard l’efficacité relative des politiques ciblées sur des zones et celles qui ciblent des individus, que les auteurs concluent par cette interrogation sur la politique des zones franches : « Est-il justifié de fournir des aides à une zone spécifique au lieu d’aider directement les individus qui habitent dans cette zone ? Pourquoi introduire des distorsions nouvelles dans les décisions d’investissement des entreprises au lieu de fournir une assistance directe comme, par exemple, la formation professionnelle, l’éducation, les services publics locaux (crèches, gardes d’enfants) ? En outre, la relocalisation de certaines activités vers les zones franches, même si elles aident celles-ci, peut se faire au détriment d’autres zones, non reprises dans la liste des zones prioritaires mais qui peuvent très bien se trouver sur le fil du rasoir. Dans ce cas, le bilan est loin d’être clair » (Thisse et al. 2003).
Les Entreprise Zones ont-elles un impact ? Les enseignements contradictoires des évaluations anglo-saxonnes
La création des Zones franches urbaines, en 1996, s’inscrit dans un courant international, qui a pris naissance en Grande-Bretagne avec les Entreprise Zones (EZ). Elles ont été rapidement popularisées aux États-Unis. Les administrations Reagan et Bush ont essayé, en vain, dans les années 80, de créer des Enterprise Zones fédérales, mais le Congrès n’en a pas voulu. À défaut, les EZ ont essaimé dans une quarantaine d'États, jusqu’à l’adoption, en 1993, du programme Empowerment Zones/Enterprise Communities de l’administration Clinton dont l’ambition était toutefois plus globale qu’un simple dispositif d’allègement de taxes. Également mises en oeuvre dans d’autres pays anglo-saxons (Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande…), les Entreprises Zones ont suscité une littérature économique considérable. Pourtant, aucun consensus ne se dégage de ces travaux s'agissant de leur impact sur l’activité économique ou l’emploi. C’est ce que mettent en évidence, à propos de l’emploi, les économistes français, Laurent Gobillon, Thierry Magnac et Harris Selod.
Gobillon L. et al. (2010), « Do unemployed workers benefit from Enterprise zones ? The Greater Paris experience », Working paper, March 3.
Les instruments fiscaux utilisés dans les programmes d’Enterprise Zones prennent des formes très variables : il s’agit tantôt d’allègements d’impôt sur les entreprises, tantôt d’exonérations de charges sociales sur les embauches ou sur l’ensemble des salariés, ou encore d’une combinaison des deux. Les mesures adoptées varient aussi en fonction du mode de désignation des zones, de la conditionnalité éventuelle des avantages fiscaux et sociaux, de l’intensité, du champ, de la durée de ces avantages, ou encore de l’exigence ou non de concevoir un projet de développement urbain en même qu’est créée la zone franche.
Une série de critiques économiques ont été formulées concernant le potentiel de développement de l’emploi des EZ. La première concerne l’effet d’aubaine, dénué d’impact, par définition, sur le niveau de l’emploi local. Mais le fait de conditionner les avantages fiscaux à des recrutements locaux, comme c’est souvent le cas, peut renforcer l’impact des EZ sur le marché du travail. Une autre critique, liée à la précédente, porte sur des transferts d’emplois d’un territoire à l’autre qui ne s’accompagnent d’aucune création nette. Cependant, même dans un jeu à somme nulle, on peut considérer qu’il s’agit d’un succès de la politique menée à partir du moment où il apparaît socialement souhaitable de redistribuer les emplois existants au profit des territoires désavantagés. Un troisième argument est que la labellisation stigmatise les zones ciblées, la question étant alors de savoir si les bénéfices en termes d’emploi l’emportent sur cet éventuel effet pervers. Une quatrième objection pointe l’absence de compensation des pertes fiscales, avec un effet négatif sur les services publics qui peut être à son tour préjudiciable à l’emploi, ou a minima au bien-être des habitants. Une cinquième critique fait valoir des effets bénéfiques mais qui prennent fin avec l’arrêt des exonérations. Ou alors ces exonérations sont prorogées, et cela revient à pérenniser une politique très coûteuse. On peut avancer enfin que les incitations fiscales sont insuffisantes pour améliorer l’emploi local quand des raisons plus structurelles expliquent le chômage, par exemple le problème de formation de la population active du quartier.
Étonnement, alors que la littérature évaluative sur les Entreprises Zones est abondante, beaucoup d’évaluations conduites jusqu’au milieu des années 1990 n’ont pas respecté les standards méthodologiques devenus courants dans l’évaluation des politiques publiques. Dans nombre de cas, ces prétendues évaluations ont seulement recueilli des données sur l’emploi local, à l’échelle des EZ ou parfois en comparaison avec d’autres territoires, en laissant dans l’ombre la question de l’effet propre du dispositif. Ajoutons à cela que certaines évaluations poursuivent des buts politiques ou idéologiques.
Ce manque de rigueur et d’indépendance politique a longtemps obscurci les enseignements de la littérature sur les EZ. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour qu’émergent des évaluations appuyées sur des techniques d’observation adéquates et mobilisant une diversité d’indicateurs relatifs au marché du travail. Pourtant, même ces évaluations économétriques donnent des résultats contrastés. La première étude du genre, celle de Papke (1994), a porté sur les effets du programme EZ mis en place dans l’Indiana en 1983. Elle montre une diminution du chômage de 19 % dans l’année qui a suivi l’instauration de la zone. À l’inverse, dans une étude du programme EZ du New Jersey reposant sur une méthode d’observation similaire, mais cette fois à l’échelle des municipalités concernées, Boarnet et Bogart (1996) ne détectent aucun effet. Pour l’expliquer, les auteurs suggèrent l’existence de transferts d’emplois internes aux municipalités.
Ces résultats contrastés conduisent à se demander si certaines EZ ne seraient pas plus efficaces que d’autres selon leurs caractéristiques propres. Bondonio et Engberg (2000) ont estimé l’effet sur l’emploi local de cinq programmes différents conduits dans des États américains. En dépit de leur variété, l’impact différentiel des EZ sur l’emploi apparaît très faible. Comme Boarnet et Bogart, ils suspectent des effets de transfert. Bondonio et Greenbaum (2007) ont élargi l’étude à onze États pour observer, de façon séparée, l’effet des EZ sur les entreprises nouvelles, existantes et celles qui disparaissent. Ils constatent que le dispositif augmente bien l’emploi dans les nouveaux établissements, mais que cet effet est contrarié par une accélération des pertes d’emploi dans les établissements qui disparaissent. Ils montrent également que les avantages attachés aux emplois eux-mêmes ou à l’élaboration de projets locaux de développement ont un impact plus fort sur les entreprises existantes.
O’Keefe (2004) a étudié les Enterprise Zones de Californie, où les avantages sont attachés au recrutement de bas salaires pendant une durée de six ans, pour savoir si les effets sur l’emploi s’arrêtaient au terme de ces six années et si les exonérations n’étaient pas tout simplement absorbées dans des augmentations des salaires. Il apparaît que la croissance de l’emploi a été supérieure de 3,1 %, tout au long du programme, à ce qu’elle aurait été sans Enterprise Zone. Mais cet effet est bel et bien transitoire, ce qui s’explique probablement par l’extinction des exonérations à l’issue de la période, mais aussi par la saturation progressive des terrains et locaux disponibles. En revanche, le niveau des salaires ne semble pas affecté par le programme EZ. Ce dernier résultat est toutefois contredit par Bostic et Prohofsky (2006) qui se sont également intéressés au programme californien. Ils montrent que les salaires augmentent plus vite dans les zones concernées.
C. LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le Programme de réussite éducative a été institué par la loi de programmation du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale. Depuis lors, 531 Projets de réussite éducative (PRE) ont été mis en place dans 718 communes et 1 361 quartiers prioritaires. Ces projets s’adressent spécifiquement aux enfants ou adolescents de moins de 16 ans « les plus fragilisés », résidant en ZUS ou scolarisés en éducation prioritaire, ainsi qu’à leur famille. L’originalité de la démarche tient au passage d’une approche territoriale –celle qui fonde traditionnellement l’éducation prioritaire– à une approche ciblée sur des publics, résidant certes dans des territoires prioritaires, mais qui font l’objet d’un traitement individualisé ou « sur-mesure », selon l’expression figurant dans la circulaire de la DIV aux préfets du 11 février 2006. Le ministre de l’Éducation nationale d’alors, M. Gilles de Robien, parlait de « recentrer les ressources en passant d’une logique de territoire à une logique d’élèves », puisque « nous ne sommes plus dans une logique de réparation territoriale mais dans une logique d’ambition pour chaque élève »122.
Avec un budget en progression constante depuis 2005, qui atteint 90 millions d’euros d’autorisations d’engagement dans le projet de loi de finances pour 2009, contre 62 millions en 2005, la réussite éducative est devenue le programme le plus important de la politique de la ville s’adressant directement à des personnes123. Il convient cependant de souligner que plus de la moitié de ces crédits est utilisée pour le financement d’« équipes pluridisciplinaires de réussite éducative », comme précisé dans le bilan annuel effectué par l’ACSÉ en septembre 2009124. Ce bilan souligne aussi qu’une centaine de quartiers CUCS de « niveau 1 » ne sont toujours pas couverts par le dispositif en 2009. Du fait de son mode de financement par des appels à projets, des disparités importantes subsistent aussi entre régions, départements et sites concernés. L’ACSÉ note d’ailleurs que ces disparités se sont accrues au fil des ans, les PRE validés en 2005-2006 apparaissant mieux dotés que les suivants (ACSÉ, 2009).
Les équipes pluridisciplinaires sont chargées de mettre en place, essentiellement hors temps scolaire, des actions dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture ou des sports en direction d’un nombre restreint d’enfants et de familles. La prise en charge des premiers est qualifiée de « parcours individualisé de réussite éducative », dont on voit qu’il dépasse le seul registre scolaire, l’hypothèse étant que « les difficultés scolaires que rencontrent beaucoup d’enfants et d’adolescents résultent bien souvent de facteurs liés à leur environnement social, culturel et familial ou à des difficultés de santé qui peuvent entraîner le décrochage et l’absentéisme scolaires, le repli sur soi et, parfois, des problèmes de comportement »125. Portées par les équipes pluridisciplinaires, l’approche individualisée et l’approche globale forment ainsi deux facettes a priori indissociables de la réussite éducative, dont il est attendu tout à la fois qu’elle améliore la réussite scolaire, le comportement et l’état de santé des enfants, en même temps qu’elle produise des effets sur leur environnement social, culturel et familial. Les travaux évaluatifs que nous avons pu consulter renseignent en fait bien davantage sur les modes d’action originaux des PRE que sur l’atteinte de ces objectifs.
1. Quels effets de l’approche individualisée ?
La référence à l’individualisation dans l’éducation n’a pas attendu la réussite éducative pour faire son apparition dans les discours et pratiques de l’Éducation Nationale. Apparue dans les années 1970 et 1980 sous la bannière de la « pédagogie différenciée », invitant les enseignants à prendre en compte l'hétérogénéité des publics, elle a été consacrée par la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (dite loi Jospin) appelant à placer « l’élève au centre du système éducatif ». Cette approche s’est déclinée dans les notions de « projet personnel » ou de « contrat » entre l'élève et son établissement. Cette approche individualisée s’est traduite plus récemment par le lancement, au sein des collèges, des « Programmes personnalisés de réussite éducative » (PPRE), apparus en 2005 concomitamment aux PRE, puis en 2008 de l’« Accompagnement éducatif » dans les écoles et collèges.
Cette « nouvelle doxa » qu’est la thématique de l'individualisation (Joly-Rissoan et al., 2006) dépasse la seule institution scolaire. Elle concerne l'ensemble des politiques sociales qui tendent à mobiliser et responsabiliser les individus pour l’accomplissement d’une trajectoire personnelle (Donzelot, Roman, 1998), sur la base d’un « contrat moral » passé entre le professionnel et le bénéficiaire. Mais ces notions sont plus prisées encore dans le champ de la jeunesse et de l’éducatif où la problématique du rapport à la règle et à l’autorité fait figure d’enjeu majeur. Les jeunes, comme leurs parents, sont désormais priés de témoigner de leur engagement à participer activement aux actions qu’on leur propose et à respecter les « normes » édictées par les institutions (Goirand, 2009). Autant de principes inscrits dans les démarches de réussite éducative.
a) De fortes réticences initiales
La première étape d’une démarche de réussite éducative consiste dans le repérage d’un enfant en difficulté ou présentant des troubles comportementaux par un professionnel du secteur socio-éducatif (enseignant, animateur, éducateur…) qui saisit l’équipe pluridisciplinaire de réussite éducative (EPRE) ou un « référent » local en charge du dispositif, afin d’établir une demande d’intervention en direction de l’enfant ou de ses parents. Une fois les parents avertis de la démarche, et sous réserve de leur accord obligatoire, la « situation » est présentée aux différents partenaires de l’équipe susceptibles de connaître l’enfant. Puis s’enclenche une évaluation partagée de la situation par les différents professionnels impliqués, devant déboucher sur des propositions de réponse (Goirand, 2009).
Le programme a connu un démarrage très laborieux qui s’explique notamment par les fortes résistantes qu’a suscitées la notion même de « repérage » des enfants et, derrière eux, d’un milieu familial qui serait propice à l’échec scolaire ou à des comportements déviants. Le contexte national était très défavorable, avec la publication du rapport de la commission Prévention du groupe d’études parlementaire sur la sécurité intérieure, présidée par M. Jacques-Alain Bénisti (2004), qui identifiait le fait de parler une langue étrangère dans le foyer comme un facteur de délinquance, puis d’un rapport de l’INSERM (2005) sur les Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent qui proposait de repérer, jusque dans les premiers mois de la vie de l’enfant, divers facteurs de risque associés à son tempérament ou sa personnalité. Sans compter la préparation d’une loi sur la prévention de la délinquance qui entendait organiser le partage d'information entre le maire et les travailleurs sociaux.
Dans ce contexte, de nombreux intervenants sociaux, sanitaires et éducatifs ont accueilli avec suspicion une politique de réussite éducative dans laquelle ils voyaient une inspiration comportementaliste, une approche sécuritaire et un pilotage par les élus locaux qui allaient à l’encontre de leur culture professionnelle (Bier, 2007 ; IREV, 2007). Comme l’ont souligné de nombreuses études et rapports officiels, les nouveaux coordonnateurs « réussite éducative » ont rencontré des difficultés pour faire accepter le dispositif de réussite éducative par certains partenaires sociaux et éducatifs (CNV, 2007c ; Morel, 2007 ; ACSÉ, 2009 ; Comité de suivi du Plan de cohésion sociale, 2009). Le moindre des obstacles n’a pas été la dimension déontologique, soulevée par les travailleurs sociaux (respect de la volonté de la famille, protection des dossiers, confidentialité…), qu’ils relèvent de Conseils généraux, de Caisses d'allocations familiales ou de l'Éducation nationale. La préparation de « chartes de confidentialité » a donc été un élément, sinon de blocage du moins de sérieux retard dans le démarrage du programme. La réussite éducative n’était pas seulement en décalage avec la culture des travailleurs sociaux, elle les dépossédait d’un élément constitutif de leur identité professionnelle en créant un circuit parallèle de repérage d’individus en difficulté (Joly-Rissoan et al., 2006).
La notion même de « parcours individualisés » suscitait –et suscite encore– des réserves de taille chez les professionnels de la politique de la ville ou de l’éducation, dès lors que la prise en compte de la singularité des situations paraît occulter l’analyse des inégalités et discriminations inhérentes aux systèmes éducatifs, scolaires et sociaux qui contribuent à créer ces situations (Résovilles, 2010). L’idée que chaque enfant est unique rencontre l’adhésion des professionnels, mais ceux-ci soulignent le risque qu’il y aurait à extraire la situation personnelle de la situation sociale de l’enfant, en reportant sur lui le problème repéré, et en agissant à ce seul niveau, pour le « responsabiliser », alors même que ses conditions de vie ne lui permettent pas toujours de répondre à cette injonction. En travaillant sur les « fragilités » de l’enfant, les PRE pourraient donc traiter le symptôme et non sa cause (Glasman, 2008), en risquant d'enraciner ces « fragilités » dans un substrat psychologique ou dans une situation familiale qui réduirait l’approche globale à une « pathologisation de la famille » (Joly-Rissoan et al., 2006). D’où la distinction parfois proposée entre approche « personnalisée » et approche « individuelle », car « l’individualisation renvoie à un être pensé comme un isolat, responsable de sa situation, sur lequel on interviendra sans prendre en compte le contexte », alors que « la personnalisation implique la prise en compte de la personne, c’est-à-dire d’un sujet pris dans une globalité » (Bier, 2007).
Une façon de lever ces doutes est de concevoir l’approche individualisée de la réussite éducative comme un instrument d’accès aux droits, à condition toutefois de s’écarter d’explications comportemantalistes du « non-recours au droit », fréquentes chez les professionnels considérant que certains individus n’y accèdent pas pour des raisons qui tiendraient à leur manque de motivation ou à leur négligence et non en raison des carences dans l’offre de services (Warin, 2003). Cette question touche alors à celle de la légitimité des équipes de réussite éducative dans leur fonction d’interpellation du droit commun (Résovilles, 2010). Dans certains sites, la réussite éducative représente une opportunité pour « relire » l'offre de services et retravailler les actions existantes (CR-DSU, 2009). Mais elle peut aussi servir à combler des manques (IREV, 2007). Ainsi la réussite éducative semble-t-elle osciller entre deux modèles : l’ouverture d’une ère nouvelles pour les services publics d’éducation au sens large, qui mobiliserait une plus grande diversité d’acteurs à travers ce que l’analyse de situations individuelles révèle des défaillances du droit commun ; elle pourrait à l’inverse accompagner le retrait des services publics, qui sous-traitent au PRE des questions qu’ils ne peuvent plus traiter, quand par exemple une MJC ferme ses portes et livre des enfants à la rue, ou quand des postes d’assistants d’éducation ne sont plus assurés dans les écoles ou les collèges (Glasman, 2007a ; CR-DSU, 2009).
Une autre interrogation porte sur la focalisation, induite par la notion de « repérage » des difficultés, sur les seuls handicaps des enfants et de leur famille. Certes, le discours des équipes PRE valorise d'abord leurs « potentiels » et « compétences » (Résovilles, 2010). Mais en pratique les grilles de repérage des publics intègrent rarement des critères mettant en avant ces ressources et lorsqu’elle a lieu, cette inflexion serait le fait de travailleurs sociaux (IREV, 2007). La question est notamment soulevée à propos du regard porté sur les parents que les équipes de réussite éducative ont, là aussi, tendance à valoriser, en jouant notamment un rôle de médiation entre les familles et l’école (Aures, 2008). Mais les acteurs de la réussite éducative constatent la persistance de rapports de « sujétion » ou de « domination » entre l’Éducation nationale et les parents (Résovilles, 2010). Les dispositifs de réussite éducative leur accordent eux-mêmes une place ambiguë. D’un côté, les parents sont considérés comme des partenaires indispensables, ne serait-ce qu’en raison de l’autorisation expresse et écrite qu’ils doivent donner à la prise en charge d’enfants mineurs ; les acteurs institutionnels savent aussi que la mobilisation des parents est un élément d’efficacité incontournable, comme l’ont montré des études scientifiques à propos de l’accompagnement scolaire (Piquée, Suchaut, 2002). Mais de l’autre côté, ces parents sont un « public-cible », au même titre que leurs enfants, puisqu’ils sont supposés prendre part aux interactions conduisant aux situations d’échec de ces derniers (Bouamama, 2009).
La considération pour les familles ne va d’ailleurs jamais jusqu’à conférer une place effective à leurs représentants au sein des équipes pluridisciplinaires. La relation entre les acteurs du PRE et les familles serait donc marquée par une dissymétrie fondamentale : les premiers proposent une aide, un accompagnement, qui assignent les seconds à une position définie par l’incomplétude de savoirs, de moyens ou de compréhension (Herreros, 2008). Fondée sur la mobilisation individuelle –et non pas collective– des parents, la volonté de les impliquer ne saurait donc occulter des relations de pouvoirs (Bouamama, 2009). Si la distance, voire l’hostilité de certains parents de milieux populaires à l’égard de l’école participe des mécanismes de non-réussite de leurs enfants (Thin, 1998 ; Périer, 2005), l’école ne serait pas la mieux placée pour les rallier aux PRE (Joly-Rissoan et al., 2006).
Cela ne veut pas dire que les familles se désintéressent de la réussite de leurs enfants, et de l’apport potentiel des PRE à leurs enfants ou à eux-mêmes (Aures, 2008). Ainsi, quand les parents sont autorisés à solliciter directement l’équipe pluridisciplinaire, certains saisissent cette possibilité pour venir exposer leurs problèmes (Résovilles, 2010). Mais leur mobilisation reste généralement en deçà des attentes des professionnels, quand les familles ne vont pas jusqu’à provoquer des abandons de parcours (Act Consultants, cité par ACSÉ, 2009). C’est que la notion d’engagement contractuel apparaît souvent formelle et dénuée de contenu mobilisateur (Aures, 2008). Passer contrat peut requalifier symboliquement les parents, mais il peut s’agir aussi d’une quasi « extorsion » par les professionnels, si les parents sentent peser sur eux la menace des institutions. Et pour certains, la responsabilisation proposée va au-delà de leurs moyens. Du coup, cette responsabilisation peut se retourner contre eux, car on pourrait leur dire cette fois que l’échec de leur enfant leur incombe (Joly-Rissoan et al., 2006 ; Glasman, 2007a).
Ce serait l’un des risques de la réussite éducative : à force d’invitation à la performance, les publics ciblés se verraient stigmatisés s’ils échouent (Herreros, 2008). Puisque les dispositifs de réussite éducative ont « maximisé les chances de réussir », l’individu deviendrait responsable de son échec (Étienne, 2009). Ce risque de stigmatisation concernerait aussi et peut-être d’abord les parents (Bouamama, 2009), à cause d’un modèle d’interprétation « clé en main » de la fragilité de l’enfant qui renverrait inévitablement à l’éducation familiale (Joly-Rissoan et al., 2006). Aussi faudrait-il « sortir des équations hasardeuses », refuser les « discours a priori » et les « schématisations » sur les causes de l’échec, « si l’on ne veut pas se condamner à l’inefficacité » (Bier, 2007). Or, la tentation de plaquer ces grilles d’analyse sur les milieux populaires serait d’autant plus forte que les professionnels sont le plus souvent issus de classes moyennes et que les dispositifs de réussite éducative comportent inévitablement une dimension normative sur ce que sont la réussite, le fait de bien s’occuper de ses enfants, le rôle du père, etc. D’où des malentendus, des résistances, voire des refus, de la part des publics visés par le PRE (Glasman, 2008).
Il est très difficile de savoir si ces craintes, exprimées par différents sociologues et chercheurs en sciences de l’éducation, mais aussi par des professionnels de la politique de la ville (IREV, 2007), se sont vérifiées dans les pratiques locales. Le danger de la stigmatisation est certes officiellement reconnu par l’ACSÉ : « La co-éducation propose de sortir du discours qui invalide souvent les parents, précaires socialement notamment. Cependant, le PRE en mettant l’accent sur l’individualisation de l’intervention comporte le risque d’une stigmatisation » (ACSÉ, 2009). Pour ce qui concerne les professionnels, les réticences initiales se seraient dissipées si l’on en croit le Comité de suivi du Plan de cohésion sociale dans ses « observations sur le Programme de réussite éducative ». Tout en reconnaissant qu’« il ne s’agit en aucune façon d’une évaluation scientifique, mais du fruit des observations portant sur les témoignages des acteurs », le Comité de suivi considère que « dans la plupart des cas, les réticences qui sont apparues en 2005 (...) sont rapidement tombées, à l’exception de quelques municipalités qui ont maintenu leur hostilité pour des raisons politiques ». La notion de repérage, en particulier, se serait « finalement imposée ». C’est un véritable plébiscite du PRE par les professionnels chargés de sa mise en œuvre que décrit le Comité : « Tous les témoignages recueillis font état d’une grande satisfaction dans le déroulement du programme, et manifestent un attachement profond, non seulement parce qu’il permet de répondre différemment et plus en profondeur que ne pouvaient le faire les dispositifs de droit commun existant, mais également parce qu’il interroge toutes les pratiques professionnelles et qu’il enrichit la pratique de chacun » (Comité de suivi du Plan de cohésion sociale, 2009). Il est cependant difficile de discerner, à travers ce document comme dans les évaluations locales qui n’ont guère étudié cet aspect, si les pratiques professionnelles ont été effectivement interrogées jusqu’à « changer le regard des professionnels et bénévoles de l’éducation sur ces jeunes ainsi que sur leurs familles » et jusqu’à « reconnaître le rôle parfois humiliant des institutions », comme y invitait Bernard Bier dans ses propositions pour « réussir la réussite éducative » (Bier, 2007).
b) Le parcours individualisé : une rupture à relativiser avec les pratiques antérieures
Le lancement des PRE a suscité des débats locaux sur la notion d’individualisation. Certains ont traduit le mot d’ordre national en termes d’actions elles-mêmes individualisées (Joly-Rissoan et al., 2006). Mais cette approche est désormais récusée par les coordonnateurs PRE, qui critiquent « une forte tension (...) autour de la notion de parcours individualisé et d'accompagnement collectif, comme si les deux étaient incompatibles ». Cette tension serait entretenue par l'État central et local qui incite, par ses financements, à accroître le nombre d'actions individuelles au détriment des actions collectives (CR-DSU, 2009 ; IREV, 2007). Une « Note de cadrage pour la mise en oeuvre du Programme réussite éducative » de la DIV, datée du 9 février 2005, a explicitement cherché à réserver des actions au seul public potentiellement éligible au PRE : « Quel que soit le dispositif dans lequel elles sont inscrites (Contrat éducatif local, Contrat local d’accompagnement à la scolarité, Contrat Temps Libre, Contrat Enfance, Veille éducative, Ateliers Santé-Ville…), pour être éligibles au "projet de réussite éducative", ces actions devront s’adresser spécifiquement aux enfants et aux adolescents de 2 à 16 ans les plus fragilisés habitant en ZUS et/ou scolarisés dans les établissements en ZEP et REP ». Cette orientation a été confirmée par une circulaire de la DIV venue préciser que le PRE était « l'occasion de revisiter certaines actions du contrat de ville en les ciblant sur les enfants les plus en difficulté et en leur donnant un contenu réellement éducatif »126. Cette orientation a été ensuite infléchie, par la circulaire relative au volet éducatif des CUCS, estimant « souhaitable de ne pas stigmatiser les enfants les plus fragiles et de les intégrer dans des actions collectives réunissant des publics hétérogènes », tout en rappelant la nécessité « de leur proposer, ainsi qu’à leur famille, des interventions complémentaires adaptées à leurs besoins spécifiques, inscrites dans la durée et dont les résultats sont périodiquement évalués est évidente »127.
Le souci de mesure des résultats de la réussite éducative explique en grande partie la priorité accordée à ces actions « ajustées » à certains publics. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre l’insistance des bilans de l’ACSÉ sur la mesure des progrès de « l’individualisation », même si ces bilans témoignent d’une regrettable confusion entre réalisations et résultats. Celui de septembre 2009 considère qu’une dynamique est en marche : 110 796 situations ont été étudiées par une équipe pluridisciplinaire, en chiffres cumulés depuis 2005, contre 68 672 en 2008 et 38 926 en 2007 ; sur l’ensemble de ces situations examinées, toujours en chiffres cumulés, 93 581 ont débouché sur un « parcours individualisé de réussite éducative », contre 52 858 en 2008 et 27 750 en 2007. Si nombre d’enfants bénéficiant d’une « action », augmente régulièrement (365 143 bénéficiaires depuis 2005), l’individualisation mesurée par les « parcours » progresserait plus vite encore : ces parcours constituaient 35 % des situations traitées durant l’année scolaire 2008-2009, contre 22 % sur l’ensemble de la période 2005-2008 (ACSÉ, 2008, 2009).
L’ACSÉ distingue clairement parcours individualisés » (définis comme « un repérage individualisé des difficultés de l’enfants, un premier contact avec la famille, un regard collectif des professionnels sur la situation présentée et l’élaboration de réponses dans différents domaines (soutien scolaire, parentalité, santé, accès au sport et à la culture etc. »)) et « actions collectives », en suggérant que les secondes ne participent pas du processus d’individualisation. L’agence regrette à ce propos que « l'individualisation et les "parcours éducatifs" progressent128 mais peinent encore à s'imposer par rapport aux anciennes pratiques » (ACSÉ, 2008). Reprenant la même catégorisation, le Comité de suivi du Plan de cohésion sociale considère que « la question de "l’intégration" d’actions collectives dans le PRE peut poser problème ». Le Comité s’interroge : « Certaines municipalités auraient-elles eu l’intention de faire financer tel ou tel dispositif préexistant dans le cadre du PRE ? ». Pour y remédier, il préconise « d’affiner les pourcentages, et, le cas échéant, de rectifier les situations où des pratiques abusives seraient mises à jour » (Comité de suivi du Plan de cohésion sociale, 2009). Le CNV s’est demandé en ce sens « ce qui distingue ces actions de celles de même type organisées précédemment, par exemple dans le cadre des contrats éducatifs locaux » (CNV, 2007c). Un première recherche confiée par la DIV à des chercheurs était plus affirmative, considérant que « les PRE en action ne rompent guère avec les modes de suivis expérimentés et reconnus », même s’ils sont « ici ou là affublés des termes "individualisé" » comme si « dire que c'est "individualisé" suffisait » (Joly-Rissoan et al., 2006).
Des typologies plus ou moins similaires ont été proposées, distinguant des PRE « collectivisés », s’inscrivant dans le prolongement d’autres dispositifs qu’il viennent conforter ou auxquels ils se substituent en partie, et des PRE « individualisés » se positionnant d’emblée comme un dispositif très différent et irréductible aux autres (Joly-Rissoan et al., 2006) ; un PRE du troisième type, « collectif ciblé », serait hybride, comme son nom l’indique, en accueillant deux types de publics : les jeunes inscrits dans les parcours individualisés et jeunes aux caractéristiques proches qui ne relèvent pas du PRE (CNV, 2007c). Derrière ces grandes catégories, le rapport des universitaires soulevait une question à propos de l’individualisation des prises en charge, qui conserve semble-t-il une actualité : « A lire les rapports des consultants, on est frappé (...) de voir que rien n'est dit nulle part sur le contenu des actions, leur orientation, leur pertinence au regard de la "fragilité" identifiée, du type de prise en charge et du suivi. Tout au plus, on mentionne : "accompagnement scolaire", "appui à la parentalité", autrement dit des noms génériques d'actions, parfois expérimentées de longue date. Or, on sait très bien que sous ces appellations coexistent des pratiques extrêmement différentes, qui sont loin d'être toutes aussi fécondes (...). Nulle part on ne se demande finement ce qu'il faut pour qu'un enfant "fragilisé" s'en sorte, quelles en sont les conditions en termes d'accompagnement, d'appui, de cadrage, etc. (...) On fait comme si le problème était celui de l'identification, du repérage, du diagnostic, et de la coopération inter-institutionnelle pour le diagnostic et la mise sur pied du suivi individualisé. Mais que fait-on au juste et exactement avec le jeune, en quoi ce qu'on lui propose est-il susceptible de l'aider, on ne le sait guère » (Joly-Rissoan et al., 2006). Gageons que la connaissance a progressé depuis lors dans le cadre des évaluations locales des PRE, même si celles que nous avons consultées ne sont pas très éclairantes. La présente note a vocation à capitaliser des travaux scientifiques et/ou évaluatifs de portée nationale. Et comme on ne saurait inclure les bilans de l’ACSÉ ou du Comité de suivi du Plan de cohésion sociale dans cette catégorie129, les questions essentielles posées par les universitaires en 2006 quant au contenu et aux effets du processus d’individualisation, restent pour l’heure sans réponse bien assurée.
Une dernière limite au processus d’individualisation vient du fait que certains sites « évitent les publics les plus en difficulté ou nécessitant une approche particulière » (ACSÉ, 2008). Ce constat rejoint celui de sociologues, comme Agnès van Zanten qui observe que la logique d’individualisation ne concerne pas l’ensemble des élèves, car « suite à un ensemble de processus, pour la plupart officieux et invisibles, de "requalification", les destinataires finaux de la politique ne sont pas les élèves les plus défavorisés évoqués dans les textes » (van Zanten, 2008).
2. Quels effets de l’approche globale ?
Les praticiens locaux s’interrogent sur les contours de la réussite éducative, un concept certes plus ample que celui de réussite scolaire, mais néanmoins marqué par un certain flou (IREV, 2007 ; Glasman, 2007b). Si pour certains, notamment à l’Éducation Nationale, les deux notions semblent pouvoir être confondues (Comité de suivi du Plan de cohésion sociale, 2009), leur distinction revêt une portée symbolique pour d’autres acteurs (élus, associations d’éducation populaire…) qui ont longtemps reproché à l’école son « impérialisme » ou son caractère excessivement « scolaro-centré » (Glasman, 2007b). Certains se sont donc inquiété de voir le PRE ne pas rompre assez nettement avec cette orientation, à l’instar de Bernard Bier de l’INJEP130 : « La "réussite éducative" est, ou peut être, l’opportunité de nous faire sortir d’une approche qui a longtemps été (en France !) trop exclusive des "savoirs scolaires", (...) d’où l’inquiétude qui est la nôtre lorsque les critères de la réussite éducative (...) se réduisent aux critères scolaires » (Bier, 2007).
Pour apprécier le caractère global ou non des PRE, les bilans de l’ACSÉ mettent en avant deux critères principaux : la part des financements de l’État consacrée à l’accompagnement scolaire et le classement des thématiques prioritaires par les responsables locaux. Sur ce double plan, un certain rééquilibrage semble se dessiner : en 2009, les sites en PRE ne consacraient plus, en moyenne, que 23 % des financements de l’État à l’accompagnement scolaire, contre 28 % en 2008, avec toutefois de très fortes variations locales ; quant à la thématique scolaire, elle n’est affichée en 2009 comme priorité première que dans 46 % des sites, contre 60 % en 2007. Ce serait là un effet de la mise en place par l’Éducation nationale de ses propres dispositifs d’accompagnement éducatif, d’aide personnalisée ou de stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires) qui permettrait de remobiliser les crédits de la réussite éducative sur d’autres actions131 (Trajectoires 2008 ; ACSÉ, 2008, 2009).
En particulier, le thème de la santé, qui était peu présent à l’origine dans les PRE, s’est peu à peu imposé comme prioritaire pour une partie d’entre eux, les repérages contribuant à pointer l’intensité du problème. La santé est désormais classée parmi les trois priorités principales dans la moitié des PRE (ACSÉ, 2009) et plus de la moitié des responsables d’Ateliers santé-ville déclarent travailler en lien avec le dispositif de réussite éducative (Kynos, 2009). Plus largement, grâce au travail avec les orthophonistes, les Centres médico-psychologiques, les professionnels de la santé mentale ou encore le dépistage buccodentaire, certains PRE ont donné à la santé une place souvent ignorée, voire impensée par les politiques éducatives (CR-DSU, 2009).
Malgré ces avancées, l’ACSÉ a reconnu que « c'est sans aucun doute le principe de la globalité qui a le plus de mal à être mis en oeuvre : il est encore rare en définitive de trouver une conception de cellule pluridisciplinaire qui allie l'ensemble des champs (santé, social, scolaire, loisirs). Beaucoup de projets locaux de réussite éducative restent centrés sur la scolarité avec notamment des actions d’accompagnement à la scolarité. Le scolaire, dans les 2/3 des PRE environ, est la porte d’entrée puisqu’il est plus facile de parler des mauvais résultats scolaires d’un enfant que de son comportement ou de son hygiène par exemple » (ACSÉ, 2008). De fait, le repérage, l’analyse des signes de « fragilité » et la définition des mesures qui en découlent dépendent des partenaires impliqués et de leur prisme professionnel respectif. Or, il a été rapidement observé que l’Éducation nationale était le pivot du Programme de réussite éducative. Elle participait à 97,5% des PRE en 2008, en étant à l’origine de 74,5% des repérages (Trajectoires, 2008), même si la tendance est à la baisse en 2009, avec 70 % de l’ensemble des repérages (ACSÉ, 2009). En fait, plusieurs cas de figure se rencontrent : soit le repérage est ouvert à l’ensemble du réseau d’acteurs locaux, et les programmes d’action prennent alors une coloration médico-sociale ; soit il s’appuie essentiellement sur l’Éducation nationale et prend une coloration très scolaire (Joly-Rissoan et al., 2006). Cependant, même quand le repérage a un caractère pluraliste, il repose le plus souvent sur l’agrégation des critères portés par chaque institution, sans que la confrontation des regards et points de vue n’ait été organisée. Le cloisonnement se vérifierait au sein même de l’Éducation nationale, avec des critères scolaires pour les enseignants, médicaux pour les médecins scolaires, sociaux pour les assistantes sociales scolaires (IREV, 2007).
Si le ministère de l’Éducation nationale a fortement incité ses agents s’impliquer dans la réussite éducative, tous n’ont pas vu d’un bon œil arriver des partenaires extérieurs qui viendraient s'immiscer dans leurs relations avec les familles. Des inspecteurs d’académie ont également manifesté leur mécontentement en voyant que leur administration n’était pas seul maître d’ouvrage du dispositif. La coopération n’a pas non plus été toujours optimale au niveau ministériel, comme l’a illustré le boycott par l’Éducation nationale d’un séminaire national sur le PRE organisé en juillet 2006. Mais il semblerait que les réticences initiales aient été levées (CNV, 2007c ; Comité de suivi du Plan de cohésion sociale, 2009). Et si au final l’école joue le jeu, c’est qu’elle est face à une impasse avec certains enfants ou adolescents, incapable d’accomplir sa mission de les faire réussir (Glasman, 2007b), ni même de les scolariser si l’on pense aux « décrocheurs » (Esterle-Hedibel, 2006).
La prééminence des actions de type scolaire, enrichies par des actions médico-sociales et familiales, pose donc la question du caractère véritablement pluridisciplinaire de la réussite éducative. Comme le remarquent les universitaires chargés d’observer la mise en place du programme, « l’ouverture des problématiques scolaires se fait vers deux ensembles de fragilité (médico-sociale et familiale) qui non seulement mettent l’Éducation nationale à la limite de ses compétences et contrarient son action, mais qu’il lui est en plus aisé de percevoir… et de résoudre avec l’aide de ses partenaires : des problèmes de lecture ? On s’oriente vers les orthophonistes. Les familles ne sont pas mobilisées dans la scolarité des enfants ? On travaille à leur implication ». (Joly-Rissoan et al., 2006)
Les actions dites « collectives », d’animation ou de socialisation, se rapprochent des activités plus traditionnelles de la politique de la ville et de l’éducation populaire. Le recours à ces actions s’inscrit, pour les équipes de réussite éducative, dans une logique de « pédagogie du détour » dont il est attendu des effets positifs, à moyen ou long termes, sur la scolarité. Les « référents de parcours » évitent ainsi de se focaliser sur le problème précis pour lequel ils ont été sollicités (les résultats ou les comportements à l’école). Il s’agit de placer l’enfant ou le jeune en position de réussite dans d’autres domaines que l’école et de faire ainsi évoluer positivement la perception qu’ont les institutions à son égard (Profession banlieue, 2009), ce qui peut avoir un impact scolaire indirect, puisque les difficultés scolaires sont souvent aggravées par les représentations négatives des enseignants (Croizet, Claire, 2003).
Le rabattement des objectifs de la réussite éducative sur la réussite scolaire n’est pas exclusivement imputable à l’Éducation nationale. Sur ce point, la réussite éducative répond également aux préoccupations et demandes des familles. Celles qui sont d’origine immigrée, en particulier, nourrissent des aspirations élevées quant à la réussite scolaire de leurs enfants (Brinbaum, Kieffer 2005). Que signifierait pour elles un objectif de réussite éducative qui ne serait pas d’abord décliné en termes scolaires, sinon un dispositif visant seulement la normalisation des comportements et, derrière elle, l’éducation des parents eux-mêmes ? (Glasman, 2007b) Ainsi pourrait s’expliquer la place de choix donnée à l’accompagnement scolaire dans le PRE, car c’est la pratique qui stigmatise le moins les pratiques parentales (Joly-Rissoan et al., 2006).
b) Des effets non démontrés sur les performances des élèves
Quelles que soient les actions envisagées pour l’atteindre, la réussite scolaire est l’objectif ultime du Programme de réussite éducative. À côté d’indicateurs reflétant l’activité des PRE (nombre de situations repérées, d’enfants concernés, de parents aidés…), les circulaires ministérielles n’ont d’ailleurs retenu que deux indicateurs d’impact sur le public visé –l’« évolution des performances scolaires » et l’« évolution du nombre de situations de très grande difficulté scolaire dans les ZUS »– qui concernent tous deux la réussite à l’école. Ces « indicateurs de suivi de la mise en oeuvre du projet de réussite éducative » figurent aussi dans toutes les conventions-types passées avec les structures locales qui portent les PRE.
Les circulaires précisent que la mesure des performances scolaires nécessite un « protocole à définir en lien avec l’Éducation nationale ». Après quelques années de mise en œuvre du programme, ce partenariat ne semble guère avoir progressé. Le premier bilan national de l’ACSÉ indiquait que « si les impacts scolaires existent, il reste à les évaluer de façon précise avec l'Éducation nationale » (ACSÉ, 2008). Localement, les réticences de ses agents à communiquer des chiffres sur les résultats scolaires des élèves suivis par le dispositif de réussite éducative sont pointées comme l’une des difficultés centrales de son évaluation (CR-DSU, 2009).
Faute de données, l’existence d’un lien entre la mise en oeuvre du programme et l’évolution des performances scolaires demeure incertaine. Lancée au démarrage du programme, la première étude nationale d’envergure sur la réussite éducative (Joly-Rissoan et al., 2006), s’appuyait pour l’essentiel sur les « rapports d’évaluation » de consultants sollicités par la DIV, dont les travaux n’ont porté que sur les aspects organisationnels et institutionnels du PRE. En 2007, l’ACSÉ a confié une étude quantitative au cabinet Trajectoires qui a élaboré un questionnaire national se situant dans le même registre (Trajectoires, 2008). Le « Rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative » présenté au Parlement n’apporte pas non plus d’informations précises sur les résultats de la réussite éducative. Préparé par l’ACSÉ et déposé en juillet 2008, puis actualisé en septembre 2009, ce rapport synthétise les résultats de diverses enquêtes conduites par des consultants ou des préfectures (ACSÉ, 2008, 2009), fondées pour l’essentiel sur des questionnaires remplis par les responsables locaux du programme. Dans son bilan 2008, l’ACSÉ a mis en exergue les « impacts constatés sur les bénéficiaires d’une vingtaine de PRE par les enseignants », en prenant appui sur les résultats très favorables d’une enquête : « 76,92 % d’amélioration des résultats scolaires, 46,15 % d’amélioration de la motivation, 30,77 % d’amélioration des relations entre établissement scolaire et parents » (ACSÉ, 2008). Comme l’a pointé la Cour des comptes, cette étude menée auprès de responsables de PRE portés par un établissement public d'enseignement local (EPLE) « ne peut cependant guère être considérée comme significative, car les EPLE représentent moins de 10 % des structures juridiques porteuses, et les personnes interrogées bénéficiaient de soutiens financiers, ce qui pouvait conduire à un biais d’appréciation » (Cour des comptes, 2009).
Dans son bilan 2009, l’ACSÉ présente les résultats d’une autre étude conduite auprès d'un échantillon de 30 PRE portés par différentes structures juridiques. Les résultats sur la réussite scolaire sont nettement plus mitigés que dans la précédente étude, avec 13 PRE déclarant que « la réussite scolaire fait partie des objectifs atteints », mais 11 déclarant le contraire. Interrogés plus largement sur la question de savoir si « au regard des objectifs initiaux, les résultats obtenus au terme des parcours sont satisfaisants », les responsables locaux ont répondu par l’affirmative pour la quasi totalité des bénéficiaires dans 56,7 % des cas et pour environ la moitié des bénéficiaires dans 20 % des cas. Ainsi, selon l’ACSÉ, « les résultats analysés globalement permettent d’affirmer que 70 % des enfants concernés tirent bénéfice des actions », l’agence mettant ce chiffre en rapport avec 63 % de fins de parcours motivées par des « objectifs atteints ». L’ACSÉ se félicite aussi de ces résultats obtenus « par rapport à une partie du public pour lequel d’autres solutions avaient été auparavant appliquées, sans succès » (ACSÉ, 2009).
Ces bilans, fondés sur les seules déclarations des responsables de PRE, apparaissent peu fiables. C’est pourquoi l’ACSÉ a engagé une « étude d’impact » avec l’ONZUS sur une quinzaine de sites. En attendant ses résultats, la Cour des comptes a considéré que « les PRE présentent un coût global et par programme élevé, alors même que l’évaluation de leur impact ne peut, en l’état, s’appuyer sur des études de cohorte validées » (Cour des comptes, 2009)132, un suivi de cohorte dont la mise en place était pourtant préconisée, dès 2005, par la DIV. Si le suivi de cohorte apparaît adapté pour suivre les effets de la réussite éducative, qui s’inscrivent dans une temporalité pluriannuelle (Suchaut, 2008, 2009), il ne résout pas toutes les difficultés méthodologiques que soulève l’appréciation des effets de ces programmes sur les élèves. Car les effets attendus dépassent les seuls acquis scolaires. Or, apprécier les effets des PRE sur les comportements et attitudes des élèves est beaucoup plus difficile que la seule mesure des résultats scolaires.
La littérature française relative à l'accompagnement scolaire se révèle dans l’ensemble assez pauvre et faiblement étayée (Suchaut, 2008). Concernant la réussite scolaire proprement dite, les études existantes indiquent un effet global assez ténu de l’accompagnement : à caractéristiques scolaires et sociales comparables, les élèves ayant fréquenté un dispositif, quelle que soit sa configuration, ne progressent pas différemment, en moyenne, des autres élèves comparables non pris en charge par ces dispositifs. Mais cette moyenne peut masquer des résultats tantôt positifs, tantôt négatifs, selon les caractéristiques des dispositifs et des élèves. Les dispositifs les plus efficaces sont en fait les plus directement en prise avec le travail scolaire (Piquée, 2003 ; Glasman, Besson, 2004 ; Suchaut, 2008).
Enfin, et surtout, l’efficacité potentielle des dispositifs d’aide aux élèves est d'abord fonction de l’efficacité des pratiques pédagogiques des enseignants, c'est-à-dire de ce qui se passe dans la classe (Attali, Bressoux, 2002). La réussite éducative n’aura elle-même d’efficacité que si elle s’articule avec le droit commun éducatif, dans une logique qui ne se résume pas à l’externalisation de ses difficultés par l’école, mais qui engage une transformation des pratiques pédagogiques (Bier, 2007). Force est de constater que les évaluations de la réussite éducative n’éclairent guère cet enjeu qui semble pourtant le plus essentiel. On peut penser que si les pratiques pédagogiques ne sont jamais prises, à notre connaissance, comme objet des évaluations locales, c’est que ce n’est pas non plus l’objet du Programme de réussite éducative. C’est sans doute là le paradoxe d’un Programme de réussite éducative qui se donne pour finalité ultime la réussite scolaires des enfants et des jeunes, mais qui ne se donne pas les moyens d’agir sur les conditions proprement scolaires de cette réussite.
L’ensemble de ces limites à l’évaluation de la réussite éducative rend bien hasardeuse l’imputation aux PRE de l’évolution des difficultés scolaires dans les ZUS, qu’il s’agisse de déceler des signes de réduction des écarts et de les mettre au crédit des PRE133 ou, au contraire, de considérer leur échec dès lors que les établissements concernés ne parviennent pas à réduire les écarts, ces derniers ayant plutôt tendance à s’aggraver (ONZUS, 2009).
La réussite éducative peut-elle faire sortir l’école de son extra-territorialité ? L’exemple des relations école-communauté au Québec
La réussite éducative repose sur le postulat selon lequel la réussite de l’enfant ne dépend pas seulement des ressources scolaires et familiales, mais aussi des ressources plus larges de son environnement social et institutionnel. Les analyses qui précèdent ont montré que l’un des freins à la mobilisation des ressources de l’environnement venait d’une forme d’extra-territorialité de l’école, que d’aucuns présentent comme un « sanctuaire ». Du coup, les relations qu’elle établit avec les acteurs extérieurs ne se développent pas forcément sous le signe de la confiance mutuelle, ni sur un pied d’égalité. La comparaison avec le Québec est assez édifiante de ce point de vue. Nous présentons ci-après les résultats d’une recherche québécoise qui témoigne d’une grande proximité avec le programme français de réussite éducative en ce qui concerne l’approche individualisée et globale, mais qui rend compte aussi d’une fluidité apparemment plus grande des rapports entre l’école et la « communauté », au sens du quartier et des acteurs évoluant sur un territoire.
Bilodeau A., Bélanger J. (2007), L’évaluation de l’efficacité de mesures innovantes de soutien sur les compétences et la réussite scolaire au primaire, Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport du Québec, février.
Le ministère de l’Éducation du Québec incite les écoles à faire non seulement davantage, mais autrement en direction des milieux défavorisés et multi-ethniques. Dans cet appel à l’innovation, les écoles sont invitées à analyser l’efficacité de leurs pratiques et à diversifier leurs approches pour soutenir intensivement les élèves « à risque », à développer des échanges réciproques avec les parents, et à participer aux « communautés ». Appelées à reconsidérer leurs pratiques ordinaires pour développer des solutions adaptées au contexte de l’enfant et de son milieu, les écoles sont confrontées à des défis importants qu’elles ne peuvent surmonter à elles seules. L'échec scolaire, en tant que problème social, nécessite une participation collective à sa résolution. D’où l’importance des rapports de collaboration avec la communauté, afin de mettre en commun les ressources, les compétences et les activités de chaque organisation dans l’objectif de favoriser le bien-être des enfants dans différents domaines (santé, soutien scolaire et social, sports et culture, prévention de la violence et de la toxicomanie, etc.).
Cette évaluation porte sur un programme mis en oeuvre depuis 1995 dans neuf quartiers défavorisés de Montréal. Connu sous le nom de Priorité Jeunesse, ce programme combine des mesures universelles et sélectives : la promotion des compétences sociales à l’école, la création d’un environnement favorable à la santé (mesures universelles), l’accompagnement soutenu et intensif à la réussite scolaire par des projets communautaires et l’intervention auprès des parents (mesure sélectives).
L’évaluation porte plus particulièrement sur ces mesures sélectives. Elle s’appuie sur un suivi comparatif et longitudinal (sur trois ans) mêlant méthodes qualitatives et quantitatives. La comparaison est faite à deux niveaux : entre un quartier engagé dans Priorité Jeunesse (Hochelaga-Maisonneuve) et un autre qui ne l’est pas (St-Michel) ; puis, au sein de chaque quartier, entre les enfants bénéficiant de mesures de soutien scolaires et/ou communautaires et les enfants ne recevant pas ces aides.
Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, deux espaces sociaux développent ces mesures de soutien à la réussite scolaire des enfants du primaire : la « Table de concertation Enfance-Famille Hochelaga-Maisonneuve » (espace communautaire) et les écoles (espace scolaire). Rassemblant des intervenants publics et communautaires, la Table de concertation constitue un espace communautaire de résolution collective des problématiques du quartier, et plus précisément celles qui touchent au bien-être des enfants et de leurs familles. Ce qui se traduit par la mise en commun de l’expertise des différents participants pour identifier des priorités à partir d’une vision d’ensemble, élaborer des projets de développement social en lien avec ces priorités et assurer une complémentarité des activités de chacun. De son côté, l’espace scolaire est centré sur la réalisation des objectifs de l’école, c'est-à-dire favoriser l’intégration et la réussite scolaire des enfants. Cet espace scolaire rassemble le personnel enseignant et non enseignant, la direction, les parents et les intervenants de la communauté qui oeuvrent en son sein.
Un aspect notable de la collaboration entre l'école et les organismes communautaires est son caractère égalitaire. L'école ne cherche pas à influencer les activités de ses partenaires communautaires. C’est un Comité local d'action qui commande la prise de décision collective. L'égalisation des rapports se vérifie dans le fait que ce Comité ne place pas l'école au centre du processus : les objectifs poursuivis s'inscrivent explicitement dans une logique de développement communautaire et non de soutien à la mission scolaire de l'école.
L’accompagnement scolaire décidé dans ce cadre vise à développer les compétences académiques, instrumentales et socio–affectives nécessaires à la réussite scolaire des enfants sélectionnés, de même que le développement, chez leurs parents, des compétences instrumentales nécessaires à leur fonction d’encadrement scolaire de leur enfant. C’est toute la différence avec le quartier St-Michel, servant de point de comparaison, où l’accompagnement scolaire mis en oeuvre par le service des études dirigées, est centré sur les seules compétences académiques. L’espace communautaire permet ainsi le déploiement d’une série de mesures de soutien non scolaires.
L’étude d’impact montre que dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve, pourtant socialement défavorisé, les élèves rencontrant des problèmes d’apprentissage et recevant un soutien communautaire améliorent leurs performances scolaires en comparaison des élèves du même quartier qui rencontrent les mêmes problèmes mais qui ne reçoivent pas ce soutien. De même, on observe une plus grande capacité d’encadrement des parents qui participent au programme. Cependant, on ne peut pas dire que ce service soit plus performant que les études dirigées mises en oeuvre en œuvre dans le quartier-témoin de Saint-Michel, puisque ce dispositifs obtient aussi des résultats, mais avec des enfants moins défavorisés. Les résultats obtenus à Hochelaga-Maisonneuve restent d’ailleurs modestes compte tenu des facteurs structurels à l’origine de la reproduction des inégalités sociales. La « performance » de l’intervention communautaire réside pour l’essentiel dans la réponse collective aux besoins spécifiques du quartier défavorisé.
Abalain M., Jubien C. (2009), « État des lieux et perspectives d’avenir du commerce dans les territoires prioritaires de la politique de la ville », in ONZUS, rapport 2009.
Acadie (1999), Évaluation régionale de la politique de la ville, Rapport pour la Préfecture de Région Aquitaine.
Acadie (2005), Étude prospective sur l’impact des démolitions de logements sociaux en Ile de France et conséquences en terme de besoins, Rapport pour la DREIF, marss.
Acadie (2006), Évaluation des contrats d’agglomération, Rapport pour la DIACT, avril.
Acadie (2007), La mobilité résidentielle des ménages immigrés, Rapport pour le FASILD, février.
Acadie (2009), Étude prospective exploratoire sur les futurs territoires de la politique de la ville, Rapport pour la DIV.
ACSÉ (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) (2008), Bilan de la mise en oeuvre du programme de réussite éducative, juillet.
ACSÉ (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) (2009), Rapport Réussite éducative 2009, Direction Education Santé, septembre.
Act Consultants et al. (2009), Diversification de l’habitat et mixité sociale dans les quartiers en rénovation urbaine, Rapport pour le CES de l'ANRU. *Allen B. (2003), « Les Tarterêts, un quartier d'accueil ?, Annales de la recherche urbaine, n°94, décembre.
Althing (2009), Analyse du volet prévention et sécurité des Contrats urbains de cohésion sociale, Rapport pour la DIV.
Amnyos, Pluricité (2007), Analyse critique des Contrats urbains de cohésion sociale, Rapport pour la DIV, juillet.
André P. (2002), Les zones franches urbaines, un succès et une espérance, Rapport d’information sur les zones franches urbaines, Commission des affaires économiques, Sénat.
André P. (2005), Contrat de ville : rénover et simplifier. Rapport d’information sur l’avenir des contrats de ville, Commission des Affaires économiques et du Plan, Sénat.
André P. (2006), Rapport d’information sur le bilan et les perspectives d’avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d’années, Mission commune d’information du Sénat.
Andrieux V., Bonnefoi E. (2004), « Un déficit d’emploi en zones franche urbaine », Ile-de-France à la page, INSEE, n°235, avril.
APU (Atelier populaire d’urbanisme) (1983), Participation des habitants à la conception d’un CES adapté à leur quartier, Rapport de recherche pour le Plan urbain.
Argos, Cirese (2007), Guide de l’évaluation des CUCS, DIV, août.
ARESS (2008), Enquête et étude sur la mise en oeuvre du programme Ville, Vie, Vacances, Rapport pour l’ACSÉ.
Arkwright E. et al. (2007), Économie politique de la LOLF, Rapport du Conseil d'analyse économique, La Documentation française.
Armand A., Gille B. (dir.) (2006), La contribution de l'éducation prioritaire à l'égalité des chances des élèves, Inspection générale de l’éducation nationale, Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.
Arnaud A., Valette M. (2006), « Menaces sur les projets de territoire ? », Économie & Humanisme, n°376, mars 2006.
Ascher F. et al. (1995), Le logement en questions, l’habitat dans les années 1990, continuité et rupture », Éditions de l’Aube.
Ascher F. (1998), Méthodes et perspectives pour la politique de la ville, Contribution au rapport de la Commission Sueur, Tome 2, La Documentation française.
ASDO (2009), Les actions relevant du lien social dans les Contrats urbains de cohésion sociale, Rapport pour la DIV.
Atkinson R., Kintrea K. (2000), « Owner-occupation, Social Mix and Neighbourhood Impacts », Policy and Politics, vol. 28, n°1.
Attali A., Bressoux P. (2002), L’évaluation des pratiques éducatives dans les premier et second degrés, Rapport Pour le Haut conseil de l’évaluation de l’école.
Augustin J-P, Montané M-A (2004), « Différenciation et dualisation de l’action publique : le cas des quartiers fragiles et de la jeunesse urbaine en France », Lien social et politiques, n°52.
Aures (2007), Enquête ingénierie du projet local, Rapport pour la DIV et l’IRDSU.
Aures (2008), Évaluation des parcours de réussite éducative, Rapport pour les CCAS de Nantes, Rezé, St Herblain, St Nazaire et Trignac.
Aures (2009), La relation au droit commun et la place de l’évaluation. Enquête d’opinion auprès de 23 professionnels de la politique de la ville en France métropolitaine, Enquête ingénierie DIV/IRDSU, mars.
Autès M. (1995), « Le sens du territoire », Recherches et prévisions, n°39.
Authier J.-Y. (2007), « La question des "effets de quartier" en France. Variations contextuelles et processus de socialisation », in J-Y Authier et al. (dir), Le quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, La Découverte.
Authier J.-Y. et al. (dir.) (2007), Le quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, La Découverte.
Avenel C. (2005), « La mixité dans la ville et dans les grands ensembles. Entre mythe social. et instrument politique », Informations sociales, 125.
Avenel C. (2007a), « La politique de la ville et ses destinataires. Une politique de gestion d’un sentiment d’abandon ? », Informations sociales, n°141, mai.
Avenel C. (2007b), « La politique de la ville : instrument de discrimination positive territoriale ou substitut du droit commun ? », in B. Bouquet et al., Territoires et action sociale, L'Harmattan.
Avenel C., Cathelain M-A (2009), « Enquête sur le travail social des CAF. Etat des lieux », Dossier d’étude de la CNAF, n°115, avril
Avide E. (2008), Évaluer la politique de la ville : une exigence impossible ? Problèmes d’évaluabilité et perspectives pour les surmonter, Mémoire Mastère Aménagement sous la dir. de S. Fol, Université Paris I.
Avide E. et al. (2009), La diversification de l’habitat en territoires de rénovation urbaine, Rapport réalisé dans le cadre d’un Atelier d’urbanisme entre le CES de l'ANRU et le Master 2 professionnel « Projets d’AmeÅLnagement » (Université Paris 1), sous la direction de W. Le Goff et S. Fol.
Bachelet F. (2000),. « La réforme de la coopération intercommunale et la politique de la ville », Annuaire des collectivités locales, Tome 20.
Bachelet F., Rangeon F. (1996), « La politique de la ville ou les difficultés de l’interministérialité locale », Politiques et management public, vol. 14, n°3.
Bachelet M. (2007), « Les zones franches urbaines en 2005 : des embauches encore fortement concentrées dans les anciennes ZFU », Premières Informations, n°26.1.
Bachelet M. (2008a), « Les contrats d’aide à l’emploi du Plan de cohésion sociale dans les Zones urbaines sensibles en 2006 », Premières synthèses informations, DARES, 20.1, mai.
Bachelet M. (2008b), Les embauches dans les territoires de la politique de la ville en 2006 : forte hausse des embauches dans les zones franches urbaines créées en 2004, recul dans les zones de redynamisation urbaine, Premières synthèses informations, DARES, n°47.3, novembre.
Bachelet M. et al. (2007), « Les dispositifs de politique de l’emploi dans les zones urbaines sensibles : un accès privilégié des demandeurs d’emploi aux CES et SIFE collectifs », Premières synthèses informations, DARES, 13.4, mars.
Bachmann C., Le Guennec N. (1996), Violences urbaines. Ascension et chute des classes moyennes à travers 50 ans de politique de la ville, Albin Michel.
Bacqué M-H (2005), « L’intraduisible notion de d’empowerment vu au fil des politiques urbaines américaines », Territoires, 460, septembre.
Bacqué M-H., Fol S., (2007), « L’inégalité face à la mobilité : du constat à l’injonction », Revue suisse de sociologie, vol. 33, n°1.
Bacqué M-H, Denjean J-M (2006), « Les émeutes, signe d’échec de la politique de la ville ? », Mouvements, 44, février.
Bacqué M.-H., Sintomer Y. (2002), « Peut-on encore parler de quartiers populaires ? », Espaces et sociétés, n°108-109.
Ballain R. (2000), « Regard sur la politique du logement en faveur des défavorisés », Recherches et prévisions, Dossier Villes et logement de la CNAF, n°62, décembre.
Barilari A. et al. (1998), Rapport d’enquête sur le dispositif des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaines, Inspection générale des finances, Inspection générale de l’administration.
Barthélémy A. (1995), Un avenir pour la ville. Face à la crise urbaine, Éditions Esprit.
Batty E. et al. (2010), The New Deal for Communities Experience: A Final Assessment, The New Deal for Communities Evaluation Final Report, Volume 7, Centre for Regional Economic and Social Research, Sheffield Hallam University, Department for Communities and Local Government, March.
Baudin G. (2006), « La mixité sociale : utopie urbaine et urbanistique », in Y. Marin (dir.), Les utopies de la ville, Cahiers du Crehu, n°10.
Baudin G., Genestier P. (2006), « Faut-il vraiment démolir les grands ensembles ? », Espaces et sociétés, n°124-125.
Beauvallet M. (2009), Les stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire mieux, Le Seuil.
Béhar D. (1991), « Réussir l'intégration : les moyens de partir, l'envie de rester », Projet, n°227.
Béhar D. (1995a), « Banlieues ghettos, quartiers populaires ou ville éclatée ? », Les Annales de la recherche urbaine, n°68-69.
Béhar (1995b), La question sociale et les services au public, in Politique de la ville : les services au public dans les quartiers, Actes du colloque du 29 juin 1995, DIV, Les éditions d’ensembles, novembre
Béhar D. (1997a), « La politique de la ville mérite-t-elle d'être évaluée ? », Urbanisme, n°297, novembre-décembre.
Béhar D. (1997b), « Améliorer les services publics dans les quartiers : incertitudes d’une évidence », Les cahiers du DSU, CR-DSU Rhône-Alpes, décembre
Béhar D. (1997-1998), « Le territoire et la nouvelle question sociale : incertitudes des politiques publiques », Quaderni, n°34.
Béhar D. (1999a), « Les fausses évidences de l’impératif territorial », in E. Heurgon, N. Stathopoulos (dir.), Les métiers de la ville. Les nouveaux territoires de l’action collective, Cerisy, Éditions de l’Aube.
Béhar D. (1999b), « En finir avec la politique de la ville ? », Esprit, novembre.
Béhar D. (2004), Intervention in Table-ronde « La mixité urbaine est-elle une politique ? », Esprit, n°303, mars-avril.
Béhar D., Estèbe, P. (1995a), Ville et pauvreté, essai bibliographique, Centre de documentation de l'urbanisme.
Béhar D., Estèbe P. (1995b), « La puissance publique et le lien social », in Collectif, Plan urbain, services urbains et gestion locale. Enjeux et perspectives de recherches 1985–1993, Ministère de l’Équipement.
Béhar D., Estèbe P. (1996a), « Le Pacte de relance pour la ville », Esprit, mars. *Béhar D., Estèbe P. (1996b), « Le chef de projet et le sous-préfet à la ville entre norme et projet », Espace et société, n°84-85.
Béhar D., Estèbe P. (2006), « Développement économique : la fausse évidence régionale », Annales de la recherche urbaine, n°101.
Béhar D., Gorgeon C. (1998), Évaluation de l’appel à projets plates-formes de services publics, Acadie, DIV.
Béhar D. et al. (1998), « Les détours de l'égalité : remarques sur la territorialisation des politiques sociales en France », Revue française des affaires sociales, n°4.
Bel M., Berthet T. (2009), « Proximité et relation emploi-formation : au carrefour des disciplines », Espaces et sociétés, n°1-2.
Belmessous H. (2006), Mixité sociale, une imposture : retour sur un mythe français, L'Atalante.
Belorgey J.M. (1993), Évaluer les politiques de la ville, Conseil national des villes.
Bénabou R. et al. (2004), « Zones d’éducation prioritaire : quels moyens pour quels résultats ? Une évaluation sur la période 1982-1992 », Économie et statistique, n°380.
Benatsou F. (2009), Les entreprises dans les Zones franches urbaines : bilans et perspectives, Avis du Conseil économique, social et environnemental.
Bengaouer M., Pestre-Mazières M. (1999), Les services publics en milieu urbain. Synthèse des diagnostics établis par les préfets. Rapport de l’IGA au ministère de l’Intérieur et à la Délégation interministérielle à la ville.
Benguigui F. (dir.) (1997), La politique du logement à l’épreuve de la précarité. Regards croisés chercheurs-acteurs, PCA.
Bénisti J-A (2004), Rapport sur la prévention de la délinquance, Rapport de la Commission prévention du Groupe d’études parlementaires sur la sécurité intérieure au ministre de l’Intérieur, octobre.
Berland-Berthon A. (2004), La démolition des ensembles de logements sociaux : l’urbanisme entre scènes et coulisses, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux III.
Berthet T. (dir.) (2005), Des emplois près de chez vous. La territorialisation des politiques d’emploi en questions, Presses universitaires de Bordeaux.
Berthet T. (2008), « Les enjeux de l’évaluation territoriale des politiques publiques », Informations sociales, n°150, juin.
Bertolotto F., Joubert M. (dir.) (1998), Adaptation des services publics. Santé, Dossier thématique de l’Instance d’évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France, octobre.
Bertolotto F. et al. (2003), Les Ateliers santé ville. Territoires, santé publique et politique de santé au niveau local, Études et Recherches, Les éditions de la DIV.
Bertrand D. (2009), « Valoriser les ressources des quartiers en politique de la ville : un changement de paradigme, un exercice salutaire », Recherche sociale, n°191, juillet-septembre.
Bevan G., Hood C. (2006), « What’s Measured is What Matters : Targets and Gaming in Healthcare in England », Public Administration, vol. 84, n°3.
Bezès P. (2008), « Le tournant néomanagérial de l'administration française », in O. Borraz, V. Guiraudon (dir.), Politiques publiques 1. La France dans la gouvernance européenne, Presses de Sciences Po.
Birchen J-P, Crossonneau N. (2005), Services à la mobilité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bilan exploratoire des méthodologies et des outils de mesure, CERTU, août.
Bier B. (2007), « Réussir la réussite éducative : quelques enjeux », Intervention au Pôle ressources du Val d'Oise, mai.
Billard et al. (2005), Ville fermée, ville surveillée : la sécurisation des espaces résidentiels en France et en Amérique du Nord, Presses universitaires de Rennes.
Bilodeau A., Bélanger J. (2007), L’évaluation de l’efficacité de mesures innovantes de soutien sur les compétences et la réussite scolaire au primaire, Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport du Québec, février.
Blanc M. (1999), « Participation des habitants et politique de la ville », in L. Blondiaux et al. (dir.), La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, PUF.
Blanc M. et al. (2002), Référentiel de compétences des métiers du développement social urbain : le métier de chef de projet politique de la ville, Rapport pour la DIV, mars.
Böhme C. et al. (2008), The Programme “Social City” (Soziale Stadt). Status Report, Centre for Knowledge Transfer « Social City », German Institute of Urban Affairs, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs, July.
Boisson M. (2010), « Des "ghettos » français : abus de langage ou réalité ? », Note de veille, Conseil d'analyse stratégique, n° 178.
Bonetti M. (1995), « L’enjeu de la gestion urbaine », Annales de la recherche urbaine, n°68–69.
Bonetti M. (2007), Chronique de la dégradation annoncée des opérations de rénovation urbaine liée au déficit de gestion urbaine, CSTB, avril
Bonetti M. (2009), « La politique de la ville : une profusion d’initiatives mais une impasse grave sur la transformation du fonctionnement des organisations publiques », in Colloque ENS-LSH Triangle, La politique de la ville 20 ans après, 25 septembre 2009.
Bonnemaison G. (1983), Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité, Rapport au Premier ministre, La Documentation française.
Bonneville M. (2005), « The Ambiguity of Urban Renewal in France : Between Continuity and Rupture », Journal of Housing and the Built Environment, vol. 20, n°3.
Boquet M. (20008), Les banlieues entre ouverture et fermeture: réalités et représentations de l'enclavement dans les quartiers urbains défavorisés, Thèse de géographie, Université du Havre.
Borraz O., Le Galès P. (2005), « France : the intermunicipal revolution », in B. Denters, L. E. Rose (dir.), Comparing Local Governance : Trends and Developments, Palgrave.
Bouamama S. (2009), Accompagnement éducatif et social des enfants et des jeunes en difficulté. Quels enseignements des pratiques locales ?, Cycle de qualification « Éducation & territoires », 2007-2009, novembre.
Boumaza N. (1996), « Territorialisation des Maghrébins : regroupement contraint et désir de dispersion », in N. Haumont (dir.), La ville : agrégation et ségrégation sociales, L'Harmattan.
Boutet A. (2003), La contractualisation territoriale. Un mode d'action publique en renouveau permanent ou un outil d'avenir pour l'aménagement ?, DATAR, novembre.
Bouveau P. (1997), « L’école à l’ère des ZEP », Annales de la recherche urbaine, n°75.
Bravo J. (dir.) (1999), Rapport final de l’Instance d’évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France, Préfecture de région d'Ile-de-France, Conseil régional d’Ile-de-France.
Brévan C., Picard P. (2000), Une nouvelle ambition pour les villes. De nouvelles frontières pour les métiers, Rapport au ministre délégué à la Ville.
Brinbaum Y., Kieffer A. (2005), « D’une génération à l’autre, les aspirations éducatives des familles immigrées : ambition et persévérance », Education & formations, n°72.
Brouant J-P (2003), « A propos de la rénovation urbaine », AJDA, n°41.
Brouant J-P (2004), « L’Association Foncière logement et le renouvellement urbain », in Droit de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat, Éditions du Moniteur.
Brun J., Rhein C. (dir.) (1994), La ségrégation dans la ville. Concepts et mesures, L'Harmattan.
Bruston A. (2004), « A-t-on jamais évalué les politiques de la ville ? », Les Cahiers du CR-DSU, n° 41, automne.
Brabant-Delannoy L. (2009), « Face à la conflictualité et à la violence, quelle efficacité de la médiation ? », La Note de veille, CAS, n°147, juillet.
Buguet B. (1998), Évaluation du dispositif zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaines, Inspection générale des affaires sociales.
Bureau M-C (2006), « L’engagement des acteurs de l’insertion dans les réseaux économiques locaux : retour sur des expérimentations », in Colloque Territoires, action sociale et emploi, Centre d’Études de l’Emploi, Cnam, Profession Banlieue, 22-23 juin 2006.
Burgess E. W. (1925), « The Growth of the City : An Introduction to a Research Project », Traduit in Y. Grafmeyer, I. Joseph (dir.), L'école de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine, Aubier (1990).
Caille J-P (2001), « Les collégiens de ZEP à la fin des années 90 », Éducation et Formations, n°61.
Gwénaële C. (2004), La discrimination positive, Que sais-je ?, PUF.
Carrel M. (2004), Faire participer les habitants ? La politique de la ville à l’épreuve du public, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris 5.
Castel R. (1991), « De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle », in J. Donzelot (dir.), Face à l’exclusion. Le modèle français, Éditions Esprit.
Castel R. (1995), Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard.
Castel R. (2007), Discrimination négative, citoyens ou indigènes ?, coll. « La République des idées », Le Seuil.
Castells M. (1972), La question urbaine, François Maspero.
Castells M. (1973), Luttes urbaines, François Maspero.
Cavallier G. (dir.) (1999), Nouvelles recommandations pour la négociation des contrats de ville de la nouvelle génération (2000-2006), Rapport au ministre de la Ville.
CERTU (2006), Rénovation urbaine et offre de mobilité. Mieux intégrer les transports en commun en site propre aux projets de rénovation urbaine, septembre.
CERTU (2007), La résidentialisation en question, Ville de Grenoble, mai.
CES de l'ANRU (Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU) (2007), De nouvelles perspectives pour la rénovation urbaine. Rapport d’évaluation 2006, La documentation française.
CES de l'ANRU (Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU) (2008a), Conduire les projets ANRU à une échelle pertinente.
CES de l'ANRU (Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU) (2008b), Pour une gouvernance rénovée du Programme national de rénovation urbaine, La Documentation française.
CES de l'ANRU (Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU) (2008c), Rénovation urbaine 2004-2008. Quels moyens pour quels résultats ?, La Documentation française.
CES de l'ANRU (Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU) (2010), La rénovation urbaine à l’épreuve des faits. Rapport 2009, La Documentation française.
CES de l’ANRU (Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU), CGCP (Conseil général des ponts et Chaussées) (2007), Expertise sur les conditions de mise en oeuvre du Programme national de rénovation urbaine. Capacités des maîtrises d’ouvrage et ingénieries locales, rôle des DDE, La Documentation française.
CGPC (Conseil général des Ponts et Chaussées) (2003), Politique d'accompagnement des démolitions de logements sociaux.
Chaline C. (1997), Les politiques de la ville, Que sais-je ?, PUF.
Chanal M., Uhry M. (2004), « Une notion floue, dangereuse et inopérante. Contre la mixité sociale », Territoires, n°450, septembre.
Chamboredon J., Lemaire M. (1970), « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », Revue Française de Sociologie, vol. 11, n°1.
Champion J-B, Marpsat M. (1996), « La diversité des quartiers prioritaires : un défi pour la politique de la ville », Economie et statistique, n°294-295.
Charmes E. (2009), « Pour une approche critique de la mixité sociale. Redistribuer les populations ou les ressources ? », La Vie des idées, mars.
Chauveau G., Rogovas-Chauveau E. (1999), « ZEP et pédagogie de la réussite », Ville-École-Intégration, n°117, juin.
Cinget A. et al. (2009), La résidentialisation. Dossier bibliographique, Certu, juin.
CNDSQ (Commission nationale pour le développement social des quartiers) (1982), Rapport du groupe de travail sur la présence active des habitants.
CNDSQ (Commission nationale pour le développement social des quartiers) (1986), Culture et quartiers, Actes du Forum de Bordeaux.
CNDSQ (Commission nationale pour le développement social des quartiers), CNFPT (Conseil national de la fonction publique territoriale) (1987), Services municipaux et développement social des quartiers, Séminaire organisé de Lyon, 18-19 novembre 1986.
CNFPT (Conseil national de la fonction publique territoriale), DIV (Délégation interministérielle à la ville) (1992), Services des villes et développement social urbain, Séminaire d’Angers, 15-16 novembre, Éditions du CNFPT.
CNH (Conseil national de l’habitat) (2007), Politique de l’habitat et décentralisation. Deux ans après la loi du 13 août, Rapport du groupe de travail présidé par Dominique Braye.
CNV (Conseil national des villes) (1998), Rapport 1994–1997, La Documentation française.
CNV (Conseil national des villes) (2001), Grands Projets de Ville : premiers éléments d’évaluation, Groupe de travail « Quelle ville voulons-nous ? ».
CNV (Conseil national des villes) (2003), Avis sur les enjeux du développement économique dans le renouvellement urbain, septembre.
CNV (Conseil national des villes) (2007a), Avis sur la première étape de mise en œuvre des Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), décembre.
CNV (Conseil national des villes) (2007b), Avis sur la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS), novembre.
CNV (Conseil national des villes) (2007c), Avis sur la mise en place des programmes de réussite éducative, avril.
Comité de suivi du Plan de cohésion sociale (2009), Observations sur le Programme de réussite éducative.
Comité d’évaluation des expérimentations du revenu de solidarité active (2009), Rapport final sur l’évaluation des expérimentations rSa, mai.
Conjuguer (2007), Politique de la ville et intercommunalité, Rapport pour la DIV.
Conseil d’État (1997), Sur le principe d’égalité, Rapport public 1996, Études & Documents, n°48, La Documentation française.
Cordier-Deutsch M., Saint-Macary E. (2010), « La mise en oeuvre des politiques locales de l’habitat à l’épreuve des représentations sociales », in Colloque du Pôle Ville de l’Université Paris-Est, 20-22 janvier 2010.
Cour des comptes (1995), Rapport public annuel, La Documentation française.
Cour des comptes (2002), La politique de la ville. Rapport public particulier, Journal officiel.
Cour des comptes (2007), La gestion des crédits d’intervention de l’Etat au titre de la politique de la ville, Rapport à la commission des Finances du Sénat sur le fondement de l'article 582 de la LOLF.
Cour des comptes (2009), L’articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation nationale dans les quartiers sensibles, Rapport effectué au titre de l’article 58 alinéa 2 de la loi organique du 1er août relative aux lois de finances.
CR-DSU (Centre de ressources et d’échanges pour le développement social urbain Rhône-Alples) (2009), « Repères évaluatifs de la réussite éducative. Synthèse des Ateliers permanents 2008-2009 », Les échos des ateliers permanents du CR-DSU, n°4, juin.
Croizet J-C, Claire T. (2003), « Les enseignants contribuent-ils aux inégalités sociales ? », in J-C Croizet, J-Public Leyens (dir.), Mauvaises réputations. Réalités et enjeux de la stigmatisation sociale, Armand Colin.
CSE (Conseil Scientifique de l'Évaluation) (1991), L'évaluation de l'expertise à la responsabilité, Premier rapport annuel sur l'évolution des pratiques d'évaluation des politiques publiques, La Documentation française.
CSE (Conseil Scientifique de l'Évaluation) (1996), Petit guide de l’évaluation des politiques publiques, La Documentation française.
Dallier P. (2010), Rapport d'information n°514 fait au nom de la commission des Finances sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et la politique de la ville, Sénat.
Dallier P., Karoutchi R. (2006), Rapport d’information sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, Sénat.
Damamme D., Jobert B. (1995), « La politique de la ville ou l'injonction contradictoire en politique », Revue française de science politique, vol. 45, n°1.
Damon J. (2009), « Quelques remarques sur le développement social local (DSL) », Revue de droit sanitaire et social, vol. 46, n°5.
Dansereau F. (dir.) (2002), La mixité sociale en habitation, Rapport pour la ville de Montréal, mai.
Davezies L. (2002), « La solidarité redistributive entre territoires », in C. Floquet (dir.), Pour en finir avec la dé-centralisation, Éditions de l’Aube.
Davezies L. (2003), « Les inégalités territoriales, la lutte du pot de terre contre le pot de fer ? », in S. Wachter (dir.) L'aménagement durable : défis et politiques, Éditions de l'Aube.
Davezies L. (2004), « Prendre en compte tous les mécanismes de redistribution », Problèmes politiques et sociaux, n° 906.
de Maillard J. (2000), « Les chefs de projet et les recompositions de l’action publique. Un nouveau métier urbain », Annales de la recherche urbaine, n°88.
de Maillard J. (2004), Réformer l'action publique. La politique de la ville et les banlieues, LGDJ.
Deboulet A. (2006), Le résident vulnérable. Questions autour de la démolition, Mouvements, mai-juin, n°47-48.
Delarue J.-M. (1991), Banlieues en difficulté. La relégation, Syros.
Deleau M. et al. (1986), Évaluer les politiques publiques, La Documentation française.
Delevoye J-P (dir.) (1997), Cohésion sociale et territoires, Rapport du Commissariat général du Plan, La documentation française.
Denieuil P-N., Laroussi H. (2005), Le développement social local et la question des territoires, L’Harmattan.
Denton N. A., Massey, D. S. (1988), « The Dimensions of Residential Segregation », Social Forces, vol. 67, n°2.
Derycke P-H (2007), « Regards sur l’économie urbaine, 40 ans de recherches francophones 1965-2007 », in Les dynamiques territoriales. Débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires, XLIIIème colloque de l’ASRDLF, Grenoble-Chambéry, 11-13 juillet.
Deschamps E. (1998), Le droit public et la ségrégation urbaine (1943-1997), LGDJ.
Deschamps E. (2003), La notion de mixité sociale dans le champ normatif, Rapport introductif du Séminaire du GRIDAUH sur « Le principe de mixité sociale », 25 avril, Paris I.
Despond D. (2010), « Effets paradoxaux de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) et profil des acquéreurs de biens immobiliers en Île-de-France », Espaces et sociétés, n°140-141, janvier-février.
Desrosières A. (1993), La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, La Découverte.
DIV (Délégation interministérielle à la ville) (1993), Les contrats de ville du XIème Plan. Dossier–ressources.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (1995a), L’évaluation des contrats de ville. Dossier-ressources, Éditions de la DIV.
DIV (Délégation interministérielle à la ville) (1995b), Politique de la ville. Les services au public dans les quartiers, Synthèse des journées thématiques de la ville, Cycle 1994–1995.
DIV, Les Grands projets urbains dans la politique de la ville. Bilan-évaluation, Département des GPU, janvier 1998.
DIV (1999), Le pilotage du projet, bilan des sites pilotes.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2002a), Les débats d’Arc et Senans. Vers une stratégie d’évaluation des contrats de ville 2000-2006, Les Éditions de la DIV.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2002b), Pilote de l’évaluation des contrats de ville 2000-2006, Les Éditions de la DIV.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2002c), État d’avancement du programme des GPV à la fin 2001, janvier.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2003), Historique législatif des ZUS-ZRU-ZFU, Note de la DIV.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2008), Politique de la ville et santé publique : une démarche locale pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, Séminaire du 6 au 8 octobre 2008, Les Éditions de la DIV.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2009a), Géographie prioritaire de la politique de la ville et contractualisation. Document pour la concertation, mars.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville), (2009b), Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale. Guide Méthodologique, Cahiers pratiques. Hors série, Éditions du CIV.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville) (2010), Synthèse des réponses au questionnaire d’évaluation des CUCS, février.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville), FNAU (Fédération nationale des agences d'urbanisme) (2008), Observation locale et politique de la ville. Note stratégique & guide méthodologique, Cahiers pratiques. Hors série, Les Éditions de la DIV, septembre.
DIV (Délégation interministérielle à la Ville), PUCA (Plan urbanisme construction architecture) (2008), Démolitions-reconstructions et trajectoires résidentielles des ménages. État des savoirs et perspectives d’action, Actes du colloque du 15 avril 2008.
Donzelot J. (dir.) (1991), Face à l'exclusion, le modèle français, Éditions Esprit.
Donzelot J. (1999), « La nouvelle question urbaine », Esprit, n°11, novembre.
Donzelot J. et al. (2003), Faire société. La politique de la ville aux États-Unis et en France, Le Seuil.
Donzelot J. (2004a), Préface, in Estèbe P. (2004), L'usage des quartiers. Action publique et géographique dans la politique de la ville (1982-1999), L'Harmattan.
Donzelot J. (2004b), « La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, périurbanisation », Esprit, n°303, mars-avril.
Donzelot J. (2006), Quand la ville se défait : quelle politique face à la crise des banlieues ?, Le Seuil.
Donzelot J. (2007), « La cohésion sociale : origine et contours d’un concept flou », in S. Paugam (dir.), Repenser la solidarité : l'apport des sciences sociales, PUF.
Donzelot J., Epstein R. (2006), « Démocratie et participation. L’exemple de la rénovation urbaine », Esprit, n°326.
Donzelot J., Estèbe P. (1992), Le développement urbain. Constitution d’une politique (1982–1992), Rapport pour le Comité national d’évaluation de la politique de la ville.
Donzelot J., Estèbe P. (1994), L’État animateur. Essai sur la politique de la ville, Le Seuil.
Donzelot J., Estèbe P. (1999), « Réévaluer la politique de la ville », in R. Balme, A. Faure, Mabileau A. (dir.), Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de l'action publique, Presses de Sciences Po.
Donzelot J., Jaillet M-C (1997), Les zones urbaines défavorisées. Synthèse de l’étude pilote, Plan Urbain, CDSM.
Donzelot J., Mével C. (2001), « La politique de la ville, une comparaison entre les USA et la France : mixité sociale et développement communautaire », 2001 +, n°56, mai.
Donzelot J., Roman J. (1998), « 1972-1998 : les nouvelles donnes du social », Esprit, n°3-4, mars-avril.
Donzelot J., Wyvekens A. (2004), La magistrature sociale. Enquêtes sur les politiques locales de sécurité, La Documentation française.
Dormois R. et al. (2005), « Path-dependency in Public–private Partnership in French Urban Renewal », Journal of Housing and the Built Environment, vol. 20, n°3.
Douillet A.-C., de Maillard J. (2008), « Le magistrat, le maire et la sécurité publique : action publique partenariale et dynamiques professionnelles », Revue française de sociologie, vol. 49, n°4.
Dourlens C., Vidal-Naquet A. (1987), Ayants droit et territoire. L'attribution des logements sociaux dans le champ de l'expérimentation, Rapport au ministère de l'Equipement.
Dourlens C., Vidal-Naquet P. (1993), L’autorité comme prestation. La justice et la police dans la politique de la ville. Rapport de recherche, Cerpe, Commissariat général du plan, DIV, IHESI, Plan urbain.
Doytcheva M. (2007), Une discrimination positive à la française ? Ethnicité et territoire dans les politiques de la ville, La Découverte.
Driant J-C (2004), « Le schéma directeur de la région Ile-de-France et la recherche sur le marché du logement », in J-C Driant et al., Les apports de la recherche urbaine. Les échelles de la ville : mobilité, mixité et choix résidentiels, IAURIF.
Driant J-C. (2007), Délégation des aides à la pierre. Regards croisés des acteurs de l’habitat, Rapport pour l’USH.
Driant J-C, Lelévrier C. (2006), « Le logement social : mixité et solidarité territoriale », in H. Lagrange, M. Oberti (dir.), Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française. Presses de Sciences Po.
Dubedout H. (1983), Ensemble, refaire la ville, La Documentation française.
Dubet F. (1987), La galère : jeunes en survie, Fayard.
Dubet F., Lapeyronnie D. (1992), Quartiers d’exil, Seuil.
Dubois V. (1999), La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Economica.
Dubrac D. (2008), Pour des villes et des quartiers solidaires : l’activité économique au cœur d’une nouvelle dynamique urbaine. Recommandations et propositions de la CCIP, Rapport présenté aux noms des Commissions Aménagement et développement économique régional, du Commerce et des échanges, de l’Emploi et des affaires Sociales, mars 2008
Duclos H., Grésy J-E (2008), Évaluation de l'utilité sociale de cinq structures de médiation sociale, Rapport au ministre du Logement et de la Ville, janvier.
Ducros P. et al. (dir.) (1998), Action municipale, innovation politique et décentralisation : les années Dubedout à Grenoble, La Pensée sauvage.
Duflo E. (2010), Lutter contre la pauvreté 1., Le Seuil, République des idées.
Dupuy S., Giaccobe N. (1988), Le jardin secret des attributions, Rapport de recherche, MEDINA, ministère de l’Equipement.
Duran P., Thoenig J.C. (1996), « L'État et la gestion publique territoriale », Revue française de science politique, vol. 46, n°4.
Duru-Bellat M. (2003), « Les apprentissages des élèves dans leur contexte : les effets de la composition de l’environnement scolaire », Carrefours de l’éducation, n°16, juillet-décembre.
Duru-Bellat M. (2009), Accès à l’éducation : quelles inégalités dans la France d’aujourd’hui ?, Document de référence préparé pour le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2010/Atteindre les marginalités, UNESCO.
ECs (2009a), Évaluation qualitative des impacts et des conditions de mise en œuvre locale du dispositif des Zones Franches Urbaines, Rapport pour la DIV.
ECs (2009b), Analyse du volet emploi-insertion par l’activité économique et développement économique des contrats urbains de cohésion sociale, Rapport pour la DIV, mai.
Egis et al. (2009), La mobilité et la qualité urbaine dans le cadre des projets de rénovation urbaine, Rapport pour le CES de l'ANRU, octobre.
Eme B. (1994), « Insertion et économie solidaire », in J-L Laville, B. Eme (dir.), Cohésion sociale et emploi, Desclée de Brouwer.
Epstein R. (1999), L’évaluation de la politique de la ville : synthèse critique des analyses disponibles, CNAF, Dossier d’étude n° 3, décembre.
Epstein R. (2004), « La loi Borloo : renforcement ou remplacement de la politique de la ville ? », Revue de droit sanitaire et social, n°3.
Epstein R. (2005), « Les politiques territoriales post-contractuelles : le cas de la rénovation urbaine », Politiques et management public, n°23, mars.
Epstein R. (2007a), « L'évaluation en développement ? Retour sur vingt ans d'évaluation de la politique de la ville, in B. Bouquet et al. (dir.), Les défis de l'évaluation en action sociale et médico-sociale, Dunod.
Epstein R. (2007b), Les opérations de rénovation urbaine : système d’action et logiques d’acteurs, Rapport pour le PUCA, février.
Epstein R. (2008a), Gouverner à distance. La rénovation urbaine, démolition-reconstruction de l’appareil d’État, Thèse de sociologie, ENS-Cachan.
Epstein R. (2008b), « L'éphémère retour des villes. L'autonomie locale à l'épreuve des recompositions de l'Etat », Esprit, février.
Epstein R. (2009), « A quoi sert l'évaluation ? », Tracés, n° 9, Hors-série, mars.
Epstein R. (2010), « Des politiques publiques aux programmes : l’évaluation sauvée par la LOLF ? Les enseignements de la politique de la ville, Revue française des affaires sociales, n°1-2, janvier-février.
Epstein R. (à paraître), « Du futur faisons table rase. Le développement urbain durable au prisme de la rénovation urbaine », in V. Béal et al. (dir), Le développement durable changera-t-il la ville ? Le regard des sciences sociales, Presses universitaires de Saint-Étienne.
Epstein R., Kirszbaum T. (2003), « L’enjeu de la mixité sociale dans les politiques urbaines », Regards sur l’actualité, n°292.
Epstein R., Kirszbaum T (2005), Synthèse nationale des évaluations à mi-parcours des contrats de ville 2000-2006, Rapport pour la DIV.
Epstein R., Kirszbaum T. (2006), « Après les émeutes, comment débattre de la politique de la ville ? » Regards sur l'actualité, n°319.
Equation Management (2009), Évaluation du programme Adulte-relais : enquêtes auprès des employeurs et de leurs partenaires, Rapport pour l’ACSÉ.
Ernst E. (2008), « L’activité économique dans les zones franches urbaines », Insee Première, n° 1187.
Espaces et sociétés (revue) (2010), Paradoxes de la mixité, n°140-141, janvier-février.
Esprit (coll.) (1991), Citoyenneté et urbanité, Éditions Esprit.
ESSEC (2009), Étude sur la prise en compte des territoires urbains sensibles dans les projets de développement des agglomérations, Rapport pour la DIV, avril
Estèbe P. (dir.) (1998), Adaptation des services publics, Dossier thématique de l’Instance d’évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France, octobre
Estèbe P. (2004a), L'usage des quartiers. Action publique et géographique dans la politique de la ville (1982-1999), L'Harmattan.
Estèbe P. (2004b), « Les quartiers, une affaire d'État », in Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po.
Estèbe P. (2004c), « Le territoire est-il un bon instrument de la redistribution ? Le cas de la réforme de l’intercommunalité en France », Lien social et politiques, n°52.
Estèbe P. (2007), « Le bulldozer et l’ascenseur », Innovations et sociétés, n°3.
Estèbe P., Epstein R. (1998), Synthèse nationale des évaluations régionales et locales du XIème Plan, Acadie, Rapport pour la DIV.
Esterle-Hedibel M. (2006), « Absentéisme, déscolarisation, décrochage scolaire. Les apports des recherches récentes », Déviance et Société, n°30, janvier.
Etienne R. (2009), « Individualiser... ou personnaliser ? », XYZep, n°35.
Exertier A., Gramain A. (2006), Décentralisation et accompagnement des chômeurs, Le 4 pages du Centre d’études de l’emploi, n°29, avril.
Fatmi G. et al. (2009), Diversification de l'habitat et programmes immobiliers privés dans les territoires de la rénovation urbaine, Atelier de Master 2ème année de l’IATEUR, sous la direction de M. Bazin et N. Brevet, juin.
Feins J., Goering J. (dir.) (2003), Choosing a Better Life ? Evaluating the Moving to Opportunity Experiment, The Urban Institute Press.
Faucher-King F., Le Galès P. (2007), Tony Blair 1997-2007, Presses de Sciences Po.
Faure S. (2006), « De quelques effets sociaux des démolitions d'immeubles. Un grand ensemble HLM à Saint-Etienne », Espaces et sociétés, n°124-125.
Ferret J., Mouhanna C. (dir.) (2005), Peurs sur les villes, PUF
Figeat D. (1981), « Bilan des opérations Habitat et vie sociale menées pendant la période du VIIe Plan », Rapport pour le Commissariat général du Plan.
Fitoussi J-P et al. (dir.) (2004), Ségrégation urbaine et intégration sociale, Conseil d'analyse économique, La Documentation française.
Fondation Abbé Pierre (2006), L’état du mal-logement en France.
Foret C. (2007), Travail de mémoire et requalification urbaine, Les Éditions de la DIV.
Fortin J-P (1999), Grands ensembles. L'espace et ses raisons. Éditions du PUCA.
Fourcade M. et al. (2005), Évaluation de la mobilisation des crédits de droit commun de l'Etat et contribution à l'évaluation des contrats de ville sur trois territoires, Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales.
Fribourg A-M (1991), Intervention In G. Garin-Ferraz, V. de Rudder (dir.), Loi d'orientation pour la ville. Séminaire chercheurs-décideurs, ministère de l'Équipement.
Garin-Ferraz G., Rudder V. de (dir.), (1991), Loi d'orientation pour la ville. Séminaire chercheurs-décideurs, DAU, ministère de l'Équipement
Gaudin J-P (1993), Les nouvelles politiques urbaines, Que sais-je ?, PUF.
Gaudin J-P (1995), « Politiques urbaines et négociations territoriales : quelle légitimité pour les réseaux de politiques publiques ? », Revue française de science politique, vol. 45, n°1.
Gaudin J-P (dir.) (1996), La négociation des politiques contractuelles, L’Harmattan.
Gaudin J-P (1997), Les nouvelles politiques urbaines, Que sais-je, PUF (1ère éd. 1993).
Gaudin J-P et al. (1995), La ségrégation : aux sources d’une catégorie de raisonnement, Collection « recherches », PUCA, n°69.
Gaudin S. (2007), « Murs après murs : Les jeunes face aux politiques de rénovation urbaine. L’exemple de la démolition dans deux quartiers d’habitat populaire bretons », Sociétés et jeunesses en difficulté, n°4, automne.
Gaultier G., Huet A. (2002), « Rendre évaluables les Contrats de ville », in DIV, Les débats d’Arc et Senans. Vers une stratégie d’évaluation des contrats de ville 2000-2006, Les Éditions de la DIV.
Gautron V. (2006), Les politiques publiques de lutte contre la délinquance, Thèse, Université de Nantes.
Gautron V. (2010), « La coproduction locale de la sécurité en France : un partenariat interinstitutionnel déficient », Champ pénal/Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie, vol. VII.
Geindre F. (1989), L'attribution des logements sociaux, Rapport au ministre de l'Equipement, du logement, des transports et de la mer.
Geindre F. (1993), Villes, démocratie, solidarité : le pari d’une politique, Rapport du groupe « Villes » du Commissariat général du plan, La Documentation française.
Genestier P. (1990), « Éloge du ghetto. Stéréotypes et termes repoussoirs de la pensée urbanistique », Villes en parallèle, n°15-16, juin.
Genestier P. (1999), « Le sortilège du quartier : quand le lieu est censé faire lien », Annales de la recherche urbaine, n°82, mars.
Genestier P. (2003), Le mot « ségrégation » : entre dénonciation des inégalités et invocation d’un idéal holiste, in Colloque de l’ASRDLF « Concentration et ségrégation, dynamiques et inscriptions territoriales », Lyon 1-3 septembre.
Genestier P. (2006), « Comment loger les plus pauvres si l’on démolit les HLM ? », Mouvements, n°32, février.
Georges N. et al. (2010), « Comment réduire la fracture spatiale ? Théorie et application en Île-de-France », Document de travail, Centre d’études de l’emploi, n°126, juin.
Ghorra-Gobin C., Kirszbaum T. (2001), « La proximité à l'ère métropolitaine. Accès à l'emploi en France et aux États-Unis », Annales de la recherche urbaine, n°90, septembre.
Giffo-Levasseur A-M, Pasquier E. (2005), « Négocier l’espace partagé. Les Bouderies : un quartier populaire de Nantes », in B. Haumont, A. Morel (dir.), La société des voisins : partager un habitat collectif, Maison des sciences et de l’homme.
Gilbert G., Guengant A. (2004), Évolution des effets péréquateurs des concours de L’Etat aux collectivités locales, Rapport pour le Commissariat général du Plan.
Gill M., Spriggs, A. (2005), Assessing the impact of CCTV, Home Office Research, Development and Statistics Directorate.
Gilli F. (2006), « Entreprises et développement urbain : les zones franches ont-elles rempli leur mission ? », in C. de Boissieu C. Deneuve, (dir.), Les Entreprises françaises en 2006, Economica.
Gilli F., Kirszbaum T. (2008), « Ghettoïsation, inégalité des chances, réduction des écarts : les justifications du Plan Espoir Banlieue », Regards sur l’actualité, n° 342, juillet.
Glasman D. et al. (1998), École ouverte. Observation, évaluation et analyse à partir de quatre sites, Rapport à la DPM, CRE, Université Jean Monnet Saint-Etienne, octobre.
Glasman D. (2007a), Intervention in IREV, « La réussite éducative à l’épreuve du terrain », Repères pour agir, n°1.
Glasman D. (2007b), « Il n’y a pas que la réussite scolaire ! Le sens du programme de réussite éducative, Informations sociales, n°141, mai.
Glasman D. (2008), « Mise en perspective nationale », in L’évaluation des parcours personnalisés de réussite éducative « Chemins Faisant », Actes du démarche du 10 décembre 2008, ville de Nantes et al.
Gobillon L. et Selod H. (2007), « Les déterminants locaux du chômage en région parisienne », Économie et Prévision, n° 180-181, avril.
Glasman D., Besson L. (2004), Le travail des élèves pour l'école en dehors de l'école, Rapport pour le Haut conseil de l'évaluation de l'école.
Gobillon L. et al. (2010), « Do unemployed workers benefit from Enterprise zones ? The Greater Paris experience », Working paper, March 3.
Goirand S. (2009), « L’individualisation des politiques socioéducatives : famille sous assistance ou famille sous surveillance ? Le cas des "parcours individualisés de Réussite Educative », Recherches en éducation, n°7, juin.
Gorgeon C. (dir.) (1998), Adaptation des services publics. Police, Dossier thématique de l’Instance d’évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France, juin.
Gorgeon C. et al. (2000), « De la prévention sociale à la tranquillité publique. Glissement sémantique et renouveau de l’action publique », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°39.
Goujard A., L’Horty Y. (2010), « La définition des zones témoins pour l’expérimentation du revenu de solidarité active », Revue française des affaires sociales, n°1-2, janvier-février.
Grafmeyer Y. (1994), « Regards sociologiques sur la ségrégation », in J. Brun, C. Rhein (dir.), La ségrégation dans la ville. Concepts et mesures, L'Harmattan.
Grafmeyer Y., Joseph I. (dir.) (1990), L'école de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine, Aubier.
Granovetter M. (1995), Getting a Job: A study of Contacts and Careers, University of Chicago Press.
Grémion C., Mouhanna C. (1995), Le sous-préfet à la ville, L’Harmattan.
Guelton S., Chignier-Riboulon F. (2000), « Les zones franches urbaines », Géocarrefour, vol. 75, n°2.
Guengant A (2007), « Péréquation, solidarité et correction des inégalités financières urbaines », in C. Ghorra-Gobin (dir.), Construction du bien commun à l’échelle métropolitaine, dépasser l’insoutenabilité du découpage communal, Séminaire ENS/PUCA septembre.
Guigou B. (dir.) (2008), Observation et évaluation de la politique de la ville en Ile-de-France depuis 2003. État des lieux et orientations, IAURIF, avril.
Guigou B. et al. (2005), Ségrégation urbaine et politiques publiques : étude comparative. Synthèse des monographies, IAURIF.
Guigou B. et al. (2009), La mixité fonctionnelle dans les quartiers en rénovation urbaine. Fiches sur la mixité fonctionnelle dans les dix sites, IAU Ile-de-France, CES de l'ANRU, octobre.
HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) (2007), Conférence de consensus sur la diversité sociale dans l’habitat, Rapport du jury présidé par Nicole Notat remis au ministre du Logement, octobre.
Hamel G., André P. (2009), Une conception rénovée de la politique de la ville : d’une logique de zonage à une logique de contractualisation, Rapport au Premier ministre, septembre.
Hammouche A. (1998), « La politique de la ville entre médiation et proximité », Droit et société, n°38.
Harzo C. et al. (2007), Trajectoires résidentielles des personnes relogées lors des opérations de renouvellement urbain en région Rhône-Alpes, OSL/Co-cité, Rapport pour PUCA.
Harzo C., Lauriac N. (2009), Analyse critique du volet Habitat et cadre de vie des contrats urbains de cohésion sociale, Co-Cité, Rapport pour la DIV.
Hatzfeld H. (1986), « Municipalités socialistes et associations. Roubaix : le conflit de l'Alma-Gare », Revue française de science politique, vol. 36, n°3.
Haumont B., Morel A. (dir.), La société des voisins : partager un habitat collectif, Maison des sciences et de l’homme.
Haurie J-L (2005), « Le développement social territorial Une stratégie de modernisation de l’action des CAF inscrite dans la durée », Recherches et prévisions, n°81.
Haüsserman H. (2006), « The National "Social City Program". Findings from the Midterm Evaluation », German Politics and Society, vol. 24, n° 4, Winter.
HCLPD (Haut comité pour le logement des personnes défavorisées) (2005), Face à la crise : une obligation de résultat, 11ème rapport.
Helluin J-J (2002), « Les limites de l'approche quantifiée. Le cas de l'indice de mixité sociale », in CERTU, Évaluation des politiques publiques : faut-il quantifier pour évaluer?, CERTU.
Herreros G. (2008), Un regard latéral sur les projets de réussite éducative, Synthèse du rapport de séminaire (novembre 2007 - septembre 2008), INRP.
Heurgon E., Stathopoulos N. (dir.) (1999), Les métiers de la ville. Les nouveaux territoires de l’action collective, Éditions de l’Aube.
Heymann-Doat A. (1993), L'élaboration de la loi d'orientation pour la ville, Collection « recherches », PCA, n°31.
Hiscock R. (2002), « Mixing Tenures: Is it Good for Social Well Being ? », Paper presented at the ENHR Conference, Vienna, 1–5 July.
Holec N. (1999), « Villes et développement durable », in Synthèses... Réflexion sur la connaissance des territoires urbains, DGHUC, CDU, ministère de l'Équipement,
Holzer H. (1988), « Search Method Use by Unemployed Youth », Journal of Labor Economics, vol. 6.
Houard N. (2008), Logement social, droit au logement, et mixité, Thèse de doctorat IEP de Paris.
IGAS (Inspection générale des affaires sociales) (1996), Rapport d'enquête sur l'implication des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans la politique de la ville, mars.
IHESI (Institut des hautes études sur la sécurité intérieure) (2000), Guide pratique de la police de proximité, La documentation française.
INHES (Institut national des hautes études de la sécurité) (2008), La vidéoprotection : conditions d'efficacité et critères d'évaluation, juillet.
INSEE (2001), Enquête "Vie de quartier". Partie variable de l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, avril.
INSERM (2005), Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent.
Ion J. et al. (1996) Évaluation, évaluabilité et action publique, Rapport pour le Commissariat général du Plan.
IREV (Institut régional de la ville) (2007), « La réussite éducative à l’épreuve du terrain », Repères pour agir, n°1.
Jacquier C. (2003), Politiques intégrées de développement urbain durable et gouvernance urbaine en Europe. Quelles relations mutuelles, novembre.
Jacquier C. (2004), « Évaluation de la politique de la ville et mutations institutionnelles : un étonnant silence », Les Cahiers du CR-DSU, n° 41, automne
Jaillet M.C. (1993), « L’insertion par l’économique », in Comité national d’évaluation de la politique de la ville, Les enjeux de l’action, DIV, Plan urbain, Caisse des dépôts et consignations.
Jaillet M-C (1998), « A propos de la mixité », Les Cahiers du CR-DSU, n°21, décembre.
Jaillet M-C (1999), « Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes ? » in J. Donzelot, M-C Jaillet (dir.), La nouvelle question urbaine, Actes du séminaire 1999–2000, Collection « recherches », n°126, PUCA.
Jaillet M-C (2000), « La politique de la ville, une politique incertaine », Regards sur l'actualité, n°260.
Jaillet M-C (2003), « La politique de la ville en France : histoire et bilan », Regards sur l'actualité, n°296, décembre.
Jaillet M-C (2005), « La mixité sociale : une chimère ? Son impact sur les politiques urbaines », Informations sociales, n° 123, mai.
Jaulent C. (2007), « Mieux connaître le poids des allocataires des ZUS », Informations sociales, n°141, mai.
Jeannot G. (2001), « L'impossible fin de la "solution équipement" », Annales des ponts et chausées, n°98.
Jégouzo Y. (2005), « Contenu et articulation des contrats d'agglomération », in J-P Brouant (dir.), Contractualisation et territoires. Le rôle des contrats d’agglomération, La Documentation française.
Joigny M. et al. (2008), Audit thématique d'initiative nationale sur l'action des services du MEDAD dans la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, Rapport du Conseil général des Ponts et chaussées.
Joly-Rissoan O. et al. (2006), Le Programme de réussite éducative : mise en place et perspective, Université de Savoie, Rapport pour la DIV.
Joubert M. et al. (1993), Quartier, démocratie et santé, L’Harmattan.
Joubert M., Mannoni C. (2003), Les Ateliers santé-ville. Expérimentation en Seine-St- Denis, Profession Banlieue, mars.
Jouve B. et al. (2006), « L'empowerment : entre mythe et réalités, entre espoir et désenchantement », Géographie, économie, société, vol. 8, n°1, janvier-mars.
Kain J. F. (1968), « Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization », Quarterly Journal of Economics, n°82.
Kertudo P., Vanoni D. (dir.) (2009), La gestion urbaine de proximité dans les projets de rénovation urbaine, Rapport pour l’ANRU, mars.
Kesteloot C., Mistiaen P. (1998), « Des limites de la mixité sociale comme stratégie de gouvernement », Cahiers marxistes, n°211, décembre.
Kesteman N. et al. (2008), « L’accompagnement social par les CAF des opérations de restructuration de l’habitat. Évaluation comparée de cinq opérations », Dossiers d’études de la CNAF, n°105.
Kingsley T. G. et al. (2003), « Patterns of Section 8: Relocation in the HOPE VI Program », Journal of Urban Affairs, vol. 25, n°4.
Kirszbaum T. (1998), Fonction de coordination des services de l’Etat et contractualisation dans la politique de la ville. Essai de synthèse des évaluations produites dans le cadre du XIème Plan, CEDOV, Rapport pour le Plan Urbain.
Kirszbaum T. (2001), Modernisation des services publics et éclatement de la ville, sous le regard des chercheurs, Coll. « Recherches », n°124, PUCA.
Kirszbaum T. (2002), Le traitement préférentiel des quartiers pauvres. Les Grands projets de ville au miroir de l'expérience américaine des Empowerment Zones, CEDOV, Rapport pour le PUCA.
Kirszbaum T. (2003), « De Baltimore à Grigny, le traitement préférentiel des quartiers pauvres » Hommes & migrations, n°1245.
Kirszbaum T. (2004a), « Discrimination positive et quartiers pauvres : le malentendu franco-américain », Esprit, n°3-4, mars.
Kirszbaum T. (2004b), « Services publics et fractures de la ville : la "pensée publique" entre diversité, éclatement et souci du rapprochement », Sociologie du travail, n°46.
Kirszbaum T. (2004c), « La discrimination positive territoriale : de l’égalité des chances à la mixité urbaine », Pouvoirs, n°111.
Kirszbaum T. (2004d), « Intérêt commun et intérêt public : la philosophie des instruments d’intégration socio-urbaine, Lien social et politiques, n°52, automne.
Kirszbaum T. (2004e), « Discours et pratiques de l’intégration des immigrés. L’exemple des Grands projets de ville », Annales de la recherche urbaine, n°97, décembre.
Kirszbaum T. (2007), Les élus, la République et la mixité. Variations discursives et mise en débat de la norme nationale de mixité dans neuf communes franciliennes, REPS, Rapport pour le PUCA.
Kirszbaum T. (2008a), Mixité sociale dans l’habitat. Revue de la littérature dans une perspective comparative, Études & Recherches, HALDE, La Documentation française.
Kirszbaum T. (2008b), La mixité résidentielle : une politique (anti)discriminatoire ? Le cas de la rénovation urbaine aux États-Unis et en France, Volet d'une recherche comparative « Les approches anglo-saxonnes et française de la lutte contre les discriminations ethniques », CERI, DREES-MIRE, ministère de la Santé et des solidarités.
Kirszbaum T. (2008c), « Rénovation urbaine, une mixité très peu sociale », Projet, juin, n°307.
Kirszbaum T. (2009a), La programmation des Contrats urbains de cohésion sociale face aux réformes de la politique de la ville. Enquête à Argenteuil, Dreux et Lormont, REPS, Rapport pour l’ACSÉ, décembre.
Kirszbaum T. (2009b), Rénovation urbaine. Les leçons américaines, Coll. « La ville en débat », PUF.
Kirszbaum T. (2009c), « Un Janus aux deux visages : la diversité dans l'habitat. Réflexions sur les politiques de déségrégation résidentielle aux Etats-Unis et en France », Raisons politiques, n°35, mars.
Kirszbaum T. (2010), Articuler l’urbain et le social. Enquête sur onze site « historiques » en rénovation urbaine, REPS, Rapport pour le CES de l'ANRU.
Kirszbaum T., Simon P. (2001), « Les discriminations raciales et ethniques dans l'accès au logement social », Notes du Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations, n°3.
Kokx A., Kempen R. van (2010), « Dutch Urban Governance : Multi-level or Multi-scalar ? », European Urban and Regional Studies, vol. 17, n°4, October.
Kynos (2009), Résultats de l’enquête sur les Ateliers Santé Ville au 31 décembre 2008, Rapport pour l’ACSÉ, avril.
LARES (2001), Vers un référentiel national d’évaluation des GPV. Le point de vue des acteurs locaux, Document pour la DIV.
Latz A. (2009), « Évaluation : de quoi parle-t-on ? », in IREV, Évaluer et piloter les projets de développement social urbain, Jeudis de la ville, avril.
Laé J-F (1991), Entre le faubourg et le HLM. L’éclipse du pauvre, Iresco.
Lafore R. (1995), « L’ordre consensuel. Le droit des politiques sociales », Le nouveau Mascaret, n° 37, septembre
Lagnaoui A. (2009), Crise immobilière et mixité sociale, Esprit, mars-avril.
Lamarque D. (2004), L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ.
Langlais J-L et al. (1991), Les services publics de proximité dans les quartiers en difficulté, Rapport au ministre d'État, ministre de la Ville.
Lapeyronnie D. (2008), Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourdhui, Robert Laffont.
Lascoumes P., Le Bourhis J-P (1998), « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et procédures », Politix, n°42.
Laval-Reviglio M-C (2005), « L’objectif de mixité sociale et les discriminations familiales », in Logement et famille : des droits en question, Dalloz.
Laville J-L (1994) (dir.), L’économie solidaire. Une perspective internationale, Desclée de Brouwer.
Laville J-L (1998), « Les services solidaires : une autre construction des services de proximité », in M. Bonnet, Y. Bernard (dir.), Services de proximité et vie quotidienne, PUF.
Le Galès P. (1995), « Politique de la ville en France et en Grande-Bretagne : volontarisme et ambiguïtés de l'Etat », Sociologie du travail, vol. 37, n° 2.
Le Galès P. (2003), Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Presses de Sciences Po.
Le Galès P., Mawson J. (1995), « Contracts versus Competitive Bidding : Rationalizing Urban Policy Programmes in England and France », Journal of European Policy, vol. 2, n°2.
Le Gall G. (2008), Réunifier et réconcilier la ville. Constat et propositions, Avis du Conseil économique et social.
Le Garrec S. (2006), Le renouvellement urbain, genèse d'une notion fourre-tout, Éditions du PUCA.
Le Goff T. (2002), « Les contrats locaux de sécurité à l'épreuve du terrain : réflexion sur l'action publique locale en matière de sécurité », Politiques et management public, vol. 20, mars.
Le Goff T. (2008), Vidéosurveillance et espaces publics. État des lieux des évaluations menées en France et à l’étranger, IAU Ile-de-France, octobre.
Lefèvre C. (1998), « Gouvernance, institutions et territoires : les gouvernements métropolitains dans les pays occidentaux », in N. May et al. (dir.), La ville éclatée, Éditions de l’Aube.
Lefèvre B. et al. (1992), La politique du logement : cinquante ans pour un échec, L'Harmattan.
Lefebvre H. (1968), Le droit à la ville, Anthropos.
Lelévrier C. (2001), « La mixité sociale et les politiques urbaines », Passages, n°109-110, mai-juin.
Lelévrier C. (2004a), « Que reste-t-il du projet social de la politique de la ville ? », Esprit, n°303, mars-avril.
Lelévrier C. (2004b), « Les politiques de lutte contre la ségrégation : mixité des quartiers ou intégration des populations ? », in ADEF, Les mécanismes fonciers de la ségrégation, 1er trimestre
Lelévrier C. (2005a), « La mixité : de la controverse à une redéfinition des politiques locales », in Profession Banlieue, Mixité sociale, un concept opératoire ? Cycle de qualification, 26 novembre-3 décembre 2004.
Lelévrier C. (2005b), « Rénovation urbaine, relogement et recompositions territoriales », FORS Recherche sociale, n°176, octobre-décembre.
Lelévrier C. (2007), Mobilité et trajectoires résidentielles des ménages dans trois opérations de rénovation urbaine en Ile-de-France, CRETEIL, LOUEST, Université Paris-12, juillet.
Lelévrier C. (2008), Mobilités et trajectoires résidentielles des ménages relogés lors d’opérations de renouvellement urbain. Synthèse des travaux menés entre 2004 et 2007, Rapport PUCA-DIV-DREIF.
Lelévrier C. (2010), « La mixité dans la rénovation urbaine : dispersion ou re-concentration ? », Espaces et sociétés, n°140-141, janvier-février.
Lelévrier C., Guigou B. (2005), « Les incertitudes de la résidentialisation. Transformation des espaces et régulation des usages », in B. Haumont, A. Morel (dir.), La société des voisins, Maison des sciences de l’homme.
Leloup X. (1999), La ségrégation résidentielle. Le cas d’une commune Bruxelloise, L’Harmattan.
Leroy M. (1998), La polyvalence dans les administrations, DGAFP, La Documentation française.
Leroy M. (1999), « La négociation de l'action publique conventionnelle dans le contrat de plan Etat-région », Revue française de science politique, vol. 49, n°4.
Levan V. (2009), « Mesurer les effets de la sécurisation des quartiers populaires : un état des lieux de la littérature anglo-américaine », Déviance et Société, vol. 33, n°1.
Levy F. (1988), Bilan/Perspectives des contrats de développement social des quartiers, Rapport du Commissariat général du Plan.
Lévy J-C (2006), « Mixité à la française. Une vision politique de la ville lissée », Mouvements, n°45-48, avril-mai.
Lévy J-P, Dureau F. (dir.) (2002), L'accès à la ville. Les mobilités spatiales en questions, L'Harmattan.
Linhart V. (1996), La « ville » comme objet de politique publique. Genèse et institutionnalisation de la politique de la ville en France, Thèse de doctorat, IEP Paris.
Lorrain D. (1989), « La montée en puissance des villes », Économie et humanisme, n°305.
Lorrain D. (1993) « Après la décentralisation. L’action publique flexible », Sociologie du travail, vol. 35, n°3.
Lorrain D. (2006), « La dérive des instruments. Les indicateurs de la politique de la ville et l'action publique », Revue française de science politique, vol. 56, n° 3.
Loudier C. (2002), La sûreté dans les espaces publics urbains. L'apport des méthodes nord-américaines à la question française et francilienne, IAURIF, PUCA.
Louvet N., Jemelin C. (2007), Évaluation de la mobilité dans les projets de renouvellement urbain financés par l’ANRU, Rapport pour le CES de l'ANRU, juin.
Madry P. (2007), « La mixité sociale facteur de risque économique », Études foncières, n°127.
Maguer A., Berthet J-M (1997), Les agents des services publics dans les quartiers difficiles, Rapport à la DGAFP, La Documentation française.
Mandouze D. (2008), Analyse et suivi du changement social et de l’opinion publique dans les communes du Grand projet des villes, ARCUS, novembre.
Mannoni C. (2007), La démarche Atelier santé-ville. Des jalons pour agir, Profession Banlieue.
Marcou G. (1994), « Les instruments contractuels de l’aménagement du territoire dans les relations entre les collectivités publiques », in H. Groud, J-C Némery (dir.), Le renouveau de l’aménagement en France et en Europe, Economica.
Marcou G. et al. (1997), La coopération contractuelle et le gouvernement des villes, L’Harmattan.
Marissing E. van et al. (2006), « Urban Governance and Social Cohesion. Effects of Urban Restructuring Policies in two Dutch Cities », Cities, vol. 23, n° 4.
Maurin E. (2004), Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Le Seuil.
May N. et al. (dir.) (1998), La ville éclatée, Éditions de l’Aube.
Méjean P. (1997), « Les contrats de ville du XIème Plan. Contribution au bilan », septembre.
Méjean P. (2002), « Conduite et agencement de l’évaluation, in DIV, Les débats d’Arc et Senans. Vers une stratégie d’évaluation des contrats de ville 2000-2006, Les Éditions de la DIV.
Méjean P. (2003), « La politique de la ville à l'épreuve de la loi Borloo », Etudes foncières, n° 106.
Meuret D. (2000), « Les politiques de discrimination positive en France et à l’étranger », in A. van Zanten (dir.), L’école : l’état des savoirs, La Découverte.
Mignot D. (2004), « Transport et justice sociale », Reflets et Perspectives, XLIII, n°4.
Mignot D., Bouzouina L. (2007), « Les disparités entre communes augmentent-elles ? », Constructif, n°18, novembre.
Milburn P. (2010), « Les procureurs de la République : passeurs de justice ou gestionnaires des politiques pénales ?, Droit et société, n°74.
Ministère délégué à la Ville (2001), Bilan des Zones franches urbaines, Rapport au Parlement, juillet.
Ministère délégué à la Ville et à la rénovation urbaine (2002), Bilan des Zones franches urbaines, Rapport au Parlement, décembre.
Minonzio J. (2007), « Programme de recherche et d’études de la CNAF : quelques enseignements pour la période 1990-2005 », Recherches et prévisions, n°88, juin.
Mission Banlieues 89 (1991), Pour en finir avec les grands ensembles, Actes des assises de Bron du 4 et 5 décembre 1990.
Moisan C., Simon J. (1997), Les déterminants de la réussite scolaire en zone d’éducation prioritaire, INRP.
Mollet A. (dir.) (1981), Quand les habitants prennent la parole, Éditions du Plan Construction, Ministère de l’urbanisme et du logement, Littera.
Mollet A. (dir.) (1986), Droit de cité. À la rencontre des habitants des banlieues délaissées, coll. « Villes et entreprises », L'Harmattan.
Monjardet D. (1991), « Une mission sur un territoire. De la difficulté des policiers à entrer dans les politiques de prévention de la délinquance », Bulletin. Revue du CLCJ, n°26.
Monjardet D. (1999), « Réinventer la police urbaine », Cahiers de l’IHESI, n°37, 3ème trimestre.
Monnier E. (2004), « La politique de la ville est-elle évaluable ? », Les Cahiers du CR-DSU, n° 41, automne.
Mordret X., Maresca B. (2009), « Commerces et Zones urbaines sensibles. Politiques publiques et besoins des habitants », Cahier de recherche, Credoc, n°260, décembre.
Morel S. (2007), La réussite éducative en Seine-Saint-Denis. Nouvelles pratiques professionnelles, Profession banlieue, décembre.
Morlet O. (2001), « La Caisse des dépôts renouvelle ses crédits à la ville », Études foncières, n°90, avril.
Musterd S., Ostendorf, W. (2008), « Integrated Urban Renewal in the Netherlands : a Critical Appraisal », Urban Research & Practice, vol. 1, n°1, March.
Newman O. (1972), Defensible Space. People and Design in the Violent City, The Architectural Press.
Noyer J., Raoul B. (2008), « Concertation et "figures de l’habitant" dans le discours des projets de renouvellement urbain », Études de communication, n°31, janvier.
Noyé C. (dir.) (2009), Diversification de l'habitat et diversification fonctionnelle dans les opérations de rénovation urbaine en Île-de-France, IUP, Université de Paris XII.
Oberti M. (2001), « Le "communautarisme de classe" : distance spatiale et sociale comme alternative à la mixité sociale », Mouvements, n°15-16.
Oblet T. (2005), Gouverner la ville, PUF
Oblet T. (2008), Défendre la ville. La police, l’urbanisme et les habitants, PUF.
Oblet T., Villechaise A. (2010), « Les relogés de la rénovation urbaine : un bilan plutôt positif altéré par les difficultés des plus démunis », Mouvements (site web), 16 août.
ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) (2004), Rapport 2004, Éditions de la DIV
ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) (2005), Rapport 2005, Éditions de la DIV
ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) (2006), Rapport 2006, Éditions de la DIV
ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) (2007), Rapport 2007, Éditions de la DIV
ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) (2008), Rapport 2008, Éditions de la DIV
ONZUS (Observatoire national des zones urbaines sensibles) (2009), Rapport 2009, Éditions de la DIV
Orr L. et al. (2003), Moving to Opportunity for Fair Housing Demonstration Program: Interim Impacts Evaluation, Abt Associates, Office of Policy Development and Research, HUD.
Pan Ké Shon J.-L. (2009), « Ségrégation ethnique et ségrégation sociale en quartiers sensibles. L’apport des mobilités résidentielles », Revue française de sociologie vol. 50, n°3
Papke L. E. (1993), « What do we know about Enterprise Zones ? », in J-M Poterba (ed.), Tax Policy and the Economy, MIT Press.
Pêcheur B. (1991), Valoriser les hommes et les femmes du service public dans le cadre de la politique de la ville, Rapport de la DGAFP.
Pellegrin J-P (1996), « Quelles prises en compte des territoires dans les politiques d’emploi », in Politiques d’emploi et territoires. Actes des rencontres du 13 janvier 1995, La Documentation française.
Peraldi M. (1995), « Le cycle du fusible, Pour une histoire sociale du DSU à Marseille », Annales de la recherche urbaine, n°68-69.
Périer P. (2005), École et familles populaires. Sociologie d’un différend, Presses universitaires de Rennes.
Perret B. (2001), L’évaluation des politiques publiques, La Découverte.
Perret B., Roustang G. (1993), L'économie contre la société. Affronter la crise de l'intégration sociale et culturelle, Seuil.
Peyrat D. (2001), Les maisons de justice et du droit : la distance comme problème, la proximité comme solution ?, Revue française des affaires sociales, n°3, janvier-mars.
Picard P. (1991), L'amélioration du service public dans les quartiers, Rapport au ministre d'Etat, ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire.
Piketty T., Valdenaire M. (2006), L'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées français. Estimations à partir du panel primaire 1997 et du panel secondaire 1995, Ministère de l'Éducation nationale.
Pinson D. (1996), « La monumentalisation du logement ou l’architecture des ZUP comme culture », Les Cahiers de la recherche architecturale, n°38-39.
Pinson G. (2009), Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes, Presses de Sciences Po.
Piquée C., Suchaut B. (2002), Efficacité pédagogique d’une action d’accompagnement scolaire : l’évaluation du « Coup de pouce » de Colombes, Rapport pour l’APFEE, Irédu, Université de bourgogne.
Piquée C. (2003), « Public, modes de fonctionnement et efficacité pédagogique de l'accompagnement à la scolarité », Ville-Ecole-Intégration, n°132, mars.
Piron O. (1990), Les grands ensembles : bientôt des quartiers comme les autres, Rapport pour le ministre délégué au Logement.
Piron O. (2001), Vers un indice de mixité sociale, Note du Secrétariat permanent du PUCA.
Plan Urbain (1994), Les régies de quartier, expérience et développement. Regards de chercheurs.
Popkin S. J. et al. (2004), A Decade Of HOPE VI : Research Findings And Policy Challenges, The Urban Institute, The Brookings Institution, May
Préteceille E. (1993), Mutations urbaines et politiques locales. Volume 2 : Ségrégation sociale et budgets locaux en Île-de-France, Centre de sociologie urbaine, CNRS.
Préteceille E. (2002), « Comment analyser la ségrégation sociale? », Études Foncières, n°98.
Préteceille E. (2006), « La ségrégation sociale a-t-elle augmenté ? La métropole parisienne entre polarisation et mixité », Sociétés contemporaines, n°62, février.
Profession banlieue (1998), La politique de la ville. Entre exception et droit commun.
Profession banlieue (2009), Référents de parcours de réussite éducative : quelles pratiques professionnelles, février.
Rathelot R., Sillard P. (2008), « Zones franches urbaines : quels effets sur l’emploi salarié et les créations d’établissements ? », Économie et statistique, n° 415-416
Recherche Sociale (revue), (2005), Les projets sociaux de territoires : mieux articuler action sociale et politique de la ville, n°174, avril-juin.
Remy J. (1990), « La ville cosmopolite et la coexistence inter-ethnique », in Bastenier A., Dassetto F. (dir.), Immigrations et nouveaux pluralismes, De Boeck.
Résovilles (2010), Les programmes de réussite éducative. Recherche-action interrégionale Languedoc-Roussillon/Bretagne/Pays de la Loire.
Robert C. (2005), « L’ANRU au risque de l’évaluation. Que va-t-on réellement évaluer et quand va-t-on s’y mettre ? », Recherche sociale, n° 176.
Robin-Rodrigo C., Bourguignon P. (1999), Le territoire de la cité au service de l’emploi, Rapport au Premier ministre, juin.
Roché S. (2004), « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et européanisation de la sécurité intérieure », Revue française de science politique, vol. 54, n°1, février.
Rochefort R. (dir.) (2008), Un commerce pour la ville, Credoc, Rapport au Ministre du Logement et de la Ville, février.
Roman J. (dir.) (1993), Villes, exclusion et citoyenneté, Éditions Esprit.
Salais R. (2010), « Usages et mésusages de l’argument statistique : le pilotage des politiques publiques par la performance », Revue française des affaires sociales, n°1-2, janvier-février.
Sala-Pala V. (2006), « La politique du logement social est-elle raciste ? L’exemple marseillais, Faire savoirs, n°6, mai.
Sardais C. (1990), Rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville, Inspection des finances.
Sauvage A., Gillio C. (1993), Évaluation et jugement, Actes du séminaire de Rennes, LARES, Plan urbain.
Schwartz B. (1981), L’insertion professionnelle et sociale des jeunes, Rapport au Premier ministre, La Documentation française.
SEU (Social Exclusion Unit) (2001), A New Commitment to Neighbourhood Renewal : National Strategy Action Plan, Cabinet Office.
Siblot Y. (2005), « Adapter » les services publics aux habitants des "quartiers difficiles". Diagnostics misérabilistes et réformes libérales », Actes de la recherche en sciences sociales, n°159, avril.
Silverman E. et al. (2005), A Good Place for Children? Attracting and Retaining Families in Inner Urban Mixed Income Communities, Joseph Rowntree Foundation.
Simon P. (1992), « Banlieues :de la concentration au ghetto », Esprit, n°182.
Simon P. (1996), « L'intégration et le ghetto », in E. Malet, P. Simon (dir.), Les territoires de l'intégration, Passage, Unesco.
Simon P. (2001), « Exemples d'ailleurs », in IAURIF, Mixité sociale et ségrégation : les réalités d'hier et d'aujourd'hui et les actions publiques, Actes de la Table-ronde du 12 décembre 2000.
Sintomer Y. (2001), « Mixité sociale et lutte pour l’égalité », Mouvements, n°15-16, mai-août.
Spenlehauer V., Warin P. (2000), « L’évaluation au service des conseils régionaux », Sociologie du travail, vol. 42, n° 2.
Stavo-Debauge J. (2007), « L’invisibilité du tort et le tort de l’invisibilité », EspacesTemps.net.
Subra P. (2006), « Heurs et malheurs d’une loi antiségrégation : les enjeux géopolitiques de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) », Hérodote, n°122, mars.
Suchaut B. (2005), « Un regard sur l’efficacité des dispositifs de lutte contre l’échec scolaire », Regards sur l’actualité, n°310.
Suchaut B. (2008), « Accompagnement à la scolarité et réussite éducative. Intérêts et enjeux de l’évaluation », Dialogue, 129-130.
Suchaut B. (2009), « L’aide aux élèves : diversité des formes et des effets des dispositifs », Communication aux 2èmes rencontres nationales sur l’accompagnement, St-Denis, 4-5 avril 2009.
Sueur J-P (1998), Demain, la ville. Tome 1, Rapport au ministre de l’Emploi et de la solidarité, La Documentation française.
Sylla F. (2008), L'emploi des jeunes des quartiers populaires, Avis de Conseil économique et social.
Tabard N. (1993), « Des quartiers pauvres aux banlieues aisées : une représentation sociale du territoire », Economie et statistique, n°270.
Tanter A., Toubon J-C (1995), « Vingt ans de politique française du logement social », Regards sur l’actualité, n°214.
Tanter A., Toubon J-C (1999), « Mixité sociale et politiques de peuplement : genèse de l'ethnicisation des opérations de réhabilitation », Sociétés contemporaines, n°33-34, avril.
Ten (1985), Ces quartiers où s'invente la ville, CNDSQ.
Tetra (2006), Étude sur la prise en compte des établissements scolaires dans les opérations de rénovation urbaine, Rapport pour la DIV, décembre
Tetra (2009), L’école dans le cadre des projets de rénovation urbaine, Rapport pour le CES de l'ANRU, octobre.
Tevanian P., Tissot S. (2003), « La “mixité” contre le choix », Prochoix, n°25, été.
Thélot H. (2005), « Les zones franches urbaines en 2003 ; un dynamisme impulsé par la vigueur des nouvelles implantations », Premières synthèses informations, DARES, n°19.1, mai.
Thélot H. (2006), « Les zones franches urbaines en 2004 : lancement de 41 nouvelles zones », Premières Informations, n° 06.2, février.
Thin D. (1998), Quartiers populaires. L’école et les familles, Presses universitaires de Lyon.
Thisse J-F et al. (2003), « Ségrégation urbaine, logement et marchés du travail », Revue française d'économie, vol. 17, n°4.
Tissot S. (2004), « Identifier ou décrire les "quartiers sensibles" ? », Genèses, n°54, janvier.
Tissot S. (2006), « Logement social : une discrimination en douce », Plein droit, mars.
Tissot S. (2007), L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique, Le Seuil.
Toubon J-C (1980), Opérations « habitat et vie sociale » en région d’Ile-de-France. Une tentative d’évaluation, IAURIF.
Toubon J-C (1992), « Du droit au logement à la recherche de la diversité », Hommes & migrations, n°151–152, février–mars.
Touraine A. (1991), « Face à l’exclusion », in Esprit (coll.), Citoyenneté et urbanité, Éditions Esprit.
Trajectoires (2008), Analyse des résultats de l’enquête sur les PRE, Rapport pour l’ACSÉ, septembre.
Trancart D. (1998), « L'évolution des disparités entre collèges publics », Revue française de pédagogie, vol. 124, n°1.
Trancart M. (2006), « Résidentialiser les logements sociaux », in La gazette des communes, n°39/1857, 16 octobre 2006.
Tréguer C (2002) Les politiques publiques favorisent-elles les quartiers pauvres ? Essai d’élaboration d’une comptabilité sur le cas de deux quartiers, un banal et un pauvre, Thèse de doctorat, Institut d'Urbanisme de Paris.
Trosa S., Perret B. (2005), « Vers une nouvelle gouvernance publique ? La nouvelle loi budgétaire, la culture administrative et les pratiques décisionnelles », Esprit, n° 2.
Türk A., André P. (2006) Un nouveau pacte de solidarité pour les quartiers. Rapport d’information. Mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années, Sénat.
USH (Union sociale de l’habitat) (2009), Le relogement, résultats et pratiques, mai
Vallet B. (2007), « Aux origines de la résidentialisation : le lien avec la prévention situationnelle », in CERTU, La résidentialisation en questions, Éditions CERTU, Ville de Grenoble.
Vamplew C., Wood M. (1999), Neighbourhood Images in Teesside: Regeneration or Decline, York Publishing Service.
Van de Walle I., Britton M. (2007), « La mobilisation des entreprises dans la politique de développement économique des zones urbaines sensibles », Cahiers de recherche, Credoc, n°244, décembre.
Van Zanten A. (2008) « L’éducation prioritaire entre territoires et individus »., XYZep, n° 33.
Vanoni D. (2005), « La rénovation urbaine en question. Débat avec P. Peillon », Informations sociales, n°123, mars.
Vaucelle B. (2008), « Les fonctions territoriales de la prestation d'animation globale », Recherches et prévisions, n°93, septembre.
Verhage R. (2003), « The Role of the Public Sector in Urban Development. Lessons from Leidsche Rijn Utrecht (The Netherlands) », Planning Theory & Practice, vol. 4, n°1.
Vieillard-Baron H. (2005), « Logement social et mixité en Europe », in Profession Banlieue, Mixité sociale, un concept opératoire ?, Cycle de qualification, novembre-décembre 2004.
Vieillard-Baron H. (2009), « Le zonage en question », Projet, n°312.
Viveret P. (1989), L'évaluation des politiques et des actions publiques, La Documentation française.
Voléry I. (2003), « De la question sociale à la question familiale. Quelle mobilisation des familles dans les quartiers urbains stigmatisés ? », Politix, vol. 16, n°64, quatrième trimestre.
Wacquant L. (2006), Parias urbains : Ghetto, banlieues, État, La Découverte.
Warin P. (1996), Contractualisation et participation. Point de vue sur la mise en oeuvre de la politique de la ville et son évolution, CERAT, PIR-Villes, CNRS, mai.
Warin P. (2003), « Le non-recours aux services publics, une question en attente de reconnaissance », Informations sociales, n°109.
Wilson W. J. (1994), Les oubliés de l’Amérique, Desclée de Brouwer (traduction ff. Ed. Originale: The Truly Disadvantaged : the Inner City, the Underclass and Public Policy (1987), University of Chicago Press.
Windle J. (2008), « In Remembrance of Things Past ? Strategies of Public Pedagogy for Urban Renovation », Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, vol. 30, n°5, November.
Wuhl S. (1996), Insertion : les politiques en crise, PUF.
Zauberman R. et al. (2009), « L’acteur et la mesure. Le comptage de la délinquance entre données administratives et enquêtes », Revue française de sociologie, vol. 50, n°1.
Zémor P., Jullien P. (1995), Les services de proximité d’intérêt collectif dans les quartiers d’habitat social, Rapport du groupe de réflexion de l’UNFOHLM.
ÉTUDE PORTANT SUR
LES RÉSULTATS D’ACTIONS D’ÉVALUATION RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
15 septembre 2010
——
Cabinet E. C. s.
Étude conduite sous la direction d’Arnaud de Champris
SYNTHÈSE
La présente étude, demandée par les rapporteurs du CEC, est une synthèse des résultats des actions de la politique de la ville tels qu’il sont retracés par les évaluations des contrats urbains de cohésion sociale d’un échantillon de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) . Cet échantillon, initialement prévu de 15 contrats a été étendu à 22. Il correspond à des situations locales contrastées représentant la diversité des types de territoires et des problématiques urbaines et sociales recouvertes par les CUCS. Une typologie en a été dégagée. Des entretiens ont été menés avec les responsables (élus, directeurs généraux des services, directeurs du développement social urbain, chefs de projet). Les observations ont été croisées avec les résultats du questionnaire adressé par le SG-CIV aux préfectures au début de l’année 2010.
TYPOLOGIE DES CUCS : ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DE TERRITOIRE
Rappel : le classement initial des quartiers prioritaires selon trois niveaux de priorité s’est dans un premier temps appuyé sur la mesure des écarts des revenus médians entre les quartiers et l’unité urbaine, et sur les propositions des préfets. Dans les faits, la liste issue de cette analyse nationale ayant présenté un nombre très restreint de quartiers par rapport à ceux relevant précédemment des contrats de ville, la mobilisation des acteurs locaux a finalement permis d’élargir largement cette liste. Aujourd’hui, les 497 CUCS signés regroupent 2 492 quartiers, dont 1 102 de niveau 1, 763 de niveau 2, et 627 de niveau 3.
La présente étude s’appuie également sur une typologie des territoires construite en prenant en compte la taille des territoires concernés, leur configuration socio-urbaine et le type de portage :
Type 1 – Ville petite ou moyenne en bassin de vie rural, 3 sites de l’échantillon, présentant un ou deux quartiers prioritaires rarement classés en ZUS ;
Type 2 – Ville petite ou moyenne dans un système urbain, en orbite métropolitaine, 3 sites de l’échantillon présentant un petit nombre de quartiers prioritaires mais de plus grande taille ;
Type 3 – Pôle urbain à rayonnement départemental, 6 sites de l’échantillon, aux quartiers plus nombreux et hétérogènes : quartiers de centre ancien ou faubouriens dégradés et précarisés ; quartiers périphériques de « grands ensembles » d’habitat social collectif enclavés ; quartiers de communes limitrophes, ou quartiers plus éloignés moins en difficulté ;
Type 4 – Villes suburbaines, 5 sites de l’échantillon, globalement pauvres, en périphérie de métropoles, rassemblant, des quartiers prioritaires de grande taille, enclavés, concentrant un habitat social collectif de type « grands ensembles ». L’intervention de la politique de la ville y est ancienne et aujourd’hui normalisée dans les modes de production des politiques publiques locales ;
Type 5 – Pôle urbain métropolitain; 5 sites de l’échantillon rassemblant de très nombreux quartiers très hétérogènes.
Sauf pour le type 2 où le portage est communal, les CUCS sont portés majoritairement au niveau intercommunal dans la sélection étudiée.
I. – COMMUNAUTÉ DE CULTURE ET DIVERSITÉ DES PRATIQUES ÉVALUATIVES
L’évaluation est un processus de réflexion collective conçu pour permettre de produire la connaissance des réalités sociales et urbaines des quartiers, l’identification des enjeux d’action publique, la formalisation des objectifs et des engagements respectifs, la déclinaison des programmes d’actions (évaluation a priori ou ex ante), l’analyse de la cohérence des textes, des dispositifs et des systèmes d’acteurs (évaluation intermédiaire), comme la mesure des réalisations et de la consommation budgétaire, des résultats et des impacts (évaluation a posteriori ou ex post). Ainsi l’évaluation mobilise les acteurs, mutualise les connaissances et les réflexions, et stabilise l’accord des volontés qui donne sens au contrat autour d’une stratégie commune. Cette démarche partenariale produit également les outils de pilotage et de suivi en principe en mesure de dynamiser la conduite de projet.
Matériau documentaire de base de la présente étude, les évaluations menées par les sites en CUCS étaient présupposées présenter les résultats et les impacts des actions menées durant la première période triennale 2007-2009. C’est très loin d’être le cas.
La culture évaluative est globalement intégrée à une culture commune de la politique de la ville. Inscrite depuis plus de dix ans dans les circulaires régissant les politiques de la ville, elle est à la fois un outil de redynamisation des ressources humaines et le cadre du dialogue stratégique. En 2009 et 2010, elle révèle le déséquilibre de l’investissement politique, stratégique, opérationnel et financier des partenaires, des objectifs souvent très formels et des programmations parfois inégales ou même bancales… Dans les meilleurs des cas, elle permet la prise de conscience de ces dysfonctionnements et donc leurs corrections… Et en 2009, elle a permis aussi d’une certaine manière de former à la politique de la ville des équipes municipales nouvelles, parfois peu expérimentées.
Les pratiques demeurent inégales selon le degré d’implication et le degré d’acculturation à l’évaluation. L’évaluation est à la fois tributaire de la compréhension du partenariat et de la « bonne intelligence » des cocontractants. Elle est un facteur de bon fonctionnement pour ce partenariat. Une évaluation négligée peut-être le symptôme de la non implication du maire ou du président d’EPCI, de la faiblesse du portage des élus, des distorsions partenariales, d’un accord contractuel formel et « artificiel », passage obligé des financements extérieurs, et qui n’est guère « l’accord des volontés » de partenaires peu coopératifs.
On peut identifier trois approches de l’évaluation :
Ÿ une évaluation stratégique : démarche d’intelligence des territoires et de l’action, et de dialogue stratégique des partenaires permettant de produire une véritable connaissance du territoire et de mobiliser ces connaissances pour répondre aux enjeux locaux à moyen/long terme ;
Ÿ une évaluation-action partenariale et programmatique : démarche participative visant une réflexion sur les enjeux et la mise en œuvre, et l’élaboration de la contractualisation suivante ;
Ÿ une évaluation-animation : considérée comme une obligation formelle, l’évaluation souvent limitée à un bilan, est réduite à une démarche d’animation des acteurs.
Les outils de connaissance des territoires et des publics sont mis au point empiriquement et se révèlent donc hétérogènes. Ainsi, des services en charge de l’évaluation, plus ou moins compétents, mettent au point des indicateurs de fiabilité inégale.
L’observation territoriale rencontre de nombreuses lacunes : il est difficile d’obtenir une information statistique actualisée et à l’échelle des quartiers. Aussi la connaissance des quartiers se fonde avant tout sur une approche qualitative généralement riche mais peu opératoire. Le suivi et l’évaluation des actions se fondent sur une approche essentiellement qualitative des résultats propres à chaque site du fait d’une quantification impossible ou peu éclairante. Le décalage de périodicité entre la production des données statistiques et le temps de l’action rend nécessaire la production d’outils de suivi-évaluation dynamiques. À ce besoin répond le constat général d’une montée en compétence dans le pilotage et la mise en œuvre des évaluations, et un investissement croissant des acteurs de la politique de la ville dans les actions de suivi. La carence d’indicateurs spécifiques d’état des territoires témoigne d’un volontarisme déficient autant que de difficultés techniques.
II. – LES RÉSULTATS ET LES EFFETS DES ACTIONS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Rappel - L’architecture théorique d’un contrat urbain de cohésion sociale peut être figurée comme un projet de développement social urbain présentant une stratégie globale d’action commune des signataires, déclinée en cinq programmes d’action thématique, qui activent et coordonnent l’ensemble des dispositifs existants et captent les politiques de droit commun correspondantes.

La thématique de l’éducation a généralement été prioritaire et dominante, les volets citoyenneté et prévention de la délinquance d’une part, et développement économique, emploi et l’insertion d’autre part, étant généralement les deuxième et troisième postes de financement, avant un volet habitat et cadre de vie d’importance faible. Le volet logement a pâti d’un défaut d’articulation au PRU et le volet santé apparaît lent à émerger. La montée en puissance d’une thématique du lien social consommatrice de crédits spécifiques a été constatée. Les thématiques transversales dédiées à l’intégration et à la lutte contre les discriminations ont été inégalement développées.
II-A OBJECTIFS, ACTIONS ET RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
Dans de nombreux quartiers bénéficiaires, les améliorations sont notables, perceptibles et relatées ; mais sur le mode qualitatif seulement. Un croisement des dires d’acteurs permet de qualifier l’amélioration ; mais d’une part, celle-ci ne saurait être imputée à l’action du CUCS avec certitude, et d’autre part rien ne permet de prédire la durée de l’amélioration perçue.
a) Habitat et cadre de vie
Des effets positifs sont constatés sur l’accès au logement et la réduction des charges. Des opérations d’auto-réhabilitation ont été parfois mises en place et ont contribué au maintien dans le logement des ménages concernés. Sur la gestion urbaine et sociale de proximité, thématique investie également dans le cadre du PRU, les résultats sont très hétérogènes. La définition même de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) et de son contenu n’est pas stabilisée et un défaut de formation des acteurs est parfois souligné. Toutefois, la très grande majorité des sites ayant mis en place une GUSP font état d’une amélioration sur le plan de l’interface entre les habitants d’une part, les bailleurs et la ville / l’EPCI de l’autre, dans la résolution de difficultés liées notamment à l’entretien ou la requalification des espaces, ou encore la collecte des déchets.
b) Emploi, insertion et développement économique
De manière générale, le CUCS permet le financement d’actions plus ou moins innovantes visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à un parcours d’insertion professionnelle pour des publics éloignés de l’emploi. Les thèmes d’action les plus fréquents sont l’accompagnement à l’emploi, la création d’activités économiques, la coordination du champ de l’insertion professionnelle et l’action contre les freins à l’emploi (mobilité, logement, garde d’enfants, etc.). L’ensemble des CUCS de l’échantillon fait apparaître des initiatives nombreuses qui aboutissent à des actions remplissant des fonctions essentielles, mais pas de stratégie globale mettant en cohérence ces actions permettant de proposer des parcours fluides à l’ensemble du public des quartiers prioritaires. La présence d’un PLIE (plan local d’insertion par l’emploi), ne permet pas toujours une organisation générale des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) permettant aux différentes catégories de public de mener un parcours complet. Cependant chaque site dispose d’au moins une SIAE et de nombreuses actions d’insertion individuelles sont réalisées.
c) Réussite éducative
Les effets combinés du CUCS et du PRE ont conduit à une augmentation du suivi des élèves et du soutien scolaire, des activités socio-éducatives à dimension sportive, culturelle, artistique. Le volume de personnes touchées dans les quartiers s’est sensiblement accru. Le PRE a permis de progresser dans le repérage, l’orientation des publics et le partenariat, tandis que le CUCS a contribué à densifier et diversifier l’offre d’accompagnement socio-éducatif à disposition des quartiers prioritaires. Le développement de l’ingénierie, de la formation des acteurs et de la méthodologie, a permis de proposer au public cible des actions d’accompagnement à la scolarité, de soutien à la fonction parentale et des activités socio-éducatives diverses, davantage adaptées aux besoins spécifiques des quartiers prioritaires. Le principe de la réponse individualisée mis en œuvre par les équipes pluridisciplinaires, dès lors qu’il ne remet pas en cause le financement des actions collectives, ne fait plus guère débat aujourd’hui, et les PRE présentent des résultats positifs sur lesquels une grande majorité des acteurs s’accordent. Leur mise en œuvre pas les CUCS apparaît comme leur première réussite.
d) Citoyenneté et prévention de la délinquance
En matière de prévention de la délinquance et de sécurité, les résultats sont perçus en termes de socialisation ou d’apprentissage des règles de la vie collective ou encore de citoyenneté. Des résultats satisfaisants ont été obtenus concernant le suivi des jeunes en situation de rupture et la prévention de la récidive. Le Conseil local sécurité prévention de la délinquance (CLSPD) a pour sa part permis un diagnostic partagé et une meilleure coordination des acteurs mais apparaît encore souvent comme assez formel. Les actions d’accès au droit et d’aide aux victimes, très largement développées, ont permis d’accompagner dans leurs démarches juridiques ou sociales un grand nombre de personnes éloignées des institutions. Il est à noter que les actions de ce volet portent parfois indifféremment sur la prévention primaire et la prévention de la récidive, entraînant ici ou là un chevauchement avec la thématique du lien social développée de manière autonome ou transversale par de nombreux CUCS. De ce fait, il est possible de mettre au crédit de ces actions les améliorations ressenties au plan du climat et de l’image des quartiers.
Les résultats des actions du volet santé, peu nombreuses mais en développement, portent en particulier sur l’effort de diagnostic et de coordination des acteurs locaux mobilisés sur l’accès au soin et la prévention, surtout sur les sites disposant d’un atelier santé ville (ASV). En matière d’accès au soin, le travail réalisé a permis sur certains sites de favoriser le repérage et l’orientation des personnes ayant besoin de soins, notamment par les structures d’accueil de proximité (centres sociaux, CCAS, associations) vers les structures d’aide et de soins adéquates. En matière de prévention sanitaire, les actions développées sont le plus souvent ponctuelles. Les addictions constituent le thème le plus fréquemment traité. Les résultats de ces actions sont difficiles à mesurer, mais le public touché a globalement augmenté.
Certains sites ont créé un volet dédié à la culture, tandis que d’autres l’ont érigée en thématique transversale. La culture peut être perçue comme une fin en soi, sur le constat d’un accès difficile des habitants des quartiers CUCS à la culture, ou comme un moyen au service d’objectifs de développement du lien social, d’insertion sociale, de prévention de la délinquance ou de réussite éducative. Les résultats des actions en matière de culture sont le plus souvent envisagés en termes de socialisation, de développement personnel, de valorisation de soi, d’épanouissement, d’ouverture aux autres, etc.
g) Intégration et lutte contre les discriminations
L’enjeu d’intégration est très largement relié aux actions relevant de l’accès au droit ou de l’apprentissage de la langue française et de l’alphabétisation. Peu de sites font de la question des discriminations un objectif et en mesurent les résultats. Au final, la visibilité est faible sur le volume d’actions mises en place et y répondant effectivement. La thématique des discriminations sur le marché du travail a été la plus développée.
II-B APPROCHE DES EFFETS GLOBAUX DES CUCS
Plusieurs types d’effets peuvent être compris comme la conséquence indirecte des résultats d’actions du CUCS et sont en fait imputables à l’ensemble des politiques publiques, le CUCS pouvant contribuer à mobiliser celles-ci. Jouent également des facteurs exogènes tels que, en particulier, la création d’emplois et les dynamiques économiques des bassins d’activité. Ces effets sont généralement de l’ordre de l’amélioration, plutôt de la cohésion et de la dynamique sociales dans les quartiers, que de la situation socio-économique des habitants. Ils s’analysent par les différents sites de la manière suivante :
Ÿ l’amélioration du lien social, comme fin en soi mais également comme facteur de réussite des actions ; la mixité culturelle et le dialogue interculturel ;
Ÿ l’amélioration du sentiment de sécurité, l’amélioration de l’image des quartiers et son appropriation par les habitants ;
Ÿ l’évolution des comportements individuels, notamment en termes de respect des personnes et des lieux, de confiance en soi et d’autonomie ;
Ÿ l’amélioration de la dynamique associative, la professionnalisation des intervenants et la mise en réseau des acteurs associatifs ;
Ÿ le renouvellement de la dynamique d’action publique, la politique de la ville permettant d’une part de renforcer la présence des institutions dans les quartiers et d’autre part de mieux connaître les attentes et besoins des quartiers, les relais de proximité contribuant à une plus grande lisibilité des actions et une meilleure orientation des publics vers les structures de droit commun, la restauration du lien de confiance entre les acteurs publics et les usagers, et un certain changement de regard des institutions sur les publics, celles-ci cherchant par exemple dans leur fonctionnement les raisons de difficultés d’accès des publics-cibles, plutôt que dans l’inadaptation de ces publics.
Concernant l’amélioration du lien social et de la vie de quartier explicitement visée par de nombreux CUCS comme objectif stratégique ou comme finalité sous-jacente et parfois implicite, les actions ont globalement permis un développement associatif produisant des actions d’animation du quartier ou activités socioculturelles qui ont touché des publics isolés échappant généralement à la dynamique collective. Les résultats sont perçus en termes d’amélioration du « vivre ensemble », de la dynamique sociale, la rupture de l’isolement, la remobilisation, la prévention de l’exclusion… Les activités de médiation sociale et familiale, d’accueil et d’écoute des habitants présentent des effets positifs sur le lien social, intercommunautaire et intergénérationnel. Le dispositif des adultes relais paraît à cet égard devenu incontournable.
Ainsi que formulé dans la dernière partie de ce chapitre, les impacts et les résultats des actions menées sur les quartiers prioritaires sont difficilement mesurables. L’ensemble des données disponibles et les dires d’acteurs permettent toutefois de dégager des tendances significatives d’une amélioration, stagnation ou dégradation de la situation. Nous relevons que s’ajoute une quatrième situation : celle dans laquelle les écarts se creusent entre les quartiers ciblés par la politique de la ville.
III – FACTEURS D’EFFICACITÉ DES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
III-A MUTATIONS URBAINES, MOBILITÉS SOCIALES : LES PROCESSUS ET LES FREINS
Deux « processus socio-urbains » sous l’action, entre autres, de la politique de la ville, peuvent schématiser les problématiques de la mise en œuvre des actions de la politique de la ville, et ce, en termes d’impact des actions en fonction du contexte et du type de territoire, et de la gouvernance.
Les quartiers apparemment pris dans un « cercle vicieux» : ces quartiers, profondément et historiquement handicapés par une concentration ancienne de chômage et de précarité, sont multi-impactés par des facteurs de contexte endogènes et exogènes. Ces quartiers sont aussi les plus éloignés d’un centre urbain, et les plus mal reliés. Bénéficiant d’un PRU, celui-ci ne porte guère d’effets visibles à court terme : la dynamique démographique et l’image négative du quartier demeurent quoique sa physionomie commence à changer. Malgré l’implication politique et stratégique souvent forte des partenaires financeurs et un pilotage offensif du CUCS et du PRU, les acteurs expriment que les actions de l’un et de l’autre sont insuffisantes pour être perceptibles dans le vécu présent des habitants. Les effets du PRU mais aussi du PRE et de l’éducation prioritaire n’apparaîtront qu’à terme. Au quotidien l’action du CUCS est divisée entre deux approches déterminantes et également nécessaires, l’approche sociale et éducative, soit l’approche « préventionniste », et une approche « sécuritariste ». L’échelle de traitement de ces quartiers ne devrait pas être le seul quartier, mais l’agglomération, le bassin d’emploi et d’activités et la région. Et les réponses à mobiliser devraient figurer au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, au schéma régional de développement économique, au contrat de projet État - région, au plan de déplacements urbains, au programme local de l’habitat communautaire. Par ailleurs, des quartiers sont apparemment pris dans un « cercle vertueux ». En général, ils bénéficient d’un PRU qui opère le désenclavement du quartier et commence à modifier son image. Le PRU a pu être complété, par exemple par une structure d’accueil d’entreprises tandis que le CUCS soutient l’aide à la création d’entreprise. CUCS et PRU bénéficient d’une gouvernance stratégique commune et d’un pilotage opérationnel appuyés sur un consensus durable des financeurs, en premier lieu le représentant de l’État en binôme avec le maire (ou le président de l’EPCI). Le service public de l’emploi est actif et son intervention facilitée par le CUCS. Si les indicateurs de l’emploi ou de la délinquance n’évoluent encore que faiblement, les acteurs soulignent des effets seconds positifs sur un sentiment de « mieux vivre ». Pour beaucoup ce cercle vertueux est encore fragile et appelle à consolider la concentration des efforts, c'est-à-dire à maintenir au moins autant que les moyens financiers, une gouvernance forte intégrant les deux dimensions du social et de l’urbain.
Entre ces deux processus, on peut relever un effet de stagnation, malgré une politique de la ville ancienne, une gouvernance parfois dynamique, et souvent le démarrage d’un PRU. Le quartier - encore monofonctionnel – remplit une fonction d’accueil social qui le voue à recevoir les populations les plus précarisées et fragiles. L’action menée sur ce quartier, optimisée par des facteurs exogènes liés le plus souvent à la reprise d’activités sur le bassin et à une période de croissance économique, entraînera des impacts positifs… mais ceux-ci s’observent ailleurs.
Ces trois processus ne sont pas figés ni isolés : ils peuvent se succéder dans un même quartier. Les clés d’analyse de ces trois processus type sont à rechercher dans la double problématique de l’ouverture et de la fermeture du quartier et de ses habitants. En effet, l’ouverture physique du quartier est un déterminant premier comme le développement des modes de mobilité et des liaisons avec l’ensemble du bassin. L’ouverture immatérielle – culturelle – des habitants est un deuxième déterminant : elle entraîne comme elle dépend de capacités de mobilité physique et psychologique qui se traduisent dans les parcours scolaires, les parcours d’insertion, les parcours résidentiels, les parcours professionnels, etc.
Selon la taille des territoires, on relève deux types tendanciels : les petites agglomérations caractérisées par de petits quartiers au niveau de précarité moyen ; l’ingénierie y est faible, mais la coordination des acteurs facilitée ; les grandes agglomérations avec des quartiers plus grands au niveau de précarité élevé, l’ingénierie est alors forte mais la coordination des acteurs difficile.
III-B GOUVERNANCE : PARTENARIAT, PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
L’analyse de la gouvernance conduit à dire qu’une complexité bien gérée, organisée et admise peut être fluide ; a contrario, la gouvernance d’un système complexe mal admis est vécue comme un ensemble de complications lourdes, consommatrices de temps et d’énergie et peu productrices de résultats. Les EPCI offrent des exemples contrastés, à la fois d’une meilleure cohérence du projet, mais aussi parfois d’une plus grande complexité lorsque les compétences sont dissociées entre ville et EPCI. Les facteurs déterminants d’une gouvernance fluide sont la cohésion des acteurs autour d’une stratégie commune et d’une organisation rodée.
La qualité de l’engagement des signataires a pour critères leur implication effective et la continuité des financements. L’engagement coordonné des partenaires selon leur compétence et l’échelle de mise en œuvre est un facteur de réussite du partenariat dans la mise en œuvre d’une stratégie commune. On observe un lien étroit entre le poids du portage politique et la qualité du pilotage d’une part, et la qualité stratégique du CUCS. De manière générale, un portage politique fort, un comité de pilotage moteur, susceptible d’impulser une dynamique de projet, conditionnent la mise en œuvre et le suivi d’un vrai projet stratégique qui sera in fine facteur d’efficacité et de pertinence des actions du CUCS.
La place et l’implication des opérateurs associatifs des actions du CUCS dans la définition des objectifs et la mise en œuvre du CUCS s’avèrent généralement insuffisantes : les opérateurs sont peu associés à la définition des objectifs du CUCS en amont ; leur coordination souvent insuffisante freine l’efficacité des actions.
III-C L’ARTICULATION DU CUCS AVEC LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE
L’articulation des dispositifs mobilisés par le CUCS avec le PRU autour d’un projet urbain révèle que, quand le PRU est moteur, l’efficacité du CUCS s’accroît ; inversement, un CUCS non entraîné par un dispositif moteur comme un PRU, risque de voir les dispositifs qu’il englobe s’autonomiser, le CUCS perdant ainsi son caractère de projet global et structurant.
III-D LA MOBILISATION DU DROIT COMMUN, FINALITÉ PARTAGÉE MAIS ESQUIVÉE
La définition des crédits spécifiques détermine celle du droit commun, mais cette frontière entre les deux est variable selon les sites. Pour certains, ce sont tous les moyens autres que les crédits de l’ACSé, les crédits fléchés (adultes relais, ateliers santé ville, PRE, FIPD) et les financements associatifs. Mais ils s’opposent aussi aux crédits issus des collectivités signataires ayant voté des lignes « politique de la ville ». Dès lors, les co-financements ne se feraient qu’entre crédits fléchés, dispensant le droit commun de co-financer. Il est difficile de quantifier l’importance de la mobilisation du droit commun, du fait de ce flou conceptuel entraînant une difficulté arithmétique.
La mobilisation du droit commun apparaît inégale selon les sites (de 50 à 85 % des crédits des actions du CUCS), la moyenne s’établissant entre 70 et 75 %. La fonction des crédits politiques de la ville vis-à-vis du droit commun n’est pas pas identique entre les différents sites, l’ambiguïté étant entretenue par l’emploi approximatif de la notion d’effet de levier, qui ne répond pas à une définition claire et commune. Ainsi, le rôle joué par les crédits spécifiques est, selon les sites et selon les thématiques, celui de levier, de complément ou encore de substitution, sans que cela puisse être formellement établi et affirmé. Si tous les acteurs partagent la finalité de la politique de la ville de démultiplier l’investissement des partenaires, on observe souvent des esquives à cette finalité, par exemple quand le droit commun se concentre hors géographie prioritaire.
A contrario, à la fin de chaque contrat se pose le problème de la continuité des financements pour les actions entreprises dans le cadre du CUCS. La grande majorité des communes et des EPCI prennent le relais afin de préserver les postes créés ou de poursuivre une action efficace, en l’absence d’une doctrine claire sur le devenir des actions du CUCS et sur leur modalité d’intégration dans le droit commun.
II-E LIMITES D’UNE POLITIQUE D’EXCEPTION, EFFICACITÉ D’UNE POLITIQUE DURABLE
Les crédits « spécifiques » devaient permettre le « raccrochage » de ces quartiers affectés par les crises économiques successives. En tendance générale, et nonobstant les nombreux succès, non seulement les quartiers historiques de la politique de la ville n’ont pu être « raccrochés » du fait de ces seuls crédits spécifiques, mais la géographie prioritaire a été régulièrement étendue. Les crédits spécifiques ne sont guère relayés par les crédits de droit commun de l’État mais tendanciellement et de facto par l’action des communes. Les communes internalisent de plus en plus les chefs de projet et prennent la main sur le pilotage des dispositifs, et les intercommunalités exercent la compétence politique de la ville.
La politique d’exception est devenue une politique de long terme, les crédits spécifiques aspirent à leur « sanctuarisation » mais celle-ci signifie-t-elle que la géographie prioritaire doit le rester, ce qui voudrait dire que la politique de la ville est face à l’impossible transformation des quartiers et à l’échec de leur retour aux politiques de droit commun ? La politique de la ville tend à devenir une politique « normale » des collectivités – locale, départementale, régionale. L’État, inspirateur de cette politique et financeur exceptionnel de la transformation urbaine, peut-il inscrire son intervention dans la durée, clé de l’efficacité ?
IV - PISTES POUR OPTIMISER L’ACTION
Dans le présent contexte d’incertitude et de questionnement des acteurs locaux sur l’avenir de la géographie prioritaire et de la contractualisation, il conviendrait de conforter non seulement la deuxième reconduction pour un an des CUCS, mais de rappeler et de réaffirmer la validité des éléments de doctrine énoncés de 2003 à 2008 par des lois et des circulaires… tant qu’aucune nouvelle doctrine n’est venue les remplacer.
Rappelons que rien ne les invalide, leur bien fondé est reconnu, mais l’obligation ou l’incitation à les mettre en œuvre ont manqué. Les CUCS ont été des contrats de ville plus formels et mieux organisés sur le papier. Par ailleurs les attentes et demandes des acteurs restent les mêmes qu’en 2006, notamment pour : plus de stratégie, la prévalence d’un projet global de territoire, la recherche d’un projet intégré de développement durable au quotidien, plus de dynamique collective et de mobilisation partenariale, des programmes d’action inter-thématique en mesure de mettre en œuvre effectivement le projet de quartier, un portage politique fort, une meilleure reconnaissance aussi des acteurs et des opérateurs. En revanche, le pilotage de projet par objectif de résultats ne fait pas consensus.
Si, pour beaucoup, l’insuffisance des moyens est le frein à l’efficacité, l’observation comparative des modes de gouvernance des dispositifs de la cohésion sociale conduit à souligner que la recherche de l’efficacité appelle l’optimisation des moyens (efficience) au moins autant que leur multiplication. Les contrats de ville puis de cohésion urbaine et sociale ont apporté une cohérence des partenaires locaux. Aujourd’hui, dans bien des sites cette cohérence formelle nécessaire est insuffisante. Les enjeux du développement social urbain appellent à passer de la cohérence à la synergie – a fortiori si les moyens n’augmentent pas. Pour favoriser cette nouvelle étape, il conviendrait de prescrire, au plan national, aux politiques de droit commun de l’État et des collectivités territoriales, un objectif de convergence. Et par là, prévenir que des politiques nationales, régionales ou départementales ne contredisent de facto des objectifs par ailleurs contractuellement reconnus comme prioritaires, par les représentants locaux de ces mêmes administrations. Et prévoir dans ces politiques de droit commun, leurs incidences sur les quartiers de la géographie prioritaire: ainsi, par exemple, des réductions d’effectif décidées nationalement, quand un surcroît d’effort est contractualisé localement. Et de même, éviter que des dispositifs de l’État d’appui aux quartiers, tels les zones franches urbaines, ne soient ici ou là ni compris ni valorisés, parce que non demandés.
Il conviendrait également de rationaliser l’exercice de la compétence politique de la ville par les établissements publics de coopération intercommunale en précisant les rôles respectifs de l’EPCI et de la commune.
Dans les quartiers bénéficiant d’un PRU, il conviendrait de relier de manière systématique les objectifs du PRU avec ceux du CUCS, qui devraient en découler. La logique voudrait que le PRU exprime un projet global de quartier, donne les finalités du CUCS et par là, prescrive au CUCS ses actions, au moins sur les volets emploi-insertion et développement économique, habitat et cadre de vie, ainsi que prévention de la délinquance.
Le paysage de l’insertion par l’activité économique devrait être rationalisé : la diversité des structures, correspondant à des législations successives, des instances (conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, conseil local), des plans d’échelles distinctes et superposées (programme départemental d’insertion, plan local d’insertion, plan local pour l’insertion et l’emploi), des financements (État, fonds social européen, conseils généraux), rend aujourd’hui riche le tissu des structures d’insertion par l’activité économique, mais complexe l’articulation des politiques, et difficile la coordination des acteurs autour de programmes précis, ajustés et adaptés aux quartiers.
Ainsi, conviendrait-il de garantir :
– la cohérence des textes d’envergure nationale des politiques de droit commun de l’État, des textes d’envergure régionale (schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, contrat de projet État-région, schéma régional de développement économique, plan régional de développement des formations, etc.), des schémas et plans départementaux (plan local d’insertion, plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées), des schémas directeurs et d’organisation (schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains), des autres politiques contractuelles (contrat d’agglomération, contrat de site, mais aussi charte de parc naturel régional ;
– la cohérence stratégique des partenaires financeurs et opérationnels autour de stratégies d’action commune : repenser la forme et le statut de la contractualisation, et les critères d’éligibilité aux financements ;
– la cohésion opérationnelle des acteurs au sein et entre les thématiques d’intervention.
En agissant à l’échelon supérieur, celui des textes de référence nationaux, régionaux, départementaux, territoriaux, la cohérence stratégique des partenaires pourrait être stimulée jusqu’aux acteurs de terrain qui s’en trouveraient re-légitimés. Leur cohésion opérationnelle, régulièrement observée, est aujourd’hui le meilleur facteur d’efficacité, parfois le seul.
Dès lors, d’une part, une nouvelle forme de contractualisation devrait être subordonnée à la formulation de projets stratégiques globaux de quartiers eux-mêmes intégrés au projet stratégique global de territoire ; et, d’autre part, ses objectifs devraient être intégrés aux schémas directeurs d’aménagement et de développement durable et aux plans et schémas thématiques d’échelle supérieure.
On pourrait ainsi compenser la logique « curative » dominante d’une politique de la ville concentrée sur des interventions « d’urgence » ou des traitements de « longue durée » des « pathologies » urbaines. A contrario, des démarches de projet ascendantes, émanant des quartiers et de leurs habitants, permettraient de valoriser, pour les soutenir, les potentialités et les perspectives positives, dans une logique de développement. Et le portage politique, clé majeure de l’efficacité, deviendrait incontournable.
Dès lors, une logique de projet déterminerait l’éligibilité du projet aux aides des co-contractants, en cohérence avec les compétences de droit commun, et avec la nature de ces aides : ressources humaines, financement de droit commun, subventions et crédits spécifiques, investissement, exonérations fiscales. Telle action ou opération serait ainsi logiquement cofinancée par les crédits de droit commun des partenaires et collectivités correspondants, puisque s’inscrivant dans leurs compétences et priorités respectives.
D’une certaine manière, l’évolution vers une contractualisation unique de l’État et des EPCI est engagée, et celle-ci devrait se traduire par le co-financement de programmes d’action multi-thématiques sur des quartiers réaffirmés comme prioritaires. La politique de la ville n’a pas vocation à redevenir le volet social des contrats d’agglomération (qui n’a jamais vraiment vu le jour), mais une politique globale de cohésion territoriale et sociale intégrant l’urbain, l’habitat, l’économie, les transports, l’environnement, les services, trouverait dans un contrat unique ses traductions opérationnelles déclinées à différentes échelles intégrées, elles-mêmes marquées par des critères de priorité précis.
En outre, il apparaîtrait pertinent d’adapter la durée des contractualisations à la périodicité électorale, pour favoriser l’engagement des élus, leur prise de conscience et leur sensibilisation à cette problématique, de façon à permettre la coïncidence de l’agenda du projet global de territoire et de ses déclinaisons sur les quartiers prioritaires avec le projet de mandat.
Enfin, la prospective et la réflexion stratégique attendues des acteurs, et le pilotage dynamique des programmes ne peuvent se développer sans un appui fort de l’État sur plusieurs plans. D’abord, repréciser un tronc commun d’indicateurs de contexte de l’ensemble des quartiers prioritaires en lien avec l’INSEE et harmoniser le recueil des données nécessaires pour les renseigner, synchroniser ce recueil au plan local et au plan national, rendre obligatoire la transmission locale à périodicité courte (trimestrielle ou semestrielle) des données brutes de terrain par les services déconcentrés de l’État, les collectivités et les grands opérateurs dans les domaines de la fiscalité, de l’emploi, de l’insertion, du développement économique, de la santé, de l’éducation, du logement, de la sécurité.
Il conviendrait également de promouvoir une nouvelle culture de l’intelligence territoriale et du pilotage stratégique, facteur par elle-même de performance de l’action publique. À cet égard et, à titre d’exemple, il y aurait lieu de :
– concevoir un nouvel indice synthétique permettant d’échelonner l’ensemble de la géographie prioritaire, le cartographier et le communiquer sur un site internet dédié ;
– organiser localement le suivi des indicateurs et mettre au point un protocole de suivi-évaluatif dynamique obligatoire et commun à tous les sites ;
– étendre les pratiques de pilotage mises en place par l’ANRU aux actions de la cohésion sociale avec des revues de projet, des points d’étape ponctuant les étapes évaluatives.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 217
A. MÉTHODOLOGIE : CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON 217
B. TYPOLOGIE DES CUCS : ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DE TERRITOIRE 218
1. Les quartiers CUCS : une analyse fondée sur les écarts de revenu médian, une sélection aussi déterminée par la négociation locale 220
2. Type 1 - Petite ou moyenne ville en bassin de vie rural 222
3. Type 2 - Petite ou moyenne ville dans un système urbain en orbite métropolitaine 222
4. Type 3 - Pôle urbain à rayonnement départemental 223
5. Type 4 - Ville suburbaine (ville moyenne ou grande en périphérie de métropole) 224
6. Type 5 - Pôle urbain métropolitain 225
C. CONCLUSION 226
PREMIÈRE PARTIE - COMMUNAUTÉ DE CULTURE ET DIVERSITÉ DES PRATIQUES ÉVALUATIVES 229
A. PERCEPTION ET APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE 230
1. Une culture évaluative globalement partagée au sein d’une culture commune de la politique de la ville 231
2. Mais des pratiques inégales selon le degré d’implication et le degré d’acculturation à l’évaluation 233
3. Des outils de connaissance des territoires et des publics empiriquement mis au point et donc hétérogènes 235
4. Une visibilité et une compréhension très inégales des résultats et des impacts 237
5. Trois approches de l’évaluation 238
B. OBSERVATION TERRITORIALE, SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIONS : OUTILS ET MÉTHODES 240
1. Une observation territoriale globalement lacunaire 240
2. Une approche essentiellement qualitative des résultats, due à une quantification peu éclairante 241
C. CONCLUSION DE LA PARTIE 243
DEUXIÈME PARTIE - LES RÉSULTATS DES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : ANALYSE THÉMATIQUE 245
A. L’ARCHITECTURE DES CUCS ET LA DÉCLINAISON DES VOLETS THÉMATIQUES EN OBJECTIFS : L’ARCHITECTURE DU CUCS EST LE REFLET DES STRATÉGIES CONJOINTES OU DISJOINTES DE L’ÉTAT ET DES PARTENAIRES 248
1. Généralement, une conformité à la circulaire du 24 mai 2006, mais développement d’un formalisme, une sorte de « conformisme » obligé pour bénéficier des crédits spécifiques 250
2. Soit le CUCS se moule dans les contraintes de l’État (cas majoritaire) mais les objectifs sont peu mis en œuvre 251
3. Soit il s’investit dans les volets optionnels (minoritaire) pour amener les partenaires sur les priorités locales 251
B. LES OBJECTIFS : UNE FAIBLE PORTÉE STRATÉGIQUE ET UNE ORGANISATION THÉMATIQUE ASSEZ FORMELLE, DES PRIORITÉS AU FINAL SOUVENT SIMILAIRES 252
1. De la déclinaison formelle des objectifs de l’État à l’intégration réelle du CUCS dans un projet de territoire 252
2. Une prépondérance des thématiques Éducation et Prévention, puis Emploi 262
C. OBJECTIFS, ACTIONS ET RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE 263
1. Les volets thématiques 263
2. Les volets transversaux : difficultés de mise en œuvre et bonnes pratiques 287
D. CONSTATS SYNTHÉTIQUES PAR THÉMATIQUE 289
E. APPROCHE DES IMPACTS GLOBAUX DU CUCS 293
F. CONCLUSION DE LA PARTIE 299
TROISIÈME PARTIE - CONDITIONS D’EFFICACITÉ DES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE :
ANALYSE TRANSVERSALE 303
A. INFLUENCE DES VARIABLES DE CONTEXTE SUR L’EFFICACITÉ PAR TYPE DE TERRITOIRE 305
1. La taille du territoire et la part d’habitants en quartier CUCS comme critère principal de distinction (variables de contexte) 305
2. Deux types tendanciels 308
B. GOUVERNANCE : PARTENARIAT, PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL 309
1. Qualité du partenariat 309
2. Pilotage stratégique 312
3. Pilotage opérationnel : de l’engagement à l’implication, quelle démarche de projet ? 318
4. Place et implication des opérateurs dans la définition des objectifs et la mise en œuvre du CUCS 321
5. Participation des habitants 322
C. L’ARTICULATION DU CUCS AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS POLITIQUE DE LA VILLE 323
1. Intégration des dispositifs politiques de la ville au CUCS : le CUCS coordonnateur face aux inévitables tendances à l’autonomisation des dispositifs 323
2. L’importance de la rénovation urbaine : articulation avec les PRU, importance du discours sur la rénovation urbaine, qualité de la coordination 324
D. LA MOBILISATION DU DROIT COMMUN 326
1. Une mobilisation du droit commun difficilement appréciable 327
2. Effet de levier des crédits politique de la ville… ou effet de substitution ? 330
3. Dans l’opacité conceptuelle, le culte de l’ambiguïté profite à tous 337
4. Un basculement de la politique de la ville vers le droit commun difficile à mettre en œuvre sans ces clarifications d’une part, mais surtout sans une nouvelle doctrine claire 338
E. CONCLUSION DE LA PARTIE 338
QUATRIÈME PARTIE : PISTES POUR OPTIMISER L’ACTION 340
ANNEXE 1 : SIGLIER 343
ANNEXE 2 : ANNEXE 1 DE LA LOI N° 2003-710 DU 1er AOÛT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RÉNOVATION URBAINE 345
Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques a souhaité faire réaliser une étude, sur appel d’offres, analysant et synthétisant les résultats des actions d’évaluations réalisées, au titre d’un échantillon de contrats urbains de cohésion sociale en cours, dans le cadre de la politique de la ville.
A. MÉTHODOLOGIE : CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON
Le cahier des charges de l’étude stipule que le prestataire réalisera une « synthèse des résultats d’actions d’évaluation engagées en matière de politique de la ville sur le périmètre de 15 communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ».
Dans un premier temps, les CUCS de l’échantillon ont été sélectionnés par le CEC, en lien avec le SG-CIV, en fonction d’une part de l’existence d’évaluations et de leur transmission par les différents sites, et d’autre part, du croisement de plusieurs critères permettant de représenter des situations contrastées. Ce premier travail a abouti à un premier échantillon élargi à 22 CUCS.
Face aux difficultés que posait le premier échantillon, il a été réajusté afin de rétablir la diversité des situations (démographie, localisation géographique, nature du signataire, etc.) et en fonction de la qualité des évaluations.
L’échantillon retenu vise à représenter la diversité des types de territoires et donc de problématiques territoriales recouvertes par les CUCS. Dans cette perspective, il s’est agi de choisir des sites permettant d’étudier des situations locales contrastées. Ainsi, la représentativité statistique des territoires n’a pas été recherchée. Le premier critère utilisé est celui de la démographie du territoire concerné par le CUCS (ville ou agglomération), en tenant compte également de la part de la population habitant en quartier prioritaire.
TABLEAU 1. POPULATION DES TERRITOIRES CUCS DE L’ÉCHANTILLON
Population ville / agglo |
Population en quartier CUCS (population des ménages) |
Population en ZUS | |
Lodève |
7 334 |
1 294 (18 %) |
1 294 (18 %) |
Aulnoye - Aymeries |
8 870 |
8 870 (100 %) |
0 |
Autun |
14 806 |
1 930 (13 %) |
0 |
Frontignan |
22 409 |
5 618 (25 %) |
5 618 (25 %) |
Oullins |
25 694 |
2 742 (10 %) |
2 207 (9 %) |
Clichy-sous-Bois |
29 412 |
22 174 (75 %) |
22 174 (75 %) |
Salon-de-Provence |
40 147 |
14 887 (37 %) |
10 360 (26 %) |
Grasse |
48 801 |
13 997 (29 %) |
0 |
CA Brive |
50 009 |
6 962 (14 %) |
0 |
Sartrouville |
51 599 |
19 065 (37 %) |
11 528 (22 %) |
Bourges |
70 828 |
18 220 (26 %) |
14 085 (20 %) |
Montreuil |
101 587 |
54 883 (54 %) |
16 039 (16 %) |
Site perpignanais |
115 325 |
24 820 (22 %) |
18 276 (16 %) |
CA Chambéry Métropole |
121 143 |
25 716 (21 %) |
19 994 (17 %) |
CA Poitiers |
133 753 |
33 197 (25 %) |
5 524 (4 %) |
Vénissieux |
57 179 |
43 644 (76 %) |
22 349 (39 %) |
CA Valenciennes Métropole |
164 465 |
112 051 (59 %) |
30 995 (19 %) |
CU Nice Côte-d’Azur |
347 069 |
186 664 (54 %) |
49 698 (14 %) |
CU Nantes Métropole |
388 302 |
79 391 (20 %) |
43 239 (11 %) |
CA Rouen |
392 800 |
57 867 (15 %) |
39 226 (10 %) |
CA Grenoble Alpes Métropole |
396 700 |
92 568 (23 %) |
39 468 (10 %) |
Marseille |
839 038 |
577 952 (67 %) |
215 465 (26 %) |
CA : communauté d’agglomération (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants).
CU : communauté urbaine (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 500 000 habitants).
Le second critère utilisé est celui de la configuration socio-urbaine du territoire. Par le croisement des deux critères, on obtient la représentation souhaitée.
B. TYPOLOGIE DES CUCS : ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DE TERRITOIRE
TABLEAU 2. TYPOLOGIE INITIALE DES SITES DE L’ÉCHANTILLON
Type de territoire
|
Petite ou moyenne ville en bassin de vie rural |
Petite ou moyenne ville dans un système urbain (orbite métropolitaine |
Pôle urbain à rayonnement départemental et/ou régional |
Espace urbain périphérique (ville grande ou moyenne en périphérie de métropole) |
Pôle urbain métropolitain |
- 25 000 habitants |
Autun (13 %) Lodève (18 %) Aulnoye-Aymeries (100 %) |
Frontignan (25 %) |
|||
25 000 –100 000 habitants |
Salon-de-Provence (37 %) Grasse (29 %) |
CA Brive (14 %) Bourges (29 %) CA Chambéry Métropole (22 %) |
Oullins (10 %) |
||
100 000 à |
Perpignan (21 %) |
Montreuil (53 %) Vénissieux (85 %) |
|||
+ de 300 000 habitants |
CA Rouen (15 %) CU Nantes Métropole (20 %) CA Grenoble Alpes Métropole (23 %) CU Nice Côte-d’Azur (38 %) Marseille (50 %) |
Observations :
– type 1 : moins de 20 % de la population totale de la commune en périmètre prioritaire, à l’exception d’Aulnoye-Aymeries ;
– type 2 : entre 20 % et 40 % de la population totale de la commune en périmètre prioritaire ;
– type 3 : aux alentours de 15 % - 20 % de la population totale de la collectivité en périmètre prioritaire ; à l’exception de la CA Valenciennes Métropole ;
– type 4 : une importante population en quartiers prioritaires : de 37 % à 85 %, à l’exception de la commune d’Oullins ;
– type 5 : une proportion hétérogène de population en quartiers prioritaires, mais globalement moyenne (de 15 % à 38 %, à l’exception de Marseille).
Ce tableau reprend les indicateurs des zones urbaines sensibles (ZUS) utilisés pour les villes et quartiers de notre échantillon, en fonction du niveau de priorité CUCS et la présence ou non d’autres périmètres.
TABLEAU 3. ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DE LA GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE
Niveaux de priorité CUCS |
Autres périmètres prioritaires |
Indicateurs INSEE et écarts | ||||||||
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
Catégorie 3 |
ZUS |
ZFU |
PRU |
Revenu fiscal médian QPV |
Revenu fiscal médian – Ecart à l’unité urbaine |
Taux de chômage QPV |
Taux de chômage – Ecart à l’unité urbaine | |
Aulnoye-Aymeries |
1 |
0 |
0 |
0 |
12 236 € |
- 3,6 % |
14,1 % |
+ 2,2 pts | ||
Autun |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
7 574 € |
- 48 % |
16,8 % |
+ 6,3 pts |
Lodève |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
10 680 € |
- 13 % |
15,8 % |
+ 4 pts |
Total TYPE 1* |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
||||
Moyenne* |
1 |
0,5 |
0 |
0,5 |
10 163 € |
- 21,5 % |
15,6 % |
+ 4,2 pts | ||
Frontignan |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
13 000 € |
- 9,4 % |
24,1 % |
+ 3,5 pts |
Grasse |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 361 € |
- 37 % |
13,8 % |
+ 3,8 pts |
Salon-de-Provence |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
11 875 € |
- 28 % |
15,8 % |
+ 4,7 pts |
Total TYPE 2* |
3 |
4 |
0 |
4 |
0 |
1 |
||||
Moyenne |
2,3 |
1,3 |
0 |
0,3 |
12 412 € |
- 24,8 % |
17,9 % |
+ 4 pts | ||
CA Brive la Gaillarde |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
9 526 € |
- 50 % |
14,9 % |
+ 7,3 pts |
Bourges |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 953 € |
- 40,6 % |
22,6 % |
+ 12,9 pts |
CA Chambéry Métropole |
2 |
6 |
6 |
2 |
0 |
2 |
11 434 € |
- 36% |
12 % |
+ 4,5 pts |
Perpignan |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
6 090 € |
- 56% |
23 % |
+ 9,6 pts |
CA Poitiers |
3 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
13 801 € |
- 18 % |
12,6 % |
+ 2,8 pts |
CA Valenciennes Métropole |
43 |
10 |
1 |
8 |
10 108 € |
- 20% |
16 % |
+ 4 pts | ||
Total TYPE 3* |
10 |
14 |
12 |
18 |
3 |
17 |
||||
Moyenne |
7,2 |
3,6 |
0,6 |
3,4 |
10 152 € |
- 36,8 % |
16,9 % |
+ 6,85 pts | ||
Clichy sous Bois |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
7 680 € |
- 60 % |
18,9 % |
+ 9,4 % |
Montreuil |
5 |
3 |
0 |
1 |
13 679 € |
- 30 % |
15,7 % |
+ 6,2 pts | ||
Oullins |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
11 056 |
- 38 % |
12,1 % |
+ 3,3 pts |
Sartrouville |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
13 743 € |
- 30 % |
13 % |
+ 3,5 pts |
Vénissieux |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
10 104 € |
- 43 % |
20 % |
+ 11,2 pts |
Total TYPE 4* |
6 |
1 |
2 |
9 |
3 |
5 |
||||
Moyenne |
2,25 |
2,25 |
0,75 |
1,25 |
11 252 € |
- 40,2 % |
15,9 % |
+ 6,72 pts | ||
CA Grenoble Alpes Métropole |
8 |
6 |
6 |
7 |
1 |
4 |
11 921 € |
- 33 % |
15 % |
+ 6,5 pts |
Marseille |
4 territoires de projets subdivisés en 10 secteurs opérationnels |
12 |
2 |
6 |
10 535 € |
- 33 % |
17,4 % |
+ 4,1 pts | ||
CU Nantes Métropole |
8 |
3 |
5 |
7 |
1 |
4 |
10 796 € |
- 39 % |
19,2 % |
+ 10 pts |
CU Nice Côte-d’Azur |
5 |
0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
10 624 € |
- 40 % |
13,3 % |
+ 3,3 pts |
CA rouennaise |
5 |
5 |
14 |
10 |
1 |
6 |
10 611 € |
- 35 % |
19,5 % |
+ 9,4 pts |
Total TYPE 5* |
26 |
14 |
26 |
40 |
6 |
22 |
||||
Moyenne |
16,5 |
8 |
1,2 |
4,4 |
10 897 € |
- 36 % |
16,9 % |
+ 6,7 pts | ||
* Type 1 : La commune d’Aulnoye-Aymeries est entièrement classée en quartier prioritaire au titre du CUCS ; les 5 quartiers de Montreuil (type 4) ne sont pas catégorisés ; les 42 quartiers de la CA Valenciennes Métropole (type 3) ne sont pas catégorisés ; les 4 territoires de projets subdivisés en 10 secteurs opérationnels de Marseille (type 5) ne sont pas catégorisés. Ils ne sont pas non plus comptabilisés dans le calcul des totaux des niveaux de priorité CUCS.
Les communes du type 1 possèdent en moyenne un seul quartier prioritaire, de catégories 1 ou 2. Ces quartiers sont généralement de petite taille, et exceptionnellement peuvent être classés en ZUS ou faire l’objet d’un PRU. Les communes du type 2 possèdent en moyenne 2,3 quartiers prioritaires de priorité 1 ou 2, une ZUS et éventuellement un PRU. Ce sont généralement des quartiers de taille limitée. Les collectivités du type 3 possèdent un nombre plus conséquent de quartiers (7,2 en moyenne), de catégories 1, 2 et 3 (presque autant de quartiers de chaque catégorie) ; ainsi que d’autres périmètres d’intervention politique de la ville (plus de 3 ZUS, plus de 3 PRU et quasiment 1 ZFU, en moyenne). Il s’agit donc dans ce type d’une intervention large de la politique de la ville. Les communes ou intercommunalités du type 4 possèdent généralement 1 ou 2 quartiers prioritaires (2,25 en moyenne), de grande taille et de priorité 1 (dans presque 70 % des cas) ; de grandes ZUS étendues ; des projets de rénovation urbaine. Les collectivités (intercommunalités majoritairement) du type 5 rassemblent de très nombreux quartiers prioritaires (16,5 par collectivité en moyenne) dont de nombreux quartiers de priorités 2 et 3. Avec plus de 4 PRU, plus d’une ZFU et 8 ZUS en moyenne, elles totalisent donc un grand nombre de périmètres « politique de la ville ».
1. Les quartiers CUCS : une analyse fondée sur les écarts de revenu médian, une sélection aussi déterminée par la négociation locale
Le Livre Vert de la Délégation interministérielle à la ville (DIV) de mars 2009 portant sur la géographie prioritaire de la politique de la ville indique que la sélection des quartiers prioritaires et la détermination de leur niveau de priorité dans le cadre des CUCS s’est appuyée sur « une analyse nationale […] conduite à partir du découpage en IRIS (îlots regroupés pour l’information statistique) d’une part, et des propositions des préfets d’autre part. Cette analyse reposait principalement sur les écarts de revenu médian des ménages ».
Dans les faits, la liste de quartiers prioritaires issue de l’analyse nationale présentait initialement un nombre très restreint de quartiers par rapport à ceux qui faisaient l’objet d’une intervention dans le cadre des contrats de ville. La circulaire DIV du 15 septembre 2006 relatif à la géographie prioritaire des contrats urbains de cohésion sociale confirme que le revenu médian a été le critère principal permettant de déterminer cette liste, l’indice PRV (134) permettant un « lissage » des résultats, l’appréciation des situations locales par le préfet devant également être prise en compte. Ces données statistiques devaient entrer en ligne de compte pour la sélection des quartiers de niveaux 1 et 2, la sélection de quartiers de niveau 3 étant laissée à l’appréciation du préfet. La mobilisation des acteurs locaux a finalement permis d’élargir très largement cette liste. Aujourd’hui, les 497 CUCS signés regroupent 2 492 quartiers (135), dont 1 102 de niveau 1, 763 de niveau 2, et 627 de niveau 3.
TABLEAU 4. SYNTHÈSE DES CRITÈRES ENTRANT EN COMPTE DANS LA DÉFINITION DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Type de quartier |
Critères de sélection |
ZUS |
Critères qualitatifs « grands ensembles » et « déséquilibre emploi/habitat » |
ZFU et ZRU |
Indice PRV chômage part des jeunes part de non diplômés potentiel fiscal par habitants |
Quartiers CUCS niveaux 1 et 2 |
Revenu fiscal médian, et appréciation des acteurs locaux |
Quartiers CUCS niveau 3 |
Appréciation des acteurs locaux |
Les quartiers CUCS retenus dans l’échantillon confirment dans une certaine mesure ces modes de définition des quartiers prioritaires : tous ont utilisé le revenu médian comme un critère objectif permettant de mesurer l’écart des territoires à la moyenne de la commune, l’agglomération ou l’unité urbaine et in fine de déterminer la classification en catégories 1 et 2 ; la classification ayant généralement fait l’objet d’une négociation locale débouchant sur une décision préfectorale. Aussi, la majorité des périmètres définis font-ils consensus ? Dans deux sites, les périmètres prioritaires ont été fixés par l’État en désaccord avec les choix des acteurs locaux ou sur des critères financiers qui ont induit un recentrage des périmètres non avalisé par tous.
Seuls 14 sites de l’échantillon ont fondé la définition, ou la confirmation, des périmètres de leurs quartiers prioritaires par une mobilisation réelle de l’indicateur de revenu médian de l’INSEE.
Critères | |
14 sites ayant utilisé les indicateurs |
Revenu médian essentiellement et autres indicateurs en renfort éventuellement (indicateurs de chômage par exemple) |
6 sites n’ayant pas utilisé les indicateurs |
- Mauvaise qualité voire absence d’indicateurs pertinents : 4 sites - Mobilisation d’indicateurs d’écarts et/ou catégorisation en priorités jugées non pertinentes : 2 sites |
Dans cinq des sites de l’échantillon, les priorités 1 ont été définies au regard de projets ou de périmètres préexistants (ZUS, PRU, PNRQAD). Enfin, la majorité des quartiers prioritaires au titre du CUCS sont des quartiers traditionnels d’intervention de la politique de la ville et déjà prioritaires au titre des contrats de ville précédents notamment ; à l’exception notable des sites du type 2 (ville petite ou moyenne dans un système urbain) qui ont tous modifié les périmètres d’intervention, de fait resserrés, en 2007.
La géographie prioritaire se fonde sur des indicateurs nationaux et des négociations locales
La définition des périmètres de mise en œuvre du CUCS et des niveaux de priorité s’inscrit de façon générale dans une prise en compte des indicateurs locaux de précarité fournis par l’INSEE, le revenu médian par habitant essentiellement. Toutefois les modalités de définition s’élaborent surtout au niveau local sans réelle prise en compte des orientations fixées au niveau national : négociations des acteurs locaux, consensus, ou imposition des positions de l’État ; et qui aboutissent à une caractérisation hétérogène des éléments déterminant les périmètres et les priorités : reprise des géographies antérieures, superposition des géographies ZUS et PRU aux priorités 1…
2. Type 1 - Petite ou moyenne ville en bassin de vie rural
Site CUCS du type 1 : Autun, Lodève, Aulnoye-Aymeries
Le type 1 regroupe les petits ou moyens centres urbains qui polarisent un large bassin de vie et d’emploi essentiellement rural, ou rural ouvrier en crise, qui couvre un territoire élargi éloigné des pôles économiques et dont la lente reconversion est en cours. Leur situation géographique éloignée des grands centres urbains renforce les difficultés, d’accès à l’emploi en particulier, ainsi que les difficultés à y mettre en œuvre une politique de la ville efficace (tissu associatif insuffisant ; grosses structures, d’insertion notamment, en provenance des grandes villes voisines). Ces territoires subissent donc un effet d’isolement.
Les trois communes du type 1 et leurs quartiers se caractérisent de façon très homogène par :
– des indicateurs de précarité préoccupants, à l’échelle des quartiers politique de la ville mais aussi de la commune entière ; indicateurs relativement plus élevés que la moyenne départementale. Le taux de chômage de l’ensemble de la commune est élevé et supérieur à la moyenne départementale (et les écarts avec des unités urbaines déjà pauvres ainsi minimisés). Il existe une précarité et une pauvreté diffuses et généralisées ;
– une délinquance faible et en baisse qui s’exprime de façon isolée et irrégulière par des actes d’incivilité généralement, des indicateurs de santé qui font état d’une certaine précarité mais surtout d’une carence en matière d’accès à la santé et d’éducation sanitaire (offre de soin déficitaire) ;
– le classement en géographie prioritaire d’un ou deux quartiers de la commune uniquement et donc une part peu élevée de la population en QPV, mais une intervention politique de la ville élargie à d’autres périmètres, voire au territoire communal dans son ensemble. La commune d’Aulnoye-Aymeries en est un exemple, la totalité de son territoire est classée en périmètre CUCS.
Les populations des quartiers prioritaires sont assez homogènes. On retrouve toujours un élément commun de surreprésentation des populations étrangères, un taux de chômage élevé, un âge moyen des habitants relativement bas : à Autun, la population de l’ensemble de la ville est vieillissante et en baisse, alors que les familles nombreuses sont en augmentation dans le quartier lodévois par exemple.
3. Type 2 – Petite ou moyenne ville dans un système urbain en orbite métropolitaine
Site CUCS du type : Frontignan, Grasse et Salon-de-Provence,
Les communes du type 2 se caractérisent par leur appartenance à un système urbain soit un ensemble de villes petites ou moyennes généralement satellisées par une métropole régionale qui les polarise, contrairement aux villes petites et moyennes du type 1 suffisamment isolées pour ne pas être polarisées.
Elles se caractérisent aussi par l’importance limitée des périmètres CUCS. En plus des quartiers périphériques d’habitat social collectif, on y trouve des quartiers plus centraux ou faubouriens, non isolés géographiquement mais dégradés et concentrant une précarité certaine. Le dynamisme démographique de ces communes et de leurs quartiers (explosion du nombre de familles monoparentales) et la forte pression foncière qui en résulte contribuent à renforcer les indicateurs de précarité : les taux de chômage y sont plus élevés que les moyennes départementales, notamment chez les jeunes. Les problèmes de délinquance sont en augmentation, alors que la situation sanitaire dans les sites de l’échantillon, si elle est préoccupante, n’est guère alarmante. Aucun des sites du type 2 ne fait l’objet d’un classement de ses établissements scolaires en éducation prioritaire.
Il s’agit donc pour le type 2 de quartiers peu nombreux, à taille limitée (après un recentrage avec le passage des contrats de ville aux CUCS en particulier), qui ont essentiellement une fonction d’habitat pour des populations à faible revenu (Grasse et Salon-de-Provence). Si la situation de ces quartiers justifie une intervention particulière des pouvoirs publics, ils peuvent néanmoins bénéficier du dynamisme, économique notamment, de leurs communes d’appartenance.
Ces communes, malgré la similarité des quartiers politique de la ville et de leurs problématiques, sont plus hétérogènes : si Frontignan est une ville relativement pauvre (plus de la moitié des ménages non imposables ; potentiel fiscal faible), Grasse et Salon-de-Provence ne présentent pas de signes de précarité apparents hors les quartiers CUCS. Aussi les QPV de Frontignan ne sont-ils pas en réel décrochage par rapport à leur environnement et nécessitent plus une action d’animation socioculturelle ; alors que pour Salon-de-Provence et Grasse, les écarts entre les QPV, précaires, et l’unité urbaine, globalement plus riche, sont plus significatifs.
Le quartier, une échelle d’action pertinente ?
Les problématiques des types 1 et 2 sont liées à des problèmes globaux de dynamiques de bassin et d’activité économique ; d’isolement ou de dépendance à l’égard un pôle urbain éloigné créant des enjeux de mobilité singuliers. Elles questionnent d’ores et déjà sur les périmètres d’intervention de la politique de la ville pensée en termes de quartiers et de publics cibles.
4. Type 3 - Pôle urbain à rayonnement départemental
Sites CUCS du type : Bourges, CA Brive, CA Chambéry Métropole, Perpignan, CA Poitiers, CA Valenciennes Métropole
Les collectivités du type 3 connaissent des dynamiques globales positives et des caractéristiques démographiques globalement similaires (surreprésentation des PCS moyennes et supérieures). Les indicateurs socioéconomiques se situent dans la moyenne nationale. Dans l’ensemble, il s’agit de communautés d’agglomération moyennes qui rassemblent autour de leur ville-centre des communes résidentielles périurbaines et des communes rurales ou « rurbaines ». De fait, les écarts entre les QPV et l’agglomération sont donc renforcés, alors même que la présence de communes rurales dans l’agglomération atténue les écarts des QPV à l’unité urbaine de référence (136).
Les quartiers prioritaires du type 3 sont hétérogènes : quartiers de centre ancien ou faubouriens dégradés et précarisés ; quartiers périphériques de « grands ensembles », d’habitat social collectif, enclavés ; quartiers de communes limitrophes qui concentrent l’essentiel de l’intervention de la politique de la ville, ou quartiers plus éloignés des communes de l’agglomération classés au titre du CUCS, stigmatisés mais dont les indicateurs ne sont pas alarmants. Bien souvent les écarts sont importants dans l’échelle des problèmes urbains et sociaux entre la ville centre et les autres communes de l’agglomération.
Malgré l’hétérogénéité des quartiers :
– la question de l’emploi est préoccupante et la mobilité est un des principaux freins à l’emploi ;
– ils concentrent généralement la majorité des logements sociaux des communes de l’agglomération.
Les actions de la politique de la ville orientées traditionnellement sur les quartiers de la commune centre (et éventuellement la commune limitrophe qui accueille les QPV de type « grands ensembles ») tendent donc à s’étendre à certains quartiers en voie de paupérisation (centraux ou faubouriens, ou territoires plus périphériques et ruraux).
L’élargissement de la géographie prioritaire et le portage par l’EPCI
L’hétérogénéité des quartiers qui induit un élargissement des périmètres traditionnels de mise en œuvre de la politique de la ville est l’expression d’une complexification de l’intervention de la politique de la ville et de ses enjeux. De plus, la présence d’une géographie prioritaire sur un nombre minoritaire de communes dans le contexte d’un portage intercommunal du CUCS suppose une réflexion sur les possibles réticences qui peuvent naître au sein des communes contributrices à la politique de la ville mais non bénéficiaires.
5. Type 4 - Ville suburbaine (ville moyenne ou grande en périphérie de métropole)
Sites CUCS du type : Clichy-sous-Bois, Montreuil, Oullins, Sartrouville, Vénissieux
Rassemblant les communes en périphérie de métropoles, le type 4 se caractérise par :
– des communes globalement pauvres, au potentiel fiscal faible et dont une grande partie de la population n’est pas imposable ;
– des quartiers CUCS de grande taille, enclavés, dans lesquels se concentre un habitat social collectif de type « grands ensembles » souvent dégradé (mais ayant aussi souvent fait l’objet de réhabilitations), et des ensembles de copropriétés (à Clichy-sous-bois notamment) ;
– des populations très fragiles et précaires ; une surreprésentation des nationalités étrangères ; une population jeune, aux besoins éducatifs et d’encadrement importants ;
– des enjeux forts liés à l’insécurité et à la citoyenneté ; mais des indicateurs de délinquance globalement en amélioration ;
– un tissu associatif dynamique et dense, un bon taux d’équipements publics.
L’intervention de la politique de la ville y est ancienne et aujourd’hui normalisée dans les modes de production des politiques publiques locales.
6. Type 5 - Pôle urbain métropolitain
Sites CUCS du type : CU Nantes Métropole, CU Nice Côte-d’Azur, CA Grenoble Alpes Métropole, Marseille, CA Agglomération rouennaise
Le type 5 regroupe deux communautés d’agglomération de grande taille, deux communautés urbaines, et Marseille dont le CUCS a été signé à l’échelle communale. Métropoles, polarisant plusieurs bassins de vie et bassins d’activité et d’emploi, ces collectivités rassemblent un grand nombre de communes aux problématiques diverses. Du fait de leur taille et de l’hétérogénéité des communes membres, les quartiers classés au titre du CUCS sont eux aussi très hétérogènes. Les communes périphériques à la ville-centre regroupent souvent des quartiers de type « grands ensembles », engagées de longue date dans la politique de la ville. Le tissu associatif y est dense, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) nombreuses.
Le type 5 se caractérise par :
– le très grand nombre de quartiers prioritaires, tous niveaux de priorité confondus ; mais hétérogènes par leur taille, leur type d’habitat, leur enjeux et problématiques ;
– une taille conséquente, qui appelle à réfléchir à la combinaison d’une politique de quartiers et d’une stratégie métropolitaine globale ;
– un CUCS signé et porté au niveau intercommunal et une définition de la stratégie à une large échelle communautaire (sauf Marseille).
Dans la mesure des données et des informations disponibles, l’analyse des éléments de contexte territorial des collectivités et de leurs quartiers prioritaires au titre du CUCS, de leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociodémographiques et politiques, conforte la caractérisation des cinq types de la typologie.
La variété des types, leur hétérogénéité, suppose une diversification des problématiques urbaines et sociales auxquelles les CUCS doivent répondre. L’extension des périmètres d’intervention de la politique de la ville – extension théorique, dans sa définition, ou physique, dans ses périmètres géographiques d’intervention – qui représente un défi nouveau pour cette politique interroge : un décalage est-il en train de naître entre la définition de la politique de la ville et la réalité de la mise en œuvre dans les communes ou les EPCI concernés ? Autrement formulé : la définition de la politique de la ville évolue-t-elle au rythme de l’hétérogénéisation de ses modalités et territoires d’intervention ?
Depuis son origine, la politique de la ville a évolué sans modifier ses principes de base : elle se différencie des politiques de droit commun par une démarche volontariste apte à mobiliser les compétences institutionnelles et à concentrer les moyens des partenaires, à les coordonner transversalement et à les dynamiser dans une logique de projet collectif et territorialisé sur un périmètre prioritaire, sur des objectifs partagés et contractualisés visant la réduction des écarts entre ces quartiers et leurs unités urbaines. Cette conception d’une action publique optimisant son efficacité, plus ou moins interprétée – élargie ou réduite à sa plus simple expression – s’est trouvée successivement mobilisée sur de nouveaux territoires et de nouvelles problématiques urbaines et sociales. Des centres urbains concentrant des poches d’habitat privé ancien dégradé par exemple ont vu l’arrivée de la politique de la ville – ou l’appellent aujourd’hui. La jonction entre les problématiques de l’habitat et les problématiques de publics s’est effectuée sur des quartiers d’habitat social et collectif (regroupés sous le terme générique de « grands ensembles ») majoritairement issus de l’urbanisme des « trente glorieuses ». Mais le curseur se déplace aujourd’hui sur de nouveaux territoires où il rencontre des problématiques nouvelles qui, par nature, échappent à l’intervention classique de la politique de la ville ; mais elle y est interpellée car y vivent des publics ciblés qui appellent un renforcement de l’action publique locale. Par exemple :
– quartiers d’habitat individuel privé et de copropriétés dégradés ;
– territoires ruraux ou rurbains, territoires de rayonnement de certains CUCS qui ont été appelés à la faveur de l’intercommunalité ;
– centre-ville dégradés ; comme le centre-ville marseillais constitué de populations migrantes, immigrées, bi-résidentes, etc. ;
– les territoires de sédentarisation des gens du voyage, par définition précaires et sur lesquels la politique de la ville intervient aisément ;
L’intervention de la politique de la ville axée sur une logique de quartier périmétrant ses bénéficiaires – que la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est venue renforcer (137) – s’est étendue face au constat de nouvelles problématiques d’habitat qui portent et comportent de nouvelles problématiques d’habitants et de publics sur de nouveaux territoires. Cette extension a-t-elle progressivement modifié la nature et l’esprit de la politique d’exception qu’est en principe la politique de la ville ou réduit son exceptionnalité ? Ou bien la distinction des problématiques et donc la différenciation des enjeux et, in fine, des réponses conduisent-elles à réaffirmer et à recentrer l’exceptionnalité de l’intervention sur des périmètres sur-priorisés ? La cohésion sociale appelle-t-elle des réponses par type et par échelle de territoire ? Toutes celles-ci relèvent-elle de la politique de la ville ?
PREMIÈRE PARTIE - COMMUNAUTÉ DE CULTURE ET DIVERSITÉ DES PRATIQUES ÉVALUATIVES
Matériau documentaire de base de la présente étude, les évaluations menées par les sites en CUCS étaient présupposées présenter les résultats et les impacts des actions menées durant la première période triennale 2007-2009. Cependant, c’est très loin d’être le cas, et ce, pour de multiples raisons.
Pourtant, la politique de la ville est la politique dont l’ensemble des acteurs sont, depuis l’origine, le plus acculturés à l’évaluation parmi l’ensemble des politiques publiques. En effet, s’il existe une culture commune de la politique de la ville partagée parmi ses acteurs, elle a intégré très largement la culture évaluative qui en est devenue une dimension forte.
Les acteurs de la politique de la ville pratiquent l’évaluation conformément au décret du Premier ministre d’août 2000 qui la rendait obligatoire pour toutes les politiques contractuelles. Pourquoi cette dimension est-elle devenue si nécessaire à la politique de la ville – alors que les autres politiques contractuelles sont loin de la pratiquer aussi régulièrement (hormis les CPER, mais qui répondent aussi à cet égard à une injonction communautaire) ? Parce que partenariale et précisément contractuelle, elle mobilise une diversité d’acteurs institutionnels et d’opérateurs associatifs et privés, et repose sur l’accord des volontés qu’est supposée consacrer la contractualisation. Parce qu’elle porte sur des champs d’intervention relevant de plusieurs ministères, et de tous les types et niveaux de collectivités territoriales – et ce faisant croise des compétences de droit commun réparties entre ceux-ci et une compétence politique de la ville partagée par l’État et les intercommunalités, et, de facto, encore portée par de nombreuses communes. Parce que répondant à une approche globale, elle veut concentrer des moyens exceptionnels sur des quartiers urbains désignés comme prioritaires. Parce qu’elle se présente comme une combinatoire de réponses multiples et coordonnées à des enjeux de cohésions urbaine et sociale par nature complexes. Parce que la démarche de mise en œuvre de ces réponses - aussi complexe que les enjeux – appelle une dynamique de projet collectif, et donc des pratiques d’action publique distinctes de l’action et de la culture administratives courantes.
Dès lors la culture évaluative c’est-à-dire les principes, les outils et les pratiques de l’évaluation, sont apparus de nature tant à permettre qu’à mesurer la pertinence, la cohérence, l’efficacité et l’efficience de ces contrats urbains de cohésion sociale aujourd’hui, contrats de ville hier.
L’évaluation est l’étape du processus d’intelligence collective apte à produire la connaissance des réalités sociales et urbaines des quartiers, l’identification des enjeux d’action publique, la formalisation des objectifs et des engagements respectifs, la déclinaison des programmes d’actions (évaluation a priori ou ex ante), l’analyse de la cohérence du système d’acteurs (évaluation intermédiaire), comme la mesure des réalisations et de la consommation budgétaire, des résultats et des impacts (évaluation a posteriori ou ex post). Ainsi l’évaluation est par nature la démarche maïeutique de concertation et de négociation menée par un professionnel extérieur, qui mobilise les acteurs, mutualise les connaissances et les réflexions, et stabilise l’accord des volontés qui donne sens au contrat autour d’une stratégie commune.
On voit qu’en politique de la ville singulièrement, l’évaluation n’est pas supposée n’être qu’une obligation formelle, qu’un compte rendu aux financeurs, qu’une occasion de « mettre tout le monde autour de la table ». Elle a vocation à être une dimension essentielle de sa gouvernance et l’instrument stratégique de son évolution. On verra ici qu’elle l’est effectivement pour un nombre restreint de CUCS qui deviennent ainsi les plus performants, tant au plan de leur pilotage qu’à celui de leurs résultats. À l’inverse, négligée, elle révèle plus que ses propres insuffisances : elle est le symptôme de la non implication du maire ou du président d’EPCI, de la faiblesse du portage des élus, des distorsions partenariales, d’un accord contractuel formel, « artificiel », passage obligé des financements extérieurs qui n’est guère « l’accord des volontés » de partenaires peu coopératifs. Ou encore révèle-t-elle le déséquilibre de leurs investissements politiques, stratégiques, opérationnels et financiers, et donc des objectifs très formels et des programmations parfois inégales ou même bancales… Dans les meilleurs des cas, elle permet la prise de conscience de ces dysfonctionnements et donc leurs corrections. En 2009 ou 2010, elle a aussi permis d’une certaine manière de former à la politique de la ville des équipes « arrivées aux affaires » à l’occasion des élections municipales de 2008, parfois peu expérimentées.
Enfin dans la logique du présent rapport, cette première partie entend souligner comment la démarche collective apte à produire l’intelligence des enjeux des quartiers, produit également la « bonne intelligence » des acteurs ; celle-ci conditionne et la pertinence d’une stratégie commune (2ème partie) et la capacité collective à la mettre en œuvre – et donc la capacité à produire des résultats et des impacts conformes aux objectifs stratégiques et opérationnels qu’ils s’étaient fixés (3ème partie).
A. PERCEPTION ET APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE
Comme le précise le guide méthodologique de l’évaluation des CUCS commandité et présenté par la DIV (138), l’évaluation continue des CUCS doit prendre en compte une double exigence : « une évaluation qui se réfère à la fois aux grands objectifs nationaux de la politique de la ville et à ceux des projets locaux » et « une évaluation qui tienne compte des spécificités de la structure des CUCS ». Cela comprend :
– la prise en compte du cadre de référence législatif, dont l’annexe à la loi de programmation du 1er août 2003 concernant les indicateurs d’observation et d’évaluation ;
– l’évaluation des résultats et des impacts des CUCS qui doit faire expressément le lien entre les objectifs définis au niveau de l’État et ceux formulés dans le cadre de la contractualisation locale. « Pour permettre de mesurer les impacts généraux, il conviendra de se référer aux principaux indicateurs de contexte identifiés dans l’annexe 1 de la loi du 1er août 2003 » ;
– une appréciation de l’impact et du fonctionnement du contrat lui-même, en plus de l’évaluation des résultats des actions et de leurs impacts ;
– une évaluation de la transversalité et de la dynamique de projet territorial ;
une mise en perspective de l’ensemble des dispositifs mobilisés sur un même territoire, tout « en sachant que nombre d’entre eux feront par ailleurs l’objet d’évaluations sectorielles spécifiques » ; « c’est l’appréciation de l’impact global de l’ensemble de ces dispositifs sur un même territoire qui est attendue ».
Enfin le guide méthodologique conclue que l’évaluation s’inscrit dans une logique de résultats et pas seulement de compte-rendu de réalisations (l’obligation d’établir un bilan annuel de réalisation signifie bien que ce bilan ne saurait à lui seul tenir lieu d’évaluation) (139).
Malgré le cadre réglementaire et théorique – globalement diffusé et partagé – de l’évaluation des CUCS et l’explicitation des notions, des méthodes et des outils à mobiliser, les démarches évaluatives des sites de l’échantillon sont très diverses et la conception qu’ils en ont – et l’usage qu’ils en font— très hétérogènes.
1. Une culture évaluative globalement partagée au sein d’une culture commune de la politique de la ville
a) Une certaine exemplarité de la politique de la ville en matière d’évaluation
Ÿ Une étape au cœur de la politique de la ville à forte vertu managériale
Revenant tous les trois ans, l’étape évaluative est pratiquée par quasiment tous les sites bénéficiaires d’un CUCS. Elle apparaît à peu près partout utile et nécessaire, même si c’est parfois a minima. À cet égard, elle apparaît comme un acquis fort de la politique de la ville qui pratique par elle un questionnement récurrent sur ses modes d’action et ses résultats et peut ainsi se réorganiser et se réorienter. À tout le moins se rend-elle visible et compréhensible par des acteurs locaux qui cherchent souvent le sens de leur action. A minima elle est un outil de redynamisation d’une ressource humaine régulièrement au bord de la démotivation.
Inscrite depuis plus de dix ans dans les circulaires régissant la politique de la ville (140), l’évaluation est une démarche constitutive de la politique de la ville. Les CUCS sont par ailleurs soumis en tant que dispositifs contractuels aux démarches d’évaluation, tel que défini dans la circulaire du 25 août 2000 relative à la mise en œuvre de l’évaluation dans les procédures contractuelles (contrats de plan – contrats de ville et d’agglomération – contrats de pays – contrats conclus avec les parcs naturels régionaux) pour la période 2000-2006, entrée en vigueur le 31 août 2000.
La circulaire du 24 mai 2006 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale, qui présente et fixe ce nouveau cadre contractuel de la politique de la ville, précise que l’élaboration du projet de développement social et urbain devra, entre autres, « tenir compte des évaluations des précédents dispositifs » ; de même est-il demandé aux préfets de veiller « tout particulièrement à la définition de critères d’évaluation dès la signature des conventions », les contrats faisant l’objet « d’une évaluation à échéance de trois ans, de manière à pouvoir être réorientés de manière plus substantielle et, à terme, de manière à analyser les écarts entre les objectifs prévus et les résultats observés et afin de pouvoir établir une appréciation d’ensemble sur leur conception et leur mise en œuvre ». La circulaire du délégué interministériel à la ville du 15 septembre 2006 relative à la géographie prioritaire des CUCS, leur contenu et calendrier de mise en œuvre adressée aux préfets de régions et de départements (141) insiste, d’une part, sur l’intégration aux CUCS d’une partie consacrée aux modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation et, d’autre part, sur la nécessité d’intégrer les démarches évaluatives dès l’élaboration des contrats.
Ÿ Le cadre du dialogue stratégique
Dans le cas d’une politique contractuelle et partenariale, l’évaluation est le lieu et le moment d’un dialogue des partenaires financeurs entre eux, entre eux et les opérateurs qu’ils financent, entre eux et les autres porteurs de politiques publiques de droit commun, et un dialogue avec les bénéficiaires visés par leurs actions.
Il dépend des partenaires participant à l’évaluation qu’elle leur fournisse le cadre d’une simple mais nécessaire rencontre (cas très fréquent), d’un bilan utilement commenté (cas fréquent) ou d’un vrai dialogue stratégique apte à rechercher effectivement l’efficacité (cas moins fréquent). L’évaluation apparaît cependant de plus en plus comme la condition d’un dialogue stratégique de qualité.
En effet, l’élaboration du projet d’évaluation et du référentiel nécessite une réunion des décideurs pour la sélection des questionnements évaluatifs. Le choix des indicateurs dans un second temps se fait collectivement et le renseignement des indicateurs au moment de l’évaluation suppose un travail étroit avec les opérateurs et partenaires concernés. Enfin, la définition et l’organisation de la (les) instance(s) d’évaluation en 2007, puis la mise en œuvre de l’évaluation en 2009/2010 – réunion des groupes de travail évaluatifs, thématiques, présentation des modalités d’évaluation et communication sur sa mise en œuvre – sont autant d’éléments renforçant le caractère partenarial de la politique de la ville. Ainsi deux sites de l’échantillon ont-ils mobilisé les parties du contrat en mettant en place des comités d’évaluation et des groupes de travail évaluation (GTE) pour la mise en œuvre de la démarche ainsi définie. Les GTE de l’un d’eux ont permis l’organisation de plusieurs réunions partenariales en amont – présentation de la démarche, premiers bilans sur les champs considérés, prédéfinition des questions d’évaluation, modalités de mobilisation des GTE. L’intérêt de ces instances partenariales et leur rôle fédérateur et mobilisateur est d’autant plus fort qu’il peut exister des désaccords sur la méthodologie de l’évaluation.
La mise en place de ces instances et l’évaluation de façon plus générale permet donc de redéfinir, réorienter ou repréciser les objectifs et les programmes d’action, en même temps qu’il permet une dynamisation de la transversalité entre les services administratifs, des réunions des partenaires et une coproduction de l’évaluation avec les opérateurs, les acteurs de terrain et les habitants.
b) Une déclinaison des points d’étape propres à la démarche d’évaluation partagée par les acteurs
L’évaluation des CUCS doit en effet porter à la fois sur le contrat lui-même, les programmes d’action qu’il décline et les pratiques partenariales et organisationnelles qu’ils induisent. Aussi la démarche évaluative en continu se décline-t-elle dans les textes en un bilan annuel de réalisation qui comprend notamment un bilan physico-financier (et éventuellement un bilan triennal en complément, ou en substitut des bilans annuels). Le(s) bilan(s) de réalisation constituent un préalable nécessaire à la réalisation de l’évaluation à proprement parler qui mesure les résultats et impacts des actions mises en œuvre.
Des bilans annuels à l’évaluation triennale, en passant par les bilans évaluatifs d’actions ou de territoires… L’hétérogénéité des productions évaluatives est en réalité bien grande. En effet seuls 3 sites de l’échantillon ont réalisé des bilans triennaux comportant un bilan physico-financier global – i.e. sur l’ensemble de la programmation triennale ; 3 sites ont réalisé des bilans-évaluations partielles focalisés sur des actions ou des thèmes phares. Tous les sites ont par ailleurs initié la démarche d’évaluation triennale ; parmi les évaluations achevées disponibles dans l’échantillon, 5 y ont inclus des focus thématiques ou territoriaux sur des actions, programmations ou territoires phares de la mise en œuvre du contrat.
Il convient de souligner la singularité de la démarche de certains sites, un site de type 5 qui a choisi de n’évaluer qu’une thématique et un territoire prioritaire par année ; un site de type 3 qui a réalisé une évaluation poussée de quelques-unes des actions prévues au titre du CUCS ; ou un site de type 5 qui, par souci de transversalité, de débat et de participation, a souhaité organiser des forums (ateliers) évaluatifs. De fait, ces sites n’ont pas produit de rapport d’évaluation global. Un site de type 5 permet de mettre en lumière l’impact sur le processus évaluatif d’un mode de portage intercommunal décentralisé : en l’absence de cahier des charges précis et unique adressé aux communes membres et dans la mesure où les démarches d’évaluation sont laissées à l’initiative et au pilotage des communes, certaines ont de fait privilégié une entrée thématique, d’autres une évaluation territoriale ; certaines se sont essayées à une évaluation large d’une politique sectorielle, sans limitation à l’intervention politique de la ville. La très grande diversité des documents fournis aux services de la communauté urbaine rend difficile la vision globale à l’échelle de l’agglomération.
Au niveau de l’échantillon retenu, la très inégale qualité des évaluations fournies – beaucoup sont d’ailleurs à qualifier de bilans plutôt que d’évaluations (142)– rend difficile une vision globale et une appréciation d’ensemble des exercices évaluatifs et partant, des résultats et des impacts des CUCS.
2. Mais des pratiques inégales selon le degré d’implication et le degré d’acculturation à l’évaluation
Selon le rapport d'information du Sénateur Dallier de novembre 2007, « les circulaires du 24 mai 2006 et du 15 septembre 2006 prévoient une évaluation des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) après 3 ans. Cette évaluation doit s'appuyer sur des bilans annuels de réalisation préexistants et prévus par la loi du 1er août 2003. La circulaire du 24 mai 2006 invitait les préfets à veiller « tout particulièrement à la définition de critères d'évaluation dès la signature des conventions ». La circulaire du 15 septembre 2006 insiste sur la nécessité d'intégrer cette préoccupation dès la phase d'élaboration des CUCS. Le guide méthodologique des CUCS distingue deux phases différentes d'appréciation des résultats du contrat :
- Un « bilan », institué par la circulaire du 24 mai 2006 et présenté comme un outil de pilotage des CUCS. Ce bilan doit présenter les éléments de suivi physique et financier du CUCS et se référer aux indicateurs de résultats du contrat ;
- L'« évaluation » qui doit « reposer sur un portage politique fort ». Dans cette perspective, une « instance d'évaluation » doit être instituée et rassembler « les partenaires ainsi que des représentants des habitants et du secteur associatif ». Cette évaluation doit intervenir à l'échéance de trois ans. » (143)
Faisant référence au rapport de la Cour des comptes, le même rapport rappelait le « manque d'accompagnement méthodologique pour la définition du volet évaluatif » et indiquait que « ce cadrage est en cours de définition :
- « Une note de cadrage sur l'évaluation des CUCS a été diffusée par la DIV en février 2007 ;
- « Cette note devrait être accompagnée de la publication d'un guide d'évaluation dans le courant de l'année 2007 ».
a) Une acculturation à l’évaluation tributaire de la compréhension du partenariat et de la « bonne intelligence » des cocontractants
L’évaluation est le moment critique de rencontre et d’échange des acteurs. La grande majorité des acteurs soulignent l’apport de l’exercice évaluatif dans la redéfinition des objectifs à partir de la compréhension des enjeux et de la mutualisation de la connaissance des territoires et des publics.
b)…mais l’évaluation est aussi la condition de la bonne marche de ce partenariat
Ÿ Non seulement entre les partenaires du CUCS, et en premier lieu l’État et les collectivités…
L’évaluation du CUCS d’un site de type 5 est survenue au moment d’une restructuration de la politique de la ville à l’échelle de la communauté urbaine : de fait le partenariat – les réunions plus précisément – s’est avéré difficile.
Dans le cadre d’un portage intercommunal, l’évaluation peut permettre aux communes membres de l’EPCI de (re)dynamiser le partenariat et la coopération avec les instances intercommunales porteuses du CUCS. Ainsi sur un site de type 5, l’exercice évaluatif a amené les communes « à se reparler », et a permis de remobiliser politiquement les élus et les services ; il a également entraîné la constitution de pôles de suivi d’évaluation des politiques publiques. Sur un autre site de type 5 a été mise en place une « conférence des maires » réunissant les maires des treize communes les plus importantes afin de débattre des résultats de l’évaluation ; d’autre part l’évaluation a permis des réunions plus fréquentes avec les services de l’État. Au niveau local, l’évaluation a permis une remise en question collégiale des orientations du contrat. L’évaluation permet donc de donner un souffle nouveau à la logique partenariale. Elle est un outil clé de remobilisation et de visibilité sur la gouvernance et le pilotage, d’autant plus indispensable dans le cadre d’une politique de la ville intercommunale.
Ÿ …mais aussi avec les opérateurs et les habitants.
L’évaluation apparaît également comme le gage d’un souci d’efficacité des actions et de la responsabilisation des acteurs locaux dans la mise en œuvre efficace des programmes d’actions des CUCS. Un site de type 2 a par exemple mis en place des réunions intermédiaires avec les associations impliquées au titre de son CUCS pour recenser les difficultés à établir des stratégies et s’inscrire en cohérence avec les autres actions. L’évaluation et l’implication des opérateurs que sa méthode participative implique s’avèrent en effet utiles pour eux en tant qu’elle leur permet de « se saisir de ses résultats, de réorienter leur action et de se situer dans le dispositif général » comme le souligne la chef de projet CUCS d’un site de type 1. Aussi, malgré la réticence de certains opérateurs à ce qu’ils considèrent comme un « contrôle », les associations sont souvent fortement impliquées dans la démarche, ce qui souligne par ailleurs l’intérêt du principe de transparence (étape de la restitution). Tous les sites de l’échantillon reconnaissent donc le rôle de (re)mobilisation des opérateurs et des partenaires que permet le moment de l’évaluation.
L’évaluation est aussi la condition d’une bonne mise en marche du CUCS avec les habitants. Les réunions de bénéficiaires sont une pratique évaluative partagée par tous les sites de l’échantillon, y compris ceux dont les évaluations respectent le moins les principes d’une « bonne évaluation » (144). Quatre sites de l’échantillon ont par ailleurs réalisé des enquêtes habitants, auprès d’un public plus large et de façon plus récurrente qui permettent, en complément de la concertation menée dans les quartiers prioritaires, de recueillir des témoignages plus détaillés sur les impacts des actions de la politique de la ville sur les territoires. C’est le cas d’un site de type 3 qui produit un questionnaire habitants sur un quartier et une enquête en cours auprès des personnes relogées dans le cadre du programme de rénovation urbaine, sur leur satisfaction à terme de six mois. Pour répondre aux cinq questions évaluatives qu’elle a définies, un site de type 5, en plus des échanges avec les acteurs de la politique de la ville que permettent les forums politique de la ville qu’elle organise, a organisé des travaux participatifs ouverts impliquant dans une certaine mesure les habitants des quartiers concernés.
3. Des outils de connaissance des territoires et des publics empiriquement mis au point et donc hétérogènes
Des bilans annuels à l’évaluation triennale, en passant par les bilans d’actions thématiques, les équipes opérationnelles, après leurs opérateurs, consacrent un temps important à « reporter » les réalisations, les résultats bruts et les financements effectués. On observe un éventail d’outils extrêmement divers des plus simples aux plus sophistiqués. Devant entre autres les difficultés présentées par le logiciel Poliville (145) (logiciel de gestion des projets qui permet d’instruire en ligne toute nouvelle demande de subvention) – très inégalement présent –, les sites ont pour la plupart mis au point leurs propres outils. Il en découle une certaine hétérogénéité des modes de suivi, et beaucoup de lassitude à l’endroit de cette tâche très administrative, qu’aurait pu réduire un outil apte à harmoniser et fluidifier tout à la fois l’instruction des demandes de subvention, et un « reporting » homogène et donc « centralisable » aisément.
a) Des services en charge de l’évaluation de compétences variables dans ce domaine
La charte de l’évaluation des politiques publiques de la SFE, que reprend le guide de l’évaluation des CUCS élaboré par la DIV, définit les principes d’une « bonne évaluation » dont le respect est un gage de la qualité du pilotage et du rendu d’une évaluation : la pluralité, la distanciation, la compétence, le respect des personnes, la transparence, l’opportunité et la responsabilité.
Il est question ici d’interroger la réalité des principes de distanciation et de compétence dans les exercices évaluatifs dont le cabinet a disposé pour la présente étude.
À noter : l’évaluation en France n’est pas une profession reconnue et son exercice ne répond pas à des qualifications, des normes ou un agrément – à la différence de nombreux pays où, sous des formes diverses, celle-ci est un acte intégré de longue date aux politiques publiques (Canada, États-Unis, Royaume Uni, Pays-Bas, pays scandinaves, mais aussi dans une moindre mesure, Allemagne, Belgique entre autres ; s’ajoutent l’Union Européenne, et les organisations gouvernementales d’aide au développement qui ainsi entraînent la constitution de réseaux professionnels dans les pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie). On ne dispose donc pas de critères quels qu’ils soient pour qualifier ou non d’évaluateur le cabinet ou l’expert mandaté par le partenariat contractuel du CUCS aux fins de mener l’évaluation de ses actions. Pourtant, s’agissant de cette politique contractuelle, des textes de référence, une littérature nombreuse, et le guide de l’évaluation réalisé à la demande de la DIV par un ancien président de la Société française de l’Evaluation (SFE), tendent à cadrer l’exercice, tant au plan de ses pratiques que de ses outils méthodologiques. En outre la SFE, seule organisation qui en France fédère la communauté professionnelle de l’évaluation (commanditaires publics et mandataires privés), a élaboré une charte de l’évaluation à laquelle souscrivent ses adhérents, invités à la mettre en exergue dans les cahiers des charges de la commande publique comme dans les offres qui leur répondent.
À ce stade, nous mobiliserons donc l’appartenance à la SFE pour tenter, non pas de dire la qualité des évaluations, mais leur caractère effectivement spécifique, distinct d’un audit ou d’une étude, a fortiori d’un contrôle, identifié comme tel par un commanditaire informé et formé, et proposé comme tel par les évaluateurs revendiquant y compris une déontologie. Cela ne préjuge pas de la qualité des évaluations des uns ou des autres.
Appartenance à la Société française de l'évaluation (SFE)
du commanditaire et du prestataire de l'évaluation
Collectivités membres de la SFE |
Collectivités non membres de la SFE | |
Collectivités ayant recouru à un cabinet membre de la SFE |
2 |
2 |
Collectivités ayant recouru à un cabinet non membre de la SFE |
1 |
14 |
Cabinets évaluateurs membres de la SFE |
Argos, Enéis Conseil, Acadie, Cabinet E.C.s, Cirese | |
Cabinets évaluateurs non membres |
Trajectoires, Rémy Crouzoulon Consultant, ExtraMuros, COPAS, ESC2 | |
** dont deux collectivités ayant recouru l’une à des étudiants de l’INET, l’autre à un Centre de gestion.
Cinq sites ont réalisé l’évaluation en interne dont un site qui a réalisé ses bilans triennaux en interne et qui lance l’externalisation de l’évaluation en 2010.
Ÿ Un respect mitigé du principe de distanciation
Au vu du tableau synthétique ci-dessus, le respect du principe de distanciation ne peut être vérifié. On ne peut qu’indiquer que lorsque l’évaluation est déléguée à une structure externe, il ne s’agit pas systématiquement de structures affichant une qualification spécifique à l’évaluation. Il convient de citer les exemples d’un site de type 4 qui a missionné les étudiants de l’Institut national des études territoriales (INET), et de deux autres sites (type 2 et type 5) qui ont mobilisé le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale.
Ÿ La compétence et l’aptitude à évaluer en question
Aussi, lorsqu’elle est effectuée en interne, la qualité est tributaire de la qualification des acteurs, de la coordination avec les organismes détenant les données (CAF, éducation nationale, sécurité publique, Insee, etc.) ou de l’existence de structures d’observation telles que les agences d’urbanisme ou les observatoires socio-urbains éventuellement mis en place. Souvent la confusion persiste entre évaluation et bilan. Par ailleurs, quelles compétences spécifiques les chargés de mission politique de la ville justifient-ils en matière d’évaluation. La majorité des acteurs institutionnels soulignent cependant la difficulté que représente la démarche d’auto-évaluation : manque de formation des acteurs sur l’identification des besoins, d’analyse des indicateurs, de distanciation critique et d’un regard externe neutre, d’expertise.
Ainsi, la difficulté est d’apprécier le caractère neutre et impartial du recueil et de l’analyse des données tant quantitatives que qualitatives.
b) Des indicateurs hétérogènes et de fiabilité inégale
La pertinence des indicateurs dont n’est pas toujours claire pour les acteurs ; les méthodes de calcul et de recueil de données ne sont pas homogènes (problématique des associations, coefficient multiplicateur pour l’effet de levier, part du droit commun, etc.).
Les indicateurs qualitatifs, non normés, ne sont pas utilisables de manière homogène, utile et pertinente.
4. Une visibilité et une compréhension très inégales des résultats et des impacts
a) Une confusion entre impacts et résultats chez les acteurs de la politique de la ville qui mène à confondre efficacité (impact) et effectivité (résultat)
L’effectivité répond à des questions de moyens et de mise en œuvre opérationnelle en fonction d’objectifs opérationnels fixés en amont et l’efficacité répond à des questions de répercussion des actions sur le territoire en fonction des objectifs stratégiques du contrat. Les acteurs de terrain confondent souvent les deux notions ce qui provoque une confusion entre les impacts et les résultats.
b) Une confusion et un manque de visibilité qui empêchent parfois les acteurs de redéfinir leurs orientations au terme de l’évaluation
Cette confusion est problématique dans le sens ou l’évaluation doit servir à recadrer, à réorienter le programme afin de l’améliorer, or si les acteurs confondent résultats et impacts, ils peuvent suivre une mauvaise orientation.
c) Au contraire, une bonne visibilité de ces enjeux engendre des réflexions et des remaniements productifs
L’exemple d’un site de type 5 est une bonne illustration de remaniements productifs suite à l’évaluation puisqu’ils ont décidé d’une mise en synergie du GIP CUCS et GIP PRU, ce qui manquait auparavant.
5. Trois approches de l’évaluation
« L’évaluation des CUCS relève d’une démarche particulière. Elle consiste à mettre en place un dispositif de débat et d’analyse afin de porter un jugement collectif sur des actions menées. L’évaluation se nourrit de données d’observation de nature statistiques, de données de suivi et d’enquêtes (entretiens, sondages, questionnaires, etc.) auprès des habitants et des professionnels. (…) L’évaluation doit reposer sur un portage politique fort, les élus étant ainsi à même d’orienter les objectifs ou le fonctionnement du CUCS. Une instance d’évaluation est installée pour assurer la mise en œuvre du projet d’évaluation. Elle regroupe les partenaires ainsi que des représentants des habitants et du secteur associatif. (…) Le projet d’évaluation trouve sa traduction opérationnelle dans un référentiel d’évaluation. Ce document met en cohérence questionnements évaluatifs, objectifs du projet et indicateurs d’évaluation, au travers des hypothèses formulées par les partenaires. (…) Cette évaluation permettra d’apprécier l’efficacité de la politique menée et d’être en capacité de décider de son éventuelle reconduction, en réorientant le cas échéant les objectifs du projet » ( ).
On constate un certain décalage entre les attendus du guide méthodologique de l’évaluation des CUCS (ci-dessus) et la réalité :
Ÿ L’utilisation de statistiques est très inégale et souvent manquante.
Ÿ Le portage stratégique de l’évaluation, ne se fait pas au niveau requis, celui du maire (ou président d’EPCI) et du préfet (ou sous-préfet).
Ÿ La pratique du référentiel évaluatif préalable s’est bien développée.
Ÿ L’appréciation de l’efficacité ne repose pas sur des données quantitatives stables et partageables ; l’évaluation anime le plus souvent une concertation des acteurs sur la réorientation des objectifs ou leur reconduction.
Au vu des éléments précédents de conception, de compréhension et d’utilisation de la démarche évaluative, il est possible de distinguer trois approches évaluatives et de regrouper les sites dans ces trois types d’évaluation.
Approche évaluative Sites de l’échantillon |
Evaluation animation-communication |
Evaluation action partenariale-programmatique |
Evaluation stratégique | ||||
Type 1 |
1.1 |
||||||
1.2 |
|||||||
1.3 |
|||||||
Type 2 |
2.1 |
||||||
2.2 |
|||||||
2.3 |
|||||||
Type 3 |
3.1 |
||||||
3.2 |
|||||||
3.3 |
|||||||
3.4 |
|||||||
3.5 |
|||||||
3.6 |
|||||||
Type 4 |
4.1 |
||||||
4.2 |
|||||||
4.3 |
|||||||
4.4 |
|||||||
4.5 |
|||||||
Type 5 |
5.1 |
||||||
5.2 |
|||||||
5.3 |
|||||||
5.4 |
|||||||
5.5 |
|||||||
Ÿ Une démarche d’intelligence des territoires et de l’action, et de dialogue stratégique des partenaires permettant de produire une véritable connaissance du territoire et de mobiliser ces connaissances pour répondre aux enjeux locaux
Ÿ L’exemple d’un site de type 1 : l’évaluation fut l’occasion d’établir un diagnostic en l’absence de politique de la ville avant le CUCS
b) Une évaluation - action, partenariale et programmatique
Ÿ Une démarche participative visant une réflexion sur les enjeux, la mise en œuvre et l’élaboration de la contractualisation suivante
c) Une évaluation – animation / communication
Ÿ Une démarche considérée comme une obligation formelle, « détournée » en démarche d’animation et de mobilisation
B. OBSERVATION TERRITORIALE, SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIONS : OUTILS ET MÉTHODES
1. Une observation territoriale globalement lacunaire
a) Des indicateurs de contexte difficilement accessibles à l’échelle des quartiers
Il est difficile d’obtenir de bons indicateurs à l’échelle du quartier. En effet, les grands indicateurs nationaux fournis par l’INSEE ne présentent pas ce type de découpage puisqu’ils s’arrêtent au niveau administratif, donc de la commune.
b) Un manque important d’informations localisées sur certaines thématiques : éducation, santé et délinquance en particulier
Certaines thématiques disposent de très peu d’informations localisées à l’échelle des quartiers prioritaires. Les bases de données du ministère de l’éducation nationale peuvent cibler par école mais pas par quartier au sens strict des ZUS par exemple. De plus, les données à l’échelle des établissements scolaire sont très rarement communiquées aux collectivités mettant en œuvre les CUCS. Il en est de même pour les thèmes santé (notamment concernant l’état de santé de la population habitant en quartiers prioritaires, d’autant qu’on se heurte dans ce cas au secret médical) et délinquance (pour laquelle des données sont disponibles mais peu pertinentes).
c) Une actualisation insuffisamment fréquente pour suivre les évolutions
L’actualisation des données se fait avec un décalage de plusieurs années, pour un programme prévu pour trois ans. Les indicateurs à l’échelle ZUS sont actualisés plus régulièrement par l’ONZUS. Il faut attendre les « données urbaines infra-communales par quartier » afin d’obtenir ces informations, mais elles sont généralement datées plusieurs années en arrière. En 2010, les données disponibles à l’échelle du quartier sont datées de 2005 à 2007.
Par ailleurs, des données infra communales, plus récentes et actualisées plus souvent, sont également disponibles à l’IRIS (mi 2010, on trouve des données CAF et CNAM de 2009, des données ANPE et SIREN de 2008 notamment), mais cette échelle pose problème : d’une part, certains sites ont défini la géographie prioritaire en respectant les IRIS, justement dans un souci de faciliter la collecte d’indicateurs, mais en conséquence certains IRIS apparaissent trop larges au regard de la zone effectivement ciblée, créant des effets de moyenne du fait de la présence dans l’IRIS, avec la zone effectivement ciblée, de zones d’habitat privé parfois très favorisé ; d’autre part certains sites ont défini plus précisément la géographie prioritaire sur les zones ciblées, et donc ne peuvent pas utiliser pertinemment les données produites à l’échelle de l’IRIS.
d) À l’échelle des quartiers, une approche qualitative généralement riche mais peu opératoire
Les acteurs locaux ont une bonne connaissance des territoires, mais qui remonte d’observations/de dires des opérateurs sur le terrain généralement.
2. Une approche essentiellement qualitative des résultats due à une quantification peu éclairante
a) Une difficulté à concevoir et à mesurer les résultats par le biais d’indicateurs quantitatifs
De manière systématique, on retrouve au sein des différentes évaluations des indicateurs quantitatifs liés aux financements et aux actions par thématique. On retrouve alors les indicateurs suivants :
- financements par thématique
- financements par année
- nombre d’actions par thématique et par année
Certaines évaluations précisent le financement par action. De manière moins fréquente, on retrouve des informations sur le nombre de bénéficiaires, (parfois leur sexe et la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent), ainsi que des informations concernant les réalisations par territoire prioritaire.
L’évaluation du CUCS d’un site de type 5 constitue un exemple de recherche systématique d’indicateurs quantitatifs lorsqu’ils sont disponibles. Sous la forme d’un rapport d’évaluation de 514 pages, le CUCS a fait l’objet d’une attention particulière en termes d’évaluation. Cette évaluation se fonde sur une première approche par territoire. On y trouve les indicateurs quantitatifs suivants : nombre d’actions par année et par territoire, montant des actions financées par année et par territoire, montant moyen des actions par territoires, financement thématique par financeur par territoire, la répartition entre action nouvelles et actions reconduites par année et par territoire. La seconde approche par thématique est plus ou moins détaillée selon l’importance du volet. Cette partie aborde des questions précises propres à chaque thématique (« zoom »). Pour chaque volet les financements et le nombre d’actions sont déclinés par territoire. Le principal volet – éducation – a fait l’objet de l’analyse la plus détaillée et permet d’obtenir des « ordres de grandeurs quant aux résultats du volet en termes de bénéficiaires et d’emplois directement créées (voir encadré).
Les éléments quantitatifs du volet éducation sur un site de type 5
L’évaluation du CUCS est l’exemple d’une démarche évaluative rigoureuse à même de présenter des éléments chiffrés. Bien que les informations mobilisées soient assorties d’une précaution sur la fiabilité des données, elles font ressortir des informations lisibles :
Le nombre d’enfants bénéficiaires de l’accompagnement à la scolarité
« - plus de 8 000 enfants pour l’accueil des plus fragiles,
- près de 14 000 enfants pour l’objectif de développement des actions éducatives de proximité (lecture/écriture),
- près de 5 000 enfants pour l’accompagnement en termes de réussite éducative » (p. 436)
L’estimation du nombre d’emploi représenté par les actions éducatives par grand territoire.
« - [Quartier 1] : 29 ETP
- [Quartier 3] : 19 ETP
- [Quartier 4] : 22 ETP
- [Quartier 5] : 7 ETP
Soit un total de 77 ETP/an en moyenne. »
- le nombre d’enfants dont la situation a été examinée par les équipes du PRE : 394
- le nombre d’enfants inscrits dans un parcours éducatif du PRE : 165, 249 et 221 enfants sont inscrits dans un parcours en 2007, 2008 et 2009.
Au-delà de ces indicateurs, les quantifications des résultats sont rares et hétérogènes. Plusieurs évaluations renseignent des informations liées au personnel d’encadrement des actions : la formation du personnel, les coûts de personnel dans le coût global des actions ou le taux de bénévolat. L’évaluation du CUCS d’un site de type 3 renseigne également le taux de renouvellement des actions selon l’opérateur (association, collectivité, organisme public).
Les indicateurs de chaque thématique ne sont pas homogènes entre les différentes évaluations. Seul le volet emploi fait l’objet de quelques indicateurs quantitatifs réguliers. Parmi les indicateurs des réalisations liés au volet, on peut trouver :
- le nombre de personnes insérées professionnellement de manière durable à la suite d’un chantier de réinsertion est ainsi occasionnellement renseigné ;
- le nombre de personnes embauchées ou équivalents temps plein conclus au profit de publics prioritaires ou concernés par la clause d’insertion.
Les autres volets ne font l’objet d’aucun indicateur systématique. Souvent déclinés en fonction de sous-objectifs propres au CUCS, les indicateurs de réalisations sont renseignés au cas par cas.
b) Une approche qualitative hétérogène
Les approches des résultats sont essentiellement qualitatives, fondées sur des impressions d’acteurs. La diversité des actions et des situations qui leurs sont liées conduit souvent à des approches monographiques par thème, parfois par action. Les évaluations de trois sites se fondent essentiellement sur des descriptions qualitatives de ce qui a été réalisé et les résultats selon la perception d’acteurs. Les informations sont peu chiffrées et subjectives ; « mobilisation limitées du monde économique » ; « ambition chez les porteurs de projets d’innover » ; « confiance » des familles bénéficiaires dans les institutions, ou encore implications des partenaires, maillage des actions, nouvelles initiatives générées.
Les approches qualitatives permettent également de s’interroger sur la cohérence des actions. C’est à ce moment que sont réinterrogées les actions au vu des objectifs initiaux, parfois selon des déclinaisons fines entre objectifs principaux, objectifs intermédiaires et objectifs opérationnels qui font l’objet d’une approche détaillée ou synthétique sous forme de tableaux.
L’évaluation du CUCS d’un site de type 3 constitue un exemple intéressant de formulation des résultats. Les informations relatives aux actions de deux volets sont présentées selon les critères suivants : cohérence, pertinence, efficience, efficacité et impact. Ainsi, les résultats sont abordés au en termes d’efficacité, selon des informations qui mêlent quantitatif (participation des habitants) et qualitatif, et sont présentés sous forme de notes sur 10, 15 ou 20 selon le nombre d’indicateurs. Cette technique ne constitue pas une approche plus objective, mais le caractère synthétique de l’information permet d’attirer l’attention sur les réussites et les points faibles de la démarche. Elle constitue ainsi un dispositif d’animation intéressant pour faire partager un constat.
Dans l’approche qualitative, la dimension participative de l’évaluation est à prendre en compte. L’exemple d’un site de type 5 est instructif. La CA a rassemblé de nombreux acteurs institutionnels au sein d’un forum des politiques de la ville. Les comptes-rendus ne font guère ressortir d’informations précises sur les réalisations où les résultats, néanmoins pour chaque action des consensus semblent émerger sur la perception de l’action.
Un bon usage des questionnaires est riche d’enseignements en termes de résultats. Plusieurs sites ont fait un usage différent de cet outil et les questionnaires s’avèrent plus ou moins révélateurs pour saisir les résultats des actions. L’évaluation du CUCS d’un site de type 3 fait quant à elle ressortir que 77 participants interrogés sur 78 se prononcent pour une reconduction de l’action concernée. Un tel résultat s’avère biaisé par l’implication même des personnes interrogées dans le dispositif, un résultat contraire eut été surprenant. Plus instructif, un autre site de type 3 a mené deux enquêtes de satisfaction auprès des habitants des quartiers prioritaires en 2002 et 2009. De cette manière, les enquêtes menées permettent de faire ressortir des informations déterminantes – entre résultat et impact – quant à la perception des habitants des actions menées et son évolution. Des constats majeurs se dégagent selon trois thèmes abordés : perception des changements, vie du quartier et sécurité au sein du quartier.
– un sentiment d’amélioration globalement en hausse (36% en 2002 à 42% en 2009), essentiellement lié aux travaux de voirie, néanmoins contrasté selon les quartiers.
– une perception de vivre dans un quartier « aussi bien que les autres » majoritaire (92% en 2009) et une perception inverse liée principalement aux « problèmes avec la population (manque de civisme, de convivialité) ».
Il y a presque autant de manières de rendre compte des résultats qu’il y a d’évaluations. Il existe un socle quantitatif commun où l’on retrouve les informations directement disponibles liées aux financements (par année, par thématique). Les évaluations présentent peu d’indicateurs quantitatifs qui puissent faire l’objet de comparaisons. La pratique de l’évaluation des résultats et les indicateurs utilisés dépendent du type d’évaluation mise en œuvre. Les résultats sont surtout interprétés en termes d’effet sur les changements de pratiques et les informations relatives aux changements de situations des bénéficiaires sont rares. Cette approche essentiellement qualitative est à lier parallèlement à l’injonction régulièrement rappelée dans les différents documents d’évaluation de « s’adapter aux caractéristiques du territoire ».
L’évaluation est une démarche de connaissance et d’intelligence collectives : elle est un acquis fort de la politique de la ville, qui permet d’en gérer la complexité. Lorsqu’elle est correctement mise en œuvre, elle permet d’établir une stratégie commune durable et mobilisatrice.
Mais un décalage de périodicité entre la production de données statistique et le temps de l’action rend nécessaire la production d’outils de suivi-évaluation dynamiques.
D’une manière générale, on observe une montée en compétence dans le pilotage et la mise en œuvre des évaluations, et un investissement croissant des acteurs Politique de la Ville dans les actions de suivi. L’absence d’utilisation d’indicateurs d’état des territoires semble témoigner à la fois d’un manque de volontarisme et de difficultés techniques particulières.
DEUXIÈME PARTIE -
LES RÉSULTATS DES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : ANALYSE THÉMATIQUE
Que disent les évaluations des résultats et des impacts obtenus par l’action des CUCS ? L’impact étant la conséquence à terme du résultat, répondant à l’objectif stratégique ; le résultat étant le produit de l’action et répondant à l’objectif opérationnel.
Il convient ici de distinguer les résultats tangibles des résultats intangibles qui sont présentés au point C. de la présente partie, et dans la 3ème partie. Les résultats tangibles sont les conséquences immédiates, concrètes et observables sur les publics et sur les quartiers bénéficiaires des actions. Les résultats intangibles sont plus immatériels et perceptibles dans l’organisation et les modes d’action, dans la sensibilisation des acteurs et des publics, dans l’effet de priorisation obtenu en faveur des quartiers.
Les résultats concrets devaient normalement être recensés et repérés à l’occasion du bilan des actions qui, selon la circulaire de 2006, devait permettre les évaluations triennales.
Ils devaient également être quantifiés et ainsi mis en regard avec les objectifs opérationnels qui eux-mêmes devaient être quantifiés, de manière à apprécier le degré de réalisation des objectifs.
Peu d’évaluations précisent des chiffres consolidés. Certaines cependant s’y attachent avec succès. Les attentes exprimées par le guide de l’évaluation des CUCS n’ont à cet égard guère été reprises par les cahiers des charges des commandes d’évaluation, les prescriptions de la circulaire n’ayant pu être toujours mises en œuvre. Entre autres et surtout, les objectifs opérationnels n’ont pratiquement jamais été chiffrés.
Parfois, parce que le chiffrage n’aurait de pertinence que par rapport à des enjeux eux-mêmes bien quantifiés… ce qui n’a guère été possible par manque d’implication des organismes détenteurs des données locales (CAF, SPE, Conseil général, bailleurs sociaux etc.), ou même par manque de partenariat effectif avec ceux-ci. Mais peut-être ce chiffrage n’a pas été voulu dans certains cas. Ici apparaît l’affrontement entre deux approches de l’efficacité, très clivées : les tenants d’une efficacité résolument quantifiable et ceux d’une efficacité non quantifiable. On ne peut ignorer que cette confrontation recouvre une certaine ligne de fracture idéologique. Et parfois, l’absence de quantification peut répondre au refus de voir subordonner les financements aux résultats chiffrés obtenus.
Ce refus, rarement exprimé, en tout cas non écrit, s’appuie aussi sur la conviction partagée par beaucoup d’acteurs de la politique de la ville de la non pertinence d’objectifs par définition irréalistes : la politique de la ville ne pourra pas opérer le « rattrapage » de nombreux quartiers et de leurs habitants, le « raccrochage » de ces quartiers à leur ville que la mesure suivie des écarts à l’unité urbaine est supposée décrire. À l’égard de certains quartiers en situation d’écart extrême, présentant une concentration très élevée de pauvreté et de précarité, l’action des CUCS n’est plus même de l’ordre du curatif, mais de l’ordre des « soins palliatifs ». Et les effets du renouvellement urbain n’étant envisagés qu’à long terme, ses actions ne peuvent que réduire ou retarder l’aggravation, mais non améliorer la situation. Nombre d’acteurs disent que les CUCS ne peuvent qu’amortir les effets de la dernière crise économique et financière de 2008, comme les contrats de ville précédents ont amorti les effets des crises successives depuis les années 80.
Ces observations pourraient conduire à interroger la forme et le principe de l’instrument de la politique de la ville qu’est le contrat urbain de cohésion sociale, et la manière dont les CUCS sont rédigés : certes ils ne peuvent que présenter des objectifs formulés en termes positifs, mais lorsque ceux-ci paraissent incantatoires, ils n’entraînent pas l’adhésion ni la mobilisation des acteurs et des opérateurs. Au mieux, simplement ignoré, le contrat est une déclaration d’intention et non une feuille de route pour l’action. Au pire, il démotive par l’écart entre les « belles intentions » et l’impossibilité de les mettre en œuvre. Là encore, un effort de mesure des enjeux doit permettre d’ajuster les objectifs aux problématiques du quartier.
L’appréciation des résultats doit s’opérer en outre à la lumière d’un facteur temps qui joue fortement et de manière contrastée. La politique de la ville combine dans l’espace des interventions multiples mais elle les combine également dans le temps. Elle agit sur le temps long – celui de l’urbain, de la transformation de la ville –, elle agit sur le temps court, du vécu présent des habitants – celui des politiques « curatives » : l’éducation, l’insertion, la santé, la prévention –, et elle agit sur un temps intermédiaire, celui de la prévention d’une dégradation sociale et urbaine qui menace certains nouveaux quartiers – et menace même les progrès effectués sur d’anciens quartiers pourtant améliorés.
Dans ces trois dimensions temporelles, la mesure du réalisé, la quantification des résultats bruts des actions, l’appréciation qualitative de ces résultats, ne peuvent contribuer par eux-mêmes à la mesure d’impacts quantitatifs.
Pourtant dans de nombreux quartiers bénéficiaires, les améliorations sont notables, perceptibles et relatées ; mais sur le mode qualitatif seulement. Un croisement des dires d’acteurs permet de qualifier l’amélioration ; mais d’une part, celle-ci ne saurait être avec certitude imputée à l’action du CUCS, et d’autre part rien ne permet de dire la durée de l’amélioration perçue.
La présente partie tend à mettre en perspective l’intentionnalité collective exprimée par les objectifs du contrat et leurs réalisations, les résultats, quand ils sont disponibles, étant une dimension du réalisé ; et donne une première approche des impacts, abordés par une petite minorité de sites.
On observe que l’existence d’une stratégie commune définie à partir d’une connaissance fine du territoire et de ses enjeux, conditionne l’efficacité de la politique de la ville.
En interrogeant la pertinence des échelles d’intervention et de stratégie d’action, on observe que si la stratégie d’action doit bien porter sur le quartier, elle ne peut être réellement efficace que si elle s’inscrit dans une stratégie plus globale à l’échelle de la ville pour le moins, de l’agglomération le plus souvent, du bassin – bassin de vie, bassin d’activité et d’emploi – parfois. Dès lors, les stratégies d’action efficaces combineront logique d’urbanisme de quartier et logique de cohésion sociale et territoriale, alors que les CUCS concentrés sur les quartiers réduisent leur capacité de résultat.
À l’échelle du territoire d’intervention, doit répondre l’échelle de mobilisation des acteurs publics et de production de la stratégie : les cocontractants principaux sont historiquement les mêmes depuis l’origine de la contractualisation, mais ils ne sont pas forcement ceux qui s’impliquent ni dans l’élaboration de la stratégie d’action ni dans sa mise en œuvre. Les CUCS qui produisent des résultats significatifs – et qui d’ailleurs mobilisent des moyens – sont ceux qui sont portés par les maires et présidents d’EPCI en interaction étroite avec le représentant de l’État personnellement impliqué. Ce cas ne s’observe au demeurant que si le PRU est fortement intégré au CUCS, les deux dispositifs fonctionnant en synergie et mobilisant des compétences à différentes échelles.
La mobilisation des politiques de droit commun de l’État et des collectivités se fera également en proportion de l’implication personnelle des signataires, ce qui rend cette mobilisation rare et très inégale. Lorsque le préfet prend personnellement en main les CUCS de son département, le niveau homologue dans les collectivités s’implique. Et, presque automatiquement, les liens sont faits entre le CUCS et les autres documents cadre des politiques de l’État, de la région, du département et de l’EPCI, parfois contractuels et partenariaux, tous résultant d’une concertation État-collectivités. Mais sans cette implication personnelle des signataires, il est rare que la cohérence entre le CUCS et les documents cadre de ces politiques soit recherchée aux différentes échelles : régionale (CPER, SRADDT, SRDE, PRDF par exemple), départementale (PDALPD, PDI par exemple), territoriale (contrat d’agglomération, PLH, PDU, PLI, par exemple). Ceci ne permet pas la prise en compte réciproque de ces politiques par le CUCS et du CUCS par ces politiques. Les leviers d’activation des moyens de droit commun sont réduits d’autant, la capacité de résultat de l’action spécifique sur les quartiers aussi.
On voit que la réflexion sur la stratégie d’action, et les échelles d’intervention et de mobilisation anticipe et détermine celle de la gouvernance et du pilotage traitée dans la 3ème partie. Eu égard à la conception de la stratégie, la question du « chef d’orchestre » de la politique de la ville, de sa capacité effective à mettre en musique les partenaires autour d’une partition commune, n’a généralement pas été posée. Au demeurant, les textes des CUCS ont pour la plupart respecté la demande des circulaires de prévoir le pilotage et l’ingénierie. Mais la mise en œuvre des CUCS montre qu’il y a parfois un écart important entre le texte et son application et qu’il n’a pas toujours été donné au pilotage la capacité de fédérer et d’agir.
Enfin, se pose la question de l’échelle pertinente pour permettre de dégager des « économies d’échelle » en termes de stratégie et de gestion. Sur ce thème, on observe que l’intercommunalité peut être mobilisée efficacement en particulier dans le cas des petites et moyennes villes. Dans ce cas, la faible démographie et la nécessité de connecter les quartiers au bassin de vie rendent possible voire nécessaire la gestion stratégique et opérationnelle des actions menées sur les quartiers à ce niveau.
Les intercommunalités difficiles à structurer autour de villes moyennes importantes portent plus difficilement le CUCS, qui pourtant trouve toute sa pertinence à cette échelle : on observe des divergences tant dans les objectifs que dans sa gestion effective. Les négociations intercommunales difficiles freinent le développement d’une pensée stratégique et donc la pertinence du projet.
Le portage par les grandes communautés d’agglomération et urbaines appelle une gouvernance complexe : la dominante communale s’impose par la présence d’une grande ville-centre bien sûr mais aussi parce que les communes périphériques ont une histoire et une identité de communes urbaines importantes : dès lors si l’EPCI trouve le mode de régulation des équilibres entre les identités urbaines, met le curseur sur le juste point d’équilibre entre le respect de ces entités politiques et la nécessité communautaire, une gouvernance fédératrice est possible ; sinon, il est limité dans son efficacité : au pire, les communes tendent à le réduire à un guichet de financement ; au mieux, il devient le gestionnaire délégué du CUCS au profit des communes.
A. L’ARCHITECTURE DES CUCS ET LA DÉCLINAISON DES VOLETS THÉMATIQUES EN OBJECTIFS : L’ARCHITECTURE DU CUCS EST LE REFLET DES STRATÉGIES CONJOINTES OU DISJOINTES DE L’ÉTAT ET DES PARTENAIRES
La loi du 1er août 2003, dans ses articles 1 et 2, références de la circulaire de mai 2006, dispose :
« Chapitre Ier - Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles
Article 1 : « En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en œuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un représentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant des sociétés d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi. Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 2 - Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national. »
La circulaire du 24 mai 2006 précise :
« Le contrat urbain de cohésion sociale comporte :
Ÿ un projet urbain de cohésion sociale, visant l'ensemble des objectifs de résultat définis aux articles 1 et 2 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (annexe1) pour l'amélioration de la vie quotidienne et la promotion de l'égalité des chances des habitants et la meilleure intégration de ces quartiers dans la ville et l'agglomération ;
Ÿ des programmes d'actions pluriannuels déclinant ce projet sur des champs et des quartiers prioritaires, avec des objectifs précis, lisibles et directement évaluables et précisant les engagements de chacun des partenaires, tant dans le cadre de leurs politiques de droit commun que des moyens spécifiques dédiés à ces quartiers. L'annexe 2 précise la structure impérative du contrat ;
Ÿ les modalités de mise en œuvre, d'évaluation, de suivi et d'adaptation du projet urbain de cohésion sociale et des programmes d’action. »
Et encore :
« Ce contrat prendra en compte tant les politiques structurelles développées à l'échelle communale ou intercommunale influant sur la situation des quartiers (emploi, développement économique, transport, habitat et peuplement, politique éducative et culturelle, santé, insertion sociale) que les actions conduites au sein même de ces quartiers pour améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants. Il intégrera et mettra en cohérence l'ensemble des dispositifs existant sur le territoire concerné et concourant aux objectifs prioritaires fixés, quelle que soit leur échelle d'intervention : convention de rénovation urbaine, programme local de l'habitat (PLH), zones franches urbaines (ZFU), plan local d'insertion par l'économie (PLIE), équipe de réussite éducative (ERE), contrat éducatif local (EL), Ecole ouverte, contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS), contrats d'éducation artistique, illettrisme, atelier santé ville, (ASV), réseaux d'accès aux droits, contrat local de sécurité (CLS), Ville-vie-vacances (VVV), chartes de cohésion sociale. C'est donc bien un contrat global et cohérent qui est proposé. »
D’où il ressort que l’architecture théorique d’un contrat urbain de cohésion sociale peut être figurée de la manière suivante (cf. schéma page suivante). Un projet de développement social urbain présente une stratégie globale d’action commune des partenaires sur les quartiers de la géographie prioritaire. Cette stratégie se décline en au moins cinq programmes d’action thématiques dont les finalités convergentes sont formulées dans le projet urbain de cohésion sociale ; et dont les mises en œuvre sont articulées dans le cadre du pilotage global du CUCS. S’y ajoutent des thématiques optionnelles traitées soit de manière transversale aux cinq volets prioritaire soit de manière autonome.

Le modèle mis au point en 2006 était supposé rationaliser le modèle antérieur du contrat de ville dont les thématiques n’étaient pas normalisées, dont les contenus pouvaient être très disparates, et dont les résultats et les impacts étaient peu ou pas « objectivables ». Le rapport de la Cour des Comptes de 2005 avait à cet égard tiré un signal d’alarme.
Il permettait d’organiser les interventions et leur financement en fonction d’abord des cinq priorités retenues par l’État tout en laissant l’initiative aux structures porteuses de thématiques particulières, traduisant à la fois des enjeux spécifiques et des modes d’action propres – mais que l’État ne financerait pas prioritairement. Il appelait à définir des stratégies d’action collectives périmétrées, simples et structurées ; et à les décliner en « programmes d’action » concrets sur des « objectifs de résultats » quantifiés et par conséquent mesurables. Il reliait l’ensemble aux opérations de rénovation urbaine mises en place par l’ANRU créée par la loi de 2003 ; celles-ci étaient ainsi appelées à devenir – du moins sur les sites concernés – les moteurs de la politique de la ville. Et les CUCS dont le volet « habitat et cadre de vie » était supposé abriter le PRU, avaient vocation à mieux coordonner l’ensemble des autres thématiques en appui de la transformation urbaine. D’une manière générale, le but recherché de l’organisation en cinq volets sous une stratégie commune était la convergence d’actions très coordonnées.
1. Généralement, une conformité à la circulaire du 24 mai 2006, mais développement d’un formalisme, une sorte de « conformisme » obligé pour bénéficier des crédits spécifiques
La très grande majorité des CUCS ont repris les cinq volets voulus par l’État. Seuls trois CUCS de l’échantillon n’ont pas repris l’ensemble des cinq thématiques.
De manière marginale, les acteurs locaux se sont appropriés les thématiques prioritaires de l’État et ont défini des volets en fonction de leurs priorités stratégiques locales. À titre d’exemple, une communauté d’agglomération propose une reformulation systématique et intègre les thématiques éducation, santé, sécurité et prise en charge de la grande précarité dans une priorité plus vaste « Assurer les conditions de la promotion sociale et de l’autonomie des individus ».
Par ailleurs, si la plupart des sites ont repris les cinq volets de la circulaire, certains sites ont ajusté les intitulés des thématiques en fonction de leurs priorités.
La thématique « Habitat et Cadre de vie » apparaît comme l’intitulé le plus fidèlement repris par les collectivités de l’échantillon. Dix-neuf des vingt sites de l’échantillon l’ont repris. Un site y a ajouté la « vie sociale ». Un autre site a séparé « aménagement urbain » et « proximité et cadre de vie ». Enfin, une collectivité propose une complète reformulation « Faire du renouvellement urbain un levier de la promotion sociale et de l’attractivité des territoires ».
La thématique « Santé » est également largement reprise dans les CUCS (quinze sites de l’échantillon). Ce volet est reformulé par quatre membres seulement (deux ne le citent pas). Un site l’inclus dans un volet « prévention et sécurité », deux sites l’associent à « la prévention », un site l’associe à l’» exclusion sociale ». Un autre enfin propose la santé comme l’un des quatre objectifs d’un axe plus vaste.
La thématique « Accès à l’emploi et développement économique » est intitulée ainsi par quatorze membres de l’échantillon. Huit intitulés s’articulent autour de l’emploi seul ou l’emploi et l’insertion et ne citent pas le développement économique. Un site fait apparaître uniquement le « développement économique ».
La thématique « citoyenneté et prévention de la délinquance » est inégalement reprise par les sites de l’échantillon : neuf sites ont adopté cet intitulé, tandis que onze s’en différencient (il n’en est pas fait mention sur un seul site). Un site intitule le volet « tranquillité publique, prévention de la délinquance et sécurité ». Quatre sites séparent en deux objectifs distincts « citoyenneté » et « lutte contre le délinquance ». La citoyenneté fait alors partie d’un volet à part entière ou plus vaste. Quatre sites articulent l’intitulé autour de la prévention et la sécurité. Deux sites y associent le « lien social » ou la culture. Un site le complète d’un volet distinct « Médiation sociale et accès aux droits » pour des raisons de répartition de compétences entre ville et communauté d’agglomération.
La « Réussite éducative » ou « l’éducation » sont évoqués dans quatorze intitulés. Cinq sites y associent le thème de la jeunesse. Deux sites y associent à l’éducation l’» égalité des chances » ou la « solidarité ». Un site y associe la « formation ».
La culture est un thème dont se sont emparés sept sites dans leur CUCS.
La lutte contre les discriminations ou l’égalité des chances font l’objet d’un axe transversal pour quatre sites de l’échantillon. Un site consacre un volet à la participation des habitants.
Enfin la lutte contre la précarité fait l’objet d’un volet pour 2 sites.
2. Soit le CUCS se moule dans les contraintes de l’État (cas majoritaire) mais les objectifs sont peu mis en œuvre
Comme évoqué précédemment, les CUCS comprennent les cinq thématiques de l’État, la plupart du temps. Toutefois, pour certains d’entre eux, les volets sont uniquement repris de manière formelle mais ne font pas l’objet d’un réajustement des objectifs stratégiques ni d’une déclinaison dans un programme d’action cohérent. C’est le cas sur un site de type 1 par exemple, où le CUCS est avant tout considéré comme une enveloppe financière. Les cinq volets sont présentés dans la convention cadre mais ne guident aucunement la programmation des actions.
On observe également dans quelques cas – qui restent marginaux – des sites qui présentent les cinq volets, mais où un plusieurs volets ne comportent aucune action. Des volets sont ainsi affichés mais restent vides. C’est le cas par exemple du CUCS d’un site de type 3 où la thématique « emploi-développement économique-insertion » ne fait l’objet que d’une action sur le thème de l’emploi, et d’aucune action concernant le développement économique.
3. Soit il s’investit dans les volets optionnels (minoritaire) pour amener les partenaires sur les priorités locales
Les collectivités porteuses du CUCS peuvent être amenées à définir des objectifs répondant à des priorités définies localement. L’élaboration de volets optionnels reprenant souvent des objectifs transversaux visent ainsi à mobiliser les moyens humains et financiers sur les enjeux prioritairement désignés. C’est par exemple le cas d’un site de type 3 où le volet « Prévention et lien social » contient des objectifs de santé, de citoyenneté, de prévention de la délinquance aussi bien que des actions culturelles, collective et de participation des habitants. Dans ce cas, le choix d’architecture est le résultat d’une déficience technique liée à l’absence de diagnostic et à une volonté politique de mobiliser les différents partenaires, par exemple autour du dispositif de REAAP dans le cadre du soutien à la parentalité ou du CLS, intégrés à ce volet.
B. LES OBJECTIFS : UNE FAIBLE PORTÉE STRATÉGIQUE ET UNE ORGANISATION THÉMATIQUE ASSEZ FORMELLE, DES PRIORITÉS AU FINAL SOUVENT SIMILAIRES
1. De la déclinaison formelle des objectifs de l’État à l’intégration réelle du CUCS dans un projet de territoire
La circulaire du délégué interministériel à la Ville du 5 juillet 2007 sur l’évaluation des contrats urbains de cohésion sociale stipule que l’évaluation doit se référer à la fois aux grands objectifs nationaux et aux projets locaux… ce qui implique que les CUCS eux-mêmes s’y réfèrent. Elle recommande également de « mettre en évidence l’inscription du CUCS dans un projet de territoire (projet d’agglomération, projet de Pays, etc.) ». Pour présenter une vertu stratégique et ne pas être un guichet de financement et de gestion locale, un CUCS devait formaliser la convergence entre la stratégie de l’État et la stratégie globale du territoire (quelle que soit sa forme ou son texte support) d’une part, décliner des objectifs respectifs à l’échelle des quartiers sous l’égide d’un projet urbain de cohésion social fixant des objectifs stratégiques à terme et apte à guider (sinon même à prescrire) la mobilisation des moyens d’autre part – et non à se laisser guider par les seuls consommateurs de ces moyens.
a) La définition d’un projet stratégique urbain décliné par thématique et par quartier non généralisée
Ÿ Les difficultés de définition d’une stratégie d’action commune
La très grande majorité des sites de l’échantillon n’a pas défini de « Projet Urbain de Cohésion Sociale » tel que mentionné dans la circulaire de 2006 (146).
On observe d’une part une relative méconnaissance du PUCS que devaient comporter les CUCS, et d’autre part, une certaine confusion entre ce projet global et l’organisation du CUCS en 5 volets thématiques, les thématiques étant alors comprises comme les objectifs stratégiques eux-mêmes.
Ainsi, un très faible nombre de CUCS comporte en amont de la définition des objectifs et des actions, une stratégie globale de développement social et urbain des quartiers, définie de manière collective sur la base d’une connaissance fine des difficultés et des potentiels des territoires et de leurs habitants.
Dans les rares cas où un projet est établi, celui-ci est davantage l’objet d’une validation par les partenaires que le fruit d’une véritable concertation et co-construction entre la collectivité et les services déconcentrés de l’État d’une part et, d’autre part, avec les autres partenaires du CUCS qui diffèrent selon les sites (région, département, CAF, bailleurs, etc.) (147).
Par ailleurs, lorsqu’une stratégie globale est définie, celle-ci est souvent restreinte à la durée de la première période de contractualisation du CUCS (2007-2009). D’une part la stratégie s’inscrit peu dans la continuité des précédents dispositifs de la politique de la ville et d’autre part celle-ci ne décline pas des objectifs à moyen et long terme. On observe ainsi une faible capitalisation de l’expérience des contrats de ville précédents. Par ailleurs, les nombreuses incertitudes des acteurs locaux quant à la reconduction de leur CUCS freinent leur capacité de projection des objectifs stratégiques au-delà de la durée du contrat.
Enfin, l’absence de définition d’un projet global ne permet pas d’organiser les dispositifs, actions et interventions de la politique de la ville sur le territoire et la vocation initiale de fédération du CUCS est rarement assurée.
Ÿ L’absence de déclinaisons en projets de territoire
De manière générale, on observe peu de projets déclinés aux différentes échelles de territoire.
Si la plupart des CUCS intercommunaux ont défini des orientations stratégiques par commune, peu de CUCS ont défini un projet global de territoire décliné ensuite en fonction des caractéristiques particulières des quartiers. À l’inverse, on observe parfois une difficulté à raisonner à une échelle plus large que celle des quartiers. À titre d’exemple, les acteurs d’un site de type 3 font observer une difficulté à définir une vision stratégique globale à l’échelle de la communauté d’agglomération à la suite de la prise de compétence politique de la ville en 2001. Les acteurs soulignent la nécessité de redéfinir un projet de territoire global déclinant ensuite des orientations par territoire.
Par ailleurs, selon les thématiques, certaines échelles de territoire apparaissent plus pertinentes que d’autres pour la définition d’objectifs stratégiques. En effet, quand certaines thématiques appelleront une prise en charge globale à l’échelle intercommunale, d’autres nécessiteront davantage une logique de proximité et une réponse plus locale (voir 3eme partie B 2 b).
Ÿ Une variante relativement fréquente : des projets formalisés mais non mis en œuvre
Si dans quelques cas, les conventions cadres font apparaître une stratégie globale de développement social et urbain des quartiers, les résultats des évaluations et les dires des acteurs consultés montrent que celle-ci n’a pas été mise en œuvre. À l’inverse, des lignes stratégiques ont parfois été mises en avant par les partenaires, lors des comités de pilotage du CUCS notamment, et influent sur la programmation du CUCS, mais celles-ci ne sont pas véritablement formalisées en amont des conventions-cadre des CUCS.
Ÿ Un dialogue État-collectivités souvent hésitant, parfois tendu, rarement consensuel
La qualité du dialogue entre l’État local et la structure porteuse du CUCS, ainsi que ses communes membres si celles-ci sont réunies dans un EPCI, est au cœur de l’enjeu rappelé plus haut d’une convergence entre la stratégie de l’État au plan national et la stratégie et/ou l’action locales. Il est aussi la condition d’un CUCS à vraie valeur contractuelle. C’est le cas, une fois encore lorsque la collectivité ou la structure porteuse est dotée d’une stratégie de territoire qui commande la mobilisation de moyens sur la géographie prioritaire : dans ce cas, la rencontre avec les objectifs des politiques nationales, se fait aisément d’autant que ces objectifs – peut-être formulés différemment – sont déjà ceux de la collectivité ou de l’EPCI. Mais le cas le plus répandu est celui d’une prudence par laquelle le niveau stratégique « laisse faire » le niveau opérationnel, niveau auquel l’accord se fait, mais par thématique et par quartier, non globalement ni transversalement. Dans ce cas, l’engagement se fait de manière opérationnelle dans le cadre d’une démarche pratique mais non stratégique comme c’est le cas sur des petits territoires de type 1.
Dans certains cas, on observe un désaccord sur la « philosophie » du CUCS, une dénonciation du retrait de l’État, et de ses financements, la critique d’une approche trop urbaine (et pas assez sociale), ou d’une approche « sécuritariste » ; ce qui entraîne une dialogue tendu qui peut réduire l’engagement contractuel.
Ÿ Deux postures caractéristiques du rapport à l’État des structures porteuses : les « attentistes » et les « proactifs »
Face aux transformations institutionnelles récemment actées à l’échelle nationale (passage de la DIV au SG-CIV, création de directions régionales de la cohésion sociale, etc.) et dans un contexte de concertation sur les orientations futures de la politique de la ville, les collectivités porteuses du CUCS (ville ou agglomération) ont adopté deux types de postures.
D’une part, les craintes et incertitudes quant au renouvellement de la contractualisation, à la pérennité de la géographie prioritaire et à la possibilité de continuer à financer les projets, ont fragilisé certaines collectivités porteuses et freiné leur capacité de projection dans un projet à long terme. Celles-ci sont dans une posture « d’attente » de décisions nationales. Les évaluations ainsi que les acteurs consultés montrent que les collectivités porteuses du CUCS sont en attente d’une plus grande cohérence de la politique étatique qui viendrait appuyer une stratégie de long terme. Les inquiétudes conduisent à un certain essoufflement des initiatives locales et à une certaine démotivation des équipes de projet. La reconduction des projets d’une programmation à l’autre prévaut sur l’expérimentation de nouvelles actions et l’on observe une certaine logique de guichet au détriment d’une dynamique de projet.
D’autre part, certaines collectivités porteuses du CUCS ont adopté une posture davantage « proactive » dans leur rapport à l’État, s’appuyant sur une stratégie locale forte. Face au flou entourant les engagements futurs de l’État, certaines collectivités ont décidé d’avancer de façon plus autonome. Ainsi sur un site de type 4, les élus ont validé le principe d’élaborer un projet territorial de cohésion sociale, véritable document stratégique dans lequel viendrait s’inscrire le futur CUCS, mais qui anticipe une éventuelle disparition de la géographie prioritaire, voire le non-renouvellement de la contractualisation et la non-reconduction des crédits exceptionnels. Parallèlement, la région est sollicitée pour engager la même démarche et pour s’accorder sur des priorités communes. Par ailleurs, la commune a fait le choix délibéré de s’affranchir des thématiques de l’État, le PUCS étant présenté en termes d’objectifs.
b) Une articulation à un projet global de territoire généralement défaillante
De manière générale, le PUCS, lorsqu’il existe, est rarement coordonné avec un projet plus global de territoire : projet d’agglomération et/ou projet de ville.
Si certains CUCS font référence à un projet d’agglomération, cela ne conduit généralement pas à une coordination effective entre les deux projets et à la définition de finalités structurantes. Dans un cas de l’échantillon, il semble que le CUCS aurait gagné à une coordination avec un Parc Naturel Régional.
Dans de rares cas, le projet d’agglomération est susceptible de structurer la stratégie du CUCS autour de finalités intégratrices.

Ÿ Cas 1. Absence de vision stratégique
Ce premier cas de figure regroupe les CUCS correspondant à une mise en application stricte de la circulaire de l’État. Les cinq orientations thématiques sont reprises de manière formelle et seuls les grands objectifs fondamentaux de la circulaire sont mis en évidence, au détriment d’objectifs stratégiques ajustés aux problématiques spécifiques du territoire.
Plusieurs sites partagent plusieurs des aspects qui suivent. Un site de type 3 les totalise.
Le CUCS apparaît comme un dispositif parmi d’autres, un outil et une enveloppe financière. Sa vocation à organiser la politique de la ville sur le territoire, et à fédérer les dispositifs spécifiques et de droit commun, est perdue de vue. Le CUCS, le PRU et le PRE, notamment, fonctionnent en autonomie. L’ASV émergent doit s’affirmer seul. Les dispositifs de l’emploi et de l’insertion de même. Ils sont dénués de liens avec la politique de développement économique, quand elle existe. On voit des ZFU rendues inopérantes par cette situation. Tout dépend de la compétence et de l’initiative de quelques techniciens référents sur telle ou telle thématique.
Le portage politique est pauvre : parfois des élus récents ni informés ni formés, qui paraissent perdus dans la jungle des sigles et qui cherchent pourtant à s’affirmer, souvent des élus de faible poids dont la désignation traduit l’intérêt marginal du CUCS pour le Maire ou le Président de l’EPCI pour qui le CUCS est une réserve de subventions aux associations sportives, de loisir pour la jeunesse, et de quartier. Le partenariat est peu dynamique : sans moteur les partenaires restent inertes, investis au mieux seulement chacun dans sa thématique, au pire contestant ouvertement l’utilité du CUCS, consommateur de temps et d’énergie. Les comités de pilotage ne portent pas sur des orientations communes et sur la définition d’objectifs spécifiquement qualifiés et quantifiés.
L’État n’intervient pas au niveau attendu. Les comités de pilotage sont des séances de travail de comités techniques de programmation. Un sous-préfet par exemple discute à l’euro près des subventions aux associations, une par une, atomisant un peu plus le saupoudrage, en accord avec des élus référents soucieux de garantir des promesses de subvention à de petites associations de quartier. Le délégué du préfet, nouvellement nommé, sans expérience de la politique de la ville, et non formé, n’intervient pas. Le travail préparatoire des techniciens est contredit comme les objectifs des documents-cadre ; alors qu’ils attendent des directives à six mois, en cohérence avec les autres politiques de la municipalité et de l’État sur les quartiers, et des observations sur l’évolution des quartiers, en fonction d’une vision à terme – qui n’existe pas.
Les collectivités et EPCI porteurs sont la plupart du temps dans une posture d’attente par rapport à l’État, et les incertitudes liées aux engagements financiers de l’État contribuent à vider de sens une dynamique de projet qui a pu pourtant exister dans le passé. La démotivation est sensible parmi les équipes opérationnelles.
La culture de l’évaluation est absente, marginalisée ou oubliée ; l’évaluation, incomprise et redoutée, est un exercice formel pour maintenir des subventions. Un évaluateur faible, bouc émissaire des frustrations des acteurs, deviendrait manipulable.
Dans ce cas de figure, les freins à l’efficacité des actions, sont multiples. L’absence de stratégie et de portage conduit à une forte reconduction des projets d’une année à l’autre au détriment du financement de nouvelles actions expérimentales et innovantes. Par ailleurs, les moyens ne sont pas ciblés sur les actions les plus pertinentes au regard des enjeux. La logique de guichet prévaut sur la logique de projet et l’on dissémine des financements à des associations « sous oxygène ».
Toutefois, on compte quelques facteurs d’efficacité. L’absence de stratégie limite d’éventuels désaccords entre les partenaires et permet une mise en œuvre des actions de quartiers, certes très formelle, mais fluide grâce à l’implication des opérateurs de terrain.
Ÿ Cas 2 : Définition de grands objectifs stratégiques non formalisés
À la différence du cas précédent où la pensée stratégique est absente, on observe l’émergence d’une volonté de stratégie, reposant sur le besoin ressenti par les acteurs de « plus de stratégie ». Mais sans culture stratégique homogène et partagée, cette volonté encore confuse peine à aboutir. Le hiatus est souvent entre chef de projet ou directeur de la politique de la ville ou partenaires de l’État (singulièrement DDE) d’une part, et les élus d’autre part, ces derniers ne présentant pas leur vision à terme des quartiers, en cohérence avec un Projet de territoire porté par exemple par le contrat d’agglomération ou un « contrat de mandature » quand il existe. Ou bien, élus récemment, ils ne s’approprient pas ou ne reconnaissent pas la validité du Projet antérieur, sans en avoir (encore) un à lui substituer.
Des lignes apparemment stratégiques ont été définies par les partenaires, mais aucun projet n’a été formalisé dans un document à vraie portée stratégique. Il s’agit le plus souvent d’objectifs partagés de manière quasiment implicite par les acteurs, à partir d’une connaissance empirique des problématiques des quartiers prioritaires et de leurs habitants.
Ces grands objectifs ne se retrouvent pas véritablement dans le CUCS, et ne sont généralement pas mis en œuvre de manière effective, faute d’un diagnostic précis permettant la définition d’objectifs et d’actions ciblés. Dans ce cas de figure, on observe également une compréhension inégale de la notion de Projet de cohésion urbaine et sociale, avec des éléments de langage non stabilisés, non homogènes et non mutualisés. À titre d’exemple, on note une confusion entre la définition d’une stratégie et la priorisation des cinq thématiques de la circulaire.
Les volets du CUCS et leurs dispositifs sont dispersés, et tendent à l’autonomie. Le PRU est déconnecté. La logique de guichet persiste malgré les tentatives antérieures de passer à la logique de projet. La « fidélisation » des associations est plus forte que la nécessité de prioriser.
Dans ce cas de figure, parmi les facteurs d’efficacité des actions, on compte un dialogue partenarial généralement de qualité, malgré une déconnexion avec la mise en œuvre opérationnelle et l’absence de mutualisation effective des moyens permettant de répondre aux grands objectifs.
Au regard de l’échantillon, on observe que ce cas de figure concerne plus particulièrement les sites de type 2, soit des villes petites ou moyenne dans un système urbain/en orbite métropolitaine. Les éléments de contexte caractérisant ces sites permettent d’aboutir à une action efficace malgré un défaut de stratégie. Entre autres, la taille limitée, et le petit nombre de quartiers CUCS de ce type de site, permet une certaine proximité des acteurs et un lien plus étroit entre les acteurs stratégiques et les techniciens, et ainsi une certaine fluidité des décisions et des actions. Ces sites présentent par ailleurs des quartiers à problématiques urbaines et sociales moins fortes que les grands quartiers d’habitat sociale ou les grands centre ville dégradés.
Ÿ Cas 3 : Absence d’accord sur une stratégie commune
Des volontés stratégiques existent ainsi qu’une pensée stratégique, mais l’absence de consensus entre les différents partenaires du CUCS ayant formulé des priorités, freine voire bloque la définition d’un projet commun.
Il peut exister des désaccords notamment entre l’EPCI / collectivité porteur et l’État local (préfecture, sous-préfecture, services déconcentrés). Le plus souvent, les collectivités porteuses reprochent aux services de l’État leur manque d’implication et d’accompagnement au-delà des seuls engagements financiers perçus comme en rétraction et insuffisants. De leurs côtés, les services déconcentrés de l’État considèrent qu’il incombe à la collectivité de définir son projet local, et sont en attente du projet et d’une impulsion stratégique de la part de la collectivité, pour ensuite prendre position. Dans ce contexte où chacun attend l’autre, s’ajoutent des difficultés de dialogue, d’où découle une absence de cohérence entre les objectifs ; un cercle vicieux bloque la possibilité de travailler sur un projet commun. À titre d’exemple, un site de type 5 souligne des difficultés à dialoguer avec les acteurs de l’État et à s’entendre sur des priorités stratégiques. Or la communauté urbaine souligne la nécessité fondamentale d’avancer avec l’État, entre autres, du fait de ses engagements financiers incontournables.
L’absence de stratégie peut également être le résultat d’un désaccord entre l’intercommunalité et une ou plusieurs communes. Le CUCS est parfois porté politiquement et mis en œuvre par une commune, alors même que l’intercommunalité a la compétence politique de la ville. Par ailleurs, dans le cas d’un CUCS intercommunal, les désaccords entre la ville centre et une ou plusieurs villes périphériques peuvent représenter un frein à la définition d’un projet commun, les problématiques de la ville centre étant parfois très éloignées de celles des autres communes, souvent rurales. Autre cas fréquent, on note un déphasage entre l’action intercommunale et le CUCS, alors même que l’intercommunalité exerce des compétences qui concernent directement le CUCS, notamment l’emploi et le développement économique.
On observe enfin des désaccords entre l’État, la collectivité porteuse et les grands partenaires signataires : la région et/ou le département. Sur un site de type 5 par exemple, les acteurs consultés notent une difficulté à travailler avec le département, du fait d’un défaut de cohérence entre leurs objectifs respectifs. Dans une des régions comprenant un site de type 1, le conseil régional a refusé de signer les CUCS et signe avec les sites en CUCS un PUCS (projet urbain de cohésion sociale). Les deux sont très proches. La volonté politique a conduit à conclure des accords séparés… alors que les équipes opérationnelles travaillent pourtant en bonne intelligence avec les services de la région. Certains départements font observer la difficulté de trouver une convergence entre la logique de public qui préside à l’action du conseil général en matière d’insertion, et la logique de territoire proposée par les CUCS.
Dans ce cas de figure, le portage politique du CUCS est généralement assuré par plusieurs élus se répartissant des thématiques de la politique de la ville et inégalement investis. L’implication insuffisante des maires et/ou du président d’EPCI, et leur absence de participation au débat stratégique, freine la possibilité de fédérer les acteurs et de dépasser les éventuels dissensus.
Toutefois, les acteurs consultés soulignent que le principe de contractualisation dans le cadre du CUCS permet de maintenir un niveau minimal de dialogue entre les partenaires. À titre d’exemple, un site de type 5 explique que les partenaires ont une faible visibilité sur l’action du CUCS et une difficulté à se saisir des différents dispositifs de la politique de la ville, mais c’est grâce à la contractualisation que les partenaires ne se retirent pas
Ÿ Cas 4 : projet global non décliné par thématique ni par territoire
On observe dans ce quatrième cas de figure, la formalisation d’un projet stratégique en amont de la convention cadre du CUCS. Ce « chapeau » stratégique est parfois présenté comme le projet urbain de cohésion sociale et définit effectivement les objectifs fondamentaux du CUCS, au-delà des thématiques, et à une échelle territoriale large : agglomération ou commune.
Le PUCS a ainsi vocation à mettre en perspective les acteurs, actions et dispositifs de la politique de la ville et les acteurs de droit commun sur l’ensemble du territoire. On note une volonté de prise de recul et d’organisation des différentes politiques publiques.
Toutefois, la déclinaison effective de ce projet dans les différents volets thématiques du CUCS est absente. Le projet est annoncé en amont, mais l’on ne retrouve pas ses finalités structurantes dans les objectifs stratégiques, opérationnels et dans le programme d’action. A titre d’exemple, on note un site de type 4, où un projet global a été défini mais doit être affiné et reprécisé pour devenir opératoire.
Par ailleurs, si le projet est défini à une échelle relativement large, il n’est pas explicitement décliné aux différentes échelles, notamment à l’échelle des quartiers CUCS. La géographie prioritaire est finalement peu prise en compte, le projet se contente parfois seulement de rappeler en amont qu’une attention plus particulière sera portée sur ces secteurs.
Dès lors, on note un déphasage entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Les grandes orientations stratégiques traduisant la volonté politique de certains partenaires sont parfois éloignées de la question de leur mise en œuvre. Le projet est d’ailleurs rarement appuyé sur une connaissance fine des enjeux des quartiers et de leurs habitants. Parfois, le PUCS a été indirectement et implicitement le lieu d’expression d’un désaccord entre l’exécutif local et les prescriptions nationales : rejet du principe de géographie prioritaire ou désaccord sur les quartiers retenus considérés généralement comme insuffisants, critique implicite des cinq priorités de l’État, proposition de thématiques transversales problématisant telles ou telle de ces priorités, affirmation de priorités spécifiques (le développement culturel des quartiers pour le un site de type 5, le lien social pour un autre hors échantillon, la participation des habitants, l’intégration, la valorisation de la femme etc.).
Dans ce contexte, l’efficacité du CUCS dépend étroitement de la capacité de l’équipe opérationnelle à se saisir du projet qui influera ensuite implicitement sur la conduite du CUCS, dans l’instruction des demandes de financement par exemple.
Ÿ Cas 5 : stratégie de programme
Ce cas de figure regroupe essentiellement les sites de type 5 (selon la typologie initiale des CUCS définie supra).
Ces sites ont généralement défini une stratégie de transformation urbaine par quartier, entraînant un programme multithématique d’action cohérent. Le projet s’appuie sur un diagnostic thématique et territorial précis, permettant une déclinaison par thématique et par échelle de territoire.
Dans ce contexte, le PRU a souvent joué un rôle d’accélérateur dans la mise en place d’une dynamique de projet. Les volumes financiers drainés par le PRU, sa plus grande lisibilité pour les partenaires, mais aussi pour les habitants, lui donnent un rôle moteur pour les autres dispositifs, dont le CUCS.
Si la tendance majoritaire concernant l’articulation entre PRU et CUCS est celle d’une dissociation des deux dispositifs, l’émergence d’une réelle stratégie de programme est permise par une recherche de complémentarité entre les deux. Les priorités du CUCS sont ici définies en lien avec celles du PRU. Par exemple, les priorités du CUCS d’un site de type 5 ont été déterminées au regard des objectifs stratégiques des trois opérations de rénovation urbaine. Les deux dispositifs sont fortement intégrés. De la même manière, un autre CUCS de type 5 apparaît fortement en lien avec les onze opérations de rénovations urbaines menées sur le territoire.
Dès lors, le pilotage du projet est souvent assuré par le maire adjoint chargé de la rénovation urbaine en lien avec l’État, fortement mobilisé par le PRU.
Il s’agit de programmes forts, portés politiquement ; mais ils ne font pas référence à un projet de territoire plus global, qui pourrait logiquement être le projet d’agglomération. Ils ne sont donc pas intégrés à une dynamique de projet collectif englobant un système d’acteurs plus vaste et dépassant le clivage politique de la ville / droit commun, mais surtout le clivage quartiers/ville/agglomération/bassin.
Parfois ces programmes multithématiques apparaissent plus comme des documents cadre sur des engagements financiers, que comme des projets de quartier à moyen/long terme construits sur les enjeux. Dès lors ils ne se veulent pas vecteur d’une dynamique de projet. Ainsi sur un site de type 5, on note aussi un relatif défaut de cohérence entre les objectifs des partenaires.
La stratégie de programme devrait être la déclinaison à l’échelle des quartiers d’une stratégie de projet à l’échelle supérieure. Si celle-ci manque, cela n’enlève rien à la vertu opératoire de ce mode d’action qui traduit et implique une mobilisation et une organisation partenariale à la hauteur de la complexité des enjeux territoriaux et sociaux.
Ÿ Cas 6 : Stratégie de projet territorial
Ce cas de figure représente le niveau stratégique le plus « haut » comparativement aux différents degrés de stratégie observés. Le CUCS est effectivement stratégique parce qu’il décline sur ses quartiers un projet de territoire qui lui préexiste et a vocation à organiser les politiques publiques à une échelle plus vaste autour d’objectifs à long terme décrivant l’avenir choisi de ce territoire. Généralement marqué au sceau du développement durable tel que prescrit dans la LOADDT de 1999, ce projet vise à combiner les quatre piliers interdépendants de la société, de l’économie, de l’environnement et de la gouvernance. Le CUCS propose une stratégie de transformation urbaine et sociale des quartiers corrélée aux dynamiques des mutations économiques et sociales du territoire et aux politiques appelées à les soutenir. Le projet de territoire global et fédérateur de la ville, de l’agglomération ou du bassin commande l’activation des différents dispositifs de droit commun et de la politique de la ville, et ce, aux différentes échelles pertinentes.
Si la structure porteuse (Ville ou EPCI) est dotée d’outils d’observation performants, soit des outils de veille dynamique ou « d’intelligence territoriale » permettant d’enregistrer en « temps réel » ses mutations (ce qui suppose d’avoir fédéré et mis en synergie les multiples acteurs publics qui détiennent chacun une fraction de la connaissance), le projet de territoire peut être fondé sur une prospective globale à moyen-long terme, et appuyé sur des diagnostics thématiques et territorial précis. Ce qui permet sa déclinaison par thématique et par échelle de territoire. Dès lors les partenaires et opérateurs du CUCS peuvent détenir une connaissance fine et partagée des enjeux.
La conception même du PRU n’a pu se faire qu’en cohérence avec la prospective urbaine globale. Fortement intégré au CUCS, ils sont sollicités par la prospective et par le projet. Le CUCS articule à travers ses différents volets thématiques, l’ensemble des dispositifs susceptibles d’intervenir sur les quartiers. Par exemple, le volet éducation du CUCS organise les actions éducatives sur les quartiers du CUCS, tout en étant articulé au projet éducatif local, correspondant aux objectifs de développement social du projet territorial global. De même, la mixité urbaine et sociale se développe en proportion des objectifs fixés au projet. Et le volet emploi, insertion et développement économique du CUCS peut être pensé en fonction des politiques coordonnées de l’économie et de l’emploi à l’échelle du bassin d’activités – ce qui n’est à ce jour pratiquement jamais le cas.
On note que la plupart des sites de l’échantillon ayant impulsé un projet territorial correspondent au type 3, soit aux pôles urbains à rayonnement départemental. Toutefois, ces projets sont encore embryonnaires, suite à une prise de conscience de la nécessité d’une montée en puissance stratégique, souvent déclenchée au moment de l’évaluation. Trois sites ont ainsi souligné la nécessité de formaliser un projet de territoire global et de le décliner ensuite par thématique et par quartier. Certains de ces sites, précédemment « attentistes » à l’égard de l’État, dont ils attendaient les nouvelles dispositions et directives, adoptent aujourd’hui une posture « proactive » et décident d’enclencher une démarche de projet stratégique global pour que celui-ci – et non les directives de l’État – active les dispositifs.
Signalons le cas particulier d’un site de type 5 qui a tôt entrepris une démarche de prospective stratégique à une vaste échelle. Détenteur de la compétence politique de la ville, l’intercommunalité met en cohérence les stratégies communales pour les quartiers prioritaires, et déploie une stratégie d’équilibre économique et social à l’échelle communautaire qui mobilise entre autres la politique de la ville.
On note a contrario que de nombreux sites dont les structures porteuses sont dotées d’un Projet de territoire de type projet d’agglomération ou de pays, ou membres d’intercommunalité porteuse de tels projets (deux sites), ou même membre d’un Parc naturel régional (un site de type 1), n’ont établi aucun lien entre les deux – alors qu’à l’évidence par exemple l’économie du bassin commande l’économie et l’emploi des quartiers. Une situation qui trouve sa cause entre autres dans la répartition des compétences entre commune et intercommunalité, et dans la division des compétences entre délégations au sein d’une même municipalité.
Lorsque le projet existe, la collectivité porteuse du CUCS est généralement dans une posture « proactive » vis-à-vis de l’État. Le projet est piloté par le maire ou président d’EPCI. Le représentant de l’État et les services déconcentrés, déjà associés à la dynamique du projet de territoire, souscrivent généralement aux initiatives prises dans le CUCS et le PRU en faveur des quartiers. Les acteurs stratégiques sont en lien avec une équipe opérationnelle configurée en fonction des priorités du projet.
Seuls freins à l’efficacité de ce type de projet, une multiplication des interlocuteurs, avec parfois des cultures professionnelles et des langages distincts, une ingénierie parfois lourde avec un rythme de travail en commun parfois difficile à maintenir.
2. Une prépondérance des thématiques Education et Prévention, puis Emploi
a) La répartition des crédits par thématique
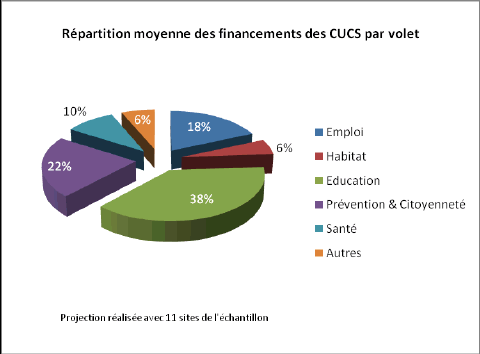
Le CUCS de chaque site est ici représenté d’égale manière, indépendamment de son poids financier. Ce graphique ne prend en compte que 11 sites de l’échantillon et est à lire avec prudence. Il fait néanmoins ressortir quelques phénomènes explicités dans la partie suivante.
On note synthétiquement les éléments suivants :
– La thématique Education est généralement prioritaire dans le CUCS ;
– Un volet Prévention de la délinquance important, est généralement le deuxième poste de financement ;
– L’emploi, mobilisateur de financements, est souvent parmi les orientations prioritaires au niveau stratégique, mais il n’est paradoxalement que le troisième poste de financement ;
– Un volet Santé est lent à émerger ;
– Un volet Habitat et cadre de vie faible, du fait d’un défaut d’articulation au PRU.
On note également que les disproportions du social et de l’urbain sont génératrices d’écarts et de déphasage dans les mises en œuvre et dans les dynamiques de projet.
Par ailleurs les volets optionnels captent l’implication des communes qui y investissent leurs priorités, ou plus exactement leur approche politique de la cohésion sociale.
La montée en puissance d’une thématique du lien social depuis 2007 a progressivement imprégné certains volets : parfois la thématique s’est constituée en volet autonome.
L’effet de « saupoudrage » est proportionnel au phasage de l’urbain et du social : plus le PRU commande le CUCS, plus il cible ses interventions autour de ses projets. A contrario, le CUCS disperse ses interventions quand il n’est pas relié aux projets du PRU.
C. OBJECTIFS, ACTIONS ET RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
a) Habitat et cadre de vie
Le volet « Habitat et cadre de vie » tient une place particulière dans le CUCS dans la mesure où il est supposé, sur la plupart des sites (20/22 dans l’échantillon), compléter l’action menée dans le cadre du volet social du PRU. Il faut préciser que le CUCS, contrairement aux précédents contrats de ville, ne permet pas de mobiliser des crédits d’investissement, mais seulement de fonctionnement. Le volet habitat constitue un des volets du CUCS les moins pourvus de financements sur les sites de l’échantillon, certains d’entre eux disposant d’un PRU n’ayant même pas financé d’action sur celui-ci. À l’inverse, les deux sites qui ne disposent pas d’un PRU l’ont investi davantage (à noter que les deux sites sans PRU relèvent du type 2). Les différences entre sites sur ce volet sont plus significatives selon le clivage PRU / sans PRU que selon la typologie utilisée pour cette étude.
Concernant cette thématique, et contrairement aux autres, l’intitulé « Habitat et cadre de vie » issu de la circulaire du 24 mai 2006 est repris tel quel dans la quasi-totalité des CUCS (20/22). Sur les deux autres sites, on recense les intitulés suivants :
– « Faire du renouvellement urbain un levier de la promotion sociale et de l’attractivité des territoires »
– « Habitat / cadre de vie / vie sociale ».
L’étude du contenu du volet à travers la lecture des objectifs du CUCS permet de dégager trois problématiques distinctes :
– Population, équipement et aménagement du quartier
– Conditions de logement
– Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP)
Objectifs et thématiques d’action développés sur ce volet
Thèmes des objectifs |
Récurrence des objectifs | |||||
Type 1 (sur 3) |
Type 2 (sur 3) |
Type 3 (sur 6) |
Type 4 (sur 5) |
Type 5 (sur 5) |
TOTAL | |
Population, équipement et aménagement du quartier | ||||||
Améliorer l’image du quartier |
* |
* |
**** |
***** |
*** |
14 |
Réhabiliter le quartier et les logements |
* |
** |
*** |
*** |
*** |
12 |
Articuler les actions avec celles du PRU |
* |
** |
*** |
*** |
*** |
12 |
Favoriser la mixité sociale dans les quartiers et l’équilibre du parc de logement |
* |
* |
**** |
* |
** |
9 |
Favoriser la mobilité des habitants |
* |
* |
*** |
** |
7 | |
Accompagner les personnes vers les services sociaux |
* |
* |
* |
3 | ||
Maintenir / développer les services publics et privés dans le quartier |
* |
** |
3 | |||
Favoriser l’accueil des nouveaux arrivants et développer les rencontres et échanges |
* |
* |
2 | |||
Faciliter les parcours résidentiels |
* |
* |
2 | |||
Connaître la situation sociale des habitants |
* |
1 | ||||
Conditions de logement | ||||||
Favoriser l’accès au logement |
* |
* |
**** |
**** |
** |
12 |
Accompagnement social ou juridique sur les questions de logement (maîtrise des charges, accès aux droits) |
**** |
** |
** |
8 | ||
Lancer une démarche PLH ou la poursuivre |
* |
*** |
4 | |||
Accompagnement social des gens du voyage |
*** |
3 | ||||
Identifier les besoins en termes de mobilité, d’habitat, des jeunes et personnes âgées |
* |
* |
2 | |||
GUSP | ||||||
Développer le partenariat entre les acteurs locaux : bailleurs, ville, police |
* |
*** |
* |
5 | ||
Mieux connaitre les attentes des habitants concernant l’habitat et le cadre de vie |
* |
** |
3 | |||
Améliorer la participation des habitants à la GUSP |
* |
** |
3 | |||
Veiller à l’état des bâtiments et des espaces publics |
* |
* |
2 | |||
Résidentialisation / sécurisation |
** |
2 | ||||
Favoriser l’essor d’associations d’habitants |
* |
1 | ||||
Requalifier et entretenir les parties communes |
* |
1 | ||||
Améliorer les conditions de stationnement |
* |
1 | ||||
* : les astérisques signifient le nombre de sites sur lesquels la thématique apparaît dans les objectifs du CUS.
Au sein de la thématique Population, équipement et aménagement du quartier, les objectifs les plus récurrents portent sur l’amélioration de l’image du quartier, la réhabilitation du quartier et des logements, et l’articulation des actions avec celles du PRU. Viennent ensuite la mixité sociale dans les quartiers et l’équilibre du parc de logement, et enfin la mobilité des habitants (notamment sur les sites de type 4 et 5).
Concernant la problématique Conditions de logement, les objectifs les plus récurrents sont le soutien à l’accès au logement, et l’accompagnement social sur les questions de logement (maîtrise des charges, accès au droit), ce dernier étant développé uniquement par les sites de type 3, 4 et 5). Ànoter également que l’accompagnement des gens du voyage entre dans le cadre de ce volet pour 3 des 5 sites de type 5.
Enfin, sur la Gestion urbaine et sociale de proximité, les objectifs les plus récurrents sont le développement du partenariat entre les acteurs locaux (bailleurs, ville, police), la meilleure connaissance des attentes des habitants concernant l’habitat et le cadre de vie, et l’amélioration de la participation des habitants à la GUSP. Les objectifs de cette thématique sont plutôt développés par les sites de type 3, 4 et 5. Moins présente dans les conventions cadre que les objectifs des deux précédentes problématiques, les enjeux liés à la GUSP font dans la réalité l’objet d’une attention particulière – mais relativement récente – chez les acteurs mobilisés autour de ce volet.
Situation des quartiers et action en matière d’habitat
Type de territoire |
Nom du CUCS |
Estimation des crédits affectés au volet (moyenne annuelle) |
Soit en % du coût total du CUCS |
PRU ? |
Part de logements sociaux dans l’agglomération |
1 |
1.1 |
0 € |
0% |
Oui |
24% |
1.2 |
59 914 € |
9% |
Oui |
35% | |
1.3 |
5 252 € |
1% |
Oui |
14% | |
2 |
2.1 |
105 000 € |
15% |
Non |
15% |
2.2 |
0 € |
0% |
Oui |
9% | |
2.3 |
183 416 € |
12% |
Non |
16% | |
3 |
3.1 |
0 € |
0% |
Oui |
11% |
3.2 |
147 747 € |
6% |
Oui |
27% | |
3.3 |
nd |
nd |
Oui |
23% | |
3.4 |
nd |
nd |
Oui |
11% | |
3.5 |
nd |
nd |
Oui |
24% | |
3.6 |
77 766 € |
4% |
Oui |
22% | |
4 |
4.1 |
324 500 € |
nd |
Oui |
24% |
4.2 |
31 667 € |
1% |
Oui |
24% | |
4.3 |
nd |
nd |
Oui |
24% | |
5 |
5.1 |
nd |
nd |
Oui |
18% |
5.2 |
613 643 € |
6% |
Oui |
17% | |
5.3 |
nd |
nd |
Oui |
19% | |
5.4 |
47 638 € |
3% |
Oui |
9% | |
5.5 |
714 878 € |
9% |
Oui |
32% |
Le principal élément concernant la gouvernance du volet porte sur l’articulation entre celui-ci et le PRU, en particulier sur son volet social qui comporte des objectifs communs, en particulier la GUSP.
Lorsque le CUCS n’a financé aucune ou très peu d’actions sur ce volet par volonté de développer cette thématique dans le cadre du volet social du PRU en priorité, on considère en général que les acteurs du CUCS ont largement contribué par leur expertise au développement des actions d’accompagnement de relogement et de GUSP (la mobilisation des clauses d’insertion est davantage reliée au volet emploi). Sur les sites de petite ou moyenne taille, le chef de projet CUCS a parfois la charge du volet social du PRU par exemple. Sur les sites de plus grande taille, la personne en charge du volet social du PRU est généralement mobilisée prioritairement dans la réflexion concernant le volet habitat du CUCS. Ces pratiques sont significatives d’une bonne articulation, voire de synergies entre le CUCS et le PRU. Elles sont favorisées par le regroupement des équipes en charge du CUCS et du PRU au sein d’un même service de la Ville ou de l’EPCI, ou d’un GIP.
On observe parfois à l’inverse une déconnexion totale des acteurs du CUCS et du PRU, en particulier dans le cas où les compétences habitat et politique de la ville sont séparées entre Ville et EPCI. En conséquence, tant le volet habitat du CUCS que le volet social du PRU peuvent devenir résiduels et sans lien l’un avec l’autre. Cet écueil peut également être observé, moins fortement toutefois, lorsque les deux dispositifs relèvent de services différents et relativement cloisonnés dans la même structure, Ville ou EPCI. Souvent, l’écart important entre les moyens financiers des deux dispositifs (conséquents pour le PRU mais marginaux pour le CUCS) et donc la différence de leur importance stratégique aux yeux des élus notamment est avancé comme facteur explicatif de cette déconnexion.
Quels résultats des actions du volet ?
Si le volet habitat ne mobilise qu’une très faible partie des financements CUCS (sauf pour les sites ne disposant pas d’un PRU), ces données ne reflètent pas le niveau de priorité accordé au volet. L’ingénierie est forte sur cette thématique, qui mobilise également les acteurs en charge du CUCS. Les actions sont nombreuses, mais en grande majorité financées dans le cadre du PRU.
Concernant les objectifs portant sur la population, l’équipement et l’aménagement du quartier (image du quartier, mixité sociale, mobilité dans le logement), les avancées obtenues sont davantage le fait du PRU et du PLH que du CUCS, qui ne finance pas d’actions d’investissement contrairement au contrat de ville précédemment. Le PLH peut constituer la base d’une politique d’équilibre social de la population à l’échelle d’une ville ou d’une agglomération, c’est donc lui, d’autant plus lorsqu’il est complété par un PRU, et non le CUCS qui peut permettre à moyen / long terme des impacts en termes de mixité sociale des quartiers.
Le PRU est notamment largement mis en avant comme ayant eu des impacts très importants, tant sur le plan de la mixité sociale que sur le cadre de vie et l’image des quartiers. Toutefois, un effet pervers du PRU a été évoqué plusieurs fois : il apparaît que les difficultés résorbées sur un quartier grâce au PRU ont tendance à se déplacer dans les autres quartiers prioritaires non couverts par le PRU, et notamment les plus dégradés, puisque ceux-ci perdent en attractivité relative vis-à-vis du quartier rénové, ce qui peut provoquer une baisse des prix des loyers et donc la concentration accrue des populations les plus précaires. Dans ce cas, les acteurs locaux appellent à une nouvelle génération de PRU destiné à ces quartiers.
Certaines actions financées dans le cadre du CUCS ont permis d’améliorer l’image du quartier et le cadre de vie, c’est le cas par exemple des chantiers ou ateliers jeunes proposant en période de vacances scolaires une contribution des jeunes, contre rémunération, à des réhabilitations sur les espaces publics du quartier. Ces actions permettent également aux jeunes de mieux s’approprier le quartier et de prévenir les dégradations, en les responsabilisant dans l’entretien de leurs lieux de vie.
Concernant les conditions de logement, des effets positifs sont constatés dans l’accès au logement et la réduction des charges sur les sites, relativement nombreux, qui ont mis en place via le CUCS des services d’accompagnement social et juridique sur ces deux sujets. Par ailleurs, des opérations d’auto-réhabilitation ont été parfois mises en place, et ont contribué au maintien dans le logement des ménages concernés.
Sur la GUSP, thématique investie tardivement, les résultats apparaissent très hétérogènes entre les sites. Tout d’abord, les évaluations relèvent que la manière de concevoir la GUSP pose certaines questions méthodologiques. La définition même de la GUSP et de son contenu n’est pas stabilisée sur les territoires, qui disposent d’un cadre relativement ancien et général qu’il s’agit d’adapter aux spécificités du territoire (148). Le défaut de formation des acteurs aux logiques d’action de la GUSP est d’ailleurs souligné dans certaines évaluations.
On constate que sur la plupart des sites dotés d’un PRU, la GUSP a davantage été développée dans le cadre du PRU. Sur les sites de type 3 à 5, les moyens financiers apportés par le CUCS, plus élevés qu’ailleurs, ont permis de développer la GUSP sur les quartiers hors PRU.
Les actions développées dans le cadre du CUCS ou du PRU ont le plus souvent consisté à mobiliser les habitants dans un effort de diagnostic et / ou de veille, puis de les impliquer dans la recherche de solutions en lien avec les bailleurs ainsi que la Ville ou l’EPCI, sur des thématiques telles que l’entretien ou la requalification. La participation des habitants a été améliorée inégalement selon les sites et selon les quartiers, les constats faisant également état d’une mobilisation parfois trop ponctuelle, et d’une partie du public, la plus isolée, qui échappe à cette dynamique. Ces éléments de bilan relèvent d’une analyse qualitative issue de la perception des évaluateurs et personnes impliquées dans les démarches de GUSP étant données les difficultés conceptuelles et méthodologiques liées à la mesure de la participation. Une explication des écarts, notamment entre quartiers, réside dans la différence de qualité et de densité des relais associatifs préexistants. Sur ce point, les quartiers historiquement au cœur de la politique de la ville ont bénéficié d’un accompagnement qui a progressivement permis l’émergence d’un tissu associatif professionnel et bénévole dense, qui constitue un avantage pour le développement d’une dynamique collective autour de la GUSP.
Ainsi, sur les sites de type 1 et 2, les évaluations font plus qu’ailleurs le constat d’une difficulté à mobiliser tant les habitants que les partenaires, ce qui peut s’expliquer par le fait que les moyens financiers limités ne permettent pas de mobiliser une ingénierie suffisante pour engager une démarche structurée, d’autant que les relais associatifs y sont au départ moins développés.
Toutefois, la très grande majorité des sites ayant mis en place des éléments de GUSP font état d’une amélioration sur le plan de l’interface entre les habitants d’une part, les bailleurs et la Ville / l’EPCI de l’autre.
b) Emploi, insertion et développement économique
L’action menée dans le cadre du CUCS en matière d’emploi, d’insertion et de développement économique s’est inscrite dans un contexte particulier marqué par la crise économique depuis fin 2008. L’absence de données statistiques disponibles à partir de 2009 rend difficile l’estimation de l’impact de la crise économique en terme de chômage sur les quartiers prioritaires. L’ONZUS souligne que l’impact de la crise sur les ZUS à la fin de l’année 2008 n’y est pas plus important que dans les autres quartiers, elle affirme toutefois qu’une main d’œuvre jeune et peu diplômée constitue un facteur de faiblesse face à l’emploi. De plus, de nombreux acteurs affirment que les quartiers prioritaires ont été plus rapidement et plus fortement touchés que le reste du territoire par la montée du chômage. Ainsi, il s’avère difficile d’appréhender les améliorations en termes de développement économique engendrées par la mise en œuvre des CUCS.
Par ailleurs, le contexte institutionnel, marqué par la révision générale des politiques publiques, a pour sa part contribué à freiner la dynamique partenariale sur les territoires. De 2008 à 2010, les incertitudes liées à la fusion de l’ASSEDIC et de l’ANPE en Pôle Emploi et la refonte générale des services déconcentrés de l’État, ont bien souvent mis l’État en retrait dans le pilotage des politiques locales de l’emploi. Àce jour, le rôle des services de l’État dans leur configuration nouvelle reste à être précisé, et la nouvelle gouvernance locale à se structurer.
Toutefois, l’action du CUCS entre 2007 et 2010 a probablement contribué à limiter les effets du contexte économique dans les quartiers grâce à un ensemble de dispositifs locaux relevant de l’innovation sociale, conçus pour apporter une réponse spécifique aux besoins des différentes catégories de publics ciblés par la politique de la ville. Ceux-ci, construits pour la plupart avant la signature des CUCS grâce à la dynamique impulsée par les Contrats de ville, se sont progressivement stabilisés, et sur la plupart des territoires la période du CUCS correspondent davantage à une phase de consolidation et de capitalisation de l’expérience acquise que d’expérimentation.
Objectifs et thématiques d’action développés sur ce volet
Récurrence des objectifs | ||||||
Thèmes des objectifs |
Type 1 (sur 3) |
Type 2 (sur 3) |
Type 3 (sur 6) |
Type 4 (sur 5) |
Type 5 (sur 5) |
total |
Accueillir, orienter et accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi |
** |
** |
**** |
** |
**** |
14 |
Accompagner la création d’entreprises / de micro-entreprises, notamment services à la personne |
* |
* |
** |
** |
**** |
10 |
Favoriser l’insertion professionnelle et coordonner les parcours |
* |
* |
*** |
** |
* |
8 |
Favoriser l’implantation d’entreprises dans les quartiers prioritaires (notamment en ZFU) |
* |
*** |
*** |
7 | ||
Agir contre les freins à l’emploi (mobilité, logement, garde d’enfants, etc.) |
** |
* |
* |
*** |
7 | |
Lutter contre les discriminations |
** |
* |
** |
** |
7 | |
Renforcer le lien entre acteurs de l’emploi / de l’insertion et les entreprises |
* |
* |
** |
** |
6 | |
Améliorer l’accès à la formation de base |
* |
** |
3 | |||
Améliorer la connaissance de la situation de l’emploi dans les quartiers prioritaires |
* |
** |
3 | |||
Développer l’offre d’insertion (SIAE) |
* |
* |
* |
3 | ||
Développer les clauses d’insertion dans les marchés ANRU |
* |
* |
* |
3 | ||
Promouvoir l’insertion professionnelle auprès des entreprises |
** |
* |
3 | |||
Développer l’offre de formation professionnelle |
* |
* |
2 | |||
Renforcer l’innovation, l’ingénierie technique dans l’accompagnement ou la création d’actions |
* |
* |
2 | |||
Améliorer la connaissance des besoins en main d’œuvre des entreprises |
* |
1 | ||||
Rapprocher les entreprises et les demandeurs d’emploi |
* |
1 | ||||
Développer l’utilisation du microcrédit |
* |
1 | ||||
Les thèmes les plus récurrents – quel que soit le type de territoire – sont l’accompagnement à l’emploi, la création d’activités économiques, la coordination du champ de l’insertion professionnelle, l’action contre les freins à l’emploi et la lutte contre les discriminations.
Dans la réalité des programmations du CUCS, on retrouve davantage cette dimension d’accès à l’emploi pour des publics éloignés des structures de droit commun (Pôle Emploi et Mission locale). La coordination des parcours d’insertion se fait davantage par l’intermédiaire du PLIE. Toutefois certaines SIAE sont financées par le CUCS et s’inscrivent donc dans la même dynamique. La création d’activités économiques est effectivement bien développée dans les quartiers prioritaires (services d’amorçage de projet devenus CitésLab notamment), mais les crédits CUCS ne sont pas prépondérants sur ces actions (les financements directs proviennent en grande partie de la Caisse des dépôts et des régions en particulier). La lutte contre les discriminations sur le marché du travail constitue un objectif largement affiché, mais il fait rarement l’objet d’une action réellement structurante (voir sur ce point la partie consacrée aux objectifs transversaux). La lutte contre les freins à l’emploi (mobilité, logement, garde d’enfants, etc.) est souvent citée, mais les acteurs font souvent le constat d’une difficulté à agir dans ce sens dans le cadre du CUCS. Enfin, peu présent dans l’échantillon, l’objectif de mobilisation des clauses d’insertion dans les marchés ANRU et autres marchés publics fait dans la réalité l’objet d’une attention croissante au sein des équipes en charge des CUCS. À noter que l’enjeu de formation est peu présent dans les CUCS, et que les acteurs locaux déplorent généralement une déconnexion entre celui-ci et le CUCS.
De manière générale, le CUCS permet le financement d’actions relevant d’une innovation sociale visant à favoriser l’accès à l’emploi ou à un parcours d’insertion professionnelle pour des publics éloignés de l’emploi. Ils permettent souvent l’ouverture de points d’accueil situés au sein des quartiers, permettant de recevoir des personnes en recherche d’emploi dans des conditions plus souples que dans les structures de droit commun, et de trouver des solutions adaptées à la situation globale de la personne reçue.
Le volet emploi-insertion-développement économique se distingue par des actions en moyenne plus lourdes que celles des autres volets, quelque soit le type de territoire. En effet, les actions d’aide à l’insertion, d’accompagnement à l’emploi ou d’aide à la création d’entreprise sont les plus répandues et nécessitent une ingénierie coûteuse en moyens humains et donc financiers.
On constate peu d’influence du type de territoire sur les thématiques développées, sauf concernant globalement la thématique du développement économique. En effet, le développement du tissu économique des quartiers – aide à la création ou à l’implantation d’activités – est d’autant plus recherché que le territoire CUCS est grand et qu’il dispose d’une ZFU (type 4 et 5).
Situation des quartiers et action en matière d’emploi-insertion-développement économique
Type de territoire |
Nom du CUCS |
Part de chômeurs |
Ecart des quartiers par rapport à l’agglomération |
Estimation des crédits affectés au volet en moyenne annuelle |
Part des crédits affectés au volet emploi |
Dispositifs |
1 |
1.1 |
14 % |
+ 2,2 pts |
34 624 € |
12 % |
PLIE, plateforme emploi |
1.2 |
17 % |
+ 6,3 pts |
39 942 € |
6 % |
PLIE, RQ | |
1.3 |
16 % |
+ 4 pts |
78 779 € |
15 % |
PLIE, RQ | |
2 |
2.1 |
24 % |
+ 3,5 pts |
259 000 € |
37 % |
PLIE, GSE |
2.2 |
14 % |
+ 3,8 pts |
307 171 € |
21 % |
PLIE, plateforme emploi | |
2.3 |
16 % |
+ 4,7 pts |
397 402 € |
26 % |
MDE | |
3 |
3.1 |
15 % |
+ 7,3 pts |
226 355 € |
12 % |
PLIE |
3.2 |
23 % |
+ 12,9 pts |
492 491 € |
20 % |
ZFU | |
3.3 |
12 % |
+ 4,5 pts |
nd |
n.d. (non prioritaire) |
PLIE | |
3.4 |
23 % |
+ 9,6 pts |
nd |
n.d. (non prioritaire) |
PLIE, MDE | |
3.5 |
13 % |
+ 2,8 pts |
nd |
n.d. (2nde thématique) |
PLIE | |
3.6 |
16 % |
+ 4 pts |
872 105 € |
47 % |
PLIE, MDE, ZFU | |
4 |
4.1 |
19 % |
+ 9,4 pts |
nd |
12 % des crédits Acsé |
ZFU |
4.2 |
16 % |
+ 6,2 pts |
302 500 € |
13 % |
PLIE | |
4.3 |
13 % |
+ 3,5 pts |
nd |
n.d. |
ZFU | |
4.4 |
12 % |
+ 3,3 pts |
nd |
n.d. |
PLIE | |
4.5 |
20 % |
+ 11,2 pts |
nd |
n.d. |
PLIE, ZFU | |
5 |
5.1 |
15 % |
+ 6,5 pts |
nd |
n.d. |
PLIE, ZFU |
5.2 |
17 % |
+ 4,1 % |
1 329 559 € |
13 % |
PLIE, MDE, ZFU | |
5.3 |
19 % |
+ 10 pts |
nd |
n.d. |
PLIE, ZFU, GSE | |
5.4 |
13 % |
+ 3,3 pts |
190 550 € |
12 % |
PLIE, ZFU, GSE | |
5.5 |
19 % |
+ 9,4 pts |
2 217 965 € |
27 % |
PLIE, ZFU |
Au vu de l’échantillon, il ne semble pas possible d’établir un lien entre la taille ou le type de territoire et le niveau de priorité du volet emploi-insertion et développement économique. Il semble tout de même globalement peu investi sur les territoires de type 1, et dans les autres catégories les écarts entre les sites apparaissent importants.
Acteurs, gouvernance et articulation des dispositifs
La présente thématique est celle qui mobilise la plus forte ingénierie (avec l’éducation) et surtout le plus d’institutions partenaires impliquées tant dans la définition des orientations que dans la mise en œuvre des actions. En découlent globalement une grande complexité du paysage institutionnel local, une dilution de la stratégie et une difficulté d’impulser un portage global. De fait, entre l’État et les différentes collectivités, intervenant dans la définition de nombreux dispositifs, rares sont les cas pour lesquels il est abouti à une stratégie partagée et à un accord global sur la répartition des missions et l’articulation des différents dispositifs.
Les actions CUCS se veulent une réponse adaptée à un public qui rencontre des difficultés spécifiques auxquelles le droit commun ne répond pas. Elles peuvent donc s’y substituer lorsque les structures de droit commun sont éloignées géographiquement ou peu adaptées aux spécificités du public (accompagnement à l’emploi notamment), ou bien s’inscrire en complément ou en amont du droit commun (mise en relation avec les entreprises, aide à la création d’entreprises).
De manière générale, les objectifs, les actions, les dispositifs et les modes d’organisation des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du volet emploi/insertion/économie sont faiblement articulés à un cadre stratégique global et structuré. Ainsi le CUCS n’est que rarement parvenu à constituer le centre de la définition d’une stratégie partagée à destination des publics des quartiers prioritaires, déterminant les conditions de mobilisation des politiques de droit commun et positionnant clairement les interventions de la politique de la ville en cohérence avec celles-ci. L’illisibilité des limites respectives des politiques de droit commun et de la politique de la ville constitue le constat le plus prégnant concernant cette thématique. Le positionnement du volet emploi/insertion/économie par rapport au droit commun demeure dans la grande majorité des cas une question non résolue. La distinction entre les crédits est elle-même faiblement maîtrisée par les acteurs. A minima, on observe une recherche de complémentarité du volet avec le droit commun.
Ces constats négatifs s’expliquent à la fois par un manque de convergence des partenaires, un déficit d’implication partenariale des décideurs qui tendent souvent à se replier sur leurs logiques propres et à concevoir les dispositifs de manière relativement cloisonnée. On est alors davantage dans une logique d’institution, où l’on recherche la cohérence de ses propres interventions, que dans une logique de projet où la cohérence d’ensemble serait recherchée.
Toutefois, si l’articulation des dispositifs fait défaut sur le plan formel et décisionnel, il semble que la cohérence soit tout de même recherchée au niveau technique, dans la mise en œuvre concrète des actions et dispositifs. En l’absence de stratégie partagée et de claire répartition des missions, les marges de manœuvre sont utilisées par les équipes, souvent au cas par cas, par une application souple des critères et procédures d’inscription des personnes dans les dispositifs, pour retrouver cette cohérence au niveau individuel, celui des personnes accompagnées, en fonction des besoins et suivant une logique de parcours.
De manière schématique, on peut faire le constat suivant :
Sur les territoires les plus petits et donc les moins dotés en crédits Acsé et de droit commun (type 1 et dans une moindre mesure 2), la faiblesse des moyens affectés au CUCS ne permet pas la mise en place d’actions structurantes et donc d’une politique de l’emploi en faveur des quartiers qui soit impulsée par le CUCS lui-même. Le droit commun représente la quasi-totalité de l’intervention sur le territoire, et les actions politiques de la ville sont marginales et visent principalement à combler les déficiences du droit commun. Dans le cas minoritaire où il existe une plateforme locale de coordination des politiques en faveur des quartiers de type GSE, ceux-ci peuvent faire l’objet d’une attention particulière et d’une action coordonnée. C’est le cas sur un site de type 1 où une telle plateforme rassemble la Ville, le GIP DSU intercommunal, le PLIE, Pôle Emploi et les SIAE du territoire, et met en cohérence les actions.
Toutefois, la taille réduite du territoire d’intervention restreint de fait la taille des équipes mobilisées autour de la thématique et permet une visibilité plus forte sur l’action menée du fait d’une plus grande proximité des décideurs notamment vis-à-vis du terrain, ce qui tend à faciliter la coordination des politiques et des actions.
Le constat d’une difficulté à impulser une véritable politique est surtout valable pour les sites de type 1. Sur les sites de type 2 de l’échantillon, on recense plusieurs initiatives de mise en place de plateformes de coordination (GSE sur un site et plateforme ad hoc sur un autre) permettant une certaine dynamique partenariale parmi les acteurs du CUCS et de droit commun, et une ingénierie tendanciellement plus développée.
Sur les territoires les plus grands et donc les plus dotés en crédits Acsé et de droit commun (type 3, 4 et 5), le CUCS peut constituer le centre de la définition d’une stratégie en faveur des quartiers prioritaires, articulant le droit commun et les actions relevant de la politique de la ville. Toutefois, le nombre important de structures présentes, la complexité de concilier l’approche par public et l’approche par territoire et l’éloignement des décideurs vis-à-vis du terrain contribuent à une certaine incapacité à parvenir à une logique d’ensemble et à une lisibilité effective des contours de l’intervention de chaque institution ou dispositif. Rares sont les territoires sur lesquels ce travail de définition d’une stratégie partagée définissant clairement les missions de chaque institution ou dispositif a été réalisé au moment de la signature des contrats.
Il apparaît que les sites de type 3 de l’échantillon font le constat quasi unanime d’une forte incapacité à coordonner les politiques et dispositifs de l’emploi sur le territoire. Le PLIE en particulier fonctionne de manière autonome vis-à-vis du CUCS. Toutefois, on ne peut affirmer qu’il ne s’agit pas d’un hasard de l’échantillon, aucun GSE ou plateforme équivalente n’est d’ailleurs recensé parmi les six sites de type 3 de l’échantillon. Les sites de type 4 disposent d’une ingénierie tendanciellement plus lourde, et généralement d’instances de coordination rassemblant les acteurs de la politique de la ville et de droit commun. Le fait qu’on soit à une échelle territoriale relativement réduite (communale) permet d’éviter l’écueil d’un paysage institutionnel trop complexe et d’un éloignement du terrain, qui est généralement constaté pour les sites du type 5 qui recherchent une coordination des acteurs de l’emploi à l’échelle d’une métropole entière. Sur ces sites, la « force de frappe » du droit commun peut souvent aboutir à une certaine marginalisation des acteurs et des logiques de la politique de la ville, celle-ci tendant à fonctionner en autonomie relative. Sur certains sites toutefois, des tentatives de clarification des compétences et missions des acteurs semblent aller dans le bon sens.
Dans tous les cas de figure, la coordination des politiques de l’emploi en faveur des quartiers doit faire l’objet d’un travail de mise à plat des missions et compétences de chaque acteur. La période à venir de redéfinition des modalités de mise en œuvre de la politique de la ville devra impérativement voir ce travail accompli, d’autant plus que la réforme générale des politiques publiques se met en place localement, et que les nouveaux services déconcentrés doivent également se positionner dans la nouvelle gouvernance locale. L’articulation et les interactions possibles entre le CUCS et l’action de Pôle Emploi doivent impérativement être précisées, au niveau national et local, de manière à ce que cet acteur incontournable du droit commun puisse prendre sa place dans la dynamique de la politique de la ville, ce qui n’a pas été le cas dans la première période de contractualisation du CUCS. Un travail de même nature doit être réalisé concernant le PLIE. Dans cette perspective, il est important d’avoir une connaissance et une analyse très fine des publics, pour un diagnostic puis une stratégie partagée par l’ensemble des partenaires.
Quels résultats selon les types de territoire ?
Il apparaît que les résultats, en matière d’emploi en particulier, sont d’autant plus difficiles à envisager que le territoire en question est grand. Toutefois, de manière schématique, on peut faire les constats suivants :
Sur les territoires de type 1, le manque de moyens financiers, d’ingénierie et de structures professionnalisées dans le développement social dotées d’une capacité d’innovation nécessaire pour concevoir des réponses adaptées constitue un véritable frein. Des actions d’accompagnement à l’emploi permettent le suivi d’un nombre réduit de bénéficiaires, et la taille réduite du territoire permet parfois une coordination des acteurs au cas par cas et ainsi des parcours d’insertion cohérents.
Les territoires de type 2 apparaissent comme ceux pour lesquels l’action en faveur de l’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires semble être à la fois enrichie par des moyens certains apportés par la politique de la ville et à la fois facilitée du fait d’une taille relativement réduite du territoire, celle-ci tendant à rendre plus aisée la coordination des acteurs.
Les territoires de type 3 présentent une taille supérieure, et font ainsi face à la difficulté de coordonner les acteurs de l’emploi sur le territoire. La complexité se trouve renforcée dans le cas des CUCS intercommunaux – nombreux sur le type 3, d’autant plus lorsque la compétence emploi demeure du ressort des communes. Le CUCS ne peut dans ce cas devenir le centre de la définition d’une stratégie en matière d’emploi, et donc le droit commun, le PLIE et le CUCS tendent à fonctionner de manière autonome. Dans ce cas, les actions du CUCS sont focalisées sur l’accès à l’emploi des publics éloignés des structures de droit commun et se positionne donc difficilement, vis-à-vis du PLIE et de la mission locale en particulier. Dans certains cas particuliers, la problématique de l’emploi au sein du CUCS est intégrée à la problématique du renouvellement urbain, et les clauses d’insertion dans les marchés ANRU, porte d’entrée vers une généralisation aux autres marchés publics, constitue l’outil principal d’intervention auprès du public des quartiers prioritaires, aux côtés des espaces d’accueil et d’accompagnement à l’emploi souvent ouverts à l’intérieur des quartiers. Les résultats pour les sites de type 3 sont généralement considérés comme insuffisants au vu de la situation de l’emploi dans les quartiers, et les acteurs se trouvent dans l’incapacité de les envisager de manière globale et en sont réduits à les concevoir par dispositif (Pôle Emploi, PLIE, antenne locale, clauses d’insertion, etc.).
Le type 4 apparaît particulier dans la mesure où les CUCS y sont communaux, ce qui réduit l’échelle de territoire par rapport à ceux du type 3. La coordination des acteurs et l’articulation entre dispositifs s’en trouve facilitée, ce qui permet au partenariat de fonctionner de manière plus fluide et de rendre les résultats plus visibles. Toutefois, étant donné la prégnance des problématiques d’emploi sur ces territoires, les moyens alloués par la politique de la ville ne permettent pas de constater à l’échelle des quartiers dans leur ensemble une amélioration de la situation de l’emploi. Les résultats positifs portent sur un nombre réduit de personnes au départ très éloignées de l’emploi et qui ont fait l’objet d’un accompagnement lourd comparé à celui que peut leur apporter le droit commun.
Sur les sites de type 5, qui disposent d’une ingénierie forte étant donné la taille de leur territoire, une importance certaine est conférée à l’enjeu que constitue l’emploi. Or, dans le cas d’une grande métropole, ces enjeux se trouvent très fortement localisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le CUCS est donc d’importance stratégique forte, et peut devenir le centre d’une réelle politique de l’emploi. Tendanciellement, il s’articule donc plus aisément par rapport aux autres dispositifs. Par ailleurs, les moyens financiers importants permettent la mise en place d’actions à caractère d’innovation sociale relativement structurantes, qui parviennent à atteindre les publics ciblés de manière précise - à plus forte raison lorsqu’un effort de diagnostic fin a été produit – et présentent à des résultats en progression à mesure que les expérimentations aboutissent à des prestations réellement adaptées au public visé.
L’ensemble des CUCS de l’échantillon fait apparaître des initiatives nombreuses qui aboutissent à des actions remplissant des fonctions essentielles, mais pas de stratégie globale mettant en cohérence ces actions permettant de proposer des parcours fluides à l’ensemble du public des quartiers prioritaires.
Bien que sur le plan formel, on peine à décider d’une organisation générale permettant aux différentes catégories de public de s’inscrire dans un parcours, dont les différentes étapes sont recensées et les réponses adéquates à chaque situation définies, au niveau individuel on parvient parfois à construire ces parcours au cas par cas en utilisant les marges de manœuvre existantes du fait de l’imprécision de la définition des dispositifs, ou plus précisément de la manière dont ils s’articulent.
c) Réussite éducative
Le volet Réussite éducative constitue le premier volet du CUCS au regard des montants mobilisés, sur la plupart des territoires, soit 8 sur les 13 CUCS de l’échantillon pour lesquels la répartition des crédits par volet a pu être mesurée. Seuls deux d’entre eux présentent un volet Réussite éducative mobilisant moins de 20 % des crédits du CUCS. Il vient en complément des Programmes de réussite éducative (dont disposent 19 des 20 sites de l’échantillon) qui mobilisent également des volumes financiers très importants, en général très supérieurs aux crédits consacrés au volet éducation du CUCS. Le Contrat éducatif local (développé par 11 des 20 sites de l’échantillon) s’articule également à ces deux dispositifs, finançant, comme le volet Réussite éducative du CUCS, des activités socio-éducatives et culturelles sur le temps extrascolaire ou périscolaire.
Concernant cette thématique, l’intitulé « Réussite éducative » issu de la circulaire du 24 mai 2006 est repris tel quel dans la moitié des CUCS de l’échantillon. Parmi les onze autres sites :
– 8 préfèrent le terme d’éducation à celui de réussite éducative ;
– 5 ajoutent à la dimension d’éducation celles de l’enfance ou de la jeunesse ;
– 3 ajoutent une autre dimension particulière : solidarité, citoyenneté ou égalité des chances.
L’étude du contenu du volet à travers la lecture des objectifs du CUCS permet de dégager trois problématiques distinctes :
– Accompagnement / orientation / suivi du parcours scolaire ;
– Activités éducatives et socio-éducatives ;
– Parentalité ;
Objectifs et thématiques d’action développés sur ce volet
Récurrence des objectifs | ||||||
Thèmes des objectifs |
Type 1 (sur 3) |
Type 2 (sur 3) |
Type 3 (sur 6) |
Type 4 (sur 5) |
Type 5 (sur 5) |
TOTAL |
Accompagnement / orientation / suivi du parcours scolaire | ||||||
Accompagner la scolarité |
** |
**** |
**** |
**** |
14 | |
Accompagner les jeunes en situation de décrochage scolaire ou de fragilité / lutte contre l’absentéisme |
* |
** |
** |
** |
**** |
11 |
Orienter les parcours scolaires |
* |
** |
* |
*** |
7 | |
Lutte contre l’illettrisme / apprentissage de la langue française |
** |
* |
* |
* |
5 | |
Renforcer la responsabilisation des jeunes |
* |
* |
2 | |||
Favoriser l’accès aux savoirs de base |
* |
* |
2 | |||
Activités éducatives et socio-éducatives | ||||||
Développer l’accès aux sports et loisirs éducatifs |
* |
*** |
** |
* |
*** |
10 |
Favoriser l’accès aux activités culturelles et artistiques |
** |
*** |
* |
** |
* |
9 |
Développer les actions socio-éducatives hors temps scolaire |
* |
* |
** |
* |
* |
6 |
Promouvoir la mixité sociale et culturelle |
* |
* |
* |
*** |
6 | |
Mettre en place des chantiers éducatifs |
* |
** |
3 | |||
Parentalité | ||||||
Accompagner les parents dans l’exercice de la fonction parentale |
** |
** |
***** |
**** |
***** |
18 |
Renforcer le lien parent-enfant |
* |
*** |
*** |
7 | ||
Renforcer le lien entre les parents et l’équipe éducative |
* |
**** |
*** |
7 | ||
Il ressort de l’étude des objectifs du volet Réussite éducative des CUCS que les thématiques développées varient très peu selon le type de territoire concerné.
Dans la thématique Accompagnement / orientation / suivi du parcours scolaire, ce sont les objectifs d’accompagnement à la scolarité (14/22) et d’accompagnement socio-éducatif des jeunes en situation de décrochage qui sont les plus récurrents. Ensuite, viennent ceux de l’orientation des parcours scolaires, et de l’apprentissage de la langue française et de la lutte contre l’illettrisme, volet qui s’adresse davantage à un public d’adultes, et à ce titre est souvent financé sur le volet citoyenneté, voire sur le volet emploi.
Dans la thématique Activités éducatives et socio-éducatives, l’accès aux pratiques culturelles et sportives, aux activités socio-éducatives et aux loisirs est prépondérante, ainsi que la dimension de mixité culturelle. La mise en place des chantiers éducatifs n’est inscrite comme objectif du CUCS que dans quelques sites de type 1 et 2.
Dans la thématique Parentalité, les objectifs développés varient peu d’un site à l’autre : l’accompagnement à l’exercice de la fonction parentale (18/22), le lien parent-enfant et le lien entre les parents et l’équipe éducative. Dans les faits, cette thématique parait davantage investie par les sites de type 3 à 5.
Action en matière d’éducation dans le cadre du CUCS et en dehors
Type de territoire |
Nom du CUCS |
Estimation des crédits affectés au volet |
Soit en % du coût total du CUCS |
PRE ? |
1 |
1.1 |
138 494 € |
47% |
PRE, CEL |
1.2 |
389 438 € |
59% |
PRE, CEL | |
1.3 |
236 336 € |
45% |
CEL | |
2 |
2.1 |
231 000 € |
33% |
PRE, CEL |
2.2 |
244 059 € |
17% |
PRE, CEL | |
2.3 |
336 264 € |
22% |
PRE, CEL | |
3 |
3.1 |
1 112 911 € |
59% |
PRE |
3.2 |
1 132 729 € |
46% |
PRE, CEL | |
3.3 |
nd |
nd |
PRE | |
3.4 |
nd |
nd |
PRE | |
3.5 |
nd |
nd |
PRE | |
3.6 |
228 534 € |
11% |
PRE | |
4 |
4.1 |
1 858 500 € |
nd |
PRE |
4.2 |
883 333 € |
37% |
PRE | |
4.3 |
nd |
nd |
PRE | |
5 |
5.1 |
nd |
nd |
PRE, CEL |
5.2 |
3 784 129 € |
37% |
PRE, CEL | |
5.3 |
nd |
nd |
PRE, CEL | |
5.4 |
603 409 € |
38% |
PRE, CEL | |
5.5 |
1 005 898 € |
12% |
PRE, CEL |
La thématique de l’éducation doit faire face à l’échelle des territoires à des enjeux de coordination très importants, étant donné le nombre de dispositifs, d’institutions et d’acteurs compétents ou intervenant dans le domaine. Tous les sites CUCS sont équipés en structures associatives ou institutionnelles agissant dans le domaine éducatif, bien que l’offre ne permette pas partout de couvrir l’ensemble des quartiers et l’ensemble des besoins.
Comme pour le volet emploi, les petits territoires disposent d’un avantage pour accéder à une lisibilité et à une cohérence de ce champ d’action. L’exemple d’un site de type 1, où le service jeunesse de la ville cordonne à la fois le PRE, le PEL et le volet éducation du CUCS, est à ce titre significatif. Les territoires de plus grande taille font état d’un champ d’action relativement éclaté et illisible. Toutefois, les PRE, encore aujourd’hui dans une période de rodage sur la plupart des sites, contribuent à coordonner les acteurs de l’éducation, voire sur certains sites un champ d’acteurs plus large, non pas de manière globale mais au niveau des élèves accompagnés individuellement, mobilisant les partenaires, les actions et dispositifs en fonction des besoins.
Le constat général sur les résultats de la thématique ne permet pas de dissocier strictement les effets dus au PRE et ceux à mettre au crédit du CUCS. On peut tout de même identifier des effets combinés des deux dispositifs : l’augmentation du suivi des élèves et du soutien scolaire, la densification et la diversification des activités socio-éducatives (à dimension sportive, culturelle, artistique).
De manière schématique tout de même, on peut conclure que, tendanciellement :
– le PRE a permis de progresser dans le repérage, l’orientation des publics et le partenariat,
– tandis que le CUCS a contribué à densifier et diversifier l’offre d’accompagnement socio-éducatif à disposition des habitants des quartiers prioritaires.
Le développement de l’ingénierie, de la formation des acteurs et de la méthodologie, souligné par l’ensemble de évaluations et imputable tant à la politique de la ville qu’au droit commun (État, CAF et Villes notamment), a permis d’accompagner le public cible vers des actions d’accompagnement à la scolarité, de soutien à la fonction parentale et des activités socio-éducatives diverses, davantage adaptés aux besoins spécifiques public des quartiers prioritaires.
Considérant les résultats de l’action menée sur la situation des publics pris en charge, aucun site ne propose d’indicateur quantitatif, mis à part à la marge, à l’échelle d’une action (par exemple, la réinscription ou non dans un parcours scolaire pour une action d’accompagnement de jeunes en situation de décrochage). Ainsi, peu d’entre eux font état dans les évaluations de l’évolution des résultats scolaires, et encore moins à l’échelle des quartiers CUCS, ce qui s’explique par la très grande difficulté à obtenir ces données de ce type. Certains tout de même qualifient cette évolution, sans la chiffrer. Selon les sites, on constate alors une stabilité ou persistance des difficultés ou une certaine amélioration, dans aucun cas une aggravation. Etant donné les écarts entre les quartiers politique de la ville et le reste du territoire, et au vu des moyens très importants mobilisés sur cette thématique, on peut estimer que globalement, la politique de la ville a simplement contribué à contenir une aggravation de la situation qui serait advenue sans elle.
Au niveau des résultats des actions de la politique de la ville, les évaluations font état d’avancées en particulier sur l’accompagnement social et scolaire des élèves en difficulté. En l’absence de mesure des résultats sur la situation des enfants et adolescents accompagnés, qui nécessiterait un suivi à long terme malaisé à mettre en place au niveau local, les résultats sont plutôt conçus en termes de réponse à la demande dans une logique de couverture des territoires et des publics. Sur ce plan, le PRE notamment, ainsi que le CUCS via les structures de proximité telles que les centres sociaux ou grandes associations professionnelles, ont contribué à toucher un public de plus en plus nombreux dans les quartiers prioritaires (entre 2007 et 2009, dans plus des deux tiers des sites de l’échantillon) et ainsi à approfondir la connaissance des publics et des problématiques sociales pouvant constituer un frein à la réussite éducative des enfants et adolescents. Toutefois, une limite est mise en avant par certains sites sur la capacité des acteurs à apporter des réponses dépassant le champ de l’éducation (santé et logement notamment), ce qui pourtant relève des objectifs des équipes pluridisciplinaires du DRE notamment.
Concernant les actions socio-éducatives, les effets sur les publics sont très difficiles à envisager, les évaluations sur la perception des acteurs et des bénéficiaires, qui fait généralement état d’un enrichissement des personnes ou d’un élargissement d’horizon, d’une ouverture d’esprit, et également d’une meilleure prise en compte des règles de vie collective.
Les actions portant sur la parentalité, développées tant dans le cadre du PRE (a fortiori sur les sites de type 1 et 2) que du CUCS, expriment leurs résultats en termes de remobilisation des parents et de meilleure appréhension de leur rôle éducatif, de meilleure implication dans la scolarité des enfants, de gains en autonomie et en compétences sociale et relationnelles, de développement du lien parent-enfant, ou d’amélioration du dialogue entre parents et équipe éducative.
Au final, dans la logique stratégique largement répandue sur ce volet de réponse aux besoins recensés, on peut dresser les constats suivants :
– Du point de vue de la couverture du public cible, les sites CUCS ont mis en place une palette d’actions diversifiées, recherchant à améliorer continuellement leur attractivité par l’innovation et l’expérimentation, ce qui a effectivement permis de toucher un public large. Dans certains sites toutefois, l’offre socioéducative et l’accompagnement social des lycéens est considéré comme insuffisant.
– Du point de vue de la couverture du territoire, les acteurs de la politique de la ville ont localement été confrontés à la fermeture de structures d’accompagnement à la scolarité notamment, relevant du droit commun, et certains sites constatent que certains quartiers sont mieux dotés que d’autres, soulevant ainsi un enjeu d’équilibre territorial, difficile à maîtriser lorsque les actions ne sont pas pérennisées.
d) Citoyenneté et prévention de la délinquance
La thématique « Citoyenneté et prévention de la délinquance » a été appropriée de manière relativement hétérogène par les différents territoires. Si on constate comme pour les autres volets une certaine récurrence des thématiques d’actions (cf. infra tableau Objectifs et thématiques d’action développés), une grande diversité apparaît dans les intitulés du volet, et certains des objectifs se rapportant à cette thématique sont parfois ventilés sur d’autres volets ou constituent même un volet séparé.
Ainsi, sur les 22 sites de l’échantillon :
– 10 CUCS reprennent exactement l’intitulé de la circulaire du 24 mai 2006 ;
– 7 CUCS présentent dans deux volets séparés la problématique de citoyenneté, incluant souvent l’accès au droit, parfois le lien social ou la vie de quartier, et la problématique de la prévention de la délinquance, cette dernière étant alors davantage conçue sous l’angle de la sécurité (dans ce cas, les deux volets sont traités ensemble dans cette partie du rapport) ;
– 2 CUCS ajoutent une notion supplémentaire à la thématique : culture pour l’un et lien social pour l’autre ;
– 1 CUCS ne mentionne que la prévention de la délinquance dans l’intitulé mais reprend les objectifs ayant trait à la citoyenneté
– 1 CUCS ne développe pas la notion de citoyenneté ;
– 1 CUCS ne traite pas la prévention de la délinquance, tandis que la citoyenneté est traitée dans la thématique éducation.
Il faut préciser que ces constats sont issus de la lecture des conventions cadre CUCS. À l’inverse, dans le suivi des actions et leur évaluations, les actions de la thématiques sont souvent regroupées sous un intitulé proche de celui de la circulaire, séparant parfois les dimensions prévention de la délinquance et citoyenneté / accès au droit / lien social.
Au final, dans les thématiques développées, on voit comme le montre le tableau suivant, trois dimensions principalement développées, s’articulant de manière différente dans la convention cadre :
– Prévention de la délinquance / sécurité
– Citoyenneté / accompagnement social / lien social / vie de quartier
– Accès au droit / aide aux victimes
Au-delà d’une certaine disparité entre les sites dans la part de crédits mobilisés sur les enjeux de cette thématique, celle-ci apparaît de manière générale comme l’une des trois principales, avec l’éducation et l’emploi.
Situation des quartiers et action en matière de Citoyenneté et prévention de la délinquance
Type de territoire |
Nom du CUCS |
Estimation des crédits affectés au volet (moyenne annuelle 2007-2009, sauf précisé) |
Soit en % du coût total du CUCS |
CISPD / CLSPD ? |
Eléments de diagnostic qualitatifs recueillis localement |
1 |
1.1 |
49 462 € |
17% |
CISPD |
Actes isolés et irréguliers seulement |
1.2 |
79 885 € |
12% |
CISPD |
Niveau de délinquance faible, en baisse | |
1.3 |
141 801 € |
27% |
Non |
Niveau de délinquance faible, en baisse Désœuvrement, mal être chez certains jeunes | |
2 |
2.1 |
84 000 € |
12% |
CISPD |
Délinquance en légère augmentation, désœuvrement, incivilités |
2.2 |
256 248 € |
18% |
Non |
Sentiment d’insécurité, lien social distendu | |
2.3 |
137 562 € |
9% |
CLSPD |
Niveau de délinquance assez faible, mais problématique d’isolement et de lien social | |
3 |
3.1 |
471 572 € |
25% |
CLSPD |
Délinquance faible, mais lien social distendu, isolement |
3.2 |
541 740 € |
22% |
CLSPD |
Sentiment d’insécurité et délinquance en augmentation sur certaines zones | |
3.3 |
nd |
nd |
CISPD |
Addictions, violences notamment intrafamiliales ou envers les institutions | |
3.4 |
nd |
nd |
CLSPD |
Fortes tensions entre groupes sociaux en difficulté | |
3.5 |
nd |
nd |
CISPD |
Délinquance moyenne, de voie publique, concerne des mineurs. Présence de marginaux : toxicomanie, alcoolisation, troubles mentaux, etc. | |
3.6 |
109 319 € |
5% |
CLSPD |
nd | |
4 |
4.1 |
649 000 € |
nd |
CISPD |
En baisse légère, moyenne départementale, mais violences urbaines ponctuellement Faible taux d’inscription sur les listes électorales |
4.2 |
835 000 € |
35% |
CLSPD |
Délinquance (notamment les violences contre les personnes et intrafamiliales) et sentiment d’insécurité relativement forts, concerne des mineurs | |
4.3 |
nd |
nd |
CLSPD |
Délinquance générale en baisse mais hausse des violences urbaines | |
5 |
5.1 |
nd |
nd |
CISPD |
nd |
5.2 |
2 863 665 € |
28% |
CLSPD |
nd | |
5.3 |
nd |
nd |
CLSPD |
Augmentation des violences et de la délinquance des mineurs | |
5.4 |
571 650 € |
36% |
CLSPD |
Niveau de délinquance moyen, mais conduites à risques se développent Problématiques d’isolement | |
5.5 |
2 760 101 € |
34% |
CLSPD |
Niveau de délinquance moyen, concentré dans le centre de l’agglomération |
|
Récurrence des objectifs | |||||
Thèmes des objectifs |
Type 1 (sur 3) |
Type 2 (sur 3) |
Type 3 (sur 6) |
Type 4 (sur 5) |
Type 5 (sur 5) |
Total |
Prévention de la délinquance / sécurité | ||||||
Développer la prévention des conduites à risques |
* |
** |
**** |
*** |
**** |
14 |
Réduire et lutter contre les violences et les incivilités |
* |
* |
** |
*** |
* |
8 |
Prévenir la récidive |
* |
* |
**** |
6 | ||
Lutter contre la violence faite aux femmes et le sexisme |
* |
* |
*** |
* |
6 | |
Coordonner les acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance auprès des jeunes |
* |
*** |
** |
6 | ||
Lutte contre le sentiment d’insécurité |
* |
** |
** |
5 | ||
Développer les actions de prévention de la délinquance |
* |
* |
** |
* |
5 | |
Développer la connaissance des phénomènes de délinquance |
** |
* |
* |
4 | ||
Citoyenneté / accompagnement social / lien social / vie de quartier | ||||||
Développer la médiation familiale et sociale |
* |
** |
**** |
*** |
*** |
13 |
Favoriser le développement associatif et de la vie de quartier |
*** |
** |
** |
7 | ||
Accompagner les jeunes en situation de rupture socio éducative |
* |
*** |
** |
* |
7 | |
Développer les actions sociolinguistiques |
* |
** |
*** |
6 | ||
Favoriser l’insertion sociale |
* |
* |
** |
** |
6 | |
Soutenir les pratiques artistiques, culturelles et sportives |
** |
** |
** |
6 | ||
Accueil, écoute et orientation des habitants |
*** |
* |
* |
5 | ||
Animation de la vie sociale dans les structures de proximité |
* |
** |
* |
4 | ||
Favoriser la citoyenneté |
* |
** |
* |
4 | ||
Renforcer le lien social |
** |
* |
3 | |||
Favoriser la mixité sociale |
* |
* |
2 | |||
Accompagnement social des gens du voyage |
* |
1 | ||||
Accès au droit / aide aux victimes | ||||||
Développer le conseil juridique (accès au droit) |
* |
*** |
*** |
** |
**** |
13 |
Développer l’aide aux victimes |
* |
* |
** |
** |
*** |
9 |
Au sein de la problématique Prévention de la délinquance / sécurité, ce sont les objectifs ayant trait à la prévention des conduites à risques, et la réduction des violences et incivilités qui sont le plus récurrents. Viennent ensuite la prévention des récidives (types 3, 4 et 5 uniquement), les violences faites aux femmes et l’enjeu de coordination acteurs de la prévention de la délinquance. À noter que l’objectif d’améliorer la connaissance des phénomènes de délinquance est peu récurrent mais fait très souvent l’objet d’une attention particulière par les acteurs du territoire.
L’action menée ici s’articule avec celle du contrat local de sécurité, laquelle traite des questions de sécurité et de tranquillité publique notamment via des crédits d’investissement (sécurisation des lieux publics, vidéoprotection, etc.), en lien avec la police ou la gendarmerie, la police municipale et la justice. Le CUCS se positionne plutôt sur une prévention « sociale » (actions sur les facteurs de délinquance liés aux personnes) plutôt qu’ « urbaine » (facteurs liés à la configuration des espaces urbains) qui est davantage traitée dans le cadre du CLS ou des projets ANRU. À noter, selon les sites, le CUCS et le CLSPD se partagent ou se répartissent la fonction de diagnostic sur cette thématique.
Une problématique Citoyenneté / accompagnement social / lien social / vie de quartier, très hétérogène, se détache de l’analyse des objectifs au sein du volet. Les objectifs les plus récurrents sont la médiation sociale et familiale, le développement associatif et de la vie de quartier, l’accompagnement des jeunes en situation de rupture socio-éducative, les savoirs sociolinguistiques, l’insertion sociale, l’accès aux pratiques culturelles et sportives. Ces thématiques rejoignent souvent la préoccupation de prévention de la délinquance en ce qu’elles agissent sur ses déterminants sociaux indirects : l’isolement social, l’exclusion, le désœuvrement, ou la déscolarisation, plus fréquents dans les quartiers prioritaires selon les éléments de diagnostic recueillis localement (cf. tableau suivant).
La troisième problématique entrant dans le champ de ce volet porte sur l’Accès au droit et l’aide aux victimes. Les objectifs, très récurrents, portent sur l’assistance juridique, et l’aide aux victimes qui peuvent recouvrir les dimensions juridique et psychologique. Le constat qui fonde ces objectifs est celui, pour l’accès au droit en particulier, d’une méconnaissance tant des lois que des solutions existantes en la matière, du fait d’un éloignement culturel ou psychologique vis-à-vis des institutions (comprenant la barrière de la langue notamment), ainsi que le manque de moyens financiers permettant d’accéder aux services d’un avocat par exemple.
Quels résultats des actions du volet ?
Le caractère multithématique du volet impose de concevoir ses résultats par problématique, soit celles identifiées ci-dessus.
En matière de Prévention de la délinquance / sécurité, les actions développées sur ce volet s’articulent avec celles menées et financées dans le cadre du CLS.
La question du caractère communal ou intercommunal du CLSPD parait complexe à trancher, la pertinence de l’une ou l’autre configuration dépendant fortement du contexte local :
Un CLSPD intercommunal permet de traiter la question de la délinquance comme phénomène mobile, ce qui parait nécessaire puisque la délinquance a tendance à se déplacer à l’extérieur du quartier, dans les centres-villes ou centres commerciaux par exemple. Toutefois, la coordination des acteurs mobilisés autour de la sécurité et de la prévention de la délinquance à l’échelle d’une agglomération rassemblant des communes dotées de polices municipales distinctes, avec des orientations politiques différentes voire opposées, s’avère parfois difficile.
À l’inverse, un CLSPD communal offre une échelle pertinente au point de vue politique, et de taille réduite, ce qui tend à faciliter la coordination des acteurs, de fait moins nombreux. Mais elle ne permet pas de concevoir la délinquance dans sa dimension mobile.
De manière générale, le fait d’avoir un CLSPD a permis un diagnostic partagé et une meilleure coordination des acteurs pour concevoir des réponses en matière de prévention de la délinquance.
Les actions sur cette problématique ont produit des résultats inégaux, et sont de manière générale peu mis en avant. Le niveau de délinquance a rarement connu une baisse sensible, si ce n’est sur un des sites de type 4, mais où ils sont attribués à la vidéoprotection, non financée par le CUCS puisque relevant de crédits d’investissement. Plusieurs évaluations ont souligné l’augmentation des violences intrafamiliales, face auxquelles le CUCS peine à trouver des réponses.
Concernant les actions de prévention, les résultats sont conçus en termes de socialisation ou d’apprentissage des règles de la vie collective. Des résultats satisfaisants, plus aisés à mesurer lorsqu’il s’agit d’un suivi individualisé, ont été obtenus sur certains sites concernant le suivi des jeunes en situation de rupture et la prévention de la récidive. Sur un des sites de type 5, sont également mis en avant les résultats positifs de l’action de médiation de nuit qui a permis de prévenir et de contenir les débordements.
Concernant la problématique Citoyenneté / accompagnement social / lien social / vie de quartier, les résultats sont également difficiles à mesurer. Les actions développées ont globalement permis un développement associatif développant des actions au contenu difficile à circonscrire.
Une certaine partie des crédits CUCS a été consacrée à des actions d’animation du quartier ou d’activités socioculturelles diverses, répondant à un objectif de développement du lien social. La caractéristique de ces actions peut être leur caractère innovant, souvent mis en avant, qui permet de toucher des publics isolés échappant généralement à la dynamique collective. Les résultats sont alors conçus en termes d’amélioration du vivre ensemble, de la dynamique sociale, la rupture de l’isolement, de remobilisation, de prévention de l’exclusion…
Les activités de médiation sociale et familiale, d’accueil et d’écoute des habitants ont été largement développées, sans présenter de résultats mesurables, mais auxquelles les acteurs attribuent des effets positifs sur le lien social, intercommunautaire et intergénérationnel.
Les actions répondant directement à un objectif de citoyenneté, à caractère éducatif, sont celles qui sont le moins évoquées sur le plan des résultats, conçus essentiellement sous l’aspect de l’apprentissage des règles de vie collective.
Enfin, la thématique de l’Accès au droit / Aide aux victimes a très largement été développée. Les résultats des actions sont envisagés selon le nombre de personnes bénéficiaires, généralement en forte augmentation. Plusieurs sites soulignent le succès de ces actions et déplorent qu’elles ne puissent pas être reprises par le droit commun. Sur un site de type 1, l’évaluation indique que cette thématique « phagocyte » les crédits destinés au volet. Une bonne pratique est identifiée, celle du financement d’une permanence d’un travailleur social au commissariat de police (un site de type 4), qui offre une aide psychologique et juridique aux victimes venant porter plainte, faisant le lien entre la police et les services sociaux vers lesquels il les oriente.
e) Santé
La thématique Santé a été de manière générale assez peu développée dans les programmations des CUCS. Toutefois, elle a fait l’objet d’une attention assez tardive, et beaucoup de diagnostics santé ont été lancés dernièrement, dans le cadre d’un ASV ou d’un projet d’ASV notamment.
Objectifs et thématiques d’action développés sur ce volet
|
Récurrence des objectifs | |||||
Thèmes des objectifs |
Type 1 (sur 3) |
Type 2 (sur 3) |
Type 3 (sur 6) |
Type 4 (sur 5) |
Type 5 (sur 5) |
TOTAL |
Accès au soin | ||||||
Garantir une offre de soin adaptée aux besoins à tous (migrants, Français…) |
*** |
* |
*** |
** |
***** |
14 |
Faciliter l’accès au soin |
* |
* |
** |
**** |
* |
9 |
Identifier les besoins |
|
* |
* |
** |
*** |
7 |
Coordonner la réponse des acteurs de la santé sur le territoire |
* |
|
|
* |
** |
4 |
Prévention santé | ||||||
Développer la prévention en matière de santé |
** |
*** |
**** |
**** |
**** |
17 |
Lutter contre les addictions (alcool, stupéfiants, alimentaires, sexuelles…) |
* |
* |
** |
***** |
** |
10 |
Développer l’éducation à la santé |
* |
|
** |
** |
** |
6 |
Quelles thématiques de santé sont citées dans les CUCS ? | ||||||
Santé mentale (troubles psycho-sociaux et pathologies) |
|
|
* |
** |
*** |
6 |
Sexualité |
* |
* |
|
* |
** |
5 |
Addictions |
* |
|
* |
|
* |
3 |
Nutrition / obésité |
|
* |
|
* |
* |
3 |
Bien-être / mieux-être |
|
* |
* |
|
|
2 |
Handicap |
|
|
|
* |
|
1 |
Situation des quartiers et action en matière de Santé
Type de territoire |
Nom du CUCS |
Part de bénéficiaires de la CMUC dans les quartiers prioritaires |
Estimation des crédits affectés au volet (moyenne annuelle) |
Soit en % du coût total du CUCS |
ASV ? |
1 |
1.1 |
15 % |
69 247 € |
24% |
Non |
1.2 |
26 % |
89 870 € |
14% |
Oui | |
1.3 |
17 % |
0 € |
0% |
Non | |
2 |
2.1 |
14 % |
21 000 € |
3% |
Non |
2.2 |
11 % |
345 879 € |
24% |
Oui | |
2.3 |
17 % |
229 271 € |
15% |
Oui | |
3 |
3.1 |
16 % |
0 € |
0% |
Non |
3.2 |
30 % |
147 747 € |
6% |
Oui | |
3.3 |
12 % |
nd |
nd |
Non | |
3.4 |
44 % |
nd |
nd |
Non | |
3.5 |
19 % |
nd |
nd |
Oui | |
3.6 |
20 % |
485 377 € |
23% |
Non | |
4 |
4.1 |
23 % |
118 000 € |
nd |
Oui |
4.2 |
15 % |
0 € |
0% |
Oui | |
4.3 |
10 % |
nd |
nd |
Non | |
5 |
5.1 |
15 % |
nd |
nd |
Oui |
5.2 |
31 % |
nd |
7% |
Oui | |
5.3 |
24 % |
nd |
nd |
Oui | |
5.4 |
13 % |
715 916 € |
11% |
Non | |
5.5 |
23 % |
nd |
3% |
Oui |
La particularité du volet santé du CUCS réside dans le fait qu’il s’agit d’une thématique nouvelle et très peu investie jusqu’à récemment par les collectivités responsables de la mise en œuvre du contrat. En effet, la santé ne constitue pas une compétence, au sens juridique, des Villes et EPCI. Leur légitimité en la matière ne tient qu’à travers la compétence de la ville, ce qui, face aux moyens relativement réduits alloués à ce titre et face aux enjeux forts de l’emploi et de l’éducation notamment, contribue à freiner largement leur investissement sur le champ de la santé. Ainsi, le CUCS et les Ateliers santé ville peinent à devenir le centre de définition d’une politique locale de santé. En conséquence, la majorité des CUCS de l’échantillon laisse davantage apparaître un ensemble d’actions relativement isolées, sans grande cohérence d’ensemble. Sur certains sites toutefois, une dynamique a été impulsée dans ce sens grâce au CUCS et aux ASV, mais trop récemment pour aboutir à une politique structurée et lisible.
Un autre frein, lié au précédent, apparaît au niveau des opérateurs susceptibles de mettre en œuvre des actions de santé dans le cadre du CUCS. Deux types d’opérateurs peuvent être identifiés :
– D’une part, des opérateurs associatifs, professionnels du champ de la santé, parfois organisés en réseaux thématiques, bien encrés dans le réseau des acteurs du secteur sanitaire et médical, mais peu familiarisés aux logiques de la politique de la ville (inscription dans un projet et transversalité notamment) et peu ancrés dans les quartiers prioritaires ;
– D’autre part, des acteurs traditionnels de la politique de la ville, en particulier des structures de proximité de type centres sociaux ou associations à caractère socioéducatif, bien ancrés dans les quartiers et en lien étroit avec les acteurs de la politique de la ville, mais peu formés aux questions de santé et relativement déconnectés du champ sanitaire et médical.
Ces deux types d’opérateurs peuvent intervenir sur des actions de prévention ou d’éducation à la santé, et d’intervenir dans le repérage des personnes ayant besoin de soins, sur des problématiques diverses telles que les addictions, la nutrition / l’obésité, les psychopathologies ou troubles psychosociaux, l’hygiène bucco-dentaire, VIH, etc.
Ce constat illustre le relatif cloisonnement qui existe entre acteurs du champ social et les acteurs du champ de la santé, et que la politique de la ville a vocation à dépasser. Schématiquement, à la lecture des évaluations, on peut conclure que ce cloisonnement tend à se réduire sur les sites qui ont mis en place un ASV conjointement au volet santé du CUCS. L’ASV favorise dans ce cas le développement d’une culture commune entre ces acteurs, fonctionnant comme une plateforme de coordination, de diagnostic partagé et de définition conjointe de priorités d’actions, mises en place par la suite notamment grâce aux financements du CUCS et du droit commun. En l’absence d’ASV, comme sur un site de type 4, le CUCS peut financer des actions, de prévention essentiellement, mais sans mise en cohérence de celles-ci.
Quels résultats des actions du volet ?
Les résultats de l’action menée dans le cadre du volet santé du CUCS portent donc en particulier sur l’effort de diagnostic et de coordination des acteurs locaux mobilisés sur l’accès au soin et la prévention (7 sites), et donc surtout sur les sites disposant d’un ASV.
En matière d’accès au soin, le travail réalisé a permis sur certains sites de favoriser le repérage et l’orientation des personnes ayant besoin de soins, notamment par les structures d’accueil de proximité (centres sociaux, CCAS, associations) vers les structures d’aide et de soins adéquates (5 sites). À noter que sur deux sites de type 5, l’accent est mis sur l’accès aux soins psychiatriques.
Ces efforts se sont traduits selon les sites par des sessions d’information ponctuelles (notamment sur les addictions) ou plus régulières (information sur les bilans de santé de la CPAM) sur l’accès au soin, ou des démarches plus structurées de repérage et d’orientation, dans quel cas le nombre de personnes suivies et engagées dans une démarche de soin a partout augmenté. Sur un site de type 3, les acteurs des structures accueillant du public ont été formés sur les addictions, et fonctionnent comme des relais vers la prise en charge. Sur un autre site de type 3, un travail a été réalisé avec les SIAE, qui comble les lacunes du droit commun, le constat ayant été fait de l’absence de la médecine du travail, pourtant conviée, dans les structures. Sur un site de type 5, des parcours de soin ont été développés, en particulier sur la psychiatrie, via les structures d’hébergement d’urgence notamment, mais également sur d’autres problématiques via le DRE, les missions locales et les bailleurs, ce qui atteste d’une prise en compte transversale de l’objectif d’accès aux soins.
En matière de prévention, les actions développées sont le plus souvent ponctuelles (6 sites). Les addictions constituent le sujet le plus développé (5 sites). Les résultats de ces actions sont difficiles à mesurer, mais le public touché a globalement augmenté.
Si les constats concernant le volet santé font état d’un investissement croissant et d’une augmentation du public touché, certaines évaluations soulignent que les capacités de prise en charge des personnes orientées demeurent insuffisantes. Or on peut constater que le CUCS n’a généralement pas permis de développer l’offre de soins dans les quartiers prioritaires ou à disposition des habitants des quartiers. Aucune évaluation ne souligne de travail réalisé pour attirer du personnel de santé dans les quartiers. On ne retrouve également que rarement cette préoccupation dans les objectifs du CUCS. Quelques exceptions sont tout de même à souligner : une permanence de psychologues, et un centre municipal de santé procurant notamment des vaccinations, mais ce dernier ayant été créé avant le CUCS.
2. Les volets transversaux : difficultés de mise en œuvre et bonnes pratiques
a) Culture
La culture est un thème dont se sont emparés cinq sites de l’échantillon dans leur CUCS (5 sites). Un site consacre un volet à la culture et la participation.
En l’absence d’un volet Culture, on trouve donc des activités à dimension culturelle dans les volets Réussite éducative et Citoyenneté et prévention de la délinquance. La culture est conçue comme une dimension privilégiée pour toucher les publics les plus éloignés des institutions et de la dynamique collective.
La culture peut être en effet perçue comme une fin en soi, sur le constat d’un accès difficile des habitants des quartiers CUCS à la culture, soit du fait de l’absence d’équipements culturels, soit par manque de moyens financiers. En atteste la présence dans les CUCS d’objectifs d’accès à la culture, soit dans un volet dédié, soit dans le volet citoyenneté et prévention de la délinquance.
À l’inverse, la culture peut être considérée comme un moyen au service d’objectifs de développement du lien social, d’insertion sociale, de prévention de la délinquance ou de réussite éducative, voire très indirectement d’insertion professionnelle (2 sites). Dans le cadre du volet habitat également, on peut trouver des actions visant à valoriser l’image du quartier, ou à l’occasion de la transformation du quartier apportée par le renouvellement urbain.
Les résultats des actions en matière de culture sont le plus souvent envisagés en termes de socialisation, de développement personnel, de valorisation de soi, d’épanouissement, d’ouverture aux autres, etc., autant de critères qui ne sont évidemment ni objectivables ni quantifiables.
b) Lutte contre les discriminations
Les enjeux d’intégration et de lutte contre les discriminations ont vocation à faire l’objet d’une prise en compte transversale, comme le définit la circulaire du 24 mai 2006, qui appelle à une « prise en compte, dans chacune des thématiques, d’objectifs en faveur de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances ».
Dans les CUCS, l’intégration, la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances font l’objet le plus souvent d’un volet ou axe transversal (12 CUCS sur 20), ou d’objectifs intégrés à certains volets (4 CUCS sur 20), en particulier Citoyenneté et prévention de la délinquance.
Volet dédié |
Objectif transversal à l’ensemble des thématiques |
Objectif intégré à une ou plusieurs thématiques | |
Prise en compte de la thématique « intégration et lutte contre les discriminations » |
2 / 20 |
12 / 20 |
4 / 20 (en particulier sur la citoyenneté/prévention, mais également emploi, habitat et santé) |
Non prise en compte de la thématique |
1 / 20 | ||
On constate tout d’abord, dans les évaluations, une certaine séparation entre les enjeux d’intégration et de lutte contre les discriminations. L’enjeu d’intégration est très largement relié aux actions relevant de l’accès au droit ou d’apprentissage de la langue française et d’alphabétisation (voir sur ce point les parties qui y sont consacrées dans les volets « Citoyenneté et prévention de la délinquance » et « Réussite éducative »).
Très peu d’évaluations font de la question des discriminations un objectif dont il s’agit de mesurer les résultats. Au final, on a très peu de visibilité sur le volume d’actions mises en place y répondant effectivement.
Six sites de l’échantillon ont mis en place un Plan territorial de lutte contre les discriminations sur le marché du travail, dispositif national élargi et renforcé par le CIV du 9 mars 2006, régi par un appel d’offres national et une délégation de crédits aux préfets de départements, délégués de l’Acsé. Si ce dispositif n’est pas entièrement intégré au CUCS, il peut faire émerger des actions mobilisant des financements CUCS. Les évaluations des six sites en question ne mentionnent pas les plans de lutte, et ne posent pas la question des résultats des actions répondant à cet enjeu :
– Site de type 1 : l’évaluation mentionne un objectif de lutte contre les discriminations dans le volet emploi avec deux actions dont le contenu et les résultats ne sont pas précisés.
– Site de type 3 : une question évaluative porte sur l’apport du CUCS en matière de lutte contre les discriminations. L’évaluation fait mention d’une action de job dating qui contribue à lutter contre les discriminations dites spatiales ou territoriales (le fait d’habiter dans un quartier connoté négativement) à l’embauche ;
– Site de type 3 : le sujet des discriminations n’est pas traité dans l’évaluation ;
– Site de type 3 : l’évaluation présente certaines actions des volets emploi, développement social et culture comme ayant pour objectif secondaire la lutte contre les discriminations, sans analyser leurs résultats ;
– Site de type 5 : un objectif territorialisé de lutte contre toutes les formes de discriminations et d’exclusion fait l’objet d’actions qui rejoignent des enjeux d’intégration / accès au droit. Leurs résultats ne sont pas analysés ;
– Site de type 5 : un travail d’analyse sociologique des discriminations subies par les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires a conduit notamment à des actions orientées contre les discriminations spatiales ou liées à la jeunesse, sans que leurs résultats soient analysés ;
Parmi les sites de l’échantillon ne disposant pas d’un plan de lutte, trois évaluations évoquent cet enjeu et y apportent des commentaires. Ce sont plus les réalisations qui sont évoquées que les résultats, difficiles à mesurer :
– Site de type 3 : l’évaluation s’intéresse à la question des discriminations, indiquant qu’aucune action n’a été mise en œuvre pour répondre à l’objectif d’amélioration de la connaissance des faits de discrimination. Aucun observatoire ou dispositif d’analyse et de mesure des faits de discriminations n’a été mis en place. En revanche d’autres actions qui visent l’intégration et à la lutte active contre les discriminations ont été menées, reliant les préoccupations d’accès au droit, d’apprentissage de la langue française, ou de mémoire de l’immigration, ou des actions de lutte contre les discriminations liées au genre.
– Site de type 4 : la question des discriminations est posée dans l’évaluation du volet Réussite éducative. Au-delà des actions d’apprentissage de la langue française, une action propose un accompagnement social à un public prioritaire de femmes migrantes. Les résultats ne sont pas analysés davantage.
– Site de type 5 : l’évaluation mentionne plusieurs actions répondant à l’objectif de lutte contre les discriminations, en les rattachant à la thématique de l’intégration et de l’accès au droit. Les prestations de conseil juridique et d’interface avec les institutions (notamment pour des personnes illettrées ou ne maîtrisant pas la langue française) financées par le CUCS permettent en effet de répondre aux besoins d’un public placé dans une situation d’exclusion relative.
D. CONSTATS SYNTHÉTIQUES PAR THÉMATIQUE
Les constats synthétiques sur les résultats par thématique, en termes d’effectivité de la mise en œuvre des actions sont les suivants.
Les volets Éducation, Citoyenneté et prévention de la délinquance et Emploi ont été généralement prioritaires dans la période 2007-2009.
La mise en place des Programmes de réussite éducative qui a fait débat en 2006 en suscitant entre autres une polémique entre les tenants des actions collectives traditionnellement financées dans le cadre des contrats éducatifs locaux, et les tenants de l’action individualisée, cœur de doctrine de la réussite éducative, a accru l’implication des acteurs locaux et permis la formalisation de véritable politiques éducatives locales, en germe déjà grâce aux CEL et aux PEL. Au lieu de se substituer aux actions collectives, les actions individualisées se sont généralement ajoutées, permettant aux volets éducatifs des CUCS d’offrir une palette diversifiée d’interventions. L’affectation d’une enveloppe fléchée tant au niveau national qu’au niveau local, et l’organisation spécifique du dispositif autour d’un coordonnateur dédié et d’une équipe pluridisciplinaire, a donné une lisibilité forte à la Réussite éducative, et sans doute aussi les moyens d’un suivi, qui permettra demain une évaluation locale et nationale, qui pourrait être riche d’enseignements sur une politique de facto expérimentale. Par ce volet, les communes plus que les intercommunalités ont affirmé un chef de file, qui redit le rôle de premier plan qu’elles souhaitent tenir dans la politique de la ville. Le portage du dispositif ayant été également proposé aux établissements scolaires, on observe également l’implication forte de l’Education nationale dans cette politique locale. Dans ce cas de figure, le dispositif s’est parfois plus centré sur la sphère de l’établissement et été ainsi moins coordonné avec le CUCS. Il est à noter que, porté par l’établissement scolaire ou par la commune, le dispositif repose sur ses crédits spécifiques qui financent y compris le temps des fonctionnaires de l’Éducation nationale. Malgré les débats du début, le volet éducatif du CUCS, à forte effectivité, a indéniablement, de l’avis de nombreux acteurs, produit des résultats positifs, et il est à gager qu’une évaluation apte à suivre des cohortes de bénéficiaires observerait demain des impacts positifs.
Le volet prévention de la délinquance et citoyenneté a été régulièrement important et fortement investi, particulièrement par l’État qui poursuit au travers du CLSPD (ou CISPD) un dialogue avec la collectivité porteuse. Pour autant, sur plusieurs CUCS la programmation paraît floue : elle chevauche les objectifs parfois du volet éducation, ou des volets optionnels sur lesquels la collectivité préfère couvrir des actions en faveur du lien social, de la culture, du sport et des loisirs pour les jeunes, qui pour beaucoup traduisent implicitement des objectifs de prévention primaire. Le volet est bien identifié en revanche pour le dispositif VVV qu’il mobilise régulièrement. Financé par le FIPD qui prévoit d’allouer des enveloppes significatives à la vidéoprotection, le volet se voit parfois solliciter à cette fin. Cet outil de prévention situationnelle fait toujours débat et cristallise l’antagonisme entre une approche « sécuritariste » et une approche « préventionniste » de ce volet du CUCS. Sur certains sites, la demande des représentants de l’État d’installer une vidéoprotection est rejetée ou différée par la collectivité, et ce sujet peut devenir bloquant.
Les nouvelles stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance, mesure 25 du plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes du 2 octobre 2009, ne sont évoquées sur aucun des sites de l’échantillon ni sur les autres sites connus du cabinet. Elaborées par le CLSPD, lui-même en principe relevant du CUCS ou à tout le moins relié à lui, ces stratégies territoriales apparaissent comme le nouvel instrument thématique du volet prévention de la délinquance. Il est substitué à l’ancien CLS qui, trop formaliste et peu opératoire, est abandonné. Cependant, ses textes (circulaires, livret pratique...), pourtant pour certains cosignés par le ministre de la cohésion sociale, ne font pas référence au CUCS, ni à la politique de la ville. Ses actions à l’instar de celle des CLS antérieurs, sont cofinancées par les crédits politiques de la ville et « territorialisées dans les CUCS » (rapport du SG- CIPD 2008). Le FIPD, abondé par les crédits de l’Acsé, est géré par le SG-CIPD. Le volet sécurité et prévention traduit donc aujourd’hui plus encore qu’hier la tendance générale des dispositifs thématiques à s’autonomiser, et d’une certaine manière à s’émanciper du CUCS. Dans ce cas, cela est d’autant plus paradoxal que ses crédits sont parmi ceux, qui clairement fléchés, sont des crédits spécifiques de la politique de la ville.
Sous réserve d’informations complémentaires sur ce dispositif nouveau encore peu développé, il apparaît que les articulations – souhaitées ou non – entre les stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance et les volets et actions de la politique de cohésion urbaine et sociale devraient être précisées.
Le volet emploi-insertion et développement économique, a été fortement mobilisateur de financements, dont beaucoup de droit commun… qui auraient été investis sans doute de la même manière sans le CUCS. Au moins en théorie. Car indéniablement le CUCS a permis la concentration des acteurs et des moyens sur les publics des quartiers prioritaires, et suscité une pro activité (aller au devant des publics et non les attendre derrière un guichet) peu naturelle au service public de l’emploi. Et par le seul effet de concentration in situ, a multiplié les réalisations et les résultats.
La faiblesse de ce volet – et donc facteur d’inefficacité – est son déphasage des politiques et dispositifs de développement économique ainsi que de l’entreprise et des institutions consulaires. Symptôme supplémentaire de l’enclavement de la politique de la ville dans ces quartiers, aggravé par la répartition des compétences entre EPCI et Région d’une part, communes d’autre part, et la division des délégations en leur sein propre, les CUCS se sont trouvés en grande difficulté d’intéresser à leurs quartiers les acteurs du développement économique. Et ce, parfois même lorsqu’ils comprennent une ZFU.
Le volet habitat et cadre de vie devait à l’origine couvrir le PRU et ainsi mettre celui-ci en lien avec les autres actions du CUCS. Celui-ci devait appuyer et optimiser le PRU. Mais d’une part le PRU, du fait de son budget et de sa logique propre, était appelé à avancer à son rythme, et d’autre part tous les sites, loin s’en faut, ne sont pas concernés par un PRU. En l’absence de PRU, le volet ne présente guère d’action lourde sur l’habitat et le cadre de vie. En présence d’un PRU, rares sont les sites à les avoir mis en synergie. Ce qui a contribué à affaiblir le volet. Quand CUCS et PRU sont effectivement intégrés, le volet habitat trouve plus aisément son sens. Dans les deux cas, le volet s’investit souvent dans une convention de Gestion urbaine de proximité avec les bailleurs.
Le volet santé a globalement peu été investi, quelques exceptions mises à part. Ceci peut s’expliquer par le fait que la santé n’est pas directement de la compétence des collectivités territoriales. Toutefois, devant le constat dressé grâce à des diagnostics récents de plus en plus nombreux, d’une concentration des problèmes de santé dans les quartiers prioritaires, une action de coordination des acteurs de la santé et du social ainsi que des actions de prévention sont progressivement mises en place sur les territoires CUCS, autour des Ateliers santé ville.
Le défaut de stratégie est la cause principale des impasses de certaines actions de la politique de la ville. Cette déficience est intrinsèquement liée au manque de connaissance territoriale mutualisée et d’intelligence collective. Cependant, selon les thématiques, se font jour de véritables stratégies d’action locale, pour l’éducatif et la prévention par exemple... mais stratégies isolées. L’opacité de l’affectation des crédits Acsé à une partie des opérateurs associatifs de la politique de la ville serait liée à la montée en puissance de la thématique transversale « lien social ».
Cette situation mène à plusieurs questions : la professionnalisation des acteurs de la politique de la ville nécessaire ou non ? Ce qui ne va pas sans poser des questions sur l’essence même de la politique de la ville (dont les interventions financières sont par nature souples, peu « procédurées » et peu « critérisées » pour précisément soutenir les associations locales bénévoles et non professionnelles). La question de la participation des habitants : quels types de participation, à quelles fins ? Les liens entre ces thématiques et la problématique globale de l’intégration ?
Quelle architecture les CUCS présentent-ils finalement aujourd’hui ? Les volets sont de taille inégale, mais surtout sont activés par les instances formelles ou informelles, les acteurs, qui les régissent. Ainsi ne paraissent-ils pas pilotés globalement et transversalement par le comité de pilotage du CUCS. En l’absence de stratégie globale, des stratégies thématiques dominent : celle du CLSPD, du PRU, du CEL. Dès lors, les volets apparaissent comme un mode de classement des actions et des financements. Les programmes d’actions ciblés et coordonnés entre eux appelés par la circulaire de 2006, n’ont pas véritablement vu le jour.

E. APPROCHE DES IMPACTS GLOBAUX DU CUCS
Comme évoqué en introduction de la 2ème partie, les évaluations menées en 2009 ou 2010 sur la période triennale 2007-2009, portent généralement sur la cohérence de la politique contractuelle, c’est-à-dire sur l’ensemble des conditions de mise en œuvre, ce qui est souvent le cas d’une évaluation intermédiaire, parfois sur la pertinence des objectifs et des actions, mais rarement sur l’efficacité. L’efficience est limitée à un bilan physico-financier des programmations. Efficience et efficacité supposent une mesure des impacts absente pour des raisons déjà présentées. En outre, les sites présentent une maîtrise inégale de la notion d’impact. En effet, lorsqu’une partie y est consacrée dans l’évaluation, où lorsque le sujet est évoqué par les acteurs consultés, on observe parfois des confusions notamment entre impacts et résultats des actions.
Alors que les résultats sont les conséquences brutes et immédiates des actions, les impacts en sont les conséquences secondes, à terme. Les premiers devraient être la réponse aux objectifs opérationnels, les seconds la réponse aux objectifs stratégiques. Pour les déterminer, il conviendrait que les objectifs aient eux-mêmes été formulés de manière précise, ajustés aux problématiques spécifiques des quartiers, et quantifiés. La circulaire du 15 septembre 2006 insiste sur le fait que les CUCS doivent intégrer la préoccupation évaluative dès leur phase d’élaboration et que, pour cela, ils doivent formuler des objectifs et des résultats attendus qui soient évaluables. On l’a vu, les prescriptions à cet égard des circulaires de 2006 et de 2007, comme de l’annexe 1 à la loi de 2003 n’ont pratiquement jamais été mises en œuvre. Il y aurait lieu à cet égard de s’interroger sur le rôle de l’État local et sur sa capacité à relayer ces prescriptions, et à faciliter leur mise en œuvre ; entre autres, à obtenir des services déconcentrés et de certains grands opérateurs les données dont ils sont seuls à disposer ; et qu’ils transmettent effectivement lorsqu’ils sont personnellement impliqués… ou qu’ils en ressentent l’obligation.
Pourtant, des impacts sont sensibles, perceptibles et perçus par les acteurs. Ils correspondent aux transformations sur les quartiers et sur leurs habitants, à l’évolution de leurs conditions socio-économiques, en ce qu’elles seraient en partie attribuables au CUCS et plus largement à la politique de la ville ; les impacts peuvent aussi porter sur tel ou tel aspect de la vie du quartier, son climat, sa perception, son image, ou la vie associative par exemple. Tangibles ou intangibles, d’ordre matériel ou immatériel, leur causalité est multiple, et s’ils sont d’autant plus difficiles à mesurer et à quantifier, ils ne peuvent être méconnus. D’où la difficulté du présent exercice qui, croisant et synthétisant des données qualitatives, doit retracer en toute relativité les impacts relevés par les sites de l’échantillon de leur action.
L’analyse des impacts est réalisée notamment dans les évaluations des CUCS de 4 sites (type 3 et 5) et de manière plus ponctuelle dans les évaluations de 8 autres.
Plusieurs types d’impacts, compris comme la conséquence indirecte des résultats d’actions du CUCS, sont ainsi recensés par les différents sites. De manière générale, lorsque des améliorations sont perçues par les acteurs locaux et par les habitants, celles-ci correspondent à une amélioration de la cohésion et de la dynamique sociale dans les quartiers, plutôt qu’à une amélioration de la situation socio-économique des habitants.
L’amélioration du lien social
La problématique globale du lien social est rémanente et sous-jacente depuis l’origine d’une politique spécifique en faveur des quartiers défavorisés – quand elle n’est pas explicite. Mais il semble qu’elle soit montée en puissance au cours de la dernière décennie. Elle recouvre plusieurs problématiques spécifiques liées à des facteurs très différents :
– les relations des publics issus de l’immigration entre eux et avec les autres habitants de la ville et du quartier, leur capacité culturelle et linguistique à l’intégration, leur volonté aussi à cet égard, le renouveau du fait religieux parmi elles, etc. ;
– l’implication dans la vie du quartier et de la ville, liée à un sentiment d’appartenance inégal selon l’ancienneté de l’arrivée en France et dans le quartier, et selon le pays d’origine ;
– le chômage et la rupture avec une activité générateurs de repli physique et psychologique ;
– les conséquences sanitaires et psychologiques induites entre autres par le chômage et la diminution des revenus ;
– les comportements sociaux principalement des publics jeunes ;
– le creusement de l’écart culturel entre les générations ;
– les rivalités entre quartiers.
La très grande majorité des sites relève un effet particulièrement positif des actions menées dans le cadre du CUCS, mais aussi plus largement dans le cadre de la politique de la ville, sur le lien social, au regard des différentes problématiques mentionnées. Malgré certaines limites, ils soulignent, de manière générale, une évolution positive des quartiers prioritaires concernant :
– la rencontre des habitants et leur implication dans la vie du quartier et de la ville : à cet égard, la participation des habitants aux activités financées par le CUCS ou autour des projets et réalisation de rénovation urbaine est considérée par les acteurs locaux tant comme un facteur de réussite des actions qu’une finalité en soi des actions de la politique de la ville.
D’une part, la participation des habitants aux activités socio-éducatives et culturelles financées par le CUCS et organisées par des structures de proximité (notamment les maisons d’activités, maisons de quartier, maisons du citoyen, etc.) est mise en avant par la grande majorité des sites comme un vecteur de lien social et de rencontre entre les habitants dans les quartiers prioritaires (8 sites). Sur un site de type 3 par exemple, l’implication des publics dans les activités menées sur les quartiers est reconnue dans l’évaluation du CUCS comme le premier facteur d’efficacité des actions.
D’autre part, le principe même de participation des habitants aux activités est mis en avant comme un effet positif des actions et comme une dimension de l’amélioration du quartier. Plusieurs degrés de participation sont ainsi mis en avant par les sites : de la simple fréquentation ponctuelle des structures de proximité, à la participation active et suivie dans les activités, mais sur un mode de « consommation » de l’activité, jusqu’à l’investissement de l’habitant dans l’élaboration de projets sur le quartier.
Par ailleurs, la rencontre des habitants et l’implication dans la vie du quartier sera d’autant plus importante que le quartier bénéficie d’une opération de rénovation urbaine. La mise en place d’actions de concertations, de chantiers d’insertion mais aussi d’événements d’inauguration autour de la mise en œuvre du PRU sont en effet générateurs d’implication des habitants dans la vie de leur quartier.
Toutefois, le postulat qui consiste à considérer la participation des habitants comme une finalité en soi peut être interrogé (cf. 3ème partie, point 6. Participation des habitants), notamment dans la mesure où celui-ci se heurte à la difficulté d’élargir le noyau dur des habitants impliqués.
En effet, il existe pratiquement toujours une fraction de population naturellement impliquée, et une autre fraction se tenant à l’écart de la vie du quartier ; proportionner ces deux fractions n’est possible que qualitativement. Et si la première est plus visible – et permet d’observer une certaine vitalité sociale –, elle fait écran à la seconde, encore moins quantifiable, repérable et mobilisable. On peut relever cependant le cas de publics particulièrement difficiles à mobiliser : les personnes en rupture sociale, comme le public en errance, les publics en repli communautaire, ou encore, de manière assez générale, les communautés de gens du voyage en voie de sédentarisation.
La mixité culturelle et le dialogue interculturel sont une autre composante du lien social mis en avant par les différents sites (5 sites). Ceux-ci relèvent un impact favorable du CUCS et plus largement de la politique de la ville sur les relations des publics issus de l’immigration entre eux et avec les autres habitants de la ville et du quartier, leur capacité culturelle et linguistique à l’intégration, et leur volonté aussi à cet égard. Entre autres, les actions de sensibilisations aux diversités culturelles, à travers des ateliers cuisine par exemple, mis en œuvre sur un site de type 5, sont mises en avant par les sites comme des moyens efficaces de favoriser le dialogue interculturel.
Cependant, on observe une difficulté à toucher certaines communautés – a fortiori quand l’appartenance culturelle est déterminée par le fait religieux. Certains sites ont mis en évidence que les habitants de certaines communautés restent entre eux et participent moins aux activités proposées, alors même qu’ils peuvent représenter une part très importante de la population dans les quartiers. Ceci est en partie lié au fait qu’ils disposent de leurs propres réseaux et équipements, selon les acteurs consultés.
Les liens inter quartiers : de nombreux sites estiment qu’ils ont été renforcés, entre autres, grâce à certaines actions du CUCS mais également et surtout du PRU. Le CUCS, à travers la mise en place dans les quartiers prioritaires d’activités attractives pour les habitants du reste de la ville et de l’agglomération (compétitions sportives inter quartiers par exemple), mais aussi à travers l’organisation de sorties hors du quartier, pour les habitants, permet de favoriser les liens entre les quartiers et surtout de réduire les rivalités tournant parfois à l’affrontement entre groupes de jeunes s’identifiant à leur quartier ou commune.
Toutefois, l’évolution positive des liens inter quartiers est nettement plus visible dans les quartiers objets d’un PRU. Sur un site de type 5, par exemple, les opérations de démolition-reconstruction dans le désenclavement des quartiers concernés et leur ouverture sur le reste de la ville et l’agglomération, ont des résultats importants à cet égard.
La diminution de l’isolement et du repli sur soi est mise en avant par de nombreux sites de l’échantillon comme un effet notable du CUCS. Les actions d’animation sociale de proximité permettent un accès pour des personnes relativement isolées socialement et/ou à faibles revenus à des activités collectives créatrices de lien social. Par ailleurs, les actions de médiation sociale, développées entre autre dans le cadre de la GUP, permettent de développer des temps d’échanges et d’écoute et d’aller à la rencontre des habitants. Ces types d’actions sont généralement perçus comme un succès par les acteurs locaux.
L’amélioration du sentiment de sécurité
Sur un nombre relativement important de sites, les évaluations et les acteurs consultés font observer un effet positif du CUCS et des actions de la politique de la ville sur le sentiment d’insécurité dans certains de leurs quartiers prioritaires. Il s’agit avant tout d’appréciations qualitatives appuyées sur le ressenti et les observations des acteurs locaux, des acteurs associatifs, techniciens, élus ; mais aussi dans des cas plus rares, d’appréciations quantitatives appuyées sur des enquêtes auprès des habitants (enquêtes dont on regrette cependant de ne pas toujours connaître les méthodologies, ni les bases quantitatives sur lesquelles elles s’appuient, ce qui ne peut que conduire à relativiser la viabilité des résultats transmis).
On observe ainsi sur de nombreux quartiers, une amélioration du sentiment de sécurité et ce, sans recensement précis de l’évolution des faits de délinquance, ou, alors même que les faits de délinquance sur le quartier ont stagné ou ont augmenté (dans les cas où le site a mis en place un outil de veille territoriale permettant de mettre en évidence l’évolution de la délinquance à l’échelle des quartiers prioritaires).
Par exemple, les « enquêtes écoute habitants » menées dans le cadre de l’évaluation du CUCS et du PRU d’un site de type 3 (149), montrent qu’en moyenne, sur l’ensemble des quartiers prioritaires, de plus en plus d’habitants se sentent en sécurité dans leur quartier (en 2002, 82% des personnes interrogées se sentaient en sécurité dans leur quartier, contre 88% en 2009).
L’amélioration du sentiment de sécurité est également relevée, mais de manière plus qualitative cette fois, sur 4 sites.
Dans ce cadre, les acteurs mettent en avant le rôle primordial du renforcement de la présence de proximité et notamment des médiateurs sociaux sur les quartiers. Un site de type 3, qui a mis en place des médiations de nuit, met en avant cet effet sur le lien social, l’apprentissage du vivre-ensemble, la régulation et la facilitation des relations sociales la nuit. Elle semble permettre le rétablissement du dialogue, notamment entre les jeunes et les autres habitants mais aussi entre voisins. L’existence même des médiateurs de nuit permet de marquer une présence pour les habitants ; l’effet symbolique est fort. Potentiellement, les habitants peuvent faire appel à ces médiateurs. Les effets directs produits par les médiateurs de nuit à ce sujet sont complexes à mesurer, mais il n’est pas douteux qu’ils sont une présence rassurante.
Aussi l’occupation des espaces publics par les jeunes participe-t-elle d’une certaine crainte, due à une méconnaissance mutuelle qui, in fine, peut renforcer le sentiment d’insécurité. Le sentiment d’amélioration repose aussi en grande majorité sur l’aménagement des espaces extérieurs, espaces verts et de loisirs, travaux de voirie (éclairage notamment)…. Un ensemble d’interventions sur le bâti et le cadre urbain qui sont portées par un PRU apparait, à cet égard, comme un des éléments clés de la perception de la sécurité dans nombre des sites de l’échantillon. Les modifications urbanistiques et architecturales inspirées par la prévention situationnelle, ont donc, semble-t-il, porté leurs fruits.
Toutefois, les acteurs relèvent l’existence de perceptions différentes, entre les quartiers et y compris au sein des mêmes sites CUCS. Ainsi, les habitants qui eux se sentent en sécurité attribuent généralement ce sentiment au calme du quartier et, dans une mesure moindre mais de façon significative aux relations existantes entre eux, comme le souligne l’évaluation du CUCS d’un site de type 3 : 18 % des enquêtés attribuent la diminution de l’insécurité au fait que « tout le monde se connaît ».
L’amélioration de l’image des quartiers, aux yeux des habitants et à l’extérieur
Les habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, quartiers « sensibles », « difficiles »… doivent souvent composer avec l’image peu attractive qui s’en dégage, connotée et qui perdure ; les représentations négatives des quartiers difficiles sont plus lentes à modifier que le quartier lui-même. Pourtant les impacts des actions du CUCS et de la politique de la ville à cet égard sont notables ; ils ont permis une valorisation de l’identité du quartier et sa reconnaissance des habitants extérieurs. Comme le souligne un des acteurs consultés: « tous ces éléments d’identité et de reconnaissance sont difficilement mesurables mais apparaissent incontestables, notamment dans la dynamisation du quartier ». Un des quartiers d’un site de type 4 a par exemple bénéficié d’actions culturelles qui semble avoir porté ses fruits sur l’identité du quartier, qui est aujourd’hui reconnu comme un quartier vivant et dynamique culturellement. L’ensemble des actions culturelles qui y sont menées participent à valoriser positivement ses habitants et un certain nombre d’habitants de la ville fréquente les manifestations culturelles.
Les actions menées dans le cadre de la GUP et de la rénovation urbaine sont également facteurs de modifications positives des représentations vis-à-vis des quartiers.
L’appropriation du quartier
Les actions de la politique de la ville, rénovation urbaine y compris, par les effets sur le lien social, l’amélioration du sentiment de sécurité, la valorisation de l’image du quartier et des habitants, jouent un rôle sur le sentiment d’appartenance à un quartier et son appropriation par les habitants.
L’ensemble des activités et animations proposées dans les quartiers, avec l’appui du CUCS permet aux habitants de dépasser leur éventuelle perception négative de leur quartier et de se l’approprier. Par ailleurs, la consultation régulière des habitants dans le cadre du PRU, le soutien apporté aux habitants durant les phases de chantier permet d’accompagner la transformation urbaine et de favoriser l’appropriation par les habitants de leur nouveau quartier.
Dans ce contexte, on note une réelle plus-value des sites où le CUCS vient en accompagnement de la rénovation urbaine, en portant des projets en concordance avec la temporalité du PRU. À cet égard, on observe que le champ culturel est souvent privilégié pour que les habitants s’approprient la nouvelle image de leur quartier (ateliers écriture, concours photo attestant de l’évolution du quartier, fresques, etc.).
L’évolution des comportements individuels
Respect des lieux et des personnes : d’une part, la participation des habitants aux actions socio éducatives, sportives, culturelles et de loisirs développées avec l’appui du CUCS ont favorisé leur immersion dans une vie de groupe et l’apprentissage de règles communes.
D’autre part, le développement des liens sociaux au sein du quartier et l’implication croissante d’une partie des habitants dans la vie de leur quartier favorisent le respect des lieux et des personnes. Par exemple, l’évaluation du CUCS d’un site de type 5 montre que l’impact des actions sur l’environnement des quartiers semble positif : « les rues alentours sont plus calmes, les habitants vivent plus en lien et dans un respect renouvelé des locaux. Les liens entre les habitants se sont améliorés avec des signes de respect plus présents, des dégradations moins importantes et des « gestes » nouveaux de la vie quotidienne comme les salutations plus nombreuses ». Toutefois, on note plusieurs limites à l’amélioration des comportements avec, notamment, des signes de manques de respect des personnes et des dégradations du cadre urbain, des graffitis sur les façades.
Confiance en soi et autonomie : de manière générale, les acteurs observent une évolution positive des publics entre le moment où ils intègrent une action et le moment où ils la quittent, en termes de comportement, d’autonomie, de confiance, de réussite. Sur un site de type 5, les engagements progressifs de bénévoles jusque là « repliés sur eux mêmes » ou mal à l’aise dans leur communication, les capacités à sortir de chez soi, les projets de formation, les désirs d’aller vers l’emploi, les souhaits d’activités au sein du quartier ou en association manifestent une dynamisation sociale durable. De même, les actions d’accompagnement à la scolarité semblent participer au progrès des enfants avec un effet de levier qui est la confiance en soi et en ses capacités.
L’amélioration de la dynamique associative
Si l’on observe des résultats tangibles liés aux financements du CUCS, comme la consolidation des structures associatives existantes et l’émergence de nouveaux projets associatifs, on relève également des résultats plus intangibles sur la dynamique associative, et notamment :
– de nouvelles pratiques associatives : de nombreux sites mettent en avant un impact réel des actions du CUCS sur les pratiques professionnelles des associations. On observe que de nombreux porteurs de projets ont adopté des démarches proactives. Sur un site de type 3, par exemple, la rencontre sur le quartier a été adoptée comme nouvelle méthode de travail et nouveau mode d’organisation par plusieurs associations œuvrant sur les quartiers prioritaires. Le CUCS a permis à cet égard de sensibiliser les porteurs de projets à la nécessité d’aller vers les habitants des quartiers, plus difficiles à toucher, et traiter différemment la personne notamment lors du premier accueil.
– une certaine professionnalisation des intervenants associatifs, par exemple, à travers l’accompagnement des opérateurs dans le montage des projets ou encore la formation des porteurs de projets à l’évaluation,
– une plus grande mise en réseau des acteurs associatifs, par exemple, à travers les réunions de coordinations dans le cadre du CUCS qui permettent entre autres, de dépasser une certaine logique concurrentielle entre les associations. Sur un site de type 2, le travail de mise en réseau des associations a donné des résultats positifs en termes de coordination et de mise en cohérence des actions politique de la ville sur les quartiers.
Le renouvellement de la dynamique d’action publique
De manière générale, on note une évolution des méthodes d’intervention des acteurs publics (collectivités et services de l’État) sur les quartiers et leurs habitants. La majorité des évaluations met en avant un impact positif du CUCS sur les relations entre intervenants et publics, grâce à l’appui des acteurs et structures de proximité dans les quartiers.
En effet, les opérateurs présents dans les quartiers permettent de faire le lien entre les publics et les institutions. Le renforcement des relais de proximité dans la quasi-totalité des CUCS permet, de manière directe ou indirecte et suivant une logique descendante, de renforcer la présence des institutions dans les quartiers, d’une part ; et permet d’autre part, par le biais de ces intermédiaires, la remontée des attentes et des besoins des quartiers vers les responsables d’actions publiques, suivant une logique ascendante.
Le fait que les acteurs publics s’appuient davantage sur des relais de proximité permet une plus grande lisibilité des actions et une meilleure orientation des publics vers les structures de droit commun (3 sites). Par exemple, sur un site de type 2, les actions de proximité en direction des demandeurs d’emploi sur les quartiers prioritaires permettent d’assurer le repérage et l’accès d’une partie des demandeurs d’emploi aux services de droit commun: Pôle emploi, Plan locaux d’insertion par l’emploi, Mission locale d’insertion, services sociaux…
Les évaluations et acteurs consultés soulignent également un impact des actions du CUCS sur la restauration du lien de confiance entre les acteurs publics et les usagers. La majorité des actions met en avant l’implication ou du moins la recherche de participation des publics de façon directe ou indirecte. Cette recherche de participation s’effectue en établissant les conditions de mise en confiance avec les publics et une relation de proximité à travers des moments ou des temps de dialogue ou d’échange.
Par ailleurs, plusieurs sites relèvent un certain changement de regard des institutions sur les publics (2 sites). L’expérience d’un site de type 3 représente un cas emblématique dans lequel les acteurs publics, dans le cadre du volet éducation du CUCS, cherchent dans leur fonctionnement les raisons de difficultés d’accès des publics-cibles, plutôt que dans l’inadaptation de ces publics. Les acteurs ont identifié ce qu’ils devaient modifier dans leurs représentations (des causes de l’absentéisme scolaire, en l’occurrence), et partant, dans leurs attitudes et leurs organisations, pour mieux traiter les difficultés scolaires. Cette évolution de la posture des acteurs publics conduit à faire évoluer les modalités d’action publique qui éloignent les personnes, plutôt que d’attendre un changement de la part des personnes qui (se) seraient éloignées de l’action publique.
Ainsi que formulé dans la dernière partie de ce chapitre, les impacts et les résultats des actions menées sur les quartiers prioritaires sont difficilement mesurables. L’ensemble des données disponibles et les dires d’acteurs permettent toutefois de dégager des tendances significatives d’une amélioration, stagnation ou dégradation de la situation. Nous relevons que s’ajoute une quatrième situation : celle dans laquelle les écarts se creusent entre les quartiers ciblés par la politique de la ville.
Evolution de la situation des quartiers selon les entretiens obtenus et les questionnaires adressés aux préfectures par le SG-CIV
Sites |
Ne se prononce pas |
Dégradation |
Stagnation |
Amélioration |
Creusement des écarts entre quartiers |
TYPE 1 | |||||
Site 1.1 |
|||||
Site 1.2 |
|||||
Site 1.3 |
|||||
TYPE 2 | |||||
Site 2.1 |
Dégradation sur certains quartiers |
Sur le plan de l’éducation et de la sécurité |
|||
Site 2.2 |
L’évaluation évoque une « paupérisation » |
Amélioration de la « dynamique interne »aux quartiers |
|||
Site 2.3 |
|||||
TYPE 3 | |||||
Site 3.1 |
Dégradation sur l’emploi et l’insertion |
Sur le plan de l’éducation et de la jeunesse |
Sur les quartiers ANRU et concernant la prévention et le lien social |
||
Site 3.2 |
X |
||||
Site 3.3 |
Des poches de pauvreté subsistent |
X |
|||
Site 3.4 |
X |
||||
Site 3.5 |
X |
Sur 1 quartier hors ANRU |
Sur 3 quartiers dont 1 ANRU |
Sur 2 quartiers dont 1 ANRU |
|
Site 6.3 |
X |
||||
TYPE 4 | |||||
Site 4.1 |
X |
||||
Site 4.2 |
X |
Hors quartier ANRU |
Sur le quartier ANRU |
||
Site 4.3 |
|||||
Site 4.4 |
X |
Sur la ZUS |
Raccrochage de certains quartiers |
||
Site 4.5 |
X |
||||
TYPE 5 | |||||
Site 5.1 |
X |
||||
Site 5.2 |
X |
Décrochage de certains quartiers désamorcé |
|||
Site 5.3 |
X |
Hors quartiers ANRU |
Sur les quartiers ANRU |
||
Site 5.4 |
|||||
Site 5.5 |
X |
||||
Source : dires d’acteurs responsables de la politique de la ville et observation formulée par les préfectures dans le cadre du questionnaire du SG-CIV
Légende :
Commentaires : constats issus des évaluations et des entretiens menés
X : constats issus des questionnaires transmis par les préfectures au SG-CIV
Concernant les données recueillies, on constate :
– une relative concordance des constats issus des questionnaires transmis par la DIV, et des acteurs interrogés dans le cadre de la présente évaluation, c’est-à-dire les chefs de projet et les élus politiques de la ville ;
– les avis sont divergents dans deux cas seulement, dans lesquels la vision d’une stagnation de la situation de la préfecture est contredite par une vision plus pessimiste des acteurs de la politique de la ville (dégradation).
Dans l’ensemble, on observe que :
– la majorité des sites de l’échantillon (13 sur 20 sites) observent des améliorations sur leur territoire, constat qui est à mettre en perspective avec les données issues des questionnaires transmis par la DIV aux préfectures qui ne relèvent des améliorations que dans 4 cas sur 14. Ceci est à nuancer toutefois avec le fait que sur ces quatre cas, deux corroborent les dires des acteurs (dans les deux autres cas, les acteurs ne se sont pas prononcés). Par ailleurs, il faut noter qu’environ la moitié des personnes interrogées dans le cadre de ce questionnaire n’ont pas souhaité se prononcer. On peut donc conclure à l’observation d’une amélioration tendancielle des quartiers telle que relatée par les acteurs de la politique de la ville ;
– certains sites relatent une tendance à l’amélioration sur certains de leurs quartiers et à la dégradation sur certains autres de leurs quartiers. Dans ces cas, les difficultés se concentrent spécifiquement sur les quartiers hors ANRU ou en ZUS ou sur une thématique comme sur un site de type 3 où la thématique emploi insertion enregistre de mauvais résultats selon les acteurs interrogés ;
– certains sites déclarent observer d’une part une situation stagnante et d’autre part d’autres quartiers en voie d’amélioration Ces derniers sont souvent des quartiers ANRU tandis que les quartiers en stagnation ne bénéficient pas de rénovation urbaine ;
– d’autre part, le croisement de ces résultats par type ne fait pas apparaître selon nous de tendances significatives, sauf à considérer que les améliorations sont plus sensibles sur les quartiers de petite échelle. Une tendance en termes de typologie se dégage pour les sites ayant connus une dégradation de la situation. Les difficultés semblent en effet se concentrer sur les territoires de type 2 (2 sites sur 3) et de type 3 (3 sites sur 5) – contre un site sur 5 en type 5, un site sur 4 en type 4 et aucun en type 1 ;
– enfin, les écarts entre quartiers se creusent dans 7 cas sur 20. Dans certains cas, on peut noter qu’il s’agit notamment de territoires dont certains quartiers ont fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain et enregistrent une nette amélioration en termes de cohésion sociale et de cadre de vie dans son ensemble, tandis que les autres quartiers, par contraste, font ressortir une stagnation ou une dégradation.
TROISIÈME PARTIE -
CONDITIONS D’EFFICACITÉ DES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE :
ANALYSE TRANSVERSALE
Cette troisième partie tente de mettre en évidence les éléments qui ressortent des évaluations comme étant les nœuds problématiques dans la mise en œuvre des actions de la politique de la Ville : en termes d’impact des actions, en fonction du contexte et du type de territoire, et de la gouvernance. Une typologie des « processus socio-urbains » sous l’action de la politique de la ville, peut être par commodité schématisée ainsi :
Le quartier apparemment pris dans un « cercle vicieux » : le processus de dégradation n’a pu être enrayé car le quartier, profondément et historiquement handicapé par une concentration ancienne de chômage et de précarité, est multi-impacté par des facteurs de contexte endogènes et exogènes : crise économique du bassin non ou mal reconverti, attractivité résidentielle nulle ou négative (on ne vient y habiter que par défaut et malgré soi), appauvrissement de l’économie résidentielle, fuite des jeunes diplômés, reproduction intergénérationnelle de l’échec, repli communautaire, échec de l’intégration, etc. Ces quartiers sont aussi les plus éloignés d’un centre urbain, et les plus mal reliés. Bénéficiant d’un PRU, celui-ci ne porte pas d’effets visibles à court terme : la dynamique démographique ne suit pas le rythme des démolitions-reconstructions, et quoique le quartier change physiquement, la pesanteur de son image et l’inertie démographique pourraient rendre vaines les actions de la politique de cohésion sociale. Quoique dans ces cas extrêmes l’implication politique et stratégique des partenaires financeurs soit forte, et que le pilotage du CUCS et du PRU soit offensif, les acteurs sentent bien et expriment que les actions de l’un et de l’autre sont insuffisantes pour améliorer les conditions de vie et la cohésion sociale à court terme de manière perceptible dans le vécu présent des habitants. Les effets du PRU mais aussi du PRE et de l’éducation prioritaire n’apparaîtront qu’à terme. Des facteurs d’aménagement du territoire et de développement économique durable sont surdéterminants. Et ce sont précisément ces facteurs que ni le CUCS ni le PRU ne peuvent mobiliser. L’échelle de traitement de ces quartiers n’est pas le quartier, c’est le bassin d’emploi et d’activités et la région ; et les réponses à mobiliser devraient figurer au SRADDT, au SRDE, au CPER, au PDU, au PLH communautaire. Tandis qu’au quotidien l’action du CUCS est divisée entre deux approches déterminantes et également nécessaires, l’approche éducative et « préventionniste » et l’approche « sécuritariste ».
Par ailleurs, des quartiers sont signalés comme reflétant une dynamique d’évolution positive ; ils sont apparemment pris dans un « cercle vertueux » : les acteurs y constatent et ressentent une amélioration significative ou substantielle… mais guère quantifiable. En général, ce quartier bénéficie d’un PRU qui développe ses réalisations au rythme prévu ou sans trop de retard. Les handicaps structurels étaient plus facilement corrigeables : le désenclavement s’opère, les liaisons au centre ville et aux pôles d’activités sont améliorées. Le PRU est équilibré, et s’il ne l’était pas, il a été amendé et complété, par exemple par une structure d’accueil d’entreprises et d’aide à la création d’entreprise. Mais aussi et nécessairement, CUCS et PRU bénéficient d’une gouvernance stratégique commune et d’un pilotage opérationnel appuyés sur un consensus dur et durable des financeurs, qui stimule et légitime constamment l’action. L’accord des volontés n’est pas une vaine expression, et l’implication conjointe du représentant de l’État et de l’exécutif élu est apte à mobiliser et à mettre en synergie effective tous les acteurs et les moyens nécessaires autour d’une démarche de projet dynamique. Le service public de l’emploi est actif : sa présence sur le quartier est facilitée par le CUCS (qui finance le fonctionnement d’une structure par exemple). Mais si les indicateurs de l’emploi ou de la délinquance n’évoluent encore que faiblement, les acteurs soulignent des effets seconds positifs et non concrètement tangibles, sur le climat du quartier, les relations sociales, l’image et un sentiment de « mieux vivre ». À tous égards, si l’imputation « mécaniste » de ces effets aux actions financées par le CUCS, n’est guère possible, ils ne peuvent en être dissociés. Le cercle vertueux de ce processus – qu’il s’agisse d’un frémissement ou d’une mutation engagée – est le produit de l’action publique à laquelle contribuent les dispositifs de la politique de cohésion urbaine et sociale. Pour beaucoup ce cercle vertueux est encore fragile, et vulnérable, et appelle à consolider la concentration des efforts, c'est-à-dire à maintenir une gouvernance qui reste la condition de l’efficacité au moins autant que les moyens financiers.
Entre ces deux processus, un processus intermédiaire est relevé par les experts, sociologues et urbanistes, et observés également par les élus. On ne peut parler ni de cercle vertueux ni de cercle vicieux, mais d’un effet de stagnation malgré la concentration des efforts d’une politique de la ville ancienne, et malgré parfois une gouvernance coordonnée et dynamique, malgré également souvent le démarrage d’un PRU. Dans des ensembles urbains aux morphologies et aux échelles diverses, le quartier remplit une fonction d’accueil social qui le voue à recevoir les populations les plus précarisées et fragiles : quartier d’habitat social souvent monofonctionnel, il accueille ceux qui ne peuvent aller ailleurs, et qui au mieux le quittent lorsqu’ils le peuvent ; le « quartier d’accueil social » remplit la fonction que le système urbain dans lequel il s’inscrit lui a en quelque sorte imposé, et il conservera donc ses indicateurs négatifs tant qu’il en sera ainsi. Cependant, l’action menée sur ce quartier, optimisée par des facteurs exogènes liés le plus souvent à la reprise d’activités sur le bassin et à une période de croissance économique, entraînera des impacts positifs… mais ceux-ci s’observent ailleurs.
Ces trois processus ne sont pas figés ni isolés : ils peuvent se succéder sur un même quartier. Ce qui souligne que sortir un quartier de sa spirale négative ne relève pas seulement des moyens mobilisés, mais du bon pilotage de ces moyens, c’est-à-dire d’abord une stratégie globale pour le quartier à moyen et long terme, intégrée dans un projet global d’agglomération ou métropolitain, tenant compte lui-même des prospectives stratégiques régionales et des politiques globales d’aménagement et de développement durable.
Les clés d’analyse de ces trois processus type sont à rechercher dans la double problématique de l’ouverture et de la fermeture du quartier et de ses habitants d’une part, des mobilités d’autre part. En effet, l’ouverture physique du quartier – à quoi s’emploient généralement les projets de rénovation urbaine – est un déterminant premier comme le développement des modes de mobilité et des liaisons avec l’ensemble du bassin. L’ouverture immatérielle – culturelle – des habitants est un deuxième déterminant : elle entraîne et dépend de capacités de mobilité physique et psychologique qui se traduisent dans les parcours scolaires, les parcours d’insertion, les parcours résidentiels, les parcours professionnels, etc. La politique contractuelle de cohésion urbaine et sociale est celle qui permet la mise en synergie des politiques publiques, depuis le désenclavement urbain jusqu’à l’intégration effective.
A. INFLUENCE DES VARIABLES DE CONTEXTE SUR L’EFFICACITÉ PAR TYPE DE TERRITOIRE
1. La taille du territoire et la part d’habitants en quartier CUCS comme critère principal de distinction (variables de contexte)
a) Indicateurs de contexte renseignés pour les 20 sites
La lecture des indicateurs de contexte ci-dessus – non pris en compte dans la classification des sites par type – indique une grande hétérogénéité dans la situation des quartiers prioritaires à l’intérieur de chaque type.
Situation moyenne des quartiers prioritaires de chaque site
|
Revenu fiscal médian QPV 2005 - SF |
Revenu fiscal médian – Ecart à l’unité urbaine |
Taux de chômage QPV 2006 - ANPE, SF |
Taux de chômage – Ecart à l’unité urbaine |
Part de bénéficiaires de la CMUC - CNAM |
Part de bénéficiaires de la CMUC - Ecart à l'unité urbaine |
Part de logements sociaux dans l’agglomération 2006 - SF |
1.1 |
12 236 € |
-4% |
14% |
+ 2 pts |
15% |
+ 2 pts |
24% |
1.2 |
7 574 € |
-48% |
17% |
+ 6 pts |
26% |
+ 17 pts |
35% |
1.3 |
10 680 € |
-13% |
16% |
+ 4 pts |
17% |
- 1 pt |
14% |
Total TYPE 1* |
|||||||
Moyenne* |
10 163 € |
-21% |
16% |
+ 4 pts |
19% |
+ 6 pts |
24% |
2.1 |
13 000 € |
-9% |
24% |
+ 3 pts |
14% |
= |
15% |
2.2 |
12 361 € |
-37% |
14% |
+ 4 pts |
11% |
+ 5 pts |
9% |
2.3 |
11 875 € |
-28% |
16% |
+ 5 pts |
17% |
+ 9 pts |
16% |
Total TYPE 2* |
|||||||
Moyenne |
12 412 € |
-25% |
18% |
+ 4 pts |
14% |
+ 5pts |
13% |
3.1 |
9 526 € |
-50% |
15% |
+ 7 pts |
16% |
+ 10 pts |
11% |
3.2 |
9 953 € |
-41% |
23% |
+ 13 pts |
30% |
+ 24 pts |
27% |
3.3 |
11 434 € |
-36% |
12% |
+ 4 pts |
12% |
+ 6 pts |
23% |
3.4 |
6 090 € |
-56% |
23% |
+ 10 pts |
44% |
+ 25 pts |
11% |
3.5 |
13 801 € |
-18% |
13% |
+ 3 pts |
19% |
+ 5 pts |
24% |
3.6 |
10 108 € |
-20% |
16% |
+ 4 pts |
20% |
+ 5 pts |
22% |
Total TYPE 3* |
|||||||
Moyenne |
10 152 € |
-37% |
17% |
+ 7 pts |
24% |
+ 12 pts |
20% |
4.1 |
7 680 € |
-60% |
19% |
+ 9 pts |
23% |
+ 15 pts |
24% |
4.2 |
13 679 € |
-30% |
16% |
+ 6 pts |
15% |
+ 7 pts |
24% |
4.3 |
11 056 € |
-38% |
12% |
+ 3 pts |
24% |
+ 16 pts |
22% |
4.4 |
13 743 € |
-30% |
13% |
+ 3 pts |
10% |
+ 2 pts |
24% |
4.5 |
10 104 € |
-43% |
20% |
+ 11 pts |
29% |
+ 21 pts |
22% |
Total TYPE 4* |
|||||||
Moyenne |
11 252 € |
-40% |
16% |
+ 7 pts |
20% |
+ 9 pts |
23% |
5.1 |
11 921 € |
-33% |
15% |
+ 6 pts |
15% |
+ 8 pts |
18% |
5.2 |
10 535 € |
-33% |
17% |
+ 4 pts |
31% |
+ 23 pts |
17% |
5.3 |
10 796 € |
-39% |
19% |
+ 10 pts |
24% |
+ 16 pts |
19% |
5.4 |
10 624 € |
-40% |
13% |
+ 3 pts |
13% |
+ 7 pts |
9% |
5.5 |
10 611 € |
-35% |
19% |
+ 9 pts |
23% |
+ 12 pts |
32% |
Total TYPE 5* |
|||||||
Moyenne |
10 897 € |
-36% |
17% |
+ 7 pts |
21% |
+ 13 pts |
19% |
* QPV : quartier en politique de la ville
Seuls les sites de type 5 forment un ensemble plus homogène, présentant des moyennes assez proches les unes des autres sur l’ensemble des indicateurs. On peut expliquer cette homogénéité par un effet de moyenne dû au fait qu’ils regroupent chacun un grand nombre de quartiers aux caractéristiques différentes. Il s’agit donc de prendre en compte les écarts entre quartiers à l’intérieur de chaque site.
Ecarts entre les quartiers prioritaires de chaque site
au vu des indicateurs de contexte sélectionnés
|
Revenu fiscal médian QPV 2005 |
Taux de chômage QPV 2006 |
Part de bénéficiaires de la CMUC QPV 2006 | |||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum | |
1.1 |
12 236 € |
14% |
15 % | |||
1.2 |
7 085 € |
8 063 € |
15% |
20% |
25 % |
27 % |
1.3 |
10 680 € |
16 % |
17 % | |||
TYPE 1 |
7 085 € |
12 236 € |
14 % |
20 % |
15 % |
27 % |
2.1 |
11 207 € |
14 794 € |
9 % |
16 % |
9 % |
15 % |
2.2 |
11 574 € |
13 148 € |
11 % |
14 % | ||
2.3 |
10 175 € |
14 573 € |
15 % |
19 % |
11 % |
23 % |
TYPE 2 |
10 175 € |
14 794 € |
9 % |
19 % |
9 % |
23 % |
3.1 |
8 414 € |
10 638 € |
14 % |
18 % |
14 % |
21 % |
3.2 |
8 000 € |
11 762 € |
14 % |
26 % |
22 % |
33 % |
3.3 |
10 531 € |
17 352 € |
6 % |
19 % |
1 % |
19 % |
3.4 |
3 705 € |
11 680 € |
16 % |
30 % |
26 % |
52 % |
3.5 |
9 138 € |
19 211 € |
6 % |
24 % |
2 % |
39 % |
3.6 |
7 053 € |
15 783 € |
9 % |
36 % |
5 % |
37 % |
TYPE 3 |
3 705 € |
19 211 € |
6 % |
36 % |
1 % |
39 % |
4.1 |
7 680 € |
19 % |
23 % | |||
4.2 |
6 541 € |
26 605 € |
13 % |
17 % |
7 % |
20 % |
4.3 |
9 904 € |
13 998 € |
9 % |
20 % |
15 % |
29 % |
4.4 |
12 246 € |
15 240 € |
12 % |
14 % |
8 % |
12 % |
4.5 |
7 888 € |
14 278 € |
12 % |
20 % |
11 % |
30 % |
TYPE 4 |
6 541 € |
26 605 € |
9 % |
20 % |
7 % |
30 % |
5.1 |
7 013 € |
19 925 € |
5 % |
28 % |
3 % |
35 % |
5.2 |
3 373 € |
25 085 € |
5 % |
45 % |
1 % |
61 % |
5.3 |
6 462 € |
15 389 € |
4 % |
33 % |
7 % |
39 % |
5.4 |
2 581 € |
15 471 € |
7 % |
21 % |
7 % |
25 % |
5.5 |
6 058 € |
15 068 € |
8 % |
33 % |
6 % |
40 % |
TYPE 5 |
2 581 € |
25 085 € |
4 % |
45 % |
1 % |
61 % |
On constate au vu des indicateurs de contexte sélectionnés que les écarts entre quartiers sont différents d’un type de territoire à l’autre.
Les écarts les plus faibles sont constatés sur les sites de type 1 et 2, ce qui s’explique par le fait qu’étant donné leur petite taille et leur caractère moins urbain que les autres sites, ils comportent un nombre limité de quartiers en géographie prioritaire (3 maximum).
La même analyse peut être faite pour certains sites de type 4. Ceux d’entre eux qui regroupent un petit nombre de grands quartiers d’habitat social aux caractéristiques relativement similaires présentent en effet des écarts assez faibles. À l’inverse, l’un des sites présente pour sa part 5 quartiers (3 maximum sur les autres sites) de physionomie très différente et donc des écarts particulièrement importants, notamment en ce qui concerne le niveau de revenus.
Les types 3 à 5 sont ceux qui logiquement présentent les plus forts écarts. En effet, il s’agit bien souvent d’agglomérations, présentant un grand nombre de quartiers aux caractéristiques très différentes.
Synthèse de la situation des territoires relativement aux autres sites
TYPE 1 |
Revenus faibles Taux de chômage moyen - bas Part de CMUC moyenne Ecarts entre quartiers faibles à moyens |
TYPE 2 |
Revenus élevés Taux de chômage moyen - haut Part de CMUC basse Ecarts entre quartiers faibles à moyens |
TYPE 3 |
Revenus faibles Taux de chômage moyen Part de CMUC haute Ecarts entre quartiers forts |
TYPE 4 |
Revenus moyens Taux de chômage moyen - bas Part de CMUC moyenne Ecarts entre quartiers moyens |
TYPE 5 |
Revenus moyens Taux de chômage moyen Part de CMUC moyenne Ecarts entre quartiers forts |
b) Critique de la typologie initiale : variables de contexte influençant effectivement le succès des actions
L’étude menée sur les résultats des actions de la politique de la ville conclue à des résultats très hétérogènes entre les sites de chacun des types proposés. Au final, les variables de contexte ne paraissent pas influencer directement le succès des actions.
Toutefois, on peut observer que les quartiers les plus en difficulté concentrent effectivement l’action et donc sont susceptibles de connaître les améliorations les plus sensibles. L’ANRU notamment, priorisé sur les quartiers d’habitat social les plus dégradés, a permis une dynamique partout signalée comme positive, dont les premiers effets se font sentir ou sont attendus d’ici la fin des opérations.
À l’inverse, certains quartiers qui ne sont pas ceux sur lesquels la politique de la ville s’est déployée de manière prioritaire, mais qui concentrent une certaine précarité parfois plus forte que dans les ZUS, sont menacés d’une forte dégradation de la situation. C’est le cas des centres anciens très dégradés comprenant des poches de précarité, ainsi que des aires d’accueil des gens du voyage, souvent classés en priorité 3, souvent peu équipés et au tissu associatif peu développé, du fait d’une prise en compte plus récente par la politique de la ville.
Au-delà de ces facteurs de contexte, il semble que certains facteurs tels que le volume de moyens humains et financiers, le portage politique, la qualité de la définition de la stratégie, du partenariat et du pilotage ou encore l’articulation des dispositifs, constituent des leviers de réussite plus évidents.
c) L’impact du contexte justifie la redéfinition de la typologie initiale, réduite au nombre de deux cas de figure principaux.
Pour rappel, la typologie construite dans le cadre de cette étude repose sur deux critères : la taille et la configuration socio-urbaine du territoire.
Au final, il s’avère que le critère de la configuration socio-urbaine n’influe pas visiblement sur les résultats. C’est davantage la taille du territoire qui est susceptible d’influer sur les résultats, de manière indirecte.
a) Petites agglomérations et petits quartiers, niveau de précarité moyen : faible ingénierie, mais coordination des acteurs facilitée
Sur les territoires les plus petits et donc les moins dotés en crédits Acsé et de droit commun (type 1 et 2), la faiblesse des moyens affectés au CUCS ne permet pas la mise en place d’actions structurantes et donc d’une politique de l’emploi en faveur des quartiers qui soit impulsée par le CUCS lui-même. Le droit commun représente la quasi-totalité de l’intervention sur le territoire, et les actions politiques de la ville sont marginales et visent principalement à combler les déficiences du droit commun. Dans certains cas tout de même, le CUCS joue une fonction mobilisatrice du droit commun au profit des quartiers prioritaires, et des effets positifs sur la situation du quartier peuvent alors être perçus, d’autant plus lorsqu’un PRU est mis en place.
Toutefois, la taille réduite du territoire d’intervention restreint de fait la taille des équipes mobilisées autour du CUCS et permet une visibilité plus forte sur l’action menée du fait d’une plus grande proximité des décideurs notamment vis-à-vis du terrain, ce qui tend à faciliter la coordination des politiques et des actions.
b) Grandes agglomérations et grands quartiers, niveau de précarité élevé : forte ingénierie, mais difficile coordination des acteurs
Sur les territoires les plus grands et donc les plus dotés en crédits Acsé et de droit commun (type 3, 4 et 5), le CUCS peut constituer le centre de la définition d’une stratégie en faveur des quartiers prioritaires, articulant le droit commun et les actions relevant de la politique de la ville. Toutefois, le nombre important de structures présentes, la complexité de concilier l’approche par public et l’approche par territoire et l’éloignement des décideurs vis-à-vis du terrain contribuent à une certaine incapacité à parvenir à une logique d’ensemble et à une lisibilité effective des contours de l’intervention de chaque institution ou dispositif. Rares sont les territoires sur lesquels ce travail de définition d’une stratégie partagée définissant clairement les missions de chaque institution ou dispositif a été réalisé au moment de la signature des contrats.
Il apparaît que les sites de type 3 de l’échantillon font le constat quasi unanime d’une grande difficulté à avoir une lisibilité de l’ensemble formé par la politique de la ville sur chacun des quartiers. Les sites de type 4 disposent d’une ingénierie tendanciellement plus lourde, et le CUCS fonctionne comme une instance de coordination rassemblant les acteurs de la politique de la ville et de droit commun. Le fait qu’on soit à une échelle territoriale relativement réduite (communale) permet d’éviter l’écueil d’un paysage institutionnel trop complexe et d’un éloignement du terrain, qui est généralement constaté pour les sites du type 5 qui recherchent une coordination des acteurs à l’échelle d’une métropole entière. Sur ces sites, la « force de frappe » du droit commun peut souvent aboutir à une certaine marginalisation des acteurs et des logiques de la politique de la ville, celle-ci tendant à fonctionner en autonomie relative. Sur certains sites toutefois, des tentatives de clarification des compétences et missions des acteurs semblent aller dans le bon sens. Les effets positifs d’une politique cohérente et mobilisatrice peuvent alors être ressentis.
B. GOUVERNANCE : PARTENARIAT, PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
L’analyse de la gouvernance conduit à dire qu’une complexité bien gérée, organisée et admise peut être fluide ; a contrario, la gouvernance d’un système complexe mal admis est vécue comme un ensemble de complications lourdes, consommatrices de temps et d’énergie et peu productrices de résultats. Les facteurs déterminants d’une gouvernance fluide sont la cohésion des acteurs autour d’une stratégie commune et d’une organisation rodée.
a) Qualité de l’engagement stratégique des signataires
Au total on observe que :
– la région est signataire de près de la moitié des CUCS (9 territoires), et l’est davantage des CUCS de type 3 et 5, dans une moindre mesure de type 4 et est quasiment absente des CUCS de type 1. On peut en déduire une concentration de l’engagement stratégique de la région sur les CUCS de grands territoires ou ayant vocation à concerner un territoire qui polarise au-delà des quartiers prioritaires du CUCS ;
– le département est signataire de plus de la moitié des CUCS (13 territoires au total), et en particulier sur les territoires de type 3 et 5, le premier s’expliquant par le fait que le territoire du CUCS a un rayonnement départemental, le second qu’il s’intègre dans une stratégie métropolitaine. Toutefois le conseil général cofinance très largement les actions du CUCS, même lorsqu’il n’est pas signataire ;
– les EPCI ont été signataires dans seulement 3 cas lorsque le CUCS est porté par la commune. Par contre, dans le cas où l’EPCI est porteur du CUCS, la ville est généralement signataire à l’exception des cas de deux pôles urbains métropolitains.
Au-delà de la signature, l’engagement stratégique des partenaires est variable selon les échelons territoriaux. La signature n’est pas un critère déterminant dans la qualité du partenariat et de l’engagement stratégique des partenaires.
Si la région est signataire de seulement 9 sites sur 22 sites de l’échantillon, et elle paraît cependant plus engagée dans les CUCS que dans les précédents contrats de ville. Elle pourrait cependant être en effet un partenaire privilégié au titre de sa compétence en matière d’aménagement, de développement économique et de formation. Son engagement est déterminé par l’existence ou non d’une doctrine sur sa valeur ajoutée en politique de la ville ; celle-ci sera réfléchie en général au regard de ses compétences dans la formation, professionnelle, plus que dans l’aménagement du territoire et dans le développement économique. La présence d’un vice-président en charge de la politique de la ville atteste de cette volonté politique de la région de s’engager. Il est à déplorer cependant que l’implication de la région ne se traduit pas toujours par une meilleure prise en considération de ses propres politiques de développement économique et d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, et de manière atypique, on observe son engagement dans la démarche GUP, considérée comme un facteur de réussite de ce dispositif en particulier sur des territoires CUCS du type « ville petite ou moyenne dans un système urbain ». Sur un site de type 2 par exemple, l’implication de la région dans la démarche GUP a permis d’obtenir des crédits d’investissement, et ainsi d’accroître la capacité d’autofinancement de la collectivité. Sur ce territoire notamment, la région intervient sur d’autres thématiques telles que la culture et la jeunesse.
Par ailleurs, on observe que si le département est signataire de plus de la moitié des sites, il n’est pas fortement engagé dans les CUCS au niveau stratégique. Le département, qui intervient prioritairement sur les dispositifs d’insertion notamment à travers le PDI, reste politiquement sous-investi dans la politique de la ville. L’engagement du département se concrétise en effet davantage à travers le soutien à des actions qui relèvent de sa compétence et par la présence de ses structures territorialisées et de ses travailleurs sociaux dans les quartiers, que par un engagement stratégique définie par une politique spécifique. Ce constat d’un département peu impliqué dans la politique de la ville a pour cause entre autres la difficile convergence de deux logiques distinctes : la logique de public du conseil général en matière d’insertion, et la logique de territoire qui préside aux CUCS. Cette divergence stratégique met en porte à faux le département dans le partenariat avec les autres échelons territoriaux, et ne réduit pas pour autant le risque de doublon. Cependant, on observe depuis la mise en place des CUCS un regain d’intérêt de la part de certains départements parmi les plus « urbains » pour la politique de la ville. Sur l’échantillon, on observe une faible mobilisation stratégique mais une intervention « à la carte » selon ses compétences
Le niveau intercommunal est enfin fortement mobilisé dans la stratégie des CUCS. Dans les territoires où l’intercommunalité n’est pas la structure porteuse du CUCS, elle peut n’être pas signataire. Toutefois, la structure intercommunale est alors fortement mobilisée, sur un plan opérationnel. Dans les CUCS portés au niveau intercommunal, la ville est pratiquement toujours fortement impliquée dans la mise en œuvre des actions, en particulier pour les villes où les quartiers prioritaires se trouvent situés dans le centre, comme c’est le cas à sur deux sites de type 3.
Par ailleurs, dans le cas où la structure intercommunale ne serait pas impliquée, la définition d’une stratégie cohérente peut devenir problématique, en particulier sur les petits territoires. Sur la majorité des sites de l’échantillon et des sites connus du cabinet, le PLH de l’intercommunalité ne fait aucune référence aux CUCS des communes membres. Dans ce cas, l’exercice limité de la compétence politique de la ville de l’intercommunalité a eu pour effet un manque de coordination des politiques en direction des quartiers défavorisés entre les communes du territoire.
La CAF et les bailleurs sont les deux autres partenaires principaux les plus récurrents. La stratégie de la CAF est fortement définie en amont du CUCS. Les CAF sont des partenaires essentiels pour identifier et agir auprès des publics les plus précarisés. Leur rare absence dans certains CUCS, difficilement explicable, fait perdre à ceux-ci beaucoup d’efficacité.
S’agissant des bailleurs, leur participation à la définition d’une stratégie est souvent déterminante de la qualité et de l’efficacité des actions du CUCS. Ils sont en outre incontournables bien sûr dans les PRU. Au titre du CUCS, ils sont les premiers intéressés à la mise en œuvre d’une GUP. Financeurs et bénéficiaires de ces dispositifs, leur posture est en conséquence souvent atypique.
Ÿ Les critères de qualité du partenariat
Sur l’ensemble des territoires, les critères de qualité d’engagement des signataires se conçoivent en termes d’animation et d’ingénierie d’une part, et de financement d’autre part. La distinction entre ces deux types d’engagement n’est souvent pas claire pour les acteurs interrogés, la qualité de l’engagement stratégique étant largement tributaire de l’engagement financier des signataires.
Ce n’est toutefois pas tant la hauteur de l’engagement financier qui est déterminant que sa pérennité. Par exemple, l’engagement financier des partenaires d’un CUCS de type 2 en aval de la définition des stratégies de territoire étant aléatoire, cela rend difficile la mise en œuvre des actions qui doivent être arrêtées en cours faute de financements suffisants.
Par ailleurs, l’engagement coordonné des partenaires selon leur compétence et l’échelle de mise en œuvre est un facteur de réussite du partenariat dans la définition commune d’une stratégie. La coordination permet ainsi d’éviter les effets de doublon et d’opérer un effet de mutualisation des structures et des moyens aux différentes échelles du territoire.
D’autre part, la bonne relation entre les services politique de la ville et la sous-préfecture est un facteur de qualité du partenariat, sans laquelle la logique de guichet tend à prévaloir.
b) Compétences partagées et chaînage opérationnel
La région est un partenaire privilégié sur les sites de l’échantillon au titre de sa compétence en matière de formation. Par ailleurs, et de manière atypique, on observe son engagement dans la démarche GUP, considérée comme un facteur de réussite de ce dispositif en particulier sur des territoires CUCS du type « ville petite ou moyenne dans un système urbain ». Sur un site de type 2 par exemple, l’implication de la région dans la démarche GUP a permis d’obtenir des crédits d’investissement, et ainsi d’accroître la capacité d’autofinancement de la collectivité. Sur ce territoire notamment, la région intervient sur d’autres thématiques telles que la culture et la jeunesse.
Le département intervient prioritairement sur les dispositifs d’insertion notamment à travers le plan départemental d’insertion, et par l’intervention dans les quartiers de ses travailleurs sociaux inégalement mobilisés par les dispositifs, mais il reste globalement sous-investi dans la stratégie des CUCS.
Sur les CUCS portés au niveau intercommunal, le choix a pu être fait de ne pas donner pleine compétence à la communauté d’agglomération en politique de la ville, comme c’est le cas sur un site de type 3 où les questions de prévention et de médiation sociale sont restées des compétences de la commune tandis que la communauté d’agglomération intervient sur les problématiques de développement économique, et à travers le PLIE sur les questions d’insertion professionnelle. Dans ce cas, le partage de compétence répond pour les acteurs de la politique de la ville interrogés à la volonté de préserver une logique de proximité. La qualité de l’engagement stratégique de la ville aux côtés de l’agglomération peut passer par une articulation entre les priorités locales et la vision stratégique globale de l’agglomération. Le partenariat est dans ce cas plutôt efficace, bien que les communes veuillent souvent préserver leur « voix prépondérante » au titre de leur connaissance des publics et de leur capacité à agir dans la proximité. Parfois cependant, la prévalence des communes est telle que le rôle de l’agglomération n’est que d’assurer une sorte de gestion externalisée des dispositifs.
Enfin, la qualité de l’engagement des signataires dans la stratégie est tributaire du portage politique du CUCS. En théorie, ce serait aux élus d’une part d’acquérir la connaissance de la politique de la ville s’ils ne l’ont pas à leur élection, et d’autre part de recruter et animer des personnels compétents. Dans le cas général, c’est la capacité des équipes de projet à mobiliser les élus qui est facteur de réussite du partenariat et d’efficacité des actions. Dans tous les cas, c’est l’implication personnelle et constante du maire (ou du président d’EPCI et des maires) qui, garant de la qualité du dialogue stratégique avec les partenaires, et de la cohérence du projet et de l’action, est le facteur premier de mobilisation, et donc d’efficacité globale du CUCS. Sur ce point, il convient de souligner que l’engagement stratégique des signataires est surdéterminé par le calendrier électoral.
a) Poids du portage politique : implication des élus et rôle stratégique ou non du comité de pilotage
On observe un lien étroit entre le poids du portage politique et le pilotage stratégique, et le degré de stratégie du CUCS. De manière générale, un portage politique fort, un comité de pilotage moteur, susceptible d’impulser une dynamique de projet, conditionnent la mise en œuvre et le suivi d’un vrai projet stratégique qui sera in fine facteur d’efficacité et de pertinence des actions du CUCS. Un cercle vertueux s’instaure : plus le point de portage est élevé dans la hiérarchie, plus le portage est fort, plus le projet est stratégique et plus il est mobilisateur.
Toutefois, on observe un degré inégal d’implication des partenaires du CUCS à un haut niveau stratégique (maire, président d’agglomération, sous-préfet, préfet, directeurs de service au sein de la région, du département, de la CAF, etc.) et un comité de pilotage plus ou moins dynamique selon les sites.
Quatre degrés de portage politique peuvent être mis en avant, en lien avec les degrés de stratégie présentés en partie 2.A.B du présent rapport. (cf. schéma récapitulatif page suivante).
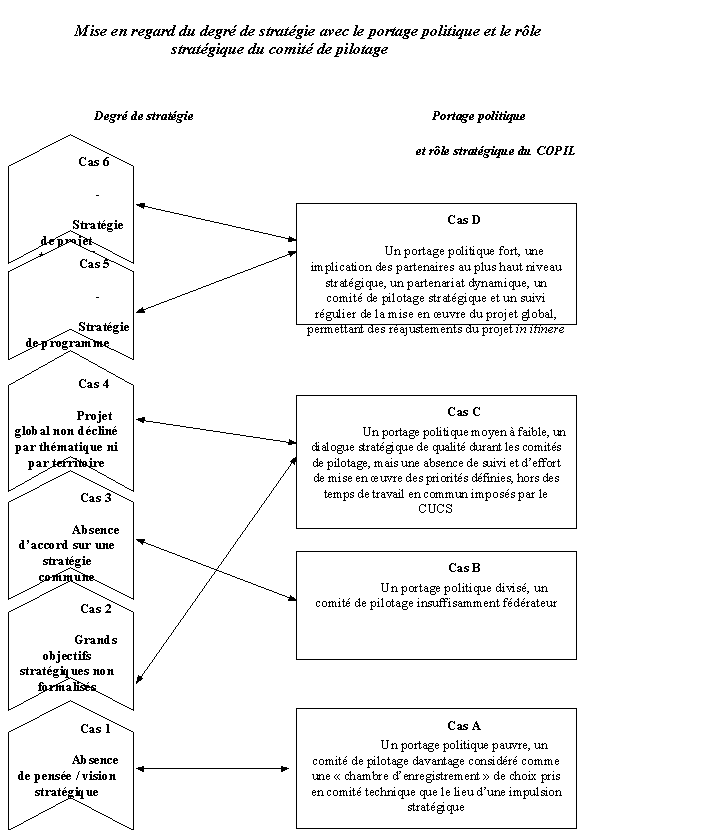
Ÿ Cas A - Un portage politique pauvre, un comité de pilotage d’avantage considéré comme une « chambre d’enregistrement » de choix pris en comité technique que le lieu d’une impulsion stratégique
Dans le cas d’une absence de pensée ou de vision stratégique, le portage politique est faible. Il est généralement assuré par un ou plusieurs élus en charge de la politique de la ville, si cette délégation a été mise en place par la municipalité ou l’EPCI, ou un élu d’une thématique proche (solidarité et lien social, par exemple, et souvent jeunesse) lorsque le CUCS est rattaché à lui.
Le maire et/ou le président de l’EPCI ont une faible visibilité sur le CUCS et ne sont pas impliqués dans le pilotage. Ils ne viennent pas en soutien aux élus référents du CUCS et ces derniers peinent à faire le lien entre le CUCS et les autres politiques de droit commun portées par la collectivité. Par ailleurs, ces élus ont souvent des difficultés à s’approprier la logique de la politique de la ville, à se saisir des enjeux, et à maîtriser la complexité des mécanismes et des dispositifs existants. C’est le cas par exemple sur un site de type 1, où les techniciens de la politique de la ville ont peu de rapports avec les élus. Ces derniers ont une faible compréhension de la logique politique de la ville et rencontrent des difficultés à admettre une logique de quartier.
L’État n’est pas impliqué au niveau attendu. Le sous-préfet ou le préfet est absent, ou, lorsqu’ils sont présents, se prononcent uniquement sur des engagements financiers sans lien avec des objectifs stratégiques définis. Dans certains cas, les moyens engagés n’étant pas à la hauteur des objectifs stratégiques fixés en amont, le pilotage des dispositifs s’est réduit à des arbitrages pour respecter les équilibres financiers.
L’absence de portage par la collectivité et l’État freine la mobilisation des autres partenaires : région, État, CAF, qui restent sur leur thématique, leur procédure, leur échelle d’intervention, leurs objectifs propres. Le délégué du préfet intervient généralement peu.
Les comités de pilotage sont au mieux, le lieu d’enregistrement de choix pris par l’équipe opérationnelle en comité technique, sans autre plus-value ; parfois ils peuvent être amenés à contredire tant le travail préparatoire des techniciens que les objectifs des documents-cadre.
La logique de guichet et le saupoudrage des actions sont prédominants.
Dans des cas extrêmes mais non pas rares (comme par exemple, hors échantillon, un CUCS de ville moyenne déjà évoqué) les carences cumulées à tous les niveaux d’intervention conduisent à la démobilisation des partenaires et des opérateurs d’une manière générale, à la démotivation des techniciens (à leur démission morale traduite par l’absentéisme), à une déperdition générale de temps, d’énergie et de moyens… et devraient conduire à la dénonciation de la convention de renouvellement urbain et à celle du CUCS, si cela était possible. La méconnaissance de ces situations que les évaluations ne parviennent pas à relater parce que le consensus a minima de l’État et de la collectivité s’en satisfait, rend impossible une évolution positive… et les acteurs s’accordent sans le dire à attendre ici la mutation d’un sous-préfet, là le changement d’équipe municipale, et parfois les deux.
Ÿ Cas B - Un portage politique divisé, un comité de pilotage insuffisamment fédérateur
Dans les sites où un projet stratégique n’a pu être développé du fait d’une absence de consensus entre les partenaires du CUCS, le portage politique est généralement assuré par plusieurs élus en charge de thématiques concernant le CUCS, inégalement investis, et peu en lien avec les services déconcentrés de l’État.
L’implication insuffisante des acteurs à un haut degré stratégique (maire, président d’agglomération, sous-préfet, préfet) et leur absence aux comités de pilotage ne permet pas de dépasser les clivages entre les priorités stratégiques divergentes de certains partenaires.
Ÿ Cas C - Un portage politique moyen à faible, une mobilisation irrégulière et inégale des partenaires hors des temps de travail en comité de pilotage
Lorsque de grandes lignes stratégiques ou un projet global ont été définis, sans déclinaison thématique ni territoriale, on observe généralement un portage politique inégal et discontinu.
Les élus, les services déconcentrés de l’État sont impliqués au moment des comités de pilotage et le dialogue partenarial est de qualité. Les participants s’entendent sur des priorités stratégiques. Toutefois, la mobilisation des partenaires s’effrite hors des temps de travail commun, faute de feuille de route stratégique formalisée et déclinée de manière opératoire. De même, les partenaires ne traduisent pas les objectifs définis en comité de pilotage du CUCS dans la conduite des actions menées par l’institution qu’ils représentent.
Les partenaires s’entendent sur des enjeux stratégiques mais s’interrogent peu sur les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions. Les outils d’observation du territoire sont inexistants ou peu maîtrisés, les données sont peu mutualisées, et ne permettent pas de donner une visibilité sur les réajustements des objectifs à réaliser, au regard de l’évolution des enjeux.
Dans ce cadre, la réussite des actions dépend étroitement de la conduite du projet par l’équipe opérationnelle qui parviendra plus ou moins à s’approprier, à clarifier, à homogénéiser et à traduire de manière opérationnelle les orientations des acteurs stratégiques.
Ÿ Cas D - Un portage politique fort, une implication des partenaires au plus haut niveau stratégique, un partenariat dynamique, un comité de pilotage stratégique et un suivi régulier de la mise en œuvre du projet global, permettant des réajustements du projet in itinere
Lorsque les sites ont développé une stratégie de programme ou une stratégie de projet territorial, le portage politique est fort. Dans le cas d’une intercommunalité, l’ensemble des maires est mobilisé, ainsi que le président d’agglomération. Le sous-préfet ou le préfet, participe aux comités de pilotage du CUCS.
Les partenaires (région, département, CAF, etc.) sont mobilisés à un haut degré stratégique (directeurs, élus,) et permettent de faire le lien entre les décisions prises en COPIL et les politiques de l’institution qu’ils représentent.
Le comité de pilotage se réunit régulièrement. Il joue un rôle actif dans la définition, le suivi et le réajustement du projet, et est le lieu de rencontre et de dialogue stratégique entre les interlocuteurs des différentes politiques publiques du territoire.
b) Différents schémas de pilotage
Au niveau stratégique, « le pilotage politique est garant de la cohérence d’ensemble du projet », ainsi que le rappelle le guide méthodologique des CUCS publié par la DIV. Il est assuré par une instance réunissant le préfet, le président de l’EPCI compétent, les maires, le président du conseil général et du conseil régional et les représentants des principaux partenaires. Quand il existe un GIP-DSU sur le territoire, le pilotage politique du CUCS est porté par le conseil d’administration du GIP.
Quatre schémas de pilotage peuvent être identifiés au regard des principales tendances d’organisation locale observées. Ces modalités de pilotage stratégique et opérationnel influent sur la qualité de la mise en œuvre des actions, et in fine, sur leur efficacité.
Ÿ Le cas majoritaire est celui d’une organisation « fonctionnelle »
Dans ce schéma de pilotage, le dispositif CUCS fonctionne correctement, mais suivant une logique principalement administrative. Le CUCS est avant tout porté par les techniciens de la collectivité porteuse du CUCS. Ces derniers sont en contact avec les techniciens des services déconcentrés de l’État et des autres institutions partenaires.
Toutefois, ces liens apparaissent fonctionnels, c'est-à-dire avant tout régis par les textes administratifs, et suivant les logiques et compétences propres à chaque acteur. Les dossiers des porteurs de projets sont jugés notamment au regard de leur « solidité » économique plutôt que sur leur conformité aux priorités stratégiques définies par les partenaires. Prévaut alors une logique de guichet plutôt qu’une logique de projet.
Par ailleurs, dans le cas d’un CUCS intercommunal, on observe que ce schéma de pilotage induit une fragmentation du CUCS intercommunal en plusieurs CUCS communaux. S’il existe une convention cadre unique, il y a en fait autant de CUCS que de communes. En effet, chacune des villes instruit les dossiers au regard des priorités de son territoire, sans qu’il y ait une mise en cohérence des priorités au niveau de l’agglomération.
On observe que ce type d’organisation fonctionnelle concerne invariablement les différents types de territoires, des petits territoires ruraux aux grandes agglomérations.
Ÿ Le schéma d’une organisation « délégataire »
Dans le schéma d’une organisation « délégataire », le pilotage et l’animation d’une ou plusieurs thématiques du CUCS sont confiés à des structures à part entière, le PLIE ou la maison de l’emploi, par exemple, pour le volet emploi, ou le CLS pour le volet prévention de la délinquance. Dans ce schéma, les acteurs clés sont ceux des dispositifs qui portent les volets. Ce type d’organisation permet une coordination assez large des acteurs au sein de chacune des thématiques, grâce, notamment, aux réseaux bien institués de ces dispositifs.
Toutefois, on observe une certaine réduction des différents volets du CUCS aux compétences des structures porteuses, et dans l’autonomie de cette structure par rapport aux autres volets et aux pilotes du CUCS. En effet, « l’absorption » des volets par des dispositifs conduit à les spécialiser et à exclure d’autres dimensions d’action possibles du CUCS. À titre d’exemple, si le volet emploi, insertion et développement économique est porté par le PLIE, la thématique insertion sera fortement privilégiée, au détriment, par exemple, de la dimension développement économique du volet.
Par ailleurs, ce schéma de pilotage peut poser une difficulté de complémentarité entre les territoires d’action et les publics propres aux structures porteuses et les territoires et publics prioritaires du CUCS. Pour reprendre l’exemple du volet emploi, on observe parfois une certaine difficulté du PLIE, dont l’action se déploie à l’échelle du bassin d’emploi, à mettre en œuvre des actions sur les quartiers CUCS.
Ÿ Le schéma d’une organisation « interpartenariale»
Dans quelque cas, un GIP a été mis en place pour piloter le CUCS. Cette démarche montre une volonté d’un pilotage stratégique et opérationnel partagé entre les partenaires du CUCS et présente l’avantage de fournir une plateforme inter partenariale unique et commune, entièrement dédiée au CUCS ou non, où les acteurs stratégiques d’une part, et opérationnels d’autre part, peuvent se coordonner. Ce type de pilotage favorise en outre la prise en compte de la logique transversale de la politique de la ville en instituant un pilote unique hors des différents services de la collectivité porteuse du CUCS, ce qui permet de sortir la réflexion stratégique d’une logique sectorielle.
Toutefois, lorsqu’il existe un blocage entre les acteurs stratégiques, le système se trouve paralysé.
Ÿ Le schéma d’une organisation transversale
Enfin, le schéma d’une organisation transversale, relativement observé, permet à la fois la co-construction d’une stratégie à partir des acteurs de terrain jusqu’aux pilotes, et, à l’inverse, une déclinaison de la stratégie des pilotes jusqu’aux acteurs au niveau des territoires. Ce type d’organisation permet en outre une forte cohérence entre les acteurs et favorise les synergies. Toutefois il est coûteux en ressources humaines et requiert une ingénierie importante. Ce modèle recourt à un portage par un GIP.
c) L’impact de l’existence d’une intercommunalité : un risque de complexité maîtrisé par une ingénierie et une cohérence politique fortes
Intercommunalité et compétence politique de la ville
En vertu de la loi n°99-596 du 12 juillet 1999, les communautés d’agglomération (de 50 000 à 500 000 habitants) ainsi que les communautés urbaines (plus de 500 000 habitants), détiennent une compétence obligatoire en matière de politique de la ville. D’autres compétences ayant un caractère transversal avec la compétence politique de la ville sont obligatoires.
Les communautés d’agglomération ont ainsi des compétences obligatoires en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et d’équilibre social de l’habitat. Quant aux communautés urbaines, elles exercent des compétences obligatoires dans les mêmes domaines que les communautés d’agglomération auxquelles s’ajoute une compétence élargie dans les domaines de l’aménagement, du cadre de vie, du développement économique, de la culture, de la protection et de la mise en valeur de l’environnement. Si les communautés de communes n’exercent pas de compétences obligatoires en matière de politique de la ville, leur rattachement au CUCS par le biais de la compétence équilibre de l’habitat et cadre de vie ou celle relative à l’action sociale communautaire, voire pour la mise en place d’un CISPD, est gage d’efficacité.
Dans le cadre de la mise en œuvre des CUCS, ces compétences sont mobilisées de manière transversale pour mettre en œuvre les stratégies de la politique de la ville. La circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale stipule ainsi que le CUCS « prendra en compte tant les politiques structurelles développées à l’échelle communale et intercommunale influant sur la situation des quartiers (emploi, développement économique, transport, habitat et peuplement, politique éducative et culturelle, santé, insertion sociale) que les actions conduites au sein même de ces quartiers pour améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants. »
Le transfert de compétence à l’intercommunalité introduit une complexité liée à la multiplicité des communes et au déséquilibre entre ville centre et villes (et villages) périphériques. En effet, lorsque la ville centre est la seule à avoir des quartiers prioritaires, il est difficile pour l’EPCI de se positionner sur la thématique politique de la ville puisqu’elle doit agir pour l’ensemble des communes.
L’agglomération peut être une valeur ajoutée lorsqu’elle consolide une stratégie globale. Elle fait prévaloir une vision plus large et plus globale du territoire, ce qui apporte une meilleure cohérence au projet.
Le transfert de compétence peut aussi être un frein s’il y a une dissociation des compétences entre ville et EPCI, par exemple entre « développement économique » et « politique de la ville ».
3. Pilotage opérationnel : de l’engagement à l’implication, quelle démarche de projet ?
a) Concentrer ou déconcentrer : comment transversaliser ?
Ÿ La création d’un GIP : une solution au manque de transversalité et une simplification de l’organisation ?
L’État a préconisé la création de groupements d’intérêt public pour piloter les nouveaux grands projets de ville dès la fin des années 1990. Quelques villes disposaient déjà de cette structure pour les grands projets urbains ; généralement, elles l’ont conservée pour les PRU. Cependant, le GIP, qui ne gérait antérieurement que des crédits destinés à l’infrastructure, doit désormais prendre en charge les crédits de fonctionnement liés à la politique de la ville (puisque le contrat de ville est intégré au GPV). Le but est de structurer la maîtrise d’ouvrage en créant une instance qui regroupe tous les partenaires pour avoir une gouvernance collective. Cela peut provoquer des difficultés dans le positionnement des différentes collectivités.
De plus, la politique de la ville étant une procédure contractuelle, certains contrats ne se superposent pas, par exemple entre CUCS, contrat de plan État région et grand projet urbain, comme dans le cas hors échantillon d’un ensemble de communes en périphérie de grande métropole, comparables aux sites de type 4. Historiquement, le GPU était compris dans le contrat de plan État région mais pas dans le contrat de ville cadre ; son successeur, le GPV ne faisait plus partie du contrat de plan régional et il est devenu une « convention d’application territoriale unique du contrat d’agglomération 2000-2006 ». Aujourd’hui, le PRU est géré par le GIP intercommunal. Malgré l’usage d’un organe externe, guichet unique pour les partenaires, l’organisation entre les divers dispositifs reste souvent complexe.
Les grandes politiques de droit commun dépendent de l’État or la politique de la ville est une compétence des collectivités territoriales. Le rôle des GIP est donc de fédérer les différentes politiques à tous les niveaux, de l’État aux collectivités.
Les groupements d’intérêt public peuvent être mal perçus par les acteurs de la politique de la ville, qui considèrent parfois que la gestion d’un GIP est très lourde administrativement, et donc que cela ralentit les procédures déjà bien complexes par ailleurs.
Aujourd’hui, l’État local conteste aussi souvent l’existence d’un GIP perçu comme une structure supplémentaire ajoutée à l’architecture déjà lourde du contrat et de son pilotage. Le principal atout des GIP est d’être une structure unique de dépense et donc de mutualiser les enveloppes. Mais les vertus de ce système de décision simplifié et d’équipes transversales effectives, semble perdu de vu. On peut en outre lui reprocher d’opacifier l’affectation des crédits et de diluer le poids décisionnel respectif des grands financeurs. Finalement, un GIP est facteur d’efficacité lorsque les partenaires financeurs partagent et s’impliquent effectivement dans la mise en œuvre de leur stratégie. En cas de désaccord des partenaires, le GIP bloqué ne parait plus être facteur d’efficacité.
Ÿ La politique de la ville s’est construite par un effet « d’agglutinement » de dispositifs sectoriels qui freine la transversalité
La politique de la ville « s’est construite par sédimentation successives, en regroupant des programmes publics apparus au début des années 80, destinés à la prévention de la délinquance, à la lutte contre la toxicomanie, au DSQ… Chacun de ces programmes avait une vocation interministérielle affirmée, même s’il est préférable de parler de gestion multisectorielle, tant les conflits et les représentants de différentes expertises en ont marqué le fonctionnement (150)). » L’accumulation des dispositifs thématiques marque le retour aux politiques sectorielles, ce qui va à l’encontre de la philosophie originelle de la politique de la ville. Les chefs de projet sont des généralistes, donc capables d’animer des réunions sur une thématique santé, éducation ou sécurité ; mais les équipes sont davantage composées de chargés de mission, spécialistes de leur domaine d’intervention, recrutés spécifiquement pour un des dispositifs.
La création de dispositifs thématiques renvoie au découpage des ministères à la tête de l’État. Mais si la politique de la ville était conçue au départ comme une politique spéciale, elle est de plus en plus intégrée aux politiques de droit commun, puisque les dispositifs thématiques renvoient au droit commun.
b) Équipe opérationnelle : chef de projet, référents thématiques, équipes MOUS
Ÿ Le chef de projet politique de la ville
La taille et la composition des équipes opérationnelles diffèrent selon le type de CUCS et le contexte local. En effet, plus la ville est de petite taille, plus l’équipe opérationnelle est réduite, et inversement. Le poste de chef de projet peut être financé à 50 % par la préfecture, s’il est attribué à un contractuel et non à un fonctionnaire. Dans certains cas, cette mesure permet de recruter une personne, ce qui aurait été impossible sans cette aide financière. Cependant, nous pouvons observer que le chef de projet n’est pas toujours uniquement chargé de CUCS. Il arrive, en particulier dans les petites villes rurales, qu’une seule personne soit en charge de l’ensemble des dispositifs de développement social (il est alors désigné comme « chargé de mission développement social urbain »).
À partir de 1995, l’État souhaite même participer au recrutement des chefs de projet tout en cosignant leurs ordres de mission avec les maires (circulaire du 20 novembre 1995 (151). Cette mesure permet à l’État de conserver la main sur la politique de la ville mais cette règle n’est, à quelques exceptions près, jamais appliquée. L’État local a rarement joué pleinement son rôle pour éviter que les élus municipaux se sentent désinvestis et qu’ils se sentent dégagés de cette forme de « tutelle » préfectorale. Mais au fur et à mesure, de nombreux maires ont souhaité être les seuls employeurs des chefs de projet afin de se détacher des ordres préfectoraux. L’intégration des chefs de projet, leur « municipalisation » conditionne les stratégies d’intervention qu’ils vont pouvoir mettre en œuvre. Cela, tout en garantissant leur position institutionnelle.
Contrairement aux anciens chefs de projet militants, les chefs de projet suivent aujourd’hui les logiques d’actions municipales. Leurs nouveaux modes d’action ont pu conduire à des conflits face aux autres services car certains n’ont pas voulu se soumettre à l’autorité de la hiérarchie, ils ont cherché à contacter directement les dirigeants politiques car ils s’appuyaient sur une légitimité militante. Les chefs de projet parlent de la nécessité d’avoir accès au bureau du maire pour la réussite de la politique.
Généralement, on observe que les fonctionnaires sont souvent hauts placés dans la hiérarchie de la commune, ce qui leur permet de mobiliser le droit commun plus facilement, mais dans la majorité des cas ils sont aussi très dépendants du maire, tandis qu’un contractuel, recruté conjointement avec l’État, est généralement placé hiérarchiquement plus bas, ce qui ne lui permet pas de mobiliser le droit commun ni les autres services de la commune. Le risque existe aussi que lors de négociations, le chef de projet municipalisé soit perçu comme défenseur des intérêts de la commune car il est identifié à elle. Le risque d’apparaître comme partisan est fort et cela limite la portée de leur parole.
Avec la multiplication des acteurs du développement social urbain (avec des postes dans l’éducation nationale, à la CAF, au conseil général), les chefs de projet se retrouvent parfois dans des logiques contradictoires qui créent une concurrence avec les autres acteurs tandis qu’ils font la promotion de dispositifs qui s’enchevêtrent et se chevauchent. Lorsque le chef de projet parle de la logique de projet, il est confronté à d’autres professionnels qui n’ont pas la même définition selon leur institution de rattachement (ou associatif). « Les appartenances professionnelles et/ou institutionnelles conditionnent les logiques d’actions spécifiques, durables, reposant sur un rapport au réel, que les nouvelles professions urbaines ne peuvent infléchir radicalement » (152).
Ÿ Les coordonnateurs thématiques
Plusieurs postes de « coordonnateurs » ont été créés avec l’arrivée des autres dispositifs politique de la ville : référent de parcours réussite éducative, coordonnateur pour l’insertion professionnelle, coordonnateur santé dans le cadre de l’ASV… Généralement situés sous l’autorité directe du chef de projet CUCS dans les villes de type 3, 4 et 5 ; ces chargés de mission travaillent sous la hiérarchie du directeur général adjoint ou dans les communes de taille inférieure. De même que pour les chefs de projet, la signature des contrats a permis de financer la création de poste. Ces contractuels vont devoir chercher de nouveaux financements auprès des principaux partenaires. Ils ne sont pas rares à dire que la survie de leur poste dépend d’eux, puisque financés au départ pour une durée limitée, ils sont obligés de trouver de nouvelles subventions. On peut donc souligner qu’il y a un véritable effet levier grâce à la création des dispositifs thématiques.
Ÿ Les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
Les équipes MOUS regroupent l’ensemble des chargés de mission politique de la ville et rénovation urbaine. Globalement, elles tendent à s’éloigner du terrain et des bénéficiaires pour assurer un rôle davantage de gestion de dossiers.
L’équipe MOUS peut être soit intégrée à l’équipe PRU, soit dissociée de cette dernière. Ce que l’on observe le plus souvent c’est le cas de dissociation entre un PRU suivant sa logique propre et un CUCS au périmètre plus large, porté par une direction générale ajointe. L’appellation « équipe » prend généralement tout son sens dans les villes de type 4 et 5, puisqu’elle est conditionnée par la présence d’un PRU et favorisée par une gestion externalisée de ce dernier. La maîtrise d’œuvre déléguée à un GIP peut favoriser la coordination entre le social et l’urbain en intégrant les deux volets à une seule et même équipe.
Dans les communes de petite taille, la MOUS est, le plus souvent, assurée par des chargés de mission qui dépendent des deux directions générales : affaires sociales et habitat, urbanisme. Dans ce cas, bien que cela soit demandé par les textes, les équipes éprouvent des difficultés à travailler ensemble et à mutualiser leurs connaissances autour d’un vrai projet de territoire. « On a essayé de trouver un axe sur lequel on aurait pu travailler ensemble, mais ça n’a rien donné ». De nombreuses communes modifient leur organigramme afin de laisser transparaître un lien entre les deux directions générales, en plaçant un agent à cheval sur deux hiérarchies, mais sans que ce lien soit réellement effectif.
c) Comité technique : l’arrivée du délégué du préfet ?
L’arrivée récente des délégués du préfet a parfois eu un effet « chien dans le jeu de quilles ». Peu encadrés, et d’ailleurs souvent peu formés à la politique de la ville, mais souvent bons connaisseurs des quartiers, ils ont eu parfois tendance à doublonner la « chaine de commandement », ce qui n’a pas manqué d’avoir des effets déstabilisateurs sur les équipes opérationnelles, pour certaines déjà inquiètes de l’avenir de leur contractualisation. Mais ils apportent maintenant souvent une plus value dans la coordination.
4. Place et implication des opérateurs dans la définition des objectifs et la mise en œuvre du CUCS
Des opérateurs peu associés à la définition des objectifs du CUCS en amont
La plupart des sites soulignent l’urgence dans laquelle le CUCS a été rédigé. Ainsi, les opérateurs ont généralement peu été impliqués dans l’identification des enjeux stratégiques et des objectifs et actions permettant d’y répondre. Or l’absence de mobilisation des opérateurs au moment de la définition des objectifs n’a pas permis de vérifier, en amont, la concordance des objectifs avec l’offre des opérateurs sur le territoire. Dès lors, on observe dans de nombreux cas des objectifs voire des volets « vides » d’actions, lorsqu’aucun porteur de projet n’a pu proposer une action correspondant aux objectifs définis.
Par ailleurs, l’absence de définition des objectifs suivant une logique ascendante, soit avec une remontée des attentes et des besoins des quartiers et de leurs habitants par les acteurs de terrain, est susceptible de limiter la pertinence des actions menées.
Une coordination souvent insuffisante des opérateurs qui freine l’efficacité des actions
De manière générale, les évaluations et les acteurs consultés soulignent des marges de progrès nécessaires quant à la cohérence des actions menées par les porteurs de projet. De nombreux sites pointent des insuffisances à cet égard, ce qui nuit à l’efficacité des actions menées. En effet, la coordination des opérateurs conditionne l’efficacité du CUCS dans la mesure où elle permet de dépasser l’éventuelle logique concurrentielle entre les opérateurs et d’éviter les redondances entre les projets. Elle permet de renforcer la complémentarité des actions financées par le CUCS et ainsi combler les éventuels manques dans l’offre sur le territoire (en matière de santé, emploi, éducation, etc.). À titre d’exemple, la cohérence des acteurs dans le cadre du volet emploi insertion et développement économique permet de garantir des parcours d’insertion fluides en proposant des prises en charge aux différentes étapes de l’insertion professionnelle. Le réseau permet à chaque partenaire d’intégrer une vision plus globale de la personne dans le projet de sa structure.
Toutefois, on note que si la coordination stratégique des opérateurs est à renforcer, on observe un dialogue informel régulier entre les associations, ce qui permet dans de nombreux cas une certaine complémentarité – géographique ou thématique – de leurs actions.
Une difficile mobilisation des opérateurs dans l’exercice évaluatif
Si certains sites ont mis en place des formations des porteurs de projets à la logique évaluative, on observe dans de nombreux sites une difficile mobilisation des opérateurs dans les évaluations, notamment pour les petites associations, qui n’ont ni le temps ni les outils pour s’investir dans l’évaluation de leurs actions.
On observe dès lors une inégale appropriation par les porteurs de projets des fiches bilans et une qualité variable des éléments fournis par les opérateurs. En effet, les données fournies par les opérateurs dans les bilans annuels ne sont pas toujours exploitables au moment de l’évaluation dans la mesure où elles fournissent un matériau très hétérogène et inégalement renseigné.
5. Participation des habitants
Une thématique qui se retrouve dans la majorité de CUCS de l’échantillon, mais des mises en œuvre variées
Rappelons que la circulaire du 24 mai 2006 est relativement évasive sur la question de la participation des habitants. Elle précise seulement, concernant la mise en œuvre opérationnelle du CUCS, la nécessité de « veiller (...) à ce que soient mises en place les modalités de participation des habitants ». Par ailleurs, la circulaire cite la participation des habitants parmi les actions transversales possibles du CUCS.
Dès lors la participation des habitants est-elle formalisée de manière différente dans les CUCS. Elle peut être présentée comme un axe transversal aux cinq volets, au même titre que la lutte contre les discriminations, l’intégration et la promotion de l’égalité des chances (cas fréquent), comme sur 3 sites de l’échantillon ; ou, encore, faire l’objet d’un volet à part entière (cas minoritaire), comme dans un CUCS de type 5.
De manière générale, on observe que la participation des habitants a été organisée et mise en œuvre de manière variée selon les sites. Si les habitants ont parfois été mobilisés au moment de l’évaluation (à travers des réunions de bénéficiaires par exemple), ils n’ont quasiment jamais été conviés aux réunions permettant de travailler les besoins et les enjeux du CUCS. À noter ici une différence importante entre les quartiers bénéficiant d’un PRU où des actions de concertations (prévues par le projet) sont mises en œuvre et permettent de faire remonter les attentes des habitants et une participation accrue et suivie des habitants.
En revanche, la participation est soulignée dans la quasi totalité des CUCS comme une dimension devant être nécessairement prise en compte par les opérateurs de terrain (associations, structures de proximité, etc.) dans la mise en œuvre de leurs actions.
La participation perçue a priori comme facteur de réussite et surtout, l’absence de participation comme facteur d’échec
Comme évoqué précédemment (2ème partie, C. Approche des impacts), la grande majorité des évaluations et des acteurs consultés met en avant la participation des habitants aux actions comme un facteur de réussite, voire le premier facteur de réussite des actions. La recherche d’implication des habitants apparaît d’ailleurs comme le fil conducteur de la quasi-totalité des actions des CUCS. Faire participer les habitants aux activités des structures de proximité, du moins faire en sorte qu’ils les fréquentent permet entre autres d’identifier et de rendre visible les habitants les plus fragiles, en situation d’exclusion sociale, ou concernés par différentes problématiques (santé, emploi, etc.).
Toutefois, plusieurs limites à la participation des habitants sont mises en avant dans les évaluations. Celles-ci pointent notamment une difficulté à mobiliser les habitants sur des actions de long terme, élargir le noyau dur des habitants impliqués pour constituer de nouveaux relais dans les quartiers mais surtout à toucher les publics les plus éloignés, notamment les publics en situation de repli communautaire ou le public en errance.
C. L’ARTICULATION DU CUCS AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS POLITIQUE DE LA VILLE
1. Intégration des dispositifs politiques de la ville au CUCS : le CUCS coordonnateur face aux inévitables tendances à l’autonomisation des dispositifs
Historiquement, les équipes politiques de la ville se sont principalement constituées par un effet d’» agglutinement » des divers dispositifs autour du CUCS. En effet, depuis les années 1990, les dispositifs se sont accumulés autour du chef de projet.
Les communes dans lesquelles les problèmes sociaux sont les plus importants ont bénéficié de l’ensemble des dispositifs. Ainsi, les équipes politiques de la ville se sont étoffées au fur et à mesure, autour du premier chef de projet, selon le schéma ci-dessous.
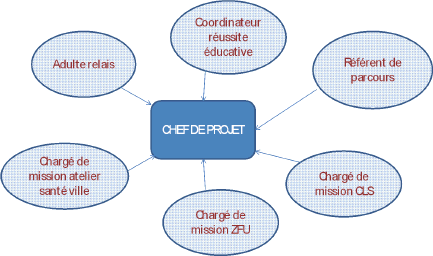
Avec le temps, les équipes ont regroupé de plus en plus de personnel, ce qui a créé un type d’organisation encore plus complexe. Les premiers chargés de mission thématique sont, le plus souvent, devenus chefs de projet dans leur domaine d’intervention et ils chapotent les nouveaux chargés de mission. Et le premier chef de projet politique de la ville, est devenu directeur général adjoint, son service est devenu tout aussi important en terme d’effectifs que les autres services municipaux. Nous avons donc une organisation qui ressemble au schéma suivant :
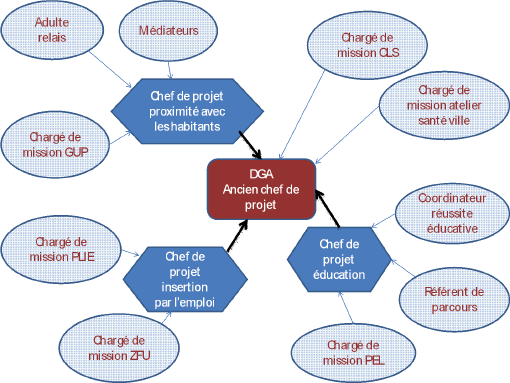
On peut remarquer que lorsque le chef de projet est devenu directeur général adjoint dans une commune, c’est qu’une importance particulière a accordée à la politique de la ville par les élus. Mais il arrive aussi que les postes liés à chaque contrat (PRE, GUP, CLS…) soient rattachés au service thématique (DGA éducation, enfance, ou DGA urbanisme, habitat...).
Les chefs de projet qui sont devenus directeurs généraux adjoints entretenaient de bons rapports avec le directeur général des services ainsi qu’avec les élus. Leur nouvelle fonction est la marque de l’institutionnalisation de la politique de la ville, et de son glissement vers le droit commun.
2. L’importance de la rénovation urbaine : articulation avec les PRU, importance du discours sur la rénovation urbaine, qualité de la coordination
Les PRU s’inscrivent dans une continuité des grands projets urbains, puis des grands projets de ville, l’agence nationale pour la rénovation urbaine a souhaité que les communes retenues conservent (ou créent) un groupement d’intérêt public pour piloter les opérations. Les projets ANRU sont définis par les villes, qui sont les porteurs de projet, signataires du contrat, mais la plupart ont tendance à conserver une structure externe de pilotage par un GIP ou à confier la gestion du PRU à la communauté d’agglomération.
Malgré l’antériorité d’un GIP dans le cadre des grands projets de ville, certaines communes ont préféré opter pour une maîtrise d’œuvre interne. Dans la majeure partie des cas, c’est le service urbanisme qui pilote le projet de rénovation urbaine, beaucoup plus rarement le service politique de la ville.
Parfois, c’est la communauté d’agglomération qui pilote le dispositif du PRU. C’est le cas sur plusieurs sites de l’échantillon. L’EPCI emploie les chefs de projet rénovation urbaine, ces derniers étant mis à disposition des maires, ils travaillent au sein des communes, pour la commune, mais ne sont pas salariés par celle-ci. Cela pose une ambiguïté sur les rapports qu’ils entretiennent d’une part avec les élus municipaux et d’autre part avec la communauté d’agglomération.
Un exemple hors échantillon : une communauté d’agglomération a signé un contrat territorial de rénovation urbaine. C’est un programme développé sur l’ensemble des communes puisque toutes ont un PRU. La direction de la rénovation urbaine s’est mise en place, suite à la fusion des trois GIP qui existaient. Il y avait environ une dizaine de personnes, les directeurs de GIP ne font plus partie de l’équipe PRU, contrairement à l’ensemble du reste de l’équipe qui a été rattaché, et qui constitue aujourd’hui l’équipe de la direction de la rénovation urbaine à l’intercommunalité. Ensuite, ils ont recruté, pendant deux ans pour renforcer les équipes de la rénovation urbaine. Ce mode d’organisation permet d’avoir une vision beaucoup plus globale sur le territoire et mettre en cohérence les différents projets des communes.
a) Quand le PRU est moteur, le CUCS suit
Le PRU attire généralement davantage l’attention des élus que le CUCS, puisqu’il présente une enveloppe financière plus importante. De plus, les effets visibles du renouvellement urbain auraient un impact direct sur les intentions de vote, et favoriseraient ainsi le renouvellement des mandats électoraux. Lorsque le projet stratégique de rénovation urbaine crée une synergie entre les différents partenaires, il est conçu comme un projet global et il intègre bien le développement social des quartiers, souvent en mettant en avant la gestion urbaine de proximité. L’antériorité d’une démarche de projet sur les quartiers conditionne également le niveau stratégique du projet de rénovation urbaine.
Cependant, il arrive que le dossier de PRU soit monté sans réel projet stratégique, uniquement dans le but d’améliorer un habitat délabré, sans incidence sur la vie des habitants du quartier. Dans ce cas, l’articulation et la coordination entre CUCS et PRU est très faible. « Dans tous les cas, l’ANRU se doit de renforcer sa capacité à être le moteur d’une approche réellement transversale, cohérente et coordonnée des volets urbains, économiques et sociaux des projets de transformation des quartiers, même si les financements qu’elle apporte sont affectés de façon privilégiée sur le volet urbain de ceux-ci » (153).
b) Le CUCS sans moteur se disperse et les dispositifs s’autonomisent
Un CUCS non entraîné par un dispositif moteur comme un PRU, risque de voir ses dispositifs connexes s’autonomiser, ou se rattacher naturellement au service thématique correspondant. Sur un site de type 3, chaque dispositif est indépendant des autres, symptôme d’un déficit de portage, d’un déficit de projet stratégique. Les chargés de mission communiquent très peu et les interactions se font rares.
D. LA MOBILISATION DU DROIT COMMUN
Le schéma ci-après n’a pas la prétention de décrire le fonctionnement d’un CUCS, mais seulement d’en donner une image théorique inévitablement approximative, incomplète et imprécise. Il signale d’abord qu’en amont, deux sphères de la décision et du financement (ovales sur fond bleu) énoncent d’une part la doctrine générale de l’État, d’autre part les approches particulières des collectivités territoriales appelées par l’État à orienter une intervention prioritaire en faveur des quartiers défavorisés. La politique contractuelle vise à les faire converger en additionnant leurs compétences et leurs moyens dans des programmes d’action thématiques abrités dans les cinq volets du CUCS. Les objectifs et actions des volets, doivent donc théoriquement capter, en plus des moyens spécifiques apportés par le CUCS en provenance de l’Acsé, les moyens normalement mobilisés par les compétences de droit commun détenues par l’une ou l’autre des collectivités ou des services déconcentrés de l’État.
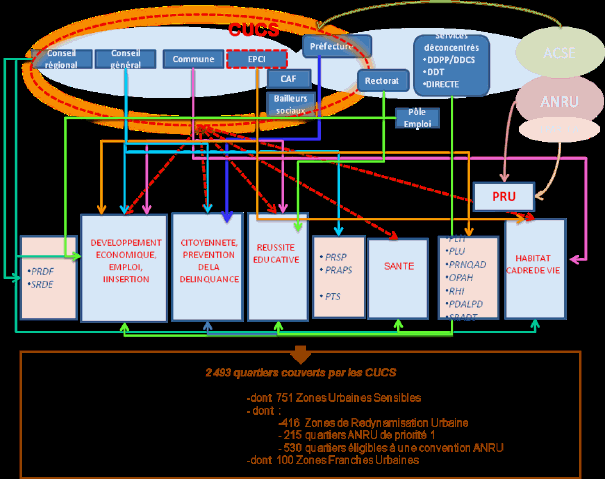

Pour ce faire, les différents instruments d’action publique qui formalisent les politiques selon ces compétences, sont susceptibles de venir en appui des volets du CUCS. D’où ces inévitables entrelacs de compétences croisées et souvent partagées. Notons que, normalement détenue par l’intercommunalité, la compétence politique de la ville pour sa part, est de facto toujours portée par de nombreuses communes. En aval, les périmètres de mise en œuvre des actions du CUCS sont eux-mêmes variables – et selon l’intensité des difficultés et des enjeux, ces quartiers de trois niveaux de priorité, dotés ou non d’un programme de rénovation urbaine, ou d’une zone franche urbaine, mobiliseront plus ou moins les compétences et les moyens du droit commun.
Il y a lieu de souligner à ce stade et une fois encore que la gouvernance et le pilotage de la contractualisation sont au moins aussi déterminants que la somme des moyens qu’elle parvient à capter… puisqu’ils en sont la condition.
Ce schéma fait apparaître également, que la condition première d’efficacité du pilotage est de s’appuyer sur une stratégie d’action apte à conférer à la contractualisation une effective vertu fédérative, et qui permet aussi de simplifier et de fluidifier les circuits de décision et de financement.
1. Une mobilisation du droit commun difficilement appréciable
a) Une définition floue du droit commun selon les sites ; une confusion entre crédits de droit commun et crédits spécifiques
Ÿ Précisions terminologiques
Un des enjeux fondamentaux de la nouvelle contractualisation que concrétise le passage des contrats de ville aux CUCS est la mobilisation et la coordination des politiques et moyens de droit commun, non seulement de l’État mais de tous les partenaires (154).
La circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des CUCS précise que le contrat doit articuler autant les actions de droit commun que les interventions menées au titre de la politique de la ville (155). Sa partie 3 « élaboration du contrat » précise que « la définition de ce projet devra être l’occasion d’impliquer l’ensemble des acteurs du territoire dont le relais sera pris par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances […] », que les collectivités doivent y être associées (par la mobilisation de leurs compétences respectives) et demande aux préfets de « défini[r] parallèlement, avec l’ensemble des services de l’État concernés […] les modalités d’intervention de l’État ainsi que les priorités et les moyens à arrêter dans le cadre des politiques de droit commun qu’ils mettent en œuvre ».
Le guide méthodologique de l’évaluation de la DIV complète ces orientations en précisant très clairement la définition du droit commun : « par la mobilisation du droit commun, il faut comprendre la mobilisation des actions, des outils et des dispositifs existants, éventuellement des moyens en personnel, pour concourir à la réussite des objectifs du CUCS. Ces actions, outils, dispositifs ne sont pas financés par des crédits spécifiques de la politique de la ville et proviennent de financeurs très divers qui veilleront à accentuer leurs efforts sur les quartiers définis par le CUCS ».
Ÿ Dans la pratique : des définitions bien aléatoires et hétérogènes des crédits spécifiques et de droit commun
Dans la pratique, la définition de ce que recouvre le droit commun et ses financements – et donc les crédits spécifiques de la politique de la ville débloqués au titre des CUCS – reste toutefois floue pour nombre d’acteurs, y compris institutionnels ; et ce alors même que la circulaire du 15 septembre 2006 précise on ne peut plus clairement, dans son chapitre 3 « répartition prévisionnelle des enveloppes locales de crédits spécifiques », que les enveloppes de crédits spécifiques « incluront les crédits pour des actions élaborées dans le cadre des CUCS et les crédits nécessaires à la mise en place de l’ensemble des dispositifs : VVV, ERE, adultes relais, ASV, crédits intégration (crédits du FASILD contractualisés) ».
Toutes les évaluations n’indiquent pas la proportion de crédits spécifiques. Par ailleurs, leur définition diffère très largement d’un CUCS à l’autre. Certaines collectivités distinguent les financeurs mais pas le type de crédit : deux évaluations ne renseignent que l’apport global de l’État sans différencier les crédits spécifiques débloqués par l’Acsé et les crédits de droit commun. Dans certaines évaluations, la distinction est floue quand le terme de « crédits spécifiques » n’est même pas évoqué. Un site distingue les parts de financement « CUCS », « droit commun » et « ville » (crédits de droit commun ou spécifiques ?) ; un autre distingue « crédits contractualisés » et crédits de droit commun. D’autres collectivités ne considèrent comme crédits spécifiques que les crédits débloqués par l’Acsé et englobent les autres crédits spécifiques dans les crédits de droit commun. Un site considère comme crédits spécifiques la somme des crédits Acsé, Acsé « hors CUCS », crédits du FSE, et crédits de l’éducation nationale au titre des programmes de réussite éducative et de lutte contre les discriminations ; un autre comprend dans crédits Acsé les crédits DIV/VVV.
b) Une mobilisation inégale du droit commun
Globalement, les « crédits spécifiques » sont donc peu évoqués, ou de façon floue – voire erronée. Il est de fait très difficile de quantifier l’importance de la mobilisation du droit commun, du fait de ce flou conceptuel généralisé constaté ; flou conceptuel qui induit, par conséquent, une méthode de quantification douteuse… alors même que le guide méthodologique de l’évaluation des CUCS de la DIV prévoyait la mise en place d’une méthode précise et rigoureuse de recueil des informations sur le droit commun :
Ÿ « Définir, avec tous les partenaires du CUCS, ce que l’on entend précisément par droit commun (dispositifs, crédits…),
Ÿ Choisir ceux qui veulent faire l’objet d’un savoir particulier (quelques uns présentent un enjeu particulier),
Ÿ Intégrer dans la fiche de suivi des opérateurs, des informations portant sur le droit commun,
Ÿ Mettre en place une procédure de suivi qui s’appuie sur le dispositif de suivi défini précédemment » (156).
L’entretien avec les responsables institutionnels de l’une des communes de l’échantillon interroge sur les raisons d’un tel non respect de cette méthode. La collectivité affirme ainsi la facilité avec laquelle elle mesure la mobilisation du droit commun, qui fait l’objet d’un vote au sein de la collectivité et d’un suivi via les fiches de dépôts de projets des associations.
Part des crédits spécifiques dans le coût total des actions des CUCS (2007-2009)

Précision méthodologique. Les chiffres présentés ci-dessus respectent autant que faire se peut les précisions précédentes – à savoir la somme des crédits Acsé, VVV, équipes de réussite éducative, adultes relais, ASV, crédits intégration (crédits du FASILD contractualisés) – pour les collectivités dont le détail des financeurs et des financements est disponible. Toutefois sur certains des neuf sites, la somme des « crédits Acsé » peut éventuellement comprendre – ou exclure – des enveloppes financières (FIPD, FSE ou crédits de l’éducation nationale affectés aux structures en ZEP notamment).
D’une part, peu de sites – quinze – dans l’échantillon retenu sont en capacité de renseigner le poids des crédits Acsé et de chiffrer la mobilisation du droit commun – ou même de fournir les données financières nécessaires à ce calcul.
D’autre part, concernant le sous-échantillon des sept sites pour lesquels la disponibilité des données financières permet de mesurer la mobilisation des crédits spécifiques et de droit commun, on observe d’importantes disparités – de 50 % à 85 % de droit commun, la moyenne environnant 75 % à 80 %. Ce sous-échantillon ne saurait être représentatif de l’échantillon dans son ensemble ni, par extension, être le reflet d’une tendance générale nationale de la mobilisation du droit commun. Toutefois la variation observée ici est bien un exemple de l’hétérogénéité des situations individuelles.
Ÿ Une appréciation qualitative de la mobilisation du droit commun fondée sur l’expérience
D’après les entretiens réalisés avec les responsables et les acteurs de la politique de la ville des sites de l’échantillon, on peut synthétiser la mobilisation du droit commun de la façon suivante :
– une forte mobilisation du droit commun : 4 sites, pour lesquels la mobilisation se renforce ;
– une mauvaise mobilisation du droit commun : 4 sites dont 1 en régression et 1 sur lequel le droit commun est difficile à activer ;
– un chiffrage mauvais ou inexistant : 2 sites.
Enfin, il convient de souligner que la mesure quantitative est aussi tributaire d’une information qui peut se révéler incertaine. D’après les acteurs interrogés, certains chiffres fournis par les porteurs de projets dans les dossiers et les fiches bilans peuvent être soumis à caution. Les bases de données constituées par la remontée de l’information depuis le secteur associatif peuvent comptabiliser des informations non rigoureuses (dans la distinction crédits, financements, etc.), ou encore surévaluer le coût des actions afin d’obtenir des subventions supplémentaires.
2. Effet de levier des crédits politique de la ville… ou effet de substitution ?
a) Un effet de levier non évalué, en l’absence de chiffrage ou du fait de chiffrages incorrects… et en l’absence de compréhension du mécanisme
Ce panorama de l’hétérogénéité des acceptions du droit commun, des crédits spécifiques et des mesures se reflète dans les compréhensions différentes qui sont faites du fameux effet de levier que doit permettre la mobilisation du droit commun sur la politique de la ville. Ces dissimilitudes appellent nécessairement une clarification conceptuelle de l’effet de levier.
Le cas d’un site de type 5 illustre cette confusion autour du concept. En effet, l’évaluation révèle que :
« [l]a politique de la ville a vocation à compléter et à servir de levier aux politiques de droit commun menées par l’État et les collectivités territoriales dans les différents domaines en rapport avec les orientations définies par le comité interministériel des villes du 9 mars 2006. Cet effet de levier traduit ainsi la relation existant entre les subventions DSU accordées dans le cadre du CUCS et le coût total des actions conduites par les porteurs de projet. En moyenne, entre 2007 et 2009, 1 € de subvention politique de la ville s’est donc traduit par 6,3 € dépensés dans le cadre de l’ensemble de la programmation CUCS. ».
Suite à notre entretien avec les responsables de la politique de la ville, il s’est avéré que des clarifications terminologiques étaient nécessaires. Le rapport évaluatif a ainsi été complété avec les précisions suivantes :
« Il convient toutefois de prendre avec beaucoup de précautions les informations du tableau ci-dessus pour deux raisons majeures :
– tout d’abord, les informations relatives au coût total des actions renseignées par les porteurs de projet dans les dossiers bilan sont sujettes à caution dans la mesure où l’on sait qu’une partie de ces derniers a parfois tendance à surestimer ces montants, dans l’espoir d’obtenir des subventions plus importantes ;
– ensuite, au-delà de ces résultats statistiques bruts et de la définition strictement statistique de l’effet de levier rappelée dans le paragraphe ci-dessus, il est important d’insister sur le fait la politique de la ville n’a ni la vocation, ni la capacité, d’exercer un réel « effet de levier », au sens littéral du terme, dans l’ensemble des thématiques. Ainsi, dans le champ éducatif, le CUCS joue effectivement un rôle moteur, il impulse une réelle dynamique dans les quartiers prioritaires et l’on peut alors parler de l’existence d’un « effet de levier » des fonds de la politique de la ville. En revanche, si l’on prend l’exemple de la thématique emploi-insertion-formation, le CUCS n’intervient qu’en complément, qu’en bouclage d’actions qui sont très largement impulsées par le droit commun. De fait, parler d’ « effet levier » des financements CUCS pour les actions liées à l’emploi peut apparaître comme un abus de langage, et ne correspond pas à la réalité. »
La compréhension du mécanisme par les responsables de la politique de la ville ne va pas de soi et l’effet de levier demeure pour obscur pour beaucoup.
La mobilisation des moyens de droit commun est l’objectif prioritaire des CUCS. Le contrat doit mobiliser et organiser les crédits de droit commun et partant, doit permettre un meilleur ciblage des crédits spécifiques : « la mobilisation des moyens de droit commun doit constituer le socle des engagements des partenaires. Elle doit permettre de mieux cibler les crédits spécifiques sur des actions prolongeant ou renforçant les politiques de droit commun vers les quartiers en difficulté » (157).
Ce rôle activateur et fédérateur des crédits CUCS correspond à un effet de levier. Autrement dit, les crédits spécifiques qui sont engagés sont l’élément moteur, déclencheur, des crédits de droit commun en direction de publics et de territoires ciblés alors même que le droit commun intervient de façon uniforme sur les territoires et les publics de façon à garantir l’égalité de traitement républicaine. L’intervention de la politique de la ville au titre du CUCS, par définition priorisée, territorialisée et discriminante, doit forcer – tout du moins favoriser – le droit commun à prioriser son intervention et ses financements : ainsi l’investissement, financier, matériel ou humain, de la politique de la ville produit-il un effet multiplicateur des financements, en nombre de financeurs et en volumes de financements.
La temporalité est alors un élément déterminant dans la réalité de l’effet de levier : c’est la présence du crédit spécifique dans un premier temps qui appelle la mobilisation des crédits de droit commun. Cette dynamique n’est que l’expression de la volonté fédératrice du CUCS : c’est la stratégie du CUCS, préexistante – et elle-même déterminée par la qualité du projet territorial et de ses portage et pilotage – qui détermine et sollicite l’intervention du droit commun.
1 € « spécifique » engagé (T1)
ò
X € « droit commun » (T2)
Ainsi le rapport [crédits spécifiques engagés / coût total de la programmation] qui est souvent calculé dans les bilans annuels, triennaux ou les évaluations triennales des sites de l’échantillon et assimilé à l’effet de levier mais qui ne fait que mesurer le poids des crédits spécifiques dans la programmation, ce qui ne permet en aucune mesure de déduire mécaniquement le rôle d’un euro spécifique engagé sur le déblocage de X euros de droit commun. Le calcul de l’effet de levier est donc une fonction arithmétique multiplicative… qui se mesure difficilement, …ou qualitativement. On peut mesurer le rôle d’activateur des crédits politique de la ville en observant s’il en découle un engagement parallèle de crédits du droit commun.
Par exemple, lorsqu’est mis en place un PLIE dans le cadre de la thématique prioritaire emploi-insertion-développement économique et que cette structure mobilise des crédits FSE, l’effet de levier est évident dans la mesure où c’est effectivement le CUCS qui a stimulé sa mise en place ; de même lorsque sur un site hors échantillon, une annexe de pôle emploi s’installe dans un quartier prioritaire, hébergée dans une structure ad hoc animée par un chargé de mission financé en partie par des crédits spécifiques, autorisant ainsi une présence inédite de l’institution sur ledit quartier au profit de ses habitants.
Certains acteurs ont bien compris ce rôle moteur des crédits politique de la ville et affirment que « la labellisation politique de la ville facilite le financement par le droit commun. Les deux s’articulent autour de sujets bien précis, mais la politique de la ville débloque le droit commun. Les financements politique de la ville permettent de démarrer une action qui pourra être pérennisée dans le droit commun ».
Ce rôle mobilisateur s’accompagne d’une fonction d’alerte. La politique de la ville alerte sur des problématiques particulières et propose d’innover pour y répondre. C’est ce qui a été mis en avant lors de l’entretien avec un site de type 4 : la situation singulière des quartiers d’intervention de la politique de la ville implique qu’on ne puisse laisser le droit commun proposer uniquement ses solutions classiques ; la politique de la ville est bien là pour apporter des diagnostics précis et spécialisés et mobiliser les services pertinents sur des problèmes bien identifiés, pour proposer ses solutions novatrices et adaptées.
b) Une confusion répandue entre « effet de levier » et effet de « bouclage» des crédits Acsé
D’autres sites, pourtant majoritaires d’après l’échantillon retenu, travaillent avec une conception erronée du droit commun et, bien souvent, confondent levier et bouclage.
Certains crédits spécifiques complètent des financements du droit commun, pour clôturer le budget initial. Cela tient plus à ce qu’on peut aisément qualifier d’un effet de bouclage que de levier ; c'est-à-dire, dans le cas concret de la programmation d’une action, que les crédits spécifiques sont mobilisés en complément du budget d’une action et permettent de le renforcer voire de le boucler. Les crédits spécifiques de la politique de la ville, dont le budget prévu pour une action et l’engagement du droit commun déterminent alors le montant des crédits spécifiques à engager – au lieu d’être déterminés par ce montant défini initialement – jouent ainsi un rôle de complément – au lieu de levier – permettant l’existence d’actions et/ou leur élargissement.
De l’analyse des financements et des entretiens avec les responsables politiques comme techniques des services politique de la ville des sites de l’échantillon, il ressort que la réalité du rôle des crédits spécifiques dans beaucoup de cas tient plus à l’effet de bouclage que de levier. « La politique de la ville pallie les lacunes du droit commun et bride la fonction d’innovation et d’expérimentation », « la politique de la ville finance des actions qu’il n’est pas possible de financer par le droit commun », « les crédits de droit commun ne sont pas en croissance, orientant de fait les opérateurs vers les crédits dédiés à la politique de la ville. Les crédits CUCS seraient donc utilisés majoritairement afin de pérenniser les actions en droit commun »… Bien souvent les crédits spécifiques interviennent donc en complément, de façon additionnelle à l’intervention des enveloppes de droit commun. En fait, ils en pallient les carences.
c) Évolution des financements spécifiques et de droit commun
De façon générale et d’après les sites dont les financements sont représentés dans les graphiques ci-après, on observe que lorsque les enveloppes de l’Acsé augmentent, les financements totaux triennaux augmentent.
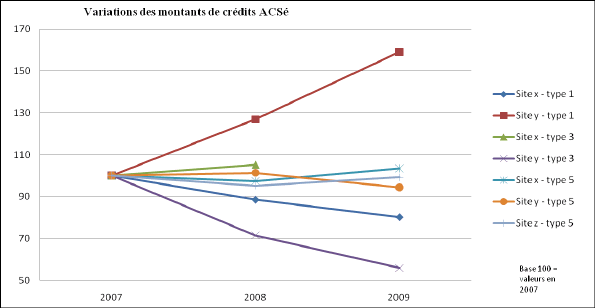
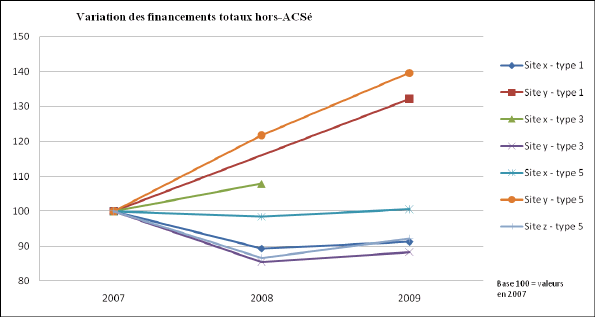

Ceci est la traduction d’un bon effet d’accompagnement – peut-on parler d’effet de levier ? Si les financements Acsé diminuent, on observe en revanche des situations contradictoires (cf. annexe 4 pour le détail) :
– soit les sites ont la capacité de compenser la perte de subventions Acsé en augmentant les volumes de financements de droit commun. C’est le cas d’un site de type 5, dont les financements hors Acsé augmentent à mesure que les financements Acsé diminuent. De fait, le financement total triennal du CUCS augmente de façon relativement importante. Il est à supposer que seules les collectivités de taille importantes et/ou aux bonnes ressources peuvent se permettre de subir une telle diminution des financements Acsé sans que cela impacte la mise en œuvre des contrats.
– soit les sites voient les financements Acsé diminuer et avec eux le financement total des contrats ; autrement dit, ces sites n’ont pas la capacité de compenser une diminution substantielle des volumes de crédits Acsé. Ils subissent alors la perte et les acteurs peuvent se retrouvent dans une situation d’incertitude, comme ils ont pu l’évoquer dans les évaluations et/ou les entretiens.
Les observations dans les territoires ne permettent pas d’établir de généraliser à une conclusion sur les corrélations entre financements Acsé et montants globaux : les cas où l’augmentation des financements Acsé est corrélée à un gonflement des financements globaux (corrélation avérée) existent mais ne semblent pas majoritaires (158). Lorsque la corrélation n’est pas vérifiée et que le financement global augmente ou est maintenu, il est intéressant de noter que des compensations locales peuvent éventuellement être trouvées… dans le droit commun.
d) Levier, complément … ou substitution
Dans une des communes de type 3, un quartier fait l’objet d’ « une politique de la ville plus préventive que curative ». Peu d’actions CUCS y sont menées car peu de porteurs de projets sont présents sur un territoire au profil sociologique différent des quartiers plus « traditionnels » de la politique de la ville. Ce type de quartier peut-il, doit-il, ou nécessite-t-il de relever de la politique de la ville ? La commune en question n’envisage pas de ne mobiliser uniquement le droit commun sur ce type de quartier qui nécessite une attention particulière. « Il ne faut pas sortir ce quartier de la géographie prioritaire dont la politique de la ville apporte une prise en compte globale, à laquelle le seul droit commun ne peut répondre. Quand on rassemble droit commun et politique de la ville, on s’aperçoit que la cette dernière est le moteur car elle comble les trous du droit commun et apporte son approche territoriale et transversale en plus d’un droit commun monothématique et obéissant à une logique institutionnelle ».
L’intervention de la politique de la ville à travers les financements spécifiques et la quête incessante de l’effet de levier via l’intervention politique de la ville induit donc un effet doublement pernicieux : lorsque la fonction de levier des crédits spécifiques n’existe pas et que ceux-ci viennent pallier les carences de l’intervention de droit commun, ce dernier intervient d’autant moins que les crédits spécifiques sont mobilisés pour combler ce défaut croissant d’intervention. Cet engrenage est d’autant plus fort que le rôle d’appel exercé par l’investissement politique de la ville sur l’intervention renforcée du droit commun dans les quartiers prioritaires tend à se normaliser ; autrement dit le droit commun a tendance à intervenir de moins en moins spontanément en tant que droit commun – et ce y compris lorsque l’effet de levier est bien compris et/ou réel. Le cas – extrême – d’une ex-direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS, aujourd’hui DDCS, hors échantillon) est à ce titre plus que révélateur : la totalité des crédits Acsé devrait financer la totalité des opérateurs agissant au titre de la politique de la ville en même temps que les enveloppes de droit commun destinées aux associations seraient exclusivement réservées à des structures hors politique de la ville, essentiellement sur des territoires ruraux. L’effet de substitution serait ici total.
Aussi le mécanisme de substitution est-il un effet auto-entretenu par la mauvaise compréhension de l’effet de levier et les contraintes des acteurs de la politique de la ville et des responsables des CUCS.
L’indétermination généralisée des acteurs sur la définition des crédits spécifiques et des crédits de droit commun (cf. supra) participe de ce mécanisme de substitution. Les collectivités et les services déconcentrés de l’État, en baptisant politique de la ville ou crédits spécifiques des crédits ordinaires de droit commun dans leurs exercices budgétaires – parce qu’intervenant spécifiquement au titre de la politique de la ville pour des publics ou dans des territoires ciblés – complexifient la compréhension et le suivi des financements. Ces crédits de droit commun fléchés politique de la ville s’ajoutent-ils ou se substituent-ils à d’autres crédits de droit commun ? Ils ne renforcent pas nécessairement le surcroît d’investissement. Il en va de même pour les crédits issus des plans ministériels déclinant le « plan dynamique espoir banlieue » qui ne sont pas, dans les textes, des crédits spécifiques politique de la ville ; le « plan égalité des chances » du ministère de la défense ou le « plan triennal » pour une dynamique culturelle dans les quartiers prioritaires du ministère de la culture (159) par exemple, prévoient des enveloppes budgétaires, se fondent sur des dispositifs et des moyens humains mobilisés en faveur des quartiers prioritaires… mais constituent du droit commun en ce que les enveloppes proviennent des budgets de chacun des ministères.
Pourquoi, dans les pratiques, les moyens de la politique de la ville se substituent-ils à l’intervention du droit commun ? La diminution des moyens de droit commun semble être un premier élément de réponse. La révision générale des politiques publiques (RGPP), initiée par le premier conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 12 décembre 2007 entraîne une réduction des moyens constante des directions territoriales de l’État, en plus d’un défaut de moyens, qui oblige à une réduction des crédits de droit commun dans les territoires CUCS. De plus, l’intégration des missions ville – qui assuraient la mise en œuvre des objectifs des contrats, le partenariat entre les collectivités signataires et l’État et la coordination des services de l’État en faveur des quartiers politique de la ville – aux nouvelles directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), a semé un certain trouble chez les acteurs locaux et a pu créer une certaine distance avec la nouvelle direction ; et ce alors même que la création des DRJSCS répond à des objectifs d’efficacité et de proximité (160).
Parallèlement, les collectivités territoriales, et les départements (161) en premier lieu, sont soumis à un effet de ciseaux résultant de la hausse des charges et des prestations et de la diminution de leurs ressources. Dans une agglomération du type 3, le chef de projet CUCS regrette que la politique de la ville se substitue à un droit commun absent : il cite l’exemple de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS, ex-DDJS) qui ne dispose quasiment pas de moyens de droit commun, lesquels sont, de surcroît, répartis à l’échelle du département. Si l’on prend en compte les communes et intercommunalités, correspondant principalement aux types 1, 2 et 4 de l’échantillon, collectivités pauvres – potentiel fiscal faible –, ce sont bien à des collectivités aux ressources amoindries que revient la mise en œuvre d’une politique de la ville qui, elle, appelle des moyens renforcés. Une commune du type 4 de l’échantillon explique ainsi un droit commun « déficient » : « la municipalité n’est pas à la hauteur pour développer un droit commun satisfaisant » ; une commune du type 1 de l’échantillon précise à destination des familles et des très jeunes ne peuvent être financées par le droit commun, faute de moyens… la politique de la ville est là pour pallier.
Par ailleurs, il convient d’envisager tous les aspects du droit commun et de ne pas seulement considérer les volumes financiers. À la mobilisation des crédits de droit commun que définit la politique de la ville depuis ses origines, à laquelle on s’est essentiellement intéressés jusqu’à présent, on doit aussi considérer la mobilisation des moyens et des ressources humaines issus du droit commun. Si la mobilisation des crédits spécifiques est très relative, la réalité est que les moyens humains et organisationnels issus des dispositifs et administrations de droit commun sont eux effectivement mobilisés. Parfois même, de façon suffisante. Mais ce droit commun là ne se mesure pas, ou encore plus difficilement que les volumes financiers.
Mais il ne faut pas oublier que la mobilisation du droit commun s’effectue dans des orientations stratégiques pertinentes et articulées avec l’ensemble des politiques publiques. La réussite des CUCS, et plus largement de la politique de la ville, est conditionnée à la mise en cohérence et convergence de toutes les politiques publiques.
Prenons l’exemple d’une des communes du type 1 de l’échantillon dans laquelle le CUCS mène une importante action sur la réussite éducative, mais doit subir en parallèle la suppression depuis le ministère de l’éducation nationale de postes d’enseignants et d’instituteurs : le jeu des tendances contradictoires nuit à la bonne mise en œuvre des actions. Le droit commun ne peut subir des réductions drastiques là où, précisément, la politique de la ville l’interpelle. Autre exemple notable, celui du plan égalité des chances du ministère de la défense, mis en œuvre parallèlement à la fermeture de sites de défense qui ont pour impact final une suppression d’emplois. On ne peut contester le choix politique qui est fait, mais les transformations et reconversions de l’administration et de l’action publiques doivent pouvoir se faire en lien avec la politique de la ville et ses objectifs.
Aussi la recherche de cohérence doit-elle être double : à l’échelon national et à l’échelon local. Quand les stratégies sont coordonnées, globales, les effets de la mobilisation du droit commun sont démultipliés. Certes la cohésion opérationnelle sur le terrain existe même sans cohérence stratégique, et la volonté est réelle de co-investir et de se co-investir… mais dans une moindre mesure !
3. Dans l’opacité conceptuelle, le culte de l’ambiguïté profite à tous
Cette ambiguïté sur les complémentarités entre les crédits politique de la ville et les crédits de droit commun, entre effet de levier et de bouclage, entre complémentarité, substitution ou additionnalité nécessite d’être levée au plus vite … mais « on ne sort de l’ambiguïté qu’à son désavantage ».
Cette ambiguïté repose d’abord sur l’imprécision quant à la visibilité des crédits gérés par l’Acsé et dont l’enveloppe est déléguée à l’État local sauf sur les dispositifs identifiés (VVV, adultes relais…). Les autres enveloppes Acsé affectées au financement associatif font l’objet d’une opacité relativement gênante. Deuxième facteur d’ambiguïté, celui lié au budget voté par les collectivités sur des lignes budgétaires de la politique de la ville et qui est un moyen pour elles de ne pas affecter des crédits de droit commun supplémentaire, une sorte de détournement des actions de droit commun (politiques de l’habitat, du développement économique par exemple) : véritable effet pervers qui participe du mécanisme de substitution. Cette affectation de crédits, que l’on peut a priori considérer comme positive peut être interprétée, elle aussi, comme un effet pervers. De surcroît, elle participe de l’ambiguïté par rapport aux crédits fléchés de l’État car ils ne sont pas de même nature et relèvent de logiques différentes.
La finalité de ces crédits en termes de complémentarité appelle donc à être précisée. Peut-on imaginer une conditionnalité des crédits propre aux CUCS ? C’est-à-dire une affectation des crédits conditionnée à l’inscription des projets dans des objectifs précis, à la qualification des opérateurs, aux cofinancements par les collectivités et les services de l’État compétents ? Cette conditionnalité peut relever d’une doctrine générale au plan national mais peut aussi être précisée localement en fonction du projet de territoire ou du projet de quartier. Cette clarification nécessaire se traduirait donc par des contraintes et des objectifs supplémentaires, auxquelles les élus et les administrations sont généralement réticents ; d’autant qu’elle impliquerait également la non fongibilité des crédits.
4. Un basculement de la politique de la ville vers le droit commun difficile à mettre en œuvre sans ces clarifications d’une part, mais surtout sans une nouvelle doctrine claire
La question de la pérennisation des actions sous-tend celle de l’intégration de la politique de la ville dans le droit commun. À la fin de chaque contrat se pose le problème de la continuité des financements pour les actions entreprises dans le cadre du CUCS. La très grande majorité des communes prennent le relais afin de préserver les postes créés ou de poursuivre une action qui lui semble efficace. Cependant, il conviendrait d’établir une doctrine claire sur le devenir des actions CUCS à la fin du financement et sur leur modalité d’intégration dans le droit commun.
Des facteurs d’efficacité comme des facteurs d’échec ressortent de cette analyse : bien sûr la nécessaire coordination des dispositifs et des modes de pilotage, la clarification des échelles d’action et de gouvernance (EPCI/commune, quartier/ville/bassin), les articulations avec le droit commun, l’enjeu de la participation des habitants etc. Mais sur ces différents points, beaucoup de choses sont déjà dites.
La recherche de l’efficacité appelle l’optimisation des moyens (efficience) avant leur multiplication. Elle appelle aussi l’optimisation de la cohérence :
– la cohérence des textes d’envergure nationale des politiques de droit commun de l’État impactant parfois marginalement les quartiers de la politique de la ville, des textes d’envergure régionale impactant inévitablement aussi les quartiers de la politique de la ville (schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, contrat de projet État - région, schéma régional de développement économique, plan régional de développement des formations, etc.), des schémas et plans départementaux, des schémas directeurs et d’organisation (schéma de cohérence territoriale, etc.), des autres politiques contractuelles (contrat d’agglomération, mais aussi charte de parc naturel régional) ;
– la cohérence stratégique des partenaires financeurs et opérationnels autour de stratégies d’action commune : repenser la forme et le statut de la contractualisation, et les critères d’éligibilité aux financements ;
– la cohésion opérationnelle des acteurs au sein et entre les thématiques d’intervention.
Le constat paradoxal est que cette cohésion opérationnelle des acteurs de la politique de la ville est régulièrement observée, alors que souvent la cohérence stratégique est affichée mais non effective. En agissant à l’échelon supérieur, celui des textes cadres nationaux régionaux, départementaux, territoriaux, la cohérence stratégique des partenaires pourrait être stimulée (de manière contraignante, incitative ?). Ainsi, on passerait de la cohérence formelle à la synergie effective, condition de l’efficacité dans un contexte d’incertitude budgétaire. Les acteurs de terrain s’en trouveraient re-légitimés.
La politique de la ville est-elle une politique d’exception ? Pensée comme telle à l’origine, elle avait vocation à répondre par une concentration de moyens limitée dans l’espace et dans le temps à des situations de décrochage urbain et social de quartiers affectés par les crises économiques successives des décennies 70 et 80. Les crédits « spécifiques » devaient permettre le « raccrochage » de ces quartiers. En tendance générale, et nonobstant les nombreux succès localisés rencontrés par la politique de la ville, non seulement, les quartiers historiques de la politique de la ville n’ont pu être « raccrochés » du fait de ces seuls crédits spécifiques, mais la géographie prioritaire a été régulièrement étendue. À la crise de l’emploi, s’est ajoutée une crise sociale recouvrant de multiples problématiques qui éloignent un peu plus de l’emploi les publics qui en sont affectées. Reconduits de contractualisation en contractualisation, les crédits spécifiques n’ont guère été relayés par les crédits de droit commun comme prévu. Ce qui n’a pas empêché les communes d’internaliser de plus en plus les chefs de projet et de prendre la main sur le pilotage des dispositifs, ni les intercommunalités d’exercer la compétence politique de la ville.
Mais la politique d’exception est devenue une politique de long terme. La multiplication des cycles courts a engendré un cycle long justifiant la reconduction des actions et de leurs financements. Entrés dans une logique de pérennisation, en tension entre l’État financeur et les collectivités bénéficiaires, les crédits spécifiques aspirent à leur « sanctuarisation »… mais celle-ci veut-elle dire que la géographie prioritaire doit le rester, ce qui voudrait dire que la politique de la ville est face à l’impossible transformation des quartiers et à l’échec de leur retour aux politiques de droit commun ?
QUATRIÈME PARTIE : PISTES POUR OPTIMISER L’ACTION
Dans le présent contexte d’incertitude et de questionnement des acteurs locaux sur l’avenir de la géographie prioritaire et de la contractualisation, il conviendrait de conforter non seulement la deuxième reconduction pour un an des CUCS, mais de rappeler et réaffirmer la validité des éléments de doctrine énoncés de 2003 à 2008 au travers des lois et circulaires… tant qu’aucune nouvelle doctrine n’est venue les remplacer.
Rappelons que rien ne les invalide, leur bien fondé est reconnu, mais l’obligation ou l’incitation à les mettre en œuvre ont manqué. Les CUCS ont été des contrats de ville plus formels et mieux organisés sur le papier. Par ailleurs les attentes et demandes des acteurs restent les mêmes qu’en 2006 : plus de stratégie, prévalence d’un projet global de territoire, un projet intégré de développement durable du quartier déclinant le précédent, plus de dynamique collective et de mobilisation partenariale, des programmes d’action inter-thématique aptes à mettre en œuvre effectivement le projet de quartier, un portage politique fort, une meilleure reconnaissance aussi des acteurs et des opérateurs…En revanche, le pilotage de projet par objectif de résultat ne fait pas consensus.
Si, pour beaucoup, l’insuffisance des moyens est le frein à l’efficacité, l’observation comparative des modes de gouvernance des dispositifs de la cohésion sociale conduit à souligner que la recherche de l’efficacité appelle l’optimisation des moyens (efficience) au moins autant que leur multiplication. Les contrats de ville puis de cohésion urbaine et sociale ont apporté une cohérence des partenaires locaux. Aujourd’hui, en bien des sites cette cohérence formelle nécessaire est insuffisante. Les enjeux du développement social urbain appellent à passer de la cohérence à la synergie – a fortiori si les moyens n’augmentent pas. Pour favoriser cette nouvelle étape, il conviendrait de prescrire au plan national aux politiques de droit commun de l’État et des collectivités territoriales, un objectif de convergence. Et par là, prévenir que des politiques nationales, régionales ou départementales ne contredisent de facto des objectifs par ailleurs contractuellement reconnus comme prioritaires, par les représentants locaux de ces mêmes administrations. Et prévoir dans ces politiques de droit commun, leurs incidences sur les quartiers de la géographie prioritaire. Ainsi par exemple des réductions d’effectif décidées nationalement, quand un surcroît d’effort est contractualisé localement. Et de même, éviter que des dispositifs de l’État d’appui aux quartiers, tels les ZFU, ne soient ici ou là ni compris ni valorisés, parce que non demandés.
Il conviendrait également de rationaliser l’exercice de la compétence politique de la ville par les EPCI en précisant les rôles respectifs de l’EPCI et de la commune.
Sur les quartiers bénéficiant d’un PRU, il conviendrait de relier de manière systématique les objectifs du PRU avec ceux du CUCS, qui devraient en découler. La logique voudrait que le PRU exprime un projet global de quartier, et qu’ainsi il donne les finalités du CUCS et par là, prescrive au CUCS ses actions, au moins sur les volets emploi-insertion et développement économique, habitat et cadre de vie, ainsi que prévention de la délinquance.
Le paysage de l’insertion par l’activité économique devrait être rationalisé : la diversité des structures, correspondant à des législations successives, des instances (conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, conseil local), des plans d’échelles distinctes et superposées (programme départemental d’insertion, plan local d’insertion, plan local pour l’insertion et l’emploi), des financements (État, fonds social européen, conseils généraux), rend aujourd’hui riche le tissu des structures d’insertion par l’activité économique, mais complexe l’articulation des politiques, et difficile la coordination des acteurs autour de programmes précis, ajustés et adaptés aux quartiers.
Dès lors, d’une part, une nouvelle forme de contractualisation devrait être subordonnée à la formulation de projets stratégiques globaux de quartiers eux-mêmes intégrés au projet stratégique global de territoire ; et, d’autre part, ses objectifs devraient être intégrés aux schémas directeurs d’aménagement et de développement durable et aux plans et schémas thématiques d’échelle supérieure.
On pourrait ainsi compenser la logique « curative » dominante d’une politique de la ville concentrée sur des interventions « d’urgence » ou des traitements de « longue durée » des « pathologies » urbaines. A contrario, des démarches de projet ascendantes, émanant des quartiers et de leurs habitants, permettraient de valoriser, pour les soutenir, les potentialités et les perspectives positives, dans une logique de développement. Et le portage politique, clé majeure de l’efficacité, deviendrait incontournable.
Dès lors, une logique de projet déterminerait l’éligibilité du projet aux aides des co-contractants, en cohérence avec les compétences de droit commun, et avec la nature de ces aides : ressources humaines, financement de droit commun, subventions et crédits spécifiques, investissement, exonérations fiscales. Telle action ou opération serait ainsi logiquement cofinancée par les crédits de droit commun des partenaires et collectivités correspondants, puisque s’inscrivant dans leurs compétences et priorités respectives.
D’une certaine manière, l’évolution vers une contractualisation unique de l’État et des EPCI est engagée, et celle-ci devrait se traduire par le co-financement de programmes d’action multi-thématiques sur des quartiers ré-affirmés comme prioritaires. La politique de la ville n’a pas vocation à re-devenir le volet social des contrats d’agglomération (ce qui n’a jamais vraiment vu le jour), mais une politique globale de cohésion territoriale et sociale intégrant l’urbain, l’habitat, l’économie, les transports, l’environnement, les services, trouverait dans un contrat unique ses traductions opérationnelles déclinées à différentes échelles intégrées, elles-mêmes marquées par des critères de priorité précis.
En outre, il apparaîtrait pertinent d’adapter la durée des contractualisations à la périodicité électorale, pour favoriser l’engagement des élus, leurs sensibilisation et formation d’abord si nécessaire, puis la coïncidence de l’agenda du projet global de territoire et de ses déclinaisons sur les quartiers prioritaires avec le projet de mandat.
Enfin, la prospective et la réflexion stratégique attendues des acteurs, et le pilotage dynamiques des programmes, ne peuvent se développer sans un appui fort de l’État sur plusieurs plans. D’abord, repréciser un tronc commun d’indicateurs de contexte de l’ensemble des quartiers prioritaires en lien avec l’INSEE et harmoniser le recueil des données nécessaires pour les renseigner, synchroniser ce recueil au plan local et au plan national, rendre obligatoire la transmission locale à périodicité courte (trimestrielle ou semestrielle) des données brutes de terrain par les services déconcentrés de l’État, les collectivités et les grands opérateurs dans les domaines de la fiscalité, de l’emploi, de l’insertion, du développement économique, de la santé, de l’éducation, du logement, de la sécurité.
Il conviendrait également de promouvoir une nouvelle culture de l’intelligence territoriale et du pilotage stratégique, facteur par elle-même de performance de l’action publique. À cet égard et, à titre d’exemple, il y aurait lieu de :
– concevoir un nouvel indice synthétique permettant d’échelonner l’ensemble de la géographie prioritaire, le cartographier et le communiquer sur un site internet dédié ;
– organiser localement le suivi des indicateurs et mettre au point un protocole de suivi-évaluatif dynamique obligatoire et commun à tous les sites ;
– étendre les pratiques de pilotage mises en place par l’ANRU aux actions de la cohésion sociale avec des revues de projet, des points d’étape ponctuant les étapes évaluatives.
Acsé |
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances |
ANPE |
Agence nationale pour l’emploi |
ASV |
Atelier santé ville |
CA |
Communauté d’agglomération |
CAF |
Caisse d’allocations familiales |
CDG |
Centre de gestion de la fonction publique territoriale |
CC |
Communauté de communes |
CEL |
Contrat éducatif local |
CG |
Conseil général |
CHRS |
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale |
CLAS |
Contrat local d’accompagnement à la scolarité |
CLS |
Contrat local de sécurité |
CLSPD |
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance |
CMUC |
Couverture maladie universelle complémentaire |
CNAM |
Caisse nationale d’assurance maladie |
CPER |
Contrat de projet État - région |
CR |
Conseil régional |
CU |
Communauté urbaine |
CSP |
Catégories socioprofessionnelles |
CUCS |
Contrat urbain de cohésion sociale |
DIV |
Délégation interministérielle à la ville (devenue SG CIV) |
DSQ |
Développement social des quartiers |
EEI |
Equipe emploi insertion |
EN |
Education nationale |
FASILD |
Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations |
FIPD |
Fonds interministériel de prévention de la délinquance |
FJT |
Foyer des jeunes travailleurs |
FPH |
Fonds de participation des habitants |
FSE |
Fonds social européen |
FTU |
Fonds de travaux urbains |
GPU |
Grand projet urbain |
GPV |
Grand projet de ville |
GSE |
Groupe solidarité emploi |
GTE |
Groupe de travail évaluation |
GUP et GUSP |
Gestion urbaine de proximité et Gestion urbaine (sociale) de proximité |
INET |
Institut national des études territoriales |
INSEE |
Institut national de la statistique et des études économiques |
MOUS |
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale |
OPAH |
Opération programmée d’amélioration de l’habitat |
PCS |
Professions et catégories socioprofessionnelles |
PDU |
Plan de déplacements urbains |
PEL |
Plan éducatif local |
PLH |
Programme local de l’habitat |
PLIE |
Plan local pour l’insertion et l’emploi |
PLSP |
Plan local de santé publique |
PME |
Petite et moyenne entreprise |
PNRQAD |
Programme national de requalification des quartiers dégradés |
PNRU |
Programme national de rénovation urbaine |
PRE |
Plan réussite éducative |
PRU |
Programme de rénovation urbaine |
PTCD |
Plan territorial de lutte contre les discriminations |
PUCS |
Projet urbain de cohésion sociale |
REAAP |
Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents |
SF |
Sources fiscales |
SG CIV |
Secrétariat général du Comité interministériel à la ville |
SIAE |
Structure d’insertion par l’activité économique |
SRADDT |
Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire |
SRDE |
Schéma régional de développement économique |
TPE |
Très petite entreprise |
VVV |
Ville Vie Vacances |
ZEP |
Zone d’éducation prioritaire |
ZFU |
Zone franche urbaine |
ZUS |
Zone urbaine sensible |
ANNEXE 2 - ANNEXE 1 DE LA LOI N° 2003-710 DU 1ER AOÛT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RÉNOVATION URBAINE
OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Introduction
a) Principes généraux : La présente annexe précise, pour chaque politique publique concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs assignés sur une période de cinq ans. Ils sont précisés au niveau national par une série d'indicateurs et d'éléments d'évaluation qui ont vocation à être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport annuel visé à l'article 5. Ces objectifs sont précisés et complétés à l'occasion de la mise en œuvre locale de la politique de la ville par les différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire contribuent à l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs recueillis localement pourront enrichir le système d'observation. Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en œuvre pour réduire les inégalités constatées dans les zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la ville.
b) Le financement du programme national de rénovation urbaine : Les ressources destinées au programme national de rénovation urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs groupements et des investisseurs, les contributions suivantes : La contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;
Les contributions de la Caisse des dépôts et consignations ; Le cas échéant, les subventions de l'Union européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative communautaire URBAN ; Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période 2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la période 2006-2008 ; Les contributions de solidarité versées par les organismes d'habitations à loyer modéré cités à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
1. L'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun » La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun ». Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans leur ensemble. Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situation socioéconomique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par l'article 5.
2. Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi D'après les données des recensements, le taux de chômage a augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit 491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts considérables entre les ZUS, certaines d'entre elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %. Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des ZUS était en 1999 de 40 %, soit 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des habitants des ZUS constitue un handicap pour l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise en œuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître globalement un déficit d'accès des publics visés par ces politiques en ZUS par rapport aux mêmes publics résidant dans d'autres territoires.
2.1. Les objectifs
Réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans. Rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui de l'ensemble de leur agglomération de référence. Mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification. Renforcer les politiques d'insertion par l'emploi des populations à faible qualification et de celles durablement exclues du marché de l'emploi.
2.2. Les indicateurs de résultats
Evolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations concernées par la politique de la ville. Evolution du même taux pour les actifs de faible niveau de formation, et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les ZUS et les agglomérations de référence. Evolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) dans les ZUS et des demandeurs d'emploi étrangers résidant en ZUS.
2.3. Les indicateurs de mise en œuvre des dispositifs de la politique d'emploi et de développement économique
2.3.1. Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi dans les ZUS
Comparé aux agglomérations : - aides à l'embauche en entreprise ;
- aides aux emplois des entreprises d'insertion ;
- aides aux emplois d'utilité sociale ;
- stages de formation et d'insertion ;
- contrats en alternance.
2.3.2. Développement économique et emploi dans les ZUS et en particulier dans les zones franches urbaines (ZFU) :
- nombre d'entreprises existantes, créées ou transférées ;
- nombre d'emplois existants, transférés et créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en ZUS ;
- taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de l'emploi ;
- investissements publics réalisés dans chaque ZUS, zone de redynamisation urbaine (ZRU) et ZFU.
3. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain
3.1. Les objectifs
Les objectifs visent sur une période de cinq ans : La réalisation du programme national de rénovation urbaine Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner des objectifs précis. Le programme national de rénovation urbaine et les moyens arrêtés par la présente loi visent néanmoins à atteindre les objectifs suivants : La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements seront construits au sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles font partie ; ils viendront en complément des programmes de logements sociaux destinés à l'accroissement du parc hors besoins spécifiques liés à la rénovation urbaine ; La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un regain durable d'attractivité ; La démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue nécessaire par les besoins de restructuration urbaine ; La résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux ; La réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces collectifs ; L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant des espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties ; La diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le soutien à la construction de logements locatifs à loyers intermédiaires et de logements destinés à l'accession à la propriété ; Le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque le maintien du régime de copropriété est un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les projets de restructuration urbaine. La qualité de la gestion urbaine de proximité
L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de proximité pour toutes les ZUS de plus de 500 logements ainsi que pour les sites faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics précis, donner lieu à des engagements contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise en œuvre, du diagnostic à l'évaluation.
3.2. Les indicateurs
Nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les ZUS.
Nombre annuel de logements sociaux construits dans les ZUS.
Nombre annuel de logements sociaux démolis dans les ZUS.
Nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les ZUS.
Nombre de logements concernés par des transformations d'usage.
Nombre de conventions de gestion urbaine de proximité.
Nombre de logements vacants et évolution.
Taux de rotation dans le logement.
Nombre de logements traités en opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat.
Nombre de plans de sauvegarde dans les ZUS.
Nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins de 20 % de logements sociaux.
Nombre de logements individuels destinés à l'habitation principale, réalisés ou acquis par des propriétaires et situés dans les ZUS.
4. Santé : développer la prévention et l'accès aux soins
Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de proximité et de qualité, à la fois curative et préventive, est l'ambition de notre système national de santé. En ZUS, celui-ci doit s'adapter pour tenir compte de la spécificité des populations qui y résident et améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire général de la population.
4.1. Les objectifs
4.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé.
Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque ZUS un bon niveau de démographie médicale. Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'état de l'offre médicale et paramédicale en ZUS en un plan quinquennal de résorption des zones déficitaires identifiées. Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et paramédicales et le développement à la fois des maisons de santé et des réseaux de santé publique, tels que définis par l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. Les maisons de santé créées répondent au besoin d'une médecine de ville de proximité et permettent d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins. Elles ont vocation à conduire des actions de prévention sanitaire, en particulier en direction des populations étrangères et des femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en ZUS sera encouragé dans ce cadre.
4.1.2. Accompagner les programmes de prévention.
Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les ZUS grâce à des instances locales de concertation, de déclinaison et d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les ateliers « santé-ville », qui réunissent les acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales et les associations concernées. Le développement de la médiation dans le domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui des maisons de santé, notamment par le programme adultes relais. Pour apprécier les efforts en la matière, les systèmes d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de santé publique et des activités correspondantes permettront de distinguer les ZUS.
4.1.3. Renforcer la santé scolaire.
Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au niveau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé scolaire et développer les programmes de prévention en direction des jeunes. Une attention particulière sera portée à la réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé.
4.2. Les indicateurs
Démographie médicale et paramédicale
Ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour 5 000 habitants dans les ZUS et nombre d'actes par médecin généraliste.
Nombre de maisons de santé existantes et créées en ZUS.
Nombre de réseaux de santé publique intervenant en ZUS.
Accès aux soins
Ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la population totale.
Nombre de permanences d'accès aux soins de santé en ZUS.
Importance des programmes de santé publique
Part du budget des programmes de santé publique affectée en ZUS.
Santé scolaire
Taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé scolaire.
5. Améliorer la réussite scolaire
La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des territoires urbains en raison de son incidence directe sur les stratégies résidentielles des ménages et de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes qui habitent dans ces quartiers.
Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les écarts de réussite scolaire entre les établissements situés en ZUS et l'ensemble du territoire national. Si les difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux jeunes résidant en ZUS, elles revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et sociales.
5.1. Les objectifs
Pour réduire les écarts de niveau entre certains élèves et les autres élèves scolarisés en ZUS et leur garantir une formation adaptée, le système éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une démarche de veille éducative, permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs, sera systématiquement mise en œuvre au plan local. L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation significative de la réussite scolaire dans les établissements des réseaux d'éducation prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs résultats de ceux des autres établissements scolaires.
5.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation prioritaire.
Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur la base du contrat de réussite que seront définis les engagements des autorités académiques. Au sein des réseaux d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau d'éducation prioritaire et la ville.
5.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives.
La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un territoire. Les procédures et cadres contractuels seront simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.
5.2. Les indicateurs
5.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en ZUS :
- nombre d'enseignants pour cent élèves dans les écoles ;
- nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au collège ;
- dotation totale horaire dans les collèges ;
- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le même collège;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les écoles ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les collèges ;
- nombre de classes d'enseignement général de lycées ;
- nombre d'établissements d'enseignement supérieur.
5.2.2. Indicateurs de résultats :
- résultats aux évaluations nationales (considérés dans tous les cas à partir de l'écart aux moyennes nationales) ;
- proportion d'élèves en retard au début du cycle 3 ;
- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3 ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 6e ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 3e générale, sauf 3e d'insertion ;
- taux d'accès de 6e en 3e ;
- devenir des élèves de 3e en fin de seconde générale et technologique ;
- devenir des élèves de 3e en fin de seconde professionnelle ;
- résultats au diplôme national du brevet des collèges ;
- taux de réussite aux baccalauréats général, technologique et professionnel ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au brevet des collèges ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au baccalauréat.
Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à l'entrée en 6e.
6. Sécurité et tranquillité publiques
Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les actes de délinquance et les atteintes à la tranquillité publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent fragilisée et exposée à une insécurité économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de proximité, une présence souvent insuffisante des services et équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre générations, services publics et usagers confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité. Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en ZUS : 46,4 %, comparé à 7,7 % pour les habitants de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17 % pour les habitants d'agglomérations avec ZUS). Ces problèmes d'insécurité réduisent l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
6.1. Les objectifs
L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et d'améliorer la tranquillité et la sécurité publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, mais également d'œuvrer à la cohésion sociale et de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures. Cela implique la mobilisation de tous : l'État, les maires animateurs des politiques locales de prévention et de tranquillité publique mais aussi les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de l'aide aux victimes. Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs suivants :
6.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment sécurité ainsi que celles qui ont des incidences criminogènes à long terme.
Sont notamment concernés :
- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et injures) ;
- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de véhicules privés, cambriolages) ;
- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles à l'intervention de services de sécurité ou de secours, atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de services publics et à leurs agents) ;
- les agressions en milieu scolaire ;
- le trafic de stupéfiants ;
- les mauvais traitements et abandons d'enfants.
6.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale.
Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :
- réduire les nuisances environnementales par des actions de veille, de prévention et de remise en état ;
- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain après réalisation d'un diagnostic de sécurité en relation avec les forces de police et de gendarmerie ;
- réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans l'accès aux services publics ;
- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la justice ;
- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des réponses en matière de tranquillité et de sécurité et leur mise en œuvre ;
- favoriser l'accès au droit.
6.2. Les indicateurs
La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de statistiques pour chaque ZUS par les administrations concernées, en cohérence avec les agrégats réalisés par le dispositif national mis en place par l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure à travers l'Observatoire national de la délinquance.
6.2.1. Indicateurs de résultats :
-nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sensibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par catégorie d'infraction (statistiques « état 4001 » - coups et blessures volontaires criminels et délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique, destructions et dégradations de véhicules privés, cambriolages de locaux d'habitation principale, destructions et dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;
- taux d'élucidation (des faits précédents) ;
- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique (« état 4001 ») ;
- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges sur la base des données du système de recensement et de signalement des faits de violence ;
- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment de sécurité).
6.2.2. Indicateurs de moyens :
- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des mineurs et brigade de prévention de la délinquance juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une ZUS ;
- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes comprenant une ZUS ;
- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice (maisons de la justice et du droit, point d'accès au droit) ;
- nombre de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- nombre d'éducateurs de prévention spécialisée ;
- nombre d'agents de médiation sociale.
7. Mobiliser les services publics
La proximité, la facilité d'accès et la simplicité d'usage des services publics, demandées par les Français, revêtent une importance particulière en ZUS où les services publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien apporté à leur personnel constituent les orientations quinquennales qui seront mises en œuvre.
7.1. Les objectifs
7.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics.
Des schémas locaux des services publics en ZUS seront réalisés. Ils concerneront l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et leurs établissements publics respectifs. Ils viseront à déterminer le niveau d'engagement de chaque service public sur les sites concernés, les seuils minimaux de présence effective de ces services au regard des niveaux constatés au sein de l'agglomération de référence, le calendrier de remise à niveau des effectifs et des moyens humains et les modalités de résorption des vacances de postes constatées. Ils préciseront les modalités d'adaptation des services aux réalités locales et aux attentes des usagers, en particulier en ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la médiation interculturelle. Ils identifieront les équipements d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, être implantés en ZUS. Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment par la création de maisons des services publics.
7.1.2. Développer les transports publics.
Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement. Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux équipements et services publics, les pôles de commerces et de loisirs et les centre-villes. Les caractéristiques de l'offre de transport devront s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les situations d'exclusion générées par les obstacles à la mobilité.
7.2. Les indicateurs
Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont précisés service public par service public, y compris pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants sont établis :
- ratios effectifs-population pour les ZUS ;
- taux de vacances de postes ;
- durée moyenne de présence dans le poste ;
- nombre de maisons des services publics.
1 Suivant la définition donnée dans le décret du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques.
2 Circulaire interministérielle de 9 décembre 1993 relative à l’évaluation des contrats de plan et contrats de ville.
3 Circulaire du Premier Ministre du 31 décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006 ; circulaire du Premier Ministre du 25 août 2000 relative à la mise en oeuvre de l’évaluation dans les procédures contractuelles pour la période 2000-2006 ; circulaire du ministre délégué à la Ville du 13 novembre 2000 relative à l’évaluation des contrats de ville et des politiques régionales de la ville pour la période 2000-2006.
4 Voir également la synthèse nationale effectuée par Kirszbaum (1998), dans le cadre d’une commande du Plan urbain (ministère de l'Équipement).
5 Une exception notable est l’évaluation régionale de la politique de la ville conduite à la fin des années 1990 en Ile-de-France, qui a abouti à la définition d’une grille de lecture régionale des processus d’exclusion et à des propositions d’adaptation des politiques régionales à ces différents types de territoires, qui ont été reprises dans le CPER 2000-2006 (Bravo, 1999). Mais il s’agit bien d’une exception si l’on compare cette démarche régionale avec les évaluations locales de Contrats de ville (Guigou, 2008).
6 Il s’agissait de réduire de moitié l’écart de réussite scolaire des deux villes par rapport à la moyenne départementale et de réduire le chômage au même rythme que pour l’ensemble du département.
7 Circulaire du 15 septembre 2006 relatif à la géographie prioritaire des CUCS.
8 Circulaire du 24 mai 2006 sur l’élaboration des CUCS.
9 Circulaire du 5 juillet 2007 sur l’évaluation locale des CUCS.
10 Secrétariat général du Conseil interministériel des villes, prenant la suite de la DIV.
11 L’indice synthétique était calculé de la manière suivante : ISE = (taux de moins de 25 ans) x (taux de non-diplômés) x (taux de chômeurs de longue durée) x (population du quartier) / potentiel fiscal de la commune.
12 Patrick Sillard, cité par Avide (2008).
13 Décret du 29 juin 2010 modifiant le décret du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
14 Le reporting consiste à collecter des informations précises sur des procédures, des résultats et les moyens utilisés dans des systèmes d’informations qui assurent la disponibilité immédiate de ces informations pour les responsables (Faucher-King, Le Galès, 2007).
15 Circulaire du 24 mai 2006 sur l’élaboration des CUCS.
16 Circulaire DIV/DOE du 13 juin 2000 sur la mise en œuvre des ateliers santé-ville.
17 Circulaire interministérielle DGS/DHOS/SD1A du 4 septembre 2006 relative à l’élaboration et à la mise en oeuvre des projets de santé publique dans les territoires de proximité et au développement des ateliers santé-ville.
18 Ce tableau de bord a été publié par Professionnalisation Banlieue dans le cadre d’un travail animé par C. Mannoni (2007), chercheure au Resscom.
19 Une étude réalisée pour l’inter-réseau du développement social urbain (association professionnelle des techniciens de la politique de la ville) en juin 2007 sur un échantillon de 200 sites donnait la mesure de l’écart : « Le projet de rénovation urbaine constitue bien le poids lourd financier des dispositifs sur le terrain, disposant d’une enveloppe moyenne de 4 188 euros par habitant concerné. Avec ses 31,2 euros en moyenne pour la gestion urbaine de proximité, ses 29,2 euros pour le CUCS, ou encore ses 19,1 euros pour le projet de réussit éducative, le projet de rénovation urbaine n’a pas son équivalent parmi les autres procédures et programmes » (Aures, 2007).
20 L’analyse détaillée des profils des entrants et des sortants proposée par l’ONZUS témoigne d’une nette spécialisation sociale « par le bas » des ZUS. Mais elle infirme l’idée suivant laquelle ces quartiers seraient engagés dans un cercle vicieux ségrégatif de type « ghetto » marqué par l’enfermement de toutes les catégories d’habitants.
21 Jusqu’à la dernière réforme de la Constitution française, qui a introduit un droit à l’expérimentation, le problème était aussi juridique.
22 Depuis 1990, la France a connu pas moins de 18 responsables de la politique de la ville : 2 ministres en charge de la ville, 7 ministres responsables de pôles d’activités intégrant la politique de la ville, 5 ministres délégués et 4 secrétaires d’État.
23 Circulaire du 3 mars 1977 relative au Fonds d’aménagement urbain et au groupe Habitat et vie sociale.
24 Sur ce thème, voir également Donzelot et Roman (1998).
25 Le travail sur la mémoire connaîtra par la suite un renouveau évident dans le contexte d’opérations de requalification urbaine. Mais l’objectif a évolué : il s’agit moins de valoriser le quartier que de faire accepter par les habitants des changements qui leur sont imposés, voire d’étouffer les tensions ou les luttes sociales que ceux-ci pourraient générer (Foret, 2007).
26 Voir notamment Castel (1991, 1995) qui rejette cependant le terme « exclusion ».
27 Née aux États-Unis dans les années 60, cette politique peut se définir comme l’ensemble des activités visant tout à la fois à redonner une valeur à ces quartiers et à renforcer le capital – cognitif, social, économique et politique – de leurs habitants. Son originalité réside dans la nature même des organisations « communautaires » (au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire au sens géographique du quartier) qui puisent leur légitimité auprès des habitants, dont elles sollicitent l’engagement civique en même temps qu’elles développent des services en leur direction (Kirszbaum, 2009b).
28 Décret du 16 juin 1984.
29 Politique qui devait s’organiser autour de quatre principes (concentration des efforts de l’État sur les 400 quartiers les plus en difficulté ; diversification des fonctions ; participation des habitants ; création d’emploi pour les habitants des quartiers, sinon dans ces quartiers) et s’appuyer sur six leviers principaux (unité de commandement ; remise à niveau des services publics ; application de la loi Besson pour le logement des personnes défavorisées ; vote d’une loi pour la maîtrise foncière ; redéploiement des aides de l’État aux communes ; mobilisation des entreprises publiques et privés).
30 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999.
31 Loi sur le renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999.
32 Loi du 13 décembre 2000.
33 En ce sens, voir également le rapport du Commissariat général du plan intitulé Cohésion sociale et territoires qui préconisait une combinaison diversifiée d’échelles territoriales d’intervention pour la politique de la ville (Delevoye, 1997).
34 L’expression de « quartiers comme symptôme » est de P. Estèbe (2004a).
35 Une enquête sur les conceptions de la mixité des élus locaux a montré que ceux du parti socialiste défendaient les positions les moins homogènes (Kirszbaum, 2007).
36 Selon les termes du porte-parole du gouvernement, Louis Le Pensec, in Le Monde du 8 mars 1990, cité par Houard.
37 La même année, le ministère de l’Équipement s’était saisi de cette question en commandant un rapport sur l’attribution des logements sociaux au maire socialiste d’Hérouville Saint-Clair, F. Geindre (1989). Parmi ses propositions, la loi Besson conservera l’idée de « Protocoles d'occupation du patrimoine social » (POPS) qui devaient être les lieux d’une conciliation locale entre deux finalités : assurer le droit au logement tout en empêchant la concentration des personnes « défavorisées » dans certains quartiers et patrimoines (Deschamps, 1998). Précédant la loi Besson, une circulaire du 30 mars 1990 précisait déjà la fonction des POPS : identifier des « catégories de populations jugées prioritaires à partir d’une analyse de la demande locale » et fixer des « objectifs quantitatifs globaux d’accueil », tout « en tenant compte de la capacité d’accueil du parc ».
38 Il s’agissait des communes de plus de 3 500 habitants situées dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants comprenant moins de 20% de logements sociaux parmi les résidences principales ; la loi fixait aussi un seuil de 18% de ménages bénéficiaires de l'Aide personnalisée au logement (APL).
39 Source : conférence de presse sur les projets et priorités pour le logement et l'urbanisme, 24 avril 2001.
40 Source : C. Bartolone, Rencontres nationales des GPV, le 10 décembre 1999.
41 Source : C. Bartolone, Rencontres nationales des GPV, le 14 décembre 2000.
42 Source : Rencontre nationale des GPV, le 14 décembre 2000.
43 Source : Conseil interministériel des villes, relevé de décisions, 1998.
44 Source : Rencontre nationale des GPV, le 10 décembre 1999.
45 Source : « Réussir la rénovation des grands ensembles », In Masboungi A. (dir.), Régénérer les grands ensembles, Éditions de la Villette, 2006.
46 L’ANRU affiche désormais un chiffre presque moitié moins élevé de 135 000 démolitions présentés à ce jour à son comité d’engagement, alors que le PNRU est en quasi-totalité programmé. En dehors des démolitions, la loi prévoit aussi des réhabilitations, résidentialisations et constructions conçus comme autant de leviers permettant d’atteindre l’objectif de mixité sociale Voir infra III-A-1.
47 Voir par exemple, les déclarations de MM. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration, et Éric Raoult, ministre délégué à la ville et à l'intégration, lors du séminaire de travail sur les zones franches urbaines à Marseille le 14 avril 1997.
48 Cf. supra I-B.
49 Dossier de presse du Palais de l’Elysée, Une nouvelle politique pour les banlieues, vendredi 8 février 2008.
50 Pour une présentation de cette controverse et des analyses scientifiques en appui des différentes positions, voir Authier et al. (2007) ; Bacqué, Fol, 2007 ; Kirszbaum (2008a) ; Boisson (2010).
51 Pour une présentation plus exhaustive de ces débats, voir Kirszbaum (2008a).
52 Établissements publics de coopération intercommunale.
53 Quatre ans plus tard, le rapport du sénateur Pierre André, co-signé avec le député-maire de Dreux, Gérard Hamel, a vanté à son tour la commune comme « acteur légitime de proximité » et « échelon pertinent de pilotage » de la politique de la ville.
54 Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
55 Les résultats de cette seconde étude sont plus favorables que la première, mais comme l’a noté la Cour des comptes dans son rapport sur La gestion des crédits d’intervention de l’État au titre de la politique de la ville, la méthodologie de l’enquête réalisée par le cabinet Conjuguer repose sur un questionnaire diffusé aux EPCI, ce qui induit « un risque de surestimation du rôle des intercommunalités » dans la politique de la ville (Cour des comptes, 2007).
56 Loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
57 Brice Hortefeux, alors ministre du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, déclarait ainsi lors des Journées de la rénovation urbaine tenues en juin 2009 à Bordeaux : « La politique de rénovation urbaine doit répondre à sa mission de base : casser ce qui peut constituer les ghettos urbains. Cela suppose de diversifier la localisation des relogements. (...) Les équilibres de population, dans les quartiers, doivent radicalement évoluer si l’on veut atteindre l’objectif de mixité sociale. C’est pourquoi je tiens tout particulièrement au respect de l’obligation de reconstitution de l’offre de logements démolis au moins pour moitié dans des secteurs autres que le quartier d’origine ».
58 Loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004.
59 Les mesures relatives aux Programmes locaux de l’habitat et à la gestion territorialisée des attributions de logements sociaux de la loi Engagement national pour le logement de juillet 2006 ont renforcé ce mouvement de prise de responsabilité des agglomérations sur les politiques du logement social (Driant, 2007).
60 Pour des résultats convergents, croisés avec l’orientation politique des élus locaux, voir Kirszbaum (2007), qui observe cependant l’accord très large des élus avec la doctrine de l’ANRU (Kirszbaum, 2010). Il montre aussi que la période des GPV préfigurait, à certains égards, la fonction d’un État central énonciateur de la substance même des projets locaux (Kirszbaum, 2004d). On peut remarquer enfin que la technique de l’appel à projets national n’est pas une innovation radicale du PNRU. Elle était déjà la marque de fabrique du Pacte de relance pour la ville en 1996.
61 Le FIV a subi une diminution de 10% dans la loi de finances initiale pour 2004, puis de 18% dans la loi de finances pour 2005, pour atteindre finalement près de 25% par rapport à la loi de finances pour 2004 à la suite à de gels budgétaires décidés au cours de l’année 2005. Chiffres cités par Epstein (2008a).
62 Ce phénomène n’est pas absolument nouveau, car les crédits contractualisés ont toujours côtoyé des crédits non-contractualisés dans la politique de la ville (Chaline, 1997).
63 C’est ainsi que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, groupement d’intérêt public dont la fusion dans l’ACSÉ avait été annoncée lors du CIV du 9 mars 2006, est finalement parvenue à préserver son indépendance. En 2009, l’ACSÉ s’est également vue retirer la gestion de crédits liés à la politique d’intégration, lesquels sont passés dans le giron du nouvel Office français de l’immigration et de l’intégration au sein du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
64 Directions départementales de l’équipement et de l’agriculture, devenues Directions départementales des territoires avec la RGPP.
65 Les effets de sectorisation de la LOLF ont été plus largement démontrés : « En segmentant fortement l’activité de l’État autour des politiques publiques, en mettant comme contrepartie à la globalisation de l’autorisation budgétaire de fortes contraintes de gestion, en déléguant les responsabilités, la LOLF risque de rendre plus difficile à la fois la coordination des politiques publiques et le travail des services sur des projets communs ; cette préoccupation s’exprime vivement au niveau territorial où le préfet cherche à mettre en cohérence les actions de l’État » (Arkwright et al., 2007). Pour une analyse de son impact sur la politique de la ville en général et la rénovation urbaine en particulier, voir Renaud Epstein (2008a).
66 Circulaire du ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l’élaboration des CUCS, 24 mai 2006.
67 Source : Projet de loi de finances pour 2010 « Ville et logement ».
68 Voir notamment son rapport d’activité 2008.
69 En particulier au cours des Journées nationales d'échanges des acteurs de la rénovation urbaine, tenues en juin 2009 à Bordeaux.
70 Pour un résultat convergent, voir Aures (2009).
71 Groupement d’intérêt public. Au début des années 2000, la formule du GIP avait été promue par la DIV comme la solution idoine au problème de la coopération partenariale. Mais les GIP ont été généralement affaiblis en tant que plates-formes communes de portage des thématiques urbaines et sociales. Les programmes de l’ANRU et de l’ACSÉ, organisés selon un principe de séparation des crédits d’investissement et de fonctionnement, ont suscité de nouveaux cloisonnements et contribué à étioler les partenariats territoriaux développés dans ce cadre (Kirszbaum, 2010).
72 Source : C. Bartolone, Rencontre nationale des Grands Projets de Ville, Vaulx-en-Velin, 10 décembre 1999.
73 Cette seconde stratégie s’est concrétisé par différents programmes visant à faciliter la sortie du ghetto. Pour une présentation, voir Kirszbaum (2009b).
74 Cf. supra II-A-3.
75 Cf. supra, II-A-2.
76 Sauf pour le critère relatif au potentiel fiscal des communes qui était celui de 1996.
77 Discours d'installation du nouveau Conseil national des villes le 25 mai 2010.
78 DIV, Circulaire du 15 septembre 2006 sur la « Géographie prioritaire des CUCS, contenu et calendrier de mise en œuvre ».
79 Soit 3,56 milliards d’euros mobilisant 29 programmes ministériels contre 769,26 millions d’euros de crédits spécifiques du programme 147.
80 On peut ajouter que les aides au logement versées dans ces quartiers, qui représentent près du cinquième de l’effort financier total de l’État pour la politique de la ville (4 milliards d’euros en 2007), y sont intégralement comptabilisées, ce qui peut surprendre s’agissant de présenter, en principe, l’effort supplémentaire de l’État en faveur des quartiers prioritaires (Epstein, 2008a).
81 L’indice de précarité a été calculé sur la base du nombre de bénéficiaires du RMI et d’allocataires de prestations sociales à bas revenus des CAF.
82 Voir supra II-A-2.
83 Direction générale des affaires sociales.
84 Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle.
85 Circulaire du SG-CIV du 5 mars 2010.
86 Trajet d’accès à l’emploi.
87 Direction de l'animation de la recherche des études et des statistique du ministère du Travail.
88 Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise.
89 Stage d’insertion et de formation à l'emploi.
90 Nouveau service-Emploi jeune (NS-EJ) ou Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (ou « Contrat jeune en entreprise ») (SEJE).
91 Contrat d’avenir (CA), destiné à accueillir les bénéficiaires de minima sociaux et Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), ouvert aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
92 Contrat initiative emploi « nouvelle formule ».
93 CES et CES dans le secteur non-marchand : CIE « ancienne formule » pour le secteur marchand.
94 Ce type d’écart peut s’expliquer dans les 20 % de collèges situés en ZUS qui ne relèvent pas de l’éducation prioritaire.
95 Selon Alain Guengant et Guy Gilbert, « l’équité territoriale vise, d’une part, à favoriser l’égalité des usagers et des contribuables devant la dépense publique et l’impôt et, d’autre part, à préserver l’autonomie de décision des autorités locales » (Gilbert, Guengant, 2004).
96 Le même phénomène a été observé quelques années plus tard aux États-Unis avec le programme fédéral Empowerment Zones/Enterprise communities, mais le pouvoir fédéral a laissé une large latitude aux partenaires locaux pour définir le contenu des projets (Kirszbaum, 2004d).
97 Instituée par la loi du 13 mai 1991, la DSU constitue l’une des trois composantes péréquatrices de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes. Outre la création de la DSU, la loi du 13 mai 1991 sur la solidarité financière a institué deux mécanismes supplémentaires de péréquation fiscale en faveur des communes pauvres : une Dotation particulière de solidarité urbaine destinée à prendre en compte la situation de certaines communes qui ne remplissaient pas tous les critères pour pouvoir bénéficier de la DSU et un Fonds de solidarité pour les communes d'Ile-de-France alimenté par des cotisations des communes riches, transférées vers les communes les plus pauvres de la région.
98 Sous réserve que la croissance de la DGF des communes et de leurs groupements soit supérieure d’une année sur l’autre à 500 millions d’euros.
99 Dotée de 50 millions d’euros en 2009, cette dotation budgétaire est attribuée, selon un système d’enveloppes départementales, à 100 communes éligibles à la DSU classées selon un indice synthétique de ressources et de charges. Mais son montant reste très inférieur à celui de la DSU. Le rapport Hamel-André (2009) a souhaité que soit atteint un équilibre progressif entre les deux dotations.
100 Voir supra I-B-3.
101 Le président du conseil d'administration de l’ANRU déclarait en 2006 : « L’ANRU est amenée à analyser les projets et à suivre pour cela quelques critères. Le premier critère est la mixité sociale. Si le projet tel qu’il est présenté débouche, à peu de choses près, sur la même composition sociale du quartier et si on n’a pas démontré que l’on était en capacité de fabriquer de la diversité sociale dans un lieu où se concentrent toutes les précarités et toutes les difficultés, il faut évidemment le retravailler » (André, 2006).
102 Titre III-1-6.
103 Voir aussi le Projet de loi de finances pour 2010 « Ville et logement ».
104 Avec succès dans la loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat qui réduisait fortement la portée de la loi d'orientation pour la Ville.
105 Une seule référence était faite « nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins de 20 % de logements sociaux », dans l'annexe 3.2 de la loi, mais au titre d’indicateur de suivi et non d’objectif.
106 Chiffres au 31 décembre 2008, cités par le CES de l'ANRU (2010).
107 Sur cette distinction entre mixité endogène et exogène, voir Dansereau et al. (2002).
108 Source : ANRU, Rapport d’activité 2008.
109 Circulaire du ministre de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et du ministre du Logement et de la ville du 18 juin 2008 relative à « un plan d'actions pour favoriser l'égalité des chances dans l'accès au logement pour les populations, en particulier étrangères, cumulant difficultés économiques et sociales ».
110 Règlement général de l’ANRU, titre II, article 1.1.3.1..
111 L’étude devait être financée par le SG-CIV, l’ANRU, le CES de l’ANRU, l’USH, la DHUP, l'ACSÉ e la Caisse des dépôts et consignations.
112 Voir supra II-B-3.
113 Encore au stade expérimental, ce nouveau programme intitulé « Choice Neighborhoods » accroît fortement les garanties apportées aux habitants initiaux.
114 Les exonérations portent sur la taxe professionnelle, l’impôt sur les sociétés, la taxe foncière, les cotisations sociales patronales sur la fraction du salaire horaire inférieure à 1,4 SMIC, les cotisations dues au titre du fonds national d’aide au logement, le versement transport ainsi que les cotisations sociales personnelles maladie et maternité des artisans et commerçants.
115 La même étude révèle que les transferts d’entreprises ont un meilleur taux de survie que les créations : les transferts survivent à peu près aussi bien en ZFU que leur unité urbaine (41,7 % contre 42,2 %), alors que les créations montrent de plus grandes difficultés de survie en ZFU (27,8 % contre 33,4 %). La part élevée des implantations en ZFU procédant de transferts (33,8 % sur la période 1997-2001 contre 26,4 % dans les unités urbaines) contribue ainsi à limiter le désavantage global en survie dans ces quartiers. Dans certains secteurs, les taux de survie sont même meilleurs en ZFU que dans l’unité urbaine, par exemple les cabinets médicaux (+ 11,2 points), le conseil informatique (+ 9 points) ou l’ingénierie-études techniques (+ 7 points). Cependant, les secteurs qui ont le moins bon taux de survie sont ceux qui ont la plus forte propension à s’implanter en ZFU : la maçonnerie (– 6 points) ou la construction (– 4,4 points). Le secteur du commerce aussi des résultats beaucoup plus faibles en ZFU avec un taux de survie inférieur de 10,5 points aux urbaines de référence.
116 D’autres études (ONZUS, 2007 ; Ernst, 2008) concluent à une part beaucoup plus limitée des transferts, mais elles portent sur l’ensemble des flux d’installation et non sur le seul effet propre du dispositif ZFU.
117 Voir supra III-A-4.
118 Ceci peut s’expliquer par le fait que les exonérations sont plus avantageuses pour les petites entreprises. En effet, les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sont accordées pendant une durée de cinq ans maximum à 100 %, puis à taux dégressif sur trois ans pour les entreprises de plus de cinq salariés, et sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés.
119 L’ONZUS note aussi que 29 % des ZFU créées en 1996 ont connu, entre 2002 et 2006, une progression supérieure à 5% du revenu médian par habitant relativement au reste de leur agglomération, alors que seules 19% des ZUS non ZRU ni ZFU sont dans ce cas (ONZUS 2009).
120 Le déficit de femmes des quartiers prioritaires parmi les salariés embauchés en ZFU constitue une autre caractéristique notable : près de 70 % d’entre eux sont des hommes en 2006 (Bachelet, 2008b), ce qui peut s’expliquer par les secteurs d’activité fortement présents dans ces zones (services aux entreprises, construction, industrie) (Van de Walle, Britton, 2007).
121 Voir supra II-B-2.
122 Interview de Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, in Revue Ville-École-Intégration Diversité, n°144, mars 2005. Cité par Joly-Rissoan et al. (2006).
123 Suivi de près par celui des Adultes-relais qui mobilisait 88,5 millions d’euros dans le PLF 2009.
124 Le programme Réussite éducative permet aussi de soutenir des projets d’Internat de réussite éducative, proposant un cadre d’étude stable à des jeunes de moins de 16 ans connaissant des difficultés familiales ou environnementales pouvant compromettre leurs chances de réussite. Cependant, comme l’a relevé un bilan de l’ACSÉ daté de juillet 2008, « la mise en oeuvre d’un projet d’internat de réussite éducative a peu à voir avec un PRE ». En effet, ces 38 internats accueillaient seulement une moitié d’élèves provenant de territoires ZUS, CUCS et/ou ZEP et seuls 7 internats étaient situés en géographie prioritaire, à cette date, contre 13 en zone rurale (ACSÉ, 2008).
125 Circulaire DIV sur la « définition et mise en œuvre du volet éducatif des contrats urbains de cohésion sociale » du 11 décembre 2006.
126 Circulaire DIV du 14 février 2006.
127 Circulaire DIV du 11 décembre 2006.
128 En appui sur un tableau de bord réalisé par le cabinet Trajectoires (2008), l’agence se félicite de ce que 70 % des PRE soient entrés « dans une réelle dynamique d’individualisation des parcours », avec plus de 20 % de parcours, lesquels sont majoritaires par rapport aux actions collectives dans deux tiers des cas. Les 30 % de PRE restants ne comptent en moyenne que 7 % d’enfants en parcours individualisés, et une dizaine de sites « ne pratiquent pas l’individualisation », tout en pesant lourdement sur la moyenne nationale, ce que semble regretter l’agence.
129 Voir supra I-B-3 les constats formulés par la Cour des comptes sur l’absence d’évaluation nationale de la réussite éducative (Cour des comptes, 2009).
130 Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.
131 Si désormais l’Éducation nationale affiche aussi des dispositifs ayant une visée « éducative », en créant par exemple son propre Programme personnalisé de réussite éducative, les contenus demeurent en réalité essentiellement scolaires (Glasman, 2008).
132 Le rapport de la Cour des comptes évoque une seule expérience en ce sens conduite à Chanteloup-les-Vignes.
133 Ainsi lit-on dans l’introduction au rapport 2007 de l’ONZUS, ces mots de la présidente de son conseil d’orientation : « Si les écarts de réussite scolaire sont toujours importants entre les ZUS et leurs agglomérations, certains signaux positifs sont enregistrés comme une légère résorption des retards scolaires. Faut-il déjà y voir l’effet du dispositif de réussite éducative ? On peut en tout cas relever que les collèges bénéficiant de ce dispositif voient leur taux de succès au brevet s’améliorer tout en restant très loin des résultats nationaux » (ONZUS, 2007).
134 () Indice PRV pour « Pacte de Relance pour la Ville », dénomination de la loi qui l’instaure. Il est calculé à partir de la population totale de la zone, du taux de chômage, de la proportion de jeunes (moins de 25 ans), de la proportion de plus de 15 ans sans qualification, du potentiel fiscal de la commune. L’indice PRV calculé comme le produit des quatre premiers éléments, divisé par le cinquième.
135 () Source : site internet du SG-CIV, http://sig.ville.gouv.fr/page/13/geographie-prioritaire-des-cucs
136 () Contrairement au type 3 pour lequel les écarts des QPV sont faibles avec la commune d’appartenance, riches et importants avec l’unité urbaine de référence qui englobe souvent une métropole économiquement dynamique.
137 () Le resserrage initial de la politique de la ville sur le programme national de rénovation urbaine a écarté d’emblée, par exemple, les quartiers d’habitat spontané, informel ou de centres anciens des interventions de l’ ANRU et a limité la prise en charge de leurs enjeux et problématiques au champ du droit commun.
138 () CIRESE pour la DIV, Guide de l’évaluation des CUCS, version 2, août 2007. Ce « guide pratique » est venu expliciter les exigences réglementaires sur les CUCS et leur évaluation et, selon ses propres termes, « constitue la déclinaison méthodologique de la note de cadrage sur l’évaluation continue des CUCS diffusée par la DIV ».
139 () Ibid.
140 () CIRESE pour la DIV, op. cit.
141 () Qui complète la circulaire du 24 mai 2006.
142 () Au sens de la Société française de l’évaluation( SFE) notamment, dont la charte de l’évaluation a été reprise par le cabinet CIRESE pour la DIV dans son guide de l’évaluation des CUCS, op. cit.
143 () Philippe Dallier, au nom de la commission des Finances, Rapport d’information n° 71 (2007-2008), déposé le 7 novembre 2007.
144 () Toujours selon la charte de l’évaluation de la SFE.
145 () Le logiciel Poliville permet « la mise à disposition, pour tous les partenaires, des informations collectées par le guichet unique, sans qu’il soit nécessaire de procéder, à chaque fois, à une nouvelle saisie des données » (lettre de la DIV aux préfets de département, 2004). Cela permet de faire un bilan des actions, en particulier un bilan financier.
146 () Pour rappel, la circulaire du 24 mai 2006 dispose : « le CUCS comporte : – un projet urbain de cohésion sociale, visant l’ensemble des objectifs de résultat définis aux articles 1 et 2 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour l’amélioration de la vie quotidienne et la promotion de l’égalité des chances des habitants et la meilleure intégration de ces quartiers dans la ville… »
147 () Voir 3ème partie, B.2.a.
148 () La Note de cadrage de 1999, DIV, DGUHC, USH, précise les objectifs et le périmètre de la GUP pour ses signataires : « La gestion urbaine de proximité est l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier. (…) Le volet ‘gestion urbaine de proximité’ des contrats de ville traitera essentiellement les actes de gestion liés à l’habitat, tels que : organisation des espaces publics et privés, stationnement, circulation ; propreté, entretien, maintenance des immeubles et des espaces extérieurs et traitement paysager... ; présence, accueil, gardiennage et surveillance, médiation, tranquillité publique... ; travail social de proximité, accompagnement social lié au logement ; services urbains : ordures ménagères et tri sélectif, économies d’énergie (chauffage, distribution de l’eau... ).»
149 () De 2002 à 2005, quatre enquêtes ont été menées et concernaient les quartiers prioritaires du Contrat de Ville. À partir de 2008, ces enquêtes concernent les quartiers inscrits à la nouvelle géographie prioritaire définie lors de la mise en place du CUCS. Au total, 260 personnes ont été interrogées durant le mois d’avril 2008.
150 () Franck Bachelet, François Rangeon, « La politique de la ville ou les difficultés de l’interministérialité locale », in Politiques et management public, volume 14, n° 3, septembre 1996, p.3.
151 () « Vous [les préfets] co-signerez avec (le ou les) maire(s) impliqués dans les contrats une lettre de mission au chef de projet le mandatant conjointement pour l’ensemble de ses tâches. »
152 () Jacques de Maillard, « Les chefs de projet et les recompositions de l’action publique. Un nouveau métier urbain », in Les annales de la recherche urbaine, no 88, 0180-930-XII-00/88, p. 17.
153 () Capacités des maîtrises d’ouvrage et ingénieries locales, rôle des DDE, Rapport de la documentation française, 2006, p. 35.
154 () PLURALIS pour la DIV, op. cit.
155 () Circulaire du 24 mai 2006, partie 1 « objet du CUCS » : « Ce contrat prendra en compte tant les politiques structurelles développées à l’échelle communale ou intercommunale influant sur la situation des quartiers (emploi, développement économique, transport, habitat et peuplement, politique éducative et culturelle, santé, insertion sociale) que les actions conduites au sein même de ces quartiers pour améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants ».
156 () PLURALIS pour la DIV, op. cit.
157 () Circulaire du 24 mai 2006, point 4 « engagements », « un meilleur ciblage des crédits spécifiques ». Le paragraphe précédent « Une priorité à l'engagement des crédits de droit commun » stipule : « Vous veillerez à ce que chaque partenaire s’engage prioritairement, sur la durée du contrat, sur son domaine de compétences et d’intervention en termes d’objectifs, ainsi que de moyens financiers et humains. Ainsi l’Etat devra-t-il mobiliser ses moyens budgétaires de droit commun et orienter ou redéployer, chaque fois que possible, ses moyens en personnel en lien avec les priorités du projet de cohésion sociale. […] ».
158 () Au vu des analyses ci-dessus, des évaluations et des documents exploités, ainsi que des dires des acteurs interrogés.
159 () Circulaire du 25 février 2009 de la ministre de la Culture : Culture et politique de la ville : mise en place du plan triennal du ministère de la Culture et de la Communication déclinant le Plan Dynamique Espoir Banlieues à la suite du Comité interministériel des villes et de la Communication, à l’attention des DRAC et des préfets de région.
160 () « L’efficacité des politiques de cohésion sociale au profit des populations les plus fragiles a été renforcée avec la création d’une part de 21 directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) le 1er janvier 2010, d’autre part de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), le 25 janvier 2010. En associant des entités autrefois distinctes (directions régionales de la jeunesse et des sports, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (partie « cohésion sociale »), directions régionales de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), les nouvelles DRJSCS constituent un interlocuteur unique, bénéficiant d’une certaine proximité avec son public, au service du renforcement du lien social et de la promotion du « vivre ensemble ». Cet interlocuteur permet des synergies dans le pilotage des différentes actions en faveur de la cohésion sociale (jeunesse, sport, vie associative, inclusion sociale des publics les plus vulnérables). » site du ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/index.php?id=52&tx_ttnews[tt_news]=498&tx_ttnews[backPid]=42&cHash=2fca95ff98
161 () Pierre Jamet, « Rapport à M. le Premier ministre sur les finances départementales », 20 avril 2010.
© Assemblée nationale