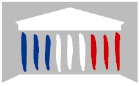N° 4334
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2012
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et
de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
sur la prévention sanitaire,
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Jean-Luc PRÉEL,
Député.
——
INTRODUCTION 7
I.- DE VASTES AMBITIONS PORTÉES PAR DE MULTIPLES ACTEURS POUR DES RÉSULTATS DÉCEVANTS 11
A. UNE POLITIQUE PUBLIQUE AMBITIEUSE 11
1. Les frontières incertaines de la prévention 11
a) Des définitions évolutives 11
b) Un aboutissement législatif 12
2. L’affirmation d’une approche intégrée 14
a) Des objectifs ambitieux : une population responsabilisée, des inégalités sociales et territoriales face à la maladie réduites 14
b) Une opposition entre soins et prévention dépassée : la prévention comme investissement 16
B. UN FOISONNEMENT D’ACTEURS 19
1. Des interventions multiples 20
a) L’État 20
b) Les intervenants de la santé au travail 23
c) Les collectivités territoriales 25
d) L’assurance maladie 27
e) Les complémentaires santé 30
f) Les professionnels de santé 31
g) Les associations 32
2. Des compétences mal identifiées 33
a) Au sein de l’État 33
b) Dans le monde professionnel 35
c) Entre l’État et les collectivités territoriales 36
d) Entre l’assurance maladie et les complémentaires santé 37
3. Les agences régionales de santé : un espoir malgré une mise en place difficile 37
C. DES RÉSULTATS DÉCEVANTS 40
1. Des priorités mal identifiées, car trop nombreuses 40
2. Une évaluation malaisée, des données cloisonnées 41
3. Des exemples : le cancer, les maladies infectieuses, l’hypertension artérielle 43
a) Le cancer 43
b) La recrudescence de maladies infectieuses 45
c) La question de l’hypertension artérielle 45
II.- POUR UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION PILOTÉE, COORDONNÉE ET INNOVANTE 47
A. UN PILOTAGE AFFIRMÉ 47
1. Le pilotage politique 47
2. Un pilotage territorial 49
B. UNE COORDINATION RENFORCÉE 51
1. Améliorer la complémentarité des acteurs 51
a) Au sein de l’État 51
b) Entre les professionnels de santé et l’État et l’assurance maladie 52
c) Entre les régimes obligatoires d’assurance maladie et les complémentaires santé 59
2. Faciliter les échanges de données 61
C. UNE INNOVATION ASSUMÉE 64
1. Repenser certaines actions traditionnelles 64
a) Le dépistage 64
b) Les vaccinations 65
c) La lutte contre les addictions et l’obésité 66
d) La promotion des bilans de santé personnalisés 67
2. Développer des actions d’éducation et de promotion de la santé 68
3. Lutter contre les inégalités 72
a) Sociales 72
b) Territoriales 73
4. Promouvoir la médecine prédictive 74
a) Un espoir 74
b) Des réserves 75
LISTE DES 36 PROPOSITIONS DE LA MISSION 77
CONTRIBUTION DE MME JACQUELINE FRAYSSE ET DES DÉPUTÉS DU GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (GDR) 81
TRAVAUX DE LA COMMISSION 83
ANNEXES 105
ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION 107
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 109
ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 113
L’examen des statistiques retraçant l’état de santé de la population française met en évidence une situation paradoxale.
Par exemple, si l’espérance de vie à la naissance en France figure parmi les plus élevées au sein de l’Union européenne, le taux de mortalité prématurée, défini comme la part des décès intervenus avant soixante-cinq ans dans le total des décès, reste très importante. Ainsi, en 2010, l’espérance de vie à la naissance atteignait quatre-vingt-quatre ans pour une femme et soixante-dix-huit ans pour un homme (1). Pour sa part, le taux de mortalité prématurée s’élevait, en 2008, à 20,7 % du total des décès en moyenne et à 27,5 % pour les hommes (2). Ce hiatus entre ces deux situations illustre la priorité donnée par notre système de santé à la prise en charge des soins au détriment du préventif et des actions d’éducation à la santé.
La prévention, parent pauvre de la politique de santé publique ?
Orienté d’abord vers le curatif, notre système de santé négligerait le préventif.
Par ailleurs, il est difficile de mesurer précisément le montant des dépenses consacrées à la prévention dans l’ensemble des dépenses de santé.
La dernière étude globale sur le sujet, réalisée par l’Institut de recherche et de documentation en économie (IRDES), qui remonte à 2002, évaluait le coût de la prévention à 6 % des dépenses de santé. Selon la Cour des comptes, les estimations oscillent entre 1 et 10 milliards d’euros (3), tandis que la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé (4) avance la somme de 5,9 milliards d’euros. Il faut regretter, à ce titre, l’absence de document de politique transversale sur la prévention sanitaire annexé au projet de loi de finances.
C’est dans ce contexte que la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a proposé, en décembre 2008, à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, de poursuivre et achever ses travaux sous la XIIIe législature par cette question importante de la politique de santé publique qu’est la prévention sanitaire.
Elle a pu, pour ce faire, bénéficier de l’expertise préalable de la Cour des comptes, qui a confié à sa sixième chambre le soin de réaliser une étude sur le sujet. Votre Rapporteur tient, à cette occasion, à remercier la Cour pour sa disponibilité et sa précieuse collaboration.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2011 relative à la prévention sanitaire remise, sur le fondement de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières à la Commission des affaires sociales et transmise à la MECSS, a pu ainsi mettre en évidence plusieurs points :
– une absence de pilotage des politiques menées en matière de prévention ;
– des priorités peu hiérarchisées et mal évaluées ;
– une absence de coordination entre de multiples intervenants ; en effet, de nombreux et divers acteurs concourent à la prévention : professionnels de santé dont les médecins dans le cadre du colloque singulier avec leurs patients, assurance maladie et complémentaires santé dans le cadre de campagnes d’information ou de bilans de santé, mais aussi collectivités territoriales qui agissent sur des déterminants de la santé comme le logement, les transports, les cantines scolaires ou encore l’environnement ;
– une incertitude sur le montant des dépenses consacrées à la prévention dans l’ensemble des dépenses de santé.
La MECSS a également procédé à l’audition de nombreux experts, responsables de l’assurance maladie, de complémentaires santé, directeurs d’agences régionales de santé (ARS), élus, directeurs d’agences sanitaires, représentants des professions de santé et responsables de l’administration ainsi qu’un membre du Gouvernement.
Elle a étudié les priorités assignées aux politiques de prévention et s’est penchée sur les différentes approches retenues et les actions menées par les multiples acteurs intervenant dans ce domaine.
La prévention a élargi son champ d’action : faire de la prévention, c’est avant tout préserver le capital santé de chacun et bien sûr vacciner, dépister, accompagner des patients souffrant de maladies chroniques, mais c’est aussi encourager une éducation à la santé qui passe à la fois par les professionnels de santé, l’école et le monde du travail.
Sans doute, le système de santé français souffre d’un manque de culture de la prévention. Sans doute, les moyens financiers consacrés à cette politique sont insuffisamment mobilisés. Mais, surtout, en la matière, le problème français tiendrait à une absence de pilotage, à des priorités mal identifiées, à une coordination insuffisante entre les acteurs qui concourent à la prévention, ainsi qu’à des actions transversales insuffisantes aggravées par le caractère parcellaire des données de santé.
C’est pourquoi, votre Rapporteur recommande de redéfinir un pilotage exercé au niveau national mais aussi au niveau territorial, d’améliorer la complémentarité entre les différents acteurs, de renforcer les actions transversales, notamment dans le domaine de la santé au travail et de la santé scolaire, et d’assurer une plus grande fluidité dans les échanges des données de santé.
Par ailleurs, la prévention au quotidien doit privilégier des approches innovantes, tout en améliorant ses actions traditionnelles.
I.- DE VASTES AMBITIONS PORTÉES PAR DE MULTIPLES ACTEURS POUR DES RÉSULTATS DÉCEVANTS
A. UNE POLITIQUE PUBLIQUE AMBITIEUSE
1. Les frontières incertaines de la prévention
Après plusieurs évolutions de sa définition théorique, la prévention a été inscrite dans le code de la santé publique en 2002.
Conçue au départ comme une démarche visant à éviter l’apparition de pathologies, la prévention a évolué vers une acception plus large de promotion de la santé.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévention sanitaire se définit comme l’ensemble des mesures prises pour éviter l’apparition, le développement ou la complication d’une maladie. Elle établit une classification en trois groupes :
– la prévention primaire destinée à réduire l’incidence d’une maladie en agissant sur les causes, la vaccination y contribue ;
– la prévention secondaire qui vise à détecter la maladie, dont le dépistage ;
– la prévention tertiaire qui tend à diminuer les récidives, les complications et les séquelles de la maladie.
Face à l’évolution des pathologies actuelles dans laquelle le facteur comportemental joue un rôle important, cette approche, inadaptée, a été remise en cause.
En 1983, M. Robert Sirkosky Gordon (5) a proposé une autre définition plus globale, davantage tournée vers la population. Il distingue ainsi :
– la prévention universelle, destinée à l’ensemble de la population qui rassemble les grands principes d’hygiène ou éducation pour la santé. L’idée est de responsabiliser la population et de permettre que chacun devienne un acteur de sa santé ;
– la prévention orientée, qui privilégie un groupe de la population ayant un risque plus élevé que la moyenne de développer un trouble et qui recouvre le champ de prévention des maladies ;
– la prévention ciblée, qui est tournée vers ce groupe de la population lorsque le risque est avéré et qui correspond à l’éducation thérapeutique.
Lors de son audition, M. Didier Tabuteau (6), responsable de la chaire Santé de Sciences Po, a proposé une autre approche. Il classe la prévention en trois catégories :
– la prévention non médicalisée, qui recouvre deux principaux types d’actions : celles portant sur les comportements, par le biais de l’éducation ou de la promotion de la santé ; celles tendant à réduire d’une manière générale les facteurs de risques liés au travail, aux transports ou au logement, qui sont des déterminants fondamentaux de la santé ;
– la prévention médicalisée, qui passe par les acteurs du système de santé, qu’il s’agisse des professionnels ou des établissements de santé et consiste en des actes médicaux tels que le dépistage ou les analyses ;
– les soins, qui ont aussi, en sus de leur fonction curative, une vocation préventive. C’est notamment le cas dans le traitement des maladies chroniques.
Face à la difficulté de définir cette notion de prévention, M. Dominique Libault (7), alors directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales, a proposé de l’assimiler, de manière synthétique, à la préservation du capital santé de chacun.
b) Un aboutissement législatif
L’aboutissement législatif d’une définition stricto sensu de la prévention au sein de la politique de santé publique est tardif.
En effet, ce n’est qu’en 2002 (8) qu’apparaît, pour la première fois, dans le code de la santé publique une définition de la politique de prévention menée par les pouvoirs publics.
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’article L. 1417-1 de ce code disposait ainsi :
« La politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population en évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d’accident. À travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d’améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1° À réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l’altérer, tels l’environnement, le travail, les transports, l’alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris la santé ;
« 2° À améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
« 3° À entreprendre des actions de prophylaxie et d’identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
« 4° À promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;
« 5° À développer des actions d’information et d’éducation pour la santé ;
« 6° À développer également des actions d’éducation thérapeutique. »
La loi du 9 août 2004 a abrogé ces dispositions, le législateur ayant alors considéré la prévention et la promotion de la santé comme une composante de la politique de santé publique.
L’article L. 1411-1 du même code énonce désormais :
« La politique de santé publique concerne : (…)
« 3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ; (…)
« 5° L’information et l’éducation à la santé de la population et l’organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
« 6° L’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d’environnement et des conditions de travail, de transport, d’alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l’altérer ;
« 7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire. »
2. L’affirmation d’une approche intégrée
Ayant désormais comme objectif explicite de promouvoir la santé, les politiques de prévention menées en France se sont vu fixer des objectifs ambitieux, comme la responsabilisation de la population et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, ce qui nécessite une approche plus intégrée.
a) Des objectifs ambitieux : une population responsabilisée, des inégalités sociales et territoriales face à la maladie réduites
● Une population responsabilisée
Au XIXe siècle, le développement de maladies infectieuses, comme la variole ou la tuberculose, légitime l’intervention des pouvoirs publics et fait émerger la notion de responsabilité collective. Une des premières lois de santé publique en matière de prévention adoptée en France sera la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique.
Cette loi fixait des mesures à prendre pour prévenir ou éradiquer les maladies transmissibles et imposait la vaccination antivariolique. Le maire, sous le contrôle du préfet, était chargé de veiller à la salubrité publique et à l’assainissement du milieu.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la prédominance de maladies liées au comportement individuel entraîne une évolution des politiques préventives vers une approche incitative, tournée davantage vers la responsabilité individuelle. Ainsi, selon l’OMS, la santé ne dépendrait qu’à hauteur de 15 % des soins, le reste serait issu des comportements. MM. Patrick Negaret (9), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et Roger Rua (10), secrétaire général du Syndicat des médecins libéraux, ont insisté sur cette donnée.
Par ailleurs, la prévalence dans la société des notions de liberté individuelle et d’autonomie de la personne explique également cette nouvelle démarche, comme le soulignent MM. Pierre Chirac et Philippe Schilliger de la revue Prescrire, également auditionnés par votre mission.
C’est ainsi qu’émerge une nouvelle notion : l’individu, acteur de sa santé.
C’est ce concept qui figure dans un des axes de la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour la période 2010-2013. Un des objectifs fixés consiste ainsi à « aider les assurés à être acteurs de leur santé » en leur apportant de l’information, en renforçant les programmes existants, en accompagnant les patients atteints de pathologies chroniques et en développant l’éducation thérapeutique.
Cette conception est renforcée par :
– la nécessité d’une forte participation de la population pour mesurer l’efficacité des campagnes de prévention collectives, que ce soit pour le dépistage ou la vaccination. Selon MM. Pierre Chirac et Philippe Schilliger (11) de la revue Prescrire, pour évaluer le bénéfice de ces campagnes, il faudrait que 80 % de la population y participe et, pour assurer l’efficacité des campagnes de vaccination, il serait impératif d’obtenir un taux d’au moins 90 % de la population vaccinée ;
– l’implication individuelle conditionne la qualité du suivi dans les programmes d’éducation thérapeutique.
● Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Parallèlement, dans cette seconde moitié du XXe siècle, apparaît une notion nouvelle, le droit à la santé. Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce : « Elle (la République) garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé… »
Atteindre et responsabiliser les populations les plus fragilisées est le nouveau défi posé à la prévention. Rappelons qu’à ce titre, l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique (12) dispose que « L’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé ».
Les statistiques attestent d’une moindre espérance de vie selon les catégories socioprofessionnelles.
L’écart chez les hommes entre l’espérance de vie à trente-cinq ans des ouvriers et des cadres est de plus de six ans (13).
Plus préoccupant, les politiques menées en matière de prévention accentueraient ces inégalités. Ainsi M. Dominique Libault (14), ancien directeur de la sécurité sociale, citant la lutte contre l’obésité, a constaté que la population éduquée était plus réceptive aux politiques nutritionnelles.
Selon M. François Bourdillon (15), président de la commission prévention du Haut Conseil de la santé publique, l’inégalité entre des enfants de cadres et d’ouvriers dans l’obésité se situe dans un rapport de 1 à 5. En 2005, la prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants de dix-onze ans dont le père est cadre est de 7 %, alors qu’elle est de 25 % chez les enfants d’ouvriers (16).
C’est pourquoi, le deuxième axe de la convention d’objectifs et de gestion, conclue entre l’État et la CNAMTS vise, en intégrant cette lutte dans les programmes de prévention, à réduire les inégalités de santé.
L’accès à la santé diffère également selon les territoires. Les études de la DREES montrent une espérance de vie à la naissance différente selon les régions.
En 2008, il existe en France métropolitaine des disparités régionales avec un gradient nord-sud. Ce gradient est plus marqué pour les hommes : leur espérance de vie s’élevait à soixante-quatorze ans dans le Nord-Pas-de-Calais et à soixante-dix-neuf ans en Île-de-France, juste avant les régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le gradient est moins net pour les femmes et l’amplitude des variations est également moindre : leur espérance de vie varie de quatre-vingt-deux ans dans le Nord-Pas-de-Calais à quatre-vingt-cinq ans dans les Pays de la Loire et quatre-vingt-quatre ans en Île-de-France.
Ce constat est le même s’agissant de la mortalité prématurée évitable.
La mortalité la plus élevée est observée dans le Nord-Pas-de-Calais puis en Bretagne, la plus basse en Île-de-France et en Alsace.
C’est pourquoi, le Haut Conseil de la santé publique est chargé par la loi d’analyser les problèmes de santé de la population et d’établir un rapport dressant notamment un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités géographiques relatives aux problèmes de santé (17).
b) Une opposition entre soins et prévention dépassée : la prévention comme investissement
● Une approche globale
Pour atteindre ces deux objectifs de responsabilisation de la population et de réduction des inégalités sociales et territoriales, une approche intégrée est nécessaire.
La santé publique doit devenir un tout : soins et prévention ne doivent plus être opposés dans l’élaboration des politiques publiques, comme l’a souligné à juste titre M. Didier Tabuteau (18), responsable de la chaire Santé de Sciences Po.
D’une logique de promotion de l’offre de soins, la politique de santé publique évolue vers une logique de promotion de la santé.
Mme Emmanuelle Wargon (19), secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, a d’ailleurs rappelé que la mise en place des agences régionales de santé répondait à ce besoin d’affirmer que la prévention était une dimension à part entière de la santé publique.
Le corollaire de cette approche globale est l’évolution vers une plus grande intégration des secteurs du soin, de la prévention, du social et du médico-social.
Deux phénomènes plaident en ce sens :
– la prévention s’oriente de plus en plus vers l’accompagnement des populations âgées et de leurs pathologies ;
– la prévention cherche à toucher les populations défavorisées.
Mme Marie-Sophie Desaulle (20), directrice de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, a insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte la dimension médico-sociale dans les politiques de prévention et prôné une plus grande association des acteurs de ce secteur dans ces politiques. Le docteur Leicher (21) du syndicat MG France a abondé dans ce sens.
Quant à M. Dominique Libault (22), ancien directeur de la sécurité sociale, il a cité, à ce titre, une expérimentation conduite entre les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’allocations familiales d’Île-de-France en faveur d’une aide à la parentalité en matière de nutrition destinée à prévenir l’obésité des enfants.
Par ailleurs, le champ de la prévention s’élargit à des facteurs de risques extérieurs au système de santé, comme les transports, le logement, l’environnement ou le travail. L’annexe à la loi de santé publique de 2004 (23) indique que « la politique de santé publique traite des déterminants dans l’environnement physique, social, économique et culturel qui contribuent à créer des conditions favorables pour améliorer l’état de santé ».
Enfin, la démarche individuelle est associée également à la démarche collective. Dans la même annexe, figure expressément la nécessité, pour mener des actions de prévention, d’articuler l’approche individuelle et l’approche populationnelle qui sont complémentaires.
● Un investissement
Contrairement aux idées reçues, la prévention n’induirait pas nécessairement, au moins à court et moyen terme, des économies substantielles pour le système de santé. Ce point a été parfaitement développé par M. Gérard Dubois, membre de l’Académie nationale de médecine (24).
En effet, selon votre Rapporteur, la prévention doit être considérée comme un investissement, qui, à terme, améliore l’état de santé et donc limite le recours aux soins. Lors de son audition, M. Didier Tabuteau (25), responsable de la chaire Santé de Sciences Po, a confirmé cette approche en présentant les politiques de prévention comme un investissement et non comme un moyen de réguler le système de santé.
Ainsi, la nature même de la prévention induit un laps de temps important entre l’acte de prévention et son résultat. Celui qui prescrit cet acte n’est que rarement celui qui en constate le bénéfice. Dès lors, la question de la rémunération de l’acte de prévention s’avère complexe.
La mission des professionnels de santé est essentiellement curative. C’est pourquoi, le système ne pourra évoluer en faveur de la prévention que si le système de rémunération des actes qu’elle suppose incite les professionnels de santé à développer ce type d’actes. La nouvelle convention médicale conclue entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins, décrite infra, amorce, de ce point de vue, un mouvement qu’il convient d’encourager et qui devra faire l’objet d’une évaluation.
Si la nature de la prévention s’analyse de plus en plus clairement comme un investissement, le financement des actions entreprises en la matière reste, comme on l’a vu en introduction, difficile à mesurer car éclaté dans différents documents.
Au niveau de l’État, le programme budgétaire 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ne représente qu’une partie des moyens financiers mis en œuvre ; pour 2012, il regroupe les actions suivantes :
– action n° 12 Accès à la santé et éducation à la santé, à hauteur de 31,6 millions d’euros en crédits de paiements (CP) ;
– action n° 13 Prévention des risques infectieux et des risques liés aux soins, qui intègre, notamment, les crédits liés à la politique vaccinale, à hauteur de 9,6 millions d’euros en CP ;
– action n° 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, à hauteur de 66,8 millions d’euros en CP ;
– action n° 15 Prévention des risques liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation, qui regroupe notamment les crédits destinés aux plans Environnement et santé et Nutrition santé, soit 21,6 millions d’euros en CP ;
– action n° 18 Projets régionaux de santé, qui intègre l’ensemble des crédits alloués aux agences régionales de santé, afin de mettre en œuvre leurs politiques publiques menées au titre de la prévention, de la promotion et de l’éducation à la santé ainsi que leurs actions liées à la sécurité sanitaire, soit 182,4 millions d’euros en CP.
Au niveau des caisses d’assurance maladie obligatoire, le financement des programmes de prévention est assuré par un Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires (26) (FNPEIS), dont la mission est d’attribuer aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter leur budget de prévention. Ce fonds verse également aux agences régionales de santé des crédits destinés à financer leurs actions de prévention.
Le montant de ce fonds a été doublé en dix ans, passant de 200 millions d’euros en 2000 à 452 millions d’euros en 2010. Le montant prévisionnel pour 2012 du FNPEIS a été fixé à 507,2 millions d’euros (27).
Un autre fonds, le Fonds de prévention des accidents du travail, contribue à prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail (28).
À ces fonds, il convient d’ajouter les dépenses, plus difficilement mesurables, liées au colloque singulier entre les médecins traitants et leurs patients et financées par l’assurance maladie.
Au risque de la confusion et de la dilution des responsabilités, de nombreux acteurs, que ce soit à l’échelon national ou territorial, concourent à la mise en œuvre de cette politique ambitieuse de prévention.
1. Des interventions multiples
La politique de santé publique et les actions de prévention relèvent des missions régaliennes de l’État. Ce point a été réaffirmé par plusieurs intervenants auditionnés (29).
Au sein même de l’État, les acteurs sont multiples.
Le ministère de la santé joue un rôle pilote, même si de nombreux autres ministères sont appelés à participer à des degrés divers à des actions de prévention. Leur rôle sera décrit ci-après.
Deux directions, qui coexistent au sein des ministères chargés des affaires sociales, contribuent à des missions de prévention :
– la direction générale de la santé (DGS) fixe des priorités de santé publique, élabore des programmes de prévention et de gestion du risque infectieux et sert d’interface avec les intervenants locaux ;
– la direction de la sécurité sociale gère les relations avec les régimes obligatoires d’assurance maladie et les professionnels de santé, sous l’angle des dépenses de santé.
Lors de son audition, M. Jean-Yves Grall (30), directeur général de la santé, a défini le lien entre ces deux directions en indiquant qu’il appartenait à la direction de la sécurité sociale d’optimiser les ressources pour atteindre les objectifs fixés par la direction générale de la santé.
● Les instances de conseil
La Haute Autorité de santé (HAS) (31), autorité publique indépendante à caractère scientifique mise en place en 2004, est chargée de fournir aux décideurs politiques une expertise en matière de santé.
Lors de son audition (32), M. Jean-Luc Harousseau, président de la HAS, a défini ainsi le rôle de l’institution en matière de prévention :
– dans le cadre de la prévention primaire, la haute autorité évalue l’efficacité des actions d’éducation à la santé et donne son avis sur le taux de remboursement des vaccins ou des stratégies thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique ;
– dans le cadre de la prévention secondaire, elle mène une évaluation médico-économique, notamment sur les stratégies de dépistage ;
– enfin, dans le cadre de la prévention tertiaire, elle joue un rôle d’encadrement pour l’élaboration de protocoles d’éducation thérapeutique ou de prise en charge de pathologies et publie des guides méthodologiques pour les agences régionales de santé ou les porteurs de projet.
Quant au Haut Conseil de la santé publique (33), organisme consultatif rattaché à la direction générale de la santé, il définit des objectifs pluriannuels de santé publique, en assure l’évaluation et le suivi. Une de ses commissions est plus particulièrement chargée de la prévention, de l’éducation et de la promotion de la santé.
● Les agences sanitaires
Le ministère de la santé peut s’appuyer sur plusieurs agences sanitaires afin de mener ses actions de prévention.
La principale agence sanitaire œuvrant dans ce domaine, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) (34), créée en 2002, dotée d’un statut d’établissement public de l’État, est le bras armé de ce dernier dans la mise en œuvre de ses actions de prévention.
Ses missions sont triples :
– l’institut est chargé d’assurer la communication des programmes nationaux de prévention ;
– il apporte son expertise en sciences humaines afin d’inciter à une évolution des comportements. Il établit également des programmes de formation à l’éducation à la santé ;
– il est chargé d’assurer le développement de l’éducation à la santé sur tout le territoire ; à ce titre, il décline au niveau régional les plans de prévention nationaux en partenariat avec les agences régionales de santé, par l’intermédiaire des pôles de compétences régionaux.
L’État peut s’appuyer également sur deux autres agences sanitaires :
– l’Institut national de lutte contre le cancer (INCA) (35), groupement d’intérêt public, chargé d’évaluer le dispositif de lutte contre le cancer et de coordonner les actions dans ce domaine ;
– l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (36), établissement public administratif, dont la mission est d’assurer la sécurité sanitaire dans l’alimentation, l’environnement et le travail.
Il convient également de citer l’Agence de la biomédecine (37) qui est chargée de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire et peut contribuer, à ce titre, à des actions de prévention.
● Une structure interministérielle
Créée en 1999, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) (38) anime et coordonne les actions des ministères compétents en matière de prévention contre la toxicomanie.
● La santé scolaire
Si l’on se réfère aux textes, la médecine scolaire est fondamentalement une médecine de prévention, bien qu’elle soit chargée de contribuer à d’autres missions, comme l’intégration des élèves handicapés ou la protection de l’enfance en danger. Elle participe également à la réduction des inégalités sociales de santé car le médecin scolaire est parfois le seul interlocuteur pour les populations défavorisées.
L’article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1995 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale dispose que ces médecins sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de la promotion de la santé auprès de l’ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés.
La médecine scolaire assure un suivi médical obligatoire des élèves et participe à des actions de dépistage de la santé des élèves.
L’article L. 541-1 du code de l’éducation (39) instaure des visites médicales à six, neuf, douze et quinze ans au cours desquelles est réalisé un bilan de santé. La direction générale de la santé a souligné l’importance du dépistage à l’âge de six ans qui permet de détecter des troubles et d’intervenir de façon préventive.
La médecine scolaire participe également à l’information et à l’éducation à la sexualité des élèves adolescents. Les infirmiers scolaires sont autorisés à renouveler les prescriptions de médicaments contraceptifs oraux pour une durée maximale de six mois renouvelable (40).
La médecine scolaire connaît des problèmes d’effectifs ; lors de son audition Mme Jeanne-Marie Urcun (41), conseillère technique auprès du directeur général de l’enseignement scolaire, a cité les chiffres suivants : 7 842 médecins et 1 314 infirmières scolaires exercent pour environ 60 000 écoles, 7 400 collèges et 2 500 lycées. De plus, 62 % des postes de médecins scolaires et 69 % des postes d’infirmières scolaires étaient pourvus en 2010 (42).
b) Les intervenants de la santé au travail
Fixés dès la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail, plusieurs principes généraux s’appliquent à la santé au travail :
− le principe d’universalité, en vertu duquel l’ensemble des salariés du secteur privé doit être couvert par la médecine du travail. Selon l’article L. 4111-1 du code du travail, sont tenus d’organiser un service de santé au travail les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé et les établissements de santé sociaux et médico-sociaux.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, les employeurs sont tenus, notamment, « de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ».
Les travailleurs indépendants doivent mettre en œuvre eux-mêmes les principes généraux de prévention définis à cet article (43) ;
− le caractère obligatoire de la médecine du travail dont la gestion et le financement sont à la charge des employeurs. Dans les entreprises de plus de 2 200 salariés, un service de santé au travail autonome doit être créé. Dans les autres entreprises, les employeurs ont le choix entre la mise en place d’un service de santé autonome ou d’un service interentreprises. Ces services sont des institutions privées ;
− le caractère préventif des missions dévolues aux médecins du travail.
Le médecin du travail est un salarié de droit privé lié par un contrat de travail.
L’article L. 4622-2 du code du travail (44) précise que les services de santé au travail ont pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils conseillent les employeurs et les travailleurs afin de diminuer les risques professionnels, prévenir la pénibilité au travail ou contribuer au maintien à l’emploi. Le médecin du travail doit effectuer une visite médicale des travailleurs avant leur embauche (45) et des examens médicaux périodiques au cours de leur vie professionnelle, au moins tous les vingt-quatre mois (46). Il n’a, cependant, pas accès au dossier médical du salarié.
La médecine du travail souffre d’un manque d’effectifs. 5 500 médecins du travail doivent suivre 16 millions de salariés (47). M. Bernard Salengro (48), secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, a souligné, par ailleurs, lors de son audition, que l’activité de ces médecins s’effectuait le plus souvent à temps partiel. Selon lui, une des explications à ce déficit démographique tient aux contraintes administratives de la formation médicale qui lie le choix de la spécialité médicale au classement au concours.
En 2010, selon les statistiques de la CNAMTS, environ 658 000 accidents du travail avec arrêt ont été recensés, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2009. Néanmoins, le nombre des accidents graves, soit environ 41 000 cas avec incapacité permanente, a baissé de 4,3 %. Le nombre de décès, qui a atteint, en 2010, 529 accidents mortels, a reculé, pour sa part, de 1,7 %.
M. Bernard Salengro (49) s’est également déclaré « choqué de voir le nombre d’accidents du travail baisser aussi lentement alors qu’avec la désindustrialisation que connaît notre pays, et la multiplication des acteurs de prévention, nous aurions dû observer une chute du nombre d’accidents qui ne s’est pas produite ».
Face à ce constat, la loi relative à l’organisation de la médecine du travail adoptée en juillet 2011 (50) s’efforce de moderniser le dispositif.
En matière de gouvernance, la loi a mis en place une organisation paritaire des services de santé au travail interentreprises (51). Le service de santé doit désormais être administré par un conseil composé de représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes et de représentants des salariés des entreprises adhérentes désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Néanmoins, le président est élu parmi les représentants des employeurs et a voix prépondérante.
Concernant le statut du médecin, la loi a conforté son indépendance vis-à-vis de son employeur en mentionnant expressément que le « médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi » (52).
Afin de faciliter le recrutement de médecins, elle prévoit à titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’internes qui exerceraient sous l’autorité d’un médecin du travail expérimenté (53).
S’agissant des politiques de prévention, elle introduit la notion de projet de service (54). Les services de santé au travail interentreprises doivent élaborer un projet collectif et définir des priorités d’action pluriannuelles. Les médecins devront rejoindre ce projet qui fera l’objet d’une contractualisation avec l’État et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
c) Les collectivités territoriales
Comme l’a rappelé M. Laurent Chambaud (55), inspecteur général des affaires sociales, la France dispose d’un atout majeur grâce à l’implication de ses collectivités territoriales dans des actions de prévention.
À l’origine, la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique confie à la commune un rôle important en matière de salubrité publique.
Celle-ci continue de s’impliquer. Le maire a conservé d’un pouvoir de police sanitaire (56) et certaines communes bénéficient d’un service communal d’hygiène et de santé.
Toutefois, leur participation à des actions de prévention est variable et dépend de l’implication des élus et de la taille de la commune. Lors de son audition, Mme Isabelle Maincion (57), maire de La Ville-aux-Clercs, a cité quelques actions menées par les communes contribuant à l’éducation à la santé.
Ainsi, l’appui des collectivités territoriales et notamment des communes est indispensable à la mise en œuvre du plan national Nutrition santé ; à ce titre, les communes peuvent agir par l’intermédiaire des cantines scolaires, en proposant des menus équilibrés, en favorisant l’achat de produits frais et en formant le personnel. Le soutien aux associations sportives pour favoriser l’exercice physique, l’organisation de l’espace de vie afin de préserver la santé, en traçant, par exemple, des cheminements doux qui améliorent la sécurité des cyclistes et des piétons, sont autant de moyens à la disposition des maires pour prévenir l’obésité.
Au sein du programme Nutrition santé II a été créé un label « Villes actives » destiné aux communes qui s’engagent à mettre en œuvre les priorités du plan.
Par ailleurs, les communes sont souvent amenées à soutenir des associations exerçant dans le domaine de la prévention en leur octroyant des subventions.
En outre, dans un premier temps, les départements, dans le cadre de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, se sont vu attribuer la compétence de droit commun en matière de prévention sanitaire. En conséquence, les vaccinations, la lutte contre les maladies infectieuses et sexuellement transmissibles, ainsi que le dépistage des cancers leur ont été confiés.
Mais, dans un second temps, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a opéré, en sens inverse, un transfert de ces missions vers l’État.
Néanmoins, le département a conservé une compétence en matière de protection maternelle et infantile (PMI) et dans le domaine de l’aide à l’autonomie des personnes âgées.
Il participe également au plan Nutrition santé.
La protection maternelle et infantile L’article L. 2111-1 du code de la santé publique définit la protection maternelle et infantile comme l’ensemble des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d’éducation à la santé en faveur des futurs parents et des enfants ainsi que des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants âgés de moins de six ans. Les principales actions menées par le département consistent dans une aide et une délivrance de conseils aux familles et aux enfants âgés de moins de six ans : – des actions d’accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et plus particulièrement des futurs parents en situation de précarité ; dès réception de la déclaration obligatoire de grossesse, le conseil général prend contact avec la future mère, qui pourra bénéficier d’un suivi assuré par des sages-femmes. Un conventionnement du conseil général avec l’assurance maladie permet la gratuité de ces consultations. Ce suivi s’effectue soit à domicile, soit dans des centres ; – des actions de prévention médicales psychologiques ou d’éducation à la santé pour les parents et les enfants. Des puéricultrices peuvent effectuer un suivi postnatal. Les familles fragilisées sont privilégiées. Des actions collectives en faveur de la parentalité sont organisées dans les centres ; – des actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de six ans. Les centres peuvent assurer des consultations gratuites de nourrissons, qui visent notamment à réaliser les vaccinations et à vérifier l’état physique et psychomoteur de l’enfant. Par ailleurs, le département doit organiser une visite médicale dans les écoles maternelles afin d’établir un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans* et de contribuer à dépister des handicaps, que ce soit des troubles auditifs, visuels ou du langage. Les résultats sont adressés au médecin traitant. * L’article L. 2112-2 du code de la santé publique, issu du IV de l’article 1er de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, prévoit que le service de PMI des conseils généraux doit organiser l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle. |
Une ébauche de coordination entre ces collectivités se traduit par la signature de contrats locaux de santé entre l’agence régionale de santé et les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé (58). Ces contrats sont ciblés sur des territoires précis afin de mieux répondre aux besoins de la population en matière de prévention et de promotion de la santé.
Ils favorisent une politique régionale de santé en améliorant le contexte environnemental et social. Ils contribuent à l’accès des personnes, notamment précaires, aux soins, aux services, et à la prévention. Ils s’appuient sur des initiatives de démocratie sanitaire, comme les conférences de territoire ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie.
Dès 1988 (59), la notion de prévention est introduite dans le code de la sécurité sociale, à travers la création d’un Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS), avant même qu’elle ne figure dans une loi de santé publique.
L’article L. 262-1 du code de la sécurité sociale assigne aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail une mission de prévention, d’éducation et d’information sanitaire.
L’article L. 321-1 du même code prévoit la couverture par l’assurance maladie des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique.
Si la fixation des axes de la politique de prévention incombe à l’État, l’assurance maladie est chargée de les mettre en œuvre. C’est pourquoi les programmes de prévention de la CNAMTS déclinent les priorités définies dans la loi de santé publique d’août 2004 (60). Cela passe par la signature de conventions d’objectifs et de gestion pluriannuels entre l’État et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et entre l’État et les trois régimes obligatoires d’assurance maladie, la CNAMTS, la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI).
La convention signée entre l’État et la CNAMTS pour la période 2010-2013 comporte un programme (61) ayant comme enjeu de développer et promouvoir la prévention autour de cinq objectifs :
– accroître la participation aux programmes de dépistage organisé du cancer ;
– faire progresser la couverture vaccinale de la population, en particulier celle des enfants ;
– renforcer les actions dans le domaine bucco-dentaire pour les enfants ;
– prévenir l’obésité ;
– lutter contre les dépendances notamment celles des femmes ayant un projet de grossesse.
Les actions de prévention menées par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont diverses :
● Bilans de santé de la CNAMTS
La CNAMTS décline ses bilans de santé selon les classes d’âge.
À destination des jeunes, il est prévu une consultation de prévention gratuite pour les assurés ou ayants droit du régime général de la sécurité sociale âgés de seize à vingt-cinq ans.
Les assurés adultes du régime général bénéficient d’un examen périodique de santé pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’il est réalisé dans un centre d’examens de santé.
Quant aux assurés âgés de plus de soixante-dix ans, ils peuvent bénéficier d’une consultation de prévention effectuée chez leur médecin traitant et prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Elle est destinée à prévenir les facteurs conduisant à la dépendance et faciliter le dépistage précoce de handicaps comme les troubles de la vision et de l’audition.
● Examens de santé de la MSA et du RSI
Dans le même esprit, la MSA et le RSI ont mis en place des programmes d’examens de santé différenciés selon l’âge, intitulés pour la première « Instants santé » et pour le second « Parcours prévention ». Quatre tranches d’âge ont été retenues. Les assurés sont sollicités par courrier comprenant un auto-questionnaire et la prescription d’examens biologiques, qui serviront de support à la visite chez leur médecin traitant.
● Le dépistage des cancers
L’article L. 1411-6 du code de la santé publique (62) prévoit l’organisation de programmes de santé destinés à éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation de maladies qui comprennent des examens de dépistage. L’objet de ces examens de dépistage, l’équipement requis et les conditions de mise en œuvre de ces consultations sont précisés par des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale.
À ce titre, deux programmes de dépistage des cancers sont organisés à l’échelle nationale auprès de la population âgée de cinquante à soixante-quatorze ans, le cancer du sein et le cancer colorectal (63).
La première expérimentation relative à un dépistage organisé autour du cancer du sein a été conduite entre 1989 et 1991 par la CNAMTS dans une dizaine de départements pilotes, financée par son FNPEIS. À l’issue de cette opération, en 1994, la direction générale de la santé a décidé de développer un programme national de dépistage organisé du cancer du sein qui sera généralisé sur tout le territoire en 2004.
Les régimes obligatoires d’assurance maladie proposent à leurs assurées âgées de cinquante à soixante-quatorze ans d’opérer un dépistage gratuit comprenant une mammographie et un examen clinique (64) incluant une double lecture en cas d’anomalie détectée.
Les campagnes organisées contrôlent la qualité des matériels et des clichés et la formation des personnels.
Quant au programme de dépistage organisé du cancer colorectal, mis en place initialement dans 23 départements pilotes, il propose, depuis 2008, un test gratuit de détection de sang occulte dans les selles tous les deux ans aux personnes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans à risque moyen pour ce cancer.
● Prévention de pathologies infectieuses aiguës
La vaccination s’inscrit dans une démarche de prévention collective et a pour objectif de maîtriser un agent infectieux. Elle prévient l’apparition de la maladie et empêche sa transmission.
Les caisses d’assurance maladie mènent des campagnes d’incitation à la vaccination et prennent en charge certains vaccins. Le vaccin contre la rougeole est ainsi gratuit pour les enfants jusqu’à l’âge de dix-sept ans. La vaccination anti-grippale est prise en charge pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ainsi que pour les personnes atteintes de pathologies inscrites au titre des affections de longue durée.
Les actions de prévention de l’assurance maladie peuvent être complétées par les complémentaires santé et sont conduites aussi bien par les mutuelles, les compagnies d’assurances que par les institutions de prévoyance.
La mission des complémentaires consiste en premier lieu à couvrir des frais qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Comme le rappelait M. Alain Rouché (65), directeur Santé de la Fédération française des sociétés d’assurance, des contrats peuvent rembourser la vaccination anti-grippale lorsqu’elle n’est pas prise en charge par l’assurance maladie (66) ou des médicaments de sevrage tabagique, en sus des forfaits pris en charge par celle-ci.
Les assureurs ont développé des contrats responsables qui prennent en charge au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires à l’aune des objectifs de santé publique.
Néanmoins, il convient de relever que les assureurs font face à deux difficultés :
– la durée des contrats, limitée généralement à sept ans, est trop courte pour être compatible avec des politiques de prévention menées sur le long terme ;
– les données de santé sont confidentielles et il leur est difficile d’obtenir la transmission de ces données par l’assurance maladie.
En deuxième lieu, les complémentaires santé mènent des programmes expérimentaux de prévention à destination de leurs assurés. La Mutualité française a élaboré un programme intitulé « Priorité santé mutualiste » qui accompagne ses adhérents dans la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et l’obésité.
En troisième lieu, les mutuelles gèrent des établissements et services de santé, qui sont ouverts à leurs adhérents mais aussi à tous les assurés sociaux.
Lors de leur audition (67), les représentants de la Mutualité française ont indiqué que cette dernière finançait des actions de prévention à hauteur de 4,4 millions d’euros par an sur la période 2012-2014 et souligné que, par un effet de levier, au travers des partenariats noués avec les agences régionales de santé, les associations ou les collectivités territoriales, 12 millions d’euros étaient, au total, mobilisés en faveur de la prévention.
f) Les professionnels de santé
Le médecin est au cœur de la prévention. Au cours du colloque singulier avec le patient, la consultation mêle le curatif et le préventif.
L’article L. 4130-1 du code de la santé publique (68) pose le principe de la mission de prévention dévolue au médecin généraliste de premier recours. Il précise que ce dernier « contribue à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation à la santé ».
Ainsi, 25 % à 35 % de l’activité du médecin généraliste serait consacrée à des actes relevant de la prévention primaire ou secondaire, selon M. Claude Leicher (69) du syndicat MG France. La mise en œuvre de la convention médicale signée entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins, décrite infra, encourage cette activité. Un exemple de campagne de prévention réussie est celle menée par l’Union française pour la santé bucco-dentaire et les dentistes en partenariat avec l’assurance maladie. La campagne « M’T dents » incite les enfants de six à dix-huit ans à consulter leur dentiste pour un examen de prévention bucco-dentaire, pris en charge par l’assurance maladie.
Par ailleurs, des dentistes interviennent dans les établissements scolaires pour rappeler les règles d’hygiène de base.
Ce type de campagne doit être encouragé tout en veillant, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, à ce que sa mise en œuvre se fasse en toute transparence et dans un souci de neutralité.
Quant aux pharmaciens, présents de manière homogène sur tout le territoire, 4 millions de personnes par jour de tous âges, de toutes conditions sociales fréquentent leurs officines.
Or, l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique (70) prévoit que le pharmacien peut participer à l’éducation thérapeutique, proposer des conseils et prestations destinés à améliorer ou maintenir l’état de santé de la population. Au quotidien, ce professionnel délivre vaccins, « pilule du lendemain » et préservatifs.
Ce rôle complémentaire a récemment été accru par la mise en œuvre d’un nouveau mode de rémunération de leur activité de prévention, développé infra.
Enfin, pour parachever la description de ce paysage dense, il convient de rappeler que de nombreuses structures associatives contribuent à l’éducation à la santé et mènent des actions de prévention.
Deux réseaux émergent en particulier, celui des comités départementaux d’éducation à la santé (CODES) et celui des observatoires régionaux de la santé (ORS).
Les CODES et, au niveau régional, les comités régionaux d’éducation à la santé (CRES) sont des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et implantées au niveau local. Ils mènent des actions de prévention globales et favorisent la concertation entre les différents acteurs, que ce soit l’assurance maladie ou les collectivités territoriales.
Une première tentative de rationalisation a eu lieu à partir de 2009 grâce au regroupement des CODES et des CRES, sur la base du volontariat, au sein d’instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (IREPS).
Les observatoires régionaux de la santé, également associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 (71), sont présents dans chaque région. Leur mission principale est l’aide à la décision des acteurs régionaux par la production de données, d’informations sur l’état de santé et les besoins de la population de la région. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent s’appuyer sur ces observatoires pour disposer de données (72). Le champ des travaux des observatoires est large et porte aussi bien sur des études épidémiologiques ou des facteurs de risque que sur des évaluations d’actions ou de structures.
Par ailleurs, il convient de citer l’existence d’associations de patients qui sensibilisent les pouvoirs publics sur la situation de patients atteints d’une certaine maladie et d’associations de santé œuvrant dans des domaines précis, cette liste étant loin d’être exhaustive :
– l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;
– la Ligue nationale contre le cancer ;
– AIDES pour lutter contre le virus d’immunodéficience humaine (VIH).
2. Des compétences mal identifiées
Cette multiplicité d’intervenants et d’actions entraîne des chevauchements de compétences. Dans certains domaines, comme la santé au travail ou la santé scolaire, l’insuffisance de coordination nuit à l’efficacité de la politique de prévention.
Ainsi que l’a résumé M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine (73), la prévention est par essence une politique interministérielle, et ce d’autant plus que les politiques de prévention sont de plus en plus appréhendées sous le prisme des déterminants de santé, définis par l’OMS comme des facteurs à la fois personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou des populations.
Cette approche entraîne donc l’implication de tous les acteurs ministériels, à des degrés divers dans les politiques de santé publique.
Le ministère de la santé conserve néanmoins un rôle pilote ; la conception des missions de la direction générale de la santé (DGS) en matière de prévention, définie par l’article R. 1421-1 du code de la santé publique est extensive : la DGS « participe à la définition et contribue à la mise en œuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l’environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l’eau et à l’alimentation. Elle définit la politique nutritionnelle ».
Il n’en demeure pas moins que d’autres ministères interviennent également dans ce périmètre. Le ministère de l’environnement intervient au titre de la santé environnementale (74) et le ministère de l’agriculture participe au comité de pilotage du programme national Nutrition santé et gère la sécurité alimentaire. Les ministères en charge des transports et du logement agissent aussi dans des domaines où figurent des facteurs de risque pour la santé.
Cette multiplicité d’acteurs ministériels aux compétences qui peuvent parfois se chevaucher se double d’une absence de coordination interministérielle.
En effet, les tentatives pour instituer des instances de coordination entre ministères n’ont pas abouti.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait prévu la création d’un comité technique national de prévention chargé de faciliter la coordination entre les différents acteurs ministériels en matière de prévention et de sécurité sanitaire. Présidé par le ministre de la santé, il avait vocation à réunir des représentants des ministères chargés notamment de la santé, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l’environnement et de l’équipement, avec des représentants de l’assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
Ce comité, qui n’a jamais été mis en place, a été abrogé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a créé un comité national de santé publique (75) ayant notamment pour mission de coordonner l’action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention.
De l’avis même de M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé, ce comité n’est pas opérationnel et mériterait d’être redéfini.
Cette définition imprécise des frontières se retrouve au niveau des actions de prévention menées par les agences sanitaires.
Comme le constatait notre collègue Yves Bur dans son rapport sur les agences sanitaires (76), la pertinence des frontières entre agences est parfois discutable, certaines compétences peuvent être redondantes et aboutissent à des « zones grises ».
La politique vaccinale est un exemple de ces compétences croisées ; trois agences interviennent dans ce domaine :
– le Haut Conseil de la santé publique, par l’intermédiaire de son comité technique des vaccinations, élabore le calendrier vaccinal en fonction des données épidémiologiques et propose des adaptations en matière de recommandations et d’obligations vaccinales ;
– l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, appelée à devenir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autorise la mise sur le marché les vaccins ;
– la Haute Autorité de santé (HAS), quant à elle, se prononce sur le taux de remboursement des vaccins.
La Cour des comptes (77) a dénoncé le caractère peu lisible des rôles et compétences de ces instances à l’occasion de la gestion de la pandémie grippale H1N1.
Par ailleurs, la répartition des missions du Haut Conseil de la santé publique et de la HAS gagnerait à être clarifiée comme le relève la communication de la Cour des comptes transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire. M. Yves Bur, dans son rapport précité, constatait que le haut conseil n’avait pas réussi à trouver sa place dans le dispositif d’aide à la décision et suggérait de confier l’expertise de la gestion des risques à la HAS.
Enfin, un domaine particulier, celui de la santé scolaire, malgré son importance majeure pour la réussite de la prévention, souffre d’une intégration insuffisante de ses actions dans le cadre plus général de la politique de prévention.
C’est le constat qu’a effectué, dans sa communication transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire, la Cour des comptes, qui déplore la faiblesse des liens actuels entre les personnels de la santé scolaire et les acteurs de la santé publique.
De même, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale, dans son rapport sur la médecine scolaire (78), a pointé l’insertion insuffisante de son action au sein du système de santé.
Le rattachement institutionnel de la médecine scolaire à l’Éducation nationale se traduit par l’inscription dans le code de l’éducation et non dans le code de la santé publique de ses missions et par l’intégration à l’Éducation nationale des médecins et infirmières scolaires.
Lors de leur audition (79), les syndicats de médecins ont déploré l’absence de communication avec leurs confrères de l’Éducation nationale, particulièrement lors du dépistage d’un trouble. Le suivi s’opère alors par l’intermédiaire du carnet de santé.
b) Dans le monde professionnel
La médecine du travail est perçue comme une discipline spécifique, comme l’a rappelé M. Jacques Texier (80), président du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise, alors même qu’elle ne peut être dissociée de la santé publique.
Le rôle de prévention assigné au médecin du travail est lié à l’activité professionnelle du salarié, alors que, selon M. Bernard Salengro (81), secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, « la santé n’est pas divisible. Une personne en bonne santé est plus productive. Si elle travaille dans des conditions qui ne respectent pas la physiologie humaine, cela se traduit par des accidents – " un stressé est accidentable ", dit le Bureau international du travail ».
Par ailleurs, l’élaboration des normes applicables à la santé au travail relève de la direction générale du travail, tandis que la CNAMTS, qui gère la branche accidents du travail et maladies professionnelles, a développé un volet prévention.
c) Entre l’État et les collectivités territoriales
Cette absence de coordination et ces frontières incertaines entre différentes actions se retrouvent au niveau territorial.
Malgré la clarification apportée par la loi d’août 2004 (82), qui a opéré un recentrage des actions de prévention vers l’État, les départements peuvent continuer à participer à des actions de prévention en matière de dépistage et de politique vaccinale dans un cadre conventionnel.
Ainsi, ce sont des structures de gestion départementales ou interdépartementales qui assurent le dépistage organisé du cancer du sein. Les conseils généraux peuvent les soutenir de manière logistique et financière. Cela se traduit par des actions d’informations ou par des investissements plus conséquents comme la mise en place de « mammobiles », camions équipés qui pratiquent le dépistage du cancer du sein dans les territoires ruraux.
On retrouve cette dualité d’actions dans le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du VIH. Les conseils généraux peuvent financer, en partie les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles qui coexistent avec d’autres centres à savoir les centres de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites B et C.
Enfin, les conseils généraux peuvent, par le biais de conventions signées avec l’État, continuer à proposer des actions de vaccination, que ce soit par l’achat de vaccins ou la gestion de centres de vaccination.
Par ailleurs, au sein même des collectivités territoriales, selon les propos de Mme Isabelle Maincion (83), maire de La Ville-aux-Clercs, « les communes, les départements et les régions méconnaissent les différents intervenants : nous ignorons les compétences de chacun ».
d) Entre l’assurance maladie et les complémentaires santé
Les actions des complémentaires santé recoupent souvent des objectifs fixés par l’État et l’assurance maladie. La Mutualité française a ainsi indiqué que son action en matière de prévention s’articulait autour de quatre axes : favoriser l’égal accès de tous, réduire les inégalités sociales, renforcer la capacité de chacun à agir individuellement pour sa santé et garantir par des actions collectives le droit des populations à la protection de leur santé. Ces axes rejoignent les deux axes fixés par l’État dans sa convention d’objectifs et de gestion avec l’assurance maladie.
Mme Isabelle Millet-Caurier (84), directrice des affaires publiques à la Fédération nationale de la mutualité française, a souligné que ces axes avaient été retenus par les agences régionales dans leurs schémas de prévention.
3. Les agences régionales de santé : un espoir malgré une mise en place difficile
Afin de résoudre ces difficultés, un nouvel acteur a été créé au niveau de la région et chargé de favoriser la complémentarité entre tous les intervenants du secteur de la santé.
● Un nouvel acteur clé : l’agence régionale de santé
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé des agences régionales de santé.
Ces nouvelles structures répondent à plusieurs objectifs :
– mettre en cohérence toutes les composantes des politiques de santé, que ce soit la prévention, l’organisation des soins ou l’accompagnement médico-social ;
– rapprocher les services de l’État et de l’assurance maladie ;
– agir au près plus des populations et de leurs besoins et, de ce fait, réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.
En premier lieu, l’agence est chargée de décloisonner et de développer une synergie entre tous les acteurs.
Son objectif est de piloter, à l’échelon régional, l’ensemble du système de santé ; à ce titre, elle doit assurer deux grandes missions :
– réguler l’offre de santé ;
– piloter la politique de santé publique qui comprend notamment la définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé.
Les agences ont donc vocation à porter cette démarche d’approche globale de la prévention qui décloisonne soins et prévention et doivent contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, comme l’a rappelé Mme Marie-Sophie Desaulle (85), directrice de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Pour ce faire, elles doivent élaborer un schéma régional de prévention qui fixe la liste des priorités et des actions médicales ou non mises en œuvre, afin de favoriser la promotion de la santé, la prévention de certaines maladies ou risques et la mise en place de l’éducation thérapeutique.
L’article L. 1434-5 du code de la santé publique définit ce schéma comme un document incluant des dispositions relatives à la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire.
L’agence est surtout le lieu de coordination entre tous les acteurs régionaux ; il est ainsi expressément indiqué à l’article R. 1434-3 du code précité que les actions de prévention et de promotion de la santé mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte dans les schémas de prévention.
Une instance dont la mission est de favoriser la complémentarité des actions de prévention est ainsi créée : la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile.
Elle rassemble, outre les représentants de l’État, des collectivités territoriales et le directeur général de l’agence, le recteur de l’académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région, des représentants des organismes d’assurance maladie des régimes obligatoires et le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (86). Cette commission se réunit, au moins, une fois par trimestre. D’autres participants peuvent être associés, comme, par exemple, dans les Pays de la Loire, la Mutualité française.
La directrice de l’agence régionale des Pays de la Loire, Mme Marie-Sophie Desaulle (87), a décrit ce travail de coordination menée avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de la prévention comme un processus permettant d’aboutir à une feuille de route partagée.
Cette coordination s’effectue également avec les associations et notamment les associations de patients qui permettent d’assurer au plus près de la population une visibilité des actions menées par les agences.
Sur le modèle de celui des Pays de la Loire, les relations entre les agences et les associations se traduisent de différentes manières :
– sur un plan institutionnel, elles participent aux réunions pour élaborer le schéma régional de prévention. Votre Rapporteur recommande de conforter leur rôle ;
– sur un plan conventionnel, les associations peuvent répondre à des appels à projets ou signer des contrats pluriannuels avec les agences ciblées sur des thématiques ou des populations.
En second lieu, l’agence est chargée de décliner au niveau local les orientations nationales.
Une plus grande efficacité de la prévention passe par une plus grande proximité. C’est pourquoi, la mise en place des agences cherche à répondre à ce besoin.
L’agence est ainsi chargée d’articuler au niveau régional les actions de prévention avec l’assurance maladie. L’article L. 1434-14 du code de la santé publique prévoit un programme pluriannuel régional de gestion du risque comprenant des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales élaboré après concertation avec le représentant au niveau régional de chaque régime obligatoire d’assurance maladie.
Selon Mme Marie-Sophie Desaulle (88), une bonne articulation entre le niveau national et le niveau local nécessite à la fois l’élaboration d’une stratégie nationale assortie d’indicateurs de résultats et la définition d’actions adaptées aux logiques de territoires.
● La mise en place difficile des agences régionales de santé
Même si la mise en place des agences est récente et les premières années ont été consacrées à résoudre des problèmes organisationnels et à intégrer des personnels à statuts différents, nombre d’entre elles viennent tout juste d’adopter leurs schémas régionaux de prévention. De plus, les responsables auditionnés ont fait part de leurs réserves sur les mécanismes de coordination et ont souligné la difficulté à mener des actions complémentaires et de proximité.
Ainsi, la mise en œuvre d’actions de prévention menées en commun entre l’assurance maladie et les agences s’avère difficile. Le constat est partagé par les deux parties.
Au niveau des agences, en Île-de-France, M. Laurent Chambaud (89), directeur de la santé publique de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, a indiqué qu’une expérimentation visant à encourager la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ou ROR, qui visait à simplifier le parcours médical, se heurtait à des réticences et considérations administratives contraignantes de la part de la CNAMTS.
Au niveau de l’assurance maladie, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué que les relations avec l’agence régionale d’Île-de-France étaient parcellaires.
Quant aux commissions de coordination des agences régionales de santé, Mme Sophie Desaulle et M. Laurent Chambaud (90) ont relativisé leur rôle, en soulignant que l’intérêt de leurs réunions était tributaire du niveau de représentation de leurs membres et de leur participation effective.
Par ailleurs, si l’article L. 1432-4 du code de la santé publique fixe une collaboration entre les agences régionales de santé et les conférences régionales de la santé et de l’autonomie, cette dernière n’a qu’un rôle de proposition dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé régionale et elle ne peut émettre que des avis consultatifs.
Les actions menées dans le domaine de la prévention donnent des résultats décevants. Les priorités assignées à la prévention sont mal hiérarchisées, trop nombreuses et difficilement évaluables. Par ailleurs, la transmission des données de santé est limitée.
1. Des priorités mal identifiées, car trop nombreuses
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fixe la liste, en annexe, des 100 objectifs de santé publique, assortis d’indicateurs.
Ces objectifs sont déclinés autour de cinq plans stratégiques nationaux :
– plan national de lutte contre le cancer ;
– plan national de lutte contre la violence, les pratiques addictives et les comportements à risque ;
– plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs de l’environnement ;
– plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie de personnes atteintes de maladies chroniques ;
– plan national pour améliorer la prise en charge des maladies rares.
La Cour des comptes, dans sa communication transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire, a relevé fort justement que la multiplicité d’objectifs non hiérarchisés n’était pas pertinente et menait à un risque de dispersion. Elle a critiqué également la mise en place d’indicateurs plutôt que d’objectifs.
Lors des auditions, plusieurs intervenants ont partagé ce constat. Selon MM. Hubert Allemand (91), adjoint au directeur de la CNAMTS, et Jean-Yves Grall (92), directeur général de la santé, il serait préférable de limiter les priorités et de définir un nombre limité d’objectifs et de les assortir d’indicateurs facilement évaluables.
La Cour souligne également que ces cinq plans sont concurrencés par d’autres types de plans, alors même « qu’il n’existe pas de différence dans leur élaboration, ni dans leur suivi, ni dans leur gradation ». Ainsi, dans le domaine des maladies chroniques, on peut citer le plan Alzheimer, le programme de développement des soins palliatifs, le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur, le programme d’actions en faveur de la broncho-pneumopathie chronique obstructive et le plan national maladies rares qui complètent deux des cinq plans stratégiques nationaux à savoir le plan Cancer et le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies rares.
2. Une évaluation malaisée, des données cloisonnées
Les politiques de prévention souffrent également d’une évaluation déficiente.
● Une évaluation malaisée
Dans sa communication transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire, la Cour a regretté l’absence d’évaluation médico-économique ex-ante lors de la mise en place des plans de prévention, seul moyen permettant de s’interroger sur le rapport coût-efficacité des actions engagées.
L’évaluation médico-économique disponible en France est réalisée par la HAS (93), chargée d’émettre des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription et de prise en charge plus efficiente.
Néanmoins, la HAS évalue selon le principe du coût-efficacité et non du coût-utilité. Une soixantaine d’études ont été menées depuis 2008 parmi lesquelles des recommandations sur le dépistage du cancer du col de l’utérus en novembre 2010 ou celles sur les stratégies de dépistage biologique des hépatites B et C en mai 2011.
L’article 47 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 propose d’aller plus loin et met en place, au sein de la HAS, une commission spécialisée pour les études médico-économiques.
M. Jean-Luc Harousseau (94), président de la HAS, a reconnu qu’il existait un problème culturel en France où donner un chiffrage de la valeur humaine est délicat.
Selon M. Didier Tabuteau (95), responsable de la chaire Santé de Sciences Po, ces études doivent être renforcées, même si cela n’entre pas dans la culture française. De même, pour M. Jean-Yves Grall (96), directeur général de la santé, il est nécessaire de se préoccuper de la pertinence médico-économique des actions de prévention.
● Des données cloisonnées
Cette évaluation malaisée est accrue par la difficile transmission et la transparence limitée des données de santé.
Il est vrai que le principe du secret médical rend délicat la transmission de ces données (97). Cependant, les bases de données de l’assurance maladie sont une source d’information sur les pathologies les plus répandues et permettent de dresser un état des lieux de l’état sanitaire de la population ; elles favoriseraient ainsi une meilleure adéquation des politiques de prévention.
Par ailleurs, l’action des régimes des complémentaires santé serait facilitée et plus efficiente si elles pouvaient proposer de façon ciblée à leurs assurés des programmes de prévention adaptés.
M. David Giovannuzzi (98), directeur des accords collectifs d’AG2R La Mondiale, a relaté les difficultés auxquelles il avait été confronté lors de la mise en place d’un programme de prévention de l’asthme à destination des boulangers. En raison de l’étanchéité des données de l’assurance maladie, il n’a pas pu cibler au départ son action sur les boulangers souffrant de cette pathologie.
Une autre expérimentation menée par Groupama s’est heurtée aux mêmes difficultés. L’assureur met en place un rétinographe mobile afin de prévenir la rétinopathie diabétique, dont le dispositif sera décrit infra, sans pouvoir cibler précisément ses assurés diabétiques.
3. Des exemples : le cancer, les maladies infectieuses, l’hypertension artérielle
En premier lieu, les campagnes de dépistage organisé s’avèrent décevantes.
Malgré l’effort mené tant par l’assurance maladie que les complémentaires santé et les campagnes de communication de type « Octobre rose », en 2010, le taux de participation à la campagne de dépistage organisé du cancer du sein s’est élevé à 52 % (99). Ce taux stagne depuis 2008, alors que l’objectif fixé par le ministère de la santé serait d’atteindre un taux de participation de 70 %.
Quant au cancer colorectal, sur la période 2009-2010, sur 17 millions de personnes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans invitées à se faire dépister, seules 5,1 millions d’entre elles ont adhéré au programme, soit un taux de participation de 34 %, alors que le référentiel européen préconise un taux de participation de la population cible supérieur ou égal à 45 % (100).
En second lieu, certaines campagnes de dépistage systématique sont remises en cause.
Celles du cancer du sein et de la prostate suscitent des interrogations.
Dans le cas du cancer du sein, selon MM Pierre Chirac et Philippe Schilliger de la revue Prescrire (101), le bénéfice des campagnes de dépistage organisé serait au mieux modéré. La revue critique la méthode qui n’informe pas les femmes de l’existence de « faux négatifs » (102) ou de « faux positifs » (103), de l’importance de la double lecture, ainsi que de l’absence d’évaluation indépendante de ces campagnes.
Quant à M. Jean-Luc Harousseau (104), président de la HAS, il a fait état d’un « surdiagnostic ». La recommandation de la haute autorité sur les moyens et les mécanismes permettant d’accroître la participation des femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans au dépistage organisé du cancer du sein a conclu à la nécessité d’informer les femmes et de maintenir le cap du dépistage organisé. Elle conclut néanmoins au manque d’intérêt du dépistage avant l’âge de cinquante ans au motif que le bénéfice attendu est incertain.
Cette question se retrouve dans la communication de la Cour des comptes transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire qui souligne l’absence d’intérêt d’un dépistage du cancer du sein avant l’âge de cinquante ans.
Cependant, même si les intervenants auditionnés ont fait part de réserves concernant un dépistage systématique, ils ont insisté sur les garanties du dépistage organisé, notamment en raison de sa double lecture et du contrôle qualité des appareils. Se pose donc la pertinence du maintien d’un double dépistage à la fois individuel et collectif.
Lors de son audition (105), Mme Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, s’est déclarée favorable au maintien des deux dépistages qui sont complémentaires.
Quant au dépistage systématique du cancer de la prostate, selon MM. Gérard Dubois et Michel Huguier, membres de l’Académie de médecine (106), il ne serait d’aucune utilité. Après soixante-quinze ans, ce dépistage ne paraît pas opportun. En effet, l’évolution à cet âge de ce type de cancer est lente et les conséquences d’une intervention chirurgicale peuvent être dommageables.
4,4 millions de dosage d’antigène prostatique spécifique (PSA selon l’abréviation en anglais en usage) pour un coût de 85 millions d’euros ont été réalisés en 2009. Cette opinion est partagée par MM. Pierre Chirac et Philippe Schilliger de la revue Prescrire (107). Selon M. Jean-Luc Harousseau (108), président de la HAS, il conviendrait de cibler les populations à risque.
Pour le cancer du col de l’utérus dépisté par un frottis réalisé tous les trois ans, la HAS recommande une campagne organisée et s’interroge sur l’effet négatif du vaccin contre le papillomavirus qui dissuaderait les femmes de recourir à un suivi ultérieur.
En tout état de cause, le lancement de campagnes de dépistage organisé devrait être précédé d’une évaluation de son bénéfice risque, d’un établissement de priorités, d’une association des représentants des usagers de la santé, ainsi que le suggère M. Pierre Chirac de la revue Prescrire.
b) La recrudescence de maladies infectieuses
Les taux de couverture vaccinale restent insuffisants pour permettre l’élimination des maladies infectieuses. L’objectif de la loi de santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004 qui fixait l’obtention et le maintien d’un taux de couverture vaccinale d’au moins 95 % aux âges appropriés n’a pas été atteint.
La tuberculose a réapparu particulièrement en Île-de-France, alors même qu’en 2007, l’obligation de vacciner les enfants a été suspendue (109). En 2009, environ 5 000 cas ont été recensés.
Quant à la rougeole, alors qu’en 2008, une quarantaine de cas étaient enregistrés, l’année 2010 a connu une explosion avec 5 071 cas notifiés dont 8 complications neurologiques, 287 pneumopathies graves et 2 décès. En septembre 2011, près de 14 500 cas ont été enregistrés, dont 15 ont présenté une complication neurologique, 639 une pneumopathie grave et 6 sont décédés (110).
Ces chiffres illustrent l’insuffisance de la couverture vaccinale ; le taux de vaccination est de 87 % pour une dose pour les enfants âgés de moins de deux ans, alors qu’il faudrait atteindre le taux de 95 % pour deux doses. À titre d’exemple, en Vendée, le taux de couverture vaccinale contre la rubéole oreillons rougeole ou ROR des enfants âgés de moins de deux ans est de 59 % en 2010 (111).
c) La question de l’hypertension artérielle
L’hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire, pouvant entraîner des séquelles importantes. Des traitements, pris régulièrement, permettent de limiter les complications. Alors que l’hypertension artérielle était considérée dans sa forme sévère comme une affection de longue durée, les traitements étaient jusqu’à présent pris en charge à 100 % par l’assurance maladie. Le décret du 24 juin 2011 (112) a retiré l’hypertension artérielle sévère de la liste des affections de longue durée, au motif que celle-ci n’était pas une pathologie avérée mais un facteur de risque.
M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine, s’est étonné de cette décision qu’il a qualifiée de dysfonctionnement grave, tout en soulignant le coût de cette maladie chronique qui représente 35 millions de consultations par an pour un montant de 5 milliards d’euros (113).
Votre Rapporteur s’interroge sur les motivations de cette décision, qui ne peut qu’aller à l’encontre d’une politique de prévention, puisque les patients hypertendus qui ne pourront plus se soigner risquent de développer des complications.
Lors de son audition (114), Mme Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, a indiqué que la direction générale de la santé, avait mis en place un groupe de travail présidé par M. Joël Ménard et chargé de réfléchir à la prise en charge optimale de l’hypertension sévère.
II.- POUR UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION PILOTÉE, COORDONNÉE ET INNOVANTE
Il appartient à l’État qui a toute légitimité à exercer la mission régalienne de santé publique d’initier une impulsion politique. Pour ce faire, il lui revient de définir au niveau national des priorités qui seront ensuite déclinées au niveau local et mises en œuvre par l’intermédiaire de l’assurance maladie, des agences régionales de santé et des collectivités territoriales.
En premier lieu, il incombe à l’État de choisir ces priorités.
Il est essentiel, pour votre Rapporteur, qu’elles soient en nombre limité et hiérarchisées.
La définition de ces priorités pourrait être confiée à l’expertise de la Haute Autorité de santé (HAS).
Selon M. Michel Huguier (115), membre de l’Académie de médecine, les messages de prévention doivent être simples, clairs, et les mesures applicables et évaluables.
Selon l’Académie de médecine, trois grandes priorités sont à privilégier : la lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme et l’obésité.
La revue Prescrire a, de son côté, mentionné la prévention des erreurs de soins.
Au fil des auditions, il est apparu qu’une action essentielle est la lutte contre la sédentarité qui passe par la pratique d’une activité physique.
Votre Rapporteur propose donc de retenir quatre priorités : la lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme, la surcharge pondérale et la sédentarité.
Il conviendrait d’élaborer une nouvelle loi de santé publique quinquennale qui fixerait un nombre limité de priorités qui seraient déclinées dans les conventions d’objectifs et de gestion signées entre l’État et les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Chaque année, ces priorités feraient l’objet d’un débat d’orientation au printemps au Parlement, et l’affectation de leurs moyens humains et financiers afférents serait discutée à l’automne à l’occasion du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En second lieu, il importe que ces priorités soient évaluées.
Comme le soulignait M. Laurent Chambaud (116), inspecteur général des affaires sociales, la durée d’évaluation de ces priorités devrait être d’au moins une dizaine d’années afin d’assurer une continuité et de travailler sur le long terme. L’échéance de cinq années, fixée dans la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, pour évaluer les objectifs et les priorités de santé publique lui semble peu pertinente.
Une fois ces priorités définies, une instance, bien identifiée, doit être chargée, au sein de l’État, de piloter cette politique de prévention.
Constatant l’absence de pilotage global des politiques de prévention et le manque de coordination entre ministères, la Cour des comptes, dans sa communication transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire recommande d’instituer le directeur général de la santé (DGS) comme délégué interministériel.
Selon M. Didier Tabuteau (117), responsable de la chaire Santé de Sciences Po, ce délégué devrait également servir d’interface avec les collectivités locales.
Selon votre Rapporteur, cette solution présenterait deux inconvénients :
– dépendant du ministère de la santé, le DGS bénéficierait d’une autorité relative sur les autres ministères ;
– le DGS, dont les missions sont déjà nombreuses ne pourrait plus remplir ses fonctions premières.
Selon votre Rapporteur, il importe que cette instance interministérielle de pilotage de la politique de prévention sanitaire soit dotée de l’autorité nécessaire afin de préparer les arbitrages entre ministères et permettre de prendre en compte le principe anglo-saxon de « la santé dans toutes les politiques » (118). C’est pourquoi votre Rapporteur préconise de créer un délégué interministériel à la prévention sanitaire rattaché au Premier ministre, nommé en conseil des ministres et chargé d’assurer le pilotage politique et de coordonner les actions entre tous les acteurs.
Ce délégué interministériel exercerait également les missions aujourd’hui confiées au secrétaire général du comité de pilotage des agences régionales de santé.
Il serait, par ailleurs, chargé de travailler avec le président de la Conférence nationale de santé.
Bras séculier de ce délégué, l’Institut national de la prévention et d’éducation pour la santé (INPES) pourrait se transformer en « Agence nationale de prévention », chargée notamment de diffuser des actions de promotion et d’éducation à la santé. Disposant avec les agences régionales de santé de relais au niveau territorial, elle serait à même de recenser les initiatives menées au niveau régional.
Votre Rapporteur propose donc d’élargir les missions de l’INPES, rattaché au délégué interministériel à la prévention sanitaire, chargé à la fois de mener des actions de promotion et d’éducation à la santé et d’évaluer des expérimentations locales dans le domaine de la prévention et, le cas échéant, de les généraliser à l’échelle nationale.
Par ailleurs, dans un souci de rationalisation et pour reprendre une des recommandations du rapport d’information de notre collègue Yves Bur sur les agences sanitaires (119), votre Rapporteur suggère d’intégrer le collège du Haut Conseil de la santé publique au sein de la HAS, ce qui permettrait de réduire le nombre de structures tout en conservant l’expertise médicale du haut conseil dans l’évaluation des stratégies de santé publique.
Ce dernier contribue en effet à l’évaluation des plans de santé publique. Lors de son audition, Mme Nora Berra (120), secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, s’est félicitée de ce qu’il se prononce sur la pertinence de la stratégie médicale en termes de santé publique et a cité ses dernières évaluations : plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, plan Antibiotiques 2007-2010, le plan national Bien vieillir 2007-2009, plan national Maladies rares 2005-2008 et le premier plan Cancer.
De même, la Cour des comptes (121) a jugé son expertise intéressante.
La position des agences régionales de santé en tant que pilotes de la politique territoriale de prévention doit être consolidée.
Votre Rapporteur déplore l’approche « en tuyaux d’orgue » suivie par les administrations centrales, approche marquée par une forte réticence à laisser les directeurs d’agences régionales de santé décider de l’utilisation de leurs moyens financiers. Malgré la volonté exprimée lors de leur création de leur accorder plus de souplesse dans l’utilisation de leurs crédits, ces derniers restent, dans les faits, « fléchés ».
Auditionnés, MM. Yves Bonnet et Bertrand Brassens (122), inspecteurs généraux des finances, auteurs d’un rapport sur les fonds d’assurance maladie (123), ont plaidé pour doter les agences régionales des moyens fongibles afin de les responsabiliser et de leur permettre de développer des actions de prévention adaptées au niveau régional.
C’est l’idée du fonds d’intervention régional (FIR), qui permettrait une approche différenciée selon les régions car cet échelon est bien placé pour identifier les besoins sanitaires. Ce dispositif a été créé par l’article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (124). Il doit servir au financement d’actions, d’expérimentations ou de structures contribuant à la prévention des maladies, à la promotion de la santé et à l’éducation à la santé. Il est proposé de permettre la fongibilité des crédits tout en maintenant le principe de la fongibilité asymétrique pour les crédits directement affectés à la prévention.
Votre Rapporteur se félicite de cette première étape mais suggère de renforcer le pilotage régional, échelon le plus à même de répondre au plus près des besoins de la population.
C’est pourquoi, il recommande :
– de renforcer la mission transversale assumée par les agences régionales de santé dans le domaine de la prévention, en exigeant la mise en œuvre effective de leurs commissions de coordination et en prévoyant l’évaluation de cette mission ;
– de renforcer au niveau régional le rôle des conférences régionales de la santé et de l’autonomie qui définiraient leurs priorités avec l’aide des observatoires régionaux de la santé et transmettraient leurs propositions à la Conférence nationale de santé ; cette dernière sera chargée d’en élaborer une synthèse proposée au Parlement lors du débat d’orientation sur les priorités de santé publique. Les membres composant la Conférence nationale de santé devront être issus des conférences régionales de la santé et de l’autonomie au sein desquelles, la participation des associations de patients devra être confortée.
– de favoriser des contrats de santé de territoire au plus près des besoins de la population.
1. Améliorer la complémentarité des acteurs
● La santé scolaire
Pour parvenir à une approche intégrée et à une meilleure articulation des missions de prévention de la médecine scolaire avec les plans de santé publique, plusieurs initiatives ont été mises en place.
Sur un plan national, le ministère de l’éducation nationale participe au Comité national de santé publique chargé d’assurer une coordination interministérielle.
Par ailleurs, la direction générale de l’enseignement scolaire a noué des partenariats avec plusieurs instances sanitaires. Une convention cadre signée en mars 2010 avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) établit un programme de travail annuel qui vise à développer les actions de communication à destination des élèves. La direction générale participe, en outre, au comité de pilotage interministériel de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).
Au niveau territorial, au sein des agences régionales de santé, des représentants du rectorat participent au conseil de surveillance et à la commission de coordination qui réunit tous les acteurs de la santé en région.
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le rectorat d’Aix-Marseille a signé une convention avec l’agence régionale de santé afin que les résultats relatifs à l’indice de masse corporelle des enfants âgés de six ans relevés lors de la visite médicale réalisée par le médecin scolaire lui soient communiqués. Ces indices devraient permettre un meilleur suivi et une meilleure articulation avec les plans Nutrition santé.
En Île-de-France, l’agence régionale de santé a signé une convention avec les trois recteurs d’académie pour décerner un label aux actions les plus réussies menées au sein de l’Éducation nationale en matière de prévention.
Le partenariat s’exerce aussi avec les collectivités territoriales et les complémentaires santé. Ainsi, des inspections académiques ont signé des conventions avec les conseils généraux dans le cadre de la protection maternelle et infantile.
La Mutualité française, quant à elle, a mis en place dans 17 régions un programme dénommé « Bouge, une priorité pour ta santé » à destination des collèges, en partenariat avec l’Union nationale du sport scolaire.
Enfin, pour parfaire cette intégration de la médecine scolaire, la communication des médecins traitants avec leurs confrères de l’Éducation nationale doit être favorisée.
La Cour des comptes, dans son rapport remis sur ce sujet au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale (125), préconise d’inciter les agences régionales de santé à mettre en place des échanges d’informations entre l’ensemble des professionnels de santé, en vue d’un suivi plus efficace des élèves.
Afin de favoriser la coordination entre le médecin scolaire et le médecin traitant, votre Rapporteur propose de garantir la transmission au médecin traitant de l’élève des conclusions recueillies par le médecin scolaire à l’occasion des visites médicales obligatoires.
Ces visites pourraient par ailleurs être rationalisées.
Le CEC, dans son rapport sur la médecine scolaire (126), recommande de « saisir le Haut Conseil de la santé publique sur la pertinence d’actions de dépistage systématiques lors de la neuvième, douzième et quinzième années ».
Ces visites ne sont pas toutes réalisées, c’est pourquoi, votre Rapporteur recommande de mettre l’accent sur les visites médicales des élèves âgés de six ans et de quinze ans et, en conséquence, de supprimer les visites des élèves âgés de neuf et douze ans.
b) Entre les professionnels de santé et l’État et l’assurance maladie
● Les médecins
La relation de confiance qui règne entre le patient et son médecin est un atout pour relayer des messages de prévention essentiels et influer sur des comportements à risque. C’est pourquoi, le médecin est au cœur de la prévention. Lors de leur audition, les syndicats de médecin ont tous plaidé pour un rôle accru dans le dispositif de prévention (127).
Le médecin généraliste peut tout à fait, comme le rappelait M. Claude Bronner, président de l’Union généraliste Fédération des médecins de France, être chargé de l’application des politiques voulues par les pouvoirs publics en les adaptant aux risques propres de son patient. D’ailleurs, 25 % à 35 % de l’activité du médecin généraliste serait consacrée à des actes relevant de la prévention primaire ou secondaire, selon M. Claude Leicher (128) du syndicat MG France.
S’agissant des vaccinations recommandées et notamment celle contre la rougeole, il pourrait inciter sa patientèle à se faire vacciner. La Cour des comptes dans sa communication transmise à la MECSS relative à la prévention sanitaire et M. Pierre Chirac de la revue Prescrire partagent ce point de vue.
Dans le même esprit, M. Michel Combier, président de l’Union nationale des omnipraticiens français-Confédération des syndicats médicaux de France, a plaidé pour la mise en place d’une consultation de prévention axée sur les risques propres à chaque tranche d’âge, comme les addictions pour les personnes de moins de trente-cinq ans ou les risques cardiovasculaires pour celles de plus de trente-cinq ans. Par ailleurs, il est important, particulièrement autour de trente ans où les facteurs de risques se constituent, de prévoir une consultation dédiée à la prévention.
La prévention serait inscrite dans le parcours de soins du patient et ainsi l’opposition entre soins et prévention n’aurait plus lieu d’être, comme le rappelait M. Laurent Chambaud (129), inspecteur général des affaires sociales.
Ainsi, le régime d’assurance maladie obligatoire agricole a choisi de se reposer sur le médecin traitant pour faire réaliser les bilans de santé que la Mutualité sociale agricole propose à ses assurés.
Par ailleurs, Mme Marie-Sophie Desaulle (130), directrice de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, a souligné que, dans le cadre des programmes d’éducation thérapeutique, l’avenir reposait sur l’implication, dans leur suivi, de l’ensemble des professionnels de santé de premier recours.
À ce titre, le médecin traitant est associé aux programmes expérimentaux comme « Sophia » et « Tensio forme », décrits infra, pilotés par l’assurance maladie et les complémentaires santé. Il doit donner son accord avant la mise en œuvre de ces programmes. Il est destinataire des informations recueillies dans ce cadre.
L’incitation financière est un des moyens développés par l’assurance maladie pour renforcer l’association des médecins aux politiques de prévention.
M. Didier Tabuteau (131), responsable de la chaire Santé de Sciences Po, a avancé l’idée d’un mandat de santé publique donné au médecin traitant pour l’associer à des actions de prévention, via un mode de rémunération particulier.
En 2009, une démarche innovante fondée sur la rémunération à la performance a été mise en place entre l’assurance maladie et les médecins conventionnés, sur la base du volontariat. La signature de contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) incite les médecins à atteindre certains objectifs en contrepartie d’incitations financières. Trois objectifs de prévention figurent dans les CAPI :
– inciter à la vaccination anti-grippale chez les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ;
– encourager le dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées entre cinquante et soixante-quatorze ans ;
– lutter contre la iatrogénie médicamenteuse chez les plus de soixante-cinq ans en réduisant les vasodilatateurs et les benzodiazépines.
Selon la revue Prescrire, nombre d’indicateurs seraient trop quantitatifs et gagneraient à évoluer vers du qualitatif afin de garantir la qualité des soins individuels.
En avril 2011, 16 000 médecins avaient signé un CAPI, soit 38 % des médecins éligibles. La prime moyenne annuelle versée a été de l’ordre de 3 000 euros par médecin.
L’évaluation a montré une meilleure prise en charge de la prévention, sauf pour le dépistage du cancer du sein, et une amélioration du suivi des maladies chroniques des patients par les médecins.
Face à ces résultats encourageants, la nouvelle convention médicale signée en juillet 2011 entre la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), le Syndicat des médecins libéraux (SML) et Médecins généralistes (MG France) et l’assurance maladie poursuit cette démarche (132).
Cette convention généralise la rémunération à la performance versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique. Parmi ces objectifs, figurent le développement de la prévention et l’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques.
L’implication des médecins sera mesurée par un dispositif de points, dans lequel la part accordée aux actions de prévention et au suivi des maladies chroniques est importante : 500 sur les 1 300 points.
Huit indicateurs sont dévolus à des actions de prévention comme le dépistage des cancers, les vaccinations, l’antibiothérapie. Ils reprennent les objectifs fixés par l’État aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans leurs conventions d’objectifs et de gestion.
La rémunération tiendra compte de l’atteinte des objectifs des indicateurs mais aussi des progrès accomplis. M. Dominique Libault (133), ancien directeur de la sécurité sociale, a souligné que ce nouveau contrat prendrait en compte l’évolution des comportements et non plus seulement le taux d’atteinte des objectifs. Ce point, pour votre Rapporteur, est essentiel.
Néanmoins, il conviendrait de prévoir un module spécifique aux actions de prévention dans les programmes de formation ; les syndicats de médecins ont reconnu que cette matière, en tant que telle, n’était pas enseignée.
Un point préoccupe particulièrement votre Rapporteur : de plus en plus de personnes sont considérées comme présentant un facteur de risque lié à leur tension ou leur taux de cholestérol. Ce phénomène résulte de l’évolution à la baisse des seuils et normes définis par l’OMS et associés, notamment, à la tension ou au cholestérol. Selon M. Joël Ménard (134), professeur agrégé de médecine, cet abaissement régulier des normes minimales résulte des travaux des épidémiologistes qui établissent des modèles selon un profil cardiovasculaire idéal. Cela entraîne, à chaque abaissement de seuil, un fort développement du marché des médicaments prescrits par les médecins, mouvement fortement encouragé par l’industrie pharmaceutique.
Pour éviter tout risque de conflits d’intérêts, M. Joël Ménard a rappelé que s’« il n’existe pas de formule idéale… la norme doit résulter d’un consensus ».
C’est pourquoi, votre Rapporteur préconise de confier l’élaboration des seuils retenus pour fixer des facteurs de risque à des conférences de consensus, sous l’égide de la Haute Autorité de santé.
De telles conférences, définies comme une méthode d’élaboration de recommandations médicales et professionnelles visant à définir une position consensuelle dans une controverse portant sur une procédure médicale, dans le but d’améliorer la qualité des soins, permettraient, en effet, d’élaborer des seuils reconnus par tous les acteurs du système de santé, en toute transparence et en dehors de toute pression.
● Les pharmaciens
Le rôle complémentaire accru dévolu aux pharmaciens s’est traduit par l’introduction dans la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 d’un nouveau mode de rémunération de leur activité (135). En contrepartie d’engagements portant sur la participation à des actions de dépistage ou de prévention ou d’accompagnement de patients souffrant de pathologies chroniques, le pharmacien recevra une rémunération versée par les régimes obligatoires d’assurance maladie en fonction de la réalisation des objectifs fixés par ces derniers.
Par ailleurs, les pharmaciens pourraient jouer un rôle essentiel dans le suivi de la couverture vaccinale en incluant dans le dossier pharmaceutique la délivrance des vaccins, comme le préconise le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur les pharmacies d’officine (136).
Dans un autre domaine, M. Alain Rouché (137), directeur Santé de la Fédération française des sociétés d’assurance, a évoqué une proposition faite à la CNAMTS de suivre, par l’intermédiaire des pharmaciens, les patients placés sous anticoagulants.
Votre Rapporteur propose, à ce titre, que le pharmacien contribue à prévenir les risques iatrogéniques en encourageant la prescription de doses administrées en médecine de ville, notamment vis-à-vis des personnes âgées, et en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
● La santé au travail
Un secteur professionnel particulier, le monde agricole, illustre la porosité entre les politiques de prévention sanitaire et les politiques de prévention des risques professionnels. Lors de son audition, M. Michel Brault (138), directeur général de la Mutualité sociale agricole, a cité plusieurs exemples de programmes de santé destinés à ses assurés qui peuvent relever à la fois de ces deux politiques : la vaccination anti-tétanique, la sensibilisation à l’utilisation de pesticides ou les mesures à adopter pour prévenir les cancers de la peau liés à l’exposition au soleil.
Votre Rapporteur a été intéressé par trois programmes expérimentaux qui mettent en œuvre une approche combinant prévention des risques professionnels et prévention sanitaire. Le milieu professionnel sert de point d’entrée pour mener des politiques préventives ciblées.
Trois programmes emblématiques de santé au travail RSI Pro est un programme élaboré par le RSI en partenariat avec les services de la santé au travail et les organisations professionnelles*. Conçu en fonction des métiers et de leurs morbidités spécifiques, il vise à sensibiliser les travailleurs indépendants aux risques professionnels auxquels ils pourraient être confrontés. Ce programme incite les assurés à une consultation de prévention liée au métier exercé auprès de leur médecin traitant, après avoir rempli un auto-questionnaire. Lors de la visite médicale prise en charge à 100 % par l’assurance maladie, le médecin identifie les risques spécifiques et sensibilise son patient et préconise le cas échéant un suivi. Cette expérimentation est menée depuis 2010 en Picardie et dans les Pays de la Loire auprès des boulangers pâtissiers et des coiffeurs, soit environ 8 000 assurés ; selon une première évaluation, elle a été suivie par environ 900 personnes, ce qui correspond à un taux de participation d’environ 11 %. 85 % des médecins se sont déclarés prêts à renouveler leur participation et 85 % des assurés boulangers et 81 % des assurés coiffeurs ont jugé le programme intéressant. L’application des recommandations a été suivie par 79 % des boulangers et 84 % des coiffeurs. Ce programme a été étendu en 2011 aux métiers du bois, aux commerçants ambulants, aux gérants de pressing, aux chauffeurs de taxi, aux garagistes et aux plombiers et expérimenté dans d’autres régions : la Bretagne, le Centre, l’Est, l’Ouest, la Provence et Midi-Pyrénées. Dans le même esprit, une institution de prévoyance, AG2R, a lancé un programme de prévention innovant au sein de la boulangerie qui regroupe les régimes obligatoires d’assurance maladie** et la médecine du travail autour de deux risques majeurs pour cette profession, la carie dentaire et l’allergie à la farine. Un objectif individuel, informer et dépister les assurés sur le risque dentaire, et un objectif collectif, évaluer la santé dentaire globale de la profession, sont poursuivis. Une première étape consiste à dresser un état des lieux. Les assurés sont incités à consulter leur dentiste pour établir un diagnostic. Cette visite est prise en charge à 100 %. Une évaluation est supervisée par le dentiste-conseil. Sur les 90 000 assurés concernés, 8 550 ont répondu, soit environ 10 % des assurés. Une deuxième étape agit sur les garanties proposées et prend en charge les consultations chez le dentiste et propose le cas échéant le remboursement des prothèses dentaires. L’objectif serait de toucher 15 % des assurés. L’évaluation a montré que cette population développait une prédisposition à des caries professionnelles d’où la nécessité d’actions préventives. Par ailleurs, 46 % des assurés ont moins de trente-cinq ans, facteur plaidant pour des campagnes à long terme. Un troisième programme mené par l’institution interprofessionnelle de prévoyance Malakoff Médéric illustre la façon dont peut être conduite une action de prévention de manière transversale. En partenariat avec l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais et la CNAMTS, cette institution de prévoyance a développé un programme autour de l’hypertension intitulé « Vigie santé » mené au sein de l’entreprise. Sur la base du volontariat, après un dépistage pratiqué dans les entreprises, un programme d’accompagnement personnalisé a été proposé aux assurés via un système de télémédecine. Votre Rapporteur regrette néanmoins que les médecins du travail n’y aient pas participé. * La CNAMTS pour les boulangers salariés et le RSI pour les artisans libéraux. ** Audition du 10 novembre 2011 de M. Stéphane Sellier, directeur général du RSI. |
Au niveau des politiques menées par l’État, l’élaboration depuis 2005 de plans « Santé au travail » traduit la nouvelle approche des pouvoirs publics dans ce domaine. Centrée, à l’origine, sur une problématique liée à l’emploi avec la réglementation des accidents du travail, des maladies professionnelles et l’aptitude médicale au travail, la santé au travail a évolué vers une démarche globale tournée davantage vers la santé et l’amélioration des conditions de travail.
Le nouveau plan Santé au travail 2010-2014 adopte une approche qui se veut plus intégrée, en lien avec la réforme de la médecine du travail. Comme l’a rappelé Mme Valérie Delahaye-Guillocheau (139), chef de service à la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, le nouveau plan identifie quatre axes d’intervention prioritaires :
– développer la recherche et la connaissance en santé en travail ;
– développer les actions de prévention des risques professionnels ;
– renforcer l’accompagnement des entreprises dans leurs actions de prévention en tenant compte des problèmes spécifiques liés aux petites entreprises ;
– renforcer la coordination et la mobilisation des différents partenaires.
Cette volonté d’articulation renforcée avec la politique générale de santé publique en matière de prévention se traduit au niveau national par une plus grande interaction avec d’autres plans.
Le plan Cancer II comporte des dispositions qui se trouvent dans le plan Santé au travail.
Le plan Santé environnement II comporte une même préoccupation à de prévention des risques chimiques et notamment cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques et neurotoxiques.
Le plan national d’action concertée 2009-2012 de la branche risques professionnels de la CNAMTS reprend des actions du plan Santé au travail.
Cette logique se retrouve au niveau territorial. Le plan Santé au travail 2010-2014 se décline dans les plans régionaux qui ont été élaborés en partenariat avec les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, avec les agences régionales de santé (140), avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, mais aussi avec la Mutualité sociale agricole et avec les associations régionales de l’amélioration des conditions de travail.
Les relations entre médecin traitant et médecin du travail sont encouragées.
Dans le quatrième objectif du plan Santé au travail II, il est prévu de sensibiliser les médecins traitants aux cancers professionnels et de former les médecins de soins à l’identification des maladies professionnelles. Mme Patricia Maladry (141), responsable de l’inspection médicale à la direction générale du travail, a indiqué que, dans le cadre de la formation générale des médecins, un stage dans les services de santé au travail était désormais prévu dès le deuxième cycle. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la médecine du travail, des médecins d’autres spécialités pourront se former avec l’aide d’un tuteur spécialiste au sein des services de santé au travail.
Il n’en reste pas moins que l’absence de transmission de données entre le médecin traitant et le médecin du travail implique que ces derniers « ne peuvent connaître la nature des soins qui pourraient être prodigués par ailleurs à leurs patients, tandis que les médecins traitants ignorent si leurs patients travaillent ou non dans un contexte pathogène », selon les propos de Mme Patricia Maladry, responsable de l’inspection médicale à la direction générale du travail.
C’est pourquoi, votre Rapporteur suggère de confier au médecin du travail le soin de rédiger un document qui précise les risques éventuels que peut comporter un poste et qui sera transmis au médecin traitant.
Par ailleurs, afin de pallier le déficit démographique des médecins du travail, votre Rapporteur recommande de revaloriser cette fonction.
c) Entre les régimes obligatoires d’assurance maladie et les complémentaires santé
Lors des auditions (142), les représentants de la Mutualité française, des compagnies d’assurances et des institutions de prévoyance ont tous fait part de leur souhait d’accroître ou de développer leur coordination avec l’assurance maladie.
M. David Giovannuzzi, directeur des accords collectifs d’AG2R La Mondiale, a déclaré : « Notre rôle est de relayer des actions que le régime de base considère comme étant prioritaires, d’être complémentaires de la sécurité sociale et non redondants. »
Dans les faits, de nombreux programmes communs de prévention sont mis en œuvre dans le cadre de partenariats.
Le programme d’éducation thérapeutique décrit ci-dessous, « Sophia », est réalisé en commun entre l’assurance maladie et les complémentaires santé.
Un autre programme d’éducation à la santé intitulé « Tensio forme » (143) élaboré par la Mutualité française est expérimenté dans deux régions, en Île-de-France et en Auvergne, en partenariat avec l’assurance maladie et les agences régionales de santé.
Il a pour objectif d’améliorer la détection précoce de l’hypertension et ainsi de permettre le recours aux stratégies non médicamenteuses ainsi que d’éviter chez les sujets à risque l’apparition de la maladie et de ses complications lorsque celle-ci s’est déclarée.
Ce programme s’adresse aux hommes âgés de plus de quarante-cinq ans et aux femmes âgées de plus de cinquante ans qui présentent un risque de développer cette maladie. Composé de modules, mêlant éducation thérapeutique et incitation à modifier son comportement, comme la pratique d’une activité physique, l’arrêt du tabac ou le respect d’un équilibre alimentaire, il se déroule dans les centres de santé des mutuelles et au sein d’organisations sportives partenaires comme des fédérations de marche. Il est fondé sur le volontariat.
L’objectif est de former une cohorte de 2 000 participants, 250 s’y sont inscrits dans l’immédiat.
Le partenariat est à la fois financier et scientifique ; ainsi, le coût de ce programme qui s’élève à 360 euros par an et par participant est pris en charge à hauteur de 250 euros par l’assurance maladie et de 110 euros par les institutions mutualistes. Quant à l’élaboration du dispositif, il résulte d’un travail commun entre l’assurance maladie, les agences régionales de santé et la Mutualité.
C’est l’exemple même d’une bonne pratique à généraliser, si l’évaluation est concluante.
Néanmoins, ce programme présente dès à présent un biais : en effet, parmi les participants, 90 % seraient des cadres. Il s’avère difficile de mobiliser la population qui en aurait le plus besoin.
Afin de renforcer cette complémentarité entre assurance maladie et complémentaires santé, le levier des incitations financières devrait être encouragé.
C’est tout l’enjeu de la mise en place de contrats responsables. Il conviendrait ainsi de subordonner l’obtention, par les complémentaires santé, du bénéfice d’exonérations sociales et fiscales sur ces contrats (144) à la prise en charge d’au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires à l’aune des objectifs de santé publique figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel, qui comprend aussi bien le détartrage dentaire, le dépistage des troubles de l’audition que l’ostéodensitométrie pour les femmes âgées de plus de cinquante ans.
Votre Rapporteur suggère d’encourager, dans ce type de contrats, l’introduction de clauses obligatoires définies en conformité avec les priorités de prévention définies dans la loi de santé publique.
2. Faciliter les échanges de données
Il est important de disposer de bases de données fiables et normalisées afin que tous les acteurs puissent s’y référer pour élaborer leurs actions.
C’est à ce titre qu’a été créé en 2004 (145), sous la forme d’un groupement d’intérêt public, l’Institut des données de santé (IDS), chargé d’analyser et de croiser les données de santé réparties dans des bases publiques et privées. Selon l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, il a pour mission d’assurer la cohérence des systèmes d’information et de mettre à disposition notamment de ses membres et de la Haute Autorité de santé des données, en garantissant l’anonymat, pour répondre à des problèmes de santé publique.
Une base de données existe, celle de l’assurance maladie, le Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM), qui regroupe les données de remboursement ambulatoires des bénéficiaires des régimes d’assurance maladie obligatoire mais la circulation de ses informations est délicate(146).
Interrogé sur l’exploitation de sa base de données pour définir une stratégie de prévention, M. Hubert Allemand (147), adjoint au directeur général de la CNAMTS, a reconnu qu’elle pourrait être utilisée pour mieux définir les besoins en matière de prévention.
Une première étape a été franchie en permettant à l’agence régionale de santé d’avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de ses missions, dont celles contenues dans les systèmes d’information des organismes d’assurance maladie, sous condition d’anonymat(148).
Quant à l’échange de données avec les complémentaires santé, des progrès ont été faits.
Un rapport, remis en 2003 au ministre de la santé par M. Christian Babusiaux (149), préconisait, moyennant certaines garanties, l’accès des assureurs complémentaires aux données de santé figurant sur les feuilles de soins électroniques transmises à l’aide de la carte Vitale.
Le projet Monaco en expérimentation, via l’IDS, a pour objectif d’apparier les bases de données de 11 complémentaires santé (150) avec celle de l’assurance maladie.
Une seconde étape doit être franchie en permettant une transmission des données entre professionnels de santé.
Dans le même esprit, M. Jean-Luc Vieilleribière, inspecteur général des affaires sociales (151), a évoqué l’idée de transmission des données entre médecins, approche qui garantirait le respect du secret médical.
Un outil, le dossier médical personnel (DMP), a été créé mais tarde à entrer en application.
Le dossier médical personnel L’article 3 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie institue un « dossier médical personnel » (DMP)* et prévoit qu’« afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d’un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l’assurance maladie dispose… d’un dossier médical personnel ». Le DMP poursuit plusieurs objectifs. En premier lieu, il cherche à améliorer la coordination et la continuité des soins grâce à la traçabilité de l’information. Conçu comme un service de partage de documents entre professionnels de santé, l’accès à l’historique médical du patient devrait leur permettre une meilleure prise en charge du patient, éviter les actes redondants et agir contre les interactions médicamenteuses. Les professionnels de santé et les établissements de santé devront ainsi reporter dans le DMP toutes les données de santé à caractère personnel qu’ils recueillent ou produisent à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, « notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins ». Le DMP doit aussi comprendre « un volet spécialement destiné à la prévention ». En second lieu, le DMP doit inciter le patient à participer davantage à sa prise en charge et à devenir acteur de sa propre santé. Dans la continuité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a introduit le droit pour toute personne d’accéder directement à son dossier médical, le DMP facilite l’accès du patient à ses données de santé. Le DMP est soumis à des règles d’autorisation d’accès contrôlées par le patient : – le consentement éclairé du patient doit être recueilli pour sa création ; – sous réserve de l’autorisation du patient, valable pendant un an renouvelable, le professionnel de santé a accès au DMP de son patient ; – le patient peut à tout moment supprimer un document en en faisant la demande à un professionnel de santé, notamment à son médecin traitant. Initialement prévu pour une ouverture au public en juillet 2007, le projet DMP a été relancé par le ministère de la santé en avril 2009. Il est depuis lors facultatif. Son développement doit être progressif, élaboré à partir d’expériences locales et construit comme un bouquet de services « à forte valeur ajoutée » pour les patients comme pour les professionnels de santé. Il est mis en œuvre par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé)**. Depuis sa création, celle-ci a notamment : – mis en place une procédure d’agrément des différents hébergeurs de données de santé ; – défini l’identifiant national de santé qui permettra d’accéder au DMP ; – publié un cadre national d’interopérabilité des systèmes d’information en santé et adopté un certain nombre de normes et standards ; – relancé les projets régionaux susceptibles d’aboutir à la mise en œuvre du DMP et procédé à l’arrêt des projets qui ne l’étaient pas ; – organisé un appel d’offres relatif à l’hébergement de référence du DMP. Le programme de relance du DMP définit une trajectoire progressive de déploiement entre 2010 et 2013 qui prévoit : – le déploiement, à l’échelle nationale, d’un « DMP-socle », comportant des services de partage de documents entre les professionnels de santé et fournissant une première gamme d’informations à valeur médicale comme des antécédents et allergies, prescriptions médicamenteuses ou des résultats d’examens de biologie ; – l’expérimentation de téléservices spécialisés « à valeur médicale supplémentaire », concernant par exemple le suivi du diabète, le DMP de l’enfant, la prescription électronique (« e-prescription »), le partage de l’imagerie médicale et de comptes rendus ; – la mise en œuvre de divers services aux patients, consistant soit à leur transmettre par voie électronique certaines informations, comme des résultats d’analyses biologiques, soit à les aider dans l’organisation de leur prise en charge, notamment au moyen d’outils de rappel des échéances de leur calendrier de vaccination et de soins, ou et des programmes d’accompagnement thérapeutique. * Article 50 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 codifié aux articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique. ** Article 45 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. |
La Cour des comptes a relevé, lors de l’audition de ses représentants (152), que cette question de la circulation de l’information entre médecins traitants, médecins scolaires ou médecins du travail relevait du dossier médical personnel « qui devrait donc progressivement devenir le vecteur d’une information partagée ».
Selon votre Rapporteur, il serait souhaitable que le médecin traitant soit destinataire des données recueillies par le médecin scolaire ou le médecin du travail.
Afin d’assurer une meilleure coordination et complémentarité entre tous les acteurs de la prévention, votre Rapporteur recommande donc :
– de permettre, pour chaque patient, l’élaboration par le médecin traitant d’un document médical de synthèse annuel qui pourrait être transmis aux autres médecins et qui permettrait de constituer une base de données ;
– de favoriser la transmission et l’accès aux dossiers médicaux entre médecins scolaires, médecins du travail, médecins-conseils et médecins traitants, liés par le secret médical ;
– d’élargir les missions de l’Institut des données de santé (IDS) qui serait chargé de collecter de manière normalisée les données de santé anonymisées en matière de prévention et dont la transmission serait obligatoire pour tous les acteurs du système de santé à l’échelle nationale et territoriale et de les héberger, afin de disposer d’un système d’information unique.
1. Repenser certaines actions traditionnelles
Votre Rapporteur suggère en premier lieu d’informer la personne du bénéfice-risque avant tout dépistage.
Dans le cadre du dépistage du cancer colorectal, votre Rapporteur préconise de remplacer le test de l’hémoccult par celui de l’immuno-histo-chimique (IHC). Le plan Cancer II va dans ce sens en comprenant une action intitulée « Déployer progressivement l’utilisation du test immunologique de dépistage de cancer colorectal sur l’ensemble du territoire » (153).
La France propose un dépistage à la fois individuel et collectif du cancer du sein, avec tous les inconvénients que cela peut comporter ainsi que votre Rapporteur l’a évoqué ci-dessus. C’est pourquoi, tout en maintenant ce double dépistage, il est proposé d’harmoniser le dépistage individuel et collectif du cancer du sein en imposant des référentiels de bonne pratique dans la convention médicale et en imposant les mêmes critères de qualité.
Comme cela a été rappelé, la mauvaise couverture vaccinale de la population française nécessite de réhabiliter une prévention primaire collective.
Afin de rétablir la confiance de la population vis-à-vis de la vaccination, il convient de favoriser le débat public. La commission d’enquête de notre collègue Jean-Pierre Door sur la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 (154) recommandait l’organisation d’états généraux sur les enjeux de la vaccination. Composés d’un panel de citoyens représentatifs et ayant reçu une formation, ces états généraux permettraient un débat avec des scientifiques sur la politique vaccinale menée en France.
Lors de son audition (155), Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé, a indiqué que la direction générale de la santé avait créé un groupe de travail chargé de réfléchir à l’amélioration du calendrier vaccinal et à sa plus grande lisibilité. Il s’orienterait vers une approche par âge plus que par vaccin.
Votre Rapporteur recommande :
– de réformer le calendrier des vaccinations, sous la responsabilité du délégué interministériel à la prévention sanitaire et selon les recommandations de la HAS ;
– de rendre obligatoire la vaccination ROR ;
– d’assurer le suivi des vaccinations par le médecin scolaire et le médecin traitant et de mentionner ce suivi dans le dossier médical et pharmaceutique du patient.
c) La lutte contre les addictions et l’obésité
La lutte contre le tabac, l’alcoolisme et l’obésité sont des priorités majeures dans une politique de prévention. Elles figureront dans la nouvelle loi de santé publique. Ce sont aussi des domaines où apparaissent des conflits d’intérêts.
Les conflits d’intérêts Comme le relève la Cour des comptes dans sa communication transmise à la MECSS, les stratégies de prévention peuvent entrer en conflit avec les intérêts des groupes de pression et des intérêts économiques. Dans deux politiques de prévention, la lutte contre l’obésité et la lutte contre l’alcoolisme, des groupes de pression ont pu agir pour limiter les effets des campagnes mises en œuvre ou des initiatives proposées. Le secteur agro-alimentaire, industrie française importante, est particulièrement vigilant face aux actions menées pour prévenir l’obésité. Lors de la discussion de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un amendement déposé le 6 février 2009 par M. Jean-Marie Rolland, député, qui proposait d’interdire des messages publicitaires portant sur des produits alimentaires sucrés pendant les émissions destinées aux enfants, a été rejeté. En mai 2010, dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, un amendement déposé par M. Jacques Muller, sénateur, visant à interdire la publicité pour les produits alimentaires dans les émissions de télévision destinés aux enfants de moins de treize ans a été de nouveau repoussé. Lors de son audition, la Cour des comptes a souligné que la directrice générale de l’alimentation entendue lors de l’élaboration de la communication à la MECSS, même si elle était engagée sur les questions liées à la qualité nutritionnelle et à la lutte contre l’obésité, n’en était pas moins très consciente des problèmes agro-alimentaires qui se posaient. Dans ce domaine, le secteur audiovisuel peut également faire montre d’une certaine réticence car, selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la suppression de la publicité alimentaire aurait des conséquences économiques sur le secteur, soulignant ainsi que ce type de publicité assurait une part importante de ses recettes. Une charte a d’ailleurs été négociée et signée le 18 février 2009 par les représentants de l’industrie agro-alimentaire, des principales chaînes de télévision et leurs régies publicitaires et les ministères de la santé et de la culture*. Elle vise à « promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et publicités diffusées à la télévision ». Le CSA en assure le suivi. Quant à la lutte contre l’alcoolisme, des intérêts viticoles peuvent exercer des pressions pour différencier, au sein des boissons alcoolisées, les alcools forts du vin. Créé par décret en 2006**, le Conseil de modération et de prévention a pour mission d’assister et de conseiller les pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d’alcool. Il peut être saisi par le ministre de la santé ou un cinquième de ses membres sur toute question relative aux usages et risques liés à la consommation de boissons alcoolisées. La communication précitée de la Cour des comptes mentionne une saisine du ministère de la santé par le Conseil de modération et de prévention contre une campagne de l’INPES intitulée « Alcool info service », au motif qu’elle aurait stigmatisé le vin. S’agissant, plus généralement, de l’éducation thérapeutique, il est nécessaire d’être vigilant et d’éviter toute initiative qui favoriserait une relation directe entre le patient et les laboratoires ou firmes pharmaceutiques. * Charte pour promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusées à la télévision. ** Décret n° 2006-159 du 14 février 2006 portant création du Conseil de modération et de prévention. |
Votre Rapporteur propose trois mesures emblématiques :
– dans le cadre de la lutte contre le tabac, instituer une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les fabricants de produits de tabac dont les recettes seraient affectées à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ; cette mesure, qui avait été proposée par un amendement déposé par notre collègue Yves Bur dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, n’a pas été adoptée ;
– dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme, supprimer le Conseil de modération et de prévention ; des organismes existent déjà pour prévenir l’alcoolisme, à l’exemple de la MILDT ou de l’INPES. Il est d’ailleurs précisé de manière spécifique dans l’article 1er du décret instituant le conseil, qu’il est « une instance de dialogue et d’échange qui ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière de santé publique ou de politique agricole ». C’est pourquoi, dans un souci de rationalisation, cette instance pourrait être supprimée.
– dans le cadre de la lutte contre l’obésité, interdire les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des produits alimentaires à forte densité énergétique durant les programmes à destination des enfants (156).
d) La promotion des bilans de santé personnalisés
Comme le soulignaient les médecins auditionnés, seuls leurs patients malades viennent consulter, c’est pourquoi il est important, particulièrement autour de trente ans où les facteurs de risques se préparent, de prévoir une consultation dédiée à la prévention.
Sur le modèle des bilans de santé proposés par la MSA ou le RSI décrits ci-dessus, votre Rapporteur propose de développer, chez le médecin traitant, des consultations de prévention systématiques en fonction des tranches d’âge, en s’appuyant sur des recommandations de la HAS. Elles pourraient s’effectuer tous les cinq ans à partir de trente ans et tous les trois ans chez le dentiste. Il serait judicieux de prévoir une consultation obligatoire chez le dentiste pour toute personne entrant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
2. Développer des actions d’éducation et de promotion de la santé
● Une instruction sanitaire
Une prévention efficace débute dès le plus jeune âge, c’est pourquoi l’école doit être chargée de diffuser une éducation à la santé, mission essentielle dans une approche intégrée de la prévention.
Mme Marie-Sophie Desaulle (157), directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, a relevé lors de son audition que l’enfance et la jeunesse devaient constituer la première population cible en matière de prévention. M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine, a quant à lui souligné que l’état de santé à une soixante d’années était la résultante de la vie passée, d’où l’importance de commencer les messages de prévention à l’école.
Dans le même esprit, M. Didier Tabuteau (158), responsable de la chaire Santé de Sciences Po, a, quant à lui, préconisé une « instruction sanitaire ».
Votre Rapporteur a été frappé par les résultats d’une expérimentation menée dans la région Alpes-Provence-Côte d’Azur par le CRES en partenariat avec l’Éducation nationale (159).
Campagne équilibre de vie, prévention des cancers et des toxicomanies De 1985 à 1995, une campagne de sensibilisation intitulée « Campagne équilibre de vie, prévention des cancers et des toxicomanies en milieu scolaire en Provence Alpes Côte d’Azur » a été menée auprès d’élèves des classes de primaire. Des modules d’environ une heure axés sur l’apprentissage d’un mode de vie équilibré et orientés autour de l’alcool, du tabac, du petit-déjeuner et des médicaments étaient délivrés tout au long de l’année scolaire par des éducateurs de santé, en concertation avec les enseignants. Au total 55 210 enfants y ont participé. L’évaluation effectuée a montré que ces élèves avaient assimilé les messages de prévention. En 1995, une évaluation a été menée sur un échantillon de 200 élèves scolarisés en classe de troisième, issu des 10 116 élèves ayant reçu le programme en classe de CM2, soit avec un recul de quatre années. Cet échantillon était comparé à deux autres échantillons : 200 élèves n’ayant pas participé au programme et 164 élèves ayant reçu des programmes d’autres organismes. Les résultats sont significatifs dans le domaine de l’alcool et du tabac. Lors de sorties entre amis, 10 % des élèves ayant reçu le programme consomment des boissons alcoolisées contre 24 % des élèves n’y ayant pas participé. Le taux de fumeurs est de 13,5 % dans le premier groupe contre 23 % pour le second. La réussite de ce programme réside dans sa durée et sa répétition et s’inscrit dans une démarche d’éducation à la santé globale. |
Parvenir à éduquer dès le plus âge nécessite donc une meilleure implication des enseignants.
Le CEC dans son rapport sur la médecine scolaire (160) recommande de « permettre une meilleure prise en compte des enjeux de l’éducation à la santé au sein de l’institution scolaire ».
Comme l’a relevé Mme Nadine Neulat (161), chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, de la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale, l’objectif est de se préoccuper de la santé de l’enfant et non de l’élève.
Néanmoins, la faiblesse du nombre de médecins (162) et d’infirmières scolaires ainsi que le taux d’occupation insuffisant des emplois leur imposent de se concentrer sur leurs missions de suivi de la santé des enfants au détriment d’actions de promotion et d’éducation de la santé.
Votre Rapporteur tient à souligner que le passage dans la catégorie A (163) du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, relevant du ministère de la santé, alors que les infirmières scolaires continuent à relever du cadre B (164), ne pourra qu’accentuer ces mauvais chiffres.
Votre Rapporteur préconise donc :
– de rendre obligatoire une instruction sanitaire durant la classe de CM2 concentrée sur les grands facteurs de risques ;
– d’encourager la participation des enseignants aux actions d’éducation à la santé et de favoriser l’accueil dans les établissements scolaires d’intervenants extérieurs de type éducateurs à la santé ;
– de revaloriser les métiers de la santé scolaire.
● Des programmes d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique
Cette logique d’éducation à la santé doit se poursuivre à l’âge adulte. De nombreuses actions de prévention proposées aussi bien par l’assurance maladie que par les complémentaires santé privilégient des programmes d’accompagnement, dans une logique de plus grande responsabilisation des assurés.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a expérimenté un programme dénommé « Santé active » qui s’adresse, sur la base du volontariat, à tout assuré.
Selon les propos de M. Patrick Negaret (165), à l’origine du projet, ce programme « vise à responsabiliser l’assuré social au lieu d’encourager une certaine forme de passivité, à lui apprendre à gérer son capital santé et, enfin, à maîtriser les coûts, étant entendu que les affections de longue durée représentent les deux tiers des dépenses et comptent pour les neuf dixièmes dans l’évolution de celles-ci ».
Le programme a recours à des brochures d’informations, des débats contradictoires, mais a aussi lancé des actions plus novatrices sous la forme d’ateliers qui permettent à chaque personne d’agir sur des déterminants de santé comme l’hygiène de vie ou les comportements.
Après un entretien individuel dans un espace dédié, un conseiller propose à l’assuré l’inscription à l’un des trois programmes suivants : santé du dos, santé du cœur ou nutrition active. Le participant bénéficiera, par la suite, d’un accompagnement personnalisé. De janvier 2009 à juin 2010, 2 583 assurés y ont participé.
L’évaluation menée a donné lieu à des résultats encourageants, mettant en exergue une inversion des tendances sur les arrêts maladie, sur la consommation de médicaments et un moindre recours au médecin généraliste de la part des assurés participant au programme.
L’expérience a été étendue du Mans à Versailles, puis à Bobigny et devrait concerner, en 2012, 10 caisses, l’objectif étant de couvrir à la fin de l’année 2013 la moitié des caisses.
Selon la même approche, des programmes d’éducation thérapeutique sont encouragés pour répondre aux maladies chroniques. Ils proposent un accompagnement adapté au stade de la maladie.
La loi du 21 juillet 2009 a consacré l’éducation thérapeutique en l’inscrivant dans le parcours de soins du patient (166). L’article L. 1161-3 du code de la santé publique définit les actions d’accompagnement comme une assistance et un soutien aux malades dans la prise en charge de la maladie.
Ces programmes doivent être conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre de la santé. Ces programmes sont autorisés par les agences régionales pour une durée de quatre ans renouvelables et sont évalués par la HAS.
L’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale (167) a autorisé l’assurance maladie à proposer ce type d’actions : « Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d’accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d’orientation dans le système de soins et d’éducation à la santé. »
En 2008, la CNAMTS a lancé un programme expérimental intitulé « Sophia » à destination de ses assurés majeurs souffrant de l’affection de longue durée du diabète de type 1 et 2. L’objectif affiché est triple :
– améliorer la prise en charge de l’état de santé des patients ;
– diminuer la fréquence des complications ;
– et réduire le coût de la pathologie.
Sur la base du volontariat, après avoir rempli un questionnaire, les malades bénéficient d’un accompagnement personnalisé, auquel est également associé le médecin traitant. Des infirmières-conseils recrutées par l’assurance maladie assurent l’accompagnement téléphonique. Le dispositif, présent dans 19 départements et qui concerne environ 103 000 patients, devrait être généralisé à tout le territoire en 2012.
L’évaluation parcellaire (expériences locales et échantillons de petite taille) menée par la HAS a conclu que ces programmes étaient prometteurs pour les diabètes de type 1, la cardiologie et l’asthme pédiatrique.
Néanmoins, afin d’éviter toute relation directe, source de conflit d’intérêts, entre le patient et des firmes ou laboratoires pharmaceutiques, il convient de garantir la neutralité de ces programmes par l’intervention des pouvoirs publics.
Ces expérimentations restent prometteuses selon votre Rapporteur, c’est pourquoi il recommande :
– de renforcer les politiques d’éducation thérapeutique et de prendre en charge l’hypertension artérielle sévère ;
– de repérer, d’évaluer et de diffuser les bonnes pratiques expérimentées au niveau local en matière d’éducation et de promotion à la santé, sous l’égide des agences régionales de santé.
3. Lutter contre les inégalités
Les actions de prévention sont réorientées vis-à-vis des populations les plus fragiles. L’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique (168) dispose : « Les programmes de santé publique mis en œuvre par l’État ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées. »
Les centres d’examens de santé de l’assurance maladie, dont la mission première est de dispenser des bilans de santé, ont vu leur fonction évoluer et sont chargés de détecter les situations de précarité et d’accompagner les personnes fragilisées. Un des objectifs est d’inciter ces personnes à être acteurs de leur santé afin d’améliorer leur insertion sociale et professionnelle.
M. Laurent Chambaud (169), inspecteur général des affaires sociales, a ainsi évoqué une expérimentation en Île-de-France menée par l’agence régionale de santé et un centre d’examens de santé, en liaison avec Pôle emploi pour aider les patients à retrouver un emploi.
M. Hubert Allemand (170), adjoint au directeur général de la CNAMTS, a indiqué que ces centres dispensaient également des programmes d’éducation thérapeutique vis-à-vis des populations précaires.
Ces priorités se retrouvent dans le contrat d’objectifs et de gestion signé entre l’État et la CNAMTS qui assigne à l’assurance maladie d’atteindre 50 % des populations les plus démunies. 48 % ont eu recours à ces programmes.
Afin de cibler les populations les plus fragilisées, votre Rapporteur propose de développer et d’encourager la visite à domicile des familles dans le cadre de la PMI.
La lutte contre les inégalités en matière de prévention concerne aussi les régions et notamment l’inégalité entre les territoires urbains et ruraux.
Dans ce cadre, Groupama et la MSA ont développé depuis 2009 une expérimentation : « Pays de santé » dans deux régions, le nord de la Dordogne et l’ouest des Ardennes dont le but est de contribuer à maintenir dans les territoires ruraux un accès aux soins adapté aux besoins de la population.
Une conseillère, rémunérée par Groupama, assure la coordination avec les professionnels de santé dans leurs actions de prévention. Le coût par an et par territoire est estimé à 100 millions d’euros.
Une expérience que votre Rapporteur trouve particulièrement intéressante est la mise en place d’un rétinographe mobile qui permet de pratiquer un examen du fond d’œil pour prévenir la rétinopathie diabétique, dans le département des Ardennes, dans lequel le nombre des ophtalmologues est réduit et concentré dans les plus grandes agglomérations.
M. Bertrand Arnoux, ophtalmologue, membre du réseau de santé CARéDIAB, a présenté cette expérimentation à la mission (171). Un rétinographe itinérant est installé pour des durées d’un à trois mois sur des sites médicalisés sélectionnés pour leur faible densité médicale. Une publicité est faite à l’avance, par la distribution de brochures d’information et par la sensibilisation des médecins ainsi que des pharmaciens. Les patients diabétiques peuvent prendre rendez-vous pour une consultation. Les clichés seront transmis sur un serveur et lus par des ophtalmologues afin de diagnostiquer une éventuelle rétinopathie diabétique.
Cette initiative existe dans de nombreuses régions. On peut citer, à ce titre, le Réseau de télémédecine pour le dépistage de la rétinopathie diabétique de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (OPHDIAT) en région parisienne ou le programme Diabète Midi-Pyrénées (DIAMIP) en Midi-Pyrénées.
Ces exemples montrent qu’il n’est pas de prévention efficace sans égal accès de tous à la prévention sur l’ensemble du territoire et la nécessité d’assurer une présence médicale équilibrée.
4. Promouvoir la médecine prédictive
La médecine prédictive permet de révéler si une personne sera susceptible de développer au cours de son existence une maladie, en se fondant sur la recherche de ses caractéristiques génétiques.
L’article R. 1131-1 du code de la santé publique (172) encadre cette pratique.
Les tests génétiques ne peuvent avoir pour objet que :
– de poser, confirmer, infirmer le diagnostic d’une maladie à caractère génétique chez une personne ;
– de rechercher les caractéristiques d’un ou plusieurs gènes susceptibles d’être à l’origine du développement d’une maladie ;
– d’adapter la prise en charge médicale d’une personne selon ses caractéristiques génétiques.
Parmi les applications les plus répandues décrites par M. Dominique Royère (173), chef du pôle Stratégie procréation, embryologie et génétique humaine à l’Agence de la biomédecine, se trouvent :
– le dépistage prénatal de la trisomie 21 ; réservé, au départ aux femmes âgées de plus de trente-huit ans, le test a été étendu par la suite aux femmes qui le souhaitaient lors du deuxième trimestre de leur grossesse, puis par l’arrêté du 23 juin 2009 aux femmes enceintes au stade du premier trimestre (174). Le dépistage repose à la fois sur des examens biologiques et échographiques qui mesurent le risque et, en cas de risque majoré, un diagnostic nécessitant une ponction peut être réalisé. Sur 830 000 femmes concernées en 2010, 650 000 y ont eu recours ;
– le dépistage néonatal, obligatoire depuis 1980, de la phénylcétonurie et de trois autres graves maladies (175) pouvant conduire à des handicaps mentaux sévères ; un traitement adapté permettra d’éviter le développement ultérieur de telles maladies. Ainsi, dans le cas de la phénylcétonurie, le respect d’un régime alimentaire spécifique empêchera l’apparition de la maladie ;
– la détection de maladies asymptomatiques et la présence de gènes associés à des cancers. Ainsi une femme porteuse du gène BRCA1 a entre 40 % et 85 % de chances de développer un cancer du sein contre 10 % pour l’ensemble de la population et risque de 10 % à 63 % d’être atteinte d’un cancer des ovaires contre 1 % pour l’ensemble de la population. Des actes de chirurgie peuvent ainsi intervenir de manière préventive.
L’intérêt de la médecine prédictive réside donc à la fois dans la possibilité de prévenir certaines pathologies et une meilleure prise en charge de la maladie lorsqu’elle est décelée de façon précoce. De plus, elle permet une meilleure information vis-à-vis de la parentèle.
En premier lieu, 4 ou 5 millions de personnes en France seraient susceptibles de développer une maladie génétique. Lors de son audition, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave (176), directrice de l’Agence de la biomédecine, a souligné : « Si toutes les maladies rares ne sont pas génétiques, la quasi-totalité des maladies génétiques sont rares. En ce domaine, la médecine prédictive, hormis les tests de prédisposition, concerne donc peu de monde. Néanmoins les maladies génétiques sont souvent graves ; elles supposent donc des dépenses lourdes. »
De plus si certaines maladies sont liées à la présence d’une anomalie génétique, d’autres facteurs expliquent leur apparition.
En second lieu, cette pratique soulève de nombreuses questions éthiques.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave n’a pas manqué de rappeler que tout acte médical suppose le consentement de la personne concernée et, en corollaire dans le cas de tests génétiques, son droit de ne pas savoir.
L’article R. 1131-4 du code de la santé publique (177) impose l’information de la personne sur notamment le degré de fiabilité des analyses, les possibilités de prévention, les modalités de transmission génétique de la maladie et oblige la personne à donner son consentement par écrit si elle entreprend d’engager une démarche de test génétique.
C’est pourquoi, ainsi que l’a souligné M. Dominique Royère, chef du pôle Stratégie procréation, embryologie et génétique humaine à l’Agence de la biomédecine, la décision de recourir à des tests génétiques doit être réalisée à bon escient et motivée par un contexte précis lié à l’âge ou à l’histoire familiale.
Votre Rapporteur recommande donc d’encourager le développement des tests génétiques, tout en prenant en compte les questions éthiques et les contraintes financières.
*
* *
En conclusion, votre Rapporteur tient à rappeler que la préservation du capital santé est également tributaire de déterminants extérieurs au système de santé proprement dit.
Les facteurs environnementaux tels que la qualité de l’air, de l’eau, des risques liés à des substances toxiques présentes dans la vie quotidienne ou au travail ont des conséquences sur la santé. Il est évident que l’examen de ces questions dépassait très largement le cadre d’un rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Il convient toutefois de relever que conscient de l’importance de ces enjeux, le Gouvernement a élaboré un plan national de Santé environnementale qui vise à répondre à trois objectifs majeurs : garantir un air et boire une eau de bonne qualité, prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers et mieux informer le public et protéger les populations sensibles comme les enfants et les femmes enceintes.
LISTE DES 36 PROPOSITIONS DE LA MISSION
Le pilotage politique
● Proposition n° 1 : Élaborer une nouvelle loi de santé publique quinquennale qui fixera un nombre limité de priorités déclinées dans les conventions d’objectifs et de gestion signées entre l’État et les régimes obligatoires d’assurance maladie et en assurer son évaluation.
● Proposition n° 2 : Débattre chaque année au Parlement, au printemps, de l’orientation de ces priorités et discuter de l’affectation de leurs moyens humains et financiers, à l’automne, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
● Proposition n° 3 : Instituer un délégué interministériel à la prévention sanitaire, rattaché au Premier ministre, nommé en conseil des ministres et chargé d’assurer le pilotage politique ainsi que de coordonner les actions entre tous les acteurs. Il exercerait également les missions aujourd’hui confiées au secrétaire général du comité de pilotage des agences régionales de santé.
● Proposition n° 4 : Intégrer le collège du Haut Conseil de la santé publique au sein de la Haute Autorité de santé en conservant son expertise médicale d’évaluation des stratégies de santé publique.
● Proposition n° 5 : Élargir les missions de l’Institut national de la prévention et d’éducation pour la santé (INPES) rattaché au délégué interministériel à la prévention sanitaire, chargé à la fois de mener des actions de promotion et d’éducation à la santé et d’évaluer les expérimentations locales, afin le cas échéant de les généraliser à l’échelle nationale.
Le pilotage territorial
● Proposition n° 6 : Renforcer la mission transversale assumée par les agences régionales de santé dans le domaine de la prévention, en exigeant la mise en œuvre effective de leurs commissions de coordination et en prévoyant l’évaluation de cette mission.
● Proposition n° 7 : Renforcer au niveau régional le rôle des conférences régionales de la santé et de l’autonomie qui définiraient leurs priorités avec l’aide des observatoires régionaux de la santé et transmettraient leurs propositions à la Conférence nationale de santé. Cette dernière sera chargée d’en élaborer une synthèse proposée au Parlement lors du débat d’orientation sur les priorités de santé publique. Les membres composant la Conférence nationale de santé devront être issus des conférences régionales de la santé et de l’autonomie au sein desquelles, la participation des associations de patients devra être confortée.
● Proposition n° 8 : Favoriser des contrats de santé de territoire au plus près des besoins de la population.
AmÉliorer la complémentaritÉ des acteurs
Santé au travail :
● Proposition n° 9 : Confier au médecin du travail le soin de rédiger un document précisant les risques éventuels que peut comporter un poste de travail et transmis au médecin traitant.
● Proposition n° 10 : Revaloriser la fonction de médecin du travail.
Santé scolaire :
● Proposition n° 11 : Garantir la transmission au médecin traitant de l’élève des conclusions recueillies par le médecin scolaire à l’occasion des visites médicales obligatoires.
● Proposition n° 12 : Mettre l’accent, dans un souci de rationalisation, sur les visites médicales des élèves âgés de six ans et de quinze ans et, en conséquence, supprimer les visites des élèves âgés de neuf et douze ans.
● Proposition n° 13 : Revaloriser les métiers de la santé scolaire.
Entre les professionnels de santé et l’État et l’assurance maladie
● Proposition n° 14 : Confier l’élaboration des seuils retenus pour fixer des facteurs de risque à des conférences de consensus, sous l’égide de la Haute Autorité de santé.
● Proposition n° 15 : Prévenir les risques iatrogéniques en encourageant la prescription de doses administrées.
Entre les régimes obligatoires d’assurance maladie et les complémentaires santé
● Proposition n° 16 : Inscrire dans les contrats responsables des clauses légales déclinant les priorités définies dans la loi de santé publique.
Faciliter les Échanges de donnÉes
● Proposition n° 17 : Favoriser la transmission et l’accès aux dossiers médicaux entre médecins scolaires, médecins du travail, médecins-conseils et médecins traitants.
● Proposition n° 18 : Charger le médecin traitant d’élaborer un document médical de synthèse annuel pour chaque patient qui pourrait être transmis aux autres médecins.
● Proposition n° 19 : Élargir les missions de l’Institut des données de santé (IDS) chargé de collecter de manière normalisée les données de santé anonymisées et de les héberger, afin de disposer d’un système d’information unique.
Repenser certaines actions traditionnelles
Vaccinations
● Proposition n° 20 : Réformer le calendrier des vaccinations sous la responsabilité du délégué interministériel à la prévention sanitaire, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé.
● Proposition n° 21 : Rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).
● Proposition n° 22 : Assurer le suivi des vaccinations par le médecin scolaire et le médecin traitant et mentionner ce suivi dans le dossier médical et pharmaceutique du patient.
Lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et l’obésité
● Proposition n° 23 : Instituer une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les fabricants de produits de tabac dont les recettes seraient affectées à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme.
● Proposition n° 24 : Supprimer le Conseil de modération et de prévention.
● Proposition n° 25 : Interdire les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des produits alimentaires à forte densité énergétique durant les programmes à destination des enfants.
Bilans de santé personnalisés
● Proposition n° 26 : Organiser des consultations de prévention systématiques en fonction des tranches d’âge chez le médecin traitant en s’appuyant sur des recommandations de la Haute Autorité de santé.
Dépistages
● Proposition n° 27 : Informer la personne du bénéfice-risque avant tout dépistage.
● Proposition n° 28 : Remplacer le test de l’hémoccult par celui de l’immuno-histo-chimique (IHC) pour le dépistage du cancer colorectal.
● Proposition n° 29 : Harmoniser le dépistage individuel et le dépistage collectif du cancer du sein en imposant des référentiels de bonne pratique dans la convention médicale et en imposant les mêmes critères de qualité.
DÉvelopper des actions d’Éducation et de promotion de la santÉ
Instruction sanitaire
● Proposition n° 30 : Rendre obligatoire une instruction sanitaire durant la classe de CM2 concentrée sur les grands facteurs de risques.
● Proposition n° 31 : Encourager la participation des enseignants aux actions d’éducation à la santé et favoriser l’accueil dans les établissements scolaires d’intervenants extérieurs de type éducateurs à la santé.
Éducation thérapeutique et éducation à la santé
● Proposition n° 32 : Renforcer les politiques d’éducation thérapeutique et prendre en charge l’hypertension artérielle sévère.
● Proposition n° 33 : Repérer, évaluer et diffuser les bonnes pratiques expérimentées au niveau local en matière d’éducation et de promotion à la santé, sous l’égide des agences régionales de santé.
Lutter contre les inÉgalitÉs
● Proposition n° 34 : Développer la visite à domicile dans les familles en situation précaire dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI).
● Proposition n° 35 : Favoriser l’égal accès à la prévention sur tout le territoire en assurant une présence médicale équilibrée.
Promouvoir la mÉdecine prÉdictive
● Proposition n° 36 : Encourager le développement des tests génétiques, tout en prenant en compte les questions éthiques et les contraintes financières.
CONTRIBUTION DE MME JACQUELINE FRAYSSE
ET DES DÉPUTÉS DU GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (GDR)
Alors que la prévention est un maillon faible de notre système de santé, ce qui laisse une importante marge de progression, ce rapport sur la prévention sanitaire est marqué par un flagrant manque d’ambition.
Certaines propositions sont certes intéressantes, et notamment celle préconisant de « Débattre chaque année au Parlement, au printemps, de l’orientation de ces priorités et discuter de l’affectation de leurs moyens humains et financiers, à l’automne, à l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale » (proposition n° 2), ou celle visant à « Confier l’élaboration des seuils retenus pour fixer des facteurs de risque à des conférences de consensus » (proposition n° 14), ou lorsqu’il s’agit de « Favoriser la transmission et l’accès aux dossiers médicaux entre médecins scolaires, médecins du travail, médecins conseils et médecin traitant » (proposition n° 17). Il en est de même pour la proposition n° 25 qui préconise d’« Interdire les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des produits alimentaires à forte densité énergétique durant les programmes à destination des enfants » dont il faut noter cependant que nous l’avons déjà formulée sous forme d’amendement lors de l’examen du projet de loi HPST, et qu’elle a été rejetée par les députés de la majorité.
Le rapport propose également de « Développer la visite à domicile dans les familles en situation précaire dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI) » (proposition n° 34), mais on peut s’étonner qu’il ne mette jamais en regard les moyens nécessaires.
Cependant la majorité des préconisations s’apparentent à des déclarations d’intentions, notamment lorsqu’il s’agit de « Renforcer la mission transversale assumée par les agences régionales de santé dans le domaine de la prévention » (proposition n° 6), de « Renforcer au niveau régional le rôle des conférences de santé » (proposition n° 7), de « Favoriser des contrats de santé de territoire au plus près des besoins de la population » (proposition n° 8), de « Prévenir les risques iatrogéniques en encourageant la prescription de doses administrées » (proposition n° 15), d’« Informer la personne du bénéfice-risque avant tout dépistage » (proposition n° 27), ou encore de « Diffuser les bonnes pratiques expérimentées au niveau local en matière d’éducation et de promotion à la santé » (proposition n° 33).
Enfin, d’autres propositions sont plus polémiques. Ainsi, le rapport préconise de définir un nombre limité de priorités (proposition n° 1), qui pourraient être la lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme, la surcharge pondérale et la sédentarité, négligeant les secteurs les plus sinistrés de la politique de prévention, la santé scolaire et la santé au travail, ou la lutte contre les cancers liés aux facteurs environnementaux (pollution, pesticides, mal-bouffe, etc.) qui sont bien plus difficiles à remettre en cause.
Globalement, la lecture de ce document donne l’impression d’un catalogue de bonnes intentions qui présentent surtout l’avantage de ne pas engager de dépenses publiques supplémentaires. Car ce qui caractérise ce rapport, ce sont ses manques, lesquels sont essentiellement liés à des questions financières :
Ainsi, n’y a-t-il rien pour responsabiliser les employeurs en luttant contre la sous-déclaration des AT-MP. Bien plus, la seule recommandation concernant la santé au travail consiste à « Confier au médecin du travail le soin de rédiger un document précisant les risques éventuels que peut comporter un poste de travail qui pourrait être transmis au médecin traitant » (proposition n° 9), là où une médecine du travail ambitieuse devrait, au contraire, s’employer à supprimer ces « risques éventuels ». Mais quelle action préventive peut-on attendre d’une médecine du travail dont le gouvernement a réduit l’indépendance vis-à-vis des employeurs ?
Rien non plus sur la lutte contre la souffrance au travail et les méthodes managériales pathogènes.
Rien sur l’état déplorable de la médecine scolaire, sinon une note en bas de page pour préciser, sans s’en alarmer, que « 62 % des postes de médecins scolaires et 69 % des postes d’infirmières scolaires étaient pourvus en 2010 ». Le rapport propose de « Garantir la transmission au médecin traitant de l’élève des conclusions recueillies par le médecin scolaire à l’occasion des visites médicales obligatoires » (proposition n° 11), mais encore faut-il qu’il y ait suffisamment de médecins pour organiser de telles visites car actuellement il n’y a qu’un médecin scolaire pour 12 000 élèves. C’est sans doute pour ces raisons que le rapport propose également de gérer la pénurie en « Supprimant les visites médicales des élèves âgés de neuf et douze ans » (proposition n° 12).
Par ailleurs, le rapport ne dit rien sur la poursuite du subventionnement par l’État de substances dangereuses, et notamment des engrais chimiques qui continuent à bénéficier d’un taux réduit de TVA (article 278 bis du code général des impôts).
Rien non plus sur les déterminants sociaux qui conditionnent un mauvais état de santé : si les pauvres mangent trop peu de fruits et de légumes, ce n’est pas essentiellement par manque d’éducation à la santé, mais surtout par manque de pouvoir d’achat. Il en va de même pour les conditions de logement qui retentissent gravement sur l’équilibre et la santé des enfants comme des adultes.
En conclusion, Jacqueline FRAYSSE et les membres du Groupe GDR, ayant fait l’expérience du rejet par le ministre et sa majorité de tous les amendements qu’ils avaient déposés, notamment lors de l’examen du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoire », tiennent à manifester leur insatisfaction devant le manque d’ambition et de moyens préconisés par ce rapport.
Ils souhaitent toutefois à saluer la légitime interrogation du rapporteur sur la décision de retirer l’hypertension artérielle sévère de la liste des ALD (décret du 24 juin 2011), ce qui va « à l’encontre d’une politique de prévention, puisque les patients hypertendus qui ne pourront plus se soigner risquent de développer des complications » (page 45). Ce faisant, cette observation souligne, peut-être involontairement, l’incompatibilité entre les objectifs strictement budgétaires de court terme du gouvernement, et une véritable politique de prévention nécessitant par définition des moyens pérennes et des actions de long terme.
La Commission des affaires sociales a examiné le rapport d’information de M. Jean-Luc Préel en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la prévention sanitaire au cours de sa première séance du mercredi 8 février 2012.
M. le président Pierre Méhaignerie. Après les médicaments, les affections de longue durée, la prestation d’accueil du jeune enfant, le fonctionnement de l’hôpital et la lutte contre la fraude sociale, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MECSS, s’est penchée sur la politique de prévention sanitaire, qui apparaît comme le « parent pauvre » de notre système de santé. Il s’agit pourtant d’un véritable investissement, source d’économies à moyen terme, et d’un moyen efficace pour garantir un vieillissement en meilleure santé.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Après trois mois d’auditions et avec l’assistance de la Cour des comptes, la MECSS a adopté mercredi dernier, 1er février, son rapport sur la prévention sanitaire à l’unanimité de ses membres présents. Je souhaiterai souligner, en préambule, le travail très constructif qui a été mené au sein de la MECSS, enrichi des nombreuses suggestions de ses coprésidents, Jean Mallot et Pierre Morange, ainsi que de ses autres membres.
Notre pays souffre d’un manque de culture de santé publique.
L’assurance maladie, lors de sa création, a concentré son action sur la prise en charge des soins. Le système de santé français reste donc très orienté vers le curatif. Il est reconnu, à ce titre, comme performant, même si des gains d’efficience sont possibles et nécessaires. En revanche, il est considéré comme médiocre pour la prévention et l’éducation à la santé.
En l’améliorant, on peut espérer améliorer l’état de santé de la population et, en conséquence, diminuer le recours aux soins. La prévention peut ainsi être considérée comme un investissement, même si, comme l’indique M. Didier Tabuteau, « la santé publique est un tout, la prévention ne doit pas être opposée aux soins ».
La Cour des comptes, dont nous avons pu bénéficier de l’expérience, a, dans sa communication transmise à la MECSS, clairement mis en évidence les difficultés suivantes : absence de coordination de nombreux intervenants, insuffisance, voire absence, de pilotage, grande incertitude sur le montant des financements consacrés à la prévention, manque d’évaluation de plans divers et peu cohérents entre eux, défaut de hiérarchisation des objectifs fixés dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Définir la prévention n’est pas aisé. La définition la plus utilisée, la plus classique, reste celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle distingue trois catégories de prévention : la « prévention primaire » qui a pour but d’éviter l’apparition de la maladie en agissant sur ses causes et qui inclut la vaccination, la « prévention secondaire » qui vise à détecter la maladie et qui comprend le dépistage, la « prévention tertiaire » qui a pour but de réduire les risque de récidive, les complications et les séquelles.
Cette définition classique conserve une coloration très sanitaire. Or, chacun sait ici que, parmi les déterminants de la santé, le facteur comportemental joue un rôle important. C’est pourquoi M. Robert Sirkosky Gordon a proposé une définition plus globale de la prévention. Ainsi, il distingue la « prévention universelle », destinée à l’ensemble de la population et qui rassemble les grands principes, la « prévention orientée », qui privilégie un groupe de population ayant un risque plus élevé, et la « prévention ciblée », tournée vers ce groupe de population et qui correspond à l’éducation thérapeutique.
M. Didier Tabuteau, auditionné par la mission, a, pour sa part, proposé une autre approche intéressante qui classe également la prévention en trois catégories : la prévention non médicalisée qui recouvre les actions portant sur les comportements et visant à réduire les facteurs de risques liés notamment au travail et aux transports, la prévention médicalisée qui passe par les acteurs de santé et repose sur des actions non techniques comme l’éducation à la prévention et des actions techniques, telles que le dépistage ou les analyses biologiques, et, enfin, les soins qui peuvent intégrer une composante préventive. Il faut donc retenir l’idée d’un capital santé qu’il convient de préserver en agissant sur les déterminants qui sont, bien entendu, fort nombreux, comme l’environnement, les transports ou encore l’alimentation.
Il est commun de considérer la prévention comme un investissement qui permettrait des économies. En réalité, si elle améliore l’état de santé et contribue à préserver des vies, la plupart des économistes considèrent qu’elle n’entraîne pas automatiquement des économies mesurables. Dans un premier temps, elle peut même créer des dépenses supplémentaires.
Tout au long de nos auditions, nous avons retrouvé les défauts dénoncés par la Cour des comptes, au premier rang desquels figure l’absence de priorités clairement définies. La loi de santé publique d’août 2004 a constitué un réel progrès mais elle a retenu une centaine d’objectifs quantifiés, sans véritable hiérarchisation. À ceux-ci se sont ajoutés de multiples plans de santé, une trentaine au minimum. Chacun de ces plans a pour but de répondre à une question estimée, sur le moment, très urgente mais souvent sans les moyens humains et financiers suffisants, exception faite, sans doute, des plans Cancer et Alzheimer. Au total, des chevauchements regrettables s’accumulent.
Ensuite, nous avons constaté que de multiples intervenants proposaient certes des actions intéressantes mais modestes et surtout sans coordination et sans pilotage.
Intervient tout d’abord l’État qui, en principe, fixe les grandes orientations, la politique de santé publique relevant de ses missions régaliennes. Mais, en son sein, plusieurs ministères sont concernés : le ministère de la santé, tout d’abord, avec ses trois directions qui peuvent être concurrentes, mais aussi le ministère du travail, ceux de l’éducation nationale, de l’environnement, des transports, ou de l’agriculture, chacun défendant son territoire. Dans la description de ce paysage, on ne saurait omettre de mentionner de nombreuses agences sanitaires.
Les collectivités territoriales interviennent également. Les conseils généraux se sont vu attribuer des compétences par les lois de décentralisation de 1983 en matière de vaccination, de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et de dépistage des cancers. Même si la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a opéré, à l’inverse, un transfert de ces missions vers l’État, certains départements ont choisi de conserver certaines compétences comme la vaccination. En tout état de cause, la protection maternelle et infantile et l’aide à l’autonomie des personnes âgées sont restées dans le champ de compétence des départements.
Les communes jouent un rôle important. Le maire exerce un pouvoir de police sanitaire. Les communes peuvent intervenir par l’intermédiaire des cantines scolaires, participent au programme Nutrition santé, assurent le soutien des associations ainsi que la préparation et la mise en œuvre des contrats locaux de santé signés avec les agences régionales de santé.
Le troisième intervenant dans le domaine de la prévention est bien entendu l’assurance maladie qui intervient par le biais du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS). La convention signée entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés prévoit ainsi cinq objectifs : accroître la participation aux programmes de dépistage organisé du cancer, faire progresser la couverture vaccinale, renforcer les actions dans le domaine bucco-dentaire pour les enfants, prévenir l’obésité et lutter contre les dépendances.
La Mutualité sociale agricole, qui possède son propre fonds de prévention, organise des examens périodiques par tranche d’âge et insiste sur les risques professionnels encourus par les agriculteurs, comme le tétanos, les pesticides et le cancer de la peau.
Les complémentaires santé, de leur côté, proposent des actions de prévention très intéressantes, prévues notamment dans des contrats collectifs concernant certaines professions, comme les boulangers et les métiers du bâtiment, ou axées sur certaines pathologies, telles que le diabète ou l’asthme. Mais, ces complémentaires sont confrontées à la durée limitée de leurs contrats, en moyenne sept ans, et à la difficulté d’obtenir, auprès de l’assurance maladie, des données de santé.
Les professionnels de santé jouent également un rôle essentiel. Les médecins sont au cœur de la prévention. Au cours du colloque singulier avec le patient, la consultation mêle le curatif et le préventif. Ainsi, 25 % à 35 % de l’activité du médecin dit « de premier recours » serait consacrée à des actes relevant de la prévention primaire ou secondaire. La mise en œuvre de la nouvelle convention médicale signée avec l’assurance maladie prévoit ainsi une rémunération en fonction d’indicateurs liés à la prévention et au dépistage.
Les dentistes participent notamment à la campagne « M’T dents » et les pharmaciens contribuent à l’éducation thérapeutique et proposent des conseils de prévention. Ce rôle sera mieux reconnu grâce à l’adoption, dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale, d’une disposition prévoyant un nouveau mode de rémunération pour cette activité. Les autres professionnels, infirmiers ou kinésithérapeutes, prennent également une part importante aux actions de prévention.
Enfin, de nombreuses associations contribuent elles aussi à la prévention par l’entremise de deux réseaux principaux : les comités départementaux d’éducation à la santé (CODES), regroupés au niveau régional en instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (IREPS), et les observatoires régionaux de santé (ORS). Mais il ne faut pas oublier les associations spécifiques et les associations de patients, notamment la Ligue nationale contre le cancer, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ou encore AIDES.
Force est de constater que les intervenants sont multiples, et que la coordination est faible.
La Cour des comptes a par ailleurs estimé les dépenses consacrées à la prévention entre 1 milliard et 10 milliards : la fourchette est donc large.
Devant ce manque de pilotage, un espoir apparaît cependant depuis la création, en 2009, des agences régionales de santé. Celle-ci avait pour but principal de revenir sur la coupure absurde qui prévalait alors, entre la prévention et le soin, la ville et l’hôpital, le sanitaire et le médico-social, et d’instituer un responsable unique de la santé au niveau régional. La commission de coordination permet d’ailleurs de réunir à cet échelon territorial tous les acteurs chargés de la prévention.
Cependant, la mise en place des agences régionales a été difficile, car il a fallu résoudre des problèmes organisationnels, notamment en intégrant des personnels à statuts différents, tandis que le partage des compétences avec l’assurance maladie a été incomplètement clarifié.
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été construit avec des enveloppes « fléchées », alors que des objectifs régionaux des dépenses d’assurance maladie (ORDAM), sous forme d’enveloppes globales déléguées, auraient dû être la conséquence logique de la création des agences régionales.
Les conférences régionales de santé et de l’autonomie vont sans doute jouer demain un rôle plus important, même si elles n’ont qu’un rôle consultatif.
Pour pallier ces difficultés, la MECSS fait trente-six recommandations que vous trouverez en annexe du rapport. Je ne les développerai pas toutes mais je souhaiterais néanmoins insister sur certaines.
Tout d’abord, je soulignerai la nécessité d’élaborer une nouvelle loi quinquennale de santé publique, qui fixerait un nombre limité de priorités, et d’en prévoir l’évaluation. Quatre priorités paraissent essentielles à la MECSS : la lutte contre l’alcoolisme qui fait 50 000 morts par an, la lutte contre le tabagisme qui occasionne 60 000 morts par an, la lutte contre l’obésité et la lutte contre la sédentarité.
Un débat d’orientation devrait être organisé, au printemps, au Parlement sur les priorités de santé à partir des observations des conférences régionales de santé et de l’autonomie, les moyens afférents étant examinés lors de la discussion, à l’automne, du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Un pilote ayant de réels pouvoirs sur l’ensemble des intervenants doit être clairement identifié. Il ne peut s’agir que d’un délégué interministériel rattaché au Premier ministre, nommé en conseil des ministres, ayant ainsi autorité sur tous les ministères. Les missions aujourd’hui assurées par le secrétaire général du comité de pilotage des agences régionales de santé seraient transférées à ce nouveau délégué interministériel.
Ainsi, nous disposerions de réelles priorités de santé publique hiérarchisées, de moyens financiers et d’un pilote responsable.
D’autres préconisations nous semblent également importantes.
Pour mener à bien sa mission, le délégué interministériel pourrait s’appuyer sur l’Institut national de la prévention et de l’éducation pour la santé (INPES), dont les missions seraient, elles aussi, élargies pour en faire une véritable agence nationale de la prévention qui mènerait des actions de promotion et d’éducation à la santé et évaluerait les expérimentations menées au niveau local pour, le cas échéant, les généraliser.
La MECSS recommande de favoriser l’échelon local, le plus à même d’agir au plus près des besoins de la population. Pour ce faire, en premier lieu, la mission d’évaluation des expériences locales et de coordination confiée aux agences régionales de santé devrait être renforcée. Ce pilotage territorial passerait, en deuxième lieu, par un rôle accru dévolu aux conférences régionales de la santé et de l’autonomie. Elles définiraient leurs priorités avec l’aide des observatoires régionaux de santé et transmettraient leurs propositions à la Conférence nationale de santé. Les membres de celle-ci seraient issus des conférences régionales de la santé et de l’autonomie. La conférence nationale serait chargée d’élaborer une synthèse qui serait proposée au Parlement lors du débat d’orientation sur les priorités de santé publique.
Une politique de prévention digne de ce nom ne pourrait se concevoir sans intégrer deux composantes essentielles : la santé scolaire et la santé au travail. Ces deux domaines sont aujourd’hui insuffisamment pris en compte. Certaines des personnalités auditionnées par la mission ont même indiqué que la médecine scolaire était « en déshérence ».
C’est pourquoi la MECSS préconise de favoriser une plus grande transversalité entre la médecine du travail, la médecine scolaire et les politiques de santé publique.
Le médecin du travail devrait établir un document qui préciserait les risques que peut comporter le poste de travail, ce document étant transmis au médecin traitant. Quant au médecin scolaire, il devrait transmettre à ce dernier les conclusions relevées à l’occasion des visites médicales obligatoires.
Il est indispensable de revaloriser la fonction de médecin du travail en confortant son indépendance. De même, il est nécessaire de revaloriser les professionnels, médecins et infirmières, de la médecine scolaire.
Une « instruction sanitaire », pour reprendre les termes de M. Didier Tabuteau, obligatoire serait mise en place durant la classe de CM2 et concentrée sur les grands facteurs de risques. Les enseignants seraient encouragés à participer à ces actions.
Par ailleurs, la coordination entre tous ces acteurs nécessiterait une plus grande fluidité dans les échanges de données.
Les missions de l’Institut des données de santé seraient élargies pour qu’il puisse collecter et héberger les données de santé anonymisées qui lui seraient transmises de manière obligatoire et ainsi les communiquer à tous les acteurs.
Il importe de favoriser les échanges de données entre médecins, que ce soit le médecin scolaire, le médecin du travail, le médecin-conseil ou le médecin traitant, tous soumis au secret médical. Ainsi, le médecin traitant rédigerait chaque année un document de synthèse à l’issue d’une consultation de prévention.
Parmi les autres préconisations, je citerai l’élaboration de consultations de prévention par tranche d’âge sur le modèle de la Mutualité sociale agricole, notamment entre trente-cinq et cinquante-cinq ans, période où apparaissent ou s’accentuent les facteurs de risques, alors même que la personne se sent bien portante, l’élaboration des seuils de facteurs de risques comme le cholestérol ou la tension par les conférences des consensus sous l’égide de la Haute Autorité de santé, ou encore la nécessité de revoir le calendrier des vaccinations et de rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole.
Il serait nécessaire d’instituer sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les fabricants de produits de tabac une taxe dont les recettes seraient affectées à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme, d’interdire les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés qui portent sur des produits alimentaires sucrés, salés et gras durant les programmes à destination des enfants, et de supprimer le conseil dit « de modération et de prévention » qui modère surtout les campagnes contre l’alcoolisme.
Pour prévenir les risques iatrogènes, il faut encourager la prescription à doses administrées. Quant au dépistage du cancer du sein, il convient d’imposer au dépistage individuel les mêmes critères de qualité qu’au dépistage organisé et, pour le cancer colorectal, de remplacer l’hémoccult par le test immuno-histo-chimique.
Quant à l’hypertension artérielle sévère, après sa suppression malencontreuse de la liste des affections de longue durée, il est primordial de veiller à un suivi des hypertendus. Enfin, il conviendrait d’intégrer le collège du Haut Conseil de la santé publique au sein de la Haute Autorité de santé tout en conservant son expertise médicale d’évaluation des stratégies de santé publique.
Pour conclure, il est essentiel de préserver le capital santé en intervenant dès le plus jeune âge et en prenant en compte les déterminants santé.
Nous aurons besoin de définir clairement dans une loi quinquennale de santé publique quelques priorités déclinées au niveau régional et de mettre en place un chef d’orchestre national ayant l’autorité suffisante, sans oublier la nécessité d’une coordination de proximité impliquant tous les acteurs.
Pour terminer, je voudrais remercier mes collègues de la MECSS, les deux coprésidents ainsi que toutes les personnalités que nous avons auditionnées.
M. le président Pierre Méhaignerie. Monsieur Jean-Luc Préel, je vous remercie pour ce rapport passionnant. Celui-ci devrait constituer, notamment pour les élus locaux, un précieux outil d’action dans le domaine de la santé, dont je rappelle qu’elle figure parmi les toutes premières préoccupations de nos concitoyens. Ce document devra donc être largement diffusé. Je n’aurai qu’une observation : peut-être aurait-il pu s’attarder davantage sur les divers niveaux de mise en œuvre de la prévention sanitaire, en tentant de déterminer lequel, des échelons national ou local, est le plus approprié.
M. Pierre Morange, coprésident de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Je pense que nous serons unanimes pour louer la qualité du travail mené par notre rapporteur Jean-Luc Préel. Il s’inscrit ainsi dans la lignée des précédents rapports de la MECSS, adoptés à l’unanimité par ses membres, ce qui fait toute leur force dans la perspective d’une mise en œuvre opérationnelle.
Comme cela a été souligné, la politique de prévention sanitaire se caractérise par une dispersion des acteurs, une mauvaise coordination et un pilotage insuffisant des actions menées. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui avait donné lieu à de nombreux débats lors de son examen, a finalement davantage relevé de la posture que de l’ambition de mettre en œuvre une politique de prévention effective. Il convient aujourd’hui d’élaborer une nouvelle loi de santé publique quinquennale, afin de se doter d’un outil efficace. J’espère donc que les préconisations émises dans le rapport seront effectivement appliquées.
M. Jean Mallot, coprésident de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Nous sommes tous d’accord pour dire que la politique de prévention sanitaire est un sujet important. Mais, une fois cela dit, on constate que peu est fait en la matière… Nous avons été nombreux à insister, au sein de la MECSS, pour que celle-ci se penche sur ce thème d’étude qui nous semblait insuffisamment traité. J’y vois plusieurs raisons. En premier lieu, la prévention sanitaire obéit à un calendrier particulier : les effets des actions de prévention ne se font sentir qu’à long terme, dans un délai de cinq à quinze ans, alors que l’horizon temporel d’un Gouvernement se limite généralement à trois années. Le « retour sur investissement » n’est donc pas immédiat et difficile à mesurer… En deuxième lieu, les acteurs de la prévention sont rarement ceux qui bénéficient de celle-ci, à savoir les organismes payeurs. Enfin, le secteur de la prévention se caractérise par des conflits d’intérêts importants. Ainsi en est-il, par exemple, en matière de nutrition, en particulier celle des enfants, où s’opposent les intérêts respectifs des producteurs, des consommateurs et des diffuseurs ou communicants ; le même constat s’impose s’agissant du tabac.
Le travail de la mission a été précédé par la remise d’une communication de la Cour des comptes qui a permis d’orienter nos travaux. La Cour a souligné combien les actions de prévention sanitaire étaient disparates et mal coordonnées ; elle a déploré qu’un trop grand nombre de priorités ait été fixé, de telle sorte qu’aucune ne soit finalement prioritaire ; elle a enfin signalé les difficultés rencontrées par le système de santé pour détecter, évaluer puis généraliser les bonnes pratiques expérimentées localement.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons réussi à surmonter le cloisonnement généralement effectué entre médecine de ville, médecine du travail et médecine scolaire. Nous avons en effet jugé impensable de traiter de la prévention sanitaire sans évoquer ces deux derniers domaines qui sont particulièrement importants, bien qu’ils n’entrent pas strictement dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale.
Par ailleurs, bien que ce point ne constitue pas le sujet central d’étude de la mission, il me semble que la question de la prévention sanitaire ne peut être dissociée de celle de l’accès aux soins, au sens large, sur l’ensemble du territoire, car les déséquilibres constatés dans le domaine curatif sont reproduits en matière de prévention, certains territoires ruraux et quartiers urbains sensibles étant tout particulièrement démunis.
J’en viens aux préconisations émises par la mission. Certaines peuvent paraître évidentes, mais il est des évidences qu’il est bon de rappeler. Nous devons nous doter, enfin, d’une loi de santé publique dont la prévention constituerait « l’acte premier », en fixant un nombre limité de priorités et en procédant à une évaluation périodique de sa mise en œuvre. La coordination des actions doit être renforcée, en instituant, par exemple, un délégué interministériel rattaché au Premier ministre. Les actions menées doivent en outre être coordonnées avec celles des agences régionales de santé qui constituent un nouvel outil sur lequel on doit s’appuyer. J’ai insisté pour renforcer les préconisations relatives à la médecine du travail et à la médecine scolaire. Il convient de revaloriser ces métiers, ce qui suppose de renforcer leurs moyens mais aussi de leur accorder une plus grande place. D’autres préconisations ont été émises sur lesquelles, n’étant pas médecin, je ne me suis pas forgé d’opinion particulière, en particulier concernant le remplacement du test de l’hémoccult par celui immuno-histo-chimique pour le dépistage du cancer colorectal ; j’accorde toute ma confiance au rapporteur sur ce point.
Je soulignerai enfin deux insuffisances, du rapport, insuffisances qui ne m’ont cependant pas empêché de l’adopter. En premier lieu, il ne va pas assez loin sur certains points. J’ai évoqué la médecine scolaire et la médecine du travail ; il conviendrait, plus largement, de renforcer les moyens permettant de se doter d’une véritable politique de santé publique et de prévention sanitaire. En second lieu, il n’aborde pas suffisamment la question, certes délicate mais essentielle, des modalités de rémunération des actions de prévention qui sont difficiles à appréhender selon la tarification à l’acte.
En conclusion, le rapport qui vous a été présenté constitue un document très important et même indispensable, sur lequel nous devrons à l’avenir nous appuyer pour mettre en œuvre la politique de prévention sanitaire. Cela nécessitera certes une volonté politique ; celle-ci existe dans mon groupe et je puis vous assurer que, si nous sommes portés aux responsabilités, nous donnerons suite au travail qui a été mené, pour mener une politique de prévention sanitaire inscrite dans la durée.
Mme Jacqueline Fraysse. La prévention sanitaire est un sujet extrêmement important, dont nous sommes souvent amenés à débattre. Nous partageons tous le même constat : dans ce domaine, la France est en retard, et des efforts doivent être consentis.
Certes, « mieux vaut tard que jamais ». Permettez-moi néanmoins de regretter que ce rapport ait été si tardif. Je reconnais qu’il résulte d’un travail important, que je tiens à saluer, et qu’il contient des éléments intéressants, tant en ce qui concerne le constat que pour certaines de ses préconisations. Je ne partage toutefois pas l’enthousiasme dont a fait preuve le président de notre commission, car j’estime que ce rapport manque cruellement d’ambition au regard de la situation actuelle.
Certaines propositions méritent certes notre intérêt, comme l’élaboration d’une nouvelle loi de santé publique que nous réclamons dans nos rangs depuis longtemps, la coordination des actions entreprises, l’organisation d’un débat parlementaire sur les orientations retenues en matière de santé publique, un accès et une transmission des dossiers médicaux facilités entre médecins scolaires, médecins du travail, médecins-conseils et médecins traitants, ou encore l’interdiction de messages publicitaires portant sur certains produits alimentaires. Sur ce dernier point, permettez-moi de rappeler que notre groupe, mais pas seulement, a déjà eu l’occasion de déposer des amendements en ce sens et qu’ils ont toujours été rejetés par la majorité… Il est certes tout à fait « sympathique » d’émettre aujourd’hui une telle préconisation, mais encore faudrait-il, lorsque l’occasion en est donnée, y donner suite !
J’estime qu’en réalité, une grande partie des préconisations de la mission s’apparentent à des déclarations d’intention. Ainsi, la proposition d’un développement de la visite à domicile dans les familles en situation précaire dans le cadre de protection maternelle et infantile est évidemment excellente, mais pourquoi un tel dispositif n’existe-t-il pas aujourd’hui ? Où sont donc les moyens humains, en particulier les assistantes sociales, qui permettraient de le mettre en œuvre ? De la même manière, il est proposé de renforcer les missions transversales des agences régionales de santé en matière de prévention sanitaire, mais on sait bien que ces instances travaillent surtout à supprimer des services sanitaires et des hôpitaux et qu’elles consacrent beaucoup moins de moyens à adapter la réponse sanitaire aux besoins de santé.
Ce rapport, catalogue de bonnes intentions, comporte de nombreuses carences et ne propose pas de mesure sérieuse ou ambitieuse pour améliorer la situation. Ainsi en est-il en matière de médecine du travail : rien n’est proposé pour responsabiliser les employeurs et réduire la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Tout au plus préconise-t-on de confier au médecin du travail le soin de rédiger et transmettre au médecin traitant un document précisant les risques éventuels que peut comporter un poste de travail… Quelle sera l’efficacité d’une telle mesure qui vise non pas à supprimer les risques mais simplement à les signaler, d’autant que les dernières réformes ont conduit à fragiliser l’indépendance des médecins du travail à l’égard de l’employeur ? Des insuffisances similaires peuvent être observées en matière de médecine scolaire. Les préconisations émises manquent singulièrement d’ambition au vu de la situation de ce secteur. Je rappelle qu’on ne compte en moyenne qu’un médecin scolaire pour 12 000 élèves et que seulement 62 % des postes de médecins scolaires et 69 % des postes d’infirmiers scolaires sont pourvus. Pourquoi cette situation ? Comment la surmonter ? Le rapport ne donne pas de réponse à ces questions ; il se borne à proposer la suppression des visites médicales des élèves âgés de neuf et douze ans, ce qui me laisse dubitative.
Le rapport est également silencieux sur le subventionnement par l’État de substances dangereuses, en particulier des pesticides qui bénéficient d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, sur les déterminants sociaux qui déterminent le mauvais état de santé ou encore sur les inégalités d’accès aux soins.
Pour toutes ces raisons, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) juge très insatisfaisant ce rapport qui témoigne d’une ambition bien en-deçà de ce que la situation actuelle aurait exigé, notamment en termes de moyens consacrés à la prévention sanitaire. Ses insuffisances sont telles que nous nous sommes abstenus sur l’adoption du rapport.
M. Jean-Pierre Door. Membre de la MECSS, je souhaite faire quelques observations sur le rapport, de grande qualité, qui nous a été présenté. Il résulte d’un travail approfondi ; son analyse est juste ; ses propositions sont pertinentes.
Je rejoins le constat dressé : notre système se caractérise aujourd’hui par la prépondérance des démarches curatives, au détriment de la prévention. Les actions de prévention sont en outre mal organisées, inégalement réparties entre les différents acteurs – caisses d’assurance maladie, mutuelles et collectivités territoriales – et résultent, souvent, davantage d’initiatives associatives que de décisions institutionnelles.
Comme l’a souligné le rapporteur, la communication en faveur de la prévention sanitaire souffre de certaines insuffisances. C’est le cas lorsqu’elle s’adresse aux plus fragiles, mais aussi quand elle est menée en milieu professionnel où la prévention sanitaire est souvent mal perçue et jugée intrusive par les salariés et leurs représentants syndicaux.
Certes, des campagnes de dépistage ont été mises en œuvre à grande échelle, tant par l’État que l’assurance maladie ou les mutuelles. Des expérimentations sont menées. Une politique de lutte contre les risques en milieu professionnel a également été développée. Mais nous n’avons pas atteint les résultats escomptés, sans doute parce que l’on privilégie encore trop l’approche curative par rapport à la démarche de prévention.
Les propositions figurant dans le rapport sont, de ce point de vue, tout à fait intéressantes et doivent être encouragées. Il nous faut valoriser la prévention auprès de nos concitoyens et inventer de nouveaux dispositifs incitatifs. Nous devons viser une mise en œuvre précoce de la prévention sanitaire, non seulement dans le cadre de la médecine de ville mais aussi dans le milieu professionnel ou scolaire. La participation des médecins à la démarche de prévention est à cet égard fondamentale. On pourrait sans doute utilement s’inspirer des expériences suédoise et danoise.
Je conclurai en appelant l’ensemble des membres de la commission à autoriser l’adoption de ce rapport.
M. Bernard Perrut. Ce rapport est intéressant mais j’ai trouvé que certains points développés par le rapporteur étaient assez négatifs et pessimistes. Il parle de résultats décevants, de foisonnements d’actions, de compétences mal identifiées, de confusion, de dilution des responsabilités, de priorités trop nombreuses, d’évaluation malaisée. Si l’analyse est juste, des efforts, sur le terrain, sont faits, en particulier, comme l’a souligné le président Pierre Méhaignerie, par les collectivités territoriales. À côté du rôle de l’État et des départements dans ce domaine, les communes sont directement impliquées dans des actions utiles. La prévention, selon moi, n’est pas seulement l’affaire des pouvoirs publics, c’est aussi la responsabilité de chacun, de chaque citoyen. Une action d’information et de responsabilisation doit être mise en œuvre sur tout le territoire. Les maires sont les mieux placés pour y contribuer à travers, comme vous l’indiquez dans votre rapport, les actions de prévention en direction des jeunes par exemple, actions qui passent par les cantines, l’éducation à la santé faite dans les écoles, ou le programme national Nutrition santé, mis en œuvre par beaucoup de communes. Ces dernières peuvent également négocier un contrat local de santé avec les agences régionales de santé, mettre en place un service communal d’hygiène et de santé qui mène des actions dans les différents quartiers et pour certaines, dont ma ville, créer des maisons des adolescents, en liaison avec les hôpitaux. Ces structures prennent en charge les problèmes de santé des jeunes, en particulier pour répondre à des fragilités psychologiques et au besoin d’accompagnement à des moments importants de leur vie.
Il faut donc valoriser l’action des collectivités locales. La prévention telle que vous la décrivez a pour but d’informer, d’accompagner, de vacciner ou de dépister. Un véritable pilotage est nécessaire. C’est ici que doit se situer le rôle des agences régionales de santé qui doivent élaborer un schéma régional de prévention. Ont-elles déjà commencé à le faire ? Il leur appartient, en effet, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques de prévention.
Mme Michèle Delaunay. Je ne partage pas la satisfaction de Bernard Perrut sur la mise en œuvre des politiques de prévention dans lesquelles l’État, en charge de la santé publique, a un rôle majeur à jouer. Un fait capital ne doit pas être méconnu : notre médecine est en train de basculer. Si les maladies lésionnelles ou infectieuses régressent globalement, les hôpitaux voient se développer des maladies sociétales, comportementales. Elles sont évitables et relèvent de ce fait de la santé publique. Malheureusement la progression de ces pathologies est considérable.
Autre constat, une grande loi de santé publique est évoquée depuis le début de la législature, et en particulier lors de la discussion de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, de même qu’une loi sur la dépendance, nous les attendons encore. Cette dissociation entre le dire et le faire conduit à regretter que ce rapport n’ait pas été plus incitatif.
En matière de santé publique, tout le monde s’accorde sur les propositions, comme celle consistant à favoriser les bons comportements, à repérer et à soutenir les actions utiles, mais ce genre de remarques pourrait figurer dans tous les rapports. Il serait souhaitable de faire des suggestions qui sortent de l’ordinaire.
Par exemple, l’éducation à la santé en milieu scolaire, que vous préconisez, devrait être plus tonique : l’éducation sanitaire et environnementale, qui pour moi est la même chose, devrait être un des savoirs fondamentaux de l’école et ce dès le plus jeune âge, comme c’est le cas dans les pays du Nord.
De même, et je m’oppose parfois sur ce point à certains de mes collègues dans mon propre groupe, il faut savoir transgresser cette règle inscrite dans le code de la santé publique selon laquelle seules les vaccinations et les actes médicaux concernant les maladies infectieuses sont obligatoires. Certains processus de prévention, comme la prévention secondaire et le dépistage, ne touchent que les personnes les mieux informées et n’atteignent donc pas celles auxquelles ils devraient être d’abord destinés. C’est par exemple le cas du suivi et des soins buccodentaires pour les enfants, qui fait consensus contrairement à d’autres.
J’aurais également souhaité que soit davantage soulignée la prévention du vieillissement. Ce n’est bien sûr pas une maladie évitable : ce n’est pas une maladie et le vieillissement est inéluctable. Mais il est possible de prévenir le vieillissement dans de mauvaises conditions, qui malheureusement dépend d’abord du niveau de revenus des personnes âgées.
Le dépistage et la prévention des maladies mentales n’ont pas été évoqués. Or ils doivent être un axe majeur d’une politique de santé publique, les maladies mentales prenant actuellement un caractère pratiquement épidémique.
Dernier point, vous avez rappelé à juste titre la dispersion des initiatives, et il est notoire qu’un grand ministère de la santé publique et de la santé durable ainsi qu’une intégration de ces différentes composantes de la prévention que sont la santé scolaire et la santé au travail seraient nécessaires.
Mme Anny Poursinoff. Je profite du débat sur ce rapport d’information pour vous rappeler celui que j’ai présenté cet automne dans le cadre de mon avis budgétaire sur les crédits de la santé dans le domaine de la prévention et de la sécurité sanitaire. Son audience a été faible parce que nous n’avons disposé que de peu de temps pour le présenter. Or je constatais alors que le budget consacré à ces actions diminuait. J’entends aujourd’hui qu’il faudrait que ce domaine soit prioritaire, alors que votre majorité a adopté ces crédits en baisse. Ce double langage me semble préjudiciable à l’élaboration de politiques de long terme.
Vous souhaitez que l’on vaccine davantage, mais pour cela il faudrait une plus grande confiance des citoyens dans la vaccination, un groupe de travail de députés a d’ailleurs été créé sur ce point. Des inquiétudes demeurent, en particulier sur les adjuvants contenant de l’aluminium qui peuvent avoir un impact sur la santé des personnes se faisant vacciner. Là non plus vous ne faites pas de propositions précises pour redonner confiance dans la vaccination.
S’agissant d’alimentation, vous rappelez qu’il faut responsabiliser les citoyens, nous avions fait dans ce domaine des propositions concrètes qui consistaient à imposer la mention sur les produits un signe de type feu vert, orange ou rouge en fonction de la composition des aliments, propositions qui ont toutes été repoussées. Ce moyen était pourtant simple. L’utilisation de produits « bio » que nous préconisions dans la restauration scolaire, notamment pour les plus petits – l’effet des pesticides étant particulièrement néfaste sur la santé –, n’est pas davantage prise en compte dans le rapport.
Le principe de précaution que nous avons introduit dans notre Constitution ne concerne que l’environnement et non la santé. Je plaide donc pour un élargissement du champ de ce principe. Cette mesure nous éviterait de prendre des décisions sans précaution, comme pour les ondes électromagnétiques, ou l’implantation des centrales nucléaires, alors que le nombre de leucémies augmente autour de ces dernières.
Enfin, je regrette de ne pas trouver dans le rapport des mesures favorisant le rôle de la marche ou du vélo. Plus précisément, rien n’est envisagé pour que nos villes rendent ces activités praticables simplement.
M. le Président Pierre Méhaignerie. Il serait bien que le rapport qui a été distribué soit lu… Et l’État ne peut pas tout imposer. En la matière, Bernard Perrut nous l’a rappelé, place doit être laissée à la responsabilité individuelle.
Mme Anny Poursinoff. Des recommandations pertinentes sont certes présentées, mais qui ne se traduisent pas dans la vie quotidienne de nos concitoyens, à qui on se contente de suggérer qu’il convient de se responsabiliser, sans leur en donner les moyens. Des incitations fiscales existent pour utiliser une voiture ou les transports en commun, pourquoi ne pas, de même, inciter à utiliser un vélo ? Je m’abstiendrai donc sur l’autorisation de publication de ce rapport qui ne présente que des vœux pieux.
M. Yves Bur. Le rapport qui nous est présenté est utile et réaliste. Si, comme le relevait également notre collègue Bernard Perrut, il peut apparaître parfois négatif, il décrit cependant la réalité de la politique de prévention. La question que l’on peut se poser est de savoir s’il n’y a pas trop de « pilotes dans l’avion »… Comment rendre le pilotage plus lisible ? On assiste au déploiement des actions d’une multiplicité d’intervenants qui organisent chacun la prévention dans son secteur. Ce manque de clarté dans le pilotage est bien illustré par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui avait recensé une centaine priorités de santé, autant dire aucune…
Les efforts sont dispersés alors que des priorités sont faciles à identifier. Aujourd’hui, nous savons que ce sont les maladies non transmissibles qui constituent le phénomène le plus critique pour la santé publique dans les pays développés. Dans le monde, elles représentent également plus de pathologies et de décès que les maladies infectieuses. Les progrès de l’hygiène, la lutte contre les épidémies portent leurs fruits. Les maladies que nous devons combattre sont maintenant celles du comportement de vie.
Ces maladies inscrites dans les affections de longue durée vont constituer 70 % des remboursements de l’assurance maladie en France, ce qui va poser un vrai défi financier. Il est donc nécessaire d’étudier les facteurs à l’origine des maladies non transmissibles. Ce fut l’objet d’un sommet des Nations Unies, au mois de novembre dernier je crois. Le tabac, l’alcool et la mauvaise alimentation sont apparus comme les facteurs les plus négatifs. Là doit se situer notre action. La lutte contre le tabagisme donne des résultats à l’horizon des dix ou quinze prochaines années, ce qui n’est pas une durée du même ordre que celle du temps politique. C’est aussi le cas des actions contre la surconsommation d’alcool. Les répercussions de la prévention en matière de comportements alimentaires sont également visibles sur le long terme. Les questions d’alimentation, le surpoids ou l’obésité sont aux États-Unis des facteurs de mort prématurée qui commencent à avoir un impact sur l’espérance de vie.
Jean-Luc Préel l’a souligné, il faut mettre en place un vrai pilotage de la prévention au niveau national, sur un plan interministériel. C’est nécessaire, sans créer de nouvelles structures mais en redéployant l’existant pour le rendre plus efficace. Les problèmes d’alimentation relèvent en effet de la santé mais aussi de l’agriculture qui en a aujourd’hui la responsabilité principale, de l’Éducation nationale ou de la politique familiale. Un pilotage interministériel serait donc parfaitement utile.
La volonté politique pourra se traduire à travers cette nouvelle organisation régionale que sont les agences régionales de santé qui sont au commencement de leur fonctionnement. Les plans régionaux de santé seront adoptés dans les prochains mois. Les agences régionales devront donc devenir le pilote interministériel régional, permettant une mise en phase des politiques de prévention menées par les différents acteurs. Quel sens aurait, en effet, une action des communes sur certains déterminants de santé ou les maladies non transmissibles si, par ailleurs, le citoyen usager de santé est au cours de sa vie pris en charge par la médecine scolaire, la protection maternelle et infantile, la médecine du travail, le médecin de famille. Un pilotage médical devra donc également se mettre en place à ce niveau.
Pour conclure, je regrette simplement que ce rapport, utile, présente trente-six pistes, ce qui me semble encore beaucoup et insuffisamment hiérarchisé.
M. le Président Pierre Méhaignerie. Le rapporteur a cependant dégagé trois ou quatre priorités les plus importantes.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je confirme que ce rapport était évidemment attendu et indispensable. Je regrette simplement qu’il arrive un peu tard en cette fin de législature. Je remercie en tout cas notre collègue Jean-Luc Préel pour ce travail, auquel il tenait beaucoup et qui nous permet d’avoir ce débat ce matin.
J’insisterai pour ma part sur le fait que la prévention sanitaire dans notre pays est le « parent pauvre » de la santé publique. Nous l’avons d’ailleurs souligné à maintes reprises au cours des débats menés sur certains textes depuis cinq ans, de même que nous avons demandé l’élaboration d’une grande loi de santé publique. Aujourd’hui, nous constatons une absence de pilotage sur le territoire alors que les intervenants sont nombreux.
De façon plus précise, je souhaiterais revenir sur deux points : la protection maternelle et infantile et la santé scolaire. S’agissant de la protection maternelle et infantile, des difficultés sont constatées dans tous les départements, comme l’ont souligné de nombreux rapports et différents experts. Beaucoup de familles ne mesurent pas l’importance de la prévention. La question se pose de savoir comment mieux toucher les jeunes parents ou les futures mamans. Ce point a été évoqué lors d’une des premières auditions de la mission. Les propositions sur ce sujet mériteraient d’être renforcées.
Par ailleurs, dans le cadre de la protection maternelle et infantile et de la médecine scolaire, la question du dépistage se pose. On a besoin de dépister plus tôt les troubles des très jeunes enfants en matière de vision, d’audition, de langage ou d’autres types de handicap. Certains enfants seront sujets à des handicaps plus lourds simplement parce que leurs difficultés n’auront pas été détectées à temps et qu’ils n’auront pas fait l’objet d’un suivi. Une volonté affichée est nécessaire pour dépister et faire fonctionner la protection maternelle et infantile et la médecine scolaire. Encore faut-il qu’il y ait suffisamment de personnel pour assurer ces missions, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Il y a dans tous les départements des organismes tels que les centres médico-psycho-pédagogiques ou d’autres instances, qui très souvent ne peuvent pas organiser leurs missions de manière partagée. Il serait bon de dépasser les frontières entre ces différentes entités.
Il est enfin nécessaire de rapprocher les intervenants et les dispositifs médicaux des lieux de vie sur les territoires. Nous savons que certaines personnes aujourd’hui renoncent aux soins ou les diffèrent. Il est donc important, en matière de prévention, d’intervenir de manière plus organisée et plus forte. Plusieurs propositions du rapport vont certes en ce sens. Mais il faut une politique très forte. On ne saurait se contenter de propositions qui risqueraient de rester au stade des intentions. Des trente-six propositions contenues dans le rapport, il serait bon de mettre quelques-unes plus particulièrement en exergue, en insistant sur la nécessité d’une intervention dès le plus jeune âge.
Mme Catherine Lemorton. Je ne reviendrai pas sur le manque d’une loi de santé publique. Concernant le plan Santé Jeunesse de février 2008 présenté par Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de la santé, nous n’en avons pas vu le commencement.
S’agissant de la proposition n° 12 du rapport, qui vise à mettre l’accent, dans un souci de rationalisation, sur les visites médicales des élèves âgés de six ans et quinze ans et, en conséquence, à supprimer les visites des élèves âgés de neuf et douze ans, il me semble que le suivi scolaire devrait commencer dès l’âge de trois ans, ce qui permettrait de limiter les inégalités sociales.
Quant à la proposition n° 15, elle a pour ambition de prévenir les risques iatrogéniques en encourageant la prescription de doses administrées. À ce sujet, j’aimerais que les industries de la santé réfléchissent sur les doses pédiatriques pour éviter certains accidents.
Enfin, je rappelle que, dans le cadre de la discussion de l’article 33 de la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, la présente majorité a refusé d’intégrer l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé dans le groupement d’intérêt public nouvellement créé pour recueillir les données de santé de l’assurance maladie. Or, la proposition n° 5 du présent rapport inclut cet institut dans la politique de santé publique. C’est incohérent. En tout cas, nous avions raison : l’institut national avait bien sa place dans le groupement d’intérêt public.
M. le rapporteur. Je n’ai jamais dit le contraire.
M. Christophe Sirugue. Je tiens à souligner l’intérêt de ce rapport. Cela dit, je me concentrerai sur la proposition n° 35 qui s’inscrit dans la lutte contre les inégalités. Elle fixe comme objectif de favoriser l’égal accès à la prévention sur tout le territoire en assurant une présence médicale équilibrée. Je m’étonne que le rapport ne mette pas plus en avant les difficultés d’accès aux soins et les difficultés de la prévention en faveur des personnes en situation d’exclusion. Il ne s’agit pas seulement des personnes sans domicile fixe mais également de ceux qui renoncent de manière substantielle aux soins. Si je partage beaucoup de préconisations énoncées dans ce rapport, en revanche il me semble qu’il y a là un manque, notamment en termes de mobilisation de moyens.
Je voudrais aussi faire deux remarques concernant des décisions prises récemment. Des restrictions ont été mises en place concernant l’accès à l’aide médicale de l’État. La mise en place du droit de timbre a provoqué un moindre recours à l’offre de soins, notamment pour des pathologies particulièrement infectieuses. Ceci fait peser des risques sur la santé publique.
Par ailleurs, les moyens des centres d’examens de santé ont été diminués. Or, ce sont précisément des lieux où la population défavorisée, notamment ceux qui renoncent aux soins, pourraient trouver des éléments importants de prévention.
La prise en charge de ces personnes en précarité est indispensable pour éviter la recrudescence de certaines pathologies, notamment celles qui sont particulièrement transmissibles.
Je souligne que nous parlons ici de charges financières importantes. Le rapport que nous avions publié sur l’aide médicale de l’État montrait que, plus les gens arrivaient tard à l’hôpital, plus cela coûtait cher à la collectivité. La notion d’investissement est donc déterminante.
M. Roland Muzeau. Je ne vais pas reprendre les propos de notre collègue Jacqueline Fraysse, que je partage entièrement. J’ai une préoccupation récurrente, concernant la santé au travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Nous sommes fort éloignés de ce qu’il conviendrait de faire en la matière. Ce sujet est toujours relégué, comme par hasard, à la fin de la discussion des projets de lois de financement de la sécurité sociale. Un ministre s’était engagé à aborder ce sujet beaucoup plus tôt dans les débats. Toutefois, en pratique, cela n’a jamais été fait.
Les problématiques de reconnaissance de certaines pathologies liées aux maladies professionnelles et des effets de certains produits toxiques sur la santé me semblent essentielles. Je regrette qu’elles ne soient traitées dans ce rapport qu’au détour d’une phrase sur les médecins du travail et la nécessité de transmettre ce type d’information. On est loin du compte.
Mme Martine Pinville. La proposition n° 13 du rapport incite à revaloriser les métiers de la santé scolaire. Avec notre collègue Gérard Gaudron, j’ai travaillé sur ce sujet, dans le cadre d’un rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Il faut déplorer la faiblesse du nombre de médecins et d’infirmières scolaires, relevée par le rapport. Je rappelle par ailleurs qu’un médecin scolaire en début de carrière est moins bien rémunéré qu’un interne. Plus encore que la rémunération, c’est la place de la médecine scolaire qui doit être revue. Plus généralement, j’invite à réfléchir à la mise en place d’un corps de médecins de santé publique dédiés à la prévention.
M. Jean Bardet. À mon tour, je voudrais féliciter le rapporteur pour ce rapport riche et très intéressant. Comme cela est mentionné dans son introduction, la prévention a été longtemps le « parent pauvre » de la médecine car elle n’était pas prise en charge par la sécurité sociale.
En tant que médecin, je suis très attaché à la prévention, mais il serait fallacieux de croire que celle-ci pourrait permettre des économies. N’oublions pas que nous sommes tous mortels et que nous dépensons au cours de la dernière année de notre vie 50 % à 90 % du total de nos frais de santé.
Les causes de mortalité se divisent en trois groupes d’importance à peu près égale : les maladies cardiovasculaires, les cancers et les autres pathologies. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas prises en compte en tant que telles dans ce rapport. Certes, on parle du tabagisme, de l’obésité ou encore de l’hypertension artérielle. Je partage l’interrogation du rapporteur sur le fait que l’hypertension artérielle ne soit plus prise en charge à 100 % car c’est un facteur important de maladie cardiovasculaire. S’agissant du cancer du sein, le rapport l’évoque en mentionnant toutes les précautions qui s’attachent au résultat du dépistage. Il cite aussi le cancer de la prostate avec la même circonspection et celui du col de l’utérus, mais il omet un autre type de cancer, pour lequel le dépistage est possible : le cancer cutané.
Dans les conclusions, il n’est pas fait de propositions réelles, sauf pour le cancer colorectal. Pour le cancer du sein, il s’en tient au statu quo. Pour le cancer de la prostate et pour le cancer du col de l’utérus, aucune proposition n’est faite.
Parmi les maladies infectieuses, je n’ai pas vu mentionnée, ou en tout cas pas suffisamment mise en lumière, la question du SIDA. Pour les jeunes, c’est capital.
Pour ce qui est du dossier médical personnel, le rapport consacre un encadré à ce sujet. Il parle de la loi d’août 2004, mais pas de l’amendement voté l’année dernière à la proposition de loi de loi déposée par M. Jean-Pierre Fourcade modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, permettant d’établir un dossier médical personnel sur un support amovible. Cette disposition nécessitait, pour être appliquée, des décrets qui devaient être publiés avant le mois de décembre 2011. On attend toujours ces décrets. Si le dossier médical personnel voyait enfin le jour, ce serait un élément important en termes de coordination entre les médecins et un moyen de prévention notamment des maladies iatrogéniques.
M. Dominique Tian. Je voulais souligner d’abord l’excellent travail accompli.
Sur le fond, nous avons fait le constat ce matin que la médecine scolaire était un échec. Pour en trouver la cause, il faut remonter à l’époque des discussions qui ont présidé à l’adoption de la loi du 13 août 2004 sur la décentralisation. J’avais plaidé pour que ce soit les régions ou les départements qui assument la charge de la médecine scolaire. Les syndicats ont refusé cette décentralisation et le transfert du personnel. Il n’y a pas eu de liberté de choix : on a décidé que les médecins et les infirmières scolaires resteraient de la compétence de l’État. Aujourd’hui, la situation est dramatique. Or, nous sommes confrontés à un taux particulièrement élevé de suicide chez les adolescents. Je dis à l’opposition qu’elle n’arrête pas de plaider pour la décentralisation mais qu’elle n’en tire pas les conséquences, en se focalisant non sur la santé des enfants mais sur les exigences syndicales.
Ce rapport relève l’absence de pilotage. Il est vrai qu’on n’a pas suffisamment rapproché la population des moyens de prévention. Mais cela n’a pas de sens de rechercher un seul pilote au niveau national. Cela ne fonctionnerait pas mieux.
Il y a quelque chose d’autre qui manque. La proposition n° 18 vise à charger le médecin traitant d’élaborer un document médical de synthèse annuel pour chaque patient qui pourrait être transmis aux autres médecins. S’agit-il de la dernière version officielle du dossier médical personnel ? S’agit-il de reprendre la proposition de loi relative à l’expérimentation du dossier médical sur support numérique portable que j’avais cosignée avec nos collègues Jean-Pierre Door et Pierre Morange et qui a été reprise dans la loi issue de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Fourcade ? Il s’agit de permettre aux professionnels de santé de partager l’information plutôt que de confier celle-ci au seul médecin traitant. J’aurais aimé que ceci soit mentionné dans le rapport.
Mme Bérengère Poletti. Un sujet aussi important et aussi vaste que la politique de prévention aurait sans doute nécessité un délai d’examen plus long que trois mois : le rapporteur a donc dû privilégier certains thèmes et cette situation explique que certains points restent peu développés. L’éducation à la santé doit être encouragée dans les écoles et dans les familles dès le plus jeune âge. Des mesures de bon sens, comme le simple fait de ne pas fumer en présence d’un enfant ou le fait de se laver les mains avant de passer à table, ne semblent plus être appliquées aujourd’hui dans toutes les familles et dans tous les établissements scolaires. S’agissant du dossier médical personnel, je partage l’avis de Dominique Tian, il est regrettable que la mesure qu’il a proposée ne soit toujours pas mise en œuvre tant les lacunes en matière de transmission de l’information entre professionnels de santé sont patentes. Le rapport aurait aussi pu évoquer la prévention de la dépendance, car il s’agit d’une problématique essentielle. Des mesures d’adaptation de l’habitat pourraient être utilement préconisées. D’autres sujets auraient aussi pu être développés : l’impact de l’environnement sur la santé – le plan national Santé environnement, qui fait l’objet d’un groupe de suivi que je préside, témoigne de l’importance de ce sujet – l’éducation à la sexualité, l’accès à la contraception et la prévention des grossesses non désirées ou les maladies sexuellement transmissibles…
M. Gérard Bapt. Le rapport propose de mettre en place un délégué interministériel à la prévention sanitaire rattaché au Premier ministre. Il serait chargé d’assurer le pilotage administratif et de coordonner les actions entre tous les acteurs et il exercerait également les missions aujourd’hui confiées au secrétaire général du comité de pilotage des agences régionales de santé. Je me demande si l’allocation des ressources permettrait de confier à ce délégué interministériel les missions aujourd’hui dévolues aux agences régionales de santé. Une telle réforme serait opportune car la politique de prévention constitue actuellement la variable d’ajustement des budgets de ces agences. Ainsi, dans la région Midi-Pyrénées, les effectifs affectés à cette politique ont diminué d’un tiers. Se pose aussi la question du rétablissement de la confiance vis-à-vis de la vaccination à la suite de la pandémie grippale H1N1. J’ai interrogé le directeur général de la santé sur une proposition formulée par Jean-Pierre Door dans son rapport sur la gestion de cette maladie et qui concerne la suppression du Comité national de lutte contre la grippe, créé dans la plus grande discrétion auprès de la direction générale de la santé. Ce comité a-t-il disparu ou a-t-il été intégré au Haut Conseil de la santé publique ? Je tiens aussi à souligner le manque de volontarisme politique en matière de lutte contre le tabagisme comme en témoigne l’augmentation de la consommation de tabac chez les adolescents depuis trois ans. On peut regretter que la taxe sur la valeur ajoutée sociale ne s’applique pas au tabac puisque les droits d’accises vont être réduits : cela aurait permis de dégager des fonds non négligeables en faveur des politiques de prévention. Enfin, je regrette que l’expérimentation du dossier médical partagé sur un dispositif de type clé USB, adopté à l’initiative des plusieurs parlementaires de la majorité, n’ait pas encore été mise en œuvre. Pas un seul décret d’application n’a, pour l’instant, été adopté. Cela témoigne d’un grand mépris du Gouvernement à l’égard du Parlement et même de sa majorité. Alors que certains sites très sécurisés, à l’instar du Pentagone, font actuellement l’objet d’attaques informatiques, la mise en place d’un tel support serait de nature à limiter la centralisation des données et donc à éviter d’éventuelles modifications de ces données par des pirates informatiques. Le recueil des données serait limité au seul médecin traitant.
Mme Véronique Besse. Les associations qui, dans chaque département, sont chargées de l’organisation du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal font un travail essentiel. Ces associations qui réunissent notamment des élus, des professionnels de santé et des représentants des caisses primaires d’assurance maladie, ne bénéficient que de moyens financiers limités alors même que la communication dans ce domaine est essentielle pour vaincre les réticences des personnes concernées à l’égard de ce dépistage et que d’autres maladies feront très certainement l’objet de telles campagnes dans les années à venir.
M. Dominique Dord. Je suis surpris, lorsqu’on évoque la prévention sanitaire, qu’on n’aborde pas la question du « bien vieillir » qui est pourtant au cœur de notre société. En tant que maire d’une ville thermale, je pense que le travail effectué auprès de nos compatriotes âgés, notamment dans le cadre des cures thermales, a un impact important en matière de prévention sanitaire.
M. le rapporteur. Je tiens, en premier lieu, à rappeler que la mission a disposé d’un temps limité alors que le thème de la prévention est particulièrement vaste. Cependant, la lecture du rapport et du compte rendu des nombreuses auditions vous permettra de constater que les sujets que vous avez évoqués ont tous été abordés. La question du « bien vieillir » est notamment évoquée au travers de la question du « bien vivre » et de l’expérimentation menée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, dénommée « Santé active » et qui sera étendu à d’autres caisses primaires. Par ailleurs, je regrette le retard pris pour mettre en place le dossier médical partagé sur clé USB. Cela améliorerait grandement la transmission de l’information entre professionnels de santé. À titre d’exemple, lors de son audition, le docteur Leicher, représentant du syndicat MG France, a notamment proposé que le médecin traitant fasse, chaque année, une synthèse sur la santé du patient à destination du médecin du travail et que ce dernier transmette au médecin traitant des éléments sur les risques d’exposition au poste. S’agissant de la médecine scolaire, je partage, à titre personnel, le constat de Dominique Tian : la médecine scolaire est aujourd’hui peu développée, alors que l’éducation sanitaire est primordiale dès le plus jeune âge. Un transfert de la responsabilité de la gestion des médecins et des infirmières concernés aux collectivités territoriales serait de nature, j’en suis convaincu, à améliorer l’efficacité de cette médecine.
La politique de prévention est aujourd’hui le « parent pauvre » de la politique de santé en raison d’une culture française davantage tournée vers le « curatif » mais aussi en raison de la multiplicité des acteurs, des lacunes dans le pilotage de cette politique et du manque de priorités. C’est pourquoi, je propose une nouvelle loi de santé publique qui comprendrait quatre priorités et dont la mise en œuvre serait régulièrement évaluée. De même, le pilotage national et régional de la politique de prévention doit être réformé. Au niveau national, la création d’un délégué interministériel, rattaché au Premier ministre et ayant capacité à agir sur l’ensemble des ministères, me semblerait de nature à faire de la politique de prévention une priorité. La direction générale de la santé n’a pas aujourd’hui une telle capacité interministérielle. Au niveau régional, les agences régionales de santé permettent de réunir tous les acteurs dans les commissions de coordination. Une fois les priorités de la politique de prévention définies et le pilotage réformé, je pense que cette politique pourra être déclinée dans différents secteurs comme la médecine scolaire, la médecine du travail ou les déterminants de santé… J’espère que la prochaine législature verra la mise en œuvre des préconisations de cette mission ; les deux coprésidents de la MECSS y veilleront très certainement.
La Commission autorise à l’unanimité le dépôt du rapport d’information sur la prévention sanitaire en vue de sa publication.
ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION
Présidents
M. Jean Mallot (SRC)
M. Pierre Morange (UMP)
Membres
Groupe UMP
M. Georges Colombier
M. Rémi Delatte
M. Jean-Pierre Door
Mme Bérengère Poletti
M. Dominique Tian
Groupe SRC
Mme Gisèle Biémouret (depuis le 14 octobre 2011)
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Mme Marie-Françoise Clergeau
Mme Catherine Génisson (jusqu’au 30 septembre 2011)
Mme Catherine Lemorton
Mme Marisol Touraine
Groupe GDR
Mme Martine Billard
Mme Jacqueline Fraysse
Groupe NC
M. Claude Leteurtre
M. Jean-Luc Préel
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Pages
AUDITION DU 13 OCTOBRE 2011
– M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître, et Mme Carole Pelletier, rapporteure 113
AUDITIONS DU 20 OCTOBRE 2011
– M. Didier Tabuteau, conseiller d’État, responsable de la chaire Santé de Sciences Po et du Centre d’analyse des politiques publiques de santé de l’École des hautes études en santé publique 125
– M. Hubert Allemand, professeur de santé publique, médecin-conseil, adjoint au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, et Mme Catherine Bismuth, directrice des assurés à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, en charge du dossier prévention 133
– M. Laurent Chambaud, inspecteur général des affaires sociales 141
– MM. les professeurs Michel Huguier et Gérard Dubois, académiciens, membres de l’Académie nationale de médecine 146
AUDITIONS DU 3 NOVEMBRE 2011
– Mme Évelyne Baillon-Javon, directrice du pôle Prévention et promotion de la santé de l’agence régionale de santé de l’Île-de-France, et M. Laurent Chambaud, directeur de la santé publique, Mme Marie-Sophie Desaulle, directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, et M. Christophe Duvaux, directeur général adjoint, chargé de la direction de la prévention et de la promotion de la santé, et Mme Zeina Mansour, directrice du comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 155
– M. Stéphane Lévêque, président de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et M. Patrick Negaret, directeur 171
– Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales 180
AUDITIONS DU 10 NOVEMBRE 2011
– Mme Évelyne Guillet, directrice Santé du Centre technique des institutions de prévoyance, Mme Miriana Clerc, directrice Communication et relations extérieures, M. David Giovannuzzi, directeur des accords collectifs-pôle alimentaire d’AG2R La Mondiale, et M. Philippe Quique, directeur du développement services santé, et Mme Isabelle Hébert, directrice Stratégie et marketing, santé et prévoyance du Groupe Malakoff Médéric, Mme Marika Lefebvre, responsable du pôle Prévention-promotion de la santé à la direction de la santé de la Fédération nationale de la mutualité française, Mme Isabelle Millet-Caurier, directrice des affaires publiques, M. Vincent Figureau, responsable du département des relations institutionnelles nationales, et Mme Annabel Dunbavand, conseiller médical à la direction déléguée à la santé, M. Alain Rouché, directeur Santé de la Fédération française des sociétés d’assurances, et M. Jean-Paul Laborde, directeur Affaires parlementaires, M. Laurent Moreau, directeur médical de Groupama, et Mme Catherine Masclet, direction Santé prévoyance d’Allianz 190
– M. Stéphane Seiller, directeur général du Régime social des indépendants, et Mme Stéphanie Deschaume, directrice adjointe de la santé 206
AUDITIONS DU 17 NOVEMBRE 2011
– MM. Pierre Chirac et Philippe Schilliger, rédacteurs de la revue Prescrire 214
– MM. Yves Bonnet et Bertrand Brassens, inspecteurs généraux des finances, et M. Jean-Luc Vieilleribière, inspecteur général des affaires sociales, coauteurs du rapport sur les fonds d’assurance maladie (juillet 2010) 226
– M. Michel Brault, directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et M. Philippe Laffon, directeur de la santé 237
AUDITIONS DU 24 NOVEMBRE 2011
– M. Dominique Libault, directeur à la direction de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé 248
– M. Jean-Yves Grall, directeur général à la direction générale de la santé au ministère du travail, de l’emploi et de la santé 256
– M. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé, et M. Dominique Maigne, directeur, M. François Bourdillon, président de la commission Prévention, éducation et promotion de la santé du Haut Conseil de la santé publique, chef du pôle Santé publique, évaluation, produits de santé du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, et M. Didier Jourdan, vice-président, et Mme Thanh Le Luong, directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, et Mme Jocelyne Boudot, adjointe à la directrice générale 265
AUDITIONS DU 1ER DÉCEMBRE 2011
– M. Michel Combier, président de l’Union nationale des omnipraticiens français-Confédération des syndicats médicaux de France, M. Roger Rua, secrétaire général du Syndicat des médecins libéraux, M. Claude Bronner, président de l’Union généraliste-Fédération des médecins de France, et M. Claude Leicher, président de MG France 279
– M. Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, Mme Catherine Morel, vice-présidente de l’Union nationale des pharmacies de France, M. Claude Baroukh, secrétaire général de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, M. Claude Dreux, président du Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, et M. Xavier Desmas, membre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens 295
AUDITIONS DU 8 DÉCEMBRE 2011
– M. René-Paul Savary, vice-président de l’Assemblée des départements de France, sénateur et président du conseil général de la Marne, et Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire, et Mme Isabelle Maincion, représentant l’Association des maires de France, maire de La Ville-aux-Clercs, et Mme Marie-Claude Serres-Combourieu, responsable de l’action sociale, éducative, culturelle et sportive 308
– Mme Jeanne-Marie Urcun, médecin, conseillère technique auprès du directeur général de l’enseignement scolaire, et Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, de la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale 319
AUDITIONS DU 15 DÉCEMBRE 2011
– M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine à l’université René Descartes Paris V 327
– Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, et M. Dominique Royère, chef du pôle Stratégie procréation, embryologie et génétique humaine à la direction médicale et scientifique 334
– M. Jean-Claude Étienne, rapporteur de l’avis du Conseil économique, social et environnemental relatif aux enjeux de la prévention en matière de santé 340
– Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, chef de service à la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, Mme Mireille Jarry, sous-directrice des conditions de travail, et Mme Patricia Maladry, responsable de l’inspection médicale 345
AUDITIONS DU 12 JANVIER 2012
– M. Bernard Salengro, secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, et M. Jacques Texier, président du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise, et M. Martial Brun, directeur 353
– M. Bertrand Arnoux, ophtalmologue, membre du réseau de santé CARéDIAB 366
AUDITION DU 17 JANVIER 2012
– Mme Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé 370
AUDITION DU 18 JANVIER 2012
– M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, et Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître 384
ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition de M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, de Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître, et de Mme Carole Pelletier, rapporteure.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur le président, mesdames, nous sommes heureux de vous accueillir pour entendre les conclusions de votre rapport sur « la prévention sanitaire ».
M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes. Au terme de son enquête, la Cour a trois messages à vous transmettre.
En premier lieu, la prévention sanitaire étant multiforme, il n’existe pas de définition rigoureuse de la notion. Certes, une définition de la politique de prévention a été arrêtée par la loi il y a quelques années, mais elle a été remise en cause depuis lors. Nous en rappelons toutefois les termes dans l’introduction de notre rapport, dans la mesure où le périmètre ainsi circonscrit est à la fois vaste et relativement précis. Dans cette acception, la politique de prévention vise à empêcher la survenue d’épisodes de santé défavorables et à influencer les comportements grâce à une action résolue sur les facteurs de risque, en utilisant une approche à la fois collective et individuelle. Même si le concept reste flou, il existe un consensus sur ces points fondamentaux.
Nous avons porté une attention particulière à la question de la dépense, que nous avons cherché à éclairer de manière transversale. Premier constat : son montant est mal connu. Les crédits inscrits au titre du programme budgétaire 204, Prévention et sécurité sanitaire, ne concernent pas uniquement la prévention, et la direction générale de la santé (DGS) s’avère incapable de distinguer, au sein de cette enveloppe budgétaire – qui s’élevait à 389 millions d’euros en 2010 –, ce qui correspond à de la prévention au sens strict du terme et ce qui relève, plus largement, de l’action sanitaire. En outre, d’autres programmes budgétaires, relevant d’autres ministères – comme le programme 230 Vie de l’élève –, contribuent à la politique de prévention et il n’existe pas de document de politique transversale donnant une vision consolidée de l’effort budgétaire de l’État dans ce domaine.
Nous avons par ailleurs constaté que, si l’action de prévention de l’assurance maladie est importante, elle est, elle aussi, extrêmement difficile à évaluer. La dotation du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) a doublé en dix ans, passant de 200 à 400 millions d’euros ; elle est aujourd’hui légèrement supérieure à celle du programme 204. Cependant, les dépenses imputées sur ce fonds sont très hétérogènes et ne rendent pas compte de l’effort de prévention de l’assurance maladie, l’essentiel de ce dernier étant financé au titre du risque maladie. Une étude de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) montre d’ailleurs que les actions de prévention financées par l’assurance maladie, tous régimes confondus, représentaient déjà en 2002 quelque 5,5 milliards d’euros, soit dix fois plus que les dépenses actuelles du seul Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.
Une approche en termes de comptabilité nationale ne permet pas de lever ces incertitudes. Les études disponibles font en effet apparaître des imprécisions dans la méthode de collecte des informations ainsi que dans l’agrégation des données, avec des estimations fort variables.
En résumé, le bilan financier de la prévention ne peut être fait avec certitude. Si l’on s’en tient à une approche restrictive, en ne prenant en considération que les crédits de l’État et ceux de l’assurance maladie explicitement destinés cet emploi, la dépense s’élève à 1 milliard d’euros ; mais si l’on privilégie une conception plus large, on arrive à un montant qui dépasse les 10 milliards d’euros.
M. le coprésident Pierre Morange. Je crois savoir que la troisième chambre a présenté récemment un rapport sur l’évaluation de la médecine scolaire. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, afin que nous puissions en tenir compte dans notre réflexion ?
M. Antoine Durrleman. Sur ce sujet, au-delà des problèmes d’effectifs et de positionnement des services de santé scolaire au sein des établissements mis en lumière par ce rapport, il convient de déplorer la faiblesse des liens actuels entre les personnels de la santé scolaire et les acteurs de la santé publique. Par le passé, des conventions avaient été conclues entre le ministère de l’éducation nationale et celui de la santé, mais elles n’ont pas été reconduites. Les services de santé scolaire sont impliqués dans la vie de l’établissement et l’accompagnement des élèves, mais il est essentiel de développer leurs relations avec l’extérieur, car la prévention commence dès le plus jeune âge, et c’est dans le milieu scolaire que l’on peut agir sur les comportements et faire acquérir les bons réflexes. C’est pourquoi il est à déplorer que le programme Vie de l’élève ne soit pas relié, sous la forme d’un document de politique transversale, aux autres dimensions de l’effort budgétaire de l’État en matière de prévention.
En deuxième lieu, nous avons étudié comment étaient fixées les priorités de la politique de prévention.
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique entendait donner des perspectives stratégiques aux politiques de santé publique. Des objectifs ont été définis et déclinés sous la forme de plans de santé publique – une trentaine au total –, qui comportaient tous un volet de prévention.
À l’analyse, ces objectifs s’avèrent insuffisamment hiérarchisés ; ils ont d’ailleurs été mal suivis. La cause en est leur statut ambigu et peu contraignant : il s’agit d’indicateurs plutôt que d’objectifs. De surcroît, leur définition ne résulte pas d’une analyse médico-économique. Bref, on n’a pas cherché à retenir les actions potentiellement les plus efficaces pour un résultat donné. De ce point de vue, la démarche française contraste avec celle adoptée par d’autres pays, où l’on a retenu un petit nombre d’objectifs, mais fortement étayés, avec une mobilisation de l’ensemble des acteurs. Par comparaison, la loi de 2004 avait défini pas moins de cent objectifs : il y avait un risque évident de dispersion.
En troisième lieu, le pilotage de la politique et des acteurs de la prévention s’avère insuffisant. Au plan national, il n’existe pas d’autorité interministérielle chargée de la politique de prévention, alors que celle-ci est par nature extrêmement large et nécessite la mobilisation de plusieurs administrations. Le directeur général de la santé, loin d’être le primus inter pares, n’est qu’un directeur d’administration centrale parmi d’autres, qui doit essayer de convaincre ses collègues de s’associer aux objectifs dont il a la responsabilité.
Ce manque de coordination est d’autant plus à déplorer que l’on note une multiplication des structures d’expertise, parfois concurrentes, voire redondantes. Se pose notamment la question de la bonne articulation des périmètres de la Haute Autorité de santé et du Haut Conseil de la santé publique.
Par ailleurs, les organismes d’assurance maladie ne se sont engagés que tardivement dans une politique coordonnée avec l’État, essentiellement sous l’effet des dernières conventions d’objectifs et de gestion ; la convention d’objectifs et de gestion 2010-2013, en particulier, a défini des objectifs en matière de prévention. L’assurance maladie a introduit une dimension de prévention dans plusieurs dispositifs conventionnels, en particulier celui du médecin traitant, qui se veut un dispositif d’accompagnement, d’orientation et de conseil aux patients, et celui des contrats d’amélioration des pratiques individuelles, qui prévoient explicitement la participation des médecins contractants à des actions de prévention ; pour l’heure, ce sont au total 16 000 médecins qui ont accepté de prendre un tel engagement. Même s’il est encore trop tôt pour dresser le bilan de ce dispositif, cela nous paraît un signal intéressant.
La nouvelle convention médicale entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins, signée le 26 juillet dernier, a renforcé cette dynamique, puisque des actions de prévention seront incluses dans les objectifs pouvant donner lieu à des formes particulières de rémunération pour les médecins contractants. Sur un total de 1 300 points, 250 seront ainsi consacrés spécifiquement à des actions de prévention. Le dispositif entrera en vigueur en 2012, et les premières évaluations pourront être faites à partir de 2013.
L’assurance maladie a également engagé des actions propres, notamment en matière d’accompagnement des patients ; le programme Sophia, service d’accompagnement de l’assurance maladie pour les malades chroniques, destiné aux personnes diabétiques, concerne ainsi, de manière spécifique, 103 000 patients dans dix-neuf départements.
La cour a par ailleurs noté avec intérêt qu’à la suite des observations qu’elle avait émises à l’occasion d’un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a décidé de réorienter l’activité des centres d’examens de santé vers l’éducation thérapeutique, au bénéfice en particulier des personnes en situation de précarité, auprès desquelles il est souvent difficile de mener des actions de prévention.
Enfin, l’organisation régionale, en cours de recomposition du fait de la création des agences régionales de santé (ARS), demeure extrêmement complexe. Ces agences reprennent non seulement les compétences des agences régionales de l’hospitalisation (ARH), mais également celles des groupements régionaux de santé publique, fortement engagés dans la prévention. Dans ce domaine, de nouvelles responsabilités ont donc été attribuées aux agences, notamment au travers des schémas régionaux de prévention, qui doivent s’intégrer dans les projets régionaux de santé. Les contractualisations avec les collectivités territoriales, en particulier avec les départements, sont essentielles ; ce sera une des clés du succès de l’action des agences régionales en la matière.
Au-delà, la cour a noté que les dispositifs locaux d’observation et de participation à l’effort de prévention étaient extrêmement importants. Nous avons analysé plus particulièrement deux réseaux associatifs. Les comités départementaux et régionaux d’éducation pour la santé (CODES et CRES), qui se transforment progressivement en instances régionales, constituent un réseau important, mais insuffisamment piloté, de même que les observatoires régionaux de santé, qui ne s’articulent pas toujours très bien avec les autres structures intervenant dans le secteur. Au total, 1 215 structures interviennent au niveau local : preuve que la prévention est prise en charge par une multiplicité d’acteurs, emportant de ce fait des risques de dispersion. C’est pourquoi la question du pilotage de la politique de prévention nous semble centrale, aussi bien au niveau interministériel qu’au niveau régional.
Pour finir, il convient de souligner que l’évaluation de la politique de prévention sanitaire est délicate, car il n’existe pas de dispositif permettant de suivre en permanence les actions engagées. Les expertises existantes sont fragiles, parfois contradictoires. Cela est en partie dû à une approche pluridisciplinaire trop limitée.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Comme vous l’avez dit, la prévention est un vaste domaine et votre rapport a le mérite d’essayer d’en faire le tour.
Le premier problème qui se pose est celui de sa définition. Avez-vous des propositions en la matière ?
La prévention, à laquelle on peut ajouter l’éducation à la santé, est considérée comme le parent pauvre de notre système, notamment par rapport aux soins. La difficulté, c’est qu’un grand nombre d’acteurs y participent, chacun avec peu de moyens, sans qu’il y ait un ministre responsable. Chaque caisse, chaque organisme d’assurance maladie complémentaire possède sa propre politique de prévention – notamment les associations de prévoyance. Quelles propositions feriez-vous pour améliorer la coordination ? Devrait-elle être plutôt régionale ou plutôt nationale ? Quelle est votre opinion sur la prévention en milieu scolaire et sur la médecine du travail ? Disposez-vous d’informations sur l’action de la Mutualité sociale agricole (MSA) ?
Vous avez évoqué les cent objectifs de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et noté que, contrairement aux Britanniques, nous n’avons pas concentré nos efforts sur un petit nombre de priorités. Faudrait-il changer d’orientation ?
Pourriez-vous nous dire un mot des centres d’examens de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ? Qui les fréquente ? Quelles sont les conséquences des examens qui y sont pratiqués ?
Vous distinguez, dans votre rapport, le dépistage organisé et le dépistage spontané. Quelles conséquences en tirez-vous, en particulier sur le dépistage du cancer du sein, du cancer de la prostate – que la Haute Autorité de santé déconseille au-delà de soixante-quinze ans – et de l’hypertension artérielle ?
Reprenant les conclusions du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, vous estimez que le Haut Conseil de la santé publique n’est pas très utile. Iriez-vous jusqu’à en proposer la suppression ?
M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission des affaires sociales. Personnellement, je crois aux politiques de prévention ; je suis d’ailleurs sur le point de signer un contrat local de santé publique. Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur, la multiplicité des structures et des objectifs ne facilite pas la compréhension du dispositif actuel. Je pense, pour ma part, que les politiques de proximité sont les plus efficaces. Quel est selon vous le meilleur niveau d’action : la région, le département, le bassin d’emploi ou la communauté d’agglomération ? Ne devrait-il pas y avoir une autorité responsable ?
Les citoyens doivent par ailleurs prendre conscience de leurs propres responsabilités en la matière. Comment assurer la diffusion des bonnes pratiques ?
M. Antoine Durrleman. S’agissant de la définition de la prévention, il est clair qu’il faut associer l’approche individuelle et l’approche populationnelle : loin de se contredire, elles sont l’une et l’autre nécessaires. Nous avons rappelé un certain nombre de définitions scientifiques, afin de montrer que le concept est en cours d’affinement et que l’on tend, de plus en plus, à considérer que la prévention a un impact à la fois personnel et collectif. Il reste, bien entendu, qu’il existe des recoupements avec d’autres concepts, comme l’éducation thérapeutique ou l’éducation à la santé, qui, sans être de la prévention stricto sensu, y participent.
S’agissant du pilotage, nous estimons qu’il est nécessaire de se doter d’une autorité interministérielle stable et aisément identifiable, et nous proposons que le directeur général de la santé soit, ès qualités, délégué interministériel à la prévention sanitaire, ce qui lui conférerait l’autorité nécessaire pour mobiliser l’ensemble des administrations impliquées dans cet effort collectif.
En effet, beaucoup d’initiatives sont lancées à l’extérieur du ministère de la santé. De ce point de vue, la question de l’environnement, au sens large, est essentielle. Rappelons que les grandes avancées en matière de santé publique ont été obtenues, au début du XXe siècle, grâce aux progrès de l’hygiène et de l’urbanisme ainsi qu’à une politique de prévention très stricte en matière de lutte contre la tuberculose.
Par ailleurs, la santé au travail relève d’un autre ministère – même si le ministre est parfois commun aux deux administrations. Les services de la santé au travail dépendent ainsi des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Or ces dernières ont peu de moyens à y affecter ; il y a bien des médecins inspecteurs, qui tentent d’encourager les synergies entre les services interentreprises de santé au travail, mais ils sont peu nombreux, se heurtent à des obstacles et, globalement, peinent à peser sur ces services. La faiblesse des moyens rend la politique d’agrément difficile à conduire ; plusieurs responsables régionaux ont bien essayé d’aller plus loin, mais les résultats s’avèrent inégaux.
Autre acteur important, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) dépend, elle aussi, du ministère du travail. Il s’agit pourtant d’un aspect déterminant de la prévention. Les troubles musculo-squelettiques, par exemple, sont fréquemment liés à de mauvaises postures de travail. Il faudrait engager une réflexion sur l’ergonomie générale des installations, sans se contenter du regard porté par le médecin du travail au sein de chaque entreprise. Pour toutes ces raisons, un point de convergence, y compris pour la médecine scolaire et l’éducation à la santé en milieu scolaire, est nécessaire.
La question de sa transposition à l’échelon local est bien évidemment cruciale. À quel niveau doit-on définir les objectifs d’une politique locale de prévention ? La création des agences régionales de santé répondait à l’idée qu’une politique de santé publique doit s’exercer au niveau régional, mais aussi se décliner à un niveau inférieur – quant à savoir lequel, la décision est laissée à l’appréciation de chaque agence. Celles-ci ont opéré des choix très divers ; certaines ont divisé leur territoire d’après les circonscriptions administratives existantes, en général les départements ; d’autres ont opté pour une segmentation plus fine, en fonction de bassins territoriaux. Il est encore trop tôt pour faire le bilan de ces approches. Il semble néanmoins envisageable que les objectifs conventionnels liant l’assurance maladie et les médecins soient déclinés selon une approche territoriale plus fine que celle adoptée jusqu’à présent. On pourrait ainsi imaginer que les objectifs nationaux définis par la convention médicale du 26 juillet 2011 soient transposés en fonction de problématiques locales, celles-ci étant tantôt transversales, tantôt spécifiques.
S’agissant des centres d’examens de santé, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés tend à réorienter leur mission vers la prise en charge des populations précaires. Il se trouve que la cour a récemment contrôlé la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, département confronté à des problèmes de santé importants, mais où le nombre de médecins libéraux est, proportionnellement, le plus faible. L’effort de réorientation de l’activité des centres d’examens de santé y est réel, mais il ne va pas sans difficultés, dans la mesure où il convient d’abord, d’identifier les personnes en situation de précarité, de leur adresser ensuite une convocation individuelle, enfin, qu’elles répondent à cette convocation. Or on note une déperdition entre le nombre de convocations envoyées, le nombre de rendez-vous pris et le nombre de personnes se présentant effectivement au centre. Plutôt que de convoquer ces gens, ne devrait-on pas aller vers eux ? Il reste que ces centres ont une histoire, une légitimité et un poids qui rendent leur évolution nécessairement lente.
Les organismes d’assurance maladie complémentaire conduisent eux aussi des actions de prévention importantes. La Fédération nationale de la mutualité française a créé un fonds national de prévention et développe plusieurs initiatives en ce sens ; les institutions de prévoyance font de même, ainsi que les sociétés d’assurance ; en outre, dans le cadre des contrats responsables, a été intégrée l’obligation pour les assurances maladie complémentaires de prendre en charge au moins deux prestations de prévention figurant sur une liste allant du détartrage dentaire au dépistage des troubles de l’audition, en passant par l’ostéodensitométrie.
Quant à la Mutualité sociale agricole, elle conduit un programme financé par son propre fonds national de prévention, qui mobilise chaque année quelque 54 millions d’euros. Elle met notamment en œuvre, depuis 2008, une action appelée « Les instants santé », qui vise à proposer aux assurés âgés de seize à soixante-quatorze ans six examens de santé au cours de leur vie, avec des objectifs variables suivant la classe d’âge concernée. Cela nous semble une tentative intéressante pour affiner les notions de consultation de prévention et d’examen de santé, qui mériterait de faire école au sein du régime général.
Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître à la Cour des comptes. Nous avons essayé de montrer, d’une part, que la mise en œuvre d’un dépistage organisé tout en autorisant le maintien parallèle d’un dépistage individuel réduisait l’efficacité du premier et, d’autre part, qu’un dépistage individuel trop poussé pouvait engendrer plus d’effets négatifs que d’effets positifs en termes de santé publique.
Dans le premier cas, nous avons pris l’exemple des deux dépistages organisés existants, c’est-à-dire le dépistage du cancer du sein et celui du cancer colorectal. Pour mesurer l’efficacité d’un dépistage organisé, il faut un taux d’adhésion au programme de plus de 70 %, ce qui n’est pas le cas pour le moment. La persistance du dépistage individuel conduit certaines personnes à privilégier cette démarche, ce qui affaiblit l’adhésion au programme collectif et empêche de tirer des conclusions en termes de santé publique et de politique de prévention. La dualité des dépistages limite en définitive l’efficience des politiques de prévention se fondant sur une approche populationnelle.
Lorsqu’il n’est pas prévu de dépistage organisé, ce qui est le cas du dépistage du cancer du sein avant cinquante ans ou du dépistage du cancer de la prostate, on observe que les dépistages individuels proposés par les médecins – souvent acceptés car le dépistage bénéficie d’une image positive auprès des patients –, non seulement contribuent à accroître les dépenses d’assurance maladie, mais peuvent entraîner des inconvénients pour les patients. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, un dépistage crée nécessairement une angoisse ; par ailleurs, les patientes ne sont pas toujours dûment informées des conséquences des examens ultérieurs et elles peuvent être amenées à subir des soins qui, en définitive, n’auraient pas été nécessaires : d’après les études médicales que nous avons consultées, il existe des cancers du sein non évolutifs, qui auraient pu rester en l’état, mais dont le dépistage conduit à des ablations du sein traumatisantes.
De même, un dépistage trop poussé du cancer de la prostate peut s’avérer néfaste, dans la mesure où il conduit à mettre en œuvre des soins, alors qu’un homme de soixante-quinze ans a de toute façon 80 % de chances de devenir centenaire. En d’autres termes, il est parfois préférable de ne rien faire.
Mme Carole Pelletier, rapporteure à la Cour des comptes. Nous avons retenu la prise en charge de l’hypertension artérielle comme exemple d’une action de prévention individuelle d’un problème de santé publique particulièrement grave. Vu le nombre de personnes touchées et les risques encourus, il importe de choisir les traitements les mieux évalués. Selon l’étude Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, portant sur 42 000 patients, les traitements par diurétiques sont les seuls pour lesquels on peut apporter la preuve d’une réduction de la morbimortalité cardiovasculaire. Or cette classe de médicaments ne représente que 20 % des traitements ; dans le reste des cas, on utilise les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les sartans, pourtant vingt fois plus chers. Cela montre que les préoccupations économiques peuvent recouper les critères d’efficacité.
Mme Catherine Lemorton. L’hypertension artérielle modérée et sévère a été retirée il y a quelques mois de la liste des affections de longue durée (ALD). Les personnes qui en souffrent ne bénéficient donc plus du dispositif de prise en charge à 100 % – de même que celles atteintes d’un cancer depuis plus de cinq ans. Il faut mettre en œuvre des actions de prévention sur le capital santé qui leur reste, alors même que les organismes d’assurance maladie complémentaire ne leur appliquent plus le tarif de base. Avez-vous évalué la déperdition dans le suivi médical, dans la prévention, et, partant, les dégâts en termes de santé publique qui en résultent ? Ces personnes se font-elles moins suivre ? Que pensez-vous du retrait de certaines maladies de la liste des affections de longue durée ?
À la page 118 de votre rapport, vous mettez en parallèle une observation de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et une étude de l’Association nationale des industries agroalimentaires sur la prévention de l’obésité chez les enfants. Pour ma part, j’aurais plutôt tendance à faire confiance à l’organisme public qu’est l’Institut national, quand il note une plus grande prévalence de l’obésité lorsqu’on maintient les publicités en faveur des produits trop sucrés, trop salés ou trop gras – sachant que d’autres facteurs entrent en jeu. Ce qui m’inquiète, c’est que le Conseil supérieur de l’audiovisuel considère que, « si la suppression de la publicité alimentaire dans les programmes pour enfants est loin d’être un instrument efficace dans le combat contre l’obésité, ses conséquences économiques seraient en revanche certaines sur notre secteur audiovisuel structurellement sous-financé » ! Il est certain que nous utiliserons votre rapport pour appuyer notre lutte contre l’obésité chez les enfants, épidémie qui touche particulièrement les milieux sociaux défavorisés.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Le rapport de la cour relève que la multiplication des plans risque de nuire à leur articulation, à leur lisibilité, voire à leur efficacité. Comment améliorer la situation ? Aurions-nous à intérêt à accompagner la personne dans les différentes étapes de la vie ? Les campagnes de dépistage et les différents plans ne devraient-ils pas plutôt être centrés autour de la personne et ce dès le plus jeune âge ?
S’agissant du vieillissement, qui est un véritable enjeu de société, il reste beaucoup de progrès à faire, notamment de la part des médecins qui ne sont apparemment pas suffisamment informés de certains risques, en dehors des plans bien connus. Ainsi, je ne suis pas sûre que les médecins connaissent le plan « Bien vieillir » qui pourrait pourtant prévenir certaines difficultés.
La Mutualité sociale agricole a souvent fait preuve d’une perception fine dans son approche des problématiques de santé. Proposer, entre seize et soixante-quatorze ans, six examens de santé pourrait constituer une réponse à la question que je vous ai posée. Il faut en effet accompagner les personnes dès le plus jeune âge. Dans cette tranche de la population, les dépistages doivent être améliorés même si la double compétence de la médecine scolaire et de la santé complique l’action.
Dans les territoires, certaines expériences locales peuvent être mises à profit. Il reste à résoudre la question du pilotage et de la coordination. Il me semble que le niveau régional serait adapté, mais les actions doivent aussi se décliner au niveau départemental. Une des premières choses à faire est de recenser les acteurs.
Mme Gisèle Biémouret. Le dépistage organisé du cancer rencontre des difficultés sur le terrain, et peine avant tout à obtenir l’adhésion des médecins. C’est sans doute là l’une des raisons pour lesquelles les patients restent indifférents. Il faudrait aussi sensibiliser davantage les hommes, car les femmes sont plus réceptives en matière de santé – les très bons résultats du dépistage du cancer du sein sont là pour l’attester. Mais, s’agissant du cancer colorectal, nous devons mieux faire, et surmonter le manque d’adhésion des médecins. Très peu de gens vont jusqu’au bout des tests, malgré l’importance des sommes investies. Comment améliorer les choses ? Enfin, comment aller vers les publics précaires ?
M. Antoine Durrleman. Nous n’avons pas les moyens de vous répondre au sujet des personnes qui ne sont plus prises en charge au titre des affections de longue durée : le réaménagement des dispositifs est trop récent pour faire une évaluation. Manifestement, une des réponses à vos interrogations réside dans l’éducation thérapeutique du patient. Elle doit viser en priorité les personnes atteintes de maladies chroniques, quelles que soient les modalités de prise en charge par l’assurance maladie, et être adaptée selon les pathologies, leur chronicité, la complexité du suivi du traitement, qui peut ne pas être que médicamenteux, de façon à préserver le capital santé résiduel. L’action conduite par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés dans la prévention du diabète est très intéressante, bien qu’elle reste encore expérimentale. C’est sans doute une forme d’accompagnement indispensable. Même si le concept reste un peu flou, l’expérimentation lui confère une définition concrète.
La santé bucco-dentaire illustre bien la bonne articulation qui peut exister entre les différents modes d’intervention. On ne peut que constater l’amélioration de la santé de nos concitoyens dans ce domaine, du fait d’une action précoce financée en particulier par l’assurance maladie – la campagne « M’T dents » en milieu scolaire – qui a été relayée par les professionnels libéraux. Une information a aussi largement été diffusée sur les règles d’hygiène bucco-dentaire. Et les progrès ont été considérables. Cette réussite montre que des actions bien articulées entre elles, adaptées aux différents âges de la vie, font bouger les lignes, même si elles ne font pas disparaître tous les problèmes, notamment ceux du vieillissement.
Pour centrer autour de la personne les multiples plans qui sont mis en œuvre, sans doute faut-il agir aux différents âges de la vie en se fixant quelques priorités. La multiplication des plans de santé publique est la conséquence de la volonté de n’oublier personne, ni aucun facteur de risque, mais se focaliser sur certains objectifs n’interdit pas d’agir aussi sur d’autres. Cela implique seulement de mobiliser tous les acteurs, pour obtenir des progrès dans des domaines précis. L’exemple de la santé bucco-dentaire peut paraître modeste, mais c’est un enjeu pour la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. Elle conditionne la relation à l’autre, et c’est, avec les problèmes dermatologiques, un des marqueurs de la précarité.
Comme dans d’autres domaines de la prévention, le rôle des professionnels est central dans l’accompagnement du vieillissement. Les médecins prennent en compte cette dimension dans le dialogue singulier qu’ils nouent avec leur patient. Mais on ne peut pas en rendre compte car il n’est pas possible de faire la part, dans chaque consultation, de ce qui relève de la prévention de ce qui n’en relève pas. L’un des intérêts des nouveaux modes conventionnels sera d’expliciter cette action de prévention, de la rendre visible, voire mesurable.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous avez souligné la difficulté qu’il y a à mesurer l’effort de prévention réalisé par les praticiens. Dès lors, comment appliquer la nouvelle convention médicale censée pourtant rémunérer le travail de prévention ? Sur quel fondement ?
Vous dénoncez le défaut de pilotage des actions de prévention et vous souhaitez confier au directeur général de la santé un rôle particulier dans ce domaine. Or, votre recommandation n° 4 préconise de « mettre en pratique les recommandations du guide méthodologique produit par la DGS, lors de l’élaboration des plans de santé publique ». Si ses instructions ne sont pas appliquées, la direction générale de la santé aura encore du chemin à faire avant d’être en mesure de coordonner l’ensemble des acteurs. À quelles conditions lui confier ce rôle ?
Quels sont les « éventuels conflits d’intérêts » que vous visez dans la recommandation n° 7 et qui pourraient faire obstacle à la politique de prévention ?
M. le rapporteur. Je m’étonne, en dépit de votre mise en garde contre les difficultés d’évaluation, que la Cour des comptes ait fixé une fourchette de dépenses aussi large de 1 à 10 milliards d’euros, voire davantage, d’après ce que vous venez de dire ! Il est vrai que le médecin traitant fait de la prévention tous les jours et que le contrat d’amélioration des pratiques individuelles qui comportera de nombreux indicateurs devra en tenir compte.
Le Premier président Didier Migaud, en présentant il y a quelques jours le rapport consacré à la médecine scolaire, a insisté sur l’absence à la fois de moyens humains et financiers mais aussi de pilotage et de hiérarchisation des objectifs. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Rien n’a été dit non plus sur la protection maternelle et infantile (PMI), qui est importante pour la prévention. Comment associer les départements à la prévention générale ?
Comment demander à la prévention d’être financièrement rentable ? Il est probable qu’elle coûtera plus cher dans un premier temps. Lors de la mise en place de Sophia, il est apparu que les diabétiques ne faisaient pas tous les examens qu’il faudrait – fond d’œil, suivi rénal… S’ils le faisaient, cela coûterait plus cher, même si cela évite par la suite des complications.
J’ai cru voir dans votre rapport que l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé manquait d’indépendance et qu’il servait surtout de courroie de transmission à la communication au Gouvernement. Que proposez-vous pour y remédier ? J’avais suggéré de s’appuyer sur la fédération des comités départementaux et régionaux d’éducation pour la santé de l’époque, car il faut trouver les moyens de rendre la prévention efficace sur le terrain. Les associations peuvent-elles être regroupées dans des comités départementaux d’éducation pour la santé ou au niveau régional ? Peut-on s’appuyer sur les très nombreuses associations, comme celles réunissant les insuffisants rénaux ou celles qui luttent contre le tabac et l’alcool par exemple ? Comment les associer au niveau départemental et coordonner leur action ?
Parmi les priorités, ne va-t-on pas retenir logiquement les mortalités prématurées évitables ? Une fois que l’on aura désigné la lutte contre l’alcool, le tabac et le cancer, y aura-t-il autre chose ? Et tout ce que l’on fait déjà depuis des années est-il vraiment efficace ?
M. Antoine Durrleman. La contradiction entre la suggestion de confier à la direction générale de la santé un rôle interministériel et le constat qu’elle n’applique pas elle-même ses propres recommandations n’est qu’apparente. Judicieusement, la direction générale s’est efforcée de tirer du bilan en demi-teinte des plans de santé publique un retour d’expérience qui ne peut qu’être positif et opérationnel pour les nouveaux plans de santé publique qu’elle est en train de préparer. Nous lui rappelons seulement de s’appliquer à elle-même les conclusions qu’elle a tirées au cas où l’urgence risquerait de les lui faire oublier.
M. le rapporteur. À propos du pilotage, comment s’articulera, dans le champ de la prévention, le rôle de la secrétaire générale du comité de pilotage des agences régionales de santé, qui est important, et celui de la direction générale de la santé ?
M. Antoine Durrleman. La secrétaire générale pilote la mise en place des agences régionales de santé, ce qui lui confère des fonctions de mécanicienne, plus que d’animatrice de la politique de prévention. Elle est chargée de coordonner à la fois la direction générale de la santé, la direction générale de l’offre de soins, la direction générale de la sécurité sociale et la participation de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne le financement, avec, en particulier la création, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, du fonds d’intervention régionale qui mettra 1,5 milliard d’euros à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé. Elle assure le pilotage des agences régionales, mais non le pilotage de la politique de santé publique même si ces agences de santé ont été conçues pour mailler les différents acteurs de la chaîne de soins, que ce soit les hôpitaux, le secteur médico-social ou la médecine de ville. Il n’est pas antinomique qu’un directeur d’administration centrale ait une casquette interministérielle. Par exemple, la sécurité routière prouve qu’une politique de prévention peut être efficace dès lors qu’elle est construite, coordonnée et assortie d’objectifs précis, ainsi que portée par l’ensemble des ministères concernés.
Il arrive que les administrations représentent des intérêts liés à leur sphère de compétence. Dès lors qu’il existe des intérêts concurrents, il faut un arbitrage. Sinon, soit les plans risquent d’être flous soit restent inexécutés. Cet arbitrage doit être exercé au niveau interministériel pour que toutes les administrations travaillent dans le même sens. C’est la raison pour laquelle nous avons traité en détail la politique de prévention de l’obésité de l’enfant qui est l’enjeu de conflits entre intérêts sanitaires et intérêts économiques au sein de l’administration.
La médecine scolaire souffre pour partie d’un manque de moyens, dans la mesure où elle est un parent pauvre de l’éducation nationale. Le programme Vie de l’élève comporte de multiples actions. Son action Santé scolaire est faiblement dotée, outre qu’elle n’est pas pilotée – le responsable de la mission n’y voit pas un objectif principal et les relations entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la santé se sont distendues au fil du temps.
La protection maternelle et infantile est un remarquable vecteur de prévention, mais elle a été décentralisée au niveau de chaque département et les écarts en termes de moyens et de stratégie sont considérables. A-t-on maintenu le système historique de la visite à domicile, qui peut garder tout son sens pour certains types de famille, ou bien a-t-on opté pour la consultation ? Le sujet reste peu exploré. Pourtant, il mériterait de l’être car nous constatons avec inquiétude la détérioration des indicateurs de périnatalité. Grâce à un effort de plus de trente ans, la France avait enregistré une amélioration substantielle de ces indicateurs, mais elle a tendance à reculer, au moins en termes relatifs, certains pays progressant plus vite que nous. Certains indicateurs ne sont pas bons, notamment ceux relatifs à la mortalité dans les premiers mois de la vie. Pour le coup, cela justifierait une politique de santé publique beaucoup plus forte et mieux articulée. Nous sommes d’ailleurs en train d’y travailler.
Le retour sur investissement – plutôt que la rentabilité financière – dépend de l’organisation du système de soins. La politique de prévention passe par les acteurs libéraux, les acteurs spécialisés, mais rarement par le système hospitalier. Cela ne veut pas dire qu’il reste en dehors du circuit de prévention, mais, si des économies peuvent être faites à l’hôpital, elles doivent être redéployées sur d’autres acteurs pour mieux articuler son action en matière de prévention. Ne pas agir en prévention, c’est-à-dire ne pas se préoccuper de l’accompagnement thérapeutique du patient, se traduira par des pathologies aggravées que l’hôpital devra plus tard prendre en charge à des coûts très élevés.
Nous avons légèrement égratigné l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Il a néanmoins le mérite d’être désormais clairement identifié comme un acteur de la prévention sanitaire. Il serait utile d’avoir un pilote interministériel mais il est aussi utile de disposer d’un outil dédié qui apporte son expertise et peut organiser une communication cohérente sur les problématiques de prévention. L’institut a donc sa valeur et qu’il s’agisse d’un établissement public n’est pas anormal. La prévention relève de la santé publique qui est de la responsabilité de l’État. Ce dernier ne doit pas s’en défausser.
M. le coprésident Pierre Morange. S’agissant des indicateurs de mortalité et de morbidité périnatales, avez-vous relié leur déclin à la hausse de la précarité dans notre pays et procédé à une analyse régionale ?
Mme Catherine Lemorton. À propos des conflits d’intérêts, je déplore que l’Assemblée ait repoussé une proposition de loi le 11 octobre dernier tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d’outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l’Hexagone.
S’agissant de la mesure du retour sur investissement, la vaccination ROR (rougeole, oreillons, rubéole), écrivez-vous, ne fait sentir ses gains substantiels qu’après vingt-cinq ans. Il en sera de même pour les conséquences d’un relâchement…
Vous dites à juste titre que la politique de prévention doit rester dans les mains de l’État. Or, la campagne de vaccination contre le papillomavirus – laquelle coûte 400 euros par adolescente vaccinée et rend très difficile un quelconque retour sur investissement – est largement prise en charge par les industriels. Je ne suis pas sûre non plus qu’elle cible les populations qui en ont le plus besoin. De toute façon, si j’en crois la Haute Autorité de santé, ce vaccin ne dispense pas de faire un frottis annuel du col de l’utérus toute sa vie, à partir de vingt-cinq ans. Dans un tel contexte, je m’interroge sérieusement sur l’opportunité d’un investissement aussi lourd.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce vaccin pourrait avoir des effets neurologiques – il provoquerait notamment des états de narcolepsie – selon une publication internationale.
M. Antoine Durrleman. La Cour des comptes n’a pas les moyens d’évaluer un quelconque retour sur investissement. Nous nous sommes fondés sur des études scientifiques internationales qui concluent que 20 % des mesures de prévention ont un retour sur investissement quantifiable. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y en ait aucun, mais ce constat montre la nécessité d’entreprendre ex ante une démarche d’évaluation médico-économique. Il faut systématiquement s’interroger sur le rapport coût/efficacité des actions engagées, sans préjuger d’ailleurs de la réponse apportée. Mais il faut qu’elles aient été documentées. D’une manière générale, notre pays a des progrès considérables à faire sur ce point. Nous l’avons signalé dans le rapport que nous vous avons présenté sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, à propos de l’évaluation des nouvelles molécules médicamenteuses. Une démarche symétrique est nécessaire avant de définir les stratégies de santé publique, même si ce ne doit pas être le seul critère de décision.
Nous sommes en train d’examiner les raisons des mauvais indicateurs de périnatalité. Outre la précarité, on trouve le recul de l’âge de la mère à la naissance. Mais il n’existe aucune étude disponible dans le temps qui puisse éclairer cette problématique. Cela étant, les indicateurs sont suffisamment alarmants pour déclencher des mesures fortes.
Mme Marianne Lévy-Rosenwald. Quand la précédente ministre de la santé avait demandé à la direction générale de la santé de réfléchir à ce que pourrait être le contenu d’une nouvelle loi de santé publique, un des thèmes qui avait émergé à l’époque était la question des inégalités sociales en matière de santé. En apparence, le sujet est à la marge de la politique de prévention, mais il s’agit d’un facteur déterminant.
M. le coprésident Pierre Morange. Les dernières enquêtes sur les inégalités d’espérance de vie tendent à montrer que le paramètre le plus influent est le capital culturel et éducatif, qui n’est pas sans lien avec la précarité.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. La précarité est devenue un problème très important pour notre société. Les études montrent également que 30 % des Français environ diffèrent des soins, voire y renoncent. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans la précarité, mais une autre fraction de la population est touchée. On en ignore encore les effets, il faudra en mesurer les conséquences sur la santé publique.
M. le coprésident Pierre Morange. Vos remarques rejoignent les propos de Mme Catherine Lemorton sur le coût d’adhésion à une mutuelle et sur l’impact d’un reste à charge qui risquent de faire obstacle à l’accès aux soins.
*
AUDITIONS DU 20 OCTOBRE 2011
Audition de M. Didier Tabuteau, conseiller d’État, responsable de la chaire Santé de Sciences Po et du Centre d’analyse des politiques publiques de santé de l’École des hautes études en santé publique.
M. Didier Tabuteau, conseiller d’État, responsable de la chaire Santé de Sciences Po et du Centre d’analyse des politiques publiques de santé de l’École des hautes études en santé publique. Je vais vous présenter les réflexions élaborées à partir des travaux que nous menons sur les politiques publiques de santé, plutôt qu’un exposé sur la prévention proprement dite, pour laquelle d’autres personnes sont plus qualifiées que moi.
D’abord, il est important de garder à l’esprit que la santé publique est un tout : la prévention ne doit pas être opposée aux soins dans l’élaboration des politiques publiques.
Il faut distinguer trois domaines essentiels. En premier lieu, la prévention non médicalisée, qui se fait hors du système de santé au sens strict du terme – retenu dans les comptes nationaux de la santé. Elle recouvre deux principaux types d’actions : celles portant sur les comportements, par le biais de l’éducation ou de la promotion de la santé ; celles tendant à réduire d’une manière générale les facteurs de risques liés au travail, aux transports ou au logement, qui sont des déterminants fondamentaux de la santé.
En deuxième lieu, la prévention médicalisée, qui passe par les acteurs du système de santé, qu’il s’agisse des professionnels ou des établissements de santé. Elle comporte également deux types d’actions : les unes sont non techniques – l’éducation et la promotion de la santé, l’intervention des professionnels auprès des patients – ; les autres, techniques, tels le dépistage ou les analyses biologiques notamment, qui tendent à se développer.
Troisièmement, les soins, qui ont aussi, en sus de leur fonction curative, une vocation préventive. C’est notamment le cas dans le traitement des maladies chroniques.
Ces trois piliers ne peuvent être dissociés si l’on veut réfléchir à la façon dont la santé publique doit se développer.
Deuxième constat liminaire : notre pays souffre d’un manque de culture de santé publique. Cela tient à des facteurs historiques : au XIXe siècle, la France a joué un rôle majeur en matière de théorie de la santé publique, mais a peu mis en pratique celle-ci par comparaison avec la Prusse ou la Grande-Bretagne. Elle a ainsi été un des derniers pays développés à prévoir une vaccination obligatoire, en 1902. De même, elle a mis beaucoup de temps à adopter le raccordement à l’égout ou à mettre en place une organisation publique de la santé.
Au XXe siècle, l’assurance maladie a été ciblée sur la prise en charge des soins et il a fallu attendre 1988 pour qu’un Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires soit constitué en son sein. Cela ne veut pas dire qu’elle ne remboursait pas les actions de prévention, mais elle le faisait implicitement, dans le cadre notamment des consultations médicales.
De plus, les législations sur la prévention étaient très spécialisées : au-delà des grandes lois « Veil » et « Evin » de 1976 et de 1991 sur la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, il s’agissait de mesures spécifiques sur les fléaux sociaux, qui ne se sont jamais diffusées dans l’ensemble du système de santé.
Une nouvelle étape a été franchie dans les années 1990 avec le développement de la prévention liée aux questions de sécurité sanitaire, touchant aux produits de santé, à l’environnement, au travail ou au nucléaire.
Juridiquement, la prévention n’apparaît en tant que politique générale dans le code de la santé publique qu’avec la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui en définit le contenu, en fait une composante de la politique de santé et prévoit un certain nombre d’outils à cet effet. Cette définition sera abrogée en 2004 : la politique de prévention est alors présentée simplement comme une composante de la politique de santé publique.
Ce manque de culture se traduit par des résultats contrastés, lesquels sont bons ou très bons dans la prise en charge des soins mais relativement mauvais, par rapport à d’autres pays, dans les principaux domaines où la prévention a vocation à agir. Le taux de mortalité prématurée est un des plus élevés, 1,5 million d’enfants sont en surpoids et on compte un tiers de fumeurs dans la population.
Troisième constat liminaire : l’économie de la prévention est assez paradoxale. Les actions de prévention identifiées dans les législations ont toujours été, dans le passé, financées par des crédits limitatifs alors que les soins l’étaient dans le cadre du risque maladie, dans un contexte pourtant de contrainte budgétaire moindre. Puis la loi du 4 mars 2002 précitée a prévu des programmes prioritaires de prévention qui devaient, comme les soins, être financés dans le cadre de ce risque. Ses effets mériteraient d’ailleurs d’être évalués.
Pour le reste, on s’en tient toujours à l’étude de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé de 2002, qui avait apprécié le coût de la prévention implicite à 6 % ou 7 % des dépenses de santé, et non à 4 %, comme le faisaient les comptes nationaux de la santé. Cette proportion reste néanmoins très faible.
Le débat sur l’économie de la prévention est complexe : si l’on retient une approche médico-économique, les bilans sont très disparates. Certaines stratégies de prévention réduisent les dépenses en diminuant les risques, tandis que d’autres ne se révèlent pas efficaces sur le plan économique, tout en étant aussi légitimes. La prévention doit être considérée comme un investissement et non comme un élément de régulation du système de santé, même si, dans certains cas, elle peut contribuer à la maîtrise des dépenses.
Dès lors, la prévention doit nécessairement être plurielle et coordonnée, sachant que les acteurs sont très nombreux dans ce domaine, en raison de compétences partagées entre l’État et les collectivités locales – au XIXe siècle, l’autorité de santé était déjà la commune – et d’un partage très complexe entre les différentes autorités ministérielles selon qu’il s’agit de la médecine du travail, de la médecine scolaire, de la protection maternelle et infantile, de la sécurité routière, des conditions de logement ou de la sécurité des consommateurs.
La coordination de ces acteurs est donc difficile : les agences régionales de santé constituent, au niveau régional, un bon moyen à cet effet, conformément à ce qu’a prévu la loi. Une instance nationale comme le comité technique national de prévention, créé par la loi en 2002 mais finalement abandonné en 2004, serait aussi un outil intéressant.
Une action multiforme de l’action de prévention est également nécessaire, car son efficacité passe aussi par des acteurs extérieurs au système de santé – associations locales ou clubs sportifs pouvant avoir, notamment auprès de jeunes, un discours autonome de celui prévalant au sein du système de santé.
Il est par ailleurs essentiel que la politique de prévention ne soit pas dissociée de la politique de soins. Plusieurs propositions peuvent être faites à cet égard.
D’abord, les médecins généralistes pourraient avoir un mandat de santé publique intégrant, à travers notamment un mode de rémunération particulier, des actions de prévention, de participation à des programmes de dépistage ou de veille épidémiologique. Il est important que ce qui est pratiqué de façon implicite devienne explicite et que ce mandat permette de reconnaître ce travail normal des médecins.
Deuxièmement, les fonctions de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique doivent être prises en compte également dans l’activité hospitalière. Or les modes de tarification et les évolutions de la tarification à l’activité rendent problématique le financement de cette approche, notamment s’agissant de l’éducation thérapeutique. Le développement de consultations spécialisées dans ce domaine serait utile.
Troisièmement, il faut s’interroger sur un éventuel rapprochement, avec toutes les difficultés que cela comporte, entre des secteurs aujourd’hui très séparés mais qui doivent être coordonnés. Je pense notamment aux médecins traitants par rapport à la médecine du travail, à la médecine scolaire ou à la médecine universitaire. Les médecins traitants devraient, dans le respect des règles déontologiques, être destinataires des informations de ces services, qui sont aussi importantes pour l’évolution de la santé de leurs patients.
Quatrièmement, la prévention doit donner naissance à ce qu’on pourrait appeler une organisation collective. Au-delà de la coordination des politiques nationales, doit prévaloir une coordination entre les structures publiques, qu’il s’agisse des structures départementales pour la protection maternelle et infantile ou des services de l’État pour les grands programmes prévus par le code de la santé publique.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous préciser le schéma organisationnel de cette coordination ?
M. Didier Tabuteau. Sur les politiques nationales relevant de l’État, voire des autres acteurs publics, l’existence d’un comité national de coordination, permettant de réunir régulièrement les acteurs – qu’il s’agisse du logement, de la santé au travail, de l’éducation, de la santé scolaire et universitaire ou de la santé des consommateurs –, un peu à l’image de ce qui s’est fait en matière de sécurité sanitaire, serait souhaitable.
M. le coprésident Pierre Morange. Que pensez-vous de la suggestion de la Cour des comptes, évoquant la création d’une délégation interministérielle, dont la charge pourrait être assumée par le directeur général de la santé ?
M. Didier Tabuteau. Le directeur général de la santé a légitimement vocation à réunir l’ensemble des acteurs de la prévention. Je ne sais si cela doit donner lieu à la création d’une délégation interministérielle ou à la reconnaissance de la compétence de la direction générale de la santé en tant que telle.
Mais il faudrait aller au-delà, pour intégrer les interventions des collectivités territoriales – notamment des conseils généraux et des communes qui jouent un rôle important, en particulier s’agissant des cantines scolaires, de la protection maternelle et infantile ou des interventions à l’égard des personnes âgées en perte d’autonomie.
Cinquième proposition : l’éducation à la santé doit donner lieu à une action générale dans les programmes scolaires ou les activités des associations sportives et culturelles. En matière de prévention, seules les actions ciblées ont une véritable efficacité, notamment pour réduire les inégalités sociales de santé. Les résultats de la politique de prévention sont étroitement liés à ces inégalités, peut-être plus encore que pour les soins.
Enfin, les programmes de prévention doivent être financés. Le clivage historique entre prévention et soins a pour conséquence une déconnection entre les programmes et les financements. Si la loi de 2004 précitée définit une centaine d’objectifs intéressants, elle a été critiquée pour ne pas offrir une programmation en termes de moyens. En outre, son articulation avec les lois de financement de la sécurité sociale est modeste et gagnerait à être renforcée.
Il faut faire confiance aux professionnels de santé dans la construction d’une politique de prévention. D’où l’utilité d’un mandat de santé publique pour les médecins conventionnés et le renforcement des activités hospitalières dans ce domaine. Il ne faut pas opposer une politique portée par les services administratifs ou les actions médiatisées par les pouvoirs publics et le travail quotidien des professionnels de santé, qui jouent un rôle essentiel.
M. le coprésident Pierre Morange. Comment concevez-vous ce mandat de santé publique ?
M. Didier Tabuteau. La convention médicale devrait – le législateur pourrait d’ailleurs le prévoir, voire l’imposer – spécifier qu’il y ait nécessairement dans l’activité des professionnels de santé conventionnés avec la sécurité sociale et passant un contrat avec le service public de l’assurance maladie une fonction de santé publique, comportant un volet prévention et une participation aux programmes organisés à cette fin, moyennant rémunération.
Dans la dernière convention et la précédente, on trouve certes des éléments de rémunération à la performance, mais il serait plus efficace d’afficher en tant que tel ce mandat de santé publique.
Il convient par ailleurs de renforcer les études médico-économiques sur les stratégies préventives et non, seulement, sur les stratégies de soins, afin d’aider les pouvoirs publics à prendre leurs décisions.
La participation des associations de patients à la politique de prévention est également un élément important, notamment pour la prévention thérapeutique, d’autant qu’elles disposent de moyens techniques et d’une véritable légitimité.
Enfin, le volontarisme des pouvoirs publics en matière de lutte contre l’obésité, l’alcoolisme ou le tabagisme constitue un levier important pour mobiliser l’ensemble des acteurs.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Votre distinction entre les trois piliers de la prévention mérite d’être prise en compte.
Comment pourrait-on associer la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et les assurances complémentaires santé à la coordination nationale que vous suggérez ?
De même, comment coordonner l’action de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé avec celle de l’État ?
Comment l’Éducation nationale pourrait-elle être associée à la politique de prévention ?
De quelle manière pourrait-on mieux coordonner les acteurs, notamment les associations, au niveau local ? Le transfert des comités départementaux d’éducation pour la santé au niveau régional est-il une bonne chose ? Ne faut-il pas renforcer la coordination au niveau départemental ?
Enfin, quel pourrait être le mode de financement des hôpitaux en matière de prévention ?
M. Didier Tabuteau. La place de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, que j’ai évoquée au travers de la création du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires et de la modification de la convention médicale, est éminente. Mais elle n’élabore pas la politique de santé, qui relève de l’État : elle la met en œuvre. Il va de soi que l’assurance maladie, en tant que service public garantissant l’accès aux soins et la prévention médicalisée, a un rôle majeur à jouer.
Les assurances complémentaires jouent également un rôle important – qui tend à s’accroître –, à travers l’information et l’éducation à la santé qu’elles peuvent apporter à leurs adhérents, mais aussi en raison de la place qu’elles peuvent avoir dans les grandes entreprises notamment, par le biais d’un certain nombre d’accords. Mais, si leur coordination avec les politiques nationales est utile, l’action de ces assurances complémentaires à un impact très inégalitaire sur la population. De manière générale, on constate que toute action non ciblée tend à accroître les inégalités sociales.
L’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé est le bras armé de la direction générale de la santé et du ministère de la santé : c’est un opérateur – qui a un rôle important d’expertise, notamment pour le développement des campagnes ou l’animation des réseaux – mais non un organisateur de la politique de prévention.
L’Éducation nationale est bien entendu un acteur majeur de la prévention externe au système de santé. Son investissement dans ce domaine est essentiel. Il doit y avoir de l’instruction sanitaire comme il y a de l’instruction civique. Outre que les enfants y sont tout à fait ouverts, cette formation permet de réduire les inégalités familiales en termes de connaissances sur ces questions. L’Éducation nationale doit donc être au cœur du dispositif de coordination. D’autant que la santé scolaire joue également un rôle substantiel en matière de prévention, notamment pour les enfants de milieux modestes.
Les associations de patients et d’usagers doivent enfin être associées au niveau national et régional à l’élaboration des politiques de prévention. De ce point de vue, les agences régionales de santé et les conférences régionales de la santé et de l’autonomie peuvent jouer un rôle clé. Mais il faut aussi concevoir les politiques de prévention avec des associations n’appartenant pas au système de santé, telles que les associations sportives, culturelles, de quartier, qui sont au plus près des publics concernés, souvent les plus en difficulté, et permettent de réduire les inégalités. Elles jouent un rôle crucial.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur la base de quels critères et par qui ces publics en difficulté seraient définis ? Il n’est en effet pas aisé d’identifier des sous-groupes dans la population française, au risque d’être accusé de les stigmatiser.
M. Didier Tabuteau. Il ne s’agit pas d’identifier des sous-groupes, mais de mettre l’accent sur des territoires présentant les difficultés économiques ou socio-culturelles les plus fortes.
M. le coprésident Pierre Morange. S’agissant des études médico-économiques, on observe que nombre d’entre elles présentent des données obsolètes : il existe un décalage entre des principes généraux, vertueux, et une méconnaissance de la réalité du terrain.
M. Didier Tabuteau. Un travail économique d’actualisation régulière des données doit être entrepris, notamment dans le cadre de l’élaboration des comptes nationaux de la santé. Cela suppose un dispositif statistique approprié – avec un financement correspondant – permettant de suivre les politiques de prévention, un peu sur le mode de ce que l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé a fait il y a une dizaine d’années.
Mais ce travail, qui donnerait une visibilité annuelle aux politiques de prévention, est limité par le fait qu’il ne couvrirait que la prévention réalisée dans le cadre du système de santé, la prévention extérieure étant difficile à identifier.
Concernant les études médico-économiques, qui mesurent l’efficience ou le coût des stratégies de prévention, tout ou presque reste à faire. Cela vaut aussi pour les soins. Notre pays a impérativement besoin de ces études, qui doivent éclairer la décision publique sans naturellement s’y substituer.
Monsieur Jean-Luc Préel, le financement des hôpitaux est un sujet difficile et sensible : leur tarification est au cœur des débats de la communauté hospitalière. Il faudra revenir à un financement mixte, en trois parties, distinguant les activités relevant respectivement du prix de journée, d’une dotation globale et d’une tarification à l’activité (T2A). Celle-ci, lorsqu’elle est systématique, introduit des biais, conduisant à mal prendre en compte la prévention. Des dotations permettant de développer les activités de suivi médical, d’éducation thérapeutique ou à la santé, ainsi que des consultations spécialisées de prévention sont nécessaires : elles doivent être bien distinctes et ne pas servir de variables d’ajustement à la T2A. Chaque mode de financement doit avoir sa logique et sa régulation propres.
Mme Gisèle Biémouret. J’ai été saisie par des associations départementales de dépistage collectif, qui sont inquiètes de l’organisation qui risque de leur être plus ou moins imposée dans le cadre de la coordination régionale. Quel est votre avis sur ce point ?
Quelle doit être la place des conseils généraux dans la prévention de la dépendance et à l’égard des publics précaires ? Certains, après la loi de 2004, ont conservé une politique de prévention et disposent à ce titre de crédits d’État. Par ailleurs, la compétence sociale occupe une place majeure dans l’activité de ces conseils, qui, avec les centres communaux d’action sociale et les centres communaux d’initiative sportive, connaissent le mieux les personnes âgées et ce type de publics.
M. le rapporteur. Comment mieux organiser le dépistage individuel et collectif ? Que pensez-vous de la position de la Cour des comptes à ce sujet ?
M. Didier Tabuteau. Sur l’impact de la mise en place des agences régionales de santé sur les structures départementales de dépistage, je ne suis pas en mesure de porter une appréciation. Mais la coordination régionale est une avancée.
Les conseils généraux, au travers de leurs activités sociales majeures, et les municipalités, du fait de leurs fonctions de proximité immédiate, notamment à l’égard de publics en difficulté, jouent un rôle essentiel. Certaines collectivités régionales développent également des politiques de santé publique et de soutien à certaines actions de prévention. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des collectivités territoriales doit être associé à la coordination du système. Leur rôle a montré qu’elles devaient être parties prenantes des politiques de santé publiques. L’efficacité de l’engagement des villes dans les programmes de lutte contre l’obésité à travers l’amélioration des menus des cantines scolaires est à cet égard exemplaire.
La prévention en matière de dépendance est déjà bien engagée, s’agissant notamment de l’aménagement du domicile, avec la prévention des risques de chute ou de l’isolement.
D’ailleurs, la clarification des compétences opérée depuis 2004 a été positive à cet égard.
Je n’ai pas pris connaissance des analyses du rapport de la Cour des comptes en matière de dépistage. J’estime néanmoins que nous pâtissons en France, par un manque de culture de santé publique, d’une insuffisance des dépistages organisés. Nous devons poursuivre l’effort selon une approche rationnelle : les programmes doivent être ajustés et évalués en permanence.
Quant aux dépistages individuels, ils relèvent de la conscience et de la compétence des médecins et des professionnels de santé. Ils ne posent pas, selon moi, de problème spécifique au regard des pratiques de soins.
Cela dit, il faut essayer de faire coïncider au mieux les pratiques de dépistage avec l’état de la science. Toutes les recommandations et bonnes pratiques élaborées par la communauté médicale dans ce domaine sont les bienvenues.
M. le rapporteur. Les personnes qui vont se faire dépister individuellement et collectivement peuvent se recouper et on a du mal à atteindre un taux de dépistage collectif efficace, de l’ordre de 70 % à 75 % de la population, le taux se limitant à 50 % ou 55 % dans certains départements.
Par ailleurs, est-il raisonnable d’avoir retenu cent objectifs dans la loi de santé publique de 2004, alors que le Royaume-Uni par exemple se limite à quatre ?
M. Didier Tabuteau. Le dossier médical personnel devrait permettre de résoudre le problème des doublons entre dépistage individuel et dépistage collectif. Mais il est plus difficile de faire participer des personnes restant à l’écart des programmes, généralement d’ailleurs pour des raisons socioculturelles. L’action territoriale ciblée est alors la seule façon d’y remédier, notamment par le biais des médecins traitants.
Le débat sur la multiplicité des objectifs est récurrent. On se souvient des critiques provoquées par les vingt-deux plans de santé publique de Bernard Kouchner en 2002 ou les cent objectifs de la loi de santé publique de 2004.
Pour que la politique de santé publique suscite une adhésion générale, il faut se limiter à deux ou trois objectifs principaux bien identifiés. Mais la définition des cent objectifs a néanmoins été utile, chaque objectif, s’il est bien construit et associé à un certain nombre de programmes, de financements, de modes d’organisation ou de rationalisation de la prise en charge, mobilisant le secteur auquel il s’adresse – patients, associations, professionnels hospitaliers ou médecins de ville.
Mme Catherine Lemorton. La médecine scolaire est dévastée : la présence d’une infirmière pour 1 600 élèves dans un lycée est notoirement insuffisante. Ne faut-il pas prioritairement remédier à ce problème, sans impliquer financièrement les collectivités territoriales, qui ont de moins en moins de moyens et peuvent être conduites, comme j’ai pu le constater en matière de prévention de l’obésité, à laisser des industries pharmaceutiques ou agroalimentaires animer les campagnes en apposant leur logo sur les carnets de correspondance ? N’y a-t-il pas lieu de sacrifier éventuellement une ou deux heures d’enseignement général pour offrir aux élèves une formation préventive sur l’hygiène de vie qui pourra leur être utile tout au long de leur vie ?
Quel est le coût de la prévention dans le colloque singulier entre le patient et le médecin libéral, certains actes de prévention étant réalisés dans ce cadre sans être comptabilisés comme tels ? À cet égard, les éléments de performance que vous avez évoqués vont finalement conduire à verser une sorte de treizième mois aux médecins pour rémunérer des actions participant de leur travail de base…
M. Didier Tabuteau. L’Éducation nationale et la santé scolaire sont en effet deux éléments majeurs de la politique de prévention : un investissement dans ce domaine est à la fois efficace et nécessaire.
La politique de santé publique est une mission régalienne. C’est la raison pour laquelle il faut financer les programmes de santé et articuler la loi de santé publique et les lois de financement de la sécurité sociale. J’ai beaucoup regretté à cet égard que n’ait guère été appliquée la disposition de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoyant qu’il y ait, avant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un débat pour fixer les grands programmes de santé de manière à ce que ce projet les mette en œuvre.
D’ailleurs, la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique comportait un titre sur le financement, même si elle n’a été que très imparfaitement appliquée.
Sur le coût de la prévention, je n’ai pas d’autre étude que celle de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé de 2002 que j’évoquais, selon laquelle 45 % des dépenses de prévention étaient identifiées comme telles dans les comptes nationaux de la santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Selon le rapport de la Cour des comptes fourni à la demande de la MECSS, l’enveloppe financière consacrée à la prévention serait comprise entre 1 et 10 milliards d’euros, en fonction des critères retenus…
Par ailleurs, s’agissant de la médecine du travail, qui porte sur plus de 1,3 milliard d’euros, les études médico-économiques que vous évoquiez auraient également tout leur sens.
M. Didier Tabuteau. Je le répète : le rapprochement entre le médecin traitant et la médecine scolaire, universitaire ou du travail est nécessaire. On doit y réfléchir, car les déterminants en matière de prévention résident largement en dehors du système de santé. Le régime agricole, où existe une relation plus étroite entre médecins-conseils et médecins du travail, est très intéressant à cet égard.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie.
*
Audition de M. Hubert Allemand, professeur de santé publique, médecin-conseil, adjoint au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, et de Mme Catherine Bismuth, directrice des assurés à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, en charge du dossier prévention.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Je vous remercie, madame, monsieur, de votre présence.
Si, de l’avis général, nous sommes plutôt performants dans le domaine des soins, tel n’est en revanche pas le cas s’agissant de la prévention et de l’éducation à la santé. La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ayant un rôle majeur à jouer en la matière, que pensez-vous de cette situation ? Comment participez-vous aux actions de prévention et comment jugez-vous le rôle des praticiens hospitaliers et libéraux ? Enfin, après la publication du rapport de la Cour des comptes, quelle est la situation des centres d’examens de santé, comment pouvez-vous la faire évoluer et quelles sont leurs performances ?
M. Hubert Allemand, professeur de santé publique, médecin-conseil, adjoint au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. S’il est en effet courant d’entendre dire que nous ne faisons pas suffisamment d’efforts en matière de prévention, la situation évolue toutefois, en particulier s’agissant du système de soins. Le rapport de la Cour des comptes, quant à lui, fait en effet état des difficultés que nous rencontrons et des interrogations qui sont soulevées : faut-il mettre en place un pilotage global des problèmes de santé ou convient-il de déterminer des objectifs relativement ciblés avec des délais et des financements précis ?
La politique de prévention de l’assurance maladie contribue à la politique de prévention coordonnée par l’État dont elle reprend intégralement les objectifs – en particulier s’agissant des plans et des programmes nationaux – mais elle se distingue principalement par son caractère médicalisé et son orientation vers les pathologies, les soins et la prévention des affections. Plus précisément, elle développe une quinzaine de programmes autour de deux axes majeurs définis dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État : la réduction des inégalités sociales ; la responsabilisation de l’usager-citoyen-patient-assuré-acteur de sa santé.
Nous avons certes intégré notre réseau de caisses primaires d’assurance maladie et de services médicaux à cette politique de prévention afin d’aller au contact des professionnels et des assurés mais, également, des professionnels de santé – depuis l’avant-dernière convention médicale de 2004-2005, nous avons en particulier réalisé des efforts importants en ce sens. De plus, un pas supplémentaire important a été franchi récemment puisque, dans le cadre de notre dernière convention, nous avons proposé aux médecins d’accroître leur action auprès de leur patientèle en s’inscrivant dans la politique de rémunérations sur objectifs de santé publique à travers des objectifs et des indicateurs en liaison avec ceux des pouvoirs publics.
J’insiste : l’un des problèmes majeurs de la prévention réside dans la difficulté à définir son périmètre et, dès lors, les moyens à lui attribuer. Les évaluations qui ont été réalisées, notamment dans le dernier rapport de la Cour des comptes, sont en deçà de la réalité. Lorsque les professionnels de santé surveillent le déroulement des grossesses via, par exemple, des échographies, ils font de la prévention alors que ces actes relèvent du domaine des soins. Il en est de même lorsque dix millions d’hypertendus – dont l’immense majorité souffre d’une affection modérée – bénéficient chaque jour d’un traitement : nous essayons d’ailleurs de maîtriser un facteur de risque assez rare puisque seules quelques personnes sur mille profiteront – au bout de quelques années qui plus est – de cette action de prévention. Le champ de la prévention est donc très vaste comme en atteste aussi la pédiatrie dont une grande partie de l’exercice en relève, alors que son financement, lui, relève du risque. Je signale, enfin, que le rapport de la Cour des comptes mentionne de manière significative dans le champ de la prévention les préventions primaire et secondaire – les vaccinations – et non la prévention tertiaire – comme, par exemple, la prévention des complications chez les diabétiques. Il est manifestement assez facile de se faire piéger par une définition.
M. le coprésident Pierre Morange. La base de données extrêmement complète dont dispose l’assurance maladie s’agissant des dépenses de santé est-elle suffisamment exploitée pour définir une stratégie de prévention, tant par le gestionnaire du risque que vous êtes que par l’État ?
M. Hubert Allemand. Il est vrai que, depuis peu, nous disposons de ce moyen certes puissant mais limité puisque nous n’avons pas un grand nombre d’informations médicales et que nous ignorons, par exemple, si un diagnostic est réalisé à titre préventif ou curatif. Quoi qu’il en soit, nous travaillons à la coordination de différents moyens avec d’autres acteurs de manière à utiliser une telle base dans le sens des politiques définies par l’État. Ainsi est-il par exemple désormais très facile de repérer le nombre de personnes hypertendues ou victimes d’un infarctus du myocarde de manière à évaluer – peut-être grossièrement dans un premier temps – l’impact des stratégies de prévention sur les pathologies : l’espérance de vie en bonne santé augmente-t-elle ? La morbidité ou la mortalité des grandes pathologies est-elle retardée ou diminuée ? Cette base doit être exploitée au maximum pour répondre à de telles questions et permettre aux décideurs de mieux définir les besoins et les actions de soins. Nous souhaitons donc bénéficier pour ce faire des services d’une petite équipe qui associerait l’ensemble des institutions ayant une responsabilité dans la surveillance du système de soins – Institut de veille sanitaire, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Haute Autorité de santé –, afin que les pouvoirs publics puissent répondre aux besoins nouveaux. En l’occurrence, nous sommes à l’orée d’une nouvelle période. S’il est en effet possible de suivre l’action de santé publique d’un professionnel de soins comme un médecin traitant par exemple – sa patientèle est en effet connue –, il est également possible d’aller plus loin dès lors que les bonnes questions sont posées.
Plus généralement, la prévention constitue une activité beaucoup plus difficile que le soin en raison notamment d’une obligation de résultat – et non d’une obligation de moyens. Si, pour un médicament, des évaluations permettent en effet de déterminer le bénéfice-risque, il n’en va pas de même avec la prévention. De quelle prudence et de quelle rigueur d’exécution faut-il faire preuve dans le lancement de programmes ! On y songe rarement alors qu’en la matière, tout peut recéler un danger, y compris l’éducation à la santé. Souvenons-nous que naguère on recommandait que les nouveau-nés soient couchés sur le ventre pour s’endormir et que l’on a fini par s’apercevoir que cela contribuait à accroître la mort subite du nourrisson ! Rien n’est anodin.
En outre, nos politiques de prévention véhiculent des systèmes de valeur même si l’on ne s’en rend plus compte : un dépistage prénatal, par exemple, peut servir à éliminer une personne ou un être en devenir ; il ne saurait donc être considéré comme neutre.
M. le rapporteur. Faites-vous allusion aux tests proposés au moment de la grossesse ?
M. Hubert Allemand. Je pense, en effet, à l’usage qui peut être fait du diagnostic prénatal dans une société qui peut avoir du mal à accueillir les personnes démunies, faibles ou handicapées. Dès lors qu’un dispositif est généralisé, ceux qui veulent le récuser peuvent éprouver des difficultés et se voir opposer, le cas échéant, le fait qu’ils n’ont pas su faire le nécessaire et, dès lors, être regardés d’une manière curieuse. Il faut y prendre garde. Je me garde de porter un jugement mais je tiens à poser la question.
De la même manière, des parlementaires ont évoqué la possibilité, pour les jeunes adolescents de douze à dix-sept ans, de recevoir une contraception à l’insu de leurs parents. Si je comprends les difficultés que peuvent rencontrer certaines jeunes filles, je m’interroge néanmoins sur l’attitude plus globale qui consisterait à contourner les parents, alors que l’on considère par ailleurs qu’il est bon de discuter de toutes sortes de choses en famille. Il faut toujours garder à l’esprit que la prévention peut avoir des effets bénéfiques ou délétères et s’interroger sur les valeurs que nous souhaitons défendre car elles influent peu à peu sur l’ensemble de la société.
Nous disposons donc de programmes de prévention qui accompagnent des programmes nationaux – vaccinations contre la grippe, dépistage des cancers –, mais également, de programmes plus spécifiques consacrés au problème de l’obésité chez les jeunes, à l’accompagnement des femmes enceintes qui présentent des facteurs de risques, à l’hygiène bucco-dentaire, lesquels fonctionnent correctement et sont d’ailleurs évalués.
Les centres d’examens de santé, quant à eux, participent de la politique générale de lutte contre les inégalités de santé et de responsabilisation des patients que j’ai évoquée. Réalisant environ 550 000 examens périodiques de santé par an, ils s’adressent aux populations démunies, précaires ou éloignées du système de soins. C’est un travail difficile que nous effectuons en liaison avec les caisses d’allocations familiales, les centres communaux d’action sociale, les associations et les missions locales. Il importe, en effet, d’aller à la rencontre de ces personnes, afin qu’elles puissent éventuellement bénéficier d’un bilan de santé et, ainsi, se réinscrire au sein du système de soins en prenant, par exemple, un médecin traitant. Je précise, une fois de plus, combien il est difficile d’agir tant il convient à la fois de se montrer très attentifs à ces personnes sans jamais les stigmatiser.
En outre, nous avons développé au sein des centres d’examens de santé des services d’éducation thérapeutique pour la santé : 48 disposent ainsi d’un programme orienté sur les diabétiques de type 2 et 19 sur la broncho-pneumopathie chronique obstructive. Les personnels sont quant à eux formés afin d’aborder ces populations difficiles dans les meilleures conditions. À ce jour, 4 000 personnes se sont rendues dans ces lieux d’éducation thérapeutique au sein des centres d’examens de santé ; 55 % d’entre elles sont en situation de précarité. Nous savons en effet fort bien que, d’ordinaire, ce sont d’abord les populations les plus favorisées qui utilisent les services de prévention et les centres d’examens de santé ont donc été très fortement réorientés vers les populations précaires. Le contrat d’objectifs et de gestion impose au demeurant d’atteindre à hauteur de 50 % les publics les plus démunis - nous en sommes aujourd’hui à 48 % environ. Le programme d’éducation thérapeutique se déroule en six séances : diagnostic, séances thématiques, évaluation – dont une six mois plus tard afin de vérifier si les objectifs définis ont été atteints.
M. le rapporteur. Serait-il possible de connaître précisément ce programme ?
M. Hubert Allemand. Absolument. Nous pouvons vous communiquer un bilan précis.
Mme Catherine Bismuth, directrice des assurés à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, en charge du dossier prévention. En effet, nous pourrons vous donner le protocole national qui permet aux médecins traitants, dans les centres d’examens de santé, de bénéficier de ce programme d’éducation thérapeutique autorisé par l’agence régionale de santé en tant qu’offre de service et, également, les évaluations qui ont été réalisées après une année d’expérimentation, laquelle a montré d’excellents résultats : médecins traitants et patients sont en effet satisfaits, le taux de participation aux séquences de travaux pratiques et au bilan réalisé au bout de six mois étant élevé – pourtant, ce ne sont pas moins de cinq ateliers qui sont dédiés au diabète !
M. le coprésident Pierre Morange. Est-il possible de disposer d’un panorama de l’ensemble de vos actions et des évaluations que vous avez évoquées ? Qu’en est-il précisément de l’efficience médico-économique ? Comme souvent, nous constatons l’existence de bonnes pratiques qui, hélas, ne sont pas généralisées.
M. Hubert Allemand. Ce que vous dites est fondamental. Nous avons en effet le sentiment que de nombreuses expériences sont réalisées dans le champ de la prévention mais qu’elles souffrent de ne pas être généralisées à l’ensemble de la population.
Les centres d’examens de santé, enfin, abritent la cohorte « Constances » : 200 000 volontaires y viennent faire des bilans régulièrement, des examens complémentaires ayant lieu en fonction de leur âge ou du domaine de recherche des épidémiologistes. Les résultats sont alors croisés avec les bases de données de l’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, afin de disposer d’un regard assez complet de leur situation ainsi que de leur environnement et de comprendre les différentes situations de santé. J’ajoute que « Constances » est pilotée essentiellement par l’Institut de recherche de santé publique − groupement d’intérêt scientifique créé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale −, la direction générale de la santé et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Notre programme Sophia, quant à lui, a été lancé dans dix départements, en couvre aujourd’hui dix-neuf et est en cours de généralisation à la suite des premiers éléments d’évaluation dont nous disposons – participation, satisfaction des patients et des professionnels, utilisation des moyens du système de soins comme les médicaments ou les hospitalisations. En revanche, nous avons besoin de recul s’agissant des résultats sanitaires en termes de morbidité ou de mortalité. J’ajoute que cette généralisation est d’ailleurs très modulée : si Sophia concerne les 3 millions de diabétiques français, certains d’entre eux ne sont sollicités qu’à travers la réception de documents, de journaux, de livrets ou de questionnaires. La segmentation de cette population permet de faire en sorte que plus la personne est à risque ou connaît des complications – cardiovasculaires par exemple –, plus elle est accompagnée y compris, par exemple, dans le cadre d’échanges téléphoniques. Certains ont parlé de gestion de la maladie (disease management) mais tel n’est pas le cas : nous accompagnons en effet les personnes pour les aider à mieux maîtriser leur maladie et à suivre ce que les professionnels de santé – et, notamment, leur médecin traitant – leur ont proposé. Nous veillons à ce que tous les moyens existant sur un territoire donné soient utilisés au mieux pour les patients en fonction de leurs besoins. Une telle segmentation étant évidemment assez sophistiquée, elle requiert une certaine technicité.
Autre expérimentation mais qui, cette fois-ci, n’est pas généralisée tant il est difficile de savoir comment et avec quels moyens elle pourrait l’être : le dépistage de la surdité. Il en va de même de la vaccination contre le cancer du col de l’utérus dû au papillomavirus (Human Papilloma Virus − HPV). En l’occurrence, le taux de couverture de la population est de 35 %, mais, là encore, il s’agit vraisemblablement des femmes les plus favorisées qui, demain, seront suivies en tout état de cause par un gynécologue. Nous considérons que cette cible n’est pas la bonne et qu’il conviendrait, si nous devions proposer cette vaccination, d’en viser une autre. Il convient d’évaluer notre politique en la matière et d’en mesurer le coût, en sachant qu’au Royaume-Uni 95 % des jeunes filles de quatorze ans sont vaccinées et que de telles actions de prévention, hélas, sont parfois abandonnées au fil de l’eau.
Soyons un peu provocateur. Nous proposons en France 53 examens de santé tout au long de la vie : examens prénataux, postnataux, examens obligatoires des enfants de moins de six ans, bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, visites médicales des sixième, neuvième, douzième et quinzième années, entretien personnalisé en classe de cinquième, examen bucco-dentaire de prévention, consultations annuelles de prévention des jeunes de seize à vingt-cinq ans, certificat médical pour la journée d’appel et de préparation à la défense, examen préventif médical, social et psychologique des étudiants des universités, consultations prénuptiales, consultations de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans, etc. Nous ne disposons d’ailleurs pas d’évaluation de ces examens auxquels s’ajoutent donc les programmes des centres d’examens de santé. En fait, il serait plus efficace de formuler des objectifs plus précis et peu nombreux. Cela ne signifie certes pas qu’un pilotage d’ensemble soit inutile – je songe aux 100 objectifs annexés à la loi de santé publique de 2004 – mais il conviendrait de définir de façon précise ceux que nous voulons atteindre dans les dix prochaines années dans de grands domaines, l’approche systémique de tous les leviers qui doivent être activés et dont nous ne manquons d’ailleurs pas sur le plan national, régional et départemental – y compris le réseau internet – venant éventuellement ensuite. Cette politique doit donc être repensée à travers un pilotage global et une réduction sérieuse du nombre des objectifs. L’assurance maladie, quant à elle, essaie de faire preuve de pragmatisme et de s’intégrer dans les dispositifs en vigueur. En l’état, ses ambitions – qui sont grandes – sont circonscrites à la quinzaine d’objectifs que j’ai signalés : il n’y en a pas cinquante !
M. le rapporteur. Vous vous êtes en effet montré provocateur mais vous ne proposez la suppression d’aucun des 53 examens en question – et surtout pas, j’imagine, celle des examens prénataux – lesquels n’ont rien à voir avec les 100 objectifs de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cela dit, il est exact que nous souffrons de ne pas avoir défini trois ou quatre objectifs principaux.
Quelles sommes, globalement, consacrez-vous au risque et à la prévention ? Travaillez-vous de façon coordonnée avec les autres caisses, et, notamment, la Mutualité sociale agricole, le Régime social des indépendants et les régimes complémentaires ? N’y a-t-il pas des problèmes de partage de données avec ces derniers ?
La vaccination contre le HPV est-elle obligatoire au Royaume-Uni ?
Si vous financez le dépistage individuel du cancer du sein, à combien votre participation au financement du dépistage collectif s’élève-t-elle ? Existe-t-il des doublons ?
Mme Catherine Lemorton. Les campagnes de vaccination tombent sous le coup de ce que j’appellerais une loi d’exception, puisque les laboratoires peuvent gérer celles qu’ils veulent promouvoir. En l’occurrence, la vaccination contre la rougeole me paraît bien plus relever de l’urgence de santé publique que le cancer du col de l’utérus mais – je ferai moi aussi de la provocation – il est vrai que cette vaccination rapporte sans doute beaucoup moins. Convient-il donc de laisser les campagnes de vaccination aux mains des laboratoires ou relèvent-elles de la responsabilité de l’État ?
De plus, la vaccination contre le HPV n’empêche en rien les actions de prévention primaires, telles que l’examen annuel du col de l’utérus à partir de vingt-cinq ans, et il me semble qu’il serait plus utile de consacrer les 350 euros que coûte la vaccination d’une personne à la réalisation de frottis réguliers.
Vous avez évoqué les hypertensions artérielles dites légères, la délivrance d’un médicament étant en l’occurrence également préventive contre d’éventuelles complications. N’est-ce pas là le signe d’un échec, puisqu’il aurait dû être possible de cibler les comportements qui en sont à l’origine ? Que pensez-vous, en outre, de la sortie des hypertensions sévères de la liste des affections de longue durée ? Les personnes qui en souffrent éprouvant des difficultés à accéder à des contrats mutuels, la politique de prévention à leur égard n’en pâtira-t-elle pas ?
Je ne suis pas choquée qu’en matière de contraception des jeunes filles puissent échapper au contrôle parental : outre que c’est de leur corps qu’il s’agit, il est parfois très difficile d’aborder ces sujets dans certaines familles. Je rappelle, de surcroît, que la contraception d’urgence sous anonymat a été instaurée assez facilement et que 200 000 interruptions volontaires de grossesse par an ont encore lieu en France.
Enfin, n’êtes-vous pas sensible à certains paradoxes législatifs ? Les dégâts de santé publique liés à l’alcool sont considérables. Or, la publicité pour l’alcool est autorisée sur internet. De la même manière, le prélèvement d’une taxe sur les jeux a été voté afin de financer les problèmes liés à la perte d’autonomie des personnes âgées. Or, la libéralisation des jeux en ligne favorise un accroissement de l’addiction. N’est-on pas en train de faire tout et n’importe quoi ?
M. Hubert Allemand. Des consultations de prévention, monsieur Jean-Luc Préel, peuvent sans doute être supprimées. Outre qu’il n’est pas possible de généraliser des programmes qui, précisément, ne fonctionnent pas bien et dont seules quelques personnes profitent, une consultation annuelle de prévention entre seize et vingt-cinq ans me paraît inutile même si la plupart du temps elles ne sont d’ailleurs pas effectuées.
Nous essayons de coordonner nos actions avec les autres régimes obligatoires, Régime social des indépendants, Mutualité sociale agricole, ainsi qu’avec les régimes complémentaires, même s’il importe que chacun d’eux conserve un champ d’action de prévention bien défini en fonction des spécificités de ses assurés. Plus précisément, nous avons proposé que l’opération Sophia soit réalisée en commun.
Mme Catherine Bismuth. Nous avons mis en place des campagnes communes avec les autres régimes comme, par exemple, celles sur les risques cardiovasculaires ou « M’T dents ». Les assurés bénéficient alors des mêmes programmes.
M. Hubert Allemand. Nous essayons donc de travailler avec les régimes complémentaires notamment sur un programme concernant le domaine cardiovasculaire et nous avons proposé qu’il en soit de même avec Sophia, même si cela est un peu difficile, pour des raisons techniques de partage de données. Dans le champ conventionnel, nous disposons bien entendu de programmes communs portés par M. Frédéric Van Roekeghem, les différentes actions mises en place étant toujours définies par les directeurs des trois caisses, en particulier s’agissant de ce qui relève du champ conventionnel.
M. le coprésident Pierre Morange. Mesurer l’efficacité de la prévention implique de se situer sur le long terme et, sans doute, de poser un regard sur les exemples étrangers dont les systèmes de santé sont comparables au nôtre et disposent de recueils de données objectifs et assez exhaustifs. Des échanges de données sont-ils institutionnalisés ? Existe-t-il une programmation visant à s’inspirer des bonnes pratiques ?
M. Hubert Allemand. Il est en effet très important d’être avisés des réussites à l’étranger mais il ne l’est pas moins de les adapter.
M. le coprésident Pierre Morange. Les éléments culturels et éducatifs, par exemple, sont naturellement essentiels.
M. Hubert Allemand. Nous observons les différentes situations et nous essayons donc, ensuite, de les adapter au système français – la rémunération à la performance a été ainsi conçue « à la française ».
Mme Catherine Bismuth. En ce qui concerne les programmes de prévention, les comparaisons internationales permettent en effet de savoir ce qui est efficace ou non. Le programme Sophia a ainsi démarré à partir des expériences américaine, britannique et allemande. S’agissant des problèmes liés à l’obésité, en revanche, nous n’avons pas trouvé d’expériences étrangères ayant été évaluées susceptibles d’être adaptées au système français – ainsi souhaitons-nous placer le médecin traitant au cœur de la prévention contre l’obésité alors qu’à l’étranger, elle relève plutôt de la santé scolaire ou de la pédiatrie.
M. Hubert Allemand. L’évaluation est en effet nécessaire. À ce jour, environ 150 000 personnes sont parties prenantes du programme Sophia quand l’ensemble des réseaux nationaux dédiés au diabète en compte vingt-huit mille. L’impact est d’ores et déjà considérable en termes d’information et d’accompagnement : comment organiser l’activité physique des patients, leur alimentation, l’usage des médicaments et du système de soins, etc.
Le pourcentage de vaccinations contre le virus HPV au Royaume-Uni ne m’a pas, quant à lui, étonné en raison de l’organisation du système de soins : la population étant rattachée à des cabinets de médecins généralistes, ces derniers vérifient au fil des consultations si ce qui doit être fait l’a été. Ainsi 95 % des diabétiques de type 2 bénéficient-ils annuellement d’un examen de fond d’œil contre 45 % chez nous. Les patients britanniques, en l’occurrence, ne se rendent pas chez un ophtalmologiste car un rétinographe permet de réaliser l’examen chez le médecin généraliste.
Nous disposons d’une politique de dépistages individuels et collectifs des maladies du sein ainsi que colorectales et les frottis cervico-vaginaux sont désormais inclus dans la convention de rémunération sur objectif de santé publique. Des progrès seront donc sans doute réalisés auprès des 30 % de la population qui ne bénéficient pas de ce dernier examen mais qui se rendent cependant chez leur médecin traitant, lequel est le mieux placé pour les solliciter – ce qui ne signifie pas qu’il réalisera lui-même l’examen.
Outre les dépistages organisés, il en est de spontanés. Si nous avons choisi de ne pas rendre obligatoires les dépistages organisés – bien qu’ils soient bien meilleurs en termes de qualité en raison d’une double lecture – car, chez nous, le drapeau de la liberté flotte très haut, il nous semble toutefois important de faire évoluer les comportements et les mentalités en expliquant l’intérêt qu’il y a à bénéficier de programmes performants. Il serait également possible de ne plus rembourser des mammographies de dépistage spontanées mais, outre que cela ne serait pas de bonne politique, des difficultés ne manqueraient pas de surgir : laissons donc leur liberté aux individus et continuons d’additionner le dépistage spontané et le dépistage organisé puisque nous avons les moyens de le faire, tout en étant déterminés à montrer combien le dépistage organisé est préférable !
Les campagnes de vaccination, quant à elles, relèvent à mon sens de la responsabilité de l’État : je ne peux pas imaginer que des industriels du médicament proposent des programmes qui n’auraient pas été décidés par l’État. Il s’agit là d’actions populationnelles qui ne sont pas sans risques et qui doivent être sereinement décidées. L’essentiel, une fois qu’il en est ainsi, c’est qu’elles soient menées à bien. Il faut bien constater que la programmation de nombre de campagnes de vaccination n’ayant pas été ultimement décidée échoue. Les pouvoirs publics doivent faire savoir qu’ils recommandent telle ou telle vaccination, les différents opérateurs – dont l’assurance maladie – agissant ensuite de manière à assurer son succès. Le travail des laboratoires, c’est de trouver des vaccins utiles pour les populations en France et dans le monde, ce qui est déjà beaucoup !
L’hypertension artérielle légère, qui est la plus massive, se combat également par une hygiène de vie. L’alcool étant le plus grand hypertenseur en France, nous savons que la tension artérielle d’une personne dépendante qui arrête sa consommation d’alcool baisse. Il en est de même en ce qui concerne la consommation de sel : sa diminution d’un gramme par jour constituerait d’après une étude américaine une opération des plus rentables en termes de santé publique. Un dollar investi, ce sont quinze dollars récupérés ! En la matière, nous sommes au cœur du paradoxe de la prévention puisqu’une mesure appliquée à beaucoup ne profite qu’à quelques-uns – six pour mille en ce qui concerne les mammographies. La logique de la prévention implique une exécution au cordeau.
Bien des personnes connaissant une hypertension artérielle sévère – laquelle vient donc de sortir de la liste des affections de longue durée – souffrent également d’une autre pathologie et demeurent comme telles inscrites en affections de longue durée – je vous rappelle d’ailleurs que l’on enregistre depuis peu l’ensemble des motifs d’inscription. De surcroît, nous sollicitons nos 50 000 médecins généralistes afin qu’ils suivent mieux l’hypertension artérielle, leur objectif dans le cadre de la rémunération à la performance étant de parvenir à normaliser 60 % de leurs 10 millions de patients qui en sont atteints. Cela aura un autre impact que l’exclusion de quelques centaines de milliers de personnes dont le traitement sera pris en charge par leur régime complémentaire – si l’on considère que c’est injuste, il faut alors introduire aussi l’hypercholestérolémie parmi les affections de longue durée !
Notre programme de prévention des maladies cardiovasculaires, quant à lui, est extrêmement important puisqu’il touche 2,3 millions de personnes chaque année.
Mme Catherine Bismuth. En effet, tous les hommes à partir de trente-cinq ans et toutes les femmes à partir de quarante-cinq sont sollicités.
M. Hubert Allemand. Cela représente 1,7 million de personnes auxquelles s’ajoutent les 7 000 personnes auxquelles on envoie un document d’information sur les maladies cardiovasculaires chaque fois que leur médecin demande un examen lipidique. Il s’agit là de la prévention primaire.
Mme Catherine Bismuth. Afin de réaliser une véritable prévention, le programme concernant l’hypertension artérielle concerne les personnes jeunes dont les statistiques montrent qu’elles n’ont pas atteint la moyenne d’âge des entrées en affections de longue durée.
M. Hubert Allemand. Outre que nous avons mis en place des guides sur les affections de longue durée disponibles auprès des médecins traitants, nous n’abandonnons pas, je le répète, les personnes qui en sont sorties.
Le dispositif de contraception d’urgence, quant à lui, fonctionne bien.
M. le coprésident Pierre Morange. En connaissez-vous les chiffres alors que 200 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées chaque année ? La prévention, en la matière, n’est que très peu efficace.
M. Hubert Allemand. Je vous les communiquerai – ils continuent d’ailleurs à croître.
M. le coprésident Pierre Morange. Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse demeure donc élevé.
M. Hubert Allemand. En effet.
Nous savons, de plus, que ce sont parfois de jeunes garçons qui se rendent dans les pharmacies mais est-ce pour leur amie ou leurs parentes ? Je crois, de plus, que certains départements semblent plus concernés que d’autres.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous faire parvenir vos programmes d’éducation thérapeutique et préciser, à l’occasion, quel est le suivi du programme Sophia ?
M. Hubert Allemand. D’autant plus assurément qu’une évaluation externe et indépendante est quasi permanente.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie.
*
Audition de M. Laurent Chambaud, inspecteur général des affaires sociales.
M. Laurent Chambaud, inspecteur général des affaires sociales. Permettez-moi en préalable de vous présenter brièvement mon parcours personnel. Je suis médecin en santé publique et j’ai suivi ma formation au Québec où j’ai travaillé pendant neuf ans dans le secteur dit « de la santé communautaire ». À mon retour en France, j’ai exercé les fonctions de médecin inspecteur dans divers départements de l’Ouest, puis ai intégré, en tant qu’enseignant, l’École nationale de la santé publique – car telle était sa dénomination à l’époque. J’ai ensuite rejoint la Commission européenne en 1996, ce qui m’a permis de vivre « en direct » la crise dite « de la vache folle » qui résultait d’un problème principalement agricole mais avait des conséquences importantes en matière de santé publique. Après un bref passage, en 1998, à l’Institut de veille sanitaire, je suis devenu directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne, puis directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté et enfin inspecteur général des affaires sociales. Je suis actuellement en détachement auprès de l’agence régionale de santé d’Île-de-France. J’ai ainsi pu, au cours de ma carrière, appréhender les questions de santé publique à divers niveaux, sur le plan local, national et international. J’ajouterai que j’ai présidé, pendant quatre ans, la Société française de santé publique.
Vous m’avez fait parvenir plusieurs questions. La première, partant du constat que deux politiques de prévention coexistent, l’une axée sur les pathologies et l’autre axée sur des groupes de population, portait sur l’approche qu’il conviendrait de privilégier.
En réalité, il existe trois catégories de politiques de prévention car celle fondée sur les populations peut être scindée en deux approches : soit par groupe populationnel (par exemple, les femmes, les personnes âgées ou les jeunes), soit par milieu de vie – école, milieu de travail ou encore quartier. On ne retrouve pas cette approche dans les plans de santé publique alors qu’elle est particulièrement intéressante.
Mon expérience m’a en outre montré que, s’il est évidemment important de distinguer, classiquement, prévention primaire, secondaire et tertiaire, comme le fait d’ailleurs la Cour des comptes, il n’est procédé à aucune distinction selon les responsables de la prévention. On peut considérer que la prévention relève principalement de la responsabilité du système de soins, ce qui correspondrait à ce que les Québécois appellent les « pratiques cliniques préventives » ; mais on peut également appréhender la prévention dans sa dimension sociétale – il s’agirait alors d’une prévention primaire à vocation généraliste et généralisée, comme par exemple dans les domaines de l’éducation nutritionnelle ou encore de la sécurité sanitaire. Je pense qu’il faut garder ces deux aspects de la prévention à l’esprit car cette approche permet de mieux saisir les conditions dans lesquelles le système de santé est capable d’intervenir.
Vous m’avez également demandé quelle était la politique de prévention qui, selon moi, était la plus efficace : une politique incitative ou coercitive ? Il faut sans doute mêler les deux approches. Mais surtout, il convient d’opérer une distinction entre mesures « passives » et mesures « actives ». C’est un point important. Dans certains domaines, si des mesures actives sont adoptées, elles peuvent conduire les personnes concernées à modifier, individuellement, leur comportement. Ainsi en est-il de la santé au travail : porter un casque de protection ou un appareillage destiné à protéger l’audition suppose une démarche active. Mais des mesures « passives » peuvent aussi être prises en amont, comme réduire les nuisances sonores dans l’entreprise ou aménager l’environnement de travail pour y éviter les chutes d’objet. On comprend bien que l’adoption de telles mesures pour assurer un environnement sain conduit les comportements individuels à exercer une influence positive sur l’état de santé. Cela étant, je pense qu’il faudra toujours en passer par certaines mesures coercitives comme le port de la ceinture de sécurité obligatoire. Mais leur efficacité sera accrue si elles sont mises en œuvre dans un environnement amélioré.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Pourriez-vous nous faire part de votre opinion sur le système de prévention français et notamment ses modalités de pilotage, au vu de vos expériences québécoise et européenne ?
M. Laurent Chambaud. Le système français me paraît caractérisé par une difficulté de pilotage. C’est un système complexe, dans lequel on ne sait pas qui est responsable. Même si l’on note des tentatives de pilotage unifié tant au niveau national qu’au niveau local avec les agences régionales de santé, les structures demeurent très nombreuses, éparpillées entre services de l’État, l’assurance maladie avec ses divers régimes, les mutuelles et les collectivités territoriales. Le système en devient difficilement lisible.
Une autre particularité française me semble résider dans le poids des déterminants sociaux en matière de santé – ils sont fondamentaux. Les inégalités constatées en matière de santé sont intimement liées à des inégalités sociales. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires n’a fait que reconnaître que les leviers en matière d’action sociale ne relevaient plus de l’État mais des collectivités territoriales. Je souligne qu’au Québec, les agences sanitaires sont des agences « de la santé et des services sociaux ». Cette approche conjuguant les deux aspects, sanitaire et social, est d’ailleurs partagée par de nombreux autres pays.
J’attirerai l’attention sur un autre point qui pose problème : les pratiques cliniques préventives ne pourront être bien organisées que si tel est aussi le cas de la médecine de premier recours. La loi du 21 juillet 2009 précitée a certes défini ce niveau de premier recours, mais il demeure mal organisé, d’où les difficultés rencontrées pour faire le lien entre prévention et soins.
Notre pays possède en revanche un réel atout, sur lequel on n’a pas assez insisté : il s’agit de l’implication des collectivités territoriales dans la politique de prévention. J’ai pu le constater dans le cadre des fonctions que j’exerce au sein de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, cette dernière souhaitant d’ailleurs développer fortement les contrats locaux de santé. Alors que de nombreux pays s’interrogent sur les moyens permettant de mieux impliquer les collectivités territoriales dans la prévention, celles-ci sont en France très présentes qu’il s’agisse des communes, des communautés de communes et d’agglomération, des départements et, dans une moindre mesure, des régions. Ce point n’est pas suffisamment valorisé. J’ai pu constater qu’au Québec, les instances locales étaient au contraire peu actives dans le domaine de la prévention, celui-ci étant du ressort du ministère chargé de la santé et de son « bras armé » que constitue le réseau des agences. Dans une telle situation, il est ardu de promouvoir l’interdisciplinarité que suppose la politique de prévention au plan local, car il faut convaincre les collectivités territoriales du bien-fondé de cette approche. L’implication des collectivités locales françaises constitue donc une opportunité sur laquelle il conviendrait de miser davantage.
M. le rapporteur. Quelle est votre position concernant la distinction opérée en France entre dépistage individuel et collectif ? Estimez-vous que d’autres approches devraient être adoptées ? Par ailleurs, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fixé 100 objectifs. Qu’en pensez-vous ? Jugez-vous des améliorations possibles – je rappelle que l’objet de notre mission est certes de dresser un état des lieux mais aussi d’émettre des propositions ?
M. Laurent Chambaud. Les 100 objectifs fixés par la loi de 2004 relative à la politique de santé publique sont en réalité plutôt un tableau d’indicateurs, avec ses avantages mais aussi ses limites. Cette loi a prévu cinq plans stratégiques, qui n’ont pas tous été mis en œuvre ; j’estime qu’un des problèmes réside justement dans l’accumulation de plans. Mais je pense également que, quel que soit le gouvernement en place, il sera toujours tenté de répondre aux pressions de divers groupes par des plans qui sont autant de « facilités ». Il me paraît donc illusoire de croire que l’on pourrait y renoncer. L’important, en réalité, est la « toile de fond » dans laquelle ils sont élaborés. Ils doivent reposer sur des orientations fortes et un nombre limité de priorités – pas plus d’une dizaine. Il convient aussi de résister à la tentation de « dérouler » un plan jusqu’à son niveau le plus détaillé. L’échelon national doit définir un cadre de travail ; son rôle est d’orienter les opérateurs qui déclineront ensuite, au niveau local, les axes qu’il a déterminés. Il n’a pas à définir un plan d’action qui relève, en réalité, des agences régionales de santé.
Je tiens par ailleurs à évoquer la difficulté que soulève la durée des plans élaborés. Les plans français courent généralement sur une période de cinq ans, ce qui est peu adapté lorsqu’on souhaite un nouvel élan. Dans les pays anglo-saxons, la durée des plans avoisine la dizaine d’années – c’est ainsi le cas au Québec. Or, l’on sait qu’en matière de prévention, les actions s’inscrivent dans la durée et nécessitent un certain temps pour être mises en place. Un horizon temporel de quatre ou cinq ans n’est pas suffisant. J’ajoute que, si un débat public était engagé sur les grandes orientations retenues, celles-ci transcenderaient les clivages politiques et seraient moins affectées par les changements de gouvernement. Il me semble fondamental d’assurer une continuité des actions de prévention, faute de quoi elles sont forcément mises en cause et entrecoupées de périodes d’incertitude.
J’en terminerai avec un dernier point important : de nombreux pays rencontrent des difficultés pour que coïncident une dynamique « verticale descendante » et les dynamiques locales. Je pense qu’on ne peut se fier à un modèle unique de prévention qui serait décliné jusqu’à l’échelon des quartiers. Les problématiques sont différentes, de même que leurs modalités d’appréhension. On ne pourra mener des actions identiques dans différentes régions, ni même, au sein d’une même région, dans différentes communes ou différents quartiers. Ainsi, à Montréal, existent des « tables de concertation » dans chaque quartier pour y développer une approche d’ensemble des déterminants de santé à cet échelon. Cela conduit à des propositions précises, comme la création de pistes cyclables pour développer l’exercice physique, des mesures de sécurité routière ou de protection en milieu scolaire, ou encore en matière de logement. Chaque quartier se « prend en main ». Il me semble important de soutenir les initiatives locales qui traduisent l’expression d’une mobilisation de la population.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur ce point, j’ai la même analyse que vous et je pense qu’il convient d’avoir une vision stratégique nationale déclinée par les acteurs locaux, sa mise en œuvre relevant des collectivités et des bassins de vie, dans un schéma élaboré à l’échelle régionale. Votre expérience québécoise vous a-t-elle permis d’identifier des démarches ayant une plus grande efficacité ?
M. Laurent Chambaud. Il faut continuer à évaluer les expériences étrangères et pas seulement celles du Québec pour retenir les plus efficaces. Les politiques menées ont souvent induit des changements de comportement, une plus grande capacité à contrôler des problèmes de santé. Cependant, ces démarches, appelées « démarches de santé communautaires » au Québec restent difficiles à évaluer puisqu’elles portent sur la capacité des personnes et des populations à mieux contrôler leur propre santé. Les publications de la Cour des comptes ou d’autres organismes s’appuient sur des éléments quantifiés mais, s’agissant des politiques publiques locales, elles ne sont pas toujours directement transférables. Cela étant, des programmes existent aussi en France, comme le programme ICAPS (intervention auprès des collégiens centrée sur l’activité physique et la sédentarité), sur la nutrition et l’activité physique à l’école. Le programme a respecté des critères scientifiques pertinents et a montré, au bout de deux ans, des résultats réels dans le domaine du surpoids et d’obésité.
Mme Catherine Lemorton. Vous avez rappelé l’importance des déterminants sociaux sur la vie des individus et leur santé, sur l’accès aux soins et la prévention. Vous avez relevé la difficulté de l’articulation entre le secteur social et le secteur médical en France. Notre modèle, qui repose sur une médecine de ville libérale avec un médecin au sommet d’une pyramide de professions dépendant de leurs prescriptions, est-il encore pertinent ? Un transfert de certaines compétences des médecins vers les professions médicales ou paramédicales, relevant de la quatrième partie du code de la santé publique, ne serait-il pas pertinent puisqu’une fois la prescription intervenue, ce sont les principaux interlocuteurs des patients, qu’ils soient infirmières, masseurs-kinésithérapeutes ou orthophonistes par exemple ? N’est-ce pas là une voie à suivre pour articuler de façon plus efficiente le caractère social et médical de la prévention, en particulier en direction des populations les plus démunies ?
Le rapport de la Cour des comptes sur la prévention sanitaire comporte un passage d’anthologie où il est relevé qu’en matière d’obésité, la « maladie du XXIe siècle », l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé fait remarquer que l’interdiction de la publicité pour les produits trop sucrés, trop salés ou trop gras dans les créneaux horaires des programmes audiovisuels destinés aux enfants a bien fait diminuer la prévalence de l’obésité dans les tranches d’âge concernées, malgré les déclarations contraires de l’Association nationale des industries alimentaires et l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel contestant l’efficacité de l’interdiction de la publicité en termes de santé publique tout en soulignant le risque de diminution des financements pour la création audiovisuelle. Pouvez-vous confirmer que cette interdiction, déjà ancienne au Québec comme en Suède, de certaines publicités pour le secteur agroalimentaire destinées aux jeunes publics a bien fait diminuer la prévalence de l’obésité ?
M. le coprésident Jean Mallot. Avez-vous connaissance de méthodes permettant de surmonter des conflits d’intérêts de ce type, dans le domaine de la publicité et plus généralement du financement de l’audiovisuel, le poids de l’industrie pouvant jouer un rôle pervers comme l’a montré l’exemple récent du bisphénol A ?
Les actions ou les initiatives de prévention sont diverses et variées. Or, dans notre société, tout se quantifie et se mesure : les actes médicaux, la tarification des hôpitaux, etc. La prévention n’est pas facile à valoriser ni à rémunérer bien que la convention médicale nouvelle le prétende : avez-vous dans ce domaine également des suggestions à nous faire, à moins, puisqu’elle n’est pas quantifiable, de faire de la prévention sans le savoir et donc de façon peu optimale ?
M. Laurent Chambaud. Faut-il transférer des compétences ? Mon sentiment personnel, des expériences ayant déjà été faites dans ce domaine, est que les actions de prévention, et notamment les pratiques de clinique préventive, doivent être complètement intégrées à l’action de l’ensemble des professionnels de santé et pas seulement des médecins. La répartition des compétences pose des problèmes partout, y compris au Québec, entre les différents professionnels de santé. Un débat est nécessaire sur ce point même si l’histoire de la constitution de ces professions, spécifique à chaque pays, est un élément explicatif incontournable.
Je peux cependant vous délivrer un message d’espoir : dans mes fonctions à l’inspection générale des affaires sociales avant de rejoindre l’agence régionale de santé de l’Île-de-France, j’ai participé à une mission sur les maisons de santé pluridisciplinaires. Il y a moins de deux ans, donc, nous avons auditionné les syndicats des professionnels de santé successivement, mais les jeunes professionnels, internes, étudiants infirmiers et autres ont décidé de produire un mémoire commun. Des évolutions de la perception des modalités de l’exercice professionnel sont donc en cours, elles doivent être accompagnées sur le plan financier. Un consensus est en voie d’élaboration sur ce plan aussi. Il ne s’agit pas de passer de la rémunération à l’acte au salariat ou à la capitation totale, mais de mettre en place des formules mixtes permettant de respecter, par exemple dans le cas des maladies chroniques, un mode de forfaitisation, seul à même d’assurer un suivi sur le long terme des populations intéressées ou, dans d’autre cas, des formes de capitation ou, comme au Royaume-Uni sur des points précis, d’actes. Cette approche mixte se retrouvera dans les financements des modes groupés, les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, voire les pôles de santé. Les modalités d’intervention dans les différents actes de prévention peuvent dès lors être différentes selon que l’on est médecin, infirmière, kinésithérapeute, chirurgien-dentiste. La France en est, sur ce point, au tout début.
Les analyses de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé se fondent sur des études scientifiques, mais la lutte contre l’obésité ne se résume pas à l’interdiction de la publicité. Le problème de l’obésité et du surpoids au Québec comme au Canada n’est pas comparable avec la situation française. L’interdiction de la publicité pour les enfants est une mesure passive, sans aucune intervention des enfants ou de leur famille. En termes de prévention, les mesures passives réduisent les inégalités alors que les mesures actives les accentuent. Cependant l’exemple du Québec montre que ce n’est pas suffisant. Le contexte économique, social et culturel joue en effet un grand rôle. Les réalités en matière d’obésité au Québec, même si elles y sont un peu moins impressionnantes que dans d’autres provinces canadiennes, sont ainsi complètement différentes des nôtres. Les seules mesures passives, isolées du contexte général, ne sont donc pas suffisantes. On constate ainsi qu’au Québec l’obésité et la mauvaise nutrition affectent la majorité de la population. En France, en revanche, pour des raisons qu’il serait intéressant d’étudier, ce n’est pas le cas et, si la question du surpoids chez les enfants reste une préoccupation dans certains milieux, on observe parallèlement une accentuation des inégalités en la matière. Dans ce cadre complexe, néanmoins, je maintiens que des mesures passives, quand elles sont possibles, sont de loin préférables.
Ai-je des modèles ou des méthodes en matière de conflits d’intérêts ? Au risque de vous décevoir, non. Tous les pays que je connais y sont confrontés. La solution relève de la négociation politique. Je reste persuadé que le débat démocratique peut aider les pouvoirs publics à prendre les décisions qui s’imposent.
Rémunérer la prévention dans le cadre des pratiques cliniques préventives que j’ai définies devrait être possible. Un forfait sur l’éducation thérapeutique du patient comprendrait cet aspect, comme la prise en charge de la vaccination ou des dépistages, dans le cadre de la capitation ou d’autres modes de rémunération. La seule prévention qui ne serait pas concernée est la prévention primaire qui, de mon point de vue, est une question sociétale, ses actions relevant donc d’un financement collectif.
Mme Catherine Lemorton. Je n’affirmais pas que la prévention passive par l’interdiction de la publicité était suffisante, je constatais simplement qu’elle était nécessaire dans l’action contre l’obésité…
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Laurent Chambaud, je vous remercie.
*
Audition de MM. les professeurs Michel Huguier et Gérard Dubois, académiciens, membres de l’Académie nationale de médecine.
M. Gérard Dubois, membre de l’Académie nationale de médecine. Je suis professeur de santé publique. J’ai par ailleurs passé dix ans au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. J’ai aussi créé la première mouture du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.
À titre liminaire, je tiens à souligner qu’il me paraît pertinent d’utiliser la classification établie par l’Organisation mondiale de la santé entre prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire. Il importe en effet de bien distinguer des situations très différentes les unes des autres afin de pouvoir ensuite définir, pour chacune d’elles, les modalités d’action possibles. La prévention primaire, qui vise à éviter l’apparition de la maladie, ne relève pas complètement de l’assurance maladie, mais rentre plutôt dans le champ de compétence du législateur : il s’agit de l’hygiène publique, que l’on désigne aussi sous l’expression de « sécurité sanitaire ». Je fais ici référence, par exemple, à l’hygiène de l’eau, de l’air ou encore à l’alimentation. Les financeurs de l’assurance maladie ne sont guère concernés par ces problématiques.
Dans la prévention primaire, on retrouve des actions générales, que l’on désigne sous les termes d’« éducation à la santé » ou de « promotion de la santé », mais aussi des actions médicalisées. On a souvent tendance à oublier ces dernières, mais les maladies ne manquent pas de se rappeler à notre souvenir. Se développe ainsi en ce moment une épidémie de rougeole : les cas répertoriés en France représentent la moitié de tous les cas connus en Europe aux yeux de l’Organisation mondiale de la santé. Parmi les actes médicalisés, on trouve donc bien entendu la vaccination, qui présente à la fois un intérêt individuel pour faire face à certaines maladies, comme le tétanos, mais aussi un intérêt collectif, s’agissant de maladies transmissibles.
La place de l’assurance maladie dans la vaccination est d’une grande complexité. D’âpres discussions ont d’ailleurs eu lieu d’emblée à ce sujet au moment de la création de la sécurité sociale. La vaccination étant un acte préventif, l’assurance maladie avait d’abord déclaré qu’elle n’était nullement concernée par ce sujet. Finalement, après des discussions juridiques ardues, il a été décidé que l’assurance maladie devait prendre en charge les vaccinations obligatoires de l’enfant. Il est clair toutefois que c’est une cote mal taillée : il existe encore aujourd’hui des vaccins qui sont pris en charge en tant que médicaments, avec l’intervention des mutuelles, alors qu’ils relèvent du champ de la prévention.
Je citerai un autre exemple, relatif cette fois-ci à la prévention secondaire. Une mammographie qui est effectuée à la suite d’une tumeur que la femme a perçue se rattache aux soins, alors qu’une mammographie réalisée dans une optique de dépistage sera qualifiée de manière totalement différente et rattachée à la prévention.
Pour poursuivre mon propos, je voudrais maintenant rappeler que je me suis toujours opposé à l’affirmation selon laquelle la prévention induirait nécessairement des économies. Cela peut, certes, être le cas parfois. Je pense par exemple au dépistage néonatal de l’hypothyroïdie, où l’investissement est minime et l’économie très importante. Ce n’est toutefois certainement pas une généralité.
La prévention peut éviter de décéder d’une cause, mais c’est pour mourir d’une autre plus tard. Au XIXe siècle, les adolescents mouraient de tuberculose. Une fois éradiquée cette maladie, les adultes sont morts davantage de maladies cardiovasculaires. Lorsque les maladies cardiovasculaires ont reculé, les gens ont commencé à s’éteindre avec la maladie d’Alzheimer. En termes d’âge de décès, on est passé de celui de vingt ans à cinquante ans, puis à quatre-vingts ans. On sait cependant que la longévité de la vie humaine reste autour de cent vingt ans. La prévention consiste donc à augmenter la proportion de gens qui vieillissent en bonne santé.
J’aborde maintenant un autre point. Quand je suis arrivé à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, il y avait deux types de budgets. Le premier budget, connu de tous, était celui du remboursement des soins. C’est la fonction même de l’assurance maladie, son point de départ historique. Le second budget, plus restreint, que je trouvais d’une intelligence rare, visait à prendre en charge ce qui n’était pas prévu par la loi. C’était le budget de l’action sanitaire et sociale des caisses primaires. Aux niveaux régional et national, il permettait de financer des associations et des expérimentations ; lorsque celles-ci réussissaient, leur développement rendait le budget insuffisant et justifiait alors une décision législative ou réglementaire. C’est ainsi que le dépistage prénatal et anténatal a, au départ et pendant longtemps, été financé sur le fonds d’action sanitaire et social.
Il n’y a pas de maîtrise opérationnelle des soins. Comment, par exemple, mettre en œuvre le dépistage du cancer du sein si la mammographie est déjà dans la nomenclature des actes remboursables ? Un dépistage consiste à proposer systématiquement à une population définie un acte médicalisé, à un rythme défini. Une fois que le procédé est dans la nomenclature des actes remboursables, on perd la maîtrise du système.
J’ajouterai que, quand un malade rencontre un médecin, une relation entre deux personnes s’instaure, et le financeur est un tiers qui solvabilise cette situation. Dans le cadre du dépistage, ce n’est plus le patient qui est demandeur ; ce sont en général les pouvoirs publics qui lui suggèrent d’aller faire, par exemple, un hémoccult, un frottis ou encore une mammographie. La relation intime entre le médecin et son patient n’est plus centrale ; il y a une relation à trois. L’idée de départ du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires était de tenir compte de ce nouveau type de relation et d’y affecter un budget.
M. Michel Huguier, membre de l’Académie nationale de médecine. J’ai été chirurgien, professeur de chirurgie digestive et chef de service à l’Hôpital Tenon. Je suis ici en tant que secrétaire de la commission Assurance maladie de l’Académie nationale de médecine. J’ai aussi eu la chance d’être, de 1977 à 1979, conseiller technique de Mme Simone Veil.
En guise de propos préliminaire, je voudrais dire que, selon moi, les trois grands problèmes actuels en matière de prévention primaire sont l’alcoolisme, le tabagisme et l’obésité.
De façon générale, dans le domaine de la prévention, il me paraît d’abord essentiel, en premier lieu, que les messages délivrés soient clairs. Cela nécessite évidemment une certaine simplification de données médicales souvent complexes. En deuxième lieu, plus nos recommandations sont nombreuses, moins elles ont de chances d’être efficaces. Certains rapports comportent une centaine de recommandations : ça me paraît déraisonnable. Troisièmement, des mesures ne doivent être arrêtées que si elles sont applicables et contrôlables. Enfin, toutes les mesures arrêtées doivent être assorties de critères permettant de juger de leur bien-fondé.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Aujourd’hui, il y a un vrai problème de pilotage de la politique de prévention et d’éducation. Comment améliorer ce pilotage ? Comment mieux coordonner les nombreux acteurs qui interviennent sur le terrain, y compris les associations locales, dans le domaine du tabac comme dans d’autres domaines ? Que pensez-vous de la controverse actuelle concernant l’intérêt du dépistage individuel et collectif, en particulier en matière de lutte contre les cancers du sein et de la prostate ? Comment mettre en place et appliquer des référentiels ?
M. Gérard Dubois. Le sujet de la « prévention » est gigantesque. C’est un peu comme si l’on voulait parler du « traitement » ou encore du « diagnostic ». Il est donc difficile d’apporter des réponses générales à vos questions, quand bien même on se cantonnerait, par exemple, au seul « dépistage », voire au « dépistage des cancers ».
Ce qu’il me paraît important de préciser d’abord, c’est que la responsabilité de la santé publique, au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé, incombe aux gouvernements. Force est de constater, à cet égard, que la France a connu une épidémie assez unique de scandales de santé publique. Je ne mets pas en cause ici la compétence des gens qui travaillent au ministère de la santé. Le problème réside dans l’organisation générale de la santé publique et le niveau de décision. La création d’agences sanitaires spécifiques n’a pas été une réponse suffisante. Une réflexion est indispensable sur leur nombre, leur pilotage et leurs relations avec la direction générale de la santé. Une agence peut être, le cas échéant, indépendante intellectuellement mais une indépendance politique est contradictoire avec l’idée de responsabilité gouvernementale à laquelle je faisais allusion précédemment. À ce propos, la décision de créer un Haut Conseil de la santé publique avait pour finalité de disposer d’un organisme doté d’un certain pouvoir d’investigation, mais non pas d’un pouvoir de décision. Il s’agissait donc d’une instance destinée à aider les ministères.
Le dépistage, en particulier mammographique, du cancer du sein, pouvait se fonder, à partir de 1986-1987, sur des études démontrant son utilité. Ce dépistage était coûteux, mais nécessaire. J’ajouterai qu’un dépistage doit reposer sur une double lecture. De ce point de vue, il n’est pas satisfaisant de voir qu’aujourd’hui une grande partie des femmes en France bénéficie d’un dépistage spontané, dans lequel il n’y a ni contrôle de qualité ni évaluation.
S’agissant du dépistage du cancer de la prostate, la situation est pire. Mme Catherine Hill et moi-même, chacun de notre côté, avons publié des articles en 2007 démontrant que ce dépistage était non seulement inutile, mais aussi dangereux. D’ailleurs, il n’existe pas de dépistage « inutile » : soit le dépistage est utile, soit il mérite d’être qualifié de dangereux car tout acte médical comporte un risque pour la personne qui s’y prête.
Très tôt, ce dépistage a été publiquement déconseillé par la direction générale de la santé, la Haute Autorité de santé et l’Institut national du cancer. Malgré cela, on recensait 2,7 millions d’examens de dosages d’antigène prostatique spécifique (PSA, pour Prostate Specific Antigen en anglais) en 2003 et 4,4 millions en 2009. Au sein de l’Institut national du cancer, un groupe de travail sur le dépistage du cancer de la prostate a été constitué : je peux affirmer ici que l’ensemble de ses membres s’est opposé à un dépistage systématique du cancer de la prostate, à l’exception de deux d’entre eux : les représentants des urologues. Ainsi, c’est à l’initiative de la Société française d’urologie, et contre l’avis des autorités sanitaires que sont la direction générale de la santé, la Haute Autorité de santé et l’Institut national du cancer, que le dépistage du cancer de la prostate a été promu en France.
Les 4,4 millions d’examens de dosages de PSA pratiqués en 2009, dont le coût atteint 85 millions d’euros, ne sont pas tous inutiles : certains sont nécessaires pour le suivi des cancers établis. Bien qu’il ne soit pas possible de distinguer dans ce volume d’actes les examens de dosages de PSA utiles de ceux clairement inutiles, il est certain que le suivi des cancers de la prostate connus n’explique ni le nombre total de dosages, ni son quasi-doublement en six ans. En outre, les autorités scientifiques internationales partagent le point de vue des autorités sanitaires françaises. Un récent article du New York Times a fait état de pressions exercées sur l’American Cancer Society dès lors qu’elle s’était prononcée contre le dépistage systématique du cancer de la prostate. Cet article indiquait aussi que l’autorité internationale la plus reconnue en matière de dépistage, l’United States Preventive Services Task Force, avait longtemps retardé la publication d’un avis classant ce dépistage en catégorie D, c’est-à-dire comme étant inefficace, du fait des pressions qui s’étaient exercées sur elle.
Aussi, depuis 2007, on a assisté à un retournement de l’opinion scientifique concernant ce dépistage, qui n’est désormais plus soutenu que par les urologues. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de dire à un ministre de la santé que les personnes qui comprendraient qu’elles ont été victimes de ce dépistage alors que son inefficacité voire sa nocivité étaient déjà connues pourraient mettre en cause l’action publique. L’affaire du Mediator nous invite à réfléchir.
À l’inverse, certains dispositifs de dépistage sont bien organisés, à l’instar des systèmes de dépistage néonatal ou anténatal, avec des structures régionales cohérentes, un réseau associatif efficace et un système de contrôle de qualité souvent cité en exemple à l’étranger.
S’agissant des maladies dites non transmissibles, ou chroniques, les politiques de prévention doivent prendre une forme particulière. Récemment, les associations internationales spécialisées dans les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et le diabète ont obtenu la tenue, à New York, d’une réunion internationale de responsables politiques de haut niveau, réunion au cours de laquelle les cliniciens n’ont pas demandé aux responsables politiques des moyens financiers ou technologiques supplémentaires mais, en priorité, la mise en œuvre d’actions de santé publique relative à la lutte contre le tabac, l’alcool, la sédentarité et encourageant une meilleure nutrition.
Ainsi, les moyens au service de la prévention varient d’un sujet à l’autre, en fonction de la présence de groupes de pression. Dans certains domaines, l’action publique ne se heurte pas à des puissances industrielles – c’est le cas, par exemple, en matière de lutte contre la tuberculose ou contre le sida. Mais, dans d’autres domaines, comme l’alimentation ou la lutte contre le tabac, des groupes de pression puissants influencent les comportements des personnes ; plus que l’assurance maladie, c’est au législateur d’agir, pour contrebalancer ces influences, en établissant des règles appropriées de taxation des produits et d’encadrement de la publicité. Il faut aussi définir des règles équilibrées de contrôle technique de certains produits, comme l’alcool, sans tomber dans un extrême ou dans un autre, dès lors que la société réussit spontanément à en encadrer la consommation.
Le rôle de l’assurance maladie, en tout état de cause, peut consister à financer des associations d’éducation à la santé. Ainsi, les politiques de prévention ont des aspects non seulement médicaux, mais aussi non médicaux, législatifs, réglementaires, judiciaires, juridiques, diplomatiques – il existe une convention internationale de lutte contre le tabac. L’assurance maladie y participe dans la mesure de ses moyens, même si ceux-ci sont parfois dispersés.
M. le rapporteur. Comment s’assurer que les professionnels de santé appliquent les bonnes pratiques professionnelles ? S’agissant du dépistage du cancer de la prostate, s’il est vrai qu’en général, un dépistage rapide améliore les chances de guérison, un dosage de PSA normal chez un patient âgé peut donner à penser que le cancer n’est pas évolutif et qu’il n’y a pas lieu de pratiquer un acte chirurgical. Dans le même ordre d’idées, on a beaucoup parlé récemment d’opérations pratiquées sans nécessité sur des patientes ne présentant que des lésions mammaires limitées et non évolutives.
Par ailleurs, ce que vous avez dit des pressions auxquelles sont soumises les autorités sanitaires rejoint les déclarations qu’a faites devant nous M. Hubert Allemand. L’industrie pharmaceutique aurait réussi à obtenir un abaissement des niveaux de glycémie et de tension artérielle reconnus sans risques, ce qui a eu pour effet d’augmenter le niveau de gravité apparent de certains cas de diabète et d’hypertension artérielle, conduisant les médecins à les traiter par voie médicamenteuse plutôt qu’en prescrivant un régime alimentaire sans sel ou une pratique sportive. L’indépendance des autorités chargées de fixer ces normes constitue donc un enjeu crucial.
M. Michel Huguier. Prenons l’exemple de l’obésité : améliorer les politiques de prévention suppose d’adresser à la population des messages clairs et, pour ce faire, il ne faut pas mettre l’accent sur les facteurs génétiques à l’œuvre dans cette pathologie : leur effet reste marginal et cela risque de troubler les messages de santé publique, voire de servir d’alibi à ceux qui s’y opposent. En outre, s’agissant des facteurs environnementaux – et notamment familiaux –, il ne faut pas non plus confondre association et causalité.
Associer les acteurs locaux aux politiques de prévention est par ailleurs fondamental. C’est par exemple le cas en matière d’équilibre nutritionnel des enfants : un décret de septembre 2011 a réglementé de façon très stricte l’équilibre des repas servis dans les cantines scolaires. Ce ne me semble pas une démarche pertinente. Il aurait mieux valu subventionner les cantines pour qu’elles enrichissent leurs menus en fruits frais et légumes cuits, en partenariat avec les producteurs locaux et les fédérations d’agriculteurs ; une telle mesure aurait d’ailleurs aidé plus efficacement les agriculteurs que les allègements de charges qu’on leur propose aujourd’hui…
Par ailleurs, en matière de dépistage, il ne faut pas confondre expert et spécialiste. Un médecin spécialiste peut avoir une grande expérience clinique, sans pour autant posséder la rigueur scientifique et les connaissances méthodologiques requises des experts. C’est pourquoi il faut faire appel aux professionnels qui possèdent ces qualités, comme les biostatisticiens, qui ont en outre l’avantage d’être relativement neutres vis-à-vis des différentes spécialités médicales.
M. Gérard Dubois. Rappelons que, sur quatre ou cinq cancers de la prostate dépistés, un seul évolue de façon symptomatique, sans même entraîner nécessairement le décès du patient. Or, il n’est pas possible de distinguer aujourd’hui dans les cancers dépistés entre ceux qui évolueront et ceux qui resteront asymptomatiques. Il faut donc éviter le « surdiagnostic » de ces cancers : une fois un cancer dépisté, le patient souffre d’un effet d’étiquetage préjudiciable, même si son cancer n’évolue pas. Pour un sujet âgé de soixante-quatre ans, la probabilité d’avoir un cancer « dans » la prostate – je ne dis pas : un cancer « de » la prostate – s’établit d’ailleurs entre 60 % et 70 % ; mais seuls 3 % des hommes meurent d’un cancer de la prostate, et le fait est connu depuis les années 1930 : c’est pourquoi l’United States Preventive Services Task Force recommande de réserver l’examen du dosage de PSA au suivi des cancers connus.
L’idée selon laquelle plus tôt on découvre une maladie, mieux on la soigne, n’est pas toujours exacte. Elle est pertinente pour les maladies à développement relativement rapide, comme le cancer du col de l’utérus. D’ailleurs, il avait été envisagé de mettre en place un dépistage organisé de ce cancer dans le cadre du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, mais cela aurait supposé une modification profonde des pratiques de dépistage existantes. En effet, une minorité de femmes bénéficiaient d’un dépistage très intensif, avec des frottis plus fréquents qu’il n’était nécessaire mais pris en charge par l’assurance maladie, tandis que la majorité des femmes n’en bénéficiaient pas. Le projet de dépistage organisé a été retiré pour des motifs politiques.
En revanche, l’idée qu’un dépistage organisé permet le dépistage précoce d’une affection et facilite ainsi son traitement ne se vérifie ni pour les cancers à développement très rapide, comme les cancers du poumon ou du pancréas, ni pour les cancers à développement très lent, comme le cancer de la prostate. Elle vaut pour les cancers dont la vitesse de développement est intermédiaire, comme le cancer du sein.
M. le coprésident Jean Mallot. L’académie interpelle-t-elle les décideurs publics sur ces sujets ?
M. Gérard Dubois. En 2003, contre mon avis, l’Académie nationale de médecine s’est prononcée en faveur du dépistage du cancer de la prostate. Elle a réexaminé le sujet en 2006 et, du fait de dissensions internes, elle n’a pas émis d’avis. Pour ma part, j’ai pris publiquement des positions personnelles défavorables à ce dépistage.
Si j’ai une proposition à formuler, elle consisterait à rendre opposables les référentiels d’application des actes inscrits à la nomenclature. Faisons le parallèle avec le marché des médicaments : lorsqu’un médicament a une portée préventive, et donc un large marché, on assortit sa prise en charge par l’assurance maladie de certaines conditions et on ajuste son prix de façon à optimiser la dépense publique. Le système de remboursement des actes de diagnostic n’est pas adapté aux politiques visant à organiser un système de dépistage : si, par exemple, les mammographies sont inscrites dans la nomenclature des actes remboursés, on ne peut pas cibler ces actes sur les patientes pour lesquelles ils seraient vraiment pertinents. C’est pourquoi je préconise de subordonner leur prise en charge au respect d’un référentiel contraignant, qui prévoirait par exemple que la mammographie à double lecture soit réservée aux femmes de plus de cinquante ans.
On retrouve là l’idée que la nomenclature et le système habituel de soins sont inadaptés à la prévention. C’est pour y remédier qu’il était prévu à l’origine, dans le cadre du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, qu’un certain nombre de référentiels deviendraient opposables, avec un contrôle a posteriori possible. L’examen du dosage du PSA me semble relever de cette approche. Le contrôle médical doit pouvoir s’interroger sur le bien-fondé de sa prescription.
M. le coprésident Pierre Morange. Cela vous semble politiquement possible ?
M. Gérard Dubois. Oui. Lors de la mise en place du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, le vaccin grippal était pris en charge à 100 %, parce qu’il ne s’inscrivait pas dans le colloque singulier entre le praticien et son patient face à un symptôme ou à une maladie, mais qu’il mettait en cause une relation à trois, le troisième provoquant la rencontre entre le malade et le médecin et devant donc le financer, justifiant ainsi le tiers payant. Le tiers payant ou la gratuité pour la mammographie de dépistage n’a pas provoqué de révolte chez les radiologues. Ils ont accepté la double lecture, nécessité du dépistage. Il convient de bien différencier le soin, du dépistage et de la prévention.
S’agissant du cancer du sein, toutes les recommandations suggèrent le dépistage après cinquante ans. On a malheureusement en France un dépistage massif avant cinquante ans, bien qu’aucun avantage n’ait été démontré et qu’il ne semble pas qu’on puisse espérer une amélioration du pronostic. Les études « randomisées » ont fait l’objet d’une revue Cochrane en avril 2011. Rappelons qu’elle est l’œuvre d’un groupe d’auteurs indépendants qui passe en revue un ensemble d’études publiées en fonction de leur qualité et propose des méta-analyses. Leurs conclusions sont donc très respectées. Une distinction y est faite entre les études absolument parfaites où le dépistage est considéré sans effet et les bonnes études qui montrent l’efficacité du dépistage. Personnellement je reste partisan du dépistage chez les femmes de plus de cinquante ans tous les deux ans, tel qu’il est pratiqué.
Il convient de remarquer par ailleurs qu’un dépistage, par définition, débusque des cas et les augmente ainsi artificiellement. Au début d’un dépistage apparaît une pointe qui se résorbe ensuite pour une population identique, le dépistage ne faisant que révéler les cancers plus tôt. Aussi, normalement, sur une période de dix ou quinze ans, le nombre total de cas doit être identique. Dans les faits, il apparaît que le nombre de cancers dépistés est légèrement supérieur, d’une part, parce que d’autres causes de mortalité peuvent dissimuler les cancers non dépistés et, d’autre part, parce qu’il y a, dans le cas du cancer du sein, un sur-diagnostic qu’on estime à environ 5 % à 10 %, alors qu’il atteint 300 % à 400 % dans le cas du cancer de la prostate. La revue Cochrane évalue, elle, ce sur-diagnostic à 30 %. En conclusion et au vu de ces données, les recommandations restent en faveur du dépistage s’agissant du cancer du sein, mais sont totalement défavorables à tout dépistage du cancer de la prostate. En revanche, je regrette que le dépistage du cancer du col de l’utérus ne soit pas mieux organisé.
M. le rapporteur. Les taux de mammographie restent encore modestes, ils sont donc à la limite du significatif. Ils devraient être de 70 % à 75 % de la population et on en est loin.
M. Gérard Dubois. Ils sont significatifs si on ajoute le dépistage individuel au dépistage organisé, avec les limites que j’ai indiquées pour le premier. La région parisienne se caractérise par une majorité de dépistages individuels du cancer du sein, l’offre y étant extrêmement importante, les dépistages organisés n’y sont, de mémoire, que de 20 %. Rappelons tout de même que l’examen du taux de PSA coûte 85 millions d’euros. Avec une telle somme il serait possible d’améliorer beaucoup de choses dans le dépistage des cancers du sein, du colon et même du col de l’utérus.
M. le rapporteur. Merci de votre intervention. Pour conclure par un domaine qui vous est familier, où en est-on de la prévention du tabagisme, il semble que malgré toutes les mesures prises, la consommation augmente chez les jeunes femmes, ce qui est préoccupant ?
M. Gérard Dubois. J’avais évité le sujet… Le ministère de la santé polonais organise prochainement à Poznan, dans le cadre de la présidence polonaise de l’Union européenne, une réunion sur la prévention du tabagisme. J’y suis invité pour présenter les succès français en la matière. En fait, la France est à la fois un exemple et un contre-exemple. Les mesures qui y ont été adoptées ont amélioré nettement la situation mais le relâchement de cette politique de lutte contre le tabagisme a conduit à une dégradation.
Entre 1991, date de la promulgation de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « loi Evin », et aujourd’hui, les ventes de cigarettes ont été divisées par deux. Le cancer du poumon des hommes de trente-cinq à quarante-quatre ans a diminué de façon spectaculaire, plus rapidement que ce ne fut le cas au Royaume-Uni et aux États-Unis. C’est donc un succès.
De façon plus détaillée, on constate que la consommation a augmenté rapidement avant la loi n° 76-663 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, dite « loi Veil », encore peu coercitive mais très en avance sur son temps et que, depuis cette date, la consommation s’est ralentie. La « loi Evin » a, elle, entraîné une chute spectaculaire des ventes de cigarettes : une diminution de 14 % en six ans, due, entre autres, à l’augmentation des prix. Puis, parallèlement au ralentissement de l’augmentation des prix de 1997 à 2002, on a constaté un plateau dans la baisse de la consommation du tabac.
En 2002, une première augmentation de 12,5 % des prix, à l’initiative du Gouvernement de M. Lionel Jospin, a été suivie en 2003 par le plan Cancer de M. Jacques Chirac avec trois augmentations en douze mois, de plus de 50 % des taxes ayant conduit à une baisse de plus de 30 % des ventes de cigarettes. Les achats transfrontaliers ne l’ont pas compensée, contrairement à ce qui a été affirmé. La protestation des buralistes a ensuite conduit à une trêve, à l’initiative de M. Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre. On a alors constaté, à partir de 2004, une nouvelle stabilisation de la vente de cigarettes, puisqu’il n’y a pas eu d’augmentations dissuasives et répétées des prix : les trois hausses intervenues en 2007, 2009 et 2010, de 6 % chacune, l’ont été à la demande de l’industrie du tabac, preuve qu’elles n’étaient pas supposées avoir un impact sur le niveau des ventes.
En 2011 et 2012, les taxes sur le tabac ont été augmentées de 6 %, mais, pour qu’elles soient efficaces sur la consommation du tabac, il aurait été nécessaire de les réunir : 12 % d’augmentation du prix des cigarettes garantit une baisse d’environ 4 % de leurs ventes. La preuve qu’une diminution de la consommation de tabac n’est pas attendue d’une augmentation de 6 % des taxes telle qu’elle est actuellement prévue ressort clairement des documents budgétaires eux-mêmes qui prévoient 6 % de recettes supplémentaires. Aucune diminution de la consommation n’est donc prévisible en 2012. On a même assisté en 2009 et 2010, comme vous venez de le souligner, monsieur le rapporteur, à une augmentation de la consommation de tabac. Un point positif tout de même, l’augmentation des prix de 9 % du tabac à rouler, qui était souvent oublié.
M. le rapporteur. Ne pourrait-on pas alors taxer les entreprises du secteur sur leur chiffre d’affaires, comme l’envisageait hier le rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, M. Yves Bur ?
M. Gérard Dubois. J’en suis absolument partisan. C’est d’ailleurs la position de la Ligue nationale contre le cancer. L’Organisation mondiale de la santé envisage d’évoquer cette question au niveau international et cette idée pour financer ses propres actions, le tabac étant la première cause de mortalité évitable au plan mondial. Il serait souhaitable de l’appuyer.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie, messieurs les professeurs, de vos propos précis et argumentés.
*
AUDITIONS DU 3 NOVEMBRE 2011
Audition de Mme Évelyne Baillon-Javon, directrice du pôle Prévention et promotion de la santé de l’agence régionale de santé de l’Île-de-France, et M. Laurent Chambaud, directeur de la santé publique, de Mme Marie-Sophie Desaulle, directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, et M. Christophe Duvaux, directeur général adjoint, chargé de la direction de la prévention et de la promotion de la santé, et de Mme Zeina Mansour, directrice du comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Mesdames, messieurs, la prévention est considérée comme le parent pauvre de notre système de santé, tourné essentiellement vers le soin. Récemment créées, les agences régionales de santé sont devenues les responsables uniques de la santé au niveau régional. Comment intègrent-elles la prévention dans leurs préoccupations ?
Quelles sont vos relations avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, avec les régimes complémentaires, qui ont souvent leurs propres programmes de prévention, mais aussi avec les associations de terrain ? Comment les associez-vous à vos programmes de prévention et d’éducation ?
Une prévention au niveau régional est-elle possible en l’absence de relations avec l’Éducation nationale et avec la médecine du travail ?
Parmi les priorités nationales – pour peu qu’elles soient vraiment définies puisque la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique en énumère une centaine ! –, incluez-vous la mortalité prématurée évitable dans vos priorités ?
Enfin, doit-on avoir des politiques régionales de prévention, sachant qu’entre le Nord-Pas-de-Calais et l’Île-de-France, par exemple, les priorités peuvent être différentes ?
Mme Marie-Sophie Desaulle, directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire. Dans la mesure où les agences régionales de santé existent depuis un peu plus d’un an et demi, nous commençons à avoir une bonne vision de la manière dont nous pouvons mettre en œuvre une politique de santé régionale.
Comme l’a souhaité le législateur, l’intérêt de l’agence régionale de santé est d’apporter une vision transversale et décloisonnée de l’organisation du système de santé, au cœur duquel la prévention doit permettre de développer des soins primaires et un accompagnement médico-social.
Certes, l’agence régionale de santé est le responsable unique de l’organisation du système de santé au niveau régional, néanmoins la santé scolaire et la santé au travail ne relèvent pas de sa compétence. Pourtant, en matière de prévention, l’enfance et la jeunesse constituent la première population cible, tandis que celle des adultes est parfois difficilement accessible à nos messages.
Il existe en Pays de la Loire une commission de coordination des politiques publiques en matière de prévention. Elle réunit, une fois par trimestre, des représentants de l’Éducation nationale, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, des régimes d’assurance maladie, des complémentaires, du conseil régional et du conseil général, en résumé tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce domaine. Ainsi, il existe un lieu d’échanges destiné à construire une politique de prévention commune au niveau régional.
Les agences régionales de santé travaillent actuellement à l’élaboration d’un schéma régional de prévention, dans le cadre d’un projet régional de santé. Il existe par ailleurs un plan Santé au travail, un plan Éducation nationale, mais aussi des plans particuliers développés par certains conseils généraux. Il est toutefois possible, en raisonnant par action, d’impulser une dynamique commune. C’est pourquoi nous travaillons actuellement à l’élaboration, pour 2012, d’une feuille de route partagée.
Si ce travail n’intègre pas les associations de terrain, nous n’en avons pas moins avec elles des relations de trois sortes. Tout d’abord, nous élaborons en commun le schéma régional de prévention, puisqu’elles participent à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Ensuite, nous passons avec elles, et plus particulièrement avec les têtes de réseau que sont l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé et l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, des contrats pluriannuels qui leur donnent une certaine visibilité pour la conduite de leurs actions. Enfin, nous avons maintenu en Pays de la Loire une dynamique d’appels à projets, qui offre la possibilité aux associations de mener, sur des thèmes que nous définissons, des actions innovantes et des expérimentations. Pour ce faire, nous avons cherché à élaborer des cahiers des charges précis, assortis d’indicateurs clairs en termes de résultats.
Nous coopérons également avec les collectivités territoriales. En particulier, nous avons commencé à signer des contrats locaux de santé concernant des territoires précis, en y associant des communes, mais aussi des professionnels libéraux par l’intermédiaire notamment de maisons de santé pluridisciplinaires.
Ainsi, nous avons la possibilité de développer une politique régionale de prévention. Elle est bien sûr – et c’est d’ailleurs là tout son intérêt – adaptée à la situation de notre région, sachant que les problématiques diffèrent d’une région à l’autre.
S’agissant de l’articulation de notre action avec la loi de santé publique et les priorités nationales, il est important que nous soient fixés au niveau national des objectifs selon une logique de résultats, mais aussi qu’on nous laisse le soin de déterminer les moyens à mettre en œuvre et leur affectation en fonction des priorités locales et, surtout, la liberté de définir les actions permettant d’atteindre ces objectifs. Autrement dit, c’est la définition d’une stratégie nationale assortie d’indicateurs de résultats, d’une part, et la définition d’actions adaptées aux logiques de territoire, d’autre part, qui permettront la bonne articulation entre le niveau national et le niveau régional.
M. le rapporteur. Les autres agences régionales de santé fonctionnent-elles de la même façon ?
Comment l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et le ministère s’intègrent-ils à cette organisation ?
M. Laurent Chambaud, directeur de la santé publique à l’agence régionale de santé de l’Île-de-France. Chaque région anime les dispositifs issus de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Une commission de coordination des politiques publiques en matière de prévention existe aussi en Île-de-France : elle réunit les mêmes interlocuteurs que dans les Pays de la Loire – un certain nombre d’entre eux étant définis par décret –, au minimum une fois par trimestre.
Dans la mesure où la loi permet d’y inclure des financeurs supplémentaires, y ont été admis les représentants régionaux de la Mutualité française et la sous-commission « Prévention » de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, ce qui présente pour nous un intérêt particulier lors de l’élaboration du schéma régional de prévention. Nous avons ainsi deux lieux de concertation dans le domaine de la prévention.
Avec nos partenaires locaux – caisse primaire d’assurance maladie et autres régimes, notamment la Mutualité sociale agricole –, qui participent à nos instances, nous avons des relations assez suivies, à l’occasion bilatérales, sur un certain nombre de sujets, en liaison ou non avec les questions spécifiques de gestion du risque.
S’agissant de nos relations avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la situation est plus complexe.
En effet, dernièrement, nous avons réuni tous nos interlocuteurs – caisse primaire d’assurance maladie, régimes mutualistes, Éducation nationale, collectivités locales à travers les services de la protection maternelle et infantile, les médecins libéraux et les pharmaciens à travers l’Union régionale des professionnels de santé –, dans le but de faire progresser la couverture vaccinale de la rougeole chez les enfants et chez les moins de trente et un ans, un nombre important de cas et d’hospitalisations ayant été enregistré en Île-de-France en 2009 et 2010.
Le dispositif actuel de la vaccination – visite chez le médecin qui délivre l’ordonnance, puis chez le pharmacien qui remet le vaccin, puis une nouvelle fois chez le médecin pour se faire vacciner – n’est pas très motivant, en particulier pour les jeunes adultes, sans compter que le vaccin n’est remboursé à 100 % que pour les moins de dix-huit ans. Nous avons alors mis au point, avec l’ensemble de nos partenaires, une formule consistant à raccourcir le circuit grâce à la suppression de la première visite chez le médecin. Or, après plusieurs semaines de discussions avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, nous n’avons pas réussi à imposer ce nouveau dispositif, fût-ce à titre expérimental et pour quelques mois seulement. C’est regrettable, à tel point que M. Claude Evin a écrit au ministre de la santé et au directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour les alerter sur les difficultés que nous avions à faire prévaloir des mesures de santé publique et de prévention par le biais de dispositifs attrayants.
M. le coprésident Jean Mallot. Quels arguments la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a-t-elle invoqués ?
M. Laurent Chambaud. D’abord, il est très difficile, nous a-t-on dit, de mettre sur pied un système permettant l’émission de bons permettant aux assurés de se rendre directement chez le pharmacien. Pourtant cela avait été possible lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1…
Ensuite, les textes ne prévoient pas la possibilité pour les pharmaciens de délivrer directement ces vaccins, du moins pour celui qui ne peut être délivré que sur prescription médicale.
Enfin, il est très difficile de trouver un système permettant de couvrir les personnes à 100 %, y compris celles qui ne sont pas couvertes par leur mutuelle.
Ainsi, le problème n’est pas tant dans les relations que nous entretenons avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés que dans la lourdeur et dans la complexité du système français, qui nous empêche de réaliser des actions de prévention de ce type.
M. le rapporteur. Vous n’êtes pas les décideurs !
M. Laurent Chambaud. Ce n’est pas cela, car tous nos partenaires étaient favorables à la mise en place de ce dispositif. C’est le système actuel qui ne le permet pas. Si, demain, un problème se pose au niveau régional, on ne pourra pas réagir en mettant en place un dispositif souple, car les textes sont extraordinairement contraignants.
M. le rapporteur. Quelles sont vos relations avec les centres de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ? Êtes-vous partie prenante du programme Sophia d’accompagnement des patients diabétiques, animé par la caisse nationale ?
L’hypertension artérielle sévère a été retirée de la liste des affections de longue durée. Dans ces conditions, comment envisager une prévention efficace de ce type de maladie ?
M. Laurent Chambaud. Notre agence a des relations assez développées avec les centres d’examens de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, avec les centres de santé mutualistes et avec ceux des collectivités locales. En Île-de-France, certains centres d’examens de santé participent aux campagnes de dépistage du cancer ; d’autres sont plutôt orientés vers l’aide aux personnes défavorisées – en particulier, l’un d’eux est utilisé par notre agence pour mener à bien un projet en faveur du retour à l’emploi avec Pôle emploi.
S’agissant des actions de prévention telles que le programme Sophia, la difficulté à laquelle on se heurte réside dans la fragilité de leurs financements. En effet, elles ne sont pas prévues dans la nomenclature des actes des professionnels de santé et ce sont souvent les financements de l’agence régionale de santé qui viennent abonder les structures. Or, ces financements sont plutôt destinés à financer des actions collectives d’éducation pour la santé.
Sophia est un dispositif expérimental développé par l’assurance maladie. La question des modalités du financement de tels programmes de gestion de la maladie (disease management) et d’éducation thérapeutique du patient se pose. Pour l’instant, ces programmes sont financés soit sur l’enveloppe hospitalière dans le cadre des missions d’intérêt général, soit dans le cadre d’expérimentations menées avec des centres et des maisons de santé, comme le permet l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
M. le coprésident Jean Mallot. Qu’en est-il dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Mme Zeina Mansour, directrice du comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comité régional d’éducation pour la santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un proche partenaire de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est membre de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, du comité de pilotage du schéma régional de prévention et de son comité technique.
S’agissant du partenariat avec l’Éducation nationale, vous me permettez d’évoquer un exemple très précis et récent dans le cadre du suivi d’indicateurs de santé : le rectorat d’Aix-Marseille vient de passer convention avec l’agence régionale de santé pour la mise à disposition d’un indicateur, celui de l’indice de masse corporelle des enfants à l’âge de six ans. Tous les ans, les indices de tous les enfants de l’académie examinés à six ans par la médecine scolaire seront communiqués à l’agence régionale de santé, ce qui permettra un suivi de différents plans, en particulier du plan national Nutrition santé.
Il serait très intéressant que cette initiative soit généralisée par la mise à disposition d’autres indicateurs régulièrement suivis par les conseils généraux – je pense notamment à ceux qui concernent les vaccinations –, par l’Éducation nationale, par la médecine du travail – dans le cadre de laquelle les adultes sont pesés et mesurés – et par les centres d’examen de santé. Cela nous permettrait de contrôler l’efficacité de différents plans sans avoir à relancer des études à chaque fois.
Un deuxième exemple est la création, grâce à un partenariat entre l’Éducation nationale et la faculté de médecine de Marseille, d’une formation des étudiants en médecine à la sexualité et à la contraception, dans le cadre d’un module optionnel. Ce premier objectif s’accompagne d’une deuxième finalité : permettre aux étudiants d’intervenir directement auprès de collégiens. Le troisième objectif est bien évidemment d’améliorer la connaissance des collégiens.
Il s’agit là d’une expérience intéressante de formation de médecins à la prévention et à l’approche éducative vis-à-vis des jeunes. Cette intervention de jeunes auprès d’autres jeunes, dite « de pair à pair », est très appréciée et semble avoir porté ses fruits au terme de cinq à six années de pratique.
M. le rapporteur. Que pensez-vous de l’évolution des comités départementaux d’éducation pour la santé et des comités régionaux d’éducation pour la santé ?
Quelles sont vos relations avec l’agence régionale de santé et avec la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ?
Comment fonctionnez-vous avec les associations qui interviennent dans les écoles et les collèges, notamment sur l’alcool et le tabac ?
J’ai un souhait, peut-être utopique : celui de voir les comités départementaux d’éducation pour la santé réunir l’ensemble des associations et les comités régionaux d’éducation pour la santé associer les comités départementaux, car cela permettrait d’accroître l’efficacité des actions dans les départements. Ce n’est pas le chemin qui a été pris. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, quelles sont vos relations avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et avec la Fédération nationale des comités d’éducation pour la santé ?
Mme Zeina Mansour. Je ne répondrai pas au nom de la fédération nationale, n’ayant pas été mandatée pour le faire aujourd’hui, mais pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Chaque région a son histoire, et je pense que la restructuration du réseau peut être différente d’une région à l’autre. Dans la nôtre, nous disposons de six comités départementaux d’éducation pour la santé – un par département – et d’un comité régional d’éducation pour la santé. Depuis fort longtemps, chacun a été correctement identifié sur son territoire respectif, reconnu et soutenu politiquement, tant par les services de l’État – que ce soit la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le groupement régional de santé publique puis, aujourd’hui par l’agence régionale de santé – que par les collectivités territoriales. Il est important de le préciser : si nous avons un comité départemental d’éducation pour la santé par département aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont le soutien de leur conseil général et des principales collectivités.
Notre organisation au niveau régional est la suivante.
Le comité régional d’éducation pour la santé est un centre de ressources qui assure de nombreuses missions de coordination au niveau régional et qui anime le réseau des comités départementaux d’éducation pour la santé. Nous travaillons dans la complémentarité de manière à éviter toute redondance et pour que le comité régional d’éducation pour la santé apporte une plus-value à l’action des comités départementaux d’éducation pour la santé. Au niveau départemental, ces derniers sont moteurs et assurent également des interventions de terrain, ce que nous ne faisons pas au niveau du comité régional d’éducation pour la santé.
La dynamique de réseau nous permet de concevoir et de réaliser des actions d’éducation pour la santé concertées sur l’ensemble de la région. Elles sont lancées par le comité régional d’éducation pour la santé, puis déclinées localement par les comités départementaux d’éducation pour la santé, dont les équipes sont auparavant formées collectivement, et enfin évaluées au niveau du comité régional d’éducation pour la santé. Il me semble que cette organisation est très intéressante car elle nous permet de professionnaliser des équipes et de conduire des actions sur l’ensemble de la région.
Avec l’agence régionale de santé et avec le conseil régional, nous avons signé plusieurs conventions pluriannuelles, notamment dans le cadre du contrat de projets État-région. Actuellement, l’agence régionale de santé nous propose une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau schéma régional de prévention.
Quant à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, il finance depuis cette année des pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé, qui ont effectivement pour vocation de coordonner les acteurs, de les professionnaliser et d’impulser une évolution de l’éducation pour la santé. Dans notre région, ce pôle est porté par le comité régional d’éducation pour la santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec les comités départementaux d’éducation pour la santé. Il s’agit de coordonner d’abord le réseau lui-même, de mettre en œuvre des actions collectives et partagées, de professionnaliser les autres acteurs grâce à des formations – nous organisons chaque année 85 sessions qui permettent de former 500 personnes –, de développer une culture commune et, enfin, de permettre des échanges avec nos principaux partenaires têtes de réseau – Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, Centre régional d’information et de prévention du sida, etc. –, avec lesquels nous avons régulièrement des réunions techniques pour harmoniser nos pratiques.
Voilà pour l’expérience de la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celle des autres régions peut effectivement être différente.
Enfin, depuis 2002-2003, nous disposons d’une Fédération nationale des comités régionaux d’éducation pour la santé. Elle est installée dans les mêmes locaux que l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, qui lui verse une subvention. Cela permet une mobilisation nationale de l’ensemble de notre réseau.
M. le coprésident Pierre Morange. Depuis combien de temps ce schéma organisationnel est-il mis en œuvre ? Et quels éléments précis et concrets sont issus de l’évaluation, c’est-à-dire de la mesure de l’efficacité des dispositifs ?
Mme Zeina Mansour. Dans la mesure où les activités sont annuelles – elles sont en fait réalisées sur neuf mois, donc extrêmement brèves –, nous ne pouvons réaliser que des évaluations dites « de processus », c’est-à-dire de mise en œuvre, et parfois des évaluations de satisfaction ou de connaissance.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce sont donc des évaluations de méthodologie et de moyens, mais pas de résultats.
Mme Zeina Mansour. Nous avons effectivement rarement l’occasion de procéder à des évaluations de résultats intéressantes. Je voudrais tout de même évoquer un exemple d’évaluation qu’il est rare de pouvoir réaliser.
Il y a quelques années, nous avons souhaité évaluer, avec quatre années de recul, un programme d’éducation pour la santé mené en milieu scolaire. Il s’agissait de retrouver des enfants en classe de troisième qui avaient bénéficié, en classe de cours moyen deuxième année, de ce programme très intéressant qui était intégré au programme de l’Éducation nationale, à raison d’une intervention toutes les deux semaines, tout au long de l’année et sur toutes les thématiques.
Nous avons interrogé ces jeunes de troisième sur quatre sujets – tabac, alcool, petit déjeuner et médicaments – selon une méthode dite épidémiologique de cas témoins, consistant à comparer les réponses des élèves qui avaient bénéficié de la campagne avec celles d’élèves qui n’en avaient pas bénéficié. Les questions portaient sur les connaissances aussi bien que sur les comportements acquis. Mais nous avons ensuite découvert qu’existait un troisième groupe d’enfants : ceux qui avaient bénéficié d’actions ponctuelles, tantôt sur le tabac, tantôt sur l’hygiène bucco-dentaire ou encore sur le sida, et nous avons souhaité en faire un second groupe témoin.
Nous avons été extrêmement – et agréablement – surpris de constater que les jeunes qui avaient bénéficié de campagnes tout au long de l’année avaient un niveau de connaissances très nettement supérieur à tous ceux des deux autres groupes et qu’ils étaient deux fois moins nombreux à fumer quand ils étaient avec leurs amis, en dehors de leur domicile. La prise du petit-déjeuner était équivalente dans les trois groupes. Enfin, s’agissant des médicaments, 7 % ont déclaré en prendre en cas de mal de tête ou de ventre, ce que nous n’avons pas considéré comme un problème majeur.
En outre, les réponses du groupe ayant bénéficié d’interventions thématiques ponctuelles étaient équivalentes à celui qui n’avait jamais bénéficié d’interventions à l’école !
Cette évaluation, que j’ai eu le plaisir de réaliser moi-même, mais qui n’a malheureusement pas fait l’objet d’une publication, si ce n’est dans la littérature « grise », a été valorisée par la direction générale de la santé dans le cadre d’un colloque intitulé « L’éducation à la santé, ça marche », qui s’est tenu il y a fort longtemps. Elle avait pu être réalisée grâce à des crédits européens. Malheureusement, de telles occasions se présentent très rarement.
M. le rapporteur. Qu’en est-il de votre association avec les agences régionales de santé dans les campagnes de prévention ?
Mme Zeina Mansour. Le comité régional d’éducation pour la santé est membre de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Tous les comités départementaux d’éducation pour la santé sont membres de la conférence de territoire de chacun des départements.
Nous sommes de très proches partenaires de l’agence régionale de santé, puisque nous participons à l’ensemble des comités de pilotage, des comités techniques et des groupes de travail mis en place pour l’écriture des programmes.
La direction générale de la santé et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ont organisé une semaine nationale de la vaccination. Le comité régional d’éducation pour la santé copilote avec l’agence régionale de santé cette opération en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce qui permet de coordonner les actions, mais aussi de mobiliser les différents acteurs, cependant que des comités de pilotage départementaux ont été constitués en partenariat avec les comités départementaux d’éducation pour la santé. C’est ainsi qu’un programme lancé au niveau national se retrouve mis en œuvre dans un institut de formation de soins infirmiers, par exemple, à Gap ou à Briançon.
Il me semble que cette chaîne est très intéressante. L’agence régionale de santé ne manque d’ailleurs aucune occasion de nous associer à sa programmation et à la mise en œuvre du schéma.
M. le rapporteur. Les associations qui s’occupent, par exemple, de la prévention de l’alcoolisme dans leurs départements respectifs sont souvent concurrentes en raison de leur nombre. Comment les associez-vous ?
Mme Zeina Mansour. J’ai parlé tout à l’heure de culture commune. Le choix que nous avons fait, notamment vis-à-vis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé qui nous a demandé des rapprochements avec les têtes de réseau et les réseaux eux-mêmes, est de constituer des groupes techniques communs et d’organiser des partages de méthodes. Autrement dit, nous avons pris le parti, non pas de la concurrence, mais d’un enrichissement mutuel. Pour l’instant, c’est ainsi que nous procédons en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Certes, nous pourrions nous sentir concurrents des têtes de réseau, et même de la Mutualité française, mais les besoins sont tels qu’il est difficile de l’être. Le vrai problème est plutôt celui de l’insuffisance des moyens.
M. le rapporteur. Les Pays de la Loire ont-ils une expérience identique ? Et qu’en est-il de Sophia et du problème de l’hypertension artérielle dans cette région ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. Avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé, qui est une organisation régionale dotée d’antennes départementales, nous avons signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Nous nous employons à rapprocher les associations, à les inciter à travailler ensemble. Cette préoccupation se décline selon deux modèles.
D’abord, nous travaillons avec les associations à un rapprochement autour d’une thématique globale, en vue d’une action concertée. C’est ainsi que nous avons demandé à celles qui se mobilisent contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et à celles qui s’occupent du planning familial de travailler en commun sur la santé sexuelle.
Ensuite, nous les incitons à se regrouper pour travailler sur des populations cibles. C’est ainsi qu’après avoir identifié des populations en situation de précarité, par exemple, nous élaborons des dispositifs de prévention. À cet égard, l’exemple de l’action coordonnée de prévention en Provence-Alpes-Côte d’Azur est très intéressant.
Telle est la tendance qui se dessine en Pays de la Loire. Certes, la situation n’est pas si simple dans la mesure où se posent la question de l’autonomie des associations et peut-être, à terme, celle de leur existence même. Mais il me semble que la multiplicité des acteurs est contreproductive au regard de l’objectif de prévention globale.
Pour ce qui est de l’hypertension artérielle, il me semble que nous devons travailler avec les professionnels de santé – les médecins libéraux, mais également les maisons de santé pluridisciplinaires –, afin de fixer des objectifs de suivi des personnes atteintes d’une maladie chronique. Et, au-delà de la question de savoir si l’hypertension est une affection de longue durée ou non, il est nécessaire de définir une stratégie de prévention et des logiques de suivi des personnes à risque.
S’agissant du diabète, on aura toujours besoin, parallèlement au programme Sophia, du médecin généraliste, du diététicien et de l’infirmier qui, dans le colloque singulier avec le patient, l’inciteront à adopter les bons comportements. Notre objectif est donc de nous appuyer sur cet ensemble de professionnels de premier recours à des fins de suivi et de prévention.
J’ajoute que tous les acteurs du secteur médico-social doivent trouver leur place dans cette dynamique de prévention. Il est en effet frappant de constater que les personnes les plus éloignées des dispositifs de prévention sont souvent les personnes âgées, notamment celles qui sont en perte d’autonomie, voire les personnes en situation de handicap, alors même que ce sont elles qui, le plus souvent, vivent avec une maladie chronique ou présentent un risque important de décompensation. Il faut donc mobiliser et former aux actions de prévention les acteurs de proximité – services à domicile, établissements d’hébergement, centres d’intervention en alcoologie et toxicomanies, etc. – qui font de l’accompagnement médico-social au quotidien.
M. le rapporteur. Les agences régionales de santé n’ont pas été associées à la décision de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés d’exclure l’hypertension des affections de longue durée, alors qu’elles sont chargées d’en assumer les conséquences et sont les responsables uniques de la santé au niveau régional… Quelles sont vos réflexions à ce sujet, sachant que, dans son rapport sur la prévention, la Cour des comptes insiste sur l’absence de pilotage au niveau national ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. Il est légitime qu’un pilote prenne des décisions au niveau national, à charge pour les agences régionales de santé, qui ne sont que des acteurs au niveau régional, de les appliquer le plus efficacement possible.
Ce qu’attendent les agences régionales de santé, c’est qu’on les associe davantage à la réflexion en amont de ces décisions, qu’on sollicite davantage leur avis sur les conséquences de telle ou telle mesure arrêtée au niveau national. Or, dans l’élaboration des plans nationaux de santé publique, la phase amont de concertation n’est peut-être pas toujours à la hauteur des espérances de celles et ceux qui traitent des questions posées en région.
M. le coprésident Pierre Morange. Madame Zeina Mansour, la MECSS serait très intéressée d’obtenir le contenu du programme proposé aux classes de cours moyen deuxième année dont vous nous avez parlé, car ce type de bonne pratique a évidemment vocation à être généralisé.
Mme Gisèle Biémouret. Je suis élue du département du Gers où les pharmaciens ont déposé un dossier auprès de l’agence régionale de santé Midi-Pyrénées pour être autorisés à proposer à leurs clients un dépistage précoce du diabète. L’idée me semble pertinente puisque, présents même dans les toutes petites communes, ces professionnels de santé sont très proches de la population, d’autant que les gens, surtout dans les campagnes, se rendent souvent dans les officines avant d’aller chez le médecin.
Mme Marie-Sophie Desaulle. Aux termes de la loi, les pharmaciens peuvent avoir un rôle d’accompagnement pour certaines situations. Ils sont d’ailleurs très désireux de développer des actions, et ce d’autant plus qu’un certain nombre d’entre eux ont des difficultés à maintenir leur chiffre d’affaires.
Ces actions – dont les modalités devraient probablement s’inscrire dans une logique de forfait – nécessitent un accord de l’agence régionale de santé et, plus largement, un accord entre les autres professions de santé, en particulier avec les médecins généralistes. Or, en Pays de la Loire par exemple, cet accord entre professionnels n’est pas acquis.
M. Laurent Chambaud. Effectivement, une forte demande s’exprime à travers le pays de la part de certains professionnels de santé, notamment les pharmaciens. La coopération est un point important. Celui de la rémunération devra, à mon avis, être étudié pour en définir la base forfaitaire. En outre, il ne suffit pas de déclarer vouloir dépister, encore faut-il qu’une bonne volonté se transforme en une bonne pratique. À cet égard, il convient de définir les bases scientifiques d’un tel dépistage, mais aussi la méthode d’évaluation, y compris en termes de suivi. D’où l’importance d’un dépistage imaginé avec l’ensemble des professionnels de santé.
Je voudrais apporter un élément de réponse sur la question du pilotage.
Dans le cadre de ma mission relative à l’accompagnement national des contrats locaux de santé, j’ai interrogé un certain nombre d’interlocuteurs nationaux, dont la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, sur leur vision de ces contrats. Il en est ressorti que l’organisation de la caisse nationale ne lui permet absolument pas d’impulser des initiatives régionales, ni même locales, car elle agit dans une optique nationale. Elle est donc relativement prudente – c’est un euphémisme – à l’égard des contrats locaux de santé, ne souhaitant pas s’engager sur des dispositifs qui ne sont pas maîtrisés au niveau national. Or j’y vois un des obstacles à la prévention qui doit, certes, obéir à des orientations stratégiques nationales, mais aussi faire une place à l’autonomie locale, sachant que des publics particuliers nécessitent des initiatives locales. D’où la nécessité de trouver un équilibre entre, d’un côté, des orientations fortes portées au niveau national, et, de l’autre, des modalités adaptées aux populations qui vivent dans des territoires particuliers.
M. le coprésident Pierre Morange. Les acteurs de terrain que sont les associations doivent bien évidemment être associés à la politique de santé publique. Il n’empêche que, dans la mesure où cette dernière est financée par de l’argent public, il est tout à fait légitime que la collectivité ait un droit de regard sur la logique médico-économique d’une campagne de prévention.
La validation des projets par les différents financeurs se fait-elle toujours à la lumière de cette lecture médico-économique ? Des personnes auditionnées par la MECSS ont fait état de l’efficacité toute relative du dépistage du cancer de la prostate, notamment pour une certaine tranche d’âge, les préconisations étant relativement peu suivies malgré un raisonnement médico-économique parfaitement clair. L’action associative sur le terrain prend-elle en compte cet élément essentiel ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. L’analyse médico-économique, par exemple sur l’intérêt d’un diagnostic précoce du cancer de la prostate, ne peut être effectuée qu’au niveau national et la décision appartient à différents organismes. Cela ne dépend donc pas des agences régionales de santé. Avant d’engager un dépistage, les agences régionales s’appuient sur les évaluations disponibles. C’est ainsi que nous avons entrepris en région le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal – dépistages qui ont fait la preuve de leur efficacité – mais non celui du cancer de la prostate. Le dispositif que nous entendons mettre en place consiste à fixer des objectifs, comme celui d’atteindre 60 % de la population, puis à vérifier que les sommes engagées ont permis d’atteindre cette cible : c’est une évaluation, mais non une évaluation médico-économique à proprement parler.
M. le rapporteur. Quels sont les financements que les agences régionales de santé consacrent à la prévention ? Sont-elles suffisamment autonomes pour financer des actions qu’elles jugent prioritaires – par exemple la prévention des suicides en Bretagne ?
Êtes-vous favorable à l’instauration d’un objectif régional des dépenses d’assurance maladie qui vous donnerait la liberté de choisir ce que vous financeriez ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. Dans la région Pays de la Loire, nous consacrons aux actions de prévention destinées à la population générale 10 millions d’euros, que nous utilisons en signant des contrats avec des têtes de réseau comme les Instances régionales d’éducation et de promotion de la santé ou les Association multidisciplinaires pour l’algologie. Nous lançons également des appels à projets, pour 2,5 à 3 millions d’euros suivant les années. Ces actions laissent toute sa place à l’initiative. Nous avons en outre réservé une somme aux contrats locaux de santé afin d’engager des actions locales de prévention, financées en coopération avec les collectivités territoriales.
Ces crédits nous permettent de développer des actions prioritaires au regard du diagnostic propre à la région des Pays de la Loire. Celle-ci connaissant un taux de mortalité évitable supérieur à la moyenne nationale, dû à l’alcoolisme et aux suicides, nous finançons des actions en conséquence.
De quelles marges de manœuvre aurions-nous besoin ? La création d’un fonds d’intervention régional nous permettrait de disposer de différents crédits, dont ceux venant de l’hôpital et destinés à des missions d’intérêt général – je pense à l’éducation thérapeutique du patient, qui n’est financée qu’à l’hôpital. Ce fonds pourrait en outre inclure un faible pourcentage de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie médico-social. Voilà pour nos besoins les plus urgents. Ensuite, bien entendu, il faudrait procéder à une évaluation ex post, notamment au regard du principe de fongibilité asymétrique.
Devons-nous aller jusqu’à créer un objectif régional des dépenses d’assurance maladie ? Il se trouve que je siège, au titre des agences régionales de santé, au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, qui a engagé une réflexion sur ce thème : entrer dans une logique d’objectif régional des dépenses d’assurance maladie serait objectivement complexe. Il faudrait peut-être, dans un premier temps, construire un objectif régional des dépenses d’assurance maladie informatif et non prescriptif, simplement pour suivre les évolutions des dépenses de santé année après année et pour évaluer l’impact de la politique de santé menée en région.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous mettez l’accent sur la nécessité de disposer d’outils de mesure pour élaborer une véritable politique de santé publique. En tant que directrice d’une agence régionale de santé, disposez-vous d’informations suffisamment précises et actualisées ? Existe-t-il des échanges entre les différents collecteurs de données ?
M. Laurent Chambaud. La centaine d’objectifs de santé publique définis par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ne sont que des indicateurs, comme l’a rappelé la Cour des comptes dans sa communication d’octobre 2011. On en a renseigné quelques-uns, mais près du tiers d’entre eux ne sont pas encore stabilisés.
Notre travail le plus important sera d’obtenir les données, mais surtout de déterminer celles dont nous avons besoin. Il serait intéressant de réfléchir au niveau national à la possibilité de réduire le nombre d’indicateurs pour en faire de véritables tableaux de bord. Les indicateurs correspondent généralement à des moyennes ; or il existe des inégalités au sein d’un même territoire, voire à l’échelle d’un micro-territoire. D’où l’intérêt de développer des systèmes d’observation, y compris au niveau local. Quelques travaux sont en cours sur cette question – notamment de géolocalisation – mais certains pays sont plus avancés que nous. Les organismes nationaux devraient engager une réflexion approfondie sur le suivi et l’actualisation des données au niveau régional. Nous sommes d’autant plus conscients des problèmes qui se posent à cet égard que nous participons actuellement à la révision des indicateurs des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, mais le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est confronté à la même situation car les données dont il dispose datent de 2007, de 2008 et de 2009.
Il convient toutefois de relativiser le problème. J’ai travaillé avec l’Institut de veille sanitaire : en matière de dépistage, il y a une durée incompressible entre la campagne de recueil des données et leur analyse. Ce temps doit être le plus court possible mais nous pouvons travailler sur des indicateurs qui nous permettent au moins d’établir une tendance, même si les données de départ sont imparfaites. Ce travail reste encore à faire.
Mme Marie-Sophie Desaulle. Certaines de nos difficultés sont liées au partage de données. Certains sont jaloux des leurs…
M. le rapporteur. La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est un très bon exemple à cet égard !
Les observatoires régionaux de santé ne fonctionnent pas tous aussi bien que celui des Pays de la Loire, mais ne pourrait-on les charger de recueillir les données et de fournir les bons indicateurs ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. Vous avez raison de mentionner l’observatoire de santé des Pays de la Loire, mais les observatoires ne s’intéressent pas au domaine médico-social. Or les problèmes de santé sont souvent liés au parcours des personnes – c’est particulièrement vrai pour celles qui souffrent de maladies chroniques. En outre, les observatoires ne sont pas totalement regroupés partout.
On pourrait également penser aux centres régionaux pour l’enfance, l’adolescence et les adultes handicapés. Certaines agences régionales de santé se sont aussi dotées d’un service statistique pour étudier les données. Confier à un observatoire la responsabilité d’établir la cartographie des risques sur un micro-territoire n’est pas la solution. Il nous faut plutôt obtenir des conventionnements et des accords avec ceux qui possèdent les données, quels qu’ils soient.
M. Gérard Bapt. L’une de vos régions est-elle concernée par l’expérimentation du dépistage systématique, par frottis, du cancer du col de l’utérus ?
Mme Évelyne Baillon-Javon, directrice du pôle Prévention et promotion de la santé de l’agence régionale de santé de l’Île-de-France. Le département du Val-de-Marne procède actuellement à une campagne de dépistage de cette maladie.
Mme Zeina Mansour. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association ARCADES a fait la promotion de ce dépistage à titre expérimental, mais les taux de participation se sont révélés extrêmement faibles, passant de 2 % à 6 % de la population féminine seulement. Plus récemment, le professeur Lucien Piana a insisté pour s’engager en faveur d’un autre mode de dépistage, à savoir l’auto-prélèvement du papillomavirus. Depuis, les taux de participation auraient nettement augmenté.
Mme Gisèle Biémouret. Le conseil général du Gers, dont je suis vice-présidente, a conservé la compétence en matière de prévention sanitaire – nous avons un médecin de santé publique, qui est par ailleurs médecin coordinateur de l’Association pour le dépistage des cancers. Après le vote de la loi du 9 août 2004 précitée, mes collègues ne souhaitaient pas conserver cette compétence. Convaincue que le département est la collectivité la mieux placée pour s’intéresser aux problèmes sociaux de la population, je me suis battue pour la maintenir. Cela coûte cher à la collectivité, certes, mais il me semble qu’y renoncer serait une erreur.
M. Laurent Chambaud. Dans la région d’Île-de-France, comme dans beaucoup d’autres certainement, les situations et les investissements des départements sont très disparates. Trois sur huit ont conservé leur compétence en matière de prévention. Aux termes de la loi du 9 août 2004 précitée, il s’agit pour l’agence régionale de santé d’une compétence déléguée : nous sommes responsables des résultats obtenus, qu’ils proviennent des structures issues de cette loi ou des conseils généraux.
Nous souhaitons nous appuyer sur un cahier des charges le plus précis possible et disposer d’objectifs négociés avec les opérateurs – collectivités locales ou associations. L’investissement du conseil général est une véritable plus-value pour le département car il entraîne les collectivités locales dans des actions de prévention. C’est dans cette optique que nous préparons des campagnes sur divers sujets : prévention de la tuberculose, dépistage des cancers, vaccinations.
Les montants que nous consacrons aux actions de prévention proviennent des financements de l’État mais aussi de l’assurance maladie, à travers le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires. Les contrats locaux de santé montrent que les collectivités locales – communes ou communautés de communes, pour celles auxquelles ces compétences ont été transférées – investissent également énormément dans ce domaine.
Mme Zeina Mansour. En sus des actions bénéficiant de subventions, il en existe un certain nombre, mises en œuvre par l’Éducation nationale, par les conseils généraux, par les communes, etc., qui ne bénéficient pas de financements spécifiques… Le comité régional d’éducation pour la santé de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, anime par exemple le réseau des 31 villes actives du programme national Nutrition santé. Nous montons ainsi avec l’agence régionale de santé des programmes collectifs qui ne font l’objet d’aucun financement particulier mais dont les répercussions peuvent être très intéressantes. Le dernier en date est l’accompagnement de la suppression de la collation matinale à l’école.
S’agissant des indicateurs et des bases de données, l’observatoire régional de la santé pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en place un système d’information en santé, travail et environnement. Cette base de données, interrogeable en ligne, est la plus importante dans le domaine de la santé publique. Elle permet de suivre en permanence les indicateurs de santé, en particulier les taux de mortalité et de morbidité. Parallèlement, le comité régional d’éducation pour la santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a réalisé une base de données destinée à faire connaître et à valoriser, dans le domaine de la santé publique, les actions financées ainsi que celles n’ayant fait l’objet d’aucun financement, appelée OSCARS, pour observation et suivi cartographique des actions régionales de santé.
M. le rapporteur. L’Éducation nationale ayant peu de moyens, la santé des enfants n’est peut-être pas sa première priorité… Les infirmières et les médecins scolaires sont devenus rares. Comment dès lors coordonner éducation et santé ? Alors que les infirmières hospitalières appartiennent à la catégorie A de la fonction publique, les infirmières scolaires relèvent de la catégorie B. Comment, dans ces conditions, l’Éducation nationale peut-elle s’y prendre pour les recruter ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. Il y a un travail que nous pouvons entreprendre en collaboration avec l’Éducation nationale. Dans les Pays de la Loire, où l’enseignement privé est fortement implanté, nous sommes en train d’élaborer un livret de compétences, destiné aux enfants, sur les questions de santé. Quant aux moyens humains dont dispose l’Éducation nationale pour assurer le suivi médical des enfants, il faut bien reconnaître qu’ils sont modestes et nous devons donc réfléchir à la façon de les utiliser au mieux. Le choix ayant été fait de laisser la médecine scolaire à la charge de l’Éducation nationale et la médecine du travail à celle des entreprises bien que les agences régionales de santé aient la responsabilité de la médecine de premier recours, il en résulte un cloisonnement qui ne facilite pas la mobilisation de cette ressource rare que sont les médecins, les infirmiers et les psychologues.
M. Laurent Chambaud. En Île-de-France, l’agence régionale de santé, représentée par M. Claude Evin, a signé une convention avec les trois recteurs d’académie. Il s’agit d’une convention cadre énumérant un certain nombre d’actions. Nous préparons notamment un label destiné à récompenser les actions engagées au sein de l’Éducation nationale ; nous avons aussi travaillé à l’amélioration de l’accueil des enfants handicapés.
Je voudrais vous alerter sur la situation de la protection maternelle et infantile en Île-de-France. Nous assistons à une désertion des médecins – due sans doute à leur rémunération, beaucoup plus faible que dans d’autres secteurs. Cette situation inquiète tant les conseils généraux que certains d’entre eux investissent des sommes importantes dans ce domaine, majeur pour l’offre de soins de premier recours dans certains territoires, comme dans le département de la Seine-Saint-Denis, où ce secteur assure le suivi de 80 % des enfants. Mais les conseils généraux ne parviennent plus à recruter des médecins et des sages-femmes. Cela pose un problème majeur d’accès aux soins.
M. le coprésident Jean Mallot. Dans notre société, tout ce qui est entrepris doit être rémunéré. La nouvelle convention médicale prévoit ainsi de rémunérer les actions de prévention engagées par les médecins généralistes. Mais pour rémunérer autrement qu’à l’acte, il faut déterminer un certain nombre de critères – nombre de vaccinations, de personnes reçues, etc. –, sachant qu’il est impossible de mesurer l’efficacité d’une action de prévention. Cette difficulté rend le système peu satisfaisant, tant pour la puissance publique que pour les praticiens, qui de ce fait traitent la prévention comme un parent pauvre. Comment la développer dans ces conditions ?
M. Laurent Chambaud. Pour évaluer ce que peut faire un praticien ou un groupe de professionnels de santé en matière de prévention, nous ne sommes pas totalement démunis. On pourrait en particulier étudier les exemples étrangers, en particulier anglais, mais plus encore écossais ou gallois. Il existe aussi des travaux sur ce qu’on peut attendre des programmes d’éducation thérapeutique du patient, ce qui a conduit à prévoir leur formalisation dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. De nombreux médecins pratiquaient déjà cette éducation thérapeutique. Bien encadrés, ces programmes produisent de bons résultats. Il faudrait cependant un dispositif national, que nous pourrions relayer au niveau régional.
Promouvoir la prévention passe également par des programmes pluriannuels et par le développement de méthodologies complexes pour parvenir à ce que les Anglo-saxons nomment « la santé publique fondée sur les preuves ». Je regrette qu’en France il existe peu d’instances pour développer ces méthodologies et pour évaluer les actions stratégiques. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé serait, je pense, en mesure de nous apporter des éléments bibliographiques et de nous aider à négocier avec les opérateurs. Ceux-ci ne manquent pas de bonne volonté et seraient prêts à s’engager dans des programmes, mais à condition que nous leur fournissions les éléments nécessaires. Le projet d’intervention auprès des collégiens centrée sur l’activité physique et la sédentarité (ICAPS), développé récemment par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, offre un exemple, certes rare, de ce qui serait réalisable.
Mme Marie-Sophie Desaulle. Je souscris aux propos de M. Laurent Chambaud. De tels programmes doivent être structurés au niveau national et mis en place par un ou deux opérateurs pour que nous puissions les appliquer en région. Néanmoins, il sera sans doute impossible de juger, par exemple, de l’efficacité d’un programme relatif à l’évolution du taux de mortalité évitable car nous ne pourrons pas l’isoler de son contexte.
La prévention dépend plus du comportement des individus que de l’organisation de notre système de santé. Or il est difficile de prévoir l’impact sur les comportements de telle ou telle action. Nous pouvons isoler des programmes dont une évaluation médico-économique a prouvé l’efficacité, mais nous ne saurons jamais avec certitude ce qui a permis une amélioration de l’indicateur. Nous sommes donc obligés, pour montrer l’efficacité de notre système de santé, de tenir compte à la fois, d’une part, de l’évaluation médico-économique de programmes correctement structurés et, d’autre part, comme en Angleterre, du suivi d’un nombre restreint d’indicateurs comme l’évolution de l’espérance de vie sans incapacité, ou encore le taux de mortalité évitable.
Mme Zeina Mansour. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé promeut un outil de catégorisation des résultats dont l’objectif est de démontrer que l’état de santé de la population dépend de déterminants sur lesquels on peut agir. Il est vain, certes, d’examiner de façon isolée le déterminant « Comportements individuels et psychosociaux » sans tenir compte de l’évolution de l’environnement physique et social, mais la maîtrise de cet outil permet néanmoins de mener une politique globale et d’en garantir l’efficacité. Si nous ne sommes pas en mesure d’évaluer certains programmes de manière permanente, il est indispensable de nous assurer, en amont, que toute action sur les comportements individuels s’accompagne d’une action simultanée sur l’environnement physique et social. D’où la nécessité d’une coordination avec les autres acteurs institutionnels et avec les collectivités. Comment par exemple traiter de nutrition sans se préoccuper du contenu des repas dans les cantines ?
M. le rapporteur. Nous recevrons prochainement les représentants de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé : ils nous présenteront certainement ce programme.
La nouvelle convention médicale prévoit une rémunération à la performance et la mise en place d’indicateurs relevant de la prévention comme le dépistage du cancer du sein ou la vaccination contre la grippe. Cela va dans le bon sens. De même, l’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, que nous avons voté hier, dispose que les pharmaciens percevront une nouvelle rémunération fondée à la fois sur l’acte et sur la performance.
J’avais souhaité la création d’une agence nationale qui laisserait à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés la seule fonction de remboursement. Actuellement, les décisions proviennent d’interlocuteurs situés à plusieurs niveaux, ce qui entraîne selon moi bien des difficultés. Est-ce aussi votre sentiment ?
Mme Marie-Sophie Desaulle. Aucune instruction ne parvient aux agences régionales de santé sans avoir été validée par le Conseil national de pilotage, qui regroupe l’ensemble des acteurs – directions de l’administration centrale, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – qui peuvent ainsi évoquer ensemble les politiques et les stratégies à mettre en œuvre. La coordination nationale n’est donc pas inexistante.
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a un rôle d’assureur : signer une convention avec des professionnels de santé fait partie de ses compétences, et cette convention peut être un atout pour la mise en œuvre d’une politique régionale. L’agence régionale de santé intègre ainsi dans sa politique les indicateurs de prévention qu’elle contient pour atteindre les objectifs qu’elle-même s’est fixés.
M. Laurent Chambaud. La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est un acteur majeur en matière de prévention et joue un grand rôle auprès des professionnels de santé. Il faut donc maintenir la plus grande cohérence possible entre ses actions et celles des agences régionales de santé. Le pilotage unique des actions de prévention paraît utopique, et j’incline à penser que c’est plutôt une bonne chose. Le conseil régional d’Île-de-France pilote des actions de prévention, notamment en matière de contamination par le VIH et dans le domaine de la contraception. Certes, ce pilotage manque de cohérence en amont, mais nous serons toujours confrontés à ce problème.
Au sein de la mission de coordination, un sous-groupe réunissant les services de la protection maternelle et infantile des huit conseils généraux de la région contribue également à la cohérence de notre politique. Les collectivités locales aussi ont un rôle majeur à jouer dans des domaines de leur compétence, comme le logement, le transport, la nutrition, l’activité physique. L’agence régionale de santé a une légitimité suffisante pour faire asseoir autour de la même table tous ces partenaires, afin de développer une logique et une vision communes des actions de prévention, étant entendu que chacun conserve naturellement ses compétences.
M. le rapporteur. La solution de la commission de coordination vous paraît-elle suffisante en l’état ? Faut-il y faire participer d’autres acteurs ? L’agence régionale de santé est-elle suffisamment autonome ?
M. Laurent Chambaud. La commission de coordination fonctionne depuis peu. Les acteurs s’y investissent de façon très différente, que ce soit au niveau de la participation ou au niveau de leur représentation. Nous avons donc besoin, aussi, de relations plus étroites avec certains partenaires, afin d’engager avec eux des actions spécifiques. L’entreprise n’est pas toujours aisée, car il en est qui sont soumis à une forte logique nationale. C’est le cas de l’assurance maladie, par exemple, mais nous ne pouvons nous contenter de la seule relation au sein de la commission de coordination. Avec les collectivités locales, la difficulté est autre : nous devons tenir compte à la fois de leur diversité et de l’enchevêtrement des compétences.
Il y a là un travail à mener de toute nécessité, sachant qu’il faut du temps pour conquérir sa légitimité.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie.
*
Audition de M. Stéphane Lévêque, président de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et de M. Patrick Negaret, directeur.
M. le coprésident Pierre Morange. Si nous avons souhaité vous entendre dans le cadre de cette série d’auditions consacrée à la prévention, messieurs, c’est que les assureurs que vous êtes n’ont pas vocation à payer aveuglément, mais sont appelés à participer à la gestion des risques sanitaires dans le cadre d’une politique globale définie par l’État, en particulier à travers le nouveau cadre posé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Votre expérience locale en matière de prévention et d’éducation à la santé nous intéresse particulièrement, en effet.
Quelles relations entretenez-vous avec l’agence régionale de santé d’Île-de-France, mais également avec l’Éducation nationale et avec la médecine du travail ? Comment appliquez-vous vos politiques de prévention ? Enfin, qu’attendez-vous des indicateurs de performance inscrits dans la nouvelle convention médicale ?
M. Patrick Negaret, directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Avant de répondre à vos questions, je précise que, conformément à ce qui m’a été demandé, je vous présenterai plus particulièrement une expérience que j’ai menée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
En l’état, nos relations avec l’agence régionale de santé sont assez distantes, ce qui peut s’expliquer dans la mesure où celle-ci a dû, comme ses homologues, se consacrer tout d’abord à sa mise en place.
La politique de prévention, quant à elle, s’est limitée aux appels à projets qui ont été lancés – nous avons d’ailleurs retenu sans grande difficulté ceux qui parmi eux étaient bien présentés.
Le paiement à la performance me semble constituer l’aspect le plus important de la nouvelle convention : comme les anciens contrats d’amélioration des pratiques individuelles, elle intègre des indicateurs de prévention qui favoriseront l’action dans ce domaine alors que les disparités demeurent importantes entre départements, voire entre cantons, et entre les médecins eux-mêmes.
Il importe, en la matière, de distinguer les actions à caractère national – vaccination anti-grippale, dépistages des cancers du sein et colorectaux, programme Sophia – et les expériences locales qui ont fait leur preuve et qu’il est temps de démultiplier. Une action de prévention, en effet, ne peut être efficace que si les différents acteurs de terrain y sont parties prenantes. L’information et la sensibilisation sont certes nécessaires mais elles ne suffisent pas. Même si la tâche n’est pas aisée, il faut amener nos concitoyens à changer leurs comportements, faute de quoi nous ne parviendrons pas à obtenir de résultats tangibles.
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins car, si les caisses d’assurance étaient jusqu’ici des « entreprises de production et de services », l’informatisation en cours permettra de dégager des moyens qui devront être investis dans d’autres domaines – sans pour autant perdre de vue la nécessité de poursuivre la réduction des effectifs.
M. Stéphane Lévêque, président de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Je croyais, pour ma part, que nous allions travailler un peu plus avec l’agence régionale de santé. Or tel n’a pas été le cas, contrairement à ce qui se passait auparavant avec la direction des affaires sanitaires et sociales – je songe, en particulier, à la question du transport sanitaire, sur lequel nous avons le plus grand mal à obtenir des informations.
M. le coprésident Pierre Morange. Voilà une information particulièrement intéressante, qui corrobore les impressions ressenties sur le terrain. Les procédures conventionnelles ont été fortement décriées et la caisse d’assurance maladie des Yvelines a lancé une procédure judiciaire au titre de l’article 40 du code de procédure pénale à propos des pratiques auxquelles vous venez de faire allusion – je suis d’ailleurs perplexe face à l’inertie qui semble l’emporter dans le traitement de ce dossier et à ce manque d’articulation que vous venez de signaler avec l’agence régionale de santé, structure désormais compétente en la matière et chargée du contrôle de légalité.
M. Stéphane Lévêque. S’agissant des procédures de conventionnement, nous n’avons pas de relations avec l’agence régionale de santé – à la différence, donc, de ce qui se passait avec la direction des affaires sanitaires et sociales – et nous ne pouvons plus faire part de notre point de vue. Voilà par exemple plus d’un an que je n’ai pas assisté à une réunion sur le conventionnement des ambulances ou des taxis. S’agissant des dossiers actuels que vous connaissez bien, monsieur le président, nous n’avons pas de réponses ! Ils relèvent désormais du procureur.
M. le coprésident Pierre Morange. Précisément, qu’en est-il de l’institution judiciaire ?
M. Stéphane Lévêque. Nous attendons. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de parler de ce problème avec le préfet il y a deux jours.
M. le coprésident Pierre Morange. Il serait sans doute pertinent que votre avocat demande par écrit des nouvelles. Je rappelle qu’il a été question d’un détournement de fonds publics à vocation sanitaire via un processus de surfacturation.
M. le rapporteur. Quelles mœurs, dans les Yvelines !
M. le coprésident Pierre Morange. En l’occurrence, il n’est pas vain de parler des écuries d’Augias !
M. Stéphane Lévêque. Je partage votre souci. En l’état, il n’est pas possible de prétendre que ce dossier ait beaucoup avancé même si des informations nous parviennent parfois de la part du procureur à propos de mises en garde à vue ou de dates de jugement mais sans que rien ne soit pour autant effectif. L’un de mes collaborateurs m’a dit hier qu’il avait envoyé un courriel à l’agence régionale de santé il y a quinze jours et un autre il y a une semaine ; ils sont restés sans réponse. Le téléphone de l’agence, quant à lui, est sur répondeur. Peut-être la situation est-elle meilleure dans d’autres départements mais, chez nous, elle est très médiocre.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’en est-il donc, monsieur Patrick Negaret, du programme que vous avez mis en place dans la Sarthe ?
M. Patrick Negaret. Le concept de « Santé Active », marque déposée, diffère de celui de l’assurance maladie en ceci qu’il vise à responsabiliser l’assuré social au lieu d’encourager une certaine forme de passivité, à lui apprendre à gérer son capital santé et, enfin, à maîtriser les coûts, étant entendu que les affections de longue durée représentent les deux tiers des dépenses et comptent pour les neuf dixièmes dans l’évolution de celles-ci. Ce programme vise à agir sur ces déterminants de la santé que sont l’hygiène de vie, les comportements et l’environnement grâce à un certain nombre d’outils : magazines, rendez-vous, forums dont les débats sont contradictoires et publics – ils ont attiré 12 000 personnes –, ateliers de cuisine, etc. J’ai également fait ouvrir au cœur du Mans, place de la République, un espace fréquenté par 15 000 personnes chaque année. À travers cette opération d’affichage, l’objectif était que les assurés perçoivent le changement de paradigme en cours et se disent : « J’ai des droits, certes, mais j’ai aussi des obligations. » Nous sommes tous coresponsables de l’assurance maladie !
Nous avons également ouvert des ateliers d’accompagnement en direction des assurés sur des thèmes importants générateurs de dépenses, avec pour objectif de développer la prévention primaire auprès d’une frange de la population un peu oubliée : celle qui n’est ni en situation de précarité ni en affection de longue durée, qui cotise mais se demande ce qui est fait pour éviter son basculement, un jour, en affection de longue durée. Trois thèmes ont été retenus : la santé du dos, car nombre d’arrêts de travail sont dus à des lombalgies chroniques, la santé du cœur – les affections cardiovasculaires sont très répandues – et, enfin, la nutrition et les activités physiques, la plupart des affections chroniques étant dues à une mauvaise alimentation et au manque d’activités physiques ; nous avons également réalisé avec des diététiciens des bilans « Nutrition Active » gratuits et nous avons ouvert une ligne téléphonique « Nutrition Active » qui délivre des renseignements.
Afin de mener à bien ce projet, il nous a semblé important de suivre les comportements sanitaires et la consommation alimentaire des individus. C’est ce que nous faisons au sein du club « Santé Active » − avec l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés –, dont les adhérents, qui sont des assurés « privilégiés », reçoivent un relevé de leur consommation de soins une fois par an. Les données sont ensuite transmises au département de mathématiques de l’université du Maine afin d’évaluer scientifiquement les résultats obtenus, par comparaison avec ceux d’un groupe témoin.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est l’effectif concerné ?
M. Patrick Negaret. De 900 personnes au début, nous en sommes arrivés aujourd’hui à 3 000. C’est à partir de la fin de 2008 que nous avons mis en place ces ateliers centrés sur des thèmes précis, permettant une évaluation solide – ce qui n’était pas le cas auparavant lorsque nous travaillions sur des sujets tels que le bien-être ou le sommeil.
Les résultats que nous avons obtenus sont très intéressants et sont bien entendu à votre disposition : la consommation de médicaments diminue – inhibiteurs de la pompe à protons, antalgiques, psychotropes – de même que le nombre d’arrêts de travail et les recours au médecin généraliste. Les dépenses d’hospitalisation, quant à elles, n’augmentent pas. Notre objectif n’est certes pas de diminuer les soins, mais bien d’éviter le développement des affections chroniques ou de faire en sorte qu’elles ne prennent pas rapidement un tour aigu. Nous continuerons ce travail afin de disposer de longues séries pour démontrer que ces résultats sont probants mais, d’ores et déjà, nous avons constaté que la consommation de certains médicaments pouvait être divisée par quatre en un mois. L’Organisation mondiale de la santé l’a montré : la santé dépend des soins à hauteur de 15 % seulement, le reste étant fonction du comportement ou de l’hygiène de vie. Nous nous doutions que l’impact de notre action serait important mais pas à un tel point.
S’agissant du difficile problème des affections de longue durée – outre le protocole de soins entre le médecin traitant et le médecin-conseil –, les ateliers de « Santé Active » pourraient faire partie d’un parcours obligé.
M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, m’a demandé de généraliser ce travail pour l’étendre à l’ensemble de notre territoire. Nous commençons donc par celui de Versailles, caisse très importante et au fort potentiel, puis nous continuerons avec celui de Bobigny et de dix autres caisses primaires – nous avons d’ailleurs lancé un appel à candidatures auquel quarante collègues ont répondu. En 2013, l’extension devrait être envisagée.
Pour assurer des résultats durables, nous nous apprêtons à lancer un appel d’offres pour l’acquisition d’un logiciel de suivi des comportements – un assistant virtuel, en quelque sorte – que l’on pourra donner aux personnes qui ont suivi les ateliers ou à celles qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas les suivre. Il est d’ailleurs notable, à ce propos, que le public en situation précaire se prête plus volontiers à ce type d’actions quand elles passent par internet.
Je suis convaincu que le programme « Santé Active » est de nature à procurer une plus grande légitimité à l’assurance maladie, dans la mesure où il lui permettra de mener une réelle action de prévention sanitaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Même si vous ne disposez pas de beaucoup de recul, les résultats obtenus sont assez spectaculaires. Quel est selon vous le rapport coût/bénéfice pour l’assurance maladie ?
M. Patrick Negaret. À raison, les statisticiens mettent en garde contre toute extrapolation mais le gain immédiat, s’il n’est pas énorme, n’en est pas moins réel. Il le sera encore plus ultérieurement dès lors que les assurés ne tomberont pas en affection de longue durée – ou y tomberont le plus tard possible. Quant au coût, celui du programme d’accompagnement « Santé du cœur » s’élève à 64 euros par personne.
M. le coprésident Pierre Morange. Combien de temps dure-t-il ?
M. Patrick Negaret. Entre dix et quinze assurés participent à trois, quatre ou cinq ateliers d’une heure et demie à trois heures chacun. Les programmes « Nutrition active » et « Santé du dos » coûtent respectivement 82 euros et 94 euros, coûts qui sont sans commune mesure avec ceux d’un centre d’examens. L’Institut régional pour la santé dont dépendent la Sarthe et onze autres départements facturait ainsi 240 euros un examen de santé, ce qui représente le coût de quatre participations au programme « Santé du cœur ». C’est d’autant plus cher que des examens systématiques ne sont pas toujours nécessaires, sauf pour des populations ciblées. J’ai d’ailleurs fait part à M. Frédéric Van Roekeghem de l’utilité de recentrer l’activité des centres afin d’en réduire les coûts.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’en est-il de l’articulation avec la médecine scolaire ou avec la médecine du travail ? Une telle coordination existe-t-elle au sein du programme « Santé Active » ? Par ailleurs, dans quelles tranches d’âge se recrutent les participants ?
M. Patrick Negaret. Une telle action n’est concevable que dans le cadre d’un partenariat solide entre les différents professionnels de santé – médecine du travail et médecine scolaire comprises, donc –, mais aussi avec les collectivités, par l’intermédiaire des cantines. Tous étaient donc représentés dans notre comité de pilotage. Je travaillerai dans le même esprit dans les Yvelines : ce soir même, je rencontrerai les représentants des syndicats de médecins afin de leur expliquer le programme « Santé Active » tout comme j’ai eu l’occasion de le faire devant le président de la communauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sans ces relations, le système ne pourrait pas fonctionner.
Les ateliers peuvent être conduits par un infirmier, par un médecin rééducateur, par une diététicienne… Nous nous mettons d’accord pour y déléguer la personne la mieux à même de réaliser cet exercice, sous la responsabilité de celle qui est la plus compétente dans le domaine concerné.
Je ne méconnais toutefois pas le risque qu’il y aurait à opposer une médecine traditionnelle à une médecine plus moderne, grâce à laquelle des personnes qui souffrent de lombalgies retourneraient au travail au lieu de multiplier les arrêts maladie. Les méthodes évoluent et il faut mettre en évidence celles qui fonctionnent. L’idée n’est pas de jeter l’opprobre sur telle ou telle pratique mais d’encourager les médecins à se former.
La moyenne d’âge des participants diminue puisque la plupart ont maintenant moins de cinquante-cinq ans. Notre pari est de toucher des personnes qui sont en activité, et pas forcément des personnes âgées souffrant de plusieurs affections. Nous souhaitons également la participation des mères de famille, en particulier à nos ateliers cuisine où l’on apprend à lire les étiquettes des produits, car elles constituent un relais décisif auprès des enfants.
J’ajoute que nos ateliers sont également ouverts le samedi jusqu’à 19 heures – ce n’est pas courant au sein de la sécurité sociale ! –, ce qui participe de la nouvelle image que nous voulons donner : si j’ouvrais à Saint-Quentin-en-Yvelines une boutique « Santé Active » qui fermerait ses portes le samedi, les gens se moqueraient ! Cela a nécessité un travail d’explication auprès des syndicats mais les volontaires sont nombreux. Pour quatre postes, nous avons reçu 50 appels téléphoniques et 27 candidats se sont immédiatement déclarés.
M. le coprésident Pierre Morange. Les ateliers sont-ils fréquentés par les seules personnes actives ou des mineurs y participent-ils ?
M. Patrick Negaret. En l’état, seuls des salariés y participent.
Dans la Sarthe, nous n’avons pas visé une population particulière mais nous avons procédé à des entretiens de motivation, même si cela peut paraître risqué pour un service public. Nous expliquons ainsi aux futurs participants que, faute de motivation, nous ne pourrons pas les aider à changer de comportement et que notre objectif est aussi de faire réaliser des économies à l’assurance maladie en insistant sur le fait que ces ateliers ont un coût. Je précise également que nous sommes en train d’étudier la faisabilité d’un ciblage de la population dans le cadre du programme national, afin de ne pas être dépassé par le nombre de demandes.
M. le coprésident Pierre Morange. Cela n’induit-il pas un biais statistique entre les différentes cohortes, selon que les personnes ont ou non passé un entretien de motivation ?
M. Patrick Negaret. C’est bien pour prévenir ce risque que nous avons constitué un groupe témoin standard sans aucune considération de la motivation de ses membres.
M. le coprésident Pierre Morange. Il serait intéressant de vérifier si le degré de motivation de ce groupe est similaire à celui de la cohorte d’adhérents.
M. Patrick Negaret. En effet, car, de la même manière, si 15 000 personnes se rendent chaque année dans l’espace que nous avons ouvert au Mans, c’est qu’elles sont motivées. Il est difficile de procéder autrement. Si nous n’atteignons que 30 % de la population, ce sera déjà du bon travail – je laisse à d’autres le soin de s’occuper des 70 % restants !
M. le rapporteur. Les « passeports Cigogne et Bout’chou » mentionnent un guide de prévention et d’informations administratives à destination des femmes enceintes mais, également, l’existence d’un entretien individuel. Qu’apportez-vous de plus qu’un gynécologue ou un médecin traitant ?
M. Patrick Negaret. J’appelle cela un service de santé intégré dédié à des personnes qui ont vraiment besoin des services de la caisse primaire d’assurance maladie. Les femmes enceintes, notamment celles de leur premier enfant, sont très inquiètes et se demandent si elles auront droit à des prestations et dans quels délais – en moyenne, elles passent quatre appels ! Nous avons donc décidé de leur faire intégrer un atelier comportant une sage-femme et éventuellement un gynécologue, afin de leur expliquer les données sanitaires de base, et au cours duquel les professionnels relatent le déroulement d’un accouchement et rappellent qu’une future mère ne doit ni fumer ni boire de l’alcool.
M. le rapporteur. Quelles femmes participent à ces ateliers ?
M. Patrick Negaret. Nous envoyons des courriels et elles se présentent volontairement, souvent encouragées par leur gynécologue ou leur sage-femme.
M. le rapporteur. À propos de la sclérose en plaques, il est question dans votre brochure d’un programme « Home et vous » réalisé pour un laboratoire pharmaceutique ? Avez-vous des liens d’intérêt ?
M. Patrick Negaret. Non, je vous rassure ! Je me suis simplement rendu compte que certains laboratoires pharmaceutiques disposaient d’un véritable « assistant virtuel » interactif – et non d’une simple vidéo – pour certaines pathologies. Comme ces logiciels sont assez bien faits, j’ai pensé que nous pourrions les utiliser dans le cadre de la lutte contre le mal de dos ou pour promouvoir une nutrition saine. Ainsi, le programme « Home et vous » explique aux malades qui souffrent de sclérose en plaques comment ils doivent se comporter dans leur lieu de vie. Un tel procédé est rentable et le sera de plus en plus lorsqu’il sera généralisé dès lors qu’il évite ou complète le « présentiel », qui coûte cher.
M. le rapporteur. Quel est votre rapport avec le programme Sophia pour les diabétiques ?
M. Patrick Negaret. Je pense faire inclure notre programme dans Sophia, premier projet très important de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés dans le registre des « services en santé ». À ce jour, ce sont en effet presque 250 infirmières salariées de l’assurance maladie qui y contribuent et l’on ne peut accroître indéfiniment leur nombre – non seulement il faut les trouver mais il faut les payer. Les ateliers ou bien le système d’assistant virtuel me semblent constituer un bon échelon intermédiaire. Sans eux, l’offre de l’assurance maladie serait incomplète.
M. le rapporteur. Vous jouez un rôle important auprès des médecins avec les délégués de l’assurance maladie. Comment envisagez-vous votre mission de responsable du suivi des indicateurs de performance ?
M. Patrick Negaret. Un directeur de caisse primaire doit comprendre son interlocuteur et faire preuve d’empathie même s’il doit aussi se montrer ferme comme j’ai eu l’occasion de l’être lors d’une affaire de prothèses de hanche. En l’occurrence, les médecins-conseils seront beaucoup plus associés à notre travail puisque certains indicateurs ont un caractère médical prononcé – cela me semble d’autant plus positif que ce ne fut pas toujours le cas. Les délégués, quant à eux, seront formés pour aller conseiller les médecins généralistes et les aider à atteindre leurs objectifs faute de temps : lorsque Mme Untel est en surpoids, le médecin sait bien qu’elle doit suivre un régime, mais, s’il met trois quarts d’heure à le lui expliquer alors qu’il a vingt-cinq personnes dans sa salle d’attente, cela soulèvera des difficultés. Notre action se veut complémentaire de celle des médecins traitants, qui bénéficieront du retour d’information de « Santé Active » et des éléments procurés par le logiciel d’assistance virtuelle.
Mme Gisèle Biémouret. Quels sont les partenaires qui soutiennent votre démarche – collectivités territoriales ou autres financeurs ? N’allez-vous pas toucher uniquement les publics les plus motivés et les mieux informés ?
M. Patrick Negaret. S’agissant du financement, nous n’avons pas trouvé de partenaires sauf de manière ponctuelle – pour nos forums, nous avons été ainsi soutenus par l’AG2R, la mairie du Mans, l’État, les conseils général et régional. Globalement, je n’ai pas rencontré d’écho très favorable de la part des régimes complémentaires. Dans la Sarthe, j’aurais pourtant été ravi de bénéficier de locaux, par exemple, tant ils coûtent cher.
Si nous touchons des personnes plus sensibilisées que d’autres à ces questions de santé, elles ne suivront pas pour autant les conseils qui leur sont donnés. Un cadre de quarante ans qui a arrêté le sport depuis longtemps et qui a pris 15 kilos sait bien qu’il devrait reprendre une activité physique, mais il ne le fera pas nécessairement. Si, en revanche, on l’encourage grâce à ces ateliers où il peut venir pendant cinq samedis de dix heures à midi, il sera motivé par le médecin rééducateur, le kinésithérapeute ou la diététicienne, mais aussi par les autres participants. On ne peut apprendre à jouer au golf dans un livre ; si l’on prend des cours avec cinq ou six amis, les progrès seront en revanche sensibles, les uns entraînant les autres. Notre action dans les ateliers est un peu comparable : nous créons du lien social et nous favorisons le développement des pratiques sportives. Cela étant, je suis conscient qu’il n’est pas possible de s’occuper ainsi de l’ensemble de la population.
M. le rapporteur. J’ai bien compris que vous ne vous intéressiez pas à ceux qui ne sont pas passionnés !
M. Patrick Negaret. J’essaie d’être efficace !
M. le rapporteur. Les indicateurs de performance responsabiliseront les professionnels mais ne pensez-vous pas qu’il conviendrait également de motiver les patients – par exemple en morigénant un diabétique qui aurait omis de faire un examen de fond d’œil ?
En outre, disposez-vous d’informations sur les femmes qui se sont rendues au dépistage organisé du cancer du sein et sur celles qui se sont abstenues ? Les premières se recrutent-elles dans les couches sociales les plus favorisées ? En Suède, les autorités ont menacé les récalcitrants aux dépistages ou à la vaccination de leur retirer leur carte électorale ; il m’est arrivé de dire par plaisanterie que le procédé ne serait efficace en France que si l’on remplaçait la carte électorale par la carte Vitale ! Plus sérieusement, le dépistage systématique du cancer du sein ne touche que 65 % des femmes concernées et il est difficile de dépasser ce seuil, certaines préférant ne pas savoir, d’autres comptant parmi les populations les plus défavorisées.
M. Patrick Negaret. Je suis convaincu de la nécessité de responsabiliser à la fois les assurés et les professionnels de santé. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de diffuser aux assurés des lettres d’information sur les arrêts de travail ou sur la surconsommation de médicaments. Voilà une quinzaine d’années, j’avais même envoyé à toutes les personnes qui avaient eu plus de trois arrêts de travail de huit jours une lettre leur annonçant un contrôle lors de leur prochain arrêt : les deux tiers d’entre elles n’ont plus été plus malades !
Il est vrai que la participation au dépistage du cancer du sein plafonne à 65 %. Nous avons réalisé des campagnes téléphoniques, d’envois postaux, d’affichage mais une frange de la population demeure très difficile à atteindre pour différentes raisons. En Allemagne, les soins dentaires ne sont remboursés totalement qu’à ceux qui ont passé des examens de prévention avant leur vingt-et-unième anniversaire, seuil à partir duquel la santé dentaire est à peu près assurée. Ce type d’incitation pourrait faire l’objet d’une réflexion – même si l’on peut difficilement envisager de ne pas rembourser une patiente atteinte d’un cancer du sein.
Par ailleurs, si nous parvenons à augmenter le taux de la prévention, nous nous heurtons ensuite, comme dans le cadre du programme Sophia, au secret médical. Nous ne sommes pas censés savoir que tel patient est diabétique ; dans ces conditions, que peut faire un directeur de caisse primaire pour atteindre le taux requis par les indicateurs ? C’est à ce genre de difficultés que nous sommes confrontés lorsque nous voulons améliorer l’efficacité des campagnes de dépistage ou d’information.
Mme Gisèle Biémouret. Vice-présidente d’une association de dépistage du cancer dont la caisse primaire d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, le conseil général et la Ligue contre le cancer sont partenaires, je considère que l’organisation du suivi est également importante. Ce dernier est sans doute plus facile dans un département peu peuplé comme le mien, mais il importe de relancer les personnes concernées et, par exemple, de renvoyer rapidement les résultats de la seconde lecture des mammographies. Or, après la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et la mise en place des agences régionales de santé, je suis un peu inquiète du pilotage régional des politiques de prévention.
M. le rapporteur. Comment organiser une prévention efficace si l’on n’entretient pas de relations suivies avec la médecine du travail, la protection maternelle et infantile et l’Éducation nationale ?
M. Patrick Negaret. Nous entretenons de telles relations puisque « Santé Active » intègre les actions de santé au travail et que des contrats sont également conclus avec la protection maternelle et infantile dans le cadre du planning familial.
En ce qui concerne, par exemple, cette maladie professionnelle que sont les troubles musculo-squelettiques, l’augmentation des indemnités journalières est de l’ordre de 12 % par an. Or, nous savons qu’il est possible de juguler une telle progression à travers des actions de prévention ciblées. Outre les conventions, la réunion de différents acteurs comme je l’ai fait avec « Santé Active » – syndicats d’employeurs, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, médecine du travail – permet de définir des actions que nous pouvons efficacement conduire conjointement, afin de réduire maladies professionnelles et accidents du travail. Cela vaut aussi pour la restauration scolaire, par exemple : lorsque j’étais dans la Sarthe, nous avons lancé un appel d’offres assorti d’exigences de qualité pour la fourniture de 650 repas chaque jour ; nous avons reçu sept réponses qui ont permis d’améliorer considérablement la qualité des repas sans en augmenter le coût moyen. Ce genre d’action, bien que ponctuelle, n’en est pas moins réaliste et efficace.
« Santé au travail » est en plein redéploiement du fait du manque de médecins, et des difficultés de recrutement d’infirmières mais son rôle n’en demeure pas moins important pendant la période de reprise du travail du salarié ou dans la lutte contre les troubles musculo-squelettiques.
M. le rapporteur. L’action de « Santé Active » sera-t-elle nationale, désormais ?
M. Patrick Negaret. Son déploiement à l’échelle nationale est en effet en cours.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est, plus précisément, votre calendrier ?
M. Patrick Negaret. M. Frédéric Van Roekeghem souhaiterait que ce déploiement soit terminé quand la convention d’objectifs et de gestion arrivera à son terme, à la fin de 2013. En l’état, dix candidatures de caisses primaires seront retenues dans les jours prochains pour 2012 et, si tout fonctionne correctement, le nombre de candidats ne fera que croître.
Nous proposons, en effet, une forme de « franchise » comprenant l’ensemble - normé – des contenus des ateliers, lesquels sont d’ailleurs en train d’être validés par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. À une telle échelle, les résultats obtenus permettront de déterminer le rapport coût-qualité. Nous devons également mettre en place un nouveau mode de relation entre les directeurs de caisses primaires, faute de quoi nous serions condamnés à l’échec. Le délai dont nous disposons est court mais nous pouvons raisonnablement envisager une intégration de la moitié des caisses à la fin de 2013.
M. le coprésident Pierre Morange. En 2004 ou 2005, M. Frédéric Van Roekeghem envisageait l’achèvement du plan informatique de l’assurance maladie en 2008, mais il nous a confié récemment que l’échéance serait reportée jusqu’en 2013 ou 2014. Si l’on ajoute à cela les problèmes de partage des informations et d’hétérogénéité des systèmes, serez-vous à même de tenir l’objectif ambitieux que vous venez d’annoncer ?
M. Patrick Negaret. Des progrès ont été réalisés mais j’ai veillé à ce que nous ne soyons pas directement dépendants du système informatique : l’assurance maladie pourra ainsi utiliser notre logiciel d’assistant virtuel mais une intégration dans son système informatique aurait en revanche retardé notre projet. L’essentiel, en effet, est de pouvoir extraire des données et d’avancer assez rapidement. Le fait de généraliser une expérience locale ne doit pas impliquer une centralisation qui paralyserait l’action. S’affranchir de certaines contraintes organisationnelles, de ce point de vue-là, permet d’aller plus vite. Un directeur de réseau peut contribuer à faire avancer considérablement la situation.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie.
Jean Mallot et moi-même adresserons une lettre ouverte au procureur de Versailles afin qu’il nous tienne informés, comme nous avons le droit de l’exiger, de l’évolution du dossier judiciaire concernant le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, pour lequel il a été saisi non seulement d’une plainte dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale mais aussi d’une plainte contre X avec constitution de partie civile par un ancien directeur général du centre. Nous n’avons pu que constater une certaine inertie un peu similaire à celle que vous avez soulignée, monsieur Stéphane Lévêque. Quasiment aucune audition n’a été réalisée dans le cadre de cette action judiciaire et, alors que ce dossier aurait dû être réactualisé à partir du mois de septembre, nous ne disposons toujours pas d’informations. Dès lors, cette démarche paraît s’imposer.
*
Audition de Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Avec la création, puis l’installation des agences régionales de santé, nous avons connu une réforme importante, mais qui pose un problème de pilotage. Certains ont même souhaité la mise en place d’une agence nationale. Par ailleurs, le ministère chargé de la santé comporte plusieurs directions qu’il n’est pas toujours aisé de coordonner. Vous devez donc probablement exercer une fonction diplomatique de conciliation.
Interviennent, en outre, plusieurs organismes, dont la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés qui possède son propre programme de prévention et définit ses propres priorités. L’élabore-t-elle seule ou en concertation ? Avez-vous été associée par exemple à la décision, dont on peut craindre qu’elle n’ait des conséquences dommageables à long terme, de retirer l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée ?
Comment les indicateurs de performance figurant dans la nouvelle convention médicale seront-ils suivis ?
Des commissions de coordination se mettent en place au niveau régional. Comment peut-on en améliorer le fonctionnement, sachant que des responsables d’agences régionales de santé nous ont indiqué que leurs membres s’impliquaient de façon inégale ? D’autre part, comment mieux associer à la politique de prévention les représentants de la santé scolaire et de la santé au travail ?
Les agences régionales de santé sont-elles suffisamment autonomes pour définir leurs priorités et pour se procurer les financements correspondants ? Le fonds d’intervention régional devrait, certes, constituer un progrès à cet égard, mais comment son action s’articulera-t-elle avec celle des fonds de prévention des régimes d’assurance maladie et des divers fonds d’État ?
Les agences régionales de santé peuvent-elles servir d’observatoires pour la définition des indicateurs de santé ?
Enfin, que pensez-vous du rôle de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et de celui de la fédération des comités régionaux d’éducation pour la santé, les comités régionaux d’éducation pour la santé ? Comment améliorer encore leur fonctionnement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. Mon rôle consiste à piloter les agences régionales de santé au niveau national. Ma fonction ne me permet pas d’exercer une autorité sur les directions du ministère chargé de la santé mais seulement sur leurs « fonctions support » : je suis donc responsable des moyens des agences régionales de santé et je joue un rôle d’animation et de coordination des « directions métier » du ministère.
Ma fonction exige en effet des qualités de diplomate puisqu’elle consiste à essayer d’amener les différentes directions à travailler ensemble et de façon convergente, notamment en ce qui concerne les consignes qu’elles donnent aux agences régionales de santé. De ce fait, je ne suis pas compétente pour vous parler des affections de longue durée, sujet qui relève de la concertation entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la direction de la sécurité sociale.
Au niveau national, nous nous efforçons de donner aux agences de grandes orientations et de leur fournir des outils méthodologiques afin qu’elles travaillent en fonction d’objectifs et, après évaluation, des résultats obtenus. Les agences régionales de santé se sont engagées sur une trentaine d’indicateurs globaux, dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés avec les ministres compétents. Un petit nombre de ces indicateurs sont des indicateurs de moyens mais il s’agit, pour l’essentiel, d’indicateurs de politique publique, dont quelques-uns de santé publique et de prévention, tels que le taux de réalisation des dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal ou le taux de vaccination des enfants de vingt-quatre mois contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Je noterai aussi la présence de quelques indicateurs ambitieux, comme la trajectoire de réduction de la mortalité évitable.
L’ensemble de ces indicateurs a été établi à partir d’une cible nationale. Par exemple, pour la participation des femmes de cinquante à soixante-quatorze ans au dépistage du cancer du sein, l’objectif consiste à passer d’une valeur – nationale – initiale de 52 % de la population féminine à une valeur cible de 65 % en 2013. Sur cette base, la cible a été déclinée par les agences régionales de santé car la moyenne nationale recouvre des disparités régionales, pouvant aller de 25 % à 60 %. On demande donc aux régions en retard d’atteindre au moins la moyenne nationale et aux régions en avance de poursuivre encore leur effort en vue de dépasser l’objectif moyen fixé pour 2013.
Les indicateurs ayant été validés et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés, nous sommes maintenant entrés dans la phase d’évaluation selon un cycle de discussions qui débute le 15 novembre avec l’agence régionale de santé de Guadeloupe et qui s’achèvera fin janvier 2012, afin d’établir un bilan annuel des trajectoires de l’ensemble des agences, pour chaque sujet et pour chaque indicateur.
Outre ceux que j’ai déjà mentionnés, les indicateurs de santé publique portent sur la mortalité prématurée évitable, sur les décès par suicide, sur la prévalence de l’obésité chez les enfants, sur la qualité de l’eau, sur le nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire au titre des procédures d’insalubrité et sur les contrats locaux de santé publique.
Existent par ailleurs des indicateurs d’offre, tels que l’égalité d’accès aux soins sur la totalité du territoire, intégrant l’évolution de la densité médicale et le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires, ou encore le retour à l’équilibre financier des établissements hospitaliers.
Sur cette base, il revient aux agences régionales de santé de « prendre la main » : à elles de trouver les moyens d’avancer dans les directions indiquées. Pour cela, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires leur enjoint d’élaborer un schéma régional de prévention et un plan régional stratégique de santé comprenant une partie purement stratégique et des schémas opérationnels, dont, pour la première fois, un schéma de prévention. Car la prévention n’est pas un élément subsidiaire par rapport à l’organisation de l’offre, mais une dimension à part entière de la politique de santé publique. C’est pourquoi, alors que les agences régionales de l’hospitalisation se contentaient d’élaborer des schémas régionaux d’organisation de l’offre de soins et que la prévention relevait surtout des groupements régionaux de santé publique, les agences régionales de santé qui leur ont succédé disposent désormais d’une vision unifiée et élaborent des schémas de prévention sur la totalité des champs de la santé, ambulatoire, hospitalier et médico-social. Elles réalisent aussi, comme auparavant, des schémas d’organisation des soins comportant un volet ambulatoire ainsi que des schémas de l’offre médico-sociale.
Il y a environ un an, avec le concours des autres directions du ministère, la direction générale de la santé a confectionné un guide de méthodologie pour l’élaboration des schémas de prévention. Une bonne moitié des agences régionales de santé ont déjà produit un tel schéma, les autres devraient terminer le leur d’ici à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, en fonction de l’état d’avancement des consultations. Car les agences produisent le document en concertation, aussi bien avec la commission régionale de la santé et de l’autonomie qu’avec les collectivités territoriales, qui mènent de leur côté des actions de prévention.
Une question récurrente nous est posée : les agences régionales de santé produisent-elles autre chose que du papier ? Il est vrai que la loi du 21 juillet 2009 précitée a prévu beaucoup de documents, notamment à travers ce grand plan régional, de nature à structurer l’activité de l’agence régionale de santé mais assez lourd à concevoir et à formuler. Toutefois, en même temps qu’elles édifient leur cathédrale de papier, les agences nous fournissent aussi des exemples d’actions concrètes : en Bourgogne, un programme, dénommé « Peace and lobe », de sensibilisation aux risques sonores auxquels s’exposent les jeunes dans les boîtes de nuit ; en Île-de-France, où la prévalence de cette maladie est assez élevée, un programme contre la tuberculose, à la fois de soins et d’information vis-à-vis des populations les plus fragiles, mobilisant des équipes mobiles qui réalisent des radios des poumons et vérifient la vaccination des enfants ; dans les Pays de la Loire, un programme relatif à la pollinisation et à la recherche des facteurs d’allergies, comportant la culture d’un jardin expérimental permettant de mesurer la vitesse de propagation des allergies au pollen, afin de sensibiliser les professionnels de santé au problème.
Jusqu’ici, la question de l’articulation entre les plans régionaux et les plans nationaux de santé publique ne se posait pas. Les plans nationaux existants ont été largement repris dans les projets régionaux et on retrouve ici et là les mêmes priorités, d’autant qu’il existe aussi un cadrage national de la politique de santé fait par la direction générale de la santé qui met l’accent sur la mortalité évitable, notamment périnatale, sur le suivi des maladies chroniques, sur l’accompagnement du vieillissement et de ses pathologies… La difficulté risque d’apparaître maintenant : une fois que chaque agence régionale de santé aura arrêté son plan régional, comment élaborer de nouveaux plans nationaux articulés avec ce que les régions auront déjà mis en place ? Il devrait s’agir de cadrages nationaux déclinables régionalement ou laissant, pour leur mise en œuvre, une marge importante de souplesse aux agences régionales de santé. Telle est bien la question qu’on se pose aujourd’hui à la direction générale de la santé. Par chance, son nouveau directeur général, M. Jean-Yves Grall, était encore il y a six mois directeur général d’une agence régionale de santé. C’est pourquoi nous essayerons, dans le cadre du prochain plan de santé publique consacré à la santé mentale, de trouver la meilleure déclinaison opérationnelle possible entre le niveau national, dont la valeur ajoutée réside principalement dans la sensibilisation des acteurs nationaux, dans un diagnostic national et dans des préconisations issues de la recherche, et le niveau régional, où chaque agence régionale de santé doit pouvoir intégrer les nouveaux plans au fur et à mesure de leur élaboration. En effet, je ne vois pas comment on pourrait cesser d’élaborer des plans de santé publique pendant quatre ans, le temps que se termine la première phase de contractualisation avec les agences. C’est pourquoi, les procédures engagées continuant de se dérouler en flux, nous réfléchissons actuellement à la meilleure façon d’assurer la cohérence entre les deux niveaux territoriaux.
La dernière convention médicale conclue par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés converge plutôt avec les objectifs figurant dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des agences régionales de santé. Sans avoir été négociés avec cette préoccupation – l’autonomie de l’assurance maladie l’excluait –, il se trouve que les indicateurs figurant dans la partie de la convention médicale relative au paiement à la performance se révèlent assez proches de ceux qui ont été donnés aux agences régionales de santé, hormis ceux qui ont trait à la prescription et qui, de toute façon, ne les concernent pas comme la vaccination et le dépistage des cancers… Je ne crois donc pas que nous éprouvions de grandes difficultés à articuler les objectifs assignés aux agences pour sensibiliser les professionnels de santé, d’un côté, et le paiement à la performance, de l’autre.
Les programmes de prévention de l’assurance maladie font l’objet d’un accord-cadre avec l’État prévoyant non seulement la gestion du risque à la fois par l’assurance maladie et par les agences régionales de santé, mais visant aussi certains programmes de prévention, tels que celui portant sur le dépistage de certaines maladies et le programme « M’T dents », issu de l’assurance maladie et décliné localement. L’étape suivante consisterait à ouvrir une discussion avec l’assurance maladie sur des programmes de prévention demandés par les agences régionales de santé et relayés par elle. On peut, à cet égard, prendre l’exemple de la rougeole, sujet actuel de préoccupation puisque la prévalence de cette maladie a beaucoup augmenté, occasionnant le décès d’adultes. Cela résulte de la montée, au cours de la période précédente, des incertitudes relatives à la vaccination, dont le taux a fortement diminué. L’agence régionale de santé d’Île-de-France a donc lancé l’idée d’un programme de prévention de la rougeole nécessitant un appui de l’assurance maladie et consistant à favoriser un rattrapage de la vaccination de la classe d’âge la plus déficiente, celle des seize-trente ans. Dans ce cadre, des visites de vaccination pourraient être prises en charge à 100 %, par dérogation aux règles de droit commun du régime général, comme cela se pratique déjà pour le programme « M’T dents ». Lors de discussions au sein du Conseil national de pilotage, l’assurance maladie s’est montrée ouverte à cette idée et un groupe de travail a été constitué, en vue d’une concertation qui s’étalera sur plusieurs mois.
Après un an et demi d’existence – deux ans si on compte la phase de préfiguration –, les agences régionales de santé sont aujourd’hui en fin de phase de montage. Elles se sont d’abord occupées de leur organisation propre, avant d’installer toutes les commissions de partenariat, ce qui n’était pas une entreprise aisée. Les tensions que vivent aujourd’hui les services de l’État ne favorisent guère une coordination locale consistant à demander à chaque institution administrative de se mettre en cohérence avec la conduite d’une politique publique. La meilleure façon d’aborder la question consiste donc à identifier quelques points sur lesquels une action concrète est rapidement possible, puis à constater que, comme toujours, c’est en marchant qu’on apprend à marcher.
Les commissions de coordination au niveau local étant maintenant en place et les priorités dans le domaine de la prévention ayant été définies puis soumises à la concertation, les différentes administrations publiques devraient s’impliquer plus facilement.
Une fois que les systèmes d’information régionaux auront été intégrés aux agences régionales de santé, toutes les actions de prévention menées par des réseaux régionaux, comme par exemple la notification des infections nosocomiales, devraient également converger vers elles, ce qui fera de chacune un acteur central détenant le plus grand nombre possible de leviers.
Or, une telle politique nécessite des moyens, quand les crédits de la prévention, comme tous les crédits d’intervention de l’État, sont plutôt orientés à la baisse : ainsi du programme budgétaire 204 relatif à la prévention, la sécurité sanitaire et l’offre de soins, du fonds national de prévention et d’éducation en information sanitaire, ainsi que du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins qui fait déjà l’objet d’un gel de crédits afin que soit respecté l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. Dans ces conditions, accroître la fongibilité des crédits augmente la capacité de les réorienter. Cette fongibilité doit demeurer asymétrique afin de préserver les crédits de prévention, ce que demandent fortement les agences régionales de santé afin d’avancer sur les sujets qu’elles ont jugés prioritaires pour leur région.
M. le rapporteur. Dans son rapport, la Cour des comptes estime que la politique de prévention manque d’un pilotage national. Or vous êtes en charge de celui des agences régionales de santé et celles-ci sont devenues les responsables uniques de la santé au niveau régional. Vous êtes donc le chef d’orchestre ! Cependant, la santé scolaire, comme la protection maternelle et infantile et la médecine du travail, manquent de personnels, de moyens – et de coordination.
Que pensez-vous du rôle du Haut Conseil de la santé publique ? En d’autres termes, qui doit définir la politique de santé dans notre pays, notamment la politique de prévention ? Qui doit être chargé de sa coordination ?
Mme Emmanuelle Wargon. Lors d’une précédente audition devant votre mission, M. Antoine Durrleman a distingué deux niveaux dans la politique de prévention : celui de l’élaboration des politiques publiques et celui, auquel je me situe, de fonctionnement « mécanique » du système. Dans la configuration actuelle, c’est, non au secrétariat général, mais à la direction générale de la santé qu’il revient, en sus de gérer les crises sanitaires, de définir la politique nationale de santé. La politique de prévention constitue un élément important de celle-ci. La Cour des comptes suggère de créer une fonction de délégué interministériel. Ce pourrait être une manière d’affirmer la position de la direction générale de la santé afin de promouvoir une politique de santé dépassant l’action des différentes directions du ministère de la santé et entraînant celle d’autres directions centrales, telles que la direction générale du travail ou la direction générale de l’enseignement scolaire.
Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a pour mission de permettre aux agences régionales de santé de décliner les politiques nationales de santé et de trouver, à l’intérieur de cette déclinaison, les marges de manœuvre nécessaires pour répondre aux besoins régionaux…
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous comprenons bien mais, lors de la précédente audition, nous avons entendu le président de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines nous expliquer qu’il n’avait aucun interlocuteur à l’agence régionale de santé d’Île-de-France. Aucune relation ne s’est établie entre les deux organismes, ce qui est, pour nous, un peu difficile à accepter, même si nous admettons qu’au cours des dix-huit derniers mois, les agences se soient surtout occupées de leur propre installation et de leurs méthodes internes de travail. N’y a-t-il pas là une contradiction flagrante avec votre propos ? Il est bien sûr possible que certaines agences régionales de santé se soient montrées plus rapidement opérationnelles que d’autres mais il faudrait que l’attitude des meilleures devienne la règle commune, notamment la règle pour cette agence régionale qui couvre 12 millions d’habitants…
Mme Emmanuelle Wargon. L’agence régionale de santé d’Île-de-France entretient des relations avec l’assurance maladie en Île-de-France. Mais, conformément au souhait de cette dernière, elles passent par un coordonnateur de gestion du risque, qui est le correspondant de l’agence régionale de santé et aussi le directeur de la caisse primaire de Seine-Saint-Denis. Les niveaux régionaux de l’assurance maladie, les unions régionales des caisses d’assurance maladie, ont été absorbés par les agences et la coordination des caisses primaires se fait par l’interlocuteur de référence de l’agence régionale de santé.
Il est donc anormal que le président de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’ait aucune relation avec l’agence régionale de santé d’Île-de-France et cela me paraît d’autant plus curieux que l’agence, comme toutes les autres, conduit un programme de gestion du risque comportant dix priorités définies nationalement et déclinées localement. Un bilan régulier en est dressé, un Conseil national de pilotage se tient demain à ce sujet, l’agence régionale de santé Île-de-France est membre du comité national de suivi de la gestion du risque. Et j’ai plutôt l’impression que ce programme se déroule dans de bonnes conditions.
M. le coprésident Pierre Morange. Le président de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a également fait état d’un certain manque de suivi de plusieurs procédures judiciaires, particulièrement en matière de transports sanitaires pour laquelle l’articulation avec l’agence régionale de santé serait vraiment nécessaire.
Mme Emmanuelle Wargon. Cela traduit soit un problème d’organisation, soit un problème de personne, soit les deux. Je vais étudier la question. Mais la gestion du risque me semble donner lieu à des relations régulières entre les caisses primaires et l’agence régionale de santé.
Je reconnais que les relations sont moins soutenues en matière de prévention, même si elles existent pour l’organisation des dépistages, certains s’effectuant dans les centres d’examens de santé dédiés de l’assurance maladie. Il nous revient donc de construire une politique commune de prévention entre l’assurance maladie et les agences régionales de santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Le président de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, M. Frédéric Van Roekeghem, a décidé de généraliser un programme intitulé « Santé active », expérimenté dans la Sarthe. Avez-vous eu connaissance de cette initiative, dans le cadre de la coordination entre l’assurance maladie et les agences régionales de santé ?
Mme Emmanuelle Wargon. L’assurance maladie ne nous a pas encore présenté ce programme mais il devrait l’être en Conseil national de pilotage afin qu’on puisse l’intégrer dans l’évolution des programmes de prévention du ministère.
Fragile et récente, la coordination nationale n’est pas encore parfaite. Mais je constate que les questions que nous traitons font l’objet d’une véritable coordination et aboutissent à des procédures cohérentes entre les directions participantes. Le travail est parfois long et laborieux, mais il avance. La difficulté réside dans les sujets que nous ne traitons pas. Il faut donc inclure dans le champ de la coordination nationale la totalité de ce qui doit en relever. Les programmes de l’assurance maladie doivent pouvoir être discutés, au niveau national, entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et les directions du ministère, non pour empiéter sur l’autonomie de l’assurance maladie mais pour que ses programmes entrent en résonance avec les actions de l’État, ce qui peut favoriser des complémentarités ou éviter des doublons.
M. le rapporteur. La prévention constitue un parfait exemple de la nécessité de mieux coordonner les politiques nationales dans lesquelles interviennent de nombreux acteurs, non seulement la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui entend préserver son autonomie de décision, mais aussi les autres caisses d’assurances maladie, comme la Mutualité sociale agricole qui a ses propres programmes, les caisses complémentaires, leur union nationale ainsi que les associations de terrain, regroupées dans des fédérations nationales. Leurs relations ne sont pas toujours très simples, de même qu’avec les ministères en charge, par exemple, de l’éducation nationale et du travail.
Cette coordination n’est pas aisée a priori : on se souvient des réticences de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés à la création des agences régionales de santé. J’avais, à cette époque, demandé s’il ne serait pas utile de disposer d’une agence nationale de coordination des agences et de nommer à sa tête le président de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés…
Mme Emmanuelle Wargon. Nous ne vivons pas dans un système où une autorité administrative peut s’imposer à toutes les autres dans le champ des politiques publiques. Je constate cependant que, lorsqu’on parvient à attirer un sujet dans le champ de la coordination, on finit, sur le long terme, par le traiter convenablement : ainsi de l’articulation entre le zonage conventionnel et celui des agences régionales de santé, ou de la permanence des soins ambulatoires pour laquelle nous avons réussi à articuler l’action de l’assurance maladie et celle des directions du ministère chargé de la santé.
Il faut donc que, au-delà de ce que nous mettons à l’ordre du jour de la coordination, les directions du ministère et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés acquièrent, chacune de leur côté, les réflexes qui leur permettront de travailler en commun.
Je le répète, la force de coordination est récente et fragile mais elle va dans le bon sens. À quelle vitesse avance-t-elle en vue d’intégrer la plus grande partie des thèmes de santé publique ? Il serait probablement utile de préparer une nouvelle loi de santé publique, la dernière remontant à août 2004 et ayant formellement expiré en 2009. Cela permettrait de réunir tous les partenaires autour de la table et de mettre en cohérence les grands objectifs de santé publique, dont les politiques de prévention. En attendant, nous pourrions inscrire ce thème à l’ordre du jour d’un prochain Conseil national de pilotage et passer en revue toutes les actions possibles.
Nous passons progressivement d’un système dans lequel chaque direction défendait farouchement son autonomie à un autre dans lequel nous devons apprendre à travailler ensemble : cela prend nécessairement du temps.
M. le rapporteur. Il est parfois difficile de distinguer la prévention telle que la pratique un médecin de premier recours et les actions de prévention stricto sensu.
Qui définit les sous-objectifs fixés dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ? Votre secrétariat général suit-il l’utilisation des moyens financiers attribués aux agences régionales de santé ? Comment peut-on aller vers davantage de fongibilité ?
Mme Emmanuelle Wargon. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie et la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale relèvent de la direction de la sécurité sociale, au titre du cadrage national, et de la direction générale de l’offre de soins pour sa partie hospitalière. Cette dernière alloue les crédits des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation tout en assurant le montage de la campagne budgétaire hospitalière.
La fongibilité constitue un instrument d’avenir. Aujourd’hui, une partie des crédits sert à payer des actes, que ce soit à l’hôpital à travers la tarification à l’activité (T2A) ou en médecine de ville par le financement des actes à travers les conventions médicales. À l’avenir, les autres crédits devraient progressivement devenir aussi fongibles que possible et relever des agences régionales de santé avec le moins de « fléchage » préalable possible. Il reviendrait alors aux régions, bénéficiant de délégations de crédits indifférenciés, de les répartir en fonction des priorités définies dans les projets régionaux de santé.
On ne sait pas exactement où commence et où s’arrête la prévention. Les actions correspondantes vont du dépistage précoce des maladies aux visites médicales et aux programmes d’éducation thérapeutique. Les agences régionales de santé ont la responsabilité de répartir les moyens financiers en fonction des besoins tels qu’elles les évaluent. À cet égard, le remplacement de neuf acteurs, durant la période précédente, par un seul, pour mobiliser tous les financements constitue un indéniable progrès.
M. le rapporteur. Comment parvenez-vous à coordonner les agences régionales de santé alors que vous n’attribuez pas leurs financements ? Qui contrôle la part de chaque sous-objectif ?
Mme Emmanuelle Wargon. Il en va différemment pour la médecine de ville et pour l’hôpital.
Dans le premier cas, les crédits ne passent pas par les agences régionales de santé, hormis ceux du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination mais dont le comité de gestion se situe en dehors de la sphère des agences régionales de santé car il est copiloté par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et par la direction générale de l’offre de soins. Mais l’année prochaine, si l’article du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatif au fonds régional d’intervention est adopté, celui-ci intégrera la part régionale et sera divisé en 26 tranches par le comité national de pilotage. Il sera ainsi supervisé par le secrétariat général.
Dans le deuxième cas, les grandes masses concernant les tarifs et les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sont déterminées par la direction générale de l’offre de soins en comité de pilotage de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sous le contrôle du ministre, à qui appartient la décision. Le secrétariat général, comme les directions, n’est que partie prenante de la discussion visant à trouver le bon équilibre en la matière.
Il existe plusieurs manières de déléguer des crédits. Ainsi, pour le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, la délégation de crédits s’opérait par la direction générale de l’offre de soins sur chaque sous-ligne : une quinzaine de circulaires s’étalaient donc au cours de l’année pour indiquer le montant délégué à une action, sans aucune vision d’ensemble ni marge de manœuvre possible au niveau régional. Cette année, sous l’impulsion du secrétariat général, il n’y a eu qu’une seule circulaire pour le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés. Elle délègue la totalité des crédits en même temps, récapitule leur ventilation dans un tableau annexe et indique aux agences régionales de santé qu’elles peuvent les répartir, soit selon ce tableau, soit de façon différente, en rendant alors compte de leur choix au secrétariat général. Nous demandons que les délégations soient les plus globales possible et qu’elles comportent des objectifs assortis d’indicateurs de résultats.
M. le rapporteur. Que pensez-vous donc des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, dont je suis un fervent partisan ?
Mme Emmanuelle Wargon. Si nous conservons le cap actuel, nous arriverons à cette formule. Le problème posé est celui des tarifs régionaux. Car un objectif régional des dépenses d’assurance maladie, supposant une masse de crédits finançant des actes, conduit à ce qu’on permette aux régions de moduler les prix en fonction de l’évolution du volume des actes, ce qui implique qu’il n’existe plus de tarifs nationaux, ni en ville, ni à l’hôpital. C’est en effet ainsi qu’on pilote l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, selon une connexion entre les prix et les volumes. Si l’enveloppe devient régionale, il faudra faire de même. Nous n’en sommes pas encore là : acceptera-t-on qu’une consultation médicale ou que la T2A soit facturée à un prix différent d’une région à une autre ?
Il faut bien distinguer, je le répète, ce qui est payé à l’acte des dotations hors actes. Si, déjà, nous parvenions, comme je l’ai dit à l’instant, à déléguer pleinement ce second volet aux agences régionales de santé, nous ne serions pas encore dans un objectif régional de dépenses d’assurance maladie stricto sensu mais la marge de manœuvre des agences en serait très sensiblement accrue.
M. le rapporteur. Nous nous orientons, d’une façon ou d’une autre, vers des aides différentes selon la densité des zones géographiques et donc vers des enveloppes financières qui ne seront plus tout à fait nationales. Pourquoi alors ne pas mettre les objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie rapidement en place ? Puisque nous avons connaissance du montant que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a délégué cette année, il suffirait de reprendre le montant constaté dans chacune des 26 régions et de lui affecter un certain pourcentage d’augmentation, commun à toutes. À chaque région alors de respecter son enveloppe. Une telle formule conduirait à responsabiliser chacun des acteurs.
M. le coprésident Jean Mallot. Le rapporteur a droit à un avis personnel… Mais a-t-il d’autres questions ?
M. le rapporteur. On ne m’a pas répondu sur le Haut Conseil de santé publique.
Mme Emmanuelle Wargon. Il s’agit d’un organisme consultatif placé auprès de la direction générale de la santé, qui peut être utile pour appeler l’attention sur la dimension interministérielle des politiques de santé, en particulier en matière de prévention. Il peut servir ainsi de tribune pour que les politiques publiques associent à l’objectif de santé pure des préoccupations plus larges, notamment éducatives et environnementales.
Le directeur général de la santé s’interroge sur le positionnement de cet organisme qui dépend de la direction générale de la santé, tout en ayant une certaine autonomie, situation qu’il conviendrait sans doute de clarifier.
M. le rapporteur. La Cour des comptes s’est demandé s’il était vraiment utile.
Mme Emmanuelle Wargon. Il existe deux organismes consultatifs, le Haut Conseil à la santé publique et la Conférence nationale de santé, qui vient d’être renouvelée. La répartition des compétences mériterait d’être précisée entre ces deux organismes. Le premier est plus technique, remplit davantage une fonction d’expertise : il faut le conserver à ce titre en mettant ses compétences à la disposition d’un plus grand nombre de ministères.
*
AUDITIONS DU 10 NOVEMBRE 2011
Audition de Mme Évelyne Guillet, directrice Santé du Centre technique des institutions de prévoyance, Mme Miriana Clerc, directrice Communication et relations extérieures, M. David Giovannuzzi, directeur des accords collectifs-pôle alimentaire d’AG2R La Mondiale, et M. Philippe Quique, directeur du développement services santé, et Mme Isabelle Hébert, directrice Stratégie et marketing, santé et prévoyance du Groupe Malakoff Médéric, de Mme Marika Lefebvre, responsable du pôle Prévention-promotion de la santé à la direction de la santé de la Fédération nationale de la mutualité française, Mme Isabelle Millet-Caurier, directrice des affaires publiques, M. Vincent Figureau, responsable du département des relations institutionnelles nationales, et Mme Annabel Dunbavand, conseiller médical à la direction déléguée à la santé, et de M. Alain Rouché, directeur Santé de la Fédération française des sociétés d’assurances et M. Jean-Paul Laborde, directeur Affaires parlementaires, M. Laurent Moreau, directeur médical de Groupama, et Mme Catherine Masclet, direction Santé prévoyance d’Allianz.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui des représentants des mutuelles, des assurances et des institutions de prévoyance, qui constituent les trois « familles » des complémentaires santé, dont le rôle, déjà très important dans notre protection sociale, est sans doute appelé à se renforcer.
Chacun s’accorde à reconnaître que la prévention est le parent pauvre de notre système de santé, tourné essentiellement vers le soin. Cela étant, le curatif n’exclut pas le préventif, et il est souvent difficile de faire la part exacte entre les deux.
Une communication de la Cour des comptes a relevé une absence de pilotage de la politique de prévention au niveau national. Chaque « famille » de complémentaires santé n’est-elle pas portée à définir sa propre politique en la matière ? Vous concertez-vous ? Avez-vous mis en place un pilotage commun ? Le rapport de la Cour a également montré que les 100 objectifs de santé énumérés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique n’étaient pas réellement pris en compte.
Travaillez-vous en coordination avec les agences régionales de santé ? Quelles relations entretenez-vous avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’assurance maladie, l’Éducation nationale et la médecine du travail ? Il paraît en effet difficile d’élaborer une politique de prévention sans liens avec la médecine du travail ou avec l’Éducation nationale. À cet égard, menez-vous des actions spécifiques en direction des jeunes ?
Mme Marika Lefebvre, responsable du pôle prévention-promotion de la santé à la direction de la santé de la Fédération nationale de la mutualité française. Nos actions de prévention en matière de santé sont conduites par les mutuelles, les unions régionales de la mutualité française, les services de soins et d’accompagnement mutualistes. L’ensemble de ces acteurs met en œuvre la stratégie définie au niveau de la fédération.
Les mutuelles financent pour partie les actions des unions régionales à travers le fonds national de prévention. Certaines financent également elles-mêmes des actions de prévention destinées à leurs adhérents ou au grand public. Et, bien entendu, elles intègrent des prestations de prévention dans leurs garanties.
Les 25 unions régionales ont une activité de prévention et de promotion de la santé, structurée de très longue date à travers des services spécialisés qui conçoivent et conduisent des actions en direction du grand public, mutualiste ou non.
Tout cela se fait en partenariat avec le secteur sanitaire et médico-social, les collectivités locales, l’Éducation nationale et le milieu associatif. Bien qu’elles déclinent des priorités nationales élaborées par la Mutualité française, les actions n’en prennent pas moins en compte les spécificités sanitaires et sociales régionales.
L’objectif de la Mutualité française en matière de prévention est de réduire les risques pour la santé et d’améliorer la qualité de vie de tous dans une logique de santé publique.
Notre action s’organise autour de quatre axes stratégiques : favoriser l’égal accès de tous à la prévention et à des soins de qualité ; réduire les inégalités sociales de santé ; renforcer la capacité de chacun à agir individuellement pour le bien de sa santé ; garantir par des actions collectives le droit des personnes et des populations à la protection de leur santé. Ces axes se déclinent autour de priorités thématiques comme la prévention des maladies chroniques, de la perte d’autonomie, ou bien encore des actions dans le domaine de la petite enfance et de la jeunesse.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous nous donner quelques éléments chiffrés, tant sur les montants dépensés que sur les publics bénéficiaires ? Pourriez-vous également nous dire comment s’articule votre action avec celle des agences régionales de santé, de l’assurance maladie et de la direction générale de la santé ? En effet, chacun le sait, qui trop embrasse mal étreint, et tel a malheureusement été le cas de la loi relative à la politique de santé publique, dont la dispersion des objectifs a fait perdre en efficacité et n’a pas permis les résultats escomptés.
Mme Marika Lefebvre. Le fonds national de prévention, alimenté par l’ensemble des mutuelles de la Fédération nationale de la mutualité française, alloue 4,4 millions d’euros par an aux unions régionales en se fondant sur plusieurs critères, dont la prise en compte des priorités nationales. Aux appels à projets annuels se sont substituées des conventions triennales d’objectifs et de moyens, dont la première portera sur la période 2012-2014 pour un montant total resté inchangé. Les partenariats noués au niveau local avec les agences régionales de santé, les collectivités et les associations permettent, par un effet de levier, de démultiplier l’effort. Avec ces 4,4 millions d’euros, ce sont au final 12 millions d’euros d’actions qui peuvent être initiées.
Le nombre de bénéficiaires varie en fonction des régions, de la politique de communication et des partenaires de chaque union régionale, mais les actions de prévention de la Mutualité française étant ouvertes à tous, il est en tout état de cause élevé.
S’agissant de la prévention des maladies chroniques, il convient de réduire l’exposition aux facteurs de risque communs à ces maladies, qu’ils soient indépendants du comportement individuel, comme l’environnement chimique, physique ou biologique, ou qu’ils soient liés aux conditions de travail ou au mode de vie. Sur ce dernier point, nous incitons les assurés à avoir une alimentation saine, à pratiquer une activité physique régulière et à limiter la consommation de tabac et d’alcool. La Mutualité française propose également un programme d’accompagnement et d’éducation thérapeutiques à l’intention des personnes atteintes de maladies chroniques, les aidant à mieux se prendre en charge afin d’éviter des complications ultérieures.
Mme Annabel Dunbavand, conseiller médical à la direction déléguée à la santé de la Fédération nationale de la mutualité française. En partenariat avec l’assurance maladie et les agences régionales de santé, la Mutualité française a, dans deux régions, lancé un programme expérimental d’éducation thérapeutique sur l’hypertension artérielle, « Tensioforme ». L’expérimentation sera évaluée avant d’être éventuellement généralisée.
Mme Isabelle Millet-Caurier, directrice des affaires publiques de la Fédération nationale de la mutualité française. Le mouvement mutualiste possède une culture ancienne de la prévention. On constate aujourd’hui une nette convergence entre les quatre axes stratégiques de la Mutualité française qui viennent d’être rappelés et ceux retenus par les agences régionales de santé dans leurs schémas de prévention. La Mutualité française souhaite être un partenaire de l’action des pouvoirs publics au niveau régional et il existe un fort besoin de coordination avec les agences régionales de santé. Certaines, comme celle des Pays de la Loire, ont permis à la Mutualité française de participer à la commission de coordination des politiques publiques chargées de la prévention, ce qui traduit une meilleure coordination des acteurs de terrain.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous présenter vos actions de prévention dans les contrats collectifs que vous proposez, et notamment celles relatives à la santé au travail ? Vous avez évoqué des partenariats avec les associations, mais comment cela se passe-t-il concrètement sur le terrain ? Quel type d’accords avez-vous avec l’assurance maladie ? La Mutualité française est-elle par exemple associée au programme Sophia de l’assurance maladie pour les patients diabétiques ?
Mme Annabel Dunbavand. Nous travaillons bien sûr en partenariat avec l’assurance maladie. Le programme Tensioforme est cofinancé par nos mutuelles, l’assurance maladie et les agences régionales de santé. Mais le partenariat n’est pas seulement financier : les agences régionales de santé participent au conseil scientifique du programme, à la mise au point duquel a également contribué l’assurance maladie. Celle-ci le finance à 65 %, les 35 % restants étant supportés par les mutuelles.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels montants cela représente-t-il et combien y a-t-il de participants dans les deux régions ?
Mme Annabel Dunbavand. Ce programme Tensioforme, dont les participants sont pris en charge pour une durée d’un an, coûte 360 euros par an et par personne. L’assurance maladie y contribue à hauteur de 250 euros pour l’éducation thérapeutique, les mutuelles à hauteur de 110 euros, notamment pour inciter à réduire les facteurs de risque. Nous visons à terme une cohorte de 2 000 participants. La première phase de recrutement est terminée : 550 personnes ont d’ores et déjà commencé le programme, qui se déroule dans des centres de santé, en partenariat avec des fédérations sportives comme la Fédération française de randonnée pédestre et des associations sportives telles que le Paris université club.
M. le coprésident Pierre Morange. La cohorte est-elle constituée de façon aléatoire ou sur la base du volontariat, auquel cas les participants appartiennent déjà à une population motivée, ne reflétant pas exactement, de par sa composition sociologique et ses caractéristiques médicales, la population française générale ?
Mme Annabel Dunbavand. Les personnes sont volontaires. Les sept mutuelles partenaires de l’expérimentation, qui a lieu à Paris et Saint-Étienne, ont, dans les deux régions concernées, adressé un courrier à leurs adhérents masculins de plus de quarante-cinq ans et à leurs adhérents féminins de plus de cinquante ans. Ce courrier, outre la présentation du programme, contenait un questionnaire permettant à chacun d’évaluer ses risques. Les intéressés étaient invités à appeler notre plateforme « Priorité santé mutualiste » pour avoir un entretien téléphonique avec un médecin, afin d’affiner leur profil de risques.
Mais il est extrêmement difficile de réduire les inégalités en matière de santé. Alors que ces programmes de prévention – l’évaluation médico-économique du programme Sophia l’a encore démontré récemment – s’adressent en théorie à toute la population, ce sont en réalité les personnes les mieux informées, les plus éduquées et qui bénéficient déjà le plus de prévention, qui y accèdent. C’est une véritable difficulté, comme vous l’avez souligné. Ainsi, ce sont en majorité des cadres qui participent à Tensioforme et on n’y dénombre que 11 % d’ouvriers et d’employés bien que notre population initiale qui est constituée à 60 % d’adhérents de la Mutuelle générale de l’éducation nationale, composée pour l’essentiel des cadres, introduit de facto un biais. Avant de généraliser l’expérimentation, nous nous sommes demandés si une action spécifique de sensibilisation ne devrait pas être conduite en direction des ouvriers et employés.
M. le rapporteur. Vos contrats collectifs comportent-ils un volet prévention ? Quelles relations entretenez-vous avec la médecine du travail ?
Mme Marika Lefebvre. La santé au travail fait partie des priorités de la Mutualité française. Chaque mutuelle décline comme elle le souhaite ce volet d’action.
M. le rapporteur. Quelles sont vos relations avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ?
Mme Marika Lefebvre. Nous avons des échanges réguliers et menons des actions en partenariat au niveau national. Il existe aussi des liens très forts au niveau local, les unions régionales entretenant elles-mêmes des relations avec les représentations locales de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Mme Isabelle Millet-Caurier. Nous pouvons citer le travail commun mené par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et la Fédération nationale de la mutualité française sur le thème de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, qui intègre un volet prévention. Après une audition publique à la Haute Autorité de santé, des travaux ont été menés sous l’égide du Conseil national consultatif des personnes handicapées, où la Mutualité française a animé un groupe de travail. Nous avons travaillé avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sur le sujet de la prévention bucco-dentaire des personnes en situation de handicap.
Mme Annabel Dunbavand. La Mutualité française siège au conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Elle donne son avis sur les campagnes nationales de l’institut et les décline dans les unions régionales, où travaillent les cent quarante personnes de l’ensemble du réseau prévention.
M. le rapporteur. Nous allons maintenant entendre les représentants des assureurs.
M. Alain Rouché, directeur Santé de la Fédération française des sociétés d’assurances. La prévention est au cœur du métier de l’assurance. Les assureurs font de la prévention dans des domaines aussi divers que l’automobile, le vol ou l’incendie. L’assurance santé présente des particularités : en raison, tout d’abord, du poids de l’assurance maladie obligatoire ; ensuite, parce que la durée moyenne des contrats n’est que de sept ans, alors que la prévention exige une approche de long terme ; enfin et surtout, parce que les sociétés d’assurances ignorent les affections dont souffrent leurs assurés.
La Fédération française des sociétés d’assurances fait de la prévention, mais ce sont surtout les grandes sociétés d’assurances qui s’en chargent. Toutes, développent des programmes de prévention.
Il y a tout d’abord des actions d’information et de sensibilisation sur les principaux facteurs de risque. À la Fédération française des sociétés d’assurances, l’association Assureurs prévention, qui regroupe désormais dans une même entité l’ensemble de l’activité prévention, diffuse de l’information par le biais de son site internet. Elle a également édité une trentaine de dépliants sur des sujets comme la lutte contre le tabagisme, les bienfaits de l’activité physique, la prévention de l’obésité, en particulier chez les enfants. Les sociétés d’assurances informent elles aussi largement.
M. le rapporteur. À qui s’adresse cette information ?
M. Alain Rouché. Ces dépliants visent un très large public. Ils sont diffusés dans les cabinets médicaux ainsi que dans certaines pharmacies. Le milieu scolaire nous en commande aussi très régulièrement. Nous les fournissons bien entendu gratuitement.
Le deuxième type d’action développé par les assureurs concerne les services et prestations de prévention inclus dans les contrats. Ainsi certaines assurances remboursent-elles la vaccination contre la grippe chez des personnes pour lesquelles l’assurance maladie ne la prend pas en charge. Certains contrats d’entreprise peuvent comporter des actions spécifiques de prévention des troubles musculo-squelettiques par exemple. Il y a quelques années, la Fédération française des sociétés d’assurances avait travaillé avec trois sociétés d’assurances à la prévention des risques cardiaques. Un accord avait été conclu avec des cardiologues pour proposer aux assurés qui le souhaitaient une consultation approfondie de prévention.
L’accompagnement des assurés dans la lutte contre les facteurs de risque est un autre type d’action. Les sociétés d’assurances le font essentiellement dans le domaine de la nutrition et de la lutte contre le tabagisme.
Il y a enfin l’accompagnement des personnes qui sont, hélas, déjà malades. Les sociétés d’assurances ont développé des services d’orientation de leurs assurés dans le système de soins. Et les « assisteurs », qui sont en général des filiales de ces sociétés, proposent des services comme la livraison de médicaments à domicile ou la fourniture de dispositifs d’alerte pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Pour ce qui est de la coordination, nous avons proposé il y a quelques mois à M. Frédéric Van Roekeghem, directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, divers projets, sur lesquels nous n’avons pas encore eu de réponse. Il n’existe donc pas encore à ce jour d’actions coordonnées avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, mais nous souhaitons en mener.
M. le rapporteur. Quelles propositions avez-vous faites ?
M. Alain Rouché. Nous avons proposé, dans le cadre des possibilités ouvertes par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, de suivre, par l’intermédiaire des pharmaciens, les patients placés sous anticoagulants à leur sortie de l’hôpital. Si la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ne donne pas suite, les sociétés d’assurances sont prêtes à le faire seules.
Nous pensons également proposer une consultation approfondie de prévention chez le médecin traitant pour les assurés à partir de cinquante-cinq ans, avec pour objectif de prévenir les affections les plus fréquentes pouvant survenir à cet âge.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels sont les montants financiers affectés à ces actions de prévention ? Combien de personnes en bénéficient ? Disposez-vous de premiers résultats d’évaluation des programmes que vous avez mis en œuvre ?
M. Alain Rouché. Je ne connais pas les sommes que les sociétés d’assurances consacrent à la prévention, beaucoup plus importantes que celles mobilisées au niveau de la Fédération française des sociétés d’assurances. Notre association Assureurs prévention dispose d’un budget annuel légèrement inférieur à 1 million d’euros. En direction du public, nous diffusons quelque 5 millions de dépliants chaque année.
M. le rapporteur. Par qui est assuré le programme d’accompagnement proposé aux assurés ?
M. Alain Rouché. Chaque société d’assurance a sa propre organisation. Je vous propose donc de laisser la parole à M. Laurent Moreau pour vous détailler ce que fait Groupama, en liaison avec la Mutualité sociale agricole.
M. Laurent Moreau, directeur médical de Groupama. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés dans la mise en œuvre des programmes de prévention. La première tient au recul indispensable à toute évaluation. Pour pouvoir évaluer les résultats de nos actions de prévention, il est nécessaire que les personnes restent assurées dans notre groupe sur une période assez longue. Or, la durée moyenne des contrats est relativement brève. La deuxième difficulté est liée au manque de coordination.
Notre action est triple. Il y a tout d’abord ce qui est contenu dans les contrats eux-mêmes : diverses actions, pas ou peu financées par l’assurance maladie, peuvent être prises en charge, le cas échéant, par l’assurance complémentaire.
Ensuite des messages spécifiques d’information et de prévention sont diffusés auprès des assurés, au travers de trois canaux. Le premier canal consiste en des lettres d’information santé envoyées régulièrement aux assurés – chez Groupama, ces lettres, diffusées à environ 500 000 exemplaires, comportent chacune des fiches de prévention rédigées par des professionnels de santé et qui s’inspirent très largement des priorités de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Ensuite, il existe un deuxième canal qui utilise les sites internet – celui de Groupama comporte une rubrique spécifique prévention, mais nous avons aussi ouvert il y a quelques mois un site spécifique « Vivons prévention », destiné à l’ensemble de la population, avec l’ambition qu’il devienne un site de référence. Enfin, le dernier canal réside dans les conférences santé, organisées sur l’ensemble du territoire, qui rassemblent chaque année plusieurs milliers de personnes et au cours desquelles est délivrée de l’information sur la nutrition, l’activité physique, la lutte contre le surpoids ou le tabagisme. Pour chaque conférence, un expert vient en région débattre de l’un de ces sujets, au plus près de la population.
Enfin, nous développons, en liaison avec la Mutualité sociale agricole le plus souvent, divers programmes expérimentaux de santé publique. Le premier, « Partenaires santé », a été lancé en 2000 dans le cadre des expérimentations « Soubie », fondées sur l’ancien article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, et se poursuit, ayant d’ailleurs été repris par l’assurance maladie dans certaines régions, notamment en Bretagne. Il réunit les professionnels de santé en groupes de pairs avec pour objectif de favoriser la qualité des soins. Nous travaillons avec les médecins à réduire certains facteurs de risques. Un programme a ainsi été lancé visant à limiter le nombre de médicaments prescrits chez les personnes âgées et abaisser la morbidité liée à la polymédication. Un autre a permis de diminuer de moitié les prescriptions de benzodiazépines de la part des médecins participants. Les résultats de ces expérimentations ont été publiés dans des revues médicales.
Un autre type de programme comportant d’importants volets prévention, intitulé « Pays de santé », mené là encore avec la Mutualité sociale agricole, vise à maintenir une offre de soins adaptée aux besoins de la population en milieu rural. En effet, les incitations financières et fiscales ne suffisent pas à lutter contre les déserts médicaux. La qualité de l’exercice professionnel est déterminante. Quand elle se dégrade par trop, les praticiens partent exercer en ville, dans un environnement plus favorable, ou du moins perçu comme tel. Nous avons donc mis en place dans certains territoires ruraux une infirmière de santé publique qui coordonne toute une série de services, destinés à faciliter la tâche des professionnels de santé, comme des patients.
En matière de prévention, il convient de mentionner notre action d’éducation thérapeutique classique, effectuée en liaison avec la Mutualité sociale agricole, en direction des patients diabétiques ou souffrant de maladies cardiovasculaires. Dans une perspective de prévention tertiaire, l’objectif est d’éviter l’aggravation des pathologies. Cela fonctionne parfaitement quand on travaille au plus près du terrain, avec les acteurs locaux. Coordonner l’action des médecins, des élus, des associations au niveau d’un canton permet de toucher davantage de gens que si l’on agit au niveau départemental et a fortiori régional. Pour la prévention de l’obésité, nous avons mis en place un programme semblable s’adressant à des patients en surpoids que les médecins orientent préventivement vers des diététiciennes afin d’éviter qu’ils ne deviennent obèses.
Il existe un autre type d’action de prévention, développée dans les Ardennes en partenariat avec le réseau de santé CARéDIAB − Champagne Ardenne Réseau DIABète−, qui y met à disposition un rétinographe mobile. L’examen du fond d’œil, réalisé sur place chez des patients diabétiques, est analysé à distance par un ophtalmologiste. L’enjeu de santé publique est important car, si ces patients n’effectuent pas régulièrement cet examen, ils risquent vraiment de perdre la vue. Or, dans les zones rurales notamment, outre la longueur du trajet pour pouvoir consulter un ophtalmologiste, il n’est pas rare, comme dans les Ardennes, de devoir attendre neuf ou douze mois pour obtenir un rendez-vous. Le déplacement de cet appareil sur le terrain, couplé à la télémédecine, permet de dépister précocement et de traiter à temps les rétinopathies spécifiques du diabète.
M. le rapporteur. Comment l’ophtalmologiste qui donne son avis est-il rémunéré ?
M. Laurent Moreau. Il l’est dans le cadre d’un contrat préalablement passé entre l’Union régionale des caisses d’assurance maladie à l’époque et CARéDIAB. Toute la difficulté réside dans le recrutement des patients. Il ne suffit pas de disposer de l’appareil ni de proposer l’examen pour que les patients s’y soumettent. Encore faut-il qu’ils soient bien informés et convaincus de l’intérêt de cette prévention, de même d’ailleurs que les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les associations telles qu’Aide à domicile en milieu rural. La mobilisation de tous est nécessaire pour inciter les patients qui n’iraient pas d’eux-mêmes chez un ophtalmologiste à se faire dépister ainsi. C’est dans ce cadre que notre intervention est importante. Toute la question est bien de savoir comment faire accéder aux soins de prévention les patients qui, tout en étant ceux qui en ont le plus besoin, sont en général ceux qui y ont le moins accès, quand bien même une offre existe.
M. le rapporteur. Il y a un foisonnement d’initiatives intéressantes à travers tout le pays. Mais comment généraliser les expériences quand elles sont concluantes ?
M. Laurent Moreau. Nous faisons évaluer de manière rigoureuse ces expérimentations par un évaluateur externe et diffusons l’ensemble des résultats. Pour cela, nous travaillons bien sûr avec les agences régionales de santé, qui sont étroitement associées aux projets. Celles-ci participent notamment aux comités d’organisation régionaux. Notre conseil scientifique comprend des représentants de la Haute Autorité de santé, du Conseil national de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, ce qui permet de faire connaître largement les résultats. Groupama ne peut bien entendu pas déployer ces expérimentations sur l’ensemble du territoire, mais peut en faire bénéficier d’autres, par exemple en matière d’ingénierie.
M. le rapporteur. Nous allons laisser la parole aux représentants des institutions de prévoyance, qui, je l’espère, nous parleront des contrats collectifs car, sur ce point, je dois avouer ne pas avoir eu les informations attendues.
Mme Évelyne Guillet, directrice santé du Centre technique des institutions de prévoyance. Les institutions de prévoyance, organismes à but non lucratif et à gouvernance paritaire, sont spécialisées dans la prévoyance et l’assurance complémentaire santé pour les entreprises. Leurs actions de prévention s’adressent donc en priorité aux salariés et à leurs familles. Organisées au plus près de la population couverte, elles sont menées au travers d’accords de branche ou de contrats d’entreprise.
Dans le cas où il existe un accord de branche, l’objectif premier est pour nous d’identifier, en liaison avec les partenaires sociaux, les spécificités de la profession en matière de santé. Deux cas se présentent : soit la branche possède déjà un organisme paritaire chargé de la prévention ; soit elle n’en bénéficie pas encore et l’organisme gestionnaire, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et assisté d’un comité d’experts, peut les aider à en élaborer le projet. Dans la branche du bâtiment et des travaux publics, il existe un organisme paritaire professionnel de prévention, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, en soutien des actions duquel intervient BTP Prévoyance.
Je laisse le soin à M. David Giovannuzzi de vous présenter l’accord de branche qui existe dans le secteur de la boulangerie.
M. David Giovannuzzi, directeur des accords collectifs-pôle alimentaire d’AG2R La Mondiale. Je suis, de par mes fonctions, chargé de suivre une vingtaine de professions du secteur alimentaire. Depuis plusieurs années, la tendance, qui n’est d’ailleurs pas propre au secteur, est à la conclusion d’accords de branche en santé. Je vous parlerai plus précisément de l’accord de la boulangerie artisanale, qui date de 2007 – c’est celui sur lequel on a le plus de recul – et qui couvre plus de 100 000 salariés.
Dans un contrat collectif classique d’entreprise, la société d’assurance est moins encline à s’engager en matière de prévention, dans la mesure où elle peut chaque année perdre son client à l’échéance du contrat. C’est un facteur économique essentiel à prendre en considération. Dans un accord de branche, c’est au contraire une vision à moyen et long terme qui peut prévaloir. Les partenaires sociaux ont un réel souci de réduire les risques dans un métier donné et d’élaborer des tableaux de bord pour suivre leur évolution dans la durée.
On compte quelque 33 000 boulangeries en France qui n’emploient pour la plupart qu’un ou deux salariés, même si, en région parisienne, on en trouve de beaucoup plus importantes. Au total, ce sont 100 000 salariés et 98 % des effectifs de la branche qui sont couverts par l’accord de branche du secteur, dont les règles, définies par les partenaires sociaux, sont très contraignantes.
Nous avons procédé en trois étapes. La première a consisté dans un diagnostic, établi par un comité d’experts, où siégeaient des représentants de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, du Régime social des indépendants, de la commission paritaire nationale avec des représentants des chefs d’entreprise et des organisations syndicales, des médecins du travail de la branche, un pneumologue, un dentiste-conseil et un opticien-conseil. Deux risques professionnels sont clairement identifiés dans la boulangerie : la carie dentaire, dite « du boulanger », et l’allergie à la farine, première cause d’asthme professionnel en France. Ce sont les deux thèmes sur lesquels nous travaillons depuis 2007. Nous avons très vite proposé aux partenaires sociaux une action de prévention dans le domaine de la carie dentaire. Tous les salariés ont reçu un courrier leur proposant une consultation gratuite de prévention, financée à 100 % par le régime. Pour des raisons de rapidité, nous avons dans un premier temps préféré ne pas recourir à l’assurance maladie. Mais nous tenons informée la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et étudions comment nous pourrions dans le futur travailler avec elle, puisque notre action est complémentaire de son propre programme « M’T dents » à destination des jeunes jusqu’à dix-huit ans. Nous en prenons en quelque sorte le relais dans la boulangerie où l’on compte beaucoup d’apprentis, hommes et femmes d’ailleurs, celles-ci étant plutôt employées dans la vente, où les moins de vingt-cinq ans représentent 40 % de l’effectif et où l’âge moyen n’est que de trente ans.
En lançant cette opération, nous nous sommes d’emblée imposé d’en évaluer les résultats. Les partenaires sociaux en étaient eux-mêmes très soucieux. Nous avons, sous le contrôle de notre dentiste-conseil, qui connaît bien la profession, et de la Confédération nationale des syndicats dentaires, élaboré un questionnaire à la fois simple et précis, auquel les dentistes étaient chargés de répondre. C’est ainsi que nous savons qu’en 2008-2009, 10 % des salariés de la boulangerie ont consulté leur dentiste et nous disposons désormais d’une base de données sur l’état bucco-dentaire de près de 9 000 salariés. Alors que s’achève le deuxième train d’actions de prévention, nous allons pouvoir établir des comparaisons.
En tant qu’assureur du risque, nous avons proposé aux partenaires sociaux de mieux rembourser les dépassements d’honoraires sur les prothèses dentaires et de prendre en charge les implants. Nous avons également lancé une campagne de sensibilisation pour que les boulangers consultent un dentiste au moins deux fois par an, la carie propre à cette profession présentant la particularité d’être indolore et de se situer à la base des gencives, ce qui peut conduire très rapidement chez des sujets fragiles à la perte des dents.
M. le rapporteur. Comment s’explique ce risque particulier de carie ?
M. David Giovannuzzi. Il est lié à une exposition permanente au sucre. Les boulangers, comme d’ailleurs les pâtissiers et les confiseurs, goûtent en permanence des produits sucrés, en même temps qu’ils absorbent des poussières de sucre lorsqu’ils en vaporisent.
Nous espérions toucher 15 % de l’effectif du secteur. Nous avons gagné en efficacité lors du deuxième volet d’actions et nous devrions être proches de l’objectif. La diffusion d’un dépliant, comportant des photos très réalistes des caries auxquelles sont exposés les boulangers et de leurs conséquences, n’y est sans doute pas étrangère. Sans pouvoir nous appuyer comme l’assurance maladie sur des données qualitatives détaillées, nous n’en avons pas moins connaissance des principaux agrégats : dépenses de soins dentaires, nombre respectif de prothèses acceptées et refusées, nombre de bénéficiaires par type d’acte, notamment. Nous avons ainsi pu constater que notre action de prévention a fortement accru la consommation de soins dentaires. Notre meilleure prise en charge des prothèses et implants y a sans doute aussi contribué.
M. le coprésident Jean Mallot. Le risque dentaire est le même pour un boulanger, qu’il soit salarié ou indépendant. Or, si j’ai bien compris, votre action ne s’adresse qu’aux salariés de la boulangerie. Comment étendre votre démarche aux chefs d’entreprise ?
M. David Giovannuzzi. Dans les 33 000 boulangeries du territoire national, quelque 20 000 chefs d’entreprise non salariés cotisent au Régime social des indépendants. Notre dentiste-conseil nous avait invités à porter l’effort sur les boulangers de moins de vingt-cinq ans, dont certains d’entre eux deviendront patrons. Nous étudions comment associer le Régime social des indépendants à nos actions. Il est représenté dans notre comité d’experts et nous échangeons déjà sur les bonnes pratiques. La Confédération nationale de la boulangerie nous a demandé de mettre en place à compter du 1er janvier une garantie pour les chefs d’entreprise identique à celle des salariés, intégrant cette approche préventive. Les partenaires sociaux ont insisté pour que tous les professionnels de la branche, quel que soit leur statut, bénéficient de cette prévention.
Mme Isabelle Hébert, directrice stratégie et marketing, santé et prévoyance du groupe Malakoff Médéric. Le triptyque de la prévention repose sur les trois piliers de la prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Je ne m’étendrai pas sur la prévention primaire, qui est assez commune à l’ensemble des organismes. Les thèmes sont bien connus et ne sont d’ailleurs pas propres à notre pays : nutrition, tabac, activité physique, entre autres. Nos contrats collectifs standards incluent ainsi, sans surcoût, le remboursement de certains dépistages et de certaines vaccinations, et des services d’accompagnement concernant la nutrition et la lutte contre le tabagisme. Telle est notre offre pour les entreprises moyennes. Les grandes entreprises ont, quant à elles, un choix un peu plus large et peuvent opter pour plus ou moins de prévention primaire.
De nos discussions avec les directeurs des ressources humaines, il ressort qu’ils sont parfaitement conscients que nos actions sur les facteurs de risque ou les pathologies chroniques contribueront à réduire les coûts globaux de santé supportés par le régime obligatoire et les régimes complémentaires, mais auront aussi une incidence sur la prévoyance, du fait par exemple d’un moindre absentéisme ou d’une meilleure prévention de la perte d’autonomie.
J’en viens à la prévention secondaire. Nous avons lancé un projet sur l’hypertension artérielle dans le cadre d’un appel d’offres émis par le ministère de l’industrie. Celui-ci recherchait un consortium de partenaires capables d’apporter des solutions complètes en matière de prévention, par le biais de la télémédecine. Nous n’avons pas hésité à constituer, sous l’égide du Centre technique des institutions de prévoyance, un dossier en partenariat avec certains de nos concurrents, notre idée étant que la prévention est plus efficace si elle est bien coordonnée.
Ce projet consiste à dépister l’hypertension artérielle chez les salariés au sein même des entreprises, ce qui a posé d’ailleurs le problème de la coordination avec la médecine du travail et les partenaires sociaux, et à offrir aux sujets hypertendus le moyen de « gérer » leur hypertension à domicile, avec à la fois un dispositif communicant offrant une interface pour le médecin traitant et un programme d’accompagnement médicalisé personnalisé ne se limitant pas à une assistance de base, mais comportant une réelle dimension psychologique. La technologie en effet ne suffit pas. L’accompagnement est essentiel pour que, d’une part, les dispositifs médicaux soient correctement utilisés et que, d’autre part, les patients s’engagent durablement dans le programme.
Notre projet a été retenu par le ministère de l’industrie qui souhaitait que se développe dans notre pays une nouvelle industrie autour de la médecine. Nous avons obtenu un soutien financier au titre du programme « Initiative Entreprises Innovantes » : il fallait en effet une petite et moyenne entreprise capable de développer à la fois des interfaces web et des dispositifs communicants. Après que notre dossier a été accepté, nous avons trouvé d’autres partenaires – entreprises de haute technologie, médecins à même d’apporter l’intelligence clinique nécessaire dans les dispositifs, plateformes de programmes d’accompagnement, acteurs régionaux et institutionnels – et avons pu nous autofinancer en partie.
Le pilote a été lancé dans le Nord-Pas-de-Calais, en accord avec l’agence régionale de santé, et nous devons signer tout prochainement avec celle-ci le contrat définitif. Elle a d’ailleurs inclus ce projet de télémédecine dans son schéma de prévention. Nous avons aussi travaillé avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés parce que prévenir et traiter à temps l’hypertension représente un gain aussi bien pour l’assurance maladie obligatoire que pour les régimes complémentaires.
Nous avons été nous-mêmes surpris de l’intérêt de nos clients, toutes catégories confondues, pour ce programme. Notre plus gros client y a adhéré tout de suite, mobilisant ses propres équipes de communication et mettant à profit sa « journée santé » pour promouvoir le programme. Le succès a été au rendez-vous du côté des entreprises mais aussi des salariés, nombreux à être venus se faire dépister sur leur lieu de travail, en toute confidentialité. Le Nord-Pas-de-Calais présente sans doute des caractéristiques sanitaires particulières, mais en moins de trois semaines une hypertension a ainsi été détectée chez plus de cinq cents personnes, qu’elles l’aient découverte à cette occasion ou qu’elles aient eu connaissance de leur état antérieurement. Et, dans une seule entreprise, cent cinquante personnes sont déjà entrées dans le programme. Celui-ci s’étalera sur dix-huit mois, comme prévu dans le cadre du financement du ministère de l’industrie. L’objectif est de parvenir à un millier de personnes bénéficiant d’un programme d’accompagnement. Au-delà de la satisfaction des patients, nous évaluerons aussi l’expérience d’un point de vue médico-économique. Nous allons travailler sur ce point avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et l’école d’ingénieurs Télécom Bretagne, l’idée étant de créer un modèle industriel reproductible sous une forme peut-être différente tout en faisant appel à la même technologie, pour d’autres pathologies, d’autres populations comme les retraités et d’autres régions. Nous avons travaillé avec de très nombreux partenaires et ce que nous avons appris pour mettre au point cette action complexe de prévention multidimensionnelle nous sera précieux pour envisager les modalités d’une généralisation de l’expérience.
M. le rapporteur. Agissez-vous, au sein de l’entreprise, en collaboration avec la médecine du travail ?
Mme Isabelle Hébert. Dans la première version du dossier que nous avions présenté au ministère de l’industrie, la médecine du travail était intégrée au processus de dépistage, mais les trois ministères concernés –industrie, santé et travail – nous ont demandé de revoir notre dossier au motif que le médecin du travail n’avait pas à jouer ce rôle. Nous avons trouvé une solution en faisant intervenir nos propres infirmières dans les entreprises, à charge pour la médecine du travail de nous fournir un local permettant d’assurer la confidentialité des consultations.
M. le coprésident Pierre Morange. Il serait intéressant que chaque acteur institutionnel nous présente une photographie des publics concernés. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la mutualité représente trente-quatre millions d’adhérents et effectue 23 milliards d’euros de remboursement de dépenses de santé, mais consacre 4 millions d’euros à la prévention. En réalité, elle dépense beaucoup plus, car cette somme correspond aux seules actions relevant d’une logique de prévention. La Cour des comptes évalue la somme consacrée à la prévention sanitaire de 1 à 10 milliards d’euros, en fonction des critères utilisés.
Notre rapporteur a mis l’accent, à juste titre, sur l’éclatement des centres décisionnels, l’absence de coordination et la difficulté de généraliser les évaluations médico-économiques, ce qui souligne l’absence de stratégie de l’État en matière de santé publique. Mais des données chiffrées permettraient de mettre en lumière les forces potentielles de votre secteur.
M. le rapporteur. Il en va de la prévoyance comme des assurances : chacun mène sa propre politique. Seule la mutualité est en mesure de fédérer les actions de l’ensemble du secteur.
M. le coprésident Pierre Morange. Il est vrai que les multiples objectifs de la loi quinquennale ne sont pas très lisibles. Une analyse, même sommaire, des grands facteurs de risque que sont le tabac, l’alcool, la surcharge pondérale, la sédentarité et les accidents domestiques permettrait de mesurer leur incidence médico-économique et de déclencher une dynamique collective.
L’installation des détecteurs automatiques de fumée dans tous les lieux d’habitation permettrait à l’assurance maladie d’économiser 1 milliard d’euros. Il serait intéressant que la Fédération française des sociétés d’assurances s’intéresse à la généralisation de cet outil car je rappelle que quatre cents ou cinq cents morts sont dues chaque année aux incendies domestiques.
M. le rapporteur. Le fait que le contrat porte en moyenne sur une période de sept ans pose un problème. Qu’en est-il pour les associations de prévoyance ?
Mme Évelyne Guillet. S’agissant de la prévoyance, la durée est du même ordre que pour les contrats d’entreprise.
M. Alain Rouché. Elle est plus longue pour les contrats qui relèvent des accords de branche.
Mme Évelyne Guillet. En effet.
M. le rapporteur. En raison de l’absence de coordination entre l’assurance maladie et les complémentaires santé, vous ne connaissez pas la pathologie de vos adhérents. Cela pose un réel problème.
Mme Isabelle Millet-Caurier. Les unions régionales et les mutuelles prennent de nombreuses initiatives, mais en l’absence d’évaluation et de modélisation, elles ne peuvent les généraliser. C’est la raison pour laquelle le mouvement mutualiste a exprimé le souhait de définir des axes prioritaires dans le cadre d’un plan stratégique de prévention. Les actions de prévention définies par ce plan seraient financées par un fonds de financement.
Le mouvement mutualiste entend être un partenaire, de l’assurance maladie mais également des agences régionales de santé. Mme Emmanuelle Wargon, au cours de son audition, a évoqué cette difficulté de coordination. La Fédération nationale de la mutualité entend promouvoir la coordination et la lisibilité des actions de prévention des unions régionales et des mutuelles.
Certes, nous aurions pu vous présenter une sorte de catalogue des actions menées par les mutuelles, mais la journée n’y aurait pas suffi. Nous avons préféré mettre en évidence les actions qui nous sont apparues comme des priorités.
M. le rapporteur. Connaissant les difficultés d’une coordination avec la médecine scolaire et l’Éducation nationale, quelles sont les actions que vous menez en faveur de la petite enfance ? Quelles sont vos relations avec la Mutuelle générale de l’Éducation nationale et les infirmières ? Est-il possible d’améliorer la coordination entre tous les acteurs de la prévention ?
Mme Marika Lefebvre. En partenariat avec l’Union nationale du sport scolaire, la Mutualité française a mis en place le programme « Bouge…, une priorité pour ta santé », qui a pour but de favoriser l’activité physique des collégiens. Dix-sept régions participent à ce programme.
Un certain nombre de régions ont choisi de sensibiliser les jeunes sur la thématique des risques auditifs liés à l’écoute intensive de musique en leur présentant un concert pédagogique produit par la compagnie Peace and lobe.
Je ne peux moi non plus vous dresser un catalogue exhaustif des actions engagées sur ces thèmes, mais je vous propose de vous faire parvenir une liste précise des actions prioritaires que les régions mettront en œuvre entre 2012 et 2014.
Mme Annabel Dunbavand. Outre le défaut de coordination et le morcellement des actions sur le territoire, nous avons nous aussi du mal à recruter des participants. C’est particulièrement vrai dans le cadre du programme Tensioforme. En cherchant à comprendre les réticences de la population, nous nous sommes aperçus que les personnes ciblées ne se sentaient pas concernées par ce programme, bien que 75 % d’entre elles présentaient des facteurs de risque. Nous devons donc agir sur la manière dont la population perçoit le risque et la persuader que l’action de prévention lui est destinée.
M. le coprésident Jean Mallot. Cela démontre simplement que vous n’aviez pas choisi la population pertinente.
Mme Annabel Dunbavand. Non, car seules les personnes qui n’ont pas répondu ne se sentaient pas concernées.
M. le coprésident Jean Mallot. Elles le sont sur le plan sanitaire, et c’est ce qui nous intéresse.
Si une somme de 4,5 millions d’euros est consacrée à la prévention au niveau national, cela signifie que chaque département reçoit 45 000 euros.
Il est naturel que les organismes de prévoyance préfèrent engager des actions dont ils peuvent mesurer les résultats à court terme. Il faudrait revoir la durée du contrat car elle va à l’encontre de notre préoccupation commune : améliorer la santé de la population.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le retour sur investissement du dépistage du cancer colorectal et du cancer du sein pour les organismes d’assurance complémentaire ?
Mme Marika Lefebvre. Dans plusieurs régions, notamment dans les zones défavorisées, l’action de l’union régionale a démultiplié l’accès du public à la campagne nationale de dépistage.
M. le coprésident Pierre Morange. Je ne doute pas de l’investissement des unions régionales, mais la Cour des comptes a émis des réserves sur un certain nombre de campagnes de dépistage du cancer. Nous aimerions connaître le sentiment de chaque acteur de l’assurance complémentaire.
M. David Giovannuzzi. En matière d’évaluation des actions de prévention, nous sommes très modestes face à la sécurité sociale, qui a la capacité d’analyser et de se lancer dans un processus de gestion de la maladie (Disease management). J’ai découvert avec plaisir l’ampleur de l’action Sophia, qui sera généralisée à partir du 1er janvier 2012. Quant à nous, il nous manque des éléments. Notre rôle est de relayer des actions que le régime de base considère comme étant prioritaires, d’être complémentaires de la sécurité sociale et non redondants.
La sécurité sociale a évalué à deux cent vingt-cinq mille le nombre des asthmatiques vivant en France. Elle a pu le faire à partir du nombre des traitements contre l’asthme qu’elle rembourse. Nous ne pouvons, avec les partenaires sociaux de la boulangerie, connaître le nombre de personnes souffrant de l’asthme du boulanger car nous sommes dans l’incapacité totale d’identifier ces personnes. Nous pourrions jouer un rôle intéressant en identifiant, sur les deux cent vingt-cinq mille asthmatiques, les vingt mille ou trente mille asthmatiques qui travaillent dans le secteur de la boulangerie, et en leur délivrant des messages à connotation professionnelle. Pour l’instant, l’étanchéité des fichiers nous en empêche, mais c’est une piste à suivre.
En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal, nous disposons de fichiers très précis et nous adressons très régulièrement des courriers à nos ressortissants. C’est notre façon de participer au dépistage et de contribuer à la prévention. L’asthme est un excellent exemple de notre complémentarité avec l’assurance maladie et nous travaillons actuellement avec les responsables de la prévention de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour mettre en place des actions en direction de l’asthme professionnel des professions de la boulangerie. Mais, j’en conviens, nous contenter de n’être qu’un relais est un peu frustrant.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Alain Rouché, quel est le retour sur investissement, sur un contrat moyen de sept ans, des actions de prévention des accidents domestiques ?
M. Alain Rouché. La décision du Parlement d’étendre l’usage du ticket modérateur aux actes de prévention traduit sa volonté de faire jouer un rôle aux complémentaires santé. Soit on leur demande uniquement de financer une partie des actes de prévention, par le biais du ticket modérateur, soit on leur demande de s’impliquer davantage. Nous y sommes tout à fait prêts, mais nous avons besoin d’un minimum d’informations pour accompagner au mieux nos assurés, qu’ils soient atteints de telle ou telle pathologie ou qu’ils présentent des facteurs de risque.
M. David Giovannuzzi. En ce qui concerne la durée du contrat, qu’elle soit de court, moyen ou long terme, nous préférons observer rapidement les résultats de nos actions. Si le régime a investi 500 000 euros dans une action de prévention dans le domaine bucco-dentaire, soit de 4 % à 6 % des efforts rapportés au poste, c’est sur le constat que 30 % des dépenses totales de la branche, soit 12 millions d’euros, sont consacrés aux soins dentaires. Mais en matière de prothèse dentaire, quand verrons-nous un retour sur investissement ? Si, demain, la branche professionnelle change d’assureur, elle pourra poursuivre cette action et en récolter les bénéfices dans vingt ans. Or le bénéfice d’une telle action ne peut être perçu avant dix ans. Nous avons opté pour le long terme parce que le poste dentaire est le plus important pour la population dont nous parlons. En tout état de cause, il faut saluer le courage des partenaires sociaux d’avoir osé se lancer dans une opération à moyen et long terme.
M. le rapporteur. En matière de problèmes musculo-squelettiques, les actions engagées par les entreprises vont vous permettre de réaliser des économies. Tout le monde a intérêt à faire de la prévention : l’entreprise, l’employeur et l’assureur.
M. Alain Rouché. L’entreprise est pénalisée par de nombreux arrêts de travail qui engendrent des indemnités journalières, voire des rentes d’invalidité. Les prestations versées aux salariés tiennent à deux problématiques : les troubles musculo-squelettiques et les arrêts de travail dus à un état dépressif. Nous travaillons actuellement avec quelques-uns de nos clients pour tenter de limiter le nombre des arrêts de travail.
Il est difficile de réaliser de réelles économies si l’on réduit les cotisations d’assurance en fonction des résultats obtenus. Dans un certain nombre de branches d’activité, à un certain âge, il n’est pas anormal de souffrir de problèmes de dos. Au-delà de la prévention, il faudrait réussir à maintenir au travail les personnes concernées, mais à un autre poste, en résumé adapter le poste de travail en fonction de l’âge et des problèmes de santé de la personne.
Mme Isabelle Hébert. Les partenaires sociaux et les directions des ressources humaines exigent des contreparties, évoquant le travail de communication que leur ont demandé les plans de prévention. Tous reconnaissent l’impact de la prévention sur l’absentéisme, mais ils nous demandent de développer des modèles économiques qui leur permettraient de récupérer de 1 % à 4 % sur le montant de la prime d’assurance. Nous leur proposons de travailler ensemble et d’analyser les gains.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous mesuré l’incidence de l’exposition au tabagisme passif en termes de morbidité, de mortalité et d’absentéisme professionnel ? Certains pays étrangers, qui comme nous ont adopté l’interdiction de fumer dans les lieux publics, ont constaté une baisse de près de 10 % du nombre des arrêts maladie. Faites-vous le même constat ?
Mme Isabelle Hébert. Nous ne disposons pas des éléments qui nous permettraient d’aboutir à un tel constat.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous participé à une conférence de consensus avec l’assurance maladie ? La communication de la Cour des comptes indique que le dépistage du cancer du sein n’est efficient que si au moins 70 % de la population y participent. Or, dans le meilleur des cas, le pourcentage de participation ne dépasse guère les 50 %, ce qui ne permet pas d’aboutir à une amélioration statistique de la mortalité et de la morbidité. Quelle est l’appréciation du secteur de l’assurance complémentaire santé sur ce sujet ?
M. David Giovannuzzi. La campagne de vaccin antigrippal nous a permis de constater que, lorsque les entreprises s’investissent et informent leurs salariés sur la nécessité de la prévention, le nombre des participants peut augmenter de 50 % à 60 %.
M. le rapporteur. Le dépistage du cancer de la prostate passe par des dosages de taux de PSA (Prostate Specific Antigen) qui ne sont pas forcément utiles et par des interventions chirurgicales parfois traumatisantes. En ce qui concerne le cancer du sein, les jeunes femmes sont exclues du dépistage systématique, sans oublier celles qui préfèrent « ne pas savoir » et certaines populations défavorisées qui n’y ont pas accès. Or c’est à elles que doit s’adresser la prévention. Quant au dépistage du cancer du col de l’utérus, la vaccination des jeunes filles ne fait pas l’unanimité.
Les exemples que vous avez cités illustrent un certain nombre de difficultés : la durée des contrats, les relations avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la médecine du travail et l’Éducation nationale. Je retiens également la difficulté de renforcer les initiatives locales prises par des assurances complémentaires santé. Il faut favoriser de telles initiatives ainsi que les campagnes visant à diminuer la mortalité prématurée évitable, qui doit être l’une de nos priorités de santé publique.
Mme Isabelle Millet-Caurier. La durée des contrats a peu d’importance pour le mouvement mutualiste car nous accompagnons nos adhérents tout au long de leur vie, de la petite enfance à la perte d’autonomie. La perte d’autonomie est un volet essentiel du champ de la prévention, qui décloisonne les aspects sanitaire et médico-social au profit d’une vision globale de la personne.
Monsieur Jean-Luc Préel, j’adhère en partie à votre ébauche de conclusion. Nous devons en effet parvenir à une meilleure coordination, en matière de gestion du risque, entre l’assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires santé. Or l’organisation de la gestion du risque au niveau régional se heurte à d’importantes difficultés. L’accès aux données de santé en est la parfaite illustration.
Mme Catherine Masclet, de la direction santé prévoyance d’Allianz. Je voudrais vous parler d’un partenariat novateur que nous menons depuis le début de l’année avec le Collectif national des groupements de pharmaciens d’officine dans le domaine du risque cardiovasculaire. Les pharmaciens qui ont souhaité nous rejoindre, qu’ils soient adhérents au collectif national ou indépendants, organisent des actions de dépistage de différentes affections, que ce soit le cholestérol, la glycémie, le surpoids ou le tabagisme. Ils remettent un coffret de dépistage personnalisé et un cédérom aux participants, et ils les orientent, le cas échéant, vers des professionnels de santé, médecins traitants ou cardiologues.
Allianz a participé, avec deux autres assureurs, Axa et Swiss Life, à une opération de consultation cardiologique approfondie menée avec le Syndicat national des spécialistes du cœur et des vaisseaux. Dans le cadre de cette opération, nous avons proposé une consultation, pour un coût de 90 euros, naturellement remboursé, à tous nos assurés entre trente-cinq ou quarante ans a priori en bonne santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors d’une audition antérieure, on nous a relaté une expérience intéressante mise en œuvre par le comité régional d’éducation pour la santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur : il s’agit d’un programme d’éducation sanitaire, destiné aux classes de cours moyen deuxième année, dispensé tous les quinze jours pendant un an. Quelques années plus tard, on a pu constater chez les jeunes qui avaient bénéficié de ce programme, qui étaient à présent adolescents, une consommation d’alcool et de tabac et un indice de masse corporelle deux fois moins importants que la moyenne.
Quelle est votre position sur ce type d’expérience, qui a fait la démonstration de son efficacité ? Seriez-vous prêts à réfléchir de façon collective à la mutualisation de vos moyens ?
M. Alain Rouché. Je répondrai positivement ; à partir du moment où l’efficacité d’une action a été démontrée, les assureurs ne peuvent être opposés à sa généralisation.
Par le biais de notre association Assureurs prévention, nous avons soutenu significativement pendant plus de cinq ans le programme « Ensemble, prévenons l’obésité des enfants » (EPODE), qui a obtenu des résultats très probants en raison des liens qu’il a créés entre l’école et la municipalité. La prise en charge locale, la mise en œuvre des réseaux locaux, en particulier l’Éducation nationale, sont des éléments extrêmement importants.
Mme Évelyne Guillet. Les institutions de prévoyance y son également favorables. L’expérience décrite par AG2R sur la boulangerie montre l’intérêt de la mutualisation, qui nous aide à nous positionner par rapport au régime d’assurance maladie de base.
M. David Giovannuzzi. S’agissant de la pédagogie, les partenaires sociaux ont récemment décidé d’assurer la formation en éducation sanitaire de formateurs de vingt mille apprentis.
Mme Isabelle Millet-Caurier. La Mutualité française y est également prête, à condition d’être associée à une action coordonnée et d’apparaître, non comme un financeur, mais comme un partenaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Mesdames, messieurs, nous vous remercions pour ces propos porteurs d’espoir.
*
Audition de M. Stéphane Seiller, directeur général du Régime social des indépendants, et de Mme Stéphanie Deschaume, directrice adjointe de la santé.
M. Stéphane Seiller, directeur général du Régime social des indépendants. Le Régime social des indépendants apporte la couverture de la sécurité sociale de base aux artisans, commerçants et professions libérales contre le risque maladie. Il assure également, pour les deux premières catégories professionnelles, la couverture retraite et le régime complémentaire afférent. Créé en 2006, le régime a d’abord traversé quelques années troublées, notamment en raison de la création de l’interlocuteur social unique, qui prévoyait un recouvrement des cotisations partagé avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ce système a rencontré, à ses débuts, de grandes difficultés de mise en œuvre, qui sont actuellement en voie de résorption, mais qui ont consommé beaucoup d’énergie dans les deux organismes.
La prévention, dans le cadre du Régime social des indépendants, a cependant continué de se développer dans le prolongement des efforts déjà engagés par le régime qui couvrait auparavant les mêmes populations contre le risque maladie, avec la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes comme tête de réseau.
Notre budget de prévention a sensiblement augmenté depuis la création du Régime social des indépendants, passant d’environ 9 millions d’euros à près de 20 millions d’euros en 2011. Cet effort se justifie notamment par les caractéristiques des populations que nous couvrons, moins enclines que les autres à appréhender leurs problèmes de santé, et plus attentistes en face du système de distribution des soins, a fortiori en matière de prévention.
Dans ce contexte particulier, le Régime social des indépendants a élaboré un ensemble d’actions de prévention regroupées sous le terme générique de « Parcours prévention ». Son but consiste à couvrir la population en fonction de l’âge. Nous commençons par les enfants des commerçants, artisans et professions libérales, depuis la grossesse de leur mère jusqu’à l’âge de six ans ; nous les suivons ensuite par des cycles d’offre de prévention selon les grandes tranches d’âge. Nous proposons ainsi des prestations telles que le suivi préventif des femmes enceintes et des enfants en bas âge, la promotion de la vaccination contre la rubéole, les oreillons et la rougeole, la prévention bucco-dentaire, les bilans de prévention consistant en consultations approfondies proposées chez les médecins traitants à différents âges, l’aide au sevrage tabagique, la prévention des risques professionnels, sur laquelle nous mettons particulièrement l’accent, la vaccination anti-grippale, le dépistage du cancer du col de l’utérus, de celui du sein, du cancer colorectal et, pour les diabétiques, un accompagnement thérapeutique.
60 % des actions inscrites dans notre budget de prévention s’insèrent dans des programmes nationaux soutenus par les pouvoirs publics, dont je viens de citer quelques exemples. Nous versons aussi chaque année 2,7 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et 1,2 million aux différentes agences régionales de santé. Les 40 % restants correspondent à des actions spécifiquement conduites par le Régime social des indépendants, dont le bilan bucco-dentaire. Ces actions nous coûtent, au total, 5 millions d’euros. À ce titre, nous proposons un bilan annuel aux enfants de nos affiliés, à partir de l’âge de six ans et jusqu’à dix-huit ans. Il en va de même des examens de prévention chez les médecins traitants.
Nous sollicitons les affiliés concernés par un courrier comprenant un auto-questionnaire, qui sert ensuite de guide pour une consultation médicale. Le coût global de l’opération s’élève à un peu plus de 1,5 million d’euros.
M. le rapporteur. Combien de personnes sont-elles concernées ?
Mme Stéphanie Deschaume, directrice adjointe de la santé du Régime social des indépendants. Pour la campagne 2011, toujours en cours, nous nous sommes adressés à environ 180 000 personnes. Nous avions obtenu, au cours de la campagne précédente, un taux de participation de 15 %.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur combien d’adhérents ?
Mme Stéphanie Deschaume. Nous couvrons près de 4 millions de personnes, dont environ 2,8 millions dans la population visée, celle des seize à soixante-dix ans.
Notre démarche repose sur des cycles à long terme ayant pour objectif de proposer ce type d’examen quatre fois dans une vie, soit pour quatre classes d’âge : les quinze–vingt-cinq ans, les vingt-six–quarante ans, les quarante et un–cinquante-cinq ans et les cinquante-six–soixante-dix ans. Sur une période de dix ans, nous touchons ainsi l’ensemble de la population.
M. Stéphane Seiller. Un axe important de notre politique de prévention vise les risques liés à l’activité professionnelle, élément spécifique à la population de nos affiliés. Nous avons, depuis trois ans, consenti un effort particulier dans ce domaine et souhaitons pouvoir, dans le cadre de notre convention d’objectifs et de gestion en cours de discussion avec l’État, lui affecter des moyens supplémentaires.
Cette action de prévention comporte deux aspects : le premier, de nature médicale, concerne le suivi des personnes en fonction de leur métier en s’appuyant sur le dispositif de consultation spécifique que je viens d’évoquer ; le second consiste en actions plus directement liées aux conditions de travail et pour lesquelles, compte tenu des limites de notre capacité d’expertise interne, il nous faut recourir au partenariat avec des organismes tels que le réseau des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les services de santé au travail et les organisations professionnelles des secteurs les plus concernés par la problématique de l’incidence de l’activité sur la santé de la personne, c’est-à-dire d’abord les professions artisanales. Nous avons ainsi ciblé certains métiers et élaboré, pour chacun d’eux, une documentation spécifique.
Dans l’ensemble, la politique de prévention fonctionne bien au niveau du Régime social des indépendants qui, depuis longtemps, a investi en la matière. Elle reste cependant une sorte de terre de conquête puisque, je le répète, le public auquel nous nous adressons est réticent à considérer suffisamment tôt ses problèmes de santé. Cela se traduit par des montants de dépenses par personne protégée sensiblement inférieurs à ceux observés dans le cadre du régime général de la sécurité sociale ou de celui de la Mutualité sociale agricole. Ce montant s’élève en 2011 à 5,17 euros, contre 8,46 euros pour le régime général et 9,21 euros pour la Mutualité sociale agricole.
Nous négocions donc actuellement avec l’État, dans la perspective de notre prochaine convention d’objectifs et de gestion, pour 2012-2015, la possibilité de faire progresser raisonnablement nos investissements dans la prévention.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous avez indiqué que vos affiliés accusaient un certain retard dans leur comportement envers la prévention. On pouvait sans doute affirmer cela il y a vingt ou trente ans mais, aujourd’hui, toute la population est couverte et les préoccupations sanitaires sont largement partagées. Comment expliquer la persistance de ce retard et les difficultés à le combler ?
M. Stéphane Seiller. Le mot « retard » n’est pas le plus approprié. Les travailleurs indépendants font d’abord tourner leur entreprise ou leur commerce et ne s’occupent que secondairement de leur santé. Le niveau de leurs dépenses le prouve.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous en rappeler les chiffres ? Nous savons que les dépenses par assuré social s’élèvent à environ 2 200 euros par an dans le cadre du régime général.
Mme Stéphanie Deschaume. Le chiffre est très inférieur dans le cadre du Régime social des indépendants et une partie importante de la population correspondante ne recourt à aucun soin sur une période d’un an, à la grande différence du régime général. Mais nos affiliés sont très volatils, de nombreux travailleurs devenant indépendants sur une courte période de transition.
M. Stéphane Seiller. Les taux de participation aux démarches de prévention sont moindres que ceux que l’on constate dans les autres régimes de protection sociale. Une des explications est liée au fait qu’un travailleur indépendant s’échappe moins facilement de son activité professionnelle qu’un salarié et dispose donc de moins de temps pour aller voir un médecin ou écouter les messages relatifs à la prévention.
Mme Stéphanie Deschaume. Quelques chiffres permettent d’illustrer ce phénomène. Ainsi, pour le dépistage du cancer du sein, la participation des travailleurs indépendants s’élève à 43 %, contre 50 % dans le régime général et 55 % dans le régime agricole. Il en va de même pour le dépistage du cancer colorectal : 21 % contre 34 % dans le régime général, ainsi que pour la vaccination antigrippale : 44 % contre 53 %.
Toutes les études réalisées afin de connaître les motifs d’une absence de participation à une démarche de prévention l’imputent à un manque de temps des personnes concernées. Le travailleur indépendant s’extrait plus difficilement de son activité professionnelle.
M. le coprésident Jean Mallot. Mais ces écarts se réduisent-ils avec le temps ?
Mme Stéphanie Deschaume. Oui, et nous le constatons notamment pour le dépistage du cancer du sein, la vaccination contre la grippe et la prévention bucco-dentaire, mais sur des périodes relativement longues, entre cinq et dix ans.
M. Stéphane Seiller. Et nous espérons que cette réduction des écarts va continuer, grâce à la poursuite d’une politique de prévention dynamique.
M. le rapporteur. La communication de la Cour des comptes a montré l’importance du pilotage national des actions de prévention.
Vous avez mentionné votre participation financière à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Quelles sont vos relations avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ? Êtes-vous associé à la définition de ses campagnes et à leur mise en œuvre ? Participez-vous, par exemple, au programme Sophia contre le diabète ? La campagne contre la carie du boulanger, destinée aux salariés, a-t-elle son équivalent pour les travailleurs indépendants ?
M. Stéphane Sellier. Les actions de prévention se développent de façon satisfaisante pour le compte du Régime social des indépendants. Ainsi, la campagne en faveur de la vaccination antigrippale s’est parfaitement coordonnée avec l’action du régime général. Le bilan bucco-dentaire s’inscrit dans la démarche globale du régime général, mais le Régime social des indépendants a décidé de lui octroyer des moyens supplémentaires.
Il y a deux ans, alors en fonctions à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, j’avais souhaité un rapprochement avec le Régime social des indépendants dans le domaine de la prévention des risques professionnels car le régime général éprouve bien des difficultés à toucher les salariés des petites entreprises. Il s’agissait de sensibiliser à ces risques les dirigeants des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises en leur faisant comprendre qu’eux-mêmes étaient aussi concernés comme le montre l’exemple de la carie du boulanger que vous avez évoquée. C’est pourquoi, nous avons, à la fin de l’année dernière, signé une convention par laquelle nos deux régimes mettent en place un partenariat, le régime général apportant son expertise du risque et le Régime social des indépendants sa capacité de toucher les publics visés.
Le diabète constitue un autre bon exemple de notre coordination dans le domaine de la prévention. Le régime général a lancé Sophia mais le Régime social des indépendants avait déjà engagé un programme expérimental « RSI diabète », qui répond plus à un souci d’éducation qu’à un souci d’accompagnement des personnes dans le suivi des traitements, comme le fait Sophia. La question se pose aujourd’hui de sa prolongation ou d’un rapprochement avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour s’articuler avec Sophia.
Mme Stéphanie Deschaume. Nous avions identifié un sur-risque de diabète chez certaines catégories de travailleurs indépendants, notamment chez les commerçants, eu égard à leurs pratiques alimentaires, souvent atypiques. D’où la création de « RSI diabète » afin, d’une part, de faire accéder les assurés diabétiques de type 2 à une éducation thérapeutique, d’autre part, à travers un portail de prévention santé, de leur permettre de suivre personnellement leur respect des référentiels fournis par la Haute Autorité de santé. Ce programme a été déployé dans toutes nos régions et couvre environ 46 000 personnes, soit 45 % de notre population diabétique de moins de quatre-vingts ans. Le taux de participation s’établit à un peu plus de 16 %. Le programme est en plein déploiement, le principal frein provenant de l’insuffisant maillage territorial de l’offre d’éducation thérapeutique. Mais nos assurés, ainsi que leurs médecins traitants, se disent satisfaits de notre démarche. Nous observons aussi, par les réponses à nos questionnaires, une forte modification des habitudes alimentaires et des comportements d’hygiène de vie. Ainsi, la population du programme augmente de six points son respect des référentiels précités par rapport à la population témoin.
Quelles synergies pouvons-nous trouver avec Sophia ? Des échanges ont déjà eu lieu, montrant que le régime général recherche aussi une complémentarité entre l’accompagnement et l’éducation thérapeutique. On peut donc imaginer à terme la présentation à nos affiliés d’une offre leur permettant de bénéficier du programme Sophia.
M. Stéphane Sellier. Ce type de sujet devrait faire l’objet de discussions au sein du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie car nous disposons des premiers résultats de l’évaluation des deux programmes expérimentaux lancés récemment par le Régime social des indépendants : « RSI prévention professionnelle » et « RSI diabète ».
M. le rapporteur. Des réunions sont-elles organisées entre les médecins chefs des trois régimes rassemblés dans l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ?
Mme Stéphanie Deschaume. Les trois médecins-conseils nationaux se réunissent régulièrement.
M. le rapporteur. Vos affiliés adhèrent encore un peu moins facilement aux campagnes de prévention que ceux du régime général. Comment améliorer cette situation ? On constate d’importantes variations d’un département à l’autre, sans doute également liées au plus ou moins grand nombre de relances effectuées par les associations locales.
Mme Stéphanie Deschaume. Nous souhaitons, dans ce but, nous intégrer de façon complémentaire dans les actions de communication de l’État et du régime général car celles-ci bénéficient d’un important effet de masse. Il est patent que la façon de proposer un programme conditionne largement son succès. Demander une implication individuelle importante conduit à l’échec auprès des travailleurs indépendants. Il faut, au contraire, leur proposer une information et un modèle simples, ainsi qu’un accès facile à la démarche de prévention. À titre d’exemple, on n’invite pas un commerçant à se rendre dans un centre d’examens de santé fermé le lundi…
M. le rapporteur. Certains examens de santé nécessitent moins de temps que d’autres. Il en est ainsi du test hémoccult.
Mme Stéphanie Deschaume. Celui-ci ne bénéficie pas partout d’une bonne acceptation. Notre population est, aux deux tiers, masculine, et l’on sait que la capacité d’acceptation des examens médicaux est, chez les hommes, plus faible que chez les femmes, toutes catégories sociales et professionnelles confondues.
M. le coprésident Pierre Morange. La Cour des comptes ne mentionne pas le Régime social des indépendants dans sa communication sur la prévention sanitaire. Vous a-t-elle entendus ?
Mme Stéphanie Deschaume. Non.
M. le rapporteur. Entendre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés suffirait-il ?
M. Stéphane Seiller. Certainement pas !
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous fournir des précisions concernant votre politique de prévention des risques professionnels, concernant notamment sa typologie et son évaluation ?
M. Stéphane Sellier. Les résultats de l’évaluation nous sont tout juste parvenus. Depuis deux ou trois ans, le Régime social des indépendants a ciblé les professions touchées par des morbidités spécifiques et engagé à la suite un travail de sensibilisation sous la forme de brochures d’information par profession. Ainsi sont visés les couvreurs, les maçons, les plâtriers, les chauffeurs de taxis, exposés aux risques de troubles musculo-squelettiques en raison de leur position au volant, ainsi que les coiffeurs.
Le programme consiste à proposer aux intéressés un auto-questionnaire et une consultation approfondie par le médecin traitant qui, lui-même, aura préalablement reçu une documentation sur les risques afférents.
M. le coprésident Pierre Morange. On ne peut que saluer cette démarche, dont l’évaluation médico-économique de l’efficacité est plus facile, notamment pour ce qui concerne la mesure du retour sur investissements, que celle de politiques de prévention indifférenciées et à très long terme. Quelle impression générale en retirez-vous ?
M. Stéphane Sellier. Dans l’ensemble, les participants se montrent satisfaits du procédé.
Mme Stéphanie Deschaume. Nous avons expérimenté, à la fin de 2010 et au début de 2011, ce type de campagne pour deux types de population : les boulangers et les coiffeurs, en Picardie et en Pays de la Loire. Selon les premières données rassemblées, leur participation s’établit globalement à 11 %, mais avec une différence très nette entre les deux populations : un peu plus de 5 % chez les boulangers et plus de 15 % chez les coiffeurs. Cet écart résulte notamment du caractère plus masculin de la première de ces deux professions. L’implication de leurs organisations professionnelles respectives fut également différente : nos deux caisses concernées ont rencontré plus de facilité avec l’une qu’avec l’autre. Nous devons, pour l’avenir, en tirer la leçon de l’importance de nos liens avec les organisations professionnelles.
Les publics participants se sont déclarés très satisfaits de l’expérience : plus de 85 % des deux catégories de population l’ont considérée comme bonne ou très bonne. Les médecins traitants, bien que dépourvus de formation à la médecine du travail, partagent le point de vue général : ils se sont efforcés d’identifier les risques de chaque profession grâce à un kit très simple, facilitant les dépistages au cours de leur consultation et en vue, le cas échéant, d’une proposition de suivi thérapeutique.
Les risques ainsi identifiés chez les boulangers et les coiffeurs concernent, d’abord, les troubles musculo-squelettiques, puis le stress, généralement important chez les travailleurs indépendants, comme le montre par ailleurs une expertise réalisée en collaboration avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Viennent ensuite le diabète et l’hypertension artérielle, ainsi que les asthmes et rhinites directement liés à l’exercice des deux professions sélectionnées.
Nous avons identifié 22 groupes professionnels prioritaires, représentant 850 000 assurés, afin de déployer progressivement à leur intention le même type de démarche en fonction du mandat qui figurera dans notre prochaine convention d’objectifs et de gestion.
M. Stéphane Sellier. L’implication des médecins traitants est essentielle pour la réussite de telles opérations. Elle exige de leur part un investissement dans des matières qui ne leur sont pas a priori familières.
Parallèlement, nous devons développer des partenariats avec la branche accidents du travail du régime général pour des professions spécifiques dont les risques sont bien identifiés. Des expérimentations sont engagées à ce titre dans plusieurs régions : nous cherchons à adopter une démarche commune de sensibilisation de certains métiers à certains risques. Il existe ainsi, en partenariat avec la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine, un projet visant à sensibiliser les peintres en bâtiment, qu’ils emploient ou non des salariés, aux risques de chutes des échelles et à leur proposer une aide financière pour s’équiper de plateformes sécurisées.
M. le coprésident Pierre Morange. Comment s’opère l’articulation avec la médecine et l’inspection du travail ?
M. Stéphane Sellier. C’est une question complexe. Dans mes fonctions précédentes à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, j’avais déjà essayé de rapprocher les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail des services de santé au travail. La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail associe désormais les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail à la gouvernance de la médecine du travail. En s’appuyant sur elle, le Régime social des indépendants pourra mieux déployer ses initiatives. Mais il faut, pour cela, pouvoir mobiliser les acteurs à l’échelon local, dont les branches professionnelles.
Dans une optique purement médicale, pourra-t-on impliquer durablement les médecins traitants dans un domaine un peu extérieur à leur champ d’action traditionnel ?
M. le rapporteur. Et leur assigner des indicateurs de performance ?
M. Stéphane Sellier. Il faudrait que les conventions médicales le stipulent.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelles sont vos relations avec les agences régionales de santé ?
M. Stéphane Sellier. Elles dépendent évidemment de chaque région. Par exemple, pour la partie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui dépend de notre caisse de Marseille, celle-ci coopère avec l’agence régionale de santé pour faire face au défaut de vaccination ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, dans le cadre d’un programme spécifique.
Mme Stéphanie Deschaume. Le Régime social des indépendants est membre des commissions de prévention des agences régionales de santé, où se définissent les programmes qui dépendent du schéma régional de prévention. Le régime s’associe, en tant que de besoin, aux différentes actions correspondantes, selon les thèmes prioritaires retenus : dépistages, vaccinations, hygiène bucco-dentaire, par exemple. Toutes nos caisses sont donc impliquées en fonction de l’état d’avancement dans chaque région, du schéma de prévention.
M. le rapporteur. La principale difficulté consiste à favoriser les initiatives locales et professionnelles. Vous en avez fourni de bons exemples avec les peintres, les coiffeurs et les boulangers. Nous connaissons aussi la nécessité de coordonner les grandes campagnes nationales de prévention.
La transmission des données de santé se fait-elle convenablement ? Plusieurs programmes ont été ici évoqués, manquant d’indications statistiques indispensables pour certaines affections. La commission présidée par M. Christian Babusiaux sur l’accès des assureurs complémentaires aux données de santé préconisait, en 2003, un accès aux données sur les feuilles de soins électroniques transmises grâce à la carte Vitale. Quelle est la position du Régime social des indépendants à ce sujet ?
M. Stéphane Sellier. Nous nous situons plutôt dans la ligne du régime général. Nous ne divergerons probablement pas de la position de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés sur cette question sensible. Nos prestations sont en effet servies par des organismes conventionnés dans le cadre du respect du secret médical.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels sont les coûts de gestion du Régime social des indépendants ? Sont-ils plutôt comparables à ceux du régime général obligatoire ou à ceux des mutuelles ?
M. Stéphane Sellier. Les sections locales mutualistes gèrent les assurés affiliés au régime général mais dont les prestations sont servies par les mutuelles. Dans ce cadre, nos coûts de gestion s’élèvent à environ 40 ou 50 euros par personne couverte, soit un ordre de grandeur comparable.
M. le coprésident Pierre Morange. Madame, monsieur, nous vous remercions.
*
AUDITIONS DU 17 NOVEMBRE 2011
Audition de MM. Pierre Chirac et Philippe Schilliger, rédacteurs de la revue Prescrire.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Le développement de la prévention fait l’unanimité. Mais, parmi les nombreux rapports qui ont été récemment publiés sur le sujet, celui de la Cour des comptes déplore une absence de pilotage au niveau national. En tant qu’acteurs d’une revue indépendante, que pensez-vous de notre système de prévention sanitaire ?
M. Pierre Chirac, rédacteur de la revue Prescrire. Prescrire, qui compte 36 000 abonnés, médecins, pharmaciens et étudiants dans les professions de santé, est surtout connue pour ses analyses sur les médicaments. Une partie de notre revue est néanmoins consacrée à l’évaluation des stratégies de diagnostics et des stratégies thérapeutiques. Dans ce cadre-là, il nous arrive fréquemment d’évoquer la prévention, que celle-ci soit dispensée à titre individuel de la part des soignants ou collectivement dans le cadre de programmes de prévention.
M. Philippe Schilliger, rédacteur de la revue Prescrire. Avec l’affaire du Mediator, en 2011, il semble bien que la société, dans son ensemble, ait pris conscience que les médicaments n’avaient pas que des effets positifs, et qu’il valait mieux s’intéresser à leur balance bénéfice-risque avant de décider de leur utilisation. Malheureusement, cette prise de conscience ne se vérifie pas dans le domaine de la prévention.
Je prendrai l’exemple des campagnes de dépistage du cancer du sein par mammographie, qui suscitent bien des interrogations.
Ces campagnes sont positives, parce qu’il s’agit d’inciter le plus possible de femmes à participer à ce dépistage. Mais les brochures ne font que suggérer le problème des dépistages « faux négatifs » – tous les cancers ne sont pas dépistés – et abordent d’une seule phrase, assez lapidaire, celui des « faux positifs ». Or, d’après les données dont nous disposons aujourd’hui, le bénéfice que peuvent tirer les femmes de ce dépistage est au mieux très modéré : d’assez nombreuses femmes sont inquiétées à tort et doivent subir des ponctions et des biopsies, qui sont des actes invasifs ; les interventions lourdes, qu’un dépistage précoce est censé éviter, sont toujours aussi nombreuses.
Ces questions apparaissent peu dans le débat public et pas du tout, ou très peu, dans l’information dispensée aux femmes. La loi n° 2004-206 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, puis le plan Cancer 2009-2013, ont fixé comme objectif un dépistage à hauteur de 80 %. Cet objectif a été repris par la sécurité sociale, notamment dans la convention médicale précédente, laquelle incitait les généralistes à délivrer une information incitative destinée à vaincre les réticences. Les contrats d’amélioration de pratiques individuelles en ont fait une incitation financière, qu’on retrouve dans la convention médicale de 2011.
N’est-ce pas en contradiction avec la nécessaire information raisonnable des patientes et avec la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ? Selon ce texte, toute personne à qui l’on propose une intervention médicale doit être informée des bénéfices qu’elle peut en attendre et des risques qu’elle court si elle s’y soumet ou si elle la refuse. Cette situation témoigne en tout cas de l’insuffisante prise en compte des avantages et des inconvénients ou des bénéfices et des risques des interventions médicales. C’est d’autant plus regrettable que l’on est dans le domaine de la prévention et que l’on s’adresse à des personnes qui ne sont pas malades.
M. le rapporteur. Que pensez-vous des indicateurs ? Par exemple, il est admis que 80 % des femmes doivent se faire dépister pour que l’on puisse espérer faire baisser les statistiques de la mortalité liée au cancer du sein.
Vous avez déploré par ailleurs le nombre des « faux positifs ». Mais je ne suis pas sûr qu’on puisse les éviter et, de toute façon, ils ne conduisent pas à des opérations mutilantes. En revanche, j’aimerais savoir si l’on peut éviter de pratiquer des interventions importantes pour des cancers qui auraient évolué très lentement – problème qui a été soulevé par la Cour des comptes dans sa communication.
M. Philippe Schilliger. Je ne pense pas que l’on puisse répondre aujourd’hui à votre question.
Malgré tout, on commence à s’interroger, dans la littérature internationale, sur la méthode et sur les procédures liées au dépistage. De très belles synthèses ont été réalisées par des équipes indépendantes comme celles de Cochrane sur les études relatives au dépistage du cancer du sein. Les questions que l’on peut se poser sont les suivantes : dans le dépistage du cancer du sein, qui est une opération de prévention généralisée portant sur une vaste population, sait-on vraiment quel est l’objectif poursuivi ? Y a-t-il une évaluation permanente et indépendante des équipes qui pratiquent le dépistage ?
Prescrire suit en permanence le dossier du cancer du sein. Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de vous donner des détails techniques, mais il est certain que le problème des « faux positifs » est lié à la qualité de lecture des mammographies.
M. Pierre Chirac. Il y a quatre ou cinq ans, Prescrire a publié un article critique sur le dépistage, ses limites et ses effets indésirables. À l’époque, cela a beaucoup surpris. Certains journaux féminins ont jugé cet article inadmissible. Or aujourd’hui, la littérature internationale, comme British Medical Journal et Cochrane Review notamment, fait état de plus en plus souvent des évaluations sur du long terme et sur de grands échantillons, qui soulignent les limites du dépistage.
Nous ne sommes pas contre la prévention, ni le dépistage, loin de là. Simplement, nous pensons qu’il est indispensable, lorsque l’on mène une politique de santé publique, de dire la vérité. Si on ne le fait pas, comme il s’agit d’interventions sur des personnes qui ne sont pas malades, les conséquences défavorables risquent d’être extrêmement mal perçues. Dans le domaine de la vaccination, c’est évident.
M. le rapporteur. Les personnes ne sont pas malades ? Mais on peut leur trouver, par exemple, une lésion au sein.
M. Pierre Chirac. Absolument, car il existe plusieurs niveaux de prévention : primaire, secondaire.
Il faut faire très attention aux messages qui sont délivrés, respecter le libre choix des personnes et leur fournir tous les éléments, en l’occurrence le bénéfice attendu du dépistage, ses limites et ses effets indésirables. Il est tout à fait possible, en donnant une telle information, d’obtenir de bons taux de participation.
Une étude sur le dépistage du cancer colorectal, réalisée en Allemagne auprès de 1 500 personnes, récemment publiée dans le British Medical Journal, en atteste. Il s’agissait de présenter à ces personnes, soit la brochure officielle qui n’attirait l’attention que sur les bénéfices du dépistage, soit une brochure beaucoup plus complète qui en montrait les limites et les effets indésirables. Plusieurs critères ont été retenus : le fait d’avoir un bon niveau de connaissance sur ce cancer, sur sa prévalence, sur les performances du test. Les personnes qui ont eu en leur possession la brochure complète avaient un niveau de connaissance bien supérieur, ont fait un choix beaucoup plus informé et, globalement, ont autant participé que les autres au dépistage – dont l’intérêt, selon Prescrire, était d’ailleurs modeste.
La crainte des soignants et des acteurs de santé publique est que, si l’on parle des effets indésirables des médicaments ou des campagnes de santé publique, les gens ne suivent pas le traitement ou ne se font pas dépister. Or cette étude allemande et d’autres études montrent qu’une telle crainte est infondée. En 2011, ne pas dire la vérité aux gens, que ce soit sur un vaccin, un dépistage ou un médicament, crée de la défiance. C’est un point sur lequel nous voulons insister.
M. le rapporteur. La double lecture et la qualité des mammographies constituent un progrès. Mais il me semble que les femmes qui se font dépister aujourd’hui sont celles qui étaient déjà suivies et que l’on a beaucoup de peine à atteindre les populations dites « défavorisées », qui ne sont pas spontanément intéressées par le dépistage.
Cela dit, le cancer du sein pose des problèmes compliqués, au contraire du cancer de la prostate. Je comprends d’autant moins les difficultés que l’on rencontre en ce domaine. Nous savons qu’à partir d’un certain âge, le dosage du taux de PSA (pour, en anglais, Prostate Specific Antigen) ne présente pas d’intérêt. Pourtant, on continue à le pratiquer, avec pour conséquence des interventions chirurgicales inutiles et mutilantes. Comment éviter cette situation ?
M. Philippe Schilliger. Il convient de distinguer l’évaluation d’un bénéfice-risque pour un individu de l’évaluation collective d’une action de prévention. Si l’on souhaite amener 80 % des femmes à se faire dépister, c’est pour avoir une idée de l’efficacité d’une action de prévention collective.
Il faut résoudre une équation entre, d’une part, le libre choix et le principe d’autonomie des personnes et, d’autre part, les études de coût-efficacité et, surtout, de coût-bénéfice pour la société. Une action de prévention est coûteuse.
Pour Prescrire, les évaluations individuelles doivent primer : pas d’action sans appréciation des avantages et inconvénients, des bénéfices et des risques individuels, avant de passer à une action collective, en toute connaissance de cause, de la part de toutes les parties prenantes.
S’agissant du cancer de la prostate, nous pouvons nous demander pourquoi nous ne sommes pas parvenus à arrêter les dépistages spontanés alors que toutes les évaluations scientifiques et tous les scientifiques qui prennent position annoncent qu’il vaudrait mieux ne pas effectuer d’examen de taux de PSA, surtout à partir d’un certain âge – et que cela ne relève pas de la prévention. J’imagine que personne n’a de solution toute faite à proposer.
Il est pourtant possible d’arrêter un programme de dépistage. Je peux vous citer le cas du neuroblastome de l’enfant, une tumeur rare mais grave, que l’on désirait détecter précocement pour éviter des traitements lourds et mutilants. Cette détection a été expérimentée en 1990 dans différents pays et en France dans différentes régions, dont la région Rhône-Alpes. Le test était simple et les professionnels, les centres anticancéreux et les familles y ont adhéré. Mais les évaluations ont montré qu’on ne détectait chez les nouveau-nés que des tumeurs dont la plupart auraient régressé spontanément. C’est pourquoi, en 1998, on a arrêté ce dépistage.
De la même façon, pour pouvoir décider l’arrêt du dépistage du cancer de la prostate, il faudrait s’appuyer sur tous les acteurs – familles, médecins, scientifiques et autorités publiques. On devrait disposer de toutes les données et en discuter collectivement.
Notre position est claire : si l’on décide d’un dépistage, il est nécessaire qu’il soit organisé, pour bénéficier de procédures qui ont fait leur preuve, avec au moins la sécurité d’une double lecture pour ce qui concerne les mammographies. Nous ne voulons pas de dépistage spontané, individuel.
M. le rapporteur. Qui décide d’un dépistage et sur quelles données ?
M. Philipe Schilliger. Une autorité publique doit être capable, pour le compte de la population qu’elle a accepté de prendre en charge, de décider en toute transparence des dépistages. Dans le paysage actuel, nous n’imaginons pas que ce soit une agence spécialisée qui en décide. Un directeur général de la santé, par exemple, peut être chargé du dépistage et en être responsable.
M. le rapporteur. On doit pouvoir s’appuyer sur les travaux d’experts indépendants…
M. Philippe Schilliger. …et sur tous les autres acteurs. J’imagine la tenue d’une conférence nationale de santé…
M. le rapporteur. …ou une conférence de consensus.
M. Pierre Chirac. En premier lieu, il faut établir un relevé épidémiologique pour dresser un état des lieux de la morbi-mortalité, savoir si la prévention est possible et établir des priorités. S’agissant de santé publique et du lancement de campagnes d’information destinées à modifier les comportements, il est important d’y associer la population, d’une façon ou d’une autre.
Plusieurs acteurs sont tentés d’intervenir. Par exemple, la sécurité sociale avec les contrats d’amélioration de pratiques individuelles qui incitent à un dépistage individuel du cancer du sein ; ou, selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la pharmacie, des acteurs privés qui vont mettre en place un certain nombre de tests dans les pharmacies – sans compter les tests à domicile, les tests médicaux, car tout un marché du diagnostic se prépare.
Nous avons intérêt à mettre en place une organisation collective qui associe, notamment, les représentants des usagers de la santé, et pas seulement des patients car une partie des interventions concernent des personnes qui ne sont pas encore malades.
Il faut tirer des leçons de la grippe H1N1. Le fait de ne pas avoir associé à la campagne de vaccination des acteurs clés comme les médecins généralistes a eu des effets très regrettables qui se font encore sentir – à commencer par la défiance de la population.
M. le coprésident Jean Mallot. Dans le domaine de la santé, on doit toujours mettre en balance les bénéfices et les risques, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif. Il faut coordonner les initiatives, rassembler les données scientifiques, prendre des positions éclairées, mais c’est l’État qui, à un certain moment, doit dégager l’intérêt général.
Néanmoins, vous êtes aussi des gens de communication. À ce titre, pouvez-vous nous dire comment on peut informer et communiquer sur tous ces sujets afin d’éviter les messages erronés et les malentendus ? Qui communique et, éventuellement, qui fait de la publicité ?
M. Philippe Schilliger. J’ai affirmé tout à l’heure que nous n’imaginions pas qu’une agence spécialisée puisse prendre en charge une décision de santé publique. Pour les autres acteurs, c’est la même chose. Prenez l’exemple de la prévention des cancers du col utérin, qui repose sur un examen régulier – par frottis – destiné à dépister des lésions, si possible avant qu’elles ne donnent lieu à un cancer. Des vaccins ont été développés contre le papillomavirus à l’origine de ces lésions. Or la communication sur ces vaccins a surtout été le fait des firmes qui les fabriquent.
M. le coprésident Jean Mallot. Pensez-vous qu’actuellement le système ne soit pas suffisamment performant pour éviter les dérives ?
M. Philippe Schilliger. Effectivement, et nous l’avons déclaré dans d’autres enceintes. S’agissant du médicament, c’est une évidence.
Au cours des Assises du médicament, nous avons affirmé qu’il fallait veiller à ne pas mélanger l’intérêt général et les intérêts privés, quels qu’ils soient – notamment l’intérêt des entreprises ou de certains professionnels de santé. De fait, s’agissant du dépistage du cancer de la prostate, les urologues sont davantage concernés que les firmes. Plus généralement, chaque acteur du système a un intérêt, qui peut être particulier, à telle ou telle action. Et la pression de l’opinion publique et l’aspect émotionnel de la question ne doivent pas être négligés non plus. C’est donc bien à une autorité publique, légitime, de régulation qu’il revient de fixer les priorités et de décider.
La « conférence de consensus », évoquée par monsieur Jean-Luc Préel, est une méthode parfaite pour établir le consensus du moment, en toute transparence, en pondérant les arguments et en prenant en compte les différents intérêts. Dans une telle configuration, un jury fait une proposition qui n’entraîne pas forcément une action, mais il prend une position argumentée à partir des données qui lui sont présentées. C’est une des voies possibles pour mettre au point des stratégies et des plans de prévention et de santé publique à la fois raisonnables, évaluables, et peut-être réalisables. Et si tous les acteurs sont impliqués, peut-être pourra-t-on disposer d’une évaluation du bénéfice-risque et d’une évaluation des coûts étayées, permettant de maîtriser le processus.
M. Pierre Chirac. Je voudrais revenir sur la question importante de la formation et sur la campagne sur le vaccin contre le papillomavirus humain, à l’occasion de laquelle une firme s’adressait aux mères en leur demandant : « Aimez-vous votre fille ? » Nous comprenons très bien l’efficacité commerciale d’un tel message culpabilisateur. Mais celui-ci est totalement inacceptable. Dans un message de santé publique, selon Prescrire, il convient d’avoir un discours de vérité, de présenter les avantages et les inconvénients d’une action, afin de permettre des échanges éclairés entre les soignants, les patients et les usagers du système de santé.
M. le coprésident Jean Mallot. Cet exemple, qui n’est pas isolé, nous conduit au moins à nous interroger. Comment a-t-on pu autoriser ce genre de messages ? Sur quels arguments s’est-on fondé ? Les modifications législatives en préparation sont-elles de nature à éviter qu’ils ne perdurent ?
M. Pierre Chirac. Le Sénat avait supprimé toute possibilité, pour les firmes, de faire des campagnes de vaccination. Je ne sais pas ce qui a été adopté hier par la Commission des affaires sociales, mais je pense qu’il y a été dit qu’il était impossible de l’interdire, puisque le cas était déjà prévu par la directive européenne. Quoi qu’il en soit, la position de Prescrire est de ne pas autoriser les firmes à faire de la publicité auprès du grand public.
Je voudrais attirer l’attention sur le fait que la Commission européenne a proposé une nouvelle version de sa directive sur la possibilité, pour les firmes pharmaceutiques, de communiquer auprès du grand public sur des médicaments de prescription. Les versions précédentes avaient été rejetées par le Parlement européen et, globalement, par le Conseil, même s’il ne s’était pas officiellement exprimé. En effet, de nombreux pays, dont la France, étaient défavorables à ce qui constituerait un élargissement, le droit actuel permettant déjà aux firmes de communiquer sur les pathologies – sans viser, il est vrai, un médicament précis.
Le nouveau texte devrait permettre aux firmes, sinon de communiquer directement, du moins de mettre à la disposition du grand public, par l’intermédiaire de professionnels de santé, médecins ou pharmaciens, des informations sur les médicaments de prescription. Cela nous inquiète beaucoup parce que l’expérience prouve que les médecins et les pharmaciens ne se préoccupent pas toujours des informations qu’ils mettent à la disposition du public. Plutôt que de l’élargir, il vaudrait mieux limiter la possibilité pour les firmes de communiquer des informations sur la santé ou sur les produits de santé.
Les députés français ont tenté de faire en sorte que les messages utilisés par les firmes soient les plus proches possibles de ceux des experts en matière de santé publique. Seulement, il ne suffit pas d’imposer certaines mentions minimales obligatoires sur le support du message publicitaire, écrit ou audiovisuel : ce qu’il faut contrôler, c’est le fond du message – le message subliminal. Or, on ne le fait jamais.
M. le rapporteur. Il semble que, pour éradiquer une maladie, le taux de vaccination de la population doive se situer entre 75 % et 80 %. Pensez-vous que le vaccin soit un moyen utile de prévention ? Peut-il faire disparaître certaines maladies ? Dans l’affirmative, faut-il décider d’une vaccination collective et obligatoire ? Comment faire respecter cette obligation ?
M. Philippe Schilliger. On ne peut pas vous répondre sur les vaccinations en général. On ne peut que répondre, vaccin par vaccin, à différentes questions. Que veut-on éviter ? Quel est le risque absolu face à telle pathologie, pour une population donnée ? Quelles actions se donne-t-on ? Là encore, il s’agit de faire la balance entre ce que l’on peut espérer et le prix humain et collectif que l’on est prêt à payer.
Un taux vaccinal de 70 % est sans doute un peu faible pour certaines maladies infectieuses. Pour la rougeole, en particulier, il vaudrait mieux qu’il soit plus élevé. En effet, on assiste actuellement à une recrudescence des épidémies de rougeole, qui risquent de s’intensifier.
Il y a très peu de vaccinations obligatoires. Par exemple, la vaccination ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole n’est que recommandée. En revanche, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires et inscrites dans la loi.
La vaccination contre la variole n’est plus obligatoire depuis les années 1970. Ce n’était plus un objectif de santé publique. En outre, l’État était confronté à des problèmes de responsabilité.
Enfin, la suppression de l’obligation de la vaccination contre la tuberculose s’appuie sur des arguments épidémiologiques qui semblent très sérieux : la vaccination ne joue plus son rôle dans la période actuelle, sauf pour certaines populations bien ciblées.
Il convient donc de bien déterminer quelle est la population ciblée, quel est l’objectif poursuivi, quels moyens sont utilisés, notamment pour convaincre les individus de se faire vacciner. Encore une fois, l’information doit être honnête, claire, étayée et efficace.
On peut s’étonner que l’information soit dispensée par certains acteurs, notamment par les firmes, dont on peut déplorer les démarches commerciales, sans que soient utilisés des moyens collectifs publics pour dispenser une contre-information solide, efficace et sincère.
Prenons l’exemple du dépistage du cancer de la prostate. Où se trouve l’information des organes de santé publique nationaux annonçant qu’il ne faut pas recourir au dosage du taux de PSA ? Quelles actions ont été entreprises pour essayer de limiter ne serait-ce que les prescriptions spontanées de dosage du PSA ou pour délivrer une contre-information sur les tests à domicile qui seront bientôt disponibles sur le marché ?
Quand la vaccination apparaît justifiée par une balance bénéfice-risque favorable, Prescrire recommande à ses lecteurs de la proposer aux patients. Ensuite, c’est aux pouvoirs publics d’agir : rendre une vaccination obligatoire est un acte d’autorité publique.
M. le rapporteur. Les vaccins ont permis d’éliminer la variole, la poliomyélite et le tétanos. Que pensez-vous du vaccin contre l’hépatite B ?
M. Philippe Schilliger. Pour nous, la balance bénéfice-risque de ce vaccin reste favorable et les patients ont intérêt à ce que les soignants le leur proposent. Mais je parle de la période actuelle et non des campagnes de vaccination généralisée contre l’hépatite B.
M. le rapporteur. Comment expliquez-vous qu’une grande partie de la population, y compris parmi les professions de santé, ait pu remettre en cause le bien-fondé de cette vaccination ?
M. Pierre Chirac. Prescrire est arrivé à la conclusion que ce vaccin avait une balance bénéfice-risque favorable pour certains individus, mais pas nécessairement pour l’ensemble de la population. Certains n’ont pas compris notre position et nous ont critiqués.
Il faut d’abord évaluer la balance bénéfice-risque chez certaines populations, ensuite s’interroger sur la généralisation du vaccin à l’ensemble de la population et enfin savoir comment informer la population et l’inciter à se faire vacciner. Ce sont trois stades bien différents, et la configuration est la même qu’il s’agisse du vaccin contre le cancer du col de l’utérus, contre l’hépatite B ou la grippe H1N1. En l’occurrence, le vaccin contre l’hépatite B a été généralisé de façon abusive, et sans doute a-t-on dissimulé certaines informations sur ses effets indésirables.
Au niveau individuel, la prise en compte d’effets indésirables aboutit à un pari : vais-je ou non rencontrer ces problèmes ? Collectivement, elle s’explique, si l’on essaie de valoriser la balance bénéfice-risque en limitant la vaccination aux groupes qui en retireront le plus grand bénéfice. Le risque devient alors plus acceptable.
La généralisation abusive de la vaccination contre l’hépatite B a contribué à renforcer le mouvement « antivaccination », qui existait déjà en France et qui soulève indéniablement des difficultés. C’est ainsi qu’il sera difficile d’atteindre un taux de vaccination de 90 % ou 95 %, qui serait pourtant utile, pour lutter efficacement contre la rougeole.
Dans sa communication, la Cour des comptes suggère d’utiliser le colloque singulier entre le médecin et son patient pour proposer des vaccinations. Nous sommes dans cette logique, car nous ne sommes pas favorables à ce qui relève de l’obligatoire ou d’une logique commerciale. Établir une relation de confiance entre les soignants et les soignés favoriserait la prise de décisions partagées et serait le moyen de toucher tout le monde, y compris les populations plus éloignées du système de soins.
M. le coprésident Jean Mallot. Au détour d’une phrase, vous avez soulevé la question des conflits d’intérêts. Comment ceux-ci interviennent-ils ? Comment les maîtriser et les éviter ?
M. Pierre Chirac. L’actuel projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé contient de nombreuses dispositions intéressantes. Prescrire sera très attentif à leur mise en œuvre.
Dans le domaine du vaccin, les risques de conflits d’intérêts sont encore plus importants que dans le domaine du médicament : d’une part, il y a très peu de producteurs - dont un seul producteur français d’importance, auquel les experts sont probablement tous liés – ; d’autre part, jusqu’à une période récente, l’évaluation des vaccins était particulièrement indigente. Aujourd’hui, les essais cliniques sont de meilleure qualité, cette évaluation doit être encore renforcée avant et après la mise sur le marché des vaccins, et il convient de procéder de manière attentive au recueil des effets indésirables. C’est pourquoi, il est nécessaire d’être particulièrement vigilants.
M. le coprésident Jean Mallot. À mon sens, on doit avoir une approche plus extensive des conflits d’intérêts. C’est ce qui ressort des observations de la Cour des comptes à propos de la lutte contre l’obésité et de ses analyses sur les produits alimentaires, notamment à destination des enfants. En effet, pour lutter contre l’obésité, il faut s’attaquer à certains produits alimentaires consommés par les enfants, et donc limiter la publicité dont ces produits font l’objet. Mais si l’on restreint cette publicité, les ressources de l’audiovisuel sont affectées. Des conflits d’intérêts existent donc bien à ce niveau aussi. Comment faire, sinon s’en remettre à une volonté politique ?
M. Pierre Chirac. Exactement. Nous avons été consternés qu’une députée de la majorité ait dû abandonner une mesure forte d’interdiction de la publicité pour les produits alimentaires gras, salés ou sucrées lors des émissions de télévision pour enfants, Mme Roselyne Bachelot-Narquin lui ayant promis, au dernier moment, que l’on rédigerait une charte sur le sujet. Or, on sait très bien que les chartes n’aboutissent qu’à peu de résultats.
Comme le souligne la Cour des comptes, la prévention vise à modifier des comportements et fait appel à la responsabilité personnelle. Je remarquerai, pour ma part, que la prévention suppose un meilleur niveau de connaissances sur la santé, auquel l’école peut contribuer.
Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux devant l’information et nous n’avons pas tous la capacité de nous projeter dans l’avenir. Il est donc parfois plus équitable d’édicter des interdictions. Pour lutter contre l’obésité, l’interdiction de la publicité en faveur de produits sucrés, salés et gras, à l’heure des émissions consacrées aux enfants, nous semble être une bonne solution – adoptée d’ailleurs dans d’autres pays.
M. le rapporteur. La Cour des comptes a montré qu’il y avait un défaut de pilotage de la prévention au niveau national. Il n’y a pas de vraie coordination entre les caisses d’assurance maladie, l’Éducation nationale, la médecine du travail, entre autres. Qu’en pensez-vous ? Comment améliorer le système ?
M. Philippe Schilliger. Il faut d’abord que l’on soit collectivement convaincu de l’objectif à atteindre. À partir de là, seuls les pouvoirs publics auront la légitimité nécessaire pour diriger l’orchestre et coordonner le jeu de tous les acteurs.
La difficulté qui peut survenir est celle de la faiblesse du dispositif. De fait, dans de nombreuses actions de prévention, nous avons l’impression qu’on ne sait plus quel est l’objectif que l’on cherche à atteindre, ni qui pilote.
Le pilotage s’appuie sur quatre piliers : impliquer tout le monde, tenir compte des intérêts et des conflits d’intérêts, évaluer et informer en permanence. Nous serions enchantés si, un jour, s’affirmait un pilote de santé publique, explicite, disposant d’une autorité sur les autres acteurs et capable de les faire intervenir en cohérence.
M. le rapporteur. Quel rôle a joué l’assurance maladie dans la mise en place des indicateurs concernant le dépistage du cancer du sein ? La décision vient-elle de l’assurance maladie elle-même ou du ministère ?
Par ailleurs, nous avons auditionné la semaine dernière des représentants de Groupama. Cet assureur a passé avec la Mutualité sociale agricole un accord portant sur un rétinographe mobile, qui permet de transmettre par TéléSanté à un ophtalmologiste les clichés des examens de patients souffrant de diabète et d’hypertension artérielle. Mais Groupama ne connaît pas qui, parmi sa population adhérente, souffre de diabète ou d’hypertension. Or la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est très jalouse de ses propres données.
Que pensez-vous du partage des données de santé entre les différents acteurs ?
M. Philippe Schilliger. Que l’assurance maladie défende ses assurés, soit toute la population du territoire, paraît assez logique. En outre, qu’elle consacre une partie de son budget à des actions de promotion de la santé et de contrôle des actes et des procédures, et qu’elle participe à l’évaluation nous semble aussi bien légitime. Cela fait des années que nous le réclamons.
Il semble bien, d’après les informations dont nous disposons et à la suite du travail que nous avons mené sur les contrats d’amélioration des pratiques individuelles, que de nombreuses actions aient été initiées par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Certes, les relations entre cette caisse et l’État sont à organiser. Mais, ce qui nous intéresse d’abord, c’est l’intérêt général. En l’occurrence, nous ne pouvons que nous réjouir de l’implication de la sécurité sociale.
S’agissant des indicateurs, beaucoup d’entre eux ne nous conviennent pas parce qu’ils sont purement quantitatifs et qu’ils ne peuvent garantir en rien la qualité des soins individuels. Il ne suffit pas de dire qu’il faudrait prescrire à 80 % des diabétiques, des hypocholestérolémiants ou de l’aspirine : encore faut-il que les diabétiques concernés en aient besoin. Les indicateurs purement quantitatifs sont des indicateurs d’activité, qui peuvent, au mieux, inciter les professionnels à s’interroger sur les soins qu’ils administrent.
En conclusion, je dirai que certains indicateurs nous conviennent, que d’autres nous paraissent contestables et que d’autres encore nous semblent carrément hors de propos. Nous pourrons vous donner des détails supplémentaires, car nous avons écrit sur le sujet.
S’agissant des données de santé, notre position est claire : ce sont des données publiques qui appartiennent à la collectivité et qui doivent donc être accessibles à tous les acteurs à partir du moment où elles sont anonymisées, où les protocoles sont clairs, validés par une instance qui décide sur des critères explicites que les objectifs poursuivis sont légitimes.
Au passage, je rappelle que l’Institut des données de santé a autorisé Prescrire à utiliser les données qui concernaient les médicaments prescrits contre la maladie d’Alzheimer. Il l’a fait parce qu’il y a vu un intérêt de santé publique.
Ces données existent et il serait dommage qu’un acteur, aussi puissant soit-il, se les approprie : elles sont publiques et l’assurance maladie n’en est que le dépositaire.
M. le coprésident Jean Mallot. L’article 1er de la Constitution renvoie à la Charte de l’environnement, qui prévoit l’application du principe de précaution pour prévenir des dommages incertains affectant l’environnement – mais pas explicitement la santé. Comment abordez-vous ce genre de problématique ? L’affaire du Mediator a montré comment on pouvait prendre position sur des risques non avérés et comment on pouvait appliquer, ou ne pas appliquer, ce principe de précaution dans le domaine de la santé. Mais il faut éviter la confusion entre la prévention et le principe de précaution. Quelle est votre position ?
M. Pierre Chirac. Nous n’appliquons pas le principe de précaution. Nous nous fondons sur la balance bénéfice-risque, rapportée à la situation de la gravité de la pathologie dans la population concernée.
Dans toute activité médicale, il y a une part d’incertitude. Par exemple, un médicament n’est jamais efficace à 100 % – et n’a jamais d’effets indésirables à 100 %. Si l’on appliquait le principe de précaution, on ne pourrait pas aller très loin. On raisonne donc à partir de faisceaux d’arguments pour vérifier que les bénéfices d’un médicament, par exemple, sont supérieurs aux effets indésirables qu’il risque d’entraîner.
Prescrire attire l’attention de ses lecteurs sur les effets indésirables parce que, dans la formation des médecins et des soignants, initiale ou continue, cet aspect est sous-estimé. Il n’est pas non plus mis en avant dans les publications sur les essais cliniques. Il est clair que les investigateurs sont surtout intéressés par le progrès que représentera tel ou tel nouveau médicament. Il est admirable d’espérer améliorer la situation de tel ou tel patient, mais encore faut-il se préoccuper de ne pas lui nuire. Il doit en être de même au niveau des décisions de santé publique. Là aussi, il faut avoir constamment à l’esprit les deux côtés de la balance.
Concernant le Mediator, nous avions des faisceaux d’indices qui nous faisaient penser que, compte tenu de la nature chimique du benfluorex, il y avait de forts risques qu’il entraîne les mêmes problèmes que les autres dérivés de la même famille.
M. le coprésident Jean Mallot. Dans ce cas précis, on ne peut pas parler de principe de précaution. Il me semble pourtant que votre approche n’en soit pas très éloignée.
M. Pierre Chirac. De par notre activité de veille documentaire et d’analyse des résultats d’essais cliniques, nous sommes sûrs qu’au moment de l’autorisation de mise sur le marché, les éléments les plus bénéfiques du médicament sont exposés, les firmes ayant intérêt à les communiquer. Mais nous sommes également certains que seul le minimum de ses effets indésirables est porté à la connaissance de l’autorité concernée. D’autres effets indésirables risquent de se manifester : d’abord parce le médicament va être administré à un plus grand nombre de patients ; ensuite et surtout – c’est avéré à la faveur de nombreux procès – parce que les firmes dissimulent d’une façon ou d’une autre des données concernant ces effets indésirables.
Dans ces conditions, nous considérons que le doute doit bénéficier au patient. Cela aide à prendre les bonnes décisions, sans recourir nécessairement au principe de précaution.
M. le rapporteur. Le doute peut jouer dans les deux sens !
M. Philippe Schilliger. Il n’empêche que c’est un pari : à dix contre un, on espère gagner, mais à trois contre sept, on risque de perdre. Et il convient de partager cette incertitude avec celui qui va jouer et courir le risque.
Ce qui est valable au niveau individuel est valable au niveau collectif. Il est tout à fait légitime d’entreprendre une action collective de prévention si elle est évaluée de façon explicite et permanence.
Nous n’avons sans doute pas le temps de vous parler longuement des effets indésirables graves liés aux soins. Sachez toutefois que les nombreuses études menées sur le sujet montrent que la moitié d’entre eux auraient pu être évités.
Si l’on extrapole les conclusions des études américaines, on peut en déduire qu’il y a chaque année dans notre pays entre 10 000 et 20 000 décès par effets médicamenteux indésirables. Selon les récentes études françaises de l’enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins, on compte 1 000 effets indésirables pour 10 000 consultations en soins de premier recours, et peut-être une dizaine d’effets indésirables pour 1 000 journées d’hospitalisation. Enfin, une hospitalisation sur vingt serait liée à un effet indésirable grave, lequel met en jeu le pronostic vital.
Les études menées par l’enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins entre 2004 et 2009 ne montrent aucun progrès dans les chiffres globaux. C’est un sujet d’interrogation, en tout cas pour les soignants et pour Prescrire. En effet, la prévention des effets potentiellement évitables est une belle cause de santé publique qui demande la mobilisation de nombreux acteurs.
La prévention touche donc de nombreux secteurs. Elle ne se traduit pas forcément dans une loi de santé publique, mais par la fixation de quelques objectifs de santé publique bien compris, concernant l’obésité, le diabète et l’hypertension, les médicaments, les erreurs médicamenteuses et les erreurs de soins en général.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous faire savoir quels sont les points qui vous paraissent importants et que vous n’avez pas eu l’occasion d’aborder ?
M. Pierre Chirac. Un seul n’a pas été évoqué : les seuils d’intervention en traitement préventif, par exemple, de l’hypertension ou du diabète. Il est bon de faire baisser le taux d’hémoglobine glyquée. Mais si on le fait trop baisser, cela devient nocif pour le patient. Il convient, là encore, de faire la balance entre les bénéfices et les risques.
M. le rapporteur. Nous avons entendu que les firmes, qui sont des multinationales, interviennent auprès de l’Organisation mondiale de la santé pour faire baisser les normes et les seuils. Évidemment, plus on baisse les seuils de la glycémie ou de la tension artérielle, plus on a besoin de médicaments. Est-ce un fantasme ?
M. Philippe Schilliger. Non ! Les seuils qui semblent raisonnables pour obtenir un bénéfice dépendent beaucoup de ceux qui les émettent.
Ainsi, l’International Society of Hypertension, qui n’est pas dénuée de conflits d’intérêts, a fixé pour le compte de l’Organisation mondiale de la santé des seuils de plus en plus bas. Bien sûr, si vous abaissez le seuil d’hypertension, vous augmentez ipso facto le nombre d’hypertendus. La Société européenne d’hypertension, quant à elle, a retenu une autre définition, qui mérite d’être rappelée : le seuil d’intervention est celui au-dessus duquel on fait plus de bien que de mal.
Les normes actuellement utilisées en France sont relativement raisonnables. En revanche, le bénéfice que l’on peut attendre d’un traitement hypertenseur en prévention primaire – on traite un facteur de risque – est limité, puisqu’il faut traiter environ 1 000 personnes pendant deux à six ans pour espérer éviter quelques accidents vasculaires cérébraux ou quelques infarctus du myocarde, qui ne sont pas forcément mortels. Cela signifie que l’évaluation de l’intervention thérapeutique doit être extrêmement étayée si l’on veut être sûr de ne pas faire pire avec des médicaments. Rappelons par ailleurs que la lutte contre l’obésité, la diminution du sel dans l’alimentation et la pratique d’une activité physique équilibrée contribuent elles aussi à limiter les risques d’hypertension.
Les sociétés internationales ont fini par créer un syndrome de « préhypertension artérielle ». Le traitement de la préhypertension avec un petit médicament leur a ouvert, de fait, un marché énorme.
Le même phénomène se vérifie pour le diabète. En prévention primaire, beaucoup d’interventions sont de cet ordre-là. Et, comme pour l’hypertension, les seuils ont baissé. Pour avoir exercé la médecine générale pendant une trentaine d’années, j’ai pu constater que la définition du diabète avait évolué, passant de 1,40 à 1,26 gramme par litre de sang et qu’en distinguant le diabète potentiel, le diabète génétique et le prédiabète, on avait multiplié le nombre des diabétiques. Remarquons tout de même que ce n’est pas la même chose que d’avoir 1,40 gramme à quatre-vingts ans qu’à cinquante ans, et qu’il ne faut pas faire baisser l’hémoglobine glyquée au-delà du raisonnable, car cela peut être mortel.
La définition des seuils est donc une notion indispensable en santé publique et dans le domaine de la prévention : elle fixe l’objectif à atteindre. L’exemple des médicaments et de l’hypertension s’applique à toutes les interventions de santé et nous permet de résumer notre propos : dans toute action, il faut que l’on sache quel est l’objectif à atteindre et à quel prix.
*
Audition de MM. Yves Bonnet et Bertrand Brassens, inspecteurs généraux des finances, et de M. Jean-Luc Vieilleribière, inspecteur général des affaires sociales, coauteurs du rapport sur les fonds d’assurance maladie (juillet 2010).
M. Jean-Luc Vieilleribière, inspecteur général des affaires sociales et coauteur du rapport sur les fonds d’assurance maladie. Le rapport sur les fonds d’assurance maladie que nous avons remis en juillet 2010 fait suite à la mise en place des agences régionales de santé. Il s’agissait de savoir comment faire de ces fonds des leviers utiles. Il y a essentiellement trois types de fonds : les fonds de prévention des principaux régimes d’assurance maladie − celui du régime général des salariés, celui des exploitants agricoles et celui des indépendants –, le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins et le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.
La prévention n’est qu’une des composantes des dépenses que nous avons examinées dans le cadre de notre mission. Elle représente en effet 220 millions d’euros de contribution aux agences régionales de santé à travers deux canaux différents : d’une part, les fonds de prévention des grands régimes d’assurance maladie pour 40 millions d’euros et, d’autre part, le programme budgétaire 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins pour 180 millions d’euros. Cela donne une enveloppe de 220 millions d’euros délégués aux régions, à comparer aux autres dépenses des autres fonds délégables aux régions, à savoir 200 millions d’euros pour le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins et moins de 100 millions d’euros pour le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés hors investissements. Bien sûr, ces 220 millions d’euros ne sont qu’une petite part des dépenses générales de prévention qui, selon la Cour des comptes, avaient été évaluées entre 1 et 10 milliards d’euros.
Nos préconisations sont simples : nous proposons de déconcentrer au maximum la gestion de ces fonds aux agences régionales de santé – cela concerne surtout le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés – et de donner une plus grande responsabilité de gestion des fonds aux agences régionales en leur permettant de rendre ces crédits fongibles, sous réserve, bien sûr, de certaines règles de fongibilité asymétrique puisque la loi pose le principe que les crédits de prévention ne peuvent pas être affectés à d’autres actions.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. La Cour des comptes a montré la difficulté de définir le financement de la prévention, les montants qui lui sont destinés allant de 1 à 10 milliards d’euros selon les bases retenues. Avez-vous une idée de ce qu’est la prévention ? Le médecin traitant, qui est payé à l’acte, ne mène-t-il pas aussi une action de prévention avec ses patients ?
M. Jean-Luc Vieilleribière. C’est le rapport de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé de 2002 qui a fourni l’étude la plus aboutie dans ce domaine. La prévention, et c’est une bonne chose, est très intégrée dans le dispositif de soins lui-même. Distinguer ce qui relève de la prévention de ce qui relève du soin est donc très difficile. Certes, il y a des dépenses de prévention isolables en tant que telles mais, pour avoir une idée globale de la prévention, il faut procéder à des enquêtes qualitatives. En outre, s’il est important de se demander combien on consacre à la prévention, le plus intéressant est de savoir comment sont faites les dépenses. Sont-elles efficaces ? N’y a-t-il pas redondance dans la prescription d’examens et d’analyses ?
M. le rapporteur. Le fonds d’intervention régional sera le résultat de la fusion de différents fonds. Mais la ligne « Prévention » va être maintenue au niveau du ministère. Cette distinction est-elle justifiée ?
M. Yves Bonnet, inspecteur général des finances et coauteur du rapport sur les fonds d’assurance maladie. Nous sommes persuadés qu’il faut donner des moyens fongibles aux agences régionales de santé pour les responsabiliser et leur permettre de développer des actions de prévention adaptées au niveau régional. Il n’est pas nécessaire, en effet, de mener la même politique partout. Ainsi, l’alcoolisme n’est pas aussi flagrant dans toutes les régions françaises – et je pourrais citer bien d’autres exemples. Je ne vois donc pas pourquoi les fonds d’État ne devraient pas être également répartis dans les fonds régionaux d’intervention.
M. le rapporteur. Quel est l’obstacle ?
M. Jean-Luc Vieilleribière. Aux termes du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, il semble que le nouveau fonds régional d’intervention regroupera les fonds régionaux de l’État. Cela correspond à nos préconisations. Quant à savoir si d’autres fonds pourraient être sollicités, cela revient à poser la question générale du partage entre l’échelon national et l’échelon régional. Il n’y a pas de raison par exemple, selon moi, de déconcentrer les moyens de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. De même, il reste un champ pour les dépenses nationales pour financer les actions menées sous l’étiquette prévention. En revanche, lorsque les décisions peuvent être prises par les agences régionales de santé, les dépenses visant à subventionner les opérateurs doivent être déconcentrées.
M. Bertrand Brassens, inspecteur général des finances et coauteur du rapport sur les fonds d’assurance maladie. Tout cela nous renvoie à la question du niveau pertinent de responsabilité pour la mise en œuvre d’une politique. Procédant actuellement à un audit des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, j’ai constaté que le problème était similaire. Le ministre de la santé détermine de grandes politiques nationales fléchées – tel le plan Cancer – et souhaite que les crédits soient distribués verticalement. Il revient ensuite aux agences régionales de santé de faire au mieux dans leur territoire, en définissant par exemple une politique de prévention adaptée. Mais cela implique que le directeur de l’agence ait une vraie lettre de mission, avec des objectifs suffisamment clairs qui lui permettront de faire des choix. Or les administrations centrales sont réticentes à laisser les directeurs régionaux décider seuls. Leur vision reste l’approche « en tuyaux d’orgue ». Un directeur d’agence régionale de santé est-il alors en mesure de choisir ses domaines d’intervention en matière de prévention ? A-t-il suffisamment de moyens ? Peut-il les gérer différemment que son voisin ? Quelle est sa légitimité ? Sur quels résultats sera-t-il jugé ?
Globalement, le Gouvernement essaie de mettre en place des structures horizontales, mais la légitimité reste verticale.
M. le coprésident Jean Mallot. Cela pose aussi le problème de l’évaluation des politiques. À quel niveau la politique de prévention doit-elle être évaluée ?
M. Yves Bonnet. Personnellement, je suis très favorable à l’échelon régional, qui n’est pas reconnu aujourd’hui à sa juste dimension. Ne devrait rester à l’échelon national que ce qui a vocation à s’appliquer de manière identique sur l’ensemble du territoire et certaines actions pour des raisons de coût. Il en est ainsi de la lutte contre le cancer, qui implique des méthodes de prévention identiques partout. Tout le reste devrait être régionalisé, à mon sens.
En ce qui concerne l’évaluation, mon collègue de l’Inspection générale des affaires sociales sera sans doute plus favorable à un système d’évaluation nationale. Mais c’est très difficile à mettre en œuvre. Je considère, quant à moi, qu’il vaudrait mieux procéder à une bonne évaluation au niveau régional, surtout si la politique est régionalisée.
M. le coprésident Jean Mallot. Qui procéderait à l’évaluation ?
M. Yves Bonnet. Pourquoi ne pas permettre aux agences régionales de santé de faire appel à des organismes d’évaluation nationaux sur un domaine d’enquête régionalisé ? Peut-être faut-il solliciter de nouveaux acteurs ?
M. Jean-Luc Vieilleribière. C’est la question fondamentale de la répartition des rôles entre échelon national et échelon régional. S’agissant de l’identification des besoins d’organisation sanitaire, les instances locales sont les mieux placées. Or on a tendance à procéder de façon inverse, en partant du niveau national. Il faut d’abord connaître les besoins au niveau territorial et entendre le directeur d’agence régionale de santé. Dans un deuxième temps, il importe de voir comment peuvent être financées les actions et fixer des objectifs aux différents acteurs. Dans un troisième temps, enfin, il convient d’évaluer. Mais pour mettre en place un tel système, un dialogue entre les différents échelons est nécessaire. Il faut réfléchir ensemble aux moyens nécessaires. Dans le domaine de la prévention, c’est encore plus compliqué car la dimension temporelle doit également être prise en compte. Cela repose beaucoup sur des systèmes d’information. Or il y a beaucoup de travail en la matière. On a besoin de nouveaux outils. À cet égard, les agences régionales de santé ont eu la sagesse d’inciter le ministère à commencer à élaborer une stratégie d’information qui devrait permettre de répondre de mieux en mieux aux questions posées s’agissant de la prévention ou des dépenses de santé.
M. Bertrand Brassens. Dans ces domaines, l’approche régionalisée est sans doute la meilleure. Mais cela implique un état des lieux partagé entre l’agence régionale de santé et le Conseil national de pilotage. Il faut une lettre de mission fixant ces objectifs partagés et, sur la base de cette lettre, une évaluation des indicateurs. Or cela n’existe pas, c’est pourquoi il convient d’en rester à l’évaluation nationale pour l’instant. Si nous sommes persuadés que c’est au niveau régional qu’il importe de faire porter les efforts, nous devons savoir où sont les besoins, contractualiser des objectifs avec les agences régionales de santé et définir des outils d’évaluation pour vérifier que ces dernières ont bien tenu leurs engagements. Si la direction n’est pas clairement affirmée, nous risquons de rester dans une situation incertaine.
M. le rapporteur. Le niveau régional me convient parfaitement. J’ai toujours été favorable aux agences régionales de santé, même si la façon dont elles ont été mises en place ne correspond pas tout à fait à ce que je souhaitais, leur organisation me semblant trop jacobine. Vous dites qu’il faut plus d’autonomie et de fongibilité, et qu’à cet égard la création du fonds d’intervention régional constitue un progrès. Mais vous avez aussi indiqué qu’il y avait des difficultés pour distinguer la prévention et le soin à proprement parler. La logique de la création des agences régionales de santé, qui reviennent sur la séparation entre la prévention, les soins, la médecine de ville, l’hôpital, le sanitaire, le médico-social, devrait conduire à créer des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, qui leur donneraient une véritable autonomie. On m’a expliqué que ce serait très compliqué à mettre en place. J’ai le sentiment, mais c’est peut-être un peu simpliste, qu’il suffirait de donner à chaque région pour 2012 ce qu’elles ont perçu dans le secteur de la santé en 2011 augmenté de 2,5 % ou de 2,8 %. Qu’en pensez-vous ?
M. Yves Bonnet. On ne peut pas sous-estimer les difficultés soulevées par des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, dans lesquels il y a une part de dépenses qui viennent d’une multitude d’acteurs et qui ne sont pas maîtrisables : la partie pilotée est très faible. Nous indiquons dans notre rapport que les fonds d’assurance maladie représentent moins de 1 % de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Cela étant, pour responsabiliser les acteurs, il faut permettre une gestion globale et transversale des dépenses. Telle est la bonne direction.
M. Jean-Luc Vieilleribière. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie est un outil de régulation des dépenses d’assurance maladie. Pourquoi ne pas envisager des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie ? La première question est de savoir comment répartir les dépenses entre les différentes régions. Vous suggérez d’en rester aux bases historiques. Certes, mais cela pose un premier problème politique. En effet, dès lors qu’il existe des disparités de dépenses par tête selon les régions, comment justifier l’organisation du système à partir de bases historiques ? On peut imaginer une convergence progressive vers une cible, mais comment organiser cette convergence ?
Enfin, se pose la question de la régulation. On a décidé en 2005 de développer massivement le champ de la tarification à l’acte en passant d’une dotation globale à la tarification à l’activité sur le champ hospitalier, qui est en elle-même un facteur de rééquilibrage régional direct et massif. Aujourd’hui, les dépenses de médecine et de chirurgie-obstétrique vont là où les soins sont effectués…
M. le coprésident Jean Mallot. Mais pas forcément là où ils sont nécessaires !
M. Jean-Luc Vieilleribière. J’ai dit que c’était plus juste : je n’ai pas parlé de justice parfaite. Cela me semble préférable à une dotation globale reposant sur des bases historiques datant de plusieurs décennies. Lorsque j’étais à la direction de la sécurité sociale, j’ai lancé des études permettant de comparer la consommation de soins entre les différents départements et les différentes régions. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a beaucoup travaillé sur ces sujets à partir des données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés afin d’avoir la vision la plus globale possible. Aux termes de ces enquêtes et après avoir redressé les caractéristiques sanitaires et sociales de la population, il apparaît que les écarts régionaux ou départementaux de dépenses de soins hospitaliers ne sont pas très importants. En matière de soins ambulatoires, en revanche, il reste de nombreux facteurs inexpliqués. On sait que les dépenses par tête de soins de ville sont beaucoup plus importantes dans le sud de la France que dans le nord, ce qu’explique peut-être en partie la structuration différente du médico-social.
Dès lors qu’on adopte un système de tarification nationale et de liberté d’installation des professionnels de santé, il serait délicat de résoudre la contradiction qui apparaîtrait si les objectifs étaient fixés au niveau régional. Souhaite-t-on politiquement pousser la confusion jusqu’au bout ? Les tarifs deviendraient alors régionaux, ce qui ne manquerait pas de poser des questions concernant l’égalité financière des citoyens. Souhaite-t-on remettre en cause la liberté d’installation ?
S’agissant toujours de la régulation, je veux souligner un autre paradoxe. Nous avons fortement développé la tarification à l’acte en passant à la tarification à l’activité (T2A), mais les leviers de régulation infra-annuelle, en cas de risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, se concentrent sur les reliquats budgétaires, et notamment sur nos fameux fonds alors même qu’on a créé des agences régionales de santé. On prétend instituer des agences régionales de santé responsables, mais on régule les seuls leviers directs dont elles disposent. Pourquoi ne fait-on pas porter davantage la régulation infra-annuelle sur le tarif des actes ? À peine les agences régionales de santé sont-elles créées qu’on commence à amputer leurs moyens !
M. Yves Bonnet. Je ne pense pas que la régulation puisse porter sur la tarification. Avoir des tarifs uniformes permet de réguler le système.
Avec l’objectif régional de dépenses d’assurance maladie, on pourrait sans doute sensibiliser les acteurs locaux. La simple réunion de la conférence de l’agence régionale de santé en cas de dépassement des dépenses conduirait chacun des intervenants à prendre conscience des difficultés propres à son territoire.
Il faudrait prendre des mesures pour favoriser la régulation, mais des mesures qu’on ne peut pas prendre au niveau national, car ce serait ingérable politiquement – je pense à la liberté d’installation des médecins. On pourrait développer au niveau régional des mesures incitatives de redéploiement de la population médicale en fonction de critères divers et variés restant à définir.
M. le coprésident Jean Mallot. Comment procéder à un rééquilibrage entre les régions ? Comment déterminer des objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie ? Cela pourrait donner lieu à un débat parlementaire fort intéressant… Ces objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie pourraient être différents d’une région à l’autre, dans leur taux d’évolution, leurs structures et leur contenu. Si une région s’écartait des objectifs plus qu’une autre – je ne ferai pas de comparaison déplacée avec la zone euro –, comment pourrait-on corriger les déséquilibres ?
M. Yves Bonnet. Tout en étant favorable à une régulation au niveau régional, je ne suis pas opposé à une régulation nationale, ni au fait que la représentation nationale se saisisse de ce problème. Notre système est trop centralisé et les solutions sont devenues frontales. Les acteurs du système de soins se transforment en groupes de pression au lieu de prendre en compte la réalité des difficultés et des dépassements de dépenses. C’est à travers ce travail de prise de conscience et d’appel à la responsabilité de chacun que nous pourrons, lentement sans doute, faire en sorte qu’un objectif régional de dépenses d’assurance maladie permette une régulation.
M. Bertrand Brassens. En tout état de cause, il n’y aurait aucun objectif régional de dépenses d’assurance maladie parfait car, entre le poids du passé et l’objectif à atteindre, il y aurait forcément des équilibrages politiques. L’essentiel est de sortir d’un système d’irresponsabilité. La responsabilité des agences régionales de santé est affirmée alors qu’elles sont retenues par des liens bien que leurs fonds soient assez limités. Le directeur d’une agence régionale de santé doit être un vrai patron disposant, dans une enveloppe limitée, de moyens fongibles et de capacités d’intervention. C’est ainsi qu’il doit être jugé.
Je crains qu’on ne refasse avec les agences régionales de santé ce qui avait été mis en place avec les agences régionales de l’hospitalisation et qu’on retrouve à la tête des agences régionales des gens incapables de prendre leurs responsabilités. Ne restons pas au milieu du gué !
M. le rapporteur. Vos remarques sur les agences régionales de l’hospitalisation sont très intéressantes. Il y a eu recentralisation entre les agences régionales de l’hospitalisation de première et de deuxième génération. Pour ce qui concerne les objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, j’ai proposé de reprendre les bases historiques pour des raisons de simplicité. Peut-être suffirait-il de prévoir un taux d’évolution et de corriger les disparités en prenant des critères simples comme notamment la morbidité, la mortalité et l’âge de la population.
Quant à la prévention, comment la pratiquer dans de bonnes conditions si l’on ne prend pas en compte l’Éducation nationale et la médecine du travail ? Comment peut-on coordonner la santé, l’Éducation nationale et la médecine du travail en termes financiers et d’efficacité ?
M. Bertrand Brassens. C’est au niveau régional qu’il est le plus facile de contractualiser. Certes, le préfet de région n’a pas autorité pour tout. Mais dès lors qu’un accord est intervenu entre l’agence régionale de santé, le rectorat et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la contractualisation sur des objectifs est possible. Au lieu de chercher la perfection, il importe de passer des contrats pour les objectifs sur lesquels il est possible de disposer d’une marge de manœuvre et de vérifier ensuite si l’on a progressé.
M. Jean-Luc Vieilleribière. L’échelon territorial me paraît le plus pertinent. La gouvernance des agences régionales de santé prévoit d’ailleurs des commissions de coordination sur tous ces sujets de prévention, que ce soit la santé scolaire et la santé au travail. Pour avoir travaillé sur les organismes de planification et d’éducation familiale, j’ai appris aussi que les départements ont un rôle très important à jouer sur certains aspects de la prévention. Les agences régionales de santé sont d’ores et déjà reconnues par les différentes parties prenantes comme des interlocuteurs légitimes pour les aider à se coordonner sur le plan sanitaire. Dans le domaine de la planification et de l’éducation familiale, il suffit par exemple de vérifier que les départements et les inspections d’académie ont une vision globale des établissements scolaires couverts par les interventions en matière de santé sexuelle.
M. le coprésident Jean Mallot. La prévention consiste en des actions quotidiennes, immédiates, multiples, dont on ne mesure pas toujours le bénéfice, lequel existe cependant, à long ou à très long terme. Comment faire en sorte que les organismes qui investissent à court terme puissent en tirer un bénéfice ? À défaut, la motivation ne peut qu’être atténuée. On a constaté que certains organismes privilégiaient les actions de prévention dont ils pouvaient mesurer l’impact assez rapidement, or cela ne correspond pas forcément à l’intérêt général.
M. Yves Bonnet. Peut-être le système de rémunération à l’acte pourrait-il être complété par une rémunération par patient, dans le cadre du système du médecin référent, qui serait l’unique interlocuteur et qui orienterait à ce titre toute la politique de prévention et de soins. Cela ne devrait pas être trop coûteux.
M. Bertrand Brassens. Dans le cadre des contractualisations passées avec les maisons de santé, on a précisément fixé des objectifs de prévention novateurs – la tâche est plus facile lorsqu’on est proche des acteurs de terrain. On peut ensuite en mesurer les effets.
M. le rapporteur. Dans les nouvelles conventions médicales, les indicateurs sont quantitatifs, et non qualitatifs, ce qui est regrettable.
M. Jean-Luc Vieilleribière. Le paiement à l’acte n’est pas l’alpha et l’oméga du financement du système de santé. Nous avons besoin d’une diversification des modes de rémunération. C’est dans cette voie que s’engage d’ailleurs la dernière convention médicale à travers le paiement à la performance, avec des indicateurs, certes perfectibles, au fil de l’expérience et du temps. Vérifier le suivi des vaccinations ainsi que des dépistages et les analyses des diabétiques est déjà un progrès.
Plus nous progresserons dans la diversification des modes de tarification, plus nous disposerons de marges de déconcentration vers les échelons territoriaux. Aujourd’hui, elle s’opère dans le cadre conventionnel. Peut-être y aura-t-il toujours une place pour le paiement à la performance dans ce cadre, mais on peut aussi envisager des modes de paiement à la performance plus déconcentrés à l’avenir.
S’agissant du rendement des dépenses de prévention, la question est extrêmement complexe. Sauf dans certains cas très particuliers, il est très difficile d’avoir une perception de ce rendement. En tout état de cause, je ne pense pas que les décisions de faire ou de ne pas faire de la prévention reposent d’abord sur des considérations économiques. Certes, le raisonnement économique a sa place, mais il est encore plus présent lorsqu’il s’agit de choisir entre les différents moyens de faire de la prévention. On trouverait sûrement des marges de redéploiements financiers importants si, sur chaque objectif précis de prévention de santé publique, on s’interrogeait sur l’efficacité sanitaire et le rendement économique du dispositif. Il faudrait en outre vérifier que le dispositif en question ne contribue pas à renforcer les inégalités de santé, car le public le plus sensible à la prévention n’est souvent pas celui qui en a le plus besoin.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Vous avez insisté sur l’importance du niveau régional, voire départemental et municipal. La lutte contre l’obésité peut en effet être traitée dans les écoles et l’on sait que des communes sont intervenues dans la composition des repas servis dans les cantines. Les associations jouent aussi un rôle intéressant. Mais vous avez également souligné une lacune au niveau du pilotage national. Dans votre rapport vous avez mis l’accent sur les relations entre le comité de pilotage des agences régionales de santé, les directions du ministère et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Peut-on imaginer un pilotage national interministériel ? La Cour des comptes proposait que le directeur général de la santé soit le délégué interministériel à la prévention. Qu’en pensez-vous ?
M. Yves Bonnet. Il existe dans la loi organique relative aux lois de finances des outils permettant de suivre les missions interministérielles en termes budgétaires et de performance. Certes, on peut prévoir un délégué interministériel, mais ceux que j’ai rencontrés ne m’ont pas convaincu de l’importance de leur rôle et de leur capacité à piloter ou à favoriser l’évolution des systèmes.
Je n’ai pas de solution parfaite à proposer. Toutes les bonnes volontés peuvent concourir aux actions de prévention. Il serait ainsi dommage de se priver du niveau communal si un travail de fond y est réalisé. Le rôle du délégué interministériel pourrait précisément consister à centraliser les résultats des différentes expériences menées. Aujourd’hui, nous ne recueillons pas les fruits de ces expériences.
M. Bertrand Brassens. Je suis réservé sur la multiplication des structures et des délégués : plus on a de pilotes et moins on en a vraiment !
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Nous proposons qu’il n’y ait qu’un seul pilote.
M. Bertrand Brassens. Il y a déjà la délégation générale de pilotage des agences régionales et les administrations centrales. Il me paraît préférable de conforter le rôle de l’agence régionale de santé. Au lieu de rechercher une architecture ambitieuse et parfaite que nous ne parviendrons jamais à mettre en place, essayons plutôt de trouver des éléments sur lesquels nous pourrions apporter des améliorations. Demandons aux agences régionales de santé de faire un état des lieux, de choisir des sujets sur lesquels un travail partenarial utile pourrait être conduit dans leurs régions, comme le diabète dans une région ou l’obésité dans une autre, puis de montrer qu’elles ont réussi à faire collaborer le département, la région et les associations, en injectant les crédits nécessaires. C’est sur ces actions positives qu’elles seront jugées.
Un tel système aurait une valeur pédagogique. Il resterait ensuite à diffuser les résultats de l’expérience.
M. Jean-Luc Vieilleribière. Le travail entre les institutions doit d’abord passer par une action de terrain. Les agences régionales de santé sont bien placées à cet égard. On a organisé une transversalité au niveau des agences régionales de santé ; il faut à présent organiser le pilotage national. Pour que le système soit efficace, un dialogue disposant de moyens entre l’échelon national et l’échelon régional doit être instauré. Ce chantier est prioritaire. Certes, on peut créer des délégations interministérielles, mais je crains qu’elles n’accaparent les énergies, d’autant plus qu’il faut compter avec les actions à mener pour assurer le partage de l’information avec toute la sphère santé, dont l’assurance maladie et les hôpitaux.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Je souhaite que soit renforcé le rôle des conférences régionales de santé car elles permettent de réunir tous les acteurs de la santé au niveau régional. On pourrait leur demander de veiller à la répartition et au fonctionnement de l’objectif régional de dépenses d’assurance maladie. Ce serait un moyen de responsabiliser les acteurs, et notamment les professionnels de santé, qui sont souvent en position de revendication. Ce point de vue n’est malheureusement pas partagé pas tout le monde…
Comment peut-on mieux prendre en compte les problèmes de prévention et définir les priorités ? Que pensez-vous du rôle du Haut Conseil de la santé publique ? Est-il utile ? Doit-on prendre en compte ses propositions ?
M. Jean-Luc Vieilleribière. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions de santé publique et je ne pense pas que l’Inspection générale des affaires sociales ait une doctrine en la matière. Il me semble que toutes ces instances de démocratie sanitaire ont leur place. Les agences régionales de santé ont précisément pris en compte une forte composante de démocratie sanitaire dans leur organisation. Les analyses économiques et financières doivent éclairer les décisions prises dans le cadre du processus de démocratie sanitaire. Pour autant, ce n’est pas à elles de définir tous les objectifs. Certes, il faut cibler davantage les priorités en matière de santé publique, mais il ne faut pas se priver d’une batterie d’indicateurs sur l’ensemble des sujets car ceux-ci doivent être suivis dans le temps.
M. Yves Bonnet. Le monde de la santé est extrêmement centralisé. C’est sans doute cela qui a conduit à l’échec de la première réforme des agences régionales de l’hospitalisation. La culture fondamentale est celle du détail au lieu d’être dans le conseil. Or, assez curieusement, la structure sanitaire qui est extrêmement centralisée se dote d’une multitude d’organismes susceptibles de lui donner des avis comme sur le médicament, par exemple. Mais cela ne fonctionne pas.
Je partage donc votre sentiment sur l’intérêt d’une forte déconcentration. Si des outils d’évaluation nationaux me paraissent toujours nécessaires, pourquoi ne pas en créer également au niveau local ? S’il faut réfléchir aux priorités, il faut pouvoir retrouver ces outils d’orientation sur le plan régional.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Comment le Conseil national de pilotage fonctionne-t-il à côté des directions du ministère de la santé ?
M. Yves Bonnet. Le Conseil national de pilotage est théoriquement présidé par le ministre de la santé. Mais je ne pense pas qu’il ait le temps pour assurer cette fonction et je ne suis pas sûr que, statutairement, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ait les moyens d’imposer une vue transversale aux différentes directions. Peut-être cela va-t-il changer…
M. Bertrand Brassens. À l’époque de l’élaboration de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, j’avais le sentiment qu’il fallait plutôt renforcer le rôle du Conseil national de pilotage en matière de diffusion des bonnes pratiques, d’aide à la contractualisation, à la fixation d’objectifs.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. C’est la raison pour laquelle, lors de la création des agences régionales de santé, certains avaient proposé de mettre en place une agence nationale de pilotage. Nous avons le sentiment que les directions du ministère de la santé se surveillent les unes les autres, ce qui complique le fonctionnement de l’ensemble. Le pilotage global des agences régionales de santé est pourtant essentiel même si on leur laisse une grande liberté. On sait que le ministère est tenté de les recadrer et de leur donner des directives. Du reste, le maintien des enveloppes fléchées avec des sous-objectifs est une façon de les contrôler. C’est ce qui me fait plaider en faveur d’objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie.
M. Bertrand Brassens. Montrer, dans un système fléché, qu’une initiative prise par une agence régionale de santé a débouché sur des résultats donnera des idées à d’autres. Plus les expériences positives seront connues, plus nombreuses seront les agences régionales de santé désireuses de prendre leurs responsabilités. Il apparaîtra alors au niveau national que l’échelon régional est opérationnel. Les actions menées au niveau régional n’ont pas été suffisamment valorisées jusqu’à présent. En le faisant, nous favoriserons l’irréversibilité de la décentralisation et nous renforcerons ainsi la logique partenariale régionale, et non plus une logique verticale.
M. Jean-Luc Vieilleribière. Je ne pense pas qu’on puisse résoudre des segmentations nationales en transformant simplement les sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il faut modifier les outils de tarification. Ces sous-objectifs n’existent que parce qu’il y a des leviers de régulation différents. Concrètement, une grande partie des dépenses hospitalières sont faites dans l’objectif « soins de ville » à travers les actes des médecins libéraux qui interviennent dans les cliniques. C’est à travers les tarifs de soins de médecine de ville qu’on régule cette dépense et non pas par l’intermédiaire des leviers hospitaliers.
Cela nous renvoie à la question posée précédemment : les outils tarifaires doivent-ils se situer au niveau national ou au niveau régional ? Je ne suis pas sûr qu’il faille passer par le prisme de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour résoudre toutes ces contradictions.
Le Conseil national de pilotage est-il une instance suffisamment structurante par rapport à l’étape franchie dans le domaine de la transversalité via les agences régionales de santé ? La question méritera d’être posée dans quelque temps. Pour structurer les systèmes d’information des agences régionales de santé, nous aurons besoin d’une politique parfaitement coordonnée entre les différentes administrations centrales et, au-delà, avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, voire avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ne décide pas elle-même du montant du fonds de prévention. Puisqu’il n’y a plus de conseil d’administration, puisque les partenaires sociaux ne décident plus, puisque son directeur est nommé en conseil des ministres, quelle est la légitimité de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ? N’est-elle pas devenue aujourd’hui une simple agence plus ou moins indépendante ? Elle s’occupait surtout de la médecine de ville, mais son directeur souhaitant à présent s’occuper aussi de l’hôpital, fonctionnera-t-elle en harmonie complète avec le ministère ?
M. Jean-Luc Vieilleribière. L’organisation actuelle de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés résulte de la réforme de l’assurance maladie intervenue en août 2004. La logique de celle-ci consistait à déléguer les responsabilités aux différents acteurs. C’est notamment pourquoi ont été créés les différents sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, considérant qu’existaient à la fois un pilote des soins de ville avec l’assurance maladie, un pilote des soins hospitaliers à travers ce qui était alors la direction de l’offre de soins et enfin un pilote du secteur médico-social qui était la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, soit un pilote défini pour chaque grand champ de dépenses de santé. La création ultérieure des agences régionales de santé a croisé cette logique en organisant une certaine transversalité entre ces secteurs.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. La question de la transmission des données de santé est cruciale. La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés se montre réticente à ce que les caisses complémentaires aient accès à des données dont elle se sent propriétaire et pour lesquelles elle évoque le principe du secret médical. Au cours de l’une des auditions de la semaine dernière, a pourtant été évoquée une expérience tout à fait enrichissante, conduite par Groupama et la Mutualité sociale agricole, consistant à mettre en place un rétinographe mobile afin de réaliser des examens de fond de l’œil dans les zones rurales pour mieux y suivre les cas de diabète et d’hypertension artérielle. Les informations ainsi recueillies étaient ensuite transmises, par télémédecine, à un ophtalmologue chargé de les interpréter. Mais cette expérience s’est heurtée à la difficulté de prendre contact avec les patients concernés en raison d’une mauvaise connaissance du public potentiel. Comment éliminer ce type de frein aux actions de prévention ? Ne faut-il pas lever l’anonymat afin de pouvoir s’adresser aux seuls patients visés ?
M. Jean-Luc Vieilleribière. En la matière, l’implication du législateur peut être déterminante : la confiance du citoyen dans le secret médical constitue en effet une des conditions de base du fonctionnement de notre système de santé et d’assurance maladie. Le partage des données médicales ne saurait s’opérer sans garanties de confidentialité pour les personnes : c’est un enjeu politique majeur. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit déjà ce partage entre l’assurance maladie et les agences régionales de santé qui est essentiel pour toute une série d’actions d’évaluation des politiques de santé. La Haute Autorité de santé peut également avoir besoin, soit directement, soit par des experts qu’elle mandate, d’utiliser des données médicales. Il faut alors savoir qui est responsable de la préservation du caractère anonyme de celles-ci.
M. Yves Bonnet. Le problème du secret médical pourrait être assez facilement résolu par la transmission des données exclusivement entre médecins, rattachés à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés comme aux caisses complémentaires. Le régime de la propriété des données appelle une intervention du législateur afin d’établir clairement que des nécessités d’intérêt public peuvent autoriser les organismes publics responsables de la politique de santé d’avoir accès aux données.
Je me suis aperçu, grâce une étude réalisée par des médecins de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, que la prévention du cancer du sein aboutissait à un nombre excessif d’interventions chirurgicales. La responsabilité médicale individuelle incite en effet à intervenir trop en amont sur la base de la détection d’un risque de cancer. Il y aurait donc intérêt à ce que les données médicales individuelles soient rendues davantage accessibles afin qu’on puisse les retraiter et en tirer des orientations. C’est à la loi qu’il appartient de dire ce qu’il est, ou non, possible de faire dans ce domaine.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Ce que vous avez dit du cancer du sein rejoint les remarques formulées par la Cour des comptes concernant le cancer de la prostate et l’excès d’interventions opérées sur des personnes déjà trop âgées pour y résister sans séquelles. Le problème du cancer du sein se pose différemment : une anomalie détectée lors de la mammographie entraîne une biopsie extemporanée ; si celle-ci démontre l’absence de cancer, on ne va pas plus loin en chirurgie. Mais la patiente, avant d’être rassurée, a été inquiétée. La Cour des comptes a certes observé que l’on pouvait distinguer les cancers selon leur degré plus ou moins élevé d’évolution. Mais est-il sage de ne pas toucher à un cancer au motif qu’il serait peu évolutif ? Je ne suis donc pas très convaincu par votre argumentation sur les excès d’interventions chirurgicales.
Avez-vous d’autres remarques dont vous voudriez nous faire part ?
M. Yves Bonnet. Oui, mais en dehors du champ de la prévention.
Le fonds régional d’intervention qui va être créé n’intégrera pas les dépenses d’investissement. Or, il serait possible de laisser à disposition de l’agence régionale de santé des dépenses inférieures à un certain seuil.
Il va falloir construire de nouveaux hôpitaux. Nous l’avons fait massivement dans le passé, et pas toujours de façon pertinente. Un nouvel établissement hospitalier constitue un équipement visible, à la différence des investissements dans l’informatique ou dans l’organisation, bien que ceux-ci s’avèrent plus productifs pour l’équilibre du système de santé. C’est pourquoi, en dehors des très grands investissements qui exigent une compétence centrale, il conviendrait de retirer du niveau national une partie des moyens financiers, en fixant par exemple le seuil à 10 millions d’euros, en dessous duquel la compétence deviendrait régionale. D’importants efforts sont à réaliser dans des domaines tels que celui de la chirurgie ambulatoire, qui en France accuse un gros retard et pourrait être développée grâce à des fonds locaux.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 propose justement de retirer du fonds régional une partie de l’investissement hospitalier, considéré comme déjà suffisant. Mais je suis étonné chaque année des annulations ou des non-reconductions de crédits en raison de leur non-consommation au cours du précédent exercice. Comment expliquer cette non-utilisation de fonds alors que les besoins existent ? Nous avons tous entendu, hier les agences régionales de l’hospitalisation, aujourd’hui les agences régionales de santé, se plaindre de leur manque de moyens et nous avons dû constater ensuite, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’annulation d’une partie de ceux qui étaient inscrits.
M. Bertrand Brassens. Cela résulte notamment de l’insuffisante fongibilité des crédits : affectés à des actions très précises, ils ne peuvent être transférés sur d’autres postes dans l’hypothèse où, pour des raisons de délais ou de procédure, celles-ci ne peuvent être totalement exécutées. On retrouve encore l’opposition classique entre la logique verticale, qui ne saurait disparaître du fait de l’existence de politiques nationales, et la meilleure adaptation au niveau régional des agences régionales de santé à certains arbitrages afin d’appliquer le principe de responsabilité des décisions prises et de leur évaluation. Une plus grande fongibilité, pour des montants d’investissements relativement faibles, permettrait d’éviter que des crédits restent inemployés ou soient utilisés autrement, sans évaluation satisfaisante, simplement pour qu’on ne les annule pas.
M. Jean-Luc Vieilleribière. La fongibilité apporte en effet une première réponse à la sous-consommation de certains crédits. Mais la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, qui a créé le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, a déjà prévu une déchéance quadriennale. Il existe aussi des explications rationnelles à certains cas de sous-consommation, notamment en matière d’investissements ou de programmes pluriannuels dans le domaine médico-social. Car des délais incompressibles séparent la prise de décision, selon l’inscription des crédits dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, de la matérialisation des dépenses correspondantes. L’abus du levier de régulation consistant à annuler les crédits non consommés dans les temps peut provoquer l’effet pervers d’inciter les gestionnaires à dépenser le plus possible afin de saturer leurs enveloppes. Nous avons souvent constaté cette pratique au cours de notre enquête.
M. Yves Bonnet. Les agences régionales de l’hospitalisation constituaient de petites équipes qui n’avaient pas les moyens d’assurer un suivi des décisions d’investissement, alors que les actuelles agences régionales de santé peuvent le faire, aussi bien sur la durée des opérations que pour relever l’abandon de certaines d’entre elles.
M. Bertrand Brassens. Cela suppose que l’on se dote d’un véritable système d’évaluation, indissociable de la responsabilité, mais nous n’en sommes qu’à ses débuts. Tant qu’il ne sera pas au point, l’échelon central freinera toujours la délégation comme la fongibilité des crédits.
Il faut commencer par fixer quelques engagements sur des objectifs de performance et juger les responsables sur les réalisations correspondantes.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Messieurs, je vous remercie.
*
Audition de M. Michel Brault, directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et M. Philippe Laffon, directeur de la santé.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Messieurs, je ne vous rappellerai pas qu’on reproche à notre système de santé une trop grande orientation vers les activités curatives au détriment des actions de prévention. La Cour des comptes préconise dans ce domaine une politique coordonnée et « pilotée ».
Votre organisme joue un rôle important auprès d’une population spécifique en faveur de laquelle il déploie déjà des actions de prévention.
Comment, selon vous, distinguer la prévention du soin ? En indiquant à un patient comment améliorer son hygiène de vie, un médecin n’exerce-t-il pas aussi une action de prévention ?
La Cour des comptes estime ainsi, dans une fourchette large, le montant des dépenses de prévention entre 1 et 10 milliards d’euros.
Quelle est votre participation aux fonds dédiés à la prévention ? Quelles évolutions attendez-vous de la création du fonds d’intervention régional ?
M. Michel Brault, directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La Mutualité sociale agricole entretient une approche spécifique de la prévention dans la mesure où elle gère l’ensemble des risques – maladie, famille, retraite, accidents du travail et maladies professionnelles – et exerce directement d’importantes actions sanitaires et sociales, comprenant notamment des services de médecine du travail et des « préventeurs ». Pour nous, la notion de prévention ne couvre pas exclusivement les questions de santé mais, plus largement, le rapport au vieillissement, à la dépendance, à l’isolement ou aux risques professionnels.
Nous n’inscrivons dans nos comptes, au titre de la prévention, que les dépenses correspondant à sa stricte définition et telle que codifiée. Nous n’avons donc pas connaissance de la part de prévention dans la consultation classique du médecin traitant.
Selon cette conception, étroite, nos activités de prévention s’élèvent à environ 32 millions d’euros, soit 0,3 % de la totalité de nos dépenses d’assurance maladie, qui s’élèvent à environ 11 milliards d’euros. Le montant correspondant est prévu dans notre convention d’objectifs et de gestion et ainsi planifié sur cinq ans avec une quasi-stabilité de son niveau. Chaque année, un arrêté ministériel le confirme et indique la nature des dépenses que nous pouvons engager dans ce cadre.
Environ la moitié de cette somme, soit 16,5 millions d’euros, est affectée à des actions pilotées par l’État, telles que les dépistages des cancers, les campagnes de vaccinations et de prévention bucco-dentaire. 1,2 million d’euros, soit 4 % de l’enveloppe, alimentent les fonds de prévention des agences régionales de santé. 14,2 millions d’euros - 45 % de l’enveloppe – financent des actions institutionnelles définies par la Mutualité sociale agricole. Il s’agit, en majorité, pour 12,2 millions d’euros, de ce que nous appelons les « Instants santé », dénommés autrefois « Examens de santé », actions ciblées en fonction des tranches d’âge. L’enveloppe restante, de 2 millions d’euros, s’insère, pour l’essentiel, dans les plans nationaux de la Mutualité sociale agricole, tels que « Seniors, soyez acteurs de votre santé », ou les « Ateliers du bien vieillir », ainsi que dans des actions d’éducation thérapeutique. Enfin, nous consacrons environ 300 000 euros à des initiatives locales, conduites par chacune de nos trente-cinq caisses.
Nous menons parallèlement, et pour des sommes plus substantielles – environ 115 millions d’euros –, d’importantes actions de médecine du travail et de prévention des risques professionnels, mais qui n’entrent pas dans le champ de la prévention stricto sensu.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Quand vous menez, par exemple, une action d’information sur les pesticides, dans quelle rubrique la classez-vous ?
M. Michel Brault. Elle est classée dans la rubrique de la prévention du risque accidents du travail soit des salariés, soit des exploitants agricoles. Elle ne figure donc pas dans l’enveloppe de 32 millions d’euros. Mais notre approche globale de la personne ne permet pas de distinguer strictement la santé du risque professionnel ou de problèmes tels que l’isolement. Ainsi, lorsque nous mettons en œuvre un plan de prévention du suicide, il est difficile d’apprécier dans quelle rubrique, santé ou risque professionnel, le rattacher.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Pour certaines agences régionales de santé, notamment en Bretagne et en Pays de la Loire, la question du suicide fait partie des priorités de la prévention.
M. Philippe Laffon, directeur de la santé de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La prévention du suicide constitue une problématique de santé publique, comme le montre le plan gouvernemental qui vient d’être annoncé par Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé. Mais la Mutualité sociale agricole a abordé le sujet sous l’angle professionnel car il s’agit, principalement, d’un risque psychosocial, contre lequel nous recourons à l’expertise de médecins du travail, de conseillers en prévention des risques professionnels qui se rendent dans des exploitations ou dans des entreprises. Pour autant, le phénomène résulte de facteurs multiples, qui peuvent être d’ordre privé, familial, conjugal ou professionnel. Il faut donc établir des passerelles entre ce qui relève du cadre de la prévention générale de santé publique et ce qui relève de la prévention des risques professionnels. C’est sous l’aspect purement budgétaire et administratif que nous avons classé cette action dans la deuxième catégorie.
On pourrait citer d’autres exemples comme celui des pesticides ou, plus généralement, ceux des maladies d’origine professionnelle. Des études montrent qu’une problématique particulière du cancer de la peau, le mélanome, se manifeste dans la population que nous couvrons.
Nous devons donc proposer des actions au titre des risques professionnels, comportant des conseils pour l’exercice de l’activité professionnelle, ce qui n’empêche pas une prévention au titre de la santé publique afin d’inciter les personnes à protéger leur peau. Il en va de même de la vaccination antitétanique : c’est souvent à l’occasion d’examens liés à l’activité professionnelle que nous repérons des personnes particulièrement exposées, du fait de leur contact fréquent avec des animaux, avec du bois ou des épines. Mais, dans le cadre d’examens de santé généraux, comme nous les pratiquons avec les « Instants santé », nous rappelons aussi l’intérêt de se tenir à jour de ses vaccinations. Les frontières administratives et financières entre les deux types de prévention, étanches au plan de l’organisation, ne le sont pas dans les relations avec nos assurés.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Les 115 millions d’euros que vous avez mentionnés correspondent-ils à des actions autonomes ou sont-ils intégrés dans la convention d’objectifs et de gestion avec l’État ?
M. Michel Brault. Ils sont intégrés dans la convention mais inscrits à un chapitre spécifique, à l’instar du fonds de la médecine du travail et des fonds relatifs à la prévention des accidents du travail. Nous menons une politique globale qui, néanmoins, respecte un cadre dissocié que justifient des financements différenciés. Ainsi, pour la médecine du travail, nous prélevons une cotisation de 0,42 % sur les salaires mais, pour la prévention, nous appliquons une quote-part de la cotisation accidents du travail, tandis que le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires agricoles est imputé sur l’assurance maladie.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Vous avez indiqué que vos crédits de prévention étaient stables pour les cinq prochaines années. Comment l’expliquer alors que la prévention doit être développée ? La même stabilité vaut-elle pour les 115 millions d’euros ?
M. Michel Brault. Nos crédits progressent de 1,4 % par an seulement afin de compenser l’inflation. Il est vrai que nous avons sollicité beaucoup plus du ministère. Mais celui-ci a considéré que notre population diminuait et donc que le maintien du niveau du fonds équivalait à une certaine augmentation… Nous restons bien sûr preneurs d’autorisations de dépenses supérieures.
Dans le domaine de la médecine du travail, nous disposons d’une plus grande souplesse car, nos obligations réglementaires s’appliquant à la couverture des salariés agricoles, un quota de médecins est fixé en fonction du nombre d’assurés et de la nature de leur activité, selon qu’elle s’exerce dans des bureaux ou sur des exploitations. Nous pourrions donc dépasser nos autorisations budgétaires dès lors que l’on constaterait une augmentation du salariat agricole.
Nos populations sont particulièrement précaires et fragiles en raison de l’importance occupée par le travail occasionnel et saisonnier. Souvent, la médecine du travail ne prend pas en compte les salariés dont l’activité est inférieure à quarante-deux jours de travail par an. Or, c’est justement l’occasion de faire bénéficier à ces salariés d’examen de médecine du travail. Nous avons là une approche spécifique à mettre en œuvre.
Si la masse salariale est stable, nos fonds de prévention le sont également.
L’essentiel de nos charges dans ce domaine correspond aux salaires des médecins du travail et des « préventeurs ».
Les entreprises nous versent quelques subventions pour accompagner certaines de nos actions, pour environ 10 millions d’euros, ce qui est minime par rapport à la masse de nos dépenses.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Disposez-vous de centres d’examens de santé spécifiques ?
M. Michel Brault. Non. Dans le cadre de nos « Instants santé », nous recourons à des laboratoires et à des médecins extérieurs à la Mutualité sociale agricole.
M. Philippe Laffon. Nous n’avons pas de centres d’examens de santé comme il en existe pour le régime général. Nous recourons essentiellement à la médecine de ville et aux médecins généralistes pour mettre en œuvre nos actions de prévention. Le code rural et de la pêche maritime prévoit d’ailleurs l’obligation de proposer à nos assurés un examen périodique de leur état de santé, que nous réalisons tous les dix ans, par tranche d’âge à partir de vingt-cinq ans. Nous adressons aux personnes un auto-questionnaire d’évaluation de leur santé, nous leur demandons de procéder à des analyses biologiques, puis nous rémunérons leur médecin traitant pour une consultation de prévention au cours de laquelle il effectue un examen global.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Selon quelle cotation ?
M. Philippe Laffon. C2.
Nous disposons ainsi d’un panorama global de l’état de santé de la personne.
De même, nos actions d’éducation thérapeutique destinées aux patients dans le cadre de notre programme relatif aux pathologies cardiovasculaires sont assurées par le médecin traitant auquel nous ne voulons pas nous substituer, étant au contraire très soucieux de son implication dans la prévention.
M. Michel Brault. Les populations rurales se montrent particulièrement attachées au médecin généraliste. C’est pourquoi la Mutualité sociale agricole estime que le médecin traitant est le mieux placé pour être le pivot de l’organisation de la santé publique, notamment de la politique de prévention.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Quelle est votre participation aux fonds de l’assurance maladie ?
M. Philippe Laffon. De même que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés dispose de son Fonds national de prévention, d’éducation et d’information en santé, dont elle fixe le montant et les grandes orientations à travers une convention d’objectifs et de gestion, la Mutualité sociale agricole dispose de son équivalent agricole.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Et pour le fonds d’intervention régional ?
M. Philippe Laffon. Nous sommes très attentifs aux discussions parlementaires en cours et devant présider à sa création. Nous avons compris que celui-ci visait à améliorer la fongibilité des crédits d’intervention des agences régionales de santé ainsi qu’à rapprocher les crédits du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ceux du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés selon une fongibilité asymétrique s’agissant des dépenses de prévention.
Le législateur a déjà prévu qu’une partie de notre fonds national de prévention serait directement affectée aux agences régionales de santé, pour un montant de 1,2 million d’euros. Il s’agit globalement des crédits antérieurement destinés aux groupements régionaux de santé publique, ce qui représentait déjà une certaine mutualisation des dépenses d’intervention des différents acteurs au niveau régional. Celle-ci se trouverait donc renforcée par l’institution du fonds régional d’intervention, ce qui, pour nous, n’apporterait pas de changement notable par rapport au dispositif de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il restera à l’agence régionale de santé le soin de définir sa stratégie de prévention sur le territoire régional, à savoir ses risques prioritaires et ses moyens d’intervention. Nous sommes donc en attente de la parution des schémas régionaux de prévention. Les caisses de la Mutualité sociale agricole participent aux commissions de coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ainsi qu’aux commissions régionales de gestion du risque qui peuvent aussi intervenir dans le champ de la prévention en reliant directement l’agence régionale de santé aux trois grands régimes d’assurance maladie.
La loi précitée a déjà prévu la possibilité de conclure un contrat entre chaque agence régionale de santé et chaque organisme d’assurance maladie pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Ces contrats sont en cours de signature dans la plupart des régions. Mais le décalage dans le temps que l’on observe entre leur élaboration et la parution des schémas régionaux de prévention fait qu’ils comprendront probablement peu de dispositions relatives à la prévention. Malgré tout, des partenariats se mettent en place au niveau local, comme nous l’avons vu à propos de la prévention du suicide, comme en Auvergne.
Les agences régionales de santé ont déjà beaucoup communiqué sur leurs priorités en matière de prévention ; elles ont négocié avec l’État des contrats précis d’objectifs et de moyens, mais tous les acteurs attendent le document de référence pour le pilotage local des actions de prévention que sera le schéma régional de prévention.
M. Michel Brault. J’insiste sur notre attachement à la prévention des risques professionnels, domaine où le rôle des agences régionales de santé ne semble pas précisément défini. Le fait que la Mutualité sociale agricole compte en son sein des services de médecine du travail nous permet une approche globale de cette thématique. Tous nos plans sont arrêtés au niveau national, à l’issue d’une négociation avec les partenaires sociaux, puis déclinés au niveau local, et nous ne voudrions pas que cette dynamique soit remise en cause. Les commissions nationales de prévention réunissent des représentants de l’ensemble des organisations représentatives des employeurs et des salariés et du ministère de l’agriculture.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Chaque caisse doit-elle appliquer le programme national ?
M. Philippe Laffon. Le code rural est très précis sur les procédures de détermination des actions en matière de santé au travail dans chaque secteur d’activité particulier. Des comités techniques nationaux de prévention sont chargés d’examiner, pour chaque filière, les plans de prévention proposés par la Mutualité sociale agricole. Dans le cadre des comités de protection sociale, les élus des trois collèges – celui des exploitants, celui des salariés et celui des employeurs de main-d’œuvre – sont consultés sur ces actions. Ces plans doivent enfin être validés par la Commission nationale de la prévention, instance de concertation où, sous l’autorité du ministère de l’agriculture, la Mutualité sociale agricole discute de ces actions avec les organismes professionnels. Au niveau régional, ce sont des comités techniques régionaux qui évaluent ces actions dans le cadre d’un partenariat étroit entre la Mutualité sociale agricole, les filières et les acteurs professionnels et, désormais, les services déconcentrés de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Au sein de la nouvelle organisation sanitaire mise en place par la loi du 21 juillet 2009, la commission de coordination des actions de prévention fait intervenir des secteurs qui ne sont pas directement sous l’autorité de l’agence régionale de santé, tels que la médecine scolaire, la protection maternelle et infantile, ou encore la santé au travail. C’est dans ce cadre que nous présenterons aux agences régionales nos actions et les plans locaux définis par les caisses, afin que les agences puissent disposer d’une vision globale des actions en santé.
Nous ne présentons évidemment pas le même type d’offres en matière de prévention des risques dans tous les territoires et pour tous nos adhérents : s’agissant d’un régime agricole, les problématiques auxquelles les caisses locales sont confrontées varient considérablement selon les régions. Ce volant de souplesse est absolument indispensable pour répondre aux souhaits des partenaires sociaux et aux problématiques propres à chaque terroir agricole.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. La commission de coordination fonctionne-t-elle ?
M. Philippe Laffon. À en croire ce qui remonte des caisses, ce n’est pas forcément la plus dynamique.
M. Michel Brault. Les agences régionales de santé semblent avoir eu d’autres priorités au moment de leur mise en œuvre…
M. Philippe Laffon. Il est vrai qu’étant encore en phase de déploiement, elles préfèrent peut-être se consacrer d’abord à l’élaboration des schémas régionaux d’organisation sanitaire, des schémas régionaux de prévention ou à la mise en place des actions de gestion du risque.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Participez-vous au fonctionnement de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et comment déclinez-vous les politiques nationales ?
M. Philippe Laffon. D’une façon générale, nous avons noué des partenariats étroits avec les établissements publics en charge des politiques de santé. Nous avons ainsi passé des conventions avec l’Institut de veille sanitaire, l’Institut national du cancer ou l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et nous sommes en train d’élaborer la convention qui doit formaliser les multiples partenariats qui nous lient à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Nous avons ainsi présenté à celui-ci nos outils en matière de campagnes de dépistage.
Je vous citerai un autre exemple : l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé constitue la « force de frappe » d’un comité de pilotage chargé de réfléchir aux actions de soins ou de prévention, dans le domaine du « bien vieillir » et de la prévention contre les effets du vieillissement, que nous avons mis en place avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, le Régime social des indépendants, l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres et l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Du fait de notre fonctionnement en guichet unique, nous sommes amenés, dans la gestion de la couverture vieillesse, à déployer des actions de prévention qui relèvent plutôt de l’action sociale dans d’autres régimes. Nous avons, par exemple, mis en place le « pack Eurêka », mis en œuvre dans des ateliers collectifs destinés à entretenir les mécanismes de la mémoire chez les personnes âgées. Ce type d’action est financé par notre fonds national de prévention.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Que pensez-vous des critiques formulées par la Cour des comptes à propos du dépistage des cancers du sein et de la prostate ?
M. Philippe Laffon. Il n’entre pas dans la mission d’un régime de protection sociale d’évaluer les critères scientifiques et épidémiologiques des actions de dépistage. En ce domaine, nous nous conformons aux instructions de la Haute Autorité de santé et de la direction générale de la santé. Les critères d’âge, notamment, sont déterminés par les autorités scientifiques compétentes. Notre rôle est de rembourser les soins rapidement et, autant que possible, d’assurer la prise en charge des dépenses de soins et de prévention de qualité. Néanmoins, nous devons répondre aux questions du public que nous touchons à travers nos campagnes d’incitation au dépistage du cancer du sein, surtout depuis la parution du livre accusant la politique de dépistage du cancer du sein menée par notre pays de provoquer un « surdiagnostic » de cette pathologie. Nous nous sommes donc tournés vers l’Institut national du cancer pour obtenir des éléments de réponse scientifiques et déterminer la pédagogie susceptible de rassurer nos adhérents. L’Institut national du cancer qui, à côté de ses missions scientifiques et de recherche, travaille aussi sur le dialogue avec le patient, s’est montré très intéressé par les éléments d’information que notre proximité avec le terrain nous permet de recueillir en matière de campagnes de dépistage.
S’agissant du dépistage du cancer de la prostate, il y a un consensus pour reconnaître qu’il ne doit pas être systématique.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Sachant que le taux de participation au dépistage du cancer du sein reste faible dans notre pays, quelles actions menez-vous pour inciter les femmes à se faire dépister ? Comment expliquez-vous que certaines d’entre elles n’aillent pas se faire dépister ? Est-ce par crainte ou par négligence ?
M. Michel Brault. Nous obtenons un taux de participation de 55 %, supérieur à ceux des autres régimes d’assurance maladie. Ce résultat est dû à notre maillage territorial, les caisses locales relayant nos actions de sensibilisation. C’est cette organisation cantonale et départementale qui assure également une meilleure efficacité à nos campagnes de vaccination contre la grippe.
M. Philippe Laffon. Nous ne nous contentons pas, en effet, d’envoyer un courrier à nos adhérents, mais nous menons de véritables actions de proximité, sur les marchés, dans les salons professionnels, à l’occasion de conférences débat que nous organisons. S’ajoute un autre facteur, difficilement quantifiable : nos adhérents constituent une population plus « civique », réceptive aux messages de prévention, du fait peut-être de son caractère rural et plus âgé ; nos conférences de sensibilisation en la matière rencontrent toujours un grand succès. Par ailleurs, nos adhérents, habitant en zones rurales, sont moins concernés par le phénomène du dépistage individuel.
Quant aux freins à la participation au dépistage, vous en avez évoqué quelques-uns : il peut s’agir de la crainte du résultat du diagnostic, mais on peut aussi évoquer la difficulté d’accès aux cabinets de radiologie.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Ce taux, dont vous vous félicitez, reste cependant nettement en deçà de celui qui assurerait une véritable efficacité à la prévention du cancer du sein.
M. Philippe Laffon. C’est pourquoi nous nous sommes fixé des objectifs supérieurs dans le cadre de notre convention d’objectifs et de gestion avec l’État. La déclinaison de la convention nationale au niveau local tient compte des résultats de nos caisses, département par département, afin d’inciter celles qui ont des résultats plus faibles à égaler les autres, et celles qui obtiennent les meilleurs résultats à atteindre les objectifs assignés par les plans nationaux de santé publique.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Quels sont vos liens avec le régime général de l’assurance maladie, d’une part, et les assurances complémentaires, d’autre part, notamment en matière de transmission des données de santé ? Il semble que Groupama ne parvient pas à développer son dispositif de rétinographe mobile, pourtant très utile pour le dépistage de l’hypertension artérielle et du diabète, faute de pouvoir cibler la population concernée. Vous considérez-vous, à l’instar de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, comme les propriétaires des données de santé ?
M. Michel Brault. Nous entretenons des liens historiquement étroits avec les assureurs complémentaires du monde agricole, Groupama, Mutualia et Agrica, auxquels nous sommes liés par des conventions. Aux termes de ces conventions, nous remboursons directement les dépenses de santé de nos adhérents, tant pour la part obligatoire que pour la partie complémentaire. De ce fait, nous avons été amenés à développer avec eux des actions de prévention, telles les conférences débat évoquées par M. Philippe Laffon. Au-delà, nous avons la volonté de développer avec eux des expérimentations afin de tester des démarches innovantes. Nous avons ainsi lancé, en partenariat avec Groupama, l’expérimentation « Pays de santé ».
En matière de transmission des données de santé, cependant, nous nous heurtons à la réglementation en vigueur, qui nous interdit de transmettre toutes les données.
M. Philippe Laffon. L’expérimentation « Pays de santé », que nous déployons dans les Ardennes et en Dordogne en partenariat avec Groupama, a pour objectif de lutter contre la désertification médicale en zone rurale. Il s’agit d’assurer la coordination des soins de premiers recours dans des bassins ruraux souffrant d’une pénurie de médecins généralistes. Un conseil « Pays de santé » permet aux habitants, aux élus et aux médecins de dialoguer sur les problématiques de santé ; une infirmière salariée par Groupama est chargée, en tant que conseillère « Pays de santé », de coordonner l’action des médecins et de proposer des actions de prévention. C’est dans le cadre de cette expérimentation qu’une campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique vient de démarrer, en collaboration avec le réseau de santé CAReDIAB, et qui comporte le recours à un rétinographe mobile.
Nous entretenons un lien permanent et quotidien avec le régime général de l’assurance maladie, tant au niveau national qu’au niveau local. Sur le plan institutionnel, nous sommes membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. À ce titre, nous siégeons à son conseil, M. Michel Brault est membre du collège des directeurs et nous sommes tenus informés des négociations conventionnelles. Nous sommes étroitement associés aux orientations fixées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en matière de simplification des démarches administratives ou de mise en place de services électroniques à destination des professionnels de santé.
Nous ne sommes pas propriétaires des données de santé, celles-ci étant la propriété des patients. Nous veillons à les mettre à la disposition de la recherche. Ainsi, le partenariat que nous avons noué avec l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé doit permettre à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé d’exploiter ces données afin de contribuer à une meilleure connaissance scientifique et médico-économique du secteur sanitaire. Comme vous le savez, le droit encadre strictement la transmission des données personnelles de santé.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Comment mener des actions ciblées quand on ne connaît pas la cible ?
M. Philippe Laffon. Le Système national inter-régions d’assurance maladie, le SNIRAM, à qui nous transmettons beaucoup de données, devrait permettre aux agences régionales de santé de mener localement des actions innovantes et ciblées.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Les indicateurs de performance mis en place dans le cadre de la nouvelle convention médicale, et censés améliorer l’efficience de notre système de soins, sont essentiellement quantitatifs. Or les représentants de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales, que nous venons d’auditionner, préconisent des critères plus qualitatifs. Pensez-vous que ces indicateurs puissent être améliorés dans la perspective de la prévention ?
M. Philippe Laffon. La plupart des 1 300 points de la nouvelle rémunération à la performance créée par la convention médicale correspondent à des objectifs classiques de maîtrise de dépenses médicalisées. D’autres indicateurs sont plus originaux, comme ceux concernant l’organisation du cabinet médical dont notamment l’élaboration d’une synthèse annuelle par le médecin traitant du dossier médical informatisé, ou des indicateurs de suivi des pathologies chroniques. Ces derniers indicateurs contribueront surtout à la prévention secondaire, en améliorant la prise en charge de personnes souffrant d’une affection de longue durée. La convention comprend par ailleurs des grands indicateurs de prévention, ayant trait aux dépistages ou aux vaccinations les plus importants.
Ces indicateurs coïncident avec nos propres objectifs. Les pouvoirs publics demandant aux régimes d’assurance maladie de sensibiliser leurs assurés au dépistage du cancer du sein ou du cancer colorectal ou à la vaccination contre la grippe saisonnière, il est assez logique que l’assurance maladie demande aux professionnels de santé de respecter ces objectifs. Le « double cliquet » constitué par les conventions d’objectifs et de gestion signés par les régimes d’assurance maladie et la rémunération à la performance des médecins est censé renforcer l’efficience du système. En raison de la nouveauté de ce dispositif de rémunération à la performance dans notre pays, nous manquons encore du recul suffisant pour en juger. Les indicateurs eux-mêmes ne sont pas intangibles : ils devront sans doute être améliorés, en tenant compte notamment de la pratique des professionnels de santé et de leurs effets en santé publique. Reste qu’au moment de définir les grandes orientations de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’utilisation de ce nouveau dispositif pour améliorer la prévention a fait consensus, tant au sein du Conseil qu’au sein du collège des directeurs.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Une consultation de prévention tous les dix ans est-elle suffisante ? Une consultation approfondie chaque année, ou tous les deux ou trois ans, ne serait-elle pas préférable pour que soit assuré un suivi réel et global des patients ?
M. Philippe Laffon. Plutôt qu’à une modification de la périodicité, nous réfléchissons à une simplification de notre procédure d’examen périodique, les médecins traitants n’étant pas nécessairement réceptifs au principe d’une consultation périodique et générale, du fait de la culture d’abord curative de nos praticiens. C’est pourquoi notre objectif est d’abord de fidéliser des médecins traitants et d’inciter nos assurés à se rendre à ces consultations, en ciblant ceux qui en ont le plus besoin.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Cette consultation s’appuie-t-elle sur un référentiel ?
M. Philippe Laffon. L’assuré remplit un questionnaire d’auto-évaluation, qui constitue une grille d’orientation pour la consultation. Ce questionnaire porte sur des points tels que la nutrition, la tabagie, la consommation d’alcool, le sommeil, avant de porter sur des pathologies éventuelles. Il varie en fonction de la classe d’âge concernée : les quinquagénaires, par exemple, devront évaluer davantage leurs risques cardiovasculaires. Des examens biologiques sont également proposés.
M. Michel Brault. Nous avons eu la surprise de constater que 25 % de nos adhérents, après avoir rempli le questionnaire et passé les examens, ne se rendaient pas à la consultation.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Peut-être parce que les deux premières étapes leur avaient permis de constater qu’ils n’avaient pas de problème.
M. Philippe Laffon. Le principe d’une consultation de prévention est qu’elle concerne des gens qui n’ont pas a priori de pathologies.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Faut-il généraliser le recours à d’autres professionnels de santé pour résoudre le problème des déserts médicaux ?
M. Philippe Laffon. Il n’y a pas de solution unique à ce problème complexe, dont les causes vont de l’inadaptation du numerus clausus à la définition des spécialités et au manque d’attractivité des zones rurales. La délégation de tâches à d’autres professionnels, notamment dans le domaine de la prévention, peut évidemment être une des solutions.
La nouvelle convention médicale comporte deux nouvelles mesures incitatives, l’une destinée à favoriser le maintien en milieu rural de professionnels de santé exerçant dans le cadre de regroupements, l’autre incitant des praticiens à venir, ponctuellement, en soutien de leurs confrères des zones sous-dotées. Selon une comparaison internationale menée par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l’incitation faite aux lycéens des zones rurales à s’engager dans des études de médecine semble la mesure la plus efficace.
De façon générale, la médecine de premier recours a besoin d’être coordonnée, car des professionnels de santé isolés ne suffiront pas. C’est la raison pour laquelle la Mutualité sociale agricole s’efforce de développer des maisons de santé, des réseaux de santé ou d’autres formes de regroupement des professionnels de santé.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Y aurait-il un autre message que vous souhaiteriez faire passer ?
M. Michel Brault. Il me semble qu’en matière de prévention, le fait que la Mutualité sociale agricole couvre l’ensemble des risques – santé, famille, vieillesse et accidents du travail – nous permet d’être plus efficaces, car nous disposons ainsi d’une approche globale de l’assuré. Cette vocation singulière de la Mutualité sociale agricole se révèle particulièrement intéressante dans le traitement de dossiers tels que celui de la pénibilité. Notre objectif est de conforter cette dynamique.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Messieurs, nous vous remercions.
*
AUDITIONS DU 24 NOVEMBRE 2011
Audition de M. Dominique Libault, directeur à la direction de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Le système de santé français est considéré comme performant dans le domaine des soins, mais peu efficace dans le domaine de la prévention. La communication de la Cour des comptes évoque notamment un défaut de pilotage. Selon vous, monsieur le directeur, quel doit être le rôle de l’État ? Quelle gouvernance adopter afin d’améliorer le pilotage des politiques publiques ? Pourquoi ne pas inclure la médecine du travail et la médecine scolaire dans le périmètre de la prévention sanitaire ?
M. Dominique Libault, directeur de la direction de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Comme le note la Cour des comptes, la première difficulté est de définir le concept de prévention sanitaire. Sa communication met justement en garde contre la tentation d’isoler ce qui est consacré explicitement à la prévention, comme le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, et d’en déduire que les moyens mis en œuvre pour la prévention en France ne sont pas suffisants. Une telle approche serait beaucoup trop réductrice, notamment au regard de la conception de l’Organisation mondiale de la santé, qui inclut dans la prévention tout ce qui tend à éviter l’aggravation d’une maladie.
Selon moi, il y a deux idées à prendre en considération.
D’abord, la prévention doit s’attacher à préserver le capital santé de chacun plutôt qu’à éviter les maladies. Nous arrivons actuellement au terme d’un système où l’individu est libre de ses actes, l’État-providence venant ensuite réparer les problèmes de santé et prendre en charge les personnes exclues du marché du travail ou considérées par les entreprises comme trop âgées pour travailler. Nous devons inventer un nouveau rapport à la sécurité sociale, dans lequel le système de redistribution, de transferts sociaux et de services publics aiderait chacun à mieux vivre sa vie, à savoir fonder une famille, réussir la transition entre la vie professionnelle et la retraite et préserver le plus longtemps possible son capital santé.
Ensuite, il est frappant de constater que, si la santé générale de la population s’améliore et que l’espérance de vie en bonne santé s’accroît, les inégalités, notamment sociales mais aussi devant les indicateurs de la santé, perdurent. Certaines politiques de prévention semblent même les aggraver ; c’est ce que tendent à indiquer les premiers résultats des politiques de prévention nutritionnelle, qui sont mieux reçues par les personnes disposant d’un certain niveau d’éducation, l’obésité devenant alors un marqueur social.
Il convient donc de fixer des objectifs aux politiques de prévention et de retenir les outils et le pilotage adéquats. Il s’avère que la politique qui a le plus contribué à la prévention dans la période récente est la généralisation des radars automatiques de contrôle routier, dans la mesure où cette installation a évité bien des morts et des handicaps. C’est pourquoi les politiques de santé publique ne doivent pas se borner à faire appel aux instruments traditionnels, mais doivent recourir à une palette d’outils la plus vaste possible, incluant l’interdiction, le contrôle et la tarification, comme les mesures relatives aux boissons sucrées, au tabac et à l’alcool, à côté de l’information, de l’éducation à la santé, de l’éducation thérapeutique et du temps médical consacré à la prévention.
Le pilotage de ces outils doit bien évidemment revenir à l’État, qui est le seul à pouvoir assurer une coordination de leur utilisation. Vous avez raison de préciser que par « État », il ne faut pas entendre le seul ministère de la santé, mais l’État dans toutes ses composantes, y compris la médecine du travail et la médecine scolaire. Une telle politique interministérielle doit cependant être pilotée par le ministère de la santé, qui, seul, dispose d’une vision globale du sujet et des moyens d’évaluer les différentes politiques – car ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une politique de prévention qu’il ne faut pas en mesurer l’efficience.
À l’échelon territorial, il importe d’améliorer la coordination entre les acteurs et de développer des synergies. Les agences régionales de santé me paraissent les mieux placées pour la mettre en œuvre, même si la médecine du travail ne relève pas de leur responsabilité ; il convient en effet de mieux coordonner non seulement l’État avec l’assurance maladie, mais aussi les différentes composantes de l’État entre elles.
S’agissant de l’évaluation, j’adhère totalement au constat de la Cour des comptes selon lequel l’addition de dizaines de priorités de santé publique n’aboutit pas à une politique de prévention efficace. Il faut d’abord hiérarchiser les actions, puis les évaluer ; de surcroît, tout ne repose pas uniquement sur la dépense publique.
Pour conclure, dire que le système français est bon dans le domaine curatif, mais moins bon dans le domaine préventif, c’est, d’une certaine manière, rendre hommage à la sécurité sociale qui a assuré l’accès de tous aux soins. Toutefois, il ne faudrait pas que ce soit un alibi pour tolérer le laisser-faire en amont, dans les politiques de gestion du risque. Il convient de responsabiliser les différents acteurs et d’aider chacun à prendre en charge sa propre santé.
M. le rapporteur. Si l’on va jusqu’au bout de votre raisonnement, ne risque-t-on pas d’aboutir à des situations paradoxales : renoncer à l’État réparateur ne revient-il pas à dire que c’est au fumeur de payer pour son cancer du poumon ? Et regretter que les populations les plus favorisées soient les principales bénéficiaires des campagnes de prévention et de dépistage doit-il conduire à ne rien entreprendre ? Comment toucher les personnes les plus éloignées des systèmes de soin ?
M. Dominique Libault. Bien évidemment, la sécurité sociale doit prendre en charge l’ensemble des pathologies. Il serait scandaleux de traiter les gens différemment suivant leur comportement antérieur. En revanche, envoyer des signaux par le moyen de hausses de prix afin de contrecarrer certains comportements me semble une politique efficace ; mais il ne s’agit aucunement de remettre en cause l’accès aux soins de qui que ce soit.
Quant aux grandes campagnes de prévention, elles sont nécessaires mais non suffisantes. Il faut mettre en place autre chose. Selon moi, il serait bon que les structures sanitaires et les structures sociales travaillent davantage ensemble et que l’on recourt aux travailleurs sociaux qui sont au contact direct des populations en situation précaire pour délivrer des messages sanitaires. Une action possible, que je ne suis pas encore arrivé à mener à bien, consisterait à ce que les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’allocations familiales collaborent à des programmes nutritionnels dans le cadre de l’aide à la parentalité.
De même, dans un autre domaine, quand j’essaie de diffuser l’aide à la complémentaire santé, les gens ne sont pas réceptifs spontanément. Nous sommes obligés de procéder à des échanges de fichiers très importants entre les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’allocations familiales et d’envoyer des courriers individualisés aux bénéficiaires potentiels.
Je citerai un dernier exemple montrant dans quel sens nous entendons travailler. Nous procédons à des expérimentations auprès des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État : à Paris et à Bobigny, nous proposons à ceux qui viennent la solliciter un bilan de prévention dans un centre d’examens de santé. Cette démarche sert leurs intérêts, mais aussi celui de la santé publique, puisque des pathologies ou des épidémies que l’on croyait disparues réapparaissent.
M. le rapporteur. Comment, concrètement, parvenir à ce que la caisse de l’assurance maladie et la caisse des allocations familiales travaillent ensemble ? Au niveau local, les travailleurs sociaux dépendent aussi des collectivités territoriales, notamment des conseils généraux et des municipalités. Comment faire pour coordonner tous ces acteurs et atteindre le public visé ?
M. Dominique Libault. Une des solutions, c’est de les décloisonner, afin de mener des actions transversales. Or nous ne disposons pas de ligne budgétaire pour cela ; les budgets des caisses de sécurité sociale sont liés aux conventions d’objectifs et de gestion. C’est pourquoi je préconise, depuis plusieurs années, l’institution d’un « fonds de performance » qui nous procurerait un petit budget pour organiser des actions transversales de toutes natures entre les caisses. Je remercie d’ailleurs l’Assemblée nationale d’avoir adopté une telle mesure dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2012. C’est une des clés de l’amélioration de nos politiques publiques, notamment en matière de prévention.
M. le coprésident Jean Mallot. Proposer une visite de prévention aux étrangers qui demandent l’aide médicale de l’État est louable. Mais devront-ils payer le droit d’entrée de 30 euros de cette visite ?
M. Dominique Libault. Il faut bien distinguer deux choses.
D’une part, le Parlement a en effet souhaité que les personnes qui demandent à bénéficier de l’aide médicale de l’État versent chaque année une petite participation financière. Nous sommes en train de mettre en œuvre cette disposition. Il est donc encore trop tôt pour en faire le bilan. Nous verrons si l’on nous signale des difficultés ; pour l’heure, nous n’avons pas eu d’échos négatifs.
D’autre part, notre expérimentation vise à vérifier si les populations concernées adhéreront ou non à notre proposition. Il se peut fort bien que, pour diverses raisons, elles se montrent réticentes à s’inscrire à des examens médicaux. Pour l’instant, la réponse semble positive. L’enjeu est également d’avoir une connaissance de ce que de tels examens permettront de diagnostiquer et, par voie de conséquence, des frais qu’ils permettront d’éviter à la collectivité publique, dans la mesure où ces populations peuvent souffrir de pathologies lourdes. Dans ce cas comme dans bien d’autres, il vaut mieux prévenir que guérir.
M. le rapporteur. Que peut-on faire pour dépister d’éventuelles maladies transmissibles chez les demandeurs de carte de séjour, qui n’ont pas de médecin traitant ?
M. Dominique Libault. Je ne suis pas sûr que ce sujet relève de ma compétence ! Aujourd’hui, des flux considérables de personnes gagnent notre territoire, y compris pour de très courts séjours. La meilleure façon de prévenir la transmission d’éventuelles maladies me semble être la coopération avec les pays partenaires sur des politiques de santé globales, plutôt que la pratique d’examens systématiques à la frontière. Il reste que ce sujet est du ressort de la direction générale de la santé plutôt que de celui de la direction de la sécurité sociale.
M. le rapporteur. Comment concevez-vous la répartition des tâches entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ? Vous contrôlez l’utilisation du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ; une convention a instauré une rémunération à la performance, en fonction d’indicateurs relatifs, notamment, au dépistage et à la vaccination. Êtes-vous intervenu pour définir ceux-ci ou la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en a-t-elle discuté directement avec les professionnels ?
M. Dominique Libault. La convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la caisse nationale définit les objectifs et les moyens alloués à chacun des fonds gérés par cette dernière, y compris le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires. La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés dresse régulièrement un bilan et transmet l’évaluation des actions conduites à l’aide de ces sommes, en vertu du principe selon lequel l’État stratège fixe les orientations mais fait confiance pour leur mise en œuvre à l’opérateur, à charge pour celui-ci de lui rendre régulièrement des comptes.
Cela étant, une grande partie des actions de prévention consiste en des programmes nationaux de santé publique très pilotés, comme les dépistages ; l’autre partie est organisée à l’échelon régional, les fonds venant abonder les agences régionales de santé en vertu de conventions passées avec l’assurance maladie. Les fonds sont ensuite gérés dans un souci de cohérence territoriale. Le regard de l’État est donc double : national, à travers la convention d’objectifs et de gestion, et territorial, à travers les agences régionales de santé.
Nous veillons à maintenir cette cohérence, sans nous priver de la force de frappe de l’assurance maladie. Lorsque les agences régionales de santé ont été mises en place, certains ont plaidé pour qu’elles reçoivent l’ensemble des fonds destinés à la prévention. J’y suis personnellement réticent. Disposant des médecins-conseils, du Fonds de prévention d’éducation et d’information sanitaires et des assistantes sociales, l’assurance maladie est en effet particulièrement bien placée pour transmettre des messages de prévention, par l’intermédiaire des professionnels de santé ou de ses délégués, et pour négocier des objectifs de performance, y compris en santé publique, dans le cadre des conventions. On ne peut pas à la fois déplorer que l’assurance maladie se consacre trop au curatif et pas assez au préventif et vouloir qu’elle se désintéresse de la prévention. Je crois que cette erreur a été évitée jusqu’à présent.
S’agissant des indicateurs négociés avec les médecins, je rappelle que le Gouvernement a proposé au Parlement un contrat d’amélioration des pratiques individuelles. L’initiative en revient à la direction de la sécurité sociale : nous avions en effet constaté que les partenaires conventionnels montraient une certaine réticence à traiter la question de l’évolution des modes de rémunération et, en particulier, du passage à la rémunération à la performance. À l’époque, les syndicats y étaient même totalement opposés. Il nous a paru intéressant de nous doter d’un aiguillon et de donner la possibilité à l’assurance maladie de proposer aux médecins, individuellement, un contrat de performance. Celui-ci a très bien fonctionné, puisque 15 000 généralistes y ont adhéré. Au vu de ces résultats, les syndicats se sont convertis à l’idée et ont proposé d’intégrer le contrat de performance à la convention médicale, ce qui a été accepté par le Gouvernement et l’assurance maladie. On a largement repris les indicateurs initiaux des contrats d’amélioration des pratiques individuelles, en y incluant toutefois quelques modifications consécutives aux négociations.
M. le coprésident Pierre Morange. Tout cela est fort séduisant sur le papier, mais disposez-vous d’une évaluation, ne serait-ce que partielle, de ces contrats de performance ? Le dispositif se révèle-t-il efficace ?
M. Dominique Libault. Permettez, monsieur le président, que je réponde auparavant à la question du rapporteur sur les rôles respectifs de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’État – ce qui ne sera d’ailleurs pas sans rapport avec l’évaluation.
Au-delà de ces contrats de performance individuels, l’État a lancé une stratégie de diversification des modes de rémunération des professionnels de santé, notamment pour promouvoir l’exercice pluridisciplinaire, nécessaire à l’amélioration de la prévention, avec des objectifs de performance.
Il reste que vous avez raison : il ne suffit pas de définir des objectifs, il faut en évaluer les résultats.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous rappellerai en effet, monsieur Dominique Libault, que la MECSS garde le souvenir précis d’objectifs, tous on ne peut plus pertinents, mais dont la mise en œuvre et l’évaluation furent des plus aléatoires. C’est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à pouvoir, derrière le discours, mesurer avec précision l’efficacité des dispositifs.
M. Dominique Libault. C’est un souci que nous partageons.
S’agissant des nouveaux modes de rémunération, nous avons, dès le départ, prévu une évaluation, que nous avons confiée à l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Nous pourrons vous exposer avec précision la stratégie retenue à cet effet, qui est scientifique et particulièrement complexe.
Les contreparties d’une évaluation pertinente, ce sont en effet sa complexité et sa lenteur, surtout dans un domaine comme la prévention où il s’agit d’examiner l’évolution des comportements et l’impact sur la santé publique, ce qui nécessite de longs mois de travail ! C’est une des raisons pour lesquelles la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu la prolongation de l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération.
Pour mener à bien un tel projet, il faut définir des indicateurs et disposer de systèmes d’information pour recueillir les données ; nous travaillons avec l’Agence des systèmes d’information partagés de santé, afin de doter les maisons de santé des logiciels nécessaires, qui font souvent défaut. Hier encore, je rencontrais un prestataire de services qui me montrait des logiciels qui satisfont au cahier des charges que nous avons établi et qui commencent à fonctionner dans certaines maisons de santé, de manière à bâtir des indicateurs.
M. le coprésident Pierre Morange. Lorsqu’on a conçu les contrats de performance en prévoyant qu’ils devraient être évalués, on n’a donc pas prévu d’outils de mesure et d’enregistrement des données ?
M. Dominique Libault. Si. Il existe deux manières de mesurer et d’évaluer. D’abord, à travers les systèmes de l’assurance maladie – pour résumer, le système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie. Ce système est fiable, et il peut être opposé aux professionnels de santé. C’est sur cette base qu’a été construit le premier contrat de performance, le contrat d’amélioration des pratiques individuelles.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans ce cas, quels sont les premiers résultats ?
M. Dominique Libault. M. Frédéric van Roekeghem est mieux placé que moi pour vous les communiquer. Certaines rémunérations sont liées aux taux d’atteinte des objectifs. L’assurance maladie les a mesurés ainsi que leur dispersion. Elle estime que, si les objectifs ne sont pas atteints en totalité par les professionnels, ils le sont tout de même en moyenne – je parle de mémoire – dans une proportion de 60 % à 70 %.
Il convient cependant d’aller au-delà des chiffres pour examiner si les comportements ont réellement changé. C’est pourquoi, dans les nouveaux contrats, la rémunération à la performance dépend à la fois de données objectives, comme le taux de dépistage, mais aussi de l’évolution des comportements. Il s’agit, selon moi, d’un élément fondamental.
J’essaie pour ma part de trouver un indicateur qui permettrait de prévenir les hospitalisations, ce qui contribuerait à réduire les coûts et, d’une certaine manière, à améliorer la prévention ; ainsi, par exemple, les hospitalisations ne contribuent pas toujours à maintenir le capital santé des personnes âgées dépendantes.
M. le rapporteur. Nous allons auditionner tout à l’heure le directeur général de la santé. Quels sont vos rôles respectifs ? La Cour des comptes propose l’institution d’un délégué interministériel et estime que cette fonction devrait revenir au directeur général de la santé. Qu’en pensez-vous ?
M. Dominique Libault. Je le répète : selon moi, la gouvernance de la politique de santé publique doit revenir à l’État, au niveau interministériel, et le ministère de la santé doit en être le pilote. Je souscris donc à la proposition de la Cour des comptes.
Le partage des rôles est aujourd’hui simple : la direction de la sécurité sociale n’est pas compétente pour définir les priorités de santé publique ; ce rôle revient à la direction générale de la santé. En revanche, s’agissant du pilotage de la sécurité sociale, on ne peut à la fois regretter que le système privilégie le curatif au détriment du préventif et refuser toute intervention de notre part. C’est pourquoi nous devons réfléchir sur les sujets qui relèvent de notre compétence et proposer des initiatives comme le mode de rémunération des professionnels de santé libéraux ou la manière d’inciter à des actes de prévention. En général, les professionnels de santé libéraux indiquent qu’ils souhaiteraient faire davantage de prévention, mais relèvent qu’ils ne sont pas rémunérés pour cette prestation ou ne disposent pas d’assez de temps pour cela.
M. le coprésident Jean Mallot. Certes, il ne vous appartient pas d’établir une hiérarchie parmi les 100 objectifs de la loi n° 2004-806 du 9 août 2044 relative à la santé publique ; cela relève de la direction générale de la santé. Néanmoins, c’est bien votre direction qui dispose, directement ou indirectement, des éléments permettant de mesurer l’efficacité des actions conduites en fonction de ces objectifs. Comment ces deux démarches s’articulent-elles ?
M. Dominique Libault. Nous ne sommes pas compétents pour mesurer les résultats d’une politique de santé publique ; c’est la direction générale de la santé qui en est chargée. En revanche, si l’on estime qu’il serait intéressant de faire évoluer les modes de rémunération des professionnels de santé pour encourager les actions de prévention, nous devons travailler avec l’assurance maladie pour élaborer les indicateurs pertinents en liaison avec la direction générale de la santé, voire la Haute Autorité de santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous ne semblez pas avoir tout à fait conscience que l’absence de coordination opérationnelle est déplorée par tous, notamment par la Cour des comptes ; il conviendrait de chercher des solutions un peu plus précises et rigoureuses… Tel est le sens de l’idée d’instaurer un délégué interministériel.
Dans le cadre du ministère, quelles sont vos relations avec les services chargés de la médecine du travail ? Eu égard à vos responsabilités, vous pourriez assurer une coordination dans ce domaine, afin d’en améliorer l’efficience de ces services.
M. Dominique Libault. J’estime que ce ne sont pas seulement les relations entre l’État et l’assurance maladie qui sont en cause, mais aussi les relations entre les services de l’État. Dans cette perspective, la santé au travail est une question essentielle. Force est de constater qu’elle continue à relever de la compétence du ministère du travail, et non de celle du ministère de la santé. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit l’organisation la plus efficace.
M. le rapporteur. Qu’en est-il de la médecine scolaire ?
M. Dominique Libault. Il s’agit en effet de l’autre grand domaine qui échappe à la compétence du ministère de la santé. Cela étant, la direction de la sécurité sociale travaille assez peu sur ces questions.
En revanche, vous avez raison, la médecine du travail est un sujet sensible, qui nous interpelle. D’une part, se pose la question de la tutelle de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, dont les missions consistent dans la réparation des accidents, mais aussi à mener des actions de prévention. D’autre part, se pose le problème des retraites ; je considère qu’on ne relèvera le défi du vieillissement actif qu’en travaillant non seulement sur l’emploi des seniors, mais aussi sur la durabilité de la santé au travail : comment nos concitoyens peuvent-ils préserver leur capital santé au travail tout au long de leur vie ? Telle est la question centrale.
M. le coprésident Pierre Morange. Et au-delà de ces réflexions générales, peut-on espérer un passage à l’action ?
M. Dominique Libault. C’est la direction générale du travail qui pilote le dossier et les plans « Santé au travail ». Des progrès existent dans la mesure où ces plans sont désormais menés beaucoup plus en synergie avec le ministère de la santé et avec la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui gère la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ce domaine, il y a de plus en plus de cohérence au sein de l’État et de synergie entre tous les acteurs.
Je rappelle par ailleurs que j’ai fait changer le nom des caisses régionales d’assurance maladie en « caisses d’assurance retraite et santé au travail », afin d’indiquer qu’elles devaient s’investir non seulement dans la réparation, mais aussi dans la prévention et dans la santé au travail. Je ne vous cache pas que, sur le terrain, les choses évoluent lentement, car ces deux univers sont très éloignés l’un de l’autre. Les services commencent cependant à travailler ensemble, mais cela nécessitera du temps.
M. le coprésident Pierre Morange. Toutes ces périphrases ne font que souligner des difficultés d’articulation. Qu’entendez-vous par « nécessiter » ?
Il est évident qu’un certain recul est nécessaire pour évaluer la mise en œuvre des objectifs de santé publique. Néanmoins, le sujet est sur la table depuis quelques décennies ; n’existe-t-il pas un calendrier ? On a l’impression qu’il s’agit d’idées en l’air !
M. le rapporteur. Il est évident qu’il existe un problème de coordination entre le ministère de la santé, le ministère du travail et le ministère de l’éducation nationale ; c’est d’autant plus compliqué que la médecine du travail est souvent gérée de façon paritaire.
Vous avez indiqué que la prévention avait pour enjeu la préservation du capital santé des individus. À ce titre, elle recouvrirait tout ce qui est du domaine environnemental, comme la qualité de l’air ou de l’eau ! Comment peut-on assurer une coordination dans ces conditions ?
M. Dominique Libault. On peut même estimer qu’une grande partie de l’État ne s’occupe que de préserver le capital santé de nos concitoyens !
La santé au travail a connu des améliorations. La lutte contre le travail illégal est toutefois un préalable car ce dernier comporte des risques majeurs d’accidents et de maladies professionnelles. Cette lutte recouvre, outre l’action de la direction des risques professionnels, la mission de contrôle des inspections du travail et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui doivent s’assurer que tout travailleur est déclaré. C’est une notion de base pour la préservation de la santé au travail.
Nous avons par ailleurs des pistes pour renforcer la coordination. Actuellement, je réfléchis à la meilleure manière d’atteindre les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. La réforme de la médecine du travail a ouvert de nouvelles possibilités en matière d’organisation du travail ; on doit œuvrer davantage en synergie avec les caisses d’assurance retraite et santé au travail. Il existe aujourd’hui toute une gamme d’outils pour aider les entreprises à faire de la prévention sur des sujets comme les troubles musculo-squelettiques, qui sont actuellement l’enjeu prioritaire compte tenu des incapacités au travail engendrées. La difficulté est de toucher les très petites entreprises sur ces questions, alors que les moyens des services publics sont limités dans ce domaine.
Nous avons par ailleurs réformé la tarification des accidents du travail, de façon à ce que la prévention soit prise en compte à travers un mécanisme de bonus et de malus et que le système qui était initialement fondé sur la stigmatisation en cas d’accidents graves soit plus intelligent et davantage axé sur les efforts de prévention. Nous réalisons donc des actions tangibles, qui nécessitent beaucoup de travail.
En la matière, je crois au rôle de l’État, mais aussi à celui des partenaires sociaux. Représentants des entreprises et des salariés mènent d’ailleurs un travail constructif dans ce domaine au sein de la direction des risques professionnels.
M. le rapporteur. La transmission des données est un autre problème, sur lequel M. Christian Babusiaux travaille depuis longtemps. Lors d’une précédente audition, un représentant de Groupama nous a indiqué que le groupe utilisait dans les Ardennes un rétinographe mobile afin de dépister d’éventuelles complications chez les patients souffrant d’hypertension artérielle et de diabète ; les clichés sont envoyés à un ophtalmologue. Faute de disposer des données nécessaires, Groupama ne sait pas qui, dans une commune, présente ce type de pathologies. Comment surmonter cette difficulté ?
M. Dominique Libault. Nous travaillons avec les complémentaires santé, afin de les inciter à organiser des actions de prévention. Nous leur avons demandé d’en prévoir systématiquement dans les contrats responsables. Beaucoup ont mis en place des initiatives en ce sens, qu’il s’agisse des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des assureurs, en priorité dans des domaines qui les concernent au premier chef, c’est-à-dire l’optique et les soins dentaires.
De temps en temps, les complémentaires rencontrent en effet des problèmes de transfert des données. Nous essayons d’y remédier, en liaison avec l’Institut des données de santé et M. Christian Babusiaux. Depuis quelques années, les échanges de données se multiplient. Cela devrait s’améliorer encore dans les années à venir.
M. le rapporteur. Cela s’améliore lentement… Quand je lui ai posé la question, il y a deux jours, M. Frédéric van Roekeghem m’a répondu qu’il souhaitait rester le principal dépositaire des données : il n’était pas visiblement favorable à leur transmission.
M. Dominique Libault. Il est vrai qu’il faut parfois brusquer la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, mais c’est le rôle de l’État. Il est tout aussi vrai qu’il faut être attentif dans la transmission des données, à savoir vérifier leur nature et leurs destinataires. Nous avons eu le même débat à propos de la transmission de données à des laboratoires pour des études post-autorisation de mise sur le marché. Dans le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le Gouvernement et le législateur ont jugé prudent de créer un groupement d’intérêt économique pour examiner la recevabilité des demandes et leur pertinence scientifique. Il reste que nous sommes favorables à des échanges entre les bases de données de l’assurance maladie et celles des complémentaires santé – dans les deux sens, d’ailleurs. Le projet Monaco devrait permettre d’aplanir nombre de difficultés.
*
Audition de M. Jean-Yves Grall, directeur général à la direction générale de la santé au ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Monsieur Jean-Yves Grall, j’aimerais comprendre l’articulation, au sein du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, entre la direction de la sécurité sociale et la direction générale de la santé. Qui définit la politique de santé – et donc de prévention sanitaire – de notre pays ? Quelles relations la direction générale de la santé entretient-elle avec la direction de la sécurité sociale, et donc avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ?
La Cour des comptes souligne, dans sa communication, une absence de pilotage de la politique de santé et propose de charger de cette mission un délégué interministériel, qui pourrait être… le directeur général de la santé. Nous sommes bien conscients des problèmes de coordination qui se posent à la fois avec l’Éducation nationale, chargée de la médecine scolaire, la médecine du travail, administrée de façon paritaire et les collectivités territoriales, qui gèrent la protection maternelle et infantile. Sans oublier que notre santé dépend aussi de la qualité de l’environnement, de l’air et de l’eau. Mais un grand délégué interministériel, responsable de la prévention, serait-il à même de coordonner l’ensemble ?
M. Jean-Yves Grall directeur général à la direction générale de la santé au ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Nommé depuis maintenant six mois, je commence à avoir une vision d’ensemble du dispositif et j’ai conscience qu’il est nécessaire aujourd’hui plus que jamais d’optimiser l’utilisation de nos ressources pour atteindre nos objectifs. Cela justifie l’existence d’un lien très fort entre l’État et la direction générale de la santé, d’une part, et l’assurance maladie, d’autre part.
Ce lien se traduit formellement, au niveau de la direction générale de la santé, par l’existence de trois dispositifs : le Comité national de santé publique où, à côté des représentants de l’État, siège le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; la convention d’objectifs et de gestion entre l’État et l’assurance maladie ; le contrat État-Union nationale des caisses d’assurance maladie qui détermine des objectifs sur lesquels se fondent les actions. L’objectif est bien de concentrer, d’optimiser et de coordonner ces dernières.
Au niveau de l’État, chacun des ministères mène, sinon sa politique de prévention, du moins des actions que le Comité national de santé publique a pour mission de coordonner. Mais, très objectivement, même s’il se réunit régulièrement, ce comité créé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique n’est pas très opérationnel et ses décisions ne conduisent pas à une résultante sur laquelle les ministères pourraient s’aligner.
Ce lien est davantage organisé entre l’assurance maladie et l’État. Le régime général, la Mutualité sociale agricole, le Régime social des indépendants ou d’autres intervenants agissent dans le cadre de programmes pluriannuels. Une nouvelle convention a été passée avec les acteurs de santé, en particulier avec les médecins qui peuvent s’appuyer sur les contrats d’amélioration des pratiques individuelles pour évaluer leur pratique professionnelle.
Le lien entre l’assurance maladie et l’État se traduit aussi dans la déclinaison des politiques au sein des agences régionales de santé. Il existe en effet un Conseil national de pilotage des agences régionales de santé – dont fait bien sûr partie le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés – qui discute de la mise en œuvre de ces politiques dans le cadre du contrat qui lie l’État et les agences.
Enfin, sur le terrain, le lien entre l’État et l’assurance maladie se concrétise à travers des actions et des consultations. Je pense, notamment, dans le cadre du projet régional de santé, aux commissions de coordination des politiques menées, dont la politique de prévention – formellement inscrite dans la loi.
Ce lien existe donc. Il convient effectivement de le renforcer, ne serait-ce qu’au niveau de l’État.
Le pilotage d’une politique de santé homogène supposerait que le Comité national de santé publique joue un rôle beaucoup plus important. Je le répète : même s’il se réunit souvent, il est très peu opérationnel – peut-être parce que les directions y sont relativement sous-représentées. Ce comité devrait être à même de défendre une stratégie. Il doit donc être dirigé par une personne disposant d’une forte légitimité, susceptible de peser sur les choix et les décisions. Voilà pourquoi je soutiens l’idée selon laquelle il devrait s’agir d’un pilote identifié comme tel, et disposant d’une assise juridique solide.
Quant à la santé environnementale, la direction générale de la santé a engagé une réflexion prospective sur la politique de santé publique, qui recouvre notamment ce champ. Un document détermine les axes selon lesquels travailler et l’action que doivent mener sur le terrain les agences régionales de santé, qui sont liées à l’État par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Les agences régionales de santé concluent en particulier des contrats locaux de santé, qui constituent un des éléments de la transversalité découlant d’une stratégie nationale et un levier très fort pour le déploiement des politiques de santé – santé environnementale, soins de premier recours, prévention, en particulier en relation avec les collectivités territoriales.
M. le rapporteur. On a l’habitude de dire qu’en France, la politique de santé est plutôt bonne dans le domaine des soins, mais mauvaise en matière de prévention. Néanmoins, il est difficile de distinguer ce qui relève de cette dernière et ce qui relève du curatif. De fait, dans le colloque singulier avec son patient, un bon médecin fait aussi de la prévention. La Cour des comptes évalue d’ailleurs les sommes consacrées à celle-ci à un montant compris entre 1… et 10 milliards d’euros.
Que pensez-vous de la loi n° n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et de ses 100 priorités ? Comment suivez-vous les indicateurs de performance ? Un nouveau texte avait été prévu, mais il n’a pas abouti. Sera-t-il au moins procédé à une actualisation de cette loi ? Pensez-vous qu’il faille conserver un aussi grand nombre de priorités ? Ne serait-il pas plus sage, et plus efficace, de s’en tenir à trois ou quatre, bien précises ?
D’autre part, si l’on consent des efforts considérables pour ramener en dessous de 5 000 le nombre annuel de morts en raison d’accidents routiers, j’observe que l’on en fait beaucoup moins pour les 60 000 décès liés au tabac et les 50 000 liés à l’alcool.
M. Jean-Yves Grall. Effectivement, la Cour des comptes a donné une fourchette allant de 1 à 10 milliards d’euros de dépenses, en fonction de ce que l’on considère comme relevant ou non de la prévention. Certains crédits sont « fléchés » : le programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins et le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de l’assurance maladie permettent une certaine traçabilité. Mais pour le reste, il devient difficile, en raison de leur imbrication, de distinguer parmi les crédits pour apprécier la part consacrée à la prévention. Et comme vous l’avez fait remarquer, on ne saurait morceler l’acte du médecin généraliste.
Nous pouvons néanmoins agir sur des actions transversales qui sont moins fléchées, mais qui renvoient, au niveau régional, à certaines thématiques, comme la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Sans avoir besoin d’isoler des financements spécifiques, qui sont liés pour les uns à la prévention, pour les autres à l’hospitalisation ou au médico-social, on s’assure ainsi d’une approche beaucoup plus transversale.
Par ailleurs, la loi du 9 août 2004 précitée reposait sur trois piliers principaux : l’expertise par le Haut Conseil de la santé publique ; la démocratie sanitaire, avec la création de la Conférence nationale de santé ; enfin, la coordination des actions par le Comité national de santé publique. Je pense que nous devons nous appuyer davantage sur l’évaluation du Haut Conseil de la santé publique et, surtout, nous préoccuper de la pertinence, notamment médico-économique, des actions de prévention menées.
Quant au dernier point : la définition de priorités de santé publique pour notre pays, 100 objectifs ne constituent pas des priorités en tant que telles. Il faut sans doute les regrouper par thèmes et en faire de réelles priorités. À mon sens, un nombre trop important de priorités peut annihiler la notion même de priorité.
M. le coprésident Jean Mallot. Certes, mais dans la période 2004-2008, quelques priorités, quatre ou cinq, avaient été fixées. Nous sommes en 2011 : en a-t-on arrêté d’autres ? Et quelles sont les vôtres ?
M. Jean-Yves Grall. De 2004 à 2011, la situation a beaucoup évolué, et nous avons dû nous adapter. Ainsi la question de la résistance aux antibiotiques est devenue une priorité de santé publique. Voilà pourquoi nous avons mis au point, très récemment, un plan d’action sur ce thème. Mais il ne faut pas oublier une autre priorité, plus large : la lutte contre les inégalités sociales et les inégalités en santé, qui sont génériques.
Nous nous adaptons donc en permanence, avec des priorités thématiques mais aussi des priorités d’action, qui sont celles de la direction générale de la santé.
M. le coprésident Jean Mallot. Les quatre ou cinq priorités de la période 2004-2008 avaient été fixées dans la loi. Nous attendons la suite. Que de nouvelles priorités soient apparues, nous le concevons. C’est même la loi du genre. Mais si ces priorités ne sont pas fixées et encore moins connues des différents acteurs, elles peuvent difficilement être prises en considération.
M. Jean-Yves Grall. C’est justement l’objet du programme et des éléments que nous avons voulu mettre en place. D’une part, des indicateurs sont élaborés par le Haut Conseil de la santé publique. D’autre part, la nouvelle loi que la direction générale de la santé prépare met au point un document d’orientation stratégique, qui sert trois finalités : promouvoir l’égalité devant la santé ; préserver ou restaurer la capacité d’autonomie de chacun ; renforcer la protection de la santé face aux évolutions des enjeux sanitaires.
Ce document s’appuie sur les principes suivants : une approche globale ; une réponse fondée sur les progrès des connaissances ; une prise en charge adaptée aux situations de santé ; une action lisible, susceptible de susciter l’adhésion de la population.
Il définit une stratégie nationale de santé, avec cinq axes de travail : prévenir et réduire les inégalités de santé dès les premiers âges de la vie ; anticiper et accompagner le vieillissement de la population ; maîtriser et réduire les risques pour la santé et l’autonomie ; se préparer à faire face aux crises sanitaires ; adapter le système de santé aux besoins sanitaires et aux enjeux d’efficience.
M. le coprésident Jean Mallot. Ce sont des objectifs très vastes ! Comment mieux les définir et, le moment venu, en mesurer l’efficience ?
M. Jean-Yves Grall. Ce document d’orientation a été soumis à la concertation. L’avis de la Conférence nationale de santé a notamment été sollicité afin d’affiner les priorités.
M. le rapporteur. Dans sa communication, la Cour des comptes est assez critique sur le dépistage du cancer. Doit-on dépister des petites tumeurs qui ne seraient pas évolutives ? Seulement, et c’est un médecin qui vous le demande, comment sait-on qu’une petite tumeur ne va pas évoluer ? Et le dosage du taux de PSA (antigène prostatique spécifique), est-il vraiment toujours utile pour détecter le cancer de la prostate ?
Mais j’aimerais évoquer également un secteur qui me préoccupe, celui de la médecine prédictive. Doit-on s’engager dans cette voie ? Cela risque de poser des problèmes éthiques au moment de la grossesse et de provoquer des angoisses alors qu’on n’est jamais certain que la maladie va se déclarer. Qu’en pensez-vous en tant que directeur général de la santé et en tant que médecin ?
M. Gérard Bapt. Bien que n’appartenant pas à la MECSS, j’aimerais vous poser deux questions. La première concerne le dépistage du cancer du sein. Il semble que 20 % des femmes ne soient toujours pas suivies, le dépistage systématique restant trop balbutiant pour suppléer le dépistage volontaire. Des autoprélèvements ont été expérimentés au centre hospitalier universitaire de la Timone, à Marseille. Cette méthode faciliterait grandement le dépistage. Qu’en pensez-vous ?
Ma seconde question concerne l’antibiothérapie. Lorsque j’ai présenté mon rapport spécial sur les crédits de la mission Santé, j’ai fait une proposition relative aux réservations hospitalières des molécules de dernière génération. De son côté, une de nos collègues a déposé un amendement visant à rattacher la direction générale de l’alimentation au ministère de la santé. C’était un peu audacieux mais il me semble malgré tout que le ministère de la santé devrait être plus vigilant à l’égard des prescriptions antibiotiques en milieu vétérinaire. Quelle est votre position ?
M. le rapporteur. J’avais moi-même proposé que les médicaments vétérinaires soient dispensés en pharmacie et non par les vétérinaires. Aujourd’hui, ceux-ci sont rémunérés en partie par la vente de médicaments qu’ils prescrivent eux-mêmes, tels que les antibiotiques et les anabolisants administrés dans les élevages. Est-ce bien judicieux ?
M. Jean-Yves Grall. Le plan stratégique que nous avons présenté dernièrement prévoit de maintenir dans la réserve hospitalière les antibiotiques de dernière génération. Il faut en effet éviter de compromettre par un mauvais usage ces antibiotiques, qui sont encore peu producteurs de résistances, d’autant qu’il n’est pas envisagé, dans l’avenir, d’en développer de nouveaux.
Nous avons par ailleurs repris l’idée de doter les établissements de santé de référents en antibiothérapie, prévus par une circulaire de 2002. Certains antibiotiques ne doivent être délivrés dans les établissements que sur avis ou sur prescription de ces spécialistes formés. Ces derniers doivent par ailleurs s’organiser en réseau au sein des régions, pour fournir à l’ensemble des prescripteurs, y compris aux médecins de ville, une référence pour bien adapter l’antibiothérapie.
En outre, une double contractualisation a été mise au point : dans le cadre de la nouvelle convention, les médecins s’engagent, dans les contrats d’amélioration des pratiques individuelles, à une juste prescription des antibiotiques, qui devrait aboutir de facto à une diminution de leur utilisation ; de la même façon, les agences régionales de santé cosignent avec les établissements de santé, une annexe « qualité » du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sur la bonne prescription d’antibiotiques.
Enfin, cette action d’alerte et de prévention à la résistance aux antibiotiques est menée de façon globale. L’État et l’assurance maladie organisent des campagnes d’information dans des établissements de santé, mais aussi au niveau interministériel : les ministères de la santé et de l’agriculture ont ainsi participé ensemble à la Journée européenne d’action sur les antibiotiques. Des plans d’action sont développés sur le thème de l’antibiothérapie en milieu animal. Il s’agit en effet de travailler sur la sélection de germes interhumains mais aussi sur la transmission des germes animaux à l’espèce humaine, qui suscite des difficultés au niveau national, mais surtout au niveau international.
M. le rapporteur. Nous comprenons bien que la diminution des prescriptions d’antibiotiques répond à un objectif de santé publique et d’économie. Mais nous pouvons avoir besoin demain d’antibiotiques, par exemple contre le staphylocoque résistant. Comment inciter l’industrie à mener des recherches sur le sujet si elle sait que le médicament sera peu prescrit et vendu à un prix modique ? Les industriels ont plutôt intérêt à trouver un médicament contre le cholestérol ou contre les maladies dégénératives, qui sera prescrit à grande échelle.
M. Jean-Yves Grall. Il s’agit certes de réduire la consommation d’antibiotiques, mais surtout de les prescrire correctement, de façon à diminuer les résistances, ce qui induira une diminution de leur utilisation. Quant au motif financier, il est secondaire : c’est le motif de santé publique qui prime.
Comment développer des produits dans un contexte industriel et commercial qui n’y est pas favorable ? C’est un des sujets sur lesquels nous travaillons. À l’heure actuelle, aucun développement de nouveaux antibiotiques susceptibles de nous aider n’a été trouvé. Je ne peux donc pas vous donner de réponse claire.
On ne peut lancer des campagnes organisées de dépistage que si l’on est certain qu’elles présentent un intérêt pour la santé publique. S’agissant de la prostate, aucune n’est organisée. Tous les éléments dont nous disposons laissent à penser, et une étude américaine va sans doute renforcer cette appréciation, que la prescription du dosage de PSA n’est pas systématiquement justifiée et doit donc être adaptée. C’est pourquoi nous avons sollicité la Haute Autorité de santé sur les bonnes prescriptions et sur les bonnes pratiques en la matière.
Il faut bien sûr développer la médecine prédictive, mais nous devons être conscients que cela génère de nombreuses difficultés, notamment du point de vue éthique – je pense plus particulièrement au dépistage des anomalies fœtales. Nous devons donc réfléchir aux modalités de ce développement. Nous disposons d’un certain nombre d’outils et d’instances de saisine, qui sont soit le Haut Conseil de santé publique, ou la Haute Autorité de santé, pour nous aider à faire la juste part des choses dans chaque discipline.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur le directeur général, vous avez vous-même souligné la multiplicité des objectifs de la loi quinquennale d’août 2004 précitée. Mais, en matière de santé publique comme dans d’autres domaines, « qui trop embrasse mal étreint ». Ne serait-il pas plus pertinent de se concentrer sur les quatre grands facteurs de risque qui ont été clairement identifiés : l’alcool, le tabac, la surcharge pondérale et la sédentarité ?
M. Jean-Yves Grall. Je partage votre avis : pour être efficace, il faut parfois sérier les priorités et si la coordination s’impose en cette période de contraction des moyens, ce doit être d’abord au bénéfice d’actions bien ciblées.
Vous avez cité les quatre déterminants de santé majeurs. La difficulté, pour la direction générale de la santé, est de maintenir une certaine constance dans l’action, éventuellement dans le cadre de plans. Tel est le cas pour la lutte contre le tabac et pour la lutte contre l’alcool, même si cette dernière n’est peut-être pas assez valorisée. Pour lutter contre le surpoids et l’obésité, nous avons élaboré un plan national Nutrition et un plan Obésité, qui s’accompagnent d’actions concrètes dont les effets se font déjà sentir.
M. le coprésident Pierre Morange. Un certain nombre de bonnes pratiques, qui ont démontré leur efficacité, ont été identifiées. Mais elles semblent faire partie d’une muséographie sanitaire et on se garde bien de les généraliser. C’est paradoxal, pour ne pas dire irritant.
La MECSS a été frappée par une expérimentation, menée dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur deux cohortes d’élèves du primaire dont une seule avait bénéficié d’un programme d’éducation à la santé, à raison d’un enseignement tous les quinze jours sur le tabac, l’alcool et les régimes alimentaires. Les tests qui ont été réalisés quelques années après ont montré que les comportements d’addiction à l’alcool et au tabac et les problèmes de surcharge pondérale étaient deux fois moindres dans la cohorte qui avait suivi ce programme. C’est le type même de la bonne pratique que l’État stratège aurait intérêt à soutenir.
M. Jean-Yves Grall. Vous avez raison. Il faut savoir rassembler ces actions menées sur le terrain, pour en obtenir un résultat. Des agences comme l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé peuvent mettre en œuvre les bonnes pratiques et en faire la promotion, à travers des actions de santé et des campagnes.
Il y a aussi, au sein de chaque agence régionale de santé, des échanges afin de décliner…
M. le coprésident Pierre Morange. J’entends bien, mais cela nous renvoie au propos liminaire : il faut un stratège et une responsabilité clairement identifiée. L’État, dans ses fonctions régaliennes, tant en matière de santé que d’éducation ou de travail, dispose tout de même d’une légitimité et d’une autorité qui devraient lui permettre de mener aisément ce type de programmes.
S’agissant de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, son rôle s’impose avec la force de l’évidence. L’expérimentation que j’évoquais a d’ailleurs été conduite par la structure régionale de cet institut.
Quant à l’action des agences régionales de santé, elles sont de qualité variable : nous avons auditionné un président de caisse primaire d’assurance maladie, celle des Yvelines, qui nous a indiqué qu’il n’avait pas d’interlocuteur quand il voulait évoquer des actions de prévention.
M. Jean-Yves Grall. Pour vous répondre en même temps qu’au propos liminaire du rapporteur, je dirai qu’un pilote, quel qu’il soit, doit avoir la légitimité suffisante pour imposer une stratégie resserrée autour d’objectifs précis, correspondant aux déterminants de santé majeurs. Les plans stratégiques d’action, qui seront déclinés au plus proche des populations, dans le temps et par les acteurs sur le terrain, doivent rassembler les bonnes pratiques. Il faut mettre en œuvre, dans le champ de la santé publique et de la prévention, ce qui se fait dans le champ du soin, avec l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé ou médico-sociaux, ou ce qui se faisait avec l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.
Une fois donnée l’impulsion stratégique, la déclinaison sur le terrain va traduire l’état des forces, des compétences et de la qualité des uns et des autres, mais l’exemple évoqué de l’Île-de-France ne doit pas être généralisé à l’ensemble du territoire. C’est au directeur général de l’agence régionale de santé de définir, sur la base des objectifs arrêtés, les liaisons à établir et la politique à mener en fonction des situations locales.
Au niveau national, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé est soumis au contrat d’objectifs et de performance passé avec l’État. C’est un moyen, pour le pouvoir régalien, d’affirmer les grandes lignes de la politique qui sera ensuite déclinée localement. La Conférence nationale de santé s’est penchée sur la traduction opérationnelle de la politique de santé sur le terrain. Cette politique doit être visible pour que les gens puissent se l’approprier et prendre leur santé en main. Après, c’est une affaire de pratique intrarégionale.
La politique nationale a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire avec des inflexions qu’il revient aux agences régionales de santé de définir en fonction de situations qui peuvent varier au regard des déterminants de santé, même si le corpus auquel se référer est le même.
M. le rapporteur. Je voudrais revenir sur le dépistage du cancer du sein. Malgré la campagne nationale, les taux de dépistage sont encore trop faibles. Que propose la direction générale de la santé pour convaincre les femmes qui ne se sentent pas concernées ?
Selon le professeur Hubert Allemand, l’industrie est parvenue à faire diminuer, au niveau mondial, les normes en matière de diabète, d’hypertension artérielle ou de cholestérol admis. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, avez-vous proposé de retirer l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée ? Est-ce bien compatible avec le souhait de prévenir les accidents cardiovasculaires ?
M. Jean-Yves Grall. Les trois questions sont liées.
Concernant le dépistage du cancer du sein, dont on a vu les limites, je ferai trois observations. D’abord, le taux de dépistage fait partie des indicateurs arrêtés en liaison avec l’État et les agences régionales de santé dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ensuite, nous travaillons avec l’assurance maladie sur l’efficience et l’homogénéisation des pratiques dans les centres de gestion, dont nous partageons la charge. Enfin, des campagnes d’information sur la nécessité de se faire dépister ont été lancées. Mais la communauté scientifique s’interroge sur les bonnes pratiques, sur les populations à dépister et sur les conditions de ce dépistage. Nous avons saisi la Haute Autorité de santé à ce propos.
Il appartient en particulier à la Haute Autorité de santé de déterminer les référentiels, les bonnes pratiques et les normes concernant les différentes pathologies. Nous arrêtons nos politiques sur le fondement de ses avis.
Enfin, pour ce qui est de l’hypertension artérielle, nous allons constituer un groupe qui sera chargé d’étudier sa définition et sa prise en charge.
M. le rapporteur. Vous n’avez pas répondu à ma question. La décision de retirer l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée a-t-elle été prise à l’initiative de la direction générale de la santé ? Celle-ci a-t-elle simplement donné un avis ? Dans l’affirmative, a-t-elle été ou non entendue ? Nous pouvons craindre que, si les malades ne sont plus pris en charge à 100 %, ils se soignent moins, ce qui pourrait se traduire demain par des complications, notamment par des accidents vasculaires cérébraux.
M. Jean-Yves Grall. Cette décision a été prise il y a quelque temps. La direction générale de la santé a fait remarquer que l’important était d’évaluer le nombre de personnes qui, dans ces conditions, risquaient de renoncer à se soigner.
M. le rapporteur. Vous êtes très prudent !
Je souhaiterais revenir sur les normes. Selon les explications du professeur Hubert Allemand, l’industrie a, grâce à son poids, réussi à les faire abaisser au niveau mondial. Plus la norme est basse, plus le médicament doit être prescrit à dose importante. La direction générale de la santé a-t-elle le pouvoir de redéfinir les normes, en relation peut-être avec la Haute Autorité de santé ?
M. Jean-Yves Grall. Quel est le seuil pour considérer qu’une personne est hypertendue et que son état justifie une prise en charge et un traitement, éventuellement médicamenteux ? C’est aux sociétés savantes de définir ces normes avec la Haute Autorité de santé et c’est à partir de leur définition que nous prendrons des décisions sur le sujet.
Comment se prémunir de la diminution de normes qui obéiraient à des objectifs éloignés de la santé publique ? Ce sujet a été évoqué lors des discussions du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, à propos des liens d’intérêt et des conflits d’intérêts qui peuvent exister au sein des commissions chargées de donner un avis sur les médicaments – voire au sein de la Haute Autorité de santé, quand il s’agit de faire des recommandations.
M. le coprésident Jean Mallot. Il existe peut-être des conflits d’intérêts au sein de la Haute Autorité de santé, mais ils sont présents au sein de l’appareil d’État. On cite souvent cet exemple mentionné par la Cour des comptes : la lutte contre l’obésité implique de limiter les publicités de produits alimentaires gras, salés et sucrés destinées aux enfants, mais cette démarche vient contrecarrer la politique qui vise à assurer des recettes publicitaires à l’audiovisuel. Or vous occupez un poste clé pour traiter ces conflits d’intérêts, qui dépassent les agences elles-mêmes.
M. Jean-Yves Grall. Vous avez raison. Il convient d’agir de façon cohérente et je considère, en tant que dépositaire des intérêts de santé publique, qu’on ne peut pas mener une politique volontariste de lutte contre l’obésité ou le surpoids et accepter de transiger par ailleurs.
M. le coprésident Jean Mallot. Qu’il faille une cohérence, certes. Mais pensez-vous avoir les moyens de l’assurer ?
Cela me conduit à vous interroger sur la coordination. Il ressort de nos auditions que la direction générale de la santé est probablement en mesure de jouer un rôle de coordination. À la suite de ces auditions, nous allons formuler des préconisations. Soit vous considérez que vous avez les moyens d’assurer cette politique de prévention dans le pays, soit vous pensez qu’il vous manque quelques outils pour ce faire et, dans ce cas, quelles préconisations souhaiteriez-vous de notre part ?
M. le rapporteur. J’ai connu un ancien directeur général de la santé qui était cardiologue, qui avait accepté ce poste avec enthousiasme en espérant conduire de vraies politiques de prévention. Il m’a relaté ensuite qu’il s’était rendu compte que sa tâche consistait essentiellement à dégager sa responsabilité et à répondre aux journalistes chaque fois qu’il se produisait un cas de méningite. Il a fini par abandonner son poste assez rapidement… Que souhaitez-vous pour pouvoir exercer vraiment votre fonction de directeur général de la santé ?
M. Jean-Yves Grall. Vu la multiplicité des acteurs, il faut avoir une légitimité très forte et affirmée pour pouvoir mener les politiques de prévention en maintenant le cap en dépit des intérêts divers – ceux des filières viticole, alimentaire ou pharmaceutique – qui interfèrent en permanence avec les impératifs de santé publique.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous pensez que cette affirmation n’est pas assez forte aujourd’hui ?
M. Jean-Yves Grall. Je pense que chaque ministère a ses propres impératifs.
M. le coprésident Pierre Morange. En tant que directeur général de la santé, que souhaitez-vous ou qu’auriez-vous à suggérer ? S’il s’agit de modifications réglementaires, nous pourrons formuler des préconisations auprès de l’exécutif. S’il s’agit de modifications législatives, nous aurons à cœur de les traduire par des amendements.
M. le rapporteur. Chacun garde en mémoire les problèmes rencontrés au moment de la grippe H1N1. Quels changements seraient nécessaires pour que nous soyons demain mieux préparés face à une crise sanitaire ?
M. Jean-Yves Grall. Il faut élaborer une nouvelle loi de santé publique solidement appuyée sur des débats parlementaires, qui aborde l’ensemble des sujets et fixe des priorités. Pour l’appliquer comme il convient, il faut également renforcer le pilotage intersectoriel et l’articulation avec l’expertise et l’évaluation. Mais il faut surtout convaincre la collectivité nationale de l’intérêt de cette loi.
M. le rapporteur. A-t-on vraiment tiré les enseignements de l’affaire de la grippe ?
M. Jean-Yves Grall. Je crois pouvoir répondre par l’affirmative. Nous nous sommes dotés de dispositifs, d’agences, de plans, mais nous devons aussi adapter le système en permanence, de façon à ne pas être pris trop au dépourvu le moment venu.
M. le rapporteur. Les plans de santé ne manquent pas, en effet, mais comment les articuler pour mener une politique pertinente ? Et puisqu’on évoque aujourd’hui un plan de santé mentale, comment pourrait-on le mener à bien si l’on ne s’occupe pas des autres domaines ?
M. Jean-Yves Grall. C’est la difficulté de ces plans, qui s’échelonnent parfois dans le temps sans cohérence. Nous avons besoin, là aussi, d’un pilotage intersectoriel et inter-plans.
Le plan Santé mentale allie une démarche stratégique au niveau national et une déclinaison opérationnelle au niveau des régions. Mais tout l’enjeu réside en effet dans la coordination permanente entre la trentaine de plans existants, dans l’évaluation de ces plans et dans l’affectation de leurs crédits.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions.
*
Audition de M. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé, et M. Dominique Maigne, directeur, de M. François Bourdillon, président de la commission Prévention, éducation et promotion de la santé du Haut Conseil de la santé publique, chef du pôle Santé publique, évaluation, produits de santé du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, et M. Didier Jourdan, vice-président, et de Mme Thanh Le Luong, directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, et son adjointe, Mme Jocelyne Boudot.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Le système de soins français est très orienté vers le curatif, au détriment de la prévention. Selon la Cour des comptes, entre 1 et 10 milliards d’euros sont consacrés à cette dernière. Encore faut-il savoir ce qu’on entend exactement par prévention…
Comment mieux organiser cette prévention dans notre pays ? Nous sommes notamment désireux de vous entendre sur le problème du pilotage national de la prévention, que la Cour des comptes a soulevé dans sa communication, et sur les campagnes de prévention.
J’interrogerai par ailleurs plus spécifiquement la Haute Autorité de santé sur les normes qu’elle est chargée de définir.
M. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé. Permettez-moi d’abord de rappeler quel est le rôle de la Haute Autorité de santé dans le domaine de la prévention. Aux termes de la loi, nous sommes chargés d’évaluer l’efficacité des actions ou des programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic et de soins. Nous intervenons à des degrés variables. S’agissant de la prévention primaire, notre rôle est limité. Nous collaborons avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre de conventions comme, par exemple, pour l’évaluation de certaines recommandations de santé publique et sur les enquêtes et sondages de santé publique. S’agissant des vaccinations, notre rôle se borne à l’évaluation, par la commission dite « de la transparence », de l’intérêt des vaccins en vue de l’admission au remboursement.
Notre rôle est plus important en ce qui concerne la prévention secondaire. La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 nous a en effet confié une mission d’évaluation médico-économique des actions de santé publique. La Cour des comptes a consacré un chapitre de sa communication à l’absence d’une telle évaluation. Mon prédécesseur ayant répondu à la communication provisoire, je m’en tiendrai à une remarque de fond : cette mission est venue s’ajouter aux missions historiques de la Haute Autorité de santé, sans être assortie de moyens supplémentaires. Malgré cela, nous avons mené à bien depuis 2008 une soixantaine d’études médico-économiques, en particulier sur le dépistage de certaines maladies infectieuses et du cancer. Cette action médico-économique reste cependant insuffisante dans le contexte actuel : si la Haute Autorité de santé a pour mission de dire aux professionnels de santé comment soigner mieux, elle doit désormais le faire en les incitant à tenir compte du niveau des ressources. De même, les études médico-économiques doivent nous permettre de mieux évaluer l’efficience des actions de prévention. C’est pour cette raison que j’ai sollicité l’extension de nos missions, qui figure à l’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 en cours de discussion, consacré à la mission médico-économique de la Haute Autorité de santé. Celle-ci concerne principalement l’évaluation des produits de santé à la fois médicaments et dispositifs médicaux et elle est assortie d’une taxe qui devrait nous permettre de renforcer nos moyens pour mener cette tâche à bien.
On nous reproche parfois de ne pas en faire assez. Je rappelle que nous avons conduit un certain nombre d’études sur le dépistage des cancers, en particulier du cancer du col de l’utérus, du cancer de la prostate et du cancer du sein. Nous avons également formulé des recommandations relatives au dépistage de maladies génétiques ou infectieuses.
Mais c’est aussi la nature des évaluations économiques que critique la Cour des comptes. Sa communication relève en effet qu’il n’existe pas, comme en Grande-Bretagne, d’évaluations du coût par année de vie gagnée, pondérée par un facteur qualité, le QALY, quality-adjusted life year. C’est un problème difficile, qui est d’ordre culturel : en France, on n’a pas coutume de chiffrer la valeur de la vie, d’où une certaine réticence, en particulier dans le corps médical, à se lancer dans des études du type de celles que conduit le National Institute for Health and Clinical Excellence sur la quantité et la qualité des vies sauvées par les interventions médicales. Le rapport remis à la Haute Autorité de santé sur le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) comportait, il est vrai, une évaluation économique, mais nos rapports médico-économiques restent principalement des rapports coût/efficacité, et non des rapports coût/utilité. Le Parlement peut bien sûr inciter la Haute Autorité de santé à faire ce travail, mais c’est un choix politique, qui devra tenir compte de la difficulté culturelle que je viens d’évoquer.
Quant à la prévention tertiaire, elle s’inscrit pleinement dans notre mission, puisqu’elle consiste à éviter l’aggravation ou la récidive de maladies. Nos missions concernent ici les pathologies chroniques, les parcours de soins et, en particulier depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’éducation thérapeutique. En la matière, le rôle de la haute autorité est un rôle d’encadrement. En effet, nous n’avons pas les moyens matériels d’évaluer chacun des 2 500 protocoles en cours dans les régions françaises. Nous avons donc élaboré des guides méthodologiques, à l’intention d’abord des agences régionales de santé, pour les aider à évaluer les programmes d’éducation thérapeutique qui leur sont soumis, puis des porteurs de projets. Notre mission est une mission générale d’encadrement et d’évaluation plutôt qu’une mission d’analyse au cas par cas de tous les protocoles d’éducation thérapeutique.
M. le rapporteur. Si vous disposez d’un document reprenant l’ensemble de ces éléments, nous serions heureux d’en disposer.
J’aimerais interroger le président de la Haute Autorité de santé en même temps que le cancérologue qu’il est sur le dépistage des cancers, auquel la Cour des comptes a consacré un chapitre de sa communication. S’agissant du cancer du sein, nous savons que le nombre insuffisant de femmes dépistées ne permet pas de parler d’un véritable « retour » en termes d’amélioration de la santé.
M. Jean-Luc Harousseau. En ce qui concerne le dépistage des cancers, nous sommes intervenus dans les recommandations sur les tests immuno-histo-chimiques dans le dépistage du cancer colorectal, et surtout sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, du cancer de la prostate et du cancer du sein. Le cancer du col de l’utérus est un sujet d’actualité, en raison de la polémique sur la vaccination par le Gardasil et le Cervarix : certains médecins ont critiqué ces vaccins au motif qu’ils entraîneraient des effets secondaires, qu’ils seraient insuffisamment efficaces, ne couvrant que certains sérotypes du virus, et qu’on ne disposerait pas encore de connaissances sur leur action véritablement préventive. Pour notre part, nous avons recommandé de manière très ferme un dépistage organisé, et ce par la technique cyto-histologique en l’absence de certitudes concernant les techniques nouvelles sur le dépistage du génome viral.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous être plus précis en ce qui concerne le vaccin ?
M. Jean-Luc Harousseau. À ma connaissance, nous n’avons pas la preuve que ce vaccin ait une toxicité particulière. Je ne pense pas que ses effets secondaires soient différents de ceux d’autres vaccins. Je crois savoir que le Haut Conseil de la santé publique a aussi pris position en reconnaissant l’intérêt de ce vaccin, et souligné qu’il n’y avait pas de cas reconnu de sclérose en plaques. Mon inquiétude ne porte donc pas sur l’efficacité du vaccin. Ce que je redoute, c’est que les jeunes filles ne se soustraient au dépistage au motif qu’elles ont été vaccinées : il ne faudrait pas que la vaccination entraîne une perte d’efficacité pour les politiques de dépistage organisé, qui demeurent notre règle.
S’agissant du cancer du sein, nous menons actuellement une étude sur les rapports entre dépistage organisé et dépistage individuel. Là encore, le sujet est d’actualité, la presse ayant fait allusion à un risque de surdiagnostic lors du dépistage individuel. Je ne puis vous en parler tant que le collège n’en a pas délibéré, mais nous rendrons prochainement notre décision, qui défendra, je pense, le dépistage organisé et insistera pour que le dépistage individuel se fasse dans les mêmes conditions. Nous avons par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas de preuve scientifique que le dépistage ait un intérêt avant cinquante ans, en particulier chez les femmes jeunes, et après soixante-quinze ans. Son extension n’est donc pas envisagée.
M. le rapporteur. J’ai cru lire dans la communication de la Cour des comptes que l’on pouvait diagnostiquer de petits cancers qui ne seraient pas évolutifs. Comment poser ce diagnostic et les distinguer des autres cancers ?
M. Jean-Luc Harousseau. Si mon épouse avait un petit cancer, je préférerais le traiter et ne pas jouer la carte d’un cancer qui n’évolue pas… La seule vraie question est celle du surdiagnostic, qui conduit à inquiéter les femmes inutilement et à faire faire des prélèvements qui s’avéreront négatifs. Ce problème technico-médical ne remet cependant pas en cause le dépistage organisé.
En ce qui concerne le cancer de la prostate, nous avons rendu – en accord avec l’Institut national du cancer – un avis soulignant l’absence d’intérêt d’un dépistage systématique par le dosage de l’antigène prostatique spécifique (PSA). Nous allons confirmer cet avis pour le sous-groupe des patients potentiellement à risque plus élevé. Nous n’avons en effet pas les moyens de définir ces populations, ni de dire si ce risque plus élevé correspond à des cancers plus graves, ni de montrer qu’une intervention plus rapide changerait le pronostic.
M. le rapporteur. La Haute Autorité de santé est chargée de définir des référentiels de bonnes pratiques. Comment intègre-t-elle les normes internationales et les référentiels ? Je vous pose cette question car le professeur Hubert Allemand, que nous avons entendu, observe qu’il existe une tendance à « durcir » les normes de santé : on est désormais considéré comme diabétique lorsque la glycémie atteint 1,26 gramme par litre, contre 1,40 auparavant ; de même, on a diminué le niveau de la tension artérielle normale. Il soupçonne l’industrie pharmaceutique d’agir auprès des instances mondiales pour obtenir une diminution des normes de glycémie, d’hypertension artérielle et de cholestérol, afin de mieux vendre ses produits. Cette évolution est déraisonnable, car elle conduit à utiliser le produit à des doses de plus en plus fortes, à telle enseigne qu’on finit, par exemple, par constater des hypotensions artérielles orthostatiques. La Haute Autorité de santé a-t-elle une opinion sur ce point ?
M. Jean-Luc Harousseau. Vous posez là la question de nos méthodes de travail. La Haute Autorité de santé s’appuie à la fois sur des études publiées et sur des avis d’experts. S’agissant de ces derniers, le problème est d’en sélectionner qui n’aient pas de conflits d’intérêts. Sur un sujet aussi vaste que l’hypertension artérielle, il importe de ne pas retenir les seuls spécialistes, mais aussi des médecins généralistes. Depuis l’affaire du Mediator, nous avons encore durci nos règles : nous ne retenons plus aucun expert ayant des conflits d’intérêts pour participer à la délibération sur les recommandations de bonnes pratiques. Nous avons parfois recours à des experts extérieurs, que nous auditionnons, mais en gardant à l’esprit qu’ils ont des conflits d’intérêts.
Je ne puis, en revanche, vous répondre sur les médicaments contre l’hypertension artérielle, dont l’évaluation est en cours de révision par la commission médico-économique.
M. le coprésident Jean Mallot. Cela signifierait-il que, jusqu’à la période récente, il y avait à la Haute Autorité de santé des experts ayant des conflits d’intérêts ?
M. Jean-Luc Harousseau. La Haute Autorité de santé a toujours tenu à conserver son indépendance intellectuelle. Le guide déontologique qui avait été rédigé à sa création, en 2006, a été renforcé en 2010. Les règles actuellement en vigueur correspondent à peu près à ce que vous allez voter dans le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Entre 2006 et 2010, elles étaient, il est vrai, moins strictes : nous pouvions recourir à des experts qui avaient fait état de leurs liens d’intérêts dans une déclaration publique. Dans tous les cas litigieux, nous faisions cependant appel à notre groupe de déontologie, qui était présidé par un conseiller d’État. Le législateur a décidé de créer un comité d’éthique dans chaque institution ; pour notre part, nous l’avons déjà mis en place et il faut convenir que les problèmes ont été rares depuis la création de la Haute Autorité de santé, même s’ils ont existé.
Deux recours ont en effet été déposés devant le Conseil d’État par une association indépendante, le Formindep. À la suite de cela, la haute juridiction administrative a abrogé une de nos recommandations sur le diabète de type 2. J’ai alors pris la responsabilité de suspendre la recommandation sur la maladie d’Alzheimer. Mais nous sommes allés plus loin : nous avons revu toutes les recommandations de bonnes pratiques que nous avions formulées entre 2005 et 2010 et suspendu toutes celles dans lesquelles il manquait ne serait-ce qu’une déclaration d’intérêts ou dans lesquelles il y avait ne serait-ce qu’un conflit d’intérêts potentiel. Elles étaient au nombre de six, dont une portant sur l’hypertension artérielle. Nous avons donc fait tout ce qui était en notre pouvoir pour qu’il n’y ait plus de problèmes. Certes, la composition de la commission de la transparence est fixée à l’avance. Certains médecins peuvent donc avoir des liens d’intérêts dans un domaine et pas dans d’autres. La règle est pourtant simple : s’ils ont un lien d’intérêt dans un domaine, ils ne siègent pas.
M. le rapporteur. L’hypertension artérielle a été retirée de la liste des affections de longue durée. Cela fait-il suite à une recommandation de la Haute Autorité de santé ? Qu’en pensez-vous ?
Disposez-vous de référentiels pour le dépistage à la naissance des pathologies du jeune enfant ? Je vous pose cette question car nous venons de voter une disposition visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l’audition. Or, de telles dispositions ne me paraissaient pas nécessaires : ce dépistage doit faire partie de ceux qui sont automatiquement mis en œuvre à la naissance.
Que pensez-vous enfin de la médecine prédictive ? Est-elle nécessaire ?
M. Jean-Luc Harousseau. Voilà d’excellentes questions.
La Haute Autorité de santé a travaillé sur l’affection de longue durée n° 12, à savoir l’hypertension artérielle sévère, en 2007. Pour nous, la question posée était de savoir si cette dernière devait être considérée comme une affection de longue durée ou comme un facteur de risque. C’est donc le problème général de la prise en charge des affections de longue durée qui se trouvait posé : sortir une maladie de la liste des affections de longue durée au motif qu’elle est un facteur de risque impliquait, à notre sens, de trouver une solution de remplacement au soutien apporté dans le cadre de l’affection de longue durée. La stratégie prônée par la Haute Autorité de santé, qui reste d’actualité, consistait donc à conduire une réflexion sur la prise en charge de ces maladies chroniques. La Haute Autorité de santé a réitéré clairement cette position dans un courrier adressé au ministre de la santé peu avant ma prise de fonctions. Le ministre a pris la décision de retirer l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée, au motif qu’elle n’était pas une maladie, mais un facteur de risque. Sans être spécialiste en ce domaine, j’estime, quant à moi, qu’il s’agit bien d’une maladie. Une requête a d’ailleurs été déposée devant le Conseil d’État par le Collectif inter-associatif sur la santé. Elle se fonde sur l’inégalité de traitement entre les patients déjà inscrits en affection de longue durée n° 12, qui sont pris en charge à 100 %, et ceux pour qui le diagnostic est plus récent, qui ne le seront pas. La position de la Haute Autorité de santé est claire : cette maladie ne devait pas être retirée de la liste des affections de longue durée sans avoir pris de nouvelles dispositions. Nous travaillons d’ailleurs sur une solution globale de prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée, qui serait centrée sur le parcours de soins et sur l’évaluation médicale et médico-économique d’un parcours de soins optimal.
J’en viens au dépistage à la naissance. Nous avons travaillé en 2007 sur une stratégie de dépistage de la trisomie 21. Plus récemment, le collège de la Haute Autorité de santé a adopté des recommandations sur l’extension du dépistage néonatal à plusieurs erreurs innées du métabolisme par une technique de spectrométrie de masse.
Quant à la médecine prédictive, je vous répondrai en tant que cancérologue. Les progrès faits dans la compréhension du mécanisme des cancers permettent parfois de mettre en œuvre des thérapeutiques ciblées, c’est-à-dire dirigées spécifiquement vers une anomalie biologique correspondant généralement à une modification génétique acquise. Certains médicaments constituent des révolutions thérapeutiques. Le traitement de la leucémie myéloïde chronique qui agit spécifiquement sur le produit d’un changement génétique dans la cellule leucémique en est un exemple.
Dans certains cancers, on a ciblé des patients ayant des modifications de certains récepteurs. Il existe des traitements qui agissent spécifiquement sur ces récepteurs de croissance tumorale et permettent de les bloquer. Ils sont très efficaces, mais uniquement dans ces cas de modification des récepteurs. C’est le cas du médicament contre le cancer du colon. Il faut donc limiter le traitement aux patients qui peuvent en bénéficier, ce qui présente un double intérêt : être efficace en l’espèce et ne pas appliquer le traitement, qui coûte très cher, lorsqu’il est inutile. Cela implique évidemment de faire des tests biologiques. Nous aurons sans doute à l’avenir d’autres exemples de cette stratégie de médecine ciblée. Nous n’en sommes pas encore au traitement personnalisé, mais nous pouvons désormais individualiser ceux des patients pour lesquels un test biologique va permettre de prescrire le traitement adapté.
M. le rapporteur. Vous évoquez ici des traitements. Je pensais pour ma part à une recherche systématique des gènes prédisposant au cancer du sein – puisqu’il y en a – ou à certaines maladies. À partir de quand procéder à une recherche systématique ?
M. Jean-Luc Harousseau. C’est désormais le cas grâce au plan Cancer I, qui a permis de développer les consultations d’oncogénétique. Par exemple, on recherche chez les femmes qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein les gènes prédisposant à ce cancer – ce qui peut conduire le cas échéant à une décision de mammectomie.
M. le rapporteur. Si je comprends bien, il n’est pas question d’intégrer la médecine prédictive dans le dépistage organisé ?
M. Jean-Luc Harousseau. Pour l’instant, ce n’est pas envisagé : on ne recherche la modification du gène que dans les familles où il y a un risque particulier.
M. le rapporteur. Nous allons maintenant donner la parole aux représentants du Haut Conseil de la santé publique.
M. François Bourdillon, président de la commission Prévention, éducation et promotion de la santé du Haut Conseil de la santé publique, chef du pôle Santé publique, évaluation, produits de santé du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. On considère de façon schématique que la prévention médicalisée comprend la prévention primaire, c’est-à-dire antérieure au développement de la maladie, dont le prototype est la vaccination ; la prévention secondaire, lorsque la maladie s’est déclarée et il faut la détecter avant qu’elle n’entraîne des symptômes et ne devienne grave, dont le prototype est le dépistage ; et enfin la prévention tertiaire, qui consiste à éviter les rechutes et les complications. Telle est du moins la vision de l’Organisation mondiale de la santé qui est très restrictive. Elle est aujourd’hui rejetée par la majorité des professionnels de santé publique, qui entendent promouvoir une vision positive de la prévention et travailler sur les environnements et la qualité de vie. Dans cette acception, l’aspect « promotion de la santé » doit être pris en compte dans le calcul du coût de la prévention.
De nombreux travaux ont tenté de chiffrer ce coût, ce qui s’avère particulièrement complexe. Comment intégrer les coûts de la prévention à l’école ou de la médecine du travail ? Une autre question est de savoir si l’on est dans la prévention ou dans le soin. Prenons l’exemple du traitement du VIH, qui réduit la transmission : est-ce de la prévention ou du soin ? Il est toujours malaisé de le dire. Globalement, les experts estiment que les dépenses de prévention représentent 7 % des dépenses de santé et qu’il faudrait atteindre le taux de 10 % pour avoir une vraie politique de santé, comparable à celle de certains pays anglo-saxons.
Pour prendre un autre exemple, le congé de maternité – institué au début du siècle dernier – a permis de réduire le risque de prématurité et de mort maternelle. Faut-il l’intégrer dans la prévention ? Cela paraît délicat. Pourtant, c’est l’une des plus formidables actions de prévention qui soient !
Prenons maintenant l’exemple du diabète. Cette maladie grave, qui touche 3 millions de personnes en France, est la première cause d’insuffisance rénale chronique, dont le coût atteint 100 000 euros par an et par personne et représente quatre fois le coût du QALY acceptable pour les Britanniques. Or, nul ne refuserait aujourd’hui une dialyse à un patient en insuffisance rénale terminale, car cela peut lui sauver la vie et le faire vivre encore de nombreuses années. Il faut être très attentif à la question que pose ce modèle anglo-saxon du QALY – que refusent d’ailleurs les Américains. Plus la moyenne d’âge s’élève, plus ce calcul est défavorable à l’investissement ; mais les sociétés modernes refusent qu’on ne prenne pas en charge les personnes âgées dans ce domaine.
Première cause d’insuffisance rénale chronique, le diabète est aussi la première cause de cécité et d’amputation des membres inférieurs. Il est donc important de le traiter dans de bonnes conditions, du moins si l’on reste dans un modèle très médicalisé. Mais on peut tout aussi bien s’interroger sur les causes du diabète et choisir de faire de la prévention primaire. On s’intéressera alors à l’obésité, au surpoids, et donc à la politique globale mise en œuvre pour que les gens vivent en harmonie avec la société. Pour lutter contre le diabète, il faut donc penser augmentation de l’activité physique, lutte contre la sédentarité et alimentation équilibrée, autrement dit se préoccuper des politiques publiques à mener sur tous ces points. Cela a abouti au premier plan national Nutrition santé, en 2001.
On ne pourra promouvoir la santé dans notre pays si l’on reste attaché aux seules questions liées à la maladie : il faut s’intéresser à l’équilibre de notre société et donc promouvoir l’éducation pour la santé. Il conviendra de réfléchir, par exemple, comment s’appuyer sur les valeurs culturelles françaises pour que les enfants mangent correctement et de manière équilibrée, comment s’assurer que les repas servis dans les crèches et les écoles sont de qualité ou comment intégrer suffisamment d’activités physiques à l’école, puisque, avec les moyens de transport modernes, les Français marchent de moins en moins. Intervenir dans ce domaine suppose donc une réflexion globale.
Quant aux normes de santé, elles sont construites à partir de données statistiques et de données de risque. La prévention est souvent très liée aux risques, ce qui est une approche assez réductrice. D’une manière générale, on fixe une limite et l’on s’aperçoit qu’à 1,26 gramme par litre, il y a moins de risque à dix, quinze ou vingt ans. La communauté scientifique s’accorde alors à penser que c’est là que la limite doit être mise. C’est une décision internationale, émise par l’Organisation mondiale de la santé. Je ne pense pas que l’on puisse remettre ces normes en cause s’agissant du diabète et de l’hypertension. Je vois, en revanche, émerger dans la presse internationale la notion de pré-hypertension, et l’idée qu’il faut traiter celle-ci. Peut-être les industriels se créent-ils ainsi de nouveaux marchés… Reste que pour ces deux grandes maladies, il n’y a pas lieu de remettre en cause les normes actuelles.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous préciser comment votre périmètre d’action s’articule avec celui de la Haute Autorité de santé et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ? Nous nous intéressons en effet tout particulièrement à la problématique de la coordination, de l’évaluation et de la définition d’objectifs communs.
M. François Bourdillon. Le Haut Conseil de la santé publique est une instance consultative, mise à la disposition du ministère de la santé et composée d’experts choisis de manière indépendante, en fonction de leur curriculum vitae et de leurs diplômes, mais aussi dans une optique multidisciplinaire, par des responsables d’unités de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale éloignés du champ.
Le Haut Conseil de la santé publique compte plusieurs commissions. J’ai l’honneur de présider la commission Prévention, éducation pour la santé et promotion de la santé, mais d’autres commissions interfèrent avec ce champ : je pense à la commission Maladies transmissibles ou au comité technique des vaccinations, qui construit le calendrier des vaccinations et rend un avis – indépendamment de notre commission – sur leur mise sur le marché. Notre commission examine pour sa part les conditions de mise en œuvre des vaccinations. Pour reprendre l’exemple du Gardasil, c’est au comité technique des vaccinations qu’il revient de juger de l’opportunité d’utiliser ce vaccin. Il vient d’ailleurs de rendre un avis dans lequel il estime que les données sur les effets indésirables du vaccin ne sont pas suffisantes pour remettre en cause son intérêt et d’émettre une nouvelle recommandation sur son intérêt économique. Notre commission, quant à elle, va par exemple se demander s’il est opportun de consacrer de gros investissements à un vaccin qui nécessite trois rappels pour être efficace et réfléchir à l’amélioration de la procédure de vaccination. C’est un champ que nous n’avons pas encore étudié.
Notre commission s’intéresse notamment à la question du tabac. Nous avons rendu un avis l’an dernier et travaillons à présent sur la taxation comme outil de régulation de la consommation. Nous nous intéressons également à la médecine scolaire et à l’éducation pour la santé, ainsi qu’à la réduction des inégalités de santé, qui demeurent importantes. Pour l’obésité, par exemple, le rapport entre les enfants d’ouvriers et de cadres supérieurs est de 1 à 5 et cet écart s’accentue. De même, l’écart entre l’espérance de vie à trente-cinq ans des ouvriers et des cadres supérieurs est aujourd’hui de sept ans.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce n’est pas un phénomène nouveau.
M. François Bourdillon. Certes, mais cela doit nous interpeller.
M. Didier Jourdan, vice-président de la commission Prévention, éducation et promotion de la santé du Haut Conseil de la santé publique. J’insiste d’emblée sur la complexité et les enjeux du pilotage national de la prévention. Les propos que nous avons entendus jusqu’à présent sont restés centrés sur la seule optimisation de la prévention médicalisée. Or la puissance publique se doit de construire un pilotage national structuré autour de l’autre volet, à savoir la mobilisation de l’ensemble des acteurs en faveur de la prévention. Traiter la question de la gouvernance et du pilotage de la prévention sous le seul angle de la prévention sanitaire, c’est prendre le risque de passer à côté de nos meilleures chances en termes de gains de santé. L’histoire de la santé publique démontre en effet que ce sont les dispositifs permettant d’agir sur les déterminants de la santé qui ont permis d’obtenir l’essentiel de ces gains. La question posée est donc de savoir comment mobiliser l’ensemble des acteurs, notamment le milieu scolaire où travaillent 1 million de personnes qui peuvent être – et sont déjà – des acteurs de prévention.
Nous reprenons à notre compte la première recommandation de la Cour des comptes sur le développement d’une politique transversale. Celle-ci ne peut cependant être pertinente qu’à la condition de permettre aux structures concernées, et notamment aux différentes institutions, d’acculturer la prévention dans leur propre gouvernance. Là réside sans doute l’enjeu clef. Nous ne manquons pas d’injonctions en direction de l’Éducation nationale – la « sur-prescription » d’objectifs est devenue effarante, à tel point qu’on peut se demander ce qui ne relève pas du champ de l’école. Faut-il pour autant abandonner l’idée selon laquelle le système éducatif doit être un acteur de prévention ? Nous devons trouver les moyens de construire une politique de santé scolaire adaptée à la culture, aux missions et à l’identité professionnelle des acteurs de l’école. Tout l’enjeu est d’avoir à la fois des dispositifs médicalisés extrêmement centrés sur la prévention et la capacité de développer des politiques adaptées. La prévention dans le système éducatif existe déjà, mais il faut encore progresser sur un certain nombre de points : sur la redéfinition du rôle du système éducatif – qui doit être centrée sur ce que sont les missions de l’école, notamment sa mission émancipatrice, comme la réussite des élèves – et surtout sur l’environnement scolaire – François Bourdillon a évoqué la cantine – et psychosocial.
La politique de santé de l’Éducation nationale doit être axée sur les trois grands pôles classiques : prévention, protection et éducation. Un deuxième élément aujourd’hui déterminant est la création d’un curriculum. Il existe, selon les pays européens, des disciplines d’éducation à la santé ou de santé à l’école. Ce n’est pas nécessairement pertinent en France, mais il existe un véritable enjeu à structurer un curriculum santé – de la maternelle au lycée – centré sur le développement de compétences qui sont d’abord des compétences scolaires. Prenons l’exemple de la sexualité : pour pouvoir faire passer le moment venu des messages de prévention, il faudra d’abord avoir travaillé en maternelle sur le schéma corporel et l’estime de soi. Nous sommes donc dans une dynamique qui doit se construire en référence aux missions de l’école, dans le cadre d’un curriculum.
En termes de prévention, c’est la mise en cohérence des stratégies de prévention à l’échelon régional qui fait le plus défaut. Cela s’explique par l’absence de culture commune aux différents acteurs. La question de l’accompagnement et de la formation de ces acteurs est un enjeu déterminant pour des progrès en ce domaine.
La France est l’un des seuls pays à ne pas disposer d’un réseau des écoles en santé. La volonté de ne pas introduire de différence entre les établissements est ici une limite. Pour agir sur les inégalités de santé, sans doute faut-il permettre aux établissements qui le souhaitent de progresser sur cette question – à condition bien sûr qu’ils respectent un cahier des charges ou une charte –, surtout lorsqu’ils scolarisent de nombreux enfants vulnérables.
M. le rapporteur. Vous avez beaucoup parlé de l’école, mais la médecine du travail et la protection de l’environnement jouent aussi un rôle important.
Je donne maintenant la parole à Mme Thanh Le Luong pour présenter l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, qui intervient comme relais du ministère de la santé dans cette politique de la prévention, mais mène également ses politiques propres, aux niveaux local et régional, en s’appuyant sur les associations de terrain. Vous nous expliquerez notamment, madame, les difficultés que vous rencontrez pour conduire une vraie politique.
Mme Thanh Le Luong, directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé a pour mission de décliner le volet prévention des plans de santé publique, aujourd’hui au nombre d’une quarantaine sans compter les plans qui sont de niveau gouvernemental, comme la lutte contre les addictions.
Notre mission consiste à promouvoir des comportements favorables à la santé, les habitudes de vie et l’environnement qui permettent aux individus de faire des choix positifs pour leur santé. Nous ne travaillons donc pas seulement sur les facteurs de risque, mais aussi sur les facteurs de protection. Et, contrairement à la Haute Autorité de santé, qui est compétente pour définir les bonnes pratiques et émettre des recommandations, nous ne travaillons pas seulement sur un modèle biomédical, mais aussi sur les aspects psychosociaux. Nous mettons en œuvre une expertise en sciences humaines, puisque nous travaillons sur les changements de comportement. Sachant que les trois quarts des déterminants de santé se situent en dehors du système de santé, il s’agit de travailler sur ces déterminants pour éviter l’apparition de la maladie.
Nous ne sommes pas opérateurs de terrain. Nous travaillons donc en partenariat avec les agences régionales de santé, les associations et d’autres partenaires locaux. Nous participons ainsi au Salon des maires : même si elle n’a pas de compétence légale dans ce domaine, la collectivité locale peut jouer un grand rôle en matière de santé. Pour prendre un exemple, la lutte contre la sédentarité est un facteur déterminant pour un grand nombre de pathologies – obésité, maladies cardiovasculaires, cancers – comme pour le bien-être des personnes âgées ou handicapées. Pour aider chacun à pratiquer, conformément à la recommandation qui est faite, trente minutes d’activité physique par jour, nous sommes, par exemple, en train de promouvoir une signalétique urbaine en temps de trajet, et non en distance. Nous ne pouvons le faire sans le soutien des collectivités locales. Mais il ne s’agit pas seulement d’informer les gens, car il y a un fossé entre l’information et le changement de comportement – les médecins ne figurent-ils pas parmi les plus gros fumeurs ? – nous nous attachons donc à conduire des études sur les changements de comportement.
Nos programmes concernent d’abord les habitudes de vie comme la consommation d’alcool ou de tabac, les activités physiques et sportives, les addictions… Nous nous inscrivons ici dans la ligne de la résolution adoptée le 19 septembre dernier par les Nations Unies, qui réclament une volonté politique forte pour lutter contre les maladies non transmissibles. L’Organisation mondiale de la santé estime en effet que l’élimination des quatre facteurs de risque que sont l’alcool, le tabac, la sédentarité et la mauvaise alimentation permettrait d’éradiquer 80 % des maladies non transmissibles. Nous essayons de travailler très en amont, au moyen de différents outils : l’éducation à la santé, la formation, les outils pour les professionnels, le soutien aux actions de proximité, les partenariats et enfin des interventions directes auprès du grand public, via les campagnes que vous connaissez.
Dans nos interventions sur le terrain, nous travaillons avec les agences régionales de santé, qui sont un levier sans équivalent pour piloter une politique régionale. Nous leur laissons définir celle-ci, mais nous mettons des moyens à leur disposition. Nous animons notamment les pôles de compétences régionaux. Il s’agit de plateformes qui mettent à la disposition des acteurs de terrain des outils pour améliorer la qualité de leurs actions et de leurs projets, autrement dit la professionnalisation de la prévention. En France, nous manquons de recherche en prévention, alors que nous avons besoin d’évaluations scientifiques. C’est une faiblesse que la communication de la Cour des comptes a bien identifiée.
Nous conduisons également une politique de subventions pour soutenir les associations, en fonction de critères de qualité bien définis. Nous lançons des appels à projets. Nous avons ainsi travaillé avec une équipe alsacienne qui a conduit un essai contrôlé randomisé montrant que, dans les collèges où l’on pratiquait une activité physique, le poids des élèves était optimal, ce qui n’était pas le cas dans les autres collèges. Nous avons donc publié un guide et étendons cette action via des appels à projets.
Nous animons par ailleurs chaque année la Semaine de la vaccination, action préconisée par l’Organisation mondiale de la santé. Ce sont les 26 régions qui mobilisent, sur la base du volontariat, les acteurs de terrain pour conduire une action de sensibilisation à la vaccination. Nous mettons à leur disposition des outils, des dossiers de presse ; nous faisons de la formation aux médias ; mais nous leur laissons toute latitude pour ce qui est des actions à mener.
Nous essayons de plus en plus de décliner nos campagnes en coopération avec les régions. C’est le cas en matière de contraception ou encore de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH dans les départements d’outre-mer, où la prévalence est élevée.
M. le rapporteur. Quelles sont les parts respectives de la communication institutionnelle et de vos actions propres ? Quelles sont vos relations avec les comités régionaux et départementaux d’éducation pour la santé ainsi qu’avec la Fédération nationale d’éducation pour la santé ?
Par ailleurs, un prélèvement va être opéré sur votre fonds de roulement, qui s’élève à 17 millions d’euros. Comment se fait-il que la somme dont vous disposez ne soit pas entièrement utilisée ? Manqueriez-vous d’idées ?
Mme Thanh Le Luong. Croyez bien que non ! Le niveau de notre fonds de roulement s’explique par le fait que notre budget primitif est limité en autorisations de dépenses : nous n’avons pas le droit de dépasser le niveau de dépenses qui a été voté, quelles que soient nos recettes.
M. le rapporteur. Autrement dit, vous disposez d’argent dont vous ne pouvez disposer ?
Mme Thanh Le Luong. En effet.
M. le rapporteur. D’où vient le frein ?
Mme Jocelyne Boudot, adjointe à la directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Du plafond de dépenses qui figure dans le budget fixé par la tutelle – à savoir les ministères des finances et de la santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Je suis frappé par la diversité des actions que vous menez. En ce qui concerne la stratégie de l’action comportementale et sociétale, la MECSS est persuadée que le fait culturel et familial contribue de manière déterminante à expliquer les écarts d’espérance de vie.
Compte tenu de la grande diversité de vos actions, on pourrait espérer une généralisation de celles qui, en particulier dans le cadre éducatif, visent à changer les comportements. J’évoquais lors d’une audition précédente une expérimentation que vous avez conduite en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les résultats ont été spectaculaires. Pourrions-nous en avoir un bilan précis sur le plan financier – coût de l’étude et moyens humains déployés –, afin de pouvoir éventuellement généraliser une bonne pratique qui a fait la preuve de son efficacité ?
Si vous prenez des initiatives, la coordination entre les différentes structures est peu perceptible. Nous avons eu l’occasion d’évoquer ce problème à de multiples reprises lors des auditions précédentes.
En tant qu’ancien rapporteur de la mission qui a conduit à l’interdiction du tabagisme dans les lieux publics, j’aimerais demander au Haut Conseil de la santé publique s’il dispose d’une évaluation des effets de cette décision. L’application de ce type de mesure a en effet débouché sur une chute spectaculaire du nombre des urgences cardiovasculaires et cérébrovasculaires dans un certain nombre d’États américains.
M. François Bourdillon. Les mesures d’interdiction du tabagisme dans les lieux publics ont partout été suivies d’une diminution particulièrement nette des recours aux urgences et des infarctus du myocarde, sauf en France. En Irlande et en Italie, cette diminution a atteint 15 % dans les trois mois.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourquoi cette exception française ?
M. François Bourdillon. Nous avons une politique de lutte contre le tabac plus ferme depuis la loi n° 91-32 du 12 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Les politiques publiques ont conduit à une réduction progressive du tabagisme. L’interdiction de fumer dans les lieux publics a donc été moins brutale qu’en Irlande ou en Italie, où elle est entrée en vigueur du jour au lendemain. Mais nous avons certainement progressé, car les taux de prévalence de l’infarctus du myocarde ne sont pas plus élevés en France qu’en Italie.
M. le coprésident Pierre Morange. La grande critique que l’on peut faire à la loi de 1991 précitée, au demeurant pertinente sur le fond, est l’absence de moyens. L’objet de notre mission fut donc de donner des armes à cette ambition sanitaire au moyen d’une interdiction claire et nette. Elle était du reste indispensable, puisque la Cour de cassation avait mis en évidence une obligation de résultats – et non plus seulement de moyens – de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Il était donc légitime d’espérer une amélioration plus nette des statistiques aux urgences, voire une forte diminution. Il semble que ce n’ait pas été le cas.
M. François Bourdillon. Cela ne veut pas dire que cette diminution ne se produira pas à moyen terme.
M. le rapporteur. Je reviens au rôle institutionnel de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Une part de votre budget est consacrée aux campagnes institutionnelles, madame la directrice générale ; mais c’est ici le ministère qui décide. Pouvez-vous préciser les parts respectives de la communication institutionnelle et de vos actions propres ?
Par ailleurs, je réitère ma question sur vos relations avec les comités régionaux d’éducation pour la santé et la Fédération nationale d’éducation pour la santé.
Mme Thanh Le Luong. La programmation des campagnes institutionnelles est élaborée avec le ministère de la santé et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui est notre principal financeur, en concertation également avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
L’articulation avec les comités régionaux d’éducation pour la santé et les comités départementaux d’éducation pour la santé s’effectue dans le cadre des pôles de compétences régionaux dont je vous ai parlé. Ces derniers intègrent en effet les comités départementaux d’éducation pour la santé et les comités régionaux d’éducation pour la santé, qui sont fédérés au sein des instituts régionaux d’éducation pour la santé. Nous finançons la partie méthodologique de ces plateformes puisque par principe, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ne finance pas d’actions locales, mais seulement des actions à visée nationale. Ce sont donc les agences régionales de santé ou les collectivités locales qui financent les comités départementaux d’éducation pour la santé et les comités régionaux d’éducation pour la santé. La Fédération nationale d’éducation pour la santé fédère tous ces comités locaux et a pour vocation de les structurer et de les piloter.
M. le rapporteur. C’est dire la complexité du système. Nous avons pourtant besoin d’intervenants de terrain pour agir dans les écoles et des associations pour, par exemple, prévenir l’alcoolisme et le tabagisme. C’est pourquoi j’avais proposé de fédérer toutes les associations à l’échelle départementale, autrement dit d’avoir de vrais comités départementaux d’éducation pour la santé. Dans l’organisation actuelle, vous intervenez sur des campagnes nationales, décidées par le ministère ou la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui apportent une partie du budget. Quant à votre budget propre, vous n’en êtes même pas maîtres, puisque vous disposez de recettes que vous ne pouvez pas dépenser. Peut-être la Cour des comptes n’est-elle pas allée assez loin dans ses critiques !
M. François Bourdillon. Permettez-moi quelques réflexions sur les rapports entre État et territoires en matière de prévention. Chacun conviendra que nous avons besoin de relais locaux au plus près des lieux de vie des personnes pour promouvoir la santé. Ce tissu social est donc important, mais il est très fragile, puisqu’il dépend de subventions annuelles. Or il n’existe pas de services déconcentrés dans le domaine de la prévention. On s’est donc toujours appuyé sur des structures départementales et régionales – les comités départementaux d’éducation pour la santé et les comités régionaux d’éducation pour la santé – qui se sont regroupés au sein des instituts régionaux d’éducation pour la santé. Différents modèles existent : ainsi, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a associé l’Association nationale de prévention en alcoolisme et addictologie et d’autres structures de promotion de la santé. Néanmoins, ces structures restent fragiles. Elles sont subventionnées à la fois par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et les agences régionales de santé, dont les budgets sont relativement contraints. M. Daniel Lenoir, directeur de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, m’informait il y a quelques semaines que, sur les 11 milliards d’euros du budget de la santé de l’agence régionale de santé, il disposait de 30 millions pour la prévention. Cela donne une idée du déséquilibre qui prévaut et de la faiblesse du dispositif censé porter cette politique au plus près des lieux de vie.
M. le coprésident Pierre Morange. Diriez-vous faiblesse ou insuffisance de coordination ? La Cour des comptes, qui évoque des montants allant de 1 à 10 milliards d’euros, fait le constat d’une insuffisance de coordination. Certes, les dépenses de prévention représentent 7 % des dépenses de santé, alors qu’il y faudrait sans doute 10 %. Mais la mutualisation et la coordination ne sont-elles pas les premières actions à mettre en œuvre, avant même le renforcement des moyens ?
M. François Bourdillon. Nous en sommes d’accord. Les agences régionales de santé disposent de crédits d’intervention pour la prévention, mais, bien que des schémas régionaux de prévention aient été élaborés, l’assurance maladie continue à financer certains acteurs de manière indépendante, en fonction de ses priorités propres. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est claire : les agences régionales de santé pilotent et coordonnent la prévention. Il est nécessaire qu’elles disposent des moyens de le faire. Sans doute existe-t-il des faiblesses de coordination, mais il y a aussi des insuffisances de financement. Or il est particulièrement difficile de faire bouger le curseur. Médecin hospitalier, je suis bien placé pour savoir que, dans la situation actuelle, les professionnels de santé se dresseraient contre toute diminution des moyens de l’hôpital, fût-ce pour financer la prévention. Pour pouvoir réduire les soins, il faut investir dans la prévention. L’action doit être menée sur le long terme.
M. le rapporteur. Je plaide depuis longtemps en faveur d’enveloppes régionales ou d’objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie, assurant une vraie fongibilité, et qui permettent aux agences régionales de santé d’intervenir. J’appelle également de mes vœux des observatoires régionaux de la santé. Nous en avons un qui fonctionne très bien dans les Pays de la Loire. Il n’empêche que de multiples structures dédiées se mettent en place ; l’assurance maladie elle-même n’est guère pressée de communiquer les données de santé, alors que ce serait là le moyen de faire l’économie de nombre de ces structures nouvelles. M. Christian Babusiaux s’efforce depuis des années d’essayer d’améliorer la transmission de ces données, mais les barrières entre territoires ne sont pas près de s’effacer. La proposition de la Cour des comptes d’instituer un délégué interministériel chargé de coordonner tous les acteurs est intéressante. Néanmoins, confier ce soin à la direction générale de la santé, dont nous venons d’auditionner le directeur, semble délicat, alors que ses liens avec les autres directions du ministère sont déjà complexes.
J’ai cité à plusieurs reprises un exemple que je juge très significatif. Les représentants de Groupama nous ont confié, lors de leur audition, qu’ils avaient acquis un rétinographe mobile afin de pouvoir effectuer des fonds d’œil chez les personnes hypertendues ou diabétiques dans les Ardennes. Ce dispositif intéressant se heurte cependant à une difficulté : comment identifier ces personnes dans une commune donnée, sachant que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés refuse de communiquer les données en sa possession ? Les barrières entre structures semblent parfois des frontières infranchissables…
N’hésitez donc pas à nous communiquer vos propositions – officielles ou officieuses !
M. le coprésident Pierre Morange. Mesdames et messieurs, je vous remercie d’avoir participé à cette audition.
*
AUDITIONS DU 1ER DÉCEMBRE 2011
Audition de M. Michel Combier, président de l’Union nationale des omnipraticiens français-Confédération des syndicats médicaux de France, M. Roger Rua, secrétaire général du Syndicat des médecins libéraux, M. Claude Bronner, président de l’Union généraliste-Fédération des médecins de France, et M. Claude Leicher, président de MG France.
M. le coprésident Jean Mallot. La prévention sanitaire est un vaste domaine, qui recouvre des actions diffuses, menées en ordre dispersé. Des progrès sont donc nécessaires, et sans doute possibles dans un paysage institutionnel en pleine évolution, du fait notamment de la création des agences régionales de santé. Mais cela suppose des arbitrages, qui peuvent être délicats, entre ce travail de longue haleine et les impératifs de court terme, trop souvent privilégiés. D’où le rôle primordial de l’État, qui doit donner les impulsions nécessaires, et fournir les moyens.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il est unanimement reconnu que notre système de santé est plutôt bon dans le domaine des soins, mais mauvais en matière de prévention. Dans sa communication, la Cour des comptes montre qu’il est difficile d’identifier les moyens consacrés à cette dernière : la fourchette de dépenses qu’elle fournit oscille de 1 milliard d’euros – correspondant à la prévention individualisée comme telle – à 10 milliards d’euros – toutes actions confondues. De fait, les consultations données par les médecins comportent, au-delà des soins, une dimension préventive.
Que pensez-vous du rôle joué par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, avec son fonds de prévention, d’éducation et d’information sanitaires et ses centres d’examens de santé ? Quelle est votre opinion sur l’organisation actuelle du dépistage, en particulier celui du cancer de la prostate qui a fait l’objet de critiques de la cour ? Quel est votre point de vue sur le système de prévention français ? Comment pourrait-on l’améliorer ? Quelles relations sont possibles entre les médecins traitants et les médecins scolaires, ou les médecins du travail ?
M. Michel Combier, président de l’Union nationale des omnipraticiens français-Confédération des syndicats médicaux de France. Dans le travail du médecin traitant, il y a en effet une part de prévention qui n’est pas toujours visible. Par ailleurs, tous ceux qui auraient besoin d’une action de prévention ne se rendent pas systématiquement dans un cabinet médical – c’est le cas notamment de gens qui souffrent d’addictions au tabac ou à l’alcool mais qui ne se perçoivent pas comme malade. C’est la raison pour laquelle on avait envisagé à une époque des consultations de prévention, dites « de santé publique », une fois par an ou tous les deux ou trois ans, en fonction des tranches d’âge ou des milieux professionnels, parallèlement aux actions conduites par la médecine scolaire ou par la médecine du travail.
Il reste que nous faisons de la prévention, même si cela se limite aux patients que nous voyons. La convention médicale de juillet 2011 donne même une impulsion nouvelle aux actions de prévention, puisqu’elle permet d’impliquer le médecin traitant dans la prophylaxie de la grippe – au travers de la vaccination des plus de soixante-cinq ans, mais aussi des personnes atteintes de maladies chroniques telles que l’asthme ou le diabète –, dans le dépistage du cancer du col de l’utérus ou du sein, ou encore dans la maîtrise du risque iatrogénique chez les personnes âgées. Cela correspond à un travail de fond : au regard de l’élément fondateur constitué par le contrat d’amélioration des pratiques individuelles, il semble que les pratiques des généralistes en matière de prévention s’améliorent beaucoup. Cela étant, elles ne peuvent être évaluées que sur plusieurs années.
Une consultation régulière du médecin traitant, axée sur des risques propres à chaque tranche d’âge comme les addictions pour les moins de trente-cinq ans ou les risques cardiovasculaires pour les personnes de plus de trente-cinq ans, par exemple, pourrait permettre d’atteindre les personnes qui ne se sentent pas malades mais qui ont néanmoins des problèmes de santé.
M. Roger Rua, secrétaire général du Syndicat des médecins libéraux. Monsieur le rapporteur, vous avez mis le doigt sur le vrai problème : nous n’avons pas une véritable culture de la prévention dans notre pays ! Si nous avons une excellente médecine curative et si nous faisons de la prévention au jour le jour, ce sont surtout des patients malades qui viennent nous consulter. Or le propre de la prévention est de s’adresser aux bien portants ! Les médecins chinois étaient honorés, dit-on, à proportion du nombre de leurs patients en bonne santé…
Nous n’avons pas de véritable politique en la matière, peut-être parce que les termes « prévention », « santé publique » font peur. Il existe certes des plans nationaux, mais qui ne sauraient suffire : il faut un grand élan, pour une politique de prévention ambitieuse. À défaut, notre système d’assurance maladie connaîtra la faillite que nous essayons de conjurer chaque année avec de plus en plus de difficulté, parce que l’augmentation du nombre de maladies chroniques se poursuivra.
J’attache une importance particulière à la prévention primaire, qui consiste principalement à éviter l’apparition des maladies. Si, pendant longtemps, cette action n’a pas été prise au sérieux, des études scientifiques en démontrent l’efficacité comme dans le rapport rédigé en 2007 par le professeur Jean-François Toussaint pour le compte de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Quand on évite 30 % de cas de diabète par ce type de prévention, on en mesure l’intérêt, sachant combien coûte le traitement de cette maladie !
La politique à conduire doit faire la synthèse entre la prévention du risque individuel et la prévention collective, qui est également nécessaire. L’objectif doit être de parvenir à changer les comportements individuels : c’est une mission qui peut être assignée en priorité à la médecine libérale de proximité, parce qu’elle touche une grande partie de la population. Mais, dans la mesure où, lorsqu’elle se fait au cours des consultations habituelles, elle n’est pas dissociée de l’action curative, il faudrait consacrer à cette prévention des consultations spécifiques ; on pourrait les organiser en fonction des tranches d’âge, mais aussi des milieux professionnels et il en faudrait aussi dans les maisons de retraite, car on sait que l’activité physique des personnes âgées permet de réduire leur consommation de médicaments.
Une approche globale et indépendante de l’action curative est nécessaire : c’est précisément ce qui manque aujourd’hui pour qu’il existe une véritable politique de prévention.
Cette participation des médecins libéraux à la prévention primaire devrait concerner tous les publics, aussi bien les enfants, les adolescents – exposés aux addictions – et les étudiants – souvent oubliés – que nos concitoyens entrés dans la vie active : entre vingt-cinq-trente ans et quarante-cinq ans, certains Français ne consultent jamais de médecin alors que c’est à cet âge que se décident le diabète, l’hypercholestérolémie ou les problèmes cardiovasculaires de la cinquantaine. Et, comme je l’ai indiqué, dans les maisons de retraite, la prévention primaire pourrait réduire le coût des soins.
La prévention primaire est importante mais c’est celle qu’il est le plus difficile d’imposer, étant donné sa simplicité apparente. La prévention secondaire et la prévention tertiaire ne doivent bien évidemment pas être négligées pour autant, mais elles sont déjà pratiquées au travers des dépistages et de tout ce qui vise à atténuer les complications d’une maladie.
M. Claude Bronner, président de l’Union généraliste-Fédération des médecins de France. L’organisation de la prévention en France est à l’image de celle du système de soins : elle foisonne en dispositifs de toute nature, simplement juxtaposés. Mais le médecin traitant, qui est pourtant le premier acteur de terrain, ne dispose pas de vrai rôle. Cela étant, il accomplit des actes de prévention, et en définitive pas si mal que ça !
Si les centres d’examens de santé enregistrent parfois des résultats intéressants, globalement – tous les rapports l’ont montré – ils ne se révèlent pas d’une grande efficacité au regard des sommes investies. La plupart du temps, ils reçoivent des personnes que nous voyons déjà, sauf lorsqu’ils se concentrent sur des publics particuliers comme ils l’ont fait au cours des dernières années au profit des personnes en difficulté. La plupart de mes patients qui passent des bilans de santé n’en ont pas besoin. Il faudrait revoir complètement le dispositif, ce qui libérerait des moyens humains et financiers.
Quant aux dépistages, ils font l’objet de toute notre attention : des experts comme M. Dominique Dupagne ou M. Philippe de Chazournes font partie de notre fédération. Nous estimons que le médecin traitant devrait être le moteur dans ce domaine grâce à un dossier organisé à cet effet.
On peut sans doute discuter de l’utilité de ces dépistages, s’agissant notamment du cancer du sein, pour lequel on a monté toute une procédure qui ne paraît pas d’une efficacité absolue. En ce qui concerne celui de la prostate, nous sommes à peu près tous d’accord avec la Haute Autorité de santé pour dire que le dépistage organisé ne présente pas d’intérêt. Quant au cancer du col de l’utérus, la convention médicale autorisait les gynécologues et les généralistes à facturer à part le prélèvement réalisé au cours d’une consultation, mais on est revenu presque aussitôt sur cette décision intelligente…
S’agissant de la médecine scolaire et de la santé au travail, il faudrait repenser complètement leur fonctionnement en liaison avec les médecins traitants.
La convention médicale est un document complexe qui risque de décourager les médecins de se lancer dans la prévention. Au surplus, le dispositif est fondé sur des éléments discutables. En fait, il n’y a pas eu de négociation sur ce point. On s’est contenté de rénover un peu le contrat d’amélioration des pratiques individuelles de M. Frédéric Van Roekeghem…
Il faudrait d’abord mettre l’accent sur ce qui est le plus utile pour être en bonne santé : avoir une activité physique. C’est de notoriété publique, mais aucune action n’est entreprise.
Deuxièmement, il conviendrait d’assurer un suivi correct des vaccinations : l’être humain est beaucoup moins bien suivi en France à cet égard que l’animal ! Cela fait vingt ans qu’il en est ainsi !
Enfin, l’organisation du suivi de la prévention par le médecin traitant devrait être une priorité.
Le problème tient moins à l’absence de politique de prévention qu’au foisonnement d’actions allant dans tous les sens.
Faut-il des consultations spécifiques de prévention ? À cette question, je ne donnerai pas de réponse tranchée, mais je note qu’on a trop tendance à mener des actions ponctuelles, en s’appuyant sur des organisations importantes, alors que la prévention peut très bien s’inscrire dans une pratique continue – celle du médecin traitant –, complétée par des actions ciblées pour lesquelles il conviendrait de mettre au point des dispositifs afin de toucher les personnes qui ne consultent pas. À cet égard, les visites annuelles du sport sont d’extraordinaires opportunités dont on ne tire pas profit.
Nous estimons donc qu’il y aurait probablement moyen d’agir simplement et efficacement en inscrivant la prévention dans le parcours de soins du patient. Cela supposerait d’en finir avec une culture de l’assurance maladie qui entraîne, soit qu’on y consacre des fonds spécifiques, soit qu’on ne la prend tout simplement pas en charge.
M. Claude Leicher, président de MG France. La prévention n’est pas seulement un problème de santé, mais un tout où l’accès à l’eau potable, l’assainissement, l’emploi et une alimentation saine comptent beaucoup plus. D’où la nécessité d’une approche médico-sociale.
Beaucoup de plans de prévention sont élaborés : la plupart atteignent partiellement leurs objectifs, mais beaucoup y échouent faute de s’adresser de manière adéquate aux populations qu’on cherche à toucher. En effet, si la prévention n’est pas qu’une affaire de santé, elle n’est pas qu’une affaire de médecins !
Les centres d’examens de santé de la sécurité sociale se sont opportunément reconvertis. Au lieu d’une prévention menée dans toutes les directions avec des bilans de santé tels qu’on les a connus dans les années 1970 – dont on s’est aperçu qu’ils étaient peu rentables quand on ne visait pas une population précise –, ils ont accordé la priorité aux publics précaires, que nous ne voyons pas beaucoup dans nos cabinets et qui ne sont pas culturellement enclins aux démarches de prévention. Encore faut-il évaluer le rapport coût-efficacité de cette nouvelle approche et apporter, au besoin, les mesures correctrices propres à l’améliorer.
S’agissant de la santé au travail, dans un éditorial qui m’a été confié il y a un mois pour la revue de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sur la relation entre le médecin du travail et le généraliste, j’ai rappelé que nous connaissions mal les risques professionnels : si l’on me demandait par exemple la liste de mes patients qui ont été exposés à l’amiante, je serais en peine de la fournir… Nous défendons l’idée d’un document médical de synthèse annuel, élaboré à partir des données dont nous disposons sur chaque patient – y compris en matière de prévention. Nous souhaiterions dans le même esprit que les médecins du travail nous fournissent un document comparable sur les risques au travail, qui viendrait nourrir l’historique du patient. Ce serait particulièrement précieux une fois celui-ci à la retraite car c’est alors que certains risques se concrétisent – je pense en particulier à l’exposition à l’amiante. Nous sommes donc favorables à des relations avec le médecin du travail allant au-delà des contacts que nous pouvons avoir à propos d’une reprise du travail ou d’un aménagement de poste.
Quant à la médecine scolaire, elle a quasiment disparu. La prévention pour les enfants s’arrête à trois ans, quand est réalisé le dernier bilan de la protection maternelle et infantile. Nous disposons néanmoins d’éléments grâce au carnet de santé et aux informations des parents, mais nous souhaiterions avoir des relations plus étroites avec les médecins scolaires, lorsqu’ils détectent quelque chose, ainsi qu’avec la protection maternelle et infantile.
Les plans de prévention nationaux souffrent d’un manque d’articulation avec la médecine générale. Et si, dans la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, vous avez fort opportunément rappelé – notre organisation n’y est d’ailleurs pas étrangère – que le médecin de premier recours est notamment chargé du soin, de la prévention, du dépistage et de l’éducation thérapeutique, aucun décret d’application n’a été publié : nous élaborons les mesures d’application à mesure que les occasions s’en présentent.
Une de ces occasions nous a été fournie par la convention médicale, qui a été négociée longuement sur ce point. Nous avons souhaité qu’elle soit déclinée en trois volets, consacrés respectivement au médecin traitant, au médecin correspondant et au médecin de plateau technique lourd, et, dans le premier volet, nous avons introduit des objectifs de santé publique. Le contrat d’amélioration des pratiques individuelles avait un défaut à nos yeux : celui d’être un contrat individuel, sans aucune dimension collective. Nous manquons de modes d’organisation systématiques, y compris en matière de production de données, d’évaluation et d’ajustement des mesures prises. Il convient de voir comment mieux articuler les actions des professionnels de santé de proximité, dans leur ensemble car on ne saurait s’en tenir au seul médecin.
Je rappelle que, si les pharmaciens voient 100 % et les médecins généralistes 95 % de la population chaque année, les infirmières n’en voient que 8 %. Par conséquent, penser qu’on peut mener par leur intermédiaire une action de prévention touchant la population générale est une vue bien théorique. Elle ne m’inspire pas d’objection de principe, les infirmières ayant un rôle indéniable en matière de vaccination, mais il faut mettre davantage l’accent sur l’équipe de soins de proximité, dont le modèle est constitué par les maisons de santé. Toutefois, comme celles-ci ne regrouperont à terme que 5 % à 10 % des médecins, il convient d’aller plus loin en développant des équipes de soins de premier recours. La création des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires a été utile à cet égard.
M. le rapporteur. Tout le monde reconnaît que la médecine scolaire est quasiment inexistante : comment dès lors faire intervenir le médecin traitant, par exemple pour prévenir les addictions ? Sous la forme de consultations de prévention ? Et, s’agissant des actifs, ne pourrait-on imaginer un partage des tâches avec le médecin du travail, celui-ci se consacrant à juger de l’aptitude au poste tandis que le généraliste serait compétent pour l’aptitude au travail ?
M. Claude Leicher. Nous sommes, je crois, à peu près tous favorables à l’idée d’une consultation annuelle de prévention et nous avons, pour notre part, élaboré des recommandations applicables à la population générale, étant entendu que les actes relevant de cette rubrique doivent être adaptés à la situation de chaque patient et retracés dans son dossier médical. Ainsi, le dépistage du cancer du sein, par exemple, ne s’effectuera pas de la même façon selon qu’il existe ou non des antécédents familiaux. Il conviendra donc de pouvoir s’appuyer sur le dossier médical de synthèse. Ce document dont nous avons proposé la création lorsqu’a été institué le médecin référent – et qui ne doit pas être confondu avec le dossier médical personnel – indiquera les antécédents, les problèmes en cours et les facteurs de risque. C’est à partir de ces données que pourra être définie une politique de prévention individualisée.
À ce sujet, je rappelle que le choix d’un médecin traitant ne s’impose qu’aux plus de seize ans ; or, il faut que ce médecin puisse soigner les patients dès leur naissance. L’existence de la pédiatrie n’est plus un obstacle : cette spécialité disparaît en dehors de l’hôpital et, en outre, les pédiatres peuvent être reconnus comme médecins traitants. Quant au problème des couples divorcés, soulevé par le ministre de la santé, rien n’empêche, si les parents n’habitent pas au même endroit, que chacun choisisse un médecin traitant, à charge pour celui-ci de coopérer avec son confrère.
Le document médical de synthèse permettrait de définir une stratégie annuelle, qui est le préalable indispensable à la consultation annuelle de prévention, de dépistage et d’éducation à la santé.
M. Michel Combier. Les jeunes restent, en matière de santé, largement sous la dépendance des parents : il ne leur est guère possible de consulter sans que ceux-ci en soient informés, ne serait-ce qu’au travers du remboursement. Se pose donc un problème de confidentialité, même s’il est souvent contourné, le médecin de famille s’abstenant de faire payer la visite. Mais il est de fait que se pose aussi la question de savoir à partir de quel âge on a le droit d’être pris en charge par un médecin traitant. Elle soulève un problème de responsabilité, qui doit être réglé à l’extérieur du cabinet médical.
Comme cela a été mentionné, les centres de santé se sont consacrés aux populations socialement en difficulté, que nous ne rencontrons pas en général. Il ne faut donc pas perdre de vue l’essentiel.
Pour les personnes âgées de vingt-cinq à quarante ans, il serait intéressant de connaître, par exemple, quelle est la proportion de celles qui, convoquées ou incitées à aller chez le dentiste, s’y rendent effectivement. Le constat serait sans doute le même que pour le dépistage du cancer du sein : certaines femmes ne veulent pas en entendre parler, ne serait-ce que pour des raisons sociales ou culturelles, et le médecin traitant passe beaucoup de temps à essayer de les repérer mais les convocations qui leur sont envoyées peuvent rester sans effet.
Le réseau de santé que l’on doit mettre en place sera donc confronté à deux questions : quelle est la responsabilité du patient à l’égard de la prévention ? Comment faire que, dans un pays où l’accès aux soins est relativement aisé, les gens en profitent le mieux possible ?
M. Roger Rua. Je ne viens pas ici pour défendre telle ou telle solution au nom d’une approche corporatiste, mais pour examiner pourquoi on n’est pas parvenu, en France, à avoir une politique de prévention digne de ce nom.
S’agissant des moyens, des propositions ont été faites – ainsi l’examen de non-contre-indication à la pratique du sport constitue un excellent moyen de toucher des populations qui ne sont pas malades. La question est bien plutôt de savoir comment toucher l’ensemble de la population tout en étant suffisamment efficaces pour modifier les comportements individuels à risque : ceux-ci expliquent la plupart des maladies chroniques lourdes, qui coûtent le plus à l’assurance maladie – sans parler de leur coût humain.
La médecine libérale de proximité est volontaire pour participer à cette politique de prévention. La publicité en faveur de l’activité physique, rappelant la nécessité d’environ une demi-heure de marche à pied par jour ou la publicité sur le thème « Les antibiotiques, c’est pas automatique » nous ont beaucoup aidés, mais il faut une impulsion politique forte. Sans action globale sur les comportements, rien de ce que nous ferons dans nos cabinets ne contribuera à éviter les maladies. Nous avons besoin d’un soutien politique marqué pour passer du tout curatif, que la médecine d’excellence française a pratiqué durant des années, à une politique efficace de prévention.
M. Claude Bronner. Il est toujours tentant de recourir à des mesures spécifiques, mais il faut partir de l’idée que la prévention requiert une pratique continue et une action individualisée. Le dossier de synthèse et le programme personnalisé pour le patient dont parle M. Claude Leicher participent de cette logique. Tel était aussi l’objectif visé par l’institution du médecin référent, même s’il n’a pas été atteint – et est maintenant quasiment oublié.
Cela étant, dans certaines situations, des consultations spécifiques plus longues peuvent être utiles. Quand on fait de la prévention au quotidien, on ne peut généralement y consacrer tout le temps nécessaire. La solution repose donc, non sur la seule consultation spécifique, mais sur un dispositif mixte au sein duquel elle viendra compléter, au besoin, une gestion au long cours.
En matière de médecine sportive, s’il est assez aisé de savoir quel est l’état de santé requis pour la pratique du football par exemple, la chose devient plus compliquée pour des sports plus élaborés. Dans les bonnes fédérations, la commission médicale fournit cependant un document donnant toutes les indications utiles…
M. Roger Rua. Je siège dans une commission médicale qui l’a fait et nos confrères généralistes ont marqué des réserves à l’égard de ce type de documents, qu’ils trouvent trop longs.
M. Claude Bronner. Certaines disciplines sportives imposent d’aller dans le détail… De même, il se rencontre en entreprise des situations pour lesquelles il nous faudrait davantage d’informations de la part des médecins du travail ; d’autres encore relèvent de la médecine spécialisée, mais elles sont rares. Le médecin généraliste peut donc faire face à la plupart des exigences en matière de prévention, pour peu qu’on lui facilite la tâche dans certains cas.
M. le rapporteur. Vous appelez de vos vœux une politique de santé globale et de grandes campagnes nationales conduites par le ministère de la santé : comment pourriez-vous vous impliquer dans celles-ci et accroître votre efficacité auprès des patients et des familles que vous rencontrez ?
Compte tenu des difficultés rencontrées par la médecine scolaire et par la médecine du travail, quel peut être votre rôle au titre de la prévention primaire, secondaire et tertiaire ?
M. le coprésident Pierre Morange. Un consensus se dégage pour estimer que la prévention primaire exige d’agir sur les comportements et donc sur les déterminants culturels, sociaux, environnementaux, éducatifs, professionnels, etc. Pour ce faire, il faut une coordination entre tous les acteurs. À de nombreuses reprises, il a donc été préconisé de confier la responsabilité de la politique de la prévention à une autorité unique, à une sorte de délégation interministérielle qui pourrait être confiée au directeur général de la santé.
Ce même souci de coordination impose aussi de pouvoir partager l’information à l’intérieur d’un véritable parcours de soins, conçu de façon globale…
M. Claude Leicher. À la notion de parcours de soins, nous préférons celle de parcours de santé, qui est plus large.
On est trop enclin, en France, à une vision pessimiste des choses. Or, comme vous l’avez rappelé, la Cour des comptes a donné une estimation des dépenses de prévention comprise dans une fourchette de 1 à 10 milliards d’euros. En tant que médecins généralistes, nous consacrons entre 25 % et 30 % de notre activité à des actes relevant de la prévention primaire ou secondaire. Les consultations de nourrissons, les consultations prénatales pour des grossesses physiologiques, les consultations de surveillance de l’hypertension sont essentiellement consacrées à de la prévention primaire. On ne peut donc affirmer qu’on ne fait pas de prévention en France, ni que le budget qui lui est consacré n’est pas suffisant !
En revanche, tous les experts insistent sur la nécessité de mieux intégrer, à côté du soin, la prévention, le dépistage et l’éducation thérapeutique dans l’organisation sanitaire.
Vous avez défini dans la loi le médecin traitant comme l’initiateur du parcours de santé de la population. Nous essayons de faire qu’il en soit ainsi en pratique : c’est tout le sens de la démarche conventionnelle, au sein de laquelle j’ai cherché pour ma part à introduire des objectifs de santé publique. Mais, quand on lance un plan Cancer en annonçant que le médecin généraliste doit en être partie prenante, il est regrettable qu’on ne dise rien des mesures concrètes retenues à cet effet ! MG France propose donc d’organiser les dispositifs de soin, de prévention et de dépistage autour de la fonction de médecin traitant. Il faut en outre considérer que celui-ci ne travaille pas de façon isolée et que nous nous orientons vers un travail en équipe de soins de premier recours, dans lequel le médecin traitant conserve la responsabilité de la coordination et du parcours de santé – et quand vous accepterez, comme nous le souhaitons, d’étendre la compétence du médecin traitant aux enfants dès leur naissance, nous partagerons une partie de ce rôle avec la pédiatrie, si elle existe encore en tant que telle hors de l’hôpital.
Il ne faut pas non plus oublier la coordination médico-sociale, nécessaire à une politique de prévention des maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents. L’accès de ceux-ci aux cabinets médicaux doit être facilité, de même que leur accès à la contraception – les généralistes pourraient ainsi délivrer des boîtes de Norlevo aux adolescentes ayant eu des rapports sexuels non protégés.
Les Britanniques ont des structures centrées, non sur le médecin, mais sur des populations et sur des territoires. Or, la loi du 21 juillet 2009 précitée a introduit la notion de territorialisation qui a suscité des craintes chez les médecins libéraux mais qui vous donne un outil politique permettant d’affirmer que nous ne sommes plus seulement des médecins ou des pharmaciens, mais des acteurs libéraux dans un territoire donné, et que nous devons vous proposer des modes d’organisation efficaces.
Le médecin traitant généraliste doit donc être chargé in fine de l’application des politiques voulues par le législateur ou par le Gouvernement, sachant, encore une fois, que celles-ci doivent être adaptées en fonction des risques propres à chaque patient.
S’agissant des modes de rémunération, il faut prévoir un temps de consultation consacré à l’explication du système ainsi qu’un temps pour l’organiser. En effet, il nous manque aujourd’hui la production de données. Aujourd’hui, on n’en élabore pas autrement que par les procédures de liquidation de l’assurance maladie. Nous devons donc éditer des données, ce qui est un des objectifs sous-jacents de la rémunération sur objectifs de santé publique. Il s’agit de dire aux médecins : soit l’assurance maladie produit vos données – de façon d’ailleurs plus ou moins juste –, soit vous le faites vous-mêmes. Il faut ensuite confronter celles-ci à un référentiel préalablement fixé, puis prendre les mesures d’adaptation qui s’imposent.
C’est ainsi que nous allons travailler dans le cadre de la convention médicale, en nous appuyant sur des indicateurs – et si ces indicateurs ne sont pas adéquats, nous les modifierons. Ainsi en est-il pour la mammographie : l’objectif de santé publique doit être modifié parce que les références internationales changent et il faut adapter les indicateurs en conséquence. C’est sur le fondement de ce travail que nous pourrons ensuite nous préoccuper des « niches » de population restées à l’écart des actions de prévention.
Par ailleurs, il serait pertinent de laisser les partenaires conventionnels déterminer si cette consultation de prévention doit être rémunérée à l’acte, au forfait ou en fonction d’objectifs. Nous cernerons les besoins des médecins et nous nous mettrons d’accord sur la manière de procéder. Pour MG France, l’intérêt de la forfaitisation serait de tenir compte du travail effectué en dehors de la présence du patient. L’un des principaux objectifs stratégiques de la convention est en effet que le médecin ne soit pas seulement dans une relation binaire avec le patient : il faut qu’il prenne le temps d’examiner la situation de l’ensemble de sa patientèle au regard de la vaccination ou des dépistages, ce qui produira des données dont l’agrégation devrait, à une échéance que j’espère proche, nous permettre d’adapter nos pratiques.
C’est à un problème d’organisation générale que nous sommes aujourd’hui confrontés en France. Je ne suis pas sûr que nous ayons vraiment besoin d’une haute autorité interministérielle : il existe assez de directions au ministère de la santé pour définir les politiques et, même si la direction générale de la santé était chargée de les coordonner, il resterait l’essentiel, à savoir déterminer le moyen de les traduire sur le terrain. Actuellement, aux termes de la loi, cet instrument est la contractualisation, sous les auspices de la convention médicale. Nous aurons toute possibilité de conclure, avec les autres acteurs du système de soins, des conventions interprofessionnelles, car la politique de santé publique doit être confiée au réseau territorial de proximité qui est constitué par les acteurs de soins de premier recours. En revanche, si d’autres acteurs interviennent sans cesse, nous serons dans une situation d’inefficacité permanente.
L’articulation avec la politique de la ville est nécessaire à ce que j’appelle la coordination médico-sociale. C’est un peu moins vrai pour la médecine scolaire, en raison de l’absence de politique du Gouvernement en ce domaine, mais si celle-ci était réactivée, il faudrait veiller avant tout à son articulation avec la fonction de médecin traitant et avec les équipes de soins de premier recours.
M. le rapporteur. La définition, par les agences régionales de santé, des schémas de territoire permettra-t-elle de résoudre ce problème ?
M. Claude Leicher. Les agences régionales de santé établissent des cartes. C’est bien, mais c’est un peu comme les frontières en Afrique, tracées à la règle ! Les territoires doivent être définis par les acteurs de soins de premier recours, les agences régionales de santé se bornant à en prendre acte. S’agissant de la permanence des soins par exemple, nous avions prévu, en 1997, 3 200 secteurs de garde, il est apparu qu’ils étaient trop nombreux. Nous avons donc réduit ce nombre à 2 500 et les restructurations ne se sont pas trop mal passées. Il n’empêche : la définition des territoires doit se faire en coordination avec les agences régionales de santé, bien sûr, mais à partir des besoins des professionnels de santé et de manière à les inciter à travailler ensemble, ce qui n’est pas encore bien compris. Le législateur et le Gouvernement doivent se convertir à cette organisation par territoire d’activité, de population, le premier territoire fonctionnel étant la patientèle du médecin traitant. C’est un élément extrêmement puissant introduit par la loi n° 2004-810 du 15 août 2004 relative à la réforme de l’assurance maladie et dont nous essayons de nous servir de la façon la plus intelligente possible.
M. Michel Combier. La pratique régulière de la médecine m’a appris l’humilité et la tolérance. D’abord, nous devons être modestes dans les objectifs que nous nous fixons. Nous nous attachons à améliorer la prise en charge des actions de santé publique et de prévention par une population de médecins qui a largement dépassé la cinquantaine et à permettre aux médecins plus jeunes de mettre en œuvre, au sein du système libéral, les enseignements reçus dans leurs études. Nous devons être tolérants, ensuite, parce que la personne à laquelle nous nous adressons a le droit de choisir. Ainsi certaines vaccinations sont obligatoires, mais l’État n’a pas pour autant prévu de sanctions à l’encontre de ceux qui les refusent…
Plutôt que de multiplier les objectifs, il faut définir quelques priorités et permettre aux médecins de s’investir pleinement pour les atteindre. D’où la place accordée dans la convention médicale à la prévention des maladies chroniques, pour laquelle le recours au médecin traitant est une source non seulement d’économies, mais surtout de confort pour le patient. En effet, le médecin traitant pourra, par exemple, à la fois éviter l’apparition de troubles de la vision chez les diabétiques et, à partir de cette pratique, réfléchir aux moyens d’améliorer encore la prévention ; en outre, dans la mesure où il reste le médecin de famille, il pourra examiner les enfants de ces patients, leur prescrire des dépistages qui leur éviteront la même maladie… L’amélioration de la prévention se fera ainsi de façon progressive, d’autant qu’il faudra associer à ce travail les acteurs de soins de deuxième recours, ces spécialistes auxquels il est si difficile d’accéder dans certaines régions.
Quant à la population qui ne vient pas dans nos cabinets, on la contraint à s’inscrire chez un médecin traitant mais celui-ci n’a pas le pouvoir de lui imposer une vaccination oubliée. La prévention se heurte donc à certains blocages et nous devons par conséquent réfléchir à la manière de faire sauter ces verrous.
M. Roger Rua. Il faut dépasser le simple aspect curatif et nos préoccupations égoïstes de médecins ! Orienter la politique de santé vers la prévention ne pourra résulter que d’un travail interministériel, car le ministère de la santé n’est malheureusement que le ministère du soin. Or la santé, c’est éviter le soin. En Suisse, certains patrons ont diminué le temps de travail de leurs employés de deux heures par semaine pour qu’ils puissent se consacrer à une activité physique encadrée et ils ont constaté que la productivité de ces salariés s’en trouvait améliorée. Il faut donc aller au-delà de notre propre réflexion de médecins.
M. le rapporteur. Si le délégué interministériel à la prévention est le directeur général de la santé, comme le propose la Cour des comptes, cela changera-t-il quelque chose ?
M. Roger Rua. Les ministères chargés de la jeunesse, des sports et du travail sont concernés. L’organisation doit donc être transversale. Ne retombons pas dans les schémas anciens, « égocentrés » ! La prévention, ce n’est pas le soin.
M. Claude Leicher. En France, nous avons tendance à empiler des structures et nous allons encore en ajouter ! Je ne vois aucun inconvénient à ce que le directeur général de la santé soit chargé de la coordination interministérielle, mais ce n’est pas à ce niveau que les choses se joueront. On est allé jusqu’à préconiser 100 mesures, dont 10 seulement ont réellement été appliquées. Nous devons être pragmatiques : il faut définir les acteurs les plus pertinents pour toucher chaque catégorie de population ; travailler à cerner les causes de l’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, ou entre les ouvriers et les cadres, afin de réduire la mortalité évitable ; chercher comment agir sur les comportements des gens de trente-cinq à cinquante ans pour réduire les risques cardiovasculaires… Plutôt qu’ajouter une nouvelle structure, mettons en œuvre les bonnes politiques avec des moyens en conséquence – si la Cour des comptes parle de 10 milliards d’euros, cela signifie qu’ils sont disponibles !
Ce que nous faisons, nous, médecins généralistes, n’est pas toujours visible parce que, je le répète, nous ne produisons pas de données et nous n’évaluons pas notre activité. Corrigeons cela, mais restons dans la logique d’organisation du système de santé que vous avez définie et qui s’articule autour du médecin traitant. Confions à celui-ci la partie prévention et dépistage, en association avec les autres acteurs ! La direction générale de la santé peut être le lieu de l’évaluation et du recueil des données, mais affirmer que le ministère de la santé ne produit pas de données de santé, c’est occulter toutes les publications de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
M. le rapporteur. Qui a décidé de retirer l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée ? Quelles seront les conséquences d’un tel retrait auquel le directeur général de la santé n’aurait pas été favorable, d’après ce que j’ai compris ?
M. Claude Bronner. Est-il si important de savoir qui a pris la décision ? Il est toujours possible de corriger une mauvaise décision. En l’occurrence, le directeur général de la santé n’était pas favorable à un tel retrait, mais j’ai aussi des exemples où il était favorable à des politiques qui n’ont pas produit de bons résultats. Ce qui s’est passé avec la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 est la preuve absolue que ce n’est pas parce que l’État organise une procédure extraordinaire qu’elle va être efficace ! Pour fonctionner, le système n’a pas besoin d’une organisation pyramidale ; il doit être construit sur des principes clairs et être décliné, sur le terrain, par les acteurs intéressés. Ainsi que l’a mentionné M. Claude Leicher, il faut placer la population et le médecin traitant au centre du dispositif. Et il est nécessaire également d’établir un lien avec la médecine spécialisée. Il est par exemple aberrant qu’après avoir fait autant d’efforts d’organisation pour mettre en place un médecin traitant, ni les femmes ni nos confrères gynécologues n’avertissent celui-ci qu’un frottis a été réalisé et ne lui en communiquent le résultat. C’est une illustration des aberrations dues au défaut d’organisation, indépendant de la question des institutions.
M. le rapporteur. Vous avez négocié la convention médicale avec le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et vous avez défini des indicateurs de performance. Est-ce vous qui avez proposé ces indicateurs ? En êtes-vous satisfaits ?
M. Claude Leicher. Les indicateurs sont issus d’un consensus. Les indicateurs de soins sont centrés sur les pathologies chroniques, avec un volet prévention extrêmement important. Ils ont pour objectif d’améliorer les résultats de santé. Les médecins qui affirment que nous sommes passés d’une obligation de moyens à une obligation de résultats n’ont pas dû lire attentivement la convention. Celle-ci ne prévoit pas une obligation de résultats, mais les médecins doivent s’intéresser aux résultats de leur patientèle en termes de santé publique. Et s’ils ne le font pas, ils ne devront pas se plaindre si un jour on confie ce travail à un autre acteur ! Étudier les résultats, faire sa propre évaluation en vue de les améliorer, c’est le travail normal de tout professionnel. Et il faut commencer par s’intéresser aux gens qui ne font pas d’examens de santé, car c’est le moyen le plus sûr d’accroître fortement les succès de la prévention. S’occuper précocement des diabétiques, pendant les dix premières années de leur maladie, est une nécessité absolue. Il y a vingt-cinq ans, les Britanniques se sont attaqués au tabagisme selon des critères anglo-saxons, c’est-à-dire brutalement, mais le résultat est aujourd’hui spectaculaire : le taux de cancers du poumon baisse chez les hommes et chez les femmes, alors qu’en France, il diminue chez les hommes mais augmente chez les femmes, de sorte que, dans cinq ans, les deux courbes se croiseront. Que fait-on en attendant ? Je proposerai donc à M. Frédéric Van Roekeghem l’introduction d’un indicateur relatif au tabac.
Nous avons discuté et commencé par reprendre ce qui avait déjà été mis en place. Je vous rappelle que 16 000 médecins généralistes l’ont plébiscité contre l’avis du Conseil national de l’ordre, de l’industrie pharmaceutique et de certains syndicats. Nous en avons pris acte et avons préféré une gestion commune à une gestion individuelle. Donc, nous avons discuté et, oui, nous sommes d’accord avec tout. Cela dit, le dépistage par la mammographie fera l’objet d’un débat. Si un consensus se dessinait sur le fait que la mammographie n’améliore pas l’espérance de vie des femmes, ce qui serait tout de même étonnant, nous en tiendrions évidemment compte. Quant au dépistage du cancer de la prostate par le dosage de l’antigène prostatique spécifique (PSA), vous connaissez la polémique dont il fait l’objet et il ne figure donc pas au nombre des indicateurs.
Parfois aussi, nous ne comprenons pas l’attitude des pouvoirs publics. Les médicaments contre la maladie d’Alzheimer ne sont d’aucune utilité, ils n’améliorent pas la santé de la population concernée, augmentent sa mortalité, et le service médical rendu a été dégradé par la Haute Autorité de santé. Pourtant ces médicaments restent remboursés – à raison de 280 millions d’euros chaque année ! Nous, médecins, nous demandons donc parfois comment les décideurs analysent l’information disponible. Il faut un peu de courage politique, même si je comprends bien que c’est difficile !
En conclusion donc, monsieur Jean-Luc Préel, nous avons discuté des indicateurs de performance, nous approuvons ceux qui ont été choisis, mais il faudra très certainement les améliorer.
M. Michel Combier. Nous sommes allés voir la pratique en Californie, en Grande-Bretagne, en Autriche… et cela nous a parfois rassurés ! Dans le système britannique de paiement à la performance par exemple, la rémunération du médecin augmente une première fois au-delà de quatre minutes de consultation et une seconde fois lorsque la durée de l’entretien dépasse huit minutes, alors qu’une consultation en France dure entre seize et dix-sept minutes. De plus, en Grande-Bretagne toujours, cette rémunération est majorée si le patient est reçu dans un délai de cinq jours ou de quarante-huit heures s’il s’agit d’un malade chronique. Ce sont des mesures que nous n’avons pas eu besoin de prendre en France parce que les médecins français sont plus attentifs à leur patientèle.
Le contrat d’amélioration des pratiques individuelles était centré sur l’efficience, c’est-à-dire, pour appeler les choses telles qu’elles sont, sur la diminution de la prescription de médicaments et la sanction y tenait une place importante. Avant que nous ne nous penchions sur la question dans un cadre conventionnel concerté, il suffisait qu’un médecin se trompe sur l’un des éléments de la prescription pour qu’il perde tout le bénéfice de son travail de prévention. Nous avons corrigé cela et, en outre, nous avons introduit des dispositions relatives à l’organisation, qui vont permettre aux médecins de s’informatiser et de commencer à s’échanger des informations. Comme l’a souligné M. Claude Bronner en prenant l’exemple du frottis, le retour des informations vers le médecin traitant est crucial pour que celui-ci puisse prescrire les examens utiles – et seulement ceux-là – sans avoir à se livrer à un interrogatoire de police, parfois vain.
En reprenant les indicateurs adoptés dans les autres pays et en nous référant aux référentiels de la Haute Autorité de santé et aux conclusions des sociétés savantes, nous avons construit un système qui, j’en suis persuadé, contribuera à faire évoluer les esprits et à améliorer progressivement la prévention, y compris la prévention primaire.
M. le rapporteur. Le taux de dépistage organisé du cancer du sein fait partie des indicateurs. Comment aller au-delà du niveau actuel, sachant que beaucoup de femmes sont réticentes à un tel examen ? Et que se passera-t-il pour le médecin traitant si son pourcentage de dépistage n’augmente pas ?
Par ailleurs, s’agissant du dépistage du cancer de la prostate, comment se fait-il que certains médecins prescrivent aujourd’hui des dosages de PSA pour des hommes de soixante-dix ou soixante-quinze ans ?
M. Claude Leicher. S’agissant du cancer du sein, nous débattons actuellement au niveau international de l’utilité du dépistage pour faire baisser la mortalité chez les femmes. Pour l’instant, rien ne prouve qu’il permet d’allonger l’espérance de vie, contrairement aux conclusions des premières études, réalisées dans les années quatre-vingt-dix. Nous serons peut-être amenés à modifier cette recommandation si les données de la science évoluent mais, pour l’instant, ce n’est pas le cas.
Par ailleurs, trop de mammographies sont réalisées avant cinquante ans, à un âge où la densité de la glande mammaire gêne la lecture de tels examens qui, en outre, se traduisent par des irradiations. Il y a de même trop de frottis réalisés sur les femmes jeunes, pas assez sur celles de plus de cinquante ans, tandis que des populations entières ne bénéficient pas de cette technique de dépistage. Or, la population est informée et se demande pourquoi les gynécologues persistent dans ces prescriptions. Une certaine méfiance commence ainsi à se développer à l’égard de recommandations dont on s’aperçoit qu’elles sont entachées de conflits d’intérêts.
Si les taux de dépistage d’un médecin n’augmentent pas, c’est à nous, syndicats, et à l’assurance maladie, de nous interroger sur les raisons de ce fait. C’est probablement parce qu’il ne suffit pas de s’en remettre au système de santé, qu’il faut actionner d’autres leviers et agir, notamment, sur les déterminants culturels. Notre façon d’aborder la santé n’est pas adaptée à certaines des populations que nous soignons.
Quant au dépistage du cancer de la prostate, je commencerai par observer qu’il s’arrête à soixante-quinze ans, alors que nous voyons de plus en plus d’hommes de plus de quatre-vingts ans dans nos cabinets. Cela étant, il importe que les médecins soient protégés des pressions exercées par les patients par des recommandations claires, précises et unanimes. Or, d’un côté, l’Association française d’urologie préconise un dépistage en population générale tous les deux ans à partir de cinquante ans et, de l’autre, la Société française de santé publique et toutes les sociétés internationales de santé publique nous disent qu’étendre trop le dépistage entraîne des opérations qui accroissent la mortalité, le nombre d’hommes incontinents et les problèmes d’impuissance post-chirurgicale, alors même que ces cancers n’auraient peut-être pas évolué. Nous, médecins généralistes, sommes donc partagés et je vous avoue humblement que, parfois, je craque, d’autant que nous avons aussi des patients de soixante-quinze ans en pleine forme, auxquels on ne donne pas leur âge et qui ne comprennent pas pourquoi on arrête de les soigner. Lorsqu’une demande de la population se manifeste, la loi la prend souvent en compte quelques années plus tard. Le législateur finit lui aussi par céder !
M. Roger Rua. Nous évoquons là la prévention secondaire, mais j’en reviens à ma marotte de la prévention primaire : le fait d’arrêter la consommation de tabac est plus efficace que le dépistage. C’est donc sur ce point qu’il faut se battre. Les indicateurs conventionnels pour le paiement à la performance sont surtout économiques, ne nous leurrons pas ! Nous sommes auditionnés pour savoir s’il existe réellement une volonté politique de faire de la prévention, et non pas pour évoquer des problèmes techniques qui se posent dans nos cabinets. Une fois que cette volonté sera acquise, nous pourrons décliner les préventions primaire, secondaire et tertiaire, réunir les acteurs et trouver des moyens. Et je ne veux pas ajouter une énième structure : je souhaite une seule agence de prévention, parce qu’il nous faut un ensemble cohérent. C’est en effet cette cohérence qui fait défaut et les indicateurs de performance n’y remédieront pas grand-chose. Prescrire moins de médicaments, c’est sans doute une prévention très efficace, mais une politique de prévention ambitieuse, c’est autre chose !
M. Claude Bronner. Hormis les indicateurs liés à l’organisation, qui sont nouveaux et ont effectivement été discutés, les autres figuraient dans le contrat d’amélioration des pratiques individuelles : comment pourrait-on croire qu’ils ont été négociés alors que tous les syndicats étaient opposés à ce contrat d’amélioration des pratiques individuelles – sans doute à tort d’ailleurs puisque les médecins l’ont plébiscité ? En fait, il n’y a pas eu de négociations, pour de simples raisons d’organisation, parce que tout s’est déroulé rapidement. Et le résultat ne sera pas à la hauteur des ambitions que nous placions dans le dispositif, j’en suis convaincu.
M. le coprésident Jean Mallot. Si je conviens que l’organisation pyramidale n’est pas la panacée, cela néanmoins peut contribuer au maintien d’une constance de la volonté politique. Pensez-vous que la formation initiale et continue des professionnels de santé soit à la mesure de ce que nous pourrions espérer et cohérente avec cette éventuelle volonté politique ?
Par ailleurs, pourriez-vous, monsieur Claude Leicher, préciser ce que vous entendez par « conflits d’intérêts » ? Nous avons un cas avec la politique visant à limiter la publicité en faveur des produits gras, salés et sucrés, afin de lutter contre l’obésité. Elle vient contrecarrer les efforts que fait le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour que la télévision dispose de ressources publicitaires suffisantes, mais il y a sans doute des exemples moins médiatiques…
M. Claude Leicher. Je partage votre point de vue : il faut une volonté politique cohérente. Nous voulions simplement éviter d’ajouter de nouvelles structures. De nombreuses personnes compétentes peuvent assurer cette cohérence et le système conventionnel a bien l’intention de travailler en ce sens, en tenant compte du contexte réglementaire et législatif.
Si vous souhaitez que la politique de prévention s’organise autour du médecin traitant et des soins de santé de premier recours, cela signifie que la formation initiale à la prévention et au dépistage fait partie des missions des enseignants de médecine générale et de santé publique, prévus par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Notre pays compte actuellement 11 000 étudiants en médecine générale, 25 professeurs et une centaine d’enseignants maîtres associés, ainsi que des maîtres de stage dont le nombre a sensiblement augmenté, grâce notamment à l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. Lorsque les jeunes internes viennent dans nos cabinets, ils réalisent bien que notre temps est partagé entre la prévention, le dépistage et le soin. Comment, d’ailleurs, un médecin pourrait-il aujourd’hui se désintéresser de la prévention alors que la population se préoccupe de préserver sa santé ?
La formation médicale initiale est absolument essentielle et l’on ne peut que se féliciter de l’existence, désormais, d’un tronc commun à différentes professions de santé. S’impose ainsi petit à petit l’idée qu’il faut sortir du tout médical. Les sages-femmes, par exemple, ont toute leur place dans le champ de la prévention : même si elles ne sont pas très nombreuses dans le secteur libéral, ce sont elles qui suivent l’essentiel des grossesses à l’hôpital, à nos côtés puisque, en périnatalité, la part des généralistes a nettement augmenté ces dernières années. Il est indispensable d’avoir la culture de la santé publique, et pas seulement de la santé de l’individu qui est en face de soi. Or, sur ce plan, la convention médicale assure un gain qualitatif majeur.
Quant aux conflits d’intérêts, les médecins y sont sans cesse confrontés dans la mesure où ils ont intérêt à avoir devant eux des gens malades – à moins qu’ils ne soient salariés, auquel cas l’intérêt est inverse ! D’où la nécessité, précisément, de valoriser l’activité de prévention et de dépistage. Il n’est pas raisonnable, pour revenir à cet exemple, que tant de frottis soient prescrits à de jeunes femmes. D’où notre idée de faire figurer dans la convention un contrat d’amélioration des pratiques individuelles centré sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et d’améliorer la rémunération à condition que le dépistage s’effectue dans le cadre des recommandations – je rappelle que celles-ci prévoient un dépistage tous les trois ans, et non pas tous les deux ans comme cela se pratique actuellement. L’assurance maladie a donc fait un bon calcul. En effet, même si leur nombre devrait légèrement augmenter, on fera moins de frottis à des femmes qui n’en ont pas besoin et plus à celles qui en ont besoin.
Le fait de mettre en concurrence les professionnels de santé entre eux – cela a longtemps été le cas des pédiatres et des gynécologues face aux médecins généralistes – génère une concurrence inappropriée sur le nombre d’actes, et c’est un facteur majeur de dépenses indues qui n’est pas pris en compte. On ne peut, par exemple, systématiquement prescrire des ostéodensitométries à toutes les femmes ménopausées, car ce n’est absolument pas justifié et ne correspond à aucune recommandation. En matière de santé, les conflits d’intérêts ne peuvent se résumer à ceux qui ont été médiatisés et qui concernaient le médicament. Les professionnels peuvent y être confrontés dans l’exercice même de leur activité. Il faut donc veiller à ce que les modes de rémunération permettent de gérer correctement ces situations en récompensant le respect des référentiels de qualité.
M. Roger Rua. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, la prévention n’est pas du tout enseignée aux étudiants en médecine français. Nous avons donc beaucoup de progrès à faire pour surmonter ce handicap culturel, y compris dans le cadre de la formation continue.
Quant aux conflits d’intérêts, toutes les professions en connaissent en permanence. Il faut donc arrêter de se focaliser sur le sujet et essayer de faire son métier le mieux possible, dans l’intérêt du patient.
M. Claude Bronner. Des conflits d’intérêts, il y en a bien sûr partout. L’important, c’est de les connaître.
Quant à la prévention, il est vrai que nos confrères ne se précipitent pas sur les formations dispensées en la matière, simplement parce que le dispositif n’est pas organisé pour cela, parce qu’ils n’y voient pas un intérêt direct et immédiat, et parce qu’ils pensent que, globalement, ils font ce qu’il faut. Je prendrai pour exemple l’éducation thérapeutique - expression que je n’apprécie pas vraiment, mais qui a du sens. On reconnaît qu’elle exige une formation, car c’est un concept relativement nouveau qu’il faut développer, mais rien n’est organisé à cet effet ! La formation suit l’expression, par les médecins, de besoins qui dépendent eux-mêmes de l’organisation de leur travail et de la manière dont ce travail est reconnu. Il faut certes investir dans la formation, mais il faut aussi que ceux à qui elle s’adresse y trouvent de l’intérêt.
M. le rapporteur. Dans certaines spécialités, le médecin prescrit lui-même les examens qui le font vivre : ainsi, pour un gastro-entérologue, les fibroscopies, coloscopies et autres écho-endoscopies. N’y a-t-il pas là des conflits d’intérêts regrettables ?
Par ailleurs, s’agissant des vaccinations obligatoires, pourquoi les rappels ne sont-ils pas systématiquement faits chez les jeunes puisque vous connaissez leur dossier médical ? Y a-t-il des réticences de la part des parents ?
M. Michel Combier. La campagne de vaccination contre le virus H1N1 a été l’occasion de contestations sur internet : le discours de l’État ne valait rien – c’était la théorie du complot – et il fallait écouter l’avis de tel ou tel spécialiste autoproclamé. S’agissant du dosage de PSA, tout le monde a bien compris dans quelles conditions il fallait prescrire cet examen mais, les gens parlant entre eux de leurs problèmes de santé, chacun se demande pourquoi il n’a pas subi d’examen, contrairement à son voisin…
Même si elle a été affectée un temps par l’épisode de la grippe H1N1, la vaccination, en général, ne pose guère de problèmes hormis le cas de certaines familles qui y sont culturellement hostiles et qu’il est très difficile de faire changer d’avis, d’autant que nous n’avons pas de pouvoirs de police, ce qui est préférable d’ailleurs. Ces enfants sont néanmoins en danger et ils bénéficient tout de même de la vaccination des autres alors qu’ils ne participent pas à l’effort collectif. C’est à vous, mesdames, messieurs les députés, de modifier les choses. Pour notre part, nous ne pouvons qu’essayer de convaincre.
Un autre problème se pose quand les jeunes ont dix-huit ans. C’est souvent l’âge où ils quittent le domicile familial, ne retrouvent plus leur carnet de santé et ne se rappellent plus s’ils ont eu leur rappel de vaccination. C’est pourquoi nous préconisons un système très simple : un dossier médical professionnel contenant les informations essentielles, qui permettrait la transmission des informations entre les médecins.
Si nous voulons réaliser des économies dans le cadre d’une démarche de santé publique, les pouvoirs publics devront trouver le moyen d’inciter la population à adopter une attitude de prévention. Il faut commencer très tôt, à l’école, dans les familles, et le problème est plus celui du temps que les jeunes passent devant la télévision que celui de ce qu’ils mangent en la regardant.
M. le rapporteur. Si chacun de vous avait un message essentiel à faire passer, quel serait-il ?
M. Claude Leicher. Nous souhaitons connaître les règles dans lesquelles vous souhaitez que nous nous inscrivions. Si vous persistez à penser que le travail du médecin traitant doit comprendre des actions de prévention, de dépistage et d’éducation à la santé, nous établirons des accords conventionnels pour mettre en œuvre cette politique sur le terrain avec tous les partenaires nécessaires. Déjà, en transposant dans le champ conventionnel l’une des mesures du plan Alzheimer, nous lui avons donné une « visibilité » réelle auprès des généralistes et de la population concernée. Mais j’insiste : la cohérence est indispensable dans la structuration des parcours de santé. C’est ce que l’on appelle le management intégré des soins primaires.
M. Michel Combier. Le ministère ne pouvant suffire à tout, si l’on veut déléguer certaines tâches à l’assurance maladie, il faut s’y tenir et il faut permettre aux partenaires conventionnels de faire leur travail. Nous avons prouvé par le passé que nous le pouvions, et nous continuerons à condition que l’on nous en donne les moyens légaux et financiers.
M. Roger Rua. Mon message essentiel est le suivant : que la prochaine loi de santé publique ouvre la voie à la prévention, notamment à la prévention primaire car c’est la plus efficace. Créons donc une agence nationale de la prévention, et une seule, pour mener une politique cohérente qui implique, au-delà des seuls médecins libéraux, tous les acteurs ayant un intérêt majeur collectif à ce que la santé ne se résume pas aux soins.
M. Claude Bronner. J’aurais répondu comme le docteur Claude Leicher, ce qui me permet de formuler un second message, lequel va à l’encontre de ce que dit le docteur Roger Rua ! Les médecins libéraux sont nombreux et ils sont au contact de la population. Fixez-leur des objectifs, donnez-leur des moyens d’évaluer, mais ne les soumettez pas à des règles contraignantes et à une paperasserie insupportable ! Alléger au maximum l’organisation sera gage d’efficacité sur le terrain.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions, messieurs.
*
Audition de M. Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, de Mme Catherine Morel, vice-présidente de l’Union nationale des pharmacies de France, de M. Claude Baroukh, secrétaire général de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, de M. Claude Dreux, président du Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, et de M. Xavier Desmas, membre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
M. le coprésident Pierre Morange. La communication de la Cour des comptes montre que les dépenses consacrées à la prévention sont comprises, selon les périmètres et les critères retenus, entre 1 et 10 milliards d’euros. Les moyens sont donc présents. Cependant, la cour a aussi souligné des problèmes de coordination et la complexité des schémas organisationnels. Quel est votre rôle au sein de cette organisation globale ? Votre analyse d’acteurs de terrain, en contact direct avec l’ensemble de la population, nous intéresse tout particulièrement.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Les pharmaciens souhaitent manifestement devenir des acteurs à part entière de la santé publique et participer davantage, à ce titre, au suivi de maladies chroniques ainsi qu’à la prévention. Comment envisagez-vous votre coopération avec les médecins, tentés de défendre leur périmètre ?
M. Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine. Le rôle des pharmaciens d’officine dans la prévention et le dépistage, bien qu’il soit souvent contesté, est clairement établi et défini par la loi précitée du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce texte vient d’être renforcé par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 précitée, qui leur permet d’intégrer les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires. Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a inclus dans le champ conventionnel certaines actions de dépistage réalisées par les pharmaciens, ce qui contribuera à mieux organiser la prévention en liaison avec les caisses d’assurance maladie, et a autorisé des rémunérations spécifiques, jusqu’ici exclues.
Cette base législative claire est d’autant plus utile que, comme l’ont montré quelques auditions de directeurs d’agences régionales de santé, notamment d’Île-de-France et des Pays de la Loire, certains réflexes corporatistes, chez les médecins, rendent parfois difficile la coordination des actions de prévention.
En tout état de cause, les pharmaciens sont déjà acteurs de la prévention : ils peuvent désormais vendre des médicaments d’accompagnement du sevrage tabagique sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une prescription, ou des vaccins anti-grippaux, ainsi rendus éligibles au remboursement avant même leur prescription. La profession avait également pris, il y a vingt-cinq ans, des initiatives fortes en matière de lutte contre le sida et l’hépatite, en distribuant par exemple des « stéribox » aux toxicomanes. Avec la distribution de la pilule du lendemain, venant après celle du préservatif, elle a encore montré son implication dans un problème qui, au-delà de son aspect médical, est un problème de société. Enfin, dans le cadre de la prévention des risques nucléaires, les pharmaciens se sont vu confier la distribution de comprimés d’iode aux populations qui vivent à proximité des centrales.
D’autres actions de prévention moins connues ont été menées, notamment au niveau local comme en région Rhône-Alpes : l’information des populations sur l’ambroisie et ses effets puissamment allergisants ou la prévention, en coopération avec certaines compagnies d’assurance, des risques de maladies cardiovasculaires ou le suivi du calendrier vaccinal. Ces initiatives exigent de la conviction car elles sont parfois mal comprises, notamment en Île-de-France.
Les 4 millions de contacts quotidiens établis par les pharmaciens sur l’ensemble du territoire sont précieux pour le suivi des patients, particulièrement des plus précaires, qui fréquentent peu les cabinets médicaux. Nous pouvons ainsi nous engager dans la prévention et le dépistage de pathologies mal détectées – cholestérol, diabète ou hypertension – et dont les effets sont d’autant plus graves que les patients peuvent ignorer longtemps qu’ils en sont atteints. Comme le soulignait monsieur le rapporteur, les pharmaciens entendent bien jouer tout leur rôle, notamment dans l’accompagnement de ces patients souffrant de maladies chroniques, comme le leur permet le statut de pharmacien correspondant.
Le réseau pharmaceutique a le double avantage d’être réparti de façon homogène sur tout le territoire et composé de professionnels déjà présents sur le terrain : s’appuyer sur lui est donc peu coûteux lorsqu’il s’agit, par exemple, de rectifier certains messages d’une campagne de prévention. Les pharmaciens ont par ailleurs noué des collaborations avec l’assurance maladie, avec les assureurs – le groupe Allianz pour la prévention des risques cardiovasculaires, par exemple – et, bien entendu, avec les instituts et agences sanitaires.
La prévention doit selon nous reposer, non sur la concurrence, mais sur la complémentarité entre tous les professionnels de santé, chacun d’eux disposant d’atouts spécifiques.
Mme Catherine Morel, vice-présidente de l’Union nationale des pharmacies de France. Je veux intervenir en tant qu’actrice de terrain puisque, depuis trente ans, je m’efforce de collaborer avec les travailleurs sociaux, les médecins et les patients.
Les pharmaciens d’officine constituent le premier réseau de professionnels à l’écoute des patients, même si ce réseau est parfois méprisé par l’administration. Par leur action quotidienne, ils assurent une prévention individuelle. En amont du diagnostic, l’officine est souvent l’antichambre du cabinet médical : sans jamais faire de diagnostic, nous expliquons les comptes rendus d’analyses biologiques et, le cas échéant, nous efforçons d’en dédramatiser les résultats afin de préparer au mieux la consultation.
En aval, le pharmacien peut être, passez-moi l’image, le morceau de sucre qui adoucit la médecine, notamment lors de l’annonce d’une pathologie lourde. L’officine est souvent le lieu où la parole se libère, non seulement celle des patients mais aussi celle des aidants. Dans mon département, qui connaît une recrudescence des cancers, c’est souvent au sein même des officines que la souffrance morale des familles s’exprime. Les pharmaciens contribuent à la recherche de solutions pour permettre aux proches de mieux accompagner le malade – ce en concertation avec le médecin traitant s’il s’agit, par exemple, de ménager une pause dans l’activité professionnelle d’un parent.
Ce réseau informel de proximité, pour autant qu’il repose sur le respect de chaque intervenant et de ses compétences – car c’est ainsi que l’on prévient tout conflit –, est celui qui se révèle être le plus utile au patient.
L’intervention des pharmaciens dans des actions collectives s’explique, à l’origine, par le constat de dysfonctionnements. On peut à cet égard citer quatre principaux domaines : la psychiatrie, l’addictologie, la gériatrie et les petites urgences – que nous essayons de gérer afin de décharger les hôpitaux. Afin d’assurer ces missions au mieux et de façon pérenne, les pharmaciens ont besoin de moyens financiers. Imagine-t-on de changer de médecin traitant tous les deux ou trois ans ? La prévention suppose une relation de confiance et de dialogue dans la durée ; or, sur ce point, la situation des pharmaciens d’officine est gravement compromise.
La prévention devrait à mes yeux constituer une orientation prioritaire des politiques de santé publique. Je comprends mal les opérations des groupes de pression, les conflits de pouvoir et autres chevauchements de structures. Il est difficile de se repérer dans la multiplicité des thèmes : quelques actions prioritaires, décidées au niveau national, seraient assurément plus efficaces.
Je m’étonne par exemple que le plan Cancer, pour lequel plusieurs structures interviennent, ne mette pas prioritairement l’accent sur la prévention du tabagisme, mis en cause dans toutes les pathologies, que ce soit les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les broncho-pneumopathies chroniques obstructives. Où est l’action de l’État en la matière ?
Les pharmaciens sont, comme les autres professionnels de santé, déroutés par le grand nombre d’intervenants, par le jargon trop fréquent et par la complexité des procédures. J’avais imaginé un guichet unique, mais il présenterait l’inconvénient de méconnaître les priorités sanitaires spécifiques à chaque territoire, lequel doit se voir accorder une marge de manœuvre sur le fondement des données fournies par les observatoires régionaux de santé.
Le ministère de la santé avait décidé que 2011 serait l’année des patients et de leurs droits ; la semaine dernière était consacrée à la sécurité, avec trois thèmes prioritaires : « Bien utiliser les médicaments » ; « Comprendre les indicateurs de qualité » ; « Agir sur les actions à risques ». Qui en a entendu parler ? Personne. C’était pourtant l’occasion d’informer les patients dans les officines, dans les cabinets médicaux et dans l’ensemble des structures publiques et parapubliques.
L’Union nationale des pharmacies de France aimerait que les pharmaciens soient associés aux campagnes de prévention ou aux projets dès leur élaboration, et pas seulement pour apporter leur soutien a posteriori, comme ce fut le cas avec le programme Sophia.
Les pharmaciens souhaitent aussi être rémunérés lorsqu’ils interviennent dans ces campagnes de prévention, ce que tous leurs interlocuteurs font dans le cadre de leur activité professionnelle : les pharmaciens sont les seuls, lors de ces campagnes, à devoir mettre leur activité entre parenthèses. L’absence de rémunération est un mauvais signal adressé à nos interlocuteurs ; peut-être contribue-t-elle aussi à déresponsabiliser certains professionnels de santé.
Les campagnes de prévention doivent être plus simples, et leurs objectifs hiérarchisés. L’État doit affirmer explicitement que la santé est sa première préoccupation.
M. Claude Baroukh, secrétaire général de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Je m’efforcerai de vous exposer le rôle qui, selon moi, doit être celui des pharmaciens d’officine dans la prévention sanitaire.
Notre champ d’intervention est défini par les articles 36 et 38 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, aux termes de laquelle « les pharmaciens sont contributeurs des soins de premier recours qui englobent : la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients […] ; l’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; l’éducation pour la santé ». La profession est organisée dans le respect des exigences de proximité - laquelle peut être définie selon les deux critères de la distance et du temps de parcours –, de qualité et de sécurité.
Par ailleurs, l’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit, dans la rémunération des pharmaciens d’officine, une part liée à l’acte de dispensation et à la performance.
Enfin, la loi du 10 août 2011 précitée a instauré les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, dont le seul objet est l’éducation thérapeutique et la coordination entre professionnels de santé.
Comme l’a noté M. Gilles Bonnefond, les officines sont fréquentées tous les jours par 4 millions de personnes de tous âges et tous milieux, quel que soit le stade de leur pathologie, ainsi que par des personnes en bonne santé, ou qui croient l’être.
On peut définir l’intervention des pharmaciens d’officine dans la prévention à partir du schéma de l’Organisation mondiale de la santé. Si la vaccination, exemple type de la prévention primaire, fait l’objet de protocoles précis, son historique, consigné sur des supports papier, est soumis à trop d’aléas, puisqu’il dépend de la vigilance des personnes, vigilance qui peut varier selon les milieux socioprofessionnels. Or les pharmaciens disposent tous de systèmes d’information qui permettraient ce suivi vaccinal. Par ailleurs, le contact avec des jeunes qui ne fréquentent qu’occasionnellement les cabinets médicaux constitue un atout des pharmacies d’officine qui autoriserait à en faire des relais privilégiés pour l’information sur la prévention des comportements alimentaires à risque et sur le sevrage tabagique.
La prévention secondaire, qui vise à réduire la gravité d’une maladie en la diagnostiquant le plus tôt possible, est assurée par le dépistage. En ce domaine, la pharmacie d’officine est sous-utilisée, même si de nombreuses initiatives sont mises en œuvre sur le terrain : dépistage du cancer colorectal, du diabète, de l’asthme ou de l’insuffisance rénale chronique – sur laquelle, comme le montre le document que je vous ai fait distribuer, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a commencé à travailler.
S’agissant de la prévention tertiaire, dont l’objet est d’empêcher la récidive de maladies, les pharmaciens peuvent intervenir en contribuant à l’éducation thérapeutique et à l’accompagnement des patients : les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires s’y prêtent parfaitement.
Je n’oublie cependant pas le problème des financements. Ceux-ci pourraient d’abord être pris en charge par l’assurance maladie – qui, au regard de la prévention, mériterait d’ailleurs d’être rebaptisée « assurance santé » – via un système de capitation, car une enveloppe fermée permet un meilleur pilotage budgétaire. Nous pourrions ainsi lancer de premières expérimentations, puis les évaluer.
Les régimes complémentaires pourraient également être appelés à contribuer, puisqu’ils sont tenus, pour bénéficier d’exonérations de charges sociales, de prendre en charge au minimum deux actes de prévention sur une liste fixée par arrêté ministériel. Cette liste pourrait être complétée par des actes réalisables dans les officines, qu’il s’agisse des tests de diabète, de cholestérol ou de PSA, de la prise de tension ou des mesures de capacité respiratoire.
M. le rapporteur. Comment les officines pourraient-elles réaliser des analyses de PSA ?
M. Claude Baroukh. Il existe des tests de PSA réalisables à domicile – 3 millions ont été commercialisés en Allemagne. Il est donc possible de les réaliser en officine.
M. le rapporteur. Le dépistage du taux de PSA est l’un de ceux qui posent le plus de problèmes, car on le réserve souvent aux hommes de plus de soixante-dix ans.
M. Claude Baroukh. La recommandation est pourtant de le faire à partir de cinquante ans.
M. Gilles Bonnefond. Les pharmaciens, je veux insister sur ce point, ne font pas de diagnostics. Les mesures ou les tests qu’ils effectuent leur permettent seulement de détecter une anomalie : il leur appartient de convaincre les personnes qui se croient en bonne santé, et qui présentent certains de ces signes, de consulter leur médecin pour que celui-ci établisse un diagnostic. Certains médecins confondent dépistage et diagnostic, qui sont pourtant deux actes distincts.
M. le rapporteur. Cette précision est en effet importante.
Les médecins n’ont pas toujours accès à certaines populations. À cet égard, madame Catherine Morel, comment travaillez-vous avec le secteur social, puisque vous avez mentionné ce point ?
Mme Catherine Morel. Nous travaillons par exemple avec l’Association pour le développement social urbain. Je vous ai apporté un document relatif à la campagne que nous avons menée au niveau local, en 2001-2002, sur la santé des jeunes de douze et treize ans : à partir de données fournies par des médecins psychiatres, nous avions pu constater que la souffrance, au sein de cette classe d’âge, était sous-estimée. Cette campagne associait pharmaciens, travailleurs sociaux et collectivités, dans le respect des compétences de chacun. Les travailleurs sociaux se sont aperçus que les pharmaciens étaient au contact des personnes qui vivent dans la plus grande précarité : celles-ci viennent chercher dans les officines, qui un pansement, qui une dose de sérum physiologique. Nous avons ainsi créé des réseaux informels, non pérennes – puisqu’ils ne disposent pas de financements –, destinés à traiter certaines difficultés. Si de telles expériences ne constituent pas forcément un modèle transposable partout, elles sont utiles au niveau local. « Petit budget, petit projet », dit souvent l’administration. Mais cette expression m’irrite car, comme j’ai pu le constater dans mon département du Pas-de-Calais, ces projets sont précisément ceux qui permettent à certaines populations abandonnées de vivre moins mal.
M. Claude Dreux, président du Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française. Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, que je préside depuis onze ans et dont Fabienne Blanchet est la directrice, a été créé il y a une cinquantaine d’années. Son objectif a toujours été de donner aux pharmaciens les moyens d’agir dans le domaine de la santé publique, à travers la prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique. 4 millions de personnes fréquentent quotidiennement les officines qui, partout sur le territoire, assurent un rôle de conseil auprès des patients préalablement à la consultation. Commission permanente de l’ordre des pharmaciens, qui le finance, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française s’appuie sur les grandes agences, telles que l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ou l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que sur de grandes associations, comme la Ligue nationale contre le cancer et la Fédération française de cardiologie. Par son indépendance – notamment à l’égard des industries de santé –, notre organisation s’est acquis une légitime réputation d’objectivité et de qualité. J’assume pour ma part mes fonctions de président de façon bénévole. Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française travaille en outre en symbiose avec l’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie, auxquelles j’appartiens.
Les pharmaciens sont très désireux de participer à la prévention ainsi qu’à l’éducation pour la santé et à l’éducation thérapeutique. Celle-ci suppose une action collective, comme l’illustre le titre d’un numéro récent du Journal de l’ordre des pharmaciens : « Coopération entre les professionnels de santé. Le patient, centre de la chaîne de soins ». Cette coopération associe non seulement les médecins et les pharmaciens, mais aussi les biologistes : n’oublions pas que 85 % des 4 000 laboratoires privés et 50 % des laboratoires en milieu hospitalier sont dirigés par des professionnels ayant une formation de pharmacien.
Ouvert il y a deux ans, notre site internet est régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité de la santé publique ; un certain nombre de médecins le consultent aussi. Les pharmaciens peuvent commander par ce biais les documents relatifs aux campagnes de prévention ; ils les reçoivent en vingt-quatre ou quarante-huit heures. À titre d’information, je vous transmettrai une copie de notre rapport d’activité de 2010.
Notre rôle est de donner aux pharmaciens les moyens d’informer le public sur les campagnes de prévention. Mme Agnès Buzyn, présidente de l’Institut national du cancer, a récemment déclaré que les pharmaciens jouaient un rôle essentiel pour faire passer les messages de prévention et que les campagnes de dépistage du cancer s’appuyaient sur eux. De fait, les pharmaciens d’officine connaissent souvent bien les familles, notamment en province : ils peuvent les informer, en particulier sur cet élément essentiel de la prévention qu’est la vaccination. Les campagnes parfois menées contre les vaccins sont très dommageables : médecins et pharmaciens doivent agir pour assurer une meilleure couverture vaccinale car notre pays est à la traîne en ce domaine ; aussi publions-nous tous les ans des informations issues du Bulletin épidémiologique.
Les pharmaciens peuvent agir dans plusieurs domaines où les interventions restent insuffisantes, comme les addictions et le tabagisme. Le tabac est, avec l’alcool, la drogue la plus nocive. Il est donc impératif de renforcer la lutte en ce domaine : c’est l’objectif de l’Alliance contre le tabac, dont le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française fait partie. Il est regrettable à cet égard que les pharmaciens ne puissent délivrer des substituts nicotiniques : pour se les faire rembourser, les patients doivent en effet s’en faire prescrire par les médecins sous forme de cure.
Les pharmaciens participent tous les ans aux campagnes de dépistage du cancer du sein et militent en faveur d’un dépistage plus systématique du cancer colorectal ; l’Académie nationale de médecine, par mon intermédiaire, a fait plusieurs recommandations à ce sujet. Il faut savoir que le test hémoccult donne 40 % de faux résultats positifs et 50 % de faux négatifs : ce n’est bien entendu pas satisfaisant pour un cancer qui tue plus de 20 000 personnes tous les ans, d’autant qu’il existe des méthodes immunologiques recommandées par la Haute Autorité de santé et par l’Institut du cancer, mais qui ne sont toujours pas appliquées en raison de l’opposition de certains groupes de pression. Par principe, les pharmaciens participent aux campagnes de dépistage de ce cancer, mais des progrès sont assurément nécessaires pour en améliorer la prévention, de même que celle des autres cancers. Des campagnes relatives à la vaccination contre le cancer du col de l’utérus ont ainsi été lancées ; mais, pour cette maladie, la vaccination ne suffit pas : il faut un suivi régulier.
Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française fait également diffuser dans les pharmacies – à raison de six par an, soit une tous les deux mois – des affiches comportant des messages de santé publique, sans aucun aspect commercial. Elles ont beaucoup de succès auprès des patients et les incitent à pousser la porte des officines pour se procurer les documents explicatifs correspondants.
Comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de juin 2011, les pharmaciens désirent s’engager dans la prévention : selon une enquête, 96 % d’entre eux souhaitent participer au dépistage du diabète, 97 % à celui de l’hypertension artérielle et 92 % au suivi vaccinal.
D’une façon générale, la France est la plus mauvaise élève en Europe pour la prévention, puisqu’elle n’y consacre que 5 % à 6 % du budget de la santé, contre 7 % à 10 % dans les autres pays. Les priorités variant d’une région à l’autre, nous souhaitons que chaque agence régionale de santé réserve à cette politique un budget spécifique et non fongible.
M. le rapporteur. L’éducation thérapeutique n’a été évoquée que partiellement ; j’aimerais, monsieur Xavier Desmas, avoir votre sentiment sur ce point. Qu’en est-il de la prévention des risques iatrogéniques, dans laquelle le pharmacien a un rôle à jouer, au moyen notamment du dossier pharmaceutique ? Enfin, la préparation des doses à administrer – la PDA – est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur : pourriez-vous en dire quelques mots ?
M. Xavier Desmas, membre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Je souscris à ce qui vient d’être dit sur le rôle des pharmaciens, mais je souhaite ajouter un mot sur la vaccination. Selon un rapport d’avril 2011 de la direction générale de la santé, « il n’est pas constaté de baisse récente générale des couvertures vaccinales dans le public. […] En revanche, il est toujours noté une insuffisance de couverture vaccinale qui s’accentue avec l’âge et reste plus marquée pour certains vaccins […] ».
Les pharmaciens ont, selon nous, un rôle primordial dans la sensibilisation du public aux bénéfices de la vaccination ; ils peuvent aussi contribuer à une meilleure connaissance du statut vaccinal et des recommandations du calendrier vaccinal en indiquant aux patients, le cas échéant, les différentes modalités de rattrapage. Un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales note d’ailleurs qu’ils pourraient organiser le suivi vaccinal ; à ce sujet, le Conseil de l’ordre étudie la possibilité d’étendre à la France une expérience réalisée en Suisse : il s’agirait de permettre aux patients qui possèdent un numéro d’inscription au répertoire de créer leur dossier sur un carnet de vaccination électronique, moyennant toutes les protections prévues par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce dossier serait alimenté par le patient lui-même, par le médecin et éventuellement par le pharmacien, même si, pour ce dernier, la difficulté est que la dispensation d’un vaccin ne prouve pas son injection.
Il existe par ailleurs des logiciels dont les algorithmes permettent le suivi vaccinal : il est tout à fait possible de les intégrer à nos propres logiciels d’aide à la dispensation.
Enfin, l’inclusion de la vaccination dans le dossier pharmaceutique, qui suppose quelques modifications législatives, permettrait de conserver une trace, sinon de l’injection, du moins de la délivrance des vaccins.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS accueille favorablement de telles préconisations. En attendant la mise en place du dossier médical personnel, qui se fait attendre, celui-ci pourrait présenter un réel intérêt, puisque le système est déjà efficient et, de surcroît, autofinancé.
M. le rapporteur. À ma connaissance, les données consignées dans le dossier pharmaceutique ne concernent que les quatre derniers mois. Or, la vaccination suppose un suivi tout au long de la vie.
M. Xavier Desmas. Oui, c’est pourquoi des modifications législatives seraient nécessaires.
M. le rapporteur. Si cette limitation à quatre mois paraît suffisante pour les médicaments, elle ne l’est pas, en effet, pour les vaccins. Quoi qu’il en soit, le dossier pharmaceutique n’est pas encore obligatoire ; il subsiste aussi le principe selon lequel c’est au médecin traitant de suivre son patient.
M. Gilles Bonnefond. Le dossier pharmaceutique existe, alors que le dossier médical personnel n’en est qu’à ses prémices. En tout état de cause, il serait un simple complément du dossier médical et permettrait d’enrichir le suivi vaccinal en alertant au besoin les patients.
En Rhône-Alpes et en Île-de-France, la rougeole se développe dans des proportions alarmantes. Or, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a refusé, même à titre expérimental, les initiatives prises par les agences régionales de santé en association avec les médecins et les pharmaciens, empêchant par là même une réelle dynamique de la prévention. Pourquoi ne pas déployer pour la rougeole les mêmes moyens que pour la grippe saisonnière et pour la grippe H1N1 ?
M. le rapporteur. L’ordre, qui a financé le dossier pharmaceutique, est-il prêt à financer le dossier électronique ?
M. Xavier Desmas. Oui, mais je rappelle que l’ordre n’est que le regroupement des pharmaciens.
M. Claude Baroukh. La ville de province où j’habite ne possédant pas d’université, les jeunes gens la quittent dès qu’ils ont obtenu le baccalauréat pour poursuivre leurs études. Il serait utile de pouvoir prolonger le suivi.
M. le coprésident Pierre Morange. Les initiatives que vous avez décrites se sont-elles accompagnées de démarches d’évaluation ?
M. Gilles Bonnefond. S’agissant du tabac, de la grippe, de la lutte contre le sida et de la prévention des interruptions volontaires de grossesse avec la dispensation de la pilule du lendemain, l’évaluation a été faite et le champ d’accès aux patients a été élargi. La capacité des pharmaciens à distribuer aux populations concernées les comprimés d’iode et à en expliquer l’utilisation a également été évaluée – de fait, le dernier incident à la centrale nucléaire à Marcoule a bien montré que le premier réflexe des populations était d’aller s’informer auprès des pharmaciens. Pour les autres initiatives, l’évaluation est difficile. Elle est en cours avec un assureur sur le risque cardiovasculaire, mais elle a été arrêtée pour la rougeole et pour le calendrier vaccinal. Notre rôle est de confronter les idées et d’apaiser le débat.
M. le coprésident Pierre Morange. Comment s’explique la situation de blocage que connaît la campagne vaccinale, notamment contre la rougeole ? Le défaut de couverture est lié à la composition de la population ou à une tradition privilégiant les thérapeutiques alternatives comme l’homéopathie, mais, au-delà des concepts philosophiques, le déficit de couverture vaccinale contre la rougeole se traduira inévitablement, dans quelques décennies, par une épidémie de la maladie de von Bogaert.
M. Gilles Bonnefond. Alors que l’agence régionale de santé avait réussi à mettre d’accord les médecins et les pharmaciens, le blocage tient à ce que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ne dispose pas des fichiers qui lui permettraient de connaître sur une durée suffisante l’historique de la vaccination de ses assurés – données que fournirait le dossier pharmaceutique. On nous a également opposé le fait que le vaccin a le statut de prescription médicale obligatoire et que le pharmacien n’est pas prescripteur. Ces arguments devraient être rapidement écartés face aux risques encourus.
M. Claude Dreux. Le service qui gère le dossier pharmaceutique, situé dans les mêmes locaux que le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française, a tout à fait les moyens d’assurer la surveillance des vaccinations au moyen d’un carnet de préférence électronique. L’efficacité du carnet de suivi des patients sous anticoagulants montre l’intérêt d’une telle opération. En effet, faute d’un suivi suffisant dans la prise des anticoagulants prescrits, le surdosage ou sous-dosage de ces médicaments – du reste difficile à détecter par le patient – est la pathologie qui entraîne le plus grand nombre d’hospitalisations, voire de décès. Nous avons donc instauré, avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un carnet de suivi des anti-vitamines K, partagé entre le médecin, le pharmacien et le biologiste, et dont 800 000 exemplaires ont été distribués. Cette procédure entre dans le cadre de l’éducation thérapeutique au titre de la prise en charge du patient. Hier, lors d’une conférence sur les nouveaux anticoagulants, les médecins nous ont indiqué que la pathologie liée à la surdose d’anticoagulants avait beaucoup régressé.
Le dossier pharmaceutique couvre maintenant 90 % des officines et 18 millions de personnes. Un carnet de vaccination pourrait être mis en place en utilisant les mêmes méthodes – à condition que les données soient stockées à vie, et même jusque trois années après la dernière intervention.
On reproche parfois au dépistage du cancer de la prostate d’entraîner un « surdiagnostic », qui pousse à opérer des patients dont on ignore si leur cancer va devenir très actif et produire des métastases. Or, le dépistage précoce permet de traiter ce cancer par des méthodes peu invasives – ultrasons ou curiethérapie – qui, sans ablation, évitent aux patients des métastases osseuses très douloureuses. Comme pour les accidents de la route, l’évaluation de l’efficacité vaccinale ou du dépistage des cancers ne tient compte que de la mortalité. Il arrive ainsi que l’on renonce à effectuer ce dépistage chez les septuagénaires au prétexte qu’ils ont toutes chances de mourir d’autre chose, mais sans tenir compte des dix ou vingt années qu’ils passeront peut-être à souffrir de douleurs osseuses. Dans un livre que nous venons de finir de rédiger, avec le professeur Jean-François Mattei et d’autres membres des académies de médecine ou de pharmacie, nous insistons beaucoup sur la notion d’humanisme. Ainsi, dans un chapitre intitulé « La vaccination, un geste citoyen et humaniste », le professeur Pierre Bégué pose la question de savoir que faire devant la progression des refus vaccinaux. De fait, le vaccin est une protection à la fois pour le patient et pour les autres.
M. le rapporteur. Les pharmaciens ont le devoir de conserver très longtemps les ordonnanciers – quasiment à vie. La forme en est-elle manuscrite, ou informatisée ?
Mme Catherine Morel. Nous utilisons les deux supports.
M. le rapporteur. Le dossier pharmaceutique pose peut-être un problème vis-à-vis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mais il permet de retrouver les vaccinations reçues par le patient.
La maîtrise des risques iatrogéniques fait également partie de la prévention. Dans la pratique, une pharmacie peut-elle refuser de délivrer un médicament si elle constate en consultant le dossier du patient que le médicament a déjà été délivré ailleurs ?
Mme Catherine Morel. Ce n’est pas une possibilité, mais un devoir !
Les nouvelles missions assumées par les officines entraînent de nouvelles façons de travailler. Cette profession dont les interventions passaient jusqu’à présent, pour l’essentiel, par la communication orale, doit désormais se plier à des démarches de qualité, à des procédures garantissant la traçabilité des actes et la conservation des données. Ainsi, en cas de refus, le pharmacien photocopie l’ordonnance, inscrit le refus de délivrance et archive le tout, qui devient opposable. Il s’agit là d’un bouleversement de l’activité pharmaceutique. Les pharmaciens devront s’initier à ces nouvelles méthodes de travail, ce qui commence dès la faculté. Au Canada et en Suisse, l’abord du patient est très différent.
Quant aux campagnes de dépistage du cancer, leurs résultats insuffisants tiennent au dénigrement dont elles font l’objet, en grande partie de la part des professionnels de santé. Pour les mêmes raisons, le taux de vaccination antigrippale ne retrouvera certainement pas le niveau atteint avant l’épisode de la grippe H1N1.
En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, la participation n’est aujourd’hui que de 50 %, faute peut-être d’y avoir associé les pharmaciens, mais sans doute aussi parce que les patients sont en général les grands absents de la prévention : ils sont les financeurs et les consommateurs du système, mais on ne leur demande jamais leur avis – même pour une expérimentation – et on les traite en sujets passifs. Il est probable que, si on les consultait, les femmes de cinquante à soixante-quinze ans feraient savoir que l’envoi d’un imprimé ne suffit pas à les inciter à se soumettre à une mammographie.
M. Claude Baroukh. Monsieur le rapporteur, on ne peut évoquer l’iatrogénie, notamment les anti-vitamines K, sans évoquer aussi la nécessité d’un décloisonnement des structures. La transversalité, à laquelle je sais que vous êtes attaché, est plus que souhaitable ! Ainsi, les anti-vitamines K, même sous leur dernière forme, sont des médicaments non substituables et qui ne souffrent pas d’interruption du traitement. Or, si le service hospitalier n’appelle pas la pharmacie du patient quand celui-ci sort de l’hôpital, une interruption de traitement est possible car ces produits ne sont pas courants et les protocoles peuvent varier d’un centre hospitalier à l’autre, de sorte que le dépannage auprès d’autres officines peut se révéler difficile. Une préconisation importante consisterait donc à faire figurer dans le dossier d’admission à l’hôpital, au même titre que le nom du médecin traitant, celui du pharmacien habituel du patient.
Quant à la préparation des doses à administrer, il se trouve que je suis en charge de ce dossier pour la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Deux réunions ministérielles ont eu lieu à ce propos au ministère et une enquête de l’Inspection générale des affaires sociales a été diligentée, menée par M. Michel Thierry. Cette dernière décision m’étonne dans la mesure où l’Inspection générale des affaires sociales a déjà conduit une première enquête, confiée à M. Pierre Naves et à Mme Muriel Dahan, qui, en dehors de quelques aspects positifs, portait une appréciation critique sur l’intégration des médicaments dans les forfaits de soins des maisons de retraite. Sur les 270 expérimentateurs – dont il ne reste plus que 250 –, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a constaté un dépassement de 15 % des budgets prévisionnels. Cette forfaitisation n’ayant pas produit les résultats escomptés par le législateur, une nouvelle expérimentation est donc lancée, mais à quoi servira-t-elle si l’on ne tire pas les conséquences de la première ?
Mme Catherine Morel. Un groupe de travail, que nous avons constitué avec la Société française de pharmacie clinique, a formulé une recommandation qui va dans le sens de celle que vient de faire M. Claude Baroukh. De fait, des liaisons s’ébauchent avec nos confrères pharmaciens hospitaliers et, malgré les problèmes de logistique et d’informatique auxquels nous nous heurtons, nous souhaiterions que des systèmes sécurisés permettent au pharmacien hospitalier d’alerter le pharmacien d’officine au retour du patient. De leur côté, les médecins urgentistes nous disent eux aussi qu’ils aimeraient disposer des coordonnées du pharmacien lors de l’interrogatoire du patient, car il est fréquent que celui-ci ne sache même pas quels médicaments il prend.
M. Xavier Desmas. Nous sommes heureux que le projet de loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé prévoit d’autoriser des expérimentations dans le cadre desquelles les médecins hospitaliers pourront récupérer les données du dossier pharmaceutique des patients.
Pour en revenir à la préparation des doses à administrer, celle-ci fait partie intégrante de l’acte de dispensation aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique. Elle doit bénéficier de la sécurité du circuit pharmaceutique. Nous sommes dans l’attente d’un décret et d’un arrêté sur le sujet.
M. le rapporteur. Ils sont imminents depuis deux ans et demi !
M. Xavier Desmas. On nous les a promis pour la fin de l’année, pour consultation du moins. Le 12 décembre, le Conseil national de l’ordre débattra précisément d’une résolution relative à la préparation des doses à administrer, demandant la parution de ce décret et de cet arrêté de bonnes pratiques. Nous savons que la préparation des doses à administrer est majoritairement destinée aux résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et réalisée par quelques « faiseurs », dans des conditions dont nous ignorons la qualité. Nous souhaiterions que, le cas échéant, puisse être proposée la sous-traitance dans un cadre pharmaceutique.
M. le rapporteur. Il me semblait que, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes comme pour les soins à domicile des personnes âgées, la préparation des doses à administrer, bien faite et bien contrôlée, représentait un progrès en termes de qualité par rapport aux semainiers.
M. Claude Baroukh. Il s’agit d’un acte d’accompagnement de la dispensation indispensable pour les personnes dépendantes et polymédiquées qui ne sont pas en état de gérer elles-mêmes leur traitement. Cela concerne près de 2,4 millions de personnes, notamment celles qui résident en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je rappelle à ce propos que le « h » d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes signifie « hébergement », et non pas « hospitalisation » : certains niveaux d’intervention en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont pas normaux. Mais les personnes qui ont le plus besoin de cet accompagnement sont celles que l’on est contraint de maintenir à domicile, du fait du manque de places en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et du coût du séjour dans ces établissements – 2 500 euros par mois au minimum alors que la retraite moyenne est de l’ordre de 1 000 euros !
La situation peut être éclaircie si l’on répond à trois questions : combien, comment et qui ? Pour la première de ces questions, l’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui autorise une rémunération du pharmacien déconnectée de la marge, peut permettre des progrès dans le cadre de discussions conventionnelles. Au « comment ? » pourraient répondre les arrêtés de bonnes pratiques et le décret relatif à la préparation des doses à administrer. Quant à la question « qui ? », on peut y répondre en levant le tabou qui pèse sur la sous-traitance, à condition de veiller à une étanchéité totale entre le sous-traitant et le patient, grâce au filtre du pharmacien dispensateur.
M. le rapporteur. Je ne comprends pas pourquoi le décret, qui semblait faire consensus, est bloqué depuis près de deux ans. Lorsque j’interviens auprès du cabinet du ministre, on me répond toujours que sa publication est imminente.
M. Claude Baroukh. Nous ne souhaitions pas que ce décret sorte avant qu’il soit possible de rémunérer cet acte très chronophage, puisqu’il demande au moins dix minutes par patient et par semaine.
M. le rapporteur. C’est donc vous qui freiniez le processus !
M. Claude Baroukh. Je n’ai pas cette prétention, mais nous avons en effet contribué au retard.
M. Claude Dreux. Au Québec, bien qu’on les trouve dans les supermarchés, les pharmacies sont de vraies officines, tenues par de vrais pharmaciens, beaucoup plus nombreux qu’en France – et il en est de même dans les hôpitaux où l’on en compte souvent une trentaine, à la grande satisfaction des médecins car ceux-ci sont aussi mal formés que leurs confrères français en matière de médicaments. Dans ces pharmacies, on dispense différents actes de santé publique, dont des « consultations pharmaceutiques » qui, même si le terme est mal choisi car de nature à heurter les médecins, sont des consultations de prévention visant à développer au sein de la population une véritable culture en la matière, comme le précise un accord récemment conclu avec les médecins.
Pour que les pharmaciens s’engagent pleinement dans de telles initiatives, qui prennent du temps et exigent une formation, il faut prévoir une rémunération. Cette pratique permettra aux pharmaciens de jouer pleinement leur rôle de prévention, ce qui est d’autant plus souhaitable que les consultations de prévention confiées aux médecins n’ont eu aucun succès. C’est une question de bon sens.
M. le rapporteur. Madame, messieurs, je vous remercie.
*
AUDITIONS DU 8 DÉCEMBRE 2011
Audition de M. René-Paul Savary, vice-président de l’Assemblée des départements de France, sénateur et président du conseil général de la Marne, accompagné de Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire, et de Mme Isabelle Maincion, représentant l’Association des maires de France, maire de La Ville-aux-Clercs, accompagnée de Mme Marie-Claude Serres-Combourieu, responsable de l’action sociale, éducative, culturelle et sportive.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans sa communication sur la prévention sanitaire, la Cour des comptes a relevé un défaut d’organisation, lié à la multiplicité des intervenants. Nous souhaiterions connaître les observations des représentants de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des maires de France à ce sujet.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Nous avons déjà auditionné des médecins, des pharmaciens, des représentants du ministère de la santé, de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et des assurances complémentaires mais, en matière d’éducation et de prévention sanitaires, les départements jouent également un rôle important. Pourriez-vous le rappeler, monsieur René-Paul Savary ?
M. René-Paul Savary, vice-président de l’Assemblée des départements de France, sénateur et président du conseil général de la Marne. Le département ne joue certainement pas un rôle de premier plan et, de surcroît, tous les départements ne sont pas de la même manière impliqués dans ces actions, car la répartition des compétences est variable de l’un à l’autre. Le champ d’intervention le plus fréquent est la vaccination, qui relève de la protection maternelle et infantile. La vaccination se situe à la jonction du médico-social et du sanitaire, domaine dans lequel les conseils généraux ne souhaitent pas s’impliquer, compte tenu des conséquences financières que cela ne manquerait pas d’occasionner. Cela étant, la moitié des départements ont choisi de conserver cette compétence, qui est exercée d’une manière relativement correcte, même si les vaccinations sont effectuées à 80 % par les médecins libéraux. Les enfants bénéficient d’un suivi régulier dans le cadre de la protection maternelle et infantile jusqu’à l’âge de six ans, les médecins généralistes prenant ensuite le relais – à un moment, d’ailleurs, où les maladies se font moins fréquentes.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’en est-il de l’articulation entre les services de la protection maternelle et infantile et ceux de la médecine scolaire ?
M. René-Paul Savary. Elle aussi varie d’un département à l’autre. Même si la médecine scolaire n’est pas de notre compétence, nous menons des actions en ce domaine via la protection maternelle et infantile et, à ce propos, il ne serait pas inutile de clarifier la répartition des tâches entre les deux auteurs concernés. Le bureau de l’Assemblée des départements de France s’est même demandé un moment si les conseils généraux ne devraient pas assumer la compétence de la médecine scolaire, car, s’il est clair que nous ne sommes pas en état d’en assumer le financement, il ne serait pas illogique que nous continuions à suivre les enfants une fois qu’ils sont scolarisés.
Mme Marylène Jouvien, attachée parlementaire de l’Assemblée des départements de France. Lors de l’acte II de la décentralisation, nous avions suggéré un amendement visant à organiser ce transfert, mais nous nous sommes heurtés aux réticences des médecins scolaires qui ne souhaitaient pas relever des départements.
M. le coprésident Pierre Morange. Un tel refus est tout à fait compréhensible mais, avant même de réfléchir à un éventuel transfert, il faudrait se préoccuper d’améliorer une coordination qui apparaît défaillante dans un certain nombre de départements. Par ailleurs, le niveau des prestations de protection maternelle et infantile est variable, ce qui est choquant au regard du principe d’égalité.
M. René-Paul Savary. C’est un effet de la décentralisation : à l’intérieur d’un cadre fixé nationalement, les départements s’organisent comme ils le souhaitent pour exercer les compétences qui leur sont dévolues. S’agissant de la protection maternelle et infantile, les situations sont en effet très diverses, notamment selon la taille des départements. Les plus petits – ceux de moins de 300 000 habitants – comme les plus gros – au-dessus de 1 million d’habitants – ont des difficultés à obtenir des résultats satisfaisants, les premiers parce que la modestie de leurs moyens et la dispersion d’une population majoritairement rurale ne permettent pas une politique efficace, les seconds parce qu’ils sont confrontés à de fortes concentrations de populations, dont une partie en situation précaire. Seuls les départements de taille moyenne – entre 500 000 et 800 000 habitants – peuvent conduire une action bien ciblée grâce à une connaissance relativement bonne des populations.
M. le rapporteur. Comment fonctionne la protection maternelle et infantile, à qui s’adresse-t-elle et quelle proportion d’enfants suit-elle ?
M. René-Paul Savary. J’ai demandé une note à mes services sur le sujet, mais je ne suis pas sûr que nous puissions disposer de données précises pour l’ensemble des départements.
M. le coprésident Pierre Morange. Il serait pourtant opportun de disposer d’un état des lieux relativement exhaustif.
M. le rapporteur. J’espère que nous pourrons recevoir d’utiles précisions avant de publier notre rapport mais, globalement, comment les enfants sont-ils suivis après leur naissance et qui a recours à la protection maternelle et infantile ?
Mme Marylène Jouvien. À ce jour, le service social de l’Assemblée des départements de France n’a pas réalisé une enquête aussi précise, mais je me propose de relayer votre demande.
M. René-Paul Savary. La protection maternelle et infantile de la Marne, en 2010, comptait 13 médecins et 46 infirmières puéricultrices. Nous avons dénombré 6 500 déclarations de grossesse, 2 500 visites pré- et post-natales effectuées par les sages-femmes, 7 300 avis de naissance et 1 400 consultations « jeunes enfants » organisées dans 44 lieux différents. Ouvertes à tous les publics, celles-ci s’adressent toutefois en premier lieu aux populations vulnérables et défavorisées, même si l’on constate que de plus en plus de jeunes familles ne relevant pas forcément de ces catégories consultent les services de protection maternelle et infantile.
M. le rapporteur. Cela s’explique-t-il par un manque de pédiatres ?
M. René-Paul Savary. Non. Elles éprouvent le besoin de conseils, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ma propre fille, qui a accouché de ses deux enfants à Lyon, s’est ainsi régulièrement rendue aux consultations de la protection maternelle et infantile, comme d’autres parmi ses relations, alors qu’elle ne vient pas d’une famille défavorisée.
M. le rapporteur. Ces services ont-ils connaissance de toutes les naissances ? Une convocation est-elle adressée à tous les nouveaux parents ?
M. René-Paul Savary. Je ne sais pas ce qu’il en est d’éventuelles convocations mais les parents reçoivent en effet les bulletins relatifs aux visites obligatoires et les services connaissent de ce fait le nombre exact de naissances.
M. le coprésident Pierre Morange. Les auditions que nous avons réalisées montrent que la médecine scolaire et l’éducation sanitaire ont un rôle essentiel à jouer depuis les premières années de la vie jusqu’au cours moyen deuxième année (CM2). Le nombre de visites de contrôle de la protection maternelle et infantile afin de dépister les troubles praxiques, sensoriels ou d’acquisition diffère-t-il ou non d’un département à l’autre ?
M. René-Paul Savary. Probablement. Le suivi est surtout intense entre zéro et neuf mois, le nombre des consultations décroissant ensuite jusqu’au vingt-quatrième mois. C’est donc durant cette période que l’on peut procéder aux dépistages. Mais, dès le premier mois de grossesse, le médecin de famille peut prescrire une consultation de protection maternelle et infantile, auquel cas les médecins de ce service en sont avertis et peuvent prendre contact avec la future mère.
Les familles défavorisées fréquentent volontiers ces consultations et y sont de toute façon incitées par les travailleurs sociaux.
S’agissant précisément des dépistages que vous avez mentionnés, je n’ai pas de statistiques globales mais on pourrait envisager une enquête, même si l’on en demande déjà beaucoup aux départements.
M. le rapporteur. Comment les vaccinations sont-elles organisées ? À ma connaissance, les départements peuvent prendre en charge les vaccinations contre les maladies tropicales et les vaccinations contre les maladies de l’enfant et, dans ce dernier cas, ils peuvent soit confier la tâche à leurs services, soit fournir le vaccin aux médecins libéraux qui procéderont ensuite aux injections.
M. René-Paul Savary. Les départements ne sont pas tous impliqués dans la vaccination contre les maladies infectieuses ; ainsi, dans la Marne, nous préférons nous en remettre à un excellent centre qui existe au centre hospitalier universitaire de Reims. Les pratiques diffèrent : certains viennent avec leur vaccin, ou bien le produit peut être commandé, puis remboursé par la sécurité sociale. Les tarifications peuvent alors être différentes d’un département à l’autre.
M. le rapporteur. Êtes-vous satisfaits d’une participation de 50 % des femmes concernées au dépistage du cancer du sein – action menée le plus souvent par des associations départementales – et, si tel n’est pas le cas, comment améliorer ce taux ?
M. René-Paul Savary. Les départements, en effet, sont en principe impliqués dans ce type d’associations et nous ne saurions bien évidemment nous satisfaire du taux de participation actuel. Cela étant, si nous ne pouvons nous désintéresser de la question, elle relève avant tout la sécurité sociale qui en retirera tout le bénéfice économique et qui doit donc en assumer la responsabilité financière. Le département de la Marne a été pionnier pour le dépistage du cancer du sein mais, dès que le dispositif a bien fonctionné, nous nous en sommes retirés : nous n’avons pas les moyens de financer de telles actions, qui relèvent au surplus du domaine sanitaire pour lequel nous n’avons pas compétence.
Les conseils généraux peuvent en revanche – et ils y ont même tout intérêt – conduire des actions de prévention en faveur des publics relevant de leur champ de compétence : les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées. Nous nous préoccupons ainsi de prévenir les accidents domestiques, qui peuvent avoir des répercussions médico-sociales ; chez les personnes âgées, ils conduisent souvent à la dépendance, et donc à une prise en charge par le département.
Même si le conseil général de la Marne a arrêté les actions de prévention du cancer du sein ou du colon, nos services n’en sont pas moins attentifs à ce que les personnes défavorisées soient contactées dans le cadre des actions que nous menons dans le domaine social. Un dépistage leur est alors proposé dès lors qu’elles correspondent aux critères établis. Nous contribuons donc à augmenter le taux de dépistage parmi le public qui nous est connu.
Cela dit, je le répète, la situation varie d’un département à l’autre.
M. le rapporteur. En effet, puisque certains subventionnent de nombreuses associations de dépistage ou de prévention de l’alcoolisme ou du tabagisme, notamment dans le cadre des comités départementaux d’éducation pour la santé…
M. René-Paul Savary. Il est très difficile d’avoir une idée exacte des actions menées dans les départements, mais il est certain que nombre d’entre eux se préoccupent, par exemple, de la prévention des grossesses ou de la lutte contre le tabagisme, en particulier dans les collèges dont ils ont la responsabilité. Comme ces actions relèvent de l’initiative de chaque département et présentent des formes diverses selon les territoires visés, que ce soit des grandes villes ou des espaces ruraux, une analyse globale est à peu près impossible : on en restera forcément au stade de l’énumération. Quant à en évaluer le coût…
Les départements ont eu la liberté de mener des actions dépassant le cadre strict de leurs compétences officielles, mais ils n’en possèdent plus aujourd’hui les moyens financiers, ceux-ci étant absorbés par le versement des prestations de solidarité. Même si au sein des départements le projet politique domine largement sur les préoccupations purement comptables, ils devront opérer des choix douloureux et ces actions de prévention en quelque sorte « facultatives », dont ils ne tireront pas le bénéfice, seront les premières à en pâtir. C’est pourquoi j’insiste pour qu’on s’attache à déterminer plus clairement les responsabilités de chacun dans la prise en charge de la prévention.
M. le rapporteur. À défaut de pouvoir nous informer sur les actions des autres départements, pouvez-vous préciser quelles actions vous menez pour prévenir les accidents des enfants et des personnes âgées ou handicapées ?
M. René-Paul Savary. Il s’agit de la prévention des accidents de la vie quotidienne et, notamment, des chutes. Il est parfois difficile de faire comprendre aux personnes âgées qu’elles ont intérêt à enlever les tapis pour ne pas trébucher ou à faire de la place dans une pièce encombrée pour pouvoir y circuler facilement avec leur déambulateur. Ce genre de prévention, qui relève vraiment de la responsabilité des conseils généraux, permet de les maintenir à domicile – et donc d’économiser sur les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie. Dans le même esprit, je m’efforce de développer la télésurveillance. La sécurité sociale, quant à elle, devra s’intéresser à la télémédecine pour rationaliser certains dispositifs, ce qui allégera d’autant la charge des organismes d’assurance maladie.
Ce qui me guide en l’occurrence, ce n’est pas un souci sanitaire, mais celui de prévenir la dépendance. L’agence régionale de santé peut avoir là un rôle de supervision, étant entendu que chacun doit, dans le cadre de loi actuelle, rester dans le champ de ses compétences – mais c’est peut-être là que réside la difficulté, la frontière entre le sanitaire et le médico-social n’étant pas clairement tracée.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous évalué ces actions de prévention des accidents ?
M. René-Paul Savary. Pas suffisamment. D’une manière générale d’ailleurs, les collectivités manquent d’une culture de l’évaluation – et, de surcroît, les actions menées, je le répète, sont très différentes d’un territoire à l’autre. Quoi qu’il en soit, il conviendra de renforcer cette évaluation après avoir déterminé les compétences de chacun. Nous aurions tout intérêt à nous doter à cet effet d’une grille, qui pourrait être appliquée aux actions comparables.
M. le coprésident Pierre Morange. S’il est difficile de distinguer entre le sanitaire et le médico-social, je note aussi que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires vise à améliorer l’articulation entre les deux domaines, grâce à une coordination au niveau régional qui serait garante de politiques plus rationnelles, et la prévention pourrait être emblématique de cette nouvelle logique. Comment cette évolution est-elle perçue dans votre département et au sein de l’Assemblée des départements de France ?
M. René-Paul Savary. Je ne peux m’exprimer sur le sujet au nom de l’Assemblée des départements de France, au sein de laquelle je m’occupe principalement d’insertion.
Au niveau départemental, je ne suis pas certain que la situation ait été simplifiée : l’agence régionale de santé est en effet formée par l’association d’organismes qui préexistaient tandis que les départements – dont les compétences sont bien affirmées dans le domaine médico-social – disposaient déjà de schémas de prévention dédiés par exemple aux personnes âgées ou handicapées. Cette superposition est un facteur de complexité.
De plus, si là encore les situations diffèrent d’un département à l’autre, nombre de conseils généraux déplorent les actions de leur directeur d’agence régionale de santé. Dans la Marne, les relations sont satisfaisantes mais nous devons lui rappeler fermement nos compétences : la montée en puissance des agences régionales de santé, je le répète, amène ces dernières à travailler sur des schémas concurrents des nôtres, ce qui entraîne des actions redondantes – je songe en particulier, dans le domaine médico-social, à l’implantation des structures d’hébergement ou aux nouveaux services rendus aux personnes. En revanche, la légitimité de ces agences est incontestable s’agissant de la coordination des actions de prévention et la nécessité de leur donner des moyens à cette fin est unanimement reconnue. Néanmoins, les agences régionales de santé ont été créées récemment et il reste encore à chacun de trouver ses marques.
M. le rapporteur. Cela ne relève pas à proprement parler du domaine de la prévention mais il est vrai que les agences régionales de santé se sont dotées de responsables du secteur médico-social et disposent, dans les départements, de personnels pour assurer les liens entre les différents acteurs.
Les départements étant responsables de la gestion des collèges, que proposent-ils afin de prévenir l’obésité ? Ont-ils, à l’instar de certaines municipalités, signé des accords avec des associations en vue de promouvoir une alimentation équilibrée ?
M. René-Paul Savary. Aucune enquête, là encore, n’a été réalisée, mais des actions spécifiques sont menées car les présidents de conseils généraux sont très sensibles aux questions de nutrition. Cependant, si nous pouvons inciter les collèges, par exemple, à recourir aux productions locales pour leurs cantines, nous leur demandons également de passer des appels d’offres afin de réduire le coût des repas, ce qui se traduit par une moindre qualité diététique…
Dans la Marne, nous menons avec les associations de lutte contre l’obésité des actions en quelque sorte « facultatives », qui risquent d’être abandonnées en raison des restrictions budgétaires mais qui sont efficaces parce que nous ciblons un public précis - 22 000 collégiens –, à la différence des bilans de santé pour lesquels les caisses primaires d’assurance maladie ont dépensé argent et énergie en vain.
M. le coprésident Pierre Morange. Madame Isabelle Maincion, quelle est l’implication des maires dans les actions de prévention – en particulier dans l’enseignement primaire, qui relève de leur responsabilité ?
Mme Isabelle Maincion, maire de La Ville-aux-Clercs, représentant l’Association des maires de France. Maire d’une commune de 1 340 habitants, je suis depuis déjà quelques années membre du comité de pilotage du programme national Nutrition santé pour l’Association des maires de France, et je préside le Pays vendômois qui regroupe 105 communes pour lesquelles nous essayons d’élaborer un contrat local de santé, afin d’aider l’agence régionale de santé à coordonner les actions de prévention mais, également, à favoriser l’accès aux soins.
Il y a autant de façons d’aborder la question de la prévention qu’il existe de communes en France ! Certaines municipalités importantes comme Besançon, Rennes ou Marseille se sont engagées depuis longtemps sur ce terrain et l’Association des maires de France a commencé en 2004 à réfléchir aux actions à mener dans ce domaine. Il reste que les différences demeurent importantes entre les « villes Santé » de l’Organisation mondiale de la santé et les petites communes qui essaient de faire selon leurs moyens. J’ajoute que de tels projets dépendent également de la motivation des élus.
Il reste que des actions intéressantes ont ainsi été conduites, en particulier par plusieurs communes du nord de la France dans le cadre du programme « Ensemble prévenons l’obésité des enfants ». À ce propos, il est compréhensible que nombre d’entre elles aient été choquées qu’on les accuse de « faire grossir » les enfants quand tant de maires – j’en suis – s’emploient à améliorer la restauration scolaire.
Pourquoi les enfants sont-ils en surpoids ? L’alimentation n’est pas seule en cause : il faut également incriminer le manque d’exercice, aggravé par la prolifération des écrans. Mais le goût de la facilité, qui mène à une « américanisation » des comportements, induit aussi un abus de boissons sucrées ou de plats préparés. D’autre part, un enfant qui ne mange pas correctement à la cantine ou chez lui est porté à grignoter toute la journée.
Les communes ont toute latitude pour adapter les menus des cantines aux besoins des enfants et à ce qu’ils peuvent accepter, mais – et c’est tout l’enjeu du programme national d’alimentation – elles doivent aussi former leur goût, leur apprendre à manger ! Un autre travail consiste à former les personnels de cantine. L’Association des maires de France a, quant à elle, pour mission d’encourager les bonnes pratiques et d’empêcher que des maires ne reculent devant cette mission supplémentaire. Nous sommes à peu près tous réticents à l’accumulation des réglementations contraignantes, incompréhensibles, inapplicables et donc mal appliquées : d’ailleurs, il a fallu trois ans pour que celle qui régit la restauration scolaire devienne à peu près intelligible pour tous !
Il est évidemment plus facile de proposer des repas variés quand on sert 3 000 ou 4 000 repas par jour qu’une centaine. Quoi qu’il en soit, le chantier est ouvert mais je ne sais pas ce qu’il en adviendra : son sort dépendra des intérêts et des moyens de chacun.
Il revient également aux communes d’organiser et de coordonner les associations sportives pour favoriser l’accès au sport du plus grand nombre.
La conclusion avec les agences régionales de santé de contrats locaux de santé, quant à elle, est plus facile dans les grandes agglomérations qui disposent d’un atelier Santé Ville, comme à Marseille, première ville à s’en être dotée. Dès 2003, j’ai participé pour la région Centre aux réflexions menées dans le cadre du schéma régional d’organisation sanitaire. II devait définir un territoire de santé pertinent, car il importe de travailler à une échelle inférieure à celle du département. Mais nous n’avons pas réussi, et nous en sommes donc restés à l’échelon départemental, avec toutes les incohérences que cela implique quand on défend une vision régionale de l’organisation des soins et de la prévention.
En la matière, comme l’Association des communautés de communes de France s’en est d’ailleurs rendu compte, les situations diffèrent d’une région à l’autre. La région Bretagne, par exemple, semble très en avance, alors que, dans la région Centre, seuls six ateliers Santé Ville et deux pays disposeront d’un contrat local de santé en 2012.
Cette coordination est pourtant d’autant plus nécessaire que les communes, les départements et les régions méconnaissent les différents intervenants : nous ignorons les compétences de chacun. En tant que membre du groupement régional de santé publique, je me faisais parfois remplacer aux réunions du comité technique par l’un de mes collègues, par ailleurs pharmacien : quelle n’a pas été sa surprise de découvrir qu’une association de sa commune – de 2 000 habitants – avait déposé une demande de subvention pour une action de prévention ! Il ignorait son existence… Le domaine de la santé est organisé en tuyaux d’orgue depuis longtemps, d’où une situation complexe pour les collectivités qui tentent de travailler de façon transversale. Avec des moyens financiers limités, nous essayons quant à nous de nous organiser, dans notre pays du Loir-et-Cher, avec l’observatoire régional de santé et avec un observatoire des territoires unique en France.
M. le rapporteur. Comment ces deux observatoires travaillent-ils ensemble ?
Mme Isabelle Maincion. Notre pays a été l’un des premiers territoires à bénéficier d’un diagnostic territorial de santé, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant envisagé d’en faire une zone un peu expérimentale en raison des graves problèmes d’accès aux soins qu’y a entraînés la chute de la démographie médicale. Nous nous sommes très rapidement aperçus que l’échelle – 105 communes, 70 000 habitants – était trop petite pour mener à bien ce diagnostic quantitatif sur certaines pathologies et qu’un diagnostic qualitatif était nécessaire. L’observatoire régional de santé n’ayant pas pu nous l’offrir, nous nous sommes tournés vers l’observatoire des territoires, dont la mission est à la fois économique et sociale – en ce moment, nous essayons d’ailleurs de constituer une base de données de développement durable. Cela étant, on m’a assuré la semaine dernière que l’observatoire régional de santé proposait maintenant ce type de diagnostic, mais ces observatoires sont de petites structures…
M. le rapporteur. Celui des Pays de la Loire donne toute satisfaction.
Mme Isabelle Maincion. La directrice de l’observatoire régional de santé de la région Centre est également très compétente !
M. le rapporteur. Comment les contrats locaux de santé sont-ils élaborés ? Quelle est la part respective de l’initiative locale et de l’initiative régionale ? Sur quels thèmes portent-ils et à combien s’élève la participation financière de la collectivité ?
Mme Isabelle Maincion. Nous avons souhaité signer un contrat local de santé dès que ce dispositif a été institué mais nous avons dû attendre, ses promoteurs n’étant pas convaincus de la pertinence de l’outil pour un territoire de 70°000 habitants – bien que cela représente tout de même le tiers du département.
L’accès aux soins constitue un enjeu primordial pour tous les territoires et, en milieu rural, le problème se pose dans les mêmes termes qu’à la périphérie des grandes agglomérations ; c’est d’ailleurs moins un problème de démographie médicale que de répartition des médecins sur le territoire. Quoi qu’il en soit, lorsque les médecins font défaut, la population est désespérée, je peux en témoigner, et à ce désespoir succède celui des maires. Avec les élus les plus sensibilisés à cette question, nous avons donc souhaité rencontrer les professionnels afin d’élaborer la demande de diagnostic et de préparer des solutions, les sujets les plus préoccupants étant les addictions et la santé mentale ; en dix ans de mandat, en effet, j’avoue que les internements d’office ont été pour moi le fardeau le plus lourd à porter. Nous avons alors eu, médecins compris, la bonne surprise de constater que les acteurs de terrain étaient nombreux et souvent de qualité.
Aujourd’hui, nous élaborons un plan de financement avec l’ensemble des communes du pays et avec la contribution des fonds européens puisque nous avons la chance de bénéficier d’un programme LEADER. Nous réalisons également un annuaire, qui sera régulièrement actualisé, dans lequel chacun trouvera l’information nécessaire. Nous pourvoyons donc à la coordination qui faisait défaut…
M. le rapporteur. Fort bien mais, en pratique, quelles mesures de prévention avez-vous prises contre les addictions ?
Mme Isabelle Maincion. Cela dépend des communes.
Comme nous n’avions pas le personnel compétent, nous avons demandé à la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé de nous aider à rédiger le contrat local de santé et, dans la mesure où elle a précisément pour vocation de fédérer les associations de prévention, de diriger les comités de pilotage.
Le repérage des situations d’addiction incombe à tous les partenaires de santé, notamment aux médecins. La médecine du travail joue, en la matière, un rôle irremplaçable au sein de l’entreprise.
Notre champ de compétence couvre notamment la détection de ces addictions d’un type nouveau que sont les addictions à l’écran. Nous en sommes aux balbutiements : toutefois, notre communauté de communes ayant la chance de disposer d’un service Jeunesse et de points d’information jeunesse, chaque commune peut bénéficier du travail que ceux-ci réalisent sur ces addictions qui sont malheureusement en plein essor. Nos animateurs sont régulièrement formés en conséquence.
Les addictions touchant les adolescents demeurent la principale difficulté, l’alcool n’est pas seul en cause, et, dans ce domaine aussi, nous souffrons d’une mauvaise connaissance des intervenants. La région Centre et l’agence régionale de santé ont compris la nécessité d’améliorer la communication – ainsi, dans le Vendômois, s’agissant de l’éducation à la sexualité, aucun jeune ne vient plus rencontrer la gynécologue qui est à leur disposition tous les mercredis. Pour combattre les addictions, l’idée nous est donc venue de faire appel, sur le modèle des éco-délégués dans les lycées, à des adolescents référents qui acceptent d’être sensibilisés et formés en matière d’accès à la santé et à la prévention. Il est notoire en effet qu’auprès d’un jeune, la parole d’un autre jeune est cent fois plus efficace que celle d’un adulte.
Je déplore d’autant plus le manque d’infirmières dans les écoles – mais le phénomène touche également les collèges et les lycées – que la médecine scolaire n’existe pratiquement plus. C’est un accompagnement qui nous fait cruellement défaut. On pourrait utiliser les personnels dont les collectivités disposent à tous les niveaux et qui sont volontaires pour une formation, étant entendu que ces mêmes collectivités ne peuvent assumer à elles seules la charge de la prévention. Des ateliers Santé Ville réalisent un travail remarquable mais l’organisation verticale nuit à la mise en commun de nos efforts. Les contrats locaux de santé devraient permettre de travailler de manière plus transversale.
M. le rapporteur. Pourriez-vous donner un exemple de travail réalisé par des adolescents référents en matière d’addiction ?
Par ailleurs, comment les communes s’intègrent-elles au programme national Nutrition santé ?
Mme Isabelle Maincion. Les adolescents référents sont, comme je l’ai mentionné, inspirés des éco-délégués, qui sont élus par leurs camarades et formés par un enseignant volontaire aux gestes quotidiens du développement durable comme éteindre la lumière quand on sort de la classe ou utiliser les feuilles recto verso. Leur action auprès de leurs camarades permet de réaliser des économies de fonctionnement, même s’il faut recommencer cette formation chaque année.
En place, à titre expérimental, depuis septembre, les adolescents référents, qui ont reçu une formation en matière de santé, ont pour rôle d’entrer en contact avec un camarade qui se drogue ou qui est rivé à un écran pour l’inciter, par exemple, à pratiquer un sport. L’agence régionale de santé soutient l’initiative et la région Centre a alloué un petit budget pour encourager ces jeunes à se mobiliser sur les problèmes de nutrition, de drogue ou d’alcool car il n’est pas rare en milieu rural qu’un jeune rentre le mercredi soir ivre mort à l’internat. Nous envisageons d’étendre cette prévention à l’éducation sexuelle, car nous constatons une recrudescence des grossesses précoces – dont quelques-unes sont voulues, car c’est aussi une façon de s’opposer aux parents.
S’agissant de la nutrition et de la santé, le programme national Nutrition santé I ne concernait que les professionnels de santé et les ministères parties prenantes du programme. Or tous ces acteurs se sont aperçus que l’appui des collectivités locales leur était indispensable pour mener des actions emblématiques comme, par exemple, la distribution d’un fruit à la récréation. L’Association des maires de France m’a alors demandé de participer à un groupe de travail sur la façon dont nos collectivités pourraient s’impliquer dans ce programme, ce qui, accessoirement, m’a permis de réaliser que, comme M. Jourdain de la prose, je faisais depuis longtemps de la prévention sans le savoir – en particulier dans la maison de retraite gérée par le centre communal d’action sociale, où je luttais contre la dénutrition des personnes âgées en formant le personnel en conséquence.
Il convenait en premier lieu de déterminer les compétences respectives des collectivités locales et de l’État en matière de santé, car ces champs se recoupent. À partir de ce constat, nous avons créé, au sein du programme national Nutrition santé II, le label « Villes actives » destiné aux communes qui s’engagent à mettre en œuvre chaque année une des priorités du programme, que ce soit les maisons de retraite, l’alimentation ou le sport.
Un colloque est prévu tous les deux ans – le premier s’est déroulé à Nancy et le second cette année à Marseille – pour évaluer l’engagement des collectivités. Cela commence par l’urbanisme. L’organisation de notre espace de vie contribue en effet à la préservation de la santé : cheminements doux afin d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, aménagements divers, cages d’escaliers rendues plus attractives pour diminuer le recours à l’ascenseur – je pense au travail réalisé en la matière par un architecte à Bordeaux et à Nancy dans le cadre de la réhabilitation ou de la construction d’immeubles. En matière d’alimentation, l’accent a été mis non seulement sur l’équilibre des repas servis dans les restaurants scolaires, mais également sur la consommation effective de ces repas par les enfants, en vue de réduire la quantité de déchets. Il convient également de promouvoir l’achat de produits locaux et la consommation des fruits et légumes de saison.
Hormis les actions dans le cadre des cantines, c’est notamment dans le cadre de « Villes actives » qu’a été généralisée la formule des pédibus, expérimentée en centre-ville. Mais, d’une part, il n’est pas besoin d’avoir le label pour s’emparer des bonnes pratiques et, d’autre part, se pose la question de la transposition du dispositif en milieu rural. Nous réfléchissons à un système de vélobus, ce qui implique de créer des accès cyclables pour les enfants et de prévoir des abris à vélos dans les écoles. Nos politiques d’aménagement sont désormais pensées en fonction de préoccupations tournant autour de la santé – il en est ainsi, dans ma commune, de la réorganisation du restaurant scolaire.
L’Association des maires de France a créé un groupe de travail sur la restauration collective et sur les achats responsables. Avec son soutien, notre commune a répondu à l’appel à projets national relatif au programme national d’alimentation : nous prévoyons de réaliser des fiches sur nos pratiques en vue de les diffuser auprès de toutes les mairies de France.
M. le rapporteur. La prévention se décline habituellement en prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais il est vrai qu’aucun domaine n’y échappe : c’est aussi affaire de qualité de l’air, de l’eau ou de la vie. Le risque est alors de devenir responsable de tout !
La médecine scolaire étant en déshérence, pouvez-vous prendre des responsabilités en la matière, alors même que vous avez déclaré vouloir laisser les siennes à l’État ? Assurer la prévention dans les établissements primaires est nécessaire pour garantir aux enfants le meilleur développement possible, mais les collectivités locales peuvent-elles combler le vide existant, même si cela ne relève pas de leur compétence directe ?
Mme Isabelle Maincion. Malheureusement, la majorité des communes sont contraintes de s’y employer. C’est une évolution, toutefois, que nous récusons : il n’est pas normal que nous devions effectuer des signalements parce que les visites médicales obligatoires à l’école primaire ne sont plus assurées. Les enseignants nous aident en nous signalant les problèmes sociaux et sanitaires qui peuvent se poser.
Pour une petite commune, toutefois, la réponse ne peut être que collective : c’est pourquoi il faut des lieux où élaborer des projets communs.
M. le rapporteur. Les addictions à l’alcool et à la drogue induisant des problèmes de délinquance et de sécurité publique, on ne saurait en effet cloisonner.
M. René-Paul Savary. Le pragmatisme des propos de Mme Isabelle Maincion, élue de terrain, me réjouit.
Il est clair que personne ne peut plus s’enfermer dans son rôle spécifique mais la disparition de la médecine scolaire et la désertification médicale en milieu rural, qui empêchent la prévention, la rendent dans le même temps encore plus nécessaire pour pallier ce manque de médecins !
Puisque les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont des difficultés à disposer d’un médecin coordinateur, qu’il est délicat d’organiser la prévention dans les maisons départementales des personnes handicapées et que la médecine scolaire et les services de la protection maternelle et infantile ne trouvent pas de médecins en nombre suffisant, pourquoi ne pas s’organiser par bassin de vie en y créant un pôle de médecins de prévention pour intervenir dans tous ces lieux ? Nous sommes condamnés à innover.
M. le rapporteur. Des départements ont bien mis en place des animateurs culturels par canton : pourquoi ne pas imaginer un animateur Prévention par territoire, qu’il s’agisse d’un médecin ou d’une infirmière formée à cette fin ? L’idée des adolescents référents va d’ailleurs dans ce sens – et leur message porte davantage auprès de leurs camarades que celui d’un ancien alcoolique ou d’un ancien fumeur.
Mme Isabelle Maincion. Je connais une très grosse entreprise de la région parisienne – 8 500 salariés – qui a embauché un salarié dont la fonction consiste non seulement à lutter contre les addictions mais également à accompagner le retour des anciens dépendants à une vie normale, ce qui est un point essentiel. J’ai moi-même été confrontée en tant qu’élue au décès dû à l’alcool de deux salariés, un employé de la maison de retraite et un agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Nous n’avons pas nécessairement besoin de spécialistes : ce qui est nécessaire, c’est accompagner ceux qui acceptent de se soigner. Je fais partie de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile au sein de l’agence régionale de santé : il est dommage qu’au lieu d’effectuer un travail de fond, cette commission se contente de répartir les subventions entre les différentes associations.
M. le rapporteur. La communication de la Cour des comptes dénonce une absence de pilotage de la politique de prévention, mais qui peut selon vous assurer ce pilotage ? La cour propose de le confier à un délégué interministériel : qu’en pensez-vous et souhaitez-vous être associés à ce travail ?
M. René-Paul Savary. Les acteurs sont trop nombreux. Du reste, selon la cour, le budget de la prévention serait compris entre 1 et 10 milliards d’euros…
M. le rapporteur. Tout dépend si on prend en compte le budget directement dédié à la prévention ou toutes les actions de prévention réellement menées, comme celles qu’effectue normalement le médecin généraliste chaque fois qu’il reçoit un patient.
M. René-Paul Savary. Mon expérience de médecin m’a appris qu’une personne qui se montre réfractaire à un message de prévention peut y devenir réceptive à un moment donné : c’est ce moment qu’il ne faut pas manquer. C’est vrai aussi bien pour les adultes que pour les jeunes. C’est pourquoi il faut réorganiser les actions de prévention à partir du terrain, des territoires, pour être à même de détecter ce moment et de le mettre à profit.
M. le rapporteur. Les anciens alcooliques évoquent le « déclic ».
M. René-Paul Savary. La communication évoque des modèles étrangers : on pourrait s’en inspirer mais je crains qu’ils ne soient incompatibles avec le modèle social français.
Mme Isabelle Maincion. Les collectivités locales doivent assumer le poids des réglementations et, de plus, les maires reçoivent des sollicitations de toutes sortes. Nous avons donc besoin de priorités claires et ce ne sont pas les acteurs de terrain qui peuvent les définir : au sein du comité de pilotage du plan national Nutrition santé, chaque acteur – et il y en a beaucoup – est persuadé que son domaine d’intervention est primordial, de sorte que le programme est devenu un catalogue !
Si possible, commençons par simplifier ! Nous essayons de le faire à notre échelon car, même à ce niveau, il y a des redondances. C’est du reste la raison pour laquelle nous avions tenu à réaliser un diagnostic territorial.
M. le rapporteur. Je suis d’accord avec vous : c’est dans le même esprit que j’ai critiqué les 100 objectifs de la loi de santé publique.
M. le coprésident Pierre Morange. Je constate une convergence des constats entre les départements et les communes : la multiplicité des acteurs et le fonctionnement de notre protection sanitaire et sociale en tuyaux d’orgue rendent impérative une coordination, pour parvenir à une action transversale. Dans le cadre de ses compétences régaliennes, l’État stratège doit définir des objectifs clairs et peu nombreux : nous n’avons pas besoin en effet d’un « inventaire à la Prévert ». S’attaquer aux quatre fléaux que sont le tabac, l’alcool, la surcharge pondérale et la sédentarité suffirait pour faire reculer les trois quarts des pathologies.
Il est donc nécessaire de faire prévaloir une logique de coordination nationale au travers d’une délégation interministérielle et de décliner cette rationalisation des efforts dans les départements, par l’intermédiaire de la médecine scolaire, de la médecine du travail ou des caisses primaires d’assurance maladie.
*
Audition de Mme Jeanne-Marie Urcun, médecin, conseillère technique auprès du directeur général de l’enseignement scolaire, et Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, de la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale.
M. le coprésident Pierre Morange. Mesdames, M. Jean-Luc Préel, notre rapporteur, vous posera des questions. Mais auparavant, nous aimerions avoir votre appréciation sur le rapport de la Cour des comptes et sur celui du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale sur la médecine scolaire.
Mme Nadine Neulat, chef du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, de la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale. Le directeur général de l’enseignement scolaire a été auditionné par la Cour des comptes et son sous-directeur par l’Assemblée nationale. Nous disposons désormais de deux rapports nous permettant de réfléchir de nouveau sur les progrès à réaliser en termes d’organisation et de mission dévolues à la santé scolaire. Une des difficultés du sujet tient à son caractère multiforme, si bien que chacun a une interprétation différente de ce que recouvre l’expression « médecine scolaire ».
Nous ne sommes chargés que d’une partie du suivi des élèves au sens strict, le code de l’éducation prévoyant des visites médicales dans le cadre scolaire et un suivi de la santé des élèves.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les visites obligatoires ?
Mme Nadine Neulat. Le code de l’éducation prévoit quatre visites obligatoires : la première à avoir été mise en place est celle de la sixième année, lors du cours préparatoire, au commencement des apprentissages proprement dits. Les trois autres visites, prévues par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance à neuf, douze et quinze ans, nous posent des difficultés. En effet, la loi ne prévoit pas stricto sensu que l’Éducation nationale prend complètement en charge l’organisation de ces visites puisqu’elles peuvent être effectuées à l’initiative des parents : dans ce cas, elles doivent être gratuites. Cela suppose que l’assurance maladie les prenne en charge, ce qui se révèle assez problématique.
Nous avons examiné les questions soulevées par ces trois visites complémentaires avec le ministère de la santé. La première concerne l’âge de ces visites. Le ministère de la santé partage notre avis sur l’absence de pertinence des visites des neuf ans et des quinze ans ; seule la visite des douze ans pourrait avoir un intérêt du point de vue de la santé publique. La seconde question est liée à l’impossibilité où nous sommes d’assurer la réalisation de ces trois visites, compte tenu du nombre des médecins de l’Éducation nationale disponibles.
Mme Jeanne-Marie Urcun, médecin conseillère technique auprès du directeur général de l’enseignement scolaire. Il existe une autre visite médicale obligatoire : c’est la visite d’aptitude aux travaux normalement interdits aux mineurs par le code du travail. Cette visite est passée par les élèves qui suivent un enseignement technologique ou professionnel et ont, de ce fait, accès, au sein des ateliers, à des machines dont l’utilisation leur est normalement interdite.
M. le rapporteur. Un compte rendu de la visite des six ans et des douze ans est-il adressé aux parents et au médecin traitant ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Les parents sont toujours prévenus du déroulement de ces visites. Entre 85 % et 90 % d’entre eux sont présents à la visite des six ans. De plus, les conclusions du bilan sont transcrites sur le carnet de santé. Si, à la suite de la découverte d’une pathologie, un examen supplémentaire est nécessaire, un courrier est adressé au médecin généraliste par l’intermédiaire de la famille – c’est à elle que revient d’effectuer cette démarche.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’en est-il du suivi ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Il dépend des informations renvoyées par la famille. Sans ces informations, nous n’aurons connaissance du suivi que de manière fortuite, par exemple si un enfant qui avait besoin de lunettes en porte désormais en classe.
Mme Nadine Neulat. S’agissant du retour des avis donnés par les médecins scolaires, les données dont nous disposons ne sont pas satisfaisantes. Il faut donc mettre en place des dispositifs permettant de mieux connaître les suites données aux avis des médecins scolaires.
Plusieurs études ont été conduites sur le sujet d’où il ressort que seulement 30 % à 40 % des visites ont été suivies d’effets. Certains départements ont mené des expérimentations de travail en partenariat avec des accompagnants santé, rémunérés par l’assurance maladie : leur rôle est d’accompagner les familles pour aider celles-ci à acheter des lunettes ou à prendre un rendez-vous chez leur médecin traitant. Nous voudrions amplifier cet accompagnement.
Nous étudions également les dispositifs de réussite éducative instaurés dans le cadre de la politique de la ville, dispositifs mis en œuvre par des partenaires évoluant autour de l’école dans différents domaines. Ils prévoient des accompagnements santé pour les élèves qui en ont besoin.
M. le coprésident Pierre Morange. Conviendrait-il de prévoir des dispositifs d’ordre réglementaire ou législatif instaurant une automaticité du suivi, voire un pouvoir d’injonction, dès lors que la logique de dépistage de la médecine scolaire est déficiente et qu’il existe des parents laxistes ?
Dans l’intérêt de l’enfant, un financement du système assurantiel ne devrait-il pas se substituer à une carence parentale, notamment pour des raisons de précarité ?
M. le rapporteur. Lors de la visite des six ans, l’enfant présente normalement son carnet de santé : celui-ci est-il bien tenu ? C’est important car le médecin traitant pourra y prendre connaissance de l’avis donné par le médecin scolaire.
Mme Jeanne-Marie Urcun. Le carnet de santé permet au médecin scolaire d’avoir connaissance des bilans des visites obligatoires de la petite enfance, réalisées dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Le lien avec la protection maternelle et infantile est ainsi assuré, le dossier protection maternelle et infantile étant envoyé aux services de l’Éducation nationale. Nous avons donc une connaissance de base de l’état de santé de l’enfant.
Quant au courrier indépendant du carnet de santé, il devrait permettre un aller-retour nous informant du suivi.
Les parents ne se désintéressent pas tant de l’état de santé de leurs enfants, mais ils ne comprennent pas toujours l’utilité de l’avis du médecin scolaire. Parfois, également, ils ne peuvent pas accéder facilement aux soins. À cet égard, on observe que, dans les zones d’éducation prioritaire, l’offre de soins est plus importante que dans les secteurs ruraux : le suivi orthophonique ou dentaire d’un enfant n’est pas facile à assurer lorsqu’on doit parcourir vingt à trente kilomètres. Il faut accompagner certaines familles dans leurs démarches auprès du spécialiste concerné ou du médecin généraliste, qui doit orienter le parcours de soins de l’enfant.
Dans certaines municipalités, les services sociaux réalisent encore ce travail d’accompagnement des enfants du premier degré. La problématique du second degré est multifactorielle et donc plus compliquée : je ne l’évoquerai pas.
Mme Nadine Neulat. Prévoir des mesures d’ordre législatif pour imposer aux familles le suivi médical ne me semble pas approprié. Il est préférable de s’orienter vers une amélioration du soutien à la parentalité, qui est d’ailleurs lié à d’autres politiques auxquelles nous participons, d’autant que les études ont montré que les causes de non-suivi de la part des parents se posent moins en termes financiers qu’en termes d’accessibilité de l’offre de soins ou de non-compréhension de l’importance du suivi demandé pour le déroulement de la scolarité de l’enfant.
M. le rapporteur. Quel rôle joue la médecine scolaire dans le diagnostic et le suivi d’un handicap, d’ordre psychomoteur notamment, pouvant donner lieu à l’intervention d’un auxiliaire de vie scolaire ? Quelles sont les relations avec le spécialiste ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Le médecin scolaire participe à l’accueil de la famille, bien souvent à l’annonce du handicap, et construit avec l’enseignant référent un projet personnalisé de scolarisation. Ce travail en amont permet de transmettre à la maison départementale des personnes handicapées une proposition de scolarisation spécifique. C’est la maison départementale qui décide des attributions particulières, notamment en termes de moyens humains comme les auxiliaires de vie scolaire. L’accompagnement des enfants malades ou handicapés représente une part importante du travail du médecin de l’Éducation nationale.
M. le rapporteur. Quels liens celui-ci entretient-il avec les centres médico-psycho-pédagogiques ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Le centre médico-psycho-pédagogique est un partenaire naturel. À la suite du bilan des six ans, où peuvent être décelées d’éventuelles difficultés d’apprentissage, les partenaires le plus souvent sollicités sont, pour 15 % à 20 % des cas, le centre médico-psychologique, le centre médico-psycho-pédagogique, le psychologue scolaire, les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et les centres de référence, ces derniers n’étant sollicités que dans 2 % à 3 % des cas.
Mme Nadine Neulat. Une enquête a été réalisée il y a quelques années, avec l’aide de Mme Marie Choquet, sur les liens entre les établissements scolaires, les centres médico-psychologiques et les centres médico-psycho-pédagogiques. Il ressort de cette enquête que des progrès importants peuvent encore être réalisés en termes non seulement de connaissance des deux dispositifs par les établissements scolaires mais également de délais : trop souvent, même en cas de difficulté grave, les élèves attendent six mois pour obtenir un rendez-vous, si bien que toute l’année scolaire ou presque est écoulée quand ils s’y rendent. Ce problème de disponibilité des réseaux de proximité en soutien des établissements scolaires s’ajoute à celui du dépistage par nos personnels dans l’établissement.
M. le rapporteur. Quel est le nombre de médecins et d’infirmières scolaires ? Combien y a-t-il de postes disponibles ? Existe-t-il des difficultés de recrutement ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Les chiffres dont je dispose proviennent de la réponse à une question de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2012 : la situation en 2011 est de 7 449 équivalents temps plein délégués pour les emplois d’infirmières, 1 488,64 équivalents temps plein délégués pour les emplois de médecins, et 2 560,50 équivalents temps plein délégués pour les emplois d’assistantes sociales.
M. le rapporteur. Pour quel nombre d’établissements scolaires ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Pour environ 7 400 collèges, 2 500 lycées et 60 000 écoles. Il faut noter qu’il s’agit du nombre d’équivalents temps plein délégués, et non pas d’équivalents temps plein effectivement consommés. Certaines académies sont très déficitaires en personnels de santé.
Mme Nadine Neulat. L’Éducation nationale compte actuellement 185 postes de médecins vacants. La chute générale de la démographie médicale sévit également dans l’Éducation nationale, notamment dans les académies de Reims, d’Amiens, d’Orléans-Tours. L’académie de Clermont-Ferrand commence également à être touchée par le phénomène.
M. le rapporteur. N’y a-t-il pas un problème spécifique de manque d’attractivité de la carrière d’infirmière scolaire, qui relève toujours du cadre B de la fonction publique, alors que les infirmières de la fonction publique hospitalière sont passées en catégorie A ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. La question se pose à la direction des relations humaines du ministère de l’éducation nationale. Le corps des infirmières étant un corps interministériel, il est géré par le ministère chargé de la fonction publique. Notre propre ministère est actuellement engagé dans des négociations difficiles pour obtenir de ce ministère le passage des infirmières scolaires en catégorie A, soit de manière progressive, sur une période qui pourrait être de quinze ans, soit de manière beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si nous y arriverons : nous attendons la réponse du ministère chargé de la fonction publique.
M. le rapporteur. La communication de la Cour des comptes fait état d’un défaut de pilotage de la politique nationale de prévention sanitaire. Elle propose que cette mission soit confiée à une délégation interministérielle qui relèverait de la direction générale de la santé. Comment pourrait-on assurer la coordination au niveau national entre les différents acteurs de la prévention : Éducation nationale, sécurité sociale, etc. ? Qui pourrait être chargé de cette coordination ? Comment en assurer l’efficacité ?
M. le coprésident Pierre Morange. La médecine scolaire est-elle engagée dans un processus d’identification et de généralisation des bonnes pratiques en matière de prévention sanitaire ? D’une manière générale, quelles sont les modalités d’évaluation des programmes de prévention sanitaire en milieu scolaire ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Il faut, pour répondre à vos questions, distinguer au préalable entre ce qui relève du suivi de la santé des élèves, notamment à travers les visites médicales, et tout ce qui est du domaine de l’éducation à la santé : ces deux domaines ne se recouvrent pas totalement et n’impliquent pas nécessairement les mêmes personnels. Si le suivi de la santé des élèves relève exclusivement de la compétence des personnels de santé, à savoir les médecins et les infirmières scolaires, le ministère entend impliquer de manière beaucoup plus significative les enseignants dans l’éducation à la santé. En effet, 1 500 médecins et 7 000 infirmières ne suffiront pas pour assurer l’éducation à la santé de la maternelle aux lycées. Cette implication de l’ensemble des équipes éducatives se justifie d’autant plus que l’éducation à la santé et à la prévention relève du socle commun de connaissances et de compétences que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. L’éducation à la santé est une mission qui doit être largement partagée avec les enseignants et les partenaires de l’Éducation nationale.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur ce point, nous sommes tous d’accord. Cela étant, avez-vous identifié, parmi les actions menées par les différentes académies en matière d’éducation à la santé, des programmes particulièrement efficaces ?
Mme Jeanne-Marie Urcun. Certaines actions autour de thématiques de prévention, développées par les académies en partenariat avec différents acteurs comme les agences régionales de santé ou les associations, nous semblent particulièrement fécondes. Je pense, par exemple, à une action d’éducation à la sexualité engagée dans l’académie de Lyon et qui a réuni, autour de ce thème assez sensible, des formateurs partageant la même philosophie et porteurs des mêmes messages auprès des élèves et des personnels. L’académie de Lille a vu également se développer des formations associant différents acteurs sur le même thème. Les académies de Limoges et de Poitiers ont lancé des actions du même type, cette fois dans le domaine de la prévention des conduites addictives.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces actions ont-elles été évaluées ? Quels publics scolaires visaient-elles ? Ces actions ont-elles permis d’échanger des informations et d’élaborer un recueil des bonnes pratiques au niveau du ministère ?
Mme Nadine Neulat. Si on veut impliquer la communauté éducative dans des projets de ce genre, il faut d’abord s’adresser aux adultes, et non aux élèves, même si ceux-ci sont le public ciblé. En effet, c’est cette formation préalable des adultes qui permet d’accompagner la réflexion des élèves.
Les académies évaluent la satisfaction des adultes ayant participé à ces stages de formation et ces évaluations donnent généralement des résultats très positifs. En revanche, évaluer une éventuelle évolution des comportements des élèves est beaucoup plus difficile : un comportement change sur le long terme. Certes, la dernière enquête sur la santé des Français révèle une petite amélioration, à laquelle nous avons sans doute contribué. Toutefois, il est difficile de savoir ce qu’on mesure réellement. Il faut comprendre, en outre, que certains objectifs sont par nature inatteignables. Ainsi, on ne peut pas viser un objectif « zéro grossesse non désirée » chez les adolescentes, sachant que certaines de ces grossesses précoces répondent à un réel désir d’enfants, qu’il soit conscient ou non. De même, viser une absence de consommation d’alcool ne saurait constituer un horizon crédible. Une véritable étude des changements de comportement ne pourra porter que sur de grandes cohortes populationnelles, suivies pendant des années. Ainsi, le tassement de l’augmentation de l’obésité auquel on assiste actuellement, notamment chez les élèves de cours moyen, peut être perçu comme le résultat des grandes campagnes d’éducation à la santé.
Impliquer dans ces démarches d’éducation à la santé des personnels dont ce n’est pas le cœur de métier – un enseignant peut considérer que sa mission est de transmettre des savoirs, non des savoir-faire, et encore moins des « savoir-être » – suppose tout un travail de persuasion auprès des établissements scolaires. On peut considérer cependant que l’éducation à la santé est devenue un élément incontournable du paysage de l’Éducation nationale, même si les méthodes ont évolué : on travaille moins désormais à transmettre directement des notions de prévention sanitaire, au sens premier du terme, qu’à conduire les élèves à réfléchir sur leurs choix et leurs comportements.
Mme Jeanne-Marie Urcun. À titre personnel, j’ai quelque réticence à l’instauration d’un pilotage interministériel de la prévention sanitaire. Nous avons déjà l’expérience de la gouvernance interministérielle dans certains domaines. Dans le domaine de la prévention de la toxicomanie, par exemple, nous travaillons avec la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie aujourd’hui rattachée au Premier ministre. Une structure interministérielle placée sous l’autorité de la direction générale de la santé permettrait peut-être un meilleur suivi sanitaire, au sens strict, des élèves, en assurant notamment une meilleure coordination avec la médecine générale. Je crains cependant que la création d’une telle structure n’aboutisse à déporter l’éducation à la santé vers le ministère de la santé, l’éloignant encore davantage du monde enseignant, qui peine déjà à assumer cette mission.
Mme Gisèle Biemouret. On parle beaucoup d’une recrudescence des grossesses précoces. Est-ce une réalité ? J’ai été surprise d’apprendre que quatre élèves appartenant au même lycée dans mon département étaient enceintes.
Mme Nadine Neulat. Ce n’est pas exceptionnel. Cependant, même si nous ne disposons pas de chiffres pour l’ensemble des académies, il ne semble pas que le nombre des grossesses précoces augmente notablement, excepté dans certaines franges de la population et dans certains territoires. Il faut remarquer aussi, quoi qu’on en pense, que ces grossesses sont parfois désirées par des adolescentes en quête de reconnaissance sociale. C’est toute la difficulté de l’éducation à la santé, et tout particulièrement de l’éducation à la sexualité : un jeune informé ne modifiera pas forcément ses comportements. C’est pourquoi, au-delà de l’éducation sexuelle proprement dite, il convient de faire réfléchir les élèves sur les conséquences de conduites qui peuvent nous sembler irrationnelles et, en l’occurrence, sur ce que signifie le fait de devenir parent.
Mme Jeanne-Marie Urcun. La distribution de la contraception d’urgence par les infirmières scolaires est un moyen favorable de faire de la prévention, puisque c’est pour elles l’occasion d’entamer un dialogue avec les adolescentes. L’autorisation du renouvellement par les infirmières des contraceptifs oraux constituera de ce point de vue un moyen supplémentaire de prévention des grossesses chez les adolescentes.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous mesuré l’incidence sur le nombre d’interruptions volontaires de grossesse des programmes d’éducation à la sexualité que vous avez cités ? Il est notoire que le taux d’interruptions volontaires de grossesse reste désespérément stable, en dépit de la multiplicité des moyens de contraception.
Mme Jeanne-Marie Urcun. À ma connaissance, le ministère de l’éducation nationale ne dispose pas de données sur le sujet. D’une façon générale, il faut se montrer très prudent dans l’interprétation du résultat de ces actions via des indicateurs du comportement des élèves, ceux-ci étant très influencés par leurs pairs ou par leur famille. Il est de ce fait très difficile d’imputer un comportement à une action. C’est toute la difficulté pour évaluer la prévention : s’il est facile de décrire les actions menées et le ressenti des publics ayant participé à ces formations, il est délicat d’en mesurer les effets sur les comportements. Je ne sais même pas s’il serait possible d’évaluer cette incidence, à moins de suivre des cohortes populationnelles sur du long terme. Une telle étude suppose des moyens qui ne sont dévolus qu’à la recherche.
Mme Nadine Neulat. C’est la problématique de l’évaluation de la prévention sanitaire, quel que soit l’âge de la population visée et quelles que soient les thématiques. On peut tout de même observer que l’état de santé de la population française s’est amélioré depuis qu’elle bénéficie d’une éducation à la santé. Je répète en outre qu’on ne parviendra jamais à réduire totalement certains comportements qui relèvent de l’irrationnel.
Mme Jeanne-Marie Urcun. L’utilisation du préservatif, aujourd’hui banalisée, est un indicateur assez objectif de l’incidence de l’éducation à la santé.
M. le rapporteur. Les représentants des communes et des conseils généraux que nous avons auditionnés se sont plaints d’une certaine déshérence de la médecine scolaire dans le domaine de l’éducation à la santé. Certes, l’enseignement primaire relève de la compétence des communes et l’enseignement dans les collèges de celle des départements, mais ceux-ci n’ont pas les moyens de se substituer à l’État dans cette mission indispensable. Par ailleurs, les médecins libéraux ne pourraient-ils pas participer à la médecine scolaire ?
Mme Nadine Neulat. Cette vision des choses prouve la confusion qui règne sur cette question. L’éducation à la santé n’est pas réservée aux personnels de santé : nous sommes des conseillers techniques chargés de valider la démarche d’une réflexion sur la santé, mais nous n’avons ni la prétention, ni mêmes les moyens, d’être les seuls acteurs légitimes à assurer l’éducation à la santé ; les citoyens et les élus peuvent eux aussi participer à cette démarche. Les personnels de santé de l’Éducation nationale sont en quelque sorte les médecins du travail de l’élève. C’est la spécificité de la médecine scolaire, qui justifie l’existence d’un corps à part entière, où on entre par la voie d’un concours particulier et où on reçoit une formation spécifique. Le bilan de santé réalisé lors de la visite médicale obligatoire des élèves de six ans et de douze ans a pour objectif de repérer tout trouble qui pourrait constituer une difficulté pour suivre les apprentissages, de faciliter l’accueil de l’enfant malade ou handicapé ou de s’assurer que l’état de santé de l’élève est compatible avec l’orientation choisie. Cet accompagnement individuel de l’enfant-élève diffère de l’éducation à la santé en général. Il suppose, outre des connaissances médicales, la connaissance du milieu où l’enfant évolue en tant qu’élève, c’est-à-dire du monde de l’Éducation nationale.
L’obligation d’une visite médicale à six, neuf, douze et quinze ans relève d’une autre logique qui est de suivre l’état de santé général de l’enfant, et non de l’élève. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire que les visites médicales obligatoires à neuf et quinze ans, si elles doivent être maintenues en dépit de leur peu d’intérêt en termes de santé publique, soient effectuées par un médecin ou une infirmière de l’Éducation nationale. C’est dans cette perspective que nous avons longuement débattu avec le ministère de la santé et la direction de la sécurité sociale de la question de la prise en charge de ces visites médicales.
Mme Jeanne-Marie Urcun. La participation des médecins généralistes aux missions de la médecine scolaire pourrait être en effet un moyen de pallier l’insuffisance des personnels. Il resterait à en définir le cadre et les modalités, notamment en ce qui concerne la prise en charge de ces visites, aujourd’hui gratuites pour les familles. On pourrait même envisager, conformément à une suggestion de la direction générale de la santé, de rationaliser le système de ces visites obligatoires, dont le nombre est ahurissant. Il s’agirait de déterminer leur opportunité, de redéfinir leur contenu et de préciser les compétences de chacun, dans cet ensemble dont nous ne sommes qu’un maillon.
Mme Nadine Neulat. Le dossier médical personnel de l’enfant pourrait, dans l’intérêt de l’enfant-élève, devenir une plateforme commune d’échanges d’informations.
M. le coprésident Pierre Morange. Mesdames, je vous remercie.
*
AUDITIONS DU 15 DÉCEMBRE 2011
Audition de M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine à l’université René Descartes Paris V.
M. le coprésident Jean Mallot. Il est aussi difficile de mesurer les actions menées en matière de prévention, qui sont vastes et protéiformes, que d’en proposer un chiffrage financier. Faudrait-il instaurer dans ce domaine, comme le recommande la Cour des comptes, une coordination nationale, qui serait assurée par la direction générale de la santé ? Comment pourrait-on prendre en compte des objectifs à long terme, dont la réalisation serait évaluée par des acteurs différents de ceux qui les ont définis ? Telles sont nos premières interrogations.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Trois raisons au moins justifient votre audition. D’une part, lorsque vous avez été directeur général de la santé, vous vous êtes heurté à la difficulté de mener de front une politique de prévention ambitieuse, tout en étant sollicité sans cesse pour des actions au jour le jour. D’autre part, vous êtes responsable du plan Alzheimer, qui appelle des mesures de prévention. Enfin, nous souhaitons connaître votre réaction, en tant que spécialiste de la question, à l’exclusion de l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée prises en charge à 100 % par la Caisse nationale d’assurance maladie.
M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine à l’université René Descartes Paris V. Quand j’étais directeur général de la santé, en 1998-1999, j’ai constamment paré à l’urgence, les problèmes se réglant généralement le vendredi soir faute de temps le reste de la semaine, alors que plus personne n’était disponible. Par ailleurs, j’ai organisé les conférences nationales de santé, que M. Alain Juppé avait instaurées dans le droit fil de la politique de santé publique initiée par M. Claude Evin. En 1992, celui-ci avait créé le Haut Comité de la santé publique, en s’inspirant de l’exemple étranger, pour prendre acte des campagnes de lutte contre le tabagisme menées par MM. Claude Got, Maurice Tubiana et François Grémy. C’est dans ce contexte qu’a été précisé le concept de prévention, bien que celle-ci existait déjà dans les faits, puisque l’espérance de vie était plus élevée en France que partout ailleurs.
La Conférence nationale de santé a montré qu’il était possible d’adopter chaque année un plan national étalé sur cinq ans. Mais issu des premières conférences régionales, apparues en 1994, un autre mouvement s’est développé. Compte tenu de leurs spécificités, les régions ont isolé certaines priorités de santé publique. Ensuite, il fallait créer des liens entre leurs analyses. Je considère toujours qu’il faudrait définir chaque année un plan national, complété d’initiatives régionales. Mais il faut limiter leur nombre, car il est inutile de multiplier les annonces, documents superbes à l’appui, si elles restent sans effet.
Depuis le début des années 1990, on constate une fragmentation des structures, dont M. Yves Bur a décrit récemment, dans son rapport sur les agences sanitaires, les effets désastreux : 17 institutions, à la place mal définie, se partagent 6 100 équivalents temps plein. L’affaire du sang contaminé ou celle de l’hormone de croissance ont révélé un système éclaté et coûteux, que le directeur général de la santé n’a pas les moyens de coordonner. Je souscris totalement à cette analyse, même si, depuis mon départ de la direction générale, je me suis abstenu de toute intervention dans le débat public pour ne pas gêner mes successeurs.
M. le rapporteur. Puisque la prévention associe des partenaires aussi divers que les caisses d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, les complémentaires santé, les départements ou l’Éducation nationale, la Cour des comptes, qui regrette l’absence de pilote, propose de confier au directeur général de la santé la coordination interministérielle de toutes les actions. Cela lui permettrait-il d’être plus efficace ?
M. Joël Ménard. La prévention relevant, au-delà de la santé, de l’Éducation nationale, de l’agriculture ou de l’environnement, pourquoi ne pas créer en effet un délégué interministériel – à condition qu’il soit doté des pouvoirs nécessaires ? Si j’ai pris en charge le plan Alzheimer, c’est avant tout parce que c’était une initiative présidentielle, ce qui permettait de faire travailler les gens ensemble. La gestion en étant confié à une spécialiste, tout le monde a apporté sa collaboration. Elle a organisé chaque mois une réunion, que chacun se sentait tenu de préparer. Une telle contrainte est indispensable, car la prévention est toujours soumise à des forces centrifuges. La direction générale de la santé, celle de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, les agences sanitaires, l’Institut de veille sanitaire ou l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé sont comme les musiciens d’un orchestre : un chef d’orchestre est nécessaire. Si l’on confie cette responsabilité au directeur général de la santé, il ne pourra plus s’occuper, comme j’ai dû le faire moi-même, de la grippe ou du sida. J’ai plaint M. Didier Houssin qui a dû intervenir à tout propos, sous la pression des journalistes, sur la grippe H1N1 en plus de ses fonctions de directeur général de la santé. Quant à moi, estimant que je ne pouvais pas mener tous les dossiers de front, j’en ai tiré les conséquences et je n’ai exercé les fonctions de directeur général de la santé que durant deux années.
M. le rapporteur. Selon vous, il faudrait à la tête de chaque plan un responsable doté d’un pouvoir réel.
M. Joël Ménard. Ce responsable doit être nommé par le Premier ministre, puisqu’un plan relève plusieurs ministères. Celui de la santé n’a pas les moyens de tout gérer. Quand on prépare un plan de prévention sur la lutte contre le tabac, il est impératif d’intervenir dans les établissements scolaires. Si, dans le milieu clos de l’Éducation nationale, on considère que ce n’est pas une priorité, il est impossible d’agir. De même, pour examiner la situation dans les prisons, il faut une coordination avec le ministère de la justice. En matière de prévention, un plan de santé publique est toujours multifactoriel et, pour le mettre en œuvre, il faut prévoir les moyens, l’organisation et les structures.
Le plan Alzheimer a mobilisé à temps plein cinq personnes de haut niveau, notamment Mme Florence Lustman, inspecteur général des finances. Elles étaient dotées d’un pouvoir réel. Mais, dans les autres plans, chaque acteur reste autonome, ce qui signifie qu’on ne peut organiser une réunion avec un directeur sans qu’il s’y fasse représenter soit par un sous-directeur, un chef de bureau, voire un chargé de mission, qui arrive généralement en retard et s’éclipse avant la fin de la réunion. C’est ce type fonctionnement que j’ai combattu quand j’ai mis en œuvre le plan Alzheimer.
M. le rapporteur. En admettant qu’il y ait un responsable par plan annuel, qui coordonnera leur action ? Un directeur général de la santé y parviendra-t-il si les délégués reçoivent leur pouvoir du Premier ministre ?
M. Joël Ménard. Le directeur général de la santé ne peut pas être sur tous les fronts. Dès qu’on annonce un plan, l’opinion publique se mobilise et, le nombre de personnes concernées étant considérable, un autre acteur doit prendre le relais. À mon époque, une trentaine de personnes en étaient capables, sur un effectif de 300. Lorsque plusieurs ministères sont concernés, l’appui de chaque ministre est nécessaire, car, si les membres de leur cabinet n’ont pas de bonnes relations, rien n’avance. Ainsi, quand une campagne de prévention contre l’obésité dénonce des publicités destinées aux enfants, le ministre de la santé doit travailler avec celui de la communication. Il est normal, quand un problème est national, que s’expriment certains groupes de pression dont les objectifs sont différents des nôtres. C’est pourquoi il faudrait, comme nous l’avons demandé à l’Union européenne, que toute action comprenne un volet santé, car, la plupart du temps, quand on signale les dangers d’un produit toxique, nos partenaires – mauvaise foi ou aveuglement ? – refusent d’envisager ses conséquences sanitaires. Il faut lutter sans cesse, sans garantie de succès. Ainsi, je n’ai jamais obtenu qu’on régule la quantité de sel dans l’alimentation, alors même que j’ai été invité à prononcer des conférences à ce sujet dans différents pays. Le Portugal a agi dans ce domaine, à la différence de la France. Peut-être m’a-t-il manqué le caractère d’un ayatollah.
M. le rapporteur. Comment articuler les plans nationaux et les priorités définies au niveau régional, comme la prévention du suicide ou de l’alcoolisme ?
M. Joël Ménard. Au plan local, la géographie, les aspects socioculturels et l’histoire peuvent être pris en compte. Ensuite, le directeur général de la santé doit organiser des journées d’échanges entre les responsables. Quand j’étais directeur général de la santé, le dépistage des cancers fonctionnait bien en Isère et en Bourgogne, ainsi que dans le Bas-Rhin, le Calvados et les Bouches-du-Rhône. C’est en comparant ces expériences qu’on a pu rédiger un cahier des charges national pour le dépistage. La Bourgogne était en avance pour le cancer colorectal, les Bouches-du-Rhône ou l’Aquitaine pour celui du sein. Croiser les initiatives permet de définir une action nationale. Tous les problèmes de santé ne peuvent être prévus de la capitale : ainsi, en Aquitaine, nul ne s’inquiète du radon qui préoccupe davantage l’Auvergne ou la Bretagne.
On m’a souvent demandé comment étaient arrêtés les plans de prévention. Si j’ignore pourquoi le Président de la République a retenu le dossier Alzheimer, il existe des techniques d’aide à la décision. En utilisant le travail mené en 1996 à l’Organisation mondiale de la santé et à Boston sur le poids de maladies, j’ai refait a posteriori les calculs portant sur la maladie d’Alzheimer. Si celle-ci est un problème lourd, c’est à cause du poids qu’elle impose aux malades et à leur famille. Mais il n’est pas seulement technique. La population peut être particulièrement sensible à une maladie dont l’importance n’apparaît pas dans nos calculs. Le vécu amène à définir des priorités. Le Haut Conseil de la santé publique joue aussi son rôle. Depuis 1996, il apporte sa réflexion au directeur général de la santé, qui la traduit en actes.
M. le rapporteur. Un secrétaire général supervise les agences régionales de santé, qui coordonnent les plans au niveau régional et fixent des priorités. Comment simplifier ses relations avec le directeur général de la santé ?
M. Joël Ménard. C’est une question d’entente. On découvre parfois avec consternation que deux personnes, voire deux ministres, ne peuvent travailler ensemble. Si j’étais actuellement directeur général de la santé, je demanderais à Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, de recevoir le groupe d’études des conférences régionales de la santé, car, quand les responsables des agences régionales de santé se rencontrent à Paris, leur priorité n’est pas de définir une politique de santé publique dont les effets n’apparaîtront pas avant cinq ou dix ans. C’est même la première chose à laquelle ils renoncent. Il faut repenser tout le système, en incitant les acteurs à se rencontrer périodiquement. Jadis, j’organisais des rendez-vous réguliers entre les directions départementales et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, tandis que M. Édouard Couty rencontrait les responsables des agences régionales de l’hospitalisation. Il ne s’agissait pas d’instaurer une compétition mais un échange entre la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la direction générale de la santé. D’autres fois, je recevais les agences régionales de l’hospitalisation et M. Édouard Couty les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, car des tensions existaient déjà entre le système de soins et la santé publique. Mais de telles difficultés sont gérables. Si j’étais actuellement directeur général de la santé, je m’adapterais au système tel qu’il a évolué.
M. le rapporteur. Le Haut Conseil de la santé publique, constitué d’experts, est-il encore utile depuis qu’il existe des conférences régionales et une Conférence nationale de santé ?
M. Joël Ménard. M. Yves Bur écrit dans son rapport qu’il ne voit pas l’utilité de cette instance. À côté du Haut Comité de la santé publique, de nombreux comités, qui dépendaient directement de la direction générale de la santé, ont été intégrés dans le haut conseil, dont le périmètre de responsabilité est étendu. Le haut conseil établit un rapport sur l’état de la France. S’il suffit que celui-ci ne soit remis que tous les cinq ans, il est indispensable qu’il associe des compétences diverses comme par exemple celles des médecins et des sociologues et qu’il soit rédigé en anglais, ce qui permettra de le diffuser dans tous les pays européens.
Quand j’étais directeur général de la santé, je jugeais essentiel d’avoir à mes côtés le président du Haut Comité de la santé publique. Engagé dans l’action et manquant de temps pour réfléchir, j’avais besoin de sa réflexion et de celle de ses groupes de travail. J’ai découvert les arcanes de l’administration : lorsque j’ai été nommé président de la première Conférence nationale de santé, le directeur général de la santé et le président du Haut Comité de santé publique me considéraient comme un intrus. De fait, j’étais un nouveau partenaire. Cela s’est bien passé parce que je les connaissais tous deux, que je ne prenais la place de personne et que je leur ai laissé expliquer leur politique. Il faut vaincre la méfiance pour pouvoir travailler ensemble. Mais comment coordonner 17 instances différentes ?
M. le rapporteur. Qui a exclu l’hypertension artérielle sévère des affections de longue durée ? Pourquoi cette décision ? En a-t-on évalué les conséquences ?
M. Joël Ménard. C’est un dysfonctionnement si grave que, bien que j’aie cessé de travailler sur l’hypertension depuis quinze ans, je suis sorti de ma réserve en apprenant la nouvelle. Loin de moi l’idée d’endosser le rôle d’enquêteur, mais ma double culture de médecin et de directeur général de la santé me permet de deviner ce qui s’est passé.
À partir de 2006, on a remarqué que les affections de longue durée, en tant que maladies chroniques, coûtaient de plus en plus cher à l’assurance maladie obligatoire. Mais qu’est-ce qu’une maladie chronique, sinon une maladie qui n’est plus mortelle mais qui est soignée par un traitement régulier ? La création de maladies chroniques est un succès de la médecine, même si leur coût est élevé.
En 1998, les caisses d’assurance maladie ont décidé de couvrir à 100 % les hypertensions artérielles de toute nature et, malgré ma sensibilité de chrétien de gauche qui aurait pu me pousser à favoriser cette décision, je m’y suis opposé. Je n’ai pas ménagé les courriers pour limiter la prise en charge aux cas d’hypertension sévère. Les sommes en jeu étaient considérables : près de 5 milliards d’euros pour un total de 10 à 12 millions d’hypertendus. J’ai obtenu qu’une nouvelle rédaction des textes distingue l’hypertension banale, qui ne demande guère plus d’un cachet par jour, soit moins d’un euro, le patient prenant lui-même sa tension, et les cas graves, qui sont beaucoup plus rares et coûteux. Sans être parfait, le système a fonctionné.
En 2006, s’est posé un autre problème, indépendant de la liste des affections de longue durée : celui du reste à charge, qui va conduire aux discussions sur le bouclier sanitaire. Tous les rapports de cette période ont été conservés : beaucoup d’experts ont écrit des choses très sensées, mais, bien que la Haute Autorité de santé se soit saisie du problème en 2007, aucune décision n’est intervenue avant le décret du 24 juin 2011, qui a retiré l’hypertension artérielle sévère de la liste des affections de longue durée, au motif qu’elle ne constituerait qu’un « facteur de risque » et non une pathologie avérée.
Pourquoi ce décret, qui ne résout ni le premier ni le second problème ? En principe, la sécurité sociale vérifiait que les patients souffrant d’une affection de longue durée consultaient leur médecin une fois par an, mais ce dispositif a été contesté au motif qu’il coûtait cher – 40 euros par visite – ou qu’il était vain, la sécurité sociale se dispensant des vérifications. En résumé, les affections de longue durée ont été critiquées sans pour autant que soit proposée de solution. C’est dans ce contexte qu’a été décidée la dernière mesure, qui frappe près d’un million de personnes et particulièrement ceux qui, en dépit de la couverture maladie universelle complémentaire, des mutuelles ou des assurances complémentaires, sont en dehors du système. Il est toujours difficile de trouver une solution à deux problèmes différents, mais celle-ci est inacceptable. Comment un ministre, sortant de son rôle, peut-il commettre un tel contresens ? C’est un dysfonctionnement typique de notre organisation.
Parce que je me bats contre l’hypertension depuis 1973 et que des confrères m’ont demandé mon aide, j’ai écrit des articles très critiques. Il est notoire que, l’an prochain, la nouvelle majorité politique, quelle qu’elle soit, sera confrontée à un manque de moyens financiers. Il faudra prendre des décisions. Quand une pathologie est à l’origine de 35 millions de consultations par an, qui coûtent en tout 5 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 5 autres milliards d’euros d’examens, peut-on diminuer de 10 % les sommes qui lui sont allouées ? Certes, des solutions existent, mais elles supposent de supprimer d’autres dépenses. Reste à savoir comment l’expliquer aux professionnels concernés.
M. le rapporteur. Nous connaissons bien le problème. Nul besoin d’être spécialiste pour savoir que l’hypertension artérielle non soignée entraîne des complications au niveau des yeux, des reins ou du cœur. Si la décision est uniquement économique, son résultat est douteux. Qui l’a prise ? N’y a-t-il eu aucune coordination avec l’assurance maladie et les complémentaires santé ?
M. Joël Ménard. Je n’ai pas envie d’essayer de trouver le coupable.
M. le coprésident Pierre Morange. Cela permettrait pourtant de ne pas commettre deux fois la même erreur !
M. Joël Ménard. Voyons plutôt comment il faudrait procéder. Les représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’État doivent s’entendre, ce qui n’était pas le cas, jadis, entre M. Gilles Johanet et Mme Martine Aubry. Face à une telle question, j’aurais évité de prendre une décision immédiatement et j’aurais réuni autour de la table les partenaires concernés, sans oublier les associations de malades, très présentes aujourd’hui. J’imagine qu’on serait parvenu à la solution à laquelle on aboutira le 31 mars. Il faut actualiser le profil de l’hypertension sévère, en retenant les seuils 180/110, que viennent d’adopter les États-Unis. En France, 450 000 personnes seraient concernées.
En même temps, il faut travailler sur les génériques. Par rapport à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, nous avons mené depuis dix ans une politique désastreuse. En 2010, nous avons dépensé 1,7 milliard d’euros, contre 0,8 milliard d’euros en Angleterre, pour le même nombre d’unités de médicaments, prescrits dans les mêmes quantités. Seules les politiques de santé divergent, les Britanniques ou les Allemands ayant anticipé la situation, ce que nous n’avons pas su faire.
Je n’ignore pas certaines objections. Préconiser les génériques, c’est s’aliéner les pharmaciens. Pour traiter un hypertendu, un médecin a besoin d’une vingtaine de médicaments, alors qu’il existe 390 génériques, pour 120 médicaments. Comment garantir la sécurité des malades quand, à partir des 20 molécules nécessaires, il y a 390 possibilités de médicaments ? Je n’ai pas de solution, mais celle qu’on nous propose, coûteuse pour la nation, ne convient ni aux malades ni aux médecins.
M. Gérard Bapt. La semaine dernière, M. Gilles Johanet m’a assuré, au cours d’un dîner-débat, que le prix du médicament, princeps et générique, n’est pas plus élevé en France qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, alors que, selon certaines publications, leur prix varierait du simple au double. Il serait nécessaire d’y voir plus clair.
La multiplication du nombre de génériques pour une seule molécule découle des règles de la concurrence. Si l’on en croit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le ministre s’oriente vers la procédure des appels d’offres, sachant que les pharmaciens, qui perçoivent des marges arrière, sont très sollicités par les génériqueurs.
Auditionné dans le cadre de la mission sur le Mediator et la pharmacovigilance, créée après l’affaire du Mediator, M. Philippe Even a souligné que la règle de normalité du cholestérol avait été abaissée, permettant d’élargir le champ des prescriptions des statines, même si elles s’avèrent peu efficaces en prévention primaire et qu’elles produisent de graves effets indésirables. Si, à l’époque où je faisais mes études, on admettait que la tension augmentait progressivement en fonction de l’âge, la définition de la normalité a baissé, elle aussi. À cet égard, quelle est la position du Haut Conseil de la santé publique, dont la gestion ne peut éviter d’éventuels conflits d’intérêts ?
M. Joël Ménard. Vos propos, pertinents au début, sont devenus désagréables à la fin : je commencerai par la fin, afin de rester sur l’agréable. (Sourires.)
Tout envisager à travers l’affaire du Mediator n’a aucun sens.
M. Gérard Bapt. Les problèmes qui lui sont liés ne sont toujours pas réglés.
M. Joël Ménard. Certes, mais certains raisonnements sont désastreux.
M. Gérard Bapt. Nous avons auditionné le professeur Philippe Even il y a quelques mois, mais il pourrait tenir les mêmes propos aujourd’hui.
M. le rapporteur. Selon le professeur Hubert Allemand, c’est l’industrie du médicament qui exerce une pression au niveau mondial pour faire baisser les normes. Le même problème se pose d’ailleurs pour le diabète. Qui peut, selon vous, définir le niveau de la norme qui détermine le dosage des médicaments ?
M. Joël Ménard. Lorsque, en 1985, mes étudiants m’interrogeaient sur la norme de la tension, je leur répondais : 160/95 pour la sécurité sociale et 110/70 pour l’industrie. En cette matière, il n’existe pas de formule idéale mais la norme doit résulter d’un consensus.
Reste à savoir si ce consensus peut être biaisé, en particulier par les industriels. La baisse des normes a en réalité trois causes. La première est la tendance naturelle du corps médical à l’exagération : voyez Knock. En toute bonne foi, les médecins surestiment les risques des maladies et sous-estiment ceux des traitements.
Ensuite, les épidémiologistes, qui n’ont pas affaire aux malades mais travaillent sur des chiffres, lient l’espérance de vie au niveau de la tension ou du cholestérol. Ils ont établi dans les années 1980, pour l’essentiel à partir des données de Framingham, un modèle fondé sur les 10 % de la population qui leur semblent avoir le profil cardiovasculaire idéal. Or, si l’on ne parvient pas à atteindre cet idéal par l’alimentation ou les exercices physiques, on préconise le recours aux médicaments.
La troisième cause vient en effet de l’industrie. Si les experts sont soumis à des conflits d’intérêts, je dois être à vos yeux, monsieur Gérard Bapt, celui qui l’est le plus ! J’ai en effet commencé ma carrière en 1969 et dirigé l’entreprise Ciba-Geigy pendant trois ans et demi, à Bâle. De tels soupçons me font pourtant sourire : de 1970 jusqu’à aujourd’hui, mes comptes sont restés transparents ; par ailleurs, j’ai toujours refusé de travailler sur les dossiers liés à l’hypertension, étant un spécialiste en ce domaine. Du coup, et bien que je connaisse les statines et les prescrive à mes patients, on m’a fait observer, lors d’une réunion en 1992 ou 1993 consacrée à la pravastatine, que l’on ne suivrait pas mes observations car je n’étais pas considéré comme un expert. Les experts qui sont aussi des praticiens sont soupçonnés de conflits d’intérêts, et les autres, qui ont une connaissance plus théorique, ne sont pas reconnus en tant que tels ; dans les deux cas, on est exclu du système.
Le prix des médicaments peut dépendre de la dose, auquel cas il est dit linéaire, soit rester fixe, auquel cas on parle de prix plateau. Pour le prix linéaire, la tricherie est la règle. Les études préconisent volontairement un faible dosage au départ, que l’on augmente par la suite, de sorte que le nombre de comprimés prescrits est multiplié d’autant. Une vraie politique de santé publique voudrait que l’on ajuste la dose en fonction du malade. Pour la pravastatine, le dosage initial était de 20 milligrammes ; mais, après l’étude WOSCOPS - West of Scotland Coronary Prevention Study –, qui avait fixé la dose utile à 40 milligrammes, les patients se sont vu prescrire deux comprimés au lieu d’un.
À la demande de la direction générale de la santé, j’ai rédigé un rapport sur les statines en 2005 et, avec l’appui de Mme Blum-Goisgard, de la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, je me suis opposé aux conceptions du professeur Hubert Allemand sur ces médicaments. Sans trancher sur les statines – une telle décision revient en fin de compte à la population –, je me suis borné à indiquer que la prise systématique d’un comprimé, à titre préventif, pourrait présenter un bénéfice-risque favorable pour un homme âgé de cinquante à soixante ans. Si l’on ne peut formellement recommander un tel traitement, on peut le proposer individuellement aux patients.
M. le rapporteur. Quelle est la place de la prévention dans le cadre du plan Alzheimer ?
M. Joël Ménard. Il est difficile de répondre d’une manière générale. La prévention doit intervenir à tous les âges de la vie, dès la grossesse et la petite enfance : les personnes ayant un haut niveau d’éducation et de culture déclarent en moyenne la maladie plus tardivement. La politique de prévention dans le domaine cardiovasculaire est positive, même si l’on ne peut réduire la maladie d’Alzheimer aux facteurs cardiovasculaires. Avec mes collègues de Bordeaux, je travaille à des projections pour voir si l’absence de pathologie cardiovasculaire retarderait l’apparition de cette maladie. Le concept essentiel, cependant, reste celui de la prévention durant la vie entière.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur le professeur, je vous remercie.
*
Audition de Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, et M. Dominique Royère, chef du pôle Stratégie procréation, embryologie et génétique humaine à la direction médicale et scientifique.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Votre audition doit nous permettre d’aborder la façon dont la médecine prédictive peut contribuer à la prévention.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine. La manière générale dont les médias présentent la médecine prédictive est source de confusions entre le prédictif proprement dit, qui correspond à l’appréciation d’un léger sur-risque, et ce que l’on pourrait dénommer la génétique récréative, à savoir la susceptibilité à différents agents, laquelle n’a aucune utilité en termes de santé publique.
Si l’on excepte les aspects anténataux, la médecine prédictive concerne des personnes porteuses de gènes entraînant, de façon certaine, une pathologie à déclaration tardive. Les tests de susceptibilité, eux, reposent sur l’appréciation des antécédents familiaux.
Tout autre est la pharmacogénétique : elle consiste à tester un traitement sur un patient qui présente certaines caractéristiques génétiques, mais qui n’a déclaré aucun symptôme de maladie génétique ; ce test a précédé, par exemple, l’autorisation de mise sur le marché de la molécule traitant l’hépatite. Une telle démarche permet d’optimiser l’efficacité d’un traitement ou d’en limiter la nocivité.
Si toutes les maladies rares ne sont pas génétiques, la quasi-totalité des maladies génétiques sont rares. En ce domaine, la médecine prédictive, hormis les tests de prédisposition, concerne donc peu de monde. Néanmoins les maladies génétiques sont souvent graves ; elles supposent donc des dépenses lourdes.
La pharmacogénétique, qui porte essentiellement sur les cancers, est en plein essor ; elle permet d’apprécier les différents traitements à partir des caractéristiques génétiques du patient ou de sa maladie.
M. Dominique Royère, chef du pôle Stratégie procréation, embryologie et génétique humaine à la direction médicale et scientifique de l’Agence de la biomédecine. En matière de tests génétiques, la médecine prédictive peut s’envisager à partir des patients ou des tests eux-mêmes. Les tests ont un intérêt pour le patient, qu’il soit asymptomatique ou symptomatique, ou pour sa parentèle ; ils peuvent aussi apporter une information sur une prédisposition génétique, qu’elle soit avérée pour l’individu ou statistique par rapport à la population.
Je prendrai deux exemples de maladies asymptomatiques à déclaration tardive, et dont le diagnostic est certain. Le premier est celui de la chorée de Huntington, destruction de cellules neuronales qui entraîne de terribles souffrances mais ne fait l’objet d’aucune prise en charge. La médecine prédictive peut rendre des services en évaluant les risques pour la descendance du patient.
Le second exemple est celui de la maladie de Steinert, dystrophie musculaire dont la détection précoce s’avère très utile, car cette maladie peut s’accompagner de troubles cardiaques.
La détection des maladies asymptomatiques peut aussi avoir un réel intérêt pour la parentèle. Le cas le plus typique, dans l’hypothèse d’une prédisposition avérée, est celui de gènes associés à des cancers tels que BRCA1 et BRCA 2 pour le cancer du sein, par exemple. Ainsi, une femme porteuse du gène BRCA1 a entre 40 % et 85 % de risque de déclarer un cancer du sein et entre 10 % et 63 % de déclarer un cancer des ovaires, contre, respectivement, 10 % et 1 % pour l’ensemble de la population. Ces variations s’expliquent par l’histoire familiale, dans la mesure où le risque augmente de génération en génération ; par conséquent, plus l’antécédent est ancien dans la famille, plus les actes de chirurgie prophylactique doivent intervenir tôt. Si un système d’information recensant les personnes porteuses de tel ou tel gène peut être utile, l’essentiel est d’apprécier cette information au regard de l’histoire familiale.
La prédisposition génétique peut aussi reposer sur une évaluation statistique par rapport à la population ; c’est l’objet des tests génétiques sur internet. Les maladies concernées – insuffisance coronarienne, diabète ou hypertension – sont fréquentes ; l’essor des nouvelles technologies a permis de les associer à certains marqueurs, dits SNP – Single Nucleotid Polymorphism. Reste que cette information, purement statistique, ne contribue qu’à hauteur de 10 % à l’explication de la pathologie chez un individu.
Pour les patients symptomatiques, les tests peuvent avoir un intérêt direct ; on l’a vu avec les gènes BRCA1 et BRCA2, dont la détection permet une prise en charge plus précoce, et aura un impact sur les conduites à tenir. Cependant, si le gène n’est pas détecté chez un patient mais qu’il est présent dans sa famille, c’est probablement que la pathologie est liée à un autre gène, si bien qu’il faudra prendre les mêmes précautions.
S’agissant de la pharmacogénétique, on a cité l’exemple de l’hépatite C, qui implique le gène IL28B, et du traitement à l’interféron alpha. Celui-ci n’est efficace que pour les patients ayant un certain profil génétique ; pour les autres, non seulement il sera inefficace, mais il engendrera des effets secondaires. De même, le tamoxifène, molécule anti-œstrogène proposée pour le traitement du cancer du sein, n’est réellement efficace que s’il est associé au variant CYP2D6. On pourrait prendre bien d’autres exemples, tels que le Plavix ou la warfarine, voire, pour le cancer du sein évolutif, l’herceptine, autrement dit le trastuzumab, lequel n’a d’intérêt thérapeutique qu’en présence de certains variants. Dans tous les cas, ces informations améliorent donc la pertinence du traitement.
Les tests ont aussi un intérêt pour la parentèle des patients symptomatiques, comme on l’a vu avec le BRCA1. On peut aussi prendre l’exemple du cancer colorectal, lié, dans 3 % des cas, au syndrome de Lynch : la présence de ce syndrome chez un patient indique que, pour sa parentèle, le risque de développer le même cancer avant l’âge de soixante-dix ans est d’environ 45 %. On conçoit l’intérêt de ce type d’information pour l’approche préventive.
Il convient donc de distinguer entre risque statistique et risque individuel, l’impact du dépistage pour le patient et pour sa parentèle. Par ailleurs, certains dépistages à valeur purement statistique n’ont guère de portée en termes de prévention sanitaire : ils relèvent de la « génétique récréative », pour paraphraser Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, ou de la « génomancie ». Je passe enfin sur l’exploitation de ces tests, c’est-à-dire sur l’aspect commercial, qui touche à la liberté individuelle.
Les tests génétiques vont faire l’objet de validations successives. L’an dernier, l’administration américaine a ainsi recueilli des prélèvements issus de tests proposés sur internet. Certains résultats se sont révélés fantaisistes.
En plus de cette validation analytique, il faut une validation clinique, qui détermine le niveau de prédictibilité : en quoi la présence de tel ou tel marqueur chez un individu l’expose-t-il à un risque par rapport au reste de la population ?
À un troisième niveau se pose la question de l’utilité clinique du test, c’est-à-dire de sa plus-value.
La présence d’un certain marqueur sur le chromosome 9 conduirait, par exemple, à un risque d’infarctus de 1,68 contre 1,52 pour le reste de la population. Un tel dépistage n’a pas de sens : il vaut mieux étudier l’histoire familiale et appliquer des mesures de prévention.
En dernier lieu, il convient d’examiner le rapport entre le coût du test et le bénéfice attendu. On ne considère pas seulement l’efficacité ou l’efficience du dépistage, mais aussi son intérêt en matière de survie et de qualité de survie – on s’intéresse aussi bien à la mortalité qu’à la morbidité.
M. le rapporteur. Qu’en est-il du diagnostic anténatal dans le cadre des lois de bioéthique et de la prévention des maladies dont les gènes associés sont connus ? Je pense en particulier au cancer du sein et à l’hémochromatose.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. La loi de bioéthique ouvre deux possibilités, lesquelles concernent des populations et des cas différents.
Il y a, tout d’abord, les diagnostics préimplantatoires réalisés après une fécondation in vitro : on prélève une cellule sur l’embryon pour dépister une maladie grave, incurable et mortelle que les parents ont déjà transmise à un enfant ou qu’ils sont susceptibles de transmettre. Ce sont des maladies à transmission héréditaire qui sont concernées, et non des mutations de novo – je rappelle que la trisomie résulte, la plupart du temps, d’une mutation. Selon la volonté des parents, les embryons porteurs de la maladie sont détruits ou donnés à la recherche ; les autres pourront être implantés. Seuls quelques centaines de couples sont concernés chaque année par ce dispositif, pour une cinquantaine de naissances in fine.
Le contexte du diagnostic prénatal est un peu différent : il fait suite à un acte d’imagerie médicale ou à un examen bactériologique laissant penser qu’il existe un risque. En ce qui concerne la trisomie 21, on propose systématiquement un dépistage qui fait appel à des examens biologiques et échographiques pour mesurer le risque. S’il est « majoré », un diagnostic peut être réalisé. L’an dernier, 650 000 femmes ont fait un dépistage sur un total de 830 000 potentiellement concernées, certaines d’entre elles y ayant renoncé. Le diagnostic est ensuite invasif, car il s’agit d’une ponction permettant la réalisation du caryotype. Environ 35 000 femmes ont été orientées vers les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, seuls habilités à délivrer une attestation autorisant une interruption médicale de grossesse – 6 000 attestations sont délivrées chaque année. Dans les autres cas, des gestes de prévention ont été réalisés pendant la grossesse – on peut traiter le fœtus ou la mère – ou juste après la naissance.
La plupart du temps, ce ne sont pas des maladies génétiques que l’on identifie dans ce cadre, mais des malformations telles qu’une transposition simple des gros vaisseaux, une absence de paroi abdominale ou un syndrome « transfuseur-transfusé ». On peut intervenir in utero en réalisant des actes de prévention pour permettre la naissance d’enfants sains au lieu d’une interruption spontanée de la grossesse ou de la naissance d’enfants lourdement handicapés.
À ces deux dispositifs s’ajoute le dépistage néonatal, qui n’entre pas aujourd’hui dans la sphère de compétence de l’Agence de la biomédecine. Cinq tests sont effectués d’office pour dépister des maladies extrêmement graves, pouvant conduire à des handicaps mentaux très sévères, mais susceptibles d’être prévenus par un simple régime.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous revenir sur le taux de trisomie préalablement au dépistage ? Quelle est l’incidence de ce dernier ?
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. Ce dépistage a lieu depuis plus de vingt ans, mais nous n’avons pas de statistiques systématiques.
M. Dominique Royère. Les méthodes ont évolué : le dépistage et le diagnostic ont longtemps été réservés aux femmes de plus de trente-huit ans, avant l’adoption du dosage des marqueurs sériques du deuxième trimestre. En raison de l’insuffisante sensibilité de ce test, on a ensuite multiplié les gestes invasifs, avec une efficacité en réalité modeste. Des femmes s’inquiétaient beaucoup de devoir réaliser une amniocentèse, alors que la probabilité de trisomie 21 était inférieure à 10 %. Depuis quelques années, il existe un nouveau procédé de dépistage reposant à la fois sur le dosage des marqueurs sériques du premier trimestre et sur une échographie, laquelle permet notamment de mesurer la clarté nucale. L’objectif n’est pas de découvrir davantage de cas, mais de réduire les gestes invasifs en améliorant la sensibilité de détection. Cet objectif a vraisemblablement été atteint, car le nombre d’amniocentèses a diminué de 30 % ou 40 % en 2010. Il reste à vérifier que la capacité de détection n’a pas changé.
Je précise, par ailleurs, que les 74 000 examens cytogénétiques réalisés chaque année ne concernent pas tous le dépistage de la trisomie 21.
Outre les décisions d’interruption de la grossesse à la suite d’anomalies majeures, le diagnostic prénatal peut conduire à des mesures de prévention. La possibilité de connaître très tôt le rhésus permet notamment d’éviter les incompatibilités sanguines fœto-maternelles : on peut réaliser des transfusions in utero et empêcher la fabrication d’anticorps par la mère. La découverte de maladies métaboliques telle qu’un déficit d’ornithine carbamyl transférase, enzyme intervenant dans le métabolisme des protéines, conduit également à des mesures préventives : un régime alimentaire normal serait toxique pour le cerveau et pourrait nuire au développement psychomoteur de l’enfant.
M. le rapporteur. Dans quels cas réalise-t-on le test ?
M. Dominique Royère. Tout dépend du contexte, notamment de l’histoire familiale. Pour ce qui est du dépistage néonatal, les tests dépendent de la fréquence des anomalies attendues : s’il fallait dépister toutes les maladies rares – on en compte entre 6 000 et 7 000 en France –, le coût serait supérieur au budget de la sécurité sociale.
Mme Bérengère Poletti. La surdité constitue une anomalie pour certains et une identité culturelle pour d’autres. Nous nous sommes ainsi interrogés sur la mise en place d’un dépistage néonatal et sur l’action, médicale ou non, à adopter. Quel regard portez-vous sur ces deux questions ?
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. La surdité peut résulter d’une altération du génome. Considérer un variant génétique ou une mutation comme une anomalie, dans la mesure où l’on s’écarte de la normalité, ne revient pas à porter un jugement. On ne dit pas que les porteurs de l’anomalie doivent suivre tel ou tel traitement.
Quel que soit le dépistage, les parents doivent être informés et leur consentement recueilli : cela relève de l’autorité parentale. Le dépistage et le traitement d’une maladie ne peuvent être imposés par les pouvoirs publics que dans certains cas, tel celui de l’hyperplasie congénitale des surrénales, une des cinq maladies concernées par le dépistage néonatal : l’enfant risque de mourir ou de souffrir d’un handicap mental profond si son régime alimentaire n’est pas adapté. Pour la plupart des autres maladies, la stratégie médicale résulte d’un dialogue entre les professionnels de santé et les parents.
Mme Bérengère Poletti. Les parents sourds d’un enfant lui aussi atteint de surdité partagent un même environnement. Ils peuvent donc lui offrir toutes les possibilités de développement et d’insertion au sein de la société. Or, ce n’est pas le cas des parents non sourds. En l’absence de dépistage et de traitement, leurs enfants risquent de souffrir de retards mentaux très importants.
M. Dominique Royère. Il y a la question de la disponibilité du test, et celle de sa performance : le dépistage doit être fiable et relativement simple. Puis son coût doit être évalué au regard de son rendement social, lequel dépend du nombre de personnes concernées. C’est pourquoi, par exemple, le dépistage et la prise en charge précoce de l’hypothyroïdie congénitale présentent un intérêt considérable.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. La médecine prédictive fait partie de la médecine. Il faut donc préserver la notion de consentement aux soins, pour soi comme pour ses enfants. Quand un dispositif est rendu obligatoire, il faut mesurer l’atteinte aux libertés fondamentales que cela implique et mettre en balance la nécessité de santé publique et l’atteinte aux libertés.
Dans le cas de la surdité, l’avenir de l’enfant est en jeu, de même que son insertion sociale. C’est aux pouvoirs publics de se prononcer. Quel que soit le bénéfice attendu d’un dispositif, les professionnels de santé ne doivent pas oublier que les patients ont la liberté de ne pas se soigner, de ne pas savoir et de ne pas soigner leurs enfants – dans la limite du raisonnable, le procureur de la République pouvant intervenir en cas de mise en danger d’autrui.
S’agissant des maladies génétiques, l’information peut être utile pour les descendants, mais c’est beaucoup moins vrai quand il n’est question que de soi ou quand il n’existe pas d’arsenal thérapeutique. Si votre père ou votre oncle est mort de démence à l’âge de quarante ans, vous pouvez souhaiter vous organiser en conséquence, mais vous avez aussi le droit absolu de ne pas savoir. Si des soins sont possibles pour les proches, le législateur a souhaité, en revanche, que l’on fasse tout pour qu’ils soient avertis.
M. le rapporteur. Quand il n’existe pas de traitement, le diagnostic d’une maladie ne peut que susciter de l’angoisse. La situation est un peu différente lorsqu’il peut y avoir des conséquences pour la parentèle : le diagnostic est susceptible d’éviter l’apparition de la maladie.
S’agissant de l’hémochromatose, il existe un diagnostic et un traitement peu intrusif permettant d’éviter les complications hépatiques et cardiaques. La question est de savoir à qui l’on fait passer le test.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. L’hémochromatose est un cas d’école : le dépistage fait appel à toute la sophistication de la génétique et, quand le résultat est positif, le traitement repose sur une technique en vogue au XVIIe siècle – mais en l’occurrence très efficace –, la saignée.
Le problème est celui de la prescription, dont la fréquence a connu une progression foudroyante depuis que le test a été inscrit dans la nomenclature. On observe d’ailleurs le même phénomène s’agissant de la thrombophilie non rare : près de 40 % des tests génétiques moléculaires effectués en France sont afférents à ces deux maladies. Or, nous sommes convaincus qu’une grande partie de ces prescriptions est inutile. Ces tests font donc courir, nous le pressentons, un grand risque pour les finances publiques.
Les tests de génétique moléculaire permettent de diagnostiquer des maladies génétiques rares, mais graves. Cependant, s’ils sont prescrits trop largement sous prétexte qu’ils sont très efficaces et qu’un traitement correspondant est disponible, nous irons devant de graves difficultés sur le plan financier. La pression augmente avec la progression des techniques. Certes, les puces à ADN, les tests permettant de repérer un SNP (single nucleotide polymorphisme) ne sont pas coûteux à l’unité. Mais leur banalisation, elle, le serait, surtout si l’acte n’a aucune utilité clinique et ne sert qu’à rassurer.
M. Dominique Royère. Je ferai deux remarques complémentaires, l’une concernant l’offre de soins, l’autre sur les conséquences d’une prescription non sélective.
On le voit avec le développement du schéma régional d’organisation des soins : en matière de génétique, la réflexion menée actuellement en liaison avec la direction générale de l’offre de soins porte non seulement sur l’aptitude de tel laboratoire à procéder à tel examen, mais aussi sur la nécessité de replacer le patient au centre du dispositif. Entre le patient et le laboratoire se trouve le médecin : ce dernier doit non seulement prescrire de façon pertinente et au bon moment, mais aussi rendre compte au patient du résultat et de la façon dont on peut l’interpréter. Le niveau de compétence nécessaire pour satisfaire à ces deux exigences est un élément crucial à prendre en compte lors du maillage du territoire.
S’agissant des conséquences financières d’une prescription non sélective, le groupe de travail chargé de réfléchir, aux États-Unis, à la mise en pratique des tests génétiques et à leur intérêt clinique a réalisé une évaluation très précise du rapport coût-bénéfice de la détection de la mutation à l’origine du syndrome de Lynch, compte tenu du risque de cancer colorectal. Or, ce rapport est vingt fois plus favorable quand la prescription s’appuie sur la connaissance du contexte – âge, histoire familiale – que lorsque l’examen est prescrit de façon systématique : le coût est de 10 000 dollars dans le premier cas, mais de 260 000 dollars dans le second. S’agissant de l’hémochromatose, une analyse du rapport coût-efficacité aboutirait probablement à des résultats similaires : celui-ci est bien meilleur quand la prescription n’est pas réalisée de façon aveugle, mais guidée par un contexte.
M. le rapporteur. L’inscription du dépistage de l’hémochromatose dans la nomenclature a permis d’en autoriser le remboursement. Le problème est de le prescrire à bon escient, ce qui relève de la responsabilité du médecin et de la Haute Autorité de santé, et nécessite un contrôle des bonnes pratiques.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. Le problème va se poser de façon aiguë pour la pharmacogénétique. Certes, des marqueurs peuvent permettre de déterminer si un traitement sera efficace ou au contraire toxique pour le patient. Mais cette relation n’est pas toujours aussi claire. Or, de plus en plus, des firmes pharmaceutiques proposent des molécules associées à un outil diagnostique de recherche de marqueur, si bien qu’au lieu de rembourser seulement le coût de la molécule, la sécurité sociale en vient à rembourser également le coût du développement du marqueur. Cela semble pertinent si on a la certitude que le traitement est inefficace en l’absence de marqueur – comme dans le cas de l’hépatite C –, car on ne prescrit alors le traitement qu’aux gens qui en tireront bénéfice. Mais le caractère systématique de la recherche de marqueurs et la facilité à les mettre en évidence ont, en l’absence de validation, quelque chose d’assez inquiétant. Une réflexion s’impose, non seulement dans notre pays mais au niveau mondial, sur l’opportunité de généraliser le lien entre prescription et recherche génétique. Dans le cas contraire, il en résulterait un surcoût dont ni les patients ni les comptes de la sécurité sociale ne pourraient tirer le moindre bénéfice.
M. le rapporteur. Il faut distinguer les marqueurs s’attachant à la personne et ceux qui sont liés à une tumeur.
Mme Emmanuelle Prada-Bordenave. Mes propos ne concernaient pas l’oncogénétique.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci pour ces réponses précises.
*
Audition de M. Jean-Claude Étienne, rapporteur de l’avis du Conseil économique, social et environnemental relatif aux enjeux de la prévention en matière de santé.
M. le coprésident Pierre Morange. La communication de la Cour des comptes sur la prévention sanitaire a dénoncé le manque de coordination entre les organismes chargés de la prévention et l’absence de hiérarchisation des priorités en la matière. Quelle appréciation portez-vous à ce sujet ?
M. Jean-Claude Étienne, rapporteur de l’avis du Conseil économique, social et environnemental relatif aux enjeux de la prévention en matière de santé. Le rapport sur les enjeux de la prévention en matière de santé n’a pas encore été adopté par le Conseil économique, social et environnemental, ni même validé par les sections concernées ; je m’exprimerai donc à titre personnel.
La prévention rencontre beaucoup d’intérêt aujourd’hui : depuis trois ans, le sujet est à la mode. Pourtant, même si l’on sait a priori qu’elle coûte assez cher, les derniers chiffres disponibles, selon lesquels les dépenses en ce domaine s’élèvent à 10,5 milliards d’euros, soit 0,6 % du produit intérieur brut et 6,4 % des dépenses de santé, datent de dix ans. Du point de vue financier, les données précises manquent donc, d’autant plus que prévention et soin s’entremêlent souvent.
Dans son communiqué du 29 septembre relatif à la programmation de ses travaux, la MECSS ne s’est pas contentée de citer l’Organisation mondiale de la santé pour définir la prévention sanitaire – « l’ensemble des mesures prises pour éviter l’apparition, le développement ou la complication d’une maladie » ; elle a aussi rappelé la coexistence de deux approches, l’une centrée sur les pathologies et l’autre sur les populations. Or ce dernier aspect est fondamental et reste négligé par beaucoup de ceux qui écrivent sur le sujet.
Il existe en effet en France un travers culturel que d’autres pays comme la Grande-Bretagne, les pays scandinaves ou certains Länder allemands ne connaissent pas dans la même mesure : pour les professionnels de santé comme pour le reste de la population, c’est la maladie qu’il faut guérir, en particulier dans ses manifestations les plus aiguës. Or la courbe exprimant l’investissement financier en fonction de l’âge montre bien que les dépenses de santé culminent dans les dernières années de la vie. La prévention – et notamment la prévention primaire – doit intervenir avant, au moment où cela coûte le moins. Financièrement parlant, il convient de séparer le bon grain, ce que l’on dépense en faveur de la prévention primaire, de l’ivraie, c’est-à-dire du désordre des autres dépenses de prévention – préventions secondaire, tertiaire, et même quaternaire, contre la surmédicalisation –, qui se mêlent aux dépenses consacrées aux soins. Tant que l’on n’aura pas effectué cette séparation, on ne pourra pas estimer le coût de la prévention.
Que cette dépense soit ou non équivalente à ce qu’elle était il y a dix ans, j’ai le sentiment qu’elle pourrait être plus efficace. Avant de se préoccuper de nouveaux moyens de financement, il importe donc de chercher des solutions pratiques, concrètes, simples et pas nécessairement très coûteuses qui permettraient d’être plus efficient. Nos résultats ne sont certes pas mauvais, mais ils sont loin d’égaler ceux qu’obtiennent certains pays européens à niveau de développement comparable. Cela tient à cette culture du « tout curatif » qui imprègne notre pays : être soignant, c’est d’abord soigner un malade.
Désormais, nos concitoyens, avec raison, demandent à la collectivité de les accompagner afin qu’ils restent en bonne santé : c’est le champ de la prévention. Même si les assurances qu’elle peut procurer sont encore scientifiquement incertaines, certaines pistes sont déjà reconnues comme très prometteuses.
Je ne peux donc qu’approuver les dix préconisations formulées par la Cour des comptes. Mais si l’on s’en tient à ces mesures, nous n’aurons encore effectué qu’une petite partie du chemin. Il reste à décliner concrètement, dans la vie de nos concitoyens, l’action de prévention, notamment primaire, même sans la certitude d’obtenir des résultats immédiatement tangibles. La prévention, surtout primaire, est comme le placement or : coûteux au début, mais rentable ultérieurement. Le retour sur investissement apparaît lorsque l’on passe au versant curatif. C’est pourquoi j’appellerai dans mon rapport à rechercher la meilleure utilisation possible des fonds actuellement consacrés à la prévention primaire.
Dans un pays préoccupé avant tout par la performance des technologies curatives, il convient en premier lieu de diffuser une culture de prévention. Mais nous n’obtiendrons rien de nos concitoyens si nous cherchons à leur imposer des préconisations trop éloignées de la vie courante. Je souscris donc à la notion de prévention tout au long de la vie, en commençant dès l’âge scolaire. Ainsi, en matière de consommation de tabac, les enfants du cours moyen sont les meilleurs vecteurs de prévention. Celle-ci doit par conséquent dépasser le cadre trop étroit du ministère de la santé et associer l’Éducation nationale. Pour l’instant, la prévention n’apparaît pas dans les programmes scolaires relatifs aux sciences et techniques de la vie, alors qu’à l’époque de mon grand-père, instituteur de campagne, les manuels donnaient des règles d’hygiène. Or les jeunes élèves ne peuvent se contenter de disséquer le muscle gastrocnémien chez la grenouille ; ils doivent également diffuser une culture de prévention auprès de leurs aînés.
De même, chaque étape de la vie mérite de bénéficier d’un relais en matière de prévention. Alors que celle-ci se décline aujourd’hui de manière confuse à travers de nombreux programmes, il n’existe pas d’étape obligée permettant à un professionnel – de santé ou non – de dispenser des conseils en la matière.
J’ai examiné le programme de formation des aides-soignantes : la partie consacrée à la prévention, qu’elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, reste insuffisante. Elles pourraient pourtant jouer, à moindre coût, un plus grand rôle en ce domaine. D’une façon générale, la prévention doit être enseignée à tous ceux qui interviennent auprès de nos concitoyens en matière de santé. Toutes les catégories doivent être concernées et pas seulement les médecins. Ces derniers sont d’ailleurs ceux qui font le moins de prévention, car les personnes bien portantes, par définition, les consultent rarement. Quant aux autres, elles souhaitent avant tout guérir, et peu leur importe de savoir ce qui leur aurait permis d’éviter de tomber malade. De toute façon, le médecin n’a pas de temps de s’occuper d’autre chose que de soin.
Le résultat est que les contacts entre la population et les médecins se limitent à une action curative. Les contrats d’amélioration des pratiques individuelles pourraient permettre la diffusion d’une culture de prévention, mais celle-ci doit également occuper une plus grande place dans la formation des médecins ou des infirmières ; ainsi, dans les questions d’internat, la prévention tient en deux lignes sur un total de quinze pages. Pourtant, former à la prévention l’ensemble des professionnels de santé et en diffuser la culture auprès des associations ne seraient pas coûteux, à la différence des messages de prévention pour lesquels on dépense aujourd’hui des sommes considérables sans en évaluer correctement l’efficacité !
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse à ce propos. Pour tester la pertinence de ces messages, il suffirait d’utiliser l’imagerie par résonance magnétique qui renseigne sur leur mémorisation ! La mention « Fumer tue », apposée sur les paquets de cigarette, n’a absolument pas fait diminuer le tabagisme. En revanche, les informations selon lesquelles la fumée du tabac peut rendre malade son entourage, en particulier les enfants, ou encore selon lesquelles les spermatozoïdes sont beaucoup moins mobiles chez les fumeurs, ont un réel impact sur la population. L’approche cognitive préalable que permet cette imagerie par résonance magnétique, et dont le coût est beaucoup moins élevé qu’une enquête de résultats réalisée au bout de deux ou trois ans, permet de donner une consistance objective à ces observations. D’ailleurs, cette approche scientifique moderne est en usage chez certains de nos voisins.
Je suis favorable à la mise en place de quatre visites de prévention, une à chaque grande étape de la vie. La première, pour les enfants, serait celle qui est déjà assurée par la protection maternelle et infantile des départements. La deuxième concernerait les jeunes étudiants et les apprentis. La troisième devrait être effectuée par la médecine du travail, à l’entrée dans la vie professionnelle. Les visites périodiques de prévention obligatoires pour les entreprises, selon le code de la santé publique, ne sont malheureusement réalisées qu’à raison d’une sur trois aujourd’hui ! Enfin, la quatrième visite – ô combien utile – doit se faire au moment de la retraite. Dernièrement, j’ai reçu en consultation à l’hôpital un retraité qui ressentait une douleur au pli de l’aine : il n’avait jamais eu de problèmes articulaires avant sa cessation d’activité et marchait quatre kilomètres chaque jour, comme le préconisent toutes sortes de publications. L’examen médical a révélé qu’il souffrait d’une coxarthrose, qu’une visite de prévention lui aurait épargnée en permettant de détecter une coxa valga et une coxa retrorsa, ce qui aurait conduit à prescrire le vélo ou la natation, mais surtout pas la marche à pied ! Combien de gonarthroses et de coxarthroses pourraient ainsi être évitées grâce à une visite de prévention autour de la soixantième année !
En outre, les résultats de ces visites devraient être consignés dans le carnet de santé ou, à défaut, dans un document renseigné par les professionnels de santé – pas seulement par les médecins – et que le patient conserverait toute sa vie. Le coût pour le budget de l’État ne serait pas important.
À ce propos, je me permets d’appeler votre attention sur le fait que le dossier médical personnel, pour lequel de gros investissements ont été réalisés, n’est toujours pas opérationnel : la prévention n’y est même pas formalisée et, des quatre régions dans lesquelles il est expérimenté, une seule a souhaité qu’on y remédie !
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique énumère 100 thèmes, dont certains se recoupent très largement ; ainsi la maladie d’Alzheimer y est citée trois fois, l’accident vasculaire cérébral deux fois. Or la prévention ne peut reposer sur « un inventaire à la Prévert », qui ne peut conduire à une politique budgétairement viable. Cette liste n’est d’ailleurs pas exhaustive puisqu’elle n’inclut aucun élément se rapportant à l’environnement et aux différentes étapes de la vie – si ce n’est une petite ligne sur la consultation préretraite et une autre sur les activités physiques et sportives.
Une des oppositions à la hiérarchisation des priorités de santé publique est la crainte qu’en cas d’effort consenti pour le cancer, les cardiaques ne se sentent lésés. Il faut sortir de cette ambiguïté, dénoncée par la Cour des comptes dans sa recommandation n° 8, car elle est coûteuse et contre-productive.
La hiérarchisation relève d’une décision politique. Tant qu’elle ne sera pas effectuée, la prévention primaire se révélera inefficace, sans compter que son évaluation budgétaire restera impossible. Une nouvelle loi de santé publique est aujourd’hui nécessaire afin de définir, non pas les priorités, mais la méthode à suivre pour déterminer celles-ci. Cette méthode devrait nous conduire à faire porter l’effort sur les maladies pour lesquelles n’existe pas de dispositif curatif et pour lesquelles la prévention primaire présenterait par conséquent le plus fort intérêt.
Ainsi que le montre la Cour des comptes, d’autres pays ont procédé à cette hiérarchisation, comme certains Länder allemands, mais aussi le Royaume-Uni qui a retenu quatre thématiques seulement : les maladies cardiovasculaires pour sauver 200 000 vies, les cancers pour en sauver 100 000, les accidents pour en sauver 12 000 et la santé mentale pour en sauver 4 000 – assorties d’indicateurs de suivi. Nous gagnerions beaucoup à nous inspirer de ces exemples, étant entendu qu’il conviendrait chez nous de faire prévaloir la prévention des cancers sur celle des maladies cardiovasculaires.
Au lieu de cela, on lance à grands frais un plan Alzheimer tandis que certains politiques soutiennent qu’une fois diagnostiquée, cette maladie évolue inéluctablement. Or la recherche clinique a montré, certes depuis un an et demi seulement, qu’il était possible de prévenir le changement de stade de la maladie. Ce serait donc une erreur dramatique que de porter l’effort sur les cas les plus graves et non sur les patients atteints au premier stade de la maladie ! C’est justement au moment du diagnostic que la prévention secondaire doit intervenir pour éviter une aggravation ! C’est donc à ce moment qu’il convient d’investir, d’autant que les scientifiques sont très loin d’avoir mis au point le médicament qui agira sur la corne de l’hippocampe, malgré les sommes consacrées à cette recherche ! Je ne préconise pas l’arrêt de la recherche médicamenteuse sur les maladies pour lesquelles il n’existe pas de procédure curative efficace ; mais je souligne que le seul levier dont nous disposons aujourd’hui est celui de la prévention primaire et secondaire.
Il faut non pas des financements supplémentaires, messieurs les parlementaires, mais une refonte du système, car il est possible de faire beaucoup mieux avec les moyens budgétaires actuels.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Quand pourrons-nous disposer du rapport du Conseil économique, social et environnemental ?
Comme l’a montré la Cour des comptes, de multiples acteurs interviennent dans le domaine de la prévention. Afin de remédier au défaut de pilotage, elle propose de donner au directeur général de la santé les compétences de délégué interministériel à la prévention sanitaire. Or comment ce dernier pourrait-il avoir autorité à la fois sur la médecine du travail, sur la médecine scolaire et sur tout ce qui relève de l’environnement, de l’agriculture et de la santé ? Que proposez-vous pour votre part ?
M. Jean-Claude Étienne. Notre rapport sera rendu public dès que nous aurons achevé de traiter du problème de la gouvernance. En la matière, je pense que la prévention doit cesser de relever du seul ministère de la santé, car elle relève de bien d’autres ministères : ceux de l’éducation nationale, du travail, du logement, de l’environnement ou encore des transports. À défaut, elle restera en déshérence.
Il nous faut une entité dédiée à la prévention, même si on ne peut la concevoir sans le soutien du ministère de la santé. J’aurai deux propositions à faire en ce sens.
Premièrement, le Comité d’animation du système d’agences devrait être davantage ouvert aux autres départements ministériels impliqués dans la prévention. Certes, c’est une instance de travail collectif, mais il est actuellement trop dépendant du ministère de la santé.
Deuxièmement, il faudrait créer une structure ad hoc comme dans certains Länder allemands qui se sont dotés, à côté d’un office de la santé, d’un office de la prévention, les deux collaborant. Une délégation interministérielle, dépendant directement du Premier ministre, permettrait d’assurer la participation des différents ministères intéressés, mais aussi de garantir le suivi des indicateurs de prévention indépendamment de celui des indicateurs de santé. Chaque ministère impliqué serait satisfait. On appliquerait pour la prévention ce que M. José Luis Rodriguez Zapatero voulait faire pour la santé quand il affirmait que tous ses ministres étaient des ministres de la santé et que ceux qui ne l’étaient pas encore devaient le devenir…
En revanche, si, comme certains le proposent, le directeur général de la santé animait un groupe « pluriministériel » mais que la prévention restait dans le seul giron du ministère de la santé, je doute fort que les choses évoluent favorablement.
En résumé, la prévention nécessite une approche pluridisciplinaire associant l’ensemble des acteurs éducatifs et sociaux et impliquant tous les ministères, chacun agissant dans son domaine respectif, sur des thématiques précises et hiérarchisées conformément à une méthode définie par le Parlement. Il ne s’agirait pas d’un bouleversement, mais d’une évolution à partir de l’existant, qui m’apparaît toutefois indispensable si l’on veut que les choses changent à l’avenir.
M. le rapporteur. La situation est complexe. D’une part, au niveau régional, où les agences de santé sont chargées à la fois du soin et de la prévention, il existe de fortes inégalités en matière de taux de suicide ou d’alcoolisme par exemple. Par ailleurs, la prévention doit inclure le dépistage : comment un délégué interministériel pourrait-il intervenir sur le dépistage du cancer de la prostate, par exemple ? Il nous faut trouver une solution viable…
M. Jean-Claude Étienne. Plusieurs directeurs d’agences régionales de santé m’ont interrogé sur ce point. Ils doivent en effet pour la première fois élaborer un document pour l’exercice 2012 sur cette thématique de la prévention. Ils disposent au demeurant d’un budget dédié. Or les exigences en matière de prévention diffèrent en effet considérablement d’une région à une autre. Selon nos préconisations, chaque agence régionale de santé aurait donc à décliner pour sa région les thématiques fondamentales, hiérarchisées qui seraient dotées financièrement au niveau national.
Il y a donc deux niveaux pour la prévention : un niveau national, qui nécessite une gouvernance regroupée, et un niveau local, qui doit être l’échelon régional, où la gouvernance relève de l’agence régionale de santé.
M. le rapporteur. Que devient dans ce cadre le Haut Conseil de la santé publique ?
M. Jean-Claude Étienne. Si vous acceptez le principe de la hiérarchisation, ce qui serait pour la prévention en France une révolution dont il vous reviendrait de prendre la responsabilité politique, le Haut Conseil de la santé publique et, peut-être, la Haute Autorité de santé auraient à définir la méthode permettant de l’appliquer. En effet, cette tâche ne relève pas des politiques, mais des experts en la matière que sont ces instances d’ailleurs constituées ad hoc.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions pour cette audition placée sous le signe de la pédagogie.
*
Audition de Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, chef de service à la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, Mme Mireille Jarry, sous-directrice des conditions de travail, et Mme Patricia Maladry, responsable de l’inspection médicale.
M. le coprésident Pierre Morange. Mesdames, vous savez que, dans sa communication sur la prévention sanitaire, la Cour des comptes a insisté, en même temps que sur le défaut de coordination et de hiérarchisation des objectifs de santé publique, sur la nécessité d’intégrer dans une politique ambitieuse de prévention la contribution de la médecine scolaire et de la médecine du travail. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous entendre.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Pas plus que l’Éducation nationale, en effet, la médecine du travail ne peut être ignorée d’une politique de prévention. La première question a trait à la gouvernance générale du système. Pour permettre aux ministères de la santé, de l’environnement, du travail ou encore de l’agriculture de collaborer, la Cour des comptes propose la nomination d’un délégué interministériel. Est-ce la bonne solution ? Quelle serait l’autorité de ce délégué interministériel vis-à-vis des ministères ?
Malgré la réforme de cet été, la médecine du travail est confrontée à un certain nombre de difficultés : les visites sont de plus en plus espacées et la démographie médicale est préoccupante. Comment établir un lien entre médecins traitants et médecins du travail pour prévenir, notamment, les maladies musculo-squelettiques ? Comment s’articulent la médecine du travail, la prévention et la prise en compte de l’environnement ?
Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, chef de service à la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Je vous prie d’excuser M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, retenu par une réunion de la Commission nationale de la négociation collective.
Le particularisme de la politique de la santé au travail par rapport aux autres politiques de santé publique tend à s’atténuer. Ainsi, au cours de la dernière décennie, nous avons nous aussi élaboré des plans – nous en sommes aujourd’hui à la deuxième génération, avec le plan Santé au travail 2010-2014. Cette politique n’en présente pas moins des spécificités, inhérentes à son ancrage dans le monde de l’entreprise. Ainsi deux acteurs y jouent un rôle important : l’entreprise et les partenaires sociaux, et, sur un sujet comme la prévention des troubles musculo-squelettiques – l’une des priorités de l’actuel plan Santé au travail –, l’action n’est même possible qu’en collaboration avec ce binôme : elle suppose en effet de travailler à la fois sur l’organisation du travail, sur l’aménagement des postes et sur la gestion des ressources humaines.
La politique de prévention et de santé au travail s’inscrit également dans une continuité historique, qui relie la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail à certaines dispositions du code du travail actuel, spécialement à l’article L 4121-1, qui pose clairement le principe de la responsabilité de l’employeur en matière de santé et de sécurité des salariés. Cette responsabilité trouve sa traduction dans le fait que les cotisations pour financer le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont exclusivement des cotisations patronales. Aucune autre politique de santé publique ne présente cette particularité, qui se traduit également dans l’obligation faite à l’entreprise de tenir à jour un document d’évaluation des risques professionnels – obligation réaffirmée dans le cadre de la transposition des directives européennes.
Cependant, ses spécificités ne remettent pas en question la place de la médecine du travail, dont l’apport est essentiel à la construction des politiques de prévention au sein de l’entreprise.
Comme je l’ai dit, l’articulation avec la politique générale de santé publique et de prévention a été renforcée au cours de la dernière décennie. Élaboré en 2008-2009, le deuxième plan Santé au travail a été lancé en 2010. Il identifie quatre axes d’intervention prioritaires, parmi lesquels une meilleure connaissance des risques professionnels, un développement de la prévention de certains risques particulièrement importants et une prise en compte des problèmes spécifiques aux petites entreprises. Il a été élaboré et appliqué en interaction constante avec d’autres plans de santé publique. Ainsi le plan Cancer II comporte des dispositions qui se retrouvent dans le plan Santé au travail par la priorité donnée à la connaissance des cancers professionnels. La convergence est également forte avec le plan national Santé environnement II en ce qui concerne la prévention des risques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. De même, un certain nombre d’actions du plan Santé au travail trouvent un écho dans le plan national d’action concertée 2009-2012 de la branche des risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et sont reprises dans la convention d’objectifs et de gestion de celle-ci. Nous travaillons par ailleurs en étroite collaboration avec les services de santé sur le plan du virus VIH et avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et la direction générale de la santé sur la lutte contre les addictions. La tutelle conjointe exercée sur des opérateurs tels que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, la participation aux comités de pilotage des différents plans de santé ou celle de la direction générale de la santé au comité d’orientation des conditions de travail sont autant d’autres occasions de travail en partenariat.
La même logique est à l’œuvre au niveau territorial. Le plan Santé au travail II se décline ainsi dans des plans régionaux de santé au travail, qui ont été élaborés à partir de l’été 2010 en partenariat avec les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, avec les agences régionales de santé, avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, mais aussi avec la Mutualité sociale agricole et avec les associations régionales de l’amélioration des conditions de travail. Instruction avait en effet été donnée par le directeur général du travail pour que ces plans régionaux soient soumis aux commissions de coordination des politiques publiques qui travaillent sous l’égide des agences régionales de santé. Dans certaines régions, des collaborations et des coordinations s’opèrent entre la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et l’agence régionale de santé, s’agissant de l’application du plan régional de santé au travail et de son articulation avec le plan régional de santé publique.
On ne peut donc plus vraiment dire – comme le faisait un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales en 2003 – que la politique de santé au travail se déploie de manière totalement autonome et cloisonnée par rapport aux autres politiques de santé publique.
Compte tenu de l’existence de tous ces lieux d’échange et de coordination, faut-il parfaire le dispositif en instituant une délégation interministérielle, comme le propose la Cour des comptes ? Pour notre part, nous sommes plutôt dubitatives. Nous avons ouvert un certain nombre de pistes en faveur d’une action coordonnée et d’une plus grande complémentarité. L’effort mérite sans doute d’être amplifié, mais cela n’implique pas nécessairement de mettre en place un système très structuré, qui risquerait de poser des difficultés. Car, quand bien même la direction générale de la santé serait le point d’ancrage et détiendrait cette autorité interministérielle de coordination des politiques de santé publique, rien ne dit qu’il ne faudrait pas s’en remettre dans certains cas à l’expertise du ministère du travail… À la suite des drames qui ont endeuillé France Télécom à l’automne 2009, le ministre de l’époque, M. Xavier Darcos, avait arrêté un plan d’urgence pour la prévention des risques psychosociaux. Le travail qui a été conduit en liaison avec la société, à tous ses niveaux, exigeait une connaissance très intime des problèmes spécifiques à l’entreprise. Il faut donc conserver une souplesse qui permette de rester en prise avec les particularités du monde du travail. C’est pourquoi nous sommes assez réservées sur l’idée de confier à la direction générale de la santé une fonction de supervision. La coordination et le partenariat mis en œuvre aujourd’hui sont réels et sont positifs : nous ne sommes plus dans une logique de cloisonnement. Le système actuel pourrait donc utilement prospérer.
M. le rapporteur. Vous ne m’avez pas répondu sur la coordination entre les médecins traitants et les médecins du travail.
Mme Valérie Delahaye-Guillocheau. La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail commence seulement à entrer en application, puisque nous travaillons encore sur ses décrets d’application qui seront prochainement soumis au Conseil d’État. Il est donc un peu tôt pour estimer que ce texte n’atteindrait pas tous ses objectifs…
L’évolution de la démographie médicale entraîne, il est vrai, une situation tendue. Mais, tout en préservant la particularité et le rôle éminent de la médecine du travail, la réforme vise à tirer le meilleur profit de la composition pluridisciplinaire des services de santé au travail, qui ne comptent pas seulement des médecins, mais aussi des ingénieurs, des ergonomes, des infirmiers, des assistants de santé au travail pour pouvoir concentrer le temps disponible des médecins du travail là où leur valeur ajoutée est la plus évidente. Les visites périodiques sont l’un des éléments sur lesquels on peut avoir une marge de manœuvre pour assurer un fonctionnement optimal de ces services.
Quant à l’articulation entre médecins du travail et médecins traitants, certains suggèrent que ces derniers pourraient jouer un rôle en matière de santé au travail. J’objecterai que les médecins généralistes ne connaissent pas nécessairement les milieux de travail. Il serait par exemple difficile de leur demander d’apprécier l’aptitude au poste des personnes concernées.
À l’inverse, on peut se demander dans quelle mesure les médecins du travail pourraient jouer un rôle dépassant leur fonction de conseil et d’appui à l’employeur, de responsable de la santé du travailleur et intervenir dans des actions de santé publique au sens large – par exemple en participant à des plans de prévention de l’obésité. On peut certes établir des passerelles entre les différentes politiques de santé, pour autant, et compte tenu du problème de démographie médicale que vous avez rappelé, l’entreprise n’apparaît pas nécessairement comme le lieu où mettre en œuvre toutes ces actions. Il convient donc de rester prudent face à cette tentation.
Mme Patricia Maladry, responsable de l’inspection médicale à la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé. Les relations entre médecin traitant et médecin du travail sont longtemps restées insuffisantes. Une des raisons réside d’abord dans la formation générale des médecins : dans les centres hospitaliers universitaires, le temps d’enseignement de cette discipline était jusqu’à présent compris entre deux et quatorze heures, ce qui est très inférieur à la moyenne européenne. Des progrès ont néanmoins été accomplis : la médecine du travail a investi les amphithéâtres, et le nombre d’heures d’enseignement dispensées aux étudiants en deuxième cycle d’études médicales a augmenté. L’objectif est de susciter des vocations, la spécialité en médecine du travail n’étant pas, comme chacun le sait, la plus prisée à l’examen national classant de fin de deuxième cycle, mais aussi de sensibiliser ceux qui se tourneront vers des spécialités susceptibles d’être concernées par les risques professionnels – cancérologie, pneumologie, dermatologie, psychiatrie. Des stages dans les services de santé au travail sont désormais prévus dès le deuxième cycle, afin que les futurs médecins découvrent cette discipline. Tous ne deviendront pas médecins du travail, mais du moins connaîtront-ils les missions de ces spécialistes – ce qui sera déjà un progrès.
La réforme de la médecine du travail prévoit par ailleurs que des médecins d’autres spécialités pourront se former, avec l’aide d’un tuteur spécialiste, au sein des services de santé au travail. Elle rend également obligatoire, à l’issue de tout arrêt maladie de plus de trois mois, la visite de pré-reprise – qui peut être demandée au médecin du travail par le médecin traitant, par le médecin de la sécurité sociale ou par le patient lui-même. N’oublions pas, en effet, que le maintien dans l’emploi fait partie des objectifs de la médecine du travail. Cette mesure devrait contribuer à améliorer la communication entre les praticiens.
M. le rapporteur. Les problèmes de démographie touchent également les médecins généralistes.
Même si les médecins du travail ne semblent guère favorables à l’idée, ne pourrait-on imaginer que le médecin traitant, qui par définition connaît très bien son patient, puisse déclarer si ce dernier est ou non apte au travail, le médecin du travail déterminant quant à lui la nature du poste auquel il peut prétendre en fonction des nuisances auxquelles il pourrait être exposé dans l’entreprise ? La question se pose d’autant plus que le médecin du travail pourrait ne pas avoir accès au dossier médical personnel, ce qui n’est pas propice à un bon suivi puisqu’il pourrait ignorer les pathologies affectant ses patients.
Mme Patricia Maladry. Les médecins du travail ont en effet souvent demandé à avoir accès au dossier médical personnel, mais, hélas, sans succès. C’est dommageable puisque, comme vous l’avez mentionné, ils ne peuvent de ce fait connaître la nature des soins qui pourraient être prodigués par ailleurs à leurs patients, tandis que les médecins traitants ignorent si leurs patients travaillent ou non dans un contexte pathogène. Mais il faut aussi préciser que, jusqu’à présent en tout cas, les médecins du travail ont à se prononcer, non sur l’aptitude au travail du salarié, mais sur son aptitude à occuper tel ou tel poste de travail : le travail d’un coiffeur, en effet, peut différer selon le salon où il exerce même si le métier est le même.
Lors d’une récente rencontre, un enseignant en médecine du travail spécialisé dans la médecine factuelle « evidence based medecine » (EBM), m’assurait, suite à une méta-analyse réalisée dans plusieurs pays et contrairement aux idées reçues, que la visite d’embauche était probablement la plus utile de toutes. Cela étant, compte tenu de la démographie médicale, peut-être pourrait-on envisager que les visites périodiques soient l’occasion d’une collaboration avec le médecin traitant.
M. le rapporteur. L’amélioration sensible de la coopération dont vous faites état concerne-t-elle les services de l’assurance maladie et, plus particulièrement, ceux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ?
Mme Patricia Maladry. La situation est assez variable, mais les médecins du travail et les médecins-conseils des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail souhaitent renforcer leur coopération, en particulier sur les questions relatives au maintien dans l’emploi. Une des premières mesures pourrait être une meilleure organisation des visites de pré-reprise. Lorsque le médecin-conseil constate que la pathologie est susceptible de modifier l’aptitude au travail d’un salarié, il ne peut obliger celui-ci à consulter le médecin du travail. La solution passe par un effort de pédagogie auprès du patient.
De la même manière, il appartient au patient de transmettre au médecin de la sécurité sociale les informations reçues du médecin du travail et relatives au poste qu’il peut occuper. Je rappelle, en effet, que le médecin du travail se prononce sur l’aptitude au poste de travail et le médecin de la sécurité sociale sur l’employabilité de la personne. Quoi qu’il en soit, l’un et l’autre se rencontrent régulièrement et parviennent à mieux communiquer au cas par cas.
Enfin, mais c’est un autre aspect du problème qui ne concerne pas les médecins-conseils de la sécurité sociale, la prévention des risques professionnels dans les entreprises relève également des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
M. le coprésident Pierre Morange. Vos propos démontrent quand même la réalité d’un cloisonnement dû à la diversité des schémas d’organisation. Une meilleure structuration serait donc nécessaire.
Quelles que soient les spécificités de la médecine du travail, que vous avez rappelées, nul ne peut nier que les grands facteurs de risque pour la santé que sont l’alcoolisme et l’intoxication tabagique ont une incidence immédiate sur l’aptitude au poste de travail et sur la productivité du travailleur. Dès lors, il ne serait pas absurde que la médecine du travail les prenne en compte, dans le cadre plus large des dispositifs de prévention définis par les autorités interministérielles.
Mme Valérie Delahaye-Guillocheau. Le cloisonnement que vous dénoncez résulte d’une histoire administrative particulière, certains acteurs appartenant à l’administration d’État et d’autres relevant de la sécurité sociale. Dans ce contexte, nous agissons quotidiennement pour améliorer la coordination et la coopération. Il en est ainsi, au niveau national, lorsque le plan Santé au travail reprend des axes de la convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ou, au niveau local, lorsque les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mènent des actions conjointes. Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ont intérêt en effet à une prévention efficace des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la mesure où ils influent sur leurs charges et sur le niveau des cotisations patronales, mais les actions de leurs ingénieurs de prévention peuvent très bien s’articuler avec l’action des inspecteurs du travail ou du médecin inspecteur régional des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. De la même manière, la direction générale du travail travaille régulièrement avec la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Une organisation institutionnelle entièrement remodelée permettrait-elle d’agir encore plus efficacement ? La question reste ouverte.
Les problèmes d’addiction se posent sans doute aussi sur les lieux de travail, mais la politique nationale de prévention définie en la matière peut-elle s’appliquer sans spécifications dans les entreprises ? Par exemple, jusqu’à quel point le règlement intérieur peut-il proscrire la consommation de certaines substances ? La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la direction générale de la santé et celle du travail ont récemment élaboré un guide sur ces questions, comportant un certain nombre de recommandations à l’adresse des entreprises.
Mme Mireille Jarry, sous-directrice des conditions de travail à la direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi et de la santé. L’alcool et la drogue peuvent en effet constituer des facteurs d’accidents du travail dont le médecin du travail doit tenir compte en tant qu’acteur de la prévention des risques professionnels. Cependant, la médecine du travail étant, comme la branche accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les cotisations des employeurs, ceux-ci insistent fortement pour qu’elle s’en tienne là. De fait, une hypercholestérolémie, par exemple, a peu à voir avec les risques professionnels…
M. le rapporteur. Cette mission n’entend nullement remettre en cause l’organisation globale de la médecine du travail. Nous cherchons simplement à œuvrer à l’amélioration de la santé publique. Mais précisément, quand vous suggérez que la médecine du travail n’a pas se préoccuper de l’obésité, du diabète ou de l’hypertension d’un salarié, même si j’admets votre argument relatif à la position des employeurs, vous démontrez à nouveau l’existence de cloisonnements tout à fait déraisonnables au regard de cette préoccupation.
M. le coprésident Pierre Morange. Les addictions ayant un effet immédiat sur la productivité du travailleur, on ne peut concevoir que les employeurs soient indifférents à cette question. Il ne s’agit évidemment pas ici de faire un procès à la médecine du travail, mais, compte tenu du coût de la politique nationale de prévention – entre 1 et 10 milliards selon la Cour des comptes –, il est essentiel qu’elle gagne en efficacité grâce à une plus grande coordination des acteurs, chacun la relayant à son niveau. Les financeurs y ont un intérêt évident.
M. le rapporteur. Nous ne visons pas spécialement la médecine du travail. Il est notoire qu’en matière de prévention, plus une action est précoce, plus elle sera efficace. Or la médecine scolaire n’est pas une priorité pour l’Éducation nationale comme en atteste le nombre d’infirmières et de médecins scolaires. De surcroît, la dernière réforme du statut des infirmières ne concerne pas les infirmières scolaires, qui continueront d’être recrutées au niveau bac + 2 alors que leurs collègues des hôpitaux le seront au niveau bac + 3. Cette absence de coordination est évidemment dommageable pour qui veut améliorer la santé de nos concitoyens et c’est pourquoi nous déplorons la persistance des cloisonnements, où qu’ils se situent.
Mme Patricia Maladry. Le terme de cloisonnement est un peu excessif. La médecine du travail et les partenaires sociaux – l’employeur, en effet, ne peut rien seul – contribuent, et à mon sens habilement, au règlement des problèmes que vous avez évoqués car ils s’efforcent de conjuguer la prévention des risques professionnels avec les priorités de santé publique.
Par exemple, la médecine du travail contribue grandement au programme national Nutrition santé en s’intéressant aux travailleurs de nuit et postés, dont le rythme de travail a une incidence sur leur mode de nutrition. Faire le procès du cloisonnement est vain dès lors que les différents acteurs travaillent ensemble. Cette collaboration s’étend même à la définition de la formation des médecins du travail : la Haute Autorité de santé et la Société française de médecine du travail ne sont pas les seules à formuler des recommandations sur ce sujet, c’est aussi le cas des associations d’endocrinologues, de nutritionnistes, de rhumatologues ou d’orthopédistes.
Mme Valérie Delahaye-Guillocheau. Il est en effet très important d’assurer aux patients une prise en charge continue, quelle que soit la diversité des professionnels de santé auxquels ils ont recours, et, dans le cas de la médecine du travail, même si leur maladie n’a pas une origine professionnelle.
Nous travaillons en ce moment avec l’Association France-Parkinson sur la question des pathologies chroniques lourdement invalidantes et sur le maintien dans l’emploi. Les salariés n’étant pas tenus de déclarer une telle maladie auprès du médecin du travail, certains retardent le moment de la déclaration, de peur de perdre leur emploi ou de subir une discrimination, ce qui fait obstacle à un bon suivi – et pose aussi, pour l’accès du médecin du travail au dossier médical personnel, un problème qui a été évoqué lors d’un colloque à Sciences-Po. Le cloisonnement du système, en l’occurrence, n’est pas responsable.
Si la politique de santé au travail participe des politiques de santé publique, elle s’inscrit également dans le cadre des politiques de l’emploi, et pas seulement parce que la prévention des risques professionnels relève de la responsabilité de l’employeur : les dispositions relatives à l’emploi des salariés âgés ou à la pénibilité, par exemple, ont des incidences sur elle. Ainsi l’incitation à élaborer des accords ou des plans d’action en faveur de la prévention de la pénibilité, qui figure dans la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, engage les partenaires sociaux à travailler sur ce difficile problème, au niveau des branches et des entreprises. Plus largement, le report de l’âge de la retraite à taux plein n’est pas sans effet sur les actions que nous devons mener en faveur du maintien dans l’emploi et de l’employabilité.
M. le rapporteur. Ces précisions étaient utiles. J’étais quant à moi favorable à ce que le médecin du travail ait accès au dossier médical personnel puisqu’il est soumis au secret médical, mais certains ont fait valoir qu’il est lié à l’employeur et que le risque était grand, dès lors, que ce secret ne soit pas respecté. Nous devons donc nous attacher à convaincre que cet accès au dossier est nécessaire – comment assurer le suivi d’un salarié en ignorant s’il souffre de telle ou telle pathologie ? –, et rappeler que le médecin du travail est en principe indépendant de l’employeur. Le ministre du travail qui est en même temps celui de la santé devrait être en mesure de résoudre la difficulté – qui, il est vrai, ne se posera que lorsque le dossier médical personnel existera vraiment…
M. le coprésident Pierre Morange. Ce qui risque de prendre d’autant plus de temps que le Royaume-Uni – pour des raisons budgétaires – et l’Allemagne en ont abandonné l’idée. La Cour des comptes s’apprête d’ailleurs à se pencher très attentivement sur l’évaluation des financements consacrés à ce dossier attendu. L’Assemblée nationale, quant à elle, a suggéré, non des solutions alternatives, mais des mesures complémentaires, qui me semblent autrement plus pertinentes, telles que le recours à des supports informatiques sécurisés comme les clés USB.
Enfin, vous avez eu raison d’élargir le débat en rappelant que la santé au travail participe aussi de la problématique de l’emploi. De ce point de vue, le thème de la « flexi-sécurité », tel que défini à la suite du Traité de Lisbonne, me semble crucial.
*
AUDITIONS DU 12 JANVIER 2012
Audition de M. Bernard Salengro, secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, et de M. Jacques Texier, président du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise, et M. Martial Brun, directeur.
M. le coprésident Jean Mallot. Les activités de prévention sanitaire sont diffuses et difficiles à mesurer. Nous nous accorderons néanmoins sur le fait qu’elles sont insuffisantes, que leurs résultats sont inégaux et que la cohérence globale du pilotage n’apparaît pas de manière évidente. En outre, d’autres activités de prévention relèvent d’autres administrations, qu’il s’agisse de la médecine du travail ou de la médecine scolaire. Tous ces secteurs devraient agir de manière coordonnée, afin d’engager les actions de prévention sanitaire le plus en amont possible et de rendre les prises en charge curatives moins tardives et moins coûteuses.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Il est convenu de considérer le système de santé français comme plutôt performant dans le domaine curatif mais comme assez médiocre dans le domaine préventif. La communication de la Cour des comptes met en évidence le manque de pilotage global et la faiblesse de la coordination entre les multiples intervenants de ce domaine. La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 définit une centaine d’objectifs sans fixer de véritables priorités. Les relations du système de soins français avec la médecine scolaire et la médecine du travail ne sont pas assez satisfaisantes, le coprésident Mallot vient de le rappeler. Les responsables du ministère de l’éducation nationale et du ministère du travail le reconnaissent, tout en souhaitant, dans le même temps, que chaque secteur conserve son autonomie.
Quelle pensez-vous de l’efficacité de la prévention dans le domaine de la santé au travail ? Comment améliorer la coordination, sachant que les institutions de prévoyance et les complémentaires santé mènent, de leur côté, des actions de prévention auprès des mêmes populations que vous ?
M. Jacques Texier, président du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise. Le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME) est l’organisme représentatif des services de santé au travail interentreprises. Il négocie la convention collective de la branche, qui représente 15 000 salariés répartis dans 280 services en France métropolitaine et d’outre-mer. Ces services suivent les 14,5 à 15 millions de salariés du secteur privé. Les grandes entreprises n’en relèvent pas : elles possèdent des services autonomes qui suivent environ 1 million de salariés.
Le nombre de services interentreprises s’est élevé à 350 avant qu’un mouvement de rapprochement n’intervienne. La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail concrétise une réforme prévue de longue date, qui vise notamment à organiser la médecine du travail au niveau régional.
Les médecins du travail en France sont 5 500, représentant, en raison du recours assez fréquent au temps partiel, 4 500 emplois en équivalents temps plein. Du fait de l’évolution de la démographie médicale, il n’y aura plus, à brève échéance, qu’environ 3 000 emplois en équivalents temps plein.
Le centre interservices est une fédération. Ses administrateurs sont élus. Je suis pour ma part président de l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France (ACMS), qui assure le suivi d’environ 1 million de salariés. Les compétences de ce type d’association sont en effet circonscrites à une zone, un département ou une région. Tous les services adhérents du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise sont des associations relevant de la loi de 1901. Leurs membres sont des entreprises assujetties à l’obligation de prévention et de suivi des salariés.
Je viens du monde de l’entreprise. En tant que président de l’Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France, j’ai été pendant plusieurs années administrateur du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise avant d’en devenir le président.
En matière de prévention, la Cour des comptes indique bien qu’elle n’a pas inclus la dimension de la santé au travail dans son étude. Du reste, elle mène depuis deux ans une mission sur la médecine du travail. Elle travaille sur quatre services de taille différente. Des pré-rapports ont déjà circulé mais les conclusions définitives ne sont pas encore connues.
On le voit, il existe une tendance à considérer la santé au travail comme spécifique, ce qui rejoint vos propos sur l’insuffisance de coordination en matière de prévention avec d’autres politiques de santé publique.
Sans doute ce phénomène a-t-il une explication historique. Dans la France d’après 1946, les salariés bénéficiaient d’un suivi au travail fortement médicalisé. Les emplois étaient relativement fixes et le secteur secondaire était encore important. Par ailleurs, la situation sanitaire globale de la population restait médiocre. C’est pourquoi, il était considéré comme prioritaire que des médecins suivent l’état de santé des salariés soumis à des visites médicales. L’aptitude au poste était fonction de la santé du salarié et le médecin restait un acteur incontournable de la santé au travail. Même si le système était fondé sur une philosophie préventive, il n’était pas orienté directement vers la prévention.
La réforme de juillet 2004 traduit un grand changement.
Il faut rappeler les étapes précédentes. Ainsi, il a été très malaisé d’intégrer dans le système français la directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, tant les dispositifs et les conceptions sont différents en Europe. La philosophie de cette directive a été reprise dans un accord interprofessionnel du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, accord dans lequel on a commencé à donner la priorité à la prévention par rapport à l’approche médicalisée de la santé au travail. Le problème de démographie médicale fait déjà envisager un recours à la médecine de ville.
Viennent ensuite la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, qui définissent la prévention comme une priorité. Comme souvent en France, cela s’est traduit par une réglementation pointilleuse : le médecin du travail doit consacrer un tiers de son temps – soit 150 demi-journées – à la prévention dans les entreprises qui lui sont affectées, et le service dont il relève doit pouvoir en justifier.
L’obligation de la visite d’embauche et du suivi des salariés demeure mais, pour des raisons capacitaires, la visite périodique, annuelle jusqu’en 2004, devient bisannuelle. Néanmoins, dans les secteurs où un risque existe – travail de nuit, possibilité d’exposition aux radiations –, la périodicité peut être abaissée à six mois ou un an.
La réforme a entraîné une autre modification que nous approuvons pleinement : alors que, jusqu’en 2004, la totalité des administrateurs des services étaient élus par les assemblées générales composées des seuls adhérents employeurs, un tiers d’entre eux sont désormais désignés par les organisations syndicales des entreprises concernées. L’objectif fixé par la réforme est de parvenir à une proportion de 50-50, ce qui est déjà le cas dans certains services. La loi réserve toutefois une voix prépondérante au président élu par la partie employeurs.
La question des décrets d’application a donné lieu à un vaste débat, au point que des universitaires ont pu écrire au moment de la promulgation de la loi : « Monsieur le ministre, tout reste à faire. » Nous ne sommes pas loin de partager cet avis, mais nous pensons aussi que cette loi a permis de donner un cadre législatif à l’expérimentation réussie sur le terrain par nos services en matière de prévention : un travail d’équipe faisant le lien entre la prévention et le médical, prenant en compte la complexité croissante des postes, le caractère de plus en plus morcelé du travail, le développement des emplois de services et la baisse des emplois industriels.
L’approche de prévention est devenue complexe. Parmi les grands objectifs, figure la réinsertion professionnelle. Face à la multiplication des restructurations et des réductions d’effectifs, les salariés ont l’impression d’être de moins en moins aptes à occuper des postes de plus en plus changeants. Certes, le responsable principal reste l’employeur, qui est du reste soumis à une obligation de résultat ; mais, aux termes de la loi, le médecin doit jouer un rôle de coordination et d’animation au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Dès lors, les décrets d’application devraient permettre une bonne répartition des capacités en fonction des priorités, sachant que le nombre de médecins est en baisse et que les effectifs pluridisciplinaires sont en augmentation. Le problème réside donc dans des textes qui maintiennent pratiquement toutes les obligations en matière de visites médicales.
Précisons que ce secteur s’autofinance puisque la totalité des coûts – 1,3 à 1,5 milliard d’euros – est couverte par la cotisation des employeurs.
Nous vivons une période de grands changements en matière d’efficacité, de pilotage et de redéploiement des équipes. Nos services fonctionnent sous agrément mais la loi introduit une notion de contrat d’objectifs et de moyens passé par chaque service avec les autorités publiques, c’est-à-dire avec le ministère du travail, et, en pratique, avec les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui restent responsables de l’agrément, mais aussi avec la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, l’agence régionale de santé et les partenaires sociaux.
M. Bernard Salengro, secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres. Je me félicite de l’initiative de votre mission, que j’appelle de mes vœux depuis que j’exerce. La prévention est le parent pauvre de notre système de santé. Une des raisons de mon engagement syndical est la colère à la fois devant l’inaction des pouvoirs publics – essentiellement les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui délivrent sans discernement leur agrément aux services de santé au travail – et face aux insuffisances de ce secteur.
Je suis médecin du travail depuis plus de trente-cinq ans. J’ai choisi cette voie en ayant également une formation de psychiatre. Certaines de mes publications ont trouvé quelque écho. J’ai même été à l’origine de l’abaissement du poids du sac de ciment de 50 à 35 kg ! Après avoir découvert le monde syndical, qui permet de s’exprimer et de porter la parole, j’y ai pris quelques responsabilités : je suis président du Syndicat des médecins du travail, secrétaire national de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, administrateur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
S’agissant de la santé au travail, mon point de vue diffère quelque peu de celui de monsieur Jacques Texier. Il est significatif que l’appellation a toujours été « médecine du travail » et non « médecine des travailleurs ». Dès le 11 octobre 1946, la loi relative à l’organisation des services médicaux du travail précise que l’objet de cette discipline est d’éviter toute altération de la santé du fait du travail. Dans ce texte fondateur, la visite médicale n’est nullement une obligation, contrairement aux idées reçues. Cette évolution résulte des employeurs, auxquels le législateur a confié la responsabilité de l’organisation du système de façon fort peu judicieuse et qui préfèrent que l’on examine les salariés plutôt que les conditions de travail.
Le législateur a tenté de corriger cette déviation dès mars 1979 – et non en 2004 – en indiquant que le principe du tiers temps, en application duquel le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail, était prioritaire, conformément à l’esprit de la loi précitée de 1946. Or, à cette heure, le tiers temps n’est toujours pas réalisé !
S’agissant de l’objet de cette audition, la prévention sanitaire en général, une donnée importante est l’éclatement des personnels composant les médecins du travail. La coordination assurée par le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise concerne surtout, comme l’a indiqué monsieur Jacques Texier, la négociation de la convention collective. Le reste est secondaire. Les pouvoirs publics auraient pu organiser ces personnels. J’interpelle le ministère du travail à ce sujet depuis longtemps : il dispose en effet des rapports annuels dans lesquels les médecins colligent toutes les constatations médicales effectuées, toutes les maladies professionnelles et leurs facteurs, mais aussi toutes leurs observations de santé publique. Il suffirait d’un logiciel adapté pour traiter ces informations et dresser un tableau de toute la population salariée. Nous serions le premier pays à disposer d’un tel outil, sans aucun coût supplémentaire !
Les confédérations patronales : Confédération générale des petites et moyennes entreprises, Mouvement des entreprises de France, Union professionnelle artisanale, ont le souci de maintenir cet éclatement et d’éloigner la médecine du travail du terrain et des besoins. Dès 2000, pourtant, nous avons obtenu la création des observatoires régionaux de santé au travail, dont l’objectif était de réunir, devant l’instance régionale des partenaires sociaux, l’ensemble des acteurs de la santé au travail : médecine du travail, organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, association régionale pour l’amélioration des conditions de travail, comité régional de prévention des risques professionnels… Il s’agissait, pour les représentants du terrain, de demander à ces organismes de travailler ensemble sur le sujet.
Malheureusement, les pouvoirs publics et la sécurité sociale ont quelque peu étranglé ce dispositif, qui est aujourd’hui en déshérence.
Les partenaires sociaux sont depuis longtemps conscients de l’éclatement et de l’impuissance organisée du système de la médecine du travail. Cela étant, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail sont en pleine révolution. Des projets de fusion entre les associations régionales et les services de santé au travail circulent au sein du ministère. D’autres concernent les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, sur le modèle de la Mutualité sociale agricole, qui intègre la médecine du travail dans ses services. Il s’agit là de pistes dont on peut discuter les avantages et les inconvénients. Ce qui est indéniable, c’est que l’action des personnels de ces structures en matière d’observation, de conseil et de prévention n’est ni reconnue, ni analysée, ni évaluée comme elle le mérite, et qu’il existe un manque de coordination avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, l’Institut national de recherche et de sécurité, l’Institut national de veille sanitaire et l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
Évitons la séparation schizophrénique entre santé au travail et santé publique. Une personne stressée développe toutes sortes de maladies qui ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles mais que l’on retrouve dans les problématiques de santé publique. Après de nombreuses analyses et méta-analyses, le Bureau international du travail a conclu que l’estimation basse du coût direct et indirect du stress est de 3,5 % du produit intérieur brut, soit plus de 50 milliards d’euros. Lorsque l’on rapporte cette somme aux 170 milliards d’euros de dépenses d’assurance maladie et aux 10 milliards d’euros de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, on mesure toute l’action que l’on pourrait engager si les constatations des médecins du travail remontaient vers des centres de pouvoir comme les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
De mon expérience de terrain et de celle de mes confrères, il ressort que le médecin du travail, soumis au secret médical, est le seul acteur dont l’éthique et la compétence sont garanties, quand bien même il ferait partie d’une équipe pluridisciplinaire. Loin de moi l’idée de critiquer les compétences complémentaires, mais quelles garanties offrent les intervenants en prévention des risques professionnels, dont on parle beaucoup actuellement ? Le médecin est le seul intervenant dont le salarié sache avec certitude que son seul objectif est la protection de sa santé, et non la productivité de l’entreprise. Son travail de constatation mais aussi de rectification est considérable. De nombreux patients lui demandent conseil – par exemple pour une opération suggérée par tel ou tel chirurgien – parce qu’ils le connaissent bien et qu’ils savent qu’il n’est pas rémunéré à l’acte. Les examens cliniques que nous menons permettent de dépister un nombre impressionnant de diabètes, d’albuminuries, d’apnées du sommeil, d’hypertensions mal soignées… Notre exercice ne devrait porter que sur les aspects de la santé relatifs au travail, certes, mais nous sommes médecins et l’homme est un tout !
J’insiste de nouveau, les données rassemblées dans le rapport annuel constituent un outil précieux qu’il suffirait de traiter au niveau national : il existe ainsi un suivi diachronique, quantifié, documenté, de l’ensemble de la population salariée que même les médecins généralistes ne pourraient probablement pas fournir.
Le médecin du travail assure les trois étapes de la prévention – primaire, secondaire et tertiaire – évoquées par la Cour des comptes. Le médecin du travail est un docteur en médecine qui a accompli quatre ans de spécialisation ! Après le décret du 20 mars 1979, la moitié de ces praticiens se sont spécialisés en ergonomie.
En excluant la santé au travail de son étude, la Cour des comptes répond à une logique administrative qui a recueilli le consensus des partenaires sociaux. Pourtant, ce dispositif n’a pas fait preuve d’une grande efficacité. La santé n’est pas divisible. Une personne en bonne santé est plus productive. Si elle travaille dans des conditions qui ne respectent pas la physiologie humaine, cela se traduit par des accidents – « un stressé est accidentable », dit le Bureau international du travail – ou par des pathologies qui ne paraissent pas avoir de rapport avec le travail, à l’exception de ceux qui connaissent le sujet !
M. le rapporteur. Par définition, notre mission a pour tâche d’évaluer et de contrôler l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale, dont les budgets de la médecine du travail ne relèvent pas. J’ai pourtant insisté pour que nous vous entendions, estimant que l’on ne pouvait mener un travail sur la politique de prévention sans y inclure la médecine du travail et la médecine scolaire.
Par leur contact avec les salariés, les médecins du travail jouent un rôle très important en matière de prévention. Deux problèmes se posent néanmoins : l’évolution de leur démographie et la question de leur indépendance par rapport à l’employeur. Lors du débat sur l’instauration du dossier médical personnel, certains collègues ont souhaité que l’accès à ce dossier ne soit pas permis aux médecins du travail sous prétexte que ceux-ci seraient soumis aux pressions des employeurs.
Comment améliorer le lien entre le médecin traitant et la médecine du travail ? Certains syndicats souhaiteraient que le médecin généraliste effectue une synthèse annuelle de son patient et que le médecin du travail transmette à cet effet l’analyse d’exposition au poste dudit patient.
Les médecins du travail souhaitent-ils avoir accès au futur dossier médical personnel ? Doivent-ils être associés à certains dépistages comme celui du cancer colorectal ?
Que pensez-vous des différents plans de santé publique, notamment le plan Santé au travail ?
Quelle appréciation portez-vous sur la coordination avec la branche assurance maladie et avec la branche accidents du travail et maladies professionnelles ?
Les agences régionales de santé, responsables de la prévention et des soins en médecine de ville et hospitalière, sont censées avoir mis en place des comités régionaux de coordination en matière de prévention. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi y sont-elles seules représentées ? Les médecins du travail y participent-ils ou souhaitent-ils y participer ? Pour améliorer la prévention dans notre pays, une amélioration de la coordination régionale et nationale ne vous semble-t-elle pas nécessaire ?
M. Martial Brun, directeur du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise. Vos questions renvoient à la façon dont se structure la politique de santé au travail dans notre pays. Il s’agit d’un phénomène nouveau : longtemps, les services de santé au travail, dont l’exercice était encadré par le code du travail, n’ont pas fait l’objet d’une politique publique, ni d’orientations particulières. C’est seulement en 2004 que des priorités leur ont vraiment été assignées, sous l’impulsion du gouvernement de l’époque et dans le cadre du premier plan Santé au travail. Ainsi, le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, qui réunit les partenaires sociaux et des représentants de la société civile, formule des attentes en termes de prévention des risques professionnels. De même, des objectifs sont fixés par le plan Santé au travail, lequel est décliné au niveau régional.
La mise en place de ces outils de coordination se heurte toutefois à des difficultés. Les objectifs fixés au plan national doivent être déclinés par les comités régionaux de prévention des risques professionnels chargés d’élaborer des plans régionaux de santé au travail. De son côté, l’État passe avec l’assurance maladie une convention d’objectifs et de gestion qui se décline, au niveau régional, dans les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. La coordination est plus ou moins réalisée sur le terrain. On peut espérer que l’élaboration du plan régional Santé au travail soit l’occasion d’une synthèse entre ces orientations, afin que la volonté des différents acteurs – partenaires sociaux, société civile, administration, Gouvernement – se traduise par des objectifs sur lesquels les services de santé au travail devront contractualiser.
Comme l’a noté monsieur Bernard Salengro, la santé au travail est certes un secteur particulier, mais qui ne doit pas être séparé du reste de la santé publique. On peut donc envisager des réflexions communes, notamment sur des sujets comme celui du cancer. Cela étant, prenons garde à ne pas détourner les moyens de la santé au travail en faveur de la santé publique, car les besoins restent très importants en matière de prévention des risques professionnels. C’est un choix politique : faut-il avoir recours aux médecins du travail
– pourtant de moins en moins nombreux – pour réaliser des tests de dépistage, ou doivent-ils se consacrer exclusivement à la prévention des risques professionnels ?
Quoi qu’il en soit, les outils existent, même s’ils n’ont pas toujours fonctionné. N’oublions pas que pour l’instant, un seul plan Santé au travail est parvenu à son terme. Nous sommes passés d’une visite annuelle systématique, principe en vigueur depuis octobre 1946, à une politique affichée et coordonnée au niveau régional : cela demande du temps et un apprentissage.
La loi a par ailleurs introduit la notion de projet de service. Les services de santé au travail doivent élaborer un projet collectif et définir des priorités d’action. Cela implique de faire des choix plutôt que d’agir de façon systématique. En effet, la pratique adoptée depuis octobre 1946, consistant à proposer la même chose à tous les salariés tous les ans, n’a guère fait la preuve de son efficacité, tant elle incite à la dispersion, comme dans l’exemple des 100 indicateurs de santé publique de la loi de santé publique d’août 2004. Il convient donc d’identifier les domaines d’action prioritaires, les métiers, les branches professionnelles, les situations sur lesquelles la médecine du travail doit se concentrer.
Dans ce but, les médecins du travail doivent rejoindre un projet collectif, le projet de service, objet d’une contractualisation avec l’État et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et qui doit permettre une action coordonnée. Le dispositif paraît pertinent ; il faut seulement contrôler sa mise en œuvre. Après avoir demandé, en 2004, aux médecins du travail de donner la priorité à l’action sur le milieu de travail et de concentrer leurs efforts sur certains risques, rien ne serait plus dommageable que de changer d’orientation et de les inciter à revenir au cabinet médical et aux visites systématiques.
Je me réjouis, en tout cas, que votre mission ait décidé de se pencher sur ce sujet : alors que le débat sur la médecine du travail s’est souvent limité à la question de la gouvernance ou à celle de l’indépendance des médecins spécialisés, on se préoccupe enfin de la prévention, c’est-à-dire des actions à mener pour obtenir des résultats en santé. La veille sanitaire fait partie de ces actions.
Pour parvenir à un accord sur les objectifs et les priorités à adopter, il est nécessaire de poser des diagnostics partagés sur les besoins de la population salariée. Parmi les sources d’information disponibles, on peut avoir recours aux chiffres des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, mais ces indicateurs de réparation, s’ils sont utiles, ne doivent pas être considérés isolément. En effet, l’assurance maladie indemnise pour des événements qui remontent parfois à dix, vingt, voire trente ans auparavant. Ainsi, un cancer dont les origines sont professionnelles peut se déclarer au bout de trente ans : quand il donne lieu à réparation, la situation de travail n’est parfois plus la même. Il en est de même pour les troubles musculo-squelettiques, qui peuvent se déclarer après dix ans d’exposition. Il convient donc de développer d’autres indicateurs, plus pertinents. Telle est la démarche de l’observatoire EVREST (Évolution et relations en santé au travail) qui recherche les signes avant-coureurs de dégradation de la santé. C’est ce genre de diagnostic qui doit être posé par les comités régionaux de prévention des risques professionnels, dans le but de mobiliser les acteurs de terrain et les institutions et de faire face aux problèmes identifiés. Cela demande beaucoup d’organisation.
M. Bernard Salengro. Une observation au préalable : en tant qu’administrateur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, on dit aujourd’hui « conseiller », je suis perplexe devant le rattachement de la branche accidents du travail dans l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM. Dans le cas de l’assurance maladie, cela est justifié puisque les patients et les professionnels de santé doivent gérer une certaine somme correspondant à l’effort consenti par la nation. Mais, si on y inclut les accidents du travail, il convient que les employeurs agissent de telle sorte que moins d’accidents surviennent par rapport à l’année précédente. Il faut donc s’en donner les moyens politiques.
Or, ces moyens font défaut. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont le rôle est très important puisqu’elles donnent non seulement l’agrément aux services de santé au travail, mais passent avec eux des contrats d’action, n’ont rien fait depuis 1946. Elles ont témoigné de la soumission, de la complicité : j’assume totalement le choix de ces termes. Elles n’ont effectué aucun travail sérieux sur le sujet, et j’ai bien peur que cela ne continue, quand bien même la loi leur a donné plus de pouvoirs.
Quant à la démographie médicale, la baisse du numerus clausus ces dernières années faisait consensus, les médecins en activité étant désireux de conserver leur clientèle. Depuis, l’expérience a montré que le nombre de malades n’a pas décru. On tente donc de pallier le manque d’effectifs, d’autant plus que les techniques ont évolué ; une opération effectuée autrefois par un seul médecin requiert désormais plusieurs personnes, à savoir un anesthésiste, un chirurgien et deux ou trois infirmières. En outre, le nombre de spécialités a augmenté, et la médecine du travail réclame plus d’effectifs.
Le faible nombre de médecins du travail ne s’explique pas par un manque d’attractivité du poste, mais par les contraintes administratives liées à la formation médicale qui n’encouragent pas les vocations. Tout d’abord, le choix de la spécialité est lié au classement à un concours : ainsi certains qui souhaitent devenir psychiatres finissent médecins du travail, tandis que d’autres optent pour la psychiatrie alors qu’ils visaient la radiologie. Ensuite, l’exercice d’une spécialité est exclusif : si un chirurgien souhaite devenir médecin du travail, il doit refaire l’internat, soit quatre ans d’étude ! Aucune autre profession n’est soumise à des contraintes aussi aberrantes.
Le problème démographique a été exagéré. Monsieur Jacques Texier a donné les vrais chiffres, qui tiennent compte du fait que plus de la moitié des médecins du travail exercent à temps partiel, souvent de manière subie. Ce problème est purement administratif et pourrait être résolu en deux ou trois ans si l’université proposait un enseignement adapté à la reconversion des médecins généralistes dans les services de santé au travail.
Quant à l’indépendance des praticiens, elle est d’autant plus forte que la loi les protège. Or, aujourd’hui, seul le médecin du travail est protégé, d’une part à cause du prestige lié à sa formation, d’autre part parce que la loi interdit son licenciement. Aucun autre acteur de la médecine du travail, pas même le directeur du service, ne bénéficie de la même protection, ce qui est justifié par sa latitude à avoir à tout moment accès à l’entreprise, les autres acteurs devant obtenir l’accord de l’employeur.
Avec d’autres, monsieur Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la santé, imaginait qu’il existait une collusion entre les médecins du travail, les employeurs et les compagnies d’assurance, d’où son refus de leur donner accès au dossier médical. Cette décision a choqué les médecins du travail. Si elle a établi définitivement la réputation du ministre aux yeux de ses confrères, elle s’avère surtout préjudiciable aux patients. Les médecins traitants n’ont en effet aucune connaissance du monde de l’entreprise, et ils font preuve, en matière de pathologies professionnelles, d’une profonde ignorance. Cette dernière peut entraîner des dégâts : combien de dépressions d’origine professionnelle, qui sont traitées comme des dépressions réactionnelles au moyen de tranquillisants ou de thymoanaleptiques, ont été ainsi aggravées et rendues chroniques, alors qu’un retour à l’emploi se serait avéré nécessaire ? De nombreux salariés sont ainsi poussés vers une situation d’invalidité alors qu’un aménagement de poste aurait été envisageable. Le médecin du travail, qui connaît l’entreprise et son dirigeant, est à même de négocier pour obtenir un tel aménagement tandis que le médecin traitant ne connaît que les circuits de l’assurance maladie.
Cette impossibilité d’échanger entre médecins du travail et médecins traitants par l’intermédiaire du dossier médical est donc, du point de vue de la coordination médicale, une occasion manquée. Déjà, les médecins du travail déplorent le trop grand nombre de lettres restant sans réponse, parce que les médecins de ville ne veulent pas consacrer de temps à cette activité non rentable.
Le plan Santé au travail, sur lequel vous m’avez interrogé, est perçu par les professionnels comme imposé du sommet, sans grandes répercussions sur le terrain. Les « préventeurs » des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, s’exprimant à propos du plan national d’actions coordonnées de la branche accidents du travail et des plans régionaux, se plaignent d’être devenus des « cocheurs » d’indicateurs, au risque de perdre leur efficacité. Une telle politique est sans doute à même de rassurer les décideurs, mais je suis sceptique quant à ses résultats.
C’est pour ces raisons que je suis favorable à un vrai paritarisme et non à celui institué par la loi, dans lequel l’employeur reste décideur sans possibilité d’alternance. J’en profite pour préciser que la règle selon laquelle un tiers des administrateurs des services de santé au travail sont désignés par les organisations syndicales ne date pas du décret de 2004 : elle a été obtenue par la négociation dès 2000.
En ce qui concerne les relations avec les agences régionales de santé, les directeurs de services de santé au travail, nommés par les employeurs, se sont empressés d’orienter le système selon leurs conceptions. Ils sont efficaces, mais ce ne sont pas des acteurs de terrain. On peut donc craindre que leur influence s’ajoute à celle des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour imposer une conception technocratique de la prévention, fondée sur des indicateurs, et dont je serais étonné qu’elle obtienne des résultats.
M. le rapporteur. Seriez-vous intéressés par une participation aux conférences régionales de santé ?
M. Bernard Salengro. Une participation des organisations syndicales de la santé au travail serait certainement enrichissante pour les décisions de l’agence régionale de santé.
Mme Gisèle Biémouret. À propos de démographie médicale, quelles sont les collectivités les moins bien dotées, au risque d’un mauvais fonctionnement de la médecine du travail ?
Avec le développement des entreprises de services, notamment à destination des personnes âgées, on observe la montée d’une nouvelle forme de salariat, plus précaire, et qui concerne surtout des femmes, confrontées à un travail physiquement pénible. Cette évolution est-elle prise en compte par la médecine du travail ?
M. Patrick Lebreton. En matière d’accidents du travail, un outil mis en place en 2001, le document unique, semble donner de bons résultats, puisqu’après une hausse du nombre d’accidents dans les années 1990, on a plutôt observé une stabilisation dans la décennie suivante. Dans mon département, La Réunion, où l’évolution a été comparable, seules 40 % des entreprises sont dotées de cet outil, d’après l’ingénieur-conseil de la caisse régionale de sécurité sociale. Les élus ne donnent pas un meilleur exemple, puisque sur une trentaine de collectivités territoriales – en incluant les établissements publics de coopération intercommunale –, une seule, la mienne, a adopté cette démarche et l’a menée à son terme. Il faut reconnaître que son coût est très élevé et que le Centre national de la fonction publique territoriale n’est pas toujours en mesure de nous aider.
Pourtant, seul l’inventaire des risques spécifiques à une structure est réellement de nature à faire baisser l’accidentologie professionnelle. Il s’agit d’un investissement. Ne pensez-vous pas que l’État devrait se doter de moyens budgétaires conséquents pour aider les collectivités à se doter de ce document ?
M. Bernard Salengro. Il est vrai que dans certaines régions, la démographie médicale est catastrophique, soit en raison d’une mauvaise qualité des services, soit parce que la région n’est pas la plus accueillante ; a contrario, la ville de Nice, par exemple, ne manque pas de médecins du travail. La situation est donc indiscutablement très tendue, et si nous ne voulons pas voir la profession disparaître, une augmentation du numerus clausus est nécessaire. Le secteur a connu deux grandes vagues démographiques, en 1946 et en 1975, mais la troisième tarde à s’annoncer.
De son côté, le salariat connaît une évolution indiscutable. Les personnes travaillant chez des particuliers, des associations intermédiaires, des artistes sont désormais mieux pris en compte par la loi, ce qui était nécessaire, car ces professions de services sont soumises à une forte pénibilité et ont besoin de conseils et de surveillance.
Le document unique est un outil remarquable, équivalent pour l’employeur de la fiche d’entreprise renseignée par le médecin du travail. Cette dernière existe depuis octobre 1946, mais n’est jamais consultée par les inspecteurs du travail, ce qui est regrettable, car un tel document est plus important que la fiche d’aptitude.
Résoudre la situation que vous décrivez à La Réunion n’est pas une question de moyens, mais demande une action combinée à la fois coercitive et financière. Pourquoi le nombre de morts de la route est-il revenu de 17 000 tués à moins de 4 000 tués en quelques dizaines d’années ? Les infrastructures ont été améliorées, certes, mais surtout les policiers sont devenus plus sévères, et les assureurs n’hésitent pas à majorer les primes. L’effet de cette politique est indiscutable, mais la même démarche n’a pas été adoptée dans le milieu professionnel. Je suis d’ailleurs choqué de voir le nombre d’accidents du travail baisser aussi lentement alors qu’avec la désindustrialisation que connaît notre pays, et la multiplication des acteurs de prévention, nous aurions dû observer une chute du nombre d’accidents qui ne s’est pas produite.
M. Martial Brun. La démographie médicale, en matière de médecine du travail, recouvre le phénomène plus général de désertification médicale. Ainsi, le littoral est plutôt mieux pourvu que certains départements centraux et isolés. C’est pourquoi il convient d’adapter les politiques de prévention en fonction du contexte local et d’éviter les actions systématiques, qui risquent de ne pas être appliquées dans les territoires les moins bien dotés. Ainsi, dans certains secteurs de la Nièvre, les médecins du travail ont intégré une maison médicale, de façon à proposer aux citoyens un plateau de services médicaux de proximité.
Pour nous, la prévention est un investissement. Mais nous faisons partie du secteur privé. Si l’État investit, la question se posera de savoir qui décide des mesures de prévention. La contractualisation décidée en juillet 2011 doit associer l’État, l’assurance maladie et les entreprises afin de coordonner leur action et de définir des priorités. Ce contrat maintient la responsabilité de l’entreprise. Mais, si l’État devient le seul décisionnaire, le risque est que les entreprises se défaussent d’une partie de leur responsabilité, en matière de réparation, par exemple. Il convient de conserver un équilibre. Dans le secteur public, les mesures de prévention et les obligations sont différentes.
Certains pays, comme la Finlande, ne font pas obstacle au partage des données relatives à la santé au travail, contrairement à la France. Or, tant que des informations sur la santé ou les conditions de travail ne pourront être inscrites sur la carte Vitale, un échange au moins partiel entre la médecine de soins et la médecine du travail ne pourra pas être assuré. Il est certain que le médecin du travail n’est pas un médecin choisi. Mais, s’il existe des cas de pressions de l’employeur sur le médecin du travail, ils concernent plutôt les services autonomes que les services interentreprises. En outre, l’échange d’information peut être très utile aux salariés : un gastro-entérologue, par exemple, a intérêt à savoir si son patient est exposé à des solvants dans son milieu professionnel. Il convient donc de choisir entre la protection des données personnelles et les exigences de prévention sanitaire.
Monsieur Bernard Salengro a fait allusion à la source d’informations que constituent les rapports des médecins du travail. Mais, en l’absence d’un thésaurus commun, il est délicat de définir les données à colliger. Nous avons, au Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise, accompli un travail important pour établir une nomenclature commune utilisable dans tous nos systèmes d’information. De telles démarches permettent une meilleure capacité de veille sanitaire et de diagnostic territorial et doivent être encouragées par l’État.
M. le rapporteur. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ?
M. Martial Brun. Si, par exemple, vous cherchez à mesurer l’exposition au bruit, mais que le codage varie d’un document à l’autre à savoir « bruit supérieur à 85 décibels » d’un côté, « ambiance sonore dangereuse » de l’autre, le système informatique ne permettra pas de savoir de quoi il retourne. C’est pourquoi des thésaurus sont élaborés avec l’aide d’agences spécialisées comme l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Si ces informations étaient rendues disponibles sur une carte électronique, la carte Vitale n’est qu’un exemple, nous serions en mesure de les partager et de les mettre au service des politiques publiques relatives à la santé au travail.
M. Jacques Texier. En ce qui concerne la démographie médicale, je partage l’avis de monsieur Bernard Salengro : nous pouvons retrouver des marges de manœuvre en augmentant les capacités de recrutement et en permettant aux médecins de suivre plus d’une carrière. Un rapport sur la santé au travail, rédigé par M. Paul Frimat et deux de ses confrères, a montré que de nombreux médecins de soins exprimaient l’envie d’une carrière différente. Or, la médecine du travail répond à cette aspiration, car les difficultés auxquelles elle est exposée ne sont pas les mêmes que pour la médecine de soins. Une opération a d’ailleurs été lancée avec succès il y a quelques années pour encourager les reconversions.
En ce qui concerne la disparité géographique, le plafond fixé par la loi – pas plus de 3 300 salariés par médecin du travail – est atteint, voire dépassé pratiquement partout. Et dans certaines régions, on monte à 10 000, voire 15 000 salariés. Cela pose un problème majeur, et c’est pourquoi nous sommes partisans d’encourager les reconversions et d’augmenter les capacités.
L’éventuel recours aux médecins traitants est un sujet difficile, pour ne pas dire tabou. Pourtant, il existe : les travailleurs indépendants, qui n’avaient pas accès aux services de santé au travail, ont passé un accord avec des médecins de ville afin d’organiser leur suivi médical. Mais il est vrai que la connaissance du poste de travail, celle des risques qui lui sont associés, mais aussi des aspects psychosociaux et organisationnels, sont autant d’éléments essentiels qui rendraient presque impossible le recours à d’autres professionnels que les médecins du travail. Cela étant, le médecin de ville a connaissance de l’état physique de son patient, l’entrée dans un poste ne pose pas nécessairement un problème, et certains postes ne présentent pas de risques particuliers. Les services de santé au travail peuvent suivre 10 millions de personnes par an. S’ils doivent également suivre toutes les embauches – soit 20 millions –, on peut imaginer une procédure particulière pour les salariés en bonne santé prenant un poste sans risque particulier. Bien entendu, le recours aux médecins de ville aurait un coût qu’il faudrait prendre en charge, et aurait pour effet de détourner une partie de leur activité.
Même si c’est difficile, la médecine du travail ne pourra que s’adapter aux nouvelles formes de travail. D’une manière générale, si le médecin s’entoure d’une équipe de santé, c’est parce qu’il doit faire face à des situations de plus en plus variées, de plus en plus complexes, à des maladies professionnelles plus nombreuses : affections physiques ou psychosociales, liées à l’âge, aux restructurations, à la mobilité professionnelle… Il faut, en particulier, trouver des modes d’organisation pour prendre en charge le million et demi de salariés travaillant à domicile. Là encore, un recours au médecin traitant peut être envisageable. En tout état de cause, nous sommes à la veille d’assister à des évolutions très intéressantes.
Il est vrai que le premier plan Santé au travail, s’il a donné lieu à de nombreuses signatures de principe, n’a pas eu les résultats escomptés, faute d’une bonne adaptation à ce nouvel outil. Le deuxième plan, compte tenu de la réforme que vous avez votée et des décrets attendus, pourrait changer la donne. Mais il convient d’améliorer l’organisation de la prévention, de faire en sorte que les capacités soient adaptées – sans quoi la plupart des visites d’embauche se réduiront à une simple formalité.
S’agissant de la coordination et du pilotage, une réflexion doit être menée sur la représentativité, notamment au sein du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Malgré l’importance du retour de terrain dont nous bénéficions, nous n’avons jamais la possibilité d’apporter au bon moment à nos interlocuteurs que sont l’État et les partenaires sociaux le fruit de notre expérience, sans même parler de prise de décision.
M. le rapporteur. Je serais heureux que vous puissiez me transmettre une note faisant la synthèse de vos propositions. Notre mission, monsieur Jacques Texier, n’est pas de réformer la médecine du travail. Et si, pour ma part, je suis favorable à ce que les médecins traitants puissent jouer un rôle dans ce domaine, la question est très complexe et ne fait de toute façon pas partie des attributions de cette mission.
J’ai simplement voulu évoquer les relations entre le médecin du travail et le médecin traitant en matière de prévention et de suivi médical. Ce dernier connaît bien son patient, il dispose d’informations sur sa vie familiale, ses antécédents, ses vaccinations. C’est pourquoi certains syndicats médicaux ont proposé qu’une synthèse du dossier médical soit transmise chaque année au médecin du travail, et inversement que ce dernier adresse au médecin traitant un bilan des risques auxquels le salarié est exposé à son poste, et des conséquences que ces risques peuvent avoir sur sa santé.
De même, il me semble souhaitable que le médecin du travail puisse accéder au dossier médical. Il serait en effet logique de recourir dans ce but à la carte Vitale, mais ce serait franchir un pas supplémentaire. M. Philippe Douste-Blazy n’était cependant pas le seul à s’opposer à cet accès : le groupe auquel appartient monsieur Jean Mallot y était tout aussi hostile. Certains pensent encore, en effet, que le médecin du travail est dépendant de l’entreprise et que l’employeur est aussitôt informé de tout ce qu’il est amené à apprendre.
En conclusion, je rappellerai notre volonté de mettre en place une véritable coordination. Ainsi, la logique voudrait que les plans régionaux de santé au travail, déclinaisons du plan national, soient en cohérence avec les plans stratégiques élaborés par les agences régionales de santé : la santé au travail est une partie de la santé. Il serait opportun de travailler ensemble au bénéfice du capital santé de chacun, ce qui est difficile car chacun défend ses intérêts : l’assurance maladie, par exemple, ne veut pas partager ses données de santé avec les complémentaires santé. Certains campent sur leur position plutôt que de les assouplir !
M. Bernard Salengro. Les médecins du travail subissent en partie la pression de l’employeur, de même qu’un médecin du régime minier – je le sais par expérience – subit la pression de la sécurité sociale minière. Quant aux médecins traitants, qui se disent libéraux, ils subissent de la part de l’assurance maladie et des praticiens conseils une pression particulièrement bien organisée, grâce aux contrats d’amélioration des pratiques individuelles, et doivent se soumettre aux prescriptions de M. Frédéric Van Roekeghem. L’indépendance totale n’existe pas, seul compte l’équilibre des pressions – et c’est pourquoi je réclame l’application d’un strict paritarisme.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les médecins libéraux tiendraient de meilleurs dossiers médicaux n’est pas justifiée pour les médecins du travail, dont les dossiers sont informatisés depuis très longtemps, et mieux suivis. Ces derniers ne demandent donc pas l’accès aux dossiers des médecins traitants jugés brouillons, mais regrettent de ne pouvoir transmettre leurs conclusions ou alertes. Dans le cas d’un retraité souffrant d’un cancer de la plèvre, par exemple, qui peut relever d’une exposition professionnelle à l’amiante, les confrères de la médecine de ville n’établiront pas ce diagnostic, ignorant les pathologies professionnelles.
M. Martial Brun. Je rappelle qu’une prévention réussie, c’est d’abord une évaluation des risques. Tous les efforts consentis en ce domaine auront pour effet d’améliorer la qualité de la prévention, d’autant que cette évaluation requiert l’intervention de tous les acteurs, y compris dans l’entreprise, afin de trouver des solutions pratiques sur le terrain.
Par ailleurs, nous participons, au sein des agences régionales de santé, aux conférences régionales de santé et de l’autonomie : deux sièges sont en effet réservés aux représentants des services de santé au travail. Mais de nouveau, tout repose sur le diagnostic, les atlas régionaux de santé doivent donc intégrer la dimension de la santé au travail ce qui donnera beaucoup de visibilité à la politique régionale.
M. Jacques Texier. Une seule question n’a pas été abordée dans ce débat, celle de la pénibilité, associée à la réforme des retraites. Cette nouvelle mission confiée aux médecins du travail implique des accords entre partenaires sociaux, et un travail de définition. Il faudra également se doter d’un outillage informatique considérable.
M. le coprésident Jean Mallot. Merci pour cette contribution très utile à nos réflexions.
*
Audition de M. Bertrand Arnoux, ophtalmologue, membre du réseau de santé CARéDIAB
M. le coprésident Jean Mallot. Monsieur Bertrand Arnoux, je vous souhaite la bienvenue. A été régulièrement évoqué, au cours de nos travaux, l’engagement des acteurs de terrain du dépistage. Je laisse à monsieur le rapporteur le soin de vous interroger plus précisément sur votre rôle en la matière.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Merci, monsieur le président. En effet, nous avons entendu, dans le cadre de nos travaux, des représentants de Groupama. Ceux-ci ont évoqué la mise en place réussie, dans le département des Ardennes où les ophtalmologues sont peu nombreux, d’un dispositif de dépistage du diabète par examen du fond de l’œil grâce à l’utilisation d’un rétinographe mobile, les données recueillies étant télétransmises à des médecins ophtalmologistes chargés de les interpréter. Notre attention a cependant été appelée sur certaines des limites auxquelles s’est heurtée la mise en œuvre de ce dispositif, en raison, notamment, de la difficulté qu’il y avait pour le réseau à repérer les patients souffrant de diabète, faute d’une transmission par l’assurance maladie des données utiles à Groupama. Pourriez-vous nous faire part de vos observations sur cette question ?
M. Bertrand Arnoux, ophtalmologue, membre du réseau de santé CARéDIAB. Je participe au réseau CARéDIAB (Champagne-Ardenne Réseau Diabète) en tant que médecin ophtalmologiste « lecteur » des données qui me sont télétransmises. Groupama a d’abord sollicité CARéDIAB pour mener l’expérimentation que vous avez décrite dans les environs de Signy-l’Abbaye, durant quelques semaines. Puis, des actions similaires ont été conduites dans l’ensemble du département des Ardennes.
Nous exerçons notre activité de dépistage du diabète en utilisant, dans divers sites préalablement déterminés, un rétinographe non mydriatique. Les lieux le plus souvent sélectionnés sont caractérisés par une faible densité médicale. On compte en effet, comme vous l’avez noté, peu d’ophtalmologues dans les Ardennes – seulement huit ou neuf – et ceux-ci sont regroupés à Charleville-Mézières, Sedan et Rethel. Le département comporte donc de nombreuses « zones d’ombre ». C’est pourquoi CARéDIAB, organisation dont le siège est situé à Reims, a choisi de faire porter son action dans les départements où l’accès des patients à des consultations en ophtalmologie est réduit.
C’est ainsi que, depuis 2009, divers sites ont été sélectionnés pour y installer, pour une durée de un à trois mois, le rétinographe. Nos séances sont prévues longtemps à l’avance. Nous avions dans un premier temps fait appel aux médias pour faire connaître notre action de dépistage et indiquer les lieux où la consultation est organisée. Les résultats ayant été décevants, nous diffusons désormais des brochures d’information, éditées par CARéDIAB et distribués dans les boîtes aux lettres ainsi qu’auprès des médecins traitants, des pharmaciens et des infirmiers. Les patients diabétiques, souvent peu suivis par un ophtalmologue, peuvent alors prendre rendez-vous pour une consultation. Une orthoptiste gère le rétinographe que l’on place généralement dans un lieu médicalisé, par exemple un hôpital ou une maison de retraite. Les clichés pris par l’orthoptiste sont ensuite transmis sur un serveur et lus par deux ophtalmologues, le docteur Jean-Bernard Colombain et moi-même, dans un délai de huit à dix jours.
M. le rapporteur. Quelle a été l’origine de ce projet ? Comment est-il coordonné ?
M. Bertrand Arnoux. CARéDIAB est un réseau créé par une association rémoise dont le rayon d’action s’étend à l’ensemble de la région Champagne-Ardenne. La région compte en réalité deux réseaux, ADDICA (Addictions Précarité Champagne-Ardenne), spécialisé dans le domaine des addictions et de la précarité, et CARéDIAB, qui suit le diabète. Ce dernier nous a sollicités, mon confrère et moi-même, en 2008 pour participer au dépistage du diabète par examen rétinographique du fond de l’œil. Nous avons alors mis en œuvre le dispositif que je vous ai décrit dans les Ardennes où la présence d’ophtalmologues et la prise en charge des pathologies diabétiques étaient faibles. Ce faisant, nous nous sommes largement inspirés de systèmes similaires existant à peu près partout sur le territoire national et reposant sur la prise de clichés dans un centre fixe ou mobile. Nous avons opté pour un centre itinérant de trois mois en trois mois.
M. le rapporteur. Vous nous avez déclaré que CARéDIAB était une association. Quels en sont les membres ?
M. Bertrand Arnoux. CARéDIAB a été créée en 2004 par l’association ADDICA, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, elle-même créée en 2001 ; par la suite, divers regroupements ont eu lieu au sein d’une association rebaptisée « Réseau(x) de santé addictions, précarité et diabète de Champagne-Ardenne ». Le réseau CARéDIAB dont l’objet consiste à améliorer la prise en charge des patients diabétiques travaille donc avec les médecins spécialistes concernés. C’est donc à ce titre que moi-même et mon confrère y participons.
M. le rapporteur. La création de ce réseau résulte-t-elle de l’initiative de diabétologues ou d’associations de patients diabétiques ? Par ailleurs, comment l’acquisition d’un rétinographe a-t-elle été financée ?
M. Bertrand Arnoux. Cet investissement a été financé grâce à une dotation du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS). CARéDIAB bénéficie en outre du soutien financier de divers investisseurs comme l’agence régionale de santé et le conseil régional de Champagne-Ardenne.
M. le rapporteur. Vous nous avez indiqué avoir connu des difficultés pour vous faire connaître auprès des patients et avoir, en conséquence, distribué diverses brochures d’information. Pour sa part, Groupama nous a fait part de problèmes de transmission de données médicales. Votre action, destinée aux patients diabétiques, serait sans doute grandement facilitée si vous pouviez les identifier et ainsi les inviter directement à vos consultations. Une transmission de données par l’assurance maladie, de médecin à médecin, ou une invitation des patients transmise par leurs médecins traitants seraient-elles envisageables ?
M. Bertrand Arnoux. Les invitations peuvent effectivement être transmises par les médecins traitants. Nous rencontrons en revanche des difficultés pour obtenir des caisses primaires d’assurance maladie des listes de patients diabétiques que nous pourrions directement contacter, alors même qu’elles disposent de ces informations. Cela étant, j’ai pu constater, lors de mon exercice en tant que médecin libéral, que des patients diabétiques reçoivent de l’assurance maladie des courriers les incitant à participer à des actions de dépistage, soit dans le cadre du réseau CARéDIAB, soit dans celui de contrôles annuels du fond de l’œil, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé de mars 2011. Il n’en demeure pas moins que nous pourrions sans doute espérer davantage de coopération de la part des caisses primaires et que nous sommes, pour l’instant, contraints à pratiquer une forme de démarchage pour faire connaître notre dispositif.
M. le rapporteur. La proportion, pour un secteur donné, de la population diabétique se rendant à vos consultations de rétinographie a-t-elle été évaluée ? Par ailleurs, ne pourriez-vous pas vous avoir recours aux pharmaciens pour vous faire connaître des diabétiques ?
M. Bertrand Arnoux. Bien sûr, de même que nous faisons connaître notre dispositif par l’intermédiaire des médecins traitants qui sont informés à l’avance du passage du rétinographe dans la région où ils exercent. Des réunions médicales sont ainsi organisées par CARéDIAB dans les deux ou trois mois qui précèdent ce passage afin de présenter aux médecins traitants la rétinographie diabétique et les inciter à promouvoir le dépistage auprès de leurs patients. On constate néanmoins parfois chez eux une certaine frilosité…
M. le coprésident Jean Mallot. À quoi l’imputez-vous ?
M. Bertrand Arnoux. Je ne saurais dire… Il m’arrive de recevoir dans mon cabinet des patients n’ayant bénéficié d’aucun contrôle de rétine depuis quatre à cinq ans, sans que je ne me l’explique. Le message de prévention n’est peut-être pas très bien perçu… Cela étant, la question est de plus en plus évoquée. La Haute Autorité de santé a récemment émis des recommandations en la matière. J’ai aussi constaté, au cours de l’émission À vous de voir sur France 5, que madame le professeur Pascale Massin, de l’hôpital Lariboisière, a alerté sur les dangers d’un dépistage trop tardif de la rétinopathie diabétique. Il est possible que la province soit moins réceptive à ces messages.
M. le rapporteur. Vos propos, fort intéressants, renvoient à la problématique générale de la prévention. Il est erroné de penser que la prévention permet de faire des économies, au moins à court terme. Ainsi, il est notoire que les diabétiques sont mal suivis. Si tel n’était pas le cas et s’ils bénéficiaient d’examens réguliers, cela se traduirait, dans un premier temps, par une charge sensiblement accrue pour l’assurance maladie. Ce n’est qu’ensuite qu’apparaîtrait un intérêt financier en raison des complications évitées grâce à la prévention. Je m’interroge par ailleurs sur les réticences que certains médecins éprouvent à promouvoir les actions de dépistage qui pourraient peut-être être surmontées grâce à la formation initiale et continue. La nouvelle convention de juillet 2011 régissant les rapports de l’assurance maladie et des médecins libéraux a heureusement prévu la mise en place d’indicateurs de suivi des diabétiques ; on peut espérer que celle-ci sera suivie d’effets.
M. le coprésident Jean Mallot. Est-il prévu une évaluation du dispositif que vous avez mis en œuvre, en vue de son éventuelle généralisation ? Présente-t-il des spécificités par rapport aux expérimentations qui ont pu être menées dans d’autres départements, notamment en termes de modalités d’exercice ?
M. Bertrand Arnoux. Non. Nous avons reproduit le système qui existait un peu partout en France. La plupart des régions sont dotées d’un dispositif de dépistage similaire. Le plus connu et dont nous nous sommes inspirés est le réseau OPHDIAT, piloté par l’hôpital Lariboisière. Il comprend une trentaine de sites en région parisienne, un en Guyane et d’autres en milieu carcéral. Mais de nombreux autres réseaux existent, tels DIAMIP (Diabète Midi-Pyrénées), Atlantique Diabète dans la région Atlantique ou encore PrévArt (Prévention Artois), dans le Nord. Chacun comporte ses spécificités : utilisation d’un rétinographe fixe ou mobile, télétransmission ou transmission des clichés par d’autres moyens.
Pour ce qui concerne CARéDIAB, notre expérience de dépistage est relativement récente puisqu’elle a débuté en 2009. Elle n’a pas été évaluée à ce jour, si ce n’est dans le cadre d’une thèse de fin de stage par un médecin de santé publique. Je ne peux donc vous communiquer de données précises sur ce point, mais j’ai le sentiment que nous disposons d’une marge de progression importante. Nous en sommes au troisième ou quatrième passage du rétinographe dans certaines communes ce qui nous permet de commencer à être connus et les patients reviennent nous consulter.
M. le rapporteur. Quel est le budget de fonctionnement annuel de l’association ? Quelles sont vos modalités de rémunération ?
M. Bertrand Arnoux. 12 à 15 patients sont examinés par semaine. La lecture des clichés est partagée entre les deux médecins ophtalmologistes. Chaque lecture donne lieu à une rémunération de 15 euros, qui nous est acquittée par CARéDIAB. Le fonds de roulement de l’association provient essentiellement de dotations du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
M. le rapporteur. De tels dispositifs ont indéniablement un impact financier, surtout dans la durée.
M. Bertrand Arnoux. Je fais tout mon possible pour que nous progressions, afin de prévenir les complications. Cela est parfois difficile et nous pouvons nous heurter à certaines réticences.
M. le coprésident Jean Mallot. Monsieur Bertrand Arnoux, je vous remercie de nous avoir exposé votre expérience, particulièrement intéressante.
*
AUDITION DU 17 JANVIER 2012
Audition de Mme Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir Madame Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé.
Madame la secrétaire d’État, je vous souhaite la bienvenue au sein de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la prévention sanitaire. Votre audition, qui constitue l’avant-dernière de la série, nous permettra de connaître le point de vue du Gouvernement sur à un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés par la Cour des comptes.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. Merci, madame la secrétaire d’État, d’avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous le savez, le système de santé français est très orienté vers le curatif, et se révèle encore médiocre en matière de prévention.
La récente communication de la Cour des comptes montre qu’il est difficile d’évaluer les sommes qui sont consacrées à la prévention, puisqu’elles oscillent entre 1 milliard d’euros, si l’on prend uniquement en compte le fonds de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de l’assurance maladie et le programme 204 du ministère de la santé, et 10 milliards d’euros, si l’on prend en compte toutes les actions, notamment celles des professionnels de santé.
Mais surtout, il révèle un défaut majeur de pilotage. Plusieurs ministères interviennent dans la prévention – santé, éducation nationale, environnement. Chaque caisse mène sa propre politique – Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, Mutualité sociale agricole, par exemple, sans compter les professionnels de santé, comme les dentistes ou les associations ou encore les collectivités territoriales.
La Cour des comptes dénonce par ailleurs la loi de santé publique du 9 août 2004 et ses 100 objectifs, qui ne permettent pas de dégager de réelle priorité, ainsi que la quarantaine de plans existants, dont les moyens sont souvent insuffisants et dont les résultats ne sont pas toujours satisfaisants.
Ce sera l’objet de ma première question : comment définir demain des priorités, afin d’être efficace ? L’Angleterre, par exemple, n’en a retenu que trois ou quatre.
Ma deuxième question sera liée au pilotage de la prévention, La Cour des comptes propose d’en charger le soin à un délégué interministériel, qui pourrait être le directeur général de la santé. Mais est-ce possible, dans la mesure où celui-ci a déjà des responsabilités très importantes au sein du ministère ? Quels seraient ses pouvoirs sur les ministères de l’éducation nationale et du travail ? Les agences régionales de santé ayant à leur tête un responsable unique de la santé au niveau régional, ne pourrait-on pas imaginer plutôt que la secrétaire générale du Comité national de pilotage des agences régionales de santé soit chargée de piloter la prévention dans notre pays ?
Madame la secrétaire d’État, ces deux questions me semblent particulièrement importantes. J’aurai l’occasion de vous en poser d’autres tout à l’heure.
Mme Nora Berra, secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé. Messieurs les coprésidents, monsieur le rapporteur, merci de m’avoir invitée à travailler avec vous sur cette question majeure qu’est la prévention sanitaire.
Vous venez d’évoquer certains constats opérés par la Cour des comptes sur la politique de santé publique de notre pays ainsi que les 100 objectifs de la loi de 2004, laquelle a identifié cinq plans stratégiques : le plan de lutte contre le cancer, le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives, le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs d’environnement, le plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques et le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies rares. D’autres plans, comme le plan Alzheimer, sont venus se surajouter.
On peut évoquer ce qui ne va pas. Mais il ne faut pas oublier de mentionner ce qui marche bien. Je citerai donc l’amélioration de l’état de santé des Français et la progression continue de l’espérance de vie à la naissance, le recul de la mortalité infantile depuis cinquante ans, la bonne santé et la bonne information des jeunes, la diminution de la consommation d’alcool et la meilleure prise en compte des déterminants environnementaux. Cela dit, des progrès restent à faire dans plusieurs domaines : la lutte contre la mortalité prématurée, puisque 20 % des décès sont évitables ; les problèmes de santé liés au grand âge ; le surpoids et l’obésité ou les maladies chroniques.
La stratégie en matière de santé amène à prendre en compte plusieurs déterminants, et notamment des déterminants de santé communs sur lesquels on peut agir transversalement : par exemple, les inégalités sociales de santé ou les problèmes liés à l’alcool ou au tabac que l’on retrouve dans une multitude de plans, dans la mesure où ils ont été identifiés comme facteurs de risque dans diverses pathologies.
Cette stratégie amène à prendre en compte l’interministérialité des sujets qui mériterait d’être renforcée, et la diversité des acteurs. Je pense tout particulièrement aux agences régionales de santé, acteurs nouveaux dans notre paysage sanitaire, qui sont chargées de mettre en œuvre, à l’échelle des territoires, la politique de santé publique, tout en prenant en compte les spécificités territoriales.
Le ministère de la santé a donc élaboré la stratégie nationale de santé 2011-2015, qui reflète une vision commune et partagée des objectifs de la politique de santé. De fait, cette stratégie nationale n’a pas été élaborée au niveau central par l’administration centrale, mais l’a été avec la participation d’associations de malades, d’usagers du système de santé et des professionnels de santé. Et elle a été plutôt bien accueillie par la Conférence nationale de santé.
La démarche dans laquelle nous nous sommes engagés consiste à renforcer le pilotage et le suivi de la stratégie globale et des plans ou programmes prioritaires, en associant l’ensemble des directions des ministères, des caisses, des agences nationales et régionales. Les agences régionales de santé ont mené un travail d’intégration et de vision transversale, allant de la prévention vers le soin et vers le médico-social, à travers les projets régionaux de santé.
Cette démarche de coordination stratégique des différents acteurs a déjà commencé. Certains des grands plans de santé publique, comme le plan national de lutte contre le VIH/SIDA, le plan Maladies rares ou le plan Obésité, disposent d’un comité de suivi et de prospective, que j’ai moi-même installé. Ces comités de suivi et de prospective permettent d’apprécier, à partir d’un certain nombre d’indicateurs, les actions engagées, mais surtout de proposer leur réorientation, si besoin est.
Vous avez évoqué l’éventualité de nommer le directeur général de la santé délégué interministériel à la prévention. Cette proposition mérite d’être étudiée. Je ne suis pas opposée à une transversalité pilotée par la direction générale de la santé. D’une part, les plans de santé sont tous interministériels. D’autre part, si le directeur général de la santé assurait une telle fonction, nous serions dans une configuration équivalente à celle que nous avons connue lors de l’épisode de la grippe aviaire, avec la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire. Le directeur général de la santé aurait alors compétence auprès des différents ministères.
M. le rapporteur. Nous avons reçu des représentants du ministère du travail - qui gère la médecine du travail – et du ministère de l’éducation nationale – qui gère la médecine scolaire, aujourd’hui en déshérence. Or nous n’avons pas senti de leur part une grande volonté de coopération.
Pour que la situation s’améliore, il faudrait que ce délégué dispose d’un vrai pouvoir sur l’ensemble des acteurs de la santé. Il pourrait être nommé par le Premier ministre, ce qui le sortirait, d’une certaine façon, du ministère de la santé. Ce dernier n’y est sans doute pas favorable. Mais il n’est pas évident de trouver un responsable de la santé qui ait pouvoir à la fois sur la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la Mutualité sociale agricole, les complémentaires et les ministères. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que l’exemple de la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire soit vraiment un bon exemple.
Mme la secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, j’ai fait les mêmes constats que vous. Je voudrais moi aussi que l’on consolide la médecine scolaire. Et je suis tout à fait d’accord pour renforcer le pilotage des politiques de santé, dont l’éclatement nous fait perdre en efficience.
Nous avons besoin d’un pilotage unifié, avec une vision transversale et interministérielle, pour que chaque politique progresse efficacement.
Le directeur général de la santé pourrait être délégué interministériel à la prévention, dans la mesure où c’est de la direction générale de la santé que part toute politique de santé. Vous avez suggéré que ce soit la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. Certes, le secrétariat général pilote les agences régionales de santé. Mais il me semble qu’il a davantage un rôle opérationnel qu’un rôle d’élaboration des stratégies, dans une optique transversale. Cela dit, je ne suis pas opposée cette idée.
Par ailleurs, si je vous ai donné l’exemple de la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, c’est parce que le délégué interministériel tenait son pouvoir du Premier ministre. Pour plus de cohérence et d’efficacité, nous pourrions tout à fait imaginer qu’il en soit ainsi du directeur général de la santé.
M. le rapporteur. Nous avons auditionné plusieurs directeurs généraux de la santé, dont l’actuel : ils sont très pris par le quotidien et pensent n’avoir aucun pouvoir sur le ministère du travail et de l’éducation nationale – et sans doute peu sur la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Au moment de la création des agences régionales de santé, l’idée a été lancée d’une Agence nationale de santé. On pourrait envisager que son directeur, ayant un pouvoir sur l’ensemble des intervenants, s’occupe de la prévention.
Mme la secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, il y a déjà beaucoup d’agences et l’organisation de notre système de santé manque de lisibilité. Nous pourrions prendre comme modèle la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire en faisant en sorte que ce soit le Premier ministre qui octroie au directeur général de la santé cette responsabilité. Cela devrait suffire à contrecarrer toute tentative de récupération par l’un ou l’autre ministère. Mais je vous l’accorde : nous nous heurtons aujourd’hui, au niveau central, à un certain cloisonnement entre les différentes administrations des différents ministères.
M. le rapporteur. C’est l’un des problèmes qu’il nous faudra résoudre. Mais venons-en à d’autres questions plus précises.
S’agissant du cancer du sein, la Cour des comptes dénonce le système en vigueur, qui fait coexister un dépistage organisé, avec la certification des mammographes et la garantie d’une double lecture, et un dépistage individuel. Comment remédier à ce problème, si ce n’est en demandant que l’on applique les mêmes critères au dépistage individuel ? Par ailleurs, le dépistage organisé ne touche que 50 % des femmes concernées, ce qui est insuffisant pour remporter le succès que l’on pourrait espérer. Comment l’améliorer ?
S’agissant du cancer du côlon, tout le monde est bien conscient des défauts du test hémoccult. La Haute Autorité de santé demande qu’on le remplace par le test immuno-histo-chimique. Le ministère de la santé y est-il favorable ?
M. le coprésident Pierre Morange. Madame la secrétaire d’État, ne serait-il pas judicieux de se recentrer sur trois ou quatre objectifs prioritaires, à l’instar de ce que font nos amis d’outre-Manche, afin de donner plus d’efficience à notre politique de santé publique ?
Mme la secrétaire d’État. Le dépistage organisé du cancer du sein touche 50 % des femmes ciblées tandis que, parallèlement, le dépistage individuel en toucherait à peu près 10 %. On peut considérer que ce n’est pas suffisant. Malgré tout, je crois qu’il faut maintenir ce dépistage individuel, qui concerne des femmes qui pourraient ne pas se soumettre au dépistage organisé. Une certaine frange de la population féminine n’intégrera pas le dépistage organisé, parce qu’elle considère qu’il s’adresse aux femmes qui n’ont pas les moyens de financer leur mammographie. Il me semble donc important de conserver les deux dispositifs, qui sont finalement assez complémentaires.
Mais comment motiver davantage de femmes qui ne se font pas dépister, soit parce qu’elles ont peur d’être malades ou parce qu’elles ne se sentent pas concernées ? Comment les persuader que le dépistage concerne toutes les femmes et qu’il permet d’éviter que la maladie ne s’aggrave, si elles devaient la développer ? Le problème est là.
M. le rapporteur. On connaît les causes, notamment psychologiques, de la faiblesse du dépistage. Mais on a surtout du mal à atteindre certaines femmes qui sont un peu « hors circuit », celles qui sont peu suivies et appartiennent plutôt aux milieux défavorisés. Il en est d’ailleurs de même du dépistage du cancer du col utérin.
S’agissant du cancer du sein, la Cour des comptes a insisté sur le fait que l’on risquait de dépister des petits cancers qui n’évolueraient pas ou peu. Je ne comprends pas très bien son point de vue. Comme l’a dit M. Jean-Luc Harousseau auditionné par notre mission, mieux vaut enlever un petit cancer plutôt que d’attendre pour voir s’il évolue ou non.
Selon moi, il faut maintenir le dépistage individuel parce qu’on ne pourra pas l’éviter. Mais il faudrait aussi en améliorer la qualité en imposant la certification des mammographes, voire la double lecture, comme on l’a fait pour le dépistage collectif.
S’agissant du cancer colorectal, j’insiste sur le manque de performance du test hémoccult, caractérisé par 40 % de « faux négatifs » et 50 % de « faux positifs ».
Mme la secrétaire d’État. Il s’agit bien évidemment d’inciter les femmes à se faire dépister. C’est le rôle des campagnes de sensibilisation. Mais il faut aussi mobiliser les professionnels qui sont parfois réticents à préconiser ce dépistage en raison d’un risque de « surdiagnostic ». C’est le rôle des structures de gestion, qui sont les instances opérationnelles assurant l’organisation locale des dépistages des cancers dans un ou plusieurs départements.
Il faut continuer à travailler avec ces professionnels et peut-être réfléchir à la mise en place d’une consultation de prévention/dépistage, pour cibler les individus en fonction des différents facteurs de risque. Mais cette consultation ne concernerait pas que les femmes et ne porterait pas que sur les cancers du sein.
S’agissant du cancer colorectal, l’Institut national du cancer mène en ce moment un travail sur l’intérêt de remplacer le test hémoccult par les tests immuno-histo-chimiques. Il a identifié trois différents tests immuno-histo-chimiques, qui font l’objet d’évaluations techniques et médico-économiques et dont les résultats devraient être connus d’ici à quelques semaines. C’est en fonction de ces résultats qu’une décision pourra être prise.
M. le rapporteur. Il serait temps d’évoluer.
Vous avez eu raison de parler des consultations de prévention, car la demande est importante. Celles-ci pourraient être organisées en fonction des âges. En effet, nos interlocuteurs ont déploré que les personnes entre trente et cinquante ans, qui se considèrent en bonne santé, ne consultent pas. Pourtant, c’est pendant cette période de la vie que certaines maladies comme l’hypertension artérielle ou le diabète commencent à se développer. Ces consultations permettraient de déceler ces maladies et de prodiguer des conseils d’hygiène de vie.
La Mutualité sociale agricole a eu une idée intéressante, que la mission reprendra peut-être : elle envoie un auto-questionnaire à ses adhérents, avec une préconisation d’examen biologique, et ceux-ci vont consulter leur médecin traitant pour une consultation de prévention tous les cinq ans.
Mme la secrétaire d’État. C’est ce que fait la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dans les centres d’examens de santé.
M. le rapporteur. Non, parce que ces centres ont été réorientés vers les populations à risque et qu’il n’y a pas de consultation de prévention.
Mme la secrétaire d’État. Cela s’adressait à tout le monde.
M. le rapporteur. Ce n’est plus le cas. La Cour des comptes a d’ailleurs critiqué l’abandon des consultations systématiques dans les centres d’examens de santé. Mais on pourrait imaginer d’organiser des consultations de prévention auprès du médecin traitant.
Mme la secrétaire d’État. Je suis tout à fait d’accord. D’ailleurs, la situation évolue. Dans le cadre de la convention médicale qui vient d’être signée, est explicitement prévue la rémunération, sur une base forfaitaire, des consultations de prévention/dépistage s’adressant des personnes qui auraient des antécédents familiaux ou seraient particulièrement exposées à certaines pathologies.
M. le rapporteur. Je vous propose de passer à un autre sujet, très sensible pour la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés : la transmission des données de santé.
Aujourd’hui, un éclatement des flux permet aux complémentaires d’intervenir. Or la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est en train de mettre en place un nouveau système informatique qui évitera cet éclatement et qui retirera aux complémentaires des informations qu’elles possèdent déjà.
Par ailleurs, Groupama a mis en place, notamment dans le département des Ardennes, un dépistage du fond d’œil pour des patients souffrant de diabète et d’hypertension artérielle : un rétinographe mobile envoie par TéléSanté les clichés à un ophtalmologue, pour qu’il les interprète. L’initiative est intéressante. Le problème est que l’on ne sait pas qui, localement, souffre de diabète ou d’hypertension artérielle. Comment faire pour mieux connaître la population intéressée ? On pourrait imaginer que le médecin de la caisse transmette au médecin de l’assurance le nom des personnes concernées, qui pourraient être invitées à se présenter. Mais la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est très jalouse de ses pouvoirs.
Il n’y a pas de transmission des données entre la médecine scolaire et le médecin traitant. Lors de la visite destinée aux enfants de six ans, le médecin scolaire donne une lettre aux parents, mais ne l’envoie pas au médecin traitant. Il ne faut pas s’étonner que l’année suivante, ses préconisations n’aient pas été suivies d’effet.
Il n’y en a pas non plus entre le médecin traitant et le médecin du travail. Le président du syndicat MG France préconise donc que, chaque année, le médecin traitant fasse une synthèse des données de son patient et la transmettre au médecin du travail. Ce dernier lui transmettrait les risques du poste de travail, dont le médecin traitant n’a pas connaissance. Cette idée nous semble intéressante.
Malheureusement, nous nous heurtons à des blocages. En particulier, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ne veut pas transmettre ses données aux complémentaires, lesquelles considèrent qu’elles opèrent des remboursements en aveugle, dans la mesure où elles n’ont pas connaissance de toutes les données. Il semble même que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés soit en train, pour ainsi dire, de renforcer ses frontières.
Mme la secrétaire d’État. Le code de la santé publique ne permet pas le partage des données de patients entre des médecins traitants et des médecins qui font un travail de prévention, les médecins du travail étant considérés comme tels.
M. le rapporteur. Le code de la santé publique se change par la loi.
Mme la secrétaire d’État. Nous n’en sommes pas là. Cela dit, le dossier médical personnel peut constituer une réponse intéressante, dans la mesure où il comporte des données renseignées par le médecin traitant et les autres médecins et accessibles au patient. Le patient a la main sur son dossier et peut rendre confidentielles certaines données qu’il n’a pas envie de faire partager.
M. le coprésident Pierre Morange. Un amendement, issu d’une proposition de loi, a autorisé, à titre expérimental, la mise en place de cette information médicale sur des supports informatiques, clés USB ou cartes mémoires. L’Agence des systèmes d’information partagés de santé en a été chargée. Or elle ne nous a pas fourni, sur cette expérimentation, les informations que nous serions en droit d’attendre. Quelles que soient les modalités choisies, des dispositions législatives ont été votées. Il importe qu’elles soient appliquées.
Je précise que nos amis britanniques ont englouti dans le dossier médical personnel des sommes énormes, pour un résultat des plus contestables. Quant à nos amis allemands, ils ont abandonné le principe d’un dossier médical personnel avec serveurs centraux. Cela rend d’autant plus légitime l’idée consistant à utiliser des supports informatiques, comme par exemple les clés USB, qui assurent plus de souplesse.
La représentation nationale serait donc très attentive à ce que, du fait de votre fonction éminente, vous nous fassiez un rapport très précis de la question.
Mme la secrétaire d’État. J’ai bien entendu votre interpellation, monsieur le coprésident. Sur ces questions très techniques, liées au dossier médical personnel, j’interrogerai l’Agence des systèmes d’information partagés de santé afin de vous faire un état des lieux complet des expérimentations en cours.
S’agissant du dossier médical personnel avec serveur, 30 000 dossiers, avec interopérabilité entre les différents acteurs, sont aujourd’hui opérationnels. Pour le moment, le dispositif mis en place semble fonctionner. On peut le diversifier. Je n’ai pas d’a priori. Mais ce qui compte, c’est que l’on puisse faire gagner des chances au patient.
M. le rapporteur. Revenons à la prévention sanitaire. L’année dernière, lorsqu’il avait été question de retirer l’hypertension artérielle bénigne des affections de longue durée, j’avais fait remarquer que si cette hypertension n’était pas bien traitée, nous irions au-devant de complications. Or cette année, c’est l’hypertension artérielle sévère qui a été retirée de cette liste.
J’ai cru comprendre que certaines directions du ministère n’étaient pas très favorables au retrait de l’hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée. M. Jean-Luc Haroussseau nous a dit clairement qu’il en était de même de la Haute Autorité de santé. Et M. Joël Ménard, l’ancien directeur général de la santé, par ailleurs cardiologue, y est tout à fait opposé. Pouvez-vous donc m’indiquer qui a pris cette décision ?
Mme la secrétaire d’État. Ce qui compte, c’est de prendre en charge l’hypertension sévère pour prévenir des risques sanitaires graves. Le médecin qui vous parle en est tout à fait convaincu. Mais faut-il ou non la prendre en charge dans le cadre des affections de longue durée ? C’est une question tout à fait pertinente. Qui a pris la décision de la retirer de la liste ? Je crois que c’est la direction générale de la santé. Cela dit, sensibilisée par M. Joël Ménard, celle-ci a mis en place avec lui un groupe de travail pour tenter de définir les modalités d’une prise en charge optimale de l’hypertension sévère dans le cadre du parcours de soins.
M. le rapporteur. Qu’on espère faire ainsi des économies, je le comprends. Reste qu’en termes de santé publique, cette mesure de retrait ne me paraît pas très bonne. Et là-dessus, tout le monde est à peu près d’accord.
Je souhaiterais maintenant évoquer la question du calendrier des vaccinations. Certaines vaccinations sont obligatoires. Mais qui vérifie qu’elles ont bien été faites ? Que fait-on quand ce n’est pas le cas ?
Mme le secrétaire d’État. Il y a peu de vaccinations obligatoires. Il faut se demander comment sensibiliser les familles et, surtout, les professionnels de santé.
Le calendrier vaccinal est un agenda très complexe. Il faut le retravailler pour lui donner davantage de clarté et donc de lisibilité. Dans ce but, avant l’été, j’ai demandé à la direction générale de la santé de mettre en place un groupe de travail qui se concerte avec les organisations professionnelles concernées, le Conseil national de l’ordre, le Haut Conseil de la santé publique. Je peux d’ores et déjà vous dire que le nouveau calendrier vaccinal sera plus pratique et prendra davantage en compte l’âge des enfants. Aujourd’hui, il est établi vaccin par vaccin, ce qui explique qu’il soit difficile de s’y repérer. Demain, le professionnel saura immédiatement quel vaccin et quel rappel faire à l’enfant qui est en face de lui.
M. le rapporteur. Pensez-vous qu’il faille rendre le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) obligatoire ?
Mme la secrétaire d’État. Je ne suis pas convaincue que cela améliorerait la couverture vaccinale.
M. le rapporteur. Sauf si on intègre cette obligation dans les performances des médecins traitants !
Mme la secrétaire d’État. La couverture vaccinale du ROR, même si elle n’est pas parfaite, n’est pas non plus complètement catastrophique. Il ne faut pas noircir exagérément le tableau. L’action entreprise depuis plusieurs mois par le Gouvernement a d’ailleurs permis de remonter les ventes de ce vaccin de 3 %, ce qui prouve le succès des campagnes que nous avions mises en place. La semaine européenne de la vaccination a même été entièrement dédiée au ROR.
M. le coprésident Morange. Ne pensez-vous pas que le courant de pensée qui prône de résister à la protection vaccinale est en train de se développer ? Quels qu’en soient les fondements philosophiques, il aboutit à renvoyer la responsabilité de l’immunité collective sur son voisin. Ne conviendrait-il pas de faire preuve de davantage de fermeté ? En deçà de 75 % à 80 %, la couverture vaccinale n’est pas efficace. Or nous assistons à l’émergence de certaines maladies, dont la rougeole.
Mme la secrétaire d’État. En effet, c’est une question de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. À chaque campagne vaccinale, qu’il s’agisse de la semaine européenne de la vaccination ou de la campagne de vaccination contre la grippe, je martèle ce message : il faut éviter d’être malade soi-même et de contaminer les autres. Mais sans doute devrons-nous faire preuve d’innovation pour mieux sensibiliser le public. Je reste ouverte aux propositions que vous pourriez me faire.
M. le rapporteur. Le Haut Conseil de la santé publique a été quelque peu critiqué par la Cour des comptes. M. Yves Bur a même proposé sa suppression. Ce conseil ne fait-il pas double emploi avec la Conférence nationale de santé et la Haute Autorité de santé ? Qu’en pensez-vous ?
Mme la secrétaire d’État. Personnellement, je ne crois pas qu’il y ait lieu de supprimer le Haut Conseil de la santé publique. En dehors des recommandations qu’il nous fait lorsque nous le sollicitons, ce conseil évalue les plans de santé publique. Il a évalué dernièrement le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur (2006-2010) ; le plan Antibiotiques 2007-2010 ; le plan national Bien vieillir 2007-2009 ; le plan national Maladies rares 2005-2008 et le premier plan Cancer…
M. le rapporteur. La Haute Autorité de santé ou la Conférence nationale de santé ne pourrait-elle pas s’en charger ?
Mme le secrétaire d’État. Le Haut Conseil de la santé publique évalue les plans, non pas du point de vue médico-économique, mais du point de vue médical. Il se prononce sur la pertinence de la stratégie médicale en termes de santé publique, ce qui est très important. Son avis est sollicité sur la programmation et la décision en prévention, la conception et l’évaluation des stratégies de sécurité sanitaire.
M. le rapporteur. Nous avons reçu ses représentants.
Mme la secrétaire d’État. Le Haut Conseil de la santé publique est une force de proposition et une instance d’expertise.
M. le rapporteur. Je n’en fais pas une affaire de principe. Mais admettez que l’on puisse s’interroger devant le nombre des structures existantes.
S’agissant de la Conférence nationale de santé, je remarque que la loi qui l’avait créée prévoyait la tenue d’un débat annuel sur la santé, destiné à définir des priorités avant l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Mais ce débat n’a jamais vu le jour, ce qui est regrettable.
Mme la secrétaire d’État. La Conférence nationale de santé est l’organe où s’exerce véritablement la démocratie sanitaire.
M. le rapporteur. Qui nomme ses membres ?
Mme la secrétaire d’État. Ne me dites pas que les usagers n’y sont pas représentés…
M. le rapporteur. D’autres propositions avaient été faites : la Conférence nationale de santé aurait pu être l’émanation des conférences régionales.
Mme la secrétaire d’État. Mais c’est pourtant ce qu’elle est…
M. le rapporteur. Les représentants des conférences régionales qui siègent à la Conférence nationale de santé sont nommés au niveau national.
Mme la secrétaire d’État. Aujourd’hui, la présidente de la Conférence nationale de santé est une présidente de conférence régionale. Il y a donc homologie entre le niveau régional et le niveau national. Cela dit, des améliorations sont toujours possibles, et j’accepte que l’on m’en propose.
M. le coprésident Pierre Morange. Notre rapporteur ne se focalisait pas sur le Haut Conseil de santé publique, dont nous ne contestons ni la qualité, ni les compétences. Mais il ne serait pas absurde de l’intégrer à la Haute Autorité de santé, car la réunion des deux structures pourrait renforcer leur capacité d’expertise. Le sujet avait été évoqué dans le rapport d’une mission d’information sur les agences sanitaires.
M. le coprésident Jean Mallot. J’ai également quelques questions à poser à madame la secrétaire d’État, que je remercie pour sa présence. Mais j’en profite pour lui adresser une requête en tant que vice-président du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de notre assemblée : les demandes que nous avions formulées concernant le suivi du rapport d’information présenté par nos collègues Christophe Sirugue et Claude Goasguen sur l’évaluation de l’aide médicale de l’État, rendu il y a quelques mois, sont restées sans réponse. Sans doute cette réponse est-elle restée bloquée « dans les tuyaux » de votre cabinet. Pourriez-vous vérifier ce qu’il en est ? Le comité d’évaluation doit en effet se réunir à la fin du mois.
Revenons à notre sujet. J’ai suivi attentivement vos échanges avec le rapporteur et le coprésident Pierre Morange. Or mon inquiétude va croissant : y a-t-il, dans notre pays, une vraie volonté politique de développer des actions de prévention sanitaire ? J’ai plutôt tendance à répondre par la négative, ne serait-ce que parce que nous attendons depuis maintenant deux ans la loi de santé publique qui aurait dû être présentée au Parlement.
Au cours de nos auditions, nous avons entendu parler de très bonnes pratiques en matière de prévention, qui mériteraient d’être généralisées sur l’ensemble du territoire. D’où ma première question : comment, en tant que membre du Gouvernement en charge de la politique de la santé dans ce pays, avez-vous concrètement organisé vos services pour détecter ces bonnes pratiques, les évaluer et les généraliser le cas échéant ?
J’ai bien conscience qu’il faut prendre en compte le caractère interministériel des sujets. Comment faites-vous pour y parvenir ? Les agences régionales de santé ont un rôle majeur à jouer. Quelles directives leur avez-vous données ? Comment organisez-vous le suivi de la mise en œuvre de ces directives en matière de prévention sanitaire ?
Il est temps de passer à l’action.
Par ailleurs, j’observe qu’on ne peut pas parler de prévention sans parler de médecine scolaire et de médecine du travail. Or la médecine scolaire a quasiment disparu du paysage, toutes les personnes auditionnées ont été d’accord pour le reconnaître. Quelles mesures a donc pris le Gouvernement pour la rétablir ? La médecine du travail, quant à elle, ne bénéficie pas à l’ensemble des travailleurs. De nombreuses catégories, en particulier les travailleurs indépendants, ne sont pas couvertes. Quelles mesures a pris le Gouvernement pour y remédier ?
Enfin, comment pensez-vous qu’il faille rémunérer les actes et les actions de prévention ? La question est difficile, d’autant que les organismes bénéficiaires des actions de prévention ne sont pas ceux qui les ont mises en œuvre. Je pense, pour ma part, que la convention médicale ne peut pas être la seule réponse en la matière. Mais, si vous le souhaitez, nous pourrons en reparler tout à l’heure.
Mme la secrétaire d’État. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos questions.
Les agences régionales de santé sont en effet les mieux à même de détecter les expériences fructueuses réalisées dans le domaine de la prévention. Elles ont une vision transversale de la santé, qui va de la prévention à la prise en charge et à l’accompagnement social. Elles évaluent et font remonter au niveau national les projets qui leur sont soumis. Au sein de chaque séminaire organisé par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, qui réunit l’ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé, elles ont l’opportunité d’évoquer certains sujets et de partager leurs expériences. J’ajoute que, si les expériences portées par des associations ou des professionnels de santé sont isolées, les plans de santé publique comportent tous un volet prévention/dépistage, qui est développé, décliné en actions concrètes et mis en œuvre par les agences régionales de santé. Ainsi la prévention se déploie-t-elle du haut vers le bas, à travers les axes de santé publique, et du bas vers le haut, à travers les expérimentations portées par d’autres acteurs.
Jusqu’à présent, le mode de rémunération des actes de prévention n’était pas clairement identifié. La convention médicale n’est peut-être pas la seule réponse à ce problème de rémunération. Néanmoins, elle a permis de faire évoluer les choses en instituant une rémunération au forfait pour les consultations longues et les consultations de prévention, et une rémunération à la performance, en fonction de certains critères.
Vous m’avez enfin interrogée sur la médecine scolaire et la médecine du travail.
Comment mieux organiser la médecine scolaire ? D’abord, la question relève du ministère de l’éducation nationale. Ensuite, nous avons besoin d’une meilleure gouvernance qui nous assure une vision transversale de ce qui se fait en matière de santé.
M. le coprésident Jean Mallot. La convention médicale prévoit en effet la rémunération des actes de prévention. Mais ne risque-t-on pas de reproduire ce qui s’était passé avec la tarification à l’activité des hôpitaux, c’est-à-dire une multiplication des actes ? Or l’efficience de la prévention s’apprécie sur le long terme et, en la matière, la qualité compte davantage que le nombre d’actes. Je ne pense pas que la convention médicale aille dans ce sens-là.
Par ailleurs, une récente mesure ne me paraît pas constituer un bon signal. Je veux parler de l’augmentation à 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée sur les préservatifs. Laisser, sur ces produits, le taux de cette taxe à 5,5 % aurait été cohérent avec les grandes campagnes de prévention.
Mme la secrétaire d’État. Je ne pense pas qu’une telle augmentation, qui ne représente que quelques centimes d’euro par unité, soit un frein à l’utilisation du préservatif. Il faut savoir relativiser l’impact de certaines mesures.
Comment, après la consultation de prévention, qui est rémunérée au forfait, évaluer l’efficience de la prévention ? Vous faites remarquer que celle-ci ne peut s’apprécier que sur le long terme. J’ajoute qu’on ne peut la mesurer que globalement, à l’échelle du territoire, à partir d’indicateurs précis, sur des questions très ciblées. Cette évaluation ne peut pas se faire à l’échelle individuelle, au niveau du médecin.
M. le rapporteur. Revenons sur les agences régionales de santé qui, malgré des débuts difficiles, dus au fait qu’elles ont dû intégrer des personnels venant d’horizons différents, sont maintenant en place. Elles sont en train de faire voter les schémas régionaux de santé, qui seront déclinés au niveau territorial. Or je ne suis pas sûr que la prévention constitue une priorité, si ce n’est en termes d’affichage.
Par ailleurs, je m’inquiète grandement du manque de coordination entre le ministère de la santé et le ministère de l’éducation nationale, qui risque de compromettre l’avenir de la médecine scolaire. En effet, les infirmières, dont les diplômes sont maintenant reconnus, pourront passer cadre A, au bout de trois ans d’exercice en hôpital. En revanche, à l’Éducation nationale, elles seront recrutées en cadre B. Pourquoi, dans ces conditions, des infirmières choisiraient-elles d’intégrer l’Éducation nationale ? Comment une telle réforme a pu être mise en place sans qu’un accord ait été passé sur ce point entre les deux ministères ?
Mme la secrétaire d’État. Les fonctions publiques sont différentes.
M. le rapporteur. Quoi qu’il en soit, on risque bien de ne plus avoir d’infirmières scolaires. Une revalorisation est envisagée, mais dans quinze ans seulement ! Cet exemple n’a rien à voir avec la prévention, mais il montre bien qu’entre le ministère de l’éducation nationale et de la santé, des progrès restent à faire en termes de coordination.
Je crois par ailleurs qu’il faudrait insister sur la mise en œuvre d’une véritable consultation de prévention. Ne pourrait-on pas s’inspirer de ce que fait la Mutualité sociale agricole, par exemple en instituant une telle consultation, tous les cinq ans, par tranche d’âge ?
Mme la secrétaire d’État. Monsieur Jean Mallot et monsieur Jean-Luc Préel, vous avez raison : il est nécessaire de renforcer la médecine scolaire. Nous sommes tous concernés. Les visites sont importantes, en particulier vers neuf, dix ou douze ans, âges où les messages de prévention – contre les addictions et les risques sexuels – passent facilement.
M. le rapporteur. Pourtant, j’ai cru comprendre que l’Éducation nationale souhaitait supprimer la visite des enfants de neuf et de douze ans.
Mme la secrétaire d’État. Je ne veux pas répondre sur ce que fait l’Éducation nationale. Je ne fais que vous donner mon point de vue.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous sommes convaincus que le succès de la prévention, qui a vocation à induire une modification comportementale, passe par la coordination de différentes politiques. On ne doit d’ailleurs pas s’appuyer seulement sur les professionnels de santé, ceux de la filière sanitaire, de la médecine scolaire ou de la médecine du travail, mais aussi sur d’autres acteurs, notamment sur les éducateurs.
Mme la secrétaire d’État. Je suis d’accord avec vous. Cela dit, je tiens à rassurer monsieur Jean-Luc Préel.
Si l’on demande aux agences régionales de santé de travailler sur un projet régional de santé, c’est bien parce que l’on souhaite aller de la prévention vers l’accompagnement en passant par la prise en charge : il existe un schéma régional de l’organisation de la prévention, à côté d’un schéma régional d’organisation des soins et d’un schéma régional de l’organisation médico-sociale. Il existe par ailleurs une commission régionale de coordination des politiques publiques en matière de prévention, au sein de laquelle interviennent divers acteurs et associations appartenant, notamment, au monde de l’éducation.
La prévention constitue donc un volet important des projets régionaux de santé, qui seront consolidés d’ici à la fin de 2012. Voilà pourquoi, monsieur Jean-Luc Préel, ce n’est pas qu’une question d’affichage.
M. le rapporteur. On peut toujours afficher des schémas. De la même façon, on peut toujours afficher des plans. D’ailleurs, il doit y en avoir 40 ou 50. Le problème est ensuite de savoir si l’on aura les moyens humains et financiers de les réaliser.
Mme la secrétaire d’État. Vous savez bien que chaque plan de santé publique a son enveloppe.
Cela dit, je ne nie pas qu’il puisse y avoir quelques faiblesses, ici ou là. Comme vous l’avez fait remarquer, nous nous sommes beaucoup consacrés à la prise en charge médicale et à l’accompagnement social, parfois au détriment de la prévention. Mais nous sommes en train de rattraper notre retard. Une organisation se met en place. Les plans de santé publique accordent une place de plus en plus importante à la prévention.
Pour terminer, j’évoquerai la loi de santé publique, que vous attendez.
La stratégie nationale de santé 2011-2015 est un préalable à cette loi de santé publique sur laquelle nous aurons peut-être le plaisir de travailler ensemble plus tard. Cette étape était indispensable. Chacun a eu son mot à dire sur les axes prioritaires qui ont été définis. En effet, on ne peut pas envisager une loi si on n’en discute pas les principes avec ceux-là mêmes qui seront le lendemain « aux manettes ».
Sous le chapeau « Adapter le système de santé aux besoins sanitaires et enjeux d’efficience », quatre axes stratégiques ont été proposés : prévenir et réduire les inégalités de santé dès les premiers âges de la vie ; anticiper et accompagner le vieillissement de la population ; maîtriser et réduire les risques pour la santé ou pour l’autonomie, avec une attention particulière aux atteintes prématurées ou évitables ; se préparer à faire face aux crises sanitaires.
Cette stratégie nationale de santé a été soumise à la Conférence nationale de santé, organe de démocratie sanitaire, qui a donné un avis positif sur ces différents axes.
M. le rapporteur. J’aurais encore quelques questions à vous poser.
La première concerne l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, qui n’est pas maître de son propre budget. En effet, quelques dizaines de millions lui ont été ponctionnés cette année et sa directrice nous a expliqué qu’elle ne pouvait pas décider de ses dépenses parce qu’elles étaient limitées par décision ministérielle – ce qui nous a un peu étonnés. Et comme elle ne peut pas dépenser ce qu’elle souhaite, son fonds de roulement augmente chaque année.
Ma deuxième question porte sur l’abaissement des seuils – pour la glycémie, la tension artérielle, etc. – qui constitue un vrai problème. Il serait souhaitable d’organiser des conférences de consensus avec la Haute Autorité de santé, pour définir ces seuils de manière claire.
La dernière question à laquelle j’aurais aimé obtenir une réponse est relative à la démocratie sanitaire : les comités départementaux d’éducation pour la santé (CODES) et les comités régionaux d’éducation pour la santé (CRES), réunissant les associations, ont été centralisés, au niveau régional, dans des instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (IREPS). Or cela limite le terrain des associations. Je souhaiterais qu’on puisse réunir toutes les associations d’un département pour leur permettre de travailler ensemble.
Mme le secrétaire d’État. Vous abordez une multitude de sujets. Mais je voudrais revenir sur certaines de vos affirmations.
Je ne conteste pas ce que vous me dites à propos de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Mais vous avez bien compris que nous sommes dans une situation un peu particulière et que nous devons faire au mieux avec les moyens dont nous disposons. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé n’est pas isolé. Il travaille avec nous et a toujours répondu présent s’agissant des campagnes liées aux enjeux définis dans les plans de santé publique.
M. le rapporteur. Et à propos de la définition des seuils ?
M. le coprésident Pierre Morange. Les praticiens sont soumis à un diktat des normes sous l’aiguillon, éventuellement intéressé, de l’industrie pharmaceutique.
Les normes de tension artérielle sont contestées par certains industriels. Quant aux normes biologiques, elles ont baissé au cours des vingt dernières années de façon sans doute excessive. Il conviendrait de relativiser cette pseudo-perfection, cet idéal biologique ou paramétrique.
Mme la secrétaire d’État. Il faut que les sociétés savantes se penchent sur la question de l’hypertension artérielle. Et sur les questions spécifiques, il existe des conférences de consensus, ce sont elles qui décident des normes.
M. le coprésident Jean Mallot. Espérons-le.
M. le rapporteur. Et espérons qu’elles en décident en dehors de tout conflit d’intérêts.
M. le coprésident Pierre Morange. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie.
*
AUDITION DU 18 JANVIER 2012
Audition de M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, et Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Je vous remercie, madame, monsieur, de votre présence.
En entendant la Cour des comptes, nous terminons nos auditions comme nous les avons commencées, ainsi que le veut l’usage.
La Cour a proposé dans sa communication remise à la MECSS que le directeur général de la santé puisse devenir le délégué interministériel responsable du pilotage global de la politique de prévention sanitaire. Or, l’actuel directeur général de la santé et plusieurs de ces anciens collègues nous ont fait part du caractère extrêmement prenant de leur travail quotidien. De surcroît, le directeur général de la santé n’a guère de pouvoir sur les autres directeurs du ministère de la santé et, s’il est certes possible de lui conférer une certaine prééminence, il n’aura a fortiori tout de même aucune autorité sur les ministères du travail et de l’Éducation nationale. Enfin, de quel pouvoir disposerait-il sur la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ?
Les agences régionales de santé, quant à elles, sont désormais responsables de la prévention et disposent d’une commission dite « de coordination » au sein de laquelle interviennent la médecine du travail et la médecine scolaire. Si le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales n’a pas le pouvoir de s’occuper de l’ensemble de la politique de santé, il est possible que, nommé en conseil des ministres, sous la responsabilité du Premier ministre, chargé de coordonner les agences régionales de santé, elles-mêmes chargées de coordonner l’ensemble de la politique de santé, y compris la prévention, ce fonctionnaire soit in fine le mieux placé pour disposer d’un certain pouvoir vis-à-vis des ministères de l’Éducation nationale, du travail, de l’environnement ou de l’agriculture ainsi que de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
En conclusion, comment un responsable du pilotage de la politique de prévention sanitaire pourrait-il bénéficier d’un réel pouvoir sur l’ensemble des acteurs concernés ?
M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes. C’est évidemment la question centrale car si nous disposons d’une institution-pivot sur le plan territorial, tel n’est pas le cas sur un plan national. En la matière, il faut tenir compte du niveau interministériel, absolument nécessaire, mais aussi de la façon dont il est possible de mobiliser l’ensemble d’un Gouvernement.
De notre point de vue, il importe d’avoir un responsable interministériel désigné dont les prérogatives n’entrent pas en contradiction avec celles du ministre de la santé – d’où l’idée d’un délégué interministériel qui serait en même temps directeur général de la santé. Néanmoins, comme vous l’avez souligné et comme il ressort des comptes rendus des auditions auxquelles vous avez procédé, le directeur général de la santé ne peut être responsable de tout : M Joël Ménard, en particulier, a souligné combien il a passé son temps à gérer des crises. C’est donc un problème organisationnel qui se pose.
En outre, le directeur général de la santé-délégué interministériel pourrait s’appuyer davantage sur l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mais le statut de cet organisme est un peu incertain puisque ce n’est pas une agence nationale de prévention stricto sensu, ni une agence sanitaire disposant d’une feuille de route claire dans ce domaine. Dès lors, le directeur général de la santé-délégué interministériel n’aurait plus qu’une fonction de coordination et d’animation. Il serait cependant possible d’imaginer un opérateur dédié, doté de plus de pouvoirs, à même de rendre compte auprès d’une structure interministérielle placée auprès du Premier ministre, peut-être un comité national de prévention présidé par ce dernier et comprenant l’ensemble des ministres parties prenantes, sur le modèle de ce qui existe pour la politique de sécurité routière, où un délégué, dont les fonctions sont à la fois ministérielles et interministérielles, rend compte à un comité présidé par le Premier ministre.
Un nouveau profilage des rôles du directeur général de la santé et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ainsi que la mise en place d’une véritable dimension interministérielle impliquant les membres du Gouvernement concernés par la politique de prévention seraient donc envisageables, même si d’autres solutions existent. Je le répète : un délégué interministériel qui ne serait enté que sur la direction générale de la santé n’aurait guère de pouvoir. Si, en revanche, une agence nationale de prévention, véritable opérateur de l’État, animait la politique de prévention, les choses seraient un peu différentes.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Lors de la création des agences régionales de santé, il avait été envisagé de disposer d’une Agence nationale de la santé mais la ministre et le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés d’alors s’étaient interrogés sur les prérogatives qui leur resteraient. Il est vrai que la création d’une telle agence, qui disposerait de l’ensemble des pouvoirs, demeure possible.
Comme je m’étonnais que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ait prévu le retrait d’une partie importante des fonds de roulement de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sa directrice m’a expliqué que l’utilisation de son budget nécessitait une autorisation ministérielle. Comment donc faire évoluer cette structure, déjà chargée de la communication gouvernementale, dont l’« indépendance » est quelque peu problématique ?
M. Antoine Durrleman. Peut-être en clarifiant plus nettement sa mission, en lui conférant une responsabilité particulière au sein du réseau des agences sanitaires et en en faisant un véritable bras séculier de l’État.
Cela pourrait s’inscrire dans le cadre d’une réflexion plus globale lors de l’élaboration d’une nouvelle loi de santé publique qui ne serait pas seulement une loi d’orientation dédiée à un certain nombre de thématiques mais qui déclinerait concrètement les moyens permettant de s’assurer que l’on tendra vers les objectifs qui ont été définis. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, quant à elle, n’a pas mis en place le dispositif institutionnel qui, indépendamment d’une multiplicité excessive d’objectifs, lui aurait permis d’être efficace.
D’autres solutions, bien entendu, sont possibles. Eu égard aux agences régionales de santé, s’il est certes censé de conférer une responsabilité particulière, dans ce domaine, au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, il n’en est peut-être pas de même vis-à-vis des autres ministères qui contribuent à la politique de prévention, comme celui de l’environnement ou celui de l’agriculture qui joue un rôle important dans la lutte contre l’obésité et dans les relations avec le monde viti-vinicole. Je ne suis pas certain que ces deux ministres accepteraient d’être parties prenantes d’un dispositif dirigé par un haut-fonctionnaire. La force du directeur général de la santé, depuis toujours, est d’être un médecin éminent qui, comme tel, dispose évidemment d’une grande légitimité quel que soit son profil, je songe, par exemple, à messieurs Joël Ménard ou Lucien Abenhaim. Cela me semble particulièrement important afin qu’il puisse travailler avec d’autres ministères. Certes, certains énarques sont aussi médecins mais cette qualité-là ne leur est jamais reconnue dès lors qu’ils ont franchi la porte de l’École nationale d’administration.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Lors de nos auditions, j’ai demandé à plusieurs personnes si elles savaient qui avait pris la décision de sortir l’hypertension artérielle sévère de la liste des affections de longue durée. Si nul ne m’a vraiment répondu, j’ai toutefois compris que ce n’était pas le directeur général de la santé pas plus que la Haute Autorité de santé. Alors que les complications oculaires ou rénales de cette pathologie peuvent être importantes si les malades ne sont pas soignés correctement, une décision médicale a tout de même été prise sans se soucier de l’avis du directeur général de la santé ou de la Haute Autorité de santé, ce qui constitue manifestement un problème.
M. Antoine Durrleman. La Cour des comptes est agnostique quant au mode de prise de décision gouvernementale !
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Nous avons également auditionné les représentants des ministères du travail et de l’Éducation nationale et nous avons compris que chacun souhaite garder son indépendance, considérant que la situation est correcte dans son secteur même s’il est certes toujours possible d’apporter quelques aménagements… Pourtant, si les infirmières appartiennent à la catégorie A lorsqu’elles travaillent dans les hôpitaux, elles sont encore recrutées dans la catégorie B au sein de l’Éducation nationale. Le manque de coordination entre les différents ministères est patent et préoccupant.
M. Antoine Durrleman. En effet.
La question de la santé au travail constitue un sujet majeur. Il n’en a pas été question dans la communication que nous vous avons remise au mois de septembre puisque la Cour des comptes travaille par ailleurs sur cette question ; elle examine, en particulier, le fonctionnement des services interentreprises de santé au travail. Quoi qu’il en soit, ce secteur est assez largement en déshérence.
La question du positionnement institutionnel est historique mais, au-delà de ce problème, les comptes rendus d’audition dont j’ai pris connaissance mettent en lumière l’importance des difficultés de communication entre les différents acteurs et, donc, la question de la circulation de l’information, alors que des renseignements pourraient être transmis entre médecins traitants, médecins scolaires ou médecins du travail, ce qui, en principe, relève du dossier médical personnel qui devrait donc progressivement devenir le vecteur d’une information partagée. C’est là un projet difficile sur lequel nous allons travailler cette année, étant entendu qu’à la demande de la MECSS, nous nous intéresserons particulièrement à la question des coûts. Des marges de progrès sont donc réalisables sur ce plan-là.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. La loi interdit de communiquer les données médicales au médecin du travail, ce dernier étant certes soumis au secret médical mais aussi, selon les partisans d’une telle interdiction, à l’employeur. Ainsi que me l’ont suggéré certains syndicats de médecins, je serai sans doute amené à préconiser dans ce rapport sur la prévention sanitaire une plus grande implication du médecin traitant ou « de premier recours » au sein de la médecine du travail. Les médecins, plus précisément, ont proposé la réalisation d’une synthèse annuelle des dossiers de leurs patients qui pourrait être transmise aux médecins du travail, ces derniers faisant part, quant à eux, des risques d’exposition liés aux postes des salariés.
Dans le même ordre d’idée, il est surprenant qu’après la visite médicale obligatoire à l’école pour les enfants de six ans, le médecin scolaire transmette un courrier à la famille sans qu’aucun lien ne soit établi avec le médecin traitant. Il n’est donc pas étonnant que les préconisations ne soient pas suivies d’effets. Nous aurions donc tout intérêt à travailler à l’amélioration des relations entre médecins traitants, médecins scolaires et médecins du travail.
M. Antoine Durrleman. Les modes de relation entre médecins doivent être en effet repensés en tenant compte de l’instauration du médecin traitant, chaque Français âgé de seize ans devant en choisir un. Les parcours ou les suivis médicaux ne sont pas véritablement organisés mais soulèvent un certain nombre de questions liées en particulier au temps médical et à la rémunération. Celles-ci ne relèvent pas seulement du domaine conventionnel, la politique de prévention constituant à la fois une mission de l’assurance-maladie et de l’État, les discussions entre les deux parties pouvant d’ailleurs être assez vives !
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. M. Christian Babusiaux, que vous connaissez bien, est chargé depuis quelques années de l’amélioration de la transmission des données de santé mais se heurte à quelques difficultés.
Afin de pallier le manque d’ophtalmologues dans les Ardennes et afin de suivre les complications oculaires liées au diabète, Groupama a encouragé la mise en place un rétinographe mobile, le fond d’œil étant étudié à distance par un ophtalmologue avec lequel une convention a été passée. Un tel dispositif de prévention à distance, compte tenu de la démographie médicale, me semble intéressant. Néanmoins, comme peu de personnes se déplacent faute d’un ciblage adéquat, la mission envisage de promouvoir une transmission des données de santé vis-à-vis des complémentaires santé. Il faudrait bien entendu réfléchir avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mais la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ou, en l’occurrence, la Mutuelle sociale agricole ne pourraient-elles pas passer par le médecin traitant ou par celui de l’assurance maladie obligatoire ou complémentaire afin d’atteindre les personnes concernées ?
S’agissant de la transmission des données, M. Étienne Caniard, président de la Mutualité française, a récemment fait part de son inquiétude face à l’éclatement des flux entre le régime de base et les régimes complémentaires, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés étant, semble-t-il, en train de mettre en place un nouveau système qui lui permettrait de traiter toutes les données directement, sans que les complémentaires puissent y avoir accès. Si c’est bien le cas, cela ne simplifiera pas la transmission des données telle que l’on pourrait la souhaiter.
M. Antoine Durrleman. Les frontières établies par les uns et par les autres illustrent le fractionnement de ce secteur. Cela étant, des marges de progrès demeurent possibles. Je le répète : nous avons besoin d’un opérateur dédié permettant de délivrer les protocoles de rapprochement et de transmission. Or, dans le domaine de la prévention en particulier, la multiplicité des opérateurs est patente. Sur le plan local, les agences régionales de santé constituent en la matière une véritable vigie, même si elles sont sollicitées par de nombreuses tâches et si la prévention n’est pas leur première préoccupation.
Les expériences de terrain réussies, faute de disposer de relais idoines, peinent à remonter jusqu’au niveau central, où dominent les préoccupations financières. Personne n’est en situation d’évaluer une expérimentation réussie comme, par exemple, une articulation entre les systèmes d’assurance maladie complémentaires ou un travail réalisé par un service de santé scolaire avec des médecins traitants. Il importe donc de trouver un tel relais afin que le politique puisse ensuite faire des choix. La territorialisation, qui constitue l’apport essentiel de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, devrait permettre de bénéficier d’une meilleure visibilité sur ce plan-là.
Un certain nombre de chaînons manquent entre l’animation interministérielle, les missions opérationnelles et le pilotage gouvernemental. Je le répète, un comité interministériel auprès du Premier ministre pourrait jouer un rôle décisif, le Parlement élaborant quant à lui les orientations. Même si la loi d’août 2004 précitée a été une réussite inégale, elle était porteuse d’une vision de la santé publique et de la prévention qui bien qu’améliorable certes, n’en avait pas moins le mérite de définir l’enjeu comme foncièrement national et relevant du Parlement. Il est quelque peu dommageable que, depuis 2009, ce premier essai n’ait pas été confirmé : la mécanique institutionnelle locale autour des agences régionales de santé a été privilégiée au détriment de cette dimension essentielle de la santé publique. De nombreux plans ont été élaborés sans grande cohérence et ne contribuent pas à une politique de santé publique organisée.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Certes, mais les agences régionales de santé ayant été récemment instituées, elles ont consacré beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner leurs structures, lesquelles comportent des personnels dont les statuts ne sont pas identiques, ce qui n’est pas simple. Les premiers schémas régionaux de santé sont en train d’être mis en place ; j’espère qu’ils comprendront un volet dédié à la prévention mais je crains que cela relève plus de l’affichage que d’une volonté bien affirmée puisque les agences régionales de santé sont d’abord confrontées aux problèmes de démographie médicale et de permanence des soins, la prévention pouvant passer au second plan ; le ministre m’a bien entendu assuré qu’il n’en serait rien mais une véritable politique de prévention risque, dans ces conditions, d’être difficile à mettre en œuvre.
En ce qui concerne les données de santé, j’avais naguère déposé une proposition de loi afin de créer un Institut national de la santé. Il m’avait en effet semblé opportun, entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui disposaient de données importantes, et les professionnels de santé, qui tentaient de mettre en place leur propre système, d’installer un organisme chargé de recueillir l’ensemble des données, de les traiter et de les diffuser auprès des professionnels intéressés. J’avais même été plus loin en proposant de régionaliser l’Institut national de la statistique et des études économiques afin d’alimenter ensuite les agences régionales de santé. Je ne sais si cela pourrait être encore d’actualité mais il n’en reste pas moins, sans parler de guerre économique ou politique, que celui qui dispose de telles données est bien placé pour imposer sa volonté aux uns et aux autres. Ce n’est évidemment pas un reproche formulé à l’encontre du directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qui souhaite faire fonctionner la caisse aussi bien que possible. Mais disposant de toutes les données, cela lui confère une position d’autorité et il est réticent à partager ces données avec ceux qu’il considère d’une certaine façon comme des concurrents.
Je comprends fort bien la légitimité d’un médecin à la tête du pilotage national de la politique de santé et de la prévention mais les agences régionales de santé, qui sont aujourd’hui chargées à la fois de la prévention, du soin et du secteur médico-social, ont mis en place des commissions de coordination au sein desquelles siègent le recteur et l’inspecteur d’académie, le responsable de la médecine du travail et celui de l’environnement qui, si elles fonctionnent – c’est encore un peu tôt pour le dire – permettront d’envisager une véritable coordination sur le terrain, échelon essentiel pour que la prévention soit efficace en assurant une bonne déclinaison territoriale.
Dès lors, sur le plan national, pourquoi ne pas instituer une Agence nationale de santé avec un comité de coordination permettant de regrouper tous les intervenants sous l’autorité d’une personne qui serait nommée par le Premier ministre et qui soit vraiment responsable, tant il est vrai qu’il n’est en effet pas facile, même si l’on est un éminent médecin, de faire travailler ensemble plusieurs ministères, directions et institutions ?
M. Antoine Durrleman. Assurément.
La solution parfaite n’existe sans doute pas mais il existe en revanche un véritable enjeu de coordination interne au ministère de la santé, lequel est structuré par des directions puissantes, jalouses de leur histoire et de leur pouvoir. Plus globalement, l’ensemble des ministères concernés, dont les clientèles peuvent se transformer en groupe de pression, peut également entretenir des logiques plus « sécantes » que sanitaires.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Il suffit en effet de constater ce qui se passe lorsque l’on évoque les questions de l’obésité ou celles liées à la production vinicole.
M. Antoine Durrleman. La Cour des comptes a auditionné la directrice générale de l’alimentation qui, pour être engagée sur les questions liées à la qualité nutritionnelle et à la lutte contre l’obésité, n’en est pas moins très consciente et c’est logique, des problèmes agro-alimentaires qui se posent. Lors d’un arbitrage, je crains que les légitimités administrative et politique du haut-fonctionnaire ou d’une personne désignée par le Premier ministre ne suffisent pas : il est nécessaire de disposer d’une légitimité scientifique. Soit l’arbitre est un grand chercheur, par exemple, un épidémiologiste reconnu, soit il est un médecin éminent même si bien entendu plusieurs systèmes peuvent se concevoir.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Le problème essentiel est l’absence d’organisation et de pilotage national. Il est acquis qu’il convient de lutter contre l’obésité mais lorsque l’on réunit les ministères de l’agriculture et de la culture et de la communication afin d’élaborer une législation évitant la publicité de produits à forte densité énergétique lors de la programmation d’émissions pour enfants, deux logiques s’affrontent et un arbitrage doit être rendu. On comprend fort bien les réticences de l’un et de l’autre mais si la lutte contre l’obésité est prioritaire, il faut que chacun s’y soumette.
Les blocages ou une volonté limitée de coopérer sont également patents avec la médecine scolaire et la médecine du travail. Faute d’expression d’une véritable volonté, le statu quo l’emportera.
Selon M. Didier Tabuteau, il est important de modifier le mode de tarification des établissements hospitaliers et, notamment, des hôpitaux, ces derniers ayant un rôle essentiel à jouer dans l’éducation thérapeutique et la prévention. La tarification à l’activité (T2A), de ce point de vue-là, semble mal adaptée. À ce jour, les hôpitaux disposent de trois enveloppes différentes dédiées respectivement à l’activité, à l’hébergement et à une mission d’intérêt général qui n’est pas très éloignée des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation dans laquelle on pourrait éventuellement inclure la prévention et l’éducation thérapeutique.
M. Antoine Durrleman. La logique stricte de la T2A est par définition centrée sur l’acte curatif. Poussée à l’extrême, elle rend bien compte du privilège culturel accordé au soin alors que les missions d’intérêt général visent précisément à tenir compte d’autres dimensions. Il est vrai que les hôpitaux ont une activité d’éducation thérapeutique comme nous avons pu l’observer dans la prise en charge du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : ainsi le travail pédagogique réalisé par les services hospitaliers dans le domaine de la prévention et de l’éducation thérapeutique en matière d’observance des trithérapies a été particulièrement important et a contribué au développement de la politique de prévention. Néanmoins le cadre de tarification n’était alors pas le même, puisque nous nous relevions d’une logique de dotation globale et d’une situation financière moins contrainte. Il serait donc intéressant de reconnaître l’existence d’une mission d’intérêt général « prévention » afin que la T2A ne fasse pas disparaître la vocation d’éducation thérapeutique essentielle du système hospitalier. Pour ce faire, il ne me paraît pas nécessaire de modifier l’ensemble de la tarification hospitalière, qui est assez souple.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Je ne reviens pas sur la question du dépistage du cancer de la prostate, évoquée avec M. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé.
S’agissant du double dépistage du cancer du sein, organisé à la fois à titre collectif et individuel, je ne pense pas qu’il soit possible de supprimer le second, un gynécologue ne pouvant pas refuser à une patiente de passer une mammographie. Ce contrôle individuel pourrait en revanche être soumis aux mêmes contraintes qualitatives que le dépistage collectif en vérifiant la certification des mammographes et en demandant une double lecture afin de parvenir à une qualité de dépistage identique.
M. Antoine Durrleman. Il est évident que les garanties de qualité sont nécessaires. Cela étant, un médecin traitant doit pouvoir également indiquer à une patiente que ce dépistage, compte tenu par exemple de son âge, ne s’impose pas. Son rôle n’est pas seulement d’orienter son patient vers un spécialiste mais de souligner la pertinence ou non d’un acte. Se pose une question très importante : qu’attend-on de lui ? Je ne suis pas certain que les Français qui ont dû choisir leur médecin traitant aient réalisé l’apport de ce détour méthodologique obligatoire.
M. Jean-Luc Préel, président et rapporteur. Vous avez d’autant plus raison qu’il est tout de même assez facile de changer de médecin traitant et d’accéder directement à certains spécialistes.
Un autre problème essentiel est celui des consultations de prévention. Pourraient-elles être organisées par tranches d’âge « obligatoires » ? Comme l’ont relevé la Mutuelle sociale agricole et un syndicat de médecin, personne, entre trente et cinquante ans, ne consulte, dès lors qu’aucun problème particulier ne se pose, alors même que c’est dans cette période de la vie que s’installent parfois certains déterminants de l’obésité, de l’hypertension artérielle ou du cholestérol. Peut-être serait-il judicieux d’organiser une consultation systématique pour cette tranche d’âge alors que des mesures préventives, comme de l’exercice physique ou un régime alimentaire, pourraient être envisagées ? La Mutuelle sociale agricole organise des consultations de prévention avec les médecins traitants tous les cinq ans après avoir envoyé à ses assurés un questionnaire comprenant la prescription d’examens biologiques. Que pensez-vous donc de la généralisation de ce type de consultation ?
M. Antoine Durrleman. Il convient en tout cas de réfléchir à la multiplicité des consultations de prévention, qui commencent dès le plus jeune âge. Il serait sans doute pertinent de les prescrire aux moments adéquats : en effet, pendant le très jeune âge et l’âge scolaire, nous constatons en effet une suraccumulation des dispositifs, alors que, pour les jeunes adultes, il n’y en a plus aucun, notamment depuis la suppression, pour les hommes, de la conscription qui constituait jusqu’alors un véritable système de rattrapage. Sans doute une scansion différente des consultations s’impose-t-elle en fonction des tranches d’âges quitte, donc, à en supprimer certaines.
M. Jean-Luc Préel, rapporteur. La mission proposera sans doute la suppression des visites médicales à l’école entre neuf et douze ans tout en maintenant celles qui ont lieu à l’âge de six ans et à l’adolescence. À l’âge adulte, il serait opportun d’en instaurer une vers l’âge de trente-cinq ans, puis avant le départ à la retraite.
Les contrats locaux de santé, quant à eux, sont relativement peu nombreux.
Comment articuler lois de santé publique, où seraient définies quatre ou cinq grandes priorités, et plans pluriannuels ? M. Joël Ménard souhaiterait un plan par an mais sur cinq ans nous en aurions cinq ? Les besoins sont en effet réels comme nous l’avons constaté encore cet été à propos des questions liées à l’hospitalisation sous contrainte et aux hôpitaux psychiatriques. Le ministre a certes fait état d’un plan dédié à la santé mentale mais il s’articulera sans grande coordination ni moyens humains et financiers avec ceux que nous connaissons déjà.
M. Antoine Durrleman. Il est possible d’imaginer une loi de santé publique qui comprendrait quelques objectifs prioritaires, ce qui ne signifie pas que la puissance publique se désintéresse des autres problématiques de santé. Il convient donc d’agir à partir de plusieurs plans mais si l’on veut faire bouger les lignes en mobilisant tous les acteurs en même temps, il faut définir un nombre de champs et d’objectifs restreint.
Il convient, de surcroît, de s’inscrire dans une durée suffisamment longue : cinq ans, c’est très peu pour agir dans le domaine de la santé publique tant il faut compter avec des résistances culturelles et des problématiques psychosociales ou environnementales.
De plus, en complément des schémas de prévention des agences régionales de santé qui doivent « décliner » au niveau régional les priorités nationales en faisant en sorte que les différents acteurs interviennent en synergie, on pourrait imaginer que les agences complètent ces objectifs par un petit nombre de priorités adaptées cette fois aux caractéristiques sanitaires et socio-économiques spécifiques de leur territoire, en se donnant plus de temps, en évaluant les efforts consentis et en définissant les perspectives.
Il convient certes de définir une enveloppe de moyens afin qu’un plan fonctionne, mais il faut aussi lui assigner un responsable. Les plans de santé publique qui ont fait la preuve de leur efficacité étaient en effet pilotés par des responsables clairement désignés : cela a notamment été le cas du plan Cancer, avec le président de l’Institut national du cancer, et du plan Alzheimer avec M. Joël Ménard.
Une action, un responsable : telle pourrait être la règle.
M. le coprésident Jean Mallot. Lors de l’audition, hier, de madame la ministre, j’ai été frappé par la capacité du Gouvernement à faire l’analyse de la situation en matière de prévention sanitaire, à déplorer un certain nombre de points, à souligner la nécessaire prise en compte de l’interministérialité des problèmes, de la recherche de l’efficience, de la mise en place de comités de suivi et de prospection. Je ne peux en dire autant de ses capacités à agir. Serait-ce pour des raisons politiques ? Je m’interroge sur les causes qui ont empêché le Gouvernement de proposer un projet de loi de santé publique, pourtant attendu depuis des années. Je n’ai pas obtenu de réponse.
Les auditions que nous avons réalisées ont permis d’identifier des actions concrètes intéressantes menées sur le territoire par tel ou tel organisme ou, parfois, tel ou tel individu en matière de prévention sanitaire. Après avoir été repérées, elles pourraient être évaluées et le cas échéant généralisées. Or, l’organisation actuelle de l’État ne le permet pas. Je suis donc assez perplexe et déplore que nous rations certaines occasions.
Enfin, s’agissant de la rémunération des actes ou des actions de prévention, indépendamment de la convention médicale censée prévoir un certain nombre de dispositifs, je note qu’il existe souvent un décalage entre l’organisme ou celui qui met en œuvre une action et ceux qui en bénéficieront un jour. Par analogie avec la T2A, on constate qu’il est assez facile de rémunérer la quantité d’actes produits mais on ne peut pas en dire autant de la qualité. Or, en matière de prévention, celle-ci est largement aussi importante que celle-là.
M. Antoine Durrleman. Une véritable logique au service de l’innovation est en œuvre sur le terrain mais il est vrai qu’elle n’est pas perçue au niveau central. Néanmoins, la création des agences régionales de santé et leur rôle spécifique en matière de prévention impliqueront une attention nouvelle portée aux meilleures initiatives dans le cadre régional et devraient faciliter le repérage.
Dès lors, se pose la question de trouver un moyen de capitaliser ces expériences sur le plan national afin de les généraliser. De ce point de vue-là, il est légitime de se demander si l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé joue pleinement son rôle. Agence de prévention qui ne s’appelle pas « Agence nationale de prévention », elle fonctionne du haut vers le bas et ce serait pertinent que ce soit l’inverse. Si l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé devenait une interface opérationnelle permettant de créer et d’évaluer un certain nombre de dispositifs, elle jouerait le rôle que la direction générale de la santé ne peut endosser faute d’être organisée pour cela. Si la réflexion relative à l’interministérialité est donc nécessaire, celle qui porte sur l’opérateur ne l’est pas moins. Or, celui-ci ne peut pas être la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés car tel n’est pas son métier. La mission de prévention relève bien plutôt de la responsabilité de l’État. Créer une institution supplémentaire dans le panorama actuel des opérateurs est sans doute compliqué, mais se demander si un institut existant peut devenir plus opérationnel serait sans doute judicieux.
S’agissant de la rémunération, il conviendrait peut-être de prendre mieux en compte, au sein des missions d’intérêt général des hôpitaux, la dimension de la prévention et de l’éducation thérapeutique. En ce qui concerne la médecine de ville, les « consultations longues » n’ont jamais vraiment fonctionné, mais il est possible de réfléchir à des éléments de rémunération forfaitaires et, donc, à une redéfinition du mode de financement de la médecine libérale. La dernière convention médicale instituant une forme de rémunération « à la performance » aboutit quant à elle à susciter des éléments de rémunération différents. La réflexion sur ce sujet difficile n’est donc pas encore achevée.
M. le rapporteur. Cette convention avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés constitue sûrement un progrès, mais elle vise d’abord à réaliser des économies, les critères retenus ne tenant guère compte de la prévention sauf en ce qui concerne par exemple le taux de vaccination contre la grippe. Sans doute serait-il utile d’accroître le nombre de critères qui iraient en ce sens, de même d’ailleurs qu’au sein des contrats responsables des assurances complémentaires, où le volet prévention pourrait être renforcé.
M. Antoine Durrleman. Il est en effet légitime de se demander s’il ne faudrait pas « durcir » les conditions des contrats responsables, qui sont d’ailleurs majoritaires. Y inclure plus d’actes préventifs pourrait être une solution. Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale du mois de septembre dernier, la Cour des comptes avait noté que le niveau des frais de gestion pouvait également constituer un problème. Autrement dit : jusqu’où les contrats sont-ils vraiment… responsables ?
M. le rapporteur. Cette question dépasse notre préoccupation actuelle mais elle ne manque pas d’intérêt.
Lors de la création de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, je m’étais montré quelque peu critique en considérant que cet organisme était chargé en grande partie de la communication gouvernementale sur la prévention, alors qu’en tant que partisan de la décentralisation, j’aurais quant à moi plutôt souhaité que cette institution parte de la base, de nombreuses associations de lutte contre le tabagisme ou l’alcoolisme étant présentes dans chaque département sans être vraiment coordonnées. J’aurais souhaité que de véritables comités départementaux d’éducation pour la santé les regroupent, de même que, sur le plan régional, les instances régionales d’éducation et de promotion de la santé et, enfin, sur le plan national, une fédération des comités régionaux, afin de prendre en compte la situation du terrain, et que le système fonctionne dans les deux sens. Ce manque de coordination constitue un véritable problème.
M. Antoine Durrleman. Un chaînon fait défaut, à moins qu’il ne s’agisse d’un maillon faible, entre les directions d’administration centrale, les agences régionales de santé et les autres acteurs. À moins d’être renforcée, la prévention risque de demeurer la dernière roue du carrosse.
M. le rapporteur. L’administration centrale se montre très réticente vis-à-vis des organismes plus ou moins indépendants. J’ai souvent défendu les observatoires régionaux de santé, dont certains fonctionnent très bien comme, par exemple, celui des Pays de Loire dont les rapports sont excellents. Pourquoi faudrait-il dès lors toujours créer d’autres structures alors qu’en l’occurrence ces derniers, s’ils disposent des moyens humains et financiers adéquats, travaillent bien ? Les conférences régionales de santé pourraient ensuite s’appuyer sur leurs travaux pour évaluer les besoins de santé régionaux ainsi que l’adéquation entre l’offre et la demande de soins. Si la Conférence nationale de santé émanait de ces dernières, la situation serait sans doute meilleure.
M. Antoine Durrleman. Nous avons certes besoin d’une démarche ascendante nourrie de l’expertise du terrain, mais celle-ci n’invalide pas pour autant le fait qu’une politique de santé publique implique la définition d’un certain nombre de priorités sur le plan national. L’essentiel, c’est d’établir une dialectique qui fonctionne entre ces deux niveaux. Ce n’est actuellement pas le cas parce que les messages et les priorités sont brouillés et les interfaces inexistantes. Un véritable travail de maillage et d’élagage des priorités voire de certains acteurs doit être accompli – localement, leur multiplicité entraîne en effet leur neutralisation. Cela dit, la situation demeure complexe.
Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître à la Cour des comptes. Sur un plan local, la situation a été très perturbée ces dernières années. À peine les groupements régionaux de santé publique, qui avaient pour mission de coordonner des acteurs de santé publique, ont-ils été définis qu’ils ont été remis en cause. Les trois ou quatre dernières années ne sont donc sans doute pas les plus significatives pour juger de la pertinence de la politique de prévention au niveau régional.
M. le rapporteur. Comme M. Yves Bur, je suis assez partisan de la suppression du Haut Conseil de la santé publique dont je me demande quelle est son utilité alors qu’il existe une Haute Autorité de santé. Y êtes-vous particulièrement attaché ou pensez-vous que l’on pourrait…
M. le coprésident Jean Mallot. … Élaguer !
M. Antoine Durrleman. L’existence d’une instance visant à expertiser les plans de santé publique n’est pas mauvaise en soi. Cela étant, nous avons relevé les difficultés de positionnement du Haut Conseil de la santé publique, qui est certes une institution scientifique mais rattachée à l’autorité de la direction générale de la santé, ce qui peut soulever des problèmes. Sans doute la Haute Autorité de santé pourrait-elle reprendre certaines de ses attributions, mais il serait dommage que sa suppression se traduise par la perte d’une capitalisation d’expertises dont la Cour des comptes a éprouvé la richesse.
En complémentarité avec le Haut Conseil de la santé publique, nous avons en effet évalué en 2011 l’exécution du plan Psychiatrie et santé mentale lancé par les pouvoirs publics en 2005. Au mois de décembre, nous avons rendu un rapport public thématique sur l’organisation des soins psychiatriques et le Haut Conseil de la santé publique, parallèlement, a quant à lui évalué la mise en œuvre de ce plan sous un angle plus médical – prises en charge thérapeutiques, relations avec les patients et les familles.
Son expertise évaluative est très intéressante comme nous avons pu le constater également au cours de la conférence évaluative organisée par ce dernier au mois de mai dernier.
Le Haut Conseil de la santé publique dispose donc d’une certaine légitimité auprès des acteurs de soins.
M. le rapporteur. Il est donc complexe de rationaliser un dispositif, même si l’on pourrait aussi imaginer que le Haut Conseil de la santé publique soit rattaché à la Conférence nationale de santé ou à la Haute Autorité de santé où il siégerait au sein d’un collège !
M. Antoine Durrleman. Il est en effet tout à fait possible de créer un collège supplémentaire au sein de la Haute Autorité de santé de manière à maintenir cette forme d’expertise.
M. le coprésident Jean Mallot. Il faut veiller à ce que cette fonction soit toujours assumée sans pour autant multiplier les acteurs.
Nous avons achevé notre cycle d’auditions dédié à la prévention sanitaire et nous ne manquerons pas d’échanger avec vous sur les conclusions de notre rapport, lequel sera examiné dans une quinzaine de jours environ et, si la Commission des affaires sociales l’autorise, publié une semaine plus tard.
Je vous remercie pour votre participation, qui nous est toujours très précieuse.
*
1 () L’état de santé de la population en France, ministère chargé de la santé, 2011.
2 () Chiffres de l’Institut de recherche et de documentation en économie (IRDES).
3 () Communication de la Cour des comptes d’octobre 2011.
4 () « Les comptes nationaux de la santé en 2010 ; dépenses de prévention organisée (individuelle ou collective) », Études et résultats de la DREES, 2011.
5 () « An Operational Classification of Disease Prevention » in Public Health Reports, 1983.
6 () Audition du 20 octobre 2011.
7 () Audition du 24 novembre 2011.
8 () Article 79 de loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
9 () Audition du 3 novembre 2011.
10 () Audition du 1er décembre 2011.
11 () Audition du 17 novembre 2011.
12 () II de l’article 2 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
13 () Différentiel de 6,3 années selon le rapport précité de la DREES.
14 () Audition du 24 novembre 2011.
15 () Audition du 24 novembre 2011.
16 () DREES, op. cit.
17 () Article L. 1411-2 du code de la santé publique.
18 () Audition du 20 octobre 2011.
19 () Audition du 3 novembre 2011.
20 () Audition du 3 novembre 2011.
21 () Audition du 1er décembre 2011.
22 () Audition du 24 novembre 2011.
23 () Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
24 () Audition du 20 octobre 2011.
25 () Audition du 20 octobre 2011.
26 () Article 10 du décret n° 89-321 du 18 mai 1989 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale et relatif à l’action de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale, codifié à l’article R. 262-1-1 du code de la sécurité sociale.
27 () Annexe de la convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la CNAMTS pour 2010-2013.
28 () Article R. 421-5 du code de la sécurité sociale.
29 () MM. Didier Tabuteau, responsable de la chaire Santé de Sciences Po, et Hubert Allemand, adjoint au directeur général de la CNAMTS.
30 () Audition du 24 novembre 2011.
31 () I de l’article 35 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, codifié aux articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale.
32 () Audition du 24 novembre 2011.
33 () V de l’article 2 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique codifié aux articles L. 1411-4 et suivants du code de la santé publique.
34 () Article 79 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifié aux articles L. 1417-4 et suivants du code de la santé publique.
35 () Article 33 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, codifié aux articles L. 1415-2 et suivants du code de la santé publique.
36 () Article 2 de l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, codifié aux articles L. 1313-1 et suivants du code de la santé publique.
37 () Article 2 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique codifié à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique.
38 () Article 3 du décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
39 () Article 1er de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
40 () I de l’article 88 de la loi du 21 juillet 2009 précitée codifié à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique.
41 () Audition du 8 décembre 2011.
42 () Réponses au questionnaire budgétaire du Sénat pour le projet de loi de finances pour 2012.
43 () Article L. 4535-1 du code du travail.
44 () Article 1er de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.
45 () Article R. 4624-10 du code du travail.
46 () Article R. 4624-16 du code du travail.
47 () Audition de M. Jacques Texier, président du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise du 12 janvier 2012.
48 () Audition du 12 janvier 2012.
49 () Audition du 12 janvier 2012.
50 () Loi du 20 juillet 2011 précitée.
51 () Article 3 de la loi du 20 juillet 2011 précitée, codifié à l’article L. 4622-11 du code du travail.
52 () Article L. 4623-8 du code du travail.
53 () Article 12 de la loi du 20 juillet 2011 précitée, codifié à l’article L. 4623-1 du code du travail.
54 () Article 5 de la loi la loi du 20 juillet 2011 précitée, codifié à l’article L. 4622-14 du code du travail.
55 () Audition du 20 octobre 2011.
56 () Article L. 1421-4 du code de la santé publique en matière d’habitat, issu de l’article 83 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
57 () Audition du 8 décembre 2011.
58 () Article L. 1434-17 du code de la santé publique.
59 () Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.
60 () Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
61 () Programme n° 5 de la convention d’objectifs et de gestion pour 2010-2013.
62 () Article 10 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
63 () L’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers fixe un cahier des charges organisant ces dépistages.
64 () Article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers.
65 () Audition du 10 novembre 2011.
66 () La prise en charge est accordée aux personnes de plus de soixante-cinq ans ou atteintes d’une affection de longue durée.
67 () Audition du 10 novembre 2011.
68 () III de l’article 36 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
69 () Audition du 1er décembre 2011.
70 () I de l’article 38 de la loi du 21 juillet 2009 précitée.
71 () À l’exception des ORS d’Île-de-France, de Guyane et de Guadeloupe.
72 () Article 118 de la loi du 21 juillet 2009 précitée codifié à l’article L. 1431-2 du code de la santé publique.
73 () Audition du 15 décembre 2011.
74 () Le Comité de la prévention et de la précaution auprès du ministère exerce une fonction de veille et d’expertise sur la santé environnementale.
75 () Article 2-VII de loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, codifié à l’article L. 1413-1 du code de santé publique.
76 () M. Yves Bur, Rapport d’information déposé par la commission des affaires sociales sur les agences sanitaires. Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 3627, 6 juillet 2011.
77 () Cour des comptes, « La campagne de lutte contre la grippe A : bilan et enseignements », in Rapport public annuel, février 2011.
78 () M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville, Rapport d’information sur la médecine scolaire, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 3968, 17 novembre 2011.
79 () Audition du 1er décembre 2011.
80 () Audition du 12 janvier 2012.
81 () Audition du 12 janvier 2012.
82 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
83 () Audition du 8 décembre 2011.
84 () Audition du 10 novembre 2011.
85 () Audition du 3 novembre 2011.
86 () Article 1er du décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, codifié à l’article D. 1432-1 du code de la santé publique.
87 () Audition du 3 novembre 2011.
88 () Audition du 3 novembre 2011.
89 () Audition du 3 novembre 2011.
90 () Audition du 3 novembre 2011.
91 () Audition du 20 octobre 2011.
92 () Audition du 24 novembre 2011.
93 () Article 41 de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008, codifié à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
94 () Audition du 24 novembre 2011.
95 () Audition du 20 octobre 2011.
96 () Audition du 24 novembre 2011.
97 () Article 3 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifié à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
98 () Audition du 10 novembre 2011.
99 () DREES, étude précitée.
100 () Bulletin épidémiologique de l’Institut national de veille sanitaire (INVS).
101 () Audition du 17 novembre 2011.
102 () La maladie est présente alors que le signe est absent : le résultat du test sera négatif.
103 () La maladie est absente alors que le signe est présent : le résultat du test sera positif.
104 () Audition du 24 novembre 2011.
105 () Audition du 17 janvier 2012.
106 () Audition du 20 octobre 2011.
107 () Audition du 17 novembre 2011.
108 () Audition du 24 novembre 2011.
109 ()Décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG.
110 () Bulletin épidémiologique de l’Institut national de veille sanitaire (INVS), septembre 2011.
111 () Chiffres de la PMI pour deux doses.
112 () Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l’hypertension artérielle sévère de la liste des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au 3° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
113 () Audition du 15 décembre 2011.
114 () Audition du 17 janvier 2012.
115 () Audition du 20 octobre 2011.
116 () Audition du 20 octobre 2011.
117 () Audition du 20 octobre 2011.
118 () « Health in all policies ».
119 () Rapport précité.
120 () Audition du 17 janvier 2012.
121 () Audition du 18 janvier 2012 de M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes.
122 () Audition du 17 novembre 2011.
123 () MM. Yves Bonnet, Bertrand Brassens et Jean-Luc Vieilleribière, Les fonds d’assurance maladie (FNPEIS, FNPEISA, FNPM, FIQCS et FMESPP), Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires sociales, juillet 2010.
124 () Article L. 1435-8 du code de la santé publique.
125 () Rapport demandé par le Président de l’Assemblée nationale pour le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques Contribution à l’évaluation de la médecine scolaire, septembre 2011.
126 () M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville, rapport précité.
127 () Audition du 1er décembre 2011.
128 () Audition du 1er décembre 2011.
129 () Audition du 20 octobre 2011.
130 () Audition du 3 novembre 2011.
131 () Audition du 20 octobre 2011.
132 () La Fédération des médecins de France a signé la convention en décembre 2011.
133 () Audition du 24 novembre 2011.
134 () Audition du 15 décembre 2011
135 () Article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
136 () Inspection générale des affaires sociales, Pharmacies d’officine, rémunération, missions, réseau, juin 2011.
137 () Audition du 10 novembre 2011.
138 () Audition du 17 novembre 2011.
139 () Audition du 15 décembre 2011.
140 () Les plans régionaux ont été soumis aux commissions de coordination des agences.
141 () Audition du 15 décembre 2011.
142 () Audition du 10 novembre 2011.
143 () Audition du 10 novembre 2011.
144 () Article 4 du décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 relatif à la participation de l’assuré prévue à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, codifié à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
145 () Article 64 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
146 () L’article L.5121-28 du code de la santé publique prévoit que lorsque la réalisation d'études de vigilance et d'épidémiologie impliquant notamment des médicaments rend nécessaire un accès au SNIIRAM ou une extraction de ses données, l'accès ou l'extraction peuvent être autorisés par un groupement d'intérêt public constitué à cette fin entre l'État, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’INVS et la CNAMTS.
147 () Audition du 20 octobre 2011.
148 () Article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, codifié à l’article L. 1435-6 du code de la santé publique.
149 () Christian Babusiaux, Louis Breas, Laurence Esclous et Dominique Thouvenin L’accès des assureurs complémentaires aux données de santé des feuilles de soins électroniques, Rapport au ministre de la santé, juin 2003.
150 () Cinq compagnies d’assurance : Allianz, Assurances du Crédit Mutuel, Axa, Groupama, Swiss Life ; trois institutions de prévoyance : AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, Pro BTP ; trois mutuelles Eovi, Oceane et Santévie.
151 () Audition du 17 novembre 2011.
152 () Audition du 18 janvier 2012 de M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes.
153 () L’INCA a remis en novembre 2011 un rapport relatif aux modalités de migration vers l’utilisation des tests immunologiques de dépistage.
154 () MM. Jean-Christophe Lagarde et Jean-Pierre Door, Rapport d’information déposé par la commission des affaires sociales sur la campagne de vaccination antigrippale 2009, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 2698,6 juillet 2010.
155 () Audition du 17 janvier 2012.
156 () Amendement déposé par M. Jean-Marie Rolland le 6 février 2009 lors de la discussion de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
157 () Audition du 3 novembre 2011.
158 () Audition du 20 octobre 2011.
159 () Audition du 3 novembre 2011 de Mme Zeina Mansour, directrice du Comité régional d’éducation pour la santé de Provence Alpes Cotes d’Azur.
160 () M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville, rapport précité.
161 () Audition du 8 décembre 2011.
162 () 7 842 médecins et 1 314 infirmières scolaires, taux d’occupation : 62 % des postes de médecins scolaires et 69 % des postes d’infirmières scolaires étaient pourvus en 2010 selon les réponses au questionnaire budgétaire du Sénat pour le projet de loi de finances pour 2012.
163 () Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière.
164 () Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’État.
165 () Audition du 3 novembre 2011.
166 () I de l’article 84 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, codifié à l’article L. 1161-1 du code de la santé publique.
167 () II de l’article 91 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
168 () II de l’article 2 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
169 () Audition du 20 octobre 2011.
170 () Audition du 20 octobre 2011.
171 () Audition du 12 janvier 2012.
172 () Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales.
173 () Audition du 15 décembre 2011.
174 () Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
175 () L’hypothyroïdie congénitale, l’hyperplasie congénitale des surrénales et la mucoviscidose.
176 () Audition du 15 décembre 2011.
177 () Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales.
© Assemblée nationale