

______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juillet 2013
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) (1)
sur la conduite des programmes d’armement en coopération
et prÉsentÉ
par MM. François CORNUT-GENTILLE, Jean LAUNAY
et Jean-Jacques BRIDEY
Rapporteurs
___
MM. Olivier CARRÉ et Alain CLAEYS
Présidents.
____
La mission d’évaluation et de contrôle est composée de : MM. Olivier Carré, Alain Claeys, Présidents, Gilles Carrez, Président de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, M. Christian Eckert, Rapporteur général, MM. Jean-Jacques Bridey, Christophe Caresche, Christophe Castaner, François Cornut-Gentille, Charles de Courson, Marc Francina, Mme Annick Girardin, MM. Jean-Pierre Gorges, Laurent Grandguillaume, Jean Launay, Mme Véronique Louwagie, MM. Hervé Mariton, Michel Piron, Nicolas Sansu, Mme Éva Sas, MM. Thomas Thévenoud, Philippe Vigier, Éric Woerth
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LES PROGRAMMES D’ARMEMENT EN COOPÉRATION SONT DEVENUS UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE QUI RENCONTRE DES SUCCÈS INÉGAUX 7
A. UNE RÉALITÉ DEVENUE INCONTOURNABLE 7
1. La grande diversité des champs de la coopération en matière de programmes d’armement 7
2. Avec des partenaires identifiés 8
3. Pour des projets ambitieux de coopération en matière d’armement 12
B. QUI RENCONTRE DES SUCCÈS INÉGAUX 15
1. Le bilan de l’exécution des principaux programmes d’armement en coopération 15
a. Les principaux programmes 15
b. Les « rendez-vous » manqués et les « chantiers » à venir de la coopération 17
2. Des dérives obèrent trop souvent les gains attendus de la coopération 19
a. Un exercice difficile par nature 19
b. Les exigences des États : spécifications nationales et « juste retour industriel » 22
II. LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ARMEMENT DOIT S’INSCRIRE DANS LE CADRE D’UNE VÉRITABLE VISION POLITIQUE, STRATÉGIQUE ET INDUSTRIELLE 25
A. LE NÉCESSAIRE ENCADREMENT POLITIQUE DES PROGRAMMES D’ARMEMENT MENÉS EN COOPÉRATION 25
1. La coopération dans le domaine de l’armement implique un fort volontarisme politique ainsi qu’une démarche pragmatique et opportuniste 25
a. La condition première d’une coopération réussie dans le domaine de l’armement dépend de la volonté politique des États impliqués 25
b. Les programmes d’armement menés en coopération doivent s’inscrire dans le cadre d’une démarche pragmatique et opportuniste pour se révéler performants 27
2. La gouvernance de ces programmes doit être améliorée et consolidée pour une meilleure efficience 30
a. Les investissements de défense doivent bénéficier d’une plus forte visibilité politique pour gagner en efficacité et en cohérence 30
b. La gouvernance des organismes de coopération dans le domaine de l’armement doit être consolidée pour gagner en efficience 31
B. LA COOPÉRATION, EN MATIÈRE D’ARMEMENT : UNE OBLIGATION FINANCIÈRE, MILITAIRE ET INDUSTRIELLE 33
1. Les programmes d’armement menés en coopération peuvent générer des économies importantes à certaines conditions 34
a. La contrainte budgétaire a des répercussions directes sur les programmes d’armement 34
b. La coopération dans le domaine de l’armement permet une mutualisation des coûts 38
c. La coopération pour générer des économies doit répondre à certains impératifs 39
2. Les programmes d’armement menés en coopération favorisent l’interopérabilité des armées européennes 41
3. L’industrie de défense, un secteur dont la pérennité et la compétitivité pourraient être assurées grâce à la coopération européenne 42
a. La coopération dans le domaine de l’armement, moteur potentiel d’une restructuration de l’industrie de défense européenne 42
b. La coopération, un outil à même d’assurer la pérennité d’un secteur créateur de richesse et d’emploi 46
CONCLUSION 49
LES RECOMMANDATIONS 51
EXAMEN EN COMMISSION 53
ANNEXES 57
I. LISTE DES PROGRAMMES MENÉS EN COOPÉRATION 57
II. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 59
III. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 61
Notre pays est engagé aujourd’hui dans un vaste effort de réflexion sur sa politique de défense, comme le montrent la publication récente du dernier Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et l’élaboration d’une nouvelle loi de programmation militaire.
De profondes évolutions affectent actuellement le contexte international, diplomatique aussi bien qu’économique : le repositionnement stratégique américain vers l’Asie, les contraintes financières lourdes en Europe qui pèsent sur les budgets militaires. Les menaces, les défis stratégiques persistent et se font même plus pressants.
Dans cette situation difficile, inédite, la France est amenée naturellement à renouveler la conduite de programmes d’armement en coopération, ce qui permet de renforcer l’interopérabilité des armées.
La commission des Finances a souhaité précisément mesurer l’efficacité de ces programmes, en cette période où l’argent public devient rare et où les tensions internationales perdurent, en confiant à sa mission d’évaluation et de contrôle une analyse de la manière dont sont conduits les programmes d’armement menés en coopération.
Ceux-ci lui sont apparus d’abord comme une réalité devenue incontournable qui rencontre pourtant des succès inégaux. Il faut pourtant dès à présent souligner – contrairement à une idée répandue – que les programmes d’armement réalisés dans un cadre de coopération internationale ne font pas apparaître de distorsions particulières par rapport à celles constatées pour les programmes d’armement conçus et réalisés dans un cadre national. Ces derniers ne sont pas plus rationnels, fonctionnels ou économiques. Les uns et les autres connaissent en effet des dépassements de coûts et des glissements calendaires importants. Il reste que les programmes d’armement en coopération sont confrontés à deux écueils majeurs, spécifiques, que sont le problème de l’harmonisation des besoins opérationnels et la question du « juste retour industriel », auxquels il faudra apporter des réponses.
Pour les auteurs de ce rapport, la coopération dans le domaine de l’armement est une nécessité – aucun grand programme d’armement conventionnel ne pouvant plus, comme par le passé, être lancé dans un cadre strictement national – qui doit s’inscrire dans le cadre d’une véritable vision politique, stratégique et industrielle.
I. LES PROGRAMMES D’ARMEMENT EN COOPÉRATION SONT DEVENUS UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE QUI RENCONTRE DES SUCCÈS INÉGAUX
Les actions d’armement menées en coopération sont devenues une réalité incontournable qui répond à une logique stratégique, financière et industrielle.
Il importe de prendre d’abord la mesure de ces programmes, avant de faire un point sur leur exécution.
A. UNE RÉALITÉ DEVENUE INCONTOURNABLE
Même si elle peut sembler aujourd’hui moins dynamique qu’il y a dix ou vingt ans, époque où ont d’ailleurs été engagés plusieurs grands programmes toujours en cours d’exécution, la coopération en matière d’armement reste une constante ; ne serait-ce, que parce qu’elle organise le partage des coûts de conception, de développement et de production et qu’elle permet de disposer, à plusieurs, de capacités qu’un État ne pourrait développer seul en raison des masses financières en jeu.
La coopération permet aussi d’éviter les ruptures technologiques et elle facilite l’effort d’exportation, les partenaires commerciaux acquérant plus facilement des matériels produits en commun.
1. La grande diversité des champs de la coopération en matière de programmes d’armement
Les investissements réalisés en coopération représentent aujourd’hui environ 30 % du total de nos investissements dans l’armement, hors force de dissuasion.
Le flux annuel des paiements correspondants s’élève, comme l’a rappelé M. Laurent Collet-Billon, délégué général à l’armement, lors de son audition par la mission, à environ 1,5 milliard d’euros, inscrits au programme 146 (Équipement des forces) du budget de la défense.
La France est actuellement engagée dans 24 programmes dont 12 sont de grande ampleur. Parmi cet ensemble, elle participe à 7 des 8 programmes relevant de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) (2) organisme qui gère, sur la base de mandats que lui confient les États, des programmes d’armement en coopération.
La France participe à plusieurs grands programmes en coopération comme celui de l’avion de transport militaire A400M ou le programme de frégates multi-missions, les FREMM. Tous les programmes d’hélicoptères, principalement le NH90 et le Tigre se font en coopération. Le missile air-air longue distance Méteor fait l’objet d’un développement conjoint, comme tous les programmes de communication par satellite et d’imagerie spatiale. Sont explorés maintenant de nouveaux champs de coopération : la guerre des mines, les drones, la surveillance maritime, le secteur terrestre…
Comme l’a indiqué à la mission l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées, les programmes d’armement recouvrent, en réalité, une grande diversité de matériels, allant de la puce électronique jusqu’au porte-avions à propulsion nucléaire, c’est-à-dire du composant d’un système au système de systèmes. Ils peuvent de fait mobiliser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’entreprises. Pour des États qui, comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni entendent être présents sur l’ensemble du spectre capacitaire, tous ces programmes pourraient être conduits en coopération.
« La coopération, a indiqué l’amiral Édouard Guillaud, est aujourd’hui envisageable dans tous les domaines, à l’exception de certaines « niches » touchant les fondements de notre souveraineté opérationnelle, en particulier dans le domaine de la dissuasion ou technologique, celles que l’on qualifie du point de vue industriel de « capacités du premier cercle. » (…) La coopération est plus aisée, s’agissant des capacités du « deuxième cercle », celles que l’on envisage de développer dans un cadre européen, voire de celles du « troisième cercle », qui sont ouvertes au marché mondial… »
« Compte tenu du coût des programmes d’armement modernes et de la multinationalisation croissante des industriels du secteur, la coopération reste une voie à privilégier, sous les réserves précédemment décrites, lorsqu’elle ne s’impose pas de fait. »
2. Avec des partenaires identifiés
Le Royaume-Uni est le principal partenaire de la France dans la conduite de ces programmes. La coopération porte pour l’essentiel sur les missiles et les matériels volants. En effet, à la différence de ce que l’on observe avec nos partenaires italiens et allemands, les actions communes ont été moins nombreuses dans les domaines maritime et terrestre.
Signés en novembre 2010, les traités de Lancaster House formalisent la relation prioritaire nouée entre la France et le Royaume-Uni dont le Livre blanc est venu confirmer l’importance.
Nos deux pays coopèrent sur le futur missile anti-navire léger (ANL)(3), pour lequel la France a décidé récemment de s’engager dans une phase de développement et de production. Embarquant une charge explosive limitée, l’ANL reste un programme d’ampleur assez modeste, visant à assurer des frappes mieux ciblées.
Le programme de missile de croisière SCALP-EG conduit en coopération avec les Britanniques et qu’ils appellent le Storm Shadow fait, quant à lui, l’objet d’une révision.
L’ensemble de ces projets dans le secteur missilier inspirent une nouvelle vision stratégique, un effort de consolidation de l’industrie des missiles que nos partenaires nomment One complex weapon ou One MBDA, du nom de l’industriel concerné.
La coopération porte également sur la mise au point de drones de guerre des mines pour lesquels le développement et la production de deux prototypes identiques sont envisagés ainsi que sur le drone tactique Watchkeeper. L’effort commun porte sur la formation, le soutien et les évolutions futures de ce système qui va être mis en service dans l’armée britannique et que la France va très prochainement acquérir.
Dans le domaine de la recherche technologique, il faut faire référence au futur drone de combat aérien le Future Combat Air System (FCAS) pour lequel une étude de faisabilité préparant un futur programme conjoint de démonstrateur technologique et opérationnel a été entamée.
La coopération porte enfin sur les systèmes d’information ainsi que sur l’harmonisation des systèmes satellitaires de communication, le Syracuse français et le Skynet britannique devant être remplacés.
Il faut noter que les traités de Lancaster House signés entre la France et le Royaume-Uni en novembre 2010 donnent lieu à un suivi spécifique renforcé bien en phase avec l’importance de ces traités pour nos deux pays. Ces traités ont ainsi organisé une gouvernance souple et réactive dont les Britanniques eux-mêmes avaient demandé la mise en place : des groupes de travail créés au niveau des directeurs nationaux d’armement font vivre cette coopération au quotidien et le Senior Level Group comprenant le National Security Advisor ainsi que le chef d’état-major particulier et le conseiller diplomatique du Président de la République en assure la gouvernance.
Ces accords peuvent faire l’objet ainsi de réajustements rapides en fonction de données politiques, militaires ou industrielles.
Il faut mentionner enfin le programme Teutatès-Épure qui relève de la dimension « dissuasion nucléaire » des accords de Lancaster House. Ce programme répond à deux objectifs communs à la France et au Royaume-Uni : le besoin d’outils de simulation des armes nucléaires après la ratification par les deux pays du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires du 10 septembre 1996 et la nécessité de réaliser des économies budgétaires.
Les traités de Lancaster House qui prévoient ainsi un début de coopération sur les capacités du « premier cercle » ont eu pour objet la construction de deux installations : l’une dans laquelle seront réalisées des expériences de certification des armes, qui se trouve en France, à Valduc, l’autre, le centre de développement technologique (TDC), qui est un laboratoire de recherche commun destiné à la coopération scientifique et au soutien technique qui est situé au Royaume-Uni sur le site de l'Atomic Weapons Establishment (AWE) à Aldermaston.
L’Italie est également un partenaire historique important, la relation avec ce pays étant particulièrement étroite depuis plus de vingt ans.
La coopération existe principalement dans le domaine naval : elle concerne, après le programme de frégates Horizon arrivé à terme, les frégates multi-missions (FREMM) ; il s’agit d’un programme ambitieux qui a débuté en 2002, la livraison des frégates à la marine nationale ayant été échelonnée de 2012 à 2022.
Sont également produites avec l’Italie des torpilles légères MU90, dont les livraisons devraient s’achever en 2014.
La coopération avec l’Italie s’est également développée dans le domaine spatial, principalement le programme d’observation ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation ou système combiné d’observation optique et radar de la Terre), fournissant des images satellitaires de renseignement à partir des systèmes d’observation radar italien et optique français, le programme Hélios II ainsi que le programme MUSIS (Multinational space-based imaging system for surveillance, reconnaissance and observation ou système multinational d'imagerie spatiale pour la surveillance, la reconnaissance et l'observation) qui est en cours de définition.
Pour les systèmes d’armes, font l’objet d’un programme de coopération les missiles Aster 15 et 30 et dans le cadre du programme Météor, le missile air-air longue distance dont la mise en service pourrait intervenir en 2015.
Enfin, l’Italie coopère avec la France pour la mise en place de plusieurs démonstrateurs : celui du drone de combat nEUROn, comme le démonstrateur européen de communications tactiques utilisant la technologie radio-logicielle ESSOR (European Secure Software Defined Radio).
Avec l’Allemagne, nos coopérations sont moins étoffées. Elles portent sur la décontamination de matériels sensibles, la modernisation de lance-roquettes, le domaine des missiles et, pour le domaine aéronautique, la poursuite des programmes d’hélicoptères Tigre et NH90.
La France et l’Allemagne mènent cependant des réflexions communes sur la défense anti-missile, les drones MALE, les systèmes terrestres et la navigabilité des aéronefs.
La Pologne occupe dans cet ensemble une place singulière, comme le montre son engagement dans le « Triangle de Weimar », forum de rencontres et d’échanges entre la France, l’Allemagne et la Pologne sur les questions politiques et de coopération, instauré en 1991.
La coopÉration franco-polonaise en matière de dÉfense : une nouvelle opportunitÉ
La Pologne est l’un des rares pays d’Europe qui ait augmenté significativement son budget de la défense ces dernières années. En 2011, les dépenses militaires représentaient 1,9% de son PIB selon les données de la Banque mondiale. La France a développé avec cet État des relations étroites qui devraient se traduire dans l’avenir par des réalisations concrètes dans le domaine de l’armement. La Pologne s’interroge actuellement sur une possible adhésion à l’OCCAr et envisage par ailleurs, de solliciter l’AED pour la définition, et éventuellement ensuite le partage des avions ravitailleurs.
En raison du repositionnement de la politique de défense américaine vers la zone Asie-Pacifique, la Pologne a actuellement tendance à se rapprocher du reste de l’Union européenne et se trouve presque systématiquement en accord avec les positions de la France, ce qui constitue une véritable opportunité que notre pays doit saisir selon l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées. Ainsi, en octobre prochain se déroulera avec la Pologne un exercice de l’OTAN, auquel de très nombreux pays ont refusé de participer, parce qu’il fallait y envoyer des hommes. Seule la France y fournira un contingent important. C’est là un engagement qui a un coût, mais le chef d’état-major des armées a décidé de le maintenir, malgré nos difficultés budgétaires actuelles au nom du Triangle de Weimar.
Les rencontres entre Chefs d’État et de Gouvernements, responsables ministériels et parlementaires sont fréquentes. Cette forme de coopération trilatérale présage de liens à venir sûrement plus forts, pouvant contribuer à une relance de la défense européenne.
À ces partenaires traditionnels, il faut ajouter d’autres pays avec lesquels une coopération globale est possible et serait tout à fait souhaitable.
L’amiral Édouard Guillaud a présenté ainsi à la mission l’intérêt de développer des programmes en coopération avec l’Espagne, avec laquelle nous partageons une vision stratégique commune et qui nous permet de mieux comprendre l’Amérique latine, comme avec les pays de l’Europe du Nord : Danemark, Norvège et Suède.
Le Danemark, rappelait l’amiral Édouard Guillaud, a été le premier pays à nous rejoindre en Libye et au Mali ; malgré leur positionnement de neutralité, les Suédois sont présents sur de nombreux théâtres d’opérations ; la France mène des actions de coopération de niche avec la Norvège et ces trois pays soutiennent habituellement les positions de la France dans les instances de l’OTAN ou de l’Union européenne.
Le Portugal lui-même pourrait devenir un partenaire au même titre que ces États de l’Europe du Nord.
3. Pour des projets ambitieux de coopération en matière d’armement
– L’avion de transport militaire A400M a eu une naissance difficile, mais il a pu voler récemment à l’occasion du salon du Bourget ; très perfectionné, cet avion de transport marque une rupture importante avec ses prédécesseurs. Il est non seulement « stratégique », étant doté de capacités de projection, d’altitude et d’une vitesse qui lui permettent de projeter des moyens, de la charge utile et des forces loin et vite, mais il est aussi « tactique », car il peut intervenir sur un théâtre d’opérations en milieu hostile. Il peut ravitailler et être ravitaillé en vol.
L’A400M est un quadrimoteur – alors que le Transall n’était qu’un bimoteur – de 79 tonnes qui pourra emporter 36 tonnes de fret ou 11 parachutistes en équipement de combat ou encore 66 brancards en configuration d’évacuation sanitaire. C’est un appareil rapide (850 km/h), dont l’autonomie lui permettra de franchir jusqu’à 8 700 kilomètres, sans ravitaillement en vol.
Depuis son lancement en 2001, participent à ce programme, avec la France : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Turquie.
C’est un avion de type Airbus et la fabrication des systèmes et des structures est celle d’un avion civil : la voilure est réalisée au Royaume-Uni, le fuselage en Allemagne. La pointe avant, le système électrique et les commandes de vol, le sont en France.
L’A400M est un avion certifié civil et militaire ; il innove en matière de technologie, avec la première voilure tout carbone, un moteur particulièrement puissant et des systèmes de gestion de vol plus complexes que ceux de l’A380 ou du Rafale.
Enfin, il n’existe pour cet avion qu’une seule chaîne d’assemblage.
L’objectif retenu par ce programme dont la gestion a été confiée à l’OCCAr est de compléter ou de remplacer les flottes actuelles composées de C-130 Hercules américains et de C-160 Transall franco-allemands.
– Dates-clés du programme A400M :

Source : ministère de la Défense.
– Le programme FREMM (frégates multi-missions), qui a débuté en 2002, constitue le plus important programme naval lancé en Europe. Le 23 novembre 2012, la première frégate, l’Aquitaine a été livrée à la marine française. Ces frégates doteront la France de capacités déterminantes pour la maîtrise du milieu aéro-maritime et pour la frappe dans la profondeur.
Ce programme géré par l’OCCAr et dont l’exécution est prévue jusqu’en 2022 a visé à créer une nouvelle génération de frégates destinée à remplacer les frégates anti-sous-marines et la plupart des frégates antiaériennes, à l’exception des frégates de classe Horizon.
Avec le programme FREMM, la France a cherché la mise au point d’un nouveau type de bâtiment : plutôt que de construire un bateau de guerre capable de résister à des missiles très puissants, l’on a cherché à disposer, en assez grand nombre, de bateaux capables, une fois touchés, de quitter la zone d’opération.
Les frégates ont été commandées par les marines française et italienne, au titre d’un contrat passé entre l’OCCAr et un consortium industriel réunissant DCNS, pour la France et, pour l’Italie, Orrizonte Sistemi Navali constituée de Fincantieri et Finmeccanica.
– Dates-clés du programme FREMM :

Source : ministère de la Défense.
– Le Tigre, hélicoptère d’assaut et de combat produit par la société Eurocopter a été mis en service en 2005. Ce programme d’armement réunit la France et l’Allemagne qui avaient entamé des discussions dès 1975 et depuis 2004, l’Espagne. Sa gestion a été confiée à l’OCCAr en 2001.
Le Tigre se présente sous plusieurs versions : une version antichar (UHT), demandée par l’Allemagne dans le contexte de la guerre froide : une version « appui protection » (HAP) et une version « appui destruction » (HAD). Une version reconnaissance (ARH) a été développée avec l’Australie.
Les qualités que réunit cet hélicoptère franco-allemand, sa précision de tir, sa structure moderne, le fait qu’il n’exige qu’une maintenance réduite en font un équipement très opérationnel notamment dans sa version « appui protection » (HAP), comme l’ont montré ses engagements en Afghanistan dès 2009, en Libye dans le cadre de l’opération Harmattan en 2011, plus récemment au Mali lors de l’opération Serval.
À la différence de l’avion de transport A400M, l’hélicoptère Tigre fait l’objet de plusieurs versions et de trois chaînes d’assemblage, en France, en Allemagne et en Espagne.
– Dates-clés du programme Tigre :
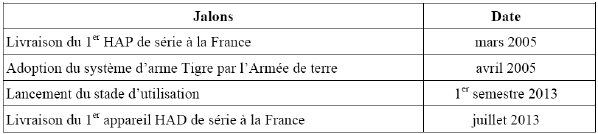
Source : ministère de la Défense.
– L’hélicoptère NH90 (NATO Helicopter) est un hélicoptère de manœuvre et de combat naval produit par Eurocopter. Ce programme d’armement en coopération réunit la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, le Portugal et la Belgique.
Il en existe deux versions : une version de transport tactique (TTH) et une version de lutte anti surface et anti-sous-marine (NFH). L’armée française sera elle-même dotée des deux versions d’hélicoptère qu’elle a dénommé : Caïman pour l’armée de terre et Caïman marine pour la marine nationale.
Ce programme est géré par une agence de l’OTAN : NAHEMA (Nato Helicopter Management Agency).
– Dates-clés du programme NH90 :

Source : ministère de la Défense.
B. QUI RENCONTRE DES SUCCÈS INÉGAUX
On tentera d’établir un bilan des principaux programmes d’armement conduits en coopération, en analysant l’état des livraisons de matériels, les coûts et les délais d’exécution de ces programmes, avant de se pencher sur les « rendez-vous » manqués de la coopération et les « chantiers » à venir.
On observera ensuite que certaines dérives dans l’exécution de ces programmes d’armement obèrent les gains qui en sont attendus.
1. Le bilan de l’exécution des principaux programmes d’armement en coopération
– L’A400M, programme assez emblématique de la coopération entre pays Européens, a rencontré des difficultés en 2009 et 2010. La question de son maintien s’est alors posée. Un avenant conclu en 2011 a redessiné les échéances et les structures et permis ainsi la poursuite de cette action en commun.
Le délai de livraison initialement prévu n’a pas été respecté, puisque l’industriel n’a pas livré le matériel en 2009 comme prévu. On peut cependant noter que le vol initial du premier prototype du C-17 américain a demandé dix années, alors que cette durée correspond, en fait, à la livraison du premier A400M.
– Les FREMM ont connu des difficultés qui ont conduit à des aménagements du programme plus importants encore.
Deux versions étaient initialement prévues : l’une, pour l’action vers la terre (AVT), l’autre, pour l’action anti-sous-marine (ASM). La France devait produire dix-sept frégates, neuf AVT et huit ASM. Une frégate devait être livrée à la France tous les sept mois, à partir de la fin 2012.
Le programme a été réduit à onze unités pour la France ; la version AVT a été abandonnée, une nouvelle version de frégate antiaérienne (FREDA) étant prévue en deux exemplaires pour succéder au programme Horizon.
Un premier bâtiment a été livré à la marine nationale en novembre 2012. La France a commandé au total onze frégates de ce type en tranche ferme.
Quatre facteurs expliquent la dérive des coûts qui a été observée pour le programme FREMM, selon les indications apportées à la mission par M. Patrick Boissier, président-directeur général de DCNS : la réduction du nombre des frégates à construire, la suppression de la version AVT remplacée par la version FREDA plus onéreuse ; l’allongement de sept à dix mois du délai moyen entre deux livraisons et enfin les différentes demandes de spécifications nationales.
Il faut ajouter que le gain que permet la coopération sur ce programme n’a été évalué par M. Patrick Boissier qu’à 30 millions d’euros, pour un programme ayant un coût global de 6 milliards d’euros.
– Le programme Tigre comportait initialement des spécifications destinées au combat antichar en Europe. Les autorités françaises les ont modifiées afin de tenir compte du nouveau contexte stratégique.
Les projections initiales étaient respectivement de 212 et 215 appareils pour l’Allemagne et la France. Les cibles ont été ensuite revues à la baisse à plusieurs reprises. La France avait commandé initialement 80 appareils, 70 HAP, la version « appui protection » et 10 HAD, la version « appui destruction » ; elle a ensuite revu sa commande à 40 HAP et 40 HAD.
Les aménagements prévus sont largement dus à des évolutions géopolitiques ; l’hélicoptère Tigre apparaît d’ailleurs comme un succès de la coopération sur un plan opérationnel. Pourtant, ce programme a enregistré un accroissement de près de 80 % des coûts unitaires et un étalement des livraisons, le dernier exemplaire devant être livré en 2020, alors qu’il aurait dû l’être dès 2013.
– Le programme NH90 est un projet de grande ampleur et revêt pour la France une importance primordiale dans un contexte d’attrition de la flotte d’hélicoptères Puma. Pour un montant global de 16 milliards d’euros, 530 hélicoptères vendus ont été livrés, dont 61 à la France. La composante navale de ce programme a cependant présenté des retards importants. Le premier NFH français, de lutte anti surface et anti-sous-marine n’a été livré qu’en mai 2010.
Le premier TTH français, de transport tactique l’a été en décembre 2011.
La cible totale du programme pour la France est en théorie de 160 NH90 (133 Caïman Terre et 27 Caïman Marine) afin de remplacer les hélicoptères de manœuvre des deux armées.
Le tableau ci-après synthétise l’exécution des principaux programmes d’armement actuellement menés en coopération. Les nouvelles prévisions se fondent sur le dernier Livre blanc, dans l’attente de la prochaine loi de programmation militaire qui pourra faire évoluer les cibles et la cadence des livraisons :
EXÉCUTION DES PROGRAMMES D’ARMEMENT EN COOPÉRATION
Parc actuel (Au 31/12/12) |
Cible |
Livraisons 2012 |
Livraisons 2013 |
Livraisons 2014 | |
A400M Prévision initiale |
0 |
50 |
0 |
3 |
5 |
A400M Prévision Livre blanc |
0 |
Cinquantaine d’avions de transport tactique |
0 |
2 |
4 |
FREMM Prévision initiale |
1 |
11 |
1 |
0 |
1 |
FREMM Prévision Livre blanc |
1 |
15 frégates de premier rang |
idem |
idem |
idem |
TIGRE Prévision initiale |
39 |
80 |
4 HAP |
4 HAD |
6 HAD |
TIGRE Prévision Livre blanc |
39 |
140 hélicoptères de reconnaissance et d’attaque |
|||
NH90 Prévision initiale |
5 TTH 7 NFH |
133 TTH 27 NFH |
4 TTH 2 NFH |
8 TTH 4 NFH |
9 TTH 2 NFH |
NH90 Prévision Livre blanc |
5 TTH 7 NFH |
115 hélicoptères de manœuvre NFH: non précisé |
4 TTH 4 NFH |
4 TTH 2 NFH |
Source : État-major des armées.
b. Les « rendez-vous » manqués et les « chantiers » à venir de la coopération
On mentionnera d’abord la question des drones puis celle du projet de « deuxième porte-avions », deux types d’armements indispensables et qui ne pouvaient être mis au point en Europe que par un effort mené en commun.
Aéronefs commandés à distance qui emportent des charges utiles destinées à des missions de surveillance, de renseignement, de combat ou de transport, les drones sont un matériel indispensable pour répondre aux défis stratégiques de demain.
La famille des drones comprend plusieurs catégories :
– Les drones tactiques appelés TUAV (Tactical Unmanned Air Vehicle) ;
– Les drones volant à moyenne altitude et de grande autonomie dénommés MALE (Medium Altitude Long Endurance), sans doute les plus connus ;
– Les drones volant à haute altitude et de grande autonomie appelés HALE (High Altitude Long Endurance) ;
– Les drones de combat appelés UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle)
On a vu précédemment que la France mène aujourd’hui avec les Britanniques une coopération sur des projets de long terme. Des réflexions, des recherches communes, des études de faisabilité sont engagées sur la mise au point de drones de guerre des mines navales, de drones tactiques comme de combat aérien.
On a vu, de la même façon, que le projet de démonstrateur de drone de combat qui réunit, aux côtés de la France, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Suisse et la Suède a abouti en décembre 2012 avec le premier vol du nEUROn.
Pourtant, le délégué général à l’armement, M. Laurent Collet-Billon, a estimé devant la mission : « Nous avons manqué le virage des drones il y a à peu près vingt-cinq ans, malgré la coopération franco-allemande alors initiée et qui a échoué… »
En conséquence, la France est conduite à recourir aujourd’hui, à la formule de l’« achat sur étagère ». En l’absence de fabrication de ce type d’appareil par l’industrie européenne, le Gouvernement a annoncé récemment l’achat de douze MQ-9 Reaper, des drones MALE fabriqués par la société américaine General Atomics ; deux de ces drones doivent être livrés à la fin de l’année 2013.
– Le projet de deuxième porte-avions
Le développement d’un porte-avions franco-britannique fait partie lui aussi des projets de coopération avortés.
La construction d’un deuxième porte-avions (PA2) aux côtés du Charles de Gaulle était apparue il y a plusieurs années comme une nécessité stratégique en Europe. Or, seule la coopération pouvait permettre la réalisation de cet équipement.
Les projets franco-britanniques se sont heurtés à des différences de conception et à des incertitudes surtout touchant au financement de ce porte-avions. Et, aujourd’hui les Britanniques poursuivent la réalisation de deux porte-avions qui ne seront livrés que dans dix ans.
2. Des dérives obèrent trop souvent les gains attendus de la coopération
La conduite des programmes d’armement en coopération s’est heurtée à de multiples obstacles et a parfois connu des dérives. L’exercice de la construction en commun d’équipements militaires est de fait par lui-même difficile, mais les États le rendent plus complexe encore, en se focalisant, dans leurs démarches de collaboration, sur des exigences strictement nationales.
a. Un exercice difficile par nature
Dans le propos liminaire à son audition, le général Jean-Robert Morizot, sous-chef d’état-major « Plans » au sein de l’état-major des armées a tenu à le rappeler : les programmes de coopération en matière d’armement ne sont pas une donnée simple : « Le thème retenu par votre mission correspond à l’une des pistes suivies pour résoudre l’équation difficile qui nous est posée : construire un modèle d’armée qui réponde aux ambitions politiques du pays, tout en étant moins coûteux. Dès le début de nos travaux, les notions de coopération, de mutualisation et de partage ont été très présentes. Leur approfondissement a permis de montrer que ces démarches sont longues et complexes. Et même si elles sont sans doute génératrices d’économies, il est clair qu’elles ne pourront régler, à court terme, la question des économies à réaliser. Les processus de concertation entre les armées, les nations, les industriels, prennent du temps. On le voit, par exemple, s’agissant de la coopération bilatérale engagée en 2010 avec le Royaume-Uni. »
Leur finalité étant militaire, celle du combat, les programmes d’armement en commun doivent répondre d’abord, de manière optimale, aux besoins opérationnels des forces armées. Pour citer toujours le général Morizot : « L’Agence européenne de défense (AED) avec le concept de mutualisation et de partage capacitaire (pooling and sharing), l’OTAN avec celui de « défense intelligente » (smart defence), ont eu un rôle important dans les réflexions menées en 2012. Mais, très vite, on se trouve confronté à la réalité de l’existant, des problématiques industrielles, aux programmes en cours, aux besoins de nos forces et aux ressources escomptées. Le recours d’emblée à la mutualisation pour régler les problèmes n’est pas toujours la solution : avant de pouvoir coopérer, on a besoin de garanties sur le besoin opérationnel, la cohérence des calendriers, les ressources disponibles et évidemment la réelle volonté de coopérer. Or ces discussions sont toujours délicates et faites de nombreux allers retours. »
Ces contraintes opérationnelles sont toujours très fortes. Le radar de contrebatterie Cobra réalisé en collaboration avec l’Allemagne dans le contexte de la guerre froide est devenu inopérant dans le contexte militaire actuel ; l’Allemagne a regretté que ses hélicoptères Tigre conçus pour le combat antichar soient inadaptés sur le théâtre d’opérations afghan et, en toute hypothèse, peu en phase avec les scénarios d’emploi de demain. La France a déploré que l’A400M n’ait pu être utilisé dans le cadre de l’opération Serval au Mali.
Et, en même temps qu’ils doivent répondre aux nécessités opérationnelles, les programmes d’armement en coopération sont tenus de satisfaire à une logique de cohérence et de n’engendrer ainsi ni surcoûts, ni pertes de performances, ni retards prohibitifs.
À ces contraintes très lourdes, s’ajoute le fait que les programmes d’armement en coopération s’inscrivent aujourd’hui dans le temps long, du fait de leur complexité et de leur potentiel d’évolution.
Comme le rappelait l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées, plusieurs décennies séparent les premières esquisses d’un programme de son lancement. La première fiche programme de l’avion A400M a été rédigée en 1984, c'est-à-dire il y a près de trente ans.
Ils engagent ainsi profondément l’avenir, en même temps qu’ils imposent une réflexion sérieuse sur le long terme.
Une volonté politique forte des États parties est, en toute hypothèse, indispensable, comme l’a rappelé à la mission l’amiral Édouard Guillaud et suppose un engagement identique de chacun de ces États sur toute la durée de vie du programme, « cet engagement », déclarait l’amiral Guillaud, « se déclinant en trois volets principaux, l’entretien de la confiance entre les États partenaires, le soutien des industriels et l’implication des armées. »
Il faut tenir impérativement compte aussi des singularités, des différences culturelles entre pays partenaires, si l’on veut parvenir à une coopération efficace.
Le contre-amiral Henri Schricke, attaché de défense près l’ambassade de France à Londres, a rappelé devant la mission certaines particularités britanniques qui ont pu hypothéquer les coopérations passées avec la France : le pragmatisme d’Outre-Manche, différent de la vision française, traditionnellement plus conceptuelle ; l’existence de besoins différents en matière maritime ou terrestre.
De nombreux aspects de la politique de défense rapprochent, cela étant, nos deux pays : une volonté de réflexion et de programmation pluriannuelles comparable exprimée soit par le Livre blanc, soit par la Strategic Defence and Security Review ; un effort budgétaire de niveau similaire ; le fait que les deux pays sont des puissances nucléaires ; la culture expéditionnaire commune, tous éléments qui distinguent cette coopération de celle qui peut exister avec l’Allemagne ou l’Italie.
On doit d’ailleurs observer, à partir notamment de l’exemple de l’opération Harmattan en Libye, que la coopération opérationnelle de la France avec le Royaume-Uni a été en définitive plus forte qu’avec l’Allemagne, avec laquelle nous avons pourtant créé des forces conjointes (4) qui ne sont jamais intervenues en opération.
Le général Philippe Chalmel, attaché de défense près l’ambassade de France à Berlin a rappelé de la même façon à la mission quelques éléments de ce qu’il a appelé le « code génétique » de nos alliés allemands : le rôle du « facteur temps » dans la prise de décision politico-militaire, mais aussi politico-industrielle, qui contraste avec un certain souci français « d’aller vite » ; l’existence d’un système politique qui place le Parlement au centre des décisions, chaque engagement devant être précédé du vote d’un mandat par la majorité la plus consensuelle possible ; la farouche indépendance constitutionnelle des ministères des affaires étrangères, de la défense, de l’industrie et de l’économie ; le souci enfin de demeurer l’une des grandes nations de l’armement en Europe, les Allemands, conscients de ne pas être présents dans certains secteurs, tels que le nucléaire ou les capacités aéronavales, comptant sur leur niveau technologique élevé, la diversité de leur industrie et leurs capacités à l’exportation.
Les relations franco-italiennes en matière de défense présentent de la même façon des spécificités, du fait d’héritages historiques différents, spécificités mises en lumière par le colonel Henri Sowa, attaché de défense adjoint à Rome : l’Italie « répudie la guerre », selon l’article 11 de sa Constitution ; elle garde, depuis notamment le Plan Marshall, un lien particulier avec les États-Unis ; elle craint d’être écartée des coopérations internationales, ce qui peut la conduire à des réactions opportunistes mais elle n’opère pas, comme la France avec le Livre blanc, d’analyse de long terme dans le domaine capacitaire et celui de l’équipement des forces. Très attachés aux coopérations, les Italiens le sont aussi au « juste retour industriel », ce qui peut entraver ces dernières.
Un dernier élément qui rend difficile l’exercice du développement d’armements en commun tient au contexte économique et financier actuel, celui de budgets militaires particulièrement contraints. L’argent devenu rare incite fortement aux coopérations, mais, en sens inverse, cette situation crée aussi une incertitude pour les forces-armées, les industriels et les États, susceptible de les conduire à renoncer à certaines capacités, voire à abandonner certains programmes.
Comme l’estimait M. Patrick Bellouard, ancien directeur de L’OCCAr, « les budgets de défense contraints n’offrent plus aucune flexibilité, compte tenu des programmes déjà lancés et les pays européens, qui parent au plus pressé, préfèrent préserver le court terme… »
C’est parce que la gestion de programmes d’armement en commun reste un exercice difficile en soi, que M. Marwan Lahoud, directeur de la stratégie et du marketing d'EADS, pouvait estimer devant la mission, que « depuis une quinzaine ou une vingtaine d’années, la dynamique qui s’était créée autour de la coopération a connu un certain ralentissement, des réticences, voire des retours en arrière ». M. Lahoud ajoutait : « Bien qu’il soit plus fort dans d’autres pays européens, le repli sur soi est visible en France. Ce qui a fait la dynamique de coopération durant trente ans, c’est une forte volonté française et l’écoute qu’elle a rencontrée chez certains de nos partenaires. La France a joué un rôle moteur dans la coopération franco-allemande en matière de défense et d’armement, comme dans la coopération franco-britannique récente. Nous sommes certes plus enclins à coopérer, mais nous sommes désormais en-dessous du seuil critique qui est nécessaire pour entraîner les autres. »
b. Les exigences des États : spécifications nationales et « juste retour industriel »
Les exigences des États susceptibles d’entrer en contradiction avec la logique de la coopération se cristallisent sur la demande de spécifications, autrement dit, les particularités nationales et la question du « juste retour industriel ».
Ce n’est pas un phénomène nouveau : le Livre blanc de 2008 précisait déjà que : « La coopération sur les programmes a régressé ou s’enlise dans une course au retour industriel entre États membres et la recherche de la satisfaction des besoins spécifiques de chaque armée, au point que certaines coopérations sont devenues de véritables contre-exemples ».
Lors de son audition par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2012, M. Jean-Marie Guéhenno, président de la commission chargée de l’élaboration du nouveau Livre blanc déclarait, de la même façon, « L’industrie de défense européenne a connu des réussites insuffisamment soulignées, notamment avec les missiles MBDA. Elle a eu aussi des déceptions, à chaque fois que l’on a souhaité additionner des spécifications, par exemple pour le programme d’hélicoptères NH90. Des programmes ainsi conçus sont trop coûteux et trop compliqués à réaliser. L’ensemble des appareils de défense devra se discipliner, car si chacun persiste à vouloir augmenter le modèle initial de particularités correspondant à sa tradition nationale, on n’y arrivera pas ! Si une leçon doit être tirée des échecs et des réussites passés, c’est que l’on progresse quand il y a un pilote et que, lorsque l’on additionne des spécificités nationales, loin de faire des économies, on accroît la dépense. »
L’avion de transport militaire A400M a donné lieu à une démarche d’identification des besoins communs en matière de spécifications qui avait été établie par les responsables des états-majors de huit États (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Turquie, Belgique, Portugal et Italie, ces deux derniers ayant depuis quitté le programme) ; 90 % des spécifications sont ainsi communes aux États partenaires, même si ce souci de prendre en compte tous les besoins des États a pour contrepartie la complexité de cet avion.
En revanche, il existe vingt-quatre versions de l’hélicoptère de manœuvre et de combat naval NH90, car l’on a construit, dans ce cas, autant de types d’appareils que de parties prenantes.
Pour le Tigre, hélicoptère de combat, il existe deux grandes versions. Ce programme comportait initialement des spécifications destinées au combat antichar en Europe centrale, puisqu’il a été lancé dans les années quatre-vingt à l’époque de la guerre froide. Les autorités françaises ont par la suite modifié les spécifications initiales pour adapter les appareils à la nouvelle donne géopolitique, contrairement aux responsables allemands.
Mais le programme FREMM de construction de frégates multi-missions qui réunit la France et l’Italie est sans doute le plus symptomatique de l’effet négatif des demandes de spécifications nationales.
Devant la mission, M. Patrick Boissier président-directeur général du groupe DCNS en charge du côté français de la construction de ces frégates a ainsi estimé : « Les différences de spécifications entre les frégates françaises et italiennes sont si nombreuses qu’il serait plus facile de faire la liste des spécifications communes. Les plateformes sont différentes. La vitesse maximale des FREMM françaises et italiennes est différente, ce qui a des conséquences sur la puissance des navires et sur leurs chaînes de propulsion. Les FREMM françaises sont très automatisées – elles embarquent un équipage de 108 marins, détachement hélicoptère compris, soit un personnel deux fois et demi moins nombreux que sur les frégates antiaériennes en service actuellement –, alors que les frégates italiennes ont besoin de 145 marins. Les radars sont différents, de même que les armements choisis. De plus, les frégates italiennes sont équipées d’un canon à l’arrière, contrairement aux nôtres. Finalement, les FREMM n’ont de commun que leur nom et quatre équipements ; même leur silhouette est différente. Malgré cela, par rapport à la complexité du programme Horizon, la simplification est considérable ; nous produisons en fait des programmes nationaux avec une coopération pour certains équipements. »
Le programme FREMM aboutit ainsi à la construction de plusieurs bateaux différents, qui ne naviguent pas à la même vitesse, n’emportent pas le même nombre de marins et se retrouvent même en compétition frontale sur le marché de l’exportation. Seulement 15 % des éléments du programme sont communs aux frégates françaises et italiennes et les entreprises, DCNS, du côté français, Orizzonte Sistemi Navali, pour l’Italie travaillent de manière indépendante.
L’ingénieur en chef Cyril Croze, attaché d’armement à Rome, a confirmé cette analyse devant la mission en estimant qu’« il faut distinguer les frégates Horizon et les FREMM. Les quatre frégates franco-italiennes Horizon sont à 95 % communes ; le programme est véritablement mené en coopération, les bâtiments sont communs et les deux marines ont fait récemment des exercices remarquables au large de Toulon. Ce n’est pas tout à fait le cas pour les FREMM où on se trouve devant deux produits assez différents. »
L’image du sablier est peut-être celle qui rend le mieux compte des effets perturbants que peuvent avoir les demandes de spécifications nationales sur les mécanismes de la coopération : dans le cône du haut, figureraient les États, les états-majors et les industriels, la partie étroite du milieu correspondant au processus de décision en commun, qui lance un programme aux caractéristiques similaires ; on constate que, dans le cône du bas, les caractéristiques se diversifient à nouveau, du fait des demandes de spécifications nationales.
Si les produits résultant des programmes conduits en coopération ne sont pas similaires, ils n’apportent pas alors les gains attendus sur le plan de l’homogénéité opérationnelle et des coûts de développement et d’acquisition, puisque l’effet de série ne joue pas.
Il faut se garder pour autant de voir les demandes de spécifications techniques comme une sorte de « caprice » notamment des états-majors, qui, intervenant en cours de programme, n’aboutiraient qu’à compliquer la mise au point des armements et à augmenter les coûts.
Les considérations opérationnelles pèsent d’une manière générale de tout leur poids, lorsque sont définies les demandes de spécifications techniques. Le général Morizot l’a bien expliqué aux membres de la mission : « La définition du besoin militaire découle de la manière même de combattre de chaque armée. Aussi, plus le matériel envisagé se rapproche du savoir-faire des armées, leur cœur de métier, c’est-à-dire des phases opérationnelles, plus les choses deviennent compliquées et les compromis difficiles à trouver. Ce n’est pas une question de traditions, mais, j’insiste, de savoir-faire et de tactique : si l’expression des besoins des armées paraît parfois rigide, c’est que ceux qui les formulent se représentent des situations concrètes de combat et font appel à leur expérience. Le compromis peut s’avérer difficile à établir, même si interviennent d’autres considérations d’ordre politique ou technologique et la nécessité de réaliser des économies ».
Les effets négatifs de l’exigence d’un « juste retour industriel » ont été eux aussi souvent analysés. La demande de chaque partenaire d’un retour industriel à proportion de son engagement financier n’a souvent abouti qu’à accroître les coûts et les délais de livraison des matériels.
M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d’Eurocopter estimait sur ce point : « Pour parler du partage industriel, on pourrait penser que chacun doit réaliser ce qu’il sait le mieux faire. Or il est rare que cela se passe ainsi : en général, on profite plutôt d’un programme en coopération pour se lancer dans un domaine que l’on ne connaissait pas et rattraper ses concurrents. C’est une erreur fondamentale contre laquelle il faut lutter… »
A contrario, le programme A400M n’a pas eu à subir systématiquement la règle du « juste retour industriel », grâce principalement à l’activité civile d’Airbus.
I. LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ARMEMENT DOIT S’INSCRIRE DANS LE CADRE D’UNE VÉRITABLE VISION POLITIQUE, STRATÉGIQUE ET INDUSTRIELLE
A. LE NÉCESSAIRE ENCADREMENT POLITIQUE DES PROGRAMMES D’ARMEMENT MENÉS EN COOPÉRATION
Le retour d’expérience des différents programmes d’armement menés en coopération ces dernières décennies doit permettre de tirer pour l’avenir les enseignements nécessaires pour en améliorer significativement l’efficience.
1. La coopération dans le domaine de l’armement implique un fort volontarisme politique ainsi qu’une démarche pragmatique et opportuniste
a. La condition première d’une coopération réussie dans le domaine de l’armement dépend de la volonté politique des États impliqués
Les questions relatives aux équipements des armées relèvent des missions régaliennes de l’État. De l’armement de nos forces dépend la place de la France dans le monde, le succès opérationnel de nos armées, ainsi que la bonne santé économique de notre industrie de défense.
La coopération dans le domaine de l’armement est ainsi à la croisée d’enjeux politiques, stratégiques, opérationnels, diplomatiques, économiques et industriels.
Lancer un programme d’armement en coopération est une entreprise lourde de conséquences économique et militaire. Pour qu’elle réussisse en permettant la livraison d’équipements performants, technologiquement avancés, à des coûts maîtrisés, il est indispensable que la coopération soit portée tout au long de la vie du programme d’armement par une forte volonté politique. Le bon fonctionnement du programme suppose, en effet, que les engagements des États impliqués soient identiques du lancement de la coopération jusqu’aux premières livraisons du matériel. Une coopération exemplaire pourrait même aller jusqu’aux opérations de soutien, voire aux opérations de retrait de service des équipements concernés.
La volonté politique est pour l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées, l’une des trois conditions qui permettent à une coopération dans le domaine de l’armement de parvenir au succès ; les deux autres éléments essentiels étant la constitution d’un montage industriel adéquat et une correcte harmonisation des besoins opérationnels. Le rôle des responsables politiques apparaît ainsi primordial, des prémices de la coopération jusqu’à la fin du cycle de vie des matériels visés, car de leur implication dépendra très fortement le destin de ces programmes.
La France a toujours été en Europe une nation-moteur dans le domaine de la coopération en matière de défense et d’armement. Ainsi, notre pays a souvent été à l’origine des rapprochements avec nos partenaires privilégiés que sont notamment l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Par ailleurs, la France a été un des pays fondateur de l’OCCAr en 1998 et a soutenu l’initiative de création de l’AED (Agence européenne de défense) en 2004. Néanmoins, il semblerait que nous assistions actuellement à un repli sur soi des différents pays européens sur les questions de coopération.
Certains industriels à l’instar des représentants du groupe EADS ont regretté devant la mission, la faiblesse actuelle de la volonté politique dans ce domaine. Il est vrai, par exemple, que depuis plusieurs années le nombre d’études amont sur la base desquelles peuvent émerger des programmes d’armement multinationaux n’a cessé de décroître. L’indicateur de performance 1.1.3. Taux de coopération européenne en matière de recherche et de technologie (études amont et subventions aux organismes de recherche) du programme 144 (Environnement et prospective de la politique de défense) de la mission Défense qui assure un suivi de la performance des efforts consacrés aux travaux de recherche menés en coopération – le plus souvent dans le cadre d’accords bilatéraux ou sous la houlette de l’Agence européenne de défense – était en recul de quatre points par rapport à la prévision initiale en 2011 (5) et accuse une nouvelle diminution de deux points en 2012 par rapport à l’exercice précédent (6).
Pour Claude-France Arnould, directrice exécutive de l’AED, les chiffres sont « inquiétants sur la baisse des budgets, particulièrement en matière de recherche et technologie, et encore plus pour les projets menés en coopération » (7). Entre 2006 et 2010 l’effort budgétaire des États européens consacré à la recherche et technologie dans le domaine de la défense a ainsi baissé de 22 %. La part de cet effort budgétaire consacré à la coopération en matière de recherche et technologie ne représente plus que 12 % du budget contre une ambition fixée initialement à 20 %. En matière de recherche et développement les ambitions de l’AED sont élevées – notamment en ce qui concerne la question des ravitailleurs en vol – mais son budget n’étant pas suffisamment important, ses réalisations en matière d’armement, par conséquent, ne sont pas significatives.
Ce recul de l’investissement en matière de recherche au niveau européen pourrait avoir d’importantes conséquences. En effet, nous ne sommes plus en mesure de développer et de produire dans un cadre national certains équipements technologiquement très avancés au coût très important, alors que les besoins opérationnels existent. Ainsi, si cette situation devait durablement se poursuivre, les États européens seraient nécessairement conduits à privilégier l’achat « sur étagère » en lieu et place d’un développement et d’une production européenne en coopération, qui pourtant permettrait de créer de la valeur ajoutée.
C’est bien aux responsables politiques qu’il revient donc d’intervenir pour mobiliser les forces nécessaires au niveau national et européen. Ils doivent porter les programmes d’armement qui peuvent faire l’objet d’une coopération et se doivent par la suite de soutenir durablement ces projets pour qu’au final les programmes menés en coopération puissent porter leurs fruits, que ce soit au niveau stratégique, opérationnel, mais également économique et industriel. Le développement d’un outil de défense européen crédible et efficace ne pourra émerger qu’en raison d’une forte volonté politique. De ce volontarisme dépend également la pérennité et la compétitivité de notre industrie de défense dans un secteur où l’État, qu’il soit actionnaire ou client, demeure un acteur incontournable.
b. Les programmes d’armement menés en coopération doivent s’inscrire dans le cadre d’une démarche pragmatique et opportuniste pour se révéler performants
L’ensemble des acteurs de la coopération en matière d’armement s’accordent sur un point : une coopération trop fortement ouverte à son lancement est condamnée à l’inefficacité ou aux accidents d’ordre financier, industriel et calendaire. Les « grandes multinationales de la coopération » attrayantes en théorie peuvent conduire à des écueils qu’il serait souhaitable d’éviter.
Comme le souligne Hubert Védrine dans son rapport au Président de la République sur Les conséquences du retour de la France dans le commandement militaire intégré de l’OTAN, et sur l’avenir de la relation transatlantique et les perspectives de l’Europe de la Défense du 14 novembre 2012 il faut cesser de plaider sur un mode incantatoire pour une énième relance de l’Europe de la Défense, mais il faut agir concrètement pour construire progressivement un système de défense européen qui passera nécessairement par la coopération dans le domaine de l’armement.
Cet outil de défense européen, il semble possible de le construire par une « politique des petits pas », de façon pragmatique et circonstancielle. L’expérience montre qu’il est nécessaire de privilégier pour une bonne conduite des programmes, une coopération réduite à l’origine, constituée d’un « noyau dur » de deux ou trois États maximum. Un faible nombre de participants permet, en effet, de faire converger plus rapidement les besoins et les solutions et de s’accorder plus aisément sur les objectifs du programme. Mais il est essentiel que cette approche ne soit pas exclusive et reste ouverte pour les phases suivantes de la coopération. En effet, une fois les objectifs correctement définis et les modes de gouvernance consolidées, il est tout à fait souhaitable d’ouvrir ces programmes à d’autres États intéressés. Les traités de Lancaster House de 2010, signés avec le Royaume-Uni, s’inscrivent directement dans cette ligne. L’armée de terre est actuellement en train de se doter de drones tactiques britanniques Watchkeeper et, comme cela a été dit, Londres et Paris vont très prochainement lancer ensemble un programme de missiles anti-navire léger (ANL). Pour les rapporteurs, une telle démarche, unique en son genre à ce jour, mériterait d’être menée avec d’autres partenaires – et pas nécessairement ceux auxquels nous pensons en général de prime abord – notamment avec la Pologne, l’Espagne et les pays scandinaves – pays avec lesquels nous partageons une même vision stratégique et avec lesquels nous pourrions bâtir dans certains domaines particuliers des coopérations fructueuses.
Une telle démarche de coopération initialement limitée à quelques acteurs présente l’avantage de faciliter l’harmonisation des besoins opérationnels et de consolider en amont la gouvernance du programme. De nouveaux partenaires peuvent rejoindre, s’ils le souhaitent, le programme mené en coopération mais en se conformant aux règles initialement actées. C’est conformément à cette approche ouverte et pragmatique que le Danemark a récemment fait savoir qu’il souhaitait s’associer à la force expéditionnaire interarmées conjointe franco-britannique (Combined Joint Expeditionary Force ou CJEF) mise en place par les traités de Lancaster House de 2010. La France a émis un avis favorable à cette demande.
Par ailleurs, il est impératif de privilégier des coopérations avec des partenaires ayant les mêmes visions stratégiques et les mêmes ambitions militaires que les nôtres. Ce sont là les coopérations qui ont le plus de chance d’être couronnées de succès. Comme l’indiquait devant la mission l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées : « la coopération doit être opportuniste et pas forcément exclusive. Il s’agit, en effet de choisir nos partenaires avec pragmatisme, en fonction des domaines où cette coopération sera gagnante. Leur volonté de coopérer, leur fiabilité à l’horizon envisagé et leur potentiel réel ou raisonnablement prévisible sont des critères primordiaux. ». Ainsi, le Royaume-Uni apparaît comme un partenaire de choix puisqu’en Europe, il est l’un des très rares pays, assumant un effort de défense similaire au nôtre comme le montre le graphique ci-après :
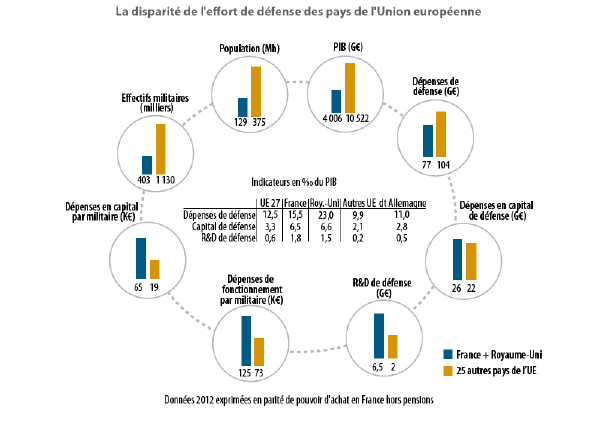 Source : ministère de la Défense.
Source : ministère de la Défense.
Il reste que la coopération ne devrait pas se limiter à une approche programme par programme mais être appréhendée dans sa globalité pour chacun de nos partenaires. Pour cette raison la coopération dans le domaine de l’armement se doit d’être pragmatique – « politique des petits pas » – et opportuniste – tel programme d’armement avec tel partenaire spécifique. Ce qui compte ce sont les gains globaux qui peuvent être retirés d’une relation avec un partenaire et non les gains sur tel ou tel programme d’armement. Comme l’indiquait l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées devant la mission : « le partenariat doit être gagnant ; les gains attendus peuvent porter sur le programme lui-même, mais il n’est pas forcément nécessaire que chaque programme pris individuellement soit gagnant. Il importe en revanche que la coopération avec un pays soit gagnante dans sa globalité ».
Dans cet ordre d’idée la France a fait récemment un geste politique fort en acceptant de lancer une coopération avec les Britanniques au sujet du missile ANL, dont le besoin opérationnel était fortement exprimé outre-Manche. En retour, la France attend du Royaume-Uni qu’il s’engage à ses côtés dans le développement et la production de « drones mouillés » (8) outils essentiels de la guerre des mines du futur.
Aujourd’hui, nous nous efforçons de soutenir un pays allié comme l’Espagne, qui connaît d’importantes difficultés budgétaires – en 2012, le budget de la défense de l’Espagne a été ramené à 0,65 % du PIB, soit 6,3 milliards d’euros. La France contribue ainsi plus fortement que l’Espagne en matière de coopération car il est essentiel de préserver cette relation avec un allié qui partage avec nous une même vision du monde.
2. La gouvernance de ces programmes doit être améliorée et consolidée pour une meilleure efficience
a. Les investissements de défense doivent bénéficier d’une plus forte visibilité politique pour gagner en efficacité et en cohérence
Le pouvoir politique doit être le garant de la bonne conduite des programmes d’armement menés en coopération. Il doit être en mesure par ses arbitrages de permettre à ces programmes d’être pleinement avantageux. Il ne s’agit pas de se limiter à œuvrer diplomatiquement pour la signature de coopérations ou à intervenir lorsque surviennent des blocages.
Les responsables politiques doivent, au contraire, être en mesure de superviser ces programmes d’armement tout au long de leur cycle de vie, de leur lancement à la livraison effective des équipements. Comme nous l’avons précédemment vu, la volonté politique est un des éléments essentiels conditionnant le succès d’une coopération dans le domaine de l’armement. Une fois le programme en coopération lancé le politique doit s’assurer qu’une gouvernance consolidée a bien été actée et doit par la suite s’assurer de son respect. Si un mandat est confié à une agence exécutive, qu’elle soit nationale, comme la DGA, ou multinationale, à l’image de l’OCCAr, les responsables politiques doivent s’assurer que le mandat de gestion du programme sera pleinement respecté et mis en œuvre par l’ensemble des acteurs. Au final, ce sont bien les responsables politiques qui apparaissent comme la clef de voûte permettant d’assurer la bonne conduite d’un programme d’armement. Cette affirmation est d’ailleurs valable que le programme soit mené dans un cadre national ou en coopération avec d’autres partenaires.
Afin de renforcer la visibilité politique des investissements de défense, il semblerait opportun de réaffirmer le rôle de chef de file du Ministre de la défense dans la conduite des programmes d’armement menés en coopération, en s'appuyant sur le ministre délégué, comme cela est déjà engagé actuellement. Il semble indispensable de faire émerger une meilleure coordination des méthodes de travail avec les autres ministères concernés
– ministère des Affaires étrangères et ministère de l’Économie et des finances – ainsi qu’avec nos partenaires européens. Par ailleurs, il semble primordial que sur ce sujet le Ministre de la Défense établisse des relations directes et visibles avec le Ministre du Redressement productif afin de développer une approche industrielle ambitieuse et cohérente dans le domaine de l’armement, secteur riche en emplois et en valeur ajoutée.
b. La gouvernance des organismes de coopération dans le domaine de l’armement doit être consolidée pour gagner en efficience
La conduite des programmes d’armement menés en coopération peut s’inscrire dans deux cadres différents :
– d’une part l’exécution de ces programmes peut être menée sous la houlette d’un organisme multinational. C’est le cas des programmes pilotés par l’OCCAr (A400M, Tigre, FREMM) ou par l’agence de l’OTAN NAHEMA (NH90). Il est également possible pour les besoins d’une coopération spécifique de créer un organisme multinational ad hoc chargé de la conduite dudit programme.
– d’autre part l’exécution de ces programmes peut s’inscrire dans le cadre du modèle de la « nation-cadre », modèle qui a généralement les faveurs des Anglo-saxons. Dans ce cas-là, l’État chef de file a la charge de la conduite du programme d’armement pour l’ensemble des pays participants.
Ce dernier modèle semble pertinent lorsqu’un État supporte une part significative des coûts d’un programme et dispose par conséquent d’un pouvoir d’influence très fort. Tel est le cas de la France dans le cadre du programme Hélios, où elle prend en charge près de 80 % des coûts du programme. Mais dans le cas d’une participation équitable des différents partenaires, le modèle de la « nation-cadre » présente des inconvénients importants, dans la mesure où la nation chef de file concentre l’ensemble des pouvoirs et des informations. Au contraire, la mise en œuvre du programme par l’organisme international offre des garanties de transparence et de traitement équitable pour l’ensemble des participants à un programme.
L’OCCAr a pour mission de mener à bien la conduite des programmes d’armement élaborés en commun par certains États ou par l’AED. Cette agence permet la mise en commun de moyens support (ressources humaines, département juridique…) et l’agrégation des différents retours d’expérience. C’est une petite structure, avec un effectif comptant environ 250 personnes seulement, ce qui est peu au regard des huit programmes dont elle a la charge actuellement. Cet organisme, dont le tropisme européen est indéniable, existe néanmoins en dehors des structures de l’Union européenne. Il semble préférable que l’OCCAr continue d’évoluer en dehors de l’Union européenne afin de maintenir le dynamisme et l’initiative des pays les plus engagés en matière de défense. En effet, une coopération à 28 – et plus particulièrement encore dans le domaine de la défense – se révélerait extrêmement difficile à piloter et perdrait inéluctablement en efficacité. L’OCCAr permet par ailleurs de développer « la politique des petits pas » que préconisent les rapporteurs en matière de coopération.
L’OCCAr semblerait bien être l’outil le plus pertinent pour mener à bien des coopérations européennes dans le domaine de l’armement – elle offre un cadre normatif qui permet d’éviter de devoir systématiquement réinventer la conduite des programmes – pour peu que les États consentent à en respecter les statuts. Les responsables politiques, qui doivent être les garants de la bonne conduite des programmes d’armement, devraient dans un premier temps promouvoir le recours à l’OCCAr pour la gestion des programmes en coopération, et devraient ensuite s’assurer du bon respect du mandat de gestion confié par les États participants à l’OCCAr. En effet, une coopération fonctionne beaucoup mieux lorsqu’une agence exécutive est dotée de larges pouvoirs, sans que les États ne demandent à être impliqués dans l’ensemble des relations entre les acteurs industriels et l’organisme gestionnaire du programme. Actuellement, les nations semblent souvent trop interventionnistes, même pour des décisions relativement secondaires, comme l’a indiqué devant la mission M. Patrick Bellouard, ancien directeur de l’OCCAr. Ce type de comportement a pour effet de réduire à néant la plupart des avantages qui devraient être procurés par la démarche coopérative. En effet ces agissements alourdissent les procédures, ralentissant le processus décisionnel et diluent les responsabilités.
Ce fonctionnement par consensus des États est contreproductif, si l’OCCAr existe, il faut à présent lui donner les moyens d’agir ou à défaut promouvoir le modèle de la « nation-cadre », l’entre-deux apparaissant comme la moins satisfaisante des solutions. Les responsables politiques doivent donc réaffirmer auprès des forces armées, de l’administration en charge de l’armement mais aussi auprès de leurs homologues européens, la nécessité de confier à une agence exécutive le soin de conduire un programme en coopération, à charge pour cette agence de rendre régulièrement des comptes aux pays participants qui lui ont confié ce mandat. Lors de son audition devant la mission, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, a rappelé son attachement à l’autonomie de l’OCCAr. Il existe un conseil de surveillance au sein duquel sont représentés les États, qui se doit de suivre et de contrôler le travail réalisé par l’agence exécutive, mais à ses yeux sans une autonomie réelle, l’existence de l’OCCAr perdra irrémédiablement de son sens.
Une agence exécutive commune ne disposant pas d’un véritable leadership dans la conduite d’un programme d’armement mené en coopération ne fait finalement que s’ajouter aux agences exécutives nationales et se trouve alors dans l’incapacité de générer de l’efficience. Le démonstrateur technologique nEUROn offre un autre exemple intéressant, son succès tenant sans doute comme l’a indiqué M. Éric Trappier, président-directeur général du groupe Dassault Aviation, au fait que la DGA a été désignée comme agence exécutive, pilote du programme et donneurs d’ordre unique pour les industriels et que Dassault Aviation a été désigné maître d’œuvre sur ce projet.
Pour renforcer son action, il serait également possible de déléguer davantage de responsabilités à l’OCCAr : à l’heure actuelle, à la différence de la DGA, l’OCCAr ne peut augmenter aucun poste de dépense à l’intérieur d’un même programme sans l’autorisation des États et ce même si le montant global de l’enveloppe reste identique. Revenir sur cette interdiction – jusqu’à un certain niveau financier fixé pour chaque programme et à la condition de ne pas augmenter le coût total – permettrait d’accélérer la prise de décision et constituerait ainsi une avancée notable.
Au cours des auditions de la mission, de nombreux industriels ont partagé ce constat d’un écart trop important entre les attributions de l’OCCAr et l’autonomie de gestion limitée dont elle jouit dans la réalité. Ce hiatus obère semble-t-il significativement les gains que nous pourrions attendre de la coopération.
Par ailleurs, les rapporteurs tiennent à rappeler que l’OCCAr n’a encore jamais, à ce jour, conçu par lui-même l’organisation industrielle et financière des programmes menés en coopération. Les différents montages industriels des programmes dont il assure actuellement la gestion ont été actés avant même sa création, sauf celui du programme A400M, mais qui a été directement élaboré par les États participants. Il semblerait nécessaire de donner sa chance à cet organisme à l’avenir et de laisser l’OCCAr proposer aux États concernés le montage industriel et financier des futurs programmes menés en coopération afin de permettre la réalisation de véritables gains d’efficience.
B. LA COOPÉRATION, EN MATIÈRE D’ARMEMENT : UNE OBLIGATION FINANCIÈRE, MILITAIRE ET INDUSTRIELLE
Il est important de rappeler que les coopérations sont désormais envisageables dans tous les domaines de l’armement, comme l’a indiqué l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées, devant la mission. Seuls les équipements du « premier cercle », c’est-à-dire ceux touchant les fondements de la souveraineté nationale – essentiellement la dissuasion nucléaire – ne sauraient être concernés par la coopération ou de manière très limitée et encadrée, comme cela est le cas avec les Britanniques dans le cadre du programme de coopération Teutatès-Épure concernant la simulation des armes nucléaires.
Pour l’armement conventionnel la coopération est à présent la norme, comme l’énonce clairement l’instruction n° 1516 (9) du 26 mars 2010 relative au déroulement et la conduite des opérations d'armement. À ce jour près de 30 % des investissements, hors dissuasion, sont réalisés en coopération. Cette part devrait augmenter de manière significative dans les années à venir car la coopération devient aujourd’hui, dans un contexte budgétaire contraint, une véritable obligation financière. La coopération se présente également de plus en plus comme une nécessité militaire pour des forces armées qui interviennent régulièrement dans le cadre de coalition internationale comme en Afghanistan au sein de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) ou en Libye dans le cadre de l’opération Harmattan. Les programmes d’armement menés en coopération favorisent, en effet, l’interopérabilité opérationnelle et permettent un rapprochement des doctrines d’emploi des différentes armées européennes.
Mais avant toute chose, la coopération dans le domaine de l’armement se doit de répondre à une vision stratégique et politique. Pour les rapporteurs, la coopération dans le domaine de l’armement ne peut se limiter à être un palliatif de la situation difficile des finances publiques. Cette approche coopérative devrait, au contraire, être un des moyens de doter l’Europe des capacités lui permettant d’assurer, par ses propres moyens, la défense de son territoire et de ses intérêts vitaux. Elle doit donc pleinement s’inscrire dans un projet d’élaboration d’une défense européenne.
1. Les programmes d’armement menés en coopération peuvent générer des économies importantes à certaines conditions
a. La contrainte budgétaire a des répercussions directes sur les programmes d’armement
Les contraintes budgétaires actuelles imposent de fait une rationalisation et un rapprochement des programmes d’armement, que ceux-ci soient menés avec nos partenaires européens ou avec d’autres pays alliés (pays membres de l’Alliance Atlantique, pays émergents…). En effet, la nette contraction des budgets de défense occidentaux se traduit par une réduction des cibles et l’étalement, voire l’abandon de certains programmes. Or la satisfaction des besoins opérationnels a un coût, qui ne cesse d’augmenter, en raison de la complexification technologique des équipements et de l’apparition de nouveaux besoins capacitaires, notamment dans le domaine de la cyberdéfense, des drones et de la défense antimissile balistique. Le nouveau Livre blanc énonce très clairement la nécessité de la coopération internationale dans le chapitre consacré aux fondements de la stratégie de défense et de sécurité nationale : « la situation des finances publiques en Europe et le caractère commun des menaces et des risques encourus accroissent la nécessité pour les États membres de l’Union de prendre collectivement les dispositions leur permettant de peser plus efficacement sur leur environnement. La situation actuelle doit donc être mise à profit pour examiner les capacités que les Européens ne peuvent plus développer ou entretenir sur un mode seulement national et pour organiser, en conséquence, des interdépendances capacitaires mutuellement consenties » (10).
En 2011, la France a consacré 45,7 milliards d’euros au budget de la défense, ce qui la situe au 4e rang mondial et lui confère une position intermédiaire, similaire à celle du Royaume-Uni – qui dispose pour la même année d’un budget défense de l’ordre de 45,4 milliards d’euros – et de l’Allemagne – qui dispose d’un budget défense de l’ordre de 34,1 milliards d’euros. À titre de comparaison les États-Unis consacrent près de 541 milliards d’euros par an à leur défense.
Le tableau ci-après présente les évolutions des principaux budgets consacrés à la défense :
ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX BUDGETS MILITAIRES,
PENSIONS INCLUSES
Pays |
Dépenses 2011 en Md€ |
Évolution depuis 2001 |
% du PIB |
% des dépenses mondiales |
Dépenses 2010 en Md€ en parité de pouvoir d'achat |
États Unis |
540,8 |
79,0 % |
4,2 % |
43,2 % |
540,8 |
Chine |
101,4 |
213,9 % |
1,9 % |
8,1 % |
179,9 |
Russie |
50,3 |
99,1 % |
3,7 % |
4,0 % |
48,7 |
France |
45,7 |
1,4 % |
2,2 % |
3,7 % |
38,4 |
Royaume-Uni |
45,4 |
25,5 % |
2,5 % |
3,6 % |
68,3 |
Japon |
42,8 |
– 1,5 % |
1,0 % |
3,4 % |
34,3 |
Inde |
34,7 |
65,6 % |
2,6 % |
2,8 % |
49,6 |
Arabie Saoudite |
36,2 |
66,7 % |
7,5 % |
2,9 % |
31,7 |
Allemagne |
34,1 |
– 6,4 % |
1,3 % |
2,7 % |
95,8 |
Italie |
25,1 |
– 18,6 % |
1,5 % |
2,0 % |
21,9 |
Brésil |
24,8 |
21,4 % |
1,3 % |
2,0 % |
26,4 |
Corée du sud |
22,2 |
48,9 % |
2,7 % |
1,8 % |
32,9 |
Australie |
18,0 |
42,7 % |
1,6 % |
1,4 % |
12,9 |
Canada |
18,1 |
53,9 % |
1,4 % |
1,4 % |
15,8 |
Turquie |
14,7 |
– 6,2 % |
1,8 % |
1,2 % |
20,0 |
Top 15 |
1 054,2 |
2,7 % |
84,2 % |
1 217,1 | |
Total Monde |
1 251,6 |
100,0 % |
Source : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Dollars US (USD) convertis en euros (taux moyen de 2010 : 1 USD = 0,7843 €).
En trente ans, le budget de la défense français a baissé de moitié. Dès la fin des années 1990, le budget de la défense est passé sous la barre des 2 % du PIB annuel, seuil minimal qu’une nation doit consacrer à sa défense selon les standards de l’OTAN. La crise économique de 2009 et la situation des finances publiques en Europe ont conduit la plupart des grandes nations militaires européennes à réformer leur outil de défense, à le rationaliser pour le rendre plus efficace et moins coûteux. Ainsi les armées allemande, britannique, française et italienne ont été profondément remaniées ces dernières années.
En six ans, le ministère de la Défense français a perdu près de 45 000 emplois, a été conduit à fermer ou transférer un peu moins de 100 unités, à réformer l’organisation du soutien des armées avec la création des nouvelles bases de défense – rompant ainsi l’organisation multiséculaire des régiments – et a dû opérer un étalement dans le temps de plusieurs programmes d’armement, voire procéder à certaines annulations.
Le graphique ci-après présente l’évolution du budget de la défense sous la Ve République :
ÉVOLUTION DU BUDGET DE LA DÉFENSE FRANÇAIS
(en % du PIB - périmètre : mission « défense » hors gendarmerie et pensions)
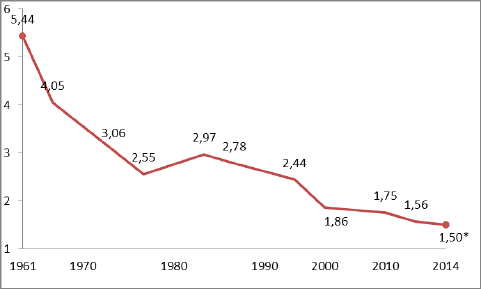
* Prévisions
La baisse des budgets de défense en Europe ces dernières décennies a eu pour effet d’accentuer fortement le décrochage européen vis-à-vis des États-Unis mais également vis-à-vis de certains pays émergents. En 2002, l’effort global de l’Europe en matière de défense s’élevait à 60 % de l’effort américain, en 2011 il se situait à 35 % seulement de celui-ci.
Le graphique ci-après indique la persistance de ce décrochage en 2012 :

Source : ministère de la Défense.
Par ailleurs, en dix ans l’effort européen de défense est passé de 100 % à 60 % de l’effort cumulé des BRICS. Entre 2010 et 2011, l’Inde a accru son budget de défense de l’ordre de 13 %, la Corée de Sud de 10 %, le Brésil de 9 % (11). Ces pays qui étaient traditionnellement des clients pour les exportations françaises vont peu à peu se transformer en partenaire potentiel dans le cadre d’une coopération d’un nouveau type car ils demandent des transferts de technologie en échange de l’adoption de nos matériels.
Entre 2007 et 2009, le Royaume-Uni a réduit de près de 30 % les crédits dédiés à la recherche et développement dans le secteur de la défense. À l’heure actuelle les pays européens ne peuvent plus compter sur les seuls efforts de défense britannique et français, qui eux-mêmes ne peuvent plus se reposer sur le soutien des États-Unis. En effet, les Américains opèrent actuellement un recentrage géographique sur la zone Pacifique et le continent asiatique estimant qu’il revient aux nations européennes d’organiser elle-même leur outil de défense. La coopération apparaît ainsi comme une des réponses à ce contexte difficile, permettant de dégager des économies substantielles en se rapprochant de nos alliés pour développer et produire ensemble les capacités opérationnelles dont nos forces ont besoin. Comme l’a indiqué Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, devant la mission « à défaut de pouvoir dépenser plus, il nous faut dépenser mieux ». La coopération dans le domaine de l’armement s’inscrit dans ce cadre.
Le Président de la République a récemment indiqué que l’effort budgétaire en faveur de la défense serait maintenu à 1,5 % du PIB par an environ afin de garantir la crédibilité et la pérennité de notre outil de défense. La part annuellement consacrée aux équipements de défense devrait ainsi continuer de se situer aux alentours de 13 milliards d’euros, soit un effort équivalent à celui consentis par les Britanniques. Mais qui reste en deçà du seuil minimal de 2 % retenu par l’OTAN.
b. La coopération dans le domaine de l’armement permet une mutualisation des coûts
La situation des finances publiques en Europe, le coût croissant du développement et de possession des équipements, leur longévité, et les faibles séries commandées militent de facto pour une meilleure intégration européenne en matière d’armement.
Une telle mutualisation permettrait ainsi de réduire le coût unitaire grâce aux économies d’échelle mais aussi et surtout de partager les coûts de conception et de développement, que plus aucun pays ne peut plus assumer seul sauf pour les petits éléments. Aucun pays partie prenante au programme A400M n’aurait été en mesure de supporter seul les coûts de recherche et de développement de cet appareil pourtant indispensable à nos forces.
L’Agence européenne de défense a récemment évalué que des économies substantielles pourraient être obtenues concernant des capacités essentielles si une véritable mutualisation était mise en œuvre (12):
– 5,5 milliards d’euros d’économie environ seraient envisageables concernant les programmes de véhicules blindés ;
– 2,3 milliards sur dix ans pour les frégates ;
– 1,8 milliard d’euros dans le domaine spatial.
Comme l’a indiqué l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées, devant la mission lorsqu’un programme en coopération associe deux partenaires, son coût est multiplié par 1,4. Dès lors que ce coût est également réparti entre eux, chacun n’aura à payer que 0,7 fois ce coût, soit une économie de 30 %. En présence de trois partenaires, ce coût est multiplié par 1,7. Chacun n’aura donc à financer que 0,6 fois ce coût soit une économie de 40 %.
c. La coopération pour générer des économies doit répondre à certains impératifs
La coopération internationale est de plus en plus présentée comme incontournable, essentiellement en raison des avantages économiques qu’elle procure en termes de partage des coûts mais une bonne conduite des programmes est indispensable pour permettre de réels gains d’efficience. À l’inverse une coopération mal menée peut se révéler très onéreuse.
Au cours des auditions de la mission, il est apparu que les coopérations dans le domaine de l’armement ne pouvaient pleinement réussir que si un certain nombre de conditions étaient remplies, que seul un véritable pilotage politique est à même de garantir :
– Une volonté réelle et partagée de coopérer des différents partenaires ;
– Un montage industriel pertinent et efficace ;
– Une harmonisation des besoins opérationnels.
À l’inverse, un programme mené en coopération au suivi mal assuré, s’inscrivant dans le cadre d’un montage industriel non efficient, pour lequel se seraient multipliées les demandes de spécifications et de « juste retour industriel » peut conduire à une explosion des coûts ou même un abandon du programme en cours d’exécution.
L’avion de transport militaire A400M est un très bel outil qui permettra à nos forces armées de disposer très prochainement d’une capacité à projeter qui commençait à leur faire défaut. Cet avion sera progressivement livré aux nations participantes – la France devrait en réceptionner trois en 2013, avec quatre années de retard. Néanmoins, même si ce produit se révèle finalement être un succès, on ne peut que constater les échecs qui ont émaillé la conduite de ce programme.
Le surcoût du programme A400M s’élève à 6,2 milliards d’euros, EADS en prenant en charge 4,2 milliards, les 2 milliards restants incombant aux États au prorata du nombre d’avions commandés, ce qui équivaut à une hausse de 10 % du coût unitaire des avions. Lors de la signature de l’avenant au contrat en 2011, qui a permis de poursuivre le programme, les États ont également renoncé aux pénalités de retards qui auraient dû s’élever à 1,2 milliard d’euros et ont accepté de verser à Airbus Military, maître d’œuvre, un complément de 1,5 milliard d’euros sous la forme d’aides remboursables à l’export. Pour la France cela représente une augmentation des coûts unitaires de 556 millions auxquels il faut ajouter 417 millions au titre de ces aides remboursables à l’export (13).
Il faut également souligner la désorganisation que de tels « accidents » industriels peuvent entraîner pour les armées. Ainsi, le décalage entre les cibles initialement annoncées pour l’A400M et le calendrier effectif des livraisons a imposé au ministère de la Défense de prolonger la durée de service effectif des Transall, dont la flotte très ancienne se révèle fragile et coûteuse. Il a également impacté les entraînements des pilotes de l’armée de l’air.
Les dÉmarches de mutualisation et de partage capacitaire : le « Pooling and sharing » de l’AED et la « Smart defence » de l’Alliance Atlantique
La coopération apparaît comme l’une des pistes permettant de résoudre l’équation difficile suivante : construire un modèle d’armée qui réponde aux ambitions politiques du pays tout étant moins onéreux. L’action de l’AED, via la notion de « Pooling and sharing » (partage et mutualisation capacitaire) ou des agences de l’OTAN au travers du concept de « Smart defence » (défense intelligente) s’inscrivent dans cette même lignée
L’AED créée en 2004 regroupe 27 États – 26 pays membres de l’Union européenne sans le Danemark, et la Norvège. Sa principale mission consiste à identifier les besoins opérationnels communs et à promouvoir des mesures permettant de les satisfaire. Elle participe ainsi à la définition d’une politique européenne en matière de capacités opérationnelles et d’armement. La France considère que « l’AED doit pouvoir jouer un rôle d’incubateur capable de déclencher, très en amont, les futures coopérations technologiques et industrielles entre partenaires de l’Union » (14).
La démarche de « Pooling and sharing » a été entérinée par les ministres de la défense de l’Union européenne à l’issue du sommet de Gand de 2010 à l’initiative de l’AED. Ce concept vise à encourager le développement et l’acquisition en commun de biens d’armement – la mutualisation ou « pooling » – et pourrait également permettre d’aller plus loin encore en disposant en commun de certaines capacités opérationnelles – le partage capacitaire ou « sharing ».
Les principaux projets de l’AED menés dans le cadre de la démarche « Pooling and sharing » concernent la formation des pilotes d’hélicoptères, le soutien médical et un laboratoire anti-engin explosif improvisé. Son projet phare concerne les ravitailleurs en vol, dont l’absence avait posé d’importants problèmes aux Français et Britanniques dans le cadre de l’opération Harmattan. En définitive les résultats apparaissent assez décevants en matière d’armement faute d’un financement suffisant. Elle dispose en effet d’un budget de seulement 30 millions d’euros environ, dont seulement 8 millions d’euros environ consacrés à la recherche ce qui ne lui permet pas d’impulser de véritables synergies dans le domaine de l’armement. Depuis trois ans son budget n’a pas été augmenté, et les Britanniques se sont même en 2013 opposés à toute prise en compte de l’inflation alors même que l’ensemble des autres pays y était favorable. La règle de l’unanimité a ainsi empêché toute avancée sur ce point. Ce qui pour Claude-France Arnould, directrice exécutive de l’AED, représente sur trois ans une perte de près de 8 millions d’euros (15).
À la suite de la réunion des ministres de la défense de l’Union européenne à Chypre fin septembre 2012, un code de bonne conduite du « Pooling and sharing » a été adopté le 19 novembre 2012. Le but de ce code de bonne conduite est d’éviter que les coupes budgétaires rendues nécessaires par la crise économique ne concernent les programmes menés en coopération. Ce code préconise, par ailleurs, de réinvestir les économies réalisées grâce à la coopération dans la recherche et développement en matière de défense.
La « Smart defence » a été lancée par A. Rasmussen, Secrétaire général de l’OTAN, quatre mois après l’initiative de l’AED. Elle est proche dans son principe du concept de « Pooling and sharing » de l’AED et dépend du commandement suprême allié à la transformation (SACT) qui est dirigé par le général français Jean-Paul Paloméros depuis septembre 2012. Néanmoins comme le soulignait Hubert Védrine à la suite de la publication de son rapport sur l’OTAN, il est impératif de veiller à ce que les projets de l’Alliance Atlantique ne viennent pas dupliquer ceux du « Pooling and sharing ». Les deux approches pour être réellement gagnantes se doivent d’être complémentaires.
Cependant les rapporteurs tiennent à rappeler qu’un renforcement de la coopération dans le domaine de l’armement en Europe – secteur spécifique à la croisée des enjeux stratégiques, politiques, opérationnels et industriels – ne peut pas obéir à la seule logique économique. Cette approche en faveur d’une coopération renforcée et d’une intégration européenne plus poussée doit en premier lieu répondre à une véritable vision politique et stratégique. Comme l’énonce le dernier Livre blanc : « les coopérations, avec un ou plusieurs États, en matière de programmes d’armement doivent être envisagées non pas comme des alternatives ou des substituts, mais comme des leviers supplémentaires pour susciter une dynamique capacitaire européenne ». Agir ensemble, permettra de faire des économies, et favorisera l’apparition d’un outil de défense européen, permettant ainsi au Vieux continent d’être en mesure d’assurer plus efficacement sa propre défense.
2. Les programmes d’armement menés en coopération favorisent l’interopérabilité des armées européennes
La coopération apparaît également de plus en plus comme une obligation militaire. En effet, les armées européennes sont de plus en plus amenées à œuvrer ensemble sur les différents théâtres d’opérations extérieures. Pendant plus de dix ans, les armées occidentales ont ainsi travaillé côte à côte en Afghanistan au sein de la FIAS sous commandement de l’OTAN. De même les Britanniques et les Français ont étroitement collaboré lors de l’opération Harmattan en 2011 en Libye, faisant d’ailleurs apparaître de criants manques capacitaires, notamment en ce qui concerne le ravitaillement en vol de nos avions de combat. À nouveau, les forces armées européennes ont soutenu l’effort militaire français au Mali dans le cadre de l’opération Serval et seront très certainement amenées à opérer ensemble à nouveau.
Comme l’indiquait à la mission l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées, la coopération, a pour effet de renforcer significativement l’interopérabilité : « Si l’interopérabilité est pour nous primordiale, c’est que nous ne sommes pas les États-Unis et qu’il nous est par conséquent difficile de tout faire tout seuls partout. La nécessité de coopérer s’illustre d’ailleurs aujourd’hui au Mali (…)à l’heure des opérations interarmées, internationales et combinées, l’interopérabilité est une clé du succès, tant le fait de disposer de matériels communs ou, à tout le moins, compatibles, conditionne la synergie en matière de doctrine et de procédures. ». La coopération, tout comme le travail en coalition, permet un rapprochement des savoir-faire opérationnels et logistiques.
Non seulement, les programmes d’armement menés en coopération permettent une certaine forme de standardisation des équipements. Mais, les forces armées européennes, œuvrant souvent en ensemble sur les théâtres d’opération, sont désormais dans l’obligation de rapprocher aussi leur doctrine d’emploi. Il faudrait, par exemple, absolument éviter que ne se reproduisent les écueils du programme d’hélicoptères NH90, qui comptent aujourd’hui 24 versions différentes pour 17 pays participants, alors qu’il devrait être possible d’envisager une manière similaire de transporter des hommes et du matériel en hélicoptère. Il semble nécessaire comme l’a indiqué devant la mission M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d’Eurocopter de privilégier une montée en puissance progressive des programmes, c’est-à-dire débuter avec des versions simples, avant de monter en grade de manière échelonnée et optionnelle vers des versions plus compliquées. La plateforme commune des équipements serait ainsi plus aisée à développer et à produire et pourrait par la suite se voir enrichie en fonction des demandes nationales. Il semble nécessaire que les équipements développés en coopération disposent d’une seule et unique certification et qualification quel que soit le pays, quitte à ce que l’on puisse par la suite y greffer des options supplémentaires.
La coopération apparaît également comme une obligation militaire pour les nations européennes, à l’heure où les États-Unis se recentrent vers la zone Pacifique et le continent asiatique et semblent de plus en plus se désintéresser stratégiquement de l’Europe. En effet, grâce à la coopération certains pays européens pourraient se doter des capacités opérationnelles leur faisant aujourd’hui défaut, permettant ainsi d’éviter des ruptures technologiques dommageables notamment dans les domaines suivants : ravitaillement en vol, drones, surveillance maritime, gestion militaire du ciel unique européen, domaine spatial, cyberdéfense. Une coopération renouvelée et renforcée dans le domaine de l’armement avec quelques partenaires européens pourrait ainsi apporter une réponse à la critique que l’ancien secrétaire d’État à la défense américain, Robert Gates, avait livrée en 2011 à l’encontre de l’effort militaire des Européens : « Si l'actuel déclin des capacités militaires européennes n'est pas stoppé voire renversé, les futurs dirigeants américains – ceux qui n'ont pas connu comme moi l'enseignement de la guerre froide – risquent tout simplement de conclure que le retour ne mérite pas l'investissement des États-Unis dans l’OTAN ». L’Europe doit développer une nouvelle approche en matière de défense pour pleinement contribuer à assurer militairement sa propre défense. La coopération, qui peut nous permettre de réaliser des économies budgétaires conséquentes, devrait pouvoir nous aider à élaborer un outil de défense européen crédible et efficace.
3. L’industrie de défense, un secteur dont la pérennité et la compétitivité pourraient être assurées grâce à la coopération européenne
a. La coopération dans le domaine de l’armement, moteur potentiel d’une restructuration de l’industrie de défense européenne
La coopération a déjà produit des effets positifs sur une meilleure intégration de l’outil industriel européen dans le secteur de la défense, comme en atteste la création de l’entreprise EADS à la fin des années 1990. La coopération est ici un moyen permettant d’atteindre des objectifs de taille critique, garantie de la pérennité de l’industrie de défense en Europe. La taille critique est la capacité pour une entreprise à investir dans la technologie, dans le développement de la gamme de produits et dans la présence commerciale afin de tenir son rang dans la compétition mondiale. Or, les budgets de défense des différents pays européens ne suffisent plus à l’heure actuelle à maintenir les objectifs de taille critique pour les industries d’armement. En résumé, les industries de défense européennes, compte tenu du contexte économique, n’ont plus les moyens de développer des programmes concurrents au niveau européen. Certains industriels se sont montrés très alarmistes devant la mission, M. Antoine Bouvier, président-directeur général de l’entreprise missilière franco-britannique MBDA indiquant : « la taille critique reste notre obsession, et elle ne peut être atteinte que grâce à la coopération, à la consolidation de la demande et de l’offre. Si nous n’atteignons pas la taille critique, si nous ne coopérons pas, si nous ne restructurons pas l’industrie, dans dix ans, nous ne serons plus là ! ».
Mais cet effort de consolidation industrielle qui a débuté en Europe depuis la fin de la guerre froide, en raison de la contraction des dépenses militaires, n’a pas, pour autant, conduit à l’émergence d’une véritable base industrielle et technologique de défense européenne. En effet, l’essentiel des fusions acquisitions dans ce domaine a été réalisé dans un cadre national. La création de groupes industriels de dimension européenne, tel EADS, n’a pas permis d’enclencher une dynamique globale allant en ce sens.
L’absence de visions stratégiques et politiques concordantes des États européens, et leur légitime volonté de protéger leur souveraineté, peut en partie expliquer cette situation. L’échec de la fusion EADS-BAe Systems fin 2012 en est l’illustration. Il reste que sur un marché mondial très concurrentiel cette situation n’est pas sans poser problème et handicape in fine notre zone économique.
Le tableau ci-après indique le classement mondial des groupes industriels de défense :
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS DE DÉFENSE DANS LE MONDE
Nationalité |
Chiffre d’affaires 2011 (Md€) |
Part défense |
Chiffre d’affaires défense |
Rang | |
Lockheed Martin |
États-Unis |
33,4 |
95 % |
31,73 |
1 |
Boeing |
États-Unis |
49,9 |
45 % |
22,46 |
2 |
BAE Systems |
Royaume-Uni |
22,1 |
97 % |
21,44 |
3 |
General Dynamics |
États-Unis |
23,5 |
78 % |
18,33 |
4 |
Raytheon |
États-Unis |
17,8 |
93 % |
16,55 |
5 |
Northrop Grumman |
États-Unis |
19,0 |
81 % |
15,39 |
6 |
EADS |
Europe |
49,1 |
24 % |
11,78 |
7 |
Finmeccanica |
Italie |
17,3 |
61 % |
10,55 |
8 |
L3 Communication |
États-Unis |
10,9 |
83 % |
9,05 |
9 |
THALES |
France |
13,0 |
52 % |
6,76 |
10 |
Rolls-Royce |
Royaume-Uni |
13,0 |
27 % |
3,51 |
11 |
Textron |
États-Unis |
8,1 |
37 % |
3,00 |
12 |
MBDA |
Europe |
3,0 |
100 % |
3,00 |
13 |
DCNS |
France |
2,6 |
100 % |
2,60 |
14 |
Mitsubishi |
Japon |
25,3 |
10 % |
2,53 |
15 |
Safran |
France |
11,7 |
21 % |
2,46 |
16 |
SAAB |
Suède |
2,6 |
90 % |
2,34 |
17 |
Rheinmetall |
Allemagne |
4,5 |
52 % |
2,34 |
18 |
Russian Helicopters |
Russie |
2,5 |
77 % |
1,93 |
19 |
Elbit Systems |
Israël |
2,0 |
95 % |
1,90 |
20 |
Kawasaki |
Japon |
11,7 |
16 % |
1,87 |
21 |
IAI |
Israël |
2,5 |
73 % |
1,83 |
22 |
Cobham |
Royaume-Uni |
2,1 |
72 % |
1,51 |
23 |
Qinetiq |
Royaume-Uni |
1,7 |
82 % |
1,39 |
24 |
KMW |
Allemagne |
1,3 |
100 % |
1,30 |
25 |
TKMS |
Allemagne |
1,5 |
n.d. |
n.d. |
- |
Nexter |
France |
0,9 |
100 % |
0,90 |
26 |
Dassault-Aviation |
France |
3,3 |
27 % |
0,89 |
27 |
Chemming Group |
Royaume-Uni |
0,9 |
97 % |
0,87 |
28 |
Fincantieri |
Italie |
2,4 |
33 % |
0,79 |
29 |
Meggitt |
Royaume-Uni |
1,7 |
40 % |
0,68 |
30 |
Ultra Electronics |
Royaume-Uni |
0,8 |
82 % |
0,66 |
31 |
Diehl |
Allemagne |
2,9 |
22 % |
0,64 |
32 |
RUAG |
Suisse |
1,4 |
42 % |
0,59 |
33 |
Patria |
Norvège |
0,6 |
91 % |
0,55 |
34 |
Indra |
Espagne |
2,7 |
19 % |
0,51 |
35 |
Namm |
Suède |
0,4 |
100 % |
0,40 |
36 |
Almaz DITEM |
Russie |
0,3 |
85 % |
0,26 |
37 |
Sources : Agence des participations de l’État (APE) et direction générale de l’armement (DGA).
Aux dix premières places du classement des principaux groupes industriels de défense dans le monde, se retrouvent quatre entreprises européennes, dont une britannique (BAE Systems ; 3ème avec 21,44 milliards de chiffre d’affaires dans le domaine de la défense en 2011), une italienne (Finmeccanica ; 8ème avec 10,55 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la défense en 2011), une française (THALES, 10ème avec 6,76 milliards de chiffre d’affaires dans le domaine de la défense en 2011) et une de dimension européenne avec une base franco-allemand (EADS ; 7ème avec 11,78 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la défense). Toutes les autres entreprises sont américaines, dont les deux premières du classement (Lockheed Martin avec 31,73 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la défense en 2011 et Boeing avec 22,46 milliards de chiffre d’affaire).
Une intégration mieux organisée du secteur européen de la défense permettrait sans conteste à l’industrie européenne de défense de peser plus fortement sur un marché mondial qui devient de plus en plus concurrentiel. La diminution du budget de défense américain, qui devrait baisser de 1 000 milliards de dollars en dix ans, soit 100 milliards par an, conduit les industries de défense outre-Atlantique à renforcer plus encore leur stratégie à l’export. C’est d’ailleurs pour cette raison que la France a milité – et obtenu gain de cause – pour que le secteur de la défense soit exclu des négociations des accords de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne. De plus, l’arrivée de nouveaux acteurs, en provenance des pays émergents, exacerbe également la concurrence dans ce secteur. Pour cette raison, il semble important de mener une réflexion globale sur la base industrielle et technologique de défense européenne car notre industrie d'armement nous permet d’assurer notre autonomie opérationnelle et constitue dans le même temps un levier économique important.
Il va sans dire qu’une meilleure intégration des industries européennes de défense faciliterait la réalisation des programmes d’armement menés en coopération. Un maître d’œuvre unique européen se révèle, en effet, plus efficace et sûr qu’un conglomérat d’entreprises concurrentes sur d’autres activités, réunies pour les besoins d’un programme. Une maîtrise d’œuvre européenne, qui est donc totalement maîtresse de son circuit de prise de décision, offre de meilleures et plus efficaces capacités d’arbitrage et permettrait d’éviter l’écueil auquel se sont heurtés nombre de programmes menés en coopération : la question du « juste retour industriel ».
Il semble impératif, dans un premier temps, de promouvoir de meilleurs montages industriels. Les « justes retours industriels » qui conduiraient à élaborer des arrangements industriels contre-productifs devraient être proscrits comme le précise très clairement le dernier Livre blanc : « le principe du juste retour a été dévoyé : au lieu de privilégier le meilleur des compétences et des capacités existantes, le souci d’acquérir des compétences nouvelles a souvent conduit à des duplications, aboutissant à des capacités redondantes et dispersées. Le partage des activités de développement et de production doit désormais être organisé selon un strict principe d’efficacité industrielle et de performance économique ».
Une règle devrait imposer que l’industriel le plus performant technologiquement et financièrement soit systématiquement choisi en lieu et place d’un choix géographiquement orienté mais non nécessairement pertinent. L’idée de « juste retour industriel » n’est pas illégitime en elle-même, puisqu’il est normal qu’un pays contributeur à un programme puisse profiter des retombées économiques d’un investissement aussi conséquent, mais ce « juste retour industriel » devrait être globalisé, c’est-à-dire s’entendre sur l’ensemble d’une coopération et non de manière fragmentée sur chacun des programmes menés en coopération. Plus généralement il serait souhaitable qu’émergent progressivement des pôles d’excellence complémentaires en Europe et des groupes « multi-domestiques » à l’image de One MBDA qui vise à regrouper les activités missilières françaises et britanniques sous une même bannière.
Il ne s’agit pas pour autant de céder à une vision trop « angélique » de l’européanisation de nos compétences industrielles. La création d’EADS au début des années 2000 correspondait comme l’indique la Cour des comptes dans son rapport sur Les faiblesses de l’État actionnaire d’entreprises industrielles de défense (16) à « une vision optimiste, selon laquelle la logique industrielle privée et l’internationalisation au niveau européen ne paraissaient présenter que des avantages et être une garantie de succès ». Les difficultés de gouvernance avec des partenaires privés (Lagardère côté français et Daimler côté allemand) dans un domaine industriel relevant de l’indépendance stratégique des États a depuis conduit le Gouvernement a adopté une approche plus pragmatique. Comme l’indiquait Mme Astrid Milsan, sous-directrice au sein de l’Agence des participations de l’État (APE), devant la mission : « il est certain que la baisse des budgets militaires européens se traduira à l’avenir par un vaste mouvement de consolidation du secteur de la défense en Europe ». L’important est donc que les services de l’État, que celui-ci soit client ou actionnaire, soient organisés au mieux afin de défendre les intérêts de notre industrie de défense nationale dans ce mouvement d’intégration européen, qui sera in fine globalement positif s’il permet d’assurer la pérennité et la compétitivité d’une industrie de défense sur le continent européen.
b. La coopération, un outil à même d’assurer la pérennité d’un secteur créateur de richesse et d’emploi
Par ailleurs, les rapporteurs tiennent à souligner l’efficacité économique du secteur de la défense et son importance en matière d’emploi industriel. La France est actuellement le cinquième exportateur mondial pour le secteur de l’armement. À l’heure où les pays occidentaux connaissent une nette contraction de leurs budgets de défense et où en sens inverse les pays émergents développent un véritable tissu industriel dans ce même secteur, leur donnant ainsi les moyens de devenir très prochainement de grands exportateurs, il semble indispensable pour les rapporteurs que la France et l’Europe réagissent.
L’industrie de la défense peut et doit participer au redressement productif de notre pays et peut contribuer à relancer globalement la croissance en Europe. Actuellement l’État est le premier investisseur du secteur de la défense : les trois quarts de ses dépenses d’investissement y sont consacrés, soit 9 milliards d’euros par an environ, c’est un secteur économiquement très important puisqu’il compte environ 4 000 entreprises pour un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards d’euros. Environ 5 % de la population active travaille dans le secteur de l’armement, soit autant que dans le secteur agricole, quand le secteur de l’automobile en mobilise 9 %. Il apparaît ainsi très clairement que l’industrie de défense est un levier économique important. Or, une coopération renforcée, mieux encadrée, et un secteur industriel européen plus intégré pourraient permettre de doter l’Europe d’une industrie de défense à même de peser économiquement sur un marché mondial qui se révèle être de plus en plus concurrentiel.
Renouveler les coopérations dans le domaine de l’armement et favoriser une meilleure intégration de l’industrie européenne de défense permettraient de donner à l’Europe les moyens d’assurer sa propre défense tout en créant des emplois et de la valeur ajoutée. Sachant que les investissements en matière de recherche et développement dans le domaine militaire peuvent engendrer des retombées économiques civiles positives, une approche duale des programmes d’armement peut ainsi se révéler globalement bénéfique pour l’ensemble de la société au-delà des seules questions de sécurité et de défense.
Les rapporteurs tiennent également à rappeler que la coopération permet aux programmes concernés de jouir d’une plus grande attractivité sur le marché mondial. Ainsi, un équipement produit en coopération bénéficiera à l’export du soutien de plusieurs Gouvernements ce qui renforcera sa crédibilité aux yeux des pays potentiellement acquéreurs. En effet, un hélicoptère qui a été adopté par les forces armées française, allemande, néerlandaise et italienne a ainsi plus de chance de l’être à l’export par des pays tiers. S’ils avaient été conçus par les seuls Français les hélicoptères de combat Tigre ou les hélicoptères de transport NH90 auraient eu du mal à l’emporter sur le marché mondial face aux Apache et Black Hawk de l’industrie de défense américaine.
La nécessité de recourir à la coopération, avec nos partenaires européens en particulier, est clairement énoncée dans le Livre blanc de 2013 : « La France partage avec ses partenaires européens la plupart des menaces et des risques auxquels elle est confrontée : la conclusion pragmatique de ce constat est que nous y ferons face plus efficacement si nous nous mettons en mesure d’y répondre ensemble. C’est pourquoi, dans le cadre de sa stratégie de défense et de sécurité nationale, la France considère que la construction européenne en matière de défense et de sécurité est une priorité. Mue par la conviction qu’une réponse européenne serait supérieure à la somme des réponses nationales, elle se tourne vers l’Union européenne avec la volonté d’y apporter sa connaissance des crises et ses propositions concernant les réponses à leur donner. Elle souhaite en retour bénéficier de celles de ses partenaires européens ».
Une coopération plus dynamique et volontariste dans le domaine de l’armement permettra à notre pays en particulier, et plus généralement aux nations européennes, de maintenir leur autonomie militaire tout en réduisant significativement les coûts et permettra à notre industrie de défense, riche en emploi et en valeur ajoutée, de tenir son rang dans la compétition mondiale.
Les programmes d’armement menés en coopération sont désormais un impératif pour les équipements technologiquement avancés. Si nous ne voulons pas subir de rupture capacitaire en Europe, une volonté politique forte doit se manifester pour que de nouvelles coopérations émergent dans les années à venir. Les rapporteurs pensent notamment aux futurs avions de combat, qu’ils disposent de pilote ou non. Si nous voulons continuer d’exister dans ce domaine, l’Europe doit absolument éviter les concurrences suicidaires pour son industrie du type Rafale-Eurofighter. Pour toutes ces raisons, une coopération renouvelée et renforcée de certaines nations européennes apparaît comme une obligation financière, militaire et industrielle.
Lors du Conseil européen consacré aux questions de défense de décembre prochain – le premier depuis 2008 – la France devrait faire preuve d’initiative dans ce domaine, de manière pragmatique et non conceptuelle pour qu’émergent de nouvelles pistes de coopération à même de satisfaire les besoins capacitaires de nos armées.
Proposition n° 1 : – Réaffirmer le rôle de chef de file du Ministre de la Défense dans la conduite des programmes d’armement menés en coopération – en s'appuyant sur le Ministre délégué, comme cela est déjà engagé actuellement – afin de conférer une visibilité politique renforcée aux investissements de défense et permettre une meilleure coordination des méthodes de travail avec les autres ministères concernés – ministère des Affaires étrangères et ministère de l’Économie et des finances – ainsi qu’avec nos partenaires. Proposition n° 2 : – Favoriser une meilleure intégration européenne de l’industrie de défense, qui faciliterait le montage industriel des coopérations et permettrait in fine de peser sur un marché de plus en plus concurrentiel. Veiller en parallèle à développer une véritable articulation entre les différents services de l’État concernés par les programmes d’armement (DGA et APE notamment) pour qu’ils puissent, lorsque surviendront des consolidations, préserver au mieux les intérêts stratégiques et industriels français. Proposition n° 3 : – Privilégier une approche pragmatique et opportuniste de la coopération dans le domaine de l’armement en favorisant des coopérations initialement limitées à un ou deux partenaires mais de manière non-exclusive. Ainsi, une fois les objectifs du programme clairement identifiés et la gouvernance consolidée, ces coopérations pourraient être ouvertes à d’autres partenaires. Proposition n° 4 : – Renforcer le rôle de l’OCCAr et doter cet organisme d’une véritable autonomie dans la gestion des programmes, afin de permettre de réels gains d’efficience, à charge pour cette agence exécutive de rendre régulièrement des comptes aux pays participants aux programmes en question. Proposition n° 5 : – Encadrer le concept du « juste retour industriel » en se fondant uniquement sur les principes d’efficacité industrielle et de performance économique. Le retour sur investissement de la coopération doit être apprécié de façon globale, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des programmes menés en coopération avec tel pays et non programme par programme. Proposition n° 6 : – Harmoniser au maximum les besoins opérationnels afin de limiter les demandes de spécifications et permettre le développement de plateformes communes pour tous les pays participants, auxquelles pourrait être ajoutées, si nécessaire par la suite, des options. Proposition n° 7 : – À l’occasion du prochain Conseil européen sur les questions de défense, en décembre 2013, la France devrait faire preuve d’initiative et permettre l’émergence de nouvelles pistes de coopération notamment dans des domaines peu ou pas explorés : à savoir les capacités maritimes et terrestres. |
Au cours de sa séance du 10 juillet 2013 à 10 heures, la Commission des Finances examine le présent rapport.
Un débat s’engage après l’exposé des rapporteurs.
M. Marc Francina. Pourquoi n’avons-nous pas réussi à construire des drones grâce à de tels programmes en coopération ?
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Plusieurs facteurs expliquent cet échec : la concurrence entre industriels, les moyens financiers limités de la DGA, mais aussi les hésitations, voire les conservatismes, des armées. Encore une fois, cet exemple montre que le politique doit suivre les projets de plus près, trancher et donner des ordres – ce qu’il n’a pas assez fait depuis dix ou quinze ans.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. La France et l’Europe ont raté le virage du drone MALE (moyenne altitude longue endurance), il y a vingt ou vingt-cinq ans parce que ni les politiques, ni les états-majors n’ont considéré ces avions sans pilote comme une voie d’avenir. Des tentatives – avec les Allemands, puis avec les Anglais – ont été lancées, mais elles ont échoué. Aujourd’hui, nous devons donc acheter aux Américains des drones MALE sur étagère.
L’Europe doit absolument développer un drone MALE de deuxième génération, qui pourra équiper nos armées dans vingt à vingt-cinq ans. J’espère qu’il en sera question lors du Conseil européen du mois de décembre.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. La coopération avec les Britanniques en matière nucléaire – sujet sensible s’il en est – s’est très bien passée : c’est parce que le suivi politique était permanent. Cela évite de s’enliser dans des discussions techniques et financières.
M. Régis Juanico. Vous n’avez pas parlé de l’armement terrestre. Nexter, l’ancien GIAT, est un acteur important en ce domaine, chargé notamment des blindés et des véhicules de l’infanterie. En ces domaines, pensez-vous qu’il soit opportun de mettre en place des coopérations ? Cela implique-t-il des rapprochements entre les différentes entreprises européennes ?
M. Jean Launay, rapporteur. L’armement terrestre est effectivement le grand absent de la coopération… M. le ministre de la Défense a été très clair sur le fait que de nouvelles coopérations étaient nécessaires dans ce domaine ; il a même prévu de mettre l’accent sur cette nécessité lors du Conseil européen qui doit se réunir à la fin de cette année.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. L’État est à la fois client et actionnaire : il doit être aussi stratège. Il faut, pour l’ensemble des équipements, penser à l’échelle européenne – même dans le domaine nucléaire, dans lequel nous avons fait des pas en direction des Britanniques.
L’État doit se donner des ambitions, des projets, et les faire partager par ses partenaires, pour améliorer la mutualisation et l’interopérabilité, donc l’efficacité des armées. Il doit également réfléchir à une nouvelle politique industrielle.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Pour nouer des accords, il faut une vision d’ensemble des capacités, des forces, des faiblesses et des opportunités.
La DGA dispose de plusieurs centres d’essais, en tout 4 % de l’activité de ces centres répond à une demande de clients privés. En les ouvrant davantage, ne pourrait-on pas imaginer de nouvelles mutualisations ?
Les responsables politiques doivent ici faire preuve d’imagination : les techniciens ont la compétence, mais n’ont pas de vision globale. En regardant tout cela de beaucoup plus près, je suis persuadé que l’on pourrait découvrir de nouvelles possibilités de coopération : cela implique un suivi politique beaucoup plus fin qu’il n’est aujourd’hui.
M. Olivier Carré. Un industriel m’indiquait que, dès lors que le virage du drone avait été raté, le marché mondial étant finalement réduit, il n’était plus opportun de développer les recherches nécessaires à la fabrication de nos propres drones. Qu’en pensez-vous ?
L’écart dans la recherche et développement (R&D) entre l’Europe et les États-Unis est gigantesque. Quels retards sommes-nous en train d’accumuler ? À l’inverse, quels sont nos points forts ?
Enfin, parmi les investissements d’avenir annoncés hier par le Premier ministre, 1,5 milliard d’euros doit être consacré à l’armement. J’en ai été surpris : cela ne dissimule-t-il pas une réorientation de budgets aujourd’hui inscrits dans le budget du ministère de la Défense ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Les différences en R&D entre les États-Unis – où les effectifs sont pourtant moindres – et l’Europe sont lourdes de conséquences pour l’avenir.
En matière budgétaire, je m’inquiète d’une autre dérive dangereuse : les reports d’une année sur l’autre se multiplient. Comment arrêter cela ?
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Le marché des drones est effectivement limité. L’intérêt de travailler à une nouvelle génération de drones, c’est de ne pas perdre les capacités des bureaux d’études, de garder les compétences qui nous seront nécessaires, dans dix ou vingt ans, pour construire l’avion du futur.
M. Olivier Carré. Pourquoi attendre ?
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Il n’y a pas aujourd’hui d’accord entre États, ni d’ailleurs entre industriels, pour développer un nouvel avion de chasse.
Sur les investissements d’avenir, je ne peux pas vous répondre ce matin. Je comprends vos craintes. On peut aussi être optimiste : Alain Juppé et Michel Rocard, lorsqu’ils avaient piloté les investissements d’avenir, avaient, je crois, eu tort de ne pas inclure certaines dépenses de défense. Je pense notamment aux supercalculateurs : nous étions parmi les tout premiers au monde il y a cinq ou six ans dans ce secteur, mais nous sommes en train d’être distancés. C’est un enjeu d’avenir décisif, et cela concerne aussi bien les militaires que les civils.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. L’écart de R&D est inquiétant à double titre : pour toutes les technologies liées à la dissuasion, nous sommes dans l’excellence mais est-ce que ce sera encore le cas dans trente ans ? Il faut donc mutualiser le développement et la production d’équipements avec les autres pays européens, mais pour cela il faut convaincre nos partenaires d’augmenter leurs dépenses de R&D ou alors, nous serons obligés d’abandonner des pans entiers de technologies pourtant essentielles à notre souveraineté.
D’autre part, quand nous exportons, nous transférons désormais de plus en plus souvent de la technologie : en conséquence nous devons toujours être à la pointe en matière d’innovation. Pour cela, la R&D est cruciale.
Pour que nos bureaux d’étude conservent leurs compétences et leur savoir-faire, le ministre a souhaité pour les études amont une limite budgétaire minimale de 600 ou 700 millions d’euros – mais nous dépassions le milliard d’euros il y a quelques années.
M. Jean Launay, rapporteur. Je suis moins pessimiste sur le sujet des calculateurs car le CEA est bien présent en ce domaine.
S’agissant des questions budgétaires évoquées par Mme Dalloz, notre réunion d’hier était effectivement édifiante. La préparation du nouveau Livre blanc a sans doute accentué ces glissements, et nous pouvons espérer que la LPM offrira une visibilité nouvelle aux acteurs de la défense et permettra un meilleur respect des engagements.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. La commission de la Défense a examiné ce matin un rapport de MM. Fromion et Rouillard sur les dérives budgétaires de la LPM actuelle : nous en sommes tout de même à 5,5 milliards, dont 3 milliards pour le seul programme 146 « Équipement des forces ». Nous devons dès aujourd’hui nous interroger sur la construction d’une LPM cohérente et respectueuse à la fois de nos ambitions et des contraintes budgétaires.
La Commission autorise la publication du rapport d’information de la Mission d’évaluation et de contrôle sur la conduite des programmes d’armement en coopération, en application de l’article 145 du règlement.
I. LISTE DES PROGRAMMES MENÉS EN COOPÉRATION
Programmes |
Nations |
Agence ou Ministère de la Défense mandataire |
A400M |
Allemagne Belgique, Espagne, Luxembourg, Royaume-Uni, Turquie |
OCCAr |
MUSIS |
Allemagne Belgique, Espagne, Grèce, Italie |
OCCAr |
HELIOS II |
Belgique, Espagne, Italie, Grèce |
CNES |
ATHENA-FIDUS |
Italie |
Italie |
SICRAL 2 |
Italie |
Italie |
Air Command and control system |
OTAN |
OTAN |
Bi strategic allied information system |
OTAN |
OTAN |
SATCOM OTAN |
OTAN |
OTAN |
Contrôle aérien Khandahar |
OTAN |
OTAN |
Final operational Capability |
OTAN |
OTAN |
Système déployable de communication et d’information DCIS |
OTAN |
OTAN |
Surveillance de l’espace avec capteurs radars et/ou optronique à partir du sol |
Agence spatiale européenne – AED |
Agence spatiale européenne |
Multifunctional Information Distribution System-Low Volume Terminal |
Allemagne, Espagne, Italie |
OTAN |
GEODE 4D |
À confirmer : |
France |
NH90 |
Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Portugal |
NAHEMA (OTAN) |
Tigre |
Allemagne, Espagne |
OCCAr |
Anti-navire léger (ANL) |
Royaume-Uni |
Royaume-Uni |
Famille de missiles sol-air futurs (SAAM et SAMP-T) |
Italie |
OCCAr |
PAAMS (Principal anti-air missile system) |
Italie, Royaume-Uni |
DGA OCCAr (soutien) |
FREMM |
Italie |
OCCAr |
HORIZON |
Italie |
OCCAr |
Torpille MU90 |
Italie |
France |
Système de lutte anti-torpille SLAT |
Italie |
France |
Système de lutte anti-mines futur (Espadon) / Programme de déminage maritime (Maritime Mine Counter-Measures) |
Royaume-Uni |
OCCAr |
MÉTÉOR |
Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède |
Royaume-Uni |
Radar de contrebatterie COBRA (stade de soutien) |
Allemagne, Royaume-Uni, Turquie |
OCCAr |
CTA 40 mm |
Royaume-Uni |
France et Royaume-Uni |
SDMS |
Allemagne |
Allemagne |
PLÉIADES |
Autriche, Belgique, Italie, Espagne, Suède |
CNES |
Lance-Roquettes Unitaire (LRU) |
Allemagne, Italie |
Allemagne |
Source : Direction générale de l’armement
II. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Pages
Audition du 13 mars 2013
À 16 heures 30 : M. Patrick Boissier, président-directeur général du groupe DCNS. 61
Audition du 13 mars 2013
À 17 heures 30 : M. Éric Trappier, président-directeur général du groupe Dassault Aviation. 69
Audition du 4 avril 2013
À 9 heures : Général Jean-Robert Morizot, sous-chef d’état-major « Plans » au sein de l’état-major des armées, et du contre-amiral Charles-Henri Garié, de la division « Cohérence capacitaire » de l’état-major des armées. 74
Audition du 4 avril 2013
À 10 heures : M. Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement (DGA) 82
Audition du 4 avril 2013
À 11 heures 30 : M. Patrick Bellouard, ancien directeur de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) 89
Audition du 25 avril 2013
À 9 heures : Dirigeants du groupe EADS (programmes A400M et NH90) : M. Marwan Lahoud, directeur général délégué d’EADS, président d’EADS France, accompagné de M. Philippe Coq, directeur adjoint des affaires publiques d’EADS France, et du général Philippe Tilly, conseiller défense du président d’EADS ; M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d’Eurocopter, accompagné du général Georges Ladevèze, conseiller du président d’Eurocopter ; M. Cédric Gautier, directeur du programme A400M, président d’Airbus Military France 94
Audition du 25 avril 2013
À 9 heures : M. Antoine Bouvier, président-directeur général de MBDA, accompagné de M. Olivier Martin, secrétaire général de MBDA France, de l’amiral Jean-Pierre Tiffou, conseiller défense du président 106
Audition du 23 mai 2013
À 9 heures : Attachés de défense et d’armement de l’ambassade de France à Berlin, général Philippe Chalmel et ingénieur en chef de l’armement Yves Marie Gourlin 112
Audition du 23 mai 2013
À 10 heures : Attachés de défense et d’armement de l’ambassade de France à Londres : Contre-amiral Henri Schricke et l’ingénieur en chef de l’armement Nicolas Fournier, 122
Audition du 23 mai 2013
À 11 heures : Attachés de défense et d’armement de l’ambassade de France à Rome : Colonel Henri Sowa et l’ingénieur en chef Cyril Crozes, 129
Audition du 6 juin 2013
À 9 heures 30 : Amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées 135
Audition du 6 juin 2013
À 10 heures 30 : M. Daniel Verwaerde directeur des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 148
Audition du 6 juin 2013
À 11 heures 30 : Mme Astrid Milsan, sous-directrice services aéronautique, défense au sein de l’Agence des Participations de l'État 155
Audition du 2 juillet 2013
À 17 heures : M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense 159
Les Présidents et les Rapporteurs de la mission d’évaluation et de contrôle tiennent à remercier particulièrement M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes et M. Stéphane Jourdan, auditeur, pour la précieuse assistance qu’ils ont apportée aux travaux de la MEC.
III. COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition du 13 mars 2013
À 16 heures 30 : Audition de M. Patrick Boissier, président-directeur général du groupe DCNS.
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, président. Nous tenons aujourd’hui la première réunion de la Mission d’évaluation et de contrôle consacrée à la conduite des programmes d’armement en coopération. Trois rapporteurs ont été désignés : M. François Cornut-Gentille, M. Jean Launay, membres de la commission des finances, et M. Jean-Jacques Bridey, membre de la commission de la défense.
Nous accueillerons tout au long de nos travaux des magistrats de la Cour des comptes. M. Stéphane Jourdan et M. Bruno Rémond participent aujourd’hui à nos travaux.
Cette mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances a pour but d’évaluer la conduite des programmes d’armement menés en coopération. À l’heure actuelle, la France est impliquée dans vingt-quatre programmes de ce type pour la production d’équipements de première importance comme l’A400M, avion de transport militaire, ou les FREMM, les frégates multimissions.
Le cadre institutionnel et industriel de chacun de ces programmes est différent : certains sont bilatéraux, d’autres multilatéraux ; certains, comme l’A400M, sont menés sous l’égide de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), d’autres, comme l’hélicoptère NH90, le sont sous la houlette de l’OTAN.
L’objectif de cette mission est d’analyser la conduite de ces programmes au niveau politique, industriel, technique et financier. Comment naissent-ils ? À quels besoins répondent-ils ? La mutualisation des financements et des capacités industrielles permet-elle, in fine, de réaliser des économies, sachant que la coopération est bien souvent la condition même de la réalisation de ces programmes ?
Dans le cadre d’une première série d’auditions, centrée sur les industries de défense, nous recevons tout d’abord M. Patrick Boissier, président-directeur général du groupe DCNS.
M. Patrick Boissier, président-directeur général du groupe DCNS. DCNS a été créé il y a dix ans, mais l’entreprise a quatre cents ans si l’on prend en compte sa filiation avec la direction des constructions navales. Depuis 2003, DCNS est une société de droit privé qui appartient à 64 % à l’État, via l’Agence des participations de l’État, à 35 % au groupe Thales et à 1 % à son personnel et qui est l’un des leaders mondiaux de l’industrie navale de défense.
Alors que nous dépendions à près de 85 % de la commande publique navale, nous avons pour objectif de consacrer notre activité à parts égales à la commande navale nationale, à la commande navale à l’exportation, et aux nouveaux métiers du secteur de l’énergie, en particulier à l’énergie nucléaire et à l’énergie marine renouvelable.
Nous sommes aujourd’hui à mi-chemin de cette évolution : notre activité se répartissait l’année dernière entre l’industrie navale nationale, pour les deux tiers, et l’exportation pour le tiers restant – le secteur de l’énergie n’en étant qu’au stade des balbutiements. Nous prévoyons de parvenir à une répartition en trois tiers d’ici à la fin de la décennie. Dans ce délai, notre chiffre d’affaires, qui s’élève à près de 3 milliards, aura doublé par rapport aux 2 milliards d’euros enregistrés en 2009.
DCNS est impliqué dans la plupart des programmes de la marine nationale. Deux programmes actuellement en cours concernent de nouvelles constructions : le sous-marin nucléaire d’attaque Baraccuda et les frégates multimissions FREMM. Un autre programme est consacré à la conversion de nos sous-marins nucléaires afin de les adapter à l’utilisation des missiles M51. Notre activité de maintien en condition opérationnelle (MCO) des navires de la marine nationale représente un chiffre d’affaires annuel de 800 à 900 millions d’euros.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Je souhaiterais avoir des précisions sur les évolutions probables, possibles et souhaitables du programme FREMM et de la relation contractuelle. Au regard de votre expérience, de quelle manière la conduite des programmes d’armement menés en coopération pourrait-elle être améliorée ?
Au-delà du cas des FREMM, comment le politique intervient-il dans la prise de décision initiale et lors de la conduite d’un programme ?
La direction générale de l’armement (DGA), habituée à participer à des projets franco-français, parvient-elle à s’adapter aux coopérations ? Qu’en est-il des états-majors ?
M. Jean Launay, rapporteur. Pourriez-vous nous en dire plus sur la genèse de la coopération bilatérale avec l’Italie pour le programme FREMM ?
Une coopération de ce type est-elle envisageable avec d’autres pays européens ? Président du groupe d’amitié France-Pologne de l’Assemblée nationale, je sais que les armées polonaises souhaitent acheter certains matériels et que nous avons des contacts avec ce pays. Or, les procédures d’appels d’offres ne sont pas systématiques dans ce pays. Dans ce cadre, comment DCNS peut-elle se positionner et faire valoir ses arguments ?
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Quels sont, selon vous, les avantages, et les désavantages des coopérations ?
À l’origine, le programme FREMM visait à mutualiser les efforts de la France et de l’Italie, dans la réalisation d’un équipement commun, afin de réduire les coûts d’étude et de production. À l’arrivée, deux équipements différents, voire concurrents sur le marché international sont construits. Dans ces conditions, on peut se demander à quoi sert la coopération ?
M. Patrick Boissier. L’objectif du programme FREMM est de créer une nouvelle génération de frégates destinée à remplacer les frégates anti-sous-marines et la plupart des frégates antiaériennes à l’exception des frégates de classe Horizon. Les frégates FREMM sont multimissions, comme leur nom l’indique, même s’il existe différentes versions, selon leur spécialisation.
Initialement, deux versions étaient prévues : l’une pour l’action vers la terre, l’autre, pourvue d’un sonar, pour l’action anti-sous-marine. La France devait produire dix-sept frégates, neuf en version action vers la terre (AVT), et huit en version anti-sous-marine (ASM). L’Italie s’est jointe à ce programme commun pour un total initial de vingt-sept frégates. Une frégate devait être livrée à la France, tous les sept mois, à partir de la fin 2012.
Aujourd’hui, le programme a été réduit à onze unités pour la France. La version AVT a été abandonnée, mais une nouvelle version de frégate de défense antiaérienne (FREDA) a été commandée en deux exemplaires pour pallier la réduction du programme Horizon.
Le premier bâtiment FREMM a été livré à la marine française en novembre 2012. Une douzième frégate ayant été vendue au Maroc qui devrait la recevoir à la fin de l’année, la livraison des FREMM destinées à notre marine sera décalée. De son côté, l’Italie a commandé six frégates et pris une option pour quatre unités supplémentaires – elle a réceptionné le premier de ces bâtiments en 2012.
Les frégates ont été commandées par les marines italienne et française au titre d’un même contrat passé entre l’OCCAR et des industriels – DCNS pour la France, et Orrizonte Sistemi Navali pour l’Italie, société constituée de Fincantieri et Finmeccanica, qui a fabriqué les frégates Horizon italiennes.
M. Alain Claeys, président. Comment l’OCCAR est-elle constituée ?
M. Patrick Boissier. Le bureau de l’OCCAR, qui a pris en charge la signature et l’exécution du contrat, représente les États français et italien. Cet organisme comprend une équipe venant de chacun des deux pays. L’équipe française est composée de personnels de la DGA et de la marine. Dans le cadre de la relation contractuelle, nous transmettons à l’OCCAR des revues de programme mensuelles et nous assurons des communications de données régulières.
Le mode de coopération retenu pour le programme FREMM s’inspire des expériences tirées des programmes comme Horizon ou Charles-Quint.
Le programme franco-italien Horizon, prévoyait la construction de quatre frégates identiques, deux unités pour chaque pays. Pour que les retombées industrielles soient les mêmes des deux côtés des Alpes, il avait été procédé à un partage strictement égalitaire des tâches. Cette organisation extrêmement complexe a finalement pesé sur les coûts et sur les délais, au point que le programme n’a pas été mené à son terme et que seulement deux bâtiments pour la France et deux pour l’Italie ont été construits.
Le programme de la frégate Charles-Quint, associant l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas, s’est limité à mettre en commun les achats de certains équipements, chaque partenaire conservant sa liberté pour ce qui concernait le flotteur et le reste de l’armement.
Le programme FREMM prévoit une conception commune en amont, et l’achat en commun de la turbine, du système de stabilisation, du système de guerre électronique et du sonar. Ces matériels représentant environ 10 % du coût du navire, l’opération permet d’économiser à peu près 1 million d’euros par bâtiment.
Moins de 10 % du coût des études a été mutualisé, ce qui représente une économie apparente de 50 millions d’euros pour chacun des partenaires. En fait, si l’on tient compte du coût supplémentaire des études spécifiques relatives aux plateformes différentes pour chaque pays, et du surcoût lié à la coordination, le montant économisé est ramené à une quinzaine de millions d’euros. En définitive, grâce à cette coopération, la France aura donc économisé environ 30 millions d’euros, soit 1 % à 1,5 % du coût total du programme.
La coopération s’organise grâce à une équipe franco-italienne, l’International coordination team. Composée, côté français, de trois personnes pendant la période des études communes, elle ne mobilise plus aujourd’hui qu’un demi-emploi. L’OCCAR rend compte à la DGA pour la partie française du projet. Cette dernière est notamment sollicitée pour son expertise technique et pour un suivi en matière d’assurance qualité.
Le programme FREMM aurait sans aucun doute pu être mené à bien dans un cadre franco-français, avec des conséquences nulles en termes de délai et infinitésimales en termes de coût.
M. Jean Launay, rapporteur. Selon vous, la coopération nous a permis d’économiser 30 millions d’euros sur l’ensemble du programme. S’agit-il du montant supplémentaire que nous aurions dû dépenser si nous avions construit cette frégate sans l’Italie ?
M. Patrick Boissier. Je vous rappelle que le coût global du programme s’élève à 6 milliards d’euros. C’est en ce sens que je qualifie une économie de 30 millions « d’infinitésimale », d’autant que nous sommes dans un ordre de grandeur correspondant aux marges d’incertitude quant au coût final du projet.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Si l’économie de 30 millions est à ranger du côté des avantages que nous retirons de la coopération, qu’en est-il des désavantages ?
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Vous ne parlez pas des décisionnaires. Qui a décidé de la coopération ? Est-ce DCNS, la DGA, le ministre ?
M. Patrick Boissier. DCNS n’a fait que répondre à la volonté de l’État.
Vous m’avez interrogé par écrit sur les différences de spécifications entre les frégates françaises et italiennes. À vrai dire, elles sont si nombreuses qu’il serait plus facile de faire la liste des spécifications communes. Les plateformes sont différentes. La vitesse maximale des FREMM françaises et italiennes est différente, ce qui a des conséquences sur la puissance des navires et sur leurs chaînes de propulsion. Les FREMM françaises sont très automatisées – elles embarquent un équipage de 108 marins, détachement hélicoptère compris, soit un personnel deux fois et demi moins nombreux que sur les frégates antiaériennes en service actuellement –, alors que les frégates italiennes ont besoin de 145 marins. Les radars sont différents, de même que les armements choisis. De plus, les frégates italiennes sont équipées d’un canon à l’arrière, contrairement aux nôtres.
Finalement, les FREMM n’ont de commun que leur nom et les quatre équipements que j’ai cités ; même leur silhouette est différente. Malgré cela, par rapport à la complexité des programmes Horizon, la simplification est considérable : nous produisons, en fait, des programmes nationaux avec une coopération pour certains équipements.
La relation contractuelle a considérablement évolué depuis l’origine, ce qui a eu un impact non négligeable sur le coût final du programme. L’unicité du contrat oblige les deux parties à approuver tout avenant, même lorsqu’il ne concerne que l’une d’entre elles. Ce processus ne constitue pas un facteur de souplesse. L’avenant 4 porte sur les frégates françaises : onze FREMM doivent être livrées à la France qui renonce à la tranche conditionnelle de six unités, le délai de livraison entre deux bâtiments passe de sept à dix mois, et la version AVT est supprimée au profit de la version FREDA.
Ces évolutions contractuelles ont entraîné l’augmentation d’environ 200 millions d’euros du coût non récurrent d’étude, de développement et de logistique, dont 160 millions pour le seul développement de la version FREDA. Le coût moyen des frégates est passé de 308 à 404 millions d’euros en raison de l’étalement des livraisons, de demandes supplémentaires, de la complexité des modèles FREDA et de la réduction du nombre de bâtiments commandés. Le coût du MCO prévu dans le contrat – 100 millions d’euros pour 184 mois-frégates – n’a pas été modifié.
Monsieur Cornut-Gentille, vous m’avez interrogé sur les évolutions probables, possibles et souhaitables du programme. Dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire, il est probable qu’un nouvel étalement des livraisons sera envisagé et le nombre de frégates commandées pourrait être réduit. Le passage de sept à dix mois avait coûté environ 400 millions d’euros, soit le prix d’une frégate. L’impact économique du seul étalement de dix à quatorze mois serait de 500 millions d’euros. Sur le plan social, il entraînerait aussi la perte de 500 emplois industriels pour DCNS Lorient et ses sous-traitants locaux, et celle de 500 emplois supplémentaires chez ses fournisseurs, soit un total de 1 000 emplois. Si l’étalement devait dépasser les quatorze mois, nous serions dans l’obligation de mettre en place un plan social à DCNS Lorient.
Les évolutions concernent aussi d’éventuelles commandes à l’export. L’Arabie saoudite, le Brésil, le Canada ou la Grèce semblent intéressés par les FREMM dans leur version antiaérienne. Toutefois, la version actuelle n’est sans doute pas adaptée aux marchés d’exportation. Il paraît donc souhaitable, y compris dans l’intérêt de notre marine, d’évoluer vers la production de frégates antiaériennes de nouvelle génération ou FREMM/ER pour extended range (longue portée). Les radars à panneaux fixes qui équipent ces frégates ont une portée supérieure et permettent d’intégrer un système de défense antimissile balistique. Le passage à la FREMM/ER, plus onéreuse que la FREDA du fait de ses coûts de développement, nous ferait bénéficier d’un accès aux marchés étrangers, qui compenserait éventuellement le coût de l’étalement des programmes, voire la baisse du nombre de frégates commandées par la marine nationale.
M. Jean Launay, rapporteur. Qui formule les demandes techniques dont vous avez fait état ? Pourquoi interviennent-elles en cours de programme, ce qui augmente les coûts ? Évidemment, les militaires peuvent avoir des exigences, mais ne peut-on pas imaginer dans le cadre de coopérations des modèles plus intégrés, afin d’éviter de multiplier les spécifications techniques ?
J’ai eu la chance de visiter le bâtiment de projection et de commandement (BPC) Dixmude : ce navire intégré multimissions, presque passe-partout, semble avoir été conçu sur un modèle qui paraît être à l’opposé de celui des FREMM.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Qui arbitre quand les militaires ne sont pas d’accord entre eux ? Une reprise en main par les politiques n’est-elle pas la condition indispensable à la réalisation de programmes en coopération ?
Pourquoi la question de l’exportation ne se pose-t-elle qu’en fin de programme ? À mon sens, cette dimension essentielle devrait être prise en compte dès sa phase initiale.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Il semble, à vous entendre, que les bénéfices de la coopération soient inférieurs à ses inconvénients ? L’avantage se limite à la mutualisation de certaines études et à l’achat en commun de certains matériels. Ce déséquilibre est-il dû à la mauvaise définition des objectifs en amont ou aux évolutions ultérieures du programme ? Ne peut-on tirer aucun autre avantage d’une coopération ?
M. Patrick Boissier. Le programme FREMM s’étale sur plus de quinze ans et porte sur des navires extrêmement sophistiqués. Sur une telle durée, les évolutions sont donc normales et inéluctables, car tant les menaces que les techniques évoluent. Je ne crois pas que ce programme ait subi plus de modifications que d’autres. Quant à l’introduction de la version FREDA, elle s’explique par l’abandon de l’Horizon ; elle n’est pas liée à la nature du programme.
Monsieur Launay, il est difficile d’établir une comparaison avec le Dixmude. Ce bâtiment qui répondait à des normes civiles, a été construit par les Chantiers de l’Atlantique, en moins de deux ans. Dans un tel délai, les modifications n’ont pas lieu d’être.
DCNS a mis à la disposition de la marine nationale le patrouilleur L’Adroit construit et développé sur ses fonds propres. Le cahier des charges faisait trente pages, alors que le seul cahier des charges de l’interface homme-machine du système de combat de la FREMM en compte 1 500 ! On ne peut pas comparer les deux navires, mais la surspécification coûte cher en temps et en argent.
Les divers modèles de programmes en coopération sont finalement aussi mauvais les uns que les autres. Soit on prend en compte tous les besoins des partenaires, comme pour le programme de l’A400M, avion extrêmement complexe. Soit on construit autant de versions que de parties prenantes, comme pour l’hélicoptère NH90 produit en vingt-quatre versions. On peut aussi fabriquer un matériel identique en partageant les retombées économiques entre les partenaires, comme pour l’Horizon qui est devenu de ce fait extrêmement coûteux. On peut enfin, comme pour le programme FREMM, mettre en place une coopération très limitée ne portant que sur quelques équipements. Les bénéfices de la coopération sont alors réduits ; ils restent toutefois supérieurs aux faibles surcoûts engendrés.
Si nous voulons mettre en place en Europe des programmes de coopération afin de fabriquer des matériels de façon plus efficace et plus économique, il faut impérativement une expression commune des besoins et une offre commune qui nécessite un rapprochement préalable entre les industriels. Ainsi, dans le secteur de l’aéronautique civile, les compagnies aériennes expriment leurs besoins de la même façon – les divergences ne portent que sur la couleur des fuselages –, et l’offre est commune grâce à Airbus.
Tant que les différentes marines n’exprimeront pas leurs besoins de la même façon, nous construiront des navires soit différents, soit complexes. Si une offre commune ne voit pas le jour, chaque pays continuera d’exiger un juste retour pour son industrie nationale.
Aujourd’hui, cinq programmes de frégates se font concurrence en Europe, mais ils se limitent tous à la commande de quelques unités – le programme FREMM du côté français étant le plus lourd avec onze bâtiments –, alors qu’aux États-Unis la production d’une frégate se fait par soixante unités !
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Les différentes marines ne cultivent-elles pas leurs différences ? Les états-majors européens ont-ils vraiment la volonté de coopérer ? L’OCCAR est une coquille un peu vide. Quelle instance politico-technique serait la légitimité pour imposer une réelle coopération aux états-majors ?
M. Patrick Boissier. Seule l’autorité politique peut permettre l’expression commune des besoins, pour cela il faut créer une véritable Europe de la défense.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Qu’en est-il du côté des industriels ?
M. Patrick Boissier. Dans tous les secteurs, les entreprises fusionnent et se concentrent en raison de l’existence de leviers comme les effets de série, la nécessité d’amortir les coûts de développement, de conquérir de nouveaux marchés, la volonté d’acquérir des marques… Ces leviers naturels ne jouent pas pour l’industrie navale qui ne compte pas de grands groupes internationaux. De plus, chaque nation est soucieuse de préserver l’indépendance d’une industrie qui fabrique des outils de souveraineté. Or nous ne créerons le secteur naval de défense européen que s’il y a conjonction d’une volonté industrielle et d’une impulsion politique.
M. Jean Launay, rapporteur. Qu’en est-il des éventuels rapports avec la Pologne ?
M. Patrick Boissier. Aucun programme de coopération n’est en cours avec la Pologne. Ce pays n’a pas de grand projet de construction de navire, mais nous sommes prêts à participer au programme de sous-marins en cours. Cela dit, il s’agira plutôt d’une relation avec un marché à l’exportation que d’une réelle coopération.
M. Jean Launay, rapporteur. Peut-être une relation de collaboration permettrait-elle de se positionner par rapport à un marché dont nous avons du mal à saisir le fonctionnement ?
M. Patrick Boissier. Nous avons fait cette proposition.
M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes. Paradoxalement, votre mission commence par l’étude d’un programme qui en réalité est purement national.
L’idée du programme FREMM date du début des années 1990. L’amiral Louzeau, qui était alors chef d’état-major de la marine, avait imaginé la construction d’une frégate multimissions, mais ce projet trop coûteux n’avait pas vu le jour, supplanté par la production des frégates de classe Lafayette.
La question s’est de nouveau posée avec le programme Horizon qui, à ses débuts, réunissait le Royaume-Uni, l’Italie et la France. Après le retrait de Londres, le programme de quatre frégates avait dû être divisé par deux. Le même schéma s’est reproduit pour le programme FREMM, commencé en partenariat tripartite devenu bilatéral après la défection des Britanniques. La configuration à deux n’est pas la plus propice à une coopération internationale, car elle facilite les revendications en termes de spécificités et de retour industriel de la part des parties prenantes – qu’il s’agisse des politiques, des industriels ou des militaires des deux pays concernés.
Par ailleurs, le programme FREMM a été lancé sans que son financement soit prévu à une époque où l’on enregistrait une diminution singulière des crédits d’équipement du ministère de la défense. Il était inscrit dans la loi de programmation militaire sans qu’aucun crédit ne lui soit affecté. Il a donc été confronté à toutes les difficultés que peut rencontrer un programme d’armement national ou international.
En tout état de cause, les propos de M. Boissier l’ont montré, ce programme n’est que facticement international. Il n’a d’ailleurs été géré par l’OCCAR que dans une seconde phase. Un mémorandum d’entente a même été signé entre la France et l’Italie avant que le programme ne soit « occarisé ». Aujourd’hui l’OCCAR comporte six États. L’un de ses bureaux – il en compte autant qu’il traite de programmes en coopération – gère le projet FREMM. Ce projet n’a quasiment aucune des caractéristiques des programmes internationaux. De tels programmes doivent permettre de construire un produit unique afin de faire des économies sur les coûts de conception et de développement, et entraîner une baisse du coût par effet de série. Ils doivent aussi permettre d’en finir avec la demande de chaque partenaire d’un retour industriel à proportion de son engagement financier qui freine la diminution des coûts de production. J’ajoute que la communautarisation des matériels doit aussi avoir un bénéfice en termes tactique et stratégique – elle diminue les frais de MCO.
Aucun de ces éléments ne se retrouve dans le programme FREMM, pas plus d’ailleurs que dans de nombreux autres.
M. Patrick Boissier. Il est certain que nous n’avons pas affaire à un véritable programme en coopération.
Quatre facteurs expliquent le glissement du coût moyen d’une frégate FREMM : la réduction du nombre de navires à construire ; la suppression de la version AVT remplacée par la version FREDA plus onéreuse ; l’allongement de sept à dix mois du délai entre deux livraisons, et l’évolution des spécifications. La réduction du programme et son étalement ne sont donc pas, comme on l’entend dire, des conséquences inévitables de la dérive des coûts ; ils en sont les causes.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Vous n’avez guère évoqué le rôle de la DGA. Selon vous, au-delà du cas du programme FREMM, est-elle en mesure de s’adapter au travail sur des programmes en réelle coopération ? Qu’attendez-vous d’elle dans ce cadre ?
M. Patrick Boissier. Pour ma part, je ne vois pas de réelle différence entre l’intervention de la DGA dans un programme national et dans un programme en coopération puisqu’il n’existe pas aujourd’hui de véritable programme en coopération.
Le projet commun de porte-avions franco-britannique illustre la nocivité de l’idée de juste retour. Alors que les Britanniques souhaitaient construire deux porte-avions, et les Français un porte-avion supplémentaire, des consultations communes aboutirent au projet de construction d’un monstre qui a finalement avorté. Si nous avions mis en commun ce que les deux pays savent faire le mieux, les trois porte-avions en question seraient déjà en service, et le coût total aurait été inférieur à ce que les Britanniques paieront pour deux unités qui ne seront pas en service avant dix ans.
M. Alain Claeys, président. Nous vous remercions pour vos explications.
Audition du 13 mars 2013
À 17 heures 30 : Audition de M. Éric Trappier, président-directeur général du groupe Dassault Aviation.
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, président. Nous poursuivons les auditions de la mission d’évaluation et de contrôle sur le thème de la conduite des programmes d’armement en coopération.
M. Éric Trappier, président-directeur général du groupe Dassault Aviation. Je centrerai mon propos sur l’avenir de la filière de l’aviation de combat, c’est-à-dire sur le nEUROn. J’aborderai également la méthodologie de développement des coopérations européennes, ainsi que les aspects positifs et négatifs de ces dernières.
Dans les années 2000, pour contribuer au développement des bureaux d’étude et de l’avion de combat américain, le Joint Strike Fighter (JSF) développé par Lockheed Martin, les budgets de développement européens ont été sollicités avec force. Cette contribution s’élevait, pour la seule phase de la recherche et développement et de pré-industrialisation, à près de 8 milliards de dollars courants. Selon Richard Aboulafia, analyste des questions aéronautiques, ce projet avait deux objectifs : équiper les forces américaines et tuer l’industrie européenne de l’avion de combat.
Face à cette menace, en 2003, nous avons fait part au ministère de la défense de notre souhait de lancer un programme portant des développements technologiques permettant de maintenir la capacité de la France à développer un avion de combat. La direction générale de l’armement (DGA) et le ministère de la défense nous ont demandé que sa réalisation s’inscrive dans le cadre d’une coopération européenne.
Le pays le plus favorable à une telle coopération était la Suède, qui possédait une industrie aéronautique nationale qui fabriquait alors le Gripen. L’Allemagne, a finalement décliné l’offre, car elle souhaitait une coopération à 50-50 avec la France, tandis que notre pays, qui entendait conserver le leadership du projet, tenait à y avoir une part de 50 %, le reste se partageant entre les autres partenaires. Le Royaume-Uni a également décliné la proposition, jugeant qu’il convenait de se placer sous le parapluie américain – proposition cohérente avec la contribution de 3,7 milliards de dollars qu’il a apporté au programme du JSF.
L’Italie, l’Espagne, la Suisse et la Grèce ont, en revanche, répondu favorablement.
Dassault a ainsi conclu des accords avec Saab pour la Suède, Finmeccanica-Alenia pour l’Italie, EADS CASA pour l’Espagne, Hellenic Aerospace Industries pour la Grèce et RUAG pour la Suisse.
Ce démonstrateur technologique avait plusieurs ambitions : développer les compétences technologiques critiques à l’aéronautique de combat futur notamment celles liées à la furtivité et au vol non habité ou à l’emport d’armement en soute et mettre en place un laboratoire de coopération européenne selon des méthodologies permettant de maîtriser les coûts. La France assumant le rôle de nation-cadre, la DGA a été désignée comme agence exécutive, pilote du programme, et Dassault reconnu par ses partenaires, en termes de légitimité et de compétences, comme devant être le maître d’œuvre.
En résumé, le projet du nEUROn poursuivait donc un double objectif : le développement des technologies liées aux drones assurant, outre le pilotage depuis le sol, la discrétion et la capacité de tirer des armes à partir d’une soute intégrée, et la mise en place d’une coopération innovante, avec des partenaires choisis en fonction de leurs compétences et non pas selon des arbitrages politiques.
Le budget hors taxes de l’élaboration de ce démonstrateur technologique a été fixé à environ 400 millions d’euros, dont la moitié fournie par la France. On peut comparer ce chiffre aux 8 milliards de dollars correspondant à la contribution de quelques pays européens au bureau d’étude de Lockheed pour le développement d’un avion de combat américain.
Les Britanniques ont, du reste, été associés au programme nEUROn, pour lequel a été choisi un moteur issu d’une coopération entre le Français Turbomeca et le Britannique Rolls-Royce. Plusieurs sociétés de chaque pays ont été impliquées – Thales en France et Saab, Ericsson et Volvo en Suède –, mais un industriel chef de file devait être désigné pour chaque pays.
L’absence de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et de l’Agence européenne de défense (AED) dans ce programme s’explique d’abord par le fait que le nEUROn est un programme de recherche et technologie (R&T), et non pas un programme de développement opérationnel. La France ayant décidé d’être leader, elle a en outre considéré que la DGA devait être l’agence exécutive du programme, ce qui a été accepté par les autres partenaires. Au demeurant, l’AED n’existait pas encore en 2003. Enfin, l’équipe française a considéré que, le programme n’étant pas réellement un programme de développement opérationnel, le coût du recours à l’OCCAR n’était pas justifié au regard des objectifs.
Dans l’hypothèse où un programme opérationnel serait engagé, il me semble que le rôle de l’AED consisterait à établir une synthèse des besoins – car il est fondamental que les militaires s’entendent sur un besoin unifié comportant, à la rigueur, une ou deux variantes, afin d’éviter la multiplication des versions. Rien ne s’oppose non plus à ce que l’on recoure à l’OCCAR : cette décision relève des pouvoirs publics des pays concernés, qui peuvent tout aussi bien préférer recourir à la DGA ou à ses homologues.
M. Alain Claeys, président. Quel est le rôle de la DGA dans le programme nEUROn ?
M. Éric Trappier. La DGA a été le maître d’ouvrage, fédérant les besoins des six pays en matière de technologie et constituant le donneur d’ordres unique pour les industriels ; Dassault Aviation en étant le maître d’œuvre. Le schéma était donc très simple : la DGA parlait au nom des six ministères de la défense et Dassault au nom des six industriels jouant chacun le rôle de leader dans son pays. Des réunions plénières ont en outre rassemblé tous les partenaires, investis chacun d’un rôle bien précis. Cette organisation simple était acceptée par l’ensemble des participants.
M. Jean Launay, rapporteur. Comment s’est déroulée la mise en œuvre de l’opération et quel en a été le suivi, en particulier pour ce qui concerne les relations avec la DGA ?
M. Éric Trappier. Sur la base d’un cadrage des coûts et des délais imposés par la DGA, nous avons négocié avec nos partenaires des contrats détaillés de sous-traitance, à la suite de quoi un contrat a été établi avec la DGA. Un important travail de partage des tâches avait donc déjà été réalisé, notamment pour définir des règles de maîtrise d’œuvre en matière de protection de la propriété intellectuelle et des savoir-faire des industriels. Il a ainsi été convenu que chaque participant mettait gratuitement du savoir-faire à la disposition du programme et acceptait, si ce savoir-faire devait un jour être utilisé, de le mettre à disposition de l’utilisateur moyennant un contrat conclu avec celui-ci. Ces règles ne sont pas celles qui s’appliquent dans le cadre de l’AED ou du programme Horizon 2020 de la Commission européenne, où chaque industriel doit donner son savoir-faire à l’ensemble des États contribuant au projet, qui peuvent le céder gratuitement aux industriels de leurs pays – mauvaise méthode qui poussera inévitablement les industriels à se retirer.
Conformément aux objectifs de performance fixés par la DGA pour les deux types de furtivité devant faire l’objet de la démonstration – discrétion électromagnétique et infrarouge –, les partenaires ont précisé la nature du démonstrateur et prévu un certain nombre d’essais en vol et au sol. Le directeur de programme de la DGA a géré ce programme face à Dassault, tout en organisant des réunions destinées à informer ses homologues des autres pays, parallèlement aux réunions que nous organisions nous-mêmes avec nos partenaires industriels.
Dassault a imposé d’emblée des outils informatiques communs permettant, selon la méthodologie de la gestion du cycle de vie du produit (PLM), de définir le travail de chacun. Un « plateau physique » a réuni pendant un peu plus de six mois les participants des pays impliqués pour définir le partage des tâches, après quoi chaque participant restait lié au bureau d’étude par le biais d’un dispositif informatique sécurisé – le « plateau virtuel » – permettant notamment d’alimenter une « maquette virtuelle » où sont entièrement définis chaque pièce et son mode de fabrication. Ces outils permettent une production plus rapide et une bien meilleure montée en puissance en termes de qualité. La DGA a contribué à la mise en place de ces équipes et a joué son rôle de maître d’ouvrage, vérifiant les progrès réalisés par le constructeur.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Le modèle de coopération idyllique que vous venez de décrire, unissant les industriels de six pays, semble avoir bien fonctionné dans la phase de R&T. Comment cette coopération peut-elle se poursuivre dans une phase opérationnelle de production et de commercialisation ? Certains éléments doivent-ils être corrigés ? Des inquiétudes ou des interrogations se font-elles jour ?
M. Alain Claeys, président. Des avenants ont-ils été apportés au contrat initial dans la phase de développement ?
M. Éric Trappier. Plusieurs avenants ont été apportés au contrat. La DGA a ajusté plusieurs objectifs de performance au fil de l’avancement du programme, celui-ci ayant précisément pour vocation, dans une perspective de R&T, de repousser la limite des savoir-faire industriels. Les structures budgétaires ont également été révisées, compte tenu des dérives intervenues au cours d’un programme qui a débuté en 2003 et doit encore se prolonger deux ans. L’un des objectifs du programme étant également le maintien des compétences, l’impératif d’un délai de livraison n’était pas essentiel et le programme a ainsi connu un retard de quelques mois.
Il est vraisemblable que les six pays partenaires ne vont pas poursuivre ensemble ce programme. Comme pour toute coopération, la question qui se pose est en effet celle de la volonté politique des différents pays de poursuivre l’engagement sur les trente ou quarante ans que requerraient des programmes de ce type.
Ainsi, le Royaume-Uni, est peut-être prêt à engager des actions de coopération européenne – au moins bilatérales, comme dans le cadre des accords de Lancaster House. La Grèce, serait prête à poursuivre sa participation mais ne saurait s’engager à ce stade. L’Espagne éprouve, elle aussi des difficultés budgétaires. Restent donc l’Italie et la Suède, dont on ne sait pas encore si elles souhaiteront continuer à s’associer à un programme opérationnel. L’Allemagne pourrait réviser sa position pour intégrer le programme à cette phase. Tout dépend donc de la décision politique des pays concernés.
L’autre question est de savoir s’il existe un besoin opérationnel commun à ces pays.
Sur cette base, dès lors que les États auront convenu d’un budget commun – placé indifféremment dans le cadre de l’OCCAR, de l’AED ou de la DGA –, les industriels s’entendront. Pour Dassault, il ne fait aucun doute que tout se fera dans le cadre d’une coopération européenne – mais pas sous l’égide de la Commission européenne. Il revient aux politiques de décider de coopérations à trois ou quatre États et d’y affecter des budgets. Nous serons quant à nous disponibles avec nos technologies et nos bureaux d’étude.
M. Jean Launay, rapporteur. Deux ans suffiront-ils pour achever le programme en cours et des interventions de la DGA sont-elles encore prévues ?
M. Éric Trappier. Le premier vol du démonstrateur a eu lieu en décembre 2012. Le nEUROn est actuellement soumis à des mesures de discrétion, au sol. L’avion effectuera ensuite des essais en Suède, pour effectuer ensuite une campagne de tirs en Italie, ce pays ayant apporté son savoir-faire en matière d’armement embarqué dans une soute intelligente. Une campagne supplémentaire sera ensuite organisée à Istres.
Au terme de ces deux années, nous aurons vérifié la pertinence des compromis choisis entre discrétion et aérodynamisme.
Le besoin opérationnel reste à écrire. Chaque mois ou presque, depuis 2002, nous présentons aux militaires notre savoir-faire en matière de drones de combat et de surveillance. Si, en 2000, on affirmait aux ingénieurs que nous sommes que les drones ne servaient à rien, on nous déclare aujourd’hui que, sans drones, on ne sait pas gagner les guerres. Nous avons fait la démonstration des technologies disponibles : aux militaires de nous dire ce qu’ils veulent en faire.
Nous préconisons la réalisation, en collaboration avec les militaires, d’un démonstrateur technico-opérationnel qui, appuyé sur des simulations réalisées dans un laboratoire au sol, permettrait de préparer la guerre de demain ou d’après-demain. Compte tenu du coût d’un programme opérationnel, il ne sera possible de l’engager que lorsque nous aurons épuisé les livraisons des avions de combat actuellement produits en Europe – le Rafale en France, l’Eurofighter Typhoon dans d’autres pays et le Gripen en Suède.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Sur quelle période s’étendrait la réalisation du démonstrateur opérationnel ? Par ailleurs, étant entendu que Dassault aurait sans doute pu réaliser seul ce démonstrateur, que vous a apporté la coopération avec vos partenaires industriels ?
M. Éric Trappier. Dans le cadre des accords de Lancaster House, des discussions ont été engagées avec le Royaume-Uni et un contrat d’étude a été confié cet été par la DGA et le ministère britannique de la défense à BAE Systems et Dassault en vue de formuler fin 2013 des propositions de démonstrateur opérationnel franco-britannique. Dans l’idéal, une commande de démonstrateur opérationnel pourrait intervenir en 2014 et occuperait les bureaux d’étude jusqu’à 2025, après quoi pourrait être engagé un programme de fabrication.
S’il est toujours plus simple de travailler seul – ce qui n’est du reste jamais vraiment le cas, car Dassault travaille avec ses sous-traitants, ainsi qu’avec Thales et Safran –, la coopération à six avec une nation-cadre pour les États et un chef de fille autre pour les industriels, nous a permis de livrer à la DGA un produit conforme à ses spécifications en respectant les délais et, à une légère dérive près, les coûts impartis. Ce démonstrateur, dont le budget représente un dixième ou un-quinzième de ce que la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dépense aux États-Unis pour les programmes comparables, est très compétitif.
Dassault Aviation est conscient que le futur programme d’avions de combat piloté ou non piloté sera réalisé en coopération européenne. Mais il faut qu’au préalable, les États-majors définissent un besoin opérationnel commun et que les États prévoient les budgets associés. Enfin, il est indispensable si les États souhaitent que cette coopération soit un succès, qu’une organisation efficace soit mise en place avec la désignation d’un maître d’œuvre industriel. Pour que ces appareils puissent adresser le marché export avec succès, ils doivent être compétitifs. Nous avons donc tout intérêt à ce que la coopération ne génère pas de surcoûts.
Sans doute certains points appellent-ils des corrections, mais cette coopération est un bon exemple d’organisation. Nous sommes, je le répète, favorables à la coopération dès lors qu’elle est décidée par les États, nos clients.
M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes. Vous avez bien mis en évidence la différence substantielle entre une coopération conçue par des industriels et proposée à des acheteurs – les États – et une démarche faussement commune de différents États en direction d’industriels, démarche qui présente tous les défauts que l’on déplore dans la coopération internationale.
Ce programme d’un coût relativement modeste montre bien que, lorsque les politiques ne parviennent pas à s’entendre sur un même produit et qu’une divergence d’objectifs et de spécifications apparaît, générant une divergence dans les processus de production industrielle, la coopération rencontre de nombreux problèmes. C’est le cas pour l’Airbus A400M. La coopération est très efficace, en revanche, lorsqu’il n’y a pas de divergences, comme cela a été le cas pour le Jaguar, le Transall, ou les frégates tripartites.
M. Alain Claeys, président. Monsieur Trappier, je vous remercie.
Audition du 4 avril 2013
À 9 heures : Audition du général Jean-Robert Morizot, sous-chef d’état-major « Plans » au sein de l’état-major des armées, et du contre-amiral Charles-Henri Garié, de la division « Cohérence capacitaire » de l’état-major des armées.
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, président. Cette première audition de responsables de l’état-major des armées va nous permettre de connaître plus précisément les exigences des forces armées en matière d’équipement. À quels besoins militaires répondent les programmes d’armement menés en coopération ? La mutualisation peut-elle, au-delà des économies escomptées, renforcer l’intégration des différentes forces armées, pour une meilleure interopérabilité sur les théâtres d’opérations ? Dans quelle mesure l’état-major des armées est-il impliqué dans le pilotage de ces programmes particuliers ? Comment les armées peuvent-elles expliquer les nombreuses demandes de spécifications – demandes qui, au final, complexifient grandement la conduite de ces programmes ?
Je vous propose de commencer cette audition par un propos liminaire de quelques minutes, puis nous vous poserons des questions.
M. le général Jean-Robert Morizot, sous-chef d’état-major « Plans » au sein de l’état-major des armées. De par mes fonctions, je suis responsable de la planification et de la programmation des capacités ainsi que des aspects budgétaires liés à ces sujets. Actuellement, je consacre l’essentiel de mon temps à l’élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et du projet de loi de programmation militaire.
Le thème retenu par votre Mission correspond à l’une des pistes suivies pour résoudre l’équation difficile qui nous est posée : construire un modèle d’armée qui réponde aux ambitions politiques du pays tout en étant moins coûteux. Dès le début de nos travaux, les notions de coopération, de mutualisation et de partage ont été très présentes. Leur approfondissement a permis de montrer à beaucoup de gens que ces démarches sont longues et complexes. Et même si elles sont sans doute génératrices d’économies, il est clair qu’elles ne pourront régler, à court terme, la question des économies à réaliser. Les processus de concertation entre les armées, les nations, les industriels, prennent du temps. On le voit, par exemple, s’agissant de la coopération bilatérale engagée en 2010 avec le Royaume-Uni.
L’Agence européenne de défense (AED) avec le concept de mutualisation et de partage capacitaire (pooling and sharing)¸ l’OTAN avec celui de « défense intelligente » (smart defence), ont eu un rôle important dans les réflexions menées en 2012. Mais, très vite, on se trouve confronté à la réalité de l’existant, des problématiques industrielles, aux programmes en cours, aux besoins de nos forces et aux ressources escomptées. Le recours d’emblée à la mutualisation pour régler les problèmes n’est pas toujours la solution : avant de pouvoir coopérer, on a besoin de garanties sur le besoin opérationnel, la cohérence des calendriers, les ressources disponibles et évidemment la réelle volonté de coopérer. Or ces discussions sont toujours délicates et faites de nombreux allers-retours.
M. le contre-amiral Charles-Henri Garié, de la division « Cohérence capacitaire » de l’état-major des armées. Sous les ordres du général Morizot, je travaille à la construction d’un modèle d’armée qui réponde aux ambitions politiques et leur donnant une traduction militaire. Ma division veille à la cohérence d’un ensemble qui ne doit comporter ni lacune, ni surabondance par rapport aux besoins, tant en matière d’armement – ce n’est qu’une partie de la question – qu’en matière d’effectifs, d’entraînement, de maintien en conditions opérationnelles, etc.
Une douzaine de programmes d’armement de grande ampleur sont menés en coopération.
La France a réalisé avec l’Italie les frégates antiaériennes Horizon, ainsi qu’un programme de torpilles.
Parmi les principaux programmes en cours, on citera celui de l’A400M, conduit avec sept autres nations, et les frégates européennes multi-missions (FREMM), de nouveau en coopération avec l’Italie. Pratiquement tous les programmes d’hélicoptères se font en coopération. C’est le cas pour le NH90 d’Eurocopter, hélicoptère de manœuvres ou de combat naval, et pour l’hélicoptère d’assaut et de combat Tigre. Le missile air-air longue distance Météor fait également l’objet d’un développement conjoint, ainsi que tous les programmes de communication par satellite et d’imagerie spatiale. Nous avions commencé à coopérer avec les Italiens à l’occasion du programme Syracuse, nous le continuerons avec les Britanniques sur le programme de remplacement des communications protégées par satellite, qui est nécessaire à nos opérations et à l’obtention d’une couverture mondiale correspondant à nos ambitions. En matière d’imagerie, le programme Hélios, servant au renseignement préalable aux opérations, avait fait l’objet d’une coopération multinationale. Nous cherchons aujourd’hui à coopérer – non sans quelques difficultés – sur le programme Musis qui lui succède.
Nous avons ouvert de nombreux autres champs de coopération avec les Britanniques : en matière de guerre des mines, tout d’abord, afin d’assurer la sécurité de nos sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, mais aussi de drones et de missiles.
Ces coopérations peuvent être bilatérales, multilatérales, ou s’inscrire au sein de l’OTAN ou de l’AED. Elles sont souvent pilotées par l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr). Il n’existe pas de programme de coopération à vingt-sept. Les coopérations qui réussissent sont celles qui partent d’un noyau de deux, trois ou quatre pays.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. La genèse et le suivi des programmes manquent parfois de clarté. Comment un programme en coopération naît-il ? L’état-major prend-il l’initiative de solliciter d’autres états-majors dont il suppose qu’ils ont des besoins similaires ? Les industriels proposent-ils aux états-majors tel ou tel projet ? Le Gouvernement demande-t-il à l’état-major de se rapprocher de ses homologues étrangers pour avancer sur un sujet ?
M. Jean Launay, rapporteur. Un programme étant, pour reprendre vos termes, la traduction militaire d’ambitions politiques, comment ces ambitions se font-elles jour ? Par qui sont-elles exprimées, comment sont-elles transmises, et comment le programme en coopération qui s’ensuit se met-il en route ?
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. La façon dont une coopération s’engage reste en effet entourée d’un certain flou. La mutualisation des études est sans doute ce qui fonctionne le mieux. Le passage à la production est-il réalisé pour harmoniser les équipements des différentes armées ? Ouvre-t-il un champ plus important à l’exportation des matériels ? Ne conviendrait-il pas de distinguer les coopérations qui procèdent de projets industriels et celles qui correspondent à une véritable volonté des États ?
M. le général Jean-Robert Morizot. M. Cornut-Gentille a bien décrit les différentes façons de lancer une coopération. Pour être en mesure d’identifier des pistes de coopération, nous avons mis en place avec la Direction générale de l’armement (DGA), un processus de réseau de veille active visant à identifier ce qui pourrait être réalisé en partenariat. Les points de départ d’une coopération sont en effet divers : parfois une réflexion industrielle, parfois une réflexion opérationnelle, parfois un besoin capacitaire proche, souvent ce sont également des considérations de coût. Plusieurs instances et forum permettent de confronter toutes ces idées. Avec ses compétences en matière de recherche et de technologie et de politique industrielle, la DGA est à même de dégager des pistes qui débouchent sur des coopérations industrielles – mais tous ces travaux s’appuient toujours sur la réponse à des besoins des forces armées. La coopération entre l’état-major des armées et la DGA est donc étroite.
Par exemple, pour ce qui est de l’état-major des armées, nous avons depuis longtemps, dans le cadre du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) des groupes qui se rencontrent régulièrement pour croiser des informations sur les besoins existants, pour voir et identifier si ces besoins et les calendriers peuvent être convergents. Ce travail est à la base de la réflexion sur d’éventuelles pistes de coopération. Ce dialogue est maintenant plus formalisé avec les Britanniques dans le cadre des traités de Lancaster House, il existe également dans le cadre de l’AED et, le cas échéant, de l’OTAN.
En plus de dessiner des synergies potentielles, ce « balayage » des besoins a également pour objectif d’améliorer l’interopérabilité, ce qui est pour nous depuis longtemps une priorité.
Ensuite, les armées entrent dans la phase la plus délicate pour elles, qui consiste à converger sur un besoin commun. Selon les pays, différentes procédures sont utilisées. Le processus est en général assez long dans la mesure où l’on se trouve souvent confronté à des difficultés liées aux calendriers, aux différences de besoins militaires et ensuite à la répartition de la charge industrielle.
Pourquoi est-il si difficile de converger sur un besoin ? Parce que la définition du besoin militaire découle de la manière-même de combattre de chaque armée. Aussi, plus le matériel envisagé se rapproche des savoir-faire des armées, leur cœur de métier, c’est-à-dire les phases opérationnelles, plus les choses deviennent compliquées et les compromis difficiles à trouver. Ce n’est pas une question de traditions mais, j’insiste, de savoir-faire et de tactique : si l’expression du besoin des armées paraît parfois rigide, c’est que ceux qui les formulent se représentent des situations concrètes de combat et font appel à leur expérience. Le compromis peut s’avérer difficile à établir, même si interviennent d’autres considérations d’ordres politique ou technologique et la nécessité de réaliser des économies.
M. le contre-amiral Charles-Henri Garié. Il existe plusieurs façons de faire « germer » des programmes d’armement menés en coopération.
La première d’entre elles est consécutive aux opérations. La mission Harmattan que nous avons menée avec les Britanniques en Libye a permis de dégager des axes forts de coopération, en particulier pour la boucle de commandement et de décision. Nous nous rapprochons aujourd’hui de nos partenaires en matière d’ISR (intelligence, surveillance, renseignement) et de communications. Le fait d’avoir les mêmes ambitions politiques et la même manière de travailler facilite la mise en œuvre de coopérations.
La coopération peut également découler d’échanges bilatéraux entre états-majors d’une même arme ou entre états-majors d’armée, ou encore provenir de la R&T (recherche et technologie) au sein de l’industrie. Les perspectives sur le successeur du Rafale et des drones de combat s’inscrivent dans ce dernier champ. Le programme nEUROn, dont vous parlera le Délégué général pour l’armement, naît aussi d’un partage de R&T très en amont. De la même manière, le partenariat avec les Britanniques en matière de drones de guerre des mines commence avec le démonstrateur.
Enfin, le projet « One MBDA », c’est-à-dire la constitution d’un champion européen en matière de missiles par rapprochement entre la partie britannique et la partie française de MBDA, nous conduit à coopérer sur différents types de missiles : missile à courte portée pour les forces terrestres, missiles ANL (anti-navire léger), pour lequel la coopération avec les Britanniques est en germe, etc.
Parallèlement, les coopérations reposant sur une réflexion systématique dans le cadre de l’AED ou dans celui de l’OTAN prennent de plus en plus d’ampleur.
L’AED a ainsi permis d’élaborer un projet pour quinze nations en matière de guerre des mines, ce qui a permis à la France et au Royaume-Uni d’engager un programme sur la base du besoin commun exprimé. Nous espérons que la Belgique et les Pays-Bas nous rejoindront.
D’autres coopérations naissent du soutien, sans être directement liées à un programme d’armement. Possédant des équipements aériens ou navals communs, les nations réfléchissent à des synergies amenant à imaginer la génération suivante. Cela a été le cas du soutien pour les frégates Horizon : la mise en commun des rechanges a créé une dynamique de coopération pour le soutien aux FREMM.
Il y a enfin des coopérations stratégiques qui s’imposent. Les Britanniques, par exemple, sont clairement venus vers nous pour partager des recherches en matière de dissuasion nucléaire.
Tous ces schémas peuvent paraître diffus. En amont, pourtant, la réflexion est de plus en plus organisée avec l’Allemagne et le Royaume-Uni et, de manière plus large, avec l’AED et l’OTAN.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Cette démarche semble plus marquée par l’opportunisme que le volontarisme. En est-il de même dans les autres pays ? Peut-être convient-il désormais, notamment pour des raisons financières, d’accélérer le mouvement. Voyez-vous une méthodologie qui permettrait d’avancer en ce sens ?
On coopère d’autant mieux que l’on fait la guerre de la même manière, avez-vous dit. Sachant que nous menons des opérations communes avec les Britanniques et que notre effort budgétaire de défense est du même ordre, ne doit-on pas considérer que la coopération franco-britannique est la priorité des priorités ? J’aimerais, à cet égard, que vous fassiez le point sur l’application des traités de Lancaster House. J’ai l’impression que l’on a clairement identifié l’axe franco-britannique comme l’axe majeur et le seul possible, mais que l’on n’en tire pas toutes les conclusions opérationnelles.
M. Jean Launay, rapporteur. Les éléments déclencheurs et les instances de réflexion sur la coopération sont-ils formels ou informels ? Varient-ils selon la nature du programme envisagé ?
Par ailleurs, comment s’articulent les initiatives émanant de l’industrie et celles qui reposent sur des considérations opérationnelles ? Existe-t-il une primauté des unes sur les autres ? Comment s’effectue l’ajustement entre le coût inscrit au budget et le retour attendu par l’industriel – en d’autres termes, quel est le mode de formation du prix ? Estime-t-on le coût au départ et comment en suit-on l’évolution ?
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous l’avez dit, ces coopérations sont complexes et s’inscrivent dans le long terme. Permettez-moi toutefois de remarquer que le programme FREMM a abouti à la construction de plusieurs bateaux différents, qui ne naviguent pas à la même vitesse, n’emportent pas le même nombre de marins et se retrouvent quasiment en concurrence sur le marché de l’exportation ! Et l’on pourrait prendre un autre exemple dans l’aéronautique. D’où vient cette distorsion entre la volonté de coopérer et le résultat ? Il y a là une perte de temps, d’énergie et d’argent, sans compter les problèmes d’interopérabilité qui s’ensuivent. Comment éviter ces dérapages et obtenir que les réalisations finales soient conformes aux objectifs de départ ?
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Concernant les FREMM, on peut formuler l’hypothèse que les industriels et les états-majors n’avaient aucune envie de coopérer mais on a mis en exergue la coopération pour faire passer la pilule aux gouvernements.
Bref, la coopération ne sert-elle pas parfois aux industriels et aux états-majors pour mettre les gouvernements dans la seringue ?
M. le contre-amiral Charles-Henri Garié. S’agissant de la méthode, je répondrai par un exemple.
Aujourd’hui, nous travaillons avec les Britanniques – dont chacun connaît le pragmatisme – à la création d’une synergie opérationnelle avec à sa tête les deux chefs d’état-major des armées. Ce cadre commun devrait nous permettre de constituer un état-major commun ad hoc.
En outre, nous nous efforçons d’étendre la coopération aux moyens existants, qui peuvent se révéler complémentaires. Ainsi, les Britanniques disposent d’hélicoptères lourds Chinook, tandis que nous avons des hélicoptères de manœuvre en nombre plus important que les Britanniques. Nous espérons pouvoir, le moment venu, partager ces deux ressources.
Le Royaume-Uni possède aussi des drones tactiques Watchkeeper. Nous souhaiterions en acheter à l’industrie britannique, mais en coopérant ensuite avec nos partenaires pour partager les rechanges, le soutien et la formation. Nous avons d’ores et déjà envoyé des soldats de l’armée de terre se former au maniement de ces drones auprès des Britanniques.
Sur ce terrain, donc, les résultats sont satisfaisants et l’entente est bonne.
S’agissant des capacités, le Délégué général pour l’armement et son homologue britannique mènent une coopération plus méthodique, appuyés par un groupe qui rassemble les instances de la DGA et de l’état-major français et leurs équivalents britanniques. La coopération sur des projets d’armement est plus compliquée : non seulement nous n’avons pas les mêmes calendriers, mais il y a certains sujets sur lesquels nos amis britanniques n’ont, en réalité, pas envie de coopérer.
Nous développons néanmoins une démarche méthodique visant à recenser tous les sujets capacitaires. Nous disposons en France de schémas directeurs indiquant, sur trente ans, les grands axes à suivre, de manière à établir des priorités en fonction du budget disponible. Nous sommes en train de rapprocher ces schémas directeurs de ceux de nos partenaires afin d’établir une grille de lecture permettant d’explorer toutes les coopérations en termes de faisabilité et d’économies sur le plan des achats et du soutien.
Cette méthode permet de cadrer la réflexion entre états-majors et entre directions générales pour l’armement sur des sujets qui, sans cela, n’auraient jamais été explorés. Une fois ce premier travail accompli, nous rechercherons des projets de coopérations à une échelle plus fine au sein de chaque schéma directeur, programme par programme.
Une telle démarche constitue une réelle nouveauté. Nous essaierons d’appliquer la même méthode avec les Allemands. Ce que nous avons engagé laisse entrevoir une systématisation en matière de recherche de coopération.
L’AED, pour sa part, travaille sur la R&T et sur des coopérations très en amont, ainsi que sur le rapprochement du besoin opérationnel. Ce deuxième sujet est à nos yeux la base de toute coopération. Sans besoin opérationnel commun et sans rapprochement des doctrines d’emploi, on ne peut arriver à coopérer.
La coopération au sein de l’OTAN est plus difficile en raison du spectre des financements en commun. Comme le disait M. Védrine, notre intérêt est de renforcer le pilier européen de l’OTAN pour répondre au repositionnement stratégique des États-Unis en direction du continent asiatique. Or les petits pays européens, qui ont des budgets de défense réduits, préfèrent financer en commun plutôt que d’apporter leur pierre à l’édifice. Les États-Unis les encouragent en ce sens puisque l’industrie américaine s’en trouve favorisée.
Les financements en commun permettent aux petits pays de coopérer sans s’engager. La France, dont la part dans le dispositif s’élève à environ 11 %, préférerait que cet argent soit consacré au développement de l’industrie nationale et européenne. Nous avons accepté un financement commun pour le système de commandement et de contrôle (C2) du programme OTAN de défense active multicouche contre les missiles balistiques de théâtre (ALTBMD) mais nous ne voulons pas aller plus loin.
S’agissant enfin du programme FREMM, que je connais bien pour y avoir travaillé, il faut rappeler que nous avions pour toute expérience, au départ, le montage industriel extrêmement complexe et coûteux du programme Horizon et que la France, de ce fait, voulait au départ réaliser des FREMM à très bas coût. Plutôt que de construire un bateau de guerre capable de résister à des missiles de plus en plus modernes, il s’agissait de construire, en plus grand nombre, des bateaux capables, une fois touchés, de quitter la zone d’opérations. Nous avions imaginé une architecture de combat entièrement nouvelle qui aurait permis d’économiser de l’argent. Les Italiens voulaient, au contraire, tous les perfectionnements possibles.
À ces difficultés relatives au besoin militaire et au concept du bateau est venu s’ajouter la question du retour industriel. En conséquence, nous avons dû écrire un besoin commun sur la base de ce partage. Tout un travail a été fait pour pouvoir afficher une coopération, mais le résultat est là !
M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes. Il faudrait distinguer la coopération en matière d’action militaire et en matière de programmes d’armement. Si la France coopère très bien avec le Royaume-Uni en opérations, c’est moins vrai pour ce qui est de l’armement, bien au contraire. Si l’on fait le bilan des trente dernières années – le Jaguar et le Transall étant bien antérieurs – seuls deux programmes ont donné lieu à une coopération satisfaisante : le système d’armement PAAMS (principal anti air missile system) des frégates Horizon et le missile SCALP-EG, dont la France avait payé seule les frais de développement. Du reste, alors qu’il est membre de l’OCCAr, le Royaume-Uni ne participe qu’à un nombre très réduit de programmes dans ce cadre.
Les processus conduisant à décider d’une coopération sont moins « flous », que très diversifiés selon l’époque, l’objet, les pays et les industriels concernés, et chacun possède sa rationalité propre.
Il était logique, par exemple, de coopérer avec l’Allemagne en matière d’hélicoptères puisque Eurocopter a une entité française et une entité allemande. On l’a vu avec le Tigre et le NH90. De même, il est normal que des processus de coopération avec l’Italie s’engagent en matière de torpilles, Eurotorp étant un groupe franco-italien.
Autre cas de figure, celui où l’on estime que les frais de développement d’un nouveau matériel sont trop importants pour que notre pays les assume seul. Outre l’avantage que constitue le partage de ces frais, l’effet de série propre à une production en coopération permettra de mieux faire adopter le programme par le pouvoir politique et de le rendre plus réalisable financièrement et techniquement. L’exemple type est l’A400M, que ni la France ni les pays partenaires ne pouvaient financer seuls.
Le mécanisme des coopérations s’apparente à un sablier : dans le cône du haut, on trouve plusieurs États, états-majors et industriels ; la partie étroite, au milieu, correspond au processus décisionnel commun, qui lance un programme aux caractéristiques similaires ; et, dans le cône du bas, les caractéristiques se diversifient de nouveau, au gré des différentes préoccupations et spécifications. C’est ce que l’on constate aujourd’hui : les produits résultant des programmes menés en coopération ne sont pas similaires et, partant, n’apportent pas les gains attendus en matière d’homogénéité opérationnelle et de coûts de développement et d’acquisition puisque l’effet de série ne joue pas.
Pour remédier au défaut actuel de la coopération, il faudrait donc s’attaquer à la partie basse et, si je puis dire, transformer le sablier en entonnoir et s’en tenant à un produit homogène.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Comment les états-majors perçoivent-ils le rôle de la DGA dans la discussion des programmes en coopération ? Donne-t-elle un éclairage technique susceptible de rapprocher les points de vue de chaque armée ? Les méthodes des DGA des autres pays sont-elles très différentes ? Comment voyez-vous son rôle à l’avenir ?
M. Jean-Jacques Bridey rapporteur. Les états-majors estiment-ils que certains équipements ou certaines recherches ne doivent en aucun cas faire l’objet de coopérations, tant dans la conception que dans l’élaboration industrielle ?
M. le général Jean-Robert Morizot. La question sur la DGA est difficile. La DGA a un rôle essentiel car in fine une coopération n’est vraiment concrète que lorsqu’il y a un contrat qui lance un programme d’armement. La conduite de ces programmes est toujours délicate et nous apprenons, État-major et DGA, à chaque réalisation. Nous avons par exemple beaucoup appris avec l’A400M, la DGA dans la négociation avec l’industrie via l’OCCAr, les États-majors dans l’établissement et le respect des besoins opérationnels. Chacun doit jouer sa partition.
Une bonne coopération entre nous est donc essentielle. Il peut néanmoins exister des divergences, notamment lorsque plusieurs possibilités de coopération sont envisageables. La DGA pourra par exemple soutenir une idée qui lui fait entrevoir une consolidation de la base industrielle ou un abaissement du coût d’un équipement difficile à financer seul mais sur lequel nous avons du mal à converger sur le besoin opérationnel. Dans d’autres cas, l’état-major défendra une possibilité dont il aura discuté avec ses homologues des armées étrangères par exemple de l’intérêt d’opérer sur le même matériel, alors que la DGA n’y souscrit pas pour des raisons de politique industrielle. La discussion peut alors être serrée, mais elle se déroule dans un cadre établi et le ministre rend ses arbitrages.
Nous en sommes à la deuxième génération de coopérations. Nous commettons encore probablement des erreurs mais nous travaillons déjà à les corriger pour la suite, un des enjeux étant clairement l’expression des besoins.
Les discussions autour de nEUROn, par exemple, nous amènent à réfléchir à ce que sera l’aviation de combat en 2045 et à nous poser la question de l’avion de combat européen. La démarche de R&T et de coopération industrielle peut démarrer, mais les considérations opérationnelles reviennent naturellement dans le jeu. Même si des décalages se produisent et si le processus peut paraître lourd, chacune des parties est immanquablement conduite à discuter avec les autres avant que des décisions ne soient prises.
De même, nous ne pourrions jamais, dans le contexte budgétaire actuel, financer seuls des satellites militaires. Il est donc normal d’essayer de trouver une coopération, puisque le besoin existe dans plusieurs pays. Sans drones, sans satellites, sans missiles performants, une armée moderne n’est plus capable d’accomplir les missions qui lui sont demandées. Même si l’industrie française de défense est capable de développer pratiquement tous les équipements dont nous avons besoin, nous n’avons plus la capacité de développer seuls la totalité des équipements. Nous devons nous adapter, l’industrie aussi. Le processus d’« urbanisation », comme on dit en informatique, est long mais il finira par aboutir. Nous sommes en période d’apprentissage.
Il reste néanmoins, Monsieur Bridey, des domaines qui relèvent entièrement de la souveraineté. Nous ne sommes pas prêts à partager, par exemple, la technologie de nos sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, les autres pays ne le sont pas plus d’ailleurs. Il s’agit de savoir-faire élaborés pendant des dizaines d’années. Cette souveraineté étant parfois essentielle pour nos capacités opérationnelles.
M. Alain Claeys, président. Je vous remercie pour vos réponses.
Audition du 4 avril 2013
À 10 heures : Audition de M. Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement (DGA)
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, président. Monsieur le délégué général, nos questions sont simples. Comment les programmes d’armement naissent-ils ? À quels besoins répondent-ils ? La mutualisation des financements et des capacités industrielles permet-elle, in fine, de réaliser des économies, sachant que la coopération est bien souvent la condition même de la réalisation de ces programmes ?
La DGA jouant un rôle majeur en la matière, nous souhaitons vous interroger sur la manière dont sont prises les décisions « en interne », sur vos relations avec les forces armées et avec les organisations européennes de coopération et sur le sens même de la politique de coopération, c’est-à-dire sur son but et sur ses partenaires.
M. Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement. Les programmes d’armement en coopération occupent maintenant une place importante dans notre politique d’acquisition d’équipements militaires, notre principal partenaire en la matière étant le Royaume-Uni. Les investissements réalisés en coopération représentent, ainsi, environ 30 % du total de nos investissements dans l’armement, hors force de dissuasion.
Le champ des coopérations n’est pas limité et permet une gestion plus économique d’un argent public devenu rare. Mais la coopération exige des concessions et provoque parfois des frustrations.
Le flux annuel de paiements correspondants s’élève à environ 1,5 milliard d’euros, inscrits au programme 146 (Équipement des forces) de la mission Défense. Il est confié, pour 1,3 milliard, à l’Organisation conjointe pour la conduite des programmes d’armement en Europe (OCCAr) et, pour le reste, à la NAHEMA, l’agence de l’OTAN chargée de la conduite du programme d’hélicoptères NH90. Quelque 17 à 18 % de nos paiements s’effectuent dans le domaine de la recherche et de la technologie (R&T). Les quelques grands exemples de coopération sont : l’A400M, le Tigre, le NH90, le système de défense antiaérienne Météor.
Après le traité de Lancaster House de 2010, qui comportent un volet nucléaire, la coopération avec le Royaume-Uni continue de progresser. Nous collaborons aussi avec d’autres pays, notamment ceux du triangle de Weimar, spécialement la Pologne.
Une réunion commune des ministres de la défense des différents ensembles régionaux européens s’est tenue récemment. La transparence progresse, les malentendus s’estompent.
La coopération multilatérale se pratique d’abord dans le cadre de l’OTAN. Elle porte sur la défense antimissile balistique et la gestion de l’espace de défense aérienne en mettant en commun des outils de communication et de contrôle. Elle s’exerce ensuite au sein de l’Agence européenne de défense (AED).
Seule la coopération nous permet d’accéder à un certain nombre de capacités, qui seraient impossibles à développer seuls en raison de leur coût de recherche et développement. C’est le cas, par exemple, pour l’A400M.
Notre collaboration avec le Royaume-Uni porte non seulement sur les équipements mais aussi sur les technologies. Nous travaillons ensemble à un missile antinavire léger (ANL), à un système de lutte antimines qui remplacera nos vieux chasseurs de mines, à des drones tactiques – dont le contrat fut signé à la fin de 2012 et qui font maintenant l’objet d’une évaluation à Istres – à des drones de combat, à un démonstrateur de guerre des mines, à la rationalisation industrielle des missiles présents des deux côtés de la Manche et à la qualification de petits équipements.
L’Italie représente un autre partenaire historique : dans le domaine maritime, avec les frégates multi-missions et Horizon ; dans le domaine spatial, avec le programme Hélios ; pour le développement des missiles sol-air Aster 15 et 30, utilisés par l’armée de terre comme par la marine ; enfin dans le domaine électronique avec la radio tactique.
La coopération avec l’Allemagne constitue un champ d’espoirs. Les réalisations tardent mais nous discutons de l’observation de la terre, des drones MALE, des systèmes terrestres…
Le démonstrateur de drone de combat nEUROn donne lieu à un mode de coopération particulier. Nous avons demandé à Dassault Aviation, tout en conservant 50 % des parts, de réunir des industriels européens qui devront eux-mêmes motiver leurs gouvernements, ce qui a donné de bons résultats. Le premier nEUROn a ainsi volé à la fin de l’année dernière et ouvre d’importantes perspectives.
La réduction générale des budgets militaires en Europe conduit à une diminution des programmes en coopération. Les ajustements financiers ont été assez forts dans certains pays. Même les Britanniques ont procédé à quelques coupes. L’Espagne a quasiment disparu du champ des discussions, sauf sur quelques sujets marginaux. La collaboration s’est également restreinte avec l’Italie. L’Allemagne, engagée très tôt dans une politique de résorption du déficit budgétaire, a sauvegardé son effort de défense tout en se montrant très prudente à l’égard de la coopération, du fait de la professionnalisation de son armée et de l’attente des prochaines élections générales.
Redynamiser la politique de coopération exige de regarder au-delà de l’Europe. Hormis la Russie et la Chine, qui annoncent régulièrement de très grands programmes d’armement, et avec lesquels il sera difficile de collaborer au-delà des bâtiments de projection et de commandement (BPC), des pays émergents se lancent aujourd’hui dans d’importants efforts de défense : la Malaisie a accru son budget militaire de 20 % entre 2010 et 2011, l’Inde de 13 %, la Corée du Sud de 10 % et le Brésil de 9 %. Ces pays, traditionnels clients pour nos exportations, vont devenir des partenaires dans un nouveau type de coopération. Ils demandent en effet des transferts de technologies en échange de l’adoption de matériels français, ce qui doit nous inciter à investir massivement dans l’innovation, faute de quoi nous serions évincés du paysage.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Fait-on vraiment tout ce qu’il faut pour développer la coopération ? Ou faut-il aller plus loin ?
Comment concevez-vous le rôle de la DGA ? De quelle façon évolue-t-il ? Servez-vous plutôt de conseiller technique aux états-majors des armées ou bien de conseil politique au gouvernement, par exemple sur la situation des États émergents en dehors de l’Europe ? Êtes-vous outillés pour cela ? Comment vous adaptez-vous à l’évolution de la donne internationale et travaillez-vous avec vos homologues étrangers ? Jusqu’où peut-on aller dans le transfert de technologies ? Certains modèles extérieurs, parmi les homologues de la DGA, peuvent-ils vous servir ?
M. Jean Launay, rapporteur. Vous limitez-vous au suivi technique, industriel et financier des principaux programmes d’armement ou êtes-vous « à la manœuvre », pour initier des programmes ?
Comment s’établissent vos relations avec l’OCCAr ?
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. On nous annonce, après sept ou huit ans de silence à ce sujet, un Conseil européen de défense pour la fin de l’année. La DGA, et les directions équivalentes en Europe, sont-elles impliquées dans sa préparation ? Peut-on faire avancer l’éternelle question de l’Europe de la défense, qui prend une importance renouvelée avec le repositionnement stratégique des États-Unis, le débat sur le rôle de l’OTAN, la diminution quasi générale des budgets militaires et, peut-être, l’inconscience de certains gouvernements après plus de cinquante années de paix sur notre continent ?
M. Laurent Collet-Billon. La conduite de certains programmes d’armement en coopération, comme l’A400M ou le NH90, a souffert de retards montrant les limites de l’exercice et les améliorations à apporter, notamment dans les méthodes de conduite et de gestion de ces programmes.
Cela provient en partie du fait que les règles encadrant la réalisation des programmes sont très variables selon les pays. Par exemple, les pénalités de retard sont plafonnées en Allemagne. On en a mesuré les conséquences avec le Tigre.
Par ailleurs, il en va de même du comportement des administrations. En effet, la DGA discute en continu avec les industriels sur les spécifications techniques et sur les conditions d’avancement d’un programme, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays, sauf au Royaume-Uni.
Il faut évidemment aller plus loin dans la coopération internationale, ne serait-ce qu’en raison des prévisions économiques. Nous avons engagé un renouvellement massif du parc d’équipement de nos armées, notamment de toute la gamme de nos blindés moyens (véhicule de l’avant blindé, cher AMX10-RC…) Devons-nous le faire seul ou en coopération européenne ?
M. le président Alain Claeys. Qui pilote la coopération ?
M. Laurent Collet-Billon. Le ministre de la défense, bien sûr. Dans les faits, la DGA est à la source de la plupart des projets de coopération.
Les discussions menées avec les Britanniques dans le cadre des traités de Lancaster House, balayent un champ très large de thèmes, comparant nos projets de programmation militaire, confrontant nos savoir-faire techniques, considérant les concordances possibles de nos calendriers respectifs et de nos financements, examinant les possibilités de coopération industrielle, comme dans la guerre des mines pour laquelle est en cours un travail de convergence technique, calendaire et financière. Il ne s’agit là que de procédures très classiques de conduite des programmes, menées avec un autre État plutôt qu’avec nos seuls états-majors.
Le lien avec les besoins opérationnels peut s’établir de deux façons : soit les opérationnels discutent entre eux de façon constructive et on aboutit à des spécifications communes (Common Staff Targets), soit chaque « DGA » de chacun des pays se charge de convaincre son état-major d’adopter telle ou telle spécification.
M. Henri Guaino. Quels sont les exemples, depuis vingt ans, des coopérations à succès, et selon quels critères ?
M. Laurent Collet-Billon. Indiscutablement le Tigre, fabriqué par Eurocopter en coopération avec l’Allemagne, est un succès. Mais les spécifications du même matériel ne sont pas identiques de part et d’autre du Rhin, et les démarches vis-à-vis des industriels sont différentes entre la DGA et la BWB. La DGA a par exemple accompagné l’industrie privée dans l’amélioration de l’hélicoptère. Au final, cela s’est traduit dans le fait que cet appareil n’a pas pu être utilisé de la même façon en Afghanistan selon qu’il était allemand ou français…
Les frégates multi-missions (FREMM), excellents bateaux, et les frégates Horizon, en coopération avec l’Italie, sont aussi des réussites même si ces programmes n’ont pas été menés à 100 % en coopération.
Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur l’A400M, dont on attend la première livraison, qui a subi un accident industriel majeur, Airbus Military ayant mal mesuré la complexité des développements nécessaires.
La version terrestre du NH90 est excellente, comme sa version marine même si elle a pris du retard.
D’une façon générale, le principal défaut des coopérations internationales est qu’elles prennent beaucoup trop de temps. Le franchissement des jalons successifs impose en effet de recueillir à chaque fois une unanimité préjudiciable à la bonne conduite des programmes. Les discussions, en 2009 et 2010, sur les aménagements du contrat A400M ont ainsi nécessité dix-huit mois.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Quels sont les points forts et les points faibles de notre coopération avec les Britanniques ?
Le missile antinavire léger (ANL) n’était qu’une priorité relative, pour la DGA comme pour les états-majors : le pouvoir politique a-t-il ainsi disposé d’un éclairage suffisant pour prendre les bonnes décisions ? Pourquoi le dossier est-il monté jusqu’au niveau le plus élevé de l’exécutif, aussi bien en France qu’au Royaume-Uni ?
Comment s’organise la coopération avec les pays non européens ?
M. Jean Launay, rapporteur. La coopération bilatérale avec le Royaume-Uni permet-elle de surmonter les inconvénients que vous avez signalés dans la coopération multilatérale ?
L’ANL est-il bien adapté aux besoins des deux pays ?
M. Laurent Collet-Billon. Le dialogue avec les Britanniques fonctionne bien. Il touche aux domaines des missiles, des drones de combat futurs et de la guerre maritime des mines, qui représente un saut technologique par l’utilisation de drones navals. Nous pourrons déminer en toute sécurité non seulement les abords de Brest mais également, si nécessaire, le détroit d’Ormuz.
L’ANL est une facette du projet « one MBDA », société unique transmanche facilitant les transferts des biens, des personnels comme des savoir-faire, en simplifiant notamment les contraintes posées par les réglementations CIEEMG et douanière. Ce projet est indispensable pour l’émergence d’un groupe missilier plus structuré que MBDA, avec des actions de rationalisation des pôles technologiques de chaque côté de la Manche. Rappelons cependant que ce dernier est l’un des rares industriels européens à jouer sur le plan mondial aux côtés des deux groupes américains (Lockheed Martin et Raytheon) s’agissant des missiles. C’est une position à préserver. Rappelons encore que l’exportation de plates-formes aériennes navales, depuis la France ou le Royaume-Uni, ne peut se faire que grâce à une offre autonome en matière de missiles. Ce qui milite encore pour un approfondissement de notre collaboration et fait du projet « one MBDA » un projet important.
L’ANL n’embarque qu’une charge explosive modeste, à la différence des Exocet, de façon à assurer des frappes mieux ciblées. Il ne représente pas un besoin prioritaire pour les armées mais j’ai le sentiment qu’il y a une place pour ce missile, par exemple pour immobiliser, au large d’Aden, un pétrolier piraté, en tirant un ANL dans son gouvernail, plutôt que de le faire exploser avec un Exocet au risque de provoquer une marée noire. Les Britanniques ont proposé d’en supporter le financement à court terme, décalant notre prise en charge vers 2017 et au-delà. Ils en font probablement un test pour la solidité de notre coopération et la main qu’ils nous tendent peut difficilement être refusée.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Et en dehors de l’Europe ?
M. Laurent Collet-Billon. La coopération internationale est en plein bouleversement. Pour s’y adapter, la DGA est organisée en deux directions complémentaires, couvrant d’une part la zone Europe et l’OTAN, et d’autre part le reste du monde, classiquement « grand export », essentiellement l’Asie, dont l’Asie centrale, et l’Amérique Latine, et avec une supervision générale des coopérations technologiques et industrielles. La relation est à la fois multilatérale, dans les cadres OTAN et Union Européenne, et bilatérale pour les autres pays, parfois avec des volets de coopération, qui ont vocation à se développer. Cette évolution va également impliquer fortement les états-majors.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Les états-majors travaillant sur des schémas directeurs à horizon de 30 ou de 35 ans, ceux-ci doivent être partagés dans le cadre de la coopération internationale. Les industriels développent de leur côté des programmes dont la durée totale, depuis les premières études jusqu’à la fin de vie des matériels, est encore plus longue. Comment concilier ces deux visions ? Quel rôle joue la DGA en la matière ?
La France, il y a vingt ans, a apparemment manqué le rendez-vous des drones, peut-être en voulant préserver son industrie aéronautique classique. Comment éviter de reproduire les mêmes erreurs et comment la DGA peut-elle y contribuer ?
M. Jean Launay, rapporteur. La satisfaction de l’ingénieur pèse-t-elle, et de quelle façon, sur les décisions politiques ? Si oui, quel est le mécanisme de dialogue ?
M. Laurent Collet-Billon. La DGA est évidemment impliquée dans la préparation des schémas directeurs, dont elle discute régulièrement avec les états-majors, y apportant notamment ses connaissances sur les évolutions technologiques à long terme.
Mais je sais, par expérience, que trente ans, c’est bien long ! Des variations de toutes sortes se produisent à bien plus court terme.
Le partage des schémas directeurs avec nos partenaires européens soulève deux problématiques. Il faut, en premier lieu, rappeler que nous sommes les seuls, avec les Britanniques – et peut-être demain avec les Allemands – à posséder une approche capacitaire globale et à fournir un important effort de défense, dont un apport à la défense de l’Union Européenne, ce qui limite le dialogue avec les autres pays. En second lieu, il faut savoir qu’il est presque impossible de discuter à 26 ou à 27. Les séances de l’Agence européenne de défense (AED) montrent que la principale préoccupation des pays membres réside dans l’espoir de retours industriels en faveur de leur économie nationale. Tous, sauf Chypre, adhèrent à l’OTAN et aucun ne respecte la norme fixée par l’Alliance atlantique, de 2 % du PIB consacré à la défense.
Je ne crois donc qu’à l’efficacité d’un noyau dur de quelques pays européens, lui-même variable en fonction de la conjoncture financière et de la volonté de consentir un effort de défense. La Pologne y accorde, par exemple, une grande importance car elle raisonne désormais selon un schéma similaire à la France qui lie cet effort à l’industrie nationale, à la compétitivité et à l’emploi.
Nous avons, en effet, manqué le virage des drones il y a, à peu près 25 ans, malgré la coopération franco-allemande alors initiée et qui a échoué. L’Europe a besoin de drones MALE, mais sans offrir de marché correspondant à l’industrie. Les prévisions d’achat de drones MALE par la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne sont négligeables comparativement au marché domestique américain. L’analyse économique met en évidence qu’il n’est donc pas choquant d’acheter des drones aux États-Unis, pays allié, comme nous leur avons déjà acheté des avions AWACS, E2C ou C135, plutôt que de consacrer des investissements importants à développer un système national et à produire des équipements difficiles à vendre par la suite.
M. Stéphane Jourdan, magistrat à la Cour des comptes. Existe-t-il des exemples de coopération dont les inconvénients l’emportèrent sur les avantages ?
M. Laurent Collet-Billon. Oui : le radar de contrebatterie Cobra, réalisé en collaboration avec l’Allemagne dans le contexte de la guerre froide : on ne sait pas quoi faire maintenant des treize ou quatorze exemplaires que nous possédons ! Les menaces ont fortement évolué.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Comment prenez-vous en compte les nécessaires restructurations industrielles dans la hiérarchisation des programmes d’équipement ?
M. Laurent Collet-Billon. Nous entendons, avant tout, préserver la prééminence en Europe de l’industrie française d’armement, qui contribue à ce que la France soit aujourd’hui dans les cinq premiers exportateurs mondiaux. Sur les dix premières entreprises d’armement européennes, cinq sont françaises. Des rapprochements sont néanmoins possibles avec les pays souhaitant développer leur industrie de défense. C’est pourquoi, par exemple, nous encourageons Eurocopter et MBDA à collaborer avec les Polonais, dans des ateliers ou des usines.
L’industrie de défense européenne est encore en phase de structuration : aux États-Unis, plusieurs consortiums réalisent plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an et disposent donc de capacités d’autofinancement très supérieures à celles des industries françaises et européennes. Une réorganisation en profondeur de celles-ci pourrait constituer l’un des sujets du conseil européen de la fin de l’année, mais il faudrait la faire précéder par une évolution en France. Ainsi, plusieurs projets, comme le rapprochement de Thales et de Safran, sont à l’ordre du jour. De même, nous encourageons régulièrement des industriels de taille plus modeste à s’engager dans cette voie.
M. Alain Claeys, président. Nous vous remercions.
Audition du 4 avril 2013
À 11 heures 30 : Audition de M. Patrick Bellouard, ancien directeur de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr)
Présidence de M. Jean Launay, co-rapporteur
M. Jean Launay, président et rapporteur. Nous avons déjà entendu ce matin le général Jean-Robert Morizot, sous-chef d’état-major « Plans » au sein de l’état-major des armées, le contre-amiral Charles-Henri Garié de la division « Cohérence capacitaire » de l’état-major des armées et M. Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement.
M. Bellouard, M. Jean-Jacques Bridey, co-rapporteur de la mission pour la Commission de la défense et des forces armées, et moi-même souhaitons vous interroger sur le fonctionnement de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) – que vous avez dirigée de mars 2008 à mars 2013 – sur les programmes qu’elle pilote, sur la genèse des coopérations et sur leur suivi technique, industriel et financier.
M. Patrick Bellouard, ancien directeur de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr). L’OCCAr a été créée en 1998 par l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ; la Belgique et l’Espagne les ont rejoints, respectivement en 2003 et en 2005. Sa mission consiste à assurer la gestion des programmes d’armement conduits en coopération. Ceux-ci sont confiés à l’OCCAr par des États, sur la base d’un mandat dont le contenu varie selon les projets.
Pour chaque programme, les six pays membres prennent une décision d’intégration ; celle-ci autorise l’OCCAr à initier les travaux d’intégration du programme avec les États – membres ou non membres – qui se sont montrés intéressés par sa réalisation. Au moins un État membre de l’OCCAr participe à chacun des huit programmes actuellement en cours. Les États non membres prenant part aux programmes existants sont tous membres de l’Union européenne (UE), à l’exception de la Turquie – candidate à entrer dans l’Union et dans l’OCCAr – qui participe, notamment, au projet de l’avion de transport militaire A400M.
Les États suivent de très près la réalisation des programmes. Pour chaque projet, il existe un conseil de programme (Program Board), composé des directeurs de l’armement, qui fixe les orientations stratégiques du programme. Au niveau inférieur, le comité de programme est l’organe décisionnel dans lequel les États assurent le suivi de la mise en œuvre du projet ; il se réunit tous les six mois – voire davantage, si cela se révèle utile, comme pour le programme A400M dans les premières années de son lancement.
L’OCCAr dispose des meilleurs outils de gestion et rend compte régulièrement aux États – à l’occasion de chaque comité de programme et dès qu’un pays en formule la demande. Cette transparence permet aux nations d’obtenir l’ensemble des informations nécessaires au contrôle de la réalisation du programme.
Il serait souhaitable que les États délèguent davantage de responsabilités à l’OCCAr dans la gestion des programmes, afin de renforcer son efficacité. En effet, la convention qui a fondé l’OCCAr recommande de doter l’Organisation de capacités de gestion étendues, qui s’avèrent, en pratique, variables d’un programme à l’autre.
M. Jean Launay, président et rapporteur. Qui transmet les demandes des États auxquelles vous avez fait allusion et quel est le contenu de ces requêtes ? Restent-elles de nature technique ?
Vous identifiez l’augmentation de la capacité de décision de l’OCCAr comme une source d’amélioration de la gestion des programmes. Là encore, qui serait chargé de la prise de décision, qui n’appartient pas aujourd’hui – d’après vous – à l’OCCAr ? Quels sont les obstacles à cette évolution ?
M. Patrick Bellouard. La direction des opérations de la Direction générale de l’armement (DGA) pour les conseils de programme et les directeurs d’unité de management (DUM) pour les comités de programme sont chargés de la représentation de la France dans les projets – sept sur huit – auxquels notre pays participe.
La DGA élabore les spécifications requises pour le développement et la production des armements d’un programme. Après avoir été définies par chaque pays, ces spécifications sont discutées entre les participants au programme. Dans la phase d’intégration, l’OCCAr assure un simple rôle de coordination et peut émettre des avis ; ensuite les États s’engagent auprès d’elle pour lancer un programme, en lui donnant un mandat – défini par une « décision de programme » – pour le conduire. Même si les États peuvent, au cours de la réalisation du programme, adresser des demandes, on évite de modifier les spécifications pour ne pas procéder à des changements contractuels coûteux. La durée longue des programmes peut conduire l’OCCAr, en lien avec l’industriel, à proposer des améliorations aux États, ceux-ci pouvant refuser toute évolution. Il est regrettable cependant que l’OCCAr ne puisse augmenter aucun poste de dépense sans l’autorisation des États, et ce même si le montant global de l’enveloppe du programme reste identique. Revenir sur cette interdiction – jusqu’à un certain niveau financier fixé pour chaque programme et à la condition de ne pas en augmenter le coût total – permettrait d’accélérer la prise de décision et constituerait une avancée. Dans le cadre des programmes nationaux, la DGA dispose de cette faculté vis-à-vis des états-majors.
Pour le programme de l’A400M, il existe une délégation limitée qui permet à l’OCCAr d’adopter des avenants ayant un impact financier limité. Cette souplesse est quelque peu entravée par l’attitude de certains États, qui demandent à être impliqués dans l’ensemble des relations entre l’acteur industriel et l’OCCAr, ce qui alourdit les procédures. Puisque l’OCCAr est chargée de la gestion du programme, elle devrait être seule responsable de la conduite des relations contractuelles avec l’industriel, à charge pour lui de rendre compte aux États de son action.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. S’agissant des huit programmes pilotés par l’OCCAr – certains en phase d’élaboration, d’autres proches de leur achèvement –, quel bilan dressez-vous de la coopération, programme par programme ? Quels sont les échecs et les réussites, et comment l’OCCAr aurait-elle pu améliorer la mise en œuvre de certains projets et en réduire le coût si elle avait disposé de marges de manœuvre supplémentaires ?
M. Patrick Bellouard. L’A400M constitue, contrairement à ce l’on a pu entendre, le meilleur programme de coopération mis en œuvre à ce jour en Europe. Il repose sur une démarche rare d’identification des besoins communs en matière de spécifications, établie, en 1997, par les chefs d’état-major de huit États (l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie, la Belgique, le Portugal et l’Italie, ces deux derniers ayant depuis quitté le programme). Un contrat de développement et de production unique a conféré de larges responsabilités au maître d’œuvre, ce qui a permis de cantonner les interventions étatiques et de faire face aux retards de développement.
Dans la gestion de ce programme, l’OCCAr a montré toute son efficacité. Par ailleurs, l’A400M n’a pas eu à subir systématiquement la règle du juste retour industriel – contrairement à l’ensemble des précédents programmes de coopération – il est vrai grâce à l’activité civile d’Airbus, qui avait déjà développé des spécialisations industrielles en Europe. Cela a permis de répartir le travail de manière plus aisée, même si nous avons dû évidemment résoudre certains problèmes de sous-traitance.
Le calendrier était très serré, puisque le premier avion devait être livré six ans après la notification du contrat. L’industriel s’était engagé à le respecter, mais n’ayant pas pris la mesure de cette exigence il n’a pas pu honorer son engagement. Cela nous a contraints à signer un avenant – notifié en avril 2011 – pour réorganiser le programme, celui-ci restant exemplaire en termes de maîtrise du coût et du délai ; par comparaison, le vol initial du premier prototype du C-17 américain a demandé dix années, alors que cette durée suffira pour livrer le premier A400M – en mai ou en juin prochain.
La France ne participe pas au programme Boxer, mais ce programme constitue également un succès pour l’OCCAr, puisque plus de 100 véhicules ont été livrés à l’Allemagne, ce matériel étant déployé en Afghanistan à la grande satisfaction de l’armée allemande.
Le Cobra est un succès dont se félicitent la France, le Royaume-Uni – bien qu’il se soit retiré du programme – et l’OCCAr, qui affiche une grande fierté d’avoir atteint, pour cet instrument, un tel niveau de disponibilité en opération.
Il est trop tôt pour tirer toutes les leçons du programme ESSOR qui se déroule de manière satisfaisante. Le cahier des charges du programme de démonstration sera respecté avec un léger retard. Ce retard, qui n’est pas anormal pour un programme de cette nature, ne modifie pas le contrat, ni le coût initialement prévu pour les États. Je souhaite que ce programme fasse l’objet d’une seconde phase permettant de passer du démonstrateur de radio logicielle sécurisée à un système doté d’une capacité opérationnelle. Des discussions sont en cours sur ce point entre les États qui ne s’étaient engagés que sur le programme de démonstration.
Le programme FSAF-PAAMS est aussi un succès. L’OCCAr est responsable depuis l’an dernier de la troisième phase de ce programme très ancien. Il porte sur des systèmes antimissiles pour les forces terrestres mais aussi des systèmes embarqués à bord des frégates italiennes et françaises ainsi qu’à bord du porte-avions Charles de Gaulle et du porte-aéronefs italien Cavour. La capacité opérationnelle de ces systèmes, y compris anti-balistique, a été éprouvée. Les tirs des deux dernières années ont été des succès. Il reste à démontrer la disponibilité de ces matériels à un prix satisfaisant. Il convient également pour l’avenir d’éviter la remise en cause des cibles du programme qui entraîne des surcoûts.
Je n’évoque pas le programme MUSIS qui est en phase de définition
Concernant le programme Tigre, on peut regretter l’existence de différentes versions de l’hélicoptère Tigre. Ce programme comportait initialement des spécifications destinées au combat antichar en Europe centrale puisqu’il a été lancé dans les années 80 en pleine guerre froide. Les autorités françaises ont par la suite modifié les spécifications initiales pour adapter les appareils à la nouvelle donne géopolitique, contrairement aux responsables allemands, qui le regrettent sans doute aujourd’hui.
Les projections initiales étaient respectivement de 212 et 215 hélicoptères pour l’Allemagne et la France. Les Allemands disposent actuellement de 80 UHT – la version antichar de l’hélicoptère, proche des spécifications initiales. La France avait initialement commandé 80 appareils, 70 HAP – la version appui-protection – et 10 HAD – la version appui-destruction. À la faveur de l’entrée de l’Espagne dans le programme qui a en grande partie financé le développement de la version HAD, la France a pu, à la satisfaction de tous et avec un surcoût mineur, revoir sa commande pour obtenir 40 HAP et 40 HAD.
Nous sommes très satisfaits de la mise en service des hélicoptères Tigre qui ont fait la preuve, dans la version HAP, de leur capacité opérationnelle en Afghanistan, en Libye ainsi qu’au Mali. Le déploiement des hélicoptères allemands en Afghanistan, sur lequel je ne dispose pas de retour d’expérience, a obligé à des modifications de ces appareils conçus pour le combat antichar afin de les adapter au combat sur le théâtre afghan. La France a apporté des modifications moins coûteuses puisque la version HAP était déjà apte à ce type d’intervention.
L’existence de différentes versions de l’hélicoptère et de trois chaînes d’assemblage – en France, en Allemagne et en Espagne – n’est malheureusement pas génératrice d’économies, contrairement à l’A400M dont l’unique chaîne de montage est située à Séville. Un programme équivalent au programme Tigre, programme qui n’a pas été sous la responsabilité de l’OCCAr à son lancement, aurait pu être conduit à moindre coût. Je suis néanmoins satisfait, comme les forces armées, de la capacité opérationnelle du Tigre.
Le programme FREMM donne lieu à une coopération très restreinte entre la France et l’Italie. Seuls 15 % des éléments du programme sont communs aux frégates italiennes et françaises. Ce programme a fait l’objet d’un contrat unique entre l’OCCAr et un consortium réunissant d’une part DCNS, côté français et d’autre part Orizzonte Sistemi Navali, côté italien. Mais ces entreprises travaillent de manière indépendante, même si elles utilisent des matériels communs – diesel, turbine, sonar, lanceur, système de contre-mesure, etc. L’intérêt de la coopération est donc limité.
M. Jean Launay, président et rapporteur. Le programme Boxer, dont la France n’est pas partie prenante, est-il plus vertueux, en matière de prise de décision et dans son déroulement, que les autres ?
Concernant le programme Tigre, y a-t-il une place pour la décision politique ? À quel moment intervient, par exemple, le choix coûteux de multiplier les chaînes d’assemblage ? Comment cette décision s’articule avec le pouvoir de représentation octroyé à la Direction générale de l’armement ?
M. Patrick Bellouard. Le programme Boxer n’est ni plus ni moins vertueux que les autres. Le bon déroulement d’un programme repose largement sur la personnalité des représentants des nations et sur les relations entre ces derniers et l’OCCAr. Nous devons parfois nous défendre contre leurs intrusions et leur rappeler qu’ils sont tenus par les décisions antérieures. Le programme Boxer se déroule de manière satisfaisante mais nous avons par le passé été amenés à faire face au comportement assez intrusif des Pays-Bas.
La signature de la décision de programme fixant le mandat de l’OCCAr est précédée d’une discussion entre les nations et au sein de chacune d’entre elles, d’une discussion sur le contenu du programme. C’est à ce stade que l’échelon politique est sollicité, selon des modalités différentes dans chaque pays. En France, la Direction générale de l’armement rapporte au Gouvernement tandis qu’en Allemagne, le ministère de la défense rapporte au Bundestag. L’OCCAr peut se prononcer sur l’opportunité de certains choix, comme la mise en place de plusieurs chaînes d’assemblage, mais la décision politique des nations intervient en amont du mandat de l’OCCAr.
M. Stéphane Jourdan, magistrat à la Cour des comptes. Quelle est la valeur ajoutée de l’OCCAr par rapport à des structures bilatérales ou multilatérales ad hoc pour conduire des programmes d’armement ?
M. Patrick Bellouard. L’OCCAr a le mérite d’exister. Elle apporte un soutien dans la gestion des programmes d’armement en mettant à disposition des différents programmes des outils de gestion, des instruments financiers et des ressources humaines. Une structure ad hoc doit créer ses propres outils pour mener à bien un programme.
L’OCCAr permet également d’échanger sur les leçons tirées du déroulement des programmes afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Des groupes de travail sont mis en place à cet effet.
L’OCCAr permet enfin la mise en œuvre très rapide d’un nouveau programme car le cadre existe déjà. La négociation du protocole d’accord (memorandum of understanding) et de la décision de programme confiant le mandat à l’OCCAr ne porte que sur les éléments spécifiques au programme, les autres éléments de la décision étant standardisés.
Par rapport aux agences de l’OTAN, l’OCCAr est économe en matière de ressources humaines, conformément aux exigences posées par les États membres lors de sa création. Les rémunérations y sont inférieures à celles des agences de l’OTAN. Un directeur de programme à l’OTAN perçoit un salaire équivalent voire supérieur à celui du directeur de l’OCCAr qui est en charge de huit programmes.
Par rapport au modèle de « nation-cadre » que les Britanniques essaient d’imposer, en vertu duquel une nation gère un programme pour le compte des autres parties, l’OCCAr offre des garanties de transparence et de traitement équitable de tous les participants. Au sein de l’OCCAr, tous les États ont le même pouvoir et ont accès aux mêmes informations, alors que dans le cas du modèle « nation-cadre », l’État chef de file concentre les pouvoirs et peut ne délivrer que des informations choisies aux autres. Ce modèle de gestion des programmes est valable si le pourvoir d’influence d’un État est très fort – c’est le cas de la France pour le programme Hélios qu’elle finance à 80 %. Lorsque les participations sont équilibrées, ce modèle ne répond pas aux besoins.
M. Jean Launay, président et rapporteur. Merci, Monsieur Bellouard.
Audition du 25 avril 2013
À 9 heures : Audition de dirigeants du groupe EADS (programmes A400M et NH90) : M. Marwan Lahoud, directeur général délégué d’EADS, président d’EADS France, accompagné de M. Philippe Coq, directeur adjoint des affaires publiques d’EADS France, et du général Philippe Tilly, conseiller défense du président d’EADS ; M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d’Eurocopter, accompagné du général Georges Ladevèze, conseiller du président d’Eurocopter ; M. Cédric Gautier, directeur du programme A400M, président d’Airbus Military France
Présidence de M. Jean Launay, co-rapporteur
M. Jean Launay, rapporteur, président. En l’absence du président Alain Claeys, il me revient de présider cette séance, tout en assumant la fonction de rapporteur qui m’a été confiée – aux côtés de mes collègues François Cornut-Gentille, membre comme moi de la commission des finances, et Jean-Jacques Bridey, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées – pour cette mission consacrée à la conduite des programmes d’armement en coopération. Nous sommes accompagnés par deux magistrats de la Cour des comptes, M. Stéphane Jourdan, ici présent, et M. Bruno Rémond, qui est absent ce matin.
Nous entendons aujourd’hui les dirigeants du groupe EADS, pour évoquer plus particulièrement les programmes A400M et NH90. Nous accueillons donc M. Marwan Lahoud, directeur général délégué d’EADS, président d’EADS France, qui est accompagné de M. Philippe Coq, directeur adjoint des affaires publiques d’EADS France, et du général Philippe Tilly, conseiller défense du président d’EADS, M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d’Eurocopter, accompagné du général Georges Ladevèze, conseiller du président d’Eurocopter, M. Cédric Gautier, directeur du programme A400M, président d’Airbus Military France, et Mme Annick Perrimond du Breuil, directrice des relations avec le Parlement.
M. Marwan Lahoud, directeur général délégué d’EADS, président d’EADS France. La coopération en matière d’armement suit la construction de l’Europe de la défense ou en est l’un des moteurs – si tant est que cette ambition soit portée par les États membres. Or, depuis une quinzaine ou une vingtaine d’années, la dynamique qui s’était créée autour de la coopération a connu un certain ralentissement, des réticences, voire des retours en arrière. Une entreprise comme EADS, conçue dans toutes ses composantes, y compris civiles, autour de programmes en coopération, ne peut que le déplorer.
Il s’agit là d’une question politique. Chaque fois que notre pays a été confronté à une urgence opérationnelle ou à une menace – que ce soit, pendant la guerre froide, sur le territoire national ou, par la suite, sur un théâtre d’opérations extérieures –, il s’est tourné vers ses alliés européens. Pour l’intervention au Mali elle-même, opération pourtant purement française à l’origine, il a très vite été conduit à les solliciter. On constate donc un décalage entre la coopération opérationnelle, l’intégration de l’industrie à l’autre bout de la chaîne de la coopération, et, entre les deux, la disparition de toute volonté de coopérer. Lorsque j’ai commencé ma carrière à la Direction générale de l’armement (DGA), il y a plus de vingt ans, la coopération était pourtant inscrite dans les manuels scolaires de tous les jeunes et futurs ingénieurs de l’armement ou responsables de programme. Ce n’est plus le cas.
Il faut envisager la dimension économique de la coopération. Les programmes en coopération, dit-on, sont coûteux, mais il convient de distinguer la complexité d’exécution – ou les erreurs d’exécution, dont nous sommes prêts à parler dans la plus grande transparence – de ce que j’appellerais le surcoût structurel.
En ce qui concerne les erreurs d’exécution, EADS a acquis une certaine expertise qui lui permet de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je me permettrai donc deux recommandations.
Un programme en coopération, tel l’A400M, marche beaucoup mieux lorsqu’une agence exécutive contractante est dotée de tous les pouvoirs. Dans le cas du programme Meteor de MBDA, les six pays participants ont délégué l’exécution à l’un d’entre eux : l’agence contractante est l’Agence britannique d’achat de défense (British defense procurement agency). La joint-venture représente un cas de figure particulièrement mauvais, avec la création d’un nouveau bureau de programme qui a toutes les apparences de l’agence exécutive, mais n’est qu’une agence « Canada Dry », puisqu’il faut demander l’autorisation de chacun des mandants pour traiter la moindre question.
Ce qui vaut pour les agences contractantes ou pour les agences exécutives vaut pour les maîtres d’œuvre. Mieux vaut avoir un maître d’œuvre industriel établi plutôt qu’une joint-venture, un organisme ad hoc que l’on fabrique – car ce sont alors trois personnes, et non plus deux, qu’il faut mettre d’accord. La complexité s’en trouve accrue.
Quant aux surcoûts structurels, ils sont notamment liés au fait que faire à plusieurs signifie souvent faire un peu plus que lorsque l’on est seul. Dans mon manuel de jeune ingénieur de l’armement, j’ai aussi appris que la somme des coûts individuels restait malgré tout inférieure au coût pour une nation qui ferait cavalier seul. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a une erreur d’exécution.
M. Jean Launay, président. Je vous remercie du caractère direct et franc – voire sévère – de votre propos. « La coopération en matière d’armement suit la construction de l’Europe de la défense ou en est l’un des moteurs – si tant est que cette ambition soit portée par les États membres », avez-vous dit, avant d’estimer que cette dynamique était aujourd’hui ralentie. Ce constat renvoie à la responsabilité du portage. Ce portage est-il politique ou militaire ? En somme, qui commande – et qui paye ?
S’agissant du montage des opérations, les programmes bilatéraux fonctionnent-ils mieux ? C’est en tout cas une thèse que nous avons entendue.
Quant à la question des coûts, qui renvoie à celle de la décision et du portage politique, permet-elle d’envisager un avenir pour ce type d’opérations ?
M. Marwan Lahoud. Les programmes bilatéraux ou multilatéraux avec un petit nombre d’acteurs fonctionnent de manière plus efficace. Lorsque je parle de la construction européenne, je ne m’inscris dans aucun processus multilatéral institutionnel. Mon commentaire est beaucoup plus sévère, puisque même la coopération bilatérale n’a plus la cote. Cela tient à la résurgence des nationalismes que l’on observe un peu partout en Europe. Le personnel politique n’est pas suffisamment convaincu de la nécessité de la coopération pour en être un moteur. Certes, il y a des exceptions, mais, en règle générale, la volonté ardente de faire quelque chose ensemble ne s’exprime plus. Lorsque j’étais jeune ingénieur de l’armement, on nous apprenait que la première question à se poser après avoir défini ce que l’on voulait faire était de savoir avec qui – ou plus exactement avec quel Européen – coopérer. Ce n’était pas seulement une exigence dans la formation des ingénieurs de l’armement, mais une volonté politique.
Il existe une autre explication à la résurgence des nationalismes. L’expérience a montré qu’il n’est pas souhaitable de créer de nouveaux bureaux de programme, entités qui entrent en contradiction avec leur maison-mère, et que, plutôt que des joint-ventures, il vaut mieux procéder à des fusions, c’est-à-dire à des abandons de souveraineté ou d’autorité. Cela suscite un certain repli sur soi, cette fois au niveau des agences exécutives : la DGA n’a bien sûr aucune envie de céder ses prérogatives à un organisme international. C’est un réflexe qui est de l’ordre de l’inconscient. Il peut être surmonté, mais n’en contribue pas moins à remettre la coopération en question.
J’en viens à la question budgétaire. Pour avoir eu la chance de diriger quelques programmes en coopération qui ont très bien marché lorsque j’étais à la tête de MBDA, je suis convaincu que nous n’aurions pas de missiles de croisière, ni d’Aster, si nous n’avions pas coopéré. Ces programmes ont eu leur lot de difficultés. Un programme est un paquet de mauvaises nouvelles, et le bon directeur de programme est celui qui se révèle capable de retourner une situation et de trouver les bonnes nouvelles qui viendront compenser les mauvaises. Notre ambition est de développer un métier qui consiste à gérer les programmes, donc à transformer les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Vous dites qu’il n’y a plus d’incitation politique à la coopération. Comment cette incitation s’exprimait-elle dans la période précédente ? Le ministre de la défense était-il plus présent, exerçait-il une pression plus forte sur la DGA ? Ou bien celle-ci agissait-elle spontanément en ce sens ? Et comment concevoir cette pression politique ? Nous en avons un exemple avec la coopération franco-britannique, qui ne semble pas vraiment produire tous les résultats espérés.
M. Marwan Lahoud. Je ne parle pas de grandes envolées lyriques, mais de choses très terre à terre. En 1995 a été lancé un programme de drones tactiques. Deux options étaient envisageables, une option nationale et une option en coopération. Leurs qualités étaient équivalentes, mais il n’y a pas eu l’ombre d’un doute : c’est la seconde qui a été retenue. Il en allait de même pour de tout petits volumes. S’il existait une possibilité de conduire une étude en coopération plutôt qu’à l’échelle nationale, elle était systématiquement privilégiée. La coopération était donc le sésame qui permettait de déclencher le lancement d’un programme. Dans ces conditions, il n’était nul besoin d’incitations. Philippe Coq, qui a vécu ce basculement d’une période à l’autre, peut en témoigner.
M. Philippe Coq, directeur adjoint des affaires publiques d’EADS France. La consigne était en effet de faire en coopération, sauf dans les domaines relevant pleinement de la souveraineté, tels que la dissuasion ou le renseignement. Nous avons constaté un retournement qui s’est exacerbé dans les six ou sept dernières années. Il y a pourtant de moins en moins d’argent ; les programmes importants ne peuvent plus être menés seuls. Nous sommes donc contraints de partager, à moins de préférer des achats « sur étagère » aux États-Unis ou en Israël – donc de renoncer à toute production de valeur ajoutée sur le territoire national.
M. Marwan Lahoud. Le Livre blanc sur la défense de 1994 a été le premier à théoriser la coopération, en distinguant trois cercles : les équipements de souveraineté, qui doivent être faits en national, un certain nombre de produits qui peuvent être achetés « sur étagère », et le reste, qui doit être fait en coopération.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Cela n’a jamais été mis en œuvre.
M. Marwan Lahoud. En effet, puisque le volume d’activités conduites en coopération n’a cessé de diminuer depuis cette date.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Le manque de volonté politique que vous déplorez affecte-t-il notre pays ? Iriez-vous jusqu’à dire qu’il y a vingt ou vingt-cinq ans, votre groupe n’aurait pas été encouragé ?
M. Marwan Lahoud. Notre groupe n’existerait pas s’il n’y avait eu une très forte volonté de coopération entre 1970 et 2000. Pour prendre une image sans doute maladroite, la création d’un groupe comme le nôtre s’apparente à un mariage après un long concubinage. Il faut avoir travaillé ensemble sur des projets, et en avoir en commun, pour créer une coentreprise de l’importance de la nôtre. Eurocopter a ainsi été créé sur la base de deux grands projets, le Tigre et le NH90, sur lesquels les deux entreprises – la division hélicoptères d’Aerospatiale et Messerschmitt-Bölkow-Blohm – MBB – travaillaient depuis longtemps, puisque les premiers travaux relatifs au Tigre remontaient à 1977. Le NH90, lancé en 1992, est le projet commun autour duquel on mobilise Eurocopter. Airbus a démarré en 1970 ; pendant trente ans, il a donné lieu à un travail en commun entre British Aerospace (BAE), DASA, Aerospatiale et Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA), avant que toutes ces entités ne se fondent dans une même entreprise. Sans volonté de coopération, EADS ne serait pas. De même, MBDA s’est construit autour du Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP).
Bien qu’il soit plus fort dans d’autres pays européens, le repli sur soi est visible en France. Ce qui a fait la dynamique de coopération durant trente ans, c’est une forte volonté française et l’écoute qu’elle a rencontrée chez certains de nos partenaires. La France a joué un rôle moteur dans la coopération franco-allemande en matière de défense et d’armement, comme dans la coopération franco-britannique récente. Nous sommes certes plus enclins que d’autres à coopérer, mais nous sommes désormais en dessous du seuil critique qui est nécessaire pour entraîner les autres.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. La théorie des trois cercles était-elle une bonne idée qui n’a pas été exploitée ? Ce type de stratégie est-il encore d’actualité ?
L’évolution du capital d’EADS, telle qu’elle se dessine aujourd’hui, permettra-t-elle d’aller plus loin ? Le retrait des États est-il une opportunité, ou présente-t-il des risques ?
M. Marwan Lahoud. La théorie des trois cercles mériterait de rester d’actualité. Encore faudrait-il la mettre en application, avec une nuance : il y a beaucoup moins de programmes aujourd’hui qu’il n’y en avait en 1994. Cela n’enlève bien sûr rien à sa pertinence.
J’en viens à la baisse de la part des États dans le capital de notre entreprise. Le Livre blanc de 1994 avait défendu une autre théorie, celle de la séparation des rôles de l’État. Dans une industrie comme la nôtre, l’État joue plusieurs rôles : il est à la fois régulateur, client et parfois actionnaire. En pratique, aucun de ces trois rôles ne dépend de l’autre. Les évolutions récentes chez EADS montrent que les États exercent leur influence sur un groupe comme le nôtre par d’autres moyens que l’actionnariat. Il ne me semble donc pas que nous assistions à une disparition programmée des États. Dire les choses sans se cacher derrière des artifices est au contraire de nature à renforcer leur rôle au sein de l’industrie. Même si l’Agence des participations de l’État (APE) ne détenait aucune part du capital, les États auraient un pouvoir sur l’industrie de défense du seul fait de sa nature. C’est bien plus efficace que de dériver son influence via un pacte d’actionnaires où ils se cacheraient derrière des actionnaires privés. Aucune entreprise privée ne peut en effet se prévaloir d’incarner le pouvoir régalien.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous dites que, pour certains pays, il est plus facile d’acheter « sur étagère » que de s’engager dans une coopération. L’industrie française d’armement n’est-elle pas davantage tournée vers la coopération que vers la production de produits pouvant se vendre « sur étagère » ? Si tel est le cas, comment parvenir à un changement ?
M. Marwan Lahoud. Permettez-moi de donner quelques chiffres qui dissiperont cette impression. Si l’on tient compte des programmes réalisés en coopération européenne, l’industrie de défense française fait 42 % à 43 % de son chiffre d’affaires en France. Le reste – soit plus de 55 % – correspond donc à l’export, c’est-à-dire à l’achat « sur étagère » de nos produits par d’autres États. Les caractéristiques de cette industrie font néanmoins qu’un client étranger n’achète un produit français « sur étagère » que s’il est en service dans l’armée française – ou conçu pour pouvoir l’être. Il ne peut donc y avoir de substitution exclusive. Autrement dit, si l’on peut concevoir une complémentarité, l’export venant combler le manque à gagner sur le marché domestique, on ne peut remplacer le produit domestique par un autre destiné à l’export. Ce n’est pas seulement une vue de l’esprit : nous l’avons expérimenté, notamment avec Dominique Maudet chez MBDA. Nous avions développé un produit pour l’exportation, le Merlin, qui ne s’est jamais vendu, alors même qu’il était rustique, peu onéreux et disponible « sur étagère ». La première question que posent nos interlocuteurs est en effet de savoir si le produit est en service dans nos armées. Si la réponse est négative, il n’a aucune chance de les intéresser.
M. Dominique Maudet, directeur général exécutif d’Eurocopter. Sans coopération, EADS n’existerait peut-être pas ; Eurocopter, certainement pas. Mais que nous a apporté la coopération pour ces deux grands programmes que sont le Tigre et le NH90 ? Il y a vingt ans, les Américains détenaient une position dominante dans le domaine des hélicoptères : Boeing, Sikorsky et Bell écrasaient le marché – notamment à l’exportation. Depuis une dizaine d’années, Eurocopter est devenu le numéro un mondial. Les quatre « grands » du secteur sont désormais Eurocopter, avec 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, Sikorsky, avec 5 milliards, AgustaWestland et Bell – Boeing est un peu marginalisé. Cette position nous procure des devises, puisque 75 % de notre chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation. La moitié de notre production est assurée en France, non seulement par Eurocopter, mais par toute la filière aéronautique, qu’il s’agisse des moteurs, de l’avionique, des équipements électroniques. Cela représente aussi des emplois.
Il y a une cohérence dans tout cela. Notre pays jouit d’une certaine position internationale. Nos armées sont visibles : elles se déploient et ont un rôle dans le positionnement des grandes problématiques géopolitiques – avec le matériel, l’industrie et les exportations qui vont avec. Bref, il s’agit d’un dispositif global. Peut-être sommes-nous les seuls dans ce cas en Europe – ce qui constitue une difficulté supplémentaire pour la coopération européenne.
J’en viens maintenant au NH90. Deux exigences s’imposent pour le bon déroulement de ce type de programme : il faut d’une part une harmonisation des exigences des États en amont du programme, et d’autre part la création d’une véritable structure décisionnelle. S’agissant du NH90, nous avons une structure compliquée, notamment en raison de la présence d’un de nos concurrents – AgustaWestland – dans le consortium industriel. Il y a vingt ans, le Tigre a fait Eurocopter. Il s’agit à l’origine d’un projet franco-allemand, qui a été rejoint par les Espagnols, puis par les Australiens. Le NH90 associe encore davantage de pays, puisque sont venus s’ajouter aux précédents l’Italie et les Pays-Bas. Sans doute espérions-nous à l’époque fabriquer un Airbus des hélicoptères, avec les Britanniques et les Italiens ; cela ne s’est pas fait. De fait, nous sommes aujourd’hui en coopération sur un programme avec l’un de nos principaux concurrents sur le territoire européen, ce qui constitue une difficulté notable.
On évoque souvent les retards du programme NH90. Je ne reviendrai pas sur la théorie des coûts, qu’a évoquée M. Lahoud. Ce programme a deux composantes, navale et terrestre. La seconde est à l’heure. Bien que la commande française ait été passée très tard, en 2007, elle a été livrée en 2011. Quant à la composante navale, elle correspond à un appareil beaucoup plus compliqué, pour lequel nous dépendons bien plus de notre partenaire AgustaWestland qui assure la maîtrise d’œuvre de cette version, tandis que nous assurons celle de la composante terrestre. Les hélicoptères sont néanmoins opérationnels à ce jour pour les missions de sauvetage en mer et de contre-piraterie maritime.
En termes d’exportations, nous en sommes à 529 hélicoptères vendus – pour soixante et un commandés par la France. C’est bien le fait d’avoir développé un hélicoptère « sur étagère » dans un contexte européen, c’est-à-dire en regroupant les besoins de plusieurs pays, qui nous assure une certaine force à l’international. Ce succès a permis à Eurocopter d’atteindre une certaine taille et de passer à une dimension supérieure du point de vue technique et technologique, par exemple en termes de composite ou de commandes de vol électriques – nous sommes les premiers au monde à les avoir implantés sur un hélicoptère de cette gamme. Au-delà de l’aspect chiffre d’affaires, volume d’activité et emplois, nous avons franchi une marche technologique qui nous permet de mieux aborder le domaine commercial.
M. Lahoud a insisté sur la nécessité d’avoir des agences opérationnelles et décisionnelles, qui s’applique parfaitement à nos programmes – en particulier au NH90, qui est bien plus compliqué à cet égard que le Tigre, géré par l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr).
À l’origine, nous n’avions pas de standards, ce qui est une erreur. Des programmes aussi compliqués que le Rafale, l’A400M ou le NH90 imposent en effet de passer par un mode de montée en puissance, c’est-à-dire de commencer par des versions simples avant de « monter en grade » vers des versions plus compliquées, intégrant notamment des systèmes d’armes. Tous les grands programmes – en particulier en coopération – devraient prévoir cette montée en puissance échelonnée d’un point de vue contractuel – ceci afin d’éviter les renégociations de contrats.
Le NH90 est un projet de grande ampleur – 16 milliards d’euros, sachant que le chiffre d’affaires d’Eurocopter s’élevait auparavant à 3 ou 4 milliards. L’enjeu est donc de taille, y compris en termes de risque.
Pour les États, les retards sont bien sûr problématiques du point de vue de la disponibilité et de la capacité. Ce n’est pas le cas du point de vue du coût, puisque les contrats Tigre et NH90 sont des contrats à prix fixe, dans lesquels les dérives de calendrier et de coût sont supportées par l’industriel. Cela explique d’ailleurs qu’ils ne soient pas aussi rentables que d’autres pour Eurocopter. Pour l’État client, le surcoût est tout à fait acceptable.
S’agissant du report de l’affermissement de la commande française de trente-quatre NH90 transport tactique (TTH) supplémentaires – ou deuxième tranche de la version terrestre – au-delà de la date limite prévue par le contrat en vigueur, il nous appartient de faire preuve de compréhension à l’égard de notre principal client et de ses contraintes budgétaires. Nous avons donc repoussé de deux mois la date limite de passation de la commande. J’en profite pour rappeler qu’un dédit contractuel d’environ 35 millions d’euros est prévu au cas où celle-ci ne serait pas passée.
L’aspect de partage industriel est bien sûr fondamental. Le partage de ce qui est fait en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie est fondé sur les quantités pour lesquelles les États se sont engagés. Le pays qui ne respecterait pas ses engagements s’exposerait à une demande de transfert d’activité industrielle vers les autres. Cela signifierait pour nous un transfert d’activité de Marignane vers l’Italie et les Pays-Bas. Le prix des appareils est également lié à la quantité qu’il a été convenu d’acheter. Au cas où la commande d’un certain nombre d’hélicoptères – bien supérieur aux trente-quatre dont nous avons parlé – ne serait pas passée d’ici à 2020, les prix pourraient être revus à la hausse.
L’Allemagne a récemment revu ses quantités, mais elle l’a fait à budget constant, en réduisant la quantité des appareils terrestres au profit d’appareils navals qu’elle n’avait pas achetés. Elle a en quelque sorte économisé le coût d’un programme naval – qu’elle avait identifié – pour le financer sur le programme terrestre. Mais, comme le programme naval n’existait pas, il ne figurait pas dans les commandes prévues. Nous avons donc procédé à une redéfinition du périmètre des hélicoptères, à budget constant, sans impact sur l’aspect industriel. Cette renégociation a été fort bien menée par notre partenaire.
À ce jour, 141 des 529 hélicoptères vendus ont été livrés. Quasiment tous les pays volent avec le NH90. Quelques contrats – notamment avec la Nouvelle-Zélande et Oman – arrivent à échéance dès l’année prochaine. C’est d’ailleurs problématique pour le site de Marignane, qui n’aura plus d’activité – en dehors de deux hélicoptères navals – à partir de 2016. Sans la commande française des trente-quatre NH90 TTH, la chaîne de production devrait donc s’arrêter.
M. Jean Launay, président. Les prix dépendent aussi de la complexité des programmes. En dehors de l’exemple – ou du contre-exemple – de l’Allemagne que vous venez de citer, vous souhaitez éviter les renégociations de contrats. Les spécifications techniques demandées par les États sont-elles nombreuses ? Qui en prend l’initiative ? Sont-elles justifiées en termes de rapport coût-efficacité, l’efficacité dépendant de la capacité opérationnelle des appareils livrés, ou relèvent-elles du simple caprice ?
M. Dominique Maudet. Je dirais qu’il y a un peu de tout. Le NH90 est un mauvais exemple, puisqu’il en existe plus de vingt versions. Cela étant, nous sommes tous un peu responsables. Cela a commencé très en amont : les états-majors auraient dû s’accorder sur un certain nombre de configurations. Il n’y tout de même pas trente-six façons de transporter dix-neuf commandos dans un hélicoptère ! Vous savez d’autre part que les Tigre français et allemands ne sont pas identiques.
Pour reparler du partage industriel, on pourrait penser que chacun doit réaliser ce qu’il sait le mieux faire. Or il est rare que cela se passe ainsi : en général, on profite plutôt d’un programme en coopération pour se lancer dans un domaine que l’on ne connaissait pas et rattraper ses concurrents. C’est une erreur fondamentale, contre laquelle il faut lutter.
J’en viens au « juste retour ». Si les Pays-Bas achètent des hélicoptères sans avoir une industrie, il faut quand même qu’il y ait un retour. Selon moi, il faut globaliser les retours sur plusieurs programmes, et sans doute, à terme, instaurer une spécialisation. Si j’ai dit que nous étions tous responsables, c’est aussi parce que chacun fait du lobbying pour être présent sur les hélicoptères, et que les industriels vont aussi faire tout ce qu’ils peuvent dans leur pays pour avoir leur place. C’est un sujet à traiter si l’on veut réduire les coûts et les risques.
M. Marwan Lahoud. C’est pour régler ce genre de problèmes que j’ai insisté sur la nécessité d’avoir un maître d’œuvre industriel. Le cas que vient d’évoquer Dominique Maudet – à savoir celui des pays qui font ce qu’ils ne savent pas faire – se produit lorsqu’il y a plusieurs industriels autour de la table, mais pas de chef d’orchestre pour répartir le travail.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. En l’absence de chef d’orchestre, n’est-ce pas à la DGA de modérer les ardeurs des états-majors sur les spécifications et de rendre des arbitrages ? Elle est, semble-t-il, la seule en mesure de le faire, et son expertise pourrait ici être utilement sollicitée.
M. Marwan Lahoud. C’est à l’agence exécutive de programme qu’il revient de jouer ce rôle de filtre. Mais c’est aussi une question de processus et de méthode. L’instruction ministérielle sur les programmes est inspirée de ce qui s’est fait pour le développement de la force de frappe. La méthode est le fameux « V du développement » : l’objectif d’état-major est transformé en fiche de caractéristiques militaires, elle-même traduite en spécifications techniques adressées à l’industrie, qui remontent ensuite sous forme d’une offre technique. Entre l’utilisateur et l’officier d’état-major qui transforme l’objectif en fiche de caractéristiques militaires, il y a déjà un premier décalage. Celui-ci ne fera que s’accentuer : à chaque étape, chacun ajoute sa marge. Il faut rechercher un changement d’attitude et de méthode pour tâcher d’avoir des boucles courtes entre l’utilisateur et l’industriel. Cela ne signifie pas qu’il est inutile de réunir tous les acteurs autour de la table, mais que la méthode doit davantage relever du travail de plateau que de la chaîne. Tant que l’on sera dans une chaîne, chacun ira de sa précaution supplémentaire, et le produit qui sortira répondra certes à l’objectif d’état-major, mais d’une manière compliquée.
M. Cédric Gautier, directeur du programme A400M, président d’Airbus Military France. La naissance de l’A400M a été difficile, mais le premier avion de série français est enfin prêt. Il a déjà volé et subi avec succès tous les essais industriels. Les équipages français ont été formés et sont qualifiés. Nous sommes donc en train de négocier avec l’OCCAr et la DGA le démarrage du processus de livraison dans les prochains jours, afin que l’A400M puisse être présent sous les couleurs françaises au Salon du Bourget.
De par ses caractéristiques, l’A400M marque une rupture par rapport aux autres avions de ce type. En effet, il est à la fois stratégique et tactique : stratégique, car il est doté de capacités de projection, d’altitude, et d’une vitesse qui lui permettent de projeter des moyens, de la charge utile et des forces loin et vite ; tactique, car il permet d’intervenir sur un théâtre d’opérations en milieu hostile. C’est un avion polyvalent, unique en son genre, ce qui fera sa force à l’export, mais aussi sa complexité. Enfin, il peut ravitailler et être ravitaillé en vol.
Les pays qui, depuis son lancement, participent au programme avec la France sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Turquie. Nous avons déjà un premier client à l’export, la Malaisie, qui a commandé quatre avions.
Sur le plan de la coopération industrielle, il s’agit bien d’un Airbus, et la fabrication des systèmes et structures est distribuée comme pour un avion civil : la voilure est réalisée au Royaume-Uni, le fuselage en Allemagne, la pointe avant, le système électrique et les commandes de vol en France. La base industrielle est donc connue et maîtrisée.
L’histoire du programme – avec notamment les difficultés de 2009 et 2010 – est connue. On distingue deux grandes étapes contractuelles : le contrat signé en 2003, et son amendement dit 38, signé en 2011, qui a redessiné les échéances et la structure du programme afin de le rendre faisable.
L’A400M est aussi un programme de rupture technologique très ambitieux, qui a été sous-estimé par l’industriel. Il est le fruit d’une coopération internationale étendue. L’avion est certifié civil et militaire – là encore, c’est une première, qui a ses avantages et ses contraintes. Il innove en matière de technologie, avec la première voilure tout carbone, le moteur le plus puissant jamais construit dans le monde occidental et des systèmes de gestion de vol – flight management systems (FMS) – ou de gestion moteur – full authority digital engine control (FADEC) – d’une complexité très supérieure à ceux de l’A380 ou du Rafale.
Par rapport à Eurocopter, nous avons l’avantage d’avoir une organisation structurée, du côté des clients, par l’OCCAr – qui agit véritablement au nom des nations – et, du côté des industriels, par un maître d’œuvre – la société AMSL (Airbus Military Sociedad Limitada), contrôlée à 90 % par EADS. Nous mesurons tous les jours les avantages d’avoir une agence commune. Il faut toutefois qu’elle soit dotée d’un réel pouvoir et qu’elle ne soit pas, pour reprendre l’expression de M. Lahoud, une agence « Canada Dry » – auquel cas elle ne fait que ralentir les processus. Un accord trouvé avec l’agence peut être désavoué le lendemain par l’une des sept nations, ce qui nous contraint alors à reprendre tout le processus de décision. J’en ai fait l’expérience à plusieurs reprises dans les derniers mois. Tant que nous ne serons pas arrivés à une certaine maturité dans l’organisation, nous ne parviendrons pas à l’efficacité attendue dans l’exécution des programmes.
Un autre avantage du programme A400M par rapport au NH90 est que nous avons une seule et unique certification et qualification, quel que soit le pays. Il y a donc un seul standard, sur lequel peuvent bien sûr se greffer des options. Le principe est semblable à ce qui se fait dans l’industrie automobile : une version de base, à laquelle on peut ajouter telle ou telle option. C’est un point fort du programme A400M.
Autre facteur d’efficacité, il y a une seule chaîne d’assemblage ; il n’y a pas de duplication au niveau des structures.
M. Marwan Lahoud. C’est le fait d’avoir un maître d’œuvre qui permet d’obtenir ce résultat.
M. Cédric Gautier. Un programme en coopération présente un avantage certain au niveau du partage des coûts non récurrents (NRC). Le coût global de développement sera certes structurellement supérieur à celui d’un programme national, mais le coût pour un pays restera toujours plus faible que s’il devait l’assumer seul. C’est le cas pour l’A400M, dont la France finance 28 % du développement.
Le deuxième avantage est que le coût unitaire d’un avion commandé à 170 exemplaires sera nécessairement très inférieur à celui d’un avion commandé à cinquante exemplaires par une seule nation.
Parmi les inconvénients, il faut noter la complexité structurelle liée au fait que l’on travaille à plusieurs. Pour pallier cet inconvénient, il faut éviter que, dans les fiches de spécifications, le produit ne devienne l’enveloppe de toutes les demandes nationales. À un moment donné, chacun des clients doit accepter que toutes ses contraintes nationales ne soient pas couvertes, sans quoi le cahier des charges est irréalisable. Cela a été le cas pour l’A400M ; c’est la raison pour laquelle quelques options maximalistes ont été retirées lors de la renégociation du contrat en 2011.
Je ne reviens pas sur les règles du retour géographique. C’est toujours une contrainte, même si, dans notre cas, le fait d’avoir un seul maître d’œuvre industriel permet d’assurer une régulation. On ne peut cependant faire abstraction du fait qu’une nation qui commande un certain nombre d’avions doit, d’une manière ou d’une autre, voir un retour. Ce sont les contraintes intrinsèques des programmes en coopération, mais j’ai la faiblesse de croire que leurs avantages l’emportent sur les inconvénients.
En ce qui concerne les coûts, le programme a été revu en 2011, pour un montant total d’un peu plus d’une vingtaine de milliards d’euros. Il n’y a pas de montants par tranche, mais un prix de l’avion de base et un prix des options, avec une formule de révision de prix – qui devra tôt ou tard être revue, car elle est complètement déconnectée de la réalité des évolutions de prix dans le secteur de l’aéronautique.
Le prix est bien sûr lié à la fois aux quantités commandées et aux cadences. Comme pour le NH90, le contrat prévoit que, si une nation réduit ses commandes, un dédit est dû, puisque l’économie du programme s’en trouve profondément modifiée.
M. Jean Launay, président. Je me demandais si, lorsqu’elle doit assurer le suivi technique, financier et industriel du programme, l’OCCAr est vraiment facilitatrice, utile et indispensable. Mais M. Gautier et M. Lahoud y ont amplement répondu.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Pouvez-vous développer votre réponse sur les coûts ? Où en est-on ? Comment s’amorcent les discussions ? Les perspectives à l’export sont-elles encourageantes ?
M. Cédric Gautier. Le contrat qui a été renégocié en 2011 redéfinit clairement les objectifs du programme, avec un échelonnement progressif des standards militaires et une nouvelle planification, ainsi qu’une augmentation d’une dizaine de centiles de la contribution des nations. Les coûts pour l’industriel sont malheureusement très élevés : nous avons provisionné plus de 4 milliards d’euros de pertes sur ce programme. Nous avons la ferme volonté de l’exécuter sans dépasser cette enveloppe.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. À quel niveau d’exportations faut-il parvenir pour stabiliser la situation et éviter le gouffre ?
M. Cédric Gautier. Il faut découpler le contrat de lancement, sur lequel nous avons en effet passé des provisions, et notre objectif de remporter des contrats profitables à l’export. Nous avons une farouche volonté de développer ce programme à l’export. Nous n’en avons guère fait état jusqu’à présent, car nous devions concentrer nos efforts sur le développement – cinq avions d’essai volent quasiment jour et nuit dans le cadre du programme d’essais. Nous approchons d’importantes échéances et allons entrer dans une phase commerciale active. C’est pourquoi il est capital que l’A400M soit présent – sous les couleurs françaises – au Salon du Bourget. Comme l’a expliqué M. Lahoud, il ne pourra se vendre que s’il est en service dans nos armées.
M. Marwan Lahoud. La question de M. Cornut-Gentille est inspirée par une illusion que les industriels, la DGA et les agences exécutives ont entretenue pendant des années : le programme A400M aurait été comparable à un programme civil. Or il s’agit bien d’un programme militaire. M. Gautier a décrit le modèle d’affaires des programmes militaires : d’abord le lancement, puis le développement initial pour les marchés domestiques, enfin l’exportation pour réaliser un profit et sans laquelle le modèle ne serait pas tenable. Les problèmes rencontrés en 2009 et 2010 ont dissipé l’illusion : les marchés domestiques nous permettent de développer nos produits, mais c’est à l’export que nous réalisons des profits.
M. Stéphane Jourdan, auditeur à la Cour des comptes. Vous avez évoqué les limites de l’OCCAr. En tant qu’industriels, estimez-vous qu’il est préférable de travailler avec l’OCCAr ou avec une DGA qui serait l’agence unique pour l’ensemble des partenaires ?
Par ailleurs, le fait d’être en coopération est-il un avantage pour développer l’exportation, ou cela a-t-il au contraire des inconvénients ?
M. Cédric Gautier. Je ne parlerai pas de « limites de l’OCCAr », car il suffirait d’appliquer les statuts à la lettre pour que la situation s’améliore. Il y a en effet un écart entre les attributions de l’OCCAr et la liberté dont elle jouit dans la réalité. Mieux vaudrait la laisser exercer la plénitude de ses pouvoirs. Certes, on observe un certain abandon d’autorité des agences nationales, mais ce serait, je crois, un gage d’efficacité pour la conduite des programmes.
M. Marwan Lahoud. Nous pouvons trouver tous les modèles dans les programmes en coopération. J’ai évoqué tout à l’heure le programme Meteor, dont l’agence exécutive est la British Defense Procurement Agency. Si ses statuts étaient pleinement appliqués, l’OCCAr aurait un réel pouvoir. Quant à savoir s’il aurait été préférable d’avoir la DGA comme agence exécutive pour le programme A400M, c’est difficile à dire. Ce qui est certain, c’est qu’il y aurait eu une agence exécutive détenant tous les pouvoirs. C’est finalement cela qui importe.
M. Dominique Maudet. Nombreux sont les exemples qui témoignent, pour Eurocopter, de l’intérêt de la coopération européenne, car le monde regarde davantage l’Europe que nous ne le faisons nous-mêmes. Je me rends la semaine prochaine en Australie : un hélicoptère qui a été choisi par la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie a toutes les chances de l’être par ce pays. S’ils sont conçus par les seuls Français, le Tigre et le NH90 ne peuvent l’emporter contre l’Apache ou le Black Hawk américains.
Un autre exemple illustre l’intérêt de la complémentarité franco-allemande. Il y a une dizaine d’années, Eurocopter a remporté un contrat de 350 hélicoptères aux États-Unis. Compte tenu de l’état des relations franco-américaines à l’époque, nous n’aurions jamais pu l’espérer si nous n’avions pas été aussi allemands. Nous avons d’ailleurs mis cette qualité en avant pour remporter le contrat.
M. Jean Launay, président. Permettez-moi, pour finir, d’aborder une question qui ne touche pas directement au sujet, monsieur Lahoud. Ayant eu la chance de visiter la semaine dernière l’unité de Casablanca d’EADS Sogerma, je souhaitais vous interroger sur la stratégie d’EADS en termes de localisation et d’emplois. Les difficultés évoquées dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle sur la conduite des programmes d’armement en coopération pèsent-elles sur vos choix en la matière ?
M. Marwan Lahoud. Quatre-vingt-quinze pour cent de nos effectifs sont implantés dans nos quatre pays domestiques – la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Outre l’usine de Sogerma au Maroc, nous avons une chaîne d’assemblage en Chine ; nous en lançons actuellement une autre aux États-Unis. Jusqu’à présent, notre stratégie de localisation correspondait à une approche d’ouverture de marchés. Ce n’est pas le cas pour Sogerma au Maroc, mais c’est l’exception qui confirme la règle. Le poids de notre présence en Europe, en particulier dans l’hypothèse d’un renforcement de l’euro, nous conduit néanmoins de plus en plus à nous interroger sur notre localisation. Notre activité est en forte croissance : nous n’allons donc pas supprimer des postes en Europe pour en créer ailleurs. Sur les cinq dernières années, nous avons d’ailleurs créé plus d’emplois en Europe qu’en dehors de l’Europe. Ce rapport est-il appelé à s’inverser ? C’est une question qui est désormais posée. Le principal critère pour y répondre sera le coût du travail et des facteurs de production en général en Europe et ailleurs. Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Nous avons eu l’occasion d’en parler avec les autorités françaises et allemandes. Contrairement à d’autres industries, nous n’avons pas une approche agressive de la question. Nous sommes très attachés à notre enracinement européen, qui fait notre force. Il reste que l’évolution du coût des facteurs de production ne joue pas en faveur de la France.
Notre ancien patron a fait des propositions en matière de compétitivité, mais les décisions prises ne vont pas assez loin pour être intéressantes pour EADS. Nous sommes une industrie de personnels qualifiés. Or le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ne concerne guère plus de 2 % de nos salariés. Son impact sera donc limité à une vingtaine de millions d’euros pour 2013. Ce n’est certes pas négligeable, mais, à l’échelle du groupe, on ne peut qualifier cela de choc de compétitivité, d’autant que le changement de législation en matière de fiscalité des participations nous coûtera 24 à 25 millions d’euros. Je m’en suis ouvert à Louis Gallois, qui m’a expliqué qu’il aurait voulu aller plus loin et fixer le plafond des salaires concernés à 4, voire à 5 SMIC au lieu des 2,5 qui ont été retenus. Le coût des facteurs de production commence en tout cas à nous poser de sérieux problèmes.
M. Cédric Gautier. J’ai dirigé Sogerma et j’ai été président d’EADS Maroc Aviation. Il faut se méfier du mot « délocalisation ». Nous ne sommes pas dans le secteur textile, où l’on délocalise massivement. Pour notre part, nous avons identifié pour chacun des work packages de Sogerma les activités à faible et à forte valeur ajoutée. Nous avons envoyé le bas de la chaîne de valeur à Maroc Aviation. C’est dans ce sens que j’ai développé cette entreprise. Cela nous a permis de gagner des appels d’offres supplémentaires, Sogerma étant fortement orientée vers l’export. Paradoxalement, et comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer en Poitou-Charentes, plus nous avons envoyé de charge à Maroc Aviation et plus nous en avons créé à Bordeaux et à Rochefort, car cela nous permettait d’être compétitifs sur l’ensemble du work package. La vision superficielle de la délocalisation véhiculée par les médias ne permet pas de rendre compte de ce phénomène, qui est une force dans le domaine de l’aéronautique.
M. Jean Launay, président. Vous noterez que je n’ai pas parlé de « délocalisation », mais de « localisation ». Votre successeur à Casablanca nous a d’ailleurs bien expliqué comment fonctionnait le renvoi de charge en France. La question méritait néanmoins d’être posée à l’heure où l’on parle de retour de l’emploi en France. Quant au concept de « co-localisation », je le fais volontiers mien.
M. Marwan Lahoud. C’est un sujet stratégique pour la maison EADS. Nous savons bien gagner des marchés en transférant de la production. Mais cette question se pose désormais avec acuité. Nous avons créé plusieurs milliers d’emplois par an en France pendant les quelques années écoulées ; nous comptons continuer. J’espère néanmoins que le choc de compétitivité n’est qu’une première étape et que le Gouvernement ira un peu plus loin dans cette direction. Certes, cela représente un coût pour l’État, mais c’est bon pour l’industrie et pour l’emploi.
M. Jean Launay, président. Nous vous remercions pour ces échanges qui seront précieux pour nos travaux.
Audition du 25 avril 2013
À 9 heures : Audition de M. Antoine Bouvier, président-directeur général de MBDA, accompagné de M. Olivier Martin, secrétaire général de MBDA France, de l’amiral Jean-Pierre Tiffou, conseiller défense du président.
Présidence de M. Jean Launay, co-rapporteur
M. Jean Launay, rapporteur, président. Nous recevons maintenant, sur le thème : « La conduite des programmes d’armement en coopération », M. Antoine Bouvier, président-directeur général de MBDA, accompagné de M. Olivier Martin, secrétaire général de MBDA France, de l’amiral Jean-Pierre Tiffou, conseiller défense du président, et de Mme Patricia Chollet, chargée des relations avec le Parlement.
M. Antoine Bouvier, président-directeur général de MBDA. La coopération européenne est au cœur du modèle de MBDA, car elle permet la consolidation et l’intégration de l’industrie de défense. En effet, la coopération n’est pas un objectif en soi : c’est un moyen pour atteindre la taille critique, permettant ainsi d’assurer la pérennité de l’industrie de défense en Europe.
La question de la taille critique, c’est-à-dire de la capacité de l’entreprise à investir dans la technologie, dans le développement de la gamme de produits et dans la présence commerciale, est essentielle pour garantir notre position de leader mondial. Le chiffre d’affaires de chacun de nos deux concurrents américains – Raytheon et Lockheed Martin – est supérieur à l’ensemble des budgets missiles de l’ensemble des pays de l’Union européenne. L’intégration et l’exportation sont nécessaires aux industries européennes de défense – les budgets européens ne suffisant pas à maintenir leur taille critique, une notion essentielle si nous voulons conserver notre position de leader mondial non seulement face à nos concurrents américains, mais également, demain, face aux entreprises des pays émergents.
Cette notion de taille critique ne répond donc pas seulement à une préoccupation financière. Le chiffre d’affaires de MBDA s’élève à 3 milliards d’euros : il représente entre 20 % et 25 % du marché mondial. Si MBDA est légèrement plus petit que Raytheon et légèrement plus gros que Lockheed Martin, la différence essentielle entre nous et nos deux concurrents américains, c’est que, sans compter nos clients dans le reste du monde, nous avons, pour la seule Europe, autant de clients qu’il y a de pays européens, tandis que nos concurrents américains ont un client principal, le Pentagone. Alors que nos concurrents américains ont toute latitude pour optimiser leur base industrielle entre leurs différents sites sur le territoire américain, nous avons encore des progrès à réaliser en matière d’optimisation de notre base industrielle et d’intégration de nos activités dans les différents pays européens.
L’objectif de taille critique n’est donc pas seulement quantitatif : c’est aussi un objectif d’organisation industrielle et de consolidation de la demande. La taille critique pour MBDA ne peut être assurée qu’avec la mise en place de programmes en coopération au plan européen, ce qui implique de progresser dans l’intégration et l’optimisation de la base industrielle. Ces deux aspects sont directement liés.
Si MBDA est en avance en Europe en matière de spécialisation, d’intégration et de consolidation industrielle, nous sommes encore très défavorisés par rapport à nos concurrents américains sur la consolidation de la demande. C’est la raison pour laquelle les programmes en coopération sont aussi importants.
Je le répète, la coopération est un moyen avant d’être un objectif. En effet, pour les gouvernements européens, la coopération, c’est le moyen de partager des ressources rares : elle permet à chaque État de n’assumer qu’une part de ses dépenses de développement de nouveaux programmes tout en lui garantissant une plus grande efficacité grâce à des séries de production plus longues. Pour les États, la coopération est donc une réponse aux pressions qui s’exercent de manière de plus en plus forte sur les budgets de défense. Pour les industriels, la coopération entre les pays européens sur les programmes est le moyen d’obtenir la taille critique et de développer une position d’acteur global en utilisant au mieux des ressources financières qui se font de plus en plus rares. En effet, les budgets de défense européens étant de plus en plus contraints, MBDA n’a plus les moyens de développer des programmes concurrents en France et au Royaume-Uni : ce serait faire le plus mauvais usage des deniers publics. L’intérêt des États et celui de l’industrie sont donc soumis à la même problématique. Notre stratégie de champion européen et d’acteur global, qui vise à nous positionner sur le long terme face à nos concurrents américains, a donc besoin de programmes en coopération. Je le répète : rien ne serait plus inefficace que de dupliquer nos programmes pour nos différents clients européens.
Les conditions du succès des programmes européens en coopération sont au nombre de trois.
La première est liée à l’expression des besoins des forces armées en vue d’assurer la convergence des besoins opérationnels des différents pays qui décident de lancer une coopération. Pour rencontrer le succès, cette convergence doit être réalisée très en amont, l’industrie procédant à une analyse de la valeur, qui consiste dans un processus itératif permettant de chiffrer, sur le plan des risques techniques, des délais et des coûts, les évolutions des performances de l’équipement demandées par les forces armées. Ce processus permet d’obtenir une optimisation de la spécification et de l’expression des besoins capacitaires. Encore une fois, plus ces besoins sont exprimés en amont, plus le processus itératif se révélera efficace et plus la convergence sera réussie.
Je prends un exemple. Il paraît maintenant acquis que le programme antinavire léger (ANL) a fait l’objet d’une décision au plus haut niveau – je ne peux que m’en réjouir même si nous en attendons toujours l’annonce officielle. MBDA travaille sur ce programme franco-britannique depuis presque cinq ans. À l’origine, les besoins opérationnels exprimés par la Marine nationale et par la Royal Navy étaient très différents en matière de performances et de solutions techniques. Si l’industrie n’a aucune légitimité pour définir les besoins opérationnels, elle a en revanche un rôle essentiel à jouer dans la convergence de ces besoins en éclairant les deux marines sur les conséquences de leurs choix en termes de coûts, de risques techniques et de calendrier. C’est ce qu’elle a fait.
Amiral Jean-Pierre Tiffou, conseiller défense du président. L’industrie apporte également des moyens de simulation aux futurs utilisateurs pour éclairer leurs choix.
M. Antoine Bouvier. L’industrie a documenté les différentes solutions techniques : que voit le tireur sur son écran, de quelles fonctionnalités dispose-t-il, quelles sont les interfaces homme/machine ? Ce processus a permis de faire converger très en amont les besoins opérationnels des marines française et britannique, afin d’optimiser les spécifications du produit.
La deuxième condition est d’avoir en face de soi un client solide. Rien n’est pire pour un industriel que d’avoir affaire à un client faible sur les plans technique ou contractuel, incapable de prendre des décisions. L’industriel a besoin d’un client fort, qui a une bonne expertise technique et qui est capable de prendre des décisions sans être contraint par un environnement ingérable sur les plans hiérarchique et réglementaire. Le client idéal doit donc avoir la délégation des différents pays, ce qui permet de garantir le processus de décision. Compétence technique, réactivité et capacité de décision : telles sont les caractéristiques du bon client, vu de l’industriel.
La troisième condition de la réussite consiste, pour le client, à avoir en face de lui un maître d’œuvre industriel tout aussi solide. Pour des raisons structurelles de prise de décision, ce ne saurait être un groupement d’intérêt économique (GIE). Le maître d’œuvre doit en effet avoir la capacité industrielle, technique et contractuelle de prendre les bonnes décisions et de maîtriser l’ensemble de ses programmes. C’est pourquoi le maître d’œuvre le plus efficace ne peut être qu’une société européenne comme MBDA, qui, si je prends l’exemple du programme Meteor, est présent dans quatre des six pays que regroupe ce programme – France, Italie, Royaume-Uni et Allemagne –, possède une filiale espagnole spécifiquement dédiée à Meteor et entretient des relations de sous-traitance avec la Suède. La maîtrise d’œuvre industrielle de ce programme est donc assurée par une entreprise européenne qui, étant maîtresse de son circuit de prise de décision, a la capacité de procéder en interne aux bons arbitrages.
En revanche, lorsque le maître d’œuvre coopère avec des entreprises autonomes concurrentes sur les autres activités, le processus de décision est plus incertain. MBDA, dans le partage des tâches comme dans l’application et la mise en œuvre des projets, a évidemment intérêt à ce que chaque pays contribue au programme européen par ce qu’il sait le mieux faire. Au contraire, en cas d’entreprises concurrentes, chacune essaie de se positionner par rapport à l’autre. Dans le cadre d’un programme comme Meteor, MBDA a cherché à atteindre la meilleure organisation industrielle possible. Le partage des tâches entre les différents pays doit consister dans l’addition de leurs forces et non dans celle de leurs faiblesses.
Les conditions qui sont valables pour les programmes en coopération le restent pour les programmes qui ne sont pas en coopération : travailler suffisamment en amont pour réduire les risques technologiques et permettre la meilleure spécification possible, disposer d’équipes compétentes et avoir des objectifs réalistes. Ces conditions sont génériques.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Vous avez évoqué le travail préparatoire, qui est indispensable pour rapprocher les points de vue des états-majors dans le cadre des programmes en coopération. Dans le cas du programme ANL, qui est un exemple intéressant à tous points de vue, qui a pris l’initiative de réunir les états-majors et de leur demander de discuter en amont avec les industriels ? C’est un fait : ce travail préparatoire n’est pas toujours mené. Dans le cas d’ANL, est-il une initiative des industriels ? Le pouvoir politique a-t-il fait pression sur les états-majors ?
M. Antoine Bouvier. MBDA n’a reçu aucune instruction et je pense qu’il en est de même des états-majors. Nous entretenons simplement, tant en France qu’au Royaume-Uni, des relations très confiantes avec les deux marines. Que l’entreprise soit située en France ou au Royaume-Uni, MBDA fonctionne comme une seule et même entité. Alors que le besoin exprimé par les Britanniques n’était pas partagé par les Français il y a quelques années, les discussions entre les marines française et britannique ont permis aux besoins opérationnels de la Marine française et de la Royal Navy de mûrir. MBDA a également pris l’initiative d’organiser des séminaires, au cours desquels nous avons présenté et chiffré les différentes options techniques.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Il s’agit d’une démarche commerciale intelligente.
M. Antoine Bouvier. MBDA est une entreprise intégrée : au Royaume-Uni et en France, la ligne hiérarchique et les équipes sont les mêmes. Je le répète : elle fonctionne en France et au Royaume-Uni comme une seule entité. C’est la raison pour laquelle nous avons pu leur apporter un plus.
Amiral Jean-Pierre Tiffou. Je suis arrivé à MBDA en 2008.
L’entreprise a compris que, tout en souhaitant depuis plusieurs années disposer d’un missile antinavire léger tiré à partir d’hélicoptères embarqués, la marine française avait conscience de ne pas pouvoir l’obtenir dans le cadre d’un programme national. Aussi avons-nous réuni des pilotes français et britanniques d’hélicoptères, d’avions de patrouille maritime et d’avions de chasse en vue de réfléchir en commun à la meilleure solution technologique, dans le cadre d’un rapprochement des besoins opérationnels.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Ces résultats ont été obtenus grâce à la structure industrielle intégrée de MBDA et à ses bonnes relations avec les marines française et anglaise. Ce modèle peut-il être transposé par exemple au sein du groupe EADS ?
M. Antoine Bouvier. Cela pourrait tout à fait être le cas, et c’est même ce qui s’est déjà produit dans le domaine spatial avec le projet MUSIS ou, avec plus de difficultés, en raison de l’alternative Syracuse, avec les propositions sur Skynet 5, et pour un certain nombre de programmes d’hélicoptères.
Il est certain que la confiance et la proximité avec le client jouent un rôle essentiel. Quant à l’intégration de la structure industrielle, elle rend à coup sûr les choses beaucoup plus faciles.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Le programme de missile antinavire léger ANL ne peut être comparé à celui du Rafale ou de l’A400M, mais, malgré sa relative modestie, on comprend aisément qu’il est stratégique, aussi bien sur le plan industriel que pour la relation franco-britannique. Malgré cela, il a fallu que le Premier ministre britannique saisisse directement le Président de la République pour le faire avancer ! Pourquoi la DGA ou les états-majors n’éclairent-ils pas suffisamment le pouvoir politique sur l’importance des enjeux ?
Il semble que certains sujets, parfois majeurs, soient gérés au jour le jour sous un angle technique, mais sans vision stratégique. Je ne cherche pas des coupables ; je souhaite seulement que les choses s’améliorent. Aujourd’hui, nous ne prenons pas assez en compte en amont les nécessités de la coopération et les questions stratégiques et industrielles. Comment y parvenir ? Dans quelle mesure la façon dont nous sommes organisés explique-t-elle ces difficultés ?
M. Antoine Bouvier. Ma réponse ne pourra concerner que l’aspect industriel du problème. D’expérience, nous savons que, pendant la période de préparation d’un Livre blanc, il est extrêmement difficile de prendre des décisions, car elles anticiperaient sur les arbitrages à venir et sur le vote de la loi de programmation militaire. Ainsi, lorsque, en 2008, un client potentiel se proposait de financer la majeure partie d’une feuille de route européenne sur la défense antimissile jusqu’à l’Aster block 2, il ne nous a pas été possible d’obtenir une décision, car la réflexion sur le Livre blanc était en cours.
S’il ne pèse pas très lourd budgétairement, le programme Antinavire léger est essentiel en termes de coopération européenne. La période actuelle n’était sans doute pas la plus propice, mais les enjeux, qui dépassent largement la question des missiles antinavires, auraient pu être pris en considération plus tôt. Fait exceptionnel en ce qui concerne un programme d’envergure apparemment limité, le Premier ministre britannique a écrit au Président de la République pour désigner l’ANL comme un besoin prioritaire et comme un test pour la coopération franco-britannique. J’avoue que, des deux côtés de la Manche, nous avons contribué à faire comprendre l’importance du programme : en octobre, lorsque nous avons compris que la situation n’évoluait pas dans le bon sens, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour mettre en lumière les enjeux.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Quels sont-ils selon vous ?
M. Antoine Bouvier. Ils ne peuvent pas tous être rendus publics, car le sujet est très sensible.
Le programme ANL conditionne la mise en œuvre de douze centres d’excellence. Autrement dit, il conditionne la poursuite de la coopération franco-britannique dans le domaine des missiles. Pour rétablir l’équilibre avec notre partenaire, il faut donc qu’il s’engage avec nous, en commençant par l’ANL. Les centres d’excellence auront ensuite valeur de test.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Les enjeux sont tels que la décision coulait de source. Le problème n’est donc pas seulement lié au fonctionnement des structures ; il y a bien des processus de décision à revoir dans notre pays.
M. Antoine Bouvier. En tout état de cause, on peut se féliciter que la confirmation de l’importance du programme ANL, de l’approche « One MBDA » et de la coopération franco-britannique soit venue du plus haut niveau de l’État de façon publique !
M. Jean Launay, président. M. François Cornut-Gentille exerce en quelque sorte un devoir de suite puisque nous nous sommes saisis de ce sujet dès la préparation de l’examen du projet de loi de finances pour 2013.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Monsieur Bouvier, les quatre conditions nécessaires au succès d’une coopération que vous nous présentiez sont-elles remplies, alors que nous traversons une période globale de frilosité, en particulier sur le plan industriel ?
M. Antoine Bouvier. Il est vrai que, paradoxalement, plus les programmes en coopération sont nécessaires, plus les conditions de leur mise en œuvre sont difficiles à réunir. En effet, la réduction des budgets rend les coopérations indispensables en même temps qu’elle entraîne de l’incertitude et un manque de visibilité, tant pour les États que pour les industriels, et qu’elle conduit à un repli des nations sur elles-mêmes.
Les difficultés actuelles ne sont évidemment par étrangères aux errements du programme ANL. Je rappelle tout de même que, pour ma part, je m’étais formellement engagé auprès de la DGA à ce que MBDA dégage des marges de manœuvre sur les autres programmes deux à trois fois supérieures au montant nécessaire pour financer ce programme pour la période 2013-2020.
Cela dit, il n’y a pas d’alternative. La taille critique reste notre obsession, et elle ne peut être atteinte que grâce à la coopération, à la consolidation de la demande et de l’offre. Si nous n’atteignons pas la taille critique, si nous ne coopérons pas, si nous ne restructurons pas l’industrie, dans dix ans, nous ne serons plus là !
M. Stéphane Jourdan, auditeur à la Cour des comptes. Des structures communes comme l’Agence européenne de défense ou l’OTAN peuvent-elles aider les clients à faire converger leurs besoins ?
M. Antoine Bouvier. Parce qu’ils touchent au cœur de la souveraineté, certains sujets, comme la frappe dans la profondeur, ne peuvent pas – au moins à ce stade – relever d’une structure telle que l’Agence européenne de défense. Cette question doit par exemple être discutée dans le cadre franco-britannique, même si nous essayons d’y associer progressivement, dans un deuxième cercle, d’autres nations européennes comme l’Italie, qui utilise le missile Scalp, l’Allemagne, la Suède et l’Espagne qui disposent du missile Taurus – les six nations concernées étant les signataires de l’accord-cadre pour la mise en œuvre de la Letter of Intent (LoI) de 1998 visant à faciliter la restructuration et le fonctionnement de l’industrie européenne de l’armement.
En revanche, il est des sujets sur lesquelles l’Agence européenne de défense a un véritable rôle à jouer comme en ce qui concerne le remplacement à l’horizon 2020 des différents systèmes européens de défense aérienne à courte portée – en particulier ceux de l’Europe de l’Est. Les industriels ne peuvent pas agir seuls, pas plus que les partenaires de la LoI – la France et la Grande-Bretagne ne sont en mesure de fédérer les besoins communs à de nombreux pays. MBDA dialogue avec l’Agence européenne de défense sur un certain nombre de sujets comme le ravitaillement en vol, le combat terrestre – afin de permettre la coopération des pays équipés en missiles Milan –, le projet générique de frappe air-sol, ou le projet de défense aérienne de courte portée.
Nous avons une bonne expérience du travail avec l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr). Il nous semble que ses membres pourraient toutefois lui accorder des délégations plus larges.
M. Jean Launay, président. Monsieur Bouvier, je vous remercie pour les éclairages que vous nous avez apportés.
Audition du 23 mai 2013
À 9 heures : Audition des attachés de défense et d’armement de l’ambassade de France à Berlin, général Philippe Chalmel et ingénieur en chef de l’armement Yves Marie Gourlin
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, président. Nous entendons aujourd’hui des attachés de défense et d’armement de nos ambassades à Berlin, Londres et Rome. L’objectif de la mission est d’analyser la conduite des programmes d’armement du point de vue politique, industriel, technique et financier. Les auditions auxquelles nous allons procéder ce matin devraient nous permettre de connaître plus précisément la teneur et la portée des programmes actuellement menés en coopération avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie, ainsi que les attentes de nos principaux partenaires européens en matière de défense.
M. le général Philippe Chalmel, attaché de défense près l’ambassade de France à Berlin. Monsieur le président, Messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, c’est toujours un plaisir et un honneur que d’avoir à s’exprimer devant la représentation nationale, surtout, pour nous, militaires en poste à Berlin, en ces temps de profondes réformes, où sont remises en cause, de part et d’autre du Rhin, nombre de réalités et de certitudes politiques, géostratégiques, opérationnelles, financières et culturelles, en matière de politique européenne de défense et de sécurité.
Votre sujet peut sembler relativement technique, mais, aussi techniques que les rouages de la coopération puissent être, ils tournent dans un bain d’huile fait de toutes ces réalités.
Je vais donc vous fournir d’abord quelques éléments de mise en perspective afin d’expliquer, pour pasticher notre ministre des affaires étrangères, en quoi un Allemand, qu’il soit homme politique, militaire ou industriel, n’est pas un Français qui parle allemand. Il est en effet capital de comprendre nos profondes différences afin de coopérer plus efficacement, en faisant de ces différences des sources de complémentarité plutôt que d’opposition. Car nombreux sont les exemples d’échecs ou de difficultés ayant simplement résulté d’un problème de forme, d’un manque d’empathie culturelle chez l’un des deux acteurs ou de leur part à tous deux.
Notre responsabilité principale consiste à comprendre ce qui se passe d’un côté du Rhin et à le faire comprendre de l’autre côté suffisamment tôt pour laisser à chacun le temps de s’approprier l’information. Souvent, lorsque je propose de faire progresser la coopération, je me heurte d’un côté de la frontière à un : « la situation est assez compliquée comme cela, on ne va pas la compliquer plus avec les Allemands », et de l’autre à la question suivante, en allemand dans le texte : « Quel est l’agenda caché de la grande nation ? »
Les différences « génétiques » dont il faut tenir compte sont nombreuses et, le plus souvent, incidentes à votre réflexion. La première, et la plus importante, est sans nul doute le rôle du « facteur temps » dans la prise de décision politico-militaire, et politico-industrielle. Dans ce domaine, en Allemagne, le sommet de l’État s’organise d’abord autour d’une loi électorale obligeant le gouvernement à gouverner en coalition ; or qui dit coalition dit consensus, qui dit consensus dit discussion, et qui dit discussion dit temps. Bien souvent, c’est la volonté française d’aller vite, facilitée par un système constitutionnel différent, qui, d’emblée, pose en croix les rails de la coopération.
Nous en avons vu récemment un exemple lorsque nous, Français, avons voulu étendre la logique du commandement européen du transport stratégique, au ravitaillement en vol. Soucieux de respecter une échéance politique – le conseil des ministres franco-allemand du 6 février 2012 –, nous avons voulu « tordre » en quelques jours le bras de nos amis allemands, qui, alors qu’il n’existait aucune divergence quant au fond, se sont aussitôt interrogés sur nos raisons et nous ont soupçonnés, à tort, de chercher à leur faire acheter des Airbus MRTT. Un mois de préavis aurait suffi à la machine décisionnelle allemande pour s’adapter et pour saisir nos intentions. Je précise que les conclusions de ce conseil des ministres franco-allemand demeurent à mes yeux une feuille de route valable pour nos actions de coopération, en matière d’armement comme dans les autres domaines.
Toujours dans le droit-fil de ce que souhaitaient les Alliés en 1945, les contraintes de la coalition sont amplifiées par un système politique qui place le Parlement au centre de la décision, selon la logique de ce que l’on appelle à Berlin l’« armée parlementaire ». Chaque engagement doit ainsi être précédé du vote d’un mandat par la majorité la plus consensuelle possible. Il est intéressant de noter que les exportations d’armement relèvent toutefois de la responsabilité d’une commission spécialisée ad hoc placée sous l’égide de la chancelière, sans que le Parlement prenne véritablement part à la décision. On peut donc distinguer « l’hypercontrôle » parlementaire en matière d’opérations, d’une forme de distanciation démocratique s’agissant des exportations d’armement.
Au facteur temps, s’ajoute la farouche indépendance constitutionnelle des ministères, notamment, ceux des affaires étrangères, de la défense, de l’industrie et de l’économie. S’y ajoute le fait que, depuis la création de la République fédérale allemande, le ministre des affaires étrangères a presque toujours été le leader du parti faible de la coalition, dépourvu de cohérence partisane avec le chancelier ou la chancelière comme avec le ministre de la défense. C’est le cas de M. Westerwelle aujourd’hui. De plus, il n’existe pas en Allemagne d’organisme supra-ministériel comparable à notre Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui puisse amener ou contraindre les ministères à coordonner leurs points de vue. Et, le plus souvent, la chancelière, contrainte par la nécessité de préserver la cohérence de la coalition, refuse d’imposer une ligne directrice contraignante à tel ou tel ministère.
Voilà qui explique en grande partie pourquoi l’Allemagne, malgré les récents bouleversements contextuels, n’a pas remis à jour son Livre blanc de 2006. Seules des « lignes directrices pour la défense » ont été rédigées pour donner, en une vingtaine de pages, une apparence de cohérence à la réforme en cours, laquelle consiste avant tout à revoir les structures et les procédures et à faire œuvre d’harmonisation, bien loin de la réforme de fond que l’on aurait pu attendre. Même ses motivations restent floues. Au départ, M. zu Guttenberg devait réaliser une économie de 8 milliards d’euros, puis cette contrainte financière a laissé la place à une contrainte démographique : il n’était plus question que de l’armée dont l’Allemagne pouvait disposer en termes de ressources humaines.
La Bundeswehr reste présente sur toute l’étendue du spectre capacitaire, en contrepartie d’une incapacité à durer qui n’est pas gênante dès lors que l’armée peut s’en remettre à cet égard à la coalition au sein de laquelle elle agit systématiquement. Quant à la réduction des parcs, elle n’a pas obéi à une contrainte financière mais visait à adapter aux ambitions du pays les maquettes régissant les ressources humaines et l’équipement.
Les « lignes directrices pour la réforme » laissent tout de même apparaître des nouveautés importantes, ainsi la formalisation de la notion « d’intérêt national », dont la protection des voies de communication et d’approvisionnement fait, par exemple, partie.
Le cas particulier de la marine allemande est intéressant : c’est, sans doute, cette armée qui a connu le plus de bouleversements ces dernières années, passant du statut de « marine de la Baltique » dont elle était dotée sous la guerre froide – aux capacités parfaitement cohérentes avec son contexte d’emploi –, à celui de « marine océanique », mais sans que cela n’ait jamais été formalisé par une refonte complète et officielle de sa stratégie, ni de ses moyens.
En outre, le ministre de Maizière dessine progressivement les contours d’un nouveau positionnement politico-stratégique, par exemple en affirmant que « la prospérité crée la responsabilité » sur la scène internationale. Il ne s’écarte toutefois pas clairement de la doxa allemande habituelle qui, toujours conformément aux vœux des Alliés en 1945, relègue l’action militaire au rang d’ultime recours au sein d’une approche plus globale de la prévention et du traitement des crises, théorisée par le ministre des affaires étrangères Westerwelle sous le nom de vernetzte Sichereit, que l’on peut traduire par « défense en réseau interministériel » ou par « défense globale civilo-militaire » – nettement plus civile que militaire.
Je conclurai par ce qui constitue à mon sens le premier des intérêts nationaux pour l’Allemagne, même s’il demeure tacite : la vitalité de son économie nationale, notamment industrielle, et de son principal ressort, la capacité du pays à exporter. Toute discussion, toute coopération, notamment dans le domaine qui nous intéresse, doit être éclairée par la conscience de cette réalité primordiale dans la société et dans la politique allemandes.
M. Yves-Marie Gourlin, ingénieur en chef de l’armement, attaché d’armement près l’ambassade de France à Berlin. La coopération européenne est un élément central de la politique allemande d’acquisition d’armement. Il existe cependant une grande différence en Allemagne entre le domaine des systèmes aériens et des missiles, où la quasi-totalité des programmes font l’objet de coopérations, et les domaines terrestre et naval, dans lesquels les coopérations sont plutôt l’exception.
EADS est le réceptacle principal des coopérations européennes menées par l’Allemagne – Eurofighter, A400M, Tigre, NH90, Meteor, Taurus, Trigat, etc. Les contrats conclus par l’intermédiaire des différentes branches d’EADS représentent environ 70 % de la dépense d’armement allemande. L’Allemagne mène également certains programmes en coopération transatlantique, mais les deux les plus emblématiques sont en passe d’être arrêtés : il s’agit du système de défense anti-aérienne MEADS, qui devrait être stoppé à la fin de son développement, et du programme de drones de renseignement Eurohawk, qui fait actuellement les gros titres de la presse allemande.
J’aborderai brièvement les trois questions suivantes : l’Allemagne veut-elle coopérer ? Pour quels futurs grands programmes d’armement ? Avec quels partenaires ?
L’Allemagne se perçoit comme l’une des trois grandes nations de l’armement en Europe, au même titre que la France et que le Royaume-Uni, et elle entend conserver ce rang. Conscience de ne pas être présente dans certains secteurs – nucléaire, capacités aéronavales –, elle occupe, grâce au niveau technologique élevé et à la diversité de son industrie, une position de force dans d’autres secteurs – matériaux, composants, sous-ensembles – qui contribuent à ses performances à l’exportation.
L’Allemagne se conçoit en outre comme un pilier de la coopération européenne en matière d’armement. Nation fondatrice de l’OCCAr, l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, elle est habituée à inscrire son action dans un cadre multilatéral. Elle ne dispose pas d’un véritable domaine de souveraineté comparable au nucléaire pour la France, mais exprime des préoccupations stratégiques à propos, par exemple, de la cryptologie, craignant de tomber dans une dépendance unilatérale vis-à-vis de pays dotés en ce domaine. Toutefois, l’Allemagne reste solidement positionnée dans certains secteurs, en particulier le terrestre et les sous-marins classiques, qu’elle exporte avec succès sous couvert de coopération – en Espagne pour les chars ou en Italie pour les sous-marins.
Par ailleurs, en Allemagne, une large part de l’innovation et de l’initiative est directement portée par l’industrie, qui perçoit les logiques de coopération différemment des administrations. Ceci explique que les autorités soient souvent en retrait vis-à-vis des nouveaux programmes en coopération.
En somme, l’Allemagne est une nation très ouverte à la coopération, qui entend la mener au plus haut niveau en Europe, avec la France et les États-Unis, mais conserve certaines préventions vis-à-vis de certains de ses aspects.
Quels pourront être les futurs grands programmes d’armement en Allemagne ? L’Allemagne cherche aujourd’hui à nouer des partenariats avec ses voisins à l’Est, en particulier avec la Russie ; en d’autres termes, elle ne se voit plus d’ennemi manifeste. En outre, elle ne possède aucune culture expéditionnaire. Ceci rejaillit directement sur son appétence envers de nouveaux programmes d’armement coûteux – à l’image de ceux qui concernent les drones de combat en France –, lesquels ne sont pas toujours suffisamment consensuels au sein de la société allemande.
Toutefois, les industriels qui vendent bien leurs produits – sous-marins, chars – à l’export veilleront à renouveler leurs gammes et chercheront pour cela le soutien du gouvernement. Ils pourront accorder de l’importance aux perspectives de coopération afin d’assurer un soutien politique plus large à de tels programmes et de conserver des séries significatives. Dans le domaine terrestre, le business case est tombé de plusieurs milliers de blindés à plusieurs centaines. Les ventes allemandes de matériel d’occasion, notamment de Léopard 2, restent significatives mais les ventes de matériel neuf sont rares.
L’Allemagne semble veiller à maintenir son budget de défense à un niveau comparable – hors nucléaire – à ceux de la France et du Royaume-Uni : ni supérieur, car elle ne veut pas s’afficher comme la première puissance militaire européenne, ni sensiblement inférieur, car elle n’entend pas être reléguée dans le deuxième peloton alors que sa force économique est éclatante. Elle devrait donc conserver la capacité de financer des programmes d’armement ambitieux aux côtés des partenaires européens qu’elle aura choisis.
Aujourd’hui, Berlin identifie deux grands domaines susceptibles de donner le jour à des coopérations industrielles majeures en Europe : les drones MALE et la défense anti-missiles. L’observation satellitaire est également importante, mais, dans ce domaine, la coopération est considérée comme capacitaire plutôt que comme véritablement industrielle.
Quels seront les partenaires de l’Allemagne à l’avenir ? Dans son histoire, le pays en a eu principalement quatre : la France, les États-Unis et le couple formé par le Royaume-Uni et l’Italie, essentiellement dans le cadre des programmes Tornado et Eurofighter. Or la coopération avec les États-Unis est actuellement ternie par la décision américaine d’arrêt du MEADS et par l’impossibilité de certifier en Europe le drone Eurohawk, qui a conduit à stopper le programme éponyme. L’Allemagne pourrait donc avoir quelques réticences à travailler avec ce partenaire au cours des années à venir. Par ailleurs, ayant perçu le traité de Lancaster House comme potentiellement exclusif, elle a veillé courant 2012 à relancer les perspectives de coopération franco-allemande.
La nouvelle place, centrale, que prend l’Allemagne dans une Europe élargie se traduit également par la conclusion de partenariats avec les pays qui l’entourent, dont les Pays-Bas pour les systèmes terrestre et naval ou la Suède pour les missiles. La Pologne et la Turquie semblent également considérées par Berlin comme des partenaires potentiels, mais, dans les deux cas, les frontières entre coopération et export sont floues.
En conclusion, l’Allemagne conserve les moyens financiers de nourrir une industrie d’armement au plus haut niveau. Son tissu industriel très riche contribue à en faire un partenaire de premier plan. Elle persistera à lancer de grands programmes d’armement qu’elle cherchera le plus souvent à mener en coopération, pour des raisons tant politiques que financières et industrielles. Elle continuera de veiller à bâtir des coopérations avec la France, notamment dans le domaine aérospatial, où nous sommes son partenaire naturel par l’intermédiaire du groupe EADS. La coopération franco-allemande peut aussi s’étendre à d’autres domaines – terrestre, naval –, dans la mesure où ils permettront des partenariats « équilibrés » bâtis sur une « confiance réciproque », deux concepts essentiels, notamment pour Berlin.
M. Jean Launay, rapporteur. Merci de votre exposé, qui dépasse le strict cadre de notre mission en évoquant, au-delà du bilan, les perspectives d’avenir. Cette approche nous montre comment articuler l’analyse du passé, à la mise en perspective. Nous mesurons en outre, à vous écouter, combien le rythme auquel les développements industriels débouchent sur une décision politique varie selon les pays, ce qui complique concrètement la mise en œuvre des programmes d’armement.
Les auditions que nous avons déjà menées m’ont conduit à m’interroger sur l’OCCAr – son action, son rôle, auquel l’Allemagne est apparemment très attachée, la façon de le gérer. Ma première impression était que le recours à cet outil avait quelque peu compliqué le lancement des programmes. Comment l’utiliser à l’avenir au service des grands programmes d’armement, en tenant compte du contexte politique propre à chaque pays ? Pour le dire de manière très directe, est-ce un point de passage obligé ?
M. le général Philippe Chalmel. Je suis de plus en plus convaincu que toute action de coopération doit commencer par se donner un objectif, avant d’étudier les moyens d’y parvenir. On a trop souvent fait l’inverse. De l’extérieur, un Transall allemand et un Transall français semblent rigoureusement identiques alors qu’à l’intérieur, il ne s’agit pas du tout de la même machine. « Pour quoi faire ? – Pour répondre à une menace. – Laquelle ? », etc. : c’est sur ces questions qu’il faut se mettre d’accord au préalable.
Par ailleurs, pour qu’un programme parte sur de bons rails, il faut à mon sens qu’il réunisse à l’origine un petit nombre de partenaires – comme le permettent Lancaster House ou nos accords avec les Allemands – et que d’autres ne soient éventuellement invités à les rejoindre que dans un second temps. Il faut en effet éviter que le programme ne se dissolve dans des spécificités nationales qui en remettent d’emblée en cause le noyau dur, prolongeant les délais et accroissant les coûts.
M. Jean Launay, rapporteur. En d’autres termes, vous estimez qu’il faut commencer par des accords bilatéraux ?
M. le général Philippe Chalmel. C’est en effet mon opinion.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Notre mission a pour objet de dresser le bilan des actions de coopération en matière d’armement. La partie allemande a-t-elle la même perception que nous des limites, voire des défaillances des programmes ? Sur les trois matériels : l’A400M, le Tigre et le NH90, l’on pourrait tirer des conclusions différentes sur l’efficacité de notre coopération. Le passage du Livre blanc consacré à la coopération regrette comme nous l’absence d’objectifs clairement définis au départ et l’absence d’impulsion initiale d’un État ou d’un industriel capable d’inciter ses partenaires à développer l’armement conformément aux besoins des armées nationales.
M. le général Philippe Chalmel. Si les Allemands possèdent une vision de leur action à l’exportation, ils n’ont pas de vision des besoins de leur armée, faute d’une refonte stratégique telle que celle que propose le Livre blanc.
M. Alain Claeys, président. Soyons plus précis : les besoins allemands et français coïncident-ils ou non ?
M. le général Philippe Chalmel. Les deux nations ont exprimé leur volonté de rester présentes sur l’ensemble du spectre capacitaire. Dans tous les domaines, nous avons donc intérêt à nous mettre d’accord sur des matériels communs.
M. Yves-Marie Gourlin. En ce qui concerne l’OCCAr, il me semble qu’il est apprécié par les autorités allemandes. Il a fait ses preuves malgré des périodes difficiles, notamment au sujet de l’A400M. Les Allemands sont conscients du fait que ce genre de grand programme comporte des risques importants, notamment industriels, surtout lorsque plusieurs sont menés quasi simultanément, comme l’A380 et l’A400M. Même les programmes nationaux ou transatlantiques peuvent entraîner des difficultés, à l’instar d’Eurohawk, programme national allemand assis sur une plateforme américaine. L’Eurofighter a lui aussi connu des retards. La situation est différente pour le Tigre, très affecté par le changement stratégique intervenu après la chute du Mur et potentiellement inadapté aux scénarios d’emploi de demain.
Le mode de sélection de l’OCCAr, fondé sur la compétence des personnes recrutées et non sur leur seule nationalité, en fait un outil performant. Les méthodes de management y évoluent chaque année en fonction du retour d’expérience. Peut-être l’OCCAr pourrait-il actuellement trouver des limites dans les domaines qui nécessitent un niveau de secret très élevé.
M. Jean Launay, rapporteur. Comment l’action de l’ambassade, celle de l’Allemagne et celle de la DGA s’articulent-elles ? Dans les réponses que vous nous avez apportées par écrit, vous précisez que « [l]es directions de programmes et l’ambassade se tiennent informés en tant que de besoin » et que « l’ambassade concentre son action sur les tâches qu’aucune autre entité de la DGA n’est susceptible de réaliser ». Est-ce à dire que c’est la DGA, jouant son rôle de relais auprès des industriels, qui représente l’interlocuteur principal ? En d’autres termes, la communication franco-française, dont la nature rejaillit sur notre relation avec notre partenaire allemand, est-elle fluide ?
M. le général Philippe Chalmel. Ce que vous décrivez correspond aussi à nos relations avec l’état-major des armées. Notre rôle n’est pas de nous substituer à la multitude de canaux, de ponts, d’organisations de coopération efficaces instaurés depuis le traité de l’Élysée, en 1963, mais de repérer, à l’avance, ce qui risque de ne pas fonctionner pour des raisons de forme, de percevoir de part et d’autre du Rhin la tension potentielle pour mieux la désamorcer. L’EMA et le ministère allemand de la défense, la DGA et son homologue allemand entretiennent des relations de travail qui ne passent pas nécessairement par l’ambassade. En revanche, celle-ci contribue à préparer chaque rencontre importante entre les deux nations et y assiste.
M. Yves-Marie Gourlin. Il y a dix ans, il y avait cinq ingénieurs français au titre de la mission armement en Allemagne. Nous ne sommes plus que deux et nous nous concentrons nécessairement sur les relations avec les autorités gouvernementales, notamment au niveau ministériel. Il existe déjà des comités de programme au sein desquels les éventuelles difficultés sont débattues par les directions nationales de programme. Nous pouvons être amenés à y participer, mais de manière limitée puisque d’autres sont missionnés pour le faire et que nous sommes nous-mêmes attendus ailleurs, dans un contexte de réduction des ressources humaines pour des raisons – au demeurant tout à fait valables – de diminution de la dépense publique.
L’ambassade et la DGA échangent des informations, mais surtout sur les sujets qui peuvent poser des problèmes. À l’ambassade, nous travaillons essentiellement sur les perspectives de nouveaux programmes avec la direction allemande de l’armement, qui s’occupe de préparer l’avenir tandis que l’agence qui passe les contrats, le BAAINBw -- anciennement BWB – se consacre aux programmes en cours. S’agissant de ces derniers, sauf si des difficultés se présentent qui sont du ressort de l’ambassade, les directions de programme communiquent directement.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. L’Allemagne, disiez-vous, tient à rester l’une des trois grandes puissances militaires du continent, au côté de l’Angleterre et de la France. Compte tenu des problèmes qu’elle rencontre, notamment démographiques, cela ouvre-t-il la voie à une inflexion de sa stratégie qui remettrait en cause le principe de non-intervention du corps expéditionnaire ? L’Allemagne serait-elle prête à s’investir davantage dans l’Europe de la défense, qui fera l’objet d’un Conseil européen à la fin de l’année ? Comment cette inflexion stratégique se prépare-t-elle le cas échéant ?
M. Alain Claeys, président. Quels sont selon vous les leviers d’une coopération européenne renforcée en matière de défense ? Le rôle de l’agence européenne de défense et celui de l’OCCAr peuvent-ils être étendus ? Quelle est la position de l’Allemagne sur ces points ?
M. le général Philippe Chalmel. Depuis près de quatre ans, depuis la démission de Horst Köhler, une véritable révolution est en marche, par petites touches impressionnistes. C’est M. zu Guttenberg qui a mis ce processus en marche : il y a cinq ans, qui aurait pu imaginer que l’on suspendrait la conscription ? Il a ensuite été remplacé, pour les raisons que l’on sait, par M. de Maizière, connu, au sein du gouvernement et plus largement en Allemagne, pour son sens de la méthode et sa rigueur, qui a mis la réforme sur les rails parce que « la prospérité créant la responsabilité » l’Allemagne doit s’investir davantage à l’extérieur. Simplement, la doctrine n’est pas exprimée clairement et officiellement, sous la forme d’un Livre blanc.
Un Livre bleu fournirait une occasion idéale d’agir ensemble. La France et l’Allemagne se sont reconnu des intérêts stratégiques communs : la protection des voies de communication, la lutte contre la piraterie ; l’approvisionnement en drogue depuis l’Amérique du Sud pourrait également être concerné. Pourquoi une marine nationale ? Au nom de quels intérêts stratégiques communs ? Ne pouvons-nous nous entendre sur le matériel permettant de réagir à ces menaces, par exemple une frégate 124 pour lutter contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes ? Sur ces questions, une réflexion très riche reste à mener.
Il est vrai que les dix-huit mois qui viennent de s’écouler n’étaient guère propices à la concertation : se sont succédé la campagne électorale française et l’élaboration de notre Livre blanc, avant que ne débute la campagne électorale allemande. Mais M. de Maizière semble véritablement désireux de regarder vers l’avenir, et de le faire en coopération.
M. Yves-Marie Gourlin. L’Allemagne envisage d’acquérir deux joint support ships – équivalents des BPC, ou bâtiments de projection et de commandement – à l’horizon 2025 ; c’est un signe concret du fait que cette inflexion stratégique est possible. Il témoigne d’une volonté de développer l’armement selon un modèle pouvant déboucher sur une force expéditionnaire, ce qui n’appartient pas à la tradition allemande. On l’oublie en effet trop souvent, l’Allemagne n’a pas la même histoire que la France et la Grande-Bretagne, qui mènent des opérations extérieures depuis cinq cents ou six cents ans, partout dans le monde, ensemble ou l’une contre l’autre. Il s’agit en l’occurrence pour l’Allemagne d’un profond changement, qui se concrétise avec la suppression du service militaire et se développe avec l’arrivée de nouveaux cadres au sein des forces armées. Ceci a un impact sur l’armement, comme par exemple au sujet des capacités du Tigre allemand conçu pour servir au combat à l’Est contre les chars russes et moins adapté que son homologue français à des scénarios expéditionnaires.
Toutefois, la société civile n’a pas nécessairement le même point de vue que ceux qui, au sein de l’appareil politico-militaire, sont de plus en plus conscients de la nécessité de s’engager au côté des grands partenaires européens de l’Allemagne. Celle-ci n’en aura que davantage intérêt à passer par des coopérations pour développer ses nouveaux programmes, qui seront alors plus faciles à défendre auprès de l’opinion publique.
M. Jean Launay, rapporteur. Président du groupe d’amitié France-Pologne, j’aimerais savoir sur quels programmes nouveaux la relance du triangle de Weimar pourrait déboucher.
M. le général Philippe Chalmel. Aux principaux dossiers mis en avant lors du Conseil des ministres franco-allemand du 6 février 2012 et que M. Gourlin a évoqués, il convient d’ajouter la réflexion – qui progresse à son rythme, mais qui progresse – sur les armements terrestres futurs. Mais si l’on demande à des Allemands et à des Français quels engins terrestres ils souhaitent, les seconds répondront : « On peut discuter de tout, sauf d’une chose : ils seront à roues ! », les Allemands assurant quant à eux que tout est négociable mais qu’ils seront à chenilles. Cela s’explique. Pour les Allemands, le « proche étranger » européen se situe logiquement dans un espace qui s’étend, du grand Nord jusqu’au Kosovo en passant par la Baltique, la Pologne et le triangle de Visegrád. Notre vision est bien différente, incluant la Méditerranée et nos territoires d’outre-mer. Tout l’intérêt d’un travail binational, auquel pourrait en effet se joindre la Pologne, est de rapprocher ces points de vue afin que l’Europe ait une vision globale de ses intérêts.
En ce qui concerne le triangle de Weimar, il me paraît cohérent de commencer par la France et l’Allemagne puis, une fois que les rails sont posés, d’inviter tous ceux qui le souhaitent à monter dans la locomotive, et d’abord, bien entendu, les Polonais. L’axe nord-est-sud-ouest s’ouvrirait ensuite vers l’Italie et l’Espagne pour s’étendre à Weimar +.
M. Yves-Marie Gourlin. Parmi les domaines pouvant être développés dans le cadre du triangle de Weimar, les Allemands s’intéressent à la défense anti-missiles. Mais, en la matière, les capacités industrielles de chacune de nos trois nations sont assez diverses. Un dialogue bilatéral, voire trilatéral en associant l’Italie, notre partenaire à tous deux – pour l’Aster s’agissant de la France, pour le MEADS s’agissant de l’Allemagne –, paraît donc nécessaire avant d’aller plus loin avec la Pologne.
Pour répondre à votre question sur l’opportunité, vu de Berlin, de développer l’OCCAr : je crois que l’OCCAr est apprécié en Allemagne, il devrait être le véhicule naturel de ses futurs programmes en coopération. S’agissant de l’AED, pour les Allemands comme pour les Français, la question est plus complexe car les enjeux stratégiques sont plus sensibles. L’OCCAr sert surtout à passer des contrats et à les mettre en œuvre une fois qu’ils ont été décidés et lancés par un petit groupe de nations. Les aspects politiques et stratégiques y paraissent donc moins décisifs.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Y aura-t-il un Livre blanc en Allemagne après les élections et le Conseil européen sur la défense, afin de moderniser la vision stratégique allemande et de la rapprocher de celle de la France, du Royaume-Uni et même des pays du Sud en vue de construire l’Europe de la défense ?
M. le général Philippe Chalmel. L’évolution dont nous avons parlé n’est pas un changement complet de génération, bien que le taux de renouvellement du Bundestag à chaque élection soit très élevé. Cette tendance n’est pas générale même si elle est transpartisane – on la retrouve à la CDU, au SPD, chez les Verts. Un groupe de travail intégrant des fondations a été créé sous l’égide du ministère allemand des affaires étrangères pour réfléchir aux éléments d’un Livre blanc mais il semble que la réflexion ne soit guère concluante.
Le Conseil européen de fin d’année fournirait une belle occasion de relancer le processus.
M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes. Puisque vous dressez le bilan des coopérations passées en matière d’armement, n’oublions pas que c’est avec l’Allemagne que nous avons le plus coopéré, en nombre de programmes comme en montant investi. Citons le programme Brevel, qui a malheureusement échoué du fait de la France, le Transall, le NH90, le Tigre, Hélios et l’A400M, auxquels s’ajoute la nouvelle torpille lourde actuellement en préparation.
En revanche, les coopérations n’ont guère existé dans les domaines terrestre et maritime, comme le rappelait le général Chalmel. En matière terrestre, c’est nous qui avons mis fin à la démarche entamée, afin de préserver Giat et Nexter. Dans le domaine maritime, alors que DCN n’était pas encore une société privée, les Français ont voulu se saisir du dossier de manière quelque peu martiale, si j’ose dire, ce qui n’a pas du tout plu aux autorités allemandes, notamment lorsque le chantier naval était à vendre, de sorte qu’il a d’abord été vendu à des Américains.
Le traité de Lancaster House, dont il a été précédemment question, n’a encore eu aucun effet concret si l’on excepte le programme Epure, qui bat d’ailleurs de l’aile. Du point de vue conventionnel, le traité n’a généré aucune coopération franco-britannique susceptible de concurrencer nos relations avec les Allemands.
Quant à l’OCCAr, c’est plutôt un agrégat de bureaux de programme gérés pour l’essentiel par les DGA et leurs équivalents. Il serait souhaitable qu’il devienne l’organe chargé de concevoir les programmes d’armement, de la manière la plus homogène possible, à la demande des armées des différents pays membres, mais il ne l’est pas encore.
M. le général Philippe Chalmel. Les partenariats stratégiques noués par les Allemands, dont ils n’ont pas souhaité pour l’instant nous communiquer la liste en réponse à votre questionnaire, les lient à tous les grands pays, notamment les BRICS, pour des raisons analogues à celles qui nous motivent. L’Allemagne entretient également des partenariats bilatéraux très importants avec tous les pays composant l’arc qui s’étend de leur grand nord-est à leur grand sud-est. Outre les motivations classiques, il s’agit de sécuriser son accès aux matières premières, dont les terres rares, essentielles à ses yeux. Elle cherche aussi en Inde, au Brésil ou en Afrique du Sud de nouveaux bassins démographiques susceptibles de lui fournir de jeunes ingénieurs qui seront formés puis employés en Allemagne, pour remplacer ceux qui, après les ouvriers, commencent d’y faire défaut. Le ministre Westerwelle a formulé explicitement ce dernier objectif à plusieurs reprises.
Audition du 23 mai 2013
À 10 heures : Audition des attachés de défense et d’armement de l’ambassade de France à Londres : contre-amiral Henri Schricke et M. Nicolas Fournier, ingénieur en chef de l’armement.
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, Président. Nous auditionnons aujourd’hui les attachés de défense et d’armement en poste à Londres et je souhaite la bienvenue au contre-amiral Henri Schricke et à l’ingénieur en chef de l’armement Nicolas Fournier. L’objectif de cette audition est d’analyser la conduite des programmes d’armement menés en coopération au niveau politique, industriel, technique et financier, avec le Royaume-Uni.
M. le contre-amiral Henri Schricke, attaché de défense près l’ambassade de France à Londres. Avant d’en venir aux aspects plus techniques, je vous exposerai l’état d’esprit qui préside à notre coopération à Londres, où Nicolas Fournier et moi sommes en poste depuis un an environ. Bénéficiant d’un solide réseau, nous croyons utile de vous apporter un éclairage sur l’atmosphère qui y règne.
Les coopérations franco-britanniques, qui existent depuis longtemps, portent essentiellement sur les missiles et matériels volants. Dans les domaines terrestre et maritime, elles ont été moins fructueuses.
Les traités de Lancaster House, signés en novembre 2010, ne marquent pas l’an I de cette coopération, mais ils ont apporté une impulsion politique et envoyé un signal fort tant aux industriels et aux administrations qu’à nos alliés occidentaux, tels le Canada et les États-Unis. Enfin, ils sont un exemple pour l’Europe.
Le contexte politique est actuellement très favorable. Les traités de Lancaster House sont bipartisans au-delà de la Manche et en deçà puisqu’ils ont été élaborés sous un gouvernement travailliste, signés par Nicolas Sarkozy, mis en œuvre par David Cameron et le gouvernement français issu des élections de 2012 leur a réitéré son soutien. Le Premier ministre britannique est convaincu, malgré l’euroscepticisme ambiant, de la nécessité de s’allier avec les Européens pour nouer des alliances industrielles, et les industriels poussent fortement dans ce sens. À moyen et long terme, les Britanniques pensent qu’ils ne pourront plus compter sur les Américains.
Par ailleurs, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui insiste sur l’importance du binôme franco-britannique, a été bien reçu à Londres. Et l’heure est à l’harmonie et à la confiance, comme en témoigne la conférence annuelle du conseil franco-britannique qui s’est tenue les 15 et 16 mai à Londres en présence de trois ministres, dont notre ministre de la défense, des directeurs nationaux d’armement et dirigeants des industries de défense.
Toutefois, les progrès sont fonction de fenêtres d’opportunité qui s’ouvrent et se ferment, selon le calendrier politique de chacun des deux pays. Or, autant le contexte est aujourd'hui favorable, autant, à partir de mi-2014, il deviendra plus difficile en raison du référendum sur l’indépendance de l’Écosse et la campagne des élections générales de 2015.
Les difficultés auxquelles s’est heurtée la coopération bilatérale dans le domaine industriel sont de quatre ordres. Premièrement, pendant longtemps, Londres a opposé son pragmatisme, résumé dans le mot d’ordre best value for money, à la vision française, plus conceptuelle. Deuxièmement, les Britanniques se sont révélés incapables de gérer les programmes d’armement les plus ambitieux, et ce lourd passif du ministère de la défense est devenu un enjeu de politique intérieure, entre conservateurs et travaillistes. Se pose ainsi la question de l’avenir du processus d’acquisition. Actuellement, le ministre de la défense envisage au moins partiellement son externalisation, laquelle hypothéquerait, et c’est le troisième obstacle – la capacité future de la Grande-Bretagne à coopérer tant avec les États-Unis qu’avec la France. Enfin, dans le passé, l’expression de besoins très différents de part et d’autre dans les domaines maritime et terrestre rendait les rapprochements très difficiles. Pourtant, aujourd'hui, ils semblent s’esquisser.
S’agissant de la conception des matériels et des ambitions politiques, le Livre blanc et la Strategic Defence and Security Review (SDSR) sont finalement assez proches : même type de capacités expéditionnaires, dissuasion nucléaire…
J’ai parlé de confiance entre les acteurs, du politique à l’industriel en passant par le militaire ; restent maintenant les inconnues sur l’évolution du processus d’acquisition au Royaume-Uni et sa capacité à mener les grands programmes d’armement.
Par ailleurs les deux gouvernements auront à s’assurer de la bonne progression du projet One MBDA.
M. Nicolas Fournier, ingénieur en chef de l’armement, attaché d’armement près l’ambassade de France à Londres. Plus concrètement, depuis la fin de l’année 2010, on a avancé dans un environnement contraint. Le Royaume-Uni a mis deux ans à décliner sa SDSR en termes budgétaires d’autant que, dans le même temps, ont été lancées de profondes réformes des capacités et de l’acquisition des matériels. Les Français, de leur côté, ont entamé un processus de revue capacitaire à partir du printemps 2012. Nous avons ainsi mis en suspens les deux sujets majeurs que sont le drone MALE en gelant la stratégie franco-britannique initialement prévue, et le projet très symbolique du missile anti-navire léger (ANL) au sujet duquel la décision n’a été prise que récemment.
Une synthèse de l’état d’avancement des projets montre un programme sur le point d’être lancé, qui est précisément le missile anti-navire léger. Depuis que la France a décidé de s’engager, nous sommes sur le point de démarrer le développement et une phase de production. Le corollaire, de moindre envergure mais important pour nous, est la rénovation à mi-vie du missile de croisière que nous avions fait en coopération avec les Britanniques, le SCALP – qu’ils appellent, eux, le Storm Shadow – qui équipe nos armées respectives et dont l’obsolescence nécessite des travaux que nous espérons réaliser en commun. Ces projets concourent à la démarche de rationalisation de l’industrie missilière, One Complex Weapon, ou plus simplement One MBDA, du nom de la principale société concernée.
D’autres projets de coopération ne sont pas encore à ce stade de maturité, même s’ils avancent à bon rythme. Ce sont, d’une part, le drone de guerre des mines navales, d’autre part, le drone tactique Watchkeeper. Il s’agirait respectivement de lancer un nouveau produit et d’équiper la France d’un système qui arrive, côté britannique, en fin de cycle de développement et sur le point d’y être mis en service.
Dans le domaine de la recherche technologique (R & T), on trouve le projet emblématique du futur drone de combat aérien, le Future Combat Air System, le FCAS. Une étude de faisabilité a été lancée en juillet 2012, et nous travaillons très activement ensemble à une phase de démonstration, qui contribuerait puissamment à rapprocher nos industries opérant dans l’aéronautique de combat.
Par ailleurs, des actions sont en cours touchant aux systèmes d’information, dont l’interopérabilité doit former une sorte de couche de glue entre eux, et qui est essentielle sur le plan opérationnel. Dans la phase de montée en puissance de la force expéditionnaire conjointe – Combined Joint Expeditionary Force, la CJEF –, chaque exercice est l’occasion d’identifier des améliorations possibles. Nous travaillons également à harmoniser sur les systèmes satellitaires de communication de prochaine génération, les successeurs du Syracuse français et du Skynet britannique.
M. Jean Launay, membre de la commission des finances, rapporteur. Quels sont les différents types de drone, et, dans ce domaine, comment est mis en œuvre ce qu’annonçaient les traités de Lancaster House ? Quels sont les enjeux des différentes options offertes pour nous équiper ?
Le Livre blanc français peut donner lieu à une double lecture. Il a pu apparaître comme un frein dans la mesure où le temps pris pour la réflexion a ralenti la décision, mais il peut se révéler ensuite un accélérateur puisqu’il a remis sur le devant de la scène le missile ANL. Celui-ci préoccupait beaucoup François Cornut-Gentille l’automne dernier puisqu’il avait déposé un amendement au projet de loi de finances pour aller plus vite, l’urgence étant à l’époque à l’ordre du jour à Londres, et moins à Paris. Où en est-on ?
M. le contre-amiral Henri Schricke. Sur un plan général, faut-il que Livre blanc et SDSR soient élaborés en même temps ? À titre personnel, je plaide pour le maintien du découplage grâce auquel il y a toujours au moins l’un des deux pays qui avance. Un calage provoquerait fatalement des épisodes de latence de douze à dix-huit mois.
Pour la question portant sur l’ANL, et sur la mise en service des matériels en général, jusqu’à présent, les Britanniques n’imaginaient pas ne pas avoir ce qu’on appelle le high end sur la technologie, quelle que soit la plate-forme ; ils n’imaginaient pas non plus, officiellement, admettre au service actif des matériels qui ne soient pas entièrement équipés. D’où, en particulier, l’intense pression des Anglais qui venait de ce qu’il n’était pas question pour eux de lancer le Lynx rénové sans le FASGW – le nom de l’ANL outre-Manche.
Le cas de nos frégates La Fayette, navires de premier rang mises en service au début des années 1990 sans être en mesure d’opérer dans tous les domaines de lutte, aurait été inenvisageable au Royaume-Uni. Or ce dernier est en train de changer de perspective pour ses programmes futurs me semble-t-il.
M. Jean Launay, rapporteur. Qu’est-ce qui, en France, a fait de l’ANL une urgence ?
M. Nicolas Fournier. Le besoin de disposer d’un missile tiré depuis un hélicoptère pour atteindre des bâtiments de surface de moindre ampleur que ceux qui sont visés par les Exocet n’est pas nouveau et il est avéré. Cela fait des années qu’il n’est pas traité avec le même degré de priorité de part et d’autre. Les Britanniques étaient surtout préoccupés de la continuité de la capacité malgré le renouvellement de leurs hélicoptères. Les Français, quant à eux, n’étaient pas soumis aux mêmes échéances pour le Panther et la version marine du NH90. Vu de Londres, la décision qui l’a emporté résulte d’une analyse en termes capacitaires, industriels – les liens avec la rationalisation de l’industrie missilière – et politiques. J’ai d’ailleurs entendu notre ministre de la défense le dire. Il a fallu faire un compromis entre les différentes facettes et les impératifs financiers. Londres a compris la portée du geste, dans la continuité de l’esprit de Lancaster House.
M. le contre-amiral Henri Schricke. Lancaster House a mis en place une gouvernance remarquablement souple, légère et réactive, dont le Royaume-Uni avait fait une condition, pour être certain que la coopération se passe bien. Ont été mis en place des groupes de travail au niveau des directeurs nationaux d’armement ; le contrôle « politique » exercé par le Senior Level Group, comprenant le National Security Advisor ainsi que le chef d’état-major particulier et le conseiller diplomatique du Président, permet de conserver une vraie gouvernance à travers une structure souple.
Durant l’année qui a suivi la signature de Lancaster House, on a adopté l’expression de « paquet drone », très pratique sur le plan médiatique et politique, mais qui s’est révélé maladroite parce qu’elle englobait des systèmes extrêmement différents. Nous œuvrons pour le voir disparaître et se concentrer sur chacun d’entre eux séparément.
M. Nicolas Fournier. S’agissant des « drones », en anglais unmanned aerial systems, les Anglais soulignent, à l’intention de leur opinion publique, que ces matériels, même s’ils n’ont pas d’équipage, sont bien contrôlés par des humains. Il est donc important de ne pas parler d’autonomie de décision ou de décision prise par ordinateur.
Dans le cadre de Lancaster House, nous coopérons à trois catégories de drones aériens.
Premièrement, les drones tactiques qui sont mis en œuvre par les armées de terre. Héritiers des systèmes d’observation de l’artillerie, ils ont vocation à fournir des informations tactiques avec des senseurs optiques ou des radars à imagerie. Il s’agit aujourd'hui de choisir le matériel qui succédera au système français de drone tactique intérimaire (SDTI) français. Un des candidats les plus solides arrive au bon moment : le Watchkeeper qui va être mis en service dans l’armée de terre britannique. Il vole relativement bas, mais il exige des pistes au décollage et à l’atterrissage, alors que notre système utilise des catapultes et des parachutes.
Après les études préliminaires, nous avons signé avec les Britanniques un accord portant sur une expérimentation par la France, qui est en cours à Istres. Nous étudions, pour le plus grand bénéfice des deux partenaires, les finitions à apporter même si la France n’a pas encore pris sa décision.
Deuxièmement, les drones MALE. Il s’agit d’un matériel plus gros, qui vole plus haut et beaucoup plus longtemps. Nous nous servons aujourd'hui du système Harfang qui avait été choisi dès le début comme une solution intérimaire. Depuis une quinzaine d’années, un dilemme nous somme de choisir entre un achat sur étagère et un développement spécifique. Sur les étagères, on trouve du matériel israélien et du matériel américain. La première feuille de route de mise en œuvre des traités de Lancaster House incitait fortement à développer une solution conjointe, dont la première phase intérimaire consistait à prendre une plate-forme israélienne et la seconde à se lancer dans le développement d’une solution franco-britannique. Elle a été mise en suspens l’été dernier. Depuis, nous envisageons plutôt d’acheter à court terme le drone américain Reaper. C’est une inflexion par rapport aux directives données en matière de coopération franco-britannique. Mais elle n’est pas compromise pour autant dans la mesure où les Britanniques ont, pour des raisons tenant à l’urgence opérationnelle, fait le même choix en 2007. Comme ils envisagent eux-mêmes de le pérenniser après la fermeture du théâtre afghan, ils sont très intéressés par une coopération franco-britannique, élargie – pourquoi pas ? – à d’autres pays européens, qui ressemblerait à un club d’utilisateurs de ce matériel acheté sur étagère aux États-Unis.
Par ailleurs, ils sont aussi intéressés par les évolutions à la marge au Reaper, qui, tel quel, ne peut pas obtenir un certificat de navigabilité dans l’espace aérien européen. Or elles pourraient coûter fort cher et il faut prendre des précautions. On l’a vu encore récemment, l’Allemagne a dû renoncer à obtenir ce certificat pour des drones HALE, volant à haute altitude, achetés sur étagère aux Américains.
Le dernier type de drone est fondamentalement différent puisqu’il s’agit des drones de combat, une solution potentielle pour la prochaine génération d’avions de combat. Le drone embarque de nombreux systèmes d’armes – missiles ou frappe de précision. Nous n’en sommes qu’à la phase de R & T, mais elle est structurante pour l’industrie aéronautique, tant pour les bureaux d’études de Dassault Aviation, le motoriste Safran et l’électronicien Thales que pour leurs pendants britanniques BAe Systems, Rolls Royce, et Selex qui fabriquent le Typhoon, le rival du Rafale. L’enjeu est de construire si possible en commun leur successeur, pour éviter un nouvel affrontement direct, notamment à l’exportation. L’idée serait de lancer à partir de l’année prochaine un projet de démonstrateur, pour succéder à celui mené autour du drone français nEUROn et du drone britannique Taranis.
M. Jean-Jacques Bridey, membre de la commission de la défense, rapporteur Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous à propos du drone MALE. Il n’y a eu ni inflexion, ni recul de la part du ministre de la défense l’été dernier. Le dossier a été rouvert, parce qu’il fallait prendre position rapidement compte tenu du décalage entre la volonté de développer un drone MALE dans un cadre plus ou moins européen qui restait à définir, à l’horizon 2025-2030, et le besoin urgent que ressentaient nos armées tant en Afghanistan que maintenant au Mali, où nous dépendons, pour l’observation, de matériels américains. Le ministre nous a confirmé hier l’achat de deux drones Reaper, ce qui crédibiliserait cette option.
Effectivement, la coopération n’a pas commencé à Lancaster House. Mais les Anglais en font-ils le même bilan que nous ? Sont-ils prêts à la renforcer ou bien s’en contentent-ils ?
Vous soulignez que les Britanniques sont satisfaits de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), et moins de l’Agence européenne de défense (AED). Il me semble que cette vision est partagée, au moins outre-Rhin. Dès lors, vont-ils privilégier l’OCCAR ou les coopérations bilatérales ?
Concernant les traités de Lancaster House, le calendrier originel n’a pas été suivi mais, en dépit de l’alternance, les objectifs ont été réaffirmés dans la vision stratégique du Livre blanc. Le rapport de M. Hubert Védrine sur l’OTAN a également donné des gages à nos alliés, au premier rang desquels les Britanniques. Ces traités étendent nos coopérations à des sujets sensibles comme le nucléaire. Dans ce domaine précis, elles sont satisfaisantes malgré les incertitudes qui planent sur le financement de la simulation qui se fait en Bourgogne, et qui constitue une grande première. Autre point fort de la coopération, les capacités expéditionnaires qui ont montré leur efficacité en Libye comme sur d’autres théâtres d’opérations. La coopération franco-britannique est tout de même portée par une forte volonté politique, renouvelée par le Président de la République, et s’étend à des domaines qui étaient auparavant du domaine exclusif de chaque État.
Enfin, l’euroscepticisme n’aurait pas trop d’incidence sur la volonté du Premier ministre David Cameron, mais y a-t-il des partis pour regretter l’alliance avec les États-Unis, désormais plus préoccupés par l’Asie, et qui, à la lumière de la remise en question de l’appartenance à l’Union européenne, envisageraient une réorientation stratégique, avec les conséquences que cela impliquerait pour les coopérations ?
M. le contre-amiral Henri Schricke. David Cameron doit afficher son euroscepticisme à des fins de politique intérieure. Mais, s’il y a un domaine qui sort indemne du débat, c’est bien la défense, en tout cas, la relation franco-britannique. Les industriels et les militaires savent bien qu’ils ne peuvent agir sans leurs partenaires opérationnels, que sont les pays du Nord et la France.
Sincèrement, je ne crois pas à une inflexion stratégique. Un parti tel que l’UKIP peut jouer un rôle dans les élections locales ou européennes, mais le bipartisme devrait rester la règle pour les prochaines élections générales.
Les Britanniques prennent acte du désintérêt relatif des Américains, sans s’apitoyer sur leur sort. Du coup, le Gouvernement, quel qu’il soit, sera poussé par ses propres industriels à consolider quelques liens au sein de l’Europe.
Sur le plan opérationnel, la CEJF est en ligne avec la SDSR 2010 et le nouveau Livre blanc. Elle sert aussi à promouvoir dans son sillage d’autres coopérations capacitaires, à commencer par les systèmes d’information et de commandement. Si, demain, les deux armées devaient s’équiper de Watchkeeper, l’interopérabilité de nos forces en serait facilitée.
L’une des grandes avancées réalisées par les traités de Lancaster House réside dans la souplesse de la gouvernance. La feuille de route annuelle est l’occasion de procéder à des réajustements et de faire évoluer les priorités, en fonction des réalités politiques, industrielles et militaires. Après trois ans, et la crise budgétaire persistant, il va falloir revoir en profondeur les projets de coopération et envisager de nouvelles pistes. La question aujourd'hui n’est plus tant la mutualisation, bien admise sur le plan politique, que le niveau d’interdépendance acceptable. Le Royaume-Uni n’a plus de patrouille maritime et ses capacités ne sont plus suffisantes aujourd'hui pour mener seul des opérations. Et, si le principe de l’interdépendance est accepté, elle n’est possible qu’avec nous.
M. Nicolas Fournier. Schématiquement, les Britanniques voient dans l’AED l’incarnation de la coopération multilatérale dogmatique et dans l’OCCAR un outil de coopération multilatéral pragmatique. Ce dernier n’a aucune prétention à susciter des idées, à fédérer les points de vue ou à rapprocher les besoins opérationnels. L’OCCAR permet de mutualiser la gestion de programmes, en souscrivant des contrats et en entretenant un dialogue constructif entre clients et fournisseurs industriels. Et les Britanniques considèrent que le rapport coût/efficacité est satisfaisant. L’AED apparaît, elle, comme un forum de discussion, d’où sont lancés les projets. Dans le domaine de la R & T, les Britanniques sont contents qu’elle leur serve à trouver des partenaires pour monter des tours de table, et mutualiser le financement d’études qu’ils trouvent intéressantes. En revanche, ils ironisent sur la recherche de consensus réunissant une vingtaine de pays. En somme, ils sont très ouverts à la coopération avec certains pays européens – la France en fait aujourd'hui partie – et beaucoup moins avec d’autres, bien qu’ils s’en défendent. Sans jamais prendre de position officielle, ils diront, au détour d’une phrase, que tel petit pays n’a pas forcément son mot à dire sur le pilotage de la R & T de défense. D’où la nécessité de trouver, sous différentes formes, des plates-formes multilatérales, mais plus étroites, comme la lettre d’intention du 6 juillet 1998 qui regroupe six pays ayant des préoccupations communes.
M. Jean Launay, rapporteur. Le projet de deuxième porte-avions (PA2) est-il à ranger parmi les programmes de coopération bilatérale avortés, ou relevait-il d’une autre logique ?
M. le contre-amiral Henri Schricke. Je ne suis pas un spécialiste mais, sur un plan général, la coopération navale se heurtait jusqu’à présent à des différences de conception et à la difficulté britannique de gérer des grands programmes d’armement. L’exemple le plus criant est le tournant à 180 degrés sur les programmes de porte-avions et d’aviation embarquée. Alors qu’ils étaient bien avancés, la défense britannique était incapable d’estimer, à plusieurs milliards près, les évolutions envisagées. Ignorant combien cela nous a coûté, je ne peux pas juger.
M. Nicolas Fournier. Tout en sachant parfaitement que leurs chantiers navals restent géographiquement très morcelés, les autorités britanniques ne se sont pas engagées dans la voie de l’optimisation. La construction du porte-avions avait été répartie de façon à garantir la survie des sites. Ayant assisté aux discussions sur l’éventualité d’un deuxième porte-avions français en coopération avec le programme CVF britannique, je me suis rendu compte, comme les autres, que la rationalisation des chantiers de construction était un sujet tabou.
Plus récemment, s’est posé le problème du groupe aérien embarqué. Nous aurions apprécié que les porte-avions britanniques soient équipés de catapultes, condition d’une coopération ultérieure plus étroite dans ce domaine. Nos partenaires y ont renoncé, à mon avis, pour des raisons strictement financières, le programme ayant déjà occasionné des surcoûts considérables.
M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes. Paradoxalement, la coopération opérationnelle va plus loin avec le Royaume-Uni qu’avec l’Allemagne avec laquelle nous avons pourtant créé des forces conjointes, mais qui ne sont jamais intervenues. Et, inversement, les coopérations industrielles sont de moindre envergure alors que nos industries respectives sont davantage imbriquées de part et d’autre de la Manche que du Rhin.
Par ailleurs, les succès comme le Jaguar, ou, plus récemment, l’A400M et le Principal Anti-Air Missile System (PAAMS) ne doivent pas faire oublier certains échecs. Je pense à Horizon et aux frégates FREMM. S’agissant du Storm Shadow, le bilan est plus mitigé car il s’agit d’un dérivé du SCALP-EG et la France a assumé l’essentiel des frais de développement de la version britannique.
M. le Alain Claeys, président. Messieurs, je vous remercie.
Audition du 23 mai 2013
À 11 heures : Audition de M. le colonel Henri Sowa, attaché de défense adjoint – attaché de l’air, et de M. l’ingénieur en chef de l’armement Cyril Crozes, attaché de défense adjoint – attaché d’armement, à l’ambassade de France à Rome.
Présidence de M. Jean Launay, co-rapporteur
M. Jean Launay, président et rapporteur. Messieurs, nous vous remercions de nous avoir rejoints pour nous présenter les principaux programmes d’armement menés en coopération avec l’Italie, préciser les modalités de suivi de ces programmes par les services de notre ambassade à Rome et nous préciser les attentes de nos partenaires italiens en matière de défense.
M. le colonel Henri Sowa, attaché de défense adjoint - attaché de l’air à Rome et attaché de défense non-résident pour l’Albanie. Comme il en va pour toutes les relations bilatérales, les relations franco-italiennes en matière de défense présentent quelques spécificités, en raison d’héritages historiques différents de nos deux pays. Ainsi avons-nous eu un empire colonial alors que les possessions coloniales italiennes se limitaient à quelques pays autour de la Méditerranée. Par ailleurs, la débâcle du 8 septembre 1943 ayant profondément marqué les esprits, la Constitution, en son article 11, dispose que « l'Italie répudie la guerre ». Cette disposition oriente nombre de décisions en matière de défense. Enfin, à la suite du Plan Marshall, l’Italie a conservé un lien particulier avec les États-Unis – où vit par ailleurs une diaspora italienne très étendue, sur laquelle le pays s’appuie– et l’on y note un profond attachement à l’OTAN : pour l’Italie, l’Europe de la défense vient toujours après l’Alliance atlantique.
L’Italie tient à son rang et redoute de se voir écartée des coopérations internationales ; cela peut conduire à des réactions opportunistes. Avec la France, les relations sont ambivalentes : faute d’avoir elle-même une vision stratégique de long terme, l’Italie, quand il est question d’une coopération dans un domaine donné, s’interroge toujours sur ce que pourrait être notre stratégie « cachée », et il nous faut dissiper ces procès d’intention. D’une manière générale, l’Italie attend de la France une plus grande considération. Nos relations en matière de défense sont longtemps restées assez crispées ; une embellie a eu lieu à partir de 2010, à laquelle la crise libyenne a donné un coup d’arrêt. L’Italie a en effet considéré qu’en attaquant à la Libye on s’en prenait à son pré carré – un pays avec lequel elle avait signé un traité d'amitié et de coopération. Le sentiment de froissement s’estompe peu à peu, et depuis le dernier Sommet franco-italien de Lyon, les relations sont beaucoup plus constructives.
On constate généralement un manque de vision de long terme dans le domaine capacitaire et d’équipement des forces. L’Italie n’a pas de loi de programmation militaire et les seuls documents doctrinaux structurants émanent de l’état-major des armées. Ces documents ne procèdent pas cependant à une analyse aussi approfondie que celle de notre Livre blanc sur la défense. Le niveau d’ambition stratégique du pays est limité : l’Italie ne prévoit pas de s’engager seule, même s’il faut évacuer ses ressortissants. Elle souhaite toujours agir au sein d’une coalition, et en limitant ses interventions à la « Méditerranée élargie », pour reprendre le terme utilisé en Italie pour désigner le Proche-Orient jusqu’à l’Irak et l’Afghanistan, deux pays où elle a dépêché des forces aux côtés de l’allié américain.
Le corps des ingénieurs de l’armement n’existe pas en Italie. Ces fonctions sont occupées par des officiers des forces, qui peuvent être affectés au Secrétariat général de la défense – Direction nationale des armements (Segredifesa) avant de revenir dans les forces. Ces allers et retours créent des liens assez étroits entre l’industrie de l’armement et les officiers des forces, ce qui peut être un atout pour le soutien à l’exportation. L’interarmisation est encore balbutiante sinon dans quelques rares services de santé des armées. Enfin, l’organisation de Segredifesa rappelle celle de la direction générale de l’armement en France avant la création d’unités de management dotées d’un rôle transversal plus important.
M. l’ingénieur en chef Cyril Crozes attaché de défense adjoint – attaché d’armement à Rome. Je traiterai plus spécifiquement de la coopération avec l’Italie en matière de d’armement. L’Italie mène la très grande majorité – 70 % – de ses programmes d’armement en « coopération », que ce soit sous la forme de véritables collaborations, d’achats « sur étagère » de matériel étranger, ou de fabrication sous licence en Italie de matériels conçus à l’étranger. La France est d’assez loin le premier partenaire de l’Italie en nombre de programmes. Cette relation étroite, qui date des années 1990-1991, est particulièrement soutenue dans les secteurs naval, avec les frégates Horizon et FREMM ; spatial, avec les systèmes d’observation Helios 2 et MUSIS, et, conformément à l’accord de Turin, au travers d’ORFEO ; et dans les systèmes d’armes, avec la famille de missiles Aster ou le programme Meteor. Mais cette coopération très large se traduit aussi dans d’autres domaines : les hélicoptères NH90 par exemple ou encore la radiologicielle Essor.
Ces coopérations reposent aussi sur des réalités industrielles. Il peut s’agir d’entreprises très intégrées comme MBDA, de joint-ventures telles que les filiales communes de Thales et de Finmeccanica dans le cadre de la Space Alliance, ou encore de GIE ad hoc comme par exemple pour les torpilles ou pour la famille des systèmes surface-air à base Aster.
Les autres partenaires privilégiés de l’Italie sont les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Que les liens de l’Italie avec les États-Unis – notamment pour les matériels relevant de l’armée de l’air – soient très affirmés n’a pas empêché, dernièrement, quelques déconvenues, les Américains ayant abandonné certains programmes ; cela peut être un élément important du dialogue franco-italien.
Le poids lourd industriel italien en matière de défense est Finmeccanica. Le groupe, qui a de nombreuses filiales – AgustaWestland pour les hélicoptères, AleniaAermacchi pour l’aéronautique, Selex Electronic systems dans l’électronique de défense… –, se place au huitième rang mondial des industries de défense. Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 17 milliards d’euros, dont quelque 60 % sont réalisés dans le secteur de la défense, le reste relevant du secteur civil et de la sécurité. Finmeccanica a trois marchés « domestiques ». Le principal est l’Italie, mais il y a aussi le Royaume-Uni par le biais de sociétés créées en joint-ventures puis rachetées, et les États-Unis, depuis l’acquisition en 2008 de DRS Technologies, entreprise spécialiste des systèmes électroniques de défense. Pour financer cet investissement de 5,2 milliards de dollars, Finmeccanica s’est considérablement endettée, ce qui est à l’origine de problèmes endémiques. Le deuxième employeur industriel d’Italie après Fiat éprouve des difficultés de différents ordres. Elle connaît des difficultés sur ses marchés intérieurs parce que les budgets baissent ; elle en a aussi parce que sa compétitivité est insuffisante, le groupe ayant été beaucoup alimenté sans que l’on s’interroge réellement sur sa rentabilité. Outre cela, Finmeccanica est impliquée dans plusieurs affaires qui ont conduit au renouvellement de nombreux cadres. Le groupe s’en trouve fragilisé.
Les autres industriels de la défense notables en Italie sont Fincantieri pour la construction navale – la défense comptant pour 20 à 25 % de son chiffre d’affaires, le reste provenant des paquebots de croisière ; Avio, dont l’activité de moteurs pour l’aéronautique est en cours de rachat par General Electrics, et qui fabrique aussi des lanceurs, dont le lanceur européen Vega ; Iveco pour les véhicules terrestres, la défense ne représentant que 7 % de son chiffre d’affaires.
Le reste de la production est assuré par un millier de petites, voire très petites, entreprises essentiellement familiales, comme il en est pour le reste du tissu industriel de la deuxième puissance industrielle européenne.
Comme cela vous a été dit, l’Italie, se voit comme le quatrième membre du club des pays qui comptent en matière de défense dans l’Union européenne. Elle veut être tenue par ses pairs pour ce qu’elle est, et redoute d’être marginalisée. Alors même que l’Italie discutait avec le Royaume-Uni d’une coopération en matière de drones, elle a pris connaissance avec amertume de la conclusion du traité de Lancaster House, les Britanniques n’ayant pas donné suite aux discussions engagées. À côté du couple dominant franco-allemand en matière économique se constituait un couple dominant franco-britannique en matière de défense, et l’Italie s’est sentie isolée.
Or, avec un budget d’investissement en équipements de défense qui varie, selon les années de 4 à 6 milliards d’euros, Rome est un acteur important du paysage de défense européen, dont elle ne veut pas être exclue. Ce budget a une double source de financement : les crédits d’investissement du ministère de la défense, mais aussi les budgets spécifiques du ministère du développement économique qui alimentent toute la filière aéronautique et même les frégates FREMM italiennes. Ces lignes de crédit ad hoc sont parfois difficiles à retracer dans le budget de l’État.
L’Italie, membre fondateur de l’Union européenne, est un pays europhile et européiste qui a aussi, en permanence, un réflexe transatlantique très marqué, en matière de défense en particulier. Ses relations, ambiguës, avec la France vous ont été décrites : une certaine admiration pour la structuration de notre réflexion stratégique, assortie d’une suspicion latente qui peut compliquer le dialogue. À cela s’ajoute une rivalité à l’export, pour les hélicoptères, dans le domaine naval et dans l’électronique de défense. On peut aussi mentionner un certain pragmatisme parfois peu rationnel. Ainsi l’Italie a-t-elle investi dans deux systèmes de défense aérienne et antimissiles : le MEADS réalisé en coopération avec l’Allemagne et les États-Unis, et le SAMP/T avec la France. L’un équipe l’armée de l’air, l’autre l’armée de terre. Dans un contexte de budget contraint, on peut s’interroger sur la pertinence de ces financements parallèles, mais ils permettent à l’Italie de participer à deux programmes de défense et d’être présente auprès de grands partenaires.
J’en viens aux perspectives de coopération entre l’Italie et la France. Les programmes existants sont nombreux ; que faire de plus ? La question des drones est perçue de manière particulièrement critique par nos partenaires italiens, très perturbés par le traité de Lancaster House. Fin 2011, l’Italie a en réaction signé une lettre d’intention avec l’Allemagne, mais cela n’a pas abouti à ce stade à de grandes réalisations. L’Italie craint que son industrie aéronautique ne risque un déclassement si elle ne participe pas à un programme européen. Le pays disposant de drones Predator et Reaper, il s’agit d’une priorité industrielle plus que d’une priorité capacitaire : derrière les drones, il y a les avions de combat, et l’Italie souhaite conserver sa capacité de maîtrise d’œuvre en construction d’aéronautique de défense.
Nous avons l’opportunité de poursuivre une coopération en matière de défense antibalistique, notamment en faisant évoluer le programme SAMP/T B1 vers le B1 NT ; un dialogue soutenu et positif est en cours à ce sujet. On peut également envisager une coopération dans le domaine de la surveillance maritime, particulièrement en Méditerranée, ainsi que la poursuite de la coopération dans le domaine de la radiologicielle.
Nous avons aussi exploré la piste des pétroliers ravitailleurs, soutien logistique pour la marine, sans succès à ce stade.
En résumé, l’Italie est pour la France un partenaire majeur et fiable – exception faite de l’Airbus A400 M duquel l’Italie s’est désengagée –, avec lequel les programmes parviennent à bonne fin. En dépit d’un contexte économique difficile, le pays cherche à maintenir un haut niveau d’investissement dans la défense. Il dispose pour cela d’un tissu industriel de qualité, capable de productions de très haute technologie. Ainsi, le deuxième tir du lanceur Vega, dont le financement est pour 65 % italien et la maîtrise d’œuvre assurée par ELV Spa, a été parfait, comme l’avait été le tir inaugural – et bien peu nombreux sont les lanceurs dont les deux premiers tirs sont réussis.
L’Italie, qui a découvert cette éventualité au dernier moment, a très mal perçu les discussions relatives à une fusion entre BAE et EADS, redoutant de se trouver complètement isolée dans un paysage européen de la défense en recomposition. Cela explique les contacts soutenus noués avec plusieurs industriels pour ne pas subir un déclassement industriel redouté.
M. Jean Launay, président et rapporteur. Je vous remercie, messieurs, pour ces précisions qui, après que nous avons entendu vos homologues des ambassades de Londres et de Berlin, complètent notre aperçu général. Vous avez mentionné plusieurs fois une certaine suspicion à notre égard ; la tenez-vous pour réelle ou pour tactique ?
M. l’ingénieur en chef Cyril Crozes. Je pense qu’il s’agit d’un réflexe premier, et le soupçon que nos propositions puissent cacher un piège complique le dialogue.
M. le colonel Henri Sowa. De plus, le manque de planification à long terme en matière de défense prive l’Italie d’orientations fermes, et nous avons parfois des difficultés à faire appréhender les nôtres.
M. Jean Launay, président et rapporteur. En ce cas, la publication de notre nouveau Livre blanc devrait rassurer vos interlocuteurs : il décrit une ligne directrice affichée et montre que rien n’est caché.
M. l’ingénieur en chef Cyril Crozes. Probablement. Cependant, la méfiance surgit vite quand on aborde les questions de manière plus détaillée que ne le fait le Livre blanc. De plus, la recherche de l’intérêt industriel est toujours très présente.
M. Jean Launay, président et rapporteur. La participation de l’Italie au groupe Weimar Plus est-elle de nature à lever l’inquiétude née de la signature des accords de Lancaster House ? Des initiatives ont-elles déjà été lancées par l’état-major dans ce cadre ?
M. le colonel Henri Sowa. Que l’Italie se soit sentie « exclue » par la signature du traité de Lancaster House est certain. L'Italie a aussitôt essayé de le compenser par un accord signé avec l'Allemagne. Le sentiment d'exclusion est aussi l’une des motivations qui a conduit l'Italie à pousser pour l’élargissement du Triangle de Weimar. Je n’ai pas encore observé de déclinaison véritablement concrète de Weimar Plus au ministère de la défense, ni dans les états-majors.
M. l’ingénieur en chef Cyril Crozes. La concomitance entre la signature du traité de Lancaster House et l’élargissement du Triangle de Weimar n’est sans doute pas fortuite. L’Italie a été heureuse d’être associée au forum Weimar Plus, mais l’on ne discerne pas encore d’action quotidienne dans ce cadre. L’Italie entretient des relations privilégiées avec la Pologne, qui a de grandes ambitions en matière de défense ; les Italiens ont d’ailleurs racheté un hélicoptériste polonais. Appartenir au groupe Weimar Plus est peut-être aussi pour l’Italie une manière d’éviter que la Pologne ne dérive trop vers l’Allemagne et la France.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous avez souligné que nos amis italiens sont très amateurs de coopérations, mais aussi très attentifs au juste retour industriel, ce qui peut entraver les objectifs de la coopération internationale. Quelle opinion ont-ils de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) ? Par ailleurs l’instabilité politique du pays et la très sérieuse crise budgétaire et financière qui l’affecte ont-elles une incidence sur la politique d’investissement en matière de défense, le dimensionnement des armées et la vision stratégique ?
M. l’ingénieur en chef Cyril Crozes. L’Italie a, pour l’essentiel, les moyens industriels et technologiques pour mener à bien seule des programmes d’armement, comme le montrent le lanceur Vega ou encore le M346, avion d’entraînement évolué. Les capacités existent donc, mais de nombreux facteurs militent en faveur de la coopération. En premier lieu, elle permet, en partageant les coûts de développement, un investissement moindre pour disposer de produits de premier ordre. Cependant, le fort attachement de l’Italie au « juste retour » est une contrainte forte qui peut effectivement compliquer les discussions lorsque l’on veut établir un partage industriel qui repose sur des compétences respectives avérées. Ensuite, développer un produit de concert évite de se faire concurrence à l’export – ce n’est pas tout à fait le cas pour la FREMM, j’en conviens, et il faudra à l’avenir savoir mieux anticiper, en parallèle, la logistique et l’exportation. Dans la coopération, l’Italie trouve aussi la satisfaction d’œuvrer aux côtés des États-Unis ou du Royaume-Uni. Sans doute est-il également positif pour l’Italie d’appartenir à un environnement coopératif lui permettant de s’appuyer sur l’expertise d’autres nations, dont la France, non seulement pour la conception des produits mais aussi pour les essais. Enfin, l’Italie s’assure, par ces coopérations, le respect des standards OTAN, question fondamentale pour un pays qui souhaite l’interopérabilité avec les États-Unis.
L’Italie, qui est l’un des membres fondateurs de l’OCCAr, a toujours porté une appréciation positive sur l’Organisation, même si elle craint aujourd’hui de ne pouvoir totalement maîtriser l’outil et y imposer ses positions nationales. L’Italie se dit très satisfaite de l’action menée par Mme Claude-France Arnould à la tête de l’Agence européenne de la défense mais attend de l’Agence davantage de résultats opérationnels.
Concernant l’instabilité politique, l’Italie y est en quelque sorte habituée… En matière économique, la situation est difficile, mais la balance primaire est positive et, hors dette, les fondamentaux ne sont pas mauvais, si l’on exclut la problématique du chômage des jeunes. Les Italiens ont engagé des efforts budgétaires considérables, qui leur permettront de retrouver une marge de manœuvre un peu plus importante. Enfin, le nouveau ministre de la défense a souligné que, indépendamment des besoins capacitaires, l’investissement en matière de défense était crucial pour le tissu industriel et la recherche et développement ; il n’est pas remis en cause actuellement.
M. le colonel Henri Sowa. Le ministre de la défense sortant, l’amiral Giampaolo de Paola, a repris le dossier de la réforme et de la restructuration des forces armées, laissé en l’état depuis dix ans, lançant un plan de rationalisation des effectifs qui se traduira par une réduction de 30 000 postes à l’échéance de 2025. Les missions génériques, les domaines et les modes d'action des armées italiennes demeureront ce qu’ils étaient. Le processus de décision pour l'engagement des forces armées est plus complexe et moins réactif. Il faut du temps pour obtenir l’aval du Parlement et du Gouvernement – et parfois pour ne pas l’obtenir, nous en avons fait l’expérience récemment en essayant d’obtenir un soutien direct à l’opération Serval.
Les mêmes besoins capacitaires peuvent produire une meilleure synergie. Elle peut s’obtenir en harmonisant les besoins capacitaires et opérationnels pour développer un système en commun. On peut aussi, à l’inverse, engager une démarche industrielle commune qui facilitera la synergie dans l’emploi des matériels considérés.
M. Bruno Rémond, magistrat à la Cour des comptes. La coopération en matière de défense entre la France et l’Italie concerne tous les sujets et prend de nombreuses formes, dont l’une est unique en son genre : un GIE commun, EUROTORP. Mais certaines de ces « coopérations » – ainsi des frégates Horizon et FREMM – sont aussi des trompe-l’œil. L’Italie s’intéresse à l’OCCAr. Cela étant, pour l’instant, l’OCCAr n’est pas en mesure de créer et de piloter des programmes d’armement en coopération : il se limite à la gestion de programmes lancés avant sa création, et la diversité des processus fait que l’on ne retire toujours pas les avantages attendus d’une coopération internationale. Il faudrait sortir de cette période d’une coopération engagée de manière désordonnée, chaque État privilégiant la notion de « juste retour », ce qui a eu pour effet que nous nous trouvons à présent devant un patchwork de programmes d’armement assez dense et très enchevêtré, sans bénéficier ni de l’effet positif qu’apporterait l’uniformité des matériels, ni de la baisse des coûts qui en résulterait.
M. Jean Launay, président et rapporteur. Messieurs, considérez-vous aussi que certaines coopérations ne sont qu’en trompe-l’œil ? Vous ferez-vous les avocats de l’OCCAr ?
M. l’ingénieur en chef Cyril Crozes. Il faut, me semble-t-il, distinguer les frégates Horizon et les FREMM. Les quatre frégates franco-italiennes Horizon sont à 95 % communes ; le programme est véritablement mené en coopération, les bâtiments sont communs et les deux marines ont récemment fait ensemble des exercices remarquables au large de Toulon. Ce n’est pas tout à fait le cas pour les FREMM, où on se trouve devant deux produits assez différents.
L’OCCAr a les moyens que les États membres veulent bien lui allouer. Avec un effectif de quelque 240 personnes – ce qui est peu au regard du nombre des programmes considérés –, c’est une toute petite structure, qui reçoit les programmes préparés par les nations ou par l’Agence européenne de la défense. L’OCCAr offre malgré tout un cadre normatif qui permet d’éviter de devoir systématiquement réinventer la conduite des programmes en coopération. De plus, l’Organisation aide à la formation de consensus en s’efforçant à la neutralité vis-à-vis des nations. Mais, ayant moi-même travaillé au sein de l’OCCAr, peut-être suis-je à la fois juge et partie …
M. Jean Launay, président et rapporteur. Messieurs, nous vous remercions pour vos contributions à nos travaux.
Audition du 6 juin 2013
À 9 heures 30 : Audition de l’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées
Présidence de M. Jean Launay, co-rapporteur
M. Alain Claeys, président. Cette mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances a pour but d’évaluer la conduite des programmes d’armement menés en coopération. Dans cette perspective, nous entendrons aujourd’hui l’amiral Guillaud, chef d’état-major des armées, M. Daniel Verwaerde, directeur des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et Mme Astrid Milsan, sous-directrice des services de l’aéronautique et de la défense au sein de l’Agence des Participations de l’État. Cette mission ayant pour objet d’analyser la conduite de ces programmes aux niveaux politique, industriel, technique, et financier, nos auditions de ce matin nous permettront de connaître plus précisément la teneur et la portée des programmes d’armement.
Amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des armées. Pour le militaire que je suis, les programmes d’armement en coopération n’étant qu’un moyen et non une fin en soi, j’aborderai ici la coopération sous un angle général. Je rappellerai en outre à titre liminaire que contrairement à une opinion assez répandue, si les militaires ont toute leur importance au cœur de ce dispositif, la Direction générale de l’armement (DGA) est la première concernée.
La DGA et les forces armées doivent aujourd’hui composer avec les effets d’une crise économique durable, qui nous impose plus que jamais d’optimiser la conduite de nos programmes d’armement. Les industriels de la défense sont eux-mêmes confrontés à des difficultés très lourdes, mais dont les enjeux sont d’une autre nature et parfois contradictoires.
La coopération internationale est présentée comme incontournable, essentiellement en raison des avantages économiques qu’elle présente en termes de partage des coûts. Dans le secteur spécifique des programmes d’armement, à la croisée d’enjeux stratégiques, politiques, opérationnels, économiques et industriels, cette coopération doit être repensée à la lumière des contraintes économiques et financières actuelles, des exigences de nos partenaires et de concepts rénovés tels que le partage et la mutualisation capacitaire. Il y va en effet de la place de la France dans le monde, de sa souveraineté, du succès opérationnel de ses armées, et de la prospérité – voire de la survie – de ses industries.
Afin de cerner cet enjeu dans sa globalité, j’aborderai six points. D’ordre général, les trois premiers viseront à préciser quelles sont les principales caractéristiques des programmes d’armement, quelles opportunités nous sont offertes par les coopérations et quelles en sont les conditions de succès. D’ordre plus pratique, les trois points suivants auront pour objet d’expliciter les domaines dans lesquels il convient de coopérer, avec qui et comment. J’ai pour ma part acquis près de trente ans d’expérience en la matière puisque c’est en 1984 que je fus envoyé pour la première fois à Hambourg en Allemagne comme représentant de la marine française au sein d’un programme de coopération.
Quelles sont, en premier lieu, les cinq caractéristiques des programmes d’armement ?
Ces derniers répondent, tout d’abord, à un besoin exprimé par les armées et relèvent à ce titre du domaine régalien – celles-ci n’étant qu’un instrument au service de l’État.
Deuxième caractéristique : ces programmes sont par nature spécifiques. Car même s’ils s’appuient de plus en plus sur des technologies duales, leur finalité est militaire : c’est celle du combat et de son environnement – c’est-à-dire principalement la maintenance, la logistique et la simulation. Ce besoin implique des savoir-faire et des processus particuliers, mis en œuvre à la fois par des services étatiques et par l’industrie de défense.
Troisième caractéristique : ils recouvrent une grande diversité de matériels, allant de la puce électronique jusqu’au porte-avions à propulsion nucléaire, c’est-à-dire du composant d’un système au système de systèmes. Ils peuvent de fait mobiliser plusieurs centaines d’entreprises, et parfois même plusieurs milliers.
Quatrième caractéristique : ils s’inscrivent aujourd’hui dans le temps long, du fait de leur complexité – et donc leur coût – ainsi que de leur modularité – et donc de leur potentiel d’évolution. De fait, il s’écoule généralement plusieurs décennies depuis les premières esquisses d’un programme jusqu’à son démantèlement. Ainsi, par exemple, la première fiche programme de l’A-400, dont le premier exemplaire rejoindra bientôt notre armée de l’air, fut rédigée en 1984, soit il y a près de trente ans. De même, le premier vol du démonstrateur du Rafale date de 1986. Le premier avion de ce type a été admis au service opérationnel en 2000 dans un standard incomplet ; le premier standard complet, dit « F3 », n’est arrivé qu’en 2008. Et nous utiliserons cet avion au moins jusqu’à 2035 ou 2040.
Cinquième caractéristique : ces programmes sont dès l’origine appréhendés par le ministère de la défense de manière globale, c’est-à-dire en termes de développement, d’utilisation, de soutien et d’environnement. Dans ce contexte, nos ressources humaines constituent donc un élément central de l’équation puisqu’il nous est nécessaire d’anticiper et de décliner nos besoins en termes de recrutement, de formation et d’entraînement – s’agissant en particulier du volet de simulation dont l’importance va croissant.
Quelles sont, en second lieu, les opportunités offertes par ces coopérations ? Tout programme d’armement est destiné à satisfaire un besoin opérationnel, et donc à respecter un certain nombre d’exigences définies en termes de performances, de coûts et de délais – triptyque infernal bien connu de tous ceux qui, comme moi, ont été officier de programme. La question de l’adéquation des programmes à nos besoins opérationnels est d’autant plus prégnante que, dans cette période de construction de la loi de programmation militaire, nos ressources sont comptées.
Au regard de telles exigences, la conduite de programmes en coopération nous offre trois opportunités.
La première, celle de partager les coûts non seulement de conception, de développement et d’industrialisation, mais aussi, éventuellement, ceux d’utilisation et de soutien. Il s’agit en effet de disposer à plusieurs d’une capacité que l’on ne peut développer seul en raison des masses financières que cela implique et, quelquefois, des accès technologiques concernés.
Les bienfaits attendus de la coopération doivent toutefois faire l’objet de l’analyse la plus fine possible, de telle sorte que la complexité de la conduite à plusieurs d’une opération d’armement n’engendre ni surcoûts, ni perte de performance, ni retard prohibitif. Le programme Joint Strike Fighter (JSF) d’avions dits de cinquième génération que mènent les Américains est un exemple particulièrement parlant de ce genre de dérives, puisque tant son coût d’acquisition que les coûts totaux du programme ont doublé.
Vous n’êtes pas sans ignorer la loi en vertu de laquelle l’écart entre le coût global d’un programme en coopération et celui d’un programme national s’obtient en calculant la racine carrée du nombre de partenaires impliqués : ainsi, lorsqu’un programme en coopération associe deux partenaires, son coût est multiplié par 1,4. Dès lors que ce coût est également réparti entre eux, chacun n’aura à payer que 0,7 fois ce coût, soit une économie de 30 %. En présence de trois partenaires, ce coût sera multiplié par 1,7. Chacun n’aura donc à financer que 0,6 fois ce coût, soit une économie de 40 %. Il faut bien entendu que la répartition soit équitable, ce qui n’est pas toujours le cas : c’est un enjeu fondamental pour des pays comme le nôtre – qui sont souvent moteurs.
Deuxième opportunité : ces coopérations favorisent le renforcement des liens entre États partenaires. Le secteur de la défense étant régalien par nature, la coopération en ce domaine correspond donc à l’expression d’une forte volonté politique de rapprochement – a fortiori dans la durée – dont les conséquences sont particulièrement intéressantes, qu’elles se traduisent par la convergence des doctrines d’emploi et des savoir-faire opérationnels ou par la structuration des industries de défense.
Dernière opportunité, enfin : ces coopérations facilitent l’interopérabilité opérationnelle et logistique, ce qui peut ouvrir plus aisément la voie à des mutualisations ou à des partages capacitaires dans les domaines des opérations, de la formation, de l’entraînement ou du soutien. L’A-400 devrait d’ailleurs nous en fournir un bon exemple. Si l’interopérabilité est pour nous primordiale, c’est que nous ne sommes pas les États-Unis et qu’il nous est par conséquent difficile de tout faire tout seuls partout. La nécessité de coopérer s’illustre d’ailleurs aujourd’hui au Mali.
Quelles sont, en troisième lieu, les conditions de succès de ces programmes ? Leur conduite nécessite trois prérequis que j’exposerai en allant du plus complexe au plus simple à obtenir.
Il faut, d’abord, – et c’est le plus compliqué – définir un montage industriel satisfaisant les différentes parties en présence, montage dont la donnée d’entrée doit être la compétence et non le work sharing politique. Les risques ici encourus sont essentiellement d’ordre technique et économique, compte tenu de la nécessité de garantir un juste retour des investissements. Ils sont aussi d’ordre industriel, le but étant d’optimiser les savoir-faire nationaux – voire de réacquérir des savoir-faire perdus comme dans le cas de l’A-400. Dans tous les cas, le nombre de partenaires impliqués dans le programme constitue un facteur déterminant, tant de ses chances de succès que de sa complexité – que je souhaite bien évidemment limiter autant que possible.
Il faut ensuite une forte volonté politique, et donc un engagement identique de tous les États parties sur toute la durée de vie du programme. Cet engagement se décline en trois volets principaux : l’entretien de la confiance entre les États partenaires, le soutien des industriels et l’implication des armées.
Il faut, enfin, – c’est le plus facile à obtenir, contrairement à ce que beaucoup croient – s’entendre sur le besoin opérationnel, et donc sur les spécifications de la capacité à développer – en termes de coûts, de délais et de performances. Une telle exigence réduit ainsi les risques technologiques et opérationnels – la non-satisfaction du besoin – à condition qu’il y ait préalablement convergence de vue sur les doctrines d’emploi. Il en existe bien entendu des contre-exemples célèbres comme celui du pétrolier ravitailleur tel que vu par la Marine française d’une part, et la Marine britannique d’autre part. Mais cette situation résulte davantage d’une histoire multiséculaire que de la mise en œuvre de doctrines divergentes.
En quatrième lieu, dans quels domaines faut-il ou peut-on coopérer ? La coopération est aujourd’hui envisageable dans tous les domaines, à l’exception de certaines « niches » touchant les fondements de notre souveraineté opérationnelle – en particulier dans le domaine de la dissuasion – ou technologique, celles que l’on qualifie du point de vue industriel de « capacités du premier cercle ». Notre coopération avec les Britanniques relève néanmoins davantage de ce premier cercle que celle que nous entretenons avec d’autres pays.
La coopération est plus aisée s’agissant des capacités du deuxième cercle, c’est-à-dire celles que l’on envisage de développer dans un cadre européen, voire de celles du troisième cercle, qui sont ouvertes au marché mondial – même s’il existe des coopérations dans le domaine de la dissuasion nucléaire pour certains équipements de la force de frappe et de l’environnement des forces, ainsi que dans certains domaines réservés comme la simulation laser mégajoule et la simulation à l’aide de machines à rayon X. Il reste que dans ces domaines, le nombre de partenaires possibles se compte sur les doigts de la main, tant la coopération est difficile.
Compte tenu du coût des programmes d’armement modernes et de la multinationalisation croissante des industriels du secteur, la coopération reste une voie à privilégier – sous les réserves précédemment décrites – lorsqu’elle ne s’impose pas de fait. Elle doit en tout cas être systématiquement recherchée pour toutes les capacités nécessaires mais inaccessibles au niveau national pour des raisons de coût ou de savoir-faire technologique ou industriel que d’autres maîtrisent déjà. Parmi celles-ci, les capacités garantissant notre autonomie stratégique ou celles nous permettant de jouer en coalition un rôle conforme à l’ambition que nous avons définie dans le Livre blanc constituent la première priorité. À court terme, les moyens de renseignement stratégique comme les futurs satellites d’observation Musis, successeurs d’Helios, et les capacités d’entrée en premier comme les missiles de croisière de type SCALP, ou leur équivalent britannique Storm Shadow, et les missiles air-air à moyenne et longue portée Météor en sont des exemples.
À cet égard, ce sont évidemment les programmes « à effet majeur » – aussi bien en termes militaires qu’en termes de masses financières et de capacité technologique et industrielle à mobiliser – qui sont les plus délicats. Pour autant, environ 30 % de nos investissements, hors dissuasion, sont réalisés en coopération : outre l’A-400, on citera notamment les hélicoptères Tigre et NH-90, les frégates multi-missions (FREMM) et le missile Météor. De plus, les composants de ces programmes sont propices aux coopérations : c’est le cas, entre autres, de l’électronique, des communications ou encore des armements embarqués.
Cependant, le fait qu’ils soient aussi les plus emblématiques du savoir-faire industriel national complique – voire interdit – certains montages industriels multinationaux. Le domaine de l’aviation de combat en est un exemple éloquent puisque l’on recense sur le même créneau trois chasseurs européens ne relevant néanmoins pas de la même catégorie : le Rafale, l’Eurofighter Typhoon, et le Gripen américano-suédois.
D’autres programmes se prêtent difficilement aux coopérations, pour des raisons de confidentialité – les sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) – ou d’ambitions peu partagées – le porte-avions. Par ailleurs, les États ne disposant pas de l’industrie de défense nécessaire privilégient l’achat sur étagère – où qu’elle se situe, et pas seulement en Europe – ou en seconde main : il est certain que pour les Danois, par exemple – qui sont pourtant de grands combattants et qui nous aident systématiquement dans nos opérations –, il est absolument équivalent d’acheter un armement à Londres, Paris ou Washington.
En cinquième lieu, avec qui coopérer ? Pour répondre à cette question, quatre critères me semblent devoir être pris en compte.
Premièrement, le partenariat doit être gagnant. Les gains attendus peuvent porter sur le programme lui-même, mais il n’est pas forcément nécessaire que chaque programme pris individuellement soit gagnant. Il importe en revanche que la coopération avec un pays soit gagnante dans sa globalité – cela permet de gagner sur d’autres secteurs tels que le commerce, l’industrie ou les investissements. C’est bien là la vision que nous essayons de partager avec les Britanniques : trouver un équilibre global sur un ensemble de programmes –anti-navire léger (ANL), rénovation du SCALP-Storm Shadow et système de lutte anti-mines futur (SLaMF) –, ensemble auquel on peut d’ailleurs ajouter notre coopération en matière de simulation nucléaire, ce n’est pas faire du 50-50 dans tous les domaines.
Deuxièmement, coopérer crée une interdépendance qui doit être assumée. Le choix des partenaires doit donc intégrer l’histoire de la relation bilatérale dans son ensemble et ses perspectives à court, moyen et long termes, compte tenu de l’évolution prévisible des grands équilibres internationaux – qui sont aujourd’hui plus instables et plus évolutifs. D’où l’intérêt et l’importance de la mise à jour régulière de l’état du monde et des ambitions d’un pays dans le cadre de nos livres blancs successifs.
Troisièmement, la coopération doit être opportuniste, et pas forcément exclusive. Il s’agit en effet de choisir nos partenaires avec pragmatisme, en fonction des domaines où cette coopération sera gagnante. Leur volonté de coopérer, leur fiabilité à l’horizon envisagé et leur potentiel réel ou raisonnablement prévisible sont des critères primordiaux.
Enfin, du point de vue opérationnel, la perspective d’une coopération programmatique est d’autant plus robuste qu’elle nous associe à un allié historique ou à un véritable partenaire stratégique, avec lequel nous conduisons des opérations ou des exercices conjoints, ou avec lequel nous sommes liés par des accords de défense et de coopération. La nature de ces coopérations opérationnelles oriente de plus celle des coopérations programmatiques, comme l’illustrent l’ouverture sur Weimar et la tentative de rapprochement avec la Pologne.
Dans ce cadre, l’espace européen et, plus généralement, l’espace transatlantique constituent un vivier privilégié, d’autant plus qu’ils sont dotés d’organisations aptes à structurer les coopérations : l’Agence européenne de défense (AED) pour l’Union européenne et le Commandement de la transformation (SACT) pour l’OTAN, basé à Norfolk et commandé par un Français. Il convient cependant de se garder de tout angélisme : dans chaque domaine de coopération retenu, y compris dans nos opérations militaires, seuls comptent les alliés qui veulent et qui peuvent.
Nos partenaires et clients arabes, asiatiques, sud-américains, maghrébins et africains offrent également des perspectives contrastées, qu’il convient systématiquement d’étudier au cas par cas. Seuls les plus riches d’entre eux rentrent dans les critères d’une coopération stricto sensu. Toutefois, le cheminement allant de l’acquisition d’armements au transfert de technologies puis aux développements conjoints correspond à une forte volonté – et à une réalité –, en particulier pour les pays émergents, et notamment pour le Brésil. Le cas du contrat Rafale pour l’Inde, avec production sur place, est à cet égard symptomatique. En tout état de cause, le rôle du soutien à l’export est déterminant, au moins à moyen terme.
Quelles doivent être les modalités de ces coopérations ? L’industrie de défense mondiale est aujourd’hui marquée par plusieurs tendances : la longévité des programmes d’armement, l’augmentation sensible de leurs coûts de développement et de possession et la rationalisation des industriels du secteur entraînent une forte tension sur le marché qui est de plus en plus concurrentiel. Les Américains ne pouvant plus vivre uniquement sur leur marché, cela amplifie le phénomène dans des proportions considérables. Ainsi MBDA avait-il quasiment signé un contrat de plus de 2 milliards de dollars avec Oman en janvier, qui a ensuite été attribué à Raytheon à la suite d’un voyage du secrétaire d’État américain John Kerry. C’est là la grande agressivité commerciale des Américains : ce ne sont plus les acheteurs qui vont chez les Américains ; ce sont les Américains qui vont chercher les clients.
Comme, par ailleurs, les pays occidentaux connaissent une nette contraction de leurs budgets de défense, cela se traduit par une réduction des cibles et un étalement, voire un abandon des programmes. Pour certains, les renoncements capacitaires induits sont assumés. C’est le cas de la plupart de nos partenaires européens, qui misent sur l’OTAN pour assurer leur défense.
Ailleurs dans le monde, et en particulier dans les pays émergents, le secteur de la défense est au contraire en expansion – seuls les États européens diminuent leurs budgets de défense. On y constate ainsi une montée en puissance militaire ouvrant les perspectives du marché, un développement du tissu industriel – notamment en Afrique du Sud, État en passe de devenir un grand exportateur – et une prise de compétence dans les technologies de pointe, avec une forte volonté de s’appuyer sur des transferts de technologie.
Un tel essor exacerbe la concurrence, puisque de plus en plus de produits sont disponibles à meilleur coût – songez notamment aux « offres chinoises » sur le marché des avions de combat et des drones. D’un point de vue militaire, les risques s’en trouvent augmentés par la fourniture de capacités plus nombreuses, plus diversifiées et de meilleure qualité. En contrepartie s’accroît également le niveau d’exigence de nos clients, qui disposent parfois ou qui pourraient disposer d’un matériel français plus performant que le nôtre : Mirage 2000-9 émirien et versions du Rafale export.
Cette conjoncture risquant d’être durable, nous devrons nous y faire. Plus que jamais, les coopérations doivent donc être utiles et rentables. Il y va des capacités militaires nécessaires à nos armées comme de la survie de certaines entreprises du secteur de la défense. Dans ce contexte, notre approche des coopérations doit être renouvelée.
Les perspectives de mutualisation et de partage capacitaires, qu’elles soient portées par SACT ou par l’AED, qu’elles se nomment « Smart Defence » ou « Pooling and Sharing », sont une opportunité à saisir, mais il ne s’agit là ni de l’alpha ni de l’oméga, encore moins de la panacée. Sans doute conviendrait-il de favoriser la convergence des besoins ainsi que la rationalisation des capacités dans un cadre multinational – et ce, pour tous les volets d’une capacité. En tout état de cause, l’intérêt d’un partage ou d’une mutualisation se mesure à l’aune de la garantie d’accès à la capacité qu’elle offre en temps, en nombre et en qualité requis, sans restriction d’utilisation imposée par le partenaire autre que celles ne faisant pas obstacle à votre besoin politique.
Les spécifications doivent donc obéir, encore plus que pour les programmes nationaux, au principe de réalisme, et être fondées sur le juste besoin capacitaire et le recours à des technologies maîtrisées, ce qui relève non pas d’une question militaire, mais d’un problème d’ingénieurs. Ces derniers adorent faire de la recherche et du développement alors que nous préférons avoir un matériel simple et rustique. Si nous laissons faire les ingénieurs, nous aurons des choses formidables, mais en trop petit nombre et trop tard. L’immaturité technologique conduit à des dérives préjudiciables, qui peuvent aller jusqu’à remettre en cause l’avenir même d’un programme, comme l’illustrent les difficultés rencontrées dans le passé avec l’A-400 ainsi que les problèmes actuellement posés par le JSF – la Chambre des représentants américaine ayant failli avant-hier remettre en question le financement d’une partie de ce programme.
Le retour industriel calculé sur un seul programme ne doit plus constituer une clef d’entrée systématique, comme ce fut trop longtemps le cas. De ce point de vue, les règles de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAr) permettent désormais d’envisager un retour sur plusieurs programmes sur une base pluriannuelle. Les industriels choisis doivent l’être en fonction de leur maîtrise effective des technologies mobilisées et non pas du désir de l’industriel ou de l’État d’acquérir cette autonomie pour ensuite devenir un concurrent – comme on l’a notamment constaté en Italie.
Les « grandes multinationales de la coopération » sont séduisantes mais hasardeuses, comme nous le rappellent les cas de l’A400 ou du NH90, programme de l’OTAN comprenant vingt-quatre versions pour dix-sept pays.
Dans ces conditions, il me semble préférable d’adopter une politique des « petits pas » qui soit pragmatique et progressive, à partir de projets bilatéraux ouverts, potentiellement inclusifs, ou bien de projets multilatéraux fondés sur une forte convergence du besoin et de l’agenda, éventuellement élargis à d’autres nations, une fois les modes de gouvernance consolidés. Dans l’affaire de la frégate Horizon, nous avons commencé par coopérer avec les Britanniques. Nous avons voulu faire entrer trop tôt les Italiens si bien que les Britanniques se sont retirés, ce qui nous a donc fait perdre du temps. La chronologie et l’instanciation des décisions sont par conséquent très importantes.
En conclusion, si la coopération me paraît intéressante – en tant que chef militaire –, c’est d’abord, parce qu’elle facilite l’interopérabilité. À l’heure des opérations interarmées, internationales et combinées, cette dernière est en effet une clef du succès, tant le fait de disposer de matériels communs, ou à tout le moins compatibles, conditionne la synergie en matière de doctrine et de procédures. Ma deuxième raison est d’ordre économique. Ce n’est pas le coût unitaire du matériel qui compte ; ce sont les investissements dans la conception et le développement, qu’aucun pays ne peut plus assumer seul, sauf sur de tout petits éléments. À cet égard, la coopération favorise l’accès aux matériels de forte capacité nécessaires à la diversité de nos missions et au rôle d’entraînement que nous entendons jouer sur la scène internationale.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Quelle est l’articulation actuelle entre les différents acteurs en présence – industriels, DGA, état-major et politique ? L’organisation de votre état-major ainsi que la relation existant entre celui-ci et la DGA sont-elles suffisamment structurées pour nous permettre de bien traiter nos problèmes actuels et de repenser nos programmes de coopération dans le sens que vous indiquez ? Serait-il nécessaire de vous doter de nouvelles compétences pour vous permettre d’assurer un meilleur suivi des programmes ?
Quant à l’équilibre global dont vous nous parliez, l’une des innovations possibles en la matière ne consisterait-elle pas à envisager le retour industriel y compris sur des questions non militaires ?
M. Jean Launay, rapporteur. Vous avez insisté, à juste titre, sur les conditions nécessaires au succès des programmes d’armement en coopération. Permettez-moi par conséquent de souligner à nouveau l’importance de l’articulation entre le politique, le militaire et les ingénieurs de l’armement. Si nous nous interrogeons aujourd’hui sur ces questions, c’est parce que nous avons relevé des manques et des insuffisances en la matière – qu’il s’agisse de surcoût ou de prolongation des délais de livraison. Votre intervention nous confirme donc vers quel idéal il nous faut tendre tout en nous permettant de mesurer à quel point le passé et les évolutions géopolitiques actuelles peuvent peser sur les conditions de mise en œuvre de ces programmes.
Je souhaiterais pour ma part vous interroger sur le format « Weimar ». Ayant reçu la semaine dernière des sénateurs polonais également accueillis par notre Commission des affaires étrangères, j’ai eu l’occasion de m’apercevoir que lorsque l’on connaît mal l’histoire – notamment récente – de ce pays, il peut arriver de commettre des erreurs de langage qui obèrent ensuite nos conditions de dialogue. Cela dit, nos relations politiques avec la Pologne ont récemment repris un peu de force et nous nous trouvons désormais dans les conditions d’un véritable triangle isocèle, ce qui n’était pas le cas auparavant dans le cadre de l’axe franco-allemand.
Je poserai deux questions concernant la Pologne. Quant à la relance de la politique de défense européenne, le format de Weimar, qui est fondé sur une relation trilatérale, constitue-t-il une opportunité et une carte à jouer ? C’est peut-être en effet en ce domaine que nous parviendrons plus aisément à l’interopérabilité, à condition que l’envie de coopération – en particulier avec la Pologne – se fonde avant tout sur de véritables objectifs politiques. Si nous n’abordons en revanche notre relation avec les Polonais uniquement sous l’angle du vendeur de potentiel d’armement, nous échouerons. Qui connaît l’échiquier politique polonais s’aperçoit qu’une partie de celui-ci demeure méfiant sur ce sujet et se trouve davantage attiré par un travail partagé dans le cadre de l’OTAN. Cela étant, le fait que nous ayons réintégré le commandement militaire peut nous redonner des chances.
Que pensez-vous du regroupement des unités des trois pays depuis le 1er janvier 2013 dans le cadre de la force de réaction rapide de l’Union européenne – allant dans le sens non pas des programmes d’armement en coopération, mais de l’interopérabilité ?
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous avez insisté dans votre propos, amiral, sur l’importance de la coopération globale, voie qui n’est actuellement explorée qu’avec les Britanniques. Voyez-vous d’autres pays avec lesquels elle pourrait s’envisager ? Lors d’une audition précédente, l’un de nos attachés militaires à Rome avait indiqué que nos différences de vision stratégique avec l’Italie rendaient une telle coopération difficile, ce qui est regrettable, ce pays étant la quatrième puissance militaire de l’UE.
Ne pourrait-on pas passer d’une coopération globale à une coopération renforcée – terme utilisé au sein de l’UE dans d’autres domaines –, permettant de faire émerger une politique commune n’impliquant que des pays volontaires et constituant les prémisses de l’Europe de la défense, dont on parle depuis plus de cinquante ans sans obtenir d’avancées décisives ? Comment, enfin, préparez-vous le Conseil européen de la fin de cette année ?
Amiral Édouard Guillaud. Monsieur Cornut-Gentille, notre articulation interne doit être compatible avec celles de nos partenaires. Le système allemand s’organise en tuyaux d’orgue comme le démontre la problématique du drone Euro Hawk. À la suite du traité de Londres signé à Lancaster House, nous avons découvert que l’organisation britannique était également très différente de la nôtre. Ainsi, la fonction de DGA stricto sensu n’existe pas au Royaume-Uni, car elle a été externalisée ; on en mesure les conséquences avec les urgences opérationnelles qui coûtent plusieurs centaines de millions d’euros par an contre quelques dizaines de millions d’euros pour nous.
Nous devons également maintenir notre compatibilité avec l’UE et avec l’OTAN. Des bureaux à l’état-major des armées sont chargés de cette mission. Comme toujours, le point délicat réside dans l’articulation entre le client final – les armées – et le fournisseur étatique – la DGA ; une instruction – n° 1516 – régit cette relation en mettant en place la gestion du triptyque « coût, délai, performance ». Le militaire est intéressé par la performance du matériel dont la qualité technique et technologique est définie par la DGA, le délai relevant de la responsabilité de tous, militaires, DGA et industriels. Ces trois acteurs assument successivement le premier rôle dans la vie d’un programme, ce dont il n’y a pas à s’offusquer. Nous pouvons néanmoins réaliser des progrès dans les relations entre l’état-major des armées et la DGA. Cette coopération étroite – qui avait fait émerger la notion d’équipe de programme intégrée – est mise en œuvre par les architectes de systèmes de force de la DGA et, dans l’état-major des armées, par les officiers de cohérence opérationnelle pour les capacités du programme et par les officiers de cohérence de programme pour le contenu et la soutenabilité humaine et financière du projet par rapport aux ressources disponibles. Nous continuons de progresser, même si des améliorations sont encore possibles. Comme la coopération est indispensable à la conduite de l’essentiel de nos programmes, nous devons développer une organisation globale qui soit compatible avec celle de nos partenaires, celle de l’UE – avec l’Agence européenne de défense et l’OCCAr, plus ancienne et plus vaste que l’UE, qui suit les programmes une fois ceux-ci lancés par l’AED – et celle de l’OTAN. Cette dernière – créée en 1949 et dont nous avons rejoint le commandement intégré – n’est pas forcément plus efficace dans ce domaine malgré sa plus grande ancienneté ; la principale difficulté réside dans le nombre des membres de ces organisations : vingt-sept pour l’UE et vingt-huit pour l’OTAN.
Le ministère de la défense exprime des besoins que les ingénieurs satisfont, les choix étant effectués par les responsables politiques : ainsi, Mme Michèle Alliot-Marie engagea la construction de frégates multi-missions (FREMM) en coopération avec l’Italie, ce programme se révélant une réussite paradoxale puisque peu d’éléments – à part la coque des bateaux – sont communs aux deux pays. La frégate française fonctionne bien, les Italiens rencontrent quelques complications, mais nous avons gagné en expérience sur la coopération pluriannuelle grâce à ce programme. En revanche, nous nous retrouvons désormais en compétition frontale avec l’Italie à l’exportation, puisque nous vendons un matériel qui porte le même nom.
La volonté politique a soutenu l’anti-navire léger (ANL), qui impose désormais au DGA et à moi-même de trouver des solutions non pas techniques, mais d’allocation des crédits dont nous disposons, même si ce programme répond à un besoin militaire avéré. Les responsables politiques n’interviennent donc pas uniquement pour définir les grandes orientations. Le type de contrat et le nombre d’acteurs qui y souscrivent ont une influence sur la gestion des surcoûts : le régulateur du moteur de l’avion A 400M a été élaboré par des entreprises au Royaume-Uni et en Allemagne, ce qui a engendré un retard de trois mois pour le prototype du régulateur et de trois ans pour sa fabrication. Qui est responsable de ce surcoût et qui l’assume ? En revanche, le moteur de l’A 400M a été, à l’origine, produit par Rolls-Royce et par Snecma : il s’agit du plus gros turbopropulseur du monde – les Américains pensaient que cela ne marcherait jamais. Son succès résulte de la volonté sincère de coopérer de seulement deux industriels qui ne cherchaient pas à « pomper » le savoir faire de l’autre.
S’agissant du Triangle de Weimar, vous avez parlé, monsieur Launay, d’objectifs politiques communs. Depuis quelques années, l’ancien ministre de la défense polonais, M. Radoslaw Sikorski, et les actuels président et ministre des affaires étrangères ont impulsé une évolution dans leurs relations avec la Russie et l’Ukraine. Mon homologue polonais m’a ainsi appelé la semaine dernière pour m’informer que les Ukrainiens demandaient à participer à l’opération European Union Training Mission (EUTM) Mali, bien qu’ils n’appartiennent pas à l’UE. Favorable à cette initiative, j’ai mis au point avec mon alter ego polonais une proposition que l’Ukraine déposera à Bruxelles. Ce genre de dialogue était impensable il y a quelques années. Le repositionnement de la politique de défense américaine influe aussi. Ainsi, depuis plus d’un an, la Pologne se trouve presque systématiquement en accord avec nos positions à l’UE et nous devons saisir cette opportunité. En octobre prochain a lieu un exercice de l’OTAN : tout le monde a refusé d’y participer, parce qu’il fallait y envoyer des hommes. Seule la France y fournira un contingent important. Cet engagement a un coût, mais j’ai décidé de le maintenir – malgré nos difficultés budgétaires actuelles et alors que j’ai annulé deux exercices aux Etats-Unis et au Brésil – au nom du Triangle de Weimar. La prise d’alerte du groupement tactique (GT) de Weimar –un GT de l’UE – s’achève le 1er juillet prochain. Comme tous les GT, il coûte cher et nous n’avons pas encore réussi à le déployer – même en exercice –, mais on se rendra compte de son utilité pour l’interopérabilité. Cela pourrait déboucher sur une coopération en matière d’armement dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Où pourrait-on les déployer ? Au Kosovo, mais également en Afrique. L’intervention au Mali mobilise l’équivalent de trois GT de l’UE, qu’il a fallu déployer en quelques jours, alors que quelques mois sont nécessaires lorsque l’on passe par la commission européenne. Mais l’important est d’utiliser les forces de coopération – « use it or lose it » comme le disent les Britanniques –, ce qui est ardu à Bruxelles où la règle du consensus donne à chacun un droit de veto. Or je souhaiterais que l’on avance sur certains sujets et que l’on installe un GT au Kosovo pour y prendre la suite de l’OTAN : le Kosovo, c’est quand même en Europe !
Oui, monsieur Bridey, nous pouvons développer une coopération globale avec d’autres pays que le Royaume-Uni, mais pas forcément avec les États importants auxquels on pense habituellement. Comme vous l’avez dit, il faut d’abord une vision stratégique commune. La vision italienne reste avant tout centrée sur l’alliance américaine mais l’Italie dispose de capacités financières, économiques, industrielles, et technologiques, de ressources humaines et en matériel performantes et de connaissances utiles de leurs anciennes colonies que sont la Libye, la Somalie et l’Ethiopie.
En dehors du cas spécifique de la Pologne que nous venons d’évoquer, le seul autre grand pays avec lequel nous partageons une vision stratégique commune est l’Espagne. Les Espagnols connaissent certes une situation économique catastrophique, mais ils ont la même vision globale du monde que la nôtre et ils nous permettent de mieux comprendre l’Amérique du Sud. Trois pays de plus petite taille, situés en Europe du Nord – le Danemark, la Norvège et la Suède –, pourraient également développer un ensemble d’idées proches des nôtres.
Le Danemark fut le premier pays à nous rejoindre en Libye et au Mali – en moins de vingt-quatre heures dans les deux cas. Malgré leur positionnement actuel de neutralité, les Suédois se projettent dans de nombreux théâtres d’opération. Nous réussissons également à mener des actions de coopération de niche avec la Norvège. Ces trois pays font presque toujours front avec nous, dans l’UE comme à l’OTAN – s’ils sont membres de ces organisations bien entendu. Le Portugal pourrait devenir un partenaire semblable à ces pays nordiques.
Je suis favorable à l’idée des coopérations renforcées qui permettent une « politique des petits pas », initiée à deux ou trois pays et ouverte aux autres. Le Danemark souhaite ainsi s’associer à certains aspects de la force expéditionnaire interarmées conjointe (Combined Joint Expeditionary Force ou CJEF) de Lancaster House et nous y sommes favorables.
Quant au Conseil européen, le ministère de la défense – représenté par le cabinet du ministre, la délégation aux affaires stratégiques (DAS), la DGA ou l’état-major des armées – participe à plusieurs groupes de travail. Mais pour avancer, encore faut-il que les autres en manifestent l’envie !
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Quels risques pèsent sur la coopération franco-britannique ? Existe-t-il des opportunités à saisir et à quelles conditions pourront-elles l’être ?
M. Jean Launay, rapporteur. Nous résisterons à la tentation de rejeter sur les experts militaires et industriels la responsabilité d’éventuelles dérives dans les programmes de coopération passés ou futurs, puisque l’on a bien compris que le poids de la décision politique était important – que ce soit pour les FREMM, pour l’ANL auxquels vous avez fait allusion, mais également pour le récent achat de drones sur étagère. Amiral, quelle devrait être l’articulation entre les politiques, les militaires et les ingénieurs de l’armement ?
Amiral Édouard Guillaud. Monsieur Cornut-Gentille, la coopération franco-britannique connaît des hauts et des bas, mais même durant les périodes moins favorables, la tendance reste positive. Rapidement après le traité de Lancaster House, la guerre en Libye nous a contraints de mettre entre parenthèses certaines de nos demandes.
Un senior level group – situé à Downing Street et à l’Élysée –, la Letter of intent entre mon homologue britannique et moi-même, des groupes travail animés par nos adjoints et des high level working groups – présidés par le DGA et son homologue – permettent de faire fonctionner cette coopération et de réaliser des avancées. Si le projet de l’ANL n’avait pas abouti, des doutes se seraient exprimés sur l’état de notre entente, mais nous nous connaissons de mieux en mieux ; ainsi, nos deux pays échangent des officiers insérés – qui ne sont pas seulement des officiers de liaison, car ils remplacent des officiers nationaux – et des informations, notamment sur l’Afrique où nous profitons de leur expertise sur l’Afrique anglophone et eux de la nôtre sur l’Afrique francophone.
L’organisation actuelle, née à Lancaster House, fut initiée par Gordon Brown et elle a été poursuivie par David Cameron, alors que cette continuité n’allait pas de soi. Je ne crains donc pas de retour en arrière, même si les menaces existent : elles sont avant tout de nature économique et si l’un de nos deux pays restait plus longtemps en crise, l’autre pourrait s’en désintéresser. Afin de préserver l’avenir de notre association, nous acceptons ainsi d’assumer une charge plus lourde que la Grande-Bretagne dans notre coopération bilatérale.
Monsieur Launay, le programme 146, « Équipement des forces », est coprésidé par le délégué général pour l’armement et le chef d’état-major des armées ; la DGA a résisté à ce partage des pouvoirs au moment de la mise en place de la LOLF, mais l’exigence de cohérence prima. Certains défendent encore l’idée d’une responsabilité unique de la DGA sur ce programme, ce qui déboucherait sur la fabrication de matériels sans doute performants, mais qui ne seraient pas pensés en fonction des besoins. Je reste donc attaché à la coprésidence, système qui paraît baroque, mais qui fonctionne. Pourquoi changer ce qui marche ?
M. Bruno Rémond, conseiller-maître à la Cour des comptes. L’exacerbation technologique – évoquée par l’amiral et déjà stigmatisée par l’ancien chef d’état-major de l’armée de terre, le général d’armée. Bruno Cuche –, le décalage temporel, la dérive financière et, in fine, la réduction des cibles attendues par rapport aux objectifs initiaux affectent souvent la réalisation des programmes d’armement – qu’ils soient intégralement français ou effectués en coopération.
Il ne faut pas imputer à un mécanisme d’élaboration d’un projet des travers qui ne lui sont pas spécifiquement liés, mais qui découlent du programme global d’armement. Le comité des prix de revient des fabrications d’armement (CPRA) et la Cour des comptes ont constaté que les mêmes défaillances entraînant les mêmes conséquences, le dépassement identique des délais et les dérives financières comparables touchaient les programmes exclusivement français comme ceux réalisés en coopération. Si les programmes d’armement en coopération se révèlent insuffisants – malgré l’OCCAr, les objectifs d’absence de retour industriel, de diminution du coût des produits par extension des cibles et par homogénéisation des matériels n’ont pas été atteints –, ils ne sont pas plus défectueux que les mécanismes de fabrication des programmes d’armement français.
Amiral, vous nous avez affirmé que trois critères étaient nécessaires à la réussite d’un programme en coopération : un montage industriel satisfaisant, une forte volonté politique et une homogénéisation des caractéristiques. Pour le premier, vous avez cité l’exemple de l’A 400M : le montage industriel fut déficient puisque nous avons confié la totalité de ce programme si complexe à un seul responsable – Airbus –, ce qui a généré de grandes difficultés ; celles-ci ne sont donc pas dues aux mécanismes de coopération internationale. Vous avez indiqué que la troisième exigence était la moins difficile à remplir, ce que je ne crois pas ; au contraire, l’expérience nous montre qu’elle est la plus complexe à satisfaire, comme l’atteste l’exemple de l’hélicoptère NH 90 où les quatre États participant au programme ont développé des spécifications techniques répondant à des demandes particulières de leurs armées. On a rencontré les mêmes problèmes pour le Tigre, les FREMM et l’A 400M – l’armée française étant la seule à souhaiter que l’A 400M absorbe les véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI). Ce travers des programmes de coopération date de deux décennies ; auparavant, le Jaguar et le Transall avec les Britanniques ou les tripartites anti-mines avaient donné lieu à la fabrication de produits identiques pour chaque pays. À partir du moment où l’on a voulu répondre à des définitions opérationnelles et à des spécifications militaires différentes selon les États, on a grandement complexifié la réalisation des programmes.
Amiral, vous auriez pu évoquer la coopération étroite – presque secrète, mais très importante sur le plan scientifique et technologique – qui nous unit depuis bien longtemps avec les États-Unis en matière de dissuasion nucléaire.
Amiral Édouard Guillaud. S’agissant de la maîtrise d’ouvrage de l’A 400M, mon avis diverge du vôtre, monsieur le conseiller-maître : Airbus est l’unique maître d’ouvrage, car il convient qu’il n’y en ait qu’un pour un programme de cette taille, mais on ne lui a pas donné les moyens d’accomplir sa tâche. Il ne s’agit pas de défendre Airbus – qui a commis quelques erreurs dans la réalisation de ce projet –, mais si un maître d’ouvrage ne peut pas contraindre un pays ou son fournisseur sur les délais, il se retrouve quelque peu désarmé. Je vous assure en tout cas, ayant été officier de programme à deux reprises, qu’il ne faut qu’un maître d’ouvrage.
Je ne vous suis pas davantage sur les spécifications opérationnelles. Pour le Tigre, la différence de spécifications entre l’armée allemande et l’aviation légère de l’armée de terre française répond à une volonté non pas de l’armée allemande, mais de l’industrie de ce pays de fournir des matériels. Mon homologue allemand souhaiterait disposer de Tigre français et non de Tigre allemands qu’il vient à peine de pouvoir déployer en Afghanistan. Il est facile d’accuser systématiquement les militaires de se laisser aller à la surenchère ! Nous avons décidé de coopérer sur les drones tactiques : il n’a fallu que huit jours à l’armée de terre française pour relire la totalité des spécifications britanniques du Watchkeeper et les valider. L’accord sur l’ANL fut également très rapide. Nous agissons donc le plus simplement possible. En revanche, il arrive que l’on demande aux militaires de privilégier l’industrie nationale : ainsi, le radar de la version maritime du NH90 fut fourni, sur requête politique et industrielle de l’Italie, par une entreprise qui n’en avait jamais produit et qui dépassa le délai de quatre ans ; cela ne répondait pas à une volonté de la marine italienne ou française. De même, l’armée de terre britannique rêve d’acheter le VBCI, mais elle ne pourra pas l’acquérir pour des raisons de politique industrielle – qui peuvent par ailleurs se comprendre.
M. Alain Claeys, président. Amiral, nous vous remercions.
Audition du 6 juin 2013
À 10 heures 30 : Audition de M. Daniel Verwaerde directeur des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Présidence de M. Alain Claeys, président
M. Alain Claeys, co-président de la Mission d’évaluation et de contrôle. Nous sommes heureux d’accueillir M. Daniel Verwaerde, directeur des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour notre cinquième audition sur le thème « La conduite des programmes d’armement et de coopération ».
M. Daniel Verwaerde, directeur des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Je vous remercie pour votre invitation qui me permettra de vous présenter le programme de coopération Teutatès-Epure, que la France a engagé avec le Royaume-Uni.
Cette coopération a démarré en 2007 suite à une volonté politique très forte de la part des deux États, même si les motivations ne sont pas les mêmes de chaque côté de la Manche, comme l’ont fait apparaître les discours prononcés à Lancaster House, à Londres, le 2 novembre 2010. Pour le Président de la République française, elle traduisait une volonté de construction européenne, tandis que les Britanniques n’y voyaient plus l’intérêt que peut représenter une coopération bilatérale.
Cela dit, deux motivations étaient communes à nos deux pays : le besoin d’outils de simulation des armes nucléaires, après la ratification quasi-simultanée par la France et le Royaume-Uni du traité d’interdiction complète des essais nucléaires, et l’impérieuse nécessité de réaliser des économies budgétaires. En effet, la France et le Royaume-Uni partagent depuis plusieurs décennies la même perception des menaces potentielles qui pèsent sur leurs intérêts vitaux et ont une approche similaire des traités de désarmement et, d’une manière plus générale, de tous les traités susceptibles d’améliorer la sécurité.
Comment est né ce projet de coopération ? Sous l’impulsion du Premier ministre britannique Gordon Brown et du Président de la République Nicolas Sarkozy, le Chief Scientific Adviser du Ministry of Défence britannique, en charge de ces programmes nucléaires, et moi-même, en qualité de directeur des applications militaires, nous sommes rapprochés l’un de l’autre pour examiner les opportunités de conduire un projet commun.
La défense française et la défense britannique conduisent de nombreux programmes d’armement, mais la conduite d’un programme en coopération doit correspondre à un tel nombre de critères que vouloir tous les satisfaire élimine beaucoup de projets. Quelques-uns de ces critères ont servi de cadre au choix de Teutatès.
Le premier d’entre eux est le désir réel des responsables des programmes de travailler ensemble. Car une coopération commence plus par des hommes que par une vision stratégique. Il faut que des personnes aient envie de coopérer et considèrent qu’elles tireront de leur collaboration un bénéfice mutuel car il est infiniment plus complexe de conduire un programme en coopération que de conduire un programme national.
Deuxième critère : les objectifs techniques des deux projets doivent être quasiment identiques – les moindres divergences additionnent les besoins et produisent des « moutons à six, voire à sept ou huit pattes ». Il en va de même des objectifs calendaires.
Le troisième critère tient à la nécessité, pour les deux pays, de partager les mêmes objectifs financiers et industriels. Chacun doit y trouver son compte. Cela peut se révéler très compliqué, surtout lorsque l’on additionne les spécifications.
Un autre critère, particulièrement important s’agissant des programmes nucléaires, tient à la nécessité de préserver la souveraineté de chacun des partenaires et de protéger les secrets qui doivent l’être.
Le dernier critère est ce que j’appelle la résilience, à savoir la capacité pour chacun des pays de transformer, le cas échéant, un programme en coopération en programme purement national, après une coopération qui a duré dix, quinze ou vingt ans. Même si nous considérons, en France, la coopération comme une démarche conduisant à une Europe de la défense, nous devons être capables, dans le cas où elle ne fonctionnerait pas, de continuer à assurer notre dissuasion.
En 2008, parmi tous les programmes menés par la défense, dans le domaine nucléaire, seuls deux projets, le projet britannique Hydrus et le projet français Epure répondaient à l’ensemble de ces critères : l’objectif était de doter chacun des deux pays d’une capacité de simulation, détonique et mécanique, et de certification des armes sans recourir à des essais nucléaires.
Les spécifications des deux projets étaient quasiment les mêmes ; le besoin physique étant le même, il est logique de parvenir à des spécifications similaires.
La principale divergence entre les Français et les Britanniques tenait au calendrier. L’installation française devait être opérationnelle en 2014, celle des Britanniques en 2017. C’est pourquoi il a été décidé de réaliser l’installation en France et non au Royaume-Uni.
Le projet Epure était déjà engagé et il s’est révélé nécessaire de lui apporter de légères modifications, pour permettre de prendre en compte les critères de souveraineté. Il fallait pour cela construire un local spécifique pour les Britanniques, où ils pourraient préparer leurs expériences et recueillir les mesures. Plus de 90 % de l’investissement total est consacré à la partie commune, les locaux propres à chacun des deux pays ne représentant qu’à peine 5 %.
Le traité Teutatès est l’un des deux traités signés à Lancaster House en novembre 2010. Le premier est un traité général recouvrant les conditions d’une très large coopération, que les Anglais appellent le « Over Arching Treaty ». Le Parlement français n’a pas eu à en débattre, ce qui n’est pas le cas du traité Teutatès compte tenu de ses enjeux en termes de souveraineté et de finances publiques. Le Parlement britannique a suivi une démarche analogue, quoique beaucoup plus simple puisqu’il s’est contenté d’une approbation par procédure dite « du silence ».
Afin d’éviter la prolifération, le traité n’entre pas dans des détails confidentiels ou secrets. C’est un texte public, si bien qu’un texte « confidentiel défense » lui est annexé, intitulé Specific arrangements.
J’en viens au contenu et aux objectifs du traité. Il nous autorise à engager une coopération dans le domaine de la simulation des armes nucléaires et à partager des travaux en matière de lutte contre le terrorisme et la prolifération nucléaires. Autrement dit, moyennant des procédures de contrôle, il nous permet de développer une coopération plus large que le simple fait de partager des installations.
La première application de ce traité est de construire deux installations. La première, Epure, dans laquelle seront réalisées des expériences de certification des armes, se trouve en France ; l’autre, le Technical Development Center, est un laboratoire de recherche commun destiné au soutien technique et à la coopération scientifique dans lequel seront mis au point des instruments de mesure qui seront utilisés sur le site d’Epure.
Le traité prévoit que les expériences pourront être réalisées en toute souveraineté. Nous ne connaîtrons pas les résultats des expériences britanniques, et réciproquement. Il nous autorise en revanche à réaliser toute expérience commune qui permettrait aux deux pays de progresser scientifiquement.
En outre, le traité met en place des instances de gouvernance dans le cadre de l’Over arching treaty ainsi que des procédures d’échange d’informations classifiées et de personnels.
Enfin, il définit le schéma de principe de l’installation de Teutatès-Epure. On distingue les installations dans lesquelles nous ferons détoner les maquettes en effectuant des radiographies pour vérifier les simulations numériques tout en s’assurant qu’elles ne dégagent pas d’énergie. Près des locaux où seront réalisés les tirs, sont situés les locaux de service. La partie financée exclusivement par la France, qui devrait fonctionner en 2014, correspond à la phase 1 de la réalisation.
La phase 2, qui sera financée par le Royaume-Uni ou par les deux pays, comprend, entre autres, les halls d’assemblage et les bureaux propres aux Britanniques. Par la suite, ils contiendront une machine de radiographie, financée en totalité par les Britanniques. Le traité décrit dans le détail ces différents locaux et la répartition des financements. La troisième machine radiographique sera cofinancée à 50/50.
Le traité prévoit en outre le démantèlement de l’installation dans 50 ans, financé pour moitié par chacun des deux pays, ainsi qu’une clause de retrait permettant à chacun des pays de se retirer du programme. Ainsi, au cas où l’une des parties souhaiterait se retirer, elle pourrait interdire à l’autre partie d’accéder à l’installation sur son territoire. Il est prévu un délai de préavis de dix ans pour laisser à chacun des deux pays le temps de reconstruire sur son territoire l’installation dont il aurait perdu l’accès.
Le traité prévoit l’usage de deux langues officielles. L’exploitation se déroulant essentiellement en français, il importe que les Britanniques comprennent notre langue au cas où un danger serait signalé.
La phase 1 ayant été engagée par la loi de programmation militaire 2009-2014, cette partie est restée inchangée. L’installation Epure sera une installation régie par le droit français, ce qui donne à la France une responsabilité pleine et entière. L’installation de Valduc, près de Dijon, devrait être opérationnelle en 2014, et les premières expériences utiles pourraient être menées dès la fin 2014. Sa construction se déroule selon le calendrier prévu et les dépenses sont conformes à ce que nous avions envisagé.
Conformément aux termes du traité, nous avons mis en place des instances de pilotage à différents niveaux.
Au plus haut niveau se trouve le Senior Level Group, composé de membres du Cabinet office britannique et de la Présidence de la République française. Ce comité de pilotage assure la coprésidence de l’ensemble du traité et pilote l’ensemble des coopérations, dont fait partie le traité Teutatès.
Le deuxième niveau est constitué par un comité technique, le Steering Committee, dont nous sommes, le Chief Scientific Adviser du Ministry of Defence et moi-même, les deux coprésidents. Le comité se réunit officiellement une fois par trimestre, mais en réalité nous nous rencontrons plus d’une fois par mois.
Le troisième niveau est celui du Joint Managerial Board. Piloté par le directeur des armes nucléaires et par le Director for Strategic Technology, il assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de la construction de Teutatès. Ce board se réunit environ une fois tous les quinze jours.
Enfin, depuis 2010, nous disposons à Bruyères-le-Châtel d’une équipe « projet » qui comporte en ses rangs dix Britanniques.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Dans tous les programmes d’armement, nous essayons de comprendre le rôle que jouent la DGA, l’état-major et le politique. Selon vous, le politique impose-t-il ses programmes à l’extérieur ? Intervient-il à bon escient ? Votre programme est le seul à être doté d’une instance politique permanente de suivi, or il semble qu’il se déroule mieux que d’autres, ce qui tend à prouver que c’est une bonne solution.
À quel niveau avez-vous constaté des réticences et des freins à la coopération, et comment les expliquez-vous ?
Dans le programme que vous nous avez présenté, chaque pays conserve sa souveraineté. Pensez-vous qu’il soit possible d’aller plus loin dans le partage, tant des technologies que des coûts ?
Le fait de raisonner sur le plan militaire, d’un côté, et sur le plan civil, de l’autre, est-il un handicap ? Ne pensez-vous pas qu’une approche globalisée nous permettrait d’être plus efficaces ?
M. Daniel Verwaerde. Le programme franco-britannique est le fruit d’une volonté politique très forte. Quant aux réticences, elles peuvent apparaître à un niveau inférieur, mais le politique est toujours là pour aplanir les difficultés.
Les Britanniques, comme les Français, vivent en démocratie. Au sein même du Ministry of Defence, vous trouverez des personnes favorables à une coopération avec la France et d’autres qui préféreraient privilégier une coopération avec les Américains – ce qui, objectivement, présente certains avantages pour les Britanniques. De même, dans les rangs français, une coopération bi-nationale peut bouleverser par moment les responsabilités nationales et donc conduire à certaines difficultés.
Peut-on aller plus loin en matière de souveraineté ? Sur un plan technique, c’est possible, mais cette question relève du politique. Le citoyen que je suis peut effectivement se demander s’il a réellement envie que les forces de dissuasion de nos deux pays se rapprochent et se soutiennent mutuellement alors que la dissuasion française est purement nationale et est au cœur de notre souveraineté. Souhaitons-nous que notre dissuasion reste au cœur d’une défense nationale ou préférons-nous nous doter d’un parapluie européen qui pourrait être, par exemple, un pilier européen de l’OTAN ? C’est au Président de la République, au Gouvernement, et à vous, messieurs les parlementaires, de répondre à cette question.
Le traité offre la possibilité d’une approche plus globale, et il a ainsi été proposé de réfléchir à un programme commun pour les calculateurs, et également de partager notre laser.
M. Jean Launay, rapporteur. J’ai eu la chance de visiter la semaine dernière le site de Bruyères-le-Châtel dans le cadre de l’IHEDN. J’y ai appris que le programme Epure avait permis de diminuer les coûts de la dissuasion. Pouvez-vous, à ce stade du programme, avancer quelques chiffres à ce sujet ?
Des organismes comme l’Agence européenne de défense (AED) ou l’Organisation conjointe en matière d’armement (OCCAR) interfèrent-ils dans ce type de programme ?
Quelles sont les relations entre les ingénieurs du CEA et ceux de la DGA ?
M. Daniel Verwaerde. Le coût du programme étant classé, je ne communiquerai pas de chiffres. La logique économique du traité Teutatès est de dégager une économie substantielle pour les deux pays, même si j’estime que des dépenses supplémentaires dues au transport des éléments expérimentaux britanniques existeront pendant toute la durée de l’exploitation.
L’AED et l’OCCAR n’ont pas interagi dans ce projet, et cela pour deux raisons. La première tient à la spécificité de la sphère nucléaire, la seconde au fait que le programme franco-britannique n’est pas, au sens strict, un programme d’armement. Pour ce qui est de mettre en place un programme de coopération pour une arme, comme par exemple la tête nucléaire aéroportée, les doctrines des deux pays le permettraient difficilement. Cela toucherait de trop près la souveraineté de notre pays et les deux états-majors mettent en œuvre la dissuasion de manière différente.
Notre installation n’est pas un armement, elle ne vise qu’à partager les coûts d’exploitation d’une installation servant à construire de l’armement.
S’agissant de la production d’armes nucléaires, les séries sont toujours extrêmement limitées. Le coût de production de la série d’armes nucléaires est toujours faible par rapport au coût de son développement.
Bien sûr, nous pouvons envisager d’autres programmes de coopération avec le Royaume-Uni, notamment lorsqu’il s’agira de rénover nos installations nucléaires.
Quant aux ingénieurs, il faut les laisser innover, mais ils doivent être régulés par les politiques et les militaires. Aux forces armées d’exprimer leur besoin : quel matériel ? Veulent-ils du matériel plus robuste et moins innovant ? Quant au politique, il doit indiquer comment il entend employer l’armement et de quel budget il dispose.
La dissuasion est un système qui demande un investissement important. Dans le cadre du Conseil des armements nucléaires, les Présidents de la République successifs s’investissent. La mise au point d’un système d’arme nécessite une coopération resserrée de la part du ministère de la défense, du CEA et de la DGA. Une régulation permanente est nécessaire.
M. Jean-Jacques Bridey. Aujourd’hui nous utilisons la coopération pour réduire les coûts et partager des expériences, mais techniquement nous n’en avons pas forcément besoin. Cette situation a-t-elle des limites ? Aurons-nous un jour besoin d’une coopération, avec les États-Unis ou d’autres pays aussi avancés que nous sur le plan technologique, pour maintenir notre souveraineté ?
M. Daniel Verwaerde. Nous avons noué avec les Américains des coopérations qui nous permettent de dialoguer de façon régulière, en particulier à propos du laser.
À titre personnel, je considère que la coopération pourrait aller plus loin que le simple objectif de réduire les coûts. La France, qui est malgré tout un pays aux ressources limitées quand on le compare aux grandes puissances, n’aura peut-être pas toujours dans le futur les moyens de financer les outils qui lui permettront de conserver la maîtrise dans tous les domaines, parce que les technologies coûtent de plus en plus cher, que nous avons en face de nous des pays gigantesques qui montent en puissance, à commencer par la Chine et l’Inde. La coopération pourrait aller plus loin, jusqu’à accepter d’autres projets communs avec les Britanniques ou les Américains. Mais, je le répète, le choix de projets dans le domaine nucléaire qui concernent la souveraineté relève d’une décision politique.
M. Jean-Jacques Bridey. Est-il possible, selon vous, de dépasser le stade du dialogue avec les États-Unis ?
M. Daniel Verwaerde. Nous pouvons l’envisager. Les laboratoires américains du département de l’énergie – Los Alamos, Lawrence Livermore, Sandia – sont très demandeurs d’échanges et apprécient l’approche française, car les ingénieurs français ont une manière de penser différente de la leur. Mais autant une coopération avec les Britanniques a été possible dans le cadre de Teutatès, autant une coopération avec les États-Unis doit être étudiée de manière spécifique, car leurs moyens sont infiniment plus importants que les nôtres.
M. Bruno Rémond, conseiller-maître à la Cour des comptes. Je ferai trois remarques qui montrent que cet exemple de coopération n’est pas transposable.
Il n’est pas transposable du fait des résultats que l’on en escomptait. Cette coopération représente pour l’État une dépense inférieure à ce qu’il avait prévu d’affecter ; par ailleurs, sur le plan stratégique et scientifique, elle constitue un produit de plus grande ampleur et plus efficace que ce que nous aurions pu faire seuls ; enfin, les installations se trouvent sur le sol français.
Il n’est pas transposable compte tenu des caractéristiques du projet, de son unicité et de sa nature. Son unicité d’abord supprime le problème de la diversité des spécifications ou des spécificités qui affecte grandement la réalisation des programmes d’armement ; sa nature, ensuite, parce que ce projet, qui relève du BTP, de la science et de la technologie, n’est pas une arme.
Daniel Verwaerde considère qu’en matière de dissuasion, nous ne pouvons pas aller plus loin en termes de coopération bilatérale. Il a raison en ce qui concerne la fabrication des armes car, dans la mesure où les systèmes des Britanniques et les nôtres sont radicalement différents, c’est toute la chaîne qu’il faudrait revoir. Les Britanniques n’ont pas de composante aéroportée alors que nous en avons une. Quant à la composante océanique, leurs sous-marins, tout comme leurs missiles, sont différents des nôtres.
Cet exemple est très intéressant car il présente toutes les caractéristiques positives que nous sommes en droit d’attendre d’un programme d’armement en coopération. Mais malheureusement, en raison de ses spécificités, il est difficilement transposable à l’architecture des autres programmes que nous tentons de mener en coopération.
M. Daniel Verwaerde. Permettez-moi de conclure en soulignant que le bénéfice de cette coopération n’est pas uniquement financier : il provient en premier lieu du challenge qu’elle représente. Depuis que nous ne procédons plus à des essais nucléaires, le risque existe de ne plus être confrontés à des défis qui mobilisent les équipes. Au-delà des économies qu’elle nous permet de réaliser, tout l’intérêt d’une coopération internationale est qu’elle oblige nos personnels à donner le meilleur d’eux-mêmes, dans les confrontations intellectuelles qu’ils doivent soutenir avec leurs homologues étrangers.
M. le président Alain Claeys. Je vous remercie.
Audition du 6 juin 2013
À 11 heures 30 : Audition de Mme Astrid Milsan, sous-directrice services aéronautique, défense au sein de l’Agence des Participations de l'État
Présidence de M. Jean Launay, co-rapporteur
M. Jean Launay, rapporteur. Nous accueillons à présent Mme Astrid Milsan, sous-directrice services, aéronautique et défense au sein de l’Agence des participations de l’État.
Mme Astrid Milsan, sous-directrice services, aéronautique et défense au sein de l’Agence des participations de l’État (APE). L’Agence des participations de l’État incarne les missions de l’État actionnaire. Sa vision des programmes d’armement en coopération est nécessairement très partielle, en tout cas beaucoup plus limitée que celle de la Direction générale de l’armement (DGA), puisqu’elle est celle de l’actionnaire des principales entreprises d’armement que sont EADS – European aeronautic defence and space compagny –, Thales, Safran, DCNS, Nexter et très indirectement Dassault. En somme, nous appréhendons le sujet des programmes d’armement en coopération au travers de nos seules entreprises et essentiellement de leurs organes sociaux.
Pour autant, l’État a des préoccupations un peu plus larges que celles d’un actionnaire de droit commun. C’est ainsi que nous nous attachons à promouvoir en matière de défense une stratégie pour nos entreprises leur permettant de rester compétitives à l’export. Nous veillons à ce qu’elles parviennent à préserver leur capacité d’autofinancement dans le cadre de leurs programmes. Nous menons des réflexions stratégiques sur la consolidation de ces entreprises. Au surplus, nous prenons en compte, en étroite collaboration avec la DGA, les besoins d’approvisionnement des armées propres à garantir l’indépendance stratégique de la France. Tous ces éléments viennent s’ajouter à notre préoccupation première, la valorisation du patrimoine de l’État.
Enfin, nous nous préoccupons de la préservation de l’emploi industriel et de la compétence des industriels sur le territoire.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Le dernier rapport de l’Agence des participations de l’État, intitulé « L’État actionnaire », indique que l’Agence compte mener une réflexion au sujet des implications des contraintes budgétaires sur les dépenses d’armement et sur la reconfiguration d’une industrie européenne encore très fragmentée. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?
Dans le cadre de votre collaboration avec la DGA, abordez-vous des points précis ou avez-vous une approche globale ? Autrement dit, sur quels sujets la rencontrez-vous, à quelle fréquence et à quel niveau ?
Mme Astrid Milsan. L’un des bureaux dont j’ai la charge en tant que sous-directrice en charge des questions de défense, aéronautique et services se consacre exclusivement aux questions de défense, avec un chef de bureau et trois adjoints. Nos rapports avec la Direction générale à l’armement sont quotidiens.
Premièrement, l’APE étant réglementairement chargée d’assurer la cohérence des positions des représentants de l’État aux conseils d’administration des entreprises, elle prépare ces conseils de manière très privilégiée avec la DGA. En effet, comme nous siégeons dans toutes les entreprises de défense dont nous sommes actionnaires et que la DGA y est également représentée en tant que représentant de l’État, il n’y a pas une position qui n’ait été concertée avec elle.
Deuxièmement, nous rencontrons la DGA sur tous les sujets relatifs à la défense. D’abord, nous tenons des réunions communes quotidiennement sur la consolidation du secteur de la défense. Ensuite, nous menons conjointement et de façon très régulière des réflexions stratégiques sur les entreprises – pratiquement toutes nos réunions stratégiques avec les entreprises se font avec elle. Par ailleurs, nous abordons en permanence avec la DGA des modalités d’instauration d’une action spécifique ou des modalités contractuelles, comme ce fut le cas lorsque SNPE a cédé la SME à Safran, opération dont les incidences en matière de dissuasion nucléaire étaient importantes. De plus, nous discutons avec la DGA des projets d’acquisition. Pour EADS et BAE, par exemple, nous avons mené l’année dernière trois mois de réflexion conjointe en assistant à toutes les réunions avec nos conseils financiers et juridiques ; les négociations sur le changement de gouvernance de EADS aussi bien avec l’entreprise qu’avec les actionnaires allemands se sont tenues en présence de la DGA. Dans ces discussions, l’APE était leader puisqu’elle représentait les intérêts de l’État actionnaire, mais la DGA était présente au regard de la défense des intérêts stratégiques de la France. Quand je parle de la DGA, je fais référence à la partie service des industries de défense – et non à la partie programme.
En définitive, nos méthodes de travail sont assez proches et nos préoccupations sur le fond des dossiers se rejoignent.
La baisse inéluctable des budgets militaires a un impact considérable sur la capacité de la France à maintenir à la fois sa base industrielle sur le territoire et sa compétitivité à l’exportation. Dans ce contexte, la DGA et nous-mêmes avons parfaitement conscience que la seule solution permettant de satisfaire les besoins de l’État client et de maintenir la compétitivité de nos entreprises est de favoriser l’export et, par conséquent, de faire en sorte que les programmes français ne se traduisent pas par un déséquilibre économique pour nos entreprises – d’où la nécessité de programmes de coopération intelligents.
Il est certain que la baisse des budgets militaires européens se traduira à l’avenir par un vaste mouvement de consolidation du secteur de la défense en Europe. En effet, toutes les entreprises d’armement européennes ont les mêmes préoccupations que les nôtres du fait non seulement de la baisse des budgets militaires, mais aussi d’une compétition à l’export de plus en plus féroce entre pays européens et avec les pays émergents. Par exemple, si l’opération de rapprochement entre EADS et BAE avait été réalisée l’année dernière, elle aurait incontestablement entraîné une vaste chaine de conséquences sur le secteur : Thales se serait immédiatement positionné, DCNS se serait interrogé sur son avenir, et Safran aurait également été concerné. Nous réfléchissons avec la DGA sur le ou les schémas optimaux pour la défense de nos intérêts conjoints – de l’État client et de l’État actionnaire –, afin d’être prêts lorsqu’un premier mouvement se présentera, qui concernera soit nos entreprises – et nous devrons nous déterminer en tant qu’actionnaire –, soit des entreprises européennes en produisant des conséquences en chaîne sur nos entreprises. Ainsi, nous nous attachons à examiner tous les scénarios possibles, sachant que si l’un d’eux venait à être concrétisé, nous ne serions pas les seuls décideurs. En tout cas, nous souhaitons être proactifs en la matière.
M. Jean Launay, rapporteur. Quel reporting faites-vous au ministère du redressement productif sur la problématique de la préservation de l’emploi industriel ?
Mme Astrid Milsan. Nous réalisons auprès de l’ensemble de nos entreprises – pas seulement celles du secteur de la défense – une enquête annuelle sur les enjeux industriels et sociaux en termes d’évolution de l’emploi et des compétences, tous ces éléments étant synthétisés dans le rapport de l’État actionnaire.
Nous veillons bien évidemment à ces questions dans le cadre des conseils d’administration. La question de l’emploi se pose essentiellement en cas de projet de localisation ou de projet de création ex nihilo d’activités en dehors de la France. Dans ce cadre, nous sollicitons généralement des instructions auprès du ministre. Cette dimension de l’emploi n’est cependant pas la seule que nous prenons en compte – il y a également la dimension patrimoniale dont la défense reste notre mission première. Pour EADS, par exemple, dans le conseil d’administration duquel nous ne siégeons pas, l’ancien système de gouvernance nous conférait un droit de veto sur des projets d’importance, et nous avons été consultés sur l’implantation d’une usine dans l’Alabama pour l’assemblage des Airbus. Dans notre analyse, nous avons pris en compte à la fois l’aspect patrimonial et les aspects industriels et sociaux pour l’entreprise, et nous nous sommes prononcés favorablement sur ce projet après avoir estimé qu’il n’y aurait pas d’impact sur les usines de Toulouse et de Hambourg.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. L’État a-t-il une vision stratégique pour nos grands groupes industriels ? En d’autres termes, est-il à la manœuvre pour impulser en amont des regroupements en Europe, des mutualisations en matière de recherches, des développements de produits, etc. ?
Mme Astrid Milsan. L’État client et actionnaire est à la manœuvre – l’État actionnaire à la hauteur de ce qu’il représente : il est minoritaire dans les trois grandes entreprises que sont Safran, EADS et Thales. Néanmoins, qu’il soit minoritaire ou majoritaire au capital des entreprises, il est minoritaire dans tous les conseils d’administration, conformément à la loi sur la démocratisation du secteur public. Même si cela limite notre marge de manœuvre, nous sommes proactifs sur tous ces sujets.
Un exemple. Des discussions ont eu lieu en 2011 et 2012, à l’initiative de l’État, entre Safran et Thales sur des rapprochements partiels dans les secteurs de la génération électrique, de la navigation inertielle et de l’optronique. Nous étions très favorables à ces rapprochements, bien sûr en tant qu’État actionnaire, mais aussi comme État client, au regard de la rationalisation des dépenses de financement des bureaux d’étude dans ces secteurs. Cependant, notamment en raison de l’opposition d’une des deux entreprises, l’État n’a pas été suivi. Au surplus, notre légitimité à nous exprimer en tant qu’État actionnaire a parfois été contestée. Or, comme tout actionnaire, et en dépit de procès d’intention qui nous sont faits sur le fait que nous ne défendrions pas les seuls intérêts des actionnaires, nous avons le droit de donner un avis. En l’occurrence, nous nous sommes exprimés, en qualité d’État client, mais surtout en tant qu’actionnaire. Le projet n’a abouti que partiellement, avec une coopération dans l’optronique entre Thales et Safran via la JV Sofradir. Ainsi, nous intervenons en soutien des projets, mais nos avis ne sont pas toujours suivis.
M. François Cornut-Gentille, rapporteur. Vos réflexions avec la DGA portent-elles uniquement sur le schéma général ou vont-elles jusqu’aux programmes eux-mêmes au regard de leur opportunité pour tel ou tel rapprochement dans l’intérêt stratégique de la France ?
Mme Astrid Milsan. Je précise que toutes nos réflexions sont en cours.
Si nous jugeons opportun le rapprochement de deux entreprises, l’existence d’un programme de coopération entre elles constitue déjà un facteur positif pour la réussite de l’intégration. Cela ne signifie pas que le programme de coopération implique nécessairement l’intégration.
En outre, nous pouvons estimer qu’un programme international est essentiel pour l’avenir de telle ou telle entreprise. C’est ainsi que la DGA et nous-mêmes avons cru fortement à la JV « Torpille » que DCNS entendait réaliser avec l’Allemagne, car elle nous semblait essentielle pour asseoir la compétitivité de l’entreprise à l’export. Pour l’heure, le dossier est gelé.
Voilà comment nous intégrons les programmes dans nos réflexions.
M. Jean Launay, rapporteur. La fin d’un programme d’armement en coopération a évidemment un impact sur l’exportation de nos entreprises. Avez-vous des discussions avec le ministère du commerce extérieur sur cet aspect ?
Mme Astrid Milsan. Nous discutons très régulièrement avec la Direction générale du Trésor sur le soutien à l’export de nos entreprises, mais de manière très informelle et sans échange d’informations privilégiées. L’État actionnaire reçoit de la part des entreprises des informations qui ne peuvent pas être diffusées au Trésor, et ce dernier – qui est d’ailleurs représenté au conseil d’administration de certaines de ces entreprises – a une vision globale sur les programmes de soutien qu’il ne peut partager avec nous.
M. Bruno Rémond, conseiller maître à la Cour des comptes. Si l’État est encore fortement présent dans DCNS, il l’est moins dans Safran et de manière très diluée dans EADS. Dès lors, le rôle de l’État est plus délicat à assumer qu’auparavant en matière de programmes d’armement en coopération.
M. Jean Launay, rapporteur. Merci beaucoup, madame, de tous ces éclaircissements.
Audition du 2 juillet 2013
À 17 heures : Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense
M. Alain Claeys, président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous approchons de la conclusion de nos travaux relatifs à la conduite des programmes d’armement en coopération, avec l’audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.
Nous sommes très honorés, Monsieur le ministre, de vous recevoir aujourd’hui pour tenter d’établir avec vous un bilan des actions menées en commun en matière de programmes d’armement et esquisser ensemble quelques voies pour l’avenir.
L’intérêt des nombreux programmes en coopération dans lesquels notre pays est engagé, parfois depuis de longues années, nous est apparu clair : ces programmes répondent à des considérations désormais incontournables de coût mais aussi à des exigences d’interopérabilité. Pourtant, les demandes de spécifications nationales comme d’un juste retour industriel en affaiblissent souvent la portée et les organisations de coopération semblent insuffisamment efficientes.
Notre mission réfléchissant à la conduite des programmes en coopération, nos questions sont nombreuses et nous vous remercions d’avoir accepté d’y répondre.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Merci Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, vous avez déjà reçu ceux qu’on appelle « les grands subordonnés », qui vous ont donné beaucoup d’informations. Je voudrais me limiter à quelques propos d’ordre politique et général, quitte à répondre ensuite à des questions plus précises. Cinq raisons me paraissent justifier la nécessité de poursuivre des programmes d’armement en coopération et singulièrement au niveau européen.
La première raison, vous l’avez évoquée, Monsieur le président, est une raison financière. Puisqu’il n’est pas possible de dépenser plus, il faut dépenser mieux alors que les défis sécuritaires sont toujours plus grands. La coopération en matière d’armement permet d’utiliser au mieux les investissements consentis par les États au profit de la défense, à travers la mutualisation, le partage de nos capacités de défense, dans le respect de nos souverainetés respectives. Dans le contexte actuel de crise et de contrainte budgétaire, l’enjeu est d’éviter les réflexes de repli sur soi et de voir dans l’Union européenne des possibilités d’optimisation.
Le deuxième point, tout aussi important et parfois sous-estimé, tient à la nouvelle stratégie des États-Unis qui implique un repositionnement au profit de la zone Asie-Pacifique. De plus, le budget de la défense américain est et sera soumis à des contraintes budgétaires très significatives, de l’ordre de mille milliards de dollars pour les dix prochaines années, soit une baisse de cent millions de dollars par an en moyenne. Ces réductions vont inciter les industries de défense américaines à être d’autant plus agressives sur les marchés mondiaux, et notamment européens. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas souhaité, et nous ne sommes pas les seuls, que la défense soit concernée par les négociations commerciales à venir avec les États-Unis : le sujet, initialement inclus, en a été retiré.
Troisième point, il nous faut éviter les ruptures technologiques, maintenir les emplois et les compétences. Face à des technologies de plus en plus sophistiquées, il est de plus en plus difficile, pour les nations européennes, d’atteindre seules des volumes de commandes permettant de maintenir des bases industrielles de défenses nationales. Il importe que la coopération permette de répondre à cette nouvelle donne, technologique, financière et industrielle et d’assurer les efforts de recherche et d’innovation indispensables.
Quatrième raison, l’exportation. Quand on produit un équipement en commun, on est beaucoup plus convaincant à l’export, c’est un argument commercial de poids, de même que l’utilisation en commun d’un équipement, par plusieurs États. Exemple très significatif, mais on pourrait en citer d’autres, l’hélicoptère NH 90, produit par cinq pays européens, a pu être vendu dans neuf autres pays. Le Tigre, produit par la France, l’Allemagne et l’Espagne seulement, vient de trouver une capacité à l’exportation en Australie, et ce n’est sans doute qu’un début.
Cinquième raison, sur le plan opérationnel, la coopération en matière d’armement permet de fabriquer le ciment d’une véritable Europe de la défense, grâce à une réelle interopérabilité entre nos forces, à une capacité à conduire en commun des actions plus efficaces. C’est vrai dans le domaine de la formation, avec le centre du Luc dans le sud de la France, où l’Allemagne et la France forment en commun des pilotes d’hélicoptère Tigre. Cette interopérabilité dans les usages est un atout, alors que la brigade franco-allemande se déploie difficilement, la communication tactique entre les éléments n’étant pas interopérable. La coopération capacitaire est un facteur d’interopérabilité. Les actions menées avec les Britanniques ont permis de le constater : l’exercice maritime Corsica Lion a démontré que des progrès restaient nécessaires.
Pour tirer pleinement profit des avantages des programmes de coopération, le cadre institutionnel existe. La création de l’OCCAr en 1998 a marqué un tournant important. Elle permet la mise en commun de moyens support et l’établissement d’un référentiel commun pour conduire des programmes. L’OCCAr a un caractère explicitement européen, par l’importance donnée à la consolidation de la base industrielle et technologique de défense européenne. C’est un acquis que je considère comme inestimable. Les six pays acteurs de l’OCCAr, France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni - la Pologne n’en fait pas encore partie, mais s’interroge sur une adhésion - sont ceux dont l’industrie de défense est la plus développée. L’OCCAr a déjà conduit beaucoup de programmes, est ouvert à des participations au cas par cas et présente de nombreux avantages. Ses coûts d’intervention sont faibles (de l’ordre de 2 %), alors que ceux de l’Agence d’acquisition de l’OTAN s’élèvent à 9 %. De plus, il n’intègre pas le juste retour industriel sur un seul programme, mais cherche à assurer un équilibre sur l’ensemble des programmes, dans une conception plus large.
L’Agence européenne de défense (AED), de création plus récente, a une mission différente : elle doit faire converger l’expression de besoins opérationnels, en amont de l’OCCAr. La signature récente d’un arrangement administratif entre l’Agence et l’OCCAr a créé une dynamique qui permet la bonne coordination entre les deux organisations : à l’Agence, l’expression et la maturation du besoin opérationnel jusqu’à la décision de conduire un programme commun ; à l’OCCAr ensuite de conduire ce programme. Nous avons donc aujourd’hui tous les outils nécessaires pour mener des programmes en coopération.
Que peut-il se produire à l’avenir ? Comment concevoir la coopération pour le futur ? Nous avons les outils. Il faut agir avec volontarisme et pragmatisme. Une coopération dans le domaine de l’armement ne peut naître de rien. Elle doit reposer sur des convergences concrètes entre partenaires, s’agissant des besoins opérationnels comme du calendrier : à défaut, on perd du temps, de l’argent et les programmes peuvent même échouer, particulièrement en ces temps de contraintes budgétaires.
L’OCCAr et l’AED restent le meilleur outil institutionnel. Mais pour chaque projet, nous devons pouvoir retenir le cadre de coopération le plus adapté. À long terme, nous devons éviter les concurrences intra-européennes, qui nous pénalisent à l’exportation, je pense notamment aux avions de chasse. Le prochain avion de combat, avec ou sans pilote – et sans doute les deux – le prochain char, devront être européens. Nous devons déjà nous inscrire dans cette perspective, à défaut, les autres pays achèteront la nouvelle génération d’avions de chasse américains. En matière de coopération, les sujets les plus forts sont liés à l’aviation. Les domaines terrestre et naval ne sont pas encore au rendez-vous, à part notre coopération avec l’Italie pour les frégates, ce qui ouvre de vastes champs de coopération européenne à bâtir.
Des coopérations sont possibles ou en gestation, soit dans le cadre de l’OCCAr, soit dans le cadre de discussions avec nos partenaires. Dans le cadre de l’AED, je pense au ravitaillement en vol, à la surveillance maritime (avoir des images instantanées sur l’ensemble des flottes, comme le prévoit le programme Marsur constituerait une grande avancée), à la gestion militaire du ciel unique européen (trop souvent oubliée, ce dont l’Allemagne a été victime, pour l’achat de drones), au spatial et à la succession de satellites Hélios, ou à la question des drones.
Nous avons trois préoccupations, du fait des avancées insuffisantes en matière de coopération, à l’exception de nos actions avec les Britanniques. Il s’agit d’abord des drones tactiques, qui ont fait l’objet de discussions et d’un accord de bon emploi, pour Watchkeeper, avec les Britanniques ; ensuite, de la définition par Dassault et BAE d’un modèle expérimental pour le futur drone de combat européen, et du démonstrateur NEURON ; enfin, des drones d’observation MALE : en attendant cette nouvelle génération, nous devons utiliser provisoirement un drone américain.
Il y a donc là toute une série de perspectives potentielles de nouveaux programmes à entreprendre en commun, ce qui suppose à la fois pragmatisme et volonté. C’est aussi un moyen d’avancer vers l’Europe de la défense. Le Conseil européen qui va se consacrer aux questions de défense à la fin de l’année 2013 sera le premier organisé depuis 2003. Il serait bien inspiré d’aborder la coopération en matière d’industries de défense. C’est aussi un bon moyen d’agir sur les exportations. Il y a, je pense, une perception de cette nécessité de la part des acteurs. Il faut maintenant concrétiser cette coopération, même si les intérêts sont parfois divergents, car les résultats sont généralement à la hauteur des espérances, à l’instar de l’A 400 M qui est une vraie réussite.
M. Jean Launay. Ainsi que vous l’avez souligné, au-delà des simples raisons financières, la coopération en matière d’armement s’inscrit également dans une perspective politique : il convient en effet d’éviter tout réflexe de repli national. Au-delà de simples économies, c’est la recherche d’une plus grande efficacité dans les programmes qui est en jeu, avec la nécessité de trouver des convergences et des partenaires qui soient sur la même ligne de volonté et de pragmatisme.
Je souhaiterais vous interroger sur l’articulation du cadre institutionnel, c’est-à-dire entre l’OCCAR et l’AED : cette dernière regroupe l’ensemble des partenaires européens, ce qui n’est pas le cas de la première.
Etant président du groupe d’amitié France-Pologne, je souhaitais également vous entendre sur le cas de la Pologne qui n’est pas membre de l’OCCAR. Y a-t-il des raisons à cette absence de participation ?
En matière de coopération avec les Britanniques, les accords de Lancaster House ont été structurants. Qu’est ce qui a conduit, dans le dossier du missile anti-navire léger (ANL), à une accélération de la décision française ? Ce choix a-t-il été de nature à conforter les accords passés avec les Britanniques ?
L’hélicoptère NH 90 est un succès, commandé par beaucoup de pays. Mais le grand nombre de versions différentes atténue la portée et l’efficacité de ce programme. N’est-il pas contreproductif, sur les plans financier, opérationnel et commercial, de vouloir prendre en compte toutes les spécificités réclamées par les divers utilisateurs ? Le NH 90 est-il un contre-exemple ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Nous souhaitons renforcer notre partenariat avec la Pologne et nous avons entrepris depuis un an avec ce pays des relations de rapprochement très significatives. À titre d’exemple, depuis septembre dernier, j’ai rencontré mon collègue polonais six fois, ce qui est plus que mes collègues allemand ou britannique. Même si cela ne s’est pas encore manifesté par des projets, il y a une série d’échanges notamment bilatéraux qui paraissent très prometteurs. Les Polonais manifestent une volonté capacitaire en matière d’hélicoptères. Nous sommes également en pourparlers en matière de sous-marins, mais en concurrence avec l’Allemagne. Sans que ce soit de la coopération, nous sommes dans une phase de rapprochement politique et stratégique.
Dans le domaine de la coopération, la Pologne s’interroge positivement sur son éventuelle entrée à l’OCCAR. Ce pays envisage également de solliciter l’Agence européenne de Défense (AED) pour la définition et éventuellement ensuite le partage des avions ravitailleurs. Il y a également avec la Pologne un champ de coopération potentiel en matière de défense sol-air qui s’inscrit dans un programme de modernisation des forces armées très ambitieux. La Pologne est l’un des rares pays à augmenter de manière significative son budget de la défense. Nous avons avec cet État des relations étroites qui devraient se traduire, je pense rapidement, par des décisions fortes. Toute aide de la part de la diplomatie parlementaire sera bienvenue.
La chaîne entre l’OCCAR et l’Agence européenne de défense s’amorce. Mais l’AED est handicapée par la modicité de ses moyens. En effet, les Britanniques refusent toute hausse de son budget, même pour compenser les effets de l’inflation. L’Agence joue pourtant son rôle sur la définition des concepts, des projets et des modèles de mutualisation. Ainsi, elle travaille à l’élaboration conceptuelle en matière de surveillance maritime ou de lutte contre les engins explosifs improvisés (IED). Le processus aboutit ensuite à la conceptualisation d’un projet qui peut être présenté à l’OCCAR. La différence majeure entre ces deux structures réside dans le fait que l’AED regroupe les futurs utilisateurs alors que l’OCCAR rassemble les futurs producteurs. Et il peut parfois y avoir contradiction entre les deux. Les grands pays producteurs d’armements participent à l’OCCAR, alors que l’AED compte quasiment tous les pays donc ceux ne disposant pas d’industrie d’armement. Il est donc nécessaire de créer la bonne articulation entre les deux outils, ce qui suppose un volontarisme fort.
La décision que j’ai prise d’inscrire dans le projet de loi de programmation militaire le missile anti-navire léger (ANL) répond d’abord à une préoccupation politique. En effet, les accords de Lancaster House prévoyaient des coopérations dans plusieurs domaines, y compris nucléaire ; cela se met en œuvre. Dans le domaine des capacités classiques, le projet qui devait aboutir à l’intégration de MBDA UK et de MBDA France nécessitait une mutualisation des potentialités de chacune des entités pour constituer One MBDA. Cela nous a conduits à accélérer la mise en œuvre d’un programme de missile anti-navire léger. Il s’agit d’un armement qui s’installe sous hélicoptère et peut être utilisé dans la lutte contre la piraterie contre des embarcations de taille moyenne. Bien qu’étant moins pressés que nos alliés, nous avons voulu montrer notre attachement à la coopération franco-britannique en réalisant un acte politique et en incluant ce programme dans l’accord de Lancaster House. À charge de revanche. Dans la lutte contre les mines mise en œuvre par drone naval et inscrite dans ce même accord, nous attendons un acte de la part de notre partenaire britannique.
Nous avançons également en matière capacitaire : nous menons chaque année entre nos deux pays un exercice important dans ce domaine et nous prévoyons, en 2016, la constitution d’un corps expéditionnaire conjoint. Nous effectuons également des exercices maritimes, terrestres et aériens. Cette collaboration se déroule bien et n’est pas contradictoire avec la coopération que nous menons avec les Allemands ou les Polonais.
En matière de drone, je considère que les actes que nous avons posés en juillet dernier avec les Britanniques sont anticipateurs de ce qui pourra se produire demain pour une vraie collaboration dans cette nouvelle capacité qui est essentielle à notre sécurité.
En ce qui concerne le NH 90, sans doute avez-vous raison : lorsqu’un programme est trop diversifié, cela peut induire du retard et des aléas techniques. C’est l’inconvénient d’engager un programme d’armement qui ne correspond pas à des principes simples, à commencer par une homogénéité de calendrier et de demande capacitaire. Je considère que les pays désireux de participer à un programme déjà engagé doivent se plier aux spécificités qui ont été retenues. Si l’on multiplie les variantes, cela entraîne des retards et, inévitablement, des surcoûts.
Dans l’immédiat, à l’exception des drones, il n’y a pas d’apparition de nouveaux programmes capacitaires. Dans la loi de programmation qui sera soumise au Parlement, je vais donc poursuivre les engagements de mes prédécesseurs dont certains remontent à plusieurs décennies (Tigre, NH 90, A 400 M). En revanche, s’ouvrent à nous et à nos partenaires d’importantes possibilités de mutualisation capacitaires en matière de ravitaillement en vol, de transport ou de communications satellitaires. Dans les autres domaines, un travail prospectif reste à faire dès maintenant, sous peine d’aboutir ultérieurement à une concurrence intra-européenne suicidaire, dans l’aéronautique par exemple. Dans les domaines naval ou terrestre, les champs de coopération sont quasiment vierges.
M. Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Merci monsieur le ministre pour votre propos dans lequel vous soulignez que les conditions du succès en matière de coopération, principalement européenne, sont liées à trois facteurs : politique, industriel et militaire.
Le facteur politique est à prendre en compte sur le long terme et doit être partagé par l’ensemble des pays. Ce qui n’est peut-être pas le cas aujourd’hui, certains de nos interlocuteurs l’ont souligné. D’où notre inquiétude sur la véritable volonté politique en Europe d’avoir une coopération pour des futurs producteurs comme vous l’avez précédemment mentionné.
Le second volet est industriel. Des pans entiers européens de l’industrie de défense sont très compétitifs mais sont aussi parfois concurrentiels.
Enfin, sur le volet militaire, il arrive que les états-majors aient des exigences, des traditions, qui ne sont pas forcément les mêmes sur le terrain, ou sur la stratégie ; le programme FREMM l’a bien démontré puisqu’aujourd’hui, même si la coopération est franco-italienne, on a abouti à deux bateaux complètement différents.
J’ai une première question sur l’Europe et le Conseil européen. Deux pays, la Grande Bretagne et la France peuvent légitimement prendre une initiative en matière de défense. Y a-t-il une volonté de la France pour proposer de construire, étape par étape, une coopération renforcée en matière d’équipements militaires et peut-être de travailler sur l’interopérabilité de nos armées ?
Ma deuxième question porte sur l’OCCAr. Dans notre rapport, nous souhaitons une agence exécutive unique au niveau européen. Si c’est l’OCCAr, nous souhaitons un renforcement de son autonomie, car plusieurs de nos interlocuteurs ont évoqué des freins dans sa capacité d’intervention et une certaine inertie : comment y remédier et la France y est-elle favorable ?
Enfin, troisième question, concernant les traités de Lancaster House et le volet de dissuasion, on observe un début de coopération sur les capacités de « premier cercle », selon l’expression employée par l’amiral Édouard Guillaud : y-a-t-il ou non une volonté française de renforcer cette coopération en matière nucléaire ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Sur la dernière question, le projet de coopération qui se déroule à Valduc et concerne la simulation, n’est pas encore abouti mais il se déroule normalement. C’est un sujet neuf, tout à fait important pour lequel il faut respecter le calendrier. Les Britanniques souhaitent qu’il y ait une réciprocité localisée ensuite ; les discussions sur ce point ont débuté, mais je pense qu’il ne faut pas faire preuve de trop de volontarisme politique avant d’engranger les bénéfices de ce qui est déjà engagé. Sur la partie nucléaire, le sujet est sensible et nous devons être très vigilants. Le projet se déroule comme prévu ; c’est une coopération exemplaire sur les fondamentaux. Il faudra à l’avenir envisager une réciprocité de localisation, mais avançons pas à pas sur un enjeu essentiel.
Sur l’OCCAr, on ne m’a jamais signalé une inertie particulière dans son fonctionnement ou un manque d’autonomie. Mais je suis bien sûr favorable à l’autonomie de l’OCCAr. L’agence fonctionne avec un conseil de surveillance, auquel appartiennent la France et les autres pays membres, c’est un outil qui doit mettre en œuvre son programme et l’autonomie est évidemment nécessaire à son bon fonctionnement.
Sur la fusion AED-OCCAr, je n’ai pas de point de vue, mais je constate que l’OCCAr fonctionne plutôt bien dans son domaine et que l’AED est un très bon concept, même si, pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure, elle n’a pas encore pu aboutir à des projets significatifs de mutualisation. La fusion potentielle des deux mérite réflexion. Je souhaiterais que l’AED puisse aboutir sur un certain nombre de projets, ravitaillement en vol, Maritime Surveillance Project (MARSUR…), dans le cadre du « pooling and sharing », pour qu’elle soit renforcée. La France – mais également la Pologne – en sont des supporters actifs.
Sur l’initiative européenne, la France fera des propositions au Conseil européen de défense. Une façon d’aborder ce Conseil serait d’entrer dans une logique théorique qui consiste à redéfinir le concept de stratégie globale européenne de défense, comme cela a été le cas en 2008, certains pays (la Suède, l’Italie, la Pologne et l’Espagne) souhaitent aller dans ce sens. Selon moi, cette approche est utile et de toute façon indispensable mais il est préférable d’avancer de façon pragmatique par des réalisations concrètes, plus que par une articulation conceptuelle qui définirait les menaces et les risques au niveau européen. Car alors il faut indiquer les moyens pour y répondre, et si on présente les moyens prévus, on se trouve confronté à des différences d’appréciation selon les États. Cette situation a déjà été tentée et a échoué.
La position que je souhaite donc défendre est de donner, sur chacun des domaines, opérationnel, capacitaire, industriel, des orientations pratiques. Je donne trois exemples.
Dans le domaine opérationnel, faisons en sorte que le processus de gestion de crise soit beaucoup plus limpide et rapide. La situation au Mali est évoquée la première fois lors d’une réunion des ministres de la défense de l’Union européenne en septembre 2012 – date à laquelle l’accord pour agir est unanime. L’arrivée des premiers soldats qui font la formation de l’armée malienne à Bamako a lieu en avril 2013 c’est à dire six mois plus tard. Le processus est trop long, pas moins de sept échelons décisionnels ont dû être consultés.
Dans le domaine capacitaire, le bon objectif consisterait à renforcer le pôle de mutualisation du transport de ravitaillement, l’EATC (European Air Transport Command). Située aux Pays-Bas, cette structure s’organise entre cinq pays (la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg) en donnant des droits de tirage mutuel sur nos capacités de transport. Il faudrait l’élargir, aussi bien géographiquement que techniquement, pour que ce ne soit pas uniquement le transport, mais également le ravitaillement en vol qui soit concerné. C’est une décision simple qui pourrait être soutenue par les Britanniques, les Polonais ou les Italiens.
Dans le domaine industriel, je pense aux drones. Question équipement, on est tous au même point, pas uniquement sur le drone tactique ou le drone de combat, mais également sur le drone d’observation. Les Britanniques sont équipés du Reaper américain, les Allemands sont en attente, les Italiens sont équipés du Predator, qu’il faudra renouveler, et nous-mêmes devrons nous doter d’équipements provisoires pour couvrir les besoins liés à la situation du Sahel. L’Europe de la défense doit se doter de moyens communs d’observation et a les capacités technologiques et industrielles pour le faire.
Dans les trois domaines, voici des propositions concrètes, qui peuvent aboutir et permettre à l’Europe de la défense de progresser. Cela n’empêche pas parallèlement l’élaboration d’une stratégie européenne de défense.
M. Jean Launay, rapporteur. Le ministre a répondu à la préoccupation sous-jacente à nos travaux et aux auditions que nous avons menées, qui ont montré que nous étions au carrefour de ces trois domaines, opérationnel, capacitaire et industriel. Les auditions de l’Agence des participations de l’État (APE) et de la Direction générale de l’armement (DGA) ont montré l’importance de la décision et du contrôle politiques pour l’efficacité des programmes que la France impulse ou dans lesquels elle participe.
Vous avez montré que la construction de l’Europe de la défense pouvait se faire en utilisant les programmes d’armement en coopération comme d’un levier.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Je rappelle qu’au moment de la préparation des accords de Lancaster House, un autre processus était en cours au niveau européen qui s’était heurté à la question de l’état-major commun, blocage qui n’a pas été dépassé. Si on cherche à définir une stratégie définissant les risques, les menaces et les moyens pour y répondre, la même situation va se reproduire. D’où ma volonté de construire l’Europe de la défense par des actions concrètes.
M. Bruno Rémond, Cour des comptes. Je voudrais apporter quelques éléments complémentaires, sans faire référence à un passé ancien et glorieux (le Transall, le Jaguar, les mines tripartites,…) mais aux programmes d’armement initiés dans les années 1990 en faisant les remarques suivantes.
Premièrement, chacun de ces grands programmes a permis la conception et la réalisation de matériels militaires technologiquement très avancés dont nous souhaitions doter nos forces, si l’on excepte des échecs partiels comme les FREMM et les Horizon, ou totaux comme Brevel ou le PA2.
Deuxièmement, les programmes en coopération souvent sont conspués, car plus chers et plus longs que les programmes nationaux. Mais si on compare tous les programmes menés au niveau national avec les programmes menés en coopération, on s’aperçoit que les dérives temporelles et les dérapages financiers sont sensiblement de même ordre. Ce n’est donc pas le mécanisme de la coopération, même s’il n’est pas exempt de défauts, qui induit des difficultés, mais bien la complexité du matériel, la qualité des études de définition,…
Troisièmement, l’OCCAr est le bon outil et qu’il a besoin d’être conforté et développé. J’ai un doute sur la question de modifier l’articulation entre l’AED et l’OCCAr, compte tenu de deux différences entre ces entités. La première est d’ordre institutionnel : l’AED relève de l’Union européenne, l’OCCAr est un outil à la main de quelques États qui l’ont créé et qui le financent avec leurs propres ressources. La seconde est que l’AED est purement sur le champ conceptuel, tandis que l’OCCAr est un outil industriel. Sur la question de l’autonomie, il faut préciser que l’OCCAr n’a jamais lui-même conçu l’organisation industrielle et financière des grands programmes qu’il gère, puisqu’ils ont tous été lancés avant sa création, à l’exception du dernier d’entre eux. Il n’a pas encore été expérimenté une seule fois de donner l’organisation d’un projet à l’OCCAr.
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Je partage complètement le point de vue de M. Rémond sur le rôle de l’OCCAr et la différence entre l’OCCAr et l’agence. En effet, l’arrangement que nous avons convenu entre l’OCCAr et l’agence date d’une année seulement et nous devons attendre encore un peu pour procéder à une évaluation. Concernant les coûts comparatifs entre les programmes réalisés en coopération et ceux qui ne sont pas réalisés en coopération, je prendrai l’exemple du C17 américain pour le comparer à l’A400 M. Le programme américain a connu les mêmes délais et les mêmes dérives de coûts. Nous sommes dans des domaines où la maîtrise des coûts n’est pas évidente.
À propos du porte-avions, le projet est resté au niveau de l’écriture. Là où la coopération avec les Britanniques a été la plus problématique, c’est plutôt sur la permanence du groupe aéronaval à la mer et sur le fait que cela supposait d’avoir la même technologie de porte-avions – technologie verticale ou catapulte. À partir du moment où les Britanniques n’ont pas retenu la même technologie, la France a considéré que cela contrevenait au traité de Lancaster House.
M. Alain Claeys, président. Monsieur le ministre, nous vous remercions.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Créé en 1998 l’OCCAr rassemble, depuis cette date, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, rejoints en 2003 par la Belgique et en 2005, par l’Espagne.
3 () Future Anti-Surface Guided Weapon (FASGW) en anglais.
4 () Brigade franco-allemande (BFA) créée le 2 octobre 1989.
5 () Rapport annuel de performance pour l’exercice 2012.
6 () Rapport annuel de performance pour l’exercice 2011.
7 () Conférence de presse donnée à l’issue de la réunion des ministres européens de la défense le 22 mars 2012.
8 () Les drones mouillés regroupent les drones sous-marins UUV (unmanned underwatervehicle) et les drones navals de surface USV (unmanned surface vehicle).
9 () « La coopération constitue le cadre à privilégier pour les opérations d’armement ».
10 () Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013.
11 () « Budget de défense, le déclassement en perspective » Alexandre Negru dans la Revue Défense nationale n° 761 de juin 2013.
12 () Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive de l'Agence européenne de défense (AED) devant la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat le 5 décembre 2012.
13 () Rapport de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat « A400M tout simplement le meilleur » du 4 juillet 2012.
14 () Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013.
15 () Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive de l'Agence européenne de défense (AED) devant la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat le 5 décembre 2012.
16 () Rapport de la Cour des comptes sur « Les faiblesses de l’État actionnaire d’entreprises industrielles de défense » du 9 avril 2013.
© Assemblée nationale
